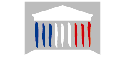______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 novembre 2014
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d’avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social,
TOME II
Président
M. Alain BOCQUET
Rapporteure
Mme Françoise DUMAS
Députés
——
Voir les numéros : 1731, 1958 et T.A. 345
La commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponse concrètes et d’avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social, est composée de : M. Alain Bocquet, président ; Mme Françoise Dumas, rapporteure ; M. Yannick Favennec, M. Michel Issindou, Mme Bernadette Laclais, M. Paul Salen, vice-présidents ; M. Jean-Noël Carpentier, M. Jean-Pierre Decool, Mme Marie-Hélène Fabre, Mme Barbara Pompili, secrétaires ; M. Jean-Pierre Allossery, M. Pierre Aylagas, M. Jean-Luc Bleunven, M. Jean-Louis Bricout, M. Guillaume Chevrollier, Mme Sophie Dion, Mme Hélène Geoffroy, Mme Edith Gueugneau, M. Guénhaël Huet, M. Régis Juanico, Mme Isabelle Le Callennec, M. Michel Lesage, M. Jean-René Marsac, M. Frédéric Reiss, M. Martial Saddier, M. Boinali Said, M. André Schneider, Mme Julie Sommaruga, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Philippe Vitel.
SOMMAIRE
___
Pages
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 7
Audition de M. Jacques Malet, président, et de Mme Cécile Bazin, directrice de l’association Recherches & Solidarités, auteurs de l’étude annuelle La France associative en mouvement 9
Audition de Mme Nadia Bellaoui, présidente, et de Mme Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif 17
Audition de Mme Viviane Tchernonog, chargée de recherche au CNRS, centre d’économie de la Sorbonne (Université Paris I), et de M. Jean-Pierre Vercamer, associé responsable du département Audit du secteur associatif (Deloitte), auteurs de l’étude Les associations entre mutations et crise économique – État des difficultés 26
Audition de Mme Joëlle Bottalico, vice-présidente du Haut Conseil pour la vie associative, de M. Thierry Guillois, membre du bureau du Haut Conseil pour la vie associative, et de M. Michel de Tapol, président de la commission « Bénévolat » 34
Audition de M. Gérard Terrien, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, et de Mme Francine Dosseh, magistrate 43
Audition sectorielle « Culture » : M. Alain de la Bretesche, président de la Coordination des fédérations et des associations de culture et de communication (COFAC), vice-président de la Fédération Patrimoine environnement ; M. Jean-Michel Raingeard, vice-président de la COFAC, président de la Fédération française des sociétés d’amis de musées ; M. Vincent Niqueux, administrateur de la COFAC, directeur général de l’Union nationale des Jeunesses musicales de France ; M. Jean-Damien Terreaux, administrateur de la COFAC, directeur de la Fédération française des Écoles de cirque. 53
Audition de M. Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports) 63
Audition de M. Patrick Audebert, chef du bureau des associations et fondations (ministère de l’Intérieur) 70
Table ronde « Associations caritatives » : Mme Florence Delamoye, déléguée générale d’Emmaüs France ; Mme Hélène Beck, directrice administration-finances du Secours catholique ; Mme Henriette Steinberg, secrétaire générale du conseil d’administration et secrétaire nationale du Secours populaire français, et M. Anthony Marque, secrétaire national du Secours populaire français ; M. Jean-Pierre Caillibot, délégué général adjoint des Petits Frères des pauvres ; M. Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre ; M. Olivier Berthe, président des Restos du cœur ; M. Pierre-Yves Madignier, président du mouvement ATD Quart Monde 75
Audition de Mme Fabienne Rosenwald, directrice des statistiques d’entreprises de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), accompagnée de M. Julien Deroyon, administrateur de l’INSEE ; et de M. Gilles Caillaud, président de Fédération ASSO 1901 94
Table ronde sectorielle « Associations du secteur sanitaire, social et médico-social » : M. Dominique Balmary, président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ; M. Florent Gueguen, directeur de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), et M. Samuel Le Floch, chargé de mission ; M. Yves-Jean Dupuis, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), et Mme Adeline Leberche, directrice du secteur médico-social 103
Table ronde « Associations d’élus » : Mme Corinne Bord, conseillère régionale d’Île-de-France, représentant l’Association des régions de France (ARF) ; M. Jean-Marie Darmian, membre du bureau de l’Association des maires de France (AMF) 118
Table ronde « Associations de consommateurs et usagers » : Mme Corinne Rinaldo, secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement ; M. Stéphane Pavlovic, directeur de la Confédération générale du logement ; M. François Carlier, délégué général de la Confédération consommation, logement et cadre de vie ; M. Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir, et Mme Béatrice Delpech, directrice adjointe à l’action politique 127
Table ronde sectorielle « Action humanitaire » : M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud ; M. Olivier Lebel, directeur général de Médecins du Monde ; M. Pierre-Yves Crochet Damais, Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) ; M. Aurélien Daunay, directeur des affaires financières, et M. Adrien Tomarchio, directeur de la communication de l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) 139
Table ronde sectorielle « Sport » : M. Aymeric de Tilly, directeur adjoint de la Ligue du football amateur (Fédération française de football) ; M. Patrice Doctrinal, vice-président de la Fédération française de rugby ; M. Christophe Zajac, directeur des affaires juridiques et institutionnelles de la Fédération française de basket-ball ; M. Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme ; M. Philippe Bana, directeur technique national, et Mme Cécile Mantel, directrice du service juridique de la Fédération française de handball ; M. Patrick Andréani, délégué technique général de la Fédération française de gymnastique 148
Audition de M. Jean-Pierre Hardy, directeur des politiques sociales de l’Assemblée des départements de France. 165
Table ronde sectorielle « Santé – Prévention » : M. Gérard Labat, membre du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR) ; M. Gérard Raymond, administrateur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), secrétaire général de l’Association française des diabétiques (AFD) ; M. Alain Legrand, directeur général d’AIDES ; M. Jean-Pierre Gaspard, secrétaire général de l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) 174
Table ronde sectorielle « Éducation populaire » : Mme Françoise Doré, trésorière du Comité pour les relations nationales et internationales des Associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) ; M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences ; M. Didier Jacquemain, délégué général de la Fédération nationale des Francas ; M. Karl Deschamps, secrétaire national délégué aux vacances à la Ligue de l’enseignement ; M. Jean-Luc Cazaillon, président du Collectif des associations partenaires de l’école (CAPE), et Mme Catherine Chabrun 184
Table ronde « Modèle économique et financier » : Mme Sophie des Mazery, directrice de Finansol ; M. Hugues Sibille, vice-président du Crédit coopératif ; M. Gérard Leseul, responsable des relations institutionnelles et internationales au Crédit mutuel ; M. Christian Sautter, président de France Active ; M. Yannick Blanc, président de La Fonda 197
Audition de Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique). 213
Audition de Mme Françoise Sampermans, présidente, et Mme Gwenaëlle Dufour, directrice juridique et fiscale de France Générosités ; de Mme Agnès de Fleurieu, vice-présidente, et Mme Nathalie Blum, directrice générale du Comité de la Charte 222
Audition de M. Stéphane Créange, chef du bureau B2 de la Direction de la législation fiscale, et de M. Jean-Luc Barçon-Maurin, chef du Service juridique de la fiscalité (Direction générale des finances publiques). 230
Table ronde thématique « Financement participatif » : M. Nicolas Lesur, président de Financement participatif France ; M. Mathieu Maire du Poset, directeur général adjoint d’Ulule ; M. François Desroziers, co-fondateur de SPEAR ; M. Ismaël Le Mouël, président de HelloAsso 236
Table ronde thématique « Bénévolat » : M. Dominique Thierry, président, et Mme Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat ; Mme Édith Archambault, universitaire. 245
Table ronde thématique « Qualité de l’emploi associatif » : M. Sébastien Darrigrand, délégué général de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), et Mme Tiphaine Perrichon, chargée de mission du développement de l’emploi à l’UDES ; M. Bernard Bazillon, vice-président de l’Institut des dirigeants d’associations et fondations (IDAF) ; M. Frédéric Amiel, secrétaire général du syndicat ASSO, et M. Vincent Laurent, co-secrétaire du syndicat ASSO ; M. Matthieu Hély, chercheur au CNRS et à l’université Paris X-Nanterre. 253
Table ronde thématique « Les administrations et l’emploi associatif » : Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ; M. Vincent Guérinet, directeur adjoint chargé des opérations à l’URSSAF Île-de-France ; M. Stéphane Holé, adjoint au directeur du recouvrement, du contrôle et de la lutte contre la fraude, et Mme Évelyne Fleuret, sous-directrice de la gestion et de la modernisation des comptes cotisants à l’Acoss. 268
Audition sectorielle « Tourisme » : Mme Michelle Demessine, présidente de l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT), et M. Sylvain Crapez, délégué général 276
Audition de M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 283
Audition de M. Jacques Malet, président, et de Mme Cécile Bazin, directrice de l’association Recherches & Solidarités, auteurs de l’étude annuelle La France associative en mouvement
(séance du 3 juillet 2014)
M. le président Alain Bocquet. Pour débuter les travaux de cette commission d’enquête, nous avons souhaité disposer d’une vue générale de la situation et des difficultés du monde associatif, et nous avons donc fait appel à cet effet à Recherche & Solidarités, réseau associatif d’experts qui recueille des informations à la source grâce à des enquêtes nationales et territoriales, qui analyse ces données pour les mettre à la disposition des acteurs de terrain et des décideurs et qui diffuse des publications ainsi nourries, menant en outre des recherches, des actions et des expérimentations avec le concours de différents partenaires. Cette association publie notamment une enquête annuelle qui fait référence, La France associative en mouvement. C’est donc en votre qualité de « vigies » du monde associatif que nous souhaitons vous entendre, monsieur le président, madame la directrice.
Cependant, je dois au préalable vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jacques Malet et Mme Cécile Bazin prêtent serment)
Mme Cécile Bazin, directrice de l’association Recherches & Solidarités. Notre réseau associatif d’experts travaille depuis dix ans sur les sujets de solidarité, la vie associative y tenant une grande part.
Au cours de ces dernières années, nous avons observé la création de 65 000 à 67 000 associations chaque année. Ce chiffre montre que la dynamique associative est forte et que le tissu se renouvelle, ce qui peut être perçu de façon positive dans une société où l’on déplore souvent le repli sur soi. Reste que la multiplication du nombre d’associations entraîne celle des besoins financiers et des besoins en bénévoles, phénomène qui peut aller jusqu’à provoquer une certaine concurrence entre associations.
Grâce à une coopération avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et avec la Mutualité sociale agricole (MSA), nous disposons d’un tableau complet de l’emploi dans les associations. La croissance constante et régulière que nous avons observée en la matière s’est interrompue en 2010 et, en 2011, quelque 10 000 emplois ont même été perdus. En 2012-2013, l’activité a repris, mais notre suivi conjoncturel montre une légère baisse, à nouveau, au cours du premier trimestre de 2014 alors que l’emploi privé se maintenait.
Notre publication, La France associative en mouvement, repose essentiellement sur ces données trimestrielles, mais aussi sur une enquête auprès des responsables d’associations qui, d’annuelle, est devenue semestrielle depuis que la conjoncture s’est dégradée. Nous avons ainsi interrogé, au mois de mai, 1 700 dirigeants représentatifs du tissu associatif et nous avons constaté que, si l’évolution du bénévolat restait pour eux le sujet de préoccupation qu’elle est de longue date, leur situation financière et l’évolution des politiques publiques figuraient désormais parmi leurs principaux motifs d’inquiétude.
Une enquête importante menée en 2013 a montré que le nombre de bénévoles augmentait – ce dont on peut se réjouir –, mais qu’ils étaient moins nombreux à intervenir de manière régulière chaque semaine : ils ne sont plus que 4,5 millions aujourd’hui, contre 5,5 millions en 2010. Leur comportement change donc, leurs attentes également, et il revient aux associations d’en tenir compte.
Grâce aux données fournies par l’administration de Bercy, nous pouvons mesurer les dons aux associations déclarés par les contribuables dans le cadre de leur déclaration de revenus, étude que nous complétons par une enquête menée auprès des donateurs. Les petits donateurs sont de moins en moins nombreux, faute de moyens. Les donateurs qui estiment percevoir des revenus convenables se montrent eux aussi assez prudents et donnent un peu moins qu’auparavant. Si nous constatons néanmoins une hausse des dons – toutefois ralentie –, elle s’explique donc par une plus grande générosité des personnes les plus aisées.
M. Jacques Malet, président de l’association Recherches & Solidarités. Le secteur associatif rencontre des difficultés en termes à la fois de représentation et de reconnaissance.
Je tiens à rester objectif en ce qui concerne le premier point : vous et nous avons du mal à construire une représentation cohérente d’un secteur qui regroupe aussi bien des associations comptant seulement quelques adhérents que d’autres employant plusieurs centaines de salariés, sans compter la diversité tenant à celle des domaines d’activité : environnement, sport, action sociale, etc. De plus, en ce qui nous concerne, nous avons coutume de distinguer, de façon quelque peu ironique, entre les associations où l’on travaille « avec les autres », celles où l’on travaille « pour les autres »… et celles où l’on travaille « contre d’autres » ! Il n’est donc pas étonnant que, malgré de grands efforts, la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA), devenue le Mouvement associatif, éprouve quelque difficulté à s’exprimer. Et cela d’autant plus qu’il existe deux formes d’associations : celles qui travaillent en réseau – notamment dans les secteurs sportif ou social – et celles qui sont autonomes et qui constituent entre 50 % et 60 % du total.
Puisque leur représentation se révèle délicate, les associations ont un problème de reconnaissance. C’est le souci premier des dirigeants et des bénévoles, qui souhaitent être considérés, non pas pour obtenir gloire et médailles, mais pour ce qu’ils font ou pour ce qu’ils pourraient faire.
Alors que j’étais en fonction au sein d’une chambre régionale des comptes, j’ai pu observer que, depuis des dizaines d’années, on passait à côté d’un effet de levier exceptionnel. Quand on engage 1 000 euros de crédits publics pour une action de l’administration, on en retire en général, dans le meilleur des cas, un bénéfice de 1 000 euros. Quand on aide une entreprise à hauteur de 1 000 euros, sachant développer un investissement, elle le valorisera à 1 200, voire 1 500 euros. Mais quand on confie 1 000 euros à une association, grâce à l’effet de levier du bénévolat, elle en fera au minimum pour deux à trois fois plus. L’exemple de Recherches & Solidarités est à ce titre assez éclairant : nous ne touchons pas de subvention de fonctionnement et nos moyens reposent à 50 % sur le bénévolat.
De ce manque de reconnaissance résulte une double difficulté : d’abord une limitation de l’action qui peut être menée, ensuite l’absence d’encouragement pour les bénévoles – une subvention de 1 000 euros, c’est pour eux du carburant, une incitation à aller plus loin.
Je relève par ailleurs une certaine faiblesse du secteur associatif, surtout lorsqu’il dépend trop fortement de la puissance publique : pour mettre en œuvre une politique publique ou pour profiter de crédits publics, il risque de dévier de son projet propre, perdant ainsi ses repères au détriment de la continuité de son action.
Il me faut aussi constater deux fractures.
La première est territoriale. Malheureusement, c’est dans les territoires en difficulté que les collectivités disposent des moyens les plus réduits, c’est-à-dire là où, précisément, on a le plus besoin des associations. Les derniers travaux de Mme Tchernonog l’ont bien montré et il conviendrait de trouver des procédures pour remédier à cette situation.
La seconde fracture est sociale. Parmi les adhérents, les bénévoles, les donateurs ou, plus encore, les dirigeants, les catégories socioprofessionnelles favorisées sont – de loin – les mieux représentées. Cela a un aspect positif : l’épanouissement de ces personnes et la mobilisation de leurs compétences. Mais le déficit d’adhésion et d’engagement bénévole parmi les personnes modestes, les jeunes et les femmes nous prive de certaines ressources.
Je terminerai néanmoins par deux notes d’espoir. À la demande du ministère chargé de la vie associative, et avec une aide financière du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), nous venons d’achever une étude sur l’utilisation du numérique dans les associations. Nous avons constaté qu’elles s’engageaient résolument dans cette voie, avec deux effets positifs. Le premier, immédiat, est que l’information et la mobilisation des citoyens sont facilitées. Le second, différé parce que plus difficile à atteindre, est le développement du bénévolat à distance. L’idée subsiste que l’adhésion à une association implique d’être présent de vingt heures à vingt-deux heures tel jour de la semaine ; or on peut très bien, à distance et en temps non contraint, c’est-à-dire au moment où l’on est disponible, aider une association à reconfigurer son site, à préparer une demande de subvention, etc., même quand on est un cadre surchargé, une jeune mère qui souhaite rester auprès de ses enfants, une personne isolée en milieu rural ou une personne handicapée. Grâce au numérique, toutes ces personnes peuvent bénéficier d’une insertion sociale forte dans le cadre associatif et s’épanouir personnellement.
Le second motif d’espoir est plus délicat à formuler. On compte 24 % de Français engagés bénévolement dans une association, mais seulement 16 % de dix-huit à vingt-cinq ans, non que ces jeunes soient plus indifférents mais parce qu’ils s’impliquent d’une manière plus informelle auprès de leurs amis, dans leur quartier, dans leur village. Il convient sans doute de consentir un effort pour les sensibiliser à la vie associative et pour les accueillir. Les personnes modestes sont également peu représentées parmi les adhérents et les responsables : elles n’osent pas pousser la porte d’une association, de même qu’elles ne poussent pas facilement celle d’une exposition, d’un musée ou d’une salle de spectacle. Cet important déficit peut être comblé. De quel droit, en effet, ces personnes seraient-elles privées de l’épanouissement personnel, de l’enrichissement, de l’acquisition de compétences et du lien social qu’offrent les associations ? En outre, un jeune, une femme, une personne de condition modeste, en adhérant à une association, a proportionnellement beaucoup plus tendance à devenir bénévole. Nous avons donc fait passer aux associations un message qui pourrait passer pour une boutade : ne cherchez plus de bénévoles, vous ne les trouverez pas ou, au pire, vous les prendrez à une autre association ; en revanche, cherchez des adhérents, apprivoisez-les, et ils deviendront des bénévoles, notamment s’ils souhaitent donner du sens à leur vie !
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci pour votre exposé, à la fois concis et complet. Vous nous ouvrez déjà de nombreuses perspectives pour notre travail.
Vous avez évoqué une fracture territoriale : en dehors du recours au numérique, comment, selon vous, y remédier ? Comment les collectivités locales peuvent-elles susciter ou accompagner la création d’associations durables dans les territoires les moins favorisés géographiquement ou culturellement ?
M. Jacques Malet. Voilà une question redoutable. Il semble utile, dans un premier temps, de mesurer réellement cette fracture. Comme je l’indiquais, elle nous est apparue de manière assez vive à la lecture des derniers travaux de Mme Tchernonog, mais ceux-ci demanderaient à être approfondis.
Ensuite, si l’on utilise l’effet de levier que j’ai évoqué, qui d’ailleurs, puisqu’il s’agit d’un investissement productif, peut entrer en concurrence avec certains autres investissements jugés, eux, moins productifs, on peut imaginer une répartition des moyens publics accordés aux associations modulée en fonction des territoires et de leurs difficultés, par exemple en renforçant le FDVA, déjà régionalisé.
Si la coopération entre les collectivités et les associations est indéniablement nécessaire, elle ne doit pas se solder par une relation de suzerain à vassal. Malheureusement, aujourd’hui, les associations jouent parfois – pardonnez l’expression – « petit bras ». Je l’ai vécu lorsque j’exerçais des responsabilités dans la fonction publique. Les associations, modestes, se réjouissent dès qu’on leur accorde un peu d’argent. Or, si elles agissent vraiment au bénéfice du plus grand nombre, il faut les convaincre qu’on leur doit cet argent. C’est sur cette base que doit se développer la coopération avec les collectivités. L’enjeu pour les associations sera aussi, d’une part, de diversifier leurs ressources, certaines d’entre elles dépendant par trop d’une seule source de financement, et, d’autre part, de mutualiser le plus possible leurs moyens pour celles, nombreuses, de leurs activités qui peuvent être réalisées en commun. Les groupements d’employeurs peuvent être un très bel outil à cet égard. Nous n’avons toutefois pas la prétention d’aller beaucoup plus loin dans nos préconisations.
M. Régis Juanico. L’association Recherches & Solidarités fait un travail remarquable qui nous permet de disposer chaque année d’un état précis de l’évolution du monde associatif et, en particulier, du bénévolat. Cependant, selon les sources, l’estimation du nombre de bénévoles en France varie beaucoup : 12 millions, 16 millions… Pouvez-vous nous fournir un chiffre précis, à supposer que ce soit possible ? Quelles indications pourriez-vous aussi nous donner, s’agissant de l’évolution de la création d’associations au cours des dernières années, ainsi que de celle de l’emploi associatif, que nous observons, à l’Assemblée, avec la plus grande attention ?
D’autre part, la lourdeur croissante des tâches administratives imposées aux associations risque de dissuader les bénévoles responsables. Avez-vous des données en la matière ?
Quand on évoque le financement de la vie associative, on fait référence aux crédits de l’État, à ceux des collectivités locales, à la participation des usagers, mais on a tendance à oublier les dépenses fiscales : les réductions d’impôt accordées aux particuliers à raison de leurs dons aux associations – que nous ne considérons pas, contrairement à certains, comme une niche fiscale – se montent à environ 1,2 milliard d’euros et c’est là un élément qui participe de l’équilibre général.
Je suis d’accord avec vous, monsieur Malet : les bénévoles ne demandent pas un statut, mais une meilleure reconnaissance de leur engagement. À ce titre, que pensez-vous des mesures en faveur du bénévolat que nous examinerons tout à l’heure, en séance, dans le cadre du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire ?
M. Yannick Favennec. La fracture territoriale que vous avez évoquée recouvre-t-elle la distinction entre territoires ruraux et territoires urbains ? Dans mon département de la Mayenne, la vie associative est très riche, grâce à la ressource humaine formidable que sont les bénévoles qui contribuent à l’animation de ces territoires ruraux et au maintien du lien social.
La reconnaissance de l’engagement des bénévoles passe-t-elle ou non par la définition d’un statut ?
Pour remédier au manque d’engagement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, que pensez-vous de la possibilité, proposée par la précédente majorité, de leur permettre de prendre des responsabilités au sein d’une association dès l’âge de seize ans ? Ne pourrait-on également susciter l’intérêt des collégiens et des lycéens pour le bénévolat en leur faisant passer une journée au sein d’une association, comme ils le font déjà dans des entreprises, pour s’initier à leur fonctionnement ?
M. Jean-Louis Bricout. La formation des bénévoles dirigeants est-elle à la hauteur de la complexité des textes administratifs régissant la vie des associations ? Quels seraient leurs besoins en la matière ?
J’ai mis en place les temps d’accueil périscolaire dans ma commune, au début de 2013, et j’ai pu constater que cette mesure avait redynamisé l’activité associative. L’avez-vous vous-mêmes relevé au niveau national ?
Quels sont les secteurs concernés par la concurrence à laquelle vous avez fait allusion ? Cette concurrence est-elle plutôt celle du secteur privé – je pense aux services à la personne ?
Enfin, pensez-vous qu’un zonage permettrait à l’État d’agir plus efficacement contre la fracture territoriale ?
Mme Marie-Hélène Fabre. Certaines associations, notamment dans le secteur de l’insertion, ont tendance à se plaindre de la concurrence d’un millefeuille qu’il faudrait simplifier. L’avez-vous constatée vous-mêmes ?
M. le président Alain Bocquet. Pensez-vous que les outils de l’État permettent une bonne connaissance d’un monde associatif très large, très divers et aux limites floues. Les données de l’INSEE sont-elles suffisantes ? Comment pourrait-on classer, selon vous, les associations ?
Ensuite, quelles mesures concrètes prendre pour le financement des associations ? Le soutien à leur apporter doit-il venir du public ou du privé ? Dans le même ordre d’idées, que pensez-vous de l’idée d’un congé pour engagement ?
M. Jacques Malet. Nous sommes très conscients des limites de nos connaissances et soucieux de rester à notre place. Les différents secteurs – sportif, social, environnemental, etc. – n’ayant pas les mêmes besoins, nous estimons qu’il revient aux représentants du mouvement associatif de proposer des mesures concrètes à partir de nos constats, de nos publications. Par conséquent, si nous dégageons parfois des pistes, nous proposons nous-mêmes rarement des mesures.
Comme vous, nous avons le pressentiment que l’organisation des activités scolaires et périscolaires, en coopération avec les associations, ne peut que renforcer le lien entre l’école et la société, mais également bénéficier aux élèves et aux associations elles-mêmes. Toutefois, nous ne disposons pas d’informations récentes, en tout cas pertinentes, sur le sujet.
Nous avons en revanche une position très précise, monsieur le président, sur la question des outils. Le secteur associatif est aujourd’hui très bien connu dans sa diversité. Nous ne sommes pas beaucoup, parmi les chercheurs, à travailler sur le sujet mais suffisamment nombreux – j’ai cité les travaux de Mme Viviane Tchernonog, mais il y a aussi ceux de Mme Édith Archambault, ceux de M. Lionel Prouteau… – et nous publions nous-mêmes des études régulières. Il faut en finir avec les allégations selon lesquelles on ne connaîtrait pas assez les associations, l’INSEE pouvant faire davantage et mieux. Les données sont assez complètes pour qu’on n’aille pas ennuyer en permanence les associations avec de multiples enquêtes.
Est-il d’une importance planétaire de savoir s’il y a un ou 1,3 million d’associations en France ? On sait qu’il y en a beaucoup et qu’elles sont même bien plus nombreuses qu’on ne peut le savoir, car les associations regroupant quelques amis que la philatélie intéresse ne demanderont jamais rien à personne. Existent en outre des associations de fait : nous pouvons très bien, à l’issue de la présente audition, en constituer une parce que nous aurons envie de réaliser un projet ; elle n’aura pas de personnalité morale, pas de compte en banque, mais cela ne nous empêchera pas d’organiser telle ou telle activité.
Notre connaissance des associations a beaucoup progressé. Fédération Asso 1901 travaille depuis plus de dix ans à un recensement très précis. Son équipe a aujourd’hui couvert près de cinquante départements, procédant de façon systématique et rationnelle : partant de la déclaration de création, elle vérifie l’existence des associations et leur action ; elle élimine celle qui sont dissoutes en leur attribuant une pastille noire ; elle attribue une pastille rouge ou jaune aux associations dont elle doute qu’elles existent encore et une pastille verte à celles dont elle a vérifié qu’elles étaient actives et dont elle connaît très précisément l’objet, la localisation et les coordonnées, y compris électroniques – puisque de nombreuses associations ont des sites ou des blogs. Elle en a ainsi recensé plus de 500 000. Nous travaillons beaucoup avec cette association à but non lucratif depuis deux ans, car nous estimons qu’elle a mis au point un outil extraordinaire. La reconnaissance, la représentation que nous évoquions tout à l’heure se trouvent là aussi.
Nous travaillons par ailleurs avec Paul Franceschi qui dirige à l’INSEE le secteur chargé des associations. Nous connaissons donc très bien l’emploi, à l’établissement près, au salarié près et à l’euro près grâce aux informations de l’Acoss, de l’URSSAF et de la MSA. Aussi, pour ce qui est de la connaissance du monde associatif, il semble plus intéressant, désormais, de porter nos efforts sur les aspects qualitatifs.
Il est vrai, monsieur Juanico, que l’avalanche de chiffres qui ne concordent pas forcément est quelque peu désespérante. Cependant, forts d’une démarche scientifique avérée puisque notre réseau rassemble des experts et des universitaires, nous sommes formels : nous connaissons exactement le nombre des bénévoles, qui représentent, je l’ai dit, autour de 24 % des Français. Reste qu’il ne faut pas confondre ce nombre et celui des interventions de ces mêmes bénévoles : 40 % d’entre eux sont actifs dans au moins deux associations, comme l’a montré très précisément une enquête menée par France Bénévolat, Recherches & Solidarités et l’IFOP en 2013 comme en 2010.
Cette enquête a mis en évidence qu’il ne fallait pas confondre les bénévoles intervenant d’une manière très utile, mais ponctuelle, et ceux qui interviennent régulièrement, formant la colonne vertébrale du secteur associatif. Au moins 85 % des associations n’ont pas de salariés et fonctionnent donc exclusivement grâce à cette ressource humaine. On sait que 10,5 % des Français sont engagés vraiment dans une association tandis qu’ils sont environ 15 % à donner du temps gratuitement sans se considérer comme bénévoles, estimant se borner à « donner un coup de main » – aussi une enquête demandant aux personnes interrogées si elles sont bénévoles serait-elle biaisée dès le départ ; c’est pourquoi toutes les enquêtes sérieuses en la matière évoquent le don de temps gratuit. Dès lors, la proportion de 24 % précédemment mentionnée passe à un peu plus de 30 % de personnes intervenant de manière informelle dans une école, auprès d’une mairie, d’une église, dans le cadre d’un syndicat ou d’un parti. Nous maîtrisons parfaitement ces chiffres.
Nous regrettons ainsi les annonces gouvernementales – et quel que soit le Gouvernement en question – qui pourraient laisser penser au dirigeant de terrain qu’il est mauvais parce qu’il n’arrive pas à recruter alors qu’il y a de plus en plus de bénévoles. Il convient de rectifier ce discours et de bien préciser que la ressource humaine n’est pas inépuisable et que les bénévoles intervenant régulièrement sont au nombre de 4,5 millions seulement.
Parmi les bénévoles qui interviennent à un rythme hebdomadaire, à savoir une grande part de dirigeants, un peu plus de 30 % ont plus de soixante-dix ans – c’est très positif en termes de lien social pour eux et d’utilité sociale pour les autres. Bien entendu, il ne faut rien changer à cela. Il faut simplement attirer les autres tranches d’âge dans les associations.
Les jeunes ont une grande soif de responsabilités. Ils ont compris depuis longtemps que l’engagement bénévole valait au moins un stage pratique dans leur CV. Il faut par conséquent les encourager dans cette voie, inciter les associations à les accueillir. Il est du reste possible qu’ils « se fassent la main » au sein des associations existant dans le milieu scolaire et universitaire – foyers, associations sportives… L’idée d’organiser le même genre de stages que ceux réalisés au sein des entreprises me paraît excellente – nous n’y avions pas pensé. Enfin, on peut très bien encourager les établissements d’enseignement supérieur à valoriser l’engagement bénévole jusque dans les diplômes. J’avais moi-même cherché à introduire une telle mesure, au titre du ministère de l’enseignement supérieur, pour certains DUT où la pratique d’une responsabilité bénévole valait quelques points supplémentaires.
Vous avez raison de souligner qu’en matière de financements, il ne faut rien oublier. L’incitation fiscale que vous mettez en avant représente en effet des sommes non négligeables et qui ont du reste très fortement augmenté, grâce à une hausse continue du taux de réduction d’impôt. Mais on ne parle quasiment jamais de tous les moyens mis à disposition par les collectivités : mise en place de services communs, aide à l’organisation de manifestations, mises à disposition de salles et parfois de personnel – le réseau national des maisons d’associations a accompli un très bon travail de mutualisation.
Quand on observe la proportion d’emplois associatifs dans l’ensemble du secteur privé, on voit qu’elle passe de 30 % en Lozère à 5 % dans les Hauts-de-Seine. Ce n’est donc pas le numérateur mais bien le dénominateur qui change tout : dans une région où le système économique est quelque peu défaillant, le secteur associatif joue un rôle proportionnellement beaucoup plus important, dans la limite de ses moyens bien entendu. En revanche, on ne relève aucune différence entre territoires urbains et territoires ruraux, même si, sur certains sujets, on note un léger écart en faveur des seconds du fait de la proximité qui y prévaut et de réflexes de solidarité – les associations compensant parfois un véritable désert économique et le manque de services. Si, de ce point de vue, le secteur rural est plus animé, le secteur urbain souffre de l’anonymat lié à la vie en ville et du problème des transports
– l’intervention « en ligne » a ses limites et le temps consacré aux trajets quotidiens l’est au détriment de l’investissement dans une association.
En ce qui concerne la formation, les dirigeants et les bénévoles en général, s’ils sont toujours aussi militants et ont toujours autant le souci d’être utiles, nourrissent de plus en plus l’ambition de réaliser un projet et se mobilisent donc beaucoup plus sur celui-ci que durablement pour une cause. Aussi sont-ils immédiatement conscients des compétences nécessaires. Nous avons observé qu’une très large part d’entre eux – quel que soit leur âge – souhaitaient recevoir formations et conseils. C’est très encourageant.
Il existe deux formes de concurrence. Celle qui oppose les secteurs lucratif et associatif n’est pas forcément malsaine à condition que les pratiques du secteur lucratif s’appuient sur une déontologie convenable – on le voit pour la petite enfance, pour l’aide à domicile. Nous travaillons d’ailleurs chaque année avec l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) sur ces sujets – au passage, je vous informe que le secteur de l’aide à domicile a perdu 7 % de ses emplois depuis 2010. En revanche, la concurrence entre certaines associations peut poser problème : la constitution d’une association dans le but de contrebalancer l’action d’une autre peut se révéler stérilisante.
Nous n’avons pas d’informations très précises sur le secteur de l’insertion, madame Fabre, si ce n’est qu’il a perdu de nombreux emplois au fil des années.
Mme Cécile Bazin. C’est en effet un secteur très difficile à appréhender du fait qu’il ne comprend pas que des associations, mais également des sociétés à responsabilité limitée (SARL) par exemple.
Pour ce qui est des jeunes, nous avons pu observer, qu’il s’agisse du bénévolat ou des dons, qu’ils étaient plus nombreux que leurs aînés à avoir des comportements solidaires. Ils sont très motivés pour servir l’intérêt général, certes, mais également motivés pour eux-mêmes ; ils sont de ce point de vue décomplexés, revendiquant un épanouissement personnel dans leur engagement plus qu’une volonté d’utilité sociale. Ils savent aussi pouvoir tirer bénéfice de leur investissement associatif pour leurs études et dans leur recherche d’emploi
– et ils ont raison.
Cette note d’espoir doit être tempérée par le fait qu’ils sont moins présents, car attirés par des démarches plus informelles ; de plus, le cadre associatif ne correspond pas à tous. L’enjeu est de les sensibiliser dès l’école, qui devrait s’ouvrir au milieu associatif.
M. le président Alain Bocquet. Nous vous remercions pour ces indications riches d’enseignements.
Audition de Mme Nadia Bellaoui, présidente, et de Mme Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif
(séance du 3 juillet 2014)
M. le président Alain Bocquet. Chers collègues, nous accueillons maintenant Mme Nadia Bellaoui, présidente, et Mme Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif.
La vocation du Mouvement associatif est d’être le porte-voix de plus de 600 000 associations qu’il fédère, réunies dans une vingtaine d’organisations thématiques. Il concentre son action sur quatre grands sujets qui sont au cœur des préoccupations de notre commission d’enquête : l’engagement, d’ailleurs érigé en grande cause nationale pour 2014 ; le dialogue civil, qui vise à promouvoir avec les autorités politiques une citoyenneté active ; l’emploi, qui a une dynamique hésitante depuis la mi-2010 ; le modèle socio-économique, qui est source d’inquiétude pour les dirigeants associatifs depuis plusieurs années.
L’an dernier, mesdames, votre organisation a alerté sur la double crise des financements et du bénévolat et il serait intéressant de voir où nous en sommes. Les difficultés sont-elles contenues ou s’aggravent-elles ? Notre commission est à l’écoute de vos diagnostics.
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Nadia Bellaoui et Frédérique Pfrunder prêtent serment)
Mme Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement associatif. Merci de votre présentation extrêmement précise de notre organisation. Pour la rendre encore plus explicite, je citerai certains de ses membres : le Comité national olympique et sportif, l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), l’Union nationale des associations familiales (UNAF), Coordination SUD, etc.
En dépit de ses difficultés, le monde associatif reste une ressource dynamique de notre pays, comme en attestent trois indicateurs : entre 2005 et 2011, le nombre d’associations a augmenté chaque année de 2,8 %, selon les chiffres fournis par Viviane Tchernonog dans Le paysage associatif français, la hausse étant particulièrement forte parmi les petites associations de bénévoles ; le bénévolat a progressé de 3 % au cours de la même période, également en rythme annuel, et était en 2013 le fait de quelque 24,5 % de nos concitoyens ; enfin, la même année, l’emploi a crû de 0,2 % dans le secteur associatif alors qu’il reculait de 0,5 % dans le secteur privé lucratif.
C’est un monde d’une très grande diversité : seulement 180 000 des 1,3 million d’associations existantes emploient des salariés ; ceux-ci, au nombre de 1,8 million, exercent pour moitié dans le seul secteur sanitaire et social ; l’employeur associatif emploie généralement un ou deux salariés qui travaillent souvent à temps partiel quand ils n’exercent pas cette activité de manière accessoire, à côté d’une carrière dans l’enseignement par exemple.
Après ces quelques indications initiales, ma collègue va vous parler des évolutions et des difficultés structurelles auxquelles ont été confrontées les associations. Je m’autoriserai ensuite quelques commentaires plus conjoncturels.
Mme Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif. Divers changements ont affecté les associations au cours des dernières années, à commencer par la généralisation des marchés publics. Alors qu’elles reçoivent une partie de leurs ressources des pouvoirs publics, elles ont en effet constaté une forte baisse des subventions au profit des appels d’offres : entre 2005 et 2011, en volume, les premières ont diminué de 17 % tandis que la commande publique augmentait de 70 %.
Une enquête réalisée en janvier 2012 par la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) et par le réseau France Active montrait qu’une association employeuse sur cinq avait conclu un marché public avec au moins l’un de ses financeurs. Outre que la réponse à des appels d’offres implique des procédures lourdes, le problème est que ce mode de financement est un frein à l’innovation pour les associations : la subvention soutient un projet tandis que l’appel d’offres demande de répondre à un besoin spécifique de la collectivité ; or l’association est construite autour d’un projet et de sa capacité à prendre l’initiative.
Ce changement de cadre entraîne des difficultés pour les petites et moyennes associations, mal armées pour triompher de procédures complexes. Il risque de décourager les bénévoles qui viennent dans une association pour développer un projet et qui se retrouvent pris dans un cadre très formaté. Enfin, il implique le développement de nouvelles logiques de gestion, avec l’application de critères quantitatifs de performance très stricts : si l’action des associations doit être évaluée, ce n’est peut-être pas le meilleur moyen de procéder.
Autre évolution : les financements de l’État baissent au profit de ceux des collectivités territoriales. Ce ne serait pas un problème, et ce serait même une bonne chose que les associations puissent trouver des soutiens divers, si les collectivités appliquaient toutes la même procédure pour les demandes de subvention. Or, alors que l’État a élaboré un formulaire Cerfa et des dispositifs pour éviter aux associations de devoir indéfiniment recommencer les mêmes démarches, les modes selon lesquels demander des subventions varient selon les collectivités, ce qui implique de refaire sans cesse des dossiers en fournissant des documents différents. Pour une association qui dispose de peu de moyens et qui fonctionne avec des bénévoles et des salariés qui ne se consacrent pas en priorité à ces questions de gestion, cela n’a rien d’anecdotique : ces démarches mobilisent des ressources importantes qui grèvent les financements accordés.
Dans ce registre, les têtes de réseau se heurtent à des problèmes particuliers. Les collectivités territoriales finançant essentiellement des projets très spécifiques, elles vont recevoir de moins en moins de moyens pour leur fonctionnement et donc pour l’appui qu’elles apportent aux associations.
Ce tassement et cette diversification des financements publics poussent les associations à chercher d’autres modèles de développement et d’autres sources de financement, mais elles rencontrent certains écueils sur ce chemin en raison de l’application des doctrines fiscales. La procédure fiscale mise en place pour caractériser l’utilité sociale des associations se déroule en trois étapes : appréciation du caractère désintéressé ou non de la gestion, évaluation de la concurrence faite aux entreprises du secteur lucratif exerçant la même activité, analyse du respect de la règle dite des « quatre P » – produit, public, prix, publicité. Nous ne remettons pas en cause ce cadre, qui nous paraît adapté, mais les associations relèvent un manque de cohérence dans l’application d’une doctrine qui, d’une région à l’autre, donne lieu à des interprétations et à des analyses assez différentes, notamment en ce qui concerne le critère de concurrence. En période de contrainte budgétaire, cela peut conduire à une augmentation progressive de la fiscalité des associations. Certaines qui œuvrent dans un champ hybride, telles que les réseaux d’aide à la création d’entreprise par les chômeurs, vont ainsi obtenir un rescrit qui confirme leur caractère non lucratif cependant que d’autres seront soumises à l’impôt.
On constate aussi une interprétation de plus en plus restrictive de la notion d’intérêt général. Nombre d’associations ne parviennent pas à obtenir le rescrit leur permettant de justifier de cette vocation d’intérêt général et ne sont dès lors plus en mesure de faire appel aux dons en toute sécurité.
Enfin, le montant de recettes commerciales en dessous duquel une association est exonérée d’impôts commerciaux n’a pas été réévalué depuis très longtemps, restant fixé à 60 000 euros, d’où une difficulté pour des associations qui souhaitent élargir leur assiette de financement grâce à des ressources de ce type.
Mme Nadia Bellaoui. Les associations fonctionnent avec 51 % de financements publics – toutes sources confondues : État, collectivités territoriales, établissements publics – et 49 % de financements privés, dont seulement 5 % proviennent du mécénat et qui sont mis à mal en temps de crise.
D’un point de vue conjoncturel, les associations vivent assez douloureusement les hésitations et les divergences à propos des réformes en cours, notamment de la réforme territoriale. Les principales inquiétudes portent, là encore, sur les financements, qui sont la manifestation la plus concrète du partenariat entre la puissance publique et les associations. Nous appelons en particulier votre attention sur le fait que le transfert de la gestion des fonds structurels européens pourrait se traduire en 2014 par une année blanche dans le financement des associations, ce qui serait dramatique pour nous. Le mode de financement par le Fonds social européen (FSE) étant particulièrement complexe, nous lançons les activités sans attendre de recevoir la convention d’engagement et le délai entre l’engagement des dépenses et la perception des ressources, s’il est accru d’un an, va devenir intolérable pour les associations, déjà en proie à des difficultés de trésorerie car le cas du FSE est tout sauf isolé. Certains élus nous incitent même discrètement à constituer des fonds de garantie pour nous assurer contre le non-paiement éventuel par la collectivité !
Dans un autre ordre d’idées, nous notons une forme d’instrumentalisation politique des associations pour faire valoir son mécontentement face à telle ou telle réforme. Or les associations n’ont pas à subir les conséquences des différences de vues sur des projets de réorganisation de l’action publique qui ne les concernent pas directement.
Enfin, vous ne pariez pas assez sur les associations qui, tout en s’organisant pour affronter à la fois des évolutions structurelles lourdes et une conjoncture difficile, peuvent œuvrer au redressement du pays et à la restauration de la confiance : pourquoi se priver de ce levier ? Ainsi la Banque publique d’investissement raisonne trop selon des ratios applicables à des entreprises dotées d’un capital et ne tient pas suffisamment compte de nos spécificités, qui ne sont en aucun cas un obstacle à notre développement à long terme ; de même, le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est refusé aux associations au motif qu’elles ne paient généralement pas d’impôt sur les sociétés, alors qu’elles sont assujetties à d’autres impôts tels que la taxe sur les salaires qui, elle, a un effet très immédiat sur l’emploi.
Nous sommes des interlocuteurs beaucoup plus engagés et dynamiques que la puissance publique ne semble le penser. Nous vous invitons donc, autant que nous pouvons nous le permettre, à regarder davantage en direction des associations, à bien cerner leurs spécificités et à leur proposer de contribuer davantage au redressement économique du pays. C’est un défi que nous sommes tout à fait capables de relever.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci, mesdames, pour ces exposés.
Les associations rencontrent finalement un peu les mêmes difficultés d’adaptation que les entreprises. Avez-vous le sentiment que cette crise est structurelle ou conjoncturelle ? Y a-t-il eu des moments de tension similaires à d’autres périodes ?
Pensez-vous que le statut des dirigeants bénévoles peut être amélioré ? Faut-il envisager des mesures différentes – y compris des dispositifs de financement différents – selon la taille et l’objet de l’association ? Est-ce que ce sont les collectivités qui doivent s’adapter aux projets associatifs ou les associations qui doivent s’adapter aux demandes et aux besoins des collectivités ? Mais la réponse se trouve peut-être dans l’entre-deux si nous voulons garantir la pérennité des associations tout en préservant leur liberté d’initiative et la place du bénévolat…
Mme Nadia Bellaoui. La crise est-elle structurelle ou conjoncturelle ? Notre environnement connaît des métamorphoses structurelles et, d’un point de vue strictement économique, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Il y a encore dix ans, les associations étaient en situation de monopole dans de nombreux domaines, en particulier dans celui de l’aide à domicile ; aujourd’hui, les entreprises lucratives regardent certaines de nos activités comme des marchés potentiels. Ce n’est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, mais un changement de donne : dans ces secteurs, nous sommes en concurrence avec elles.
Quant à la puissance publique, son action comme ses attentes ont également connu une évolution substantielle, dont le passage de la subvention à la commande publique n’est qu’un symptôme. L’association est vue comme un prestataire de services pour la collectivité, comme un instrument de surcroît souple d’utilisation, au point que certains détracteurs nous prédisent un avenir de sous-fonction publique territoriale. Les effets durables de la décentralisation se font aussi sentir ; nos échanges avec les élus deviennent plus complexes et l’État s’efface au profit des collectivités territoriales qui deviennent nos principaux partenaires.
Les usagers ont des aspirations, ce qui est tout à fait heureux. Les salariés présents de façon stable dans les associations s’interrogent sur la place des bénévoles et des élus. Ces transformations majeures que d’aucuns appellent crise démocratique se manifestent donc également au sein des associations – qui sont aussi des institutions appelées à évoluer au gré d’une capacité accrue des citoyens à peser sur leurs organisations –, mais d’une manière spécifique. Nous sommes, plutôt qu’en crise, dans une période de transition, de réinvention d’un modèle et d’un partenariat avec la puissance publique. Selon le think tank La Fonda, qui a mené un grand nombre d’entretiens dans le cadre d’un travail sur les scénarii d’avenir, le monde associatif est capable d’un « optimisme stratégique », fondé sur des réalisations et des engagements à changer. Notre préoccupation est de faire en sorte que nos partenaires veuillent conforter et développer nos spécificités, sans donc mettre de frein à nos évolutions internes.
Nous ne sommes pas a priori très favorables à l’évolution du statut associatif : nous sommes attachés à la loi de 1901, une loi de liberté, qui a été et peut encore être complétée par tout un arsenal d’agréments, d’autorisations et de droits spécifiques à mesure que l’association donne des garanties à la puissance publique.
Mme Marie-Hélène Fabre. Décrivant la mutation qui s’opère dans le financement des associations, avec le basculement des subventions vers les appels d’offres, vous redoutez qu’elle n’affecte votre capacité d’innovation. Préconisez-vous des mesures de simplification des appels d’offres et des dispositifs particuliers en faveur des associations dans le cadre du plan numérique ?
Vous n’avez rien dit du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) que nous sommes en passe d’adopter et qui donne notamment une définition de la subvention. Quelle est votre position sur le sujet ?
M. Jean-Louis Bricout. Au cours de ces premières auditions, il a été beaucoup question de l’emploi et de son évolution, mais très peu des types de contrat utilisés par les associations ou du turn over chez vos salariés. Que pensez-vous des emplois d’avenir ? Quel usage les associations font-elles de la formation et quelles difficultés rencontrent-elles en la matière ? Sachant qu’elles travaillent de plus en plus sur des appels à projets avec des financements croisés, comment accueillent-elles la réforme territoriale qui devrait réduire le nombre des dossiers qu’elles ont à remplir en supprimant une couche du millefeuille administratif ? Enfin, quelle part prennent désormais les fondations dans les financements de projets ?
M. Yannick Favennec. Le mécénat ne compte que pour 5 % dans le financement des associations, avez-vous dit. La législation en la matière est-elle suffisamment attractive, selon vous ?
M. Jean-Luc Bleunven. Ne faut-il pas redéfinir le pacte entre les élus et le monde associatif ? En tant qu’élu associatif et élu local, je constate que l’on se prête mutuellement beaucoup d’intentions et qu’on éprouve une réelle difficulté à trouver un terrain d’entente pour agir. Ne faudrait-il pas redéfinir les relations entre le monde associatif et les associations d’élus ? D’autre part, pourriez-vous nous apporter des précisions à propos de l’année blanche qui va résulter du transfert de la gestion des fonds structurels européens ?
M. Jean-Pierre Allossery. Les très petites associations, qui emploient un salarié ou deux, ont déjà beaucoup de mal à établir les fiches de paie et, alors qu’elles sont très intéressées par des formules comme les contrats emploi solidarité et les emplois d’avenir, elles sont arrêtées par les contraintes administratives imposées pour en bénéficier. Elles se heurtent aussi à des problèmes de trésorerie particulièrement aigus – je pense à une association d’insertion qui emploie quatre-vingts salariés et qui ne va peut-être pas survivre jusqu’au 31 juillet, car les fonds attendus n’arrivent pas malgré les promesses du conseil général et des autres financeurs. C’est traumatisant pour les bénévoles et pour les salariés, qui ne comprennent pas qu’une subvention votée et notifiée tarde à venir au point de compromettre le fonctionnement de leur association.
Mme Barbara Pompili. La réforme territoriale, qui va être adoptée d’ici quelques mois, aborde notamment la question des compétences. Sachant que la recherche des financements est chronophage au point d’occuper parfois un salarié à plein temps, ne serait-ce pas l’occasion de ressortir l’idée – peut-être un peu utopique – d’un guichet unique pour les associations ? À défaut, ne pourrait-on attribuer la compétence du financement des associations à une seule collectivité, à charge pour elle de récolter les demandes et de les gérer avec les autres collectivités ou partenaires ?
Avez-vous des études démontrant l’existence d’une crise du bénévolat ? Si oui, quelles en sont les conséquences pour les associations, éventuellement contraintes de se professionnaliser au risque de changer de nature ?
Mme Frédérique Pfrunder. Notre position de principe, mais justifiée, est en faveur des subventions plutôt que des appels d’offres et la simplification de ceux-ci n’est donc pas pour nous une priorité, d’autant que cette procédure est de toute façon très encadrée par le code des marchés publics. Cela étant, même dans ce cadre, peut-être les collectivités pourraient-elles recourir aux procédures d’appel d’offres adaptées ou négociées, plus souples, qui sont permises dans certains cas.
Mais le problème de la simplification se pose aussi pour les subventions et certaines collectivités territoriales s’en préoccupent. Au sein du conseil régional d’Île-de-France, le groupe Europe Écologie Les Verts a entamé avec les associations une réflexion pour trouver les moyens d’une relation simplifiée, s’agissant de la demande de subvention comme de la justification de son utilisation. En effet, les associations doivent parfois fournir des dossiers extrêmement lourds, lestés de photocopies de factures de tous ordres en multiples exemplaires. Cela ne témoigne pas vraiment d’une relation de confiance et cela n’a pas forcément de sens puisque les associations sont évidemment ouvertes aux contrôles et que nombre d’entre elles ont des commissaires aux comptes.
S’agissant des types de contrats, je pourrai vous faire parvenir les éléments dont nous disposons et qui montrent notamment que les contrats à durée déterminée restent majoritaires dans l’emploi associatif. En revanche, je n’ai pas de chiffres sur le turn over.
Esquissant une redéfinition du pacte entre les élus et les associations, une charte d’engagements a été signée en février 2014 entre le mouvement associatif, l’État et les collectivités territoriales. Cet outil peut aider à retisser des relations de confiance et permettre à chaque collectivité d’ouvrir une concertation avec les associations, dans une perspective de co-construction de projets.
Aux petites associations qui rencontrent des difficultés pour établir les fiches de paie, on peut proposer certaines solutions, passant par exemple par la mutualisation des moyens ou des salariés, ou par la création de services communs. Ce sont des solutions à développer par les associations elles-mêmes, quitte à ce qu’on leur fournisse un cadre. Elles y ont d’ailleurs tout intérêt afin de répondre à l’accroissement des exigences réglementaires et législatives.
Y a-t-il une crise du bénévolat ? Les derniers chiffres montrent un fléchissement du nombre de bénévoles, mais une augmentation de leur participation : ils s’engagent de plus en plus et dans un plus grand nombre d’associations, pratiquant peut-être une forme de zapping. Les citoyens ont donc toujours autant envie de s’engager, mais ils le font différemment et les associations ont du mal à trouver des bénévoles prêts à assumer sur le long terme des responsabilités parfois lourdes, comme celles de trésorier ou de président. C’est à elles de savoir s’adapter et le travail sur la gouvernance peut y contribuer.
Mme Nadia Bellaoui. Le renouvellement des dirigeants bénévoles pose des questions immédiates à certaines associations. Il faut qu’elles évoluent, qu’elles conçoivent la professionnalisation comme un complément du bénévolat de responsabilité et qu’elles se préoccupent de limiter la durée des mandats – l’archétype du président est un homme de plus de soixante ans appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure, alors que bien d’autres personnes sont capables d’assumer cette responsabilité.
Nous sommes revenus de l’idée selon laquelle toute action pourrait être prise en charge par un salarié, le travail des bénévoles n’étant qu’accessoire. Il faut au contraire rechercher une complémentarité entre des bénévoles qui ont la liberté de dire non, de résister ou de mettre en question la structure, et des salariés qui ne sont pas seulement des subordonnés mais qui peuvent aussi s’engager et être parties prenantes aux décisions. Il y a là des chantiers à mener en interne qui peuvent être profitables.
Faut-il, dans le cadre de la réforme territoriale, attribuer la compétence du financement des associations à une seule collectivité ? Nous trouvons étrange qu’on considère que les financements croisés seraient à bannir par principe. Réunir autour d’une même table des partenaires qui soient complémentaires prend beaucoup de temps : eh bien, les associations sont parvenues à le faire grâce aux financements croisés ; nous cherchons à bien articuler les actions du département, de l’agglomération et de la région dans le cadre d’un modèle économique viable, intégrant bien sûr les ressources propres.
Mais simplifier les procédures, créer un guichet unique, mieux articuler les divers financements, nous y sommes d’autant plus favorables que – vous avez parfaitement raison sur ce point – l’embauche d’un comptable devient quasiment la première priorité de toute association alors que la comptabilité n’est pas vraiment le cœur de notre activité.
Attribuer la compétence du financement des associations à une collectivité poserait aussi un problème aux têtes de réseau : le rôle de celles-ci étant d’aider les petites associations isolées et désorientées à coopérer avec d’autres pour être plus efficaces sans avoir à réinventer la poudre, leur champ d’action débordera toujours le territoire de cette collectivité chef de file.
Arrêter la nouvelle programmation du FSE a pris du temps – les arbitrages ne sont d’ailleurs pas tous rendus. Du coup, les régions, qui vont désormais gérer une part de l’enveloppe, nous expliquent qu’elles ne seront pas en mesure d’instruire nos dossiers à temps pour nous verser les subventions en 2014. Si tel est le cas, il faut à tout le moins envisager qu’un report sur l’année suivante soit voté lors de la dernière séance de la collectivité. Si cette année est blanche sur le plan comptable, nous devons avoir l’assurance d’obtenir un financement double l’année suivante, avant de revenir à une situation normale en 2016, faute de quoi nous courons à la catastrophe. Il est encore possible de trouver une solution, encore faut-il s’en préoccuper.
L’essentiel du financement privé perçu par les associations vient de ressources propres et le mécénat, qui bénéficie pourtant d’un régime fiscal favorable, n’y contribue en effet que pour 5 % avec les dons. Pour autant, cette ressource nous importe à un double titre : ces petits financements permettent souvent de boucler un budget et, d’autre part, leur discussion donne l’occasion d’un rapport à l’entreprise à la fois nouveau et intéressant pour nous – au stade le plus abouti, cela conduit au développement d’un mécénat de compétences qui n’est pas sans produire quelques bienfaits collatéraux : les cadres supérieurs apportent leurs qualifications à l’association où ils trouvent eux-mêmes l’occasion d’une certaine respiration.
Il est compliqué de donner à vos questions sur l’emploi et sur les types de contrats utilisés une réponse qui ait valeur générale. Deux mondes coexistent dans les associations : celui des conventions collectives, du contrat à durée indéterminée et de l’emploi à temps plein ; celui du temps très partiel, étant entendu que des progrès ont été réalisés dans ce domaine grâce aux groupements d’employeurs. Les associations font de gros efforts pour assurer correctement leur fonction d’employeur. L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) a enfin été reconnue comme organisation multiprofessionnelle et elle est associée à la conférence sociale qui va s’ouvrir dans quelques jours. C’est important, car les syndicats de salariés ont besoin de trouver chez nous des interlocuteurs vraiment conscients de leurs responsabilités d’employeurs. Pour notre part, dans le cadre de la grande cause nationale dédiée à l’engagement associatif, nous engageons un vrai travail en faveur de la qualité de l’emploi : nous avons créé un prix pour récompenser l’initiative dans ce domaine et nous mesurons de façon régulière nos progrès.
Globalement, nous ne sommes pas mauvais et il faut combattre certaines idées reçues : le niveau des qualifications dans le secteur associatif est plutôt plus élevé qu’ailleurs et nous sommes un secteur d’avenir puisque, sous le seul effet de la pyramide des âges, 500 000 emplois seront renouvelés d’ici à 2020. Il y a donc bien des motifs pour que l’emploi associatif suscite l’intérêt.
Les associations ont répondu favorablement à la création des emplois d’avenir puisque nous sommes les premiers utilisateurs de ce type de contrat, ex aequo avec les collectivités. Nous y avons recouru de manière volontariste, désireux que nous étions de prendre notre part de l’effort fait pour résorber le « noyau dur du chômage des jeunes », pour reprendre l’expression de Michel Sapin.
Mais nous avons regretté que vous n’ayez pas aussi inventé avec nous un dispositif de soutien à l’emploi associatif, au titre de l’innovation sociale dans des métiers d’avenir. Nous agissons dans les secteurs des services, de l’éducation et de la culture, qui sont appelés à se développer. Le dernier rapport de France Stratégie souligne d’ailleurs que les emplois de proximité vont bien résister – et durablement –, même dans un contexte d’économie mondialisée. Nous sommes les acteurs de cette proximité, aux côtés d’entreprises, notamment de PME. Incarnant la capacité des citoyens à se prendre en main et à répondre par eux-mêmes aux besoins, les associations ont vocation à créer durablement de l’emploi, et pas seulement de l’emploi d’insertion. Je sais qu’il est mal vu de vouloir ressusciter des dispositifs passés, mais le programme « nouveaux services, nouveaux emplois » a produit des effets durablement bénéfiques dans les associations.
Si nous n’avons pas explicitement parlé du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, c’est parce que nous avons l’impression d’y être immergés – et avec bonheur – depuis deux ans. Tout le travail de concertation effectué en amont nous a beaucoup aidés à réfléchir sur les évolutions du monde associatif et à nous projeter dans l’avenir. Il nous a permis de rediscuter avec les mutuelles, les coopératives, les entrepreneurs sociaux et à reformuler plus clairement nos spécificités respectives. Nous voulons construire progressivement une « révision associative » pour que les associations s’interrogent régulièrement sur leur complémentarité vis-à-vis de la puissance publique et des entreprises, sur l’action bénévole, sur le rapport à l’usager – qui peut toujours devenir bénévole puis dirigeant. Pour nous, une association ne peut jamais être réduite au service qu’elle rend ; elle représente d’abord la liberté d’intervenir soi-même en s’organisant collectivement.
Ce texte comporte aussi des dispositions décisives, en particulier la définition juridique de la subvention : c’est le point d’appui qui nous permettra de revenir vers les collectivités pour leur soumettre le type de partenariat que nous souhaitons construire avec elles dans la durée. D’autres mesures concernent le titre associatif, le régime de faveur pour les fusions ou le volontariat. À ce dernier égard, le projet de loi ESS nous a aussi permis de commencer à travailler sur des questions qui restent devant nous – ainsi sur le fait que la prise en charge des frais de repas et de déplacement expose à une requalification de la relation de bénévolat en contrat de travail.
La définition du périmètre de l’économie sociale et solidaire figurant dans la dernière version du texte nous donne le sentiment d’avoir été mieux entendus. En effet, s’il faut prendre en compte de nouvelles formes d’entrepreneuriat social, il est très important de ne pas diluer l’identité de l’économie sociale et solidaire au point d’y intégrer des entreprises capitalistiques qui cherchent un accès à des financements publics via des opérations en fait de simple marketing. Cela ne rendrait service à personne – et surtout pas aux finances publiques.
M. Régis Juanico. Les députés et les sénateurs sont en désaccord sur l’un des points du projet de loi, celui qui concerne la pré-majorité associative. Quel est votre avis sur le sujet ?
Mme Nadia Bellaoui. Très franchement, j’espère que l’on sortira de ce climat de défiance à l’égard des mineurs. Quand un mineur s’abonne chez Orange, on présume qu’il a l’accord de ses parents, mais, pour s’impliquer dans nos associations, il faudrait qu’il produise une autorisation explicite ? Ce n’est pas raisonnable !
M. le président Alain Bocquet. Merci, mesdames, pour cette contribution qui sera utile à notre commission d’enquête.
Audition de Mme Viviane Tchernonog, chargée de recherche au CNRS, centre d’économie de la Sorbonne (Université Paris I),
et de M. Jean-Pierre Vercamer, associé responsable du département Audit du secteur associatif (Deloitte),
auteurs de l’étude Les associations entre mutations et crise économique – État des difficultés
(séance du 3 juillet 2014)
M. le président Alain Bocquet. Merci, madame, monsieur, d’avoir répondu à notre invitation.
Vous êtes spécialistes des difficultés du monde associatif, auxquelles vous avez consacré une étude intitulée Les associations entre mutations et crise économique – État des difficultés, parue en octobre 2012, après un travail similaire publié en 2006.
Les associations traversent-elles une crise soudaine et imprévue, ou la crise n’a-t-elle qu’intensifié depuis 2008 des vents contraires qui soufflaient depuis longtemps ? Les associations sont-elles capables de s’adapter à la situation ? Si oui, à quelles conditions ? Telles sont les questions qui composent la toile de fond de nos travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Viviane Tchernonog et M. Jean-Pierre Vercamer prêtent serment)
Mme Viviane Tchernonog, chargée de recherche au CNRS, centre d’économie de la Sorbonne (Université Paris I). Je commencerai par un tableau général du secteur associatif aujourd’hui, avant d’en venir aux difficultés quotidiennes rencontrées par les associations.
Il existe très peu de données sur le secteur associatif émanant de sources officielles. Voilà pourquoi notre laboratoire conduit tous les cinq ou six ans, depuis une vingtaine d’années, une enquête visant à dresser un état des lieux du secteur, dont j’ai communiqué le résumé aux membres de votre commission. Nous travaillons actuellement, avec l’INSEE, à mettre en place une enquête réalisée à la même fréquence, mais par l’INSEE lui-même. Cette enquête reprendra le questionnaire que nous adressions jusqu’à présent aux associations, ce qui permettra de suivre des séries sur une longue période. Ses résultats ne seront toutefois disponibles que dans un an, trop tard pour que vous en teniez compte dans votre rapport. Quoi qu’il en soit, la statistique publique relative aux associations évolue.
J’exposerai les éléments de contexte qui ont le plus d’effet sur le fonctionnement des associations, puis le poids économique et social du secteur, les grandes évolutions qu’il a connues depuis 2006, en particulier du fait de la crise, enfin les conséquences des mutations intervenues et les perspectives à plus long terme.
Premier élément de contexte : le déficit public structurel, récurrent depuis la fin des années 1990 même si le problème se pose aujourd’hui avec plus d’acuité, et qui explique certaines contractions des financements d’État. Aujourd’hui, pour la première fois, il concerne aussi les collectivités locales, qui doivent réduire les financements alloués aux associations, après les avoir développés. La crise économique provoque aussi la contraction des ressources privées des associations, dont les usagers ont moins les moyens d’accéder aux services qu’elles rendent.
La professionnalisation du secteur est une autre évolution importante. La bonne volonté ne suffit plus ; les associations ont besoin d’équipements de plus en plus sophistiqués et surtout de compétences de la part des salariés, mais aussi des bénévoles. Ce phénomène explique nombre des évolutions récemment constatées.
S’y ajoute le changement social. Les sociétés évoluent toujours et la nôtre ne fait pas exception à la règle, ce qui est généralement une bonne chose. Mais les associations peinent un peu trop souvent à anticiper ces évolutions. Elles critiquent par exemple le changement de comportement des bénévoles, qu’elles accusent de « zapper », au lieu de tenir compte de ce que j’appellerais plutôt un désir de maîtriser leur parcours et de diversifier leur expérience.
J’en viens au poids économique du secteur associatif. Le budget annuel des associations s’élève à 85 milliards d’euros et leur contribution au PIB à 3,2 %, ce qui est considérable. Elles représentent 1,8 million d’emplois, mais il convient de prendre garde à un chiffre que les réseaux associatifs ont tendance à surestimer et qui recouvre énormément d’emplois à temps partiel et d’emplois atypiques. Pour avoir une idée plus juste du volume de l’emploi salarié, à défaut de le connaître directement, on peut raisonner à partir de la masse salariale, qui représente 6,5 % de celle du secteur privé. Le chiffre est donc élevé même s’il l’est moins qu’on ne le dit souvent. Quant aux bénévoles, ils sont 15 à 16 millions, et leur temps de travail, très variable, correspond à un million d’équivalents temps plein environ.
Les grands changements connus par les associations au cours des dernières années concernent principalement leur nombre, l’évolution de leur poids économique, leur financement, l’emploi salarié et l’emploi bénévole.
Le nombre d’associations continue d’augmenter, mais surtout du fait de la croissance des toutes petites structures qui animent le quartier et la vie locale : clubs, associations militantes, associations centrées sur la vie de leurs membres. Non seulement ces petites associations se développent, mais elles se renouvellent beaucoup : nombre d’entre elles meurent, d’autres se créent. La quantité d’associations qui recourent à des professionnels salariés, le plus souvent parce qu’elles interviennent auprès de populations en difficulté ou exercent une mission de service public, a augmenté nettement moins vite. La hausse globale est de 2,5 % en moyenne annuelle.
Le poids économique des associations, mesuré à partir du budget du secteur dans la période la plus récente, a augmenté depuis 2006 à un rythme annuel moyen, corrigé de l’inflation, de 2,5 %, c’est-à-dire plus vite que la croissance du PIB. Cette hausse s’explique par des facteurs démographiques, notamment le maintien de la natalité à bon niveau et le développement de la dépendance, qui créent des besoins traditionnellement pris en charge par les associations et solvabilisés par les politiques publiques, et même par les assurances privées dans le cas de la dépendance. On observe toutefois aussi un important mouvement d’externalisation vers le secteur associatif des missions autrefois rendues dans un cadre public. Cette tendance, qui n’est pas nouvelle, concerne aujourd’hui essentiellement les conseils généraux. Elle résulte principalement du fait que l’action sociale est moins coûteuse dans le cadre associatif, en raison du bénévolat mais aussi parce que l’emploi salarié y est moins rémunéré et présente globalement moins d’avantages qu’ailleurs. En d’autres termes, c’est la précarisation de l’emploi salarié dans les associations qui explique la tendance à l’externalisation. Et si le poids du secteur a augmenté, c’est aussi le cas des financements publics qui vont de pair avec les politiques ainsi rétrocédées au secteur associatif.
Les financements de toute nature des associations ont connu de très importantes mutations au cours des six dernières années. On observe d’abord un phénomène de privatisation des financements. Parmi les financements privés, les dons et le mécénat représentent 4 à 5 % du budget total du secteur, contre 45 % pour la participation des usagers aux services rendus par l’association, sous forme de cotisations ou d’achats. En d’autres termes, dire que le secteur se privatise, c’est dire que les usagers participent de plus en plus à son financement. En ce qui concerne les financements publics, nous observons depuis les années 1990 une baisse régulière du poids de l’État au profit de celui des acteurs locaux, surtout, au cours de la dernière période, du conseil général.
Enfin, on a pu observer au cours des six ou sept années qui viennent de s’écouler une fonte de la subvention publique au profit de la commande publique, qui a explosé. Le financement reste public dans les deux cas mais cette évolution a conduit le secteur à se restructurer. Elle a en effet entraîné deux conséquences majeures. D’une part, elle a privé les associations de la capacité d’initiative que la subvention publique leur avait toujours offerte et qui leur avait permis d’aspirer de nombreuses politiques publiques. D’autre part, elle a exclu les petites et moyennes structures, à l’exception de celles qui s’appuient sur le bénévolat et n’ont pas ou presque pas besoin de financement. Cela résulte d’un effet de seuil : ces associations sont trop petites pour accéder à la commande publique et manquent des ressources humaines nécessaires pour répondre aux appels d’offres. Or leur disparition risque de déboucher sur une dualisation du secteur entre de toutes petites associations de quartier et des mastodontes qui mettront en œuvre les politiques publiques, sans structures intermédiaires.
L’emploi salarié dans les associations est très atypique, caractérisé par une part énorme de temps partiel – parfois pas plus de deux heures par mois ou par trimestre pour une association dite employeuse – et par une grande précarité, avec 45 % environ de contrats à durée déterminée, de stages ou de formes atypiques d’emploi. Les emplois sont moins bien rémunérés, à qualification égale, et offrent moins de perspectives de carrière que dans le reste du secteur privé, mais ils sont en moyenne plus qualifiés.
L’emploi salarié dans les associations s’est développé très vite, parce que les associations étaient capables de créer des emplois liés à leur utilité sociale croissante, mais aussi parce qu’elles comptent nombre d’emplois tertiaires et sociaux, également très dynamiques dans le secteur privé lucratif. L’emploi salarié associatif se stabilise depuis 2010-2011 : la crise a bloqué sa croissance mais n’en a pas réduit le volume. Cela s’explique par le fait qu’il est pour moitié constitué d’emplois du secteur médico-social, qui sont acycliques, c’est-à-dire insensibles aux aléas économiques : en cas de crise, l’hôpital du coin ne ferme pas, même si l’on peut être amené à revoir la carte sanitaire à échéance de cinq ou dix ans.
Les associations ont aujourd’hui beaucoup de mal à recruter et à garder leurs salariés, car elles ne peuvent leur offrir ni des salaires aussi élevés et des perspectives de carrière aussi intéressantes que le secteur privé lucratif, ni des emplois aussi stables que le secteur public. Du coup, elles recrutent des personnes qui n’ont pas toujours la qualification requise et les forment, mais le taux élevé de rotation de ces salariés, qui vont rapidement chercher de meilleures conditions d’emploi ailleurs, génère pour elles un important surcoût.
Quant au travail bénévole, son volume, en nombre d’heures travaillées, continue d’augmenter très vite quoiqu’un peu moins qu’au cours de la période précédente. Les chiffres que nous vous communiquons font consensus auprès de la plupart des équipes de recherche qui étudient le sujet, et ils sont utilisés par l’INSEE, dans la comptabilité nationale, par le Gouvernement. Le bénévolat concerne, je l’ai dit, 15 à 16 millions de personnes en France, soit 32 % de la population âgée de plus de dix-huit ans. Cependant, les formes de bénévolat ont changé. En particulier, on a de plus en plus affaire à des bénévoles qui ont différents engagements dans plusieurs associations et qui s’impliquent moins dans chacune d’entre elles. Les bénévoles d’aujourd’hui sont de plus en plus disposés à donner un coup de main en créant un site internet, par exemple, mais sans participer pour autant en permanence à la vie de l’association.
Cela dit, la principale difficulté du travail bénévole reste la formation. Les politiques publiques ont toujours eu tendance à chercher à développer le travail bénévole, ce qui est une bonne chose en soi car une société dont les membres s’engagent est une société qui fait des progrès sociaux. Aujourd’hui, toutefois, de plus en plus de Français souhaitent être bénévoles mais les associations ne peuvent les accueillir car elles ont besoin de bénévoles dotés de compétences spécifiques dans le contexte actuel de professionnalisation. Je vous renvoie à mon ouvrage Le Paysage associatif français pour plus de détails, notamment à propos du coût du bénévolat pour les associations et du fait qu’en termes de formation, les besoins des bénévoles excèdent ce que les associations peuvent raisonnablement offrir.
J’en viens aux conséquences à long terme de ces mutations.
D’abord, les associations ont perdu en capacité d’innovation et en inventivité sociale. C’est la contrepartie du rôle de prestataire des politiques publiques qu’elles assument de plus en plus – avec une grande compétence, d’ailleurs – du fait de l’évolution du financement public.
La deuxième conséquence des évolutions observées, et l’une des principales, est la disparition des associations moyennes, qui déséquilibre fortement le secteur car elles ont pour spécificité de fédérer les initiatives citoyennes et locales.
Troisièmement, les usagers des associations sont de plus en plus mis à contribution pour financer celles-ci. Cela résulte de la contraction des financements publics, les usagers étant la seule marge de manœuvre au niveau privé, puisque les dons et le mécénat continuent de ne représenter que 4 à 5 % du financement des associations alors qu’ils bénéficient déjà, de l’avis de tous les spécialistes, de l’une des législations les plus favorables au monde. Or les usagers sont touchés par le chômage, et les solliciter ainsi revient à sélectionner, certes involontairement, les « clientèles » associatives en fonction de leur solvabilité, ce qui porte atteinte à la fonction de cohésion sociale des associations.
Enfin, les trois évolutions du financement – privatisation, décentralisation des financements publics, baisse du poids de l’État – subordonnent de plus en plus l’action associative aux capacités locales de financement. Au fil d’une évolution qui n’est d’ailleurs pas récente, les tissus associatifs se développent, voire se sophistiquent, dans des départements où le taux d’emploi et la qualification sont élevés, l’activité économique importante et les collectivités riches, alors que dans les territoires vieillissants, victimes du chômage et qui ont donc davantage besoin de solidarité, les associations ne trouvent ni auprès de leurs partenaires publics ni auprès de leurs usagers les moyens de venir en aide aux populations, même dans l’urgence.
Je conclurai par les résultats de l’enquête sur les difficultés du monde associatif que nous menons, avec Deloitte, tous les quatre ou cinq ans environ. Dans ce cadre, nous avons construit une grille des 37 difficultés que les associations rencontrent quotidiennement et nous l’avons soumise à un échantillon représentatif. Pas moins de 2 300 associations ont participé à l’enquête et le monde associatif se reconnaît bien dans nos conclusions.
J’insisterai sur trois difficultés majeures à propos desquelles il semble urgent d’agir. D’abord, les difficultés de trésorerie, dont beaucoup d’associations meurent, parfois – voire souvent, au moins pour les petites et moyennes structures – parce que la subvention municipale n’est pas arrivée à temps. D’une manière générale, le financement public pose des problèmes de délai, même s’agissant des commandes publiques. Ensuite, le problème de la formation des bénévoles, auquel il est urgent de s’atteler si l’on veut profiter de la manne que ces derniers représentent pour le secteur. Enfin, toutes les associations, et surtout les petites et moyennes, souffrent de la complexité administrative et de la judiciarisation de la société, qui bloquent le recrutement du premier salarié, c’est-à-dire le passage du bénévolat à l’emploi salarié, au sein des petites associations. Mais vous étudierez certainement cette question dans le cadre de votre travail conjoint avec la mission d’information sur la simplification législative.
M. Jean-Pierre Vercamer, associé responsable du département Audit du secteur associatif (Deloitte). Commissaire aux comptes, j’interviens pour ma part auprès de 400 associations et fondations, quotidiennement ou presque. Je vais vous donner une illustration concrète de certaines des 37 difficultés que nous avons identifiées à partir des constats établis par les associations elles-mêmes, en les présentant dans un ordre qui résulte de mon approche de professionnel du chiffre.
D’abord, les problèmes de trésorerie. Le fonds de roulement des associations ne leur suffit pas pour faire face à d’éventuelles difficultés ; 30 % d’entre elles le confirment. L’on n’a sans doute jamais vu autant qu’en 2013 d’états de cessation de paiement, qui correspondent à l’incapacité de payer ses dettes exigibles à court terme avec les fonds détenus en trésorerie. Le nombre de lancements de procédures d’alerte – qui correspondent à la découverte d’événements contrariant la continuité d’exploitation de la structure – a augmenté de quelque 17 % par rapport à 2011 ou 2012. Or leur déclenchement a pour conséquence néfaste que la situation commence à devenir de notoriété publique, ce qui peut effrayer les financeurs, les donateurs et ceux qui envisager de travailler dans ce secteur.
Une précision : le fait que notre étude porte sur les difficultés du monde associatif lui donne une tonalité sombre, mais nous ne tenons pas un discours négatif. Il nous semble à tous deux qu’une cure d’amaigrissement n’a jamais fait de mal à personne, car elle peut permettre de réaliser des économies d’échelle et de revenir à une situation plus normale. L’incitation à la performance est généralement suscitée par des difficultés plutôt que par des finances florissantes. En outre, à chaque problème on peut trouver des solutions.
Deuxième difficulté : la baisse des subventionnements publics. Une association financée à plus de 90 % par l’État, les ministères, les régions, l’Union européenne et dont les comptes accusent une baisse de 1 à 10 % de ces financements, comme j’ai pu en voir cette année, est très vite confrontée à des difficultés si elle ne possède pas de fonds propres ni n’a cherché d’autres sources de financement.
S’y ajoutent les retards de paiement. Recevoir fin août ou en octobre une subvention censée contribuer à financer tout l’exercice et que l’on est sommé de restituer si on ne l’a pas intégralement consommée avant le 31 décembre, ce n’est ni correct ni compatible avec l’exigence de qualité de service de la structure.
Ces problèmes financiers résultent de la crise de 2008. Cinq ou six ans plus tard, la trésorerie est complètement asséchée : on est dans le creux de la vague, c’est pourquoi l’année 2013 a été particulièrement difficile.
J’en viens à plusieurs items qui correspondent à des phénomènes de société.
La difficulté des associations à recruter des bénévoles pour renouveler leurs structures dirigeantes résulte, un peu comme dans le cas des maires, du découragement, ou de la crainte qu’inspirent aux bénévoles, quel que soit leur dévouement, les risques associés à ces responsabilités.
La judiciarisation croissante de la société, très connue outre-Atlantique, n’en est qu’à ses débuts en France, ce qui explique que seules 15 % des associations interrogées y voient une source de leurs difficultés. D’anciens bénévoles parviennent aujourd’hui à plaider en justice qu’avec un ordinateur, une carte de visite et une présence de huit à dix heures par jour, ils étaient en réalité salariés. De tels procès obligent les associations à payer des sommes importantes en frais d’avocat et en indemnités et les petites structures ne peuvent s’en relever. Cela met à mal le bel objet associatif qui avait été créé.
La difficulté des associations à garder leurs salariés s’explique par l’écart de salaire de 34 % entre le secteur concurrentiel et le secteur associatif.
Enfin, les contraintes administratives et fiscales sont lourdes. Pour remplir une demande de financement adressée à l’Union européenne, il faut avoir bac plus dix ! Quant à la question de savoir quel taux d’impôt s’applique à tel ou tel placement financier, les banques elles-mêmes, voire les professionnels du chiffre, peinent à y répondre. La sectorisation fiscale implique l’établissement d’une comptabilité analytique et est de manière générale source de complexité.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci à tous deux de cet exposé très dense et très exhaustif, qui nous sera précieux.
Au-delà des constats, quelles solutions pourriez-vous proposer ?
Compte tenu du poids des départements dans le financement des associations, quelles pourraient être les conséquences de la réforme territoriale sur le mouvement associatif ? La répartition des compétences qui en découle ne risque-t-elle pas de fragiliser certaines associations ?
Le développement de la commande publique au détriment des subventions concerne-t-il essentiellement le secteur médico-social ou s’étend-il à d’autres secteurs d’activité et si oui, dans quelle mesure ?
Enfin, comment armer les bénévoles face au risque de contentieux qui menace les associations – comme d’ailleurs les entreprises –, afin qu’ils puissent assumer des responsabilités sans inquiétude ?
M. Régis Juanico. Je rejoins vos constats, notamment à propos du problème de la formation. Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) est doté de crédits budgétaires limités mais forme un nombre non négligeable de bénévoles chaque année. Vous proposez que l’on décentralise un peu plus son financement et son utilisation sur le terrain. Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire vient de créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles d’associations, mais ils sont facultatifs. Comment améliorer ce système afin qu’il profite le plus possible aux bénévoles ?
En ce qui concerne les dispositifs de soutien à l’acquisition de compétences au sein des associations, à la professionnalisation du secteur et à l’emploi associatif, quelle est votre évaluation des centres de ressources régionaux et départementaux, qui ne sont pas partout présents dans les territoires ?
Mme Viviane Tchernonog. En ce qui concerne l’accompagnement du bénévolat, il n’est pas vraiment de mon ressort de formuler des propositions, mais peut-être pourrait-on envisager d’ouvrir aux bénévoles des associations, pour certaines qualifications et en certains endroits, des dispositifs de formation des salariés qui existent déjà au niveau décentralisé et dans lesquels les conseils régionaux jouent un rôle important. Certes, ce ne serait sans doute pas sans poser des problèmes étant donné le financement de la formation professionnelle.
Plus généralement, plusieurs types de mesures destinées aux associations, qu’il s’agisse de former les bénévoles ou de faciliter les démarches administratives ou encore la réponse à la commande publique, me semblent devoir passer par les fédérations et les groupements d’associations ou d’employeurs. En effet, il est plus facile de financer des structures déjà mutualisées. En outre, cela pourrait inciter les associations, souvent assez individualistes, à y adhérer.
Les conséquences de la réforme territoriale sur les associations ne sont aujourd’hui claires pour personne, bien que nous ayons commencé à y réfléchir et que certains réseaux associatifs y travaillent. Voici toutefois ce que l’on peut en dire.
Les transferts des conseils généraux aux associations correspondent aujourd’hui à 80 % au financement de politiques sociales obligatoires dans les territoires, conformément d’ailleurs à la mission des départements en matière d’action sociale. On peut donc imaginer que, si les conseils généraux étaient supprimés, d’autres collectivités prendraient le relais et que les financements correspondants leur seraient transférés. Toutefois, pour un cinquième environ des financements alloués, les conseils généraux interviennent, notamment en zone rurale, quand il n’existe pas de commune importante susceptible d’animer la vie locale dans les territoires environnants. Ici, la suppression des départements risque d’accentuer la désertification de ces territoires.
En ce qui concerne la répartition des compétences, deux difficultés majeures sont à craindre d’après nos discussions avec les réseaux associatifs. Actuellement, 60 % des associations n’ont qu’un seul partenaire public, le plus souvent la commune ; 20 % des associations perçoivent un financement du conseil général, 17 ou 18 % de l’État et 4 ou 5 % du conseil régional. Celles qui bénéficient d’un financement multiple ne sont pas nombreuses et ce sont généralement de grosses structures qui mettent en œuvre les politiques publiques. Je doute qu’elles soient les plus touchées.
Qu’en est-il en revanche des secteurs associatifs qui ne relèvent de la compétence d’aucune collectivité ? Vont-ils être délaissés parce que les collectivités vont se concentrer beaucoup plus qu’auparavant sur leurs compétences ? Elles le faisaient certes déjà, les conseils généraux se consacrant au secteur médico-social tandis que les communes et l’État menaient des politiques plus diversifiées. Mais la crainte de voir ces secteurs disparaître demeure une source de préoccupation.
Idéalement, il faudrait que ces grandes évolutions ne concernent que les grosses associations. En effet, les financements publics et même privés se concentrent fortement dans de très grandes structures dotées de gros budgets et dont on peut aisément se représenter l’avenir. Mais la plupart des associations, notamment les petites et moyennes structures, qui vivent un peu de la subvention, un peu du travail bénévole, un peu de la bonne volonté de la mairie qui met un local à leur disposition, ne pourront survivre à la suppression de la clause générale de compétence.
Je confirme enfin que l’augmentation de la commande publique concerne essentiellement – à 70 % – le secteur médico-social.
M. Jean-Pierre Vercamer. S’agissant des dons et du mécénat, je ne conteste pas que le régime français de déductibilité fiscale soit très avantageux, mais il reste beaucoup à faire dans certains domaines. En Espagne, la déduction est de 100 % pour une cause considérée comme prioritaire à l’échelle nationale. L’effet est exponentiel. Dans les pays anglo-saxons, où se sont développées des associations de caractère libéral, une structure qui alimente à 100 % l’association mais appartient au secteur concurrentiel est exonérée d’impôt dès lors que les recettes sont entièrement consacrées au fonctionnement du système associatif.
Une autre spécificité de la France dans le monde est l’importance du nombre d’associations rapporté à la population. Dans ce contexte, le terme de « fusion », qui était un gros mot il y a encore cinq ans, devient audible ; on peut d’ailleurs aussi parler de « mutualisation » des ressources et des coûts. Quoi qu’il en soit, l’évolution est engagée. Dans certains départements, en matière de handicap, il existe une multitude d’associations qui font exactement la même chose, dont certaines avec de tout petits moyens. Il faut savoir reprendre les bonnes idées de ces dernières et favoriser non leur absorption mais leur cohabitation avec les autres. On pourrait imaginer – peut-être est-ce là ce que vous appelez centres de ressources – des sortes de groupements d’intérêt économique où les associations pourraient se faire aider par des comptables et de bons connaisseurs des rouages administratifs ou des relations avec les collectivités.
Il faut aussi lutter contre l’amateurisme – sans connotation péjorative – à la française qui explique le taux élevé de mortalité des associations lorsqu’elles n’ont pas de fonds associatif de démarrage, ce qui est autorisé dans notre pays. Pourquoi dispenser les associations, qui concluent des contrats salariés, d’une obligation qui s’impose aux sociétés anonymes ? Sans fonds associatif de démarrage, le taux de mission sociale est très mauvais au cours des quatre ou cinq premières années – avant que l’on sache en appeler à la générosité publique –, les contrats salariés sont précaires, on met les gens dehors deux ans après la création de l’association et l’on finit par perdre un objet associatif de qualité.
En matière de formation, il y a beaucoup à faire pour les salariés comme pour les bénévoles. Ne pourrait-on s’inspirer, pour aider ces derniers, de la manière dont les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) utilisent les fonds à l’intention des salariés ?
Cent euros donnés en période de crise ont plus d’importance qu’en période de croissance. La notion de performance devrait donc être transcendée dans les moments difficiles. Les financeurs publics demandent que l’utilisation des fonds soit contrôlée ; au-delà du seul équilibre des comptes, les rapports de gestion des associations devraient détailler davantage l’emploi des fonds et l’objectif qu’il a permis d’atteindre. Sans vouloir citer de noms, on met encore dans notre pays beaucoup d’argent dans des poches percées ou dans des objets associatifs dépourvus de toute utilité.
Enfin, à l’heure où l’origine des aides évolue, les associations devraient être incitées à se tourner vers d’autres modes de financement – fundraising, crowdfunding, titres participatifs, etc. Nous pouvons faire dans le secteur associatif ce dont nous nous sommes montrés capables dans le domaine bancaire et financier. Il existe dans le monde de grands donateurs disposés à se montrer généreux à condition d’être convaincus de l’efficacité des demandeurs. Les pays latins ne sont pas encore très mûrs dans ce domaine, mais il n’y a aucune raison que nous ne réussissions pas comme les Anglo-Saxons l’ont fait avant nous. Cela dit, la puissance publique devrait éviter dans la mesure du possible de réduire trop brutalement ses financements comme certains banquiers ont eu le tort de le faire.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, madame, monsieur, de cette excellente contribution à notre réflexion.
Audition de Mme Joëlle Bottalico, vice-présidente du Haut Conseil pour la vie associative, de M. Thierry Guillois, membre du bureau du Haut Conseil pour la vie associative, et de M. Michel de Tapol, président de la commission « Bénévolat »
(séance du 3 juillet 2014)
M. le président Alain Bocquet. Nous entendons maintenant les représentants du Haut Conseil pour la vie associative (HCVA). Cette instance d’expertise créée auprès du Premier ministre en juin 2011 a pour mission d’enrichir le dialogue entre les pouvoirs publics et les associations et d’améliorer la pertinence des mesures prises par les pouvoirs publics. Elle doit également contribuer, par ses propositions et recommandations, à améliorer la connaissance des réalités de la vie associative. Le HCVA a ainsi rendu plusieurs avis sur des sujets importants que notre commission d’enquête sera également amenée à aborder au cours de ses travaux, en particulier ceux du bénévolat, du financement privé ou de la validation des acquis de l’expérience bénévole associative.
C’est dire si l’expertise des membres réunis au sein du HCVA sera précieuse à la commission, qui doit s’attacher en premier lieu à cerner précisément les difficultés récentes ou anciennes du monde associatif, avant de proposer des pistes de solutions concrètes.
Madame, messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Joëlle Bottalico, M. Thierry Guillois et M. Michel de Tapol prêtent serment)
Mme Joëlle Bottalico. Le Haut Conseil pour la vie associative a été d’autant plus sensible à votre sollicitation qu’il a, vous le savez, engagé un travail sur le financement des associations. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte particulier, puisque le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est en cours d’examen au Parlement et que l’engagement associatif a été déclaré « grande cause » de l’année 2014.
Nous souhaitons donc passer en revue les points sur lesquels le HCVA a pu, depuis sa création, apporter une contribution, et nous vous soumettrons quelques éclairages complémentaires liés à l’actualité.
En premier lieu, et au regard des besoins grandissants d’une population dont la situation économique s’est dégradée, les associations pointent généralement des difficultés liées au financement de leurs activités, notamment du fait d’une baisse des subventions et des avances de trésorerie consenties par la puissance publique.
Dans son rapport sur le financement privé du secteur associatif, le HCVA rappelle « qu’en 2005, les associations tiraient une part prédominante de leurs ressources (51 %) de financements publics avec une large prépondérance des subventions publiques par rapport aux commandes publiques. Les financements privés venaient, quant à eux, à hauteur de 49 %, avec 32 % de recettes d’activité (vente de services associatifs à un prix de marché, produits des fêtes et des manifestations, etc.). (…) En 2011, la part des financements publics a diminué pour ne plus représenter que 49 %. De plus, cette baisse a surtout affecté les subventions publiques (de 34 % à 24 %) et n’a été que partiellement compensée par les commandes publiques qui sont passées de 17 % à 25 %. Répondre à des appels d’offres au lieu de présenter un projet pour obtenir son financement a fortement modifié les rapports entre la puissance publique et le secteur associatif, en alourdissant les charges de ce dernier et en générant une concurrence perverse entre ses principaux opérateurs. De plus, le phénomène a contribué à la disparition d’associations de taille moyenne (9 % en cinq ans) insuffisamment outillées pour soumissionner à des marchés publics et qui pourtant contribuaient au lien social.
« Pour faire face à cette situation, les associations ont dû augmenter sensiblement leurs ressources d’origine privée, les faisant passer à 51 % de leurs ressources totales (…), amenant les associations à tirer aujourd’hui la part prédominante de leurs ressources de financements privés. Si l’on ajoute le bénévolat, seule contribution volontaire en nature estimée, les financements privés atteignent entre 62,7 et 82,5 milliards d’euros selon les calculs indiqués. »
Comme vous le faites dans le rapport appuyant la création de cette commission d’enquête, nous constatons que la baisse des fonds publics est parfois compensée, pour certaines associations, par une augmentation sensible des participations demandées aux usagers ou adhérents, ce qui se traduit par une concentration progressive de l’action vers un public encore solvable – jusqu’à ce que les entreprises privées se saisissent de ces « niches » d’activités en dénonçant une concurrence déloyale du fait de la modicité des tarifs proposés !
Est-il imaginable que les associations se trouvent, à terme, cantonnées aux seules activités accessibles à un public non solvable ? Ou, a contrario, qu’elles soient amenées à orienter leurs activités vers un public disposant d’un minimum de revenus afin de pérenniser leur existence au détriment du projet initial ?
Les associations dénoncent également les obligations de plus en plus nombreuses auxquelles elles sont soumises, les contrôles de toutes natures qui génèrent des coûts rarement pris en compte alors qu’elles prennent sur leurs fonds propres pour financer les conséquences de ces normes et obligations. À titre d’exemple, les associations qui organisent la distribution de l’aide alimentaire en provenance de l’Union européenne – tels les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Banque alimentaire – se trouvent contraintes de mettre en place une comptabilité analytique très pointue, des logiques de gestion de stock avec chambres froides et transports frigorifiques, la mise en place d’outils informatiques pour orchestrer la traçabilité des produits distribués, etc.
Dans ce contexte, les difficultés financières s’accroissent et fragilisent non seulement le fonctionnement – les subventions pour celui-ci sont en net recul –, mais aussi le bénévolat, puisque les bénévoles se voient imposer des contraintes administratives généralement éloignées des missions pour lesquelles ils se sont engagés.
Votre rapport évoque les nouveaux moyens de mobilisation de la générosité publique, notamment par le biais des plateformes proposant un « financement participatif ou collectif » – autrement dit, le crowdfunding. Pour séduisant qu’il paraisse, le dispositif n’est pas sans danger. Il donne l’illusion d’une collecte dédiée uniquement à un projet – souvent un microprojet – en occultant l’idée même de fonds nécessaires au fonctionnement et à la gestion. Il se traduit en outre par une forme assez curieuse de compte rendu au donateur : pour un petit don, on a droit à un petit compte rendu, pour un gros don, on a accès au compte rendu complet et au suivi du projet ! Cette hiérarchisation de la transparence en fonction des moyens consentis par le donateur peut nuire considérablement à l’image de l’association engagée dans un projet, et ce d’autant plus que les donateurs sont nombreux.
Au-delà des aspects financiers, demeure la question des ressources humaines en bénévoles et en salariés. Michel de Tapol vous exposera les questions que le HCVA a abordées. Pour ma part, je me permets d’insister sur l’espoir qu’a suscité l’annonce d’un congé d’engagement. Bon nombre de bénévoles, par ailleurs en activité professionnelle, souhaitent pouvoir s’investir davantage, prendre une part plus active aux décisions et à la vie démocratique. L’accès à un congé d’engagement aurait également le mérite de contribuer à une démarche d’éducation populaire en donnant à cette partie de la population les moyens d’agir.
Lors de nos débats, nous avons également relevé l’inquiétude de certaines associations concernant l’emploi associatif, qui se trouve souvent lié à une logique d’emplois aidés, faiblement rémunérés et peu qualifiés. Une certaine précarité est ainsi engendrée par ceux-là même qui la condamnent, et les emplois associatifs se trouvent largement orientés vers une démarche d’insertion sociale et professionnelle sans que les moyens de cette insertion soient mobilisés.
Le monde associatif ne se résume pas aux grandes associations, aux grandes coordinations, aux grands réseaux, pas plus qu’il ne se limite aux très petites associations, qui apparaissent parfois comme les seules capables d’innover. Il est multiple, riche de sa diversité : c’est ce qui fait son originalité. Sa force réside aussi dans sa capacité d’invention et d’innovation, à condition qu’il puisse, en toute indépendance, poursuivre son développement.
M. Thierry Guillois. Il y a bien longtemps que le secteur associatif n’a pas suscité autant d’intérêt et de travaux de la part du Parlement. En moins de deux ans, plusieurs rapports ont été remis, notamment celui de Mme Valérie Rabault et de MM. Yves Blein, Jérôme Guedj et Régis Juanico sur l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, et celui du Sénat sur l’aide à domicile, présenté hier. Il faut également saluer le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, ainsi que le travail que vous engagez dans la présente commission d’enquête.
Je tiens donc à vous exprimer toute ma gratitude. Jusqu’à présent, on nous tenait plutôt des propos très généraux sur le poids des associations en chiffre d’affaires et en nombre de salariés, sur les perspectives ouvertes en matière de développement du salariat, etc. Peu nombreux étaient ceux qui s’intéressaient aux difficultés du secteur. Or celles-ci sont le reflet des difficultés que traverse la société française depuis plusieurs années.
En tant que président de la commission juridique et fiscale du HCVA, j’ai dirigé les travaux qui ont mené à la publication du rapport sur le financement privé des associations que Mme Valérie Fourneyron nous avait commandé. Sans répéter ce que viennent de vous dire Mme Viviane Tchernonog et M. Jean-Pierre Vercamer, je souhaite appeler votre attention sur les grandes tendances qui affectent le secteur. Je souscris entièrement à ce qui vient d’être dit sur le crowdfunding : derrière ces dispositifs se cachent bien souvent des opérateurs privés à but lucratif, et le gain n’est pas toujours à la hauteur des espoirs suscités par des personnes qui manient très bien la communication ! Plus généralement, si l’on n’y prend garde, le mouvement de bascule qui s’opère actuellement vers une recherche de nouveaux financements privés par tous les moyens conduira le secteur dans une impasse économique et financière. Beaucoup d’associations dépendant de l’aide publique pour accomplir une mission d’intérêt général ne peuvent déjà plus exercer pleinement leur activité. On le voit par exemple en matière d’aide à domicile : le recul du pouvoir d’achat d’un très grand nombre de familles fait plonger le secteur.
Comment parvenir à maintenir le modèle économique associatif sans le faire basculer dans le champ du marché et de ses instruments ? Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire essaie de donner une nouvelle actualité aux titres participatifs et associatifs dont M. Vercamer vantait tout à l’heure les mérites. Or ce texte soulève beaucoup d’interrogations. Les banquiers estimaient que le risque qu’ils prennent avec les titres associatifs est insuffisamment rémunéré. Le ministère de l’économie et des finances les a fort bien entendus et ouvre la possibilité d’une meilleure rémunération.
Aujourd'hui, l’ESFIN-IDES, filiale du Crédit coopératif, n’a que deux lignes de titres associatifs, alors que cet établissement a pour vocation de souscrire des titres associatifs en très grand nombre !
Lors de réunions avec des agents du Trésor, nous avons cherché des solutions. Il a finalement été décidé de permettre par la loi un supplément de rémunération pour ces titres, ce qui porte leur rémunération totale à 7 % environ, soit le taux du marché obligataire + 2,5 % + 2,5 %. Alors que, comme le rappelait M. Vercarmer, une association est une entreprise qui doit pouvoir payer ses salaires, se doter d’un minimum de matériel, recruter des personnels compétents, investir, comment imaginer qu’elle puisse, demain, rémunérer des titres à 6 ou 7 % ? C’est tout simplement impossible !
Compte tenu de la restriction constatée des crédits publics, nous redoutons beaucoup une inflexion vers une logique d’instruments de marché, qu’il s’agisse des titres, du crowdfunding ou, plus simplement, de la recherche de nouveaux débouchés ou de l’augmentation des prix des prestations. Dès lors, la question de la concurrence se pose de façon aiguë.
Jusque dans les années 1980, les associations ne se trouvaient pas sur des marchés concurrentiels. Lors du grand essor associatif de l’après-guerre – mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, professionnalisation du secteur de la santé et du secteur médico-social grâce à la sécurité sociale, développement du tourisme consécutif aux lois de 1936, etc. –, on ne se posait pas la question. On était en pleine reconstruction, l’argent public ne manquait pas, les modifications concernaient surtout l’extension du champ d’action du secteur, par exemple, aux droits des immigrés, aux droits des femmes, etc.
Le mouvement de bascule commence quelques années après les deux crises pétrolières. Se développent alors un nombre croissant d’associations d’insertion économique et de développement local. On oublie un peu, et je le regrette, ce qui a permis à beaucoup d’entre nous, formés à l’école de l’éducation populaire – ou confessionnelle, du reste – de devenir ce qu’ils sont. Cette formation de l’adolescent trouve bien souvent sa traduction dans un pratique politique, institutionnelle, militante, bénévole.
À partir de 1980, il faut à la fois parer au plus pressé et répondre à toutes les obligations réglementaires et légales que Bruxelles et Paris nous font tomber dessus. Les associations doivent recruter de plus en plus de professionnels pour constituer des dossiers à l’intention de la Commission européenne, notamment. Certes, à la faveur de la décentralisation, les départements, les communes et les régions ont compensé l’érosion continue des crédits d’État. La tendance s’inverse toutefois en 2011, comme Mme Tchernonog vous l’a expliqué : la manne globale des aides publiques diminue.
Je le répète, cette évolution peut se révéler désastreuse car nous en sommes réduits à adopter un fonctionnement de marché qui n’est pas le nôtre. J’en veux pour preuve deux exemples.
D’abord celui des établissements d’accueil pour personnes âgées. Sans doute certains d’entre vous ont-ils été administrateurs ou présidents d’une maison de retraite communale. Il y a vingt ou trente ans, ces établissements accueillaient tous les publics, ce qui leur permettait de faire leur propre mutualisation afin de recevoir des personnes relevant de l’aide sociale et n’ayant pas les moyens de payer le même prix que les personnes plus aisées. Entretemps, cette dernière catégorie a été attraite par la concurrence : les Jardins d’Arcadie, les Hespérides, etc. Dans la même période, en effet, l’hôtellerie a effectué un redéploiement, voyant dans les personnes âgées un débouché que son activité classique ne lui offrait plus.
Depuis, les associations se sont regroupées, restructurées, mais elles doivent à la fois gérer la pénurie, appliquer toutes les nouvelles réglementations sur le handicap et la dépendance et accueillir des personnes qui n’ont pas le moyen de payer le juste prix de la prestation fournie.
Le deuxième exemple est celui de l’aide à domicile, où les associations sont confrontées à la concurrence soit de petites entreprises, soit d’entreprises plus importantes offrant des prestations de jardinage, de restauration, d’accompagnement de personnes âgées. Or le secteur lucratif écrème ce qui est intéressant pour lui et laisse aux ADMR (Aides à domicile en milieu rural), à l’UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles) ou à d’autres des publics qui n’ont pas les moyens de payer une aide de 6 ou 7 heures par semaine.
Étant donné l’importance de l’enjeu, nous avons souhaité nous faire notre idée de la situation de chaque secteur. Nous avons ainsi reçu les représentants du tourisme associatif non fiscalisé – ou ce qu’il en reste –, du secteur sanitaire et médico-social, des secteurs sportif et culturel, ainsi que de celui de l’éducation populaire.
Je regrette qu’un amendement de M. Yves Blein au projet de loi de finances rectificative, voté par votre Assemblée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, aboutisse
– contre l’intention de son auteur, cela ne fait pas de doute – à assujettir au versement transport la quasi-totalité du secteur médical et médico-social. L’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne) évaluent le coût de cette taxe supplémentaire à environ 300 millions d’euros par an. Comme Mme Marisol Touraine l’a elle-même reconnu, les agences régionales de santé, les caisses d’assurance maladie et les caisses d’assurance vieillesse ne pourront évidemment pas assumer cette nouvelle charge. Le mouvement associatif s’emploie à alerter le Sénat pour qu’il modifie ce texte, car l’enjeu est considérable. Jusqu’à présent, le Gouvernement s’était toujours engagé à sanctuariser le périmètre de l’exonération actuelle.
Le secteur du sport, quant à lui, est menacé par une bombe à retardement. Aujourd'hui, très peu d’associations sont propriétaires de leurs équipements : ce sont les collectivités qui les mettent à leur disposition à titre gracieux. Or une disposition du projet de de loi relatif à l’économie sociale et solidaire tend à rendre obligatoire l’inscription de la valorisation de ces mises à disposition à la fois dans les comptes des communes et dans ceux des associations. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai que l’amortissement d’un stade sur une année, divisé par les tranches horaires affectées aux différents clubs, peut représenter des sommes colossales en face desquelles, bien évidemment, l’association n’a aucune recette à inscrire ! En outre, les collectivités ne sont plus à même de rénover les équipements sportifs comme elles le faisaient il y a dix ou vingt ans. Comment le secteur du sport pourra-t-il surmonter ces difficultés, alors que l’on continuera à lui demander d’amener les jeunes à la pratique sportive et de les former à différents niveaux ?
Permettez-moi maintenant d’exposer les propositions de notre rapport, articulées autour de trois axes.
Le premier est celui du développement des activités privées des associations. Dans le sauve-qui-peut actuel en matière de financements publics, nous sommes contraints de nous retourner vers la seule ouverture qui s’offre à nous. Sachant que le mécénat est en régression d’un point par an en moyenne depuis 2006 et que les associations ne peuvent plus jouer beaucoup sur les cotisations, il ne leur reste plus que la vente de prestations. Je vous ai dit ce que je pensais de cette option. En outre, si les associations vendent davantage de prestations ou en augmentent le prix, elles se heurtent à la fiscalité.
Par parenthèse, j’ai participé aux négociations qui ont conduit à l’instruction fiscale de 1998, celle qui a permis de pacifier les relations entre les associations, la concurrence commerciale et les pouvoirs publics. Or, dans ce texte, le critère de distinction entre activités lucratives et non lucratives n’est pas l’utilité sociale, mais la concurrence. En d’autres termes, on est d’utilité sociale parce que l’on ne concurrence personne et parce que l’on s’adresse à des publics qui n’intéressent pas le secteur lucratif. Je considère qu’il faut inverser cette logique de marché et tenir compte de l’apport des associations à la vie de la société. Au moment où nous abordons de nouveau cette question avec l’administration fiscale, nous avons besoin de votre soutien.
Le deuxième axe est la consolidation des fonds propres. J’ai déjà parlé du titre associatif. Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire comprend également une disposition qui devrait apporter une bouffée d’oxygène : la possibilité, pour toutes les associations, de percevoir des revenus locatifs, donc d’avoir des immeubles de rapport. Nous suggérons, par ailleurs, la création de foncières éthiques pour l’accueil d’urgence des personnes en difficulté ou sans abri. Enfin, le projet de loi reprend notre proposition tendant à favoriser les fusions et regroupements d’associations.
Le troisième axe est la sécurisation des mécanismes d’appel à la générosité publique. Nous avons veillé à ce que le projet de loi de finances rectificative ne diminue pas à nouveau les réductions et déductions existantes ; nous y veillerons lorsque le projet de budget pour 2015 arrivera en discussion.
M. Michel de Tapol. Le rapport présenté en mai dernier à l’appui de la création de cette commission d’enquête montre que vous avez déjà délimité les principales difficultés qui peuvent freiner la dynamique associative ; c’est pourquoi j’axerai mon intervention sur des propositions concrètes pour que les associations, conformément à l’intitulé de votre commission, « puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu social ».
Mon angle d’attaque sera donc le bénévolat, mais je ne puis m’exonérer d’une considération d’ordre général au sujet de ce qui pèse sur son exercice.
Au-delà de la crise actuelle qui perdure, les difficultés du monde associatif viennent aussi d’une évolution assez sensible de la manière dont les pouvoirs publics – État et collectivités territoriales – organisent leurs relations avec les associations.
Pour schématiser on pourrait dire que, du temps de l’État-providence, ce partenariat était assez simple : en échange d’une participation à la construction du bien commun, l’État subventionnait ; les associations, elles, réalisaient.
Aujourd’hui, ce mode de relation a changé. La subvention a largement fait place à des procédures de passation de marché et d’appel d’offres. Dans ce contexte concurrentiel, les associations ont dû s’organiser en conséquence. Professionnalisation du bénévolat, optimisation des coûts, recherche permanente d’efficacité, ont sensiblement changé la nature même de l’engagement, comme en témoignent les appellations devenues courantes de « bénévolat de compétence » ou de « mécénat de compétence ».
Le marqueur de la réalité associative est aujourd’hui l’« utilité économique ». Cette fonction n’est pas critiquable en soi, mais nombre des difficultés que vous soulignez dans le rapport préalable prennent leur source dans cet écartèlement de l’identité même des associations, tiraillées qu’elles sont entre l’efficacité mesurable et la spontanéité des pionniers du lien social.
Vous le savez, le champ originel des associations était de satisfaire des besoins non solvables et souvent complexes. Le génie associatif réside dans l’innovation, l’expérimentation. Proches de nos concitoyens, les associations peuvent apporter de nouvelles réponses aux défis de la communauté nationale et ces réponses n’ont pas de prix, même si leur valeur est considérable.
Qu’adviendrait-il de ces associations qui font largement appel au bénévolat, comme « Le Rire médecin » ou « Les Matelots de la vie » qui apportent joie, rêve, espoir et volonté à des enfants gravement malades, mais qui, faute de pouvoir justifier leur apport économique direct, n’entreraient plus dans les cadres institués d’un financement ? Elles sont légions !
Vous souhaitez mettre en exergue par les travaux de votre commission la nécessité de financer non pas seulement l’action mais aussi le fonctionnement des associations. Nous sommes bien là au cœur d’une exigence qui concerne les 12 millions de bénévoles attachés au secteur associatif. Ceux-ci doivent être encadrés, formés, soutenus, reconnus, valorisés. Ils apportent à notre société cette dimension profondément humaine et novatrice et participent à la construction d’une citoyenneté active.
Dans un document d’orientation centré sur le « socle » du bénévolat, le HCVA fait cinq propositions d’action : mieux appréhender la réalité associative dans sa diversité ; mieux faire connaître les dispositifs existants en faveur des bénévoles ; clarifier les relations entre les associations et leurs bénévoles ; mieux assurer un accès effectif à l’engagement associatif bénévole pour tous ceux qui le souhaitent ; construire une gouvernance à l’image du monde associatif.
Un engagement précoce a toutes les chances de se poursuivre tout au long de la vie. C’est pourquoi nous proposons trois mesures destinées à favoriser l’engagement bénévole des jeunes.
Premièrement, nous préconisons que l’école, à l’instar de ce qui se passe dans certains pays étrangers comme le Canada, devienne un lieu source qui abrite l’apprentissage à la citoyenneté et favorise prise de connaissance et participation à la vie associative. Ce projet permettra également de fédérer éducateurs et familles autour du jeune dans une relation constructive.
Deuxièmement, instituons des assises de jeunes bénévoles, dans un esprit semblable à celui du Parlement des enfants ou des conseils municipaux des jeunes. Au-delà de la médiatisation potentielle, la responsabilisation des jeunes est de nature à modifier le regard que la société porte sur eux.
Troisièmement, faisons aboutir le projet de modification de la majorité associative afin que de jeunes mineurs puissent prendre des responsabilités associatives à partir de seize ans.
J’en viens maintenant à la question du bénévolat des actifs et des personnes en recherche d’emploi.
Se fondant sur l’avis que le HCVA a rendu sur le congé d’engagement, le ministère chargé de la vie associative a souhaité mettre en place un groupe de travail qui formulerait des propositions. Les travaux de ce groupe arrivent à leur terme et devraient faire l’objet d’une communication dans les semaines à venir.
Par ailleurs, à la suite d’une saisine du même ministère, le HCVA s’est penché sur le dispositif de la validation des acquis de l’expérience bénévole associative. Ce dispositif qui a fait ses preuves est d’autant plus nécessaire qu’il s’adresse à des personnes en difficulté d’emploi. Après avoir constaté différentes difficultés qui jalonnent le parcours de validation, le HCVA a fait un certain nombre de propositions, dont celle de réactiver un comité interministériel de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faciliter la mise en œuvre de ses recommandations. Or le poste dédié à la VAE, mis en place par le précédent gouvernement et qui devait permettre d’optimiser le fonctionnement du comité, n’est plus pourvu aujourd’hui.
Il convient aussi d’être attentif à la reconnaissance accordée aux seniors, en se gardant toutefois de leur attribuer, comme le prônait le précédent gouvernement, un statut particulier ou une forme de récompense. Étant moi-même senior et bénévole, je revendique le droit à être traité comme tout le monde !
Enfin, la question du renouvellement des instances dirigeantes reste d’actualité. Disposer d’une gouvernance exemplaire fédérant autour de leur projet l’ensemble des parties prenantes est une exigence pour les associations. Cette gouvernance encore à construire mobilise de nombreux acteurs de la vie associative, en particulier le HCVA, le Mouvement associatif et La Fonda.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci pour ces interventions très riches et très denses, qui nous conduisent à nous demander ce que devient la solidarité dans le monde actuel.
Vous évoquez le besoin de compenser la baisse des financements publics par des financements privés, mais aussi l’apparition de nouveaux besoins et de nouveaux risques. À ce titre, peut-être certains dispositifs sont-ils frappés d’obsolescence, y compris dans le secteur médico-social. La demande a évolué et il peut y avoir un écart temporel entre l’évolution des besoins de la société et les réponses qui leur sont apportées, puis l’adaptation des collectivités territoriales – dont la réforme amènera certainement tous les acteurs à redéfinir leur position.
À titre d’exemple, la demande de prise en charge médico-sociale des personnes âgées ou handicapées a évolué. Il existe sans doute des formes d’intervention plus souples et moins onéreuses, et les associations peuvent être aussi force de proposition, quels que soient leur taille, leur statut et leur source de financement.
C’est un débat de fond. Quelle nouvelle forme de solidarité voulons-nous pour l’avenir ? Que devons-nous préserver ? Compte tenu de la raréfaction de la ressource publique, comment adapter le service rendu tout en conservant la liberté d’initiative des associations et leur indépendance à l’égard des différents lobbies, qu’ils soient cultuels, privés ou industriels ?
M. le président Alain Bocquet. Nous partageons la quasi-totalité de votre défense de la vie associative. Cela étant, les associations sont diverses et il ne faut pas tomber dans l’angélisme, notamment en matière de sport. Même si je suis maire d’une ville élue « ville la plus sportive de France » en 2005, je crois que certaines associations, et surtout leurs fédérations, devraient balayer devant leur porte. S’il est un domaine de la vie associative qui est pollué par l’argent et où la passion l’emporte sur la raison, c’est bien celui-ci. Lorsque, comme cela arrive, 62 % des ressources d’un club remontent vers la fédération sous forme de licences, de pénalités, etc., on va dans le mur ! Le contexte est bien différent de celui de l’aide à domicile ou de l’action sociale.
Au surplus, les règles ne cessent de changer. Les collectivités se voient contraintes de changer le tracé du terrain de basket-ball, de remplacer les panneaux… Bref, le secteur sportif mérite un examen à part.
M. Thierry Guillois. N’assistons-nous pas, dans le sport également, à une fracture entre ceux qui deviennent de plus en plus riches et ceux qui s’appauvrissent ?
M. le président Alain Bocquet. D’autant que le bénévolat tend à disparaître dans ce domaine.
M. Thierry Guillois. Ailleurs, pourtant, jamais la solidarité en nature n’a été aussi vivace. La solidarité financière, elle, subit les effets de la crise : lorsque l’on donnait 100 ou 50 l’année dernière, on ne donne plus cette année que 80 ou 40.
Je pense néanmoins, madame la rapporteure, que certains réseaux, associations ou mutuelles ont réalisé un réel effort d’adaptation de l’offre de service aux nouvelles demandes ou contraintes du public des personnes âgées, pour ne prendre que cet exemple. Il existe des organismes qui proposent une gamme très développée de possibilités d’accompagnement. La maison de retraite n’est plus la solution unique. On essaie de maintenir la personne à domicile autant que faire se peut. Néanmoins, si le coût du maintien à domicile est inférieur au coût du séjour dans un établissement, la prise en charge n’est pas automatiquement la même. Il y a là un sujet de réflexion, sachant que l’inflexion que connaît actuellement le secteur a partie liée avec les difficultés des conseils départementaux et avec la contraction du pouvoir d’achat des ménages.
Mme la rapporteure. La solidarité familiale a également changé.
M. Thierry Guillois. Oui. On doit malheureusement constater que les structures familiales ont explosé et ne sont plus là pour assurer la solidarité.
Dans ma profession d’avocat, il m’est arrivé d’être commis pour accompagner des personnes en garde à vue. Une nuit, dans un commissariat de Nanterre, je dois assister un adolescent. Celui-ci m’oppose une totale absence de communication. Je demande alors au brigadier s’il a prévenu les parents. Il l’avait fait, et s’était vu répondre, comme à l’accoutumée : « Gardez-le ! On n’en veut plus ! » Le commissariat récupérait le gamin tous les matins. Sans doute ces phénomènes ne concernent-ils pas toute la population, mais c’est aussi cela, la réalité. Comment imaginer que la personne, par la suite, pourra accompagner un grand-père ou une grand-mère dont elle n’a pas grand-chose à faire ?
M. le président Alain Bocquet. Merci pour votre contribution. Nous resterons en contact avec le Haut Conseil pendant la durée de nos travaux.
Audition de M. Gérard Terrien, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, et de Mme Francine Dosseh, magistrate
(séance du 3 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Depuis de très nombreuses années, les liens entre les collectivités territoriales et les associations sont étroits, et plus encore du fait du désengagement de l’État. Il nous est donc apparu que le regard porté sur ces liens par une chambre régionale des comptes serait utile à la réflexion de notre commission.
Deux thèmes paraissent particulièrement importants à cet égard : la portée du contrôle exercé par les collectivités sur l’usage de leurs concours, en espèces ou en nature, par les associations qui en bénéficient ; la situation des associations directement soumises au contrôle de la chambre régionale, à la lumière des dernières années écoulées : gestion financière, gestion de l’emploi salarié ou bénévole, fiscalité, concurrence avec les activités du secteur lucratif.
Monsieur le président, madame, nous aimerions connaître votre expérience et votre point de vue sur les problématiques nouvelles qui pourraient se poser, dans le cadre de la situation que nous connaissons. Mme Dumas, rapporteure de notre commission, mes collègues et moi-même serons sans doute amenés à approfondir le débat.
Avant de vous entendre et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Gérard Terrien et Mme Francine Dosseh prêtent serment)
M. Gérard Terrien, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France. Avant d’en venir au fond du sujet, je souhaiterais vous présenter le cadre dans lequel nous contrôlons les associations relevant de la loi de 1901.
Il est rare que nous contrôlions directement les associations. Nous le faisons le plus souvent à travers le contrôle des collectivités territoriales. De fait, sur les cinq dernières années, nous n’avons pas contrôlé plus d’une douzaine d’associations subventionnées en Île-de-France, associations tant sportives qu’intervenant dans la politique de la ville, dans le domaine culturel, dans l’éducation, la gestion des œuvres sociales des personnels des collectivités territoriales – ce qui est un sujet important dans le secteur associatif – ou la gestion d’équipements. En revanche, dans le cadre de l’examen de gestion des collectivités territoriales, nous sommes fréquemment amenés à nous pencher sur les relations de ces collectivités avec les associations, particulièrement au regard de l’application des dispositions légales relatives aux seuils de 23 000 et de 153 000 euros, et de la façon dont les collectivités s’assurent du contrôle de ces associations. Nous l’avons fait une trentaine de fois au cours de cette même période.
Le dispositif de contrôle applicable au champ régional n’est pas obligatoire, mais facultatif : il peut être ouvert par une chambre, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou du président de la collectivité territoriale.
Les moyens de contrôle sont très importants. Dès qu’un concours financier dépasse 1 500 euros, la chambre peut intervenir et contrôler l’organisme. Si celui-ci tient un compte d’emploi de la subvention, nous pouvons nous limiter à l’examen de ce compte. Toutefois, très peu d’associations tiennent ce genre de compte. Nous ne contrôlons pas les petites associations. Le nombre d’associations recevant des subventions importantes est très faible : en Île-de-France, jusqu’à un million d’euros, elles sont 250 000 ; au-delà d’un million d’euros, un peu moins de 2 000 ; et au-delà de cinq millions d’euros, leur nombre est encore plus limité. Cela explique que nos contrôles sont assez ciblés.
Le contrôle d’une association ressemble à celui d’une collectivité territoriale : contrôle des comptes, de la gestion, des opérations de commande, contrôle des liens avec la collectivité, et éventuellement contrôle de la gestion du personnel. Mais, au vu de l’échantillon que nous avons examiné, nous n’avons pas tiré de conclusions générales.
Le rapport tendant à la création de cette commission d’enquête avait souligné le caractère hétérogène du secteur associatif. Dans la pratique, nos contrôles portent davantage sur des secteurs précis – culturels, sportifs, etc. Nous sommes rarement saisis d’un examen de gestion d’une association en tant que telle. Encore une fois, c’est plutôt à l’occasion de l’examen de gestion des collectivités territoriales que nous intervenons, notre prisme principal étant non pas l’association elle-même, mais la subvention touchée par celle-ci et la collectivité territoriale qui lui verse cette subvention. À l’occasion de cet examen, nous regardons les liens qui existent entre elles : la constitution des dossiers de subvention, la façon dont ces dossiers sont instruits et le contrôle de la collectivité territoriale.
Nous sommes conscients que le seuil, fixé à 23 000 euros par la loi d’avril 2000
– ou plutôt le décret de 2001 – pour une convention d’objectifs entre la collectivité territoriale et l’association est assez bas. Nous nous assurons que cette obligation légale est respectée. Il est fréquent que des subventions supérieures à 23 000 euros soient versées sans convention ; nous en faisons l’observation. En général, les collectivités territoriales se mettent rapidement en conformité avec la loi.
Notre contrôle s’effectue sous le prisme financier, ce qui est logique, et donc sous le prisme des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. La Cour des comptes va rendre, en octobre prochain, son deuxième rapport sur les collectivités territoriales. Au plan national, nous sommes contraints d’étudier ce dispositif de finances locales dans le cadre de la loi du 17 décembre 2012, des engagements de la France et de la loi de programmation des finances publiques, et donc d’apprécier l’évolution des finances locales dans le cadre général de la perspective de redressement des finances publiques.
En 2013 – et l’Observatoire des finances locales a fait le même constat il y a quelques semaines –, malgré une progression plus rapide des dépenses de fonctionnement que des produits de fonctionnement au plan national aussi bien que régional, il n’y a pas eu de diminution substantielle des subventions de fonctionnement au plan national. Pour les communes, le rythme est resté élevé – autour de 9 % des dépenses de fonctionnement d’ensemble. Bien sûr, en Île-de-France, des collectivités territoriales attribuent des subventions à hauteur de 1 à 2 % de leurs dépenses de fonctionnement quand d’autres vont jusqu’à 13 ou 14 %. Cela relève de la liberté d’administration des collectivités territoriales. Pour les intercommunalités, les subventions de fonctionnement ont progressé moins vite en 2013 qu’en 2012. Sans doute n’est-ce pas leur priorité ; sans doute aussi leur est-il plus facile d’intégrer une moindre progression des subventions dans leur démarche de maîtrise des dépenses. Pour les départements, le montant des subventions est resté quasiment stable, mais pour les régions, au plan national, les subventions ont faiblement diminué en 2013 par rapport à 2012.
Le message que nous cherchons à faire passer aux collectivités territoriales est que, si elles veulent continuer à investir – ce qui nous paraît nécessaire au regard du poids de leur investissement dans la formation brute de capital fixe nationale –, elles doivent maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Au risque de vous choquer, quand nous procédons à des examens de gestion et à des analyses financières, nous indiquons aux collectivités qu’elles peuvent faire des économies en réduisant les subventions, sachant qu’elles ont des dépenses de fonctionnement extrêmement importantes : charges de personnels, dépenses d’action sociale et aides sociales, etc.
Nous ne portons pas de jugement de valeur sur le secteur associatif. S’il paraît une voie d’externalisation de l’action des collectivités territoriales, le réexamen des subventions versées offre aussi des pistes d’économies. Cela relève évidemment des seules décisions des collectivités territoriales et de leur assemblée délibérante. Nous ne sommes jamais sollicités pour donner ce type d’appréciation, mais nous laissons entendre qu’il est important d’examiner l’utilité sociale du secteur associatif.
Enfin, j’observe qu’à l’occasion de nos contrôles, nous rencontrons des situations extrêmement variées. Mais je vais laisser Francine Dosseh vous en parler.
Mme Francine Dosseh, magistrate à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France. Mon propos portera sur les quelques enseignements tirés de la trentaine d’examens de gestion de collectivités effectués ces dernières années, dans le cadre desquels le thème des relations avec les associations a été abordé. Je rappelle qu’il n’y a pas de contrôle systématique, par les chambres régionales des comptes, des associations subventionnées et que le critère des subventions n’entre pas non plus systématiquement en ligne de compte, ni dans la programmation de la chambre ni dans le plan de contrôle. Ces rapports ne constituent donc pas un échantillon, mais ont valeur d’exemple.
En premier lieu, nous avons constaté que la tendance relevée au niveau national se confirmait, en tout cas pour les communes – il s’agit essentiellement d’examens de gestion de communes : l’effort financier consenti en faveur des associations est maintenu, voire augmenté, en pourcentage par rapport aux dépenses globales de fonctionnement. Nous avons observé un ou deux cas de diminution, mais cette diminution n’était qu’apparente : elle était due à des circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, la reprise en régie directe de l’activité « petite enfance », auparavant assurée par une association.
En deuxième lieu, de nombreuses aides indirectes en nature sont peu ou pas recensées, peu ou pas valorisées, y compris dans des collectivités de taille importante. Près de la moitié des rapports que nous avons étudiés critiquaient l’absence de recensement ou de valorisation correcte des aides en nature. Cela nous conduit à penser que l’effort réel des collectivités territoriales – en tout cas des communes – en faveur du monde associatif est plus important que les chiffres formellement affichés dans les documents obligatoires. C’est ainsi qu’il faut y ajouter les services que les collectivités mettent de plus en plus souvent à la disposition des associations à travers les maisons des associations, pour les aider au quotidien dans leur gestion et leur administration. La plupart du temps, ces services ne sont pas valorisés, pour des raisons de comptabilité analytique ou de nomenclature figurant dans les instructions comptables. Il faut dire qu’il n’est pas toujours facile d’identifier les coûts de personnel, de locaux, et les frais de fonctionnement liés à une telle activité. Pour en avoir une vision globale, il faudrait parvenir à consolider les différents aspects de l’aide des collectivités au milieu associatif.
En troisième lieu, les communes que nous avons contrôlées, qu’elles comptent quelques milliers d’habitants ou plus de 100 000, continuent toutes de verser à une multitude de petites associations des subventions de montants modestes. Nous n’avons pas constaté de diminution dans le nombre des associations subventionnées. Cela témoigne probablement d’une volonté de maintenir un tissu associatif de proximité, malgré le risque de saupoudrage – critique souvent présente dans les rapports – et la lourdeur de gestion de centaines de subventions de quelques centaines d’euros.
Quelques exemples tirés des rapports : la Ville de Paris subventionne quelque 2 400 associations chaque année, dont la moitié pour un montant inférieur à 4 000 euros ; la commune de Boulogne en subventionne à peu près 200, dont une trentaine seulement reçoit plus de 23 000 euros, soit le seuil de la convention d’objectifs ; Nanterre verse annuellement 200 subventions, dont quatorze sont supérieures à 23 000 euros, et Montreuil 400 subventions, dont quarante supérieures à ce seuil ; à Sarcelles, il y en a douze sur 160. La moyenne annuelle des subventions constatée sur quelques communes est de 1 200 euros à Fontenay-sous-Bois, où 200 associations sont subventionnées, de 2 000 euros à Ivry-sur-Seine et de moins de 1 000 euros pour 43 % des subventions versées à Antony. C’est dire que persiste dans les communes la volonté de subventionner des associations très locales pour des petits montants et des petits projets.
J’en viens au contrôle par les collectivités de l’utilisation des fonds qu’elles versent aux associations.
De plus en plus de collectivités ont structuré et centralisé professionnellement les services chargés d’instruire et de gérer les subventions aux associations, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. Parallèlement, elles ont généralisé l’utilisation de modèles types, de dossiers normés de demande de subventions, y compris pour les petites associations.
L’utilisation de ce type de documents, qui s’appuient parfois sur les dossiers CERFA, plus ou moins adaptés, ou sur les documents types de l’État pour les conventions supérieures à 23 000 euros, devrait donner une base suffisante à une collectivité pour assurer un contrôle minimum sur l’utilisation des fonds versés aux associations. Dans ce cadre, les associations sont en effet amenées à produire leurs comptes, leurs rapports d’activité, etc. Or, en réalité, très peu de collectivités exercent un contrôle effectif sur les subventions, y compris quand ces dernières sont d’un montant important : soit que les conventions d’objectifs ou les documents d’attribution de subvention ne répondent pas aux exigences imposées aux bénéficiaires ; soit que les bénéficiaires produisent des documents qualitativement ou quantitativement insuffisants pour pouvoir vraiment procéder à une analyse, sans que les collectivités aient exigé d’eux qu’ils remplissent leurs obligations ; soit que, finalement, les collectivités n’analysent pas les documents reçus, peut-être par manque de moyens.
Quoi qu’il en soit, la chambre rappelle dans ses rapports la nécessité, pour les collectivités, d’opérer un contrôle sur les subventions qu’elles versent, ainsi que le prévoit d’ailleurs le code général des collectivités, la convention ne faisant, finalement, que rappeler cette exigence. Ce contrôle doit être exercé par des personnels délégués soit propres à la collectivité, soit extérieurs à celle-ci. Il peut être exercé sur pièces et sur place, ce qui est un moyen de voir ce que font concrètement les associations.
Compte tenu de la très grande dispersion des subventions versées, la chambre, tout en rappelant la nécessité d’exercer ces contrôles, insiste sur le fait que ceux-ci doivent être proportionnés aux enjeux. Ainsi, les moyens que nécessiterait d’engager le contrôle de mille associations qui auraient reçu 500 ou 800 euros de subvention seraient disproportionnés par rapport aux enjeux. Le contrôle est nécessaire et il appartient à la collectivité de l’exercer effectivement, mais il ne peut pas être systématique et doit être justifié par des enjeux financiers ou autres.
Pendant toute une période, les chambres ont constaté que certaines associations étaient des démembrements des collectivités, qui externalisaient ainsi certains services. C’est une observation que nous faisons de moins en moins avec les restructurations opérées par les collectivités.
M. Gérard Terrien. Comme vient de le dire Francine Dosseh, on ne voit pratiquement plus de cas de gestion de fait, comme dans les années 1990. Les associations de démembrement, dans lesquelles les élus sont partie prenante, présentent en effet beaucoup de risques de type conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêts. Évidemment, nous nous assurons – et le corps préfectoral le fait également – qu’il n’y a pas de participation au vote quand il y a des intérêts. Vous avez d’ailleurs récemment adopté des textes renforçant le dispositif existant.
Nous essayons également de mettre en garde les collectivités sur quelques risques plus simples.
L’imprécision de la convention d’objectifs peut avoir des conséquences dommageables, notamment lorsque la collectivité veut retirer la subvention à l’association. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, cela ne sera juridiquement pas possible s’il n’y a pas de conditions suspensives ou résolutoires ou si l’association a fait complètement autre chose des fonds et que la convention ne l’a pas prévu – cela n’aura pas le caractère d’une dépense obligatoire pour l’association.
La qualification pénale est assez marginale, mais un risque plus récent est au cœur de votre sujet : l’action en comblement de passif, si jamais les dirigeants de la collectivité territoriale, de droit ou de fait, ont eu connaissance de difficultés financières de l’association et ont influé sur des choix de gestion qui se sont révélés mauvais. C’est arrivé avec une association de handball à Nice et avec une autre association sportive à Sarreguemines. Dans ce dernier cas, la collectivité, qui avait poussé l’association, dont elle connaissait les difficultés financières, à contracter un emprunt de 150 000 euros, avait brutalement interrompu les subventions qu’elle lui versait. L’association s’était retrouvée en situation de liquidation, mais la collectivité avait été considérée comme fautive. Le département de la Dordogne également s’est retrouvé, à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire d’une association, impliqué de fait dans la création, l’objet et le financement de cette association.
Cela se produit rarement, mais quand cela arrive, les conséquences peuvent être extrêmement graves en termes financiers, mais aussi en termes d’image. Il faut dire que la souplesse du schéma associatif est telle que certains pensent que l’on peut s’autoriser tout type de liens. Voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité de clarifier les liens entre la collectivité et l’association.
Jusqu’à l’adoption de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire, de nombreuses collectivités locales préféraient – et on le comprend – adopter des logiques de marché public plutôt que des logiques de subvention, en raison du risque lié à l’incertitude de la réalisation de la prestation par l’association. Cela dit, les chambres n’avaient pas fait de la requalification des subventions en commande publique leur cheval de bataille.
Si l’on peut attendre de la définition de la subvention inscrite dans la loi sur l’économie sociale et solidaire qu’elle clarifie les choses, cela n’empêchera pas toutefois une association qui n’a pas eu de subvention d’aller devant le juge administratif en parlant plutôt de prestation de service, ni les usagers ou les citoyens de continuer à contester. Je pense que l’on est face à deux types de dispositions contradictoires : d’un côté, la loi d’avril 2000 sur les relations de l’association et de la collectivité, et de l’autre, le cadre général de la commande publique fixé au plan national et au plan communautaire.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Pensez-vous qu’il soit nécessaire de revoir le lien entre les collectivités et les associations, en fonction des différents types d’activité ? Comment rendre ce lien plus pérenne et assurer une meilleure protection des deux parties ? Ne pensez-vous pas que certains secteurs d’activité sont plus fragiles que d’autres ?
M. Gérard Terrien. Les associations du secteur social et médicosocial sont soumises au code de l’action sociale et des familles. L’encadrement est donc très lourd. Pourtant, il arrive que personne ne contrôle vraiment les acteurs. En effet, la plupart du temps, leur mécanisme de financement n’est pas celui du monde associatif mais, comme tout le secteur social, un mécanisme de financement par la tarification. Nous avons récemment vu, dans le Val d’Oise, des associations pour adultes et jeunes handicapés, certes supervisées et contrôlées par le département, mais que l’on pourrait qualifier comme étant « dans une situation de non-maîtrise ». De la même façon, le secteur sportif a, lui aussi, ses contraintes propres, et il faudrait sans doute en préciser le fonctionnement.
Il est vrai que nous sommes face à une très grande hétérogénéité : certaines associations sont des relais de la collectivité, d’autres réalisent des politiques publiques – par exemple, la politique de la ville. En outre, si le cadre associatif est extrêmement souple, le cadre comptable de l’association est simple mais son cadre fiscal très compliqué. Il faudrait sans doute essayer de cadrer les différents types d’activité et de faire un recensement, secteur d’activité par secteur d’activité, pour apprécier le poids de l’intervention.
Quand nous faisons un contrôle sur des associations d’œuvres sociales des personnels locaux ou sur une association sportive, nous ne sommes pas du tout dans le cadre juridique. Nous craignons tout particulièrement les associations pluri-actives, avec des activités marchandes et des activités non marchandes. La chambre a mené, il y a quelques années, des travaux sur l’association Léonard de Vinci, à Nanterre, et ce fut très compliqué des points de vue comptable, de fiscalité et de gestion.
Il serait important de pouvoir croiser des critères et de disposer de schémas plus précis. Certes, un code associatif selon les activités irait à l’encontre de la liberté d’association. Mais après tout, cela existe pour les sociétés et pour d’autres secteurs économiques.
M. Régis Juanico. Pour faire des économies, ce n’est pas forcément sur le montant ou la nature des subventions qu’il faut jouer, mais sur la constitution des dossiers de subvention qui mobilisent beaucoup de moyens humains et financiers – souvent, entre collectivités locales, départements, régions et communes, ce ne sont pas les mêmes, même si des efforts ont été faits pour concevoir des modèles types.
Prenez l’exemple du CNDS (Centre national pour le développement du sport) : la constitution et l’instruction des dossiers mobilisent, d’un côté, 250 fonctionnaires des services déconcentrés de l’État, et, de l’autre côté, des milliers de bénévoles qui passent des heures à remplir le même dossier chaque année. Il faudrait simplifier la procédure des dossiers de subvention et passer à leur dématérialisation. En l’absence de modification, on ne devrait pas avoir à produire les mêmes pièces justificatives tous les ans. La convention pluriannuelle d’objectifs répond à un souci de sécurisation, dans la durée, du financement des associations. En outre, elle serait également le moyen de faire des économies. Avez-vous des préconisations à faire à ce propos ?
J’insisterai ensuite sur l’importance de la clarification des compétences pour les relations entre les associations et les collectivités locales. Si les montants sont faibles, c’est parce que les intérêts sont différents – communaux, départementaux, régionaux, nationaux, parfois – et finissent par se croiser. Le deuxième projet de loi sur la décentralisation prévoit de maintenir une clause de compétence générale sur le tourisme, la culture et le sport. Pour le moment, le mouvement associatif n’est pas concerné. Le Parlement en discutera.
La clarification des compétences des collectivités devrait permettre de voir qui finance quelles associations et pourquoi. Pour le tourisme, la culture ou le sport, il faudra bien, à un certain moment, confier le chef de filat à un territoire suffisamment vaste – pourquoi pas la région ? – pour assurer coordination et harmonisation et éviter que les différents niveaux de collectivité ne se chevauchent. Là encore, avez-vous des préconisations à faire ?
Mme Francine Dosseh. S’agissant des formalités et de l’énergie qu’implique un dossier de demande de subvention, un effort a été fait, et les collectivités sont fortement incitées à utiliser les modèles types qui ont été créés pour les subventions versées par l’État. Mais cela relève évidemment de la libre administration des collectivités. Certaines ont rationalisé et simplifié les formalités en utilisant leur propre modèle, ou en adaptant le modèle de l’État.
Le modèle CERFA et les conventions types pour les subventions de plus de 23 000 euros ont été pensés pour simplifier les dossiers, pour éviter les redondances et faire en sorte que certaines pièces ne soient fournies qu’en cas de modification – des statuts, par exemple. Certes, la chambre ne s’intéresse pas forcément, quand elle contrôle une collectivité, aux dossiers individuels, mais à la gestion, au traitement et à l’instruction des subventions. Pour autant, dans la trentaine des dossiers que nous avons regardés, il nous est clairement apparu que les collectivités avaient bien le souci de simplifier les choses, ne serait-ce que parce que l’hétérogénéité des dossiers de demandes leur pose des problèmes dans leurs propres services et entraîne des coûts d’instruction beaucoup plus élevés.
Par ailleurs, la dématérialisation progresse. Aujourd’hui, presque toutes les demandes de subvention adressées à la Ville de Paris sont faites en ligne. Il a fallu procéder progressivement, en faisant preuve de pédagogie, tout particulièrement auprès des petites associations. À terme, le traitement des quelque 2 000 dossiers se fera. en ligne, depuis la demande jusqu’à l’attribution de la subvention.
M. Gérard Terrien. Nous nous interrogeons à propos du seuil des 23 000 euros, qui date de 2001. Peu de seuils financiers n’ont pas bougé en treize ans. Certaines collectivités, pour des subventions dépassant largement 23 000 euros, ne demandent pas de conventions d’objectifs ; d’autres en demandent pour des montants moindres. La loi s’applique donc de façon variable, mais il faut reconnaître que 23 000 euros constitue un seuil assez faible. Faut-il le relever ? Cela simplifierait peut-être les choses.
S’agissant de la clarification des compétences, nous sommes bien conscients de l’intérêt de regarder les associations importantes, notamment les associations culturelles. Nous avons récemment contrôlé en Île-de-France plusieurs théâtres de la petite et de la grande couronne. Il est évident que, sans le concours de la commune, du département, de l’intercommunalité, de la région, de l’État – assez peu, il faut le reconnaître – et d’un certain nombre d’acteurs, le dispositif de l’association culturelle ne fonctionne pas.
Je connaissais la proposition consistant à conserver un mécanisme de clause de compétence générale. C’est vrai que cela suppose qu’il y ait un chef de file. Autrement, on se retrouve dans la logique du guichet et personne – sauf ceux qui reçoivent les documents et les analysent – ne sait à combien de guichets l’association est allée se présenter, ni quel est son financement public. Des associations culturelles peuvent être financées à 80 %, la billetterie ne dépassant pas 15 à 20 %, mais ce peut être un choix d’équilibre d’exploitation. Il est néanmoins certain que si l’on ne sait pas si les salles sont pleines, si la jauge est utilisée, si l’objectif de quatre-vingt-treize représentations dans l’année est tenu, bref s’il n’y a pas de contrôle derrière, cela n’a que l’apparence d’une politique culturelle.
Mme Bernadette Laclais. Vous avez signalé que le seuil de 23 000 euros n’a pas été réévalué depuis sa mise en place. Entre les associations qui recourent peu aux subventions et celles qui y font appel pour une part plus ou moins importante de leur budget, les situations sont extrêmement différentes, dans le domaine culturel ou dans le domaine sportif. Une association peut même être le bras séculier de la collectivité pour organiser tel ou tel festival.
Le seuil de 23 000 euros pour la conclusion d’une convention ne fait pas l’unanimité et l’on peut s’interroger sur sa pertinence. Les évolutions et la pratique actuelle n’incitent-elles pas à l’instauration d’autres types de seuil et à passer des conventions financières à des conventions d’objectifs ?
M. Jean-René Marsac. Vous avez dit qu’il n’y avait plus ou très peu de situations de gestion de fait et moins d’associations à caractère parapublic. Il me semble pourtant que l’on en voit encore beaucoup sur nos territoires.
On voit également se développer le phénomène d’interpénétration des collectivités locales au sein des conseils d’administration des associations. Ce n’est pas tant le fait des collectivités que celui des associations, qui font pression pour que des élus viennent siéger dans leur conseil, croyant, par ce biais, organiser un partenariat plus efficace. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, ni même que ce soit le moyen, pour les collectivités, d’exercer un véritable contrôle sur l’association. Je pense même que l’on introduit ainsi de l’ambiguïté.
N’y aurait-il pas lieu de clarifier les choses, s’agissant notamment du statut des conseillers municipaux ou adjoints siégeant, au titre de leur collectivité, au conseil d’administration de telle ou telle association ? Il me semble que cette interpénétration s’est amplifiée ces dernières années. Il suffit de voir les listes de délégations qui sont soumises au vote du conseil municipal en début de mandat.
M. Éric Straumann. Jusqu’où faudrait-il élever le seuil de 23 000 euros ? 50 000 ? Avez-vous des chiffres à nous proposer ?
Ne faudrait-il pas aussi envisager de relever le seuil de 153 000 euros, celui qui entraîne l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes ? En effet, les frais d’expertise comptable ont évolué. Je connais une association transparente qui doit verser 8 000 euros à ce titre, ce qui paraît disproportionné.
Enfin, on ne parle plus beaucoup aujourd’hui des subventions versées aux structures de sport professionnel, comme les clubs de football. Il y a pourtant encore des collectivités qui versent des subventions tout à fait conséquentes à de telles structures et associations.
M. Jean-Louis Bricout. Dans ma collectivité, je veille à la gestion des subventions et je regarde la décomposition des recettes : celles qui proviennent d’aides publiques, celles qui proviennent des adhérents qui pratiquent une activité sportive ou culturelle dans l’association, et celles que va chercher l’association – effort, bénévolat, manifestations, voire sponsors. Avez-vous quelques données sur la participation publique à la recette totale des associations ?
M. le président Alain Bocquet. À y regarder de près, les subventions ne représentent qu’une petite partie au regard de l’aide matérielle apportée par les collectivités. Ma commune subventionne 200 associations. Mais si on y ajoute l’occupation des salles, les moyens mis à leur disposition pour les fêtes qu’elles organisent, cela représente dix ou quinze fois plus. Certes, il est difficile d’apprécier cette aide multiple et diverse. Quoi qu’il en soit, dans ma commune, si on devait parler d’abus, il tiendrait davantage de l’aide que des subventions accordées aux associations.
Par ailleurs, certaines associations font du bénéfice et ne le disent pas. Pouvez-vous nous éclairer sur les règles existantes en pareil cas ?
Mme Francine Dosseh. À propos des seuils réglementaires, nous constatons – et nous en faisons souvent l’observation – que les conventions d’objectifs et de moyens sont purement formelles et ne sont signées que pour satisfaire à l’obligation légale : le plus souvent, ce sont des conventions types dans lesquelles l’objet n’apparaît pas ou est rédigé de façon tellement vague que cela n’a aucun sens. En toute hypothèse, cela est dû à la rigidité du seuil de 23 000 euros, et l’on peut se demander si ce montant est suffisamment élevé.
Les chambres essaient de raisonner plutôt en termes de risques, en considérant la dépendance de l’association aux fonds publics et le risque qui en découle pour elle en cas de défaillance ou de diminution des subventions, qui sont renouvelées chaque année par une assemblée délibérante. Outre les critères de ce type, elles regardent ce qu’il peut y avoir derrière ce formalisme, qui ne permet pas de se faire une idée de l’activité concrète de l’association. Celui-ci est peut-être simplement lié à la contrainte que représente le fait de remplir une convention ou de faire un compte rendu avec de vrais indicateurs – déjà difficiles eux-mêmes à trouver. Reste que les pouvoirs publics devraient réfléchir aux moyens de faire respecter les obligations sans les vider de leur sens.
M. Gérard Terrien. S’agissant de la gestion de fait et des associations transparentes, c’est le problème de l’automobiliste qui freine juste avant le radar. Aujourd’hui, on connaît bien la jurisprudence des chambres et de la Cour, qui a été très commentée, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État sur l’association transparente, qui doit remplir quatre critères cumulatifs. Pour ma part, je crois qu’il y a réellement une interpénétration, mais que celle-ci ne justifie pas l’emploi, par les juridictions financières, d’une procédure de gestion de fait. Il s’agit d’une procédure extrêmement lourde dont il est bien difficile de sortir. C’est ainsi que celle concernant Mme Richard, maire de Noisy-le-Grand, qui avait été engagée dans les années 1990, vient à peine de se terminer, après recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et toutes les juridictions possibles et imaginables. Nous sommes donc désormais très prudents, et nous préférons insister – comme la loi que vous avez votée l’an dernier – sur les conflits d’intérêts. En cas de prise illégale d’intérêts, malheureusement, le juge pénal est amené à intervenir, ce qui est plus lourd de conséquences pour les intéressés.
Le seuil de 153 000 euros a été institué en application de l’article 10 de la loi de 2000 sur la transparence des aides octroyées par les personnes publiques. Il est exact qu’il peut être onéreux de recourir chaque année à un commissaire aux comptes – surtout si les comptes sont de qualité, sincères et aisément certifiables.
Nous avons eu l’occasion de travailler sur les subventions versées aux associations de sport professionnel. Cela dit, nous le faisons de façon indirecte, par exemple lorsque des garanties d’emprunt sur le stade de football ont été accordées ou en cas de contournement des règles légales. Les garanties d’emprunt sont très faciles à donner, totalement indolores, mais cela fait très mal quand on les fait jouer. Aujourd’hui, il n’y a plus grand-monde pour contrôler les garanties d’emprunt, en dehors des conseils municipaux, des conseils généraux ou des conseils régionaux. Du côté des préfets, le contrôle est assez léger ; de notre côté, nous intervenons a posteriori, quand la garantie a été accordée.
J’insiste un peu sur ce que disait Francine Dosseh. Vis-à-vis des collectivités territoriales, nous essayons de ne pas être dans une démarche administrative – seuils, traitement des dossiers – mais plutôt dans une démarche d’analyse de risques. Cela implique tout de même parfois d’examiner les comptes de l’association et la part de la subvention. Si celle-ci représente 90 % des recettes totales de l’association, au moindre soubresaut, c’est la mort pour l’association. Sans compter les risques encourus par la collectivité locale, que j’évoquais tout à l’heure. Cette dernière doit vraiment réfléchir et ne pas mettre l’association dans une situation ingérable en baissant brutalement sa subvention d’une année sur l’autre. Cela n’est pas important si l’association est subventionnée à hauteur de 1 500 euros, mais si elle l’est à hauteur de 150 000, 200 000, 300 000 ou 500 000 euros, il en va tout autrement.
Enfin, la participation publique sur les recettes totales d’une association est extrêmement variable. Cela dépend des conventions d’objectifs et de l’attitude de la collectivité : pousse-t-elle, ou non, l’association à générer des recettes, dans la mesure où celle-ci le peut ?
Mme Francine Dosseh. Un taux important de fonds publics dans le budget d’une association qui aurait du personnel constitue un risque si la subvention publique diminue. L’association doit faire face à des charges fixes si elle emploie du personnel permanent. La diminution de la subvention publique par une commune qui a des contraintes financières peut ne pas avoir de conséquences importantes, si ce n’est d’obliger l’association à réduire ses activités. Mais la situation peut devenir très critique si l’association, par exemple, emploie cinq personnes de façon permanente. En fait, il faut croiser les critères. Tout dépend de la structure, de l’activité et du fonctionnement de l’association. Nous examinons tous ces critères pour en tirer des observations.
M. Gérard Terrien. L’aide matérielle est un réel sujet, qui concerne la gestion de la collectivité locale elle-même. D’abord, il est important que l’assemblée délibérante sache ce qui se passe ; ce n’est pas aux seuls services d’accorder des facilités sur les salles, la logistique ou le matériel. Ensuite, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la collectivité locale doit décider si elle va, ou non, le mettre gracieusement à disposition des associations ou si elle va chercher à le valoriser. Mais en a-t-elle, elle-même, une bonne connaissance ?
Un point très positif du droit des subventions, qu’elles soient financières ou en nature, c’est qu’il n’y a pas de contestation possible de la non attribution et de l’inégalité de traitement. Bien sûr, cela relève du discours juridique, et le discours politique est tout autre. Je suppose qu’au sein d’une collectivité locale, il est difficile de justifier pourquoi telle association qui a à peu près le même objet qu’une autre est la seule à bénéficier de certaines facilités pour louer des salles, du matériel, ou à bénéficier d’autres soutiens.
Enfin, monsieur le président, vous avez évoqué les associations qui faisaient des bénéfices. Il faut reconnaître que la gestion des fonds associatifs est très compliquée. Je me souviens d’avoir voulu, à titre non professionnel, dissoudre une association qui n’avait plus d’objet et qui avait un tout petit peu de fonds : il a été très difficile de les répartir correctement.
Il est certain que la collectivité qui subventionne fortement une association doit s’assurer que celle-ci ne thésaurise pas. Il arrive, en effet, que certaines associations pratiquent en quelque sorte la pluriannualité et thésaurisent chaque année quasiment toute la subvention, finissant par disposer d’une trésorerie importante.
Vis-à-vis de ces associations, la démarche que nous adoptons relève plus de l’analyse de risques. Après avoir étudié la situation de l’association, nous recevons ses dirigeants et nous les interrogeons sur leur objet associatif. Sont-ils en train de le réaliser ou sont-ils en train de thésauriser ? Quand on a beaucoup de fonds, beaucoup de trésorerie, on a tendance, en tant que dirigeant associatif, à perdre de vue l’objet de l’association. C’est le piège dans lequel était tombé le président de l’ARC.
M. le président Alain Bocquet. Monsieur le président, Madame, je vous remercie pour votre participation à nos travaux.
Audition sectorielle « Culture » :
M. Alain de la Bretesche, président de la Coordination des fédérations et des associations de culture et de communication (COFAC),
vice-président de la Fédération Patrimoine environnement ;
M. Jean-Michel Raingeard, vice-président de la COFAC, président de la Fédération française des sociétés d’amis de musées ;
M. Vincent Niqueux, administrateur de la COFAC, directeur général de l’Union nationale des Jeunesses musicales de France ;
M. Jean-Damien Terreaux, administrateur de la COFAC, directeur de la Fédération française des Écoles de cirque.
(séance du 3 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Nous commençons nos auditions sectorielles avec la Coordination des fédérations et des associations de culture et de communication (COFAC). Créée en 1999, la COFAC est constituée de vingt-trois fédérations nationales représentant 40 000 associations sur l’ensemble du territoire, environ 150 000 bénévoles responsables, et près de 3 millions d’adhérents. Elle est l’une des seize coordinations composant le Mouvement associatif, que nous avons auditionné en juillet dernier.
Nul n’ignore l’importance de la culture pour la création du lien social, à une époque où nous en avons tant besoin. La vitalité des associations dans ce domaine est essentielle. C’est donc avec un grand intérêt, messieurs, que nous allons vous écouter exposer les difficultés auxquelles vos organisations sont confrontées et les solutions que vous envisagez pour y remédier.
Avant de vous laisser la parole, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Alain de la Bretesche, Jean-Michel Raingeard, Vincent Niqueux et Jean-Damien Terreaux prêtent serment)
M. Alain de la Bretesche, président de la Coordination des fédérations et des associations de culture et de communication (COFAC), vice-président de la Fédération patrimoine environnement. La COFAC vous remercie de bien vouloir l’entendre dans le cadre de cette commission d’enquête.
Selon les chiffres du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture, notre pays compte 1,3 million d’associations, dont 267 000 associations culturelles. Sachant que le monde culturel est celui qui se fédère le moins, comme l’indique un rapport récent de M. Ferry, nous estimons que notre fédération n’est pas si mal placée avec 40 000 associations.
La COFAC représente 169 000 emplois salariés culturels associatifs, y compris les temps partiels, 35 100 associations culturelles comptant au moins un salarié. Le nombre moyen de bénévoles présents dans une association culturelle est de 18, et une association employeuse comporte en moyenne 5 salariés.
Les bénévoles consacrent à leur association au moins 63 heures par an. Ce chiffre est néanmoins très difficile à évaluer en raison de la valorisation des heures de bénévolat dans les bilans et les écritures comptables, mise en place récemment.
Le budget cumulé des associations culturelles représente 8,3 milliards d’euros. Un budget moyen s’élève à 31 000 euros – 179 000 euros pour une association employeuse.
Les exemples que vont vous présenter mes collègues vous le montreront : le travail de coordination nationale de la vie associative, en particulier pour notre secteur, est extrêmement difficile à financer. À une fédération, on donne généralement « la pièce » pour financer son budget national. C’est un vrai problème : on voit mal comment on peut financer les coordinations nationales autrement qu’avec des subventions de l’État. Or, aujourd’hui, une subvention de l’État est accordée à la condition d’avoir un projet qui permette de faire entrer de l’argent dans les caisses de la coordination nationale.
La culture est également financée par les fonds structurels européens. À cet égard, la situation française est ahurissante, avec une partie de ces fonds qui revient à l’État et une autre aux régions. On ne sait pas très bien quels critères permettent au ministère du travail de distribuer les fonds structurels européens aujourd’hui. La dimension culturelle et patrimoniale est inscrite dans le traité de Nice, or le Conseil économique et social européen ne comporte pas un seul représentant français de la culture, et la commission de la culture du Parlement européen, à part deux ou trois membres du Front national, ne compte pas un seul parlementaire titulaire français.
Vous l’avez compris : nos difficultés sont importantes. Mes collègues vont vous l’expliquer.
M. Jean-Michel Raingeard, vice-président de la COFAC, président de la Fédération française des sociétés d’amis de musées. Conformément à la réglementation fiscale, les associations doivent se doter d’un commissariat aux comptes à partir de 153 000 euros de recettes d’origine publique. Jusqu’à présent, le commissariat aux comptes était réservé aux associations et fondations d’utilité publique. Dorénavant, toutes les associations d’intérêt général sont concernées. Le problème est de savoir ce que recouvrent les 153 000 euros.
D’ores et déjà, il y a les dons, qui donnent lieu à des reçus fiscaux. En effet, depuis le passage de M. Fabius à Bercy, toutes les associations d’intérêt général clairement identifiées par leurs statuts peuvent délivrer des reçus fiscaux. Cela concerne un grand nombre, voire la totalité de nos associations.
Je souhaite alerter la représentation nationale s’agissant d’un curieux document issu du ministère précédemment intitulé « de la ville, de la jeunesse et des sports », qui mentionne à plusieurs reprises l’avis de la commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). D’abord, comment un organisme de droit privé, qui n’a pas de pouvoir administratif, peut-il servir de référence à un document public ? J’aurais préféré que le commentaire vienne de Bercy. Ensuite, selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, les aides à l’emploi associées à des contrats aidés – contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrats initiative emploi – entrent également dans le calcul des subventions, c’est-à-dire des 153 000 euros. Est-ce ainsi que vous l’aviez prévu au cours de vos débats ou un décret d’application a-t-il été pris en ce sens ? Il me paraît important que les décisions, quand bien même elles ont les meilleures intentions du monde, soient suivies dans les moindres détails par la représentation nationale ! Dans ces conditions, les associations doivent prendre en compte le montant des aides à l’emploi précitées pour déterminer si elles dépassent ou non le seuil des 153 000 euros.
Or ce seuil pose déjà problème. Dans mon secteur, les associations culturelles sont chargées de récolter l’argent manquant des musées. Une souscription pour l’achat d’une œuvre d’art ou l’organisation d’un dîner destiné à récolter des fonds fera sauter le plafond, mais dans le cadre d’un exercice où l’intervention du commissaire aux comptes n’est pas prévue. Par conséquent, il faudra que la CNCC détermine clairement si le commissariat aux comptes doit intervenir en cours d’exercice ou à la fin de l’exercice, une fois les totaux réalisés.
Se pose donc le problème de l’interprétation des mesures qui nous seraient théoriquement favorables au regard du seuil de 153 000 euros : les nouvelles responsabilités qui nous sont octroyées, d’une part, et l’assimilation à des subventions des aides à l’emploi, d’autre part, le rendent insuffisant.
En outre, dans sa chasse à toute entrave à la libre circulation des capitaux, Bruxelles pourrait requalifier ce que nous, Français, considérerions comme des subventions, alourdissant encore notre péché originel aux yeux des représentants britanniques à la Commission. Nous finirons par les rendre cardiaques !
Qui plus est, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision relative à la territorialité des dons, question qui a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport du conseiller d’État Bachelier. Dans un article intitulé « Les dons bientôt soumis à l’impôt », le Quotidien de l’art écrivait avant-hier que « le régime fiscal français des donations en faveur d’associations et fondations est au centre du débat de la Commission européenne qui a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. Le litige porte sur le fait que la France exempte de droits d’enregistrement les donations et les legs réalisés au profit d’organismes publics ou d’utilité publique ». La France risque donc d’être traduite devant la CJUE !
Si demain, sous prétexte d’unification européenne, nous devons payer les droits d’enregistrement sur les dons et legs que nous recevons, je peux vous dire, en tant qu’administrateur de la Société des amis de Versailles, que notre chantier de restauration du boudoir de Marie-Antoinette pour un montant de 800 000 euros ne pourra pas être réalisé. Il est, en effet, financé pour moitié par un don supplémentaire de nos amis et pour l’autre moitié par deux legs – un appartement sur la Côte d’Azur et un appartement en Suisse, d’une valeur de 400 000 euros.
Nous espérons que le Gouvernement prendra des mesures efficaces pour résoudre le problème, sachant que Gilles Bachelier devrait être amené à faire des propositions en la matière.
M. Alain de la Bretesche. À trois reprises depuis quatre mois, j’ai soulevé, devant les parlementaires chargés d’une mission sur les mesures de simplification, le problème des rescrits fiscaux.
La procédure du rescrit fiscal permet au bureau de l’association, par souci de sécurisation de lui-même et de ses adhérents, de se faire préciser par l’administration fiscale qu’il a bien droit à la mesure de défiscalisation applicable aux dons. Or, depuis quelque temps, les bureaux de Bercy bloquent les rescrits fiscaux, au point que les spécialistes de cette question conseillent aux associations d’arrêter d’en faire la demande. Récemment, un inspecteur général des finances a déclaré à un parlementaire en mission que, selon Bercy, tout allait bien dans ce domaine. Selon le monde associatif, c’est loin d’être le cas !
Nous souhaiterions donc obtenir des réponses, car il n’est pas possible qu’un fonctionnaire, fût-il chef du bureau des rescrits à Bercy, fasse la pluie et le beau temps en la matière.
M. Vincent Niqueux, administrateur de la COFAC, directeur général de l’Union nationale des jeunesses musicales de France. Mon témoignage portera, au-delà des Jeunesses musicales de France (JMF), sur l’éducation populaire en général et le spectacle vivant en particulier.
Depuis soixante-dix ans, les Jeunesses musicales de France organisent des concerts sur l’ensemble du territoire national, principalement sur le temps scolaire. Diffuseur discret, ce réseau propose chaque année 2 000 concerts à près d’un demi-million d’enfants, mais aussi des activités d’ateliers qui rencontrent un franc succès. Je précise que, de la maternelle à l’entrée à l’université, la majorité de ces 500 000 jeunes n’avaient jamais mis les pieds dans un spectacle musical avant de croiser les JMF.
Paradoxalement, la musique est, dans le champ culturel, l’un des plus gros secteurs socio-économiques, mais aussi l’un des plus cloisonnés, des plus marqués par les images toutes faites sur le conservatoire, l’opéra, le théâtre, l’accès à la musique, le spectacle vivant. La demande d’appui à la coordination, à l’ingénierie de projet est de plus en plus forte, en particulier de la part de petites communes en milieu rural qui ont du mal à faire travailler ensemble leur école de musique, leur école primaire, leur centre de loisirs et leur festival. De ce point de vue, le travail d’une association comme la nôtre consiste à mettre en musique l’ensemble de ces acteurs et à faire en sorte que ceux qui ont accès à la musique ne soient pas toujours les mêmes. J’insiste sur l’importance de la démocratisation musicale, au-delà du plaisir que procure l’art. Dans certains quartiers défavorisés, comme à Cergy-Pontoise, lors de la création des premiers orchestres dans les écoles, 80 % des enfants choisis pour les constituer n’atteignaient jamais la seconde ; aujourd’hui, ils sont 80 % à passer en terminale !
Ce phénomène de cloisonnement, que je viens d’évoquer, fait qu’une grande partie du public, particulièrement en milieu rural, reste exclue du champ musical, secteur au demeurant très bien doté. C’est ce qui explique la pérennité des JMF, dont l’organisation originale contribue à l’enracinement dans les territoires, grâce à une direction nationale non seulement administrative, mais aussi artistique, de management et de formation de nos 350 équipes locales, dont 250 équipes de cadres bénévoles et de « petites mains » qui, tous, ont un rôle extrêmement important.
Je ne reviendrai pas sur tous les thèmes que vous avez évoqués – mutations actuelles, besoins de formation des bénévoles, valorisation du travail et des acquis de ceux-ci, professionnalisation, complexité des procédures administratives – auxquels notre fonctionnement à la fois national et local nous confronte régulièrement. Je dirai simplement, s’agissant de la complexité croissante des procédures, qu’un minimum de coordination dans les dossiers de demandes entre les différents échelons de collectivités territoriales représenterait un gain de temps et d’énergie considérable, même si, indéniablement, l’approche différenciée de ces collectivités peut engendrer des complémentarités. J’attirerai plutôt votre attention sur deux sujets.
Le premier a trait aux emplois d’avenir. Nous avons besoin d’emplois qualifiés, voire très qualifiés. Or c’est un point sur lequel butent toutes nos procédures d’aide à l’emploi : nous avons l’impression que nos demandes sont déplacées, alors que la mutation historique à laquelle nous sommes confrontés – modification du modèle économique et des formes de bénévolat, glissement d’une partie de l’appui étatique vers les collectivités territoriales – nous oblige à reconstruire une stratégie territoriale beaucoup plus complexe qu’auparavant. Nos bénévoles n’ont pas été formés à cela, même s’ils le font parfois spontanément. La complexité est telle que le besoin se fait vraiment sentir d’instaurer une articulation entre des professionnels confirmés et les équipes bénévoles, elles-mêmes en pleine évolution, avec d’autres formes de mobilisation, plus collectives et sur de moins longues durées. Si certains de nos bénévoles sont engagés depuis cinquante ans, avec une énergie incroyable, on ne peut pas demander à de nouveaux bénévoles, comme les étudiants, de s’investir jour et nuit pendant des dizaines d’années, même s’il y a de vraies attentes, de vraies possibilités et de réelles volontés d’engagement.
Ce qu’il faut, c’est reconstruire le système de gouvernance interne de l’association et repenser les stratégies territoriales en retenant comme dénominateur commun l’aménagement du territoire et les publics. Ce seul aspect sera suffisant pour nouer des relations passionnantes avec les collectivités territoriales et les acteurs culturels locaux. Or nous calons vraiment sur l’encadrement professionnel minimum, qui est assuré actuellement avec des bouts de ficelle. Les jeunes que nous accueillons au titre du service civique – que nous distinguons bien de l’emploi – sont souvent passionnés et qualifiés, mais les huit à neuf mois de leur engagement ne nous permettent pas de les amener vers une professionnalisation, alors que nous pourrions le faire en deux ou trois ans seulement.
En lien avec ce premier sujet, le second concerne la mutation qui est en cours et qui devrait s’achever dans trois ans. Autant dire que nous sommes en état d’urgence. Nous ne faisons que lutter contre l’érosion financière, notamment des subventions, alors qu’il nous faudrait investir humainement et techniquement, et pas forcément avec des sommes colossales. Or, en étant ainsi occupés uniquement à reconstruire le château de sable qui s’effondre après chaque vague, nous ne pouvons que nous engager dans une course-poursuite très préjudiciable à la satisfaction de la demande, qui est vraiment très forte.
Nous ne revendiquons pas des subventions pérennes, un droit définitif, un dû affectif au regard de l’utilité de la grande association que nous sommes. Nous sommes capables aujourd’hui de parler évaluation, objectifs à trois ou quatre ans, nouvelle gouvernance. Nous devons gérer la transition sans savoir comment. Pour une activité cumulée pesant environ 6 millions d’euros, notre association aura besoin d’investir sur les quatre prochaines années entre 300 000 et 400 000 euros afin de reconstruire son encadrement, remobiliser ses bénévoles, repenser ses structures, rendre le travail plus collectif et revoir ses stratégies territoriales. Les sommes en jeu ne sont pas colossales ; ce qui nous manque avant tout, ce sont les outils adaptés pour parvenir à cet objectif.
Je terminerai en vous racontant une anecdote. On nous reproche parfois de n’adresser nos activités qu’aux enfants, comme si l’économie du secteur jeune public était un sous-produit. Or nos jeunes sont pleins de ressources. J’ai ainsi été récemment interrogé, à la sortie d’un concert, par un garçon de neuf ans qui voulait connaître le modèle économique des JMF. J’ai rajusté ma cravate et je le lui ai expliqué. Il faut dire que cet enfant était fils de journaliste, comme me l’a soufflé son instituteur !
M. Alain de la Bretesche. Dans le monde de la culture, le temps compte énormément. On ne peut construire un projet culturel en deux ans et demi ; or, depuis Jacques Toubon, la longévité des ministres de la culture est en moyenne de cet ordre-là. Par contre, les parlementaires peuvent impulser des choses intéressantes pendant les cinq ans de leur mandat, en particulier en favorisant les contrats multiannuels, essentiels pour nous. Les élus locaux le savent, l’annualité du budget ne sied pas aux « cultureux » que nous sommes.
M. Jean-Damien Terreaux, administrateur de la COFAC, directeur de la Fédération française des écoles de cirque. Je m’exprime au nom d’un acteur émergent de la scène culturelle française : les plus anciennes écoles de cirque sont nées il y a à peine trente ans et les plus jeunes n’ont que quelques mois. Notre pays compte environ 500 structures, qui vont de l’atelier de trente élèves à l’école de 800 élèves permanents. Notre petit réseau est assez professionnalisé puisque les techniques et l’art du cirque s’enseignent, que ce soit aux enfants ou aux adultes, ce qui nécessite des personnels qualifiés. Selon nos estimations, les écoles de cirque adhérentes à la fédération emploient environ 600 équivalents temps plein.
Notre secteur est peu soutenu, le cirque n’étant pas une discipline académique
– aristocratique, ai-je envie de dire –, en tout cas elle n’a pas assez d’ancienneté. Aussi, les associations fonctionnent-elles essentiellement grâce aux adhésions, au paiement des cours annuels, ainsi qu’aux prestations effectuées à l’extérieur.
La discipline du cirque exige des investissements très importants en matériel et en locaux d’accueil pour les élèves : un chapiteau, une école, un lieu en dur équipé dans les meilleures conditions de sécurité. Pour répondre à ces exigences, les acteurs qui se lancent dans ce genre d’activité doivent faire preuve d’un vrai professionnalisme, posséder de multiples savoir-faire et maîtriser l’art de la jonglerie – c’est le cas de le dire.
Nous nous revendiquons de l’éducation populaire : nous ne sommes pas seulement un réseau d’écoles d’art, le cirque est également un outil d’éducation. En ce sens, nous nous battons pour l’accès du plus large public possible aux disciplines circassiennes.
Depuis peu, notre réseau est en voie de fragilisation. Celui-ci a connu, de 1990 à 2010, une phase de montée en puissance marquée par l’installation des associations, l’émergence d’un modèle économique solide, la multiplication des lieux, la diffusion d’une vraie énergie sur l’ensemble du territoire. Alors qu’ils croyaient être solides, tous ces acteurs se sont retrouvés fragilisés par la crise qui sévit en France et en Europe depuis deux ans et qui s’est traduite par une stagnation, voire une baisse des inscrits aux ateliers et dans les écoles de cirque. Les familles sont amenées à faire des choix économiques pas toujours à notre avantage, car le cirque est une discipline qui peut coûter cher, notamment dans les écoles recevant peu de subventions et obligées de faire payer l’intégralité de leurs charges aux pratiquants. Dans ce contexte, l’ambition de l’art accessible à tous en prend un coup !
Notre réalité depuis un an, c’est aussi la réduction très nette des possibilités de prestation dans les établissements scolaires. Cette situation est pour le moins contradictoire avec la circulaire du 9 mai 2013 sur la mise en œuvre des « parcours d’éducation artistique et culturelle », qui préconise la mise en place d’un schéma ambitieux de découverte de l’art à l’école tout au long du parcours scolaire, et qui définit les conditions de partenariat avec les acteurs culturels que sont les écoles de musique, de cirque, de danse, et les acteurs de l’éducation populaire en général.
La réforme des rythmes scolaires entraîne une diminution globale des temps possibles d’intervention en milieu scolaire, en particulier l’après-midi, et une baisse très importante des budgets des ministères de l’éducation nationale et de la culture affectés aux actions culturelles en milieu scolaire – je pense aux classes à projet artistique et culturel (PAC), qui sont en train de disparaître. En même temps, elle est à l’origine de la création de nouvelles activités périscolaires (NAP), pour lesquelles nous sommes extrêmement sollicités par les communes, au même titre que les écoles de musique et bien d’autres acteurs. Toutefois, ces sollicitations sont assorties de conditions qui nous permettent difficilement de répondre favorablement : temps d’intervention très courts, déplacements extrêmement longs, notamment en milieu rural, et financements insuffisants pour ne pas intervenir à perte.
En conséquence, des dizaines d’associations de notre réseau se retrouvent aujourd’hui avec des capacités financières amoindries. Au mieux, elles puisent dans leurs fonds propres ; au pire, elles doivent faire face à des difficultés de trésorerie très importantes et une visibilité ne dépassant pas deux ans. Les écoles ne peuvent que s’en trouver pénalisées : elles ont de plus en plus de mal à investir dans le matériel et les locaux, sans compter qu’il est difficile pour les collectivités elles-mêmes de soutenir ce genre d’investissement.
À cela s’ajoute une précarisation extrêmement forte du salariat, observée depuis ces deux dernières années. Les offres d’emplois du site de la Fédération française des écoles de cirque portent uniquement sur des postes à temps partiel, de 24 heures par semaine au mieux. Dans ces conditions, on imagine aisément que le niveau de salaire d’un animateur dans une école de cirque ne lui permet guère d’en vivre. Cette précarisation est doublée d’un amoindrissement des capacités des écoles de cirque à financer la formation des animateurs. Alors que ces écoles sont en quelque sorte des écoles de la deuxième chance et que la fédération a beaucoup poussé pour que tous les animateurs passent le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), diplôme de niveau bac, elles n’ont plus aujourd’hui les moyens de financer le remplacement des animateurs qui partent se former dans ce cadre.
En conclusion, je crois pouvoir dire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont devenus structurels, et que les acteurs ne sont pas en mesure de les appréhender dans leur globalité. Aujourd’hui, alors qu’ils sont des milliers à être fortement sollicités suite à la réforme des temps scolaires, ils sont exposés à une précarité grandissante sans que jamais leur situation soit dénoncée, ni à la radio ni sur les bancs de l’Assemblée nationale, pas plus qu’au ministère de la culture. Tous ces animateurs, ces personnels, toutes ces associations risquent pourtant d’être dans l’incapacité de réaliser les prestations artistiques et culturelles de qualité qui seront susceptibles de leur être demandées.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci, messieurs, pour la qualité de vos interventions.
Nous avons bien entendu votre message sur la situation des emplois aidés et les conséquences sur les budgets. Ces questions feront certainement l’objet d’une réflexion dans les semaines à venir.
J’ai également noté la nécessité de construire une digue pour protéger la plage qui se réduit inexorablement au gré des réformes territoriales et de la baisse des crédits publics. Elle doit, selon vous, tenir par une nouvelle gouvernance et de nouvelles stratégies, que vous ne pouvez mettre en place à cause du manque d’outils.
Vous vous apprêtez à connaître des difficultés de gestion des ressources humaines dans les années à venir, en raison de la diversité des statuts professionnels – personnels qualifiés, emplois aidés, intermittents. Cela risque de vous empêcher de répondre aux sollicitations de plus en plus importantes, suscitées par la nécessité pour les acteurs publics de démocratiser l’accès à la culture. Au-delà du seul accès à la culture, la question, à mes yeux fondamentale, est de forger un outil majeur de cohésion sociale, un moyen de reconnaissance de la citoyenneté, de mixité et de cohésion sociale. Tout se jouera dans les trois à cinq ans, avez-vous précisé. De quels outils supplémentaires rêvez-vous ?
M. Alain de la Bretesche. Nous rêvons d’un discours cohérent entre les différents acteurs.
Les ressources des associations culturelles proviennent des subventions de l’État, éventuellement de l’Europe, des subventions des collectivités locales, des cotisations et du mécénat. L’idée court aujourd’hui d’une globalisation des besoins, mais qui la financerait ? Le budget du ministère de la culture diminue chaque année et beaucoup s’interrogent sur la nécessité pour l’État de continuer à financer tout le champ culturel. Les 340 millions d’euros du budget du patrimoine ne sont pourtant pas grand-chose par rapport aux sommes colossales que vous votez chaque année.
Mes collègues ont évoqué les budgets des collectivités et souligné l’urgence de la situation. Certains départements se désengagent, ne sachant pas s’ils continueront à détenir la compétence « culture » dans les années à venir. Les régions, elles, se doutent bien qu’elles vont remporter le gros lot, mais ne savent pas encore exactement ce qui leur reviendra. Par ailleurs, les discours sur le mécénat sont pour le moins contradictoires, d’aucuns s’interrogeant sur la nécessité de l’encourager ou pas au regard de la dépense publique que représentent les avantages fiscaux. Restent les cotisations, qui ont plutôt tendance à augmenter pour boucher les trous.
Un discours cohérent consisterait à nous dire clairement quelle sera la part du budget de la culture dans les quatre ou cinq prochaines années, quelle collectivité, de la région, du département ou de l’intercommunalité, financera le reste, et quelle est la position sur le mécénat. Une telle clarté est indispensable, car plutôt que de vivre dans l’incertitude, les professionnels préféreront mettre la clé sous la porte et leur savoir-faire sera perdu. Le restaurer prendra un long moment. Avant même de savoir s’il doit y avoir des budgets supplémentaires, c’est de cela qu’il faut se préoccuper. Un Président de la République a déclaré que, en période de crise, le budget de la culture devait être sanctuarisé : cela me semble tout à fait possible puisque le budget de la culture ne représente pas des sommes énormes par rapport au reste.
En définitive, ce qui nous irrite au plus haut point, c’est que le discours actuel soit si incohérent alors qu’un consensus existe entre les différents groupes politiques des assemblées parlementaires !
M. André Schneider. Monsieur de la Bretesche, vous avez déploré l’absence de représentants français à la commission de la culture du Parlement européen. Je tiens à vous signaler que nous sommes ici quelques-uns à siéger à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, même si sa commission de la culture n’est qu’un appendice de compétence par rapport à celle du Parlement européen.
Théophile Gautier disait que l’art ne sert à rien, que l’art sert à être beau. Pour ma part, je dirai que l’art sert à avoir une tête bien faite. J’en veux pour preuve que, dans les entretiens d’embauche de très haut niveau, la culture générale est aussi importante que les compétences techniques.
Vous avez souligné l’importance du professionnalisme et des moyens. Comme nous défendons la francophonie, nous soutenons que la culture dans le monde a un impact économique. C’est ce que nous devons démontrer pour convaincre que la culture ne doit pas être une variable d’ajustement. De même, nous ne devons plus nous satisfaire de l’objectif traditionnellement poursuivi de 1 % du budget national.
Quels conseils nous donneriez-vous pour faire valoir le rôle irremplaçable de la culture, a fortiori dans le monde actuel ?
Mme Bernadette Laclais. Pour avoir exercé des responsabilités dans le domaine culturel, je trouve étonnant que le même vocable recouvre des situations très diverses. C’est ainsi que par « écoles de cirque », on entend aussi bien les écoles de loisirs que les écoles professionnalisantes et préprofessionnalisantes, et que des associations peuvent gérer de grands équipements culturels comme de petites structures.
Alors que les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) pourraient clarifier les choses, notamment au regard des financements, leur mise en œuvre pose des difficultés en raison de la diversité des situations. Finalement, les associations qui poursuivent un objectif de cohésion sociale doivent-elles avoir le même statut que celles qui gèrent une institution culturelle pour le compte d’une collectivité ? N’aurait-on pas intérêt à promouvoir une plus grande visibilité par un dispositif plus simple ?
M. Frédéric Reiss. Le seuil de 153 000 euros n’a pratiquement pas évolué depuis son instauration. Pensez-vous nécessaire de le modifier à l’aune des dons et contrats aidés ?
Vous avez évoqué le service civique. Les jeunes pourraient-ils être intégrés professionnellement dans vos associations, et au terme de quelle durée d’engagement ?
Le temps me manque pour parler d’autres sujets importants, comme la SACEM ou le Guso, mais je ne doute pas que nous y reviendrons ultérieurement.
M. Jean-Luc Bleunven. On pourrait discuter à l’infini des moyens, dont la baisse va probablement s’accentuer. Par contre, les nouveaux rythmes scolaires peuvent être l’occasion, pour peu que les élus souhaitent coopérer, de créer des passerelles sur la durée, d’avoir une action pérenne. J’y vois une richesse supplémentaire car, dans ce cadre, votre action sur la durée est susceptible de créer des emplois qui deviendront stables.
M. Alain de la Bretesche. La COFAC est globalement satisfaite des personnes qui viennent dans nos associations au titre du service civique. Ce qui est en cause, ce n’est pas leur qualité, c’est la durée pendant laquelle ils y restent. Comme nous l’avons dit au Président de la République, la durée du service civique devrait être de près d’un an, comme initialement prévu. Cela pose des problèmes de charges sociales, nous dit-on, mais M. Hirsch avait observé qu’il y avait probablement des solutions pour financer cette durée, par exemple la franchise de six mois dont bénéficient les étudiants après leur sortie de l’université. Au-delà de cette question, le monde associatif a surtout besoin, non pas d’emplois aidés – pour lesquels nous avons joué le jeu –, mais d’emplois qualifiés.
Dans ce contexte, la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les bénévoles peut être une piste. Nous avons l’intention de travailler sur cette question, même si les choses ne sont pas évidentes – obtenir un diplôme de journaliste dans la communication, par exemple, est très difficile.
Reste que proposer des emplois qualifiés est crucial pour nous, et que, au nom de la défense de l’intérêt public, la question se pose de leur financement par les deniers publics.
M. Vincent Niqueux. Aujourd’hui, les artistes sont de plus en plus sollicités comme intervenants, non seulement parce qu’ils ne peuvent plus avoir le même rythme de diffusion dans la journée, mais parce qu’ils ne peuvent plus non plus dépasser la cinquantaine d’heures dans le système actuel de l’intermittence. Leur situation est donc très paradoxale, ballottés qu’ils sont entre le régime général et celui de l’intermittence.
Pour construire la digue, le « plan ORSEC » pour les trois années à venir doit prévoir un coup de pouce ciblé, assorti d’objectifs précis, aux grandes têtes de réseau pour leur laisser le temps de proposer un plan de restructuration. Comme je l’ai dit à mes équipes, nous sommes dans une course contre la montre et nous avons trois ans devant nous. Les contractualisations pluriannuelles sont d’une grande complexité, mais nous pouvons nous engager dans cette démarche, car nous sommes capables de gérer la mutation et de présenter des engagements. Nous sommes de vraies associations, pas des pompes à subventions.
Le modèle de l’EPCC présente un réel intérêt mais est techniquement très complexe
– il m’est arrivé d’assister à une longue délibération à vingt-cinq personnes pour annuler une créance douteuse de 25 centimes…
J’observe que nous avons un modèle de développement culturel, particulièrement dans le spectacle vivant, qui est institutionnel. Les structures que nous avons développées
– centres culturels, réseaux labellisés « national » – ne sont pas si mal dotées aujourd’hui. Toute la question est de les faire travailler en réseau et de les amener à jouer un rôle de développement, et non plus simplement d’exécution d’un cahier des charges strict. Cela passe par la recherche de nouveaux publics, le travail de terrain, l’accompagnement. C’est là que les associations peuvent se révéler un poil à gratter très intéressant.
À propos des emplois aidés, une proportion très importante de contrats emploi consolidé pour les jeunes a été conclue dans le secteur de la culture. Mais on voit bien que pour changer de modèle économique et avoir un autre type de ressources, il faut nous appuyer sur des jeunes professionnels qualifiés. Si le service civique est très intéressant par son niveau de qualification, nous avons besoin d’une durée plus longue pour basculer vers la pérennisation, qui est notre objectif.
Enfin, que faire pour promouvoir le rôle de la culture ? De nombreuses analyses économiques font déjà état des chiffres d’affaires générés par le secteur. D’autres analyses plus fines en termes de retour social, en particulier dans le domaine éducatif, sont très intéressantes et mériteraient d’être mieux connues.
M. Jean-Michel Raingeard. Comment la représentation nationale peut-elle accepter d’examiner le budget de la culture dans lequel le mot « association » ne recouvre que les associations statutaires ou établissements labellisés, en ignorant que les « cultureux » offrent des dizaines de milliers d’heures de culture gratuite à la population française grâce au bénévolat ? Comment pouvez-vous tolérer qu’un ministre vous parle de l’effort de la culture en oubliant tout ce que la société civile offre au pays, en particulier en matière d’éducation populaire ? Si des milliers de gens en France peuvent s’instruire gratuitement en histoire de l’art, c’est grâce à la Société des amis de musées, dont les 300 associations organisent des conférences à travers le pays – à Bordeaux, par exemple, ce sont 15 000 sièges qui ont été offerts.
Dans ce pays, on ne considère comme valable que ce qui vient des institutions relevant du ministère de la culture, or ce n’est pas cela la culture au quotidien ! La ministre précédente nous a bassinés avec l’éducation artistique et culturelle pour les jeunes. La COFAC a eu énormément de mal à lui faire comprendre que les Français ont droit à l’éducation populaire, c’est-à-dire à l’éducation artistique et culturelle, à tout âge de la vie. Cette dimension-là n’apparaît pas non plus dans le budget de la culture. Cette attitude constante du ministère de la culture crée un blocage important, et cette digue-là est loin d’être entamée par la marée !
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, messieurs, de votre contribution.
Audition de M. Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports)
(séance du 3 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports est la cheville ouvrière des politiques publiques qui organisent et soutiennent la vie des associations au niveau de l’administration centrale. Elle anime également les autres services de l’État intervenant dans ce domaine, et joue un rôle particulier en matière de relations avec les associations de l’éducation populaire.
La DJEPVA s’est récemment trouvée au cœur des travaux relatifs au projet de loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) : même si le champ des associations ne recoupe pas exactement celui de l’ESS, les deux sujets ne sont pas totalement disjoints. Votre expertise, Monsieur le directeur, est donc précieuse pour notre commission, qui doit s’attacher à cerner les difficultés récentes ou anciennes du monde associatif, avant de proposer des réponses concrètes.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Benoît Dujol prête serment)
M. Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). Aux termes des décrets régissant son fonctionnement, la DJEPVA est chargée de concevoir sur le plan interministériel les politiques publiques relatives au monde associatif. Elle possède à ce titre un champ d’expertise à la fois sectoriel – pour ce qui est des associations possédant l’agrément « jeunesse et éducation populaire » – et général. En lien avec le ministère de l’intérieur, nous avons beaucoup travaillé sur les différentes mesures de la loi sur l’ESS, dont la discussion parlementaire a considérablement enrichi le volet « vie associative ». Vous avez raison de souligner, monsieur le président, que le monde associatif est une composante essentielle de l’ESS – les mutuelles et les fondations, pour importantes qu’elles soient, occupant une place bien moindre tant par leur nombre que par leurs effectifs.
En ce qui concerne les financements et leurs fluctuations, je partage en grande partie l’analyse de Mme Tchernonog, chargée de recherche au CNRS, que vous avez auditionnée précédemment. Tout d’abord, les financements publics sont contraints : même si l’on constate une légère hausse de leur volume en valeur absolue – plus de 42 milliards d’euros en 2011 contre 39,8 milliards d’euros en 2005 –, leur part est passée de 51,4 % à 49,6 % durant la même période. Pour ce qui est de la part de l’État, on ne peut parler d’un désengagement, puisqu’il a continué à financer les associations à hauteur de 9 milliards d’euros environ entre 2005 et 2011 ; cependant, les évolutions institutionnelles que nous connaissons, marquées notamment par un mouvement de décentralisation, ont entraîné une modification de la répartition du financement entre les différents acteurs publics, les collectivités locales devenant progressivement des partenaires essentiels du monde associatif.
Parallèlement, le financement privé prend une importance croissante, ce qui a amené certains analystes à évoquer une « privatisation » du financement des associations. Si ce terme semble exagéré compte tenu du fait que la part du financement public se maintient aux environs de 50 %, il convient de noter que, les dons et les cotisations restant relativement stables, les associations sont amenées à augmenter le montant des prestations facturées à leurs usagers. Outre que cette pratique est susceptible de constituer un facteur de fragilité pour elles, elle suscite des interrogations en termes de préservation de la solidarité et de l’intérêt général, car on peut imaginer qu’elle les incite à sélectionner le public auquel elles s’adressent, ce qui va à l’encontre des objectifs de solidarité qu’elles sont censées poursuivre – cela dit, il ne s’agit pas là d’une tendance massive.
Plus significative est la question de l’évolution des financements publics. Les statistiques font en effet apparaître une montée en charge de la commande publique au détriment de la subvention. Les deux modes de financement sont aujourd’hui quasiment à parité, mais la répartition est très hétérogène en fonction des secteurs concernés : si la commande publique est majoritaire – de l’ordre des deux tiers – dans le secteur sanitaire et social, le rapport est inverse dans d’autres secteurs, tel celui des loisirs et de la culture. Or les incidences du mode de financement ne s’arrêtent pas au plan comptable : une association financée par la commande publique n’a pas le même type de relations avec son donneur d’ordre, ni les mêmes prérogatives en ce qui concerne la définition de son action, qu’une association financée au moyen de subventions. La différence essentielle entre les deux modes de financement réside bien dans l’initiative de la définition du service à rendre, qui revient à la collectivité ou à l’État quand une commande publique est passée, tandis que l’association conserve la maîtrise du projet qu’elle a décidé – guidée par l’intérêt général, dans le cadre du débat démocratique – de mener à bien.
Le choix du mode de financement n’est pas toujours dicté par des contraintes réglementaires. Soucieuses de sécurité juridique, les collectivités locales préfèrent recourir à la commande publique alors que ce n’est pas toujours nécessaire, comme la DJEPVA est souvent amenée à le leur rappeler. L’un des objets de la charte d’engagements réciproques signée en février dernier par le mouvement associatif et l’État était d’apporter des clarifications sur ce point, en redéfinissant les notions de commande publique et de marché, et en rappelant la possibilité de recourir, dans la majorité des cas, à une subvention pluriannuelle. La précédente charte, qui datait de 2001, année du centenaire de la loi sur les associations, était tombée dans une relative désuétude. L’une des principales innovations de la charte de 2014 est d’inclure les collectivités locales, qui se trouvent désormais placées au cœur du financement des associations.
L’emploi associatif, qui représente environ 10 % de l’emploi privé, subit avec retard les répercussions de la conjoncture économique. Cela s’explique notamment par la nature de son financement – le financement public s’est maintenu plus longtemps que la demande privée s’adressant aux entreprises à but lucratif – et par la mise en place de politiques contracycliques, sous la forme d’emplois aidés dont les associations sont les principales bénéficiaires. Cela dit, on assiste aujourd’hui à un repli, voire à un décrochage en matière d’emploi associatif, qui montre les limites de ses facultés de résilience.
L’autre pilier de la ressource humaine du monde associatif est le bénévolat, qui joue un rôle majeur dans le fonctionnement des associations, non seulement en tant que ressource d’appoint, mais aussi comme facteur essentiel de vivacité démocratique et témoin de l’importance de la notion d’engagement. On compte 13 millions de bénévoles, ce qui représente près d’un actif sur deux : dans la période de crise économique et sociale que nous traversons, ce chiffre montre la grande capacité de mobilisation de nos compatriotes, d’autant que le nombre d’interventions bénévoles s’est accru de 12 % depuis 2010. Cette progression est due en grande partie aux classes d’âge les plus jeunes, ce qui est encourageant en termes de renouvellement des bénévoles – étant toutefois précisé que, si les jeunes bénévoles sont prompts à s’engager de manière ponctuelle, directement auprès des usagers, dans un projet associatif, ils rechignent souvent à prendre des responsabilités associatives de nature statutaire, c’est-à-dire à plus long terme.
L’étude des statistiques du service civique – un dispositif qui monte en charge de manière dynamique – confirme la présence d’une importante réserve de bénévoles en France, soutenue par un attachement certain à l’idée d’engagement. Dans ce domaine, le Président de la République et le Premier ministre ont fait part de leur volonté de voir passer le nombre de volontaires du dispositif de 35 000 à 100 000. Ayant créé et dirigé l’agence du service civique qui accueillait à l’origine 6 000 volontaires, je suis bien placé pour mesurer l’ampleur des progrès accomplis en la matière depuis 2010.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Par quels moyens pourrions-nous inciter les jeunes bénévoles du service civique à s’engager de manière plus durable, afin de permettre aux associations de réduire leurs coûts et de pérenniser leur existence ? Faut-il pour cela les doter d’un statut particulier ?
M. Jean-Louis Bricout. Vous avez évoqué les difficultés auxquelles sont confrontées les associations pour renouveler leurs instances dirigeantes. Le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux vous paraît-il de nature à influencer l’attitude des jeunes à l’égard des associations ? Pour ceux qui adhèrent déjà à la vie associative, comment les accompagner et leur permettre de prendre leurs responsabilités au sein des instances dirigeantes ?
M. Régis Juanico. Comme vous l’avez dit, la représentation nationale a voté une importante loi relative à l’économie sociale et solidaire, qui comprend un volet associatif significatif, sous la forme d’une quinzaine de mesures destinées à favoriser la vie associative par le biais d’une sécurisation juridique et financière ou d’une plus grande reconnaissance de l’engagement associatif et du bénévolat. Alors que nous entrons dans la phase de rédaction des décrets d’application de cette loi, pouvez-vous nous dire où en est le travail de mise en œuvre de ces dispositions, très attendues par les associations ?
Par ailleurs, en ce qui concerne le chantier de la simplification administrative ouvert par la loi, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement une disposition d’habilitation à adopter certaines mesures par ordonnance, et a pour cela confié une mission préparatoire à notre collègue Yves Blein. Pouvez-vous nous indiquer quelles pistes vous envisagez en la matière ?
Lors de l’examen de la loi relative à l’ESS, l’Assemblée nationale et le Sénat n’ont pu s’accorder sur deux points : la pré-majorité associative et la proposition consistant à relever le seuil de lucrativité des associations. Bercy a préféré temporiser plutôt que de réserver une suite favorable aux amendements que j’avais présentés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative et qui visaient à revaloriser ce seuil demeuré inchangé depuis 2002. Pouvez-vous nous faire part de votre position sur ces deux questions, qui devraient être à nouveau débattues prochainement ?
M. Jean-Luc Bleunven. Les collectivités locales, dites-vous, sont souvent tentées de privilégier la sécurité juridique. Mais ne peut-on penser que toute relation entre une collectivité et une association comporte une certaine part de risque, et que les mesures visant à protéger les collectivités se font au détriment des associations, qui prennent également des risques ? Ne faut-il pas rappeler aux collectivités locales que la préservation de la dynamique sociale et territoriale nécessite une intervention de l’État en direction du monde associatif ?
M. le président Alain Bocquet. Les emplois d’avenir sont, à quelques exceptions près, des emplois sans qualification. Doit-on, de ce fait, considérer qu’ils ne sont pas adaptés au monde associatif qui, a fortiori durant la période de crise que nous connaissons, ne paraît pas disposer des capacités, notamment du temps nécessaire, à la prise en charge de la formation des jeunes ?
M. Jean-Benoît Dujol. Je répondrai d’abord à la question portant sur le bénévolat et sur la difficulté qu’il y a à transformer un bénévole en responsable associatif. On évoque fréquemment l’idée d’un véritable statut du bénévole comportant des protections sociales qui pourraient aller jusqu’à l’attribution de droits à retraite. Une telle orientation, qui ne me semble pas correspondre au souhait du Gouvernement, n’est pas non plus soutenue par la DJEPVA, qui privilégie une logique de promotion, de reconnaissance et d’incitation, plutôt qu’une logique statutaire. Il nous semble, en effet, que l’idée d’un statut du bénévole, comportant des acquis calqués sur ceux du monde salarié, est tout à fait contradictoire avec celle d’engagement désintéressé, et qu’il vaut mieux fidéliser les bénévoles par la formation, en recourant pour cela au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) qui, abondé par l’État et les régions, met en œuvre chaque année 11 millions d’euros au profit de la formation des bénévoles, ce qui complète de façon substantielle les ressources dont disposent les associations dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO). Un bénévole mieux formé sera plus à l’aise dans son action au sein de l’association et aura donc tendance à pérenniser son engagement.
Une autre piste, débattue dans le cadre de la loi sur l’ESS, est celle du congé d’engagement bénévole, qui permettrait de favoriser l’engagement des responsables associatifs exerçant une activité salariée. Le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans les mois qui viennent, un rapport sur ce thème, l’objectif recherché étant de mettre au point une formule suffisamment attractive pour susciter les vocations d’engagement bénévole, sans toutefois perturber la vie des entreprises concernées. La principale question qui se pose au sujet de ce congé d’engagement bénévole est de savoir s’il faut le réserver à l’exercice de responsabilités statutaires, ou s’il peut concerner toute activité bénévole à partir d’un certain seuil d’intensité. Nous considérons que, en permettant que ce congé puisse être pris pour permettre à un bénévole de participer à des activités d’un faible niveau d’implication – par exemple assemblées générales ou réunions –, nous passerions à côté de l’objectif essentiel de la mesure envisagée, à savoir favoriser la prise de responsabilités statutaires. Cela dit, il doit être possible de trouver une solution équilibrée en termes de jours de congé et d’indemnisation – que celle-ci soit obligatoire, facultative, à l’initiative de l’entreprise ou non, éventuellement abondée par le compte épargne-temps du salarié, sans toutefois aller jusqu’à instaurer une indemnité journalière du bénévole, qui ne nous paraît pas souhaitable – et d’une efficacité satisfaisante en termes d’attractivité.
Avec le service civique, nous sommes tout à fait dans l’esprit de l’engagement volontaire et bénévole propre aux associations. Cela permet aux jeunes de rencontrer un monde associatif qu’ils ne connaissent pas toujours et, s’ils le souhaitent, de prolonger une première expérience de volontariat par d’autres formes d’engagement bénévole tout au long de leur vie. Il existe d’autres modalités de reconnaissance du bénévolat : je pense notamment à la médaille de la jeunesse et des sports, récemment réformée pour devenir la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, et dont le domaine a été élargi à la valorisation de tout engagement bénévole en faveur de l’intérêt général. Pour conclure sur ce point, j’insisterai à nouveau sur l’importance du bénévolat, qui constitue l’un des piliers de la ressource humaine des associations, ainsi que l’une des conditions de leur fonctionnement démocratique du fait de l’intervention de personnes autres que des salariés, qui évite une trop grande institutionnalisation.
Le développement des nouvelles technologies peut effectivement contribuer à favoriser le recrutement au sein des associations. J’y vois d’abord un instrument permettant aux associations de se faire connaître, notamment au moyen des réseaux sociaux : ainsi le recrutement pour le service civique se fait-il intégralement par le biais d’un site internet et par l’animation d’une communauté assurée à la fois par l’agence et par les principaux organismes recruteurs. Les nouvelles technologies permettent également aux associations de se procurer des ressources financières alternatives, même si cet aspect reste encore relativement marginal pour le moment : ainsi, c’est par le crowdfunding associatif que la plate-forme HelloAsso – que nous soutenons au titre de l’opération « La France s’engage », initiative présidentielle lancée le 24 juin dernier – facilite, pour les associations, le recours à la générosité publique. Puisque je m’exprime devant le législateur, je souligne que ce nouveau mécanisme, qu’il convient d’encourager, nécessiterait sans doute d’être régulé, puisqu’il est actuellement régi par des lois votées avant qu’internet ne prenne l’importance qu’on lui connaît maintenant, et dont la lourdeur s’accorde mal avec la rapidité, pour ne pas dire l’immédiateté caractérisant les nouvelles technologies.
Pour ce qui est de la loi ESS, nous entrons dans une phase de programmation des textes, chaque ministère préparant actuellement la mise en œuvre des dispositions dont il est chargé – certaines étant confiées à la fois à Bercy et au ministère de l’intérieur. Pour sa part, la DJEPVA travaille à la fois sur un texte technique relatif aux fusions et cessions d’associations, et sur un autre relatif à l’application du Haut Conseil à la vie associative (HCVA), instance placée auprès du Premier ministre, mais dont le secrétariat et le fonctionnement relèvent de nos attributions. Notre objectif étant de permettre une entrée en vigueur de la loi dans les six mois suivant son adoption, nous ne devons pas perdre de temps pour achever la mise au point des textes d’application, attendus pour le début de l’année prochaine. Ce calendrier correspond à celui d’élaboration des ordonnances retenu par M. Blein, qui m’a auditionné dans le cadre de la mission qui lui a été confiée – d’une visée assez large, puisqu’elle consiste à préparer la simplification par ordonnances de l’ensemble des relations entre le monde associatif et l’administration, ce qui peut concerner aussi bien l’accès aux subventions que les agréments et l’ensemble des procédures auxquelles peuvent être confrontées les associations.
Avec votre collègue, nous avons abordé la question du tronc commun d’agrément : il existe déjà une disposition législative sur ce point, mais elle est tombée en désuétude faute de parution des décrets d’application s’y rapportant. Le rapport de M. Blein sera l’occasion soit de relancer cette disposition, si l’on considère qu’elle présente un intérêt suffisant, soit de proposer son abandon. Les travaux menés jusqu’à présent ont montré la grande diversité des agréments ministériels ainsi que les conditions très variables auxquelles ils répondent et les nombreux droits qu’ils peuvent conférer. Une seule association peut, de ce fait, être amenée à solliciter deux ou trois agréments distincts, ce qui entraîne l’ouverture d’autant de procédures – étant précisé par ailleurs que chaque agrément est soumis à des formalités de renouvellement, notamment en termes de périodicité, qui lui sont propres. L’idée d’un tronc commun d’agrément ayant trait, par exemple, au fonctionnement démocratique de l’association, et opposable aux différents départements ministériels, rendrait inutile la vérification de ce critère par chaque ministère concerné : comme le permet le programme « Dites-le nous une fois » mis en place pour simplifier les relations entre les entreprises et l’administration, il suffirait que cette vérification ait été faite une fois. En revanche, chaque département ministériel a bien vocation à vérifier que les actions conduites par une association dans tel ou tel domaine répondent à des critères spécifiques liés à son domaine de compétence. Il faut donc distinguer, dans l’agrément, les critères relevant de la structure de l’association de ceux relevant de l’action qu’elle mène, et procéder à une simplification en faisant un tronc commun des premiers.
Le système d’information en matière associative mériterait également d’être étudié afin d’être mieux connu qu’il ne l’est actuellement, car nous manquons de données et d’observations sur les associations, même si des travaux de longue haleine sont menés sur ce thème par le Conseil national de l’information statistique (CNIS) et l’INSEE. En tout état de cause, on peut s’interroger sur la gouvernance des systèmes d’information associatifs, notamment dans l’optique de la simplification de la vie des associations, qui soulève de nombreux sujets infralégislatifs. En matière de gestion, par exemple, les logiciels utilisés pour instruire les demandes de subvention sont très hétérogènes et imposent de lourdes contraintes aux associations, qui doivent refaire plusieurs fois la même déclaration. Dans le respect des logiques institutionnelles propres à chaque donneur d’ordres, donc à chaque personne morale octroyant une subvention, il serait bon que les différents intervenants s’accordent sur des principes communs, ce qui nécessiterait la mise en place d’une gouvernance dynamique des systèmes d’information afin de progresser en termes de qualité de service. Il existe aujourd’hui un portail associatif hébergé par la direction de l’information légale et administrative (DILA), qui permet de regrouper un certain nombre de démarches, mais je suis persuadé que nous pourrions encore avancer dans cette direction.
La pré-majorité associative, que nous avons soutenue, est un sujet délicat qui a suscité de nombreuses craintes lorsqu’il a été débattu au Sénat. Nous estimons pour notre part que ces inquiétudes ne sont pas justifiées : actuellement, il est fréquent que des mineurs adhèrent à des associations, et il serait bien dommage qu’une loi vienne limiter l’engagement des très jeunes gens au sein du monde associatif. Si certaines craintes – tel le risque de dérive sectaire ou d’endoctrinement religieux – sont légitimes, elles ne doivent pas empêcher un jeune d’adhérer à un club de football ou à n’importe quelle autre association sportive, et de devenir un véritable acteur du monde associatif. Si l’on a échoué jusqu’à présent à définir des critères de nature à écarter les risques évoqués, c’est peut-être parce que le contexte n’était pas favorable, et je pense qu’il faudra y parvenir d’une manière ou d’une autre, car l’enjeu de la pré-majorité, qui n’est autre que le recrutement des futurs responsables associatifs, le justifie pleinement.
Le seuil de lucrativité, actuellement fixé à 60 000 euros, date de 2002. Le HCVA a mené une réflexion en vue d’une actualisation raisonnable de ce seuil, correspondant au moins à l’inflation, et le chiffre de 72 000 euros a été avancé – ce qui me semble correspondre à la proposition formulée par certains députés.
M. Régis Juanico. Oui, nous proposons une réévaluation qui se situerait entre 72 000 et 80 000 euros – sans doute à 77 000 euros.
M. Jean-Benoît Dujol. Nos propositions concordent donc. La principale difficulté technique, c’est l’absence d’une étude d’impact qui permettrait de déterminer le nombre d’associations concernées par une évolution qui aurait pour conséquence de faire sortir un certain nombre de structures de l’assiette de l’impôt, dans un contexte budgétaire fortement contraint. Des discussions avec Bercy sont en cours sur cette mesure, qu’il nous semblerait logique de voir figurer dans le projet de loi de finances pour 2015 à la suite de l’adoption de la loi ESS.
Le message adressé aux collectivités locales en matière de recours à la subvention ou à la commande publique constitue un sujet d’actualité puisque, à la suite de la réforme des rythmes scolaires, de nombreuses collectivités locales sont en train de mettre en place une offre de services à l’intention des élèves et de leurs parents. Selon une idée communément répandue, le recours au marché public serait obligatoire pour faire appel aux services d’une association ; or, si cette procédure permet de bénéficier de certaines garanties, elle n’est pas obligatoire. Je veux rappeler que nous disposons d’autres outils, qu’il s’agisse de la charte d’engagements réciproques de février 2014 ou de la circulaire signée par François Fillon en janvier 2010, ayant pour objet d’établir une doctrine claire sur le champ respectif des subventions et des procédures de marché, qu’il conviendrait d’actualiser à la suite de l’adoption de la loi ESS.
En ce qui concerne les emplois d’avenir, vous avez évoqué un risque classique en matière d’intervention publique, celui de l’écrémage : alors qu’un dispositif a été conçu à l’intention de ceux qui en ont le plus besoin, il est en fait proposé à d’autres catégories de personnes – certes également confrontées à des difficultés, mais sans doute plus faciles à gérer. Le secteur « jeunesse et sports » dont nous avons la charge se caractérise par une dynamique très forte en matière d’emplois d’avenir, l’objectif de 15 000 emplois d’avenir dans ce secteur étant d’ores et déjà largement dépassé. Les associations sont très sollicitées pour les besoins en matière de formation dans un secteur possédant ses propres diplômes dans le domaine de l’animation et du sport et présentant un taux d’insertion assez élevé. Les emplois d’avenir ont donc vocation à déboucher, dans le secteur « jeunesse et sports », sur une formation professionnelle qualifiante et adaptée au marché de l’emploi. Des solutions existent : je pense notamment aux groupements d’employeurs, encore balbutiants dans notre secteur, mais qui paraissent de nature à permettre la mise en commun de ressources et, ainsi, de pérenniser des emplois répondant souvent à des besoins limités, donc à des emplois à temps partiel. Je voulais profiter de cette audition pour souligner le succès particulier du dispositif du groupement d’employeurs dans le secteur « jeunesse et sports ».
M. le président Alain Bocquet. Nous vous remercions pour votre contribution.
Audition de M. Patrick Audebert, chef du bureau des associations et fondations (ministère de l’Intérieur)
(séance du 3 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Le bureau des associations et fondations que vous dirigez, monsieur Audebert, exerce les compétences dévolues au ministère de l’intérieur en matière d’application et d’évolution de la législation concernant la vie associative, ainsi que de tutelle sur les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors des contacts préalables à cette audition, nous souhaitons que vous apportiez à notre commission des éclairages sur les tendances récentes de la dynamique associative et sur le risque d’érosion de la place et du rôle des associations dans le tissu social. Par ailleurs, quels sont les enseignements à tirer de l’exercice de la tutelle sur les associations et fondations reconnues d’utilité publique ?
Avant de vous donner la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Patrick Audebert prête serment)
M. Patrick Audebert, chef du bureau des associations et fondations. Le ministère de l’intérieur exerce la compétence régalienne vis-à-vis des associations. Les préfets reçoivent les déclarations de création, de modification et de dissolution des associations dites « simplement déclarées ». Ils ont également pour mission de délivrer les attestations de non-opposition aux libéralités – legs, donations, etc. – que certaines associations peuvent recevoir. Ces libéralités étaient auparavant soumises à un régime d’autorisation que la loi Warsmann de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures est venue assouplir il y a quelques années.
La tutelle des établissements et fondations reconnus d’utilité publique est, quant à elle, « copartagée » par l’administration centrale du ministère et les préfectures. Le ministère a la charge de la procédure de reconnaissance d’utilité publique, qui fait l’objet d’un décret en Conseil d’État, et exerce ensuite sa tutelle sur les établissements, contrepartie des avantages et du label dont ceux-ci bénéficient. Les préfets exercent également cette tutelle, selon l’emplacement du siège social.
Le rôle du ministère de l’intérieur est donc assez différent de celui de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), dont vous venez d’entendre le représentant, et qui s’occupe davantage de la dynamique associative, des subventions, des agréments, du bénévolat, etc.
Les chiffres que vous m’avez transmis avant cette audition sont conformes aux nôtres : il y a aujourd’hui en France 1,2 million d’associations. Le répertoire national des associations (RNA), tenu à jour par les préfectures et relevant l’existence de toutes les associations vivantes, nous permet d’avoir une vision précise des évolutions. Ce milieu est extrêmement dynamique : nous enregistrons environ 70 000 créations par an et environ 250 000 modifications, ce qui représente un travail assez important pour les préfectures.
Il existe, par ailleurs, 1 933 associations reconnues d’utilité publique (ARUP). Ce chiffre est relativement stable. Chaque année, nous accordons la reconnaissance d’utilité publique à quinze à vingt nouvelles entités et nous abrogeons, après avis du Conseil d’État, une dizaine de décrets de reconnaissance d’utilité publique – ce qui ne signifie pas, précisons-le, que les associations sont dissoutes ou disparaissent.
Ces abrogations ne sont pas la conséquence de contentieux ou de difficultés : très souvent, ce sont les associations qui renoncent d’elles-mêmes à la reconnaissance d’utilité publique parce qu’elles n’en ont pas l’usage. Cette reconnaissance est un label de sérieux sur lequel on peut appuyer une communication auprès du public ou de mécènes éventuels, et elle ouvre la « grande capacité juridique », qui donne la possibilité de recevoir des libéralités. Mais les associations qui utilisent peu le label et reçoivent peu de dons et de libéralités peuvent considérer que la tutelle est un peu lourde et préfèrent y renoncer.
Il existe aussi un mouvement de fusion, voire de transformation d’associations. Beaucoup d’entre elles, on le sait, interviennent dans le domaine médico-social, où les Agences régionales de santé (ARS) encouragent fortement le regroupement des structures, préférant s’adresser à des entités relativement importantes plutôt qu’à une myriade de petites associations.
Parallèlement, on assiste à un mouvement de transformation d’associations en fondations. Certaines associations, en effet, dans le domaine médico-social, de la jeunesse en plein air, des colonies de vacances, etc., détiennent parfois un patrimoine abritant leurs activités, tandis que le nombre de leurs membres décroît et que leur gouvernance se fait un peu vieillissante. Elles choisissent alors de se transformer en fondation pour mettre ce patrimoine à l’abri.
Rappelons que la clé de voûte – et la richesse – d’une association, ce sont ses adhérents, alors qu’une fondation consiste d’abord en un patrimoine. Or le patrimoine d’une fondation reconnue d’utilité publique, sa dotation, est inaliénable et inconsomptible. La valeur minimale de cette dotation – qui peut très bien être un bien immobilier – est de 1,5 million d’euros. La fondation ne peut pas en disposer, ce qui permet de s’assurer de la pérennité du bien au fil de l’évolution de la gouvernance.
Parmi les difficultés que rencontrent les associations, nous constatons dans les dossiers que nous instruisons une légère érosion des dons et des cotisations. Les associations sont également confrontées à une augmentation de la part de la commande publique par rapport aux subventions, l’évolution de la législation européenne imposant désormais à l’État et aux collectivités territoriales un système d’appels d’offres transparent qui, de fait, met les associations en concurrence avec le secteur privé. En outre, les budgets des conseils départementaux en matière d’aide sociale diminuent. Je siège, en tant que représentant du ministère de l’intérieur, aux conseils d’administration d’une trentaine de fondations à Paris
– étant chargé de la tutelle, le ministère siège dans pratiquement toutes les fondations reconnues d’utilité publique –, où l’on regrette que ces budgets, de même que ceux des autres collectivités et des ARS, soient de plus en plus serrés. Les fondations et les associations se trouvent parfois contraintes de prendre sur leur substance pour financer ce que l’argent public ne finance plus.
Enfin, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales – notamment en ce qui concerne le nombre de présents – que l’investissement associatif est en diminution. Sans aller jusqu’à parler de vision « consumériste » des associations, il existe sans doute une difficulté à renouveler les bénévoles et les adhérents, et à trouver des administrateurs. Souvent, pour modifier les statuts d’une association reconnue d’utilité publique, il faut recourir à une assemblée générale extraordinaire parce que l’on n’a pas atteint le quorum d’un quart des adhérents qu’imposent les statuts types validés par le Conseil d’État. Il y a là un signe de perte de dynamisme.
Cela dit, nous ne devons pas opposer le secteur associatif au secteur privé ou à l’action des pouvoirs publics. Le monde associatif, par sa réactivité, son ancrage dans les territoires, sa connaissance des besoins des populations, leur est complémentaire dans de nombreux domaines. Il a toute sa place, et cela doit être reconnu dans le débat entre commande publique et subvention.
Dans ce paysage, quelle est l’action du ministère de l’intérieur ?
Tout d’abord, nous sommes à l’origine d’une disposition de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui prévoit un élargissement du périmètre des associations pouvant recevoir des libéralités. Jusqu’à présent, seules les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, étaient concernées. Il n’était pas toujours facile pour les préfets de se prononcer : il suffisait que l’association ait une petite activité annexe pour ne pas bénéficier de cette qualification, au demeurant quelque peu désuète – on pense à la philanthropie des dispensaires et des orphelinats sous le Second Empire. La nécessité de soutenir des populations en difficulté, surtout en période de crise, n’a pas diminué, mais d’autres missions d’intérêt général, telles que le développement durable, la protection des animaux, la défense de la langue française, l’action humanitaire, etc., méritent d’être retenues. Le législateur a donc modifié l’article 6 de la loi de 1901 : dès lors que l’ensemble des activités d’une association est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts – condition qui, par ailleurs, donne lieu au rescrit fiscal –, cette association pourra recevoir des libéralités, ce qui élargira le financement des actions d’intérêt général. Sur notre proposition également, il a été décidé que ces associations ne seraient plus obligées de vendre les biens immobiliers reçus par legs ou par donation : elles pourront les conserver comme immeubles de rapport, de manière à diversifier leurs sources de financement.
Parallèlement à ce renforcement des avantages des associations déclarées d’intérêt général, nous avons proposé de renforcer les avantages des associations reconnues d’utilité publique en leur permettant l’achat d’immeubles de rapport. Ces mesures devraient apporter de l’air frais au monde associatif.
Sur le plan des procédures administratives, il est désormais possible sur tout le territoire national – à l’exception de l’Alsace-Moselle, où le droit local nécessite quelques ajustements – de déclarer, modifier ou dissoudre une association par une simple déclaration sur internet. La préfecture ne fait que valider les documents qui lui sont envoyés. Ceux-ci figurent ensuite au RNA et sont publiés au Journal officiel sans qu’il soit nécessaire de les saisir à nouveau. Le récépissé est envoyé dans le porte-documents de l’associé internaute.
La procédure dématérialisée dite de e-création a été généralisée au début de 2013. Aujourd’hui, 45 % des déclarations se font par internet, avec des inégalités selon les territoires, puisque le taux atteint 65 % à Paris. Les procédures de modification et de dissolution, généralisées en février 2014, sont un peu plus lentes à démarrer puisque nous n’avons pas encore atteint les 5 %. Après avoir identifié certaines raisons de ce moindre succès – référencement du site sur internet, notamment –, nous nous efforçons, avec nos partenaires, de communiquer plus largement pour rattraper ce retard.
Enfin, la loi relative à l’économie sociale et solidaire ouvre au Gouvernement la possibilité de prendre par ordonnance des mesures de simplification. Dans ce cadre, le ministère de l’intérieur réfléchit à l’allégement de certaines modalités de l’exercice de sa tutelle sur les associations reconnues d’utilité publique.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Vous avez beaucoup parlé des associations reconnues d’utilité publique. Il est vrai que nous avons en France une très grande diversité d’associations, que ce soit par le type, par la taille, par la raison sociale ou éthique. À cet égard, pensez-vous que la définition du statut associatif dans la loi de 1901 est toujours adaptée ? Ne doit-elle pas faire l’objet de transformations ? Entendez bien qu’il ne s’agit en aucun cas de la supprimer : le monde associatif est une chance inouïe pour la France et nous devons continuer à défendre à travers le monde ce « troisième pouvoir » très actif et porteur de valeurs.
Par ailleurs, au vu des raisons sociales des associations, comment exercez-vous votre contrôle a posteriori ? Voyez-vous apparaître des difficultés nouvelles qui mériteraient d’être analysées dans le cadre de nos travaux ?
M. Régis Juanico. La loi relative à l’économie sociale et solidaire compte plusieurs mesures destinées à faciliter le quotidien des associations. Ainsi, les associations reconnues d’utilité publique pourront effectuer tous les actes de la vie civile, comme l’acquisition ou la gestion d’immeubles.
Lors de la discussion du projet, l’Assemblée nationale avait souhaité ajouter une disposition relative à la pré-majorité associative. Après un débat de haute tenue en commission mixte paritaire, les sénateurs se sont finalement opposés à une modification de la loi de 1901 sur ce point. Nous souhaitions que tout mineur, quel que soit son âge, puisse devenir librement membre d’une association sans avoir à justifier d’une autorisation préalable des parents. Nous proposons également que les mineurs de plus de seize ans puissent effectuer des actes de création ou d’administration, à la condition expresse qu’il n’y ait pas d’opposition des parents.
Quelle est la position de votre administration sur ces deux sujets ? Quels sont les motifs qui s’opposent à ces avancées ?
M. le président Alain Bocquet. Les statistiques dont nous disposons sur la vie associative – nombre, taille, orientation, etc. – paraissent parfois insuffisantes. La multiplicité des associations et la diversité de leurs activités font que nous avons du mal à appréhender le sujet.
M. Patrick Audebert. Le dynamisme associatif – 70 000 créations par an – tend à montrer que le statut de 1901 répond à un réel besoin. On nous envie ce dispositif à l’étranger. Les délégations étrangères que nous recevons sont surprises, en particulier, par son libéralisme. Elles s’étonnent que l’on puisse créer une association sans contrôle, sans que le préfet puisse s’y opposer, sans qu’il ait compétence liée, et que l’on ne contrôle ni la nationalité des membres ni l’objet de l’association. Le préfet n’a la possibilité de saisir la justice que s’il estime qu’il peut y avoir atteinte aux bonnes mœurs, à la forme républicaine du gouvernement, etc., mais, autant que je me souvienne, je n’ai encore jamais rencontré un tel cas. Il est douteux, d’ailleurs, que des personnes animées de telles intentions songent à constituer une association !
Incidemment, il me semble que ce sont aujourd’hui les sites internet qui peuvent faire concurrence aux associations. Là où l’on créait une association dans le dessein de se rassembler pour mener une action, il est possible désormais de se regrouper – sans avoir la personnalité morale, certes –, de discuter et d’échanger sur différents sites.
Le statut associatif sert à tout. Il y a par exemple des associations « transparentes » auxquelles les collectivités ou l’État recourent parfois pour gérer des services publics. Cela n’est pas illégal, mais le juge peut être amené à requalifier l’organisme. Il n’est pas non plus interdit aux associations de se livrer à des activités commerciales, pour peu que celles-ci soient soumises au fisc.
Bref, le dynamisme des associations et la variété des usages qu’en font nos concitoyens montrent que la structure reste très adaptée et très actuelle. Peut-être par manque de recul, je ne vois pas très bien ce que l’on pourrait amender dans cette procédure où il suffit d’être deux personnes, de se réunir, d’élaborer des statuts et de les déposer à la préfecture.
En matière de contrôle des associations, je crois que le plus important est celui qu’exercent les donateurs. Il faut de la transparence. Aujourd’hui, les associations qui reçoivent plus de 153 000 euros de subventions ou de dons doivent avoir un commissaire aux comptes et mettre en ligne leurs comptes sur le site de la direction de l’information légale et administrative (DILA). Peut-être ce dispositif n’est-il pas assez connu, d’autant qu’il est parfois difficile de retrouver sur ce site l’association que l’on recherche. Mais, aujourd’hui, la plupart des associations ont leur site. Il faut qu’elles y fassent figurer leurs comptes. Nul n’est meilleur contrôleur que la personne qui a donné une somme d’argent, grosse ou petite, et qui se renseigne sur son utilisation.
La générosité des Français est un trésor, mais un trésor fragile – on l’a vu avec l’affaire de l’ARC (Association pour la recherche sur le cancer) survenue il y a une vingtaine d’années, qui a donné lieu à de nouvelles dispositions de contrôle. De tels événements peuvent entamer la confiance des Français dans les associations. Un contrôle est nécessaire, d’autant que les dons faits aux associations remplissant une mission d’intérêt général donnent droit à des déductions fiscales, qui se traduisent par de moindres rentrées pour l’État.
S’agissant de la pré-majorité associative, monsieur Juanico, le ministère de l’intérieur avait clairement exprimé son opposition aux dispositions que vous évoquez. Nous avions d’ailleurs rencontré à ce sujet le rapporteur du texte, M. Yves Blein. Le dispositif actuel, issu d’un amendement de Mme Marland-Militello adopté il y a deux ou trois ans, nous semble équilibré : toute personne, quel que soit son âge, peut être membre d’une association, mais, pour qu’un mineur de plus de seize ans puisse participer à son administration, il faut la non-opposition des parents et il reste constant que les mineurs ne peuvent pas faire des actes de disposition. Nous avons voulu ainsi protéger les mineurs et leurs parents. Selon le code civil, les mineurs ne peuvent pas faire d’actes. Leur permettre d’administrer une association à partir de seize ans est déjà une mesure assez généreuse et libérale.
Les statistiques figurant dans le document que vous m’avez transmis sont justes, monsieur le président. Je peux vous en fournir d’autres, notamment thématiques, puisque le RNA indexe chaque association avec des codes qui renvoient à des domaines et à des sous-domaines. Je pense que les secteurs majoritaires sont le médico-social et la culture.
Par ailleurs, nous mettons en ligne sur notre site la liste, actualisée tous les trimestres, des associations et des fondations reconnues d’utilité publique. Il est possible de trier les organismes par département, par thème, etc.
M. le président Alain Bocquet. Toutes les statistiques un peu fines nous seront utiles. Merci pour votre contribution.
Table ronde « Associations caritatives » :
Mme Florence Delamoye, déléguée générale d’Emmaüs France ;
Mme Hélène Beck, directrice administration-finances du Secours catholique ;
Mme Henriette Steinberg, secrétaire générale du conseil d’administration et secrétaire nationale du Secours populaire français, et
M. Anthony Marque, secrétaire national du Secours populaire français ;
M. Jean-Pierre Caillibot, délégué général adjoint des Petits Frères des pauvres ;
M. Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre ;
M. Olivier Berthe, président des Restos du cœur ;
M. Pierre-Yves Madignier, président du mouvement ATD Quart Monde
(séance du 4 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre commission d’enquête et je vous remercie de prendre part à cette deuxième table ronde « sectorielle », consacrée aux associations caritatives – étant entendu que la Fondation Abbé Pierre n’est pas une association loi de 1901.
Dans une société frappée de plein fouet par la précarité et la désespérance sociale, les organismes que vous représentez jouent un rôle essentiel, aux côtés de l’État et des collectivités locales. Si, comme on le dit parfois, le secteur associatif est en crise, pour les plus démunis de nos concitoyens, la crise s’ajoutera à la crise, ce qui n’est pas acceptable.
Nous attendons de vous un panorama sans fard des difficultés que vous rencontrez dans votre action quotidienne, y compris dans vos relations avec les acteurs publics, et des pistes de solution pour le législateur.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Florence Delamoye, Hélène Beck, Henriette Steinberg et MM. Jean-Pierre Caillibot, Patrick Doutreligne, Olivier Berthe et Pierre-Yves Madignier prêtent serment)
Mme Florence Delamoye, déléguée générale d’Emmaüs France. Sachez tout d’abord que nous nous sommes réunis hier afin de mettre en commun nos arguments et de nous accorder sur plusieurs problèmes graves à propos desquels nous souhaitons vous alerter. Par-delà leurs spécificités, en effet, les acteurs du monde associatif savent se concerter, ce qu’ils doivent de plus en plus faire aujourd’hui afin de se montrer le plus efficaces possible. Si un seul élément nous réunit, c’est, au-delà du lien social que nous tissons, cette volonté d’efficacité dans l’élaboration de nos projets sociaux et de nos réponses aux besoins des personnes en difficulté.
Emmaüs France, qui représente le mouvement Emmaüs sur le territoire français, se compose de 283 groupes réunissant 18 000 acteurs : bénévoles, salariés et – c’est notre particularité – compagnons et compagnes d’Emmaüs. Les ressources du mouvement Emmaüs s’élèvent à 469 millions d’euros au total, provenant pour partie de subventions et pour partie de produits de vente, puisque nous avons une activité économique importante ainsi que des activités dites de bailleurs sociaux. Il importe de souligner que nous ne sommes pas faits d’un bloc : au sein de notre mouvement coexistent des activités et des types de structure très hétérogènes. Ainsi, le mouvement Emmaüs est composé à 80 % environ d’associations loi de 1901, auxquelles s’ajoutent des coopératives – des formes de SCOP (sociétés coopératives participatives), des SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif) –, une fondation – la Fondation Abbé Pierre – et une SA HLM. Ce qui reflète la diversité du monde associatif en général, laquelle est à la fois une richesse et, dans certains cas, une difficulté.
Ce qui nous rassemble, c’est la volonté qui nous anime de répondre aux besoins sur le terrain, dans l’ensemble du territoire. Simplement, nous adaptons nos réponses aux besoins différents que nous avons identifiés. Parmi nos formats d’intervention, on trouve ainsi communautés, comités d’amis, structures d’insertion par l’activité économique (IAE), associations de lutte contre le mal-endettement, actions sociales dans le domaine du logement, dont certaines, particulières, liées au mal-logement, et actions d’urgence. Fruit de notre histoire, et parfois de celle des personnes qui ont créé les structures, cette diversité permet de répondre à des besoins émergents.
Ce qui m’amène à insister sur un point qui vous paraîtra peut-être banal, mais qui est essentiel à nos yeux : laissez-nous l’espace nécessaire à l’innovation sociale et économique dont le monde associatif s’est déjà montré capable et dont il doit pouvoir continuer de faire preuve au cours des années à venir !
Voici plus précisément nos revendications et nos sujets d’alerte.
Non aux carcans administratifs ! Le choc de simplification, annoncé par le Gouvernement, est indispensable car, dans le monde associatif, ces carcans, sans toujours être gage de sécurité pour les pouvoirs publics, entravent considérablement notre capacité d’action sur le terrain.
Non à la normalisation ! Notre diversité est notre richesse : c’est elle qui nous permet de répondre aux différents besoins de personnes en grande difficulté. Il est donc contraire à l’intérêt général de tenter de nous uniformiser sous prétexte de faciliter notre traitement administratif.
Oui, en revanche, à l’exigence de sérieux et aux contrôles, dont aucun d’entre nous ne conteste la légitimité, à l’heure où le monde associatif gagne en professionnalisme et en capacité d’adaptation.
Nous regrettons que nos actions soient si souvent appréciées selon des critères quantitatifs plutôt que qualitatifs. Je songe, par exemple, au nombre de personnes sorties d’une structure après un parcours de six mois : il ne signifie pas qu’au terme de cette période elles aient réglé tous leurs problèmes sociaux, sanitaires, de logement et d’emploi. Seuls des critères qualitatifs permettent de savoir si, en répondant à leurs besoins fondamentaux, nous leur avons permis de progresser et de franchir une nouvelle étape. Ne pas en tenir compte dans l’évaluation conduit à des résultats aberrants. De ce point de vue, nous sommes plutôt satisfaits de l’amélioration apportée par la réforme de l’insertion par l’activité économique, qui accorde à ces critères une place croissante. Ne perdons pas de vue que des tableaux de chiffres ne sauraient suffire lorsque la situation d’une personne est en jeu. Notre terreau est humain, nous créons du lien social en luttant contre l’isolement d’une population en marge, comme vous l’avez souligné dans votre rapport préparatoire. Comment mesurerait-on l’isolement d’une personne par des critères uniquement quantitatifs ?
La loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) parue cet été nous satisfait quant à sa démarche, mais son contenu nous inquiète. Le danger est grand, en effet, de faire naître un monde associatif à deux vitesses : d’un côté, l’ESS de conviction, que nous représentons, fondée sur un véritable projet social et vouée à aider les personnes en grande difficulté ; de l’autre, de nouveaux entrants incarnant une ESS de l’opportunité, c’est-à-dire de grands groupes pouvant bénéficier des financements qui nous sont en principe destinés. Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs à ce risque de dévoiement. Ne banalisons pas ce secteur, qui n’est pas une solution comme une autre mais fournit le terreau de véritables alternatives et de nouvelles réponses aux besoins. Nous ne cherchons pas à être protégés, mais à faire reconnaître notre spécificité et les solutions qu’elle nous a permis de proposer, afin de préserver celles-ci.
Voilà pourquoi nous attendons de l’État un plan ambitieux de développement des achats publics pour l’ESS, des clauses sociales d’insertion renforcées et un programme également ambitieux de soutien aux achats solidaires ou responsables du secteur privé. Il faut nous reconnaître une place privilégiée en la matière puisque nous répondons à des besoins que le privé « classique » ne peut satisfaire.
Enfin, il est important que nos financements soient sécurisés par le biais des subventions et de leur pluriannualité. On s’oriente aujourd’hui vers une logique d’appels à projets ; outre que ceux-ci devraient de toute façon être précédés d’une large concertation et assortis de critères qualitatifs afin d’éviter une politique du « moins-disant », nous leur préférerions des « appels à idées ». Laissez le monde associatif proposer des solutions pour répondre aux besoins immédiats, en favorisant l’innovation, moyennant une obligation non de résultats – inenvisageable lorsque l’humain est en jeu –, mais d’analyse et d’étude.
Mme Hélène Beck, directrice administration-finances du Secours catholique. Au nom du Secours catholique, je remercie Mme Marie-George Buffet d’avoir identifié les difficultés du secteur associatif dans son rapport et souhaité que des propositions soient formulées pour y remédier. Nous remercions également le président, la rapporteure et tous les membres de la commission d’enquête de se consacrer à ce sujet particulièrement important.
Rappelons, en effet, que le secteur associatif compte 1,3 million d’associations et emploie 1,8 million de salariés, auxquels s’ajoutent 16 millions de bénévoles qui donnent 1,7 milliard d’heures de leur temps. La valorisation de ces heures de bénévolat représente, selon le mode de calcul utilisé, 20 à 40 milliards d’euros qu’il convient d’ajouter aux 85 milliards d’euros de budget du secteur. Cela confirme son importance politique, économique et sociale. En outre, le secteur est dynamique puisqu’il a progressé de 2,8 % par an entre 2008 et 2011, progression ralentie par la crise, à laquelle il a toutefois résisté mieux que d’autres.
Pourtant, les associations ne sont pas épargnées par les difficultés nées de la crise. Le contexte économique et social accroît les besoins de services associatifs, surtout dans le domaine social, alors que les financements publics sont en retrait et que la générosité privée, particulièrement importante dans notre secteur, peine à prendre le relais. Comme cela vient d’être dit, nous craignons la concurrence nouvelle d’entreprises privées qui ne seraient pas animées des mêmes convictions que nous.
J’en viens au Secours catholique, association loi de 1901 qui soutient et accompagne 1,5 million de personnes en France, auxquelles s’ajoutent 2,5 millions de bénéficiaires de l’action internationale que nous menons dans 74 pays. Le Secours catholique a créé l’Association des cités du Secours catholique qui accueille, accompagne, héberge et loge 10 000 personnes. Nous avons également participé à la création du réseau Tissons la solidarité, qui, au titre de l’insertion par l’activité économique, accueille 1 900 femmes dans le cadre de contrats aidés, auxquelles s’ajoutent 300 personnes qui les accompagnent.
En termes économiques, le Secours catholique bénéficie de 150 millions d’euros de ressources financières auxquels il faut ajouter 190 millions correspondant à la valorisation du bénévolat. L’Association des cités est dotée de 55 millions d’euros, dont 85 % de financements publics. Il y a 1 000 salariés au Secours catholique et 900 au sein de l’Association des cités, outre ceux du réseau Tissons la solidarité.
Dans toutes nos activités d’accueil des personnes, nos charges administratives se sont alourdies. Ainsi, pour obtenir l’habilitation à délivrer l’aide alimentaire, il faut remplir des formulaires contraignants qui sont autant d’entraves à la relation. La domiciliation des personnes, la mise en œuvre du droit au logement opposable en sont d’autres exemples. Ces charges sont de plus en plus difficiles à supporter pour les bénévoles, désireux de nouer une relation d’aide. De même, alors que les demandes de subvention sont normalement formulées dans un document CERFA unique, il arrive que l’on nous réclame d’autres informations qui nous obligent à constituer un nouveau dossier.
Pour ces raisons, nous avons formulé des propositions très concrètes de simplification administrative, conformément à un souhait aujourd’hui répandu.
Toutes les structures d’hébergement sont concernées par la baisse des financements publics. L’Association des cités a naturellement fait en sorte de réduire ses coûts en conséquence. Par ailleurs, la suppression de l’exonération du versement transports l’a privée de 400 000 à 500 000 euros par an, portant son déficit – que le Secours catholique se charge de combler – de 1 à 2 millions d’euros.
Nous proposons donc que l’on revienne à l’exonération du versement transports demandée par la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) et par l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).
L’importance du financement par la générosité privée constitue une particularité du secteur caritatif et humanitaire au sein du monde associatif : pris dans son ensemble, celui-ci n’en dépend qu’à 4 % alors que la proportion atteint 80 % pour le Secours catholique. En la matière, nous reprenons les propositions formulées par le Haut Conseil à la vie associative pour développer le financement privé des associations dans le rapport qu’il a remis à la ministre Valérie Fourneyron. Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions suivantes.
Premièrement, relever le seuil d’assujettissement aux impôts commerciaux afin de développer le secteur lucratif. Aujourd’hui inexistant au Secours catholique, celui-ci nous aiderait à financer notre action sociale s’il pouvait représenter 3 % de notre activité au lieu d’être limité par le seuil de 60 000 euros de recettes annuelles. Il est gênant que ce seuil soit appliqué au Secours catholique, association unique sur tout le territoire, de la même manière qu’à chacune des fédérations qui composent d’autres organismes associatifs.
Deuxièmement, faciliter la création de foncières. Le Secours catholique et son réseau partenarial ont envisagé de créer une telle structure, qui permettrait de faire appel à l’investissement solidaire des donateurs – à distinguer du don –, à l’heure où les financements publics sont contraints et où, pour l’Association des cités du Secours catholique, le besoin de nouveaux établissements se fait pressant. Nous demandons donc l’allégement des contraintes liées à cette forme juridique, notamment la nécessité de posséder la qualité de commerçant. Puisqu’il manque des logements sociaux, aidez-nous à les développer.
Troisièmement, pour que les entreprises, en particulier les PME et TPE, puissent nous financer plus facilement, nous souhaitons que l’avantage fiscal lié au mécénat s’applique jusqu’à 10 000 euros, au-delà desquels le plafond actuel de 5 ‰ du chiffre d’affaires serait maintenu.
Une dernière chose. Pour accomplir sa mission initiale – créer du lien social, œuvrer à l’insertion et à l’inclusion sociales –, le Secours catholique devrait pouvoir montrer son action, celle de ses bénévoles, dans les médias et dans l’enseignement public, afin de la faire reconnaître.
Mme Henriette Steinberg, secrétaire générale du conseil d’administration et secrétaire nationale du Secours populaire français. J’irai à l’essentiel, en reprenant les différents objectifs énumérés dans l’intitulé de la commission d’enquête.
Pour que le Secours populaire français – et nos collègues et amis ici présents – puisse « assurer ses missions », la représentation nationale doit exercer une vigilance de tous les instants afin que nous soyons respectés ès qualité, c’est-à-dire en tant qu’association indépendante, dont l’objet social est clair, qui exerce ses activités par le bénévolat, en toute indépendance et en en recherchant les moyens matériels et financiers auprès de toutes les bonnes volontés, qu’elles soient personnes physiques ou personnes morales.
À cet égard, lorsque nous recourons à la générosité publique, nous avons à en rendre compte, de même que de l’ensemble des entrées et sorties, d’abord devant nos membres, lors de nos assemblées générales et congrès, ensuite devant la puissance publique et tous ceux qui s’y intéressent au travers de la publication de nos comptes au Journal officiel. Que nous soyons respectés ès qualités implique que le temps et les moyens que nous consacrons à cette tâche soient budgétés dans les actions elles-mêmes, afin de ne pas peser en frais généraux sur l’activité générale de nos bénévoles et de nos salariés.
Être respectés ès qualités, cela signifie encore ne pas devoir justifier partout et sans cesse que les personnes que nous soutenons et qui viennent nous rencontrer, ou à la rencontre desquelles nous allons, sont « vraiment » dans la détresse, « vraiment » dans la difficulté, « vraiment » menacées d’expulsion, « vraiment » incapables de payer leur chauffage, la cantine de leurs enfants, l’eau, les assurances, « vraiment » en carence alimentaire, ou à la limite, « vraiment » dans l’impossibilité de consulter médecins, dentistes, ophtalmologistes – la liste n’est pas exhaustive et n’aborde pas l’accès aux loisirs, aux vacances et aux sports, pourtant garanti par la loi-cadre de 1998.
Le temps que les bénévoles et les salariés de nos structures, dans l’ensemble du territoire, passent à répondre en permanence à ce type de demandes, de questions, de formulaires, de statistiques, pourrait être utilement consacré aux plus de 2 millions de personnes que nous avons soutenues en 2013 et qui s’annoncent plus nombreuses encore en 2014.
Et ne nous dites surtout pas que la simplification administrative ou la dématérialisation des données vont résoudre ces problèmes. Nous savons que toute apparente simplification, toute dématérialisation des données et absence de papier se traduisent pour les associations par l’explosion des coûts informatiques et, pour les personnes aidées, par de plus grandes difficultés à exercer un recours lorsqu’elles possèdent des droits qui n’ont pu être appelés. Les identifiants, les mots de passe, comment pensez-vous que puissent y accéder des personnes qui n’osent même plus aller chercher leurs recommandés à la poste, si du moins elles ont reçu l’avis dans leur boîte aux lettres, à supposer qu’elles en aient encore une ?
Pour ce qui est de « proposer des réponses concrètes et d’avenir », la puissance publique sous toutes ses formes – locale, nationale, européenne – devrait contribuer financièrement aux coûts techniques induits par l’activité associative – locaux d’accueil, moyens de transport, équipements technologiques – à la mesure de ce que lui coûterait l’absence de notre activité sur tout le territoire. Notre comptabilité analytique, consultable
– et consultée, notamment par les conseillers de la Cour des comptes – en fait foi.
Autrement dit, nous ne demandons pas des moyens supplémentaires en soi : pour pouvoir exercer nos missions, nous demandons que la puissance publique finance ce qui est de son ressort. Nous l’invitons à ne pas faire des déductions fiscales dont bénéficient les donateurs une variable d’ajustement qui se substituerait à ce qu’elle doit elle-même financer. Nous connaissons la valeur du temps de travail des bénévoles, et nous ne le vendons pas selon une forme de marchandisation au rabais qui ferait de nous le sous-traitant masqué d’une puissance publique qui n’en peut mais. La considération de l’intérêt général, dont la puissance publique est le garant, suppose que celle-ci en mesure le prix sans se défausser. Cette mesure n’est pas seulement financière, et, surtout, ne saurait se limiter au court terme : elle doit inclure les conséquences de la désespérance et leur coût social, de la protection de l’enfance aux suicides d’adolescents, de l’incompréhension du chômage, qui touche des catégories toujours plus importantes de personnes de tous âges et de toutes compétences, à l’économie souterraine.
Le Secours populaire est une union d’associations implantées dans tout le territoire, avec près de 3 000 adresses physiques identifiables dans nos régions, départements, communes de toutes tailles. Nous sommes d’autant plus sensibles à l’idée de « rayonne[ment] dans la vie locale et citoyenne » et de « confort[ation] du tissu social » que notre organisation décentralisée, forte de plus de 80 000 animateurs collecteurs, donne à chacune et à chacun sur le territoire la capacité d’agir, seul ou à plusieurs, pour empêcher la progression de la pauvreté, de la misère et de l’exclusion en recherchant par la collecte populaire les moyens matériels d’aider à faire face.
De même, nous savons – mais sans doute ne le faisons-nous pas assez savoir – que l’activité même du Secours populaire sert l’économie locale, au travers de nos achats de produits et services, comme de ceux des populations que nous soutenons, lesquelles sont pauvres, voire très pauvres, mais pas strictement démunies de toute ressource. Nous certifions que ce type d’activité n’est pas délocalisable. En outre, le soutien alimentaire à plus de 2 millions de personnes dans notre pays est indissociable de l’activité du secteur agro-alimentaire et de celui du transport, qui assure les livraisons. Ce soutien permet aussi aux familles de payer leur loyer, ce qui contribue à l’équilibre des budgets des bailleurs sociaux territoriaux. Nous sommes là au cœur du tissu social.
Certes, tout cela est difficile à quantifier, d’autant qu’il convient d’y ajouter l’investissement sur l’avenir, grâce auquel les personnes touchées par la précarité peuvent retrouver leur dignité et sortir durablement de la situation dans laquelle elles se trouvent à un instant de leur vie. On sait qu’en permettant aux personnes en difficulté de rechercher de l’argent et de s’investir pour tel ou tel objectif qu’elles font leur, en France, en Europe et dans le monde, on leur rend confiance en elles et le goût d’agir et de peser sur les conséquences des drames. Ce travail invisible, aujourd’hui non mesuré, concourt à long terme à leur dignité, et le tissu social en est enrichi.
Enfin, par le mouvement Copain du monde que nous développons en France, en Europe et dans le monde, nous contribuons directement à ce que les enfants d’aujourd’hui deviennent les citoyens de demain. En même temps, nous rendons l’espoir à leurs parents, à leurs frères et sœurs, nous combattons tous les obscurantismes, d’où qu’ils viennent, et nous exerçons notre mission d’éducation populaire. Nous permettons aux enfants de France de rencontrer des enfants d’autres pays du monde et de découvrir ainsi que les conditions de vie sont partout différentes mais qu’il est possible d’agir pour les améliorer. Nous souhaitons que la puissance publique fasse de même, sans plus envisager de chercher à diminuer les déductions fiscales des donateurs qui ont choisi, par leurs dons, de favoriser l’avenir, dans notre pays comme sur tous les continents.
M. Jean-Pierre Caillibot, délégué général adjoint des Petits Frères des pauvres. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, merci de nous permettre de faire ici état de notre grande préoccupation.
Fondée en 1946, l’association Les Petits Frères des pauvres compte aujourd’hui 10 000 bénévoles, qui accompagnent 10 000 personnes de plus de cinquante ans en situation d’isolement, de précarité et de pauvreté. Elle dispose d’une trentaine de maisons d’accueil, d’hébergement et de vacances. Son budget s’élève à 50 millions d’euros, dont 80 % proviennent de dons et de legs.
J’aimerais vous soumettre trois propositions destinées à soutenir les organisations, à revitaliser l’engagement associatif des citoyens et à remédier à une évolution de la réglementation qui est trop rapide pour nos bénévoles.
Je soulignerai au préalable qu’une association se caractérise par une double dimension : d’une part, sa raison d’être et l’intérêt de ceux qu’elle accompagne ; d’autre part, son pouvoir de mobilisation de nos concitoyens autour du bénévolat. Or on s’intéresse souvent au premier aspect – notre action et nos publics – au détriment du second, c’est-à-dire du bénéfice sociétal propre à la dynamique que nous créons. Il faut le rendre plus visible.
Le projet associatif a sa spécificité. Souvent, on met à notre disposition des outils qui ne sont pas adaptés à notre secteur. Ainsi, l’obligation que l’on nous impose d’instaurer des dispositifs de contrôle ou d’évaluation des prestations issus du secteur entrepreneurial témoigne d’un décalage qui masque l’essentiel : le lien social que nous sommes en mesure de tisser. C’est à nous d’y travailler, mais les pouvoirs publics peuvent nous y aider. Voici comment.
Tout d’abord, il est exact que nous sommes confrontés aujourd’hui, par obligation légale, à des questions touchant au contrôle interne, aux systèmes d’information, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aux risques psychosociaux, à la gestion du patrimoine, qui ne sont pas au cœur de nos projets initiaux. Voici donc ma première proposition : si la puissance publique pouvait intervenir, soit directement auprès des acteurs associatifs, soit auprès des fédérations censées nous soutenir, afin de nous venir en aide dans ces domaines, cela nous permettrait de consacrer les fonds dont nous disposons à notre action plutôt qu’à ces thématiques extrêmement technocratiques qui nous posent de graves problèmes. Car nous consacrons des sommes significatives à ces dispositifs, certes nécessaires – nous devons être visibles –, mais nous le faisons au détriment de notre action et des publics qu’elle vise.
La complexité parfois insupportable des aides européennes, des dossiers administratifs émanant non seulement de l’État, mais de chaque département – sans vouloir le moins du monde remettre en cause la décentralisation –, peut aller jusqu’à empêcher l’action de nos concitoyens comme de nos organisations. Le formulaire CERFA pourrait par exemple valoir pour l’ensemble des départements. Nous pourrions citer maints exemples de nos difficultés à obtenir des financements du fait de la diversité des politiques menées dans chaque département.
Notre deuxième proposition tend à revitaliser l’engagement associatif des citoyens. Je l’ai dit, en mobilisant des millions de citoyens, les associations contribuent très fortement au lien social. En rendant le secteur plus visible dans les médias, comme le suggère le Secours catholique, on incitera un plus grand nombre de nos concitoyens à le rejoindre. Il faut un engagement qui passe par une promotion grand public, laquelle pourrait, comme les campagnes de prévention, être soutenue par les pouvoirs publics. MONALISA, acronyme de Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées, nous montre l’exemple, celui de l’engagement citoyen de la société civile comme celui du soutien apporté par la puissance publique.
S’agissant de l’évolution trop rapide de la réglementation, nous avons formulé plusieurs propositions dans le cadre du projet de réforme de l’administration, car les choses sont extrêmement complexes pour tous les acteurs du monde associatif. Il faut évidemment développer la formation, mais les bénévoles qui accompagnent les personnes en grande précarité, comme ces personnes elles-mêmes, doivent pouvoir se repérer dans cette jungle. L’accès au droit est très compliqué, ce qui est inacceptable. Un exemple : la réforme des retraites a manifestement été mal intégrée par les organismes sociaux que sont la Caisse nationale d’allocations familiales et la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de sorte qu’un nombre croissant de personnes qui ne touchent plus l’allocation d’adulte handicapé ou le revenu de solidarité active en raison de leur âge se retrouvent sans ressources pendant une durée parfois insupportable. Bref, un travail colossal de simplification administrative et de cohérence entre acteurs publics reste à accomplir.
Enfin, le modèle entrepreneurial des appels à projets n’est pas adapté à la créativité et à l’innovation. Il nous empêche de prendre des risques, ce que nous devrions au contraire pouvoir faire, non pas seuls, mais avec nos partenaires, avec les différentes institutions que sont l’État et les collectivités territoriales.
M. Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Monsieur le président, merci de nous avoir conviés à cette table ronde bien que, comme vous l’avez dit, la Fondation Abbé Pierre s’y distingue par son statut. En politique – tel sera, en effet, le registre de mon intervention –, les vérités sont éphémères, de sorte que, si j’ai juré de dire la vérité, il ne peut s’agir que de la vérité d’aujourd’hui.
La mission de la Fondation Abbé Pierre est triple. D’abord, nous interpellons les pouvoirs publics et la population à propos des problèmes de logement en France, par notre rapport annuel sur l’état du mal-logement en France, nos communiqués de presse, nos auditions régulières à l’Assemblée nationale et au Sénat sur des projets ou des propositions de loi. Ensuite, nous aidons les associations locales, confrontées aujourd’hui à de grandes difficultés, à monter des projets pour lutter contre le sans-abrisme, le mal-logement ou l’isolement qui résulte d’un habitat dégradé ou absent. L’année dernière, nous avons ainsi appuyé plus de 676 projets. Enfin, nous développons l’innovation, spécificité du secteur associatif aujourd’hui menacée, comme vient de le souligner mon collègue.
Revenons sur quelques éléments de contexte. Le désengagement des pouvoirs publics – qui s’explique notamment, mais pas uniquement, par des raisons économiques connues de tous – est extrêmement problématique pour les associations, qui ne peuvent s’appuyer que sur les financements publics et sur la générosité de nos concitoyens. Ce recul de l’intervention publique survient alors même que la demande augmente avec la paupérisation et la fragilisation des ménages, depuis 2008 surtout, comme vous le confirmera le président des Restos du cœur. Cet effet de ciseau est très préoccupant. Comment pouvons-nous répondre à ces besoins croissants alors que le soutien financier des donateurs se maintient dans la plupart des cas mais n’augmente pas à due proportion, et que celui des pouvoirs publics diminue nettement ?
Deuxième constat : la dérive de la logique des appels d’offres. On a confondu la nécessaire professionnalisation du monde associatif, dans laquelle nous nous sommes d’ailleurs engagés, et la reprise des règles du marché libéral. Celle-ci est une erreur, car l’action associative en général n’est pas née de l’initiative des pouvoirs publics en vue de résoudre un problème : ce sont les associations qui, confrontées à ce problème sur le terrain, ont expérimenté des solutions qu’elles ont ensuite pu proposer aux pouvoirs publics. En l’oubliant, on renonce à l’esprit de création, d’innovation et à la capacité d’adaptation des réponses aux besoins rencontrés. Car, lors d’un appel d’offres, c’est au contraire l’administration qui, pour résoudre un problème, définit un cahier des charges et instaure une mise en concurrence. Or, sans être opposées à la concurrence, les associations sont aujourd’hui en quête de cohérence afin d’élaborer des solutions communes, ainsi qu’en témoigne le nombre de collectifs associatifs qui se créent, à rebours de l’époque, il y a trente ou quarante ans, où chacune se cantonnait à son public cible.
Le troisième phénomène à prendre en considération est la massification de la pauvreté, dont vous êtes tous conscients, mais aussi de la fragilisation, que la population ne mesure pas suffisamment. Actuellement, huit emplois sur dix proposés sur le marché sont atypiques
– contrat à durée déterminée, emploi à temps partiel, intérim, stages, emploi en alternance –, mais le monde du logement ne s’est pas adapté à cette situation, les bailleurs continuant d’exiger trois fiches de paie, des ressources au moins équivalentes à trois fois le montant du loyer et des contrats à durée indéterminée. Bref, des pans entiers de notre économie sont en décalage par rapport à l’évolution économique et sociologique du pays.
J’insisterai particulièrement sur quelques-unes des propositions déjà formulées. D’abord, la fiscalité des dons. Ce n’est pas la première fois que Bercy essaie de nous faire croire que le don fait partie des niches fiscales, qu’il souhaite limiter comme les précédents gouvernements. C’est absurde ! Comment peut-on mettre un investissement immobilier sur le même plan que le don à des associations qui se consacrent à la solidarité en matière alimentaire, vestimentaire, immobilière ou sociale ?
S’agissant de la foncière, dans un pays où il manque 500 000 à 900 000 logements mais dont le Gouvernement ne vise en la matière que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures – abstraction faite du logement social, qui ne suffit pas –, il est nécessaire d’aider nos organisations à chercher des solutions pour les personnes très défavorisées, modestes, ou les personnes âgées qui ont très peu de ressources. Dans ce domaine, la Fondation Abbé Pierre a le même projet que le Secours catholique, un peu plus avancé – mais, là encore, nous sommes complémentaires et non pas concurrents.
Enfin, c’est un peu bêtement que l’on a abandonné purement et simplement le service militaire, que je ne regrette pas en tant que tel, mais dont les vertus de brassage social étaient indéniables. Il aurait pu être très avantageusement remplacé par un service civil destiné à une bonne partie de la population. Pour les jeunes, être confrontés au sein de nos associations à un public qui n’a pas eu la chance de jouir d’un milieu social protecteur constituerait un moyen extraordinaire de comprendre ce qu’est la vraie vie, l’esprit de solidarité, et de mesurer ce qu’ils peuvent apporter à la société au-delà de leur réussite individuelle, que l’éducation nationale et le monde de l’entreprise se chargent bien assez de promouvoir.
Nous ne sommes ni des quémandeurs ni des pleureurs. La population nous sollicite, les pouvoirs publics nous adoubent en nous félicitant de ce que nous faisons, mais ce genre de compliments ne nous intéresse guère. Ce que nous voulons, c’est qu’ils préservent nos statuts ainsi que notre capacité d’innovation et de soutien aux plus fragiles de nos concitoyens, dans un contexte socio-économique extrêmement difficile qui ne va pas s’améliorer dans l’immédiat. Je l’ai appris sur les bancs de l’école, c’est l’honneur de la République que de s’occuper des plus faibles. Dans cette mission, les pouvoirs publics ne peuvent se défausser sur le secteur associatif ; ils peuvent s’appuyer sur nous, nous aider, mais ils ne sauraient se désengager.
M. Olivier Berthe, président des Restos du cœur. Beaucoup de choses ont été dites ; j’apporterai quelques compléments.
Les Restos du cœur sont bien connus : nous avons accueilli plus d’un million de personnes l’an dernier et servi plus de 130 millions de repas grâce à nos 67 500 bénévoles. Mais nos actions vont bien au-delà de la seule aide alimentaire : nos 110 points d’accueil, nos maraudes, nous permettent par exemple d’établir 40 000 contacts hebdomadaires avec les gens qui vivent dans la rue. Nous employons 1 700 personnes en contrats aidés, et nous logeons 1 800 personnes. Nous sommes la deuxième association pour l’aide au départ en vacances ; nous réalisons de l’accompagnement scolaire, nous facilitons l’accès à la justice…
Comme l’a souligné le rapport de Mme Marie-George Buffet, ces actions associatives renforcent le tissu social. J’insisterai moi aussi sur le fait qu’il faut s’intéresser à la qualité plutôt qu’à la quantité : les associations, ce sont des millions de contacts humains dans l’année, désintéressés, hors de toute hiérarchie sociale. Nous parlons à des populations que personne d’autre ne connaît, a fortiori n’aide.
Mais des menaces pèsent sur notre secteur. L’effet ciseaux que nous subissons a déjà été mentionné. Les besoins augmentent : les Restos du cœur aidaient 800 000 personnes il y a cinq ans, nous en sommes à un million aujourd’hui. Notre budget alimentaire est passé de 96 à 121 millions d’euros, notre budget non alimentaire de 28 à 40 millions. Dans le même temps, les aides publiques n’ont cru que de 100 000 euros, c’est-à-dire qu’elles ont en proportion diminué de 7 %. Or l’afflux vers nos associations ne va pas s’arrêter demain. Le chômage augmente, et nous savons que c’est souvent dix-huit à vingt-quatre mois après avoir perdu leur emploi que les gens se tournent vers nous : mécaniquement, nous devrons donc accueillir plus de personnes pendant au moins deux ans ; la reprise, si jamais elle survient, ne touchera pas d’abord ces populations fragilisées.
Pendant le même temps, nos moyens diminuent : les aides publiques se stabilisent ou même baissent, je l’ai dit ; il est aussi de plus en plus difficile d’obtenir la mise à disposition gratuite de locaux ou des aides au transport. Quant aux dons, ils sont stables – au mieux, car la crise touche aussi les donateurs.
Le bénévolat augmente, mais le bénévolat de compétences diminue : le travail des associations devient de plus en plus complexe, et certains jettent l’éponge. Les bénévoles cherchent le contact humain, beaucoup ne souhaitent pas exercer de responsabilités administratives.
Cette question de la complexité croissante touche toutes nos actions. Au niveau européen, un nouveau fonds d’aide aux plus démunis a certes été créé ; mais son règlement est très complexe, et même si difficile à mettre au point que rien n’est encore arrivé dans nos entrepôts ! Dans tous les domaines, la législation est de plus en plus compliquée : c’est le cas des règlements sanitaires, de la réforme en cours de l’IAE… La loi sur l’accessibilité des bâtiments nous obligera à réaliser d’importants travaux, mais nos budgets n’y suffiront pas.
Enfin, nous sommes menacés par le manque de confiance. Les lois ne cessent de changer, et on ne cesse de nous demander de rendre plus de comptes : nous estimons normal de rendre des comptes, mais a posteriori ! Les discours que l’on entend parfois sur l’assistanat, sur les contrôles renforcés, tout comme les effets d’annonces de certains responsables risquent de faire perdre confiance dans les associations. Si les donateurs privés, si les collectivités territoriales perdent confiance dans notre action, la diminution des dons et des aides s’accélérera.
Voici donc quelques suggestions. Tout d’abord, l’aide alimentaire ne doit pas être comprise comme une simple aide d’urgence, mais comme une action qui contribue pleinement à l’inclusion sociale. Nous regrettons que la question de l’aide alimentaire n’ait pas été intégrée au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : il faudrait l’y réintroduire. Il faudrait également consolider les ressources existantes, et notamment maintenir les aides logistiques des collectivités territoriales ; il nous semblerait souhaitable que les aides publiques soient proportionnelles aux besoins. Imagine-t-on de réduire la masse salariale en fonction de l’évolution du budget d’une collectivité ? Il serait également judicieux de diversifier les ressources, par exemple en luttant contre le gaspillage et en développant les dons en nature. Je souligne d’ailleurs que nous négocions depuis dix-huit mois des moyens de faciliter les dons agricoles, mais que, malgré notre travail et un début de mise en œuvre de dons de produits laitiers, nous n’avons pas encore abouti. Il est grand temps que les choses s’accélèrent.
Il faudrait entretenir la confiance et réduire la complexité administrative. Enfin, cela a été dit, il faut continuer à encourager l’expérimentation. C’est bien de la diversité et de l’innovation que le monde associatif tire sa force ; c’est ce qui permet à l’action des associations d’être complémentaire de celle des pouvoirs publics, même si la première a aujourd’hui tendance à se substituer à la seconde… Si nous perdons la capacité d’expérimenter, alors nous risquons à très court terme de voir des associations réduire leur activité, voire disparaître. Des populations entières n’auront alors plus d’interlocuteurs, et des territoires entiers seront désertés ; nous risquerons aussi une chute vertigineuse du bénévolat, car les bonnes volontés se décourageront, et une chute des dons. C’est une spirale très dangereuse, car on risque alors de voir apparaître d’autres acteurs, et d’autres activités, officielles ou non.
J’ai juré de dire toute la vérité, la voici : le tissu social, aujourd’hui, est abîmé. Un tissu élimé dans les coins, on n’y prête pas attention ; puis il se déchire pour de bon et finit par tomber en lambeaux à la moindre bourrasque. On nous dit alarmistes, on nous dit que nous avons toujours trouvé des solutions. Mais aujourd’hui, je n’exclus plus que, dans les mois qui viennent, nous en arrivions à des situations vraiment graves.
M. Pierre-Yves Madignier, président du mouvement ATD Quart Monde. ATD Quart Monde a été créé par des personnes très pauvres pour détruire la misère. Notre mouvement est resté fidèle à cette idée : toutes nos actions sont construites par des personnes très pauvres pour des personnes très pauvres.
Nous sommes en accord avec ce qui a déjà été dit et partageons les inquiétudes qui ont été exprimées.
Nous sommes aux côtés de ces gens que vous croisez tous les jours, mais qui doivent parfois vous paraître bien étranges. On voudrait les aider, on ne sait pas comment faire. Le projet du père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, était bien de rejoindre les plus pauvres. Celui qui va au fin fond d’un département très rural pour rencontrer les plus pauvres et leur permettre de cheminer vers la citoyenneté a chez nous autant d’importance que le délégué général.
Nous parlons donc d’un endroit très précis, et cette parole est peut-être comme le zéro que l’on rajoute parfois après certains chiffres : nous espérons que nos mots donneront du poids à ceux de nos amis ici présents. Les plus pauvres, ce sont ceux qui ont raté tous les trains, ceux que Marx appelait le « sous-prolétariat »… Il faut les écouter, car ils savent des choses que personne d’autre ne sait. Ils savent, par exemple, qu’avec les minima sociaux on ne peut pas accéder au logement social.
Il a été question de service civique, et alors on pense souvent à des jeunes gens riches qui pourraient aider les pauvres. Mais là aussi, il faut écouter les personnes très pauvres, rejetées de tous, car elles veulent aussi pouvoir donner quelque chose à la société et construire un projet citoyen. Ce sont des personnes qui doivent briser l’enfermement, échapper à la honte. Elles ne sont pas reconnues et souvent ne se reconnaissent pas elles-mêmes. L’un de nos rôles doit être de combattre les idées reçues.
Lors de l’université populaire d’ATD Quart Monde, à Lyon, en 2012, l’un de nos militants avait découvert qu’il contribuait financièrement au fonctionnement de la République – il ne payait bien sûr pas l’impôt sur le revenu, mais il payait la TVA. Il en était très fier. Les plus pauvres ne connaissent pas la Constitution. Ils ne connaissent pas l’article 40… Mais ils placent beaucoup d’espoir dans la société et dans ses élus. Cet espoir, vous le prenez parfois en pleine tronche, dans vos permanences, parce que celui qui espère peut être maladroit, voire agressif – mais il ne faut pas s’y tromper : c’est de l’espoir. Je me souviens d’une femme qui, à cette même université populaire, s’était levée pour raconter sa vie, une histoire de vie vraiment difficile ; et elle a ajouté : « j’étais vraiment dans la m*** : j’ai écrit au Président de la République, et il m’a répondu ! »
L’action des associations est citoyenne. Aujourd’hui, j’y insiste, beaucoup de grandes administrations ne savent pas comment les dispositifs que vous avez votés sont mis en œuvre. Les gens qui savent, à l’inverse, ne sont pas toujours organisés pour le dire – je le dis souvent aux présidents d’associations.
Je me retrouve entièrement dans ce qui a été dit, en particulier sur la nécessité de laisser les associations innover au lieu de les enfermer dans des appels à projets. Ceux-ci sont conçus par des gens très intelligents, mais qui ne sont pas au cœur de la réalité ! Les propos de mes collègues sont de l’or pour vous, décideurs : les associations doivent être entendues.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. J’ai été, dans une première vie professionnelle, assistante sociale, puis responsable d’un service de protection de l’enfance : je n’en mesure que mieux l’impressionnante responsabilité qui nous incombe. Nous devons vous entendre. Vous nous rappelez combien il est important d’avoir foi en l’homme et en l’humanité.
Pourriez-vous évoquer plus longuement l’esprit associatif qui vous anime ? Nous ne devons jamais perdre de vue le sens de nos actions : pourquoi est-on bénévole, pourquoi s’engage-t-on dans la vie associative ?
Vous avez également peu évoqué la question du territoire. Avez-vous imaginé des outils spécifiques pour adapter vos actions à la réalité de chaque territoire ? Ne faut-il pas inventer un nouveau maillage des territoires ? Nous devrions, je crois, aller vers une plus grande complémentarité des associations et éviter des redondances.
J’entends bien sûr vos propos sur les appels à projets : il faut en effet toujours replacer l’homme au centre de chaque action.
Mme Isabelle Le Callennec. Merci de vos interventions : ce que vous dites, en effet, nous l’entendons aussi dans nos circonscriptions, puisque nous fréquentons beaucoup les responsables locaux de vos associations.
Madame Delamoye, quels sont les besoins émergents dont vous parlez ?
Lors de la discussion de la loi ESS, il a beaucoup été question de simplification, et il est prévu qu’une mission soit confiée à Yves Blein, son rapporteur, sur ce thème. Quels sont vos interlocuteurs sur ces sujets ? Vos propositions sont-elles suivies d’effet ? Vous le savez, les auditions sont fréquentes et les rapports nombreux, qui aboutissent souvent aux mêmes conclusions : où sont les freins ?
J’apprécie énormément l’expression d’appel à idées. Il faut opérer cette véritable révolution culturelle. Manifestement, avec les appels à projets, nous sommes sur une très mauvaise pente : il faut agir tout de suite pour stopper ce mouvement.
S’agissant de la générosité privée, les pistes que vous proposez sont intéressantes. Il va de soi que ces dons ne doivent pas être considérés comme une niche fiscale.
Enfin, sur les dons agricoles par exemple, vous mentionnez des blocages : quels sont-ils ?
M. Jean-Louis Bricout. Je vous remercie, moi aussi, de vos interventions : vous décrivez en effet la réalité que nous rencontrons dans nos circonscriptions.
La loi ESS a étendu le statut de volontaire associatif. Cette mesure est-elle déjà efficace ? Prévoyez-vous de communiquer sur ce point ? Lors des débats sur cette loi, il a été longuement question de la pré-majorité associative : quelle est votre position sur ce sujet ?
Quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales ? Dans les zones rurales, plusieurs associations interviennent souvent simultanément : avez-vous mis en place des échanges de fichiers, des partages d’informations ?
Je suis très sensible à l’action d’Emmaüs dans le domaine de l’économie circulaire. C’est un gisement de croissance important, et les associations ont un rôle à jouer. Avez-vous noué des partenariats avec d’autres associations spécialisées ?
M. Frédéric Reiss. Vous nous avez fait une démonstration magistrale de ce que peut être l’engagement citoyen. Et nous avons bien entendu votre plaidoyer contre l’alourdissement de vos charges administratives.
Remarquez-vous des changements dans les territoires, notamment avec la montée en puissance des intercommunalités ? De nombreuses initiatives existent, notamment les épiceries sociales : fonctionnent-elles bien, selon vous ?
Le service civique ne dure aujourd’hui souvent que sept à huit mois, et même parfois moins. Cela représente-t-il un problème pour vous ? Les contrats d’avenir vous ont-ils rendu service ?
Vous soulignez l’importance pour vous de la générosité privée : la recherche de donateurs constitue-t-elle pour vous une grosse charge de travail ?
Mme Bernadette Laclais. Merci de vos interventions, précises et techniques, mais qui n’oubliaient pas la question des valeurs et des symboles.
Sur la baisse des moyens mis à votre disposition par les collectivités territoriales, disposez-vous de chiffres qui permettraient d’évaluer l’ampleur du phénomène ?
Vous avez peu évoqué les relations entre les associations, comme vos relations avec les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les services sociaux en général. Est-ce parce que tout se passe bien ? Quelles difficultés rencontrez-vous, si vous en rencontrez ?
La question de la simplification vous semble-t-elle pouvoir être traitée à l’échelle des associations, ou bien devrait-elle être intégrée à un plan plus vaste de lutte contre la pauvreté ?
M. Régis Juanico. Je vous remercie pour la grande qualité de cette table ronde. Nous devons vous entendre, et entendre vos inquiétudes, pour vous aider concrètement. Ensemble, nous pouvons gagner, comme l’a montré votre combat exemplaire sur le programme européen d’aide aux plus démunis.
Le modèle de l’appel à la générosité publique pour financer les associations doit absolument être préservé. Nous avons jusqu’ici réussi à faire échec aux tentatives de Bercy de remettre en cause les réductions d’impôt liées aux dons : nous continuerons. Je rappelle que cette dépense fiscale s’élève à 2 milliards d’euros chaque année.
Quant au seuil de lucrativité, nous avons présenté des amendements lors du récent collectif budgétaire : adoptés en commission, ils ont été refusés en séance publique par Bercy. Nous recommencerons en 2015 !
Vous parlez de la loi ESS et des craintes qu’elle suscite. Si je puis me permettre cette citation papale, n’ayez pas peur ! (Sourires.) Vous êtes 2 millions d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, et l’étude d’impact estime – certes de façon approximative – à 5 000 le nombre d’entreprises prêtes à aller vers votre secteur. Les critères sont très restrictifs : c’est donc un modèle économique qui restera très particulier. Je crois plutôt que vos valeurs contamineront le modèle économique classique des entreprises !
Cette loi ESS comportait de nombreuses mesures destinées à aider les associations. Elles sont perfectibles, et vous pouvez nous y aider. Mais la loi vise notamment, je le souligne, à renverser la tendance qui voit les commandes publiques et les appels à projets prendre le pas sur les subventions.
Le service militaire n’était plus, en 2011, un lieu de brassage social – le brassage social, c’est l’Éducation nationale qui s’en charge aujourd’hui ! Pour nous, l’essentiel est de favoriser l’engagement des jeunes, notamment grâce au service civique.
Enfin, s’agissant du versement transport, je sais qu’il existe des inquiétudes. Des mesures ont été votées, à l’initiative d’Yves Blein. Nous attendons un rapport du Gouvernement pour le mois d’octobre. Je veux, là encore, vous rassurer : nous souhaitons que les situations acquises ne soient pas remises en cause.
M. André Schneider. Je vous ai écoutés avec une très grande émotion. Ces personnes ont d’abord besoin de dignité, d’exister et d’être utiles, pour se reconstruire : c’est un message qu’il faut entendre.
Malheureusement, le rôle des responsables est de choisir. Quelles sont pour vous les priorités ?
M. Jean-René Marsac. Ancien responsable associatif moi-même, j’ai l’impression d’entendre ce que je disais il y a trente ans sur la complexité, sur la lourdeur des tâches administratives, sur le découragement des bénévoles ! Mais la situation, je crois, s’aggrave. Il faut une révolution culturelle des services de l’État, qui doivent travailler autrement avec le secteur associatif : la question de l’innovation n’est pas du tout prise en considération par les pouvoirs publics.
Il faudrait mieux former les hauts fonctionnaires, qui ne sont pas du tout préparés au dialogue avec le secteur associatif, qui ne sont pas prêts à accepter que des bénévoles associatifs représentent aussi l’intérêt général. Bien sûr, les administrateurs apprennent sur le tas, mais que d’énergie perdue ! C’est un problème de culture, de formation, peut-être d’organisation des services de l’État.
Enfin, on entend en Europe une petite musique nouvelle : l’entreprise sociale pourrait être, selon certains, un nouveau modèle économique ; entre l’État-providence en voie de disparition et le secteur associatif trop fragile, trop hésitant, elle construirait une économie pour les pauvres, mais selon des modèles strictement entrepreneuriaux et financiers. On peut s’en inquiéter.
M. Patrick Doutreligne. L’introduction du monde commercial dans les secteurs où nous intervenons est très préoccupante. Ainsi, les compagnies de distribution d’eau proposent parfois aux collectivités locales de prendre en charge – en plus de la distribution d’eau – les aires d’accueil des gens du voyage, secteur où l’on se précipite rarement pour intervenir, vous en conviendrez. Mais ensuite, la gestion de ces aires par ces entreprises privées est catastrophique ! Nous avons donc quelque raison de nous inquiéter.
De même, le secteur des aides à la personne, appelé à devenir très important avec le vieillissement de la population, attire des intervenants qui créent – dans les secteurs réservés au monde associatif – des associations que nous appelons Canada Dry : ce sont juridiquement des associations, mais elles n’ont pas de vrai projet associatif, social, humain. Nous avons constaté ce phénomène dans les centres de transit des demandeurs d’asile.
Les relations avec les CCAS peuvent bien sûr varier du tout au tout. Parfois, cela se passe extrêmement bien ; à certains endroits, nous participons même au conseil d’administration, ce qui est très positif. Mais, là aussi, nous nourrissons quelques inquiétudes : ainsi, de plus en plus souvent, les CCAS limitent, voire refusent, la domiciliation des personnes, qu’ils renvoient alors aux associations. À Marseille, par exemple, la situation est dramatique : plus de 1 200 personnes font appel à nous pour les domicilier. Les associations ne doivent pas être le dernier recours des pouvoirs publics quand ceux-ci ne jouent plus leur rôle !
Enfin, une réflexion sur le statut des bénévoles serait bienvenue. Il faudrait, en particulier, organiser leur protection vis-à-vis de Pôle Emploi : j’ai vu des gens radiés parce qu’ils prenaient des responsabilités associatives, ce qui est une dérive manifeste.
Mme Florence Delamoye. Le sens de notre engagement est pour nous d’une telle évidence que nous ne l’avons peut-être pas évoqué assez clairement. Nous sommes un rassemblement de personnes convaincues qu’un projet collectif peut être mené en adéquation avec l’intérêt commun. Les communautés Emmaüs, qui vivent de la collecte de dons et de la revente, sont un bon exemple d’un tel projet. Le compagnon en est un acteur majeur. Par son activité, il fait vivre la communauté, il la crée et lui permet de gagner une véritable reconnaissance. À bien y réfléchir, il est extraordinaire que nous parvenions à trouver les capacités de mener de tels projets collectifs à but non lucratif grâce à l’esprit associatif.
Les revenus générés sont destinés à faire vivre la communauté. Lorsque des recettes dépassent les besoins, les surplus alimentent la solidarité locale, régionale et internationale d’Emmaüs et servent par exemple à financer les prêts à taux zéro consentis par SOS Familles Emmaüs afin d’éviter le mal-endettement. Les acteurs qui s’investissent auprès d’Emmaüs sont donc des militants, et l’intérêt pécuniaire n’est pas la principale motivation de leur engagement. Cette caractéristique différencie le milieu associatif du secteur dit concurrentiel au sujet duquel vous avez voulu nous rassurer. J’avoue que mes craintes persistent, mais je suis prête à dialoguer sur cette question.
Le monde associatif joue un rôle de vigie. Il repère en amont les évolutions sociales. Si, dans un premier temps, nous sommes le plus souvent pris au dépourvu, dans un second temps, les associations tentent de répondre collectivement aux nouveaux besoins. Les familles monoparentales, les retraités pauvres, les jeunes en rupture familiale n’ayant jamais travaillé sont par exemple de plus en plus nombreux.
Il nous appartient de réagir en proposant des solutions innovantes. Nous l’avons fait en mettant en place le travail à l’heure, qui permet à des personnes qui se trouvent dans la rue de travailler une, deux, trois ou quatre heures. Le travail conjoint entre les maraudeurs et des chantiers d’insertion a donné de véritables résultats. De la même façon, l’accueil de personnes sortant de prison dans la ferme de Moyembrie, en Picardie, constitue un succès reconnu par les magistrats locaux. Les personnes accueillies peuvent reprendre une activité économique réelle au sein d’une AMAP, prendre le temps de construire un projet personnel et professionnel, et retrouver la réalité et l’autonomie. Dans tout le pays, Emmaüs France accueille aussi de très nombreuses personnes, parfois mineures, exécutant des travaux d’intérêt général (TIG) décidés par un tribunal. À notre avis – mais c’est aussi celui des magistrats –, cette alternative à l’incarcération est un outil formidable et constitue un moyen citoyen et efficace pour réinsérer un individu dans la société.
Concernant tous les publics que je viens d’évoquer, je note que les « besoins émergents » ne datent plus d’hier. Les années ont passé et aucune solution n’a pourtant encore été apportée à ces problèmes. L’expérimentation est nécessaire ; elle ne peut réussir sans confiance.
Emmaüs a disparu de la filière papier-carton, dans laquelle il jouait un rôle important il y a près de soixante ans. Nous savons donc parfaitement que rien n’est acquis, ce qui ne nous gêne pas. Nous considérons en revanche que la loi relative à l’économie sociale et solidaire peut faire courir des risques aux associations et aux coopératives. Les secteurs qu’elles investissent sont en général peu rentables : ce fut le cas des meubles ou du textile. Mais lorsque les filières en question commencent à rapporter de l’argent, les entrants affluent et nous ne nous sentons pas toujours assez protégés. Les verrous existent, nous avez-vous dit. Certes, mais à nos yeux, ils sont insuffisants. Prenez les écarts de salaires : dans les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, ils pourront aller de un à sept, alors qu’entre le plus bas et le plus haut salaire versé par Emmaüs, il n’y a qu’un facteur 2,86 – et, chez nous, il n’est pas question que cela change !
L’économie circulaire est pour nous fondamentale. Au travers du marché de seconde main et du recyclage, nous nous positionnons donc aussi sur une problématique environnementale essentielle.
Mme Hélène Beck. L’association avec les plus pauvres pour construire une société plus juste et fraternelle constitue le sens de la mission du Secours catholique.
Il nous semble nécessaire aujourd’hui de promouvoir dans la société civile la vie associative et l’engagement au nom de l’intérêt général. La formation de tous devrait permettre de comprendre ces enjeux. Pour notre part, nous voulons redonner une dignité à ceux que nous accueillons et les intégrer dans notre projet.
Nous avons proposé des mesures de simplification au sein du Haut Conseil à la vie associative. Le Secours catholique ressent en la matière un réel besoin, d’autant que la complexité administrative constitue une charge pour les équipes sur le terrain qui peut même les inciter à se désengager. En effet, les bénévoles qui viennent à nous pour offrir un lien social s’engagent rarement dans le but de remplir des bordereaux !
En matière de besoins émergents, nous souhaitons co-construire des réponses avec les pouvoirs publics. Nos associations peuvent à coup sûr faire des propositions différentes de celles qu’avancera le secteur entrepreneurial. Laissez-nous la possibilité d’élaborer des projets avec les personnes que nous accueillons et que nous connaissons ! Nous saurons apporter des solutions parfaitement adaptées au terrain, qui n’auront rien de théoriques.
Le Secours catholique est souvent présent au sein des centres communaux d’action sociale (CCAS). De façon générale, nous y travaillons correctement, en coordination avec d’autres associations.
Parmi les innovations sociales que nous avons expérimentées, il faut signaler que l’Association des cités du Secours catholique a désormais une expérience en matière de centre éducatif fermé. Il est essentiel que les jeunes concernés puissent connaître autre chose que la violence, et qu’ils quittent le circuit judiciaire dans lequel ils sont précocement entrés. Laissez-nous la possibilité de mener de telles actions et de mettre en œuvre les valeurs que nous défendons !
Les 65 000 bénévoles du Secours catholique s’occupent directement des personnes que nous accueillons. Leur présence permet de gommer les différences entre accueillants et accueillis. Elle permet de vivre ensemble le projet associatif et de créer des groupes de partage, des activités conviviales, des relations différentes, comme dans nos épiceries sociales et nos boutiques solidaires. Nous souhaitons aussi accueillir des jeunes volontaires qui ont une réelle facilité pour créer des liens d’amitiés et pour aider à la construction de projets. Avec eux, tous ensemble, nous voulons montrer le chemin d’une société plus fraternelle et solidaire.
Mme Henriette Steinberg. Nous n’avons aucun problème avec l’institution CCAS en tant que telle. Au quotidien, nous avons en revanche la surprise de recevoir fréquemment, dans nos permanences d’accueil, de solidarité et de relais santé, des personnes auxquelles une assistante sociale a délivré un ticket donnant « droit à » telle ou telle prestation alors qu’elle-même, apprenons-nous lorsque nous lui téléphonons, n’a pas pu agir faute de moyens. De même, il y a un problème lorsqu’un conseil d’administration de CCAS s’interroge non sur la façon dont il peut aider ceux qui en ont besoin, mais plutôt sur la meilleure façon de priver une famille d’une prestation au nom de prétendus abus ! Pour notre part, nous refusons de jouer ce jeu-là.
Certaines épiceries sociales sont parfois des courroies de transmission des municipalités. Lorsque ces épiceries rencontrent des difficultés, il est souvent fait appel au Secours populaire. Nous estimons qu’il s’agit d’un mélange des genres.
Les associations pourraient-elles se réunir pour délivrer une parole unique ? Nous estimons, pour notre part, qu’il est utile et efficace d’agir ensemble sur des sujets qui nous réunissent. Nous avons ainsi réussi à infléchir les positions de l’Union européenne concernant l’aide alimentaire – il s’agit d’ailleurs d’un succès remarquable qui devrait être bien mieux valorisé. En revanche, il n’aurait guère de sens que les associations se fondent en un organisme unique. Demande-t-on aux partis politiques ou aux députés de se fondre en un objet unique mal identifié ? Si nous sommes respectés en tant qu’associations, c’est parce que nous veillons à préserver notre indépendance. Et, si nous avons montré que nous savions converger dans une démarche commune et obtenir des résultats ensemble, nous ne pouvons être responsables que pour les seuls engagements que nous prenons, et nous ne pouvons pas nous engager pour les autres.
Une question parfois soulevée d’une façon que je qualifierai de subliminale a trait aux personnes en difficulté qui, aux dires de certains, émargeraient auprès de plusieurs associations. Je rappelle que le nombre total de repas délivrés annuellement par l’ensemble de nos associations ne correspond même pas à un repas quotidien pour chacune des personnes en grande difficulté, qui auraient pourtant droit à deux et même à trois repas par jour. Nous en sommes loin, et nous n’avons jamais entendu parler de quelqu’un qui serait mort d’indigestion pour avoir fréquenté à la fois les Restos du cœur et le Secours populaire ! L’idée qu’il nous faudrait nous réunir pour vérifier que personne ne vient manger deux fois est à la fois contraire à la réalité que nous constatons sur le terrain, et à l’opposé de nos pratiques qui consistent à accueillir ces personnes, à parler avec elles, et à créer un lien. Ceux qui imaginent que les abus constituent un véritable problème se trompent.
M. Jean-Pierre Caillibot. Les CCAS permettent de révéler des publics parfois invisibles, que nous ne connaissons pas. Ces acteurs sont donc importants et constituent le terroir de la mobilisation citoyenne.
Nos associations qui gèrent des lieux de vie et d’accueil sont soumises à des réglementations de plus en plus complexes en matière de sécurité et d’hygiène. Bientôt, nous ne serons même plus en mesure d’y faire cuire deux œufs sur le plat en y ajoutant un peu de gruyère ! Peu à peu se créent des structures aseptisées qui creusent des fossés infranchissables pour les personnes en difficulté qui veulent cheminer avec nous. Il faut absolument réintroduire de l’humain.
Les seniors jouent un rôle majeur dans l’engagement citoyen. Parce que l’on ne peut pas vraiment plaquer le modèle de l’entreprise sur le monde associatif, il serait toutefois utile d’instituer un espace d’acculturation pour les jeunes retraités. Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, en cours d’examen, devrait permettre de créer un service public senior qui pourrait constituer une solution cohérente.
M. Olivier Berthe. Je reprends à mon compte tout ce qui a été dit par Mme Steinberg concernant les collaborations locales. J’ajoute que l’on commence à voir certaines collectivités exiger que nous leur fournissions la liste des personnes que nous accueillons, et d’autres menacer de nous retirer des subventions si nous n’entrons pas dans le cadre qu’elles ont choisi. Cela va très loin ! Il faut veiller à ce que les élus locaux n’outrepassent pas leurs pouvoirs. La liste des personnes que nous accueillons n’a pas à leur être communiquée, même si elle peut faire l’objet d’échanges avec les travailleurs sociaux assermentés.
Madame Le Callennec, j’ai juré de dire la vérité : c’est Bercy qui bloque les dons agricoles. Et il ne s’agit pas des ministres. J’ai rencontré deux ministres des finances sur le sujet, M. Moscovici, puis M. Sapin : ils sont enthousiastes sur le sujet. Le ministre de l’agriculture, M. Le Foll, est sur la même longueur d’onde, et M. Ayrault, à l’époque Premier ministre, s’était prononcé il y a un an en faveur de cette idée. Le blocage ne vient donc pas du pouvoir politique mais d’une administration centrale qui considère que l’opération serait coûteuse. Certes, l’incitation fiscale que nous demandons – il en existe une pour les dons d’argent – pourrait coûter quelques millions, mais l’effet de levier serait considérable. Vous connaissez désormais l’un des freins qu’il faut desserrer pour que ce dossier avance plus rapidement.
Je vous soumets une idée concernant le bénévolat. Cet été, les médias ont largement évoqué la possibilité pour un salarié de donner du temps à un collègue – temps de congés et de RTT. Cela concernait l’aide aux personnes handicapées ou aux enfants malades, mais un tel outil pourrait aussi permettre d’éviter que le bénévolat n’attire que les retraités. Si nous ne facilitons pas l’accès des actifs au bénévolat, nous portons atteinte à la diversité du monde associatif, c’est-à-dire à sa capacité d’écoute et d’ouverture.
Parce que les fruits et les légumes produits dans la cinquantaine de jardins des Restos du cœur ne sont pas vendus mais donnés aux centres de distribution, des financeurs nous ont refusé leur aide au motif que, sans recettes, nous n’entrions pas dans leurs modèles. Pour trouver des financements, faut-il que nous vendions ce qui est produit dans nos propres jardins, et que nous achetions à d’autres ce dont nous avons besoin dans nos centres de distribution ? Il est absurde de vouloir faire entrer tout le monde dans le même moule.
Il est vrai que l’appel à la générosité publique génère des frais. La Cour des comptes est particulièrement vigilante et exigeante en la matière. Concernant les Restos du cœur, ces frais s’élèvent à 4 % des dons pour l’appel, la gestion, l’enregistrement du chèque et l’envoi du reçu fiscal. Ce chiffre très modéré montre l’efficacité du modèle associatif et doit susciter la confiance.
Monsieur le président, nous sommes tous allés à l’essentiel et, si vous le voulez bien, comme vous nous l’avez suggéré, nos sept associations compléteront leurs réponses par écrit.
M. le président Alain Bocquet. Bien volontiers ! Je vous suggère en particulier de nous présenter tous vos arguments concernant la marchandisation progressive de certaines activités. Pour ma part, je partage vos analyses, alors que je suis confronté localement à un cas concernant la gestion des aires destinées aux gens du voyage, activité qui peut devenir d’autant plus rentable que c’est la puissance publique qui paie.
N’hésitez pas à réfléchir et à inventer de nouvelles solutions ! La co-construction exigera éventuellement de modifier la loi ou les textes existants. La commission d’enquête pourra présenter des propositions en ce sens.
Peut-être pourriez-vous aussi décrire plus précisément, en donnant des exemples circonstanciés, les tracasseries administratives auxquelles vous êtes confrontés ?
Enfin, il me semblerait judicieux que vous apportiez quelques précisions concernant le statut du bénévole et du bénévolat dans le secteur spécifique qui est le vôtre, car les associations sportives ou culturelles n’auront pas nécessairement la même approche.
Mesdames, messieurs, nous vous remercions vivement. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir reçus.
Audition de Mme Fabienne Rosenwald, directrice des statistiques d’entreprises de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), accompagnée de M. Julien Deroyon, administrateur de l’INSEE ; et de M. Gilles Caillaud, président de Fédération ASSO 1901
(séance du 9 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Nous recevons aujourd’hui Mme Fabienne Rosenwald, directrice des statistiques d’entreprises de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), accompagnée de M. Julien Deroyon, administrateur de l’INSEE, et M. Gilles Caillaud, président de Fédération Asso 1901.
Chacun dans son registre, chacun avec ses méthodes et ses moyens, l’INSEE et Fédération Asso 1901 œuvrent à une meilleure connaissance du monde associatif, pour notre plus grand bénéfice, à nous législateurs et acteurs dans nos collectivités locales. Les travaux de l’INSEE sur les associations s’inscrivent dans le cadre de la mission générale qui lui est confiée. Ceux de Fédération Asso 1901 visent plus spécifiquement à constituer un annuaire national permettant de rechercher et d’identifier gratuitement des associations et, ainsi, d’entrer en contact facilement avec ce monde des plus divers – travail qui est déjà en lui-même un acte militant.
C’est donc à la fois sur les moyens permettant de connaître le monde associatif et sur la vision de ce secteur qui peut se dégager de votre travail que nous souhaitons vous entendre, madame, monsieur.
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Fabienne Rosenwald et M. Gilles Caillaud prêtent serment)
Mme Fabienne Rosenwald, directrice des statistiques d’entreprises de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’INSEE publie chaque année un état de l’économie sociale et solidaire par grandes familles – les associations en sont une, à côté des coopératives, des mutuelles et des fondations. Ces données portent sur l’emploi et sur la masse salariale et sont déclinées par région, par grande famille et par secteur d’activité. Elles permettent donc d’évaluer le poids des associations et de l’économie sociale et solidaire dans l’ensemble de l’économie. Les dernières, publiées en juin et accessibles sur notre site, portent sur l’année 2012.
À cette date, nous avons estimé, dans cet état des lieux, le nombre d’emplois salariés dans les associations à quelque 1,8 million, ce qui représente 8 % de l’effectif salarié et correspond à 6 % des rémunérations. Cela étant, dans certains secteurs, le poids de l’effectif salarié associatif rapporté à l’effectif salarié total dépasse amplement cette proportion de 8 % : sa part atteint 58 % dans le secteur de l’action sociale et 40 % dans celui des arts, spectacles et activités récréatives.
Nous publions régulièrement des INSEE Première, études de quatre pages seulement dont la finalité est de faire le point sur les données afin de décrire des mouvements de fond.
Par ailleurs, dans le répertoire SIRENE – pour « Système informatique pour le répertoire des entreprises et de leurs établissements » – géré par l’INSEE, sont immatriculées les associations régies par le code du commerce, c’est-à-dire l’ensemble des associations employeuses, et, par dérogation, celles qui reçoivent des subventions. Environ 800 000 d’entre elles y sont inscrites, beaucoup moins que dans le Répertoire national des associations (RNA), qui en répertorie deux millions au total, dont un million depuis 2007 dans une base un peu plus active.
Chaque année, l’INSEE assure un suivi des associations dans les comptes nationaux, qui distinguent plusieurs secteurs institutionnels, dont les sociétés non financières, les administrations publiques (APU) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLM), au rang desquelles sont classés les trois quarts des associations. On dénombre actuellement quelque 150 000 associations employeuses, versant une masse salariale de 40 milliards d’euros.
En outre, l’INSEE réalise régulièrement des enquêtes auprès des ménages, interrogés sur leur participation aux associations en distinguant entre adhésion, bénévolat, salariat…
– les questions sont examinées dans le cadre d’un comité d’utilisateurs très élargi. Une enquête a été réalisée en 2002, une autre en 2010 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), laquelle a estimé le nombre d’adhérents à 16 millions, celui des adhésions à 21 millions – une personne peut adhérer à plusieurs associations – et le nombre de bénévoles à 8 millions.
À la demande du Conseil national de l’information statistique (CNIS), où siègent des représentants du Parlement et des syndicats professionnels, l’INSEE a été chargé de réaliser une enquête directement auprès des associations. Il s’agit là d’une grande nouveauté, aucune enquête de la statistique publique de cette sorte n’ayant été conduite jusqu’à présent. Il existe, certes, une enquête réalisée par le Centre d’économie de la Sorbonne auprès des mairies, mais les informations ainsi recueillies sont probablement peu exhaustives dans la mesure où les mairies ne font état que des associations qu’elles connaissent comme telles.
Cette nouvelle enquête est très importante car elle dressera un état des lieux à la fois des recettes et des dépenses des associations. Pour ce faire, l’INSEE s’appuiera à la fois sur SIRENE et le RNA et interrogera aussi bien les associations employeuses que les autres. Les questions porteront donc sur les ressources humaines – salariés, volontaires, bénévoles –, et financières – dons, cotisations, mécénat, financements publics –, mais aussi sur les dépenses, notamment les salaires, sur le domaine d’activité, qui sera défini de manière beaucoup plus fine que ne le font actuellement les répertoires, et sur le rayon d’intervention de l’association.
Nous demanderons également aux associations d’évaluer l’évolution – hausse, stabilité ou baisse – au cours des trois dernières années de leur volume d’activité, de leur volume de travail, de leurs ressources, de la part des dons et des financements. Enfin, nous les interrogerons sur leur degré d’exposition à une liste de difficultés, par exemple quant à la fidélisation des bénévoles ou à la mobilisation de nouveaux bénévoles.
Comme toutes les enquêtes INSEE, celle-ci sera réalisée en lien avec un comité d’utilisateurs, représentatif de l’ensemble des acteurs sociaux intéressés. L’étude auprès des associations employeuses sera beaucoup plus fournie – elle sera longue de huit pages – que celle qui sera menée auprès des non employeuses. Cependant, cette dernière sera plus difficile à réaliser, car les associations concernées sont peu habituées aux enquêtes et un grand nombre sont répertoriées « NPAI » (« n’habite pas à l’adresse indiquée ») sans qu’on sache si elles ont cessé leur activité, ce que repère mal le RNA, ou si leur adresse est erronée.
L’enquête va débuter à la fin du mois. Les résultats, attendus pour l’année prochaine, nous fourniront des données de cadrage beaucoup plus fines sur les dépenses et recettes à l’intention de la Comptabilité nationale. Ils nous informeront également sur la qualité des répertoires, RNA et SIRENE, pour ce qui est de la connaissance des cessations d’activité, sachant que nous avons actuellement peu d’informations sur les associations qui disparaissent.
Pour réaliser cette enquête, nous nous appuierons sur un échantillon de 17 000 associations employeuses, sur les 180 000 existantes, mais nous interrogerons la totalité de celles qui comptent plus de deux cents salariés, soit 1 200, représentant 40 % de l’emploi. Enfin, nous interrogerons 12 000 associations non employeuses : 6 000 répertoriées dans SIRENE et autant dans le RNA.
M. Gilles Caillaud, président de Fédération Asso 1901. Je suis président d’une association citoyenne dont les membres fondateurs, issus de l’éducation populaire, ont, lors de la préparation du centenaire de la loi 1901, eu l’idée de constituer un annuaire des associations, qui faisait défaut en France. Comme personne ne nous avait prévenu que c’était en fait impossible, nous nous sommes lancés dans cette entreprise ! Aujourd’hui, Fédération Asso 1901 propose une base de données de 1,5 million d’associations, toutes régulièrement déclarées au Journal officiel. Ainsi, 99 % des associations créées, dissoutes ou ayant modifié leurs statuts depuis 1993 y sont répertoriées.
Dans cette base de données, les associations sont classées à la fois par département, par commune, par objet social, thème, domaine et sous-domaine. Nous avons ainsi 400 « petites boîtes » où sont répertoriées des associations qui se consacrent aussi bien aux arts de la rue qu’à l’escalade et à bien d’autres choses encore.
Hier, notre site Internet a enregistré pas moins de 5 000 visites. Il est en effet consulté par les internautes pour des raisons très diverses : l’un cherche un club sportif pour ses enfants, un autre souhaite trouver des gens qui partagent sa passion pour la paléoarchéologie, etc. Les responsables d’association peuvent en outre consulter leur fiche et la mettre à jour en y portant un numéro de téléphone, une adresse de messagerie, de site Internet ou de page Facebook.
Au moment où l’on se préparait à célébrer le centenaire de la loi de 1901, nous avions déploré l’absence d’un tel annuaire, ce qui avait pour effet que beaucoup de gens devaient déployer une énergie incroyable pour créer, chacun dans son coin, des associations ayant le même objet, en réinventant bien souvent, à chaque fois, le fil à couper le beurre ! Nous avons pensé utile de leur permettre de communiquer entre eux, pour confronter leurs expériences.
Notre association a donc été créée en 2002 et nous nous sommes attelés à la tâche, pour laquelle nous sommes peu nombreux, consistant à répertorier de manière exhaustive les associations loi 1901.
Nos « qualificateurs », bénévoles pour la plupart, se connectent à la base de données pour rajouter des informations actualisées dans les fiches, département par département – ce travail a été mené à terme pour soixante d’entre eux au cours des dix-huit derniers mois – et commune par commune. Ce travail colossal est d’une grande utilité, comme en témoignent les nombreuses visites journalières sur notre site.
Bien entendu, des associations créées entre 1901 et 1993 sont passées à travers les mailles du filet, mais nous pouvons les identifier en segmentant nos « petites boîtes » en fonction du nombre d’adhérents et de salariés, du montant des subventions et du budget, toutes informations que nous portons sur nos fiches. Ce travail, que nous avons commencé, sera très long, mais nous permettra d’améliorer nos informations.
Chaque mois, nous intégrons les 5 600 associations créées au cours du mois précédent et enregistrons les 1 200 modifications de statuts et les 800 dissolutions. Nous considérons que, sur le million et demi d’associations inscrites dans notre base de données, un million sont actives. Aux 500 000 restantes, sur lesquelles nous ne trouvons rien malgré nos recherches, nous attribuons une petite pastille rouge. Un des rares défauts de la loi de 1901 est de ne rien dire sur les associations qui arrêtent leur activité, notamment celles qui sont prédestinées à le faire au bout d’un an – et elles sont nombreuses, comme celles que des étudiants créent pour organiser un rallye 4L au Maroc. Pour notre part, nous n’avons aucune autorité en la matière, c’est au législateur de faire le « nettoyage ».
En plus des pastilles rouges, nous affectons une pastille verte aux associations que nous savons actives, une pastille jaune aux associations qui ne se sont pas manifestées depuis un à trois ans et une pastille noire à celles qui sont effectivement dissoutes. Il s’agit là d’un travail important qu’il faut poursuivre avec nos « qualificateurs » numériques, dont certains sont bénévoles et d’autres des quadras ou quinquagénaires à la recherche d’un nouvel emploi.
Ce problème de déterminer si une association est active ou non est le premier qui se pose à nous, mais il en est un deuxième qui tient au fait que les associations ne sont pas tenues, y compris en cas de dissolution, de demander la publication au Journal officiel des modifications de leurs statuts. M. Audebert vous a annoncé lors de son audition, la semaine dernière, que les formalités qu’elles doivent accomplir en préfecture seraient désormais possibles en ligne : la mesure est bienvenue, mais pourquoi ne pas proposer également la publication au JO des modifications, ce qui ne demanderait pas plus de travail aux préfectures ? Dans la mesure où cette inscription au JO est payante, ce qui constitue un frein à la déclaration, il suffirait de faire payer à la création de l’association 50 euros au lieu de 48 et de rendre gratuites toutes les modifications ultérieures.
À notre sens, ce n’était pas à nous d’élaborer cet annuaire des associations, mais plutôt aux organismes publics. Maintenant qu’il existe, nous souhaitons travailler avec l’INSEE et avec les responsables du RNA afin d’agréger toutes ces informations au moyen d’un identificateur commun. En effet, le numéro d’identification RNA, qui commence par la lettre « W » – pour « Waldec » –, est attribué seulement depuis 2009. Certaines associations modifient leur situation auprès de l’INSEE parce qu’elles demandent une subvention, envisagent de devenir employeur ou vont payer la TVA, mais elles sont peu nombreuses à le faire ; ou alors elles ont un numéro SIRENE, mais sont dissoutes depuis longtemps. Si elles ne signalent pas leur dissolution au JO, elles ne le feront pas non plus auprès de l’INSEE. Par conséquent, un nettoyage s’impose également en la matière.
Notre but est d’aider les associations à se présenter auprès de leur public et de permettre à leurs administrateurs d’entrer en relation. Nous tenons à ce que cette base de données demeure au sein de l’économie sociale et solidaire.
Nous sommes une petite association de peu de moyens – et sans subventions car nous n’en avons jamais demandé. Si l’État et les organismes publics jugent que notre travail doit être poursuivi, nous y sommes prêts, mais dans un esprit de co-construction. En effet, ce travail demande beaucoup de moyens et d’énergie, d’autant que notre base de données est régulièrement attaquée par des hackers qui tentent d’obtenir des informations – numéros de téléphone, adresses de messagerie, etc. –, problème que nos moyens ne nous permettent pas de résoudre. Des organismes qui vendent des fichiers d’entreprises pour faire du mailing s’intéressent également à notre base de données et nous ont sollicités, mais nous sommes réservés face à de telles demandes et nous avons préféré prendre contact à ce sujet avec des mutuelles et des coopératives, car nous aimerions diffuser nos données dans des conditions de sécurité maximales pour les associations et que cela ne se retourne pas contre elles.
Comme je l’ai dit, nous avons commencé un petit travail de segmentation, en testant pour un certain nombre de départements une classification selon le montant des subventions. Ce sujet s’avère très délicat. Nous sommes capables de faire ce travail de manière exhaustive grâce au numéro SIRENE de l’INSEE et, si une association touche des subventions de l’État, de la région, d’un département, d’une commune ou d’une agglomération, d’en connaître le total. Or, au-delà de 153 000 euros de subventions, la publication des comptes est obligatoire – mais il semble que cette obligation légale ne soit pas respectée…
M. Régis Juanico. Il faut renforcer les sanctions.
M. Gilles Caillaud. La loi sur l’économie sociale et solidaire propose une solution très intéressante, mais encore faut-il avoir les moyens de la mettre en application.
Nous sommes donc capables, grâce à un identifiant, d’additionner les subventions d’origines diverses et de savoir si le total atteint 153 000 euros sur une année. Ce travail est délicat, disais-je, car même si un certain nombre d’associations profitent des failles de la loi, il faut veiller à ne pas jeter le discrédit sur toutes les autres, celles qui sont subventionnées à juste titre. C’est pourquoi nous proposons de rencontrer le Mouvement associatif et les associations d’élus pour réfléchir ensemble aux moyens d’introduire davantage de transparence sur ce sujet des contributions publiques, sans dommage pour personne.
Les subventions de l’État sont passées de 1,3 milliard d’euros en 2010 à 1,4 milliard d’euros en 2011 et 1,8 milliard d’euros en 2012. On peut certes s’alarmer d’une telle augmentation, mais il convient de comparer ce qui est comparable. À titre d’exemple, la réserve parlementaire affectée aux associations est désormais considérée comme une subvention, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le périmètre peut donc évoluer, d’où la nécessité d’une étude sérieuse avant de publier des informations à ce propos.
Pour avoir travaillé à l’étranger où j’ai observé le fonctionnement des associations, je peux vous dire que la loi de 1901 est un de nos fleurons. C’est même une des choses que nous devrions exporter ! Un membre de votre commission a suggéré de délivrer une information sur le sujet dans les écoles. Une telle action serait très intéressante, certes, mais pas si elle consiste à faire parler « monsieur le président » de son association : il faut faire la démarche inverse et emmener les classes à la rencontre des associations de sorte que les enfants soient incités à agir en faveur de celles-ci. Il faut éviter de rester passif.
Nous sommes persuadés de la nécessité de rendre plus transparentes les associations, dont le budget global est estimé à 85 milliards d’euros. Mais cette démarche devra être menée par le mouvement associatif en parfaite coordination avec les associations d’élus.
Dans la mesure où nous avons prouvé notre capacité à créer les outils informatiques permettant de gérer une base de 1,5 million d’associations – et que nous sommes toujours aussi idéalistes –, nous nous sommes lancés dans l’élaboration de deux nouvelles bases de données, que je qualifierai de « politiques ».
La première serait une base de données des associations européennes. Pourquoi des gens engagés dans la culture biologique à Varsovie, à Brest ou à Malte n’auraient-ils pas la possibilité de communiquer entre eux sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et sur les solutions qu’ils peuvent proposer ? À l’heure du numérique, cette idée nous paraît particulièrement intéressante et nous avons commencé à travailler à sa réalisation.
Ensuite, nous avons à cœur de créer une base de données concernant l’Afrique. Récemment, l’État français est intervenu dans des pays de ce continent pour mettre un terme à la guerre. Le problème, c’est de construire la paix. Cela suppose que les aides octroyées ne passent plus par des circuits sous la coupe des États, ce qui génère des déperditions très importantes. Nous pensons que les crédits publics devraient être fléchés vers l’association, présente au Mali par exemple, qui aurait des liens avec une association européenne ou française. Tout se passerait alors sous le contrôle direct des citoyens.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. La liberté associative, à laquelle nous sommes tous très attachés, doit être protégée et encadrée. À vous écouter, il nous semble que le travail de recherche sur la vie associative en France n’en est qu’à ses prémices. Est-il possible de créer une base de données qualitative, qui fournisse des informations sur les motivations des bénévoles et des adhérents, sur leur âge, sur leur niveau social, etc., toutes données qui pourraient alors être mises en relation ?
M. le président Alain Bocquet. Le nombre d’associations est parfois estimé à 1,3 million ; vous l’évaluez à 1,5 million, dont 500 000 « dormantes ». Sur quel chiffre notre rapport doit-il s’appuyer selon vous ?
Mme Fabienne Rosenwald. Les « enquêtes ménages » de l’INSEE, réalisées en 2002 et 2010, permettent de déterminer les motivations des bénévoles. Nous interrogeons les ménages sur le type d’association qu’ils fréquentent, ce qui nous permet d’avoir un nombre de bénévoles sans double compte, et de dégager des profils pour dégager éventuellement des différences selon qu’on est homme ou femme. Les résultats de l’enquête INSEE Première indiquent les taux d’adhésion selon l’âge, le sexe, les catégories socioprofessionnelles, la taille de l’unité urbaine de domiciliation. Nous pourrons vous communiquer les résultats de ces études.
De la même manière que les enquêtes ménages ne sont pas réalisées annuellement, celle que nous avons prévu de faire auprès des associations sera renouvelée dans cinq ans : elle nous donnera ainsi des tendances structurelles. Les résultats des enquêtes de la sphère privée sur les motivations ou le bénévolat sont eux-mêmes assez cohérents avec ceux de l’INSEE.
M. Gilles Caillaud. Notre travail ne consiste pas à produire des appréciations qualitatives : nous ne faisons que fournir des chiffres. Mais ceux-ci sont ensuite analysés et interprétés par des experts avec lesquels nous travaillons, comme ceux de Recherches & Solidarités.
Le numérique a envahi le monde associatif et, bien souvent, un réseau Facebook existe préalablement à la création d’une association. Avec des moyens supplémentaires, nous pourrions héberger 500 000 e-mails de contact, au lieu de 300 000 actuellement. Cela suppose en effet de les trouver pour que les internautes puissent contacter les personnes qu’ils cherchent.
M. Jean-Pierre Allossery. Pour obtenir une subvention, l’association doit présenter le récépissé de déclaration délivré par l’administration. Mais je suppose qu’un grand nombre d’associations ont été créées avant l’instauration de cette formalité.
M. Gilles Caillaud. Certaines associations existantes ont même été créées avant 1901. Au commencement de notre travail, à l’époque du Minitel, nous procédions à la reconnaissance de caractères du Journal officiel, qui nous donnait des informations sur les dissolutions et créations département par département.
L’octroi de subventions est subordonné à la publication de la déclaration au Journal officiel. Mais aujourd’hui, la déclaration peut se faire par courrier ou par Internet. Dans ce dernier cas, un récépissé est adressé par voie électronique.
M. Jean-Pierre Allossery. Connaissez-vous le nombre d’associations fédérées ?
Mme Fabienne Rosenwald. Nous avons prévu de poser cette question dans le cadre de notre future enquête associations. Celle-ci nous procurera des informations que ne fournissent pas actuellement les répertoires administratifs. Elle nous permettra également de faire le point sur les associations qui n’ont pas « bougé ». Depuis 2007, le RNA est en effet divisé en deux parties : l’une regroupe un « stock » d’un million, l’autre les associations, en nombre équivalent, qui se sont créées depuis cette date ou qui ont bougé, mais parmi lesquelles certaines ont certainement cessé leur activité.
Quant à SIRENE, il distingue les associations employeuses déclarées auprès de l’URSSAF. L’INSEE reçoit en effet des informations en provenance de l’URSSAF, des greffes ou des chambres de commerce, et toutes les modifications doivent passer par un circuit officiel : nous ne pouvons enregistrer l’arrêt d’une association qu’au vu d’un acte juridique légal.
Mme Hélène Geoffroy. Connaît-on la proportion des bénévoles par rapport à celle des personnes salariées, dans les associations ?
Avez-vous des informations sur la vie des associations dans les quartiers ? En particulier, la politique de la ville leur a-t-elle permis de prospérer ?
M. Régis Juanico. Vous avez cité le chiffre de 8 millions de bénévoles ; celui que nous avons l’habitude d’évoquer est 16 millions. Quel est le nombre d’heures d’engagement que vous prenez en compte pour déterminer qu’il y a bénévolat ?
Aux termes de l’article 12 de la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), l’activité et les modalités de financement des entreprises de l’ESS font l’objet d’un suivi statistique spécifique auquel participe notamment l’INSEE. Quelles informations supplémentaires cet article de loi va-t-il vous permettre d’obtenir ?
En 2008, dans le cadre de la mission d’information parlementaire sur la gouvernance et le financement des structures associatives, présidée par Pierre Morange, nous avons plaidé pour une plus grande lisibilité des « jaunes budgétaires », offrant une vision claire du montant des subventions accordées par l’État ainsi que des dépenses fiscales en faveur du secteur associatif. Les informations contenues dans les documents budgétaires vous semblent-elles aujourd’hui satisfaisantes ?
M. Jean-Noël Carpentier. Quelle distinction opérez-vous entre adhésion et bénévolat ? Comment définissez-vous ce dernier, en particulier à l’aune du statut des bénévoles dont l’opportunité fait l’objet d’un débat à l’heure actuelle ?
Madame Rosenwald, vous annoncez une nouvelle enquête INSEE qui débutera le mois prochain. Qui vous l’a commandée et pour quelles raisons ?
Monsieur Caillaud, vous parlez de 5 500 créations et 800 dissolutions d’associations chaque mois. Cela représente 50 000 nouvelles associations par an, soit 500 000 supplémentaires dans dix ans. La réalité n’est évidemment pas aussi mathématique, mais cette évolution va-t-elle se poursuivre, selon vous ? Envisagez-vous d’établir une typologie des associations qui se créent et de celles qui disparaissent ?
M. Jean-Pierre Aylagas. Monsieur Caillaud, vous souhaitez étendre votre travail aux pays européens et à l’Afrique. Ces pays se sont-ils dotés d’une loi sur les associations équivalente à la nôtre ?
Un grand nombre de fédérations réfléchissent au statut des bénévoles. À votre connaissance, lesquelles ont le plus avancé sur ce sujet ?
Mme Fabienne Rosenwald. Notre nouvelle enquête prévoit la recherche d’informations sur l’emploi bénévole. L’estimation obtenue constituera une grande avancée, car nous pourrons alors faire des comparaisons entre emploi bénévole et emploi salarié, lequel fait déjà l’objet d’un suivi statistique de l’INSEE.
Parmi les 16 millions d’adhérents, 8 millions sont bénévoles. En effet, on peut être adhérent sans être bénévole, de la même manière que certains bénévoles ne sont pas adhérents.
Notre nouvelle enquête comportera des questions sur l’évolution qualitative au cours des trois dernières années des ressources et des dépenses des associations, ainsi que sur l’évolution du bénévolat et de l’emploi. Sachant que les résultats sont publics et que les chercheurs ont accès aux données individuelles, je pense que beaucoup d’entre eux s’attacheront à évaluer l’apport de la politique de la ville à l’aune de ces résultats.
La réalisation de cette enquête a été demandée, comme je l’ai dit, par le Conseil national de l’information statistique, l’un des trois piliers de la statistique publique, où sont représentés l’Assemblée nationale, les syndicats professionnels et les associations, etc. En effet, le rapport Archambault intitulé « Connaissance des associations », publié en 2010, a conclu à l’intérêt d’une enquête sur les associations, éventuellement renouvelable tous les cinq ans. Ce rapport très intéressant pointe également les lacunes en matière de suivi des subventions, ce qui a permis d’améliorer les informations contenues dans le « jaune budgétaire ».
Nous publions chaque année un état des lieux de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire. L’article 12 du projet de loi sur l’ESS prévoit le suivi statistique par l’INSEE, la Banque de France et la BPI, notamment. Des décrets devraient déterminer dans quel cadre les nouveaux acteurs pourront être intégrés au répertoire SIRENE, ce qui nous permettra d’opérer un suivi de l’emploi et de l’activité de ce secteur.
Enfin, les informations dont nous disposons sont disparates, chaque ministère répondant selon des modalités différentes. En outre, nous ne recevons les données fiscales que de 10 000 à 15 000 associations. Et encore ce chiffre est-il biaisé, beaucoup d’associations n’étant pas obligées de faire une déclaration, en dessous d’un certain seuil, ni de déclarer la totalité de leur activité, hormis les activités marchandes. Ces difficultés multiples nous obligent à un travail très ardu de retraitement.
M. Gilles Caillaud. La présentation du « jaune budgétaire » est différente d’une année sur l’autre. Le seul critère sur lequel nous pouvons nous appuyer est le numéro SIRENE. Or il arrive que seule l’appellation abrégée de l’association ait été déclarée. Notre travail consiste donc à rechercher le vrai nom de l’association au Journal officiel, le numéro SIRENE, auxquels nous ajoutons dans notre base de données un code QR. C’est un travail très important, que nous avons commencé et qui nous permettra d’avoir un véritable identifiant.
À ce stade, nous souhaitons donc coopérer avec l’INSEE et avec les ministères afin que cet identifiant soit mis en place. Il permettra de suivre dans le jaune budgétaire l’évolution des subventions d’une année sur l’autre, ainsi que les nouveaux bénéficiaires. Le « jaune » 2012, que nous avons étudié, indique un total de 1,8 milliard d’euros de subventions de l’État, la plus élevée étant de 50 millions et la moins importante de 128 euros.
Préalablement à ce travail, que nous pouvons faire avec la collaboration des instances nationales, nous souhaitons une concertation avec le milieu associatif et les associations d’élus pour éviter la publication d’un document potentiellement explosif parce qu’il jetterait l’opprobre sur l’ensemble des associations. L’urgence est donc de créer cet identificateur unique, qui permettra de suivre l’association depuis sa création jusqu’à sa dissolution.
Puisque vous vous préoccupez de données qualitatives, n’oubliez pas que parmi les associations se trouvent très certainement les entreprises de demain. En effet, en s’appuyant sur l’émergence de nouveaux besoins, elles sont bien souvent les promoteurs de nouvelles idées ou de nouvelles actions, qui peuvent ensuite devenir autant d’opportunités pour un marché.
Pour ce qui est des typologies, nous sommes capables, par exemple, d’indiquer la date de création des premières associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) et la progression de leur nombre année par année. Comme l’objet social d’une association peut être relié à tel ou tel secteur – énergie, développement, économie circulaire, monnaie locale, etc. –, les chercheurs sont à même de déceler à partir des nouveautés qui apparaissent dans notre base de données quelles seront peut-être les entreprises de demain.
L’équivalent de la loi de 1901 n’existe pas en Afrique et, dans beaucoup de pays, on ne peut pas créer une association sans autorisation du ministère de la justice ou de l’intérieur. Mais chaque pays s’est doté d’une loi sur les associations. Nous devons travailler sur ces bases, en espérant que les pays feront évoluer leur législation. À cet égard, notre loi est un magnifique outil qui pourrait servir de modèle dans le monde.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup pour ces contributions.
Table ronde sectorielle « Associations du secteur sanitaire, social et médico-social » :
M. Dominique Balmary, président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
M. Florent Gueguen, directeur de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS),
et M. Samuel Le Floch, chargé de mission ;
M. Yves-Jean Dupuis, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP),
et Mme Adeline Leberche, directrice du secteur médico-social
(séance du 9 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, messieurs, le secteur non lucratif de solidarité, autrement dit les associations sanitaires et sociales, est essentiel pour veiller aux intérêts des personnes vulnérables et fragiles. Il a vocation à mettre en œuvre, aux côtés de l’État et des pouvoirs publics territoriaux, des politiques sociales efficaces et bien adaptées aux besoins des populations.
Nous souhaitons vous entendre sur la situation de votre secteur d’activité, sur les difficultés que vous rencontrez, sur votre expérience de la crise du monde associatif et sur les pistes de solutions que vous pourriez éventuellement nous suggérer.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois préalablement vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Françoise Kbayaa et Adeline Leberche et MM. Dominique Balmary, Florent Gueguen, Samuel Le Floch, Yves-Jean Dupuis, Didier Arnal, Yves Verollet, Nicolas Pailloux et Thierry Nouvel prêtent serment)
M. Dominique Balmary, président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS). Monsieur le président, je vous remercie de nous avoir invités à témoigner devant votre commission sur les difficultés du monde associatif. L’UNIOPSS, association plus que sexagénaire, regroupe environ 20 000 établissements et services qui interviennent dans le domaine du handicap, de la santé, des personnes âgées, de la famille, de l’enfance, de l’exclusion, etc. Nos adhérents emploient 750 000 salariés et un million de bénévoles.
Nous connaissons tous les difficultés, notamment financières, que traverse depuis plusieurs années le monde associatif, mais, comme je n’oublie pas que j’ai été, dans une vie antérieure, délégué à l’emploi au ministère du travail, j’insisterai sur celles qui ont trait à l’emploi en soulignant d’abord un paradoxe qui me paraît résumer assez largement les problèmes de notre secteur.
Le Gouvernement conduit, avec le Parlement, une politique de l’emploi : baisse du coût du travail, invitation aux partenaires sociaux à négocier sur différents sujets, notamment sur la mise en place du pacte de responsabilité et de solidarité, etc. mais, depuis de nombreuses années déjà, on oublie que le monde associatif, en particulier le monde associatif de la solidarité, est un formidable réservoir d’emplois – d’emplois permanents et, de surcroît, non délocalisables. Ces emplois correspondent à une demande sociale que nous avons de plus en plus de mal à satisfaire tant elle croît en raison de la situation que connaît notre pays, du vieillissement de la population, de l’accroissement du nombre de familles monoparentales, de la nécessité de rendre notre société plus accueillante aux personnes handicapées ou vieillissantes et de celle de réduire les inégalités dans l’accès aux soins. Le nœud du problème se situe dans la solvabilisation de cette demande.
Or, plutôt que d’investir dans ce secteur où le moindre euro accordé au monde associatif contribue à la création d’emplois, les pouvoirs publics, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités, se désengagent financièrement, ce qui conduit à l’inverse à la destruction d’emplois. Certaines décisions pénalisent les associations. Nombre d’entre nous subissent depuis plusieurs années une réduction des subventions qui sont généralement accordées par l’État, mais aussi par les collectivités territoriales, qui ont pris son relais mais qui ont vu elles aussi leurs ressources se restreindre. Les perspectives de réduction des dotations accordées aux collectivités territoriales ne font qu’amplifier nos inquiétudes. Tous les secteurs sont touchés : l’hébergement des personnes en difficulté et sans abri, les actions de prévention que conduisent notamment les municipalités, les services à domicile sur lesquels, je pense, M. Verollet reviendra. Alors que le monde associatif créait des emplois il y a encore quelques années, le nombre d’emplois est maintenant globalement stabilisé, voire en baisse sensible dans nos secteurs.
De surcroît, on impose au monde associatif des charges nouvelles, ce qui est assez curieux. Par exemple, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est réservé aux entreprises du secteur lucratif ou à certaines petites associations, ce qui fait que les associations moyennes ou grandes se trouvent confrontées à une concurrence inédite dans les domaines sanitaire ou médico-social, où le secteur lucratif s’est développé depuis longtemps déjà. Il y a là une rupture d’égalité qui me paraît tout à fait anormale.
Avant l’été, nous avons également subi sans explication la suppression de l’exonération du versement transport, qui nous était acquise depuis trente ans environ. Certains d’entre nous sont ainsi confrontés à une dépense supplémentaire alors que nos budgets sont déjà extrêmement fragiles. Nous ne comprenons pas comment le Gouvernement peut alourdir de la sorte les charges des associations. Comble du paradoxe – et M. Verollet le dira sans doute encore mieux que moi : alors que nos politiques veulent que l’on réduise, pour des motifs économiques que l’on comprend, les durées de séjour dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux, ils diminuent dans le même temps le montant des crédits accordés aux services d’aide à domicile. Il semble que personne n’ait voulu jusqu’à présent prendre conscience de cette contradiction. Cette politique entraîne une perte d’emplois dans le secteur associatif de la solidarité alors que, je le répète, la demande croît.
Autre inconséquence : on ne prend jamais en compte les externalités négatives de cette politique – ou absence de politique – de l’emploi en direction du monde associatif ; or, s’il n’y a plus d’hébergements en volume et qualité suffisants, si les actions de prévention – en particulier celles qui sont destinées aux jeunes – se réduisent, les conséquences seront coûteuses pour l’État, ne serait-ce qu’en termes de sécurité. Mais on ne les chiffre pas. Il n’est pas certain que la cohésion sociale et la confiance du pays dans ses autorités s’en trouvent améliorées.
Tout cela nous surprend d’autant plus que nous avons signé avec le Gouvernement, au mois de février dernier, une charte d’engagements réciproques qui indique clairement que la relation entre la puissance publique, tant nationale que territoriale, et le monde associatif est une relation de partenariat. Or nous avons le sentiment que nous en sommes encore très loin. Une charte de cette nature avait déjà été signée en 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Elle a été reprise, améliorée et modernisée au début de cette année, mais nous avons le sentiment que le partenariat n’est toujours pas à l’ordre du jour et que le Gouvernement et les pouvoirs publics n’ont pas une politique de l’emploi qui correspond aux besoins généraux du pays, et plus particulièrement à ses besoins sociaux.
M. Florent Gueguen, directeur de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS). La FNARS regroupe 900 associations œuvrant dans le champ de la lutte contre l’exclusion. On distingue dans ces activités deux pôles dominants : d’une part, les actions d’hébergement, d’accompagnement des personnes sans abri, assurées essentiellement par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), par tous les dispositifs d’accueil des personnes en situation de grande exclusion, par les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et par l’ensemble des services d’accueil associatifs destinés à ces mêmes demandeurs d’asile ; d’autre part, l’insertion par l’activité économique, principalement à travers les chantiers d’insertion.
Cette audition est pour moi l’occasion d’insister, à la suite de M. Balmary, sur les très fortes tensions budgétaires supportées par le secteur associatif, particulièrement par celui de la lutte contre l’exclusion. Ainsi, en ce qui concerne l’hébergement d’urgence, nous subissons depuis plusieurs années une sous-dotation systématique du budget opérationnel de programme (BOP) 177, budget de quelque 1,2 milliard d’euros. En effet, les crédits inscrits dans la loi de finances initiale sont toujours en deçà de l’exécution des crédits de l’année précédente alors même que, chaque année, le nombre de personnes qui appellent le 115 en vue d’obtenir un hébergement dans nos établissements augmente de 10 % environ. La loi de finances initiale pour 2014 ne fait pas exception à cette règle puisque les crédits d’hébergement inscrits sont inférieurs de 5 % aux crédits exécutés en 2013. Cette insincérité budgétaire oblige l’État à accorder des rallonges multiples en cours d’année, ce qui déstabilise totalement le secteur. Mes adhérents sont composés d’associations qui ne savent pas si leurs places d’hébergement pourront rester ouvertes au-delà de trois mois, s’ils pourront continuer de suivre les personnes qui sont remises à la rue à chaque printemps
– puisque l’État continue de développer les plans hivernaux bien qu’on sache depuis longtemps que la dangerosité de la rue est aussi forte l’été que l’hiver. Il y a donc un contexte anxiogène très fort lié à un très mauvais pilotage des crédits d’hébergement. Il faudrait au minimum que la loi de finances initiale prenne en compte l’ensemble des dépenses constatées l’année n – 1.
La tension budgétaire est liée également aux dysfonctionnements maintenant connus des fonds européens. La FNARS est concernée principalement par le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen pour les réfugiés (FER). Ces fonds, en particulier le FSE, sont devenus une terrible machine bureaucratique pour le secteur associatif. Des contrôles disproportionnés interviennent deux ou trois ans après que l’action a été réalisée, des crédits sont versés deux à trois ans, parfois plus, après que l’action a démarré. Résultat : seules les grandes associations, celles qui ont de la trésorerie, peuvent faire face à ces périodes de non-financement. Actuellement, un grand nombre d’adhérents ne sollicitent plus le FSE, bien que les crédits nationaux soient en contraction et les besoins immenses. Le mécanisme de contrôle est ingérable et la mobilisation de ces fonds requerrait la création de postes administratifs dans nos associations. De surcroît, cette année sera « blanche » pour nous car nous sommes entre deux programmations FSE. Les plateformes d’accompagnement des demandeurs d’asile sont ainsi privées de crédits FSE alors que ces associations sont financées à 50 % par l’Union européenne. Bref, il faut revoir toute cette mécanique qui nous déstabilise.
Autre tendance inquiétante : le développement de la commande publique par rapport à d’autres modes de financement, notamment la subvention. Nous constatons un accroissement de 10 % par an de la part des marchés publics dans le financement des associations, ce qui représente pour celles-ci une perte de leur capacité d’initiative et d’innovation dans la mesure où elles sont soumises, dans le cadre de la commande publique, à un cahier des charges souvent fermé, à l’élaboration duquel elles n’ont pas nécessairement été associées. La commande publique contribue ainsi à une réduction du fait associatif, et entraîne une mise en concurrence et une perte d’autonomie. Or cette capacité d’autonomie est évidemment très importante. Sur ce point, la FNARS défend le conventionnement en matière de subventions. Or, si la loi relative à l’économie sociale et solidaire comporte une avancée avec la définition qu’elle donne de la subvention, nous constatons que celle-ci devient un mode de financement minoritaire dans le secteur social.
La fiscalité également est défavorable à l’emploi associatif. Comme vous le savez, le CICE ne bénéficie pas au secteur associatif alors que, comme l’a fort bien dit M. Balmary, les associations sont créatrices d’emplois d’utilité sociale reconnue et contribuent à la lutte contre le chômage et à la croissance dans notre pays. Certes, il y a bien eu un abattement de la taxe sur les salaires, mais cette mesure ne bénéficie qu’aux petites associations. Or ce sont les grandes qui embauchent le plus. Elles ne bénéficient pas non plus du CICE alors qu’elles sont souvent en concurrence avec le secteur privé sur un certain nombre de prestations. Ce crédit d’impôt a donc créé une situation de concurrence déloyale, qui n’a pas été totalement compensée par l’abattement que je viens de citer.
M. Balmary a évoqué la suppression de l’exonération de la taxe transport, taxe qui se monte à 2 % des salaires. Pour le secteur de la lutte contre l’exclusion, cette mesure se soldera par le versement de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de transports, ce qui est totalement inacceptable. Les CHRS, donc les crédits d’hébergement de l’État, vont ainsi financer les rames du RER ! Bien évidemment, les associations vont continuer à demander soit leur exonération, soit la compensation par l’État de cette charge nouvelle – en ce qui nous concerne, nous n’avons d’ailleurs pas d’autre choix puisque le secteur de la lutte contre l’exclusion est financé à 100 % par l’État. Toute taxe nouvelle doit être compensée, sinon nous serons obligés de fermer des places d’hébergement, de supprimer des emplois, ce qui serait tout à fait scandaleux.
Un mot pour finir sur la gouvernance du secteur associatif. La FNARS plaide, avec d’autres associations, pour une implication beaucoup plus forte dans cette gouvernance des personnes que nous accompagnons. Cette demande est confortée par le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, qui fixe notamment comme priorité la participation des usagers et des personnes accompagnées aux instances de décision. Nous avons engagé des actions visant à faire entrer des personnes accompagnées dans les conseils d’administration. C’est le cas à la FNARS et chez un grand nombre de nos adhérents, soucieux de reconnaître plus fortement l’expertise des personnes qui bénéficient de nos prestations.
M. Yves-Jean Dupuis, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP). Je commencerai par rappeler le poids économique de nos associations : ce sont environ 38,5 milliards d’euros qui sont consacrés au secteur social, médico-social et sanitaire, soit un peu plus de 45 % des dépenses ou des recettes du secteur associatif. C’est dire la considération qu’il convient de lui accorder dans toute réflexion sur l’avenir du secteur associatif.
Cela fait de nombreuses années que ce secteur contribue à l’amélioration de notre système de protection sociale. Si l’on remonte au XIXe siècle, on peut même dire qu’il est à l’origine de ce système. S’il s’est toujours adapté, cette adaptation est de plus en plus difficile depuis ces dix dernières années, et il s’agit maintenant de revoir les organisations, les modes de fonctionnement interne de nos associations.
Notre secteur est en crise en raison de la crise économique actuelle, mais ce n’est pas le seul facteur à l’origine de ses difficultés. En effet, dans le cadre de la décentralisation, le transfert des subventions de l’État aux associations vers les collectivités locales n’est pas neutre. Jusqu’à présent, les associations ont fait face, mais nous vous transmettrons des documents qui montrent que ces transferts n’ont pas été complets.
Le partenariat noué avec la puissance publique est actuellement surtout centré autour des départements, même si des accords ont été conclus avec l’État. Je fais miens les propos de M. Gueguen sur la transformation des subventions publiques en commande publique, évolution qui pose aujourd’hui de vrais problèmes d’adaptation de nos organisations. Jusqu’à présent, nous vivions dans un système ascendant, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’abord de résoudre les problèmes constatés sur un territoire, problèmes que les associations faisaient ensuite remonter aux services de l’État et des collectivités locales. Or, avec la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), le mouvement s’est inversé : il est devenu descendant, les pouvoirs publics exerçant une contrainte forte pour que soit mise en œuvre, au moyen de la commande publique, toute une série d’actions sans que soit nécessairement prises en compte les évolutions nécessaires de la protection sociale.
D’autre part, se pose aujourd’hui à nous un problème de ressources humaines. Nous rencontrons des difficultés pour recruter les personnes dont nous avons besoin car notre secteur est de moins en moins attractif. Du fait de nos contraintes financières, en effet, les salaires que nous versons sont tels que les salariés rechignent à venir y travailler et ont parfois intérêt à se tourner plutôt vers le secteur public ou commercial. Les études que nous avons réalisées au niveau de la branche qui regroupe la plupart des acteurs du secteur social et médico-social montrent que plus de 41 % des établissements ont du mal à recruter des infirmières et des aides-soignantes. Du coup, il devient impossible de faire fonctionner les salles de soins – on les fait dysfonctionner plutôt que fonctionner. Lorsqu’il n’y a plus d’infirmières pour couvrir les besoins dans les structures de prise en charge des personnes âgées dépendantes, on met ces structures en difficulté. Le problème est le même s’agissant des masseurs-kinésithérapeutes qui devraient s’occuper des malades revenus à leur domicile : comme un masseur-kinésithérapeute n’est pas obligé de travailler dans une structure collective et qu’il peut visser sa plaque dès qu’il a son diplôme, rares sont ceux qui acceptent de travailler à des tarifs acceptables pour les malades, avec des restes à charge supportables. Les difficultés sont également grandes en ce qui concerne le corps médical, en raison des écarts entre le secteur non lucratif et les autres – j’y reviendrai tout à l’heure.
À ces problèmes de recrutement vient s’ajouter le besoin de disposer de personnels de plus en plus qualifiés, car les prises en charge sont de plus en plus lourdes. Le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, par exemple, nécessite des personnels de plus en plus formés et professionnels. Or les moyens financiers qu’exigerait leur formation ne sont pas toujours présents.
On assiste, dans le meilleur des cas, à des concentrations, à des regroupements d’associations en raison des difficultés de fonctionnement de certaines d’entre elles, souvent de petites associations. Le danger, c’est de voir les structures non lucratives en difficulté reprises par des structures commerciales. On le constate malheureusement de plus en plus. Comme l’a indiqué le directeur de la FNARS, le secteur commercial est aujourd’hui présent dans le secteur social et médico-social, et commence à l’être dans celui du handicap. Un regroupement multisectoriel nécessite d’autre part des accompagnants internes chargés de la professionnalisation. Or, là encore, les moyens sont insuffisants, d’où des difficultés d’adaptation. Enfin, les lourdeurs dans nos organisations s’aggravent en raison de la multiplication des textes législatifs et réglementaires que nous n’avons pas la capacité de « digérer », d’où un risque juridique pour un grand nombre de nos établissements. Mais cette multiplication de textes permet à l’administration d’ouvrir le parapluie en cas de difficulté…
La gouvernance de nos organisations est assurée par des bénévoles, qui y consacrent une grande partie de leur temps. Ce sont des « passeurs » : ils sont là pour assurer la pérennité d’une association, voire pour accroître son activité, puis ils passent le témoin pour que la structure puisse continuer à vivre. Dans le secteur associatif, certaines structures existent depuis plusieurs dizaines d’années, voire depuis quelques siècles, elles font partie de l’histoire de la France. Mais, en raison des difficultés financières et des responsabilités importantes qui pèsent sur nos organisations, nous avons de plus en plus de mal à attirer de jeunes administrateurs, de sorte que 70 % de ceux qui sont en place ont plus de soixante ans, 72 % d’entre eux s’étant engagés depuis plus de cinq ans et presque tous étant des retraités. La difficulté de renouveler cette gouvernance vieillissante est grave pour l’avenir : si nous n’en triomphons pas, nous risquons de voir bien des associations péricliter demain. Bien sûr, nous travaillons en interne pour essayer de mobiliser et d’attirer des jeunes, mais ce n’est pas facile.
D’autre part, nous avons l’impression qu’il est difficile pour les autorités de l’État et pour leurs structures décentralisées de gérer un triptyque et qu’en France, on ne parvient à travailler que dans un cadre binaire : c’est soit le public, soit le privé commercial. Dès que l’on essaie de mettre en avant, dans le secteur sanitaire, médico-social et social, un troisième acteur, pourtant historiquement le plus ancien, le secteur non lucratif, il semble que guettent aussitôt des difficultés de fonctionnement. Ainsi, dans le secteur sanitaire, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) semble avoir bien du mal à gérer à la fois une structure publique et un secteur non lucratif, alors même que ce dernier est en totalité dans le secteur public hospitalier et que 99 % des médecins qui travaillent dans nos établissements sont en secteur 1 – ce qui n’est pas le cas à l’hôpital public et ce qui fait de nous les vrais garants du service public hospitalier. Le même constat vaut pour d’autres activités entrant dans le champ médico-social. Dans le même temps, le secteur commercial prend pied dans ces domaines où le secteur non lucratif est dominant. Sa stratégie consiste souvent à procéder par étapes, en prenant des parts de marché peu intéressantes financièrement dans un premier temps, mais qui le deviennent dans un parcours de soins global quand il s’est assuré une clientèle captive.
Enfin, pour compléter le propos de MM. Balmary et Gueguen, il faut insister sur les écarts considérables qui marquent le traitement fiscal des différents secteurs. Il a été question du CICE, mais on pourrait également mentionner la taxe d’habitation et la taxe foncière : nos établissements non lucratifs doivent en effet acquitter ces impôts locaux alors que l’hôpital public en est exonéré. L’activité étant la même, nous revendiquons le même traitement.
Jusqu’à présent, des aides étaient accordées dans les zones de revitalisation rurale. Or ces crédits ont disparu, ce qui a entraîné une diminution du nombre d’emplois dans ces secteurs en grande difficulté, notamment dans le Massif central et les Pyrénées.
Au-delà de l’aspect financier, qui est important, il convient que l’administration procède à un rééquilibrage entre les différents secteurs – public, privé non lucratif, voire commercial si commercial il doit y avoir. Il est important que le secteur non lucratif soit pris en compte correctement. Or ce n’est pas le cas : dans les statistiques nationales de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), il est tantôt rattaché au secteur public, tantôt au secteur commercial.
M. Didier Arnal, directeur général adjoint de la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI). La FEGAPEI est une fédération d’employeurs gestionnaires et un acteur de santé présent aux niveaux régional, national et européen. Elle regroupe un peu plus de 400 associations qui emploient 120 000 salariés au service de 240 000 personnes.
Nos organisations ont certainement besoin de voir leur statut précisé, et en tout cas clarifié, pour sortir de situations parfois difficiles. En effet, nous avons les obligations d’un service public – et c’est ce que nous souhaitons – tout en ayant un statut d’employeur privé avec toutes les obligations que cela comporte. Nous n’avons pas une délégation de service public clairement établie et qui fixe la responsabilité ou les engagements des uns et des autres.
Nos associations font depuis de nombreuses années beaucoup d’efforts de rationalisation, de mutualisation, d’organisation, bref d’efficience. La question se pose néanmoins de la pérennisation d’un certain nombre d’entre elles, y compris de grandes associations. Parfois le secteur privé est là pour prendre le relais et des solutions sont trouvées ou bricolées, mais la question demeure. Les raisons en ont été rappelées à l’instant. La première est bien sûr financière. À cet égard, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit à propos des transferts entre l’État et les collectivités locales. Notre secteur a fait et continue de faire un travail considérable de professionnalisation pour offrir une prise en charge et un accompagnement de qualité. Il sera fortement concerné par les départs à la retraite nombreux qui interviendront dans les dix ans à venir, ce alors que nous nous heurtons aux difficultés de recrutement évoquées par M. Dupuis – difficultés paradoxales dans le contexte actuel de chômage. Il nous faut trouver la capacité d’être attractifs pour des personnels formés, de qualité, compétents.
Les alternatives en matière de financement ne sont pas nombreuses. Le recours au mécénat, par exemple, ne fait pas partie de la culture française ni de celle de nos organisations. Quant aux financements européens, y recourir suppose de triompher d’un véritable maquis administratif et de contraintes nombreuses.
Si l’on peut comprendre l’esprit qui a présidé aux transferts de subventions de l’État vers les collectivités, le résultat n’est guère satisfaisant. De plus, ces dernières années, le recours aux marchés publics est venu se substituer à la subvention pour une partie de notre secteur. Or ce n’est pas du tout le même mode de financement. Quand il y a subvention générale, il y a un contrat, une relation, et la subvention est généralement reconduite, ce qui permet un développement dans la durée. Les marchés publics ont un caractère beaucoup plus aléatoire même s’ils portent sur plusieurs années et, dans ce domaine, la concurrence est de plus en plus rude – tous les arguments valent !
Pour notre fédération, la question de la pérennisation de nos organisations, et donc de leurs fonds propres, est une préoccupation quotidienne. Les associations qui œuvrent dans le secteur sanitaire, social et médico-social sont de tailles très diverses et la nature de leur activité est également variée, d’où des besoins différents de l’une à l’autre, mais elles ont en commun d’être tenues d’offrir des services de qualité, ce qui suppose des financements. Nous regardons avec beaucoup d’intérêt les dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, notamment la création de fonds dédiés auprès de la Banque publique d’investissement (BPI). Il ne faudrait pas que, comme avec le CICE, notre capacité à solliciter ces fonds soit limitée ou que nous soyons déclarés non éligibles. Sur ce point aussi, nous serons très vigilants.
À considérer la liste des lois adoptées depuis 2002, le carcan administratif s’est fortement resserré autour de notre secteur. Cette réglementation était sans doute nécessaire mais, aujourd’hui, il convient d’observer une pause.
Jusqu’à présent, nos partenaires étaient, d’un côté, l’État et les agences régionales de santé (ARS) et, de l’autre, les conseils généraux. En ce qui concerne l’État, j’ai compris que les choses restaient en l’état et c’est très bien. Mais quid des départements ? Nous aimerions savoir rapidement qui seront, demain, nos interlocuteurs et quelle sera l’organisation.
Beaucoup a été fait ces dernières années pour répondre aux besoins de places nouvelles mais, depuis 2008 ou 2009, il n’y a que peu d’appels à projets pour la création de nouvelles structures. Les besoins sont pourtant là et il s’agit pour nous d’un sujet de préoccupation relativement important.
Tout notre secteur a maintenant vingt ou trente ans, voire davantage, d’où un patrimoine qui commence à devenir vétuste et qu’il conviendrait, par conséquent, de mettre aux normes, et pas seulement aux normes administratives. Nous pourrions pour partie bénéficier des financements qui pourraient être dégagés dans le cadre de la transition énergétique, afin d’isoler les bâtiments par exemple. La piste mérite en tout cas d’être creusée pour que nous bénéficiions de ces dispositifs à l’égal d’autres.
M. Yves Verollet, délégué général de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA). L’UNA fait partie de la branche de l’aide et des soins à domicile ; sur les 220 000 salariés qui relèvent de celle-ci, ses 900 associations en emploient un peu plus de 80 000. Selon les prévisionnistes, le secteur était appelé à devenir un gisement d’emplois mais, même si nous ne désespérons pas qu’il en soit ainsi, nous constatons plutôt une stagnation de ce point de vue, depuis deux ou trois ans. Toutefois, la situation de nos concurrents du secteur lucratif privé n’est guère meilleure, ce qui montre que le problème n’est pas circonscrit aux associations. Il est plus global.
L’idée selon laquelle le secteur associatif en général et le secteur de l’aide à domicile en particulier auraient des difficultés parce qu’ils seraient mal gérés doit de toute façon être balayée. L’ensemble de la branche, et pas seulement l’UNA, a fait d’énormes efforts depuis une dizaine d’années dans le cadre de plans de modernisation, soutenus par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui a dégagé à cette fin une enveloppe dont le montant a été distribué par l’intermédiaire des conseils généraux ou des fédérations d’aide à domicile. Et comme nous consacrons plus de 2 % de la masse salariale à la formation professionnelle, nos salariés sont de plus en plus qualifiés…
Nos difficultés sont bien connues. Elles tiennent en premier lieu au fait que nous avons dans notre secteur de l’aide et des soins à domicile plusieurs interlocuteurs – la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), etc. – et sommes soumis à plusieurs modes de réglementation, mais que nous ne disposons pas de véritable gouvernance nationale. On pourrait penser que la CNSA joue ce rôle, mais tel n’est pas le cas. Elle n’intervient financièrement que de façon marginale : le coût des plans de modernisation que j’évoquais à l’instant est estimé à une centaine de millions d’euros et ce n’est pas sur le fondement de ce montant qu’on peut piloter un secteur. D’autre part, si elle redistribue aux conseils généraux la part nationale des crédits d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH), elle n’intervient pas autrement dans la gestion de ces deux prestations.
Nous souffrons aussi de l’éclatement de l’action sociale entre les différents conseils généraux, qui pratiquent des tarifications différentes. Notre secteur est également caractérisé par l’existence de régimes réglementaires très divers, un régime d’autorisation et un régime d’agrément, qui contribuent encore à la différenciation des tarifications. S’agissant de l’autorisation, par exemple, il n’y a pas véritablement d’échelle nationale des coûts et l’on relève, dans des départements tout à fait comparables et pour les mêmes activités, des tarifications allant de 18 à 23 euros de l’heure.
S’ajoutent à cela les difficultés croissantes rencontrées par les conseils généraux pour financer leur part de l’APA et de la PCH – qui est en moyenne de 70 %. Or, depuis des années, ces prestations sociales contribuent majoritairement au financement de notre secteur et ces difficultés ont bien sûr des répercussions à la fois sur les personnes en perte d’autonomie et sur nos services.
Nous espérions beaucoup des mesures en faveur de l’emploi annoncées par le Gouvernement. Las, le CICE ne nous concerne pas ! J’y reviendrai.
Toutes ces difficultés nous conduisent à avancer un certain nombre de propositions.
Tout d’abord, nous préconisons d’aller vers un régime unique d’autorisation, auquel seront soumis le privé comme l’associatif, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs
– cette proposition se retrouve dans les récents rapports de deux sénateurs et de la Cour des comptes. D’autre part, avec l’Assemblée des départements de France, les fédérations d’aide à domicile ont, depuis 2010, entamé un travail en vue de refonder les relations entre leurs services et les conseils généraux et ont fait des propositions pour réformer la tarification. Nous souhaitons que, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, le législateur s’empare de ces deux sujets afin de lancer le débat et d’aboutir à un système plus satisfaisant que le système actuel.
Nous connaissons l’état des finances publiques, mais nous serons attentifs à la bonne affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), créée pour la prise en charge de la dépendance et pour l’instant affectée au fonds de solidarité vieillesse. L’année dernière, de nombreuses interventions ont été nécessaires pour qu’une partie soit consacrée à un troisième fonds d’urgence. Il conviendrait que la CASA soit dès le début de l’année 2015 mise au service d’un secteur qui souffre durement.
S’agissant toujours du financement, je reprendrai la proposition de la Cour des comptes d’un débat sur l’ensemble des aides fiscales accordées au titre des services à la personne. Ne faudrait-il pas réduire ces incitations ou les plafonner plus strictement lorsqu’elles concernent des services de confort, en contrepartie d’un effort plus accentué en faveur des services aux publics fragiles, tels que la petite enfance et les personnes en perte d’autonomie ? La Cour, dans son dernier rapport, avait présenté trois propositions visant à faire une économie de 1,3 milliard d’euros. Il nous semblerait intéressant de reprendre cette idée.
Enfin, une proposition de l’UNA, mais largement partagée, consisterait à créer un fonds d’investissement et de garantie qui permettrait de mieux organiser notre secteur.
Pour remédier à l’absence de gouvernance nationale, nous souhaitons que la CNSA soit dotée de prérogatives claires pour piloter ce secteur. Nous nous interrogeons également sur la gouvernance locale et sur son évolution. Dans le premier projet de loi Delaunay figurait l’idée d’une gouvernance territoriale, qui a disparu de la version actuelle. Nous aimerions que les parlementaires nous disent comment le secteur sera organisé au niveau local, ce qu’il adviendra des conseils généraux et si nos services seront rattachés, au cas où ceux-ci disparaîtraient, aux intercommunalités, à une fédération d’intercommunalités ou aux agences régionales de santé (ARS). Sur ces sujets, nous avons tout entendu ! Pouvez-vous nous assurer que la réforme ne créera pas plus de difficultés qu’il n’y en a actuellement ?
S’agissant du CICE, nous avons fait, dans le cadre de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), une proposition que nous avons présentée aux services de la Présidence, du Premier ministre et des ministères concernés, lesquels l’on jugée intéressante, semble-t-il : celle d’une réforme du barème de la taxe sur les salaires. Nous allons vous la soumettre à nouveau dans le cadre du futur projet de loi de finances, l’idée étant que, parallèlement au CICE, il convient d’aider le monde associatif à tenir lui aussi son rôle dans la création d’emplois.
M. Thierry Nouvel, directeur général de l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI). Je commencerai par rappeler que ce sont les associations telles que celles que fédère l’UNAPEI qui apportent 90 % des réponses dont ont besoin les personnes handicapées, et cela autrement qu’en gérant des dispositifs. Elles ont donc un rôle sociétal essentiel.
Elles contribuent à l’élaboration des politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Leurs administrateurs et bénévoles participent activement à l’ensemble des instances locales – aux commissions d’accessibilité par exemple –, départementales – dans le cadre des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) –, régionales
– conférences de territoires, conférences régionales de la santé et de l’autonomie – et, bien sûr, nationales. Cet investissement est très lourd à supporter et les difficultés de recrutement soulignées par Yves-Jean Dupuis constituent naturellement pour nous un problème majeur. Il reste que, sans la participation et l’implication des bénévoles, il n’y aurait pas de politique du handicap dans notre pays, car tout dans ce secteur repose sur le fait associatif.
Je ne veux pas remettre en cause la nécessité d’impliquer dans cette politique les personnes handicapées et leurs représentants, qui sont des bénévoles associatifs. Pour ce qui nous concerne, ce sont très majoritairement des parents. Mais c’est – je le répète – un investissement important, qui représente souvent, pour le président d’une association de dimension départementale, plus qu’un temps plein. Il est difficile de trouver des gens qui se consacrent à ce point à une association et nous nous heurtons nous aussi au problème du renouvellement de nos adhérents : jouent contre nous l’allongement des carrières, dû au recul de l’âge du départ à la retraite, ainsi qu’à d’autres facteurs, sociétaux par exemple, mais aussi l’alourdissement des responsabilités qui incombent aux dirigeants. Le président d’une association qui gère plusieurs établissements est le responsable et l’employeur de 1 000 ou 2 000 salariés, parfois davantage, ce qui suppose des compétences et une solide formation. Il est donc nécessaire d’engager une réflexion sur le sujet.
Le congé de représentation facilite la participation aux différentes instances, mais ce dispositif ne s’adresse qu’à un public très restreint, essentiellement des fonctionnaires, qui peuvent ainsi bénéficier de neuf jours par an. Il n’existe rien de tel dans le secteur privé. De plus, les instances en cause se limitent aux instances officielles ; en sont exclus les nombreux groupes de travail qui émanent de celles-ci. Le temps que consacrent les dirigeants à leurs missions n’est en tout état de cause pas pris en compte. En prenant exemple sur ce qui se pratique dans le domaine syndical, nous souhaiterions donc qu’une réflexion s’engage sur le financement du temps associatif consacré par ces dirigeants à leurs missions de quasi-service public.
Ces dernières années, la relation entre pouvoirs publics et associations a totalement changé. Nous assistons à une institutionnalisation de l’association, qui devient le prolongement, l’outil, l’instrument des pouvoirs publics locaux, départementaux, régionaux – plus rarement – et nationaux.
Auparavant, les associations avaient un projet et se mettaient en quête d’un financement. Aujourd’hui, c’est l’inverse : c’est l’administration qui a le projet et qui demande à des associations, en les mettant en concurrence, de le mener à bien. La dynamique est totalement inversée et la concurrence importante. Ce renversement de situation fait que, lorsqu’on s’engage aujourd’hui dans une association, on devient un simple prestataire de la puissance publique. Nous sommes d’accord sur la nécessité de rationaliser, d’appliquer des normes, mais nos associations le font régulièrement et procèdent à des regroupements, consentent à des mutations.
Compte tenu de ce partenariat d’un nouveau modèle, nous nous demandons comment nous pourrons attirer des bénévoles, sauf à n’accueillir que des « notables » uniquement soucieux de décrocher le titre de président d’association. Le phénomène existe, certes, il y a même des associations de notables – vous en connaissez tous –, mais notre engagement est d’une tout autre sorte. Il est avant tout social. En effet, tout ne repose pas sur le financement public : comptent beaucoup l’accueil, l’écoute des familles confrontées à des difficultés, ce que n’assure pas la puissance publique. J’invite votre commission à réfléchir à cette inversion de la relation entre puissance publique et associations : le risque est qu’à terme, elle tue l’envie d’un engagement bénévole.
Pour ce qui est du financement, dans le secteur du handicap, les crédits proviennent pour 50 % de l’État et de l’assurance maladie, pour 40 % des conseils généraux et pour les 10 % restants de fonds propres associatifs ou de la participation des personnes concernées.
Chacun le sait, nos finances publiques s’érodent. Ainsi, sur les cinq dernières années, la part du budget des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) financée par l’État a diminué de 80 millions en euros constants. Ce sont 5 % des crédits qui ont ainsi fondu, ce qui a des conséquences sur l’action des ESAT ou sur leur développement. Les exemples du même ordre sont nombreux.
Les difficultés de financement peuvent conduire les associations à des procédures de redressement judiciaire, ce qui ne se produisait pas auparavant, sans doute parce que nous étions protégés. Certaines même sont en liquidation judiciaire, notamment dans le secteur de l’aide à domicile, mais le secteur du handicap connaît lui aussi des difficultés financières.
Les clignotants passent donc à l’orange, voire au rouge, et nos difficultés sont d’autant plus grandes que, de plus en plus, dans le cadre des appels à projets, la puissance publique nous demande d’importantes mises de fonds initiales. La part de l’association dans le projet de financement va croissant. Or la mobilisation de fonds propres est de plus en plus délicate, d’où, de plus en plus fréquemment, les appels à la générosité du public ou l’engagement dans des activités autres : le financement de la politique publique en faveur du handicap apparaît condamné à se diversifier.
Le secteur marchand commence à s’introduire dans le domaine du handicap. Nous savions que le phénomène existait, parce que 100 millions d’euros partent tous les ans en Belgique pour financer des établissements dans ce pays. Or, aujourd’hui, les opérateurs belges viennent en France et les conseils généraux financent des établissements qui ont un objectif commercial. Nous n’avons rien contre les Belges, d’autant que ces 100 millions d’euros financent des emplois au bénéfice de Français handicapés obligés de chercher ailleurs ce que notre pays ne leur offre pas, mais cela conduit à s’interroger sur notre politique du handicap. Nous préférerions que l’on finance des emplois en France plutôt qu’en Belgique.
Puisqu’on a évoqué les charges nouvelles qui pèsent sur les associations, je dirai que la suppression par le Parlement de l’exonération de versement transport dont bénéficiaient la plupart des associations est un véritable scandale. Durant l’été, j’ai mené une enquête auprès des 550 associations que fédère l’UNAPEI. Sur 113 qui m’ont répondu, 62 m’ont déclaré qu’elles étaient jusqu’à présent exonérées de cette taxe. Pour notre seul secteur, ce sont 8 millions d’euros qu’il va falloir débourser. Toutes les associations du secteur sont concernées, à des degrés divers. L’impact est colossal. Ce qui est hallucinant, c’est que vous puissiez affirmer que vous compenserez cela dans le budget des établissements en augmentant leurs dotations. De qui se moque-t-on ? Chacun sait que les budgets des établissements ne bénéficient d’aucune augmentation. Cette année, dans la loi de finances comme dans la loi de financement de la sécurité sociale, les taux directeurs dans le secteur du handicap et dans le secteur médico-social seront au mieux nuls, sinon négatifs, compte tenu des contraintes budgétaires. Les associations vont devoir faire face. J’ai fait le calcul : 8 millions d’euros répartis entre soixante associations, cela représente plus de 200 emplois en masse budgétaire !
De surcroît, nous avons découvert que la mesure allait être étendue, à l’échelon régional, même là où il n’y a pas de transports urbains ! Ainsi des établissements qui n’étaient pas assujettis à ce versement, en l’absence de transports, vont désormais subir une ponction de 0,55 % sur leur masse salariale… Lorsque le Parlement vote des lois, il faut qu’il en mesure l’impact sur le secteur associatif – je pense par exemple au CICE, dont nous ne pouvons pas bénéficier. Nous sommes des entreprises comme les autres, mais nous sommes peut-être moins entendus que d’autres…
J’en viens au mode de tarification des établissements et des services et à la relation que nous avons avec l’administration, avec les ARS et avec les conseils généraux.
Dans notre secteur, nous avons deux types de procédures : l’une classique, complètement obsolète, et ce qui s’appelle le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), dispositif souple et intelligent qui permet de se projeter, de se fixer des objectifs, de parvenir à des mutualisations. Si ce n’est que, progressivement, on change la donne.
Alors que le gestionnaire était auparavant responsable de sa gestion, des excédents comme des déficits, on nous a annoncé, il y a un an, qu’en cas d’excédents, ceux-ci nous seraient repris. À la limite, il s’agit d’argent public, mais on est loin de la « prime au bon gestionnaire » ! La conclusion est que mieux vaut faire des déficits ou, à tout le moins, ne pas faire d’excédents. Pourquoi élaborer des modes de tarification qui imposent des carcans, qui ne laissent aucune liberté au gestionnaire ? L’objectif d’une association n’est pas de réaliser des bénéfices ou de garder sous le coude les excédents ! Ceux-ci vont servir à compléter, à améliorer les réponses qu’elle apporte. Nous ne sommes pas là pour constituer des réserves ou pour distribuer des dividendes.
Les ESAT sont, pour partie, sous CPOM, ce qui permet de déroger au mécanisme des tarifs plafonds. Mais voici qu’aux termes d’une nouvelle circulaire, tout en restant sous CPOM, ils seront désormais soumis aux tarifs plafonds. La contradiction est totale entre les règles édictées par l’administration et le peu de liberté dont nous pouvons disposer en matière de gestion.
Bref, il faut totalement revoir la nature de la relation entre la puissance publique et les associations gestionnaires dans le secteur du handicap.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Vous représentez un secteur qui ne peut pas être assimilé à celui des toutes petites associations traditionnelles : vous entrez dans une logique de plus en plus concurrentielle, que l’on peut éventuellement dénoncer, mais aussi dans une logique de prestations. Vos interventions sont soumises à l’évolution des besoins des populations, ce qui appelle des prises en charge et des moyens diversifiés, à quoi s’ajoutent des histoires associatives extrêmement diverses.
Dans une précédente vie, j’ai, en tant qu’élue locale, longtemps contrôlé les établissements médico-sociaux et je mesure combien il est compliqué de passer d’une logique associative visant à répondre à un besoin social sur un territoire donné à une logique de grandes associations.
Nous serons peut-être amenés, pour la rédaction de notre rapport, à vous solliciter à nouveau pour élaborer des propositions précises tenant compte de l’évolution législative. Nous avons voté la loi relative à l’économie sociale et solidaire et nous sommes aujourd’hui en plein débat sur l’adaptation de la société au vieillissement. Puis viendra le projet de loi de finances. Si l’on ajoute à cela la réforme territoriale, il est très difficile pour nous, législateur, de vous dire aujourd’hui de quelle façon seront distribués tous les champs d’intervention du médico-social. Il s’agit d’une mutation qui est certainement très difficile à vivre pour vous, tant les incertitudes sont nombreuses. Notre rôle est de vous écouter et de prendre en compte vos besoins tout en nous adaptant à la réalité de la situation et à la raréfaction de l’argent public.
Vous avez parlé de la formation, de la qualification des administrateurs et de leur vieillissement. Pour autant, ce sont des gens qualifiés parce qu’en règle générale, l’investissement associatif est lié à l’investissement que l’on a eu dans sa vie professionnelle. Il faut, compte tenu de l’allongement de la vie, valoriser cette richesse, car c’en est une que la possibilité de mettre son expérience professionnelle au service d’associations comme les vôtres. Cela étant, pour rajeunir, pour diversifier, pour parer au risque de disparition des associations ou à leur fusion, comment voyez-vous l’évolution du bénévolat ? Accepteriez-vous l’idée d’une mise à disposition par les entreprises de personnes qualifiées, dans le cadre d’une forme de mécénat, ou cela vous paraît-il inadapté à votre champ d’intervention ?
D’autre part, n’est-il pas possible de continuer à avancer dans toutes les formes de mutualisation ? La disparition des petites associations peut être vécue difficilement, mais n’est-il pas nécessaire de faire évoluer les prises en charge et les spécialisations ne sont-elles pas indispensables ? Certes, les petites entreprises s’en trouvent fragilisées, mais quelles sont les autres possibilités pour préserver à la fois la liberté associative et la qualité des prestations ?
Vous avez parlé de regroupements multisectoriels : comment comptez-vous procéder ?
Enfin, comment voyez-vous l’évolution des différentes conventions collectives de votre secteur, notamment les deux principales ? Là encore, les différences sont considérables avec l’ensemble des autres secteurs professionnels. Ces conventions ont-elles contribué à vos difficultés budgétaires ou fait entrave à des mutations nécessaires ?
M. Jean-Noël Carpentier. Le message que j’ai entendu en tant que député, c’est celui d’un secteur confronté à de grandes difficultés et, de ce point de vue, la dernière intervention était poignante. Il nous revient de réfléchir à la façon de répondre à vos attentes, celles, non d’associations culturelles, sportives ou ludiques, mais d’un secteur qui touche au cœur de la société, qui s’adresse aux corps comme aux esprits. Vous venez en appui au système social français.
Notre commission d’enquête est chargée « d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle ». Selon vous, monsieur Nouvel, ces difficultés s’aggravent-elles à un rythme accéléré et la crise financière vous semble-t-elle en être la cause, vos partenaires faisant défaut tour à tour par une sorte d’effet domino ?
Notre société vous paraît-elle répondre mieux qu’hier aux besoins sociaux, monsieur Balmary, ou bien avez-vous le sentiment d’une dégradation dans le champ de votre activité ?
M. Jean-Pierre Allossery. Je rencontre nombre d’associations comme les vôtres sur mon territoire : toutes ont un problème de trésorerie, souvent dû au versement en retard des subventions. Bénéficiez-vous de subventions pluriannuelles qui vous assureraient une certaine visibilité ?
Ne pourrait-on étendre au domaine social une pratique que j’ai expérimentée dans d’autres domaines – sport et culture – et qui consiste à verser, en début d’année, 75 ou 80 % de la subvention ? Cela ne résout pas tous les problèmes, mais je pense que ce serait très bénéfique sur le terrain.
M. Régis Juanico. Étant l’un des auteurs du rapport sur la fiscalité du secteur non lucratif et, avec Yves Blein, l’un des auteurs de l’amendement sur le versement transport, je voudrais apporter deux précisions.
La question du versement transport a été évoquée lors d’auditions auxquelles vous avez participé, organisées en vue de notre rapport sur la fiscalité du secteur non lucratif : à cette occasion, des associations faisant l’objet d’un redressement nous avaient alertés sur les risques de contentieux. Certes, nous légiférons en fonction d’une vision un peu générale et, en l’espèce, nous avions sans doute peu d’éléments en matière d’étude d’impact, mais notre amendement visait à sécuriser le périmètre de l’exonération du versement transport pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, en faveur d’associations affiliées dont la position était fragile et dont certaines faisaient l’objet d’un redressement. Le dispositif adopté dans le projet de loi de finances rectificative n’entre pas en vigueur pour le moment. Nous avons décidé, après concertation avec vous, à Matignon, qu’un rapport du Gouvernement serait remis avant le 15 octobre pour mesurer très concrètement les conséquences de cet amendement afin de pouvoir éventuellement corriger, si nécessaire, le périmètre qui y est défini dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2015.
Bien entendu, notre objectif n’est pas de rendre redevables du versement transport des associations ou des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui, jusqu’à présent, ne l’étaient pas. Au contraire, l’objectif est, j’y insiste, de sécuriser l’exonération. Soyez donc assurés que nous allons, en lien avec vous, suivre cette affaire de très près !
Il est exact que 93 % des associations employeuses, qui ne sont pas fiscalisées, n’ont pas droit au CICE. Nous avions évalué l’impact de ce crédit d’impôt et la distorsion de concurrence entre le privé lucratif et le privé non lucratif à environ un milliard d’euros. Nous avons constaté que l’application de dispositifs fiscaux très différents entre les deux secteurs n’entraînait pas de grosses distorsions de prix pour l’usager. S’agissant du CICE, en revanche, il y a une distorsion de concurrence.
Nous avons proposé une mesure qui n’a pas été, pour le moment, suivie d’effet, mais je pense que la modulation de la taxe sur les salaires est une piste qui mérite d’être creusée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015. En effet, 40 % de cette taxe proviennent du secteur médico-social, contre 30 % pour les banques et les sociétés d’assurances – et le problème est, dès lors, que la mesure favorisera le médico-social, mais aussi les banques.
M. Thierry Nouvel. Effectivement, la crise que nous connaissons aujourd’hui a un effet domino. Nous sommes financés essentiellement par le produit de l’impôt et nous savons fort bien que l’argent public se raréfie. Cela étant, nous étions déjà en difficulté avant que ne commence la crise, mais le phénomène s’amplifie : entre 2008 et 2013, le budget des ESAT a diminué de 5 % en euros constants et à nombre de places autorisées constant. Avant la crise, je l’ai dit aussi, aucune association de notre réseau n’était placée en redressement judiciaire ni même menacée de l’être. J’explique donc notre situation par la restriction du financement public, aggravée par des contraintes de gestion de plus en plus pesantes : nous n’avons plus droit à la moindre erreur, qui se paie très cher, surtout pour les petites associations qui n’ont plus aucun filet de sécurité, faute de trésorerie suffisante.
Pour autant, c’est un choix que d’offrir des réponses de proximité grâce à de petites associations n’ayant pas une grande activité gestionnaire. Dans le domaine de la protection juridique par exemple, si l’on veut être vraiment indépendant, il ne faut pas être à la main d’une plus grosse association qui propose de l’hébergement et du soin, parce qu’il ne faut pas que la personne sous tutelle ou curatelle soit prisonnière d’un seul opérateur. Les modes d’organisation ne sont pas neutres en l’espèce.
M. Dominique Balmary. La société répond-elle aujourd’hui de façon adéquate aux besoins de ses membres ? Oui et non. Bien que gascon, je fais cette réponse de Normand, car le premier constat que l’on peut faire, c’est que, depuis une trentaine d’années ou peut-être davantage, nous sommes confrontés à une évolution très importante des besoins en matière d’action sociale, consécutive à l’évolution de la démographie et à celle de nos structures sociales. La demande adressée à nos associations est de plus en plus celle de prestations de services individualisées : nos compatriotes souhaitent une personnalisation de l’accompagnement, des conseils professionnels, des conseils familiaux, etc. Elle se fait aussi de plus en plus complexe, ne se bornant pas à la solution d’un problème particulier – de niveau de vie, de consommation, d’accueil de la petite enfance, etc. D’où le choix, pour les propositions que nous avons faites au Gouvernement l’an dernier et dont est issu le plan de lutte contre la pauvreté, d’examiner l’ensemble des problèmes liés à celle-ci et donc aussi bien les questions de revenu que de santé, d’éducation ou de logement, etc. Bien évidemment, la tâche en devient plus difficile.
La puissance publique – État et collectivités – et le monde associatif – les opérateurs – doivent tirer les conséquences de cette évolution. La première doit travailler à une osmose beaucoup plus grande entre des politiques qui, très souvent, communiquent peu entre elles. Le second doit s’organiser également de manière à mener une action transversale, en développant l’intersectorialité. Nous commençons à le faire mais, d’un côté comme de l’autre, d’immenses progrès restent à accomplir. Nous vivons encore sur des schémas de l’action sociale hérités de la Libération, avec une organisation en grands silos : le handicap, les personnes âgées, la famille… L’administration est organisée de cette façon et, par voie d’imitation, le secteur associatif également. Nous devons décloisonner tout cela, ce qui sera difficile, mais, selon moi, indispensable.
M. le président Alain Bocquet. Merci à tous de ces contributions, des plus riches et intéressantes.
Table ronde « Associations d’élus » :
Mme Corinne Bord, conseillère régionale d’Île-de-France, représentant l’Association des régions de France (ARF) ;
M. Jean-Marie Darmian, membre du bureau de l’Association des maires de France (AMF)
(séance du 9 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Les collectivités territoriales sont devenues des partenaires majeurs des associations, dont elles soutiennent les initiatives qui permettent à plus ou moins grande échelle de tisser du lien social. Ensemble, elles travaillent à mettre en œuvre des politiques publiques déterminées. Dans ce pas de deux institutionnel, les partenaires sont-ils vraiment égaux ? Leurs objectifs sont-ils toujours en harmonie ? Leurs relations se sont-elles transformées dans les années récentes ? Font-elles toujours une place suffisante à l’autonomie du projet associatif ?
C’est pour répondre à toutes ces questions, et certainement à bien d’autres encore, que nous avons le plaisir d’accueillir Mme Corinne Bord, conseillère régionale d’Île-de-France, qui représente l’Association des régions de France, et M. Jean-Marie Darmian, maire de Créon en Gironde de 1995 à 2014 et membre du bureau de l’Association des maires de France.
Mais, préalablement, madame, monsieur, je dois, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Corinne Bord et M. Jean-Marie Darmian prêtent serment)
Mme Corinne Bord, représentant l’Association des régions de France (ARF). C’est la commission « Économie sociale et solidaire » de l’ARF, commission dont je suis membre, qui est compétente pour les relations avec les associations. Les régions – et c’est une spécificité – abordent en effet la question de la vie associative principalement à travers le prisme de l’économie. Je vais y revenir, après une mise au point qui répondra peut-être à votre interrogation sur l’autonomie laissée au projet associatif, monsieur le président.
Nous considérons les nombreuses associations avec lesquelles nous travaillons comme des partenaires dans la quasi-totalité des actions que nous menons – la construction faisant seule exception, d’ailleurs de manière non absolue –, mais nous entretenons avec elles des relations de deux sortes selon qu’elles sont à l’origine d’initiatives auxquelles nous apportons notre soutien – souvent parce qu’elles sont innovantes du point de vue social ou économique – ou qu’elles mettent en œuvre nos politiques publiques en tant qu’opérateurs. Le lien contractuel ne peut être le même dans les deux cas, comme on a dû vous le dire déjà.
Dans le second cas, en tant qu’élus, nous considérons que les associations apportent une vision particulière, mais nous entendons qu’elles mettent en œuvre la politique publique que nous avons définie en fonction de critères précis. Nous avons donc recours, à leur grand dam, à des outils tels que les conventions, les marchés publics ou les appels à projets. Nous estimons légitimement que c’est la meilleure formule pour bien servir les objectifs que nous voulons poursuivre, au service de l’intérêt général tel que nous l’entendons. Il faut trouver, grâce à la discussion, la solution qui concilie au mieux nos exigences respectives dans le cadre des textes juridiques en vigueur, qui ne sont pas toujours simples.
La définition de la subvention telle qu’elle est posée dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire nous aidera, dans le premier cas, à organiser au mieux la collaboration en la sécurisant, répondant ainsi à un souci de nos services juridiques, et permettra au besoin d’introduire un peu plus de souplesse dans nos relations avec les associations.
La particularité de notre approche en termes d’économie sociale nous a conduits à soutenir fortement les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), pour relayer les appels à projets issus des ministères. Au même titre que les entreprises de l’économie sociale et solidaire et que les entreprises classiques, les associations travaillent à l’appui des projets économiques territoriaux. Cela mérite d’être souligné car on insiste en général avant tout sur leur rôle citoyen plutôt que sur leur rôle d’acteurs économiques. Or l’une de leurs revendications est d’être pleinement intégrées dans l’économie sociale et, dans un second temps, de voir l’économie sociale reconnue comme partie prenante du développement économique – vous avez tous eu connaissance des campagnes demandant que l’économie sociale ne relève plus du ministère des affaires sociales, mais de Bercy et qu’elle soit incluse, au niveau régional, dans le champ des affaires économiques et non plus dans celui des affaires sociales. Nous sommes donc en mesure de faire appel aux associations en tant qu’acteurs économiques. Cependant, leur contribution se heurte à certaines limites ou difficultés.
Celles-ci sont d’abord, bien évidemment, d’ordre financier. Nous constatons, à travers les sollicitations que nous adressent les associations, que les régions sont devenues pour elles le financeur ultime. À mesure que l’investissement de l’État a diminué, on a vu, dans les tours de table, s’effondrer à tour de rôle les autres partenaires et ne sont plus restées que nos collectivités qui, disposant encore d’une petite assise même si leur budget est contraint et en diminution, ont dû augmenter leur contribution pour compenser ce désengagement. Les régions finissent ainsi par être la dernière ressource au service de l’emploi et du service public, en particulier pour soutenir le secteur social – l’aide à domicile, notamment.
Lorsque nous faisons part aux associations de nos difficultés de financement et que nous leur opposons le fait qu’elles ne se situent pas dans notre cœur de compétences, elles rétorquent : « Vous nous tuez ! Si vous ne nous subventionnez plus, nous allons devoir mettre la clef sous la porte et licencier. » Ce sont des situations auxquelles nous sommes régulièrement confrontés et je voulais m’en faire ici l’écho.
Autre difficulté : l’affaissement des fonds propres des associations, que nous mesurons au nombre de demandes d’avances ou d’acomptes sur subvention qu’elles nous adressent. Dans la région Île-de-France, la contraction de leur trésorerie atteint des proportions catastrophiques. Lors des tours de table, ceux qui s’engagent se font rares et quand, au cours de l’année, intervient un gel sur tel ou tel poste, elles doivent tirer sur leurs fonds propres, déjà fortement entamés, ce qui les met encore plus en difficulté.
Pour remédier à l’insuffisance des subventions et à l’absence de ressources de fonctionnement pérennes, elles se lancent dans une course aux appels à projets qui permettent de couvrir pour celle-ci 10 % de ses frais, pour celle-là jusqu’à 30 ou 40 %. Stratégie très précaire car il suffit qu’elles ne soient pas retenues pour ruiner leur équilibre financier. De surcroît, cela suppose de consacrer un, voire deux permanents à la paperasserie, donc à des tâches bien éloignées du projet associatif en tant que tel. Il en faut même trois pour les aides du Fonds social européen, dont certaines me font savoir qu’elles ne les solliciteront plus faute de moyens, parce que cela exige des démarches trop complexes alors même que les délais de versement sont d’un an et demi. Cette ressource est ainsi bêtement perdue. La responsabilité de mobiliser ce fonds appartient aux régions, me direz-vous. Vaste sujet… J’indiquerai seulement que nous nous heurtons en la matière à de grandes difficultés.
Nous constatons également, je l’ai dit, des tensions liées aux outils contractuels mis en œuvre. Dans certains secteurs, des pans entiers du mouvement associatif sont dans l’incapacité de répondre aux appels à projets. C’est le cas par exemple dans le domaine du sport, où l’écart se creuse entre fédérations d’amateurs et professionnels, ou encore dans le domaine du tourisme social, où le mouvement associatif a perdu toute une part de sa capacité d’intervention. Mais, qu’on l’accepte ou non, le rééquilibrage au sein du financement public entre subventions, d’une part, et marchés publics et appels à projets, d’autre part, est indispensable : quand nous avons choisi de mener une politique publique déterminée, il est légitime de vouloir qu’elle réponde aux critères que nous avons définis et le choix de l’outil juridique en découle tout naturellement.
La question du bénévolat, également, donne lieu à des constats inquiétants. Selon certaines statistiques, le nombre de bénévoles augmenterait. Nous observons en tout cas, pour notre part, qu’il y a peu de renouvellement dans les équipes dirigeantes des associations, en raison des difficultés auxquelles il se heurte. Lorsque nous organisons des réunions avec les associations à l’échelle régionale, donc avec des têtes de réseau, que voyons-nous ? Absence de parité, quasi-absence de trentenaires ou de quadragénaires et, corrélativement, surreprésentation des quinquagénaires et des retraités. La retraite fait vivre les associations et il conviendrait d’ailleurs de mesurer l’impact du recul de l’âge de départ sur leur fonctionnement…
Il y a de quoi s’interroger sur certains processus simples de démocratie. Tous les acteurs associatifs en témoignent : ceux qui ont fait longtemps vivre leur association ne trouvent pas de relève parmi les bénévoles quand ils souhaitent céder la place. Il y a là tout un travail de formation et d’accompagnement à mener. Se pose également le problème des heures de liberté : un quadragénaire ne dispose pas forcément d’une journée entière pour gérer une association, il ne peut s’y consacrer que le soir ou le week-end. La question du congé d’engagement bénévole, dont la création a été évoquée un temps, mériterait d’être reposée. Pour le financement de la formation, des solutions de type syndical ont été trouvées pour les associations employeuses mais, pour les associations sans salariés, cela se révèle plus difficile alors même que les règles qui régissent les demandes de subvention sont de plus en plus complexes. Il est essentiel de simplifier ces procédures. Nous, régions, pouvons nous engager dans cette voie, mais il n’en faut pas moins que les bénévoles soient formés.
Il importe également de travailler à la mutualisation. Nous essayons de la développer, en Île-de-France comme dans d’autres régions. Nous encourageons les groupements d’employeurs permettant une mutualisation territorialisée des moyens, ne serait-ce que parce qu’une partie de la politique de l’emploi repose sur la capacité des associations à embaucher. Or il n’est pas facile pour un bénévole de soixante ou soixante-dix ans, qui tient son association à bout de bras, de créer un emploi. Il y a cependant un secteur qui tire bien son épingle du jeu, car il s’agit d’un secteur hybride : c’est celui de la culture.
Enfin, nous tenons à appeler votre attention sur un sujet qui est pour vous d’actualité. Nous considérons les associations comme des vecteurs d’innovation sociale : nous l’avons constaté en matière de petite enfance et nous le constatons aujourd’hui en matière d’aide à domicile. Selon nous, il faut désormais anticiper en travaillant à structurer l’emploi dans les services à la personne. Plus le personnel est professionnalisé, meilleur est le service qu’il rend, mais plus il est cher aussi, ce qui conduit à une sélection des bénéficiaires. La situation est similaire à cet égard à celle du secteur du logement où, avec la substitution de l’aide à la personne à l’aide à la pierre, on a perdu la maîtrise des prix. Nous devons donc arbitrer entre la solvabilisation de la demande, qui est souvent un puits sans fond, et le soutien à la structure du secteur économique en tant que tel, qui apparaît nécessaire. Puisque la loi sur l’adaptation au vieillissement est aujourd’hui en discussion, nous devons nous pencher sur ces questions, portées à notre connaissance par les associations qui relaient ainsi une demande sociale. Nous, régions, essayons de « penser » l’opérateur en même temps que le dispositif, ce qui n’est pas simple. Mais structurer la demande et l’offre de services et le champ des opérateurs économiques a son importance pour un territoire : ce sont l’emploi et la cohésion qui sont en jeu. La simple libéralisation ne saurait suffire, dans aucun secteur.
M. Jean-Michel Darmian, membre du bureau de l’Association des maires de France (AMF). Monsieur le président, je tiens d’abord à préciser que je ne suis plus maire. Étant opposé au cumul des mandats pour une trop longue durée, je me suis appliqué ce principe à moi-même : quarante ans de mandat, cela m’a paru suffisant.
L’AMF, par constitution, représente nos 36 000 communes et l’expérience dont je vais vous faire part touche sans doute une strate de la vie associative différente de celle dont il vient d’être question. Les associations constituent le tissu de proximité le plus important sur l’ensemble du territoire.
Selon une étude – que je vous invite à lire – parue au deuxième trimestre de cette année dans JurisAssociations, 49 % des ressources de l’ensemble des associations en France sont des ressources publiques : 12 % proviennent du bloc communal, 12 % du bloc départemental et 4 % des régions. À l’intérieur de ces premiers 12 %, la proportion des subventions – le mot a ici son importance et j’y reviendrai – s’élève à 25 %.
L’AMF s’est mobilisée en faveur du secteur associatif, à la demande de celui-ci mais surtout à la demande de Mme Fourneyron, alors ministre en charge de la vie associative, qui a tenu à ce que soient pris en compte les changements intervenus depuis la signature de la Charte des engagements réciproques de 2001 : dans le partenariat avec les associations, l’État n’est plus le seul acteur, les collectivités territoriales sont devenues parties prenantes. Pendant dix-huit mois, avec les autres organisations d’élus, l’AMF a ainsi travaillé avec les associations pour tenter de répondre à leurs attentes et à leurs inquiétudes.
Se pose tout d’abord pour elles la question de l’application de ce que j’appellerai le traité européen sur la concurrence libre et non faussée. Une grande part de leurs difficultés provient en effet de l’interprétation que font les institutions européennes de cette notion et de l’application qu’elles en font au statut des associations loi de 1901 en France, Bruxelles raisonnant davantage en termes de fondations que d’associations. Ce problème a donné lieu à la fameuse circulaire Fillon, qui a mis en alerte le monde associatif, ainsi qu’à deux lois, dont celle relative à l’économie sociale et solidaire, à l’élaboration de laquelle l’AMF a été associée. Cependant, je me limiterai ici à la question des relations entre associations et secteur marchand.
Pour donner la mesure de ce problème à l’échelle du bloc communal, je vais citer des cas très concrets dont j’ai eu personnellement connaissance en tant que maire. Une commune peut-elle continuer à subventionner un cinéma de proximité associatif lorsqu’existe dans son environnement immédiat un multiplexe ? Le cinéma associatif relève-t-il ou non du secteur marchand ? Un professeur de judo s’établissant dans une commune en tant qu’auto-entrepreneur dans une salle répondant aux normes d’accueil est-il un concurrent du club de judo qui rémunère ses professeurs ? Une personne donnant des cours de guitare concurrence-t-elle l’école de musique communale ou associative ? L’AMF a aussi été saisie de plusieurs recours posant la question de savoir si l’on devait continuer à subventionner une crèche parentale alors qu’une crèche privée, agréée par la caisse d’allocations familiales (CAF), rendait les mêmes services…
Je pourrais poursuivre l’énumération en mentionnant les coopératives, nombreuses en milieu rural, ou entrer dans le détail de tous ces problèmes sur lesquels les juristes de l’AMF ont dû se pencher. Il semblerait que la loi relative à l’économie sociale et solidaire ait permis d’en résoudre certains. Son élaboration a été très difficile et, nous le savons pour avoir participé à de nombreuses réunions préparatoires, elle a fait l’objet d’un travail très fin, mais son application est récente et nous devons attendre pour voir si ces difficultés sont résolues ou non.
Ensuite, inutile de le cacher, plusieurs points du projet de réforme territoriale suscitent une grande angoisse dans le monde associatif. J’ai récemment participé à un colloque sur les comités départementaux de sport : que vont-ils devenir si le conseil général ne dispose plus de la compétence générale en la matière ? Le sport doit-il renoncer à cet échelon d’organisation ? Le bloc communal, quant à lui, aide au fonctionnement des associations en vertu de cette même compétence générale et cela s’ajoute aux subventions versées par le département : cette possibilité de cumul va disparaître si on revient sur la clause de compétence générale. D’autre part, qui va réguler le partage des compétences dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme ? Le bloc communal deviendra-t-il le seul financeur du système associatif, sachant que les montants en cause dépassent le milliard d’euros ? L’intercommunalité soutient le milieu associatif lorsque sa compétence le lui permet, mais il est certain qu’une éventuelle suppression des conseils généraux aurait de lourdes conséquences financières pour les collectivités du bloc communal.
J’en viens aux restrictions budgétaires qui vont aller crescendo pendant les trois prochaines années. Si l’on répercute la diminution de la dotation aux collectivités locales inscrite dans le budget pour 2014 sur la dotation pour subventions aux associations, on peut aller jusqu’à une baisse de 3 milliards d’euros ! Ainsi le conseil général de la Gironde, dont je suis le vice-président chargé des finances, a appliqué une baisse générale de 18 % à ses subventions aux associations, quel qu’en soit l’objet social. L’inquiétude du bloc communal est donc de savoir qui compensera la disparition des dotations dans l’hypothèse où la réforme territoriale entrerait en vigueur.
Quelles sont nos propositions ?
L’AMF, l’ARF, l’Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et, dans une bien moindre mesure, l’Assemblée des départements de France (ADF) ont rédigé une nouvelle Charte d’engagements réciproques qui peut se décliner aux niveaux régional, départemental et local. Mme Fourneyron en attendait qu’elle sécurise le partenariat entre collectivités et associations. L’essentiel de nos discussions a porté sur le choix entre le mot « subvention » et le mot « soutien ». Il était pour nous très important que le milieu associatif prenne conscience que la subvention n’est pas le seul moyen de le favoriser. Le soutien recouvre en effet la mise à disposition de locaux et la prise en charge de leur entretien et de leur fonctionnement, et le terme a donc une acception beaucoup plus large que celui de subvention. En outre, alors que la subvention est variable, le soutien est davantage à long terme : la mise à disposition d’un local permettra par exemple à un club de judo de perdurer même si la subvention dont il bénéficie baisse.
L’AMF constate que la Charte n’a été appliquée dans aucune région, aucun département, aucune commune de taille moyenne. J’ai rencontré il y a quatre mois le préfet de la Gironde pour insister sur la nécessité de la mettre en œuvre : j’attends toujours. De leur côté, les associations réclament des conventions permettant l’établissement de rapports beaucoup plus fiables avec les collectivités territoriales, notamment avec le bloc communal, échelon de proximité dont elles ont un impérieux besoin. Dans le cadre de la Charte, elles ont demandé des plans de soutien d’une durée de trois ans, qui leur permettraient de créer des emplois durables alors qu’aujourd’hui tout peut être remis en cause chaque année.
L’AMF plaide pour le conventionnement. Il paraît utile, dans le respect des compétences respectives des collectivités et des associations, de lier le soutien à un conventionnement clair, qui éviterait aussi bien des observations de la Cour des comptes que le risque de conflits de personnes. La formule nous semble d’autant plus s’imposer que, dans cette période d’incertitudes, elle tranquilliserait les responsables associatifs.
La Charte insiste en faveur d’un statut du bénévole. Dans une commune, un bénévole responsable d’un club de football comptant 300 ou 400 licenciés a au moins autant d’importance sociale que le vingt-neuvième conseiller municipal. Or ces gens ne sont pas reconnus pour ce qu’ils font. Un poste en particulier devient très difficile : celui de trésorier. Les volontaires pour l’occuper se font de plus en plus rares car cela implique d’assumer des responsabilités de plus en plus lourdes, qu’il s’agisse des déclarations fiscales, de la déclaration de la TVA ou des exonérations de charges sur les manifestations.
Par ailleurs, il faudrait revoir les seuils. La réalisation d’un montant de recettes d’exploitation tirées d’une activité lucrative excédant 60 000 euros entraîne, comme vous le savez, la déchéance du statut d’association à but non lucratif. Or ce seuil est bas puisqu’il ne s’applique pas, contrairement à ce qu’on croit souvent dans le milieu associatif, à la seule subvention, mais au soutien, à savoir à l’ensemble des aides. Si on le maintient à ce niveau, je suis persuadé que, dans trois ans, bien des associations basculeront dans le secteur marchand alors même que la subvention dont elles bénéficient sera inférieure à 60 000 euros. Ce pourrait être le cas, par exemple, des crèches parentales qui, si l’on additionne la mise à disposition des locaux, la fourniture des fluides, la subvention même modique de la collectivité et celles de la CAF, dépassent ce montant.
Le législateur devrait élaborer une définition bien plus claire que celle qui est en vigueur du secteur non marchand. Il importe de préciser que certains secteurs associatifs
– petite enfance, culture… – ne font pas partie du secteur concurrentiel. D’autre part, il conviendrait d’assouplir certaines règles, régissant par exemple la location de salles.
L’AMF soutient la proposition de la Charte visant à créer des maisons des associations comme il y a des maisons de services publics. Dès lors qu’on considère que les associations rendent un service public, elles devraient être regroupées au sein d’un lieu qui pourrait bénéficier du soutien du bloc communal. Il s’agirait de mutualiser des espaces au sein desquels la vie associative pourrait s’exprimer.
L’ARF a raison d’encourager les groupements d’employeurs associatifs, en particulier dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pour laquelle de nombreux maires ont fait appel au système associatif mais en se heurtant chaque fois à l’obstacle des horaires, très parcellisés. Ainsi, quand vous demandez au club de judo de votre commune de prendre en charge une activité, celui-ci va déléguer quelqu’un pour seulement quatre heures par semaine, mais cela ne fait pas un emploi. Or, dans les territoires ruraux, on imagine mal cinq maires signer cinq contrats de quatre heures. Dans ma commune cependant, afin de proposer des activités de gymnastique rythmique, la fédération a créé un groupement d’employeurs et met des personnes agréées à la disposition de plusieurs municipalités, grâce à quoi les maires n’ont pas de déclaration d’emploi à faire. Il faut absolument développer ces groupements.
Enfin, il faudrait relancer l’apprentissage associatif à travers la coopération à l’école qui, jadis, favorisait la relève des bénévoles, et, dans les collèges et les lycées, à travers les foyers socio-éducatifs, actuellement en déshérence parce qu’on ne sait pas qui doit les financer – le ministère de l’éducation nationale, la collectivité territoriale concernée, les parents d’élèves ? Les instituteurs ont assuré cet apprentissage de la vie associative pendant des années, de même que de nombreux professeurs animant des clubs. Or ces structures doivent aujourd’hui vivre avec presque rien.
Je terminerai en vous encourageant vivement à peser de tout votre poids pour que la Charte d’engagements réciproques soit signée et appliquée, tant il est assuré qu’elle faciliterait les relations entre associations et collectivités territoriales.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Vos propositions, concrètes et très complètes, nous seront extrêmement utiles, notamment sur les moyens de mobiliser la jeunesse en faveur de la vie associative : il en va de la cohésion sociale.
Comment pensez-vous qu’il faille agir pour mettre en œuvre la Charte d’engagements réciproques ?
Mme Corinne Bord. À l’occasion d’un débat sur la simplification de ses procédures, en juin dernier, le conseil régional d’Île-de-France a décidé de commencer à appliquer la Charte dès cet automne en allant crescendo : en effet, de nombreuses politiques publiques sont concernées par ses dispositions, ce qui nous impose de revoir la quasi-totalité de nos délibérations ainsi que notre règlement financier. Nous travaillons donc avec les associations pour avancer pas à pas tout en tenant compte de leurs priorités. Nous comprenons d’autant mieux l’intérêt d’un conventionnement pluriannuel qu’aujourd’hui, nous passons quasiment une convention pour chaque subvention – celles-ci étant en général destinées à des têtes de réseau, les sommes en jeu sont importantes. Nous avons bien avancé en ce qui concerne le versement d’acomptes et d’avances de trésorerie. Nous progressons ainsi étape par étape dans la mise en œuvre de cette Charte, qui est avant tout une question de volonté politique.
M. Jean-Louis Bricout. Je souhaite revenir sur la réforme des rythmes scolaires, que j’ai appliquée dans ma commune de quelque 6 000 habitants dès 2013, ce qui me donne un certain recul. Je me suis appuyé sur une association pivot, un centre social et culturel dont les permanents, qui connaissent bien le sujet, s’occupent de l’organisation des rythmes scolaires. Je me suis également appuyé sur la bibliothèque municipale et sur les associations sportives et culturelles. Nous avons beaucoup travaillé avec la région Picardie, qui a adopté un dispositif de soutien aux emplois d’avenir, mais aussi avec le département, afin de faciliter l’intégration de jeunes au dispositif, en particulier grâce à l’encadrement de professionnels.
J’ai constaté, dans ma ville, un gonflement des effectifs de certaines associations. Avez-vous relevé ce phénomène dans d’autres villes ? Quel est, en outre, le degré d’implication des associations dans la réforme des rythmes scolaires ?
Je confirme votre constat de distorsions entre le secteur associatif et le secteur privé et sur le risque de concurrence. Par exemple, si un professeur de danse crée une association, s’auto-emploie et exerce l’activité concernée, nous sommes dans l’embarras : devons-nous le subventionner ou non ? Quelles solutions préconisez-vous pour régler ces situations, délicates pour les élus ?
Enfin, au-delà d’un montant de 23 000 euros de subventions, la signature d’une convention d’objectifs est obligatoire. Quel est votre avis sur le niveau de ce seuil ?
M. Régis Juanico. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales prévoit la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions, mais le maintien d’une compétence partagée pour le tourisme – dont la région sera le chef de file –, pour la culture et pour le sport – sans chef de file dans ces deux derniers cas, pour le moment. Reste que la vie associative ne se résume pas au tourisme, à la culture et au sport. Aussi faut-il, selon vous, ajouter la vie associative aux domaines relevant de la compétence partagée ?
M. Christophe Premat. Nous souffrons, comme vous l’avez montré, d’une sorte de « darwinisme » associatif du fait de la course aux appels à projets. Ne peut-on renverser la problématique et inciter davantage à l’évaluation participative en s’appuyant, si l’on sanctuarise les priorités, sur la demande citoyenne, même si ce doit être plus difficile aux niveaux régional et départemental qu’au niveau du bloc communal ? Il faudrait orienter au mieux les associations, les élus conservant le monopole de la définition des politiques publiques, mais on conçoit trop souvent l’évaluation des politiques publiques suivant un format assez rigide et il est dommage de ne pas susciter à la base l’initiative associative au moment où l’on en déplore le déclin et l’éparpillement.
D’autre part, le volontariat civique senior, en lien avec le Haut Conseil de l’âge, peut avoir son intérêt pour la transmission de la « fibre associative » entre générations. Ne peut-on en effet inciter ce type de structures – je songe aussi aux conseils des aînés dans les communes – à stimuler la volonté associative qui fait défaut ?
M. le président Alain Bocquet. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait mieux valoriser ce qu’apporte le bloc communal aux associations locales, dont le soutien ne se résume pas, en effet, à la subvention ? Mais ce soutien peut parfois poser problème. Si les chambres régionales des comptes ne sont pour l’heure pas très « regardantes », elles commencent à le devenir et certaines associations portées à en prendre à leur aise et à privatiser une partie de leur activité pourraient connaître des difficultés. Or les maires sont parfois démunis devant de telles situations, même si l’AMF peut leur apporter une aide juridique.
M. Jean-Marie Darmian. Le danger d’impliquer les associations dans la réforme des rythmes scolaires tient en un mot, celui de « prestation ». Le code des impôts est formel : si l’association devient prestataire, elle entre ipso facto dans le secteur marchand. D’où l’importance d’un conventionnement clair qui atteste que l’association anime une activité à visée sociale, mais qu’elle n’est pas prestataire puisque vous définissez un prix fondé par exemple sur une convention collective. Toute participation associative dans le cadre de cette réforme doit être définie par une convention d’objectifs, faute de quoi des problèmes seront inévitables à terme. Ainsi la Cour des comptes a-t-elle pu signifier à certaines associations au volume d’activité très important qu’elles se livraient à une prestation de services, et non plus à du bénévolat. L’AMF devrait élaborer une convention type, même s’il peut suffire d’adapter la Charte d’engagements réciproques pour en faire une charte communale.
Ce serait sûrement une excellente chose d’ajouter la vie associative au nombre des domaines de compétence partagée dans le projet de loi de réforme territoriale.
Enfin, des initiatives intéressantes sont prises par certaines fédérations sportives pour le renouvellement du bénévolat. Celle de handball, par exemple, a mis en place des doubles bureaux ; ainsi, au moment du renouvellement, le second bureau peut prendre la place du premier en étant déjà formé aux tâches à accomplir. Dans ma commune, à chaque fois qu’une association double ainsi son bureau, la subvention qui lui est accordée est majorée. Nous savons du reste que le handball a un fonctionnement plutôt « citoyen ».
M. le président Alain Bocquet. Le double bureau est une manière de démocratiser les putschs. (Sourires.)
Mme Corinne Bord. De nombreuses régions ont complété le dispositif des emplois d’avenir sur une quote-part contributive. Ainsi en Île-de-France : un projet ne peut être signé avec la région que s’il prévoit un contrat à durée indéterminée. Mais cela ne suffit pas à satisfaire notre souci d’assurer au jeune salarié d’une petite association un processus continu d’insertion, qui suppose un plan de formation bien conçu et des relations de travail formatrices, lui permettant d’évoluer. À cet égard, la formule du groupement d’employeurs paraît plus adaptée parce que l’entreprise, y compris dans le cadre associatif, se révèle plus structurante.
Ensuite, je note que les secteurs dans lesquels les régions interviennent sont bien plus nombreux que ceux précédemment mentionnés : à la culture, au sport et au tourisme, il faut ajouter l’environnement, la formation, la politique de la ville… Les collectivités de tous niveaux doivent pouvoir définir une politique publique et soutenir la vie associative dans chacun de ces secteurs. Rien ne serait pire en effet que de faire relever la vie associative de la compétence exclusive d’un niveau de collectivité, qui se retrouverait étouffé financièrement en même temps qu’on perdrait le bénéfice de liens intéressants.
Les acteurs associatifs, grâce à leur mode de fonctionnement, à leur proximité avec le terrain, à leur petite taille même, sont bien plus créatifs et réactifs que les structures régionales ne pourront jamais l’être. La vie associative ainsi entendue permet de faire émerger un modèle économique différent, à même de répondre à des attentes que nous n’aurions même pas identifiées. La région Île-de-France promeut par conséquent un appel à projets « Innovation sociale », la seule exigence imposée à la structure créée étant d’innover, en sus de dépendre de l’économie sociale. C’est pour nous un moyen de répondre à la demande sociale.
M. Christophe Premat. Que recouvre l’expression « innovation sociale » ?
Mme Corinne Bord. Le fait que la structure n’a pas d’équivalent ailleurs, qu’elle promeut de nouvelles pratiques sociales.
M. Christophe Premat. Cela touche au mode de fonctionnement de la structure ?
Mme Corinne Bord. En effet, mais aussi au mode de financement, au modèle économique. Il faut bien trouver le moyen d’innover en matière sociale sachant qu’il n’existe pas de brevets dans ce domaine.
Il ne faudrait pas que le volontariat soit la porte par laquelle les jeunes entreraient dans le monde de l’emploi et par laquelle les seniors en sortiraient. Je rêve d’une grande agence qui traiterait de tous les volontariats, du service civique au volontariat senior en passant par le volontariat international et européen, qui relèvent aujourd’hui chacun d’une agence différente. Il reste beaucoup à faire en termes de mutualisation et d’économies.
M. Christophe Premat. Le terme « volontariat » est-il adapté ? À l’étranger, des volontaires civiques, dans le cadre du volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), sont des employés.
Mme Corinne Bord. La rémunération d’un volontaire, dans une structure associative, n’est pas prise en compte dans la masse salariale ni dans les calculs de seuil. Reste qu’il faudrait réunir les conditions d’une continuité du volontariat tout au long de la vie.
Pour favoriser le bénévolat, il conviendrait de promouvoir les associations juniors et d’abaisser l’âge d’entrée dans la vie associative. Cela étant, le frein à l’engagement associatif, quand on a trente ou quarante ans, n’est pas lié à l’éducation mais au temps dont on dispose. La question se pose donc de consentir quelques heures d’allégement aux salariés désireux de s’engager dans une association, et de valoriser professionnellement cet engagement.
M. le président Alain Bocquet. Je vous remercie, madame, monsieur, pour vos contributions.
Table ronde « Associations de consommateurs et usagers » :
Mme Corinne Rinaldo, secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement ;
M. Stéphane Pavlovic, directeur de la Confédération générale du logement ;
M. François Carlier, délégué général de la Confédération consommation, logement et cadre de vie ;
M. Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir, et Mme Béatrice Delpech, directrice adjointe à l’action politique
(séance du 23 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle table ronde « sectorielle » consacrée aux associations de consommateurs et d’usagers.
Nul n’ignore l’importance d’un mouvement consumériste puissant pour protéger les intérêts des consommateurs. L’action des associations que vous représentez est tout à fait complémentaire de celle des services de l’État. Il est donc normal que celui-ci ait accompagné le développement du mouvement par différents dispositifs, dont l’instauration d’organismes tels le Conseil national de la consommation et l’Institut national de la consommation, l’agrément des associations de consommateurs et les diverses conventions d’objectifs afférentes aux subventions.
La crise économique qui sévit depuis plusieurs années amène à revoir le dimensionnement des dispositifs de soutien public. Dans quelle mesure cette évolution affecte-t-elle le fonctionnement et le dynamisme de vos associations ? Avez-vous besoin de renouveler votre partenariat avec la puissance publique, ou d’établir des partenariats avec de nouveaux partenaires ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Corinne Rinaldo, M. Stéphane Pavlovic, M. François Carlier, M. Alain Bazot et Mme Béatrice Delpech prêtent serment)
Mme Corinne Rinaldo, secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement. Veuillez excuser, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, l’absence du président de notre confédération, M. Eddie Jacquemart, retenu par le congrès de l’Union sociale pour l’habitat. Je le représenterai devant vous, à titre de secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement (CNL), plus particulièrement chargée du secteur consommation.
La CNL est une association de consommateurs, agréée comme telle depuis 1980, qui a pour spécificité de se consacrer au logement, à l’habitat et son environnement. Dans ce domaine, nous sommes aujourd’hui la première organisation de défense des usagers. Notre association contribue notablement à l’exercice de la démocratie et de la citoyenneté, dans tous les types d’habitat, et en particulier dans l’habitat social. Également reconnue dans le secteur de la consommation, la CNL réunit une centaine de fédérations départementales et plus de 4 600 associations locales. Notre association se caractérise par un maillage serré du territoire grâce à ses nombreux bénévoles. Il est important d’en avoir conscience pour comprendre les difficultés que nous rencontrons au niveau national et local.
En effet, le développement des associations est aujourd’hui freiné par une réglementation qui complique toutes nos activités et pose problème aux bénévoles qui se dévouent sur le terrain. Nos difficultés sont de deux types : administratives et financières.
Les dysfonctionnements dont souffrent les institutions consuméristes affectent plusieurs des dispositifs que vous avez évoqués, monsieur le président, dont l’installation du nouveau Conseil national de la consommation, que nous appelions pourtant de nos vœux, mais aussi les conventions d’objectifs proposées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la reconnaissance par l’agrément de l’utilité des associations.
Si la nôtre est considérée comme la première organisation de défense des usagers du logement, c’est grâce aux élections des représentants des locataires, en vue desquelles nous sommes entrés en campagne puisque le renouvellement de nos administrateurs aura lieu du 15 novembre au 15 décembre de cette année. Nous souhaitons depuis longtemps que la participation citoyenne à ces élections soit encouragée dans les quartiers et nous avons plusieurs fois demandé au Gouvernement d’y œuvrer activement, ce que nous n’avons jamais vraiment obtenu. Nous demandons aussi depuis longtemps que soit reconnu le statut d’élu social, par exemple sous la forme d’autorisations d’absence et de possibilité de remplacement des heures effectuées par les bénévoles qui occupent par ailleurs un emploi salarié. Nous souhaitons également que les bénévoles bénéficient d’un statut permettant de les rémunérer sous forme de chèques restaurants ou de chèques cadeaux.
La CNL est une organisation à caractère syndical, mais ce n’est pas un syndicat. Elle est composée de militants bénévoles et de dirigeants politiques, qui sont des dirigeants salariés. Il semble donc souhaitable de créer un statut spécifique nous permettant d’avoir des dirigeants salariés dont le nombre ne serait pas, comme aujourd’hui, limité à un ou deux, selon notre budget.
J’en viens aux difficultés financières. Nous approuvons les propositions que les représentants du mouvement associatif vous ont transmises à ce sujet. Alors qu’une partie de nos financements émane des pouvoirs publics, on constate depuis quelques années une baisse importante des subventions – elle atteint cette année 9,9 % pour la subvention consommation et 12,5 % pour la subvention FDVA (Fonds de développement de la vie associative, ex-CDVA) destinée aux formations. Dans ce contexte, il ne nous paraît pas très juste que des associations gestionnaires qui bénéficient déjà de prix de journée, de subventions et d’autres financements soient elles aussi éligibles au FDVA. Il conviendrait de revoir les financements attribués aux associations en tenant compte de la visée véritable des formations.
Naturellement, ces difficultés ont un effet notable sur nos emplois.
Nous souhaitons aussi que les conventions d’objectifs, aujourd’hui triennales, redeviennent annuelles afin de faciliter notre partenariat avec la puissance publique. Même si le dossier CERFA a été simplifié, les documents qui nous sont demandés par les institutions peuvent nous poser de gros problèmes, au niveau local comme à l’échelle nationale. D’autant qu’en sus des subventions, destinées à financer notre fonctionnement et nos actions, on nous demande souvent d’élaborer des projets. La tâche est délicate pour nos militants, notamment lorsqu’il s’agit de constituer le dossier en ligne, par exemple pour le FDVA. Les associations locales s’en plaignent. Autre exemple : alors qu’il y a quelques années c’étaient les fédérations départementales qui demandaient la subvention consommation aux directions départementales de la consommation, cette compétence a été transférée aux instances nationales, ce qui alourdit considérablement notre travail et pose problème à un nombre croissant de militants bénévoles. Tout cela nécessite selon nous de revoir ces formalités.
À la baisse des subventions s’ajoute l’incertitude quant à celles que nous allons percevoir. Ainsi, nous n’avons à ce jour aucune nouvelle de la subvention logement, sans parler de celle que nous touchons, comme association représentative du secteur du logement, de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Comment, dès lors, savoir de quelles sommes nous disposerons pour financer notre fonctionnement ? Nous aimerions donc que les subventions soient versées par mensualités ou sous la forme d’un acompte en début d’année.
On constate également des inégalités touchant au dédommagement des frais de déplacement. Nous souhaitons pour notre part que ceux-ci soient pris en charge dès lors qu’ils permettent la participation à l’installation d’une instance par les services publics, que ce soit au niveau national, régional ou local. Ainsi, nous sommes indemnisés sous forme de vacations pour les déplacements que nous effectuons afin de siéger au sein de l’instance départementale de concertation, mais ces vacations sont imposables, ce qui ne nous paraît pas normal.
La CNL a connu une année difficile à la suite du refus du Gouvernement, en 2010, de reconduire son agrément comme association de consommateurs. L’opposition d’alors, aujourd’hui majoritaire, nous a beaucoup aidés – nous avons pu compter sur vous, monsieur le président – et nous avons été agréés de nouveau. L’exécutif a ensuite argué du fait que notre publication Logement et Famille contenait des publicités, en l’occurrence pour des entreprises comme EDF-GDF ou des organismes comme l’Agence nationale de l’habitat, pour contester la légitimité de notre agrément. En réponse, nous avons fait état de nos partenariats avec ces acteurs, destinés à mieux informer les consommateurs des risques à prévenir ou des économies d’énergie réalisables. En définitive, nous avons retrouvé notre agrément, mais toutes les associations de consommateurs agréées ont la même épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Il va donc falloir éclaircir cette situation. Les pouvoirs publics ne peuvent pas refuser l’agrément à une association puis nous dire un an plus tard, par la bouche de la DGCCRF, que nous devrions développer des partenariats avec des entreprises privées pour tenir compte de la baisse des subventions ! Cette suggestion nous laisse dubitatifs : nous n’avons aucune envie de revenir deux ans en arrière et de risquer de perdre des financements publics ou notre agrément parce que nous nous serions liés à des entreprises privées qui n’appartiennent pas à notre secteur.
Les associations sont essentielles au tissu social. Le mouvement associatif doit conserver sa force et rester un partenaire pour les pouvoirs publics.
M. Stéphane Pavlovic, directeur de la Confédération générale du logement. Le sujet qui nous occupe est complexe, du fait de la diversité du monde associatif et de ses problèmes. On méconnaît souvent la structure et le fonctionnement des associations, qui varient considérablement de l’une à l’autre, y compris parmi les associations de consommateurs.
La Confédération générale du logement a été créée à la suite de l’appel de l’abbé Pierre, en 1954. Des comités de sans-logis se sont d’abord formés pour aider ceux qui étaient dans la rue, puis, au fil du temps, il est apparu de plus en plus nécessaire non de protéger les personnes dans leur logement, mais de défendre leurs droits : c’est le concept de droit au logement, pour lequel la CGL a milité.
Nous sommes une organisation pyramidale, un peu sur le modèle d’un syndicat, avec une confédération nationale et des unions départementales regroupant elles-mêmes des associations – environ 300 – composées d’adhérents individuels – quelque 20 000 au total. Nous revendiquons notre spécificité en matière de logement, bien que nous soyons également agréés comme association de consommateurs.
Cette structure pyramidale explique notre fonctionnement. Notre activité se décline ainsi selon trois axes. Premièrement, l’aide juridique et matérielle à nos structures locales et départementales. Deuxièmement, l’aide aux usagers du logement, au cœur de notre action : des personnes viennent nous voir parce qu’elles sont confrontées à un problème individuel ou collectif, le plus souvent d’ordre juridique, lié à leur logement – avec leur propriétaire, leur syndic, leur constructeur. Certains adhérents sont constitués en association, par exemple les locataires d’une résidence du parc HLM qui veulent faire front face au bailleur. Troisièmement, nous assurons, comme aujourd’hui devant vous, une mission de représentation et de consultation auprès des pouvoirs publics, devant différentes instances, dans le cadre de groupes de travail ou de commissions.
Je vous exposerai d’abord les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, puis quelques pistes de réflexion en vue d’améliorer la situation.
En premier lieu, nous avons du mal à mobiliser des financements qui sont en baisse. Ce problème est aggravé par les lourdeurs administratives. Les moyens dont nous disposons sont faibles au regard de l’ampleur de notre tâche. Je ne m’attarde pas davantage sur cet aspect très connu.
Ce sont ensuite les bénévoles que nous peinons à mobiliser, car le secteur du consumérisme lié au logement est très technique. Pour être capable d’aider les personnes qui s’adressent à nous à propos d’un litige, il faut plus qu’une petite formation de quelques jours. Il ne suffit pas de se retrousser les manches comme dans le secteur caritatif.
Nous rencontrons également des difficultés dans nos relations avec le grand public : ceux qui viennent nous trouver ont du mal à comprendre que nous leur fassions payer une cotisation d’adhésion – puisque nous ne pouvons aider que nos adhérents, conformément à la loi réglementant la profession d’avocat – alors même que nous sommes subventionnés.
Vis-à-vis des pouvoirs publics, il peut être délicat d’être à la fois un partenaire et, si l’on peut dire, un adversaire. Souvent perçus comme militants et revendicateurs, parfois à l’excès, nous devons aussi nous agir avec les pouvoirs publics pour améliorer la situation. C’est une antinomie dont on souffre beaucoup dans le secteur du logement. Il nous est difficile de défendre une association de locataires contre un office public dirigé par sa collectivité de rattachement, par exemple le maire lorsqu’il s’agit d’un office communal, et de composer par ailleurs avec cet élu dans un autre contexte pour demander des subventions. Autre exemple : lorsque le président de l’Union sociale pour l’habitat, député, soutient un amendement contraire aux intérêts des locataires, cela nous pose un gros problème.
J’en viens à nos pistes d’amélioration. Premièrement, l’exonération fiscale de la cotisation, qui existe déjà mais reste très compliquée à mettre en œuvre : les textes ne sont pas explicites et nous devons sans cesse interroger les services fiscaux pour nous assurer que nous pouvons en bénéficier. Il serait bon que nous puissions informer clairement nos adhérents de cette possibilité.
Deuxièmement, la valorisation du statut du bénévole. Il existe différents moyens de favoriser dans le droit du travail la participation à l’activité d’une association telle que la nôtre.
Troisièmement, la simplification administrative des demandes de subvention. Il faut également éviter de multiplier les appels à projet, car nous ne pouvons passer notre temps à chercher des financements, au détriment du cœur de notre activité. Pourquoi pas un guichet unique des financements ?
Enfin, sans aller jusqu’à en faire un mode de financement des associations, nous avons proposé d’articuler à l’action de groupe l’ensemble des actions en justice pouvant être intentées par les associations de consommateurs. Il est dommage que les parlementaires n’aient pas véritablement pris cette proposition en considération : on s’est focalisé sur l’action de groupe sans penser aux associations de consommateurs qui devront la financer ni à la possibilité de la lier aux autres actions collectives.
M. François Carlier, délégué général de la Confédération consommation, logement et cadre de vie. Née en 1952, la Confédération consommation, logement et cadre de vie (CLCV) est forte de 31 500 adhérents, dont 60 % sont venus à nous en raison de litiges en matière de consommation et 40 % à propos de leur logement, en particulier des groupements de locataires de HLM. Nous avons 415 administrateurs locataires HLM, désignés lors des élections HLM.
À nos yeux, la grande particularité des associations de consommateurs est leur indépendance financière vis-à-vis des professionnels. Nous le sentons lorsque nous discutons avec des associations d’autres secteurs. C’est très important : lorsque la CLCV s’exprime à propos du prix de l’énergie ou de la qualité des poissons, elle dit ce qu’elle veut. Cette indépendance doit être préservée. La subvention DGCCRF, que l’on peut juger élevée et dont on pourrait envisager sans s’émouvoir qu’elle continue de baisser, est en réalité la contrepartie de cette liberté. Si la CLCV pouvait et voulait nouer des liens avec des professionnels, nous serions riches et nous ne viendrions pas devant votre commission d’enquête ! Que cette subvention baisse de 10 % montre en ce sens le peu de valeur que les pouvoirs publics accordent à l’indépendance.
Le premier grand défi auquel les associations de consommateurs sont confrontées est la baisse des subventions en général, au niveau national comme au niveau local. Nos structures locales, lorsqu’elles sont importantes, comptent un salarié, voire plusieurs : nous y avons davantage de salariés qu’à l’échelon national. Or, après la baisse des subventions nationales arrive celle des subventions locales. Elle va donc faire particulièrement mal, surtout du point de vue de l’emploi : c’est localement que le secteur associatif aura son méga-plan social invisible.
Le second défi est Internet, à la fois concurrent et opportunité. Auparavant, quand on rencontrait un problème lié à la consommation ou lors de son état des lieux, on se tournait vers une association de consommateurs, vers l’ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement) ou la mairie ; aujourd’hui, en pareil cas, on peut trouver sur Internet bien des conseils, parfois mauvais, mais souvent bons à condition de savoir chercher. Les acteurs de l’Internet se positionnent très clairement comme des concurrents des associations de consommateurs, mais Internet nous permet aussi de développer de nouveaux services ou de trouver de nouveaux adhérents. C’est un monde très dur ; nous relevons le défi, espérant que la seconde dimension l’emportera sur la première.
Voici maintenant nos propositions.
J’aimerais d’abord rappeler, dans le contexte préoccupant de baisse de la subvention DGCCRF, que l’expression « subvention de fonctionnement » n’est pas un gros mot, contrairement à une conception qui s’est imposée depuis dix ans. Face à un financeur public, le terme est tabou : il faut toujours parler de projets. Or, outre cette hypocrisie, le financement sur projet est intéressant mais limité. Pourquoi ne pas réhabiliter cette belle expression, surtout lorsque la subvention est la contrepartie de l’indépendance vis-à-vis de Danone ou de Total ?
Nous proposons aussi d’affecter pour partie aux associations loi de 1901, sous forme de subvention, le produit des amendes élevées que prononce l’Autorité de la concurrence, aujourd’hui entièrement destiné au Trésor public.
Troisièmement, la formation des militants doit être développée pour contribuer à pallier l’asymétrie d’expertise dont ils souffrent lorsqu’ils siègent aux conseils d’administration des HLM ou dans les commissions consultatives des services publics locaux. Les associations s’organisent pour la réduire, avec succès au niveau national, bien moins efficacement au niveau local. Pour remédier à ce problème, il faut financer la formation et l’expertise indépendante, sur le modèle des comités d’entreprise (CE) ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui peuvent, aux frais de l’entreprise, recourir aux services d’un cabinet d’expertise. Il ne serait pas illogique d’étendre ce modèle lorsque le renouvellement d’un contrat d’eau pour vingt ans est en jeu.
Si notre indépendance financière vis-à-vis des professionnels doit être totale, nos difficultés financières nous amènent à revoir notre modèle économique. N’ayant guère d’espoir d’obtenir rapidement une hausse de la subvention DGCCRF, nous devrons ainsi susciter davantage d’adhésions en proposant de nouveaux services, ce qui nous conduira parfois à nouer des partenariats avec des professionnels. Il ne s’agit pas de toucher quoi que ce soit d’eux, mais de travailler avec eux pour développer ces services. Par exemple, nous inscrivant dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, nous proposons aux particuliers de valoriser par des paiements directs – et non par des bons d’achat – leurs travaux d’économie d’énergie. Pour le faire, nous passons par une structure collective agréée qui intervient sur ce marché. En contrepartie, nous demandons aux bénéficiaires de l’offre d’adhérer à notre association. Les associations de consommateurs vont devoir développer de plus en plus ce type de dispositifs, en valorisant les services proposés soit par une obligation d’adhésion, soit par des cotisations supplémentaires. Nous gagnerions à ce que le cadre juridique de ce modèle économique soit parfaitement stabilisé.
Enfin, puisque c’est surtout à l’échelon local que l’urgence économique va se faire pressante alors même que la gestion y est parfois quelque peu aléatoire, il faudrait y développer les formations à la gestion économique, comptable et juridique des associations. Il s’agit de savoir tenir une comptabilité ou établir un contrat de travail valable. Certes, c’est à une fédération ou à une confédération de former ses structures locales, mais ce travail est très fastidieux et l’aide des pouvoirs publics – je ne parle pas ici de subvention, mais d’assistance technique – nous serait précieuse.
M. Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’UFC-Que Choisir fait partie du paysage morcelé des associations de consommateurs agréées, qui sont au nombre de quinze. Créée en 1951, sous la Quatrième République, elle est la plus ancienne association de consommateurs de France et d’Europe. Elle est à bien des égards très atypique puisqu’elle ne fait partie ni des associations syndicales, ni du mouvement familial, ni des associations spécialisées : nous avons vocation à faire de la consommation, rien que de la consommation, mais toute la consommation – dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du logement, des transports, etc. De ce point de vue, la seule association qui nous ressemble est la CLCV.
Nous avons pour spécificité de publier au niveau fédéral un organe de presse grand public à très large diffusion, qui nous a rendus et continue de nous rendre célèbres. Sa version en ligne est le premier site d’information payant de France. La puissance de feu et de communication de la revue est telle qu’elle fait parfois de l’ombre à notre activité associative elle-même et au réseau sur lequel elle repose – mais je ne m’en plaindrai pas. Notre revue se caractérise par son indépendance : elle est l’une des seules publications privées en France qui n’accepte rigoureusement aucune publicité, avec Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné. Plus généralement, notre indépendance constitue notre premier capital et nous veillons jalousement à la préserver.
L’une des missions de la fédération est de consolider un réseau de proximité constitué d’associations locales et de faire en sorte de l’adapter aux besoins des consommateurs et de la société en général. Nous avons 150 associations locales, 350 points d’accueil, 130 000 adhérents et 4 500 bénévoles œuvrant sur le territoire. Mais, bien que fédérées à l’UFC, et le plus souvent regroupées en unions régionales, ces associations sont indépendantes : elles ont leur propre budget, leur conseil d’administration, leur président. Chacune jouit donc d’une certaine autonomie tout en restant soumise à des règles communes. La fédération est particulièrement attachée à son rôle de tête de réseau, essentiel dans un mouvement associatif.
À ce titre, nous avons créé un « kit de viabilité économique » afin d’analyser l’indépendance, la solidité et la capacité d’investissement des associations de notre réseau. Celui-ci, avons-nous ainsi observé, est en quelque sorte à deux vitesses : les petites associations, qui comptent moins de 1 000 adhérents, ne sont pas du tout dans la même situation économique que celles qui en ont davantage, jusqu’à 2 000 ou 3 000. Les plus importantes, celles qui rendent le plus de services à la population et aux pouvoirs publics parce qu’elles peuvent mener des actions de représentation lorsque ces derniers le lui demandent, recevoir le public, communiquer dans les médias, sont celles qui font le plus appel à des salariés ; en prenant de l’ampleur, elles doivent faire face à une hausse problématique de leurs charges fixes. On sait que la naissance d’un troisième enfant confronte la famille à un problème de logement ; c’est un peu à la même difficulté que nous nous heurtons ici lorsqu’il s’agit de les héberger. Paradoxalement, ce sont donc plutôt nos petites associations locales, dépourvues de salariés et susceptible d’être hébergées gratuitement par les communes, qui parviennent à accumuler un peu d’argent, de sorte que leur viabilité économique n’est pas menacée à court terme.
En moyenne, hors emplois aidés, 13 % des produits totaux de nos associations proviennent des subventions. L’essentiel du financement est issu des adhésions. Au nom de l’indépendance, qui représente l’une de nos valeurs cardinales, nous tenons en effet à être principalement financés par les consommateurs eux-mêmes plutôt que par les entreprises, mais aussi plutôt que par les pouvoirs publics nationaux et locaux. Les subventions d’exploitation représentent en moyenne quelque 20 % de nos ressources : viennent en premier lieu les subventions liées aux emplois aidés, suivies de celles des collectivités puis, de très près, de la subvention DGCCRF.
On peut identifier quatre sources de fragilité des associations de consommateurs, en particulier de l’UFC-Que Choisir et de son réseau.
La première est liée à la déductibilité fiscale des dons, lesquels représentent 3,8 % des ressources globales de notre mouvement. Nous souffrons de l’absence de positionnement favorable de l’administration ; nous déconseillons même à nos associations de lui demander de fixer sa doctrine par un rescrit, de peur de ne plus pouvoir proposer le reçu fiscal aux donateurs si nous nous heurtons à un refus dans un département. Cela nous empêche de valoriser le don auprès du grand public et d’encourager celui-ci à nous soutenir. En la matière, nous regrettons une inégalité marquée au sein du mouvement consumériste : les associations comme la nôtre ou comme la CLCV ne bénéficient pas de la déductibilité, contrairement aux associations de consommateurs d’abord familiales, sans parler des associations de type syndical. C’est à nos yeux inadmissible. Nous demandons régulièrement que le régime de déductibilité soit sécurisé afin que le caractère d’intérêt général du mouvement consumériste soit reconnu.
Deuxièmement, la prévisibilité des ressources publiques, qu’elles soient nationales ou territoriales. 13 % hors emplois aidés, c’est relativement peu mais c’est déjà beaucoup. Nous sommes quelque peu inquiets de l’évolution de la législation sur la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux, qui attribue à chacun des compétences beaucoup plus ciblées. Le sport, le tourisme et la culture font exception : la clause de compétence générale continuera de leur être appliquée. Mais qu’en est-il de la consommation ? Il ne faudrait pas qu’une source de financement des associations locales se tarisse pour des raisons purement juridiques. En d’autres termes, les modalités de financement de la vie associative ne doivent pas être oubliées dans la réforme territoriale.
Au niveau national, depuis 2006, la DGCCRF a refilé la patate chaude, si vous me permettez l’expression, aux têtes de réseau, désormais chargées de distribuer au réseau la subvention qui lui est destinée. Sur ce point, je formulerai plusieurs observations.
D’abord, la mesure a entraîné le transfert à notre fédération des coûts de gestion de ces sommes. Précisons qu’elle ne les fait pas peser sur le réseau – c’est notre affaire, me direz-vous.
Deuxième observation : la baisse des subventions, qui touche inégalement les associations puisqu’elle est proportionnellement beaucoup plus marquée pour l’UFC-Que Choisir, atteignant 40 %.
Cette évolution a eu lieu – c’est ma troisième observation – dans l’opacité la plus totale. En quoi l’UFC-Que Choisir a-t-elle donc plus démérité que d’autres, pour être à ce point sanctionnée ? Car il s’agit bien à nos yeux d’une sanction sournoise, qui ne dit pas son nom. Le rapporteur du budget de la consommation se dit désarmé face à l’administration, qui ne l’informe même plus depuis deux ou trois ans des conditions de distribution de la subvention. Cette situation est parfaitement intolérable.
Enfin, contrairement à certains de nos collègues, nous préférerions des conventions pluriannuelles pour une meilleure visibilité, dans le respect, naturellement, du principe d’annualité budgétaire. Nous saurions ainsi où nous allons pour trois ans, ce qui n’enlève rien à la liberté du Parlement de voter ou non les enveloppes chaque année. L’imprévisibilité est une source d’insécurité pour le mouvement associatif, dans son fonctionnement comme dans son développement.
La pérennisation de l’emploi dans les associations représente un enjeu majeur. Je rejoins sur ce point, comme souvent, mon collègue de la CLCV. Je ne parle pas ici des têtes de réseau. Nous avons 130 salariés au niveau de la fédération et autant au sein du réseau, et 6 associations du réseau sur 10 recourent à l’emploi, en particulier aux emplois aidés. Ces salariés bénéficient de formations en interne ou à l’extérieur, et nos associations locales font état de leurs difficultés à renouveler les contrats uniques d’insertion (CUI), alors que c’est essentiel à la consolidation et au développement du réseau.
Nous sommes essentiellement un réseau de militants. Les trois adjectifs régulièrement mis en avant pour définir notre mouvement sont d’ailleurs « indépendant », « militant », « expert ». Ce dernier terme renvoie à la nécessité de se former et de bénéficier de l’appui de salariés qualifiés, qu’ils soient juristes, économistes ou, de plus en plus, informaticiens. Il est donc à nos yeux essentiel d’améliorer la qualité et la sécurité de l’emploi associatif, en particulier dans les associations locales, et d’adapter à nos besoins spécifiques les dispositifs de contrats aidés réservés au secteur non marchand.
Enfin, le secteur associatif consumériste souffre d’un véritable déficit de reconnaissance institutionnelle. On entend beaucoup de discours politiques sur l’intérêt du mouvement consumériste et la nécessité d’intégrer cette partie de la société civile à la gouvernance et à la préparation des décisions, mais ils restent en général purement incantatoires : lorsque l’occasion se présente de reconnaître le rôle de notre mouvement, les pouvoirs publics sont aux abonnés absents.
En voici un exemple : chose à peine concevable, la réforme du Conseil économique, social et environnemental n’a pas prévu d’y intégrer nos associations, alors que le mouvement familial y est largement représenté.
Pourtant, on ne cesse de placer la consommation au cœur des politiques, notamment environnementales avec les concepts de consommation responsable ou durable. C’est un enjeu tout aussi essentiel des débats sur les prix, les rentes de situation, les dynamiques économiques : ce que cherchent les associations consuméristes, au-delà de leur rôle d’assistance individuelle, c’est de faire du consommateur non plus un agent passif mais un véritable régulateur de l’économie, et l’on sait qu’il n’est pas de marché sans consommateur. Nous sommes un contre-pouvoir sur lequel les autorités peuvent compter pour s’opposer à des entités de plus en plus puissantes – trusts locaux, acteurs nationaux, voire internationaux. Ainsi, dans le cas de l’eau, les collectivités locales ont-elles pu s’appuyer sur l’expertise de nos associations pour livrer bataille aux compagnies gestionnaires.
Autre exemple : les associations de consommateurs sont en tant que telles absentes du Haut Conseil à la vie associative, même si certains de leurs membres peuvent y siéger en tant que personnalités qualifiées.
Bref, l’engagement associatif et militant dans le secteur du consumérisme mérite une autre place que celle qui lui est réellement réservée aujourd’hui, au-delà des discours, dans les dispositifs de gouvernance politique et administrative.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci de vos interventions très pertinentes. Vous avez répondu par avance, et par des propositions précises, à nombre des questions que nous souhaitions vous poser.
Vous avez insisté sur vos difficultés à trouver l’expertise, à en financer l’acquisition, par la formation des bénévoles, et à obtenir qu’elle soit représentée dans les instances consultatives lorsqu’elle existe.
Comment articuler l’indépendance caractéristique des associations consuméristes et l’aide des pouvoirs publics, par exemple en matière technique ou pour créer les nouveaux services en ligne que vous avez évoqués ?
M. Jean-Louis Bricout. S’agissant des problèmes de logement, auxquels nous travaillons actuellement dans le cadre de la transition énergétique, je souhaite que les maires, notamment ruraux, soient en mesure d’intervenir pour prévenir, détecter et endiguer toutes les situations de précarité énergétique affectant nos concitoyens logés dans de véritables passoires thermiques. Comment vos structures peuvent-elles aider les élus locaux à le faire, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, au titre du règlement sanitaire départemental ou du « décret décence » (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent) ? Avez-vous dans vos associations des personnes qui se consacrent spécifiquement à ces actions ?
En ce qui concerne la réforme territoriale, quelles sont vos préconisations, en particulier afin d’améliorer la coordination entre vos associations et les élus locaux ? Je comprends votre inquiétude, s’agissant des financements croisés et de l’attribution des compétences, mais la réforme peut aussi simplifier les démarches, car les dossiers sont nombreux en cas de financements croisés.
La loi consommation a créé une procédure novatrice : l’action de groupe. L’UFC-Que Choisir a-t-elle déjà engagé ce type de procédures et si oui, quelle conclusion en tirez-vous ? Comment votre association gère-t-elle concrètement son rôle dans la procédure ? Vous paraît-il toujours souhaitable de l’étendre aux domaines de la santé et de l’environnement ?
S’agissant enfin du statut des bénévoles, la loi sur l’économie sociale et solidaire que nous avons votée cet été instaure le volontariat associatif, destiné aux jeunes de plus de vingt-cinq ans, qui pourront conclure des contrats en vue de missions précises d’une durée de six à vingt-quatre mois. Il est évidemment trop tôt pour en dresser un bilan, mais quels effets attendez-vous de cette mesure ?
M. Régis Juanico. Nous partageons les préoccupations de M. Bazot concernant la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. L’intention du législateur est, me semble-t-il, d’ajouter la vie associative aux compétences partagées que sont le sport, le tourisme et la culture, afin que les associations ne subissent pas une baisse des subventions accordées par les collectivités parce que celles-ci se déclareraient désormais incompétentes.
La sécurisation des règles de déductibilité des dons est essentielle. Nous faisons tout pour que l’administration fiscale applique les mêmes règles sur l’ensemble du territoire, aux associations décentralisées comme aux grandes associations nationales, dans l’intérêt général. Ce sera souligné dans le rapport.
M. Bazot a défendu les conventions pluriannuelles d’objectifs sur trois ans, contrairement à Mme Rinaldo.
Mme Corinne Rinaldo. Je me suis mal exprimée : nous les défendons également.
M. Régis Juanico. De fait, elles me paraissent plus sécurisantes pour vous.
En ce qui concerne la formation, nous devons faire des efforts. Certes, les crédits de l’État sont inchangés, même si vous constatez une baisse sur le terrain du fait de la répartition régionale qui résulte des budgets opérationnels de programme (BOP). Toutefois, cela ne suffit pas : il faudrait compléter ces crédits par les fonds de formation, notamment ceux que la loi sur l’économie sociale et solidaire a créés pour les bénévoles. J’espère aussi que les congés d’engagement bénévole, à propos desquels le Gouvernement doit nous remettre un rapport, aideront les salariés à exercer leur mandat associatif.
Enfin, pensez-vous que la loi sur l’économie sociale et solidaire, et la reconnaissance qu’elle implique de votre statut, vous permettra de diversifier vos financements ?
Jean-Noël Carpentier. Notre commission d’enquête s’intéresse aux répercussions de la crise sur la vie associative. Quelles sont-elles concrètement, selon vous ?
Certes, l’argent public se raréfie et les subventions nationales et locales diminuent ou risquent de diminuer, mais vous revendiquez votre indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, et on peut le comprendre à la lumière des exemples que vous avez cités. De quelle manière comptez-vous donc, en interne, remettre en question votre modèle économique ? Car votre indépendance s’entend aussi vis-à-vis des pouvoirs économiques. Comment envisagez-vous de développer les adhésions et l’activité bénévole ?
Quelle est la place du numérique dans votre secteur ?
Mme Corinne Rinaldo. Merci de ces questions, toutes très pertinentes.
En ce qui concerne la loi sur l’économie sociale et solidaire, nous n’avons tout simplement pas été consultés. Aujourd’hui, notre problème est d’abord d’être reconnus par les pouvoirs publics. S’agissant de la réforme territoriale, il faudrait commencer par étudier la possibilité d’un partenariat de concertation avec les associations locales. Nous réfléchissons depuis longtemps à la transition énergétique dans le cadre de nos travaux sur l’habitat. Nous organisons d’ailleurs le 7 novembre un colloque sur le sujet auquel vous serez conviés. Mais la réforme territoriale nous prive d’instances locales où nous réunir avec les partenaires que vous êtes, comme nous le souhaiterions.
Si nous mettons en avant les questions financières, c’est parce que, dans la situation de crise que nous vivons, nous avons besoin d’aider notre réseau et nos militants à intervenir davantage auprès de consommateurs et de familles qui connaissent des difficultés croissantes. C’est bien de parler d’Internet et du numérique, mais cela n’a pas grand sens pour nos fédérations départementales rurales qui n’ont pas de salariés.
On a supprimé les comités départementaux de la consommation ; d’une manière générale, on nous a privés d’instances de concertation. Commençons par les ressusciter dans le cadre de la réforme territoriale.
M. Stéphane Pavlovic. Pour préparer la transition énergétique, nous, associations spécialisées dans le logement, sommes évidemment mobilisées. Comment détecter les situations de précarité énergétique sinon sur le terrain, au plus près des logements – outre un appui technique au niveau national ? Pour évaluer la décence d’un habitat, il faut l’approche quasi chirurgicale d’une association qui intervient sur place. Les modalités d’intervention sont diverses, nos associations ayant chacune leur spécialité.
En ce qui concerne la place des bénévoles et le volontariat associatif, il est trop tôt pour dresser un bilan mais une mission de six à vingt-quatre mois n’est pas du tout appropriée à l’action de la CGL, qui prend durablement en charge les locataires et les copropriétaires du secteur social. Il nous est très difficile d’accueillir des personnes qui s’investissent pour si peu de temps. Nous ne faisons pas du caritatif : je le répète, il ne suffit pas, pour nous aider, de retrousser ses manches quelques semaines ou quelques mois.
On a parlé de la fiscalité des donations, mais le régime fiscal applicable aux adhésions, qui n’est pas le même du point de vue juridique, mérite lui aussi d’être clarifié et devrait les valoriser.
Le problème de l’indépendance est quasi philosophique. Nous estimons que le financement nécessaire par l’État ne remet pas en cause notre indépendance ; il témoigne de notre légitimation par les pouvoirs publics, essentielle du point de vue moral puisqu’elle signifie que l’État et la nation reconnaissent notre utilité pour les consommateurs. Cela ne nous empêche pas de dénoncer et de combattre divers acteurs de l’économie.
M. François Carlier. Le développement des adhésions est l’un des instruments clés, et c’est à nous de nous montrer inventifs pour fournir de nouveaux services. Par exemple, proposer à nos adhérents de filmer leur logement avec une caméra thermique pour les sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique ou, au niveau national, valoriser leurs travaux par le biais des certificats d’économie d’énergie selon le dispositif déjà évoqué.
Que peuvent faire quant à eux les pouvoirs publics ? Je pars de l’hypothèse que les Français aiment bien les associations, notamment les associations de consommateurs, mais je ne suis pas sûr qu’ils sachent que nous avons besoin d’adhésions et de dons. Des campagnes publiques qui le leur rappelleraient, un peu sur le modèle de celles qui incitent à voter, seraient donc bienvenues.
Quant à l’expertise, qu’elle soit économique – c’est la voie par laquelle je suis entré dans le mouvement consumériste –, technique ou juridique, les associations de consommateurs parviennent à la porter à un niveau plutôt satisfaisant avec infiniment moins de moyens humains et financiers que certaines grandes entreprises. Néanmoins, la grande habileté dont elles font preuve ne suffit pas : il y faut tout de même quelques ressources. De ce fait, lorsque les subventions et les aides diminuent, ce sont ces postes budgétaires qui sont sacrifiés et l’asymétrie d’expertise s’accentue, surtout à l’échelon local.
Mme Béatrice Delpech, directrice adjointe à l’action politique de l’UFC-Que Choisir. J’ajouterai que l’expertise est ce qui fait de nous des mouvements d’éducation populaire. Nous, associations consuméristes, agissons pour développer la capacité d’agir des consommateurs. Et cela a un coût : l’UFC-Que Choisir consacre beaucoup de temps et d’argent à la formation des bénévoles. La méconnaissance de cette vocation concourt au déficit de reconnaissance dont nous souffrons.
La déductibilité des dons est d’autant plus essentielle que les financements publics se tarissent et que l’on nous invite de toutes parts à diversifier nos ressources, ce qui est effectivement primordial. Il est inutile de faire des appels aux dons si les gens n’ont aucun intérêt à donner. La part des dons stagne aujourd’hui à 5 % du budget associatif global, et elle ne changera pas sans régime fiscal stable.
Ce qui nous reconduit à la question du modèle économique. Comme fédération, nous avons un rôle pédagogique à jouer auprès de nos associations : nous les invitons à réfléchir à la solidité de leur modèle économique, et nous plaidons quant à nous pour un modèle hybride ou mixte. Nous sommes farouchement attachés à notre indépendance, donc au primat des financements privés : c’est un choix politique. Mais les deux sources de financement sont nécessaires car nous ne pouvons être entièrement tributaires d’une baisse soit des cotisations soit des aides publiques. La ressource publique compte aussi pour nos associations locales car elle équivaut à une reconnaissance de notre action, en l’espèce de notre action territoriale. Les collectivités sont nos premiers partenaires publics et leur aide entérine notre participation à un projet citoyen et de développement territorial.
Notre fédération en tant que telle, abstraction faite de son soutien aux associations locales, réfléchit depuis bien longtemps à la filialisation ou au développement d’autres types d’actions. Nous assumons le risque qu’une partie de notre activité soit de ce fait fiscalisée. Il ne faudrait pas pour autant que l’on nous assimile à n’importe quel acteur économique : notre activité reste non lucrative et porteuse d’un projet politique et de société, d’où sa forme associative.
Mais l’essentiel à nos yeux reste l’intérêt des consommateurs, plutôt que la manière dont nous nous organisons pour le défendre. De ce point de vue, et pour répondre à votre question sur l’effet de la crise, nous constatons – une étude récente le confirme – une grande paupérisation et précarisation des personnes qui s’adressent à nous.
M. Alain Bazot. S’agissant de l’action de groupe, la loi date de mars mais le décret d’application n’est toujours pas paru. Il doit être publié en octobre, nous dit-on. Dans l’intervalle, nous sommes dans l’incapacité juridique d’agir. Mais nous sommes prêts à le faire dès que ce sera possible, même si cette forme d’action n’est pas la panacée, car c’est ce que l’opinion publique attend de nous.
M. le président Alain Bocquet. Merci de vos réponses. Vous pouvez nous adresser par écrit des compléments que nous intégrerons au rapport.
Table ronde sectorielle « Action humanitaire » :
M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud ;
M. Olivier Lebel, directeur général de Médecins du Monde ;
M. Pierre-Yves Crochet Damais, Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) ;
M. Aurélien Daunay, directeur des affaires financières, et M. Adrien Tomarchio, directeur de la communication de l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED)
(séance du 23 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. La table ronde qui s’ouvre est consacrée aux associations impliquées dans l’action humanitaire. Elle réunit M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud ; M. Olivier Lebel, directeur général de Médecins du Monde ; M. Pierre-Yves Crochet Damais, du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) ; M. Aurélien Daunay, directeur des affaires financières de l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED), et M. Adrien Tomarchio, directeur de la communication.
Avant tout, je souhaite exprimer à MM. Daunay et Tomarchio la compassion et la solidarité de l’ensemble des membres de cette commission à la suite de l’odieux assassinat de leur collègue David Haines. Je rends hommage à la mémoire de celui-ci.
Les associations d’aide humanitaire ont vocation à soutenir les populations vulnérables de par le monde et à les accompagner dans la construction d’un avenir meilleur en apportant une réponse adaptée à leurs besoins. Elles sont donc au cœur de cette solidarité si nécessaire à notre temps et qui ne peut s’arrêter à nos frontières. Leur mission consiste non seulement à répondre à l’urgence, mais aussi à construire un véritable développement qui réponde aux aspirations des femmes et des hommes auprès desquels elles interviennent.
Messieurs, alors que la crise réduit l’importance des ressources disponibles et produit peut-être un resserrement des esprits, pouvez-vous faire le point sur les difficultés qui en résultent pour votre fonctionnement, que ce soit en termes de ressources financières, de recrutements de bénévoles, de mobilisation de vos adhérents, d’évolution de l’emploi salarié, de complexité administrative, etc. ? La puissance publique se met-elle en retrait, selon vous ? L’engagement est-il une valeur en déclin ? Est-on encore suffisamment ouvert aux dons
– dons d’argent, don de soi ?
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Jean-Louis Vielajus, Olivier Lebel, Pierre-Yves Crochet Damais, Aurélien Daunay et Adrien Tomarchio prêtent serment)
M. Adrien Tomarchio, directeur de la communication de l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED). Je vous remercie de votre solidarité et de votre soutien. En tant qu’humanitaires, nous sommes choqués par l’assassinat odieux de notre collègue David Haines, qui effectuait une mission en Syrie pour venir en aide aux populations de ce pays. Nous avons reçu des milliers de messages de soutien et de solidarité de la communauté humanitaire, en France et à travers le monde, des pouvoirs publics, de nos partenaires sur le terrain et de nos employés. Ces témoignages nous touchent profondément.
L’assassinat de David va à l’encontre des principes humanitaires, mais au-delà, il touche ACTED, il touche la communauté humanitaire, il touche l’humanité. Nous allons tout faire pour que ce crime barbare ne reste pas impuni. Nous allons déposer plainte en France. Nous souhaitons également lancer un projet de fonds avec la communauté humanitaire, les citoyens français et européens et même du monde entier, afin que les crimes contre les travailleurs humanitaires et les journalistes présents sur le terrain soient qualifiés de crimes contre l’humanité, afin qu’ils deviennent imprescriptibles et que leurs auteurs soient jugés. Nous pourrons mener ce combat avec votre soutien.
Pour autant, ce crime ne doit pas nous détourner de notre mandat et de notre engagement en tant qu’humanitaires. C’est pourquoi nous avons tenu à être présents parmi vous aujourd’hui pour répondre à vos questions, témoigner des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et vous présenter les solutions que nous essayons de trouver pour résoudre nos difficultés financières – accès à des budgets pour financer nos activités, problématiques de fonds propres et de liquidités.
Le risque financier est porté par un grand nombre de petites et moyennes associations en France. ACTED est une organisation non gouvernementale (ONG) qui intervient dans 35 pays et emploie 4 000 personnes à travers le monde. Il y a dix ans, elle était encore une petite association, mais elle s’est énormément nourrie de l’expérience des autres ONG françaises. Cela fait quinze ans que nous réfléchissons aux défis que nous avons à relever.
La crise des financements, à laquelle font face les associations et certaines ONG humanitaires, est à l’origine d’un changement de paradigme qui oblige à repenser nos modèles de financement et de gouvernance. Cela est d’autant plus important que les ONG évoluent dans un monde compétitif. Il faut le dire clairement, nous sommes en compétition avec d’autres acteurs : structures anglo-saxonnes “non profit”, entreprises européennes, organisations issues des pays où nous intervenons, mais aussi entreprises privées étrangères qui répondent à des appels à propositions d’aide au développement.
En tant qu’association loi de 1901, ACTED a des valeurs à défendre. Nous devons démontrer avant tout la pertinence et l’utilité de nos interventions et de nos modèles, offrir des garanties de transparence et de responsabilité, mais aussi être perçus comme des acteurs innovants, entreprenants – voire, entrepreneurs. À cet égard, il est très important que le cadre juridique associatif offre des instruments qui permettent aux associations de défendre leurs actions et de se développer.
M. Aurélien Daunay, directeur des affaires financières de l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED). En partenariat avec le Crédit coopératif, nous avons pu mener des actions en nous appuyant sur la loi sur l’économie sociale et solidaire.
Dans un contexte de crise des financements – publics, privés ou collectés auprès du grand public –, la diversité des fonds levés est un facteur très important pour ACTED. Comme l’a souligné Adrien, nous essayons de repenser notre intervention à travers le monde. Nous avons ainsi développé une institution de microfinance qui récolte des fonds auprès du secteur privé. La définition du périmètre de l’économie sociale et solidaire – qui intègre les acteurs historiquement associés, mais aussi d’autres types de structures, comme les coopératives, les entreprises à lucrativité limitée – nous permet ainsi d’être mieux reconnus vis-à-vis des investisseurs et même du secteur associatif.
Ainsi, l’article 70 du texte de loi nous a permis de lever en deux ans 5 millions d’euros sous forme d’obligations associatives et de titres associatifs. Je me permets de rappeler ce que sont ces deux outils. L’obligation associative est une dette avec une échéance et une rémunération prédéterminées, enregistrée dans les comptes de l’association dans ses emprunts. Le titre associatif est une dette perpétuelle remboursable à l’initiative de l’émetteur, enregistrée dans les comptes de l’association dans ses fonds associatifs, ce qui permet de renforcer le haut de bilan de la structure. La loi a prévu une possibilité de clause de remboursement automatique du titre associatif dans le cas où les résultats cumulés de l’association sur sept années consécutives permettent de recouvrir au minimum le montant de celui-ci.
Nous avons commencé à lever des fonds en 2012. Ils nous ont permis de lancer des opérations d’urgence aux Philippines et dans les pays limitrophes de la Syrie, mais aussi de relancer nos activités au Liban. Il faut savoir qu’entre la signature d’un contrat avec les bailleurs de fonds institutionnels, qui sont nos financeurs, et la mise en œuvre de nos activités, le temps peut être long. Ces obligations et ces titres nous permettent donc de préfinancer nos activités humanitaires.
Nous avons également pu venir en aide à des populations en leur prêtant des fonds via la micro finance, à des coûts peu élevés. Près de 6 000 personnes ont ainsi été aidées grâce à notre institution de microfinance, OXUS.
Ces outils existaient depuis 1985 et ont été remis au goût du jour par la loi. Lors du septième forum de Convergences, les acteurs du secteur associatif ont pu échanger à ce sujet avec les acteurs du secteur bancaire et les représentants de l’État. Le renforcement des capacités de financement pour les activités du secteur associatif à vocation humanitaire internationale est essentiel. À ce titre, l’économie sociale et solidaire, les fonds d’épargne solidaire, les fonds 90-10, présentent un grand intérêt pour nos associations.
M. Pierre-Yves Crochet Damais, du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD). Le CCFD-Terre solidaire est une association de solidarité internationale qui agit dans trois domaines.
Le premier est le partenariat à l’étranger. Nous avons 450 associations partenaires dans 60 pays et n’envoyons pas d’expatriés. Ainsi, l’ensemble de nos missions témoigne d’un choix, d’une confiance réciproque et d’un cheminement de long terme.
Le deuxième domaine est l’éducation au développement. Nos 7 500 bénévoles interviennent à l’étranger mais aussi en France, dans les écoles, grandes écoles, universités, et viennent vous interpeller lors des campagnes électorales…
Enfin, le troisième domaine est le plaidoyer. La campagne contre les paradis fiscaux en est un exemple.
Notre budget, qui est passé de 40 millions à 38 millions d’euros, est essentiellement financé par la collecte et les dons. Nous faisons face à deux difficultés.
La première est la baisse de la collecte, liée à la crise économique et sociale. La générosité des donateurs historiques reste très forte – ils ont même augmenté leurs dons moyens –, mais nous avons du mal à recruter de nouveaux donateurs, comme d’autres associations. Aussi plaidons-nous pour le maintien du statut fiscal des dons aux associations et aux fondations. Il s’agit d’un enjeu sociétal majeur.
Avec le « Comité de la charte et du don en confiance », les associations se sont dotées de règles déontologiques strictes, afin de rendre compte en toute transparence à leurs donateurs et de respecter le cadre de leur mission sociale. Elles sont soumises au contrôle des autorités de tutelle – Cour des comptes, bailleurs –, mais il ne faudrait pas que nous passions trop de temps à rendre des comptes sur nos comptes si nous voulons continuer à nous consacrer à nos missions essentielles !
Deuxième difficulté : nous constatons un moindre intérêt pour la solidarité internationale, plus spécialement pour le développement et le partenariat de long terme. Bien sûr, nous agissons aussi dans l’urgence : en Haïti, le lendemain du tremblement de terre, nos partenaires locaux nous ont fait part de leurs besoins les plus urgents et nous avons pu mobiliser des fonds et agir le surlendemain. Cela étant dit, si la solidarité internationale reste un sujet difficile, l’opinion publique doit comprendre que l’aide aux pays défavorisés contribue à résoudre nos propres problèmes. C’est un message fort que je tenais à vous livrer.
Le deuxième thème sur lequel je veux intervenir est l’utilité sociale des ONG au regard du rapport Faber. Loin de moi l’idée de porter un jugement sur les entreprises désireuses d’entrer dans l’économie sociale et solidaire, mais il s’agit de dire qui fait quoi et qui doit faire quoi. La tendance actuelle des pays du Nord étant de confier au secteur privé les enjeux de développement, les fonds en question vont à de grandes entreprises privées et non plus aux ONG. Cette vision du développement sous-tendue par la croissance économique n’est pas fausse, mais ne doit pas devenir exclusive. En effet, les projets confiés à des entreprises des pays du Nord risquent de mettre de côté des domaines indispensables à la société civile.
Les pays du Sud doivent avoir une vraie politique sociale – santé, école, petite agriculture. Que des entreprises puissent contribuer à ces politiques n’est pas gênant ; par contre, le développement dans ces pays ne sera pas possible sans démocratisation. Cela suppose une mobilisation citoyenne des sociétés concernées et un appui au renforcement institutionnel des sociétés civiles du Sud, ce qui ne peut être fait que par les ONG. C’est le travail que nous essayons de faire avec nos partenaires – et je peux vous dire que nous arrivons à faire des choses, y compris en Chine, en matière de mobilisation citoyenne ! Ce développement passe aussi par les aides des pays du Nord aux pays du Sud, mais aussi par les syndicats.
À l’appui de mes propos, je vous laisserai deux documents. Le premier, réalisé par le CCDF-Terre Solidaire et l’Agence française de développement (AFD), traite du partenariat avec les sociétés civiles pour le développement. Le second, intitulé « Le baromètre des sociétés civiles », que CCDF-Terre Solidaire publiera tous les ans en partenariat avec l’Institut des relations internationales et de la stratégie (IRIS), donne le pouls des dynamiques sociales dans le monde à travers des analyses par région et par pays.
M. Olivier Lebel, directeur général de Médecins du Monde. Médecins du Monde est une association internationale de militants actifs en France et dans quarante autres pays. À partir d’expériences médicales innovantes et d’un plaidoyer basé sur les faits, nous mettons les communautés en capacité de prendre en main leur santé, tout en nous battant pour un accès universel aux soins.
Notre modèle économique repose sur les dons, qui représentent les deux tiers de notre budget, le financement public de structures françaises étant inférieur à 5 %. Notre budget en 2014 s’élève à 75 millions d’euros. Nous avons 1 500 salariés et 2 000 bénévoles, ces derniers étant essentiellement basés en France.
J’aborderai trois sujets : une relative insécurité en matière de financements publics ; les financements privés ; et deux points spécifiques de droit.
En termes de financements publics, nous avons un souci vis-à-vis des grandes structures, notamment anglo-saxonnes. Aussi pensons-nous que la France doit avoir une politique forte en faveur des acteurs français de solidarité internationale, qui passe notamment par une augmentation de la part de l’aide publique au développement transitant par les ONG.
Nous avons également un souci vis-à-vis de la DG Echo (Direction générale de l’aide humanitaire), car elle est dans une situation financière préoccupante, notamment en raison d’un décalage entre ses crédits d’engagement et ses crédits de paiement. La baisse du budget de la DG Echo en 2015 risque d’être préjudiciable aux projets des ONG françaises intervenant à l’international, ce qui aurait de graves conséquences pour les personnes vulnérables en Palestine, en Irak, en Syrie, en République centrafricaine. Aussi est-il important pour la France de soutenir ce budget de l’Union européenne en faveur de l’action internationale.
Deuxième sujet : la fiscalité des dons privés. Je rappelle la nécessité de sécuriser la fiscalité des dons – il ne s’agit pas d’une niche fiscale, le donateur ne s’enrichit pas en faisant un don. Par ailleurs, un projet de circulaire de Bercy a précisé les pays dans lesquels une action menée par une association française peut donner lieu à déductibilité fiscale pour les dons – c’est ce que l’on appelle la territorialité des dons –, selon des considérations de richesse moyenne du pays. Or nos dons sont généralement non affectés – on ne peut dire à quel pays ils sont attribués. Et une mesure selon laquelle une déduction est possible pour un don en Haïti, mais pas en Colombie, entraînera une très grande confusion pour le donateur et, par conséquent, un risque de remise en cause de la ressource.
M. Régis Juanico. Ce projet a été abandonné.
M. Olivier Lebel. Effectivement. Mais si Médecins du Monde voit ses dons croître d’année en année – de 4 % en 2014 –, ce n’est pas le cas de toutes les associations.
Une autre menace pèse sur les dons au regard du principe de mutualisation. Lorsque nous citons un exemple d’action, nous précisons aux donateurs que les dons peuvent être utilisés pour d’autres causes si besoin. Ce principe est essentiel pour notre modèle économique et celui des autres ONG françaises de solidarité internationale, comme Handicap International ou Action contre la faim.
Enfin, les dons par SMS ne sont pas possibles en France en raison d’une interprétation restrictive de la directive sur les services de paiement du 13 novembre 2007, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considérant que les opérateurs téléphoniques devraient devenir opérateurs de services de paiement, ce qu’ils refusent. En l’occurrence, se pose un problème de traduction du mot « cash » par le terme français « espèces ». Un coup de pouce nous serait utile.
Je termine par deux points spécifiques de droit.
L’article 22 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010, dite loi Kouchner, prévoit que l’État peut demander le remboursement des frais de secours engagés pour sauver une personne en situation dangereuse à l’étranger. Lors des débats parlementaires, il était entendu que les humanitaires seraient exonérés, mais les textes d’application ne le prévoient pas. Nous avons demandé au ministre des affaires étrangères de prendre un arrêté en ce sens. Une question au gouvernement à ce sujet pourrait utilement nous aider.
Enfin, une convention européenne – de mémoire de 1996 –, ratifiée par onze États, permet la reconnaissance de la personnalité juridique aux ONG dans un pays signataire. Or actuellement, nos activités en Turquie – où nous sommes très actifs pour pouvoir agir en Syrie – ne sont pas reconnues, ce pays n’étant pas signataire. Remettre au goût du jour cette convention serait une aide précieuse pour nous.
M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination Sud. Coordination Sud – Solidarité Urgence Développement est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Elle rassemble 150 membres représentant la quasi-totalité des grandes ONG françaises, beaucoup de moyennes ONG, et des réseaux de petites associations. Notre action vise à apporter de l’information à nos membres, à créer des espaces de travail thématiques et à dialoguer de façon régulière avec nos différents interlocuteurs politiques, nationaux et européens, sur l’humanitaire et le développement.
Les ONG françaises présentent une grande diversité – plusieurs milliers d’associations –, de Médecins sans frontières jusqu’aux petites associations bénévoles sur l’ensemble du territoire, qui sont en général engagées dans une coopération avec un village ou un acteur dans un pays.
Vous avez entendu trois représentants de grandes ONG, qui ont soulevé des questions spécifiques. Nous les soutenons dans leur démarche, même si nos difficultés ne sont pas forcément de même nature.
Je tiens à souligner la reconnaissance de l’opinion publique envers les associations de solidarité internationale, comme en témoignent les millions de donateurs et les 200 000 bénévoles. Cette reconnaissance est également celle des responsables politiques, et je suis heureux de constater que le Conseil national du développement et de la solidarité internationale, promis par le Président de la République, va démarrer ses travaux dans quelques jours.
Je vais insister sur les questions de financement.
D’après nos enquêtes, une association reçoit en moyenne 55 % de financement privé et 45 % de financement public.
Les financements privés proviennent, d’abord, des donateurs individuels, ensuite, des fondations. Ainsi, le nerf de la guerre de nos ONG, ce sont les financements privés et en premier lieu les donateurs. S’agissant de la fiscalité des dons, des avancées heureuses ont été réalisées ces derniers temps au regard de la territorialité. Nous plaidons auprès de nos interlocuteurs pour l’intégration de la dépense fiscale dans l’aide publique au développement, ce qui améliorait le montant de cette dernière et réglerait cette question fiscale récurrente.
Le financement public de nos associations est, d’abord, européen et international, et ensuite, français.
Le financement européen est donc le plus important. La DG Echo, qui finance les actions humanitaires d’urgence, est un très bel instrument, sauf quand s’il s’enraye, ce qui est le cas actuellement. Il est primordial d’alerter la représentation à Bruxelles sur ce problème.
Le deuxième instrument européen est EuropeAid, qui finance des projets de développement. En 2011, cette organisation a financé 130 millions d’euros aux ONG françaises. Le problème est qu’elle élabore des appels d’offres, pour lesquels les chances de gagner sont de 6 % seulement. Dans ces conditions, il est impossible de bâtir des programmes de moyen terme avec des partenaires partout dans le monde. Face à cette incertitude, un nombre croissant d’associations souhaite se passer de ce financement européen.
La France s’est engagée depuis 2012 à multiplier par deux le financement de l’action des ONG. Dans un rapport de 2013, l’OCDE indique que l’aide publique française au développement transitant par les ONG s’établit à 99 millions d’euros, contre 263 millions d’euros pour la Belgique – deux fois et demi plus –, 713 millions d’euros pour l’Allemagne, sept fois plus, et 1,7 milliard d’euros en Grande-Bretagne, soit dix-sept fois plus !
On entend dire que les ONG françaises sont des nains par rapport à leurs collègues anglo-saxons, que nous ne comptons pas dans la compétition internationale des ONG. D’abord, nos humanitaires comptent – le « sans-frontiérisme » est le fait des humanitaires français. Surtout, d’autres États consentent des efforts significatifs pour faire passer l’aide publique au développement par le canal des ONG. Et l’enveloppe globale de 99 millions d’euros au titre de l’aide française au développement est largement inférieure à celle d’EuropeAid.
Toujours au titre des financements publics nationaux, les collectivités territoriales font des efforts certains et nous faisons des choses très intéressantes avec elles. Malheureusement, les aides sont en baisse actuellement.
Quant au Fonds d’urgence humanitaire, il est doté de 8 millions d’euros – à comparer aux centaines de millions d’euros de la DG Echo. Nous avons appris qu’il serait abondé tous les ans d’un million d’euros, mais cette augmentation n’est pas à la hauteur des enjeux – je pense à l’épidémie d’Ebola, à la situation en République centrafricaine, au Mali, etc.
Vous l’avez compris, nos associations font face à une incertitude liée à la compétition pour le financement européen et l’engorgement des guichets français.
J’ajoute que le financement se fait par enveloppe sur des projets. Nous devons donc décrire nos projets en détail, indiquer un chiffre, mais l’Union européenne refuse de financer nos salariés – elle entend payer les dépenses de terrain, pas celles de nos organisations. Ainsi, un bon projet est un projet qui n’a pas utilisé de ressources humaines européennes ou françaises et pour lequel la dépense correspond exactement à la somme prévue. Or cela n’existe pas ! Ces logiques administratives et d’enveloppe nous compliquent la vie ! Il faut faire confiance aux associations.
En outre, les associations bien gérées devraient pouvoir faire des bénéfices, consolider leur haut de bilan, avoir des fonds propres, mener des travaux de formation, de recherche. Or tout cela est impossible dans la logique actuelle des financements publics.
Enfin, pourquoi une telle défiance vis-à-vis de nos structures ? Une grande association française, non représentée ici, nous a indiqué avoir connu l’année dernière 134 audits
– européens principalement, mais aussi français – sur ses projets, ce qui a nécessité trois personnes à plein temps pour recevoir les auditeurs, qui n’ont finalement pas découvert grand-chose car il s’agit d’une grande ONG bien gérée. Aucune entreprise privée ne subit autant de contraintes en matière de contrôle, alors que nous garantissons une totale transparence financière grâce au « Comité de la charte du don en confiance » auquel nous adhérons.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. La réforme territoriale vous inspire-t-elle des inquiétudes ?
M. Jean-René Marsac. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI), au sein duquel je vais siéger, sera un lieu de concertation entre partenaires publics et associations, dans la foulée de la loi relative à la politique de développement et de solidarité internationale que nous venons de voter.
M. Daunay a parlé du titre associatif, outil mobilisable pour consolider les fonds propres, et plusieurs d’entre vous ont abordé la dimension du développement économique. Des produits de placement à long terme, des produits d’investissement dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire, permettraient-ils de consolider vos actions ?
Vous avez pointé les comportements défaillants ou contradictoires des entreprises. Mais des partenariats se nouent et, dans les pays anglo-saxons particulièrement, apparaît un concept d’entreprise sociale qui aurait vocation à prendre l’espace occupé par le secteur associatif. Comment promouvoir un modèle à la française d’un partenariat entre entreprises et associations ? L’outil fondation, par exemple, pourrait-il constituer un réceptacle pour ce genre de partenariat ? Et quelle règle faudrait-il ajouter au fonctionnement des fondations pour promouvoir un partenariat riche et vertueux ?
Mme Bernadette Laclais. J’ai beaucoup apprécié les interventions.
Monsieur Vielajus, il serait intéressant que vous nous fournissiez des éléments de comparaison autres que chiffrés.
Vous avez indiqué que l’action des collectivités locales dans le domaine de l’humanitaire diminue. Certes, la réforme territoriale fait craindre, en cas d’interlocuteur unique, une baisse de la participation en faveur des ONG. Mais une meilleure coordination du travail des collectivités vous paraît-elle possible ? N’y a-t-il pas un émiettement de l’action dans certains cas ?
M. Jean-Louis Vielajus. Cette excellente question rejoint celle de M. Marsac.
À mes yeux, l’avenir des coopérations pour le développement passe par les coopérations entre territoires, dont les intérêts peuvent se rencontrer malgré leur très grand éloignement – je pense à des actions très intéressantes conduites par la région Bretagne au Burkina Faso. Plutôt que de considérer les ONG comme des contracteurs ou de financer n’importe quel projet, les collectivités doivent s’attacher à mener des projets de coopération en lien avec les ONG et les entreprises. Ainsi, une partie du lien entre associations et entreprises se fera par les territoires. Les entreprises utiles à l’international ne sont pas forcément de grandes multinationales d’origine française, ce sont aussi toutes les PME implantées dans vos territoires – j’y vois une chance.
La question est de savoir quel niveau de territoire peut impulser des projets territoriaux de coopération. Quelle sera la place de ces plus grandes régions ? Les ONG seront très intéressées à dialoguer sur le sujet. Pour moi, c’est l’un des enjeux de l’avenir de la coopération.
M. Aurélien Daunay. Nous avons rencontré beaucoup de résistance de la part d’investisseurs car les outils innovants comme le titre associatif sont encore peu connus. Il me semble donc nécessaire de réfléchir à des mécanismes de garantie ou d’accompagnement pour améliorer la visibilité de ce type d’outil.
Je pense également utile de faire la promotion des development impact bonds ou social impact bonds, développés au Royaume-Uni. Un certain nombre d’acteurs réfléchissent aujourd’hui à ces instruments qui lient opérateurs, investisseurs et représentants publics dans le cadre d’un projet.
M. Pierre-Yves Crochet Damais. Nous avons une expérience de trente ans avec Solidarité internationale pour le développement et l’investissement (SIDI), société financière qui finance du micro-crédit dans une trentaine de pays, pour laquelle nous avons monté un partenariat avec l’Agence française du développement (AFD) afin de lever des fonds dans un contexte social et solidaire extrêmement cadré juridiquement.
Je crois également beaucoup à l’outil fondation. Une fondation d’entreprise n’est pas l’entreprise elle-même, elle a une personnalité juridique et un objet social propres. Le CCFD a lancé une fondation, que nous espérons voir approuver par les autorités de tutelle
– ministère de l’intérieur et Conseil d’État. Nous considérons en effet qu’il faut profiter de la souplesse apportée par ce type d’outil.
M. Olivier Lebel. On n’imagine pas les entreprises sociales supplanter le modèle non lucratif du champ de la santé. Médecins du Monde est très sensible au maintien de systèmes non fondés sur une logique de profits. J’ignore comment cette logique sera défendue au sein du CNDSI, où le secteur de la santé est sous-représenté puisque ni Handicap International, ni Médecins du Monde, ni Médecins sans frontières n’y siègent. Mais a priori, le risque est faible, car aucune entreprise sociale dans notre pays n’intervient dans le champ de la santé.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, messieurs, de votre contribution.
Table ronde sectorielle « Sport » :
M. Aymeric de Tilly, directeur adjoint de la Ligue du football amateur (Fédération française de football) ;
M. Patrice Doctrinal, vice-président de la Fédération française de rugby ;
M. Christophe Zajac, directeur des affaires juridiques et institutionnelles de la Fédération française de basket-ball ;
M. Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme ;
M. Philippe Bana, directeur technique national, et Mme Cécile Mantel, directrice du service juridique de la Fédération française de handball ;
M. Patrick Andréani, délégué technique général de la Fédération française de gymnastique
(séance du 23 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Le sport a des visages multiples : l’activité pratiquée, son caractère individuel ou collectif ; la nécessité ou non de disposer d’équipements collectifs plus ou moins sophistiqués, plus ou moins coûteux ; mais aussi la distinction entre sport amateur et sport professionnel. Sans remonter jusqu’aux doctrines hygiénistes originelles, l’histoire du sport est également, pour partie, une histoire de santé publique, d’où l’implication majeure de la puissance publique dans le développement des installations et des pratiques sportives. Avec la crise, la donne économique change, mais peut-être pas dans les mêmes termes pour les clubs professionnels et pour les petites associations, lesquelles dépendent souvent beaucoup des collectivités locales. La vitalité des associations sportives est essentielle. C’est donc avec intérêt que nous vous écouterons exposer les difficultés auxquelles vos organisations sont confrontées et formuler, le cas échéant, des propositions de solution.
Avant de vous donner la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Patrice Doctrinal, Christophe Zajac, Bernard Amsalem, Philippe Bana, Mme Cécile Mantel et M. Patrick Andréani prêtent serment)
M. Patrice Doctrinal vice-président de la Fédération française de rugby. Je ne pourrai pas vous apporter de données chiffrées sur les difficultés rencontrées par nos clubs. Cela dit, nous avons profité des réunions de début de saison pour leur poser la question.
Le fait qu’il soit beaucoup moins professionnalisé explique peut-être que le secteur sportif – ou, à tout le moins, celui du rugby – soit un peu moins touché que les autres secteurs de la vie associative. La baisse des moyens alloués à nos associations est sans doute moins importante que ce que nous avions craint dans un premier temps. Dans le monde du rugby, les municipalités portent une attention particulière, me semble-t-il, à ne pas mettre en difficulté les 1 800 clubs existants dont, rappelons-le, seulement trente sont professionnels. Cet effort est moins évident de la part des conseils départementaux ou régionaux, dont les interventions concernent moins la vie quotidienne des associations que l’« événementiel », par exemple les tournois. Dans ce domaine, donc, il a fallu réduire la voilure.
Mais nos associations pointent surtout la diminution de la contribution du CNDS (Centre national pour le développement du sport). Cette institution est devenue un outil de politiques publiques dont le lien avec le développement du sport n’est plus évident. Dans la région Centre, dont je préside la ligue, on constate une baisse de 30 % du nombre de dossiers.
La baisse des subventions a sans doute plus affecté les associations employeurs, qui ne sont pas nombreuses dans le monde du rugby et dont la réaction a été, contrairement aux attentes de la Fédération, de supprimer des emplois et de privilégier le joueur professionnel au détriment de l’éducateur formé ou du directeur administratif.
La réponse aux difficultés a consisté d’abord en une augmentation des cotisations. Cela étant, les clubs connaissent bien leurs licenciés. Si un adhérent ne renouvelle pas sa licence en début de saison, il lui est proposé, si la raison est financière, différents accompagnements. On accepte facilement le fractionnement du paiement en trois échéances. Des dispenses de paiement sont parfois accordées. Certains dirigeants ont une formation aux aides sociales. Mais il faut aller vers les personnes et les accompagner, ce qui n’est pas toujours facile !
Pour les clubs employant des salariés, les difficultés ont pu avoir, paradoxalement, des effets positifs. On a été chercher d’autres sources de financement en s’ouvrant à des activités qui s’écartent des activités sportives traditionnelles : actions à l’école à la faveur de la modification des rythmes scolaires, action dans les domaines de la cohésion sociale, etc.
M. Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme. Depuis qu’il a diversifié son offre en créant il y a dix ans une licence « Athlé Santé Loisir », l’athlétisme rencontre beaucoup moins de difficultés pour trouver des bénévoles. À côté de l’athlétisme traditionnel, celui des compétitions que l’on voit à la télévision, nous avons désormais un volet santé et bien-être. Nous avons travaillé avec de grandes fédérations de médecins – cardiologie, pneumologie, insuffisance respiratoire, plan Alzheimer – et formé des coachs « Athlé Santé ». Ces professionnels encadrent les nouveaux publics qui viennent dans nos clubs et qui, souvent, y prennent des responsabilités. Le dispositif, fondé sur une activité qui n’est pas une activité de compétition, nourrit le bénévolat. Il y a environ 10 000 bénévoles dirigeants pour 2 000 clubs d’athlétisme en France. Ce chiffre est en augmentation alors qu’il baissait régulièrement il y a une dizaine d’années.
En revanche, nous nous heurtons à un problème d’encadrement. Après les belles performances françaises aux championnats d’Europe de Zurich, une forte demande s’est fait jour chez les enfants et adolescents. Beaucoup de clubs sont pourtant obligés de limiter leurs effectifs faute d’encadrement formé – titulaires d’un brevet d’État ou d’un brevet fédéral. Avant l’été, nous avons surtout formé des animateurs destinés à intervenir dans les écoles dans le cadre du nouveau dispositif des rythmes scolaires. Ces personnes ont une formation d’animation pour des enfants de moins de douze ans, mais pas d’entraînement.
Dans la crise du bénévolat que nous observons autour de nous, nous avons, je crois, un avantage sur les autres sports : le développement de l’athlétisme hors stade, avec la course sur route, les trails, les courses de nature. Il se tient en France 8 000 courses chaque année, et neuf millions de personnes courent régulièrement. Beaucoup de clubs organisent des « dix kilomètres », des marathons, des trails. Cela suppose un très grand nombre de bénévoles sur l’ensemble du parcours. Un marathon mobilise, selon son importance, entre 400 et 800 personnes. Or les clubs trouvent assez facilement ces bénévoles, dont ce sera parfois la seule action de l’année : la course du village, ou le marathon de Paris. En contrepartie, on leur offre une tenue, un casse-croûte, etc.
La reconnaissance est très importante pour le bénévole et va bien au-delà de ce « salaire » symbolique. En période de difficultés économiques, beaucoup de personnes ne prennent pas de responsabilités tout simplement parce qu’il n’est pas simple, quand on est au chômage et que l’on se sent isolé, de s’investir dans une association. Nous menons des expériences avec les missions locales pour proposer à des chômeurs de moins de vingt-cinq ans des parcours de formation avec un volet à caractère sportif – marche nordique, course à pied, par exemple. Cette association avec les organisations qui s’occupent des demandeurs d’emploi pour intégrer une activité sportive au parcours de l’individu me paraît intéressante.
En matière de santé, d’ailleurs, nous travaillons avec les entreprises sur la gestion du stress, nous intervenons dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), etc. Ces activités nous permettent de trouver des ressources. Beaucoup de nos ligues ont des conventions de partenariat avec les agences régionales de santé (ARS) et proposent des activités dans les hôpitaux ou les maisons de retraite autour du volet « Athlé Santé Loisir ».
Bref, c’est cette diversification de l’offre qui nous permet de nourrir le bénévolat et d’affronter l’augmentation du nombre de licenciés, qui est de 5 % par an depuis dix ans, soit deux fois plus que la moyenne de toutes les fédérations sportives. J’ajoute que nous nous sommes investis dans l’école bien avant la réforme des rythmes scolaires, créant ainsi des passerelles entre l’école et les clubs.
J’en viens maintenant à quelques propositions pour favoriser l’implication des personnes dans les clubs.
La première concerne la reconnaissance du bénévole. On doit distinguer les personnes qui sont par ailleurs salariées et les personnes qui ne travaillent pas, retraités – ils sont très nombreux à faire du bénévolat – ou chômeurs.
Pour les salariés, des dispositifs fiscaux existent, mais ces personnes, par définition, ont beaucoup de moins de temps que les autres à consacrer à l’action publique. Pour les chômeurs, il est intéressant d’intégrer une activité associative dans le parcours de recherche d’emploi. Plus généralement, on pourrait penser à un avantage fiscal valorisant le temps passé à accompagner les enfants le week-end, à encadrer une manifestation… Après tout, il s’agit d’un engagement philanthropique qui s’apparente au mécénat. Le club exercerait évidemment une surveillance et délivrerait une attestation à la personne, qui trouverait la traduction de son engagement sur sa feuille d’impôt.
Cela représente un peu d’argent, certes, mais c’est une goutte d’eau au regard de la masse de l’impôt et le dispositif serait très valorisant pour les individus.
Je soutiens la deuxième proposition depuis longtemps, sans être entendu. Les bénévoles utilisent souvent leur voiture pour accompagner une équipe, transporter des enfants, etc. L’essence leur est parfois remboursée, quand le club a quelques moyens, mais bien en dessous du coût réel. Pour ma part, je suggère l’instauration d’un « chèque essence » ou « chèque bénévole », proposé par la puissance publique et financé par une ponction sur les vastes bénéfices des grandes sociétés pétrolières ou autoroutières. Là aussi, c’est une goutte d’eau, mais en même temps un signe de reconnaissance très fort. Il est simple de déterminer, en fonction du calendrier des championnats, le nombre de « kilomètres-bénévoles » parcourus chaque année, à charge pour le club de redistribuer les sommes à chaque bénévole.
Voilà pour les marques de reconnaissance – si l’on excepte la médaille de la jeunesse, des sports et de la vie associative, pas forcément demandée par le bénévole tant il est conscient du caractère humble de son action.
Un autre problème est la complexité juridique croissante à laquelle les responsables se trouvent confrontés, surtout lorsque l’association emploie une ou plusieurs personnes sans avoir les moyens de s’adjoindre un comptable. Pourquoi ne pas faire appel aux services déconcentrés – administration fiscale, URSSAF – pour assurer, une ou deux fois par an, une formation auprès des dirigeants bénévoles ? Plutôt que de faire de contrôles, ce qui arrive de plus en plus souvent dans les petits clubs et est souvent très mal vécu, mieux vaudrait se rencontrer de temps en temps dans une démarche de formation. Il en résulterait une connaissance mutuelle plus intéressante pour les uns et les autres !
D’autres efforts de formation sont nécessaires en matière de responsabilité, d’organisation, de marketing, de management, toutes choses que l’on n’apprend pas sur le terrain et que la plupart des dirigeants bénévoles n’ont pas appris à l’école non plus.
Les difficultés économiques ont des répercussions autant sur les collectivités, premiers bailleurs de fonds des associations sportives, que sur les sponsors, qui privilégient les clubs ayant une visibilité médiatique. Dans ce contexte, les « fonds propres » du club, ce sont les cotisations, pour lesquelles des aides existent localement : « coupon sport », aides spécifiques accordées par les conseils départementaux ou par les caisses d’allocations familiales. Ne pourrait-on généraliser une aide à la prise de licence que l’on attribuerait, par exemple, aux personnes qui relèvent de l’allocation de rentrée scolaire ?
Dans l’absolu, le prix de la cotisation à un club sportif n’est pas très élevé. Si on le rapporte au nombre de séances de pratique dans l’année, on arrive à quelques centimes par séance. Il s’agit, véritablement, du loisir le moins cher de France ! Les montants varient entre 50 euros pour les moins chers et 250 euros pour les sports un peu compliqués ou nécessitant des assurances coûteuses. La cotisation peut être plus élevée dans les sports plus « riches » comme le golf ou l’équitation, mais on a affaire alors à des sociétés et non plus à des associations.
Toujours est-il qu’une aide lèverait l’obstacle que peut constituer le prix de la cotisation. On éviterait que certains jeunes traînent dans les rues, on contribuerait à leur socialisation et à la prévention.
Enfin, je considère que nous devrions réfléchir à la pertinence juridique du statut d’association pour les fédérations sportives. Celles-ci bénéficient de l’agrément du ministère, voire d’une délégation, elles gèrent de gros budgets, emploient des salariés – soixante-deux pour la Fédération française d’athlétisme, sans compter les cadres techniques mis à disposition par l’État –, elles organisent des manifestations plus ou moins importantes qui relèvent du business. Par beaucoup d’aspects, elles s’apparentent à des entreprises. Mais, comme ce ne sont pas des entreprises comme les autres, je me demande si l’on ne pourrait pas passer du statut associatif au statut intermédiaire d’entreprise sociale et solidaire. Nous intervenons dans le développement territorial et dans la solidarité locale, puisque nous intégrons des enfants dans un parcours de formation sportive et citoyenne, mais nous avons également des équipes professionnelles de haut niveau et nous organisons des événements.
Ouvrir le statut d’entreprise sociale et solidaire aux fédérations sportives permettrait à celles-ci d’accéder à la reconnaissance d’utilité publique et à des avantages fiscaux qui ne leur sont pas aujourd'hui accordés en matière de charges sociales ou de bénéfices. Lorsqu’une fédération, dans sa structure actuelle, fait des excédents, elle paie des impôts comme n’importe quelle entreprise privée. Compte tenu de l’action que nous menons sur le territoire, il y a là quelque chose de pénalisant.
Pour avoir antérieurement créé des régies de quartier et des entreprises d’insertion, je connais bien le secteur de l’économie sociale et solidaire et je pense que l’activité du secteur sportif est en très proche.
M. Christophe Zajac, directeur des affaires juridiques et institutionnelles de la Fédération française de basket-ball. Le constat général des difficultés rencontrées par les associations s’applique également au basket-ball amateur.
Tout d’abord, nous assistons à une raréfaction des ressources, avec le recentrage des aides publiques et les difficultés déjà évoquées concernant le CNDS. S’ajoutent à cela la problématique du bénévolat et un environnement institutionnel incertain : si, au niveau fédéral, nous avons une bonne connaissance du maillage territorial et de la répartition des compétences entre les différentes collectivités, les associations locales nous indiquent qu’il est compliqué de trouver le bon interlocuteur, de même qu’elles dénoncent le « millefeuille » réglementaire et normatif. Ces associations s’apparentent à de très petites entreprises : elles sont dotées de compétences juridiques, administratives et financières, ce qui suppose la maîtrise de tous ces paramètres.
Notre fédération s’est donc engagée dans une démarche de professionnalisation des structures, d’autant que le nombre d’adhérents augmente. Lors de la saison 2003-2004, nous avions 36 156 dirigeants parmi nos licenciés. Dix ans plus tard, en 2013-2014, ils ne sont plus, en dépit de nos efforts, que 33 992. Dans la même période de dix ans, nous sommes passés de 445 160 licenciés répartis entre 4 332 associations, soit une moyenne de 102 licenciés par club, à un record historique de 504 187 licenciés accueillis dans seulement 4 080 associations, soit une moyenne de 141 licenciés par club.
Nous constatons que les petites structures sont souvent fortement dépendantes de l’action et des compétences d’un dirigeant. Lorsque celui-ci part, il n’est pas toujours facile de le remplacer !
De plus, les associations sportives se trouvent localement en concurrence auprès des partenaires et sponsors potentiels, qu’elles viennent toutes solliciter.
Après un diagnostic rapide de la situation au début de son mandat, le président de la Fédération française de basket-ball a fait de l’aménagement des territoires un des trois axes de sa politique sportive. Cet axe comprend plusieurs éléments : mettre en œuvre une politique territoriale pour les structures et encourager l’innovation locale ; adapter nos pratiques à l’évolution de la société, en particulier par la pratique du 3×3 ; avoir une stratégie de développement des salles ; développer les réseaux d’influence au niveau local ; faire émerger et fidéliser les potentiels des territoires dans les différents métiers du basket ; mettre en œuvre une politique de l’arbitrage ; porter une attention particulière au turnover des licenciés par la mise en place d’une relation directe et privilégiée avec eux ; rechercher l’accroissement des ressources financières ; prendre en compte l’aménagement des rythmes scolaires.
Pour mettre en œuvre cette politique, nous nous efforçons de valoriser la formation des bénévoles. Un des objectifs de l’institut national de formation que nous avons créé est de valider les acquis de l’expérience par une certification délivrée par la Fédération. Nous avons également instauré une labellisation des clubs et des structures afin de promouvoir les initiatives locales. Le programme « Passion Club » regroupe sous un même label des actions et des services destinés aux licenciés. Nous avons enfin mis en place, il y a un an et demi, les coopérations territoriales de clubs, qui visent à remédier aux difficultés financières des associations par la mutualisation des moyens. Lorsqu’une structure est centrée sur la formation, une autre sur le haut niveau, une autre encore sur l’arbitrage, nous les encourageons ainsi à mettre en commun leurs compétences.
La Fédération organise également une université d’été – et maintenant une université d’automne – qui répond à une réelle demande. Nous nous efforçons de recenser les bénévoles, de les connaître, de communiquer plus directement avec eux et de leur apporter des compétences juridiques et financières. La plateforme informatique d’échange e-ffbb fournit aux associations des outils tels que statuts types, plans comptables, etc.
Après plusieurs retours sur des difficultés rencontrées à l’occasion de transports d’enfants, nous avons pris une assurance spécifique pour les bénévoles. Nous communiquons également sur les outils existants, comme le congé représentation et la validation des acquis de l’expérience.
M. Philippe Bana, directeur technique national de la Fédération française de handball. Notre fédération, qui regroupe 2 400 clubs, est passée en vingt ans de 200 000 à 550 000 licenciés. Cela s’est fait en diversifiant nos pratiques, ainsi que l’a bien décrit Bernard Amsalem, en ouvrant notre champ, en sortant du schéma de la compétition, en ciblant des publics d’enfants et d’adultes et en menant des actions axées sur la santé.
En dépit de l’explosion du nombre de licenciés, le nombre de clubs n’a pas changé. Pour faire court, nous avons autant de licenciés que le basket-ball avec deux fois moins de clubs. Cette crise associative profonde, nous devons l’analyser.
Les clubs se plaignent en premier lieu de la complexité administrative, très difficile à vivre pour les dirigeants bénévoles. Dans cette période de vingt ans, 2 000 emplois ont été créés via des dispositifs tels que les emplois jeune ou les emplois d’avenir, mais les associations peinent à accompagner cette professionnalisation. La fonction d’employeur est pour les dirigeants associatifs un pensum ! Ils n’y ont pas été formés. Cette situation aboutit à des échecs, des conflits et des abandons de bénévolat. Un accompagnement de la fonction employeur est impératif. Bernard Amsalem a suggéré de solliciter les administrations. Mais si ce n’est pas là le métier des CROS et des CDOS (comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs), je ne sais pas à quoi ils servent ! Ce sont précisément eux qui devraient offrir un accompagnement à la fonction de dirigeant et d’employeur et des modules de formation adaptés. Or, mis à part les CROS des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre, je n’en connais pas beaucoup qui se donnent cette peine !
De plus, le lien avec l’éducation nationale et les municipalités n’est pas affiné, comme on le voit avec les politiques d’aménagement des rythmes de l’enfant. Le boom associatif annoncé il y a deux ans avec la réforme n’a pas eu lieu. Les plans se succèdent depuis huit ans et rien ne se passe.
Il existe aussi un vrai drame des installations sportives en France. On ne peut continuer à parler de développement des associations si l’on ne crée pas des lieux de pratique. Ces lieux peuvent être modestes, en extérieur. Le plan pour les quartiers nord de Marseille a permis de constater que 30 % des installations sportives étaient dégradées ou inutilisables. Si, au-delà du projet Arena 2015, on ne lance pas en urgence un plan d’installations sportives, nous resterons le pays d’Europe le plus mauvais dans ce domaine.
Car, par ailleurs, on assiste à une explosion de l’offre. Le football en salle, par exemple, entre dans les salles de sports collectifs. Il y a fort à parier qu’avec l’Euro 2016, nous perdrons 30 % de nos créneaux horaires et que 10 % des clubs mettront la clé sous la porte faute d’endroits où pratiquer.
Le monde professionnel n’est pas aussi à l’écart de ces difficultés qu’on le dit. La part des collectivités territoriales ayant diminué ou stagné, il a augmenté sa part de financements privés. On observe des dépôts de bilan dans les divisions de niveau 3 et 4, ce qui signifie sans doute que l’on mélange sport professionnel et sport amateur. Une des recommandations pourrait être de mieux identifier le périmètre du sport professionnel pour éviter d’élargir la conception du professionnalisme à des niveaux qui ne le méritent pas et qui font sauter la caisse des clubs qui s’y fourvoient. Avec Cécile Mantel, la Fédération a mis en place des voies d’accès au professionnalisme qui précisent bien les choses.
Les groupements d’employeurs ont également constitué une réelle aide aux clubs, en leur donnant la capacité, avec d’autres clubs sportifs ou d’autres acteurs, d’agréger des métiers permettant à l’association de vivre.
Plus généralement, il convient d’exiger des fédérations qu’elles explicitent dans leurs conventions d’objectifs quels sont leurs politiques territoriales et les services qu’elles offrent aux associations. Les fédérations sont aujourd'hui des administrations, elles doivent devenir des compagnies de services.
Rappelons aussi une évidence : le sport, c’est bon pour la santé, c’est même aujourd'hui une thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager le remboursement de la licence pour certains publics, comme le suggérait Mme Valérie Fourneyron ? Loin de se cantonner à la compétition pour la compétition, les fédérations sportives sont réellement devenues des opérateurs de développement et de santé.
Le service civique, tel qu’il s’est développé ces trois dernières années en dépit des limites budgétaires, est un vrai outil pour que les jeunes s’emparent du club et le fassent vivre. Ne pourrait-on aller plus loin ?
Je terminerai par les politiques publiques d’emplois aidés. Nous avons 1 500 salariés qui ont consolidé l’emploi jeunes dont ils bénéficiaient auparavant, et 300 à 400 emplois d’avenir. Cette dernière formule est positive mais c’est une charge lourde : avec quels outils les dirigeants formeront-ils des personnes en difficulté chargées elles-mêmes d’accompagner des personnes en difficulté ?
Mme Cécile Mantel, directrice du service juridique de la Fédération française de handball. Les créneaux d’entraînement dans les équipements sportifs posent un vrai problème pour les sports collectifs en salle. En handball ou en basket, alors que les résultats du haut niveau attirent de nouveaux licenciés, on en est à refuser du monde sur certains territoires. La ligue des Pays de la Loire, qui compte 39 000 licenciés, refuse ainsi 2 000 à 3 000 demandes depuis trois ou quatre ans. La question n’est pas celle de la disponibilité ou des diplômes des éducateurs, mais bien celle des salles.
Par ailleurs, la complexité administrative et juridique à laquelle les dirigeants doivent faire face est paradoxale : alors que l’État s’emploie depuis plusieurs années à simplifier les démarches administratives, la constitution des dossiers pour le CNDS ou pour les emplois d’avenir est vécue comme de plus en plus contraignante. Pour un petit club, souvent porté par un ou deux dirigeants très investis, la dématérialisation est parfois difficile à gérer. Les documents et justificatifs apparaissent comme des contraintes insurmontables, si bien que beaucoup de clubs renoncent à demander des subventions ou des financements. Concernant plus particulièrement les emplois d’avenir, la multiplicité des interlocuteurs – Pôle emploi, la mission locale, le tuteur – et l’obligation de rendre des comptes tous les trois mois contrastent avec la souplesse du dispositif emploi jeunes.
L’URSSAF a bien essayé de mettre en place des dispositifs simples pour accompagner les dirigeants dans la fonction d’employeur. S’agissant des transports assurés par les bénévoles, un système de franchise permet de verser des primes exonérées de cotisations sociales. Mais il est régi par une circulaire de 1994 jamais actualisée, qui le limite à certaines catégories d’intervenants et en exclut les éducateurs, c'est-à-dire les personnes dont la présence est indispensable lors des matchs et autres manifestations. Il ne serait pas très difficile de lever cette exclusion !
M. Patrick Andréani, délégué technique général de la Fédération française de gymnastique. Je représente ici M. James Blateau, président de la Fédération française de gymnastique.
Les difficultés rencontrées par les clubs sont de trois ordres : financement, encadrement et management.
Les subventions publiques, on l’a dit, sont en baisse. Le CNDS, en particulier, recentre ses aides sur de plus gros projets. Peut-être cela évite-t-il le « saupoudrage », mais cela écarte aussi certaines associations. Un changement de modèle économique faisant plus appel au privé n’est guère envisageable pour la gymnastique. Notre sport est peu médiatique et nous avons du mal, tant au niveau des petites associations qu’à celui de la Fédération, à trouver des partenaires privés.
Nous avons par ailleurs relevé une légère baisse des prises de licence dans les villes où la réforme des rythmes scolaires a été mise en place. Sans doute les clubs se sont-ils trouvés quelque peu désorganisés, mais il est difficile de tirer des conclusions à ce stade.
Dans les 1 500 clubs de la fédération, 230 diplômes professionnels – certificats de qualification professionnelle, brevets professionnels et diplômes d’État – ont été délivrés pour la saison 2013-2014. En dépit de ce chiffre satisfaisant, le manque d’encadrants est flagrant. L’image de l’entraîneur exerçant en association, le travail le week-end, les salaires assez bas attirent peu de jeunes vers ce métier.
Nous sommes de plus confrontés à une fuite des encadrants de haut niveau vers des pays voisins comme la Suisse ou la Belgique, où on leur offre de meilleures conditions et de meilleurs salaires. Il arrive même que des cadres d’État, c'est-à-dire des fonctionnaires, se mettent en disponibilité ou démissionnent pour partir à l’étranger, tandis que des clubs français n’arrivent pas à pourvoir des postes d’entraîneur.
La Fédération française de gymnastique regroupe 300 000 licenciés, soit une moyenne de 200 licenciés par club. Environ 600 clubs dépassent cette moyenne, cinq clubs ont plus de 1 000 licenciés et un en a 2 000. Il y a, comme au basket-ball, une tendance inquiétante à l’hypertrophie. Les structures qui avaient cinquante ou soixante licenciés il y a quinze ans se sont regroupées. Dans la même période, la Fédération, qui ne comptait que des bénévoles, s’est professionnalisée, mais cette tendance est parfois mal vécue par les bénévoles.
Les clubs sont devenus des entreprises associatives dont la gestion est souvent difficile à assurer pour le dirigeant principal.
Parmi les solutions que nous essayons d’apporter, nous avons créé un groupement d’employeurs propre à la fédération, ce qui nous permet de créer des emplois à temps plein répartis sur deux ou trois associations. Certains clubs travaillant avec les missions locales, ils ont obtenu des emplois d’avenir – en dépit des travers de ce dispositif, notamment en matière de formation – dès l’année dernière.
Nous avons également diversifié nos activités. Il y en a maintenant quatre olympiques et quatre non olympiques, avec des activités de sport santé telles que la baby gym – qui représente à elle seule environ 90 000 licenciés – et la gym senior. C’est ce qui explique le doublement du nombre de licenciés en une quinzaine d’années.
Parmi les évolutions souhaitables, je partage ce qu’ont dit les participants au sujet de la reconnaissance des bénévoles. Lorsque l’activité bénévole est très importante, notamment dans les fédérations, pourquoi ne pas instaurer des jours de représentation, à l’instar du dispositif dont bénéficient les représentants syndicaux ?
Par ailleurs, les bons des caisses d’allocations familiales sont une formule efficace d’aide aux publics défavorisés. Les montants pourraient néanmoins être plus élevés.
Il serait également souhaitable d’aller plus loin dans l’accompagnement éducatif, en lien avec l’éducation nationale. De ce point de vue, le désengagement du CNDS représente une régression.
Le non-remboursement du certificat médical obligatoire constitue un vrai frein, même si les médecins délivrent souvent ce document gratuitement à l’occasion d’une visite. Je suis moi-même professeur d’éducation physique et sportive : lors des activités scolaires, les enfants n’ont pas besoin de certificat médical, mais ce n’est plus le cas pour les activités proposées dans le cadre de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), si bien que je perds nombre de mes élèves. Dans la ZEP (zone d’éducation prioritaire) où j’enseigne, il n’est pas toujours évident d’aller chez le médecin. Le coût de la consultation est un réel problème.
S’agissant de la simplification du traitement des dossiers, le numérique a aidé certains responsables. Mais dans d’autres cas – celui de nombreux retraités notamment –, il constitue un obstacle.
Enfin, ne pourrait-on étendre aux bénévoles encadrants la franchise sur les manifestations sportives donnant lieu à compétition dont bénéficient les guichetiers et les accompagnateurs ? Ce serait une bouffée d’oxygène.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Je remercie les participants pour la grande richesse de leurs interventions et pour les nombreuses propositions qu’ils tirent de leur expérience de terrain.
Vous avez notamment évoqué l’articulation parfois difficile entre l’école, la mairie et le monde associatif. Ne pourrait-on imaginer une autre forme de mutualisation passant par un projet de territoire, en ne raisonnant plus seulement par rapport à telle ou telle discipline sportive ? N’y aurait-il pas là une réponse aux problématiques liées à la professionnalisation, aux frais de fonctionnement, à la comptabilité et à toutes les activités exigeant des compétences précises ? Une vision plus transversale que verticale de vos organisations est-elle envisageable ?
M. Bernard Amsalem. Le projet éducatif territorial (PEDT), de création récente, me semble être l’outil idéal pour faire se rencontrer les acteurs au niveau de la commune. Rassemblant les élus municipaux, les enseignants, les parents d’élèves, les associations sportives, il est particulièrement adapté à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
La Fédération française d’athlétisme encourage depuis une dizaine d’années la mutualisation entre clubs situés en agglomération. Aujourd'hui, des groupements de clubs existent dans presque toutes les grandes agglomérations, chaque club conservant néanmoins son individualité. Ces nouvelles structures sont notamment chargées du haut niveau. Tout le reste – animation territoriale, détection, etc. – se fait commune par commune. Il y a dix ans, aucun club ne dépassait les 500 licenciés ; aujourd'hui, il y en a trente qui dépassent les mille. Les références sont Montpellier, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nantes, Reims, Lille…
Cette évolution correspond à une volonté politique de la Fédération. Toutes les métropoles ne sont pas au même diapason, mais cette démarche permet de mutualiser les moyens et d’optimiser les résultats. Contrairement, peut-être, à d’autres fédérations, nous souhaitons que nos clubs aient un nombre important de licenciés car c’est une condition de l’économie de l’athlétisme. S’il a moins de 150 licenciés, un club ne peut pas faire de l’athlétisme sérieusement. Ce sport regroupant plusieurs disciplines, il faut un encadrant pour le sprint, un encadrant pour les lancers, etc., donc une certaine surface économique.
En dix ans, donc, la moyenne du nombre de licenciés par club est passée de 50 à 140. C’est encore insuffisant mais nous sommes sur la bonne voie.
M. Patrice Doctrinal. Je m’exprimerai pour l’occasion en tant que membre du comité régional olympique et sportif de la région Centre. Nous nous efforçons en effet de fédérer l’ensemble du mouvement sportif par territoires, sachant que les ligues essaient tant bien que mal de le faire pour les disciplines particulières. Mais la transversalité est très compliquée à mettre en œuvre : entre les différents sports, la culture n’incite guère à se mettre autour d’une table ; on est plus dans une culture de rivalité sportive, de rivalité face aux financeurs et aux décideurs, de rivalité pour l’utilisation des équipements.
Depuis cinq ou six ans qu’il mène l’expérience, le CROS mesure les difficultés. Il n’est pas simple de mener avec les élus un diagnostic territorial approfondi – outil dont je regrette l’abandon récent. Nous avions choisi l’échelle des pays et des agglomérations pour profiter des moyens supplémentaires des contrats de pays. Nous sommes parvenus à travailler ensemble, avec les élus, aux diagnostics et à l’élaboration de préconisations dans douze ou quinze territoires. Mais le CROS est limité dans ses moyens pour poursuivre cette action qui, pourtant, donne de bons résultats et est favorablement accueillie par les élus concernés.
M. Jean-Louis Bricout. Les compétitions amateur se déroulent souvent le dimanche, mobilisant dirigeants, bénévoles et joueurs ce jour-là. La perspective d’une banalisation du travail le dimanche vous inquiète-t-elle ? Risquerait-elle de vous priver de ressources ?
La réforme des rythmes scolaires vous conduit à être davantage à la disposition des collectivités, en butte à de réels problèmes d’encadrement des enfants. Quelle est votre perception de la situation ?
Dans la petite ville dont je suis le maire, la mutualisation se fait plutôt entre la collectivité et l’école : c’est un centre social et culturel qui est employeur – avec notamment des emplois d’avenir – pour les activités sportives, scolaires et municipales.
Avez-vous observé un impact de la réforme des rythmes scolaires sur le nombre de licenciés ? Les activités de découvertes développées dans ce cadre constituent une bonne occasion pour les clubs d’attirer de nouveaux adhérents. Au niveau local, j’ai remarqué une augmentation.
S’agissant des recettes, j’entends souvent les clubs se plaindre d’être un peu « siphonnés » par leur fédération, que ce soit sur les licences, les billets d’entrée, etc.
M. Bernard Amsalem. Ils sont malins !
M. le président Alain Bocquet. Vous aussi ! (Sourires.)
M. Jean-Louis Bricout. Avez-vous des chiffres qui permettraient de démêler le vrai du faux ? Les recettes remontant des clubs aux fédérations ont-elles ou non augmenté au fil du temps ?
Enfin, les clubs rencontrent parfois de vraies difficultés financières lorsqu’ils passent au niveau départemental, régional ou national. Comment organiser ces évolutions sans qu’il y ait de ruptures ?
M. Jean-Noël Carpentier. Mes questions s’adressent surtout aux acteurs de l’éducation populaire que vous êtes.
Tout d’abord, la cotisation est-elle un vrai problème pour l’accès au sport en France ? Y a-t-il des inégalités territoriales dans cet accès, dues notamment à des différences de subventionnement ?
Quelle est votre appréciation de la relation entre les fédérations sportives et l’éducation nationale ? De mon point de vue, il s’agit d’un point fondamental. Dès lors que l’on vous considère comme un partenaire d’éducation, je pense que certaines frontières doivent tomber. L’école a ses prérogatives, mais elle ne peut éduquer seule le citoyen en devenir qu’est le jeune. Le mouvement sportif a-t-il réfléchi à cette question, et comment fait-il valoir ses éventuelles propositions ? Le sport à l’école sans votre participation est devenu, selon moi, quelque chose d’obsolète. À titre d’exemple, les éducateurs titulaires de brevets d’État, qui ont de grandes compétences, travaillent très peu avec l’éducation nationale. Enfin, comment faire reconnaître par l’école les compétences acquises par les jeunes dans leur pratique sportive ?
En matière d’équipements sportifs, votre constat est exact : la France est très en retard par rapport aux autres pays européens. Sans doute est-ce dû aussi à l’insuffisance de la mutualisation au niveau des territoires. Que pouvez-vous apporter à la réflexion des élus locaux sur ce point ?
Comme vous l’avez souligné avec humour, il y a toujours un peu de rivalité entre les différents sports, entre les différents niveaux, etc. Et il y a aussi, avouons-le, des rivalités entre communes ! Ce n’est pas malsain, mais il faudra savoir dépasser cela pour aller de l’avant : les investissements à venir sont très importants.
Comment la relation entre sport professionnel et sport amateur s’organise-t-elle ? Quand des milliards sont brassés au niveau professionnel, je trouve que le retour est faible pour le sport amateur, y compris en matière d’équipements. Ces équipements, les communes doivent aujourd'hui les financer à 100 % !
Il faudrait également, comme le souligne M. Bana, clarifier ce qui relève de la pratique amateur et ce qui relève de la pratique professionnelle. Il arrive que l’on rémunère des joueurs en liquide dans des clubs prétendument amateur !
Enfin, comme M. Bricout, il m’est arrivé d’entendre des responsables de club se plaindre de leur fédération. Comment concevez-vous vos relations avec ces bénévoles ?
M. Régis Juanico. Vos propositions concernant la reconnaissance du bénévolat, la prise de licence ou encore la formation sont très intéressantes. Il est vrai que les fédérations ici représentées sont dans un modèle de redistribution vers les territoires et les clubs. Elles créent beaucoup d’emplois et veillent à redonner aux clubs de base une bonne part de leurs ressources.
En matière de simplification administrative, notre collègue Yves Blein vous aura sans doute consultés. À côté de la question des dossiers de subvention et d’agrément se pose celle du certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport, qui doit être délivré chaque année. Pour avoir interrogé les médecins généralistes et les bénévoles sur les difficultés rencontrées à cette occasion, nous estimons qu’il serait souhaitable de revoir cette règle. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Ma deuxième question s’adresse plus particulièrement à M. Amsalem : quelles sont les difficultés rencontrées pour les manifestations sportives organisées sur la voie publique ? Le régime actuel de déclaration et d’autorisation ne constitue-t-il pas un frein ?
Mme Bernadette Laclais. Depuis le premier mouvement d’intercommunalité dans les années 2000, constatez-vous des évolutions positives là où les communautés se sont saisies de la compétence sport ? Y a-t-il des corrections à apporter ?
La réforme des rythmes scolaires permet-elle ou non d’améliorer la mutualisation des équipements ? Avez-vous réussi à contractualiser avec des établissements dont les équipements sont sous-utilisés plusieurs mois durant, notamment au cours des vacances scolaires ?
Vous avez évoqué les problèmes financiers des clubs mais pas la question de la mise à disposition de matériel par les collectivités. Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de difficultés majeures à ce sujet ?
Une part non négligeable des recettes des clubs provient de l’organisation de manifestations. Constatez-vous, là aussi, des difficultés dans les autorisations administratives ou dans la mise à disposition d’équipements répondant à vos besoins ? L’intercommunalité peut-elle constituer un atout en la matière ?
Je vous remercie enfin pour vos informations et remarques concernant la santé. Vous ouvrez des pistes qui seront utiles à la commission des affaires sociales lors de l’examen, dans quelques mois, de la stratégie nationale de santé.
M. le président Alain Bocquet. Je salue M. Aymeric de Tilly, qui vient de nous rejoindre.
À tous les intervenants, je souhaite demander comment ils gèrent l’équilibre entre passion et raison dans le sport. Ma ville de Saint-Amand-les-Eaux a été désignée « ville la plus sportive de France » en 2005 : 16 500 habitants, 6 700 licenciés sportifs, 42 clubs sportifs, 48 disciplines et 8 clubs dans des championnats nationaux. Bref, j’ai fait l’expérience du conflit entre passion et raison : chacun défend sa boutique, l’entraîneur et le président veulent que leur club monte le plus haut possible, et vient un moment où équipements et subventions arrivent à saturation.
D’où l’importance de l’organisation territoriale. Les collectivités de base, qui sont le principal soutien du sport, ont du mal à continuer d’aider tout le monde tout en continuant à construire des équipements.
Par ailleurs, j’ai constaté que les emplois aidés ont parfois tué le bénévolat. Le bénévole n’est là que le soir alors que le salarié est présent du matin au soir. Il arrive que le pouvoir s’acquière de cette manière. Il arrive aussi que l’on demande à la mairie d’embaucher la personne, subitement parée de toutes les qualités !
Le certificat médical, enfin, répond à une exigence de sécurité. Que pensez-vous, à cet égard, des moyens alloués à la médecine du sport ?
M. Philippe Bana. Je commencerai par votre question sur la passion et la raison, monsieur le président.
Nous sommes tous comptables des deniers publics. Aussi devons-nous encourager les collectivités à faire des choix clairs. On ne peut pas faire du haut niveau à la fois en basket-ball, en volley-ball, en football, en rugby, comme cela a été le cas à Istres, par exemple.
Toute la difficulté des responsables politiques est d’affirmer des choix pour éviter les excès de la passion. Ils peuvent étayer ces choix sur des volontés politiques, des histoires, des cultures, une analyse du territoire, mais doivent ensuite établir une grille claire de subventions par niveau : si un club veut monter à tel ou tel niveau, il saura quelle sera sa nouvelle subvention.
Il convient aussi de s’appuyer sur les politiques de conventionnement. Il ne faut pas laisser faire le mouvement sportif jusqu’au bout, mais poser des règles avant que la panique ne s’installe.
Pour ce qui est des rapports entre bénévoles et employés, je crois qu’un professionnel qui tue un bénévole, c’est un meurtrier, et qu’un bénévole qui ne se sert pas d’un professionnel, c’est un imbécile. Ne pourrions-nous dépasser ce schéma clivant et parler de professionnalisation de l’ensemble des acteurs, y compris des bénévoles ? Aujourd'hui, un président d’association a besoin d’une formation au management et à la fonction d’employeur. Lui et le trésorier ont une responsabilité juridique lourde. Il appartient aux fédérations, aux CROS et aux CDOS de créer les outils de formation, de délivrer des certificats de qualification professionnelle.
S’agissant du certificat médical, je crois que l’on doit abandonner le dispositif actuel. La visite médicale dans sa forme actuelle ne sert à rien en termes de santé et de prévention. À un moment où le ministère chargé de la jeunesse et des sports réfléchit à l’amélioration du suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau, on pourrait aussi revoir les examens de base et mettre en place un vrai dépistage et une analyse du risque. Cela aurait un prix mais donnerait au certificat médical une vraie valeur.
Mais cela n’empêchera malheureusement jamais des accidents. Il y a quelque temps, un jeune en équipe de France est décédé sur le terrain d’une maladie cardiaque indécelable à ce niveau de pratique.
Pour en revenir à la formation, il faut imposer aux fédérations sportives d’introduire dans leurs conventions d’objectifs – car ce n’est pas le cas aujourd'hui – un plan de formation et de professionnalisation, une architecture globale des formations incluant tous les acteurs. Elles se sont beaucoup concentrées jusqu’à présent sur la compétition, l’entraînement, la technicité. Elles ont maintenant le devoir de produire des plans de formation et le ministère doit les y contraindre.
Pour un club, le passage à un niveau supérieur présente en effet des risques financiers. Beaucoup de clubs sportifs vivent de financements croisés. Dans les sports collectifs, un bon tiers d’entre eux pourraient exploser si l’on abandonnait cela. Mais aujourd'hui, les rôles et les compétences ne sont pas définis. Il faudrait engager ce travail. La faute originelle, c’est l’oubli de la compétence « sport » dans la loi de décentralisation de 1982. Les collectivités s’en sont emparées ou non. Le puzzle qui en résulte est ingérable : un conseil général fait ce que fait un conseil régional à un autre endroit, etc. Qui aura le courage de définir qui fait quoi, alors même qu’on s’apprête à appuyer sur un bouton qui fera exploser nos politiques associatives ?
M. Patrick Andréani. Dans certains sports, la cotisation peut constituer un vrai frein. Mes élèves d’EPS viennent à l’UNSS, qui leur coûte 16 euros. Mais s’ils veulent continuer de pratiquer dans le club local, le coût de la cotisation – 100 euros, dont environ 40 pour la licence – est dissuasif. Certains paient même en trois fois les 16 euros de l’UNSS !
Cela dit, les projets d’accompagnement éducatif financés par le CNDS existent encore, permettant à des encadrants du club de venir travailler dans l’école. Mais, alors qu’il faudrait amplifier cet effort, j’observe que le CNDS se désengage.
S’agissant du certificat médical, il est aberrant, je l’ai déjà dit, que l’on n’en demande pas pour les cours d’EPS alors que l’on en demande pour l’activité de l’UNSS, qui se tient une heure après avec le même élève, le même professeur et le même sport. L’État s’exonère des contraintes qu’il impose aux associations ! Il faut revoir le dispositif et prévoir le remboursement de la visite.
M. Bernard Amsalem. Je suis contre la suppression du certificat médical. Lorsque le médecin fait les choses sérieusement – ce qui est majoritairement le cas –, la visite est également un moyen de prévention. Ainsi, 20 % des asthmes d’enfants sont détectés à l’occasion de la délivrance de ce certificat.
En outre, la suppression du certificat médical conduirait les compagnies d’assurance à augmenter leurs tarifs, ce qui, au bout du compte, augmentera les charges des fédérations. Sans doute faut-il revoir le protocole de la visite, mais surtout pas la supprimer !
J’en viens à la cotisation. Le montant de la fédération est compris entre 25 et 40 euros. S’y ajoutent la ligue, le comité, etc., puis le club, pour aboutir à 60 ou 70 euros pour les cotisations les moins chères et à 250 euros pour les sports les plus chers. Mais ces montants sont à rapporter au nombre de séances, de compétitions et d’événements organisés par le club en une année : on arrive alors à quelques centimes pour une séance. Aucun autre loisir n’est aussi peu cher.
En outre, les CAF et les CCAS (centres communaux d’action sociale), voire les départements, proposent souvent des aides aux familles rencontrant des difficultés financières. Certes, comme pour le CNDS, cela suppose que le club remplisse des dossiers, mais les moyens existent et la cotisation ne peut être considérée comme un frein. La France compte aujourd'hui dix-sept millions de licenciés, ce qui fait du sport le premier mouvement social du pays. Il faut arrêter de se focaliser sur la cotisation, qui représente une ressource importante à la fois pour la fédération, pour la ligue, pour le comité départemental et pour le club.
Pour ce qui est de l’organisation territoriale, la balle est dans le camp des élus. Les collectivités financent le sport à 85 %. En tant que principal sponsor, il vous appartient d’exiger la mise en place de règles pour éviter des concurrences coûteuses et des dérives. Vous serez forcément écoutés, puisque les subventions dépendent de vous. Certaines agglomérations, par exemple, ont mis fin au saupoudrage et concentré leurs subventions sur les associations ayant une visibilité nationale, voire internationale. Elles ont donc choisi un nombre limité de sports, au détriment des autres qui, eux, continuent d’être soutenus par leur commune.
La balle est d’autant plus dans votre camp qu’il y a trop de fédérations en France. Pour un sport de combat exotique, par exemple, une fédération obtiendra très facilement l’agrément. On émiette ainsi le sport alors qu’il faudrait mutualiser, se regrouper, travailler ensemble. Les partenariats entre fédérations n’existent pas. Chacun est dans son coin, d’où une concurrence que je trouve stupide. Pourquoi ne pas envisager des licences multisports, qui correspondent à l’évolution de la pratique ? Les enfants aiment bien toucher à plusieurs sports avant de choisir, à l’adolescence, celui qui leur plaît le plus.
À l’heure actuelle, nous sommes plus dans des logiques de clocher que dans des logiques de projet. L’État doit arrêter d’agréer toutes les fédérations. Il faut au contraire, encourager des rapprochements entre celles qui existent. Dans les sports de combat, par exemple, l’organisation et la préparation sont à peu près identiques ; seules les techniques diffèrent un peu, mais cela ne justifie pas l’existence d’une fédération par discipline. Pour tous les sports individuels, des rapprochements sont possibles. Aujourd'hui, nous sommes le pays d’Europe qui compte le plus de fédérations : deux fois plus que l’Allemagne ! Il y a là une source intéressante d’économies.
En matière de formation, le ministère chargé de la jeunesse et des sports délivre des diplômes d’État qui offrent immédiatement un débouché professionnel. En parallèle, la filière universitaire des STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ne permet pas toujours de trouver un emploi. Il faudra bien qu’un jour on rapproche les deux filières. Non seulement ce double système est ridicule, mais il ne permet pas aux jeunes de trouver leur voie.
Lorsque l’on parle de la nécessaire « professionnalisation » des clubs, cela ne signifie pas que l’on va rémunérer les bénévoles, mais qu’il faut avoir l’esprit entrepreneurial. La formation des dirigeants doit donc porter sur le management et, pour trouver des ressources, sur le marketing. Les fédérations sont prêtes à faire cet effort. L’État doit nous y aider en améliorant et en simplifiant ses filières.
S’agissant des courses pédestres, nous avons la responsabilité, par délégation du ministère, d’harmoniser les calendriers. Or, depuis le « décret hors stade », qui transpose une directive européenne sur les services et qui s’applique au triathlon, au cyclisme et à l’athlétisme, nous rencontrons de grandes difficultés et nous n’avons plus la maîtrise de l’harmonisation du calendrier : n’importe qui peut, muni d’une autorisation préfectorale, organiser un marathon juste avant le marathon de Paris, par exemple. Ce décret assimile nos courses sur route, pourtant organisées à 98 % par des associations sans but lucratif – clubs, comités des fêtes, associations ad hoc… –, à des activités de sociétés privées. Or seules vingt courses sur les huit mille qui se déroulent annuellement en France sont organisées par de telles sociétés.
L’assimilation à une activité commerciale ne tient pas. Les organisateurs sont bénévoles. Le droit d’inscription sert à financer la sécurité, à acheter des tee-shirts et des sandwiches pour les bénévoles, etc. En dépit de nombreuses démarches auprès du ministère, nous n’avons jamais réussi à obtenir une modification du décret. Lorsque l’on interroge à ce sujet le commissaire européen qui était à l’origine de la directive, M. Michel Barnier, il répond que le texte européen a été en l’occurrence mal interprété.
Pour ce qui est des équipements sportifs, j’aimerais qu’on s’efforce, au-delà du respect des normes, à répondre à ce que sont devenus les clubs : des lieux de vie, des instruments d’animation d’un territoire ou d’un quartier. Si l’équipement n’offre pas de salles où l’on puisse organiser une réunion, une fête, accueillir les enfants après l’école pour qu’ils fassent leurs devoirs avant le sport, on rate quelque chose. Je dis souvent que le club sportif est le dernier rempart de la République : il n’y a plus beaucoup de lieux en France où puissent se mêler des personnes de toutes origines sociales et ethniques et de tous âges ! Si l’on construit des équipements mal conçus, la vie locale s’en ressentira.
Je suis référent au comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur la question des rythmes scolaires. À ce titre, j’ai organisé des réunions avec les fédérations pour les inciter à préparer la rentrée 2014 et, plus généralement, à investir le champ scolaire de manière à ménager des passerelles vers les clubs. Mais je leur ai déconseillé de proposer les mêmes activités que dans les clubs, car cela pourrait avoir l’effet inverse. Mieux vaut offrir des activités d’éveil et de découverte sous forme de jeux. Plusieurs fédérations, dont la nôtre, ont saisi l’occasion pour inventer de nouveaux concepts et les résultats sont excellents. Nous n’avons pas perdu de licenciés. En revanche, ceux qui n’ont pas revu leur approche en perdent dans les catégories des moins de douze ans.
M. Patrice Doctrinal. Le mouvement régional olympique et sportif est très favorable à la mise en place de structures au niveau intercommunal, que nous dénommons « conseils associatifs sportifs locaux ». Une fois que le diagnostic a été réalisé et que le mouvement sportif s’est fédéré pour devenir l’interlocuteur des pouvoirs publics, tout le monde y trouve son intérêt.
Les élus ne doivent pas craindre de s’emparer de la compétence sport. Je ne partage cependant pas le point de vue de Bernard Amsalem : les pouvoirs publics ont une capacité d’incitation, bien sûr, mais on ne réussira que si le mouvement sportif se rassemble pour dialoguer de façon responsable avec les responsables politiques. Je regrette que le CNOSF n’ait pas fait de l’organisation du mouvement sportif un objectif prioritaire.
À titre d’exemple, le CROS de la région Centre a mené une « étude piscine » qu’il a soumise à toutes les collectivités, et personne n’a contesté le sérieux de ce travail. Le mouvement sportif est capable de s’organiser lui-même sans qu’on ait besoin de lui mettre le pistolet sur la tempe, et il sait se montrer raisonnable dans le contexte actuel.
En matière de rythmes scolaires, nous conseillons aux clubs de ne pas s’inscrire dans une logique de prestation de services, mais plutôt dans un partenariat avec les collectivités territoriales. Nous sommes nous aussi des acteurs des politiques publiques territorialisées.
Concernant les relations entre salariés et bénévoles, nous avons tiré les conclusions de l’expérience des emplois jeunes. Au moment où il est devenu employeur pour tirer parti de ce dispositif, le mouvement sportif n’était pas professionnalisé et ne possédait pas de véritable projet associatif. Les clubs n’avaient aucune idée des compétences dont ils avaient besoin. Ils se sont mis à rémunérer des activités que les bénévoles accomplissaient gratuitement. Il s’en est suivi une rivalité nocive. C’est pourquoi la Fédération française de rugby, s’inspirant du handball, a mis en place une politique de professionnalisation et d’accompagnement individualisé des clubs pour les amener à structurer leur projet associatif.
Pour ce qui est du certificat médical annuel, le rugby, sport de contact, ne peut s’en dispenser.
Par ailleurs, nous menons déjà de très nombreuses actions avec l’éducation nationale, à tel point que les clubs se sont posé la question de leur intérêt : en termes de licences supplémentaires, les résultats semblaient bien maigres ! Depuis, nous avons mené une étude qui montre que toute action en milieu scolaire se traduit, à un moment ou à un autre et parfois sans causalité immédiate, par une augmentation du nombre de licenciés.
Enfin, je partage l’analyse de Bernard Amsalem concernant les espaces de convivialité. Du reste, la culture du monde du rugby fait que nous commençons par construire cet espace. Nous installons ensuite le terrain et les poteaux, s’il reste un peu de place ! (Sourires.)
M. Philippe Bana. Pour aborder la question du travail le dimanche, la convention collective nationale du sport (CCNS) est un outil idéal. Même si le dispositif est perfectible, le monde du sport s’est donné une crédibilité en entrant enfin dans le droit commun.
S’agissant de la part fédérale dans les cotisations, je crois franchement qu’elle est raisonnable quelle que soit la fédération. Sans doute faudrait-il que le ministère chargé de la jeunesse et des sports exerce une surveillance pour que la qualité du service soit proportionnelle et adaptée.
Les ligues professionnelles, quant à elles, imposent des cahiers des charges assez lourds, notamment en matière d’équipements. Les collectivités territoriales ont parfois du mal à accepter des changements rapides et coûteux. Elles sont cependant représentées dans une nouvelle instance où l’on discute de ces problèmes : le Conseil national du sport.
Par ailleurs, il a été mis fin il y a deux ans aux conventions passées avec le ministère de l’éducation nationale, sans explication de la part de ce dernier. Nous nous efforçons de relancer cette dynamique à laquelle l’éducation nationale ne semble pas capable de faire face.
M. le président Alain Bocquet. Avant de vous donner la parole, M. de Tilly, je vous demande de prêter serment.
(M. Aymeric de Tilly prête serment)
M. Aymeric de Tilly, directeur adjoint de la Ligue du football amateur (Fédération française de football). Je vous prie tout d’abord d’excuser mon retard. En plus de mes fonctions à la Ligue du football amateur, je dirige un club parisien de 700 licenciés.
Je ne crois pas que le montant de la cotisation soit un réel sujet. Lorsque l’on considère les services que le club propose sur une année, on s’aperçoit que peu d’activités sont proposées à un prix aussi bas. En outre, les clubs mettent en place différentes procédures – paiement différé, etc. – pour accompagner les familles modestes, et la cotisation permet de doter l’enfant d’équipements de qualité.
La formule actuelle du certificat médical n’est pas idéale, en effet, mais un contrôle est nécessaire au moment de l’inscription. Les personnes qui s’inscrivent doivent avoir une information sur leur état de santé. Il se peut que la visite se fasse quelquefois à la va-vite, mais c’est loin d’être le cas partout. Certains clubs organisent même la visite médicale sur place.
En matière de bénévolat, le problème n’est pas de savoir qui « tue » qui, mais d’apporter les formations adaptées. Toute personne qui intervient dans un club, quelle que soit sa mission – éducateur, accompagnateur, bénévole, dirigeant –, doit être formée. Nous devons l’aider à acquérir les compétences et les connaissances pour structurer le club. C’est le seul moyen d’amener plus de gens à la pratique sportive.
Il est par ailleurs important que les clubs puissent organiser des manifestations. Ce n’est pas du commerce, ce sont juste des moments de vie qui permettent d’équilibrer les comptes, voire d’acheter des équipements ou un minibus, de refaire une buvette, etc. Tout le monde s’y rassemble, quels que soient ses origines, son âge, son sexe.
Il faut enfin que les gens aient envie de s’investir. Les dirigeants ont souvent un poids très lourd à porter. Mon association, par exemple, organise des séjours à la montagne, des stages, des enfants font de longs trajets en métro pour aller jouer au tennis. Il est normal que l’on se pose beaucoup de questions avant de s’engager dans l’aventure humaine et sportive du bénévolat, tant on met en avant les risques – réels – que cela comporte.
M. le président Alain Bocquet. Je vous remercie pour cet échange de vues très riche.
Audition de M. Jean-Pierre Hardy, directeur des politiques sociales de l’Assemblée des départements de France.
(séance du 30 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mes chers collègues, nous avons entendu le 9 septembre dernier la voix des communes et celle des régions. Nous allons entendre aujourd’hui celle des départements. J’ai en effet le plaisir d’accueillir M. Jean-Pierre Hardy, directeur des politiques sociales de l’Assemblée des départements de France.
Monsieur, comme vous le savez, les relations entre les collectivités territoriales et les associations sont au cœur des réflexions de notre commission d’enquête. Nous cherchons, en particulier, à savoir si elles se sont transformées dans les années récentes et si elles font toujours une place suffisante à l’autonomie du projet associatif.
S’agissant des départements, l’équation est peut-être compliquée par le fait que ceux-ci mettent en œuvre de nombreuses politiques sociales obligatoires, et que nombre d’entre elles sont soumises à une tarification contrôlée par la puissance publique. Peut-on aller jusqu’à dire que les associations sont devenues de simples prestataires des collectivités ?
Mais avant de vous entendre et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demanderai de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Pierre Hardy prête serment)
M. Jean-Pierre Hardy, directeur des politiques sociales de l’Assemblée des départements de France. Je commencerai par une présentation générale du secteur associatif – son poids et le rôle qu’y jouent les départements.
Vous connaissez les chiffres : 1 300 000 associations ; 85,1 milliards de budget consolidé, dont les associations du secteur social de la santé représentent 45 % avec 38 milliards d’euros, celles du secteur du sport 11 % avec 9,3 milliards d’euros, et celles du secteur de la culture 10 % avec 8,3 milliards d’euros. Les départements se sont particulièrement investis dans ces trois secteurs.
Parmi les 1 300 000 associations, il convient de distinguer les 183 000 associations employeuses, dont la masse salariale peut être conséquente.
Les financements publics dont elles bénéficient proviennent à la fois des départements (23 %), de l’État (15 %), des organismes sociaux (à 11 %), des communes (à 7,5 %) et des régions (à 0,5 %). Elles peuvent toucher d’un côté une subvention – laquelle a été redéfinie par la loi sur l’économie sociale et solidaire – et de l’autre une tarification administrée, qui répond à une autre logique et relève d’un système d’autorisation. Cette différence de nature se retrouve dans le fait que la subvention est au compte 74 dans le plan comptable, tandis que la tarification administrée est au compte 73. Une association intervenant dans le secteur soumis à tarification bénéficie d’une autorisation pour 15 ans et se trouve donc dans une situation moins précaire que si elle était financée par subvention ou dans le cadre d’une convention triennale.
21 % des associations employeuses appartiennent au secteur santé/social/médico-social, ce qui représente 54 % de la masse salariale de toutes les associations et 53 % des employeurs du secteur associatif. 28 % appartiennent au secteur du sport et 19 % au secteur de la culture.
Dans ces trois secteurs, on constate qu’entre 1999 et 2011, la part des départements dans le financement des associations, hors tarification administrée, est passée de 9,3 % à 12,3 %. Les départements se sont donc davantage investis. Il ne semble pas qu’ils se soient désengagés en 2011-2012, malgré une situation financière tendue.
En revanche, l’État s’est désengagé dans le secteur associatif, puisque sa part de financement est passée de 15 % en 1999, à 11,3 % en 2011. Il en a été de même pour les organismes sociaux, dont la part est passée de 8,6 % à 6,7 %, et pour les communes, dont la part est passée de 15,2 % à 11,5 %. Les départements ont pallié en partie ces désengagements, mais on peut se demander s’ils pourront le faire dans les années qui viennent.
Enfin, les régions se sont davantage investies, même si leur part reste modeste : 2,9 % en 1999 et 3,5 % en 2011.
J’observe qu’avec la nouvelle définition de la subvention issue de la loi sur l’économie sociale et solidaire, c’est l’association qui propose à l’organisme de financer son projet associatif. Bien sûr, dans la pratique, le processus est beaucoup plus itératif : l’association contacte les départements ou les collectivités locales pour leur présenter son projet et leur demander s’il a des chances d’aboutir. Le maire ou le président du conseil général ne découvre pas le dossier sur son bureau au dernier moment.
Cette définition est intéressante en ce qu’elle devrait permettre de garantir l’autonomie du projet associatif, ce qui n’est pas le cas avec la tarification administrée, qui répond à une logique de schéma et de planification. Cela dit, les co-constructions sont possibles – et je ne voudrais pas être dans la caricature en prétendant que les associations font tout et que les pouvoirs publics suivent, ou à l’inverse que les pouvoirs publics s’imposent et instrumentalisent l’association.
L’ADF est bien placée pour le dire puisque, s’agissant de la refondation de l’aide à domicile, nous construisons un projet complet avec 15 fédérations. De même, sur les SAAD famille et sur la notion de « parcours résidentiel » pour l’aide aux handicapés, nous pouvons parler d’une co-construction entre les associations et les collectivités, au niveau local comme au niveau national.
Je voudrais m’arrêter sur un autre élément important : il est actuellement envisagé de supprimer la clause de compétence générale. Or si les départements sont obligés, de par la loi, de se concentrer sur leurs compétences obligatoires, on est en droit de se demander s’ils ne vont pas se désengager vis-à-vis des associations.
On pourrait peut-être améliorer l’article 28 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui précise que les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. Certes, il serait difficile de confier de telles compétences à une seule collectivité
– d’autant que les départements se sont fortement engagés – ou d’empêcher telle ou telle collectivité d’intervenir. Mais ne pourrait-on pas étendre le champ de ces compétences partagées, par exemple à l’éducation populaire, à l’égalité et la défense des droits et des causes, ou au respect de l’environnement ?
Pour notre part, si la clause de compétence générale n’est pas maintenue, nous insistons, en tant qu’ADF, sur le fait que le département se trouve au cœur des solidarités sociales et territoriales. Dans ce cadre, le département conservera-t-il peut-être, au moins, le droit de s’engager au-delà du domaine des prestations d’aide sociale proprement dites.
Un exemple : à l’heure actuelle, la politique départementale de protection de l’enfance ne se limite pas aux foyers de l’enfance, aux maisons d’enfants à caractère social, à l’AEMO (action éducative en milieu ouvert) et aux secours. Elle s’intègre à une politique plus globale sur la jeunesse, qui va bien au-delà du public de l’aide sociale à l’enfance. Et c’est heureux : la prévention contre le suicide concerne aussi bien les jeunes en difficulté que ceux de certains quartiers ou de certaines écoles où la pression de la performance entraîne, notamment, des addictions.
Dans les mois qui viennent, nous lancerons un véritable débat sur les conséquences qu’aurait la suppression de la clause de compétence générale pour les départements, notamment dans le secteur associatif, et dans des domaines très importants comme la culture, le développement, le sport, qui relèvent également du développement social. Des inquiétudes se sont fait jour. À quel compromis va-t-on aboutir ?
Mais il s’agissait là de subventions. Venons-en à la tarification administrée qui, je le répète, répond à une logique de planification, de schéma, mais aussi de co-construction. Or, là encore, il y a de quoi s’inquiéter pour la compensation des charges des départements au titre des allocations de solidarité, pour la part d’« établissement », l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile et l’aide sociale à l’hébergement.
Ainsi, la rétractation de la ressource et l’augmentation de la dépense risquent d’entraîner, pour les départements, une certaine difficulté à assumer, non seulement leurs compétences non obligatoires – comme l’aide aux associations – mais aussi leurs compétences plus traditionnelles.
Par ailleurs, nous avions beaucoup espéré du rapport sur le CICE publié l’année dernière par plusieurs députés, Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico. Il comportait une vingtaine de propositions. Or celles-ci ont été assez peu reprises dans les PLFSS et PLF.
Pour notre part, nous souhaiterions que l’on reconnaisse les missions d’intérêt général dans le secteur social et médico-social, notamment dans le champ tarifé. Les dispositions législatives qui ont été votées en ce sens au Sénat à plusieurs reprises depuis le début de 2010 n’ont pas prospéré ; nous ne les avons pas retrouvées, comme nous le pensions, dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Nous vous laisserons les amendements de l’ADF portant sur la refondation de l’aide à domicile, secteur associatif très important mais en grande difficulté. Nous avons fait des propositions très concrètes : faire reconnaître la logique du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) valant mandatement – au sens du droit communautaire – du département vis-à-vis des partenaires de l’aide à domicile, qui peuvent d’ailleurs ne pas être des partenaires associatifs – CCAS, organismes agréés relevant du code du travail dans la mesure où ils acceptent les missions d’intérêt général ; promouvoir la « bientraitance » ; prévenir la précarité énergétique. Ces propositions, que nous avons faites dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, n’ont pas plus prospéré. Mme Rossignol a annoncé qu’au Sénat, on reviendrait peut-être dessus. Mais pour l’instant, nous restons en deçà des ambitions qui étaient celles de l’ADF sur la refondation de l’aide à domicile.
Il en est de même des appels à projets, qui amènent à s’interroger, notamment, sur les risques d’instrumentalisation que vous avez évoqués.
Le projet de loi d’adaptation au vieillissement a introduit quelques assouplissements en la matière. C’est de bon augure, mais nous regrettons que l’on ne soit pas allé assez loin – en matière d’extension ou de recomposition de l’offre par le biais du changement des agréments, faut-il nécessairement passer par des appels à projets ? La création des structures expérimentales, qui sont au cœur du secteur associatif, est soumise à appel à projets. Pourtant, « par définition », on n’est pas dans une logique d’appel à projets lorsqu’il s’agit de structures expérimentales : le porteur du projet et l’autorité dialoguent pour apprécier le caractère effectivement expérimental de celui-ci, puis seulement peut venir l’appel à projets qui, dans la mesure où l’on connaît déjà la structure expérimentale, sera construit en fonction du dossier que l’on aura travaillé en commun. D’ailleurs, le cahier des charges national des appels à projets pour les structures expérimentales n’a jamais été publié…
Il y a donc toute une série de dispositions à prendre pour faire évoluer la législation sur les appels à projets, la refondation de l’aide à domicile ou la reconnaissance des missions d’intérêt général – comme c’est le cas dans le sanitaire.
Ensuite, l’analyse des difficultés financières nécessiterait sans doute de passer à la création d’une centrale des bilans des associations. Un amendement de l’ADF, soutenu par plusieurs groupes politiques, a été voté en ce sens à deux reprises au Sénat.
Aujourd’hui, une association qui touche plus de 153 000 euros de subventions doit déposer ses comptes certifiés par le commissaire aux comptes sur un site du Journal officiel. On pourrait améliorer la présentation de ce site, avec des « bibliothèques », en faisant apparaître les associations sociales, voire celles qui interviennent majoritairement dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance, de la politique de la ville, etc.
Aujourd’hui ne sont concernées que les associations touchant plus de 153 000 euros de subventions. Les associations du champ médico-social autorisées, agréées pour quinze ans, tarifées en tarification administrative, ne sont pas obligées de déposer leurs comptes certifiés, puisqu’elles ne touchent pas de subventions – au titre du compte 74. C’est en tout cas ce que leur ont suggéré malicieusement certaines fédérations. Il semble malgré tout un peu dommage que soient exonérées de cette obligation des associations qui gèrent parfois plusieurs dizaines d’établissements et peuvent employer de 300 à 3 000 salariés : associations du type ADPEI (association départementale pour l’emploi intermédiaire), APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés), UDAF (union départementale des associations familiales). Si elles étaient inscrites au greffe du tribunal du commerce, ces associations feraient partie des cinq premiers employeurs du département !
Certaines d’entre elles publient leurs comptes, parce qu’elles reçoivent par ailleurs des subventions – de l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées), au titre de la politique de la ville, etc. Au lieu d’entrer par la grande porte parce qu’elles touchent 40 millions d’euros de produits de la tarification, elles entrent par la petite porte parce qu’elles dépassent un certain seuil de subventions.
Nous souhaiterions donc la mise en place d’une vraie centrale des bilans. Cela nous donnerait une vision pluriannuelle et consolidée de la situation des associations. Nous connaîtrions celles qui sont en difficulté, notamment dans le champ du handicap. Nous connaîtrions leur mode de financement – tarification administrée ou subvention. Nous saurions si elles font de plus en plus souvent appel à leurs adhérents ou à la vente de prestations. On sait par exemple que les associations sportives, qui touchent peu de subventions, touchent les adhésions du club et font appel au sponsoring.
Nous aurions ainsi une vision plus globale de la situation des associations, que l’on pourrait ainsi analyser dans la transparence. Cela me paraît être la contrepartie légitime du fait que nous devons nous pencher sur leurs difficultés.
Je terminerai sur une inquiétude. Nous nous réjouissons de la nouvelle définition de la subvention, qui permettra à des associations qui ont un projet d’obtenir une décision rapide sans passer par les arcanes des appels d’offres du médicosocial. Mais cette définition fait que de très nombreux organismes financés par des subventions d’équilibre ne pourront plus l’être. Je pense notamment aux CREAI (Centres régionaux d’études d’actions et d’informations, au service des personnes en situation de vulnérabilité), aux groupements d’entraide mutuelle ou aux MAIA (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer).
Cette subvention d’équilibre est quasiment automatiquement reconduite tous les ans, mais n’est pas demandée par les organismes eux-mêmes. Par ailleurs, ce ne sont pas des organismes autorisés pour quinze ans. La nouvelle définition, favorable pour toutes les associations de quartier engagées dans des actions de proximité, pourrait ne pas l’être pour celles qui vivent de subventions d’équilibre. Mieux vaudrait faire passer ces organismes dans une logique de tarification, et les inscrire dans la nomenclature des établissements et structures sociales et médicosociales, pour qu’ils puissent émarger à un financement non plus par subvention, mais par forfait. Nous avons donc alerté les ministères sur ces risques de déstabilisation.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci monsieur Hardy. Je souhaiterais vous interroger sur le contenu des appels à projets. Ceux-ci peuvent-ils réellement être considérés comme une co-construction de réponses encore plus adaptées aux besoins de la population ? Selon vous, comment pourraient-ils s’inscrire dans le cadre de l’innovation sociale ? Il me semble important, à l’aube de la prochaine réforme territoriale, de pouvoir prendre en compte la qualité des projets et la façon dont ils peuvent s’inscrire dans l’avenir.
M. Jean-Pierre Hardy. La position de l’ADF est que les appels à projets se justifient lorsque, sur un territoire, on n’a pas pu répondre à certains besoins, soit parce qu’il n’y a pas d’« opérateurs » pour le faire, soit parce que les pouvoirs publics estiment que la réponse d’un opérateur n’est pas ou plus satisfaisante. Dans ce cas, inutile de continuer à contractualiser avec cet opérateur, qui vit peut-être sur une sorte de « monopole historique ». Mieux vaut alors recourir à l’appel à projets après avoir défini le type d’équipements ou de prestations dont on a besoin. On a déjà vu les initiatives d’opérateurs répondre à leur rationalité propre plutôt qu’aux besoins effectifs du territoire sur lequel ils opèrent.
En revanche, les appels à projets nous semblent inutiles lorsque les partenaires travaillent bien ensemble. Autant entrer dans une logique de contractualisation. D’ailleurs, dès avant la loi Hôpital, patients, santé et territoire, l’outil CPOM permettait de contractualiser sur la recomposition de l’offre.
Nous sommes donc plutôt favorables à ce que, dans le cadre d’un contrat, on puisse intégrer la recomposition de l’offre (à la fois quantitative et qualitative) ou son extension
– bien évidemment dans la limite des enveloppes du financeur. On peut alors entrer dans une logique de filière.
Par exemple, dans les foyers de vie ou dans les foyers occupationnels, il est possible de faire des appartements partagés ou de la résidence sociale, qui ne relèvent pas du code de l’action sociale et des familles, mais du code de la construction.
Nous avons beaucoup travaillé avec certains partenaires sur ce que l’on appelle le « parcours résidentiel ». Admettons qu’il faille répondre, sur un territoire, aux besoins d’une file active de 100 à 120 personnes – 100 si elles sont lourdement handicapées, et 120 si elles le sont moins et nécessitent donc un moindre accompagnement. Peut-être que dans trois ou quatre ans, le vieillissement fera qu’il faudra abandonner des appartements qui étaient en colocation et refaire une structure un peu plus encadrée.
Par rapport à l’appel à projets, la contractualisation a l’avantage de la souplesse. Elle pourrait remplacer celui-ci, sur un territoire où l’on travaille depuis des années avec le même partenaire. Si on a autorisé l’établissement, voire la chaîne d’établissements et de services, c’est que l’on a plutôt confiance en ce partenaire.
Enfin, comme je le disais tout à l’heure, tout ce qui est innovation doit échapper à l’appel à projets. En tant que professionnel, je me souviens que dans le passé, il était difficile de mener à bien des projets innovants. La composition des CROSS, les anciens comités régionaux d’organisation sociale et médico-sociale, faisait qu’il fallait se battre contre des conservatismes, alors même que le projet avait été discuté au niveau local. Pour ma part, je considère donc que les projets innovants doivent plutôt relever du gré à gré et de la contractualisation, ce qui permet d’éviter de les dénaturer.
M. Régis Juanico. À propos de notre rapport sur la fiscalité du secteur privé non lucratif qui a été remis au Premier ministre en décembre 2013, j’observe qu’il est encore trop tôt pour dire que les propositions qu’il contient sont peu nombreuses à avoir été mises en œuvre. Des mesures ont déjà été prises et j’espère que d’autres suivront, notamment dans le cadre du PLF 2015. Ce premier volet de mesures porte sur la simplification des obligations fiscales et administratives des associations – notamment dans la loi sur l’économie sociale et solidaire.
J’observe aussi, même si des difficultés ponctuelles peuvent se poser dans tel ou tel secteur, que la nouvelle définition de la subvention est de nature à sécuriser, sur le plan financier et juridique, aussi bien les associations que les collectivités territoriales. En outre, pour la première fois dans notre histoire, cette définition de la subvention est maintenant inscrite dans la loi.
Nous avons avancé sur un certain nombre de sujets, comme la sécurisation du périmètre du versement transport – même s’il reste sans doute quelques ajustements à faire dans les prochaines semaines à l’occasion du projet de loi de finances. Nous espérons avancer sur l’augmentation des seuils de lucrativité.
Reste une question majeure, qui est davantage d’ordre budgétaire et financier : la distorsion de concurrence entre le secteur privé lucratif d’un côté et le secteur privé non lucratif de l’autre. En particulier, nous devrons nous pencher sur la taxe sur les salaires, qui s’applique d’abord au secteur associatif et le pénalise tout particulièrement. En effet, dans ce secteur, il y a beaucoup de bas salaires. Une première mesure a fait passer le seuil d’abattement de 6 000 à 20 000 euros. Peut-on encore aller un peu plus loin ? Mais surtout, est-il possible aujourd’hui de revoir ce système et de le moduler en faveur du secteur associatif ?
Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes amenés à discuter et à travailler avec le Gouvernement.
Ma question porte sur le deuxième volet de la réforme territoriale, avec la disparition de la clause de compétence générale pour les départements et les régions, et le maintien de compétences partagées, notamment dans les secteurs du tourisme, du sport et de la culture.
Avec la mention des secteurs du sport et de la culture, de nombreuses associations seront concernées. Mais comme les compétences propres et spécifiques du département tournent autour de la solidarité, comme vous l’avez fait remarquer, de nombreuses associations à caractère social pourraient être réintégrées. Et on pourrait mettre en avant l’action du département envers la jeunesse et la famille pour en réintégrer d’autres.
Je pense toutefois que nous devons éviter de dresser une liste à la Prévert, car nous risquerions d’en oublier. Mais ne pourrions-nous pas rajouter, parmi les compétences partagées, « vie associative » à « sport, culture et tourisme » ? Cela définirait un périmètre tout à fait cohérent, qui permettrait encore à la collectivité départementale d’accompagner de très nombreux projets sur le terrain, à ce niveau de collectivité. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Cela ne nous dispensera pas, bien évidemment, de clarifier les compétences entre les différents échelons.
Mme Marie-Hélène Fabre. Nous savons que depuis des décennies, l’État s’est défaussé sur les associations pour faire de la politique sociale. Si l’on ne fait pas rentrer le secteur associatif dans le champ des compétences départementales, il n’y aura plus personne pour accompagner certains publics fragiles. Je m’inquiète tout particulièrement pour les femmes victimes de violences conjugales, qui sont déjà très précarisées. Qu’en pensez-vous ?
M. le président Alain Bocquet. En février dernier, l’Assemblée des départements de France a signé avec l’État la Charte d’engagements réciproques. Selon vous, quels sont les apports et quelles sont les faiblesses de cette charte ? Comment a-t-on commencé à l’appliquer ? Constitue-t-elle un atout ?
Mme la rapporteure. S’agissant des compétences obligatoires du département, je m’interroge. Par exemple, l’action sociale en faveur de l’enfance, la protection de l’enfance et la prévention spécialisée, qui sont des compétences très proches, sont exercées à la fois par le secteur associatif, où figurent notamment des structures porteuses qui remplissent des missions directes de service public mais seront toujours à la marge entre le local et le national, et par les collectivités territoriales. Cette situation particulière a-t-elle été envisagée ?
M. Jean-Pierre Hardy. Notre point de vue est qu’il ne faut pas en rester à l’article 28 du projet de loi, qui fait du tourisme, du sport et de la culture, les seuls domaines de compétence partagée.
Nous avions quelques idées, mais c’est bien sûr à la représentation parlementaire d’y travailler et de voir ce qu’il serait possible de rajouter. Nous pensions à : « éducation populaire » ; « égalité, défense des droits et des causes », « respect de l’environnement ». M. Juanico proposait : « vie associative », mais c’est un champ très large. Il faut sans doute trouver un point d’équilibre, en tenant compte des contraintes financières, actuelles ou à venir. On voit bien en effet que l’on se dirige vers une volonté de maîtrise des dépenses des collectivités territoriales – on parle même de faire, à l’image de l’ONDAM, des « enveloppes » limitatives pour les conseils des collectivités territoriales. Une autorité financière ou de l’État pourrait dire au président du conseil général que l’association qu’il a accepté de subventionner n’intervient pas, par exemple, dans le secteur de la culture. Il faut que l’on fasse attention.
Je pense que cela répond à votre question, madame la rapporteure. Il faut pouvoir laisser ouverts ces financements. Évidemment, ce ne sont pas des dépenses obligatoires. Reste que la collectivité s’est engagée sur quinze ans en autorisant une association à gérer un dispositif et qu’elle ne peut pas retirer le financement – même si elle peut en débattre et discuter du tarif.
Sur la Charte qui a été signée, j’ai lu que le rôle de l’ADF avait été très important. D’ailleurs, son chef de file, M. Michel Dinet, le président du conseil général de Meurthe et Moselle, était très versé sur le sujet. Cette charte a évolué par rapport à celle de 2001 : les droits et les engagements des uns et des autres sont mieux équilibrés. Ce n’est donc pas un « objet non identifié » pour l’ADF. C’est même un document très important.
Sur toute une série de sujets que j’ai déjà évoqués, comme la refondation de l’aide à domicile ou l’aide à domicile vis-à-vis des familles en difficulté particulière, des projets ont été signés par l’ADF et les fédérations nationales – 15 fédérations pour l’aide à domicile, et 4 pour les problèmes des familles en difficulté particulière.
Sur les parcours résidentiels, notre projet a été repris dans un document qui a été adopté à l’unanimité des membres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : syndicats, organismes représentatifs des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Je pense donc que l’on est bien dans la co-construction, même s’il s’agit d’un partenariat où l’on doit respecter la position de l’autre sans forcément chercher le plus petit dénominateur commun.
Ensuite, la reconnaissance rapide de ce que l’on appelle les « missions d’intérêt général » nous semble particulièrement importante. Ce serait le moyen de mettre fin à une fausse concurrence entre le secteur privé commercial et les services d’aide à la personne. Bien sûr, beaucoup d’institutions essaient de s’investir dans ce domaine. Quand il s’agit d’aide à la vie quotidienne, la prestation est la même. Une heure d’aide à domicile assurée par un service commercial équivaut à celle assurée par un CCAS. En revanche, dans le cadre des missions d’intérêt général, le service à domicile pourrait faire autre chose (par exemple, de la prévention de la maltraitance) qui n’aurait d’ailleurs pas à rentrer dans le calcul d’un tarif horaire. C’est ce que nous expérimentons dans les départements.
Il faudrait donc que tous les services à domicile emploient non seulement des aides à domicile, mais aussi d’autres professionnels. Je pense, par exemple, à un ergothérapeute qui irait régulièrement au domicile d’une personne âgée pour la convaincre de quitter sa chambre située au nord pour s’installer dans une autre, mieux exposée, ou d’enlever la baignoire dans la salle de bain. Et cela ne se fait pas en un jour.
Nous souhaitons donc que l’on reconnaisse les missions d’intérêt général dans le secteur médicosocial et social, comme on l’a fait dans le secteur sanitaire. En 2010-2012, Yves Daudigny avait soutenu au Sénat des amendements en ce sens. On lui avait alors expliqué qu’on n’allait pas reconnaître les missions d’intérêt général dans le secteur médicosocial et social, puisqu’on voulait les supprimer dans le secteur sanitaire, les tarifs de T2A devant s’appliquer partout. Maintenant, des rapports du Sénat ont abouti à la conclusion qu’on ne pouvait pas fonctionner à 100 % de T2A, en raison de certaines contraintes particulières – par exemple, la précarité du public, la nécessité d’une formation, etc.
Voilà des années que nous essayons de faire passer cette idée. La reconnaissance des missions d’intérêt général apporterait de la souplesse et du financement.
Mais je reviens à vos questions. Dans les 55 propositions formulées par l’ADF en 2011 sur la perte d’autonomie, nous avions proposé la suppression de la taxe sur les salaires
– pour réduire le reste à charge – et l’application du même régime de TVA que dans les autres établissements. Aujourd’hui en effet, il y a une distorsion de concurrence entre le secteur associatif et public et le secteur commercial qui facture ses tarifs avec une TVA à 5,5 % et récupère la TVA sur l’alimentation. Ainsi, les tarifs « hébergement, restauration » dans une maison de retraite commerciale sont potentiellement moins élevés que dans le secteur public et associatif. Un alignement permettrait, soit d’améliorer la qualité de prise en charge, soit de réduire le reste à charge. Comme quoi la distorsion de concurrence n’est pas forcément dans le sens que l’on pense.
Telles sont nos propositions. Je terminerai sur une des mauvaises nouvelles qui peuvent inquiéter les départements : l’application de la taxe transport, dont étaient exonérés de nombreux établissements sociaux et médicosociaux et d’associations financées par le département. Il faut revoir la loi. Selon nous, les associations qui ont des structures habilitées « aide sociale » devraient être exonérées. Sinon, elles seront obligées – par le juge de la tarification ou par la négociation – de revaloriser leurs tarifs en 2015, ce qui se répercutera sur le reste à charge.
Il est vrai que certains, qui voulaient que seules les fédérations reconnues d’utilité publique et les associations adhérant à une fédération reconnue d’utilité publique soient exonérées, ont joué un jeu un peu dangereux. C’était une manière un peu maladroite de gagner des adhérents. Il faut rappeler qu’une association ou une fédération reconnue d’utilité publique ne peut pas franchiser sa reconnaissance d’utilité publique à ses adhérents – dans le passé, cela a causé de grosses difficultés à certaines associations. Le pouvoir de contrôler la reconnaissance d’utilité publique relève du Conseil d’État.
Ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent, dans le cadre du PLF, est important. Cette taxe sur les transports peut fortement impacter les finances départementales, mais aussi le reste à charge des personnes, notamment âgées. Les départements financent 3 milliards d’APA en établissement, à peu près 2 milliards d’aide sociale à l’hébergement. Mais les personnes âgées paient 8 milliards d’euros de tarifs, la participation de l’aide sociale n’étant que de 20 %. Voilà pourquoi nous nous inquiétons des conséquences de cette taxe.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup.
Table ronde sectorielle « Santé – Prévention » :
M. Gérard Labat, membre du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR) ;
M. Gérard Raymond, administrateur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), secrétaire général de l’Association française des diabétiques (AFD) ;
M. Alain Legrand, directeur général d’AIDES ;
M. Jean-Pierre Gaspard, secrétaire général de l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies)
(séance du 30 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle table ronde « sectorielle », consacrée aujourd’hui à la santé et à la prévention.
Le sens de votre action est multiple. Il s’agit de défendre les droits des malades, d’œuvrer pour une offre de soins organisée et solidaire, de préserver l’accès de tous aux soins, de promouvoir la santé et la qualité de vie des personnes malades, mais aussi de les aider à préserver leur autonomie.
Au-delà de cette perspective commune, n’y a-t-il pas un écart considérable entre les associations plus centrées sur les droits des malades et celles qui sont gestionnaires d’établissements médicaux ou médicosociaux ? Dans quelle mesure la crise économique qui sévit depuis quelques années affecte-t-elle le dynamisme de vos associations ? Avez-vous besoin d’établir un nouveau partenariat avec la puissance publique ?
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Gérard Labat, Gérard Raymond, Alain Legrand et Jean-Pierre Gaspard prêtent serment)
M. Gérard Raymond, administrateur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), secrétaire général de l’Association française des diabétiques. Les associations œuvrant pour la santé ont été consacrées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Grâce à cette loi et aux suivantes – loi sur la politique de santé en 2004 et loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) en 2009 –, le droit collectif de nos associations a été réaffirmé, en particulier par la reconnaissance de notre rôle de représentants des usagers de la santé, ce qui nous permet de siéger dans plusieurs instances collectives, comme le Conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Ce droit de représentation des patients et des usagers de la santé implique pour nos associations de réfléchir à leur positionnement en termes de stratégie et de fonctionnement. En effet, un grand nombre d’entre elles, au départ amicales, sont devenues de réels acteurs de santé capables de faire des propositions sur l’évolution du système de santé.
L’engagement bénévole, si beau soit-il, a des limites. Pour remplir notre mission de représentants des usagers et d’acteurs de la santé, nous devons faire des propositions attrayantes à nos bénévoles, mais aussi leur offrir des formations. Or le recrutement et la formation des personnes bénévoles nécessitent des financements importants.
En outre, l’accompagnement par les pairs sur la pathologie chronique est certainement, à côté de l’éducation thérapeutique et de l’engagement des professionnels de santé, un axe positif au regard de ce que l’on appelle l’observance ou la nécessité d’être acteur de sa propre santé. Là encore, l’engagement bénévole nécessite des formations – à la connaissance de la maladie, à l’écoute, à l’accueil et l’accompagnement avec empathie.
Or aujourd’hui, la « démocratie sanitaire » ne nous permet pas de former l’ensemble de nos bénévoles actifs. Certes, il est nécessaire aujourd’hui pour l’ensemble des associations d’améliorer leur fonctionnement en termes de projet associatif et de poursuivre leurs efforts de transparence, mais les institutions politiques doivent aussi nous permettre de relever ce défi de la « démocratie en santé ».
En conclusion, si vous voulez aider le CISS et l’AFD à jouer leur rôle de représentants des usagers et d’acteurs de la santé pour améliorer la qualité de vie des populations atteintes de pathologies chroniques, nous avons besoin de passer un contrat avec l’État qui nous permette de financer les formations et l’engagement bénévole.
M. Alain Legrand, directeur général d’AIDES. Notre association a été touchée par un plan de sauvegarde de l’emploi, avec la suppression de 10 % de ses effectifs, ce qui vous donne une idée des difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle.
Créée en 1984 à l’initiative du sociologue Daniel Defert et reconnue d’utilité publique en 1990, AIDES est la première association française de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales en France et l’une des plus importantes au niveau européen. AIDES est aujourd’hui présente dans plus de 70 villes françaises, au plus près des personnes touchées, et entretient de nombreux partenariats à l’international. Nous revendiquons 150 000 adhérents donateurs, 420 salariés, 800 volontaires et 1 500 acteurs intervenant sur les actions. Notre budget s’élève à 40 millions d’euros et est financé à égalité, comme la plupart des grandes associations, par des financements publics et des financements privés. Afin d’optimiser et de rationaliser les frais de structure, AIDES a fusionné l’ensemble des associations indépendantes qui étaient labellisées AIDES entre 2002 et 2007.
En se situant dans le champ de la promotion de la santé, notre démarche est axée sur une mobilisation active des personnes séroconcernées par le VIH et les hépatites virales, l’identification des besoins, la priorisation des orientations politiques, et l’élaboration de réponses. Elle permet à des personnes vulnérables d’accéder à des postes à responsabilités dans notre association : la décision politique au sein d’AIDES appartient aux volontaires – le nom que nous donnons aux bénévoles.
AIDES se veut aussi une force de propositions et revendique le rôle de transformateur social. Nous avons joué un rôle majeur en termes de représentation des patients et avons participé à la création du CISS. Nous sommes présents dans tous les combats auprès des populations vulnérables, touchées par le VIH et les hépatites virales.
Notre volontariat a tendance à rajeunir, probablement parce que notre association offre un vrai dispositif de formation, certes cher, mais qui va jusqu’à proposer la certification par un diplôme, en particulier du Conservatoire national des arts et métiers. Cette co-construction avec le CNAM est désormais accessible à l’ensemble des associations.
Au titre de la formation, nous pensons intéressant d’étendre le droit individuel à la formation (DIF) des salariés aux personnes exerçant un bénévolat ou un volontariat actif. Cette mesure pourrait probablement être financée par une quote-part sur les financements publics dans la mesure où les projets intègrent la valorisation du volontariat. De la même manière, nous pensons utile de prévoir le financement de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les jeunes et les personnes vulnérables en recherche d’emploi exerçant un volontariat, ce qui inciterait davantage de jeunes à s’engager dans le volontariat.
Pour une organisation comme AIDES, la ressource sûre n’est malheureusement pas l’argent public ; c’est l’argent privé, malgré la crise, qui joue le rôle de régulation.
Pour rationaliser nos coûts, nous avons fusionné l’ensemble de nos comités, une convention pluriannuelle de 2007 ayant prévu le financement de la structure, la gestion, les ressources humaines, la formation, bref tout ce qui permet de soutenir un réseau local. En 2010, lors du renouvellement de cette convention, et alors que notre dotation chutait de 20 %, il nous a été indiqué que la structure ne pouvait plus être financée et que seules les actions le seraient. Avec la Direction générale de la santé (DGS), nous avons alors trouvé un montage selon lequel un siège mène des actions. Or aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à renouveler cette convention pour 2015, on nous dit que le financement de l’action ne relève pas des services centraux, mais des Agences régionales de santé (ARS). On ne peut donc pas dire que l’État soit cohérent quant aux orientations données aux associations en matière de financements ! D’où une grande incertitude sur nos financements.
Pour le financement local par les Agences régionales de santé – j’ai envie de dire la toute-puissance des directeurs des ARS –, je prends l’exemple de la Martinique, où l’épidémie de VIH est assez élevée. Sur ce territoire, le budget de notre délégation territoriale s’élève à un peu plus de 200 000 euros, avec principalement des missions de délégation de santé publique. Selon un courrier, que je tiens à votre disposition, notre subvention représente 10 % de ce montant, soit 20 000 euros. Mais le plus choquant n’est encore pas ce montant, c’est la volonté des ARS d’exercer un pouvoir de contrôle sur l’ensemble des actions menées par l’association – comme si la délégation de santé publique s’imposait à l’ensemble du projet associatif. De la même façon, lors de la présentation d’un projet d’un montant de 100 000 euros, par exemple, 50 000 euros sont octroyés et, dans la majorité des cas, l’ARS maintient l’ensemble des activités, comme si vous aviez présenté un budget avec 50% de marge… À nous de nous débrouiller !
Ainsi, la prévention continue à être le parent pauvre ou la variable d’ajustement des budgets, la crise actuelle accentuant cette vision à court terme privilégiant le soin.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments contre les appels à projets avancés lors des auditions précédentes. Tout en partageant les inquiétudes et le constat sur ce mode d’attribution des financements, je souhaite apporter une note positive. Certes, l’appel à projets est susceptible de tuer l’innovation s’il est élaboré dans un bureau sans aucune concertation avec les représentants des publics concernés. Néanmoins, s’il repose sur un appel à idées – terme utilisé dans cette enceinte – et une véritable concertation en vue de la constitution d’un cahier des charges intégrant une part d’innovation, je ne vois pas où est le problème. N’oublions pas que l’attribution non transparente de certains financements – la reconduite systématique de financements sur les mêmes projets auprès des mêmes opérateurs – ne favorise pas l’innovation. En définitive, le plus important réside dans le dosage entre appels à projets et projets pérennes.
J’en viens à nos propositions.
Il faut bien sûr soutenir les conventions pluriannuelles, car une visibilité à moyen terme – par exemple sur 4 ans – est très favorable à nos actions.
Nos associations devraient avoir la possibilité de générer des excédents, surtout lorsqu’ils sont réalisés grâce à la collecte privée. Montrer du doigt les associations et leur supprimer des financements publics pour cause d’excédents en fin d’année – alors que ces excédents peuvent avoir été générés sur les ressources privées – est très dommageable et aboutit à fragiliser considérablement nos associations.
Au lieu de supprimer les actions qui ne sont plus efficientes, les ARS ou les collectivités locales devraient instaurer le droit à l’innovation et à l’adaptation des actions, ce qui nous éviterait d’hésiter à proposer de nouveaux projets, voire d’en abandonner certains parce que quand on propose d’en abandonner, on est sûr de perdre les financements.
L’association AIDES abonde par les financements privés l’ensemble des actions conduites, quel que soit le territoire sur lequel elles se déploient. Lorsque notre présence sur un territoire relève uniquement de la volonté d’un financeur privé, les actions devraient être financées intégralement par celui-ci, a fortiori lorsque les données épidémiologiques sont relativement faibles par rapport à d’autres territoires.
Afin de sécuriser la collecte privée, il faudrait envisager la possibilité pour les associations d’amortir la constitution d’un fichier donateurs – de la même manière que les entreprises peuvent amortir un fichier clients. Cela nous permettrait de diversifier nos modes de financement.
En outre, si les économies de structure doivent bénéficier aux financeurs, elles doivent aussi permettre aux associations d’investir dans de nouvelles adaptations et dans l’innovation. C’est un principe gagnant/gagnant.
L’élaboration d’un plan par un ministère devrait au minimum être assortie du budget correspondant. Nous devons en effet rendre des comptes sur des plans non financés, dont certains même ont été mis en œuvre pour le VIH.
Nous demandons également une harmonisation des évaluations et des bilans d’activité. Si le modèle CERFA est largement utilisé, le mode de restitution est totalement hétérogène avec des indicateurs différents au niveau des collectivités locales et des ARS. Or ces multiples modes de restitution sont particulièrement chronophages.
Si la rationalisation, la mutualisation sont de belles idées, elles ne sont malheureusement plus financées aujourd’hui. Les têtes de réseau ont pourtant consenti des efforts sans précédent pour améliorer le support à la qualité des actions, la formation des acteurs, le développement d’outils de gestion, etc. Or aujourd’hui, seules les actions sont financées, le financement des structures étant devenu un sujet tabou. C’est comme si l’État pouvait se passer de son administration centrale… Aussi proposons-nous d’instituer une quote-part de frais de siège sur l’ensemble des actions soutenues par l’État ou les collectivités territoriales, calculée sur le service rendu par la tête de réseau, mais opposable à l’ensemble des financeurs publics. Ce dispositif existe dans le secteur médicosocial, mais n’est pas reconnu pour le champ de la prévention.
Enfin, il convient de développer la place des représentants des associations dans l’ensemble des instances de la démocratie sanitaire et d’assurer le financement de cette représentation. Les acteurs investis dans le secteur associatif de la santé auraient ainsi le sentiment de participer aux décisions de la Nation, au lieu de se sentir considérés par l’État, les ARS et les collectivités comme de simples opérateurs.
M. Gérard Labat, membre du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), président de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR). L’association que je représente est beaucoup plus petite que celle de mes confrères. La FNAIR a été créée en 1972 avec pour objectif d’améliorer le sort et les soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale, une pathologie très mal connue du grand public.
À défaut de prévention, pour laquelle nous n’avons pas les moyens, nous menons des actions de sensibilisation et de dépistage. La FNAIR est une association reconnue d’utilité publique, mais depuis plus de dix ans, elle n’a pas touché un centime de financement public. Elle fonctionne uniquement sur fonds privés, si bien que lorsque la suspicion s’en mêle, les choses deviennent très difficiles pour nous. Toutes nos associations veillent à diversifier le plus possible les donateurs – à ne pas dépendre d’un seul donateur –, de façon à préserver leur équilibre. Nous avons encore été attaqués récemment à ce sujet.
Au surplus, nous sommes dans le collimateur, cette année, dans la mesure où la LFSS 2014 prévoit un champ d’expérimentation sur l’insuffisance rénale chronique. Nous devons donc répondre à de multiples convocations – j’ai moi-même été convoqué quatre fois la semaine dernière par diverses instances afin d’évoquer les aspects de l’insuffisance rénale –, ce qui est particulièrement chronophage et nécessite une certaine technicité. Or nos bénévoles sont vieillissants, peu renouvelables, et nous devons leur offrir un minimum de formation pour leur éviter de faire figure de potiche dans ce genre de commission. Tous ces problèmes se posent à nous au quotidien.
En conclusion, toute solution susceptible d’améliorer notre financement sera la bienvenue. Le projet d’« Institut du patient », évoqué par la ministre, constitue-t-il une réponse ?
M. Jean-Pierre Gaspard, secrétaire général de l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies). Je tiens à vous remercier d’avoir convié l’AFM-Téléthon à cette audition sur les difficultés du monde associatif, sujet particulièrement prégnant dans le contexte de crise. J’ai bien sûr une pensée pour les petites et moyennes associations dont les difficultés sont ô combien plus importantes que la mienne. Je tenais à le souligner car, depuis plus de vingt-cinq ans, le Téléthon est organisé grâce à l’élan de générosité publique – qui représente une centaine de millions d’euros, soit environ 80 % de nos ressources –, mais aussi grâce à l’engagement de milliers d’associations locales présentent sur le territoire.
Chaque année, le Téléthon mobilise 5 millions de Français dans les rues, dont 1 million font un don, et 200 000 bénévoles nous aident à organiser cette magnifique opération de générosité publique au début du mois de décembre. Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons la responsabilité directe ou indirecte d’environ 1 000 salariés.
Je développerai quatre thèmes.
Le premier est le financement public. Je suis tout à fait solidaire des propos tenus devant votre commission sur les difficultés engendrées par la raréfaction de l’argent public, néanmoins je ne développerai pas ce point. En effet, pour la « maison » que je représente, la générosité des donateurs se substitue au financement public.
Notre première mission sociale consiste à mettre au point des traitements pour les malades. Dans ce cadre, nous finançons nos propres laboratoires – fédérés au sein de l’Institut des biothérapies des maladies rares –, mais aussi des unités de recherche d’organismes publics français – INSERM, CNRS, AP-HP, etc. Ainsi, l’argent du donateur finance une partie de la recherche en se substituant au financement public.
Notre seconde mission sociale est la prise en charge et l’accompagnement des malades dans l’attente de la découverte d’un traitement. Notre établissement situé près d’Angers, unique en France, accueille une cinquantaine de patients en situation d’extrême dépendance, auxquels sont prodigués des soins renforcés nécessaires à la qualité et à la sécurité de leur vie. Ce type de soins n’entrant pas dans le cadre des mécanismes de tarification actuels, l’AFM-Téléthon, grâce à la générosité exceptionnelle des Français, complète le budget de cet établissement pour un montant de l’ordre de 1 million d’euros par an.
Le deuxième thème a trait au développement du financement privé. À l’appui de mon propos, je vais évoquer les deux piliers fondamentaux de notre association.
Le premier pilier est l’innovation : innovation scientifique pour les médicaments, les biothérapies ; innovation sociale en lien avec le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Inscrite dans nos gènes, cette innovation doit être préservée pour faciliter le développement du financement privé. La mission parlementaire confiée à l’un de vos collègues sur la simplification du monde associatif y contribuera probablement.
Le second pilier est l’intérêt général. Si depuis tant d’années les Français continuent à nous soutenir avec une telle générosité, c’est parce qu’ils ont bien compris que nous menons des actions d’intérêt général. Il me semble particulièrement important de préserver cette garantie de l’intérêt général dans le cadre du développement du financement privé des actions du monde associatif. À cet égard, le rapport sur le développement du financement privé, remis par le Haut conseil à la vie associative au précédent gouvernement, nous semble intéressant, notamment sur le volet mécénat.
Au-delà du financement, l’un des enjeux du monde associatif est le développement de l’emploi. Je veux ici pointer deux difficultés.
La première est relative à la taxe sur les salaires. Ainsi, sous prétexte que les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, nous subissons une double peine : la taxe sur les salaires – dont le poids est considérable pour des structures comme les nôtres – et la non-récupération de la TVA sur nos dépenses soumises à TVA. Certes, un abattement a été voté récemment pour la taxe sur les salaires, mais uniquement pour les plus petites associations.
Seconde difficulté – qui me fait dire que nous subissons en réalité une triple peine – : les associations ne bénéficient pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Je tenais à souligner ce thème, car l’emploi est primordial pour nos associations et, plus encore, pour l’ensemble du tissu social en France.
Le quatrième thème important à nos yeux réside dans l’évaluation des actions associatives. Il y a une vingtaine d’années, le monde associatif français s’est attaché à améliorer la transparence financière de ses activités, laquelle, grâce notamment aux contrôles des commissaires aux comptes ou d’organismes tels le Comité de la charte du don en confiance, est aujourd’hui de niveau comparable à celle observée à l’étranger. Par contre, l’AFM-Téléthon plaide pour une meilleure évaluation a posteriori des actions du monde associatif français, idéalement sous l’égide de la puissance publique, ce qui favoriserait du même coup la nécessaire professionnalisation des salariés et des bénévoles, domaine dans lequel notre pays accuse un retard par rapport à certains pays étrangers.
En conclusion, l’important à mes yeux est la création d’un cercle vertueux entre financements, emplois, évaluation et professionnalisation des pratiques.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci pour la qualité de vos interventions.
La professionnalisation des salariés implique une constance dans les interventions. Elle peut certainement être menée en lien avec l’État ou les collectivités territoriales.
Avez-vous le sentiment que le bénévolat évolue, qu’il rajeunit ? Devient-il plus volatile ?
Enfin, avez-vous des craintes au regard de la réforme territoriale ?
M. Jean-Louis Bricout. Merci de vos témoignages.
Beaucoup de nos concitoyens souhaitent savoir comment sont utilisés leurs dons. Percevez-vous parfois des doutes quant à l’utilisation des sommes perçues ? Quelles actions de transparence mettez-vous en place ? Les outils législatifs peuvent-ils être améliorés, selon vous, pour faciliter cet effort de transparence ?
La sensibilisation en milieu scolaire demeure essentielle. Monsieur Legrand, menez-vous des actions en ce sens dans les établissements ? Cela est-il plus difficile depuis quelque temps, ressentez-vous une certaine hostilité depuis l’émergence de certains débats de société qui ont pu réveiller des conservatismes ? Comment pouvons-nous faciliter et pérenniser ces actions ?
Comme vous, j’estime anormal que vous soyez privés de fonds publics en cas d’excédents issus des collectes privées. En tant que maire, je mets en place des ratios, en déterminant avec les associations les parts d’effort respectives de l’action publique, des adhérents et des autres financements, notamment le mécénat. Cette méthode des ratios vous paraît-elle intéressante ?
Enfin, au moment du Téléthon, les collectivités sont fortement sollicitées pour installer des chapiteaux, des tables, des chaises, etc. Avez-vous une idée du montant de ces charges supplétives, monsieur Gaspard ?
M. le président Alain Bocquet. Êtes-vous confrontés à des problèmes de renouvellement de vos organes de direction ?
M. Gérard Raymond. L’Association française des diabétiques tente, elle aussi, de professionnaliser son fonctionnement au regard son projet associatif.
Nous constatons une modification du champ associatif, y compris de l’engagement des bénévoles. En effet, il y a dix ou quinze ans, nous étions des amicales chargées d’organiser le concours de pétanque ou la galette des rois, mais aujourd’hui, nous voulons être des acteurs de santé. Par conséquent, le recrutement des bénévoles a évolué : pour en attirer de nouveaux, nous devons leur offrir des formations et leur présenter des objectifs valorisants. Nous avons donc des cahiers des charges, nous recrutons et formons des bénévoles et, soyons clairs, nous les sélectionnons – l’accompagnement par les pairs n’est pas à la portée de tous. Cela nous amène en interne à signer une charte : la formation d’un patient bénévole à l’accompagnement par les pairs nous coûte environ 1 500 euros, et nous demandons aux personnes formées de s’engager dans la structure associative pendant un ou deux ans. Aussi une meilleure reconnaissance de l’État au regard de cet engagement, avec des aides à la formation, en particulier, nous faciliterait-elle la tâche.
La réforme territoriale nous pose un réel problème, mais la réforme de la gouvernance de la santé nous préoccupe également, car un texte de loi prévoit un équilibrage pour les uns, un rééquilibrage pour les autres. La gestion des risques, du ressort des caisses primaires d’assurance maladie, pourrait se retrouver dans le champ des ARS ; il est donc important pour nous de savoir auprès de quelle instance nous devrons déposer les projets pour être en mesure de poursuivre nos missions d’acteurs de santé.
Nos financements sont à 70 % privés. Ces legs et dons sont ciblés : si nous recevons un don pour la formation des patients, il ira à la formation des patients. Nous assurons une totale transparence en la matière et notre site Internet vous renseigne sur notre budget et l’ensemble de nos financements.
L’éducation à la santé fait partie de nos objectifs, et nous avons mis au point un programme de sensibilisation sur l’équilibre nutritionnel et l’activité physique à destination des jeunes de neuf à onze ans dans les établissements scolaires. Nous avons souhaité obtenir l’agrément de l’Éducation nationale, auprès de laquelle nous avons déposé un dossier, mais celle-ci nous a répondu que le contenu de notre projet était trop axé sur la santé publique, et pas assez sur les sciences naturelles… Espérons que la future loi nous apportera une reconnaissance en la matière.
La professionnalisation de notre action suppose de professionnaliser notre fonctionnement, puisque nous avons des charges fixes – rémunérations des salariés, paiement des loyers, etc. L’AFD se doit d’être parfaitement transparente sur ses dépenses, mais aussi totalement indépendante quant à ses financements. Le CISS est lui-même d’une totale transparence en la matière.
M. Jean-Pierre Gaspard. Pour l’AFM-Téléthon, comme pour nombre d’associations, la transparence financière est un devoir au regard de la générosité des Français. Il est nécessaire d’expliquer à nos concitoyens pourquoi nous faisons appel à eux et comment nous menons nos actions. L’émission télévisée est un outil exceptionnel pour toucher le public et apporter cette information, mais nous diffusons également de manière classique des informations aux donateurs et plus largement aux Français.
Des mécanismes comptables ont été mis en place, comme le compte d’emploi annuel des ressources collectées, certainement perfectible, mais qui est une bonne chose. L’enquête de la Cour des comptes auprès des dix associations bénéficiant de la plus grande générosité du public, dont nous faisons partie, aboutira certainement à des recommandations sur ce sujet à l’initiative d’associations comme la nôtre.
Le compte d’emploi des ressources collectées implique pour l’AFM-Téléthon de valoriser à la fois le bénévolat et les prestations en nature accordées par telle mairie ou telle association. Nous nous attachons bien évidemment à rendre cette valorisation totalement transparente à l’égard de nos donateurs.
M. Alain Legrand. Notre président, Bruno Spire, a l’habitude de dire que nous ne sommes ni des infectiologues, ni des immunologues, mais des « rienologues ». Aussi les compétences acquises par les personnes touchées par la maladie doivent-elles être valorisées. Des compétences spécifiques sont également requises.
À cet égard, notre association a été à l’initiative de la démédicalisation du dépistage du VIH, en particulier avec le dépistage rapide réalisé par des volontaires ou des salariés de notre association. Vous imaginez le regard porté sur ces acteurs non médicaux : le moindre faux pas dans la réalisation de ces tests serait immédiatement sanctionné. Or à ce jour nous n’avons jamais rencontré de problèmes, notamment en matière de rupture de confidentialité, contrairement au dispositif public.
Ce dispositif de dépistage demande, au minimum, six jours de formation initiale et cinq jours de formation continue pour l’ensemble des intervenants – sans compter la formation continue tout au long de l’année. Or cela n’est pas financé, cela n’est même pas prévu dans le financement du dépistage. Nous avons un financement à l’acte, de 25 euros seulement, alors que nous intervenons auprès de populations extrêmement vulnérables sur des sites où la puissance publique ne veut pas aller – lieux de consommation sexuelle, milieux festifs en pleine campagne, etc. Or ces interventions requièrent des compétences très importantes et des formations qui nous coûtent très cher. Last but not least, le coût du dépistage mené par ces acteurs est aujourd’hui dix fois moins élevé que le dépistage classique réalisé en France.
Au sein de notre organisation, la notion de « compétences » ne signifie pas forcément professionnalisation avec acquisition d’un diplôme reconnu. Nos acteurs ont des compétences de terrain, liées à leur investissement et à leur situation personnelle au regard de la maladie.
Je ne m’attarderai pas sur le traçage des dons. Nous sommes tous bénéficiaires de labels de transparence et tous les documents sont communiqués via nos sites Internet. Ils sont d’ailleurs demandés par les donateurs, vis-à-vis desquels nous avons un devoir de transparence.
Selon nous, c’est à l’Éducation nationale d’intervenir en milieu scolaire pour mener des actions de sensibilisation au VIH. Nous concentrons notre énergie et nos moyens sur les personnes les plus vulnérables au VIH, chez lesquelles l’épidémie se développe : détenus, toxicomanes, homosexuels, personnes prostituées. Nous serons probablement plusieurs dans cette salle à avoir connu le début et la fin de l’épidémie – elle sera éradiquée dans vingt à vingt-cinq ans, c’est simplement une question de moyens. Cet espoir est un facteur de motivation et peut favoriser le militantisme dans notre organisation.
Nous appliquons nous-mêmes des ratios puisque nos dons privés sont affectés en fonction des priorités politiques et des données épidémiologiques sur les territoires. Nous affectons 40 % de nos financements privés dans les territoires prioritaires comme l’Ile-de-France ou les départements français d’Amérique, et 40 % à 10 % sur l’ensemble du territoire, afin de compléter les financements publics. Nos ratios sont parfaitement transparents. En retour, nous demandons la même transparence de la part de la puissance publique, mais aussi des financements, car nos actions de dépistage, d’accompagnement des personnes vers le soin à l’hôpital, de maintien dans le soin, constituent de véritables missions de service public au bénéfice du dispositif de santé national.
Enfin, la première volonté des militants est de s’engager dans l’action, et non d’occuper des responsabilités. Mais il y a les combats, les colères… Nous intervenons plus spécifiquement auprès d’une population scolaire victime de discriminations que sont les jeunes gays. Ces combats sont motivants et amènent les gens à prendre des responsabilités, et nos formations à la responsabilité associative leur permettent de travailler sur les projets associatifs dans les territoires et de s’investir au niveau national.
M. Gérard Labat. Notre association est très petite et certains de nos bénévoles sont encore en activité. Une personne de quarante-quatre ans récemment greffée, et donc relativement disponible, m’a expliqué refuser ma proposition de prendre des responsabilités au sein de l’association, car sa première préoccupation est de retrouver un emploi à temps plein pour nourrir sa famille.
La FNAIR compte cinq salariés et n’a pas les moyens d’en avoir plus.
Par contre, l’emploi de nos malades – maintien dans l’emploi, retour à l’emploi après des périodes de soins lourds et contraignants – constitue une de nos préoccupations. Nous avons en effet reçu de nombreux témoignages de personnes qui, après avoir annoncé leur insuffisance rénale à leur employeur, ont été immédiatement mises au placard, alors qu’elles ne vivent pas encore les contraintes lourdes de la dialyse.
La FNAIR regroupe 24 associations régionales dont les interlocuteurs principaux sont actuellement les ARS. La réforme territoriale nous dira quel sera notre interlocuteur principal – pour l’instant, j’ai entendu parler de région et non d’ARS.
Nos dons sont fléchés et figurent sur des comptes bancaires séparés et affectés à des actions définies. Nous avons entre autres un compte dédié aux séjours des jeunes dialysés pour lesquels nous organisons des séjours de vacances leur permettant d’aller à la plage, de faire du sport, tout en poursuivant leurs soins.
Quant au thème du renouvellement des organes de direction, il est lié au problème de vieillissement de nos bénévoles qui ont pris des responsabilités. Je suis aujourd’hui à ce poste un peu par hasard : comme j’étais le dernier arrivé et que peu de gens étaient disponibles, on m’a dit : « Tu t’y colles ! ».
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, messieurs, de vos témoignages.
Table ronde sectorielle « Éducation populaire » :
Mme Françoise Doré, trésorière du Comité pour les relations nationales et internationales des Associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) ;
M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences ;
M. Didier Jacquemain, délégué général de la Fédération nationale des Francas ;
M. Karl Deschamps, secrétaire national délégué aux vacances à la Ligue de l’enseignement ;
M. Jean-Luc Cazaillon, président du Collectif des associations partenaires de l’école (CAPE), et Mme Catherine Chabrun
(séance du 30 septembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, messieurs, avec cette table ronde consacrée à l’éducation populaire, c’est à un monument du monde associatif que touche aujourd’hui notre commission d’enquête.
Lorsqu’on parle d’éducation populaire, on pense facilement à un âge d’or de la vie associative militante, avec le risque de verser dans une nostalgie déplacée. Car l’éducation populaire est tout aussi nécessaire aujourd’hui que pendant les cinquante glorieuses années de l’après-guerre. Nous allons évoquer les difficultés de ce secteur, les solutions qu’il peut avancer, voire l’opportunité de réinventer un modèle.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Françoise Doré, MM. Jean-Pierre Ledey, Didier Jacquemain, Karl Deschamps, Jean-Luc Cazaillon et Mme Catherine Chabrun prêtent serment)
Mme Françoise Doré, trésorière du Comité pour les relations nationales et internationales des Associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP). Mesdames et messieurs les députés, le contexte de cette année 2014 ne peut que nous interpeller. Le livre de Viviane Tchernonog sur le paysage associatif délivre des informations précises et montre que les associations sont de taille, de structure et de fonctionnement très divers et qu’elles peuvent être ou non des employeurs. Depuis quelques années, on observe un tassement de l’emploi associatif, même si les associations continuent à faire preuve de vitalité. Toutefois, depuis 2010, on note un fléchissement qui montre leurs difficultés.
Il faut pourtant se méfier des idées reçues. On parle beaucoup de la crise du bénévolat. Dans les associations, si l’on se soucie, en effet, du renouvellement des cadres, des administrateurs et des gens qui portent les activités, il y a, dans notre secteur, une vitalité et une capacité d’initiative porteuses d’espoir.
S’agissant du financement public, le CNAJEP étudie chaque année les lois de finances et le budget opérationnel du programme « Jeunesse et vie associative », qui montrent que nous connaissons des difficultés particulières en ce qui concerne le soutien aux associations. En 2013, la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a fait le choix de maintenir le soutien aux associations et aux têtes de réseau nationales. Toutefois, l’écart est important entre les têtes de réseau nationales et les associations locales, qui ne vivent sans doute pas la même réalité. Les associations rencontrent aujourd’hui des difficultés financières, du fait du tassement des crédits d’État, et deviennent plus vulnérables au plan national comme régional. Les associations, au niveau national, n’existent que parce qu’elles peuvent mettre en synergie leurs actions, le terrain et ce qu’il se passe dans toutes nos belles régions de France.
J’en viens à ce que j’appelle le « mythe » du mécénat, autrement dit le financement privé. Les associations s’emploient depuis plusieurs années, avec plus ou moins de succès, à diversifier leurs ressources. Pour autant, les financements privés ne parviendront pas à pallier la baisse des financements publics. Des possibilités innovantes pour résoudre les problèmes financiers apparaissent, comme KissKissBankBank ou le crowdfunding. Nous doutons fortement que ce soit la bonne solution pour nous, les ressources que nous recherchons n’étant pas à la même échelle. Les ressources des associations sont donc marquées par une réelle précarisation. L’objectif, au plan national, étant de diminuer les dépenses publiques, les orientations budgétaires pour 2015-2017 ne peuvent que nous inquiéter. On constate d’ailleurs, depuis 2007, une baisse de 24 % des concours destinés à la vie associative.
Dans notre secteur, les orientations 2015-2017 le montrent, l’engagement se résume le plus souvent à des dispositifs. Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports va encourager la montée en puissance du service civique, ce qui ne fera que déplacer les difficultés.
M. Jean-Pierre Ledey, président de Planète Sciences. Planète Sciences est un petit réseau, puisque nous avons un réseau de délégations régionales, en parallèle avec l’association nationale. Notre association est plus modeste et dédiée à la culture scientifique et technique.
Planète Sciences a cinquante ans d’existence. C’était, au départ, une association de clubs aérospatiaux, qui s’est développée au début des années quatre-vingt, avec l’expansion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) dans d’autres thématiques, et qui a mis en place les délégations territoriales, qui comptent aujourd’hui 70 permanents, 150 vacataires et touchent 200 000 jeunes. L’association a mis en place des activités dans différents domaines tels que l’environnement, la robotique et l’astronomie. Nous comptons, dans le cadre de la CSTI, parmi les associations majeures, avec Les Petits Débrouillards et La Main à la pâte. Toutes ces associations ont été créées au milieu des années quatre-vingt, lors de l’expansion de la culture scientifique et technique.
Nous travaillons aussi avec les associations généralistes, comme les Francas et la Ligue de l’enseignement. Il existe de nombreuses associations, qui constituent un milieu extrêmement dispersé. Cela fait sa force, mais aussi sa faiblesse, car il est, de ce fait, assez difficile de parler d’une seule voix. Nous avons eu, ces dernières années, du mal à nous faire entendre.
Comme la plupart des associations, nous n’avons aucun soutien fonctionnel ou structurel. Nous ne fonctionnons que par appels à projets, avec beaucoup de bénévoles. Du coup, le réseau est fragilisé, précarisé, mais cela donne une certaine dynamique aux gens, qui y croient et font preuve de détermination.
Quelle est la situation de notre secteur CSTI depuis 2000 ? J’ai hésité à employer le mot de « difficultés » car elles existent, c’est vrai, mais il n’y a pas que cela : il y a aussi quelques choses positives…
Nous répondons de plus en plus à des appels d’offres et à des appels à projets, ce qui nous fait perdre notre identité, car cela nous transforme en prestataires de services. Cela nous oblige à réfléchir aux moyens de ne pas être soumis aux règles du marché : devoir payer la TVA, se trouver en concurrence avec des sociétés commerciales qui répondent aux mêmes appels d’offres. Cela inhibe l’initiative et les développements propres. Cela épuise le vivier de bénévoles et augmente la charge administrative, et finalement, cela décourage.
Ce qui était vrai avec l’État l’est maintenant avec les collectivités territoriales et cela le devient avec les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les grands établissements scientifiques avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps.
Concernant la chute des soutiens financiers, il y a d’abord eu l’État, il y a une dizaine d’années, puis les collectivités territoriales, depuis un ou deux ans. Dernièrement, ce sont les avantages en nature qui ont considérablement diminué parce que tout le monde serre les boulons, y compris dans les mairies de proximité. Nous sommes aujourd’hui dans une situation d’extrême difficulté.
Dans le même temps, nous bénéficions de financements complémentaires provenant de l’industrie et des grands EPIC, auprès desquels nous avons un certain écho. Mais cela ne compense pas la perte du budget qui, depuis le palier des années 2004-2005, est de l’ordre de 20 %. Le mécénat des entreprises est trop peu orienté vers la culture scientifique et technique, alors que c’est souvent pour eux un vivier et une façon de préparer les jeunes à la vie professionnelle.
Les emplois jeunes nous avaient énormément aidés. Ils avaient, au début des années 2000, permis une véritable expansion territoriale. Leur suppression nous oblige à recourir à des contrats à durée déterminée (CDD), ce qui fragilise tout notre système en augmentant le turnover et en nous contraignant à former de nouveau entrants. Les emplois tremplins ou les emplois d’avenir, par exemple, sont moins bien adaptés à l’animation scientifique.
Je souligne également la quasi-disparition, depuis 10 ans, de nos séjours de vacances scientifiques, soit au profit de sociétés commerciales qui n’ont pas hésité à nous faire des procès et à nous envoyer l’URSSAF pour récupérer la TVA, soit en raison de la difficulté à trouver des implantations et à payer l’encadrement nécessaire pour faire un travail de qualité. Si j’étends mon propos à l’éducation populaire, il est extrêmement dommageable que notre jeunesse ne puisse pas profiter de ces séjours.
Par ailleurs, il y a de moins en moins de conventions pluriannuelles. Il s’agit maintenant de conventions annuelles, sans garantie de reconduction. C’est un vrai problème, car une convention pluriannuelle apporte plus de sécurité.
Vous parlez d’une baisse du bénévolat. Il est toujours très présent chez nous. Ce sont des jeunes, qui ont souvent été de jeunes adhérents formés chez nous. On constate une légère désaffection, mais il s’agit davantage de gens qui ont envie de venir lors d’opérations événementielles pour se faire plaisir et qui ont plus de difficulté à venir participer à l’administration de nos associations. Globalement, nous avons perdu environ 15 % de nos effectifs dans le réseau. La situation est à peu près similaire dans les autres associations de ce secteur d’activité.
J’en viens au Programme d’Investissements d’avenir qui, au départ, semble être une perspective exaltante puisqu’il propose de financer un projet à hauteur de 50 %, l’association devant réunir le reste des fonds. Mais trois ans après la mise en place du dispositif, je me demande si ce n’est pas une fausse bonne idée. Ces programmes sont en effet conçus pour des industriels ou de grands instituts qui peuvent investir de l’argent. Le suivi et l’administration, très compliqués et très prégnants, ont eu pour conséquence de faire de notre équipe une équipe monoprojet. Car si nous n’allions pas au bout du projet, nous risquions de mettre l’association et le réseau en grande difficulté.
Nous espérons nous en sortir, mais, s’agissant des modalités de financement, je ne suggérerais pas de réitérer l’expérience, sauf à trouver des formules adaptées au milieu associatif. Des sommes considérables étaient disponibles et nous avions proposé la rénovation de nos animations. J’espère que cela nous permettra tout de même de recréer une dynamique. Tout n’est pas mauvais dans ce dispositif, mais quand on est au milieu du gué, dans le cadre d’une opération de ce type, c’est extrêmement lourd, et les milieux associatifs ne sont pas éduqués, formés, pour répondre à la complexité de ces administrations, comme peuvent l’être de grandes entreprises.
S’agissant des temps d’activités périscolaires, nous avons lancé une opération pilote qui nous semble aujourd’hui assez satisfaisante. Toutefois, nos activités demandent plutôt des temps longs, car il est difficile, en moins d’une heure et demie, de déployer du matériel et de commencer à faire faire des expériences à des jeunes. C’est aussi un peu plus cher, ce qui nous met en difficulté par rapport à certaines de nos communes partenaires. Malgré tout, nous allons poursuivre l’expérience et nous orienter vers la formation d’animateurs locaux, ce qui est l’une de nos vocations. Nos associations ne peuvent pas tout faire, mais il faut former des gens à faire les animations, d’autant qu’ils sont sur place, ce qui nous évite d’avoir à déplacer des vacataires pour passer une heure ou une heure et demie dans un coin du département.
En matière de propositions, j’insiste sur la question du soutien aux réseaux, qui sont garants d’actions menées sur un territoire. Nous aimerions avoir partout le même niveau de qualité. Pour ce faire, il faut pouvoir réunir nos équipes, les former et se voir régulièrement. Tout cela coûte cher, et c’est de l’argent qu’on ne trouve pas dans des projets.
Il faut privilégier les appels à initiatives, les projets pluriannuels, et mettre en place des conventions qui permettent une stabilité et une pérennisation des emplois. J’insiste aussi sur la formation des salariés et sur la nécessité d’adapter les procédures des marchés publics pour les petites et moyennes structures, afin d’alléger le travail administratif qui consiste à remplir d’énormes dossiers. Il conviendrait également de privilégier le soutien aux acteurs de terrain, selon certains critères, comme les actions menées, les publics touchés, la qualité des actions. Ce sont là des contreparties légitimes à un soutien structurel.
Enfin, il faut mobiliser le privé et l’industrie. La CSTI profitant directement à l’industrie, il faudrait inciter les fondations à soutenir nos pédagogies et à favoriser le bénévolat interne au profit des associations. L’aide de professionnels permet aux jeunes d’être confrontés à la vie industrielle et à nos animateurs de se former avec des gens qui ont un vécu : ce serait très profitable. Il y a quelques initiatives en la matière, qu’il faut encourager, notamment dans les grandes entreprises.
S’agissant de la culture scientifique et technique, la gouvernance a été lancée il y a quelques années. Mais, aujourd’hui, tout est quasiment bloqué. Nos associations avaient été entendues afin que nous ne soyons pas perdants dans cette affaire. Nous avions l’impression que l’animation de terrain et les gens qui allaient au plus près des jeunes avaient été complètement oubliés dans la gouvernance. On nous a promis que ce ne serait plus le cas, mais les dossiers, comme les décisions, peinent à sortir. Je me permets de signaler cette nouvelle difficulté.
M. Didier Jacquemain, délégué général de la Fédération nationale des Francas. La Fédération nationale des Francas est une association de jeunesse et d’éducation populaire, agréée au titre de sa complémentarité à l’enseignement public. Elle porte un regard national, mais aussi territorial, avec 81 associations départementales, 20 unions régionales et 5 000 centres d’activités développés sur l’ensemble du territoire national, soit par des associations locales, soit par des collectivités.
Dans le contexte de crise que nous connaissons, nous avons des craintes, des incertitudes. Les difficultés des grands réseaux nationaux n’ont pas commencé il y a quelques années : elles sont beaucoup plus anciennes. La baisse de l’intervention de l’État
– je pense notamment aux financements publics émanant de l’Education nationale – est de l’ordre de 50 % sur les vingt dernières années ; cela inclut la substitution progressive des détachements de fonctionnaires aux mises à disposition qui avaient cours précédemment.
Cette évolution s’explique par la position adoptée à une époque par rapport aux grands réseaux nationaux : on considérait alors qu’il fallait plutôt soutenir les petites associations territoriales. Aujourd’hui, on est revenu sur cette logique et on prend soin de s’assurer que les fédérations nationales arrivent à soutenir un niveau d’activité permettant, dans un contexte de crise, d’assurer une réelle animation fédérative, une réelle animation de réseau et le développement de réelles coopérations en interne. Cela suppose un niveau fédéral fort.
Depuis deux ans, nous avons engagé un travail de fond sur le modèle socio-économique de notre organisation afin de voir comment devraient évoluer les équilibres entre les concours publics, les financements issus des activités et les cotisations. Il est nécessaire de renforcer le financement de la formation des bénévoles associatifs, s’agissant notamment de ceux qui acceptent de prendre des responsabilités dans la gouvernance, afin qu’ils puissent conduire les travaux nécessaires pour assurer la pérennité de l’association, au regard des évolutions qui existent aujourd’hui. Cela suppose, dans les organisations, un niveau national suffisamment outillé, de manière à accompagner ces évolutions et à garantir que les bénévoles puissent mesurer l’impact des décisions prises, notamment dans un contexte où la commande publique connaît un développement de plus en plus important.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) vise à stabiliser le concept de subvention publique, mais au-delà de ce qui est inscrit dans la loi, il faudra observer la manière dont cette disposition sera mise en œuvre. Car, par rapport au milieu éducatif et à celui de l’éducation populaire, la logique de mise en marché et d’appel d’offres est contraire à ce qu’il faudrait pouvoir faire aujourd’hui.
Les activités périscolaires sont le signe d’une réelle transformation du modèle éducatif, qui peut donner une place particulière à l’éducation populaire. La logique d’appel d’offres à elle seule ne permet pas les innovations aujourd’hui nécessaires. Il faut, dans le cadre des associations, encourager la recherche-développement, qui ne peut trouver de financement qu’à partir du moment où la puissance publique reconnaît aux associations la vocation à innover. Dans le contexte que nous connaissons, cette innovation est nécessaire, notamment dans la mobilisation citoyenne que nos associations suscitent à travers l’éducation populaire. Il faut veiller à ce que les activités liées à l’éducation populaire échappent à la seule logique des appels d’offres.
S’agissant de la réforme territoriale, notre première préoccupation porte sur le risque de disparition de la clause de compétence générale, au niveau des départements et des régions. Aujourd’hui, nos 100 entités territoriales, au niveau régional ou départemental, sont soutenues, dans leurs projets, par les conseils généraux et les conseils régionaux. Si, demain, la suppression de la clause de compétence générale ne leur permettait plus d’agir dans le champ de l’éducation, notamment de l’éducation populaire, il y aurait un risque fort d’affaiblissement des niveaux territoriaux, qui coordonnent l’activité locale.
Notre second sujet de préoccupation porte sur les compétences. Aujourd’hui les départements et les régions n’ont pas de compétence affirmée sur la question de l’éducation et de l’éducation populaire, à l’exception du financement des infrastructures. Cela étant, les conseils généraux et les conseils régionaux sont allés bien au-delà, pour soutenir le développement de projets éducatifs. Il faut donc veiller à ce que, dans le cadre de la réforme territoriale, il y ait une compétence affectée à ces niveaux territoriaux afin que ce qui a été investi au profit de l’éducation puisse continuer à l’être.
M. Karl Deschamps, secrétaire national délégué aux vacances à la Ligue de l’enseignement. Mesdames et messieurs les députés, la Ligue de l’enseignement vous remercie de l’avoir conviée à venir exprimer ici sa vision des difficultés du monde associatif en période de crise, mais aussi de manière plus générale.
La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire ancien, qui fêtera ses 150 ans dans deux ans. Elle regroupe aujourd’hui 1,6 million d’adhérents, répartis dans 30 000 associations, qui agissent tous les jours dans 24 000 communes de notre territoire national. Les adhérents ont un objectif : permettre aux citoyens d’accéder à l’éducation et à l’émancipation républicaine par l’éducation. Voilà, en résumé, la philosophie de la Ligue de l’enseignement et le cadre de son action.
S’agissant des difficultés que nous rencontrons, à un moment où la crise a plutôt comme effet d’amener chaque citoyen à se refermer sur lui-même, le monde associatif reste un espace rempart face à cet isolement. Malgré la crise, nous avons, entre 2005 et 2011, constaté tous les ans une augmentation de 11 % du nombre d’associations et de 7 % du nombre de bénévoles. Aujourd’hui, près d’un quart des Français sont bénévoles dans une association. En 2013, le nombre d’emplois associatifs a augmenté de 0,2 %, là où l’emploi du secteur concurrentiel était en recul.
Pour autant, le monde associatif rencontre des difficultés. Mais celles-ci ne sont générées directement par la crise. La crise accélère, accroît les difficultés qui existaient déjà. Pour illustrer mon propos, je me focaliserai sur les deux difficultés qui me semblent avoir le plus évolué au cours des quatre ou cinq dernières années. Elles sont d’abord de l’ordre du financement public de la vie associative, mais aussi de la gouvernance du monde associatif.
Concernant le financement public, on pourrait résumer la relation entre le monde associatif et les pouvoirs publics de la manière suivante. Au fil des ans, nous sommes passés du rôle de partenaire à celui de prestataire. Cette relation s’explique, entre autres, par une évolution culturelle des pouvoirs publics. Depuis quelques années s’est développée, pour des raisons de bonne gestion publique, une approche consistant à codifier davantage pour assurer une meilleure sécurisation, ce qui n’est pas démontré dans les faits puisque le nombre de conventions attaquées devant les tribunaux est nettement inférieur, au regard du nombre de marchés publics, qui font, eux, l’objet de recours par milliers.
Cette évolution culturelle se conjugue avec la baisse des moyens d’intervention publics. Le nombre de recours aux marchés publics, dans le cadre de la structuration des recettes du monde associatif, de manière générale, a progressé, entre 2005 et 2011, de 8 %. Dans le même temps, la subvention publique a diminué de 10 %. Cela conduit à une évolution du rapport à la subvention, mais surtout – car ce n’est pas seulement une affaire d’argent – du rapport à la complicité entre les structures représentant des militants, des citoyens, et les élus de la République porteurs de projets politiques.
Dans le même temps, la provenance des subventions a, elle aussi, beaucoup changé, du fait de la baisse de l’intervention de l’État et, parallèlement, de la progression de l’intervention des collectivités locales. Or depuis une décennie, les collectivités locales connaissent, elles aussi, des difficultés budgétaires. Ces évolutions impactent la vie des associations. Le recours aux marchés publics, par exemple, entraîne une mise en concurrence des associations entre elles, et avec le monde concurrentiel. Or il ne s’agit pas ici de marchés, mais de formation des hommes, d’éducation et de citoyenneté.
Alors que nous portons des concepts politiques au sens noble et éducatif du terme, la concurrence s’établit sur des rapports chiffrés. Le recours au marché, qui nécessite des compétences professionnelles spécifiques, limite l’initiative citoyenne et la capacité d’innovation sociale. Les associations doivent également développer des stratégies afin de trouver des financements pérennes pour des activités dont les pouvoirs publics attendent qu’elles soient, elles aussi, pérennes. Or, par définition, un marché public n’est pas pérenne. Il faut donc développer des stratégies d’entreprise, qui entraînent une professionnalisation accrue et participent à déposséder les bénévoles d’une partie du pilotage de leur association.
La multiplication des financeurs publics alourdit la gestion administrative et financière et accroît les difficultés de trésorerie, car certaines subventions n’arrivent qu’une fois toutes les autres subventions perçues. C’est le cas, notamment, des fonds européens. Les délais administratifs et les délais de paiement de chacune des collectivités s’additionnent et génèrent de lourdes difficultés.
Enfin, la multiplication des financeurs territoriaux met en difficulté les têtes de réseau nationales et influe sur les flux nécessaires au développement de la vie associative.
On constate, depuis quatre ans, une aggravation de ces situations, connues de longue date, mais accentuées par la crise. Aujourd’hui, s’y ajoute l’effet des difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités locales, avec la baisse des moyens d’intervention. Cette baisse entraîne l’affectation prioritaire des moyens budgétaires des collectivités sur leur cœur de métier et sur le traitement des urgences : l’urgence sociale, l’urgence économique, l’accompagnement du monde de l’entreprise, par exemple. Que les collectivités accompagnent les entreprises n’est pas en soi un problème, mais cette approche très fermée évacue finalement un certain nombre de financements publics qui permettaient, entre autres, le développement de la vie associative.
Les régions, notamment, mettent en cohérence les différents dispositifs d’accompagnement du développement territorial. C’est le cas, par exemple, des maquettes européennes. Je citerai également pour exemple la question du patrimoine du tourisme social. Combien de collectivités régionales auront intégré, dans la maquette européenne, la possibilité d’accompagner la rénovation, la mise aux normes, le maintien des colonies, des centres ou des villages de vacances du tourisme social qui, aujourd’hui, permettent non seulement d’accueillir les publics en difficulté, mais surtout de créer de la mixité sociale ?
J’évoquerai pour finir la remise en cause de la clause de compétence générale, qui, sur le fond, ne nous gène guère – il s’agit d’un choix politique de structuration de la société ; néanmoins, dans les débats sur la réforme territoriale, il semble que plusieurs compétences ne soient plus prises en compte. C’est notamment le cas de la compétence « jeunesse » ou de la compétence « vie associative ». Le projet de loi portant réforme territoriale prévoit en effet la création d’une compétence partagée qui n’intègre que le sport, la culture et le tourisme. Quid des associations de jeunesse, de l’activité des collectivités locales auprès de la jeunesse, de la formation des bénévoles ? Nous proposons par conséquent d’élargir cette clause de compétence partagée aux compétences « jeunesse » et « vie associative ».
La suppression de la clause de compétence générale risque en outre de mettre les associations en rapport avec un financeur unique. Qu’aurons-nous gagné à une telle configuration, en termes financiers mais aussi en ce qui concerne les missions liées à la vie associative ?
La gouvernance associative peut se résumer ainsi : davantage de bénévoles mais moins de dirigeants ; moins de militants engagés prêts à prendre des responsabilités. Le difficile renouvellement des dirigeants associatifs est particulièrement important dans les associations de défense de l’intérêt général, de défense des droits, de l’éducation, de l’insertion, mais aussi au sein des associations promouvant le sport et les loisirs. Il s’explique en partie par l’augmentation de l’offre associative, mais également par un engagement qui se resserre parfois sur des problématiques très limitées, liées à la sphère personnelle, individuelle. Il serait trop simpliste ici de parler de montée de l’individualisme. Mais la crise crée objectivement de l’insécurité sociale pour chaque individu : qui peut être certain, à échéance de deux ou trois ans, d’habiter la même commune, d’exercer le même emploi ? Qui va, dès lors, s’engager durablement sur son territoire ? Ce changement du rapport au groupe, du rapport au collectif, influe sur le renfermement des uns et des autres dans des activités liées à leur vie quotidienne, à leur vie familiale, à leurs centres d’intérêt personnels.
La difficulté de renouveler les dirigeants associatifs tient également à la technicisation de la gestion des plus grosses associations qui enferment les administrateurs dans des responsabilités de managers, d’employeurs ou de gestionnaires, lesquelles accroissent leur perception du risque individuel encouru.
Nous appelons de nos vœux le lancement d’un plan pérenne de développement, de revalorisation de l’accès à la responsabilité associative. Il faut certes « communiquer » sur le sujet, mais aussi créer des dispositifs de formation des bénévoles – il en existe déjà, financés avant tout par les collectivités locales ; mais qu’en sera-t-il demain ? – pour leur permettre de devenir des responsables associatifs. Il convient par ailleurs de renforcer le dialogue civil : les pouvoirs publics doivent engager avec le monde associatif – troisième pilier de la République avec les syndicats et les partis politiques – un dialogue pérenne fondé non sur l’importance de l’un par rapport à l’autre, mais sur un dialogue égal de citoyens qui se regroupent pour proposer des innovations et des démarches participatives – et non pour faire pression sur les politiques ou les pouvoirs publics. Nous souhaitons enfin que ce plan aborde la simplification des textes, notamment en matière de fiscalité.
Pour ce qui concerne les marchés publics, je ferai trois propositions. D’abord nous souhaitons une clarification du cadre du recours aux marchés publics. Nous avons en effet l’impression d’avoir affaire à une approche quelque peu dogmatique en la matière. D’où, ensuite, notre vœu d’une clarification législative de la sécurisation du recours à la subvention, qui recouvre la question de la formation des acteurs – élus, personnels des collectivités locales ou de l’État – qui traitent de ces sujets. Enfin, il faut inciter les autorités européennes à reconnaître le monde de l’éducation populaire comme un service d’intérêt général (SIG) pour pouvoir simplifier et sécuriser son subventionnement – je pense notamment au secteur du tourisme social.
M. Jean-Luc Cazaillon, président du Collectif des associations partenaires de l’école (CAPE). Le CAPE, qui n’a que quatre ans d’existence, regroupe 22 associations complémentaires de l’école publique et mouvements pédagogiques. Son champ d’intervention couvre l’éducation nationale, l’éducation postscolaire et périscolaire, l’animation et les pratiques culturelles.
La première difficulté rencontrée par les mouvements que nous représentons touche à la légitimité de notre histoire, de notre action et de nos projets. Nous devons en effet sans cesse prouver que nous sommes compétents pour accompagner les actions que nous lançons. Nous devons sans cesse réaffirmer que nous sommes de bons interlocuteurs, dans une dynamique non pas seulement d’acteur mais d’auteur impliqué dans une démarche de co-construction – nous avons cette capacité à être des partenaires, à intervenir dans l’élaboration des politiques publiques à l’échelle nationale, à l’échelon local mais aussi au niveau de l’État déconcentré. Cela suppose bien la mobilisation de nombreuses compétences, dans des champs concernant plusieurs départements ministériels.
Si je prends l’exemple de la réforme des rythmes scolaires, l’aborder du seul point de vue de l’éducation nationale ne suffit pas, puisqu’elle concerne également le ministère de la jeunesse et des sports et celui de la culture. Or, à qui devons-nous nous adresser – au niveau national comme au niveau local – pour essayer de faire en sorte que les choses soient traitées globalement et non pas de façon morcelée ?
La deuxième préoccupation concerne le fait que nous sont confiées des missions relevant assez nettement d’un service public « prolongé ». Or la question – politique – de la reconnaissance de la qualité du service public que nous rendons, dans un monde où l’on oppose facilement public et privé, n’est pas anodine.
Le troisième point concerne l’échelon européen – enjeu important s’il en est. Là aussi nous devons être soutenus, accompagnés, mieux armés, notamment sur la question de la formation, du soutien administratif, de la trésorerie. Nos propositions en la matière sont similaires à celles formulées à l’instant par les représentants de la Ligue de l’enseignement et de la Fédération nationale des Francas.
Mme Catherine Chabrun, représentante du CAPE. Mon approche sera quelque peu différente puisque je représente les associations à convention annuelle – donc précaire –, petites associations qui appartiennent au CAPE, comme les mouvements pédagogiques. Je souhaite vous faire part de leurs inquiétudes et de leurs difficultés qui ont commencé avec la suppression des mises à disposition, remplacées par des postes détachés totalement à la charge des associations. Les baisses des subventions depuis longtemps rendent difficile l’équilibre des budgets : ne pouvant plus les financer, on doit supprimer ces postes de détachés. Les réductions successives de subventions provoquent des réactions d’austérité en chaîne : la diminution du budget de l’association entraîne celle de ses activités et donc celle de son financement propre. Les associations sont très inquiètes dans la perspective des restrictions budgétaires annoncées pour les trois années qui viennent.
Même si elles sont complémentaires de l’enseignement public, les associations en question éprouvent des difficultés à être reconnues, notamment dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), et donc à être en contact avec des jeunes en formation, ce qui permettrait le renouvellement de nos membres, en particulier des bénévoles. Comment donner envie aux futurs enseignants de rejoindre nos associations s’ils ne rencontrent jamais d’hommes et de femmes de terrain ?
L’obtention du statut d’association complémentaire vaut reconnaissance des actions en faveur de l’école publique. Mais si l’association ne peut plus développer ses actions, si elle est même obligée de les réduire pour équilibrer son budget, que restera-t-il de cette reconnaissance dans les années à venir alors que certaines ont plus de cinquante ans d’existence ? Le risque d’une disparition des associations dans le domaine éducatif est la plus vive de nos inquiétudes.
Pour pallier la réduction de leurs moyens, nos associations pourraient relever le niveau des cotisations mais, étant donné le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat, une telle mesure paraît impossible – d’autant plus que nous entendons faciliter l’adhésion… Elles pourraient augmenter le prix de leurs prestations – formations, publications, outils pour la classe –, mais ne risque-t-on pas, dès lors, de « marchandiser » le secteur et ainsi d’abandonner le sens du projet associatif, son utilité sociale ? Elles pourraient avoir recours à des emplois privés au lieu de postes de détachés – si ce n’est que, pour certaines actions, les enseignants restent indispensables. Enfin, on nous a souvent conseillé de faire appel aux fondations – mais il s’agit surtout de fondations d’entreprise et on se retrouve là dans une logique de concurrence qui mettrait les projets associatifs au service des objectifs de la fondation, d’où une nouvelle inquiétude face à la menace qui résulterait d’une telle solution sur la capacité des associations à contribuer à la démocratie et à l’intérêt général.
En dehors de toute considération financière, le ministère de l’éducation nationale pourrait assurer la promotion et la diffusion des actions de ces associations puisqu’elle les reconnaît, et faciliter toutes leurs activités – en particulier les stages, les formations. Enfin j’en reviens à la difficulté évoquée au début de mon intervention : les présidents, les trésoriers de nos associations sont dans leur classe, donc sur le terrain ; or, dès lors que les mises à disposition ont été supprimées, il faudrait les aider à pouvoir mieux se consacrer à leur activité associative.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Vous avez évoqué, madame Doré, vos inquiétudes quant à la montée en puissance du service civique, pouvez-vous préciser votre point de vue ?
Qu’en est-il de ce qui vous paraît nécessaire en matière de formation – initiale ou continue – des bénévoles associatifs ? Quel lien établir avec l’éducation nationale, avec des professions du champ médico-social ?
Vous avez parlé, madame Chabrun, de la difficulté pour les associations que le CAPE représente d’être reconnues au sein des ESPE. Quel est le lien avec le périscolaire ?
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les associations peuvent nouer des contrats avec les collectivités territoriales, or je suis persuadée que l’éducation populaire reste une force de proposition. Au fil du temps, votre rôle reprendra toute son importance et l’on reconnaîtra votre nécessité. Le monde de la jeunesse et de l’éducation est en pleine mutation. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur votre rôle dans les politiques que nous allons décliner en faveur de la jeunesse. La cohésion sociale, la mixité sociale passeront par le travail que vous effectuerez et par la manière dont on parviendra, y compris dans le cadre de la réforme territoriale, à contractualiser avec vous.
M. Jean-Louis Bricout. Ma commune, qui compte 6 000 habitants, applique les nouveaux rythmes scolaires depuis 2013 et je suis très satisfait de cette expérience. Nous nous sommes appuyés sur une association pivot pour l’organisation, la coordination, le suivi des formations – nous avons dû embaucher quelques jeunes « emplois d’avenir », qui n’étaient pas forcément prêts, des professionnels, des employés de la mairie et des membres d’associations locales. Tout s’est globalement bien passé malgré la difficulté de trouver les bonnes ressources.
Quel rôle, justement, pouvez-vous jouer dans un milieu rural « profond » où il peut être difficile de trouver les bonnes ressources et de coordonner ? Avez-vous été contactés par des communautés de communes qui pourraient jouer ce rôle pivot dans l’organisation, la coordination, le suivi, la montée en qualité des activités en s’associant avec des organisations telles que la vôtre – les Francas le font dans le nord de l’Aisne ?
Quel regard portez-vous sur la gratuité ? Certaines communes la pratiquent, d’autres non.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire prévoit le volontariat associatif pour les plus de 25 ans pour des missions de six à vingt-quatre mois. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, monsieur Deschamps, dans quelle mesure la réduction des dotations allouées à certaines communes fragilise-t-elle les projets de voyages pour les jeunes enfants ?
M. Jean-Noël Carpentier. Je partage l’avis de la rapporteure : vous avez un rôle important à jouer dans les années qui viennent car, les enquêtes le démontrent, comme la fameuse enquête PISA, le système éducatif français traverse une crise profonde. Nous avons mis du temps, en France, pour nous en rendre compte tant nous avons cru que notre système était immuablement bon. Et nous devons bien admettre que, depuis quelques années, notre école ne va pas si bien : elle est inégalitaire, ne favorise pas l’ascension sociale et ne met pas à niveau nos jeunes. Dans ce contexte, je crois profondément à votre rôle.
Pensez-vous avoir été suffisamment sollicités dans le débat sur la refondation de l’école ? En cas de réponse négative, il n’est pas trop tard : il existe un comité de suivi de cette loi.
Ensuite, ne pensez-vous pas que la modification de notre modèle éducatif suppose qu’on donne une plus grande importance au local, aux territoires ? Bien sûr, il faut une éducation nationale qui fixe les grandes orientations, mais pas l’éducation nationale d’arrière-grand-papa. De nouvelles collaborations avec les territoires sont donc à trouver alors que la place des communes et des agglomérations est amenée à grandir en matière d’éducation. Vous pouvez constituer un lien.
Enfin, les évolutions du numérique vous conduisent-elles à vous interroger sur vos pratiques ?
M. Régis Juanico. Un article paru la semaine dernière dans Aujourd’hui en France mentionne une étude du Collectif des associations citoyennes selon laquelle, d’ici à 2017, 260 000 emplois seraient menacés dans le milieu associatif, soit presque 15 % du total des emplois, du fait de la suppression progressive de 30 milliards d’euros de subventions. Ces chiffres sont assez alarmistes et je ne suis pas certain qu’ils soient bien étayés : je rappelle que les collectivités territoriales ne vont pas être supprimées par le projet de loi portant réforme des dites collectivités !
Pour peu que l’article du projet de loi concernant la compétence partagée soit suffisamment bien rédigé et qu’il mentionne au moins la vie associative – pour la « jeunesse », il faudrait y regarder au moins à deux fois –, les subventions ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Nous venons de voter une loi relative à l’économie sociale et solidaire qui sécurise pour la première fois la définition de la subvention. Partagez-vous le pessimisme de cette étude ?
Par ailleurs, quels compléments faudrait-il apporter à la loi relative à l’économie sociale et solidaire ?
M. Didier Jacquemain. Je partage l’idée qu’un nouveau modèle éducatif reste à construire combinant intervention nationale et intervention territoriale, que des dispositifs sont à inventer en matière de gouvernance mais aussi concernant les modes de partenariat. Si les grands réseaux comme le mien – qui demeure modeste par rapport à celui de la Ligue de l’enseignement –, si les associations comme les mouvements pédagogiques, les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), ne s’étaient pas mobilisés auprès de communautés de communes, de territoires, nous n’aurions pas réussi cette première évolution. On ne construira pas ce nouveau modèle si la mise en marché des activités est le seul mode de relation entre la puissance publique, quel que soit le niveau concerné, et les associations. Le nouveau modèle éducatif devra accorder toute sa place à l’éducation populaire car elle parvient à mobiliser des citoyens.
En ce qui concerne la question des compétences partagées, inscrire la vie associative dans le texte de loi ne suffit pas, car celle-ci est un ensemble beaucoup trop divers – mais riche de sa diversité – et ses champs d’activité sont par conséquent très différents, qu’il s’agisse des modes d’organisation ou des normes créées – il suffit, par exemple, de comparer le secteur social et celui de l’éducation pour voir combien sont différents les modèles qui ont été développés. Au regard des enjeux, il faut arriver à ce que l’éducation devienne une compétence partagée ; nous serions alors contraints de réfléchir sur ce que devrait faire l’échelon national et sur ce que devrait faire l’échelon territorial. C’est une nécessité absolue.
M. Jean-Luc Cazaillon. Je regrette que nos interventions aient pu laisser penser que nous sommes pessimistes, car nous sommes profondément optimistes, engagés, et résolument modernes. On nous fait parfois des procès en ringardise mais la valeur de nos pratiques, notre histoire, nos projets sont pour le moins d’actualité et même porteurs d’avenir. La refondation de l’école publique est un bon exemple de cette logique : nous avons été heureux de voir revenir sur la scène les principes de coéducation, de complémentarité des temps : ce sont nos combats historiques, nos projets, et ils demeurent d’actualité. Nous sommes donc dans une démarche de soutien et de combat.
Pour ce qui est des activités périscolaires, nous sommes de ces acteurs qui ont construit la complémentarité déjà évoquée : nos militants sont des éducateurs qui agissent
– intelligemment – au sein de l’école et en dehors d’elle, des acteurs de plusieurs champs de l’éducation, capables d’établir des passerelles et de créer des espaces de synthèse dont on mesure aujourd’hui l’importance, notamment à travers les projets de territoire.
Nous apportons notre soutien aux collectivités et à la formation des jeunes, enjeu d’autant plus important que la réforme des rythmes scolaires bouleverse le secteur « historique » de l’animation volontaire ou professionnelle. Celui-ci se trouve profondément impacté par l’emploi massif de jeunes et des réponses parfois inadaptées en matière de profils métiers qui n’en sont pas vraiment. Il faut que l’on puisse traiter cette situation complexe à la fois avec les collectivités et avec l’État, à savoir le ministère de l’éducation nationale, mais aussi le ministère de la jeunesse, qui doit assurer la promotion de filières historiquement de son ressort. Nous avons donc un rôle à jouer, à la fois pour être aux côtés des collectivités et des jeunes, intervenir directement, créer de la « transversalité » et répondre aux besoins d’une politique qui refuse l’exploitation de jeunes sans qualifications
– le BAFA ne doit pas devenir la réponse la moins chère, donc la moins adaptée aux profils de ces jeunes.
Enfin, en ce qui concerne la formation initiale et continue des enseignants, il faut faire vivre le second « E » de ESPE, la question essentielle n’étant pas celle du professorat mais celle de l’éducation. Cette institution doit en effet définir un projet global prenant en particulier en considération le point de vue des familles. Le 28 novembre prochain, à l’occasion du salon de l’éducation, le CAPE devrait signer un accord avec le réseau des ESPE. Nous soutenons que la réforme des rythmes scolaires, qui a beaucoup occupé le devant de la scène, n’est qu’un aspect de la refondation de l’école – projet ambitieux destiné à relever le défi lancé par les résultats des enquêtes PISA, à répondre aux enjeux sociaux et sociétaux actuels. Nous sommes à la manœuvre et ne fuirons pas nos responsabilités politiques.
Mme Françoise Doré. Le débat d’orientation sur les finances publiques de juillet 2014 pour le budget triennal 2015-2017 a donné « la priorité à la jeunesse, qui implique la création des 60 000 postes programmés dans l’éducation nationale et une trajectoire ambitieuse pour les emplois d’avenir et le service civique ». Or là est notre inquiétude : se contenter de l’affectation de moyens financiers modestes à une seule priorité. M. Cazaillon vient d’évoquer les jeunes qui s’engagent dans les associations à des titres très divers… Le mot « engagement », dans nos associations de jeunesse et d’éducation populaire, recouvre une réalité depuis des années. Je l’affirme d’autant plus sereinement que notre association fait partie de celles qui ont souhaité, dans le milieu des années 1990, qu’on accorde au volontariat une place permettant un engagement significatif au service des projets des associations, un engagement grâce auquel des jeunes acquièrent une vraie expérience.
Je ne dirais donc pas que le service civique ne soit pas intéressant. Nous en souhaitons même la montée en puissance. Le service civique est du reste la seule ligne en hausse au sein du budget de la jeunesse et des sports pour la période 2012-2014, celui alloué à la formation des bénévoles étant resté stable et les autres ayant diminué. Il faut donc trouver des moyens à la hauteur d’une ambition interministérielle, afin de ne pas sacrifier la qualité, de ne pas amputer la durée significative du volontariat à laquelle nos associations sont attachées : l’expérience en question doit être utile. Même si, entre 2013 et 2014, les coûts moyens par jeune ont baissé puisque l’on a diminué les charges sociales assumées par l’État, bien du travail reste à accomplir pour parvenir au chiffre de 100 000 jeunes en 2017.
M. Karl Deschamps. Le problème n’est pas, en effet, l’affectation de moyens au service civique, mais la baisse des moyens attribués à toutes les autres actions. Le service civique est un dispositif remarquable que toutes nos organisations ont appelé de leurs vœux et qui fonctionne, qui se conjugue avec d’autres dispositifs comme les « associations juniors » et qui montre que les jeunes de notre pays ont envie de s’investir au service de l’intérêt général.
Mme la rapporteure a évoqué la formation des bénévoles associatifs. Il existe déjà des dispositifs de formation. Nous souhaitons leur élargissement et la sécurisation de leur financement afin d’en garantir l’accessibilité. Il faut d’abord envisager le projet associatif, la démarche, la dynamique collective et son management. Il y a ensuite la question de la gestion humaine de ces dynamiques qui sollicitent des bénévoles mais aussi, parfois, des salariés. Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect plus entrepreneurial de l’économie sociale et solidaire autour des budgets, des financements, des assurances… Ces éléments sont très importants et l’on pourrait s’interroger sur l’établissement d’éventuelles passerelles avec la validation des acquis de l’expérience (VAE). Toutefois, il ne suffit pas de former les bénévoles, il faut encore les accompagner de façon permanente ; or c’est le rôle des mouvements d’éducation populaire : il faut entretenir l’énergie du bénévolat grâce, entre autres, à la démarche collective supra-associative. Il convient en effet de donner des perspectives au-delà de l’action associative.
M. Bricout m’a interrogé sur les voyages. Les structures du tourisme social, notamment celles liées au départ des enfants en colonies de vacances, rencontrent des difficultés. On constate un recul du taux de départ des Français en général et des enfants en particulier – durant l’été, 3 millions d’enfants « tiennent les murs ». Le chiffre de 2014 confirmera malheureusement les données des années précédentes. Nous avons des difficultés financières et des difficultés de partenariat avec les comités d’entreprise qui eux-mêmes se trouvent dans une situation économique et budgétaire délicate, alors qu’ils sont nos premiers partenaires avec les caisses d’allocations familiales. Il faudra par ailleurs assurer la stabilité juridique du statut des accompagnateurs, des encadrants et des animateurs.
Nous n’abordons pas le numérique, monsieur Carpentier, du point de vue de l’infrastructure, mais du contenu et des pratiques. Nous développons dans cette perspective de nombreuses actions d’éducation au maniement de cet outil extraordinaire mais qui ne doit rester qu’un outil maîtrisé par l’homme. Il reste de grandes marges de progrès en la matière.
Enfin, M. Juanico a raison : nous nous sommes peut-être montrés pessimistes dans nos propos. Toutefois, comme Jean-Luc Cazaillon, je répondrai que non seulement le monde associatif n’est pas pessimiste mais qu’il a une ambition collective, qu’il s’agisse de promouvoir le lien social, la mixité sociale, le « vivre-ensemble ». C’est de cela que nous voulons parler avec les élus de la République. Nous voulons parler du fond, de démarche politique et surtout ne pas être réduits à un rôle d’exécutants de politiques publiques qu’il n’est certes pas question pour nous de déterminer, mais de co-élaborer dans la concertation. En effet, si nous ne voulons pas que nos adhérents ne soient que des consommateurs, ils doivent avoir une place dans la société qui passe par la reconnaissance, par les élus de la République, du rôle du monde associatif.
M. le président Alain Bocquet. Cette belle conclusion marquera la fin de notre réunion… Je vous remercie.
Table ronde « Modèle économique et financier » :
Mme Sophie des Mazery, directrice de Finansol ;
M. Hugues Sibille, vice-président du Crédit coopératif ;
M. Gérard Leseul, responsable des relations institutionnelles et internationales au Crédit mutuel ;
M. Christian Sautter, président de France Active ;
M. Yannick Blanc, président de La Fonda
(séance du 2 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Dans le contexte de crise que nous connaissons depuis plusieurs années, les contraintes pesant sur la vie associative se sont faites progressivement plus fortes : réduction et transformation des financements publics, exigences accrues de transparence et de contrôle, évolution du bénévolat, présence plus affirmée du secteur lucratif dans des domaines d’activité autrefois chasse gardée des associations.
La rigueur de gestion – la « chasse au gaspi » – ne suffit plus. Ce qui est en cause, c’est la capacité des associations à obtenir des sources de financement pérennes, notamment pour financer leurs charges récurrentes et leurs frais de structure, à mobiliser des fonds propres et à optimiser les financements bancaires ou sur titres. Il faut réinventer – ou peut-être, pour certaines, inventer – des modèles économiques et financiers, ce qui passe par un retour sur soi plus global que la simple recherche de nouveaux bailleurs de fonds.
Qu’est-ce qu’un modèle économique et financier pour une association ? Que peut-elle en faire ? À entrer dans une telle démarche, risque-t-elle de perdre son âme ? Quel rôle doit jouer la finance solidaire dans les modèles économiques associatifs ? Votre expertise à tous nous sera précieuse pour y voir clair et essayer de dégager l’horizon du monde associatif.
Avant de vous donner la parole, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Sophie des Mazery, MM. Hugues Sibille, Gérard Leseul, Christian Sautter et Yannick Blanc prêtent serment)
Mme Sophie des Mazery, directrice de Finansol. Je m’attacherai à montrer comment la finance solidaire peut financer le monde associatif.
La finance solidaire est un circuit de financement qui relie des particuliers, au nombre aujourd’hui de 1 million, souhaitant donner du sens à leur épargne, à des structures à forte utilité sociale et environnementale, qu’il s’agisse d’entreprises, de coopératives ou d’associations. L’épargne solidaire se distingue du don, même si les produits de partage s’en approchent. Elle finance soit les dettes, soit le capital d’entreprises solidaires agréées répondant à un besoin humain essentiel comme le logement, l’emploi, la production d’énergie propre et reposant sur un modèle économique pérenne puisqu’elles doivent avoir la capacité de rembourser l’argent prêté.
La finance solidaire est née il y a plus de trente ans. Les années quatre-vingt ont vu, de manière concomitante, émerger l’initiative conjointe du Crédit coopératif et du Comité catholique contre la faim et pour le développement de créer le fonds commun de partage « Faim et Développement », se développer le mouvement des Cigales, clubs d’investisseurs particuliers animés de la volonté de financer des activités économiques créatrices d’emplois dans une période de fort chômage, et se créer des sociétés de capital-risque.
Il y a trois façons de constituer une épargne solidaire :
La première passe par les banques et les mutuelles, puisque pratiquement toutes proposent des produits d’épargne solidaire, même si toutes ne les promeuvent pas.
La deuxième passe par les entreprises, qui constituent le principal facteur de croissance de cette épargne. Une loi de 2001 puis la loi de modernisation de l’économie, en 2008, ont posé l’obligation pour les entreprises ayant des dispositifs d’épargne salariale de proposer au moins un fonds solidaire à leurs salariés. Le nombre des épargnants salariés contribuant à l’épargne solidaire est de 800 000, chiffre à rapporter au million d’épargnants solidaires et aux 10 à 12 millions d’épargnants salariés.
La troisième passe par l’investissement direct dans le capital d’une entreprise solidaire.
En dix ans, l’épargne solidaire a connu une forte progression : de 2002 à 2012, le nombre d’épargnants a augmenté de 39 000 à 1 million et l’encours de 300 millions d’euros à 6,2 milliards d’euros.
Les termes d’entreprise solidaire ne sont pas un oxymore. Ces entreprises reposent sur une activité économique au service du développement humain, destinée à venir en aide à des publics ou des territoires fragiles. Leur finalité première n’est pas de maximiser les résultats mais il importe qu’elles en obtiennent suffisamment pour ne pas disparaître et pour réinvestir dans leurs projets. Leur lucrativité est limitée, voire nulle, et leurs rémunérations doivent être raisonnables, comme l’impose le cadre strict de l’agrément.
Je vais maintenant évoquer les quatre grands secteurs d’activité financés par l’épargne solidaire.
Il s’agit tout d’abord du logement très social, destiné à un public en difficulté qui ne répond pas aux conditions d’attribution d’un HLM. Le plus gros acteur de ce secteur est Habitat et humanisme, qui gère aujourd’hui 7 000 logements sur l’ensemble du territoire et accompagne des personnes fragilisées vers une pleine réinsertion dans la société, comprenant l’accès à un logement et le retour vers l’emploi.
Le deuxième secteur est l’emploi. Les financeurs solidaires, au premier rang desquels France Active, développent une activité quasi-bancaire au service d’entreprises favorisant la création d’emplois et ayant une utilité sociale ou environnementale. Citons les entreprises de réinsertion Vitamine T, qui compte 3 000 salariés, et le Réseau Cocagne, association de jardins maraîchers qui emploie 1 700 personnes.
Troisième secteur : les activités écologiques citoyennes, qui comprennent l’agriculture biologique et les énergies renouvelables répondant à certains critères, précisons-le – il s’agit de financer l’installation non pas de champs de panneaux solaires dont le seul objectif serait de générer de la rentabilité mais d’éoliennes acceptées par toutes les parties prenantes.
Enfin, quatrième secteur, l’entrepreneuriat dans les pays du Sud. Bénéficiaire historique de l’épargne solidaire, c’est maintenant le moins important des secteurs financés. Je citerai ici la SIDI.
L’ambition de Finansol est, à moyen terme, que 1 % du patrimoine financier des Français soit investi dans l’épargne solidaire. Il reste du chemin à parcourir puisque sur un total de 4 000 milliards d’euros d’épargne, elle ne représente actuellement que 0,15 %. Mais cet objectif nous semble atteignable.
Au niveau international, l’épargne solidaire fait l’objet d’une prise de conscience de plus en plus forte. Le G8 a ainsi créé un groupe de travail consacré à l’impact investing au sein duquel Hugues Sibille représente la France.
Pour finir, j’aborderai la question de savoir comment l’épargne solidaire peut participer à la diversification des ressources des associations à côté des subventions, des dons et des prêts bancaires.
Le premier des trois principaux mécanismes est l’épargne de partage, fondée sur le partage des intérêts d’un produit entre un particulier et une association. Elle occupe une place modeste puisqu’à la fin de l’année 2013, les dons ainsi distribués s’élèvent à 6 millions d’euros. Le deuxième mécanisme recouvre les outils de dette, du micro-crédit aux prêts participatifs. Le troisième, qui ne concerne que les plus grosses associations, repose sur des investissements directs de sociétés de gestion à travers des billets à ordre ou des obligations associatives.
La problématique fondamentale des associations est la faiblesse de leurs fonds propres. Toutefois, certaines ont contourné cette difficulté en créant un outil de financement au service de leur projet associatif. En ce domaine, Habitat et humanisme est un précurseur : elle a mis en place une foncière, société en commandite par actions, qui lui permet d’ouvrir son capital aux particuliers et aux investisseurs institutionnels en procédant à des augmentations une à deux fois par an. Ce capital, qui atteint aujourd’hui 100 millions d’euros, est pour plus de la moitié aux mains de particuliers. Je citerai, sur le même modèle, Terre de liens, dont les 40 millions d’euros de capital sont détenus par des particuliers.
M. Hugues Sibille, vice-président du Crédit coopératif. Mon intervention sera alimentée par ma double mission de vice-président du Crédit coopératif et de président de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (AVISE).
Pour répondre au thème de cette table ronde, je me suis efforcé de définir ce que j’entendais par modèle économique et financier des associations. Voici ma définition : équilibre durable entre des produits et des charges permettant de piloter un projet non lucratif à moyen terme, sans distribuer le fruit des résultats, mais en se donnant les moyens de financer les investissements.
Maintenant, il faut se demander quel degré de difficultés connaît ce modèle, question qui fait l’objet de perceptions sensiblement différentes. Au Crédit coopératif, le coût du risque, la « sinistralité » des prêts bancaires aux associations, n’a pas augmenté en 2013 ni au premier trimestre 2014. L’AVISE, qui accompagne sur tout le territoire 6 000 à 7 000 associations par an, constate que les demandes portent pour plus d’un tiers sur le modèle économique et financier. Quant au collectif des associations citoyennes, il a diffusé ces derniers jours dans la presse des prévisions alarmistes – je n’entrerai pas dans la polémique, me contenant d’indiquer qu’il n’est peut-être pas utile de paniquer le monde associatif.
Compte tenu du contraste entre ces visions, il est bon sans doute que votre assemblée travaille à faire la lumière, en toute objectivité, sur les réalités que connaissent les associations.
Un discours global sur les associations est extrêmement dangereux car, comme le montrent les solides travaux de Viviane Tchernonog, il existe une grande diversité de modèles économiques parmi les associations. La répartition des subventions, des cotisations, des dons, des recettes d’activité, des apports du mécénat fait apparaître des écarts très importants : ainsi les subventions représentent-elles 50 % des ressources du secteur caritatif humanitaire et seulement 15 % de celles du secteur sportif, si bien que leur diminution a des incidences fort différentes. Les difficultés du monde associatif doivent être envisagées à travers le prisme de cette diversité, tout comme les réponses qu’on doit y apporter.
Dans le paysage des associations, ce sont les petites et moyennes qui sont le plus sous tension. Depuis maintenant plus de deux ans, le Crédit coopératif a d’ailleurs établi une distinction selon un critère de taille. Si celles-ci connaissent davantage de difficultés, c’est pour deux raisons principales. D’une part, la puissance publique recourt de plus en plus aux appels d’offres auxquels elles ont plus de mal à répondre que les grandes. D’autre part, elles ne disposent pas de moyens techniques et d’expertise pour rechercher les meilleurs moyens de lever des fonds, à la différence de certaines associations appartenant à France Générosités ou au Comité de la charte, comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge.
Il importe, par ailleurs, de bien distinguer les difficultés d’exploitation – équilibre charges-produits – des difficultés de trésorerie et de fonds propres. Les associations ont de plus en plus de difficultés à financer leurs frais de fonctionnement, que ni les financeurs privés, ni les financeurs publics ne semblent vouloir prendre en charge, préférant soutenir les projets.
À cela s’ajoute la complexité des procédures de demandes de subventions, soulignée par Yves Blein dans son rapport. Je pense que de multiples exemples vous ont déjà été cités. Le Fonds régional de développement de la vie associative lancé par la région Ile-de-France demande pas moins de vingt-sept documents ! Des initiatives doivent être prises en matière de simplification, dans la continuité des actions que Mme Vallaud-Belkacem avait commencé de mettre en place lorsqu’elle était ministre de la vie associative – par parenthèses, je remarque que la vie associative ne figure dans aucun des titres des ministres du gouvernement actuel ; doit-on y voir un signe ?
En outre, comme le souligne encore Viviane Tchernonog, les appels d’offres se contentent du moins-disant, ce qui a un fort impact sur les conditions d’exploitation.
S’agissant de la trésorerie et des fonds propres, les associations sont confrontées à un allongement des délais de versement, qui les oblige à trouver des solutions de financement en attendant. Elles sont en effet soumises à la règle d’antériorité selon laquelle la notification d’engagement doit précéder tout engagement de dépenses. Certaines trouvent des accords mais d’autres entrent en conflit avec la collectivité quand celle-ci refuse de prendre en charge les dépenses faites avant la notification de la subvention.
Autre élément de fragilisation des fonds propres : la complexité de l’accès aux aides du Fonds social européen. De nombreuses associations ont d’ailleurs renoncé à les solliciter.
La question majeure en ce domaine est celle des excédents. Depuis la guerre, les associations ont constitué leurs fonds propres à partir d’excédents. Cela a contribué à asseoir leur solidité financière, aujourd’hui remise en cause car on leur dénie, si ce n’est de jure du moins de facto, le droit de faire des excédents. Si la puissance publique en constate en année n, elle diminue en année n + 1 sa part de financement. C’est une mécanique tout à fait dangereuse car elle risque de décourager les associations de s’astreindre à une bonne gestion. Celles-ci réclament légitimement la possibilité de dégager des excédents raisonnables.
Par ailleurs, les difficultés auxquelles sont confrontées les associations varient selon les secteurs. Résumons : celles du secteur médico-social sont liées aux appels d’offres et aux contractions des ressources ; le secteur socio-culturel est marqué par la fragilité des trésoreries ; le secteur sportif souffre d’un manque de ressources humaines ; les associations militantes, elles, ont un accès difficile aux ressources.
Face à ces constats, quelles pistes peut-on explorer ?
La première consiste à mieux accompagner les associations. Le dispositif local d’accompagnement (DLA) s’appuie sur une centaine de structures sur tout le territoire, dont un tiers est géré par France Active. Les 25 millions qu’il coûte chaque année paraissent peu de chose par rapport au total du budget associatif. De ce point de vue, il serait intéressant de comparer les dispositifs d’accompagnement des entreprises et ceux du monde associatif. Rappelons d’ailleurs que les associations sont considérées en droit communautaire comme des entreprises. Au-delà de la nécessité de maintenir ces dispositifs, se pose la question de les inciter à mieux accompagner les associations en difficulté, dont le nombre est appelé à croître dans les années à venir. Il importe aussi de mieux accompagner les fédérations nationales pour qu’elles-mêmes accompagnent mieux leurs membres.
La deuxième piste réside dans un renforcement des fonds propres. Il conviendrait de mettre en œuvre les titres associatifs dont la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a réformé le régime car ils n’avaient été que très peu utilisés depuis leur création en 1985. Il faut également, comme je l’ai dit, autoriser les excédents raisonnables. Et l’on pourrait envisager, dans certains cas, de faciliter la transformation d’associations en coopératives d’intérêt collectif, beau prolongement qui maintient la notion d’intérêt général.
La troisième piste repose sur l’amélioration de la gouvernance associative. Les associations qui résistent le mieux, comme l’AVISE a pu le constater, sont celles qui ont la gouvernance la plus solide, ce qui suppose un bon conseil d’administration composé de personnes compétentes capables de piloter un modèle économique tel que je l’ai défini et, pour les associations employeuses, une bonne articulation entre le conseil d’administration, l’équipe technique et la direction. Il me semble que cette dimension n’est pas assez prise en compte, notamment pour ce qui est de la formation des administrateurs. Il n’y a pas d’équivalent du magnifique travail qu’a mené Daniel Lebègue avec l’Institut français des administrateurs.
Enfin, il conviendrait que l’État, au niveau national, fasse les efforts nécessaires pour mettre en ligne l’ensemble des conventions pluriannuelles d’objectifs, ce qui a été proposé mais n’a jamais été fait. En outre, le Parlement pourrait publier un rapport annuel sur l’évolution des financements aux associations.
M. Gérard Leseul, responsable des relations institutionnelles et internationales au Crédit Mutuel. Je partage les analyses de Sophie des Mazery et Hugues Sibille ; nous nous appuyons du reste sur les mêmes études pour alimenter nos réflexions, qu’il s’agisse des travaux de La Fonda, de la Conférence permanente des coordinations associatives ou de Viviane Tchernonog. Au Crédit mutuel, comme au Crédit coopératif, nous avons pu constater qu’il n’y avait pas de défaillances importantes dans le secteur associatif, ce qui n’empêche nos équipes respectives d’exercer une grande vigilance car les difficultés sont là.
Plusieurs diagnostics ont été établis, tenant compte de l’extrême diversité du monde associatif, mais les diagnostics n’impliquent pas la guérison. La principale maladie dont souffrent les associations est la raréfaction des financements. Les collectivités locales ont compensé un certain temps la désimplication de l’État dans le financement des associations mais elles procèdent – nous le voyons bien au niveau des conseils généraux et des communes – à des resserrements de financement. Il n’est donc pas exclu que des difficultés apparaissent. Je ne suis pas alarmiste mais je reste prudent.
Dans ce contexte, il importe de réfléchir à des modes alternatifs de financement et de ressources.
La question de l’intégration des excédents prend ici toute son importance. Le fait que les financeurs publics retirent leurs subventions aux associations qui en dégagent peut inciter certaines à ne pas faire preuve d’une grande rigueur de gestion. Il serait bon de leur ouvrir la possibilité de constituer des excédents.
Le volet associatif de la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), même s’il n’est pas très développé, ouvre des pistes intéressantes parmi lesquelles l’hybridation des ressources.
La simplification administrative est un autre enjeu. Les associations ne sont pas considérées en France comme des PME, mais elles pourraient dupliquer intelligemment trente à quarante des cinquante premières mesures de simplification à destination des entreprises mises en œuvre cette année. Il faudrait y ajouter des mesures qui leur seraient spécifiques de façon, notamment, à fluidifier leurs relations avec l’administration fiscale.
De manière générale, on constate que certaines administrations considèrent les associations comme des interlocuteurs quelque peu exotiques. Par exemple, si une association contacte Pôle emploi pour établir une attestation employeur dans le cadre d’un licenciement, elle se voit souvent renvoyée à d’autres structures comme le chèque emploi associatif. Il conviendrait de faire œuvre de pédagogie auprès des administrations afin de mieux faire valoir les fonctions économiques des associations, qui se heurtent aux mêmes problèmes que les entreprises en matière de droit du travail et de calcul de cotisations. Pourquoi ne pas désigner, par exemple, des interlocuteurs privilégiés, au fait du fonctionnement associatif ?
La question principale reste, selon moi, celle du financement. Les garanties ont un rôle très important à jouer à cet égard car elles sont de nature à rassurer les partenaires bancaires et constituent un fait déclencheur. Cependant, à l’heure actuelle, les organismes qui accordent des garanties le font davantage pour financer les investissements – je pense à SOGAMA – que les frais de fonctionnement. Or, comme l’a souligné Hugues Sibille, c’est le financement du quotidien qui est le plus difficile pour les associations.
À cet égard, il serait bon que la représentation nationale interroge la Banque publique d’investissement (BPI) sur les 500 millions d’euros qu’elle doit consacrer à l’économie sociale et solidaire. Selon quel calendrier et selon quelles modalités seront-ils distribués ? Qu’en est-il de l’accès des associations aux 40 millions du Fonds d’innovation sociale (FISO) prévu par la loi sur l’ESS ?
Par ailleurs, on peut penser que l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » créé par cette même loi pourra faciliter la mobilisation de l’épargne vers le secteur associatif.
À titre personnel, je reste dubitatif quant au développement des titres associatifs, car ils sont indexés sur le taux moyen de rendement des obligations. Sachant que celui-ci se situe aujourd’hui aux alentours de 2 %, cela contraint les associations à verser des sommes importantes pour le remboursement et pour les intérêts (dont le taux se situe aux alentours de 7%), ce qui n’est pas à la portée de toutes.
Pour finir, j’insisterai sur une mesure déjà évoquée : il faut absolument ouvrir la possibilité aux associations de se constituer des réserves par accumulation d’excédents. Cela suppose de faire comprendre à l’ensemble des financeurs publics qu’une saine gestion nécessite de générer de tels excédents. Faute de trésorerie suffisante, trop d’associations sont dans l’incapacité de licencier leur personnel dans les règles en cas de difficultés. Elles doivent pouvoir honorer leurs responsabilités d’employeur.
M. Christian Sautter, président de France Active. France Active est impliquée de trois façons dans le développement et le financement des associations.
Elle accompagne et finance. Pour l’année 2013, 1 063 structures solidaires ont ainsi bénéficié de notre appui, dont 70 % d’associations qui sont pour nous une clientèle
– j’emploie ce mot à dessein – centrale. Ces projets ont représenté plus de 27 000 emplois créés ou consolidés et 53 millions d’euros de concours financiers, pour l’essentiel privés.
Elle anime dans un tiers des départements les dispositifs locaux d’accompagnement, effort d’appui considérable qui a porté sur 7 000 entreprises solidaires en 2012.
Elle anime le centre de ressources DLA Financement dans le cadre duquel elle mène des études avec le Mouvement associatif.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ferai sur la santé des associations une remarque plus pessimiste que mes prédécesseurs. Certes leur mortalité n’a pas augmenté durant les dernières années, mais leur capacité à créer de l’emploi a été affectée. Jusqu’en 2008-2009, elles créaient deux fois plus d’emplois que les entreprises classiques ; depuis, leur contribution a connu un essoufflement. Elles se posent la question de réduire leurs effectifs. Or dans la période de crise actuelle, nous avons besoin de cette source de créations d’emplois.
J’insisterai sur six points.
Premièrement, je soulignerai la nécessité de bénéfices raisonnables. Comme toutes les structures économiques, les associations ont besoin de trésorerie. Elles vivent beaucoup de subventions publiques dont le versement n’est effectif que dans un délai de trois à six mois. Une association qui ne débute pas l’année avec trois à six mois de chiffre d’affaires en caisse doit s’en remettre aux banques pour se financer, à coût extrêmement élevé, dans l’attente des aides publiques.
En outre, pour financer leurs investissements, elles ont besoin d’un minimum d’autofinancement. Quand elles sollicitent les banquiers, même avec des garanties, elles risquent de susciter des interrogations si elles n’ont pas d’apport financier minimal.
Cela pose deux questions de nature culturelle. D’une part, le monde associatif appartient au monde militant, au monde de l’économie non lucrative, et les mots de « bénéfice » ou de « profit » sont presque des gros mots pour certains bénévoles ou salariés qui se dévouent à la cause commune. D’autre part, les financeurs publics ont ce très mauvais réflexe de diminuer les subventions en cas d’excédents, réflexe appelé à se développer puisque tous les acteurs publics tendent à rogner leurs aides.
Pour les associations, le bénéfice n’est pas un but en soi, comme dans les entreprises capitalistes, mais un moyen de survie et de développement.
Deuxièmement, je mettrai l’accent sur les garanties qui ont bénéficié à la moitié des 1 063 projets que nous avons soutenus en 2013. Leur principe est très simple : les projets sont analysés et confortés par les 550 salariés et les 2 000 bénévoles de France Active, puis examinés devant un comité d’engagement indépendant composé de banquiers, de cadres d’entreprise et de responsables associatifs ; munis de notre label, ils sont ensuite soumis aux banquiers qui se réjouissent avec raison de la garantie que nous apportons car si le projet réussit – dans 90 à 95 % des cas –, ils ont un nouveau client gratuit, et s’il échoue, ils se voient rembourser par France Active, avec l’aide des collectivités et de l’État, la moitié des sommes qui restent dues.
La garantie constitue un levier simple et efficace : pour 1 euro d’argent public, elle permet de lever 8 euros d’argent privé, alors que le rapport est de 1 pour 1 dans le cas des subventions. Il est très important de préserver cet outil bénéfique à l’emploi. Or nous avons quelques craintes, mesdames, messieurs les députés, car le Fonds de cohésion sociale, qui finance en partie ces garanties, risque d’être moins doté l’an prochain et dans les années à venir.
Troisièmement, l’épargne salariale solidaire – que Mme des Mazery a évoquée avec éloquence – croît très rapidement. La société d’investissement de France Active, qu’Edmond Maire a remarquablement développée, à tel point qu’elle dispose aujourd’hui d’un capital de 115 millions d’euros, investit chaque année plus de 10 millions d’euros d’épargne solidaire. Je n’ai pas de demandes particulières à formuler à ce sujet, si ce n’est qu’il faut résister à la tentation de ponctionner ce réservoir d’épargne salariale à d’autres fins que le financement solidaire. On évoque par exemple la possibilité de l’utiliser pour financer des PME classiques. Or il existe bien d’autres moyens pour ce faire, notamment dans le secteur bancaire.
Quatrièmement, j’insiste sur l’importance des DLA. En France – c’est une originalité de notre pays –, loin d’enfoncer les associations en difficulté ou de les juger, on vient à leur secours et on les aide à surmonter les difficultés transitoires. Nous aidons ainsi chaque année quelque 2 000 associations. Il s’agit d’une action discrète, qui ne fait pas la une des journaux, mais qui constitue un levier puissant : elle permet au monde associatif de souffler et de rebondir.
Cinquièmement, je tiens à mentionner l’expérience du dispositif d’appui aux structures de l’économie sociale et solidaire en consolidation (DASESS), mis en place en 2009 à l’initiative de la région Nord-Pas-de-Calais. Dans le cadre du DASESS, une sorte de kit est proposé aux associations : elles doivent d’abord réaliser un autodiagnostic, afin de prendre leur température et leur tension ; elles passent ensuite devant une cellule d’examen qui se réunit toutes les deux semaines – le dispositif n’a donc rien de « décoratif » ; elles reçoivent aussi pendant quelques jours la visite d’un consultant externe gratuit ; enfin, elles peuvent bénéficier d’avances remboursables à taux zéro sur six mois, pour surmonter leurs difficultés. Nous espérons que ce très beau dispositif essaimera à travers toute la France.
Sixièmement, les associations ont besoin de visibilité. Les régions ont un rôle essentiel à jouer en la matière : elles doivent mener une action contractuelle et pluriannuelle en faveur du développement associatif. Dans certaines régions – Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur –, les collectivités territoriales, les chambres de l’économie sociale et solidaire et les différents réseaux travaillent ensemble afin que l’économie sociale et solidaire soit non pas traitée à part, mais intégrée dans une stratégie de développement économique et de promotion de l’emploi à l’échelle régionale. France Active participe à ces travaux.
M. Yannick Blanc, président de La Fonda. J’exerce les fonctions de président de La Fonda à titre bénévole. Je suis, en outre, préfet du département de Vaucluse, et j’alimenterai donc mon témoignage par des éléments que j’ai pu tirer de l’observation rapprochée et quotidienne du terrain. Je partage l’essentiel des analyses qui viennent d’être faites à propos de l’équilibre économique des associations. La Fonda est un laboratoire d’idées du monde associatif, qui existe depuis une trentaine d’années. Depuis 2010, elle s’est engagée dans un travail de prospective participative destiné aux associations, qui vise deux objectifs : permettre non seulement aux pouvoirs publics, mais aussi à l’ensemble de la société de mieux apprécier la place du fait associatif ; aider les associations à se situer dans leur environnement économique et sociétal. Dans une société qui connaît des transformations nombreuses et rapides, à un moment où la question de la fragilité de leur modèle économique se pose de manière aiguë, les associations ont besoin de davantage d’intelligence stratégique pour anticiper et pour être convaincantes vis-à-vis de leurs partenaires.
S’agissant de l’impact de la baisse des financements publics et du texte publié à ce sujet par le Collectif des associations citoyennes, plusieurs intervenants ont constaté que la situation des associations n’avait pas connu de dégradation sensible au cours des exercices récents, que l’on se place du point de vue de la couverture du risque, du nombre des dépôts de bilan ou de l’évolution de l’emploi. Les enquêtes du réseau Recherche & Solidarités le confirment en effet. Cependant, je souhaite appeler votre attention sur un phénomène récent qui risque de s’accélérer en 2015 et qui touche principalement les associations moyennes.
Dans la typologie de Viviane Tchernonog, que vient d’évoquer Hugues Sibille, il convient selon moi de distinguer les petites associations, d’une part, et les moyennes, d’autre part. L’activité des petites associations repose essentiellement sur le bénévolat. Leur structure financière est très fragile, mais elles ont une résilience certaine : elles peuvent souvent survivre à la baisse des financements publics. Les associations moyennes, en revanche, y sont très vulnérables. Or nous vivons de ce point de vue une situation sans précédent : tous les financeurs publics s’inscrivent dans une trajectoire de diminution de leur budget et, simultanément, le mécénat d’entreprise réduit sa contribution au monde associatif à un rythme équivalent ou légèrement supérieur à la baisse des financements publics – en 2013, cette contribution a été amputée de 100 millions d’euros sur 1,8 milliard, soit une baisse d’environ 6 %.
Que se passe-t-il sur le terrain ? Les associations moyennes sont très nombreuses dans certains secteurs clés de l’action publique – champ social, éducation, justice, lutte contre l’exclusion, avec notamment les centres sociaux implantés dans les quartiers. Elles disposent souvent de ressources professionnelles et de compétences d’un excellent niveau dans leur cœur de métier, mais moins pointues en matière de gestion. Ainsi que l’ont relevé tous les autres intervenants, elles vivent depuis de nombreuses années sans fonds propres et avec une trésorerie très tendue, dans des situations parfois limites. Jusqu’à maintenant, lorsqu’une de ces associations voyait sa trésorerie tendre vers zéro en fin d’année et qu’elle risquait de ne pas boucler l’exercice, elle parvenait toujours à trouver, dans son département ou sa région, un financeur public qui, en fin de gestion, débloquait les quelques dizaines de milliers d’euros qui lui manquaient pour passer ce cap. Or cet élément d’élasticité est en train de disparaître : même avec la meilleure volonté du monde, les financeurs publics n’ont plus la capacité de réagir, surtout quand plusieurs associations tirent la sonnette d’alarme au même moment.
Les observatoires, les tableaux de bord et les instruments de suivi n’ont pas encore repéré ce phénomène émergent, mais je l’ai observé sur le terrain. Dans les mois qui viennent, nous risquons de voir des associations qui jouent un rôle clé auprès de l’État et des collectivités territoriales faire l’objet de procédures d’alerte et, rapidement, déposer leur bilan. La faiblesse en fonds propres et en trésorerie des associations, que tous les intervenants ont soulignée, est donc en train d’engendrer une fragilité de masse. Un phénomène de rupture peut se produire dans les mois qui viennent, certes pas à l’échelle de ce qu’a annoncé le Collectif des associations citoyennes sur la base de chiffres fantaisistes
– il avait ainsi prévu la disparition de 40 000 emplois associatifs en 2014, alors que l’emploi s’est globalement maintenu dans le secteur cette année, même s’il a cessé d’augmenter –, mais il convient néanmoins d’être très vigilant.
De plus, la fragilité structurelle des associations se trouve accentuée de la sorte par la conjoncture au moment même où le fait associatif devient une dimension indispensable de toute politique publique. Sans partenaire associatif, je ne peux mener à bien, en tant que préfet, aucune des politiques publiques que le Gouvernement me donne instruction de mettre en œuvre dans mon département. Tel est le cas depuis toujours dans le domaine social. Le fait associatif est essentiel, en particulier, dans la négociation des contrats de ville, qui concernent des quartiers où les enjeux en matière de maintien du lien social et de renouvellement du pacte républicain sont très sensibles. Il est également déterminant pour le succès des zones de sécurité prioritaires (ZSP). On le sait moins, car on imagine que l’action de l’État et des autorités judiciaires en matière de sécurité est plus traditionnelle : régalienne, hiérarchique et opérationnelle. Or, l’efficacité d’une ZSP dépend non seulement du déploiement d’effectifs supplémentaires sur le terrain et de la coordination accrue entre la police et la justice, mais aussi, de manière essentielle, de l’amélioration de la relation entre les forces de sécurité et la population du quartier considéré ; les acteurs associatifs jouent un rôle clé en la matière : ils sont à la fois des sources d’information, des capteurs, des relais, des médiateurs et des modérateurs.
De même, rien n’est possible sans les associations en matière de réforme des rythmes scolaires, dans aucune commune. Bien qu’il constitue un chaînon invisible dans le débat politique, le partenariat avec les associations – qui, avec leurs professionnels et leurs bénévoles, font preuve de leur capacité d’engagement et d’adaptation – est ce qui permet à cette politique publique de se mettre en œuvre, cahin-caha, sur le terrain. En somme, nous assistons à un effet de ciseaux entre, d’un côté, le développement du fait associatif comme mode d’organisation de l’action collective et, de l’autre, la fragilité croissante des associations due à l’orientation globale des finances publiques et à l’affaiblissement conjoncturel du mécénat – même si, d’une manière générale, le monde de l’entreprise est lui aussi de plus en plus conscient du poids des associations et de l’intérêt d’un partenariat avec elles.
Quels outils employer pour faire face à cette situation ? En réponse à une demande pressante et unanime du monde associatif, la loi relative à l’économie sociale et solidaire a donné un cadre législatif à la notion de subvention. Le droit en vigueur n’a pas été modifié : les critères qui permettent d’accorder une subvention à une association, notamment ceux qui dérivent de la jurisprudence européenne, ont simplement été inscrits dans la loi. Néanmoins, cela a conféré une légitimité symbolique à la notion de subvention. Le critère clé qui distingue la subvention de la commande publique est le suivant : le bénéficiaire de la subvention est celui qui prend l’initiative de l’action, il ne répond pas à une demande de la collectivité publique. Cette distinction est d’ailleurs parfois purement formelle.
S’agissant de la commande publique, les associations se plaignent souvent de la mise en concurrence et ont du mal à se mettre dans la situation d’un prestataire de services, voire ne souhaitent pas le faire parce que c’est contraire à leur projet associatif. Quant aux subventions, pour les obtenir, elles doivent être en mesure de présenter aux financeurs publics des projets de moyen ou long terme construits, viables et sérieux, ce qui suppose qu’elles renforcent leur capacité stratégique. Tel est le message que délivre La Fonda. Les dispositifs d’accompagnement ont permis à un certain nombre d’associations de monter en compétence en matière de management et de gestion. Désormais, elles ont besoin d’améliorer leur capacité de projection stratégique et d’anticipation, afin de construire des projets convaincants, qui aident les décideurs locaux à imaginer l’avenir de telle ou telle politique publique, bien que leurs budgets se réduisent. D’où les outils de prospective que propose La Fonda. Néanmoins, les associations n’acquerront pas ces compétences du jour au lendemain : elles ont besoin, à cette fin, non seulement de soutien, de compréhension et de dispositifs d’accompagnement renforcés, mais aussi d’outils comptables appropriés.
La question des outils comptables est certes technique, mais elle est essentielle de mon point de vue. Tous les intervenants ont insisté sur la légitimité des excédents et de leur mise en réserve. Malgré la permanence de cette analyse – La Fonda a publié une note à ce sujet il y a déjà cinq ans –, force est de constater que la doctrine des pouvoirs publics et le comportement des financeurs n’ont guère évolué en la matière. Il faut donc faire en sorte que la constitution d’excédents et le financement du fonctionnement des associations apparaissent légitimes aux yeux des financeurs, dans un contexte de raréfaction des ressources. Les collectivités publiques et les mécènes privés se posent les uns et les autres la même question lorsqu’ils financent un projet : quel en sera l’impact dans la société ou sur le territoire ? Les associations – même celles qui sont des partenaires permanents de l’action publique et sont donc financées en continu, par exemple les centres sociaux – doivent donc être en mesure, dans la discussion budgétaire, en particulier lors des réunions de comités d’engagement, de présenter un projet assorti d’un plan de financement et de résultats prévisionnels. Les décideurs ont besoin d’outils pertinents qui leur permettent de mesurer l’activité des associations et d’apprécier leur solidité. Mais ces outils doivent être développés sans complexifier davantage les dossiers de demande de subvention. À cet égard, je partage les remarques des autres intervenants : malgré l’élaboration d’un formulaire CERFA unique de demande de subvention il y a quelques années, la créativité des administrations – tant de l’État que des collectivités territoriales, sans parler de l’Union européenne – est proprement sidérante : elles fixent de nouveaux critères, demandent toujours plus de pièces, etc. Si nous voulons disposer d’un modèle unique de dossier de demande de subvention et, au-delà, de dialogue de gestion entre les associations et leurs financeurs, il convient d’améliorer les outils.
Il existe selon moi deux pistes pertinentes à cette fin, qui s’inscrivent l’une et l’autre dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan comptable du secteur des associations. Il s’agirait, premièrement, de clarifier voire de faire évoluer la nomenclature des fonds propres des associations. Malgré la création dans le plan comptable, il y a une quinzaine d’années, de notions telles que le « fonds associatif » ou le « financement de projet », les bilans et les comptes d’exploitation des associations restent trop souvent opaques : les reports à nouveau sont trop nombreux, les réserves ne sont pas désignées correctement. La lecture de ces documents permet rarement de se faire une idée claire sur le mode de financement d’une association ou sur sa solidité.
Deuxième piste : moderniser le compte d’emploi des ressources collectées, qui a été créé dans les années 1990 à l’instigation de la Cour des comptes pour les associations qui font appel à la générosité du public. Il s’agit d’un document comptable fondamental pour les organismes à but non lucratif, puisqu’il permet de savoir d’où vient l’argent et à quoi il sert
– le compte d’exploitation permettant, lui, de savoir comment se constitue l’éventuel excédent de l’association. De l’avis de la plupart des acteurs associatifs – que je partage –, le compte d’emploi des ressources a été sophistiqué à l’excès à la demande de la Cour des comptes : il est aujourd’hui plus utile au contrôleur qu’aux associations elles-mêmes. Si nous pouvions, en tenant compte de l’expérience de ces dernières années, nous mettre d’accord avec les contrôleurs sur un certain nombre de mesures de clarification et de simplification de ce document comptable, il deviendrait un outil très précieux pour les financeurs publics. Ceux-ci se posent en effet les mêmes questions que les donateurs privés : à quoi sert ma contribution ? Qui sont les autres contributeurs ? Comment ces différentes contributions ont-elles été affectées aux missions que s’est données l’association ?
À cet égard, le compte d’emploi des ressources permet, d’une part, d’évaluer plus directement l’impact d’un projet et, d’autre part, de connaître le ratio des frais de fonctionnement de l’association. Je plaide d’ailleurs auprès des associations – sans être toujours entendu – pour qu’elles fassent ressortir ce ratio. Dans le budget d’un projet de recherche, on distingue, d’une part, les frais de structure du laboratoire et, d’autre part, le financement de la recherche en tant que telle. Il n’y a pas de raison qu’une association ne puisse pas, de la même manière – sans pour autant développer une comptabilité analytique sophistiquée –, intégrer à sa demande de financement la part de frais de fonctionnement dont elle a légitimement besoin.
Ces propositions, techniques en apparence, sont essentielles pour faire progresser le dialogue entre les responsables associatifs et les financeurs concernant la solidité des projets. C’est la seule solution pour surmonter la fragilité que nous constatons actuellement en matière de financement des associations, les contraintes auxquelles sont soumises les différentes catégories de financeurs n’étant pas près de disparaître.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci, madame, messieurs, pour la clarté de vos propos et la passion que vous mettez à défendre ce secteur si particulier, qui contribue tant à la qualité du « vivre ensemble ». Vous avez souligné à juste titre, monsieur Blanc, la place prépondérante que le secteur associatif continuera à occuper dans notre pays, dans cette période un peu troublée, où se posent des questions tant sur le financement des associations, que sur le sens à donner à l’action publique et sur la manière de la relayer sur le terrain, afin de ne laisser aucun de nos concitoyens sur le bord du chemin.
Au-delà de son contenu, la notion même de modèle économique paraît heurter l’idéal associatif. Est-ce une notion totalement neuve dans le monde associatif ? S’est-elle imposée comme une fatalité ou bien comme une occasion à saisir ? Agit-elle comme un révélateur d’éventuelles fractures générationnelles au sein des représentants du monde associatif ? Les conseils d’administration sont souvent composés de personnes plus âgées. Cela détermine-t-il l’approche que les associations peuvent avoir de la notion de modèle économique ?
En outre, comment percevez-vous la mutation en cours ? Ne va-t-elle pas favoriser une dualisation du monde associatif entre, d’une part, les associations qui seront capables d’accomplir un effort de réflexion stratégique et sauront s’adapter et, d’autre part, celles qui ne le pourront pas ? Quel sera le facteur discriminant : la taille ? le domaine d’intervention ? Quel sens les associations pourront-elles donner à leur action, compte tenu de la réalité économique qui s’impose à tous ?
M. Frédéric Reiss. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé cette très intéressante table ronde. Nous partageons l’inquiétude qui a été exprimée quant à la diminution du mécénat et de l’argent public disponible pour les associations. Il faudra donc trouver des modes de financement alternatifs. Les différentes interventions ont toutefois révélé la difficulté de l’exercice. Les banques, en particulier, ont des attentes croissantes en matière de couverture des risques.
Vous avez évoqué, monsieur Sautter, le mécanisme de la garantie, qui permet de lever 8 euros en investissant 1 euro. Dans ma circonscription, Initiative Alsace du Nord, qui fait partie du réseau Initiative France, accorde des prêts d’honneur aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise. Les proportions sont équivalentes à celles que vous avez citées : 1 euro de prêt permet de lever 7,5 euros auprès des banques. Cet effet de levier est très intéressant, mais fonctionne dans un cadre bien précis. Compte tenu de la forte synergie qui existe entre vie économique et vie associative, peut-on imaginer une extension, voire une généralisation de ce mécanisme pour le financement du monde associatif ? Quelles sont les éventuelles limites de l’exercice ? Le problème pour les associations telles qu’Initiative Alsace du Nord est moins d’accorder des prêts et de faire jouer l’effet de levier que de trouver des crédits pour financer leur propre fonctionnement, au-delà des aides du conseil régional.
M. Régis Juanico. Plusieurs d’entre vous ont insisté sur la nécessité de permettre aux associations et aux organismes à but non lucratif de réaliser des marges raisonnables. Je vous renvoie à cet égard aux services de Bercy. À l’initiative du mouvement associatif, nous avions présenté un amendement en ce sens à l’article portant sur la subvention publique lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Or nous avons essuyé un véritable tir de barrage : on nous a opposé une série d’arguments juridiques, provenant probablement de la direction de la législation fiscale, qui ne laissaient guère la porte ouverte à une inscription de la notion de marge raisonnable dans la loi. Nous pourrons interroger plus précisément la direction de la législation fiscale lorsque nous l’auditionnerons la semaine prochaine. En outre, plusieurs collègues et moi-même sommes disposés à rencontrer avec vous les services de Bercy sur cette question, en particulier le cabinet de la secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur Sibille, nous avons inscrit le DLA dans la loi – alors qu’il n’y avait pas nécessairement sa place – dans l’objectif de préserver les financements qui lui sont consacrés. Pouvez-vous nous confirmer que tel est bien le cas dans le budget pour 2015 ? Nous devons être très vigilants sur ce point.
En matière de financements, la loi relative à l’économie sociale et solidaire a prévu de nombreux dispositifs : avances, fonds propres, garanties, prêts participatifs, fonds d’épargne salariale solidaires et agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». En outre, les financements peuvent aussi provenir du fonds dédié de la BPI – vous estimez à juste titre qu’il convient de faire pression pour savoir comment il est fléché –, du Fonds d’innovation sociale – qui comprend un volet national et un volet régional et dont le montant a été doublé pour atteindre 40 millions d’euros – et du Programme d’investissements d’avenir. Au total, les montants dédiés aux acteurs de l’économie sociale et solidaire – et, donc, aux associations, qui représentent 80 % de l’emploi dans ce secteur – sont importants. Comment mettre en cohérence tous ces dispositifs ? Comment les articuler pour leur donner du sens sur le terrain ? Sans aller jusqu’à un véritable « guichet unique », comment s’en approcher ?
M. Jean-René Marsac. En Bretagne – j’étais chargé du développement économique au conseil régional –, nous avons beaucoup progressé dans nos modes d’intervention publique en transformant une partie de nos subventions directes en garanties, tant à l’intention des entreprises classiques que du secteur de l’économie sociale et solidaire. Il conviendrait de voir, de la même manière, quelles subventions directes de l’État pourraient être remplacées par des garanties ou d’autres modes d’intervention qui peuvent impliquer un remboursement. En outre, il faudrait envisager des garanties qui assurent des financements privés – bancaires ou autres – non seulement à court terme, mais aussi à moyen ou long terme, au service d’objectifs partagés tels que la résolution de problèmes à caractère économique et social ou la contribution au développement sociétal, lesquels peuvent donner lieu par ailleurs à des interventions directes de l’État. Comment ce travail exploratoire peut-il être conduit ? Quelle ingénierie imaginer pour que l’État et le secteur associatif puissent concevoir ensemble des dispositifs nouveaux, notamment des garanties ?
Le secteur associatif contribue à l’élaboration et au suivi des politiques publiques. Les associations participent notamment à de très nombreux comités consultatifs, où elles envoient leurs bénévoles ou leurs salariés. Cependant, ce travail n’est pas rémunéré. Nous pourrions identifier plus clairement cette fonction de contribution aux politiques publiques
– distincte de la fonction de projet, de mobilisation citoyenne et de développement de la démocratie locale et participative – et mieux la reconnaître, y compris dans le cadre de l’attribution des subventions.
M. Jean-Louis Bricout. Je vous remercie, les uns et les autres, de vos interventions. Vous avez évoqué le rôle essentiel des associations dans la mise en place des politiques publiques. Comment peut-on traduire les liens entre le milieu associatif et la puissance publique sur le terrain ? Ce n’est pas simple : dès lors que la puissance publique conventionne, elle risque de s’ingérer dans le travail des associations, même si celles-ci doivent, d’un autre côté, faire preuve de transparence. Jusqu’où doit-on aller ? Doit-on en rester à de simples conventions de financement et à des appels à projets ? Ou bien peut-on aller plus loin en créant des sortes d’organismes de gestion intermédiaires, afin de traiter tous les problèmes que vous avez cités au cours de cette table ronde – suivi de la trésorerie, gestion des contrats de travail, mutualisation des moyens, simplification des dossiers ? Quelle est la limite à ne pas dépasser pour ne pas s’ingérer dans le travail des associations, ni leur imposer des contraintes administratives excessives ? Il convient en effet de leur laisser la plus grande liberté pour imaginer et exercer leurs missions.
M. le président Alain Bocquet. La mutualisation – au sein d’une même zone géographique ou dans un domaine d’intervention – pourrait être une solution pour améliorer la performance financière des associations et renforcer la qualité de leur direction. Dans ma ville et ma communauté d’agglomération, il existe des centaines d’associations, qui agissent souvent chacune dans leur coin et sans beaucoup de méthode. On constate beaucoup de perte en ligne, faute de mutualisation, notamment des commandes et des moyens de fonctionnement. Les financements pourraient être utilisés comme un levier pour favoriser la mutualisation. Certes, il n’est pas simple de remettre en cause les mentalités et les habitudes, mais nous devrions nous intéresser à ce champ en grande partie inexploré.
M. Hugues Sibille. Je suis favorable à la diversification des modes de financement, mais l’argent public représente, rappelons-le, 50 % des 85 milliards d’euros du budget associatif. Une diminution de 1 % des financements publics, c’est donc 450 millions d’euros en moins. À titre de comparaison, le budget annuel de la fondation du Crédit coopératif s’élève à 1,5 million d’euros. Il faudrait donc 300 fondations du Crédit coopératif pour compenser une baisse de 1 % des financements publics !
Nous nous orientons en effet, madame la rapporteure, vers une plus grande différenciation entre, d’une part, des associations citoyennes, militantes et bénévoles et, d’autre part, ce que j’appelle des « entreprises associatives ». Le monde associatif a peur de cette évolution, ne serait-ce que du mot « entreprise ». À titre personnel, j’estime qu’il faut l’assumer. Le mouvement est enclenché avec le développement de l’économie sociale et solidaire. Une partie du monde associatif qui ne se percevait pas comme faisant partie de ce secteur doit désormais le faire. Cessons de tergiverser : les entreprises associatives existent, ce sont des prestataires de services qui gèrent de l’argent et de la qualité. Pour autant, elles n’agissent pas comme des entreprises à but lucratif.
Merci, monsieur Juanico : votre raisonnement à propos du DLA a été tout à fait juste. Plusieurs d’entre nous s’étaient en effet mobilisés en faveur d’une inscription du DLA dans la loi afin d’en sécuriser le financement. À ce stade, celui-ci est maintenu. Mais nous devrons être vigilants chaque année, d’autant que les décideurs – notamment Bercy – ne semblent pas tous comprendre l’intérêt du dispositif en termes de retour sur investissement : le DLA n’est pas qu’une dépense, il permet de maintenir des activités.
S’agissant du fonds dédié de la BPI, l’État a déclaré que 500 millions de financements étaient disponibles, mais la BPI affirme qu’elle ne dispose pas de cette somme. Je suggère que l’Assemblée nationale demande à la BPI où se trouve cet argent !
Je suis d’accord avec vous, monsieur le président : la mutualisation est une voie à explorer. Mais le monde associatif ne s’oriente ni spontanément ni facilement vers la mutualisation ou les fusions – qui sont deux opérations distinctes. La loi relative à l’économie sociale et solidaire va faciliter les fusions d’associations, avec une approche similaire à celle qui a été retenue pour les fusions d’entreprises. Peut-être conviendrait-il que la puissance publique soit plus incitative, en conditionnant les subventions à une mutualisation ou à des groupements sur certains aspects.
Enfin, je regrette que la Charte d’engagements réciproques entre l’État, les collectivités territoriales et les associations, dont j’avais préparé la précédente version en tant que délégué interministériel à l’innovation sociale et à l’économie sociale, ne soit pas davantage utilisée pour faire évoluer le dialogue de gestion – Yannick Blanc emploie ce terme à juste titre. D’autant que les financeurs publics et les associations partagent des objectifs communs : l’intérêt général et l’utilité sociale. Dans d’autres pays, les relations entre acteurs s’appuient davantage sur des documents de cette nature.
M. Christian Sautter. La période actuelle n’est pas un mauvais moment à passer, madame la rapporteure. Il faut en effet réussir la mutation en cours, mais je suis optimiste : nous avons affaire à de très nombreuses associations dynamiques qui, loin d’être freinées par des pesanteurs – y compris par le facteur démographique que vous avez cité –, cherchent à s’en sortir. La loi relative à l’économie sociale et solidaire va d’ailleurs en accroître le nombre. Vous avez évoqué un risque de dualisation. Soyons clairs : les associations qui ne pourront pas s’adapter disparaîtront en effet, car elles ne pourront pas continuer à vivoter. Sauf – et c’est tant mieux – celles qui s’appuient sur des bénévoles et qui fonctionnent hors du champ économique, mais elles correspondent davantage au modèle anglo-saxon qu’au nôtre.
Il existe en effet, monsieur Reiss, d’autres réseaux que France Active dans le domaine de la création d’entreprise : Initiative France, l’Association pour le droit à l’initiative économique, les boutiques de gestion. Ce domaine a d’ailleurs connu, lui aussi, des évolutions. Lorsque j’ai commencé à présider France Active, les différents réseaux se regardaient en chiens de faïence et se disputaient la clientèle. Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Nous avons constaté qu’environ un tiers des créateurs d’entreprise, d’une part, et un peu moins d’un tiers des associations, d’autre part, étaient accompagnés. Nous nous coordonnons désormais au niveau régional, notamment en Alsace, pour aller au-devant des deux tiers d’associations qui sont pour l’instant livrées à elles-mêmes et qui risquent de disparaître.
Je suis tout à fait prêt à partir à l’assaut de Bercy avec vous, monsieur Juanico ! Nous devons mener une bataille à la fois idéologique et concrète : les associations ont besoin de constituer des réserves non pas pour vivre, mais pour survivre.
Plutôt que de créer un guichet unique, il convient de favoriser la coordination régionale. Les conseils régionaux et les préfets incitent tous les acteurs à travailler ensemble. Nécessité fait coordination. Nous allons dans la bonne direction de ce point de vue.
Vous suggérez, monsieur Marsac, de passer de la subvention à la garantie. D’une manière générale, nous avons beaucoup évoqué les outils au cours de la table ronde. Or l’approche de France Active a changé : auparavant nous développions des outils ; désormais, nous partons des besoins de l’association bénéficiaire et nous cherchons à lui donner les conseils gratuits les plus adaptés et à lui proposer le meilleur « paquet » financier pour l’aider non seulement à survivre, mais à prospérer. À cet égard, il faudrait demander plus souvent aux associations des bilans non seulement financiers – le financement n’est qu’un moyen pour exercer des missions –, mais qualitatifs, avec des indicateurs de performance sociale et environnementale, qui permettent, par exemple, de mesurer leur contribution à l’emploi ou à la cohésion sociale dans tel ou tel quartier.
La mutualisation est culturellement difficile à mettre en œuvre, monsieur le président : nos concitoyens – tout comme nous, probablement – y sont réticents. Nous avons des expériences, y compris à France Active, en matière de mutualisation des achats, ce qui permet de réduire les coûts. En tout cas, la mutualisation est infiniment préférable à la fusion, que des cabinets d’étude pourraient recommander un peu rapidement : la fusion n’est pas nécessairement synonyme d’une efficacité accrue.
Mme Sophie des Mazery. L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », dont l’objectif unique est de permettre à son titulaire de bénéficier de l’épargne salariale solidaire, a été profondément rénové et complexifié à outrance par la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Nous craignons donc de voir le vivier des entreprises solidaires diminuer. D’un côté, un nombre croissant d’épargnants souhaitent donner du sens à leur épargne, d’autant plus avec la crise actuelle. De l’autre, nous incitons les entreprises, notamment associatives, à solliciter cet agrément. Cependant, cela risque d’être pour elles un parcours du combattant. Nous verrons quelle sera la pratique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en la matière. Nous espérons que les décrets simplifieront, autant que possible, le dispositif, sans pour autant sacrifier l’exigence.
Nous attendons nous aussi que les outils de la BPI soient disponibles, en particulier le « fonds de fonds à impact social » qui a été évoqué il y a un an pour financer l’économie sociale et solidaire. Pour l’instant, aucun des fonds solidaires ou des sociétés de capital-risque nationales ou régionales qui ont fait la preuve de leur efficacité au service de l’emploi et de la cohésion sociale – la société d’investissement de France Active, Garrigue, Initiatives pour une économie solidaire (IES) en Midi-Pyrénées – ne peut bénéficier de ce fonds de fonds. Pourquoi la BPI n’investit-elle pas dans ces structures ? Il est désormais plutôt question de fonds destinés à financer des PME qui adoptent une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Certes, la frontière est très difficile à tracer entre l’impact investing – investissement qui associe la rentabilité financière avec un impact social ou environnemental positif – et la finance solidaire. Mais nous avons besoin des outils de la BPI.
M. Yannick Blanc. La Fonda tient le discours suivant : la mutualisation n’a de sens que si la mutualisation des moyens – M. Sautter a notamment évoqué la mutualisation des achats – s’accompagne d’une mutualisation des projets. Sur un territoire donné, les associations peuvent, tout en gardant leur personnalité et leurs spécificités – éléments essentiels de l’affectio societatis –, construire ensemble des stratégies et traiter ainsi d’égal à égal avec les pouvoirs publics.
Prenons l’exemple de la politique de santé publique. Les parlementaires sont confrontés au problème de la maîtrise des coûts, en particulier de la prise en charge des maladies chroniques, qui pèse très lourd sur le budget de l’assurance maladie. Pour être efficace, nous le savons, la politique de santé publique doit faire une place beaucoup plus importante qu’aujourd’hui à la prévention. Or, pour progresser en la matière, il faut que les bénéficiaires et les associations de malades soient eux-mêmes des acteurs de la prévention.
Dans mon département, j’ai incité toutes les associations actives dans le domaine de la prévention et de l’éducation pour la santé – associations de femmes victimes du cancer, associations de lutte contre l’alcoolisme ou contre l’obésité – à se regrouper dans un même lieu, pour former une sorte de cluster. En mutualisant ainsi des locaux et des moyens, elles dépensent leur argent de manière plus efficiente. Mais l’enjeu est surtout que les acteurs de la politique de prévention deviennent eux-mêmes les auteurs du message de prévention et d’éducation pour la santé. Si ce message provient d’une institution parisienne mal connue
– tel est le cas pour les campagnes de publicité –, il reste abstrait. Si, en revanche, il est porté par les malades eux-mêmes sur le terrain, directement auprès des personnes concernées, il gagne considérablement en efficacité. Cet exemple montre, par excellence, que 1 euro d’argent public donné à une association a un effet de levier infiniment plus important que 1 euro dépensé dans le cadre d’un budget plus classique.
M. Gérard Leseul. Au vu de l’ensemble des interventions, il serait sans doute plus juste de parler de modèle « socio-économique » plutôt que de modèle simplement « économique » du secteur associatif.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, madame, messieurs, pour vos contributions très riches et très intéressantes à nos travaux.
Audition de Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique).
(séance du 7 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Merci, madame la directrice générale de la cohésion sociale, d’avoir répondu à notre invitation.
« Cohésion sociale » : un bien beau programme que celui de votre direction générale, madame Fourcade. Notre pays en a un si grand besoin, comme nous avons pu le constater hier encore lors du déplacement que notre commission a effectué à Nîmes à l’invitation de notre rapporteure, Mme Françoise Dumas.
La DGCS n’a pas la compétence première en matière de vie associative, mais elle a une position centrale pour ce qui concerne l’économie sociale et solidaire. Vous êtes par ailleurs, ès qualités, déléguée interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale.
Le moment est particulier : la loi relative à l’économie sociale et solidaire a été votée par le Parlement, mais nous en attendons les décrets d’application. La préparation de cette loi a suscité un grand élan chez les représentants du monde associatif, mais sa mise en œuvre suscite certaines inquiétudes. Où en est le monde associatif aujourd’hui ? Est-il en train de vivre une crise mortelle ou une mutation salutaire ? Fait-il l’apprentissage d’une certaine normalisation économique, après avoir vécu pendant des décennies une relation privilégiée avec la puissance publique ? Comment innover et expérimenter quand les ressources se contractent de toutes parts ?
Avant de vous entendre, je me dois de vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1956, de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Sabine Fourcade prête serment)
Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, j’axerai mon propos sur ma double compétence, à la fois comme déléguée interministérielle, chargée de l’économie sociale et solidaire, et comme directrice générale de la cohésion sociale, chargée à ce titre de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes vulnérables – personnes en situation d’exclusion, personnes âgées ou handicapées – qui sont très largement prises en charge par des associations.
J’organiserai mon propos en trois parties : après vous avoir rapidement présenté le secteur associatif, j’en rappellerai les difficultés et je vous parlerai des réformes en cours
– parmi lesquelles celle de la loi sur l’économie sociale et solidaire – qui nous semblent de nature à favoriser le développement du modèle associatif.
Le modèle associatif est le type d’organisation le plus représentatif dans le secteur social et médicosocial, chargé de l’accompagnement et de la prise en charge des publics vulnérables. Les associations de ce secteur ne représentent que 10 % des 1 300 000 associations de notre pays, mais 45 % de leur budget total. En effet, ce sont des associations de grande taille – de plus en plus souvent des entreprises associatives – qui emploient des personnels, qui ont de gros financements et bénéficient d’importants fonds publics. De fait, 45 % de leurs ressources sont des financements publics.
Le monde associatif est représenté différemment, suivant les publics concernés, au sein du secteur social et médicosocial. Ce sont presque exclusivement des associations qui prennent en charge les personnes handicapées et les personnes en situation d’exclusion. En revanche, elles ne sont plus que 78 % pour les prises en charge d’aide sociale à l’enfance
– une partie de l’ASE est publique – et 40 % pour les prises en charge des personnes âgées. La prise en charge de ces personnes âgées se répartit de la façon suivante : une petite moitié dans des structures publiques (anciens hôpitaux locaux ou structures relevant des CCAS), un quart dans les associations et un quart dans le secteur privé lucratif.
On peut tenir compte également de la modalité de la prise en charge, en établissement ou en service. La politique du Gouvernement consiste à développer la part des services. Il s’agit de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile – c’était d’ailleurs l’un des axes du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement – et de favoriser au maximum l’intégration des personnes handicapées dans la vie sociale. Ainsi, 74 % du total des prises en charge avec hébergement et 86 % des prises en charge sans hébergement sont assurées par des associations.
Quasiment partout, les services sont rendus en majorité par des associations sur l’ensemble du champ. Le fait est ancien. La prise en charge des personnes vulnérables a été d’abord le fait d’associations, d’initiatives personnelles, caritatives ou individuelles. C’est d’ailleurs l’origine de l’action sociale. Les associations ont donc toute légitimité pour prendre en charge les publics fragiles. Certes, elles reçoivent pour cela des financements publics. Mais leur engagement – y compris celui des bénévoles – est très important et participe à la qualité de cette prise en charge.
Aujourd’hui, les associations développent de plus en plus souvent des modèles de gestion d’entreprise. On parle beaucoup d’entrepreneuriat social ou d’entreprises associatives. Le fait d’être une association n’empêche pas de développer des modèles de gestion tout à fait rigoureux et qui n’ont rien à envier au domaine privé lucratif. C’est le cas des grandes associations du domaine social et médicosocial.
Une particularité mérite d’être relevée : lorsqu’elles prennent en charge des personnes vulnérables, ces associations ont à la fois un rôle de gestion et un rôle tribunicien, puisqu’elles représentent à la fois des personnes vulnérables et ceux qui les prennent en charge. De ce fait, les pouvoirs publics n’ont pas avec elles une relation de donneur d’ordres à opérateur, mais une relation partenariale avec des acteurs qui ont une parole propre en tant que représentant les intérêts des personnes. C’est une relation parfois plus complexe, mais tout à fait intéressante et enrichissante.
Une autre particularité du secteur associatif dans le monde social et médicosocial concerne les conventions collectives : d’une part, il n’y a pas de convention collective étendue dans le domaine social et médicosocial, au point que l’on peut parler d’un « émiettement » important ; d’autre part, les relations entre les partenaires sociaux doivent donner lieu à agrément pour que les conventions collectives puissent s’appliquer.
D’une part, on peut parler d’un « émiettement » des conventions collectives.
Deux branches coexistent : la branche « sanitaire, social et médicosocial » et la branche de l’aide à domicile. La branche « sanitaire, social et médicosocial » qui regroupe l’ensemble des établissements est une branche privée non lucrative, qui est placée sous l’égide de l’UNIFED (l’Union nationale des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médicosocial). Elle est elle-même partagée entre plusieurs conventions collectives, dont les deux plus importantes sont celles de 1966 et de 1951. En revanche, la branche de l’aide à domicile est arrivée à se regrouper dans une seule convention collective étendue.
Ainsi, dès qu’on sort du secteur de l’aide à domicile, il n’y a plus que des conventions collectives différentes d’un établissement à l’autre, ce qui rend le dialogue plus complexe, et surtout donne au secteur un poids moins important que s’il n’y avait qu’une seule convention collective étendue.
D’autre part, si les partenaires sociaux sont libres de leurs négociations et de leurs accords, leurs accords ne peuvent s’appliquer que s’ils sont agréés par l’État. Cette compétence d’agrément est instruite dans ma direction, et les agréments sont signés par la ministre des affaires sociales.
Ce système d’agrément s’explique par le fait que la masse salariale des associations qui gèrent des établissements et services médicosociaux représente entre 70 et 80 % de leur budget. Il y a donc un lien très fort entre le financement qui doit être mis en place pour couvrir les charges de ces établissements, et les évolutions salariales. Ce système permet d’éviter que les négociations aboutissent à des accords qui ne soient pas financés par la puissance publique ou, à l’inverse, que la puissance publique soit contrainte de suivre des accords qui auraient été pris entre partenaires sociaux d’une façon qui serait insoutenable pour les finances publiques.
Ce système est aujourd’hui obligatoire, dans la mesure où les modalités de financement des associations se font sur la base des charges. Si l’on changeait de système de financement et que l’on passait à un système fondé sur des référentiels, l’utilité de l’agrément pourrait se poser. Mais pour le moment, on est obligé de vérifier que les charges évoluent d’une manière soutenable pour les finances publiques.
J’en viens à la deuxième partie de mon propos : les difficultés des associations, qui sont aujourd’hui bien connues.
Ce sont essentiellement des difficultés de financement liées évidemment au manque de fonds propres des associations, et donc au système associatif lui-même, mais aussi au fait que les associations du monde social et médicosocial sont financées par des financements publics qui, aujourd’hui, ont tendance à se tendre.
Ce mécanisme de tension des financements dépend du type de financement. Ma direction est ainsi en relation avec deux grands types d’associations :
D’une part, les associations qui gèrent des établissements ou services sociaux ou médicosociaux, qui sont donc dans un système d’autorisation de l’exercice pour répondre à un certain nombre de prestations. Pour ces prestations, ils ont droit à une tarification qui est prévue par les textes – notamment par le code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, les financements des établissements, qui sont en majorité des associations, sont tarifés pour tenir compte de leurs charges.
D’autre part, les associations « tête de réseau » qui représentent des usagers ou d’autres grands secteurs de l’action sociale, et qui sont subventionnées. Leurs moyens ont tendance à se tendre. En effet, si l’ensemble des crédits sociaux a continué à augmenter dans les dernières années malgré les difficultés budgétaires, c’était essentiellement pour répondre à des dépenses obligatoires – prestations ou dépenses d’établissements et de services. Les subventions « libres » servies aux associations ont tendance, sinon à diminuer, du moins à être plus difficiles d’accès.
Reste un secteur dans lequel les associations qui prennent en charge les personnes ne relèvent pas toutes du code de l’action sociale et des familles : celui de la lutte contre l’exclusion, et plus précisément l’hébergement des personnes sans abri. À côté des établissements qui relèvent du code de l’action sociale et des familles – essentiellement les CHRS (centres d’hébergement et de réadaptation sociale) – existent en effet des établissements et des services qui sont financés par un système de subventions, avec toutes les difficultés que cela peut entraîner : des subventions qui arrivent tard dans l’année, ce qui peut se traduire par des difficultés de trésorerie, et une inconnue quant à la pérennité de ces subventions.
Dans le cadre de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) le Gouvernement a pris l’engagement de déposer à la fin de l’année 2014 un rapport permettant d’étudier selon quelles modalités un statut unique pourrait être mis en place pour l’ensemble des établissements et services accueillant des personnes sans abri ou mal logées ; ce rapport est en cours d’étude, en lien avec l’ensemble du secteur et des associations concernées.
Toujours à propos des difficultés rencontrées par le secteur associatif, je voudrais m’arrêter un instant sur les difficultés propres au secteur à domicile. Ce secteur est soutenu par l’État et l’ensemble des financements publics. Depuis 2012, un Fonds de restructuration a mobilisé 130 millions d’euros et permis de le soutenir. Mais il est vrai qu’il est actuellement en difficulté après avoir longtemps été un secteur créateur d’emplois. Un comité de refondation de l’aide à domicile, coprésidé par l’État et par l’Assemblée des départements de France est en train de travailler sur les prestations rendues par les services d’aide à domicile qui prennent en charge les personnes vulnérables, et sur l’ensemble des modèles de tarification.
Cela m’amène à ma troisième partie sur les réformes en cours – ou à venir – pour développer l’ensemble du secteur associatif.
Je commencerai par évoquer la réforme de l’appel à projets qui peut être ressentie par les associations comme une difficulté. Ce n’est pas une provocation de ma part : je crois profondément que c’est une réforme intéressante.
Lorsque je parle d’appel à projets, je ne parle pas de l’ensemble des appels à projets qui peuvent, dans un certain nombre de situations, remplacer les subventions. Vous avez vu qu’à l’article 59 de la loi sur l’économie sociale et solidaire figure une définition de la subvention aux associations qui n’existait pas jusqu’à maintenant et qui permet de valoriser et de donner une existence juridique à la subvention – laquelle peut être destinée « à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire ».
L’appel à projets, tel que nous l’avons mis en place, concerne les établissements ou services sociaux ou médicosociaux qui sont autorisés, et pour lesquels les créations de places nouvelles étaient, jusqu’en 2010, développées uniquement à partir d’initiatives des porteurs de projets, donc des associations. Ces projets étaient examinés devant des instances locales qui s’appelaient les CROSM (comités régionaux de l’organisation sociale et médicosociale). Cela aboutissait à une opacité assez grande, puisqu’ils avaient tendance à trouver que les projets étaient de bonne qualité et à les approuver, même s’il n’y avait pas de financements en face. De ce fait, de nombreux projets de développement d’associations sociales ou médicosociales, malgré un avis positif du CROSM, avortaient.
La procédure d’appel à projets a renversé la logique. On part en effet du principe que, dans le cadre du développement de la prise en charge en établissement ou en service, l’important est la réponse aux besoins des personnes, et donc le schéma de développement fait par l’ARS ou par le département suivant le type de prise en charge – par le département pour les projets de vie des personnes handicapées, et par l’ARS et le département pour les personnes âgées. Les projets de schéma de développement reposent sur l’analyse du besoin sur le territoire et donnent lieu à des appels à projets qui doivent évoquer les besoins à satisfaire. Et c’est sur la base des besoins à satisfaire que les associations – ou tout autre organisme – proposent une réponse, en développant un projet qui doit être le meilleur et le plus innovant possible.
Nous avons beaucoup travaillé – et je crois que le combat n’est pas terminé – pour éviter que ces appels à projets ne conduisent à une standardisation et à une normalisation des réponses des associations. L’objectif est bien de mettre en avant l’initiative individuelle. Par ailleurs, nous souhaitons laisser la porte ouverte à des réponses innovantes et expérimentales. Enfin, nous avons prévu que les calendriers d’appels à projets soient connus à l’avance – au minimum sur l’année et si possible de façon pluriannuelle – afin que l’ensemble des porteurs de projets ait le temps de se préparer.
En outre, après trois ans de mise en place des appels à projets, un bilan a montré qu’un certain nombre d’ajustements étaient nécessaires. Je citerai la révision des seuils d’extension de capacité des établissements, la simplification de la procédure, et surtout la possibilité de passer un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) avec l’organisme en cas de transformation d’activité.
Dans cette dernière éventualité, l’organisme ne serait pas remis en concurrence. En effet, si l’appel à projets semble adapté lorsqu’il s’agit une offre nouvelle puisqu’il permet de demander à tous types d’organismes les réponses qu’ils peuvent proposer à tel ou tel besoin, lorsqu’il s’agit d’une transformation d’activité, il n’y a aucun intérêt à s’adresser à d’autres organismes. C’est au porteur de projets avec lequel on travaille qu’il est demandé de transformer son activité pour mieux s’adapter aux besoins.
Un deuxième type de réforme devrait contribuer à moderniser et à améliorer les possibilités ouvertes aux associations. Je vise là l’ensemble des travaux que nous avons engagés sur la tarification. En effet, nos mécanismes de tarification sont pour beaucoup « historiques ». Comme les services de l’État, ou des départements, ou des ARS ne peuvent pas remettre à plat tous les ans l’ensemble des besoins des établissements, la couverture des charges se fait souvent par alignement sur un taux de reconduction qui est le même pour tout le monde.
Nous essayons donc d’encourager la conclusion de CPOM, qui permettent de définir pour trois ans les objectifs et les moyens, de manière à donner de la visibilité au gestionnaire et de pouvoir avoir un engagement réciproque sur des objectifs. Par ailleurs, nous développons sur les différents secteurs – personnes âgées, personnes handicapées, hébergement des personnes sans abri et aide à domicile – des référentiels d’activités et des référentiels de coûts pour « objectiver » la tarification et la rendre plus équitable. Ainsi, un organisme qui rend les mêmes prestations pour le même type de public peut compter sur le même niveau de dotation, quel que soit l’endroit du territoire où il se trouve.
Ensuite, la loi relative à l’économie sociale et solidaire a permis des avancées importantes. Je citerai, au-delà de la définition de la subvention, la diversification et la sécurisation des financements associatifs, avec des titres associatifs qui mériteraient d’être plus actifs, avec la pérennisation des DLA (dispositifs locaux d’accompagnement aux associations) et avec la possibilité de développer les fonds territoriaux mutualisés, qui permet aux associations de mener conjointement des projets.
Au début du mois de septembre, j’ai rencontré Mme Corinne Delga, secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie sociale et solidaire. Celle-ci veillera à ce que, sur l’ensemble de ces sujets, les décrets soient pris rapidement et ne dépendent pas tous de la DGCS. En ma qualité de déléguée interministérielle, j’ai participé à l’établissement d’un tableau récapitulant l’ensemble des décrets à prendre et précisant quelle administration est responsable de l’instruction de quel décret. Une réunion interministérielle permettra de s’assurer que chaque administration y travaille.
J’ajouterai que la loi favorise l’engagement associatif bénévole, à travers la validation des acquis de l’expérience bénévole. De cette façon, une activité bénévole pourra être reconnue dans un parcours professionnel. Cela me semble important.
Enfin, nous travaillons sur l’ouverture de prêts et de financements par BPI France et sur la prolongation, pour une année supplémentaire, du PIA (programme d’investissements d’avenir) avec le lancement d’un nouvel appel à projets.
Tels sont, rapidement exposés, les différents sujets sur lesquels nous travaillons pour essayer de développer, renforcer et pérenniser ce modèle associatif qui est extrêmement important pour le monde social et médicosocial et, au-delà, pour l’ensemble de notre économie.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Madame la directrice générale, je vous remercie pour votre propos très clair, qui répond à nombre de nos questions.
Vous avez essentiellement évoqué les grandes associations de l’aide sociale. Mais il en existe d’autres. Pensez-vous qu’il soit encore possible d’améliorer le statut des associations qui interviennent à la marge des grandes responsabilités en matière d’aide sociale ?
Je voudrais ensuite vous interroger sur l’absence de contrôle a priori des associations qui œuvrent dans le champ de l’enfance. Celles auxquelles je pense n’ont rien à voir avec les associations dont vous venez de parler et ne sont pas soumises à agrément. Elles exercent donc librement des activités diverses, essentiellement du soutien scolaire. Elles mettent pourtant en relation des enfants et des adultes, qui pourraient ne pas avoir de compétences suffisantes, voire être motivés par des raisons autres que celles pour lesquelles on a eu recours à eux. Ailleurs, dans tout le champ médico-social, toutes les personnes qui interviennent auprès des enfants font normalement l’objet d’un certain nombre de contrôles.
Mme Marie-Hélène Fabre. Vous avez eu raison de remarquer que le secteur associatif était le premier partenaire du secteur social. S’il n’existait pas, je ne sais pas où en serait notre politique sociale.
Je voudrais aborder la question des appels à projets auxquels sont appelées à répondre certaines associations qui ne sont pas sous tarification administrée et qui ne touchent pas de subvention de fonctionnement. Or les appels à projets qui sont mis en place au niveau de l’État peuvent parfois impliquer également les collectivités lorsqu’elles viennent en mutualisation des financements. Cela se traduit par une surcharge administrative pour les associations. D’ailleurs, dans certaines associations, il arrive qu’un poste à temps complet soit pratiquement consacré à des recherches de financement, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau des collectivités.
Dans le cadre des financements croisés, la réforme territoriale va très certainement venir bousculer un peu ces financements. Avez-vous quelques informations à nous communiquer à ce propos et quel est votre sentiment ? Ne pensez-vous pas qu’il serait nécessaire de faire un peu de « nettoyage » pour faciliter la constitution des dossiers et alléger les démarches administratives ?
Mme Isabelle Le Callennec. Madame la directrice, les représentants des associations caritatives que nous avons reçus nous ont fait part de la difficulté qu’ils avaient avec cette notion d’appel à projets. Ils nous ont dit qu’ils lui préféraient la notion « d’appel à idées ». Cela rejoint votre propos sur la nécessité d’éviter les réponses standardisées et de partir sur la base des besoins à satisfaire. Leur argument était d’ailleurs que leurs associations travaillent au contact des personnes et qu’elles sont les mieux placées pour mesurer ces besoins.
Je voudrais maintenant aborder l’évolution des tarifs. Vous avez évoqué les référentiels d’activités et de coûts, qui sont en cours d’élaboration. Observe-t-on des différences d’un territoire à l’autre, en France ?
S’agissant de la sécurisation des financements, je rejoins les propos de ma collègue Mme Fabre. Aux difficultés de trésorerie s’ajoutent des difficultés liées à la complexité des procédures. Lorsque nous avons préparé la loi sur l’économie sociale et solidaire, il a beaucoup été question de simplification. Nous en entendons souvent parler sur le terrain.
Je me réjouis par ailleurs de vos propos sur le soutien à l’engagement associatif et sur la valorisation des acquis. Peut-on compter sur une promotion du « CV citoyen » dans lequel des personnes qui recherchent un emploi peuvent, en plus de leur expérience professionnelle, mettre en avant tout ce qu’elles ont fait dans le milieu associatif ?
Enfin, je constate que les conventions collectives de 1966 et de 1951 auxquelles vous avez fait allusion sont diversement appréciées. Pour les employeurs, elles sont très protectrices des salariés ; pour les salariés, elles ne font que mettre en œuvre des acquis sociaux. Vous semblez souhaiter que l’on parvienne à une certaine unité. A-t-on engagé une réflexion à ce propos ? En effet, les dispositions de ces conventions collectives sont de nature à alourdir les frais de fonctionnement des associations.
M. le président Alain Bocquet. Tout à l’heure, vous avez employé le terme d’entreprise associative. J’observe que parfois, l’association créée il y a cinquante ans par des parents d’enfants handicapés est devenue au fil du temps une véritable entreprise. D’où une certaine dichotomie entre l’association d’origine et l’organisation actuelle. Cela dit, sur le plan économique et financier, les entreprises associatives ne sont pas à égalité avec les autres entreprises. Par exemple, elles ne peuvent pas prétendre au CICE. En revanche, elles doivent payer la taxe transports.
Comment gérer ce genre de situation ? Nous aimerions y voir plus clair pour l’avenir.
Mme Sabine Fourcade. Madame Dumas, vous parliez des petites associations. Je partage votre souci : sur le territoire, la cohésion sociale se « tricote » petit à petit. On a besoin d’associations de proximité pour mettre les personnes en lien les unes avec les autres. Or les petites associations d’aide sociale, qui vivent de petites subventions, sont aujourd’hui en difficulté.
Je le constate moi aussi. J’essaie d’aider quelques associations nationales avec les crédits de subventions dont je peux disposer à la DGCS ; malheureusement, ceux-ci ont baissé dans la mesure où les dépenses obligatoires ont augmenté. Les départements se trouvent dans la même situation vis-à-vis des petites associations locales. Il s’agit généralement d’associations d’insertion et de centres sociaux. C’est un vrai problème et je me demande s’il ne faudrait pas essayer de sanctuariser une partie des crédits de l’action sociale au profit de l’action sociale de terrain. Car si cette dernière ne pouvait pas être mise en place, nous y perdrions beaucoup.
J’en viens aux associations qui œuvrent dans le champ de l’enfance. J’imagine que vous visiez les associations qui font, notamment, de l’aide aux devoirs. Car les contrôles existent dans les centres de loisirs sans hébergement et, plus généralement, à chaque fois qu’il y a prise en charge de mineurs. Cela ne relève pas de ma direction, mais de la DJEPVA – la direction de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. En revanche, ce sont les mêmes services territoriaux, les DRJSCS (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) et DDCS (directions départementales de la cohésion sociale) qui établissent ces contrôles dès qu’il y a accueil de mineurs.
Les seuls cas où il n’y a pas de contrôle a priori c’est lorsqu’il y a échange de prestations et de services sans accueil : soutien scolaire, cours, etc. Il est en effet difficile d’interdire l’initiative privée. Cela dit, en cas de problème, la réactivité doit être forte. Par exemple, le 119 est le numéro d’appel d’urgence qu’il faut composer dès que l’on a connaissance d’un risque ou d’un problème de maltraitance sur des enfants. Au-delà, il est vrai qu’on est un peu démuni…
Mme Fabre m’a interrogée sur les associations qui répondaient aux appels à projets des collectivités locales. Je crois que les DLA, qui sont destinés à soutenir les associations sur le terrain, sont à même de les aider dans leurs démarches. Cela dit, un besoin de simplification s’impose.
C’est bien à ce besoin de simplification que répond l’article 62 de la loi sur l’économie sociale et solidaire en permettant Gouvernement, de prendre par ordonnance des mesures visant, entre autres, à simplifier les démarches des associations. M. Yves Blein, député du Rhône, membre du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et rapporteur du projet de loi, a été nommé en mai 2014 parlementaire en mission pour préparer des ordonnances de simplification. Nous sommes donc en train d’y travailler avec lui.
Il existe déjà des systèmes de demandes de subvention en ligne, et je pense que les nouvelles technologies permettront de limiter le nombre de formulaires. Mais l’administration a besoin que les associations nous disent quelles procédures sont les plus complexes. On ne s’en aperçoit pas forcément depuis nos bureaux parisiens. M. le député Blein, au cours de sa mission, rencontrera sans doute beaucoup d’associations et fera des propositions de simplification que nous regarderons évidemment avec grande attention.
Madame Le Callennec, vous avez évoqué les appels à projets qui devraient plutôt être des « appels à idées ». Cela me semble extrêmement important. C’est pourquoi nous menons une bataille de tous les instants en ce sens. Les services de l’État, des départements et des ARS peuvent avoir tendance à définir à l’avance la réponse, parce que cela leur facilitera le dépouillement. Nous consultons régulièrement les appels à projets, qui doivent tous être mis en ligne (sur le site des ARS ou de la CNSA) et nous essayons de promouvoir les meilleurs, ceux qui définissent clairement le besoin mais laissent ouverte la réponse.
Vous m’avez par ailleurs demandé s’il y avait des différences de tarifs d’un territoire à l’autre. Bien sûr, ces différences existent. Nous essayons de développer des projets à moyen terme – car les réformes de tarification ne se font pas immédiatement – et d’assurer la transparence des tarifs et des pratiques – ce qui peut se faire beaucoup plus rapidement –, pour que chacun puisse se comparer aux autres. Nous y travaillons avec l’ensemble des ARS, qui tarifient le médico-social, et avec les services de l’État.
Nous travaillons beaucoup avec l’ensemble des services – y compris dans les départements – à des guides méthodologiques afin d’harmoniser les pratiques. C’est une autre façon de procéder, différente des circulaires qui étaient jusqu’à présent le mode de travail classique de l’administration. Il s’agit, par ce biais, de promouvoir et de diffuser les pratiques les plus intéressantes sur l’ensemble du territoire.
Il est ensuite évident qu’il faut développer le « CV citoyen » pour encourager le bénévolat. Mais c’est là une question de société : d’autres pays, notamment anglo-saxons, valorisent les étudiants qui ont eu des engagements associatifs, alors que ce n’est pas le cas de la France. Dans notre pays, les employeurs n’apprécient pas toujours qu’entre la fin des études et la recherche d’un premier emploi, on ait eu un engagement citoyen. Je crois que nous avons un vrai changement de paradigme à opérer.
Il faut également moderniser les conventions collectives de 1966 et de 1951, notamment en privilégiant, au cours de la carrière, la mobilité et l’acquisition de compétences ; jusqu’à présent, c’est l’ancienneté qui prime. On a bien tenté de faire évoluer la convention de 1951, mais les négociations sociales se sont avérées d’autant plus compliquées que nous ne sommes pas dans une période dans laquelle il y aurait « du grain à moudre ». Il est donc difficile de modifier les choses et de valoriser la mobilité ou l’expérience. Quoi qu’il en soit, nous essayons de travailler avec les partenaires sociaux sur ces conventions collectives, qui sont en effet un peu lourdes.
Enfin, monsieur le président, vous avez posé une question sur les entreprises associatives qui, à l’origine, pouvaient n’être que de petites associations comme celles créées par des parents qui s’intéressent à un handicap parce que leur enfant en est atteint.
Les entreprises associatives peuvent demeurer des associations, dans la mesure où des présidents acceptent de prendre le relais. Or il est parfois difficile de trouver des administrateurs et des présidents.
Si les associations n’arrivent pas à se développer avec un conseil d’administration bénévole mais souhaitent rester dans le monde de l’économie sociale et solidaire, elles peuvent aller vers un statut coopératif : elles se transforment en SCIC, c’est-à-dire en société coopérative d’intérêt collectif ; cette possibilité figure dans la loi sur l’économie sociale et solidaire. Bien sûr, ce n’est pas le but, mais c’est un moyen de sortir de l’impasse.
Dernier cas de figure : le regroupement entre associations ou la fusion. Cela ne peut se faire qu’à partir de la volonté des associations, et sur des projets associatifs qui se complètent et s’harmonisent. Cela ne peut donc, en aucun cas, résulter d’un ukase de la puissance publique. J’observe que certaines associations sont entrées dans des démarches de regroupement qui ont été fructueuses et qui leur ont permis de ne pas quitter le mouvement associatif.
Et puis, monsieur le président, votre commission d’enquête offrira peut-être de nouvelles perspectives aux associations, qui seront encouragées à le rester.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup.
Audition de Mme Françoise Sampermans, présidente, et Mme Gwenaëlle Dufour, directrice juridique et fiscale de France Générosités ;
de Mme Agnès de Fleurieu, vice-présidente, et Mme Nathalie Blum, directrice générale du Comité de la Charte
(séance du 7 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, nous vous souhaitons la bienvenue. Les auditions conduites jusqu’ici ont montré l’importance de la générosité publique pour les associations : si toutes ne sont pas concernées au même titre, chacune est confrontée un jour ou l’autre à la question du don.
France Générosités est le syndicat professionnel des organismes faisant appel aux générosités. Fort de ses 81 membres, il représente plus de la moitié des dons et legs collectés auprès du grand public.
Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme à but non lucratif, qui exerce depuis 25 ans une mission de contrôle de l’appel à la générosité publique, fondée sur l’élaboration de règles de déontologie, sur l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs, et sur le contrôle continu des engagements souscrits.
Nous souhaitons bénéficier de votre expertise, être à l’écoute de vos observations et de vos propositions sur la manière de promouvoir les dons des personnes privées, particuliers ou entreprises, ainsi que sur les qualités et défauts du cadre juridique et fiscal des dons. Nous n’oublierons pas l’impératif de transparence qui s’attache à la gestion des fonds ainsi récoltés, et nous serons attentifs à ce que vous pourrez nous dire de l’essor du financement participatif.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mmes Françoise Sampermans, Gwenaëlle Dufour, Agnès de Fleurieu et Nathalie Blum prêtent serment)
Mme Françoise Sampermans, présidente de France Générosités. Merci de nous recevoir. En effet, les 81 organismes adhérents de France Générosités sont ceux qui dépendent le plus de la générosité du public. Le plus gros d’entre eux, la Croix-Rouge, en tire une part importante de ses ressources même s’il est largement subventionné et vit aussi de ses prestations. Le plus petit est l’Association Laurette Fugain, que nous venons d’accueillir et qui lutte contre les maladies du sang.
Le syndicat a été créé en 1998 après le scandale de l’ARC (Association pour la recherche sur le cancer), dont tous se souviennent, hélas, en particulier les donateurs. Il s’agissait pour les adhérents – associations et organismes non lucratifs – de se réunir, de partager leur expérience, et surtout de défendre leurs intérêts et leur image, très entamée dans les années 1990. Depuis lors, la situation s’est nettement améliorée grâce aux dispositifs de contrôle et à l’action des organismes comme le nôtre.
Outre qu’il défend les intérêts de ses membres, le syndicat informe et forme les publics concernés à propos des aspects juridiques et fiscaux de la collecte ; assure un travail de veille, d’expertise et d’information ; accompagne et soutient ses adhérents dans leur stratégie de collecte ; réalise des études marketing et juridiques pour leur compte ; mutualise certains services ; enfin, il s’occupe de promouvoir la générosité privée par des campagnes institutionnelles.
Rappelons brièvement le contexte global. Les financements publics connaissent depuis plusieurs années une baisse marquée ; vous connaissez les statistiques, je n’y reviens pas. Parallèlement, les besoins croissent avec la paupérisation de la population, mais peut-être aussi sous l’effet d’exigences croissantes en matière de soins, d’accompagnement, d’humanitaire, de recherche. Le budget qui nous est nécessaire augmente en conséquence. Or la générosité publique stagne. Après une période de croissance, de 4 à 6 % par an suivant les années, les donateurs sont moins généreux depuis deux ans, en raison de la crise et peut-être de la pression fiscale. Nous avons la grande chance de connaître une stagnation plutôt que la baisse que nous avons crainte et anticipée dès 2012 : il n’y a pas de véritable catastrophe, ce qui signifie que nos donateurs restent fidèles.
En revanche, 92 % des dons émanent des mêmes donateurs : leur renouvellement est relativement faible, ce qui est inquiétant pour l’avenir. Il est vrai que les jeunes sont de moins en moins enclins à donner, pour des raisons bien connues. Nous sommes donc à la recherche de modes de collecte plus adaptés à leur culture et à leur réactivité.
Nos adhérents – je ne parlerai qu’en leur nom – disposent de ressources globales de 5,5 milliards d’euros, dont pas moins de 2 milliards proviennent de la générosité du public. Ils se décomposent en 52 % de dons, 25 % de legs, donations et libéralités, 10 % de concours d’organismes privés – redistribution de la part de fondations, mécénat d’entreprise – et 13 % issus des autres produits de la générosité : événementiel, ventes aux enchères, manifestations, courses, etc.
Quels sont aujourd’hui nos besoins ?
D’abord, le maintien des avantages fiscaux existants. Il y a eu depuis trois ans plusieurs tentatives de remise en cause du taux de défiscalisation applicable à l’impôt sur le revenu, à l’impôt de solidarité sur la fortune et même au mécénat d’entreprise. À nos yeux, il faut préserver ce système extrêmement incitatif auquel les Français sont très attachés. Si l’on touchait à la défiscalisation, fût-ce à la marge, la baisse de nos ressources serait sinon proportionnelle – les plus convaincus continueront de donner –, du moins significative. Or notre secteur n’est guère doté en fonds propres, de sorte que nos ressources ne sont pas assurées d’une année sur l’autre. La défiscalisation est donc capitale pour nous.
Nous appelons également de nos vœux la stabilisation du cadre fiscal et juridique de nos activités. Chaque année, les donateurs comme les organisations se demandent si les dispositions applicables aux dons vont perdurer l’année suivante. Or la prévisibilité à moyen et à long terme est essentielle, ne serait-ce que pour appliquer des programmes de recherche médicale ou encore des programmes humanitaires.
Troisièmement, nous souhaitons une définition plus précise de la notion d’intérêt général, qui détermine les autorisations accordées aux associations de délivrer des reçus fiscaux. En la matière, le système administratif est complexe et peut se révéler aléatoire.
Un problème auquel nous avons été confrontés de manière annexe est la territorialité des dons.
Mme Gwenaëlle Dufour, directrice juridique et fiscale de France Générosités. Le problème est celui du mécénat qui finance les actions menées à l’étranger par des structures françaises, dont les conditions de défiscalisation font l’objet d’une discussion avec l’administration fiscale. L’insécurité est très grande pour toutes ces structures dont l’activité contribue au rayonnement de la France à l’étranger et conditionne le financement réciproque par des structures étrangères d’actions conduites sur notre territoire – dans l’enseignement, par exemple.
Mme Françoise Sampermans. Nous avons également besoin d’une promotion de la générosité privée puisque celle-ci nous est de plus en plus indispensable. Naturellement, cela relève de notre responsabilité, mais on pourrait imaginer des actions communes. Je ne parlerai pas du bénévolat, puisque nous ne sommes pas chargés des aspects humains, bien que nos adhérents recourent à nombre de bénévoles et de salariés.
Nous avons enfin besoin de chercher de nouveaux donateurs, donc de développer de nouveaux modes de collecte. Le don par Internet et le prélèvement automatique se sont beaucoup développés au cours des dernières années. Le don par SMS, très prometteur, nécessite un encadrement législatif ; peut-être pourriez-vous interférer en notre faveur à cette fin.
Mme Gwenaëlle Dufour. À l’heure où les donateurs vieillissent et où nous avons du mal à en trouver de nouveaux, le don par SMS permettrait de toucher une cible jeune, que nous pourrions fidéliser en instaurant un prélèvement automatique par le même canal. Le secteur a beaucoup travaillé avec les opérateurs téléphoniques pour élaborer une offre, des tests ont été réalisés, mais la directive communautaire sur les services de paiements de 2007, qui a fait l’objet d’une interprétation très restrictive, empêche d’aller plus loin sauf à ce que les opérateurs téléphoniques se fassent agréer comme opérateurs de paiement, ce qu’ils ne souhaitent pas. Si nous nous permettons de vous solliciter à ce sujet, c’est parce que la directive est en cours de renégociation.
Parmi les nouvelles techniques, le financement participatif ou crowdfunding, que vous avez évoqué, monsieur le président, et sur lequel on a récemment légiféré, mérite toute notre attention, mais comporte quelques limites. D’abord, et même s’il est difficile d’en évaluer le poids, on parle de 20 millions d’euros de dons – tous dons confondus, y compris ceux qui ne vont pas à des structures d’intérêt général mais à des particuliers, par exemple. Ensuite, le crowdfunding finance des projets, non l’action associative ni le fonctionnement des structures. Enfin, il suppose que le projet soit suffisamment séduisant pour attirer les donateurs, ce qui en exclut certains, plus difficiles d’accès. Gardons ces réserves à l’esprit même s’il s’agit d’un très bel outil qu’il importe de promouvoir.
Mme Françoise Sampermans. J’aimerais enfin souligner trois difficultés que nous rencontrons et sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention.
La première, qui concerne nombre de nos adhérents, touche à la taxe transport, à propos de laquelle j’espère que nous pourrons trouver ensemble une solution acceptable.
La deuxième engage l’allocation des subventions publiques, attribuées en fonction d’appels à projets mais dont le règlement est souvent tardif, ce qui oblige les structures à assurer la trésorerie dans l’intervalle tout en lançant le projet dans les délais acceptés par les services territoriaux ou les ministères. Il faudrait inciter les administrations publiques à verser les subventions promises dans des délais acceptables.
Enfin, nos adhérents subissent de très nombreux contrôles de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des affaires sociales alors que la plupart d’entre eux sont déjà obligés de recourir à un commissaire aux comptes – ce qui est parfaitement logique – et appartiennent souvent au Comité de la Charte, sur la base du volontariat. Ces contrôles les mobilisent pendant plusieurs semaines. Nous tenons à la transparence vis-à-vis des donateurs, que nous développons en nous donnant des règles de déontologie et d’éthique, mais nous aimerions que ces procédures soient allégées, sans perdre leur rigueur.
Au total, le secteur est fragilisé par la baisse des subventions, la croissance des besoins et la stagnation des dons. Il subit la concurrence du secteur public puisque universités, hôpitaux, services du patrimoine et collectivités territoriales – celles-ci pouvant créer, par exemple, des fonds de dotation – font désormais appel à la générosité privée alors même que l’assiette de donateurs est inchangée. La concurrence est nécessaire, c’est une source de créativité, mais ce contexte est pour nous extrêmement difficile.
Je souhaite que nous trouvions ensemble les moyens de soutenir la générosité du public, peut-être en en faisant une grande cause nationale ou l’objet d’une journée de la générosité, afin d’éveiller les consciences.
Mme Agnès de Fleurieu, vice-présidente du Comité de la Charte. Nous avons nous aussi peu de moyens de fonctionnement et beaucoup de bénévoles. Ces derniers, que leur parcours professionnel a généralement préparés à accomplir les tâches que nous leur confions, bénéficient également d’une formation continue. Grâce aux associations de taille diverse qui siègent au sein de notre conseil d’administration, et du fait des contrôles auxquels nous procédons, nous connaissons bien la vie et les difficultés du monde associatif. Nous confirmons bien des constats établis dans le rapport préparatoire aux travaux de votre commission d’enquête ; nous pouvons proposer des pistes de solution, mais elles ne seront pas révolutionnaires compte tenu du rôle que nous jouons par ailleurs.
Mme Nathalie Blum, directrice générale du Comité de la Charte. Le Comité de la Charte est né en 1989 de la volonté des associations d’encadrer par des règles de déontologie l’appel à la générosité du public : avant même le scandale de l’ARC, le secteur avait perçu que la confiance était un élément déterminant du don. Nous avons donc pour mission d’élaborer la déontologie du secteur de la générosité publique, de délivrer un agrément aux organisations et de les soumettre à un contrôle continu.
À l’origine, nos adhérents étaient plutôt issus du secteur humanitaire et social ; aujourd’hui, le Comité est ouvert à tous les secteurs relevant de l’intérêt général, une notion qui n’est pas toujours aisée à définir, et de l’appel à la générosité du public, qui s’adressait d’abord, à l’origine, aux personnes privées, mais inclut aussi le mécénat.
Le Comité de la Charte regroupe près de 80 organisations, associations et fondations de taille diverse – à partir de 500 000 euros de ressources privées –, qui recourent à des bénévoles ou à des salariés et représentent au total 40 % de la générosité publique. 40 %, c’est à la fois beaucoup et relativement peu. En effet, nous n’intégrons pas les structures politiques, cultuelles ou syndicales. Ensuite, toutes les associations et fondations qui sont de notre ressort n’adhèrent pas : l’adhésion dépend d’une démarche volontaire, le secteur se dotant lui-même de ses règles de déontologie. Enfin, même celles qui entament le processus d’adhésion ne le mènent pas toutes à leur terme, car il est particulièrement exigeant.
Au sein de notre association, ce sont des bénévoles qui accomplissent notre mission.
Les contrôles que nous exerçons se fondent sur quatre critères : règles de fonctionnement statutaire et gestion désintéressée, rigueur de la gestion, qualité de la communication et des actions de collecte de fonds, transparence financière. C’est parce qu’ils sont irréductibles à des contrôles strictement financiers qu’ils nous permettent de connaître de l’intérieur nos adhérents, leurs problèmes de gouvernance, leur difficulté à pérenniser leur action, à anticiper, à élaborer de nouvelles stratégies.
Mme Agnès de Fleurieu. À la baisse des financements publics s’ajoutent deux autres difficultés.
D’abord, les associations, qui consacrent l’essentiel de leur énergie à agir sur le terrain, ont souvent peu de personnels compétents en matière de gestion, ce qui les pénalise dans la période actuelle de difficultés financières. Ce problème épargne les plus grandes mais pèse sur les moyennes ainsi que sur les plus petites – nous le savons même si elles ne sont pas représentées au Comité.
Ensuite, la baisse des financements publics ne peut pas être anticipée, sinon de manière générale compte tenu du contexte actuel. L’administration qui instruit les demandes de subvention y répond avec retard, car elle a elle-même perdu beaucoup d’effectifs avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) et ses avatars. Ainsi, une association peut apprendre, un an après avoir déposé sa demande, qu’on lui rogne 50 % de sa subvention, voire qu’elle n’y a plus droit du tout faute de satisfaire à tel ou tel critère. Dans l’intervalle, elle a continué de fonctionner, d’engager des dépenses, de financer des projets.
Il serait donc souhaitable que nous puissions programmer avec les associations la diminution des financements publics, si celle-ci doit inéluctablement se poursuivre au cours des trois à cinq ans à venir. Nous avons besoin de savoir si la baisse sera de 20 % par an, ou différenciée selon tel ou tel critère, etc.
Nous nous inquiétons aussi de la modification éventuelle de la clause de compétence générale des collectivités, car nombre d’associations vivent d’une multiplicité de subventions – un empilement, dit-on, mais il leur apporte des ressources cumulées.
Plus généralement, il faudrait un plan d’ensemble pour le secteur associatif, incluant la sécurisation du régime fiscal à propos de laquelle nous sommes entièrement d’accord avec France Générosités. Les associations ont besoin de connaître par avance les financements dont elles disposeront au cours des années à venir. On pourrait même imaginer des dispositifs contractuels qui les associent à la programmation de la baisse des financements. Tout plutôt que l’incertitude actuelle !
Par ailleurs, pour pouvoir en appeler davantage à la générosité publique, il faut inspirer davantage confiance aux donateurs. De nombreux acteurs espèrent conserver leur part des financements publics alors que ceux-ci sont en baisse. Dans l’appel aux dons privés, ils sont en outre concurrencés par de nouveaux intervenants, comme le Louvre par exemple. D’où le besoin de nouveaux modes de financement – ce que les fonds de dotation ne sont pas. L’appel à de nouveaux donateurs pose toutefois des problèmes de prospection et de fiscalité.
Peut-être faut-il également développer la formation, qui pourrait aider les dirigeants associatifs à faire face à leurs difficultés financières et, en leur donnant l’occasion de rencontrer les acteurs du secteur marchand, à préparer une éventuelle reconversion.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci pour ces exposés très précis. La stabilité des dons est encourageante, mais le renouvellement des gisements paraît nécessaire. À cet égard, nous avons bien noté que les nouvelles technologies sont susceptibles d’attirer les jeunes générations. D’une manière générale, il s’agit de développer la générosité privée. Celle-ci étant davantage mise à contribution dans d’autres pays, pouvez-vous établir une comparaison avec d’autres pays européens ? Mais comment lui donner plus de place tout en préservant l’impératif de transparence, l’intérêt général et l’initiative associative au sens de la loi de 1901 ? Telles sont les pistes qu’il faudra continuer d’explorer pour pallier une conjoncture économique défavorable.
M. Frédéric Reiss. Grâce à la position que vous occupez dans le monde associatif, vous nous offrez sur les questions qui nous préoccupent une précieuse vue d’ensemble.
J’aurais aimé en savoir un peu plus sur le problème de la territorialité des dons et sur les solutions envisageables.
Le renouvellement des donateurs est lui aussi problématique : 92 % des dons, dites-vous, viennent des donateurs fidèles. En va-t-il de même du renouvellement des dirigeants associatifs ? Vu les responsabilités, notamment pénales, qu’ils endossent, on peut le concevoir. La formation n’est sans doute pas la seule solution à ce problème.
Mme Isabelle Le Callennec. Comme vous, j’ai observé l’émergence d’une forme de concurrence pour capter la générosité du public. Vous appelez de vos vœux des campagnes communes d’appel à la générosité privée. Mais l’espace publicitaire vous est-il donné ou vendu ? Et, dans la seconde hypothèse, ne faudrait-il pas commencer par le rendre gratuit pour vos organisations ?
À propos du financement participatif, vous avez parlé de 20 millions d’euros de dons : est-ce beaucoup ? Est-ce peu ?
Enfin, existe-t-il un profil type de donateur et celui-ci évolue-t-il ? Vous dites que les donateurs sont très attachés à la défiscalisation de leurs dons, mais je connais beaucoup de personnes qui donnent pour donner, sans rien espérer en retour.
Mme Bernadette Laclais. Peut-on vraiment parler de concurrence au sujet des collectivités, qui lancent généralement des souscriptions très limitées – limitées au patrimoine, en particulier ?
On peut concevoir que les jeunes générations soient plus sensibles aux nouveaux outils technologiques, même si des personnes plus âgées les emploient aussi beaucoup. Mais peut-on espérer que les jeunes, en vieillissant, deviennent donateurs, ou leur réticence à donner s’explique-t-elle par une évolution culturelle ? Autrement dit, si les jeunes ne donnent pas, est-ce parce qu’ils ont d’autres préoccupations et moins de ressources, ou parce qu’ils sont les premiers témoins d’une désaffection profonde de notre société à l’égard du don ?
Enfin, le don comporte des spécificités locales, qui peuvent être affaire de contexte plus que d’histoire. Ainsi, mon département a longtemps été le premier collecteur de verre pour la lutte contre le cancer, grâce à l’action d’une personnalité locale très dynamique. Existe-t-il une tradition du don que vous auriez pu cartographier ?
Mme Agnès de Fleurieu. En ce qui concerne les problèmes de gouvernance, ils se posent à notre Comité comme à ses membres. Du fait de la complexité croissante des contrôles à effectuer pour garantir la transparence, il nous faut veiller à la fois à la compétence de nos dirigeants et à leur indépendance. Nous avons donc fait entrer dans notre conseil d’administration des personnalités qualifiées extérieures aux associations fondatrices du Comité. Nous avons revu notre projet associatif en conséquence, afin d’éviter que quiconque ne se sente lésé. Cette évolution était inéluctable.
Mme Nathalie Blum. Quant à nos organisations, leurs difficultés sont bien souvent liées à des problèmes de gouvernance et de renouvellement des administrateurs. Pour tenter de remédier à ce problème, nous avons promu des règles de transparence des modalités de gouvernance au sein des associations. C’est une question à laquelle nous sommes confrontés en permanence lors de nos contrôles. Une association dotée d’une bonne gouvernance a beaucoup moins de mal à faire face à ses difficultés.
Mme Agnès de Fleurieu. Nous avons vu des associations dont le président-fondateur est un homme remarquable qui, à l’approche de ses quatre-vingt-dix ans, n’a pas trouvé de bras droit à qui passer le relais et ne parvient plus à maîtriser le réseau territorial qu’il a créé. Nous sommes attentifs à ces situations.
Mme Nathalie Blum. En ce qui concerne les comparaisons internationales, les statistiques de nos homologues étrangers montrent que les habitudes de don sont relativement peu développées en France. Les dons représentent 290 milliards d’euros par an aux États-Unis, contre 2 milliards en France, 6 en Allemagne, 3,5 en Italie et 2,3 aux Pays-Bas. En pourcentage du PIB, les Italiens donnent deux fois plus que les Français et les Allemands trois fois plus.
Mme Agnès de Fleurieu. Outre ces valeurs absolues, la comparaison doit toujours tenir compte d’autres facteurs, dont la fiscalité.
Mme Françoise Sampermans. En ce qui concerne la recherche de nouvelles sources de financement, trois pistes existent.
D’abord, développer celles des méthodes de collecte actuelles qui n’ont pas encore été utilisées au maximum. Je songe en particulier aux legs, sur lesquels nous ne travaillons pas depuis très longtemps et auxquels nos adhérents recourent encore peu, car les campagnes, délicates à mener, requièrent un grand professionnalisme. En revanche, le marketing direct par voie postale, par exemple, a atteint ses limites.
Ensuite, rechercher de nouveaux donateurs. Les jeunes deviendront-ils des donateurs ? Oui, s’ils commencent à donner dans un contexte qui leur convient ou pour une cause à laquelle ils croient. On les voit ainsi se mobiliser lors de courses événementielles ; on atteint leur cœur avant leur portefeuille, si j’ose dire. Nous les fidéliserons à condition de nous adresser à eux de façon adaptée.
Enfin, nous tourner vers l’international. À l’étranger, dans certaines zones ou au sein de certaines catégories de population, le don est beaucoup plus habituel et spontané qu’ici. Pour des causes qui les intéressent et qui sont susceptibles d’être internationalisées, nous pouvons trouver des donateurs expatriés ou étrangers, d’autant que nombre de nos adhérents travaillent à l’international.
Nous payons la plupart du temps les espaces publicitaires, ou tout au moins les frais techniques afférents. Tous nos membres ont conclu des accords avec de grands organismes comme la RATP ou la SNCF, qui se montrent plutôt compréhensifs. En revanche, il est très difficile d’obtenir la gratuité des affichages ou des publications dans la presse. Les chaînes de télévision et de radio ont un contingent annuel d’espaces gratuits qu’elles répartissent plutôt harmonieusement aux termes d’un accord qui nous lie au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Toutefois, cette possibilité n’est pas extensible à l’infini : les médias doivent bien vivre eux aussi. Par ailleurs, des espaces nous sont offerts lors de grandes catastrophes ou encore d’événements récurrents dont l’organisation est prédéfinie. Ces partenariats sont une réussite, même si l’on peut toujours demander plus et faire mieux.
Il existe bien un profil type du donateur : une personne de 59 ans ou plus, très fidèle aux causes et aux organismes qu’elle soutient, donnant très régulièrement, de plus en plus par prélèvement automatique. Celui-ci concerne aujourd’hui 20 % des dons, dont il a l’avantage de garantir la continuité et la prévisibilité. Pour compléter cette esquisse, nous pourrons vous envoyer le résumé de notre récente étude sur le profil du donateur et celui du non-donateur, avec l’étude que nous consacrons régulièrement à la tradition du don et à sa répartition par département.
Mme Gwenaëlle Dufour. Au-delà des appels au don, il existe différents types de manifestations – ventes, prestation de services – qui s’apparentent davantage à des actions commerciales et auxquelles les structures évitent pour l’instant de recourir, pour des raisons fiscales : elles ne souhaitent pas être assujetties à ce titre aux impôts commerciaux – TVA, contribution économique territoriale. Pour les inciter à développer ces modes de financement, on pourrait actualiser le système de franchise en vigueur, ce qui n’a pas été fait depuis une dizaine d’années, ou proportionner la franchise aux ressources des structures : actuellement, une personnalité morale unique dont dépendent de nombreux comités, comme le Secours catholique, atteint très vite le plafond, contrairement aux structures fédératives où le plafond s’applique à chaque fédération.
Aujourd’hui, les structures peuvent développer des activités commerciales sans basculer dans le secteur marchand dès lors que ces activités ne sont pas « significativement prépondérantes ». Pour tenir compte du fait que ces structures sont désormais concurrencées par le secteur privé alors qu’elles ne s’adressent pas au même public, ne pratiquent pas les mêmes tarifs ni ne disposent de la même marge de manœuvre, il conviendrait d’étudier la possibilité d’un financement différentiel.
J’en viens à la territorialité. À l’heure actuelle, aux yeux de l’administration fiscale, le financement d’actions menées à l’étranger n’est éligible au mécénat que si ces actions sont humanitaires, en un sens très restrictif, ou concourent à diffuser les connaissances scientifiques ou la langue françaises. Cette condition de territorialité ne nous paraît pas pouvoir être déduite de l’article 200 du code général des impôts, qui organise la déductibilité fiscale des dons à des structures d’intérêt général. Pour nous, l’intérêt général est une notion unique qui englobe l’humanitaire, l’éducation, le social, l’activité sportive, que ce soit en France ou à l’étranger. Pourquoi pourrait-on financer à l’étranger des actions humanitaires et non éducatives ? Cette hiérarchisation des causes ne nous paraît pas fondée.
S’il est néanmoins nécessaire de maintenir un système d’exception, pour des raisons budgétaires que nous pouvons fort bien comprendre, il faut alors l’adapter aux pratiques des structures, qui financent d’importants projets souvent soutenus par l’État, notamment par l’aide publique au développement, parce qu’ils contribuent au rayonnement de la France.
Les 20 millions d’euros issus du financement participatif représentent un montant relativement faible, rapporté aux 2 milliards annuels de dons en France. Certes, ce mode de financement n’en est qu’à ses débuts. Il n’en reste pas moins difficile pour les structures de se limiter au financement de projets. Il faut soutenir le crowdfunding car il convient très bien aux petites structures, mais il est moins adapté à celles que nous représentons, notamment lorsqu’il s’agit de financer leurs frais de fonctionnement.
Mme Agnès de Fleurieu. En conclusion, les associations ont besoin d’argent, mais aussi de bien d’autres choses. Si elles pouvaient anticiper la diminution de leurs ressources, elles pourraient aussi programmer l’appel au bénévolat, facilité par l’inversion de la pyramide des âges et l’arrivée de nombreux retraités sur le marché.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup, mesdames, de cette contribution qui nourrira utilement notre rapport.
Audition de M. Stéphane Créange, chef du bureau B2 de la Direction de la législation fiscale, et de M. Jean-Luc Barçon-Maurin, chef du Service juridique de la fiscalité (Direction générale des finances publiques).
(séance du 7 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mes chers collègues, par principe, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux – impôt sur les sociétés (IS), TVA, et contribution économique territoriale (CET) – mais cette situation ne s’applique ni en toutes hypothèses ni en toutes circonstances.
Si une association ne peut échapper à l’impôt du seul fait qu’elle est réputée être un organisme à but non lucratif, quel est l’enjeu du régime fiscal de ces organismes ? Il vise tout à la fois à leur permettre de développer leurs activités dans le cadre non lucratif qu’ils ont choisi et à garantir qu’une éventuelle concurrence avec le secteur marchand ne sera pas faussée. Ces principes posés, tout l’art du politique consiste à bien positionner les curseurs. Des critères ont donc été posés pour apprécier le caractère lucratif ou non des associations, le caractère intéressé ou non de leur gestion, ou le caractère concurrentiel ou non de leurs activités.
Sur le terrain, les difficultés demeurent. L’administration fait-elle preuve d’une diligence suffisante dans la délivrance des rescrits fiscaux ? La question a souvent été évoquée lors des auditions. Par ailleurs, la doctrine est-elle uniforme sur le territoire national ? Le périmètre des mesures de défiscalisation de dons ne pourrait-il pas être élargi par exemple aux dons agricoles ?
Messieurs, avant de vous donner la parole pour un exposé liminaire, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Stéphane Créange et Jean-Luc Barçon-Maurin prêtent serment)
M. Jean-Luc Barçon-Maurin, chef du Service juridique de la fiscalité (Direction générale des finances publiques). Avant d’évoquer les relations actuelles entre l’administration fiscale et les associations, il me paraît utile de rappeler la situation qui prévalait dans les années 1990, années durant lesquelles les associations se plaignaient de faire l’objet d’un très grand nombre de contrôles fiscaux. C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont confié, en 1997, à un conseiller d’État, M. Goulard, le soin de rédiger un rapport en vue de remettre à plat la fiscalité des associations.
Depuis les années 1997 et 1998, les relations entre l’administration fiscale et les associations ont connu deux périodes.
La première, qui court jusqu’au milieu des années 2000, a tout d’abord consisté dans l’élaboration de l’instruction fiscale mettant en œuvre les grands principes de la fiscalité applicable aux associations posés dans le rapport Goulard – des principes clairs, nets, précis, opérationnels et équitables, assurant, à la fois, la reconnaissance de la spécificité des associations et le respect du principe de la coopération équitable entre les acteurs économiques.
L’administration fiscale a, durant toute cette première période, travaillé en étroite concertation avec les associations pour décliner avec précision, secteur par secteur, les grands principes de l’instruction de 1998.
Par ailleurs, les dispositions législatives, relatives notamment aux modalités de la rémunération des dirigeants, qui se sont ajoutées à l’instruction de 1998, ont donné lieu à des commentaires complémentaires de la part de l’administration fiscale : leur consolidation a abouti, en 2006, à la publication d’une instruction de synthèse sur le régime fiscal des associations.
Durant la seconde période, qui débute au milieu des années 2000 et court jusqu’à aujourd'hui, l’administration a davantage travaillé en interne pour gérer la montée en puissance du rescrit. En 2003, l’adoption de la loi sur le mécénat avait en effet traduit la volonté du législateur de favoriser le mécénat en direction des associations via l’instauration d’un rescrit « mécénat » spécifique. Ce dispositif a vivement intéressé les associations, qui ont immédiatement voulu connaître la position de l’administration sur leur droit à délivrer des récépissés aux donateurs. Or, les associations faisant très souvent partie de fédérations nationales, nous avons été rapidement confrontés aux pratiques divergentes des départements en la matière.
C’est pourquoi, afin de répondre à l’insatisfaction des associations, nous avons mis en place un dispositif leur permettant, lorsqu’elles ne jugent pas satisfaisante la première réponse de l’administration, de bénéficier d’un second regard, porté par un collège distinct de celui qui a instruit la demande de rescrit. Le recours à ce dispositif, s’il permet de réparer une éventuelle erreur, confirme, le plus souvent, la première réponse donnée par l’administration.
Le travail d’homogénéisation a consisté à apporter un meilleur soutien aux correspondants « associations » de l’administration fiscale – à l’aube des années 2000, l’ex-Direction générale des impôts avait nommé dans chacune de ses directions un correspondant plus particulièrement chargé d’accompagner le mouvement de mise en œuvre des principes de l’instruction de 1998. Ce travail est mené via la mise en ligne de consignes et de décisions particulières, la constitution, à l’intention des correspondants, d’une base de données des références sur lesquelles s’appuyer, l’organisation de réunions nationales ou interrégionales et, plus récemment, la mise en place, au sein de la DGFiP, d’un réseau social permettant aux correspondants de communiquer entre eux et avec l’administration centrale de manière fluide.
Sans doute, le temps est-il venu d’ouvrir un nouvel épisode dans les relations entre l’administration et les associations, en vue notamment d’actualiser les commentaires sur certains points de la législation relative au mécénat et d’accroître encore l’homogénéité des pratiques. Il faut savoir que, chaque année, l’administration fiscale délivre plus de 5 000 rescrits aux associations.
Toutefois, si nous jetons un regard sur le chemin parcouru depuis vingt ans, il est évident que les relations entre l’administration fiscale et les associations s’inscrivent dans un environnement radicalement différent. On peut affirmer que les relations se sont considérablement améliorées, même si notre réactivité ou le caractère parfois contradictoire des décisions prises par les différentes directions font encore l’objet de critiques.
M. Stéphane Créange, chef du bureau B2 de la Direction de la législation fiscale (Direction générale des finances publiques). Pour la Direction de la législation fiscale, qui est chargée de l’élaboration de la norme fiscale et de son interprétation, l’insertion des associations dans le tissu économique n’a pas manqué de soulever, compte tenu de son importance, de nombreuses questions relatives à l’interpénétration des secteurs et au rôle des organismes non lucratifs dans la vie économique. Un rapport parlementaire, publié l’an dernier, a ainsi évoqué les interrogations du monde associatif sur la création, il y a deux ans, du CICE, en termes de concurrence ou d’avantages comparés. Il est évidemment difficile d’y répondre.
Deux points ressortent régulièrement des contacts que la Direction de la législation fiscale entretient avec le Haut conseil à la vie associative (HCVA), le monde associatif et les ministères qui se font parfois les porte-parole des associations.
Le premier concerne les notions de lucrativité ou de non-lucrativité, qui décident de l’imposition des organismes : c’est en effet en recourant à ces notions que l’administration détermine si l’association entre dans les critères développés par la jurisprudence et par la doctrine, laquelle n’a fait souvent que consolider des décisions jurisprudentielles.
Le second vise le mécénat, qui est très dynamique en France : il fait l’objet de critiques ou de demandes régulières d’extension. Il s’agit en effet pour les associations d’une voie de ressources non négligeable.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Seriez-vous favorables à ce que les dons aux associations de consommateurs puissent bénéficier de mesures de défiscalisation quasi identiques à celles dont bénéficient les autres associations d’intérêt général ?
Par ailleurs, convient-il de relever le seuil de lucrativité, qui n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années ?
M. Régis Juanico. Vous avez évoqué le rapport parlementaire sur l’impact de la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, rapport que MM. Blein, Guedj, Grandguillaume et moi-même avons établi en décembre 2013. Les premières propositions visaient à simplifier les démarches administratives et fiscales, grâce notamment à la création d’un guichet fiscal unique. C’est vrai, l’administration fiscale dédie dans chaque département un correspondant aux associations qui souhaitent recevoir des conseils : avancez-vous concrètement sur le chantier de la dématérialisation ?
Je défendrai demain devant la commission des finances un amendement visant à relever le seuil de lucrativité de 60 000 à 77 000 euros. Or chacun connaît les réticences de l’administration fiscale en la matière : quels sont ses arguments ? Un tel relèvement pourrait-il poser des difficultés au plan communautaire ?
M. Frédéric Reiss. Vous le savez, l’Alsace vit sous le régime concordataire.
Quid du rôle particulier des paroisses ? Il existe en Alsace des conseils de fabrique et des conseils presbytéraux : par quelles règles sont-ils régis ?
Si je vous pose la question, c’est que, s’agissant de la réserve parlementaire, je rencontre des difficultés pour soutenir des projets – je pense par exemple à la restauration de l’orgue d’une église –, à partir du moment où ils sont directement financés par les paroisses et non par des associations créées ad hoc.
M. Jean-Luc Bleunven. L’administration fiscale modifie-t-elle son regard sur les associations qui font le choix de rendre lucrative une partie de leurs activités ? Sont-elles traitées différemment ?
M. le président Alain Bocquet. Vous avez évoqué 5 000 rescrits annuels : le chiffre couvre toute la France, je suppose.
M. Jean-Luc Barçon-Maurin. Oui.
M. le président Alain Bocquet. Je pensais qu’il était plus élevé.
Combien d’associations demandent-elles un rescrit ? Quelle est la proportion de satisfaction ?
Pensez-vous que nous assistions à l’heure actuelle à une mutation de certaines associations vers l’entreprise associative ? Et si oui, ne conviendrait-il pas d’adapter la législation à ces nouvelles réalités ? Nous avons reçu des entreprises associatives, qui ne bénéficient pas du CICE, mais qui paient en revanche des taxes sur les salaires qui plombent leur budget. Or elles n’entrent pas dans le champ concurrentiel puisqu’elles sont souvent les seules à être présentes sur des terrains très spécifiques. Leur situation, je l’admets, pose des problèmes de doctrine fiscale.
Enfin, des associations, que nous avons reçues, se posent la question de la territorialité des dons. Qu’en est-il en la matière ?
M. Jean-Luc Barçon-Maurin. Notre fonction est d’appliquer la loi sur le mécénat : or celle-ci prévoit une série de conditions à l’éligibilité d’une association au rescrit, parmi lesquelles figurent les types d’activités.
Lorsque nous recevons une demande de rescrit de la part d’une association qui soutient les consommateurs, nous nous demandons, une fois sa non lucrativité reconnue, si son activité est d’intérêt général ou ne vise que certaines catégories de la population et si la défense des consommateurs figure parmi les caractères mentionnés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI). Dès lors que notre service n’a pas la possibilité de rattacher de manière indiscutable l’activité d’une association à un caractère inscrit dans la loi, il lui est impossible de décréter que cette association est éligible au mécénat. Tel est le raisonnement standard que doivent faire nos services dès lors qu’ils reçoivent une demande de rescrit.
Le seuil de la lucrativité a été fixé, c’est vrai, en 1998 et légèrement revu lors du passage à l’euro. La seule question à se poser est celle de l’impact de son relèvement sur le champ concurrentiel. Je rappelle que les auto-entrepreneurs sont réputés exercer une activité économique avec un chiffre d’affaires inférieur au seuil de lucrativité des associations. Veillons à ne pas déplacer les lignes d’avantages d’un secteur vers un autre. Le relèvement du seuil ne poserait pas seulement un problème d’ordre budgétaire mais soulèverait également des questions de principe : ne mettrait-il pas en danger le bon positionnement de la ligne de partage entre les activités concurrentielles et les activités non concurrentielles, entre les entreprises et les associations ?
Pour être franc, 5 500 rescrits – c’est le chiffre des dernières années – ne justifient pas de recourir à une procédure de dématérialisation. La DGFiP a concentré son effort sur la dématérialisation de flux plus massifs : les déclarations de résultats des entreprises, de cotisations foncières des entreprises (CFE), de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou de TVA, qui se chiffrent par centaines de milliers, voire par millions. La dématérialisation offre alors un véritable intérêt économique en termes de gain de productivité. Nous nous sommes néanmoins efforcés de normaliser le type de document demandé aux associations, s’agissant notamment de la non-lucrativité – ce renseignement est également utile au mécénat, la non-lucrativité figurant parmi les conditions d’éligibilité au mécénat dans la plupart des cas. Cette normalisation des documents facilite leur traitement et permet aux associations de bien comprendre nos exigences en termes de renseignements.
Je ne connais pas le statut juridique des paroisses alsaciennes. Je me rappelle seulement des débats sur la rémunération des ministres du culte. Ce que je peux avancer, c’est que si la paroisse a un statut qui s’apparente à celui d’une association, les mêmes critères lui seront appliqués. Il conviendra évidemment de faire un sort au fait qu’il s’agit d’une association religieuse puisque le ministère de l’intérieur, chargé des cultes, est également compétent. Ma réponse mériterait d’être précisée.
Après 1998, les associations nous ont envoyé un grand nombre de demandes d’explication sur la sectorisation des activités lucratives et non lucratives. Aujourd'hui, elles paraissent les avoir bien intégrés et les questions sur le sujet sont devenues rares. Je tiens à insister sur le fait que l’administration porte le même regard objectif sur toutes les associations, qu’elles soient sectorisées ou non.
Votre question sur le droit à la réduction de la TVA n’est pas sans rapport avec le lien existant entre les trois impôts commerciaux. À mes yeux, il ne serait pas raisonnable de remettre en cause ce principe fort de l’instruction de 1998, qui a, du reste, été validé par le Conseil d’État rapidement après la publication de celle-ci. Ce critère est équitable, opérationnel et robuste sur le plan juridique, car il permet d’assurer une ligne de démarcation claire entre les associations non lucratives et celles qui interviennent sur le même terrain que les entreprises. La sectorisation dépend alors du chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur le président, l’administration fiscale délivre chaque année 20 000 rescrits : les associations représentent donc 25 % de ce total – ce sont de grosses consommatrices d’un outil juridique dont elles ont bien compris l’intérêt. Entre 250 et 300 associations, chaque année, demandent un réexamen de leur dossier après avoir reçu une réponse négative, estimant devoir poursuivre la discussion avec l’administration fiscale.
S’agissant de la mutation des associations, il faut se rappeler que, dans les années 2000, l’instauration, par le législateur, dans le secteur des aides à la personne, de crédits d’impôt substantiels en faveur des particuliers a incité toute une nouvelle palette d’acteurs privés à intervenir dans ce secteur. Des associations, qui avaient le sentiment d’œuvrer sur un terrain vierge, ont vu arriver progressivement des acteurs privés, en particulier dans le secteur des crèches ou dans celui des EHPAD. La règle des « 4 P », posée en 1998 et qui implique de prendre en considération le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et la publicité dont le produit fait l’objet, a pour vertu de protéger les associations dont l’offre est distincte de celle des opérateurs privés. Comme elles interviennent sur les populations en difficulté à des prix très modérés, si on les compare à ceux qui sont pratiqués par des entreprises privées, elles voient leur spécificité fiscale protégée et ne basculent pas dans la lucrativité. Il faut donc nuancer l’accusation selon laquelle les associations seraient contaminées par l’irruption d’acteurs privés. La règle des « 4P » permet vraiment, je le répète, de prendre en compte la spécificité des associations. Quant à celles qui demeurent totalement non lucratives et qui voient des acteurs privés bénéficier du CICE, elles ont obtenu une réponse fiscale avec le relèvement de l’abattement de la taxe sur les salaires
– lequel profite évidemment surtout aux associations qui ont un grand nombre de salariés. Toutefois, la réponse à apporter aux difficultés des associations doit-elle être seulement d’ordre fiscal ? Il serait contradictoire de créer un crédit d’impôt pour des acteurs qui ne paient pas l’impôt.
M. Régis Juanico. Le critère de la publicité, contenu dans la règle des « 4 P », est-il toujours pertinent à l’heure des nouvelles technologies ? Ne conviendrait-il pas de passer à la règle des « 3 P » ?
M. Jean-Luc Barçon-Maurin. Le simple fait de posséder un site internet n’est pas suffisant pour affirmer que l’association se conduit comme une entreprise du secteur privé. Il faut un faisceau d’indices. Dès lors que le site d’une association n’est pas truffé de liens renvoyant à des sites commerciaux mais se contente de livrer des informations sur ses activités, l’association ne saurait être inquiétée. En revanche, des sites qui se révéleraient être les faux nez d’entreprises privées seraient pris en considération pour statuer sur la situation fiscale de l’association.
M. Stéphane Créange. De plus, la publicité est le dernier critère examiné.
Le rapport parlementaire sur l’impact du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif révélait combien il est difficile de comparer la fiscalité d’un organisme qui peut payer la taxe sur les salaires mais ne paie pas d’impôts commerciaux, avec la fiscalité d’une entreprise qui, intervenant dans un secteur proche, sera soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), à la TVA ou à la contribution économique des entreprises (CET) tout en bénéficiant éventuellement du CICE.
De plus, si l’association a une activité d’intérêt général sans but lucratif, elle ne peut entrer en concurrence avec le secteur commercial. Si elle le faisait, des entreprises du secteur concurrentiel pourraient porter plainte et demander l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux. Il s’agit de situations antinomiques : leur interaction est complexe.
Nous traitons à l’heure actuelle la question de la territorialité des dons dans le cadre du mécénat du fait que la réglementation française n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. En effet, selon un arrêt de 2009, les dons d’argent entrent dans le cadre de la libre circulation des capitaux : il n’est donc pas possible, comme le fait la législation française, de ne viser que les dons à des organismes uniquement situés en France ou, s’ils étaient situés au sein de l’Union européenne, exerçant une activité en France. La conditionnalité d’exercice obligatoire en France, pour être doctrinale, n’est pas conforme au droit communautaire.
C’est pourquoi nous clarifions actuellement notre doctrine : pour faire simple, je dirai qu’une association qui exerce dans l’Union européenne égalera une association exerçant en France. Par exemple, un particulier désireux d’aider une association autrichienne d’action culturelle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt si toutes les autres conditions que doivent remplir les associations françaises le sont également par cette association autrichienne, ce qui ne sera pas sans soulever le problème concret du contrôle.
La doctrine devra également traiter la question des associations, notamment humanitaires, œuvrant à l’international. Les services de la DGFiP mènent ce travail, dans l’objectif de stabiliser les réponses aux questions d’ordre juridique avant de procéder à une consultation externe du monde associatif.
Cette évolution de la doctrine soulève une dernière question, peut-être théorique : celle du « marché des dons », c'est-à-dire de la concurrence internationale entre les associations pouvant bénéficier du mécénat. En effet, le portefeuille des donateurs n’étant pas extensible, si de l’argent est versé à une association hongroise ou roumaine, c’est le contribuable français qui financera l’aide à cette association européenne, puisque c’est lui qui, en dernier ressort, finance toute réduction d’impôt. Nous sommes toutefois contraints par le droit communautaire.
M. le président Alain Bocquet. Je vous remercie, messieurs.
Table ronde thématique « Financement participatif » :
M. Nicolas Lesur, président de Financement participatif France ;
M. Mathieu Maire du Poset, directeur général adjoint d’Ulule ;
M. François Desroziers, co-fondateur de SPEAR ;
M. Ismaël Le Mouël, président de HelloAsso
(séance du 7 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir M. Nicolas Lesur, président de Financement participatif France, M. Mathieu Maire du Poset, directeur général adjoint d’Ulule, M. François Desroziers, co-fondateur de SPEAR, et M. Ismaël Le Mouël, président de HelloAsso.
Si Ulule, SPEAR et HelloAsso sont des structures directement impliquées dans le montage d’opérations, Financement participatif France est une association loi de 1901 qui a pour objectif la représentation collective, la promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs du financement participatif, notamment auprès des autorités. C’est en quelque sorte la tête de réseau du mouvement.
Messieurs, nous souhaitons vous entendre sur le développement de ce mode de financement au profit des associations, sur les opportunités que vous leur offrez et sur les limites que vous y voyez.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(MM. Nicolas Lesur, Mathieu Maire du Poset, François Desroziers et Ismaël Le Mouël prêtent serment)
M. Nicolas Lesur, président de Financement participatif France. Financement participatif France, association qui existe depuis deux ans, regroupe environ 90 membres. Elle est composée pour moitié de plateformes de finance participative, opérateurs qui permettent à des porteurs de projet de trouver des financements grâce à Internet, et pour l’autre moitié de partenaires, c’est-à-dire de personnes physiques ou morales qui ont le souhait de promouvoir la finance participative. Il peut s’agir de banques comme le Crédit coopératif, de réseaux d’accompagnement, par exemple Réseau Entreprendre ou Initiative France, ou encore de structures de financement comme l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).
Face à l’émergence du mouvement de la finance participative, notre association souhaitait structurer les plateformes autour d’un code de déontologie. Celui-ci est signé par l’ensemble de ses membres. Il précise la manière dont nous estimons collectivement qu’il est responsable d’exercer ce métier en France. Nous avons ensuite rédigé un Livre blanc que nous avons transmis aux pouvoirs publics. Cela a débouché sur des réformes qui sont entrées en application tout récemment. Ces évolutions concernent moins directement le monde associatif que celui des entreprises puisqu’elles s’adressent surtout à ceux qui exercent le crowdfunding dans le métier des titres financiers ou le métier du prêt.
La finance participative est un moyen pour un porteur de projet, que ce soit une association, un individu, une collectivité locale, une institution culturelle ou une entreprise, de réunir des fonds via Internet pour financer un projet déterminé auprès d’une communauté de personnes, donc des internautes, qui peuvent être soit des proches, soit de parfaits inconnus.
Il existe différents systèmes permettant de collecter ces fonds. On a coutume de se diviser en trois grands métiers : le métier du don, le métier du capital et le métier du prêt.
Le métier du prêt permet aux internautes de prêter de l’argent, avec ou sans intérêts, au porteur du projet. Le métier du capital permet d’investir en achetant des titres de l’entreprise. Il s’agit souvent de start-up, mais pas uniquement. Enfin, le métier du don permet de donner de l’argent, avec ou sans contrepartie définie par le porteur du projet.
L’association Financement participatif France réalise tous les six mois un baromètre qui permet de mesurer le montant des fonds collectés et la manière dont ils le sont. Le dernier baromètre date du 30 juin dernier. Au premier semestre 2014, un peu plus de 66 millions d’euros ont été collectés par l’intermédiaire des plateformes de financement participatif, soit une hausse de 100 % par rapport à la période similaire de l’année précédente. On estime que 150 millions d’euros auront été collectés pour l’année 2014.
Cette croissance extrêmement soutenue a tendance à s’accélérer. Nous considérons que nous sommes au début d’un phénomène général qui permettra de collecter de plus en plus d’argent. 6 milliards de dollars devraient être collectés dans le monde en 2014 par l’intermédiaire du crowdfunding, soit un quasi-doublement par rapport à l’année précédente.
Depuis le démarrage du crowdfunding en France, environ un million de Français ont déjà contribué à un projet, que ce soit sous forme de don, de capital ou de prêt. Ce mouvement commence à susciter l’adhésion collective.
Le monde associatif a été l’un des premiers à utiliser ce mode de financement. Il a recours essentiellement aux plateformes de dons. Mais des systèmes lui permettent aussi d’obtenir des prêts rémunérés ou non. À ma connaissance, il se tourne peu vers l’investissement en capital.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une tendance émergente qui a vocation à se développer fortement.
M. Mathieu Maire du Poset, directeur général adjoint d’Ulule. Ulule est une plateforme généraliste qui permet à des personnes de soutenir des projets en échange de contreparties non financières. Ces contreparties sont soit symboliques, soit des objets physiques liés au projet lui-même.
Les porteurs de projet sont soit des particuliers, soit des associations, soit des entreprises. 55 % des projets présents sur notre plateforme sont à caractère culturel, 12 à 13 % sont des projets solidaires, humanitaires, les autres étant des projets entrepreneuriaux au sens large du terme puisqu’il peut s’agir de projets liés à la mode, au journalisme, à l’agriculture, à la restauration, à la technologie, etc. Depuis quatre ans qu’Ulule existe, nous avons déjà financé plus de 6 000 projets auprès de 500 000 membres, pour une collecte totale de 21 millions d’euros.
Les associations présentes sur notre plateforme œuvrent dans tous les domaines : humanitaire, solidaire, spectacle vivant, musique. Depuis sa création, Ulule a lancé au total près de 1 600 projets portés par des associations, dont un peu plus de 1 200 pour la seule année 2014, contre 380 en 2013. Sur ces 1 600 projets, 1 072 ont été financés. Le système est simple : le porteur de projet explique pourquoi il a besoin de fonds – par exemple pour acheter un local. Puis il a une période déterminée – 35 à 45 jours – pour collecter ces fonds. Si à la fin de la période le montant demandé n’est pas atteint, l’opération est dite blanche ; les internautes sont remboursés et la plateforme ainsi que le porteur de projet ne touchent rien. Par contre, si la somme a été atteinte ou dépassée, le porteur de projet encaissera les fonds et les internautes recevront les contreparties promises.
De nombreuses associations, petites et moyennes, viennent collecter des fonds par notre intermédiaire parce qu’elles ne savent pas comment s’y prendre et qu’elles n’ont pas les moyens juridiques ni transactionnels de le faire facilement. Nous leur proposons un outil de collecte avec paiement par carte bleue, chèque, PayPal, bref : des outils qu’elles n’ont pas nécessairement à leur disposition. De même, de plus en plus de grandes organisations non gouvernementales (ONG) utilisent notre plateforme, comme la Croix-Rouge, Médecins du monde, le World Wildlife Fund (WWF), car c’est pour elles une façon de multiplier leurs sources de collecte. L’essentiel de ces projets concerne aujourd’hui, d’une part le monde solidaire et humanitaire, d’autre part le spectacle vivant et la musique.
Nous travaillons beaucoup sur de petits et moyens projets puisque la somme moyenne collectée par projet sur notre site est de 4 000 euros, même si ce montant représente déjà beaucoup pour de petites associations. Le record de collecte sur notre plateforme est de près de 700 000 euros. Le porteur de projet, la nature du projet, la communauté qu’il a bâtie autour de lui vont évidemment jouer sur sa capacité à récolter des fonds importants.
Certains porteurs de projet viennent sur notre plateforme chercher la totalité des fonds dont ils ont besoin pour financer leur projet. Mais elle est de plus en plus souvent utilisée pour trouver des fonds complémentaires par rapport à tout ce qui existe déjà – subventions, prêts bancaires, etc.
M. François Desroziers, co-fondateur de SPEAR. SPEAR, acronyme de Société pour une épargne activement responsable, est une coopérative de crowdfunding solidaire qui permet à des épargnants une totale transparence sur l’utilisation de leur argent et à des porteurs de projet – que l’on qualifie de responsables –, dont certains appartiennent au monde associatif, d’avoir accès à des financements bancaires avantageux.
SPEAR a été créée en février 2012 à la suite de deux constats. Le premier, c’est le manque de transparence bancaire. Si vous avez de l’argent en banque, vous connaissez sans doute la liquidité de votre produit et son taux d’intérêt, mais vous n’avez aucune idée de ce que la banque fait de votre argent. Le rôle de SPEAR est de permettre à des épargnants de connaître la destination de leur argent et surtout de choisir à quel projet responsable ils vont pouvoir affecter leur épargne. Si l’on récolte de l’argent, c’est pour en faire quelque chose.
Deuxièmement, ces porteurs de projets que l’on qualifie de responsables, c’est-à-dire qui répondent à une problématique sociale, culturelle ou environnementale, n’ont pas nécessairement d’incitation financière à exister. Lorsqu’ils se confrontaient au secteur bancaire classique, leur activité extra-financière – par exemple l’insertion, la réduction de l’empreinte carbone, l’accès facilité à la culture – était souvent considérée comme un facteur de risque. Du coup, soit ils se heurtaient à des difficultés pour emprunter, soit ils empruntaient mais à des taux plus élevés. SPEAR souhaitait permettre à ces acteurs d’avoir un meilleur accès au crédit et un taux de crédit moins élevé du fait de leur impact social.
SPEAR se trouve sur un segment de marché assez spécifique. C’est en quelque sorte un ovni dans l’univers de la finance participative puisque ce n’est pas un intermédiaire. Nous travaillons en effet avec des banques partenaires. Lorsqu’un porteur de projet nous présente son besoin financier, nous étudions bien évidemment sa demande avant de la transmettre à nos partenaires bancaires. Actuellement, nous travaillons avec le Crédit coopératif, la Société générale, la BNP, CMP-Banque. C’est notre partenaire bancaire qui valide notre analyse financière. Tous les projets présents sur notre site Internet ont été validés par une banque partenaire de SPEAR. Ensuite une opération de crowdfunding est menée, c’est-à-dire que des épargnants choisissent le projet pour lequel ils vont épargner. Le rôle de SPEAR est d’utiliser cette liquidité pour diminuer le taux d’intérêt du porteur de projet auprès de ses partenaires bancaires.
SPEAR travaille dans le secteur de l’entreprenariat social, de l’économie sociale et solidaire et fait face à diverses typologies de structures. Nous finançons pour 80 % des entreprises et pour 20 % des associations. Les associations œuvrent principalement dans le secteur médico-social et dans le logement social. Les types de projets sont principalement d’ordre immobilier parce que ce sont les partenaires bancaires qui financent l’immobilier et que la prise de garantie est facile pour une banque. Le projet moyen d’une association chez SPEAR est de l’ordre de 250 000 euros. Depuis février 2012, date de notre lancement, nous avons soutenu une vingtaine de projets, ce qui représente un encours de crédit de 3,8 millions d’euros. Nous avons collecté plus de 2,5 millions auprès de plus de 500 personnes pour soutenir ces projets responsables.
Pour notre part, nous notons une transformation du secteur associatif. Comme vous le savez, les subventions diminuent ; il faut donc renouveler le modèle de financement, si ce n’est le modèle économique. Nous sommes confrontés à une problématique assez spécifique puisque nous intervenons sur du crédit bancaire, donc sur des associations qui sont des objets économiques en tant que tels, c’est-à-dire un modèle économique et une capacité de remboursement. L’une des grandes faiblesses du secteur associatif est l’absence de fonds propres qui peuvent être investis à très long terme. Les associations n’ont pas eu le réflexe de se constituer des fonds propres puisque la notion d’excédent n’existait pas réellement. Elles n’ont donc pas de matelas de sécurité qui leur permettrait de diversifier leurs sources de financement et de faire appel au crédit bancaire.
Nous avons constaté également qu’elles se professionnalisent, ce qui est nécessaire. Le secteur associatif se rationalise et se structure de plus en plus. Nous nous réjouissons de voir que de nombreuses associations commencent à se structurer en groupements d’associations pour mutualiser certains postes comme le poste comptable et qu’elles mettent en place des systèmes plus professionnels, ce qui leur permet d’être plus crédibles et de faciliter leur accès au crédit. Il est nécessaire d’accentuer ce processus, car il facilite l’accès à la ressource bancaire.
SPEAR est un intermédiaire entre le secteur bancaire et le secteur de l’économie positive. Ce secteur est confronté à un manque de visibilité, de compréhension par la foule mais aussi par les financeurs classiques. Nous avons un rôle pédagogique auprès de l’association afin de l’aider à avoir une structuration financière, un budget prévisionnel équilibré, un plan de trésorerie, etc. mais également auprès des banques qui découvrent ce monde et apprennent ce qu’est une entreprise d’insertion sous forme associative et ses spécificités. Si elles ne prêtaient pas à ce secteur, c’était plus par méconnaissance que par le risque trop important qu’il peut représenter.
M. Ismaël Le Mouël, président de HelloAsso. Je suis le fondateur de HelloAsso, première plateforme de financement participatif en France dédiée aux associations. Ce secteur nous intéresse tout particulièrement parce que c’est lui qui a inventé le crowdfunding. À mes yeux, le crowdfunding n’existe pas depuis dix ans, mais depuis des centaines d’années. J’en veux pour preuve que la Statue de la Liberté ou l’église de la Sagrada Familia ont été financées par le crowdfunding. Cela fait des centaines d’années que les associations collectent des fonds !
Le financement participatif est un nouvel outil qui permet de collecter des fonds de manière plus simple, plus rapide et plus efficace, via Internet. Notre mission consiste à accompagner les quelque 1,3 million d’associations françaises dans cette mutation pour leur permettre de collecter efficacement des fonds en ligne.
En France, le secteur associatif représente aujourd’hui un budget annuel cumulé de 70 milliards. Plus de la moitié des ressources financières des associations sont d’origine privée, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers. Ce sont donc plus de 35 milliards d’euros par an qui sont collectés en France par les associations. Cela montre bien que le crowdfunding n’a pas été inventé il y a cinq ans.
Nous avons souhaité que notre plateforme soit dédiée uniquement au monde associatif car le crowdfunding brouille un peu les cartes du secteur associatif et la notion de don. Jusqu’à présent, le don était destiné au secteur associatif. Dorénavant, on peut donner à un particulier, à une entreprise. Mais quoi qu’on en dise, la poche des contribuables n’est pas extensible. Quand on finance un autre type de projet, c’est probablement autant d’argent en moins pour le secteur associatif.
Comme vous le savez sans doute, le comité de la charte a érigé certaines règles éthiques en ce qui concerne la collecte de fonds, l’une de ces règles étant de ne pas prendre de commission sur les montants collectés. Or les plateformes historiques existantes prennent des commissions souvent importantes – environ 8 % – sur les dons versés aux associations. Prélever 8 % sur une somme de 35 milliards, ce n’est pas négligeable. Nous considérons que le crowdfunding est une menace pour les associations si elles ne prennent pas le bon virage de cet univers en pleine mutation. C’est pourquoi HelloAsso a décidé de reverser aux associations la totalité des montants collectés sur sa plateforme. Notre modèle repose sur une contribution au pourboire : le donateur a la possibilité de laisser une contribution volontaire, s’il le souhaite.
Nous accompagnons aujourd’hui un peu plus de 3 400 associations et nous collectons 500 000 euros par mois. Jusqu’à présent, nous avons rassemblé 7,5 millions d’euros.
Comme vous le savez, l’appel à la générosité du public sur Internet demande une déclaration en préfecture, ce qui génère des questions de la part des associations. Elles se demandent pourquoi faire une telle déclaration alors qu’elles ne s’adressent pas à un public au niveau national. Même si quelques internautes parlent du projet sur Facebook, ce n’est pas une campagne nationale. Un moyen très simple qui permettrait d’augmenter la collecte consisterait à lever ce verrou, c’est-à-dire à supprimer cette déclaration.
M. Jean-Luc Bleunven. Messieurs, je vous remercie pour votre contribution et vos explications. Effectivement, le financement participatif est en pleine croissance.
Comment sont garantis les prêts ? Il faut gérer le rapport avec les banques.
La question des frais de transaction a été posée. Il y a une question éthique que je comprends très bien. Quelle est la règle pour les autres plateformes ?
M. Régis Juanico. Jeudi dernier a eu lieu ici une table ronde sur le modèle économique et financier des associations. Il est frappant de voir la différence de génération entre vous et les acteurs que nous avons reçus la semaine dernière. Le financement participatif est un mode de financement relativement nouveau, en tout cas il est porté par une nouvelle génération, et il est très intéressant parce qu’en plein développement. Comment mettre en cohérence ces modes de financement émergents, qui fonctionnent bien grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, avec l’existant ?
La loi relative à l’économie sociale et solidaire qui est entrée en vigueur récemment ne vise pas seulement à reconnaître les acteurs et à inclure d’autres acteurs se reconnaissant dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire ; elle permet aussi de créer de nouveaux moyens de développement et de financement. Comment vous situez-vous par rapport aux modes de financement que sont les fonds de la Banque publique d’investissement (BPI), le Fonds pour l’innovation sociale, le Programme des investissements d’avenir (PIA), les fonds propres et fonds d’épargne salariale ? Comment articulez-vous ces modes de financement avec ce que vous pouvez proposer au secteur associatif ?
M. Jean-Louis Bricout. Je veux revenir sur la transparence. Nos concitoyens reçoivent souvent beaucoup de publicités concernant des appels à dons et se posent des questions sur les frais que cela engendre. Comment exercez-vous cette transparence ?
Connaissez-vous le poids du financement participatif par rapport aux autres types de financement ?
M. Nicolas Lesur. Le crowdfunding est fondé sur un principe de transparence, c’est-à-dire qu’un porteur de projet qui met en ligne sa campagne affiche aux yeux du monde entier qui il est et ce qu’il compte faire de cet argent. Il va mobiliser plus que de l’argent : des personnes qui vont le soutenir autrement que financièrement. Par exemple, quelqu’un va demander à un ami de s’engager, comme lui, à verser un don à une association, etc.
Vous avez raison de dire que c’est un phénomène générationnel. Toutes les plateformes constatent en effet que les contributeurs et les porteurs de projet sont significativement plus jeunes que leurs équivalents plus traditionnels. Ils ont besoin de donner du sens à leur argent, de savoir à quoi il sert exactement et d’être acteurs de leurs économies, qu’il s’agisse de quelques euros ou de milliers d’euros.
S’agissant de l’équilibre entre le financement participatif et les sources traditionnelles de financement associatif, il serait extrêmement présomptueux de notre part, au regard des montants collectés à ce jour, de penser que le crowdfunding pourrait contribuer à hauteur de 75 milliards d’euros au financement du monde associatif. Ce sera peut-être le cas un jour, mais pour le moment le financement participatif est un outil nouveau qui s’ajoute à toute la palette des financements possibles et qui se fait souvent de façon très complémentaire. Dans le cadre d’un projet d’entreprise, le fait de réussir une campagne de crowdfunding aide souvent à convaincre d’autres financeurs de la pertinence d’un projet.
Quant aux garanties, tout dépend des modèles des différentes plateformes. Le crowdfunding repose sur une forme de désintermédiation, c’est-à-dire que l’on crée un lien direct entre des personnes qui donnent, investissent ou prêtent, et un porteur de projet, que ce soit une association, une entreprise ou un individu. Il y a une forme de « pression de la foule » pour que les choses se passent bien. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu’il n’y a pas de risque, mais c’est une autre manière de l’appréhender. Dans le crowdfunding, on ne confie pas son argent aveuglément à un tiers, on est dans un système où le donateur, l’investisseur, le prêteur assume l’engagement qu’il prend financièrement et la part de risque qui peut être associée – à chaque plateforme d’imaginer d’autres systèmes pour adoucir cette partie-là.
Presque toutes les plateformes de crowdfunding prélèvent une commission pour la raison simple que le système se veut le plus souple et le plus rapide possible. Il ne s’agit donc pas d’aller négocier à la petite semaine des contreparties et des contrats. J’ajoute que la plupart des plateformes qui exercent en France ne sont pas rentables aujourd’hui parce que la fabrication de tels systèmes nécessite des investissements, des compétences humaines. Dans la plupart des cas, plusieurs dizaines de millions d’euros sont nécessaires pour amortir ces systèmes. Aujourd’hui, très peu d’acteurs se demandent s’ils doivent fonctionner différemment, car le système des commissions est assez banalisé sur Internet et il a le mérite de la transparence. En vérité, le taux de commission peut être de 3 à 4 % sur certaines plates-formes et de 8 % sur d’autres, sachant que sur ces 8 %, 3 % représentent les frais de transaction. La plateforme reçoit donc en fait 5 %.
M. Mathieu Maire du Poset. Le mode de communication, notamment des grandes associations, change, car les collectes ne se font pas au nom de l’association, mais sur un projet bien précis. Par exemple, le WWF communique actuellement pour sauver les éléphants de Tanzanie et la Croix-Rouge lance une campagne de collecte afin de construire une banque céréalière en Tanzanie. Ces associations expliquent quel est leur projet précis et à quoi vont servir très exactement les fonds. Cela permet aux personnes qui apportent leur soutien à un projet de rentrer dans des histoires et dans un système d’aide très différent. Elles peuvent avoir envie de soutenir la Croix-Rouge pour son projet en Tanzanie parce que cette cause les touche plus que celle des éléphants, ou inversement.
Le terme de don a été employé à plusieurs reprises. Une plateforme comme Ulule ne demande pas un don mais un soutien en échange d’une contrepartie non financière ou symbolique. Par exemple, si je soutiens un artiste à hauteur de 15 euros, je recevrai comme contrepartie son album en MP3 ; si je le soutiens à hauteur de 25 euros je recevrai son CD, etc. La contrepartie dépendra du montant du soutien. Au plan légal, 95 % des ventes réalisées sur Ulule sont des préventes. Les associations représentent un cas particulier, puisque tout dépend de leur statut. En général, elles n’ont pas le droit de faire de la vente, ou très peu. Le plafond annuel est relativement limité puisqu’il est de 60 000 euros. Les associations qui ont le droit émettent des reçus fiscaux. Dans ce cas, la contrepartie proposée sera très symbolique puisqu’elle doit avoir une valeur faciale inférieure à 25 % du soutien qui a été apporté. Concrètement, la contrepartie que recevra une personne qui aura donné 100 euros devra être inférieure à 25 euros dans la limite de 65 euros maximum. Pour ces associations, cela modifie un peu la mécanique réelle du financement participatif telle qu’elle fonctionne dans les autres domaines. Jusqu’à présent Ulule était la seule à être totalement légale dans la mesure où les fonds ne transitent jamais par nous. Il existe deux façons de collecter les fonds : soit par un agrément bancaire, soit par l’intermédiaire d’un partenaire transactionnel qui a l’agrément bancaire. C’est le cas d’Ulule. C’est pourquoi des associations comme la Croix-Rouge ou le WWF ont choisi notre plateforme.
Notre commission est de 8 % toutes taxes comprises. Pour ce qui nous concerne, nous sommes sur une compétition a minima européenne et en fait mondiale puisqu’il existe de très grandes plateformes, dans le monde anglo-saxon notamment. Notre outil doit être avant tout simple d’utilisation et les gens doivent pouvoir y partager le projet pour qu’il soit diffusé. Comme nous accompagnons beaucoup les porteurs de projet, que nous les conseillons sur la façon dont il faut faire une collecte en ligne, comment la réussir, comment communiquer, nous avons un coût humain important.
Vous avez évoqué l’aspect générationnel. Plus de 18 % des gens qui nous soutiennent ont plus de 60 ans. Ils sont plus nombreux que les moins de 25 ans, mais cela tient au fait qu’en général les plus de 60 ans ont davantage d’argent. Le public âgé est aussi très présent sur ces plateformes, soit parce qu’il est très engagé dans le monde associatif, soit parce qu’il fait partie du premier cercle des porteurs de projet – grands-parents, parents, etc.
M. François Desroziers. Je souhaite revenir sur la question des garanties. SPEAR travaille avec des acteurs bancaires qui cherchent à se garantir sur tel ou tel niveau. Cela passe par des mécanismes très classiques de prise d’hypothèque, mais aussi des contre-garanties que l’on peut obtenir auprès d’acteurs publics, semi-publics ou privés. Ce processus est très spécifique à SPEAR et n’est pas très présent dans la sphère de la finance participative. Globalement tout se passe bien, tout est transparent : si je ne rembourse pas, on pourra venir me chercher. L’opération doit être simple, effectuée en peu de clics, et le mode de paiement doit être facile également. Prévoir une garantie suppose un mécanisme complexe, d’avoir compris le risque auquel on est exposé, de définir le niveau de garantie que l’on accepte de prendre. Tout cela est trop compliqué et pas forcément adapté au financement participatif classique. Pour notre part, c’est l’une de nos spécificités.
Vous nous avez demandé comment se positionne la finance participative par rapport à des acteurs comme la BPI, le PIA et les fonds d’épargne salariale. La finance participative se fonde sur la transparence. Je le répète, SPEAR traite des objets économiques qui ont des comportements assez similaires à ceux des entreprises puisqu’ils versent des salaires et ont un modèle économique, etc. Il faut une diversité des ressources financières, prévoir des subventions d’investissement qui sont considérées comme des fonds propres. La loi relative à l’économie sociale et solidaire a renouvelé le titre associatif. D’ailleurs, je vous invite, en tant que législateurs, à apporter au titre associatif une logique défiscalisante, tout comme on peut défiscaliser un investissement en investissant dans une PME ou une TPE en phase d’amorçage ou de développement avec les dispositifs Madelin et TEPA.
Nous sommes ravis de la diversité des acteurs qui viennent compléter les modes de financement d’une association. Mes grands-mères me disaient de ne pas « mettre tous mes œufs dans le même panier ». Plusieurs typologies de financement sont donc nécessaires. Le tout crowdfunding, le tout bancaire ou le tout fonds propres n’est pas possible. Il faut donc préserver cette diversité. J’ajoute que le crowdfunding est complémentaire car il est transparent. Les fonds d’épargne salariale doivent investir 5 à 10 % de leurs encours dans des associations ou des entreprises qui ont l’agrément d’entreprise solidaire. Aujourd’hui, cela représente environ 4 milliards d’euros en France. Pourquoi ne pas permettre à des salariés de l’entreprise de choisir le projet dans lequel ils vont investir leur épargne salariale solidaire ? Beaucoup de choses sont possibles avec le crowdfunding puisqu’il repose sur la transparence, la simplicité et l’interactivité. C’est la première fois que je sais où va mon argent et que je peux lui parler. Certains de nos porteurs de projet font visiter leur entreprise, leur association à leurs épargnants. Par exemple, ils les invitent à la pose de la première pierre du bâtiment basse consommation qu’ils construisent. On crée du lien social par l’argent. Il faut superposer les différents outils qui ne sont pas du tout en concurrence.
M. Ismaël Le Mouël. L’un des intervenants a indiqué que pour être rentable une plateforme ne pouvait pas baisser sa commission et que le financement participatif reposait sur une forme de désintermédiation. Vous comprendrez que je ne sois pas du tout d’accord avec ce raisonnement. Cela ressemble beaucoup aux arguments utilisés par Airbnb, BlaBlaCar et Uber à leurs débuts. Or on en voit actuellement les dérives. De nouveaux intermédiaires sont en train de prendre des situations de monopole, ce qui est assez dérangeant pour le secteur associatif.
En ce qui concerne l’aspect générationnel, en France un donateur a en moyenne 60 ans. Bien sûr, HelloAsso a remarqué que ses donateurs sont beaucoup plus jeunes, mais les jeunes ne font pas beaucoup la différence entre un don à une association, à une entreprise ou à un particulier, ce qui pose la question du financement du secteur associatif dans les années futures.
HelloAsso est l’organisateur de la Social Good Week, événement dédié aux solidarités numériques et qui comporte une trentaine de manifestations un peu partout en France. De cet événement est né un incubateur, le Social Good Lab, qui est dédié à tous les projets qui utilisent de nouvelles technologies pour avoir de l’impact social. C’est l’un des incubateurs de Paris Région Lab.
Lorsque l’on propose un appel à projet pour des projets d’innovation sociale, nous avons constaté que des entreprises mais aussi des associations postulaient. En effet, en raison de la baisse des financements publics, les associations doivent trouver un modèle économique ; elles entrent donc dans des logiques d’innovation sociale. Il serait intéressant de voir dans quelle mesure les fonds alloués par la BPI, le PIA, les avances remboursables, etc. pourraient être ouverts aux associations qui savent innover aussi bien que les entreprises. Je ne vois pas à quel titre on pourrait déclarer que ces associations ne méritent pas, de par leur statut, de percevoir une l’aide à l’innovation.
M. Mathieu Maire du Poset. Le Comité de la charte est en cours de réflexion sur toutes ces questions afin de faire évoluer les plateformes de crowdfunding face à la demande de nombreuses associations.
Vous nous demandez comment articuler les différents types de financement. Nous avons mené une expérience avec l’association Auvergne Nouveau Monde, qui est chargée du développement de la région Auvergne, pour savoir comment articuler le financement des associations ou des entreprises entre le public, le privé et la foule. Nous lancerons pour la quatrième année un appel à projets avec cette association au mois de novembre prochain. L’année dernière, plus d’une soixantaine de projets ont été financés. Ils ont permis d’activer ces trois leviers en même temps pour faire accélérer fortement des projets associatifs notamment. Le crowdfunding vient valider, à un moment donné, le projet. Lorsque je soutiens sur une plateforme un projet en tant que citoyen, j’ai envie que des entreprises ou l’État viennent conforter ce projet. Je pense qu’il serait intéressant de développer ce point.
M. le président Alain Bocquet. Messieurs, je vous remercie pour vos contributions.
Table ronde thématique « Bénévolat » :
M. Dominique Thierry, président, et Mme Brigitte Duault,
déléguée générale de France Bénévolat ;
Mme Édith Archambault, universitaire.
(séance du 16 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Nous accueillons ce matin, à l’occasion de la présente table ronde consacrée au bénévolat, M. Dominique Thierry, président, et Mme Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat, ainsi que Mme Édith Archambault, universitaire. France Bénévolat contribue à faire reconnaître en France le rôle primordial du bénévolat dans la vie associative, accompagne les associations dans la recherche et la gestion de leurs bénévoles, et oriente les candidats au bénévolat. Mme Archambault est un pilier de la recherche française sur les associations et coauteur du rapport du Conseil national de l’information statistique sur la connaissance des associations de décembre 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander, mesdames, monsieur, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Brigitte Duault, Mme Édith Archambault et M. Dominique Thierry prêtent serment)
Mme Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat. France Bénévolat est impliqué dans le développement de l’engagement bénévole associatif. Nous sommes une association d’associations qui a pour ambition d’accompagner ses partenaires associatifs, et l’ensemble du monde associatif, dans l’accueil et l’intégration des bénévoles, qui sont la première ressource des associations, à hauteur de 85 %. Nous conduisons, pour accompagner les associations, un travail permanent de veille et de prospective sur les évolutions quantitatives et qualitatives dans le domaine, afin de leur permettre de s’adapter et de mettre en œuvre des pratiques correspondant aux nouvelles modalités existantes.
En 2010, estimant que nous ne disposions pas de données suffisantes, celles que nous utilisions remontant à l’enquête INSEE de 2002, nous avons décidé de conduire dorénavant tous les trois ans une enquête comparative en partenariat avec l’IFOP : la première a été réalisée en 2010, la suivante en 2013. Ces enquêtes quantitatives nous ont apporté trois enseignements.
Le premier, c’est que le bénévolat n’est pas en crise. À notre grande surprise, nous avons en effet constaté que le nombre de bénévoles associatifs avait augmenté de 12 %, passant de 11,3 à 12,7 millions. En outre, de nombreuses personnes donnent du temps en dehors des associations – c’est ce que l’on appelle le bénévolat informel ou direct, ou encore bénévolat de proximité. Le second enseignement, c’est que c’est ce bénévolat de proximité qui est à l’origine de la croissance des effectifs. Un tel phénomène est vraisemblablement lié aux évolutions de notre société, à l’essor du numérique, à l’accélération des échanges, qui impactent les manières d’agir. Le troisième enseignement, c’est que le bénévolat ponctuel augmente davantage que le bénévolat régulier, ce qui peut représenter une difficulté pour le monde associatif.
Face à ces constats, que préconiser ? Le bénévolat direct concerne 9,3 millions de personnes, sur 21 millions de bénévoles. C’est là, pour les associations, une source de ressources humaines potentielles. Il convient donc d’examiner les moyens de mieux articuler les deux formes d’engagement. Pour que ce bénévolat direct, plus mobile, devienne régulier, il faut faire ce que nous appelons de la pédagogie de l’engagement.
Cela nous conduit aux études qualitatives que, notamment avec le réseau Recherche & Solidarités, nous conduisons chaque année. Nous constatons que les motivations des personnes qui décident de donner de leur temps varient en fonction de l’âge. Les jeunes sont souvent dans un élan de solidarité, mais ils ont tendance à refuser de s’engager de manière régulière dans un cadre rigide. Ils sont dans des temps de vie plus instables, mobiles, et s’engagent moins facilement sur le long terme. Ce qu’ils aiment avant tout, c’est se voir confier des responsabilités, c’est qu’on leur fasse confiance et que l’on reconnaisse leurs compétences. Leur expérience bénévole peut être valorisée lors de la première recherche d’emploi. Pour les actifs, ensuite, qui n’ont pas forcément beaucoup de temps, la question du sens est importante : 40 % des actifs qui s’engagent dans le bénévolat disent avoir besoin de sens, besoin d’humain. Ils souhaitent également transmettre les compétences acquises dans leur vie professionnelle ; cet élan de solidarité est probablement l’un des effets de la crise. Enfin, les seniors ont quant à eux besoin de retrouver du lien social. L’une de nos recommandations, c’est de développer, dans l’entreprise ou au dehors, la préparation à la retraite, afin que les personnes se projettent dans ce qui peut devenir un deuxième projet de vie.
Le meilleur message que l’on puisse envoyer aux associations, c’est, tel qu’il a été exprimé par l’un de nos responsables, qu’un bénévole régulier est un bénévole ponctuel que l’association aura su élever.
M. Dominique Thierry, président de France Bénévolat. L’engagement du bénévole associatif a trois finalités. La première, c’est qu’il s’agit d’une ressource indispensable pour le développement associatif. Brigitte Duault a rappelé que 85 % du personnel associatif est bénévole : depuis trente ans, avec 15 % de monétaire, le monde associatif a un retour sur investissement de 600 %. Au passage, si ces 15 % ne sont pas maintenus, le monde associatif mourra. Le fait que la moitié des associations nous dise avoir besoin de davantage de bénévoles est pour nous très positif car cela témoigne d’une véritable dynamique associative. La seconde finalité, c’est que l’engagement bénévole est un formidable facteur d’inclusion sociale. L’un de nos slogans évoque « le droit au bénévolat pour tous » ; ce droit n’est pas respecté aujourd’hui. Enfin, le bénévolat est un facteur essentiel d’éducation, en particulier d’éducation des jeunes et d’éducation à la citoyenneté. Il est important que les associations n’oublient pas ces trois facteurs, qu’elles n’en restent pas au premier, à l’instrumentalisation du bénévolat.
Le premier impact du bénévolat concerne les autres, par le biais de la solidarité : les bénévoles s’occupent d’enfants, de personnes âgées… Mais l’impact est aussi pour le bénévole lui-même, car le bénévolat est un facteur d’inclusion, de développement de compétences et de création de lien social. Le demandeur d’emploi bénévole se dit qu’il existe parce que qu’il fait quelque chose, le retraité bénévole se dit qu’il est utile : c’est de la reconstruction identitaire. Il s’agit aussi de reconnaissance des compétences, avec le passeport bénévole, diffusé à 150 000 exemplaires et à présent reconnu dans les démarches de validation des acquis de l’expérience. Ces deux impacts ne doivent pas être opposés l’un à l’autre. Enfin, le bénévolat a un impact sur les territoires. L’un des axes de notre démarche est de faire en sorte que les associations travaillent davantage ensemble sur des projets transversaux de proximité au sein d’un territoire.
S’il ne souffre pas d’une crise au sens quantitatif, le bénévolat connaît néanmoins de profondes évolutions sociologiques. On s’engage beaucoup plus aujourd’hui qu’il y a soixante-dix ans mais pas de la même façon. Il est nécessaire que les associations s’adaptent.
Nous pouvons en revanche parler d’une crise du renouvellement des dirigeants associatifs. Nous avons conduit une étude sur le sujet en 2008, mais il ne s’est pas passé grand-chose depuis lors. Cette crise a trois causes principales : deux causes externes et une cause interne.
La première externalité négative tient à l’évolution même de la sociologie des bénévoles. Nous avons aujourd’hui affaire à un bénévolat d’action plus qu’à un bénévolat de projet. Les gens veulent bien s’engager sur de l’action, avec une perception tangible d’utilité, d’impact, de retour immédiat, mais le passage au bénévolat de projet, qui nécessite plus de recul et de responsabilité, est un exercice difficile. Cela rejoint notre notion de pédagogie de l’engagement.
La deuxième cause externe tient à la complexité croissante des responsabilités associatives. J’ai passé une bonne partie de ma vie en entreprise : il est presque plus compliqué aujourd’hui d’être président d’association que patron de PME. Il faut savoir trouver des financements, créer du réseau, travailler en équipe… Cela effraie les gens. Plus de la moitié des responsables associatifs sont des retraités, qui ont plus de temps, et, compte tenu de ce que représentent les responsabilités associatives, je suis véritablement admiratif de l’autre moitié. Il conviendrait de rendre moins complexe l’exercice de ces responsabilités.
La troisième raison, propre aux associations, c’est que leur gouvernance n’est souvent pas assez collégiale. Des dirigeants d’associations viennent nous demander de leur trouver des successeurs, comme s’il existait un vivier externe. Nous les appelons à reformuler leur projet associatif et à repenser leur gouvernance dans une logique plus collégiale, à déléguer davantage de responsabilités de façon que le président soit un primus inter pares, qui ne s’occupe pas personnellement de tout. Il faut quitter ce modèle de l’homme providentiel qui serait à chercher au dehors, un modèle repris de l’entreprise, alors que ce n’est pas du tout le modèle du management allemand, par exemple. Le renouvellement de la direction de l’association doit s’appuyer sur ses ressources internes.
Mme Édith Archambault, universitaire. Le travail bénévole est une ressource fondamentale pour les associations employeuses, actuellement au nombre de 185 000, et surtout pour le plus de un million d’associations sans salariés qui ne vivent qu’avec des bénévoles. Les trois quarts du travail bénévole vont à ces dernières.
Le travail bénévole a, au fil du temps, expérimenté des métiers nouveaux. Historiquement, tout le travail social, infirmières et autres, a été expérimenté bénévolement. Aujourd’hui, on le constate pour le bénévolat sportif, qui devient professionnel, et pour les animateurs culturels, désormais recrutés dans le cadre des activités périscolaires, qui représentent beaucoup d’emplois, mal payés, très fractionnés, comme on peut le constater dans les offres d’emploi proposées par les missions locales. C’est vrai aussi de la médiation des conflits et de la prévention de la délinquance, qui deviennent des métiers alors qu’ils étaient exercés à titre bénévole seulement il y a encore vingt ans.
Le bénévolat contribue à la qualité de la vie. Les enquêtes montrent que les bénévoles se trouvent plus heureux et sont en meilleure santé que le reste de la population. Ce peut être dû à un effet de sélection, mais il y a aussi le fait que le bénévolat est épanouissant. Le bénéfice en revient bien sûr à ceux qui reçoivent les services des bénévoles, mais aussi à la société dans son ensemble, car il est important, à une époque de plus en plus individualiste et « marchandisée », que subsiste ce témoignage de gratuité et d’altruisme.
Le bénévolat organisé s’exerce au sein d’une institution, le plus souvent – dans plus de 80 % des cas – une association : sur les 16 millions de bénévoles comptés par l’enquête de la DARES de 2010, 14 millions travaillaient dans des associations. Les autres œuvrent dans des conseils municipaux, des mutuelles et d’autres organisations. Le bénévolat informel, l’entraide entre ménages, ne relève pas de cette commission d’enquête.
Aux États-Unis, le site du Bureau of Labor Statistics présente toutes les statistiques du bénévolat de l’année précédente. En France, il y a eu une enquête de l’INSEE en 2002 et une de la DARES en 2010, cette dernière ayant une orientation plus « économique ». Nos données ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin d’une périodicité plus importante pour connaître au moins les tendances du bénévolat.
Le bénévolat en France s’oriente essentiellement vers les activités sportives, récréatives et culturelles, pour la moitié de l’engagement et du temps de travail bénévoles. Le bénévolat auquel France Bénévolat est plus spécifiquement attaché, concernant la santé et le domaine social, représente seulement 10 % de l’engagement associatif mais le quart du temps de travail : c’est le bénévolat archétypique.
Depuis une dizaine d’années, les pouvoirs publics, qui subventionnent les associations, leur demandent de valoriser leur bénévolat au pied de leurs comptes emplois-ressources. Ce travail est conduit par nombre d’associations de manière un peu désordonnée, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Selon une évaluation monétaire de l’ensemble du travail bénévole, celui-ci représente 1,5 milliard d’heures de travail, soit environ un million d’équivalents temps pleins, et de 1 à 2 % du PIB, selon qu’on valorise ce travail au SMIC ou bien au salaire de l’action sociale ou au tarif des salariés du même secteur associatif. C’est entre dix et quinze fois la générosité publique, pour laquelle il existe de nombreux avantages fiscaux, alors qu’il n’en existe aucun pour les dons de temps. Une plus grande prise en considération des frais engagés par les bénévoles serait sans doute bienvenue.
Depuis vingt ans que l’on s’intéresse statistiquement au bénévolat en France – les premières enquêtes, dans mon laboratoire, remontent à 1990 –, les effectifs de bénévoles ont doublé, passant de 8 à 16 millions. Il y a vingt ans, la perception du bénévolat n’était certes pas aussi claire qu’aujourd’hui, mais il y a indiscutablement une montée de l’engagement bénévole. Elle ne sera pas éternelle. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, pays ayant une forte tradition de bénévolat, celui-ci stagne, voire régresse légèrement. Le secteur associatif a été plus tardif en France et il est normal que notre pays rattrape son retard.
Notre bénévolat est plus masculin que féminin, comme dans les autres pays européens, mais à la différence des pays anglo-saxons, il croît de façon spectaculaire avec le niveau de diplôme et un peu moins avec le niveau de revenus, il est plus présent à la campagne que dans les grandes villes, il culmine dans les régions de tradition catholique, en raison du lien avec la pratique religieuse, et il est héréditaire : une personne ayant un parent bénévole a deux fois plus de chances de l’être elle-même – les héritiers des militants chrétiens d’après-guerre sont actuellement bénévoles dans des associations laïques. Ces caractéristiques sont partagées par l’ensemble des pays européens.
En revanche, les jeunes bénévoles sont sous-représentés en France. Les pouvoirs publics ont certainement là une action à mener, via l’école, comme dans les pays anglo-saxons. Il y a une vingtaine d’années, directrice de mon unité de formation et de recherche à Paris I, j’avais suggéré que l’on considère le bénévolat encadré des étudiants comme unité de valeur, ce qui m’avait valu une volée de bois vert de la part de mes collègues, qui craignaient que cela brade les diplômes, alors même que le sport de haut niveau ou la participation à un orchestre valait unité de valeur. Les choses ont progressé à l’université, mais il faut que la démarche commence beaucoup plus tôt.
M. le président Alain Bocquet. Merci pour ces exposés très riches. Nous en venons aux questions.
M. André Schneider. Je partage votre diagnostic, sur le bénévolat direct, à la carte, l’âge du capitaine, la complexité de la mission du responsable bénévole, et je partage également vos objectifs. Je suis président du mouvement régional du bénévolat d’Alsace-Moselle – la vie associative a beaucoup hérité des traditions germaniques – et vice-président de la fédération nationale du bénévolat associatif. Souvent, dans une situation de crise, on sait établir le diagnostic mais on a du mal à rédiger l’ordonnance. Nous sommes ensemble ici pour cela. Quelles sont vos recommandations pour une reconnaissance rapide du bénévole sous toutes ses formes ?
Mme Marie-Hélène Fabre. Que pensez-vous de la loi sur l’économie sociale et solidaire, et de son apport en matière de bénévolat ? Considérez-vous qu’il serait opportun d’ouvrir le bénévolat avant dix-huit ans, à partir de seize ans ? Le service civique peut-il être, selon vous, un creuset qui permette à des jeunes de s’engager ensuite dans le bénévolat ? Enfin, appelez-vous de vos vœux une volonté politique pour que les statistiques du bénévolat soient mieux prises en compte, notamment pour la reconnaissance des parcours professionnels ?
M. Régis Juanico. L’un des freins à la prise de responsabilités par des bénévoles, à des postes de président, trésorier, secrétaire général, est la complexité et la charge de travail. Il est donc nécessaire de simplifier les dispositifs : quels sont, selon vous, les chantiers prioritaires en matière de simplification administrative ? Par ailleurs, il faut assurer aux bénévoles une formation de qualité, parfois même pointue, dans les domaines juridiques ou financiers ; considérez-vous que cette formation est suffisamment bien assurée ou financée dans notre pays par le biais du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), l’action des régions et départements, ou encore celle des grandes fédérations nationales ?
M. Jean-René Marsac. La distinction entre engagement ponctuel et engagement plus durable est liée, me semble-t-il, à celle entre le service bénévole et la fonction dirigeante, les deux étant souvent confondus aujourd’hui ; il me semble qu’un peu plus de clarté serait bienvenue. Les dirigeants ont-ils vocation à n’être que bénévoles, en toute circonstance ? Ce sont parfois de quasi-chefs d’entreprise. Dans le secteur fédératif, on demande à des responsables d’associations locales d’assumer des responsabilités régionales ou nationales, avec tous les problèmes de gestion que cela entraîne. Si bien que les fédérations sont souvent pilotées par des directeurs de structure, plutôt que par les dirigeants élus qui ont peu la capacité de « monter » dans les différentes instances, ce qui nuit au caractère démocratique du système. Ne faut-il pas avancer vers un véritable statut du dirigeant associatif ? Les associations peuvent déjà rémunérer leurs dirigeants selon un forfait annuel ; faut-il aller plus loin ? instaurer des points-retraite ? Comment permettre à tout un chacun de mieux combiner une activité de salarié d’entreprise avec un engagement à la direction d’une association, sans que la personne soit financièrement pénalisée si elle doit réduire son temps de travail dans l’entreprise ?
Vous avez rappelé, madame Archambault, que le secteur associatif avait beaucoup puisé dans les traditions culturelles, politiques, militantes. Cela me conduit à évoquer le mouvement d’éducation populaire, dont nous sommes nombreux à avoir profité. La dynamique de celui-ci s’est effritée, les nouvelles générations n’y participent plus, alors que l’éducation populaire permet de découvrir ce qu’est le projet collectif, le « faire ensemble », qui ne s’acquiert pas dans un cursus scolaire ou universitaire, ni véritablement non plus dans un parcours professionnel. Faut-il retravailler cette notion d’éducation populaire ? De quelle manière ? Par ailleurs, que peut apporter le service civique ? L’aménagement du temps scolaire, en discussion actuellement, pourrait-il être également l’occasion de construire du temps en commun avec les acteurs associatifs ?
M. le président Alain Bocquet. Je suis de ceux qui pensent que l’école est un lieu où l’avenir du bénévolat peut être préparé. Nous sommes les enfants des hussards de la République, nos instituteurs nous ont appris, avec le timbre contre la tuberculose, par exemple, à agir, militer : ils nous ont appris le geste bénévole. Que pensez-vous de l’idée d’un stage scolaire en association ou, à l’inverse, de l’intervention d’associations dans les écoles ?
Enfin, les nouvelles technologies de l’information sont-elles un facteur de développement possible du bénévolat ou bien au contraire un frein ? Quel nouveau concept du bénévolat faut-il inventer à l’aune de ces nouvelles technologies ?
M. Dominique Thierry. En ce qui concerne l’éducation populaire, nous menons un programme AIRE21, « Actions intergénérationnelles pour la réussite éducative », dans lequel nous essayons d’impliquer des jeunes éloignés de l’emploi ou en risque de décrochage scolaire, voire ayant déjà décroché, sur des projets collectifs portés par des établissements scolaires. C’est une façon de valoriser ces jeunes, de leur redonner confiance, et cela leur permet, tout en portant des projets d’utilité sociale, de découvrir le monde associatif. Pour que nos associations acceptent d’accueillir ces jeunes un peu « cabossés », nous leur disons que c’est comme cela que l’on forme les bénévoles de demain. Je crois donc que l’on peut réinventer sous des formes nouvelles le mouvement de l’éducation populaire, duquel France Bénévolat se revendique clairement.
L’école s’ouvre lentement, mais nous n’en sommes pas encore au modèle québécois, où tous les écoliers travaillent sur des « projets communautaires », collectifs, à côté du français ou des mathématiques. France Bénévolat est fier d’avoir monté en un an trente ou quarante projets, mais cela reste peu. Les enseignants font des choses, souvent extraordinaires, mais ils se sentent un peu seuls dès lors qu’il s’agit de porter des projets en marge de nos traditions pédagogiques.
Nous avons beaucoup travaillé sur la formation des bénévoles et publié plusieurs études. La formation est désormais relativement ancrée dans les pratiques associatives. Les progrès sont toutefois plus sensibles pour la formation des bénévoles de terrain que pour celle des responsables. Notre approche consiste à souligner que la formation d’un bénévole n’est pas la même que celle d’un salarié, qu’elle implique des pédagogies spécifiques. En ce qui concerne la formation des responsables, il existe quelques bons supports universitaires, comme l’Association pour le développement du management associatif (ADEMA), mais ils forment des responsables salariés plutôt que des responsables bénévoles. Nous sommes marqués, en France, par la culture du stage, qui n’est pas adaptée à la formation du bénévolat. Il faut trouver d’autres formes pédagogiques pour ces responsables, et notre pays n’avance pas suffisamment vite en la matière.
Bien sûr, nous avons également besoin de davantage de moyens. Heureusement que le Fonds pour le développement de la vie associative existe. Nous n’avons pas d’avis sur son utilisation et, très égoïstement, nous demandons beaucoup pour obtenir peu. Reste qu’on constate une répartition objective, honnête, d’une pénurie relative par rapport aux moyens.
En outre, il faut que le FDVA trouve le moyen de répondre aux demandes des associations autrement qu’en raisonnant uniquement en termes de stages car on assimile toujours à tort une formation à un nombre de personnes au sein de modules de stage pour un nombre d’heures déterminé, ce qui ne correspond plus à la réalité.
Nous n’avons aucune objection au bénévolat des mineurs. Les juniors associations sont une bonne chose mais demeurent confidentielles. Il faut aller plus loin.
Pour ce qui est du service civique, nous y sommes totalement favorables car la complémentarité est évidente entre ses finalités et celles du bénévolat associatif. Reste que nous ne nous situons pas à la même échelle avec 30 000 personnes, au mieux, d’un côté, et quelque 3 millions de jeunes de moins de trente-cinq ans impliqués dans le bénévolat.
Mme Brigitte Duault. En ce qui concerne la simplification, je suis d’autant plus d’accord avec les positions exprimées par le mouvement associatif que je suis moi-même confrontée quotidiennement à la complexité des démarches administratives. Dans un contexte de raréfaction des financements publics, nous sommes amenés à développer des modèles socio-économiques équilibrés, très diversifiés et nous avons donc affaire à un certain nombre de bailleurs de fonds privés et publics. Une démarche de simplification a ainsi déjà été entreprise pour l’attribution des subventions publiques – on en constate déjà les effets –, démarche qu’il faudrait prévoir pour les collectivités locales dont chacune a ses exigences qui coûtent en temps donc en argent – puisque ce sont les salariés qui s’occupent de ces demandes de subventions ; les multiples certifications coûtent également cher.
Le guichet unique est une très bonne idée mais il ne doit pas s’agir du seul moyen de financement : les financements croisés présentent l’intérêt d’articuler différents niveaux d’intervention et de les rendre complémentaires. Une telle pratique est de nature à développer l’ancrage territorial et le dialogue avec les différents échelons autour d’un projet collectif.
Quant aux agréments administratifs, très rarement les structures locales, lorsqu’elles s’adressent aux administrations concernées, obtiennent le rescrit fiscal. C’est le cas pour nous : nous l’avons obtenu au niveau national et la plupart de nos comités locaux se heurtent à des refus. Or ces associations vivent en moyenne avec 5 000 euros par an et, en province, les bénévoles ont des frais de déplacements que nos équipes n’ont pas les moyens de rembourser. Elles proposent dès lors aux bénévoles de renoncer à ce remboursement au profit d’un reçu fiscal impossible à obtenir localement.
Mme Édith Archambault. La large publication des statistiques sur le bénévolat est importante. Je me suis étonnée qu’au cours des travaux de la commission Stiglitz, qui s’est intéressée au bien-être, il n’ait jamais été question du bénévolat. Et l’on note la même lacune dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire.
Le passage de dix-huit à seize ans me paraît une très bonne idée. Les jeunes qui adhèrent à des associations sont dépourvus de responsabilités et sont voués à des tâches élémentaires alors qu’ils ont des idées. Les statistiques nous montrent qu’ils prennent des responsabilités dans des associations qu’ils ont créées eux-mêmes avec une façon de les administrer complètement différente des normes traditionnelles, avec par exemple une rotation régulière des présidences, l’organisation de réunions par internet.
On prend trop peu en compte les activités bénévoles dans le parcours professionnel et les jurys qui décernent la validation des acquis de l’expérience ont un point de vue strictement académique : ils valorisent essentiellement les connaissances au détriment du « savoir-être » et du savoir-faire acquis dans le bénévolat, qui sont des qualités essentielles dans la vie professionnelle.
Des « testings » ont été réalisés par l’université Paris XII consistant à envoyer des curriculum vitae mentionnant les activités bénévoles et d’autres ne les indiquant pas. Pour un emploi dans le secteur informatique, l’engagement associatif est considéré négativement car jugé comme une perte de temps ; en revanche, le bénévolat, du fait de son caractère relationnel, est considéré positivement par le secteur bancaire. Il convient d’approfondir ce type de recherche.
Il importera par ailleurs de réfléchir aux conséquences de la suppression de la clause de compétence générale : les points de vue sur ce sujet sont différents, mais cette clause est une source de complexité et n’est de surcroît pas rationnelle.
La question du bénévolat dirigeant est déjà en partie résolue puisqu’on a le droit de rémunérer, dans un conseil d’administration, un dirigeant opérationnel, dans des limites déterminées. Cependant, dans les associations d’une taille conséquente, ce qui est essentiel est surtout le bon fonctionnement du « couple » dirigeant, à savoir le président et le directeur général. Si le bénévolat doit rester une condition pour l’ensemble du conseil d’administration, les exceptions à cette règle doivent être contrôlées et affichées, notamment pour les associations qui font appel à la générosité publique. Or, les associations sont réticentes à publier leurs trois ou cinq plus hauts salaires, alors que les entreprises le font sans difficulté. Un certain rapport à l’argent n’est pas encore réglé dans les associations.
Le projet communautaire évoqué par M. Thierry pourrait justement être inclus dans l’aménagement du temps scolaire : au-delà d’activités permettant l’enrichissement personnel, des activités collectives sont nécessaires. Nos enfants et petits-enfants qui passent tant de temps derrière l’écran de leur ordinateur manquent de supports collectifs ; nous devons donc trouver des équivalents de l’éducation populaire d’autrefois qui impliqueront nécessairement l’usage des nouvelles technologies. Il revient à la nouvelle génération de les inventer et à nous de les y aider.
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, monsieur, je vous remercie.
Table ronde thématique « Qualité de l’emploi associatif » :
M. Sébastien Darrigrand, délégué général de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), et Mme Tiphaine Perrichon, chargée de mission du développement de l’emploi à l’UDES ;
M. Bernard Bazillon, vice-président de l’Institut des dirigeants d’associations et fondations (IDAF) ;
M. Frédéric Amiel, secrétaire général du syndicat ASSO,
et M. Vincent Laurent, co-secrétaire du syndicat ASSO ;
M. Matthieu Hély, chercheur au CNRS et à l’université Paris X-Nanterre.
(séance du 16 octobre 2014)
M. Alain Bocquet, président de la commission d’enquête. Les associations créent du lien social et elles le revendiquent à juste titre. Nous savons tous qu’une partie du tissu associatif œuvre à réparer les blessures causées par le chômage ou la précarité dans l’emploi. Mais qu’en est-il des associations elles-mêmes ? Quelles difficultés rencontrent-elles dans leur fonction d’employeur ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander, madame, messieurs, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Tiphaine Perrichon, MM. Sébastien Darrigrand, Bernard Bazillon, Frédéric Amiel, Vincent Laurent et Matthieu Hély prêtent serment)
M. Sébastien Darrigrand, délégué général de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES). L’emploi associatif présente certaines spécificités : métiers caractéristiques, présence majoritaire de femmes, proportion de 12 % de contrats à durée déterminée (CDD) – soit un peu plus que dans le secteur privé lucratif –, horaires atypiques, notamment liés à une forte saisonnalité, et recours au temps partiel – 42 % des emplois – souvent choisi, parfois subi, surtout dans les secteurs liés aux services à la personne.
Le projet de créer une association est avant tout bénévole et c’est ensuite, éventuellement, que se développe une activité d’emplois et que surgissent des questions liées aux responsabilités d’employeur, responsabilités que nous assumons, au sein de l’UDES, à travers treize branches associatives parmi lesquelles l’ensemble des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, l’aide à domicile, l’animation périscolaire… Notons que la pyramide des âges vieillissante peut constituer une difficulté pour le recrutement.
J’aborderai sept points.
J’évoquerai pour commencer la paupérisation des publics pris en charge. Les associations n’ont pas été les premières victimes de la crise de 2008 dont on sait les effets immédiats sur les entreprises commerciales, notamment celles soumises aux aléas financiers. C’est dans un second temps, en effet, dans les années 2010-2011, que la crise a affecté le monde associatif, longtemps fortement pourvoyeur d’emplois – davantage que le privé lucratif. Certains secteurs ont été plus touchés que d’autres comme le tourisme, la culture, l’enseignement et, surtout, l’aide à domicile qui a perdu plus de 10 000 emplois. Si le secteur associatif se maintient globalement en 2012-2013, et mieux que le secteur privé qui perd pendant cette période 0,5 % de ses emplois, il n’en demeure pas moins que certains domaines – j’ai évoqué les services à la personne – souffrent et éprouvent non seulement des difficultés à maintenir leur activité mais aussi, désormais, à maintenir l’emploi.
Ce phénomène se traduit, second point, par une concurrence accrue avec les entreprises privées lucratives. De plus en plus d’entreprises commerciales investissent les champs couverts, historiquement, par les associations. Ainsi, la Fédération du service aux particuliers (FESP), affiliée au MEDEF, et la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), affiliée à la CGPME, investissent le secteur de l’aide à domicile depuis quelques années sous l’effet du plan Borloo et des réglementations leur permettant d’étendre leur activité à ces domaines. Les associations n’ont donc plus le quasi-monopole pour les services à la petite enfance, les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)… Les entreprises commerciales s’engagent dans le secteur en baissant les prix et en prenant des parts de marché sans reporter sur les prix le coût des politiques de professionnalisation que les associations ont à supporter en raison du développement de la qualité de l’emploi depuis quelques années, et de la mise en place de dispositifs conventionnels.
Le désavantage concurrentiel est quelque peu « accompagné » par les pouvoirs publics dès lors qu’est menée une politique de l’offre et de baisse des charges. Car la baisse des charges entraîne une diminution des cotisations sociales et patronales et remet donc en question le financement des politiques sociales et des politiques familiales. Dès lors que les pouvoirs publics mettent en place des crédits d’impôt pour accompagner des entreprises commerciales dans le développement de leurs activités, dès lors que certaines de ces entreprises sont en concurrence directe avec les associations dans le secteur des services à la personne, on crée un désavantage concurrentiel qui nuit au développement de l’activité, qui nuit au développement de l’emploi et menace la pérennité du monde associatif.
L’UDES s’est, dans un premier temps, montrée favorable au passage de 6 000 à 20 000 euros de l’abattement forfaitaire de taxe sur les salaires. Or le récent rapport parlementaire relatif à l’impact de l’application du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif constate que « pour le décile des associations les plus grosses, qui concerne environ 80 % des emplois, l’abattement de la taxe sur les salaires sera moins avantageux qu’une mise en œuvre théorique du CICE ».
L’UDES a réalisé cet été, en collaboration avec un cabinet spécialisé, une étude fondée sur l’analyse de cas concrets, objectivés et modélisables, qui a permis d’établir, dans quatre secteurs d’activités – les EHPAD, la petite enfance, l’aide à domicile et l’animation périscolaire –, que la différence de traitement fiscal subie par les organismes non lucratifs correspond en moyenne à 4 % des rémunérations qui seraient éligibles au CICE si leurs activités étaient lucratives. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, nous avons donc soumis aux députés un projet d’amendement visant à faire bénéficier les entreprises associatives – qui, contrairement à ce qu’on dit, paient un impôt sur les sociétés à taux réduit – des sommes liées à la baisse des charges dans le périmètre du CICE. Cela contribuerait à développer l’emploi et l’activité.
J’en viens à mon troisième point : la généralisation des appels d’offres. Si on peut comprendre que pour certains acteurs, localement, elle doit favoriser la qualité des prestations et l’application des réglementations et faciliter l’assujettissement à la commande publique, les appels à projets sont assez lourds et complexes à mettre en œuvre, notamment pour les petites associations qui n’ont pas forcément les reins assez solides pour y répondre. S’il est important de s’adapter à la baisse des budgets sociaux des conseils généraux, la question du financement des projets d’intérêt général reste posée : on passe d’une logique de subventions à une logique d’appels à projets, d’appels d’offres, dont les critères quantitatifs ne sont pas toujours adaptés aux associations.
Quatrième point, en ce qui concerne les politiques de professionnalisation, nous sommes confrontés à une sorte de paradoxe : les pouvoirs publics constatent que, pour soutenir certaines associations – notamment les associations réglementées –, il faudrait obérer leurs capacités à développer la professionnalisation qui pèse sur le coût des prestations ; or on répète depuis des années que le secteur associatif doit développer l’emploi, la qualité de l’emploi, et donc être outillé en conséquence. Nous avons ainsi formé nos employeurs, limité le plus possible les contentieux prud’homaux – certes encore nombreux. On ne peut donc pas nous inviter aujourd’hui à limiter la professionnalisation qui pèse sur le coût de la prestation alors que les métiers associatifs sont de plus en plus reconnus comme de vrais métiers. Si certains considèrent qu’il n’est pas opportun de développer le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale dans le cadre des interventions à domicile, nous tenons quant à nous absolument à ce que la professionnalisation se développe dans le monde associatif afin d’améliorer la qualité de l’emploi.
Mon cinquième point porte sur la réglementation : trop lourde, elle constitue un frein au développement de l’activité. Certes, des initiatives de simplification des démarches administratives ont été prises et nous nous en réjouissons. Nous reconnaissons bien sûr la valeur du dialogue social ; d’ailleurs, six de nos branches professionnelles ont mis en place des délégués du personnel à partir de six salariés, dérogeant ainsi au seuil de onze salariés. Cela étant, il nous semble nécessaire de simplifier les obligations de négocier, notamment à partir de quarante-neuf ou cinquante salariés. Au reste, la notion de seuil ne nous paraît pas être nécessairement le bon critère. Nous plaidons également pour la rationalisation, la dématérialisation de certaines procédures administratives, un meilleur fonctionnement des instances représentatives du personnel (IRP), dans un cadre un peu simplifié – et nous suivons de près la négociation en cours entre les partenaires sociaux.
Avant-dernier point, la réforme territoriale nous pose problème après une position initiale pourtant plutôt favorable de notre part puisque nous nous sommes réjouis de la perspective d’une diminution du nombre des couches du millefeuille. Or il nous paraît quelque peu dangereux aujourd’hui d’occulter le fond au seul profit de la forme. À nos yeux, en effet, la réforme de l’organisation territoriale de la République comporte le risque d’une fragmentation des politiques sociales et d’une évolution de leur financement – l’Association des départements de France s’en est récemment émue. C’est que de nombreuses associations agissent dans le cadre des politiques sociales menées par les conseils généraux, concernant la famille, le handicap, les personnes âgées, les personnes handicapées. Nous appelons à plus de concertation sur le sujet. Nous nous félicitons de la mise en place du Conseil national des services publics. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir quelle politique on veut dans les territoires au service de l’intérêt général. En outre, la suppression de la clause de compétence générale nous paraît remettre en cause certains principes : quel budget consacré aux politiques sociales sera affecté à la fois aux conseils généraux, destinés à être chefs de file en la matière, et éventuellement aux métropoles ? Quelles priorités ? Quelles politiques ? Quels acteurs seront concernés ? Enfin, le développement social doit être un enjeu à part entière de la réforme et il convient d’y impliquer les acteurs de proximité que sont les associations.
Mon dernier point portera sur le service public de l’emploi, qui n’est pas toujours au fait de la réalité de nos métiers. Pour développer l’emploi, il faut être accompagné par les prescripteurs. Or nous constatons que, parmi ces derniers – et mon propos ne concerne pas les missions locales, avec lesquelles nous avons accompli un travail tout à fait conséquent sur les emplois d’avenir –, Pôle emploi a encore du mal à comprendre qu’une association ne se résume pas au bénévolat, qu’elle recouvre des emplois, l’exercice de vrais métiers, qui peuvent être intégrés à un vrai parcours professionnel pour un salarié. Il faut renforcer le lien avec les prescripteurs mais aussi développer les relations entre l’école et l’entreprise en développant la coopération avec le monde professionnel. Nous avons formulé des propositions dans le cadre des assises de l’apprentissage le 19 septembre dernier au palais de l’Élysée. L’alternance au sens large, l’apprentissage en particulier, est en effet un levier possible d’évolution de la pyramide des âges. On pourrait procéder à des assouplissements dans certains secteurs afin de faciliter l’accès à l’apprentissage et de favoriser un volume d’accueil et un volume d’heures correspondant à des réalités professionnelles. De même, il nous paraît important de neutraliser le coût financier des interventions en binôme, impératives pour l’accompagnement d’un apprenti lors d’interventions auprès de personnes fragiles ou de jeunes enfants. Le tutorat doit donc être valorisé.
M. Bernard Bazillon, vice-président de l’Institut des dirigeants d’associations et fondations (IDAF). L’IDAF rassemble environ 150 associations et fondations dont l’objet est d’échanger les pratiques, les expertises, de mettre en place des dispositifs de formation à travers des journées, des matinales, des conférences. Je suis aussi consultant chargé de l’économie sociale auprès du cabinet d’audit et de finances KPMG. J’observe ce secteur depuis quelque vingt-cinq ans et, à travers le prisme du praticien, je ferai deux « zooms » : l’un sur le fait que pour renforcer l’emploi il faut renforcer les associations et les fondations ; l’autre sur le renforcement des politiques d’adaptation des compétences.
Sur le premier point, je rappellerai que le secteur associatif est un employeur à part entière et représente environ 10 % de la population active, et que 56 % des associations travaillent dans le secteur sanitaire et social, dont 7 % pour la santé, 19 % pour l’hébergement médico-social, 30 % dans le domaine social sans hébergement. L’évolution est positive sur le long terme d’un point de vue quantitatif mais la qualité de l’emploi tend à se dégrader à cause du recours à des CDD, de l’augmentation du temps partiel et du recrutement de personnes faiblement qualifiées dans le cadre, notamment, de missions d’insertion.
Le secteur associatif subit un effet de ciseaux : les ressources publiques de l’État et de certaines collectivités locales se dégradent, les ressources provenant de la générosité du public stagnent voire diminuent – phénomène récent –, cependant que les dépenses augmentent du fait de la demande sociale et des besoins sociaux qui ne cessent de croître, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la cohésion sociale et des soins aux personnes âgées. Je ne peux pas ne pas ajouter que l’inflation législative et réglementaire pèse sur le monde associatif – je pense à la taxe sur les salaires, au versement transports, aux temps partiels. Relevons également le coût de l’immobilier – le coût de la construction s’est envolé en effet ces dix dernières années. Il est de plus en plus difficile, par conséquent, pour le secteur associatif, de réaliser ses missions.
Or il est absolument nécessaire de préserver sa mission de service public. Pour cela, il convient de renforcer ses fonds propres et ses moyens d’action. La loi relative à l’économie sociale et solidaire adoptée en juillet 2014 y contribue mais il faut aller encore plus loin et mettre en place des dispositifs d’innovation financière. Il s’agit de mobiliser des financements à long terme pour servir le court terme et l’activité de ces associations et donc, indirectement, renforcer l’emploi associatif.
Mon second « zoom » concerne l’évolution de l’adaptation des compétences. En effet, le secteur associatif doit s’adapter aux mutations liées aux nombreuses innovations sociales et aux nouveaux besoins sociaux, s’adapter également aux mutations technologiques, en particulier dans les domaines de l’insertion professionnelle, les donneurs d’ordres étant en train de se repositionner sur des activités très techniques, technologiques, et enfin s’adapter aux contraintes budgétaires et sociales. D’où la nécessité de l’accroissement de l’employabilité des salariés, le secteur lucratif n’étant pas seul concerné, le secteur associatif le devenant de plus en plus.
Quels sont les atouts du secteur associatif au regard de la nécessaire adaptation des compétences ? On peut en déceler deux : la gouvernance et les salariés.
Le secteur associatif bénéficie d’une gouvernance très particulière avec des bénévoles en général bien formés – et de mieux en mieux –, volontaires, impliqués. Grâce à eux, des projets associatifs très pertinents, pour la plupart, sont mis en œuvre.
Quant aux salariés, il faut avoir présent à l’esprit qu’ils n’ont pas intégré une association par hasard. Je citerai l’exemple d’un directeur administratif et financier d’une filiale d’une entreprise japonaise venu dans une association qui travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : il a enregistré une chute de salaire de 30 à 40 %, effectue des trajets bien plus longs qu’auparavant et doit superviser une vingtaine d’établissements. Eh bien, malgré cela, cet engagement a donné un sens à sa vie. Ce genre de transition est de plus en plus fréquent et répond à un sens développé du service d’une cause.
Nous avons toutefois recensé un certain nombre de freins. Je pense à l’investissement important, financier et extra-financier, qu’il faut consentir pour le développement progressif d’une politique d’adaptation des compétences dans la durée ; à la très grande diversité des métiers et des parcours professionnels, qui exige une énergie certaine pour faire évoluer les compétences ; à l’ambivalence du statut – à la fois personne impliquée, parfois adhérente, et quand même toujours salarié obligé de rendre compte ; à une compréhension systémique de l’évolution de l’environnement qui reste parfois insuffisante, certains salariés s’imaginant que leur secteur d’activité peut continuer comme avant ; à la réticence inhérente à tout changement ; enfin, à la difficulté à bien percevoir individuellement, mais aussi collectivement, l’équilibre entre les gains et les pertes, entre l’engagement ou la démotivation autour de la mise en œuvre du projet associatif.
Le projet associatif doit être co-construit avec les salariés qui souvent font partie de l’assemblée générale. Il s’agit en effet d’obtenir une implication optimale de l’encadrement, qui va impulser et accompagner les mutations. Vis-à-vis des salariés, la prise en compte de l’innovation sociale et de la qualité du service rendu est essentielle : il faut partir de là pour les impliquer, les motiver, et faire comprendre que leurs compétences devront s’adapter à l’évolution des besoins sociaux.
En matière d’organisation, des demandes sans cesse plus nombreuses nous viennent des entreprises adaptées – nous discutons d’ailleurs avec l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA). Certaines de ces entreprises travaillent en sous-traitance du secteur commercial, lui-même en difficulté, et demandent des diagnostics, des plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour pouvoir s’adapter et travailler pour des secteurs à forte valeur ajoutée – comme les nouvelles technologies de l’information. Ces organismes sont demandeurs d’accompagnement au changement pour leurs personnels.
Sans se placer dans une démarche de rupture, il faut convenir que l’on n’a pas inventé l’ampoule en améliorant la bougie. Si l’on peut toujours perfectionner les dispositifs existants, il faudra bien passer à un stade supérieur de changement. Une communication et une gouvernance adaptées seront nécessaires, d’où la nécessité de mettre en place des dispositifs conjoints élus-bénévoles-salariés pour définir les plans d’action.
Il faudra également, pour finir, « implémenter » des dispositifs de formation. Je rappelle que 70 % du changement et de l’expérience proviennent du terrain, donc de cadres intermédiaires capables, au quotidien, de faire évoluer les pratiques. Ensuite, 20 % du changement proviennent de la formation informelle, c’est-à-dire du partage de savoirs par les nouvelles technologies de l’information. Enfin seuls 10 % proviennent de la formation présentielle. Le coût de ce type de dispositif peut être allégé en ayant beaucoup moins recours à des prestations externes et en internalisant l’accompagnement du changement. Il faudra pour cela mettre en place des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), quitte à les renforcer, auxquels on pourra éventuellement associer, dans le cadre des hybridations de ressources, des fonds privés.
M. Frédéric Amiel, secrétaire général du syndicat ASSO. Le syndicat ASSO (« Action pour les salariés du secteur associatif ») se félicite que l’emploi associatif soit traité par cette commission d’enquête avec l’importance qu’il mérite. Il est depuis plusieurs années en crise et je reviendrai sur les conséquences de certaines politiques publiques tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Les salariés associatifs sont très investis dans leur travail et la démotivation évoquée tout à l’heure n’est pas toujours le fait du salarié mais provient d’une perte de sens et de la difficulté que rencontrent les associations à mettre en œuvre leur projet. Certains salariés ne voient plus l’intérêt de continuer à travailler dans le monde associatif puisqu’ils y retrouvent tant de travers du secteur privé.
Je prendrai l’exemple de deux types de contrats en commençant par celui lié au service civique – anciennement volontariat puis service civil volontaire. Ce contrat est très particulier puisque hors droit du travail. En tant que syndicat nous nous sommes posé la question de savoir comment travailler avec les volontaires qui, en entreprise, sont confrontés à des problèmes similaires à ceux des salariés alors qu’ils ne relèvent pas, je le répète, du droit du travail, d’un lien de subordination avec leur employeur, problèmes qui, par conséquent, ne peuvent pas être résolus de la même manière.
La politique du chiffre dans le volontariat a conduit à créer énormément de postes assortis de conditions « de papier » : pas de remplacement de postes de salariés, pas de missions pérennes, pas de missions indispensables pour l’association. Il suffit de consulter les propositions de volontariat pour constater que ces règles ne sont pas respectées et restent mal vérifiées. C’est pourquoi il faut veiller à ne pas multiplier, dans le secteur associatif, ce type d’expérimentations qui permettent, certes, d’extraire un certain nombre de jeunes du marché de l’emploi pendant un temps, voire de leur proposer une expérience professionnelle, mais qui ne résolvent pas le problème à long terme d’un emploi stable et correctement rémunéré ni d’une évolution de carrière. En effet, même si l’on note une amélioration, les volontariats sont relativement peu reconnus dans le cadre de l’insertion professionnelle.
Le second type de contrat que je souhaite mentionner est le contrat aidé : contrat d’aide à l’emploi (CAE) et contrat unique d’insertion (CUI). Ces contrats stipulaient – ce qui partait d’une bonne intention – que l’association allait recevoir de la part d’un bailleur
– généralement une collectivité territoriale – une subvention sur trois ans, dégressive, qui lui permettrait, petit à petit, de mettre en place un système destiné à pérenniser l’emploi en le transformant en CDI s’il s’agissait d’un CDD ou, le cas échéant, à le maintenir en CDI. Seulement, cette convention était en fait semestrielle, renouvelable six fois. Aussi, au bout d’un semestre, certains bailleurs, se rendant compte que l’enveloppe budgétaire affectée à ces contrats n’était pas suffisante, ont réévalué l’attribution de leur ligne budgétaire. Et certains de ces contrats n’ont pas été reconduits, non pas pour des raisons valables – mauvais accompagnement de l’employé, absence de plan de formation… – mais uniquement par absence de budget. Des associations qui avaient pris le risque d’embaucher un salarié, parfois en CDI, pensant disposer de trois ans pour pérenniser l’emploi, ont dès lors dû procéder à des licenciements économiques au bout de six mois. Ce phénomène s’est peu reproduit, car les bailleurs institutionnels ont été instruits par l’expérience et n’ont pas répété les erreurs de la première année en signant trop de conventions, mais il montre les limites de l’accompagnement à l’emploi par les associations.
Nous vous avons communiqué plusieurs propositions suivant l’idée que l’accompagnement à l’emploi dans les associations doit être réellement pluriannuel, sur le fondement d’un budget clair et « sacralisé », à savoir insensible aux aléas des politiques budgétaires.
Nous souhaitons par ailleurs introduire le volontariat dans le code du travail ou, à défaut, créer une législation propre puisque le vide juridique qui le caractérise ne permet pas, j’y ai fait allusion, de résoudre les conflits entre un volontaire et son association d’accueil.
J’en viens à l’impact des politiques publiques, notamment budgétaires – qu’il s’agisse de l’État central ou de l’État décentralisé –, sur les associations. On a tout à l’heure évoqué « l’effet ciseaux » ; pour notre part, en tant que syndicat, nous parlons plutôt de la « double peine » du salarié associatif qui, à cause des réductions des subventions, se retrouve souvent à récupérer des missions de collègues licenciés ou non reconduits, ce qui conduit à une augmentation de la charge de travail due à une baisse des budgets. D’autre part, comme la crise économique frappe tout le monde, ou presque, en France, le nombre de ces missions augmente, en particulier dans les secteurs sociaux, de l’éducation, de la santé… Les salariés associatifs subissent donc une surcharge de travail due à la fois à des contraintes internes à l’association et à des contraintes externes.
Cette pression est accrue par les nouvelles politiques de subventions – on a mentionné les appels d’offres, les délégations de service public. Nous sommes certes tout à fait favorables à la co-construction et nous réfléchissons depuis longtemps à la manière dont les salariés pourraient être mieux associés au projet associatif. Mais quand un tel projet est dicté de l’extérieur par des appels d’offres ou par l’obligation d’obtenir des délégations de service public pour pérenniser des postes ou pour maintenir un budget à l’équilibre, il n’est même plus aux mains des bénévoles, sans parler des salariés dont l’activité perd de ce fait une grande partie de son sens. D’où une certaine démotivation.
Il s’agit par conséquent d’encadrer la manière dont les associations sont de plus en plus amenées à se substituer à des services publics de proximité. Je n’entends pas ici juger de la pertinence ou non d’avoir recours à des associations ou à des entreprises privées pour les substituer à des services publics ; en revanche, il est de notre point de vue inacceptable que ces délégations de service public ne se fassent pas à égalité de moyens. Les moyens investis dans un service public assuré par une collectivité territoriale sont sans commune mesure avec les faibles enveloppes qu’on alloue à des associations pour réaliser le même travail, notamment parce qu’on compte sur le bénévolat des associations – l’autre raison étant que l’on compte sur eux pour trouver des moyens innovants pour faire aussi bien avec moins de moyens. Il est donc important d’encadrer les délégations de service public et de s’assurer de la continuité des moyens qui y sont consacrés.
Je rappellerai ensuite que les aides aux associations, celles distribuées par l’État central comme celles dispensées par les collectivités territoriales, constituent la variable d’ajustement des budgets annuels ou des révisions semestrielles desdits budgets. Il faut dès lors s’assurer que, si l’on considère, comme vous l’indiquiez au début de cette table ronde, monsieur le président, que les associations ont un rôle social fondamental à jouer dans la construction du tissu national et comme facteur de cohésion sociale, elles doivent être protégées des aléas budgétaires, et les lignes dédiées aux associations doivent être préservées des politiques de rigueur du moment. Il convient de chercher le moyen pour les associations d’être moins touchées qu’aujourd’hui par ce phénomène si l’on veut éviter des pertes d’emplois massives.
Pour finir, le syndicat ASSO, affilié à l’Union syndicale solidaire, syndique également les salariés des comités d’entreprise. Quand nous entendons parler de la réforme des seuils sociaux, nous sommes très inquiets. L’argent versé aux comités d’entreprise ou à travers les différentes politiques sociales via les taxes sur l’emploi, est de l’argent qui revient très vite dans le circuit associatif via des prestations culturelles, des prestations de loisir, des prestations sociales. Aussi, abaisser les prélèvements revient à diminuer l’emploi dans des structures qui bénéficient de l’argent des politiques sociales et de l’argent des comités d’entreprise – vous n’ignorez pas qu’un comité d’entreprise va payer à ses employés des activités culturelles, de loisir, des vacances qui, pour une grande part, passent par des associations.
J’appelle votre vigilance sur l’équilibre à trouver entre la baisse des revenus qui profite à des emplois existants et les revenus qui pourraient être préservés par des employeurs associatifs pour créer de nouveaux emplois. Vous connaissez la solution : plutôt que de faire bénéficier les employeurs associatifs des mêmes réductions de charges qu’au secteur privé, il faut faire bénéficier le secteur privé de moins de réductions de charges.
M. Matthieu Hély, chercheur au CNRS et à l’université Paris X-Nanterre. Certains parlent de crise du monde associatif : en ma qualité de sociologue, je parlerai plutôt d’un changement de configuration historique du monde associatif. Si l’on observe de façon superficielle les évolutions du monde associatif, le nombre de bénévoles, qui est passé de 8 à 16 millions, n’a jamais été aussi élevé, ainsi que le nombre d’emplois salariés, qui approche aujourd’hui les 2 millions, soit trois fois plus que dans les années 1980. Quant aux budgets des associations, ils n’ont jamais été aussi élevés. Le monde associatif n’a jamais disposé d’autant de ressources financières. Si l’on s’en tient à ces quelques données, on peut s’étonner d’entendre parler de difficultés du monde associatif.
Si l’on appréhende ces évolutions historiques au regard de catégories qui appartiennent au passé, on se trompe de diagnostic. Ce changement de configuration historique tient en trois points : un changement de nature des modes d’intervention de l’État dans le secteur associatif, un changement assez profond dans la pratique du bénévolat associatif et un statut nouveau du travail associatif. J’expliquerai en quelques mots pourquoi je préfère parler de travail associatif que d’emploi associatif.
On peut comprendre le changement de nature des modes d’intervention de l’État en observant la manière dont l’État marquait hier les causes associatives du sceau de l’intérêt général et celle dont il les consacre aujourd’hui.
Dans la configuration historique antérieure, l’intérêt général était monopolisé par l’État – le mécanisme de financement par la subvention en est l’illustration. La puissance publique, par la subvention, reconnaît qu’une cause associative participe à l’intérêt général et la consacre, indépendamment du coût des prestations qui découlent de cette cause associative.
Le développement des réductions fiscales sur les dons des particuliers et des entreprises a conduit à un changement assez profond dans la manière de consacrer l’intérêt général puisque c’est désormais le citoyen donateur qui, par son don, choisit la cause et qui, grâce au reçu fiscal que lui délivre l’association, bénéficie d’une réduction d’impôt. Donc, d’une certaine façon, ce n’est plus l’État qui consacre la cause, comme pouvait le faire la reconnaissance d’utilité publique attribuée par le Conseil d’État.
J’insiste sur ce point, car le coût fiscal de ces réductions n’est pas négligeable pour l’État. Selon les chiffres du rapport Bachelier de 2013, le coût fiscal des exonérations du mécénat d’entreprise et des dons des particuliers est de 1,9 milliard d’euros. Quant aux subventions publiques de l’État, qui figurent sur les jaunes budgétaires, elles s’élèvent à 1,8 milliard d’euros. Pour la première fois – et cette tendance va sans doute perdurer –, on constate que le coût des incitations publiques à la générosité privée est plus élevé que celui des subventions publiques consenties par l’État aux associations. C’est un point très important pour comprendre l’importance de l’évolution du mode d’intervention de l’État. On aurait tort de parler de financements privés puisqu’ils ont un coût fiscal pour la puissance publique. L’expression « financements privés » est impropre.
Certains parlent de désengagement de l’État à l’égard du monde associatif. Quand on prend en compte les réductions fiscales, les politiques de l’emploi en termes de contrats aidés et le soutien aux contrats de service civique, l’engagement de l’État n’est pas négligeable, même en termes financiers. Je serais presque tenté de parler d’un réengagement de l’État, sous de nouvelles formes d’intervention et de soutien au monde associatif.
Dans la configuration historique antérieure, le bénévolat associatif était considéré comme un engagement militant. Dans la configuration actuelle, le bénévolat associatif est considéré comme une source d’acquisition de capital humain. Alors que 2011 était l’année européenne du bénévolat, voici quelle était la première phrase du rapport de la Commission européenne clôturant cette année-là : « Le volontariat est générateur de capital humain et social. » On voit que le rapport à l’engagement a profondément changé.
Je prendrai l’exemple du bénévolat associatif des chômeurs. Dans les années 1990, les Assedic considéraient que l’engagement bénévole des chômeurs pouvait être contradictoire et entraver leur recherche d’emploi. À ce titre, les Assedic pouvaient suspendre l’indemnisation chômage des demandeurs d’emploi impliqués dans un bénévolat associatif. Aujourd’hui, le discours de Pôle emploi sur la pratique bénévole des chômeurs s’est inversé. Faire du bénévolat est perçu comme une activité renforçant l’employabilité des demandeurs d’emploi. D’ailleurs, France Bénévolat et Pôle emploi ont passé un accord pour développer des référentiels de compétences bénévoles afin de les valoriser sur le marché du travail. On pourrait multiplier les exemples, tels que le bénévolat d’entreprise, qui favorise ce brouillage de frontière entre la pratique bénévole et le marché du travail.
J’en viens au développement du travail associatif. Je préfère parler de travail associatif parce que les frontières en sont floues. Le cas du service civique, qui vient d’être évoqué, ne relève pas du code du travail puisqu’il n’y a pas de lien de subordination dans le contrat de service civique. Toutefois, on constate, dans l’usage qu’en font les associations, qu’il peut être utilisé comme un substitut d’emploi.
On peut évoquer également le cas des stagiaires, que je connais bien puisque je m’occupe d’un master professionnel à l’université de Nanterre, dans le cadre duquel les étudiants accomplissent un stage de trois mois. On voit bien, dans les missions confiées à ces stagiaires, la confusion qu’il peut y avoir avec l’exercice d’un emploi salarié. Il est important d’avoir cela en tête, les zones d’ombre entre le bénévolat et le volontariat sont nombreuses.
Il faut aussi rappeler qu’en dépit de la baisse conjoncturelle constatée en 2011, l’emploi associatif salarié a triplé depuis les années 1980. C’est une tendance forte, qui est assez peu soulignée. On a observé une transformation des mouvements associatifs, je dirais même de ces mouvements politiques associatifs, qui se sont constitués en branches professionnelles. L’éducation populaire, par exemple, est devenue, avec l’animation, une branche professionnelle. L’insertion par l’activité économique est devenue très récemment une branche professionnelle, avec la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion. Le passage des mouvements associatifs à des branches professionnelles n’est pas terminé. La protection de l’environnement, qui n’a ni convention collective ni accords, le commerce équitable, les ONG ne sont pas constitués en branches. À mon avis, le mouvement n’est qu’enclenché.
Le travail associatif consiste très largement à assurer les missions du public dans les conditions du privé. La croissance de l’emploi associatif a été favorisée par les différents actes de décentralisation des compétences, notamment dans le secteur social, qui ont participé à un mouvement de délégation de service public dans le domaine social. On pourrait aussi évoquer le domaine périscolaire, avec la réforme des rythmes scolaires.
Les groupes professionnels qui composent le travail associatif sont très proches des caractéristiques de la fonction publique. Ce sont en majorité des femmes et le niveau de diplôme est globalement assez élevé. Puis, les enquêtes montrent que les travailleurs associatifs sont, plus fréquemment que dans le reste de la population active, des enfants de fonctionnaires, comme si, par un mécanisme de transmission sociale de valeurs d’utilité sociale, d’intérêt général etc., les travailleurs associatifs, faute de pouvoir réaliser leur destin professionnel dans le cadre de l’emploi public, trouvaient une alternative dans le monde associatif pour concilier leurs valeurs avec leur activité professionnelle.
C’est un phénomène très important, car on peut se demander si l’on n’assiste pas à la naissance d’une sorte de quatrième fonction publique du point de vue des missions, sans le statut puisque le travail associatif est réalisé dans les conditions du secteur privé, voire parfois en deçà. Si l’on se réfère aux données de l’URSSAF, la nature des contrats de travail dans les flux d’embauche montre qu’en 2011, 6 % des embauches dans le secteur associatif étaient faites en CDI, contre 16 % dans le secteur privé. Si l’on consulte les déclarations annuelles de données sociales (DADS), on constate que 30 % des salariés non couverts par une convention collective ne relèvent d’aucune convention collective adaptée à leur branche professionnelle puisque la branche n’existe pas.
S’agissant des pratiques de rémunération, toutes choses étant égales par ailleurs, c’est-à-dire niveau de diplôme, sexe et ancienneté, on est moins bien payé dans une association que dans le secteur marchand.
Le lien avec le développement des commandes publiques de la part de l’État et des collectivités territoriales conduit à ce que le travail associatif soit de plus en plus considéré par les collectivités publiques comme une véritable variable d’ajustement. Je prends l’exemple d’un appel d’offres émanant du conseil général de l’Isère et relayé par l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes, concernant une structure d’accueil pour des malades atteints d’Alzheimer. On trouve dans le cahier des charges de cet appel d’offres ces quelques lignes, que je vais vous lire, car elles reflètent bien la teneur des choses : « Le promoteur de l’appel d’offres devra optimiser sa masse salariale, soit en jouant sur les conditions de rémunération, accord d’entreprise plutôt que convention collective nationale, soit sur les classements conventionnels. L’employeur pourra avantageusement se limiter à une application partielle des conventions collectives du secteur médico-social ». C’est l’article 5. 1 du cahier des charges. Le fait que certaines collectivités publiques considèrent le travail associatif comme une variable d’ajustement aux politiques publiques est écrit noir sur blanc.
J’ai parlé, au début de mon intervention, d’un changement de configuration historique. La loi ESS promulguée cet été ne fait que le conforter. Nous sommes dans le cadre d’une table ronde associant des employeurs et un syndicat représentatif des travailleurs associatifs. Un des enjeux centraux du dialogue social interne au monde associatif réside dans l’articulation entre la cause que servent les entreprises associatives et l’organisation du travail qu’elles déploient pour servir cette cause dans les conditions les plus efficaces possible. Je voudrais souligner la contradiction qu’il peut y avoir entre la cause et le travail.
Dans un premier temps, ce qui est dénoncé à la fois par les employeurs et les salariés, la cause peut jouer contre le travail. Le brouillage des frontières fait que le temps de travail n’est pas respecté, qu’il n’y a pas de négociation sociale ni de représentation collective des salariés et que les normes du travail ne sont pas appliquées, au nom de la cause. Les dérives de ce type sont dénoncées par les deux parties. Ces dérives ne concernent pas seulement le travail salarié. Je pourrais citer l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2002 au sujet des bénévoles de la Croix-Rouge, qui a requalifié une activité bénévole en contrat de travail.
À l’inverse, il y a des cas où le travail peut jouer contre la cause. Si la rationalisation de l’organisation du travail associatif est plutôt une bonne chose – car c’est la reconnaissance du fait que l’activité relève du travail, et dans certains cas, cela la protège –, on peut se demander si le travail associatif est rationalisable sur le même mode que les pratiques du secteur concurrentiel. Pour certains, ce débat n’a pas lieu d’être. Le secteur associatif doit être soumis aux normes du secteur concurrentiel et il faut en finir avec les avantages fiscaux accordés au monde associatif. Ce sont les prises de position du Medef et de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), qui estiment que les entreprises associatives sont des entreprises comme les autres et qu’il faut les assujettir aux mêmes normes concurrentielles que le secteur marchand.
Le président de l’UDES, Alain Cordesse, dont le point de vue est différent, déclarait en 2012 : « Les entreprises de l’économie sociale ne sont pas des entreprises comme les autres. Mais, comme les autres, elles sont des entreprises. » Autrement dit, on a là un syndicat employeur qui entend incarner un patronat social et solidaire et qui ne se reconnaît pas dans l’assimilation des entreprises associatives au secteur marchand concurrentiel classique.
Ce débat est central, car l’enjeu autour du travail associatif est de redéfinir la sphère du travail non marchand en termes de statut. Quel statut donne-t-on au travail non marchand ? Et quel mode de valorisation ? On peut considérer que le travail associatif relève du secteur non marchand puisqu’il est essentiellement financé par des fonds publics. Cette richesse non marchande, que l’on peut qualifier, comme le fait la loi ESS, d’utilité sociale produite par les associations, est-elle produite à partir d’une valeur économique existante, c’est-à-dire prélevée sur la valeur produite par le secteur marchand ? Ou bien cette utilité sociale est-elle productrice de valeurs intrinsèques, que nos catégories comptables, pour l’instant, ne savent pas saisir ? C’est, selon moi, une vraie question politique. Vous conviendrez que le lieu est bien choisi…
La participation bénévole, du point de vue comptable, fait l’objet d’une valorisation. Pourquoi s’arrêter à la valorisation de la participation bénévole, en termes d’utilité sociale apportée à la société ? Par ailleurs, l’administration fiscale exonère certaines associations des impôts commerciaux lorsqu’elle estime qu’elles servent une utilité sociale. C’est la fameuse règle des « quatre P ». Cela veut dire que l’utilité sociale peut être monétarisée. Il y a du grain à moudre sur la question de la valeur produite par le travail associatif. Cet enjeu est central, à la fois pour les employeurs puisque c’est un moyen de se différencier du patronat traditionnel, mais aussi pour les salariés à qui cela éviterait d’être réduits au rôle de variables d’ajustement des politiques publiques.
M. Frédéric Reiss. Nous assistons effectivement à un changement historique du monde associatif, qu’il faut situer dans le cadre d’une mutation profonde de notre société, du fait notamment de toutes les transformations liées au numérique. Aujourd’hui, les montages pyramidaux deviennent souvent des montages à l’horizontale. Et la solidarité est une dimension très importante.
Je n’ai pas très bien compris le sens de votre intervention sur le service civique. Certes, nous sommes hors droit du travail, mais l’objectif du service civique est tout autre. Il s’adresse à des jeunes qui veulent avoir une première expérience et qui manifestent un grand intérêt pour ce dispositif. Le service civique apporte beaucoup, et tant mieux s’il arrive à dynamiser le monde associatif. Je ne partage pas le point de vue du syndicat ASSO en la matière.
Pour le reste, il est évident que les associations ont de plus en plus besoin d’emplois qualifiés, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, ce qui sous-entend de gros problèmes de formation. Ne faut-il pas de plus en plus de polyvalence, de mutualisation et de transversalité ?
M. Régis Juanico. Le problème fiscal a été posé par l’UDES. Sur les quatre secteurs que nous avons investigués, hors CICE et à fiscalité comparable, nous n’avons pas noté de distorsion de concurrence avérée entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif.
En revanche, l’abattement de la taxe sur les salaires, à hauteur de 300 ou 350 millions d’euros, ne suffit pas à compenser la distorsion de concurrence créée par le CICE, notamment pour les employeurs plus de vingt salariés. Cela étant, je ne crois pas que la mise en œuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif soit la solution. Nous pourrions peut-être progresser sur la question de la modulation de la taxe sur les salaires, qui est très pénalisante pour les associations et pour l’emploi associatif.
En ce qui concerne la générosité privée, j’en suis d’accord, l’expression « financement privé » pose problème quand on sait que la dépense fiscale en la matière s’élève à 2,4 milliards d’euros en 2014, dont 1,3 milliard d’euros de réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, sachant que ce chiffre concerne seulement les contribuables qui paient l’impôt sur le revenu. Or ce sont au total 5,6 millions de ménages qui font des dons avec déduction fiscale, ce qui, hors aspect comptable, montre le degré de générosité de nos concitoyens. C’est donc un indicateur très important. Il y a également 750 millions d’euros au titre des dons de 37 000 associations d’intérêt général ou œuvres d’utilité publique.
J’en viens à la question du seuil de lucrativité, que l’on va péniblement arriver à relever en l’indexant chaque année sur l’inflation. Compte tenu du taux actuel de l’inflation, c’est une « grande » victoire ! Ce sont encore 135 millions d’euros de dépenses fiscales. Au total, la dépense publique atteint bien 2,4 milliards.
Par ailleurs, si l’on se place du point de vue d’un syndicat de salariés relevant du droit du travail et d’un lien de subordination, on peut comprendre la position historique du syndicat ASSO sur la question du volontariat et du contrat d’engagement éducatif, sauf qu’on manie des notions qui sont un peu différentes : volontariat associatif. Dans la loi ESS, nous avons réitéré pour les plus de vingt-cinq ans. Il ne s’agit ni de bénévolat ni de salariat mais il faut effectivement que les règles et les frontières soient clairement établies – nous l’avons précisé dans la loi sur le service civique.
Si vous constatez sur le terrain des missions qui sont en concurrence avec des contrats de travail traditionnels pérennes, il faut les signaler. Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont là pour gérer ce type de problème. Nous faisons de même si nous repérons, sur le site de l’Agence du service civique, des missions qui pourraient être en concurrence avec celles de salariés. Nous avons demandé aux services de l’État de faire preuve d’une très grande vigilance sur cette question.
Nous devons être cohérents. Le service civique n’a pas été conçu pour être un élément du parcours d’insertion professionnelle : c’est un engagement citoyen dans une mission d’intérêt général ; mais il faut veiller à ce que l’esprit de la loi soit respecté.
M. Sébastien Darrigrand. Un effort conséquent a été fait dans le domaine de la formation. Les deux Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de l’économie sociale collectent plus de 700 millions d’euros pour la formation professionnelle de leurs salariés. Cette somme considérable les place au même niveau que les OPCA interprofessionnels.
Dans le secteur associatif, la notion de branche professionnelle est très importante. Nous comptons une vingtaine de conventions collectives mais tous les secteurs ne sont pas couverts. Ainsi, les ONG ou certains acteurs, notamment dans le domaine de l’insertion, ne sont pas complètement organisés en convention collective, ce qui pose la question de l’articulation entre le droit du travail et des dispositifs plus avantageux pour les salariés.
À l’UDES, nous estimons que nous n’avons pas intérêt à mégoter sur ces sujets, car les enjeux de renouvellement de la pyramide des âges dans les prochaines années conduisent à la qualification, à la certification. Nous avons besoin de gens formés pour des métiers qui sont de plus en plus complexes. Si le discours ambiant laisse à penser que, dans une association, on n’a pas forcément besoin de compétences plus avérées que dans d’autres secteurs, telle n’est pas la position de l’UDES, comme en témoigne le travail que nous menons avec nos branches professionnelles, même s’il est parfois difficile de le réarticuler par rapport aux politiques publiques.
Ainsi, nous avons du mal à émarger à certaines lignes du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mis en place par les partenaires sociaux pour financer un certain nombre d’actions autour de la formation professionnelle, comme la lutte contre l’illettrisme, le socle de développement des compétences de base ou le développement des politiques de professionnalisation en direction des contrats de professionnalisation. À cet égard, nous nous réjouissons de l’entrée de l’UDES au Conseil national sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle (Cnefop) et dans les Comités régionaux sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle (Crefop) ; nous espérons que cela va améliorer les choses.
Nous avons aussi engagé des discussions sur la mutualisation des emplois. Vous le savez, les groupements d’employeurs sont en train de se reconfigurer. Cet été, a ainsi été créée une nouvelle organisation professionnelle des groupements d’employeurs, qui pourrait d’ailleurs adhérer à l’UDES dans quelques mois. La personnalisation des emplois et le temps partiel posent la question de la capacité à nouer, sur des bassins d’emploi, des liens entre plusieurs employeurs pour développer du temps plein. Nous avons engagé un travail avec les groupements d’employeurs, pour améliorer ce dispositif.
S’agissant de la fiscalité, nous ne comprenons pas pourquoi, pour la seule raison qu’ils génèrent une activité à but non lucratif, 200 000 employeurs ne bénéficieraient pas des allégements de charges prévus dans le cadre du CICE. Nous avons plaidé en faveur d’un allégement significatif – de 4 à 6 % – sur la taxe sur les salaires. Mais nous comprenons que cela pose des problèmes notamment par rapport au financement de la protection sociale. Cela étant, une étude montre des cas avérés, modélisables et objectivés, de désavantage compétitif dans quatre secteurs : les EHPAD, la petite enfance, l’aide à domicile et l’animation périscolaire, avec un différentiel de 4 % par rapport à une entreprise lucrative agissant sur les mêmes secteurs d’activité.
La nouvelle proposition que nous faisons dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 ne consiste pas à revoir le logiciel du Gouvernement puisqu’elle s’appuie sur l’impôt sur les sociétés à taux réduit. Le CICE étant appliqué aux sociétés de droit commun, pourquoi ne serait-il pas étendu aux entreprises susceptibles d’être assujetties à l’impôt sur les sociétés à taux réduit, avec un différentiel de 4 % qui permettrait de résoudre un certain nombre de difficultés ?
Le relèvement de l’abattement de la taxe sur les salaires peut être une solution, mais ne résout malheureusement pas le problème pour les grosses entreprises associatives du secteur sanitaire et social, qui comptent un grand nombre de salariés. Il en est de même des propositions envisagées en matière d’appel à projets pour les entreprises à but non lucratif. Cela représente une part importante pour les EHPAD – puisque c’est désormais une démarche obligatoire dans le cadre de la loi de 2009. Dans d’autres secteurs, c’est moins le cas. C’est une entrée qui nous paraît assez réductrice au regard du préjudice constaté.
M. Frédéric Amiel. Vous avez eu raison de rappeler quel était l’objectif du service civique. Cela étant, nous constatons sur le terrain l’usage qui est fait de ce dispositif dans un certain nombre de structures, et pas seulement dans les associations.
La première enquête, sortie en 2012, sur les bénéficiaires du service civique montrait qu’une majorité d’entre eux étaient là en dépit d’un contrat de travail. Ainsi, même si nous arrivons à cibler les gens qui veulent vraiment vivre un engagement associatif, nous touchons aussi indirectement ceux qui saisissent simplement une opportunité. J’en ai rencontré hier encore parmi les lauréats de l’Institut du service civique qui, à l’évidence, ont fait cette démarche parce qu’ils ne trouvaient pas d’emploi et que cela leur permettait d’avoir une première expérience dans leur secteur d’activité. C’est cela qu’il faut encadrer.
Cela étant, je suis ravi d’entendre vos propos sur la vigilance qui est exercée, vigilance dont nous faisons preuve à notre échelle. Nous attendons avec impatience les prochaines conclusions qui permettront de faire un état des lieux de la situation. Aujourd’hui, si cela ne figure pas dans le droit du travail – et ce n’est peut-être pas souhaitable –, il faut tout de même garantir les moyens de recours pour un volontaire ou pour un syndicat qui voudrait dénoncer un mauvais usage du service civique. En l’état, ceux-ci ne sont pas efficaces partout.
M. Bernard Bazillon. Je voudrais revenir sur la différenciation entre le secteur privé lucratif et les associations en ce qui concerne l’activité économique.
L’activité économique doit être partagée et exercée d’une façon professionnelle pour optimiser les ressources, qu’elles soient publiques ou privées, ce qui nécessite des compétences professionnelles. Mais le marqueur n’est pas vraiment là. Bien sûr, la délégation de service public doit être la meilleure possible. Ensuite, il y a la notion d’innovation sociale et celle d’impact social. S’agissant de la première, des structures de plus en plus nombreuses sont financées par des fonds privés – fondations d’entreprise, notamment. Sur la notion comptable de valorisation du bénévolat, ne serait-il pas intéressant de valoriser l’impact social ? Certes, le lien social n’est pas monétisable, mais il y a bien d’autres aspects qui peuvent être monétisés.
Dans une association, les fonds propres, qui sont faibles, n’ont aucune signification au regard de l’enjeu, à savoir l’impact environnemental et social. Ne pourrait-on pas « activer » en fonds propres et en patrimoine de ces associations leur impact économique et social avec un grand S afin de mettre en avant, lors des appels à projets ou des appels d’offres des acteurs publics, ces notions comme étant des critères de sélection ? Cela permettrait aussi d’asseoir des financements privés.
M. Vincent Laurent, co-secrétaire du Syndicat Asso. Le coût d’un service civique, selon qu’on a ou non l’agrément, va de zéro à 100 euros : 100 euros pour l’association qui a l’agrément et zéro euro pour celle qui accueille un service civique via une association qui a obtenu l’agrément. Avec un budget de 110 millions d’euros – voire plus, après les annonces faites par M. Hollande lors de sa conférence de presse en septembre dernier –, le risque est de créer dans le secteur associatif un appel d’air privilégiant le service civique plutôt que l’embauche. Il faudrait au contraire favoriser l’apprentissage ou les contrats de professionnalisation.
Le risque était le même, il y a 9 ans, avec les stages. Promulguée le 10 juillet dernier, la loi sur l’encadrement des stages établit une claire distinction entre le stagiaire et le salarié. J’ignore quel est le nombre de contrats aidés dans le secteur associatif, mais pour le syndicat ASSO, ce secteur est, depuis des années, le laboratoire des contrats précaires. Ce sont les salariés du secteur associatif, souvent des jeunes et des femmes, qui sont les victimes de ces contrats précaires à bas coût et à bas salaire. Le service civique participe d’un phénomène global qui relève de ce laboratoire des contrats précaires que nous dénonçons. Et nous alertons les pouvoirs publics sur ces questions.
M. Régis Juanico. Il faut prendre la mesure du risque de concurrence entre le service civique et les contrats de travail traditionnels. Cela étant, songez à l’appel d’air fantastique que représentent, cette année, ces 35 000 ou 40 000 engagés. L’objectif est d’aller jusqu’à 100 000. Nous n’y arriverons peut-être pas en 2017, mais il y en aura au moins 60 000 ou 70 000. Pour les jeunes, cette mission d’intérêt général est aussi un engagement dans la vie associative. Nous avons commandé une étude à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) pour savoir si cet engagement est déclencheur d’autres engagements ultérieurs. Pour avoir beaucoup échangé avec de jeunes volontaires, j’en suis personnellement convaincu.
M. le président Alain Bocquet. Madame, messieurs, je vous remercie pour votre apport aux travaux de notre commission d’enquête.
Table ronde thématique « Les administrations et l’emploi associatif » :
Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
M. Vincent Guérinet, directeur adjoint chargé des opérations à l’URSSAF Île-de-France ;
M. Stéphane Holé, adjoint au directeur du recouvrement, du contrôle et de la lutte contre la fraude, et Mme Évelyne Fleuret, sous-directrice de la gestion et de la modernisation des comptes cotisants à l’Acoss.
(séance du 16 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, Messieurs, notre matinée s’achève par une table ronde sur l’administration et l’emploi associatif. Les associations sont concernées par la question de l’emploi à plusieurs titres : une partie d’entre elles se consacre spécifiquement à la réinsertion dans l’emploi ; la majeure partie utilise abondamment les dispositifs publics de soutien à l’emploi ; enfin, toutes peuvent vivre sous la menace de voir requalifier en contrat de travail les liens qu’elles entretiennent avec leurs bénévoles. Le monde associatif est-il un employeur comme un autre ou bien est-il à part ? Les emplois aidés dont il fait tant usage sont-ils bien adaptés à ses besoins ? Peut-on sécuriser davantage le recours au bénévolat ?
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Emmanuelle Wargon, M. Vincent Guérinet, M. Stéphane Holé et Mme Évelyne Fleuret prêtent serment)
Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Le nombre d’associations en activité est estimé à 1,3 million, parmi lesquelles un peu moins de 200 000 ont recours à l’emploi de professionnels salariés. Les associations emploient quelque 1,8 million de salariés soit environ 8 % des effectifs du secteur privé. L’emploi salarié dans les associations se maintient dans la période récente. En stagnation légèrement positive, il réagit mieux que l’emploi du secteur privé. Seuls 47 % des emplois associatifs sont en contrat à durée indéterminée (CDI), ce qui est inférieur à la moyenne nationale, et le temps partiel y est très développé. Enfin, la moitié des associations sont de tout petits employeurs qui n’emploient qu’un ou deux salariés.
La politique de l’emploi interagit avec les associations à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, ont été institués en 2002 les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), soutenus par le ministère de l’emploi et la Caisse des dépôts et consignations. Ils visent à soutenir la professionnalisation de la fonction employeur dans le secteur non lucratif en général, et, de facto, à 96 % dans les associations. Ces dispositifs d’appui se déclinent aux niveaux territorial, régional et national. Ils ont pour objet le conseil, l’expertise et l’accompagnement des associations dans leur fonction d’employeur, l’objectif étant d’aider celles-ci à devenir des employeurs de qualité et à les guider s’agissant des aides auxquelles elles peuvent avoir droit. L’État finance le dispositif de façon constante autour de 11 millions d’euros par an, le reste étant financé par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 5 millions d’euros, par des crédits du Fonds social européen à hauteur de 4 millions d’euros et par les collectivités territoriales à hauteur de 5 millions d’euros. Depuis la création du DLA, 46 000 structures ont bénéficié du dispositif et le nombre d’emplois accompagnés s’établit à 562 000.
La politique de l’emploi interagit également avec les associations par le biais des emplois aidés. Ceux-ci ne relèvent cependant pas d’une politique d’aide à l’emploi dans les associations mais d’une politique d’aide à l’emploi des personnes éloignées de l’emploi qui, pour une part importante d’entre elles, sont employées par des associations. En effet, la conception des emplois aidés part davantage des besoins des personnes que de ceux des structures employeurs.
Ainsi, 46 % des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) sont conclus avec des associations – soit 140 000 contrats aidés – et les associations sont les premiers employeurs de CAE, bien devant les collectivités locales et les établissements publics locaux. Un tiers des emplois d’avenir, soit 30 000 cette année, relève des associations. Nous menons une politique de ciblage de ces contrats : les emplois d’avenir sont réservés à des jeunes non qualifiés, avec une exception qualifiante dans les zones prioritaires de la politique de la ville et en zone rurale. Quant aux contrats aidés, ils sont ciblés sur les demandeurs d’emploi de longue durée et sur les personnes ayant de grandes difficultés à s’insérer. Il peut donc y avoir un décalage entre le type de personnes que souhaitent embaucher les associations et le type de personnes éligibles aux mesures de la politique de l’emploi
– décalage que nous assumons dans la mesure où les outils de cette politique sont d’abord ciblés vers les besoins des personnes et où ce n’est que dans un second temps que nous cherchons à trouver des employeurs en mesure d’employer ces personnes et de les accompagner. Par ailleurs, nous insistons davantage qu’auparavant sur l’importance du parcours d’insertion : une fois qu’une association a embauché une personne dans le cadre d’un contrat aidé ou d’un emploi d’avenir, elle a une responsabilité non seulement en matière de contenu de l’emploi offert mais aussi en termes de formation et d’accompagnement pendant la durée du contrat.
Enfin, nous nous appuyons beaucoup sur les associations pour favoriser l’insertion par l’activité économique. Nous disposons pour ce faire de 4 000 structures d’insertion, toutes financées par l’État : il s’agit pour moitié de chantiers d’insertion et pour le reste, d’entreprises d’insertion ou d’associations intermédiaires. 2 150 structures ont un statut associatif : c’est le cas de la quasi-totalité des chantiers d’insertion et, par définition, de toutes les associations intermédiaires. C’est moins le cas des entreprises d’insertion. Les modalités de financement de ces structures ont été substantiellement modifiées cette année sous l’égide du Conseil national de l’insertion par l’activité économique. Les chantiers d’insertion bénéficient désormais de l’aide au poste, ce qui signifie que nous leur garantissons un volume de postes d’insertion financés. En contrepartie, nous leur imposons un financement légèrement modulé en fonction de leur performance, selon trois critères : le fait que ces chantiers aillent chercher des personnes réellement éloignées de l’emploi, le fait qu’ils leur proposent un parcours positif en leur sein et qu’ils les y accompagnent, et enfin, le fait que ces chantiers fassent le lien avec le monde économique à la sortie.
M. Stéphane Holé, adjoint au directeur du recouvrement, du contrôle et de la lutte contre la fraude (Acoss). Je complèterai les chiffres d’Emmanuelle Wargon en précisant que la masse salariale dans le monde associatif représente 37 milliards d’euros et que les associations ont liquidé 14,7 milliards de cotisations sociales en 2013. Les associations sont majoritairement de toutes petites structures : 80 % des structures ont moins de 9 salariés, et 55 %, moins de 3 salariés.
Sur le plan économique, le taux de reste à recouvrer est un indicateur nous permettant de mesurer la capacité des entreprises et des associations à respecter leurs échéances de paiement. En 2013, ce taux s’élevait pour les associations à 0,39 %, ce qui signifie que 99,71 % des cotisations sont réglées par les associations. Ce taux est très bas comparé à l’ensemble du taux de reste à recouvrer de la branche qui s’élève à 0,97 %. On constate cependant que pour les associations, ce taux s’est détérioré ces dernières années : de 0,16 % en 2008, il est passé à 0,28 % en 2009, puis à 0,34 % en 2011 et à 0,39 % en 2013. Cette évolution traduit probablement un accroissement des difficultés de financement des associations. La branche accompagne d’ailleurs celles-ci, comme toutes les autres entreprises, dès lors qu’elles rencontrent une difficulté d’échéance : elle leur accorde alors dans 98 % des cas des délais de paiement de trois mois pour régulariser leur dette – délais qui sont respectés dans la plupart des cas.
Le contrôle que nous effectuons auprès des associations s’inscrit dans le cadre d’un plan de contrôle classique. Au regard des objectifs de contrôle que nous nous sommes fixés vis-à-vis de l’ensemble des cotisants – sécuriser le financement de la protection sociale en contrôlant les masses financières les plus importantes, garantir les droits des salariés et intervenir de façon neutre pour les acteurs économiques –, les associations sont pour nous des acteurs économiques comme les autres. Elles ne font l’objet ni de plus ni de moins de contrôles. En 2013, 8 000 associations ont été contrôlées pour un redressement de 51 millions d’euros dont 8 millions ont été restitués aux cotisants associatifs, à la suite d’erreurs d’appréciation de la réglementation, et notamment du dispositif Fillon.
Si nous n’adoptons pas une approche différente de la gestion des associations, nous leur offrons en revanche des services et des modalités de gestion particuliers. Mme Évelyne Fleuret vous présentera tout à l’heure les deux dispositifs phares que nous destinons aux associations de moins de neuf salariés : le chèque emploi associatif et Impact emploi association, dispositifs de simplification du régime déclaratif et d’aide à la déclaration pour les associations. Nous partons en effet du postulat que celles-ci sont, pour beaucoup, de petites structures recourant à de nombreux bénévoles.
Les petites associations bénéficient par ailleurs de dispositifs d’assiette particuliers, compte tenu du fait qu’elles recourent à des personnes qui contribuent à leur objet social sans y être des permanents. Il existe notamment des régimes déclaratifs forfaitaires simplifiés, en particulier pour les petites associations sportives, qui permettent de traiter la question du bénévolat : en effet, les associations ne comprennent pas toujours pourquoi elles peuvent être redressées dans le cadre d’un contrôle. Or, on considère une personne comme bénévole dans une association si elle y exerce une activité subsidiaire par rapport à sa participation, qu’elle n’est pas rémunérée pour cette activité et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et les dirigeants de l’association. Si un inspecteur constate sur place que l’un de ces critères n’est pas rempli, il peut requalifier comme salariat la relation existant entre la personne active et l’association concernée, cette dernière devant alors s’acquitter de cotisations sociales.
Pour éviter aux associations de se retrouver dans une telle situation, la branche propose des dispositifs en amont. Nous avons notamment conclu des partenariats avec plusieurs fédérations d’associations afin de les informer des évolutions législatives et réglementaires. Par ailleurs, chaque association peut solliciter l’URSSAF directement si elle s’interroge sur un cas particulier. Et, dans le cadre du rescrit social, l’URSSAF peut prendre position en amont d’un contrôle sur la situation réelle de la personne au sujet de laquelle l’association l’aura interrogée : si l’URSSAF estime que cette personne est bénévole, cela sécurisera pour l’avenir la situation de cette dernière. Dans le cas contraire, elle invitera l’association à entrer dans le processus déclaratif applicable aux salariés. La réglementation admet évidemment qu’un bénévole puisse être indemnisé de ses repas ou de ses frais de déplacement. Mais si un inspecteur constate qu’un défraiement couvre un montant supérieur aux frais réellement occasionnés, il pourra éventuellement requalifier la situation de la personne concernée.
C’est surtout lors d’événements particuliers que les associations mobilisent de nombreux bénévoles. La branche préconise alors aux URSSAF de prendre contact avec les autorités organisatrices de ces événements afin de les informer des règles en vigueur.
Mme Évelyne Fleuret, sous-directrice de la gestion et de la modernisation des comptes cotisants (Acoss). Parmi les 165 000 associations employeurs, 80 % emploient moins de neuf salariés. C’est pour celles-ci que nous avons mis en place il y a dix ans deux offres particulières : Impact emploi association et le chèque emploi associatif. Sur ces 80 %, soit 132 000 associations, 10 % ont recours aux services d’Impact emploi association et 25 % au chèque emploi associatif. Quant aux 65 % restants, ils ont opté pour un mode de déclaration équivalent à celui de n’importe quelle autre entreprise. Cela ne veut pas dire que nous n’ayons pas atteint notre cible ni que nos offres ne correspondent pas aux attentes des entreprises. Au contraire, nos offres ont pour but d’aider les structures souhaitant éviter des problèmes d’illégalité quand elles recourent à ce qu’elles estiment être du bénévolat alors qu’il s’agit de salariat, et de sécuriser juridiquement ces structures employeurs en leur permettant de déclarer correctement les ressources qu’elles emploient. Quant aux associations aguerries qui embauchent en contrat à durée déterminée ou à mi-temps mais qui ont une certaine habitude du salariat, elles utilisent tout naturellement le système de droit commun.
Impact emploi association est un dispositif qui s’appuie sur des tiers de confiance auxquels on délègue la gestion d’associations et pour le compte desquelles ils vont déclarer le salariat, procéder aux contrats d’embauche, déclarer les cotisations sociales et demander à l’association employeur de payer ses salariés. En 2014, on recense 258 tiers de confiance partenaires des URSSAF répartis sur l’ensemble du territoire. La couverture du territoire national est donc importante et relativement équilibrée entre les différentes régions – les disparités existantes pouvant s’expliquer par une présence variable du tissu associatif au niveau local. Ces tiers travaillent pour 13 500 associations employeurs. Le dispositif est encadré par des conventions signées en 2008 avec le Comité national olympique français qui a contractualisé avec l’Acoss et la Fédération de triathlon. Nous avons également conclu une convention avec le Groupement national Profession sport et loisirs. En 2008, en effet, s’est manifestée la volonté forte de sécuriser l’emploi dans l’ensemble du monde associatif sportif – qui s’appuyait beaucoup sur le bénévolat et dont la situation juridique n’était pas toujours claire. Dans le cadre de la convention précitée, les comités nationaux olympiques sportifs et le Groupement national Profession sport et loisirs se sont engagés à accompagner l’ensemble de leurs adhérents afin de les sensibiliser au mode déclaratif ainsi qu’à la distinction entre statut bénévole et statut salarié, et de les amener à être en phase avec leur responsabilité d’employeur. Ces organismes peuvent procéder à des formations. Ils se sont appuyés sur Impact emploi association et ont aussi permis de développer l’usage du chèque emploi associatif.
Impact emploi association et le chèque emploi associatif concernent des emplois à court terme ouvrant droit à de faibles salaires, de 850 euros en moyenne par bulletin de salaire pour l’offre Impact emploi, et 500 euros par volet social pour le chèque emploi associatif, alors que dans le droit commun, ces salaires se situent autour de 20 000 euros. Le chèque emploi associatif fonctionne exactement comme le chèque emploi service universel (CESU). Le Centre national du chèque emploi associatif est joignable par téléphone afin d’accompagner l’ensemble des employeurs en les aidant notamment à déclarer leurs salariés et à appliquer correctement la convention collective à laquelle ils sont partie. En effet, d’une convention collective à l’autre, les règles diffèrent – Stéphane Holé a d’ailleurs souligné que certaines assiettes et exonérations spécifiques varient en fonction de la nature de l’activité de l’association concernée.
Pour aider les associations, nous disposons d’une ligne front office ouverte de 9 heures à 17 heures durant la semaine. Cette offre fonctionne de manière dématérialisée, avec un volet social et une étape qui vaut déclaration préalable à l’embauche. Après l’étape valant déclaration préalable à l’embauche du salarié s’ensuit le circuit déclaratif sur internet.
M. Vincent Guérinet, directeur-adjoint chargé des opérations à l’URSSAF Île-de-France. En Île-de-France, le tissu associatif présente certaines particularités : 35 000 associations y emploient près de 350 000 salariés – soit 7 % de l’effectif francilien. Comme dans le reste de la métropole, le tissu économique associatif se porte relativement bien en région parisienne, comparé au régime général. Ainsi les restes à recouvrer sont-ils plus faibles dans le monde associatif : 0,5 % contre un peu plus de 1 % dans le régime général. L’Île-de-France présente la particularité d’accueillir des associations employant de nombreux salariés : 20 % du fichier cotisant associatif en Île-de-France a une moyenne de 41 salariés. Les associations relevant de la catégorie des moins de 10 salariés représentent 80 % du nombre total des associations inscrites ; elles ont en moyenne moins de 2 salariés.
Comme l’a rappelé Stéphane Holé, l’accompagnement des difficultés économiques, qui ne fait pas l’objet d’un traitement particulier lorsqu’il s’agit d’associations, aboutit à un taux d’accord de délais comparable en région parisienne à celui du reste de la France – 98 % environ. Pourtant, la problématique est différente lorsqu’il s’agit de très grosses structures. En termes de gestion du compte cotisant, nous disposons en Île-de-France, comme dans huit autres URSSAF en métropole, d’un dispositif de versement en lieu unique de sorte que lorsque des associations sont présentes sur l’ensemble du territoire, plutôt que de les contraindre à payer leurs cotisations à l’ensemble des URSSAF, la branche leur permet de les verser toutes auprès d’une seule URSSAF. Ce dispositif bénéficie à de très grosses associations telles que la Croix rouge.
Depuis quatre ans, l’URSSAF d’Île-de-France a accentué ses efforts auprès des associations afin de les accompagner dans la dématérialisation de la déclaration et du paiement de leurs cotisations. Le taux de télé-déclaration et de télépaiement des cotisations des associations, qui s’élevait il y a quatre ans à moins de 40 %, est aujourd’hui de plus de 90 %. Un effort considérable d’accompagnement de ces structures a donc été accompli, sur le fondement de deux types d’offres. Les associations structurées qui n’ont pas besoin de bénéficier de dispositifs particuliers utilisent notre système de télé-déclaration classique. Par ailleurs, 5 000 cotisants bénéficient du chèque emploi association. Ce dispositif a non seulement permis de faire adopter par les petites associations un modèle déclaratif respectueux de la législation pour l’embauche du premier salarié mais aussi accéléré la dynamique d’embauche. Les évolutions constatées depuis l’instauration du CESU en termes de régularisation de l’emploi particulier ayant également été constatées dans le domaine associatif avec le CEA, il semble que ce dispositif ait satisfait tant les associations que l’URSSAF et les salariés.
Nous ne ciblons pas particulièrement les associations dans le cadre de nos contrôles, notre ciblage portant plutôt sur l’assiette et les risques liés à certaines activités. Les associations étant confrontées à la complexité de la législation au même titre que les autres employeurs, nos contrôles et redressements sont sans doute liés à un manque d’expertise des petites structures et à l’activité propre aux associations – qui octroient certains avantages en nature et emploient de nombreux bénévoles. C’est souvent la définition du périmètre des défraiements qui donne lieu à redressements, davantage que la nature du lien unissant le bénévole aux responsables associatifs. Nous vérifions ainsi si les remboursements sont proportionnels aux frais engagés ou s’ils constituent une forme de rémunération de l’investissement du bénévole dans l’association. L’assiette forfaitaire, autre dispositif de simplification du régime déclaratif, peut elle aussi constituer un motif de redressement, de même que les dispositifs d’exonération de l’aide à domicile.
S’agissant des opérations spécifiques que nous menons, nous avons développé en Île-de-France des partenariats avec les grandes fédérations sportives : une opération est notamment en cours avec l’Acoss auprès de la Fédération française de football pour préparer l’Euro 2016.
Enfin, nos enquêtes de satisfaction, qui sont communes à l’ensemble du réseau, ne font pas apparaître de demandes particulières de la part du monde associatif.
Mme Isabelle Le Callennec. Mme Emmanuelle Wargon nous a indiqué que les collectivités locales versaient 5 millions d’euros par an au profit de la professionnalisation des associations. Or, ces collectivités vont voir leurs dotations baisser de manière substantielle ; cela ne risque-t-il pas d’avoir un impact sur leur implication financière en la matière ?
S’agissant du décalage, observé sur le terrain, entre le besoin des associations et le profil des personnes qui peuvent bénéficier des contrats aidés ou des emplois d’avenir, vous nous avez expliqué que la politique de l’emploi consistait surtout en une aide au poste
– notamment pour les chantiers d’insertion – s’appuyant sur des critères tels que l’éloignement de l’emploi ou le soutien à la personne embauchée tout au long de son parcours. Cela étant, la « sortie positive » de ces personnes continue à poser problème : en effet, de plus en plus d’associations nous expliquent avoir accompli des efforts pendant un ou deux ans – puisque ces contrats ne peuvent durer plus de 24 mois – et souhaiteraient disposer de temps supplémentaire pour pouvoir garantir cette sortie positive.
Je me félicite par ailleurs que des efforts aient été accomplis en matière de simplification car, comme on s’en est aperçu dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, cela correspondait à une attente très forte des associations. Je suis cependant très étonnée que le chèque emploi associatif ne touche que 25 % des associations. Vous expliquez très justement que les autres associations sont soumises au droit commun. Cela étant, n’auraient-elles pas intérêt à utiliser ce chèque ?
Enfin, dans le cadre du dispositif « argent de poche », les communes rurales proposent à des mineurs de les aider pendant les vacances scolaires afin de développer leur sens citoyen. Dans ma circonscription, plusieurs communes ont recouru à ce dispositif, qui permet aux jeunes de toucher un chèque très modique mais surtout d’accomplir un acte civique. Or, celles-ci ont vu l’URSSAF vouloir requalifier ces actes en travail. Bien que la situation soit désormais réglée localement, si le dispositif venait à se généraliser à toute la France, il conviendrait de résoudre le problème une bonne fois pour toutes.
M. Régis Juanico. Je remercie Emmanuelle Wargon d’avoir rappelé que les emplois aidés n’étaient pas réservés aux associations mais bien destinés aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Il est vrai qu’au cours de ces dernières années, la variation du nombre de contrats aidés de même que la forte diminution de leur durée ont posé de nombreux problèmes aux associations. Car, alors que ces contrats ont vu leur durée réduite à six mois, une association a besoin pour bien fonctionner de dix à douze mois de visibilité. Enfin, l’accompagnement de ces contrats aidés dans les associations a posé problème lui aussi, de même que le tutorat, l’accompagnement, la professionnalisation et la qualification des personnes bénéficiant d’un emploi d’avenir. En effet, le but n’est pas de maintenir ces personnes éloignées de l’emploi dans des contrats aidés ad vitam aeternam mais de favoriser leur sortie positive de ces contrats. Dans quelle mesure la situation a-t-elle évolué à cet égard au cours de ces dernières années, sachant que la période de récession forte que nous traversons n’est pas propice à la diminution des contrats aidés ?
Enfin, les intervenants de l’URSSAF n’ont pas évoqué un dispositif dérogatoire dont bénéficient les associations sportives et qui concerne les rémunérations soumises à cotisations et à contribution sociale : le mécanisme de franchise mensuelle de cotisations sociales sur la rémunération de sportifs ou d’éducateurs sportifs pendant cinq manifestations par mois, en deçà d’un plafond de 120 euros. Pourriez-vous nous expliquer ce mécanisme et nous préciser à combien d’associations sportives il s’adresse ?
M. le président Alain Bocquet. Je souhaiterais vous soumettre un cas concret : il y a quatre ans, dans ma région, une course pédestre, organisée depuis trente ans par trois communes et rassemblant 1 200 participants et 3 000 personnes dans le public, a été annulée. En effet, les responsables de cette course, qui, outre les droits dus à la SACEM, doivent désormais payer le soutien de la gendarmerie, ont – sacrilège fiscal – donné 50 euros à chacun des 42 signaleurs bénévoles, souvent sans emploi, nécessaires pour le bon déroulement de la manifestation. Cela a bien fonctionné à deux reprises. Puis ils ont eu un contrôle de l’URSSAF sur ces 2 100 euros au total. Comment prévenir ce type de situations ? Car il n’est pas question ici de sportifs qui s’octroieraient une rallonge de salaire sous couvert de défraiements mais bien d’une association qui contribue grandement au maintien de la vie et de l’animation sur le territoire.
Mme Emmanuelle Wargon. Le financement du DLA par les collectivités locales a plutôt augmenté dans la période récente – il était de 7 % l’an dernier – non pas que les collectivités aient été plus généreuses mais elles ont été plus nombreuses à soutenir le dispositif. Aujourd’hui, 20 conseils régionaux, 58 conseils généraux et 57 intercommunalités financent des DLA départementaux, Parmi eux, 2 régions, 9 conseils généraux et 11 intercommunalités le font depuis l’an dernier. Nous ne sommes donc pas inquiets à cet égard.
En ce qui concerne le parcours d’insertion et les structures d’insertion par l’activité économique, je ne verrais pas d’inconvénient à ce que l’on supprime les limitations de durée des contrats concernés au profit d’une contractualisation avec ces structures. La durée moyenne du parcours d’insertion pourrait ainsi varier de quelques mois à deux ans selon les cas. Il s’agit cependant à ce stade d’une position personnelle car nous n’avons pas discuté de cette question avec les structures concernées. Et une telle mesure nécessiterait des garde-fous afin que l’exception ne devienne pas la règle. L’aide au poste présente aussi l’avantage de permettre aux structures d’insertion de conclure des contrats d’une durée de travail hebdomadaire très courte au début de la période d’accompagnement, qui deviennent progressivement des contrats à temps plein. Nous en avons fait l’expérience avec des associations de lutte contre l’exclusion telles qu’Emmaüs.
Il est vrai que la situation difficile sur le marché de l’emploi ne facilite pas les sorties positives. Mais il ne me paraît pas opportun de retenir un système identique à celui qui est pratiqué dans les entreprises adaptées aux personnes handicapées – où il n’y a quasiment aucune sortie. Il convient au contraire, selon moi, de maintenir une exigence de sortie positive. En revanche, il serait envisageable de faire évoluer les critères qualitatifs que nous retenons et d’examiner en particulier le lien qu’entretient la structure d’insertion avec le monde économique. On pourrait ainsi vérifier si la structure concernée a répondu à des clauses sociales prévues par des marchés publics ou privés et si elle a formé le salarié à des qualifications utiles sur le marché du travail. Il importe en effet que les structures d’insertion ne soient pas complètement déconnectées de l’activité économique – c’est-à-dire qu’elles n’aient pas une activité tellement spécifique que les personnes qu’elles accueillent n’ont aucune chance de retrouver un travail à l’issue de leur contrat.
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, nous avons effectivement accompli un effort important pour allonger la durée moyenne du premier contrat d’insertion. Il y a deux ans, la durée moyenne d’un CAE était de six mois. Les personnes concernées restaient cependant plus longtemps en poste car leur contrat était renouvelé. Mais deux contrats de six mois n’équivalent pas à un contrat d’un an. C’est pourquoi nous avons beaucoup insisté auprès de nos services déconcentrés ainsi qu’auprès des employeurs pour qu’ils portent la durée de leurs contrats à un an. Certaines associations et collectivités jugent cette durée trop longue et la solution antérieure, plus souple. Mais tout dépend de quel point de vue l’on se place. Désormais, la durée moyenne des conventions initiales est de 11 mois.
Enfin, en ce qui concerne les perspectives budgétaires pour 2015, 350 000 CAE ont été financés cette année et 270 000 sont inscrits au budget prévisionnel 2015. Cela étant, des discussions éventuelles pourraient permettre de dépasser ce chiffre. 85 000 emplois d’avenir ont été financés en 2014 et 50 000 sont prévus l’an prochain dans le projet de loi de finances.
Mme Évelyne Fleuret. Il est légitime de se demander pourquoi toutes les associations ne recourent pas aux dispositifs simplifiés qui leur sont proposés. Mais les associations, une fois qu’elles sont bien installées et qu’elles ont appréhendé la complexité de la convention collective dont elles relèvent, ne voient aucun inconvénient à utiliser le système déclaratif normal. Il importe aussi de préciser que ces offres de service se présentent comme des guichets uniques traitant de l’ensemble des frais auxquels les associations sont assujetties, y compris en matière de prévoyance et de retraite complémentaire. On peut donc comprendre qu’un employeur préfère garder la main sur la gestion de ce type de cotisations. Voilà sans doute pourquoi le système déclaratif de droit commun semble convenir à de nombreuses associations.
Enfin, s’agissant de l’exemple que vous avez cité, si je ne peux répondre dans le détail, je rappellerai que le CEA vise précisément à faire face à ce type de cas puisqu’il est destiné aux associations qui embauchent moins de neuf équivalents temps plein (ETP) au cours d’une année. Les utilisateurs du CEA sont donc majoritairement des entreprises faisant appel à de l’emploi occasionnel.
M. le président Alain Bocquet. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Audition sectorielle « Tourisme » :
Mme Michelle Demessine, présidente de l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT),
et M. Sylvain Crapez, délégué général
(séance du 23 octobre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Nous achevons aujourd’hui nos auditions dites « sectorielles ». Merci, madame, monsieur, d’avoir accepté notre invitation.
Le tourisme social et associatif est né de la volonté de promouvoir un tourisme de qualité pour tous, notamment pour les jeunes, les ménages les plus modestes et les personnes souffrant d’un handicap. Il vise à rendre effectif le droit aux vacances. Le tourisme social aujourd’hui, c’est plus de 3 millions de personnes accueillies, plus de 20 millions de journées de vacances offertes chaque année, et environ 20 000 emplois. Peut-être jugerez-vous nécessaire d’ajuster ces chiffres.
Comment la crise de ces dernières années affecte-t-elle le tourisme social ? Quelles difficultés a-t-elle créées, révélées ou accentuées ? Vos relations avec la puissance publique ont-elles été modifiées ou devraient-elles l’être ? La concurrence du secteur lucratif s’est-elle faite plus forte, devient-elle menaçante ? Le secteur du tourisme social doit-il se réformer de l’intérieur ?
Mais, au préalable, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Michelle Demessine et M. Sylvain Crapez prêtent serment)
Mme Michelle Demessine, présidente de l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT). Merci de nous accueillir ; je ne doute pas que les conclusions de votre commission d’enquête constitueront une aide précieuse pour le secteur associatif.
Présidente de l’UNAT depuis quatre mois, je connais parfaitement le secteur du tourisme pour y avoir consacré beaucoup d’énergie en tant que secrétaire d’État au tourisme de 1997 à 2001.
L’émergence du tourisme social s’inscrit dans le mouvement des grandes conquêtes sociales de notre pays : la création des congés payés en 1936, d’une part, et la création des grands mouvements d’éducation populaire et des comités d’entreprise en 1945, d’autre part. Ces deux avancées majeures ont favorisé la massification du tourisme, auparavant réservé aux classes privilégiées. Ainsi est né un vaste réseau d’accueil sur l’ensemble du territoire, caractérisé par un fort contenu éducatif et culturel, avec les plus belles destinations de la première destination touristique mondiale, ce qui en fait un modèle dans le monde.
La richesse du tourisme social, c’est son patrimoine, acquis par ceux qui l’ont créé grâce à des actions de solidarité, mais aussi à une intervention publique forte au début de son existence. Ce patrimoine est en danger, nous y reviendrons. La richesse du tourisme associatif, ce sont aussi les hommes et les femmes qui le font vivre : des professionnels de qualité, bénéficiaires d’une convention collective nettement plus favorable que celle du secteur privé, mais aussi des bénévoles.
L’UNAT fédère 56 grandes organisations nationales et 524 membres régionaux réunis au sein de 20 unions régionales des associations de tourisme. Elle couvre un secteur économique très divers : villages de vacances, centres de vacances pour enfants et adolescents, centres sportifs, auberges de jeunesse, voyagistes, organisateurs de séjours, refuges, gîtes, centres internationaux de séjour, campings. Cet ensemble représente 1 600 établissements, 230 000 lits, 5 millions de vacanciers chaque année, et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2 milliards d’euros.
S’agissant des vacances familiales, l’UNAT s’investit dans plus de 500 sites, ce qui représente 140 000 lits, 2 millions de vacanciers, 8 000 emplois et 90 millions d’euros de retombées économiques, avec notamment VVF Villages et Cap France comme membres partenaires. Pour le tourisme des jeunes, avec en particulier l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) et la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) comme membres partenaires, elle gère plus de 190 sites, ce qui équivaut à 20 000 lits, 1 million de personnes accueillies, 1 500 emplois et 11 millions d’euros de retombées économiques. Le secteur enfants et adolescents nous amène à intervenir sur 400 sites, soit 43 000 lits, 1 million de jeunes accueillis, 7 500 emplois et 50 millions d’euros de retombées économiques. Notre secteur voyage accueille 40 000 vacanciers pour 1,5 million d’euros de retombées économiques, mais avec moins d’emplois puisque nous travaillons avec les agences de voyage. Enfin, notre réseau offre des gîtes, des refuges, des campings sur 220 sites pour 16 000 lits, soit 450 000 personnes accueillies, 1 800 emplois et plus de 23 millions d’euros de retombées économiques.
Le tourisme social et associatif présente de nombreux atouts.
D’abord, notre patrimoine est réparti sur l’ensemble du territoire, y compris la Côte d’Azur – le château d’Agecroft à La Napoule, par exemple, a été sauvé grâce au tourisme social et reçoit encore chaque année des personnes de condition modeste. Un tiers de ce patrimoine appartient en propre à nos organisations, la moitié aux collectivités territoriales, et le reste aux comités d’entreprise.
Grâce à ce patrimoine, le tourisme social est un véritable aménageur du territoire. Nous sommes présents dans 1 600 communes, dont plus de 60 % comptent moins de 3 000 habitants, essentiellement situées en zone rurale. Notre activité est essentielle à la vie des territoires car les petites communes campagnardes n’intéressent pas les grands groupes du tourisme privé. L’ensemble de nos équipements génère 175 millions d’euros de retombées fiscales et sociales, et nos seuls villages de vacances permettent d’injecter plus de 300 millions d’euros dans l’économie locale.
Ensuite, notre secteur porte des valeurs. En effet, les grandes organisations rassemblées au sein de l’UNAT s’engagent en faveur d’un tourisme de qualité, ouvert à tous, vecteur de cohésion et de progrès social au service d’une société plus solidaire et durable. Notre mission historique trouve à cet égard toute sa justification puisque notre pays compte encore un nombre important de personnes qui ne partent jamais en vacances, en particulier aujourd’hui les jeunes couples avec enfants, faute de revenus suffisants. Il s’agit là d’un recul social important, sachant que nos générations ont accédé très rapidement au droit aux vacances.
Cette audition est d’autant plus importante pour nous que l’un des rôles de l’UNAT est également de faire reconnaître l’importance économique de notre secteur qui génère 19 000 emplois et 205 millions d’euros d’impôts et taxes grâce aux 5 millions de personnes accueillies pour 27 millions de journées de vacances offertes.
En plus d’être un aménageur du territoire, le tourisme social est porteur d’innovations. En effet, les organismes du tourisme social et de plein air furent les premiers à proposer des aménagements, tels les sentiers de randonnées pédestres, les pistes de ski de fond, les pistes cyclables, l’aménagement des rives, etc., permettant de démocratiser la pratique d’activités. Le Club Méditerranée, un des fleurons du tourisme français, s’est développé sur le modèle des grands villages du tourisme social des années soixante. Aujourd’hui, le tourisme social est encore capable d’innovations, pour peu que des remèdes soient apportés aux difficultés auxquelles il est confronté.
Depuis quelques années, le tourisme social participe au développement d’initiatives que je trouve très importantes. Je pense en particulier aux conventions qu’il passe avec des communes rurales ne disposant pas d’équipements sportifs et de loisirs, afin de mettre ses propres équipements à la disposition des populations locales, comme les piscines, ce qui lui permet de contribuer à l’apprentissage obligatoire de la natation chez les jeunes.
Pour finir, je dirai que la réforme territoriale est pour nous un motif d’inquiétudes, comme pour un grand nombre d’associations, notamment au regard de nos financements. En outre, le poids des normes et des règlements est un réel problème pour notre association d’utilité publique qui regroupe des organismes à but non lucratif.
M. Sylvain Crapez, délégué général. L’Union nationale des associations de tourisme et ses membres sont très attachés à la défense du fait associatif. L’UNAT se revendique comme le réseau du tourisme social et solidaire, c’est-à-dire des acteurs professionnels du tourisme qui défendent au quotidien les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Nous avons rédigé neuf propositions. Nous vous remettrons des documents en ce sens, basés sur des études de l’UNAT, dont l’une réalisée en 2013 sur 1 000 établissements du tourisme social et solidaire montre que seulement 15 % des 130 millions d’euros investis par les acteurs de cette économie proviennent de fonds publics – des régions principalement, de l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) et des fonds européens.
Notre première proposition est de faire comprendre ce qu’est le monde associatif. En effet, nous constatons parfois une méconnaissance du fait associatif de la part de la sphère publique. Il nous semble donc intéressant que les parcours des fonctionnaires incluent une immersion dans les structures associatives, afin d’améliorer la connaissance de nos modes de fonctionnement. Avant mes fonctions à l’UNAT, dans le cadre de mon travail comme délégué général d’un réseau d’entreprises d’insertion, j’ai accompagné pendant une semaine sur les structures des contrôleurs du travail, ce qui a permis notamment de leur montrer que le temps des institutions n’est pas celui des associations, qui sont de véritables entreprises avec de vrais besoins.
Nous proposons ensuite de rompre avec l’insécurité financière des associations. Nous notons des avancées, en particulier les conventions triennales définissant les engagements réciproques, lesquelles nous apportent une meilleure visibilité en matière de subventions. Les financements européens sont un sujet d’inquiétude, mais c’est surtout la règle de minimis qui impacte notre secteur, en fixant à 200 000 euros sur une période de trois ans le montant maximal des subventions ne relevant pas du contrôle des aides d’État par l’UE. Cette règle constitue un frein à la rénovation du patrimoine du tourisme social, qui doit mener des chantiers d’adaptation et de mises aux normes particulièrement coûteux. J’observe d’ailleurs que les réglementations européennes sont appliquées avec zèle dans notre pays, alors que d’autres pays, comme la Belgique ou l’Italie, n’ont jamais entendu parler de la règle de minimis ! En Flandre, par exemple, un seuil maximal de subvention est fixé à 50 %.
Notre troisième proposition est le rétablissement des subventions d’investissement. En la matière, je pense que la dépense publique pourrait être fléchée. VVF Villages vient de rénover le très beau site de Lège-Cap-Ferret, pour 14 millions d’euros en faisant travailler un architecte bordelais et des artisans locaux. Les associations du tourisme social sont des acteurs du développement sur les territoires car, en injectant de l’argent dans l’économie locale, en faisant appel parfois à de grands groupes de travaux publics français, notre secteur participe au patriotisme économique.
Quatrièmement, nous proposons de remédier à la multiplication des agréments. Actuellement, il nous faut un agrément Éducation nationale pour l’accueil des classes, un agrément Jeunesse et sports pour l’organisation des séjours des jeunes, etc. Nous attendons une simplification de notre mode de fonctionnement, car répondre à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs nous éloigne de notre mission première.
Notre cinquième proposition est de rompre avec l’insécurité juridique, notamment en matière de marchés publics. Certains de nos villages vacances ouvrent leur piscine au grand public, d’autres proposent un service public minimum sur les territoires en lien avec La Poste. En Bretagne, un membre a fait rénover sa salle de musculation et propose de l’ouvrir hors saison aux adolescents du secteur, mais cela sera malheureusement impossible car il devrait pour cela embaucher un moniteur diplômé à temps complet. On le voit : la question du vivre ensemble et la proposition de services se heurtent à la lourdeur des normes et règlements.
La sixième proposition est de mettre fin au traitement inégalitaire sur les territoires en matière de normes et règlements, d’inspections de sécurité, etc. En effet, d’un département à l’autre, la vision est soit laxiste, soit ultra-réglementée. Nous aimerions qu’un interlocuteur unique s’assure d’un traitement équitable des situations.
Septièmement, nous proposons que la puissance publique recoure davantage à l’expertise des associations, plutôt qu’à celle de consultants ou de grands cabinets de consulting, parfois très onéreuse. Nous sommes en particulier très favorables aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).
Notre huitième proposition est la publication rapide des décrets d’application relatifs à la loi Hamon sur l’économie sociale et solidaire, texte qui constitue une réelle avancée, en particulier sur la définition de la subvention, mais aussi sur l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Cela permettra à nos entreprises travaillant dans « le tourisme au service des hommes et des territoires » d’avoir une vraie ligne de travail.
L’harmonisation des textes fiscaux constitue notre dernière et neuvième proposition. Beaucoup de nos membres étant soumis à des contrôles fiscaux inégalitaires d’un département à l’autre, nous sommes favorables à la suppression du critère de publicité dans les quatre « P » de la doctrine fiscale, comme le propose le rapport sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, rédigé en 2013 par MM. Blein, Grandguillaume, Guedj et Juanico. Ne pas reconnaître la nécessité d’une communication pour faire connaître une micro-activité économique est en effet une forme d’hypocrisie, sans compter que cette mesure ne coûterait rien à l’État.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Merci pour la qualité de vos interventions. Élue du Languedoc-Roussillon, je mesure l’importance de l’enjeu touristique. Vous êtes porteurs d’innovations. La réforme territoriale est-elle un motif d’inquiétude pour vos associations ou la considérez-vous comme une chance ?
Les besoins des populations évoluent : les gens partent plus souvent et moins longtemps en vacances et aspirent à d’autres formes de tourisme – en particulier rural, autour de certaines activités, résidentiel, ou encore adapté au handicap. Cette valorisation, à laquelle je crois beaucoup, impliquera certainement une réflexion sur la mutualisation et l’élaboration de projets sur les territoires à partir des besoins des populations. Comment pouvez-vous être force de propositions pour développer ces nouvelles formes de tourisme à partir de l’économie sociale et solidaire, dans un contexte de contraintes sociales fortes ?
M. Jean-Louis Bricout. Merci pour vos interventions. Nous mesurons l’importance de votre rôle éducatif auprès de notre jeunesse et, plus généralement, de votre rôle social sur les territoires avec la mise à disposition d’équipements.
Lors des auditions précédentes, la sécurisation des financements, la multiplication des labels et la complexité administrative ont été abordés. Je ne doute pas que notre rapport formulera des propositions en la matière.
Des associations caritatives organisent des séjours pour faire découvrir la mer à des enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Avez-vous des retours sur leurs relations avec les collectivités dans le montage des projets ? Et pensez-vous que la réforme territoriale aura un impact sur ces projets ?
Vous avez évoqué la méconnaissance du fait associatif. Que proposez-vous pour y remédier ?
En raison de la crise économique, les jeunes couples ont de plus en plus de difficultés à partir en vacances. Comment adaptez-vous vos politiques à cette nouvelle problématique et quelles sont vos propositions ?
L’association Tourisme et handicaps fait partie de votre réseau et délivre le label « tourisme et handicap ». Créée en 2001, la marque « tourisme handicap », plus communément dénommée label, a pour objectif d’apporter une information objective et homogène sur l’accessibilité des sites et les équipements touristiques. Son développement et l’accroissement de sa visibilité constituent un véritable enjeu afin de favoriser et de valoriser une véritable politique touristique inclusive pour tous les types de handicap. Quel bilan tirez-vous de ce dispositif ? Plus généralement, comment les associations traitent-elles cette problématique essentielle pour l’inclusion universelle ? On parle beaucoup de handicap, mais les problématiques d’accessibilité concernent aussi les mamans avec des poussettes, par exemple.
Enfin, quel est l’impact des comités d’entreprise sur le tourisme au regard des offres qu’ils peuvent proposer ? Ces offres sont-elles toujours attractives et comment se nouent les partenariats entre associations du secteur touristique et entreprises ?
M. le président Alain Bocquet. L’UNAT est-elle suffisamment armée pour apporter une réponse stratégique aux problèmes actuels ? Comment peut-elle aider les associations et organismes qu’elle regroupe à s’adapter aux évolutions qui s’imposent ?
Mme Michelle Demessine. La réforme territoriale inquiète tout le monde, car qui sait dans quelle situation se retrouveront les collectivités ? Nous craignons que l’existence de collectivités massives renforce la conception technocratique des choses. Sans compter que nos unions régionales devront s’adapter, bouleversement dont nous espérons sortir par le haut.
Le tourisme social souffre d’un problème d’image très important : bon nombre de nos concitoyens y voient un tourisme au rabais – certains ignorent même que les villages VVF en font partie. Certes, quelques villages ont besoin d’être rénovés, mais l’offre est généralement acceptable par rapport aux prix demandés. Lorsque j’étais secrétaire d’État au tourisme, une grande campagne de communication avait été mise en place pour améliorer l’image de ce secteur. Il faut relancer cette communication, par exemple à l’occasion des grands reportages télévisés au moment des vacances, qui malheureusement ne sont jamais réalisés sur les lieux de nos structures, alors que nous faisons partir 5 millions de personnes.
Pour casser cette image d’un tourisme social au rabais, nous avons besoin d’être soutenus financièrement. Lors de la création de ce secteur, le soutien financier public était important, avec un plan patrimoine, l’intervention des caisses d’allocations familiales, etc. Aujourd’hui, pratiquement plus personne ne nous soutient : le budget de l’État ne prévoit plus aucun plan patrimoine – le dernier date de la période où j’étais secrétaire d’État au tourisme. Au demeurant, il n’existe pas de ministère du tourisme – tout est regroupé dans des agences – et le seul dispositif existant, celui de la Caisse des dépôts, se met difficilement en place : la Caisse a mis très longtemps à accepter l’ouverture d’une ligne pour le tourisme social, laquelle n’est d’ailleurs pas entièrement consommée.
L’économie touristique, qu’elle soit sociale ou privée, doit faire face à des investissements très importants : nos structures ont besoin d’être rénovées, comme les hôtels. Elles tentent de survivre, de boucler leurs budgets, pour continuer d’offrir un accueil de qualité. Mais il est très difficile de sauvegarder sa vocation sociale quand on doit lutter pour sa survie économique. D’où l’importance d’un soutien financier par les pouvoirs publics.
Le label « tourisme et handicap » est une fierté personnelle car c’est moi qui l’ai créé lorsque j’étais secrétaire d’État au tourisme. Depuis 2001, il a été pris en main par toutes les structures, comme par les régions et les départements. La mise aux normes des équipements ne suffit pas, il faut aussi réfléchir à des parcours touristiques adaptés, travail très important auquel se sont attelées nos structures.
La modernisation technique elle-même renvoie au problème financier. Comme les collectivités, nous faisons installer des ascenseurs, par exemple, à l’occasion d’une rénovation.
Vous avez raison de m’interpeller sur les comités d’entreprise, car notre secteur se portera bien si ce partenaire essentiel est au rendez-vous. Or aujourd’hui, on ne peut pas dire que le concept de droit aux vacances pour tous est au cœur des politiques des CE. Certains, et nous le déplorons, ne font plus la différence entre tourisme privé et tourisme social, alors que ce dernier présente un intérêt éducatif et culturel avec comme objectif premier de permettre au plus grand nombre de partir en vacances.
Quant au mouvement syndical, il devrait reprendre son bâton de pèlerin pour reposer la question des non-départs. Nos structures pourraient accueillir beaucoup plus de monde, mais les gens ne sont plus aidés financièrement comme autrefois. Il est terrible pour nos générations de constater que nos petits-enfants n’imaginent pas pouvoir partir en vacances. C’est un problème politique qui nous est posé à tous !
L’UNAT est d’autant plus capable de répondre aux enjeux actuels qu’elle est l’émanation des grands réseaux. Ces grands réseaux sont des entreprises animées par des professionnels de qualité, qui ont une vraie expérience, des savoir-faire, et dont la force est d’avoir conservé des valeurs. Alors que l’esprit militant s’est effiloché au fil du temps dans bon nombre de domaines, notre réseau réunit encore des gens de très bon niveau et qui se battent pour maintenir une offre de qualité – même s’ils sont très occupés par la survie de leur structure. Nous sommes donc capables de faire face à tous ces défis, pour peu que nous soyons aidés.
Je pense que nous sommes au rendez-vous de l’évolution des besoins, car nous nous montrons depuis toujours très soucieux de l’accueil de nos bénéficiaires en termes de bien-être, de découverte du territoire, de participation aux activités. Nos réseaux commencent à s’adapter pour proposer des séjours plus courts et pourraient aller plus vite dans l’adaptation aux besoins s’ils disposaient de moyens supplémentaires leur permettant de rénover leur patrimoine. Beaucoup y sont prêts, mais ne trouvent pas les soutiens financiers nécessaires, si bien que certains baissent les bras. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation très critique : des réseaux vont fermer des villages ou sont obligés de les vendre au secteur privé. Malheureusement, les villages vendus sont d’abord ceux situés dans les plus beaux lieux, car ils attirent beaucoup d’acheteurs. Cela nous privera d’une offre sur l’ensemble du territoire, alors que notre mot d’ordre est que les gens de condition modeste ont aussi le droit d’aller sur les plus beaux sites.
Faute de ministère du tourisme, la promotion du tourisme relève du ministère des affaires étrangères, mais l’aspect territorial revient au secrétariat d’État de Carole Delga en charge du commerce et de l’économie sociale et solidaire. Notre faiblesse réside dans cette absence d’interlocuteur – nous manquons d’un « lobbying politique ». J’ai donc pris l’initiative de créer un club de parlementaires de défense et de promotion du tourisme social et associatif – je sais que les élus défendent bec et ongles les équipements présents sur leurs territoires. Nous avons besoin d’une voix plus forte pour être entendus et défendre notre patrimoine qui nous a été légué par nos prédécesseurs : les bâtiments des villages AEC, par exemple, ont été payés à l’origine par des souscriptions citoyennes. Il est important de défendre ce patrimoine, afin qu’il ne disparaisse pas, et nous comptons sur votre aide pour y parvenir.
M. Sylvain Crapez. Le tourisme social et associatif tire ses revenus des prestations qu’il réalise pour les vacances de tous, et non d’un modèle immobilier. En l’absence de politique patrimoniale de l’État, nous nous tournons souvent vers les régions. Or si certaines sont très impliquées, d’autres le sont beaucoup moins, d’où nos inquiétudes quant à la réforme territoriale.
Nous avons de beaux projets sur la Côte d’Azur avec l’UCPA, mais aussi un projet en Lozère. Notre vocation est d’être présents dans tous les départements, pour défendre la ruralité, le service public. Quand nous demandons un euro, nous voulons que cet euro soit intelligent, ciblé, qu’il génère de l’emploi local durable. Le fonds Tourisme social Investissement (TSI), produit de la Caisse des dépôts, correspond aux attentes de certains de nos membres, notamment les plus gros, mais il reste un modèle d’investisseur, en dissociant propriété SCI et gestion. Le réseau AEC a initié la finance participative. Aujourd’hui, nous avons de vraies inquiétudes au regard des changements qui vont intervenir.
Par contre, nous travaillons à l’adaptation du public : VVF Villages, par exemple, a mis en place des « bulles » pour les adolescents, qui sont des espaces dédiés. Nous nous sommes toujours inscrits dans l’innovation ; nous voulons maintenant faire valoir ces innovations, ce que nous n’avons pas été capables de faire jusqu’à présent. J’ai visité cet été le village des Quatre Vents sur l’île de Noirmoutier : avec 200 lits, 120 emplois, ce centre remarquable sous la forme d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) – assurant la blanchisserie, la restauration, l’entretien des espaces verts, l’accompagnement et le cœur de métier, les vacances –, est très apprécié des vacanciers et réalise des excédents chaque année. L’auberge de jeunesse de La Rochelle fait de l’insertion par l’activité économique. L’intérêt de l’économie sociale et solidaire est ainsi d’apporter des réponses nouvelles. Nos membres eux-mêmes sont prêts à apporter de nouvelles réponses, par exemple en travaillant sur des projets d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de crèches, qui pourraient être installés à proximité des villages vacances. C’est aussi dans ces domaines que nous voudrions inscrire le développement du tourisme social et solidaire de demain.
M. le président Alain Bocquet. Merci beaucoup de votre contribution.
Audition de M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
(séance du 13 novembre 2014)
M. le président Alain Bocquet. Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir aujourd’hui, pour la dernière audition organisée par notre commission d’enquête, M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Monsieur le ministre, l’actualité de la vie associative est riche. Les actions globales de communication liées à l’engagement, Grande cause nationale 2014, ont débuté il y a quelques semaines. La neuvième édition du Forum national des associations et fondations s’est déroulée à la fin du mois d’octobre, et vous y avez participé. Le travail d’élaboration des décrets d’application de la loi « économie sociale et solidaire » (ESS) bat son plein – du moins, nous l’espérons… Les premiers labels de l’initiative présidentielle « La France s’engage » ont été délivrés, etc.
Le monde associatif n’est donc pas oublié. Cependant, les travaux de notre commission d’enquête ont montré que les difficultés des associations sont immenses en termes de financement, de ressources humaines, de reconnaissance. Des constats ont été dressés, des appels lancés, des idées avancées. Nous avons maintenant besoin d’entendre la parole du Gouvernement, car certaines questions restent ouvertes.
Mais auparavant, je dois vous demander, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Patrick Kanner prête serment)
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Mesdames et messieurs les députés, les associations sont au cœur de mes responsabilités ministérielles, directement ou indirectement, dans le domaine de la ville, de la jeunesse et des sports. Comme j’ai coutume de le dire, sans la vitalité associative, nombre de politiques publiques ne pourraient être mises en œuvre.
Ministre de la vie associative, je coordonne, d’une certaine manière, l’intervention de mes collègues : le ministre de l’intérieur, qui doit faire respecter la loi de 1901 ; la ministre des affaires sociales, qui est particulièrement concernée par le secteur médico-social ; la ministre de la culture, qui l’est tout autant par la création culturelle ; celle de l’éducation nationale, dans la mesure où les associations interviennent dans le cadre scolaire, notamment depuis la réforme des rythmes éducatifs ; le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, en raison de la dimension économique du secteur associatif, etc.
Ainsi avons-nous parfaitement conscience, au sein du Gouvernement, du rôle essentiel que joue le secteur associatif en faveur de la cohésion nationale et du progrès social. En tant que ministre de la vie associative, il me revient donc de faire en sorte que le secteur associatif soit reconnu et encouragé dans son action généreuse et altruiste et sa vitalité préservée.
Certes, les difficultés financières que rencontrent les associations sont réelles. Je tenais néanmoins à rappeler quelques chiffres qui témoignent de l’engagement du Gouvernement, et qui vont peut-être vous rassurer.
Les subventions accordées par l’État au secteur associatif – tous ministères confondus – représentaient 1,860 milliard d’euros en 2012, soit une progression de 25 % par rapport à 2010. C’est un effort notable en période de tension budgétaire, qui prend notamment la forme d’exonérations d’impôts. Dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en débat, notre contribution progressera de 142 millions d’euros en 2015 par rapport à 2014, et de 314 millions par rapport à 2013, en particulier grâce à l’abattement de la taxe sur les salaires consenti au secteur associatif. Au final, une aide de 2,6 milliards d’euros est accordée au secteur associatif. On peut en conclure que, globalement, le soutien financier de l’État au monde associatif n’a pas diminué ces deux dernières années, et qu’il a même progressé.
Cela dit, le rôle de l’État ne se limite pas au financement des associations. Le financement est un outil au service de la triple mission qu’il exerce à l’égard du secteur, et que je résumerai ainsi : « coordination, facilitation et reconnaissance ».
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Il faudra, notamment, sécuriser davantage les financements associatifs et mettre en œuvre la Charte des engagements réciproques entre l’État, les collectivités territoriales et les associations, qui a été signée le 14 février 2014.
Cette Charte pose les bases d’un rééquilibrage entre subventions et commande publique. Elle fixe des principes et des engagements respectifs en matière de dialogue civil et de contractualisation avec la puissance publique et le secteur associatif. Elle doit permettre une déclinaison locale qui s’appuierait sur l’opportunité de créer des cadres de travail entre associations et pouvoirs publics, l’objectif étant de co-construire les politiques publiques à partir de critères partagés.
L’objectif, complexe dans sa mise en œuvre, est simple dans son énoncé : respecter l’indépendance des projets associatifs qui représentent l’innovation territoriale, qui permettent la mise en œuvre de procédures de veille et d’alerte, tout en faisant en sorte que ces projets associatifs soient en résonance avec des politiques publiques portées par le Gouvernement ou les collectivités territoriales ; en d’autres termes, rapprocher cette liberté associative des priorités publiques qui relèvent de la souveraineté des élus, qu’ils soient nationaux ou locaux. Concrètement, cela doit conduire à davantage de transparence par le vote de délibérations dans les assemblées locales, notamment sur les critères de subventionnement.
Cette Charte engage l’État comme le secteur associatif. C’est le sens de la réciprocité entre pouvoirs publics et associations. Mais je serai franc : pour être plus solide, le secteur associatif doit être capable de se réformer lui-même, de se remettre en cause continuellement, de se mettre en phase avec des aspirations démocratiques et éthiques de nos contemporains, et donc des adhérents du secteur associatif. Je pense plus particulièrement au renouvellement des mandats et à la nécessaire transparence des rémunérations des dirigeants associatifs. Pour que nous puissions avancer dans des conditions de confiance partagée, la question de la gouvernance associative doit être posée.
Une autre avancée, cette fois-ci en termes de sécurisation des financements, a été permise par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, qui définit pour la première fois ce qu’est une subvention. À ce propos, je tiens à rappeler que la subvention est un outil équivalent aux autres, qu’il n’est pas question de prohiber, dans le cadre des relations entre les pouvoirs publics et le secteur associatif. La loi met également en avant l’intérêt des conventions pluriannuelles d’objectifs. C’est le moyen de sécuriser les financements des associations, mais aussi de garantir l’efficacité des actions financées par les pouvoirs publics.
Cela suppose, je le concède, un effort de pédagogie en direction des collectivités. Un guide méthodologique est en cours de rédaction et des actions de formation seront menées en lien avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Faire savoir est une chose, le faire est encore mieux. En l’occurrence, il existe manifestement un décalage entre la volonté politique exprimée dans la loi ESS et la réalité de terrain.
Faire plus pour le secteur associatif, c’est aussi faciliter l’accès des associations à d’autres sources de financement que les financements publics. Ceux-ci représentent aujourd’hui à peu près la moitié du financement total du secteur. Comment développer l’autre moitié ?
La loi ESS propose de nouveaux outils : les titres associatifs, dont la rémunération est rendue plus attractive ; la capacité, pour les associations d’intérêt général, d’accepter des libéralités, de posséder et administrer des immeubles, de créer des fonds de garantie et apports en fonds associatifs.
D’autres outils d’appel à la générosité publique émergent, comme les plates-formes de financement participatif (crowdfunding) ou les dons via les transactions du quotidien. Nous devrons construire les cadres permettant de faciliter l’accès à ces nouveaux modes de financement, car certains problèmes se posent encore.
Faire plus pour les associations, c’est aussi leur en demander moins en termes de formalités administratives – c’est l’objet du « choc de simplification ». Cela devrait leur faire gagner du temps et leur permettre de se consacrer davantage à leur projet. La loi ESS nous a autorisés à procéder par ordonnance, s’agissant de la simplification des démarches des associations et des fondations avec les administrations. Un député, M. Yves Blein, vient de remettre un rapport au Premier ministre, où il propose cinquante mesures que nous travaillerons avec le secteur associatif.
Un volet important concerne la dématérialisation des démarches. Dès aujourd’hui, le « compte Association » sur le site Service-Public.fr incite à faire davantage de démarches en ligne – création, modification, changements d’adresse – ce qui permet de s’épargner des démarches à la préfecture, souvent fastidieuses et parfois négligées. C’est une solution rapide, accessible 24 heures sur 24, pratique et sécurisée. L’étape suivante sera la création de portails pour les subventions, afin éviter la multiplication de demandes ayant le même type de support.
Faire plus pour le secteur associatif, c’est soutenir l’engagement bénévole et volontaire. La montée en charge substantielle du service civique doit être considérée comme une véritable opportunité pour le secteur associatif. L’Assemblée nationale a voté la semaine dernière un amendement permettant de porter leur nombre à 45 000 en 2015. Je remercie ici les parlementaires qui m’ont soutenu unanimement dans cette démarche. L’objectif du Président de la République est d’atteindre, à la fin du quinquennat, 100 000 jeunes en service civique. Nous pourrons éventuellement revenir sur les annonces du Président de la République concernant l’engagement universel, qui viendrait compléter le dispositif du service civique.
C’est enfin reconnaître l’engagement bénévole. Il y aura lieu de veiller à ce que l’engagement ait des effets positifs pour l’intéressé, pour son entourage, dans son parcours de formation et dans son parcours professionnel. J’ai reçu la semaine dernière de l’association Le Rameau, structure de rapprochement entre l’entreprise et le secteur associatif, un rapport qui devrait me permettre de faciliter l’engagement des actifs, et donc d’imaginer, en concertation étroite avec les partenaires sociaux, ce qui pourrait devenir demain un « congé pour engagement ». Un tel dispositif est très attendu par le monde associatif ; il s’agirait de permettre à quelqu’un de s’engager de manière bénévole pendant son temps de travail. Cela demande bien sûr des études et une concertation, mais j’y suis prêt.
Encore une fois, monsieur le président, nous considérons, au Gouvernement, que la vitalité associative est l’un des traits identitaires de notre pays, un des ressorts principaux de sa cohésion sociale, voire de sa cohésion nationale, et un avantage économique non négligeable. Je vous rappelle que 1 800 000 de nos concitoyens travaillent aujourd’hui pour le secteur associatif. C’est aussi un formidable outil d’innovation et un rempart contre les obscurantismes qui menacent aujourd’hui dans notre société. C’est un capital culturel, social, économique que nous devons préserver et même faire fructifier.
Mesdames et messieurs les députés, j’espère que vous êtes maintenant certains de ma détermination.
Mme Françoise Dumas, rapporteure. Monsieur le ministre, merci pour votre propos liminaire. Dans le rapport que nous rédigerons à l’issue de nos auditions, nous entendons réaffirmer les principes de la loi de 1901, les adapter à notre époque et les intégrer à l’économie sociale et solidaire, et clarifier les relations des associations et des collectivités territoriales, en mettant notamment en œuvre la Charte d’engagements. D’où ma première question : comment comptez-vous, dans les semaines et dans les mois à venir, mettre en œuvre cette Charte sur les territoires, à quel niveau et par quelles mesures ?
Ensuite, pourriez-vous nous en dire plus sur le congé d’engagement ? Comment pourrait-on mieux reconnaître les connaissances acquises par le biais du travail bénévole ? Pourrait-on intégrer les personnes concernées dans le dispositif de valorisation des acquis ?
Il est par ailleurs nécessaire de faire en sorte que le recours à la commande publique continue à respecter le monde associatif dans toutes ses composantes, et surtout de diversifier les sources de financement des associations. En 2013, le Président de la République avait annoncé que 500 millions d’euros seraient débloqués par la Banque publique d’investissement (BPI) pour financer l’économie sociale et solidaire. Où en est cet engagement ? Quelles sont les perspectives pour 2015 ?
Enfin, quels outils faudra-t-il mettre en œuvre dans les mois à venir pour sécuriser davantage les financements des associations ?
M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. S’agissant de la Charte d’engagements, nous pensons utiliser comme support une circulaire du Premier ministre. Celle-ci devrait être publiée autour du 15 janvier 2015. Une première réunion de travail est d’ores et déjà prévue dans la deuxième quinzaine de novembre. J’espère que ces délais seront respectés.
S’agissant du congé d’engagement, qui serait un élément important du statut du bénévole, je viens de recevoir le rapport d’experts de l’association Le Rameau. L’objectif est de négocier avec les partenaires sociaux la structuration de ce congé bénévole et de lui donner une base juridique acceptable. Il s’agit, très concrètement, de permettre à quelqu’un de pouvoir se dégager quelques heures de son travail, sans que ce soit considéré comme un abandon de poste.
Une modification du droit travail pourrait être envisagée, et nous pensons qu’un rapport sur ce sujet complexe sera remis au Parlement au plus tard le 30 janvier 2015. Un consensus existe aujourd’hui au sein des partenaires. J’imagine que pour un employeur, ce doit être un plus de savoir qu’un de ses salariés est capable de se consacrer au bien public.
Ensuite, par nature, le dispositif de valorisation des acquis n’est pas adapté à une activité qui n’est soumise à aucun cadre professionnalisant. C’est un vrai souci. Un travail important a été réalisé depuis plusieurs années pour permettre aux bénévoles de projeter leur savoir-faire en compétences. Je pense notamment à l’idée d’un carnet de vie ou d’un passeport du bénévole, que le dispositif de l’article 65 de la loi ESS devrait permettre de mettre en place. On pourrait imaginer également que les universités créent des unités d’enseignement ou d’autres dispositifs intégrant l’engagement bénévole.
Il conviendra d’adapter les textes aujourd’hui en vigueur à cette volonté politique de valorisation des acquis. Le sujet mérite une approche très pragmatique. Pour ma part, je veillerai à ce que cela se fasse dans de bonnes conditions.
Madame la rapporteure, vous avez également évoqué le basculement de la subvention vers la commande publique, et les risques de fragilisation du projet associatif que cela représente. Selon une idée qui est communément répandue, le recours aux marchés publics serait obligatoire pour faire appel aux services d’une association. Cette procédure peut apparaître comme une forme de garantie pour le secteur public, mais elle n’est pas obligatoire. Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, nous pensons imaginer un cadre pédagogique en direction du secteur public pour montrer que l’on peut utiliser la subvention de manière tout à fait sécurisée pour faire appel au secteur associatif et éviter la concurrence. Il ne faudrait pas qu’un secteur privé lucratif prenne des parts de marché, alors même que la qualité des services rendus n’est pas garantie ; on a vu ce qu’il en était en matière d’aide à domicile.
Privilégier le secteur associatif doit donc se faire dans des conditions juridiques sécurisées. Ce guide est en préparation, et notre objectif sera de demander au CNFPT de préparer les fonctionnaires à l’utiliser de manière opportune. Ensuite, les élus territoriaux, notamment, feront leur choix. Mais la tendance actuelle qui consiste à dire que tout doit être sécurisé par le biais du code des marchés publics peut être, sinon contrariée, du moins tempérée.
Je terminerai sur une question assez technique, à savoir l’accompagnement financier de l’économie sociale et solidaire par BPI France, qui repose en effet sur une enveloppe initiale de 500 millions d’euros. Mais il ne faudrait pas que cette enveloppe se superpose à ce qui se fait déjà par ailleurs, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations.
Je vous rappelle les outils de BPI France.
Premièrement, la garantie SOGAMA est un dispositif de garantie spécifiquement dédié aux associations dans le secteur médicosocial et de l’éducation, de la formation et de la lutte contre l’exclusion ; son montant global pourrait atteindre 1 million d’euros.
Deuxièmement, le prêt participatif social et solidaire, accessible à tous les organismes de l’ESS, est distribué par le réseau des banques commerciales et accompagné d’un prêt de la banque du réseau d’un montant équivalent ; cela devrait profiter aux petites structures, pour des montants qui ne dépasseraient pas 50 000 euros sur des durées relativement courtes, de cinq à sept ans ; l’objectif serait d’accorder 50 millions d’euros de prêts par an.
Troisièmement, le Fonds d’innovation sociale est destiné à faire face aux risques spécifiques des projets innovants – évalué à 20 millions d’euros.
Quatrièmement, la plate-forme de financement participatif, qui mériterait d’être confortée afin de pouvoir récupérer toute une série de financements. Je précise qu’aujourd’hui seize acteurs sont labellisés BPI France.
Fin 2014, la mise en place des outils financiers gérés par BPI France au profit de l’ESS devrait être totalement effective. Nous y veillerons.
Tels sont, madame la rapporteure, les éléments que je pouvais vous apporter à ce stade de votre questionnement.
M. Jean-Louis Bricout. Monsieur le ministre, vous venez de faire une sorte de bilan des travaux menés par notre commission depuis maintenant trois mois. J’aimerais savoir comment vous comptez prendre en compte les recommandations que nous allons formuler, sachant que certaines d’entre elles devront être articulées avec les propositions figurant dans le rapport de simplification établi par notre collègue M. Yves Blein.
Ensuite, à l’occasion de nos travaux, nous avons fréquemment évoqué les difficultés de renouvellement du monde des bénévoles, et en parallèle, leur besoin de reconnaissance. Pouvez-vous nous parler du congé d’engagement ? Comment le faire mieux connaître et comment le rendre opérationnel ?
Par ailleurs, en tant qu’élu local, je puis témoigner des difficultés que rencontrent les associations pour remplir des demandes de subvention de plus en plus complexes. Êtes-vous favorable à la mise en place d’un dossier unique dont la gestion serait confiée à une collectivité référente ? Ne pourrait-on pas y réfléchir dans le cadre de la répartition des compétences entre régions et départements ?
Enfin, nos associations sont souvent confrontées à des difficultés de trésorerie liées au versement tardif de subventions. Ce retard risque de les mettre en danger, en raison des frais financiers que cela peut entraîner. Cela nous renvoie au principe qu’il n’est pas concevable qu’une association réalise des excédents et consolide son fonds de roulement qui serait pourtant bien nécessaire pour pallier ces problèmes de trésorerie. J’aimerais connaître votre avis à ce propos.
M. Régis Juanico. Monsieur le ministre, vous avez entièrement raison de dire que la vie associative dans notre pays est un atout et une richesse qui nous est enviée partout en Europe, avec plus d’un million d’associations et 16 millions de bénévoles. C’est un secteur très dynamique sur le plan économique et social. Le rôle des pouvoirs publics est d’assurer de bonnes conditions aux associations et aux bénévoles qui s’engagent. Voilà pourquoi il faudra, entre autres, simplifier la vie des associations, sécuriser leurs activités sur le plan juridique et financier, et mieux reconnaître l’engagement associatif et le bénévolat.
Vous avez rappelé des chiffres très intéressants qui illustrent le niveau d’engagement de l’État. Vous avez plus particulièrement cité le montant de l’abattement forfaitaire sur la taxe sur les salaires, qui constitue une mesure importante de soutien à la vie associative.
De son côté, le président de la République a évoqué il y a quelques jours, au congrès Léo-Lagrange, la distorsion de concurrence qui existe entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif, dans la mesure où le CICE est actuellement attribué au seul secteur lucratif. Il a précisé que le CICE allait évoluer sous forme d’abaissement de charges pérennes, qui concernerait alors l’ensemble des associations employeurs, et donc le secteur non lucratif. Connaissez-vous le délai ?
Le Président de la République s’est par ailleurs exprimé sur la taxe sur les salaires, en indiquant que cette fiscalité était aujourd’hui très pénalisante pour la vie associative. Sans doute devrions-nous travailler ensemble sur cette question.
J’en viens à la formation, à l’accompagnement de l’emploi associatif et à la professionnalisation des compétences dans les associations. Je crois que ces dernières sont très demandeuses, car aujourd’hui, ce sont souvent de véritables entreprises, avec toutes les charges que cela implique. Plus qu’un statut du bénévole, les associations souhaitent qu’on les accompagne, notamment dans leur fonction d’employeur.
Ensuite, comme vous l’avez dit, le rapport de notre collègue Yves Blein constitue une base dense, riche en propositions pour alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent sur l’engagement des responsables dans les associations, et les empêchent de se consacrer pleinement au cœur de leur mission, c’est-à-dire au développement de leurs activités.
Et maintenant, puisque vous êtes aussi le ministre des sports, je voudrais vous interroger sur le certificat médical de non contre-indication de la pratique sportive. Aujourd’hui, pour les associations comme pour les licenciés des clubs sportifs, son renouvellement annuel est très contraignant. Des annonces viennent d’être faites par le Gouvernement à ce sujet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Enfin, l’accélération de la montée en charge du service civique a été votée la semaine dernière par l’Assemblée nationale. Le Président de la République a émis le souhait de rendre ce service civique « universel ». Nous avions déjà eu l’occasion d’introduire dans la loi ESS le volontariat associatif pour les plus de 25 ans. Ne faudrait-il pas s’orienter vers le volontariat associatif pour les moins de 25 ans, qui différerait du service civique dans ses conditions d’indemnisation et de durée ? Je crois profondément que les jeunes qui s’engagent dans des associations, même pour deux ou trois mois, sont acquis pendant toute leur vie à la cause associative.
M. Jean-René Marsac. Monsieur le ministre, je partage nombre des réflexions qui viennent d’être faites. Je vous interrogerai à propos du bénévolat. Bien évidemment, toutes les mesures qui visent à l’encourager sont nécessaires et bienvenues. Cela dit, aussi bien au cours des auditions que sur le terrain, on nous a signalé la différence qui existe entre, d’une part, un engagement bénévole quelques heures par semaine ou par mois, effectué de manière ponctuelle ou renouvelé à intervalles choisis par la personne et, d’autre part, la fonction de dirigeant associatif, dont le renouvellement pose problème.
De fait, la responsabilité associative est de plus en plus lourde, notamment dans les associations qui emploient des salariés – gestion des emplois, pilotage stratégique, négociations, gestion au quotidien. Je sais qu’un certain nombre de dispositifs permettent d’ores et déjà de mieux reconnaître le dirigeant – en termes de rémunération, de compensation financière par rapport à des pertes de salaire éventuelles, de protection sociale, etc. Toutefois, il me semble que l’on aurait intérêt à dissocier davantage, dans nos débats, ce qui relève du bénévolat de manière générale et qui correspond à ce que nos concitoyens entendent par « donner du temps et de la compétence de manière ponctuelle », et la responsabilité de dirigeant associatif qui est d’une autre nature. Car même en allégeant les procédures, les responsabilités des dirigeants restent lourdes, ce qui explique la réticence des nouvelles générations à s’engager dans la gestion durable d’une association.
Mme Bernadette Laclais. Merci, monsieur le ministre, pour votre propos liminaire, qui reflète la passion qui vous anime pour les associations. Merci aussi d’avoir évoqué la mise en place, à l’intention des collectivités, d’un cadre pédagogique pour le recours aux marchés publics. En effet, dans la mesure où leur responsabilité risque d’être engagée – s’ils conseillent mal les élus – les services sont très réticents. De ce fait, les associations font les frais des choix politiques des élus. Il serait donc particulièrement utile que le ministère mette à la disposition des associations un cadre juridique clair.
Je voudrais par ailleurs évoquer deux points.
Premièrement, les petites associations, qui n’ont pas de gros volumes d’activité ou de financement, rencontrent souvent des problèmes de trésorerie et doivent payer des agios bancaires. Serait-il possible de réfléchir à un fonds, à une ligne qui pourrait être adossée sur les collectivités, par exemple les collectivités « chefs de file » ? Je trouve un peu dommage que de l’argent public serve à financer des agios bancaires.
Par ailleurs, je serais assez favorable à ce qu’il y ait un dossier unique et que la collectivité « chef de file » coordonne les collectivités qui versent des subventions, afin que tous les versements ne soient pas effectués le même mois. En effet, les associations ont beaucoup de trésorerie en fin d’année, mais au milieu de l’année, leur trésorerie baisse et elles doivent payer des agios bancaires.
Deuxièmement, la place des associations s’est avérée déterminante en matière de politique de la ville, notamment dans les dossiers de reconstruction-démolition. C’est ce qui ressort d’ailleurs du rapport qui avait été commandité par votre prédécesseur. Aujourd’hui, de nombreuses collectivités nous disent attendre des décrets pour mettre en place les « conseils citoyens », qui peuvent intervenir à toutes les étapes de l’élaboration des contrats de ville. Qu’en est-il, monsieur le ministre ? Pourriez-vous lever l’ambiguïté ?
Nous souhaitons leur faire passer le message qu’il serait opportun de mettre en place ces dispositifs, afin que les habitants et les associations, dont je rappelle le rôle central dans la compréhension des enjeux de la politique de la ville, puissent être des partenaires actifs dès le début des procédures, et notamment au moment des négociations.
M. Yannick Favennec. Monsieur le ministre pourquoi les termes de « vie associative » ont-ils disparu du titre de votre ministère ? C’est un curieux signal envoyé au monde associatif, dans une année aussi cruciale que 2014.
Par ailleurs, ne pourrait-on pas valoriser l’engagement bénévole en accordant des points de retraite supplémentaires, au bout d’un certain nombre d’années de responsabilités dans une association ? Dix ans de responsabilités associatives pourraient, par exemple, donner un trimestre de points de retraite supplémentaire. Sous la précédente législature, j’avais déposé, sans succès, une proposition de loi en ce sens ; au cours de cette législature, d’autres collègues ont essayé de faire passer la même idée, toujours sans succès, par voie d’amendements. Monsieur le ministre, j’aimerais avoir votre avis sur la question.
M. Jean-Pierre Allossery. Monsieur le ministre, les difficultés du monde associatif sont nombreuses : incertitudes liées aux financements publics ; arrivée tardive des subventions, qui met à mal leur fonctionnement ; recours de plus en plus massif aux appels à projets au détriment du projet associatif. On préfère utiliser les associations comme des prestataires de services, plutôt que renforcer leur rôle de partenaires incontournables de la société civile. Il va falloir accompagner le renouvellement des instances dirigeantes du mouvement associatif, car ce renouvellement pose problème.
Dans mon rapport pour avis sur la mission « Sport, jeunesse, vie associative » d’octobre 2014, j’ai souhaité travailler sur le thème de l’engagement des jeunes. Les différentes auditions que j’ai pu mener à cet effet ont mis en avant le besoin des jeunes de s’engager de manière différente, c’est-à-dire de manière momentanée et utilitaire. Ils cherchent à construire un parcours d’engagement, plutôt qu’un engagement à long terme au sein de la même association. Face à cette mutation de l’engagement et face au nécessaire besoin de renouvellement des instances dirigeantes des associations, quels outils votre ministère pourrait-il mettre en place ?
M. le président Alain Bocquet. Monsieur le ministre, je vous poserai deux questions supplémentaires.
Premièrement, que fait ou que peut faire le ministère pour promouvoir les groupements d’employeurs auprès du monde associatif ?
Deuxièmement, il me semble que l’école – au sens large – pourrait constituer un vivier pour la modernisation et la relève du mouvement associatif.
J’observe qu’en 2014, l’engagement associatif a été proclamé « grande cause nationale ». Or, à part les initiatives du ministère, on ne peut pas dire que localement, ce soit l’effervescence. Pourquoi ne pas utiliser l’école ? Aujourd’hui, on met en place des conseils d’école, d’enfants, de collégiens, de lycéens, on crée même des entreprises virtuelles dans les écoles, mais on oublie la vie associative. Ce ne fut pas toujours le cas : j’ai la chance d’avoir eu pour instituteur un « hussard de la République », qui m’a envoyé faire du porte-à-porte pour vendre des timbres contre la tuberculose. Cela m’a servi toute ma vie !
M. le ministre. Monsieur le président, si cela peut vous rassurer, j’ai fait la même chose !
Effectivement, il faut favoriser les groupements d’employeurs. Je crois beaucoup à la mutualisation des fonctions supports. La sécurisation des financements du secteur associatif passe aussi par sa capacité à se mobiliser pour éviter des doublons dans le fonctionnement. Il ne s’agit pas créer de l’austérité ou de la rigueur dans le secteur associatif, mais de lui demander de mutualiser toute une série de fonctions qui n’ont pas d’intérêt pour le projet associatif et qui lui permettraient d’avoir des éléments d’une plus grande efficacité sur le plan budgétaire. Le ministère a édité un guide en partenariat avec l’Agence pour la valorisation de l’innovation sociale (AVISE) qui réforme celui qui était paru en 2011 et qui insiste sur cette capacité pour le mouvement associatif de créer des groupements d’employeurs. C’est une petite révolution dans le fonctionnement du secteur. Il faut l’accepter, l’accompagner, convaincre pour montrer que cela peut être utile pour chacun.
La réforme des rythmes éducatifs – ce n’est pas la même notion que celle des rythmes scolaires – permettra à nos jeunes d’être dans des circuits de citoyenneté rénovés, renouvelés, avec une plus grande ouverture d’esprit. Faut-il mettre en place des modules spécifiques à l’engagement associatif ? Pourquoi pas ? Je fais mienne votre proposition car c’est une manière de préparer l’avenir de nos enfants. En tout cas, je l’évoquerai avec ma collègue Najat Vallaud-Belkacem.
Monsieur Bricout, je suis très favorable à la mise en place du dossier unique. Un travail a été engagé entre mon ministère et les grandes associations d’élus comme l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF), l’Association des régions de France (ARF), l’Assemblée des communautés de France (ADCF), etc. Faut-il un chef de file en la matière ? Le dossier unique doit-il être porté par une collectivité plutôt qu’une autre ? Il faut trouver un accord global entre des collectivités territoriales et, dans le cadre du choc de simplification, éviter qu’une association soit amenée à devoir porter toute une série de dossiers qui sont souvent identiques, en tout cas très proches. Le dossier unique constituerait une facilitation très importante.
Lors de la conférence sur le choc de simplification, le Président de la République a évoqué l’idée d’un coffre-fort numérique pour les jeunes. Peut-être pourrions-nous imaginer un coffre-fort numérique pour le secteur associatif, ce qui éviterait de devoir refaire systématiquement les mêmes demandes avec les mêmes formulaires, les mêmes justificatifs.
Madame Laclais a évoqué la question de la sécurisation de la trésorerie. Il est clair que nous manquons aujourd’hui d’un outil de gestion de trésorerie du secteur associatif. Je reconnais que, malgré la faiblesse des taux d’intérêt, le secteur bancaire ne fait aucun cadeau au secteur associatif. Faudrait-il un outil dédié, porté par exemple par la Caisse des dépôts et consignations ? Si votre rapport évoquait cette question, ce dont je ne doute pas un seul instant, le ministère pourrait ouvrir ce chantier avec le secteur associatif et peut-être avec le secteur bancaire, ainsi qu’avec la Caisse des dépôts.
Monsieur Juanico, vous m’avez interrogé sur l’évolution du CICE. Lors du congrès national Léo-Lagrange, à Dijon, le Président de la République a ouvert la porte sur ce dossier. Il s’agit maintenant de permettre au secteur associatif de bénéficier des avantages du CICE. En tout cas, il n’y a pas d’opposition de principe du pouvoir exécutif, bien au contraire, et en l’occurrence du chef de l’État, sur cette question qui nécessite des évaluations et des études d’impact préalablement à son application dans le secteur associatif, qui comporte un très grand nombre de salariés.
Vous avez raison de vouloir accompagner les associations dans leur fonction d’employeur. Le secteur associatif a besoin en effet d’être conforté en la matière. C’est toute la logique des dispositifs locaux d’accompagnement, les DLA, qui se développent et qui permettront de mener à bien les conclusions du rapport de l’association Le Rameau que je propose d’envoyer aux membres de votre commission par voie numérique. Ce rapport n’a pas été totalement validé par le ministère, mais il peut ouvrir quelques pistes.
Vous avez évoqué le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. Plus de seize millions de certificats médicaux sont délivrés chaque année, cet examen n’étant pas remboursé par la Sécurité sociale sauf erreur de ma part. Le secrétaire d’État à la réforme de l’État et à la simplification, Thierry Mandon, qui a en charge la certification, souhaite la délivrance d’un seul certificat pour tous les sports et éviter ainsi la reproduction chaque année du certificat médical. Se pose ensuite la question de la responsabilité. Il faudra sûrement légiférer pour alléger cette mesure qui s’impose aujourd’hui au secteur associatif. Si j’allais au bout de ma pensée, je vous dirais que la médecine scolaire pourrait permettre de régler cette question. Ce sujet sera peut-être évoqué un jour dans le cadre de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Je n’oublie pas que j’ai été, il n’y a pas si longtemps, président d’un conseil général et extrêmement porteur de l’idée que la médecine scolaire pouvait basculer dans les conseils généraux. Mais c’est un autre débat…
Vous avez évoqué également la question du service civique et du rôle du service universel. J’ai eu l’occasion de répondre hier à une question d’actualité posée par M. Laurent. L’engagement d’un jeune doit être reconnu par les pouvoirs publics. Mais il ne faudrait pas confondre l’engagement universel de deux mois et le service civique. Il faut préserver le service civique qui est un contrat rémunéré sur une moyenne de sept à huit mois avec, à terme, des perspectives d’intégration, y compris professionnelles. L’engagement universel, tel que le propose le Président de la République, doit entrer dans une palette nouvelle de dispositifs car il ne s’agit pas de mettre en concurrence l’engagement universel de deux mois avec l’engagement permanent bénévole de seize millions de Français. Mais comme vous l’avez dit fort justement, monsieur le député, ce dispositif peut constituer une formidable pépinière de ressources nouvelles pour le bénévolat dans notre pays. Il s’agirait d’un engagement de deux ou trois mois sous une forme à déterminer. Cet engagement du jeune pourrait être reconnu. Il pourrait, par exemple, figurer sur le curriculum vitae sous la forme d’un certificat, d’un diplôme d’engagement. On pourrait également envisager que le jeune qui s’engagerait pour la collectivité bénéficie de facilités pour passer son permis de conduire, obtenir le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs (BAFA) ou encore le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). C’est un débat que nous aurons puisque, comme je l’ai dit hier devant l’Assemblée nationale, le cap a été fixé par le Président de la République. Il m’appartient, avec ceux qui m’entourent et tous les parlementaires intéressés, de pouvoir donner du sens et du contenu à ce cap.
Monsieur Marsac, nous sommes effectivement confrontés à une crise de renouvellement des dirigeants associatifs en raison des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Le problème, c’est que le support juridique est le même pour des associations extrêmement différentes. Si votre rapport l’évoque, j’en serai très heureux. Quoi de commun en effet entre un président d’association qui a pour seul salarié un emploi d’avenir et un autre qui dirige plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes ? Il faudrait sûrement envisager de modifier les textes, en tout cas de les préciser pour encourager le renouvellement des instances dirigeantes des associations. Je suis toujours très inquiet de voir des associations, et non des moindres, dont la présidence ne tourne pas. Monsieur Bocquet, je me tourne vers vous pour citer le cas d’une grande association caritative dont le président est formidable mais qui a du mal à trouver des successeurs tant la charge est lourde.
Madame Laclais, vous avez raison, il ne faut pas utiliser le marché public comme étant l’élément de sécurisation permanente pour la relation avec le secteur associatif. Je l’ai évoqué dans mon propos liminaire. Il ne faut pas avoir peur d’utiliser la subvention pour mettre en œuvre une politique publique. Cela me paraît absolument essentiel.
Vous avez évoqué la question des conseils citoyens. Une circulaire a été envoyée il y a quelques jours par Mme Myriam El Khomri et votre serviteur pour préciser le contenu de ce dispositif.
Le conseil citoyen est déjà bien défini dans la loi de M. François Lamy. Je ne voudrais pas que ce conseil citoyen remette en cause les conseils de quartier qui fonctionnent bien et qui ont été institués pour les villes de plus de 80 000 habitants par la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. Nous sommes là sur une autre dimension. Comment, dans ces 1 300 quartiers représentant une population de cinq millions de personnes souvent en grande difficulté, faire que la décision publique soit co-construite par des citoyens, y compris tirés au sort comme cela figure dans le texte ? Il faut affiner l’organisation de ces conseils citoyens. Je ne suis pas favorable à une mesure d’ordre réglementaire qui figerait dans le temps et dans l’espace l’organisation de ces conseils citoyens. Il faut permettre à des élus locaux, en lien avec le secteur associatif et les animateurs locaux, les forces vives locales de ces quartiers, de bâtir une réponse adaptée dans une logique de subsidiarité, c’est-à-dire laisser ces conseils citoyens se créer et perdurer dans un contexte de construction collective sur place, qui peut être différent d’une ville à une autre. En tout cas, c’est le sens de la circulaire que nous avons envoyée aux préfets délégués à la ville et à leurs collaborateurs. Nous veillerons à ce qu’aucun contrat de ville ne soit signé par les préfets sans que la dimension citoyenne y soit intégrée de manière détaillée.
Monsieur Favennec, vous m’avez interrogé sur mon intitulé. Les cartes de visite n’étaient pas assez grandes pour pouvoir y mettre toutes mes attributions. Je vois que vous n’acceptez pas ma réponse, et vous avez raison ! Je veux vous rassurer : le décret relatif à mes attributions prévoit que je suis chargé de la vie associative et de l’éducation populaire. La rénovation urbaine fait partie aussi de mon champ d’intervention. C’est par mon intervention personnelle et ma détermination que vous verrez l’ambition qui est la mienne en matière de vie associative, même si ce terme ne figure pas dans mon titre. Je puis vous assurer que ma coordination ministérielle est totalement assumée et acceptée par mes autres collègues du Gouvernement. Je vous remercie par avance de votre soutien.
Vous avez évoqué la possibilité de valoriser l’engagement associatif par l’attribution de points de retraite supplémentaires. Un engagement associatif peut-il être comparé à un autre engagement associatif pour permettre une valorisation sous forme de trimestres de retraite ? Quel est le temps consacré qui justifierait une telle reconnaissance ? Je ne suis pas certain que les partenaires sociaux accepteraient ce type de proposition au vu des contraintes budgétaires qui existent en matière de financement des régimes de retraite par répartition. Cette proposition est intelligente, je dirai même « appétissante » en termes de reconnaissance pour le secteur associatif, mais l’application concrète d’un tel dispositif me paraît très difficile. Si cette proposition figure dans votre rapport, nous l’étudierons avec plaisir. Mais comprenez mes réserves en la matière. La meilleure réponse que je peux vous apporter aujourd’hui est celle du chantier du congé d’engagement qui a été évoqué par plusieurs d’entre vous. Cela me paraît être une reconnaissance pragmatique au regard de la législation actuelle.
Monsieur Allossery, vous avez posé plusieurs questions pertinentes, notamment sur l’arrivée tardive des subventions. Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que l’appel à projets peut mettre en péril le projet associatif et l’autonomie associative.
Dans mon propos liminaire, j’ai dit que le secteur associatif devait être en résonance avec les priorités publiques, ce qui ne veut pas dire qu’il doit être un suiveur par rapport aux projets publics. En l’occurrence, le danger c’est que la notion d’appel à projets transforme le secteur associatif en simple prestataire de la commande publique. On peut tuer l’innovation associative si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. Il faut donc trouver un équilibre entre le projet associatif, la liberté associative, la souveraineté associative et la nécessaire application des priorités publiques portées par les élus, qu’ils soient nationaux, régionaux, départements ou communaux. D’où l’idée de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permettant une co-construction entre le secteur public et le secteur associatif. Certains parleront de naïveté au regard des difficultés financières actuelles, mais je crois qu’il s’agit d’un système vertueux qu’il faut savoir développer.
Vous avez terminé votre propos sur la notion d’engagement. Ce sera le grand chantier du quinquennat. Il s’agit de favoriser l’engagement des Français où ils sont, là où ils veulent, là où ils peuvent apporter une valeur ajoutée. On décrit souvent notre société comme repliée sur elle-même et égoïste – on dit souvent cela des jeunes. Au contraire, elle est capable de transformer la réponse sociale à travers un engagement complet de nos concitoyens. Je rappelle que la France compte seize millions de bénévoles, que le service civique se développe – il y a actuellement quatre demandes pour une place disponible –, que le Président de la République a proposé l’élargissement du service civique qui pourrait devenir un engagement universel de deux mois, et que la garantie jeunes permettra de remettre dans le circuit des jeunes en grande difficulté. Nous avons là une « boîte à outils » qui montre que notre pays n’est pas en déclin, qu’il ne doute pas en permanence, qu’il est capable de se remettre en question. Nous avons des forces en nous qui nous permettent de changer la société. En tout cas, j’espère être un ministre facilitateur, en l’espèce.
M. le président Alain Bocquet. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre contribution à la réflexion de notre commission d’enquête qui rendra son rapport prochainement.
© Assemblée nationale