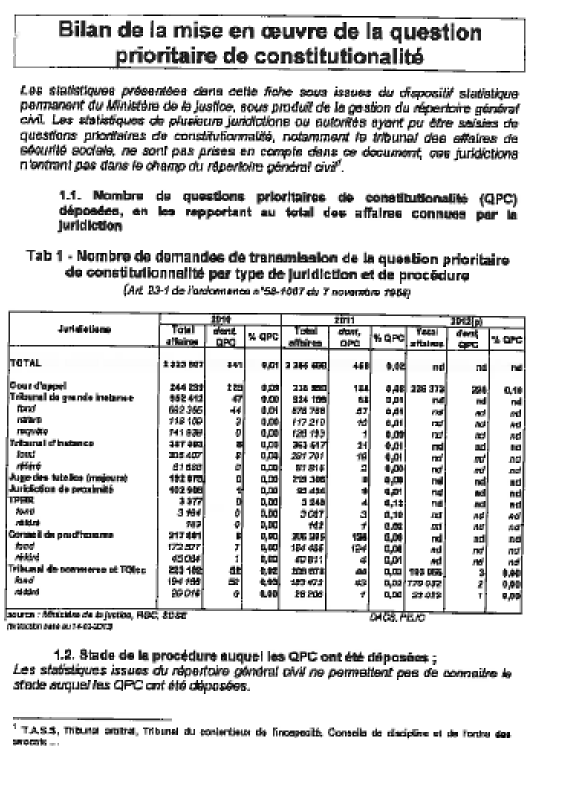![]()
N° 842
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
sur la question prioritaire de constitutionnalité,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Jean-Jacques URVOAS,
Député.
——
INTRODUCTION 5
I. LA QPC : UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE 9
A. UNE INNOVATION CONSTITUTIONNELLE QUE LES JUSTICIABLES SE SONT RAPIDEMENT APPROPRIÉE 9
1. Des QPC nombreuses 9
a) Un succès statistique... 9
b) ... permis par l’implication des différents acteurs 12
2. Des QPC variées 14
B. UN REPOSITIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 17
1. Un Conseil constitutionnel réinvesti dans son rôle de protection des droits et libertés 17
2. Un nouveau « dialogue des juges » avec la Cour de cassation et le Conseil d’État 19
3. Les rapports renouvelés entre Conseil constitutionnel et Parlement 22
II. LA QPC VUE PAR CEUX QUI LA FONT 27
A. UNE PROCÉDURE JUGÉE SATISFAISANTE 27
1. Le respect des délais et du contradictoire 27
a) Les délais 27
b) Le contradictoire 30
2. Des filtres qui remplissent leur rôle 31
B. LES AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES PAR LES DIFFÉRENTS PROTAGONISTES 36
1. Sur deux sujets transversaux 37
a) Le traitement des questions sérielles 37
b) Les difficultés liées au coût de la procédure 38
2. Au niveau du premier filtre 39
a) Des délais d’examen parfois excessifs 39
b) Des décisions dont les motivations sont très variables 41
3. Sur la phase devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation 43
a) Quelques suggestions d’amélioration des règles procédurales 43
b) Des critiques sur le fonctionnement du filtre 47
4. Sur les décisions du Conseil constitutionnel 50
a) Des interrogations autour d’un ajustement des critères d’admission des interventions 51
b) Des motivations qui pourraient être plus précises 51
c) La technique des réserves d’interprétation 52
d) L’effet dans le temps des décisions d’abrogation 53
III. LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR 57
A. ASSURER UN VÉRITABLE SUIVI DE LA QPC 57
B. PARFAIRE LA PROCÉDURE 60
C. TRANSFORMER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN VÉRITABLE COUR CONSTITUTIONNELLE : OUVRIR LE DÉBAT 64
EXAMEN EN COMMISSION 69
ANNEXES 79
Questionnaires adressés par votre rapporteur 81
Données statistiques relatives à la question prioritaire de constitutionnalité 90
Comptes rendus des auditions de la commission des Lois 109
Révolution juridique : le terme est souvent galvaudé. Pourtant, s’il fallait le réserver à une réforme que notre pays a connue depuis plusieurs décennies, il est certain que l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mériterait cette qualification.
Instituée à l’article 61-1 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la QPC permet à chacun de faire prévaloir la Constitution sur des dispositions législatives qui lui seraient contraires et d’obtenir leur abrogation. Énoncé ainsi, ce nouveau droit reconnu à tous les justiciables peut paraître abstrait. Le succès qu’a connu cette nouvelle procédure depuis son entrée en vigueur, le 1er mars 2010, témoigne pourtant des conséquences concrètes de cette réforme profonde de notre système juridique. Particuliers, associations, entreprises, plus personne n’hésite à invoquer notre loi fondamentale devant les juges, quels qu’ils soient, et, le cas échéant, à faire valoir ses droits devant le Conseil constitutionnel.
Alors que la justice française connaît des difficultés, notamment matérielles, et subit des critiques, fondées ou non, la QPC renvoie une image positive de notre organisation judiciaire entendue au sens large. Reste à déterminer si cette image correspond à une réalité. C’est l’objet du présent rapport d’information.
En effet, en novembre dernier, alors qu’approchait le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la QPC, la commission des Lois a souhaité que soit dressé un bilan de la mise en œuvre de cette procédure, principal apport de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, voulue par le président Nicolas Sarkozy.
Le chemin a été long avant d’aboutir à cette réforme. L’idée de permettre aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une instance devant une juridiction ordinaire a été formulée par Robert Badinter, puis par François Mitterrand, dès 1989, mais les deux projets de loi constitutionnelle visant à créer cette procédure, déposés en 1991 et en 1993, se sont heurtés à l’opposition du Sénat, qui y voyait la manifestation d’un abaissement de la loi. Les esprits ont évolué depuis. Quinze ans après, la réforme a été adoptée dans un quasi-consensus.
Une fois la Constitution révisée et la loi organique du 10 décembre 2009 entrée en vigueur, encore fallait-il veiller à ce que le nouveau dispositif soit mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes. La commission des Lois ayant œuvré pour cette réforme, elle ne pouvait s’en désintéresser. Dès le mois d’octobre 2010, M. Jean-Luc Warsmann, qui était alors président de la commission des Lois, se livrait à un travail d’évaluation de l’application de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en tirait un premier bilan positif, tout en mentionnant un certain nombre de questions en suspens.
Deux ans plus tard, dresser un nouveau bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité apparaissait nécessaire. Votre rapporteur a adopté une double démarche : d’abord, ont été entendus un certain nombre de personnalités et de spécialistes de la question (1) – ce qui avait déjà été fait en 2010 – ; ensuite, votre rapporteur a souhaité aller au-delà de la vision de ces experts, pour tenter de comprendre comment la question prioritaire de constitutionnalité était mise en œuvre dans les juridictions françaises et comment elle était perçue par les justiciables et leurs conseils. L’idée est bien de saisir comment les citoyens se sont emparés de cette réforme et comment, au plus près d’eux – dans les juridictions du fond – sont traitées les QPC.
La nécessité d’établir un bilan de la mise en œuvre de la loi organique du 10 décembre 2009 au terme de ses trois premières années d’application était déjà soulignée dans l’exposé des motifs du projet de loi organique : il était alors envisagé que le Gouvernement transmette un tel bilan au Parlement. En mai 2010, la ministre de la Justice avait chargé l’Association française de droit constitutionnel (AFDC) d’une mission d’étude et de recherche qui devait contribuer à la préparation de ce rapport. Après avoir rencontré un certain nombre de difficultés (2), l’AFDC a présenté un rapport d’étape en avril 2012, portant sur la première année de mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (1er mars 2010-1er mars 2011). L’association a, depuis, interrompu ses travaux, la poursuite de la mission qui lui avait été confiée n’ayant pas été confirmée par le ministère de la Justice. Elle a néanmoins transmis son rapport d’étape à votre rapporteur et celui-ci a décidé de retenir les mêmes ressorts territoriaux régionaux que ceux choisis par l’AFDC pour son étude pour interroger les différentes juridictions du fond sur la manière dont elles appliquent la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.
C’est pourquoi, votre rapporteur a adressé un questionnaire à la fois quantitatif et qualitatif aux juridictions suivantes : les tribunaux judiciaires et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Marseille, les tribunaux judiciaires et la cour d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de cette même ville, les tribunaux judiciaires, la cour d’appel et le tribunal administratif de Dijon, les tribunaux judiciaires, la cour d’appel et la cour administrative d’appel de Versailles, ainsi que le tribunal administratif de Montreuil. Toutes les juridictions administratives lui ont fourni les informations demandées ; tel n’a pas été le cas pour les juridictions judiciaires. Cette lacune est très regrettable car, d’une manière générale, les informations manquent sur le fonctionnement du premier niveau de filtrage assuré par les juridictions du fond et, en particulier, les juridictions judiciaires sont perçues par certains experts comme traitant les QPC avec plus de sévérité que les juridictions administratives, perception que des informations détaillées en provenance de certains tribunaux judiciaires auraient contribué à confirmer ou infirmer (3).
Afin d’atteindre les « usagers » de la question prioritaire de constitutionnalité, votre rapporteur a aussi adressé un questionnaire aux bâtonniers de l’ordre de avocats des barreaux de ces mêmes ressorts territoriaux, qui ont, pour la plupart d’entre eux, bien voulu y répondre. Enfin, il a constitué un échantillon de douze personnes morales ayant posé une question prioritaire de constitutionnalité (4) qui avait été examinée par le Conseil constitutionnel, en veillant à la diversité des personnes morales (entreprises, associations, collectivités locales) et des décisions finales (conformité à la Constitution de la disposition contestée, conformité sous réserves, non-conformité totale ou partielle, effets différés de la décision d’abrogation). Sept d’entre elles (5) ont pris le temps de répondre au questionnaire que votre rapporteur leur a adressé.
Si la démarche de votre rapporteur ne visait évidemment pas l’exhaustivité, elle lui a permis de recueillir des données chiffrées, mais aussi des appréciations qualitatives sur la question prioritaire de constitutionnalité, émanant des différents « acteurs » de la procédure. Il tient à remercier très vivement tous ceux qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à ses travaux.
Ceux-ci le conduisent à conclure, à l’issue de ses trois premières années d’application, à un bilan très positif de la question prioritaire de constitutionnalité, qui a constitué une véritable révolution, que l’on pourrait qualifier de tranquille. Les acteurs de la procédure jugent son fonctionnement globalement satisfaisant, même s’ils formulent parfois quelques critiques sur un point ou un autre. Aucun d’entre eux n’appelle à une réforme profonde du dispositif actuel et les recommandations que formule votre rapporteur visent simplement à améliorer le suivi de sa mise en œuvre et à lui apporter des aménagements de portée limitée, sans remettre en cause l’équilibre qui a été atteint. Pourtant, élargissant la perspective, votre rapporteur souhaite profiter de cette étude pour ouvrir le débat sur plusieurs propositions tendant à tirer les conséquences de la transformation du Conseil en véritable Cour constitutionnelle. Car la création de la QPC a manifestement transformé le Conseil en une juridiction constitutionnelle pleine et entière et ce, de manière définitive. Il importe donc d’examiner les conséquences institutionnelles qui pourraient être tirées de cette évolution irréversible pour ce qui est du nombre des membres du Conseil, des conditions de leur nomination, de leur statut, de l’organisation de cette institution et de la procédure qui a cours devant elle. Ces propositions sont livrées au débat. À chacun de s’en emparer.
I. LA QPC : UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE
Alors que son introduction dans notre droit pouvait représenter un bouleversement, la QPC a très rapidement été adoptée par les justiciables, entraînant le repositionnement de l’ensemble des acteurs institutionnels ayant partie liée à cette réforme.
A. UNE INNOVATION CONSTITUTIONNELLE QUE LES JUSTICIABLES SE SONT RAPIDEMENT APPROPRIÉE
Comme l’a écrit le professeur Dominique Rousseau, avec l’entrée en vigueur de la QPC, « la Constitution est sortie de l’univers clos des facultés de droit pour entrer dans les prétoires. Elle est devenue la chose des citoyens-justiciables, l’arme des avocats et la référence des magistrats » (6).
Au 1er mars 2013, trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme, le Conseil constitutionnel avait rendu 255 décisions sur des QPC (7). Ce chiffre témoigne de la transformation du rôle du Conseil, puisqu’il représente à lui seul près de 39 % de l’ensemble des décisions rendues depuis 1959 dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori (8).
Sur cette même période de trois ans, 314 décisions des juridictions suprêmes (177 de la Cour de cassation et 137 du Conseil d’État) avaient conclu à un renvoi au Conseil constitutionnel, tandis que 1 206 décisions de non-renvoi lui avaient été transmises (412 du Conseil d’État et 794 de la Cour de cassation) (9). Un peu plus de 20 % des questions traitées par les juridictions suprêmes ont donc fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel.
Au 31 octobre 2012, la Cour de cassation avait rendu 1 208 décisions sur des QPC (10), dont 663 soulevées lors d’un pourvoi en cassation et 545 transmises par une juridiction inférieure (11). En tendance, la part des QPC soulevées directement devant la Cour recule cependant au profit de celles émanant des juges du fond, comme l’a souligné le Premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, devant votre Commission (12) : « si, au cours de la première année d’application de la loi, les questions ont émané le plus souvent d’avocats aux Conseils, qui s’étaient sans doute mieux préparés à cette échéance, les courbes se sont rejointes, de sorte qu’aujourd’hui les questions qui proviennent des juridictions du fond et celles qui sont posées directement devant la Cour de cassation se trouvent en nombre sensiblement égal ».
Pour autant, l’origine territoriale des QPC examinées par la Cour de cassation révèle une assez grande hétérogénéité : jusqu’au 31 octobre 2012, 27 % des QPC transmises à la Cour de cassation l’ont été par les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris, loin devant les ressorts de la cour d’appel de Versailles (8 %), d’Aix-en-Provence (6 %) et de Lyon (6 %). De la même façon, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, M. Marc Guillaume (13), a indiqué qu’ « aucune QPC n’a été transmise au Conseil constitutionnel en provenance des ressorts des cours d’appel d’Amiens, de Bourges, de Limoges, de Metz, de Riom, de Fort-de-France, de Papeete et de Saint-Denis [de La Réunion]. Il existe une très forte surreprésentation des ressorts des cours d’appel de Paris – 40 % – et de Lyon – 10 % ».
Au 31 décembre 2012, le Conseil d’État avait rendu 616 décisions sur des QPC, dont 400 soulevées directement devant lui et 216 transmises par une juridiction inférieure (14). À la différence du phénomène précédemment observé au sein des juridictions judiciaires, le caractère minoritaire des QPC transmises par les juges du fond, qui s’était quelque peu réduit en 2011 (40 % du total, après 38 % en 2010), s’est nettement accentué en 2012, n’atteignant que 26 % de l’ensemble des décisions du Conseil d’État en la matière.
Au-delà du seul Conseil d’État, et à la différence des juridictions judiciaires, à propos desquelles votre rapporteur ne dispose d’aucune donnée globale, 1 537 décisions sur des QPC ont été rendues par les tribunaux administratifs (1 125 décisions) et par les cours administratives d’appel (412 décisions) depuis l’entrée en vigueur de la réforme jusqu’au 31 décembre 2012. Là aussi, une certaine disparité géographique peut être signalée – davantage de QPC émanant des ressorts des cours administratives d’appel de Paris et Marseille –, mais de moindre ampleur qu’au sein des juridictions judiciaires.
Après les impressionnantes statistiques des deux premières années d’application de la réforme, l’année 2012 a été marquée par une diminution du nombre de QPC.
Devant votre Commission, M. Marc Guillaume avait ainsi signalé que le nombre de QPC transmises au Conseil constitutionnel était « passé de 633 en 2011 à 368 depuis le début de l’année [2012]. La baisse concerne tant les non-renvois que les renvois : nous avons reçu 63 décisions [de renvoi] en dix mois, soit, en rythme annuel, une diminution de 33 % par rapport à 2011 ». Au total, entre 2011 et 2012, le nombre de décisions QPC du Conseil constitutionnel a diminué d’un tiers (74 décisions, à comparer à 110 décisions l’année précédente). Le vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé, avance deux principales explications : « il semble que, pour les justiciables comme pour leurs représentants, à la nouveauté succède progressivement le retour à une certaine routine jurisprudentielle après l’appel d’air né de l’instauration de la procédure. Ensuite, il est possible que la "réserve" de questions sérieuses s’épuise. Cela vaut en particulier des questions procédurales, mais aussi des sujets de fond » (15).
Pour autant, la plupart des acteurs s’attendent moins à une poursuite de la décrue qu’à une « stabilisation à un niveau moins élevé qu’en 2010 et 2011 » (16) du nombre de QPC, celles-ci visant alors des éléments plus techniques et plus précis de notre législation (17).
Cet indéniable succès statistique apporte un démenti à ceux qui, au moment de l’élaboration de la réforme, craignaient que, après les échecs des réformes initiées dans les années 1990 (voir l’encadré ci-après), la QPC intervienne trop tard (18), le contrôle de conventionnalité par les juges dits « ordinaires » la rendant de facto inutile (19).
À cet égard, lors de son audition par la commission des Lois, M. Marc Guillaume, a souligné que les QPC étaient « beaucoup plus nombreuses que les questions préjudicielles qui, de tous les États membres, affluèrent à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsque se développa le contrôle de conventionnalité dans les années soixante-dix et quatre-vingt. En 2011, première année pleine de la réforme, le nombre de QPC dont le Conseil constitutionnel a été saisi – 114 – s’est ainsi révélé très supérieur, non seulement au nombre des questions préjudicielles renvoyées par des juges français à la CJUE – 31 –, mais aussi à celui des requêtes visant la France devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et déclarées recevables – 25 ».
LES PRÉCÉDENTES TENTATIVES D’INTRODUCTION DE LA QUESTION DE CONSTITUTIONNALITÉ
Dans les années 1990, deux projets d’introduction de ce que l’on appelait alors l’ « exception d’inconstitutionnalité » n’ont pas abouti.
À la suite d’une suggestion de M. Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, reprise par le chef de l’État dans son interview télévisée du 14 juillet 1989, un projet de loi constitutionnelle avait été déposé par le Gouvernement de M. Michel Rocard au printemps 1990. Après son adoption par l’Assemblée nationale, le Sénat, opposé à la réforme, modifia le texte à un point tel que le Gouvernement renonça à la poursuite de son examen.
En mars 1993, après une recommandation en ce sens du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, un nouveau projet de loi constitutionnelle, portant à la fois sur la modification des règles de saisine du Conseil constitutionnel, sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur la responsabilité pénale des ministres, fut déposé au Sénat. Les sénateurs supprimèrent cependant l’ensemble des dispositions relatives au Conseil constitutionnel : si la révision constitutionnelle aboutit cette fois-ci, c’est seulement sur les deux autres points (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVIII).
b) ... permis par l’implication des différents acteurs
Outre la simplicité et la rapidité de la procédure, le succès de la QPC doit beaucoup à l’implication des différents acteurs, dès avant l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er mars 2010. « Cet amorçage rapide montre que les acteurs étaient prêts et qu’ils étaient disposés à immédiatement donner vie au nouveau mécanisme » (20).
Le Conseil constitutionnel et, tout particulièrement son président, M. Jean-Louis Debré, ont fait assaut de pédagogie, en allant présenter la nouvelle procédure directement auprès des barreaux et des juridictions. Le site Internet du Conseil constitutionnel a été enrichi, sa jurisprudence est devenue plus accessible (tables analytiques ; tableau des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution) et ses publications ont été refondues (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel).
L’École nationale de la magistrature a organisé de nombreuses formations déconcentrées, à l’intention de magistrats pour qui les questions de constitutionnalité n’étaient pas toujours familières. Les juridictions administratives, en particulier le Conseil d’État, ont également organisé des sessions de formation. Les sites Internet de la Cour de cassation et du Conseil d’État contiennent chacun un espace dédié à la QPC, notamment à ses aspects procéduraux.
S’agissant des avocats, acteurs essentiels de la réforme, le Conseil national des barreaux (CNB) a créé, dès 2009, un module de formation à la QPC, régulièrement dispensé dans les écoles d’avocats et dans les différents barreaux. Ces actions de formation, toujours en cours, méritent de continuer à être développées dans les barreaux et les ressorts des cours d’appel dans lesquelles peu de QPC ont été soulevées (21). Comme l’a souligné devant votre Commission Me David Lévy, directeur du pôle juridique du CNB (22), ce dernier « a voulu créer chez les avocats un véritable "réflexe constitutionnel" pour qu’ils puissent s’interroger sur l’aspect constitutionnel de leurs dossiers et la possibilité de poser une QPC ».
Rappelons que l’intervention d’un avocat en matière de QPC obéit aux règles de droit commun : le justiciable doit donc être représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation lorsque la QPC est soulevée devant l’une de ces deux juridictions, sauf dans les matières dispensées du ministère d’avocat (23).
La doctrine, qui avait beaucoup plaidé, en amont, pour la mise en place de la QPC, a également joué un rôle important dans sa mise en œuvre. La littérature juridique produite sur ce sujet est impressionnante : au 10 février 2013, on comptait 12 ouvrages spécialement consacrés à la QPC (24), 441 articles parus dans des ouvrages et revues juridiques et 43 articles parus dans la presse (25). Un « concours Georges Vedel » de la meilleure plaidoirie sur une QPC a été créé à l’initiative du professeur Dominique Rousseau et d’une maison d’édition juridique, sous le parrainage du Conseil constitutionnel.
De façon moins anecdotique, un « comité de suivi » de la QPC a, comme on l’a vu, été créé en mai 2010 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, composé de membres de l’Association française de droit constitutionnel (AFDC) et de représentants de la Chancellerie. Son rapport d’étape d’avril 2012, portant sur la première année d’application de la QPC, a été présenté devant la commission des Lois, le 4 décembre 2012, par les professeurs Bertrand Mathieu, président de l’AFDC, Anne Levade, secrétaire générale, et Dominique Rousseau, président du conseil scientifique (26).
De nombreuses équipes de recherche ont, au sein de plusieurs universités, fait de la QPC un objet d’étude privilégié. Tel est le cas par exemple, parmi de multiples initiatives, de la recherche menée au sein de l’université Lille 2, sous l’égide du professeur Emmanuel Cartier, avec le soutien du GIP « Droit et justice » (27). L’intérêt des universitaires pour la QPC va même bien au-delà des seuls constitutionnalistes et s’étend à de nombreuses autres branches du droit, témoignant de la diffusion de la QPC au sein de notre ordre juridique (28).
Au total, l’un des objectifs de la réforme a été atteint : les justiciables se sont réappropriés la norme suprême nationale. C’est un progrès pour l’État de droit : la justice constitutionnelle française, qui se singularisait jusqu’alors par un contentieux déclenché à la seule initiative d’autorités politiques, s’est rapprochée des standards européens. C’est aussi un progrès pour la démocratie : la Constitution est en voie de redevenir l’affaire des citoyens.
Les QPC soulevées lors de ces trois dernières années ont concerné un très grand nombre de domaines juridiques.
Les domaines qui ont suscité le plus d’abrogation par le Conseil constitutionnel sont le droit pénal et la procédure pénale (15 décisions), le droit processuel (8 décisions), le droit de l’environnement (6 décisions), le droit fiscal (5 décisions) et la santé publique (5 décisions) (29).
De nombreuses autres branches du droit ont été concernées par des QPC : le droit du travail, la bioéthique, le droit des biens, le droit commercial, le droit électoral, etc. À propos de ce dernier, on relèvera que le Conseil constitutionnel a accepté d’être saisi d’une QPC lorsqu’il statue en tant que juge électoral (30), ce que n’avait pas expressément prévu le législateur organique, sans pour autant l’exclure (31).
Devant les juridictions administratives, c’est le contentieux fiscal qui a rencontré le plus de succès, celui-ci étant en cause dans 728 des 1 537 décisions rendues par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel (soit plus de 47 %) jusqu’au 31 décembre 2012. S’il en est de même devant le Conseil d’État – qui, sur saisine directe, a rendu 120 décisions en la matière sur un total de 400 (soit 30 %) –, la part relative du droit fiscal dans les QPC diminue sensiblement au fil des mois.
Comme l’a relevé M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État (32), de 36 % en 2010, cette part est « passée à 22,6 % en 2011 puis à 15 % en 2012. Une baisse similaire est constatée en droit des collectivités territoriales et en droit des pensions. D’autres contentieux émergent, à l’inverse, comme de nouveaux champs où se déploie la question prioritaire de constitutionnalité : celui de la fonction publique, qui a connu un développement rapide, celui qui a trait à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, ou encore celui de l’environnement. Dans cette dernière matière, le taux de transmission des juridictions initialement saisies au Conseil d’État, de 43 %, et le taux de renvoi du Conseil d’État au Conseil constitutionnel, de 37 %, sont en outre particulièrement élevés. Le taux de renvoi est également important en matière d’urbanisme et d’aménagement – 38 % –, de juridictions – 33 % –, de collectivités territoriales
– 29 % –, de fonctionnaires et agents publics – 27 % ».
Devant les juridictions judiciaires, les domaines qui ont donné lieu au plus grand nombre de décisions de transmission de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel sont, en matière civile, le droit de la sécurité sociale, le droit de l’urbanisme et de l’expropriation, le droit du travail, le droit des personnes (notamment les questions liées à la filiation), le droit de la nationalité et le droit des étrangers (33). En matière pénale, les questions de procédure ont, de loin, été les plus nombreuses (34). Toutefois, comme l’a souligné devant votre Commission M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation , « une tendance à présenter davantage de questions portant sur les incriminations, notamment sur le choix de pénaliser tel ou tel comportement ou critiquant le manque de précision d’une incrimination, paraît devoir être relevée, spécialement depuis la décision qu’a rendue le Conseil constitutionnel à propos de la définition du harcèlement sexuel ». On observera cependant que le taux de renvoi au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation est sensiblement plus faible en matière pénale qu’en matière civile. À titre d’illustration, sur l’ensemble de l’année 2011, le taux de renvoi au Conseil constitutionnel de QPC en matière pénale s’est établi à 10 %, à comparer à 25 % en matière civile (35).
La variété des QPC soulevées concerne également le type de dispositions législatives contestées. Mme Anne Levade a ainsi souligné que, dès la première année d’application de la nouvelle procédure avait pu être constatée une « diversification immédiate des QPC quant à leur champ d’application matériel : toutes les branches du droit ont été concernées et tous les types de norme, qu’il s’agisse de lois antérieures ou postérieures à 1958, de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie ou des dispositions ayant fait l’objet ou non d’un contrôle a priori ».
La variété dans les QPC s’entend aussi des normes constitutionnelles invoquées par les justiciables.
Si le principe d’égalité est le moyen d’inconstitutionnalité le plus fréquemment soulevé à l’appui d’une QPC (36), de nombreux autres « droits et libertés que la Constitution garantit » (37) ont été invoqués – et reconnus comme tels par le Conseil constitutionnel. Sans prétendre à l’exhaustivité, peuvent être cités le droit de propriété, la libre administration et l’autonomie financière des collectivités territoriales, le droit à la protection de la santé, l’égal accès aux emplois publics, l’indépendance et l’impartialité des juridictions, la légalité des délits et des peines, le principe d’individualisation des peines, la non-rétroactivité des lois pénales, la liberté d’expression, la liberté d’entreprendre, le principe de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, l’obligation de prévention des atteintes à l’environnement ou encore le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Une QPC peut, en outre, fournir l’occasion au Conseil constitutionnel de dégager un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République, au sens du Préambule de la Constitution de 1946 – comme ce fût le cas en 2011 du particularisme du droit local en Alsace-Moselle (38).
Enfin, les auteurs de QPC sont également très variés : il peut s’agir tant de personnes physiques que d’associations, d’entreprises ou de collectivités territoriales. Dans les affaires jugées chaque année par le Conseil constitutionnel, les personnes physiques représentent environ les deux tiers des requérants. Le tiers restant des auteurs de QPC se partage entre les différentes catégories de personnes morales que sont les entreprises, les associations ou les collectivités territoriales. On notera, par exemple, que l’association France nature environnement a soulevé onze QPC, parmi lesquelles huit ont été transmises au Conseil constitutionnel.
Sans être requérants, des tiers intéressés par une QPC peuvent également participer à une procédure par la voie de l’intervention. Cette pratique, admise par la jurisprudence du Conseil constitutionnel avant d’être consacrée à l’article 7 de son règlement intérieur (39), peut bénéficier à toute personne « justifiant d’un intérêt spécial » pour l’affaire concernée.
B. UN REPOSITIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS INSTITUTIONNELS
1. Un Conseil constitutionnel réinvesti dans son rôle de protection des droits et libertés
En confiant au Conseil constitutionnel la mission de protéger les « droits et libertés que la Constitution garantit », l’article 61-1 de la Constitution, introduit en 2008, procède à une forme de « retour aux sources » de la décision Liberté d’association de 1971 (40), à partir de laquelle le Conseil, s’émancipant de ses fonctions initiales de simple régulateur de l’activité des pouvoirs publics, a commencé sa mutation en un organe protecteur des droits fondamentaux.
Cette mission de défense des droits et libertés explicitement confiée par le constituant au Conseil constitutionnel contraste avec sa jurisprudence des années 2000 sur la « qualité de la loi » (41), davantage centrée sur les questions de procédure. Une partie de la doctrine s’était d’ailleurs émue de cette attention, jugée parfois excessive, portée aux conditions du travail législatif plutôt qu’au contenu même de la loi, une telle orientation risquant de détourner le Conseil constitutionnel de sa fonction de protection des droits fondamentaux (42).
Mais ce « processus de "re-constitutionnalisation" des droits et des libertés » (43) représente bien davantage qu’une simple inflexion jurisprudentielle : en rupture avec l’ordre ancien, c’est désormais sur saisine des justiciables eux-mêmes que le Conseil constitutionnel peut être amené à sanctionner des lois portant atteinte aux droits et libertés.
De ce point de vue, la QPC apparaît comme une puissante source de légitimation pour le Conseil constitutionnel. Cette institution, longtemps mal connue du grand public, s’est considérablement ouverte à la société : les justiciables y ont fait leur entrée ; leurs avocats peuvent désormais plaider devant le Conseil ; les audiences relatives aux QPC sont publiques et peuvent être visionnées – en différé – sur Internet (44). Qui plus est, avec la QPC, les sujets de société les plus divers s’invitent désormais au Conseil constitutionnel, qu’il s’agisse de la corrida, du permis de conduire, du mariage de personnes de même sexe, des langues régionales, des droits sociaux des étrangers, de l’accouchement sous X ou des gens du voyage (45).
Le Conseil constitutionnel s’est très rapidement emparé de ses nouvelles fonctions. Comme l’a souligné Mme Anne Levade devant votre Commission, le juge constitutionnel a, dès les premiers mois, « utilisé toute la palette des solutions qui étaient à sa disposition : conformité, conformité sous réserve, abrogation totale ou partielle avec ou sans effet différé, non-lieu à statuer. De même, il a invoqué la plupart des griefs possibles dans le cadre du contrôle de l’article 61-1 de la Constitution. Parallèlement, il a prouvé sa volonté d’expliciter la réforme et de circonscrire clairement ce qui pouvait, ou non, être considéré comme des droits et libertés garantis par la Constitution ».
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le taux d’abrogation des dispositions législatives contestées s’établit à environ 27 %. Dans un peu moins des trois quarts des cas restants, la QPC est rejetée et la loi confirmée dans sa constitutionnalité – parfois sous réserve. Plus précisément, sur les 255 décisions rendues par le Conseil constitutionnel du 1er mars 2010 au 1er mars 2013, 60 % concluent à la conformité ou à un non-lieu, 13 % à des réserves d’interprétation et 27 % à une inconstitutionnalité, partielle ou totale. Environ la moitié des décisions de non-conformité donnent lieu à une modulation dans le temps des effets de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution (46).
Enfin, point n’est besoin de rappeler que des QPC ont déjà suscité plusieurs « grandes décisions » du Conseil constitutionnel, contribuant au perfectionnement de notre État de droit, qu’il s’agisse de la décristallisation des pensions des anciens combattants, de l’ensemble des garanties apportées en matière de procédure pénale, du développement du droit de l’environnement ou de l’encadrement des hospitalisations d’office. Sur ce dernier sujet, une association à l’origine de l’une des décisions rendues en la matière a indiqué à votre rapporteur qu’ « en l’occurrence, le biais du Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a été plus efficace que des saisines, même répétées, de la Cour européenne des droits de l’homme » (47).
2. Un nouveau « dialogue des juges » avec la Cour de cassation et le Conseil d’État
Avant l’entrée en vigueur de la QPC, les rapports entre, d’une part, le Conseil constitutionnel et, d’autre part, la Cour de cassation et le Conseil d’État, étaient relativement lointains et, en tout état de cause, toujours indirects. Ils prenaient par exemple la forme de réserves d’interprétation, émises par le Conseil constitutionnel à l’attention des juridictions ordinaires, dont le contenu s’inspire d’ailleurs parfois de la jurisprudence de ces dernières.
Le constituant de 2008 ayant décidé que les QPC devraient être renvoyées au Conseil constitutionnel par les cours suprêmes de chacun des deux ordres juridictionnels, de nouvelles relations, beaucoup plus directes, se sont instaurées entre le juge constitutionnel et la Cour de cassation et le Conseil d’État. Ces relations n’ont pas été sans heurts, comme en ont témoigné, dès la première année d’application de la QPC, plusieurs différences d’appréciation jurisprudentielle (48). Si certaines divergences perdurent, par exemple à propos des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel (49), le « dialogue des juges » avec la Cour de cassation et le Conseil d’État s’est sensiblement apaisé, au fur et à mesure de la mise en œuvre de la réforme.
À titre d’illustration de cette acculturation à la QPC de l’ensemble des acteurs, peuvent notamment être citées :
– la possibilité désormais largement reconnue au Conseil constitutionnel de se prononcer, non seulement sur la constitutionnalité du texte législatif contesté, mais aussi sur l’interprétation qu’en font les juridictions suprêmes (50) ;
– la meilleure articulation entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité. Au-delà des difficultés apparues lors de l’affaire Melki de 2010 (51), il apparaît que ces deux contrôles, loin d’être antinomiques, s’avèrent plus complémentaires que concurrents (52). On observe ainsi que, jusqu’au 31 octobre 2012, plus de la moitié des pourvois formés devant la Cour de cassation donnant lieu à QPC comportaient un moyen d’inconventionnalité, le plus souvent tiré de la CEDH, soulevé simultanément (dans 55 % des cas en matière civile et 52 % des cas en matière pénale) (53) ;
– la pratique consistant, pour les juridictions suprêmes, à procéder à des revirements jurisprudentiels « préventifs », afin de mettre en conformité leur interprétation de la loi avec la Constitution, les dispensant en conséquence de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC (54). Quoique critiquées par certains auteurs – le professeur Dominique Rousseau a ainsi considéré, devant votre Commission, que « la Cour de cassation, en faisant son travail d’examen du sérieux de la question, s’est attribué le contrôle de constitutionnalité et a réduit la compétence du Conseil constitutionnel » –, de telles pratiques témoignent de l’appropriation des exigences constitutionnelles par l’ensemble des acteurs juridictionnels.
Autre manifestation de ce phénomène, le Conseil d’État consacre désormais dans ses rapports publics annuels de substantiels développements à la QPC. Les membres de son centre de recherches et de diffusion juridiques tiennent régulièrement de riches chroniques jurisprudentielles consacrées à cette question (55). La Cour de cassation, quant à elle, s’est dotée en juin 2009 d’un bureau du droit constitutionnel, créé au sein du service de documentation, des études et du rapport, placé sous la responsabilité de deux magistrats. La Cour bénéficie par ailleurs de l’expertise apportée par le Parquet : comme l’a indiqué à votre Commission M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation (56), 85 % des décisions de transmission de QPC au Conseil constitutionnel en matière civile ont été rendues sur avis conforme de l’avocat général, ce taux atteignant 92 % des décisions de transmission en matière pénale (57).
Au-delà des seules cours suprêmes que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation, la diffusion du droit constitutionnel induite par la QPC vaut pour l’ensemble des juges du fond : « indiscutablement, la mise en œuvre de cette institution nouvelle a permis l’instauration d’un dialogue entre les juges. On a pu assister ainsi à un rapprochement de leurs modes de raisonnement. Le droit privé s’est approprié la question prioritaire de constitutionnalité, il s’est décentré vers le droit constitutionnel, tandis que celui-ci s’est lui-même insinué dans des domaines qui semblaient lui échapper jusqu’alors » soulignait M. Vincent Lamanda devant la commission des Lois.
C’est ainsi que les premiers juges saisis d’une QPC peuvent pratiquer ce qui s’apparente parfois à un « pré-jugement » de constitutionnalité. Le rapport d’étape précité du comité de suivi de la QPC indique en ce sens que « dans la majeure partie des cas, dès le stade du juge a quo, l’appréciation du caractère sérieux de la question implique une forme de pré-jugement de constitutionnalité de la disposition législative contestée. Avéré devant l’ensemble des juridictions, le constat est encore plus net devant les juridictions administratives, au point que si l’on coupait certains considérants des décisions de transmission, on pourrait penser qu’il s’agit d’extraits de décisions du Conseil constitutionnel » (58). En tout état de cause, si le Conseil constitutionnel dispose du monopole du pouvoir d’abroger une disposition législative, tout juge peut, en décidant de rejeter une QPC, se comporter comme un « juge constitutionnel négatif » (59).
En définitive, en confiant aux juges judiciaires et administratifs la mission de vérifier si la QPC mérite d’être transmise à la Cour de cassation ou au Conseil d’État (60) puis, le cas échéant, au Conseil constitutionnel, le constituant de 2008 et le législateur organique de 2009 ont fait du contrôle de la constitutionnalité de la loi une fonction partagée entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel.
3. Les rapports renouvelés entre Conseil constitutionnel et Parlement
Les relations entre le Conseil constitutionnel et le Parlement se trouvent, elles aussi, enrichies par la QPC.
Le Parlement – et notamment votre commission des Lois – a joué un rôle essentiel dans l’introduction de cette nouvelle procédure, tant au moment de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 que lors de l’élaboration de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
C’est, par exemple, au Parlement que l’on doit :
– l’extension du champ du contrôle à l’ensemble de notre législation, et non aux seules lois promulguées postérieurement à 1958 comme le prévoyait initialement le projet de loi constitutionnelle ;
– l’ajout de l’épithète « prioritaire » et, surtout, le renforcement de la priorité donnée à la QPC par rapport aux griefs d’inconventionnalité (extension de la priorité devant le Conseil d’État et la Cour de cassation ; suppression de la réserve en faveur du droit de l’Union européenne au titre de l’article 88-1 de la Constitution) ;
– la mention selon laquelle le premier juge saisi d’une QPC est tenu de se prononcer « sans délai » ;
– l’introduction du délai maximum de trois mois devant la Cour de cassation et le Conseil d’État lorsque la QPC est soulevée pour la première fois devant ces juridictions ;
– le dessaisissement de la Cour de cassation ou du Conseil d’État en cas de méconnaissance du délai de trois mois, au-delà duquel la QPC est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel ;
– l’élargissement du critère de l’applicabilité au litige de la disposition législative contestée ;
– la reformulation du troisième critère devant les cours suprêmes, selon lequel « la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ».
Le Parlement se montrant particulièrement attentif à la mise en œuvre de la réforme, c’est également à son initiative – en l’occurrence celle du Sénat – que l’article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution a supprimé la formation spéciale de la Cour de cassation chargée d’examiner les QPC.
Au-delà, les assemblées ont activement participé à la réflexion sur les possibilités de surmonter des filtrages des QPC qui s’avéreraient trop stricts et priveraient ainsi les justiciables de leur nouveau droit. Outre le rapport d’information précité de M. Jean-Luc Warsmann publié en octobre 2010, on peut notamment mentionner : la proposition de loi organique n° 656 de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois du Sénat, introduisant une possible contestation devant le Conseil constitutionnel d’un refus de transmission d’une QPC (juillet 2010) ; l’amendement n° 290, finalement retiré, de M. Pierre Morel-A-L’Huissier au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale au projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, visant à instaurer une procédure de « nouvelle délibération » par le Conseil d’État ou la Cour de cassation (en janvier 2011) ; la proposition de loi organique n° 3325 de Mme Marie-Jo Zimmermann, déposée en avril 2011, tendant à supprimer l’examen du caractère sérieux de la QPC. On verra plus loin que, compte tenu des progrès enregistrés dans la transmission des QPC, votre rapporteur n’a pas repris à son compte ces propositions (61).
Si les assemblées ont joué un rôle important dans sa mise en place, inversement, la QPC influe directement sur les travaux du Parlement.
En premier lieu, le législateur est assez fréquemment appelé à intervenir à la suite des abrogations prononcées par le Conseil constitutionnel. Une abrogation à effet immédiat peut imposer de combler au plus vite un vide juridique, comme l’a illustré la QPC relative au délit de harcèlement sexuel (62). Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D., le Conseil constitutionnel avait abrogé avec effet immédiat les dispositions législatives incriminant le harcèlement sexuel, en précisant que cette abrogation était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Une abrogation à effet différé commande nécessairement l’intervention du législateur, afin de remédier, avant une date fixée par le Conseil constitutionnel, à l’inconstitutionnalité constatée par ce dernier. Le Parlement est alors contraint, à la fois dans la détermination de son ordre du jour (63) et quant au contenu de la législation (64). Tel fût notamment le cas, en 2011, de la réforme de la garde à vue et, en 2012, de la modification des règles de participation du public en matière d’environnement (65).
En deuxième lieu, lors de l’écriture de la loi, la QPC oblige les parlementaires, encore davantage que par le passé, à prendre en compte la contrainte constitutionnelle. Le professeur Emmanuel Cartier relève ainsi « l’émergence de stratégies préventives au moment de l’élaboration de la loi, où la constitutionnalité est envisagée non plus comme un simple risque qu’une majorité pouvait prendre pour peu qu’il y ait consensus, mais comme une véritable exigence » (66).
Lors des débats sur le harcèlement sexuel, le signataire de ces lignes s’était d’ailleurs interrogé sur les conséquences, au moment de l’élaboration de la loi, de la possibilité, toujours sous-jacente, d’une QPC soulevée à son encontre
– a fortiori lorsque, comme en l’espèce, cette loi faisait suite à une première décision d’abrogation (67). La saisine systématique du Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle a priori prévu à l’article 61 de la Constitution, n’offrirait néanmoins aucune garantie contre une future QPC, sauf à ce que, pris de schizophrénie, les parlementaires ayant voté la loi la défèrent aussitôt au Conseil en la contestant au nom d’une série de motifs d’inconstitutionnalité. En effet, en cas de saisine « blanche » – c’est-à-dire sans que des griefs précis soient présentés devant lui –, le Conseil constitutionnel juge ne pas devoir procéder « spécialement » à l’examen des dispositions de la loi contestée, ce qui a pour conséquence d’ouvrir la voie à d’éventuelles QPC (68).
En dernier lieu, il apparaît cependant que la QPC ne contraint pas à l’excès le Parlement. Veillant à préserver les marges de manœuvre du législateur, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Nombre de QPC portent en outre sur des dispositions anciennes (69), sans donc que leur déclaration d’inconstitutionnalité soit ressentie aussi durement par les parlementaires que lorsque l’encre de la loi est à peine sèche : « l’inconstitutionnalité est [alors] attribuée à une sorte de Législateur perpétuel et impersonnel et non à un législateur actuel et politique » (70). De surcroît, le Conseil constitutionnel n’hésite pas, pour fonder certaines de ses décisions sur des QPC, à rechercher quelle a été l’intention du législateur, ce qui donne une importance nouvelle aux travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi. À titre d’illustration, à propos de l’adoption par les couples non mariés, le juge constitutionnel s’est appuyé sur plusieurs positions prises au Parlement pour refuser d’abroger l’article 365 du code civil interdisant l’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin (71). Au-delà, la QPC permet au législateur de se pencher sur des inconstitutionnalités révélées à l’occasion de cas concrets d’application de la loi, « permettant ainsi au Parlement de corriger la législation en se nourrissant de l’expérience de la loi vécue et mise à l’épreuve des faits » (72).
II. LA QPC VUE PAR CEUX QUI LA FONT
La QPC a ainsi été rapidement adoptée par les justiciables et a eu, en très peu de temps, des conséquences importantes sur le fonctionnement de nos institutions. Au-delà de ce constat général, votre rapporteur a souhaité mieux connaître la perception que les différents acteurs de la QPC avaient de son fonctionnement et, le cas échéant, savoir dans quelle mesure il leur semblait nécessaire que la procédure soit modifiée.
A. UNE PROCÉDURE JUGÉE SATISFAISANTE
Les auditions réalisées par votre Commission, ainsi que les réponses aux questionnaires adressés par votre rapporteur aux différents acteurs de la QPC (juridictions, ordres des avocats, personnes morales à l’origine de questions que le Conseil constitutionnel a examinées) mettent en lumière le bon fonctionnement de la procédure issue de la révision constitutionnelle de 2008. Même les personnes les plus critiques sur certains aspects de la QPC reconnaissent que la procédure fonctionne de manière globalement satisfaisante.
Ce bon résultat n’aurait pas été possible sans l’implication du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, ainsi que de l’ensemble des juridictions qui en relèvent. Beaucoup a été fait pour former, à tous les niveaux, les magistrats et les autres personnels des juridictions, en particulier les greffiers. Toutes les juridictions qui ont répondu au questionnaire de votre rapporteur ont fait état de formations assurées dans leur ressort territorial, qu’elles aient pris la forme de colloques, de conférences ou de modules de formation organisés par les juridictions suprêmes. Elles se sont aussi félicitées du contenu des informations et des outils disponibles sur les sites Internet des hautes juridictions, qui ont l’une et l’autre créé un espace consacré à la QPC, et sur celui du Conseil constitutionnel. La mise à disposition d’un vade mecum rédigé par le Conseil d’État a été très appréciée par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. La Cour de cassation a, quant à elle, comme on l’a vu, institué un bureau du droit constitutionnel chargé d’assister les juges, de la Cour comme des juridictions inférieures.
1. Le respect des délais et du contradictoire
Dans la mesure où une QPC est posée à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est essentiel que son examen n’ait pas pour effet d’allonger cette instance. C’est pourquoi la question des délais d’examen de la QPC a été l’un des points centraux de la discussion de la loi organique du 10 décembre 2009. L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, créé par la loi organique précitée, impose que la juridiction de premier niveau « statue sans délai » ; en application de l’article 23-4 de l’ordonnance, le Conseil d’État et la Cour de cassation se prononcent sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel « dans un délai de trois mois » à compter de la réception de la transmission de la demande par le juge du fond ; l’article 23-5 leur accorde le même délai lorsque la QPC est soulevée pour la première fois devant eux. Enfin, aux termes de l’article 23-10 de la même ordonnance, « le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
En l’absence de données disponibles sur les délais moyens d’examen des QPC par le juge du fond, votre rapporteur s’en remet à des données partielles et aux témoignages qui lui sont parvenus.
Lors de son audition par la commission des Lois, M. Marc Guillaume a présenté les délais moyens de traitement devant le juge du fond des QPC qui ont été examinées par le Conseil constitutionnel. Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, ces délais moyens se sont établis à 32 jours en 2010, 43 jours en 2011 et 55 jours en 2012, soit une moyenne de 40 jours pour l’ensemble de la période, qu’il juge « très satisfaisante ». Même dans les ressorts où l’on constate des écarts par rapport à cette moyenne, les délais sont inférieurs à trois mois : 83 jours dans le ressort de la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2011 et 77 jours dans celui de la cour administrative d’appel de Marseille en 2012. Les mêmes calculs ont donné des résultats plus contrastés en ce qui concerne les juridictions judiciaires : selon M. Marc Guillaume, les délais, qui étaient de 14 jours en moyenne en 2010, ont atteint 52 jours en moyenne en 2011 et 86 jours en 2012. La moyenne reste donc inférieure à trois mois, mais il existe des écarts importants par rapport cette moyenne, nous y reviendrons.
Devant la Commission, M. Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d’État, a reconnu ne pas disposer de statistiques permettant d’évaluer le délai dans lequel sont examinées les questions par les juridictions relevant du Conseil d’État, mais il a indiqué que la pratique montrait que celles-ci étaient pleinement conscientes de la nécessité de statuer rapidement sur le renvoi. Six juridictions administratives sur les sept auxquelles votre rapporteur a adressé un questionnaire ont indiqué que leur délai moyen était de l’ordre de deux mois, les délais minimaux étant compris entre quelques jours et un mois et les délais maximaux entre trois et cinq mois (73). Seule la cour administrative d’appel de Bordeaux signale, sans l’expliquer, un délai moyen de quatre-vingts jours, et un délai maximal de neuf mois. Les juridictions parviennent ainsi dans la plupart des cas à respecter les recommandations qui leur ont été adressées en septembre 2010 par le Conseil d’État et qui interprétait l’expression « sans délai » comme imposant aux juridictions saisies pour la première fois de se prononcer dans un délai de l’ordre de deux à trois mois.
Votre rapporteur n’a pu disposer d’informations de même nature en provenance des juridictions judiciaires qu’il avait interrogées par l’intermédiaire du ministère de la Justice, ce qui est profondément regrettable.
Le délai de traitement des QPC par les juridictions suprêmes est beaucoup mieux connu. Selon les données fournies par le Conseil d’État, les délais moyens globaux de jugement des QPC étaient de soixante jours en 2010, soixante-quatre jours en 2011 et de soixante-et-onze en 2012, soit une moyenne de soixante-quatre jours sur l’ensemble de la période ; les délais moyens pour les décisions prises en formation collégiale étaient stables, à deux mois et onze jours, tandis que les délais moyens des ordonnances des présidents de sous-section s’étaient établis à un mois et six jours en 2011 et deux mois et cinq jours en 2012. M. Vincent Lamada a, quant à lui, indiqué que le délai moyen de traitement par la Cour de cassation des QPC transmises et incidentes en matière civile était de 74 jours, le délai le plus court ayant été de 22 jours et le plus long de 91 jours. Un délai comparable a été constaté en matière pénale. Le Premier président a estimé que le délai légal de trois mois – qui n’avait été dépassé qu’une fois, à la suite d’une erreur d’enregistrement (74) – paraissait, à l’expérience, raisonnable.
Enfin, devant le Conseil constitutionnel, entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2013, le délai moyen de jugement était de deux mois, le délai minimal de 19 jours et le délai maximal de 92 jours.
Au total, d’une manière générale, la durée d’examen des QPC apparaît tout à fait raisonnable. Tel est aussi le sentiment exprimé par les personnes qui ont répondu au questionnaire que votre rapporteur leur a adressé. Les avocats ont souvent souligné la rapidité de la procédure, en comparaison des délais de jugement des recours pour inconventionnalité, en particulier devant la Cour européenne des droits de l’homme. Pour la FDSEA du Finistère, « les délais ont été raisonnables tout au long de la procédure, puisque sept mois se sont écoulés entre le dépôt du premier mémoire au tribunal administratif et la décision du Conseil constitutionnel ». La Société Paris Saint-Germain Football s’est félicitée d’une « décision définitive dans un délai bref » de quelques mois, alors que les délais sont souvent de plusieurs années pour une procédure « classique » devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Enfin, France nature environnement (FNE) a jugé que « les délais d’examen des QPC sont satisfaisants compte tenu de la complexité et de la connexité des mémoires déposés et échangés. Certains mémoires ont même été traités en moins de trois semaines par le Conseil d’État. »
La question des délais est en effet étroitement liée à celle du respect du principe du contradictoire, qui nécessite un minimum de temps. Ce principe est mis en œuvre à chaque étape de la procédure.
En ce qui concerne l’étape de la procédure devant le juge ordinaire et celle devant les juridictions suprêmes, l’application du contradictoire est organisée par le décret du 16 février 2010 (75) : devant les juridictions administratives, les parties disposent d’un « bref délai » pour présenter leurs observations, sauf s’il apparaît de façon certaine au juge a quo qu’il n’y a pas lieu de transmettre leur question ; devant le juge judiciaire, le ministère public doit avoir été avisé et les parties doivent avoir été entendues ou appelées avant que le juge ne statue (76) ; la notification aux parties du renvoi de la question à la Cour de cassation ou au Conseil d’État mentionne qu’elles peuvent produire des observations devant la juridiction suprême dans un délai d’un mois ; le mémoire par lequel une partie soulève pour la première fois une QPC devant l’une des juridictions suprêmes est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre, qui disposent d’un délai d’un mois (77) pour présenter leurs observations ; il en va de même, lorsqu’une question a été renvoyée à la juridiction suprême par le juge a quo.
Les règles applicables devant le Conseil constitutionnel sont fixées dans le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, adopté le 4 février 2010, qui tire les conséquences du principe posé par l’article 23-10 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 selon lequel « les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations ». L’article 1er de ce règlement intérieur organise de manière détaillée les modalités d’échange d’observations et de pièces entre les parties et les autorités qui auront été avisées du renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel (président de la République, Premier ministre, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, autorités de la Nouvelle-Calédonie s’il y a lieu) et sont autorisées à adresser, si elles le souhaitent, des observations. Est notamment prévue la possibilité de présenter des secondes observations pour répondre aux premières. La brièveté du délai de trois mois oblige le Conseil constitutionnel à refuser de verser à la procédure les observations et pièces qui auraient été adressées après la date limite qu’il a indiquée aux parties et autorités concernées. Comme prévu à l’article 3 du règlement intérieur, au cours de l’instruction, tout ce qui doit être transmis ou notifié l’est en principe par voie électronique (mais il peut être recouru à d’autres moyens de communication en tant que de besoin).
Le caractère contradictoire de la procédure s’applique aussi lorsque, pour le besoin de l’instruction, le Conseil décide de procéder à des auditions. Les parties et autorités sont invitées à y assister et il leur est ensuite imparti un délai pour présenter leurs observations, en application de l’article 6 du règlement intérieur. Dans la même logique, en application de dispositions du règlement intérieur précité, adoptées le 21 juin 2011, lorsqu’une « personne justifiant d’un intérêt spécial » adresse des observations en intervention relatives à une QPC dans un délai de trois semaines après la date du renvoi de la question au Conseil, ces observations sont transmises aux parties et aux autorités, qui disposent d’un délai pour y répondre. Le délai de trois semaines n’est pas opposable à une partie ayant posé une QPC qui n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel au motif que celui-ci était saisi d’une autre question mettant en cause la même disposition législative.
L’ensemble de ces dispositions permet de mettre en œuvre le principe du contradictoire dans de bonnes conditions, ce dont s’est félicité Me David Lévy, lors de son audition par votre Commission. Il a estimé que le dispositif garantissait le caractère contradictoire de la procédure et a dressé un « bilan très positif » du déroulement de l’instance devant le Conseil constitutionnel, qui permet le respect de ce principe en dépit de la brièveté du délai de trois mois. Il a aussi porté un jugement positif sur le traitement des interventions de tiers à l’instance. Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Dijon a indiqué que, si les QPC ont souvent été soulevées tardivement en matière pénale ou devant le tribunal pour enfants, les juridictions n’avaient pas hésité, dans certains cas, à ordonner des renvois lorsque cela était possible afin d’assurer le respect du principe du contradictoire. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a néanmoins rapporté que « dans les matières où l’atteinte aux libertés publiques impose au juge de statuer rapidement, le principe du contradictoire n’est pas toujours respecté de manière satisfaisante, le demandeur à la QPC découvrant à l’audience les moyens de ceux qui s’opposent à la transmission de la QPC ».
Les juridictions qui ont répondu au questionnaire de votre rapporteur ont souligné que la contradiction entre les parties s’opérait sans problèmes particuliers, chacun respectant les délais, même courts – ils peuvent être limités à huit jours dans certains cas. Les auteurs de QPC qui ont témoigné auprès de votre rapporteur reconnaissent aussi le bon fonctionnement des règles dans ce domaine, et jugent suffisants les délais accordés pour formuler des observations.
2. Des filtres qui remplissent leur rôle
La procédure de la QPC repose sur un double filtrage, le premier étant assuré par les juges du fond, le second par les juridictions suprêmes. Le mécanisme vise à faire en sorte que le Conseil constitutionnel ne soit saisi que des questions qui méritent véritablement qu’il les examine. Les conditions de recevabilité des QPC et les critères de transmission ont été fixées par la loi organique. Après trois années d’utilisation, ce mécanisme semble remplir son rôle.
Si votre rapporteur ne dispose pas, là non plus, de données relatives aux juridictions judiciaires, les informations fournies par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, montrent, pour l’ensemble des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, un taux de transmission moyen de 14 % entre le 1er mars 2010 et le 30 septembre 2012, taux qui ne fléchit pas puisqu’il dépassait 19 % sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2012 (il s’est établi à près de 18 % en 2010 et à 10 % en 2011).
Les réponses au questionnaire de votre rapporteur permettent de connaître de manière précise, bien que sur un échantillon réduit, les motifs pour lesquels les questions posées devant le juge administratif n’ont pas été transmises au Conseil d’État. L’intérêt de ces informations conduit à regretter l’absence des réponses de la part des juridictions judiciaires.
La part des QPC jugées irrecevables varie considérablement selon les juridictions concernées : devant la cour administrative d’appel de Versailles, une seule question a été jugée irrecevable (pour absence de mémoire distinct) sur 77 questions posées (soit 1,3 %) et devant le tribunal administratif de Marseille, quatre ont subi le même sort sur 71 QPC (soit 5,6 %) ; en revanche, la part d’irrecevabilité est de 12,5 % devant la cour administrative d’appel de Marseille (où 71 QPC ont été enregistrées) et de 13 % devant celle de Bordeaux (53 QPC y ont été enregistrées), de 17 % devant le tribunal administratif de Montreuil (82 QPC enregistrées) et devant celui de Bordeaux (43 QPC enregistrées), et de 33 % devant le tribunal administratif de Dijon – qui n’a, il est vrai, enregistré que dix-huit questions.
Le poids des différents motifs de non-transmission au Conseil d’État est également différent selon les juridictions, mais une partie de ces différences est imputable à l’effet des séries. Ainsi, sur les 77 questions déposées devant la Cour administrative d’appel de Versailles, 54 n’ont pas été transmises car le Conseil d’État étaient déjà saisi de la question posée ; un certain nombre d’entre elles contestait les mêmes dispositions, fiscales pour la plupart. De même, 52 des 71 QPC déposées devant le tribunal administratif de Marseille constituaient une série de questions identiques, en matière fiscale ; il en était de même pour 48 des 82 questions enregistrées à Montreuil. Pour les autres questions, la non-transmission est justifiée, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, soit par le fait que la disposition contestée n’était pas applicable au litige ou à la procédure, soit par le fait qu’elle avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, soit parce que la question était dépourvue de caractère sérieux. Le premier motif n’a été qu’assez rarement utilisé par les juridictions qui ont répondu au questionnaire : si la cour administrative d’appel de Bordeaux mentionne treize cas (sur 53 QPC déposées) celle de Marseille en signale seulement quatre, le tribunal administratif de Dijon deux et les trois autres juridictions aucun. Plus nombreuses ont été les questions portant sur une disposition sur laquelle le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé : on en a compté neuf devant la cour administrative d’appel de Marseille et le même nombre devant le tribunal administratif, six devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, deux devant la cour administrative d’appel de Versailles et 47 devant le tribunal administratif de Montreuil, qui compte manifestement les questions sérielles dans cette catégorie, contrairement aux autres juridictions. Aucune de ces juridictions n’a transmis de questions sur le fondement du changement des circonstances prévu au 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée.
Pour ce qui est de l’absence de caractère sérieux, il a justifié 58 refus de transmission au tribunal administratif de Marseille (qui semble inclure dans cette catégorie les questions sérielles), vingt-et-une devant la cour administrative d’appel de la même ville, seize devant la cour administrative d’appel de Versailles, dix devant le tribunal administratif de Montreuil, sept devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et quatre à Dijon. C’est évidemment le critère dont l’appréciation est la plus délicate, et donc celui qui est le plus critiqué, votre rapporteur y reviendra.
On peut certainement voir dans la relative rareté des contestations des décisions de non-renvoi à la juridiction suprême un signe du bon fonctionnement du filtre de premier niveau. En application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée, « le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Cette possibilité n’est donc ouverte que dans les cas où la question a été posée devant le juge du fond, et non directement devant la juridiction suprême. En matière civile, la Cour de cassation a enregistré 197 QPC incidentes à un pourvoi entre mars 2010 et début novembre 2012, parmi lesquelles seulement dix-huit contestant un refus de transmission, soit 9,1 % ; une seule question a finalement été renvoyée au Conseil constitutionnel. En matière pénale, les contestations sont encore plus rares : huit ont été enregistrées pendant la même période, sur 73 QPC incidentes à un renvoi, et l’une d’entre elle a été renvoyée au Conseil constitutionnel.
Parmi les quatre tribunaux administratifs qui ont répondu au questionnaire de votre rapporteur, deux avaient connaissance de la contestation d’un refus de transmission à l’occasion d’un appel, l’appelant s’étant ensuite désisté dans l’un des deux cas. Les cours administratives d’appel de Bordeaux et Marseille ont chacune indiqué que quatre contestations de décision sur une QPC avaient été formulées devant elle. Une décision prise par la cour administrative d’appel de Bordeaux a été l’objet d’une contestation à l’occasion d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Quant au Conseil d’État, il s’est prononcé, entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012, sur onze mémoires contestant les décisions rendues sur une QPC, dont six portant sur un refus de transmission.
Nous disposons d’informations beaucoup plus exhaustives sur le fonctionnement du filtre assuré par les juridictions suprêmes.
Comme l’a souligné devant votre Commission M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, le taux de renvoi au Conseil constitutionnel des QPC transmises au Conseil d’État ou présentées directement devant lui est remarquablement stable : il était de 26 % en 2010, 25 % en 2011 et de 21 % en 2012, soit 24,3 % sur l’ensemble de la période. Les données publiées dans le rapport public du Conseil d’État distinguent les QPC transmises, celles qui n’ont pas été transmises parce qu’elles étaient déjà posées au Conseil constitutionnel (le rapport parle de « non-transmission avec sursis »), celles qui n’ont pas été transmises – sans que le motif soit précisé – et les autres, qui n’ont pas été examinées pour des raisons d’irrecevabilité, de non-lieu, de désistement, etc. Sur 230 QPC traitées en 2010, 60 avaient été transmises au Conseil constitutionnel, 22 relevaient de la non-transmission avec sursis, 118 n’avaient pas été transmises (51 %) et 30 étaient dans le dernier cas (soit 13 %) ; en 2011, sur 201 questions traitées, 51 avaient été transmises, aucune n’était en « sursis », 131 n’avaient pas été transmises (soit 66 %) et 19 relevaient de la dernière catégorie (soit 8 %). En 2012, 185 questions ayant été traitées, 39 avaient été transmises, 108 n’avaient pas été transmises (58,5 %) et 38 étaient dans le dernier cas (20,5 %). En outre, il apparaît que le taux de transmission au Conseil constitutionnel est nettement plus élevé pour les QPC transmises par un juge du fond (près de 32 % sur l’ensemble de la période), qui sont à l’origine du tiers des décisions rendues, que pour les QPC soulevées directement devant le Conseil d’État (20 %).
Les données publiques ne permettent pas de connaître la part des différents motifs ayant justifié l’absence de transmission et notamment le poids des questions qui n’ont pas été renvoyées faute d’être nouvelles ou de présenter un caractère sérieux, critères fixés à l’article 23-4 de l’ordonnance précité et spécifiques aux juridictions suprêmes. À la demande de votre rapporteur, le Conseil d’État lui a fourni ces informations. Entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012, sur les 357 refus de transmission rendus par le Conseil d’État, 24 étaient justifiés par un défaut d’applicabilité au litige, soit 6,7 %, 30 par le fait que la disposition contestée avait déjà été déclarée conforme à la Constitution, soit 9,9 %, et 303 par l’absence de caractère sérieux ou de nouveauté de la question, soit 84,9 %.
Les données statistiques fournies à votre rapporteur par la Cour de cassation ne comportent pas exactement les mêmes catégories que celles élaborées par le Conseil d’État, mais elles sont très détaillées et précisent les motifs de non-transmission (de non-lieu à renvoi, pour reprendre l’expression utilisée par le Cour). Entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2012, 18,9 % des questions pour lesquelles des décisions ont été rendues (soit 1 217 questions au total) ont été renvoyées au Conseil constitutionnel, 64,5 % ont conduit à un non-lieu à renvoi au Conseil, 11,8 % ont été jugées irrecevables, 3 % ont entraîné un non-lieu à statuer et il avait été renoncé à 1,8 % des questions (au total 16,6 % des questions relèvent de la catégorie « autres » retenue par le Conseil d’État, soit une proportion proche de celle observée devant ce dernier – 14,1 % entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012). Globalement, la proportion des décisions de non-lieu à renvoi (64,5 %) apparaît légèrement supérieure à celle des non-transmissions par le Conseil d’État, qui atteint 61,8 % sur la même période (78). Sur les 717 décisions (79) de non-lieu à renvoi, le défaut d’applicabilité au litige de la disposition contestée a été mis en avant dans 70 cas, soit moins de 10 % ; 86 questions (soit 12 %) ont été écartées car les dispositions visées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution ; 561 questions ne présentaient ni nouveauté ni caractère sérieux. Ce dernier motif est donc, de loin (dans 78,5 % des cas de non-lieu à renvoi), le plus utilisé.
La prépondérance de ce critère, qui est toujours examiné en dernier, devant les deux juridictions suprêmes, montre que, même parmi les questions qui n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel, 80 % à 85 % des questions remplissaient les autres conditions et donc que les juges du fond avaient exercé un filtrage convenable (80).
Selon les rapports publics du Conseil d’État et les informations complémentaires qu’il a transmises à votre rapporteur, le Conseil constitutionnel a pris, en 2010, une décision de non-conformité sur 24,4 % des questions transmises par le Conseil d’État, part qui a diminué à 21,3 % en 2011 et qui est remontée à 30,2 % en 2012. Les non-lieux à statuer étaient limités à 9,7 % en 2010 et 2,3 % en 2012, aucun n’ayant été prononcé en 2011.
Lors de son audition, M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, a estimé que « le nombre de questions transmises mis en rapport avec le ratio de déclaration d’inconstitutionnalité finalement prononcée par le Conseil constitutionnel, autour de 27 %, démontre une application raisonnée et souple du filtrage par la Cour de cassation ».
Globalement, au cours de la première année de mise en œuvre de la QPC, soit entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2011, 10 % des décisions du Conseil constitutionnel ont consisté en un non-lieu à statuer ; en 2011, ce taux avait même chuté à 2 %, la moyenne étant de 5,3 % entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2013. La part des décisions de conformité parmi l’ensemble des décisions prises était de 50 % au cours de la première année, de 56 % en 2011 et de 52 % en 2012, soit 53,8 % sur les trois premières années d’existence de la QPC. Un taux de non-conformité totale (dans 16 % des décisions), partielle (10 %) ou avec réserve (14 %) de 40 % sur l’ensemble de la période atteste de la pertinence du fonctionnement du double filtre.
D’un point de vue qualitatif, M. Jean-Marc Sauvé a estimé que le filtre exercé par la juridiction administrative lui semblait satisfaisant en ce qu’il n’était « ni trop étroit ni trop large ». Il a détaillé comment le Conseil d’État avait veillé à ce que « le filtre serve d’entonnoir sans devenir un verrou » en acceptant qu’une QPC soit soulevée à l’occasion de toute instance juridictionnelle, y compris dans le cadre d’une procédure de référé, ainsi qu’en retenant une appréciation large de la condition d’applicabilité au litige et de la notion de question nouvelle, sans pour autant reconnaître un changement des circonstances en cas « d’évolutions marginales de l’environnement juridique ». Pour juger du caractère sérieux de la question, le Conseil d’État assure, selon son vice-président, un « contrôle de l’évidence », transmettant une question dès lors qu’un « doute raisonnable existe ».
Plus critique par ailleurs, le Premier président de la Cour de cassation a néanmoins indiqué que la Cour était « favorable au maintien du double filtrage, l’expérience montrant que, en pratique, les cours et tribunaux se bornent le plus souvent à vérifier que la demande n’a pas de caractère fantaisiste ou dilatoire et que le grief est appuyé par une argumentation cohérente, tandis que la Cour de cassation se livre à un examen nécessairement plus approfondi des conditions posées par la loi ».
Me Lévy a lui aussi estimé que le double filtre se justifiait parfaitement : « Il permet d’éviter des QPC fantaisistes ou à caractère purement dilatoire. Il faut en effet trouver un équilibre entre l’accès du justiciable à la protection de ses droits et libertés et la capacité du juge constitutionnel d’assurer sa mission – et ainsi conserver à la QPC son attractivité ».
Le respect de délais raisonnables et l’efficacité du double filtre ont certainement contribué à limiter d’utilisation de la QPC à des fins dilatoires, qui avait suscité des inquiétudes. M. Vincent Lamada a évoqué, en matière pénale, « des procédés dilatoires qui ont été utilisés dans des affaires très médiatisées », mais Mme Anne Levade a indiqué que, à son avis, l’utilisation de la QPC à des fins dilatoires était marginale. Même s’il est toujours délicat de juger du caractère dilatoire d’une question, les juridictions administratives interrogées par votre rapporteur ont estimé que cette utilisation de la QPC apparaissait rare, d’autant que la possibilité pour le juge de se prononcer par ordonnance réduisait considérablement le temps que cette procédure permettrait de « gagner ».
B. LES AMÉLIORATIONS SUGGÉRÉES PAR LES DIFFÉRENTS PROTAGONISTES
Si l’appréciation portée globalement sur la procédure applicable à la QPC est très positive, des interrogations ou des critiques ont néanmoins été formulées sur certains points particuliers. Il est proposé ici d’en faire état, sachant que votre rapporteur ne les reprend pas toutes à son compte, comme on pourra le constater dans la partie III consacrée à ses recommandations. Il faut en particulier souligner que les observations faites par les requérants interrogés par votre rapporteur ont valeur de témoignages – et ont beaucoup d’intérêt en tant que tels – mais ne présentent pas un caractère représentatif au-delà de l’expérience particulière de chacun de ces justiciables.
Chacune des phases de la procédure est concernée. Avant de les aborder successivement, seront présentés deux sujets transversaux : le traitement des questions sérielles et le coût de la procédure.
1. Sur deux sujets transversaux
a) Le traitement des questions sérielles
Le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour ont signalé quelques difficultés rencontrées par les juridictions judiciaires dans le traitement des questions sérielles.
– Pour les juges du fond
En application des articles 126-5 du code de procédure civile et R. 49-26 du code de procédure pénale, le juge n’est pas tenu de transmettre une QPC mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. Dans ce cas, le juge « sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ». Ces dispositions n’accordent qu’une faculté aux juridictions. Aussi arrive-t-il que soient transmises à la Cour de cassation des questions qui auraient pu ne pas l’être. Il semble que, souvent, les juridictions du fond préfèrent, dans le doute ou parce que les motifs ne sont apparemment pas les mêmes, transmettre la QPC à la juridiction suprême.
Deux voies sont envisagées pour éviter les transmissions inutiles. La première consisterait à obliger les juridictions à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. Le Premier président suggère même de prévoir une sanction au non-respect de cette obligation. La seconde supposerait d’exiger des auteurs de QPC qu’ils précisent, davantage qu’ils le font aujourd’hui, les griefs d’inconstitutionnalité invoqués (le droit et/ou le principe, avec leur fondement textuel) de manière à faciliter l’examen, par les juridictions du fond, des questions sérielles. La mention de ces éléments serait une condition supplémentaire de recevabilité de la QPC.
– Pour la Cour de cassation
Aux termes des articles 126-12 du code de procédure civile et R. 49-33 du code de procédure pénale, « la Cour de cassation n’est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ».
Le Premier président pose la question de savoir comment la Cour doit traiter une QPC qui porterait sur la même disposition mais reposerait sur d’autres motifs que ceux examinés dans le cadre de la question qui a été renvoyée au Conseil constitutionnel : peut-elle différer sa décision ou surseoir à statuer, ou doit-elle transmettre la question, sachant que le Conseil peut soulever d’office tout grief d’inconstitutionnalité ?
Dans la mesure où, en application de l’article 6 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC, une partie dont la question n’a pas été transmise parce qu’elle mettait en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel était déjà saisi peut adresser des observations en intervention, lesquelles peuvent comprendre des griefs nouveaux, peut-être la Cour de cassation devrait-elle inviter les parties à le faire dans le cas où leur question repose sur d’autres griefs que celle qui est en cours d’examen devant le Conseil. Une autre solution avancée consisterait à prévoir une procédure accélérée d’examen et de renvoi par la Cour de cassation des QPC sérielles portant sur des dispositions en cours d’examen.
b) Les difficultés liées au coût de la procédure
Certains des auteurs de QPC ainsi que les représentants des avocats interrogés ont soulevé la question du coût induit par le dépôt d’une QPC. Ce coût supplémentaire s’élèverait à 5 000 euros en moyenne par justiciable concerné lorsque la question est examinée par le Conseil constitutionnel (81).
Si l’association France nature environnement, qui dispose d’un service juridique, va jusqu’à contester l’obligation de représentation par un avocat pour présenter oralement des observations sur une QPC devant le Conseil constitutionnel dans les matières pour lesquelles la représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant le juge du fond, tout comme elle juge inutile le recours, devant les juridictions suprêmes, à un avocat aux Conseils dans les matières où il est requis (voir infra), d’autres auteurs de QPC, tels le syndicat Sud-AFP, mettent simplement l’accent sur les coûts induits par la procédure. Le coût d’un avocat, augmenté, si nécessaire, de celui d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est en effet à la charge du requérant.
En application du décret du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, les justiciables éligibles à cette aide peuvent aussi en bénéficier si leur question est transmise à la juridiction suprême, puis, le cas échéant, au Conseil constitutionnel. Mais, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette aide ne peut être « exceptionnellement accordée » qu’aux « personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes », et d’autre part, le niveau des ressources des personnes physiques qui y sont éligibles est si bas que, comme Me Catherine Saint-Geniest l’a observé au cours de son audition par la commission des Lois, « toute une partie de la population ne peut en bénéficier […] sans pour autant avoir les moyens de s’offrir un accès à la justice convenable ». Enfin, la rémunération accordée à un avocat à ce titre correspond à « seize unités de valeur » de plus que celles qu’il aurait perçues pour l’affaire à l’occasion de laquelle la question est posée, ce qui représente 365,44 euros hors taxe, selon Me Saint-Geniest, pour l’ensemble de la procédure. Comme l’a souligné le bâtonnier de Dijon, cette somme peut ne même pas couvrir le coût du déplacement à Paris nécessaire à la défense de la question devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, les problèmes bien connus de l’aide juridictionnelle en général se posent aussi en ce qui concerne la représentation par un avocat dans la procédure de la QPC.
Bien que votre rapporteur n’ait pas disposé de données chiffrées, il semble d’ailleurs que l’aide juridictionnelle au titre de la QPC soit rarement demandée : les tribunaux administratifs qui ont répondu à son questionnaire ont presque tous indiqué qu’ils n’avaient pas connaissance de demandes ce type. État donné la faiblesse de la rémunération accordée, on pourrait être tenté de penser que les avocats commis d’office ne sont pas particulièrement soucieux de suggérer à leur client de déposer une QPC.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel censure la disposition contestée et où le juge du fond donne satisfaction à l’auteur de la question, celui-ci peut obtenir que la partie perdante soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés. Mais, comme le fait observer l’association France nature environnement, tel ne peut être le cas lorsque les effets de la censure ont été différés par le Conseil constitutionnel (voir infra). Dans ce cas, l’auteur de la question ne tire pas bénéfice de la décision de non-conformité. S’il est débouté dans l’affaire à l’occasion de laquelle la question a été posée, l’ensemble des frais inhérents à la procédure reste à sa charge. C’est pourquoi France nature environnement souhaiterait que, dans le cas d’une décision de censure à effets différés, l’État prenne ces frais à sa charge.
2. Au niveau du premier filtre
a) Des délais d’examen parfois excessifs
Alors que les délais moyens constatés – du moins ceux dont nous avons connaissance – apparaissent acceptables, voire très satisfaisants, il semble que des délais excessivement longs ont été observés devant le juge du fond sur un certain nombre de QPC.
Lors de son audition, M. Marc Guillaume a cité des exemples effectivement inquiétants parmi les délais d’examen de premier niveau des QPC sur lesquelles le Conseil constitutionnel s’est prononcé. Ce problème semble concerner uniquement les juridictions judicaires, aucun délai supérieur à trois mois n’ayant été constaté, en ce qui concerne des QPC examinées par le Conseil, devant les juridictions administratives. Selon les informations dont dispose le Conseil constitutionnel, en 2011, l’examen d’un QPC a pris 96 jours dans les ressorts des cours d’appel d’Angers et de Nîmes et 156 jours dans celui de la cour d’appel de Toulouse. En 2012, le délai d’examen a atteint 104 jours dans le ressort de la cour d’appel de Colmar, 187 dans celui de Montpellier, 120 jours dans celui de Nîmes et plus d’un an devant la Cour nationale de l’incapacité. D’aussi longs délais posent problème au regard du fait que le juge doit statuer « sans délai » ce qui devrait, selon M. Marc Guillaume, interdire un délai de plus de cent jours.
Me David Lévy est allé dans le même sens en déclarant : « le juge du fond doit porter une attention plus soutenue à l’obligation de statuer "sans délai", laquelle a deux conséquences : répondre dans les meilleurs délais – et non dans un laps de temps considérable qui ralentit inutilement la procédure – et ne pas joindre la décision sur la QPC à la décision au fond, ce qui allonge encore le délai de réponse de celui du délibéré. » (82) Cette remarque faisait suite à des pratiques observées par les avocats, mais sur lesquelles aucune enquête systématique n’a été faite pour mesurer leur fréquence.
M. Jean-Claude Marin a reconnu que certaines juridictions interprétaient « assez souvent » l’expression « sans délai » comme signifiant non pas « immédiatement » mais « sans aucun délai précis ». Pour résoudre cette difficulté, il a suggéré que la loi fixe au juge du fond le même délai que celui imparti aux juridictions suprêmes, soit trois mois.
On peut en outre remarquer que ni la loi organique ni le décret du 16 février 2010 n’impose d’exigence en termes de délai dans le cas de la contestation du refus de transmission d’une QPC par le juge du fond. Le juge d’appel semble donc seulement tenu d’examiner ce moyen en premier – puisque c’est une question prioritaire – lors de l’audience de la requête en appel. C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Versailles a mentionné un délai maximal de seize mois pour une affaire dans laquelle le refus de transmission opposé par le tribunal administratif était examiné à l’occasion d’un recours en appel contre la décision de fond.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Dijon a dénoncé l’attitude des juges du tribunal pour enfants de Dijon, qui ont, selon lui, « tenté de faire échec durant plusieurs mois aux QPC posées considérant que celles-ci généraient un délai de traitement des dossiers incompatible avec la rapidité qu’exige la justice des mineurs ». Il ajoute : « Ce n’est qu’après trois mois d’insistance de l’un de [ses] confrères a pu obtenir l’envoi effectif de deux QPC devant la Cour de cassation. L’une d’elle a prospéré devant le Conseil constitutionnel qui y a fait droit par sa décision du 8 juillet 2011 (83). »
Afin de limiter le plus possible d’utilisation de la QPC à des fins dilatoires en matière pénale, a aussi été évoquée la possibilité d’interdire le dépôt d’une QPC à l’audience devant le juge correctionnel, de la même manière que le dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 interdit de soulever ce moyen devant la cour d’assises. En effet, le dépôt d’une QPC à l’audience conduit à devoir reporter le procès correctionnel en cause alors que, pour certaines affaires, l’organisation d’un tel procès est particulièrement lourde. Pour M. Marc Guillaume, cette mesure aurait aussi pour avantage de supprimer tout risque de voir rejeter des QPC posées à l’audience devant le juge correctionnel, en contradiction avec les règles actuelles, pratique dont l’existence n’est pas été vérifiée empiriquement mais qui pourrait, selon lui, expliquer « la quasi-disparition, en 2012, des QPC renvoyées au Conseil constitutionnel et posées au pénal devant les juges a quo » (84).
Dans le même sens, pour éviter le dépôt tardif de QPC se traduisant par la remise en cause du calendrier des juridictions, en particulier pénales, la Cour de cassation, dans son rapport annuel 2011, proposait que soit fixé un délai pendant lequel les parties pourraient déposer leurs questions, délai qui courrait à partir de leur renvoi devant le tribunal correctionnel ou de la saisine de la cour d’appel.
Sur un autre point, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé par votre rapporteur, l’association France nature environnement a souhaité que l’examen de la QPC par le juge du fond soit l’occasion d’une audience publique devant lui. Elle déplore en effet que l’une des QPC qu’elle avait posée devant le tribunal administratif de Toulouse ait fait l’objet d’une décision de non-transmission pour défaut d’applicabilité de la disposition contestée sans qu’elle ait pu, au cours d’une audience, présenter ses arguments au président du tribunal. Elle estime qu’une audience publique ne rallongerait pas le délai pour statuer sur une QPC.
b) Des décisions dont les motivations sont très variables
La phase devant le juge a quo suscite aussi quelques critiques sur la qualité de la motivation des décisions, critiques qui sont encore plus fortes aux phases suivantes de la procédure.
M. Jean-Claude Marin a ainsi regretté que « dans certains cas, les décisions de transmission par les juges a quo soient peu motivées et laissent en définitive à la Cour le soin de trancher » et indiqué que, « à la lumière, non de la vision théorique qui prévalait nécessairement au moment du débat parlementaire, mais de la pratique des juridictions que nous connaissons désormais, il apparaît que les décisions rendues par les juges a quo sur les QPC doivent être davantage encadrées en termes de délai et de motivation. »
M. Luc Briand, magistrat, dresse tous les six mois depuis février 2011, un bilan du contentieux constitutionnel devant les juridictions judiciaires du fond au cours du semestre passé, qui est publié dans la Gazette du Palais. Pour ce qui est de l’examen du caractère sérieux de la QPC, il souligne la variété des pratiques au sein des juridictions judiciaires, qui vont « du contrôle le plus restreint jusqu’à l’examen particulièrement approfondi du sérieux de la question » (85). Ce constat se vérifie à l’issue de chaque semestre (86), sans que les pratiques qu’il observe n’évoluent dans le sens de l’homogénéisation. Il cite systématiquement une ou plusieurs décisions de transmission non motivées, qui concluent que les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux, sans détailler le raisonnement qui a été suivi. D’autres juridictions se livrent à ce qu’il appelle un « examen restreint » du sérieux de la question, qui les conduit à se pencher sur l’existence éventuelle d’une atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit : s’il existe le risque d’une telle atteinte ou si une atteinte est constatée, la question est renvoyée à la Cour de cassation. Enfin, certaines juridictions procèdent à un examen approfondi de la QPC, c’est-à-dire que, après avoir relevé l’existence d’une atteinte aux droits et libertés constitutionnels, elles examinent si cette atteinte leur semble justifiée. Dans ces cas, il s’agit bel et bien d’un « pré-contrôle de constitutionnalité par le juge du fond ». Le travail mené par M. Luc Briand et Mme Audrey Bonnet, dont la méthode n’est pas précisée – il est seulement indiqué dans l’article de février 2011 que l’auteur a procédé à « l’examen, non exhaustif, de près de deux cents décisions rendues par les tribunaux de grande instance, cours d’appel, juridictions consulaires, sociales et prud’homales » –, ne permet pas de connaître la proportion des décisions relevant de l’examen minimal, de l’examen restreint ou de l’examen approfondi du sérieux de la question posée, mais l’ampleur des différences de pratiques qu’il met en évidence ne peut laisser indifférent. Il semble que ce premier niveau de filtre soit plus ou moins facile à franchir selon la juridiction qui l’exerce, du moins dans l’ordre judiciaire.
Les pratiques seraient plus homogènes dans les juridictions administratives. Celles qui étaient destinataires du questionnaire de votre rapporteur ont toutes souligné que les décisions de transmission au Conseil d’État font l’objet d’une motivation sommaire dans la mesure où les critères posés par le loi organique sont remplis et où il est donné satisfaction au requérant ; est aussi parfois avancé le souci de ne pas influencer les juridictions supérieures. En revanche, selon elles, les décisions de non-transmission font l’objet d’une motivation détaillée, présentant l’ensemble des motifs pour lesquels soit la disposition contestée n’était pas applicable au litige, soit elle avait déjà été jugée conforme à la Constitution (ce qui suppose de mentionner les références de la décision concernée), soit la question ne présentait pas un caractère sérieux (et ce, en déroulant un raisonnement juridique complet).
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a cité un exemple qui pourrait illustrer le caractère aléatoire du fonctionnement du filtre. Selon lui, la cour d’appel de Paris avait refusé, au motif d’un défaut de moyen sérieux, la transmission d’une QPC relative au régime d’hospitalisation à la demande d’un tiers, alors même que le Conseil constitutionnel a déclaré ce régime non conforme à la Constitution par une décision du 26 novembre 2010 (87). Faute de disposer des références de la décision de non-transmission de la cour d’appel de Paris, votre rapporteur n’a pu prendre connaissance de la teneur de la question posée : il n’a donc pas pu savoir si la question était posée dans les mêmes termes et si les motifs étaient identiques ; il n’est évidemment pas exclu que la décision de la cour ait été parfaitement justifiée au regard de la teneur de la question posée (88). Il n’en demeure pas moins que cette non-transmission n’a pas été comprise, peut-être faute d’une motivation suffisante, et qu’elle a conduit le bâtonnier de Versailles à y voir un exemple de « certaines réticences de la part des magistrats à la transmission de QPC ».
Dans une contribution écrite adressée à votre rapporteur, M. Didier Maus propose pour sa part d’assouplir une condition de la transmission des QPC dont la mise en œuvre ne semble pas poser problème aujourd’hui, celle de l’absence de déclaration conforme à la Constitution de la disposition en cause « dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances », prévue au 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il juge en effet qu’« il sera indispensable, un jour ou l’autre, d’admettre qu’une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution peut faire l’objet d’un nouvel examen si les moyens invoqués sont totalement nouveaux par rapport à ceux examinés lors de la précédente décision de conformité », cas de figure qui, comme il l’observe, ne semble pas pouvoir être réglé par la notion de « changement de circonstances » telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel.
3. Sur la phase devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation
Parmi les critiques relatives à l’examen des QPC par les juridictions suprêmes, on peut distinguer celles qui portent sur le déroulement de la procédure de celles qui soulèvent des questions de fond sur les critères du filtre et leur application par le Conseil d’État et, surtout, par la Cour de cassation.
a) Quelques suggestions d’amélioration des règles procédurales
Les avocats qui ont eu l’occasion de donner leur avis dans le cadre du travail de votre rapporteur et certains des auteurs de QPC ont émis des doutes sur l’utilité de maintenir l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour les QPC relevant de certaines matières. L’article R. 771-20 du code de justice administrative, issu de l’article 1er du décret du 16 février 2010 précité, dispose que : « Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d’avocat devant cette juridiction, la même dispense s’applique à la production des observations devant le Conseil d’État ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu’elles émanent d’un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ». Pour ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, l’article 126-9 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du même décret, prévoit que les éventuelles observations des parties « sont signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation » et l’article R. 49-30 du code de procédure pénale, créé par l’article 4 du même décret, dispose que, de même, les observations des parties : « sont signées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l’article 585, sauf lorsqu’elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d’infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d’un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » Ainsi, s’applique à la défense d’une QPC les mêmes règles de représentation que celles qui régissent le fond de l’affaire à l’occasion de laquelle la question est posée.
Le jugement de Me Catherine Saint-Geniest, membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, sur cette obligation est sans appel : « la reproduction du monopole de représentation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation s’apparente à un archaïsme dépourvu de sens. En effet, quand on dépose une QPC devant une juridiction du fond, l’avocat en charge de l’affaire peut la défendre, mais quand la question est transmise au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sauf dans des matières très limitées – droit pénal, droit du travail, droit électoral – dans lesquelles tout avocat peut intervenir, il faut recourir à un avocat aux Conseils alors que le sujet est exactement le même ! Cela est d’autant plus absurde qu’ensuite, devant le Conseil constitutionnel, tout avocat peut intervenir. Ce monopole ne va dans le sens ni du droit, ni des réformes successives de la procédure, et ne se justifie ici par aucune compétence spécifique (…) » (89).
Cinq des sept personnes morales auteures de QPC qui ont fait part de leur avis à votre rapporteur ont indiqué avoir dû recourir à un avocat aux Conseils pour cette phase de la procédure. A contrario, la FDSEA du Finistère a qualifié de « tout à fait appréciable » le fait de pouvoir conserver son avocat tout au long de la procédure (y compris devant le Conseil constitutionnel). Seule l’association France nature environnement a indiqué ouvertement que le concours de cet avocat n’avait rien apporté à la procédure. Mais il est vrai que l’association conteste même l’obligation de recourir à un avocat pour présenter oralement des observations sur une QPC devant le Conseil constitutionnel (90).
Cette association critique aussi l’impossibilité, pour des tiers la procédure, de déposer des observations en intervention devant les juridictions suprêmes, alors que cette possibilité est désormais ouverte devant le Conseil constitutionnel. FNE constate qu’une personne morale défendant des intérêts collectifs ne saurait intervenir devant le juge du fond en défense ou à l’appui d’une QPC dans la mesure où elle ne prend connaissance de l’existence de la QPC qu’après la transmission éventuelle de la question devant la juridiction suprême, les questions transmises étant consultables sur le site Internet du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Elle considère donc qu’il importe qu’elle puisse faire valoir son point de vue devant les juridictions suprêmes. Par une décision du 17 février 2011 (n° 344445), le Conseil d’État a jugé que FNE n’était pas recevable à intervenir devant lui à l’occasion d’une QPC transmise par un tribunal administratif relative à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme (portant sur les espaces boisés classés) ; l’association a néanmoins décidé de présenter des observations sur une autre QPC (instance n° 354022), relative à l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui définit les conditions d’agrément d’une association de protection de l’environnement par la puissance publique. Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur cette affaire. Jusqu’ici, il a admis une intervention sur une QPC transmise par le juge du fond uniquement si elle émanait d’une partie qui, en qualité de partie à un autre litige, avait elle aussi soulevé une QPC analogue contestant la même disposition législative par les mêmes griefs, et sur laquelle le juge du fond avait sursis à statuer. Quant à la Cour de cassation, FNE estime que toute intervention d’un tiers à la procédure apparaît exclue devant elle. Il est vrai que les chambres civiles de la Cour de cassation suivent, le plus souvent, la règle retenue par le Conseil d’État, et que sa chambre criminelle est encore plus réticente à admettre les observations de tiers, même lorsque ceux-ci remplissent les conditions posées par le Conseil d’État et les chambres civiles.
Le dernier point de la procédure qui est parfois l’objet de critiques est l’absence de recours contre une décision de non-renvoi d’une QPC par la juridiction suprême, alors même que des QPC peuvent être soulevées directement devant elle et ne bénéficient donc pas de la possibilité de contestation du refus de transmission à l’occasion d’un recours en appel sur le fond de l’affaire à l’occasion de laquelle la QPC a été posée.
Déjà examinée dans le cadre du bilan de la mise en œuvre de la QPC réalisé par M. Jean-Luc Warsmann en octobre 2010, cette question semble moins brûlante aujourd’hui.
Lors de son audition par la commission des Lois, M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, l’a évoquée, pour l’écarter : « Mais il importe d’abord de répondre à une question que certains se posent : faut-il instituer un recours contre les décisions de non-transmission ? La Cour de cassation n’est pas une juridiction constitutionnelle, même si le législateur lui a confié une mission de filtrage, et par suite une sorte de pré-contrôle de la constitutionnalité de la loi. Comment concilier une telle mission avec l’existence d’un recours ? Le demandeur à la question prioritaire ne manquerait pas de l’exercer. Le recours ainsi engagé aurait inévitablement pour effet de dénaturer la fonction de filtre, de la rendre illusoire, mais aussi d’instituer la Cour de cassation en une juridiction constitutionnelle, ce qui est contraire à la philosophie du texte. Ouvrir une faculté d’évocation au profit du Conseil constitutionnel produirait des effets identiques et pourrait aussi poser problème au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En pratique, la solution obligerait le Conseil à examiner l’ensemble des QPC, rendant insignifiant le rôle de filtre confié aux juridictions judiciaires et administratives, qu’il vaudrait alors mieux supprimer totalement. Pour le reste, je ne peux que renvoyer sur ce point aux arguments excellemment exposés devant votre Commission en septembre 2010, par le professeur Denys Simon en particulier. » Ces arguments étaient les suivants : un tel recours aboutirait en pratique à la disparition du filtrage car il est probable que toutes les décisions de refus de transmission seraient l’objet d’un appel ; il en résulterait un encombrement du Conseil constitutionnel, qui affecterait la célérité et l’efficacité des procédures ; cette possibilité de recours transformerait le Conseil constitutionnel en juridiction d’appel des décisions des juridictions suprêmes, ce qui semble au professeur Simon difficilement concevable avec la composition actuelle du Conseil constitutionnel ; il ne juge pas opportun de confier au Conseil constitutionnel un rôle de filtrage à propos de questions qu’il aura ensuite à trancher sur le fond de la compatibilité avec la Constitution ; enfin, du point de vue formel, un tel recours ne pourrait être créé que par une révision constitutionnelle (91).
Dans un courrier qu’il a adressé le 11 décembre dernier à votre rapporteur, M. Didier Maus a en revanche plaidé pour que « dans quelques cas le justiciable ait la possibilité de dépasser l’arrêt de non-renvoi ». Il estime que « l’appel pourrait résulter d’une démarche des auteurs de la QPC dans un bref délai à compter de la notification de la décision de non-renvoi (quinze jours) et devrait faire l’objet d’une décision d’admission du Conseil constitutionnel, rendue soit par une formation restreinte, soit en plénum, dans un délai bref. Ensuite, le délai d’examen de trois mois aurait comme point de départ la réception de l’appel. Il ne fait guère de doute que le Conseil constitutionnel serait très attentif à ne réserver un accueil positif qu’à de très rares dossiers. Le rejet équivaudrait à la validation du raisonnement de la cour supérieure concernée. »
Me David Lévy a aussi appelé de ses vœux la mise en place d’un mécanisme de réexamen des refus de transmission. Il a estimé qu’« il faudrait évaluer l’opportunité de maintenir deux filtres : on pourrait en garder un et réfléchir à la possibilité de prévoir des voies de contestation des décisions de refus de transmission ». Il a également suggéré de demander au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de délibérer de nouveau, dans une formation différente, sur la QPC dont le renvoi a été refusé. Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Dijon a, quant à lui, jugé « très opportun de permettre au Conseil constitutionnel de soulever d’office certaines QPC jugées non sérieuses par la Cour de cassation ».
Ces questions renvoient directement à celle du fonctionnement du filtre, qui est l’objet de certaines critiques.
b) Des critiques sur le fonctionnement du filtre
Les questions de fond sont relatives aux critères du filtre exercé par les juridictions suprêmes et à la manière dont ils sont appliqués. Il est souvent reproché à la Cour de cassation d’appliquer les critères du filtre de manière plus restrictive que le Conseil d’État.
La Cour aurait d’abord une interprétation plus étroite de la notion d’applicabilité au litige. Ainsi, M. Marc Guillaume a-t-il expliqué à la commission des Lois que « à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation ne dissocie pas le critère de l’applicabilité au litige, pour l’examen d’une QPC, de la question de savoir si la disposition est au nombre de celles en considération desquelles "le litige doit être tranché". Cette conception restrictive de l’applicabilité au litige s’avère particulièrement rigoureuse lorsque sont invoqués des griefs tirés de l’incompétence négative du législateur, les dispositions contestées "en tant qu’elles ne sont pas" étendues aux situations d’espèce pouvant être jugées, pour ce motif, comme n’étant pas applicables au litige. » Selon lui, « certaines appréciations tendent à filtrer fortement les renvois, comme celle qui consiste à assimiler les conditions de recevabilité de la QPC à celles du pourvoi en cassation ». Et de citer l’exemple d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2012 : « Deux QPC étaient dirigées contre l’article L. 661-5 du code de commerce, qui interdit à toutes les parties, à l’exception du ministère public, les voies d’appel et de cassation contre les jugements statuant sur les recours formés contre certaines ordonnances du juge-commissaire. Les QPC étaient posées à l’occasion d’un recours en cassation formé contre un tel jugement. La Cour de cassation a déclaré irrecevables ces pourvois, et incidemment les QPC, alors même que celles-ci visaient à contester l’interdiction du pourvoi en cassation. Une telle interprétation ferme la porte à la QPC et ce, en application de la règle même qui fermait celle de la cassation et qui était l’objet de la QPC. »
M. Jean-Claude Marin a défendu l’interprétation que la Cour de cassation faisait de ce critère : « S’agissant de l’applicabilité au litige, la loi exige uniquement un lien d’applicabilité entre la QPC et la procédure à l’occasion de laquelle elle est soulevée. Il n’est donc pas nécessaire que la réponse à la question détermine l’issue du litige. Cette analyse est partagée par le parquet général et les chambres. » Selon les données transmises par la Cour de cassation, le défaut d’applicabilité au litige explique 9,5 % des décisions de non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel qu’elle a prononcées entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2012. Devant le Conseil d’État cette proportion est limitée à 6,7 % pour les années 2010 à 2012. D’un point de vue quantitatif, il apparaît donc bien une certaine différence d’appréciation entre les deux juridictions suprêmes.
L’appréciation du caractère sérieux d’une QPC donne aussi matière à réflexion. C’est d’abord la pertinence de la différence entre les deux niveaux du filtre qui est discutée.
En application du 3° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, il appartient au juge du premier filtre de juger si « la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux », le Conseil d’État et la Cour de cassation devant pour leur part décider si « la question […] présente un caractère sérieux », aux termes de l’article 23-5 de la même ordonnance. M. Vincent Lamanda a indiqué que la distinction entre les deux critères était apparue bien théorique à l’usage et estimé qu’il pourrait être opportun de les harmoniser, en retenant le critère le plus exigeant. M. Jean-Claude Marin a en revanche jugé que « même si elle peut apparaître subtile, la nuance entre "question non dépourvue de caractère sérieux" devant le juge du fond et "question présentant un caractère sérieux" reflète le rôle régulateur de la Cour ». Dans le rapport présenté à l’automne 2010, M. Jean-Luc Warsmann concluait que « la perspective d’une unification des critères du filtre [n’était] pas à exclure, selon les évolutions à venir des jurisprudences des deux cours suprêmes » ; l’idée était alors de faire appliquer aux juridictions suprêmes le critère plus large mis en œuvre par le juge a quo, pour éviter qu’une application trop rigoureuse du caractère sérieux de la question réduise excessivement le nombre de questions transmises au Conseil constitutionnel. Il semble que ce problème ne se soit pas véritablement posé. En revanche, il est souvent reproché à la Cour de cassation – et en particulier à la chambre criminelle – d’apprécier ce critère de manière plus rigoureuse que le Conseil d’État.
Ce constat est fait par Me David Lévy : « Alors que la pratique du Conseil d’État consiste à vérifier s’il existe un doute raisonnable sur la constitutionnalité de la disposition législative en cause, celle de la Cour de cassation, qui s’appuie plutôt sur l’idée du doute manifeste, va beaucoup plus loin. » Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux a aussi déclaré que, si les juridictions de l’ordre administratif transmettaient la totalité des questions sérieuses, son avis était plus nuancé s’agissant de la Cour de cassation. De même, son collègue de Dijon a estimé que le pouvoir donné aux juridictions d’apprécier le caractère sérieux de la question constituait « un frein », avant d’évoquer « la réticence avec laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation juge actuellement du sérieux des QPC ».
M. Jean-Claude Marin a souligné que la « libre appréciation du sérieux de la question renvoie à l’essence de la mission juridictionnelle ». Il a concédé qu’« il peut arriver que ce caractère ne serve pas seulement de support à l’évaluation du doute entourant la constitutionnalité d’une disposition. Usant de sa plasticité, la Cour s’appuie aussi sur ce critère pour filtrer des QPC qui ne répondent qu’imparfaitement à la première condition légale que constitue la recevabilité. »
En tout état de cause, les données statistiques fournies par la Cour de cassation mettent en évidence un taux de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel nettement plus faible devant la chambre criminelle que devant l’ensemble des chambres : au 1er octobre 2012, alors que le ratio entre le nombre de questions renvoyées au Conseil constitutionnel et le nombre de questions sur lesquelles il a été statué est de 19 % pour la Cour de cassation dans son ensemble, il est de seulement 13,3 % devant la chambre criminelle ; certes, cette dernière a jugé des questions irrecevables plus souvent que l’ensemble de la Cour (14,5 % contre 11,8 %) et elle a pu être particulièrement touchée par l’effet de questions sérielles qui n’auraient pas donné lieu à renvoi au Conseil, mais la différence est sensible. Si on considère les critères du filtre utilisés pour fonder les décisions de non-lieu à renvoi, on constate que les parts de chacun d’entre eux sont presque les mêmes devant la Cour et devant la chambre criminelle (92) : respectivement 9,5 % et 10,5 % pour défaut d’applicabilité au litige, 12 % et 10,5 % pour conformité à la Constitution déjà déclarée, 78 % et 79 % pour défaut de nouveauté ou de caractère sérieux (93). D’un point de vue statistique, on peut en conclure que la chambre criminelle ne fait pas preuve d’une particulière rigueur dans l’appréciation du caractère sérieux des questions sur lesquelles elle se prononce, mais que c’est l’ensemble des critères du filtre qu’elle applique de manière plus sévère que la Cour de cassation en son entier.
En ce qui concerne le Conseil d’État, entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012, moins de 49,2 % des décisions qu’il a rendues consistaient en un refus de transmission pour absence de caractère sérieux ou de nouveauté, part qui atteint 85 % si on rapporte le nombre de refus de transmission sur ce critère au nombre des seuls refus de transmission.
Ainsi, d’un point de vue purement quantitatif, on peut dire, en résumé, qu’il est vrai que la Cour de cassation en général et sa chambre criminelle en particulier transmettent proportionnellement nettement moins de QPC au Conseil constitutionnel que ne le fait le Conseil d’État (la différence est de plus de dix points entre la chambre criminelle et le Conseil d’État), et que leurs refus de transmission sont en proportion plus souvent fondés sur l’absence d’applicabilité au litige de la disposition contestée et moins souvent fondés sur l’absence de caractère sérieux. Alors que la part des décisions du Conseil d’État en faveur de la transmission de la question au Conseil constitutionnel a été comprise au cours des trois années d’existence du dispositif entre 21 % et 26 %, on peut aussi s’inquiéter du fait que cette part, déjà inférieure en moyenne, tende à baisser de manière importante s’agissant des décisions de la Cour de cassation : le nombre de renvois au Conseil constitutionnel rapporté à celui des questions examinées était de 29 % en 2010, de 16 % en 2011 et de 10 % en 2012.
Enfin, l’utilité du critère de nouveauté qui figure à l’article 23-5 de l’ordonnance précitée a été contestée par M. Vincent Lamanda. Il a estimé « quelque peu académique » la distinction entre question sérieuse et question nouvelle, ce dernier critère étant rarement invoqué par les auteurs de questions et rarement utilisé par la Cour – seulement trois fois, à l’occasion de QPC relatives au mariage homosexuel, à l’absence de motivation des arrêts des cours d’assises ou à la Charte de l’environnement. Il a considéré que « la condition de nouveauté, souvent confondue avec l’exigence du caractère sérieux de la question posée, pourrait être considérée comme l’un des éléments permettant d’apprécier ce dernier ».
Pour sa part, M. Jean-Marc Sauvé a cité deux exemples de l’appréciation « large » que le Conseil d’État donnait de la notion de question nouvelle, sans remettre en cause l’intérêt de ce critère : le Conseil d’État a estimé ainsi qu’elle s’appliquait à la conformité d’une disposition législative à un principe que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore consacré comme constitutionnel, par exemple un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et a, de même, qualifié de nouvelle la question de la conformité de la compensation financière pour transfert de charges aux collectivités territoriales, alors même que les dispositions des articles 72 et 72-2 de la Constitution avaient déjà été interprétées à plusieurs reprises.
D’une manière générale, M. Dominique Rousseau a estimé devant votre Commission que « le mécanisme même du filtre rend l’utilisation de la QPC aléatoire », ce qui fragilise le succès de la QPC. Aussi préconise-t-il, à titre personnel, de revoir ce mécanisme en confiant directement au Conseil constitutionnel la charge d’examiner la recevabilité des requêtes.
4. Sur les décisions du Conseil constitutionnel
Le déroulement de la procédure devant le Conseil constitutionnel ne pose visiblement pas de problème d’organisation. Les critiques portent davantage sur la motivation des décisions et sur le recours à des techniques juridiques qui ne sont pas toujours bien comprises par les justiciables et leurs conseils.
Enfin, le fond des décisions prises par le Conseil constitutionnel n’a fait que rarement l’objet de remarques de la part des personnes qui ont donné leur avis à votre rapporteur. Parmi les personnes morales qui ont répondu à son questionnaire et dont la QPC n’avait pas conduit à une censure du Conseil constitutionnel, seul le département de Seine-Saint-Denis estime que la lecture que le Conseil constitutionnel a fait du principe de libre administration des collectivités territoriales « peut apparaître, à certains égards, plus timorée » que celle qu’en fait le Conseil d’État.
a) Des interrogations autour d’un ajustement des critères d’admission des interventions
Dans la logique de son souhait de voir autorisées les interventions de tiers en défense ou à l’appui d’une QPC examinée par le juge a quo, l’association France nature environnement est favorable à un assouplissement des conditions dans lesquelles les interventions sont admises devant le Conseil constitutionnel. Elle estime que l’« intérêt spécial » exigé par l’article 6 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité est trop restrictif, notamment en comparaison de l’intérêt à agir requis pour intervenir à l’appui des conclusions d’une partie devant le juge administratif (94) (hors QPC). Cette exigence aurait pour effet d’écarter dans certains cas les observations de personnes morales défendant un intérêt collectif pourtant directement intéressées par la matière en cause. L’association souhaite donc que la condition pour intervenir devant le Conseil constitutionnel à propos d’une QPC soit celle du simple intérêt à agir de droit commun.
À l’inverse, le bâtonnier du barreau de Versailles semble vouloir que les interventions devant le Conseil soit davantage réglementées : il souhaite que des critères d’admission soient fixées – au-delà de celui de l’« intérêt spécial », donc – et que les requérants puissent s’opposer à certaines interventions, « notamment lorsque l’examen de leur QPC pose des questions relatives à leur vie privée ».
b) Des motivations qui pourraient être plus précises
Si M. Jean-Claude Marin jugeait insuffisantes les motivations de certaines transmissions de QPC du juge du premier filtre vers la Cour de cassation, l’insatisfaction devant la motivation de certaines décisions du Conseil constitutionnel sur les QPC a été exprimée plus fortement au cours des travaux menés par votre rapporteur. Il faut reconnaître que ces décisions ont une portée beaucoup plus importante et qu’une motivation jugée insuffisante plonge l’auteur de la question, surtout s’il n’a pas obtenu la censure de la disposition qu’il contestait, dans l’incompréhension.
Toutes les personnes morales ayant déposé une question qui ont fait part de leur avis à votre rapporteur ne critiquent pas la motivation des décisions, mais, certaines, à l’instar de la société Paris Saint-Germain Football, considèrent qu’elle aurait pu être plus développée. France nature environnement juge de même que « le caractère concis sinon parfois elliptique de la décision du Conseil constitutionnel », même éclairé par son commentaire, « ne suffit pas toujours ». Après avoir cité plusieurs exemples tirés de décisions rendues sur les QPC qu’elle avait posées, l’association conclut que les décisions du Conseil « sont insuffisamment motivées pour en comprendre la portée par un non-initié et laissent les associations requérantes insatisfaites par une réponse incomplète à leurs griefs ».
Même la FDSEA du Finistère, qui a pourtant obtenu une décision (95) de non-conformité totale de la disposition contestée, a jugé décevante sa motivation dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a analysé et retenu qu’un seul des quatre moyens qu’elle avait développés, la violation du principe de participation du public, laissant entiers les problèmes de constitutionnalité relatifs aux autres moyens, alors qu’elle estimait que les questions de droit les plus importantes portaient sur la violation des principes d’égalité devant la loi et du droit de propriété. La fédération départementale indique ainsi qu’elle risque de devoir déposer une autre QPC sur des dispositions connexes pour obtenir une réponse sur ces points. Si elle estime « tout à fait compréhensible » que le Conseil constitutionnel ait conféré des effets différés à sa décision de non-conformité (voir infra), elle regrette qu’il se soit contenté de justifier ce report par les « conséquences manifestement excessives pour d’autres procédures sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public ».
Au-delà de la motivation des décisions, ce sont les techniques utilisées par le Conseil constitutionnel qui sont parfois mises en question : tel est le cas des réserves d’interprétation, et, surtout, de l’application dans le temps de certaines décisions.
c) La technique des réserves d’interprétation
Utilisées depuis longtemps par le juge constitutionnel se prononçant a priori sur un projet (ou une proposition) de loi adopté définitivement, les réserves d’interprétation le sont aussi désormais dans les décisions sur des QPC. Devant votre Commission, M. Vincent Lamanda a vivement critiqué cette pratique. Il a d’abord remarqué, exemples à l’appui, que certaines de ces réserves étaient apparues difficiles à appliquer. Il a ensuite déclaré que les réserves « peuvent avoir un effet sur la jurisprudence et la liberté d’appréciation laissée aux juridictions, en conduisant à remettre en cause une jurisprudence établie ou à figer pour l’avenir des solutions prises dans un contexte donné ». Après avoir cité une décision du Conseil qui neutralisait par une réserve l’interprétation que la Cour de cassation avait faite de la disposition législative contestée par la QPC, le Premier président a posé la question suivante : « Dans de telles situations, l’office du juge constitutionnel ne devrait-il pas être d’abroger purement et simplement la disposition contestée, plutôt que de mettre le juge de cassation dans la situation délicate de se plier à l’interprétation ainsi donnée par un juge non judiciaire ? » Et de conclure, que « la réserve d’interprétation peut ainsi paraître source de confusion et de rupture dans l’équilibre des pouvoirs ».
Cette critique de l’utilisation des réserves d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans des décisions relatives à des QPC – le Premier président a souligné que les réserves d’interprétation a priori ne posaient en revanche aucun problème –, n’est pas partagée par le procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci a en effet indiqué qu’il n’avait « pas tout à fait la même lecture que le Premier président sur les réserves d’interprétation, qui sont en général davantage motivées que les décisions de censure ou de conformité du Conseil constitutionnel : elles donnent corps à une déclaration de constitutionnalité, en précisant les conditions de celle-ci. Le Conseil est donc là dans son rôle : il ne s’agit pas d’une substitution aux ordres juridictionnels judiciaires et administratifs, mais plutôt de guides utiles. » Il n’en souligne pas moins que « ces réserves [lui] semblent devoir rester limitées, d’une part pour ne pas figer une jurisprudence – qui est toujours tributaire d’un contexte et qui par nature est appelée à se développer – et, d’autre part, pour laisser au seul juge l’exercice de sa mission d’interprète de la loi ».
Parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire de votre rapporteur, deux (France nature environnement et le département de la Seine-Saint-Denis) ont posé des QPC qui ont conduit le Conseil constitutionnel à juger les dispositions contestées conformes à la constitution sous certaines réserves d’interprétation. Ni l’une ni l’autre ne conteste cette pratique, mais le département de la Seine-Saint-Denis a déploré – sans plus de précisions – le fait que les juges du fond n’aient pas tiré de ces réserves toutes les conséquences qu’il aurait souhaitées.
d) L’effet dans le temps des décisions d’abrogation
L’autre point volontiers discuté est celui de l’application dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel. Le droit pour le Conseil de déterminer la date à laquelle l’abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle prendra effet est affirmé par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution selon lequel : « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
Dans le cas le plus simple, la déclaration d’inconstitutionnalité emporte l’abrogation immédiate de la disposition déclarée contraire à la Constitution. Il revient alors au juge du fond d’en tirer les conséquences à l’égard de l’auteur de la question, mais aussi, par exemple, lors d’une instruction pénale, à l’égard des co-prévenus poursuivis sur le même fondement. L’inconstitutionnalité peut aussi être invoquée dans les instances en cours à la date de l’abrogation et dont l’issue dépend de la disposition déclarée inconstitutionnelle. La détermination de la portée exacte d’une décision d’abrogation à effet immédiat sur les affaires mettant en cause l’application de dispositions analogues peut néanmoins se révéler parfois complexe, comme ce fut le cas s’agissant de la décision relative à la disposition législative dite « anti-Perruche ». Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution avec effet immédiat le dispositif transitoire prévoyant que ces dispositions étaient d’application immédiate dans les instances en cours, à l’exception de celles où il avait été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation (96). Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont eu des interprétations divergentes sur les implications de cette décision, notamment à cause de l’ambiguïté de la rédaction de cette dernière, dont les motifs paraissaient poser une distinction que le dispositif ne reprenait pas (97).
Le Conseil constitutionnel peut aussi décaler la date d’effet de sa décision et prononcer une abrogation différée des dispositions contraires à la Constitution. Ce fut le cas par exemple pour sa première décision QPC, relative à la cristallisation des pensions des ressortissants d’anciennes colonies françaises (98) ; le Conseil constitutionnel a laissé sept mois au législateur pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée. De même, dans la décision relative à la garde à vue (99), il a différé de près d’un an l’abrogation des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. L’adoption d’une telle solution conduit à priver la partie qui a posé la QPC du bénéfice des effets de l’abrogation prononcée puisque le litige est alors réglé sous l’empire de l’état du droit applicable, en dépit de son caractère inconstitutionnel sur certains points (100). Ce choix est fait lorsque l’abrogation immédiate de la loi aurait des conséquences excessives pour l’ordre public ou la sécurité juridique ; refusant de se substituer au législateur, le Conseil constitutionnel lui donne le temps de voter une nouvelle loi.
M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel, a indiqué à la commission des Lois que la moitié des décisions de non-conformité totale ou partielle rendues par le Conseil sur des QPC avaient donné lieu à une modulation de leurs effets dans le temps. Il a précisé qu’un tel report n’était pas toujours possible : « S’agissant des incriminations pénales jugées inconstitutionnelles sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, un juge ne peut condamner quelqu’un à aller en prison sur le fondement d’une incrimination dont le Conseil constitutionnel a censuré l’absence de définition légale. Le cas s’est présenté à deux reprises, avec la définition de l’inceste et celle du harcèlement sexuel. Le report dans le temps est, en revanche, possible dans d’autres matières, notamment de procédure. Le Conseil constitutionnel l’utilise alors pour rester dans son rôle et ne pas se substituer au législateur. C’est là l’un des principaux avantages du contrôle de constitutionnalité sur celui de conventionnalité, lequel conduit toujours à écarter l’application de la loi. » Il a ajouté que le Conseil avait dégagé deux orientations des dispositions constitutionnelles : « d’une part, l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité interdit que les juridictions appliquent la loi en cause, non seulement dans l’instance ayant donné lieu à la QPC, mais aussi dans toutes les instances en cours à la date de cette décision ; d’autre part, toute exception ou dérogation à cette orientation générale, de quelque nature qu’elle soit, ne peut résulter que des dispositions expresses de la décision du Conseil. »
Le secrétaire général du Conseil constitutionnel a indiqué que, depuis les divergences d’interprétation de la décision sur la loi dite « anti-Perruche » s’agissant de ses conséquences sur les instances en cours, le Conseil s’efforçait de préciser davantage les effets dans le temps de ses décisions.
Cette clarification, bienvenue, ne suffit pas à rendre cette pratique acceptable par l’ensemble des auteurs de QPC et leurs défenseurs.
La position exprimée par Me David Lévy devant la commission des Lois fait exception : il voit comme un facteur de réussite de la QPC le fait qu’elle constitue un élément de sécurité juridique. Il reconnaît comme légitime l’existence d’exceptions au principe, affirmé par le Conseil constitutionnel, selon lequel une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, « dès lors que l’abrogation immédiate de la disposition législative inconstitutionnelle emporterait des conséquences manifestement excessives ». Et d’ajouter : « Le Conseil met ainsi en balance l’intérêt subjectif de la personne ayant posé la QPC à obtenir la défense de ses droits et les effets qu’une abrogation immédiate aurait pour l’ensemble des autres justiciables concernés par le même problème juridique. »
Mais nombre de ses confrères ne partagent pas cet avis. Pour le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Bordeaux, la possibilité d’un report dans le temps des effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité est « incompréhensible pour les praticiens du droit ». Son collègue de Dijon juge « choquant d’interdire de fait à un requérant le bénéfice d’une procédure qu’il a portée jusqu’au Conseil constitutionnel » et le bâtonnier du barreau de Versailles juge « inconcevable que l’effet différé puisse être opposé au requérant qui voit sa QPC couronnée de succès et n’en tire dès lors aucun bénéfice ».
Tel est aussi le sentiment de l’association France nature environnement, qui est à l’origine de plusieurs décisions de non-conformité, totale ou partielle, avec effets différés (101). Elle n’a donc pas pu se prévaloir dans les instances en cours de la non-conformité à la Constitution des dispositions qu’elle contestait et porte un jugement sans appel sur cette situation :
« Cette position fait naître une forme de déni de justice chez le justiciable et interroge sur le bien-fondé de déposer une question prioritaire de constitutionnalité dont le succès ne lui bénéficiera pas, sans préjudice des coûts exposés inutilement. Sauf à être motivé par des considérations altruistes ou d’intérêt général, le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité ne présente aucun intérêt si le demandeur n’en bénéficie pas. Contrairement à la volonté du constituant, le justiciable est empêché de donner un effet utile à la protection de ses droits subjectifs par la question prioritaire de constitutionnalité. »
L’association France nature environnement propose une solution qui permettrait de concilier le bénéfice de la déclaration d’inconstitutionnalité et la sécurité juridique : « La déclaration d’inconstitutionnalité bénéficierait à toutes les instances qui ont soulevé le même moyen de droit devant les juges du fond à la date à laquelle la question prioritaire de constitutionnalité intervient. En dehors de cette hypothèse, la déclaration d’inconstitutionnalité ne bénéficierait pas aux autres justiciables, quand bien même ils auraient une instance en cours devant une juridiction devant laquelle ils pourraient déposer le même moyen de droit, et s’appliquerait à eux à la date à laquelle le Conseil constitutionnel en a différé son entrée en vigueur. Ainsi, les décisions administratives prises en application de la disposition légale non conforme à la Constitution ne seraient pas remises en cause et seraient sécurisées au plan juridique au regard de la déclaration d’inconstitutionnalité. »
* *
*
Les critiques exprimées sur tel ou tel aspect de la procédure sont de portée variable, mais aucune d’entre elles ne remet fondamentalement en cause son fonctionnement actuel. Les recommandations formulées, parfois contradictoires entre elles, n’ont pas vocation à être toutes reprises par votre rapporteur. Sur de nombreux aspects, le mieux pourrait être l’ennemi du bien.
III. LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR
Les développements qui précèdent ont montré que, globalement, la QPC est une procédure qui fonctionne de façon très satisfaisante. Dans ces conditions, trois ans après son entrée en vigueur, votre rapporteur ne souhaite pas proposer de recommandations qui, par leur nombre ou leur ampleur, risqueraient de déstabiliser le système. Tout au plus peut-on suggérer, d’une part, de remédier au caractère très lacunaire des informations aujourd’hui disponibles sur la QPC et, d’autre part, d’améliorer plusieurs aspects de la procédure. Perspective plus ambitieuse, la transformation du Conseil constitutionnel en une véritable cour constitutionnelle serait, quant à elle, une conséquence logique du mouvement de juridictionnalisation induit par la QPC. Il a paru utile d’ouvrir le débat sur ce sujet.
A. ASSURER UN VÉRITABLE SUIVI DE LA QPC
L’élaboration du présent rapport a révélé plusieurs lacunes quant aux informations disponibles sur la QPC, limitant d’autant les possibilités d’une réelle évaluation de cette procédure.
D’une manière générale, si d’assez nombreuses données sont disponibles s’agissant des plus hautes juridictions que sont le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État, tel n’est pas le cas pour les juridictions inférieures. Or, c’est avant tout devant celles-ci que se joue, au quotidien, le succès de la QPC.
Dans le cadre du présent rapport, les questionnaires adressés par votre rapporteur à plusieurs tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ainsi que les données collectées auprès des juridictions administratives par les services du Conseil d’État (102), ont très largement permis de combler ces lacunes.
Tel n’est pas le cas de l’information relative aux juridictions judiciaires. Plusieurs équipes d’universitaires et de chercheurs enquêtant sur la question se sont également heurtées à cette difficulté. En l’occurrence, votre rapporteur n’a malheureusement obtenu aucune réponse aux questionnaires adressés à des juridictions judiciaires – ce qui peut être imputé, au moins en partie, aux difficultés rencontrées par ces juridictions en termes de charges de travail et de moyens insuffisants, mais aussi à une inertie du ministère de la Justice lui-même, qui ne peut être que déplorée. Il est difficilement acceptable que la mission d’évaluation d’une politique publique, mission que l’article 24 de la Constitution assigne au Parlement, se voit opposée un tel silence – au demeurant assez inexplicable. Il est clair que la représentation nationale ne peut s’en satisfaire.
En tout état de cause, aucune donnée nationale ni aucune agrégation globale de statistiques qui seraient établies à un niveau déconcentré ne sont disponibles en matière de QPC.
Il n’est, par exemple, pas possible de déterminer si les différences territoriales signalées devant votre Commission par le secrétaire général du Conseil constitutionnel et par le premier président de la Cour de cassation s’expliquent pas l’attitude des justiciables (qui soulèveraient moins de QPC dans certaines zones géographiques), de leurs avocats (qui seraient moins familiers de cette procédure que certains de leurs confrères) ou des juridictions du filtre (qui seraient plus restrictives dans l’appréciation des critères d’admission de la QPC). Il en va de même des causes de la diminution, observée en 2012, du nombre de QPC transmises au Conseil constitutionnel. Il n’est pas davantage possible d’établir des statistiques sur les délais d’examen des QPC par les juges du premier filtre – sauf à ce que celles-ci soient parvenues jusqu’au Conseil constitutionnel (103). C’est d’autant plus regrettable que, lors de l’examen du projet de loi organique de 2009, le rapporteur de votre commission des Lois avait préconisé que le Gouvernement mette en place « des indicateurs de délai devant chaque type de juridictions », qui devaient « conduire, le cas échéant, à examiner à nouveau la question des délais d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité » (104).
Au-delà de ces lacunes statistiques, ce sont également les disparités d’information qui posent problème. Les différentes réponses reçues par votre rapporteur révèlent que les acteurs de la QPC ne disposent pas toujours, y compris au sein d’un même ordre juridictionnel, d’outils statistiques harmonisés. Tout se passe comme si chacun procédait à des comptabilisations qui lui sont propres, limitant l’intérêt et la pertinence des comparaisons.
Même au niveau des juridictions suprêmes, pour lesquelles les informations disponibles sont plus nombreuses, des améliorations demeurent possibles. Certaines données ne permettent pas de distinguer entre les QPC transmises par des juridictions de premier niveau et celles directement soulevées devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Alors qu’il a pu l’obtenir de la part du Conseil d’État (105), votre rapporteur ne dispose pas non plus du détail du sort devant le Conseil constitutionnel des QPC transmises par la Cour de cassation. Les deux cours suprêmes, de surcroît, n’utilisent pas les mêmes catégories de classement des décisions rendues en matière de QPC, en particulier celles concluant à une absence de transmission au Conseil constitutionnel. Les analyses sont également rendues difficiles par les contentieux en série (qui perturbent la signification des données moyennes) et par les décalages calendaires entre le nombre de QPC posées par les justiciables (dont sont saisies les cours suprêmes) et le nombre de décisions rendues sur des QPC (prises par ces mêmes cours).
Qu’on se rassure, face à ces différentes difficultés, votre rapporteur ne saurait prôner la création d’une nouvelle structure et d’un énième « observatoire ». Il ne saurait davantage recommander que chaque juridiction tienne un « tableau de bord », uniformément défini au niveau national, qui serait spécifique au contentieux de la QPC et viendrait s’ajouter aux différents outils déjà destinés à renseigner sur l’activité juridictionnelle.
Plutôt qu’à un dispositif global et centralisé, c’est sans doute davantage à des évaluations ponctuelles et ciblées qu’il convient de s’en remettre. De telles évaluations ne seront efficaces qu’impulsées et réalisées par ceux qui y ont directement intérêt, à savoir : le Parlement, dans son rôle d’évaluation des politiques publiques prévu à l’article 24 de la Constitution ; les chercheurs et universitaires, pour qui la QPC représente un nouvel objet d’étude de grande importance.
Ces évaluations, qui obéiraient à une périodicité à définir, consisteraient, d’abord, à élaborer des matériaux de recherche homogènes (par exemple : l’ensemble des décisions rendues en matière de QPC par telles juridictions d’un ressort territorial donné), ensuite, à définir une grille d’analyse commune permettant la construction de données statistiques et, enfin, à se livrer à une interprétation de ces données. Une démarche de ce type permettrait de confirmer ou d’infirmer certaines analyses qui, actuellement, relèvent parfois davantage du ressenti diffus que de l’examen objectif.
Pour assurer un véritable suivi de la QPC, il conviendrait donc de réfléchir à une articulation entre les travaux du Parlement – auxquels votre commission des Lois prendrait naturellement toute sa part – et ceux menés par des équipes d’universitaires et de chercheurs, seuls à même de se livrer à des investigations approfondies sur le long terme.
Quelles que soient les formes que pourraient prendre de telles collaborations, il importe que le Parlement reste, ainsi qu’il l’a été depuis sa naissance, le protecteur attentif et actif de la QPC (106).
Les personnes qui ont donné à votre rapporteur leur avis sur le fonctionnement de la QPC ont exprimé un certain nombre de critiques, généralement ponctuelles, et suggéré des améliorations procédurales. On ne peut pourtant que constater qu’il ne ressort de ces différents témoignages ni critique largement partagée, ni recommandation formulée de manière récurrente. Ce constat découle certainement du fait que, dans son ensemble, la procédure fonctionne de manière correcte, et n’appelle pas de réforme de grande ampleur.
Votre rapporteur n’a pas l’intention de proposer des modifications de la procédure applicable de la QPC pour le seul plaisir intellectuel de le faire. L’équilibre actuellement atteint apparaît satisfaisant, et il n’y a pas lieu de le remettre en cause par des réformes aux conséquences imprévisibles. Cela ne signifie pas que toute idée de modification doive être balayée d’un revers de main, mais qu’une certaine prudence s’impose.
L’idée de fixer un délai dans lequel le juge du premier niveau devrait se prononcer sur le renvoi d’une QPC est attrayante (107), mais une telle solution risque de poser plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. D’abord, s’il existe incontestablement des cas dans lesquels les QPC n’ont pas été traitées par le juge a quo avec toute la diligence nécessaire, ce qui est regrettable, il n’est pas possible, en l’état actuel de l’information disponible, d’avoir une idée précise de leur fréquence. Si un délai, de trois mois par exemple, comme devant les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel, était fixé, il faudrait prévoir une sanction à son dépassement, dont on peut difficilement imaginer qu’il consiste en autre chose que la transmission de la QPC à la juridiction suprême compétente : les juridictions suprêmes ne risqueraient-elles pas de se trouver submergées de QPC qui auraient dû être filtrées en amont ? Les juridictions du fond ne risqueraient-elles pas de renoncer à traiter les QPC, alors qu’il leur suffirait d’attendre pour être libérées de cette tâche ? Votre rapporteur n’est pas sûr que la fréquence des retards dans le traitement des QPC par le juge du fond justifie de prendre ces risques. Tant que des données chiffrées précises ne démontrent pas la nécessité d’imposer un délai au premier niveau du filtre, il estime qu’un rappel de l’impératif de diligence émanant de la chancellerie et du Conseil d’État, adressé respectivement aux juridictions relevant de la Cour de cassation et aux juridictions administratives, devrait suffire à résoudre l’essentiel des problèmes de délais manifestement excessifs.
Les témoignages recueillis ne donnent pas à penser que la QPC est souvent utilisée à des fins purement dilatoires. Il apparaît néanmoins dans les réponses au questionnaire adressé par votre rapporteur à des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que les QPC sont assez rarement déposées en même temps que la requête : une grande majorité d’entre elles est déposée au cours de l’instruction, et certaines en fin d’instruction. Il arrive même qu’une QPC soit soulevée au cours de l’audience lorsqu’il y en a une. Le dépôt tardif d’une QPC peut rendre nécessaire le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre le respect du principe du contradictoire, ce qui contribue à désorganiser le calendrier des juridictions et à ralentir encore le fonctionnement de la justice. Pour y remédier, la Cour de cassation a proposé qu’il soit prévu que les parties doivent déposer leurs QPC dans un délai déterminé à compter de leur renvoi devant le tribunal correctionnel ou après la saisine de la cour d’appel. Une autre solution consisterait à interdire le dépôt d’une QPC au cours de l’audience devant le tribunal correctionnel, à l’instar de ce qui est prévue devant la cour d’assises. Même si le dépôt d’une question juste avant l’audience pose quasiment les difficultés que son dépôt au cours de cette audience, cette seconde solution aurait le mérite d’éviter les débordements les plus manifestes sans restreindre excessivement les conditions dans lesquelles les justiciables peuvent déposer une QPC ; ce serait le cas, à l’inverse, si un délai de dépôt était instauré.
Afin de faciliter l’examen, notamment par les juridictions du fond, des questions sérielles, votre rapporteur n’a pas été insensible à l’idée émanant de la Cour de cassation d’exiger des auteurs de QPC qu’ils précisent, sous peine d’irrecevabilité, les griefs d’inconstitutionnalité invoqués : cela supposerait de préciser dans l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ce que l’on entend par l’obligation d’un écrit « motivé ». Cette exigence obligerait les auteurs de QPC à réfléchir de manière précise au droit ou au principe qui leur semble violé par la disposition législative dont ils contestent la constitutionnalité. Pour autant, le risque qu’une telle exigence soit perçue comme restreignant la possibilité qu’une QPC soit jugée recevable est réel. Il ne paraît donc pas opportun d’adresser ce signal aux justiciables.
Votre rapporteur est sensible aux arguments développés par les avocats entendus par votre Commission et par certains auteurs de QPC contre l’obligation de recourir, dans certaines matières, à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour défendre une QPC devant les juridictions suprêmes. Selon les informations fournies par le Conseil d’État, sur l’ensemble des dossiers qu’il a enregistrés jusqu’à la fin 2012, la partie ayant soulevé une QPC n’était pas représentée par un avocat dans 23 % des cas, elle était représentée par un avocat aux Conseils dans 39 % des cas et, dans les 38 % de cas restants, par un avocat à la Cour (108). Ce problème ne concerne donc qu’une minorité des questions posées devant lui. En outre, lorsque le Conseil d’État ou la Cour de cassation intervient sur renvoi d’une juridiction du fond, le justiciable n’est pas tenu de faire appel à un avocat aux Conseils car les juridictions suprêmes se prononcent alors sur le fondement des écritures déposées devant les juridictions du fond ; même dans les domaines où il est requis, le recours à un avocat aux Conseils n’est donc nécessaire que si l’auteur de la QPC souhaite déposer un mémoire complémentaire à celui présenté devant le juge du fond, ou si la question est posée directement devant la juridiction suprême. Il n’en demeure pas moins que, dans les cas où elle s’applique, cette obligation alourdit le coût de la procédure. Votre rapporteur considère que la pertinence du maintien de cette forme particulière de représentation devant les juridictions suprêmes mériterait d’être examinée d’une manière générale, et pas uniquement pour la défense des QPC, et que cette question dépasse l’objet du présent rapport. Il en est de même des problèmes relatifs au niveau insuffisant de l’aide juridictionnelle et aux conditions de revenus à remplir pour en bénéficier : ils se posent pour la QPC comme pour l’ensemble des procédures juridictionnelles et devraient être traités globalement.
Les appels en faveur de la création de modalités de recours contre le refus de renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel apparaissent aujourd’hui moins pressants qu’ils ne l’étaient en 2010, le bon fonctionnement de la procédure et le faible nombre des contestations, à l’occasion d’un appel, du refus de transmission d’un juge du fond vers la juridiction suprême témoignant de l’absence de nécessité d’une telle procédure. Cette question pourrait être à nouveau posée dans l’avenir si le filtrage assuré par les juridictions suprêmes devenait trop rigoureux, entraînant un tarissement des QPC. Le suivi régulier de la QPC par le Parlement que votre rapporteur appelle de ses voeux permettrait notamment de connaître les causes de la diminution du nombre de QPC transmises au Conseil constitutionnel au cours des derniers mois, et donc de voir dans quelle mesure il est la conséquence d’un dysfonctionnement du système de filtrage, lequel pourrait justifier la mise en place d’une voie de recours.
Quant aux autres critiques formulées contre le double filtre et aux propositions de simplification de celui-ci (unification du critère de sérieux entre les deux niveaux de filtrage, suppression du critère de nouveauté de la question), votre rapporteur ne juge pas nécessaire de les retenir. Comme il l’a souligné, le double filtrage a jusqu’ici rempli son rôle et il est, dans l’état actuel des informations disponibles, difficile de démontrer le caractère fondé de certains reproches qui lui sont adressés.
Afin d’améliorer la connaissance du fondement des décisions prises par les juridictions suprêmes, M. Marc Guillaume avait souhaité, dès son audition par la commission des Lois dans le cadre de la préparation du rapport publié par M. Jean-Luc Warsmann en octobre 2010, que les juridictions suprêmes ne transmettent pas seulement au Conseil les décisions par lesquelles elles décident de ne pas le saisir – transmission obligatoire en application de l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 – mais aussi les décisions de non-lieu à statuer et celles jugeant une QPC irrecevable. Selon les informations transmises à votre rapporteur par les juridictions suprêmes, les décisions autres qu’une transmission ou une non-transmission représentent 14 % de celles prises par le Conseil d’État (hors séries) et 16,6 % de celles prises par la Cour de cassation (109) ; ce n’est donc pas une part négligeable des décisions de ces juridictions M. Warsmann avait estimé que cette transmission pouvait être obtenue sans modification de l’ordonnance organique, mais la situation n’a semble-t-il pas évolué depuis l’automne 2010. Dans ces conditions, et comme M. Warsmann l’envisageait déjà en 2010, votre rapporteur juge qu’il pourrait être nécessaire de modifier la loi organique afin que les juridictions suprêmes transmettent au Conseil constitutionnel l’ensemble des décisions prises sur des QPC. Comme les décisions qui lui sont transmises sont mises en ligne sur le site Internet du Conseil, cette transmission exhaustive assurerait un accès aisé à toutes ces décisions, et donc davantage de transparence.
En ce qui concerne les remarques portant sur la phase d’examen des QPC par le Conseil constitutionnel lui-même, votre rapporteur en appelle aussi à la prudence. Ainsi, il juge satisfaisant l’équilibre trouvé par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne l’admission des interventions.
L’une des critiques les plus fortes émises lors des auditions menées par votre rapporteur a porté sur la légitimité de la pratique des réserves d’interprétation, qui a été sévèrement mise en cause par M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, s’agissant des décisions sur les QPC. Sans faire siennes les critiques portant sur le fait que ces réserves contraignent excessivement les juges, comme s’en plaignait le Premier président de la Cour de cassation, en ce qu’elles substitueraient l’interprétation faite par le Conseil constitutionnel à celle faite par les juges judiciaires – ce qui semble somme toute dans l’ordre des choses –, votre rapporteur partage l’idée que le recours aux réserves d’interprétation peut parfois s’apparenter à une forme de réécriture de la loi par le Conseil constitutionnel : d’un côté, cette pratique évite de contraindre le Parlement à intervenir dans l’urgence pour mettre fin à une inconstitutionnalité ; d’un autre côté, elle peut le priver de l’occasion de le faire, alors que le législateur pourrait faire usage de son pouvoir général d’appréciation. Mais votre rapporteur estime que cette question ne se pose pas uniquement lorsque les réserves portent sur une disposition contestée dans le cadre d’une QPC, mais aussi lorsqu’elles conditionnent la déclaration de constitutionnalité d’une loi soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Si les réserves sont utiles dans certains cas, leur usage doit être raisonnable : elles doivent rester d’une portée acceptable pour le législateur et être suffisamment claires et opérationnelles pour que le juge puisse les mettre en œuvre sans difficultés.
L’autre critique de fond sur les décisions du Conseil constitutionnel est relative aux effets dans le temps des décisions de non-conformité. Votre rapporteur n’a aucun doute sur la nécessité du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution (voir supra) ; il doit appartenir au Conseil constitutionnel d’organiser les effets dans le temps des décisions de censure qu’il prend et il existe des situations qui justifient, dans l’intérêt général, que les effets d’une abrogation soient reportés et que l’auteur de la QPC qui en est à l’origine ne puisse s’en prévaloir. Mais votre rapporteur comprend aussi la déception ressentie par le justiciable dans ce dernier cas. Il n’est pourtant juridiquement pas concevable qu’une censure bénéficie à quelques-uns (l’auteur de la question et ceux qui auraient soulevé le même moyen devant les juges du fond à la date à laquelle la QPC a été posée, par exemple), puis que la disposition en cause continue à être applicable pendant un certain temps, avant d’être abrogée à la date fixée par le Conseil constitutionnel.
Il est évident que le risque qu’une décision de non-conformité ne profite pas à l’auteur de la QPC réduit l’intérêt de poser la question : si l’auteur d’une QPC est sûrement très satisfait de contribuer à purger notre droit des dispositions non conformes à la Constitution, il veut d’abord défendre ses intérêts personnels. Or, actuellement, non seulement il peut ne tirer aucun profit d’une déclaration de non-conformité, mais il doit en outre prendre à sa charge les frais, non négligeables, de la procédure. Il y a là de quoi décourager bien des justiciables. C’est pourquoi votre rapporteur approuve l’idée, exprimée par l’association France nature environnement, de prévoir que les frais de justice induits par la procédure de la QPC soient pris en charge par l’État lorsque le Conseil constitutionnel a prononcé une décision de non-conformité dont l’auteur de la question ne peut se prévaloir.
D’autre part, votre rapporteur serait favorable à ce que la question des effets dans le temps d’une éventuelle décision de non-conformité fasse l’objet d’un débat contradictoire dès l’échange des mémoires entre les parties, et, en tout état de cause, à la fin de l’audience devant le Conseil constitutionnel relative à chaque QPC. Cela aurait certainement une vertu pédagogique pour les auteurs de questions et leurs conseils et permettrait au Conseil constitutionnel de connaître l’avis du Gouvernement, voire du Parlement s’il souhaite intervenir, sur la date à laquelle il serait le plus pertinent de renvoyer, le cas échéant, l’abrogation d’une disposition jugée non conforme à la Constitution. Il est d’ailleurs d’ores et déjà courant que le représentant du Gouvernement aborde cette question au cours de l’audience.
Les modifications que votre rapporteur préconise sont ainsi d’une portée limitée. Il ne s’agit nullement de réformer une procédure encore jeune et qui fonctionne convenablement, mais simplement de lui apporter quelques ajustements dont l’utilité est apparue au cours de ses trois premières années d’existence.
C. TRANSFORMER LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN VÉRITABLE COUR CONSTITUTIONNELLE : OUVRIR LE DÉBAT
Par ce qui n’est qu’un apparent paradoxe, le succès de la QPC oblige à repenser le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Si la procédure de QPC donne globalement satisfaction, elle n’en conduit pas moins à une transformation substantielle des fonctions du Conseil constitutionnel. Alors que celui-ci avait initialement été conçu comme un organe plus politique que juridique, principalement chargé d’arbitrer les conflits entre les pouvoirs publics plutôt que de statuer sur les droits et libertés des citoyens, le Conseil constitutionnel est progressivement devenu en pratique, par la force des choses, une véritable juridiction constitutionnelle.
On sait que, depuis l’élargissement de sa saisine, en 1974, à soixante députés ou soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a fait évoluer ses méthodes et ses modalités de fonctionnement. La procédure régissant le « procès fait à la loi » est, en particulier, devenue plus transparente et laisse davantage place à la contradiction. L’entrée en vigueur de la QPC a obligé le Conseil constitutionnel à franchir un nouveau cap, ne serait-ce que pour lui permettre de se conformer aux exigences du procès équitable découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Encore incomplet, ce mouvement de juridictionnalisation doit être mené jusqu’à son terme. C’est en ce sens que, devant votre Commission, le professeur Dominique Rousseau a pu qualifier de « fragile » le succès de la QPC. En plus d’une critique relative au mécanisme de filtre, ce dernier expliquait : « la deuxième cause de fragilité, c’est le Conseil constitutionnel lui-même, qui doit faire le grand écart : alors qu’il est pratiquement inchangé dans sa structure, il a complètement changé dans sa fonction. Sa composition est politique, son rôle est aujourd’hui juridictionnel. Cherchez l’erreur… » (110).
Compte tenu de ses nouvelles fonctions, qui le mettent désormais en lien direct avec les justiciables, les avocats, la Cour de cassation et le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel mérite de devenir une véritable « Cour constitutionnelle », comme l’avait proposé M. Robert Badinter, au Sénat, lors des débats sur la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (111).
Le 14 mars 2013, le conseil des ministres a adopté un projet de loi constitutionnelle tendant à supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution, qui prévoit que les anciens présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel – suppression qui ne s’appliquerait pas aux membres actuels.
C’est un premier pas, minimal.
Pour votre rapporteur, il convient d’envisager d’aller plus loin, en prenant en compte les considérations suivantes :
– le nombre actuel de membres nommés, fixé à neuf, paraît insuffisant, du fait non seulement de la charge de travail supplémentaire créée par la QPC, mais aussi des contraintes liées à l’exigence d’impartialité objective, applicable à toute juridiction. Cette exigence peut conduire les membres du Conseil constitutionnel, a fortiori dans le contexte renouvelé par la QPC, à se déporter ou à être récusés à la demande des parties (112). Comment concilier cette garantie d’impartialité offerte au justiciable avec la règle de quorum régissant la prise de décision qui demeure, depuis 1958, fixée à sept membres ? (113) Cet enjeu représente d’autant moins une hypothèse d’école que M. Marc Guillaume a indiqué à votre Commission, le 21 novembre 2012, que « sur 280 décisions rendues, des membres se sont (...) déportés une trentaine de fois. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs été saisi de trois demandes de récusation. La première a conduit deux membres à ne pas siéger, la demande ayant été écartée pour trois autres membres ; suite aux deux autres demandes, les deux membres concernés n’ont pas siégé » (114) ;
– les conditions requises pour devenir membre du Conseil constitutionnel sont aujourd’hui peu satisfaisantes. Aucune qualification juridique ni aucune connaissance particulière du droit ne sont exigées. Si les commissions des Lois du Parlement émettent désormais un avis, après audition publique, sur les candidats proposés par le président de la République et les présidents des assemblées (115), elles ne peuvent s’opposer à une nomination qu’à la condition, fort improbable, de réunir les trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
– les procédures suivies devant le Conseil constitutionnel demeurent perfectibles. Alors que, comme on l’a vu, le flux des QPC représente un véritable changement d’échelle par rapport au nombre de décisions rendues jusqu’alors dans le cadre du contrôle a priori (sans d’ailleurs que les saisines au titre de ce dernier ne se tarissent), l’organisation du Conseil constitutionnel n’a pas fondamentalement changé depuis l’entrée en vigueur de la réforme.
Afin d’ouvrir le débat sur ces différents aspects, votre rapporteur suggère plusieurs évolutions, qui toutes nécessiteraient une révision de la Constitution.
La composition du Conseil constitutionnel mériterait d’être largement revue. En plus de la suppression – qui devrait être immédiate – de ses membres de droit, le nombre de membres nommés pourrait être porté de neuf à douze. Les trois membres supplémentaires seraient nommés par le Premier ministre, assurant ainsi un équilibre entre les nominations du pouvoir exécutif et celles des présidents des assemblées parlementaires.
Les nominations seraient soumises à l’avis conforme des commissions des Lois : au lieu de l’improbable veto actuel, les commissions devraient approuver les candidats à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un accord politique plus large qu’aujourd’hui serait donc nécessaire, ce qui mettrait fin aux polémiques sur le caractère partisan de certaines nominations.
Dans le même esprit, la Constitution pourrait prévoir l’inéligibilité des membres du Conseil constitutionnel à toute fonction élective, alors que le droit actuel se contente d’une incompatibilité (116).
Il pourrait, en outre, être exigé que les membres du Conseil soient choisis parmi les personnes qui se distinguent par leur connaissance du droit : sans empêcher la nomination de personnalités politiques, cette condition minimale conforterait la crédibilité et la compétence de l’institution.
Enfin, l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes pourrait être posée dans la Constitution.
Par ailleurs, l’organisation des travaux du Conseil constitutionnel pourrait être améliorée sur plusieurs points, en s’inspirant des pratiques suivies par les cours constitutionnelles européennes.
Afin de mieux faire face à la nouvelle activité contentieuse suscitée par la QPC, il pourrait être utile de répartir les affaires entre deux chambres créées au sein du Conseil constitutionnel – ce que faciliterait d’ailleurs l’augmentation du nombre de ses membres (117). L’unité de la jurisprudence du Conseil serait naturellement garantie par la faculté de se réunir en formation plénière.
La Constitution devrait par ailleurs explicitement affirmer le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, pour l’ensemble des contentieux dont il a à connaître.
Enfin, pourrait être ouverte la possibilité pour les membres du Conseil constitutionnel d’émettre une opinion individuelle, qui serait publiée et annexée à la décision concernée. Une telle innovation contribuerait à alimenter les échanges argumentatifs au sein du Conseil constitutionnel, l’incitant à une meilleure motivation de ses décisions (118).
L’ensemble de ces changements justifierait que le Conseil constitutionnel devienne désormais une authentique « Cour constitutionnelle ».
Au cours de sa réunion du mercredi 27 mars 2013, la Commission procède à l’examen du rapport d’information présenté par M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur.
Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.
M. Patrice Verchère. Je félicite le Président Urvoas pour l’important travail accompli. L’instauration de la QPC a eu pour effet de remettre sur le devant de la scène le Conseil constitutionnel, qui désormais fait un peu d’ombre à la Cour de cassation – ou plus précisément à ses magistrats. On a pu lire, ici ou là, que la Cour de cassation ne voulait pas se laisser aussi facilement déposséder de ses prérogatives en matière de protection des libertés publiques et qu’elle avait freiné des quatre fers devant la création de cette nouvelle procédure. Comme le Président vient de le relever, il est souvent reproché au juge judiciaire d’user des critères du filtre de manière bien plus restrictive que ne le fait le juge administratif. Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel l’a dit lui-même : il a souligné qu’à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation ne dissocie pas la condition d’applicabilité au litige de la disposition législative objet de la QPC des conditions de la recevabilité d’un pourvoi en cassation et que cette conception s’avère particulièrement rigoureuse. M. le Président, ces différences d’appréciation entre les deux ordres de juridictions ne peuvent-elles pas, à terme, poser des difficultés qui plaideraient pour que soient revus les critères du filtre ? Ne faut–il pas, par ailleurs, ouvrir le débat sur la création d’une cour suprême qui résulterait de la fusion du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation ?
M. Philippe Gosselin. Je tiens à mon tour à remercier le Président pour son éclairant rapport. En dehors de tout esprit polémique, je tiens à souligner que je partage les regrets qu’il vient d’exprimer quant au caractère bien trop tardif de la transmission de données – pourtant indispensables à notre travail d’évaluation – par la Chancellerie. J’espère que cela ne se reproduira plus à l’avenir.
Sur le fond, le Président a souligné l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel : alors qu’en 1959, il était pour les uns un « canon braqué sur le Parlement », pour les autres le « chien de garde de l’Exécutif », chargé de contenir la loi dans son domaine et de faire respecter les prérogatives de l’Exécutif, il est devenu, à partir de 1971, le gardien des libertés publiques, et tout particulièrement de la liberté individuelle. À mes yeux, la révision constitutionnelle de 2008 marque un troisième temps dans cette évolution, même si on est encore loin d’avoir mesuré toutes les conséquences de cette révolution qu’a constitué l’instauration de la QPC : la « porte étroite », évoquée par le doyen Vedel dans les années 1990 est en train de s’ouvrir. Je rappelle que, sur un plan quantitatif, les décisions relatives à des QPC rendues depuis trois ans représentent plus du tiers de l’ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel depuis 1959 dans le cadre du contrôle a priori.
Tout cela doit nous conduire à nous interroger sur le fonctionnement du Conseil, la qualité de ses membres et sa jurisprudence. Je ne partage pas le point de vue exprimé par le Président sur les réserves d’interprétation même si ces dernières ne doivent à l’évidence pas conduire à un gouvernement des juges, ni à brider la liberté, certes encadrée, du Parlement. Il est temps désormais de s’interroger sur la question de savoir si le Conseil constitutionnel ne devrait pas, à terme, devenir une réelle cour constitutionnelle. Dans la rivalité qui l’oppose au Conseil d’État et, plus encore, à la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel est sans doute en train de prendre l’ascendant. Les critères de filtre devraient être unifiés. S’agissant des anciens présidents de la République, je ne serais pas choqué qu’ils ne soient plus appelés à siéger au Conseil constitutionnel ; à condition peut-être de leur trouver une autre place ? Je pense qu’au Sénat leur expérience et leur compétence pourraient pleinement trouver à s’exprimer…mais je vois que ma proposition suscite déjà quelques réactions. Le débat reste ouvert.
Je ne crois pas qu’il faille faire du diplôme en droit un critère nécessaire pour devenir membre du Conseil constitutionnel, tant il est vrai qu’en ces matières, comme dans d’autres, la validation des acquis de l’expérience doit aussi être envisagée… Pour conclure, je dirais que, si ce sujet important a des incidences dans les rapports entre les juridictions mais aussi sur le travail législatif – nous sommes de plus en plus souvent conduits à invoquer au cours de nos débats le motif de la non-conformité à la Constitution de telle ou telle disposition – il ne doit pas encombrer l’ordre du jour du Parlement et occulter les vrais urgences, de nature économique et sociale, dont nous devons nous saisir.
M. Matthias Fekl. Merci, M. le Président, pour ce rapport qui porte sur une question essentielle. La question prioritaire de constitutionnalité est effectivement une révolution juridique, qui a permis à la France de faire un saut substantiel vers l’État de droit. Le saut a toutefois eu lieu plus tardivement que dans d’autres grandes démocraties. Le contrôle de constitutionnalité est apparu dès 1803 aux États-Unis. Certaines grandes démocraties européennes l’ont introduit bien avant nous.
Les justiciables résidant en France étaient les seuls à ne pas pouvoir saisir le Conseil constitutionnel avant la mise en place de la réforme, ce qui prouve à quel point le pas qui a été franchi est important. Il faut par conséquent en tirer toutes les conséquences, s’agissant de la nature et de la composition du Conseil constitutionnel.
La question de l’évolution du nombre de membres est posée. Si l’on suit votre proposition, la question du partage des voix devra être résolue.
Je suis par ailleurs très favorable au principe d’une validation positive des nominations aux trois cinquièmes des suffrages exprimés afin qu’elles soient incontestables et qu’elles apparaissent comme telles.
Je pense qu’il nous faut aussi travailler sur la question des conflits d’intérêts susceptibles de voir le jour. On y réfléchit pour les parlementaires mais il n’y a aucune raison qu’une institution républicaine échappe à ce débat. La réflexion doit concerner les membres nommés et les membres de droit. Je suis très heureux de ce que je viens d’entendre, notamment sur les bancs de l’opposition, s’agissant de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Cette question ne doit pas donner lieu à des polémiques. L’enjeu est que notre République devienne, ou plutôt redevienne exemplaire. Lorsque l’on regarde les résultats des élections récentes, on se rend bien compte de la défiance généralisée qui s’est installée.
Les Français attendent de nous la modernisation de l’économie mais aussi celle de nos institutions et je suis convaincu que si l’on veut regagner leur confiance, il faut que l’ensemble de nos institutions soit incontestable. C’est pour cela que les anciens présidents de la République n’ont aujourd’hui plus leur place au Conseil constitutionnel. Peut-on imaginer MM. Barack Obama ou George Bush siéger à la Cour Suprême, ou encore Mme Angela Merkel rejoindre la Cour constitutionnelle allemande au terme de son mandat ? Cela n’aurait aucun sens.
Il est envisageable que les anciens présidents de la République occupent une place dans le débat public. Ils pourraient par exemple devenir sénateurs de droit, à condition que la question du non-cumul des rémunérations liées au mandat échu de président de la République et de membre de droit du Sénat soit posée. Cela n’est toutefois pas la question qui nous préoccupe aujourd’hui.
Être membre d’une juridiction tenue à des obligations de discrétion, de réserve et de lutte contre les conflits d’intérêts en même temps qu’acteur du débat public n’a aucun sens. Le premier conflit d’intérêts pour les anciens présidents de la République siégeant au Conseil constitutionnel est d’être à la fois partie prenante du débat public et d’intervenir sur des questions juridiques et politiques majeures.
Ce rapport doit nourrir des débats rationnels et précis et nous permettre de faire évoluer nos institutions car elles en ont besoin.
M. Patrick Devedjian. C’est un très bon rapport qui ouvre des perspectives et fait réfléchir. Il m’a fait penser au très bon livre de Mme Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, que je recommande à ceux qui s’intéressent à l’histoire du Conseil constitutionnel.
Il est vrai qu’avec le temps et la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est transformé. À l’origine, il a été créé pour assurer le respect de l’article 37 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n’a pas joué ce rôle, mais il en a rempli bien d’autres depuis, ce qui est une bonne chose !
La transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle est une évolution normale. Elle induit naturellement beaucoup de conséquences. J’ai entendu un peu plus tôt, sur les bancs de l’opposition, des observations sur l’attitude de la Cour de cassation. La réticence de la Cour de cassation vient du poids du Conseil d’État dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel, le second étant la courroie de transmission du premier. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est toujours issu du Conseil d’État et promis à l’avenir le plus brillant. Les rapporteurs-adjoints du Conseil constitutionnel en sont pratiquement toujours issus. Il y a là un déséquilibre qui ne va pas sans susciter des questions. Je comprends les réserves de la Cour de cassation même si je ne les approuve pas toujours. Nous devons veiller à garantir l’autonomie intellectuelle du Conseil constitutionnel.
Parmi les pistes présentées dans votre rapport, il y en a une que je trouve intéressante, en l’occurrence le soulèvement d’office d’une QPC par le juge. Cette question mérite sans doute une évolution.
Vous évoquez aussi le passage du nombre de membres de neuf à douze. On peut soupçonner les intentions politiques sous-tendant cette proposition. Je suis favorable à la disparition des membres de droit, même si je ne suis pas certain qu’il faille nécessairement s’inspirer du modèle italien et faire des anciens présidents de la République des sénateurs de droit. Il n’est pas évident qu’il faille leur réserver une place « à vie » dans nos institutions.
La désignation du président du Conseil constitutionnel par le président de la République, qui n’a pas été abordée, est une vraie question. J’observe que lorsque le président de la République est réélu, celui qui préside l’organe qui juge ses comptes a souvent été nommé par lui. Cela pose un problème d’impartialité qui invite à réfléchir à la question de la nomination du président du Conseil constitutionnel.
L’utilité du Tribunal des conflits me paraît faire débat à présent. Le Conseil constitutionnel pourrait très bien remplir les fonctions qui sont les siennes actuellement.
Je suis d’accord avec la règle proposée pour les nominations, à savoir la désignation par les commissions parlementaires aux trois cinquièmes positifs. Le soupçon ne sera pas totalement écarté mais cela constituerait néanmoins un vrai progrès.
Il faut effectivement qu’un seuil minimal de compétences juridiques soit requis pour les membres même si je constate que la pratique a évolué positivement sur ce point. Peut-être faudrait-il toutefois inscrire la règle dans notre droit.
Un point important n’a pas été abordé : les membres du Conseil constitutionnel sont presque toujours issus de la fonction publique. Je pense qu’il serait utile de prévoir une plus grande diversité afin de prévenir le corporatisme et de disposer d’une meilleure ouverture sur la société. Il n’est pas interdit d’y nommer des chefs d’entreprise, des avocats, etc.
En conclusion, je souhaiterais dire que puisque la question prioritaire de constitutionnalité fait l’unanimité, je ne peux pas m’empêcher de dire ma fierté d’appartenir à la majorité qui l’a mise en place. En tout état de cause, c’est un très bon rapport qui invite à la réflexion.
M. Philippe Houillon. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je partage en tous points les propos que vient de tenir notre collègue Philippe Devedjian. Je salue la hauteur de vue exprimée dans ce rapport, même si je ne peux que regretter que, dans son introduction, le nom du Président Sarkozy ne soit pas même mentionné – sans doute est–ce un oubli ? – alors qu’il est l’auteur de la réforme et que le parti ait été pris de faire remonter la paternité de la QPC au Président Mitterrand et à M. Robert Badinter… L’instauration de la QPC est une grande liberté publique, donc une grande étape dans la vie d’une société ; il ne serait, à mon sens, pas inutile de préciser le nom de son auteur…
M. Guy Geoffroy. Sans doute était-ce subliminal ?
M. Philippe Houillon. Je partage avec vous l’idée que le Conseil constitutionnel doit accéder au statut de cour constitutionnelle ; je ne suis en revanche pas de votre avis d’agissant des réserves d’interprétation – dont vous souhaitez que l’usage soit limité – qui sont fort utiles au Conseil pour juger des jurisprudences dégagées par le Conseil d’État ou la Cour de cassation : une construction jurisprudentielle, fondée sur une disposition législative ayant été jugée conforme à la Constitution lors d’un contrôle a priori, peut tout à fait être elle-même jugée contraire à la Constitution. La technique de la réserve d’interprétation permet au Conseil constitutionnel d’exercer la plénitude de son contrôle, même si, on le comprend bien, certaines juridictions ne voient pas d’un très bon œil les réserves d’interprétation exprimées par le Conseil constitutionnel sur ses décisions…
S’agissant de votre proposition consistant à augmenter le nombre de membres du Conseil constitutionnel, les enjeux politiques sont très clairs ; je crois qu’il faudrait trouver un autre mode de désignation pour ces nouveaux membres que celui que vous proposez.
M. François Vannson. Je voudrais vous remercier car il s’agit d’un des premiers rapports d’étape qui nous est présenté sur ce sujet. La question prioritaire de constitutionnalité a fait substantiellement évoluer les missions du Conseil constitutionnel. Je pense qu’il faut engager une réflexion sur la nécessaire réforme de ce dernier. Qu’il prenne la forme d’une Cour suprême ou non, il conviendrait d’ouvrir le Conseil constitutionnel sur la société civile tout en s’assurant des compétences juridiques de ses membres. Il ne faut pas qu’il ait l’image d’un conclave de prélats hyper-spécialistes en droit.
C’est aux commissions des Lois des assemblées parlementaires qu’il appartient de donner un avis sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel. On peut donc faire confiance à ces organes pour décider de la nomination de personnalités qualifiées pour occuper ces fonctions.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. La question prioritaire de constitutionnalité est une réforme importante, utile et saluée par tous. Votre rapport est à l’image de ces trois qualificatifs et je tenais à vous remercier. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur le rôle, la composition et la nature du Conseil constitutionnel.
Je ne voudrais pas me tromper en disant cela mais lorsque le Conseil constitutionnel statue sur la compatibilité de dispositions législatives avec des dispositions constitutionnelles précisément inscrites dans la Constitution, cela ne pose pas tellement de difficultés. En revanche, lorsqu’il s’intéresse à leur compatibilité avec les grands principes constitutionnels, et notamment avec le préambule de la Constitution de 1958, doit-on craindre certaines dérives dans l’analyse ?
Vous avez évoqué l’évolution du Conseil constitutionnel vers une Cour suprême. Je me rends compte que dans certaines décisions, le juge constitutionnel n’a pas hésité à formuler des injonctions de faire à l’endroit du législateur, notamment s’agissant de la garde à vue. D’après moi, l’essentiel serait de savoir si la saisine du Conseil constitutionnel pour avis, avant le vote et la promulgation de la loi, pourrait être envisagée. Je ne sais pas si cela existe quelque part dans le monde.
M. Jean-Louis Debré m’a un jour confié que s’agissant du principe de précaution, il revenait au Conseil constitutionnel non pas de le définir mais de l’encadrer. Cela conduit à s’interroger sur le pouvoir du législateur.
Enfin, le rôle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation doit-il être revu et amendé ?
M. Jean-Michel Clément. Je me contenterai de quelques observations. Ce rapport vient à un moment opportun : en l’espace de quelques années, la QPC a rendu la saisine du Conseil constitutionnel – jusqu’ici assez exceptionnelle – accessible à tout justiciable.
Je m’interroge sur la conversion douce mais lente vers l’ordre juridictionnel : les questions procédurales ne doivent pas ajouter encore à des délais déjà trop longs ; une autre question a trait à l’accès des citoyens à la QPC au travers de l’aide juridictionnelle, le Président en a parlé dans sa présentation.
Je m’interroge surtout sur l’écart qui s’accroît entre la composition politique du Conseil constitutionnel et son rôle juridictionnel grandissant. Il est temps désormais de faire clairement le choix entre le rôle qui était dévolu au Conseil constitutionnel en 1958 et les nouveaux instruments qui ont été mis en place depuis quelques années et ce, d’autant plus que de nouveaux principes sont entrés dans la Constitution sur lesquels le Conseil va être amené à se prononcer. La composition actuelle du Conseil pourrait ne plus convenir à ces évolutions. Je souscris aux quatre propositions faites par le Président Urvoas ; peut-être convient-il d’aller plus loin et de faire le choix, afin de répondre aux aspirations de nos concitoyens, de la création d’une véritable cour constitutionnelle dans notre pays.
M. Guy Geoffroy. Je salue la très grande qualité du travail mené, qui permet tout à la fois de faire un point précis et actualisé sur le bilan de la QPC et d’ouvrir une réflexion plus vaste sur l’avenir du Conseil constitutionnel.
Je reprends très largement à mon compte ce qui a été dit sur tous les bancs. Je souhaiterais plus particulièrement revenir sur deux points. S’agissant en premier lieu de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, je dois dire qu’à titre personnel, je n’ai pas de jugement définitif, mais que je crois crucial de poser la question de manière apaisée et raisonnable. Je rappelle qu’historiquement, c’est parce qu’il fallait trouver une place au Président Coty, qui acceptait d’abréger son mandat pour permettre le passage à la Ve République, que le Général de Gaulle a proposé que les anciens présidents de la République fussent désormais membres de droit du Conseil constitutionnel, faculté dont lui-même n’usa pas en 1969. Il ne faut en aucun cas confondre, comme le font certains, la question des fonctions que peuvent remplir les anciens présidents de la République avec celle du risque de conflit d’intérêts que peut induire une nomination au Conseil, car ce risque peut tout aussi bien frapper un ancien ministre ou un ancien parlementaire ! Il serait pour le moins contreproductif pour nos débats d’entretenir auprès de nos concitoyens la confusion entre deux questions qui sont totalement distinctes.
S’agissant de la question du possible élargissement de la composition du Conseil constitutionnel, et sans considérations liées à la personne qui occupe aujourd’hui la fonction, je ne partage pas l’idée évoquée par le Président Urvoas de confier au Premier ministre la compétence de nommer trois nouveaux membres. Les trois autorités actuelles de nomination partagent deux caractéristiques : elles participent à l’élaboration de la loi – l’Assemblée nationale et le Sénat la votent, le président de la République la promulgue – et émanent du suffrage universel. Le Premier ministre, quant à lui, a une légitimité différente car il n’est pas issu du suffrage universel, ou s’il l’était ce ne serait pas à ce titre mais indirectement, comme membre du Parlement par exemple. Si je ne suis pas opposé à ce que la composition du Conseil constitutionnel soit élargie à de nouveaux membres, je crois qu’il faut trouver une autre modalité pour leur désignation : pourquoi ne pas confier aux trois autorités actuelles la tâche de nommer quatre membres chacune, au lieu de trois ?
M. le Président Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Merci à tous pour ces interventions. Je ferai quelques remarques en conclusion de cette discussion.
Il ne faut pas exagérer les différences entre le Conseil d’État et la Cour de cassation pour ce qui est de la mise en œuvre du filtre. D’une part, leurs pratiques se sont progressivement rapprochées ; d’autre part, c’est surtout la chambre criminelle qui a des positions divergentes des autres chambres et du Conseil d’État sur un certain nombre de points.
La différence entre les deux niveaux de filtrage en ce qui concerne le caractère sérieux de la question posée apparaît pertinent. Il donne de la souplesse aux tribunaux du fond et laisse les juridictions suprêmes exercer un contrôle plus serré.
Les réserves d’interprétation sont utiles et légitimes lorsqu’elles respectent des limites. Le Conseil constitutionnel rappelle volontiers qu’il ne dispose pas du même pouvoir général d’appréciation que le législateur, mais il lui arrive de suggérer fortement à celui-ci la voie à suivre…
La mention du nom du président de la République qui est à l’origine de la révision constitutionnelle ayant donné naissance à la QPC a toute sa place dans l’introduction de mon rapport ; elle y figurera.
Il est certain que le Conseil constitutionnel d’aujourd’hui reste marqué par les circonstances de sa création ; la présence en son sein des anciens présidents de la République en est un exemple. Il faut reconnaître que son activité est restée modeste jusqu’à la décision de 1971 puis à l’ouverture des conditions de sa saisine en 1974. Il a connu de très importantes évolutions depuis.
M. Geoffroy, vous critiquez l’idée de confier au Premier ministre le soin de nommer une partie de ses membres, au motif qu’il n’est pas élu au suffrage universel. Je vous rappelle d’une part que, en 1958, le président de la République n’était pas élu au suffrage universel direct et que le Premier ministre joue un rôle décisif dans la procédure législative en déposant les projets de loi. Je ne vois pas à quelle autre autorité cette mission pourrait être confiée, mais nous aurons certainement l’occasion d’en débattre à nouveau. En tout état de cause, et quelle que soit l’autorité de nomination, l’obligation pour tout candidat d’obtenir le soutien de trois cinquièmes des membres des commissions des Lois des deux assemblées interdit les nominations critiquables. Il est évident que l’on proposera des personnalités ne prêtant pas à controverse.
La question de l’autonomie intellectuelle du Conseil constitutionnel mérite d’être soulevée. Il faudrait que chaque membre soit doté des moyens de bâtir sa propre réflexion. Dans le livre qu’elle a écrit sur son expérience au Conseil constitutionnel, Mme Dominique Schnapper a fait part de sa surprise devant le mode de fonctionnement de l’institution et l’influence du Conseil d’État sur la rédaction de ses décisions. Si je suis favorable à la publication des opinions individuelles, c’est notamment parce qu’elles permettraient de montrer que sont possibles d’autres raisonnements que celui qui a prévalu dans la décision.
Lorsque je parle de la transformation du Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle, je demande simplement que lui soit reconnu le rôle qu’il remplit de facto d’ores et déjà. Je ne demande pas qu’il devienne une cour suprême. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’estime qu’il ne saurait absorber les compétences du Tribunal des conflits : s’il le faisait, il franchirait une étape vers sa transformation en cour suprême.
La Commission autorise ensuite le dépôt du rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité.
*
* *
Questionnaires adressés par votre rapporteur :
– à certaines juridictions judiciaires 81
– à certaines juridictions administratives 84
– à certains barreaux de région 87
– à certaines personnes morales auteures de QPC 88
Données statistiques relatives à la question prioritaire de constitutionnalité :
– devant le Conseil d’État 90
– devant la Cour de cassation 92
– devant le Conseil constitutionnel 94
– devant certaines juridictions civiles (statistiques fournies par le ministère de la Justice) 95
Comptes rendus des auditions de la commission des Lois :
Audition de M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel 109
Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, et de M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’État 119
Audition de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation 127
Audition de M. Bertrand Mathieu, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, président de l’Association française de droit constitutionnel, de Mme Anne Levade, professeure à l’université Paris-Est et de M. Dominique Rousseau, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 135
Audition de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation 142
Audition de Me David Lévy, avocat, directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux, et de Me Catherine Saint-Geniest, avocate, membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris 152
Questionnaire adressé à certaines juridictions judiciaires (119)
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commission des Lois constitutionnelles, LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
de la législation et de l’administration générale
de la République
![]()
Bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité : questionnaire à destination des juridictions judiciaires
1. Bilan statistique. Indiquer, pour les tribunaux judiciaires et pour la cour d’appel, en distinguant les différentes juridictions, pour les années 2010 (à compter du 1er mars), 2011 et 2012 (au 1er décembre) :
1.1. le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées, en le rapportant au total des affaires connues par la juridiction ;
1.2. le stade de la procédure auquel les QPC ont été déposées ;
1.3. la part des QPC jugées irrecevables (absence de mémoire distinct et motivé, non-lieu à statuer, désistement, etc.) ;
1.4. la part des QPC non-transmises à la Cour de cassation, en précisant le critère (au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) retenu pour justifier la décision de non-transmission ;
1.5. la part des QPC transmises à la Cour de cassation, en précisant la proportion d’entre elles ayant ensuite fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel ;
1.6. la part des QPC transmises à la Cour de cassation en raison de l’admission d’un changement de circonstances au sens de l’article 23-2 précité ;
1.7. la répartition par matière des QPC déposées et des QPC transmises à la Cour de cassation (par exemple : droit pénal / droit du travail / droit social / droit commercial / droit fiscal / droit civil, etc.) ;
1.8. la formation de jugement qui s’est prononcée sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation ;
1.9. la part des QPC transmises n’ayant pas entraîné un sursis à statuer du juge a quo, en précisant le motif (au sens de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) ;
1.10. les délais moyen, minimal et maximal d’examen des QPC, en signalant les éventuelles différences significatives entre les matières concernées ;
1.11. le nombre de contestations d’une décision de non-transmission formulées à l’occasion d’une procédure d’appel ou de cassation, en précisant le sens de la décision alors rendue en appel ou en cassation ;
1.12. le nombre d’affaires dans lesquelles sont simultanément soulevées une QPC et un moyen d’inconventionnalité ;
1.13. le nombre de demandes d’aide juridictionnelle formulées dans le cadre du dépôt d’une QPC et la part d’entre elles qui a été accordée.
2. Recevabilité temporelle. Jusqu’à quel moment de l’instance les QPC sont-elles jugées recevables ? Les QPC soulevées à l’audience connaissent-elles un taux de transmission à la Cour de cassation différent de celui des QPC soulevées durant la phase d’instruction ?
3. Pertinence des QPC. Des QPC sont-elles fréquemment soulevées dans un but dilatoire ?
4. Requérants. Parmi les QPC soulevées, préciser la part émanant de personnes physiques et la part émanant de personnes morales. Quelle place occupent les associations, comme requérantes ou comme intervenantes au litige ? Quels sont les domaines dans lesquels les associations sont les plus actives en termes de recours à la QPC ?
5. Délais de jugement. Comment est interprétée l’exigence de statuer « sans délai » sur la transmission de la QPC ?
6. Contradictoire. La contradiction entre les parties s’opère-t-elle dans des conditions satisfaisantes ?
7. Applicabilité au litige. Comment est interprété le critère de l’applicabilité au litige de la disposition législative faisant l’objet d’une QPC ?
8. Caractère sérieux. Comment est interprétée l’exigence d’une question non « dépourvue de caractère sérieux » ?
9. Motivation. Dans quelle mesure les décisions de transmission ou de non-transmission d’une QPC sont-elles motivées ?
10. Moyens d’inconventionnalité. Quels sont les critères paraissant guider le choix des requérants dans l’invocation de moyens d’inconventionnalité plutôt que d’une QPC ? Le phénomène est-il davantage marqué dans certaines branches du droit ?
11. Questions sérielles. Quelle est l’application faite en pratique par le juge de la faculté, ouverte aux articles 126-5 du code de procédure civile et R. 49-26 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer lorsqu’une QPC a déjà été posée à la Cour de cassation ou au Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la QPC soumise à ce juge ?
12. Conséquences des décisions QPC du Conseil constitutionnel. Après la transmission d’une QPC, quel a été, le cas échéant, l’impact sur l’office du juge des décisions du Conseil constitutionnel déclarant la disposition législative inconstitutionnelle ou conforme à la Constitution sous réserve d’interprétation ? L’application dans le temps de décisions d’inconstitutionnalité (abrogation différée, abrogation avec effet sur les litiges en cours, etc.) a-t-elle déjà suscité des difficultés ?
13. Formation. Présenter les éventuelles actions de formation à la QPC conduites à l’attention des magistrats et des avocats dans votre ressort territorial (soit en vue de préparer l’entrée en vigueur de la réforme le 1er mars 2010, soit postérieurement à cette date).
14. Aménagements du dispositif. D’une manière générale, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité ? Quelles sont celles qui pourraient justifier des adaptations législatives ou réglementaires ?
Questionnaire adressé à certaines juridictions administratives (120)
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commission des Lois constitutionnelles, LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
de la législation et de l’administration générale
de la République
![]()
Bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité : questionnaire à destination des juridictions administratives
1. Bilan statistique. Indiquer, pour le tribunal administratif et pour la cour administrative d’appel, en distinguant les deux niveaux de juridiction, pour les années 2010 (à compter du 1er mars), 2011 et 2012 (au 1er décembre) :
1.1. le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées, en le rapportant au total des affaires connues par la juridiction ;
1.2. le stade de la procédure auquel les QPC ont été déposées ;
1.3. la part des QPC jugées irrecevables (absence de mémoire distinct et motivé, non-lieu à statuer, désistement, etc.) ;
1.4. la part des QPC non-transmises au Conseil d’État en précisant le critère (au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) retenu pour justifier la décision de non-transmission ;
1.5. la part des QPC transmises au Conseil d’État, en précisant la proportion d’entre elles ayant ensuite fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel ;
1.6. la part des QPC transmises au Conseil d’État en raison de l’admission d’un changement de circonstances au sens de l’article 23-2 précité ;
1.7. la répartition par matière des QPC déposées et des QPC transmises au Conseil d’État (par exemple : fiscal / collectivités territoriales / fonction publique / police / étrangers / urbanisme / pensions, etc.) ;
1.8. la formation de jugement qui s’est prononcée sur la transmission de la QPC au Conseil d’État ;
1.9. la part des QPC transmises n’ayant pas entraîné un sursis à statuer du juge a quo, en précisant le motif (au sens de l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) ;
1.10. les délais moyen, minimal et maximal d’examen des QPC, en signalant les éventuelles différences significatives entre les matières concernées ;
1.11. le nombre de contestations d’une décision de non-transmission formulées à l’occasion d’une procédure d’appel ou de cassation, en précisant le sens de la décision alors rendue en appel ou en cassation ;
1.12. le nombre d’affaires dans lesquelles sont simultanément soulevées une QPC et un moyen d’inconventionnalité ;
1.13. le nombre de demandes d’aide juridictionnelle formulées dans le cadre du dépôt d’une QPC et la part d’entre elles qui a été accordée.
2. Recevabilité temporelle. Jusqu’à quel moment de l’instance les QPC sont-elles jugées recevables ? Les QPC soulevées à l’audience connaissent-elles un taux de transmission au Conseil d’État différent de celui des QPC soulevées durant la phase d’instruction ?
3. Pertinence des QPC. Des QPC sont-elles fréquemment soulevées dans un but dilatoire ?
4. Requérants. Parmi les QPC soulevées, préciser la part émanant de personnes physiques et la part émanant de personnes morales. Quelle place occupent les associations, comme requérantes ou comme intervenantes au litige ? Quels sont les domaines dans lesquels les associations sont les plus actives en termes de recours à la QPC ?
5. Délais de jugement. Comment est interprétée l’exigence de statuer « sans délai » sur la transmission de la QPC ?
6. Contradictoire. La contradiction entre les parties s’opère-t-elle dans des conditions satisfaisantes ?
7. Applicabilité au litige. Comment est interprété le critère de l’applicabilité au litige de la disposition législative faisant l’objet d’une QPC ?
8. Caractère sérieux. Comment est interprétée l’exigence d’une question non « dépourvue de caractère sérieux » ?
9. Motivation. Dans quelle mesure les décisions de transmission ou de non-transmission d’une QPC sont-elles motivées ?
10. Moyens d’inconventionnalité. Quels sont les critères paraissant guider le choix des requérants dans l’invocation de moyens d’inconventionnalité plutôt que d’une QPC ? Le phénomène est-il davantage marqué dans certaines branches du droit ?
11. Questions sérielles. Quelle est l’application faite en pratique par le juge de la faculté, ouverte à l’article R. 771-6 du code de justice administrative, de surseoir à statuer lorsqu’une QPC a déjà été posée au Conseil d’État ou au Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la QPC soumise à ce juge ?
12. Conséquences des décisions QPC du Conseil constitutionnel. Après la transmission d’une QPC, quel a été, le cas échéant, l’impact sur l’office du juge des décisions du Conseil constitutionnel déclarant la disposition législative inconstitutionnelle ou conforme à la Constitution sous réserve d’interprétation ? L’application dans le temps de décisions d’inconstitutionnalité (abrogation différée, abrogation avec effet sur les litiges en cours, etc.) a-t-elle déjà suscité des difficultés ?
13. Formation. Présenter les éventuelles actions de formation à la QPC conduites à l’attention des magistrats et des avocats dans votre ressort territorial (soit en vue de préparer l’entrée en vigueur de la réforme le 1er mars 2010, soit postérieurement à cette date).
14. Aménagements du dispositif. D’une manière générale, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité ? Quelles sont celles qui pourraient justifier des adaptations législatives ou réglementaires ?
Questionnaire adressé à certains barreaux de région (121)
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commission des Lois constitutionnelles, LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
de la législation et de l’administration générale
de la République
![]()
Bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité : questionnaire à destination des barreaux
1. Quel bilan dressez-vous de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant les juridictions ordinaires et, le cas échéant, devant le Conseil constitutionnel ? Quelles sont les principales difficultés rencontrées ? Quelles sont celles qui pourraient justifier des adaptations réglementaires ou législatives ?
2. Dans quelle mesure les requérants (personnes physiques et morales) et les avocats vous paraissent-ils s’être approprié cette réforme ? Observe-t-on des différences significatives selon les branches du droit concernées ?
3. Quelles actions de formation à la QPC ont-elles été conduites à l’attention des avocats (soit en vue de préparer l’entrée en vigueur de la réforme le 1er mars 2010, soit postérieurement à cette date) ?
4. Devant les juges administratifs et judiciaires, la contradiction entre les parties sur les QPC s’opère-t-elle dans des conditions satisfaisantes ?
5. Des QPC sont-elles fréquemment soulevées tardivement au cours des instances ? Des QPC sont-elles fréquemment soulevées dans un but dilatoire ?
6. Quels sont les critères paraissant guider le choix des requérants dans l’invocation de moyens d’inconventionnalité plutôt que d’une QPC ? Le phénomène est-il davantage marqué dans certaines branches du droit ?
7. Constate-t-on une tendance des parties ayant soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui est renvoyée au Conseil constitutionnel à conserver leur avocat devant ce dernier ?
8. L’attribution de l’aide juridictionnelle dans le cadre du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité fonctionne-t-elle de manière satisfaisante ?
9. L’application dans le temps de décisions d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel (abrogation différée, abrogation avec effet sur les litiges en cours, etc.) suscite-t-elle des difficultés de votre point de vue ?
Questionnaire adressé à certaines personnes morales auteures de QPC (122)
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commission des Lois constitutionnelles, LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
de la législation et de l’administration générale
de la République
![]()
Bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : questionnaire à destination des personnes morales
1. Qu’est-ce qui a motivé le dépôt par votre organisme d’une (ou de) question(s) prioritaire(s) de constitutionnalité ?
2. La QPC soulevée par votre organisme a-t-elle été combinée à l’invocation d’un moyen tiré de la violation d’une convention internationale ? Si oui, quelle a été l’efficacité respective de chacune de ces deux procédures ?
3. Votre organisme est-il, sans être partie, déjà intervenu à l’appui ou en défense d’une QPC en tant que tiers intéressé ? Si oui, qu’est-ce qui a motivé cette intervention ? Quel bilan dressez-vous de la procédure en intervention ?
4. Le fait de soulever une QPC vous a-t-il conduit, devant le Conseil constitutionnel ou plus tôt dans la procédure juridictionnelle, à changer d’avocat ou à recourir à un avocat supplémentaire (en plus de celui vous représentant dans le litige principal) ?
5. Votre organisme a-t-il déjà soulevé une QPC qui a été rejetée par les juges du fond ? Si oui, quel regard portez-vous sur les conditions de transmission des QPC au Conseil constitutionnel ?
6. Quel bilan tirez-vous de la procédure applicable à la QPC (délais, formalités, sursis à statuer dans le litige principal, respect du principe du contradictoire entre les parties, etc.), tant devant les juges du fond que devant le Conseil constitutionnel ?
7. La décision du Conseil constitutionnel sur la QPC soulevée par votre organisme vous a-t-elle paru suffisamment motivée ?
8. Dans quelle mesure la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC soulevée par votre organisme vous a-t-elle donné satisfaction ? Le cas échéant, l’application dans le temps d’une décision d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel (abrogation différée, abrogation avec effet sur les litiges en cours, etc.) ou l’application des réserves d’interprétation formulées par le Conseil ont-elles suscité des difficultés de votre point de vue ?
9. D’une manière générale, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre de la QPC ? Quelles sont celles qui, selon vous, pourraient justifier des adaptations ?
La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d’État
LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL D’ÉTAT SUR DES QUESTIONS PRIORITAIRES
DE CONSTITUTIONNALITÉ (1) ANALYSÉES SELON LE MODE DE SAISINE
ET LE SENS DE LA DÉCISION
2010 (2) |
2011 |
2012 | ||
Questions soulevée directement devant le Conseil d’État |
Transmission au Conseil constitutionnel |
34 |
20 |
26 |
Rejets |
64 |
82 |
76 | |
Non-lieu à statuer QPC |
3 |
5 |
3 | |
Non-transmission avec sursis (question déjà posée au Conseil constitutionnel) |
22 |
0 |
0 | |
Non-examen |
17 |
9 |
16 | |
Non-lieu à transmission |
0 |
0 |
10 | |
Irrecevabilité manifeste |
0 |
4 |
3 | |
Désistement |
2 |
1 |
2 | |
Dessaisissement |
0 |
0 |
1 | |
Total |
142 |
121 |
137 | |
Questions transmises par un juge de fond |
Transmission au Conseil constitutionnel |
25 |
31 |
13 |
Rejets |
54 |
50 |
32 | |
Non-lieu à statuer QPC |
8 |
0 |
0 | |
Non-lieu à transmission |
0 |
0 |
2 | |
Désistement |
0 |
0 |
1 | |
Total |
87 |
81 |
48 | |
(1) sauf séries.
(2) du 1er mars au 31 décembre 2010.
Source : Conseil d’État.
DÉTAIL DU SENS DES DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
SUR DES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ (1)
|
Sens de la décision |
2010 (2) |
2011 |
2012 |
Du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 | ||||
Nombre |
Part (en %) |
Nombre |
Part (en %) |
Nombre |
Part (en %) |
Nombre |
Part (en %) | |
Transmission totale |
53 |
23 |
43 |
21,4 |
34 |
18,4 |
130 |
21,1 |
Transmission partielle |
7 |
3 |
8 |
4 |
5 |
2,7 |
20 |
3,2 |
Non-transmission avec sursis (question déjà posée au Conseil constitutionnel) |
22 |
9,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3,6 |
Refus transmission (1°) : Applicabilité au litige |
4 |
1,7 |
14 |
7 |
6 |
3,2 |
24 |
3,9 |
Refus transmission (2°) : Conformité de la disposition |
9 |
3,9 |
11 |
5,5 |
10 |
5,4 |
30 |
4,9 |
Refus transmission (3°) : Caractère sérieux |
105 |
45,7 |
106 |
52,7 |
92 |
49,7 |
303 |
49,2 |
Non-examen |
17 |
7,4 |
9 |
4,5 |
16 |
8,6 |
42 |
6,8 |
Désistement |
2 |
0,9 |
1 |
0,5 |
3 |
1,6 |
6 |
1,0 |
Irrecevabilité manifeste |
0 |
0 |
4 |
2 |
3 |
1,6 |
7 |
1,1 |
Non-lieu à statuer QPC |
11 |
4,8 |
5 |
2,5 |
3 |
1,6 |
19 |
3,1 |
Non-lieu à transmission |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
6,5 |
12 |
1,9 |
Dessaisissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0,5 |
1 |
0,2 |
Total |
230 |
– |
201 |
– |
185 |
– |
616 |
– |
(1) sauf séries.
(2) du 1er mars au 31 décembre 2010.
Source : Conseil d’État.
La question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation
QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ
SOUMISES À LA COUR DE CASSATION
1er mars – |
1er janvier – |
1er janvier – | ||
Questions enregistrées |
Questions transmises par les juridictions de fond |
192 (117 au pénal, |
231 (123 au pénal, |
184 (78 au pénal, |
Questions soulevées à l’occasion d’un pourvoi |
347 (190 au pénal, |
259 (172 au pénal, |
201 (119 au pénal, | |
Total |
539 |
490 |
385 | |
Questions examinées |
Questions ayant donné lieu à renonciation ou à une décision d’irrecevabilité ou de non-lieu à statuer |
77 |
63 |
83 |
Questions renvoyées au Conseil constitutionnel |
122 |
76 |
40 | |
Questions non renvoyées au Conseil constitutionnel |
221 |
325 |
273 | |
Total |
420 |
464 |
396 |
Source : Cour de cassation.
NATURE DES DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR DE CASSATION
SUR DES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ, SELON LA CHAMBRE
(SITUATION AU 31 OCTOBRE 2012)
Nature de la décision |
Total |
1ère Civ. |
2ème Civ. |
3ème Civ. |
Com. |
Soc. |
Crim. |
Form. spéciales | |
Nombre total de questions posées |
1 217 |
100 % |
89 |
112 |
53 |
165 |
66 |
570 |
162 |
Renvoi au Conseil constitutionnel |
230 |
18,9 % |
24 |
14 |
14 |
21 |
18 |
76 |
63 |
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
785 |
64,5 % |
50 |
63 |
38 |
103 |
42 |
398 |
91 |
Irrecevabilité |
144 |
11,8 % |
11 |
21 |
1 |
16 |
4 |
83 |
8 |
Non-lieu à statuer |
36 |
3 % |
3 |
13 |
0 |
9 |
2 |
9 |
0 |
Renonciation |
22 |
1,8 % |
1 |
1 |
0 |
16 |
0 |
4 |
0 |
NB : Ce tableau comptabilise les questions posées et non les décisions, qui sont moins nombreuses, une décision pouvant statuer simultanément sur plusieurs questions.
CRITÈRES DE NON-RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Chambre |
Défaut applicabilité |
Disposition déjà déclarée conforme |
Défaut de nouveauté ou de caractère sérieux |
Total |
1ère civile |
7 |
6 |
32 |
45 |
2ème civile |
6 |
6 |
50 |
62 |
3ème civile |
1 |
7 |
29 |
37 |
Commerciale |
7 |
30 |
53 |
90 |
Sociale |
1 |
3 |
38 |
42 |
Criminelle |
34 |
33 |
255 |
322 |
Form. spéciales |
14 |
1 |
100 |
115 |
Total |
70 |
86 |
561 |
717 |
NB : Ce tableau a été établi sur les décisions rendues.
Source : Cour de cassation.
La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel
LES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES À DES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ ENTRE LE 1ER MARS 2010 ET LE 1ER MARS 2013
Sens de la décision |
2010 (1) |
2011 |
2012 |
2013 (2) |
Totaux |
Conformité |
31 |
62 |
39 |
5 |
137 |
Non-conformité totale |
11 |
17 |
14 |
1 |
43 |
Conformité sous réserve |
8 |
16 |
9 |
0 |
33 |
Non-conformité partielle |
4 |
12 |
7 |
0 |
23 |
Non-conformité partielle et réserve |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
Non lieu à statuer |
6 |
1 |
2 |
1 |
10 |
Non lieu à statuer et conformité |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
Autres décisions (3) |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Totaux |
64 |
110 |
74 |
7 |
255 (4) |
(1) Du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012. (2) Au 1er mars 2013. (3) Il s’agit de décisions relatives à des aspects de procédure. (4) Ces 255 décisions portent sur 297 dossiers. | |||||
Sens de la décision |
2010 (1) |
2011 |
2012 |
2013 (2) |
Moyenne |
Conformité |
50 % |
56,2 % |
52 % |
71,4 % |
53,8 % |
Non-conformité totale |
16,2 % |
15,2 % |
18,6 % |
14,3 % |
16,4 % |
Conformité sous réserve |
13,2 % |
15,2 % |
13,3 % |
0 |
13,7 % |
Non-conformité partielle |
7,4 % |
11,6 % |
10,7 % |
0 |
10 % |
Non lieu à statuer |
13,2 % |
1,8 % |
2,7 % |
14,3% |
5,3 % |
Autres décisions |
0 |
0 |
2,7 % |
0 |
0,8 % |
(1) Du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
(2) Au 1er mars 2013, donc sur 7 décisions.
Source : site Internet du Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité devant certaines juridictions civiles (statistiques fournies par le ministère de la Justice)
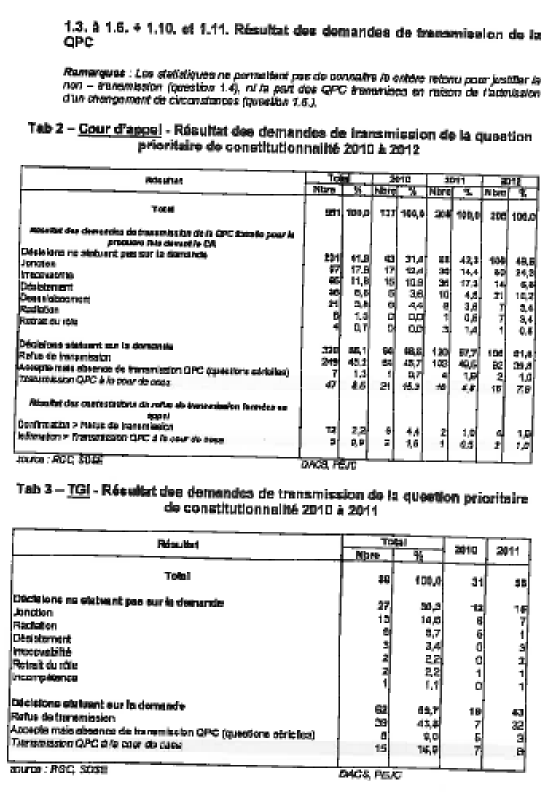
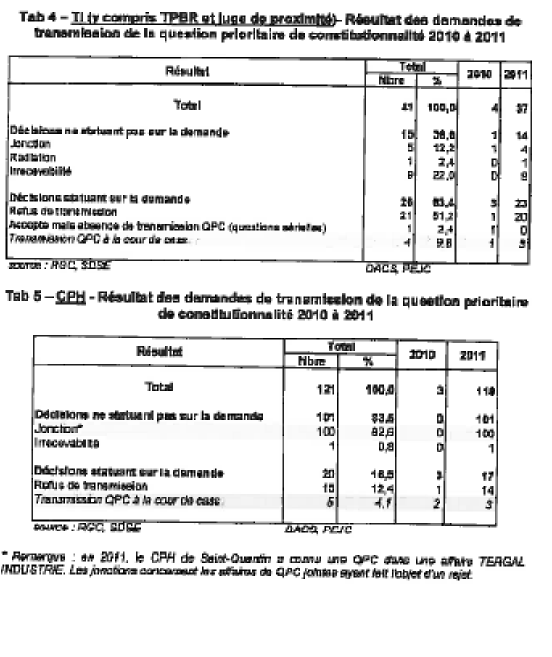
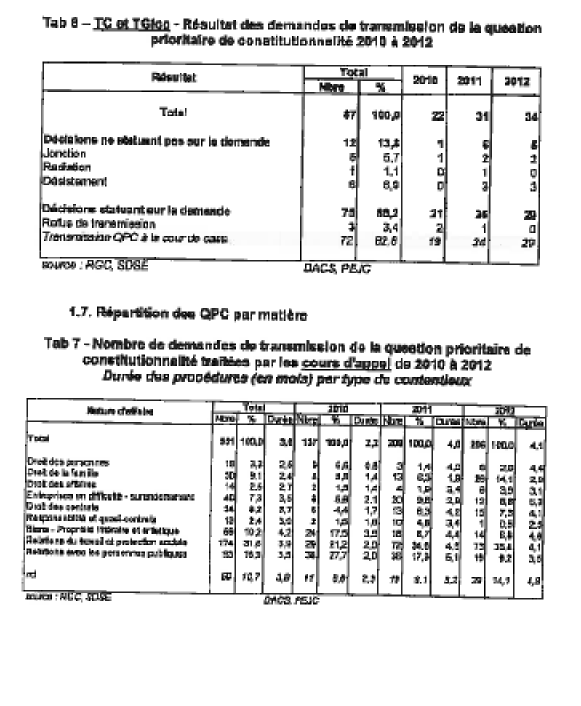
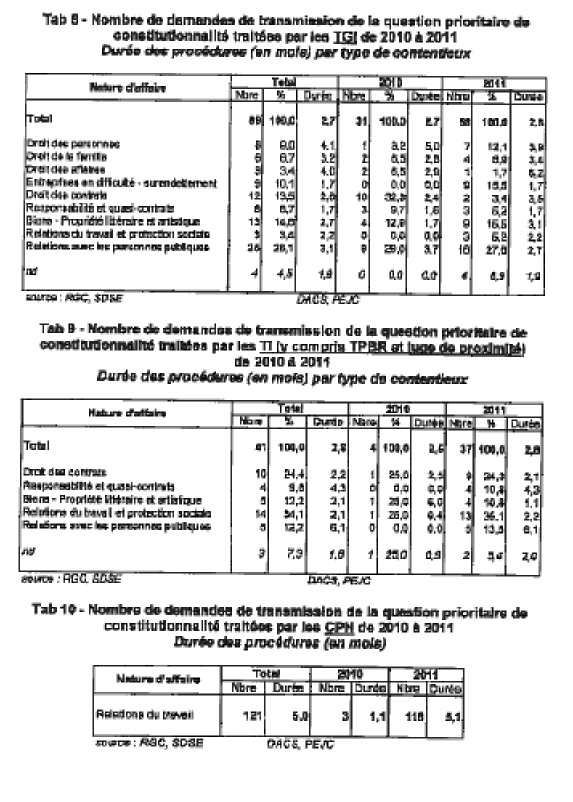
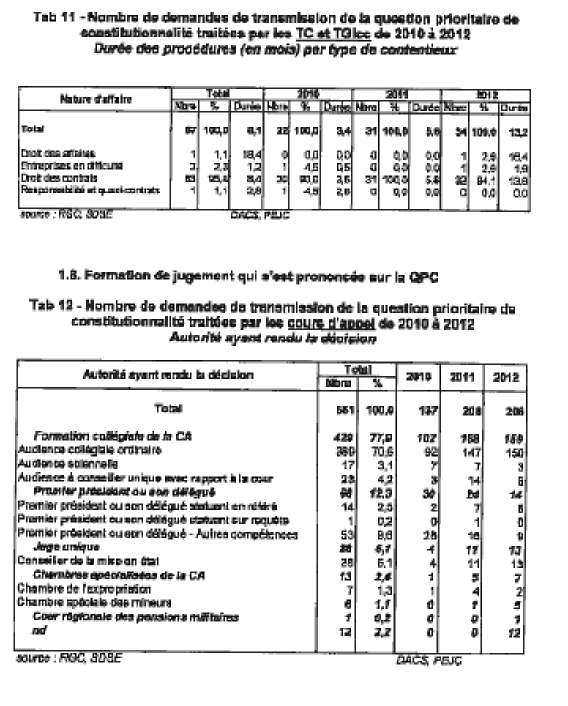
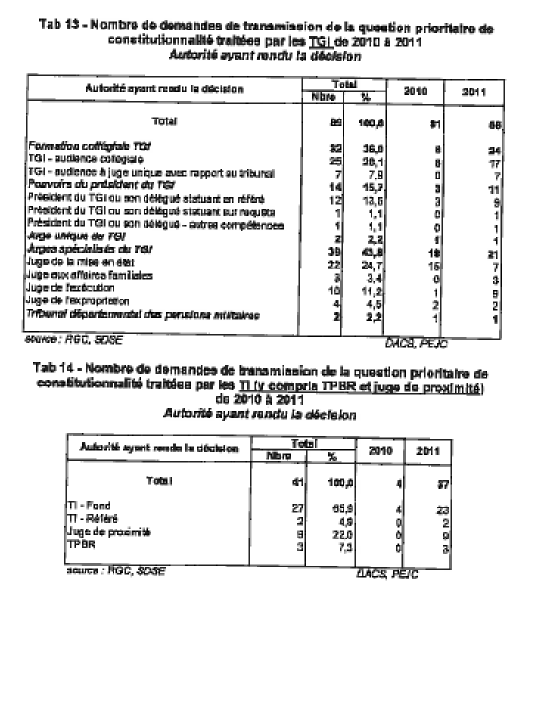
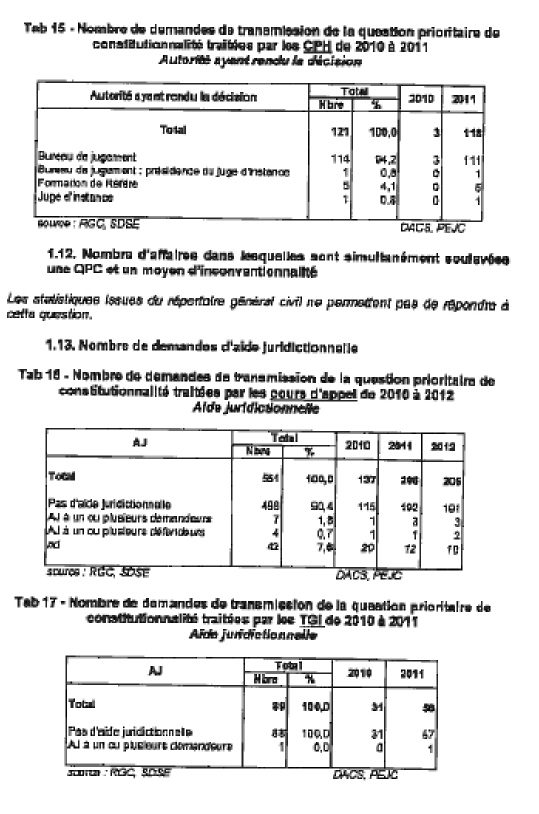
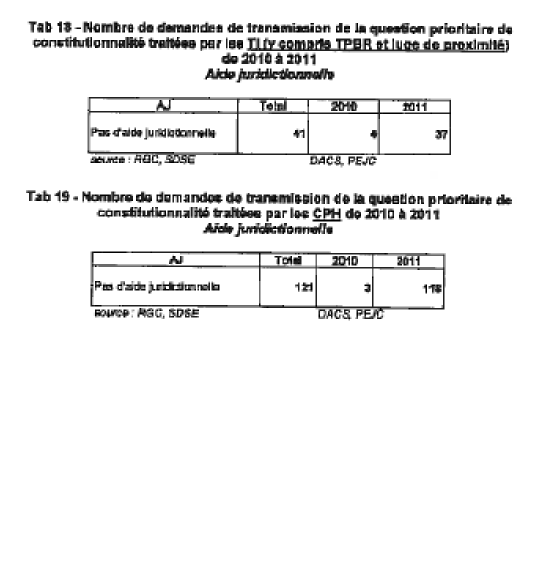
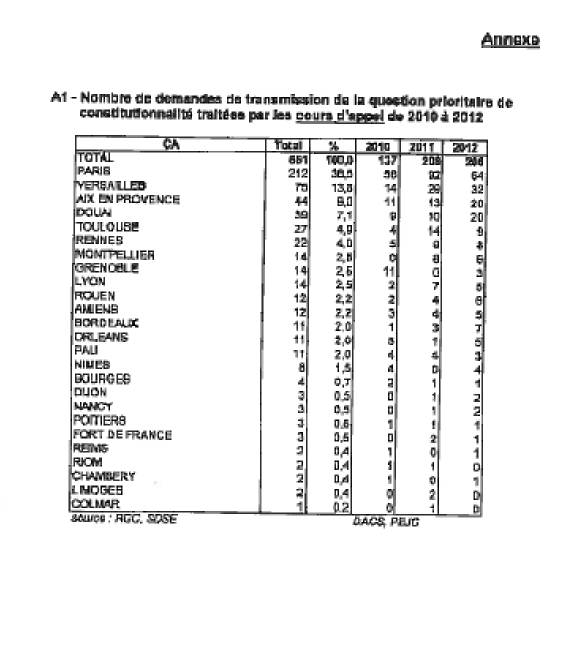
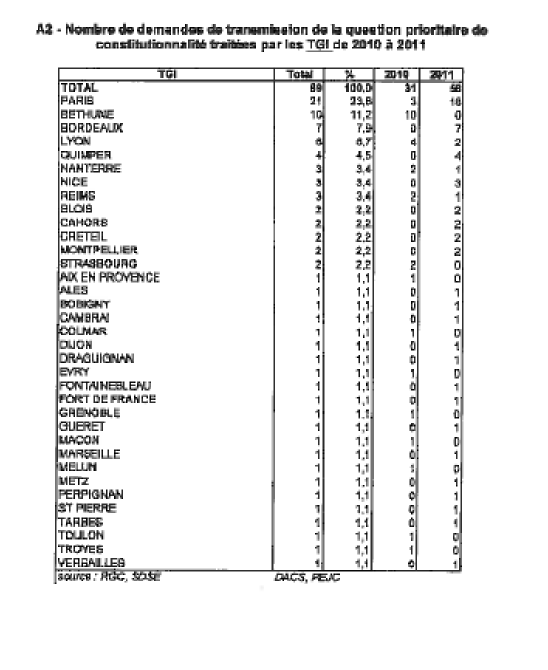
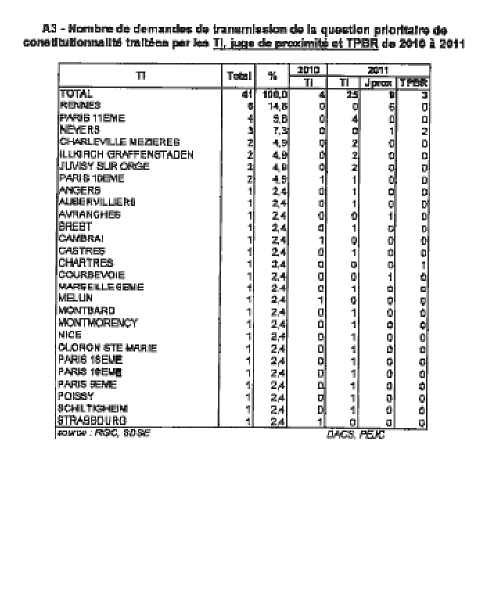
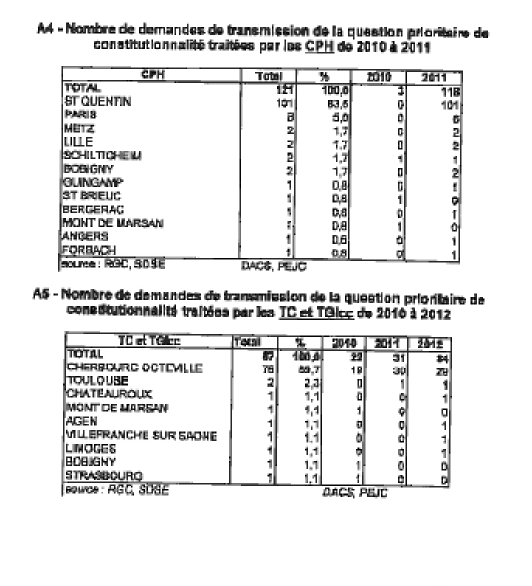
Comptes rendus des auditions de la commission des Lois
Audition de M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel
Séance du 21 novembre 2012
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le Parlement a longuement débattu de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avant de lui donner une naissance tardive. La Révolution française, ne l’oublions pas, fut aussi dirigée contre les juges, dans un esprit de sacralisation de la loi. Notre histoire, sur ce point, est à l’inverse de celle des États-Unis, où le contrôle de constitutionnalité par la Cour suprême fut reconnu dès 1803, alors qu’il a fallu attendre la loi organique du 10 décembre 2009 pour qu’il le soit en France. Trois ans plus tard, il nous a paru utile de faire un point d’étape.
L’article 61-1 de la Constitution, relatif à la QPC, fut institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il créait, en plus du contrôle de constitutionnalité a priori, un contrôle a posteriori dont l’entrée en vigueur est effective depuis le 1er mars 2010. Le projet de loi organique à l’origine de cette disposition avait fait l’objet d’un relatif consensus au sein de notre assemblée, puisque les deux principaux groupes politiques lui avaient accordé leurs suffrages.
Les trois premières années d’application montrent déjà que la QPC, qui représente un bouleversement de notre tradition juridique, est un authentique progrès pour l’État de droit, progrès qu’avait d’ailleurs salué Jean-Luc Warsmann, alors président de notre Commission, dans un rapport d’évaluation présenté dès le 5 octobre 2010. Bien qu’il soit encore trop tôt pour prendre la mesure de tous les changements intervenus, nous avons décidé d’organiser une réunion afin de réfléchir à l’évolution de ce droit nouveau donné aux justiciables. Nous disposons, pour ce faire, d’une réelle matière, puisqu’on estimait, après seulement un an de mise en œuvre – soit au 1er mars 2011 –, que près de 2 000 QPC avaient été posées devant les juges de première instance et d’appel. Au 1er janvier 2012, le Conseil constitutionnel avait enregistré 1 022 décisions en la matière – soit en moyenne dix QPC par semaine –, dont 224 décisions de renvoi – 96 émanant du Conseil d’État et 128 de la Cour de cassation – et 798 décisions de non-renvoi, soit respectivement 22 % et 78 %.
Un tel volume permet sans doute d’apaiser les craintes formulées lors de nos débats en 2009. Nous avions alors souhaité que les cours suprêmes soient associées à la procédure en jouant le rôle de filtres, car nous redoutions un engorgement lié à l’afflux de questions déjà tranchées, fantaisistes ou soulevées à des fins dilatoires, comme cela s’est observé à l’étranger. Le risque était aussi de déstabiliser notre organisation juridictionnelle par les éventuelles conséquences de la relation ascendante entre les cours suprêmes et le Conseil constitutionnel. Se posait aussi, comme le souligne Virginie Saint-James, maître de conférences à l’université de Limoges, dans un article de la Revue du droit public, une question d’équilibre interne entre, d’une part, les juridictions et, de l’autre, une volonté d’intégration et de juridictionnalisation accrue du Conseil constitutionnel.
Nous nous étions aussi beaucoup interrogés sur la latitude laissée aux juges du « second étage », c’est-à-dire au Conseil d’État et à la Cour de cassation, s’agissant du refus de transmettre une QPC. Devaient-ils avoir un rôle quasi mécanique d’appréciation de la recevabilité ou porter une première évaluation sur la constitutionnalité du texte ? Les arrêts de refus révèlent une certaine hésitation en ce domaine.
Enfin, les praticiens semblent de plus en plus nombreux à s’interroger sur l’opportunité d’audiences préliminaires, dont le rôle, purement technique, serait de purger les querelles de forme portant, par exemple, sur la recevabilité des pièces ou la prescription.
Monsieur le secrétaire général, soyez le bienvenu. Vous voudrez bien remercier le président Jean-Louis Debré de vous avoir permis de venir nous présenter vos analyses.
M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Je vous remercie de votre invitation.
La QPC marque en effet un grand progrès pour notre système juridique. D’une part, cette réforme a ouvert de nouveaux droits aux Français et aux étrangers vivant en France, qui peuvent désormais faire vérifier la conformité des lois qui leur sont applicables aux droits et libertés constitutionnels ; d’autre part, elle a permis de donner une portée concrète à la place de notre Constitution au sommet de la hiérarchie des normes. Il était anormal que la France soit le seul pays d’Europe où la Constitution demeure en fin de compte étrangère aux citoyens : la replacer au centre du pacte social doit contribuer à un meilleur « vivre ensemble » autour des valeurs de la République.
Vous m’avez adressé un questionnaire articulé selon trois thèmes : le bilan quantitatif de la QPC ; celui des premières étapes de sa mise en œuvre devant les juges de première instance et d’appel et les cours suprêmes ; l’appréciation, enfin, de la dernière étape devant le Conseil constitutionnel.
Je commencerai donc par le bilan quantitatif. Les seules statistiques dont dispose le Conseil constitutionnel concernent les QPC dont le dossier lui sont renvoyés par les deux cours suprêmes – il ne dispose pas des statistiques sur les QPC posées devant les juges a quo et non transmises aux cours suprêmes. Entre le 1er mars 2010 et le 1er novembre 2012, le Conseil constitutionnel a enregistré 1 402 dossiers adressés par le Conseil d’État et la Cour de cassation, dont 1 115 dossiers de non-renvoi, soit 79,5 %, et 287 dossiers de renvoi, soit 20,5 %.
Ces chiffres, supérieurs à toutes les prévisions formulées en 2008 et 2009, attestent la réussite de la QPC, que les citoyens et leurs conseils se sont appropriée. Les QPC sont ainsi beaucoup plus nombreuses que les questions préjudicielles qui, de tous les États membres, affluèrent à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsque se développa le contrôle de conventionnalité dans les années soixante-dix et quatre-vingt. En 2011, première année pleine de la réforme, le nombre de QPC dont le Conseil constitutionnel a été saisi – 114 – s’est ainsi révélé très supérieur, non seulement au nombre des questions préjudicielles renvoyées par des juges français à la CJUE – 31 –, mais aussi à celui des requêtes visant la France devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et déclarées recevables – 25.
Ce chiffre a néanmoins tendance à diminuer, puisqu’il est passé de 633 en 2011 à 368 depuis le début de l’année. La baisse concerne tant les non-renvois que les renvois : nous avons reçu 63 décisions en dix mois, soit, en rythme annuel, une diminution de 33 % par rapport à 2011.
Sur les 287 QPC renvoyées en deux ans et sept mois, 129 proviennent du Conseil d’État – soit 44 % – et 158 de la Cour de cassation – soit 55 %. Cette proportion doit être rapportée au nombre d’affaires jugées par chaque cour suprême. Sur la période 2012-2012 ces statistiques recouvrent des réalités qui semblent stables devant la juridiction administrative et en évolution devant la juridiction judiciaire. S’agissant de la première, les QPC ont été soumises à proportion à peu près égale au Conseil d’État et aux juges a quo – 53 % contre 47 %. Devant les juges a quo, les QPC ont été posées, pour près des deux tiers, devant les tribunaux administratifs, et pour environ un tiers devant les cours administratives d’appel. Ces proportions, sans être identiques, sont à peu près stables depuis trois ans.
La répartition géographique révèle une prédominance des QPC dans les ressorts des cours administratives d’appel de Paris et Marseille ; mais des QPC ont été posées dans chaque ressort de cour administrative d’appel. Les délais de traitement moyens sont constants et brefs : 32 jours en 2010, 43 en 2011 et 55 en 2012. Ils sont donc en très légère augmentation, mais leur moyenne – 40 jours sur la période de 2010 à 2012 – reste très satisfaisante ; dans les juridictions où l’on constate des écarts par rapport à cette moyenne, les délais demeurent inférieurs à trois mois : 83 jours dans le ressort de la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2011 et 77 jours dans celui de la cour administrative d’appel de Marseille en 2012.
Pour ce qui concerne les juridictions judiciaires, 60 QPC ont été posées directement devant la Cour de cassation – soit 38 % – et 97 devant les juges a quo – 146 QPC avant jonction, soit 62 % après jonction, ou 71 % avant jonction. Pour le coup, les évolutions sont fortes. Pour les QPC posées devant les juges a quo, on note en premier lieu une quasi-disparition, cette année, de celles qui ont été renvoyées à la suite d’une transmission par le juge pénal : 32 et 31 QPC ont été respectivement déposées devant le tribunal correctionnel et les cours d’appel en 2010, contre seulement 2 et 6 en 2012.
L’inégalité géographique est également forte, puisque aucune QPC n’a été transmise au Conseil constitutionnel en provenance des ressorts des cours d’appel d’Amiens, de Bourges, de Limoges, de Metz, de Riom, de Fort-de-France, de Papeete et de Saint-Denis. Il existe une très forte surreprésentation des ressorts des cours d’appel de Paris – 40 % – et de Lyon – 10 %.
Enfin, si les délais étaient excellents en 2010 – 14 jours en moyenne –, ils ont fortement augmenté en 2011, pour atteindre 52 jours en moyenne, certains d’entre eux dépassant même les trois mois – 96 jours dans les ressorts des cours d’appel d’Angers et de Nîmes, et 156 jours dans celui de la cour d’appel de Toulouse. La situation s’est dégradée en 2012, avec un délai moyen de 86 jours. Le délai atteint même 104 jours dans le ressort de la cour d’appel de Colmar, 187 jours dans celui de Montpellier, 120 jours dans celui de Nîmes et plus d’un an devant la Cour nationale de l’incapacité.
Je veux ajouter quelques mots sur le bilan qualitatif, c’est-à-dire sur les nombreux progrès que la QPC a permis pour l’État de droit, au bénéfice de nos concitoyens. En moins de trois ans, cette procédure a permis de rendre conformes aux droits et libertés les dispositions législatives relatives au régime de la garde à vue, à celui de l’hospitalisation sans consentement, aux procédures d’adoption des décisions ayant une incidence sur l’environnement, au droit des gens du voyage, à la composition de certaines juridictions ou encore à la vente des biens saisis en douane. Je me limiterai aux progrès intéressant la procédure pénale. En deux ans et demi, la QPC a permis la mise en conformité constitutionnelle de plusieurs dispositions. Ont ainsi été censurés plusieurs articles du code de procédure pénale, relatifs au pourvoi en cassation de la partie civile, à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, aux frais irrépétibles devant la Cour de cassation ainsi que devant les juridictions pénales ou à la désignation de l’avocat dans le cadre d’une garde à vue en matière de terrorisme.
Par des réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel a aussi assuré la conformité à la Constitution de plusieurs autres dispositions du code de procédure pénale. Pour faire respecter les droits de la défense, il a ainsi jugé que l’article 393 de ce code ne saurait permettre que soient recueillies et consignées, à l’occasion de la notification à la personne poursuivie de la décision prise sur la mise en œuvre de l’action publique, les déclarations du prévenu sur les faits visés par la poursuite. En vertu de ces mêmes droits, le Conseil constitutionnel a formulé des réserves sur l’audition libre et l’information de l’intéressé relative à l’infraction qu’on le soupçonne d’avoir commise ; sur la détention provisoire, il a également formulé une réserve pour interdire que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat aient pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public. Sur l’exécution du mandat d’amener et du mandat d’arrêt, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation pour que la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l’article 130 du code de procédure pénale ne puisse être mise en œuvre à l’encontre d’une personne qui n’encourt pas de peine d’emprisonnement correctionnelle, ni de peine plus grave.
J’en viens à l’appréciation que l’on peut porter sur les premières étapes de la QPC devant les juges a quo et les deux cours suprêmes. Les fortes disparités géographiques dont j’ai fait état appellent d’abord une connaissance plus fine de la réalité. Si l’on constate que la procédure n’est guère utilisée, il appartient aux barreaux concernés d’assurer la sensibilisation et la formation des avocats ; si le problème est la non-transmission, il convient de s’assurer que la règle de droit et les critères de transmission n’ont pas été appliqués de façon trop rigoureuse. Il en va ainsi, par exemple, de l’arrêt d’une cour administrative d’appel, qui s’est contentée de se référer à un arrêt du Conseil d’État pour justifier sa décision de non-renvoi, se dispensant par là d’un véritable examen de la QPC posée.
Le délai d’examen est devenu excessif dans divers ressorts. Après la mobilisation autour de la QPC en 2010 et 2011, l’attention s’est peut-être relâchée en 2012. Là encore, des statistiques complémentaires sont nécessaires pour examiner les délais de rejet dans les ressorts. Lors de l’examen du projet de loi organique, le Parlement avait été tenté de fixer au juge a quo un délai de deux mois pour statuer. Finalement, l’article 23-2 de l’ordonnance de 1958 modifié dispose qu’il doit statuer « sans délai », ce qui, en tout état de cause, devrait interdire un délai de plus de cent jours.
Le troisième point concerne la quasi–disparition, en 2012, des QPC renvoyées au Conseil constitutionnel et posées au pénal devant les juges a quo. Là encore, une appréhension plus fine de la réalité est nécessaire. D’une part, le rejet pour défaut de caractère sérieux pose question, puisque le droit pénal et la procédure pénale sont l’un des champs où les inconstitutionnalités sont les plus nombreuses ; d’autre part, il est nécessaire de savoir si ces QPC ont été posées pendant l’instruction ou lors de l’audience. S’agit-il d’un rejet systématique des QPC posées à l’audience, ce qui ne serait pas conforme à la réforme constitutionnelle et organique ?
L’étude des décisions du juge a quo permettrait de répondre à ces questions. Le cas échéant, des ajustements simples de la procédure sont possibles. On sait, par exemple, que les QPC doivent être posées lors de la phase d’instruction et non devant la cour d’assises elle-même. Y aurait-il avantage à transposer cette règle aux affaires pénales donnant lieu à instruction et jugées par un tribunal correctionnel ? Un tel aménagement préserverait l’efficacité de la QPC tout en améliorant son insertion dans la conduite de certains procès pénaux.
Vous m’avez également interrogé sur l’action de filtre des deux cours suprêmes. Il faut d’abord se féliciter de ce double filtre qui permet d’éviter que les juridictions subordonnées n’utilisent le renvoi direct de QPC au Conseil constitutionnel pour contester les jurisprudences des cours suprêmes. L’ordre juridictionnel français conserve ainsi sa cohérence. Ce mécanisme permet également au Conseil constitutionnel de n’être saisi que des questions sérieuses : il est en ce sens préférable à celui qui existe en Allemagne, en Italie ou en Espagne, où des milliers de dossiers arrivent devant la Cour constitutionnelle, qui souvent les rejette.
Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que les deux cours suprêmes soient devenues des juges constitutionnels négatifs : il est normal et naturel qu’elles appliquent la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans la non-transmission des QPC. Cela explique que le Conseil constitutionnel reçoive moins de QPC relatives aux dispositions fiscales depuis quelques mois, alors qu’il a été amené en 2010 et 2011 à rendre plusieurs décisions de conformité en ce domaine.
Le non-renvoi de QPC ne pose question que s’il ne correspond pas à l’un des trois critères fixés par le Parlement : disposition déjà jugée conforme, disposition applicable au litige et caractère sérieux de la question. Il est exact que les deux derniers critères peuvent soulever quelques difficultés. À la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation ne dissocie pas le critère de l’applicabilité au litige, pour l’examen d’une QPC, de la question de savoir si la disposition est au nombre de celles en considération desquelles « le litige doit être tranché ». Cette conception restrictive de l’applicabilité au litige s’avère particulièrement rigoureuse lorsque sont invoqués des griefs tirés de l’incompétence négative du législateur, les dispositions contestées « en tant qu’elles ne sont pas » étendues aux situations d’espèce pouvant être jugées, pour ce motif, comme n’étant pas applicables au litige.
L’arrêt du 11 juillet 2012 de la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre cette difficulté. Le requérant posait une QPC relative à l’interprétation faite par la Cour des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la chambre criminelle ayant jugé que la décision relative à la période de sûreté prévue par cet article n’avait pas à être motivée. La Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au motif que, en l’espèce, les juges d’appel avaient motivé leur décision. On peut donc se demander si le critère invoqué ne dissimule pas une volonté de vérifier un intérêt personnel à soulever une QPC, voire d’identifier celle-ci à une exception d’inconstitutionnalité classique, ce qui, dans les deux cas, ne correspond pas aux intentions du législateur.
Quant au critère du caractère sérieux, certaines appréciations tendent à filtrer fortement les renvois, comme celle qui consiste à assimiler les conditions de recevabilité de la QPC à celles du pourvoi en cassation. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2012 illustre ce point. Deux QPC étaient dirigées contre l’article L. 661-5 du code de commerce, qui interdit à toutes les parties, à l’exception du ministère public, les voies d’appel et de cassation contre les jugements statuant sur les recours formés contre certaines ordonnances du juge-commissaire. Les QPC étaient posées à l’occasion d’un recours en cassation formé contre un tel jugement. La Cour de cassation a déclaré irrecevables ces pourvois, et incidemment les QPC, alors même que celles-ci visaient à contester l’interdiction du pourvoi en cassation. Une telle interprétation ferme la porte à la QPC et ce, en application de la règle même qui fermait celle de la cassation et qui était l’objet de la QPC.
De tels exemples paraissent renvoyer au dialogue des juges ; j’y reviendrai en évoquant les effets dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel.
Sur l’appréciation de la dernière étape de la QPC devant le Conseil constitutionnel, vous m’avez interrogé tant sur la procédure que sur le fond.
La procédure totalement juridictionnalisée a bien fonctionné, bien qu’il ait fallu la compléter sur la question des interventions. Le délai moyen de jugement par le Conseil constitutionnel est de deux mois ; le délai minimal fut de 19 jours pour la QPC posée par Mme Le Pen, le Conseil constitutionnel ayant voulu rendre sa décision avant que ne commence le recueil des parrainages pour l’élection présidentielle. Une seule QPC a été jugée en 92 jours en septembre 2012.
Les avocats, au Conseil comme à la Cour, interviennent dans la quasi-totalité des affaires et se sont remarquablement approprié la procédure. Ils respectent sans difficulté les brefs délais de production – en général trois semaines pour les premières observations – et le délai de quinze minutes à l’audience.
Le Conseil constitutionnel tient en général ses audiences de plaidoirie le mardi. Les membres qui estiment devoir se déporter n’y siègent pas, conformément à une règle appliquée avec constance. Sur 280 décisions rendues, des membres se sont ainsi déportés une trentaine de fois. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs été saisi de trois demandes de récusation. La première a conduit deux membres à ne pas siéger, la demande ayant été écartée pour trois autres membres ; suite aux deux autres demandes, les deux membres concernés n’ont pas siégé.
À l’expérience, la principale lacune de la procédure devant le Conseil concerne les interventions qui ne figuraient pas dans le règlement adopté le 4 février 2010. Les interventions ont donc été admises jurisprudentiellement, avant que l’article 6 du règlement ne soit modifié pour inclure des dispositions spécifiques, qui exigent notamment des personnes désirant intervenir qu’elles justifient d’un intérêt spécial. Cette disposition reprend la jurisprudence du Conseil d’État sur l’intervention dans le recours pour excès de pouvoir. Les interventions sont désormais très fréquentes et admises de façon ouverte. Aux termes du règlement, la demande doit être adressée dans un délai de trois semaines suivant la transmission de la QPC au Conseil. Une quarantaine d’interventions ont ainsi été admises en 2011 et 2012, une même QPC pouvant d’ailleurs en susciter plusieurs.
Vous m’avez aussi interrogé sur le fond des décisions. Les QPC portent sur des domaines extrêmement variés : 42, soit 17 %, concernent le droit pénal et la procédure pénale, et 35, soit 15 %, le droit fiscal. Les autres QPC portent sur tous les champs du droit, qu’il s’agisse du droit social, du droit des collectivités territoriales, du droit commercial, de l’organisation judiciaire ou du droit civil.
Quant au sens des décisions, 60 % concluent à la conformité à la Constitution ou à un non-lieu, 26 % conduisent à des censures totales ou partielles et 14 % à des réserves. La moitié des 63 décisions de non-conformité totale ou partielle ont donné lieu à une modulation de leurs effets dans le temps. Cependant, un tel report n’est pas toujours possible. S’agissant des incriminations pénales jugées inconstitutionnelles sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, un juge ne peut condamner quelqu’un à aller en prison sur le fondement d’une incrimination dont le Conseil constitutionnel a censuré l’absence de définition légale. Le cas s’est présenté à deux reprises, avec la définition de l’inceste et celle du harcèlement sexuel. Le report dans le temps est, en revanche, possible dans d’autres matières, notamment de procédure. Le Conseil constitutionnel l’utilise alors pour rester dans son rôle et ne pas se substituer au législateur. C’est là l’un des principaux avantages du contrôle de constitutionnalité sur celui de conventionnalité, lequel conduit toujours à écarter l’application de la loi.
L’article 62, alinéa 2, de la Constitution définit les conditions du report des effets dans le temps. Le Conseil a cherché à préciser l’application de ces dispositions, et dégagé deux orientations. D’une part, l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité interdit que les juridictions appliquent la loi en cause, non seulement dans l’instance ayant donné lieu à la QPC, mais aussi dans toutes les instances en cours à la date de cette décision ; d’autre part, toute exception ou dérogation à cette orientation générale, de quelque nature qu’elle soit, ne peut résulter que des dispositions expresses de la décision du Conseil.
Cette question des effets dans le temps est complexe mais essentielle, car elle a des conséquences très concrètes et immédiates pour les justiciables. Il suffit, pour s’en convaincre, d’indiquer que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont tiré des conséquences exactement opposées de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi « anti-Perruche », soit parce que la décision du Conseil est mal rédigée, soit parce que l’une des cours suprêmes a refusé de l’appliquer – soit les deux. Là encore, un exemple est utile. Dans un arrêt du 4 mai 2012, le Conseil d’État a jugé que le juge administratif pouvait faire application d’une disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dès lors que, dans l’espèce qui lui est soumise, l’atteinte aux droits et libertés justifiant la censure constitutionnelle n’est pas en cause. Cependant le Conseil constitutionnel ne fait jamais de censure « en tant que », et, une fois une disposition censurée, on ne peut distinguer entre les motifs de censure. Par ailleurs, une disposition déclarée inconstitutionnelle mais dont l’abrogation est reportée dans le temps ne peut être écartée par le juge, ni avant ni après cette date pour des situations nées auparavant.
Le Conseil constitutionnel n’a sans doute pas assez précisé les effets dans le temps de ses premières décisions. Il s’efforce désormais de le faire, notamment depuis ses décisions du 25 mars 2011, et plus encore depuis quelques mois.
Au vu de ces différents éléments, une orientation paraît s’imposer. Il ne semble pas utile, pour l’heure, de modifier les textes régissant la QPC : ils posent des règles adéquates, la procédure est adaptée et les critères de transmission sont précis. Cependant, deux orientations doivent se combiner pour que la QPC continue de répondre à la volonté du Parlement et aux aspirations des justiciables. La première est une meilleure connaissance de la réalité contentieuse. Les statistiques que je vous ai données ne portent que sur les 287 QPC renvoyées au Conseil, en d’autres termes sur la partie émergée de l’iceberg. Qu’en est-il des quelques milliers de QPC posées devant les juges a quo ? Quels sont les délais d’examen, les taux de transmission et les motifs de transmission ou de non-transmission ? Un tel bilan est aujourd’hui nécessaire.
La seconde orientation a trait au dialogue des juges. Le Conseil constitutionnel et les deux cours suprêmes ont partie liée. Ils partagent un même idéal et un même souci de bon fonctionnement du système. Le dialogue des juges, indispensable, produit toujours des effets très bénéfiques : le Conseil d’État a ainsi appelé l’attention du Conseil constitutionnel sur la nécessité de préciser la rédaction de ses considérants relatifs aux effets dans le temps, et a complété sa propre jurisprudence dans une décision du 17 juillet 2012. Cette technique est la seule qui, à textes inchangés, est susceptible de répondre harmonieusement aux questions que j’ai soulevées.
Je ne peux que me réjouir avec vous de la réussite de la QPC, qui a permis à nos concitoyens de s’approprier la Constitution et leur a offert une voie de droit simple et efficace sans remettre en cause la sécurité de notre ordonnancement juridique. Ce progrès de l’État de droit résulte d’une bonne conception de la réforme par le Parlement et de sa non moins bonne application par les juges. Des ajustements sont peut-être utiles, mais des bouleversements, sûrement pas.
M. Guy Geoffroy. Quelques précisions me paraissent utiles, que vous pourriez au demeurant nous fournir ultérieurement par écrit, non seulement sur la situation actuelle mais aussi sur l’avenir de la QPC. La légère diminution du volume des QPC s’explique par la décroissance naturelle du stock des lois qui en font tour à tour l’objet. On peut néanmoins distinguer trois catégories : les lois antérieures à l’existence même du contrôle constitutionnel, celles qui lui sont postérieures et celles qui furent adoptées avant que des évolutions constitutionnelles ne modifient l’article 34 de la Constitution. Je pense en particulier aux lois relatives à l’environnement, qui peuvent désormais faire l’objet d’une QPC alors qu’elles ne relevaient pas du champ constitutionnel lors de leur adoption, et qui, en raison de leur caractère relativement consensuel, n’avaient pas occasionné de saisine du Conseil constitutionnel. Avez-vous des données sur ces différentes catégories, qu’il s’agisse du filtrage, du volume des stocks ou de la nature des décisions ?
Ma deuxième question porte sur les flux, c’est-à-dire sur les lois nouvelles. La plupart des lois soumises au contrôle a priori Conseil constitutionnel sont « clivantes », si vous me passez l’expression. Nul ne songerait à déférer au Conseil constitutionnel les propositions de loi consensuelles, qui, du reste, ne bénéficient pas du contrôle de constitutionnalité en amont qu’est l’avis préalable du Conseil d’État ; si bien qu’elles demeurent à la merci d’une QPC qui pourrait conduire à leur abrogation totale ou partielle, avec des conséquences catastrophiques. Nous ne pouvons pas exclure, par exemple, que le scénario de la loi relative au harcèlement sexuel ne se répète pas avec la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites aux femmes. Que suggérez-vous au législateur pour équilibrer les différents modes de contrôle a priori et a posteriori ? Comment mieux garantir la sécurité constitutionnelle des textes que nous votons, surtout quand ils sont consensuels ?
Mme Marietta Karamanli. La QPC, dont vous avez montré les bénéfices pour nos concitoyens, peut-elle aussi devenir un moyen de créer des incidents de procédure ? La forte juridictionnalisation de la QPC ne devrait-elle pas conduire à modifier la composition du Conseil constitutionnel ? Bien que ses membres actuels aient d’éminentes qualités, ne serait-il pas utile d’assurer une meilleure représentation des spécialistes du droit ?
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’instauration de la QPC est un élément fondamental de notre État de droit. N’appelle-t-elle pas une réforme du Conseil constitutionnel lui-même, puisqu’il est devenu une véritable juridiction ? Partant, ne faut-il pas s’interroger sur sa composition ? Enfin, la jurisprudence générée par les QPC ne doit-elle pas conduire à revoir certaines législations ? Le Conseil constitutionnel a, par exemple, estimé que les biens de section ne relevaient pas du droit de propriété mais du droit de jouissance : un tel jugement peut remettre en cause la nature juridique de ces biens et induire une réforme législative d’importance.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Dans le cadre de la procédure de la QPC, beaucoup de juges se substituent en quelque sorte au Parlement, qu’il s’agisse des juges constitutionnels négatifs que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation ou du juge constitutionnel positif qu’est le Conseil constitutionnel, lequel va de surcroît très loin dans le champ dont il est saisi comme dans les appréciations portées sur le travail du législateur.
Dans un État de droit, les mécanismes visant à garantir la constitutionnalité des lois sont évidemment nécessaires ; mais la tradition française veut aussi que le Parlement soit pleinement responsable de ce qu’il institue. De ce point de vue, la QPC a plutôt eu un effet déstabilisateur.
Y a-t-il, à votre connaissance, une concurrence entre la saisine du Conseil constitutionnel et celle de la CEDH ? Lors de la création de la QPC, de nombreux juristes estimaient que les avocats préféreraient saisir la seconde.
Enfin, on ne peut qu’être frappé par cette déstabilisation parlementaire alors même que le droit européen, qui s’impose au droit national, échappe très largement au contrôle constitutionnel. Certes, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence en matière de directives européennes, mais elle est très restrictive, le Conseil estimant que la transposition des directives est une obligation constitutionnelle et qu’il ne peut exercer son contrôle que si elles portent atteinte à l’identité constitutionnelle de la France.
M. Philippe Houillon. L’économie générale de la QPC doit effectivement être maintenue. La question reste néanmoins posée de l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire, irrecevabilité qui d’ailleurs n’empêche pas les « appels-nullité ». Cette impasse nous place au cœur du problème de la QPC. Avez-vous des suggestions à ce sujet ?
Mme Cécile Untermaier. La QPC est une grande avancée pour l’État de droit, d’autant que les filtres ont évité l’avalanche que nous redoutions, au point que l’on peut se demander s’ils ne sont pas trop efficaces. Une réflexion sur ce point me semble tout à fait opportune. Enfin, avec quels juges le Conseil constitutionnel dialogue-t-il ?
M. Marc Guillaume. Vous m’avez interrogé, monsieur Geoffroy, sur le stock et sur le flux des lois. Il est vrai que les grandes lois emblématiques, touchant par exemple à la garde à vue, à la privation de liberté ou à l’hospitalisation sans consentement, ont déjà été soumises au Conseil constitutionnel. L’expérience à l’étranger, déjà vieille de cinquante ans, montre cependant que les saisines des cours constitutionnelles vont croissant – elles s’élèvent par exemple à 6 000 pour la Cour constitutionnelle allemande. Loin de s’éteindre, la procédure visera de plus en plus les détails de la loi, même si je ne crois pas davantage à une explosion du nombre des procédures. Quoi qu’il en soit, nous nous efforcerons d’établir des statistiques en fonction de l’ancienneté des lois, comme vous l’avez suggéré.
Pour les lois nouvelles, le Conseil peut toujours être saisi par soixante députés ou sénateurs. Il se trouve que, depuis l’entrée en vigueur de la QPC, le nombre de saisines a priori a augmenté dans des proportions considérables : c’est sans doute que les parlementaires préfèrent saisir le juge constitutionnel avant qu’un particulier ne le fasse via la QPC.
Quant aux textes consensuels, la saisine du Conseil constitutionnel est toujours possible. Le président Séguin avait recouru à cette procédure pour la loi bioéthique, et les présidents des deux assemblées avaient fait de même en 2010 sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Le rapprochement avec la loi sur le harcèlement me semble infondé puisque, dans ce dernier cas, des associations féministes étaient elles aussi favorables à la censure des dispositions concernées, dont la rédaction était si mauvaise, selon elles, qu’elles n’étaient presque jamais appliquées.
Pour ce qui est des incidents de procédure, madame Karamanli, nous aimerions, en effet, mieux savoir comment la procédure est appréhendée par les juges a quo. En tout état de cause, le problème semble ne se poser que dans le domaine pénal. Il serait peut-être utile, pour les seuls procès pénaux ayant fait l’objet d’une instruction, de transposer la règle applicable aux procès d’assises, dans la mesure où les instructions pénales sont très longues – ce qui laissait d’ailleurs supposer que les requérants disposaient du temps nécessaire pour soulever une QPC pendant cette étape de la procédure. Il est vrai que les statistiques que je vous ai données sont étonnantes, et autorisent à penser qu’elles résultent de quelque raison de procédure.
Je garde la question de la composition du Conseil constitutionnel pour la fin, ce qui me permettra de ne pas y répondre si le temps est écoulé. (Sourires.)
Si certains en doutaient encore, monsieur Morel-A-L’Huissier, le Conseil constitutionnel est une véritable juridiction. La modification du règlement intérieur du Conseil du 4 février 2010, qui a fait l’objet d’une concertation avec nos partenaires nationaux et européens, a défini la procédure applicable à la QPC, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Quant aux effets des décisions, ils montrent bien la supériorité intrinsèque du contrôle de constitutionnalité sur le contrôle de conventionnalité. Cette question renvoie aussi à celle de Mme Bechtel, qui s’inquiète d’une substitution des juges au Parlement. Depuis certains arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État dans les années quatre-vingt, tous les juges peuvent contrôler que la loi respecte le droit international. L’instauration de la QPC s’inscrit dans cette évolution profonde qu’elle tend peut-être à réorienter. Par le fait, la Constitution est ce qui nous réunit tous : si chacun savait ce que recèlent exactement les notions de laïcité, de liberté religieuse ou de liberté d’aller et venir, les débats sur des sujets tels que le port du voile s’en trouveraient grandement facilités. Les conventions internationales ne touchent évidemment pas d’aussi près ce vouloir-vivre ensemble qui s’incarne dans la Constitution.
Le juge de constitutionnalité se substitue beaucoup moins au Parlement que le juge de conventionnalité : ses décisions rendent la main au Parlement, comme l’ont montré les exemples du régime de la garde à vue ou de l’hospitalisation sans consentement. Vos deux questions, monsieur Morel-A-L’Huissier, madame Bechtel, se rejoignent en ce qu’elles renvoient moins aux effets de la QPC qu’à la philosophie du contrôle exercé par les juges.
Bien que je ne dispose pas de statistiques en la matière, je suis convaincu que les QPC sont bien plus nombreuses que les questions préjudicielles de conventionnalité, en tout cas sur le contenu de la loi elle-même, puisque, dans la plupart des cas, la CEDH est saisie sur des questions d’application. Les constituants que vous êtes n’ont pas souhaité faire du Conseil constitutionnel un juge de la conformité de la loi avec les traités, afin notamment de préserver ses délais d’intervention : un mois pour les jugements a priori et trois mois pour les jugements a posteriori. Au surplus, ces jugements portent sur la conformité à la Constitution dans son ensemble, sans viser expressément aucun de ses principes en particulier. Un tel contrôle, d’ordre public, s’exerce aussi dans le cadre des QPC qui nous sont transmises. Le Conseil ne pourrait évidemment rendre des jugements de conformité aux quelque 20 000 conventions internationales avec la même diligence. Dans le cadre du contrôle de conventionnalité, le juge administratif et le juge judiciaire, eux, se prononcent seulement sur la base des griefs figurant dans le mémoire de l’avocat ; ce contrôle n’est pas d’ordre public. Le système que vous avez bâti, subtil, répond aux besoins de nos concitoyens : si le Conseil estime que telle ou telle loi n’est pas conforme à la Constitution, elle tombe et ne s’applique donc plus ; si elle est jugée conforme, la main est rendue au juge, qui vérifie les autres griefs. Bref, cet équilibre reflète notre organisation juridictionnelle : le Conseil constitutionnel n’est pas une cour suprême au-dessus du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, et de M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’État
Séance du 21 novembre 2012
M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Monsieur le président de la commission des Lois, mesdames et messieurs les députés, je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir invité en compagnie du président Stirn. Je suis particulièrement heureux que la juridiction administrative, associée dès l’origine à la conception du mécanisme de contrôle de constitutionnalité a priori des lois, puisse aujourd’hui apporter son concours à l’évaluation de la grande réforme que constitue la question prioritaire de constitutionnalité.
Dans cet exposé liminaire, et en considération du questionnaire qui nous a été transmis, je dresserai dans un premier temps un état des lieux statistique de la question prioritaire de constitutionnalité, vue de la juridiction administrative – dont le champ de vision est un peu plus étroit que celui du secrétaire général du Conseil constitutionnel, que vous venez de recevoir. J’esquisserai, en deuxième lieu, un bilan de l’application de la QPC du point de vue procédural, pour en souligner le fonctionnement à mes yeux très satisfaisant. Enfin, je soulignerai l’apport essentiel de cette réforme à l’État de droit.
S’agissant du premier point, après deux ans et près de neuf mois d’application, on peut affirmer que les justiciables ont su se saisir de cette procédure, ce qui était une condition déterminante de son succès. Le nombre de questions posées, transmises au Conseil d’État ou à la Cour de cassation et renvoyées au Conseil constitutionnel est très supérieur à ce que nous attendions au cours des toutes premières semaines de l’année 2010.
Au 30 septembre 2012, 1 630 questions prioritaires de constitutionnalité avaient ainsi été posées devant les tribunaux administratifs – pour 1 196 d’entre elles – et les cours administratives d’appel – pour 434 questions. 198 avaient été transmises au Conseil d’État, ce qui représente un taux moyen de transmission de l’ordre de 14,1 %. Ce taux ne fléchit pas : au 30 septembre, il était de 19,1 % pour l’année 2012, soit davantage qu’en 2010 et en 2011. En outre, 14 QPC avaient été transmises par des juridictions administratives spécialisées.
Aucune inégalité dans l’application territoriale de la question prioritaire de constitutionnalité ne ressort de l’analyse statistique, aucune différence substantielle entre les tribunaux ou entre les cours ne pouvant être constatée. Le nombre de questions soumises est généralement conforme à l’activité du tribunal ou de la cour, compte tenu à la fois de son ressort territorial et des spécificités des contentieux traités. La variation des taux de transmission ne reflète pas des différences de pratique, mais plutôt l’existence de phénomènes sériels justifiant, de manière corrélative, l’application du mécanisme de sursis à statuer sans transmission de QPC. Ainsi, au 30 juin 2012, les tribunaux et les cours avaient-ils sursis à statuer sans transmission au Conseil d’État dans 323 affaires.
Le Conseil d’État a pour sa part été saisi directement de 655 questions prioritaires de constitutionnalité entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2012. La part des saisines directes est supérieure à celle des transmissions en provenance des cours et des tribunaux : elle représente environ deux tiers des questions posées. Après un « appel d’air » consécutif à l’entrée en vigueur de la procédure, le nombre de questions reçues par le Conseil d’État a été très stable. En année glissante, 205 questions ont ainsi été posées d’octobre 2010 à septembre 2011 et 202 d’octobre 2011 à septembre 2012. Au 31 octobre 2012, sur ces 407 questions, 146 avaient été renvoyées au Conseil constitutionnel. Le taux de renvoi est lui-même extrêmement stable, de 24 % en moyenne, même s’il varie selon les périodes considérées. Une grande stabilité caractérise également le taux de censure des lois par le Conseil constitutionnel, qui est d’environ 25 %.
Au total, au 30 septembre 2012, 2 077 questions prioritaires de constitutionnalité avaient ainsi été posées à la juridiction administrative – tribunaux, cours, juridictions spécialisées et Conseil d’État. Ce nombre significatif témoigne du succès que cette procédure a rencontré auprès des justiciables.
La répartition des questions prioritaires de constitutionnalité par matière a évolué. Certes, le droit fiscal reste la matière dans laquelle le plus de questions prioritaires de constitutionnalité sont posées, mais sa part relative diminue fortement : de 36 % en 2010, elle est passée devant le Conseil d’État à 22,6 % en 2011 puis à 15 % en 2012. Une baisse similaire est constatée en droit des collectivités territoriales et en droit des pensions. D’autres contentieux émergent, à l’inverse, comme de nouveaux champs où se déploie la question prioritaire de constitutionnalité : celui de la fonction publique, qui a connu un développement rapide, celui qui a trait à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, ou encore celui de l’environnement. Dans cette dernière matière, le taux de transmission des juridictions initialement saisies au Conseil d’État, de 43 %, et le taux de renvoi du Conseil d’État au Conseil constitutionnel, de 37 %, sont en outre particulièrement élevés. Le taux de renvoi est également important en matière d’urbanisme et d’aménagement – 38 % –, de juridictions – 33 % –, de collectivités territoriales – 29 % –, de fonctionnaires et agents publics – 27 %.
Il faut enfin mentionner une baisse récente du nombre de QPC posées devant le Conseil d’État. Elles n’étaient que 25 en septembre et octobre 2012. Si la brièveté de la période ne permet pas de dégager une tendance structurelle, la baisse est toutefois corroborée par la situation devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel : bien que le nombre de questions posées reste élevé, la tendance existe, particulièrement au cours de l’année 2012. Elle explique la diminution en valeur absolue du nombre de transmissions au Conseil d’État en 2012 puisque, je l’ai dit, le taux de transmission est resté stable.
Cette tendance à la baisse tient sans doute à plusieurs facteurs explicatifs, dont deux m’apparaissent plus particulièrement pertinents. En premier lieu, il semble que, pour les justiciables comme pour leurs représentants, à la nouveauté succède progressivement le retour à une certaine routine jurisprudentielle après l’appel d’air né de l’instauration de la procédure. Ensuite, il est possible que la « réserve » de questions sérieuses s’épuise. Cela vaut en particulier des questions procédurales, mais aussi des sujets de fond. À cet égard, il est rassurant de constater que notre système juridique ne repose pas sur un matelas de lois inconstitutionnelles et que le stock des lois évidemment fragiles de notre ordonnancement juridique se réduit progressivement.
Si les citoyens et les acteurs du monde judiciaire se sont ainsi saisis de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, c’est parce qu’elle permet de mieux garantir leurs droits, mais aussi parce qu’elle fonctionne de manière satisfaisante. Cela résulte aussi bien de textes « remarquablement bien pensés et écrits », pour reprendre les termes de certains commentateurs, que d’une jurisprudence qui a su rapidement en préciser l’interprétation et les bornes. L’engagement résolu des juges dans cette nouvelle forme de dialogue a bien entendu contribué au succès de la QPC.
Tout d’abord, les délais brefs légitimement voulus par le législateur organique ont été pleinement respectés. Si la loi organique précise que le juge a quo statue « sans délai » – c’est-à-dire « le plus vite possible » – sur la transmission au Conseil d’État, les juridictions suprêmes disposent, pour leur part, d’un délai fixe de trois mois dont le non-respect entraîne la transmission de plein droit au Conseil constitutionnel. De fait, devant le Conseil d’État, ce délai est en moyenne légèrement supérieur à deux mois en ce qui concerne l’appréciation par les formations collégiales, et à un mois lorsqu’il est statué par ordonnance des présidents. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, nous ne disposons pas de statistiques permettant d’évaluer le délai dans lequel sont examinées les questions, mais la pratique montre que le juge a quo est pleinement conscient de la nécessité de statuer rapidement sur la transmission.
En deuxième lieu, le filtre exercé par la juridiction administrative me semble très satisfaisant en ce que, conformément à la conception du dispositif, il n’est ni trop étroit ni trop large.
Le Conseil d’État a ainsi veillé à ce que le filtre serve d’entonnoir sans devenir un verrou. Il a tout d’abord jugé qu’une question prioritaire de constitutionnalité pouvait être soulevée à l’occasion de toute instance juridictionnelle, y compris dans le cadre de l’une des procédures de référé du titre V du code de justice administrative, en particulier des référés « liberté » et des référés « suspension ».
Une appréciation large de la condition d’applicabilité au litige est également retenue, selon laquelle la disposition ne doit pas être étrangère au litige, c’est-à-dire qu’elle doit posséder un lien suffisant avec celui-ci. Une disposition susceptible d’être interprétée comme régissant la situation à l’origine du litige, de même qu’une disposition non applicable au litige mais dont il est soutenu par le requérant qu’elle aurait dû l’être, ont ainsi été jugées applicables au litige au sens des dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiées par la loi organique de décembre 2009. Enfin, le Conseil d’État a retenu une appréciation large de la notion de question nouvelle, estimant par exemple qu’elle s’appliquait à la conformité à un principe que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore consacré comme constitutionnel, par exemple un principe fondamental reconnu par les lois de la République. De même, a été qualifiée de nouvelle la question de la conformité de la compensation financière pour transfert de charges aux collectivités territoriales, alors même que les dispositions des articles 72 et 72-2 de la Constitution avaient déjà été interprétées à plusieurs reprises.
Mais le Conseil d’État a également veillé à ne transmettre que les questions répondant aux conditions posées par la loi organique. Il neutralise par exemple – selon l’expression des commentateurs de sa jurisprudence – les « évolutions marginales de l’environnement juridique » de la QPC posée en ne reconnaissant pas, dans ce cas, l’existence d’un changement de circonstances de droit ou de fait. En d’autres termes, si le filtre n’a pas vocation à être un verrou, il ne peut non plus, sans mettre en péril la stabilité du mécanisme, être une passoire.
L’appréciation du caractère sérieux d’une question illustre cet équilibre. Dès lors qu’un doute raisonnable existe, la question est transmise au Conseil constitutionnel. L’exercice auquel se livre le Conseil d’État est assurément un contrôle de l’évidence. Sont ainsi écartés non seulement les questions fantaisistes ou simplement dilatoires, mais également les cas où il n’existe pas d’atteinte excessive à une liberté compte tenu des objectifs poursuivis, où les distinctions entre des catégories de personnes ne sont évidemment pas injustifiées, ou encore ceux où il apparaît clairement que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. À l’inverse, dès lors qu’un doute existe, le Conseil d’État renvoie la question, même lorsqu’il ne peut ignorer que la réponse devrait être négative. Les décisions constatant le caractère sérieux d’une question sont généralement peu motivées ; il faut y voir la volonté du juge de renvoi de ne pas empiéter sur la compétence dévolue en cette matière au juge constitutionnel. Lorsque nous renvoyons une question, nous ne voulons pas, fût-ce par l’écriture de nos décisions, paraître dicter au Conseil constitutionnel la réponse à lui apporter.
Ni verrou ni passoire, la juridiction administrative exerce ainsi son rôle de filtre dans le respect non seulement des textes, mais également de leur esprit. En particulier, elle ne souhaite pas, dès lors que subsiste un doute sur certaines conditions de renvoi, priver la juridiction constitutionnelle de la possibilité de se saisir de ces questions. Le taux de censure par le Conseil constitutionnel suite aux questions renvoyées – qui est, je l’ai dit, d’environ 25 % – confirme au demeurant que le tamis du filtre n’est pas trop étroit.
Les éclaircissements apportés par le Conseil constitutionnel dans ses décisions ont donné le la de la jurisprudence du Conseil d’État. Dans ce domaine plus que dans tout autre, il aurait été non seulement illogique, mais également déraisonnable, que les juges administratifs ou judiciaires jouent leur propre partition. Les craintes qui se sont exprimées en ce sens devaient être apaisées et, dans tous les champs de la question prioritaire de constitutionnalité, un dialogue constructif et respectueux a prévalu entre les juridictions. Cela a été le cas, par exemple, en ce qui concerne l’appréciation de la notion de disposition législative applicable au litige, de l’admission de l’invocabilité de l’incompétence négative dans le cadre d’une QPC et, bien évidemment, de la notion de droits et de libertés que la Constitution garantit, à propos de laquelle nous avons très strictement appliqué la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État applique ainsi l’interprétation que donne le Conseil constitutionnel des critères de renvoi des questions. Mais il tire aussi pleinement les conséquences des censures du juge constitutionnel sur les instances en cours, en se conformant en particulier aux mesures éventuellement prises pour remettre en cause les effets des lois censurées. Le Conseil d’État a ainsi adopté et mis en œuvre, dans trois décisions du 13 mai 2011 rendues par sa formation la plus solennelle, l’assemblée du contentieux, la même grille de lecture que celle retenue par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a aussi clarifié sa jurisprudence sur les conséquences des abrogations à effet différé. Il peut toutefois demeurer des incertitudes sur les effets d’une abrogation dans le litige qui y a conduit. Il est par conséquent souhaitable que le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à le faire par l’article 62 de la Constitution, prenne soin d’indiquer, s’il le juge pertinent, que l’abrogation d’une loi s’accompagne, le cas échéant, de tel ou tel effet pour le passé.
La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité fonctionne ainsi de manière satisfaisante. Il est même tout à fait remarquable que les réponses jurisprudentielles aux interrogations qui restaient en suspens après le vote de la loi organique aient été apportées aussi rapidement, dès les premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur du dispositif. Le mécanisme se stabilise donc progressivement, ce qui favorise la sécurité juridique des parties et contribue encore davantage à l’État de droit.
Car, avec la question prioritaire de constitutionnalité, la primauté des droits et des libertés garantis par la Constitution se trouve plus effectivement assurée. Cette procédure a ouvert le prétoire du Conseil constitutionnel au citoyen et elle a considérablement développé son rôle de protecteur des libertés et des droits fondamentaux.
En premier lieu, des législations qui soulevaient depuis longtemps des problèmes de constitutionnalité véritables et nettement identifiés ont dû évoluer. Je pense par exemple à celles relatives à la cristallisation des pensions ou à la garde à vue – que l’on ne pouvait l’une comme l’autre appréhender que par l’intermédiaire de la Convention européenne des droits de l’homme –, ou encore à l’hospitalisation d’office. Ces textes ont donné lieu à des censures du Conseil constitutionnel que beaucoup attendaient.
La question prioritaire de constitutionnalité a en outre pleinement joué son rôle en précisant les impératifs constitutionnels, en particulier en ce qui concerne des droits et libertés qui n’avaient jusqu’alors fait l’objet que de peu d’interprétations. De nombreuses décisions ont, par exemple, défini et affiné la portée du principe de participation énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel censurant la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence au motif que celui-ci n’avait pas prévu de procédure de participation préalable à l’adoption de différents actes qui relèvent pourtant de la catégorie des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de cet article. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de QPC touche de surcroît à des sujets extrêmement divers, allant de la tauromachie à l’impartialité de l’Autorité de la concurrence, ce qui montre que cette procédure n’est pas l’apanage des professions juridiques mais intéresse tous les secteurs de la société et tous les citoyens.
Ces décisions illustrent le processus de « reconstitutionnalisation » des droits et des libertés : les normes inscrites dans la Constitution redeviennent pleinement effectives par le biais d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori, ce qui contribue à replacer la source constitutionnelle au plus haut dans la hiérarchie des normes et à mettre fin à ce qui, au fil des années, apparaissait de plus en plus comme une anomalie, issue de notre histoire constitutionnelle et qui n’était plus en phase avec l’évolution de la société et de nos systèmes juridiques.
L’autorité de la loi qui a été déclarée conforme à la Constitution s’en trouve également renforcée. En outre, les aspérités qui ont pu exister entre le droit européen et le droit constitutionnel sont pour la plupart gommées. Conformément à l’objectif recherché par le constituant, la Constitution est ainsi effectivement entre les mains des justiciables et elle est appliquée, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, par tous les juges. La maîtrise des mécanismes issus de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a aussi permis d’éviter tout effet négatif de la QPC sur la durée des procédures juridictionnelles et sur la sécurité juridique.
Près de deux ans et neuf mois après l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, l’on constate que, fondamentalement, le système fonctionne bien. Après que de virulentes controverses se sont fait jour par moments, un point d’équilibre très satisfaisant me semble avoir été trouvé. Les questions qui se posaient ont pour la plupart été résolues. Surtout, les effets spectaculaires de cette procédure sur l’approfondissement de l’État de droit, étant donné l’importance des enjeux et des questions posées et résolues, plaident, pour le moment, pour que l’on ne la modifie pas. Des adaptations mineures pourraient être envisagées, pourvu qu’elles ne perturbent pas l’équilibre délicat auquel nous sommes parvenus.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci, monsieur le vice-président. Je note que votre vision de l’avenir diffère de celle que M. Guillaume a développée en réponse à une question de Guy Geoffroy : selon lui, le flux de questions prioritaires de constitutionnalité devrait se maintenir à un niveau assez soutenu, alors que vous pariez plutôt sur une décélération des sollicitations.
M. Alain Tourret. Si je comprends la différence entre le doute simple et le doute sérieux, je me demande ce qu’est le doute raisonnable ? Peut-il être assimilé à un doute simple ?
Le principe de parité peut-il être considéré comme un principe fondamentalement reconnu par les lois de la République ? Cela pourrait entraîner la nullité de toutes les décisions, normalement individuelles, qui ne lui seraient pas conformes, en particulier en vertu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sur la fonction publique, qui va être appliquée en 2013, bien qu’il n’y ait pas de nullité sans texte et que le texte ne prévoie que des sanctions financières. Je profite de votre présence, monsieur le vice-président, pour soulever à nouveau cette question dont la réponse, m’aviez-vous dit, supposait une expertise juridique.
Enfin, la QPC est une procédure d’exception. Est-il envisageable que la saisine du Conseil constitutionnel devienne obligatoire pour toutes les nouvelles lois ? Le Conseil constitutionnel ne deviendrait-il pas ipso facto une autorité supérieure au Parlement, de plein droit, et une Cour suprême ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le deuxième point, mon cher collègue, ne présentant pas de lien immédiat avec la QPC, j’en déduis que vous profitez de l’effet d’aubaine que constitue la présence de M. Sauvé.
M. Jean-Marc Sauvé. En ce qui concerne l’avenir du mécanisme, je ne voudrais pas que mes propos suscitent un malentendu. À mes yeux, il n’y a pas la moindre probabilité que le flux des QPC se tarisse. Simplement, au vu de l’évolution constatée au cours des derniers mois, on pourrait s’attendre à une forme de stabilisation à un niveau moins élevé qu’en 2010 et 2011. Il s’agit d’une hypothèse, en aucun cas d’une prédiction. Car, ainsi que cela a été rappelé, le nombre de saisines demeure très élevé devant toutes les cours constitutionnelles des États d’Europe – l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne. Plusieurs grandes questions qui devaient être posées au cours des premiers mois d’application de la nouvelle procédure l’ayant été, ce qui est fait n’est plus à faire. En revanche, je suis persuadé que le stock de lois applicables n’a pas été entièrement passé au tamis du contrôle de constitutionnalité.
En matière fiscale, par exemple, le grand nombre de questions que nous avons reçues en 2010, et encore en 2011, a fourni au Conseil constitutionnel l’occasion d’arrêter plus précisément sa jurisprudence, ce qui a évité d’avoir à poser d’autres questions et explique le relatif assèchement constaté dans ce domaine. Je l’ai dit, un transfert s’est en revanche opéré du droit fiscal et du droit des collectivités territoriales vers le droit des agents publics, de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement. En somme, si l’on constate une certaine décélération, il n’y a pas de tarissement et il faut s’attendre à des effets de substitution. On constate également une tendance à passer de grandes questions à des questions plus précises et plus ponctuelles.
Monsieur Tourret, en ce qui concerne le doute qui justifie le renvoi, il faut que les juges interprètent fidèlement les textes. Pour qu’il y ait renvoi, il faut d’abord que la loi soit applicable au litige – règle que nous avons interprétée de manière non pas vétilleuse, mais souple et large. Il faut ensuite que la question soit nouvelle. Là encore, nous avons interprété cette notion de manière large, l’appliquant, par exemple, à des principes constitutionnels non encore reconnus. L’on aurait pu considérer que ces principes n’existaient pas, ce qui aurait conduit à écarter la question posée. Dès lors que le requérant invoquait un principe fondamental reconnu par les lois de la République, nous avons cependant voulu que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, considérant que, dans le cas où il reconnaîtrait ce principe, la question serait nouvelle.
Plus précisément, enfin, il faut que « la question [soit] nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Nous appliquons ce dernier critère de la même manière que le critère de renvoi préjudiciel aux cours européennes en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Nous ne l’interprétons pas, lui non plus, de manière très vétilleuse : nous procédons, je l’ai dit, à une forme de contrôle de l’évidence. Si la conformité à la Constitution est évidente, s’il n’y a évidemment aucun doute, nous ne renvoyons pas. Mais dès lors qu’il existe un doute, nous avons tendance à le considérer comme sérieux. En réponse à votre question, monsieur le député, il me semble donc – mais je parle sous le contrôle du président de la section du contentieux – que nous avons tendance à identifier le caractère raisonnable du doute à son caractère sérieux.
Faut-il déférer obligatoirement au Conseil constitutionnel toutes les lois qui viennent d’être votées ? Je ne le crois pas. Il faut que les autorités compétentes – le Premier ministre, les présidents des assemblées parlementaires, le président de la République – puissent saisir le Conseil sans y être tenues, de même que soixante députés ou soixante sénateurs. Pour ma part, je pensais que l’instauration de la QPC conduirait à un tarissement des saisines a priori. L’expérience a montré qu’il n’en était rien : c’est plutôt l’évolution contraire qui se dessine. Laissons-la donc suivre son cours. N’oublions pas que, lors du contrôle a priori, notamment lorsque le Conseil est saisi par le Premier ministre, les présidents des assemblées et le président de la République, il doit en principe se prononcer sur la totalité des articles de la loi. Dans le cas de lois particulièrement longues et complexes qu’il examine en urgence, un tel contrôle n’est pas possible. Il faut donc que le contrôle a priori subsiste, mais sur un fondement discrétionnaire, le contrôle a posteriori venant le compléter sur des points qu’il n’aurait pas permis de trancher.
En ce qui concerne l’application du principe constitutionnel de parité, si une QPC était posée à ce sujet à propos d’une législation existante, elle serait certainement renvoyée au Conseil constitutionnel. Si par ailleurs une demande d’avis était adressée au Conseil d’État, celui-ci s’efforcerait d’y répondre dans le cadre de ses compétences consultatives et prendrait ses responsabilités. Vous comprendrez bien que je ne saurais risquer une réponse qui serait d’autant plus malvenue de ma part qu’elle pourrait anticiper sur une délibération du Conseil d’État. Avec regret mais fermeté, monsieur le député, je m’abstiendrai donc à nouveau de répondre à cette question qui exige, je le répète, une réflexion approfondie.
M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’État. Pour la section du contentieux, l’examen des QPC – environ 200 en un an, à traiter dans un délai maximum de trois mois, qui se ramène en pratique à deux – a entraîné un travail important, auquel nous avons toutefois pu faire face sans difficulté majeure, pour trois raisons.
Premièrement, l’ensemble de nos procédures de droit commun a été utilisé et bien adapté à la QPC. Il n’a donc pas été nécessaire d’appliquer des procédures particulières. Nous avons recouru aux ordonnances s’agissant de questions tout à fait indigentes – dans un peu plus de 10 % des cas – et aux délibérations collégiales dans leur formation ordinaire, à trois ou à neuf, pour la plupart des affaires. Seules les trois affaires du 13 mai 2011 auxquelles le vice-président a fait allusion sont remontées devant l’assemblée du contentieux, qui s’est prononcée non sur les renvois – elle n’a jamais eu à le faire – mais sur les conséquences à tirer d’une décision du Conseil constitutionnel.
Deuxièmement, la QPC a d’emblée été perçue, à juste titre, comme une extension particulièrement intéressante des compétences du Conseil d’État sur le terrain constitutionnel, qui fournissait l’occasion à ses formations contentieuses de s’interroger sur la conformité des lois aux dispositions et aux principes de la Constitution. Il s’agit là d’un véritable enrichissement, conformément au vœu du constituant de replacer la Constitution parmi les normes de référence, y compris pour le juge. Un champ nouveau s’est ouvert devant nous, d’autant plus passionnant que nous sommes au sommet de la hiérarchie des normes et que de très belles questions nous ont donc été posées.
Troisièmement, la position du Conseil d’État par rapport à celle du Conseil constitutionnel a été, d’emblée, facilement déterminée. On retrouve ici la question du doute sérieux ou raisonnable. La Constitution confie au Conseil d’État un rôle de filtrage visant à éviter que le Conseil constitutionnel ne soit inutilement saisi de questions qui ne posent pas de problèmes sérieux de constitutionnalité. En revanche, chaque fois qu’une interrogation raisonnable est possible, la question doit être renvoyée au Conseil constitutionnel. C’est ce que le Conseil d’État a fait sans difficulté, dans un esprit assez proche de celui qui l’anime lorsqu’il s’agit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une difficulté d’interprétation ou d’une véritable interrogation sur la validité d’une norme de droit dérivé. Le juge national est le juge de droit commun du droit de l’Union ; lorsqu’une difficulté sérieuse se fait jour, il renvoie au juge de l’Union. De même, le juge ordinaire est devenu le juge de droit commun de l’application de la Constitution mais, en cas de difficulté sérieuse, la question est soumise au Conseil constitutionnel.
Dans un premier temps, il est vrai, certaines questions se sont posées à propos de la mise en œuvre de la procédure de QPC. Elles ont été progressivement éclaircies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Au cours des deux premières années, les grandes lois qui posaient des problèmes majeurs de constitutionnalité ont été détectées par les requérants et traitées. Aujourd’hui, ce sont plutôt des difficultés particulières qui sont soulevées.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Sauvé, vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas repéré d’inégalité territoriale dans le traitement des QPC. Est-ce à dire que vous vous êtes dotés d’une structure chargée d’observer en détail la situation dans les différents tribunaux afin d’en étudier l’harmonisation ?
M. Jean-Marc Sauvé. Monsieur le président, ce sont les questions posées par votre Commission qui nous ont conduits à enquêter sur cette question, sur laquelle nous ne nous étions pas penchés auparavant. Je profite de l’occasion pour rappeler que, dans la juridiction administrative, le polycentrisme n’existe pas. Il y a la loi, la Constitution, nos engagements internationaux, l’interprétation qui en est faite, notamment par le Conseil d’État ; il va absolument de soi qu’il n’y a pas de jurisprudence bourguignonne, marseillaise ou douaisienne en la matière.
Nous sommes un pays de droit civil, de droit écrit, et le Conseil d’État est éminemment lié à la tradition, à l’idiosyncrasie françaises. Mais il est aussi la plus britannique des institutions françaises en ce qu’il accorde une grande importance à la jurisprudence – celle du Conseil constitutionnel, celle des cours européennes, la sienne propre. Dans l’ordre administratif, toutes les juridictions sont extrêmement attachées à l’unité, à la cohérence, à la prévisibilité de la jurisprudence. C’est essentiel, car c’est ainsi que nous pouvons garantir au justiciable la sécurité juridique et l’égalité devant la loi. Cela ne signifie pas que les jurisprudences doivent rester perpétuellement stables ; elles doivent évoluer, mais de manière prévisible et en bon ordre. C’est également ainsi que nous procédons en matière de QPC.
*
* *
Audition de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation
Séance du 21 novembre 2012
M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. C’est un honneur pour le Premier président de la Cour de cassation d’être invité à prendre la parole devant les représentants de la nation, et particulièrement devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire, votre Commission et la Cour de cassation entretiennent depuis plusieurs années un dialogue utile et fructueux et nous vous savons gré de l’intérêt que vous portez à la mise en œuvre effective de la loi par les juridictions.
Vous avez souhaité, avant de dégager un premier bilan de la question prioritaire de constitutionnalité lors du troisième anniversaire de son entrée en vigueur, procéder à l’audition des responsables des deux juridictions les plus élevées de l’ordre judiciaire et administratif. Au nom de la Cour de cassation, je vous en remercie.
Je dresserai d’abord un constat globalement positif de la réforme au regard de ses objectifs, pour proposer ensuite quelques améliorations éventuelles.
Voilà plus de deux ans et demi, l’institution judiciaire s’est vu confier par le constituant la mission de filtrer les questions de constitutionnalité. Nous avons accueilli cette réforme avec un grand sens de la responsabilité, en mesurant l’importance de la tâche confiée à l’institution judiciaire. Nous l’avons aussi reçue avec une certaine appréhension, la formation des magistrats judiciaires n’étant pas jusqu’alors principalement tournée vers le droit constitutionnel et l’accroissement des missions qui en résultait ne s’étant pas accompagné de moyens supplémentaires. Mais la perspective était aussi exaltante et la tâche, d’une certaine façon, naturelle, car l’autorité judiciaire est investie, par l’article 66 de la Constitution, du rôle de gardien de la liberté individuelle. Comme le rappelait en mars 1790 Thouret, qui fut président de l’Assemblée, « le pouvoir judiciaire est celui […] dont l’exercice habituel aura le plus d’influence sur le bonheur des particuliers […] et sur la stabilité de la Constitution ».
Avant cette rencontre, j’ai souhaité recueillir l’avis de la conférence des premiers présidents des cours d’appel. Il m’a été rapporté que la question prioritaire de constitutionnalité paraît, dans l’ensemble, avoir été bien acceptée par les juridictions du fond. Indiscutablement, la mise en œuvre de cette institution nouvelle a permis l’instauration d’un dialogue entre les juges. On a pu assister ainsi à un rapprochement de leurs modes de raisonnement. Le droit privé s’est approprié la question prioritaire de constitutionnalité, il s’est décentré vers le droit constitutionnel, tandis que celui-ci s’est lui-même insinué dans des domaines qui semblaient lui échapper jusqu’alors.
Nous nous sommes attachés à répondre aussi précisément que possible, compte tenu des données dont nous disposons, au questionnaire que vous avez bien voulu nous faire parvenir. Il n’a pas été possible cependant de vous communiquer des chiffres concernant les décisions de non-transmission par les juridictions du fond de questions prioritaires de constitutionnalité puisque, par hypothèse, celles-ci n’ont pas été adressées à la Cour de cassation, qui n’a pas d’autorité hiérarchique sur les cours et tribunaux. Seule Mme la garde des Sceaux pourrait vous fournir des informations à cet égard.
De la même façon, nous ne pouvons dire avec précision, comme nous y invite l’une de vos questions, si l’on a pu assister à une spécialisation des avocats en la matière. Dès lors que la question prioritaire ne constitue qu’un moyen à l’appui d’une prétention, il me semble plutôt que les avocats spécialisés dans tel ou tel contentieux se sont efforcés de développer un réflexe constitutionnel. Devant la Cour de cassation, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dont la grande expérience, notamment en droit public, est inhérente à leurs fonctions, se sont particulièrement bien préparés dès l’entrée en vigueur de la réforme.
Dès 2009, soit avant même l’entrée en vigueur de la réforme, j’ai voulu que notre Cour se dote des outils indispensables à la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Ainsi un bureau du droit constitutionnel a-t-il été créé au sein du service de documentation, des études et du rapport. Deux magistrats y ont été affectés. Ce bureau est à la disposition aussi bien des membres de la Cour que des juridictions du fond et assiste remarquablement les juges. Un espace spécialement dédié à la question prioritaire de constitutionnalité a parallèlement été créé ; en ligne sur le site Internet de la Cour, il présente un ensemble de fiches d’information, des propositions de trames et une veille jurisprudentielle. Une liste exhaustive des questions soumises à la Cour permet en outre de vérifier si une question a déjà été transmise et quel sort lui a été réservé. Les juridictions du fond ont été sensibles à l’aide que notre Cour leur a ainsi apportée.
La Cour de cassation peut être saisie d’une question prioritaire dans les hypothèses suivantes : lorsqu’une juridiction du fond lui transmet une question prioritaire de constitutionnalité ; lorsqu’une partie forme un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel – ou contre un jugement rendu en premier et dernier ressort – qui, après avoir refusé de renvoyer la question à la Cour de cassation, statue sur le fond ; lorsqu’une partie soulève, pour la première fois devant elle à l’occasion d’un pourvoi, en demande ou en défense, une telle question ; enfin, lorsqu’un moyen d’inconstitutionnalité est soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort. L’écrit est alors immédiatement transmis par la cour d’assises. La première et la quatrième hypothèse correspondent aux questions dites « transmises ou principales », alors que les deuxième et troisième concernent les questions dites « incidentes » à un pourvoi en cassation.
Du 1er mars 2010 au 31 octobre 2012, notre Cour a rendu 1 208 décisions en la matière, dont 545 ont statué sur des questions transmises par les juridictions du fond et 663 sur des questions soulevées de manière incidente à un pourvoi en cassation. Si, au cours de la première année d’application de la loi, les questions ont émané le plus souvent d’avocats aux Conseils, qui s’étaient sans doute mieux préparés à cette échéance, les courbes se sont rejointes, de sorte qu’aujourd’hui les questions qui proviennent des juridictions du fond et celles qui sont posées directement devant la Cour de cassation se trouvent en nombre sensiblement égal.
Après de fortes saisines dans les premiers temps, la Cour traite environ une quarantaine de questions chaque mois. Au total, sur 1 217 questions posées – une décision pouvant statuer sur plusieurs questions –, 230 ont été renvoyées au Conseil constitutionnel, soit près de 20 % ; 76 d’entre elles relèvent de la matière pénale ; 785 questions n’ont en revanche pas été renvoyées et 144 irrecevabilités ont été prononcées.
En matière civile, commerciale et sociale, les questions les plus nombreuses ont été posées dans le domaine des relations du travail et de la protection sociale, notamment en droit de la sécurité sociale. Viennent ensuite les relations avec les personnes publiques, l’administration fiscale et douanière ou encore les autorités de contrôle et de régulation, le droit des personnes et de la famille, le droit de la nationalité, des étrangers ou encore le droit successoral et les hospitalisations sans consentement. On note aussi un nombre non négligeable de questions en droit des affaires, touchant singulièrement au droit des procédures collectives, en droit des biens, notamment l’expropriation, l’urbanisme ou le droit de propriété, ou encore celui de la propriété intellectuelle ou des contrats, comme les baux commerciaux ou ruraux.
En matière pénale, les QPC ont parfois été soulevées de manière récurrente ou sérielle, par exemple sur la garde à vue, la motivation des arrêts des cours d’assises ou encore le harcèlement. La procédure pénale concentre le plus grand nombre de QPC répertoriées et transmises. À titre d’exemple, quatorze questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la garde à vue ont été transmises au Conseil constitutionnel. Mais une tendance à présenter davantage de questions portant sur les incriminations, notamment sur le choix de pénaliser tel ou tel comportement ou critiquant le manque de précision d’une incrimination, paraît devoir être relevée, spécialement depuis la décision qu’a rendue le Conseil constitutionnel à propos de la définition du harcèlement sexuel.
Il est très difficile de conclure sur les matières dans lesquelles les questions seraient le plus souvent couronnées de succès. Un dépouillement manuel de décisions répertoriées de septembre 2010 au 31 octobre 2012 fournit quelques indications fragmentaires. Le délai moyen de traitement des questions prioritaires est, pour les questions transmises et incidentes en matière civile, de 74 jours – 22 jours au minimum, 91 jours au maximum. Un délai comparable est constaté en matière pénale. Le délai légal de trois mois, qui – à une exception près, résultant d’une erreur d’enregistrement – a toujours été respecté, paraît, à l’expérience, raisonnable. Il permet de procéder à un examen sérieux et contradictoire de la recevabilité et de la pertinence de la question posée.
Une analyse plus détaillée révèle que 27 % des QPC transmises par les juridictions du fond l’ont été par celles de la cour d’appel de Paris, loin devant les juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Versailles – 8 % – ou d’Aix-en-Provence – 6 % – ou d’autres cours moins importantes, ce qui concorde assez avec l’activité de ces ressorts. Le poids relatif des QPC en matière pénale varie beaucoup d’un ressort à l’autre, passant de 63 % à Paris à 33 % à Douai. Les cours d’appel et les tribunaux de grande instance arrivent en tête, loin devant les juridictions spécialisées.
L’effet sur d’autres affaires des décisions du Conseil constitutionnel examinant des QPC n’est pas négligeable, mais il n’existe pas de données chiffrées sur le nombre de procédures ayant ainsi subi les conséquences d’une décision du Conseil.
La Cour de cassation tient le plus grand compte des effets d’une abrogation décidée par le Conseil constitutionnel et des modalités de cette abrogation, sous réserve toutefois que ne soit pas ultérieurement mise en cause l’inconventionnalité de la disposition litigieuse, comme cela a été le cas en matière de garde à vue. Il est cependant apparu à l’expérience que les effets d’une abrogation n’étaient pas appréciés uniformément par chacun des ordres de juridiction. Ainsi, en matière de responsabilité médicale, le Conseil constitutionnel a déclaré une disposition transitoire de la loi « anti-Perruche » contraire à la Constitution, mais le Conseil d’État et la Cour de cassation ont interprété dans un sens opposé la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 s’agissant de ses conséquences sur les instances en cours. La mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juillet 2010 ayant censuré la composition des tribunaux maritimes commerciaux, dont la Cour de cassation a pris acte par une décision du 13 octobre 2010, n’a pas été non plus sans soulever de réelles interrogations.
Plus délicate encore est la situation où le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution des dispositions législatives sous réserve ou avec réserve d’interprétation. L’analyse de la jurisprudence montre que les chambres de la Cour de cassation prennent en compte ces réserves, soit pour rejeter un pourvoi, soit pour casser une décision. Toutefois, il est apparu difficile d’appliquer certaines réserves d’interprétation, par exemple celle concernant la faute inexcusable en matière de sécurité sociale (décision du 18 juin 2010) ou celle portant sur les nullités de procédure, en matière pénale, issue de la décision du 18 novembre 2011 relative à l’audition libre. La réserve formulée à cette occasion par le Conseil constitutionnel, appliquée aux auditions postérieures à la publication de sa décision, a une portée bien plus grande sur d’autres dispositions du code de procédure pénale.
Certaines réserves se révèlent neutres pour le juge ; d’autres, en revanche, peuvent avoir un effet sur la jurisprudence et la liberté d’appréciation laissée aux juridictions, en conduisant à remettre en cause une jurisprudence établie ou à figer pour l’avenir des solutions prises dans un contexte donné. Si, dans la plupart des cas observés, les réserves d’interprétation ne s’opposent pas frontalement à une jurisprudence établie par la Cour de cassation, elles peuvent conduire le juge à l’infléchir, comme dans le cas de la décision déjà citée du 18 juin 2010 sur la faute inexcusable, le juge civil devant apprécier désormais, poste par poste, les préjudices subis par la victime. Mais il est arrivé que le Conseil constitutionnel adopte une interprétation radicalement contraire à celle de la Cour, comme dans la décision du 11 février 2010 relative à la remise automatique des pénalités en cas d’ouverture d’une procédure collective ou, de façon plus topique encore, dans la décision du 16 septembre 2011 relative à la responsabilité du producteur d’un site en ligne.
Dans cette affaire, le Conseil semble avoir davantage combattu l’interprétation de la Cour de cassation que la disposition légale puisque, fait peu commun, il a cité dans le corps de sa décision, pour les neutraliser par une réserve d’interprétation, les arrêts de la Cour ayant retenu la responsabilité de plein droit de créateurs de sites en tant que producteurs à raison de propos diffamatoires déposés par des internautes non identifiés sur un forum. Dans de telles situations, l’office du juge constitutionnel ne devrait-il pas être d’abroger purement et simplement la disposition contestée, plutôt que de mettre le juge de cassation dans la situation délicate de se plier à l’interprétation ainsi donnée par un juge non judiciaire ? Si j’admets volontiers que la jurisprudence fait corps avec la disposition que le juge interprète, ce qui met le Conseil en position de censurer, le cas échéant, la loi telle qu’elle est interprétée majoritairement par les juges, le fait que le Conseil constitutionnel formule a posteriori une réserve qui, au mieux, sera neutre, mais qui peut aussi figer, voire remettre en cause, la jurisprudence peut sembler contraire à l’esprit et aux règles de fonctionnement de nos institutions. Il appartient au législateur de faire la loi, au juge de l’interpréter, au besoin sous le contrôle du Parlement qui peut naturellement remettre en cause la jurisprudence.
La force de la jurisprudence est son adaptabilité aux contentieux nouveaux. Ainsi évolue-t-elle dans un dialogue constant entre le juge de cassation et le juge du fond. Dans plus de 40 % des cas, l’assemblée plénière de la Cour de cassation désavoue sa chambre spécialisée en donnant raison à la cour de renvoi qui a résisté. Si la loi n’est pas conforme, elle doit être abrogée. Si elle n’est pas contraire à la Constitution, elle doit être conservée dans son intégrité. Je peux comprendre bien sûr l’intérêt pratique qui s’attache à la technique de la réserve d’interprétation, en ce qu’elle dispense le Parlement de prendre à nouveau position. Mais il est question ici des droits et libertés sur lesquels il appartient au premier chef au Parlement de se prononcer. La réserve d’interprétation peut ainsi paraître source de confusion et de rupture dans l’équilibre des pouvoirs.
Les décisions de non-lieu à renvoi sont en majorité motivées par le défaut de nouveauté et de caractère sérieux de la question posée – critère examiné en dernier –, ce qui montre que les juridictions du fond procèdent à un contrôle minimum, laissant à la Cour de cassation le soin d’opérer le dernier filtre. À l’inverse, le filtre le moins utilisé reste le défaut d’applicabilité au litige des dispositions critiquées. Le critère de nouveauté n’a été utilisé que trois fois, à l’occasion de QPC principales à propos du mariage homosexuel, de l’absence de motivation des arrêts des cours d’assises ou de la Charte de l’environnement.
Parmi les QPC examinées en matière civile et concernant la contestation des refus de transmission opposés par les juridictions du fond, douze seulement ont été enregistrées et deux finalement renvoyées au Conseil constitutionnel. Concernant la matière pénale, une seule question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée au Conseil après contestation d’un refus de transmission.
La pratique a démontré qu’en marge du moyen d’inconstitutionnalité d’une disposition figuraient parfois des moyens d’inconventionnalité invoquant souvent la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus précisément, les parties invoquent soit un grief d’inconventionnalité au soutien de leur QPC, ce qui est évidemment voué à l’échec – mais les exemples sont rares –, soit un moyen d’inconventionnalité au soutien de leur pourvoi et ce, parallèlement à leur QPC. Dans cette dernière hypothèse et en matière civile, plus de la moitié des pourvois répertoriés avec des QPC incidentes comprennent des moyens d’inconventionnalité tirés de la violation de la Convention européenne de sauvegarde, mais aussi du droit de l’Union européenne ou d’autres conventions internationales comme les conventions de l’Organisation internationale du travail ou la Convention internationale des droits de l’enfant.
À ce jour, aucune contrariété significative n’a été relevée, mais on ne peut exclure que la Cour de cassation écarte, de son propre mouvement ou sur le fondement d’une jurisprudence européenne, une loi sur un motif d’inconventionnalité, alors que la disposition litigieuse aurait été préalablement déclarée conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Si la situation ne s’est pas présentée à ce jour dans des conditions évidentes, c’est précisément parce que la Cour de cassation est déterminée à rendre compatible les deux contrôles. Son objectif unique est et sera de renforcer l’État de droit et de mieux protéger les droits fondamentaux du justiciable. C’est par un dialogue permanent et loyal entre toutes les juridictions concernées, nationales et internationales, qu’un point d’équilibre sera atteint dans la reconnaissance et la mise en œuvre effective de ces droits.
En définitive, et sous les réserves que je viens de formuler, le bilan apparaît positif puisque la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité enrichit et sécurise notre système juridique. Il montre que les objectifs du constituant, qui étaient, comme l’a rappelé en septembre 2009 le rapporteur de votre Commission des lois, d’« assurer la constitutionnalité de l’ordre juridique » et de « permettre au citoyen de faire valoir ses droits constitutionnels », ont été satisfaits.
Des précisions ou des aménagements pourraient toutefois être apportés à la loi ou aux textes réglementaires, afin de donner à la réforme toute sa mesure.
C’est essentiellement la procédure applicable à la QPC qui pourrait donner lieu à de légers aménagements. Mais il importe d’abord de répondre à une question que certains se posent : faut-il instituer un recours contre les décisions de non-transmission ? La Cour de cassation n’est pas une juridiction constitutionnelle, même si le législateur lui a confié une mission de filtrage, et par suite une sorte de pré-contrôle de la constitutionnalité de la loi. Comment concilier une telle mission avec l’existence d’un recours ? Le demandeur à la question prioritaire ne manquerait pas de l’exercer. Le recours ainsi engagé aurait inévitablement pour effet de dénaturer la fonction de filtre, de la rendre illusoire, mais aussi d’instituer la Cour de cassation en une juridiction constitutionnelle, ce qui est contraire à la philosophie du texte. Ouvrir une faculté d’évocation au profit du Conseil constitutionnel produirait des effets identiques et pourrait aussi poser problème au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En pratique, la solution obligerait le Conseil à examiner l’ensemble des QPC, rendant insignifiant le rôle de filtre confié aux juridictions judiciaires et administratives, qu’il vaudrait alors mieux supprimer totalement. Pour le reste, je ne peux que renvoyer sur ce point aux arguments excellemment exposés devant votre Commission en septembre 2010, par le professeur Denys Simon en particulier.
J’en viens aux ajustements techniques suggérés par les chambres de la Cour. Si une QPC met en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel a déjà été saisi, le code de procédure civile prévoit que la Cour de cassation « diffère » sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel. Cette notion de « différé » étant inconnue de notre droit processuel, il vaudrait mieux la remplacer par celle de « sursis à statuer ». Pour ce qui est des QPC incidentes à un pourvoi, le délai de dépôt de la question a été fixé par la jurisprudence à l’expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif. Ne faudrait-il pas apporter sur ce point une précision dans les textes ?
D’autre part, lorsque la Cour de cassation est saisie d’une question portant sur d’autres motifs que ceux examinés dans une question déjà transmise, il pourrait être envisagé d’apporter des aménagements évitant une nouvelle transmission, dès lors que le Conseil constitutionnel peut soulever d’office tout grief d’inconstitutionnalité.
Enfin, lorsqu’une nouvelle QPC porte sur un texte et sur des motifs à propos desquels la Cour a déjà considéré la question comme non sérieuse, celle-ci pourrait être déclarée irrecevable, sauf circonstances nouvelles.
En matière pénale, le regroupement des QPC in limine litis, de façon à éviter les procédés dilatoires qui ont été utilisés dans des affaires très médiatisées, pourrait être proposé. Toujours en matière pénale, un contrôle de constitutionnalité de plein droit de la loi nouvelle faisant suite à une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être institué pour éviter le renouvellement de situations comme celles apparues après la réforme de la garde à vue.
Par ailleurs, en droit allemand comme en droit espagnol, l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée que par le juge, tandis que, en droit luxembourgeois, cette faculté est partagée par le juge et les parties. En revanche, la loi française interdit au juge de la soulever d’office. Cette règle est appliquée strictement par la Cour de cassation, qui s’applique à reproduire fidèlement le texte de la question, tel que rédigé par celui qui la pose. Mais faut-il qu’il en soit ainsi ? Le principe de prééminence du droit, si essentiel aux yeux de la Cour de Strasbourg, ne commanderait-il pas, à tout le moins, d’autoriser le juge français à participer, d’un commun accord avec la partie qui a pris l’initiative de la question, à la rédaction de celle-ci ? Les présidents des chambres de la Cour de cassation s’interrogent ainsi sur leur office. Ils font état de véritables considérations de politique jurisprudentielle consistant, en présence d’une relative indétermination du caractère sérieux d’une question, à transmettre au Conseil constitutionnel un corps de texte ayant une cohérence, dans la perspective de le voir censuré ou consolidé. Un office accru du juge, au moins du juge de cassation, faciliterait cette recherche de cohérence.
En outre, il serait bon de simplifier et d’unifier les conditions de renvoi d’une QPC. À ce jour, en effet, la Cour de cassation peut renvoyer une QPC si la question est sérieuse ou si elle est nouvelle. Cette distinction, quelque peu académique, est rarement invoquée par les auteurs des questions et très peu retenue par la Cour. La condition de nouveauté, souvent confondue avec l’exigence du caractère sérieux de la question posée, pourrait être considérée comme l’un des éléments permettant d’apprécier ce dernier. En outre, il pourrait être opportun d’harmoniser les critères d’examen de la QPC par les juges du fond et la Cour de cassation, la distinction entre l’appréciation du caractère sérieux de la question ou de l’existence d’une question non dépourvue de caractère sérieux étant apparue, à l’usage, bien théorique.
En revanche, la Cour de cassation est favorable au maintien du double filtrage, l’expérience montrant que, en pratique, les cours et tribunaux se bornent le plus souvent à vérifier que la demande n’a pas de caractère fantaisiste ou dilatoire et que le grief est appuyé par une argumentation cohérente, tandis que la Cour de cassation se livre à un examen nécessairement plus approfondi des conditions posées par la loi.
Enfin, les principes de priorité et de célérité propres à la QPC s’articulent mal avec les règles de la procédure civile. La question prioritaire de constitutionnalité a été qualifiée de « moyen » aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. S’agit-il dès lors d’un moyen parmi d’autres et comme les autres dans une instance, ou faut-il au contraire renforcer son régime autonome ? En réalité, on est en présence d’un moyen de défense au fond qui, en dépit de son caractère prioritaire, ne devrait justifier un examen par le juge que s’il estime la demande régulière et recevable. On imagine mal en effet un juge incompétent ou dépourvu du pouvoir de statuer se prononcer sur le sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité, sauf bien sûr si elle concerne une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
J’espère ne pas conclure sur des points trop techniques, mais je ne doute pas que vous le pardonnerez à un juge, soucieux de l’intérêt d’une bonne justice au service des citoyens.
M. Guy Geoffroy. Merci, monsieur le Premier président, pour cet exposé très intéressant. Vos réserves, si j’ose dire, sur les réserves d’interprétation concernent-elles la seule QPC ou s’étendent-elles aux autres types de saisine, par les parlementaires, par exemple ?
M. Vincent Lamanda. Elles ne portent que sur les réserves d’interprétation relatives aux QPC, qui affectent notamment la jurisprudence. Nous avons toujours pris en considération les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, quelles qu’elles soient, et nous continuons de le faire, mais nous nous demandons si, ici, l’esprit de la QPC est bien respecté. Les réserves d’interprétation a priori ne posent aucun problème : à ce stade, le Conseil constitutionnel nous indique, conformément à son rôle, comment interpréter la loi alors qu’aucune jurisprudence n’a encore dû le faire.
Des prises de position qui n’affectent pas la jurisprudence sont également en cause. Ainsi, nous étions tout à fait d’accord pour considérer que la composition des tribunaux maritimes commerciaux posait un problème, puisque nous avions transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cela ne veut pas dire que le Conseil devait fixer lui-même la composition de ces juridictions, alors que la Convention européenne garantit à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial légalement composé.
M. Alain Tourret. Je vous remercie à mon tour, monsieur le Premier président, pour cet exposé très intéressant, en particulier par les propositions d’amélioration qu’il formule et que nous devrons reprendre une à une.
En revanche, votre réflexion sur les filtres me met très mal à l’aise. À mes yeux, en effet, les filtres – et à plus forte raison les « filtres dans le filtre » – peuvent conduire à neutraliser le droit dévolu aux individus de saisir une juridiction et d’obtenir une réponse à leur saisine. Le fait que le filtre soit une décision quasi administrative, que l’on ne peut attaquer, porte véritablement atteinte aux droits et libertés des individus.
En outre, qu’en est-il de la motivation de ces décisions par la Cour de cassation ? On constate en effet une tendance de toutes nos juridictions à motiver de moins en moins leurs décisions, qui s’explique notamment par l’avalanche des saisines et la difficulté à répondre en temps voulu. Or les justiciables veulent connaître les raisons pour lesquelles on écarte leurs questions, et il s’agit là d’un droit absolu.
M. Vincent Lamanda. Il ne me paraît ni choquant ni arbitraire que le juge, dont l’article 66 de la Constitution fait, je le répète, le gardien de la liberté individuelle, joue le rôle de filtre. Beaucoup de questions ont été transmises qui concernaient des dispositions législatives jusqu’alors appliquées par les juridictions. Celles-ci se sont véritablement emparées de cette réforme en transmettant, lorsqu’il y avait un doute raisonnable – et le Conseil constitutionnel dût-il ne pas donner suite –, des questions relatives à des difficultés qu’il n’était auparavant pas possible de contester.
S’agissant de la motivation, nous y sommes très attentifs et les QPC sont traitées avec autant de soin, voire plus encore, que les pourvois en cassation. Le rapporteur accomplit un très gros travail, avec l’assistance systématique du service de documentation, des études et du rapport, alors que, dans le cas des pourvois, ce service n’intervient que dans les affaires les plus importantes. En outre, en ce qui concerne les QPC, la motivation est plus développée que celle des décisions rejetant un pourvoi, dont on nous reproche parfois le caractère laconique. Parce que je suis sensible à la position que vous faites valoir, monsieur le député, je veille également à ce que nous transmettions systématiquement aux parties, outre les décisions motivées, tous les rapports, qui ne se contentent pas de rappeler les faits et l’état de la procédure mais analysent la question posée au regard de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire et de la doctrine universitaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci beaucoup, monsieur le Premier président. J’ai bien noté votre point de vue sur l’éventualité d’un recours contre les décisions de non-transmission, problème soulevé il y a deux ans mais à propos duquel nous avons désormais trouvé, me semble-t-il, un point d’équilibre. Suivant votre conseil, nous allons en revanche approfondir les statistiques de non-renvoi par les juges a quo en nous tournant vers la garde des Sceaux.
Compte tenu de l’emploi du temps chargé de nos collègues, je propose que nous reportions les auditions qui devaient intervenir maintenant, celles de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, et des universitaires de l’Association française de droit constitutionnel.
À la lumière de ce qui a été dit ce matin, il me semble que plusieurs questions méritent d’être approfondies.
Tout d’abord, si la pratique de la QPC devant les juridictions administratives semble assez uniforme sur le territoire, il existe – le Premier président de la Cour de cassation vient de les évoquer – des disparités entre les juridictions judiciaires, que nous n’avions pas anticipées lors des débats sur l’instauration de la QPC. Nous ne pouvons pas nous borner à constater ce phénomène : s’il est avéré, nous devons en comprendre les raisons et en tirer des conclusions.
En outre, les remarques du secrétaire général du Conseil constitutionnel et du Premier président de la Cour de cassation sur la pratique de la QPC en matière pénale suscitent des interrogations. Après un « effet d’aubaine » dans les premiers temps, le nombre de QPC en matière pénale semble s’être stabilisé. Pour sa part, le Premier président constate une certaine continuité, même si les QPC portent davantage aujourd’hui sur les incriminations. Nous allons solliciter des éléments complémentaires auprès du ministère de la Justice.
Enfin, il serait utile de mieux connaître la répartition des QPC selon les matières juridiques : droit pénal, droit fiscal, droit de la fonction publique, etc. Il semble que les auteurs de QPC délaissent le champ des grandes questions de droit pour des enjeux plus spécifiques.
À ces fins, je me propose d’adresser un questionnaire à plusieurs juridictions – nous n’avons pas les moyens de les étudier toutes – que nous choisirons en lien avec les juridictions suprêmes des deux ordres et le ministère de la Justice. À partir de cet échantillon, si vous en êtes d’accord, je présenterai en février 2013 un rapport qui alimentera un premier bilan de la QPC à la veille de son troisième anniversaire. (Assentiment).
*
* *
Audition de M. Bertrand Mathieu, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, président de l’Association française de droit constitutionnel, de Mme Anne Levade, professeure à l’université Paris-Est et de M. Dominique Rousseau, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Séance du 4 décembre 2012
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous procédons aujourd’hui à l’audition de trois universitaires, membres de l’Association française de droit constitutionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : M. Bertrand Mathieu, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, président de l’Association, Mme Anne Levade, professeure à l’université Paris-Est, et M. Dominique Rousseau, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Je les remercie de leur présence.
M. Bertrand Mathieu, professeur à l’université Paris I, président de l’Association française de droit constitutionnel. Une fois que je vous aurai expliqué le contexte de l’intervention de l’Association française de droit constitutionnel dans le suivi de la QPC, Anne Levade vous présentera le rapport intermédiaire élaboré pour le précédent garde des Sceaux. Enfin, nous vous ferons part, mesdames et messieurs les députés, d’observations plus personnelles sur le bilan de la QPC.
La garde des Sceaux, dans un courrier du 21 mai 2010, a institué un comité de suivi de la question prioritaire de constitutionnalité. Présidé par son directeur de cabinet, il est formé de membres de l’Association française de droit constitutionnel et de représentants de la Chancellerie, ainsi que du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur des affaires civiles et du sceau. L’association de la doctrine à ce suivi se référait à l’exposé des motifs du projet de loi organique qui prévoyait qu’un bilan de la mise en œuvre de la loi serait réalisé au terme des trois premières années de son application, et transmis par le Gouvernement au Parlement.
Trois axes ont été fixés dans la lettre que la garde des Sceaux nous a envoyée et que je transmettrai à votre Commission. Quatre équipes ont donc été constituées pour analyser la jurisprudence respective de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel ainsi que les décisions de plusieurs cours d’appel et de cours administratives d’appel tests, l’objectif étant de dépouiller l’ensemble des décisions rendues par ces juridictions ou par les tribunaux situés dans leur ressort.
Le cabinet du garde des Sceaux a pris l’attache des chefs de juridiction concernés pour qu’ils nous donnent accès à l’ensemble des décisions rendues. En général, un magistrat a été désigné pour nous servir d’interlocuteur. Une page a ainsi été ouverte sur le site Internet du ministère pour centraliser les informations et le travail a été effectué avec notre association, la coordination des travaux ayant été supervisée par Mme Levade. Les représentants de la Chancellerie et les responsables des équipes se sont réunis régulièrement afin de trancher les questions matérielles et de réfléchir aux problèmes de fond. Le travail a été effectué à titre gratuit par l’Association française de droit constitutionnel et ses membres, mais des vacations financées par le ministère étaient prévues pour accomplir certaines tâches de dépouillement. Un rapport d’étape que va vous présenter la professeure Levade, a donc été déposé en mars 2012.
À la suite de la formation du nouveau Gouvernement, j’ai pris contact, d’abord de manière informelle, puis de manière formelle, avec le directeur de cabinet de la nouvelle garde des Sceaux en lui transmettant le rapport d’étape et en lui demandant quelle suite il entendait donner à ces travaux. Faute de réponse, je me suis adressé directement à la garde des Sceaux, qui ne m’a pas répondu davantage.
Face à cette incertitude, les groupes de recherche ont donc pour partie suspendu leurs travaux, tout en continuant à intégrer certaines décisions qui leur ont été transmises. Juridiquement, ce comité de suivi nous semble toujours exister puisqu’il n’a pas été supprimé. Nous ne tenons pas particulièrement à occuper une position officielle, mais ce dépouillement est très lourd, il a exigé des travaux préparatoires importants et il faut en aval constituer des statistiques. Le comité ne s’est d’ailleurs pas limité au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; il s’est aussi attaqué à un terrain complètement en friche, s’agissant des décisions des juridictions du fond. Vous comprendrez que nous souhaiterions que l’incertitude soit levée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si la Chancellerie persistait dans son silence, je demanderais au président de l’Assemblée nationale que le comité de suivi puisse travailler avec notre institution, de façon que vos travaux ne profitent pas seulement aux universitaires et à leurs étudiants. Je trouverais dommage que ces efforts n’aboutissent pas.
Mme Anne Levade, professeure à l’université Paris-Est. Monsieur le président, je vous remercie pour cette information. Je vais vous indiquer comment nous avons travaillé et vous exposer les premières conclusions du rapport d’étape, rendu à la fin du premier trimestre 2012.
La méthode que nous avons suivie s’inscrit naturellement dans le cadre de la lettre de mission du garde des Sceaux. Il nous fallait aussi vérifier qu’étaient remplis les trois principaux objectifs qui avaient été définis au moment de l’élaboration de la loi organique, à savoir garantir un accès étendu à ce nouveau mécanisme de contrôle, prévenir son utilisation à des fins dilatoires, enfin assurer une articulation harmonieuse entre les juridictions.
Pour ce faire, nous avons fait un double choix méthodologique.
Le premier concernait le périmètre de la jurisprudence que nous dépouillerions de façon exhaustive. L’exhaustivité nous semblait de rigueur mais sur un échantillon précis, pour rester dans les limites du faisable. Nous avons évidemment retenu toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que celle des juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’État et la Cour de cassation. Ensuite, nous avons choisi un panel de ressorts territoriaux de cours d’appel de façon à éviter les biais. C’est la raison pour laquelle nous avons écarté d’emblée les juridictions parisiennes, qui ne sont pas révélatrices du reste du pays, et retenu les ressorts d’Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon et Versailles. Versailles présentait l’intérêt de compter un jeune tribunal administratif, celui de Montreuil. Ce choix nous a permis de constater qu’il était sollicité au titre de la QPC autant que les autres juridictions. Au sein de ces zones, nous nous sommes attachés à examiner les décisions de toutes les juridictions, judiciaires et administratives.
Le deuxième choix méthodologique a consisté à dépouiller la jurisprudence à partir de deux grilles.
La première grille d’analyse, spécifique au Conseil constitutionnel, distingue la branche du droit concernée, la nature du texte dont la disposition législative contestée est issue, le pourcentage de dispositions précédemment contrôlées dans le cadre du contrôle a priori ainsi que le type de décisions rendues. L’objectif était de dresser une typologie des décisions au fond ainsi que d’identifier la manière dont les acteurs s’étaient saisis de la QPC, c’est-à-dire quels griefs étaient soulevés, comment l’affaire était plaidée, qui la plaidait, et la façon dont le Conseil procédait.
Pour les autres juridictions, nous avons confectionné une grille unique, valable à la fois pour les juridictions de transmission, saisies au fond, et pour les juridictions suprêmes, pour ne pas introduire de distorsion entre les deux étages de juridiction. De la sorte, il était possible de voir comment les juridictions de transmission, puis de renvoi, examinaient les questions de recevabilité, et de comparer. Je rappelle que, sur la condition de caractère sérieux de la question soulevée, le législateur organique s’était interrogé sur l’opportunité de maintenir deux formulations distinctes selon le niveau de juridiction.
Cette méthodologie devait permettre d’élaborer un bilan à la fois quantitatif et qualitatif, et de déterminer si, après trois ans d’application, une révision du dispositif organique devait – ou non – être envisagée. Mais nous n’avons pas pu appliquer la méthode que nous avions prévue, car nous avons rencontré trois contraintes. Les deux premières étaient prévisibles mais nous n’avions pas anticipé la dernière.
La première était d’ordre temporel : il faisait peu de doute que la première année d’application de la QPC serait révélatrice mais ne rendrait pas compte de l’impact réel d’une réforme qui était préparée et attendue de longue date. Le nombre de QPC enregistrées cette première année n’est donc pas nécessairement représentatif de la tendance à moyen terme.
La deuxième contrainte était d’ordre substantiel. Certaines affaires emblématiques ont été soulevées d’emblée, de même que s’est produite une cristallisation du débat autour de l’articulation entre conventionnalité et constitutionnalité, et la loi organique du 10 décembre 2009 a été modifiée dès juillet 2010, afin de supprimer la formation spéciale de la Cour de cassation initialement chargée d’examiner les QPC. Dans le même temps, un premier bilan était tiré en octobre 2010 sous les auspices de la commission des Lois. Il s’agissait donc, à bien des égards, d’une année particulière.
La troisième contrainte, d’ordre matériel, tient aux conditions d’accès au corpus jurisprudentiel. Elle est en passe aujourd’hui d’être surmontée. Si nous avons reçu un très bon accueil dans la plupart des juridictions, il a été beaucoup plus difficile d’accéder à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a refusé pendant plusieurs mois de nous communiquer les jugements qui n’avaient pas été publiés. Toutefois, quelques jours avant la remise du rapport d’étape, nous avons fini par conclure avec les différentes chambres de la Cour de Cassation des conventions nous autorisant l’accès à titre gracieux à leurs décisions.
Voilà pourquoi le rapport d’étape ne comporte pas de données quantitatives relatives aux juridictions ordinaires et ne suit pas le plan qui sera retenu pour le rapport définitif.
En substance, la première conclusion du rapport est le succès rencontré par la QPC. Il tient d’abord à une mise en application immédiate et généralisée dans les deux ordres de juridiction, même s’il est logique que le juge judiciaire ait été plus fréquemment sollicité. Le comité de suivi a constaté une diversification immédiate des QPC quant à leur champ d’application matériel : toutes les branches du droit ont été concernées et tous les types de norme, qu’il s’agisse de lois antérieures ou postérieures à 1958, de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie ou des dispositions ayant fait l’objet ou non d’un contrôle a priori.
Cette diversification révèle une appropriation effective par les acteurs, notamment par les justiciables et leurs conseils, qui peut se mesurer par le nombre d’affaires, la diversité des justiciables – des personnes physiques dans trois quarts des cas et des personnes morales pour le quart restant – ; et celle des conseils. Un cinquième des affaires sont plaidées conjointement par des avocats à la Cour et des avocats aux Conseils, les quatre cinquièmes étant plaidés à parts quasi égales par chacune des deux branches de la profession, avec un petit avantage aux avocats aux Conseils.
De la même manière, les acteurs se sont bien approprié la réforme sur le fond. La lecture des décisions et des mémoires déposés montre une connaissance minimale généralisée du droit constitutionnel, même si les éléments qui sont soulevés pour fonder une QPC sont très hétérogènes. Souvent, le critère de l’applicabilité de la disposition au litige est négligé, voire pas abordé, tandis que le sérieux de la question fait l’objet de longs développements.
Venons-en aux juridictions du filtre. Elles sont tributaires de la manière dont les questions leur sont posées. La première année, beaucoup de motifs identiques ont été soulevés devant les juridictions du fond, de sorte qu’un mécanisme de régulation s’est spontanément mis en place. Les jugements et arrêts sont le plus souvent calqués sur la structure du mémoire présenté par le justiciable, ce qui signifie que la question du sérieux est prédominante et qu’il y a parfois une tendance au pré-jugement de constitutionnalité de la part des juridictions du filtre et des juridictions suprêmes. Cela étant, et contrairement à ce qu’on avait pu penser, il n’y a pas de différence significative entre la Cour de cassation et le Conseil d’État dans leur manière d’aborder les QPC. Le psychodrame autour de l’affaire Melki et du contrôle de conventionnalité ne s’est pas traduit par des approches méthodologiques distinctes.
Quant au Conseil constitutionnel, il a, lui aussi, utilisé toute la palette des solutions qui étaient à sa disposition : conformité, conformité sous réserve, abrogation totale ou partielle avec ou sans effet différé, non-lieu à statuer. De même, il a invoqué la plupart des griefs possibles dans le cadre du contrôle de l’article 61-1 de la Constitution. Parallèlement, il a prouvé sa volonté d’expliciter la réforme et de circonscrire clairement ce qui pouvait, ou non, être considéré comme des droits et libertés garantis par la Constitution, ce que n’est pas, par exemple, la reconnaissance des langues régionales mentionnée à l’article 75-1 de la Constitution. En outre, le Conseil a procédé à des modifications organisationnelles et procédurales pour traiter les QPC.
Des travaux que nous avons menés, il ressort que la mise en application de la réforme a été maîtrisée, comme l’atteste le respect des délais imposés par le législateur organique. Le délai moyen est même significativement en deçà du plafond de six mois – trois mois pour la Cour de Cassation ou le Conseil d’État, puis trois mois pour le Conseil constitutionnel.
La jurisprudence constitutionnelle a aussi définitivement réglé la question de l’articulation entre conventionnalité et constitutionnalité, ce qui explique sans doute que les mémoires sur les QPC sont désormais à peu près muets sur les questions de conventionnalité.
Enfin, le dispositif procédural au sein du Conseil constitutionnel a évolué. Le Conseil a ainsi adopté un règlement intérieur relatif à la QPC permettant de satisfaire aux exigences du droit au procès équitable.
Au terme de cette première année et compte tenu des contraintes qui ont été les nôtres, il nous a semblé que cinq questions au moins devraient être abordées dans le rapport final : la pertinence du double filtre, notamment les conditions de recevabilité et surtout la formulation de la condition de caractère sérieux des questions ; l’articulation effective entre conventionnalité et constitutionnalité qui mérite d’être appréciée sur un plus long terme ; la place effective de la QPC dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – il faut un peu de recul pour apprécier l’utilisation, à mon avis marginale, de la QPC à des fins dilatoires – ; la mutation du contrôle de constitutionnalité et l’équilibre entre contrôle a priori et a posteriori ; enfin, l’incidence sur la protection et la garantie des droits et libertés.
M. Dominique Rousseau, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Je partage le diagnostic de mes collègues quant au succès de la QPC, que je le qualifierai de juridique, de paradoxal et de fragile.
Sur le plan juridique, d’abord. Au moment de la révision constitutionnelle de 2008, la QPC est sans nul doute le point qui était le plus passé sous silence. Or, trois ans plus tard, la seule réforme véritable qui reste, et qui restera, est la question prioritaire de constitutionnalité. C’est un succès parce que les avocats comme les magistrats se sont saisis de ce nouveau moyen de droit, et même beaucoup plus rapidement qu’ils ne s’étaient saisis de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel, comprenant que ce seraient désormais les avocats qui lui donneraient du travail – et non plus les parlementaires – s’est donc efforcé de faire connaître auprès d’eux le mécanisme de la QPC tandis que, de leur côté, magistrats et avocats organisaient des cycles de formation.
Le doyen Vedel avait dit en 1990, lorsqu’il était question d’introduire une sorte de QPC, qu’il ne s’agissait ni d’un gadget ni d’une révolution. Je suis d’accord sur la première partie de l’affirmation, mais la réforme est peut-être bien une révolution, au moins dans la pratique du droit. Quand un avocat a une affaire de droit commercial, il ne peut plus se contenter de consulter le code de commerce, il doit aussi se référer à la Constitution et à la jurisprudence constitutionnelle. Les magistrats à qui il était même interdit de contrôler la constitutionnalité de la loi sont dans la même situation. La QPC a ainsi abouti à introduire dans notre pays une culture du droit qui lui manquait.
Mais l’étude que nous avons conduite m’amène à considérer ce succès comme paradoxal. À lire les travaux préparatoires et les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, il me semble que l’intention du constituant et du législateur organique était de conforter le rôle du Conseil constitutionnel comme seul juge de la constitutionnalité des lois. Or, deux ans après, selon les chiffres donnés par son secrétaire général, le Conseil constitutionnel est presque devenu le juge de l’exception et les juges administratif et judiciaire les juges constitutionnels de droit commun. Il ne s’agit pas de leur part d’une volonté de puissance ; c’est le mécanisme même de la QPC qui pousse les juges à faire du droit constitutionnel. À partir du moment où la Cour de cassation et le Conseil d’État doivent dire si la question posée par l’avocat est sérieuse, s’il y a un doute sur la constitutionnalité de la disposition législative applicable, il faut bien qu’ils fassent un premier examen de constitutionnalité.
La jurisprudence est abondante. Depuis notre rapport d’étape, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 12 avril 2012, rendu deux arrêts qui donnent le ton, même s’il ne faut pas généraliser. La constitutionnalité de l’interprétation par la chambre criminelle d’un article du code pénal qui autorise la confusion des peines était contestée au nom des droits constitutionnels reconnus aux mineurs en matière pénale. La Cour de cassation a implicitement reconnu que, jusque-là, son interprétation de cet article était inconstitutionnelle, procédé aussitôt à un changement d’interprétation et considéré en conséquence que la question n’était plus sérieuse et qu’il était donc inutile de la transmettre au Conseil constitutionnel. Autrement dit, la Cour de cassation, en faisant son travail d’examen du sérieux de la question, s’est attribué le contrôle de constitutionnalité et a réduit la compétence du Conseil constitutionnel.
La réforme a ainsi donné naissance à une forme de contrôle diffus de constitutionnalité, alors qu’il s’agissait initialement de conforter le Conseil constitutionnel. Désormais, tous les juges peuvent contrôler la constitutionnalité des lois.
Mais le succès de la QPC est fragile, pour deux raisons, non pas tant à cause de la tendance à la baisse du nombre de QPC observée cette année, qu’à cause du mécanisme même du filtre. La commission des Lois a déjà réfléchi à la question et plusieurs propositions de loi organique ont été déposées, soit pour supprimer l’examen du caractère sérieux de la question, soit pour permettre au requérant de faire appel d’une décision de non-renvoi devant le Conseil constitutionnel. Il me semble que viendra le temps où il faudra revoir le mécanisme du filtre et, peut-être, c’est un point de vue personnel, confier directement au Conseil constitutionnel la charge d’examiner la recevabilité des requêtes. Si le succès est fragile, c’est en effet parce que le mécanisme même du filtre rend l’utilisation de la QPC aléatoire.
La deuxième cause de fragilité, c’est le Conseil constitutionnel lui-même, qui doit faire le grand écart : alors qu’il est pratiquement inchangé dans sa structure, il a complètement changé dans sa fonction. Sa composition est politique, son rôle est aujourd’hui juridictionnel. Cherchez l’erreur… Pour asseoir le succès de la QPC, il faudrait renforcer la légitimité juridictionnelle du Conseil constitutionnel, sans doute en augmentant le nombre de ses membres – la moyenne européenne se situe entre douze et quinze, contre neuf en France – surtout s’il lui revient d’apprécier la recevabilité des questions. Il faudrait alors créer une chambre particulière, dont les membres ne pourraient évidemment pas siéger dans l’assemblée plénière qui délibérerait au fond.
Il conviendrait également de revoir le mode de désignation des membres, en s’inspirant de Kelsen et de l’exemple des autres pays européens qui exigent des compétences et de l’expérience en matière juridique, et une majorité positive des trois cinquièmes des parlementaires pour approuver toutes les nominations. Les anciens présidents de la République n’auraient alors plus leur place dans un Conseil devenu une véritable juridiction. Une telle réforme renforcerait la crédibilité du Conseil, qui est dorénavant en relation directe avec la Cour de cassation et le Conseil d’État. C’est à cette condition que le succès démocratique de la QPC pourra être pérennisé.
M. Bertrand Mathieu. Sur la question du filtre, la position de mon collègue n’est pas une conclusion du comité de suivi.
La première leçon que je tire de ce bilan, c’est que les pronostics ont été déjoués et que la sécurité juridique a été respectée, grâce notamment aux différents mécanismes d’application dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel. Ceux-ci ont certes soulevé beaucoup de discussions, mais ils ont contribué à la sécurité juridique.
Cette sécurité est assurée également, et c’est la raison pour laquelle je considère qu’il ne faut pas déconnecter totalement la Cour de cassation et le Conseil d’État du système, par l’autorité de chose interprétée des décisions du Conseil constitutionnel. On s’achemine petit à petit, et de manière un peu chaotique, vers une harmonisation des jurisprudences. En fait, le Conseil constitutionnel respecte l’interprétation de la loi donnée par la Cour de cassation et le Conseil d’État, qui, eux, respectent l’interprétation de la Constitution que donne le Conseil constitutionnel. Certes, il y a des dérapages, des blocages, mais, pour l’essentiel, le dispositif a amélioré globalement le fonctionnement du système juridictionnel, au-delà même du renforcement des droits et libertés fondamentaux.
Enfin, on pourrait croire que le Conseil constitutionnel intervient plus directement dans la fonction législative, en interprétant la loi, en faisant des réserves d’interprétation, en en modifiant l’application dans le temps. Or, en réalité, on s’aperçoit que, lorsque le Conseil constitutionnel traite une question, il renvoie souvent au législateur le soin de la régler. Finalement, le justiciable pose une question et le Conseil renvoie la balle au législateur. Ainsi, de manière indirecte, la QPC renforce l’intervention du législateur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce dernier point a déjà été largement débattu depuis le début de la législature. Avoir dû légiférer vite, puisque les dispositions sur le harcèlement sexuel avaient été abrogées par le Conseil dans le cadre d’une QPC, nous a amenés à nous interroger sur la tentation d’une saisine systématique du Conseil constitutionnel dès l’adoption des textes et, partant, à nous demander si nous ne légiférions pas dorénavant sous la férule du Conseil, ce qui traduirait une perte de souveraineté du législateur.
En tout état de cause, je me réjouis qu’un droit que nous voulions donner aux justiciables se soit bel et bien traduit dans les faits, car les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Il s’agissait pourtant d’un mécanisme complexe et subtil. Ces quelques années de recul nous rendent optimistes pour la suite.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’indépendance du juge vis-à-vis du législateur est un principe fondamental, mais inviter les anciens présidents de la République, comme l’a fait M. Rousseau à l’instant, à quitter le Conseil me fait m’interroger sur la légitimité respective du politique et du juge en démocratie. Sur quoi ce dernier se fonde-t-il pour juger ?
M. Dominique Rousseau. Je n’ai fait que proposer, le constituant dispose. Simplement, au terme de mon analyse, j’ai conclu qu’il serait préférable, sur le plan juridique, que les anciens Présidents ne siègent pas au Conseil constitutionnel.
Au nom de quoi les juges jugent-ils ? Au nom de principes qui ont été approuvés par le peuple : la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946 ont été plusieurs fois soumis au vote du peuple. La Constitution de 1958 a été adoptée par référendum. Les juges jugent à partir de principes écrits par le politique et confirmés par le peuple.
M. Bertrand Mathieu. L’important, c’est la cohérence démocratique. Or elle existe, même s’il y a une part d’artifice. Le Conseil constitutionnel convient qu’il n’a pas un pouvoir d’appréciation équivalent à celui du législateur. Le garde-fou du juge, c’est sa propre réserve. Il doit avoir une conception limitée de son pouvoir. Or, c’est le cas, surtout si l’on compare le Conseil constitutionnel à d’autres juridictions, notamment la Cour européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel respecte en général l’intention du législateur.
Si je suis plutôt d’accord avec Dominique Rousseau, je crois qu’il faut, d’une façon ou d’une autre, préserver un équilibre entre le politique et le juridique au sein même du Conseil.
Mme Anne Levade. Je partage la conclusion mesurée de Bertrand Mathieu. La présence des anciens chefs de l’État ne se justifie plus aujourd’hui, mais je suis pour une composition « mixte ». Il n’est souhaitable ni que le Conseil soit constitué exclusivement de magistrats ni qu’il ne compte aucun juriste.
Vous nous interrogez, madame la députée, sur le principe du contrôle des normes, c’est-à-dire du contrôle de la règle de droit. On ne juge plus en effet au nom de la loi, ou de la Loi, mais au nom de la Constitution, qui est votée par le peuple, ou par l’intermédiaire des parlementaires, en tant que pouvoir constituant.
*
* *
Audition de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation
Séance du 19 décembre 2012
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous recevons M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, accompagné de M. Jean Richard de la Tour, avocat général, et M. Pierre Chevalier, avocat général référendaire à la Cour de Cassation, sur la question prioritaire de constitutionnalité.
M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation. Plus de deux années après son entrée en vigueur, passés les premiers balbutiements, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a répondu aux espoirs attendus.
Elle constitue sans nul doute une avancée démocratique majeure dans notre État de droit, conforme aux souhaits premiers du législateur d’éliminer de notre ordonnancement juridique des dispositions législatives contraires à la Constitution.
L’encadrement procédural de la QPC, le jeu du filtrage comme le contrôle abstrait opéré par le Conseil constitutionnel renforcent la protection des droits des citoyens qui sont ainsi appelés à s’emparer de la question de constitutionnalité, sans risquer de perturber le bon déroulement du litige à l’occasion duquel elle est posée.
Le dispositif a trouvé un point d’équilibre et je voudrais saluer l’harmonie qui préside au dialogue qui s’est noué entre les juges a quo, les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel.
Je souhaite articuler mon intervention autour de trois points : l’organisation du parquet général de la Cour de cassation et l’importance de l’avis de l’avocat général ; le dispositif de la QPC, qui fonctionne bien et dont les équilibres doivent être conservés ; les quelques aménagements possibles.
Sur le premier point, une QPC transmise à la Cour de cassation ou posée à l’occasion d’un pourvoi entraîne mécaniquement la désignation d’un avocat général de la chambre concernée.
Le premier avocat général de chaque chambre est averti de l’arrivée de la QPC. La date d’audience est alors fixée en liaison avec le président de la chambre. L’avocat général désigné en est immédiatement avisé et peut travailler le dossier sans même attendre l’avis du rapporteur.
Chaque avocat général s’exprime en toute indépendance – le parquet général ne faisant pas partie du ministère public –, ce qui n’exclut pas un travail de coordination autour du procureur général dans la préparation de ses conclusions pour avoir une lecture plus transversale – inter-chambres – des questions posées. Il est destinataire, comme le rapporteur, d’une étude préalable réalisée par le service de documentation des études et du rapport de la Cour présentant la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les principes invoqués.
Enfin, dès l’entrée en vigueur de la réforme, le parquet général a mis en place des tableaux de suivi des QPC pour l’ensemble de la Cour afin d’identifier les questions connexes, de les confier à un même avocat général et d’offrir ainsi un outil de recherche des précédents performant pour tous les magistrats de la juridiction. Ces tableaux servent d’appui à l’analyse transversale des QPC posées.
Vous m’avez demandé si le ministère public faisait connaître systématiquement son avis : à la Cour de cassation, l’avocat général conclut toujours à l’occasion d’une QPC posée transmise par les juges a quo ou dans le cadre d’un pourvoi.
Devant le juge du fond, la réponse à cette question relève avant tout de la compétence du ministère de la Justice.
Cependant, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que « devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l’instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ».
Cette disposition s’applique tant en matière civile que pénale. Dans ce dernier cas, l’alinéa 1er de l'article R. 49-25 du code de procédure pénale dispose que le juge statue « après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité ». Cette règle a pour but de s'assurer que le ministère public sera mis en mesure de donner un avis dans l'ensemble des procédures pénales, y compris lorsqu'il n'est pas présent à l'audience. Elle ne souffre que d’une exception, prévue au 2e alinéa de cet article et cantonnée au contentieux pénal : « La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité », ce que la circulaire du 24 février 2010 justifie par la « bonne administration de la justice ».
Le fait de ne pas demander l’avis du ministère public est-il susceptible d’affecter la régularité de la décision rendue par le juge ? La réponse est oui puisque la Cour de cassation a estimé – dans deux arrêts de la deuxième chambre civile des 31 mai 2012 et 27 septembre 2012 – qu’elle pouvait juger irrecevable une QPC transmise alors que, devant le juge du fond, le ministère public n’avait pas été avisé.
La chambre commerciale de la Cour vient d’ailleurs de rendre deux arrêts notables sur le champ des avis obligatoires du ministère public en matière de procédures collectives.
Vous souhaitiez également connaître le taux de suivi des avis du ministère public. À partir des tableaux du parquet général, j’ai pu faire établir des statistiques.
En matière civile, sur 551 décisions, ont été rendues sur avis conforme de l’avocat général 85 % des décisions de transmission, 98 % des décisions de non-transmission et 62 % des décisions d’irrecevabilité.
En matière pénale, sur 679 décisions, ont été rendues sur cet avis conforme 92 % des décisions de transmission, 89 % des décisions de non-transmission et 80 % des décisions d’irrecevabilité.
Enfin, je réponds à votre interrogation concernant la proportion des cas dans lesquels le ministère public soulève une QPC. Devant la Cour de cassation, la question est inopérante puisque le parquet général n’est pas partie à la procédure mais intervient comme un commissaire de la loi. Mais si les textes sont muets concernant cette possibilité devant les juges du fond, je puis vous dire qu’aucune QPC n’a encore été soulevée à ce jour.
Cela étant, parce qu’il bénéficie de tous les droits et attributs d’une partie, le ministère public, partie principale, me paraît en théorie autorisé à poser une QPC.
De plus, dans la mesure où il requiert l’application de la loi, il n’est pas incohérent, au moins en droit, de soutenir qu’il puisse aussi, dans l’intérêt même de la loi, en contester la conformité aux normes supérieures. Je m’appuie à cet égard sur mon expérience de procureur général et le rôle qui m’est assigné en qualité d’autorité pouvant introduire des pourvois dans l’intérêt de la loi.
La question est plus délicate lorsque le ministère public n’est que partie jointe à la procédure car son implication est plus indirecte. Si son intervention est alors plus détachée, elle poursuit toujours la bonne application de la loi et, partant, peut en certains cas rencontrer une question propre à sa constitutionnalité.
Ces questions n’ont jamais été examinées jusqu’à présent par la Cour de cassation. Il ne semble pas que le parquet ait pris une telle initiative devant les juridictions du fond et la circulaire du ministère de la Justice 24 février 2010 précise : « il devrait être exceptionnel que le ministère public chargé de requérir l'application de la loi soulève en même temps son inconstitutionnalité, en dehors de l'hypothèse de dispositions législatives tombées en désuétude ».
Ces questionnements juridiques prennent place dans un débat plus large sur la faculté qui serait offerte aux acteurs du procès, juge ou procureur, de soulever des QPC.
Je rappelle à cet égard que la QPC est avant tout un dispositif instauré dans l’intérêt des parties citoyennes. Tout autre schéma impacterait nécessairement les fondements de la réforme. Il conviendrait alors de s’interroger sur la nature du filtrage des contrôles opérés – abstrait ou concret –, leur étendue et leur effet.
On ne peut davantage sous-estimer le danger de faire « descendre » le juge dans l’arène juridique et l’impliquer dans un débat plus politique – au sens le plus générique du terme – au risque de mettre en doute en certains cas son impartialité, notamment s’il venait à soulever une QPC sur une loi « de société ». C’est le rôle même du juge qui pourrait se retrouver modifié.
On comprend aisément qu’il puisse soulever d’office dans le procès un moyen qui défend des intérêts d’ordre public, édicté dans l’intérêt général. De même comprend-on qu’il puisse, par application de l’article 55 de la Constitution, écarter la loi lorsqu’une norme conventionnelle l’impose – et l’on sait l’importance de ce dispositif qui a conduit à des avancées majeures de notre droit.
Mais on comprendrait mal qu’il ait la faculté, en l’absence de demandes des parties ou de normes supérieures dont il assure le contrôle, de retourner son office pour introduire un débat sur la norme dont il est, selon Montesquieu, le plus fidèle interprète. On devine par ailleurs les doutes qui pourraient s’immiscer sur les intentions judiciaires poursuivies – lesquels s’accordent mal avec l’exigence de neutralité du juge et de sérénité des débats.
Toute proportion gardée, puisqu’il ne se voit pas exposé au même degré d’impartialité, le ministère public pourrait se voir opposer le même reproche. De sorte que si la faculté pour ce dernier de poser une QPC m’apparaît fondée en droit – spécialement lorsqu’il est partie principale –, la nature même de son activité, dont le rôle est de requérir l’application de la loi, et les risques que je viens d’évoquer m’inclinent à la plus grande prudence.
Si je ne sous-estime pas l’importance de ces questions, j’ai donc de fortes préventions sur une évolution du dispositif à cet égard.
Deuxième point : le système de la QPC, qui a trouvé son régime de croisière, fonctionne bien.
On s’est plu à dire, un peu vite sans doute, surtout dans les premiers temps de sa mise en œuvre, que la Cour de cassation regimbait à transmettre des questions et que sa jurisprudence, trop peu motivée, ne permettait pas d’en dégager une lecture cohérente.
Je m’inscris en faux contre cela. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la répartition des QPC posées devant le juge a quo et la Cour de cassation est équilibrée, avec environ 50 % d’entre elles pour chaque instance.
D’un point de vue qualitatif, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel des questions importantes et fondamentales relatives à la procédure pénale, l’hospitalisation d’office, l’adoption au sein de couples non mariés, la dévolution du nom patronymique, la composition de certaines juridictions, la liberté syndicale ou la procédure devant les autorités administratives indépendantes notamment.
Le parquet général a le plus souvent été fer de lance de ces transmissions, comme l’attestent les taux de suivi précédemment évoqués.
La chambre criminelle est la principale formation de la Cour concernée par la réforme : 55 % des QPC reçues relèvent de sa compétence, les cinq autres chambres se partageant les 45 % restants.
Devant la première chambre civile, le principe constitutionnel d’égalité est de loin le plus fréquemment invoqué – avec 45 % des cas – puis, par ordre décroissant, le droit de mener une vie familiale normale – 14 % des cas –, le droit à un procès équitable – 12 % –, l’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles – 11 % –, le droit de propriété
– 9 % –, les autres cas concernant la liberté matrimoniale, le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine et le principe de proportionnalité des délits et des peines.
Devant la chambre commerciale, sont invoqués en premier le droit au juge et le respect des droits de la défense, puis le principe de liberté individuelle et la garantie de cette liberté par le juge notamment, le principe du consentement à l’impôt représentant seulement 1 % des cas.
Devant la chambre criminelle, sont principalement évoqués le principe de légalité criminelle – 25 % des cas – et les principes du droit au juge et du respect des droits de la défense – 24 % des affaires.
Quantitativement, le nombre de questions transmises mis en rapport avec le ratio de déclaration d’inconstitutionnalité finalement prononcée par le Conseil constitutionnel, autour de 27 %, démontre une application raisonnée et souple du filtrage par la Cour de cassation.
Je voudrais ici insister sur le rôle de l’avis de l’avocat général.
Pour en saisir toute la portée ainsi que les potentialités des arrêts rendus, il est souvent nécessaire, voire indispensable, de lire la motivation de la décision de la Cour en se référant aux documents préparatoires.
La vision propre de l’avocat général, enrichie par les échanges noués au sein du parquet général et une lecture transversale des jurisprudences des chambres, apporte un éclairage souvent très attendu sur la réponse à apporter.
En effet, ni la préparation technique par le service de documentation de la Cour, ni le rapport objectif, aussi complet soit-il, n’expriment véritablement le sens que devrait avoir la décision. Dans ce jeu de construction intelligent que constitue l’examen de la QPC, l’avis de l’avocat général, au premier stade du litige comme en Cour de cassation, par sa richesse et la direction qu’il propose, assied la décision, quel qu’en soit le sens, et apporte le relief nécessaire à sa compréhension.
Le Conseil constitutionnel est d’ailleurs destinataire des conclusions des avocats généraux, qui sont incluses dans les dossiers qui lui sont transmis.
Enfin, on s’aperçoit que le parquet général et les chambres adoptent une ligne commune dans l’appréciation des critères de recevabilité des QPC, sous réserve de quelques nuances.
S’agissant de l’applicabilité au litige, la loi exige uniquement un lien d'applicabilité entre la QPC et la procédure à l'occasion de laquelle elle est soulevée. Il n’est donc pas nécessaire que la réponse à la question détermine l’issue du litige. Cette analyse est partagée par le parquet général et les chambres. Le taux de refus de transmission sur ce critère s’élève d’ailleurs à moins de 10 %.
Si quelques décisions – respectivement de la première chambre civile, le 14 septembre 2010, de la chambre commerciale, le 12 juillet 2011, et de la chambre criminelle, le 11 juillet 2012 – ont pu laisser croire que l’appréciation de cette condition était liée à la vérification d’un intérêt à agir de l’auteur de la question, il s’agissait avant tout dans ces affaires de donner tout son sens à la notion « d’effet utile » dégagée par le Conseil constitutionnel et de constater l’absence évidente de lien entre une éventuelle censure de la décision et la solution du litige pour se refuser à transmettre une QPC.
Bien évidemment, il faut rester vigilant pour que sous couvert « d’effet utile », la jurisprudence ne soit amenée à dénaturer le sens de ce critère, qui n’a pas à « commander » l’issue du litige.
Il appartient aussi au parquet général d’assurer ce rôle de veille, sachant que tout dépend de la nature de la QPC posée et des enjeux du litige.
Dans l’appréciation du critère d’absence de déclaration de conformité par une précédente décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, il n’y a pas non plus de divergence entre la position du parquet général et celles des chambres.
En effet, alors que, saisi d’une QPC portant sur la distinction opérée entre couples doublement infertiles et ceux dont l’un des deux membres seulement est infertile, le Conseil constitutionnel avait jugé conforme à la Constitution cette distinction établie par la loi de 1994, saisie d’une QPC portant sur la même disposition mais dans une nouvelle rédaction issue de la loi de 2004, la Cour de cassation, suivant les conclusions de son avocat général, n’a retenu aucun changement de circonstances – sans doute compte tenu de la teneur des débats préparatoires ayant présidé à l’adoption de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, confirmant l’interdiction du double don de gamètes.
Une nuance cependant mérite d’être soulignée sur le critère du changement de circonstances s’agissant d’une position prise par la chambre commerciale. Dans sa décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a en effet admis qu’une jurisprudence développée postérieurement au contrôle de constitutionnalité d’une disposition est susceptible de constituer un changement de circonstances, au sens de l’article 23-5, alinéa 3, de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, sous réserve qu’il s’agisse d’une jurisprudence constante émanant des juridictions suprêmes que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Or une cour d’appel ayant tranché un litige pendant devant elle sur le fondement d’une interprétation novatrice d’une disposition précédemment déclarée conforme à la Constitution, un pourvoi en cassation a été formé dans le cadre duquel a été soulevée une QPC portant sur la constitutionnalité de la disposition en cause, telle qu’interprétée par la cour d’appel. Le parquet général a, dans ses conclusions, soutenu que la Cour de cassation avait, dans son rôle de filtre des QPC, les mêmes pouvoirs d’interprétation que lorsqu’elle est juge de cassation de sorte qu’elle pouvait et devait confirmer ou infirmer l’interprétation novatrice retenue en appel et que, au cas où elle jugerait fondée cette interprétation, devrait être considérée comme remplie la condition tenant au changement de circonstances. La chambre commerciale a au contraire estimé, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012, « qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait issu d’une jurisprudence du Conseil d’État ou de la Cour de cassation n’est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ».
S’agissant du critère de nouveauté, à l’unisson, les chambres et le parquet général, suivant la position du Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2009, rappellent que le législateur organique a entendu imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application, en laissant dans les autres cas la Cour de cassation ou le Conseil d’État apprécier l’intérêt d’une telle saisine.
Quant au critère du caractère sérieux, il est au cœur du filtrage constitutionnel. Cadre de référence, il constitue le noyau principal de la motivation des décisions rendues.
Cette libre appréciation du sérieux de la question renvoie à l’essence de la mission juridictionnelle. Il peut arriver que ce caractère ne serve pas seulement de support à l’évaluation du doute entourant la constitutionnalité d’une disposition. Usant de sa plasticité, la Cour s’appuie aussi sur ce critère pour filtrer des QPC qui ne répondent qu’imparfaitement à la première condition légale que constitue la recevabilité.
Sur ce dernier point, à l’occasion d’une affaire particulière, siège et parquet général ont développé une analyse divergente. Il s’agissait de savoir si le critère du caractère sérieux pouvait avoir pour objet ou pour effet de sanctionner des choix procéduraux contestables d’une partie. Deux personnes de même sexe avaient saisi par requête conjointe un tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’autorisation de faire célébrer leur mariage par l’officier d’état-civil en déposant le même jour deux QPC portant sur la constitutionnalité des articles 144 et 75 du code civil. Or aucune formalité préparatoire à la conclusion du mariage n’avait préalablement été engagée par ces personnes. La QPC avait été posée à l’occasion d’une instance artificiellement ouverte pour en permettre l’examen : la recevabilité de ces questions devant le juge du fond était donc discutable au regard de l’article 61-1 de la Constitution puisque les requérants agissaient en justice à seule fin d’obtenir l’éviction de dispositions dont elles redoutaient l’application – celles-ci pouvant conduire l’officier d’état civil ou le procureur de la République à s’opposer à leur union. Certes, la Cour de cassation, instance de filtrage, n’avait pas à se faire juge de la recevabilité de la question admise par le juge a quo, mais ne pouvait-on cependant envisager, pour sanctionner la manœuvre procédurale, qu’elle déporte le sujet sur le terrain du caractère sérieux de la question posée, ainsi que le suggérait l’avocat général ? Empruntant une voie inverse, sans doute en raison de l’importance des enjeux posés, la chambre a, dans un arrêt du 16 novembre 2010, décidé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Ce faisant, elle a opté pour une analyse objective du lien entre la QPC et la procédure à l’occasion de laquelle elle a été soulevée – ce qui paraît conforme à l’interprétation du critère d’applicabilité au litige « dépris de tout caractère déterminant sur son issue », ainsi qu’à pu le remarquer le conseiller rapporteur.
Enfin, la Cour de cassation prend en compte la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel. C’est ainsi qu’elle a fait siennes les « motivations » constitutionnelles sur le principe d’égalité, le droit de propriété, la notion d’effet utile ou celle de droit vivant.
De même, les réserves interprétatives, qu’elles soient neutralisantes, directives ou constructives, s’imposent à elle comme une condition inséparable de la décision.
Ces réserves ont le mérite de la clarté : elles doivent être préférées, à cet égard, à l’exercice difficile d’interprétation que constitue l’analyse des motifs des décisions du Conseil – j’ai notamment en mémoire les difficultés posées par la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 sur le volet transitoire de la loi du 4 mars 2002, dite « anti-Perruche », et les approches opposées de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
Mais ces réserves me semblent devoir rester limitées, d’une part pour ne pas figer une jurisprudence – qui est toujours tributaire d’un contexte et qui par nature est appelée à se développer – et, d’autre part, pour laisser au seul juge l’exercice de sa mission d’interprète de la loi.
De même, la QPC peut avoir un effet indirect sur une jurisprudence. Dans plusieurs affaires, la Cour de cassation a ainsi modifié opportunément sa jurisprudence à la faveur d’une QPC afin de prévenir la censure d’anticonstitutionnalité. Il ne s’agit pas d’éluder la question ou de priver le Conseil constitutionnel de son contrôle mais, par une technique efficace et rapide, de rétablir une conformité de la loi à la Constitution mise en doute par la critique faite à la jurisprudence.
Dans ces conditions, plusieurs aménagements à la marge du régime de la QPC sont possibles.
Je rappelle que, sur la compétence propre des chambres pour traiter des QPC, passé le temps de l’émoi suscité par le transfert de compétence de la formation spécialisée aux chambres de la Cour selon leurs attributions, force est d’observer que ce transfert a conduit à confier l’examen de la question aux magistrats spécialisés dans le contentieux concerné et à une rationalisation tant dans le traitement des dossiers que dans l’étude des moyens lorsque la question est adossée à un pourvoi.
Quant au double filtrage, il présente plusieurs avantages : il permet au juge du fond, au plus près des éléments du litige, de se positionner sur la question de constitutionnalité, et à la Cour de cassation, dans son rôle régulateur, d’asseoir une « jurisprudence sur le filtrage constitutionnel ». Il est important de conserver les critères distinctifs, encore jeunes, entre ces deux instances. Aussi, même si elle peut apparaître subtile, la nuance entre « question non dépourvue de caractère sérieux » devant le juge du fond et « question présentant un caractère sérieux » reflète le rôle régulateur de la Cour.
Cependant, même si les critères de transmission ne sont pas rigoureusement identiques pour la Cour et les juridictions du fond, on peut regretter que, dans certains cas, les décisions de transmission par les juges a quo soient peu motivées et laissent en définitive à la Cour le soin de trancher.
Par ailleurs, ne serait-il pas utile de transmettre au Conseil constitutionnel les conclusions des avocats généraux, y compris en cas de décision de non-transmission ? Aujourd’hui, comme le prévoient les textes, ces conclusions ne sont transmises que lorsqu’il y a une décision de renvoi. Il me semble possible d’envisager une évolution sur ce point à seule fin de permettre au Conseil constitutionnel de mieux comprendre, par l’éclairage de ces conclusions, la décision de non-transmission qui a été prise.
De plus, pour éviter que les QPC posées devant le tribunal correctionnel ne retardent l’issue du procès, il pourrait être envisagé d’étendre en matière correctionnelle la règle posée par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée en matière criminelle chaque fois que le procès fait suite à une information judiciaire. Je rappelle que cet article dispose que le moyen de non-constitutionnalité « ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation ».
Quant aux débats autour de l’effet dilatoire – lié à des questions tardives ou à des questions multiples posées dans la même instance à l’occasion d’audiences successives –, ils renvoient au problème de l’absence de délai prévalant pour les juridictions du fond pour statuer sur les QPC. Il faudrait donc fixer aux juges a quo le même délai que celui imparti aux cours suprêmes à cet effet. Or je rappelle que la loi organique précise que la réponse apportée doit intervenir « sans délai », ce qui peut vouloir dire immédiatement ou bien sans aucun délai précis – comme c’est, dans les faits, assez souvent le cas.
S’agissant enfin des questions sérielles, aux termes des articles 126-5 du code de procédure civile et R. 49-26 du code de procédure pénale, le juge n’est pas tenu de transmettre une QPC mettant en cause, pour les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel sont déjà saisis. Néanmoins, on a constaté que, malgré l’actualisation et la mise en ligne par les services de la Cour de cassation d’un tableau sur les dispositions législatives examinées par elle, des juridictions du fond ont tout de même transmis des QPC sur ces dispositions. Dès lors, il pourrait être utile, dans ce cas, de prévoir une obligation de surseoir à statuer.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Lorsqu’elle avait débattu de la QPC, la commission des Lois avait proposé de fixer un délai pour la décision du juge a quo, puis avait accepté la solution consistant à préférer l’expression « sans délai » – laquelle signifiait, pour nous, immédiatement.
Par ailleurs, alors que devant les juges du fond, la question est transmise dès lors qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux, devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, elle doit présenter un tel caractère. Cette distinction est souvent justifiée par le rôle régulateur que devraient jouer les cours suprêmes. Elle apparaît quelque peu byzantine. Pensez-vous qu’elle doive être maintenue ?
Enfin, lors de son audition, le Premier président de la Cour de cassation a critiqué la pratique du Conseil constitutionnel consistant à formuler régulièrement des réserves d’interprétation, qui peuvent, selon lui, empiéter sur le rôle interprétatif du juge ordinaire : partagez-vous cette critique ?
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Quels sont le motif et la nature juridique de la transmission du dossier d’une QPC par le Conseil d’État ou la Cour de cassation au Conseil constitutionnel lorsque celui-ci n’en est pas saisi ? Quelles seraient les conséquences de la transmission de l’avis du parquet que vous suggérez ?
Ne crée-t-on pas un ordonnancement totalement nouveau, d’ordre juridictionnel, dans lequel une cour suprême remplacerait le Conseil constitutionnel, notamment au travers du contrôle de constitutionnalité en négatif qu’elle exerce de fait ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le degré d’indépendance des magistrats du parquet lorsqu’ils concluent devant les juridictions judiciaires du fond ne pourrait-il être accru s’agissant des QPC, notamment au regard de celle prévalant dans les juridictions administratives ? Dans quelle mesure la circulaire du garde des Sceaux de février 2010 encadre-t-elle leur pouvoir d’appréciation ?
Vous avez souhaité qu’il n’y ait pas de QPC sur les questions sociétales, tout en évoquant certains exemples de ce type : pouvez-vous préciser votre position à cet égard ?
M. Jean-Claude Marin. Monsieur le président, il apparaît que les décisions rendues par les juges a quo sur les QPC doivent être davantage encadrées en termes de délai et de motivation, à la lumière, non de la vision théorique qui prévalait nécessairement au moment du débat parlementaire, mais de la pratique des juridictions que nous connaissons désormais.
Par ailleurs, il faut entendre par « question non dépourvue de caractère sérieux » qu’il existe une probabilité qu’elle pose un problème de constitutionnalité, alors que la Cour de cassation a, dans son rôle régulateur, un devoir d’une autre ampleur : déterminer de façon claire et précise si la question présente ou non un caractère sérieux, c’est-à-dire, pose ou non un problème que le Conseil constitutionnel doit être amené à trancher. Nous ne sommes pas alors dans l’hypothèse mais dans le constat. La distinction n’est donc pas byzantine.
Je n’ai pas tout à fait la même lecture que le Premier président sur les réserves d’interprétation, qui sont en général davantage motivées que les décisions de censure ou de conformité du Conseil constitutionnel : elles donnent corps à une déclaration de constitutionnalité, en précisant les conditions de celle-ci. Le Conseil est donc là dans son rôle : il ne s’agit pas d’une substitution aux ordres juridictionnels judiciaires et administratifs, mais plutôt de guides utiles.
Monsieur Le Bouillonnec, les transmissions de dossiers qui ne donnent pas lieu à saisine du Conseil contribuent simplement à son information. Cette pratique participe du dialogue des juges sur les critères de transmission, qui est important. Cela donne corps à la philosophie du filtrage et à la nécessaire compréhension du positionnement de chacun des ordres juridictionnels.
Madame Bechtel, je ne suis pas contre la saisine du Conseil constitutionnel sur des questions relatives à des problèmes de société : j’ai seulement dit que donner à un magistrat le pouvoir de soulever d’office une QPC à propos de l’application d’une telle loi risquait de le placer dans une position où son impartialité objective pourrait être mise en cause !
Par ailleurs, je rappelle que les rapporteurs publics et les avocats généraux de la Cour de cassation s’expriment en toute indépendance : le seul pouvoir du procureur général serait de leur retirer un dossier, ce qu’il n’a jamais fait.
S’agissant des parquets des juridictions du premier ou du second degré, ils ont une liberté totale dans les affaires individuelles : en matière civile et commerciale, les directives posées par la chancellerie, notamment dans la circulaire du 24 février 2010, sont générales. Par ailleurs, la garde des Sceaux a décidé, dans une récente circulaire, de ne plus donner d’instructions individuelles, comme les articles 30 et suivants du code de procédure pénale l’autorisent à le faire. Je ne doute donc pas que devant les juridictions civiles ou commerciales, voire pénales, le parquet manifeste une totale indépendance. Cette question donne lieu à beaucoup de fantasmes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie de cette contribution à nos travaux qui devront aboutir pour le troisième anniversaire de la QPC.
*
* *
Audition de Me David Lévy, avocat, directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux, et de Me Catherine Saint-Geniest, avocate, membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris
Séance du 19 décembre 2012
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous accueillons Me David Lévy, directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux, et Me Catherine Saint-Geniest, membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Me David Lévy, avocat, directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est la révolution juridique majeure de la Ve République. Elle marque l’entrée dans une période qui voit s’affirmer la culture de la Constitution à la place de la culture de la loi qui prévalait depuis 1789.
Elle est d’autant plus importante pour les avocats qu’ils ont pleinement soutenu sa création. Elle constitue en effet un moyen utile de défense des droits et libertés de leurs clients.
La Constitution devient ainsi une norme juridique prescriptive de comportements, d’obligations de faire ou de ne pas faire. Elle est opposable à tous et tous sont obligés par elle.
Dans le cadre de cette audition, vous nous avez adressé neuf questions auxquelles nous nous proposons de répondre en deux temps, pour tenter de faire un bilan de la mise en œuvre de la QPC depuis le 1er mars 2010. De fait, s’il s’agit d’une révolution juridique réussie, certains points peuvent faire l’objet de réflexions en vue de leur amélioration.
La réussite de la QPC tient à trois facteurs principaux.
Premier facteur : les avocats se sont appropriés la réforme, notamment grâce à des actions de formation de la profession.
Ainsi, dès 2009, le Conseil national des barreaux a organisé, avec le Conseil constitutionnel, deux journées de formation sur la QPC. Nous avons également mis en œuvre, dès la même année, un module de formation à la QPC dispensé dans les écoles d’avocats et dans les barreaux qui le souhaitent. Il s’agit de faire comprendre aux avocats et aux praticiens le fonctionnement procédural de cette nouvelle voie de droit et de sensibiliser les avocats au contentieux constitutionnel – qu’ils ignoraient pour la plupart, dans la mesure où ils n’avaient pas accès au prétoire du Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi.
Le Conseil national des barreaux a également mis en ligne sur son site Internet des modèles de mémoires pour les QPC destinés à servir de trame aux avocats.
Au-delà d’une simple sensibilisation, il a voulu créer chez les avocats un véritable « réflexe constitutionnel » pour qu’ils puissent s’interroger sur l’aspect constitutionnel de leurs dossiers et la possibilité de poser une QPC.
En matière de formation des avocats et des magistrats, il faut également saluer le rôle du Conseil constitutionnel – et de son président, M. Jean-Louis Debré. Son site Internet permet ainsi désormais l’accès à l’ensemble des documents dont disposent les membres du Conseil lorsqu’ils statuent sur une QPC, qu’il s’agisse du dossier documentaire, du rapport, de la version consolidée de la loi en cause ou des mémoires.
Surtout, le Conseil a diffusé, dès fin 2009, sous la forme d’un CD-Rom, l’ensemble des tables des 50 premières années de sa jurisprudence. De même, il tient à jour, sur son site Internet, une « liste positive », recensant l’ensemble des dispositions législatives sur la constitutionnalité desquelles il s’est prononcé.
Par ailleurs, les juridictions suprêmes que sont le Conseil d’État et la Cour de cassation mettent à jour de précieux tableaux de suivi de l’examen des QPC en cours devant elles.
Deuxième facteur de succès : globalement, la procédure de la QPC fonctionne bien devant les juridictions du fond, les juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire et le Conseil constitutionnel.
Le dispositif mis en œuvre permet d’identifier la question prioritaire de constitutionnalité et de la traiter distinctement. Surtout, il garantit à la procédure le caractère contradictoire, auquel les avocats sont très attachés.
De plus, sous réserve du respect de l’obligation de statuer « sans délai » sur la QPC, les juges du fond ont globalement joué le jeu.
Par ailleurs, le bilan est très positif en ce qui concerne le déroulement de l’instance devant le Conseil constitutionnel. Si l’instruction est organisée selon un règlement de procédure en vue de traiter les QPC dans un délai de trois mois, elle n’en permet pas moins le respect du principe du contradictoire. En outre, elle permet, notamment par le double jeu d’observations des parties à l’instance, d’identifier précisément les seuls problèmes juridiques de nature constitutionnelle devant être discutés à l’audience.
Enfin, doit être mise au crédit du Conseil constitutionnel la décision rapide de modifier ce règlement intérieur pour accepter les interventions de tiers à l’instance ayant un intérêt spécial à agir. Ce fut notamment le cas à l’occasion de la décision rendue le 28 janvier 2011 sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe.
Troisième facteur de réussite : la QPC constitue un élément de sécurité juridique.
Dans les commentaires que le Conseil constitutionnel fait des décisions qu’il rend, il met en avant l’idée que les effets de la décision sur la QPC doivent bénéficier en premier lieu à celui qui l’a posée. Il peut néanmoins exister une exception à ce principe dès lors que l’abrogation immédiate de la disposition législative inconstitutionnelle emporterait des conséquences manifestement excessives. Le Conseil met ainsi en balance l’intérêt subjectif de la personne ayant posé la QPC à obtenir la défense de ses droits et les effets qu’une abrogation immédiate aurait pour l’ensemble des autres justiciables concernés par le même problème juridique.
D’ailleurs, dans la première affaire plaidée en la matière devant le Conseil, l’avocat a gardé une partie de son temps de plaidoirie pour discuter avec lui des effets de sa décision en cas d’inconstitutionnalité des dispositions législatives cristallisant les pensions.
Malgré cette réussite d’ensemble de la QPC, plusieurs améliorations peuvent lui être apportées. Quatre pistes méritent d’être retenues.
D’abord, le juge du fond doit porter une attention plus soutenue à l’obligation de statuer « sans délai », laquelle a deux conséquences : répondre dans les meilleurs délais – et non dans un laps de temps considérable qui ralentit inutilement la procédure – et ne pas joindre la décision sur la QPC à la décision au fond, ce qui allonge encore le délai de réponse de celui du délibéré.
Je rappelle que l’esprit de la QPC est de savoir si la disposition législative en cause dans le litige au fond est ou non conforme à la Constitution.
La deuxième piste consiste à ouvrir la réflexion sur la représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour défendre certaines QPC devant les cours suprêmes.
L’intervention de l’avocat se confond en effet avec les règles de représentation en justice. Ainsi, le justiciable doit prendre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation lorsque la QPC est transmise à l’une de ces juridictions suprêmes dans les matières où une telle représentation est obligatoire.
Cette obligation n’est pas forcément justifiée et elle constitue un facteur de renchérissement du coût d’accès à la procédure pour les justiciables. On pourrait donc ouvrir la défense d’une QPC devant les cours suprêmes à tout avocat dans toutes les matières.
Quant au double filtre, il se justifie parfaitement. Il permet d’éviter des QPC fantaisistes ou à caractère purement dilatoire. Il faut en effet trouver un équilibre entre l’accès du justiciable à la protection de ses droits et libertés et la capacité du juge constitutionnel d’assurer sa mission – et ainsi conserver à la QPC son attractivité.
Globalement, ce double filtre fonctionne de façon satisfaisante. Mais la manière dont le Conseil d’État et la Cour de cassation le mettent en œuvre soulève plusieurs questions. Alors que la pratique du Conseil d’État consiste à vérifier s’il existe un doute raisonnable sur la constitutionnalité de la disposition législative en cause, celle de la Cour de cassation, qui s’appuie plutôt sur l’idée du doute manifeste, va beaucoup plus loin.
Une autre difficulté tient à ce que, si la QPC n’est pas transmise, le justiciable ne dispose d’aucun moyen de contester cette décision, notamment s’il a posé la question pour la première fois devant l’une des hautes juridictions. Il faudrait donc voir dans quelle mesure les décisions de refus de transmission des QPC au Conseil constitutionnel pourraient être réexaminées. Votre Commission avait d’ailleurs, lors d’auditions menées en septembre 2010, examiné cette possibilité.
Il faudrait à cet égard évaluer l’opportunité de maintenir deux filtres : on pourrait en garder un et réfléchir à la possibilité de prévoir des voies de contestation des décisions de refus de transmission.
Enfin, on pourrait renforcer les moyens du Conseil constitutionnel. Si le caractère juridictionnel de cette instance est indiscutable, sa fonction a considérablement évolué depuis sa création. On peut donc s’interroger sur l’opportunité d’augmenter le nombre de ses membres au regard de l’important contentieux qu’il a à traiter.
De plus, les statistiques qui vous ont été communiquées par les personnes que vous avez auditionnées montrent que la QPC mobilise beaucoup les juridictions et représente un grand nombre de contentieux. Par ailleurs, on observe une augmentation du nombre de décisions résultant d’une saisine a priori par les députés et sénateurs. Se pose dès lors la question de savoir si le Conseil aura les capacités matérielles et humaines de pouvoir instruire ces affaires dans le cadre des délais qui lui sont impartis.
En conclusion, la QPC constitue une réforme extrêmement positive et un apport fondamental à l’État de droit et à la protection des droits et libertés des citoyens, qui se sont ainsi appropriés la Constitution.
Me Catherine Saint-Geniest, avocate, membre du Conseil de l’ordre du barreau de Paris. En complément des observations du Conseil national des barreaux, je souhaite évoquer la question de l’aide juridictionnelle. Celle-ci ne fait pas l’objet d’un régime spécifique : dans un dossier bénéficiant déjà de cette aide, s’il y a une QPC à déposer, sont attribuées à l’avocat chargé de ce dossier seize unités de valeur complémentaires, pour un montant dérisoire de 365,44 euros hors taxes pour toute la procédure – à savoir l’étude du dossier, la rédaction d’un mémoire assez technique et sa soutenance à l’audience. La QPC pose donc un problème de valorisation pour les avocats.
Si celle-ci constitue à la fois un succès incontestable et un instrument démocratique extraordinaire, la reproduction du monopole de représentation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation s’apparente à un archaïsme dépourvu de sens. En effet, quand on dépose une QPC devant une juridiction du fond, l’avocat en charge de l’affaire peut la défendre, mais quand la question est transmise au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sauf dans des matières très limitées – droit pénal, droit du travail, droit électoral – dans lesquelles tout avocat peut intervenir, il faut recourir à un avocat aux Conseils alors que le sujet est exactement le même ! Cela est d’autant plus absurde qu’ensuite, devant le Conseil constitutionnel, tout avocat peut intervenir.
Ce monopole ne va dans le sens ni du droit, ni des réformes successives de la procédure, et ne se justifie ici par aucune compétence spécifique : il faut donc y remédier, d’autant qu’il alourdit le coût de la procédure à la fois pour le justiciable et pour l’État – il faut ouvrir un nouveau dossier d’aide juridictionnelle.
Enfin, on observe une incohérence entre les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’État, celui-ci vérifiant l’existence d’une chance de succès sérieux de la QPC pour la transmettre au Conseil constitutionnel alors que la Cour exige plus strictement des chances de succès indéniables. Cela n’a pas de sens : les critères retenus par ces instances devraient être les mêmes en la matière.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vous indiquez que certaines juridictions du fond ignorent leur obligation d’examiner les QPC « sans délai », c’est-à-dire immédiatement : ce phénomène est-il fréquent ? Si tel était le cas, ce serait contraire à l’intention du législateur organique.
Deuxièmement, vous suggérez que la Cour de cassation est plus restrictive que le Conseil d’État – en quelque sorte, plus « généreux » – dans son interprétation : or son procureur général vient de laisser entendre que tel n’est pas le cas. Qu’en est-il exactement ?
Enfin, pourriez-vous préciser la procédure par laquelle vous estimez que les refus de renvoi de QPC devraient pouvoir être contestés ?
M. Philippe Gosselin. Nous n’avons pas encore mesuré tous les effets de la révolution que constitue la création de la QPC.
Comment envisagez-vous de revaloriser l’aide juridictionnelle dans ce domaine ? Une telle revalorisation est-elle séparable d’une réforme globale de cette aide ?
Par ailleurs, pourriez-vous préciser la réforme du Conseil constitutionnel que vous appelez de vos vœux ?
M. Jean-Frédéric Poisson. La création de la QPC est une réforme utile et démocratique, même si nous n’en avons pas en effet tiré toutes les conséquences pratiques. Devrait-elle, selon vous, conduire à modifier la spécialisation des avocats et leur capacité à intervenir devant les différentes juridictions ?
Me David Lévy. Nous avons remarqué, dès le début de la mise en œuvre de la QPC, la difficulté de certaines juridictions du fond à statuer « sans délai ». Des avocats nous ont indiqué que lorsqu’ils posaient une QPC, les magistrats prenaient du temps pour répondre et, surtout, joignaient leur décision sur ce point à la décision au fond – ce qui, comme je l’ai dit, fait perdre le temps du délibéré, qui peut parfois être relativement long. Nous leur avons conseillé de se rapprocher du référent mis en place à l’époque dans chaque cour d’appel pour superviser la mise en œuvre de la QPC, afin de voir avec lui comment faire évoluer la pratique. Mais nous n’avons pas fait d’enquête systématique sur ce sujet.
Je précise que des magistrats sont présents lorsque nous nous rendons dans les barreaux pour assurer des formations sur la QPC et qu’ils dialoguent avec nos confrères avocats, ce qui participe à la bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l’interprétation de la Cour de cassation est en effet relativement restrictive, non forcément quantitativement, mais dans la rigueur qu’elle met à apprécier les critères du filtre de la QPC. Je rappellerai à cet égard notamment la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2010, selon laquelle la QPC ne concerne pas seulement la disposition législative mais aussi l’interprétation qui peut en être faite par le juge dans le cadre d’une jurisprudence constante lui donnant sa portée effective, et les jurisprudences récentes de la Cour de cassation, faisant application d’une interprétation du Conseil constitutionnel pour refuser de transmettre une QPC à celui-ci.
Quant à dire que le Conseil d’État serait plus généreux, je ne sais pas si cet adjectif est approprié. Mais la QPC est un tel succès qu’elle a dépassé l’intention première du constituant et du législateur organique – tendant à renforcer le rôle du Conseil constitutionnel –, dans la mesure où elle a conduit, non à un contrôle concentré de constitutionnalité a posteriori, mais à un contrôle diffus, par le fait même qu’il est négatif. En effet, le Conseil d’État et la Cour de cassation sont des juges de la constitutionnalité de la loi lorsqu’ils ne renvoient pas une QPC au Conseil constitutionnel.
Pour les cas de refus de transmission d’une QPC au Conseil, le rapport de votre Commission avait évoqué trois possibilités : l’évocation, l’appel ou la demande d’une nouvelle délibération au juge ayant refusé la transmission.
L’évocation – consistant à choisir les affaires les plus importantes devant faire l’objet d’une jurisprudence, à l’instar de ce que fait la Cour suprême américaine – n’est pas dans notre tradition juridique. Le juge en France ne choisit pas son contentieux.
Quant à la voie de l’appel devant le Conseil constitutionnel, elle impliquerait de créer en son sein une chambre d’appel ou de recevabilité, ce qui aurait une conséquence sur le nombre de membres du Conseil pouvant siéger sur la QPC admise, car on voit mal un membre ayant siégé sur la recevabilité de la requête statuer ensuite sur le fond.
Enfin, on peut envisager de demander au Conseil d’État ou à la Cour de cassation de délibérer de nouveau, dans une formation différente, sur la QPC dont le renvoi a été refusé.
S’agissant de la réforme du Conseil constitutionnel, le Conseil national des barreaux n’a pas de doctrine. Mais votre Commission avait évoqué des pistes d’amélioration au moment de la réforme constitutionnelle. La première consisterait à augmenter le nombre des membres pour le porter entre 12 et 15 – ce qui correspond à la moyenne des juridictions constitutionnelles européennes. Une deuxième conduirait à réfléchir à la procédure de nomination, qui pourrait reposer sur un vote positif des trois-cinquièmes des membres des commissions parlementaires concernées. Une troisième pourrait conduire à s’interroger sur l’opportunité de demander que les candidats à la fonction de membre du Conseil aient une qualification juridique par un diplôme, une formation ou une expérience professionnelle. Il appartient au Parlement d’en décider.
Me Catherine Saint-Geniest. Les QPC constituent une goutte d’eau dans l’aide juridictionnelle. De manière plus générale, l’accès au droit soulève un problème au barreau de Paris, mais surtout dans d’autres barreaux comme celui de Bobigny ou d’Évry, qui sont totalement débordés par l’aide juridictionnelle. En effet, le barreau de Paris est suffisamment important pour que les dossiers d’aide juridictionnelle soient distribués uniquement auprès des avocats volontaires, mais cela ne les empêche pas d’être très médiocrement rémunérés !
Au-delà de la revalorisation de la rémunération des avocats, l’accès au droit pose le problème de toute cette partie de la population qui ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle – en raison du plafond très bas d’éligibilité – sans pour autant avoir les moyens de s’offrir un accès à la justice convenable.
Monsieur Poisson, je pense qu’un avocat pratiquant le contentieux dans sa matière est parfaitement à même de déposer une QPC, de la soutenir et de rédiger le mémoire à cette fin. La gestion contentieuse d’un dossier de QPC est très simple et les avocats sont extrêmement bien accueillis devant le Conseil constitutionnel. Et lorsque se pose un problème technique spécifique à ce sujet, les avocats à la cour d’appel peuvent, comme ils le font par ailleurs, consulter un autre professionnel du droit.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie pour votre contribution à nos travaux qui aboutiront à un rapport d’information avant le troisième anniversaire de la mise en œuvre de la QPC, comme la commission des Lois l’a décidé.
1 () Le compte rendu de ces auditions figure en annexe.
2 () Ces difficultés ont été présentées à la commission des Lois par M. Bertrand Mathieu et Mme Anne Levade, qui sont membres du comité de suivi de la question prioritaire de constitutionnalité mis en place par l’association, au cours de leur audition du 4 décembre 2012, reproduite en annexe.
3 () Le ministère de la Justice a toutefois adressé à votre rapporteur, juste après que le présent rapport avait été envoyé aux membres de la Commission, des éléments généraux sur le traitement des QPC par certaines catégories de juridictions civiles. Ce document est reproduit en annexe. L’envoi tardif de ces éléments n’a pas permis de les exploiter.
4 () Le texte des différents questionnaires figure en annexe.
5 () Il s’agit de l’association France nature environnement, de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Finistère, du département de Seine-Saint-Denis, de la société anonyme Paris Saint-Germain football, de l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, de la Banque populaire Côte d’Azur et du syndicat Sud AFP.
6 () « La Constitution dans les prétoires », in Dominique Rousseau (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, 2e éd., Lextenso éditions, 2012, p. 1.
7 () On dénombre 64 décisions QPC en 2010, 110 en 2011, 74 en 2012 et 7 jusqu’au 1er mars 2013. Voir les tableaux en annexe du présent rapport.
8 () Décisions dites « DC » (contrôle de constitutionnalité des lois et lois organiques, des traités et des règlements des assemblées).
9 () L’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité.
10 () Ce chiffre présente deux différences avec les données précédentes relatives au Conseil constitutionnel : il porte sur une période plus courte (jusqu’au 31 octobre 2012, et non jusqu’au 31 mars 2013) et incluent les décisions de la Cour de cassation concluant à l’absence de transmission au Conseil constitutionnel.
11 () Données fournies par les services de la Cour de cassation lors de l’audition son premier président, M. Vincent Lamanda, le 21 novembre 2012. Votre rapporteur n’a pu obtenir de données plus récentes. Voir le tableau en annexe pour des chiffres plus récents sur le nombre de QPC soumises à la Cour.
12 () Lors de son auditions par la commission des Lois, le 21 novembre 2012.
13 () Lors de son audition par la commission des Lois, le 21 novembre 2012.
14 () Voir les tableaux en annexe pour plus de détails.
15 () Voir en annexe le compte rendu de l’audition par la commission des Lois du 21 novembre 2012.
16 () M. Jean-Marc Sauvé, audition précitée.
17 () Voir en ce sens l’intervention de M. Marc Guillaume devant la commission des Lois le 21 novembre 2012 (en annexe du présent rapport).
18 () « La réforme de l’exception d’inconstitutionnalité ne vient-elle pas trop tard ? Il est malaisé de s’affranchir de ce sentiment au vu de l’expansionnisme du contrôle de conventionalité (article 55 de la Constitution) au service de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette procédure conquérante, exercée par toutes les juridictions ordinaires et la Cour de Strasbourg, apparaît d’ores et déjà comme un substitut au contrôle par voie d’exception, devenu entre-temps superfétatoire » écrivait ainsi le professeur Jean Gicquel en 2008 (« L’article 26 », Les Petites Affiches, 14 mai 2008, n° 97, p. 77).
19 () Exercé par tout juge ordinaire, le contrôle de conventionalité consiste à vérifier la compatibilité entre la loi et les engagements internationaux de la France, en application de l’article 55 de la Constitution.
20 () Christine Maugüé et Jacques-Henri Stahl, La question prioritaire de constitutionnalité, 2e éd., Dalloz, 2013, p. 261.
21 () Voir supra, a.
22 () Lors de son audition par la commission des Lois, le 19 décembre 2012.
23 () Voir infra, II, B, 2, a.
24 () Parmi lesquels le rapport d’information de M. Jean-Luc Warsmann, alors président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, intitulé « Loi organique relative à l’application de la question prioritaire de constitutionnalité : première évaluation de la procédure », n° 2838, octobre 2010.
25 () Source : site Internet du Conseil constitutionnel.
26 () Voir en annexe le compte-rendu de cette audition. Depuis, il n’a pas été donné de suite à ces travaux par le ministère de la Justice.
27 () Voir la synthèse sur le site Internet du GIP « Droit et justice » : Emmanuel Cartier, « La question prioritaire de constitutionnalité. Étude sur le réagencement du procès et de l’architecture juridictionnelle française », octobre 2012.
28 () « La doctrine constitutionnaliste a été rejointe dans son rôle de commentateur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel par les autres doctrines juridiques, ce qui marque un succès considérable de la QPC. La jurisprudence du Conseil constitutionnel n’est plus l’objet exclusif des constitutionnalistes. Elle concerne toute la doctrine juridique » écrit ainsi le professeur Xavier Magnon (« La doctrine, la QPC et le Conseil constitutionnel : Quelle distance? Quelle expertise? », RDP, 2013, p. 141).
29 () Source : site Internet du Conseil constitutionnel, bilan de la QPC au 1er mars 2013.
30 () Conseil constitutionnel, décision n° 2011-4538 du 12 janvier 2012, Élections sénatoriales du Loiret. Cette possibilité a été consacrée dans un nouvel article 16-1 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, introduit par une décision du Conseil constitutionnel du 22 février 2013 (n° 2013-126 ORGA), entrant en vigueur le 1er avril 2013.
31 () « Le texte proposé [dans le projet de loi organique] ne permet (...) pas de préjuger dans quelle mesure le Conseil constitutionnel statuant comme juge des élections législatives et sénatoriales (voire comme juge des incompatibilités et inéligibilités survenues en cours de mandat), ou comme juge de certaines opérations préalables à l’organisation des référendums, pourrait admettre une question de constitutionnalité directement soulevée devant lui. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de tirer lui-même les conséquences de la réforme constitutionnelle » écrivait le rapporteur de la commission des Lois, M. le président Jean-Luc Warsmann (rapport sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, n° 1898, septembre 2009, p. 42).
32 () Audition par votre commission des Lois le 21 novembre 2012 (données au 31 octobre 2012).
33 () Source : Cour de cassation, à partir du dépouillement des QPC renvoyées entre septembre 2010 et octobre 2012.
34 () Source : Cour de cassation, à partir du dépouillement des QPC renvoyées entre mars 2010 et octobre 2012.
35 () En matière pénale : 28 renvois sur 273 décisions ; en matière civile : 48 renvois sur 191 décisions. Source : rapport annuel 2011 de la Cour de cassation (mars 2012). La différence entre les deux domaines doit cependant être interprétée avec précaution, compte tenu de certains contentieux en série en droit pénal.
36 () Il a pu être remarqué que les juridictions judiciaires « ordonnent couramment le renvoi d’une QPC dès lors qu’elles ont constaté que la disposition législative contestée règle de façon différente deux situations, sans aller jusqu’à vérifier l’existence d’une situation différente, et encore moins celle d’un motif d’intérêt général » (Luc Briand, « Le contentieux constitutionnel devant les juridictions judiciaire du fond : second semestre 2011 », Gazette du Palais, 8 mars 2012, n° 68, p. 12).
37 () Au sens de l’article 61-1 de la Constitution.
38 () Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia.
39 () Décision n° 2010-42 QPC du 8 octobre 2010, CGT-FO et autres ; modification du 21 juin 2011 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.
40 () Dans cette décision (n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1958 et à l’ensemble des textes auxquels celui-ci renvoie : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et, depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l’environnement de 2004.
41 () Il s’agit notamment de la jurisprudence relative à la normativité de la loi, à l’accessibilité et à l’intelligibilité de la loi, au droit d’amendement (« cavaliers », règle de « l’entonnoir », etc.) et à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire.
42 () Voir par exemple Véronique Champeil-Desplats, « Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés ou cerbère de la production législative ? » et Patrick Wachsmann, « Des chameaux et des moustiques. Réflexions critiques sur le Conseil constitutionnel », in Mélanges Danièle Lochak, LGDJ, 2007, respectivement p. 254 et p. 282. Bernard Cubertafond a dénoncé, quant à lui, « le retour de la police de la loi » et critiqué « l’actuelle obsession de la loi purifiée » (« Régression du Parlement et du Conseil constitutionnel. Retour constitutionnaliste sur la délégalisation de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 23 février 2005 », Politeia, 2005, n° 8, respectivement p. 16 et 21). Précisons toutefois que le contentieux des QPC n’est pas totalement dépourvu de lien avec la qualité de la loi, ainsi qu’en témoigne par exemple la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’incompétence négative (décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l’énergie et des mines).
43 () Pour reprendre les termes de M. Jean-Marc Sauvé, devant votre commission des Lois (voir en annexe le compte-rendu de l’audition).
44 () Sauf exception : le Président du Conseil constitutionnel « peut, à la demande d’une partie ou d’office, restreindre la publicité de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des personnes l’exigent. Il ne peut ordonner le huis clos des débats qu’à titre exceptionnel et pour ces seuls motifs » (article 8 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité).
45 () Respectivement : décisions n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement
anti-corrida Europe et autre, n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, M. Thierry B., n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre, n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres, n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, M. Zeljko S., n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E, n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P.
46 () « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
47 () Il s’agit de l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, à l’origine de la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012. Cette dernière s’inscrit dans le prolongement des décisions n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mme Danielle S. et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, M. Abdellatif B.
48 () Ces aspects ont été très largement développés dans le rapport d’information précité de M. Jean-Luc Warsmann, Loi organique relative à l’application de la question prioritaire de constitutionnalité : première évaluation de la procédure, n° 2838, octobre 2010.
49 () Voir infra, II, B, 3 et III, B.
50 () Conseil d’État, 16 juillet 2010, SCI La Saulaie ; Conseil constitutionnel, n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. (« en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ») ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 30 novembre 2010, n° 1522, M. Jean-Louis L. (revenant sur l’arrêt de la formation spéciale de la Cour de cassation n° 12009 du 19 mai 2010).
51 () Affaire qui a donné lieu à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne et à des appréciations divergentes entre, d’une part, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État et, d’autre part, la Cour de cassation, à propos du caractère prioritaire de la QPC par rapport aux moyens d’inconventionalité.
52 () Le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les deux types de contrôle dans son arrêt d’assemblée du 13 mai 2011, n° 316734, M’Rida : « les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l’Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l’Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu’elles ont à trancher ; (...) il appartient, par suite, au juge du litige, s’il n’a pas fait droit à l’ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d’examiner, dans l’hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s’il doit, pour statuer sur les conclusions qu’il n’a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l’Union européenne dont la méconnaissance n’aurait pas été préalablement sanctionnée ».
53 () Données fournies par les services de la Cour de cassation lors de l’audition son premier président, M. Vincent Lamanda, le 21 novembre 2012.
54 () Cour de cassation, Crim., 5 octobre 2011, n° 11-90.087 ; Crim., 12 avril 2012, n° 12-90.004 ; Crim., 26 juin 2012, n° 12-80.319. Pour un exemple proche de la part du juge administratif (quoique n’aboutissant pas à un revirement de jurisprudence) : Conseil d’État, 14 septembre 2011, n° 348394, Pierre.
55 () Voir par exemple Xavier Domino et Aurélie Bretonneau, « QPC : deux ans, déjà l’âge de raison ? », AJDA, 2012, p. 422.
56 () Lors de son audition par la commission des Lois, le 19 décembre 2012.
57 () Audition par votre commission des Lois du 19 décembre 2012 ; données au 31 octobre 2012. Le même constat peut être dressé à propos du ministère public auprès des juridictions du fond : quoique délivrant un simple avis, le Parquet apporte une « expertise juridique (...) susceptible de contribuer grandement à une correcte appréciation par le juge de la recevabilité de la QPC, ainsi que d’enrichir la réflexion de la juridiction quant au sérieux de la question » (Luc Briand, « Quel rôle pour le procureur de la République dans le contentieux constitutionnel ? », Gazette du Palais, 13 décembre 2011, n° 347, p. 8).
58 () Rapport d’étape du comité de suivi de la QPC, avril 2012, p. 12. Le juge a quo (« à partir duquel ») désigne le juge devant lequel la QPC a été posée, avant sa transmission, le cas échéant, au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation ou le Conseil d’État.
59 () L’expression est notamment utilisée par Sophie-Justine Liéber et Damien Botteghi, « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », AJDA, 2010, p. 1361. Elle est cependant contestée par certains auteurs : par exemple, pour Jean-Philippe Derosier, Marie Gren et Ariana Macaya, « que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel ou du Conseil d’État, les missions sont similaires, sans être identiques : le premier juge la constitutionnalité de la loi tandis que le second juge l’inconstitutionnalité potentielle de la loi. Dans les deux cas, il s’agit de juges constitutionnels positifs, c’est-à-dire d’organes comparant une disposition législative aux règles et principes constitutionnels à l’aide d’un moyen d’inconstitutionnalité » (« Le Conseil d’État, juge constitutionnel ? », in Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux (dir.), L’examen de la constitutionnalité de la loi par le Conseil d’État, Dalloz, 2011, p. 43-44).
60 () Rappelons les trois critères fixés à l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
61 () Voir infra, III, B.
62 () Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
63 () Georges Bergougnous constate à cet égard que « la marge de manœuvre du Parlement, au moment où la réforme constitutionnelle entendait rééquilibrer les institutions à son profit, est fonction de la date que le Conseil assigne à l’entrée en vigueur d’une abrogation. En outre, cette marge varie également selon le nombre de décisions QPC exigeant dans le délai défini par le Conseil une intervention du législateur et il n’est pas à exclure qu’en fin de législature, ou à la veille d’une interruption assez significative des travaux du Parlement, ceci puisse conduire à opérer des choix dans le programme législatif » (« La QPC et la revalorisation du Parlement », Politeia, 2013, à paraître).
64 () Julie Benetti note en ce sens que, parfois, « la décision du Conseil constitutionnel commande très directement l’élaboration de la nouvelle loi. Non seulement le travail législatif s’engage à l’initiative du Conseil et selon le calendrier fixé par lui, mais encore la liberté d’appréciation du législateur apparaît sensiblement entamée. Ainsi, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, en attente d’examen à l’Assemblée nationale au moment où a été rendue la décision QPC du 26 novembre 2010, [a dû être] modifié pour intégrer, ainsi que l’a exigé le Conseil, l’intervention du juge judiciaire pour le maintien de l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, la liberté du législateur se limitant ici à définir les modalités de cette intervention » (« Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le travail législatif. D’une logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités », Constitutions, 2011, n° 1, p. 42).
65 () Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ; loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
66 () « La question prioritaire de constitutionnalité. Étude sur le réagencement du procès et de l’architecture juridictionnelle française », Mission de recherche Droit et justice, Synthèse, octobre 2012, p. 7.
67 () M. Jean-Jacques Urvoas, Débats, Assemblée nationale, première séance du 24 juillet 2012.
68 () Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016. Le commentaire officiel de cette disposition indique qu’ « en précisant qu’il ne procédait pas "spécialement" à cet examen, le Conseil a fait référence à sa jurisprudence (...) sur les conditions d’application du 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions de cette loi (...) ne pourra donc être opposée à une éventuelle future QPC. Par cette décision, le Conseil ne s’est nullement interdit de soulever d’office toute question de constitutionnalité qu’il estimerait nécessaire, même en cas de saisine blanche. Il continuera à examiner la loi, notamment à la lumière des travaux parlementaires, pour soulever d’office toute question susceptible d’affecter la constitutionnalité de la disposition en cause ».
69 () Et même parfois très anciennes, comme l’a récemment illustré le contrôle de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité).
70 () Julien Bonnet, « La revalorisation du Parlement et la QPC », Politeia, 2013, à paraître.
71 () Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. Le commentaire officiel de la décision est très éclairant sur ce point : « Sous les XIIe et XIIIe législatures, des amendements ont été déposés à plusieurs reprises à l’occasion de projets de loi touchant au droit de la famille et tendant à modifier l’article 365 du code civil pour permettre un partage de l’autorité parentale lors d’une adoption au sein de couples non mariés. Des propositions de loi tendant aux mêmes fins ont également été déposées. Le législateur contemporain a décidé de maintenir l’article 365 du code civil. C’est donc dans le cadre des enjeux du débat actuel sur l’article 365 que le Conseil constitutionnel a examiné l’article 365 du code civil. Le Conseil a rappelé que son contrôle n’est pas de même nature que celui du Parlement. Il a constaté que, dans l’exercice de sa compétence pour définir les règles du droit de la famille, le législateur avait estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une différence de traitement quant à l’établissement de la filiation adoptive à l’égard des enfants mineurs ».
72 () Julien Bonnet, « La revalorisation du Parlement et la QPC », op. cit.
73 () Le tribunal administratif de Bordeaux a néanmoins signalé une QPC dont le traitement avait pris plus d’un an.
74 () Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-206 QPC, Noël C. ; depuis, le Conseil d’État a aussi dépassé une fois le délai de trois mois : voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-283 QPC, M. Antoine de M.
75 () Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.
76 () Néanmoins, en matière pénale, la juridiction peut statuer sans avoir recueilli les observations du ministère public et des autres parties s’il apparaît de façon certaine qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question.
77 () En application de l’article R. 771-20 du code de justice administrative, créé par l’article 1er du décret du 16 février 2010, précité, un délai différent peut être fixé par le président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chargée de l’instruction.
78 () En comptant les non-transmissions et les non-transmissions avec sursis.
79 () Le nombre de décisions est inférieur à celui des questions posées car une décision peut statuer simultanément sur plusieurs questions.
80 () Votre rapporteur n’a pas pu mettre en évidence une éventuelle différence dans le poids relatif des trois critères de non-transmission selon que la question a été posée devant un juge du fond ou directement devant la juridiction suprême, faute de disposer d’informations aussi détaillées.
81 () Selon l’ouvrage dirigé par Dominique Rousseau, La question prioritaire de constitutionnalité, Gazette du Palais et lextenso éditions, collection Guide pratique, 2 e édition, 2012, p. 113.
82 () Audition du 19 décembre 2012.
83 () Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J.
84 () Voir audition du 21 novembre 2012.
85 () Luc Briand, « Un an (ou presque) de QPC devant les juridictions du fond », Gazette du Palais, 17 février 2011, n° 48, p. 7 et suiv.
86 () Luc Briand a publié un article sur « le contentieux constitutionnel devant les juridictions du fond : premier semestre 2011 » le 15 septembre 2011 (Gazette du Palais, n° 258, p. 7 et suiv.), un article sur le second semestre 2011, le 8 mars 2012 (Gazette du Palais, n° 68, p. 12 et suiv.), ainsi que, avec Audrey Bonnet, un article sur le premier semestre 2012, le 9 août 2012 (Gazette du Palais, n° 222, p. 5 et suiv.) et un sur le second semestre 2012, le 7 février 2013 (Gazette du Palais, n° 38, p. 5 et suiv.).
87 () C’est le Conseil d’État, saisi à l’occasion d’un pourvoi en cassation, qui a renvoyé au Conseil constitutionnel la question qui a été l’objet de sa décision n° 2010-71 QPC, Mlle Danielle S..
88 () D’autant que la question mentionnée par le bâtonnier a été posée devant le juge judiciaire, contrairement à celle qui a conduit à la décision de non-conformité.
89 () Audition par la commission des Lois du 19 décembre 2012.
90 () En application de l’article 10 du règlement intérieur du 4 février 2010, précité.
91 () Le compte rendu de l’audition de M. Denys Simon par la commission des Lois, en septembre 2010, figure en annexe du rapport d’information de M. Jean-Luc Warsmann, précité, pp. 61-62.
92 () La chambre criminelle a rendu 45 % des décisions de non-lieu prises par la Cour de cassation.
93 () Cette part est de 90 % pour la chambre sociale, mais elle n’a traité que 42 QPC sur l’ensemble de la période ; elle n’est que de 58 % devant la chambre commerciale, qui a traité 90 QPC et a fondé le tiers de ses décisions de non-renvoi sur une déclaration antérieure de conformité.
94 () Dans le contentieux pour excès de pouvoir, tout requérant qui a un intérêt direct et suffisant à l’annulation de la décision administrative qu’il attaque, est recevable à agir.
95 () Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012.
96 () Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L..
97 () Ses motifs paraissaient distinguer entre l’application du dispositif transitoire aux instances engagées après l’adoption de la loi bien que relatives à des situations nées antérieurement à celle-ci et son abrogation pour les instances engagées antérieurement, alors que le dispositif de la décision ne comportait pas de distinction de cet ordre. Le Conseil d’État en a déduit que l’application des nouvelles règles ne pouvait être écartée, pour les dommages survenus antérieurement à l’adoption du dispositif transitoire, que dans les litiges déjà engagés. La Cour de cassation a, pour sa part, jugé que les règles « anti-Perruche » n’étaient pas applicables aux dommages survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, et ce qu’ils aient ou non déjà donné lieu à l’engagement d’une instance juridictionnelle.
98 () Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L.
99 () Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres
100 () À moins que le Conseil constitutionnel n’enjoigne aux juridictions de surseoir à statuer dans les instances en cours jusqu’au terme fixé pour que l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles prenne effet.
101 () Décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012.
102 () Répondant à une question de votre rapporteur à propos de l’origine géographique des QPC reçues par le Conseil d’État, son vice-président a indiqué devant votre Commission : « ce sont les questions posées par votre Commission qui nous ont conduits à enquêter sur cette question, sur laquelle nous ne nous étions pas penchés auparavant. Je profite de l’occasion pour rappeler que, dans la juridiction administrative, le polycentrisme n’existe pas. Il y a la loi, la Constitution, nos engagements internationaux, l’interprétation qui en est faite, notamment par le Conseil d’État ; il va absolument de soi qu’il n’y a pas de jurisprudence bourguignonne, marseillaise ou douaisienne en la matière » (M. Jean-Marc Sauvé, audition du 21 novembre 2012).
103 () Voir supra, II, A, 1.
104 () Rapport de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 2e lecture, n° 2006, p. 13. Le rapporteur avait auparavant renoncé à rétablir le délai maximum de deux mois introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, délai que le Sénat avait supprimé (voir également infra, B).
105 () Voir supra, II, A, 2.
106 () Pour reprendre la métaphore de Guy Carcassonne : « c’est sans réticences apparentes, bien au contraire, que le Parlement, d’abord comme constituant, ensuite et surtout comme législateur organique, s’est approprié la paternité de la QPC. C’est ce qui pouvait arriver de mieux à cette dernière puisqu’elle y a trouvé non seulement la vie mais aussi une protection attentive, active et probablement durable » (« Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 81).
107 () Lors de l’examen, en 2009, du projet de loi organique par la commission des Lois, un délai de deux mois avait été introduit, qui a été supprimé par le Sénat, la suppression ayant été confirmée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
108 () Votre rapporteur ne dispose pas de l’information équivalente pour la Cour de cassation.
109 () Pour la Cour de cassation, il s’agit de la part des QPC posées concernées par l’une de ces décisions.
110 () Dominique Rousseau ajoutait : « Pour asseoir le succès de la QPC, il faudrait renforcer la légitimité juridictionnelle du Conseil constitutionnel, sans doute en augmentant le nombre de ses membres – la moyenne européenne se situe entre douze et quinze, contre neuf en France – surtout s’il lui revient d’apprécier la recevabilité des questions. Il faudrait alors créer une chambre particulière, dont les membres ne pourraient évidemment pas siéger dans l’assemblée plénière qui délibérerait au fond. Il conviendrait également de revoir le mode de désignation des membres, en s’inspirant de Kelsen et de l’exemple des autres pays européens qui exigent des compétences et de l’expérience en matière juridique, et une majorité positive des trois cinquièmes des parlementaires pour approuver toutes les nominations. Les anciens présidents de la République n’auraient alors plus leur place dans un Conseil devenu une véritable juridiction. Une telle réforme renforcerait la crédibilité du Conseil, qui est dorénavant en relation directe avec la Cour de cassation et le Conseil d’État. C’est à cette condition que le succès démocratique de la QPC pourra être pérennisé » (voir en annexe le compte-rendu de l’audition du 4 décembre 2012).
111 () Le Sénat avait adopté cette nouvelle qualification, qu’avait ensuite rejetée l’Assemblée nationale, entraînant l’abandon de cette proposition.
112 () L’article 4 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité dispose à ce sujet :
« Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s’abstenir de siéger en informe le président.
« Une partie ou son représentant muni à cette fin d’un pouvoir spécial peut demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n’est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la date fixée pour la réception des premières observations.
« La demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l’objet. Ce dernier fait connaître s’il acquiesce à la récusation. Dans le cas contraire, la demande est examinée sans la participation de celui des membres dont la récusation est demandée.
« Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation ».
113 () L’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que « les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal ».
114 () Les trois demandes de récusation ont porté sur les quatre affaires suivantes (les deux premières affaires, portant sur des sujets comparables, ont fait l’objet de la même demande) : n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres ; n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et de l’Hérault ; n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. ; n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre.
115 () Voir, en dernier lieu, le compte rendu des auditions par votre Commission de Mmes Nicole Maestracci et Claire Bazy-Malaurie, le 13 février 2013, en application des articles 13 et 56 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
116 () Article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
117 () Devant votre Commission, Me David Lévy s’était interrogé en ce sens : « on pourrait renforcer les moyens du Conseil constitutionnel. Si le caractère juridictionnel de cette instance est indiscutable, sa fonction a considérablement évolué depuis sa création. On peut donc s’interroger sur l’opportunité d’augmenter le nombre de ses membres au regard de l’important contentieux qu’il a à traiter ».
118 () Voir en ce sens Wanda Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, Economica et Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005 et «Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juge constitutionnels », Recueil Dalloz, 2010, p. 714.
119 () Ce questionnaire a été adressé aux tribunaux judiciaires et aux cours d’appel d’Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Dijon et de Versailles.
120 () Ce questionnaire a été adressé aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel de Marseille et de Bordeaux, aux tribunaux administratifs de Dijon et de Montreuil, et à la cour administrative d’appel de Versailles.
121 () Ce questionnaire a été adressé aux ordres des avocats des barreaux d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Marseille et Versailles.
122 () Ce questionnaires a été adressé à France nature environnement, la Fondation Hans Hartung et Anna Éva Bergman, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Finistère, le Département de Seine-Saint-Denis, la Société anonyme Paris Saint-Germain football, l’Association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, la Banque populaire Côte d’Azur, l’Association pour le droit à l’initiative économique, l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, le Syndicat Sud AFP, le Comité Harkis et Vérité et la Région Languedoc-Roussillon.
© Assemblée nationale