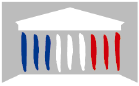N° 1085
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission sur
la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie : rapport d’étape
ET PRÉSENTÉ
par M. Denys ROBILIARD,
Député.
___
AVERTISSEMENT 7
INTRODUCTION 9
I.- LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 20 AVRIL 2012 RELATIVE AUX SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 13
A. LE DISPOSITIF DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 13
1. Le juge des libertés et de la détention et la mainlevée des soins sans consentement (II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique) 13
2. Le représentant de l’État et le prononcé de la fin des soins sans consentement (article L. 3213-8 du code de la santé publique) 14
B. LA PORTÉE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 15
1. Les personnes séjournant ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) 15
2. Les personnes déclarées pénalement irresponsables 16
C. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 17
1. L’intervention du législateur est-elle nécessaire ? 17
a) La dangerosité psychiatrique des malades concernés 17
b) Les conséquences de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution 19
c) Les dispositions indirectement visées par la décision du Conseil constitutionnel 20
2. Quel peut être l’apport du législateur ? 20
a) Le renforcement des garanties légales encadrant l’admission dans une unité pour malades difficiles (UMD) 20
b) Le renforcement des garanties légales encadrant la transmission entre l’autorité judiciaire et le préfet pour les personnes déclarées pénalement irresponsables 21
II.- LES AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES AU COURS DES AUDITIONS 23
A. L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT 23
1. Le champ de la contrainte 23
a) La question du maintien du principe des soins ambulatoires sans consentement 23
b) L’opportunité d’un contrôle juridictionnel des programmes de soins sans consentement 24
c) La question du contrôle de l’hospitalisation des mineurs 25
d) Le recours à la contention et à l’isolement 26
e) Le contrôle de la privation de liberté dans le cadre de soins somatiques ou psychiatriques dispensés hors du champ psychiatrique, voire hors de l’hôpital 28
2. Le rôle des différents acteurs dans la décision d’admission 30
a) L’intervention du préfet 31
b) L’intervention du maire 33
c) Le rôle discret mais prépondérant du directeur d’établissement 34
d) La possibilité pour le juge de prendre les mesures de soins sans consentement 34
3. Les dysfonctionnements du système : parcours et capacités 35
a) Les difficultés de la prise en charge 35
b) La mauvaise organisation des urgences et l’orientation des malades par défaut 36
c) Le « tourniquet » 37
d) La « transformation » d’hospitalisations libres en hospitalisations sous contrainte 38
4. L’appréciation de l’état du malade 38
a) La possibilité pour un médecin non psychiatre d’établir un certificat en vue d’une admission en soins sans consentement 38
b) L’insuffisance de la prise en considération des affections somatiques 39
B. L’INTERVENTION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 40
1. Les questions soulevées par l’intervention du juge des libertés et de la détention 41
a) Le rôle du juge des tutelles 41
b) Le maintien du terme de « détention » dans la dénomination du juge 41
2. La difficulté d’accès au juge des libertés et de la détention 42
a) L’exercice de leur droit de recours par les malades 42
b) L’établissement systématique par certains psychiatres de certificats dispensant le malade de comparaître devant le juge 44
c) La représentation du malade par un avocat 44
3. Les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention 45
a) Le délai dont dispose le juge pour statuer 45
b) La faculté pour le juge de rejeter sans tenir d’audience les « demandes répétées » de mainlevée « manifestement infondées » 46
c) L’obligation de communiquer au juge le bulletin n° 1 du casier judiciaire 47
d) Le lieu de l’audience 48
e) La publicité de l’audience 50
4. L’organisation judiciaire 51
a) L’inégalité des situations 51
b) La formation des magistrats 52
C. LE SUIVI DES SOINS SANS CONSENTEMENT 52
1. L’exigence de certificats médicaux successifs 52
a) Une charge excessive pour les psychiatres 53
b) Une multiplicité peu protectrice pour les patients 53
c) L’absence de certificat actualisé en appel 54
2. Les difficultés liées aux sorties 55
a) La suppression des sorties d’essai 55
b) Le conditionnement des sorties autres que thérapeutiques à la mise en œuvre d’un programme de soins 56
3. Les droits des malades 57
a) La désignation de la personne de confiance 57
b) Le respect des libertés individuelles et de la dignité 58
c) Les commissions départementales des soins psychiatriques 59
LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS 63
TRAVAUX DE LA COMMISSION 65
ANNEXES 85
ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION D’INFORMATION 87
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 89
ANNEXE 3 : INDEX DES SIGLES UTILISÉS 93
Ce document est un rapport d’étape. Le rapport définitif est donc susceptible d’être nourri par les réactions qu’il suscitera. Il pourra également l’être par les propos qui seront tenus par les personnes qui seront auditionnées au cours des prochaines semaines, dans le cadre plus général des travaux de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie.
Créée par la commission des affaires sociales le 7 novembre 2012, la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie a tenu sa réunion constitutive le 19 décembre suivant. Elle a alors décidé d’ouvrir à la presse l’ensemble de ses auditions et de retransmettre, par l’intermédiaire du site internet de l’Assemblée nationale ses travaux afin que, l’ensemble de nos concitoyens soient en mesure d’accéder à ses travaux et de bénéficier des opinions et témoignages, toujours très enrichissants, des personnes, organisations ou organismes ayant répondu à son invitation.
Une série préliminaire d’auditions a permis de cadrer les travaux de la mission, dont le champ est en effet très large. En entendant des associations de patients et de familles de patients, des médecins et des experts, l’objectif était à la fois de constituer un corpus de connaissances et d’expériences et d’identifier les principaux problèmes posés, qui feront l’objet d’un examen plus approfondi dans un second tome du rapport d’information, au travers, ici aussi, d’auditions mais également de déplacements.
La mission a choisi de se consacrer plus spécifiquement aux soins sans consentement dans une première partie de ses travaux. Le choix de cette « porte d’entrée » est guidé par des considérations juridiques énoncées par le Conseil constitutionnel et assorties d’une échéance de calendrier qui expliquent cette approche. En effet, sans cette circonstance – il convient d’y insister tout particulièrement – il n’y avait pas lieu d’aborder nécessairement en premier lieu sous cet angle la psychiatrie et la santé mentale.
Alors que la longue entreprise de révision de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation a finalement abouti à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1), qui a mis l’accent sur la sécurité des personnes, il faut cependant rappeler que le malade mental ne doit pas avant tout être envisagé potentiellement comme un trouble à l’ordre public ou un danger pour la société (2).
La mission d’information a eu communication du fait que le nombre de mesures de soins sans consentement s’était accru de près de 50 % entre 2006 et 2011 (3) et que le recours à de telles mesures varie considérablement d’un point à l’autre du territoire (4).
Pour autant c’est en raison de la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, du Conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution deux dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi de 2011, et reportant leur abrogation au 1er octobre 2013 que la mission d’information consacre le premier volet de ses travaux à la question des soins sans consentement.
Le législateur est en effet incité, avant cette échéance, désormais proche, sinon à intervenir, du moins à s’interroger sur l’opportunité d’une intervention. Il convenait donc, dans les meilleurs délais, de s’informer le plus complètement possible de l’état de cette question.
La mission d’information ne s’est pas contentée d’une approche livresque et s’est déplacée à l’unité pour malades difficiles (UMD) Henri Colin du groupe hospitalier Paul Guiraud (Villejuif). Le Rapporteur tient à saluer, à cette occasion, toutes les équipes médicales et administratives, sous la responsabilité du directeur du groupe hospitalier, M. Henri Poinsignon, et du chef de pôle UMD, le Dr. Bernard Lachaux, pour la chaleur de leur accueil, pour leur disponibilité sans faille, pour leur sens du dialogue et pour la qualité des réponses apportées aux interrogations formulées par les membres de la mission.
Le présent rapport d’étape vise, à l’issue de cette première phase des travaux de la mission d’information, soit plus de 30 heures d’auditions, à faire le point sur les soins sans consentement. Il s’efforce de récapituler de façon aussi exhaustive que possible l’ensemble des questions abordées par les personnes entendues ou rencontrées par la mission, au-delà, bien entendu, des seules dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.
En outre, les auditions et les premiers échanges de vues entre les membres de la mission ayant permis d’identifier assez clairement les points sur lesquels il convient de réfléchir, le présent rapport présente en conclusion une série de propositions.
La mission d’information poursuivra ses travaux par une seconde série d’auditions et par des visites sur le terrain, afin de parfaire sa connaissance des nombreux autres aspects de la psychiatrie et de la santé mentale en France : besoins de la population, prisons, précarité, prise en charge des soins, offre de soins, formation, recherche...
I.- LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 20 AVRIL 2012 RELATIVE AUX SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – la quatrième en matière de soins psychiatriques sous contrainte en moins de deux ans (5) – posée par le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, a déclaré contraires à la Constitution deux dispositions du code de la santé publique : issues de la loi de 2011, elles sont relatives au régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en UMD ou déclarées pénalement irresponsables.
Le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause le principe d’un régime plus strict de soins sans consentement pour certaines personnes, en l’occurrence celles ayant séjourné en UMD ou celles déclarées pénalement irresponsables.
Mais le Conseil rend une décision de non-conformité à la Constitution de deux dispositions du code de la santé publique (cf. infra) parce qu’il considère que, dans une matière touchant à la privation de liberté, seul le législateur est compétent pour préciser davantage les conditions de mise en œuvre de ce régime dérogatoire de soins sans consentement applicable aux personnes précitées
Il convient de décrire le dispositif de la décision et d’évaluer sa portée avant d’examiner les conséquences que le législateur peut ou doit en tirer.
A. LE DISPOSITIF DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution deux dispositions du code de la santé publique : le II de l’article L. 3211-12 et l’article L. 3213-8.
1. Le juge des libertés et de la détention et la mainlevée des soins sans consentement (II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique)
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique est relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le I établit la liste des personnes pouvant saisir le juge à ces fins, celui-ci ayant en outre la faculté de se saisir d’office à tout moment.
Le II prévoit que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 (6) et deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 (7) lorsqu’il s’agit d’une personne qui, au cours des dix dernières années :
– soit a fait l’objet d’une mesure d’admission prononcée par le représentant de l’État, avisé par les autorités judiciaires suite à une décision prise sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 122-1 du code pénal (article L. 3213-7 du code de la santé publique) ou ordonnée par les autorités judiciaires suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale (article 706-135 du code de procédure pénale) ;
– soit a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (ASPDRE) saisi par l’autorité judiciaire et a déjà fait l’objet d’une mesure décrite au précédent alinéa ;
– soit a fait l’objet d’une ASPDRE et a fait ou fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État (8), d’une hospitalisation dans une UMD.
Il précise que le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État (9), et que, passé ces délais, il statue immédiatement.
2. Le représentant de l’État et le prononcé de la fin des soins sans consentement (article L. 3213-8 du code de la santé publique)
L’article L. 3213-8 du code la santé publique prévoit que le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 (cf. supra) ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient, émis par deux psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 (cf. supra) lorsqu’il s’agit d’une personne faisant ou ayant fait l’objet, au cours des dix dernières années :
– soit d’une mesure d’admission prononcée par le représentant de l’État, avisé par les autorités judiciaires suite à une décision prise sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 122-1 du code pénal (article L. 3213-7 du code de la santé publique), ou ordonnée par les autorités judiciaires suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale (article 706-135 du code de procédure pénale) ;
– soit, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État (cf. supra), d’une hospitalisation dans une UMD.
Il précise que le représentant de l’État fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État (10), et que, passé ces délais, il prend immédiatement sa décision.
B. LA PORTÉE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Reprenant les termes de sa décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel ne conteste pas la faculté, pour le législateur, de définir des conditions particulières pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement prises à l’égard des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou présentant, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité. Mais il juge qu’il incombe à la loi d’encadrer la mise en œuvre de ce régime particulier en prévoyant les garanties permettant de prévenir tout risque d’arbitraire.
1. Les personnes séjournant ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD)
Pour le Conseil constitutionnel, le problème réside dans les critères d’admission en UMD, définis par l’article L. 3222-3 du code de la santé publique.
Le premier alinéa de cet article, dont la rédaction résulte de la loi de 2011, dispose en effet que les personnes atteintes de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques soit sur décision du représentant de l’État, soit parce qu’elles sont détenues, soit parce qu’elles ont été déclarées pénalement irresponsables « peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique ».
Le Conseil constitutionnel estime que cette rédaction est tautologique, car elle revient à énoncer que certaines personnes peuvent être prises en charge dans une unité spécifique... si elles ne peuvent être prises en charge que par une unité spécifique. Il la tient également pour imprécise quant aux conditions dans lesquelles est constaté l’état de dangerosité du malade et est décidé le placement en UMD.
Le Conseil constitutionnel juge donc que « ni cet article ni aucune autre disposition législative n’encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l’autorité administrative » et que l’hospitalisation en UMD est ainsi « imposée sans garanties légales suffisantes ».
Or, cette lacune dans les règles de placement en UMD, combinée avec les dispositions qu’il déclare contraires à la Constitution, a pour conséquence que certaines personnes se voient appliquer sans garanties suffisantes un régime plus rigoureux que celui applicable aux personnes admises en hospitalisation complète, notamment pour ce qui est de la mainlevée des mesures de soins sans consentement.
2. Les personnes déclarées pénalement irresponsables
De même que pour les personnes séjournant ou ayant séjourné en UMD, le Conseil constitutionnel invalide par voie de conséquence une disposition du code de la santé publique résultant également de la loi de 2011 mais autre que celles qu’il déclare contraires à la Constitution.
En effet, le premier alinéa de l’article L. 3213-7 prévoit que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes (premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal), d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que le représentant de l’État dans le département. Celui-ci ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques.
Le Conseil constitutionnel estime ici aussi que le législateur n’a pas suffisamment encadré les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire plus rigoureux. En l’espèce, l’application de ce régime résulte non d’une décision juridictionnelle mais de ce que les autorités judiciaires ont avisé le représentant de l’État. Or :
– cette transmission est « possible quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental » ;
– « l’information préalable de la personne intéressée » n’est pas prévue.
De même que pour les personnes séjournant ou ayant séjourné en UMD, l’imprécision des conditions d’admission dans ces unités est susceptible d’entraîner l’application de règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment pour ce qui est de la mainlevée des mesures de soins sans consentement, le Conseil constitutionnel considère que l’absence de garanties légales suffisantes entourant la décision de transmission au représentant de l’État par l’autorité judiciaire entraîne la non-conformité à la Constitution des dispositions relatives aux conditions de mainlevée des mesures de soins sans consentement.
Dans son commentaire de sa propre décision, le Conseil constitutionnel relève que les travaux préparatoires de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental font apparaître que les dispositions de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique n’ont pas été conçues pour fonder une différence de régime juridique entre des catégories différentes de personnes hospitalisées. Elles ont alors été modifiées simplement par souci de coordination, afin d’inclure dans le dispositif les personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour cause de trouble mental, comme le relève le commentaire, « sans considération des conséquences qui en résultent pour la personne hospitalisée ».
En revanche, pour les personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète ordonnée par une juridiction d’instruction ou de jugement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le dispositif de mainlevée de la mesure de soins sans consentement n’est pas contraire à la Constitution, car la mesure d’hospitalisation est une mesure juridictionnelle qui est prononcée à l’issue d’un débat contradictoire et qui est susceptible de recours.
C. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Il importe d’abord de savoir s’il est nécessaire que le législateur intervienne ou, du moins, qu’il intervienne dans le délai qui lui est imparti par la décision du Conseil constitutionnel.
Ensuite, si cette réponse est, en tout ou partie, positive, il s’agit d’identifier plus précisément comment le législateur peut remédier aux défaillances de la rédaction actuelle des textes.
1. L’intervention du législateur est-elle nécessaire ?
Il convient préalablement de s’interroger sur la notion de dangerosité psychiatrique avant d’envisager les conséquences qu’entraînerait une absence d’intervention du législateur avant la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité. Par ailleurs, les dispositions que la décision du Conseil constitutionnel vise par ricochet sont très fragilisées.
a) La dangerosité psychiatrique des malades concernés
Il faut d’abord rappeler que les dix UMD actuellement installées – dont six, de plus petite taille (20 ou 40 lits), ont été ouvertes entre 2008 et 2012 – disposent d’une capacité totale de 598 lits. Compte tenu d’une durée moyenne d’hospitalisation allant de 125 à 252 jours selon les unités, la file active était de 820 patients en 2012.
En mars 2011, la Haute Autorité de santé (HAS) a mené une audition publique (11) sur le thème « Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur ».
Se fondant sur l’analyse d’une très abondante littérature internationale (près de 200 références), le rapport d’orientation de la commission d’audition conclut ainsi :
« Des nombreuses publications passées en revue, quelques notions fortes peuvent être retenues :
« – l’augmentation du risque de violence chez les personnes souffrant de troubles schizophréniques comparativement à la population générale mais aussi la grande hétérogénéité du risque ainsi calculé ;
« – l’importance des biais méthodologiques et des facteurs de confusion représentés par les données biographiques et sociodémographiques associées (âge, sexe, trajectoire personnelle, isolement social, etc.) ;
« – la majoration du risque de violence par la coexistence d’un abus ou d’une dépendance à des substances psycho-actives et par le nombre de diagnostics associés ;
« – le risque considérablement plus important représenté par l’abus ou la dépendance à des substances psycho-actives que par les troubles schizophréniques ;
« – enfin l’impossibilité de conclure sur la signification du lien statistique mis en évidence entre troubles schizophréniques et violence : la démonstration d’une corrélation ou d’un risque n’est pas celle d’une relation de cause à effet. »
Ces conclusions sont particulièrement intéressantes quant aux préjugés qui dominent encore sur ces questions : sur la méthode, d’une part, en montrant qu’il ne faut pas s’en tenir à des apparences aisément trompeuses ; sur le fond, d’autre part, en faisant ressortir, s’agissant des malades schizophrènes, qu’une relation de cause à effet ne saurait être établie entre la pathologie et la violence.
b) Les conséquences de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution
Cette abrogation aurait pour effet que ne serait plus applicable aux catégories de personnes susmentionnées (cf. supra A) le régime plus strict actuellement prévu à leur égard en matière de mainlevée des mesures de soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention ou par le représentant de l’État. Dès lors, pour ces personnes, la mainlevée des mesures de soins sans consentement serait soumise au régime de droit commun.
D’un seul point de vue juridique, le fonctionnement du dispositif de soins sans consentement ne serait donc nullement interrompu. Il y a uniquement lieu de s’interroger sur l’opportunité de ne pas appliquer un régime de mainlevée plus rigoureux pour les personnes séjournant ou ayant séjourné en UMD et, a fortiori, pour les personnes déclarées pénalement irresponsables.
S’agissant des personnes séjournant en UMD, le maintien d’un régime distinct n’apparaît pas justifié. Mme Nicole Questiaux, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), l’a expliqué à la mission d’information (12) en ces termes : « À propos du régime appliqué aux personnes présentant un risque particulier, c’est-à-dire ceux qui venaient d’une décision de justice ou qui avaient été malades en UMD, le Conseil constitutionnel, au lieu de dire froidement qu’il s’agissait d’une décision médicale et que, par conséquent, il n’y avait aucune raison de prévoir des différences – si le médecin les estime guéries, c’est qu’elles ne sont plus dangereuses –, a validé le fait que la seule raison qu’elles sont passées par une UMD pouvait créer une situation particulière. »
Il convient en outre de rappeler la finalité et le rôle des UMD, bien mis en lumière par le déplacement que la mission d’information a effectué au groupe hospitalier Paul Guiraud. Malgré un cadre de type partiellement carcéral, l’UMD a une fonction qui peut être qualifiée de « réanimation psychiatrique », consistant à délivrer des soins intensifs en psychiatrie grâce à une équipe soignante renforcée. À l’issue de ces soins spécifiques, le patient n’est pas livré à lui-même et la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet n’est pas levée : ses soins se poursuivent, hors de l’UMD, soit dans un établissement spécialisé, soit dans un service de psychiatrie d’un centre hospitalier général, soit en milieu carcéral.
Dès lors, le maintien, à l’égard de ces personnes, d’un régime renforcé pour la mainlevée des mesures de soins sous contrainte ne semble pas nécessaire, d’autant qu’il pèse à l’heure actuelle sur les personnes ayant séjourné en UMD au cours des dix dernières années, instituant de fait une sorte de « casier médical ». Au demeurant, antérieurement à la loi de 2011, ces personnes relevaient du régime de droit commun.
S’agissant des personnes déclarées pénalement irresponsables, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : même en l’absence de responsabilité pénale, des actes n’en ont pas moins été commis, de telle sorte que le maintien d’un régime plus rigoureux de mainlevée des mesures de soins sans consentement apparaît souhaitable.
c) Les dispositions indirectement visées par la décision du Conseil constitutionnel
Au-delà même des deux dispositions abrogées à compter du 1er octobre prochain, faute d’intervention du législateur, deux autres dispositions du code de la santé publique paraîtraient à tout le moins fragilisées, car même si le Conseil constitutionnel ne les a pas déclarées contraires à la Constitution, il n’en a pas moins attiré l’attention sur leur caractère imparfait :
– l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, relatif aux conditions dans lesquelles les autorités judiciaires avisent le représentant de l’État lorsque l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes (premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal), d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public ;
– l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, relatif aux critères d’admission en UMD.
2. Quel peut être l’apport du législateur ?
Le Conseil constitutionnel n’interdit pas au législateur de définir, pour certaines catégories de patients, un régime plus strict de mainlevée des mesures de soins sans consentement, pour peu qu’il prévoie par ailleurs des garanties suffisantes des droits de ces patients. En tout état de cause, indépendamment du choix qu’il devra d’abord opérer quant à l’opportunité de prévoir un tel régime dérogatoire, la décision du Conseil constitutionnel semble le contraindre à renforcer les garanties encadrant l’admission dans une UMD ainsi que la transmission entre l’autorité judiciaire et le représentant de l’État pour les personnes déclarées pénalement irresponsables.
a) Le renforcement des garanties légales encadrant l’admission dans une unité pour malades difficiles (UMD)
Dans son propre commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel relève que « l’insuffisance des garanties légales apparaissait d’autant plus clairement à la lecture du décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011, qui comporte tout l’encadrement de cet "enfermement dans l’enfermement" dont les principes directeurs auraient mérité de figurer dans la loi ». De fait, les articles R. 3222-1 à R. 3222-9 du code de la santé publique forment un ensemble complet et précis de dispositions relatives aux UMD : certaines d’entre elles pourraient donc recevoir une consécration législative, par la voie d’une rédaction améliorée de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique qui permettrait de satisfaire aux conditions posées par le Conseil constitutionnel.
En particulier :
– l’article R. 3222-1 paraît donner une définition satisfaisante des UMD, « spécialement organisées à l’effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l’état des patients » faisant l’objet de soins sans consentement ;
– l’article R. 3222-2 fixe la procédure d’admission en UMD, prononcée par arrêté du préfet du département d’implantation de l’unité, sur proposition d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l’accord du psychiatre responsable de l’unité. Le préfet se prononce au vu d’un dossier médical et administratif comprenant notamment un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l’admission, l’engagement du préfet du département d’origine du patient hospitalisé ou détenu à ce que ce dernier soit hospitalisé ou incarcéré de nouveau dans le département d’origine dans un délai de vingt jours à compter de l’arrêté de sortie de l’UMD et l’indication, le cas échéant, des mesures de protection des biens du patient ;
– l’article R. 3222-6 prévoit la constitution, dans chaque département d’implantation d’une UMD, d’une commission de suivi médical. Composée de quatre membres (un médecin inspecteur et trois psychiatres n’exerçant pas dans l’UMD), nommés pour trois ans par le directeur de l’agence régionale de santé, elle peut se saisir ou être saisie à tout moment de la situation d’un patient hospitalisé en UMD et examine tous les six mois les dossiers des patients hospitalisés en UMD ;
– l’article R. 3222-5 dispose que lorsque la commission de suivi médical constate que les conditions requises pour la mesure de soins sans consentement ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d’implantation de l’UMD, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient, sous forme soit d’une levée de la mesure de soins ou d’une prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète, soit d’un transfert dans un autre établissement de santé autorisé en psychiatrie, soit d’un retour dans l’établissement de santé d’origine.
b) Le renforcement des garanties légales encadrant la transmission entre l’autorité judiciaire et le préfet pour les personnes déclarées pénalement irresponsables
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel montre clairement les orientations devant présider aux décisions du législateur en vue d’une amélioration de la rédaction de l’article L. 3213-7 quant à la transmission entre les autorités judiciaires et le représentant de l’État lorsque l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public :
– il doit envisager la possibilité de recours à cette transmission au vu de la gravité et de la nature de l’infraction commise en état de trouble mental, c’est-à-dire aux infractions révélant en elles-mêmes la dangerosité de leur auteur. La qualification de crime pourrait répondre à ces conditions ;
– il doit assurer l’information préalable de la personne intéressée. Elle pourrait l’être, en cas de classement sans suite, par le procureur de la République, en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale, par le juge d’instruction, ou, suite à une décision de cour d’assises, de tribunal correctionnel ou de chambre correctionnelle d’une cour d’appel, par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
II.- LES AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES AU COURS DES AUDITIONS
En matière de soins sans consentement, les auditions menées par la mission d’information ne se sont bien évidemment pas limitées à l’étude des seules conséquences de la décision du Conseil constitutionnel d’avril 2012 précitée. Au-delà même des modifications apportées par la loi de 2011, elles ont permis de faire apparaître de nombreuses autres difficultés. Étant précisé que toutes, tant s’en faut, ne sont pas d’ordre législatif et que certaines feront ici, à ce stade des travaux de la mission, davantage l’objet de constats que de propositions, elles sont ici regroupées autour de trois thèmes principaux : l’admission en soins sans consentement, l’intervention du juge des libertés et de la détention et le suivi des soins sans consentement.
A. L’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT
Seront successivement abordés le champ de la contrainte, les auteurs actuels ou potentiels de la décision d’admission, les conditions dans lesquelles l’admission est décidée puis réalisée et, enfin, la manière dont l’état du malade est évalué.
Cinq interrogations ont été ici identifiées : le principe même de soins ambulatoires sans consentement et leur contrôle par le juge ; l’hospitalisation des mineurs ; le recours à la contention et à l’isolement ; la privation de liberté hors du champ des établissements hospitaliers généraux et psychiatriques.
a) La question du maintien du principe des soins ambulatoires sans consentement
L’une des principales innovations de la loi de 2011 consiste en l’extension de la contrainte hors de son champ habituel, qui était jusqu’alors seulement celui de l’hôpital. Ainsi, l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne en soins sans consentement peut être prise en charge sous une autre forme que celle de l’hospitalisation complète dans un établissement autorisé en psychiatrie, incluant des soins ambulatoires qui peuvent comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Dans ce cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil. Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité : les soins demeurent sous la responsabilité de l’établissement mais peuvent être dispensés par d’autres, par exemple les centres médico-psychologiques.
Or, comme l’a fait observer devant la mission d’information le Dr. Catherine Paulet, chef du service médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire de Marseille (13), « un programme de soins ambulatoires sans consentement, c’est presque paradoxal : soit la personne sort et elle y consent, soit elle ne sort pas. En outre, on lui fait porter la responsabilité du soin en lui disant que si elle ne prend pas tel ou tel type de précautions, ce sera de sa responsabilité. Dans la terminologie et dans l’esprit, il y a donc quelque chose de problématique et qui ne dissocie pas suffisamment les deux démarches – mesures de protection et travail de soins, y compris travail autour du déni de la maladie mentale ».
Votre Rapporteur tient à souligner que la complexité de cette question nécessite qu’elle soit abordée lors de l’élaboration éventuelle d’une loi de santé publique ou de santé mentale.
b) L’opportunité d’un contrôle juridictionnel des programmes de soins sans consentement
S’il était décidé de ne pas revenir sur la notion de programmes de soins sans consentement, il demeurera en revanche opportun de s’interroger sur la manière dont ils doivent être contrôlés. En effet, il résulte du premier alinéa du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que seules les mesures de soins psychiatriques sans consentement ordonnées sous la forme de l’hospitalisation complète ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien.
Dans sa décision précitée d’avril 2012, le Conseil constitutionnel, qui avait explicitement été saisi de cette question, indique que l’absence d’un tel contrôle sur les soins sans consentement autres que ceux pris en charge sous la forme de l’hospitalisation complète n’est pas contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel relève certes qu’aucune distinction n’est créée, parmi les soins sans consentement, entre le régime de l’hospitalisation complète et celui des autres soins. Mais il estime que les dispositions de l’article L. 3211-2-1 précité n’autorisent pas l’exécution de l’obligation de soins psychiatriques sous la contrainte : dans son commentaire de sa décision, il souligne que l’obligation de soins a été conçue non pour briser par la force l’éventuel refus du malade de se soumettre à un protocole de soins mais pour passer outre son incapacité à y consentir. Il y voit la confirmation dans les dispositions du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. »
Selon lui, le régime en vigueur permet donc une obligation de soins mais ne permet pas une administration de soins par la contrainte : les personnes concernées ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins. Aucune mesure de contrainte à leur égard ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète, ce que confirme l’article R. 3211-1 du code de la santé publique, « notamment en cas d’une inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de [leur] état de santé ».
Dès lors, en ne prévoyant pas l’intervention systématique du juge, le législateur a pratiqué une conciliation « qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre, d’une part, la protection de la santé et de l’ordre public, et d’autre part, la liberté personnelle.
Le commentaire de la décision en fait, toutefois, en même temps percevoir les limites : « si la personne ne coopère pas avec le service de soins pour suivre le traitement, se rendre ou demeurer dans l’établissement, il est possible que soit proposé un passage en hospitalisation complète (dans laquelle l’administration de soins contraints sera possible) ». Autrement dit, même si, bien entendu, s’applique dès lors le régime de protection systématique par le juge, qui intervient dans un délai maximal de quinze jours, à défaut de contrainte, c’est une menace tout à fait claire qui pèse sur le malade : s’il ne se conforme pas au programme de soins, il risque de retourner en hospitalisation complète.
Il convient enfin de rappeler qu’à défaut d’un contrôle systématique des programmes de soins par le juge, la loi ouvre au patient la faculté d’introduire un recours, faculté qui semble toutefois peu utilisée.
c) La question du contrôle de l’hospitalisation des mineurs
Parmi les personnes ayant soulevé devant la mission d’information la question de l’hospitalisation des mineurs, Mme Virginie Duval, secrétaire générale de l’Union syndicale de la magistrature (USM) (14), constate que « l’hospitalisation des mineurs ne fait actuellement l’objet d’aucun contrôle, car on considère que quand l’hospitalisation d’un mineur est décidée à la demande des parents, elle est assimilée à une hospitalisation volontaire. On peut quand même considérer qu’un contrôle doit pouvoir être effectif, au moins à 15 jours puis tous les six mois, pour toute mesure d’hospitalisation, même quand elle est réputée volontaire, puisqu’à la demande des parents, avec assistance d’un avocat pour le mineur ».
De fait, l’hospitalisation du mineur, par définition, ne peut être que réputée volontaire. Hormis les cas d’ASPDRE, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur, de même que la levée de cette mesure, sont demandées par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou, sur le fondement des articles 375-3 et 375-9 du code civil, par le juge des enfants. L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT) ne peut donc s’appliquer à un mineur, mais les parents peuvent décider de la mise en œuvre de ces soins contre son gré : il est pourtant considéré comme hospitalisé en service libre, ce qui signifie en outre que la mesure ne peut faire l’objet d’un recours ou, a fortiori, d’un contrôle systématique du juge.
Dans certains cas, une telle mesure peut être inappropriée, répondant à des situations de type « crise d’adolescence » face auxquelles les parents se trouvent démunis davantage qu’à la nécessité de traiter une maladie mentale. Devant de telles possibilités de dérives, qui supposent certes l’intervention d’un médecin, se pose dès lors la question du contrôle dans ce domaine, même si le nombre de mineurs concernés est sans doute très faible, dans la mesure où peu d’entre eux sont en hospitalisation complète.
La question mérite d’autant plus d’être soulevée que le droit des mineurs est par ailleurs généralement très protecteur et que le système hospitalier se révèle inadapté. Bon nombre des personnes auditionnées ont attiré l’attention de la mission d’information sur les lacunes de l’organisation de la pédopsychiatrie. Ainsi que le soulignait M. Jean-Marie Delarue (15), Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « des mineurs en hospitalisation complète sont placés soit dans des services de pédiatrie classique, dans lesquels il ne peut être recouru à toute la thérapie nécessaire car ils n’y sont pas préparés, soit dans une unité d’hospitalisation de majeurs, de telle sorte que des adolescents âgés de 12 à 15 ans se trouvent au milieu d’adultes alors qu’ils n’ont rien à y faire ».
Votre Rapporteur est donc favorable à la poursuite de la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.
d) Le recours à la contention et à l’isolement
L’attention de la mission d’information a été attirée sur la recrudescence du recours à la contention et à l’isolement. Même si ces témoignages traduisent avant tout un ressenti qu’elle n’a pas encore pu étayer par des statistiques précises et même si, bien évidemment, la question ne touche pas que les personnes hospitalisées sans consentement, elle soulève des questions capitales, car ayant trait aux libertés fondamentales.
Ainsi que le relevait par exemple M. Jean-Marie Delarue (16), « nous pressentons quelquefois que des mesures de confort sont adoptées, notamment la nuit ; des médecins signent des ordonnances "si besoin", l’initiative revenant dès lors aux soignants ».
Dans le cadre de sa fonction de certification des établissements de santé, la Haute Autorité de santé (HAS) inclut le respect des libertés individuelles et la gestion des mesures de restriction de liberté parmi les dix « pratiques exigibles prioritaires » (« pour lesquelles le positionnement de l’établissement au regard de ces exigences fait l’objet d’une étude systématique par l’équipe d’experts-visiteurs et bénéficie d’une approche standardisée »). Le Dr. Cédric Grouchka, membre du collège de la HAS et président de la commission Recommandations de bonnes pratiques, a ainsi précisé devant la mission d’information (17) que « sur 168 établissements de santé mentale, 12 réserves ont été prononcées à ce titre, ce qui semble déjà beaucoup, compte tenu des questions essentielles liées à ce critère et de ce que le fait qu’il y ait des réserves traduit l’existence d’un problème important, une très grande majorité des points du référentiel du manuel d’accréditation n’ayant pas été remplis ».
Les personnes auditionnées ont avancé plusieurs raisons pour expliquer, sinon pour justifier, cette augmentation des mesures de contention et d’isolement. La faiblesse des effectifs soignants a ainsi été invoquée. L’installation de chambres d’isolement constitue en outre une incitation à s’en servir, tandis que l’établissement de protocoles, aussi bien pour la contention que pour l’isolement, s’il a permis d’encadrer ces pratiques aurait en même temps eu pour effet de les légitimer et, partant, d’en favoriser le développement. M. Jean-Marie Delarue (18) a également fait observer que « cette utilisation doit se faire en rapport avec ce qu’il est convenu d’appeler la "camisole chimique" », qui peut se substituer à ces mesures « physiques », même s’il a immédiatement précisé qu’« on peut intuitivement incliner à penser que [les établissements] qui ne pratiquent ni la contention ni l’isolement ne pratiquent pas non plus beaucoup la camisole chimique ».
De telles mesures peuvent sans doute parfois s’imposer pour une durée très brève : il n’appartient pas à notre mission d’information de déterminer s’il est médicalement nécessaire d’y recourir, mais les psychiatres font notamment apparaître la nécessité, au moment de la prise en charge initiale de la crise, de couper entièrement le malade de son environnement et de ses proches.
Mais l’interrogation sur ces pratiques est d’autant plus forte que les situations semblent inégales d’une région à l’autre, voire à l’intérieur même d’un établissement, alors que la prévalence des maladies n’est pas sensiblement différente : puisqu’il est établi que certains établissements n’y recourent pas du tout, pourquoi n’est-ce pas aussi le cas dans les autres ?
En tout état de cause, M. Jean-Marie Delarue (19) demande « depuis cinq ans [...] que les mesures d’isolement et de contention soient retracées dans des registres ad hoc, que la plupart des établissements ne tiennent pas, au motif que ces mesures sont déjà inscrites dans les dossiers médicaux » et alors qu’il s’agit d’une norme du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
e) Le contrôle de la privation de liberté dans le cadre de soins somatiques ou psychiatriques dispensés hors du champ psychiatrique, voire hors de l’hôpital
En novembre 2004, une conférence de consensus intitulée « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité » et organisée conformément aux règles méthodologiques préconisées par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), dont les missions ont été reprises par la HAS lorsque celle-ci a été instituée, indiquait qu’une enquête « réalisée auprès de personnes vivant en établissements avec hébergement a révélé que 120 000 personnes n’avaient pas le droit de sortir ou les moyens d’exercer leur liberté de sortir, et 100 000 ne sortaient en aucun cas. Mais, il n’est pas possible de préciser à partir de cette enquête s’il s’agissait d’une interdiction de sortir ou d’une impossibilité du fait de difficultés motrices ou d’absence de toute aide humaine ». La conférence relevait notamment que dans les établissements qui « deviennent des lieux de vie autant que de soins », « la question de la liberté d’aller et venir se pose alors pleinement et a été insuffisamment pensée ».
Dans son rapport d’activité 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté estime qu’il est « une population importante dont les risques d’atteinte aux droits fondamentaux ne sont pas minces : ce sont les personnes âgées placées en établissements d’hébergement », tout en relevant d’emblée que « quatre obstacles sérieux » s’opposent à l’extension de ses compétences à cette population :
– le placement ne trouve pas sa source dans la décision d’une autorité publique ;
– ces établissements ne sont pas associés à la notion de privation de liberté ;
– cette population n’est pas comparable à celles dont le contrôleur général a par ailleurs à connaître ;
– les moyens requis seraient considérables.
S’il relativise ensuite la portée de ces objections, tout en considérant que le plus important réside dans l’instauration d’un contrôle, quel qu’il soit, le contrôleur général déplore qu’« aucun instrument de constat sur place n’existe » et estime qu’il n’y a, « du point de vue de la garantie des droits fondamentaux, aucune différence dans la manière dont devraient être conduites les visites dans les établissements pour personnes âgées ».
Le Pr. Antoine Lazarus, professeur émérite de santé publique et de médecine sociale à l’université Paris XIII, a, lui aussi, souligné devant la mission d’information (20) que le problème était posé : « Faut-il une loi spécifique relative à la contrainte en psychiatrie et en santé mentale, alors que beaucoup de personnes sont hospitalisées sous contrainte hors du champ de la santé mentale, comme les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer qui, avec une contention dans leur lit et une barrière de chaque côté, sont privées de liberté dans les hôpitaux ordinaires ? Il faut prendre en compte de manière globale toutes les privations de liberté, notamment pour les personnes atteintes par des troubles de dégénérescence, et pas seulement la privation de liberté des personnes marquées par la maladie mentale et soignées en hôpital psychiatrique : avec l’allongement de la durée de vie et toutes les maladies chroniques qui vont invalider des personnes pendant une grande partie de leur vie, l’éthique médicale (droits des patients, loi de 2002) et les références dans le champ de la médecine et de la santé doivent-elles rester dans un monde différent de celui de la psychiatrie ou de la maladie mentale ? Tous les pays n’ont pas une loi spécifique pour la maladie mentale et la psychiatrie ; nous sommes habitués à des privations de liberté pour le bien somatique des personnes, même si elles durent des mois et des années : cette différence de sensibilité est assez étrange. »
De même, M. Xavier Gadrat (21), secrétaire national du Syndicat de la magistrature a soulevé la difficulté posée par les « nombreuses personnes placées dans des maisons de retraite spécialisées, de type Alzheimer ou autre, et qui font clairement l’objet d’une mesure d’enfermement. Il faut donc peut-être élargir à ces lieux la compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et, dès lors qu’il y a une mesure d’enfermement, il est indispensable que puisse s’exercer un contrôle ».
La question mérite assurément une réflexion approfondie, ne serait-ce que parce que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne se conçoivent pas comme des lieux de privation de liberté et que la prévalence des maladies neurodégénératives est appelée à augmenter dans les années à venir. En outre, certains de ces établissements ont, à la différence des autres lieux visités par le contrôleur général, un statut privé et les personnes âgées y ont leur domicile. Les concepts sont donc différents, mais il n’est pas interdit d’y regarder de plus près, même si les conseils généraux et les agences régionales de santé (ARS) exercent leurs propres compétences, car les conséquences potentielles sont les mêmes, à savoir la privation de l’exercice de libertés fondamentales.
La conférence de consensus susmentionnée a élaboré des recommandations en réponse à plusieurs questions, relevant par exemple qu’« une personne souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentée ne doit pas se voir interdire systématiquement de sortir seule, sauf si la situation présente à l’évidence un danger pour elle ». Le jury considérait que la contention constitue « une atteinte à la liberté inaliénable d’aller et venir. La contention systématique doit être interdite. Pour ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les études internationales démontrent que la contention ne réduit pas les risques de chute, risques qui semblent justifier le plus souvent son indication. Dans tous les cas, la recherche d’une alternative doit être réalisée : modification matérielle [...] ; approche occupationnelle [...] ; approche médicale et infirmière [...] ; approche socio-psychologique ». Le jury recommandait en outre la diffusion dans le champ médico-social des recommandations de bonnes pratiques définies en 2000 par l’ANAES pour les établissements de santé et la réalisation d’un « véritable plan national de recherche d’alternatives à la contention ».
Quelle que soit la nature des lieux fermés, il est essentiel d’y vérifier et, à défaut, d’organiser l’intervention d’un regard extérieur : c’est une garantie minimale des libertés individuelles, de prévention d’éventuelles dérives et la condition d’une réflexion constante sur les pratiques.
2. Le rôle des différents acteurs dans la décision d’admission
La loi de 2011 a notamment substitué à la notion d’hospitalisation (d’office ou sur demande d’un tiers) la notion d’admission, mais il est frappant de constater que les travaux préparatoires ne s’interrogent pas sur la portée de cette substitution, se bornant à la relever sans s’interroger sur tout le potentiel sémantique. Il y a pourtant là une véritable incohérence terminologique, dont il est difficile de croire qu’elle soit accidentelle ou, à tout le moins, qu’elle soit passée totalement inaperçue : « admission » constitue en effet un déni de la situation du patient qui, en réalité, fait l’objet d’un placement. Votre Rapporteur préconise donc de substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission. Cela étant, la décision d’admission en soins sans consentement est fondamentalement thérapeutique, dans la mesure où elle nécessite une appréciation précise et circonstanciée de l’état de santé du patient. Elle pourrait ainsi théoriquement relever d’un médecin de l’agence régionale de santé. En outre, l’admission est prononcée, avant tout, afin de protéger et de soigner le malade : la contrainte vise simplement à assurer, faute d’expression d’un consentement, la dispensation du soin.
Dans un arrêt du 2 octobre 2012 Plesó c. Hongrie , la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la maladie mentale ne constitue pas en tant que telle la justification d’une privation de liberté, mais que le respect de la liberté individuelle comme celui de l’ordre public peut conduire à écarter les recommandations médicales à l’initiative : il incombe « aux autorités médicales de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents liés, d’une part, à l’obligation pour la société de garantir aux personnes ayant des facultés réduites les meilleurs soins de santé possible et, de l’autre, au droit inaliénable de l’individu de maîtriser son destin (y compris le droit de refuser une hospitalisation ou un traitement médical, c’est-à-dire le droit d’être malade). Dès lors qu’un droit essentiel garanti par la Convention – la liberté personnelle – se trouvait en jeu, la marge d’appréciation de l’État en la matière n’était guère étendue. En effet, l’hospitalisation non volontaire ne peut être utilisée qu’en dernier recours, faute de solution moins intrusive, et uniquement si une telle mesure implique de réels bénéfices pour la santé sans faire peser sur l’intéressé une charge disproportionnée ».
La plupart des personnes auditionnées en sont convenues, mais les médecins, premiers intéressés, se refusent pour autant à prendre formellement une telle décision, même si, de fait, ils la conditionnent fortement. En outre, la décision n’est cependant pas purement médicale, car elle peut intégrer des considérations d’ordre public, notamment en cas de décision préfectorale, et qu’elle devrait systématiquement considérer la liberté individuelle. Dès lors, doit-il s’agir du préfet, du maire, du directeur d’établissement ou du juge ?
La loi de 2011, si elle a innové en faisant systématiquement intervenir le juge, n’a pas pour autant remis en cause le rôle du préfet dans la procédure de soins sans consentement, alors que les éléments de droit comparé fournis par les Parlements étrangers au travers du Service des affaires européennes de notre Assemblée font apparaître que cette caractéristique constitue une « exception française ».
En effet, les décisions de soins sans consentement relèvent :
– en Belgique, du juge de paix (ou, en urgence, du procureur du Roi sous la « forme d’une mise en observation » confirmée ou non par un juge dans les 24 heures) et, en matière pénale, des juridictions d’instruction et de jugement ;
– en Italie, du maire, autorité sanitaire la plus élevée, sur proposition d’un médecin (généraliste ou spécialiste), avec, pour l’hospitalisation, un second certificat établi par un médecin du service national de santé puis confirmation ou non de la mesure par le juge des tutelles dans les 48 heures ;
– au Québec, le juge intervenant au plus tard dans les 72 heures pour confirmer la demande d’un intervenant d’un service d’aide, du mandataire, du tuteur, du curateur, du conjoint (ou, en l’absence de conjoint, d’une personne démontrant pour la personne inapte un intérêt particulier) ou d’un proche parent, exécutée par un agent de la paix.
Mme Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne, représentant l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI), a montré, devant la mission d’information (22), qu’elle était consciente de la difficulté : « Je me rends compte que mon plaidoyer en faveur du préfet ne va pas dans le sens de l’histoire. On peut concevoir que le juge est le plus à même d’être celui qui décide de l’arrêt de la liberté. »
Cela étant, l’intervention du préfet, particulièrement au stade de la décision initiale, doit être relativisée car il prononce moins du quart des mesures de soins sans consentement. Néanmoins, il peut se prévaloir d’une place centrale dans le dispositif d’intervention d’urgence, notamment en raison de la disponibilité 24 heures sur 24 de ses services, et dispose, pour l’instruction de ses décisions, des moyens des agences régionales de santé.
Autrement dit, il apparaît que le préfet exerce aujourd’hui dans ce domaine un rôle en quelque sorte subsidiaire, lorsque aucune autre solution n’apparaît envisageable, en particulier en milieu rural, face à des violences sur la voie publique ou au domicile.
Cela étant, au stade de la décision de placement, si l’intervention du préfet dérange, au-delà même de l’immixtion d’une autorité administrative dans un processus de privation de liberté, c’est avant tout parce qu’elle est motivée par l’ordre public, même si ce n’est pas le seul motif de cette intervention. À cet égard, le témoignage du Dr. Philippe Gasser, membre du bureau de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP) et responsable d’une unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP) au centre hospitalier Le Mas Careiron (Uzès) (23), est éclairant : « J’assiste à la psychiatrisation de personnes qui ont refusé un contrôle d’alcoolémie en se querellant verbalement avec les forces de police un vendredi soir et qui aboutissent pendant 72 heures, jusqu’au lundi matin ou au mardi matin, en psychiatrie alors qu’il n’y a aucun trouble psychiatrique, sans aucun recours, sans visite, sans communication et sans le bénéfice d’un avocat. »
Il déplore de ce fait que les « troubles à l’ordre public [soient] psychiatrisés sans discrimination d’origine : on y retrouve des troubles organiques, liés par exemple à l’épilepsie, à l’hypoglycémie et aux tumeurs frontales. [...] Il y a de graves erreurs d’aiguillage : des personnes arrivent à la suite de troubles à l’ordre public pour des raisons somatiques sans jamais être passées par les urgences somatiques et aboutissent directement à l’hôpital psychiatrique par le biais de placements sous contrainte ».
L’une des causes en est selon lui qu’« il est beaucoup plus facile pour la gendarmerie de demander un vendredi ou un samedi soir au maire d’une commune rurale de prendre un arrêté, même provisoire, d’internement, plutôt que de garder des personnes en cellule de dégrisement, les gendarmes reconnaissant eux-mêmes que cela leur évite d’avoir à suivre des procédures administratives, à faire des écritures, à surveiller la cellule de dégrisement et à appeler le médecin de garde à plusieurs reprises ».
Enfin, le rôle du préfet dans la mainlevée des mesures de soins sans consentement, renforcé par la loi de 2011, interroge sans doute davantage qu’au stade de la décision initiale.
La mission a conclu que le préfet ne pouvait être exclu du dispositif des soins sans consentement.
Le maire et, à Paris, les commissaires de police peuvent prendre toute mesure provisoire nécessaire, y compris la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, « à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes [...] en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ». Le Conseil constitutionnel, saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, a supprimé, par une décision d’octobre 2011, la référence à la notion de « notoriété publique » à défaut d’avis médical.
Le maire doit en référer dans les 24 heures au préfet : celui-ci statue sans délai et prend éventuellement une mesure d’ASPDRE. Faute de décision du préfet, les mesures provisoires arrêtées par le maire deviennent caduques au terme d’une durée de 48 heures.
M. Jean-Marie Delarue (24) a indiqué à la mission d’information que parmi les ASPDT, il observe que « la part des admissions en urgence, à l’initiative du maire, sur le fondement d’un seul certificat de psychiatre [...] croît et est assez largement majoritaire dans les établissements que nous avons visités, le préfet couvrant toujours ensuite. Certaines manifestations de voie publique sont effectivement un peu spectaculaires et inquiétantes, mais il n’y a pas d’explication rationnelle et satisfaisante à ce qu’elles aient été tolérées il y a vingt ans et qu’elles ne le soient plus maintenant ».
Par sa connaissance de sa commune et sa proximité avec ses administrés, le maire peut incontestablement jouer un rôle dans la procédure. La préoccupation de la mission d’information réside toutefois dans la très grande hétérogénéité des pratiques, certains maires adoptant manifestement une conception très large des notions de « troubles mentaux manifestes » et de « danger imminent pour la sûreté des personnes » : la vigilance doit être de mise, même si ces mesures d’urgence présentent un caractère provisoire et doivent rapidement être confirmées ou infirmées par le préfet.
c) Le rôle discret mais prépondérant du directeur d’établissement
Entendus par la mission d’information, différents représentants des directeurs d’établissement ne se sont pas montrés hostiles à assumer l’ensemble des admissions en hospitalisation sans consentement, pour peu, bien entendu, qu’elles soient étayées par un avis médical, tout en considérant que cette décision ne relevait pas du pouvoir médical. À la différence de la plupart des autres acteurs de la procédure, le directeur d’établissement appréhende en effet l’hospitalisation sans consentement avec une certaine neutralité, comme une admission normale, c’est-à-dire une simple mesure d’administration : il s’assure par un contrôle formel que les pièces et conditions de l’hospitalisation sans consentement sont réunies, mais, à la différence de la décision préfectorale, ni les libertés individuelles ni l’ordre public n’entrent en considération dans le processus qui le conduit à admettre un malade.
De plus, Mme Nicole Questiaux (25) fait observer que « cette affaire est aussi l’enjeu d’une bataille considérable pour les moyens : tout le monde étant à la portion congrue, le problème est de savoir qui va obtenir les moyens. Est-ce les psychiatres des prisons avec leurs unités particulières, la psychiatrie généraliste, le secteur ou l’établissement ? Je ne pense pas qu’il faut donner ces décisions au responsable d’une des solutions ; c’est simple : celui qui est responsable des murs ne doit pas avoir la possibilité de remplir son établissement ».
Dans ces conditions, la mission d’information, à ce stade de ses travaux, ne peut conclure que l’ensemble des décisions pourraient être confiées aux directeurs d’établissement, même s’ils en prennent d’ores et déjà aujourd’hui plus des trois quarts.
d) La possibilité pour le juge de prendre les mesures de soins sans consentement
S’agissant d’une privation de liberté, il ne serait pas illogique que l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle » en vertu de l’article 66 de la Constitution, soit amenée à prendre elle-même les mesures de soins sans consentement. Plutôt que d’en contrôler la conformité a posteriori, le juge des libertés et de la détention deviendrait ainsi un « juge administrateur », avec toutefois le risque que sa dénomination même, évoquant la délinquance, puisse apparaître stigmatisante et n’exerce ainsi des effets contraires à ceux souhaités (cf. infra B.1.).
En outre, se poserait ensuite l’éternelle question : qui contrôlera le contrôleur ? En effet, devant être formé par une personne vulnérable et privée de sa liberté d’aller et venir, l’appel ne serait pas systématique : une telle réforme pourrait donc se traduire par un recul des garanties bénéficiant aux personnes faisant l’objet de mesures de soins sans consentement.
Enfin, il y aurait un risque d’engorgement du système judiciaire, d’autant que le regroupement des contentieux administratif et judiciaire, depuis le 1er janvier dernier, a déjà accru la charge des juges de la liberté et de la détention.
Une autre possibilité consisterait donc à confier ce pouvoir au procureur de la République. Le principe serait identique à celui des ordonnances de placement provisoire qu’il est habilité à prendre à l’égard des mineurs en danger, lesquelles sont confirmées ou non sous huit jours par un magistrat du siège.
Il faut cependant être conscient du fait que le patient ne gagnerait concrètement pas grand-chose au transfert à un juge du pouvoir de décision en matière de soins sans consentement, voire risquerait d’être un peu plus stigmatisé qu’il ne l’est déjà. En outre, il ne fait pas de doute que les tribunaux ne bénéficieraient pas d’un transfert des moyens que les services des préfectures pourraient ainsi dégager.
Enfin, et surtout, si l’on veut respecter le principe du contradictoire, l’audience aura nécessairement lieu au tribunal de grande instance, puisqu’à ce stade, le malade n’est pas encore hospitalisé, et que, à supposer d’ailleurs qu’il ait pu être appréhendé ou transporté, elle se déroulera, par définition, dans des conditions très difficiles s’il traverse une crise.
3. Les dysfonctionnements du système : parcours et capacités
Les auditions menées par la mission d’information font apparaître que l’admission, en raison de problèmes d’organisation du transport sanitaire et de la prise en charge en urgence et d’insuffisance des capacités d’accueil, ne se fait pas nécessairement dans de bonnes conditions, sans compter que certaines hospitalisations libres sont parfois « transformées » en hospitalisations sans consentement.
a) Les difficultés de la prise en charge
Les auditions ont d’abord fait apparaître les nombreuses difficultés concrètes que peut présenter l’exécution d’une décision d’hospitalisation sans consentement du simple point de vue du transport.
Notre ancien collègue Serge Blisko, président du conseil de surveillance du centre hospitalier Sainte-Anne et par ailleurs co-auteur avec M. Guy Lefrand du rapport d’information n° 4402 du 22 février 2012 (26), a ainsi indiqué (27) que « en cas d’hospitalisation d’office, le préfet peut requérir les moyens de la force publique et même une ambulance spécialisée ; en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, les situations sont très variables dans les faits et il est parfois difficile d’assurer le transport. L’absence de cadre réglementaire dans ce domaine est dommageable, car cette difficulté à entrer dans le circuit psychiatrique constitue un obstacle à l’obligation de soins. À Paris, toutefois, la police prête plus facilement son concours et il existe en outre les centres psychiatriques d’orientation et d’accueil (CPOA), qui font en quelque sorte office de "services portes" ainsi que l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P), qui n’est pas un établissement de santé mais qui travaille bien, et ce dans le délai maximal de 48 heures qui lui est imparti ».
M. Édouard Couty, président de la commission (28) « Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » (2008-2009), décrivait les difficultés en des termes proches : « À partir du moment où un placement en soins sous contrainte a été prescrit, sous quelque forme que ce soit, il faut assurer la mise en sécurité du malade. Or, plus le prescripteur est éloigné de l’hôpital, plus se pose la question du maintien en sécurité du patient pour lui et pour son environnement, notamment durant le transport. Je ne sais pas s’il y a une solution, car si l’on veut sécuriser le transport, il faut requérir la force publique. De mon expérience du milieu hospitalier, je me souviens qu’un patient placé en hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers arrivait à l’hôpital avec un premier certificat, le second étant signé par le médecin hospitalier. Ce n’était donc pas tout à fait la même situation [...].
« Le patient est placé sous la responsabilité de celui qui le transporte : les ambulanciers privés refusent généralement d’assurer ce type de transports et tous les hôpitaux ne disposent pas d’ambulance. Face à des situations de crise, parfois violentes, à domicile ou en famille, ce sont en fait les pompiers qui assurent le transport, mais à ma connaissance, aucune solution structurée n’a jamais été organisée, que ce soit par la loi ou par les établissements. Il est vrai que les cas sont extrêmement divers et toujours très compliqués. »
La mission d’information propose donc de mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne faisant l’objet d’un placement.
b) La mauvaise organisation des urgences et l’orientation des malades par défaut
Quand le placement intervient en urgence, beaucoup d’intervenants ont mis en lumière les difficultés posées par l’orientation du patient, hormis dans les régions, notamment l’Île-de-France, dotées de centres psychiatriques d’orientation et d’accueil (CPOA).
M. Édouard Couty décrit ainsi le parcours du patient : il arrive « aux urgences de l’hôpital général : si l’on a la chance d’y trouver, comme il se doit théoriquement, un interne en psychiatrie, il peut être orienté ; si l’on n’a pas cette chance, ce qui arrive fréquemment, il se retrouve dans les arcanes d’un système qui n’assure pas une prise en charge précoce de bonne qualité et de nature à résoudre correctement la crise. La question nous avait paru révélatrice d’un dysfonctionnement important de notre système et elle repose en grande partie sur la formation des professionnels ainsi que sur la nécessaire coopération entre les établissements spécialisés et les urgences des hôpitaux généraux ».
M. Jean-Marie Delarue (29) souligne quant à lui l’apport des unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP) : « On amène à l’hôpital, sous contrainte ou non, des malades en plein délire et en pleine crise et on s’aperçoit qu’il n’est pas forcément possible de les placer dans une unité. Il est heureux que des unités d’admission d’urgence, telles les USIP, soient actuellement développées et que des personnes en agitation y soient admises, le personnel soignant sachant parfaitement comment les traiter. Ces sas qui se créent entre le dehors et l’unité sectorielle sont bienvenus et généralement bien organisés, tant du point de vue des soins nécessaires que de la notification aux malades des voies de recours. »
Il fait également apparaître que les secteurs, « notamment dans les grandes agglomérations, sont incapables d’admettre des personnes venant sans être rattachées auparavant à ces secteurs. Le problème se pose notamment pour les détenus, incarcérés dans un département autre que celui de leur résidence et qui relèveraient d’un secteur de ce département de résidence. Les hôpitaux du département d’implantation de la prison adoptent deux attitudes : soit ils prennent tous les détenus, soit ils ne prennent que ceux qui ont la chance d’habiter à la fois dans la prison et dans le département. Ces situations sont marginales mais on risque d’avoir des personnes que les hôpitaux n’admettent pas, qui sont gardées en détention et qui ne pourront pas être soignées ».
Enfin, le Pr. Antoine Lazarus (30) s’inquiète du phénomène suivant : « Les personnes hospitalisées sous contrainte après une infraction ou un trouble à l’ordre public vont aller soit vers la psychiatrie, soit vers la prison, le plus souvent faute de dispositif intermédiaire qui permettrait d’éviter de recourir à l’une ou l’autre de ces solutions. » Sa conclusion est préoccupante : « Je me demande, pour ce qui est des hospitalisations sous contrainte, si certaines hospitalisations ou incarcérations sont décidées par défaut. »
Alors que d’autres malades attendent d’être prise en charge, des lits sont occupés en raison de la tendance des préfets à retarder la mainlevée des mesures d’hospitalisation sans consentement. Dès lors, afin de libérer des places, les établissements sont contraints de faire sortir d’autres patients trop tôt, ceux-ci risquant donc de devoir retourner en établissement à brève échéance.
d) La « transformation » d’hospitalisations libres en hospitalisations sous contrainte
M. Jean-Marie Delarue (1) rapporte qu’« il arrive [...], quand une personne souhaite quitter l’hôpital mais qu’on estime que ce n’est pas souhaitable, que des hospitalisations libres soient transformées en hospitalisations sous contrainte. Nous surveillons attentivement ces procédés dans les registres et il y en a toujours quelques cas dans les établissements : nous ne pouvons apprécier s’ils sont justifiés, mais ils sont désagréables dans leur principe ».
4. L’appréciation de l’état du malade
D’un côté, l’état de santé mentale du malade peut être apprécié par un médecin non psychiatre, tandis que, de l’autre, l’évaluation de son état de santé somatique est encore trop souvent négligée.
a) La possibilité pour un médecin non psychiatre d’établir un certificat en vue d’une admission en soins sans consentement
La décision d’ASPDT est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant des soins sans consentement (article L. 3212-1 du code de la santé publique). De même que, le cas échéant, le certificat attestant du « péril imminent pour la santé de la personne », il n’est pas nécessairement établi par un psychiatre : ce n’est qu’après l’admission en soins psychiatriques, avec ou sans consentement, qu’un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental de le personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions (article L. 3211-2-2 du même code).
La possibilité pour un médecin non psychiatre d’établir un certificat en vue d’une admission en soins sans consentement interroge plus particulièrement « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade », l’admission pouvant alors être prononcée au vu non plus de deux mais d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (article L. 3212-3). Dès lors, ainsi que le remarquait le Dr. Catherine Paulet (31), « cet avis médical doit-il être nécessairement celui d’un psychiatre ? Ce serait idéal, mais c’est bien souvent un médecin généraliste qui est appelé au chevet d’un patient en extrêmement grande difficulté ».
Or, bon nombre d’intervenants ont déploré devant la mission d’information les insuffisances de la formation initiale et continue en psychiatrie, notamment pour les médecins généralistes. Ainsi de M. Édouard Couty : « Les médecins généralistes sont peu ou mal formés à la psychiatrie : dans la maquette de l’internat de médecine générale, il n’y a pas de stage obligatoire en psychiatrie, que ce soit dans un service hospitalier, où l’on peut voir des cas lourds, ou en ambulatoire. Or, une enquête effectuée dans une région auprès de plusieurs centaines de généralistes avait montré que près de 60 % des premières consultations données par ces médecins étaient associées à un besoin de conseil psychiatrique et que le généraliste se trouvait souvent dépourvu, car il n’était pas toujours évident d’adresser le patient dans des délais rapprochés à un psychiatre libéral et encore moins facile, dans une situation de crise, de trouver une place en hôpital psychiatrique. »
b) L’insuffisance de la prise en considération des affections somatiques
M. Jean-Marie Delarue, au cours de son audition comme dans son rapport d’activité 2012, a relevé les insuffisances des examens somatiques pratiqués sur les patients traités pour des troubles mentaux. Bien que la question touche l’ensemble des malades, et pas seulement ceux qui sont hospitalisés sans leur consentement, elle est particulièrement importante, car on sait que l’espérance de vie des personnes souffrant de troubles mentaux est inférieure de quinze ans à la moyenne, et même de vingt ans pour celles atteintes des maladies mentales les plus sévères.
En effet, comme l’ont indiqué respectivement le Dr. Jean-Luc Roelandt, directeur du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche et la formation en santé mentale (Lille), et le Pr. Marion Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires Mondor (Créteil) (32), « leurs problèmes somatiques ne sont pas correctement pris en compte alors même que les déterminants de santé sont identiques » et « la majorité des patients porteurs de maladies mentales sont atteints d’une maladie somatique qui, souvent, a débuté avant même le début de la maladie psychiatrique. [...]. Ces personnes ont souvent plusieurs maladies psychiatriques et plusieurs maladies somatiques associées ».
Ainsi que l’a précisé le Dr. Cédric Grouchka (33), la HAS a désormais inclus la prise en charge somatique des patients, critère spécifique à la santé mentale, dans ses dix « "pratiques exigibles prioritaires" [...] pour lesquelles le positionnement de l’établissement au regard de ces exigences fait l’objet d’une étude systématique par l’équipe d’experts-visiteurs et bénéficie d’une approche standardisée ». Sur les 168 établissements de santé mentale soumis à certification, neuf ont fait l’objet de réserves à ce titre.
Certes, selon M. Jean-Marie Delarue (34), « la loi de 2011 a heureusement instauré l’obligation de procéder à un examen somatique à l’entrée, qui n’a pas soulevé de grosses difficultés d’application et qui se pratique à peu près dans tous les établissements que nous avons visités » (article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique). Cependant, « les services de psychiatrie liés à des hôpitaux généraux ont évidemment plus de facilité puisque des astreintes régulières de médecins somaticiens ont été mises en place : une fois par semaine en moyenne, un médecin examine les malades qui doivent l’être ».
Il observe en outre que « la situation est quelquefois beaucoup plus compliquée dans les centres hospitaliers spécialisés pour lesquels les liens avec la médecine somatique dépendent des initiatives des uns et des autres ainsi que des possibilités et de l’envie des confrères de l’hôpital général, situé, dans certains cas, à des dizaines de kilomètres : l’offre de soins est donc insuffisante, les médecins ne venant que sur demande caractérisée et les soignants en psychiatrie
– dont on peut espérer qu’ils ne sont pas incompétents dans les matières somatiques, d’autant que les infirmiers psychiatriques sont désormais des infirmiers de droit commun – ayant des évaluations généralement fondées mais interprétant parfois incorrectement la gravité d’une maladie. Comme le malade est toujours un peu en fragilité de demande et qu’il peut ne pas être cru, la gravité de certaines situations peut être méconnue. [...] Il n’y a pas de pénurie de praticiens mais simplement des problèmes d’organisation et surtout de prise de conscience des psychiatres, qui doivent s’accommoder de la présence d’autres praticiens à leur côté, lesquels vont gérer d’autres domaines de la santé du patient, évolution qui ne vient pas spontanément à l’esprit de certains d’entre eux ».
En conclusion, il estime que « dans le droit fil de la loi de 2011, il ne serait pas illégitime d’affirmer qu’un examen somatique doit être pratiqué à intervalles réguliers et que les moyens nécessaires doivent être trouvés à cette fin ».
Votre Rapporteur suggère d’améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.
B. L’INTERVENTION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
L’un des apports de la loi de 2011 a été d’instaurer l’intervention automatique d’un juge en matière d’hospitalisation sans consentement – et non pas pour les soins ambulatoires sans consentement, pour lesquels il peut toutefois être facultativement saisi (cf. supra A.1.). Cette automaticité est donc très récente : mise en œuvre très rapidement dès l’été 2011, où il a en outre fallu traiter le « stock » des mesures antérieurement prononcées, elle peut cependant déjà faire l’objet d’un premier bilan et de propositions.
Avant même toute considération sur le fonctionnement du nouveau système, les auditions ont fait apparaître une interrogation sur le choix même du juge des libertés et de la détention. En tout état de cause, l’application de la loi de 2011 soulève des problèmes au stade de l’accès au juge et à celui de son intervention ainsi que dans l’organisation judiciaire.
1. Les questions soulevées par l’intervention du juge des libertés et de la détention
Le choix même du juge des libertés et de la détention a été sinon contesté du moins questionné devant la mission d’information par plusieurs intervenants.
a) Le rôle du juge des tutelles
En novembre dernier, le congrès de l’Association des directeurs d’établissements participant au service public de santé mentale (ADESM), avait fait valoir que le juge des libertés et de la détention n’avait rien à faire dans le traitement des malades mentaux et qu’il appartenait au juge des tutelles, qui connaît bien le sujet car il statue sur beaucoup de cas de cette nature, de statuer sur le maintien de la personne à l’hôpital.
C’est toutefois sans doute méconnaître que si les établissements entretiennent une relation ancienne et de qualité avec les juges des tutelles, la nature de cette relation serait profondément bouleversée si ceux-ci devaient désormais être compétents à l’égard des mesures de soins sans consentement.
M. Jean-Marie Delarue a en outre estimé (35) qu’il ne faudrait pas « instaurer différentes sortes de juges qui vont tous statuer sur la question de la liberté d’une personne : l’unicité des contentieux est préférable, puisque seul le juge des libertés et de la détention est en mesure de porter une appréciation satisfaisante sur la liberté. Le juge des tutelles a certes quelque expérience en la matière, mais les juges des libertés et de la détention vont en avoir aussi ».
b) Le maintien du terme de « détention » dans la dénomination du juge
Il a par ailleurs été souligné que le terme de « détention », alors même que bon nombre des personnes faisant l’objet d’une décision de soins sans consentement n’ont pas commis de crime et de délit et que, au contraire, elles traversent souvent des états de terreur, est de nature à les inquiéter ou, à tout le moins, à les stigmatiser, en renvoyant au système pénal et carcéral. M. Jean-Marie Delarue suggérait ainsi : « Il faut peut-être ôter les mots "et de la détention" ».
La difficulté pourrait toutefois être contournée en disposant que le juge appelé à intervenir en cette matière est désigné par le président du tribunal de grande instance, libre à lui de choisir un juge des libertés et de la détention.
2. La difficulté d’accès au juge des libertés et de la détention
L’exercice, par les malades, de leur droit de recours se heurte à des difficultés matérielles. Il a été rapporté que certains malades sont empêchés, sinon de saisir le juge ou de bénéficier de son intervention, mais du moins de comparaître physiquement devant lui. Enfin, le cas où le malade use de son droit de ne pas se présenter à l’audience et refuse de disposer d’un avocat soulève une vraie difficulté quant à l’effectivité de ses droits.
a) L’exercice de leur droit de recours par les malades
Pour avoir accès au juge, encore faut-il que le malade, qui n’est pas familier du contentieux et, par conséquent, ignore le plus souvent les modalités de recours au juge, soit suffisamment informé de ses droits et, plus particulièrement, des voies de recours dont il dispose, conformément aux dispositions de l’article 6 de la recommandation Rec (2004) 10 du 22 septembre 2004 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux : « Les personnes traitées ou placées en relation avec des troubles mentaux devraient être informées individuellement de leurs droits en tant que patients et avoir accès à une personne ou à une instance compétente, indépendante du service de santé mentale, habilitée à les assister, le cas échéant, dans la compréhension et l’exercice de ces droits. »
Le problème se pose déjà au moment de la notification des droits au malade, qui arrive généralement à l’hôpital en urgence et dans un état d’agitation. Comme le relève le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « la plupart des soignants répondent à cette question en différant de quelques heures ou de quelques jours l’information sur les voies de recours ouvertes au malade ». Mais M. Jean-Marie Delarue va plus loin (36) : « Y pense-t-on toujours ? Le fait-on au moyen de formulaires ou simplement par oral ? Cette information est-elle rigoureuse, précise et documentée ? Après nous être enquis, auprès de soignants, de leurs pratiques et, auprès des malades, de la manière dont ils avaient été avisés de ces droits, nous pensons que ce n’est souvent pas le cas et que des précautions suffisantes ne sont pas prises. Bon nombre de formulaires d’accueil, rédigés par les établissements, sont insuffisamment précis : ils indiquent par exemple que le malade peut s’adresser au juge, mais sans mentionner d’adresse ni de numéro de téléphone. »
C’est d’abord le moment de la notification qui pose problème : elle ne doit pas intervenir trop tôt, faute de quoi le malade n’est pas en état de comprendre cette notification, de telle sorte qu’un temps d’attente doit être prévu. Faut-il, pour autant, communiquer ces informations au moment de l’intervention systématique du juge des libertés et de la détention, qui notifierait en même temps ses droits au malade ? Le délai, pouvant actuellement aller jusqu’à 15 jours, risquerait d’être trop long.
La preuve de la notification n’est guère plus aisée, si l’on ne veut pas se contenter de la simple preuve formelle que la notification a été accomplie, mais bien s’assurer que celle-ci a été correctement comprise. Reviendrait-il au psychiatre de dire si le malade est en mesure de comprendre la notification ?
Enfin, faut-il, le cas échéant, en fonction du moment et de l’état du malade, procéder à cette notification à un tiers ? Cela suppose déjà qu’il ait pu être désigné, ce qui est loin d’être la règle (cf. infra C.3.).
Toujours selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « le ministère de la santé est quelque peu défaillant pour encadrer les pratiques hospitalières : il est très déconcertant de voir que les livrets d’accueil sont conçus établissement par établissement. Les établissements doivent évidemment conserver la possibilité de le faire, mais il faudrait qu’un livret d’accueil minimal, dont les stipulations devraient être reprises par tous les livrets d’accueil, soit défini à l’échelon national, comprenant la mention des délais de recours, l’obligation de faire figurer l’adresse du tribunal de grande instance, l’affichage du tableau des avocats du ressort du tribunal, ... Tout cela devrait être universellement admis, mais les directions des établissements n’en ont pas forcément l’idée et comme les malades ne sont souvent pas en état de protester, il ne se fait rien ».
Il insiste en outre sur le fait qu’une exception au moins doit être consentie, durant la « phase de coupure du monde extérieur qui entraîne la rupture des liens téléphoniques, de l’écrit et de tout contact familial pendant une semaine, voire davantage » : l’accès à l’avocat, « faute de quoi la personne malade se trouve démunie, même si on lui a fourni les informations nécessaires pour trouver le tiers qui va faire fonction d’intermédiaire ».
M. Jean-Marie Delarue fait en outre remarquer que d’un simple point de vue matériel, les malades ne disposent pas toujours des moyens de former un recours : « Nous avons ainsi rencontré un malade qui nous a dit avoir voulu former un recours, mais qui ne disposait pas de papier, de crayon ou de téléphone. La plupart des établissements seraient sans doute prêts à régler ces questions si le ministère de la santé leur donnait des instructions suffisamment précises, qui ne relèvent pas de la loi, laquelle doit cependant énoncer que la voie et les délais de recours doivent être signifiés à la personne et doivent ensuite pouvoir se concrétiser. »
C’est pourquoi, votre Rapporteur suggère d’améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.
b) L’établissement systématique par certains psychiatres de certificats dispensant le malade de comparaître devant le juge
Estimant qu’« un certain nombre de psychiatres ont assez mal vécu l’intervention du législateur dans ce qu’ils considèrent – plus à tort qu’à raison – comme une prérogative relevant d’eux seuls » et qu’« ils n’ont donc pas accepté l’intervention du juge des libertés et de la détention dans le délai de quinze jours », M. Jean-Marie Delarue a souhaité attirer l’attention de la mission d’information sur la « grève » de la comparution devant le juge (37) : « La loi prévoit la possibilité pour le psychiatre de dispenser un malade de cette comparution en raison de son état, et, dans certains établissements de la banlieue parisienne, des certificats de ce genre étaient systématiquement produits, de telle sorte que plus aucun malade, quel que soit son état réel, ne pouvait comparaître devant le juge ». Il considère cependant que « ces manifestations sont [...] très minoritaires et vont s’atténuer peu à peu : on va heureusement comprendre que la loi s’applique à tous, y compris aux quelques psychiatres qui n’ont pas envie qu’elle s’applique ».
c) La représentation du malade par un avocat
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que « si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne [faisant l’objet de soins psychiatriques] est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office ». Pour autant, il ne règle pas la totalité du problème posé par l’absence de la personne concernée à l’audience, en particulier lorsque la personne refuse de se présenter à l’audience, tout en ne sollicitant pas la désignation d’un avocat.
Autrement dit, la personne est ainsi à la fois considérée comme incapable de consentir aux soins sans consentement mais capable de renoncer à l’un de ses droits, celui d’assurer sa défense, conformément au 4 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »). À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme considère que ces dispositions exigent que les personnes soient mises à même d’être représentées par un avocat, même si elles n’accomplissent pas elles-mêmes une telle démarche.
La présence d’un avocat semblant de fait assurée dans la quasi-totalité des cas, la question se pose sans doute davantage du point de vue des principes, même si, au-delà, les auditions ont montré que l’effectivité de la présence de l’avocat est soumise à plusieurs aléas, les moindres n’étant pas la possibilité d’une rencontre effective entre le patient et son avocat et la très faible rémunération allouée à l’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle (4 unités de valeur, soit 92,72 euros) au regard d’un coût que Me Vincent Potié (38) évalue à 525 euros en première instance et à 475 euros en appel.
Des inégalités en matière d’effectivité du droit à un avocat ont également été signalées outre-mer, tandis que le barreau de Lille, estimant qu’il n’était pas en mesure d’accomplir correctement ses missions au vu de la faiblesse du montant de l’aide juridictionnelle, a cessé de désigner des avocats commis d’office. Votre Rapporteur déplore cette situation qui dure depuis plus d’un an et souhaiterait qu’une solution soit rapidement trouvée, malgré le contexte budgétaire contraint.
Votre Rapporteur propose de rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et de modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
3. Les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention
Les principales difficultés apparues à ce titre dans l’application de la loi de 2011 ont été abordées au fil des auditions menées par la mission d’information. Il en ressort de fortes interrogations quant à la durée du délai dans lequel le juge doit statuer, à la faculté pour le juge de rejeter sans tenir d’audience les demandes répétées de mainlevée de mesures de soins psychiatriques manifestement infondées, à l’obligation de lui communiquer le bulletin n° 1 du casier judiciaire, au lieu dans lequel se tient son audience et, enfin, à la publicité de cette audience.
a) Le délai dont dispose le juge pour statuer
En cas de recours facultatif, l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours courant à compter, en première instance, de l’enregistrement de la requête et, en appel, de la saisine du premier président (25 jours si une ou deux expertises ont été ordonnées).
En cas de contrôle systématique, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique fixe un délai avant l’expiration duquel le juge doit avoir rendu sa décision (prolongé d’au plus 14 jours si une expertise a été ordonnée) : 15 jours en cas d’ASPDT et d’ASPDRE, six mois en cas de soins sans consentement décidés par le juge.
Or, un consensus ressort clairement parmi les personnes auditionnées, que résument fort bien les propos tenus par Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY) (39) : « Il ne fait pas de doute que l’opportunité d’ordonner des soins sous contrainte peut être appréciée en 72 heures. » Une hospitalisation sans consentement injustifiée est, par définition, toujours trop longue. Dès lors, pourquoi devrait-elle durer deux semaines ?
Dans ces conditions, un consensus paraît se dégager sur la nécessité de raccourcir le délai accordé au juge lorsqu’il statue dans le cadre du contrôle systématique de l’hospitalisation des soins sans consentement. Les auditions et débats montrent toutefois qu’il n’est peut-être pas opportun de le ramener à 72 heures, car il faut également tenir compte des contraintes d’organisation des juridictions.
Votre Rapporteur propose, donc, de ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.
Ce raccourcissement devrait en outre produire deux effets positifs :
– le nombre de certificats exigés des psychiatres serait moindre, ce qui allégerait des obligations administratives jugées extrêmement chronophages (cf. infra C.1.) ;
– il réduirait la durée des périodes d’hospitalisation sans consentement lorsque cette procédure est abusivement utilisée « à répétition » (par le jeu d’une levée de la mesure avant l’intervention et du prononcé immédiat d’une nouvelle mesure, le compteur du délai d’intervention du juge étant alors remis à zéro).
b) La faculté pour le juge de rejeter sans tenir d’audience les « demandes répétées » de mainlevée « manifestement infondées »
Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’USM (40), a rappelé que son organisation, lors de l’examen de la loi de 2011 par le Parlement, avait souhaité que soient prévus « des dispositifs lorsqu’une requête et un contrôle systématique parviennent au même moment devant le juge : il n’est alors pas forcément nécessaire de prévoir deux audiences. De même, si plusieurs requêtes successives sont présentées, il faut peut-être prévoir – comme c’est le cas dans un contentieux différent mais présentant certains parallèles, en matière de détention provisoire – la possibilité de regrouper ces demandes, lorsque plusieurs demandes arrivent alors qu’il n’a pas encore été répondu à la première. Le législateur a partiellement suivi cette voie, mais le décret du 18 juillet 2011, contra legem, a repris une disposition antérieure. ».
En effet, l’article R. 3211-26 du code de la santé publique prévoit que « le juge peut rejeter sans tenir d’audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées » : il contrevient clairement au principe de l’obligation de l’audience posé par la loi, même lorsque le patient ne peut comparaître à raison de son état de santé.
La loi envisage certes le cas où le juge est saisi à la fois d’une requête et d’une saisine pour contrôle systématique : l’article L. 3211-12-3 du code de la santé publique prévoit alors qu’il peut ne tenir qu’une seule audience et statuer par une même décision. Mais si le patient est absent parce qu’il n’a pas pu être transféré en juridiction, le juge ne peut statuer en son absence, sauf si le patient a expressément donné son accord pour être représenté. L’audience est donc la règle, à laquelle la loi ne prévoit que des exceptions limitées.
Cette contradiction entre la loi et le décret pourrait être réduite à l’occasion d’une révision de la loi de 2011.
c) L’obligation de communiquer au juge le bulletin n° 1 du casier judiciaire
Par une circulaire du 21 juillet 2011 (41), le ministère de la justice demande aux greffes de réclamer systématiquement le bulletin n° 1 du casier judiciaire du patient afin de vérifier si la mesure de soins sans consentement est consécutive à une décision d’irresponsabilité. Or, le directeur d’établissement, en adressant au juge la décision judiciaire ou l’arrêté préfectoral sur le fondement desquels l’admission a été prononcée, communique déjà ce renseignement.
MM. Serge Blisko et Guy Lefrand, dans leur rapport d’information précité, relevaient déjà à cet égard que « cette précision est pour le moins étonnante dans la mesure où la décision d’admission figure dans tous les cas parmi les pièces du dossier. Et son utilité apparaît d’autant plus contestable que, d’après les informations transmises à vos rapporteurs par le Syndicat de la magistrature, seules les décisions d’irresponsabilité pénale prises depuis 2008 et accompagnées d’une mesure de sûreté ou d’hospitalisation figurent au casier judiciaire. En conséquence, cette pièce n’apportera aucune information sur les décisions prises antérieurement, ni sur les décisions d’admission en soins suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale prises par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique ou, a fortiori, sur les décisions d’hospitalisation en unité pour malades difficiles ».
Alors même que cette précision paraît redondante, elle a pour conséquence la communication à toutes les parties à la procédure des informations que comporte le bulletin n° 1, soumises ici au principe du contradictoire dès qu’elles auront été transmises au greffe alors qu’elles sont en principe exclusivement réservées à l’autorité judiciaire.
Le troisième alinéa de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Il précise toutefois que « si une salle d’audience a été spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle ». Le quatrième alinéa du même article dispose que le président du tribunal de grande instance peut alors, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
Enfin, le cinquième alinéa du même article permet au juge des libertés et de la détention de décider que l’audience se déroule par visioconférence dans la salle spécialement aménagée dans l’établissement d’accueil, sous réserve qu’un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé et que le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’absence d’opposition de cette personne.
En pratique, les deux tiers des audiences se tiennent aujourd’hui au tribunal. Cette solution ne paraît pourtant pas satisfaisante. En effet, elle implique le déplacement des patients au tribunal, qui peut être très éloigné de l’hôpital : dès lors, des soignants doivent être mobilisés à cette seule fin, une ou deux fois par semaine, alors que bon nombre d’établissements souffrent déjà d’un manque de personnel soignant. En outre, ce déplacement est de nature à traumatiser des patients qui se trouvent par définition dans un état de grande fragilité. M. Jean-Marie Delarue (42) témoignait ainsi avoir « rencontré des malades absolument terrifiés, qui demandaient ce qu’ils avaient fait pour être traduits devant le juge ».
Quant à la visioconférence, les auditions font apparaître un rejet quasi unanime. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans un avis public du 14 octobre 2011, considère qu’elle ne présente pas d’inconvénients s’il s’agit de problèmes de procédure mais qu’elle est inadaptée lorsqu’il s’agit de trancher des questions de fond dans lesquelles l’échange direct entre le juge et la personne intéressée est nécessaire. En effet, ainsi que le relève cet avis, « elle suppose une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité à cet égard selon les personnes qui sont loin d’être acquises, notamment pour celles souffrant d’affections mentales ».
La visioconférence soulève également des problèmes d’ordre juridique, puisque le consentement du patient est présumé, alors qu’il ne peut pas consentir aux soins, voire qu’il ne peut pas gérer lui-même ses biens. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’il ne peut être recouru à la visioconférence qu’au regard « des buts légitimes » poursuivis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au rang desquels se trouvent la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection du droit à la vie, l’exigence du délai raisonnable des procédures judiciaires ainsi que la liberté et la sécurité des témoins et des victimes..Or, il est douteux que le manque de moyens des juridictions puisse être considéré comme un tel « but légitime ».
A contrario, le principe consistant, sauf demande du patient ou cas de force majeure, comme les conditions météorologiques, à organiser les audiences dans une salle spécialement aménagée au sein de l’hôpital recueille l’approbation – ou à tout le moins, s’agissant d’une partie des représentants des magistrats, le nihil obstat – de toutes les personnes auditionnées.
Mme Catherine Arnal (43), secrétaire générale adjointe du Syndicat des greffiers de France (SDGF-FO), faisant état devant la mission d’information de l’expérience de ses mandants et de la sienne propre en ses fonctions de greffière auprès d’un juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, a parfaitement décrit et résumé l’état de la question : « Pour la majorité voire la totalité des greffiers qui pratiquent ce service, il paraît primordial que les audiences soient organisées à l’hôpital et non pas au tribunal de grande instance. Pour avoir vécu les deux, je peux vous dire que les patients qui arrivent dans un tribunal sont déjà dans un état fragile et que le tribunal en lui-même ne fait qu’augmenter leur fragilité, car ils assimilent ce tribunal à une sanction pénale et ils ne comprennent pas bien ce qu’ils viennent faire dans un système judiciaire. Or, dans le système hospitalier, quand cela se passe bien et que les salles d’audience sont adaptées, le patient est beaucoup plus à l’aise et se sent beaucoup mieux. »
Les établissements, quant à eux, sont disposés à consentir les efforts matériels éventuellement requis, non seulement quant à l’équipement d’une salle en tout ou partie dédiée à ces audiences, mais même, comme cela a pu être rapporté à la mission d’information, à assurer dans certains cas le transport des juges et des greffiers. Ils y voient une manière d’améliorer le bien-être de leurs patients, y compris, de façon indirecte, en faisant ainsi en sorte que les effectifs régulièrement affectés à l’accompagnement des patients au tribunal puissent se consacrer à des missions de soins.
La deuxième des huit propositions du rapport d’information susmentionné de MM. Serge Blisko et Guy Lefrand consistait à « généraliser la tenue des audiences à l’hôpital ». Les auditions menées par la mission d’information confirment à la fois l’actualité et la pertinence de cette proposition.
Votre Rapporteur propose de tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et de réserver l’audience par visioconférence aux cas de force majeure.
Le premier alinéa de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique dispose que le juge « statue publiquement », sous réserve des dispositions lui permettant de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À l’unisson de la troisième proposition du rapport d’information de MM. Serge Blisko et Guy Lefrand (« Recommander la tenue des audiences en chambre du conseil »), la quasi-totalité des personnes auditionnées par la mission d’information ont souligné que ce principe de publicité n’est pas satisfaisant.
M. Jean-Marie Delarue observe (44) ainsi « qu’il peut arriver que le médecin, les soignants ou toute autre personne détaillent soigneusement la maladie dont souffre la personne qui comparaît – c’est quelquefois la première occasion pour la personne d’entendre un discours de cette nature – ou, à l’inverse, devant des tiers qui l’ont fait hospitaliser. Alors que la "loi Kouchner" a prévu des dispositions extraordinaires pour permettre aux tiers d’accéder au dossier médical, on trouve là paradoxalement le tout-venant, puisque n’importe qui peut assister à ces audiences publiques, alors que le détail de certains dossiers médicaux est déroulé ».
L’audience offre ainsi de multiples risques de violation du secret médical, d’autant que la circulaire précitée du ministère de la justice du 21 juillet 2011 précise que, dans le cas où le patient n’aurait pas eu accès aux pièces du dossier, il appartient alors au juge de lui en donner connaissance à l’audience. Soucieux de la préservation du secret médical, certains psychiatres en sont arrivés à établir, contrairement à l’esprit de la loi, des certificats médicaux au contenu trop peu explicite, quand ils ne concluent pas tout bonnement à l’impossibilité de l’audition de la personne, la privant ainsi d’un accès effectif au juge.
Dès lors que certains patients se trouvent privés de leurs droits, la question de la publicité de l’audience est nécessairement posée. L’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales inclut certes la publicité de l’audience parmi les conditions d’un procès équitable. Mais le problème doit-il être envisagé en ces termes à l’égard de personnes vulnérables, requérant par conséquent une protection ? De ce point de vue, les procédures de jugement des mineurs, délinquants ou en danger, et en matière d’affaires familiales prévoient une publicité restreinte, voire le huis clos.
M. Xavier Gadrat, au nom du Syndicat de la magistrature (45), a toutefois souhaité que le principe demeure celui de la publicité, le juge étant tenu cependant de faire droit à la demande de la personne, assistée au besoin d’un avocat, tendant à ce que l’audience se déroule en chambre du conseil. Or, les motivations ayant inspiré de telles dérogations paraissent très proches de la situation des personnes hospitalisées sans consentement présentées au juge des libertés et de la détention, de telle sorte qu’une inversion des règles de publicité des audiences actuellement fixées serait souhaitable : les audiences en chambre du conseil deviendraient la règle et les audiences publiques l’exception.
Votre Rapporteur suggère donc de tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.
Les juridictions ont dû faire face à moyens constants et dans l’urgence à la mise en œuvre du contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention institué par la loi de 2011. Les auditions de la mission d’information font apparaître que les situations varient beaucoup d’une juridiction à l’autre et que les magistrats ne sont pas toujours préparés aux particularités de ce contentieux.
Vingt-quatre juridictions rendent la moitié des décisions portant sur les mesures de soins sans consentement. Il ne s’agit pas seulement de juridictions ayant leur siège dans de grandes agglomérations ; parmi elles figurent aussi des tribunaux de petite dimension comprenant dans leur ressort d’importants établissements psychiatriques. Alors que la loi de 2011 a pu être mise en œuvre à moyens constants dans des conditions que chacun s’accorde à trouver satisfaisantes – MM. Serge Blisko et Guy Lefrand, dans leur rapport d’information précité, ont ainsi pu parler de « chronique d’une catastrophe évitée » –, certaines juridictions ne disposent évidemment pas des moyens d’affecter spécifiquement un juge et un greffier aux audiences relatives aux soins sans consentement. Selon la répartition géographique des établissements et services de psychiatrie, le juge et le greffier doivent en outre accomplir des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres entre ces établissements et le siège du tribunal, ou bien d’un établissement à l’autre.
Certaines juridictions ont ainsi dû renoncer à des audiences, notamment civiles. Surtout, le juge des libertés et de la détention est amené à intervenir bien au-delà du champ psychiatrique : permanence pénale, droit des étrangers et, en urgence, comparutions immédiates, instruction...
Quantitativement, la charge de travail n’est pas négligeable pour des juridictions de taille relativement modeste : Mme Catherine Arnal a ainsi indiqué (46) que depuis septembre dernier, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay dispose, en matière d’hospitalisation sans consentement, d’un magistrat (l’un des juges des libertés et de la détention) et d’un greffier attitrés, qui se déplacent au moins deux demi-journées par semaine et traitent chaque année environ 300 dossiers.
b) La formation des magistrats
Face à ce contentieux d’une nature très particulière, les magistrats peuvent éprouver des difficultés, que le Pr. Antoine Lazarus a évoquées au cours de son audition (47) : « Les magistrats, qui sont de plus en plus contraints de jouer un rôle d’experts, et pas seulement de rendre la justice, doivent devenir un peu plus des cliniciens : comment les former, que ce soit à l’École nationale de la magistrature (ENM) ou durant des stages dans le milieu soignant de la psychiatrie ou du social, à ne pas être seulement dans l’émotion ou dans une simple lecture formelle des procédures ? [...] Pour ceux qui ne sont jamais entrés ni dans une prison, ni dans un hôpital psychiatrique, il faut être très rodé et très habitué pour ne pas ressentir une émotion intense en entrant dans ce décor, avoir une distance suffisante et ne pas être seulement très reconnaissants pour la gentillesse des médecins qui veulent bien les guider et les accueillir, car ils ne feraient alors rien de plus que répéter en tant que juges ce que les médecins veulent leur faire dire. »
Il faut donc réfléchir aux moyens qui permettraient aux magistrats de mieux appréhender la dimension non juridique du contentieux des soins sans consentement. C’est pourquoi, votre Rapporteur suggère d’encourager la formation des magistrats, en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.
C. LE SUIVI DES SOINS SANS CONSENTEMENT
Bien que destinée à protéger le patient, l’exigence de certificats médicaux successifs peut parfois se traduire par un effet exactement inverse. Par ailleurs, la loi de 2011 a excessivement durci le régime des sorties. Enfin, des progrès doivent encore être accomplis en matière de droits des malades.
1. L’exigence de certificats médicaux successifs
Au-delà des seuls médecins, la plupart des personnes auditionnées par la mission d’information ont fait apparaître que l’exigence de certificats médicaux successifs, après le premier ou les deux premiers certificats requis préalablement au prononcé de la mesure de soins sans consentement, constitue une charge excessive pour les psychiatres, sans pour autant garantir correctement les droits des patients et alors même qu’en cas d’appel, l’exigence systématique d’un certificat médical actualisé n’est pas prévue.
a) Une charge excessive pour les psychiatres
Dr. Olivier Labouret, président de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP) (48), a rappelé que « dans le cas de la procédure d’ASPDT, il y a maintenant jusqu’à huit certificats ou avis médicaux en huit jours. La lourdeur administrative résulte donc en partie de certificats redondants qu’il serait bon de simplifier ». Il a également critiqué « la multiplication du recours aux expertises, dont l’indépendance et la pertinence sont sujettes à caution ».
Comme l’a souligné le Dr. Michel Triantafyllou, président du Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP) (1), « le dispositif est lourd et complexe, d’un formalisme extrême, surtout les quinze premiers jours, et consomme un temps soignant considérable aux dépens de la prise en charge clinique et thérapeutique du patient. Sur une année, le temps consacré par un patricien hospitalier aux certificats, avis conjoints, collèges, notification des décisions de justice, ... représente environ 8 heures par semaine [...]. C’est une journée par semaine en moins au chevet du patient ».
Cela étant, si le juge des libertés et de la détention était amené à intervenir de façon plus précoce, le nombre de certificats requis s’en trouverait ipso facto réduit (cf. supra B.3.).
b) Une multiplicité peu protectrice pour les patients
Non seulement, la multiplication des certificats médicaux requis se traduit par une charge excessive pour les psychiatres et par leur moindre disponibilité à l’égard des patients, mais paradoxalement, elle finit par nuire à leurs droits, alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, a fait de la production de ces certificats une garantie pour ces derniers.
M. Jean-Marie Delarue a ainsi estimé (49) que « la pénurie de psychiatres se traduit par de fausses garanties : s’il n’y a pas assez de psychiatres dans un établissement, un psychiatre de la grande ville voisine va être recruté et faire 80 à 150 kilomètres le week-end pour venir signer toute une série de certificats sans voir aucunement les malades. Il y a une déviance de ce qu’on a cru pouvoir trouver comme garantie : pour des motifs sécuritaires, les précautions de ce genre ont été multipliées en 2011, alors qu’il faut admettre que dans certains cas, la confiance doit être accordée à un seul psychiatre, qui doit attester que la personne soit doit rester sous contrainte, soit peut faire l’objet d’une mesure de mainlevée des soins. Il faut en revenir à un meilleur équilibre : c’est une nécessité de gestion et pour les malades eux-mêmes ».
Mme Virginie Valton considère également (50) qu’il est « indispensable d’alléger le formalisme préalable au contrôle du juge. C’est assez paradoxal mais essentiel pour renforcer l’effectivité du contrôle. À force de répéter des certificats médicaux très nombreux dans un délai très restreint, les médecins, y compris ceux qui étaient tout à fait volontaires pour une application totale et complète de la loi, commencent à être atteints par un phénomène d’usure : on utilise de plus en plus le copier-coller, ce qui peut entraîner des erreurs de dates purement formelles dans les certificats médicaux. Il y a une perte de substance dans les certificats médicaux, car quand vous devez rédiger une multitude de certificats, au bout d’un moment, vous entrez peut-être un peu moins dans le détail des symptômes, des difficultés et des conséquences que pourrait avoir une levée de l’hospitalisation, ce qui empêche en fin de compte le juge de disposer d’une réelle vision de l’ensemble de la problématique ». Or, si l’avocat doit pouvoir soulever d’éventuels vices de forme devant le juge, l’interruption d’une hospitalisation justifiée sur le fond peut en revanche se révéler préjudiciable pour le patient.
Le rapport d’information précité de MM. Serge Blisko et Guy Lefrand procédait au même constat, mais se bornait, dans sa septième proposition, à suggérer de « constituer un groupe de travail sur les certificats médicaux en vue de proposer une réduction de leur nombre compatible avec le respect des droits des patients ».
c) L’absence de certificat actualisé en appel
Il arrive que le juge des libertés et de la détention statue plusieurs jours après l’établissement du dernier certificat médical. Sa décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours, le premier président de la cour d’appel disposant ensuite de douze jours pour se prononcer. Il peut donc s’écouler vingt-cinq jours entre le dernier certificat et la décision en appel.
Or, au moment où se déroule l’audience d’appel, l’état du malade est susceptible d’avoir considérablement évolué : si le patient allègue d’une telle évolution, le premier président, en l’absence de certificat médical récent, se voit contraint d’ordonner une expertise, laquelle peut allonger jusqu’à treize jours supplémentaires la durée de l’hospitalisation sans consentement.
Une ordonnance rendue le 29 mars dernier par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles fournit un exemple typique de ces situations. Le magistrat relève qu’« alors que le dernier en date des certificats médicaux figurant au dossier remonte au 7 mars 2013, aucune des parties concernées par l’ordonnance » rendue le 13 mars par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles maintenant la mesure d’hospitalisation complète « n’est venue prétendre que devrait être maintenue la mesure qui a été décidée par le premier juge "en l’état" ». En conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est ordonnée, passé un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision, afin de permettre, s’il y a lieu, la mise en place d’un programme de soins.
Dans ses considérants, l’ordonnance relève par ailleurs que le patient « s’est rendu à l’audience seul et par ses propres moyens [...] ; qu’il ressort de la décision attaquée qu’il avait indiqué que sa sortie de l’institut [où il était hospitalisé] était prévue dans le courant de la semaine du 18 au 23 mars ; qu’il est patent que sa situation a connu une évolution ; qu’il n’est tenu pour dangereux ni pour lui-même, ni pour les tiers ; qu’il est à observer que la mesure d’hospitalisation complète contestée a été prise en raison en particulier d’une "rigidité caractérielle", de l’épuisement du personnel du foyer qui l’hébergeait et de ses rapports agressifs avec d’autres résidents, éléments qui sont nécessairement moins d’actualité puisque le même type d’hébergement a été à nouveau instauré ».
Il est intéressant d’observer que faute de certificat médical suffisamment récent à ses yeux, le dernier remontant à exactement vingt jours, le juge d’appel recherche par lui-même les éléments qui lui permettent de mesurer l’évolution de l’état de santé du patient et n’hésite pas à ordonner, sur le fondement de ses propres constatations, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Votre Rapporteur préconise donc d’introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.
2. Les difficultés liées aux sorties
La loi de 2011 a profondément aménagé le régime des sorties : si elle a maintenu les sorties thérapeutiques accompagnées de courte durée (moins de 12 heures, soumises à accord du préfet en cas d’ASPDRE ou d’admission par décision judiciaire) et a ouvert la possibilité d’un accompagnement par un membre de la famille ou par la personne de confiance, elle a en revanche supprimé les sorties d’essai et conditionné toute autre sortie que de courte durée à la mise en œuvre d’un programme de soins.
a) La suppression des sorties d’essai
Autorisées par le préfet, les sorties d’essai étaient conçues pour être de plus en plus longues afin de préparer progressivement la sortie définitive. La loi de 2011 s’inscrit dans le droit fil d’une circulaire conjointe des ministres de l’intérieur et de la santé du 11 janvier 2010 (51) venue rappeler aux préfets qu’il leur appartenait de s’assurer de la compatibilité de la sortie d’essai avec les impératifs d’ordre et de sécurité publics.
Dans son avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l’hospitalisation d’office, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constatait que « les craintes d’atteintes à l’ordre public rendent, dans un nombre croissant de départements, l’obtention des sorties d’essai plus difficile ».
L’avis explicite parfaitement la logique qui était ainsi à l’œuvre : « Il est implicitement mais nécessairement considéré par les autorités qui ont à accorder l’autorisation de sortie que, lorsque la sortie d’essai est demandée, le patient demeure aussi dangereux pour lui-même ou pour autrui qu’au jour de son hospitalisation. En tout état de cause, elles font parfois procéder à une enquête de police, laquelle, se déroulant dans les lieux où vivait la personne en cause, avant que celle-ci ne soit hospitalisée d’office, ne peut rien énoncer de plus que les faits initiaux ayant conduit à l’hospitalisation. Et comme ces faits révèlent un danger, la tentation est grande de s’en tenir à un refus de la proposition du psychiatre.
« C’est, indirectement, reconnaître qu’entre le jour de l’hospitalisation et le moment où le psychiatre propose en connaissance de cause un allégement des contraintes il ne s’est rien passé.
« Cette idée, qui ignore d’ailleurs la conscience professionnelle des soignants, est inexacte et méconnaît l’esprit de la loi en vigueur. Celle-ci repose, en effet, sur l’idée que les soins apportés au malade, notamment les traitements qui lui sont prescrits ou administrés, s’ils ne conduisent pas au retour à un état stable et dépourvu de manière permanente de tout danger, peuvent au moins garantir pour des périodes plus ou moins prolongées que le patient n’est plus dangereux. Par conséquent, dans cette hypothèse, la loi rend possible l’allégement des contraintes sous la forme d’une sortie d’essai. Certes, il ne s’agit que d’une possibilité. Mais elle ne saurait être mise en échec – s’agissant d’une privation de liberté – que pour des motifs avérés de risque de danger ou d’atteinte grave à l’ordre public. Il apparaît impossible de fonder un refus sur des faits anciens : seuls des faits actuels devraient pouvoir être pris en considération. Le rappel des faits passés ayant conduit à l’hospitalisation ne saurait établir la réalité de tels motifs. »
En supprimant les sorties d’essai, la loi de 2011 a poussé cette logique à son terme. Votre Rapporteur préconise d’autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.
b) Le conditionnement des sorties autres que thérapeutiques à la mise en œuvre d’un programme de soins
Ainsi que l’analysait le Dr. Catherine Paulet devant la mission d’information (52), « dans l’ancienne formulation, c’est-à-dire la sortie d’essai, qui était [...] imparfaite, il y avait le contenant – l’équipe psychiatrique pluridisciplinaire et le directeur d’hôpital portaient d’une certaine manière une part de responsabilité dans cette proposition faite à la personne d’essayer de sortir – et, ensuite, le contenu de cette sortie d’essai, c’est-à-dire le type de propositions thérapeutiques qui étaient formulées. Avec la loi de 2011, on a changé de paradigme, en rabattant toute la responsabilité sur l’individu ».
Ce changement de paradigme s’opère au travers de la mise en œuvre d’un programme de soins. Dès lors que le patient sort seul de l’établissement de santé, quelle que soit la durée de cette absence, un programme de soins doit être établi, si léger et formel soit-il : pour une sortie familiale durant un week-end, il y a ainsi de fortes chances que les soins se limitent à la poursuite du traitement médicamenteux, dans la mesure où les structures de prise en charge ambulatoires sont généralement fermées pendant ces deux jours.
Il devient donc difficile de s’assurer de l’aptitude des personnes à la réinsertion sociale. Face à cet état de fait, la huitième proposition du rapport d’information précité de MM. Serge Blisko et Guy Lefrand consistait déjà à « prévoir la possibilité pour les patients en hospitalisation complète de bénéficier de sorties thérapeutiques de très courte durée ».
Les deux rapporteurs, ayant en effet constaté que « dans le cas d’absences non programmées, exceptionnelles ou répétées, il appartient au médecin d’établir un programme de soins pour chacune des sorties », soulignaient qu’« à l’issue de cette sortie, le patient sera à nouveau pris en charge sous forme d’hospitalisation complète, réintégration qui impose une relance à zéro de la procédure d’admission en soins puis une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention ».
Une révision de la loi de 2011 devrait permettre d’instaurer un régime clair des sorties, reconnaissant leur caractère essentiellement thérapeutique et supprimant ou, à tout le moins, cantonnant la possibilité, pour l’autorité administrative, de s’y opposer.
La question de la notification au malade des décisions le concernant et de ses droits, notamment de son droit au recours, a déjà été abordée à propos de l’effectivité de l’accès au juge des libertés et de la détention (cf. supra B.2.). D’autres problèmes se posent toutefois : certains ne sont pas spécifiques aux soins sans consentement mais concernent tous les malades hospitalisés, comme la désignation de la personne de confiance ou le respect des libertés individuelles et de la dignité ; en revanche, le rôle des commissions départementales des soins psychiatriques intéresse plus spécifiquement les soins psychiatriques sans consentement.
a) La désignation de la personne de confiance
Au-delà du seul problème de l’exercice des recours (cf. supra B.2), la question est posée de savoir si les droits du malade définis par la loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » (53), sont applicables aux malades mentaux : ils le sont clairement, en droit, car la loi n’opère pas de distinction entre malades, mais la difficulté, pour les établissements, est d’en assurer la transposition en raison de la spécificité de la maladie mentale. Or, selon M. Jean-Marie Delarue, dans la plupart des établissements, la faculté, pour la personne malade, de désigner une personne de confiance qui la représentera et jouera un rôle d’intermédiaire entre elle et le corps médical, est refusée, en toute illégalité, aux personnes souffrant de maladies mentales sans faire pour autant l’objet d’un régime de protection.
b) Le respect des libertés individuelles et de la dignité
Devant la mission d’information, M. Jean-Marie Delarue (54) a été on ne peut plus clair : « Beaucoup de choses ne vont pas : par exemple, les conversations téléphoniques, qui devraient être confidentielles alors qu’elles se font souvent par le truchement des soignants, dans le bureau des infirmiers et, par conséquent, en présence d’un tiers, ou que, lorsqu’il y a des cabines téléphoniques, elles sont installées dans un couloir et dépourvues de protection phonique. Il faut donc soit admettre qu’on ne peut pas téléphoner, soit que si on peut le faire, c’est dans des conditions qui en garantissent la confidentialité. Il en va de même pour la possibilité d’avoir des affaires à soi : certains hôpitaux permettent de disposer dans les chambres de placards fermant à clef, moyennant bien sûr la possibilité pour les soignants d’y accéder, mais ces hôpitaux sont minoritaires. [...]
« Il ne faut pas tout sécuriser, il faut donc respecter la vie privée des personnes et au moins leur intégrité corporelle, ce qui n’est actuellement pas tout à fait garanti : le principe mériterait d’en être affirmé dans la loi et il reviendrait ensuite aux hôpitaux d’assurer la nécessaire protection des personnes. Il faut que les hôpitaux apprennent à veiller également à la confidentialité des soins : les prescriptions médicamenteuses et les soins somatiques doivent être dispensés hors de la vue et de l’ouïe des autres personnes. »
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté insiste par ailleurs sur « les fortes différences de régimes qui peuvent exister entre les unités dans un hôpital déterminé [...]. Ces unités correspondent naturellement le plus souvent aux secteurs : ce ne sont donc pas les types d’affections qui vont déterminer le régime, mais la volonté du responsable d’unité, qui va définir un régime particulier. Par exemple, l’accès au téléphone portable est autorisé dans certaines unités, sans guère de restrictions, sauf peut-être ces cas précédemment évoqués ; dans d’autres, il faut venir quémander le droit d’utiliser son propre téléphone chez les infirmiers qui le détiennent ; dans d’autres, enfin, les téléphones sont totalement interdits. Aucune raison ne justifie de telles différences, car s’agissant des droits des malades, les régimes doivent être identiques sauf si la nature de la maladie s’y oppose : il faut faire du cas par cas de santé et non pas du général par unité.
« À chaque visite, nous nous heurtons à ces différences, qui nous paraissent absolument injustifiées. Ce n’est pas simplement d’une sorte de pratique qu’il s’agit, mais d’une réglementation, qui oblige par exemple les malades à remettre leur téléphone portable ou leur ordinateur. La question sous-jacente, au travers de laquelle les choses doivent être abordées, est celle de la nature des liens qu’un malade mental peut conserver avec l’extérieur : si la nature de ces liens doit dépendre de l’état pathologique – il faut évidemment éviter qu’un paranoïaque se livre au harcèlement téléphonique – ils ne peuvent être tributaires de la volonté générale d’un praticien qui se traduit par un règlement intérieur applicable à l’ensemble des malades de l’unité ».
Relève de cette même problématique l’utilisation de la contention physique ou chimique ainsi que de l’isolement (cf. supra), sur laquelle la mission d’information entend poursuivre son travail.
c) Les commissions départementales des soins psychiatriques
Les commissions départementales des soins psychiatriques, instituées initialement par la loi du 27 juin 1990 (55) sous le nom de « commissions départementales des hospitalisations psychiatriques », comprennent six membres : quatre sont désignés par le préfet (un psychiatre, un médecin généraliste et deux représentants d’associations agréées, l’une de malades, l’autre de familles de personnes malades), un par le procureur général près la cour d’appel (un autre psychiatre) et un par le premier président de la cour d’appel (un magistrat). L’un des deux psychiatres ne doit pas exercer dans un établissement autorisé en psychiatrie.
Ses compétences, énoncées à l’article L. 3223-1 du code de la santé publique, tel que résultant de la loi de 2011 (56), sont théoriquement étendues :
– elle est informée de toute décision (autre que judiciaire) d’admission en soins sans consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
– elle reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins sans consentement ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
– elle examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins sans consentement, et, obligatoirement, celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée par le directeur d’établissement pour péril imminent ou dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
– elle saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins sans consentement ;
– elle visite les établissements, vérifie les informations figurant sur le registre que doivent tenir les établissements et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
– elle adresse, chaque année, son rapport d’activité au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au préfet, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
– elle peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins sans consentement d’ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
– elle statue sur les modalités d’accès de toute personne admise en soins sans consentement aux informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’audition de M. Jean-Marie Delarue (57) a cependant montré que la réalité était assez éloignée de ces dispositions : « En principe, les commissions départementales des soins psychiatriques existent partout mais on a beaucoup de mal à les faire fonctionner, notamment à nommer les deux psychiatres, en particulier le psychiatre libéral, qui doivent en faire partie. Par conséquent, beaucoup de ces commissions, qui doivent être renouvelées à intervalles réguliers, ne sont de fait pas réunies parce que le préfet n’a pas réussi à en nommer tous les membres.
« Une fois qu’elles parviennent à se réunir, leur rôle est extrêmement utile. Elles se rendent dans les établissements : elles peuvent écouter des malades et notamment contribuer à des mainlevées d’hospitalisations qui seraient infondées ou mal fondées. Il ne faut pas que des psychiatres de l’établissement hospitalier en cause fassent partie de cette commission, mais face à la pénurie de psychiatres, notamment dans certains départements, on ne voit pas par qui ils pourraient être remplacés : il faut évidemment un œil expert et, en cas de controverse sur des mainlevées, il faut que ces commissions comprennent deux experts.
« Au-delà de ces difficultés de composition et, partant, de réunion, s’il y a un reproche à adresser à ces commissions, c’est seulement celui de ne pas jouer leur rôle assez activement, lorsqu’elles passent très épisodiquement – une fois par an – dans un établissement et qu’elles restent inaccessibles aux malades, dont il serait bon qu’ils soient prévenus de leurs visites. Des dispositions de nature réglementaire pourraient donc utilement être adoptées afin de prévoir par exemple un minimum de visites annuelles ou la possibilité pour un malade de demander à être écouté à tout moment. »
La prépondérance de la représentation médicale au sein de ces commissions mérite également d’être examinée : son ouverture à d’autres professions, par exemple aux avocats, serait ainsi souhaitable.
C’est dans cet esprit, que votre Rapporteur suggère de modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en incluant des personnes n’appartenant pas au monde médical.
LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS
Les unités pour malades difficiles (UMD)
1. Introduire dans l’article L. 3222-3 du code de la santé publique les critères et la procédure d’admission en unité pour malades difficiles.
2. Maintenir un régime particulier pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les irresponsables pénaux ayant commis un crime.
Les soins sans consentement
3. Substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission.
4. Maintenir en l’état l’intervention du préfet dans la procédure de soins sans consentement et poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte.
5. Poursuivre la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.
6. Mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne objet d’un placement.
7. Améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.
L’intervention du juge des libertés et de la détention
8. Ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.
9. Rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
10. Tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.
11. Tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
12. Réserver l’audience par visioconférence aux seuls cas de force majeure.
13. Améliorer la formation des magistrats en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.
14. Améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.
Le suivi des soins
15. Introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.
16. Autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.
17. Modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en y ajoutant davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical.
La commission des affaires sociales examine le rapport d’information de M. Denys Robiliard en conclusion des travaux de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie : rapport d’étape relatif aux soins sans consentement, au cours de sa séance du mercredi 29 mai 2013.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous rappelle que notre commission a créé, le 7 novembre dernier, une mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie.
Dans une première phase, qui se clôt aujourd’hui, la mission d’information a choisi de concentrer ses travaux sur la question des soins psychiatriques sans consentement, matière qui a fait l’objet de plusieurs décisions récentes importantes du Conseil constitutionnel. Sa décision du 20 avril 2012 a déclaré non conformes à la Constitution deux dispositions de la loi que nous avons adoptée en 2011, ce qui devrait conduire le législateur, dans un calendrier contraint, à remettre de nouveau l’ouvrage sur le métier.
Pour marquer la fin de cette première phase, la mission a souhaité rendre un rapport d’étape. Elle a adopté ce rapport, à l’unanimité, la semaine dernière.
Au-delà de ce rapport d’étape, la mission d’information devrait poursuivre ses travaux, en abordant notamment l’organisation de l’offre de soins ou encore les conditions de prise en charge des patients.
En attendant, je vous propose de laisser la parole à Jean-Pierre Barbier, le président de la mission, puis d’entendre le rapporteur Denys Robiliard.
M. Jean-Pierre Barbier, président de la mission d’information. La mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie dont j’ai repris la présidence en avril dernier, a choisi de consacrer une première partie de ses travaux sur les soins et les hospitalisations sans consentement, un choix sous contrainte, en raison de l’actualité liée aux décisions du Conseil constitutionnel, comme vient de le rappeler madame la présidente.
Je tiens à remercier le rapporteur et les membres de la mission pour l’accueil qu’ils m’ont réservé.
Après plus de trente heures d’auditions à la fois de professionnels de santé, de juristes, de syndicats, mais aussi de représentants des familles de malades et d’usagers de la psychiatrie, et de déplacements dans des unités pour malades difficiles (UMD) et une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), la mission a émis dix-sept propositions.
Elle suggère notamment d’améliorer l’exécution des soins sans consentement, de modifier les conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention, ce qui me semble le plus important, en ramenant de quinze à cinq jours le délai dans lequel il doit statuer sur le placement de la personne et de tenir l’audience en chambre du conseil au sein même de l’établissement de santé.
Je tiens à souligner, de nouveau, que la mission poursuit ses travaux, qu’elle effectuera de nouveaux déplacements et abordera d’autres questions clés comme la formation des intervenants, le financement et la recherche. Cette dernière question est, en effet, particulièrement importante en raison du taux de prévalence des maladies mentales.
M. Denys Robiliard, rapporteur. Je vous propose tout d’abord d’évoquer des questions de méthode, de décrire ensuite quelques données et d’analyser la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement avant de vous présenter les principales propositions émises par la mission.
S’agissant de la méthode, quelque peu inhabituelle, consistant à présenter un pré-rapport, elle résulte de la décision du Conseil constitutionnel, citée par la présidente, qui a invalidé des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et a différé les effets de sa décision au 1er octobre 2013. C’est pourquoi, il nous a semblé pertinent de présenter l’état des réflexions de la mission sur les soins psychiatriques sous contrainte et de donner nos conclusions en temps utile pour légiférer sur le sujet si la commission des affaires sociales se saisissait d’une proposition de loi ou était amenée à examiner un projet de loi.
J’ajouterai que ce document est une analyse provisoire qui pourra évoluer et être reconsidérée, le cas échéant. En effet, la mission aura le souci de mettre en œuvre le principe du contradictoire et ses réflexions seront soumises aux personnes que nous avons auditionnées.
La santé mentale est un paysage compliqué, les maladies mentales ne peuvent être associées aux maladies orphelines. Selon le professeur Frédéric Rouillon, un adulte sur trois souffrira dans sa vie de maladie mentale, 1 % de la population souffre de psychoses, 2 % de troubles bipolaires, 5 % de dépression, 7 % de névroses et 2 % d’anorexie. La file active de personnes suivies pour troubles de la santé mentale s’élèverait à deux millions de personnes, dont un million sont suivies par le secteur public et un million par le secteur privé.
Une donnée frappante que je tiens à relever est que l’espérance de vie des personnes atteintes de ces troubles les plus graves est de vingt ans inférieure à la moyenne de la population et de quinze ans inférieure pour l’ensemble de la population souffrant de troubles mentaux. Plusieurs facteurs expliqueraient ces statistiques, le suicide n’étant qu’une des raisons constatées. Le malade mental serait moins en demande de soins somatiques. En conséquence, lorsqu’il aura besoin de soins, il bénéficiera d’abord de soins psychiatriques, mais non de soins somatiques, ce qui pose des difficultés.
Deuxième élément important, le placement sous contrainte a connu une forte augmentation ces dernières années. Ainsi, s’agissant placements à la demande d’un tiers, on est passé de 43 957 placements en 2006 à 63 345 admissions en 2011, soit une augmentation de 44 %. Quant aux placements à la demande du représentant de l’État, ils sont passés de 10 578 admissions en 2006 à 14 967 en 2011, soit une hausse de 41 %. J’en profite pour souligner que, parmi les préconisations du rapport, figure le retour à l’ancienne terminologie de placement, qui restitue plus la vérité d’une procédure autoritaire, certes dans l’intérêt du patient, que le terme d’admission introduit dans la dernière loi.
On peut formuler plusieurs hypothèses pour expliquer les raisons de cette augmentation. La première est l’accroissement du recours à des soins psychiatriques par la population. La deuxième est la volonté de certains psychiatres de ne pas engager leur responsabilité. Enfin, les familles prennent moins en charge leurs proches souffrant de ce type de pathologie et la pression sociale a évolué, les comportements s’éloignant de la norme étant moins bien acceptés.
La loi du 5 juillet 2011 a été adoptée à la suite du discours d’Antony de l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, contesté par les psychiatres, car associant la dangerosité aux troubles de santé mentale. Cette loi a donc une racine sécuritaire mais repose aussi sur des principes garantissant la liberté individuelle. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 novembre 2010 avait posé le principe d’un contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sous contrainte. Cette loi comporte également une dimension de santé publique, en développant une approche somatique systématique pour le malade entrant en hôpital psychiatrique et en étendant le domaine de la contrainte aux soins.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 2012, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité a invalidé deux articles du code de la santé publique : l’article L. 3211-12 relatif à la sortie de malades ayant été placés dans des UMD et l’article L. 3213-8 relatif à la sortie de certains malades présumés dangereux. La sanction porte plus sur la nature de la règle que sur sa matérialité, le Conseil jugeant que le niveau de protection des malades doit relever de la loi et non du règlement.
S’agissant des UMD, il existe sur le territoire dix unités qui totalisent six cents lits. Elles accueillent les irresponsables pénaux et les patients qui ne peuvent être gérés par les hôpitaux psychiatriques. Les soins dispensés sont similaires mais le personnel est plus nombreux dans les UMD que dans les hôpitaux, de l’ordre de un à trois.
Je souhaiterai souligner que la contrainte n’entraîne pas forcément une hospitalisation. Il existe des éléments de contrainte relevant de la pratique médicale hors tout cadre légal et je pense aux personnes âgées souffrant de maladies neuro-dégénératives résidant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui sont, de fait, privées de liberté. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a justement relevé ce point et souhaiterait pouvoir visiter ces institutions.
La mission s’est aussi interrogée sur l’absence de contrôle juridictionnel du placement des mineurs, puisque ceux-ci relèvent de l’autorité parentale et sont hospitalisés à la demande de leur famille.
Enfin, se pose la question de la contention physique ou chimique et des chambres d’isolement, pratiques différentes selon les établissements mais qui seraient en augmentation, notamment du fait de l’insuffisance de personnel. À défaut d’un encadrement, il serait intéressant de pouvoir suivre la traçabilité de cette pratique, qui figure uniquement dans le dossier médical.
J’en viens aux propositions émises par la mission.
S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, il existe deux solutions. La première est de ne pas légiférer, ce qui soumettrait les patients sous contrainte au droit commun des malades psychiatrique. La deuxième consisterait à légiférer et, dans ce cas, il faut distinguer les UMD et les irresponsables pénaux.
S’agissant des UMD, elles sont conçues comme des unités de soins intensifs qui gardent le malade durant une période allant de cent vingt-cinq jours à deux cent quarante-cinq jours avec une dimension sécurisée. La mission estime qu’il ne faut pas légiférer sur ce point, car les critères d’admission relèvent d’une décision médicale.
Quant aux irresponsables pénaux, il convient, en revanche, de légiférer et de faire figurer dans la loi les dispositions réglementaires existantes. La mission a choisi de maintenir leur statut spécifique, afin de donner des assurances à la société, lorsque ces malades sortiront.
La mission émet plusieurs préconisations ayant trait au contrôle juridictionnel. Certaines figuraient déjà dans le rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 de nos anciens collègues Serge Blisko et Guy Lefrand. Cette loi est appliquée depuis maintenant dix-huit mois et je tiens à souligner que la justice s’est mobilisée afin de respecter les délais qui y figurent. Les décisions prises sont concentrées sur vingt-quatre tribunaux, de taille différente.
La mission s’est penchée sur l’autorité compétente pour ordonner une hospitalisation sous contrainte et poursuivra ses réflexions quant au rôle du préfet, qui, il faut le relever, ne prend qu’un quart des décisions, le restant relevant des directeurs d’établissements de santé, dans le cadre des hospitalisations à la demande d’un tiers.
La mission propose de ramener de quinze jours à cinq jours le délai de saisine du juge des libertés et de la détention. En effet, au bout de soixante-douze heures, le psychiatre est capable d’émettre un diagnostic et de mettre en œuvre un programme de soins. La mission propose que le lieu de l’audience soit l’hôpital et non le palais de justice, dans l’intérêt du malade, qui ne comprend pas pourquoi il comparaît devant un juge, tout en préservant l’indépendance de la justice. À ce titre, la visioconférence devra rester exceptionnelle, sauf cas de force majeure. Elle a été unanimement décriée tant par les juges que par les médecins. L’audience devra se tenir en chambre du conseil afin de préserver le secret médical. Les dispositions actuelles permettant au malade mental de renoncer à l’assistance d’un conseil, la mission propose de rendre obligatoire la présence de l’avocat, sous la forme d’un avocat taisant si besoin est.
Enfin, une des dernières propositions que je souhaiterai développer est d’autoriser les sorties d’essai de courte durée, sous la responsabilité du psychiatre, sans condition d’établissement préalable d’un programme de soins.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je salue le travail important accompli par la mission d’information et dont témoigne son rapport d’étape. Elle a eu à traiter d’un sujet brûlant et même poignant ; nous sommes tous susceptibles d’être confrontés, directement ou indirectement, aux maladies mentales – et je le dis sans ironie aucune.
Comme l’a justement indiqué le rapporteur dans son propos introductif, les maladies mentales ne sont pas des maladies orphelines. Mais elles sont, lorsqu’on a à les vivre, toutes individuelles tant leur prise en charge doit être ciblée.
Les préconisations qui ont été formulées à ce stade me paraissent positives. J’apprécie en particulier qu’il soit proposé que les audiences se tiennent dans les établissements de santé. L’expérience montre en effet que, lorsqu’elles ont lieu au palais de justice, il peut en résulter de véritables catastrophes humaines car le fait de comparaître, dans cette enceinte, parmi des présumés délinquants, peut aggraver lourdement le mal-être de certains.
M. Gérard Sebaoun. Permettez-moi de m’exprimer au nom du groupe SRC mais également en tant que membre de la mission d’information. Je tiens à saluer, en préalable, la qualité de ses travaux et tout particulièrement celle du rapporteur qui nous apporte beaucoup par sa maîtrise de la matière juridique.
Je pense que nous abordons tous le sujet traité par la mission d’information avec une part d’ignorance et certains préjugés : préjugés sur la maladie mentale elle-même et les personnes atteintes de troubles mentaux, que nos échanges avec les professionnels de santé nous ont permis de déconstruire ; préjugés, aussi, sur la loi du 5 juillet 2011 en raison des débats et parfois des polémiques qui ont prévalu à sa naissance, comme l’a rappelé notre rapporteur, après des faits dramatiques et une intervention du Président de la République sur la question, et alors même qu’elle succédait à une loi datant du 27 juin 1990, donc relativement ancienne.
Or, en relisant l’exposé des motifs du projet qui a abouti à la loi de juillet 2011, on ne peut qu’être d’accord avec la plus grande partie de celui-ci. Je cite : lever les obstacles à l’accès aux soins et garantir leur continuité ; adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques ; améliorer le cadre juridique de la prise en charge ; renforcer le droit des personnes et respecter leurs libertés individuelles.
Mais le bât blessait sur deux points, lorsqu’étaient évoqués l’objectif d’une amélioration du suivi des patients pour leur sécurité et celle des tiers, en consacrant la pratique des soins en dehors de l’hôpital, et celui d’une amélioration de la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour autrui afin de contribuer à rendre la société plus accueillante et tolérante vis-à-vis de l’ensemble des personnes présentant un trouble mental. Il y avait là une certaine difficulté à reconnaître les malades mentaux en tant que personnes « pas plus dangereuses que le commun des mortels », pour reprendre les termes du professeur Frédéric Rouillon, chef de service à l’hôpital Sainte-Anne. C’est sur ce point que s’est cristallisée la controverse, alimentée par la parole présidentielle, lors de l’écriture de la loi.
Le travail d’audition et la qualité du travail du rapporteur ont apaisé nos craintes : les préconisations du rapport d’étape visent à répondre à la censure du Conseil constitutionnel et en aucun cas à déconstruire la loi adoptée.
Je rappelle que celle-ci avait donné lieu à un rapport d’information sur sa mise en œuvre, en février 2012, de Guy Lefrand et Serge Blisko. Il soulignait l’exceptionnelle mobilisation des professionnels ayant permis d’éviter ce qui apparaissait, à l’époque, comme une catastrophe annoncée. Ce rapport émettait huit propositions. Le rapport d’étape qui vous a été présenté reprend quatre d’entre elles.
Je pense que nous pouvons tous être d’accord sur un point : le malade souffrant de troubles mentaux ne peut pas et ne doit pas être considéré comme un danger pour la société, encore moins comme étant susceptible a priori de troubler l’ordre public.
J’en viens à nos travaux après l’examen de ce rapport d’étape. La mission d’information va les poursuivre en abordant tout le champ de la santé mentale et la spécificité de la psychiatrie dans sa mission de service public, avec pour ambition de nourrir les prochains débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et le futur projet de loi de santé publique. Quelques pistes pourront être explorées : l’état d’avancement du Plan psychiatrie-santé mentale 2011-2015, le financement de la psychiatrie et le maintien d’un budget spécifique, le développement territorial d’une offre de soins complète du dépistage à l’hospitalisation, l’organisation en secteurs qu’il faut étudier plus avant pour l’améliorer, les spécificités liées aux troubles de l’adolescence, à la précarité ou à la détention, la place des patients, de leur entourage et des associations, la connaissance de la santé mentale en France grâce à des études épidémiologiques, ou encore la nécessité de la recherche dans le domaine des neurosciences. Je doute, toutefois, que nous puissions être exhaustifs sur un champ d’étude aussi vaste.
Je terminerai mon propos en interrogeant le rapporteur sur les moyens à mettre en œuvre pour conduire à l’hôpital une personne faisant l’objet d’un placement sans consentement, sujet non résolu à ce jour et que j’ai abordé à de nombreuses reprises lors de nos auditions.
Mme la présidente Catherine Lemorton. La parole est maintenant à Jean-Pierre Barbier, pour le groupe UMP, que je remercie d’avoir accepté d’intégrer la mission d’information, en cours de route, pour la présider.
M. Jean-Pierre Barbier, président de la mission d’information. Le sujet est indéniablement très complexe. La mission d’information étudie en effet une question qui se situe à la croisée des chemins, relevant à la fois du domaine médical et du champ juridique – sans oublier, évidemment, la dimension humaine qui s’y attache. Elle nous interroge aussi sur ce qu’est la normalité pour notre société et sur notre conception de l’ordre public.
La mission d’information a procédé à l’audition d’intervenants multiples et variés, tant dans leur formation que dans leur approche du sujet. Je n’ai pu assister à la plupart d’entre elles mais j’ai pu les visionner. J’ai été frappé par leur intérêt, notamment lorsqu’ont été entendus des représentants des malades, qui ont déclaré – veuillez excuser la crudité de l’expression, mais je la reprends telle quelle – « nous sommes peut-être fous, mais nous ne sommes pas cons ». Ce point est essentiel : il traduit le fait qu’en phase de « normalité », les malades sont aptes à comprendre ce qui est décidé à leur sujet. Il ne faut pas l’oublier, surtout lorsqu’on traite de l’hospitalisation sous contrainte.
J’ai aussi été impressionné par la qualité de l’accueil des malades par le personnel médical. Il est vrai que le centre hospitalier Le Vinatier que nous avons visité disposait de deux unités quasiment neuves et d’un personnel en nombre suffisant. Il n’en demeure pas moins que la qualité de l’accueil y était remarquable, que les personnes fassent l’objet d’une hospitalisation sous contrainte ou sous décision de justice. Je tiens aussi à souligner la grande humanité du personnel pénitentiaire. Cela montre que des progrès énormes ont été accomplis au cours des dernières années, même si des améliorations peuvent être apportées.
Le rapport d’étape permet aussi d’insister sur l’aspect symbolique de la privation de liberté. Le rôle du préfet y est abordé, sans être rejeté, et je tiens d’ailleurs à souligner son importance en milieu rural. Le rapport permet en outre de rappeler que 70 % des hospitalisations sous contrainte sont décidées par les directeurs d’établissement de santé, qui disposent de compétences similaires à celle du préfet. Je pense qu’il faut continuer dans cette voie et ne pas se laisser entraîner vers une comparution systématique devant le juge.
S’agissant du processus d’une éventuelle mainlevée, je pense, moi aussi, qu’il serait opportun de ramener à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement, dès lors que les moyens de la justice le permettent. Se pose toutefois la question, parfois délicate, des relations entre le diagnostic du médecin, l’appréciation de l’avocat du patient et celle du juge : il peut parfois y avoir conflit, même si les médecins que nous avons rencontrés nous ont déclaré que cela était exceptionnel. Quant aux sorties d’essai, elles doivent être maintenues mais encadrées en veillant à ce qu’elles demeurent de courte durée, comme l’indique le rapport. Elles ne doivent pas être dévoyées pour se transformer en sorties de plus longue durée.
Mme Dominique Orliac. À mon tour de remercier, au nom du groupe RRDP, le rapporteur pour son travail. Je pense que les mesures proposées, pour être applicables, supposent des moyens suffisants. Or nous connaissons le manque de moyens des tribunaux, surtout en milieu rural. Je tiens par ailleurs à insister sur la nécessité de concilier le respect des libertés individuelles et de la sécurité publique. J’ai lu avec grand intérêt le rapport d’étape qui nous a été présenté. Je suivrai bien entendu avec attention la suite des travaux de la mission.
Mme Jacqueline Fraysse. Je souhaite, au nom du groupe GDR, saluer la qualité du travail mené, caractérisé par un grand sérieux, l’objectivité et la volonté de traiter, pour mieux le comprendre, d’un sujet difficile, grâce à un calendrier d’auditions exhaustif et des visites sur le terrain qui ont permis de mieux cerner les problématiques. J’apprécie donc beaucoup le travail qui a été mené et je pense que nous avons tous beaucoup appris.
La difficulté consiste à concilier, d’une part, la nécessité de soins imposés pour protéger les patients et des tiers et, d’autre part, le respect de la personne humaine et des libertés individuelles. La loi du 5 juillet 2011 a introduit l’intervention du juge et tous nos interlocuteurs ont confirmé qu’il s’agissait d’une bonne chose. Mais cela suppose, aussi, de dégager des moyens pour assumer les nouvelles tâches qui en résultent.
La loi du 5 juillet 2011 a été adoptée dans un contexte sécuritaire détestable, comme en témoigne le discours qui avait été tenu à Antony par l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, discours qui stigmatisait les personnels soignants et a pollué le débat. Or ces personnels sont hautement responsables et conscients de leur rôle. Ils font preuve d’une grande humanité mais aussi d’une grande compétence. Ces derniers ont aussi souligné la nécessité d’améliorer la formation et de progresser dans la recherche ; pour cela, il leur faut des moyens.
Je serai brève sur les préconisations du rapport d’étape. Je pense que le rapporteur a bien synthétisé nos préoccupations et l’esprit de consensus qui nous anime.
Les sorties d’essai avaient fait l’objet de longs débats lors du projet de loi de 2011. Les travaux menés dans le cadre de la mission d’information confirment l’opinion que je défendais alors : ces sorties doivent relever de la seule responsabilité médicale car elles sont un élément du parcours thérapeutique du patient. J’ajoute que sur ce sujet, également, tous les médecins que nous avons entendus ont montré leur sens élevé des responsabilités.
J’en terminerai en insistant, encore une fois, sur la nécessité de dégager des moyens suffisants. En unités pour malades difficiles, l’encadrement est important et même essentiel.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il est important effectivement de rendre hommage aux personnels qui travaillent auprès de ces malades comme aux juges des libertés et de la détention qui, en toute indépendance, ont à se prononcer sur ces cas.
Mme Isabelle Le Callennec. Vous l’avez rappelé, deux millions de personnes sont sous traitement pour troubles mentaux, c’est pourquoi, combien la santé mentale doit retenir notre attention. Je souhaiterai poser des questions très simples et très concrètes sur quelques-unes des dix-sept préconisations.
Sur l’intervention du préfet, il est suggéré de poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte. Quelles sont-elles, à part bien sûr les médecins psychiatres ?
Vous avez évoqué très rapidement l’hospitalisation des mineurs, avec l’idée que la réflexion se poursuive. Représentent-ils une part importante des hospitalisations sans consentement ?
Vous proposez d’améliorer la formation des magistrats : sont-ils les seuls concernés par une meilleure connaissance des soins en unités psychiatriques ? Les médecins de famille, généralistes, sont aussi des acteurs du suivi des troubles mentaux. Le cursus des études des futurs médecins comprend-il une sensibilisation à la question de la santé mentale ?
S’agissant de l’information des malades, vous avez remarqué qu’ils pouvaient connaître des difficultés particulières, elle doit donc s’étendre aux familles, qui sont souvent elles-mêmes très démunies par rapport à la maladie.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises l’idée de poursuivre la mission, en soulignant une difficulté qui commence à apparaître et qu’il faudra aborder : la situation dans les EHPAD. Enfin, la question des autistes doit être soulevée également, qui sont parfois placés en hôpital psychiatrique sans leur consentement ou celui de leur famille.
Mme Martine Carrillon-Couvreur. À mon tour je voudrai féliciter et remercier le rapporteur pour les travaux qu’il vient de nous présenter. Ils ont répondu à une attente assez forte. Ce rapport d’étape soulève de nombreuses questions et préoccupations exprimées par les personnes auditionnées comme par celles qui nous ont sollicités entre les auditions. Deux points me semblent plus particulièrement importants à ce stade des travaux : la prise en compte de la formation des professionnels et en particulier des magistrats, afin qu’ils aient une meilleure connaissance de ce milieu médical, voire parfois carcéral et de privation de liberté, et le droit des malades. Nous avons entendu M. Jean-Marie Delarue à ce sujet. Il est important que cette question soit prise en considération. Il s’agit d’une dimension humaine et nous avons vu, dans le cadre des internements et du suivi des malades, combien ce point reste délicat. Il me semble devoir continuer à être pris en compte dans la suite de nos travaux.
M. Élie Aboud. Les remarques que nous faisons sont, vous l’aurez remarqué, plutôt positives. La question traitée est extrêmement difficile, avec des zones d’ombre qui persistent partout, même au sein de l’institution médicale, entre la partie organique somatique et la partie psychiatrique. Elle est en connexion avec le monde médiatique, judiciaire et familial. Ce dernier, que nous n’avons pas encore évoqué, est partagé entre la négation et l’angoisse. Et les pressions sont fortes, entre le droit d’un malade et les devoirs d’une société.
L’amélioration de la formation des magistrats par des stages en milieu psychiatrique recueille-t-elle leur accord ?
La composition des commissions départementales de soins psychiatriques devrait selon vous comprendre davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical. Quelles sont-elles ?
La prise en charge somatique me semble extrêmement compliquée, or je ne connais pas les propos des psychiatres sur ce point ni les conclusions que vous en tirez.
Enfin je m’interroge – il peut peut-être y avoir là un léger désaccord entre nous – sur l’autorisation de sorties d’essai de courte durée, les psychiatres sont-ils demandeurs et en assument-ils la responsabilité, ou en reste-t-on à une sortie administrative ?
M. Christian Hutin. Nous sommes dans un beau pays de liberté et l’on peut se féliciter de deux choses : la vigilance d’un certain nombre de nos institutions et du Conseil constitutionnel et la qualité du travail de cette mission sur un sujet difficile. L’histoire a, hélas, montré qu’un certain nombre de régimes politiques ont considéré comme ténue la frontière séparant les soins médico-psychiatriques de l’élimination. J’ai relu la vie de l’abominable docteur Karl Brandt, dans les années 1930, or, quelques années auparavant, tout se passait bien dans la République de Weimar. De bases psychiatriques légales, la situation a évolué vers des délires profonds. Il convient de se le rappeler. La réflexion de Martine Carillon-Couvreur sur la volonté du Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’aller un peu plus loin dans le domaine du contrôle du placement en soins sans consentement me semble justifiée. Quelle est sur ce point l’opinion du rapporteur ? La marchandisation du corps est souvent évoquée ici, mais celle des esprits existe aussi. Le vieillissement de la population entraîne des difficultés. Un certain nombre d’enquêtes a montré que des lieux de séjour, souvent privés, étaient inadaptés, voire très coercitifs pour des malades qui étaient en fait des clients. Il me semblerait assez logique que les parlementaires puissent être autorisés à les visiter. Il convient enfin de penser à l’intrication qui existe entre le monde carcéral et la psychiatrie. Un bon nombre de détenus malades psychiatriques ne sont pas diagnostiqués, la médecine carcérale et en particulier la médecine psychiatrique me semblent sous-dotées, et la mission pourrait également prolonger son champ d’études dans ce domaine.
Mme Bérengère Poletti. Je félicite le rapporteur : le sujet est complexe, difficile et éminemment humain, son approfondissement mérite notre reconnaissance unanime. Vous parlez d’une file active de deux millions de personnes souffrant de troubles psychiatriques, ce qui est effectivement important, alors que l’augmentation des hospitalisations sous contrainte est de 50 %. Vous établissez un lien avec une problématique de demandes de soins et de crainte de voir une responsabilité engagée. Existe-t-il, de ce point de vue, une spécificité de la psychiatrie française ? L’analyse psychiatrique est différente en fonction des cultures et des pays, il serait intéressant de se rapprocher de ce qui est fait ailleurs dans ce domaine. Le domaine psychiatrique n’est pas le seul où le comportement des Français est différent, il en est de même pour l’absorption des médicaments psychotropes. Peut-on voir un lien entre les deux ? Les infirmiers et infirmières diplômés d’État qui travaillent dans les établissements n’ont plus, depuis mars 1992 je crois, de formation spécifique d’infirmier psychiatrique et réclament une formation master 2 pour pouvoir travailler dans le domaine psychiatrique. Quelle est votre position sur ce sujet ? En matière de contrainte, les infirmiers psychiatriques soulèvent la problématique du déplacement du patient vers le tribunal, pour les raisons évoquées par la présidente mais aussi parce que leur nombre étant insuffisant. Lorsqu’ils se déplacent, il est nécessaire de placer les autres patients sous contrainte physique pour assurer la sécurité et l’encadrement sur place.
S’agissant des EHPAD, la manière d’aborder la question des personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées me semble un peu brutale, il ne m’apparaît pas que ce soit dans ces établissements que la situation soit la plus mauvaise : ils disposent d’un personnel formé à cet effet. Les hôpitaux me semblent davantage poser de difficultés précisément parce qu’on y est moins formé à ces problématiques.
M. Bernard Perrut. Je me suis spécialement intéressé aux acteurs de la décision d’admission aux soins sans consentement, et notamment aux interventions du maire, et des maires que nous sommes. Nous sommes en effet confrontés très souvent à des situations de ce type. Vous évoquez la possibilité pour le maire de prendre toute mesure provisoire, y compris sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes et soulignez une situation qui présente une grande hétérogénéité, les maires, suivant les communes, pouvant avoir une appréciation différente de ce que peuvent être les troubles mentaux manifestes et le danger imminent pour la sûreté des personnes. Vous rappelez également que, dans les établissements de santé, une majorité des hospitalisations sont faites à la demande des maires, ce qui peut nous interroger. Vous évoquez des situations locales où il est plus facile pour la police ou la gendarmerie de faire appel au maire pour appliquer cette procédure plutôt que de garder les personnes en cellule de dégrisement. Vous évoquez également le rôle du médecin et sa décision alors qu’il n’est pas forcément un médecin psychiatre, en cas de péril imminent pour la santé de la personne, ce qui se passe dans les communes. On sait les difficultés que les maires peuvent avoir, en pleine nuit notamment, pour prendre ce type de mesures. Je souhaiterais connaître votre avis sur ces questions à la lumière des auditions comme des visites de terrain. Se pose enfin la question de l’organisation des services des urgences des hôpitaux par une meilleure orientation des personnes qui s’y présentent. En l’absence d’un interne en psychiatrie, le patient se trouve pris dans un flux et les arcanes d’un système où il est très mal pris en charge. Nous pourrions nous fixer comme objectif le développement d’unités d’admission d’urgence qui permettrait de répondre à ces difficultés au plus près des réalités du terrain. Ce sujet me préoccupe car les maires des communes rurales comme des plus grandes y sont fréquemment confrontés.
Mme Annie Le Houerou. Vous avez, monsieur le rapporteur, fait le choix de consacrer, dans un premier temps, votre mission spécifiquement aux soins sans consentement. Vous l’avez expliqué en soulignant qu’il y avait une très forte augmentation de l’hospitalisation sous contrainte, ce qui est vrai, mais il y a de moins en moins de personnes hospitalisées en permanence en psychiatrie. Ces dernières se trouvent donc en milieu ordinaire, en ville, avec les risques que l’on connaît et des difficultés sociales grandissantes. Je voudrais insister sur la prévention et sur la formation des travailleurs sociaux. De nombreuses personnes en difficulté se retrouvent isolées, non seulement les malades mais également leur famille. Il est nécessaire, au-delà de la formation, de mettre en place des équipes mobiles d’intervention en ville, cette proximité leur permettant d’accompagner l’ensemble des personnes confrontées aux nécessités d’une hospitalisation sous contrainte, en général en urgence que sont les patients mais aussi les travailleurs sociaux, les familles ou les maires. Le déploiement de ces nouveaux moyens renforcerait la prévention et, avec une prise en charge en amont, éviterait ces hospitalisations.
M. Gilles Lurton. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier porte sur la procédure qui se met en place au moment de la prise de décision de l’hospitalisation sous contrainte C’est un moment difficile durant lequel plusieurs personnes se trouvent autour du malade, dont l’élu local, le maire ou son représentant, appelé à signer les demandes d’admission et prenant de ce fait de lourdes responsabilités dans un domaine dans lequel il n’est pas toujours, selon moi, compétent pour se prononcer sur le fond. J’ai été, moi-même, confronté à des situations où j’ai dû prendre des décisions d’hospitalisation. Or elles ont pu, au moins une fois, être remises en cause, car je n’avais pas forcément bénéficié des bons conseils pour ce faire, alors que pesait cette menace de trouble à l’ordre public dont j’aurai été responsable en l’absence de décision.
Le deuxième point porte sur la sortie d’essai. Je considère, moi aussi, que le médecin a toute compétence pour décider de l’état de santé du malade et de sa capacité à sortir de l’établissement. Néanmoins, le malade une fois sorti, peuvent se poser d’importants problèmes aux collectivités, à l’entourage, à l’environnement social, souvent défavorisé. Le risque est alors de faire replonger la personne concernée dans une situation de santé extrêmement précaire avec les difficultés qui peuvent suivre.
Mme Bernadette Laclais. Quelques mots pour souligner le travail de grande qualité et extrêmement intéressant qui nous a été présenté et pour confirmer ce qui a été dit par plusieurs de nos collègues, en particulier par Annie Le Houerou. En tant que maires et élus locaux, nous sommes confrontés aux difficultés que posent à leur voisinage des personnes qui ne relèvent pas d’une décision de placement sans consentement. Ces personnes ne sont pas toujours suivies comme on pourrait le souhaiter. Je souhaite interroger le rapporteur sur le travail en réseau. Les conseils locaux de santé mentale constituent une avancée mais ils sont très insuffisants parce qu’ils reposent sur la bonne volonté des uns et des autres. Il me semble que nous pourrions réfléchir à la formation des travailleurs sociaux, à la constitution d’équipes mobiles et au suivi que les professionnels de santé, au sens large, pourraient assurer auprès de ces personnes parce que les difficultés qu’elles posent relèvent parfois simplement d’une prise médicamenteuse qui n’est pas faite ou mal faite. Nous sommes un peu de dehors du sujet de l’hospitalisation sous contrainte mais il s’agit de répondre à des difficultés sérieuses qui peuvent susciter de l’incompréhension et expliquer l’augmentation du nombre des demandes d’hospitalisation sous contrainte que vous avez soulignée dans votre rapport et qui doivent attirer l’attention du législateur. Je souhaiterai que nous puissions prolonger l’excellent travail de notre collègue en suivant ces pistes de réflexion.
Mme Véronique Louwagie. Je m’associe aux propos de mes collègues pour remercier le rapporteur pour la qualité de son travail sur un sujet difficile, qui doit concilier la liberté individuelle avec le droit de chacun à la sécurité, en proposant les soins nécessaires. Ma première remarque porte sur le rôle du préfet que vous avez souligné. Il me paraît important de maintenir ce rôle. Le préfet intervient de manière subsidiaire, en cas de défaillance des autres intervenants. C’est le rôle des services de l’État d’assurer la sécurité de chacun. Avez-vous pu constater, du fait de la hausse du nombre d’admissions d’office, des situations différentes selon les régions et des inadéquations entre les moyens déployés et les besoins des personnes accueillies ? Vous avez évoqué, dans le cas du recours à la contention et aux chambres d’isolement, qu’il n’y avait pas de statistiques précises mais des ressentis et des témoignages de patients. Vous avez constaté des pratiques différentes d’une région à l’autre et parfois aussi au sein d’un même établissement. Existe-t-il une grille de gradation de l’état du malade par niveaux, qui soit l’équivalent de la grille d’évaluation du degré de dépendance, dite AGGIR pour Autonomie, Gérontologie Groupes Iso-Ressources, graduée de GIR 1 à GIR 6 ? Une matrice identique donnerait des données plus précises et permettrait des recensements et des contrôles. Peut-on imaginer un mécanisme de cette nature ?
M. Rémi Delatte. Je tiens à saluer rapidement la qualité du travail de réflexion conduit par la mission. Je souhaite revenir sur un sujet que mes collègues ont déjà évoqué, à savoir le positionnement de l’élu local, du maire en particulier, dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. On sait que le maire est un élément clé de cette procédure. Il participe à la prise d’une décision face à laquelle il est souvent seul et sans doute mal préparé, c’est un point important. Je regrette aussi que l’élu impliqué dans cette procédure ne soit pas informé de la sortie définitive des patients ou de leur sortie d’essai. Vous avez rappelé que la sortie d’essai n’était plus soumise à autorisation, ce qui me paraît en soi justifié…
M. le rapporteur. Si, la sortie d’essai reste soumise à autorisation.
M. Rémi Delatte. Il est normal que la décision médicale d’autoriser la sortie soit prise par le médecin et, lui seul, mais il y a une information à donner à l’élu local, ne serait-ce que parce qu’il peut être confronté à des interrogations venant de la population. J’aimerais connaître votre réaction et celle de la mission devant l’organisation de réseaux de santé mentale.
M. le rapporteur. Il est important, sur ce sujet, de trouver un consensus. Je ne parviendrai peut-être pas à répondre à toutes les questions posées qui sont très nombreuses. Je rappelle à Annie Le Houerou que nous ne sommes pas au bout de la mission, que, parmi les questions qu’elle a posées, certaines d’entre elles ainsi que la problématique des prisons relèvent de la suite de nos travaux. S’agissant d’ailleurs des prisons, nous visitions hier, lundi, à Bron, près de Lyon, l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) dans le centre hospitalier Le Vinatier. L’enveloppe extérieure de l’unité est administrée par les services pénitentiaires tandis qu’à l’intérieur, c’est un hôpital. L’odeur que l’on y sent ne trompe pas : c’est une odeur d’hôpital et non de prison. Ceux qui, comme moi, ont été dans les deux types d’établissements font très nettement la distinction. La visite était intéressante de ce point de vue. Demain, nous procéderons à une série d’auditions sur le lien entre psychiatrie et prison. C’est une question lourde que nous devrons étudier. Je n’y répondrai dans son ensemble que dans le rapport de fin de mission, en octobre.
Les intervenants sont revenus à plusieurs reprises sur le rôle du médecin généraliste. Ce rôle est essentiel. Il intervient dans les décisions d’hospitalisation sous contrainte par la délivrance du certificat médical qui permet au maire de prendre cette décision en urgence et sans tiers identifié. Ce certificat n’est pas obligatoirement délivré par un médecin psychiatre, mais le plus souvent par un médecin généraliste qui, par hypothèse, connaît le patient. Ils sont à l’origine de deux tiers voire de trois quarts des prescriptions de psychotropes. La plupart des premières consultations accordées aux patients souffrant de troubles psychiatriques le sont par un médecin généraliste, parce que leurs cabinets ne connaissent pas ou peu les files d’attente importantes qui encombrent les centres médico-psychologiques (CMP) de certains secteurs. Et il importe que cette première consultation intervienne le plus tôt possible parce que l’expression d’un problème psychiatrique est le signe que la maladie est ancienne et a travaillé en silence. Il n’y a aucun intérêt à attendre, pour cette première consultation, qu’un service de psychiatrie soit disponible. Les moyens affectés aux secteurs psychiatriques sont très différents. Ils vont de un à dix. Dans la suite de ses travaux, la mission travaillera sur l’articulation entre la médecine générale et la médecine psychiatrique. Dans certains secteurs, les psychiatres travaillent avec des médecins généralistes et ceux-ci reçoivent des formations à la médecine psychiatrique. Ils ne deviennent pas psychiatres pour autant mais peuvent mieux appréhender la maladie mentale des patients qui se présentent à leur cabinet. Cette articulation est une dimension importante de notre travail à venir.
Le rôle du maire est également revenu dans plusieurs interventions. Je l’ai abordé dans la relation qu’il entretient avec le médecin généraliste. On nous a parfois décrit de manière pittoresque des problèmes d’ordre public qui ne devraient pas se traiter par la psychiatrie. Je cite le cas d’un maire qui aurait demandé au préfet l’hospitalisation sous contrainte d’une prostituée qui se trouvait devant sa mairie. Nous sommes conscients des risques de dérives mais je crois que les maires sont extrêmement précautionneux. Ils savent qu’une décision de cette nature est humainement difficile à prendre et qu’elle engage juridiquement sa responsabilité. Il a intérêt à vérifier que tous les éléments nécessaires à la prise de l’arrêté sont réunis. Il dispose de l’aide offerte par la permanence des services du préfet qui peuvent lui donner des conseils. Le rapport ne présentera pas de préconisations sur ce rôle et nous ne le modifions pas. Peut-être faudrait-il revenir sur le besoin d’information des maires qui a été souligné. Je pense cependant que, sur la base des travaux menés jusqu’à présent, le rôle du maire est essentiel parce qu’il est présent partout mais qu’il doit être le plus limité possible et doit rester résiduel parce que, s’il doit répondre aux besoins urgents qui s’expriment, sa fonction essentielle n’est pas de décider des hospitalisations sous contrainte.
Une question sur les sorties d’essai est revenue de manière récurrente. Un patient admis en soins psychiatriques sur ordre du préfet ne peut bénéficier d’une sortie d’essai qu’avec l’autorisation du préfet, quel que soit l’avis du psychiatre. C’est l’un des points de litige qui existent entre l’administration préfectorale et les psychiatres. Le régime de la sortie d’essai est la source de désaccords et d’incompréhension la plus fréquemment citée. Il y a clairement une demande d’évolution à laquelle nous avons répondu en considérant que le médecin psychiatre devait pouvoir prendre la responsabilité de la décision de sortie d’essai. Plus précisément, les préfets considèrent qu’une sortie d’essai substitue à un régime d’hospitalisation sous contrainte un régime contraignant d’un programme de soins. Il me semble que si la sortie d’essai est accordée pour une durée limitée, la procédure doit être entièrement réinitialisée. Le retour du patient en hospitalisation doit être précédé d’un nouvel arrêté de placement en soins psychiatriques sous contrainte. Il y a différents types de sorties d’essai. Certaines peuvent permettre au patient d’assister aux obsèques d’un proche. D’autres sorties d’essai tiennent à l’évolution du patient. Le médecin peut estimer favorable à son état qu’il rejoigne sa famille ou son logement s’il ne l’a pas perdu. Il faut ensuite voir concrètement ce qui se passe. Le patient peut-il vivre dans une structure d’accueil en aval de l’hôpital ou bien dans son cadre de vie habituel ? On procède en expérimentant puisque l’on n’est pas dans une science exacte. Il me paraît important de prévoir un dispositif législatif qui permette ce travail attentif du psychiatre qui suit l’évolution du patient. C’est pourquoi je propose que, dans la législation, la sortie d’essai relève de la responsabilité du médecin et qu’elle soit limitée dans le temps mais qu’elle demeure soumise au régime de l’hospitalisation sous contrainte.
Je réponds à la question récurrente que Gérard Sebaoun, très assidu aux travaux de la mission, a soulevée à de multiples reprises. Quels sont les moyens permettant la prise en charge d’un patient soumis à une décision d’hospitalisation sous contrainte qui n’a pas envie de quitter le lieu sur lequel cette décision lui est notifiée ? Il peut, par hypothèse, se trouver dans sa famille. Actuellement, on appelle les ambulanciers. Si le patient se montre violent, les ambulanciers s’en vont. On appelle alors les pompiers qui, à leur tour, alertent les policiers. Tout cela se déroule dans le cadre du régime juridique des hospitalisations demandées par un tiers tandis que les décisions d’hospitalisation sous contrainte prises par les préfets autorisent le recours à la force publique. Nous devons clarifier le dispositif juridique de l’hospitalisation à la demande d’un tiers. Se pose ensuite la question des moyens de cette prise en charge. Il serait préférable qu’elle soit assurée par des personnes formées et plus encore par des infirmiers psychiatriques. Nous n’avons pas avancé de solution sur ce point pour le moment mais la suite des travaux de la mission devrait nous le permettre. Je n’engage que moi puisque la mission n’a pas délibéré sur ce sujet.
Une intervention a établi une comparaison internationale des moyens des médecines psychiatriques. Ce qui frappe dans le cas des psychiatries française et belge est le grand nombre de médecins psychiatres par rapport à la population. Il y en a proportionnellement deux fois plus en France qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Il y a également davantage de lits d’hospitalisation que dans ces deux pays. La démographie médicale conduira 40 % des psychiatres à prendre leur retraite dans les prochaines années. Comme pour les autres corps médicaux, la répartition des psychiatres sur le territoire national est très mauvaise. Il y a des zones de surdensité, d’autres de sous-densité et, parmi celles-ci, de véritables déserts psychiatriques, même en Île-de-France, dont on dit pourtant qu’elle accueille une densité anormale de psychiatres. La mission suivra ce problème ainsi que celui de la formation des généralistes. Celle des magistrats reste fondée sur le volontariat. C’est à eux de s’inscrire aux stages qui leur sont proposés.
Il a été souligné que l’intervention du juge était acquise et que tout le monde s’en félicitait. Je serais beaucoup plus prudent. Tout le monde admet, certes, que cette intervention est exigée à la fois par la loi et par le Conseil constitutionnel. Toutefois, officieusement, certains psychiatres reconnaissent qu’ils ne se plient à cette règle que parce que la loi leur impose. Il y a donc encore une certaine réticence devant le regard extérieur.
Lorsque nous avons auditionné les syndicats de psychiatres, une demande a été formulée visant à ce que ce soit le juge des tutelles, et non plus le juge des libertés et de la détention, qui intervienne. Les psychiatres ont, en effet, de meilleures relations avec ces derniers qui s’occupent des problèmes civils ou patrimoniaux des patients et qui donc, par hypothèse, ne sont pas en opposition avec le soin prodigué et avec la contrainte dont celui-ci est éventuellement assorti. Néanmoins, si un jour le contrôle de la contrainte était exercé par le juge des tutelles, il est évident que le rapport avec le psychiatre changerait de nature. Ce point traduit bien l’existence d’une insatisfaction sur la façon dont les choses se passent, même si cette insatisfaction est moindre lorsque les audiences se passent à l’hôpital.
Madame Isabelle Le Callennec, vous avez posé toute une série de questions. Vous nous avez demandé qui pourrait être l’autorité compétente, si ce n’est pas le préfet. Nous nous sommes posé la question.
Pour y répondre, il faut se demander en quoi consiste fondamentalement la décision de mise sous contrainte. On pourrait dire qu’elle est d’ordre médical puisque c’est un médecin qui certifie que des soins sont nécessaires et que, par définition, le patient n’est pas en mesure d’y consentir. La contrainte étant la condition des soins, elle pourrait apparaître comme participant d’un acte thérapeutique. Dès lors, on pourrait imaginer de confier la prise de décision à un médecin de l’agence régionale de santé (ARS). C’est une hypothèse toutefois que nous n’avons pas retenue, ne serait-ce que parce que les médecins d’ARS sont rarement des psychiatres. Plus fondamentalement, il nous a semblé judicieux de maintenir une distinction entre, d’une part, le soin et, d’autre part, la contrainte, qui est certes la condition préalable mais qui en elle-même ne relève pas du soin.
Une autre piste serait celle des directeurs d’établissement. Cela poserait cependant d’autres problèmes. Selon Mme Nicole Questiaux, que nous avons entendue au titre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), ce n’est pas à celui qui gère les murs de les « remplir ». Je ne mets absolument pas en cause ici les directeurs d’établissement, lesquels exercent leur métier avec scrupule. Toutefois, si cette tâche leur était confiée, un doute pèserait nécessairement sur eux.
À défaut, ce ne peut être que le juge ou le procureur. Nous avons fait un peu de droit comparé. Dans les autres pays, ce sont en général les magistrats qui remplissent cette mission tout simplement parce qu’il y a une atteinte à la liberté individuelle. Le juge devient ici un juge « administrateur ». Un directeur d’établissement que nous avons auditionné a fait l’analogie avec l’ordonnance de placement provisoire. En cas d’urgence, le procureur de la République peut en effet placer un enfant, c’est-à-dire le retirer à sa famille, et il faut que dans les huit jours sa décision soit confirmée par un juge du siège, le juge des enfants. Nous n’avons pas encore tranché ce point. Si nous sommes en présence d’un processus administratif, c’est-à-dire si la décision se prend sur dossier au vu de certificats médicaux, cela revient un peu au même que ce soit un préfet ou un juge qui décide. Ajoutons que, si la réforme du Conseil supérieur de la magistrature est adoptée, elle coupera le lien entre le ministre de la justice et le procureur. Devenu indépendant, celui-ci aura pleinement la qualité de magistrat au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme. En revanche, si nous sommes en présence d’un processus judiciaire, cela change tout. Si je suis procureur de la République, que je dois prendre une décision de placement et que je veux le faire au terme d’un débat contradictoire, il faut que je me fasse amener le patient. C’est compliqué puisque, par hypothèse, la décision de placement n’est pas prise. Il faut donc que je fasse appréhender une personne qui n’a pas, ou pas nécessairement, commis d’infraction. Par ailleurs, si la décision de placement est urgente, on peut supposer que le patient est en crise, c’est-à-dire qu’il se trouve au pire moment pour comprendre le processus dont il fait l’objet et pour y participer sans le vivre comme une souffrance plus grande. En résumé, avant de changer l’auteur de la décision, il faudra s’assurer que cela apporte un gain au malade. Pour l’instant, nous n’en sommes pas persuadés.
En ce qui concerne les mineurs, nous n’avons pas de statistiques. Nous avons identifié le problème et nous y travaillons.
S’agissant des droits des malades et de leur information, le vrai problème est aujourd’hui l’effectivité du droit. S’il y a par exemple un droit à un avocat, ce droit ne doit pas rester théorique. Au barreau de Lille, depuis plus d’un an, le bâtonnier ne commet plus d’avocat d’office pour assister les patients devant les juges des libertés et de la détention, car leur indemnité, représentant seulement quatre unités de valeur, soit 95 euros, ne couvrait même pas les charges de cabinet. L’effectivité des droits implique aussi que ceux-ci soient notifiés. C’est souvent compliqué. À quel moment notifie-t-on les droits ? On le fait normalement à l’arrivée du patient mais ce n’est pas facile si le patient est en crise. Sur ce type de problématiques, chaque établissement élabore aujourd’hui ses propres outils. Nous préconisons quant à nous la rédaction d’un livret d’accueil type où toutes les informations à caractère légal soient données Les droits de la « loi Kouchner » du 4 mars 2002 sont ouverts aux malades mentaux comme aux autres malades.
Sur la situation des autistes, nous avons décidé que la mission n’aborderait pas ce sujet. Il y a déjà d’autres travaux consacrés à ce problème, dont la chose exigerait une mission à part entière.
S’agissant des EHPAD, la situation est très compliquée. Il ne s’agit nullement de stigmatiser ces établissements. Nous savons bien que, si l’on ferme à clé certains services, c’est dans l’intérêt des personnes elles-mêmes et de leur sécurité. Il y a d’ailleurs des demandes des familles en ce sens. On se heurte ici à une difficulté juridique. L’EHPAD est en effet le domicile des personnes concernées. Les solutions valables pour l’hôpital ne peuvent donc pas être appliquées ipso facto aux EHPAD. Cela dit, il y a un problème lourd qui est bien identifié et que M. Jean-Marie Delarue a clairement relevé. Des limites sont posées à la liberté en dehors de tout cadre juridique et de tout contrôle efficace. Il existe également des problèmes de contention. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce sujet.
Élie Aboud m’a interrogé sur la prise en charge somatique. La loi du 5 juillet 2011 prescrit une visite à l’entrée qui est généralement respectée. Pour le reste, il y a une facilité de prise en charge dans les hôpitaux généraux dotés d’une division psychiatrique. En revanche, on rencontre des difficultés quand l’hôpital psychiatrique n’a pas de service de médecine générale. Il est inacceptable qu’une personne en hôpital psychiatrique ne voit pas ses problèmes somatiques identifiés et soignés. Rappelons cette évidence qu’un psychiatre est en même temps un médecin.
Une dernière question m’a été posée concernant les infirmiers psychiatriques. Cette profession a été supprimée en 1992, ce qui est ressenti aujourd’hui comme une perte. La formation était différente de celle d’infirmier. Il s’agissait souvent en outre de personnes qui choisissaient cette voie vers l’âge de 40 ans, avec une expérience de vie et donc une qualité humaine spécifique. Pour autant, personne ne souhaite la réintroduction de cette profession sous sa forme ancienne. En revanche, on pourrait envisager que la psychiatrie devienne une spécialisation pour les infirmiers. On nous a dit que certaines personnes s’engageaient dans la voie de la psychiatrie par défaut et s’en allaient dès que possible. Mais nous avons pour notre part rencontré beaucoup de personnes qui y venaient délibérément et avec une forte motivation, des gens très investis auprès des patients et dont les attentes sont grandes vis-à-vis du législateur.
*
La commission autorise, à l’unanimité, le dépôt du rapport d’information de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie relatif aux soins sans consentement en vue de sa publication.
COMPOSITION DE LA MISSION D’INFORMATION
(15 membres)
——
Groupes politiques | |
M. Arnaud Robinet, président (jusqu’au 11 février 2013) |
UMP |
M. Jean-Pierre Barbier, président (désigné en remplacement de M. Arnaud Robinet à compter du 4 avril 2013) |
UMP |
M. Denys Robiliard, rapporteur |
SRC |
M. Gérard Bapt |
SRC |
Mme Kheira Bouziane |
SRC |
Mme Martine Carrillon-Couvreur |
SRC |
M. Jérôme Guedj |
SRC |
Mme Ségolène Neuville |
SRC |
Mme Martine Pinville |
SRC |
M. Gérard Sebaoun |
SRC |
Mme Valérie Boyer |
UMP |
Mme Isabelle Le Callennec |
UMP |
M. Jonas Tahuaitu |
UDI |
Mme Véronique Massonneau |
Écologiste |
Mme Dominique Orliac |
RRDP |
Mme Jacqueline Fraysse |
GDR |
Groupe UMP : groupe de l’Union pour un mouvement populaire
Groupe SRC : groupe socialiste, républicain et citoyen
Groupe UDI : groupe de l’Union des démocrates et indépendants
Groupe RRDP : groupe radical, républicain, démocrate et progressiste
Groupe GDR : groupe de la Gauche démocrate et républicaine
ANNEXE 2
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Jeudi 24 janvier 2013 :
Ø Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY) – Mme Claude Finkelstein, présidente
Ø Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) – M. Philippe Charrier, président, et M. Michel De Lisi, secrétaire général
Ø Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) – M. Serge Blisko, président
Jeudi 31 janvier 2013 :
Ø Professeur Frédéric Rouillon, professeur de psychiatrie à l’université René Descartes, chef de service et de pôle à l’hôpital Sainte-Anne (Paris)
Ø Dr. Jean Oury, directeur de la clinique de La Borde
Ø Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la recherche et la formation en santé mentale – Dr. Jean-Luc Roelandt, directeur
Jeudi 7 février 2013 :
Ø Cour des comptes, sixième chambre – Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseiller maître, présidente de la section politique et établissements de santé, et M. Alain Gillette, conseiller maître
Ø M. Édouard Couty, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la commission « Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » (2008-2009)
Ø Professeur Marion Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Henri Mondor (Créteil), directeur du laboratoire de psychiatrie génétique à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), professeur de psychiatrie à l’université Paris-Est (Créteil)
Jeudi 14 février 2013 :
Ø Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) – Mme Magali Coldefy, maître de recherche
Ø Haute Autorité de santé (HAS) – Dr. Cédric Grouchka, membre du Collège de la HAS et Président de la Commission de validation des recommandations de bonnes pratiques, et Dr. Michel Laurence, chef de service des recommandations de bonnes pratiques
Jeudi 21 février 2013 :
Ø M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Ø Dr Catherine Paulet, chef du service médico-psychologique régional (SMPR) de Marseille, expert auprès du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe
Ø Professeur Antoine Lazarus, professeur émérite de santé publique et sociale, université Paris XIII
Ø Table ronde :
– Groupement information asiles (GIA) : Mme Maryse Coureaud, présidente, M. Thierry Jouanique, vice-président
– Collectif « Mais c’est un homme » : M. Jean Vignes, secrétaire fédéral de Sud Santé Sociaux, Dr. Philippe Gasser, psychiatre, pour l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), M. Claude Deutsch, pour Advocacy France, et M. André Bitton, président du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA)
– Collectif des 39 : Dr. Patrick Chemla, psychiatre chef de pôle (centre Antonin Artaud de Reims), Dr. Thierry Najman, psychiatre chef de pôle (hôpital psychiatrique de Moisselles), Dr. Mathieu Bellahsen, et M. Serge Klopp, cadre de santé (centre médico-psychologique de Grigny)
Vendredi 22 février 2013 :
Ø Table ronde :
– Syndicat de la magistrature : M. Xavier Gadrat, secrétaire national
– Union syndicale des magistrats (USM) : Mme Virginie Valton, vice-présidente, et Mme Virginie Duval, secrétaire générale
– Syndicat des greffiers de France (SDGF-FO) : Mme Isabelle Besnier-Houben, secrétaire générale, et Mme Catherine Arnal, secrétaire générale adjointe
– Syndicat national CGT des Chancelleries et services judiciaires : M. Henri-Ferréol Billy, membre de la direction
Ø Table ronde :
– Syndicat des avocats de France (SAF) : Me Florian Borg, secrétaire général, et Me Jean-Marc André, membre du conseil syndical
– Barreau de Lille : Me Aurore Bonduel
– Conseil national des barreaux (CNB) : Me Carine Monzat, membre du Conseil national, Me Vincent Potié, personnalité qualifiée à la commission « Accès aux droits et à la justice », et M. Jacques-Édouard Briand, chargé des relations avec les pouvoirs publics
Ø Table ronde :
– Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) : Dr. Jean-Claude Penochet, président
– Union syndicale de la psychiatrie (USP) : Dr. Olivier Labouret, président
– Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP) : Dr. Michel Triantafyllou, président, Dr. Jean-Paul Bouvattier, vice-président, et Dr. Jean Ferrandi, secrétaire général
– Syndicat des psychiatres français (SPF) : Dr. Jean-Yves Cozic, président
Ø Table ronde :
– Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) : M. Thierry Amouroux, secrétaire général
– Coordination nationale infirmières (CNI) : Mme Régine Wagner et M. Thierry Alberti, membres du bureau national
Jeudi 28 février 2013 :
Ø Mme Nicole Questiaux, présidente de section honoraire au Conseil d’État, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Jeudi 14 mars 2013 :
Ø Table ronde :
– Syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) : M. Hubert Meunier, directeur du Centre hospitalier du Vinatier à Bron, et M. Claude Lescouet, directeur des soins, secrétaire national du SYNCASS-CFDT
– Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS) : M. Olivier Falanga, délégué national, et M. Guy Chiambaretto, directeur-adjoint, Hôpitaux de Saint-Maurice
– Syndicat national des cadres hospitaliers-FO : M. Hadrien Scheibert, directeur des admissions, des finances et du système d’information, Groupe hospitalier Paul Guiraud (Villejuif)
– Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens (UFMICT)- CGT : Mme Dominique Sahal, directeur-adjoint, Centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant (Toulouse)
Ø Table ronde :
– Conférence des directeurs généraux de CHU : Mme Monique Ricomes, secrétaire générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et Mme Marjorie Obadia, directrice-adjointe à l’AP-HP
– Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH) : M. Denis Fréchou, directeur général des hôpitaux de Saint-Maurice
– Association des directeurs d’établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) : M. Joseph Halos, président, et M. Antoine de Riccardis, directeur du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux
Ø Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur (ACPHFMI) : Mme Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne
Jeudi 28 mars 2013 :
Ø Mme Sophie Théron, maître de conférences en droit public à l’université Toulouse 1 Capitole, et M. Éric Péchillon, maître de conférences en droit public à l’université Rennes 1, responsable pédagogique du diplôme interuniversitaire « Droit et psychiatrie »
ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
ARS : Agence régionale de santé
ASPDRE : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État
ASPDT : Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers
CPOA : Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil
CPT : Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
HAS : Haute autorité de santé
SMPR : Service médico-psychologique régional
UMD : Unité pour malades difficiles
USIP : Unité de soins intensifs en psychiatrie
1 () Désignée, dans la suite du présent rapport, par l’expression « loi de 2011 ».
2 () Selon le Pr. Frédéric Rouillon, chef de service à l’hôpital Sainte-Anne, professeur de psychiatrie à l’université Paris-Descartes, « la dangerosité des malades mentaux n’est pas supérieure, sauf si leur pathologie est associée à la consommation d’alcool ou de stupéfiants ».
3 () Une même personne pouvant faire l’objet de plusieurs mesures successives de soins sans consentement, l’augmentation du nombre des patients concernés est, par construction, inférieure, mais cette augmentation ne s’en est pas moins élevée à 44 % pour les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT), de 43 957 à 63 345, et à 41 % pour les admissions en soins psychiatrique à la demande du représentant de l’État (ASPDRE), de 10 578 à 14 967.
4 () Le Dr. Philippe Gasser, membre du bureau de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP) et responsable d’une unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP) au centre hospitalier Le Mas Careiron (Uzès), a ainsi indiqué à la mission d’information que « selon les départements, les hospitalisations sans consentement vont de 1 à 4 pour les hospitalisations à la demande d’un tiers et de 1 à 13 pour les hospitalisations sur décision du représentant de l’État ». Mme Magali Coldefy, maître de recherche à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), quant à elle, se fondant sur le panorama des établissements de santé publié en 2012 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), a précisé que « le taux [d’hospitalisation sans consentement] varie de 1 à 30 selon le secteur, ce qui ne peut être expliqué par des différences de prévalence des troubles psychiques dans la population. ».
5 () Décisions n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 et n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011.
6 () Composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement (un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient).
7 () Liste établie par le procureur de la République après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
8 () Un an, s’entendant de l’hospitalisation continue la plus longue dans une UMD (article R. 3222-9).
9 () L’article R. 3211-6 prévoit que le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des articles L. 3212-7 et L. 3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège, mais que pour l’application des dispositions du II de l’article L. 3211-12 et du II de l’article L. 3211-12-1, ce délai maximal « est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention ».
10 () Respectivement sept et dix jours (article R. 3213-2).
11 () Ainsi que le rappelle la HAS, « Une audition publique vise à produire des orientations et si possible des recommandations destinées aux professionnels et aux décideurs de santé, voire aux patients et usagers, sur un thème de santé faisant l’objet d’une controverse professionnelle ou sociétale que peut aider à résoudre un temps de débat public entre les parties prenantes concernées. Ces orientations ou recommandations sont rédigées par une commission d’audition, à partir d’une synthèse de l’état des connaissances en prenant en compte les incertitudes existantes et les avis d’experts discutés lors du débat public. La commission d’audition est la pierre angulaire de tout le processus et rédige son rapport d’orientation en toute indépendance. »
12 () Audition du jeudi 28 février 2013.
13 () Audition du jeudi 21 février 2013.
14 () Audition du vendredi 22 février 2013.
15 () Audition du jeudi 21 février 2013.
16 () Audition du jeudi 21 février 2013.
17 () Audition du jeudi 14 février 2013.
18 () Audition du jeudi 21 février 2013.
19 () Audition du jeudi 21 février 2013.
20 () Audition du jeudi 21 février 2013.
21 () Audition du vendredi 22 février 2013.
22 () Audition du jeudi 14 mars 2013.
23 () Audition du vendredi 22 février 2013.
24 () Audition du jeudi 21 février 2013.
25 () Audition du jeudi 21 février 2013.
26 () MM. Serge Blisko et Guy Lefrand, Rapport d’information déposé par la commission des affaires sociale sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, XIIIe législature, n° 4402, février 2012.
27 () Audition du jeudi 21 février 2013.
28 () Audition du jeudi 7 février 2013.
29 () Audition du jeudi 21 février 2013.
30 () Audition du jeudi 21 février 2013.
31 () Audition du jeudi 21 février 2013.
32 () Auditions du jeudi 31 janvier et jeudi 7 février 2013.
33 () Audition du jeudi 14 février 2013.
34 () Audition du jeudi 21 février 2013.
35 () Audition du jeudi 21 février 2013.
36 () Audition du jeudi 21 février 2013.
37 () Audition du jeudi 21 février 2013.
38 () Personnalité qualifiée à la commission « Accès aux droits et à la justice » du Conseil national des barreaux (CNB) ; audition du vendredi 22 février 2013.
39 () Audition du jeudi 24 janvier 2013.
40 () Audition du vendredi 22 février 2013.
41 () Circulaire du 21 juillet 2011 relative à la présentation des principales dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
42 () Audition du jeudi 21 février 2013.
43 () Audition du vendredi 22 février 2013.
44 () Audition du jeudi 21 février 2013.
45 () Audition du vendredi 22 février 2013.
46 () Audition du vendredi 22 février 2013.
47 () Audition du jeudi 21 février 2013.
48 () Audition du vendredi 22 février 2013.
49 () Audition du jeudi 21 février 2013.
50 () Audition du vendredi 22 février 2013.
51 () Circulaire du 11 janvier 2010 : Modalités d’application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique. Hospitalisation d’office. Sorties d’essai.
52 () Audition du jeudi 21 février 2013.
53 () Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
54 () Audition du jeudi 21 février 2013.
55 () Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.
56 () 10° de l’article 8 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011.
57 () Audition du jeudi 21 février 2013.
© Assemblée nationale