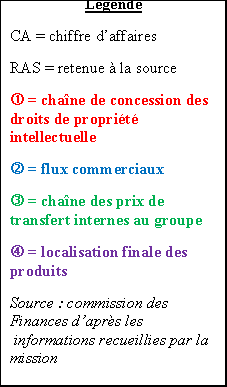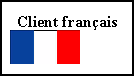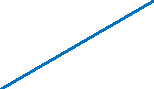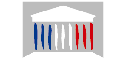
N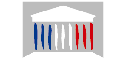
° 1243
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juillet 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux d’une mission d’information
sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Pierre-Alain Muet, Rapporteur
M. Éric Woerth, Président de la mission
M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,
Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE DU RAPPORT 9
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 15
INTRODUCTION 17
PREMIÈRE PARTIE : L’OPTIMISATION FISCALE DES ENTREPRISES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 21
I. UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE À DÉFINIR ET À QUANTIFIER 21
A. TENTATIVES DE CARACTÉRISATION DE L’OPTIMISATION FISCALE 21
1. Une pratique en principe légale, distincte de la fraude et de l’évasion 21
2. Des techniques souvent complexes, majoritairement utilisées par les plus grandes entreprises 23
3. Un critère important, mais rarement unique, des choix de développement et d’implantation des entreprises 25
B. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À MESURER 26
1. L’évolution de la part de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les recettes publiques ne permet pas de tirer de conclusions précises 26
2. Les écarts entre IS théorique et IS réel ne permettent pas, en tant que tels, de caractériser l’existence de comportements d’optimisation. 27
3. Certains flux « anormaux » d’investissements directs à l’étranger peuvent être révélateurs de comportements d’optimisation 29
4. Les chiffres parfois évoqués ne reposent sur aucune statistique réellement incontestable 30
II. LES PRINCIPAUX LEVIERS DE L’OPTIMISATION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL 32
A. L’UTILISATION DES DIFFÉRENCES DE LÉGISLATION ENTRE ÉTATS 32
1. Les régimes fiscaux nationaux restent marqués par leur disparité 32
2. L’existence de « paradis fiscaux » accentue fortement les possibilités d’optimisation. 35
a. Souvent employée, la notion de paradis fiscal ne fait pas l’objet d’une définition universelle. 35
b. Les paradis fiscaux, qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories, renforcent les attraits de l’optimisation 40
B. LES EFFETS NON SOUHAITÉS DES CONVENTIONS FISCALES 42
1. Les différents régimes d’imposition des bénéfices : mondialité et territorialité 42
2. Le risque de double imposition 43
3. Les conventions d’élimination des doubles impositions 44
4. Des principes conventionnels mal adaptés à certains aspects de l’économie moderne, notamment à l’économie numérique 46
5. L’utilisation par certaines entreprises des conventions à des fins de « double non taxation » 47
III. TENTATIVE DE TYPOLOGIE DES PRINCIPALES PRATIQUES D’OPTIMISATION 49
A. L’OPTIMISATION PAR L’ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES 49
1. Les dispositions favorables à la constitution de holdings financières 49
a. Le régime « mère-fille » prévu par le droit français 50
b. Un exemple de régime étranger plus favorable : la participation-exemption néerlandaise 50
2. Le cas particulier des « captives » d’assurance et de réassurance 51
B. L’OPTIMISATION PAR LE FINANCEMENT 52
1. L’attractivité fiscale du financement par la dette : la déductibilité des charges financières 52
2. Un intérêt fiscal accru par l’exonération de certains produits 52
3. Un régime particulièrement attractif en économie ouverte : les intérêts notionnels 54
C. LE RECOURS AUX INSTRUMENTS ET ENTITÉS HYBRIDES 55
D. L’OPTIMISATION PAR MANIPULATION DES PRIX DE TRANSFERT 57
1. Les prix de transfert : cadre conceptuel 57
2. Une problématique renouvelée par le renforcement du caractère immatériel de l’économie 62
3. Des manipulations de prix de transfert particulièrement dommageables pour les pays en développement 63
4. Différents types de manipulation des prix de transfert 64
a. Les manipulations portant sur les transferts d’actifs corporels 64
b. Les manipulations portant sur les prestations de service 64
c. Les manipulations permises par la politique de financement intragroupe 65
d. Les manipulations relatives à la rémunération des actifs incorporels 67
e. Le cas particulier des opérations de « business restructuring » 67
IV. LA COMBINAISON DES DIFFÉRENTS OUTILS D’OPTIMISATION DANS DES SCHÉMAS TRÈS COMPLEXES : LE NUMÉRIQUE 71
A. LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE PERMETTENT UNE STRATÉGIE FISCALE QUI APPARAÎT COMME LA FORME D’OPTIMISATION LA PLUS ABOUTIE 71
B. LE « DOUBLE IRLANDAIS ET SANDWICH NÉERLANDAIS », RECETTE DE GOOGLE, EST UN MONTAGE PARTICULIÈREMENT RÉVÉLATEUR DES STRATÉGIES FISCALES DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE 72
1. Le montage repose sur trois sociétés 72
2. Les bénéfices de l’entité opérationnelle située en Irlande sont fortement minorés par le versement d’une redevance aux Pays-Bas, en franchise d’impôt 73
3. Les Pays-Bas jouent un rôle d’État-tunnel vers les Bermudes 73
4. Les bénéfices transférés aux Bermudes n’y sont pas imposables 74
5. Du fait de la réglementation américaine, les bénéfices stockés aux Bermudes ne sont pas imposables aux États-Unis tant qu’ils n’y sont pas rapatriés 75
C. LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE ONT ÉGALEMENT UNE STRATÉGIE D’OPTIMISATION EN MATIÈRE DE TVA 78
SECONDE PARTIE : CE QUI A ÉTÉ FAIT, CE QUI RESTE À FAIRE 79
I. UNE CAPACITÉ D’ACTION LIMITÉE AU NIVEAU NATIONAL 79
A. DES MESURES LÉGISLATIVES RÉCENTES CONTRE L’OPTIMISATION PAR LE FINANCEMENT 79
1. La limitation de la déductibilité des charges financières 79
2. Un régime des plus-values de cession à long terme de certains titres de participation rendu plus rigoureux 80
B. LES PRINCIPAUX OUTILS DE CONTRÔLE DES PRATIQUES D’OPTIMISATION ABUSIVES 81
1. Des outils généraux : l’abus de droit et l’acte anormal de gestion 81
a. L’abus de droit fiscal 81
b. L’acte anormal de gestion 83
2. Les dispositions spécifiques relatives au contrôle des prix de transfert 84
C. LA LIMITATION DES FLUX FINANCIERS VERS DES CIEUX FISCAUX PLUS CLÉMENTS 89
1. Les régimes spécifiques aux États et territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs 89
a. La non-déductibilité de certaines charges versées dans des « paradis fiscaux » 90
b. Les règles spécifiques aux versements effectués dans des États et territoires non coopératifs 90
2. Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées : l’article 209 B du code général des impôts 91
D. LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES D’ENCADREMENT DES PRODUITS ET ENTITÉS HYBRIDES 92
1. Limiter les possibilités de déduction multiple d'une même dépense 92
2. Limiter la déduction de flux non imposables 92
3. Limiter l’exonération, au titre de l’impôt « national », de flux déductibles à l'étranger 93
4. Les leçons tirées des expériences étrangères 93
E. DES CHANGEMENTS POSSIBLES DANS LES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION FISCALE FRANÇAISE ET LES CONTRIBUABLES 94
1. Au-delà des contrôles fiscaux, il existe d’autres sources d’information sur les pratiques d’optimisation fiscale 94
2. Des avancées ont eu lieu sur ce terrain en France, mais elles pourraient être utilement complétées 97
a. Les procédures de rescrit fiscal 97
b. L’expérimentation d’une « relation de confiance » 98
c. Envisager une déclaration obligatoire des schémas d’optimisation 100
II. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFLEXION INTERNATIONALE POUR MODIFIER LES PRINCIPES D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES 102
A. LA REFONTE DU « RÉSEAU CONVENTIONNEL » EST L’OBJECTIF À ATTEINDRE 102
1. La conclusion d’une convention fiscale multilatérale représente un idéal qui se heurte à plusieurs obstacles 104
2. La renégociation des conventions bilatérales est un travail de longue haleine 105
3. À plus court terme, il convient d’envisager la redéfinition de la notion d’établissement stable, devenue obsolète du fait de la numérisation de l’économie 105
4. Ces questions font désormais l’objet d’une attention particulière du G8 et du G20. 107
5. La Commission européenne porte également des initiatives en ce sens 108
B. LES ALTERNATIVES À LA RENÉGOCIATION DES CONVENTIONS POTENTIELLES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES AVEC PRUDENCE 111
1. Les alternatives globales 111
a. Formulary apportionment 111
b. La proposition de directive ACCIS 113
2. Les alternatives sectorielles : le numérique 116
a. Les taxes spécifiques envisagées par le Président de la commission des Finances du Sénat 116
b. La taxe « prédateur-payeur » envisagée par la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique 118
c. Le numérique comme point d’entrée de la démarche ACCIS 119
III. À PLUS COURT TERME : RENFORCER L’INFORMATION ET LA TRANSPARENCE 120
A. L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS FISCALES : MIEUX CONNAÎTRE L’OPTIMISATION POUR MIEUX L’ENCADRER 120
1. Les avancées en matière de lutte contre les paradis fiscaux 120
2. Des améliorations possibles en matière d’échange d’informations 121
a. Par une appréciation renouvelée de la notion d’ETNC 121
b. Par une attention particulière portée aux rulings des administrations fiscales étrangères 121
B. AMÉLIORER L’INFORMATION FOURNIE PAR LES ENTREPRISES : LA TRANSPARENCE PAYS PAR PAYS 122
C. LE « RISQUE DE RÉPUTATION » COMME FACTEUR DE LIMITATION DES STRATÉGIES D’OPTIMISATION 124
CONCLUSION 129
EXAMEN EN COMMISSION 131
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION 145
L’impôt représente une charge pour les entreprises ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à l’optimiser, c’est-à-dire à le réduire autant que le droit le permet. L’optimisation fiscale peut en effet se définir comme l’utilisation par le contribuable de moyens légaux lui permettant d’alléger son impôt. Elle doit donc être distinguée de la fraude et de l’évasion fiscales, la première impliquant une violation de la lettre de la loi, la seconde un contournement volontaire de son esprit. Les frontières entre ces différentes notions sont toutefois loin d’être étanches. Lorsque l’optimisation utilise les failles de certaines législations nationales pour s’affranchir de l’impôt sur les sociétés, comme le font certaines multinationales en contournant de fait l’esprit des lois des pays dans lesquels elles opèrent, on n’est plus très éloigné de l’évasion fiscale à grande échelle. C’est de cette optimisation fiscale agressive qu’il sera principalement question dans ce rapport.
Délicate à définir, l’optimisation fiscale est encore plus difficile à mesurer. Le phénomène d’érosion des bases taxables du fait des stratégies d’optimisation mises en place par les grandes entreprises multinationales, constaté notamment par l’OCDE dans son récent rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, est davantage documenté par un faisceau concordant d’indices que par des données chiffrées incontestables. Figure notamment au rang de ces indices le fait que certains États pratiquant une fiscalité faible accueillent des flux d’investissements directs à l’étranger sans commune mesure avec leur richesse nationale et la taille de leur économie.
Car les différences de législation entre États – et donc de niveau de pression fiscale –sont le principal levier des stratégies d’optimisation fiscale mises en place par les entreprises transnationales. Dans une économie ouverte, il s’agit pour ces groupes de localiser les charges dans les États les plus taxateurs – pour y minorer autant que possible l’assiette imposable – et les profits sous les cieux fiscaux les plus cléments – pour limiter voire annuler la cotisation d’impôt. À cet égard, les « paradis fiscaux » sont évidemment des destinations de choix pour échapper à l’impôt.
À la disparité des droits nationaux s’ajoutent les imperfections du droit international. Afin d’éviter les doubles impositions, les États ont développé un réseau aujourd’hui très dense de conventions internationales bilatérales (environ 3 000), sous l’égide de l’OCDE, dont le modèle de convention a fait école. De manière presque paradoxale, ce réseau de conventions permet à certaines entreprises de bénéficier de doubles non-impositions, en choisissant leurs États d’implantation pour tirer profit de l’articulation des différentes conventions fiscales. Cette pratique de « treaty shopping » est rendue attractive par le fait que certains États, y compris au sein de l’Union européenne, laissent transiter en franchise d’impôt des revenus vers des paradis fiscaux.
Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.
Les grands groupes transnationaux peuvent tout d’abord optimiser leur fiscalité en choisissant les modalités d’organisation des entités qui les composent. Ainsi, des régimes de type « mère-fille » permettent d’exonérer en totalité ou quasi-totalité les dividendes qu’une filiale établie dans un État fait remonter à sa mère située dans un autre État.
L’optimisation passe également par le choix des modalités de financement de l’activité. Ainsi, il est fiscalement plus intéressant de se financer par recours à la dette (qui génère des charges financières déductibles de l’assiette imposable) que par augmentation du capital (les dividendes versés en contrepartie n’étant pas déductibles, sauf exception).
Certains produits et certaines entités permettent une optimisation particulièrement agressive, du fait de leur caractère hybride. Un produit est considéré comme hybride lorsqu’il est qualifié différemment par deux États, par exemple lorsqu’il est traité comme un titre de dette dans un État et comme un titre de participation dans un autre : son émission crée des charges financières déductibles dans le premier État, mais les produits qu’il génère (dividendes) ne sont pas imposés dans le second lorsqu’ils sont perçus sous un régime de type mère-fille. Une entité est considérée comme hybride lorsqu’elle est fiscalement transparente dans un État normalement taxateur – ses produits n’y sont donc pas imposés – et opaque dans un autre État – ses charges y sont déductibles.
Mais ce sont les prix de transfert qui sont sans doute le principal vecteur d’optimisation. Les prix de transfert valorisent les échanges transfrontaliers réalisés entre entités liées, typiquement au sein d’un groupe de sociétés. En application des principes de l’OCDE, ces prix de transfert doivent être déterminés selon le principe de pleine concurrence, comme s’ils valorisaient des échanges entre entreprises indépendantes. Or, les entreprises peuvent manipuler ces prix de transferts, toujours selon la même logique de localisation des charges et des produits.
Si elle n’est pas nouvelle, l’optimisation fiscale des entreprises est profondément renouvelée par la conjonction de deux phénomènes : la globalisation de l’économie, d’une part, et le développement de l’économie numérique, d’autre part.
Du fait de la globalisation de l’économie, les flux intragroupe représentent environ 60 % du commerce mondial ; la problématique des prix de transfert est donc cruciale. Elle l’est d’autant plus que les prix de transfert les plus difficiles à valoriser – et, pour les administrations fiscales, à contrôler – sont ceux afférents à la rémunération des actifs incorporels (typiquement, les redevances rémunérant l’utilisation de droits de propriété intellectuelle). Or, la place des actifs incorporels devient centrale du fait du développement de l’économie numérique.
De manière générale, le droit fiscal est mal adapté aux spécificités de l’économie numérique. Ainsi, les conventions fiscales bilatérales prévoient la possibilité pour un État de prélever l’impôt sur les sociétés résidentes, mais également sur les établissements stables des sociétés non résidentes. Les critères de présence d’un établissement stable, souvent résumés par la formule « des hommes et des machines » ne permettent pas d’appréhender – et donc d’imposer – l’activité réalisée en France par les géants américains du numérique, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Les stratégies fiscales de ces entreprises sont sans doute les plus abouties, combinant différents outils pour permettre de loger dans des paradis fiscaux des bénéfices résultant de l’exploitation de données collectées dans le reste du monde (hors États-Unis).
Des voix s’élèvent donc pour que soient instaurées des taxes nationales spécifiques à l’économie numérique, qu’il s’agisse des taxes sur la publicité proposée par le Président de la commission des Finances du Sénat ou de la taxe « prédateur-payeur » proposée récemment par la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, assise sur les données collectées auprès des utilisateurs d’Internet. Aussi intéressantes soient-elles, ces propositions n’ont pas été retenues par le Rapporteur. Car si l’économie numérique pose des défis particuliers aux règles fiscales nationales et internationales, ces défis sont en réalité plus généraux. Ils interrogent fondamentalement le pouvoir d’imposition des États, dont les modalités doivent être repensées pour rétablir un impôt sur les bénéfices, qui reste l’impôt sur les entreprises le plus pertinent d’un point de vue économique, mais dont l’érosion de l’assiette conduit à sa réduction au profit d’impôt plus pénalisants pour l’activité économique, notamment sur les facteurs de production les moins mobiles.
C’est pourquoi les propositions du Rapporteur s’inscrivent dans le cadre des initiatives tendant à redonner aux États les moyens de soumettre à leur juridiction fiscale ceux des bénéfices nés sur leur territoire, qui aujourd’hui leur échappent. Elles sont de ce fait en cohérence avec la réflexion internationale sur la répartition du pouvoir de lever l’impôt entre les États, lancée par Pierre Moscovici, Wolfgang Schäuble et George Osborne – les ministres des Finances français, allemand et britannique. Conduite par l’OCDE, elle doit aboutir à un premier ensemble de propositions lors de la prochaine réunion des ministres des Finances du G20 du 18 au 20 juillet à Moscou.
L’aboutissement de cette démarche à l’échelle internationale sera forcément longue puisqu’elle nécessite la renégociation des conventions fiscales, avec en ligne de mire une nouvelle définition de la notion d’établissement stable et l’élimination des doubles non-impositions. Mais elle peut aussi se décliner, à plus court terme, en mesures pertinentes tant au niveau national qu’européen.
Il conviendrait de travailler à une harmonisation des bases d’imposition au niveau européen. Porté par la Commission, le projet de directive ACCIS (assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés) a pour objet, au-delà de l’harmonisation des bases, de répartir le pouvoir d’imposer entre les États de l’Union, en fonction de critères objectifs. Engagée il y a plus de 10 ans, cette démarche achoppe sur les intérêts divergents des États. Son principal défaut reste son caractère optionnel : seules les entreprises qui y ont intérêt choisiraient l’ACCIS. Cela étant, cette démarche est particulièrement bien adaptée à la problématique de l’économie numérique, et il serait judicieux de poursuivre la réflexion en ce sens.
Au niveau national, enfin, des actions de lutte contre l’optimisation sont possibles. Certaines mesures ont d’ailleurs été récemment adoptées, notamment l’encadrement de la déductibilité des charges financières. De plus, les principes devant guider la renégociation des conventions internationales peuvent trouver à court terme des traductions nationales, notamment sur l’encadrement des produits hybrides. Des avancées pourraient avoir lieu sur le plan du contrôle, par exemple en permettant plus facilement à l’administration de constater un abus de droit, procédure par laquelle l’optimisation verse en quelque sorte dans l’évasion, et ouvre la voie à un redressement.
En matière de prix de transfert, un récent rapport de l’Inspection générale des Finances avance une série de propositions dont la plupart méritent d’être reprises, comme par exemple la nécessité pour les contribuables de prouver que les opérations de business restructuring se déroulent selon le principe de pleine concurrence.
Mais la lutte contre l’optimisation passe également par une amélioration de l’information dont dispose l’administration, ce qui peut s’inscrire dans un renouvellement plus général des relations avec les entreprises. Il pourrait ainsi être envisagé que soient communiqués à l’administration les schémas d’optimisation fiscale, comme cela se pratique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il serait par ailleurs opportun de promouvoir la « transparence pays par pays », adoptée pour certaines entreprises au niveau européen et en voie d’adoption en France : les entreprises devraient ainsi indiquer aux administrations où elles réalisent leurs profits et où elles payent leurs impôts.
Car le manque de civisme fiscal, même s’il n’est pas constitutif d’une infraction à la loi, fait peser sur les entreprises un risque réputationnel certain. Des expériences récentes ont montré que les citoyens acceptent mal, dans un contexte de crise économique qui appelle une plus grande contribution de chacun à l’effort de redressement, que les plus grandes entreprises transnationales échappent en partie à l’impôt.
Il semble en effet nécessaire de rappeler que l’optimisation se traduit en dernière analyse par un report de la charge fiscale sur les facteurs de production les moins mobiles (le travail) ou les contribuables moins bien outillés pour tirer profit des subtilités fiscales (les très petites et les petites et moyennes entreprises – TPE/PME). Poussée à l’extrême, elle contrevient au principe d’égalité devant l’impôt consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui commande que la charge fiscale soit répartie en fonction des facultés contributives de chacun.
*
Le Rapporteur tient à remercier le Président de la mission d’information pour son implication constante.
Adapter le droit fiscal international
– Soutenir les démarches internationales tendant à la renégociation des conventions fiscales bilatérales (proposition n° 11).
– Dans le cadre de la renégociation des conventions fiscales bilatérales, promouvoir la définition par l’OCDE du concept d’établissement stable virtuel (proposition n° 12).
– Prévoir dans les conventions bilatérales une « clause de sauvegarde fiscale », tendant à s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source (proposition n° 13).
Favoriser la lutte contre l’optimisation au niveau européen
– Encourager les initiatives de la Commission européenne tendant à réformer les directives relatives aux revenus passifs afin de s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source (proposition n° 14).
– Lancer une réflexion avec nos principaux partenaires européens sur une harmonisation des bases de l’impôt sur les sociétés, pouvant déboucher sur une coopération renforcée en lien avec la mise en œuvre d’ACCIS (proposition n° 15).
– Dans l’attente d’une éventuelle généralisation à l’ensemble des activités, envisager la mise en œuvre obligatoire d’ACCIS pour les entreprises de l’économie numérique (proposition n° 16).
– Promouvoir une définition européenne des États et territoires non coopératifs (proposition n° 17).
Encadrer plus efficacement les pratiques d’optimisation
S’agissant de la procédure d’abus de droit
– Renforcer la portée de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées (proposition n° 1).
S’agissant des charges déductibles
– Modifier l’article 238 A du code général des impôts afin d’aligner les conditions de déductibilité des charges logées dans des États à fiscalité privilégiée sur celles, plus exigeantes, des charges logées dans des États et territoires non coopératifs (proposition n° 7).
S’agissant des prix de transfert
– Modifier l’article 57 du code général des impôts afin de supprimer la condition de dépendance ou de contrôle lorsque les transactions s’effectuent avec des entreprises établies dans des États et territoires non coopératifs (proposition n° 2).
– Prévoir la mise à disposition de la comptabilité analytique et consolidée des entreprises soumises à l’obligation de documentation des prix de transfert en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (proposition n° 3).
– Supprimer le caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles de prix de transfert (proposition n° 4).
– Délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification (proposition n° 5).
– Dans certaines situations « à risque » (business restructuring notamment), faire peser sur le contribuable la charge de prouver le caractère normal des prix de transfert (proposition n° 6).
S’agissant des produits et entités hybrides
– Envisager l’instauration de mesures visant à empêcher la déduction ou l’exonération en France d’un flux ou produit déjà déduit ou exonéré dans un autre État (produits dits « hybrides ») (proposition n° 8).
– Envisager l’instauration de mesures visant à empêcher une entreprise de tirer un bénéfice fiscal résultant d’une différence de qualification juridique de son statut dans deux États différents (entités dites « hybrides ») (proposition n° 9).
Renforcer l’information de l’administration fiscale et la sécurité juridique du contribuable
– Au terme d’une démarche concertée, rendre obligatoire la communication préalable à l’administration fiscale des schémas d’optimisation procurant un avantage fiscal substantiel, et promouvoir parallèlement un recours plus fréquent à la procédure de rescrit (proposition n° 10).
– Favoriser la transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités françaises (têtes de groupe ou filiales) (proposition n° 18).
– Généraliser au sein de l’Union européenne la « transparence pays par pays », puis promouvoir auprès des États non membres de l’Union européenne l’adoption d’une règle similaire (proposition n° 19).
Promouvoir le civisme fiscal des entreprises privées et publiques
– Élargir le champ de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises aux conséquences fiscales de leurs activités et de leurs stratégies (proposition n° 20).
– Veiller à ce que l’État prenne en compte le civisme fiscal dans la gestion de ses participations (proposition n° 21).
– Suggérer à la Cour des comptes de prévoir l’inclusion d’un développement spécifique sur le civisme fiscal dans ses rapports de contrôle sur la gestion des entreprises publiques (proposition n° 22).
La crise économique, financière et budgétaire dans laquelle est plongée l’Union européenne depuis près de cinq ans a renforcé le besoin de redressement des comptes publics, mais également l’aspiration à la justice fiscale. En ces temps qui rendent nécessaire une contribution plus importante de chacun à l’effort public, les écarts flagrants entre la richesse de certains et la modicité de leur participation à cet effort ne sont plus acceptés. Afin d’y remédier, l’impératif premier est de faire en sorte que ceux qui ne payent pas les impôts qu’ils doivent s’exécutent : c’est le sens de la lutte contre la fraude fiscale.
Mais cette lutte, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement la justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt. Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.
Si la problématique de l’optimisation fiscale des entreprises n’est pas récente, elle est profondément renouvelée par la conjonction de deux phénomènes :
– la globalisation de l’économie se manifeste par la place croissante des échanges transfrontaliers réalisés entre des entreprises liées, appartenant à un même groupe. Ces échanges offrent aux entreprises la possibilité, grâce aux prix de transfert et aux relations financières, de localiser leurs charges dans les États pratiquant une fiscalité élevée, et leurs produits sous des cieux fiscaux plus cléments ;
– le développement de l’économie numérique et l’extension de ses principes aux autres sphères d’activité renforcent les possibilités d’optimisation, car les actifs immatériels, qui sont ici à l’origine de la production de richesse, sont presque parfaitement mobiles.
Les grandes entreprises du numérique concentrent d’ailleurs l’attention depuis plusieurs mois, étant devenues d’une certaine manière le symbole de l’optimisation fiscale. La presse généraliste s’intéresse régulièrement aux montages mis en place par ces entreprises pour échapper en quasi-totalité à l’impôt en Europe, où elles conduisent pourtant une part non négligeable de leurs activités. Les parlementaires britanniques et américains en ont auditionné les dirigeants, afin qu’ils exposent leur stratégie fiscale. En France, la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique a remis au Gouvernement, en janvier dernier, un rapport remarqué. Depuis plusieurs années, le Sénat réfléchit de son côté à l’instauration de taxes spécifiques au secteur, sous l’impulsion du Président de sa commission des Finances. Le Sénat a par ailleurs créé en 2012 une commission d’enquête sur l’évasion fiscale internationale.
Mais la question de l’optimisation fiscale des entreprises dépasse le seul champ du numérique : en atteste par exemple la contestation populaire qui s’est élevée au Royaume-Uni contre l’entreprise Starbucks, au motif qu’elle n’y payait pas d’impôt malgré son succès. Le caractère généralisé du phénomène n’a pas échappé à l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), qui a publié au début de l’année un rapport destiné à servir de matrice à la réflexion internationale. Son titre résume bien la problématique à laquelle sont confrontés les États : Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (en anglais, Base Erosion and Profit Shifting, ou BEPS) (2).
Ce rapport dresse le constat suivant : alors que le réseau dense de conventions fiscales bilatérales a été construit pour éviter les doubles impositions, l’existence de différences de législations entre États peut aboutir à des situations inverses de double exonération, situations favorisées par le caractère de plus en plus incorporel de la création de valeur. Ce constat appelle une réflexion internationale sur la répartition du pouvoir de lever l’impôt entre les États. Lancée par Pierre Moscovici, Wolfgang Schäuble et George Osborne – les ministres des Finances français, allemand et britannique – cette réflexion conduite par l’OCDE doit aboutir lors de la prochaine réunion des ministres des Finances du G20 du 18 au 20 juillet à Moscou. Un premier pas été franchi le 18 juin dernier, lors du G8 de Lough Erne (Irlande du Nord), dont la déclaration finale invite les États à modifier les règles permettant aux entreprises multinationales d’échapper à l’impôt (3).
Car l’implication des États dans l’optimisation fiscale des entreprises est majeure : si les entreprises parviennent à réduire significativement leur charge d’impôt, c’est parce que certains États ont mis en place des mesures fiscales particulièrement attractives, et que le recours à ces mesures est rendu possible par les conventions fiscales. « L’État-Janus » peut afficher deux aspirations contradictoires : attirer de l’activité économique sur son territoire par des mesures fiscales avantageuses, et lutter contre l’érosion de la base taxable qui porte directement préjudice à ses recettes.
Il est donc sans doute vain de se contenter de stigmatiser les comportements des entreprises transnationales qui recourent à l’optimisation, car ces comportements sont finalement rendus possibles par les failles de la législation fiscale, nationale comme étrangère, voire internationale.
On le voit bien, l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international pose des questions urgentes, multiples, complexes et entremêlées. C’est pourquoi la commission des Finances a décidé le 27 février dernier la création d’une mission d’information sur le sujet. Cette mission, dont la composition reflète celle de l’Assemblée, a procédé à de nombreuses auditions à Paris : OCDE, Direction générale des Finances publiques, organisations non gouvernementales, représentants d’entreprises, professionnels du droit…
Le Président et le Rapporteur se sont en outre déplacés dans deux États dont le rôle leur a paru central pour la bonne compréhension du sujet : les Pays-Bas, qui ont développé une politique avancée d’attractivité fiscale, et les États-Unis, dont sont résidentes les plus grandes entreprises de l’économie numérique. En sa qualité de membre du Bureau de la commission des Finances, le Rapporteur s’est également rendu à Berlin, où la question de l’optimisation fiscale des entreprises a été abordée avec des membres du Bundestag et des représentants de l’administration fiscale. Un questionnaire a par ailleurs été adressé à l’attaché fiscal pour le Royaume-Uni, compte tenu de l’actualité particulière du sujet dans ce pays. Enfin, un courrier a été adressé aux dirigeants de chacune des entreprises du CAC 40, leur demandant d’indiquer à la mission les implantations de leurs groupes dans des États pratiquant une fiscalité faible. Compte tenu des délais impartis, seules huit groupes ont pu répondre à cette demande ; le Rapporteur informera donc ultérieurement la commission des Finances des informations contenues dans l’ensemble des réponses.
Pour les besoins de la mission, le Président et le Rapporteur ont en outre obtenu de la commission des Finances l’octroi des pouvoirs habituellement réservés au Président, au Rapporteur général et, pour leur domaine de compétence, aux Rapporteurs spéciaux. Cette procédure, prévue par l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), a permis au Président et au Rapporteur de la mission de se faire communiquer tous les documents administratifs et financiers jugés utiles, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ainsi, la consultation des dossiers fiscaux de quelques entreprises a permis de mieux comprendre les rouages de certaines stratégies d’optimisation.
Le recours – exceptionnel – à cette procédure s’explique notamment par le fait que certaines entreprises ont refusé d’être auditionnées par la mission d’information. Sollicitées en ce sens, Apple et Ikea ont opposé une fin de non-recevoir : sans autre forme de procès pour la première, la seconde indiquant dans un courrier au Président de la mission qu’elle ne dispose « malheureusement pas de compétence dans ce domaine très technique », ce qui apparaît soit improbable soit inquiétant pour une entreprise de cette taille. Cette attitude est bien évidemment inacceptable, et la mission la regrette vivement. La mission a par ailleurs été frappée, au cours de l’organisation des auditions, par le contraste entre l’image publique de certaines entreprises de l’économie numérique – qui font de la transparence de l’information une valeur fédérative et même un fonds de commerce – et la difficulté à établir un simple contact avec elles, des informations aussi banales qu’un numéro de téléphone ou une adresse devant être débusquées au prix d’efforts inédits. La mission relève par ailleurs que bien souvent, les représentants désignés par les entreprises n’étaient pas spécialistes des questions fiscales, ce qui limite par définition – et quelle que soit la bonne volonté des personnes présentes – le degré de précision des informations obtenues d’elles.
La mission s’est d’abord fixé comme objectif d’établir un diagnostic des pratiques d’optimisation fiscale des entreprises transnationales, se fondant notamment sur les travaux déjà conduits et en cours (première partie du présent rapport). Après avoir constaté la difficulté à définir et surtout à évaluer l’ampleur de l’optimisation (I), il s’agira de montrer que les différences de législations nationales et leur articulation avec les conventions internationales sont le terreau sur lequel l’optimisation se développe (II). Sur cette base, une tentative de typologie peut être dressée (III) (4), typologie nécessairement imparfaite compte tenu de l’enchevêtrement des mécanismes à l’œuvre, bien illustré par le cas spécifique de l’économie numérique (IV).
Mais la mission se veut également prospective, en essayant de tirer des mécanismes de lutte contre l’optimisation existants des enseignements pour l’avenir (seconde partie). Le rétablissement du pouvoir d’imposition des États, qui implique une redéfinition des critères posés par les conventions fiscales, passera par un long travail de négociations internationales, qui se pense nécessairement à moyen ou long terme (II). Les pistes d’évolution envisageables à plus court terme relèvent davantage du niveau national – qu’il s’agisse de mesures anti-abus ou d’un changement de relations entre l’administration et les contribuables – (I) et du renforcement de la transparence et de l’information (III).
PREMIÈRE PARTIE :
L’OPTIMISATION FISCALE DES ENTREPRISES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL : DE QUOI PARLE-T-ON ?
I. UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE À DÉFINIR ET À QUANTIFIER
A. TENTATIVES DE CARACTÉRISATION DE L’OPTIMISATION FISCALE
1. Une pratique en principe légale, distincte de la fraude et de l’évasion
● L’optimisation fiscale est une notion particulièrement malaisée à appréhender. Si elle produit des effets analogues à ceux de la fraude ou de l’évasion fiscales – le contribuable réduit, voire annule sa charge fiscale – et si la frontière entre ces trois notions est souvent floue et fluctuante, l’optimisation se distingue des deux autres comportements par sa nature même. Une hiérarchisation des manœuvres d’évitement fiscal conduirait à distinguer trois degrés de « gravité » dans les comportements des contribuables, de celui qui contrevient frontalement et délibérément aux règles fiscales (via la fraude) à celui qui s’inscrit pleinement dans le cadre réglementaire tout en flirtant avec ses marges (grâce à l’optimisation), en passant par toute une gamme de situations intermédiaires qui forment une zone grise encore plus difficilement définissable (l’évasion).
La fraude fiscale implique nécessairement une violation de la réglementation en vigueur. Le contribuable qui y recourt contrevient sciemment à la loi par des manœuvres illicites afin d’échapper en tout ou partie à ses obligations fiscales (5). Il se place intentionnellement hors du cadre légal en menant des opérations juridiquement irrégulières dans le but délibéré d’échapper à l’impôt.
Deuxième degré d’incivilité fiscale, l’évasion est d’autant moins facile à cerner que la notion n’est pas clairement consacrée par le droit français. Se situant à équidistance entre l’optimisation et la fraude, l’évasion se fonde sur des mécanismes qui, pour réguliers qu’ils soient ou puissent paraître au regard du droit, traduisent l’intention claire de celui qui les actionne de contourner la norme fiscale, le seul objectif poursuivi étant la minoration de l’imposition. La pureté de la construction juridique peut n’être qu’artificielle, fictive et servir à déguiser la véritable nature des opérations entreprises et la réalité de la situation du contribuable.
Enfin l’optimisation fiscale – ou planification fiscale (6) – peut se définir comme l’utilisation par le contribuable de moyens légaux lui permettant d’alléger ses obligations fiscales. Elle traduit l’habileté du contribuable à tirer le meilleur parti des dispositions fiscales applicables dans son État d’imposition mais aussi, le cas échéant à l’étranger, en les combinant, en jouant de leurs contradictions et de leurs ambiguïtés afin de réduire l’impôt dû. L’ingéniosité fiscale des contribuables n’est alors pas répréhensible dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation en vigueur.
La jurisprudence administrative a d’ailleurs consacré ce « droit » à l’agilité fiscale. Concrètement, entre deux solutions produisant les mêmes conséquences juridiques, le contribuable peut opter pour celle qui aboutit à une minoration de son impôt, un tel choix étant parfaitement licite (7).
Il convient toutefois de tempérer cette affirmation. Les choix opérés par le contribuable dans le cadre de la loi ne sont pas illimités et celui-ci peut être « rattrapé » par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit, qui permet de sanctionner les comportements dont l’objet exclusif est de minorer ou d’effacer l’impôt dû (8) (cf. infra). Pour qui recourt à l’optimisation, l’abus de droit constitue une ligne rouge à ne dépasser, sous peine de se voir exposé à des sanctions pour le moins dissuasives, avec des redressements donnant lieu au paiement d’une majoration extrêmement élevée (80 %) (9) en sus des intérêts de retard (0,40 % par mois) (10).
Il faut en outre souligner que l’optimisation fiscale, en plus d’être en principe légale, peut même être légitimement considérée, du point de vue de l’entreprise qui y recourt, comme un acte de gestion normal et parfaitement justifié vis-à-vis de ses dirigeants et actionnaires. En effet la fiscalité est assimilée à une charge équivalente aux autres charges qui pèsent sur l’entreprise, et qu’il convient par conséquent de réduire au maximum afin de préserver les marges, la capacité d’investissement ou encore les possibilités de rémunération des détenteurs du capital.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel fait écho à la différence de degré entre fraude et évasion fiscales, d’une part, et optimisation fiscale, d’autre part. Ainsi, alors que plusieurs décisions récentes ont consacré la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales comme objectif à valeur constitutionnelle à part entière (11), les actions entreprises pour mettre fin à l’optimisation fiscale ne constituent qu’un « simple » motif d’intérêt général (12).
Les instances internationales les plus en pointe sur les questions fiscales éprouvent également des difficultés à définir et à distinguer l’optimisation fiscale, comme en témoigne l’encadré ci-après.
Définition de la fraude, de l’évasion et de l’optimisation fiscales par l’OCDE*
Le glossaire des termes fiscaux du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE (13) témoigne de la difficulté à caractériser les trois notions précitées, notamment pour ce qui concerne l’évasion fiscale, à laquelle les notions de tax avoidance et de tax evasion font référence.
« Fraude (fraud) : la fraude fiscale est une forme délibérée d’évasion qui revêt généralement un caractère pénal. Le terme inclut des situations au titre desquelles des déclarations délibérément erronées, de faux documents sont transmis (aux administrations fiscales), etc.
Évasion (evasion) : un terme difficile à définir mais que l’on utilise généralement pour caractériser les dispositions illégales grâce auxquelles les obligations fiscales sont occultées ou ignorées. Le contribuable acquitte un impôt moins élevé qu’il ne le devrait juridiquement en dissimulant des revenus ou des informations aux administrations fiscales.
Évitement (avoidance) : un terme difficile à définir mais que l’on utilise généralement pour caractériser les dispositions prises par un contribuable dans le but de réduire sa charge fiscale et qui, bien qu’elles puissent être strictement légales, sont généralement en contradiction avec l’esprit des législations qu’elles prétendent respecter.
Optimisation fiscale (tax planning) : dispositions prises par le contribuable dans la conduite de ses affaires fiscales professionnelles ou privées dans le but de minimiser sa charge fiscale. »
*Traduction de la commission des Finances
Les frontières entre ces différentes notions, on le voit, sont loin d’être étanches. Lorsque l’optimisation utilise les failles de certaines législations nationales pour s’affranchir de l’impôt sur les sociétés, comme le font certaines multinationales en contournant de fait l’esprit des lois des pays dans lesquels elles opèrent, on n’est plus très éloigné de l’évasion fiscale à grande échelle. C’est de cette optimisation fiscale agressive qu’il sera principalement question dans ce rapport.
2. Des techniques souvent complexes, majoritairement utilisées par les plus grandes entreprises
L’optimisation ne prend pas nécessairement la forme de multiples et complexes montages juridiques. Elle peut résulter de choix basiques opérés par les entreprises pour réduire leur charge fiscale. L’option en faveur du régime de l’intégration fiscale, présenté dans l’encadré ci-après, en est un bon exemple.
Le régime d’intégration fiscale
Prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, le régime de groupe (ou d’intégration fiscale) permet sur option à la société mère ou « tête de groupe » de se constituer seule redevable de l’IS dû par l’ensemble des sociétés membres du groupe. Pour être qualifiées de sociétés membres du groupe, les filiales doivent être détenues à 95 % au moins par la tête de groupe (directement ou indirectement), tout au long de l’exercice d’imposition.
Le résultat d’ensemble, imposé dans le chef de la société tête de groupe, est déterminé en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, somme retraitée afin de neutraliser les opérations intragroupe. Ainsi, en application du troisième alinéa de l’article 223 B, les produits de participation reçus, par une société du groupe, d’une autre société membre du même groupe depuis plus d’un exercice sont intégralement déduits du résultat d’ensemble, afin d’éviter une double imposition (d’une part, du résultat dégagé par la société du groupe – imposé dans le chef de la tête de groupe – et, d’autre part, des dividendes provenant de ce résultat et versés à la société du groupe détenant la participation).
Toutefois, et bien qu’aucune donnée statistique ne permette de l’affirmer avec certitude, le recours aux schémas les plus intéressants, du point de vue du contribuable, nécessite une maîtrise de la technique fiscale et juridique qui n’est probablement pas à la portée de toutes les sociétés. L’optimisation semble donc surtout l’apanage des grandes entreprises qui disposent des moyens humains et financiers pour tirer le meilleur parti de la réglementation. La recherche du profil fiscal optimal nécessite en effet la mobilisation de ressources importantes, tant en interne qu’à l’extérieur de l’entreprise, via le recours à des conseils dont les honoraires sont corrélés à leur niveau de compétence et au degré de technicité des montages. Pour optimiser in fine sa charge fiscale, il faut donc d’abord être en mesure de consentir des coûts immédiats élevés que seuls les contribuables disposant d’une assise financière confortable paraissent en mesure d’assumer.
L’optimisation se traduit en dernière analyse par un report de la charge fiscale sur les facteurs de production les moins mobiles (le travail) ou les contribuables moins bien outillés pour tirer profit des subtilités fiscales (les très petites et les petites et moyennes entreprises – TPE/PME). Poussée à l’extrême, elle contrevient au principe d’égalité devant l’impôt consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui commande que la charge fiscale soit répartie en fonction des facultés contributives de chacun (14).
3. Un critère important, mais rarement unique, des choix de développement et d’implantation des entreprises
La fiscalité ne constitue pas, sauf exceptions ou cas très spécifiques, le critère principal dans le choix de développement et d’implantation des entreprises. En effet les analyses économiques et les travaux empiriques menés à ce sujet tendent à démontrer que les choix de localisation dépendent essentiellement de critères économiques, géographiques et humains (15). La charge fiscale est un déterminant avéré des choix stratégiques opérés par l’entreprise, mais qui demeure somme toute secondaire par rapport à d’autres facteurs qui priment largement la recherche exclusive du profil fiscal optimal.
Ainsi, l’accès au marché et le potentiel commercial constituent sans doute le premier critère de localisation de la production. La taille du pays d’implantation ou de commercialisation, sa proximité par rapport à d’autres marchés, le nombre de consommateurs potentiels et leur niveau de vie sont essentiels (16). Les variables géographiques (distance à parcourir pour acheminer les biens, qui détermine les coûts de transport) et culturelles (langue parlée, habitudes de consommation) sont également primordiales. Le nombre et la qualité des infrastructures, l’environnement administratif et réglementaire font aussi partie des préoccupations centrales des investisseurs.
À cet égard, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) témoignent de l’attractivité de notre pays, en dépit de son taux d’impôt sur les sociétés (IS) facialement élevé de 33,1/3 %, qui peut être porté à 36 % du fait de contributions additionnelles (17). Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII), avec 58,9 milliards de dollars d’IDE entrants, la France était la cinquième destination mondiale des flux d’IDE en 2012 (18).
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’en dernière analyse, l’impôt a vocation à financer une dépense publique dont bénéficie l’ensemble du corps social, et notamment les entreprises. S’il n’est pas spontanément et directement perçu ainsi, l’impôt profite aussi à ceux qui s’en sont acquittés via le financement de multiples biens et services (infrastructures, système de formation, protection sociale, etc.). Certaines entreprises éludent donc leur impôt en France alors qu’elles utilisent les infrastructures performantes situées sur notre territoire, l’ensemble des services publics français, et embauchent des salariés à la productivité et aux compétences reconnues formés par le système scolaire et universitaire français.
B. UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À MESURER
Parfois difficile à caractériser, l’optimisation fiscale se prête plus mal encore que la fraude à toute tentative de chiffrage précis.
Dans le rapport BEPS, l’OCDE tente de quantifier le problème, tout en reconnaissant ab initio « qu’il est difficile de parvenir à des conclusions fiables sur l’ampleur du phénomène sur la base des données existantes ». L’organisation affirme même que « la plupart des études consacrées à la question n’aboutissent à aucune conclusion, même si de nombreux indices corroborent l’idée que les pratiques d’érosion fiscale et de transferts des bénéfices sont largement répandues. » (19).
De fait, l’analyse de certaines variables, notamment l’évolution des recettes de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, des investissements directs à l’étranger, et des taux effectifs d’imposition amène intuitivement
– mais sans que cela puisse être démontré « scientifiquement » – à considérer qu’un découplage croissant s’opère entre le lieu de « réalité économique » de l’activité de l’entreprise, et le lieu de « réalité fiscale ». En d’autres termes, de telles données tendent à démontrer une décorrélation de plus en plus importante entre, d’une part, le lieu d’implantation et d’exercice de l’activité productive et de l’investissement et, d’autre part, le lieu où les bénéfices résultant de cette activité sont officiellement déclarés et taxés, lorsqu’ils le sont.
1. L’évolution de la part de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les recettes publiques ne permet pas de tirer de conclusions précises
L’OCDE constate que, parmi les États qui en sont membres, la part des recettes des impôts sur les bénéfices des sociétés dans les recettes fiscales totales a connu des évolutions contrastées. De 8,8 % en 1965, cette part avait chuté à 7,6 % en 1975 pour croître continuellement jusqu’en 2007 où elle s’établissait à 10,6 %. En 2008, cette part s’est repliée à 10 %, puis 8,4 % en 2009, conséquence probable de la crise économique et financière. Une légère augmentation s’est produite en 2010, à 8,6 %.
Une telle évolution masque toutefois les choix de politique fiscale opérés par les différents pays de l’OCDE, lesquels se sont majoritairement traduits par des baisses du taux, généralement accompagnées d’élargissements de l’assiette. Les statistiques relatives aux années 2000 en témoignent, avec une diminution du taux légal moyen de l’IS de 7,2 points entre 2000 et 2011, de 32,6 % à 25,4 %.
Pour autant, la charge fiscale assumée par les entreprises au titre de l’IS, mesurée par le ratio IS/PIB, ne s’est pas considérablement réduite sur longue période. Alors qu’elle s’établissait à 2,2 % du PIB en 1965, elle a connu une croissance erratique mais continue jusqu’à un pic en 2007 à 3,8 %, avant de s’inverser pour atteindre 3 % en 2011 (après un net repli de 3,5 % à 2,8 % entre 2008 et 2009).
Il serait hasardeux de tirer une quelconque conclusion de ces observations. Si l’effet du ralentissement économique amorcé à partir de 2008 sur les recettes d’IS semble difficilement contestable, l’analyse ne permet pas d’affirmer l’existence ou l’absence de comportements d’optimisation, et encore moins d’isoler et de quantifier avec certitude, le cas échéant, les conséquences de telles pratiques sur les rentrées fiscales.
2. Les écarts entre IS théorique et IS réel ne permettent pas, en tant que tels, de caractériser l’existence de comportements d’optimisation.
● Le taux nominal (ou légal, ou facial) n’est pas en lui-même révélateur de la charge fiscale qui pèse sur les entreprises. Les diverses règles d’assiette (abattements, déductions, etc.), les modalités de calcul de l’impôt, l’existence de dispositifs fiscaux incitatifs dérogatoires au droit commun (les niches fiscales) sont autant de mécanismes qui « mitent » les recettes en réduisant ex ante l’assiette théoriquement taxable. Par ailleurs des dispositifs peuvent permettre de minimiser ex post l’impôt dû après liquidation (réductions et crédits d’impôt).
Une étude de la Direction du Trésor de juin 2011 (20) confirmait cette analyse en révélant l’écart entre le taux implicite de taxation de certaines entreprises et le taux qui leur serait normalement applicable. Le taux implicite de taxation, paramètre utilisé par la Direction du Trésor, rapporte l’IS à l’excédent net d’exploitation. Cette étude a été réactualisée dans le rapport sur les prélèvements obligatoires annexé au projet de loi de finances pour 2013 (PLF), dont est extrait le tableau ci-après (21).
Pour les grandes entreprises – définies comme celles comptant plus de 5 000 personnes – l’écart est de 8,4 points, soit 24,9 % de taux implicite contre 33,1/3 % de taux nominal. Le principal facteur expliquant cet écart est la déductibilité des charges financières, qui bénéficie principalement aux grandes entreprises (cf. infra).
FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ÉCART ENTRE LE TAUX IMPLICITE ET LE TAUX NORMAL
ET DES DIFFÉRENCES ENTRE ENTREPRISES AU TITRE DE 2010
Par écart au taux normal |
Micro |
PME |
ETI |
GE |
Manuf. |
Services |
Toutes sociétés non financières |
Règles d’assiette et de taux |
– 76,6 |
– 0,9 |
– 7,3 |
– 11,0 |
– 6,9 |
– 7,3 |
– 7,2 |
Déductibilité des intérêts |
– 3,2 |
– 4,1 |
– 9,6 |
– 11,5 |
– 8,7 |
– 8,5 |
– 8,8 |
Taux réduit PME |
– 13,5 |
– 1,9 |
0,0 |
0,0 |
– 0,4 |
– 1,8 |
– 1,4 |
Contribution exceptionnelle |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,9 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
Contribution sociale sur les bénéfices |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
Autres facteurs |
10,1 |
5,0 |
1,2 |
– 1,1 |
0,8 |
2,1 |
2 |
Démographie |
12,9 |
10,0 |
3,8 |
2,5 |
2,6 |
5,7 |
5,0 |
Part des entreprises déficitaires |
18,3 |
13,9 |
6,9 |
5,5 |
5,3 |
9,4 |
8,4 |
Report des déficits passés |
– 5,4 |
– 3,9 |
– 3,1 |
– 3,0 |
– 2,7 |
– 3,7 |
– 3,4 |
Taux implicite |
39,6 |
42,4 |
29,8 |
24,9 |
29,1 |
31,7 |
31,1 |
Micro = micro-entreprises PME = petites et moyennes entreprises ETI = entreprises de taille intermédiaire GE = grandes entreprises Manuf. = manufacture Source : rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, annexe au PLF 2013 | |||||||
● Le taux effectif d’imposition (TEI), qui désigne le rapport entre la charge d’impôt et les bénéfices taxables (22), ne permet pas d’isoler les phénomènes d’optimisation fiscale. En effet, un TEI faible peut aussi bien être la résultante de l’habileté fiscale de l’entreprise que de l’application stricte sans visée optimisatrice des règles fiscales incitatives élaborées à dessein par le législateur afin de favoriser l’activité, les deux phénomènes pouvant par ailleurs se combiner. Plusieurs études portant sur les taux effectifs d’imposition des entreprises multinationales ont récemment été conduites aux États-Unis. Par souci de concision, une seule sera évoquée ici.
Selon la banque JP Morgan, sur une période de 10 ans, les entreprises américaines multinationales riches en actifs incorporels tirés notamment de la propriété intellectuelle ont été soumises à un taux effectif d’imposition moyen de 22,6 %, tandis que les entreprises « nationales » se voyaient appliquer un taux considérablement plus élevé, de 36,8 %. La même étude affirme en outre que 1,7 trillion de dollars (23) de bénéfices enregistrés à l’étranger par des entreprises américaines sont actuellement logés dans des territoires à fiscalité privilégiée et ne sont pas rapatriés aux États-Unis afin de différer la taxation qui les frapperait au taux de 35 % (24). L’ampleur du phénomène et sa localisation géographique laissent à penser qu’il s’agit bien d’optimisation, et non de conséquences de choix stratégiques objectifs (pénétration de marchés par exemple).
3. Certains flux « anormaux » d’investissements directs à l’étranger peuvent être révélateurs de comportements d’optimisation
L’observation de la part des IDE rapportée aux PIB de certains États est sans doute plus pertinente et permet de mieux appréhender, sans pour autant le cerner totalement, le phénomène d’érosion des bases d’imposition et de transfert des bénéfices. Rappelons que l’IDE est un flux d’investissement transnational par lequel l’investisseur du pays source établit un intérêt durable dans une entreprise du pays d’accueil (25). Or certains États hébergent des stocks d’IDE sans commune mesure avec leur richesse nationale et la taille de leur économie, ce qui tendrait à prouver un découplage entre l’activité économique « réelle » réalisée dans le pays source, et sa traduction fiscale au sein d’un autre État.
Le rapport BEPS cite à ce sujet une étude conduite par le Fonds monétaire international (FMI) qui relevait qu’en 2010 la Barbade, les Bermudes et les Îles Vierges Britanniques – territoires internationalement reconnus pour la qualité de leur accueil en matière de fiscalité – avaient été destinataires de 5,11 % du flux total d’IDE (26), davantage que l’Allemagne (4,77 %) ou le Japon (3,76 %). Symétriquement, les Îles Vierges Britanniques s’étaient révélées le premier investisseur en Chine (14 %), certes loin derrière Hong-Kong (45 %), mais devant les États-Unis (4 %). Avec les Bermudes et les Bahamas, elles font partie des cinq principaux investisseurs en Russie. Quant à l’Île Maurice, qui ne surcharge pas ses résidents fiscaux, elle est le premier investisseur en Inde (24 %).
Il serait faux de penser que des situations aussi aberrantes économiquement ne se rencontrent qu’au sein d’États où la douceur de la fiscalité n’a d’égale que celle du climat. L’OCDE dispose de données plus précises sur certains pays. Elles permettent notamment d’isoler la part des stocks d’investissements détenue par des entités à vocation spéciale (EVS) (27), structures « qui n’emploient pas ou peu de personnel, ont une présence physique limitée ou nulle dans le pays d’accueil, dont les actifs et les passifs correspondent à des investissements en provenance ou à destinations d’autres pays et qui mènent essentiellement des activités de financement de groupe ou de détention d’actifs » (28). En somme, les EVS constituent une sorte de « tuyau juridique » sans réelle substance, permettant le passage de flux d’actifs.
En 2011 aux Pays-Bas, les stocks d’investissements entrants avaient atteint 3 207 milliards de dollars, dont 2 625 milliards (soit près de 82 %) avaient été réalisés via des EVS. Les investissements sortants étaient de 4 002 milliards, dont 3 023 (soit plus de 75 %) avaient transité par des EVS. La même année, le PIB néerlandais était d’environ 840 milliards de dollars : les flux entrants représentaient donc près de quatre fois le PIB, les flux sortants près de cinq fois. Les proportions étaient encore plus importantes au Luxembourg avec 2 129 milliards de dollars d’investissements entrants détenus à plus de 93 % par des EVS (1 987 milliards de dollars), cette part atteignant près de 91 % pour les investissements sortants (1 945 milliards de dollars détenus par les EVS sur un total de 2 140 milliards de dollars).
Pour impressionnantes qu’elles soient quantitativement, de telles données demeurent qualitativement imprécises. Elles ne permettent pas d’évaluer l’importance du phénomène d’optimisation fiscale, mais seulement d’en soupçonner l’ampleur. Elles témoignent toutefois d’une internationalisation grandissante des activités et des implantations des entreprises, et potentiellement d’un transfert conséquent des produits vers les territoires à fiscalité privilégiée.
4. Les chiffres parfois évoqués ne reposent sur aucune statistique réellement incontestable
● De l’aveu des plus hautes autorités en matière de fiscalité auditionnées par la mission, toute tentative de chiffrage de l’optimisation fiscale est une entreprise vaine.
Le Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE a ainsi indiqué qu’il n’existait aucune donnée sur l’ampleur globale du phénomène d’optimisation du fait de l’absence d’informations pertinentes collectées par les États membres de l’organisation.
Le Directeur général des Finances publiques n’a pas affirmé autre chose. Tout au plus a-t-il indiqué les montants réintégrés à l’assiette fiscale au titre de redressements internationaux opérés sur l’IS en 2012, soit 6 milliards d’euros. Ce montant était de 2,5 milliards en 2010 et 3,2 milliards en 2011. Les seules rectifications en matière de prix de transfert (cf. infra) sont passées de 1,4 milliard en 2010 à 3,2 milliards en 2011.
● Plusieurs études récentes ont tenté d’évaluer la perte de recettes subie par le Trésor public français du fait de l’optimisation pratiquée par les grandes entreprises du numérique et notamment l’ensemble d’entreprises communément dénommées les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).
En octobre 2009, à la demande de la commission des Finances du Sénat, le cabinet Greenwich Consulting a réalisé une étude visant à « évaluer l’impact du développement d’Internet sur les finances de l’État » (29). En 2013, le même cabinet, mandaté par la Fédération française des télécoms (FFT), a produit une analyse des mécanismes d’optimisation actionnés par les acteurs dits Over-the-Top (OTT) (30), qui regroupent les cinq entreprises précitées. Il ressort de ce rapport que les OTT, s’ils avaient été soumis à la réglementation française en vigueur sans aucun recours à l’optimisation, auraient dû payer un surcroît d’IS de près de 800 millions d’euros, et entre 400 et 700 millions d’euros supplémentaires au titre de la TVA.
Il convient sans doute de relayer de tels chiffres avec prudence compte tenu de la méthodologie retenue pour reconstituer l’assiette théoriquement soumise à l’IS (31). Selon cette étude, les OTT auraient dû payer en 2011 828,7 millions d’euros d’impôt si leurs activités réalisées en France avaient effectivement été taxées sur notre territoire, en l’absence de toute pratique d’optimisation. En réalité, elles n’auraient acquitté que 37,5 millions d’euros, soit 22 fois moins. Le tableau ci-dessous est extrait de cette étude.
IMPÔT RÉEL ET IMPÔT THÉORIQUE DES OVER-THE-TOP DU NUMÉRIQUE
CA déclaré en France |
CA estimé réalisé en France |
IS payé par les OTT en France |
IS qu’auraient payé les OTT en France sans optimisation |
Taux de croissance annuel moyen CA monde | |
138 M€ |
1,4 Md€ |
5,5 M€ |
162 M€ |
42 % | |
Apple |
257 M€ |
3,2 Mds€ |
6,7 M€ |
317,5 M€ |
38 % |
ND |
140 M€ |
0,05 M€ |
21,2 M€ |
123 % | |
Amazon |
110 M€ |
890 M€ |
3,3 M€ |
10,9 M€ |
32 % |
Microsoft |
584 M€ |
2,5 Mds€ |
22 M€ |
317 M€ |
8 % |
Total |
1 009 Mds€ |
8,13 Mds€ |
37,5 M€ |
828,7 M€ |
CA : chiffre d’affaires
M€ : million d’euros
Md€ : milliard d’euros
ND : non disponible
Source : Greenwich consulting, « Étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et les schémas d’optimisation fiscale des acteurs « Over-the-Top » », (17 avril 2013).
Dans un avis rendu en 2012, le Conseil national du numérique estimait quant à lui que, pour un total de revenus générés compris entre 2,5 et 3 milliards d’euros par an en France, quatre des plus grandes entreprises de l’économie numérique (Google, iTunes, Amazon et Facebook) ne versaient que 4 millions d’euros d’IS, alors que l’application de la réglementation française les rendrait en principe redevables de quelque 500 millions d’euros (32). La méthode d’évaluation retenue par le Conseil n’est pas précisée dans l’avis.
● En somme, les pouvoirs publics savent que l’optimisation fiscale existe, ils en connaissent les mécanismes (cf. infra), mais ils ne peuvent qu’en ignorer les conséquences précises en termes de perte de recettes fiscales. Par ailleurs, comme rappelé précédemment, dans l’hypothèse où il serait possible de caractériser avec précision et de quantifier l’ampleur du phénomène, cela n’emporterait pas la majoration à due concurrence du montant de l’impôt, sauf à constater in fine que la totalité des schémas d’optimisation relèvent en réalité de l’abus de droit ou de la fraude. Mais tel n’est pas le cas.
II. LES PRINCIPAUX LEVIERS DE L’OPTIMISATION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
A. L’UTILISATION DES DIFFÉRENCES DE LÉGISLATION ENTRE ÉTATS
1. Les régimes fiscaux nationaux restent marqués par leur disparité
● Le pouvoir de lever l’impôt constitue une compétence exclusive de l’autorité souveraine de l’État. Dans les régimes démocratiques, cette compétence échoit au seul législateur (33). De fait l’impôt revêt logiquement une forte connotation nationale et constitue un élément central de la souveraineté jalousement conservé par les États qui répugnent à l’aliéner, même partiellement, au profit d’organisations supranationales.
La constitution de zones de coopération politique et/ou économique plus ou moins intégrées, qui ont d’ailleurs souvent accompagné la globalisation de l’économie (quand elles n’ont pas été créées dans le seul but de la favoriser), n’a guère permis de dépasser les intérêts nationaux en la matière (34). Y compris au sein de l’Union européenne, qui représente pourtant la forme la plus aboutie d’intégration de ses membres, les différences demeurent et la fiscalité reste pour l’essentiel l’apanage des États, ainsi qu’en témoigne la persistance de la règle de l’unanimité sur les questions fiscales.
La disparité naturelle des régimes fiscaux nationaux n’était guère problématique lorsque le degré d’ouverture des économies était encore faible. À une époque où les échanges, l’activité et l’implantation physique des entreprises s’opéraient en économie fermée, sur une base presque exclusivement nationale, le législateur d’un État pouvait déterminer les règles de l’impôt en parfaite autonomie, sans considération particulière pour les règles établies au-delà des frontières par les autres législateurs.
La diversité et les dissemblances des législations fiscales nationales sont devenues un sujet de préoccupation pour les administrations fiscales dès lors que les entreprises ont été en mesure d’implanter leurs activités en dehors du cadre strictement national. Les possibilités d’optimisation résultant de l’application de régimes différents de taxation se sont alors multipliées et intensifiées, l’éligibilité à une législation étrangère favorable pouvant en outre renforcer la portée de certaines mesures de droit national qui permettaient déjà de réduire la charge fiscale. En somme, la mondialisation économique a agi comme un effet multiplicateur sur une optimisation « traditionnelle » auparavant circonscrite au seul espace national.
L’idée générale qui sous-tend toute pratique d’optimisation se fondant sur les différences des régimes nationaux d’imposition est la suivante : il s’agit, pour l’entreprise, de profiter des interactions entre divers principes et règles fiscales afin de localiser un maximum de charges dans les pays les plus taxateurs, et de loger les produits dans les pays les plus conciliants en matière d’imposition.
Une double optimisation s’opère alors :
– la concentration des charges au niveau du pays taxateur permet de diminuer le résultat imposable, et donc l’impôt dû (les charges étant, par principe, déductibles de l’assiette taxable au taux normal) ;
– la concentration des produits au sein du pays proposant le régime fiscal le plus favorable permet à l’entreprise d’acquitter l’impôt le plus faible possible sur ses bénéfices.
● Il arrive qu’entre deux régimes nationaux d’imposition, l’entreprise soit en mesure de choisir celui qui est objectivement le plus intéressant de son point de vue de contribuable. Il n’est pas ici nécessaire de recourir à des exemples exotiques, les disparités fiscales au sein de l’Union européenne permettant d’illustrer assez simplement cette notion.
L’exemple le plus simple résulte des écarts de taux d’IS parfois massifs qui existent entre les États-membres de l’UE. Ainsi, une entreprise du numérique fournissant à ses utilisateurs un service prenant la forme d’un système de recherche et d’indexation performant et se rémunérant essentiellement via la vente d’espaces publicitaires en ligne aura tendance à implanter sa structure européenne principale en Irlande, où le taux d’IS est de 12,5 %, plutôt qu’en France où, toutes choses égales par ailleurs, la même assiette taxable se verrait soumise au taux de 33,1/3 %.
● Mais généralement, ce sont la combinaison et les interactions entre les différentes règles nationales qui permettent à l’entreprise une optimisation maximale. Comme le souligne le rapport BEPS, « le plus souvent, ce n’est pas la législation fiscale d’un pays en particulier qui crée la possibilité d’un transfert de bénéfices, mais plutôt la manière dont les législations de plusieurs pays interagissent. » (35). Ainsi, une entreprise pourra combiner le régime favorable applicable aux flux financiers sortants d’un premier État (par exemple avec retenue à la source faible ou nulle pour les produits versés à des entités situées à l’étranger), et la fiscalité douce applicable à ces mêmes produits dans un second État.
Les stratégies-type des entreprises en matière d’optimisation fiscale
Le rapport BEPS précise qu’une entreprise qui cherche à mener une opération d’optimisation fiscale à l’échelle internationale doit mettre en œuvre un ensemble d’actions et de stratégies coordonnées en fonction des différents régimes nationaux. Ces actions et stratégies se répartissent schématiquement en quatre catégories principales :
« – minimisation de la charge fiscale dans le pays d’origine ou dans un pays étranger où l’entreprise est implantée (qui est souvent un territoire ayant une fiscalité moyenne à forte), soit par un transfert des bénéfices bruts au moyen de structures commerciales, soit par une réduction du bénéfice net au moyen d’une maximisation des déductions au niveau du contribuable ;
– une imposition faible ou nulle à la source ;
– une imposition faible ou nulle au niveau du bénéficiaire (qui peut être obtenue grâce à des pays ou territoires à faible fiscalité, à des régimes préférentiels ou à des asymétries transnationales de la fiscalité des montages hybrides), avec possibilité de se faire attribuer des bénéfices exceptionnels substantiels, souvent constitués au moyen de dispositions intragroupe ;
– une absence d’imposition courante des bénéfices faiblement taxés (rendue possible grâce aux trois premières étapes) au niveau de la société-mère effective » (36).
Exemple : La société PadimpoLux est une filiale du groupe Padimpo Inc., et par ailleurs propriétaire de la marque Padimpo. Elle est établie au Luxembourg, dont le taux d’IS est de 21 %.
PadimpoLux concède l’utilisation de la marque à sa filiale PadimpoFra établie en France où le groupe réalise l’essentiel de son activité. Le taux d’IS y est de 33,1/3 % et, en vertu des dispositions communautaires en vigueur, aucune retenue à la source ne s’applique aux redevances versées au Luxembourg.
PadimpoFra enregistre un bénéfice avant impôt de 100. Elle verse une redevance de 80 à PadimpoLux au titre de l’utilisation de la marque. Les sommes correspondantes constituant une charge intégralement déductible de son IS, celui-ci s’élève à 6,67 (20 x 33,1/3 %).
La France n’opérant aucune retenue à la source sur la redevance, elle n’enregistre aucune rentrée fiscale lors du flux financier correspondant vers le Luxembourg.
En application de la législation luxembourgeoise, les revenus issus de la propriété intellectuelle sont exonérés à hauteur de 80 % de leur montant (37). L’assiette taxable de PadimpoLux est donc de 16 et la société acquitte 3,36 d’IS (80 x 20 % x 21 %). Au total, Padimpo Inc. est donc redevable de 10,03 d’IS (6,67 en France + 3,36 au Luxembourg).
Or, si le groupe Padimpo Inc. n’était implanté qu’en France (avec PadimpoFr propriétaire de la marque), l’impôt aurait atteint 33,33 (100 x 33,1/3 %).
2. L’existence de « paradis fiscaux » accentue fortement les possibilités d’optimisation.
a. Souvent employée, la notion de paradis fiscal ne fait pas l’objet d’une définition universelle.
• L’identification d’une série de critères par l’OCDE
La notion de « paradis fiscal » n’est pas nouvelle. L’appellation serait apparue dès le Moyen Âge afin de désigner les cités abritant les ports de navigation marchande entre les villes hanséatiques, celles-ci ayant progressivement acquis de nombreux privilèges, notamment en matière fiscale (38). Très répandue dans le champ politique et médiatique, l’expression ne renvoie paradoxalement à aucune définition juridique précise et incontestable. Les territoires qualifiés comme tels sont en réalité très hétérogènes et présentent rarement la totalité des critères traditionnellement attachés au paradis fiscal.
Cette notion est d’autant moins facile à appréhender que des considérations politiques et institutionnelles peuvent encore en affaiblir la portée. Il est ainsi officiellement difficilement concevable que l’Union européenne puisse abriter des paradis fiscaux, en dépit du fait que des États membres peuvent en présenter certaines caractéristiques (cf. infra).
En réalité, le paradis fiscal ne répond à aucune définition claire et unanimement acceptée ; il se révèle à la lumière d’un faisceau d’indices, lui-même plus ou moins mouvant.
L’OCDE propose ainsi quatre facteurs d’identification du paradis fiscal (39) :
– l’absence d’imposition ou une imposition insignifiante des revenus. Condition nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante pour caractériser un paradis fiscal ;
– l’absence d’un système effectif d’échange de renseignements entre l’État considéré comme paradis fiscal et les autres États ;
– l’absence de transparence dans le fonctionnement des dispositions législatives, juridiques ou administratives du territoire considéré. Les dispositions garantissant le secret bancaire aux contribuables bénéficiant de l’imposition réduite en constituent sans doute l’exemple le plus connu ;
– l’absence d’obligation d’exercer une activité substantielle dans le paradis fiscal. À cet égard, le critère de la présence physique effective sur le territoire peut constituer un bon indicateur de la réalité de l’activité poursuivie. On songe ici aux territoires « boîtes aux lettres » comptant des milliers de filiales destinataires de flux financiers massifs et n’employant parfois aucun salarié. Ainsi les Bermudes, territoire de 53 km² et d’environ 65 000 habitants, accueillaient près de 15 000 sociétés étrangères en 2011, soit une moyenne de 283 sociétés par km² ou encore d’une société pour quatre habitants (40). À titre de comparaison, rappelons que la France compte environ 20 000 sociétés étrangères présentes sur son sol (41).
En 2000, sur le fondement de ces quatre critères, l’OCDE avait établi une première liste de 35 juridictions non coopératives.
• Une pression internationale récente
Si la société civile, notamment via les ONG, s’est saisie de longue date de la question des paradis fiscaux, les actions menées par les États en la matière étaient restées modestes et relevaient davantage d’initiatives isolées. La crise économique et financière de 2008 a brusquement changé cet état de fait en favorisant une mobilisation au niveau international.
La lutte contre les paradis fiscaux dans un cadre multilatéral a connu un nouvel élan grâce à une initiative franco-allemande. En effet, c’est à l’invitation du ministre français du Budget – Éric Woerth, Président de la présente mission d’information – et du ministre allemand des Finances – Peer Steinbrück – qu’une vingtaine de pays membres de l’OCDE se sont réunis à Paris, le 21 octobre 2008, sur le thème de la transparence et l’échange de renseignements.
Entre autres engagements, le relevé des conclusions de cette rencontre donnait mandat à l’OCDE pour « définir une méthodologie établissant une distinction claire entre les pays et territoires qui ont mis en œuvre de manière substantielle les normes de l’organisation sur l’échange de renseignements et ceux qui ne l’ont pas fait » (42), c’est-à-dire pour établir la liste des territoires non coopératifs. En réalité, l’OCDE a élaboré trois listes distinctes :
– une liste noire, qui regroupe les États qui ne se sont jamais engagés à respecter les standards (43) de l’OCDE ;
– une liste grise, qui compte les États qui se sont engagés à respecter ces standards, mais qui ne les ont pas « substantiellement » (44) appliqués. Elle est elle-même divisée en deux sous-ensembles relatifs aux territoires répondant à la définition de paradis fiscal selon l’OCDE, et aux « autres centres financiers » ;
– une liste blanche, qui recense les États ayant « substantiellement appliqué les standards internationaux ».
Ce recensement n’était bien entendu pas destiné à rester figé, mais à évoluer au gré des progrès ou des reculs constatés en la matière, ainsi qu’en témoignent les tableaux suivants. Aucun État ne fait plus partie de la liste noire, et seuls trois d’entre eux figurent encore sur la liste grise. Il convient de souligner que les ONG retiennent, pour leur part, une acception plus large de la notion de paradis fiscal. Leur liste de référence, établie par l’organisation Tax Justice Network, comprend ainsi 60 États et territoires (45).
Le sommet du G20 organisé à Londres en avril 2009 avait fait de la lutte contre les juridictions non coopératives une priorité afin de restaurer la confiance dans un système financier dont les errements avaient conduit à la dépression économique globale. La même année, l’OCDE publiait une liste des territoires non coopératifs, validée par le même G20.
LISTE DES TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS SELON L’OCDE
2009 |
2012 | |
Liste grise |
• Paradis fiscaux Andorre Anguilla Antigua et Barbuda Aruba Bahamas Bahreïn Belize Bermudes Dominique Gibraltar Grenada Liberia Liechtenstein Îles Vierges britanniques Îles Caïman Îles Cook Îles Marshall Monaco Montserrat Nauru Antilles néerlandaises Niue Panama Saint Kitts et Nevis Sainte Lucie Saint Vincent et les Grenadines Samoa San Marin Îles Turques et Caïques Vanuatu • Autres centres financiers Autriche Belgique Brunei Chili Guatemala Luxembourg Singapour Suisse |
• Paradis fiscaux Nauru Niue • Autres centres financiers Guatemala |
Liste noire |
Costa Rica Malaisie (Labuan) Philippines Uruguay |
Toutes les juridictions examinées par le Forum mondial se sont désormais engagées à respecter la norme fiscale internationale |
Source : OCDE.
• Une définition approchée en droit interne
Le droit français ignore l’expression « paradis fiscal ». Deux notions s’en approchent toutefois, consacrées par deux articles du code général des impôts (CGI), qui reprennent pour partie les critères dégagés par l’OCDE.
L’article 238-0 A concerne les « États et territoires non coopératifs » (ETNC), c’est-à-dire ceux dont le régime de transmission d’information à des États tiers s’avère insuffisant. Une liste des ETNC est établie et mise à jour chaque année par arrêté ministériel, en fonction notamment des progrès ou des régressions constatés dans les États et territoires concernés. Au total, un ETNC est une juridiction qui a fait l’objet d’une évaluation par l’OCDE et qui n’a pas conclu avec la France ni signé avec au moins douze autres États ou territoires une convention d’assistance administrative permettant l’échange de renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale des parties. Il faut signaler, pour la bonne compréhension du tableau ci-dessous, que la liste des ETNC n’a pas encore été mise à jour au titre de l’année 2013.
LES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS AU SENS DU DROIT FRANÇAIS 2010-2012
2010 |
2011 |
2012 |
Anguilla |
Anguilla |
|
Belize |
Belize |
|
Brunei |
Brunei |
|
Costa Rica |
Costa Rica |
Botswana |
Dominique |
Dominique |
Brunei |
Grenade |
Grenade |
Guatemala |
Guatemala |
Guatemala |
Îles Marshall |
Îles Cook |
Îles Cook |
Montserrat |
Îles Marshall |
Îles Marshall |
Nauru |
Liberia |
Îles Turques-et-Caïques |
Niue |
Montserrat |
Liberia |
Philippines |
Nauru |
Montserrat |
|
Niue |
Nauru |
|
Panama |
Niue |
|
Philippines |
Oman |
|
Saint-Kitts-et-Nevis |
Panama |
|
Sainte-Lucie |
Philippines |
|
Saint-Vincent et les Grenadines |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Source : arrêtes fixant la liste des ETNC
L’article 238 A définit la notion de « régime fiscal privilégié ». Les contribuables sont considérés comme bénéficiant d’un tel régime si, dans l’État ou le territoire où ils sont redevables de l’impôt, celui-ci est nul ou inférieur de plus de 50 % à l’impôt qui aurait été acquitté en France toutes choses égales par ailleurs.
Les « paradis fiscaux » et le droit français
Extraits de l’article 238-0 A du CGI
« Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.
La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. »
Extraits de l’article 238 A du CGI
« Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
b. Les paradis fiscaux, qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories, renforcent les attraits de l’optimisation
Les paradis fiscaux, puisqu’ils poussent à l’extrême les logiques de comparaison et de concurrence fiscales grâce à des réglementations littéralement extra-ordinaires, favorisent et exacerbent les comportements d’optimisation fiscale. En effet, pourquoi favoriser une implantation à Chypre au taux d’IS déjà particulièrement attractif de 10 % plutôt qu’en France dont le taux atteint 33,1/3 % s’il est possible de loger la masse taxable aux Bahamas, État totalement dépourvu d’impôt sur les bénéfices des sociétés (46) ?
Si l’on retient uniquement le critère relatif à l’absence ou à la modicité de l’imposition (47) – nécessaire mais pas suffisant ainsi qu’on l’a vu – il est possible de distinguer trois grandes familles de paradis fiscaux.
Les États sans impôt, dits « zero-havens » (48), sont les territoires au sein desquels aucun prélèvement n’est effectué au titre de l’IS. De fait, la seule imposition qui peut frapper les revenus perçus par des sociétés établies dans de tels États (intérêts, dividendes, redevances, etc.) prend la forme, le cas échéant, d’une retenue à la source opérée par l’État étranger source du versement. Encore faut-il qu’un tel prélèvement soit prévu par le droit interne du pays d’origine des flux. Ainsi, tandis que la France opérera en principe, sauf stipulation contraire prévue par la convention fiscale bilatérale, une retenue à la source de 33,1/3 % pour des versements effectués au profit d’une entreprise établie aux Bermudes (49), les Pays-Bas ne réaliseront aucun prélèvement sur les flux sortants de leur territoire, la loi fiscale néerlandaise ne prévoyant aucun dispositif de cette nature.
Il existe en réalité peu de zero-havens, mais davantage d’États qui imposent la masse taxable sur une base très restreinte ou à un taux particulièrement réduit. Au sein de cette deuxième famille, trois cas peuvent être distingués :
– les États dans lesquels l’impôt de droit commun sur les bénéfices est établi à un taux extrêmement réduit. Ainsi, le sultanat d’Oman taxe les bénéfices des sociétés à hauteur de 12 % (50), et le Monténégro à 9 % ;
– certains États prélèvent un impôt de substitution à l’IS, lequel aboutit à une taxation minorée de la société concernée. Tel est le cas des Bahamas, un zero-haven au titre de l’IS qui a toutefois institué un modeste droit annuel de licence (business licence fee) (51) ;
– enfin, certains États réduisent volontairement la base de leur IS, en accordant des exonérations ou des exemptions à certains types d’entreprises ou d’activités relevant de la catégorie des entreprises offshore. Il s’agit de sociétés qui ne réalisent aucune opération commerciale (offshore trading company) ou aucune opération financière (offshore finance company) dans l’État d’implantation. Ainsi les Îles Vierges Britanniques exonèrent de tout prélèvement les International Business Companies (IBCs), sociétés dont, précisément, les revenus ne résultent pas de la conduite d’affaires sur le territoire en question.
Il existe une dernière catégorie de paradis fiscaux : ceux qui accordent des avantages à certaines activités économiques dans le but de favoriser leur développement. Il ne s’agit pas ici de détailler l’ensemble des régimes préférentiels offerts à telle ou telle activité par tel ou tel État. Un exemple relativement bien connu du grand public permettra d’illustrer cette famille de paradis fiscaux : les avantages accordés par certains États aux compagnies maritimes battant leur « pavillon de complaisance ». Ainsi, si le taux d’IS à Panama atteint 25 %, cet État en exonère totalement les compagnies maritimes battant son pavillon ou dont les activités sont gérées depuis son territoire. Rappelons que Panama est le premier pavillon d’immatriculation au monde, avec près de 22 % de la flotte mondiale (52).
B. LES EFFETS NON SOUHAITÉS DES CONVENTIONS FISCALES
Les développements qui suivent sont le plus souvent simplifiés, afin de donner un aperçu d’ensemble aussi clair que possible de mécanismes complexes, qui seront pour partie détaillés dans la suite du rapport.
1. Les différents régimes d’imposition des bénéfices : mondialité et territorialité
Les États peuvent retenir, pour l’imposition des bénéfices des entreprises, l’un des deux grands modèles suivants :
– le modèle de mondialité prévoit l’imposition des entreprises résidentes sur les bénéfices réalisés à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire. Le critère de résidence est habituellement vérifié par l’implantation dans l’État concerné du siège de direction effective de l’entreprise ;
– le modèle de territorialité, à l’inverse, prévoit l’imposition des entreprises, y compris non résidentes, sur les seuls bénéfices réalisés à l’intérieur du territoire.
Contrairement à la plupart des États membres de l’OCDE, la France a retenu le principe de territorialité, posé au I de l’article 209 du code général des impôts : « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Ce choix original a été conforté par la récente suppression du bénéfice mondial consolidé (53).
Le régime du bénéfice mondial consolidé (BMC)
Ce dispositif dérogatoire, accordé par agrément ministériel, permettait aux entreprises de retenir, pour l’établissement de leur impôt sur les sociétés, « l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger » (article 209 quinquies du CGI).
L’appellation générique « BMC » renvoyait en réalité à deux régimes distincts :
– le bénéfice mondial permettait d’intégrer au résultat de la société passible de l’IS les pertes et profits dégagés par ses exploitations directes (succursales) établies à l’étranger ;
– le bénéfice consolidé permettait l’intégration des pertes et profits des exploitations indirectes, définies comme les filiales détenues à plus de 50 %, en France comme à l’étranger.
Ce régime avait été créé en 1965 pour favoriser le développement à l’international des entreprises françaises, en leur permettant d’imputer sur les bénéfices dégagés en France les pertes constatées à l’étranger. Au moment de sa suppression, le BMC ne bénéficiait plus qu’à cinq entreprises : en effet, le régime n’était attractif que pour les entreprises réalisant leurs profits en France et leurs pertes à l’étranger, ce qui ne correspond plus au modèle type des groupes français internationalisés.
Compte tenu du rapport entre sa faible attractivité et son coût budgétaire élevé (aux alentours de 500 millions d’euros par an), le Conseil des prélèvements obligatoires en avait préconisé la suppression dans son rapport d’octobre 2010 (Entreprises et « niches » fiscales et sociales – Des dispositifs dérogatoires nombreux).
Souvent désigné comme le principal bénéficiaire du BMC, qui lui aurait permis d’optimiser sa fiscalité en ne payant pas d’impôt en France, le groupe Total est en réalité l’un des plus imposés du CAC 40, avec un taux effectif (somme de l’impôt exigible et de l’impôt différé rapportée au résultat consolidé) dépassant régulièrement 50 %. Si le groupe ne payait pas d’IS en France du fait du BMC, c’était tout simplement du fait de la neutralisation de la double imposition (cf. infra) : l’impôt payé à l’étranger venait s’imputer sur l’impôt dû en France, dans la limite des règles d’assiette et du taux applicables dans notre pays.
2. Le risque de double imposition
La coexistence de deux modèles fiscaux différents peut aboutir à la double imposition du même produit.
Exemple : soit une entreprise implantée dans deux États, dont l’un (A) pratique le régime de mondialité et l’autre (B) le régime de territorialité. Cette entreprise réalise un bénéfice total de 100, réparti à égalité entre ses deux implantations. Elle doit payer à l’État A un impôt assis sur 100 et à l’État B un impôt assis sur 50.
Contrairement à ce que pourrait laisser intuitivement croire la lecture de cet exemple caricatural, le risque de double imposition n’existe pas uniquement en présence de deux modèles « purs » de mondialité et de territorialité : comme le relève l’OCDE dans le rapport BEPS, « dans la plupart des pays, aucun de ces deux systèmes n’existe sous une forme pure, et il n’y a pas deux systèmes fiscaux parfaitement identiques » ; or, « l’interaction des régimes fiscaux nationaux entraîne parfois des chevauchements, de sorte qu’un élément de revenu peut être taxé par plusieurs pays, aboutissant à une double imposition » (54).
Deux formes de double imposition sont habituellement distinguées :
– la double imposition juridique consiste à ce que plusieurs États imposent le même produit chez un même contribuable, au titre du même exercice. L’exemple développé ci-dessus illustre cette première forme ;
– la double imposition économique consiste à ce que plusieurs États imposent tout ou partie du même produit, mais chez des contribuables différents. L’exemple le plus typique de cette seconde forme est l’imposition chez une société mère du dividende que lui verse sa filiale située dans un autre État, dividende fruit d’un bénéfice lui-même imposé par cet État, dans le chef de la filiale.
3. Les conventions d’élimination des doubles impositions
● Afin de ne pas entraver le développement des entreprises à l’international (ou la mobilité des personnes physiques), les États ont tissé un réseau, désormais très dense, de conventions d’élimination des doubles impositions. L’OCDE remarque qu’ « en dépit des différences substantielles qui existent entre les 3 000 conventions fiscales bilatérales actuellement en vigueur, les principes qui sous-tendent les dispositions des conventions régissant l’imposition des bénéfices des entreprises sont relativement uniformes » (55).
Cette harmonisation est à mettre au crédit de l’OCDE, qui a développé à partir de 1963 un modèle de convention bilatérale, dont s’inspirent désormais la plupart des États (56). Régulièrement révisé, pour la dernière fois en 2010, le « Modèle OCDE » (57) est assorti de commentaires doctrinaux produits par le Centre de politique et d’administration fiscales (58), qui servent de guide d’application.
● L’article 7 du Modèle attribue en principe le pouvoir d’imposer les bénéfices d’exploitation à l’État dont l’entreprise est résidente. Ce principe n’est pas applicable si l’entreprise dispose d’un établissement stable dans l’autre État partie à la convention : dans ce cas, les bénéfices de l’établissement stable sont imposables dans l’État dans lequel ils sont générés, dit État de la source.
La notion cardinale d’établissement stable est définie comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » (article 5). L’existence d’un établissement stable peut se traduire par une présence physique dans l’État de la source : un siège de direction, une succursale ou encore une usine sont explicitement désignés comme des établissements stables. Mais le Modèle présume également l’existence d’un établissement stable lorsqu’un agent dépendant de l’entreprise agit pour son compte dans l’État de la source et y dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. En résumé, un établissement stable peut être dépourvu de personnalité juridique, mais être néanmoins un sujet de droit fiscal dans l’État de la source. Inversement, la qualité de filiale – et donc la personnalité juridique – n’entraîne pas mécaniquement la qualification d’établissement stable, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État (59). Plus généralement, la définition conventionnelle de l’établissement stable pose, en pratique, de nombreuses questions d’appréciation, s’agissant notamment des notions d’installation et de fixité.
Il faut remarquer que le Modèle fait échec à l’application par l’administration fiscale française de la théorie du cycle commercial complet. Dégagée par la jurisprudence administrative, cette théorie permet d’imposer en France une entreprise qui n’y est pas implantée physiquement mais qui y réalise, donc, un cycle commercial complet : par exemple, une entreprise établie à l’étranger qui revend en France des marchandises achetées en France. Par application des stipulations conventionnelles, seule l’existence d’un établissement stable, qui implique donc la présence d’éléments physiques ou d’un agent dépendant, permet à l’État de la source de soumettre un bénéfice à l’impôt.
Une fois posé le principe d’imposition dans l’État de la source en présence d’un établissement stable, il faut que les États adaptent leur droit interne afin d’éviter réellement la double imposition :
– les États qui pratiquent la mondialité permettent aux entreprises résidentes de déduire de leur impôt, en principe assis sur le bénéfice mondial, l’impôt acquitté dans l’État de la source (méthode de l’imputation) ;
– les États qui pratiquent la territorialité n’imposent pas, par définition, les bénéfices réalisés dans l’État de la source (méthode de l’exemption).
● Les revenus passifs, à savoir les dividendes (article 10), les intérêts (article 11) et les redevances (article 12) sont en principe imposés par l’État de résidence du créancier. Le Modèle prévoit toutefois la possibilité pour l’État de la source, dans lequel se trouve le débiteur, de pratiquer une retenue à la source, dont le montant est ensuite retranché de l’impôt dû dans l’État de résidence.
Exemple : une société établie dans un État A verse à une autre société établie dans un État B des intérêts en rémunération d’un prêt. Le montant de ces intérêts est imposé dans l’État B. En application de la convention, l’État A peut pratiquer une retenue à la source sur le flux qui quitte son territoire, car ce flux correspond bien à une activité conduite sur ce territoire. Afin d’éviter une double imposition de ce flux, le montant de la retenue vient en diminution de l’impôt théoriquement dû dans l’État B.
4. Des principes conventionnels mal adaptés à certains aspects de l’économie moderne, notamment à l’économie numérique
Conçu pour éviter les doubles impositions, le Modèle OCDE sur lequel se fondent la plupart des conventions fiscales bilatérales est également soucieux de conserver un certain degré de souveraineté fiscale aux États de la source, dans lesquels naissent les bénéfices ; c’est la raison d’être de la notion d’établissement stable. Or, la poursuite de ce second objectif est aujourd’hui mise à mal par certaines caractéristiques de l’économie moderne ; comme le relève l’OCDE, « les normes fiscales internationales actuellement en vigueur n’ont pas évolué au même rythme que les pratiques des entreprises au niveau mondial, en particulier dans le domaine des biens incorporels et de l’économie numérique » (60).
Dans son rapport de janvier 2013, la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique (61) identifie, au rang des principales caractéristiques de cette économie, un modèle d’affaires à plusieurs faces. Par exemple, le business model d’un moteur de recherche bien connu consiste à offrir à ses utilisateurs une indexation performante des informations figurant sur Internet (première face) et à vendre à des annonceurs des espaces publicitaires qui seront visionnés par les utilisateurs (deuxième face). Fournies par le « travail gratuit » des utilisateurs, les données sont « le flux essentiel de l’économie numérique » : par exemple, l’historique des recherches réalisées par un internaute sur le moteur de recherche fournit à l’entreprise qui l’exploite un ensemble de données lui permettant de vendre aux annonceurs une publicité « personnalisée », définie par les recoupements permis par le traitement automatisé des données.
Compte tenu du caractère immatériel des flux, propre au business model des entreprises du numérique, l’existence d’un établissement stable dans un État donné n’est pas indispensable pour y développer une activité. Plus exactement, les éléments incorporels que sont les données et le logiciel, souvent seuls présents dans l’État de la source, ne suffisent pas à constituer un établissement stable permettant de soumettre à l’impôt l’entreprise du numérique. Comme le résume l’OCDE, « il est aujourd’hui possible d’être fortement impliqué dans la vie économique d’un autre pays, c’est-à-dire de traiter avec des clients situés dans ce pays par le truchement d’Internet, sans y avoir d’implantation imposable » (62).
5. L’utilisation par certaines entreprises des conventions à des fins de « double non taxation »
● En partie inadaptées à l’économie moderne, les conventions fiscales peuvent également être utilisées par les entreprises multinationales comme des outils d’optimisation de leur charge d’impôt. La pratique du treaty shopping consiste, pour les entreprises, en une analyse comparée des conventions fiscales, afin d’organiser les flux transnationaux de sorte à bénéficier des stipulations les plus avantageuses. Pour ce faire, la solution la plus fréquemment retenue est la création dans un État donné d’une structure par laquelle transitent les flux, afin de placer lesdits flux sous le régime – plus favorable – d’une convention non applicable dans l’État de la source (63).
Exemple : soit une société Optiplus établie dans un État A. Optiplus reverse à la société Padimpo établie dans un État B un dividende, au motif que Padimpo détient une partie du capital d’Optiplus et perçoit à ce titre une quote-part de ses bénéfices. Les États A et B sont liés par une convention d’élimination des doubles impositions, en application de laquelle les dividendes transitant de A vers B sont soumis à une retenue à la source par A. A et B sont par ailleurs liés chacun par une convention à l’État C. La convention entre A et C et la convention entre B et C ne prévoient aucune retenue à la source pour les dividendes. La création de la société Bwatolètre dans l’État C permet donc de faire transiter le dividende d’Optiplus vers Padimpo, via Bwatolètre, en franchise totale d’impôt. L’État C est alors qualifié d’ « État-tunnel ».
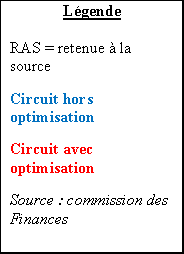
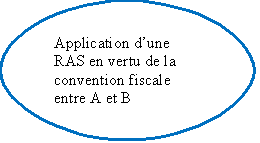


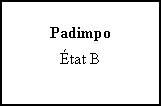
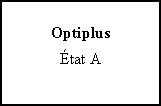
![]()
![]()
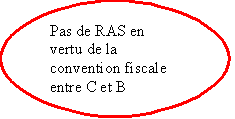
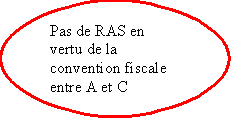


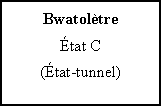
‚
Le treaty shopping est surtout pratiqué lorsqu’il permet de faire transiter le produit vers des cieux fiscaux plus cléments. Dans l’exemple précédent, l’évitement de retenue à la source permis par le détour du dividende par l’État C est d’autant plus intéressant que le niveau de taxation pratiqué par l’État B est faible. Dans l’hypothèse où la taxation par B est nulle – notamment si cet État répond aux caractéristiques d’un paradis fiscal –, le jeu des conventions internationales et des différences de législations nationales aboutit in fine à une double exonération du même produit (absence de retenue à la source du dividende chez A et C, absence d’impôt sur les bénéfices chez B).
● Les situations de double exonération ne doivent pas faire oublier la légitimité des mécanismes d’évitement de la double imposition. Car si le réseau de conventions fiscales bilatérales permet à certaines entreprises d’élaborer des stratégies d’optimisation fiscale très sophistiquées, il n’a pas fait disparaître, dans tous les cas de figure, le risque de double imposition.
III. TENTATIVE DE TYPOLOGIE DES PRINCIPALES PRATIQUES D’OPTIMISATION
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter quelques formes d’optimisation fiscale, sans prétendre à une impossible exhaustivité. Les principales techniques utilisées par les entreprises multinationales reposent, comme cela vient d’être brièvement exposé, sur les différences de législations entre les États, législations appliquées en articulation avec les conventions fiscales. L’objectif général est, schématiquement, la localisation des charges dans des États dont le niveau d’imposition est élevé, et la localisation des profits dans des États dont le niveau d’imposition est faible. Le classement des outils d’optimisation en catégories, nécessaire pour les présenter de manière compréhensible, simplifie sans doute la réalité des stratégies fiscales, qui bien souvent mêlent les différents dispositifs évoqués ci-après, mais permet une présentation plus synthétique.
A. L’OPTIMISATION PAR L’ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES
Il s’agit d’évoquer ici les régimes fiscalement favorables à la détention de participations, ainsi que les incitations à la constitution de certaines structures particulières en matière d’assurance.
1. Les dispositions favorables à la constitution de holdings financières
L’objet des sociétés holdings est la détention et la gestion de titres de participation ; leurs profits proviennent donc des dividendes qui leur sont « remontés » par les sociétés dont elles détiennent les titres. Or, ces dividendes proviennent de la réalisation, par lesdites sociétés, de bénéfices déjà taxés dans leur chef. Un mécanisme simple d’optimisation consiste donc à se placer sous les régimes, prévus par les législations nationales, qui permettent d’éviter l’imposition des dividendes. Lorsque le niveau de participation est élevé, il est possible de recourir aux mécanismes d’intégration fiscale, comme le régime de groupe français, présenté supra et sur lequel on ne reviendra pas ici. Mais, sans atteindre ce niveau de consolidation, les holdings peuvent bénéficier de régimes favorables.
a. Le régime « mère-fille » prévu par le droit français
Prévu à l’article 216 du CGI, le régime français des sociétés mères et filiales (ou régime « mère-fille ») a pour objet d’éviter la double imposition : il permet, sur option, d’exonérer d’IS les dividendes reçus par la société mère de sa filiale, que celle-ci soit établie en France ou à l’étranger. Pour prétendre au bénéfice de ce régime, la société mère doit, en application des dispositions de l’article 145 du CGI, détenir depuis au moins deux ans des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la filiale.
L’exonération n’est pas totale, l’entreprise devant réintégrer à son assiette taxable une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes reçus. Il convient de rappeler, pour la bonne compréhension des développements qui suivent, que les plus-values de cession à long terme de certains titres de participation sont également exonérées, seule une quote-part pour frais et charges de 12 % des plus-values brutes étant réintégrée à l’assiette taxable de la société cédante.
La neutralisation de la double imposition à l’IS apparaît légitime à partir du moment où les dividendes « remontés » à la société mère française par sa filiale résultent de la réalisation, par celle-ci, de bénéfices soumis dans son chef à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, pour que ce dispositif se justifie pleinement, encore faut-il que la filiale soit imposée en France ou dans un pays à fiscalité comparable. L’article 145 du CGI répond, mais seulement partiellement, à cette problématique en excluant du bénéfice du régime « mère-fille » les « produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ». Or, d’une part, la liste des ETNC s’amenuise considérablement d’année en année (cf. supra) et, d’autre part, de nombreux États non qualifiés d’ETNC proposent des taux d’IS faibles ou très en-deçà du taux français.
b. Un exemple de régime étranger plus favorable : la participation-exemption néerlandaise
Ce régime permet d’exonérer totalement d’IS les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales, ainsi que les plus-values de cession de titres de participation. L’application de ce régime de faveur est soumise à une condition de détention (la holding doit détenir au moins 5 % du capital de la filiale) et à une condition de non-passivité (la filiale doit être soumise dans son État de résidence à un IS « réaliste » et ses placements financiers doivent représenter moins de 50 % du total de ses actifs).
La loi fiscale néerlandaise est donc comparativement plus favorable que la loi française, celle-ci prévoyant que les dividendes et les plus-values restent soumis à une forme d’impôt, via la réintégration à l’assiette taxable d’une quote-part de frais et charges. Le taux normal de l’impôt est en outre plus faible aux Pays-Bas (25 %).
2. Le cas particulier des « captives » d’assurance et de réassurance
Pour couvrir leurs risques, la plupart des sociétés recourent aux services de sociétés spécialisées dans l’assurance. Elles souscrivent auprès d’elles des polices et leur versent des primes (déductibles du résultat). Certains groupes choisissent au contraire d’internaliser cette fonction assurantielle en leur sein en constituant des sociétés dédiées à cette fonction : les captives d’assurance. Comme toute société d’assurance, celles-ci facturent des primes aux autres sociétés du groupe en contrepartie de la couverture des sinistres.
Il est encore possible de raffiner cette organisation lorsque la captive décide de s’assurer elle-même contre les risques qu’elle couvre. Elle fait alors appel à un réassureur qui, lorsqu’il fait partie du même groupe, est qualifié de captive de réassurance.
D’un point de vue purement organisationnel et économique, l’internalisation du risque présente des avantages évidents. Outre les synergies et mutualisations possibles, elle permet aux captives d’obtenir des conditions d’assurance plus intéressantes que chaque société du groupe prise individuellement.
D’un point de vue fiscal, elle peut présenter d’autres attraits. Il est ainsi particulièrement aisé de localiser une captive dans un État fiscalement accueillant. Les primes d’assurance constituant un revenu taxable et l’activité de la captive étant par nature immatérielle (il s’agit de simples flux intragroupe), la société dédiée à l’assurance peut être implantée n’importe où sur le globe. Ainsi, grâce à un traitement fiscal particulièrement favorable (64), les Bermudes attirent un tiers du marché des captives d’assurance (65). Les avantages fiscaux peuvent être encore renforcés si le groupe s’adonne à la manipulation des prix de transfert, en « jouant » sur la valeur des primes versées et reçues par les sociétés du groupe, en fonction de leur implantation géographique, et donc de leur taux d’imposition (cf. infra).
B. L’OPTIMISATION PAR LE FINANCEMENT
1. L’attractivité fiscale du financement par la dette : la déductibilité des charges financières
Les entreprises disposent, pour financer leur activité et leur développement, de deux moyens : l’endettement ou l’augmentation de capital (66). Sur le plan fiscal, le recours à l’endettement est, dans la généralité des cas, plus intéressant. En effet, une augmentation de capital est rémunérée par le versement aux actionnaires de dividendes, dont le montant n’est en principe pas déductible de l’assiette taxable de l’entreprise. En revanche, les charges financières afférentes à l’emprunt (essentiellement les intérêts) sont déductibles du résultat. Toutes choses égales par ailleurs, une entreprise cherchant à minorer sa cotisation d’impôt aura donc rationnellement intérêt à se financer par emprunt, et ce d’autant plus que le taux d’imposition est élevé.
La déductibilité des charges financières entraîne d’ailleurs un biais en faveur du financement par l’endettement, particulièrement marqué en France selon la Commission européenne : « la distorsion qui favorise en France l’endettement au détriment de l’investissement sur fonds propres (telle que mesurée par l’écart entre les taux d’imposition marginaux effectifs sur les nouveaux investissements financés par l’endettement, d’une part, et sur fonds propres, d’autre part) est l’une des plus fortes de l’Union européenne » (67).
2. Un intérêt fiscal accru par l’exonération de certains produits
Combinée à d’autres dispositions de droit national, la déductibilité permet la réalisation d’opérations particulièrement attractives sur le plan fiscal, notamment l’acquisition par emprunt de titres dont les produits sont en tout ou partie exonérés d’impôt.
En France, l’articulation de la déductibilité des charges financières et de l’exonération des plus-values à long terme de certains titres de participation (68) fournissait un bon exemple de ce type de montage. Les deux régimes ont été réformés par la loi de finances pour 2013, afin notamment de limiter les stratégies d’optimisation (cf. infra). À ce stade, il faut simplement retenir que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans sont exonérées d’IS, seule une quote-part représentative de frais et charges (originellement de 5 % du montant des plus-values nettes, désormais de 12 % des plus-values brutes) étant réintégrée au résultat taxable de la société cédante.
Rien ne s’oppose à ce que les produits de participation acquis par emprunt le soient dans des entreprises établies à l’étranger. Dans son rapport précité d’octobre 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires constatait qu’« un groupe domicilié en France peut ainsi retirer des produits exonérés d’une acquisition à l’étranger, sous forme de dividendes et de plus-values en cas de revente, alors que les charges liées à cette acquisition lui auront permis de diminuer l’impôt payé. Cette asymétrie entre charges déductibles et produits exonérés va à l’encontre de la logique de l’impôt qui veut que chaque charge ait comme contrepartie un produit » (69).
Il est même possible que certains investissements dépourvus de rationalité économique soient réalisés à des fins fiscales, pour bénéficier à plein des avantages offerts par la déductibilité des charges financières et l’exonération de certains produits. Dans son commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2013, qui proposait un encadrement de la déductibilité (cf. infra pour plus de détails), le Rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale reprenait un exemple, théorique mais éclairant, développé par son prédécesseur pour illustrer ce type de montage (cf. encadré ci-dessous).
Exemple extrême d’optimisation par la déductibilité des charges financières
Soit une entreprise française A qui acquiert pour un montant de 100 une entreprise irlandaise B dont le seul actif est un portefeuille obligataire d’un rendement avant impôt de 4 % ; A et B se placent sous le régime mère-fille. Pour acquérir B, A contracte un emprunt à un taux d’intérêt de 5 %. L’opération n’est a priori pas rationnelle économiquement, puisque son coût (5) est nécessairement supérieur à son rendement (inférieur à 4). Mais, du fait de la combinaison entre la déductibilité des charges et l’exonération des produits, l’opération devient fiscalement rentable :
– les dividendes produits par le portefeuille obligataire (4) sont taxés dans le chef de B, au taux irlandais (12,5 % de 4, soit une imposition de 0,5) ;
– B fait « remonter » à A les dividendes nets, soit 3,5 ;
– en application du régime mère-fille, ces dividendes sont exonérés d’impôt, à l’exception d’une quote-part de 5 %, soit un IS de 0,06 (soit 33,1/3 % de 5 % de 3,5) ;
– A déduit de son assiette imposable les charges financières afférentes à l’acquisition de sa participation dans B, soit 5. Cette déduction minore de 1,666 (soit 33,1/3 % de 5) le montant de l’IS dû par A, à raison de ses résultats positifs dégagés par ailleurs ;
– le gain brut de l’opération pour A est de 3,5 (dividende reçu de B) + 1,666 (économie d’IS), soit 5,166 ;
– le coût de l’opération pour A est de 5 (charges financières) + 0,06 (quote-part), soit 5,06 ;
– l’opération présente donc un gain net pour A, du fait du régime fiscal.
Source : Christian Eckert, Rapporteur général au nom de la commission des Finances, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2013, tome 2, n° 251, octobre 2012, page 276 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r0251-tII.pdf
3. Un régime particulièrement attractif en économie ouverte : les intérêts notionnels
Le Royaume de Belgique a instauré en 2006 le régime des intérêts notionnels, qui permet un traitement fiscal symétrique des deux modalités de financement (debt = equity). Le caractère attractif du dispositif réside dans le fait que la symétrie est rétablie par un alignement du traitement fiscal du capital sur celui de la dette : les capitaux propres se voient affectés d’intérêts fictifs
– « notionnels » –, dont le taux est celui des obligations à long terme de l’État belge, et dont le montant est déductible de l’assiette taxable, tout comme les intérêts d’emprunt. En économie ouverte, une entreprise peut donc avoir intérêt à localiser sa source de financement en Belgique, car le traitement fiscal du financement sera aussi favorable par fonds propres que par endettement.
L’existence de ce régime permet ainsi la réalisation de montages transnationaux impliquant des entreprises françaises, comme l’illustre l’exemple ci-dessous, fourni par la Direction générale des Finances publiques. Cet exemple relève vraisemblablement de l’optimisation abusive, mais sa description permet de mieux comprendre le dispositif.
Exemple de schéma d’optimisation par recours aux intérêts notionnels
Détourné de son objectif premier, le dispositif permet de mettre en place des boucles de financement fictives, créatrices d’économies d’impôt en France qui peuvent être substantielles. Les prêts consentis par les sociétés belges donnent, en effet, lieu à des charges financières déductibles fiscalement en France. Par ailleurs, les produits financiers correspondants ne sont pas ou peu imposés en Belgique du fait de la déduction fiscale des intérêts notionnels.
Exemple : une société française F crée une société B en Belgique. Elle la dote d’un fort capital de X millions d’euros. Pour ce faire, F a emprunté X millions auprès d’une banque tierce à un taux de marché.
Elle justifie l’activité de la société B en expliquant qu’elle a décidé de faire de B le centre financier du groupe. B prête ensuite ces X millions à un taux normal proche du taux d’emprunt contracté par F auprès de la banque à des sociétés opérationnelles F1, F2 situées en France et formant avec F une intégration fiscale.
En France l’intégration fiscale constate une charge d’intérêt chez F pour l’emprunt contracté auprès de la banque et chez F1 et F2 pour le prêt accordé par B. En contrepartie F reçoit en régime mère-fille les profits réalisés par B sous forme de dividendes (ces bénéfices étant composés des intérêts d’emprunts).
En Belgique, B calcule, en application de l’article 205 bis du code de l’impôt sur le revenu belge, une déduction dénommée « déduction capital à risque » prévue à l’article 205 quater § 1. Cette déduction est égale au capital risque multiplié par un taux de référence. Il s’agit du taux moyen appliqué aux obligations linéaires de l’État sur dix ans lors de l’exercice précédent l’exercice imposable. Ce montant est appelé intérêts notionnels. Dès lors, la structure belge n’a quasiment plus de résultat taxable, ce qui revient à ce que les intérêts versés par F1 et F2 soient quasi exonérés.
C. LE RECOURS AUX INSTRUMENTS ET ENTITÉS HYBRIDES
Au-delà des simples mécanismes de déductibilité des charges financières, l’optimisation par le financement emprunte des voies plus tortueuses, que l’on peut résumer sous l’appellation générique de « dispositifs hybrides », auxquels l’OCDE a récemment consacré un rapport détaillé (70), rapport dont les développements suivants se nourrissent.
Sont rassemblés sous le vocable d’hybrides les instruments ou entités qui, parce qu’ils sont considérés différemment par les législations des différents États, permettent aux entreprises qui les utilisent de bénéficier d’un traitement fiscal plus favorable que si ces produits ou entités étaient identiquement considérés par les États.
● Les instruments hybrides sont définis par l’OCDE comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (71).
Cette double nature des titres permet à des entreprises liées qui y ont recours de bénéficier d’un traitement fiscal favorable dans chacun des États. L’exemple suivant permet de l’illustrer.
Exemple : les sociétés Optiplus et Padimpo, respectivement situées dans l’État A et dans l’État B, sont, au regard du droit fiscal de chacun des États, liées par un dispositif de type mère-fille. La mère Optiplus finance la fille Padimpo au moyen d’un titre hybride, regardé comme un titre de dette (une obligation) par l’État B et comme un titre de participation (une action) par l’État A. La rémunération de ce titre versée par Padimpo est donc, dans l’État B, un intérêt déductible de l’assiette taxable de Padimpo. La rémunération perçue par Optiplus n’est pas considérée par l’État A comme un produit financier imposable (un intérêt perçu), mais comme un produit de participation (un dividende), exonéré en application du régime de type mère-fille. Au final, la rémunération de l’instrument de financement est déductible dans l’État A et exonérée dans l’État B.
● Les entités hybrides « se voient appliquer le régime de la transparence fiscale dans un pays alors qu’elles sont considérées comme opaques dans un autre » (72). Cette différence peut entraîner la double déduction d’une charge, comme l’illustre l’exemple suivant.
Exemple : la société Optiplus, située dans l’État A, détient des participations dans la société Padimpo, située dans l’État B. Elle ne les détient pas directement, mais par l’intermédiaire de Multyfirme, société établie dans B et dont Optiplus est l’unique actionnaire. Multyfirme est la société tête du groupe qu’elle forme avec Padimpo.
Multyfirme est hybride au regard des législations des deux États :
– A la considère comme transparente (ce qui signifie que ses profits et pertes sont consolidés avec ceux d’Optiplus, seul sujet fiscal aux yeux de A) ;
– B la considère à l’inverse comme opaque (ce qui signifie qu’elle y est redevable de l’impôt sur les bénéfices, pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec Padimpo).
La seule fonction opérationnelle de Multyfirme est de s’endetter auprès d’un établissement bancaire, afin de financer l’activité de Padimpo. Les intérêts d’emprunt supportés par Multyfirme constituent dans l’État B une charge déductible du résultat d’ensemble du groupe, qui permet de minorer les éventuels bénéfices de Padimpo, et donc de réduire l’assiette taxable du groupe. Le caractère transparent de Multyfirme dans l’État A autorise Optiplus à déduire de son assiette taxable les charges d’intérêts supportées par Multyfirme. Au final, la même charge aura donc été déduite deux fois, dans chacun des États. En l’absence d’entité hybride, Optiplus aurait financé directement Padimpo en lui consentant un prêt ; les intérêts auraient été déductibles chez Padimpo, mais auraient constitué un produit financier imposable chez Optiplus.
● Le rapport de l’OCDE souligne l’impact budgétaire potentiellement important des dispositifs hybrides : « Les dispositifs hybrides peuvent réduire sensiblement la charge fiscale totale pour les contribuables. Bien qu’il n’existe pas de données complètes sur les pertes totales de recettes fiscales dues à ces dispositifs hybrides, des données fragmentaires montrent que les sommes en jeu sont considérables […]. L’Italie a indiqué récemment qu’elle avait réglé un certain nombre de cas faisant intervenir des dispositifs hybrides pour un montant d’environ 1,5 milliard d’euros » (73).
D. L’OPTIMISATION PAR MANIPULATION DES PRIX DE TRANSFERT
1. Les prix de transfert : cadre conceptuel
● La notion de « prix de transfert » désigne la valeur monétaire attachée aux transactions transfrontalières opérées entre sociétés membres d’un même groupe (74) mais établies dans des États différents : transactions portant sur des actifs matériels (achats/ventes de biens, de marchandises) ou immatériels (concession des droits de propriété attachés à une marque), prestations de services (recherche et développement, comptabilité, gestion des ressources humaines), ou encore transferts financiers (prêts donnant lieu au versement d’intérêts par le bénéficiaire, octrois de garantie). Par nature, de telles transactions sont hors marché puisqu’elles s’effectuent entre entreprises associées qui, par construction, ne sont pas concurrentes.
Sans qu’il soit possible d’estimer précisément le phénomène, la mondialisation de l’économie a fortement contribué au développement des flux intragroupe, rendant les prix de transfert stratégiques, pour les entreprises comme pour les administrations fiscales. De fait l’OCDE estime que les échanges intragroupe représenteraient plus de 60 % du commerce mondial.
Comme le souligne le récent rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) consacré aux prix de transfert (75), la problématique des échanges transnationaux internes aux groupes revêt une importance croissante du fait également :
– de la pression mise sur leurs dirigeants en termes de communication financière, le taux effectif d’imposition étant un indicateur particulièrement suivi par les actionnaires et les investisseurs potentiels (76) ;
– de la proactivité des conseils aux entreprises (avocats, juristes spécialisés, comptables, économistes), tirant profit de la complexité des règles applicables aux prix de transfert pour non seulement aider les groupes à les respecter, mais également les assister dans une démarche d’optimisation.
Car la détermination d’un prix de transfert et la localisation géographique de la valeur qui en découle produisent des conséquences directes et potentiellement massives sur le bénéfice – et par voie de conséquence l’impôt – des sociétés prenant part à la transaction. En effet, les prix de transfert constituent une charge déductible de l’assiette de l’IS pour l’entreprise qui les versent, et un produit taxable à l’IS pour l’entreprise qui les reçoit. Ils sont donc au cœur de la fiscalité internationale des entreprises, et représentent un enjeu majeur pour les sociétés comme pour les États.
Les sociétés peuvent être tentées de tirer profit des disparités fiscales nationales :
– soit en localisant habilement les points de départ et d’arrivée de telles transactions, en faisant de leurs entités établies dans les pays à forte fiscalité des sociétés « émettrices », et en concentrant les produits afférents au sein de sociétés implantées dans des territoires à plus faible fiscalité ;
– soit en manipulant la valeur des prix de transfert, c’est-à-dire en survalorisant les paiements effectués depuis les pays à forte pression fiscale et en sous-valorisant les paiements reçus dans ces mêmes pays.
Inversement, les États souhaitent attraire dans leur juridiction fiscale la plus grande base possible, et peuvent donc se disputer la répartition du pouvoir d’imposer. Comme le rappelle l’IGF dans le rapport précité : « les prix de transfert ne font donc pas l'objet d'un simple rapport de force entre un contribuable et une administration fiscale. Ils impliquent un groupe multinational et au moins deux administrations fiscales, entre lesquelles doit être réparti le pouvoir d'imposer une même matière imposable » (77).
La détermination des prix de transfert doit donc permettre d’éviter deux écueils : la localisation artificielle des produits et des charges à des fins de minimisation de la charge fiscale d’une part, la double imposition du même produit, d’autre part. À cette double fin, l’OCDE a élaboré une doctrine de détermination des prix de transfert et des méthodes d’évitement de la double imposition.
Les lignes directrices de détermination des prix de transfert (78) sont fondées sur le principe de pleine concurrence (en anglais, « at arm’s length »), prévu par l'article 9 du Modèle de convention fiscale établi par l'OCDE (cf. encadré ci-après) : les prix de transfert devraient être établis comme s’ils étaient afférents à une transaction réalisée entre deux sociétés indépendantes sur un marché concurrentiel. En effet, si elles étaient réalisées entre deux sociétés parfaitement indépendantes, les transactions intragroupe seraient systématiquement affectées d’un prix de marché révélant par principe, en vertu de la théorie économique classique, le juste prix. Lorsque le principe de pleine concurrence n’est pas respecté, il est loisible à l’État « lésé » de réintégrer tout ou partie du prix de transfert à l’assiette taxable à son profit.
Article 9 du Modèle OCDE, relatif aux entreprises associées
« 1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État
– et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. »
Le « jeu » des prix de transfert, s’il peut s’avérer préjudiciable aux recettes publiques, n’est pas exempt de tout risque pour la société qui s’y adonne. Si une ou plusieurs administrations fiscales des États concernés par la transaction rejettent le prix de transfert tel qu’il a été valorisé ex ante par l’entreprise, il en résultera comme on vient de le dire un redressement fiscal qui, en l’absence de mécanismes correctifs bilatéraux, pourra en outre aboutir à une double imposition.
Afin de minimiser ce risque, les lignes directrices de l'OCDE proposent deux mécanismes de neutralisation de la double imposition :
– en amont, un contribuable peut conclure avec les administrations fiscales concernées un accord préalable de prix de transfert, dont le but est de sécuriser juridiquement la politique de l'entreprise et, potentiellement, de parer à tout risque de redressement ultérieur (79) ;
– en aval, après un redressement, les administrations fiscales intéressées peuvent, pour se répartir le pouvoir d’imposition, engager des négociations dans le cadre d'une procédure amiable. La durée de la procédure est la plupart du temps fixée par une convention bilatérale, à l'expiration de laquelle la société en cause peut solliciter un arbitrage.
La « bonne » détermination des prix de transfert est donc une entreprise complexe. L'OCDE propose différentes méthodes de valorisation des prix de transfert : trois méthodes traditionnelles fondées sur les transactions et deux méthodes transactionnelles de bénéfices (cf. encadré ci-après). Contrairement à la position qui prévalait sous l'empire de la précédente version de ses principes directeurs, l'OCDE ne préconise aucune méthode de détermination des prix de transfert, ni ne hiérarchise les méthodes existantes. Elle indique simplement que le choix d'une méthode doit permettre d’opter pour celle qui est « la plus appropriée au cas spécifique » (80). L'organisation précise même que « les groupes multinationaux sont entièrement libres de recourir à des méthodes autres que celles exposées dans ces Principes […] dès lors que les prix fixés satisfont au principe de pleine concurrence ».
Les méthodes de valorisation des prix de transfert de l’OCDE
Les trois méthodes traditionnelles
La méthode du prix comparable sur le marché libre (Comparable Uncontrolled Price Method ou CUP), la plus simple, est aussi la plus rare. Elle consiste, comme son nom l'indique, à retenir comme valeur du prix de transfert le prix dont seraient convenues deux entreprises totalement indépendantes lors d'une transaction identique et dans des circonstances similaires. Bien adaptée pour valoriser des actifs corporels qui font régulièrement l'objet de transactions sur les marchés (produits manufacturés, matières premières), cette méthode trouve ses limites dès lors que les éléments de comparaison font défaut. Il est notamment difficile de déterminer la valeur d'actifs incorporels avec cette méthode (brevets, marques). En tout état de cause, il n’est pas si fréquent que les transactions entre deux sociétés liées soient en tous points comparables aux transactions entre deux sociétés indépendantes.
La méthode du prix de revente (Resale Price Method) prend pour point de départ le prix auquel un produit acheté à une entreprise associée est revendu à une entreprise indépendante. Est ensuite retranchée de ce prix de revente une marge brute « appropriée » (la marge sur prix de revente), c'est-à-dire la marge grâce à laquelle le vendeur réaliserait un bénéfice « convenable ». Après défalcation d'autres éléments objectifs (droits de douane par exemple), le prix ainsi obtenu peut être considéré comme le prix de pleine concurrence. La difficulté tient ici à la détermination de ce qui constitue la marge brute « appropriée ». L'OCDE précise que « c'est probablement lorsqu'elle est appliquée à des opérations de commercialisation que cette méthode est la plus efficace ».
La méthode de prix de revient majoré (Cost Plus Method) s'analyse comme le miroir de la précédente. Le point de départ est le prix de revient de l'actif transféré auquel est ajoutée une marge « appropriée » aux coûts supportés par l'entreprise qui transfère l'actif, « de façon à obtenir un bénéfice approprié compte tenu des fonctions exercées et des conditions de marché ».
Les deux méthodes dites « transactionnelles »
La méthode transactionnelle de la marge nette (Transactional Net Margin Method), doit permettre de déterminer la marge nette que réalise une entreprise lors d'une transaction contrôlée, et à la comparer à la marge « normale » qu'aurait réalisée la même entreprise dans les conditions du marché, en pleine concurrence. Une telle méthode suppose que l’entreprise dispose d'informations suffisamment précises sur ses concurrents, ce qui n'est pas toujours le cas.
La méthode transactionnelle du partage des bénéfices (Profit Split Method) vise à déterminer la répartition « normale » des bénéfices qui aurait été opérée entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires de transaction en éliminant les conséquences des « conditions spéciales, convenues ou imposées dans une transaction entre entreprises associées ».
Pour documenter leurs prix de transferts, les entreprises utilisent des bases de données mises à leur disposition par des sociétés privées ou, plus rarement, par des autorités publiques. Les comparaisons sont réalisées entre transactions ou, le plus souvent, entre entreprises. Les premières visent à comparer les prix de la transaction contrôlée examinée, d’une part, et de la transaction comparable sur le marché, d’autre part. Avec les secondes, plus répandues, il s’agit de comparer la rentabilité post-transaction de la société partie au transfert intragroupe, avec la rentabilité d’une société comparable qui aurait réalisé la même transaction sur le marché, en pleine concurrence.
2. Une problématique renouvelée par le renforcement du caractère immatériel de l’économie
Le rapport précité de l’IGF identifie comme une tendance majeure de l’économie moderne « la montée en puissance des actifs incorporels dans le processus de création de valeur des groupes multinationaux ». Or, si les modalités d’évaluation des prix de transfert semblent relativement bien adaptées lorsqu’il s’agit de déterminer le prix d’actifs corporels (biens manufacturiers, marchandises, matières premières) ou de services bien connus des marchés auxquels ont classiquement recours les entreprises (comptabilité par exemple), elles semblent trouver leur limite dès lors qu’elles visent à apprécier la valeur d’un actif incorporel pour lequel il n’existe pas ou peu d’éléments de comparaison.
De ce fait, les méthodes de détermination des prix de transfert peinent à allouer aux actifs immatériels une valeur objective concurrente de celle calculée ex ante par l’entreprise, tandis que les administrations fiscales éprouvent des difficultés certaines lorsqu’il s’agit d’opérer un redressement sur de tels éléments. Il en est ainsi des marques ou de certains actifs très particuliers (un algorithme par exemple). Difficilement valorisables à leur « juste prix » par nature (81), de tels actifs sont en outre parfois trop rares ou trop spécifiques pour faire l’objet de comparaisons objectives. Ainsi, peu d’algorithmes alternatifs existent qui concurrencent celui mis au point par Google.
Les actifs immatériels, par nature intangibles (marques, brevets, savoir-faire managérial) peuvent, plus facilement que des outils de production industrielle, être logés dans des territoires à fiscalité faible. Le schéma classique consiste alors à ce que ces actifs soient concédés à des sociétés opérationnelles exerçant leur activité dans des États plus taxateurs, puis rémunérés par le paiement de redevances : la valeur est ainsi logée là où elle sera le moins imposée, tandis que la masse imposable s’érode dans les pays les plus taxateurs.
La question de l’adaptation des règles classiques applicables aux prix de transfert est donc d’une importance capitale. L’économie numérique, qui a mis en lumière cette problématique, diffuse ses principes à l’ensemble de la sphère économique (82), que l’on songe aux biens et services facilement « dématérialisables » (banque, assurance, télécommunications, éducation, santé), mais aussi à l’essor du commerce en ligne y compris dans les secteurs « traditionnels » (réservation de voyages ou d’hôtels en ligne, commandes sur Internet, etc.).
3. Des manipulations de prix de transfert particulièrement dommageables pour les pays en développement
La manipulation des transactions intragroupe cause, toutes choses égales par ailleurs, un préjudice plus grand pour les pays en développement (PED) que pour les pays industrialisés. Plusieurs organisations non-gouvernementales (ONG) se sont saisies de cette problématique particulièrement préoccupante. L’exemple donné par la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, lors de l’audition de ses représentants par la mission d’information, est à ce titre tristement éclairant. Il s’appuie sur une étude de cas réalisée par l’ONG ActionAid (83), également évoquée par certains interlocuteurs de la mission lors de son déplacement aux États-Unis. L’encadré suivant résume ce cas à grands traits.
La stratégie fiscale du groupe SABMiller en Afrique
Le groupe britannique SABMiller possède plusieurs brasseries sur le continent africain (en Zambie, au Ghana, en Tanzanie, Afrique du Sud et Mozambique). Par le jeu de redevances et prix versés par ces entités africaines à des sociétés basées aux Pays-Bas, en Suisse ou à l’Île Maurice (en rémunération de l’utilisation de marques, pour frais de gestion, ou pour l’achat de biens) et en actionnant d’autres leviers d’optimisation (financement par la dette), le groupe parvient à effacer la quasi-totalité de l’impôt qui pourrait être dû dans les pays sources, pourtant en manque criant de recettes publiques pour financer leur développement.
En se concentrant sur le cas du Ghana, l’étude précise que SABMiller évapore la masse fiscale théoriquement due dans ce territoire via quatre schémas cumulatifs :
– les marques des bières vendues au Ghana sont détenues par une filiale établie aux Pays-Bas, SABMiller International BV, à laquelle la société ghanéenne Accra Breweries verse des redevances pour l’utilisation des droits associés ;
– elle verse également des management fees (cf. infra) à une filiale suisse du groupe, Bevman Services AG, au titre de la rémunération de multiples services (conseil financier, conseils en matière de stratégie commerciale, marketing, etc.). Selon l’étude, la réalité de telles opérations reste à prouver ;
– Accra Breweries rémunère une troisième filiale implantée à Maurice (Mubex) auprès de laquelle elle achète la moitié des fournitures et matières premières nécessaires à sa production (malt, maïs, sucre notamment) ;
– enfin, elle acquitte auprès de la même société mauricienne un intérêt relatif à un prêt consenti par celle-ci, Accra Breweries étant selon l’ONG sous-capitalisée à dessein afin d’être obligée d’emprunter (les charges d’intérêt étant déductibles de l’assiette imposable – pour plus de précision sur la notion de sous-capitalisation, cf. infra).
D’après ActionAid, ces schémas masquent tous des manipulations de prix de transfert, avec des redevances, des management fees, des prix d’achat et des intérêts surévalués par rapport aux prix du marché.
4. Différents types de manipulation des prix de transfert
a. Les manipulations portant sur les transferts d’actifs corporels
Les échanges intragroupe faisant intervenir des actifs corporels sont monnaie courante. Les sociétés liées au sein d’un même groupe s’achètent et se revendent fréquemment marchandises, matières premières, machines, terrains, immeubles, etc.
Un groupe peut alors succomber à la tentation classique de loger un maximum de charges dans les pays les plus taxateurs, et de localiser un maximum de produits au sein de territoires plus conciliants en procédant, selon les cas, à une sur-facturation ou une sous-facturation de la transaction. Cela lui permet alors de transférer artificiellement les actifs – donc les bénéfices, donc l’impôt – d’une entité du groupe vers une autre entité du même groupe, en contradiction avec le principe de pleine concurrence.
L’OCDE admet toutefois une certaine souplesse : il est ainsi possible qu’une transaction sous-valorisée entre entités parties au même groupe soit compensée par d’autres transactions opérées entre les mêmes sociétés, le principe de libre concurrence étant in fine préservé. Tel serait le cas d’une mère qui, d’une part, vendrait à sa fille une partie de sa gamme de produits à un coût sous-évalué et, d’autre part, lui vendrait l’autre partie de sa gamme avec une marge plus importante que celle qui devrait objectivement prévaloir sur le marché libre.
b. Les manipulations portant sur les prestations de service
Elles sont plus aisées à opérer et passent plus facilement le filtre des contrôles fiscaux que les manipulations relatives aux transferts d’actifs corporels. En effet, autant le transfert d’une machine-outil d’un pays A vers un pays B est facilement retraçable et observable, autant la délivrance d’une prestation de service (administratif, financier, commercial, technique) se contrôle et se constate avec plus de difficulté.
L’OCDE précise qu’une opération pourra légitimement être considérée comme une prestation de service intragroupe si « dans des circonstances comparables une entreprise indépendante aurait répondu à un besoin identifié soit en exerçant l’activité elle-même, soit en ayant recours à un tiers ». (84)
On peut identifier deux grandes familles de prestations de service intragroupe :
– les prestations de gestion, réalisées par la mère ou toute autre entité du groupe (services de contrôle financier et budgétaire, de comptabilité, de gestion des ressources humaines ou de conseil juridique). De telles prestations donnent lieu au versement de frais de gestion (management fees) ;
– au-delà de ces services « stratégiques », la mère ou toute autre filiale peut également fournir, pour le compte de l’ensemble du groupe, des services directement liés à l’activité quotidienne du groupe. Entrent par exemple dans cette catégorie les prestations relatives à la politique d’achat, à l’assistance à la production, à la distribution ou à la commercialisation.
c. Les manipulations permises par la politique de financement intragroupe
Les prêts intragroupe peuvent constituer un moyen subtil de transfert des produits entre entités liées, et donc entre États en fonction de la pression fiscale propre à chacun d’eux. Le groupe qui s’adonnerait à ce type de manipulation chercherait alors, selon les cas, à calibrer les prêts accordés à ses différentes entités en exigeant alternativement des taux d’intérêt trop élevés ou en consentant des taux d’intérêt trop faibles par rapport à ceux observables sur le marché en vertu du principe de pleine concurrence. Or il est très délicat de détecter les manipulations en la matière, les conditions d’octroi de prêt étant fonction d’une multitude de facteurs : durée du prêt, montant, nature (fixe, variable), devise utilisée, surface financière, risque de défaut de l’emprunteur, contexte économique, etc. En outre, même des sociétés indépendantes peuvent consentir ou bénéficier de prêts sans intérêt.
En la matière, la manipulation des prix de transfert peut en outre se cumuler avec le recours à d’autres leviers d’optimisation, tel le recours à des produits hybrides (pour des développements plus poussés sur les instruments hybrides, cf. supra).
Exemple : NoGlasnost (mère) et Tuyo (fille) sont deux sociétés du même groupe respectivement implantées dans un État A (IS de 10 %) et un État B (IS de 33,1/3 %). Tuyo enregistre un bénéfice de 10. NoGlasnost lui accorde un prêt de 100, au taux de 10 %, largement supérieur au taux du marché.
Tuyo verse alors un intérêt de 10 à sa mère, intérêt déductible de son assiette taxable, qui est alors totalement effacée. Le Trésor public de B ne reçoit aucun impôt sur les sociétés. Considéré comme un intérêt par le droit de B, la somme que reçoit NoGlasnost est juridiquement assimilée à un dividende par le droit de A, lequel, en application d’un régime mère-fille particulièrement favorable, admet les remontées de dividendes au profit des mères en franchise d’impôt.
Le bénéfice de 10 qui aurait produit un impôt de 3,33 en B en l’absence de prêt génère in fine un impôt nul en B, et un impôt nul en A. La mécanique de manipulation des prix de transfert associée à un instrument hybride (le même flux est considéré comme un intérêt déductible par un droit national, et comme un dividende exonéré par l’autre) permettant une double non-imposition à l’IS via une déduction (en B) suivie d’une exonération (en A).
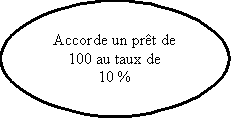
![]()
![]()
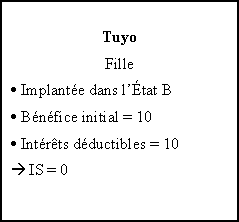
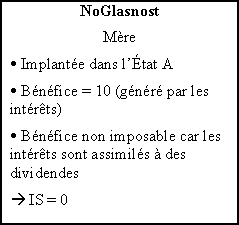


‚
d. Les manipulations relatives à la rémunération des actifs incorporels
Compte tenu de la place croissante prise par l’économie numérique dans les échanges commerciaux, et de la diffusion du numérique à l’ensemble des activités de production, la question des actifs incorporels et de leur juste valorisation lorsqu’ils font l’objet de transactions intragroupe est au cœur des préoccupations des administrations fiscales. Un exemple permettra d’illustrer simplement cette problématique.
Lors de son déplacement aux États-Unis, la mission a pu réaliser à quel point il est malaisé, pour l’administration fiscale, d’obtenir gain de cause devant la justice à l’occasion d’un recours relatif à une manipulation supposée de prix de transfert (cf. encadré suivant).
Un exemple de contentieux de prix de transfert aux États-Unis : l’affaire Veritas (85)
L’Internal Revenue Service (IRS) contestait la valorisation d’un certain nombre d’actifs incorporels (86) transférés de la société américaine Veritas Software Corp. à sa filiale irlandaise Veritas Ireland.
D’après l’administration fiscale, ces actifs avaient été largement sous-évalués, le prix convenu aux termes de l’accord entre les deux sociétés
– et donc le montant de la redevance versée par la fille Veritas Ireland, par suite imposable au taux d’IS américain de 35 % en tant que produit de la mère américaine – devant être relevé de 118 millions de dollars à 1,675 milliard.
Sourde aux arguments de l’IRS, la United States Tax Court a finalement tranché en faveur de la société, estimant que le prix de transfert avait fait l’objet d’une estimation correcte conforme au principe de pleine concurrence.
e. Le cas particulier des opérations de « business restructuring »
Les stratégies de réorganisation d’entreprise – ou business restructuring – ne constituent pas une manipulation pure et directe des prix de transfert mais elles peuvent avoir pour conséquence de redéfinir artificiellement les flux intragroupe via la relocalisation, à des fins d’optimisation, des différentes entités en fonction de considérations fiscales. Elles peuvent au surplus se doubler d’une manipulation ex post des prix des transactions intragroupe ainsi redessinées.
L’OCDE définit le business restructuring comme le « redéploiement transnational par une entreprise multinationale de ses fonctions, actifs et/ou risques » (87).
De telles opérations ne sont pas, par nature, condamnables. Elles peuvent répondre à des considérations et des logiques commerciales et industrielles objectives (pénétration d’un marché par exemple) et ne sauraient être considérées a priori comme un levier d’optimisation voire d’évasion fiscale, surtout lorsque ces réorganisations s’effectuent entre États à fiscalité « normale ». Le soupçon pourra plus légitimement naître dans l’esprit de l’administration fiscale si l’opération voit le transfert d’actifs vers un ETNC ou un État à régime fiscal privilégié.
En tout état de cause, le business restructuring emporte une double conséquence fiscale :
– au moment de la restructuration, avec un transfert d’actif d’un État A vers un État B (changement d’implantation de la société mère par exemple), le premier perdant sa capacité d’imposer ledit actif au profit du second ;
– après la restructuration, et de manière durable, avec la réorganisation des flux intragroupe – et donc des prix de transfert – résultant de la nouvelle organisation géographique de la multinationale.
On peut distinguer trois grandes modalités de réorganisation d’un groupe multinational :
– la première voit la transformation de distributeurs de plein exercice en distributeurs limités ou en commissionnaires qui agissent pour le compte d’une société liée étrangère, qui est alors donneur d’ordre ;
– la deuxième en constitue le miroir au niveau des fabricants, avec la transformation de fabricants de plein exercice en simples sous-traitants ou « façonniers » agissant pour le compte d’une entreprise associée étrangère donneur d’ordre ;
– enfin, le groupe peut choisir de centraliser des actifs incorporels au sein d’une entité dédiée, une holding par exemple, chargée de détenir et gérer les participations dans les sociétés dudit groupe.
De tels choix de gestion peuvent toutefois être détournés de leur objet premier, voire même être poursuivis dans un but exclusivement ou principalement fiscal. Tel peut être le cas des « contrats de façonnage ». Sous ce schéma, des entités françaises antérieurement considérées comme fabricants au sein de leur groupe sont transformées en « façonniers », tandis que leur siège social est implanté dans un État à la fiscalité plus accueillante. Le façonnier se contente alors uniquement de produire le bien sans en assurer la vente sur le marché et fait remonter l’actif correspondant à la valeur du produit au niveau de mère. En échange, il ne reçoit de celle-ci qu’une modeste marge, comprimée au maximum, ajoutée à ses coûts de fabrication. La masse taxable s’évapore de l’État de fabrication vers l’État moins taxateur, et la réalité fiscale se trouve totalement décorrélée de la réalité économique.
Exemple : Fabric est un fabricant intégré au groupe français Padimpo. Fabric produit des biens manufacturés d’une valeur de 100 qu’il revend ensuite en réalisant un profit de 10, taxé au taux de 33,1/3 %. L’entreprise acquitte alors un impôt de 3,33, le solde (6,67) étant remonté à la mère sous forme de dividendes en quasi-franchise d’impôt (modulo la quote-part pour frais et charges de 5 %). Padimpo n’acquitte que 0,11 d’IS sur cette somme (6,67 x 5 % x 33,1/3 %). Au total, le fisc français enregistre 3,44 d’impôt.
Le groupe Padimpo décide de mener une opération de business restructuring et implante son siège en Irlande (dont le taux d’IS est de 12,5 %). Fabric conclut un contrat de façonnage avec Padimpo aux termes duquel sa seule et unique fonction consiste à fabriquer les produits du groupe, sans en assurer la vente. Padimpo, qui désormais enregistre directement les profits tirés de la vente de biens, lui reverse un montant de 2 destiné à couvrir les coûts de fabrication et à lui assurer une marge minimale. Dans l’hypothèse où ces coûts sont de 1, Fabric dégage un profit de 1, rapportant au Trésor français un impôt de 0,33, un montant 10 fois moins élevé qu’auparavant. Le fisc irlandais prélève quant à lui un impôt égal à 1 (8 x 12,5 %). Au total, le groupe reverse un impôt de 1,33 (0,33 en France + 1 en Irlande), un montant plus de deux fois et demie inférieur à celui acquitté avant l’opération de business restructuring.
Poussée à l’extrême, une telle logique pourrait même permettre à un groupe particulièrement cynique d’utiliser le business restructuring pour rendre une décision de délocalisation plus « acceptable ». Dans un premier temps, il pourrait redéployer ses activités afin d’organiser artificiellement le défaut de rentabilité de telle ou telle filiale implantée dans un pays à forte fiscalité, et, dans un second temps, en tirer argument – apparemment objectif – pour délocaliser la production dans un territoire à bas coûts.
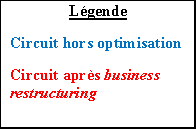
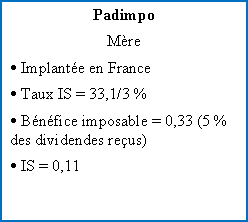
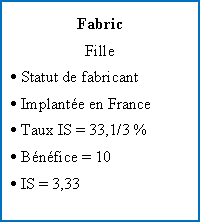
6,67 = dividendes en
régime « mère-fille »
![]()
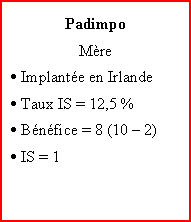
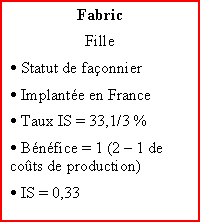
2 = couverture des coûts
de production + profit minimum
![]()
![]()
IV. LA COMBINAISON DES DIFFÉRENTS OUTILS D’OPTIMISATION DANS DES SCHÉMAS TRÈS COMPLEXES : LE NUMÉRIQUE
A. LES SPÉCIFICITÉS DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE PERMETTENT UNE STRATÉGIE FISCALE QUI APPARAÎT COMME LA FORME D’OPTIMISATION LA PLUS ABOUTIE
La question de la fiscalité des entreprises du secteur numérique intéresse et préoccupe de plus en plus les citoyens et les pouvoirs publics, en France, en Europe, mais également aux États-Unis, berceau des « géants » du numérique, parfois désignés sous les acronymes de GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), GAFAM (les mêmes plus Microsoft), ou encore OTT (pour Over-The-Top) (88).
Cette préoccupation résulte d’un constat simple : alors que ces entreprises connaissent une forte croissance et sont les vecteurs d’une transformation profonde de l’économie, leur contribution aux charges communes par le paiement de l’impôt apparaît sans rapport avec leur dynamisme et surtout leur richesse. Ce constat, difficilement chiffrable malgré les tentatives évoquées supra, est toutefois incontestable dans son principe. Les entreprises du secteur reconnaissent d’ailleurs bien volontiers qu’elles parviennent, grâce à une stratégie fiscale dont la complexité n’a d’égale que la subtilité, à échapper en toute légalité à l’impôt. En exergue de leur rapport précité, Pierre Collin et Nicolas Colin ont ainsi choisi cette déclaration d’autosatisfaction du président exécutif de Google, Éric Schmidt, qui assurait en 2012 : « Je suis très fier de la structure que nous avons mise en place. Nous l’avons fait en nous basant sur les incitations que les gouvernements nous ont proposées pour établir nos activités ». Cette phrase porte en elle le paradoxe de l’optimisation fiscale, qui est finalement rendue possible du fait de l’utilisation de dispositifs légaux, souvent expressément incitatifs, mis en place par des États fiscalement souverains, mais qui in fine portent atteinte à la capacité d’autres États à recouvrer l’impôt qu’ils peuvent estimer leur être dû.
La spécificité des entreprises du numérique, comme le relèvent Pierre Collin et Nicolas Colin, tient à ce qu’elles sont « optimisées dès l’origine du point de vue du droit fiscal » (89). Alors que l’essentiel des groupes multinationaux se réorganisent au gré de leur développement pour réduire leur facture fiscale, dans l’économie numérique, « l’organisation juridique des opérations intègre d’emblée l’objectif de minimiser le taux effectif d’imposition en cas de succès et de développement international ». Si l’optimisation est recherchée dès l’origine, elle est en outre facilitée par les caractéristiques propres des entreprises du numérique, dont la création de valeur repose essentiellement voire uniquement sur l’exploitation d’actifs incorporels (un algorithme, une marque) pouvant être aisément localisés dans des États imposant faiblement voire pas du tout les bénéfices. Pour ces entreprises plus que pour d’autres, le critère fiscal peut donc être central dans le choix de la localisation des activités.
Le cadre du présent rapport d’information dépasse le seul champ de la fiscalité du numérique. Mais il ne pouvait faire l’impasse sur un développement spécifiquement consacré à cette question, tant les montages mis en place dans ce secteur apparaissent comme une forme d’aboutissement ultime de l’optimisation fiscale. Ils mêlent en effet tous les vecteurs d’optimisation que les développements précédents ont décrits isolément, pour en faciliter la compréhension. Leur description conduira à aborder incidemment des sujets sur lesquels on reviendra plus longuement par la suite : en effet, l’ingéniosité de ces montages repose notamment sur le fait qu’ils permettent de contourner les dispositifs « anti-abus » que certains États ont mis en place afin de lutter contre l’optimisation.
Depuis quelques années, la presse comme les rapports publics évoquent régulièrement le montage mis en place par Google, fréquemment désigné sous l’expression de « double irlandais et sandwich néerlandais » (double Irish and Dutch sandwich). Le caractère largement public de ce montage a assez naturellement conduit le Rapporteur à tenter d’en exposer la subtilité. Mais, comme l’affirment Pierre Collin et Nicolas Colin, « un montage de ce type est aujourd’hui mis en œuvre par toutes les grandes entreprises américaines de l’économie numérique » (90).
B. LE « DOUBLE IRLANDAIS ET SANDWICH NÉERLANDAIS », RECETTE DE GOOGLE, EST UN MONTAGE PARTICULIÈREMENT RÉVÉLATEUR DES STRATÉGIES FISCALES DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE
1. Le montage repose sur trois sociétés
Google Inc., société de droit américain, a concédé ses droits de propriété intellectuelle pour l’essentiel de ses activités hors États-Unis à Google Ireland Holdings, filiale à 100 %.
Google Ireland Holdings concède à son tour ses droits à Google Netherlands BV, société de droit néerlandais.
Google Netherlands BV sous-concède elle-même ses droits à Google Ireland Ltd, société opérationnelle de droit irlandais installée à Dublin, qui réalise l’essentiel du chiffre d’affaires de Google hors États-Unis (encaissement des recettes publicitaires) (91), et emploie pour ce faire quelque 3 000 personnes. Google Ireland Ltd est une filiale à 100 % de Google Ireland Holdings.
Google Irleand Ltd détient des filiales dans différents États, comme par exemple Google France SARL, dont l’activité – conduite par environ 400 personnes – consiste notamment à promouvoir Google auprès des annonceurs établis en France. Mais les annonceurs ne contractent qu’avec Google Ireland Ltd, qui établit les factures et à qui ils adressent leurs paiements. Google France SARL est donc rémunérée par Google Ireland Ltd au titre de sa prestation d’apporteur d’affaires, à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires généré (au profit donc de Google Ireland Ltd) par ses activités de promotion (92).
2. Les bénéfices de l’entité opérationnelle située en Irlande sont fortement minorés par le versement d’une redevance aux Pays-Bas, en franchise d’impôt
Google Ireland Ltd reverse l’essentiel de son chiffre d’affaires (72 % selon l’étude précitée de la Fédération française des télécoms) à Google Netherlands BV, sous forme de redevance d’utilisation des droits de propriété intellectuelle que la société néerlandaise lui sous-concède. La redevance ainsi versée n’est soumise à aucune retenue à la source en Irlande, car le flux est intra-communautaire : la directive « Intérêts et redevances » de 2003 (93) exonère en effet ces catégories de revenus de toute imposition lorsqu’ils sont payés par une société d’un État membre de l’Union européenne à une société ou à un établissement stable d’un autre État membre.
L’assiette taxable de Google Ireland Ltd en Irlande est donc significativement minorée par le paiement de cette redevance ; cette assiette, au surplus, est frappée d’un taux de seulement 12,5 %, près de trois fois inférieur au taux applicable en France.
3. Les Pays-Bas jouent un rôle d’État-tunnel vers les Bermudes
La seule fonction de Google Netherlands BV (94) est de recevoir la redevance de Google Ireland Ltd et de la reverser en quasi-totalité – le chiffre de 99,8 % est souvent évoqué – à Google Ireland Holdings. Au regard du droit néerlandais comme du droit irlandais, et en dépit de son nom, Google Ireland Holdings est une société de droit bermudien et non de droit irlandais, au motif qu’elle est dirigée depuis les Bermudes, État dans lequel est implantée l’équipe de direction et où se réunit le conseil d’administration. La redevance versée par Google Netherlands BV à Google Ireland Holdings est donc, de facto, versée aux Bermudes.
L’intérêt de créer entre les deux sociétés « irlandaises » (double irlandais) une société néerlandaise (sandwich néerlandais) réside dans la différence de traitement fiscal de la redevance :
– une redevance versée depuis l’Irlande vers un État hors Union européenne est soumise à une retenue à la source, en application du droit national et des conventions fiscales bilatérales (95) ;
– les Pays-Bas ne pratiquent aucune retenue à la source sur les redevances qui quittent leur territoire. C’est ce qui leur vaut le qualificatif, souvent employé, d’« État-tunnel ».
Au total, l’impôt sur les bénéfices payé par Google Netherlands BV aux Pays-Bas, au taux de 25 %, n’est assis que sur 0,2 % du montant reçu de Google Ireland Ltd, soit le reliquat de la redevance versée à Google Ireland Holdings.
Par comparaison, si une redevance était payée par une société établie en France à une société établie aux Bermudes, elle ferait l’objet d’une retenue à la source de 33,1/3 %, en application de l’article 182 B du code général des impôts. En effet, la France n’est pas liée aux Bermudes par une convention qui, si elle existait, ramènerait vraisemblablement le taux de la retenue à un niveau plus faible. Il faut en outre signaler que si les Bermudes étaient considérées comme un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du même code, le taux de la retenue serait porté à 75 % (cf. infra les développement sur les États et territoires non coopératifs).
La conséquence de ce montage complexe est que l’essentiel du chiffre d’affaires réalisé par Google Ireland Ltd, correspondant donc à près de 90 % des activités de Google hors États-Unis, est très significativement minoré par des charges (les redevances) qui ne sont imposées nulle part en Europe.
4. Les bénéfices transférés aux Bermudes n’y sont pas imposables
Une fois parvenu à Google Ireland Holdings, le produit constitué de ces redevances est soumis à la juridiction fiscale des Bermudes, qui n’impose pas les bénéfices des sociétés enregistrées par des non-résidents et n’exerçant pas d’activité sur le territoire bermudien (régime dit des « exempted companies », auquel est par définition éligible Google Ireland Holdings).
5. Du fait de la réglementation américaine, les bénéfices stockés aux Bermudes ne sont pas imposables aux États-Unis tant qu’ils n’y sont pas rapatriés
● Introduites aux États-Unis en 1996, les « entity classification rules » permettent aux entreprises américaines ou aux entreprises détenues par des personnes physiques ou morales américaines de choisir au regard du droit fiscal américain, entre le statut de « corporation » (sujet de droit fiscal américain) et le statut de transparence (profits imposés dans le chef de l’associé américain). Ce choix, exprimé par le fait de cocher une case sur un imprimé fourni par l’administration fiscale (d’où la dénomination « check the box », la plus couramment utilisée), n’est pas ouvert aux sociétés commerciales, automatiquement considérées comme corporation au sens du droit fiscal américain. Google Ireland Holdings est une société étrangère non commerciale, car son objet est de faire fructifier des droits de propriété intellectuelle dont elle a reçu concession (de Google Inc.). Elle est donc éligible à check the box.
Parce qu’elle a un seul actionnaire (Google Inc.), Google Ireland Holdings a le choix entre seulement deux statuts : celui de corporation (par défaut) et celui de « disregarded for US tax purpose », ou ignorée de l’administration fiscale américaine. Google Ireland Holdings ayant choisi d’être disregarded, ses profits ne sont imposables aux États-Unis que dans le chef de Google Inc., lorsque lesdits profits lui sont « remontés » par le versement de dividendes notamment.
Afin d’empêcher des montages destinés à échapper à l’impôt américain, des règles anti-abus relatives aux sociétés étrangères contrôlées par des sociétés américaines ont été instaurées aux États-Unis au début des années 1960.
Ces CFC rules (pour Controlled Foreign Corporations) ont pour objet de permettre à l’administration fiscale américaine d’imposer directement les revenus passifs des CFC (intérêts, dividendes, redevances), sans attendre qu’ils soient remontés à l’actionnaire américain. Or, Google Ireland Holdings, contrôlée à 100 % par Google Inc., ne perçoit que des revenus passifs.
Mais l’exception dite « du même pays » fait échec à l’application des CFC rules lorsque la CFC perçoit des revenus passifs versés par une société opérationnelle exerçant son activité dans le même État que celui dans lequel elle est enregistrée.
Or, au regard du droit américain, Google Ireland Holdings est une société de droit irlandais car enregistrée (« incorporated ») en Irlande – alors que, rappelons-le, elle est considérée par l’Irlande comme de droit bermudien. Et c’est bien en Irlande qu’est conduite, par Google Ireland Ltd, l’activité opérationnelle à l’origine des revenus passifs de Google Ireland Holdings. L’exception du même pays est donc applicable : les bénéfices de Google Ireland Holdings ne peuvent donc être imposés aux États-Unis que dans le chef de Google Inc., lorsqu’ils lui sont remontés. Le « double irlandais », condition du « sandwich néerlandais », est également nécessaire au contournement – légal – des CFC rules américaines.
● Si les bénéfices réalisés par Google Ireland Holdings étaient rapatriés aux États-Unis en l’état du droit, ils seraient soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 35 %, ce qui aurait pour effet d’annihiler, au niveau du groupe, les effets optimisants du montage décrit ici. C’est la raison pour laquelle les bénéfices sont « stockés » aux Bermudes (96) dans l’attente et l’espoir du vote d’une « tax holiday » par le Congrès des États-Unis. En effet, il arrive que le législateur américain autorise le rapatriement de bénéfices ainsi localisés à l’étranger à des conditions fiscales favorables, par exemple avec un impôt ramené de 35 % à 5 % en 2005. Cette tax holiday, la dernière en date, aurait permis d’engranger 15 milliards de dollars de recettes fiscales. À plusieurs reprises, il a été indiqué à la mission que les bénéfices en attente d’une disposition de ce type sont évalués entre 1 700 et 2 000 milliards de dollars environ, ce qui pourrait produire un montant d’impôt maximal de 100 milliards avec une taxation ramenée au taux de 5 %.
On comprend bien que l’importance des sommes en jeu, notamment dans une période de difficultés budgétaires n’épargnant pas les États-Unis, puisse rendre attractive la perspective d’une mesure de clémence fiscale. La stratégie des grandes entreprises du numérique serait alors définitivement couronnée de succès. Mais selon les informations recueillies par la mission lors de son déplacement aux États-Unis, la tax holiday n’est pas à l’ordre du jour.
● La stratégie fiscale ainsi exposée donne lieu à des comportements qui peuvent paraître aberrants du point de vue économique. L’une des spécificités des entreprises du numérique est que l’espérance de gains de leurs actionnaires réside davantage dans la plus-value de cession, au terme d’un processus de croissance rapide et forte de l’entreprise, que dans le versement régulier de dividendes. Pour autant, s’agissant en particulier des plus grandes entreprises ayant depuis bien longtemps dépassé le stade de start-up prometteuses, la rémunération des actionnaires peut devenir nécessaire. Or, ceci est difficilement compatible avec le fait de thésauriser les bénéfices dans un paradis fiscal, en attendant de pouvoir les rapatrier aux États-Unis à moindre coût.
Dans ce contexte, l’aberration économique consiste à ce que ces entreprises empruntent sur les marchés pour rémunérer leurs actionnaires, comme l’a récemment fait Apple, qui a émis 17 milliards de dollars de titres, alors que ses réserves en attente de rapatriement s’élèveraient à 102 milliards de dollars.
![]()
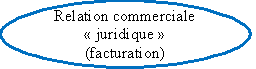
![]()
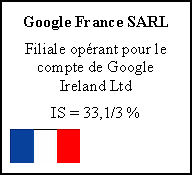
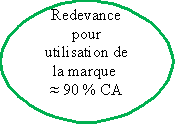
![]()
![]()
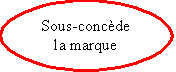
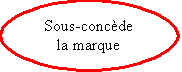
![]()
![]()
![]()
![]()
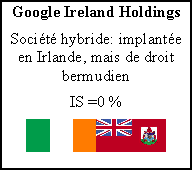
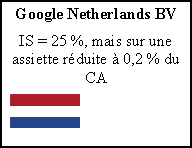
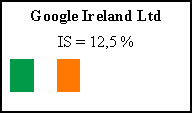
![]()

![]()
![]()
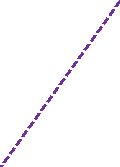
![]()
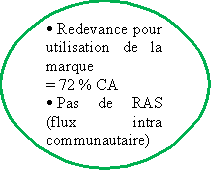
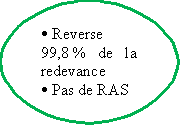
„ 
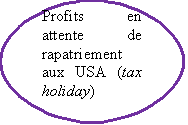
![]()
![]()
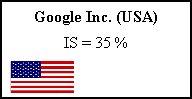
C. LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE ONT ÉGALEMENT UNE STRATÉGIE D’OPTIMISATION EN MATIÈRE DE TVA
L’optimisation fiscale pratiquée par les entreprises du numérique repose essentiellement, comme cela vient d’être expliqué, sur la combinaison de différents régimes favorables en matière d’impôt sur les sociétés. Mais il faut également indiquer, plus brièvement, que des stratégies sont également mises en œuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Au sein de l’Union européenne, en application de la dernière directive « TVA » (97), les ventes à distance de biens matériels sont soumises à cet impôt dans l’État de consommation, et non dans l’État d’établissement de l’entreprise expéditrice. La logique est inverse pour les prestations de services électroniques, lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie à la TVA (un particulier, notamment) : dans ce cas, la TVA est due dans l’État d’établissement du prestataire.
La vente de textes, de films et de musique au format numérique étant assimilée à des prestations de services et non à des ventes de biens matériels, les entreprises prestataires ont donc logiquement intérêt à s’établir, au sein de l’Union européenne, dans les États dont les taux de TVA sont les plus faibles. C’est ainsi qu’Amazon et Apple ont installé au Luxembourg leurs filiales européennes de « distribution », pour y bénéficier d’un taux normal de 15 % (contre par exemple 19,6 % – et 20 % à compter du 1er janvier 2014 en l’état actuel du droit – en France).
Cette situation est appelée à évoluer : à partir du 1er janvier 2015, la TVA sur les services rendus par voie électronique sera due dans l’État de consommation, selon les règles qui y sont applicables (98). Collectée dans l’État d’implantation du prestataire, la TVA sera reversée à l’État de consommation, par un système de guichet unique. L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles sera progressive, puisque seulement 70 % du produit de la TVA seront reversés à l’État de consommation en 2015 et 2016, puis 85 % en 2017 et 2018.
SECONDE PARTIE :
CE QUI A ÉTÉ FAIT, CE QUI RESTE À FAIRE
I. UNE CAPACITÉ D’ACTION LIMITÉE AU NIVEAU NATIONAL
A. DES MESURES LÉGISLATIVES RÉCENTES CONTRE L’OPTIMISATION PAR LE FINANCEMENT
Les débuts de la législature en cours ont été marqués, en matière de fiscalité des entreprises, par l’adoption d’une série de mesures ayant pour objectif de limiter certaines pratiques d’optimisation contribuant à éroder l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Si aucune de ces mesures ne concerne exclusivement les entreprises multinationales, certaines ont néanmoins pour objet de réagir à des problématiques fiscales qui se révèlent plus préoccupantes dans un contexte d’internationalisation des échanges et des activités économiques.
Seules deux de ces mesures, issues de la loi de finances initiale (LFI) pour 2013 (99), seront développées en détail ici : d’une part, car elles ont été évoquées précédemment, d’autre part, car ce sont celles dont les effets, notamment sur le plan budgétaire, sont les plus significatifs. La présentation détaillée des autres mesures alourdirait à l’excès le présent rapport, dont l’objet est davantage de tracer des pistes de réformes à venir que de s’attarder sur l’ensemble des mesures déjà prises. Pour mémoire, on pourra retenir que la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, adoptée en août de la même année, contient plusieurs dispositifs anti-abus, notamment l’interdiction de déduire du bénéfice imposable, sauf exception, les abandons de créance à caractère financier (article 17) (100).
1. La limitation de la déductibilité des charges financières
Comme cela a été décrit supra, le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, surtout lorsque ces charges sont afférentes à l’acquisition – y compris dans des filiales étrangères – de titres dont les produits – notamment l’éventuelle plus-value de cession ultérieure – sont exonérés d’impôt. Une série de dispositifs anti-abus préexistait à la loi de finances initiale pour 2013 (101).
L’article 23 de la loi de finances pour 2013 a ajouté à ces règles anti-abus un dispositif d’encadrement de portée générale, sous la forme d’une réintégration forfaitaire. Une fraction (15 % puis 25 % à compter de 2014) des charges financières nettes (102) doit désormais être réintégrée au résultat imposable. Pour l’application de ce nouveau dispositif, la notion de charges financières s’étend, au-delà des charges financières « classiques » (essentiellement les intérêts d’emprunt), à certains éléments de loyer (loyers de crédit-bail, loyers de location avec option d’achat, loyers simples de biens mobiliers payés entre entreprises liées). Afin de préserver les petites et moyennes entreprises, il est cependant prévu que le mécanisme de réintégration ne s’applique que lorsque le montant des charges financières nettes de l’entreprise excède 3 millions d’euros.
2. Un régime des plus-values de cession à long terme de certains titres de participation rendu plus rigoureux
Un temps envisagée, l’idée d’une réintégration généralisée dans le revenu imposable des charges financières afférentes à l’acquisition de titres dont les produits sont exonérés (donc une extension de l’amendement Carrez) a finalement été écartée par le Gouvernement car « l’asymétrie à laquelle elle cherche à remédier (charges déductibles, produits exonérés) est traitée en partie par le durcissement du régime fiscal des plus-values sur titres de participation » (103). De fait, l’article 22 de la LFI 2013 a significativement modifié le régime fiscal de ces plus-values.
En application du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans (sous le régime dit de long terme) sont exonérées d’IS depuis le vote d’un amendement sénatorial au projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Une quote-part du montant des plus-values est toutefois réintégrée à l’assiette de l’impôt : elle est supposée compenser pour partie la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition et à la gestion des titres. La quote-part était initialement de 5 % du montant net des plus-values, soit la différence positive entre les plus-values et les moins-values de l’exercice. Le taux de la quote-part a été porté à 10 % par l’article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011.
La loi de finances pour 2013 a procédé à deux modifications substantielles :
– le taux de la quote-part a été porté à 12 % ;
– surtout, la quote-part est désormais assise sur le montant brut des plus-values, et non plus sur leur montant net.
B. LES PRINCIPAUX OUTILS DE CONTRÔLE DES PRATIQUES D’OPTIMISATION ABUSIVES
1. Des outils généraux : l’abus de droit et l’acte anormal de gestion
Comme le résument joliment Maurice Cozian et Florence Deboissy, « l’abus de droit, c’est le péché des surdoués de la fiscalité » (104). Cette construction permet à l’administration fiscale d’ignorer les actes dont l’apparente régularité juridique dissimule leur objet véritable et exclusif : l’évitement de l’impôt. En droit français, cette notion et la procédure qui permet sa mise en œuvre sont codifiées à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).
Article L. 64 du livre des procédures fiscales
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
Deux comportements distincts, visant un but unique, sont susceptibles de constituer un abus de droit :
– la simulation. Le contribuable tente ici d’opposer à l’administration des actes qui « ont un caractère fictif », qui n’ont en réalité aucune substance juridique et/ou concrète (105) ;
– la fraude à la loi (106). Le contribuable recherche « le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs » ;
– dans tous les cas, le seul et unique but recherché est la minoration ou l’annulation de l’impôt, les actes n’ayant été « inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
La procédure d’abus de droit est actionnée par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle. Si le contribuable conteste les rectifications notifiées par le fisc, il peut saisir pour avis le comité de l’abus de droit fiscal (107). Cette saisine est également ouverte à l’administration.
L’abus de droit est lourdement sanctionné, le contribuable subissant :
– le rétablissement de l’impôt normalement dû ;
– le paiement d’intérêts de retard à hauteur de 0,40 % par mois (108) ;
– une majoration égale à 80 % des sommes lorsqu’il est établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (ramenée à 40 % lorsqu’une telle preuve n’a pu être apportée) (109).
Utilisation de la procédure d’abus de droit en matière de fiscalité internationale
La Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), chargée du contrôle fiscal des plus grandes entreprises, a mis en œuvre la procédure d’abus de droit à 10 reprises au cours des cinq dernières années, en matière de fiscalité internationale.
Selon les informations transmises à la mission, « les mécanismes combattus consistent principalement à endetter artificiellement des structures françaises, ou à dissimuler des prêts en apport de capital pour bénéficier du régime mère-fille, ou à créer des structures-écrans sans substance économique pour dissimuler des revenus ».
Les redressements se répartissent de la sorte entre les différents types de montage :
– remise en cause de la substance de sociétés situées dans des paradis fiscaux pour dissimuler des opérations spéculatives : 1 100 millions d’euros en base et hors pénalités ;
– montage mis en place pour bénéficier du régime mère-filles : 328 millions d’euros ;
– remise en cause de boucles fictives de financement (intérêts notionnels) : 256 millions d’euros ;
– remise en cause de montages d’endettement artificiel : 163 millions d’euros :
– lutte contre des abus conventionnels : 23 millions d’euros.
Les conditions permettant aux vérificateurs d’engager un redressement sur le fondement de l’abus de droit sont lourdes, puisqu’ils doivent cumulativement :
– prouver que le contribuable a soit sciemment menti, soit consciemment détourné l’intention du législateur ;
– démontrer qu’il l’a fait dans l’unique but de réduire son imposition. Or il peut être assez aisé pour l’entreprise d’opposer à l’administration ne serait-ce qu’un seul argument de caractère non fiscal, même ténu, à l’appui de l’acte contesté (nécessité économique ou de gestion, fût-elle vague).
Afin de faciliter le contrôle et le redressement des situations abusives et pour appréhender plus aisément les cas de manipulation de prix de transfert, il pourrait être envisagé d’assouplir l’article L. 64 du LPF, en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit ont « principalement » – et non pas « exclusivement » – pour but de minorer l’imposition que le contribuable aurait normalement supportée.
Proposition n° 1 : Renforcer la portée de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées.
Contrairement à l’abus de droit, notion législative codifiée, l’acte anormal de gestion résulte d’une construction jurisprudentielle (110) et le demeure. En principe l’administration n’a pas vocation à s’immiscer dans la vie de l’entreprise ou dans sa gestion quotidienne. Le fait qu’un dirigeant gère mal son entreprise n’est pas fiscalement répréhensible. Encore faut-il que cette mauvaise gestion soit la conséquence d’actes, certes maladroits ou mal avisés, mais pris dans l’intérêt de l’entreprise et non dans l’intérêt particulier de ses dirigeants ou de tiers.
En substance, on peut définir l’acte anormal de gestion comme celui qui accroît les charges de l’entreprise ou qui la prive d’un produit, sans que cet acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation de la société. Il a donc pour effet de créer un préjudice pour le Trésor public, soit en minorant les recettes, soit en majorant les charges déductibles de l’entreprise.
Il serait impossible de dresser une liste exhaustive de tous les agissements susceptibles de constituer des actes contraires à l’intérêt de l’entreprise. On se bornera ici à en évoquer quelques exemples, de manière à éclairer la notion. De tels actes peuvent recouvrir :
– des dépenses injustifiées : octroi d’avantages à un tiers personne physique (parent, ami) ou morale (société liée au sein d’un même groupe par exemple) ;
– des dépenses exagérées : le paiement d’un prix manifestement surévalué pour la rémunération d’un actif vendu par une société d’un groupe à une autre société appartenant au même groupe (par exemple : la société A achète à la société B au prix de 100 un tracteur déprécié acheté 20 ans plus tôt par la société B au prix de 50) ;
– la renonciation à des recettes : en reprenant l’exemple inverse du précédent, dans l’hypothèse où A transfère à B, à titre gratuit, le dernier modèle de tracteur acheté la veille pour une valeur vénale de 100.
L’acte anormal de gestion est, le cas échéant, doublement sanctionné :
– les bénéfices de l'entreprise sont rehaussés du montant des charges indues ou du manque à gagner injustifié ;
– le bénéficiaire de l’acte est imposé sur les sommes indûment reçues.
Par rapport au dispositif de l’article 57 du code général des impôts, spécifique aux prix de transfert (cf. infra), la procédure de l’acte anormal de gestion présente un avantage non négligeable : elle n’exige pas l’établissement d’un lien de dépendance entre la société française et la société étrangère pour réintroduire au résultat imposable de l’entreprise française les bénéfices indûment transférés à l’étranger.
2. Les dispositions spécifiques relatives au contrôle des prix de transfert
● Le droit national prévoit un dispositif de contrôle spécifique aux prix de transfert, dont le fondement est l’article 57 du code général des impôts.
Article 57 du code général des impôts
« Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.
À défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. »
L’application de l’article 57 est conditionnée à l’existence de liens de dépendance (ou, symétriquement, de contrôle) entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère. La dépendance, dont les critères ne sont pas définis par la loi, peut être de droit ou de fait :
– la dépendance de droit est constatée lorsqu’une entreprise détient une part prépondérante du capital ou la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
– la dépendance de fait, par définition plus difficile à établir, peut être par exemple constatée par les liens contractuels (notamment en cas de sous-traitance) ou encore par la capacité d’une entreprise à dicter à l’autre les conditions économiques de leurs relations.
La charge de la preuve d’un lien de dépendance incombe à l’administration. Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le transfert est effectué vers une entreprise établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée. Curieusement, cette condition reste exigée lorsque l’entreprise est établie dans un ETNC.
Proposition n° 2 : Prix de transfert – Modifier l’article 57 du code général des impôts afin de supprimer la condition de dépendance ou de contrôle lorsque les transactions s’effectuent avec des entreprises établies dans des États et territoires non coopératifs.
Une fois que l’administration a démontré le lien de dépendance, il lui faut encore prouver l’existence d’un transfert indirect de bénéfices. Pour ce faire, elle doit établir que la transaction (111) en cause fait apparaître au profit d’une entreprise un avantage anormal, non justifié par une gestion rationnelle de ses intérêts par l’autre entreprise. Pour prendre un exemple permettant d’incarner quelque peu ces notions aux contours nécessairement flous, le fait pour une filiale française de verser à sa société mère étrangère une redevance manifestement surévaluée est constitutif d’un transfert indirect de bénéfices, dont le montant peut être réintégré à l’assiette taxable de la filiale. Mais la tâche de l’administration pour démontrer l’écart à la norme est ardue, notamment du fait du caractère assez général des dispositions législatives.
La jurisprudence (112) a quelque peu précisé les contours de l’action de l’administration :
– par priorité, l’existence d’un avantage doit être établie par comparaison avec les pratiques des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;
– à défaut, l’administration doit réussir à prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur réelle du service rendu.
La démonstration ainsi apportée par l’administration permet d’établir une présomption de transfert de bénéfices. Mais cette présomption n’est pas irréfragable : en effet, elle peut être renversée si l’entreprise administre la preuve contraire, en établissant le caractère normal de l’avantage et l’existence de contreparties. Si la preuve contraire n’est pas apportée, les bénéfices indûment transférés sont réintégrés à l’assiette taxable en France, soit sur la base d’éléments précis (méthode d’évaluation directe), soit de manière forfaitaire par comparaison avec les pratiques d’entreprises similaires exploitées normalement (méthode d’évaluation subsidiaire).
Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a des raisons de croire qu’une entreprise a procédé à un transfert de bénéfices susceptibles d’être réintégrés à son résultat en application de l’article 57 du CGI, elle peut demander à cette entreprise une série d’informations spécifiques, sur le fondement de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales : nature des relations entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère, méthode de détermination des prix de transferts et éventuelles contreparties, activités exercées par l’entreprise étrangère, traitement fiscal des transactions dans son État de résidence. Il s’agit de permettre à l’administration de réaliser, en début de vérification, l’analyse fonctionnelle propre aux contrôles « prix de transfert ». À la différence d’un contrôle « classique », il ne s’agit pas de vérifier le juste traitement fiscal d’opérations comptables, mais de connaître et ventiler l’activité économique d’un groupe d’entreprises au niveau mondial, afin de s’assurer que les prestations de chacune des entreprises sont justement rémunérées, sans que leur facturation permette un transfert de bénéfices à des fins fiscales.
Au-delà de cette obligation de coopération dans le cadre des contrôles, l’article 22 de la dernière loi de finances rectificative pour 2009 (113) a créé à la charge de certaines entreprises une obligation permanente de documentation des prix de transfert, codifiée à l’article L. 13 AA du LPF. Cette obligation pèse sur les plus grandes entreprises, définies comme celles dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut du bilan est supérieur à 400 millions d’euros (114). Elles doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier des prix de transfert pratiqués avec des entreprises associées (115).
Cette documentation, dont la composition s’inspire des principes posés par l’OCDE, comporte deux volets :
– un « masterfile » comportant des informations générales sur le groupe, notamment la liste de ses actifs incorporels, et une description générale de sa politique de prix de transfert ;
– des informations spécifiques concernant l’entreprise objet du contrôle en France, relatives notamment à ses méthodes de détermination des prix de transfert (cf. supra).
L’obligation documentaire est renforcée en cas de transaction avec des entreprises associées établies dans un ETNC : dans ce cas, la documentation relative à ces entreprises doit comprendre l’ensemble des informations exigibles des entreprises redevables de l’IS, y compris le bilan et le compte de résultat (article L. 13 AB du LPF).
Si la documentation n’est pas tenue à disposition de l’administration, celle-ci peut mettre l’entreprise en demeure de la produire. Si cette mise en demeure n’est pas suivie de la transmission complète de la documentation, l’article 1735 ter du CGI prévoit une amende d’un montant minimum de 10 000 euros par exercice vérifié, pouvant atteindre, en fonction de la gravité des manquements, jusqu’à 5 % des bénéfices transférés.
Sauf en cas d’accord préalable de prix de transfert, le constat par l’administration fiscale d’un transfert indirect de bénéfices sur le fondement de l’article 57 peut donner lieu à une négociation avec l’État de résidence de la société réputée bénéficiaire du transfert. Il s’agit là d’un exemple typique des procédures amiables d’élimination des doubles impositions, dont le principe est posé par l’article 25 du Modèle OCDE. Depuis 2005, l’article L. 189 A du LPF prévoit que pendant la durée de la procédure amiable, l’administration fiscale française suspend l’établissement de l’impôt, sauf si les revenus réputés transférés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
● Dans son récent rapport sur les prix de transfert, l’Inspection générale des finances constate que « l’administration fiscale française est en décalage par rapport à ses homologues s’agissant du cadre juridique ».
Tout d’abord, à la différence des autres États visités par la mission d’inspection (116), le principe de pleine concurrence n’est pas explicitement évoqué par le droit positif. Sur cette base, l’Inspection propose d’introduire une référence au principe de libre concurrence dans la législation française, et de profiter de cette modification pour construire une véritable doctrine administrative sur le sujet. Cette proposition, dont les fondements sont détaillés dans l’encadré ci-après, semble en réalité satisfaite par les pratiques existantes, ainsi que par la jurisprudence précitée du Conseil d’État (2005, Cap Gemini).
Extraits du rapport de l’Inspection générale des finances, pages 20 et 21
« Dans les faits, [la France] prive ainsi son administration de la possibilité de revendiquer à son profit la doctrine de l’OCDE en vigueur à l’époque des exercices vérifiés. À l’inverse, les contribuables peuvent quant à eux y puiser nombre de règles et de méthodes qui, sans être opposables à l’administration, forment un corpus de principes difficiles à contourner dans le cadre de la procédure de vérification.
Dans le cadre d’une vérification, l’administration fiscale et les contribuables n’argumentent donc pas sur le même terrain : l’administration cherche prioritairement à comparer des transactions et à faire valoir leur éventuelle anormalité, afin de faire peser sur le contribuable la charge de la preuve du non-transfert de bénéfices ; les contribuables contre-argumentent par des raisonnements économiques en faisant valoir des échantillons d’entités comparables, plus simples à constituer et à documenter que des échantillons de transactions. Or, cette seconde approche est à la fois plus fondée et mieux reçue, soit dans le cadre des négociations potentielles avec d’autres États partenaires, soit pour emporter la conviction du juge dans l’hypothèse d’une procédure contentieuse. »
Les autres propositions formulées par l’Inspection des Finances ont davantage retenu l’attention du Rapporteur. Ainsi, l’administration fiscale française est la seule à ne pas avoir accès à la comptabilité analytique des entreprises, alors que « celle-ci fournit des informations déterminantes pour appréhender le périmètre des comparaisons entre transactions et entre entités, ainsi que le calcul des taux de marge » (117). Il est donc proposé de ménager un accès de l’administration fiscale à la comptabilité analytique des entreprises (118). Cette proposition pourrait être utilement étendue à la comptabilité consolidée, qui fournit d’importantes informations sur les groupes.
Proposition n° 3 : Prévoir la mise à disposition de la comptabilité analytique et consolidée des entreprises soumises à l’obligation de documentation des prix de transfert en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
Enfin, à la différence de la France, aucun des États visités ne suspend l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable. Le rapport de l’IGF suggère en conséquence de supprimer cette disposition que rien ne semble justifier, sauf le coût pour l’État du remboursement des sommes qu’il aurait perçues, si la procédure amiable s’avère lui être défavorable. Afin de réserver à l’administration fiscale une marge d’appréciation en fonction de la situation des entreprises, il pourrait être envisagé – sous réserve d’une expertise juridique fine –de supprimer a minima le caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt.
Proposition n° 4 : Supprimer le caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles de prix de transfert.
L’Inspection propose par ailleurs de modifier les règles de calcul de la pénalité applicable en cas de manquement à l’obligation documentaire. En l’état du droit, la pénalité est au maximum de 5 % du montant de l’éventuelle rectification. En l’absence de rectification, il n’y a donc pas de pénalité, alors même que le manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations suffisantes à la disposition de l’administration… Il est donc proposé de décoreller la pénalité du montant de la rectification, et de l’asseoir sur l’ensemble des flux entrants et sortants déterminant le bénéfice de l’entreprise.
Proposition n° 5 : En matière de prix de transfert, délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification.
L’IGF propose enfin de renverser la charge de la preuve dans certaines situations jugées à risque (notamment réorganisation d’entreprises, existence d’une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée, constat de pertes récurrentes). Il appartiendrait alors au contribuable de démontrer que les prix de transfert ne sont pas établis pour exporter des produits ou importer des charges. Le rapport est toutefois très prudent dans la formulation de cette proposition, soulignant qu’ « un renversement complet de la charge de la preuve soulève des enjeux d’attractivité du territoire » (119). Cette intéressante proposition méritera d’être affinée pour parvenir à identifier juridiquement les situations visées.
Proposition n° 6 : Dans certaines situations « à risque » (business restructuring notamment), faire peser sur le contribuable la charge de prouver le caractère normal des prix de transfert.
C. LA LIMITATION DES FLUX FINANCIERS VERS DES CIEUX FISCAUX PLUS CLÉMENTS
1. Les régimes spécifiques aux États et territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs
L’optimisation fiscale par transfert de revenus est d’autant plus efficace, du point de vue du contribuable, que l’État vers lequel les revenus sont transférés pratique une fiscalité faible. Afin de dissuader ces comportements, qui confinent parfois à l’évasion fiscale, le législateur a prévu des dispositions spécifiques lorsque l’État de destination d’un revenu est un État à fiscalité privilégiée ou un ETNC.
a. La non-déductibilité de certaines charges versées dans des « paradis fiscaux »
L’article 238 A du CGI encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu’elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises, dans leur État ou territoire de résidence, à un régime fiscal privilégié. Sont concernées les charges financières, les redevances et la rémunération des prestations de service.
Ces charges ne sont admises en déduction que si le débiteur (l’entreprise française) apporte la preuve qu’elles correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Le régime est encore plus strict lorsque l’État de destination des charges est un ETNC : le principe est celui de la non-déductibilité, sauf si le débiteur :
– d’une part, apporte la preuve exigée pour les États à fiscalité privilégiée ;
– d’autre part, démontre que les dépenses constitutives des charges ont « principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif ».
Dans un cas comme dans l’autre, il faut relever que le régime de preuve est plus sévère pour les entreprises que celui prévu à l’article 57 du CGI, puisque ce sont elles qui doivent justifier du caractère normal des transferts opérés.
Proposition n° 7 : Modifier l’article 238 A du code général des impôts afin d’aligner les conditions de déductibilité des charges logées dans des États à fiscalité privilégiée sur celles, plus exigeantes, des charges logées dans des États et territoires non coopératifs.
b. Les règles spécifiques aux versements effectués dans des États et territoires non coopératifs
Les revenus passifs versés à une société (ou à une personne physique) établie hors de France sont soumis à une retenue à la source (RAS). Si le taux de cette RAS peut être diminué par application des conventions fiscales bilatérales
– dont c’est d’ailleurs l’un des objectifs, dans un souci d’élimination des doubles impositions –, il est en revanche significativement augmenté en présence d’un ETNC, puisqu’il atteint 75 % s’agissant :
– des dividendes, alors que le taux hors ETNC varie selon les produits de 15 à 30 % (article 187 du CGI) ;
– des intérêts, alors que le taux de droit commun est de 24 %. Une « clause de sauvegarde » permet d’écarter l’application du taux majoré si le débiteur démontre que l’opération a « principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif » (article 125 A du CGI) ;
– des redevances (120) (article 182 B du CGI).
Par ailleurs, certains régimes « de faveur » sont exclus en présence de filiales établies dans un ETNC :
– les plus-values de cession à long terme de certains titres de participation ne sont pas exonérées lorsque les titres sont détenus dans une société établie dans un ETNC (article 219 du CGI) ;
– le régime mère-fille n’est pas applicable aux dividendes provenant d’une société établie dans un ETNC (article 145 du CGI).
2. Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées : l’article 209 B du code général des impôts
Par exception au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, et sous réserve des stipulations conventionnelles, l’article 209 B du CGI permet de soumettre à l’IS :
– les bénéfices réalisés par une entreprise établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’IS établie en France ;
– les revenus d’une entité juridique constituée dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, et dont la société redevable de l’IS détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
L’impôt acquitté dans l’autre État et les retenues à la source opérées sur les revenus perçus par l’entité établie dans ce même État sont imputables sur l’IS calculé en France, pour éviter les doubles impositions. Les RAS ne sont pas imputables si l’entité est établie dans un ETNC.
Le dispositif n’est en principe pas applicable au sein de l’Union européenne, sauf si est démontrée l’existence d’un « montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » (121).
L’article 14 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a simplifié le régime des autres exceptions (122). Désormais, le dispositif ne s’applique pas lorsque l’entreprise redevable de l’IS en France démontre que l’implantation à l’étranger a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée ; cette condition est notamment vérifiée lorsque l’entreprise étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective. L’un des principaux changements introduits l’année dernière est le renversement de la charge de la preuve : c’est désormais à la société redevable de l’IS en France d’établir que les activités conduites à l’étranger n’entrent pas dans le champ du dispositif de taxation.
D. LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES D’ENCADREMENT DES PRODUITS ET ENTITÉS HYBRIDES
Comme on l'a vu précédemment, les produits et entités hybrides peuvent constituer un levier important d'optimisation fiscale, à tel point que certains États ont instauré des règles d'encadrement de ces instruments. Les développements qui vont suivre se fondent essentiellement sur un rapport publié par l'OCDE en 2012 intitulé Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales.
Il s'agira ici de présenter succinctement quelques-unes des solutions nationales apportées à cette problématique. Toutes les règles instituées par ces États visent à priver le contribuable de l’avantage en impôt résultant du recours à l'hybride, en ignorant les conséquences fiscales normalement attachées à ce produit en application des différentes législations nationales.
1. Limiter les possibilités de déduction multiple d'une même dépense
Il s'agit, pour l'État du siège de l'entreprise, de refuser la déduction de dépenses déjà déduites dans un autre pays.
En Allemagne, une société mère enregistrant une perte ne peut la déduire dans le cadre du régime d'imposition de groupe si cette perte est également déductible dans un État étranger, dans des conditions d'imposition similaires à celles existant en Allemagne. Il s'agit d'éviter que les sociétés à double résidence puissent obtenir une double déduction pour la même perte, en Allemagne et à l'étranger.
La législation néo-zélandaise est encore plus contraignante à l'égard des sociétés à double résidence, en interdisant toute déduction d'une perte en Nouvelle-Zélande, même si aucune déduction n'est effectivement opérée dans l'autre pays.
2. Limiter la déduction de flux non imposables
La législation danoise offre ici un exemple intéressant. Elle vise particulièrement les titres qui, du fait des différences de législations, passent du statut de titre de dette (intérêt déductible) à celui de titre de participation (dividende exonéré) dès l’instant qu'ils franchissent une frontière.
Soit une société A établie au Danemark endettée auprès d'une société étrangère B. L'intérêt – qualifié comme tel par le droit danois – que A doit verser à B est considéré comme un titre de participation par l'État d'établissement de la société prêteuse B. Sous certaines conditions, qu'il serait superflu de détailler ici, l'administration fiscale danoise opère un changement de classification du titre. L'intérêt devient donc dividende au regard de législation danoise, ce qui emporte deux conséquences : d’une part l'intérêt versé, qui n'en est juridiquement plus un, cesse d’être déductible de l'impôt au Danemark ; d’autre part, l'éventuelle retenue à la source opérée sur le versement à la société prêteuse s'effectue au taux applicable aux dividendes.
3. Limiter l’exonération, au titre de l’impôt « national », de flux déductibles à l'étranger
Les dispositions présentées ci-après constituent en quelque sorte le miroir des précédentes.
Le Danemark, manifestement très volontariste sur la question des hybrides, n'admet pas en exonération les dividendes perçus par une société mère danoise dès lors que la filiale à l'origine du versement est en mesure d'obtenir une déduction sur ces mêmes flux en application de la législation de son État d'implantation (hors Union européenne).
En Allemagne, le principe d'exonération des dividendes reçus par la société mère est applicable, sauf si ces dividendes ont constitué ex ante des dépenses déductibles pour la société distributrice.
Comme le rappelle l'OCDE dans le rapport précité, cette problématique de « l’exonération-déduction » fait l’objet d’une attention particulière du Groupe « Code de conduite » de l'Union européenne (fiscalité des entreprises) (123).
4. Les leçons tirées des expériences étrangères
Dans son rapport, l'OCDE dresse un rapide bilan de ces initiatives nationales en relevant que la plupart des États cherchent à apporter des réponses à des cas spécifiques tels que ceux présentés supra, mais que très peu « appliquent un ensemble de règles prévoyant un traitement d'ensemble des questions posées par les dispositifs hybrides » (124). De fait, force est de constater que la matière est complexe et mouvante et que tous les législateurs n'ont pas la vocation de Sisyphe.
Il n'en demeure pas moins que « l'expérience des pays qui ont instauré des dispositions refusant expressément le bénéfice des dispositifs hybrides a été dans l'ensemble positive. » (125).
Proposition n° 8 : Envisager l’instauration de mesures visant à empêcher la déduction ou l’exonération en France d’un flux ou produit déjà déduit ou exonéré dans un autre État (produits dits « hybrides »).
Si le rapport de l’OCDE se concentre sur la question des produits hybrides, les principes qui viennent d’être exposés sont transposables mutatis mutandis aux entités hybrides. Ainsi, il pourrait être envisagé de réfléchir à l’instauration de mesures d’encadrement analogues. Il s’agirait de faire en sorte qu’une société ne puisse plus être considérée comme opaque dans un État si elle est considérée comme transparente dans un autre État, échappant ainsi deux fois à l’impôt (cf. supra). Pour reprendre l’exemple précité de Google, une mesure de ce type aboutirait à ce que la société holding située en Irlande mais dirigée depuis les Bermudes (Google Ireland Holdings) ne soit plus regardée dans ce pays comme étant de droit bermudien, mais de droit irlandais, donc imposable.
Proposition n° 9 : Envisager l’instauration de mesures visant à empêcher une entreprise de tirer un bénéfice fiscal résultant d’une différence de qualification juridique de son statut dans deux États différents (entités dites « hybrides »).
E. DES CHANGEMENTS POSSIBLES DANS LES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION FISCALE FRANÇAISE ET LES CONTRIBUABLES
1. Au-delà des contrôles fiscaux, il existe d’autres sources d’information sur les pratiques d’optimisation fiscale
● À l’heure actuelle, l’identification par l’administration fiscale des schémas d’optimisation repose avant tout sur les contrôles qu’elle conduit, contrôles qui lui permettent d’enrichir sa connaissance des pratiques des entreprises, puis en retour de mieux cibler sa politique de vérification. Cette méthode classique n’est d’ailleurs pas inefficace, puisque des schémas très pointus sont repérés par l’administration, puis étudiés par le comité de l’abus de droit fiscal, avant de justifier dans certains cas des propositions de modifications législatives (126).
Le fait que l’essentiel de l’information sur les schémas d’optimisation provienne des activités de contrôle peut cependant poser quelques difficultés :
– en termes de réactivité de l’administration et le cas échéant du législateur, d’une part. En effet, le contrôle d’un exercice donné, qui peut intervenir en vertu des règles de prescription jusqu’à trois ans après sa clôture (127), est rarement conclu avant plusieurs mois, voire avant plusieurs années en cas de contentieux, surtout lorsque le dossier est complexe. Sans qu’il soit possible d’étayer cette intuition de faits précis, il n’est pas déraisonnable de penser que l’écoulement d’un long délai entre la mise en place d’un montage optimisant et son éventuel démantèlement par le juge, l’administration ou le législateur, joue globalement en faveur des grandes entreprises multinationales et de leurs conseils ;
– en termes de niveau de connaissances, d’autre part. Quelle que soit la compétence de l’administration fiscale, qui n’est pas à prouver, le fait de rencontrer les montages à l’occasion des contrôles empêche d’avoir une vision globale sur leur fréquence d’utilisation et, par définition, sur les montages ne figurant pas dans l’échantillon contrôlé.
● Il pourrait donc apparaître nécessaire d’améliorer l’information dont dispose l’administration fiscale, pour lui permettre de mieux lutter contre les schémas les plus agressifs, et de proposer des évolutions du droit.
Dans un rapport de 2011, dont se nourrissent pour partie les développements qui suivent, l’OCDE résumait ainsi la problématique : « La base de toute réponse visant à s’attaquer à la planification fiscale agressive est la disponibilité en temps voulu de renseignements ciblés et complets. Cette disponibilité à un stade précoce permet aux administrations fiscales de mieux évaluer les risques, d’utiliser efficacement les ressources disponibles et d’améliorer ainsi la discipline fiscale globale. Elle permet en même temps aux instances de politique fiscale de prendre des décisions rapides et éclairées quant aux réponses législatives adéquates. » (128).
L’OCDE a identifié six catégories de pratiques qui, hors processus de contrôle fiscal, permettent à l’administration d’être informée des schémas d’optimisation retenus par les contribuables (cf. encadré ci-après).
Initiatives en matière de communication de renseignements recensées par l’OCDE
1. Les règles relatives à la communication préalable obligatoire de renseignements
L’obligation de communication à l’administration fiscale des schémas optimisants pèse soit sur le contribuable, soit sur le « promoteur » du schéma. Le Royaume-Uni et les États-Unis, par exemple, ont mis en place ce type d’obligation (cf. infra).
2. Les obligations de déclaration supplémentaire
Il s’agit d’adjoindre à l’habituelle déclaration de résultats une ou des déclarations spécifiques, par exemple pour bénéficier de la déductibilité des intérêts d’un emprunt consenti à une entreprise liée (Pays-Bas).
3. Les questionnaires
Certains États (Nouvelle-Zélande, Italie) en adressent à des entreprises sélectionnées du fait de leur propension à utiliser des dispositifs d’optimisation, la réponse aux questionnaires étant en général obligatoire.
4. Les programmes de discipline fiscale coopérative
Comme l’a décrit l’OCDE en 2008 dans son Étude du rôle des intermédiaires fiscaux, il peut exister, au-delà de la relation de base entre l’administration fiscale et les contribuables (relation essentiellement juridique fondée sur l’obligation de paiement de l’impôt et les moyens de contrôle de cette obligation), une relation améliorée (enhanced relationship), dans laquelle les deux parties sont davantage partenaires. Cette relation améliorée « se fonde sur l’établissement et la poursuite d’une relation de confiance mutuelle entre le contribuable et son administration fiscale » (129).
Cela implique que l’administration fasse preuve de compréhension, fondée sur la connaissance des réalités commerciales, et que les contribuables fassent preuve en retour de transparence et d’une volonté de communication. L’administration apporte aux entreprises une aide dans la gestion de leur risque fiscal ; en retour, celles-ci renforcent leur discipline fiscale.
Sous des appellations diverses, plusieurs États ont développé ce type d’environnement, notamment les États-Unis (Compliance Assurance Process – Processus d’assurance du respect de la discipline fiscale), le Royaume-Uni (Tax Compliance Risk Management Process – Processus de gestion du risque en matière de discipline fiscale) ou encore les Pays-Bas avec la supervision horizontale (cf. infra).
5. Les décisions (rulings)
Il s’agit, pour l’administration fiscale, de statuer ex ante sur la compatibilité d’une stratégie fiscale au droit. Cette technique, principalement destinée à sécuriser les contribuables, ne produit pas d’information systématique, sauf sur les contribuables qui y ont recours. Certains États ont toutefois instauré des décisions par produit (product rulings), dont peuvent en retour se prévaloir tous les contribuables utilisant les produits concernés.
6. Les règles de communication de renseignements assorties de sanctions
La dénomination retenue ne traduit pas pleinement l’esprit de cette dernière catégorie de pratiques, qui consiste à réduire les pénalités applicables en cas d’abus de droit lorsque le contribuable révèle les détails du montage. Sous des formes différentes, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande appliquent ce type de règles.
L’OCDE constate qu’en dépit du caractère récent de ces différents dispositifs, et de leur diversité, « les expériences des pays qui ont développé des initiatives dans le domaine de la communication de renseignements ont été globalement positives et peuvent être utiles pour d’autres pays qui envisagent d’adopter des initiatives nouvelles ou de revoir des initiatives existantes » (130).
2. Des avancées ont eu lieu sur ce terrain en France, mais elles pourraient être utilement complétées
Si la France n’est pas citée dans les exemples retenus par l’OCDE, il ne faut cependant pas méconnaître les évolutions qui ont permis d’aller au-delà de la relation de base entre l’administration fiscale et les entreprises contribuables.
a. Les procédures de rescrit fiscal
Notre droit fiscal prévoit une forme de ruling, certes non généralisée, la procédure du rescrit. Il faut commencer par rappeler qu’en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), la doctrine de l’administration fiscale – incarnée notamment dans ses instructions (131) – lui est opposable. Ainsi, « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Cette garantie est étendue par l’article L. 80 B du LPF aux cas où l’administration a pris position sur la situation particulière d’un contribuable, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite : c’est la procédure dite du rescrit fiscal, qui permet à un contribuable de solliciter une position de l’administration sur un montage qu’il envisage de mettre en place.
En matière de fiscalité des entreprises multinationales, deux procédures sont spécifiquement prévues aux 6° et 7° de l’article L. 80 B du LPF :
– ces entreprises peuvent demander à l’administration fiscale l'assurance qu'elles ne disposent pas en France d'un établissement stable, qui les rendrait imposable ici en application de la convention liant la France à l’État de leur résidence ;
– les accords préalables de prix de transfert, qu’ils aient été conclus avec le contribuable ou avec l’autre État, sont opposables comme tout rescrit à l’administration (cf. encadré ci-après).
Les accords préalables de prix de transfert
Prévus par les lignes directrices de l’OCDE au rang des procédures amiables d’élimination des doubles impositions (132), les accords préalables de prix de transfert (APP) ont été introduits en droit national en 1999, par instruction fiscale (133). L’article 20 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2004 (134) a donné une portée législative à la procédure d’APP, en accordant à ces accords la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF).
Les entreprises recourant aux prix de transfert peuvent donc voir leurs transactions sécurisées, sans risque de remise en cause en cas de contrôle fiscal (sauf bien évidemment en cas de manœuvres frauduleuses ou de présentation incomplète ou erronée des faits au moment de la conclusion de l’accord).
L’objet des APP étant d’éliminer le risque de double imposition, ils sont en principe, presque par nature, conclus entre les deux États concernés, représentés par leurs administrations fiscales. Mais le 7° de l’article L. 80 B du LPF mentionne également les APP conclus avec le seul contribuable, donc l’entreprise. L’article 20 de la LFR 2004 a en effet donné à l’administration la possibilité de négocier et de conclure des APP unilatéraux.
Aux termes de l’instruction fiscale précisant les modalités d’application de cet article, « l’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale française qui garantit l’entreprise demanderesse que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupe n’entrent pas dans les prévisions d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts » (135).
N’engageant pas – par définition – l’autre État, l’APP unilatéral n’offre pas au contribuable les mêmes garanties qu’un APP bilatéral. Il est donc utile notamment lorsque il n’existe pas dans l’autre État de procédure d’accord préalable de prix ; mais l’administration est invitée à privilégier, chaque fois que cela est possible, la procédure bilatérale.
L’instruction précitée prohibe la conclusion d’un APP lorsque l’entreprise étrangère est située dans un État à fiscalité privilégiée avec lequel aucune convention fiscale n’a été conclue.
b. L’expérimentation d’une « relation de confiance »
Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, présenté le 6 novembre 2012 par le Premier ministre, comporte de nombreuses mesures destinées à accompagner notre pays sur le chemin de la croissance, dont le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui allègera, à terme, en régime de croisière, de 20 milliards d’euros par an l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Au rang de ces mesures figure une expérimentation de la « relation de confiance » à partir de mars 2013.
Le texte du Pacte définit ainsi, succinctement, les contours de cette expérimentation : « Les entreprises volontaires pour cette nouvelle relation de confiance pourront, en contrepartie d’une plus grande transparence comptable, avoir la vision la plus claire et rapide possible de la conformité des déclarations fiscales, évaluer rapidement après la clôture des comptes les incidences financières d’un éventuel supplément de charge fiscale et réduire le coût de gestion interne résultant d’une opération de contrôle » (136).
La relation de confiance
Dans un document de présentation du concept de relation de confiance, en date du 21 janvier dernier, la Direction générale des Finances publiques commence par confirmer que ce projet d’expérimentation s’inscrit bien dans la ligne, promue par l’OCDE, de l’ « enhanced relationship ». À cet égard, les Pays-Bas sont cités en exemple, avec le dispositif de supervision horizontale.
Conduite avec un nombre restreint d’entreprise volontaires, l’expérimentation de la relation de confiance doit reposer sur un principe central, celui de la revue fiscale : l’administration accompagne l’entreprise pendant le processus déclaratif et valide l’exercice, de façon informelle, dans un délai raisonnable suivant sa clôture (six mois en moyenne).
La relation de confiance doit reposer sur quelques principes clés, notamment la transparence, la disponibilité et le pragmatisme (l’administration devant notamment prendre en compte, dans son travail de revue, les motivations de compétitivité).
L’entreprise doit fournir à l’administration des informations claires et précises, lui permettant de connaître le traitement fiscal des principaux évènements affectant, au cours de l’exercice, la vie de l’entreprise. L’administration doit notamment être destinataire de la comptabilité analytique, des comptes consolidés lorsque l’entreprise est membre d’un groupe, des rapports des commissaires aux comptes.
L’entreprise bénéficie d’un accès prioritaire à la procédure de rescrit.
Les échanges entre l’administration et l’entreprise, nécessairement nombreux car c’est l’un des objectifs de la relation de confiance, se tiennent sous le sceau du secret et ne sauraient être utilisés dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Lorsque la revue ne fait apparaître aucun désaccord entre l’entreprise et l’administration, celle-ci s’engage « moralement » à ne pas engager de contrôle fiscal. À l’autre extrême, en cas d’échec du dialogue, chaque partie retrouve sa liberté, et entretient avec l’autre des relations régies par le cadre normatif classique.
Il est évidemment trop tôt pour porter un quelconque jugement sur la relation de confiance, dont l’expérimentation commence à peine. Lors de son déplacement aux Pays-Bas, la mission d’information a cependant pu constater que la supervision horizontale, dont s’inspire en partie la relation de confiance, n’est pas exempte de critiques (137). Mise en place en 2005 (138), elle repose sur trois principes : confiance mutuelle, transparence et compréhension réciproque. Une commission d’évaluation indépendante a remis en juin 2012 au secrétaire d’État aux Finances un rapport sur cette méthode, dont la version anglaise a pour titre Flexible when possible, strict where necessary. Si le rapport réaffirme l’intérêt de principe de la supervision horizontale, il rappelle également qu’elle n’est que l’un des moyens dont dispose l’administration : or, celle-ci a assez peu recours au contrôle fiscal traditionnel.
Faute de données exploitables, aucune corrélation statistique ne peut être établie entre mise en place de la supervision horizontale d’une part et faible recours au contrôle fiscal d’autre part. De plus, la culture fiscale des Pays-Bas est assez différente de la nôtre, ce qui limite la pertinence des comparaisons : les Pays-Bas affichent assez clairement leur volonté d’attractivité économique et fiscale qui, outre la supervision horizontale, se manifeste par l’importance des rulings (notamment en matière de prix de transfert), mais également par des dispositifs favorables aux entreprises multinationales (participation-exemption, absence de retenue à la source sur certains revenus passifs quittant le territoire
– cf. supra). Pour autant, les limites de la comparaison n’interdisent pas la vigilance : il ne faudrait pas que la mise en place de la relation de confiance – dont on peut à juste titre espérer qu’elle permette d’enrichir en amont le niveau d’information de l’administration – encoure à terme les mêmes critiques que la supervision horizontale néerlandaise.
c. Envisager une déclaration obligatoire des schémas d’optimisation
Nonobstant l’avenir de la relation de confiance, l’une des pistes qu’il pourrait être utile d’explorer est la communication à l’administration des schémas optimisants, soit par les contribuables eux-mêmes, soit par les intermédiaires, désignés dans la terminologie de l’OCDE sous le terme de promoteurs. Une obligation de ce type existe déjà aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa mise en œuvre pourrait être envisagée dans le cadre du développement des accords préalables, dont les principes viennent d’être évoqués.
Aux États-Unis, la section 6111 de l’Internal Revenue Code prévoit l’obligation, pour tout professionnel du conseil (material advisor), de déclarer à l’administration fiscale les schémas permettant à son client de réaliser une économie d’impôt, au-delà d’un certain seuil. Les reportable transactions devant ainsi être déclarées sont définies, par la section 6707 A, comme toute transaction identifiée par le ministre comme pouvant permettre l’évasion fiscale (139).
Au Royaume-Uni, depuis 2004, les schémas doivent également être déclarés, en application du dispositif dit DOTAS, pour Disclosure of Tax Avoidance Schemes (communication des schémas d’évitement fiscal). Un schéma doit être déclaré si l’économie d’impôt qu’il permet est l’un des principaux avantages qu’il procure, et s’il répond à certains critères (hallmarks) fixés par instruction (140).
L’obligation de déclaration repose essentiellement sur les promoteurs, marginalement sur les contribuables. Le rapport précité de l’OCDE de 2011 fait état des bons résultats obtenus par ce dispositif : 2 928 schémas ont été communiqués au cours des cinq premières années d’application, ce qui a donné lieu à 49 mesures anti-évasion, mesures qui auraient permis de réduire de 12 milliards de livres sterling les possibilités d’évasion (141).
Un projet similaire avait été envisagé par le Gouvernement français dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, puis finalement abandonné. L’obligation de déclaration aurait reposé sur les professionnels du conseil s’apprêtant à commercialiser un schéma d’optimisation, mais également sur les contribuables pour les schémas procurant un avantage de plus de 100 000 euros (142). Dans un rapport consacré en 2009 aux paradis fiscaux, la commission des Finances de l’Assemblée nationale avait formulé une proposition dans le même sens : « Créer, pour les professions juridiques et financières, une obligation de déclarer les montages réalisés pour leurs clients en lien avec les paradis fiscaux » (143). Plus récemment, la commission d’enquête du Sénat consacrée à l’évasion fiscale internationale a proposé de « prévoir la communication préalable à l’administration des « schémas d’optimisation fiscale » à forts enjeux » (144).
Les comparaisons internationales montrent que l’instauration d’une obligation de déclaration des schémas optimisants est possible. Pour qu’elle ne reste pas un vœu pieux, il ne faut sans doute pas méconnaître les difficultés pratiques qu’elle pose. De nombreuses questions doivent en effet trouver une réponse pour mettre en place un dispositif véritablement opérationnel : Qu’est-ce qu’un schéma optimisant ? À qui en confier la définition ? Faut-il une définition générique laissant à l’administration une liberté d’interprétation, ou bien au contraire une liste limitative de schémas identifiés ? Sur qui faire peser l’obligation de déclaration ? Si elle pèse sur les promoteurs, comment les définir précisément ? Ces difficultés objectives ne doivent toutefois pas bloquer toute initiative en ce sens. Précédée d’une large concertation qui permettrait de répondre aux questions techniques soulevées, l’obligation de communication préalable des schémas les plus optimisants doit être envisagée.
Proposition n° 10 : Au terme d’une démarche concertée, rendre obligatoire la communication préalable à l’administration fiscale des schémas d’optimisation procurant un avantage fiscal substantiel, et promouvoir parallèlement un recours plus fréquent à la procédure de rescrit.
II. LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉFLEXION INTERNATIONALE POUR MODIFIER LES PRINCIPES D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES
A. LA REFONTE DU « RÉSEAU CONVENTIONNEL » EST L’OBJECTIF À ATTEINDRE
Les développements qui précèdent aboutissent en réalité à une même conclusion : la souveraineté fiscale de l’État s’érode, même s’il est impossible d’apprécier l’ampleur du phénomène.
Le pouvoir traditionnel légitimement reconnu à la puissance publique d’imposer la richesse produite sur son territoire est de plus en plus difficile à exercer. Ses assises classiques, largement héritées d’une époque où chaque État pouvait se penser et agir de manière autonome, se révèlent globalement inadaptées face à la mondialisation de l’économie, à l’ouverture et à l’interpénétration des marchés nationaux, à la dématérialisation croissante des échanges, au raccourcissement du temps, à la contraction de l’espace, à la diversité des régimes juridiques nationaux et à leur complexification croissante, au changement d’échelle des entreprises dont certaines deviennent de véritables sociétés-continents dotées de moyens et d’une influence considérables.
À ce constat s’ajoute une considération d’ordre plus général encore. Le temps de la démocratie n’est pas le temps de l’économie de marché. Ce qui caractérise le marché global à l’heure des technologies de la communication c’est l’extrême rapidité, voire l’instantanéité. Dans notre nouvelle économie, deux étudiants d’une vingtaine d’années peuvent créer une entreprise sur leur campus universitaire, l’introduire en bourse moins de six ans plus tard, et voir sa valeur atteindre plus de 200 milliards de dollars après seulement deux ans de cotation. La démocratie suppose des débats, parfois longs, et le respect de procédures contraignantes mais indispensables.
Dans le domaine de la lutte contre l’optimisation fiscale transnationale, un État seul sera impuissant ou, au mieux, condamné à adopter des mesures de correction marginales. La problématique étant internationale, les solutions apportées doivent être globales et s’inscrire dans le cadre de négociations multilatérales dont la principale caractéristique n’est pas toujours la célérité.
L’enjeu ici est celui de la reterritorialisation de la base imposable à l’IS. Il s’agit d’une question de politique publique déterminante, pour les pays industrialisés exportateurs de capitaux tels que la France, comme pour les pays en développement.
1. La conclusion d’une convention fiscale multilatérale représente un idéal qui se heurte à plusieurs obstacles
La perspective d’amener les États à conclure une convention fiscale multilatérale n’est pas nouvelle. Les difficultés à y parvenir non plus. L’OCDE le rappelait encore en 2010 : « lors du projet d’élaboration du Projet de Convention de 1963 et du Modèle de Convention de 1977, le Comité des affaires fiscales avait examiné la possibilité de conclure une convention fiscale multilatérale et il était parvenu à la conclusion que cela soulèverait de grandes difficultés » (145).
L’organisation concluait sur une note où le pessimisme le disputait à une certaine résignation, estimant que, en dépit de l’existence de conventions multilatérales régionales (146), « rien ne permet de croire que la conclusion d’une convention fiscale multilatérale applicable à tous les pays membres soit actuellement une solution réalisable. Le Comité estime donc que les conventions bilatérales constituent encore un meilleur moyen d’éviter la double imposition au niveau international. » (147).
S’il ne faut pas faire preuve de naïveté et s’il convient de rester conscient des limites de l’exercice, il n’y a pas pour autant lieu de rejeter a priori cette hypothèse de travail, qui constitue une sorte d’optimum de premier rang dans la lutte contre l’optimisation fiscale agressive.
Par ailleurs, le moment politique semble plus propice que jamais à une réactivation de telles négociations. La récente médiatisation des schémas d’optimisation les plus massifs a reçu un large écho auprès du grand public, les États constatant que leurs intérêts – sinon les solutions avancées – étaient convergents en la matière et tendaient vers le même but : reconstituer leur base fiscale.
L’élaboration d’une convention « universelle » qui « écraserait » les conventions bilatérales supposerait toutefois de redéfinir les principes actuels en favorisant davantage le pouvoir d’imposer de l’État de la source (148). Une meilleure prise en compte de l’État source permettrait en effet de rapprocher la réalité fiscale d’une activité de sa réalité économique. Dans certains secteurs (économie numérique par exemple), la France tirerait sans doute profit de ce rééquilibrage. Mais au total, il n’est pas certain que notre pays en retirerait un surplus fiscal net, ce changement de la géographie fiscale pouvant aussi conduire à redistribuer la localisation de bénéfices actuellement imposés en France selon le principe de résidence.
Plus généralement, si tous les États confrontés à l’optimisation fiscale agressive visent le même résultat, les intérêts nationaux portés par chacun d’eux divergent assez sensiblement. Il existe en particulier une différence entre les pays industrialisés et les pays en développement. Schématiquement, les premiers, dont les grandes entreprises ont réussi à s’établir et à se développer hors du territoire national, restent attachés au principe de l’imposition dans le pays d’implantation du groupe, même si la question des actifs immatériels peut les amener à relativiser cette position ; les seconds, qui accueillent souvent les filiales des groupes multinationaux originaires des pays industrialisés – notamment dans certains secteurs tels que l’exploitation de matières premières (149) – militent davantage pour le principe d’imposition au niveau du pays source de l’activité économique. Il faut néanmoins garder en tête que la portée et les conséquences de l’imposition selon le principe de la source sont, la plupart du temps, singulièrement réduites du fait de l’existence de régimes de consolidation permettant la remontée des produits au niveau de la mère, souvent implantée dans un pays industrialisé.
2. La renégociation des conventions bilatérales est un travail de longue haleine
Une autre alternative, en apparence moins ambitieuse mais guère moins complexe, consisterait pour chaque État à réviser les conventions fiscales bilatérales qui le lient à ses partenaires afin de les adapter aux mutations économiques (sur le cas particulier de l’économie numérique, cf. infra) et aux comportements d’évitement fiscal les plus problématiques : prise en compte de la dématérialisation croissante des actifs, traitement des entités et produits hybrides, régulation de prix de transfert, lutte contre le treaty shopping par un alignement des conventions, etc.
L’ampleur de la tâche – il existe environ 3 000 conventions bilatérales à ce jour – rend cependant cette perspective improbable à moyen terme.
Proposition n° 11 : Soutenir les démarches internationales tendant à la renégociation des conventions fiscales bilatérales.
3. À plus court terme, il convient d’envisager la redéfinition de la notion d’établissement stable, devenue obsolète du fait de la numérisation de l’économie
L’idée générale évoquée par la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économique numérique (150) consiste à redéfinir le concept d’établissement stable, qui permet à l’État de la source d’imposer les bénéfices réalisés sur son territoire.
Rappelons qu’aux termes de l’article 5 du Modèle OCDE, ce concept se définit comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Il suppose donc, en règle générale, une présence physique sur le territoire en question (151). Or un tel critère apparaît manifestement inadapté à l’économie numérique, dont les seules implantations physiques peuvent se borner, par exemple, à quelques serveurs établis à des milliers de kilomètres du bénéficiaire du service rendu (mise à disposition d’un moteur de recherche par exemple), bénéficiaire qui génère en réalité le revenu de la société.
En d’autres termes la présence économique de l’entreprise sur un territoire peut être totalement décorrélée de toute présence physique. De fait, ainsi que le rappelle l’OCDE, si un serveur peut effectivement constituer une « installation fixe d’affaires », un logiciel ou un algorithme, purement immatériels, ne peuvent aujourd’hui être considérés comme des établissements stables (152).
Afin de favoriser une meilleure appréhension de la problématique du numérique par le droit fiscal, les rapporteurs de la mission précitée estiment qu’ « il pourrait être considéré qu’une entreprise qui fournit une prestation sur le territoire d’un État au moyen de données issues du suivi régulier et systématique des internautes sur le territoire de cet État doit être regardée comme y disposant d’un établissement stable virtuel » (153).
La création de la notion d’établissement stable virtuel impliquerait vraisemblablement une modification du Modèle OCDE, puis une renégociation des conventions bilatérales (cf. supra). En effet, comme le rappelle la mission, la seule refonte du concept de l’établissement stable ne suffira pas en tant que telle à rétablir le pouvoir d’imposer des États concernés. Elle devra être complétée par des mécanismes d’attribution géographique des bénéfices dégagés par la société en fonction de la contribution des consommateurs-utilisateurs de chaque État à la réalisation de ces bénéfices.
Concrètement, il s’agirait de diviser le bénéfice mondial en autant de quotes-parts nationales attribuées aux États en proportion de l’importance économique de chacun dans l’activité de l’entreprise. Cela supposerait, au préalable, de redéfinir « la contribution respective des différents facteurs de production à la création de valeur dans l’économie numérique » (154) et notamment de considérer « la capacité de mobilisation des utilisateurs et de collecte de données comme l’équivalent d’un actif qui serait nécessairement rattaché à l’établissement stable sur le territoire et dont la contribution devrait être rémunérée à sa juste valeur » (155).
Toutefois, de l’aveu même des auteurs du rapport, « une telle démarche peut sembler aussi ambitieuse que juridiquement fragile » (156). Il ne faut en effet pas ignorer l’ampleur de la tâche, y compris dans ses modalités purement pratiques de mise en œuvre (cf. infra).
Proposition n° 12 : Dans le cadre de la renégociation des conventions fiscales bilatérales, promouvoir la définition par l’OCDE du concept d’établissement stable virtuel.
4. Ces questions font désormais l’objet d’une attention particulière du G8 et du G20.
Si la perspective d’une seule et unique convention multilatérale partagée par l’ensemble des États semble encore lointaine, les pays les plus volontaristes et les plus concernés par l’optimisation fiscale agressive pourraient tenter d’aboutir à des résultats analogues sur une base plus restreinte. De fait, si les États membres du G8 (157) soutenaient fortement une telle initiative, il ne fait nul doute qu’ils initieraient un élan décisif pour la résolution de ce problème au niveau international. À cet égard, les conclusions du G8 organisé le 18 juin dernier en Irlande du Nord (Lough Erne) invitent à un optimisme certes mesuré, mais réel.
Les principales conclusions du G8 de Lough Erne sur l’optimisation fiscale*
« 3. Concernant l’optimisation fiscale, nous soutenons le travail de l’OCDE visant à lutter contre les phénomènes d’érosion de la base fiscale et de transfert de bénéfices. Nous travaillerons à créer un modèle commun afin que les multinationales communiquent aux autorités fiscales les lieux où elles réalisent leurs profits et les lieux où elles acquittent leurs impôts. Nous aiderons les pays en voie de développement à collecter les taxes qui leur sont dues, en leur garantissant l’accès aux informations fiscales internationales dont ils auraient besoin. Nous sommes convenus de publier des Plans d’Action nationaux pour rendre disponibles les informations de nature à révéler l’identité des réels propriétaires et bénéficiaires des entreprises et des trusts auprès des administrations fiscales et des autorités chargées de faire appliquer la loi, par exemple grâce à la mise en place de registres centraux recensant les liens de propriété véritables des entreprises. […]
24. Nous saluons le travail de l’OCDE relatif à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et insistons sur la nécessité que l’OCDE développe un plan d’action complet et ambitieux à l’attention des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales qui participeront au G20 de juillet. Nous attendons avec intérêt les recommandations de l’OCDE et nous engageons à prendre toute mesure individuelle et collective nécessaire. Nous sommes convenus de travailler ensemble pour résoudre le problème d’érosion de la base fiscale et du transfert de bénéfices, et pour nous assurer que ni les règles fiscales internationales, ni nos propres règles fiscales ne permettent ni n’encouragent une quelconque entreprise multinationale à réduire sa charge fiscale globale en transférant de manière artificielle ses profits au sein de juridictions à fiscalité privilégiée. Les travaux en cours de l’OCDE se traduiront par un engagement continu de toutes les parties intéressées, y compris les pays en voie de développement. »
*2013 Lough Erne G8 Leaders' Communiqué. Traduction de la commission des Finances
L’OCDE avait été invitée par le G20 réuni au Mexique en 2012 à contribuer à la réflexion sur les modalités de répartition du pouvoir d’imposition des États. Les ministres des Finances français, allemand et britannique (Pierre Moscovici, Wolfgang Schäuble et George Osborne) furent les fers de lance de cette initiative. La prochaine réunion des ministres des Finances du G20 à Moscou, en juillet prochain pourrait constituer une tribune de choix pour débattre de ce sujet puisque l’OCDE y présentera officiellement le plan d’action évoqué dans le rapport BEPS.
5. La Commission européenne porte également des initiatives en ce sens
En novembre 2011, la Commission européenne a publié une communication relative à la double imposition au sein du marché unique (158), annonçant qu’elle engagerait des mesures concrètes à ce sujet et qu’elle lancerait, parallèlement, une procédure de consultation publique afin de recueillir des éléments relatifs au phénomène de double non-taxation.
Thèmes de la consultation organisée par la Commission européenne
entre février et mai 2012
– les différences de traitement juridique et fiscal, au sein du marché commun, d’une même entité (problématique des entités hybrides)
– les différences de traitement juridique et fiscal d’un même instrument financier (problématique des produits hybrides)
– l’application des conventions fiscales d’élimination de double imposition pouvant conduire à une double non-imposition
– les prix de transfert et les accords préalables unilatéraux
– les transactions avec des entreprises liées implantées dans des pays à fiscalité faible ou nulle
– le financement par l’emprunt d’un revenu exonéré d’impôt
– le traitement différencié des revenus passifs (redevances par exemple) et actifs
– les conventions d’élimination de double imposition signées avec des pays tiers
– la transparence
Au total la Commission a enregistré 25 contributions seulement, émanant de l’OCDE, d’entreprises, de professionnels du droit (avocats fiscalistes notamment), d’ONG, ainsi qu’une contribution anonyme. Prétendre que cette consultation a permis d’affiner l’analyse serait sans doute enjoliver excessivement la réalité. Comme le reconnaît la Commission, les contributeurs ont généralement soit éprouvé des difficultés à avancer des exemples concrets de double non-taxation (ONG), soit évité de fournir des réponses aux questions spécifiquement posées (entreprises).
En conclusion de ce travail, la Commission a toutefois décidé de poursuivre cette initiative en envisageant la publication d’une communication relative à la bonne gouvernance en matière de fiscalité, sur les paradis fiscaux et la planification fiscale agressive.
De fait, le 6 décembre dernier, la Commission a publié une recommandation relative à la planification fiscale agressive (159). Constatant qu’ « afin de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’engager tous les États membres à adopter la même approche générale vis-à-vis de la planification fiscale agressive, ce qui permettrait d’atténuer les distorsions existantes » (160), et qu’il est « nécessaire de remédier aux situations dans lesquelles un contribuable tire des avantages fiscaux en organisant la gestion de ses affaires fiscales de telle manière que les revenus ne sont imposés par aucune des juridictions fiscales concernées » (161), elle formulait deux recommandations principales aux États membres.
D’une part, il conviendrait de parer aux risques de double non-imposition : lorsque les États de l’Union européenne (UE) s’engagent à ne pas imposer un revenu en application d’une convention d’élimination de double imposition, ils devraient s’assurer qu’un tel engagement ne s’applique que lorsque ce revenu est effectivement soumis à l’imposition dans l’autre État partie à ladite convention, y compris lorsque cet État est également membre de l’UE. À cet effet, la Commission encourage les États membres à inclure dans leurs conventions une clause ainsi rédigée : « Lorsque la présente convention prévoit qu’un élément de revenu n’est imposable que dans un des États contractants ou qu’il peut être imposé dans un de ces États, il est interdit à l’autre État contractant d’imposer cet élément uniquement si l’élément en question est soumis à l’imposition dans le premier État contractant. » (162).
Proposition n° 13 : Prévoir dans les conventions bilatérales une « clause de sauvegarde fiscale », tendant à s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source.
D’autre part, la Commission encourage l’adoption d’une règle anti-abus générale commune, les États membres étant invités à introduire dans leur législation nationale une disposition ainsi formulée : « Les montages artificiels ou ensembles artificiels de montages mis en place essentiellement dans le but d’éviter l’imposition et conduisant à un avantage fiscal sont ignorés. Aux fins de la fiscalité, les autorités nationales traitent ces montages sur la base de leur réalité économique. » (163).
La Commission entend donc faire primer la substance économique réelle sur la forme juridique d’un acte. La Commission incite les États à ignorer les montages qui visent « essentiellement » – et non pas « exclusivement » comme c’est le cas dans le cadre de la procédure d’abus de droit français – à éluder l’impôt. Cette piste fait écho à la proposition n° 1 du présent rapport, formulée supra s’agissant de la réforme de la procédure d’abus de droit.
La Commission prend date avec les États membres en leur demandant de l’informer des « mesures prises afin de se conformer à la présente recommandation ainsi que des modifications apportées à ces mesures » (164).
Elle envisage pour sa part la révision de plusieurs directives relatives à l’imposition des revenus passifs, afin de mettre en œuvre les principes de sa recommandation : la directive « Mère-fille » (165), la directive « Fusions » (166) et la directive « Intérêts et redevances » (167) dite « intérêts et dividendes ».
Résumée à grands traits, cette dernière directive (168) pose le principe d'une dispense de retenue à la source sur les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées implantées dans plusieurs États membres de l’UE (169). Or, à l’heure actuelle et contrairement aux recommandations précitées de la Commission de 2012, cette directive ne conditionne pas l’exonération d’un élément de revenu dans l’État source à l’imposition de ce même élément dans l’État destinataire.
Proposition n° 14 : Encourager les initiatives de la Commission européenne tendant à réformer les directives relatives aux revenus passifs afin de s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source.
B. LES ALTERNATIVES À LA RENÉGOCIATION DES CONVENTIONS POTENTIELLES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES AVEC PRUDENCE
● Du fait de la sophistication croissante des stratégies d’optimisation fiscale développées par les entreprises, et des conséquences qu’elles emportent, des réflexions sont conduites sur la possibilité d’un changement radical des modalités d’imposition des bénéfices, changement qui aurait d’autant plus de sens qu’il serait conduit au niveau mondial.
Désigné sous le terme anglais de formulary apportionment (FA), que l’on pourrait traduire approximativement par « répartition forfaitaire », ce changement consisterait :
– à unifier les modalités de calcul de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices ;
– puis à calculer, pour chaque entreprise, l’assiette mondiale de ses bénéfices ;
– ensuite à déterminer une clé de répartition (170) de ces bénéfices par État (en fonction d’un ensemble de critères en principe objectifs comme par exemple le chiffre d’affaires, la main d’œuvre employée et les actifs corporels) ;
– et enfin à donner à chaque État le pouvoir d’imposer, selon son taux national, les bénéfices ainsi localisés sur son territoire.
La méthode FA est présentée comme un moyen de contrer les effets d’attrition des bases fiscales produits par l’optimisation : en supprimant le besoin de règles d’encadrement des prix de transfert – règles devenues obsolètes du fait des mutations de l’économie –, elle permet de restaurer la capacité d’imposition des États. Entre autres soutiens de cette méthode, l’économiste américaine Joann M. Weiner résume de manière claire les vertus attendues du FA (cf. encadré ci-après).
Extraits de l’article « Il est temps d’adopter Formulary Apportionment »,
publié en 2009 sur le site www.taxanalysts.com par Joann M. Weiner*
« La méthode de pleine concurrence est le reflet d’une époque où les entreprises livraient des biens matériels, rendaient des services physiquement, et conduisaient leurs activités grâce à des structures entrepreneuriales simples. Cette époque est terminée depuis longtemps. […]
Avec FA, la responsabilité fiscale d’une société dépend de son activité opérationnelle dans un pays, pas du revenu qu’elle attrait dans ce pays. Si une société a des employés, un chiffre d’affaires et des usines dans un pays, non seulement elle y a un revenu, mais elle y a également une responsabilité fiscale, nonobstant ce qu’indiquent ses prix de transfert internes. »
*Traduction par la commission des Finances
Formulary apportionment est assez logiquement soutenu par les pays émergents, comme le relève le rapport précité de l’IGF sur les prix de transfert : « en marge de l’OCDE, certains pays émergents, tels le Brésil ou l’Inde, commencent à faire valoir le principe de l’allocation forfaitaire pour s’écarter du principe de pleine concurrence dans leur appréhension des transactions réalisées sur leur territoire et la détermination de leur pouvoir d’imposer » (171).
La méthode est retenue aux États-Unis, pour déterminer la répartition des bénéfices par État fédéré. La difficulté à identifier les profits réalisés au sein de chacun des 50 États serait le principal facteur expliquant le recours à la répartition forfaitaire, supposée plus objective et moins sujette à manipulation que l’application du principe de libre concurrence (qui correspond à la méthode des prix de transfert). Symétriquement, la difficulté à attribuer correctement aux pays la capacité d’imposer les bénéfices militerait en faveur de l’instauration au niveau mondial de la même méthode.
● L’enthousiasme que peut spontanément susciter Formulary apportionment, simple dans son principe et sans doute louable dans son objet, ne doit pas conduire à méconnaître les difficultés qu’il pose et les défauts dont il peut souffrir.
Formulary apportionment ne ferait pas disparaître ipso facto les prix de transfert, et les stratégies d’optimisation qu’ils peuvent permettre. La logique fondamentale de l’optimisation, consistant à essayer de localiser les profits dans les États les moins taxateurs, ne serait pas totalement éliminée par cette méthode. En effet, les entreprises multinationales pourraient procéder à des réorganisations d’ensemble tendant à localiser les éléments entrant dans la clé de répartition dans les États dont le taux d’impôt est le plus faible. À l’extrême, comme le relève l’économiste américain Emil M. Sunley, la méthode pourrait être facteur de concurrence fiscale entre les États (cf. encadré ci-après).
Extrait de l’article « Avantages et inconvénients de Formulary apportionment »,
publié en 2002 sur le site www.cesifo-group.de par Emil M. Sunley*
« Formulary apportionment pourrait accroître la concurrence fiscale et conduire à une manipulation des bases taxables […].
Formulary apportionment n’éliminera pas les problèmes de prix de transfert si le chiffre d’affaires ou la valeur ajoutée font partie des critères retenus dans la clé de répartition. Si l’impôt sur les sociétés est administré là où le groupe a son siège social, l’État de résidence voudra que ses entreprises maximisent la valeur ajoutée (ou le chiffre d’affaires) sur son territoire. Cela pourrait être réalisé en sous-estimant le prix des matières brutes et autres achats aux entreprises liées, et en sur-estimant le prix des ventes à ces mêmes entreprises. »
*Traduction par la commission des Finances
Par ailleurs, en l’état de la réflexion, la méthode FA ne règle pas complètement la question posée par l’économie numérique, et plus généralement par la dématérialisation de l’activité économique. Pour reprendre l’exemple de Google, longuement développé précédemment, l’application de Formulary apportionment aurait, schématiquement, les conséquences suivantes : l’activité de Google hors États-Unis serait taxée essentiellement là ou est enregistré le chiffre d’affaires (les ventes d’espaces publicitaires aux annonceurs), là où est installé le personnel et là où sont localisés les actifs matériels. L’activité de Google reposant quasi-exclusivement sur l’exploitation d’actifs immatériels, le troisième facteur est ici négligeable. Les deux premiers, eux, sont très concentrés en Irlande, dans des proportions sans commune mesure, s’agissant du chiffre d’affaires, avec la présence dans cet État des annonceurs à l’origine dudit chiffre d’affaires.
Enfin, et peut-être surtout, le succès d’une telle méthode de répartition de la capacité d’imposer est vraisemblablement subordonné à son improbable application universelle. Comme on l’a vu, l’optimisation résulte pour beaucoup des différences entre les régimes fiscaux des États. Or, la méthode FA suppose de gommer l’essentiel de ces différences, notamment par la définition d’une assiette commune, ce qui revient à abandonner une prérogative centrale attachée à la souveraineté nationale. Même si les assiettes pouvaient s’harmoniser à l’échelle mondiale – et l’on peut écrire sans crainte de se tromper qu’il s’agit à ce jour d’une vue de l’esprit –, les différences de taux rendraient encore possibles des stratégies d’optimisation, certes moins subtiles. Enfin, la mise en place de Formulary apportionment par des États isolés serait vraisemblablement sans effet : elle produirait en effet mécaniquement des doubles impositions, qui devraient être neutralisées par voie de convention bilatérale, faute de quoi les migrations d’entreprises pour raisons fiscales ne se feraient pas attendre.
b. La proposition de directive ACCIS
● Promue au niveau mondial de manière éparse et encore assez théorique, la méthode Formulary apportionment connaît une déclinaison plus concrète au niveau de l’Union européenne, grâce à la proposition de directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), formulée le 16 mars 2011 par la Commission européenne, au terme d’un processus de réflexion amorcé 10 ans plus tôt, dès 2001 (172).
La proposition de directive offre aux sociétés constituées en groupe (173) au sein de l’Union européenne une option (174) pour une assiette commune et consolidée d’IS, se substituant à l’assiette définie par application des règles nationales. Il ne s’agit donc pas d’harmoniser les assiettes des 27 États membres, mais de créer une assiette alternative, commune à ces États.
L’assiette est dite « consolidée » car les entreprises ayant opté en sa faveur pourraient calculer leur assiette imposable à l’échelle de l’UE. Aujourd’hui, un groupe disposant d’un établissement stable dans deux États membres acquitte l’impôt dans chacun de ces États, selon les règles d’assiette qui y sont applicables, et sans pouvoir imputer les pertes réalisées dans un État sur les bénéfices réalisés dans l’autre. Un groupe optant pour ACCIS pourrait en revanche faire masse de ses profits et de ses pertes, avant de calculer l’impôt. ACCIS s’approche donc, mutatis mutandis, à l’échelle européenne, du régime français désormais supprimé du bénéfice mondial consolidé (cf. supra).
Ainsi consolidée, l’assiette serait ensuite répartie entre les États membres sur la base de critères économiques : un tiers pour les immobilisations corporelles (175), un tiers pour le chiffre d’affaires (176) (hors opérations intragroupe) et un tiers pour la main d’œuvre (appréciée pour moitié au regard du nombre de salariés et pour moitié au regard de la masse salariale brute).
Une fois l’assiette répartie selon cette clé, les taux nationaux – dont la proposition de directive ne prévoit pas l’harmonisation – seraient appliqués aux quotes-parts nationales de l’assiette européenne.
Le groupe optant pour ACCIS verrait l’ensemble de son dossier fiscal traité par une seule administration, celle de l’État de résidence de la société tête de groupe.
● La France soutient la démarche ACCIS, tout en regrettant son caractère optionnel. Ce tempérament se fonde sur des considérations budgétaires : en effet, si les études conduites jusqu’alors ne permettent pas d’évaluer de manière fiable les conséquences fiscales pour la France, il serait néanmoins assez logique que les entreprises optant pour l’ACCIS en espèrent, au-delà d’une simplification de la gestion de leur fiscalité, une moindre charge d’impôt.
Si d’autres grands États soutiennent la démarche, au premier rang desquels l’Allemagne, d’autres la rejettent, notamment le Royaume-Uni. Une troisième catégorie d’États, comme par exemple les Pays-Bas, soutient le principe de l’assiette commune mais pas celui de la consolidation, les trois critères retenus étant objectivement défavorables aux États dont l’attractivité économique repose pour beaucoup sur des actifs immatériels. Les perspectives d’aboutissement à court terme d’ACCIS, dont l’adoption nécessite l’unanimité au Conseil, sont donc faibles à ce jour, même s’il ne faut pas insulter l’avenir (177). Cela ne doit pas empêcher la France et ses principaux partenaires de réfléchir à une harmonisation de leurs bases taxables, qui pourrait in fine s’inscrire dans la démarche ACCIS.
Proposition n° 15 : Lancer une réflexion avec nos principaux partenaires européens sur une harmonisation des bases de l’impôt sur les sociétés, pouvant déboucher sur une coopération renforcée en lien avec la mise en œuvre d’ACCIS.
● Il faut, pour terminer, signaler que si ACCIS constitue potentiellement un moyen de limiter les stratégies fiscales au sein de l’Union européenne, et que si la proposition de directive n’est pas dépourvue de références à cet objectif (178), celui-ci n’est pas présenté comme le principal. Les préoccupations de simplification et d’allègement des charges des entreprises apparaissent en effet comme primordiales.
L’exposé des motifs de la proposition de directive commence ainsi par les deux phrases suivantes : « L’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) a pour objectif de lutter contre les principales entraves fiscales à la croissance dans le marché unique. En l’absence de règles communes en matière d’impôt sur les sociétés, l’interaction des régimes fiscaux nationaux entraîne souvent une surimposition et une double imposition des entreprises qui, en outre, doivent supporter de lourdes charges administratives et des coûts élevés pour se conformer à la législation fiscale ».
2. Les alternatives sectorielles : le numérique
a. Les taxes spécifiques envisagées par le Président de la commission des Finances du Sénat
● La spécificité de l’économie numérique et des questions fiscales qu’elle soulève ont conduit à une réflexion nourrie au niveau parlementaire, conduite pour l’essentiel jusqu’ici par Philippe Marini, Rapporteur général puis Président de la commission des Finances du Sénat.
En 2010, dans un rapport consacré aux conséquences du développement du commerce électronique sur les finances publiques (179), il proposait notamment la création d’une taxation sur la publicité en ligne et d’une taxation sur le commerce électronique.
Quelques mois plus tard, à l’initiative du même auteur, l’article 27 de la loi de finances pour 2011 (180) avait prévu d’instaurer une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne, due par tout preneur établi en France, et égale à 1 % du montant de la prestation. Cette taxe – dite « taxe Google » –, dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er juillet 2011, a été supprimée par l’article 19 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (181), le Gouvernement considérant qu’elle manquait sa cible. De fait, elle n’affectait pas les prestataires (tels Google), mais les annonceurs, et seulement ceux établis en France (tels les Pages Jaunes).
Un autre amendement au projet de loi de finances pour 2011, adopté par la commission des Finances du Sénat puis retiré en séance publique, proposait de créer une taxe sur le commerce électronique (Tascoé) (182). Due par le preneur, établi en France, de biens ou services en ligne, il était proposé que la taxe soit assise sur le montant des dépenses engagées pour l’achat de biens ou services par voie électronique, au-delà d’un seuil annuel de 460 000 euros, au taux de 0,5 %.
Dans sa proposition de loi pour une fiscalité neutre et équitable, déposée en juillet 2012 (183), Philippe Marini, devenu Président de la commission des Finances, a ensuite proposé :
– une nouvelle version de la taxe sur la publicité en ligne, due cette fois-ci par les régies publicitaires françaises comme étrangères (dont par exemple la régie de Google Ireland Ltd, ce qui vaut à ce dispositif le surnom de « taxe Google 2.0 »). Assise sur les sommes payées par les annonceurs, son taux serait de 0,5 % pour la fraction de l’assiette comprise entre 20 et 250 millions d'euros, et de 1 % au-delà ;
– une nouvelle version de la taxe sur le commerce électronique, due cette fois-ci par les vendeurs ou loueurs de biens ou services en ligne, établis en France ou à l’étranger. La taxe frapperait, au taux de 0,25 %, le chiffre d’affaires au-delà d’un seuil annuel de 460 000 euros ;
– de manière plus accessoire, une extension de la taxe sur la fourniture de vidéogrammes à la demande (VOD) (184) aux acteurs d’Internet établis hors de France.
Afin de s’assurer du caractère recouvrable de ces taxes lorsque les redevables sont situés à l’étranger, cette dernière proposition de loi prévoit pour ces personnes une obligation de déclaration d’activité en France :
– soit par la désignation d’un représentant fiscal, chargé de s’acquitter en France des obligations fiscales de la personne juridique qu’il représente ;
– soit en optant pour le régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique, sur le modèle prévu en matière de TVA par l’article 298 sexdecies F du CGI (185).
● La proposition de loi a été examinée par la commission des Finances du Sénat le 23 janvier dernier, sur le rapport de notre collègue Sénateur Yvon Collin (186).
S’agissant tout d’abord du volet procédural, le rapport constate que l’obligation de désignation d’un représentant fiscal est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (187), qui a jugé en 2011 qu’une obligation générale en ce sens, disproportionnée à l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale, contrevient à la liberté de circulation des personnes et des capitaux. Pour sa part, la mise en place d’un régime spécial de déclaration serait, selon les informations recueillies auprès de l’administration, lourde et complexe.
Sur le volet proprement fiscal, les deux taxes proposées, malgré les améliorations apportées aux premières versions, encourent le même type de critiques :
– elles risquent d’être répercutées sur les annonceurs eux-mêmes, et donc de « rater leurs cibles », à savoir les régies publicitaires ou les vendeurs et prestataires en ligne ;
– ce risque est d’autant plus grand que les redevables des taxes sont en position dominante sur leur marché ;
– en conclusion, les entreprises françaises se verraient donc pénalisées par ces taxes, supportées par les géants d’Internet sans nuire à leur avantage compétitif. Les taxes « Google » et « Amazon » risqueraient donc de se transformer en taxes « Les Pages Jaunes » et « La Redoute ».
Pour ces motifs, la commission des Finances a adopté une motion de renvoi en commission. Ce renvoi a été confirmé en séance publique le 4 avril dernier, afin de permettre à cette proposition de loi de poursuivre sa maturation, afin d’en perfectionner les dispositions.
b. La taxe « prédateur-payeur » envisagée par la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique
La mission d’expertise précitée sur la fiscalité de l’économie numérique, conduite par Pierre Collin et Nicolas Colin, fait sensiblement la même analyse des taxes sectorielles proposées par Philippe Marini. La principale proposition de ce rapport est plus générale, puisqu’il s’agit de redéfinir le concept d’établissement stable, pour prévoir dans les conventions fiscales bilatérales une notion d’établissement stable virtuel, permettant à l’État de la source d’imposer sur son territoire les entreprises du numérique (cf. supra). Constatant qu’une telle proposition se décline nécessairement à moyen ou long terme, compte tenu du travail de définition et des négociations internationales qu’elle implique, le rapport propose, dans l’intervalle, d’instaurer une fiscalité spécifique.
Les auteurs considèrent que seules les données peuvent constituer une assiette satisfaisante pour une fiscalité spécifique aux entreprises de l’économie numérique. Il s’agit là d’une approche très novatrice, qui pose à l’évidence de nombreuses difficultés pratiques, la première d’entre elles étant la capacité à identifier et quantifier ces données. Avec un optimisme certain, et sans proposer d’estimation du coût administratif de leur préconisation, les auteurs du rapport recommandent que l’administration fiscale suive toutes les bases de données accessibles (y compris les fiches entreprises de Wikipédia), en espérant le développement prochain de cabinets d’intelligence économique susceptibles de retracer les transactions fondées sur ces données, ainsi que leur valorisation.
Cette taxe spécifique serait assise sur les données collectées par toute entreprise, quel que soit son État d’établissement, auprès d’utilisateurs localisés en France. Seules les données correspondant au « travail gratuit » (188) fourni par les utilisateurs seraient concernées ; par analogie avec le droit de l’informatique et des libertés, le rapport propose de retenir les données issues du suivi régulier et systématique de l’activité des utilisateurs. La taxe ne s’appliquerait qu’au-delà d’un seuil, exprimé en nombre d’utilisateurs (afin de préserver le développement des start-ups).
La taxe n’aurait pas vocation à produire un rendement budgétaire massif, mais à encourager un usage des données conforme à des objectifs, que le rapport ne définit pas dans le détail mais qui pourraient être notamment le renforcement de la protection des libertés individuelles ou l’accès à de nouveaux services. Fonctionnant sur un modèle « prédateur-payeur », la taxe reposerait sur un tarif unitaire « déterminé en fonction du positionnement de l’entreprise sur une grille de comportement au regard des objectifs poursuivis par l’imposition » (189).
Les modalités précises de cette taxe devraient vraisemblablement être affinées. Le rapport propose d’ailleurs qu’elle revête, dans un premier temps, un caractère expérimental. Dans son rapport précité, le Sénateur Yvon Collin constate également que « cette proposition de taxation de la collecte et de l’utilisation des données n’est toutefois pas immédiatement opérationnelle et transposable sur le plan législatif » (190). Plus généralement, il adresse à cette proposition une série de questions et de critiques auxquelles le Rapporteur adhère pleinement et qui sont reproduites dans l’encadré ci-dessous.
Questions et critiques adressées par Yvon Collin
à la proposition de Pierre Collin et Nicolas Colin
« Quelle données, personnelles ou non, seront concernées par le dispositif ?
Comment sera fixée la valeur de ces données ou de leur traitement afin de déterminer l’assiette d’imposition ?
Qui seront les redevables ? À partir de quel volume de données et pour quelles utilisations ?
[…]
Au surplus, on peut considérer que les critiques déjà formulées à l’encontre de la taxation de la publicité en ligne et du commerce électronique peuvent, dans une certaine mesure, être transposées à la taxation de la collecte et l’utilisation de données. En effet, […] la fiscalisation des données impacterait nécessairement les acteurs français, avec la même incertitude sur l’efficacité de la procédure déclarative applicable aux acteurs étrangers. »
c. Le numérique comme point d’entrée de la démarche ACCIS
En définitive, le Rapporteur considère qu’il est plus judicieux de concentrer les efforts des pouvoirs publics sur la restauration durable de la capacité d’imposition des bénéfices (cf. supra), plutôt que sur la création de taxes sectorielles imparfaites.
En revanche, une initiative de type ACCIS – sous réserve de son caractère optionnel – semble particulièrement bien adaptée à l’économie numérique. Pour reprendre l’exemple de Google, longuement développé précédemment, le fait de limiter les possibilités de transférer les bénéfices vers des paradis fiscaux ne règlerait pas la question de la répartition du pouvoir d’imposer au sein de l’Union européenne.
La seule manière d’y parvenir est donc de répartir les bénéfices
– concentrés en Irlande – entre les différents États membres, à proportion de l’activité réalisée sur leurs territoires respectifs. Cette répartition nécessite la définition préalable de critères, qui rejoint celle de la notion d’établissement stable virtuel (cf. supra), et pose les mêmes difficultés.
Proposition n° 16 : Dans l’attente d’une éventuelle généralisation à l’ensemble des activités, envisager la mise en œuvre obligatoire d’ACCIS pour les entreprises de l’économie numérique.
III. À PLUS COURT TERME : RENFORCER L’INFORMATION ET LA TRANSPARENCE
A. L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS FISCALES : MIEUX CONNAÎTRE L’OPTIMISATION POUR MIEUX L’ENCADRER
1. Les avancées en matière de lutte contre les paradis fiscaux
Ainsi qu’on l’a vu supra, la question de l’échange effectif de renseignements est un critère central d’identification du paradis fiscal. La notion française d’ETNC repose d’ailleurs sur ce critère.
Depuis 2000, il existe une instance dédiée au suivi de ces questions au sein de l’OCDE. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange d’information en matière fiscale offre le cadre multilatéral dans lequel les travaux sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales sont menés, tant par les pays membres l'OCDE que par les autres. Il a notamment publié un modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (191) et, depuis 2006, il produit une évaluation annuelle du cadre légal et administratif pour la transparence et l'échange d'information dans plus de 80 juridictions.
Depuis 2009, plus de 800 accords prévoyant l’échange de renseignements en matière fiscale conformes à la norme internationale ont été conclus. Il n’y en avait qu’une douzaine en 2007, ce qui témoigne des progrès réalisés dans ce domaine.
Le Forum ne se contente pas de recenser les États signataires de conventions. En effet, apprécier la bonne volonté d’un État à l’aune de ce seul critère pouvait s’avérer trompeur, certains territoires considérés comme des paradis fiscaux ayant tout simplement conclu entre eux le minimum requis de conventions bilatérales pour échapper à la liste noire. Aussi le Forum opère un réel suivi qualitatif des progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des standards internationaux.
Une « revue par les pairs » (192) a donc été lancée, qui doit procéder à l’analyse des dispositifs nationaux encadrant l’échange de renseignements afin d’évaluer, d’ici 2014, la mise en œuvre effective des conventions et, le cas échéant, proposer une révision des standards pour résoudre les éventuels blocages et divergences constatés.
2. Des améliorations possibles en matière d’échange d’informations
a. Par une appréciation renouvelée de la notion d’ETNC
L’identification des paradis fiscaux, lorsqu’elle est effectivement opérée, continue à s’effectuer sur une base nationale selon des critères déterminés par chaque État. Afin de donner davantage de poids politique à cette indispensable démarche, il conviendrait d’établir une liste européenne des États et territoires non coopératifs – pour reprendre la notion consacrée par le droit français – partagée par l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Proposition n° 17 : Promouvoir une définition européenne des États et territoires non coopératifs.
b. Par une attention particulière portée aux rulings des administrations fiscales étrangères
Au-delà de la seule problématique relative aux paradis fiscaux, il pourrait être envisagé de renforcer notre système d’échange d’informations avec nos principaux partenaires, notamment européens.
Il serait particulièrement intéressant que l’administration fiscale française soit destinataire des principales décisions de nature administrative rendues par ses homologues, surtout en matière de rulings (décision rendue en amont par l’administration afin d’apprécier la compatibilité d’une stratégie fiscale au droit applicable).
Proposition n° 18 : Favoriser la transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités françaises (têtes de groupe ou filiales).
B. AMÉLIORER L’INFORMATION FOURNIE PAR LES ENTREPRISES : LA TRANSPARENCE PAYS PAR PAYS
Préoccupation majeure et légitime, portée de longue date notamment par les ONG (193), la publication par les entreprises multinationales des informations nécessaires à la connaissance et à l’analyse de leur stratégie de localisation a récemment connu des avancées substantielles.
À grands traits, l’idée générale initialement développée par ses promoteurs consistait à obliger les établissements financiers à rendre publiques, pour chaque pays d’implantation, les données clés telles que le nombre et le nom des filiales présentes, leur raison sociale, leurs effectifs, leur chiffre d’affaires, les bénéfices réalisés, les impôts acquittés.
Il convenait de rendre de telles informations disponibles non seulement pour les administrations fiscales, mais également pour les salariés des groupes, les investisseurs, les actionnaires et le grand public, via une publication en annexe des comptes annuels. Le but était de mettre en évidence, le cas échéant, la concentration de filiales dans certains territoires connus pour la faiblesse de leur législation fiscale, et de souligner l’éventuel découplage entre l’activité économique réelle de ces groupes et sa localisation fiscale, révélateur de pratiques d’optimisation, voire d’évasion ou de fraude.
Lors de la campagne présidentielle de 2012 le candidat François Hollande avait affirmé, en réponse aux propositions de l’ONG CCFD-Terre Solidaire, « [être] favorable à ce que les grandes entreprises cotées en France publient leurs comptes détaillés pays par pays, quel que soit leur secteur d’activité » (194).
De fait une avancée majeure a récemment eu lieu à la faveur du débat sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. À l’initiative de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté en première lecture, obligeant « les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes » à publier en annexe à leurs comptes annuels « des informations sur leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire » (nom et nature de l’activité, produit net bancaire et effectifs en personnel). Cette obligation doit s’appliquer « à compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 ».
Cet amendement se situait ainsi dans la droite ligne des réflexions menées dans le cadre de la révision des dispositions communautaires relatives aux exigences de fonds propres (future directive dite « CRD IV », pour Capital Requirements Directive).
Le Sénat a complété le dispositif en prévoyant que les établissements devraient également publier, à compter de 2015, « le bénéfice ou la perte avant impôt, le montant total des impôts dont les entités sont redevables », ainsi que « les subventions publiques reçues ». Il a en outre prévu des sanctions, prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les établissements qui ne respecteraient pas ces nouvelles contraintes.
En deuxième lecture, ces dispositions ont encore été renforcées avec une extension significative de leur champ d’application. Du fait de l’adoption d’un amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, la publication d’informations ne concerne plus seulement le secteur financier, mais toutes les sociétés les plus importantes dépassant un certain seuil – déterminé ultérieurement par décret en Conseil d’État –, en fonction du niveau du bilan ou du chiffre d’affaires et du nombre de salariés.
Pour les entreprises hors secteur financier, cette obligation d’information ne sera toutefois applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne et poursuivant le même objectif. De fait, les conclusions du récent Conseil européen du 22 mai 2013 soulignent que « la proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d’assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes » (195).
Sous réserve des modalités différenciées de mise en œuvre entre les entreprises du secteur financier et les autres, l’encadré suivant récapitule les nouvelles obligations qui pèseront sur ces sociétés.
Les nouvelles obligations relatives au reporting pays par pays
Les informations suivantes seraient publiées pour chaque État ou territoire :
– nom des implantations et nature d’activité ;
– chiffre d’affaires ;
– effectifs, en équivalent temps plein ;
– bénéfice ou perte avant impôt ;
– montant des impôts sur les sociétés dont les implantations sont redevables ;
– subventions publiques reçues.
Pour certains groupes, ces informations peuvent constituer un « risque réputationnel » (cf. infra) non négligeable, surtout lorsqu’ils ont bâti une partie de leur notoriété et de leur succès sur des valeurs positives telles que la transparence, l’égalité, l’éthique ou la coopération. La publication de ces données pourrait donc les contraindre à revoir, dans une certaine mesure, leur stratégie de localisation.
Sans faire preuve d’une excessive naïveté qui consisterait à penser que l’objet social d’une entreprise commerciale est d’être « morale », on ne peut s’empêcher de songer ainsi au slogan de Google, entreprise à la stratégie fiscale particulièrement audacieuse : « Don’t be evil » – « Ne soyez pas malveillant ». Ce principe était défini de la manière suivante par l’un de ses fondateurs, Sergei Brin, dans la « lettre des fondateurs » (founders’ letter) communiquée préalablement à l’introduction de l’entreprise en Bourse : « Nous avons tenté de définir précisément ce que signifie le fait d’être une force bénéfique – toujours agir de manière correcte, éthique. » (196).
Soulignons enfin que, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté une disposition consacrant l’obligation, pour les institutions financières françaises, de transmettre à l’administration fiscale les informations nécessaires à l’application des conventions internationales organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (demandes d’assistance administrative). Comme le rappelle l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, « l’échange automatique d’informations à des fins fiscales […] est en passe de devenir un nouveau standard de coopération entre les États. […] Un accord de ce type avec les États-Unis, dit FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), est en cours de finalisation et donnerait lieu à des échanges d’informations à compter de 2015. ».
Proposition n° 19 : Généraliser au sein de l’Union européenne la « transparence pays par pays », puis promouvoir auprès des États non membres de l’Union européenne l’adoption d’une règle similaire.
C. LE « RISQUE DE RÉPUTATION » COMME FACTEUR DE LIMITATION DES STRATÉGIES D’OPTIMISATION
● La lutte contre l’optimisation fiscale agressive nécessite de redéfinir le pouvoir d’imposition des États.
Cette conclusion de bon sens, dont le principe est très largement partagé, est très complexe à préciser dans un détail suffisant, et sans doute plus complexe encore à mettre en œuvre. Les actions plus ciblées, notamment en ce qui concerne l’économie numérique, présentent, comme on l’a vu, des difficultés certaines ; les moyens d’action immédiats sont davantage nationaux qu’internationaux.
Pour autant, au niveau mondial, on assiste à une véritable prise de conscience des enjeux que soulève l’excès d’optimisation fiscale des grandes entreprises. Cette prise de conscience, citoyenne et politique, peut accompagner l’action publique dans le sens d’une restauration de la capacité d’imposer.
Sans qu’aucun élément d’ordre scientifique ne puisse venir à l’appui de ce constat, on peut néanmoins observer que le débat public sur la question de l’optimisation et de l’évasion fiscale s’est longtemps focalisé sur la situation des personnes physiques, qui interpelle sans doute plus facilement les citoyens, eux-mêmes contribuables. Apprendre qu’une personne infiniment plus riche que soi paie peu ou pas d’impôt car elle bénéfice de « niches » fiscales peut, légitimement, susciter l’interrogation, la stupeur, voire la colère de qui s’acquitte normalement de sa cotisation d’impôt. Longtemps, l’indignation n’a sans doute pas été aussi forte s’agissant des stratégies fiscales des entreprises, plus complexes à identifier et à comprendre. La situation semble évoluer depuis quelques années, au travers notamment de quelques cas particulièrement médiatisés. Celui de Starbucks au Royaume-Uni, résumé dans l’encadré ci-dessous, est sans doute l’un des plus emblématiques.
Réactions citoyennes et politiques à l’optimisation fiscale
des entreprises multinationales : le cas de Starbucks au Royaume-Uni
En octobre 2012, une enquête de Reuters a souligné la contradiction entre l’absence d’imposition de Starbucks au Royaume-Uni et le discours très positif tenu aux actionnaires sur la profitabilité des activités du groupe au Royaume-Uni, estimée à 15 %.
Cette contradiction proviendrait de ce que Starbucks Coffee Company UK (société opérationnelle implantée au Royaume-Uni (ci-après Starbucks UK), réduisait son résultat imposable en imputant trois types de charges sur son chiffre d’affaires britannique :
– une redevance de 4,7 % (antérieurement de 6 %, avant contestation du prix de transfert par l’administration fiscale) versée à la société néerlandaise Starbucks Coffee EMEA BV, au titre de l’utilisation de certains droits incorporels au Royaume-Uni ;
– le coût du café que Starbucks UK achète à Starbucks Coffee EMEA BV ;
– des montants significatifs d’intérêts versés à d’autres filiales du groupe situées hors du Royaume-Uni.
Ainsi, Starbucks UK a réalisé en 2011 une perte de 32,8 millions de livres sterling, pour un chiffre d’affaires de 397,7 millions, après des résultats similaires en 2010.
À la suite de cette enquête de presse, le directeur financier de Starbucks Corporation a été auditionné par le Public Account Committee de la Chambre des Communes, le 12 novembre dernier.
Puis en décembre, face aux risques de voir ses établissements boycottés à la demande de certaines organisations non gouvernementales, Starbucks UK a décidé de renoncer unilatéralement à la déduction de certaines charges (redevances, intérêts intragroupes) afin d'augmenter son résultat et de verser 20 millions de livres d'impôt sur les sociétés
(10 en 2013 et 10 en 2014).
Après cette annonce, des manifestations ont été organisées devant une quarantaine d'établissements de la chaîne au Royaume-Uni, le principal slogan entendu étant, selon des informations parues dans la presse, « Starbucks, paie tes impôts ».
Une prise de conscience similaire a lieu s’agissant des entreprises du numérique, dont les dirigeants ont été auditionnés par la Chambre des Communes, mais également par le Congrès des États-Unis (197). Tim Cook, Chief Executive Officer d’Apple, a reconnu lors de son audition que « le code fiscal américain ne s’est pas adapté à l’économie digitale » (198). Eric Schmidt, Executive Chairman de Google Inc., va même plus loin : alors qu’il se déclarait en 2012 « fier » de la stratégie fiscale du groupe (cf. supra), il a récemment publié une tribune dans laquelle il considère que « le droit fiscal international gagnerait très vraisemblablement à être réformé » (199).
De telles inflexions de comportement (pour Starbucks) ou de discours (pour Google), aussi légères soient-elles, attestent peut-être de l’existence d’un risque « réputationnel » lié aux comportements d’optimisation fiscale. L’hostilité affichée par les citoyens à l’égard des stratégies d’évitement de l’impôt, jusqu’ici sporadique mais que l’on sent enfler, pourrait être ressentie comme une menace par les entreprises concernées, en particulier celles dont la valeur repose pour partie sur leur image. C’est sans doute le cas de Starbucks, ça l’est incontestablement des GAFA, pour qui la transparence n’est pas seulement une valeur morale, mais également un fonds de commerce. Dans leur rapport précité, Pierre Collin et Nicolas Colin constatent ainsi que « les entreprises concernées sont particulièrement attachées à leur image auprès du grand public, qui constitue pour elles un actif stratégique » (200). L’idée d’un attachement fort des entreprises du numérique à leur image, qui pourrait les conduire à modifier leur comportement fiscal, a été confirmée lors des auditions conduites par la mission, en particulier par les représentants du Conseil national du numérique, qui mène en ce moment une consultation sur la fiscalité du secteur.
Le risque réputationnel, couplé au risque proprement fiscal attaché à toute stratégie d’optimisation, pourrait avoir également un effet négatif sur les anticipations des actionnaires. Dans le rapport BEPS, l’OCDE constate ainsi que « des stratégies fiscales agressives peuvent être préjudiciables aux intérêts des actionnaires, surtout à moyen et long terme, parce qu’elles induisent un risque élevé et les coûts en cas d’échec peuvent être considérables, y compris en termes de réputation » (201).
● Les entreprises étant sensibles à leur risque de réputation, il pourrait être envisagé d’élargir au civisme fiscal la responsabilité sociétale et environnementale, comme l’a d’ailleurs proposé la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion fiscale internationale (202).
La Commission européenne définit la responsabilité sociale des entreprises comme « un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (203).
La France recourt à l’expression de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Selon la définition qui en est donnée par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, la RSE « est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique économique, responsabilité sociale et écoresponsabilité. » (204).
Moins optimiste – ou plus réaliste – que les institutions européennes quant à l’adhésion « volontaire » des entreprises à la RSE, le législateur français a institué l’obligation pour les sociétés, cotées ou non (205), d’inclure dans le rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale des « informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités » (206). Ces informations font en outre l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.
Le civisme fiscal fait partie de la RSE. L’optimisation fiscale se traduit souvent par des choix de localisation des actifs – physiques ou immatériels – qui peuvent avoir des implications très concrètes en termes d’activité, et donc d’emploi. Par ailleurs la cohésion sociale est notamment assurée par le financement, par l’impôt, de services et autres équipements publics. Le comportement fiscal d’une entreprise a donc bien in fine des « conséquences sociales », et il serait légitime de l’inclure officiellement dans le champ de la RSE.
Proposition n° 20 : Élargir le champ de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises aux conséquences fiscales de leurs activités et de leurs stratégies.
● Si les pouvoirs publics sont fondés à exiger des entreprises davantage d’exemplarité dans la conduite de leurs affaires fiscales, il ne faut toutefois pas oublier que l’État lui-même détient des participations – parfois en tant qu’actionnaire majoritaire – dans de nombreuses sociétés.
L’exemple doit venir d’en haut car un « État schizophrène » perdrait toute crédibilité dans la lutte contre l’optimisation fiscale agressive s’il ne soumettait pas à la même discipline les entreprises dont il est actionnaire. Il conviendrait donc de veiller à ce que l’État fasse du civisme fiscal l’un des critères guidant sa politique de participation.
Proposition n° 21 : Veiller à ce que l’État prenne en compte le civisme fiscal dans la gestion de ses participations.
Il serait par ailleurs judicieux que la Cour des comptes, à l’occasion des contrôles qu’elle opère sur la gestion des entreprises publiques, puisse systématiquement consacrer un développement spécifique à la stratégie fiscale des sociétés concernées.
Proposition n° 22 : Suggérer à la Cour des comptes de prévoir l’inclusion d’un développement spécifique sur le civisme fiscal dans ses rapports de contrôle sur la gestion des entreprises publiques.
● Quelle que soit la réalité du risque réputationnel et surtout de la réaction des entreprises multinationales à ce risque, il serait hasardeux d’en attendre beaucoup.
Pour revenir à l’exemple précité de Starbucks, le fait que l’entreprise ait décidé de son propre chef d’alourdir sa charge fiscale de 20 millions de livres est sans doute une bonne nouvelle pour le budget de l’État britannique. Mais est-ce une bonne nouvelle pour la notion même d’impôt ? L’impôt est une contribution obligatoirement due par ceux qui en sont redevables ; en démocratie, le consentement à l’impôt se manifeste par le vote des citoyens, le plus souvent au travers de leurs représentants.
Il est donc curieux que des entreprises qui optimisent leur fiscalité sans méconnaître le droit applicable acquittent presque discrétionnairement un supplément d’impôt, dont elles décideraient aussi du montant, pour sauvegarder leur réputation, alors qu’elles n’en sont pas juridiquement redevables. Attendre des entreprises cette forme nouvelle – et déviante – de « consentement » à l’impôt, presque d’aumône, ce serait de la part des États un ultime aveu de faiblesse, la consécration de l’idée que les plus fortunés choisissent unilatéralement leur niveau d’imposition. Puisque l’optimisation fiscale agressive résulte des failles dans les législations nationales et internationale, les réponses à y apporter, si réponses il y a, doivent être avant tout juridiques.
L’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international est un phénomène particulièrement difficile à caractériser et à quantifier. Sa réalité ne peut toutefois être mise en doute, ainsi que l’ont révélé de récentes affaires particulièrement médiatisées et qui ont mis aux prises plusieurs sociétés bien connues avec différents États et leurs opinions publiques. Certains dirigeants de ces entreprises n’ont d’ailleurs pas fait mystère – parfois même pour s’en vanter – du but poursuivi par leurs choix de localisation.
Face à de tels comportements, il pourrait être tentant de rendre les armes sans combattre, tant le temps long du politique s’accorde mal avec la quasi instantanéité du marché, et tant les intérêts nationaux en matière de fiscalité sont divergents.
Toutefois, si l’ampleur de la tâche peut sembler paralysante et si les solutions les plus à même de répondre efficacement à ce problème s’envisagent nécessairement à long terme et au niveau international, les pouvoirs publics se doivent d’agir dès à présent, avec célérité et fermeté.
Car l’optimisation fiscale agressive n’est pas seulement un sujet technique destiné à rester l’apanage de quelques initiés. Il s’agit d’une problématique éminemment politique qui renvoie à des considérations aussi fondamentales que la souveraineté de l’État et l’égalité devant l’impôt. L’optimisation constitue une menace majeure pour les recettes fiscales et pour le principe de consentement à l’impôt, menace qui s’est encore renforcée dans le contexte de crise économique et financière mondiale. En effet, alors que les États se voient contraints de demander des efforts considérables à l’ensemble du corps social, certains contribuables, parmi les plus importants, parviennent à échapper en tout ou partie à leurs obligations fiscales en tirant profit des insuffisances, des incohérences, voire des contradictions existant entre les différentes normes applicables.
La réflexion sur l’optimisation doit être conduite à l’échelle mondiale. À mesure que l’économie s’est globalisée, le cadre légal applicable en matière de fiscalité a fait de même, mais sans doute pas au même rythme ni de manière totalement satisfaisante. Les entreprises sont dorénavant soumises à des normes de droit interne et de droit international – telles que les conventions fiscales d’élimination de la double imposition –, et certains groupes multinationaux peuvent être tentés de tirer le meilleur parti de chaque disposition afin de réduire voire d’annuler leur charge fiscale. L’optimisation fiscale des entreprises est par conséquent devenue un défi mondial qui nécessite la mise en œuvre d’actions ambitieuses au niveau multilatéral, ainsi qu’en témoignent les récentes initiatives du G20 et de l’OCDE. En outre, l’émergence et le formidable développement de l’économie numérique obligent à renouveler rapidement les approches traditionnelles en la matière.
Dans ce « jeu de bonneteau » mondial, où les profits peuvent subitement et presque secrètement quitter le territoire où ils ont été générés pour se retrouver dans un territoire fiscalement plus accueillant, les États sont à la fois les joueurs – tantôt heureux, tantôt malheureux – et les organisateurs. Il n’appartient qu’à eux de se guérir du syndrome de « Docteur Jekyll et Mr. Hyde » dont ils semblent être atteints et qui les voit, d’une part, déplorer, à raison, le manque de civisme fiscal de certaines sociétés et, d’autre part, tenter d’attirer ou de retenir la masse fiscale en proposant à ces mêmes entreprises des régimes d’imposition préférentiels, ou en refusant la remise en cause de principes et de réglementations manifestement inadaptés à l’économie moderne.
Le moment politique n’a sans doute jamais été aussi propice à des avancées réelles et profondes en la matière. Il convient de saisir pleinement cette opportunité.
Au cours de sa séance du mercredi 10 juillet 2013 à 17 heures 45, la Commission examine le rapport d’information de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (M. Éric Woerth, président de la mission d’information, et M. Pierre-Alain Muet, rapporteur).
M. Pierre-Alain Muet, président. Mes chers collègues, nous examinons, au cours de cette dernière réunion de la journée, le rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international.
Cette mission est présidée par Éric Woerth et j’en suis le rapporteur. Ses membres sont MM. Pascal Cherki, Charles de Courson, Mmes Marie-Christine Dalloz et Annick Girardin, M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas. Notre Commission a décidé de créer cette mission le 27 février dernier, et ses membres ont choisi de conclure leurs travaux avant la réunion du G20 prévue du 18 au 20 juillet prochain, au cours duquel le sujet de l’optimisation sera notamment abordé.
Je vais donner la parole au président de la mission afin qu’il expose la manière dont nous avons travaillé.
M. Éric Woerth. Nous avons beaucoup auditionné – plus de 100 personnes, en France comme à l’étranger – car le sujet est techniquement complexe. Nous nous sommes rendus à Washington et à La Haye, et le rapporteur a également profité d’un déplacement du Bureau de notre Commission pour échanger avec des membres du Bundestag et des représentants de l’administration fiscale à Berlin.
Le sujet de l’optimisation a été « défriché » par un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE – qui constitue une sorte de travail fondateur : il s’agit du rapport dit BEPS, l’acronyme anglais pour Base Erosion and Profit Shifting, traduit en français par « Lutter contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices ». Il formule le constat d’une érosion mondiale des bases fiscales de l’impôt des sociétés et dresse des perspectives visant à apporter prochainement des solutions à cette problématique, solutions qui seront nécessairement le fruit d’une coopération internationale.
De nombreux Parlements étrangers se sont également saisis du sujet. On peut notamment citer le Congrès américain qui mène des travaux de cette nature, ou encore le Parlement britannique. Certaines entreprises ont en effet récemment défrayé la chronique, telles que Google, Apple ou encore Starbucks.
Nous avons reçu de nombreuses entreprises françaises opérant dans tous les secteurs, afin de déterminer si le phénomène avait une réalité pour notre pays. Nous avons également auditionné des acteurs de l’économie numérique dont l’activité provoque une érosion d’autant plus importante des bases fiscales qu’ils manient des actifs immatériels, plus propices à l’optimisation. Nous avons par ailleurs échangé avec les auteurs de différents rapports élaborés sur le sujet : nos collègues Sénateurs – M. Philippe Marini, Président de la commission des Finances, et M. Yvon Collin – ainsi que MM. Pierre Collin et Nicolas Colin, auteurs d’un rapport remarqué sur l’économie numérique.
Notre sujet ne concerne pas la fraude mais la planification fiscale dite « agressive », c’est-à-dire l’utilisation de tous les « trous » qui existent dans les conventions fiscales bilatérales, dans les législations nationales, le recours aux paradis fiscaux et aux juridictions non coopératives, en somme toutes les pratiques qui permettent aux entreprises de minimiser leur impôt.
Nous avons formulé un certain nombre de propositions qui font suite à une partie descriptive, essentielle pour la bonne compréhension d’un sujet aussi complexe. Nous avons en effet tenté de cerner le problème de la manière la plus exhaustive possible en tenant compte des rapports existants, et en apportant notre propre contribution à la réflexion. La mission a formulé plus d’une vingtaine de propositions. Vous comprendrez qu’elles sont d’abord de nature internationale car les solutions à apporter au problème de l’optimisation sont à rechercher avant tout dans un cadre multilatéral, sur le plan européen comme international. D’autres propositions très concrètes sont en outre envisageables dans le cadre national. Je cède maintenant la parole à notre rapporteur pour présenter plus en détail nos travaux.
M. Pierre-Alain Muet. Le rapport comprend en effet une partie descriptive, nécessaire à la compréhension des propositions que nous formulons. Comme l’a rappelé Éric Woerth, l’optimisation fiscale c’est l’utilisation des moyens légaux pour réduire son impôt. Elle se distingue de la fraude fiscale – qui est la violation de la lettre de la loi –, et de l’évasion fiscale – qui est le contournement volontaire de l’esprit de la loi et, in fine, de la norme elle-même. Toutefois, lorsque l’on analyse les stratégies fiscales de certaines entreprises multinationales qui utilisent les failles des législations nationales et les subtilités des conventions fiscales pour s’affranchir de l’impôt sur les sociétés dans un grand nombre de pays où elles devraient normalement le payer, l’optimisation n’est plus très éloignée de l’évasion fiscale à grande échelle. C’est cette optimisation fiscale « agressive » qui fait l’objet du présent rapport.
Les pratiques d’optimisation reposent toute, en dernière analyse, sur un schéma très simple qui consiste à loger un maximum de charges – déductibles de l’impôt – dans un État à forte fiscalité ; et de transférer un maximum de produits dans un État à fiscalité faible. Il s’agit ainsi de minorer le plus possible l’impôt sur les sociétés dans l’État le plus taxateur, et d’assurer l’imposition des bénéfices la moins élevée possible dans l’État le plus clément fiscalement, ce qui est encore plus intéressant – du point de vue du contribuable – lorsque cet État est un paradis fiscal.
Les principaux mécanismes d’optimisation peuvent être regroupés en quelques grandes familles. La plus connue, et sans doute la plus importante, concerne les prix de transfert, ces échanges intragroupe représentant environ 60 % des échanges mondiaux. Ils sont soumis au principe de pleine concurrence, dégagé par l’OCDE, et qui sert de référence à l’administration fiscale lorsqu’elle opère des contrôles relatifs à la détermination de ces prix de transfert afin de s’assurer qu’ils n’ont pas été intentionnellement faussés. Elle opère alors une comparaison entre le prix déterminé entre les entreprises du groupe, et le prix qui aurait été pratiqué entre deux entreprises non liées, au sein d’un marché pleinement concurrentiel. Ce principe s’avère bien adapté pour des transactions « classiques », faisant intervenir des actifs corporels par exemple ; il atteint ses limites dès lors que les échanges intragroupe concernent des actifs immatériels, telles les marques. L’optimisation s’effectue alors via le versement de redevances entre les sociétés liées, dont le montant est survalorisé ou sous-valorisé en fonction de l’État de destination du flux.
L’optimisation peut également s’effectuer par le recours à d’habiles stratégies de financement. Les intérêts financiers, contrairement aux dividendes versés, sont généralement déductibles de l’impôt sur les sociétés. Une entreprise aura donc rationnellement intérêt à se financer par l’emprunt plutôt que par augmentation de son capital, et ce d’autant plus qu’elle est implantée dans un État à fiscalité forte. Cette stratégie peut encore être affinée via le recours aux produits dits hybrides qui permettent une double non-imposition du même flux. Ainsi, une mère implantée dans un État à fiscalité faible pourra consentir un prêt à une fille implantée dans un État à fiscalité forte. Celle-ci déduira les intérêts de son assiette taxable afin de minorer, voire d’annuler, son impôt. Les intérêts seront ensuite considérés comme des dividendes par la législation de l’État de la mère, et donc rapatriables en franchise ou quasi franchise d’impôt en application du régime mère-fille.
L’optimisation peut également être fondée sur des stratégies d’organisation de l’entreprise. Le régime mère-fille, pour reprendre cet exemple, en constitue une illustration simple et courante : il permet de faire remonter au niveau de la mère les dividendes versés par la fille en franchise ou quasi franchise d’impôt, le droit fiscal français exigeant la réintégration à l’assiette de la mère d’une quote-part égale à 5 % des versements. Ce dispositif est d’autant plus intéressant, du point de vue du contribuable, que la mère est opportunément implantée dans un État à fiscalité faible. Le régime néerlandais dit de « participation-exemption » est encore plus attractif puisqu’il permet une exonération totale d’impôt sur les sociétés pour les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales, la même exonération étant prévue pour les plus-values de cession de titres de participation. Les entreprises peuvent également créer des filiales dans des « États tunnels » dont les conventions fiscales favorables qui les lient à d’autres États permettent le contournement de l’impôt - notamment les retenues à la source. Il est également possible de recourir à des entités dites hybrides, dont le statut au regard de la fiscalité – transparent ou opaque – varie en fonction des législations nationales. L’entreprise Google a recouru à de telles entités, ainsi que je vous l’exposerai dans quelques minutes. Il est enfin possible à un groupe de mener une réorganisation d’entreprises, ou business restructuring, laquelle peut notamment consister à transformer des filiales auparavant distributeurs ou fabricants de plein exercice en simples commissionnaire ou façonniers. Des entreprises industrielles y recourent. Les profits, antérieurement réalisés et imposés dans les États de ces filiales, sont désormais directement imputés à la mère, idéalement établie dans un État à fiscalité faible.
Des dispositifs particulièrement agressifs peuvent aboutir à une double non-imposition d’un même flux. Le phénomène est tristement ironique dans la mesure où les conventions fiscales ont précisément été conclues pour éviter la double imposition. Or aujourd’hui, elles sont utilisées par des entreprises multinationales afin d’aboutir à une double non taxation. Cette pratique est connue sous le nom de treaty shopping. Par exemple, un groupe qui souhaiterait éviter la retenue à la source prévue par la convention fiscale liant les États A et B sur les flux opérés en ces États fera transiter lesdits flux par un État C dit « État tunnel » dont la convention fiscale ne prévoit aucune retenue à la source en direction de A et B. Ainsi, un flux quittant la France pour les Bermudes fera l’objet d’une retenue à la source au taux de 33,1/3 %. Mais d’autres États, comme les Pays-Bas, ne soumettent de telles transactions à aucun prélèvement. Le flux qui quitte la France pour les Pays-Bas ne sera soumis à aucune retenue à la source car il s’agit d’un flux intra-communautaire. Il pourra ensuite être remonté aux Bermudes en franchise d’impôt en application de la législation néerlandaise.
Le recours aux produits hybrides – notamment les titres considérés comme un titre de dette en A et comme un titre de participation en B – permet également une double non-imposition du même flux, ainsi que je l’ai précédemment expliqué.
Nous avons évidemment analysé la stratégie fiscale de Google, qui a été largement médiatisée. Le schéma mis en place par la société utilise notamment à la fois un État tunnel, certaines particularités de la législation américaine qui permettent de loger les profits dans des paradis fiscaux en attente de rapatriement – système dit check the box –, et une entreprise hybride.
Dans ce schéma la première filiale établie en Irlande, Google Ireland Ltd, établit les factures des clients français et reçoit leurs paiements. La seconde société établie en Irlande, Google Ireland Holdings, est, en dépit de son nom et de sa situation géographique, une société de droit bermudien car son équipe dirigeante et son conseil d’administration se réunissent aux Bermudes.
Pour faire passer les profits de la première société irlandaise à la seconde sans subir de retenue à la source, une autre société est nécessaire. Celle-ci, Google Netherlands BV, est établie aux Pays-Bas et sa seule fonction est de recevoir la redevance de Google Ireland Ltd pour la reverser en quasi-totalité – le chiffre de 99,8 % est souvent évoqué – à Google Ireland Holdings. Le profit ainsi accumulé ne remonte pas aux États-Unis car cette dernière société est considérée comme transparente au regard du droit fiscal américain. De fait, Google parvient à n’acquitter qu’un impôt minime dans chacun de ses pays d’implantation, sans commune mesure avec l’importance de son activité économique. Ce schéma est utilisé, à quelques nuances près, par d’autres entreprises du numérique et aboutit parfois à des situations aberrantes. Lorsque la société Apple, qui dispose de 102 milliards de dollars en attente de rapatriement, a dû verser des dividendes pour rémunérer ses actionnaires, elle a préféré s’endetter en empruntant quelque 17 milliards de dollars sur le marché pour éviter un retour des sommes correspondantes aux États-Unis, où elles auraient été taxées à 35 %. Selon certaines études, également citées par l’administration fiscale américaine lors de notre déplacement à Washington, on estime à 1 700 milliards de dollars le montant des profits de multinationales américaines en attente de rapatriement offshore.
De tels phénomènes prouvent la réalité de l’optimisation fiscale agressive, quand bien même celle-ci reste difficile à quantifier. En France, et même s’il convient de relayer de tels chiffres avec prudence, des analyses estiment ainsi que les cinq grandes entreprises du numériques communément dénommées GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – représenteraient un chiffre d’affaires estimé consolidé de plus de 8 milliards d’euros et qu’elles auraient dû payer, en 2011, près de 830 millions d’euros si leurs activités avaient effectivement été taxées sur notre territoire, en l’absence de toute pratique d’optimisation. En fait, ces sociétés n’auraient acquitté que 37 millions d’euros environ d’impôt cette même année.
Face à cette situation, eu égard à l’inadaptation de l’impôt sur les sociétés à la réalité de l’économie numérique, il serait tentant de recourir à des taxes spécifiques à ce secteur. Telle est la position du Président de la commission des Finances du Sénat, avec des taxes sur la publicité en ligne, ou sur le commerce électronique. Toutefois, en réalité, ces « taxes Google » et autres « taxes Amazon » semblent « rater leur cible » et se transformeraient en « taxe Pages Jaunes » et « taxes La Redoute », entreprises qui acquittent leur impôt sur les sociétés en France.
À notre sens, le vrai problème n’est pas l’existence des entreprises du numérique mais le fait que dans un univers mondialisé il soit possible d’utiliser les failles des législations pour éluder l’impôt. L’entreprise Starbucks, qui dispose d’installations fixes, physiques, parvient à minorer son impôt en utilisant simplement le mécanisme de prix de transfert et des redevances.
La vraie question est la suivante : peut-on reconstituer un impôt sur les sociétés qui ait un sens ? Car l’impôt sur les sociétés est, de tous les prélèvements qui touchent les entreprises, le plus intelligent. En effet, il porte sur les résultats, ce qui signifie que lorsque l’entreprise a des difficultés, qu’elle ne réalise pas de profit, elle n’est pas imposée. On se trouve alors face à un paradoxe qui veut que l’impôt le plus pertinent d’un point de vue économique est le plus facile à éluder et à faire disparaître dans des paradis fiscaux. Le vrai sujet est : comment retrouver une base fiscale ? Telle est la logique que nous avons retenue dans ce rapport. Plutôt que de recourir à des impositions alternatives qui ne sont pas pleinement satisfaisantes, il faut chercher à rétablir le pouvoir d’imposition de chaque État au titre de l’impôt sur les sociétés. Pour ce faire nous avançons un certain nombre de propositions, 22 pour être précis.
Les premières visent à adapter le droit fiscal international. Nous ne méconnaissons pas l’ampleur de la tâche, il s’agira d’un travail de longue haleine puisqu’il existe quelque 3 000 conventions fiscales bilatérales. Leur renégociation doit être soutenue par notre pays car elles ne sont plus adaptées à la réalité économique actuelle – proposition n° 11. Je me permets une petite digression. L’OCDE évoque parfois l’idée d’une convention multilatérale, tout en étant pleinement consciente des obstacles auxquels une telle initiative – solution idéale dans l’absolu – se heurterait. Dans le cadre de la renégociation des conventions bilatérales, il conviendrait de promouvoir le concept d’établissement stable virtuel – proposition n° 12. Il conviendrait également de prévoir dans ces conventions une « clause de sauvegarde fiscale », tendant à s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source – proposition n° 13. Une telle recommandation, qui vise à éviter les cas de double non-imposition, figurera à trois reprises dans notre liste de propositions : au niveau international, européen, et national.
La lutte contre l’optimisation fiscale agressive peut également être menée à l’échelle européenne. Il s'agit d’encourager les initiatives de la Commission européenne tendant à réformer les directives relatives aux revenus passifs afin de s’assurer qu’un flux ou produit déduit ou exonéré dans un État membre soit bien imposé dans l’État de la source
– proposition n° 14. À titre d’exemple, à l’heure actuelle, la directive dite « intérêts et redevances » ne conditionne pas l’exonération d’un élément de revenu dans l’État source à l’imposition de ce même élément dans l’État destinataire. Il serait en outre intéressant de lancer une réflexion avec nos principaux partenaires européens sur une harmonisation des bases de l’impôt sur les sociétés, pouvant déboucher sur une coopération renforcée en lien avec la mise en œuvre d’ACCIS – proposition n° 15. Dans l’attente d’une éventuelle généralisation d’ACCIS à l’ensemble des activités, il faudrait envisager sa mise en œuvre obligatoire pour les entreprises de l’économie numérique – proposition n° 16. Je rappelle qu’ACCIS a vocation à définir, au niveau européen, une assiette commune consolidée à l’impôt sur les sociétés, assiette qui serait ensuite répartie entre les États membres sur la base de critères économiques : un tiers pour les immobilisations corporelles, un tiers pour le chiffre d’affaires hors opérations intragroupe, et un tiers pour la main d’œuvre. Le défaut du projet ACCIS est qu’il est optionnel. Les entreprises qui choisiraient d’y recourir le feraient – et c’est normal de leur point de vue – parce qu’elles y trouveraient un intérêt fiscal. Son application obligatoire au secteur du numérique permettrait de résoudre certains problèmes actuels. Pour reprendre l’exemple de Google, et dans l’hypothèse où l’on parviendrait à limiter voire annuler les transferts à destination des paradis fiscaux, ACCIS permettrait de répartir les bénéfices – concentrés en Irlande – entre les différents États membres, à proportion de l’activité réalisée sur leurs territoires respectifs. Dernière proposition au niveau européen, nous recommandons de promouvoir une définition européenne des États et territoires non coopératifs – proposition n° 17.
Les propositions nationales sont les plus nombreuses. L’encadrement des pratiques d’optimisation passe d’abord par une adaptation de la procédure d’abus de droit. Il s’agirait de renforcer la portée de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées – proposition n° 1. En effet, à l’heure actuelle, il peut être assez aisé pour l’entreprise d’opposer à l’administration ne serait-ce qu’un seul argument de caractère non fiscal, même ténu, à l’appui de l’acte contesté pour lui permettre d’échapper à la procédure d’abus de droit.
S’agissant des charges déductibles il conviendrait de modifier l’article 238 A du code général des impôts afin d’aligner les conditions de déductibilité des charges logées dans des États à fiscalité privilégiée sur celles, plus exigeantes, des charges logées dans des États et territoires non coopératifs – proposition n° 7, d’autant que la liste regroupant ces derniers s’amenuise d’année en année.
Concernant les prix de transfert, nous avons retenu plusieurs propositions formulées par l’Inspection générale des finances. Nous avons toutefois écarté celle consistant à traduire dans la loi le principe de pleine concurrence puisque la jurisprudence administrative suffit à l’exercice efficace du contrôle fiscal en la matière. En revanche, il faudrait modifier l’article 57 du code général des impôts afin de supprimer la condition de dépendance ou de contrôle lorsque les transactions s’effectuent avec des entreprises établies dans des États et territoires non coopératifs – proposition n° 2. Il conviendrait par ailleurs de prévoir la mise à disposition de la comptabilité analytique et consolidée des entreprises soumises à l’obligation de documentation des prix de transfert en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales – proposition n° 3. La mission préconise également la suppression du caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable prévue dans les contrôles de prix de transfert – proposition n° 4, suspension qui n’est en vigueur dans aucun des pays faisant l’objet d’une analyse par l’Inspection générale des finances. Nous recommandons aussi de délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification – proposition n° 5. En effet, en l’état du droit, l’administration fiscale n’applique aucune pénalité de la sorte lorsqu’elle n’opère pas de rectification in fine alors même que le manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations suffisantes à la disposition de l’administration.
Enfin, nous proposons, dans certaines situations « à risque », notamment le business restructuring, de faire peser sur le contribuable la charge de prouver le caractère normal des prix de transfert – proposition n° 6. Une telle mesure serait particulièrement utile à l’administration fiscale.
S’agissant des produits et entités hybrides, nous proposons deux mesures. Il faut envisager l’instauration de mesures visant à empêcher la déduction ou l’exonération en France d’un flux ou produit déjà déduit ou exonéré dans un autre État – produits dits « hybrides »
– proposition n° 8. Il convient également de réfléchir à l’instauration de mesures visant à empêcher une entreprise de tirer un bénéfice fiscal résultant d’une différence de qualification juridique de son statut dans deux États différents – entités dites « hybrides »
– proposition n° 9.
Une autre série de mesures vise à renforcer l’information de l’administration fiscale et la sécurité juridique du contribuable. Nous proposons, au terme d’une démarche concertée, de rendre obligatoire la communication préalable à l’administration fiscale des schémas d’optimisation procurant un avantage fiscal substantiel, et de promouvoir parallèlement un recours plus fréquent à la procédure de rescrit – proposition n° 10. De tels dispositifs existent aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous préconisons également de favoriser la transmission à l’administration fiscale française des rulings bénéficiant, dans d’autres États, à des entités françaises – têtes de groupe ou filiales – proposition n° 18. Enfin, il s’agirait de généraliser au sein de l’Union européenne la « transparence pays par pays », puis de promouvoir auprès des États non membres de l’Union européenne l’adoption d’une règle similaire – proposition n° 19.
Nos trois dernières propositions entendent promouvoir le civisme fiscal des entreprises privées et publiques, tout d’abord en élargissant le champ de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises aux conséquences fiscales de leurs activités et de leurs stratégies – proposition n° 20. Par ailleurs, il convient que l’État prenne en compte le civisme fiscal dans la gestion de ses participations – proposition n° 21. À cet égard, l’audition de l’Agence des participations de l’État – l’APE – avait été éclairante, l’APE ne se souciant pas fondamentalement des pratiques d’optimisation des entreprises dans lesquelles l’État détient des participations. Une telle affirmation est assez surprenante puisqu’on peut considérer à bon droit que l’État ne peut pas totalement se désintéresser du civisme fiscal des entreprises dont il est actionnaire. Enfin, il pourrait être utile de suggérer à la Cour des comptes de prévoir l’inclusion d’un développement spécifique sur le civisme fiscal dans ses rapports de contrôle sur la gestion des entreprises publiques – proposition n° 22.
Pour conclure, le rétablissement d’une imposition « normale » des profits des entreprises multinationales est un sujet essentiel. Autrement, la charge fiscale se reporte sur les facteurs de production les moins mobiles – le travail – ou les contribuables moins bien outillés pour tirer profit des subtilités fiscales – les très petites et les petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas les facultés d’optimisation des grandes entreprises. Poussée à l’extrême, l’optimisation fiscale contrevient au principe d’égalité devant l’impôt consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui commande que la charge fiscale soit répartie en fonction des facultés contributives de chacun. C’est pourquoi le sujet nous paraît mériter la plus grande attention, à l’échelle nationale, européenne et internationale.
M. Éric Woerth. Je souhaitais apporter un complément quant à la manière dont la mission a conduit ses travaux. À plusieurs reprises, il a été difficile d’échanger avec les entreprises du numérique. Nous avons certes auditionné, entre autres, les représentants de Google et d’Amazon, mais des sociétés comme Apple ou Facebook n’ont pas souhaité répondre à notre sollicitation. Par ailleurs, les sociétés qui ont répondu favorablement à notre demande d’audition étaient plus souvent représentées par des chargés de relations institutionnelles que par des fiscalistes, ce qui n’a pas facilité les échanges par nature techniques. Ikea, société plus « traditionnelle » pour son domaine d’activité, n’a pas non plus souhaité coopérer avec la mission.
M. Christian Eckert, Rapporteur général. Je voudrais saluer le travail effectué, qui nous donne une feuille de route avec des propositions claires, dont certaines doivent prospérer aux niveaux international et européen et doivent donc être soutenues au niveau idoine. Je souhaiterais insister sur quelques points que nous avons déjà évoqués au sein de cette Commission, soit suite à des contrôles que j’ai effectués en tant que Rapporteur général – je ne cache pas que j’ai pu consulter le dossier fiscal d’Arcelor Mittal –, soit à l’occasion d’auditions menées avec le Président Carrez dans le cadre d’une autre mission d’information davantage centrée sur la fraude fiscale des particuliers, mais au cours de laquelle nous « dérapons » parfois, dans certaines auditions, avec intérêt dans le champ des entreprises.
En écho à votre proposition n° 18, je voudrais évoquer la question des rulings. J’avais cru initialement que ceux-ci s’apparentaient à nos rescrits. En réalité, alors que nos rescrits s’inscrivent toujours dans une optique d’égalité des contribuables devant l’impôt avec une interprétation de la législation, valable pour tous et permettant d’éviter les contentieux, à la lumière d’un cas d’espèce, les rulings « dégénèrent » parfois en règlements au cas par cas dans une négociation entre les pouvoirs publics qui cherchent à attirer les entreprises en échange de décisions administratives préalables favorables. Vous proposez de favoriser la transmission des rulings à l’administration fiscale ; je serais tenté de rendre une telle transmission obligatoire au sein de l’Union européenne !
Quelques observations sur la proposition n° 4, qui s’inspire d’exemples réels. Lorsque les entreprises s’opposent à l’administration fiscale en matière de prix de transfert, elles demandent à mettre en général en œuvre la procédure dite amiable qui implique un certain nombre de délais et de lourdeurs, avec l’intervention de nombreux avocats fiscalistes qui tentent de justifier le niveau des prix de transfert retenu par lesdites entreprises. Vous avez parfaitement raison de proposer la suppression du caractère automatique de la suspension de l’établissement de l’impôt pendant la durée de cette procédure amiable.
Concernant les conventions internationales, on marche sur la tête ! Vous avez parfaitement démontré que leur utilisation à des fins d’optimisation peut aboutir à des cas de double non-imposition, à rebours de leur raison d’être initiale.
Nous avons évoqué ce matin les échanges d’informations entre États, prévus par des conventions bilatérales. Il faut aller bien au-delà, et les propositions que vous formulez sont extrêmement intéressantes.
Mme Sandrine Mazetier. Je souhaiterais saluer à mon tour ce rapport très complet et précis, et poser quelques questions. Pourquoi limiter ACCIS au seul secteur numérique et pourquoi ne pas retenir par ailleurs une taxation particulière de ce secteur ? Je pense notamment à l’une des propositions du rapport dit Collin et Colin sur la taxation des données numériques, notamment produites par les utilisateurs européens et exploitées aux États-Unis. Je constate que vous ne formulez pas de proposition tendant à modifier le seuil – actuellement établi à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires – à partir duquel les entreprises sont tenues de documenter leurs prix de transfert. Pourrait-on envisager d’abaisser ce seuil ? Je suis très favorable à la proposition relative à la transmission de la comptabilité analytique, mais cette notion est difficile à définir juridiquement. Il s’agit d’une excellente proposition, mais le concept est assez peu connu de notre droit puisqu’il n’apparaît qu’à une reprise dans le code général des impôts. Nous avons rencontré le même problème à l’occasion du projet de loi relatif à la fraude fiscale concernant la déclaration des schémas d’optimisation fiscale, lesquels semblent très difficiles à caractériser juridiquement. Avez-vous pu dépasser ces blocages ? En tout état de cause, je suis tout à fait favorable à la publication du rapport et à la traduction de ses préconisations dès le prochain projet de loi de finances.
M. Laurent Grandguillaume. Je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur, le président et les membres de la mission pour la qualité de ce rapport très complet. Je m’étais également exprimé, il y a quelques mois, sur la question des entreprises dont l’État est actionnaire et qui ont créé des holdings notamment aux Pays-Bas. Je vous félicite pour les propositions n° 20 à 22, qui apportent une réponse à ce problème. Comme vous l’écrivez très justement, l’État ne peut pas être schizophrène : il doit vérifier quelle est la stratégie fiscale des entreprises dans lesquelles il détient des participations. Plusieurs institutions pourraient être utilement mobilisées, telles que la Cour des comptes et l’Agence des participations de l’État, dont le rôle devrait sans doute évoluer pour davantage prendre en compte cette problématique. J’espère que notre Commission saura dépasser ses clivages partisans pour que ces propositions trouvent une traduction concrète.
M. Pascal Cherki. Comme mes collègues et en tant que membre de la mission, je voudrais vous remercier pour ce rapport qui bat en brèche certaines idées reçues. Certaines propositions s’inscrivent dans le long terme et s’apparentent davantage à des recommandations pour nos gouvernants ou pour les Parlements étrangers – je pense à la renégociation des conventions fiscales. D’autres sont plus opérationnelles et peuvent être traduites assez rapidement dans notre ordre juridique national. La proposition n° 1 sur l’abus de droit est assez audacieuse. À l’heure actuelle, seuls sont constitutifs d’abus de droit les actes – fictifs ou contraires à l’intention du législateur – dont le but est exclusivement d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale. L’administration fiscale éprouve donc parfois des difficultés à démontrer l’abus de droit. En proposant de renforcer la portée de cette procédure en visant les actes à visée « principalement » fiscale, on donnera davantage de moyens à l’administration fiscale en termes de contrôle, mais cela se traduira également par un changement de comportement des entreprises. Car le but de ces mesures n’est pas simplement de multiplier les contentieux fiscaux à l’égard des entreprises, mais également de modifier l’attitude de celles-ci lorsqu’elles constateront que l’administration fiscale est mieux armée qu’auparavant. La proposition de modification de l’article 238 A du code général des impôts relatif au régime de déductibilité des charges logées dans des États à fiscalité privilégiée va également dans le bon sens. S’agissant des prix de transferts, beaucoup de propositions sont très intéressantes et j’espère qu’elles se traduiront par des amendements de la commission des Finances dans le cadre du prochain projet de loi de finances, car elles permettraient de faire évoluer notre droit à très court terme. Les comportements des entreprises changent rapidement, et le droit doit s’adapter.
Mme Eva Sas. Je joins ma voix à celle de mes collègues pour ce travail très complet et très éclairant sur l’optimisation fiscale. Les exemples que vous retenez concernent principalement des grands entreprises américaines, ce qui pourrait laisser penser que les entreprises françaises ne recourent que marginalement à l’optimisation. Pourtant, les filiales des banques françaises implantées dans les paradis fiscaux doivent bien servir à quelque chose… Le phénomène d’optimisation est-il essentiellement le fait de firmes américaines ou concerne-t-il aussi les entreprises françaises ? Ma deuxième question a trait à la transparence pays par pays. Nous avons adopté le reporting pays par pays pour les banques dans le cadre du projet de loi bancaire en cours de navette, ne peut-on pas l’élargir aux entreprises multinationales ? Enfin, vous recommandez de prendre en compte le civisme fiscal dans la gestion des participations de l’État, ce que je soutiens. Pourrait-on également en faire une condition du versement de subventions publiques à une entreprise ? Je pense notamment au cas d’Amazon, récemment évoqué dans les médias.
M. Christophe Castaner. À mon tour je souhaiterais vous dire le plaisir de vous entendre et de vous lire sur ce sujet majeur. Certaines propositions peuvent s’analyser comme des mesures de rendement fiscal, ce qui nous intéresse toujours au sein de cette Commission. Mais au-delà de cet aspect il s’agit de mesures réjouissantes d’un point de vue politique, ce qui est rarement le cas, puisqu’elles renvoient au principe d’égalité devant l’impôt et de souveraineté de l’État. Je voudrais revenir sur la simplicité convaincante de certaines de vos propositions. La proposition n° 1 relative à l’abus de droit sera non seulement efficace mais apparaîtra aussi comme un soutien à notre administration fiscale qui a besoin de ce message fort. La proposition n° 6 est également intéressante, même si elle devra bien entendu être précisée, car elle permettra de mieux encadrer les opérations « à risque » et d’éviter les détournements que vous avez évoqués et que la presse n’a pas manqué de souligner. Enfin sur la question du reporting, débattue dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires comme au G20, je rejoins notre collègue Eva Sas dans sa volonté d’élargir, au-delà du seul secteur bancaire, les obligations de transparence à toutes les grandes entreprises. Une telle initiative pourrait se traduire dans le cadre d’un accord européen.
M. Thomas Thévenoud. Je vous félicite également pour la qualité de ce rapport. Selon vous, quelle serait la première mesure à mettre en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, qui pourrait faire l’objet d’un accord entre le président et le rapporteur de la mission, et donc être portée très largement au titre de la commission des Finances ?
M. Éric Alauzet. Je vais arrêter les félicitations, qui vont être trop lourdes à porter ! Je me réjouirai lorsque l’on aura traduit ces belles propositions dans la loi et que l’on aura vérifié leur efficacité. Je ressens la gravité du sujet et l’absolue nécessité de répondre à ce défi. Sinon, nos économies, nos finances publiques seront compromises et, à terme, c’est la démocratie qui est en jeu. Mes propos paraissent peut-être un peu grandiloquents, mais j’en suis persuadé. Dans le cas d’Apple, l’ironie du sort est que même l’Irlande qui a abaissé ses taux d’imposition ne récolte presque pas d’impôt, ce qui est un beau pied de nez aux États qui ont joué la concurrence fiscale à outrance. Cela signifie peut-être qu’ils seront plus coopératifs pour régler la question des paradis fiscaux, mais la concurrence fiscale reste un autre chantier majeur auquel il faut s’attaquer. Dans le cadre du projet de loi relatif à relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, notre groupe politique avait formulé des propositions relatives à la transparence vis-à-vis des comités d’entreprise. Une telle mesure pourrait-elle trouver sa place parmi vos propositions ?
M. Pierre-Alain Muet. Monsieur le Rapporteur général, vous avez évoqué les rulings luxembourgeois. D’autre pays, comme les Pays-Bas, où nous nous sommes rendus, les pratiquent également. L’administration fiscale néerlandaise nous a assuré qu’un tel dialogue avec les entreprises était très utile et permettait de mieux suivre leur activité. Il est vrai toutefois que ce type de pratiques peut parfois aboutir à un moindre degré d’exigence de la part de l’administration, notamment en termes de contrôle. La proposition n° 4 me semble effectivement très importante à mettre en œuvre. Le seul risque est celui du paiement d’intérêts moratoires plus élevés si in fine le redressement n’a pas lieu. Toutefois je pense que le bilan coûts/avantages plaide en faveur de cette proposition.
Madame Mazetier, nous avons écarté la taxe « prédateur-payeur » évoquée par MM. Collin et Colin car il s’agit d’une taxe d’attente. Or je le répète, le véritable enjeu est de reconstituer la base de l’impôt sur les sociétés, notamment grâce à la notion d’établissement stable virtuel et à la mise en œuvre d’une initiative de type ACCIS dans le secteur du numérique. En outre la taxe « prédateur-payeur » serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Cette taxe est incitative, elle aurait donc le mérite de modifier les comportements des entreprises du numérique en les poussant à une utilisation « vertueuse » des données des utilisateurs. Mais l’ensemble des personnes interrogées – y compris les inventeurs de cette taxe – ignorent comment traduire concrètement cette idée. Par ailleurs, je continue à penser qu’il ne faut pas traiter le cas du numérique à part. Certes les entreprises de ce secteur peuvent recourir plus facilement à l’optimisation, du fait notamment de la nature de leurs actifs, largement immatériels. Mais elles utilisent en réalité les mêmes schémas d’optimisation que les entreprises « traditionnelles », telle que la société citée par le Rapporteur général. Notre volonté est que l’impôt sur les sociétés reprenne tout son sens dans une économie mondialisée et, de plus en plus, « digitalisée ». La question du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel une entreprise est soumise à l’obligation de documentation des prix de transfert est intéressante. Les services en charge du contrôle fiscal n’ont pas soulevé ce problème particulier, mais la question mérite sans doute d’être creusée. Il est vrai que la notion de « comptabilité analytique » est relativement peu documentée en droit français. Il est tout aussi vrai que, lorsqu’elle existe et qu’elle est transmise au contrôle fiscal, elle s’avère d’une aide précieuse pour celui-ci. Concernant la déclaration préalable des schémas d’optimisation, il conviendra évidemment de définir et d’encadrer précisément la procédure – juridiquement, qu’est-ce qu’un « schéma d’optimisation » ? À partir de quel seuil un schéma confère-t-il un avantage « substantiel » ? Sur qui doit peser l’obligation de déclaration ? etc. – mais une telle ambition ne semble pas hors de portée dès lors que certains pays ont mis en place des procédures analogues.
M. Grandguillaume, nous avons auditionné l’APE et avons été un peu surpris de constater que l’optimisation fiscale ne faisait pas partie de ses préoccupations. Il nous a clairement été répondu qu’une « muraille de Chine » existait entre l’État actionnaire et l’État contrôleur fiscal, alors même que ces deux fonctions sont assurées par des services appartenant à la même administration. À notre sens, le civisme fiscal doit être partagé par l’ensemble des administrations publiques, et a fortiori par une administration du ministère des Finances. C’est ce qui justifie nos propositions en ce sens. Pour reprendre une expression du rapport, nous sommes parfois en présence d’un « État-Janus » qui peut afficher des aspirations contradictoires. On retrouve de tels comportements à l’étranger : ainsi le Royaume-Uni est très volontariste sur la lutte contre l’optimisation fiscale alors que, parallèlement, la législation britannique regorge de dispositifs fiscaux incitatifs qui permettent une telle optimisation. En effet, chaque État souhaite, d’une part, retenir ses ressources fiscales et, d’autre part, attirer des entreprises par des dispositions qui favorisent l’optimisation.
M. Cherki a insisté sur la proposition relative à la redéfinition de l’abus de droit. Il s’agit en effet de préciser clairement la portée de l’adverbe « principalement ». Au niveau européen, la Commission encourage l’adoption d’une règle anti-abus générale commune incitant les États à ignorer les montages qui visent « essentiellement » à éluder l’impôt. Madame Sas, vous évoquiez la présence, dans les paradis fiscaux, de filiales des banques françaises. Chacun pourra en juger, mais la Fédération bancaire française nous a assuré que les banques avaient plus ou moins pris l’engagement de cesser toute activité dans les paradis fiscaux. Nous avons par ailleurs adressé un courrier à l’ensemble des entreprises du CAC 40
– dont les plus grandes banques – leur demandant de nous fournir toutes les informations relatives à la transparence pays par pays, et notamment la présence de leur filiales dans les États et territoires non coopératifs, les États à fiscalité privilégié, et dans les États de l’Union européenne les plus réputés pour la douceur de leur fiscalité . À ce stade, une quinzaine de sociétés seulement nous ont répondu. Madame Sas et Monsieur Castaner évoquaient l’élargissement des obligations de transparence au-delà des sociétés du secteur financier. Je rappelle que dans le cadre de la discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, les dispositions relatives à la transparence pays par pays ont été renforcées avec une extension significative de leur champ d’application. Du fait de l’adoption d’un amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, la publication d’informations ne concerne plus seulement le secteur financier, mais toutes les sociétés les plus importantes dépassant un certain seuil – qui sera déterminé ultérieurement par décret en Conseil d’État –, en fonction du niveau du bilan ou du chiffre d’affaires et du nombre de salariés. Nous avons le sentiment que les banques sont assez étroitement régulées, du moins dans les États où elles exercent leurs activités à titre principal. Comme toutes les entreprises, elles pratiquent l’optimisation fiscale, mais l’impression qui se dégage est que cette optimisation touche peut-être moins l’impôt français que des prélèvements étrangers. Concernant le lien entre civisme fiscal et octroi de subventions publiques, il me semble qu’à partir du moment où ce thème constituera un volet de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, cela pourra aider les administrations et les collectivités territoriales à tenir compte du comportement plus ou moins vertueux des sociétés avant de décider l’attribution de financements.
Monsieur Castaner, le business restructuring peut effectivement constituer une situation « à risques », l’administration fiscale s’apercevant, d’un seul coup, que l’impôt sur les sociétés s’est brusquement évaporé de France pour se reconstituer dans un autre État. Nous avons pu analyser quelques exemples de ce type à l’occasion de notre contrôle sur place effectué à Bercy en application de l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances. Le renversement de la charge de la preuve dans le cadre de telles opérations sera d’une grande aide à l’administration fiscale.
Monsieur Alauzet, même si l’essentiel de la masse fiscale échappe à l’Irlande, je crois que ce pays est tout de même très heureux de compter sur son sol 3 000 salariés de l’entreprise Google, qui génèrent de l’activité et des rentrées fiscales. Aux Pays-Bas également, les stratégies d’optimisation créent indirectement de la masse fiscale via les services proposés par plusieurs milliers d’avocats fiscalistes. Sur la transparence, je pense que les mesures de reporting pays par pays ainsi que nos propositions relatives au civisme fiscal devraient permettre de satisfaire vos attentes.
Pour répondre à Monsieur Thévenoud, la première proposition qui pourrait être mise en œuvre à court terme et facilement est sans doute notre proposition n° 1 relative à l’abus de droit, que l’administration fiscale attend avec impatience. J’ose espérer qu’elle fera l’unanimité parmi les membres de notre Commission.
M. Éric Woerth. Je rejoins notre rapporteur concernant la proposition n° 1, qui sera très utile à l’administration fiscale. Je reviens sur le cas de l’Irlande qui, au fond, a arbitré entre l’impôt sur les sociétés et l’emploi, donc l’impôt sur les ménages. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la réalité de l’optimisation fiscale opérée par les entreprises françaises. Nous pêchons peut-être par naïveté – en tout état de cause le phénomène est extrêmement difficile à appréhender et à quantifier – mais nous avons le sentiment que, comparativement, l’optimisation touche sans doute moins l’impôt sur les sociétés payé en France, et peut-être davantage l’impôt acquitté à l’étranger.
Les États-Unis cherchent avant tout à rapatrier la masse fiscale non taxée en Europe notamment. Leur souci n’est pas un souci de justice fiscale vis-à-vis de l’Europe. Ces 1 700 milliards parfois évoqués qui seraient logés offshore représentent une partie de l’impôt éludé en Europe. Les but des deux grands partis politiques américains, Démocrate et Républicain, est d’inciter au rapatriement de ces profits et de restaurer la compétitivité de l’économie américaine grâce à une diminution du taux de leur impôt sur les sociétés, actuellement très élevé au niveau fédéral puisqu’il atteint 35 %.
Par ailleurs, la comptabilité analytique n’est effectivement pas normée comme la comptabilité générale. On pourrait cependant envisager la transmission de tout document de gestion utile, à partir du moment où de tels documents existent.
Sur la transmission des schémas d’optimisation, si l’administration peut effectivement éprouver des difficultés à les décrire, l’entreprise les connaît puisqu’elle les a précisément élaborés dans ce but. Le contrôle fiscal pourrait rétablir l’équilibre en fonction des sanctions qui pourraient être prononcées en cas d’absence de transmission du schéma.
En application de l’article 145 du Règlement, la Commission autorise à l’unanimité la publication du rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION
À Paris
● Sénat
– Philippe Marini, président de la commission des Finances et auteur de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable
– Yvon Collin, rapporteur de cette proposition de loi
● OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques)
– Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique et d’administration fiscales
● DGFiP (Direction générale des Finances publiques)
– Bruno Bézard, directeur général
– Alexandre Gardette, chef du service du contrôle fiscal
– Bastien Llorca, chef du bureau CF3 de la sous-direction du contrôle fiscal
– Jean-Claude Dodec, chef du bureau JF2B de la sous-direction du contentieux des impôts des professionnels
– Olivier Sivieude, directeur des vérifications nationales et internationales (DVNI)
– Édouard Marcus, sous-directeur des affaires européennes et internationales de la direction de la législation fiscale
● Agence des participations de l’État
– Astrid Milsan, directrice générale adjointe
– Jérôme Baron, secrétaire général
● Conseil national du numérique
– Benoît Thieulin, président
– Godefroy Beauvallet, vice-président
– Jean-Baptiste Soufron, secrétaire général
– Yann Bonnet, rapporteur
● Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique
– Pierre Collin, conseiller d’État
– Nicolas Colin, inspecteur des Finances
● Table ronde avec des universitaires spécialistes des questions d’optimisation fiscale internationale
– Bernard Castagnède, professeur de droit public à l’Université Paris I
– Guy Gest, professeur de droit public à l’Université Paris II
– Daniel Gutmann, professeur de droit privé à l’Université Paris I, avocat associé au cabinet CMS Francis Lefebvre
● Table ronde avec des avocats spécialistes des questions d’optimisation fiscale internationale
– Antoine Colonna d’Istria, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer
– Phililppe Derouin, cabinet Skadden
– Anne-Laure Goetzinger, cabinet Fidal
– Gianmarco Monsellato, cabinet Taj
– Michel Taly, cabinet Arsene Taxand
– Pierre-Sébastien Thill, cabinet CMS Francis Lefebvre
● Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires
– Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer financement du développement pour le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement)
– Jean Merckaert, administrateur de l’association Sherpa
– Grégoire Niaudet, Secours catholique-Caritas France
● Christian Chavagneux, journaliste d’Alternatives économiques
● Syndicat Solidaires–Finances publiques
– Florence Toquet, secrétaire nationale
– Lionel Tchang, secrétaire de la section DVNI
● AFEP (Association française des entreprises privées)
– Pierre Pringuet, président
– Stéphanie Robert, directeur
– Laetitia de La Rocque, directeur des affaires fiscales
● MEDEF (Mouvement des entreprises de France)
– Marie-Christine Coisne-Roquette, présidente de la commission de la fiscalité
– Marie-Pascale Antoni, directrice de la fiscalité
– Ophélie Dujarric, chargée de mission à la direction des affaires publiques
● Fédération française des télécoms
– Yves Le Mouël, directeur général
– Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint
● Fédération bancaire française
– Patrick Suet, président du comité fiscal
– Blandine Leporcq-Sallès, directrice du département d’expertise fiscale
● Société générale
– Patrick Suet, secrétaire général
– Thierry Métais, directeur fiscal
● BNP-Paribas Groupe
– Jean Clamon, délégué général et responsable de la fonction conformité et de la coordination du contrôle interne
– Christian Comolet-Tirman, responsable des affaires fiscales
● Fédération française des sociétés d’assurance
– Jean-François Lequoy, délégué général
– François Tallon, directeur fiscal
– Philippe Haon, président du comité fiscal
– Ludivine Azria, attachée parlementaire
● Allianz France
– Jacques Richier, président directeur général
– Christine Bouvier, secrétaire générale et directrice fiscale
● Axa
– Henri de Castries, président directeur général
– Cyrille de Montgolfier, vice-président des affaires européennes et institutionnelles
– Armand Limongi, directeur des affaires fiscales
● Total SA
– Serge Brosolo, directeur fiscal
– Nathalie Mognetti, directrice fiscale adjointe
– Francois Tribot-Laspiere, adjoint au directeur affaires publiques France et ONG
● Starbucks Coffee France
– Olivier de Mendez, directeur marketing et communication
– accompagné de Stéphane Harrouch, directeur du pôle affaires publiques d’Edelman Paris, conseil de Satrbucks Coffee France
● Google France
– Olivier Esper, directeur des relations institutionnelles
– Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, directrice de la communication
● Amazon Europe
– Andrew Cecil, directeur des relations institutionnelles Europe
– accompagné de Mathilde Defarges, directrice exécutive d’Arcturus Group, conseil d’Amazon Europe
● PriceMinister
– Pierre Kosciusko-Morizet, président-directeur général
– Philippe Favrot, directeur administratif et financier
Lors du déplacement aux Pays-Bas (La Haye)
● Représentation française
– Pierre Ménat, ambassadeur de France aux Pays-Bas
– Bernard Boidin, conseiller économique, chef du service économique de l’ambassade
– Patrick Bernard, attaché fiscal
● Parlementaires membres de la commission des Finances de la Chambre basse
– Ed Groot, parti PvdA
– Jesse Klaver, parti Groenliks
– Arnold Merkies, parti SP
– Helma Neppérus, parti VVD
● Ministère des Finances
– Edwin Visser, directeur général adjoint de la politique et de la législation fiscale et douanière
– Marian Bette, conseillère senior pour les relations internationales
– Maikel Evers, conseiller pour la fiscalité internationale
– Arjan de Klerk, conseiller pour les questions européennes
● Avocats fiscalistes
– Fanny-Marie Brisdet, cabinet Brisdet Spiegeler
– Isabelle Heuzé, cabinet Loyens & Loeff
Lors du déplacement aux États-Unis (Washington DC)
● Représentation française
– François Delattre, ambassadeur de France aux États-Unis
– Frédéric Doré, ministre conseiller, chef du service économique de l’ambassade
– Stéphane Paillaud, conseiller financier, adjoint au chef du service économique
– Florent Tesson, attaché fiscal
– David Merrien, attaché fiscal adjoint
– Cameron Griffith, chargé de liaison avec le Congrès
● Congrès
– Representative Joseph Crowley (Démocrate, État de New York), membre du Ways & Means Committee
– Representative Kenny Marchant (Républicain, Texas), membre du Ways & Means Committee
– Representative Patrick J. Tiberi (Républicain, Ohio), membre du Ways & Means Committee
– Brad Bailey, policy director auprès du Representative Tiberi
– Ray Beeman, tax counsel and special advisor for tax reform auprès du Representative Dave Camp (Républicain, Michigan), Président du Ways & Means Committee
– Kevin Casey, counsel auprès du Representative Crowley
– Jason A. Park, revenues counsel auprès de la Sénatrice Patty Murray (Démocrate, État de Washington), Présidente du Committee on the Budget
● Département du Trésor
– Robert B. Stack, U.S. Deputy Assistant Treasury Secretary for International Tax Policy
● Administration fiscale
– Michael Danilack, Deputy Commissionner (international) Large business and international division, Internal Revenue Service
● Représentants des entreprises
– Catherine Shultz, vice-présidente pour la politique fiscale du National Foreign Trade Council
– Janet C. Boyd, director of Government relations tax and benefits, The Dow Chemical Company
– Carol A. Dunahoo, attorney at law, Baker & McKenzie
– Linda C. Evans, executive worldwide tax policy Governmental programs, IBM
– James R. McCarthy, director global tax and fiscal policy, Procter & Gamble
– Catherine T. Porter, Washington counsel and director of public policy Government relations, Agilent Technologies
● Avocats fiscalistes
– H. David Rosenbloom, member, cabinet Caplin & Drysdale
– Patricia G. Lewis, attorney, cabinet Caplin & Drysdale
● Experts
– Michael Durst, ancien directeur du service des accords préalables en matière de prix de transfert de l’Internal Revenue Service
– Martin A. Sullivan, chef économiste de la revue Tax Analysts
– Eric Toder, co-directeur du Tax Policy Center – The Urban Institute
1 () Qu’il s’agisse, en France, de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu pour celles des entreprises qui en sont redevables.
2 () OCDE, Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, 2013, dit « BEPS » : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices_9789264192904-fr
3 () « Countries should change rules that let companies shift their profits across borders to avoid taxes »: https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration
4 () Sachant qu’il ne s’agit pas dans ce rapport d’étudier les niches fiscales dont peuvent bénéficier les entreprises, mais uniquement les principaux mécanismes qui leur permettent d’optimiser leur charge d’impôt eu égard à leurs activités transnationales.
5 () Cf. article 1741 du code général des impôts.
6 () En anglais tax planning, voire aggressive tax planning.
7 () Conseil d’État, 10 juin 1981, requête n° 19079.
8 () La notion d’abus de droit est définie et codifiée à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
9 () En application de l’article 1729 du code général des impôts.
10 () En application de l’article 1727 du code général des impôts.
11 () Cf. notamment : décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. (considérant 6) ; décision n° 2010-70 QPC du 20 novembre 2010, M. Pierre-Yves M. (considérant 4) ; décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société Heatherbrae Ltd (considérant 5).
12 () Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012 sur la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (considérant 19).
13 () Centre for Tax Policy and Administration : Glossary of Tax Terms: http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#T
14 () « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. »
15 () Ministère de l’Économie et des finances, Tableau de bord de l’attractivité de la France, 2012 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/377556
16 () Idem.
17 () Avec la contribution sociale sur l’IS, au taux de 3,3 % et la contribution exceptionnelle sur l’IS, au taux de 5 %.
18 () CNUCED, « Global investment trends monitor », 23 janvier 2013 :
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d1_en.pdf ;
Agence française pour les investissements internationaux, rapport annuel, 2012 :
19 () BEPS, page 19.
20 () Harry Partouche et Matthieu Olivier, « Le taux de taxation implicite des bénéfices en France », Trésor-éco, n° 88, juin 2011 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/file/325821
21 () http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2013/RPO2013.pdf, pages 45 à 51.
22 () Le TEI rapporte la somme de l’impôt exigible et de l’impôt différé au résultat imposable consolidé. Il est un indicateur très suivi par les marchés financiers.
23 () Soit 1 700 millards de dollars.
24 () JP Morgan, « Global Tax Rate Makers : Undistributed Foreign Earnings Top $1.7 Trillion; At Least 60 % of Multinational Cash is Abroad », 2012.
25 () D’après l’INSEE, les IDE sont les « investissements qu'une unité institutionnelle résidente d'une économie effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d'une autre économie et d'exercer, dans le cadre d'une relation à long terme, une influence significative sur sa gestion. Par convention, une relation d'investissement direct est établie dès lors qu'un investisseur acquiert au moins 10% du capital social de l'entreprise investie. Les investissements directs comprennent non seulement l'opération initiale qui établit la relation entre les deux unités, mais également toutes les opérations en capital ultérieures entre elles et entre les unités institutionnelles apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés. ». http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/investis-directs-etrangers.htm
26 () En 2009, le stock d’IDE entrants et sortants des Îles Vierges Britanniques représentait près de 270 fois leur PIB (Conseil d’analyse économique, note d’analyse n° 222 « Centres financiers offshore et système bancaire "fantôme" », 2011 : http://www.strategie.gouv.fr/content/note-d%E2%80%99analyse-222-centres-financiers-offshore-et-systeme-bancaire-fantome#les-ressources).
27 () En anglais, Special Purpose Vehicle (SPV).
28 () BEPS, page 22.
29 () Philippe Marini, L’impact du développement d’Internet sur les finances de l’État, rapport d’information n° 398, avril 2010, annexe 2, pages 83 et suivantes : http://www.senat.fr/commission/fin/evenements/EtudeGreenwichConsulting.pdf
30 () Greenwich consulting, « Étude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et les schémas d’optimisation fiscale des acteurs "Over-the-Top" », 17 avril 2013 : http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/brochure_ott_4_pages.pdf
31 () Ainsi, les auteurs de l’étude appliquent aux activités facturées en France le taux de marge brute standard observable au niveau de chaque groupe sur ses résultats monde, puis soumettent l’assiette ainsi calculée à un taux d’IS de 33,1/3 %.
32 () Avis n° 8 du Conseil national du numérique relatif à ses pistes de réflexion en matière de fiscalité du numérique, 14 février 2012 : http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2012/05/2012-02-14_AvisCNNum_08_Fiscalit%C3%A9.pdf
33 () En France, l’article 34 de la Constitution de 1958 dispose que « la loi fixe les règles concernant […] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
34 () Par exemple l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Mercado Común del Sur (Mercosur), ou l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
35 () BEPS, page 50.
36 () BEPS, annexe C, page 79.
37 () Revenus nets perçus par le contribuable luxembourgeois en rémunération de l’usage de droit d’auteur sur les logiciels, de brevet, de marque, de dessin ou de modèle (article 50 bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu).
38 () Patrick Rassat, Thierry Lamorlette, Thibault Camelli, Stratégies fiscales internationales, Maxima, 2010.
39 () OCDE, Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial, 1998 : http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederenseignementsadesfinsfiscales/45630364.pdf
40 () Government of Bermuda, Department of Statistics, Facts & Figures, 2012 : http://www.bdaexhibition.bm/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_980_227_1014_43/http%3B/ptpublisher.gov.bm%3B7087/publishedcontent/publish/cabinet_office/statistics/dept___statistics___additonal_files/2012_facts___figures_0.pdf
41 () Agence française pour les investissements internationaux, rapport annuel, 2012, précité.
42 () Ministère de l’Économie et des finances, Rencontre de haut niveau entre plusieurs pays de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements – Relevé des conclusions, http://www.minefe.gouv.fr/fonds_documentaire/archives/dossiersdepresse/081021evasion_fiscale/releve_conclusions.pdf
43 () Ces standards sont essentiellement reflétés dans le Modèle d’accord d’échange de renseignements en matière fiscale et ses commentaires (http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/33977677.pdf),et dans l’article 26 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE et ses commentaires (http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/120718_Article%2026-FR.pdf).
44 () L’appréciation de ce critère renvoyant concrètement à la conclusion d’au moins douze conventions fiscales conformes aux standards de l’OCDE.
45 () http://www.stopparadisfiscaux.fr/les-pfj-c-est-quoi/notre-liste/article/les-juridicitions-concernees-par-l
46 () Ainsi que, entre autres, de taxe sur le chiffre d’affaires, d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune, de droits sur les successions.
47 () Imposition des sociétés en l’espèce.
48 () Que l’on pourrait traduire par « refuge zéro [impôt] ».
49 () En application de l’article 182 B du code général des impôts.
50 () Le taux atteint en revanche 55 % pour les entreprises du secteur pétrolier.
51 () Le montant de ce droit annuel de licence est calculé selon une formule complexe associant le niveau du chiffre d’affaires dégagé et le taux de rentabilité de l’entreprise, oscille entre un minimum de 100 dollars bahamiens (environ 75 euros) et un maximum égal à 0,5 % du chiffre d’affaires ou 500 000 dollars bahamiens (environ 375 000 euros). Ces deux derniers seuils étant applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 28 millions de dollars bahamiens (plus de 21 millions d’euros) et dont le taux de rentabilité est supérieur à 75 %.
52 () CNUCED, Étude sur les transports maritimes, 2011 : http://unctad.org/fr/Docs/rmt2011_fr.pdf
53 () Article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
54 () BEPS, page 38.
55 () BEPS, page 38. Il faut signaler que la France est l’un des États dont le réseau conventionnel est le plus dense (120 conventions environ).
56 () Dès 1921, la Société des nations avait travaillé à l’élaboration d’un modèle de convention, qui a vu le jour en 1928.
57 () Dont le nom officiel est « Modèle de l’OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune » : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/modeleocdedeconventionfiscaleconcernantlerevenuetlafortunedifferentesversionsdisponibles.htm
58 () Qui rassemble notamment des experts représentant les États membres.
59 () Conseil d’État, Section, 20 juin 2003, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre Société Interhome AG, requête n° 224407.
60 () BEPS, page 9.
61 () Pierre Collin et Nicolas Colin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport au ministre de l’Économie et des finances, au ministre du Redressement productif, au ministre délégué chargé du Budget et à la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique : http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf
62 () BEPS, page 9.
63 () Cette définition est en somme une traduction de celle donnée par le glossaire des termes fiscaux de l’OCDE : « An analysis of tax treaty provisions to structure an international transaction or operation so as to take advantage of a particular tax treaty. The term is normally applied to a situation where a person not resident of either the treaty countries establishes an entity in one of the treaty countries in order to obtain treaty benefits. ».
64 () En vertu du Exempted Undertakings Tax Protection Act de1966, les captives peuvent solliciter auprès du ministre des Finances l’établissement d’un certificat d’exonération fiscale (certificate of tax exemption) qui les exonère de toute taxe sur les bénéfices ou sur le revenu jusqu’en 2016 (le dispositif est régulièrement prorogé).
65 () Conseil d’analyse économique, note d’analyse n° 222 « Centres financiers offshore et système bancaire "fantôme", 2011, précitée.
66 () La question du choix entre ces deux moyens est fréquemment résumée en anglais par la formule suivante : « debt vs. equity ».
67 () Extrait de l’évaluation par la Commission européenne du programme national de réforme pour 2012 et du programme de stabilité de la France, mai 2012 :
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_france_fr.pdf
68 () Fréquemment désigné sous le terme de « niche Copé », en référence au ministre du Budget en fonction au moment de sa création.
69 () Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et « niches » fiscales et sociales – Des dispositifs dérogatoires nombreux, octobre 2010, page 285 :
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Entreprises-et-niches-fiscales-et-sociales
70 () OCDE, Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales, 2012 : http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/HYBRIDS_FR_Final_October2012.pdf
71 () OCDE, Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales, page 7.
72 () Idem.
73 () OCDE, Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales, 2012, pages 5 et 6.
74 () Ou plus généralement entre sociétés liées. Au sens du 12 de l’article 39 du CGI, deux entreprises sont considérées comme ayant des liens de dépendance lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l’une et l’autre, directement ou indirectement, sous le contrôle d’une même entreprise.
75 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013 : http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2013/2012-M-032-03%20Note.pdf
76 () Accessoirement, il peut déterminer pour partie la rémunération des équipes dirigeantes, souvent corrélée à la bonne tenue de certains ratios dont le TEI global peut faire partie.
77 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 10.
78 () OCDE, Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2010 : ftp://s208.math.msu.su/580000/0933c92cc4ba73882e08ce0861afd1d4
79 () Les accords préalables de prix de transfert bilatéraux, conclus entre les États par lesquels transitent les flux, sont plus sécurisants pour le contribuable que les accords unilatéraux, conclus entre le contribuable et une seule administration.
80 () OCDE, Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2010.
81 () Que « vaut » réellement la marque Google ? Vaut-elle plus toutes choses égales par ailleurs, dans son univers de référence, que la marque Volkswagen ?
82 () Sur l’inadaptation du droit fiscal en général à l’économie numérique « pure » et sur le processus de numérisation de l’économie « traditionnelle », voir notamment le rapport précité de Pierre Collin et Nicolas Colin, qui emploie la formule suivant : « Le numérique dévore le monde ».
83 () http://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf
84 () OCDE, Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2010, chapitre VII « Considérations particulières applicables aux services intra-groupe ».
85 () United States Tax Court, Veritas Software Corporation & Subsidiaries, Symantec Corporation (Successor in Interest to Veritas Software Corporation a Subsidiaries), Petitioner vs. Commissioner of Internal Revenue, Respondant, 10 décembre 2009.
86 () Notamment l’utilisation de toutes les marques de la société (marques déposées, marques commerciales), les brevets, copyrights, le design, les standards de production, les standards de contrôle qualité, etc.
87 () OCDE, Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, juillet 2010.
88 () Cf. infra les développements sur les formes que prend cette préoccupation, et sur les réactions envisagées.
89 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 19. .
90 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 21.
91 () Pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (en anglais : EMEA pour Europe, Middle-East and Africa), qui représenterait près de 90 % du chiffre d’affaires non américain de Google (soit une estimation de plus de 10 milliards de dollars).
92 () À la différence d’autres filiales comme par exemple Google UK Ltd, Google France SARL perçoit un autre revenu, payé par Google Inc., au titre d’activités de recherche et développement localisées en France, activités qui emploient environ 100 personnes.
93 () Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents.
94 () Lors de son déplacement aux Pays-Bas, la mission a été informée que Google y emploie environ 100 personnes, mais il semblerait que ces personnes soient employées par l’équivalent de Google France SARL pour le même type d’activités de promotion, et non pour « gérer » la réception et le transfert de la redevance versée par Google Ireland Ltd. Le nombre de salariés de Google Netherlands BV serait, à en croire certains articles de presse, égal ou proche de zéro.
95 () Depuis la mise en place du montage, cette retenue à la source a été supprimée du droit irlandais ; le détour par les Pays-Bas ne serait donc plus nécessaire si le montage était mis en place aujourd’hui. Mais il pourrait le redevenir demain, car les pouvoirs publics irlandais envisagent un retour au droit antérieur.
96 () Selon Google, ils servent à financer les activités du groupe dans le monde, notamment en matière de recherche.
97 () Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
98 () En application de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
99 () Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
100 () Pour plus d’information, cf. Christian Eckert, Rapporteur général au nom de la commission des Finances, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, n° 79, juillet 2012, pages 258 à 265 (commentaire de l’article 14) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r0079.pdf
101 () Idem, pages 270 à 300 (commentaire de l’article 15).
102 () Soit le résultat positif de la différence entre les charges financières brutes et les produits financiers.
103 () Évaluation préalable annexée à l’article 15 du projet de loi de finances pour 2013.
104 () Maurice Cozian et Florence Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises 2012/2013, LexisNexis.
105 () Exemples : création d’une société fictive ; qualification volontairement erronée d’un acte.
106 () Cette expression usuelle peut être trompeuse ; elle signifie en réalité « contournement de l’esprit de la loi ».
107 () L’article 1653 C du code général des impôts prévoit que le comité de l’abus de droit fiscal est composé des personnalités suivantes, nommées par le ministre chargé du budget : un conseiller d’État (président), un conseiller à la Cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités (agrégé de droit ou de sciences économiques). Le ministre nomme également un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A de la Direction générale des Finances publiques.
108 () En application de l’article 1727 du code général des impôts.
109 () En application de l’article 1729 du code général des impôts.
110 () Cf. notamment Conseil d’État, 7ème, 8ème et 9ème sous-sections réunies, 27 juillet 1984, SA Renfort Service, requête n° 34588.
111 () La rédaction de l’article 57 invite en effet à une analyse transaction par transaction, davantage qu’à une comparaison générale du comportement des entreprises liées et des entreprises indépendantes.
112 () Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 novembre 2005, Ministre d’État, ministre des finances, de l’économie et de l’industrie contre Société Cap Gemini, requête n° 266436.
113 () Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
114 () L’obligation touche également :
- les personnes qui détiennent directement ou indirectement une entreprise vérifiant ce critère de 400 millions d’euros ;
- celles dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue par l’une de ces entreprises ;
- les entreprises appartenant à un groupe fiscalement intégré comptant en son sein une entité vérifiant le critère.
115 () Les entreprises associées étant définies par référence au 12 de l’article 39 du CGI (cf. supra).
116 () Allemagne, Canada, États-Unis, Pays-Bas et Royaume-Uni.
117 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 26.
118 () La commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales proposait la transmission des comptes consolidés du groupe, et non des seuls comptes sociaux de l’entreprise vérifiée : Éric Bocquet, rapporteur au nom de la commission d’enquête, L’évasion fiscale internationale, et si on arrêtait ?, rapport d’information n° 673, tome 1, juillet 2012, page 437 : http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-11.pdf
119 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 25.
120 () Mais aussi d’un certain nombre d’autres revenus, comme les rémunérations de prestations de service.
121 () Le dispositif français est ainsi conforme au droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne (12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc., affaire C-196/04).
122 () Pour plus d’information, cf. Christian Eckert, Rapporteur général au nom de la commission des Finances, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, n° 79, juillet 2012, pages 219 à 227 (commentaire de l’article 11).
123 () Cf. rapport n° 1033/10 FISC 47 du Groupe « Code de conduite » (fiscalité des entreprises) au conseil ECOFIN du 8 juin 2010. Aux termes de ce code, adopté en 1997, les États membres s’engagent à ne plus instaurer de nouvelles mesures fiscales « dommageables » et à modifier les dispositions ou pratiques jugées « préjudiciables ». Le Groupe de suivi, créé en 1998, s’assure de la bonne application de cette initiative.
124 () OCDE, Dispositifs hybrides – Questions de politique et de discipline fiscales, 2012, page 23.
125 () Idem.
126 () On retiendra par exemple que c’est le contrôle fiscal qui a mis à jour les pratiques des « coquillards » : ces entreprises vident de leur substance financière des cibles dont elles font l’acquisition, en faisant remonter des dividendes sous le régime mère-fille ou le régime de groupe. Puis elles revendent les cibles en constatant, précisément du fait de leur « vidange », une moins-value de cession des titres. Cette moins-value est déductible de l’assiette si elle intervient dans un délai de deux ans suivant l’acquisition, ce qui minore l’assiette taxable après que les dividendes ont été remontés en franchise ou quasi-franchise d’impôt. L’article 16 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a modifié le droit fiscal afin d’empêcher ce type de montage. Pour plus de précision, cf. Christian Eckert, Rapporteur général au nom de la commission des Finances, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, n° 79, juillet 2012, pages 241 à 257 (commentaire de l’article 13).
127 () Jusqu’à la fin de la troisième année suivant sa clôture plus précisément. Ce délai de droit commun peut être porté dans certains cas, jusqu’à 10 ans.
128 () OCDE, Lutter contre la planification fiscale agressive par l’amélioration de la transparence et de la communication de renseignements, 2011, page 12 : http://www.oecd.org/tax/administration/47027180.pdf
129 () OCDE, Étude du rôle des intermédiaires fiscaux, 2008, page 44 :
http://www.oecd.org/fr/royaumeuni/40233505.pdf
130 () OCDE, Lutter contre la planification fiscale agressive par l’amélioration de la, transparence et de la communication de renseignements, 2011, page 18.
131 () Désormais consolidées dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP), auquel on peut se reporter ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html.
132 () Procédures elles-mêmes prévues par l’article 25 du Modèle OCDE.
133 () Instruction du 7 septembre 1999, Bulletin officiel des impôts (BOI) 4 A-8-99.
134 () Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
135 () Instruction du 24 juin 2005, BOI 4 A-11-05.
136 () Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, page 41 : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/transversal/Dossier-presse-competitivite.pdf.
137 () Les développements qui suivent reposent notamment sur les informations utilement fournies par les services de l’attaché fiscal pour les Pays-Bas.
138 () Dans une lettre au Parlement en date du 8 avril 2005, le secrétaire d’État aux Finances définissait la supervision horizontale comme « une confiance mutuelle entre contribuables et administration fiscale, une répartition plus précise des responsabilités de chaque partie, une connaissance des options disponibles pour respecter la loi et la mise en œuvre d’engagements réciproques ».
139 () « Such transaction is of a type which the Secretary determines as having a potential for tax avoidance or evasion. »
140 () L’administration fiscale britannique, Her Majesty’s Revenue & Customs, a publié en février 2012 une instruction (guidance) actualisée sur DOTAS : http://www.hmrc.gov.uk/aiu/dotas.pdf.
141 () OCDE, Lutter contre la planification fiscale agressive par l’amélioration de la transparence et de la communication de renseignements, 2011, page 19.
142 () Ce passage, comme la description des dispositifs étrangers, repose notamment sur l’ouvrage de référence précité de Patrick Rassat, Thierry Lamorlette et Thibault Camelli, Stratégies fiscales internationales, 2010, pages 180 et 181.
143 () Didier Migaud, Gilles Carrez, Jean-Pierre Brard, Henri Emmanuelli, Jean-François Mancel et Nicolas Perruchot, La lutte contre les paradis fiscaux : 30 propositions pour passer à l’acte, rapport d’information n° 1902, septembre 2009, page 138 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1902.pdf
144 () Éric Bocquet, L’évasion fiscale internationale, et si on arrêtait ?, rapport d’information n° 673, tome 1, juillet 2012, page 431.
145 () OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 2010, page 19.
146 () Par exemple la Convention nordique concernant l’imposition du revenu et de la fortune, conclue en 1983 et qui lie le Danemark, l’Islande, la Finlande, la Norvège et la Suède ainsi que les Îles Féroé.
147 () OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 2010, page 19.
148 () Rappelons à cet égard que l’article 7 du Modèle OCDE privilégie l’imposition des bénéfices d’exploitation au niveau de l’État dont l’entreprise est résidente plutôt que dans l’État source de ces bénéfices.
149 () Industries extractives par exemple : hydrocarbures, uranium, minerais etc.
150 () Rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin, précité.
151 () Ou la présence d’un agent dépendant de l’entreprise et agissant pour son compte au sein dudit territoire. Pour plus de précisions sur la notion, cf. supra.
152 () OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 2010, commentaires sur l’article 5.
153 () Rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin, précité, page 123.
154 () Idem.
155 () Idem, Page 125.
156 () Rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin, précité, page 125.
157 () Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie. L’Union européenne est en outre représentée par le Président de la Commission (Jose Manuel Barroso) et le Président du Conseil européen (Herman Van Rompuy).
158 () COM(2011) 712 final:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
159 () C(2012) 8806 final: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_fr.pdf
160 () Idem, page 2.
161 () Idem.
162 () Idem, page 4.
163 () Idem, page 5.
164 () C(2012) 8806 final, page 6.
165 () Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
166 () Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés.
167 () Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents.
168 () Dont les dispositions ont été transposées au sein des articles 199 quater et 182 B bis du code général des impôts.
169 () Article premier : « Les paiements d’intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État d’origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d’un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d’une société d’un État membre. »
170 () C’est, littéralement, cette clé de répartition qui constitue le formulary apportionment.
171 () Inspection générale des finances, Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, 2013, page 12.
172 () Bien que la fiscalité directe ne relève pas directement de la compétence de l’Union, l’article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), base juridique de la proposition ACCIS, stipule que « le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur ».
173 () Une définition spécifique du périmètre d’intégration fiscale est donc prévue par l’article 54 de la proposition de directive : l’intégration serait possible lorsque la mère détient plus de 50 % des droits de vote et plus de 75 % du capital ou des droits à la répartition des bénéfices.
174 () Pour une période de cinq ans.
175 () L’exclusion des actifs incorporels est justifiée par « leur caractère mobile et des risques de fraude » (considérant 21).
176 () Identifié par destination, c’est-à-dire dans l’État membre dans lequel est réalisée la vente ou la prestation de service.
177 () Une coopération renforcée, autorisée par le Conseil à la majorité, est juridiquement possible, sur le fondement de l’article 329 du TFUE.
178 () L’article 80 de la proposition de directive prévoit notamment une clause générale anti-abus, stipulant que « les transactions artificielles réalisées dans le seul but d’échapper à l’impôt ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l’assiette imposable ».
179 () Philippe Marini, L’impact du développement du commerce électronique sur les finances de l’État, rapport d’information n° 398, avril 2010 : http://www.senat.fr/rap/r09-398/r09-3981.pdf.
180 () Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
181 () Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
182 () Dite Tascoé par parallélisme avec la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), dont elle se voulait le pendant.
183 () N° 682 rectifié : http://www.senat.fr/leg/ppl11-682.pdf. Cette proposition de loi fait elle-même suite à un nouveau rapport d’information de Philippe Marini : Une feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable, n° 614, juin 2012 : http://www.senat.fr/rap/r11-614/r11-6141.pdf.
184 () Prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
185 () Il s’agit d’un mécanisme de guichet unique, prévu par le droit de l’Union européenne, permettant à un opérateur de déclarer dans un seul État membre la TVA due dans plusieurs États membres, à charge pour l’État de déclaration de répartir entre les autres États la TVA collectée par ses soins.
186 () Yvon Collin, Rapporteur au nom de la commission des Finances du Sénat, n° 287, janvier 2013. Les développements de cette partie s’inspirent d’ailleurs très utilement de ce rapport : http://www.senat.fr/rap/l12-287/l12-2871.pdf.
187 () 5 mai 2011, Commission contre Portugal, affaire C-267/09.
188 () Notion évoquée supra.
189 () Rapport précité de Pierre Collin et Nicolas Colin, page 132.
190 () Idem, page 23.
191 () http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/33977677.pdf
192 () Global Forum on Transparency and Exchange of Information for tax Purposes, Tax Transparence 2012 Report of Progress : http://www.oecd.org/tax/transparency/Tax%20Transparency%202012_JM%20MB%20corrections%20final.pdf
193 () Sur cette question, on pourra utilement se référer aux travaux menés par la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires.
194 () http://ccfd-terresolidaire.org/mob/agir/campagnes/pacteterresolidaire/Suivez-l-actualite-de-la-campagne/les-reponses-des/reponse-de-francois-3319
195 () http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/137218.pdf, page 8.
196 () «We have tried to define precisely what it means to be a force for good – always do the right, ethical thing.». http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312504142742/ds1a.htm#toc59330_1
197 () Permanent Subcommittee on Investigations of the US Senate Homeland Security and Government Affairs Committee.
198 () http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/offshore-profit-shifting-and-the-us-tax-code_-part-2
199 () Traduction d’un passage de la tribune « At Google we aspire to do the right thing. So we welcome a debate on international tax reform. », publiée dans l’hedomadaire britannique The Observer, le 18 mai 2013.
200 () Rapport précité de Pierre Collin et Nicolas Colin, page 137.
201 () BEPS, page 35.
202 () Éric Bocquet, L’évasion fiscale internationale, et si on arrêtait ?, rapport d’information n° 673, tome 1, juillet 2012, page 427.
203 () Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », COM(2011) 681 final : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF
204 () http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-responsabilite.html
205 () Seules sont concernées certaines entreprises, en fonction de seuils définis par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.
206 () Article L. 225-102-1 du code de commerce.
© Assemblée nationale