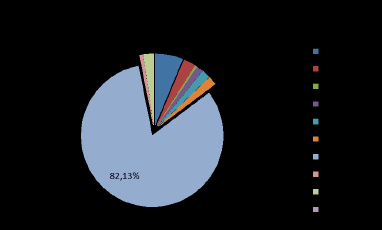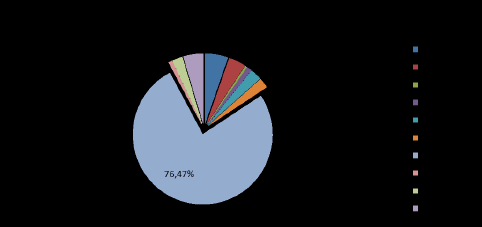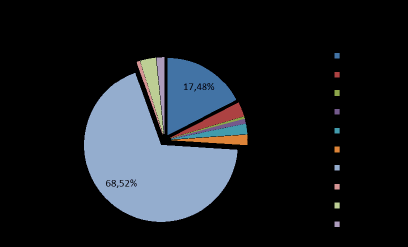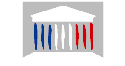
N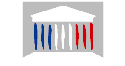
° 1535
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 novembre 2013
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 14 novembre 2012,
sur les émergents de l’Afrique anglophone
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Noël Mamère et Michel Zumkeller
Rapporteurs
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
L’HEURE DE L'AFRIQUE ? 9
I. LES PROBLÉMATIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU CONTINENT 9
A. LES STIGMATES DU SOUS-DÉVELOPPEMENT LOIN D’AVOIR DISPARU 9
1. En premier lieu, la violence et la mauvaise gouvernance 9
a. L’Afrique, théâtre de conflits meurtriers 9
b. Une démocratisation lente et fragile 10
c. Une gestion publique qui reste à améliorer 11
2. Le continent de loin le moins développé 12
a. La persistance de la malnutrition 12
b. Les indices de développement les plus faibles 12
3. Des progrès néanmoins en matière d’OMD, mais encore souvent insuffisants 13
B. DES ÉCONOMIES AUJOURD'HUI PORTÉES PAR LA MONDIALISATION 15
1. Une région aujourd'hui en forte croissance 15
a. Des données macroéconomiques nouvelles 15
b. Éléments de comparaison avec les autres régions du monde 17
2. Les fondements de la croissance africaine 19
a. Le facteur démographique et la montée des classes moyennes 19
b. Les exportations et le poids des matières premières 21
c. Un meilleur environnement et des politiques économiques améliorées 23
3. Des performances néanmoins contrastées 24
II. L’AFRIQUE ÉMERGE-T-ELLE ? 27
A. L’AFRO-OPTIMISME A LE VENT EN POUPE… 27
1. Les certitudes de nombreux observateurs 27
a. « Les conditions du décollage de l'Afrique sont réunies » 27
b. « La croissance ne peut que se confirmer » 29
2. La confiance des investisseurs 31
a. Des investissements étrangers sans cesse plus importants 31
b. Des IDE d’origine plus diversifiée… 32
c. … Mais qui restent encore majoritairement destinés au secteur primaire 33
B. IL RESTE NÉANMOINS DES DÉFIS MAJEURS À RELEVER 35
1. Des conditions qui ne garantissent pas encore tout à fait l’émergence 35
a. Une croissance encore insuffisante 35
b. La nécessité de prendre en compte certains impératifs 37
2. La dépendance vis-à-vis de l’international 40
a. L’impact de la crise sur la demande de matières premières africaines 40
b. Les incidences de la relation de l'Afrique avec les émergents 42
FOCUS SUR L'AFRIQUE ANGLOPHONE 47
I. L’AFRIQUE DU SUD, PRIMUS INTER PARES 47
A. RESITUER L’ÉMERGENCE DE L'AFRIQUE DU SUD DANS LE CONTEXTE AFRICAIN 47
1. Le géant économique incontestable du continent 48
a. L'Afrique du Sud, loin devant les autres pays africains 48
b. Un positionnement contrasté quant aux IDE 50
2. Quelques caractéristiques de l’économie sud-africaine 53
a. Le secteur minier, emblématique des réussites et difficultés de l’économie sud-africaine 53
b. Une économie cependant bien plus diversifiée que dans de nombreux pays africains 54
3. Des ambitions tous azimuts 55
a. Les moyens d’une ambition économique 56
b. La volonté de s’imposer sur la scène internationale 58
B. « SAD SOUTH AFRICA: CRY, THE BELOVED COUNTRY » 60
1. De loin, le plus petit des BRICS 61
a. Des performances économiques en fait modestes 61
b. Sur le long terme, des tendances préoccupantes 65
2. Les hypothèques sur l’avenir de l’Afrique du Sud 67
a. Des faiblesses majeures qui sont autant de véritables handicaps pour le pays 68
b. L’acuité des problématiques sociales et politiques : le rêve en panne de la nation « Arc-en-ciel » 72
II. FORCES ET FAIBLESSES DES PRÉTENDANTS À L’ÉMERGENCE 75
A. DES HANDICAPS NOMBREUX QUI N’EMPÊCHENT CEPENDANT PAS D’AVANCER 76
1. Le Nigeria, pays de tous les déséquilibres, et pourtant… 76
a. Une société fortement clivée, minée par l’insécurité et la violence 76
b. Des déséquilibres internes très profonds 80
c. Un pays viable, cependant 82
2. Les traumatismes du Kenya, réellement surmontés ? 83
a. Une remarquable sortie de crise politique 83
b. Des facteurs de tensions cependant toujours présents 85
c. D’autres défis se profilent aussi 86
B. UN DYNAMISME REMARQUABLE, DES PERFORMANCES ÉTONNANTES 88
1. Des ressources naturelles, encore et toujours, comme point de départ 88
a. Les paradoxes pétroliers du Nigeria ne l’empêchent pas de faire la course en tête 88
b. En passe de réussir la diversification et la modernisation de son économie, le Kenya monte en puissance 94
c. Le Ghana est entré en piste à son tour 96
2. Des ambitions régionales qui s’affirment aussi 98
a. Le Nigeria, acteur diplomatique important 98
b. Les visées économiques du Kenya 100
LE POSITIONNEMENT DE LA FRANCE ET LES PERSPECTIVES QUI S’OFFRENT 103
I. LE CONSTAT D’UNE PRÉSENCE MODESTE 103
A. L’ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX 103
1. C’est de loin en Afrique francophone que la France a ses parts de marché les plus importantes 103
2. Des positions en revanche généralement faibles en Afrique anglophone et fréquemment en diminution 104
a. L’évolution de nos parts de marché : le verre à moitié vide ou à moitié plein 105
b. Quelques caractéristiques de nos exportations vers l’Afrique anglophone 107
B. LA FAIBLESSE DES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS 109
1. Vue d’ensemble sur des IDE encore modestes et concentrés 109
2. Coup de projecteur sur les investissements français 111
a. Les investissements français en Afrique du Sud 111
b. Regard sur les investissements dans les autres pré-émergents anglophones 113
c. Quelques données sur d’autres destinations 115
3. Au fondement du constat, l’inadaptation aux marchés ? 116
II. FAIRE DE L’AFRIQUE ANGLOPHONE UNE PRIORITÉ : LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 117
A. RECENTRER NOS DISPOSITIFS DE SOUTIEN 118
1. La discrétion de nos instruments en Afrique anglophone 118
a. L’incidence de la désertion des banques françaises 118
b. Des mécanismes de soutien suffisamment présents ? 119
2. Aller plus loin dans la réaction bienvenue des pouvoirs publics 121
a. Une stratégie pour le commerce extérieur qui n’est peut-être pas à la hauteur de l’analyse 121
b. Des premières mesures positives mais sans doute insuffisantes 125
3. Réévaluer des relations généralement bonnes 127
a. Des relations politiques avec l'Afrique anglophone qui tournent au ralenti 127
b. Une demande et une nécessité : l’exemple venu de l’étranger 131
c. Des inflexions opportunes 133
B. L’IMPÉRATIF POUR LA FRANCE D’ÊTRE PRÉSENTE 135
1. Le poids des nombres 135
2. Un constat partagé par les entreprises françaises 136
C. RÉPONDRE AUX DIVERSES ATTENTES 139
1. Être attentif à la demande politique 139
a. Une Afrique anglophone en attente de dialogue et de partenariat politique avec la France 139
b. Le levier de la francophonie politique 140
c. Une aide au développement heureusement conséquente 141
2. Répondre à la demande économique 144
a. La francophonie comme levier économique intra-africain 144
b. Entendre la demande de France pour elle-même 145
CONCLUSION 149
EXAMEN EN COMMISSION 153
ANNEXES 163
ANNEXE N° 1 : CARTE DE L’AFRIQUE 165
ANNEXE N° 2 : LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES 167
« L’Afrique noire est mal partie », s’alarmait René Dumont en 1962, quarante ans avant que Joseph Ki-Zerbo, lui faisant écho, se demande à son tour : « A quand l’Afrique ? » 1 Cela n’empêche pas que l’on puisse aujourd'hui s’interroger sur les pays émergents de l'Afrique anglophone.
Le raccourci peut sembler saisissant. Il faut pourtant rappeler que si René Dumont analysait les causes multiples des retards qui ont conduit le continent à s’enfoncer dans les affres du sous-développement, il s’attachait surtout à démontrer que l’Afrique n’était ni maudite ni condamnée à croupir dans le « cercle infernal » de la pauvreté : à condition que d’autres pratiques et d’autres politiques publiques soient mises en œuvre, elle pourrait même se développer rapidement, forte de richesses et de potentiels.
Avec le recul, les années 1960 n’ont d’ailleurs pas été aussi catastrophiques que les décennies postérieures : il fut un temps, sans doute oublié, où l’on parlait du « miracle de la Côte d'Ivoire », lorsqu’elle affichait des taux de croissance annuel supérieurs à 10 %, jusqu’à 17,61 % ! en 1963 2 ; comme le Sénégal et le Mali, qui en 1976, étaient respectivement à 8,9 % et 3,6 % de croissance. C’était l’époque où les capitaux affluaient en masse en Afrique, notamment francophone, tandis que le Ghana, par exemple, était dans les plus grandes difficultés. C’était avant les années 80, les plus dures pour l’Afrique, celles des ajustements structurels.
Cinquante ans plus tard, les analyses de René Dumont se trouvent confirmées dans leurs grandes lignes et l’Afrique semble enfin sur de meilleures voies. On ne compte plus les pays du continent dont la croissance annuelle est depuis plusieurs années largement supérieure à 5 %, à la différence notable des pays développés en crise.
Pour autant, si l'Afrique est indéniablement en train de connaître une période faste, plus qu’à aucun autre moment de son histoire, voire de sortir du sous-développement, peut-elle être déjà considérée comme émergente ? A tout le moins certains de ses membres, et auquel cas, lesquels : les anglophones ou les francophones ?
Sans doute convient-il tout d'abord de cerner précisément les contours de la catégorie et de rappeler en premier lieu que l’émergence n’est pas un concept univoque, mesurable à la seule croissance, forte, du PIB. D’autres critères sont à prendre en compte : économiques, tels que l’affirmation de politiques économiques volontaristes et la détermination de s’insérer dans la mondialisation ; politiques ensuite, autour de l’ambition de peser dans la régulation de la mondialisation et de participer aux constructions institutionnelles internationales. En ce sens, comme le faisait remarquer Bertrand Badie 3, il y a sans doute autant de types d’émergence que d’émergents, et si on les compare aux BRICS, catégorie au sein de laquelle de nombreuses différences existent si l’on regarde la Chine, le Brésil et la Russie, aucun pays africain ne peut encore prétendre à être qualifié d’émergent.
Lorsque la commission des affaires étrangères a confié à vos rapporteurs le soin d’étudier les pays émergents de l'Afrique anglophone, elle a souhaité porter un regard sur une zone du continent qui est restée jusqu’à aujourd'hui hors du faisceau de nos radars diplomatiques. La relation de la France avec l'Afrique est d’une certaine façon hémiplégique, restée quasi exclusivement centrée sur notre pré carré francophone, dans l’ignorance du reste du continent.
Il ne s’agit pas ici de faire la critique de cette politique, mais de mettre en évidence qu’il est maintenant indispensable que la France se tourne vers cette partie de l'Afrique qu’elle connait moins. Cela, pour maintes raisons, dont les moindres ne sont pas le dynamisme exceptionnel et les atouts de pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Kenya.
Pour étudier cette réalité méconnue, vos rapporteurs ont procédé à de nombreuses auditions, d’universitaires, d’entrepreneurs, de diplomates. Ils ont aussi effectué un déplacement qui les a conduits au Kenya et en Afrique du Sud, au cours duquel ils ont notamment pu percevoir les attentes fortes que suscite notre pays sans qu’il en ait conscience. Ils en sont revenus avec la conviction qu’il est temps que notre pays, sans renier en rien son passé, sans opposer l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone, sache s’ouvrir au reste du continent et saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui. C’est sur la base de ces attentes et de ces opportunités qu’ils formulent un certain nombre de recommandations pour un rééquilibrage de notre relation à l’Afrique, dont chacun sera bénéficiaire.
I. LES PROBLÉMATIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU CONTINENT
Comme Janus, le continent africain présente aujourd'hui deux visages : d’un côté, celui d’un continent qui reste plus que tout autre marqué par le sous-développement ; mais aussi, celui d’une région qui paraît être aujourd'hui en passe de tirer enfin son épingle du jeu dans la mondialisation.
A. LES STIGMATES DU SOUS-DÉVELOPPEMENT LOIN D’AVOIR DISPARU
Longtemps, le regard porté sur l’Afrique a réduit ce continent à celui de toutes les malédictions. Si les choses semblent évoluer, comme on le verra plus loin, on ne saurait oublier que la région a cristallisé ces dernières décennies les pires caractéristiques du sous-développement, de la mauvaise gouvernance et du déni des Droits de l'Homme. Un rapide retour en arrière sur ces questions est d’autant moins inutile que les défis restent considérables.
1. En premier lieu, la violence et la mauvaise gouvernance
a. L’Afrique, théâtre de conflits meurtriers
S’agissant tout d'abord des conflits armés, comme le relevait un auteur il y a une dizaine d’années, « en laissant de côté les drames du Vietnam, du Cambodge et de l’Afghanistan, ainsi que le cas particulier de la Palestine, l’Afrique intertropicale est la région du monde où, sous des formes diverses (guerres civiles ou " interethniques ", guerres internationales), se rencontre depuis trente ans le plus grand nombre de conflits armés. » 4 Sans prendre en compte les luttes anti-apartheid ou les guerres de libération nationale postérieures à 1960 5, l’inventaire des principaux conflits survenus depuis les indépendances africaines amenait l’auteur à conclure que, « tout au plus », seuls une dizaine de pays d’Afrique subsaharienne avaient « échappé à une situation quasi-chronique de violence collective tandis que près de la moitié connaissait des guerres entraînant, directement ou indirectement, la mort d’au moins 10 millions de personnes. » 6
Sans qu’il faille y voir le résultat d’une « propension particulière à la guerre », ou encore de caractéristiques socioculturelles propres à chaque pays concerné, l’auteur rappelait que l'Afrique était de tous les continents celui qui avait « connu en un seul siècle les bouleversements les plus considérables (…), les métamorphoses (culturelles, sociales et psychologiques) que furent les quelques décennies d’occupation coloniale succédant aux traumatismes des ponctions esclavagistes », « les données démographiques, économiques, sociales, politiques propres aux populations africaines [ayant] été – plus qu’ailleurs dans le monde – radicalement transformées (…) au cours du dernier demi-siècle, et, en particulier, au cours de la dernière décennie » 7.
Indépendamment de cette violence, le continent est aussi celui dans lequel subsistent encore aujourd'hui les régimes les moins démocratiques, ainsi que les symptômes de mal gouvernance les plus criants.
b. Une démocratisation lente et fragile
L’actualité vient régulièrement l’illustrer : la démocratie en Afrique « reste un acquis fragile. » 8 On ne saurait nier que les scrutins pluralistes progressent depuis les années 1990 qui ont vu l’émergence de processus de démocratisation réels sur l’ensemble du continent. Pour autant, sans noircir exagérément le tableau, des soubresauts réguliers montrent que rien n’est définitivement enraciné. A ce sujet, le dernier rapport commun des Nations Unies, de l'OCDE et de la Banque africaine de développement, BAD, « Perspectives économiques en Afrique 2013 » considère précisément ces progrès comme trop lents. Tout en reconnaissant les avancées, il voit les institutions politiques encore trop souvent « à la merci d’une érosion progressive des normes et règles démocratiques ou de la résurgence des coups d’État militaires » 9. Les acquis sont toujours menacés, en témoigne le fait que plusieurs gouvernements élus ont été renversés ces dernières années, cf. les coups d'État au Mali en mars 2012, en République centrafricaine en mars dernier, pour ne mentionner que les cas les plus récents.
Ce n’est donc pas un hasard si la fondation Mo Ibrahim peine à remettre son « Prix pour un leadership d'excellence en Afrique ». Créée en 2007, cette distinction « identifie et récompense des dirigeants africains qui ont développé leur pays, sorti leur peuple de la pauvreté et construit les bases d’un développement durablement prospère ; met en exergue des modèles extraordinaires pour le continent ; assure que l’Afrique continue de profiter de l’expérience et de l’expertise de ses dirigeants d’exception en leur permettant de poursuivre leur action publique sous une autre forme après avoir quitté leur mandat national » 10. Indépendamment de la reconnaissance spéciale faite à Nelson Mandela, il n’a pu être remis que trois fois en sept ans : en 2007, à Joaquim Alberto Chissano, ancien président du Mozambique ; en 2008, à Festus Gontebanye Mogae, du Botswana et en 2011, à Pedro de Verona Rodrigues Pires, du Cap-Vert, la fondation préférant s’abstenir les autres années, plutôt que de le « brader » en honorant des candidats ne répondant pas aux critères fixés par son fondateur pour lequel « l’Afrique est riche. Elle n’a pas besoin d’aides. Ce qui lui manque, c’est une bonne gouvernance et une plus grande transparence ». Très récemment 11, pour la quatrième fois en cinq ans, le jury 12 a de nouveau renoncé à attribuer le prix, faute d’un leader africain porteur d’excellence le méritant. « Mo Ibrahim a quant à lui salué " la décision du comité. Ce prix récompense l’excellence qui, par définition, est rare. En sept ans nous avons trouvé trois Présidents africains et c’est magnifique. Il faut être crédible " ». 13
Dans le même esprit, d’autres indices n’incitent pas non plus à l’optimisme. Ainsi, le rapport « Perspectives économiques en Afrique 2013 » fait-il même état d’une tendance au durcissement des régimes au pouvoir, et rappelle que « le dernier rapport de Freedom House souligne un recul notoire des libertés civiles depuis cinq ans en Afrique subsaharienne. À la suite du coup d’État militaire de mars, le Mali est passé du statut " libre " à " non libre ". La Guinée-Bissau a rétrogradé d’un cran, de " partiellement libre " à " non libre ", à cause d’un coup d’État militaire en avril 2012 qui a entraîné la suspension du parlement. L’Afrique du Sud, le Kenya, Madagascar et l’Ouganda font partie des pays où les libertés civiles sont en recul. » 14
c. Une gestion publique qui reste à améliorer
Au-delà de la question démocratique, la gestion publique et la corruption restent encore des sujets de préoccupations et l’on relèvera, pour conclure rapidement ce survol, que les indices de perception de la corruption que publie chaque année Transparency International 15, ne placent pas l’Afrique parmi les régions les plus remarquables. Sur le continent, le Botswana, 30e, apparaît dans une position quelque peu singulière, cependant que l'Afrique du Sud est au 69e rang, en recul de 31 rangs en onze ans, que le Kenya est 139e sur 176, à égalité avec le Nigeria, pour ne citer que les principaux pays.
En publiant chaque année son indice composite, élaboré sur la base de quatre catégories – sécurité et État de droit, participation et Droits de l'Homme, environnement économique, développement humain, la fondation Mo Ibrahim montre aussi que la gouvernance publique reste perfectible : quelque aspect que l’on prenne en compte sur la décennie écoulée, on note un lent cheminement, parfois une certaine stabilité, voire même dans plusieurs régions, plus de reculs que d’avancées très nettes.
2. Le continent de loin le moins développé
a. La persistance de la malnutrition
À cette violence et ces déficiences en matière de gouvernance, s’ajoute une situation économique et sociale difficile qui fait du continent une zone des moins hospitalières.
Rappelons, en premier lieu, les grandes famines de ces dernières décennies : au Biafra et au Sahel, à la fin des années 1960 et au début des années 1970 ; en Éthiopie, dans les années 1970 et 1980 ; en Somalie, dans les années 1990 ou au Soudan à l’orée des années 2000. Ces tragédies n’ont pas totalement disparu du continent, si l’on rappelle la situation de crise aiguë qui a éclaté dans la Corne de l’Afrique en 2011. Si quelques pays ont été particulièrement touchés par des crises dévastatrices, dont la médiatisation a mobilisé la solidarité internationale, l’actualité africaine montre que la malnutrition est loin d’avoir disparue, et que le continent reste, de loin, celui dans lequel les populations continuent de souffrir le plus fortement de la faim. Hormis le Yémen et l’Irak, il n’y a guère qu’en Corée du nord, au Laos, au Tadjikistan, au Guatemala et au Paraguay, que la proportion de personnes sous-alimentées est de 25 à 34 % de la population ; Haïti est le seul autre pays où elle est supérieure à 35 %. Mais treize pays africains se situent dans la tranche élevée de sous-alimentation, avec de 25 à 34 % de leur population sous-alimentée, et huit dans la tranche supérieure à 35 %. En d'autres termes, aujourd'hui encore, 21 pays africains ont une proportion très importante de leur population en état de malnutrition sévère.
De la même manière, les rapports de suivi des OMD, publiés par les Nations Unies, soulignent la prévalence de la faim qui reste « inconfortablement élevée en Afrique subsaharienne » (comme en Asie du Sud), les pays africains ayant été les plus durement touchés par les crises alimentaire et financière récentes ; les analyses de la FAO démontrent leur vulnérabilité à la hausse des prix des produits alimentaires.
b. Les indices de développement les plus faibles
Chacun sait en effet que les indices de développement les moins bons se retrouvent également sur le continent africain : 34 des 50 pays les moins avancés, (PMA), se situent en Afrique. Pour mémoire, on rappellera que, selon les critères retenus par les Nations Unies, il s’agit des pays présentant les caractéristiques suivantes : « Revenu bas, mesuré en fonction du revenu moyen par personne calculé sur trois ans. Un revenu moyen inférieur à 745 dollars des États-Unis par personne, par an est pris en considération pour que le pays soit inclus dans la liste des PMA et doit être supérieur à 900 dollars des États-Unis pour que le pays soit admis au retrait de cette liste. Ressources humaines faibles, mesurées par des indicateurs de nutrition, de mortalité infantile en dessous de cinq ans ; nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire ; et taux d’alphabétisme des adultes. Vulnérabilité économique élevée, mesurée en fonction de la taille de la population ; éloignement ; diversité des produits exportés, part de l’agriculture, de l’industrie forestière et des pêcheries dans l’économie ; instabilité de la production agricole ; instabilité des exportations de marchandises et de services ; et privation de logement due aux catastrophes naturelles. » 16
3. Des progrès néanmoins en matière d’OMD, mais encore souvent insuffisants
Les plus récents rapports de suivi des OMD amènent à tirer des conclusions de la même teneur en matière de développement : quels que soient les indicateurs retenus, l'Afrique subsaharienne reste la région dans laquelle les indices sont les moins bons, malgré de réelles avancées, parfois remarquables.
Ainsi, « le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne a diminué de presque 5 points en pourcentage, passant à moins de 48 %, entre 2005 et 2008 », et « pour la première fois, le nombre absolu de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a également diminué dans la région, passant de 395 millions en 2005 à 386 millions en 2008 ». Pour autant, comme le soulignent notamment la dernière édition du rapport de la Banque mondiale et les Nations Unies sur la pauvreté dans le monde, malgré ces succès, l’Afrique reste confrontée à de sérieux problèmes de développement, de sorte que « même au rythme actuel de progression, les estimations indiquent qu’à peu près 1 milliard de personnes vivront encore avec moins de 1,25 dollar par jour en 2015, correspondant à un taux mondial de pauvreté extrême juste en dessous de 16 %. Quatre personnes sur cinq vivant dans l’extrême pauvreté vivront en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. »
Dans le même esprit, les progrès enregistrés en matière de réduction de la mortalité infantile ont été remarquables depuis le lancement des OMD. Ainsi, le rapport de suivi des Nations Unies de 2012 montre que « cinq des neuf régions en développement ont enregistré des réductions de la mortalité des moins de 5 ans de plus de 50 % de 1990 à 2010. » Certaines régions, comme l’Afrique du Nord ou l’Asie de l’est, ont d'ores et déjà atteint cet OMD. En revanche, l’Afrique subsaharienne n’a pu obtenir qu’une réduction d’environ 30 %, soit moins de la moitié de ce qui est requis pour atteindre la cible. Comme le précise le rapport, « en dépit d’un progrès résolu, une proportion croissante des décès d’enfants dans le monde se trouve en Afrique subsaharienne. Alors que certaines régions en développement vont de l’avant, les décès des moins de 5 ans en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud forment une part plus grande du total mondial. Les 6,2 millions de décès d’enfants dans ces deux régions en 2010 correspondaient à 82 % de tels décès à l’échelle mondiale. » 17
On pourrait compléter ces données à l’envi. Ainsi, en matière de santé maternelle et infantile en Afrique subsaharienne, secteur dans lequel les progrès de l’OMD n° 5, sont très insuffisants : bien qu’il ait considérablement diminué, - 26 % entre 1990 et 2009 - le taux de mortalité des femmes pendant la grossesse et l’accouchement est encore très élevé, de même que celui des enfants de moins de cinq ans.
En d'autres termes, les conditions économiques et sociales s’améliorent incontestablement en Afrique ; de même l’infection du VIH tend à se stabiliser, le niveau d’éducation, notamment dans le cycle primaire, à augmenter, tout comme l’espérance de vie, cependant que l’extrême pauvreté recule, mais de manière insuffisante. Insuffisante, par exemple, pour que l'Afrique subsaharienne réussisse à réduire l’écart d’espérance de vie avec les pays émergents ou avec ceux de l'OCDE, qui s’est accru, passant de 14,6 ans en 1970 à 19 ans en 2011. 18
Les plaidoyers en faveur du renforcement des politiques d’aide au développement mettent à juste titre en avant l’importance de ces divers éléments. S’y ajoutent d’autres aspects, en partie liés, relatifs aux désastres et autres catastrophes naturelles dont l'Afrique est coutumière. Parmi ceux-ci figurent la sécheresse et la désertification, avec leurs conséquences humanitaires, tels les déplacés et réfugiés qu’on dénombre par millions sur le continent 19 ; plus simplement, les impacts sociaux et économiques, mais aussi les tensions et bouleversements politiques et sociétaux, entre pasteurs et agriculteurs, notamment, sont également majeurs. Sans prétendre prioriser quoi que ce soit, vos rapporteurs mentionneront ici l’explosion démographique africaine, la croissance exponentielle de l’urbanisation, actuellement la plus rapide de l’histoire de l’humanité 20, le manque d’infrastructures et l’industrialisation déficiente, le faible niveau d’éducation, ou les pandémies telle que le sida.
En d'autres termes, autant de facteurs qui conduisent les pays pauvres d’Afrique à rester englués dans le sous-développement, sans pouvoir sortir des « trappes » dans lesquelles ils sont tombés, malgré les politiques d’aide internationale et le soutien qui peut leur être apporté. Comme un observateur tel que Paul Collier le soutient 21 : la conflictualité, la malédiction des matières premières, l’enclavement et la mal gouvernance induisent des cercles vicieux dont il est très difficile aux pays pauvres, qui en sont les victimes, de s’extraire.
En contrepoint de ces données et analyses, d’autres permettent de dresser le portrait d’une Afrique différente et conduisent certains à afficher un optimisme résolu envers le devenir de l’Afrique subsaharienne.
B. DES ÉCONOMIES AUJOURD'HUI PORTÉES PAR LA MONDIALISATION
Avant d’entrer dans le vif du sujet concernant les émergents africains anglophones, l’analyse des caractéristiques de cette phase de croissance générale des économies africaines, de leurs forces et faiblesses, est nécessaire. Malgré les cures d’austérité que les institutions de Bretton Woods leur ont imposées dans un passé récent, les pays africains semblent aujourd'hui commencer à sortir la tête de l’eau. Les résultats qu’ils affichent en termes de croissance économique, sont depuis quelques années remarquables.
1. Une région aujourd'hui en forte croissance
a. Des données macroéconomiques nouvelles
Depuis maintenant plus de dix ans, la croissance moyenne du continent africain n’a jamais été inférieure à 3 %. Cet étiage résulte d’ailleurs de la crise financière de 2008. En fait, le taux de croissance de l'Afrique a plus fréquemment oscillé entre 5 et 6 %. Ainsi que le met en évidence le diagramme reproduit ci-dessous, il se trouvait même sur la trajectoire d’un taux moyen de 7 %, lorsque la crise a éclaté. Le changement brusque et durable qui est mis en évidence est intervenu à partir du début des années 1990. En d'autres termes, après les « décennies perdues » les performances de l’Afrique ont commencé de s’améliorer nettement et le continent a pu entamer son rattrapage.
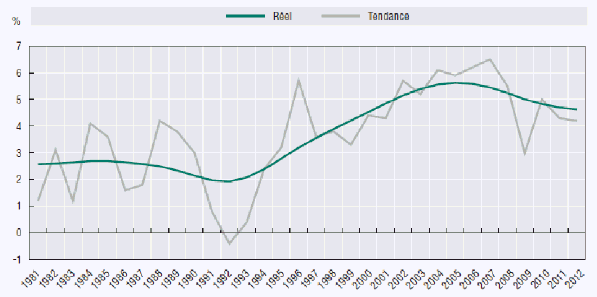
Croissance tendancielle en Afrique 22
Entre le milieu des années 1990 et 2010, le taux de croissance annuel moyen du PIB n’a cessé d’augmenter et cette évolution s’est constatée dans la très grande majorité des pays. Le PIB a ainsi progressé de 5,6 % par an en moyenne entre 2002-2008, ce qui fait de l’Afrique la deuxième région du monde, en termes de croissance, juste derrière l’Asie de l’Est 23. Cependant, cette tendance n’est pas à l’abri de soubresauts, comme l’illustre la cassure des années 2008 et 2009, due à la crise mondiale, qui a clairement affecté les courbes, comme à la fin des années 1990, avec toutefois moins d’ampleur.
Sur le court terme récent, si la chute provoquée par la crise a été brève, la reprise a été forte : de deux points en une seule année. Le parcours semble désormais plus chaotique que précédemment, comme en témoigne la ligne brisée du diagramme. Mais au niveau mondial, des 15 pays ayant enregistré la plus forte croissance économique en 2010, dix se trouvaient en Afrique.
Les projections tablent sur une croissance du continent de l’ordre de 4,8 % en moyenne pour l’année en cours et de 5,3 % en 2014. En d'autres termes, l’Afrique n’a pas encore retrouvé le niveau de croissance qu’elle connaissait avant la crise, indépendamment du pic estimé de l’an dernier, mais elle est sur une trajectoire ascendante qui devrait lui permettre de le retrouver durablement.
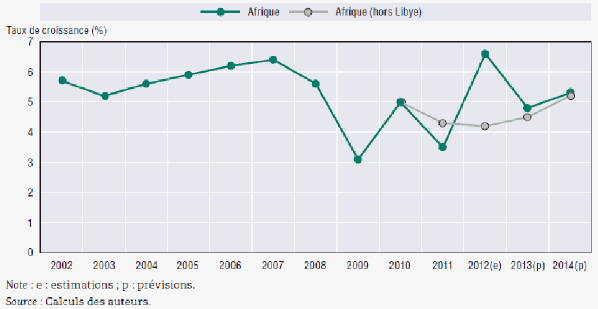
Croissance économique en Afrique (%) 24
Entre 1990 et 2010, le PIB réel des pays d’Afrique subsaharienne est passé de 273 Mds$ à 573 Mds$. Dans le même temps, l’inflation en Afrique subsaharienne diminuait fortement, - même si des tensions inflationnistes persistent -, de 15 % annuels en moyenne en 2000 à 8 % en 2012. Cette tendance se poursuit et la diminution des taux médians d’inflation est régulière : selon les estimations elle a été de 6,5 % en 2012 ; les prévisions pour 2013 et 2014 sont respectivement de 5,7 % et 5,3 %. De même, l’endettement extérieur a également été réduit, de 63 % du PIB en 2000, à 22,2 %.
Dans le même ordre d'idées, on relève aussi une croissance générale des exportations : + 117 % entre 2000 et 2010, (33 % du PIB en 2011 contre 26 % 20 ans plus tôt). Enfin, les soldes budgétaires sont également en constante progression.
b. Éléments de comparaison avec les autres régions du monde
Les données que l’on vient de rappeler sont d’autant plus intéressantes que les comparaisons internationales sont aujourd'hui à l’avantage de l'Afrique. La tendance du continent apparaît même comme une forme d’exception dans le contexte actuel, si l’on en juge par les perspectives durablement atones de l’économie des pays de l'OCDE mais aussi des BRIC qui, comme chacun sait, semblent aujourd'hui connaître un net ralentissement.
En outre, selon les analyses du FMI, les taux d’endettement publics des pays africains, considérablement plus faibles que ceux des développés, devraient continuer de diminuer, grâce à la croissance et à la faiblesse des taux d’intérêt, comme l’illustre le tableau reproduit ci-dessous.
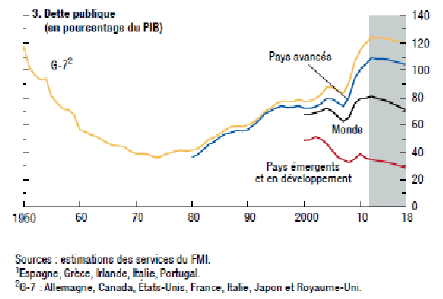
Politique budgétaire : dette publique 25
Pour mémoire, on rappellera brièvement que l’économie mondiale a connu une croissance de 2,2 % en 2012, en légère baisse par rapport à 2011, (2,7 %). La baisse de la demande, au niveau mondial, la crise de la dette dans la zone euro, la situation budgétaire aux États-Unis, sont vues comme les principaux facteurs ayant pesé sur l’environnement. Sans entrer dans les détails des performances des uns et des autres d’une année sur l’autre, à une situation morose dans les principaux pays de l'OCDE, - Union européenne en premier lieu, États-Unis et Japon -, a logiquement fait écho le ralentissement dans les pays émergents, en premier lieu en Chine et en Inde, aujourd'hui au Brésil.
En d'autres termes, les différentes régions du monde sont aujourd'hui en phase de décélération nette. C’est notamment le cas de l’Asie qui fait face à un ralentissement de sa croissance économique, tombée de 6,7 % en 2011 à 3,3 % en 2012. Dans une moindre mesure, l'Amérique latine a suivi une tendance comparable, passant d’une croissance de 4,3 % en moyenne en 2011 à 3 % l’an dernier. Cette tendance se poursuit pour l’année en cours puisque le FMI a récemment réduit ses prévisions initiales : alors qu’il avait encore tablé en avril dernier sur une légère amélioration, à 3,3 % cette année, avec une perspective moyenne de 3,9 % à l’horizon 2015, il les a ramenées à 3 % pour 2013 26. Il en est ainsi de pays comme le Mexique ou le Brésil où les prévisions sont réduites respectivement à 2,9 % et 2,3 %, alors que le gouvernement de Brasilia avait espéré une reprise à 3,5 % pour l’année 27.
En d'autres termes, les régions naguère moteurs de l’économie mondiale, sont aujourd'hui à la peine et le continent africain se révèle aujourd'hui dans une position inhabituelle.
2. Les fondements de la croissance africaine
Les performances économiques de l'Afrique reposent sur un certain nombre de facteurs considérés comme déterminants :
a. Le facteur démographique et la montée des classes moyennes
Le premier des facteurs qui a une incidence sur l’économie des pays africains est aujourd'hui la consommation intérieure, qui contribue fortement au maintien de la croissance alors que l’environnement international est plus incertain, comme on l’a vu précédemment.
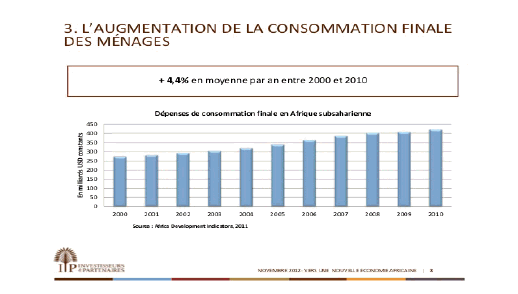
Consommation des ménages en Afrique subsaharienne 28
Le diagramme ci-dessus montre clairement la part de l’augmentation de la consommation intérieure dans la croissance soutenue de l’Afrique qui, sur l’ensemble de la dernière décennie, a été de 4,4 % par an.
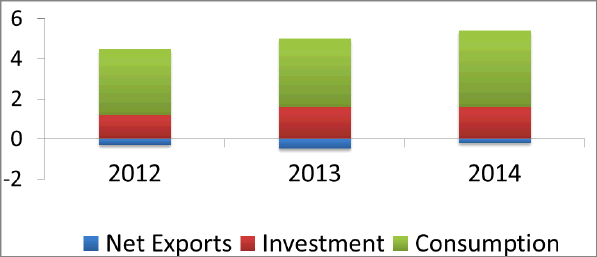
La croissance africaine stimulée par la demande intérieure (contribution des composantes de la demande au PIB en points de %) 29
En d'autres termes, comme le souligne Jean-Michel Severino 30, dans la conjonction des facteurs qui ont joué jusqu’à aujourd'hui dans la phase économique que connaît l'Afrique, la démographie est déterminante. Les effets de la transition démographique, plus tardive et plus lente qu’ailleurs, en Inde ou en Chine par exemple, sont plus modestes et plus étalés dans le temps, mais ils se font néanmoins sentir durablement : la part des actifs dans la population augmentant, elle constitue de ce fait le facteur le plus lourd et le plus durable de la croissance en Afrique.
Aux chiffres impressionnants, d’une Afrique à deux milliards d’habitants à l’horizon 2050, s’ajoute l’émergence d’une classe moyenne urbanisée. Celle-ci regroupe « les gens qui ont un revenu disponible et achètent de plus en plus de biens et de services contribuant au bien-être global de la société. Leur revenu moyen va de 1460 à 7300 dollars par an » 31. Elle a donc peu à voir avec celle des pays développés ou des pays émergents, mais il s’agit d’une catégorie située entre la population pauvre disposant de moins de 2 dollars par jour et l’élite riche 32. Selon la BAD, elle représente aujourd'hui plus d’un tiers de la population africaine, en augmentation constante depuis les années 1980, où elle comptait quelque 111 millions de personnes, soit 26 % de la population, et les années 1990, où elle approchait déjà les 200 millions d’habitants, 27 % du total. En 2030, cette classe moyenne africaine pourrait disposer de 2 200 Mds$ annuels, soit 3 % de la consommation mondiale, tandis que la majorité de la population active du continent sera toujours occupée dans le secteur informel, représentant alors les deux tiers de l’économie. En termes de parité de pouvoir d’achat, le continent se situe aujourd’hui à un niveau supérieur à l’Inde 33. On a pu faire remarquer 34 qu’une ville comme Lagos, au Nigeria, première métropole du continent, représentait un marché de consommateurs supérieur à celui de Mumbai (Inde), générant à elle seule les deux-tiers du PIB nigérian, hors pétrole, soit l’équivalent des PIB cumulés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun.
Pour reprendre le propos de Lionel Zinsou, président du fonds d’investissement PAI Partners, que vos rapporteurs ont également entendu, l'Afrique contribue aujourd'hui à la croissance mondiale de manière supérieure à la moyenne et sa démographie n’est pas forcément un obstacle : dans cette perspective, elle peut aussi être un atout, voire « une chance historique » 35, et il importe de se défaire de clichés qui ne correspondent plus à la réalité.
b. Les exportations et le poids des matières premières
Cela étant, le facteur essentiel de croissance sur la période récente est lié à l’essor des exportations africaines. Comme le montre le diagramme suivant, celles-ci ont très fortement augmenté au cours de la décennie 2000 et ont essentiellement été portées par les matières premières.
Dans la mesure où les cours internationaux des matières premières ont été élevés sur cette même période, les termes de l’échange ont en général évolué de manière positive pour les pays africains : les premiers bénéficiaires ont été les plus riches en ressources naturelles, minières ou pétrolières.
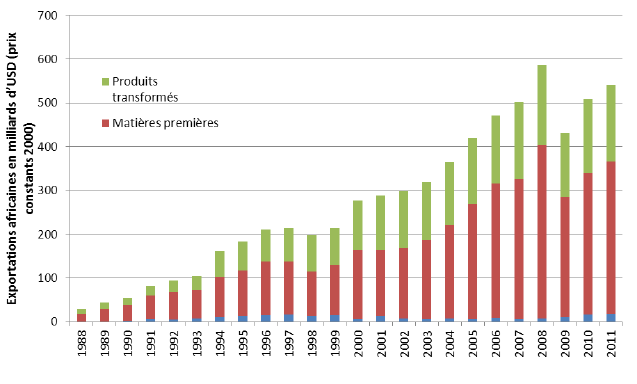 Les exportations africaines ont été essentiellement portées par les matières premières 36
Les exportations africaines ont été essentiellement portées par les matières premières 36
Le tableau ci-dessous illustre l’importance des exportations de matière premières dans les économies des pays africains et, par conséquent, leur degré de dépendance. Outre les pays d’Afrique de l’Ouest, d’autres sont évidemment dans la même situation en regard du poids de leurs ressources naturelles, minières ou agricoles : l’Angola, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale ou le Tchad, en ce qui concerne les produits pétroliers, bientôt le Mozambique et la Tanzanie, et bien d’autres encore, Burundi, RDC, Malawi, Mali, République centrafricaine, Zambie ou Zimbabwe, s’agissant d’autres produits non transformés.
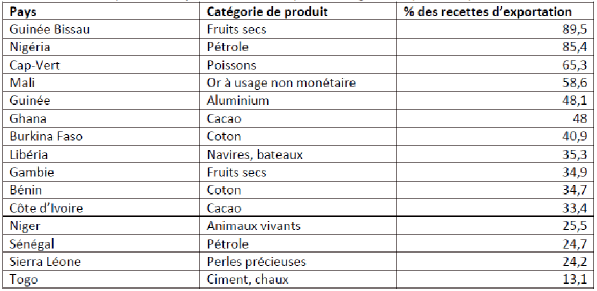 Premier produit d’exportation selon le degré de dépendance en 2010 37
Premier produit d’exportation selon le degré de dépendance en 2010 37
c. Un meilleur environnement et des politiques économiques améliorées
Parmi les facteurs déterminants pour les performances récentes de l’Afrique, alors que la gouvernance peut parfois laisser à désirer, on relève l’amélioration des politiques économiques dans nombre de pays. Comme le souligne le rapport Perspectives économiques en Afrique 2013 38, sur ce plan, les pays africains ont accompli ces dernières années de remarquables progrès. L’environnement des affaires s’est amélioré et le dernier rapport « Doing Business » de la Banque mondiale rappelle à cet égard que parmi les 50 économies qui ont fait le plus de progrès depuis 2005, la plus grande part - un tiers, soit 17 pays, - se trouvent en Afrique subsaharienne, ce dont rend compte le diagramme suivant.
Dans le même esprit, les dernières « Perspectives économiques régionales » du FMI 39 soulignent que dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, l’inflation évolue favorablement, « hormis pour un petit nombre de pays où elle reste obstinément supérieure à 10 % »
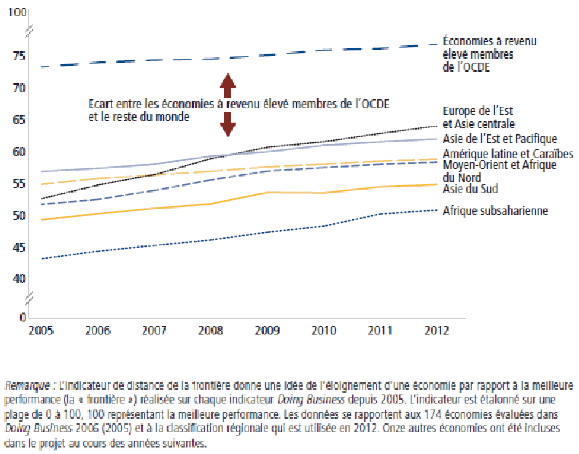
« Faire des affaires est aujourd'hui plus facile qu’en 2005, en particulier en Afrique subsaharienne, en Europe de l’Est et en Asie centrale (distance moyenne de la frontière, en %) » 40
Si à l’heure actuelle, seuls Maurice, l’Afrique du Sud et la Tunisie figurent parmi les 50 premiers pays du monde en ce qui concerne la facilité à faire des affaires et que, en tout et pour tout, dix pays africains figurent dans les 100 premiers, plusieurs sont cependant remarqués pour les progrès qu’ils ont montré en matière de recouvrement des impôts, d’amélioration de la fiscalité, ou des procédures en faveur de la création d’entreprises ou d’emplois, d’accès au crédit ou de protection des investissements. Si beaucoup reste à faire, notamment pour éliminer la corruption, on considère que « l’Afrique se mobilise pour attirer les investissements » et acquérir la crédibilité nécessaire. Pour certains, les bénéfices sont déjà visibles. Ainsi, du Rwanda, qui a récemment pu lancer un emprunt sur le marché international à hauteur de 400 millions de dollars.
3. Des performances néanmoins contrastées
Si on constate une généralisation de bonnes performances, la situation n’apparaît cependant pas totalement homogène sur l’ensemble du continent ; certains pays tirent leur épingle du jeu mieux que d’autres.
2011 |
2012 (e) |
2013 (p) |
2014 (p) | |
Croissance PIB réel (en %) | ||||
Afrique centrale |
5,2 |
5,7 |
5,7 |
5,4 |
Afrique de l’Est |
6,3 |
4,5 |
5,2 |
5,6 |
Afrique du Nord |
-0,1 |
9,5 |
3,9 |
4,3 |
Afrique australe |
4,0 |
3,7 |
4,1 |
4,6 |
Afrique de l’Ouest |
6,8 |
6,6 |
6,7 |
7,4 |
Afrique |
3,6 |
6,6 |
4,8 |
5,3 |
Croissance par régions 41
Au plan régional, comme le montre le tableau ci-dessus, les perspectives se révèlent meilleures pour les pays d’Afrique de l’Ouest que pour ceux d’Afrique australe ou d’Afrique du Nord, dont le parcours a été chaotique ces deux dernières années ; l’Afrique de l’Est est pour sa part sur une tendance légèrement supérieure à la moyenne attendue du continent.
De manière plus fine, la carte reproduite ci-après met en évidence les différences entre les pays. Elle montre tout d'abord qu’en Afrique subsaharienne, la plupart des pays connaîtront une croissance de leur PIB au moins supérieure à 6 %.
La répartition géographique des leaders est relativement équilibrée, puisque les dix plus fortes croissances africaines devraient être les suivantes : Libye : 11,6 % ; Sierra Leone : 9,6 % ; Tchad : 9,5 % ; Côte d'Ivoire : 9,3 % ; RDC : 8,8 % ; Ghana : 8,4 % ; Mozambique : 8,3 % ; Angola : 8,0 % ; Zambie : 7,6 % et Rwanda : 7,2 %. En d'autres termes, se détache un groupe de pays dont la croissance prévisible est nettement supérieure à la moyenne africaine ; le moins performant d’entre eux, le Rwanda, ayant une croissance de près de 2 % plus élevée.
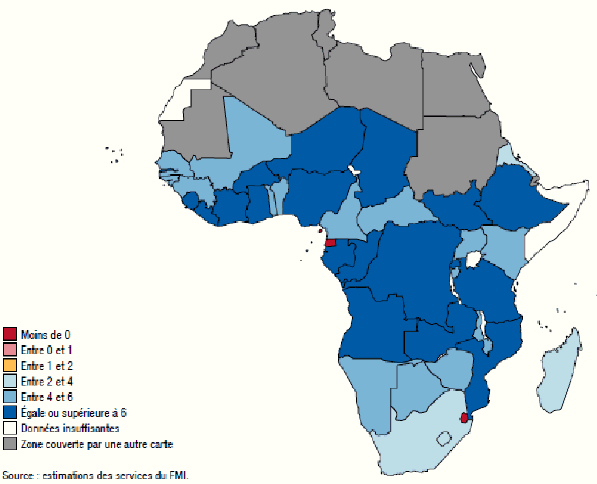
Afrique subsaharienne : prévision du PIB pour 2013 (en pourcentage) 42
En contrechamp, les dix croissances les plus faibles du continent devraient être le Swaziland : 1,3 % ; la Guinée équatoriale : 1,4 % ; l’Égypte : 2,7 % ; le Soudan : 2,8 % ; l’Afrique du Sud : 3,2 % ; les Comores et Madagascar : 3,5 % ; l’Algérie : 3,6 % ; le Lesotho : 3,7 % et enfin les Seychelles : 3,8 %. De manière symétrique à ce qui a été constaté pour les plus performants, ces pays sont très nettement en-deçà de la moyenne africaine.
On remarque aussi que les critères de discrimination sont malaisés à définir, dans la mesure où l’on trouve dans l’un comme l’autre groupe :
• des pays francophones (la Côte d'Ivoire et Madagascar) et anglophones (le Ghana et le Swaziland) ;
• des pays producteurs de matières premières et notamment de pétrole 43 (le Tchad et la Guinée équatoriale) ;
• des pays enclavés (la Zambie et le Lesotho), comme des pays disposant d’une façade maritime (la Sierra Leone et l’Afrique du Sud),
• des pays petits et peu peuplés (le Rwanda et les Comores), comme des pays beaucoup plus vastes et importants (la RDC et l’Algérie) ;
• des pays en crise ou en sortie de crise (la Libye et le Soudan), comme des pays depuis longtemps stabilisés (le Mozambique et les Seychelles), etc.
En ce sens, une typologie entre pays francophones et pays anglophones serait sans doute peu pertinente pour traiter de la question de l’émergence en Afrique subsaharienne. De nombreux facteurs jouent, comme le faisait remarquer Jean-Michel Severino 44, qui doivent être pris en compte. Par exemple, à l’intérieur des territoires riches en matières premières, on ne trouve pas de différence particulière entre pays francophones et pays anglophones ou même lusophones ; même si les prospections géologiques à venir pourraient changer la donne, comme les découvertes en Afrique de l’Est - qui comprend majoritairement des pays anglophones - l’ont récemment montré. Cela étant, des différences plus réelles peuvent exister sur d’autres plans : ainsi, la transition démographique est sans doute allée plus vite dans certains pays anglophones que dans des pays francophones comme le Niger, mais ce n’est pas toujours le cas, si l’on en juge par l’exemple du Nigeria. Il est en tout cas certain que l’Afrique francophone est historiquement moins peuplée que l’Afrique anglophone et, notamment, que la région des Grands Lacs, le poumon démographique du continent, dont la croissance a été la plus forte.
Peut-être la segmentation entre « Afrique atlantique » et « Afrique indienne » est-elle plus distinctive, cette dernière formant avec l’Inde et le Golfe un arc qui constitue désormais une nouvelle aire de prospérité. Les diasporas indiennes, présentes en Afrique orientale depuis des siècles, ainsi que les récentes délocalisations chinoises, y ont structuré un univers d’affaires – à défaut d’une unité juridique - qui permet à la zone orientale de prospérer. En ce sens, la zone francophone de l’Afrique, sur la côte Ouest, est sans doute moins favorisée. Le continent latino-américain qui lui fait face commerce assez peu avec l'Afrique, même si le Brésil tend à y développer ses relations, il se contente surtout d’une relation Nord-Sud avec les États-Unis et le Canada. Il ne constitue donc pas, pour le moment, un élément structurant de l’économie mondiale qui bénéficierait à l’Afrique de l’Ouest, de la même façon que l’Asie et le Golfe bénéficient à l’Afrique de l’Est.
En d'autres termes, s’il existe des réalités qui expliquent des différences entre Afrique francophone et Afrique anglophone, rien ne semble pour autant figé : l’Afrique francophone pourrait très bien voir sa croissance tirée vers le haut par la découverte de nouvelles matières premières dans la zone, par une accélération de sa transition démographique ainsi que par des délocalisations en provenance d’Amérique latine et d’Europe ; elles pourraient lui permettre de devenir à son tour une zone industrielle et de services, et de s’inscrire dans un arc de prospérité.
Indépendamment du fait qu’une décennie de croissance n’a pas encore réussi à sortir définitivement les populations du continent du sous-développement, la question se pose de savoir si les performances actuelles garantissent que l'Afrique est définitivement sur la bonne voie. En d'autres termes, l’ampleur des défis, qui restent impressionnants, peut tempérer la vision très optimiste du futur de l’Afrique que promeuvent certains analystes et investisseurs.
A. L’AFRO-OPTIMISME A LE VENT EN POUPE…
1. Les certitudes de nombreux observateurs
Alors que les chiffres peuvent laisser penser que les progrès constatés méritent d’être consolidés, certains experts font preuve d’une grande confiance envers le futur du continent africain.
a. « Les conditions du décollage de l'Afrique sont réunies »
Lionel Zinsou résume bien cette perception partagée par nombre d’analystes. Dans une conférence opportunément intitulée « Une vision optimiste de l’Afrique » 45, il considérait tout d'abord que les fondamentaux économiques de l’Afrique étaient aujourd'hui inversés par rapport à ceux que l’on avait connus autrefois, qu’ils étaient devenus très favorables à l’Afrique. Il ne faut pas s’arrêter à l’image d’Épinal de l’Afrique des années 1980, qui ont vu une régression de la croissance, ni à celle des années 1990, qui se sont traduites par une stagnation économique. Ces deux décennies ont été perdues, mais le phénomène est aujourd'hui enrayé et de nombreux indices prouvent que le continent africain est en train de décoller : « Je ne vois pas de continent qui ait progressé plus vite que l'Afrique ces dernières années, en termes de dynamique, de respect du droit, d’alphabétisation… » 46 Entre autres nombreux experts, Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, partage ce sentiment, qui considère que « les progrès sont tels depuis dix ans que l’on peut dire, et c’est la Banque mondiale qui le dit, que l’Afrique est en décollage économique un peu à la manière de la Chine il y a trente ans et de l’Inde il y a vingt ans. » 47
Ces appréciations se fondent sur plusieurs critères. En premier lieu, une croissance économique deux fois supérieure à la croissance démographique. Pour Lionel Zinsou, les fondamentaux sont aujourd'hui bien meilleurs et la démographie est désormais un atout et non plus une fatalité, car l’Afrique est encore un continent vide qui, aux indépendances, ne comptait que 100 millions d’habitants sur 30 millions de km2. Non seulement, aujourd'hui encore, la densité de population reste faible, mais la baisse de la mortalité et les progrès de la santé aidant, la croissance démographique permettra au continent africain d’avoir le quart de la population active du monde, d’ici à 2030. Toutes choses égales par ailleurs, c’est ce qu’il en est aujourd'hui de la Chine, et qui lui a permis son décollage ; c’est aussi ce qu’il en a été autrefois de l’Europe… Demain, l’atelier du monde sera africain et non plus chinois.
Par ailleurs, entre 1960 et 1990, l’Afrique a enregistré des flux entrants d’investissements directs étrangers, IDE, et d’aide publique au développement, APD, inférieurs aux flux sortants de remboursements de crédits et de sortie d’épargne. En d'autres termes, durant ces décennies, l'Afrique a financé la croissance économique du reste du monde… Cette tendance s’est aussi et heureusement inversée à partir de 2000 et il est légitime de penser qu’il y a une corrélation avec ce qui se joue aujourd'hui. En outre, c’est désormais l’épargne du monde qui finance l'Afrique et non plus l’inverse, ce à quoi s’ajoutent les flux financiers des diasporas africaines vers le continent qui dépassent aujourd'hui les 50 milliards de dollars (Mds$) par an, soit 5 % de son PIB global. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2013, déjà cité, cette tendance se confirme : « l’année 2012 marque un tournant pour les transferts des migrants, qui deviennent la première source d’apports financiers extérieurs à l’Afrique, devant les IDE et l’APD. » 48 Au demeurant, les montants globaux de ces transferts sont vraisemblablement très sous-estimés, compte tenu de l’importance des transferts informels non répertoriés : on considère ainsi que « l’ampleur véritable des transferts des migrants à l’Afrique est sans doute bien supérieure. Pour quelque 120 millions d’Africains, ils constituent un appui important à la consommation ainsi qu’aux dépenses d’éducation et de santé. » 49
Encore une fois, pour Lionel Zinsou, c’est précisément aussi ce qui s’est passé pour la Chine et qui a fortement contribué à son émergence. Il ne peut en être différemment de l’Afrique, l’accumulation de moyens lui permet de rendre soutenable sa croissance et lui donne un degré de liberté qu’elle n’a jamais eu.
De même, il faut se départir du discours dominant sur la mauvaise gouvernance en Afrique : la démocratie progresse partout. Quoi qu’on en dise, la gouvernance économique progresse également, comme en témoigne le redressement du Zimbabwe. Le continent africain est aujourd'hui désendetté : avec des excédents budgétaires dans de nombreux pays, les monnaies se renforcent et les banques centrales africaines sont aujourd'hui riches de plus de 430 milliards de dollars de réserves de change. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour le décollage économique de l’Afrique. Cette conviction est étayée par certaines données qui montrent en effet des performances remarquables.
Enfin, l'Afrique participe aux échanges mondiaux : beaucoup de matières premières, de métaux rares, de matières premières agricoles ou industrielles sont en Afrique. Les exportations croissent de 30 % par an. La Chine est le premier partenaire de 45 des 54 pays africains, qui sont en excédent vis-à-vis d’elle, à la différence des États-Unis et de l’Union européenne. C’est relativement sain. En d'autres termes, l’Afrique, qui « a un carnet de commande pour 30 ans de croissance » 50, est, avec l’Asie, l’un des deux continents qui peut servir de locomotive et dont on attend qu’elle tire la croissance des pays de l'OCDE dont la demande interne ne peut fournir les ressources à un rebond mondial. Nouveauté historique inédite qui ne peut que se confirmer dans les années à venir : « L'Afrique est condamnée à réussir ! Je dis bien : "condamnée" », insistait récemment le président du Forum Crans Montana. 51
b. « La croissance ne peut que se confirmer »
Cette appréciation enthousiaste et cette confiance envers le futur de l'Afrique sont aujourd'hui partagées par beaucoup d’observateurs. La revue African Business 52 rendait ainsi récemment compte d’un ouvrage collectif paru à la fin de l’année dernière, « The Fastest Billion » dans lequel les auteurs soutiennent que, quoi qu’en disent les sceptiques, non seulement la croissance de l’Afrique va continuer sur sa lancée, mais qu’elle va augmenter de telle manière qu’en 2050 le PIB du continent sera équivalent à ceux des États-Unis et de l’UE cumulés. Il y aurait même une possibilité que la croissance africaine dépasse celle de l’Asie. Plusieurs facteurs plaident en ce sens : les coûts du travail qui augmentent en Chine ; les niveaux d’éducation moyens en Afrique qui ne cessent de croître et sont d'ores et déjà équivalents à ceux du Mexique et de la Turquie il y a trente ans ; les politiques d’attraction des IDE que les gouvernements africains mettent aujourd'hui en place 53. À l’appui de leur argumentation, les auteurs rappellent aussi que, dans les années 1960, tous les indicateurs plaçaient la Birmanie sur la voie d’une success story, cependant que Singapour, (aujourd'hui 59 fois plus riche que la Birmanie), ou l’Indonésie, étaient marquées par les tensions ethniques et la violence interne. Aujourd'hui, l’Afrique est en train de se débarrasser de ses maux pour prendre un chemin similaire, si ce n’est plus performant, à celui que les « tigres » asiatiques ont emprunté il y a vingt ans, de sorte que, d’ici à 2050, le PIB global du continent pourrait être multiplié par quinze.
En ce sens, la comparaison avec l’émergence de l’Inde est parlante. Aujourd'hui l’Afrique est au même niveau que l’Asie en développement des années 1980 et que l’Inde du début des années 1990. Mais si l’on projette les taux de croissance africains actuels, en 25 ans, le PIB d’un pays comme le Nigeria sera équivalent à celui de l’Allemagne aujourd'hui. En outre, l'Afrique est considérablement avantagée par ses ressources naturelles ; elles vont continuer pendant longtemps d’être sa principale source de revenus. Les découvertes récentes de gaz et de pétrole vont considérablement transformer les économies de la région, sachant que, à ce jour, seuls quelque 20 % des ressources ont été découvertes.
Dans le même esprit, Ernst & Young a de son côté récemment publié une importante analyse 54 dont les conclusions sont très proches et peuvent se résumer en quelques mots : la croissance africaine est réelle et durable, elle repose sur un certain nombre de facteurs, dont le fait que le continent aura en 2035 la plus importante force de travail au monde avec une population très jeune, dont plus de 50 % aura moins de 20 ans. La taille de l’économie africaine a plus que triplé depuis l’an 2000, des progrès interviennent dans tous les domaines, que ce soit la démocratisation qui s’enracine, l’environnement des affaires qui ne cesse de s’améliorer : la croissance du commerce et des investissements est là pour le confirmer et des progrès notables sont réalisés dans tous les domaines. Qu’il y ait encore de nombreuses questions à régler ne doit pas occulter que l'Afrique est aujourd'hui dans un mouvement comparable à celui que le sud-est asiatique connaît depuis une quarantaine d’années.
Donc, pour l’ensemble de ces analystes et observateurs, le continent africain est sur la voie de l’émergence. Tel cet auteur 55 pour lequel 17 pays 56 africains sont désormais dans ce cas, ceux qui ont connu à la fois un taux de croissance au moins égal à 2 % entre 1996 et 2008 et des changements fondamentaux dans plusieurs domaines au cours de cette période, en matière de gouvernance démocratique et de responsabilisation des gouvernements, d’amélioration des politiques économiques, d’ouverture de nouvelles opportunités d’affaires. La fin des longues décennies de crise de la dette et le début, de ce seul fait, de nouvelles relations avec la communauté internationale, ont également joué, comme l’émergence de nouvelles élites politiques, économiques ou civiles. Six autres pays 57 montrent déjà des signes annonciateurs de tels changements.
2. La confiance des investisseurs
Les analyses et projections macroéconomiques ne sont pas les seuls indices à confirmer la réalité d’un changement important. La confiance retrouvée des investisseurs étrangers envers l'Afrique mérite d’être soulignée.
a. Des investissements étrangers sans cesse plus importants
Depuis plusieurs années en effet, les investissements étrangers, IDE, ne cessent de progresser en Afrique, comme le montre le tableau reproduit ci-dessous. En cinq ans, de 2007 à 2012, la part de l'Afrique dans les IDE est ainsi passée de 3,2 % à 5,6 %. Plus précisément, selon les données réunies par la CNUCED, c’est surtout l'Afrique subsaharienne qui intéresse aujourd'hui les investisseurs étrangers au continent.
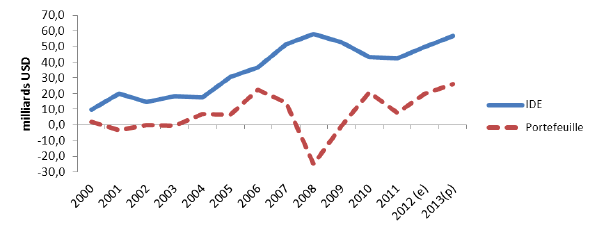
IDE et investissements de portefeuille en Afrique (en milliards de dollars courants)58
En effet, le rapport 2012 sur l’investissement dans le monde indiquait que les flux d’investissements vers l’ensemble de l’Afrique avaient atteint l’année précédente un montant total de 42,7 milliards de dollars. Il était alors en recul pour la troisième année consécutive, mais cette tendance était toutefois due à la baisse des flux vers les pays d'Afrique du Nord, notamment vers l’Égypte et la Libye, destinataires traditionnels importants, compte tenu de l’incertitude due à l’instabilité politique. En revanche, le rapport indiquait que « les flux vers l’Afrique subsaharienne se sont redressés, passant de 29 milliards de dollars en 2010 à 37 milliards de dollars en 2011, soit un niveau comparable au pic atteint en 2008. Un rebond de l’IED vers l’Afrique du Sud a accentué la reprise. » 59 En d'autres termes, les perspectives s’amélioraient, au point que, en 2012, l’Afrique a été la seule région importante du monde à connaître une hausse des IDE 60, qui devrait se poursuivre sur 2013, l'OCDE estimant qu’ils devraient augmenter de plus de 10 %, soit un niveau proche de leur record de 2008.
Les tendances ne sont toutefois pas homogènes et l’on observe de réelles différences selon les pays. Ainsi, l’an dernier, seuls le Nigeria, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la RDC et le Ghana ont-ils reçu des IDE pour un montant total supérieur à 3 milliards de dollars, suivis par le Maroc, l’Égypte, le Congo, le Soudan et la Guinée équatoriale, pour des montants de 2 à 2,9 milliards. Les raisons de l’attractivité des pays bénéficiaires sont diverses : on relève en effet que des pays aux performances récentes aussi remarquables que le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ou le Rwanda, reçoivent des IDE pour des montants nettement plus modestes et que, inversement, des taux de croissance faibles ne semblent pas dissuader les investisseurs, à en juger par les flux en direction de l’Afrique du Sud, du Soudan ou de la Guinée équatoriale 61. Même les IDE en direction des PMA augmentent de manière importante.
D’une manière générale, les bonnes performances générales du continent, la conjoncture économique et la hausse continue des prix des produits de base sont jugées comme favorables à l’Afrique subsaharienne et figurent parmi les facteurs qui ont contribué à ce redressement. Deux aspects méritent d’être relevés sur la question des IDE en direction de l’Afrique : leur origine et leur destination sectorielle.
b. Des IDE d’origine plus diversifiée…
Tout d'abord, l’origine des IDE confirme l’intérêt que les pays émergents portent au continent. Le rapport 2012 de la CNUCED soulignait que la diminution globale des IDE en Afrique s’expliquait principalement par une réduction des flux en provenance des pays développés, compensée par une augmentation de la part des pays en développement et émergents. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2013 62, « la part des pays de l’OCDE dans les IDE vers l’Afrique, en recul, est passée de 33 à 21,9 Mds$ entre 2010 et 2011. Cette tendance explique la lenteur relative de la reprise des flux d’IDE en Afrique après la crise de 2008, par rapport aux flux internationaux d’IDE », étant entendu que, en 2011, la France et les États-Unis étaient les deux plus gros investisseurs sur le continent, devant l’Italie et l’Allemagne, avec respectivement des IDE d’un montant de 5,7 et 5,1 Mds$. De même, « sur la période 2005-11, les États-Unis se classent en tête (37 mds$), suivis par la France et le Royaume-Uni (environ 31 Mds$ chacun) ».
En parallèle, les projets d’IDE depuis les BRICS ainsi que les investissements intra-africains ne cessent eux aussi de progresser, respectivement de +21 % et +33 % depuis 2007. L’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya sont les trois premiers investisseurs sur le continent et cette dynamique croissante est perçue comme la confiance des Africains eux-mêmes envers le futur de leur continent.
Sans trop de surprise, la Chine et l’Inde investissent évidemment beaucoup en Afrique, mais elles sont toutefois précédées par la Malaisie et l’Afrique du Sud : la Malaisie avait en effet un stock d’IDE de quelque 19 Mds$ sur tout le continent, plus spécialement concentrés dans l’agrobusiness, tant en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique de l’Est, ainsi que la finance, à Maurice. L’Afrique du Sud et la Chine disposent respectivement de stocks d’IDE pour 18 Mds$ et 16 Mds$, répartis sur de nombreux secteurs sur tout le continent, devant l’Inde, 14 Mds$, qui s’est recentrée sur Maurice.
c. … Mais qui restent encore majoritairement destinés au secteur primaire
Comme le montre la figure ci-dessous, les IDE ne délaissent pas, loin de là, leur destination première traditionnelle et le secteur primaire africain reste encore largement dominant, au point que, selon les agences nationales de promotion des investissements interrogées par la CNUCED, les secteurs des mines, de l’extraction et du pétrole apparaissent encore comme les plus prometteurs, derrière l’agriculture : ce sont les pays riches en ressources et les industries extractives qui attirent le plus d’IDE, encore aujourd'hui, et l'OCDE rappelle que la part des pays riches en ressources, dans le total de ces flux, s’est élevée à 70 % en 2012, pour une moyenne de 76 % sur la décennie.
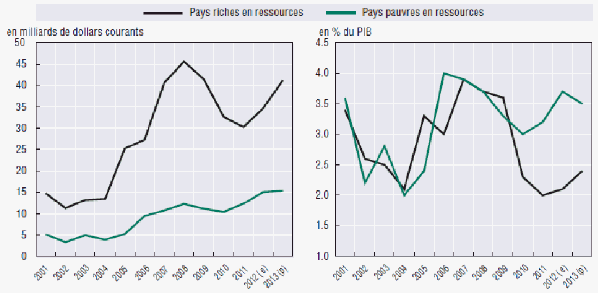
Comparaison des apports d’IDE dans les pays riches en ressources et dans les pays pauvres en ressources 63
On peut ainsi rappeler que les découvertes récentes de gisements gaziers et pétroliers sur la côte est-africaine, ainsi qu’en Ouganda, se sont traduites par des flux d’IDE supplémentaires de 2 Mds$ en 2011 et 2012. Pour près de la moitié, les opérations de capital-investissement, les fusions-acquisitions, se concentrent sur ces secteurs et l’OCDE rappelle aussi que de nouveaux investisseurs sont attirés par les ressources de l’Angola, du Mozambique et de l’Afrique du Sud.
D’autre part, en réponse à l’émergence d’une classe moyenne, même encore modeste un mouvement se dessine vers des IDE désormais plus diversifiés qu’auparavant, raison pour laquelle « en 2013, la valeur des IDE vers les pays pauvres en ressources devrait tripler par rapport à 2001. » 64 Ainsi, les secteurs de la banque, des télécommunications, du commerce de détail, sont-ils parmi ceux qui attirent désormais les investissements étrangers. La part des services dans les IDE en Afrique est ainsi passée de 7 % à 23 %, entre 2008 et 2012 et les investisseurs sont aujourd'hui attentifs aux perspectives ouvertes par les incidences des grandes tendances de la région pour les prochaines décennies et les évolutions majeures en termes de population, à savoir la croissance démographique ; la jeunesse de la population : 60 % ont aujourd'hui moins de 25 ans ; la croissance exponentielle des villes : la population africaine sera urbaine à plus de 50 % d’ici à 2050. Il s’agit de mouvements profonds, notamment en ce qui concerne l’urbanisation du continent, comparables à ceux observés en Chine et supérieurs à ceux que l’Inde enregistre. On peut ainsi rappeler que si 28 % des Africains vivaient dans des villes en 1980, ils sont aujourd’hui 40 %. Selon les projections, en 2030, la moitié des Africains vivront dans les villes et les 18 premières villes d’Afrique disposeront d’un pouvoir d’achat annuel combiné de 1 300 Mds$.
Une tendance durable à la diversification des IDE semble donc se dessiner que l’avenir ne devrait pas démentir. Bien que ce secteur soit aujourd'hui encore considéré comme le plus prometteur, les IDE ne devraient plus autant se concentrer sur les industries extractives. C’est ce que reflètent les propos tenus par les représentants du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN, devant vos rapporteurs 65 : d'ores et déjà, ils analysent les investissements en Afrique anglophone comme se dirigeant principalement dans les secteurs agricole et industriel, l’industrie pharmaceutique en premier lieu, ainsi que les services aux municipalités. Autant de secteurs dans lesquels les entreprises françaises ont un réel savoir-faire, notamment en matière de traitement des eaux et des déchets.
Les conclusions du « Rapport 2012 sur les progrès en Afrique » de l’African Progress Panel 66 résument ces perceptions, qui insistent sur « le rayonnement des économies africaines », le « moment idéal pour investir en Afrique », la diminution constante des risques, etc.
B. IL RESTE NÉANMOINS DES DÉFIS MAJEURS À RELEVER
Sans vouloir doucher l’enthousiasme assez général que vos rapporteurs ont décrit, force est de souligner que, pour rester sur ces tendances porteuses, l'Afrique doit aussi, et surtout, relever un certain nombre de défis qui conditionnent très précisément son appartenance ou non au club des émergents. La consolidation durable de la croissance sera au prix de ces efforts que l’on peut décliner en plusieurs axes concomitants, voire concordants.
1. Des conditions qui ne garantissent pas encore tout à fait l’émergence
En premier lieu, pour remarquables que soient les taux de croissance moyens que les pays africains réussissent à atteindre depuis d’assez nombreuses années, ils restent encore insuffisants pour compenser les effets de la croissance démographique. Certains des facteurs qui soutiennent cette croissance économique présentent même un certain degré de fragilité.
a. Une croissance encore insuffisante
Comme le soulignaient Jean-Michel Severino ou Henri-Bernard Solignac-Lecomte, chef du bureau Europe, Moyen-Orient et Afrique de l'OCDE lors de leurs auditions 67, la croissance démographique est encore trop forte en Afrique pour permettre de réduire la pauvreté. Tous les experts considèrent en effet qu’un taux moyen de 7 % de croissance annuelle de l’économie sur plusieurs années est indispensable pour endiguer la pauvreté dans un contexte de croissance démographique de +2 % par an. Or, comme on l’a vu précédemment, même si le continent a retrouvé des taux de croissance enviables et que les prévisions restent très positives, - 4,8 % en 2014, de 5,3 % en 2015 -, ils sont encore assez éloignés des 6 % antérieurs. Les taux actuels de croissance sont insuffisants pour avoir un réel impact sur une pauvreté qui reste massive ; l’émergence d’une classe moyenne n’empêche pas que la croissance continue de faire des exclus. Si l’on a vu que les classes moyennes se développent aujourd'hui en Afrique, il convient de garder présent à l’esprit que l’on parle ici de critères très larges, dans un contexte encore fragile, où les économies africaines sont encore très largement informelles. Comme le rappelait Henri-Bernard Solignac-Lecomte, la comparaison des taux de croissance respectifs de la Chine et de l'Afrique permet de relativiser les choses quant aux réussites et perspectives : l’économie africaine a crû de 5 à 6 % par an pendant dix ans, la Chine de 10 % pendant trente ans.
En outre, les caractéristiques de cette croissance économique appellent quelques remarques. On a vu qu’elle s’expliquait par plusieurs facteurs, au premier rang desquels la démographie occupe une place de choix, qui voit une augmentation continue, déterminante et irréversible de la part des actifs dans la population, ce qui en fait le facteur le plus lourd et le plus durable de la croissance, sans doute jusqu’à la fin du siècle. Cela étant, malgré l’émergence d’une classe moyenne aux effets bénéfiques durables sur le développement des marchés intérieurs, la croissance reste particulièrement inégalitaire, ce qui constitue un facteur non-négligeable de fragilisation à long terme ; on considère que des décennies seront nécessaires à la réduction notable de la pauvreté.
Surtout, la croissance de l'Afrique, encore tirée en grande partie par les exportations de matières premières, reste trop peu créatrice d’emplois : la focalisation des économies sur l’extraction des ressources minières a entraîné parallèlement un déficit de construction d’infrastructures manufacturières, risquant de tarir l’émergence : le nombre d’emplois actuellement créé est en effet inférieur à ce qu’il devrait être étant donné le taux de croissance. En conséquence, malgré un bon climat des affaires, il s’avère encore difficile pour le secteur manufacturier de percer, même dans des pays aux performances remarquables.
Ensuite, si le cours des matières premières a porté la croissance ces dernières années, leur volatilité en fait un facteur réversible et une cause majeure d’incertitude dans le temps, cf. les variations parfois extrêmes des cours du pétrole, qui ont par exemple fluctué dans une fourchette de 40 à 145$ au second semestre 2008 68. Cette instabilité vaut y compris pour des pays très dynamiques et riches en ressources naturelles. Le risque d’un syndrome hollandais existe et personne ne peut dire ce qu’il en sera dans dix ans si le ralentissement de la croissance des pays émergents devait se confirmer. Des effets pervers ne sont pas non plus à exclure dans un sens comme dans l’autre : ainsi le prix élevé des matières premières a eu pour conséquence une forte augmentation de l’endettement de ces pays, dont les capacités de remboursement ne sont pas menacées pour le moment, mais qui pourraient l’être si des retournements de conjoncture devaient intervenir sur ce plan.
Sur ces bases actuelles, face à des pays comme la Chine, l’Afrique reste toujours une région peu compétitive, malgré ses bas salaires, avec des niveaux de chômage et de sous-emplois élevés. Dans les secteurs à forte concurrence, cela constitue un frein considérable à la croissance du marché intérieur qui devrait néanmoins se confirmer, notamment dans les services et les activités productives, compte tenu de l’urbanisation et de la croissance démographique. Malgré l’augmentation des IDE que l’on a vu plus haut, l’Afrique continue à produire peu et la protection des marchés domestiques sous l’empire des règles de l’OMC n’étant plus permise, les perspectives ne sont pas comparables sur ce plan à ce qu’elles ont pu être jadis pour la Chine.
Si les taux de croissance actuels de l'Afrique ne devraient pas être remis en question sur le moyen terme, il n’en reste pas moins que l’objectif d’un taux de 7-8 % nécessaire suppose d’autres efforts, non seulement pour consolider les acquis mais aussi pour mettre le continent sur la voie de l’émergence. Comme on l’a évoqué, certains facteurs tiennent à la qualité des politiques économiques, d’autres sont exogènes, échappant à la maîtrise des acteurs africains.
b. La nécessité de prendre en compte certains impératifs
S’agissant des politiques économiques conduites par les pays africains, les dernières Perspectives économiques régionales du FMI sont circonspectes. Certes, sur une projection à 50 ans 69, la croissance devrait se maintenir à un taux moyen de 5 %, la classe moyenne se développer, la pauvreté diminuer, la mortalité infantile et juvénile devrait continuer de baisser ; tout comme le taux de prévalence du VIH/sida, le taux d’alphabétisation devrait poursuivre son amélioration, et les nouvelles technologies augmenter leur diffusion. Cela étant, rappelant que la croissance des pays d’Afrique subsaharienne n’a en fait « rien d’extraordinaire au vu des taux de croissance habituels des pays en développement » 70, les analyses du FMI considèrent que les données d’ensemble, évidemment favorables, ne doivent pas masquer un certain nombre de problèmes de fond que les pouvoirs publics devraient prendre en compte en urgence sous peine de voir leurs chances hypothéquées.
Ainsi en est-il de la question des déficits budgétaires, parfois insoutenables, qui rendent le rééquilibrage des finances publiques indispensable ; des pays pourtant riches en ressources naturelles poursuivent des investissements coûteux, à la rentabilité incertaine, voire au-delà de leur capacité de remboursement, compte tenu des perspectives d’exploitation de leurs richesses. C’est le cas du Tchad, du Ghana ou de l’Angola. Ailleurs, en Éthiopie notamment, ce sont des tensions inflationnistes fortes qui perdurent, ainsi que des risques possibles de surendettement. Comme on le soulignait plus haut, la croissance est à la fois peu créatrice d’emplois et sans réel effet sur la réduction de la pauvreté au rythme qui serait nécessaire pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. En d'autres termes, les politiques publiques devraient s’intéresser davantage aux secteurs permettant d’accélérer les progrès en ce sens.
À cet égard, l’investissement public dans un certain nombre de domaines est d’une importance majeure pour espérer pérenniser la croissance. Les secteurs de la santé ou de l’éducation, par exemple, sont parmi ceux qui devraient faire l’objet d’efforts particulièrement soutenus. De même en est-il de l’énergie, que le FMI considère comme « étant la clé de voûte de toute stratégie de croissance ». Comme le soulignait Jean-Michel Severino, il ne s’agit pas là d’une difficulté d’ordre macroéconomique, mais d’un problème général lié au manque d’infrastructures et de moyens logistiques. Malgré la croissance démographique, le stock de capital physique est resté le même depuis les indépendances, laissant les villes et les campagnes sous-structurées en termes de transports et d’infrastructures énergétiques. Le rythme de l’investissement africain dans les infrastructures n’est pas en phase avec le rythme de croissance : ces investissements sont de l’ordre de 40 à 50 millions de dollars par an alors que, pour un taux de croissance de 6 %, ils devraient être de l’ordre de 100 millions annuels. Or, le déficit énergétique (fréquents délestages, nécessité d’investir dans un équipement électrogène…) et, plus généralement, la défaillance de l’environnement physique, créent un coût non négligeable pour la compétitivité africaine. Si l’Afrique veut atteindre un taux de croissance de 8 %, il lui faudra faire exploser son rythme actuel d’investissements publics en infrastructures. Malgré son optimisme, Lionel Zinsou posait de son côté la question de savoir à quelle échéance l’Afrique disposerait des structures et infrastructures des pays développés et se demandait : « à quand un Bangalore africain ? », en d'autres termes une Silicon Valley, tout en rappelant que l’économie actuelle de l'Afrique est l’héritage de la colonisation, où rien n’a été dépensé pour le capital. Les auteurs d’une étude récente publiée par l'AFD 71 concluaient à ce sujet que : « Absence de spécialisation, manque de relations verticales ou horizontales inter-entreprises, vétusté des infrastructures, absence de main-d’œuvre qualifiée sont autant de facteurs expliquant le faible niveau des IDE en Afrique subsaharienne. Ceux-ci se concentrent dans les secteurs à haute intensité capitalistique, notamment liés à l’extraction de matières premières, mais dont les effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie et sur l’emploi sont très faibles. Les pays africains peinent à utiliser ces IDE comme un levier pour leur économie. Ils s’enferment dans le cycle de l’appauvrissement et du sous-développement dans la mesure où ce modèle de croissance perpétue l’exploitation systématique des richesses, sans favoriser en retour la création d’emplois et le développement d’un tissu industriel autonome. Les flux commerciaux entre les pays africains et les autres régions du monde se limitent à l’exportation de matières premières pas ou peu transformées et à l’importation de produits manufacturés. » A cet égard, le diagramme ci-dessous est éclairant sur la très - trop - faible capacité de l’économie africaine à créer suffisamment d’emplois pour absorber les effets de la croissance démographique et à permettre l’insertion professionnelle des jeunes.
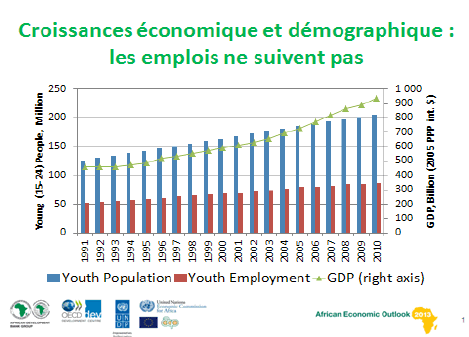
La croissance économique africaine ne crée pas suffisamment d’emplois 72
En d'autres termes, comme le soulignait Henri-Bernard Solignac-Lecomte, les conditions sont sans doute réunies pour un décollage économique de l’Afrique, mais la création d’emplois pérennes, ainsi que celle d’une véritable économie formelle, suppose des changements de politique. L’agriculture et l’agro-industrie figurent à cet égard parmi les enjeux majeurs des prochaines années pour l'Afrique qui devra nourrir ses villes. Cela suppose que les politiques publiques soutiennent enfin les industries de transformation locales et assurent un véritable développement rural, ne serait-ce que par un maillage en infrastructures nécessaires à la croissance des communications, des transports… À ce sujet, Paul Collier prend l’exemple du réseau ferré africain, aujourd'hui peu dense 73, et même en régression depuis les indépendances. Selon la Banque africaine de développement, pour devenir une des économies les plus dynamiques et productives du monde, l’Afrique devra investir massivement dans presque tous les sous-secteurs des infrastructures : transports, télécommunications, eau et assainissement, énergie. C’est à ce prix que sa croissance restera soutenue au long des prochaines décennies. À ce titre, les investissements doivent porter prioritairement sur les ressources humaines : sans main-d’œuvre compétitive et qualifiée, il n’y aura pas de bénéfices des nouvelles technologies pour l’Afrique. En clair, l’enseignement à tous les niveaux est l’un des grands défis pour l’avenir du continent africain.
Liée à ce dernier aspect, la stabilité géopolitique de l’Afrique est un autre préalable à prendre en compte. Comme le faisait remarquer Lionel Zinsou, « on ne sait pas faire de croissance quand des populations sont déplacées, quand on détourne toutes les ressources pour l’armement, quand on a des enfants soldats plus que des enfants scolarisés »74… Il est donc essentiel que le degré de conflictualité en Afrique continue de diminuer durablement pour ne pas perturber la nouvelle donne et compromettre ses chances de développement.
2. La dépendance vis-à-vis de l’international
Comme nous l’avons vu, la croissance africaine est à ce point portée par ses exportations de matières premières qu’on ne peut manquer d’y voir un facteur de fragilité important. En ce sens, l’impact de la situation économique mondiale mérite d’être évalué.
a. L’impact de la crise sur la demande de matières premières africaines
Chacun comprend que la demande de matières premières est étroitement conditionnée au dynamisme des économies des pays importateurs. Dans la mesure où la croissance moyenne des pays de l'OCDE a considérablement ralenti depuis plusieurs années, pour ne pas mentionner l’atonie de la zone euro, et où les taux de croissance des grands émergents tendent aussi à baisser, les exportations africaines risquent de se voir durablement affectées et revues à la baisse.
À titre de comparaison, on rappellera que, naguère, la région latino-américaine faisait figure de championne toutes catégories, au point que les observateurs, unanimes, parlaient du XXIe siècle comme celui de l'Amérique latine. L’ensemble des indicateurs macroéconomiques des pays de la région étaient alors au vert pour une période longue, après avoir surmonté les crises, notamment budgétaires et financières, les plus aigües, au cours des deux décennies précédentes. Ces prévisions ont été considérablement revues, au point que le Brésil, après avoir connu des performances comparables à celles des pays africains, est retombé à 0,9 % de croissance en 2012, sous l’effet de la baisse de la demande mondiale, et peine aujourd'hui à retrouver ses niveaux antérieurs. Dans cet ordre d'idées, le FMI remarquait récemment que « la croissance de l’Afrique et la montée concomitante de la classe moyenne dépendent en partie d’une hausse des investissements internationaux provoquée par une augmentation des échanges, notamment avec les pays émergents en expansion. On prévoit que le commerce avec la Chine, évalué à 10 Mds$ en 2000, dépassera 110 Mds$ en 2011, tandis qu’avec l’Inde, il passerait de 3 Mds$ en 2000 à 70 Mds$ en 2015. Ces liens comportent des risques : la croissance globale de l’Afrique est tellement corrélée à l’exportation de matières premières vers la Chine qu’elle est vulnérable aux fluctuations de la production industrielle chinoise. » 75 En cas de dégradation durable de l’économie mondiale ces prévisions pourraient être revues à la baisse ; de fait, les soubresauts constatés ces derniers temps ne sont évidemment pas étrangers à la conjoncture. Le fait que la Turquie, le Brésil ou l’Inde, tous trois importants investisseurs en Afrique, aient dû faire face à des chutes brutales de leurs monnaies respectives à l’été 2013, est un exemple qui confirme, par contrecoup, la fragilité des fondements de la croissance africaine.
Au-delà d’un ralentissement de la croissance, il n’est pas non plus exclu que les IDE affluant vers l'Afrique pâtissent eux aussi de la situation et que l’on assiste à des retournements. Selon le FMI, les possibilités d’amortissements des chocs des divers pays concernés dépendront grandement des marges de manœuvre qu’ils auront su ou pu acquérir antérieurement. Quoi qu’il en soit, la question de leur réaction face à un ralentissement prolongé de la croissance mondiale est une donnée importante pour qui s’intéresse à l’émergence de l'Afrique ; différents scénarii peuvent être envisagés, comme le montre le tableau reproduit ci-dessous.
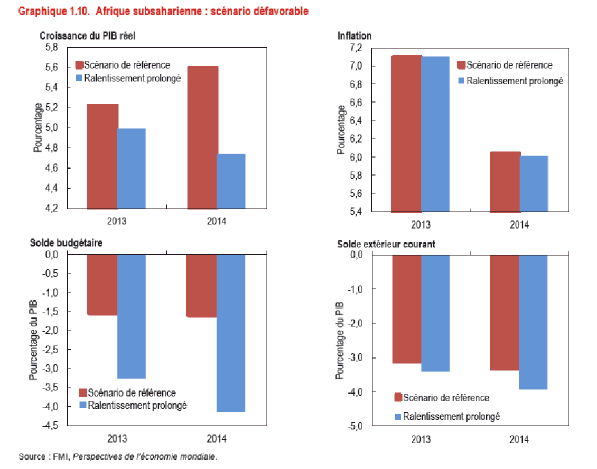
Les scenarii macroéconomiques africains en cas de ralentissement de la croissance mondiale
C’est ce qui fait dire à certains que, au fond, rien ne changerait pour l'Afrique. Ainsi, l’essayiste Axelle Kabou considère-t-elle que, malgré le réel décollage actuel de l'Afrique, comme à « chaque fois qu'il y a une redistribution des cartes à l'échelle mondiale, l'Afrique est invitée à y participer en apportant des hommes et des matières premières. Mais son rôle est subalterne, et ce mode d'arrimage perdure. En fait, l'Afrique est reconvoitée. Il suffira que la donne économique change pour qu’elle retombe dans l'oubli, la misère et les tréfonds de l'Histoire. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit d'une conquête africaine. L'Afrique reste larguée. » 76 Pour l’auteur, la démographie n’a pas à être sacralisée, le fait que le continent dispose du quart de la population active d’ici à 2050 n’est pas un levier pertinent dans la mesure où, écrit-elle, « l'Afrique ne dispose pas du socle nécessaire. Les rapports à la connaissance, la science et l'éducation sont extrêmement diaphanes. Pour qu'une dynamique d'exploitation des savoirs se mette en place, quelques décennies ne suffiront pas (…) et cela ne se fera pas sans convulsion. » Sans aller sur le terrain polémique, il n’est pas inutile de mentionner que d’autres analystes, se fondant sur « la tragédie des appareils statistiques africains », doutent carrément de l’émergence du continent et concluent que l’on en a en fait aucune idée. 77
b. Les incidences de la relation de l'Afrique avec les émergents
Mention particulière doit être faite dans cette analyse à la relation que les pays africains entretiennent aujourd'hui avec les principales puissances émergentes et à l’incidence que celle-ci a d'ores et déjà sur le continent. Le développement économique du Brésil, de l’Inde, et surtout de la Chine, dont on considère qu’il a contribué pour quelque 30 % à la croissance mondiale de la première décennie du XXIe siècle, a bouleversé la donne sur de multiples aspects. Si les pays africains exportateurs de matières premières ont évidemment bénéficié de la hausse considérable des importations chinoises, ils sont aujourd'hui, de facto, comme le FMI le souligne, dans un état de vulnérabilité critique, compte tenu de l’importance prise par ces échanges.
À l’évidence, la croissance africaine a été fortement dopée par les relations entre l’Afrique et les émergents dont les moteurs de croissance servent aujourd'hui de relais face à la récession ou au tassement de l’économie que connaissent les pays de l'OCDE. L'Afrique y puise aussi ses capacités de résilience, comme on a pu le constater lors de la récente crise financière 78. Pour autant, compte tenu du déséquilibre qui prévaut aujourd'hui, les effets pervers ne sont pas absents.
Sans entrer dans les débats complexes qui animent la communauté des économistes sur la pondération et l’incidence des divers facteurs qui interagissent sur la croissance et le développement de l’Afrique comme de la Chine, vos rapporteurs relèveront ici quelques données remarquables. Les tableaux ci-dessous rappellent ainsi la part considérable prise par la Chine sur le marché mondial des minéraux, aujourd'hui le principal débouché des exportations africaines de minerais dont elle acquiert la moitié à elle seule.
De même, depuis 2009 la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Si elle n’est pas encore un acteur majeur du marché, avec 7,1 % de la production mondiale, l'Afrique assure 27 % de ses approvisionnements : « la Chine est le premier débouché du pétrole africain et l’essor très rapide de sa demande a contribué à la hausse des cours ». 79 En 2010, le pétrole brut représentait 64 % des exportations africaines vers la Chine ; avec la métallurgie non ferreuse et les minerais, l’ensemble représentait 87 % des exportations. Toutes choses égales par ailleurs, les mêmes commentaires valent pour les exportations de bois.
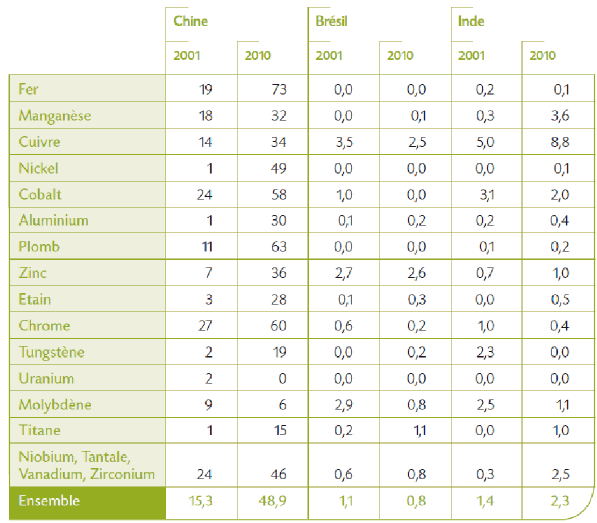
Place des puissances émergentes dans les importations mondiales de minerais (2001 et 2010, en %) 80
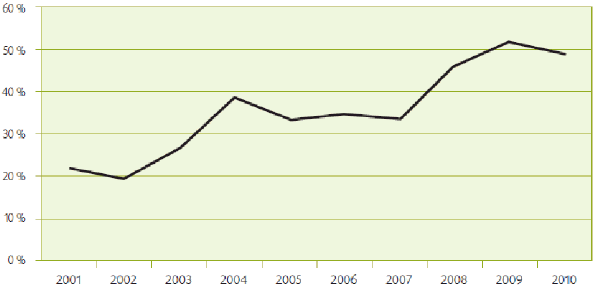
Poids de la Chine dans les exportations africaines de métaux 81
Ainsi, entre les pays africains exportateurs de matières premières et les grands émergents, au tout premier rang desquels la Chine, s’est développée une relation marquée par un certain degré de dépendance.
Les autres grands émergents ne sont pas dans la même situation que la Chine. Ainsi de la Russie et du Brésil, dont les principaux partenaires commerciaux sont le Nigeria, l’Angola, l’Afrique du Sud et la Libye ; la majeure partie des entreprises brésiliennes investissent dans le secteur des ressources naturelles, et se concentrent essentiellement sur l’Afrique lusophone.
Toutefois, dans la mesure où l’on a découvert d’importants gisements de pétrole au large de ses côtes, il apparaît clair que dans un futur plus ou moins proche, les besoins du Brésil sur le marché international, et par conséquent africain, se réduiront considérablement. Il est probable qu’il deviendra lui-même un exportateur important d’hydrocarbures. Comme le soulignait une récente étude 82, la stratégie de ses multinationales évolue d'ores et déjà sur la base de ces nouvelles données : Petrobras envisageait initialement de doubler ses investissements africains entre 2007 et 2011, il est désormais prévu que, d’ici à 2015, 95 % de ses investissements resteront au Brésil. Inévitablement, la balance commerciale entre les deux partenaires évoluera profondément en défaveur de l’Afrique ; la diminution des importations brésiliennes de pétrole africain ne sera sans doute pas compensée par l’augmentation éventuelle, sinon probable, d’autres ressources minérales ou naturelles, aujourd'hui inférieures à 3 %, de l’Afrique vers le Brésil.
Malgré des différences de degrés, Brésil et Chine reproduisent à leur échelle les mêmes problématiques vis-à-vis de l'Afrique, et l’on faisait récemment remarquer que « les relations entre la Chine et l'Afrique vont évoluer avec les transformations du mode de développement chinois, la montée en gamme de ses productions et le ralentissement de sa demande de produits primaires » 83. S’il devait se confirmer que les « trente glorieuses » chinoises sont finies, comme le titrait récemment Le Monde 84, compte tenu du ralentissement de la croissance, du vieillissement prématuré de la population, des déséquilibres territoriaux, etc., les lendemains de la croissance africaine pourraient s’inscrire dans des perspectives moins enthousiasmantes que celles envisagées.
FOCUS SUR L'AFRIQUE ANGLOPHONE
Ainsi qu’annoncé en introduction, vos rapporteurs se proposent de vous présenter dans le détail les quelques pays d'Afrique anglophone supposés les plus aptes à rejoindre le club encore fermé des émergents. Même si l’Afrique du Sud a été admise parmi les BRICS et au sein du G20, il faut malgré tout garder à l’esprit que son émergence, comme le rappelait par exemple Jean-Bernard Véron 85, et a fortiori, celle des autres candidats potentiels, est encore bien modeste par rapport à celle de la Chine ou de l’Inde. De l’avis de vos rapporteurs, les pays de cette zone sont peu nombreux à pouvoir prétendre à ce statut.
Quoi qu’il en soit, eu égard à la position qu’elle a acquise depuis longtemps et qu’elle n’a cessé depuis lors de conforter, l’Afrique du Sud mérite une place particulière dans cette présentation, malgré un chemin semé de nombreuses et très délicates embûches.
Le Nigeria et le Kenya apparaissent ensuite comme les pays d'Afrique anglophone disposant, de loin, de potentialités prometteuses ; ils ne sont pas non plus exempts de handicaps, pour certains particulièrement lourds, notamment s’agissant du Nigeria. Malgré tout, ces pays comptent d'ores et déjà en Afrique et pèsent indéniablement sur le plan régional. Ils pourraient être suivis de quelques autres sur lesquels il ne sera pas inutile de porter de rapides considérations générales ; même s’ils sont bien plus petits et qu’ils ne peuvent rivaliser en ambition avec les trois premiers, leurs performances et leur stabilité sont parfois remarquables. Raisons suffisantes pour que notre pays ne les perde pas de vue !
I. L’AFRIQUE DU SUD, PRIMUS INTER PARES
À tout seigneur tout honneur. De tous les pays d'Afrique, l’Afrique du Sud mérite qu’on lui réserve une place à part dans cette analyse, compte tenu de son poids continental et des ambitions qu’elle affiche. Même si son importance actuelle ne doit pas occulter la persistance d’un certain nombre de fragilités porteuses d’hypothèques pour l’avenir.
A. RESITUER L’ÉMERGENCE DE L'AFRIQUE DU SUD DANS LE CONTEXTE AFRICAIN
Un monde sépare l’Afrique du Sud du reste du continent. Quiconque s’est jamais rendu dans ce pays l’a perçu dès l’aéroport de Johannesburg. Quelques données rapides suffiront à illustrer cette réalité d’un géant africain, encore loin cependant des autres émergents.
1. Le géant économique incontestable du continent
Relativement vaste à l’échelle africaine, avec une superficie de plus de 1,2 million de km2, l'Afrique du Sud se classe au 9e rang du continent, couvrant près de 2,5 fois la France. Elle est aussi fortement peuplée. Avec 51 millions d’habitants, elle est le cinquième pays africain en termes de démographie, bien que très en-deçà des géants que sont la RDC, l’Éthiopie ou l’Égypte, qui comptent chacun plus de 75 millions d’habitants, et bien sûr du Nigeria, qui approche, voire dépasse, les 170 millions d’habitants 86.
a. L'Afrique du Sud, loin devant les autres pays africains
C’est au plan économique que l’Afrique du Sud surclasse le continent, comme le traduit le diagramme ci-dessous. À lui seul, son PIB est en effet égal à près du quart de celui de l’ensemble de l'Afrique. Selon les dernières statistiques disponibles, il représente plus des deux tiers du PIB de l'Afrique australe et plus du tiers de celui de toute l'Afrique subsaharienne. En 2011, il s’établissait à 408 Mds$ et occupait le 29e rang mondial, selon les données du FMI.
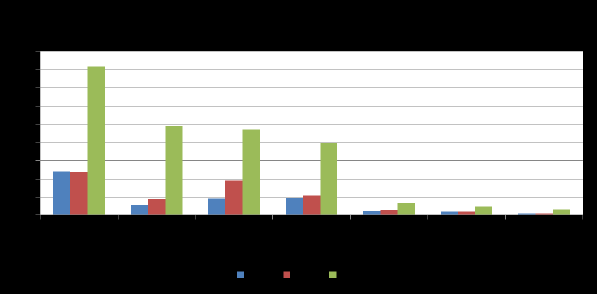
Le poids de l’Afrique du Sud dans l'Afrique subsaharienne 87
La comparaison de son PIB par habitant place aussi l'Afrique du Sud sur des standards nettement plus proches de ceux des pays de l'OCDE que des pays africains : plus de 8 000 dollars, contre une moyenne africaine qui vient de passer les 1 000 dollars pour la première fois de l’histoire, comme le président de la BAD, Donald Kaberuka, l’indiquait récemment. Le graphique ci-dessous montre à ce titre que, par comparaison avec les autres grands émergents, l'Afrique du Sud se classe ainsi très honorablement, loin devant la Chine ou l’Inde, mais nettement en retrait de la Russie et du Brésil qui font ici jeu égal.
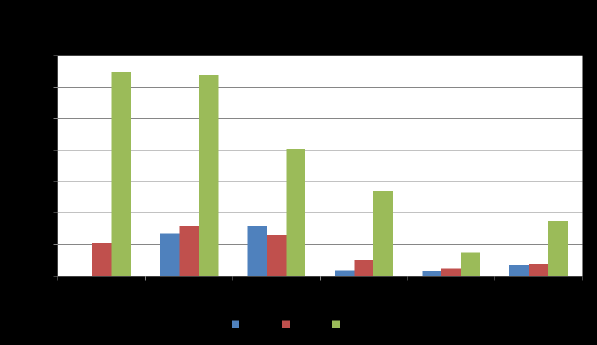
Comparaison des PIB des BRICS par habitant 88
Plusieurs autres aspects traduisent le poids incontestable de l’économie sud-africaine. De tous les pays d’Afrique subsaharienne, il est celui dont les entreprises sont, de très loin, les plus puissantes : en 2011, parmi les 500 plus grandes entreprises et groupes africains, 177 étaient sud-africains. Les groupes sud-africains représentent plus du tiers des grandes entreprises d’Afrique subsaharienne. On mesure mieux cette donnée, et le poids régional écrasant de l'Afrique du Sud, si l’on sait, par exemple, que le reste de l’Afrique australe ne compte que 27 autres entreprises dans ce cas. Il n’est pas surprenant dans ces conditions, de relever que la place boursière de Johannesburg, le Johannesburg Stock Exchange, JSE, est de très loin la première du continent, avec une capitalisation totale de près de 860 Mds$, qui représente 210 % du PIB sud-africain.
Cette situation est pour partie le résultat de l’histoire. Sans doute aussi à la différence de nombre d’autres pays de la région sur ce point, l'Afrique du Sud a-t-elle su mettre en place depuis longtemps de véritables politiques industrielles. La période de l’apartheid et de l’autarcie ont conduit les gouvernements de l’époque à développer des politiques de promotion d’un capitalisme afrikaner qui perdure. Comme le faisaient remarquer certains interlocuteurs de vos rapporteurs 89, la sagesse de Nelson Mandela aura précisément été de ne pas remettre en question les fondements de l’économie sud-africaine hérités de l’apartheid. Aujourd’hui, 85 % de l’économie sont encore aux mains des Blancs. Le changement s’est fait sur d’autres questions, Nelson Mandela ayant troqué la continuité économique contre le changement politique.
C’est le sens du Black Economic Empowerment, BEE 90, défini par les autorités gouvernementales sud-africaines au sortir de l’apartheid et inscrit dans la constitution de 1996 91. Il a institué des politiques de discrimination positive en faveur des Noirs et, plus généralement, de l’ensemble des populations, - Métis (« Coloured »), Indiens et Chinois – dont elles étaient victimes sous l’apartheid, pour en corriger les effets. 92 Ainsi ont été instituées des mesures en direction des entreprises destinées à élever le niveau de participation des Noirs, en matière d’actionnariat, de personnel d’encadrement, de formation professionnelle, de soutien aux communautés. Le bilan de cette politique ambitieuse est jugé positivement, au niveau du management intermédiaire notamment. Même si les grandes entreprises restent « blanches », le BEE a permis à une petite élite noire de s’enrichir dès les années 1990. Sept critères sont prévus, sur lesquels sont notées les entreprises par le ministère du commerce et de l’industrie. Le degré d’application de ces critères conditionne la ponctuation attribuée, par exemple, dans l’attribution des marchés publics. Les évolutions récentes de la législation sur le « BEE » tendent à renforcer les sanctions et les volets relatifs à l’actionnariat noir : jusqu’ici, une entreprise pouvait compenser un critère par un autre ; les projets de réforme prévoient que désormais, une entreprise refusant d’ouvrir son capital à hauteur d’au moins 10 %, se verra mécaniquement pénalisée. Concrètement, les entreprises étrangères qui voudraient garder un contrôle total de leurs filiales seraient par exemple exclues des marchés publics nationaux.
Cette parenthèse refermée, selon les informations communiquées à vos rapporteurs 93, les différentes institutions gouvernementales, - ministère du commerce et de l’industrie, ministère du développement économique, ministère des entreprises publiques, n’ont cessé de poursuivre les politiques industrielles antérieures de soutien et de promotion. C’est par exemple le cas sur des volets commerciaux, notamment au niveau de la SADC, comme dans le cadre des négociations entre celle-ci et l’UE sur un accord de partenariat économique. En matière de soutien à des secteurs industriels comme l’automobile, ou de préférence nationale, des mesures existent notamment pour favoriser le recours prioritaire à des fournisseurs locaux dans les appels d’offre. 94
b. Un positionnement contrasté quant aux IDE
L'Afrique du Sud occupe une place de choix sur le continent en termes d’investissements étrangers : les IDE en direction de l'Afrique du Sud classent le pays parmi les plus attractifs et le stock des IDE en Afrique du Sud est aussi très important.
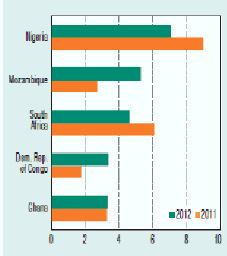
Les flux d’IDE vers les cinq principaux pays d’Afrique 95
L'Afrique du Sud est donc un pays qui retient l’attention des investisseurs étrangers. Pour autant, les données de la CNUCED montrent que le Nigeria et le Mozambique sont actuellement mieux classés qu’elle. En 2009, l'Afrique du Sud se plaçait au 4e rang des pays africains, derrière l’Angola, l’Égypte et le Nigeria, et au 79e rang dans le classement de la CNUCED pour les flux d’IDE entrants et sortants, par rapport à la taille de l’économie.
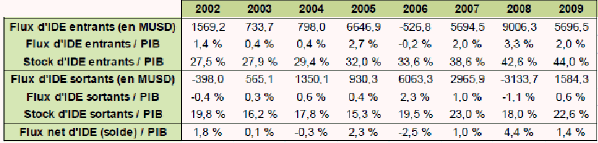
Flux et stocks d’IDE sud-africains 96
Ce que confirment les informations communiquées à vos rapporteurs par les services de l’ambassade de France en Afrique du Sud, selon lesquels, malgré une forte augmentation depuis 2007, les IDE entrants en Afrique du Sud restent relativement faibles, de l’ordre de 2,0 % du PIB en 2009, de 1,2 % en 2012. En ce sens, on relève qu’un pic a été atteint en 2008 avec l’acquisition par la Chine de 20 % du capital de la Standard Bank, ce qui a porté cette année-là le taux d’IDE à 3,3 % du PIB ; depuis lors, il n’a jamais été retrouvé et les flux d’IDE entrants sont nettement inférieurs à ceux que constatent les autres émergents : le Nigeria est par exemple à 2,6 %, avec quelque 8,9 Mds$, l’Indonésie à 2,3 %, le Brésil à 2,7 %. En 2012, l'Afrique du Sud n’était que 149e sur 181 pays, après avoir été au 108e rang en 2011, dans le classement de la CNUCED mesurant les flux d’IDE rapportés à la taille de son économie, alors même qu’elle est aujourd'hui la 29e économie mondiale. Ce sont des investissements de court terme donc « éminemment volatils » et portant le plus souvent sur des acquisitions d’actifs existants. On en veut pour preuve le fait que les flux entrants se sont contractés de près de 25 % entre 2011 et 2012, comme le montre le diagramme ci-dessus, de 6 Mds$ à 4,6 Mds$. 2011 avait présenté un rebond, après un précédent reflux en 2010. Les questions de compétitivité de l’industrie minière, de climat social détérioré, ont tendance à échauder les investisseurs étrangers et certains, notamment dans le secteur minier, n’ont pas hésité à se désengager.
Les IDE en Afrique du Sud se caractérisent surtout par des opérations de grande ampleur : en 2009, deux opérations représentaient les deux-tiers des flux.
Les graphiques ci-dessous montrent enfin, pour le premier que, de manière stable, à 80 %, les IDE en direction de l’Afrique australe vont surtout en Afrique du Sud, qui par ailleurs accapare 17 % du total des IDE à destination de l’ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le second diagramme montre une concentration des flux d’IDE, sans cesse croissante vers l'Afrique du Sud.
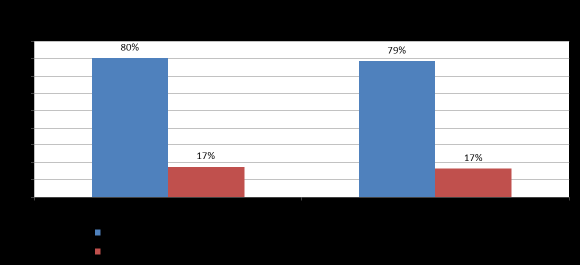
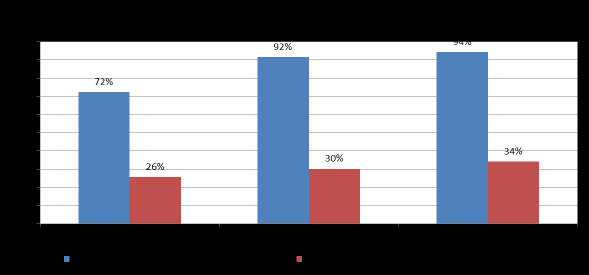
2. Quelques caractéristiques de l’économie sud-africaine
Il y a longtemps que l'Afrique du Sud occupe la première place du continent. Chacun connaît l’importance historique du secteur minier qui, aujourd'hui encore, reste un acteur essentiel de l’économie du pays. Même s’il n’est pas aussi dominant que dans nombre d’autres pays du continent, il n’est pas inutile de s’y arrêter : il peut, d’une certaine manière, servir de « fil rouge » pour analyser les potentialités et faiblesses de l'Afrique du Sud, son environnement et les difficultés auxquelles il est confronté.
a. Le secteur minier, emblématique des réussites et difficultés de l’économie sud-africaine
C’est en premier lieu sur l’exploitation de ses importantes ressources minières que l’économie sud-africaine a commencé de se développer. Ce secteur est toujours déterminant puisque, aujourd'hui encore, l’Afrique du Sud reste le principal producteur africain de la quasi-totalité des produits miniers et métaux 97, à l’exception des diamants 98, de l’uranium 99, du cuivre et du cobalt 100, des phosphates 101 et du fer.
À l’instar de ce qui se passe dans la plupart des pays africains tout aussi richement dotés qu’elle, la demande internationale de matières premières est cruciale pour l’économie du pays et joue un rôle aux effets immédiats, dans la mesure où cette production est aux trois-quarts exportée, comme le montre le diagramme ci-dessous. Après le fort recul de 2009 qui avait touché la plupart des minerais, tant en volume qu’en valeur, la production minière a retrouvé la croissance, de nouveau tirée par les exportations. A la chute de 20 % enregistrée alors a succédé une hausse des ventes des produits miniers de +25 % en 2010, revenant aux records de 2008, soit plus de 300 Mds de rands en valeur totale. Certains produits comme le minerai de fer ont connu des hausses de plus de 60 % d’une année sur l’autre, voire supérieures : +80 % pour le minerai de chrome ; +90 % pour le manganèse. En 2010, ces productions, avec celles de charbon (+12 %) et d’or (+9 %), ont représenté plus de 86 % des ventes totales de produits miniers sud-africains.
Comme les autres pays du continent, l'Afrique du Sud est dépendante de la demande extérieure. D’autant que l’on relève, sans surprise, depuis le milieu de la décennie, une forte réorientation géographique de ses exportations : en 2011, la Chine absorbe 40 % de la production exportée ; elle est la première destination des minerais sud-africains qui alimentaient naguère les marchés européen, américain et japonais.
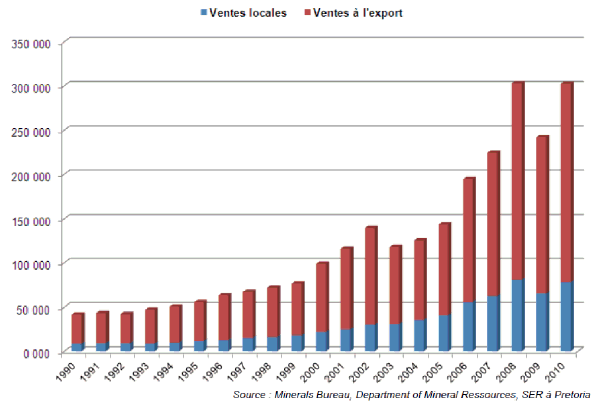
Ventes locales et exportations de produits miniers sud-africains 102
Sans être aussi dominant pour l’économie nationale que dans d’autres pays africains, le secteur minier occupe une place considérable : il contribue directement à près de 9 % du PIB, compte tenu des prix internationaux élevés et même de 20 % si l’on tient compte de l’ensemble des activités qui y sont liées. Dans le même esprit, il représente aussi 20 % de l’investissement brut, le tiers des entrées de capitaux dans l’économie comme de la capitalisation boursière de la place de Johannesburg et enfin la moitié des exportations de marchandises.
b. Une économie cependant bien plus diversifiée que dans de nombreux pays africains
Si le secteur minier, au sens large, continue aujourd'hui d’occuper cette place conséquente dans l’économie du pays, ce n’est pas, pour autant, au détriment des autres pôles. En effet, son importance tend à diminuer progressivement, par exemple en termes d’emplois : sur un million d’emplois générés, les emplois directs du secteur sont aujourd'hui inférieurs à 500 000, contre 800 000 dans les années 1980. À la différence de ce que l’on a relevé dans la plupart des pays africains, aujourd’hui l’essentiel de la croissance sud-africaine n’est pas tiré par les exportations de matières premières et ce, pour plusieurs raisons.
Par certains côtés, l'Afrique du Sud est un pays réellement développé, qui transforme lui-même une grande partie de ses matières premières avant de les exporter. Il s’agit en effet d’un secteur dans lequel les investissements industriels nationaux ont été, et restent, importants pour permettre une valorisation locale des matières premières. Ainsi en est-il du ciment, de l’or, de l’acier produit sur place à partir du minerai de fer extrait du sol, etc.
En cela, l'Afrique du Sud se distingue nettement du reste du continent. Elle a su très tôt développer un appareil industriel performant. Les transformations sociopolitiques intervenues après la chute de l’apartheid n’ont rien changé sur ce plan. De sorte que, aujourd'hui, l’économie sud-africaine se répartit principalement entre les secteurs secondaire, et surtout, tertiaire. Cette structure économique traduit un niveau de développement sans comparaison sur le continent. Pour ne prendre que ces deux seuls critères, la figure ci-dessous montre que l'Afrique du Sud a effectué sa transition agricole et que son économie s’est remarquablement tertiarisée, à en juger par le poids qu’occupent dans la structure du PIB les services financiers et immobiliers, les services publics ou à la personne. On chercherait en vain dans quel autre pays africain cet ensemble pèse pour plus de 40 % du PIB.
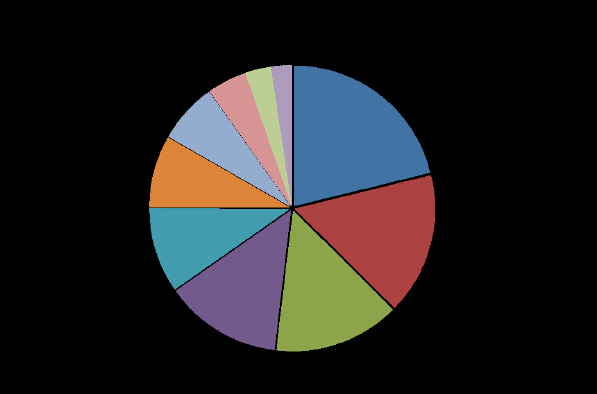
Les composantes du PIB sud-africain en 2011 : rôle indirect des mines, mais surtout une économie de services, et une industrie peu importante dans le PIB 103
Tous les analystes et observateurs le confirment, la puissante Afrique du Sud tend à s’imposer sur la scène régionale, si ce n’est au-delà, que ce soit aux plans économique ou diplomatique.
a. Les moyens d’une ambition économique
Dans cet ensemble, le poids du secteur bancaire sud-africain est tout d'abord à souligner : le total des actifs des cinq principales banques du pays 104 s’élève à près de 540 Mds$, et le revenu qu’elles génèrent a atteint 17 Mds$ en 2011 105. À titre de comparaison, le total de leurs actifs représente 3,5 fois le PIB cumulé des 15 pays de la zone franc et le revenu annuel équivaut au PIB cumulé du Benin, de la Guinée Bissau, du Niger et du Togo. Les principales banques du pays, compagnies d’assurance et autres gestionnaires d’actifs sont très présents dans la plupart des pays d’Afrique australe, notamment dans les pays membres de la SACU. Il en est de même des grandes entreprises du pays, que ce soit dans les secteurs de la grande distribution, des services non financiers, de l’agroalimentaire ou de l’industrie, aussi très présentes dans les pays voisins, notamment au Swaziland, au Mozambique et au Zimbabwe. Autant de pays très dépendants des stocks d’IDE sud-africains qui dépassent en valeur les 10 % de leur PIB respectifs. Cette importante présence n’est d’ailleurs pas sans effet négatif : les investissements sud-africains ont par exemple fortement souffert de la crise zimbabwéenne.
Les grandes multinationales sud-africaines intervenaient surtout dans les secteurs des télécommunications, des médias, de la distribution et du papier. Sur la décennie 2000, on a assisté à une évolution et les IDE sud-africains se sont nettement diversifiés : naguère essentiellement dirigés vers l’Europe, à quelque 83 % en 2001, ils se destinent aujourd'hui fortement à l’Asie, qui reçoit près de 20 % du total des IDE du pays, dont plus de 13 % en Chine, avec des flux toujours en progression, ainsi qu’à l'Afrique, qui en reçoit plus d’un quart : l'Afrique du Sud est l’un des principaux investisseurs sur le continent et cela n’est pas sans incidence sur la relation bilatérale franco-sud-africaine, comme on le verra. Logiquement, la part de l’Europe a diminué à due proportion : elle n’intéresse plus que 47 % des IDE sud-africains qui sont aujourd'hui essentiellement au Royaume-Uni (19 %), au Luxembourg (8 %) et en Autriche. En 2012, ils se sont dirigés vers cinq pays européens seulement, pour les deux-tiers vers le Royaume-Uni. La France est un pays de destination, mais les investisseurs sud-africains restent à l’évidence encore prudents vis-à-vis de notre pays, par comparaison avec les opérations qu’y mènent d’autres émergents, tels la Chine, l’Inde ou encore le Brésil, qui a fait de la France sa première destination en Europe. Au total, on ne recense que 27 groupes présents, soit 200 établissements sud-africains en France, qui emploient plus de 8300 salariés. En termes de stock, au 31 décembre 2011, la France apparaissait au 82e rang des destinations sud-africaines, avec 0,01 Md€ 106. Le rachat en 2011 du distributeur Conforama par le groupe Steinhoff pour 1,2 Md€ aura probablement réévalué cette position, mais la tendance récente semble néanmoins plutôt orientée au désinvestissement : en 2009, par exemple, le stock était valorisé à 0,17 Md€, ce qui plaçait alors la France au 52e rang des destinations d’IDE sud-africains107. En 2012, le flux a été négatif à hauteur de 10 M€.
Ce premier aspect traduit l’appétence économique sud-africaine à l’international, sa vocation d’influence sur son voisinage, comme le rappelaient divers interlocuteurs de vos rapporteurs 108. Volonté d’influence qui s’apparente à une forme de domination dont les voisins, pré-émergents, aimeraient s’affranchir. Pour l’heure, seule l'Afrique du Sud a les moyens de jouer un rôle de puissance régionale et elle ne s’en prive pas, comme quelques épisodes récents l’ont montré.
Pour rester encore brièvement sur le terrain économique, l’Afrique du Sud est en train de se détacher de ses liens anciens et forts avec les pays européens, pour se rapprocher des émergents. Ce n’est pas pour son poids économique que l'Afrique du Sud a été cooptée par les BRIC, qui ont pour l’occasion accolé un S (pour South Africa), à leur acronyme. Il faut y voir, d’abord, un geste politique : l’inclusion de l'Afrique du Sud lui permettait un rééquilibrage géopolitique et le renforcement de sa légitimité internationale 109. En même temps, dans un jeu bilatéral gagnant-gagnant, l’appartenance de l'Afrique du Sud aux BRICS permet aussi à la Chine de disposer d’une porte d’entrée plus grande ouverte en Afrique, de bénéficier de ses infrastructures qui, pour insuffisantes qu’elles apparaissent parfois, sont infiniment supérieures aux standards africains. Le leadership de l'Afrique du Sud sur le reste du continent ou, a minima, sur la région australe, ne peut objectivement que faciliter les visées de la Chine : l’investissement qu’y a réalisé dès 2007 l’Industrial and Commercial Bank of China en acquérant pour 5,5 Md$ 20 % de la Standard Bank sud-africaine, s’inscrit dans cette logique, de même que l’ouverture en 2009 du bureau sud-africain du China Africa Development Fund. 110
Dans le même esprit, l'Afrique du Sud est aussi le seul pays africain à être membre du G20, alors que son économie est encore loin d’être dans les vingt premières du monde : avec l’Argentine et l’Arabie saoudite, elle figure de loin parmi les trois plus modestes des membres de ce groupe, mais son PIB est respectivement inférieur 10 % et de 40 % aux leurs. Cette entrée dans un autre des clubs les plus fermés répond tout autant à la nécessité politique de l’Occident de maintenir un lien avec les pays du Sud, et avec l’Afrique plus précisément, que de conforter la légitimité des décisions du forum, dont on sait l’importance qu’elles ont prises depuis la crise de 2008.
Pour Mills Soko, économiste, professeur à l’université du Cap 111, la compétition très forte sur le marché africain où l'Afrique du Sud entend jouer son rôle. Elle ne veut pas laisser passer les opportunités qui s’offrent à elle, d’où sa volonté de diversification de ses relations économiques internationales. Si l’UE a été un partenaire très important, en matière d’APD et de commerce et si les échanges ont été très denses, leur baisse, compte tenu de la crise qui touche l’Europe, conduit l'Afrique du Sud à trouver des voies de diversification pour l’exportation de ses matières premières et à renforcer ses liens avec les émergents, comme la Chine ou l’Inde, en important des biens intermédiaires ou finis. D’où les partenariats stratégiques qui sont développés, avec la Turquie à la diplomatie très agressive, avec la Corée ou les pays du Golfe.
b. La volonté de s’imposer sur la scène internationale
Cela étant, les ambitions de l'Afrique du Sud se révèlent surtout dans le rôle diplomatique qu’elle entend jouer, notamment dans la gestion des crises africaines 112, théâtre sur lequel Pretoria est fortement active, avec plus ou moins de bonheur. Les exemples sont nombreux, comme l’actualité de ces dernières années ou encore de ces derniers mois l’a amplement montré. En effet, l'Afrique du Sud participe régulièrement aux missions de paix des Nations Unies sur le continent, comme au Soudan ou en RDC, à celles de la SADC ou de l'Union africaine, dont elle a aussi contribué à définir l’architecture de paix et de sécurité. De façon plus unilatérale, l'Afrique du Sud tente de jouer les médiateurs, comme lors de la crise ivoirienne, où elle a marqué son soutien au président Gbagbo, ou plus récemment en République centrafricaine, où son intervention militaire à la demande du président Bozizé, en application d’un accord bilatéral de coopération conclu en 2007, s’est non seulement révélée désastreuse et douloureuse, après la mort d’au moins treize de ses soldats dans des conditions mal éclaircies 113, mais a valu au gouvernement sud-africain de très vives critiques tant internes qu’africaines, de la part des pays de la région notamment ; que ce soit, enfin, dans l’opposition récurrente avec le Nigeria sur les dossiers continentaux, comme celui du Mali, ou dans la manière dont l'Afrique du Sud influence pour son propre compte l'Union africaine sans paraître se soucier de ses partenaires : l’élection au forceps en juin 2012 de Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-épouse du Président de la République, à la présidence de la Commission de l'Union africaine n’a pas été du goût de nombreux pays, d’autant qu’elle a été finalement obtenue après l’échec de sa première tentative au début de 2012 qui s’était traduite par la reconduction de Jean Ping, malgré un très intense lobbying de la part de Pretoria 114. De ces quelques exemples, un même fil conducteur apparaît : l’Afrique du Sud cherche à dominer sur tous les terrains, ce qui dérange non seulement les francophones mais aussi un certain nombre d’anglophones.
C’est ce qu’ont clairement perçu vos rapporteurs lors de leurs entretiens sur place : les ambassadeurs africains en poste à Pretoria se sont montrés unanimes, notamment sur l’élection de Mme Zuma, qui s’est faite en rupture avec l’idée consensuelle traditionnelle d’une organisation régionale dirigée par les petits pays qui ont gardé un goût amer de cette défaite et le sentiment d’un risque de division. 115 Les commentaires récents de la presse spécialisée sur l'Afrique confirment ce ressenti. Il y a peu, Jeune Afrique se faisait l’écho des vives critiques que la présidente suscitait quelques mois après son élection 116. Au-delà de cet épisode, ils voient l'Afrique du Sud se donner le rôle de chef d’une croisade pour la libération du continent, cherchant la reconnaissance de ses pairs pour un activisme dont ils ne sont pas demandeurs. Ses visées pour obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans l’hypothèse d’une réforme, s’expliquent dans cette volonté d’assumer les premiers rôles en lieu et place de tous les pays du continent qui ne sont pas certains d’être sur la même longueur d’onde. Porte-parole autoproclamée de l'Afrique 117, l'Afrique du Sud est surtout vue comme trop pressée de s’imposer en grande puissance, et d’occuper un vide laissé en Afrique par la France et le Royaume-Uni. Depuis la présidence de Thabo Mbeki, elle masque mal ses propres ambitions alors même qu’elle garde encore beaucoup de lacunes et de faiblesses sur lesquelles elle devrait se concentrer en priorité.
Sentiment partagé du côté de l’Union européenne où l’on juge à la fois que, sur un certain nombre de dossiers, tant internes au pays que régionaux, les relations bilatérales Afrique du Sud-Union européenne s’étaient traduites par des discussions tendues ces dernières années, tout en constatant aussi une certaine crispation aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et les membres de la SACU 118. Une crise de confiance est apparue, due au différentiel de développement : les intérêts de l'Afrique du Sud, considérablement plus développée que ses voisins, sont divergents et ceux-ci la perçoivent comme agressive, considérant qu’elle s’en sert comme d’un outil lui permettant d’asseoir sa domination commerciale régionale et de conforter l’hégémonie de ses entreprises, qui exportent vers ces quatre partenaires pour quelque 7,4 Mds$, cependant qu’elle-même n’importe que pour une valeur totale de 2 Mds$. De même, il y a quelques années, le dossier du Zimbabwe a-t-il été un dossier qui a suscité un sérieux différend entre l’Union européenne et l'Afrique du Sud, traditionnel soutien du président Mugabe.
L’Afrique du Sud en ferait décidément trop, dans une sorte de fuite en avant. Cette perception est notamment celle des pays de la SADC pour qui la présence et le poids sud-africains sont décidément trop étouffants et porteurs d’effets plus négatifs que positifs.
L'Afrique du Sud ne cache en rien ses ambitions continentales. Les membres d’un think tank proche des milieux gouvernementaux, que vos rapporteurs ont longuement rencontrés 119, ont exprimé la fierté du pays pour le miracle politique sud-africain que le monde entier reconnaît. Aujourd'hui, il y aurait consensus national sur la direction dans laquelle le pays devrait avancer d’ici à 2030 et, d’une certaine manière, c’est un chemin qu’il trace et montre au reste de l'Afrique. Certains, plus critiques 120, voient aussi dans l’ambition tous azimuts de l'Afrique du Sud et dans ses aventures militaires extérieures, peut-être insuffisamment réfléchies, sur le continent, l’effet de ses insuffisances, le besoin de s’affirmer inconsidérément dans des rivalités régionales, comme par exemple avec l’Angola. Une telle politique n’apporte aucun bénéfice économique et peut s’avérer contre-productive. Pour Thierry Vircoulon 121, directeur du département Afrique centrale à l’International Crisis Group, la pensée stratégique sud-africaine est en fait focalisée sur l'Afrique, même si elle affiche des ambitions plus larges. Elle viserait à définir des zones de sécurité, en premier lieu dans son environnement immédiat, compte tenu des menaces en termes d’instabilité, comme au Zimbabwe, aux trafics de drogues ou autres, puis dans son environnement plus lointain, au niveau des Grands Lacs, raison pour laquelle elle est intervenue dans la résolution des conflits en RDC ou au Burundi, en plus de ce que l’on a rappelé plus haut. En ce sens, peut-être, la récente création de l’agence sud-africaine de développement, la SADPA (South African Development Partnership Agency), a-t-elle aussi pour but de renforcer la présence du pays sur le continent et de conforter son image.
En résumé, on pourrait qualifier l'Afrique du Sud de géant économique régional ambitieux, peut-être parfois brouillon dans ses démarches insistantes. Il n’est pas certain qu’elle ait vraiment en mains tous les atouts ou que ceux-ci soient totalement à la hauteur de ses ambitions, comme on le verra ci-dessous, ses difficultés peuvent paraître d’une singulière acuité.
B. « SAD SOUTH AFRICA: CRY, THE BELOVED COUNTRY » 122
Reprenant dans un dossier récent le titre du célèbre ouvrage d’Alan Paton 123, The Economist a longuement analysé la situation de l'Afrique du Sud, sur les plans économique, social et politique, pour conclure au triste déclin du pays. Le journal a pointé plus particulièrement des faiblesses structurelles majeures, tenant à l’insuffisance des taux de croissance, à des taux de chômage trop élevés, et à l’un des systèmes éducatifs les moins performants qui soient. La tragédie de Marikana venait souligner les très fortes et profondes tensions qui traversent la société sud-africaine. Ainsi ce « modèle » sud-africain, se révèle-t-il mis en question, tant ses faiblesses apparaissent criantes. Si l'Afrique du Sud a fait des progrès depuis qu’elle est devenue une démocratie en 1994, pour The Economist, le pays est néanmoins aujourd'hui en train de reculer.
Il importe donc de dépasser la première image, séduisante, et d’examiner aussi l’envers du décor et, en premier lieu, de resituer l'Afrique du Sud à sa véritable place dans le cercle des émergents.
1. De loin, le plus petit des BRICS
a. Des performances économiques en fait modestes
Comme le montrent les tableaux et diagramme ci-dessous, comparée aux quatre géants que sont la Chine, le Brésil, la Russie et l’Inde, l'Afrique du Sud fait figure de nain, avec un PIB global quatre fois inférieur à celui de l’Inde.
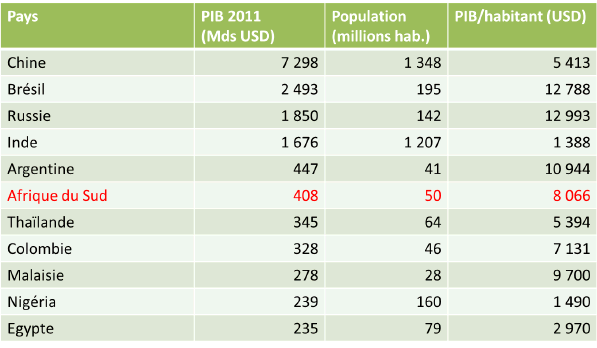
L’Afrique du Sud, première puissance économique du continent ; comparaisons internationales 124
Même si l'Afrique du Sud est indubitablement le poids lourd de l’économie africaine, sa place, reste encore relativement modeste à l’échelle mondiale. Sa position comme pays émergent doit aussi être relativisée, au regard de la progression de son PIB sur la dernière décennie, comparée aux quatre autres grands. Elle accuse une différence considérable avec ses partenaires.
Pour le dire plus crûment : l'Afrique du Sud peut-elle être considérée comme un émergent ? Comme on le verra dans les paragraphes suivants, son taux de croissance durable ne suffit pas à rendre son économie suffisamment créatrice d’emplois et de richesses, à pallier le manque d’infrastructures et à résoudre les problématiques qui pèsent sur son développement.
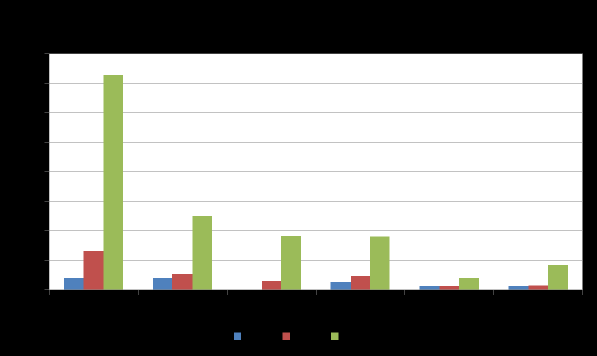
L'Afrique du Sud, une puissance qui reste régionale 125
Comme le montre le diagramme suivant, le taux de croissance moyen de l'Afrique du Sud est loin de figurer parmi les plus importants des pays africains. On a vu en effet plus haut 126 que leur taux moyen de croissance était compris entre 5 et 6 % depuis le début des années 2000, qu’il était même sur une tendance de 7 % avant la crise et que depuis 2009, les performances étaient nettement reparties à la hausse, mais de manière plus erratique qu’antérieurement.
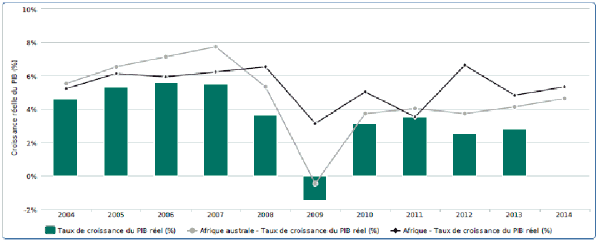
Taux de croissance du PIB réel 2013 127
On constate en revanche que la croissance moyenne de l'Afrique du Sud a toujours été inférieure à ces niveaux, et que depuis la récession de 2009, elle n’est pas sortie de la crise aussi bien que les autres pays du continent.
Pour remarquable que soit son classement mondial, par comparaison avec le rang qu’occupent les autres pays africains, la progression cumulée de son PIB sur l’ensemble de la décennie 2000-2010 place l'Afrique du Sud parmi les moins performants d’Afrique. Avec +109 % au cours de cette période, elle est loin derrière des pays comme le Tchad (+400 %), l’Angola (+560 %) et la Guinée équatoriale (+819 %). Seuls 14 pays du continent, sur les 53 que comptait alors l'Afrique 128 ont fait moins bien 129. Parmi les potentiels émergents anglophones, le Nigeria a progressé dans le même temps de +260 %, le Ghana de +220 %, l’Ouganda de +181 % 130. Certes, en 2000, l'Afrique du Sud était déjà la première puissance économique du continent et l’est restée sur la décennie, mais la meilleure dynamique n’est à l’évidence pas chez elle. Il faut en chercher les raisons dans un cumul de handicaps qui restent problématiques. Vos rapporteurs y reviendront.
Si l’on compare ensuite le taux de croissance de l'Afrique du Sud avec celui des autres BRICS, force est de constater que, à part la Russie qui peine à redémarrer après la crise, les trois autres ainsi que l’Indonésie, ont en revanche retrouvé, ou peu s’en faut, leur niveau de croissance antérieur. Non seulement les performances de l'Afrique du Sud sur la période précédant la crise étaient déjà nettement inférieures à celles des autres, mais sa reprise apparaît également beaucoup plus modeste.
Enfin, l'Afrique du Sud n’échappe évidemment pas au retour de la crise qui se manifeste aujourd'hui et touche simultanément les BRICS depuis quelques mois. Il se traduit notamment par une chute drastique de leurs monnaies : comme le titrait Le Monde cet été 131, depuis le 1er mai dernier, les devises des pays émergents sont toutes sévèrement orientées à la baisse par rapport au dollar, au point que la roupie indienne a perdu 20 % et a touché au début du mois de septembre son plus bas historique ; la roupie indonésienne, le real, le rouble ou la livre turque sont dans la même situation, tout comme le rand sud-africain qui avait perdu 13,5 % fin août.
Dans le même esprit, on notera aussi que la Banque centrale sud-africaine a récemment abaissé ses prévisions de croissance pour 2013 à 2 %, nettement en-deçà, des prévisions que les organisations internationales avaient formulées il y a quelques mois, comme le montrait le diagramme précédent 132. La raison en est la fuite massive de capitaux à laquelle les BRICS font face depuis que la FED américaine a annoncé qu’elle allait réduire ses injections de liquidités sur les marchés. Au-delà des effets collatéraux des décisions américaines, les analystes estiment surtout qu’il faut y voir un effet de la faiblesse des pays concernés qui « n’ont pas suffisamment profité des afflux de capitaux et de l’envolée des cours des matières premières de ces dernières années pour solidifier leurs économies. " La planète entière jalousait leur croissance folle, mais on découvre aujourd'hui qu’ils ont été plus cigale que fourmi. " »
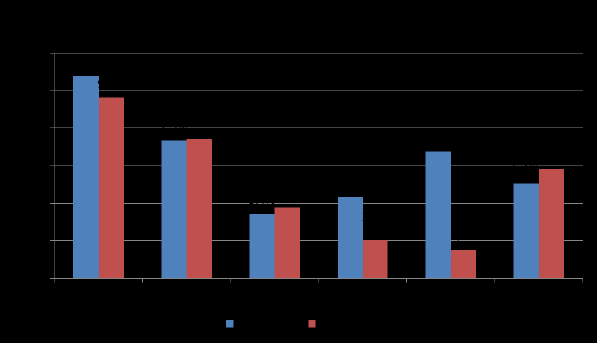
Un taux de croissance insuffisant pour s’affirmer durablement 133
Si l’on prend maintenant un autre critère de comparaison : les parts de marché à l’exportation, on note que celles de l'Afrique du Sud sont encore extrêmement réduites ; de tous les membres des BRICS, c’est le pays qui a, et de très loin, le moins de poids. On ne note surtout aucune évolution sur la longue durée. Alors que le Brésil et l’Inde grignotent peu à peu des parts de marché et présentent une courbe très légèrement positive, qui n’a certes rien à voir avec ce qu’ont réussi la Russie et surtout la Chine depuis une vingtaine d’années, celle de l’Afrique du Sud apparaît désespérément plate : la différence est spectaculaire et le diagramme ne montre aucun décollage de l'Afrique du Sud sur ce plan, fut-il timide. L'Afrique du Sud ne fait que se maintenir au même niveau : modeste.
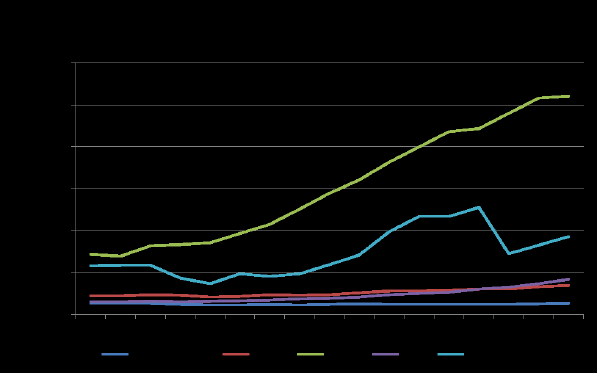
Afrique du Sud et autres émergents : comparaison des parts de marché à l’exportation 134
b. Sur le long terme, des tendances préoccupantes
Les comparaisons intra-africaines traduisent en outre un tassement de l'Afrique du Sud sur certaines rubriques.
Les graphiques ci-dessous montrent ainsi la nette et régulière érosion du pays par rapport à ses voisins d’Afrique australe. À mesure que d’autres décollent, l’Angola au premier chef, son poids dans le PIB global de la région est sans cesse plus modeste. Si, le PIB de l’Angola est passé de 6,27 % du total de celui de la région en 1991, à près de 17,5 % aujourd'hui, celui de l'Afrique du Sud, qui était équivalente à plus de 82 % du PIB régional, n’en est plus qu’aux deux-tiers aujourd'hui.
|
|
|
Poids de chaque pays de la région en % du PIB global de l'Afrique australe 135
Cette érosion du poids économique de l'Afrique du Sud qui semble inexorable se traduit d’autres manières encore. Ainsi en est-il de la part qu’elle occupe dans les exportations intra-africaines ; le graphique ci-dessous montre que, tant au sein de la SADC qu’en Afrique sub-saharienne, elle ne cesse de diminuer.
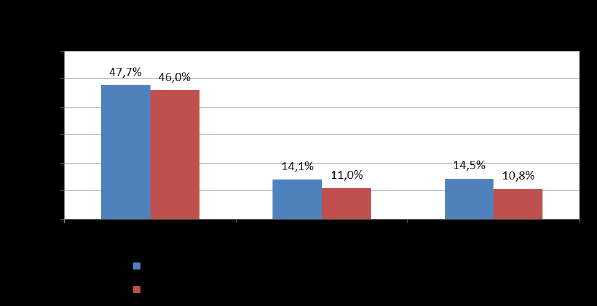
L’évolution des exportations de l'Afrique du Sud vers l'Afrique subsaharienne et la SADC 136
Cette évolution est d’autant plus notable lorsqu’on la compare au « boom » du Nigeria.
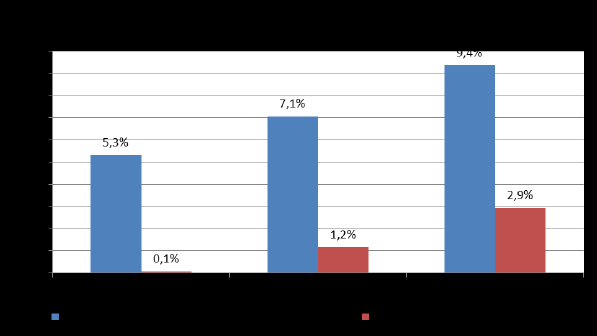 L’évolution des exportations du Nigeria vers l'Afrique subsaharienne et vers la SADC 137
L’évolution des exportations du Nigeria vers l'Afrique subsaharienne et vers la SADC 137
2. Les hypothèques sur l’avenir de l’Afrique du Sud
Comme le relevait le FMI il y a quelques mois 138, compte tenu de son poids économique, l'Afrique du Sud devrait être le moteur du continent. Pour autant, « après la crise financière mondiale, alors que la plus grande partie de l'Afrique a été relativement peu touchée et connaît une reprise de la croissance, les résultats de l'Afrique du Sud restent médiocres. » Ils ne sont pas seulement dûs à des facteurs exogènes mais à des difficultés et à des handicaps internes.
a. Des faiblesses majeures qui sont autant de véritables handicaps pour le pays
Les interlocuteurs de vos rapporteurs ont été nombreux à pointer systématiquement deux aspects à l’impact déterminant sur les mauvaises performances de l'Afrique du Sud.
La question du manque d’infrastructures, pour paradoxal que cela puisse paraître, compte tenu du niveau de développement et d’équipement du pays comparé au reste du continent, est le premier sujet de préoccupation.
Jean-Michel Debrat, par exemple, directeur de l’agence régionale de l'AFD 139, a pu ainsi confirmer le manque cruel d’infrastructures dont pâtit l’Afrique du Sud, qui se traduit en tout premier lieu par une insuffisante production d’énergie électrique, due à « l’insuffisance des investissements en nouvelles capacités de production et de difficultés temporaires de transmission » 140. Depuis 2007, cette situation est à l’origine de pénurie, et de délestages fréquents, incommodes pour les habitants et problématiques pour les secteurs de l’économie, industriels ou autres, « qui ont dû brusquement ralentir leur activité. La soudaineté du choc n’a pas donné aux entreprises le temps de s’adapter, et il est vite apparu qu’il aurait des effets durables. Une hausse des tarifs de l’électricité s’imposera pour financer de nouvelles capacités, et, jusqu’à leur installation, il sera difficile d’investir plus, notamment dans les activités à forte intensité énergétique comme les mines. » En ce sens, on retrouve, très directement, le grand intérêt de l'Afrique du Sud à s’être rapproché des BRICS, dans la mesure où, par exemple, les projets chinois des barrages d’Inga sur le fleuve Congo en RDC permettront à terme l’exportation d’électricité vers Pretoria.
Dans le même esprit, on relève aussi le sous-dimensionnement des ports sud-africains, handicapant pour l’exportation des matières premières, dans une conjoncture où les cours internationaux sont porteurs. Faute de pouvoir saisir les opportunités par manque d’infrastructures au niveau, l’Afrique du Sud ne profite pas autant qu’elle le pourrait de ses ressources. Le pays est aujourd'hui à une étape de son histoire économique où il lui faut changer de modèle énergétique. Au-delà de cette question, l'Afrique du Sud ne profite pas non plus autant qu’elle le pourrait de ses abondantes réserves en ressources naturelles, car faute d’investissements, l’industrie extractive opère en deçà de son potentiel. Pour combler rapidement le manque d’infrastructures, le gouvernement sud-africain, conscient des impératifs, a prévu l’an dernier d’investir quelque 71 Mds€ sur les trois prochaines années : le National Development Plan a récemment défini les orientations économiques du pays pour l’horizon 2030 et a en particulier prévu une hausse moyenne annuelle de 10,2 % des investissements en infrastructures d’ici à 2015/2016. Ces énormes montants suscitent des craintes en termes d’endettement public, même s’il reste soutenable à moyen terme. Pour revenir sur le secteur minier, on estime que la résolution des questions telles que les pénuries énergétiques, de main-d’œuvre qualifiée ou de manque d’infrastructures, amènerait une croissance annuelle de 3-4 % jusqu’à 2020 et à la création de 300 000 emplois.
Enfin, à la charnière de l’économique et du social, les inégalités territoriales importantes, comme le soulignait Laurent Fourchard 141, sont également l’un des facteurs qui peuvent avoir un impact négatif, dans la mesure où l’essentiel des activités économiques se développent autour de Pretoria et de Johannesburg et que la redistribution des richesses s’en voit inévitablement affectée.
Mais c’est la question de l’éducation qui semble être la faiblesse principale du système sud-africain et susciter les plus vives inquiétudes pour l’avenir. Vos rapporteurs avouent leur surprise d’avoir appris que, selon les données internationales, le système éducatif sud-africain est unanimement considéré comme l’un des pires qui soient.
Un bref retour en arrière n’est pas inutile pour rappeler que le système éducatif de l'Afrique du Sud est bien sûr hérité de celui mis en place sous l’apartheid, la « Bantu Education », qui n’avait évidemment pas pour premier souci de donner aux Noirs la meilleure des formations. Près de vingt ans après, la situation ne s’est pas améliorée, même si, comme l’indiquaient les diplomates de l’ambassade de l’Afrique du Sud à Paris 142, il n’y a plus de restriction à l’accès à l’éducation, à laquelle le gouvernement consacre un budget très important, équivalent à quelque 24 Mds$ en 2012 143. Ils conviennent toutefois sans difficulté que, malgré les efforts, c’est la qualité de l’enseignement qui pose problème, précisant que les professeurs, partout en nombre suffisant, ne possèdent pas de formation technique ; ils sont généralement très peu qualifiés et, leur métier n’est considéré que comme une simple opportunité d’emploi. Pour redresser la situation, les autorités sud-africaines travaillent dans deux perspectives : l’amélioration de l’éducation générale, d’une part, et de l’enseignement de compétences spécifiques, d’autre part. Pour ce faire, les instituts de formation technique ont été fusionnés avec les universités afin d’en améliorer la qualité tout en cherchant à augmenter l’enseignement de compétences spécifiques pour mieux répondre aux besoins de l’économie sud-africaine. Les autorités cherchent également à améliorer la qualité et les standards de l’examen d’entrée à l’université et à réduire les inégalités entre les universités « blanches » et les autres, enjeu important s’il en est. En d'autres termes, l’éducation sud-africaine doit être améliorée tant à la base qu’au sommet.
Le jugement commun est sans appel et les avis sont unanimes, qu’ils proviennent des observateurs, des politiques, des experts internationaux ou des entreprises : l'Afrique du Sud se situe dans les tréfonds des classements mondiaux en matière d’éducation ; selon certains, elle serait même à l’avant-dernier rang, derrière le Yémen ! Les performances du Zimbabwe, dont on connaît partout les difficultés depuis de nombreuses années, sont jugées incomparablement supérieures à celles de l'Afrique du Sud, au point que dans un certain nombre de secteurs de l’économie, telle la finance, ce sont surtout des immigrés zimbabwéens qui occupent les postes de spécialistes. Dans le même esprit, les médecins congolais ou nigérians, sont légions pour pallier l’insuffisance de ceux formés sur place, alors même que l'Afrique du Sud entend réduire l’immigration. La situation est comparable dans l’administration publique : la faible qualité du corps diplomatique sud-africain est légendaire ; les représentants du think tank MISTRA n’ont d’ailleurs pas hésité à reconnaître devant vos rapporteurs que leur manque de professionnalisme posait problème, dans la mesure où ils sont recrutés aux deux-tiers sur critères politiques, le reste de l’administration publique étant dans la même situation de faible qualification.
Dans une étude récente 144, l'OCDE mettait « en évidence plusieurs obstacles à l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, notamment le manque d’investissement dans les infrastructures scolaires et les matériels pédagogiques dans les zones défavorisées, des capacités administratives inégales au niveau local, une mauvaise qualité des enseignants et un enseignement médiocre de l’anglais aux élèves africains noirs. Il est recommandé de prendre des mesures audacieuses pour doter les écoles de davantage de ressources matérielles, d’une équipe de direction plus compétente et d’un corps enseignant responsable.»
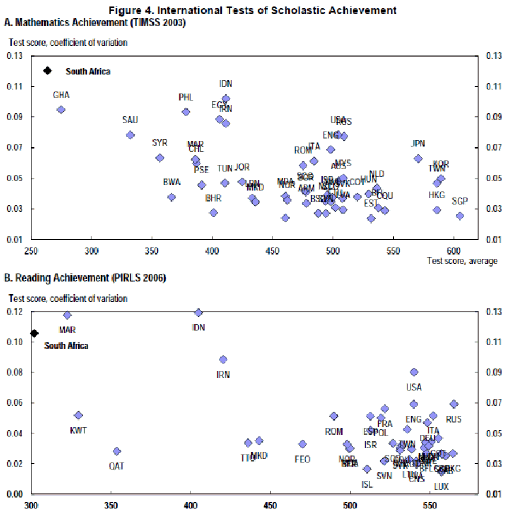
Les mauvaises performances en mathématiques et lecture du système scolaire sud-africain 145
Elle indiquait par exemple que, pour ce qui concerne la lecture et les mathématiques, l'Afrique du Sud présente les pires scores internationaux ; le système combine à la fois une mauvaise qualité et une forte inégalité, comme les diagrammes reproduis ci-dessus le mettent en évidence. 146
D’autres observateurs pointent aussi le fort poids des syndicats d’enseignants, qui ont joué un rôle majeur sous l’apartheid. La légitimité historique dont ils jouissent rend les négociations très difficiles.
La gravité de la situation est telle qu’une personnalité aussi respectée que Mamphela Ramphele pouvait dresser un constat sans appel et déclarer il y a peu que « l’effondrement alarmant de l’éducation représente un grave danger pour notre économie. Nous avons hérité d’un système dysfonctionnel et nous l’avons aggravé. » 147 Les dirigeants d’entreprises françaises 148 partagent cette préoccupation : des actions de formation professionnelle leur sont désormais fréquemment demandées et incluses dans les appels d’offres auxquels ils répondent. Quant aux journalistes rencontrés à Pretoria, ils sont unanimes pour exprimer les plus vives inquiétudes, parlant de « drame », de « handicap ». Ils ne comprennent pas pourquoi le régime n’a pas été capable de relever le défi de la lutte contre l’ignorance où l’apartheid avait tenu les Noirs. Le prix politique de cet échec risque d’être élevé, sachant que près de la moitié de la population n’a pas connue l’apartheid, et qu’elle ne peut en avoir qu’une connaissance historique et non vécue.
b. L’acuité des problématiques sociales et politiques : le rêve en panne de la nation « Arc-en-ciel » 149
Le drame de Marikana a mis brutalement en lumière la violence des tensions sociales qui agitent la société sud-africaine.
Le 16 août 2012, 34 ouvriers des mines de platine, près de Johannesburg, ont été abattus par la police. Dix autres personnes avaient été tuées dans les jours précédents, depuis qu’une grève sauvage des mineurs avait éclaté sur des revendications salariales, ignorées par les syndicats et la direction de l’entreprise. Comme le soulignait récemment Le Monde diplomatique 150, l’onde de choc a été comparable au massacre de Sharpeville du 21 mars 1960. La différence, c’est que ce sont désormais les forces d’un État démocratique et multiracial, dirigé depuis près de 20 ans par l'ANC, qui ont tiré sur des travailleurs qui constituent sa base électorale historique. « L’écrasante majorité noire et démunie de l'Afrique du Sud » est aujourd'hui sans illusion et lasse d’attendre en vain des lendemains meilleurs, sachant que le surgissement de la question sociale n’est pas récent. Laurent Fourchard 151 rappelait à vos rapporteurs que des mouvements sectoriels ont commencé à émerger à la fin des années 1990, notamment dans les secteurs des services publics et touristiques, et principalement dans les quartiers noirs.
Et de fait, « loin d’être un incident isolé, Marikana a été précédé par une montée lente, mais sûre, de l’agitation sociale. Depuis le début des années 2000, pas une semaine ne se passe en Afrique du Sud sans émeute contre les autorités locales ou gouvernementales, sur des questions de service delivery – accès aux services publics de base, eau, électricité, éducation, logement, etc. » 152
À ce sujet, les représentants de MISTRA, malgré leur proximité avec le pouvoir, ont dû convenir devant vos rapporteurs que le drame de Marikana n’était évidemment pas un hasard : que la question de la redéfinition des relations de pouvoirs dans divers secteurs était posée et que rien n’avait changé sur ce plan depuis des décennies ; que les problèmes de salaires ouvriers n’étaient pas résolus, dans des contextes de rapports de forces, de dénuement social, de non-droit, de divorce entre des syndicats captés par le patronat, en opposition avec la masse des travailleurs sans médiation. Outre Marikana, l’année 2012 a été particulièrement marquée par les grèves qui ont concerné plus de 100 000 employés, tous secteurs confondus, notamment dans les transports routiers, l’automobile ou l’industrie manufacturière et la fonction publique. En conséquence, ce n’était pas seulement des questions du registre de l’économique et du social qui étaient posées au sein des entreprises, mais un problème beaucoup plus large et profond de gouvernement de la société, aux incidences sur la démocratie sud-africaine elle-même.
Depuis août 2012, les choses ne se sont pas arrangées : des grèves sauvages continuent d’éclater dans les mines, les transports, l’agriculture, pour des revendications qui exigent le doublement ou le triplement de salaires de misère, auxquelles il est répondu par des licenciements de grévistes, des affrontements avec les forces de l’ordre, sans le moindre dialogue social. En ce sens, l’alliance gouvernementale tripartite entre l'ANC, la centrale syndicale COSATU, - au rôle évidemment ambigu -, et le parti communiste, n’aide pas. L’opposition interne au président Zuma dénonce ainsi la collusion entre le pouvoir, la bourgeoisie noire, les syndicats et le grand capital sur le dos des plus modestes, traités de la manière la plus inéquitable. Accusation récurrente de Mgr Desmond Tutu qui dénonce régulièrement le déclin moral d’une Afrique du Sud dans laquelle la corruption s’est généralisée 153, les inégalités se sont dangereusement accrues entre une élite noire enrichie et les quelque 20 à 25 millions de pauvres, où le chômage touche aujourd'hui plus du quart de la population active contre 21 % il y a cinq ans 154, la moitié des jeunes étant sans emploi, où les revenus moyens des Blancs sont six fois supérieurs à ceux des Noirs. On estime qu’il faudrait attendre 2021 pour que le salaire moyen d’un Noir atteigne le niveau de celui d’un Blanc 155. En 2012 le salaire médian des Noirs était inférieur à 2200 rands, celui des Métis à 2600 rands, cependant que celui des Indiens était de 6000 rands et celui des Blancs de 9500 rands. Seuls 8 % de la population gagnent plus de 20 000 rands.
La société la plus inégalitaire du monde, plus encore qu’à la fin de l’apartheid, est aussi l’une des plus violentes. Les conflits sociaux ne sont pas les seuls à faire de nombreuses victimes : l’Afrique du Sud comptabilise trente fois plus de meurtres par habitant que la France, soit 15 000 meurtres en 2011-2012, plus de 16 000 de mi-2012 à mi 2013, et autant de tentatives. Rapportées à la population, ces données représentent plus de 31 meurtres pour 100 000 habitants. Ces chiffres situent l'Afrique du Sud parmi les pays les plus violents : à titre de comparaison, il y a par exemple plus d’homicides en Afrique du Sud qu’en Russie, malgré une population près de trois fois inférieure 156. Plus généralement, les enquêtes sociales montrent une banalisation de la violence, que ce soit dans les manifestations de rue, qui dégénèrent fréquemment en pillages ou destructions ou dans la vie civile : entre un quart et un tiers des hommes déclarent avoir déjà commis un viol.
Sur un autre terrain, The Economist estimait que Jacob Zuma avait été incapable de juguler le fléau de la corruption et que, sous son égide, l’État de droit avait reculé, l'ANC cherchant à saper l’indépendance de la justice, de la presse, sujet sur lequel les journalistes rencontrés par vos rapporteurs ont également exprimé leurs inquiétudes. Ainsi en 2012, le gouvernement a-t-il déposé un projet de loi criminalisant les journalistes enquêtant sur la corruption. Dans la mesure où l’actionnariat de la presse est encore blanc, l'ANC n’ayant pas réussi à créer une presse de qualité, le bras de fer ancestral se joue aussi sur ce terrain.
Ce tableau est évidemment préoccupant pour les perspectives de l'Afrique du Sud, tant économiques que politiques.
L’économie est déjà clairement affectée : ainsi de la balance commerciale qui a souffert en 2012 de la situation dans les mines, traduisant un ralentissement des exportations 157, cependant que les importations continuent d’augmenter. Le défi du chômage, de la pauvreté et des inégalités extrêmes, dans le contexte actuel du tassement de la croissance, peut difficilement laisser augurer de changements considérables à court terme. En fait, le Black Empowerment n’a pas bénéficié au plus grand nombre, ni changé fondamentalement les choses, au vu de la situation sociale qui prévaut encore. Comme le disait l’ambassadeur de l’Union européenne, l'Afrique du Sud est face à un défi majeur sur les vingt ans à venir : celui de la question économique, sociale et politique. En parallèle, selon Le Monde 158, les tensions sociales et les revendications salariales surtout, font d'ores et déjà craindre des effets sur l’attractivité du pays, même si la faiblesse du rand préserve encore la compétitivité du pays. La question peut se poser de savoir qui, de l'Afrique du Sud, du Kenya ou du Nigeria, dispose des meilleurs atouts pour continuer sur la voie de l’émergence ?
Le constat actuel montre que l'Afrique du Sud n’a pas encore réussi à surmonter tous les handicaps dont elle a hérité de l’apartheid. Il y a quelques temps, l’écrivain André Brink, reconnaissant que des progrès majeurs avaient été accomplis, estimait par exemple qu’il y avait « toujours beaucoup de racisme dans les profondeurs, sous la surface de notre société » et que la possibilité d’une escalade était toujours présente 159, avant de regretter la présidence de Nelson Mandela : « Si Mandela avait pu rester cinq ans de plus au pouvoir, nous n’aurions pas eu tous ces problèmes ».
Évidemment, il ne s’agit pas de soutenir ici que rien n’a changé depuis 1994 en Afrique du Sud. Il faut au contraire souligner que des progrès importants ont été réalisés : l’accès à l’électricité s’est amélioré (huit ménages sur dix) ; le taux de couverture sociale également, qui permet à plus de 15 millions de Sud-africains de recevoir des prestations ; le taux de scolarisation s’est aussi étendu, grâce à la gratuité qui bénéficie à 8 millions d’enfants dans plus de 20 000 établissements. Plus profondément, l’extrême pauvreté a diminué, la proportion de personnes vivant avec moins de 1$ par jour est ainsi passée de 11,5 % à 5%, tandis que 30 % vivent avec moins de 2$. Mais, comme un certain nombre de leurs interlocuteurs ont pu le souligner à vos rapporteurs 160, la participation des Noirs sur le plan économique n’a pas fait de progrès et leur émancipation reste à faire. Indépendamment de la faible qualité de l’enseignement dispensé, le taux de scolarisation chute considérablement dès le secondaire, cependant que le système de santé se révèle fort inégal en qualité et que 20 % des salariés se partagent 75 % des revenus.
Au terme de ce survol des faiblesses de l'Afrique du Sud, vos rapporteurs sont tentés de partager le constat attristé de The Economist : l’impression domine que, quelle que soit l’ampleur des défis qui attendaient l'ANC au sortir de l’apartheid, des occasions ont été manquées, même si les progrès sont réels. Néanmoins, certains observateurs 161 s’interrogent sur le futur possible du pays : vers un modèle brésilien, avec des handicaps, telles la criminalité et les inégalités notamment, mais qui n’empêchent pas l’émergence ? Vers un modèle algérien, avec un mouvement de libération nationale qui a évolué vers un parti-État qui ne lâche pas les rênes du pouvoir et doit affronter de graves problèmes sociaux ? En ce sens, les prochaines échéances électorales, en 2014, seront cruciales. Dans le contexte difficile de l'Afrique du Sud, l'ANC perd des voix, sa base s’effrite, et des personnalités historiques importantes, telle Mamphela Ramphele, lancent leur propre formation, cependant que l’opposition libérale de l’Alliance démocratique enregistre des progrès importants ; elle s’est d’ailleurs fixée un objectif de 30 % des voix au niveau national pour les prochaines élections du printemps prochain, qui devraient toutefois voir le Président Jacob Zuma réélu pour un nouveau mandat de cinq ans.
II. FORCES ET FAIBLESSES DES PRÉTENDANTS À L’ÉMERGENCE
Après cette présentation détaillée de l'Afrique du Sud, vos rapporteurs vous proposent une « lecture transversale », plus rapide, de la situation des autres pays que l’on peut considérer comme prétendant à la catégorie d’émergents africains anglophones, en centrant leur propos sur leurs traits les plus caractéristiques, qu’il s’agisse de leurs atouts ou de leurs faiblesses. Sans omettre quelques incursions rapides du côté du Ghana ou de la Tanzanie, ce regard privilégiera néanmoins deux pays : le Nigeria et le Kenya.
A. DES HANDICAPS NOMBREUX QUI N’EMPÊCHENT CEPENDANT PAS D’AVANCER
Alors que leur histoire passée et récente est marquée par la violence et les conflits, le Nigeria et le Kenya paraissent digérer leurs traumatismes. Leurs handicaps importants ne se révèlent finalement pas déterminants comme le prouve la vitalité impressionnante du Nigeria.
1. Le Nigeria, pays de tous les déséquilibres, et pourtant…
S’il est un pays africain qui cumule un nombre tel de problèmes que l’on pourrait s’interroger sur sa viabilité même, c’est bien le Nigeria, pays de toutes les fractures.
a. Une société fortement clivée, minée par l’insécurité et la violence
La première des fractures est territoriale et démographique. Pour résumer les propos des divers observateurs que vos rapporteurs ont longuement rencontrés 162, la plus importante des interrogations sur le Nigeria porte sur ces déséquilibres-là.
Ce pays immense 163 est surtout, et de très loin, le plus peuplé d’Afrique : un Africain sur six est nigérian. Officiellement, le Nigeria a aujourd'hui quelque 172 millions d’habitants, il en compte sans doute plus, on prévoit 200 millions en 2025 et 400 millions à l’horizon 2050. À cette date, de septième pays le plus peuplé au monde, le Nigeria sera passé au troisième rang, derrière l’Inde et la Chine. Il est d'ores et déjà l’un de ceux dont la densité est la plus élevée. 164
Le site officiel du gouvernement d’Abuja indique qu’en 2002, la population était estimée à 130 millions de personnes. C’est dire la rapidité foudroyante de la croissance démographique, supérieure à 3 % par an. Chaque femme nigériane donne naissance en moyenne à six enfants 165, bien que ce taux soit inférieur chez celles qui sont plus éduquées. On ne s’étonnera pas que près de la moitié de la population ait moins de quinze ans, et les deux-tiers moins de 25 ans. En d'autres termes, ces premières données situent le Nigeria comme plus proche des pays sahéliens que des émergents : du Niger voisin, par exemple, qui détient le record mondial de fécondité, avec 7,2 enfants par femme. Au demeurant, les États du Nord de la fédération sont des zones semi-désertiques et peu peuplées, essentiellement de nomades, au fonctionnement tribal, dans lesquelles se retrouvent des indicateurs socio-économiques parmi les pires d’Afrique (80 millions d’habitants dont 30 millions dans l’extrême Nord du pays). Si certaines villes sont encore très reculées, comme Katsina, proche de la frontière nigérienne, d’autres, au Sud, sont définitivement mondialisées, telle Lagos, sur la côte, laquelle, avec ses 25 millions d’habitants, est la plus peuplées des métropoles africaines et se compare aux plus grandes villes chinoises.
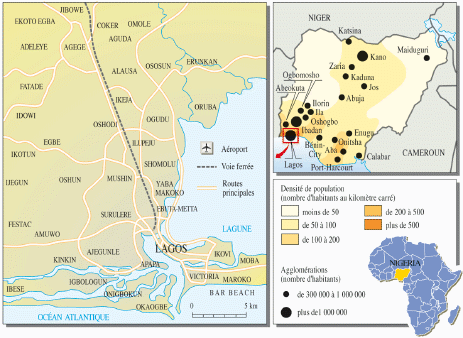
Les densités de populations au Nigeria 166
Le Nigéria doit en outre faire vivre ensemble des ethnies très différentes, ce qui n’est pas le moindre de ses défis, dans la mesure où les tensions communautaires sont chroniques et violentes, alimentées autant par les inégalités que par la montée des fondamentalismes religieux. État fédéral, composé de 36 États fédérés, auxquels s’ajoute le district de la capitale fédérale, Abuja, le Nigeria doit surmonter divers déséquilibres majeurs qui sont autant de forces centrifuges qui jouent contre l’unité du pays.
Sans présenter la situation de manière trop schématique, le Nigeria apparaît tout d'abord comme un pays dans lequel le Nord, pauvre et en déclin économique, au peuplement majoritairement musulman, est face au Sud, majoritairement chrétien, d’où provient la richesse du pays. Vos rapporteurs reviendront sur la question du pétrole, mais la carte ci-dessous est utile pour illustrer la réalité évidente de ce déséquilibre qui appellerait des politiques publiques redistributives de la richesse. Cela étant, pour Jean-Bernard Véron 167, cette ligne de fracture Nord-Sud qui se superpose à d’autres, s’explique parce que le Nigeria est une création plus ou moins artificielle du Royaume-Uni dans laquelle se sont retrouvées trois zones, le Nord, l’Ouest et le Delta, qui n’avaient pas de véritables raisons de cohabiter. La question religieuse, indéniable, masque aisément d’autres problématiques et enjeux, fonciers, économiques, politiques.

Ethnies au Nigeria et répartition géographiques des ressources pétrolières 168
De fait, les violences sont récurrentes et meurtrières, les antagonismes profonds : les grands groupes ethniques qui se partagent le territoire nigérian - les Haussa Foulani, les Ibos et les Yorubas, pour l’essentiel - se disputent le pouvoir politique et économique, sur fond de nationalisme parfois exacerbé, qui peut déboucher sur des pogroms, voire pire dans le passé, comme la guerre du Biafra dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisées ; les nombreux affrontements ethnico-religieux de ces dernières années sont là pour le prouver. Des violences de cette nature avaient précédemment eu lieu dans les années 1980 et 1990, à Kano, notamment, deuxième ville du pays, proche de la frontière Nord. Récemment, à la fin de l’année 2011, ils ont pris un tour nettement plus aigu, lorsque des attentats-suicides contre des quartiers chrétiens ont été commis à Damaturu dans le Nord-Est du pays, tuant quelque 150 personnes ou lorsque des églises catholiques, comme celle de Madalla, près d'Abuja, ont été prises pour cibles le 25 décembre, au moment des messes de Noël. La violence terroriste anti-chrétienne a ensuite continué, contre les écoles, les quartiers d’habitations. Au début janvier 2012, Boko Haram, appelait les millions de chrétiens à quitter les États du Nord dans un délai de trois jours. 169 En retour, ceux-ci, craignant un nettoyage ethnique et religieux, se préparaient logiquement à se défendre. La situation était telle que l’éditorial du journal Le Monde du 10 janvier titrait : « le Nigeria et la menace d’une guerre civile ». De fait, comme le rappelait peu après Marc-Antoine Pérouse de Montclos 170, le président nigérian lui-même avait estimé la situation « pire que lors des pogroms de 1966 qui avaient fait plus de 40 000 morts et précipité vers le Sud près de 2 millions de réfugiés de l’intérieur, essentiellement des chrétiens et des Ibos. À l’époque, ces événements avaient entraîné la création de la république sécessionniste du Biafra et une des guerres les plus meurtrières qu’ai jamais connues l’Afrique (…) ». Pour autant, selon l’auteur, le catastrophisme n’était pas de mise cette fois-ci et l’analyse détaillée de nombreux facteurs permettait de relativiser les inquiétudes qu’un regard trop superficiel pouvait faire craindre. Malgré les apparences, le pays a connu des épisodes plus dramatiques et, d’une manière générale, il est même sur une tendance à la diminution de la mortalité violente.
Pour terrible qu’elle soit, la situation actuelle est bien plus le fait de la violence aveugle de groupes terroristes, Boko Haram notamment, que de réelles et profondes tensions interethniques : ainsi, ce n’est pas sur une base confessionnelle que les déplacements de populations se produisent aujourd'hui, mais pour échapper à la brutalité de la secte qui fait l’objet d’une très forte réprobation dans la population. Par dizaines de milliers, et non par millions comme autrefois, chrétiens et musulmans, (des mosquées ont aussi été visées par les attaques), fuient ensemble les zones de combats opposant Boko Haram aux éléments de la « Joint Task Force », c'est-à-dire les forces de l’ordre fédérales militarisées, dont la répression, malgré sa brutalité, n’a toujours pas réussi à frapper la secte au cœur 171.
Politiquement, les mêmes divisions se retrouvent, qui recoupent ces aspects : la fracture au sein de la classe politique reflète la fracture Nord-Sud. Cela explique entre autres les retards du pays au plan des infrastructures, dans la mesure où la question de la redistribution de la rente pétrolière, que le Sud ne veut pas partager avec le Nord, s’avère difficile, pour ne pas dire impossible à régler, l’affrontement des gouverneurs avec le pouvoir central étant une donnée permanente. Inspiré du fédéralisme américain, le régime nigérian est en fait un système dans lequel le pouvoir central s’est progressivement affaibli face aux gouverneurs de plus en plus nombreux : de trois États au sortir de l’indépendance, le Nigeria est peu à peu passé à 36 aujourd'hui, qui sont autant de féodalités dans lesquelles les critères géographiques, ethniques 172, pèsent d’un poids considérable dans les prises de décision. En outre, au Nigeria comme ailleurs, les structures traditionnelles de pouvoir perdurent, avec lesquelles les autorités publiques doivent aussi compter. On comprend, dans ces conditions, qu’il soit difficile, selon certains experts, de parler dans ce pays d'État de droit, au sens moderne, et que certaines lois, telle celle qui prévoyait une dévolution de 10 % de la rente pétrolière aux ethnies vivant sur les terres de production, ne soit toujours pas appliquée.
b. Des déséquilibres internes très profonds
Cette violence terroriste extrémiste, mâtinée de logique fondamentaliste, s’alimente à de multiples sources dont les effets se combinent : à commencer par la désespérance sociale dont Boko Haram se nourrit dans les États du Nord où le groupe mène l’essentiel de ses activités 173 : c’est en effet dans les régions de Sokoto au Nord, de Borno au Nord-Est, que les problèmes de pauvreté et de sous-développement sont les plus sévères. Cela est d’autant plus vrai que, en parallèle, un autre terrorisme, celui du Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger, le MEND, frappe le Sud du pays avec un fanatisme semblable, sur fond d’appartenance tribale et d’animisme, également alimenté au sous-développement et à la mauvaise répartition des richesses. Le sous-développement du Nigeria et les déséquilibres dans la mauvaise redistribution, notamment des recettes tirées de l’exploitation du pétrole, sont des éléments clefs pour comprendre ce que de tels phénomènes révèlent.
Avec le Nord, le Delta est un autre point de frictions qui se nourrissent tout à la fois du manque de retombées économiques concrètes de l’exploitation du pétrole, et des problèmes environnementaux dramatiques qui s’y greffent ; la pollution condamne non seulement un écosystème fragile de mangroves, de marais et de forêts humides, mais aussi les peuples de la région qui vivent de la pêche et de l’agriculture. Or, pour l’essentiel, cette pollution n’est pas due aux pratiques de l’industrie pétrolière, même si l’état du réseau, faute d’entretien, est à l’origine de fuites et de pertes considérables 174, mais au « bunkering », qui consiste à siphonner les tuyaux pour revendre le pétrole ainsi récupéré sur les marchés locaux et internationaux. Comme on le verra plus loin, les pertes sont considérables. La contamination des sols qui y est liée est dramatique et s’ajoute à celle, également catastrophique, causée par l’exploration et le « torchage » du gaz. Mais c’est aussi une pratique contre laquelle il est difficile de lutter parce qu’il n’y a pas de volonté politique d’y mettre fin ; elle permet en effet au pouvoir central de conserver le soutien des militaires, souvent impliqués dans ce trafic. D’autre part, elle sert aussi à acheter la paix sociale au Sud en compensant les effets de la péréquation des revenus pétroliers au profit des États du Nord, en accentuant le principe de dérivation qui permet, officiellement, aux États producteurs de conserver une partie de leurs recettes.
L’insécurité dans la zone du delta du Niger prend diverses formes : des multiples prises d’otages au vol de pétrole à grande échelle, en passant par d’autres actes de sabotage contre les installations pétrolières. Aux revendications des communautés locales, qui exigent une meilleure part des richesses issues de leur sous-sol, s’ajoute la montée en puissance de groupes criminels. La piraterie règne dans la région du Golfe de Guinée depuis maintenant une décennie, et elle dispose de moyens tels que l’insécurité est autant à l’intérieur que près des côtes. Certains groupes criminels disposent de logistique leur permettant de démontrer leur capacité à opérer tant à l’étranger qu’à plus de 100 kilomètres au large. En février dernier, un pétrolier français, le Gascogne, a ainsi été attaqué et arraisonné par des pirates au large d’Abidjan et a vu son chargement siphonné dans l’État de Warri, au Sud-Est du Nigeria, dans la zone du delta, à 1100 km ! 175 Une telle opération illustre certaines des faiblesses qui touchent le Nigeria, toujours sur la liste grise du GAFI, telles la corruption politique, l’impunité généralisée, le clientélisme et la collusion des intérêts mafieux. Le piratage d’un pétrolier n’est évidemment possible que moyennant de multiples complicités, à tous les niveaux des appareils politiques et institutionnels, forces armées, douanes, autorités portuaires, etc. Elle confirme ainsi l’implication de tous les acteurs et l’intrication de l’ensemble des problématiques, locales et régionales, qu’elles soient de sous-développement ou de sécurité. Par exemple, les probabilités sont fortes que l’armement de Boko Haram ait été facilité par des officiers corrompus. 176
À cet égard, les avis des experts rencontrés sont unanimes : le Nigeria est l’un des pays les plus corrompus au monde. L’indice de perception de la corruption établi par Transparency International le confirme amplement, qui classe cette année le Nigeria à la 139e position dans sa liste, sur 176 pays, en recul de cinq places par rapport au classement antérieur 177. Le rapport du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest, GIABA, qui regroupe seize pays de la région, pouvait ainsi déclarer à l’issue de sa première revue des pairs « le Nigeria avait été considéré comme l’un des pays les plus corrompus du monde. Au Nigeria, la corruption qui est très répandue constitue un grave danger et se trouve à la base de la plupart des cas de blanchiment d’argent signalés ces derniers temps. Au cours de ces trois dernières années, plusieurs de ces anciens Gouverneurs et de Leaders politiques accusés d’avoir détourné des fonds publics estimés à plus de 250 milliards de dollars US, ont été arrêtés et traduits en justice. On présume que la majeure partie de ces fonds est dissimulée dans des banques occidentales et des centres situés à l’étranger, tandis que des sommes importantes ont été blanchies par l’acquisition de biens, de voitures de luxe et l’achat d’actions de grande valeur dans des sociétés de valeurs mobilières. » Et ce, alors même que « le Nigeria a démontré son engagement en ce qui concerne les problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le pays comme au niveau de la région. Il possède le cadre juridique le plus élaboré de la région pour la lutte contre la corruption et les crimes économiques et financiers. (…) » 178 De l’avis général, les institutions nationales de lutte contre la corruption n’ont la confiance de personne. Les autres institutions sont dans le même état d’inefficacité et l’inapplication de la loi est commune, notamment en matière de droits de l’homme et de protection des victimes.
En d'autres termes, le processus de démocratisation, sous quelque aspect que ce soit, apparaît singulièrement ardu au Nigeria. Depuis son indépendance du Royaume-Uni, en 1960, le pays a connu dix coups d’Etat et trente ans de régimes militaires, auxquels l’élection d’Olusegun Obasanjo à la présidence de la République, en février 1999, a mis fin. Trois républiques se sont succédées, avec les constitutions de 1960, 1963 et 1979 jusqu’à la promulgation de celle du 5 mai 1999, toujours en vigueur aujourd'hui. On ne compte plus les élections entachées de fraudes et de violences meurtrières, à l’exception peut-être, de celle de Goodluck Jonathan, réélu en avril 2011 après avoir succédé au président Yar’Adua, décédé en cours de mandat. Pour autant, elle n’a pas été exempte de violences, loin de là, notamment dans le Nord, après la défaite du général Buhari, musulman originaire de cette région. Le système politique est évidemment affecté par ces multiples clivages ethniques, religieux et de classe. Le Nigéria est un pays qui fonctionne mal, depuis très longtemps 179, sans pour autant devoir être considéré comme failli.
Cela étant, malgré sa fragilité, les principaux experts ne doutent pas que le Nigeria est viable. En ce sens, Marc-Antoine Pérouse de Montclos exclut tout risque d’implosion, pour plusieurs raisons : l’organisation politique fédérale du pays rend difficile les tentatives de sécession, après l’échec de celle du Biafra il y a plus de quarante ans, qui n’a pas été oubliée. Ainsi, les Ijaws, au Sud, très minoritaires, savent n’avoir aucune chance de voir une telle revendication aboutir. Les États fédérés sont devenus très interdépendants sur le plan économique, alors qu’au début des années 1960, les échanges internes étaient quasi nuls, chacun commerçant essentiellement avec l’ancien colonisateur. Aujourd'hui, quelles que soient les réticences des États du Sud, une part de la redistribution va vers les États du Nord. Quels que soient les clivages religieux ou ethniques dont la radicalisation récente n’est pas fondamentalement alimentée par des motivations sécessionnistes, les intérêts du Nord et du Sud sont aujourd'hui communs. « Les milieux d'affaires jouent un rôle très structurant dans l'organisation du pouvoir politique, et l'interdépendance économique croissante entre les États de la fédération sont les meilleures garanties contre le risque de partition. » 180
Ces quelques données montrent l’ampleur des enjeux et des défis immédiats auxquels le pays est confronté. En d'autres termes, on aurait pu rêver forces centrifuges moins nombreuses ! Malgré ce chaos politique, le Nigeria résiste à l’éclatement.
2. Les traumatismes du Kenya, réellement surmontés ?
a. Une remarquable sortie de crise politique
Dans une Afrique qui a du mal à se défaire de ses maux, encore marquée par ses traumatismes, par une violence récurrente et le sous-développement, le Kenya fait plutôt figure d’heureuse surprise, même si l’on ne saurait oublier que Nairobi est une ville dont le taux de criminalité, croissant, la classe aujourd'hui parmi les plus dangereuses du monde. Après plus de deux décennies de présidence autocratique de Daniel arap Moi, considérées comme désastreuses 181, le pays s’était particulièrement bien redressé, tant au plan politique qu’économique, au point d’être considéré à son tour sur la voie de la démocratie et de l’émergence économique, malgré sa fragilité. Rappelons que l’élection présidentielle de 2007, entachée de fraudes, avait débouché sur un violent mouvement de contestation aussitôt après la proclamation des résultats par la commission électorale ; la répression policière brutale et les affrontements interethniques entre milices qui avaient suivi s’étaient soldés par des massacres, faisant au total quelque 1500 tués, des dizaines de milliers de blessés et plusieurs centaines de milliers de déplacés. Si chacun craignait la répétition de cette spirale de la violence aux dernières élections présidentielles de 2013, fort heureusement le scénario du pire a été évité, à la grande surprise des observateurs et des chercheurs, tels ceux de l’IFRA, basé à Nairobi, que vos rapporteurs ont rencontrés.
L’élection du ticket présidentiel Uhuru Kenyatta/William Ruto, en mars dernier, face à celui conduit par Raila Odinga, Premier ministre sortant, ne s’est accompagnée d’aucune violence : aucune agitation au plan régional, des universités calmes, des milices qui ne se sont pas reconstituées et aucun dérapage ne s’est produit durant la campagne, non plus qu’aucun débordement des vainqueurs au lendemain du scrutin, les vaincus appelant à l’apaisement, même s’ils formaient un recours devant la Cour suprême motivé par diverses irrégularités et incidents techniques 182. Preuve sans doute que la mission de réconciliation nationale, menée par la communauté internationale sous l’égide de Kofi Annan, en 2008, a été un succès, en ce qu’elle a apaisé très rapidement les tensions sur le terrain. Mais il faut aussi, voir les effets des cinq années de cohabitation, - expérience unique dans l’histoire du continent, entre le président Mwaï Kibaki et le Premier ministre Raila Odinga. Ils ont permis au pays de repartir sur des bases assainies. Lors de son audition devant notre commission des affaires étrangères 183, Raila Odinga avait jugé cette cohabitation très difficile, mais souligné également l’ampleur des réformes sur lesquelles ils avaient réussi à s’accorder avec le Président de la République et à mettre en chantier : réformes constitutionnelle, agraire, électorale, territoriale ; réformes des appareils policier et judiciaire, en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de Droits de l'Homme. Un travail important destiné à pacifier la société civile avait été aussi entrepris : « Avec le président, nous avons porté la bonne parole de la réconciliation, de la compréhension et de la paix. Par ailleurs, le gouvernement a organisé, au niveau de l’administration locale, des chefs et des commissaires de district, et avec la participation des chefs religieux, des ateliers et des rencontres destinés à favoriser la réconciliation de la société civile. Quant au demi-million de personnes déplacées au moment de la crise, elles ont été réinstallées, à l’exception de quelques dizaines de milliers. »
La façon dont cette échéance électorale s’est déroulée est d’autant plus remarquable que, selon les commentaires reçus par vos rapporteurs, il y avait cette fois-ci un réel espoir d’alternance malgré une réalité électorale qui continue globalement de se traduire par un vote ethnique monolithique, quasi sans déperdition. Une certaine amertume, du ressentiment et des risques de tensions étaient donc tout à fait envisageables, d’autant qu’à la monopolisation du pouvoir par une ethnie, s’ajoutent les problématiques qui y sont liées et qui n’ont pas changé : la maîtrise foncière et d’accaparement de l’appareil administratif par les vainqueurs.
Mieux, la commission indépendante pour la vérité, la justice et la réconciliation, instituée en 2009 pour enquêter sur les violences post-électorales de 2008, a finalement rendu son rapport le 21 mai 2013, après l’avoir reporté à plusieurs reprises. Indépendamment du fait que ses travaux ont été largement salués et qu’ils documentent un très grand cas de violations des droits de l’homme, la commission a recommandé à la justice kenyane d’entamer des poursuites contre le Président de la République nouvellement élu et son vice-président pour le rôle qu’ils ont joué dans les troubles. Ils sont aujourd'hui l’un et l’autre poursuivis par la Cour pénale internationale du chef de crimes contre l’humanité 184. La commission a également proposé que diverses autres personnalités politiques, du nouveau comme de l’ancien gouvernement, ministres et parlementaires, soient également poursuivies par la justice kenyane. Connaît-on beaucoup de pays africains dans lesquels une commission indépendante, chargée de faire la lumière sur des faits aussi graves, a osé conclure sur l’opportunité de renvoyer les deux têtes de l’exécutif devant la justice ? Le fait est suffisamment rare pour être salué, même si, comme on le verra plus loin, les choses ont depuis lors quelque peu évolué.
b. Des facteurs de tensions cependant toujours présents
Si les tensions politiques s’apaisent au Kenya, le pays n’en reste pas moins profondément divisé, notamment face au problème récurrent de la répartition de la richesse et de l’augmentation de la pauvreté. Comme le soulignait Etienne de Poncins 185, alors ambassadeur de France à Nairobi, le Kenya est un pays qui fait face aux mêmes problématiques que celles de la plupart des pays africains. La question de la démographie en conditionne de nombreuses autres : chaque année, le Kenya accueille un million de nouveaux enfants ; cette croissance démographique de 2,5 % par an n’est pas soutenable, en ce qu’elle conduit mécaniquement à une augmentation du nombre de personnes pauvres. De moins de 9 millions d’habitants en 1963, au sortir de l’indépendance, le Kenya est aujourd'hui passé à 44 millions. Il est le 7e pays africain le plus peuplé, derrière le Nigeria, l’Égypte, l’Éthiopie, la RDC, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Selon la Banque mondiale, 48 % des Kenyans vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011 contre moins de 46 % deux ans plus tôt, alors que la croissance économique est régulièrement au-dessus de 5 % par an.
Dans ces conditions, le Kenya a besoin d’un taux de croissance durablement élevé pour réduire la pauvreté et de créer les infrastructures indispensables. En ce sens, l’idée s’impose d’un Kenya à deux vitesses : d’un côté un pays très moderne, disposant par exemple de centres de recherche ou de soins, de facultés de médecine de niveau international, d'un « Kenya 2.0 » pourrait-on dire, à la pointe de la déclinaison en multiples applications des technologies les plus modernes de la téléphonie cellulaire, un « Kenya utile » ; d’un autre côté, un pays déshérité sur tous les plans : économique, politique et social, qui a du mal à se défaire des pratiques traditionnelles les plus lourdes, telles que l’excision. Bref, un pays africain en développement dans lequel les déséquilibres internes et les inégalités se cumulent.
En matière sanitaire, par exemple, des taux de malnutrition très élevés sont relevés dans certaines régions du pays, au Nord et au Nord-Est notamment, ou les questions de santé maternelle et infantile sont aiguës. L’inégalité en matière d’offre de soins est forte, moins de 5 % du budget de l'État étant consacrés à la santé, ce qui est très faible dans la région. Bien que nombreuses, les structures de santé manquent de moyens de fonctionnement, même si de remarquables initiatives privées, tel l’hôpital universitaire Aga Khan, de loin la meilleure structure hospitalière régionale, existent depuis de nombreuses années et que les médecins kényans sont bien formés. Dans le même esprit, le développement anarchique des grandes villes pose d’inévitables problèmes d’eau et d’assainissement, de foncier aussi, notamment à Mombasa. Sur un autre plan, le manque d’infrastructures se traduit au niveau de l’offre universitaire, insuffisante pour permettre à chaque nouvelle génération d’accéder comme elle le souhaiterait à l’enseignement supérieur. Deux ans d’attente sont ainsi nécessaires avant de pouvoir accéder à l’université dans un pays où la valorisation des études et la sélectivité du système sont très fortes, ce qui pose des problèmes de débouchés.
À cela s’ajoutent les voisinages incertains du Kenya qui ne sont pas sans incidence sur sa situation interne. Au Nord, la Somalie, avec laquelle il partage une frontière d’un millier de kilomètres. Un très grand nombre de réfugiés somaliens, plus de 600 000 en tout, se sont installés au Kenya et le camp de Dadaab, par exemple, conçu pour accueillir 90 000 personnes, en héberge plus de 300 000. Les derniers attentats commis par les Shebab de Somalie au cœur de Nairobi prouvent le caractère explosif de cette situation. Le problème est donc majeur. De même en est-il de la frontière avec le Soudan du Sud, dont les différends avec le Soudan sont loin d’être définitivement réglés, même si l’accord sur un projet d’oléoduc pour l’exportation du pétrole vers le port de Lamu marque la promesse de recettes nouvelles et durables pour le budget kenyan. Dans le même ordre d'idées, la piraterie en haute mer qui sévit dans la région ne peut qu’affecter les échanges commerciaux du Kenya.
Lors de son audition devant notre commission, le Premier ministre Raila Odinga avait enfin dressé le tableau d’un Kenya contemporain qui, outre les défis « traditionnels » du sous-développement devait en affronter de nouveaux. Il précisait ainsi que « l’Afrique doit avant tout s’adapter aux effets des changements climatiques : au Kenya, nous vivons en permanence entre deux désastres, la sécheresse et l’inondation. La neige a fondu au sommet du Mont Kenya, comme au sommet du Kilimandjaro. Le réchauffement a provoqué l’apparition de la malaria dans les montagnes, dont les habitants ne sont pas immunisés contre cette maladie, à la différence des habitants de la plaine. Aujourd’hui le paludisme tue dans notre pays. En outre, le Kenya, qui était jusqu’ici riche en ressources agricoles, doit désormais recourir aux importations alimentaires. Nous devons mettre en place une agriculture irriguée. Nous devons également constituer des réserves en eau potable. Nous devons enfin lutter contre la déforestation du fait de l’activité humaine : alors que la forêt couvrait 12 % de notre territoire, elle n’en couvre plus que 2 %. »
c. D’autres défis se profilent aussi
Si la bonne issue de la période électorale a montré que la dynamique du pays n’avait pas été cassée par la crise précédente, un certain nombre de défis, de diverses natures, se dresse encore dans le paysage kenyan. Le fait que les deux titulaires de l’exécutif kenyan soient poursuivis par la CPI n’est pas le moindre des aléas : non seulement c’est la première fois que des personnalités sont élues alors qu’elles sont inculpées, mais c’est aussi la première fois que leur procès a lieu durant leur mandat. De fait, le procès du vice-président a débuté en septembre, celui du président devrait commencer le 12 novembre. Cela étant, si la présence du vice-président devant ses juges a semblé traduire la volonté initiale de l’exécutif kényan de coopérer avec la justice internationale, la tragédie du 21 septembre à Nairobi lui a permis de changer de posture : le Président Uhuru Kenyatta argue aujourd'hui de la situation sécuritaire nationale et régionale186 suite à l’attaque terroriste contre le centre commercial Westgate Mall pour exiger d’être exempté. Selon ses avocats, les faits justifient un report de son procès au moins jusqu’en février 2014. En parallèle, les positions de l'Union africaine se durcissent, puisque le dernier sommet des chefs d'État, réuni le 12 octobre dernier, a décidé que le dirigeant kényan ne devrait pas se rendre à La Haye tant que la requête d’ajournement que l’Union africaine a formulée n’aurait pas reçu de réponse. 187 Les pires critiques continuent d’être proférées contre l’institution, accusée de ne poursuivre que des Africains, pire, le fils du père de l’indépendance kenyane... « La CPI "n'est plus le lieu de la justice mais le jouet des pouvoirs impérialistes en déclin", a accusé le président Kenyatta, lors d'un discours devant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. "Cette Cour agit sur demande des gouvernements européens et américain, contre la souveraineté des États et peuples africains (...) des gens ont qualifié cette situation de "chasse raciale", j'ai de grandes difficultés à trouver cela faux", a-t-il ajouté. » Cela étant, comme le soulignaient les chercheurs de l’IFRA devant vos rapporteurs 188, le Kenya fait aussi preuve d’une réelle capacité de renouvellement politique, qui s’est accompagné de mesures importantes au plan institutionnel, avec l’adoption d’une nouvelle constitution et le lancement d’un processus de décentralisation qui devrait avoir un impact sur la question ethnique.
Si cet aspect est évidemment positif et de bonne augure, d’autres, en revanche, peuvent inquiéter. Ils portent sur la question du modèle de développement que le Kenya se choisit. Selon les experts de l’IFRA, ils pourraient être porteur de bouleversements majeurs pour les populations. S’additionnent, dans cet ordre d’idées, l’accaparement des terres par des entreprises qui investissent à grande échelle, notamment pour la production de biocarburants ; quelque 160 000 hectares ont par exemple été acquis par une société canadienne dans ce but. Des émeutes ont eu lieu, çà et là, sporadiques, au début de l’année, qui mettent en cause des agriculteurs et des éleveurs, sur des questions de terres et de pâturages affectés par la construction d’ouvrages hydroélectriques. Alors que les tensions et violences avaient eu lieu en 2007, essentiellement dans la capitale et dans la vallée du Rift, elles se sont déplacées désormais sur ce que l’on appelle le « corridor LAPPSET » 189 : une ligne entre le Soudan du Sud et le port de Lamu, sur l’Océan indien, le long duquel des voies de transports routiers et ferroviaires sont prévues, ainsi que des oléoducs permettant d’exporter le pétrole sud-soudanais. En tentant de résoudre la question cruciale de son manque d’infrastructures, le Kenya entre aussi sur la voie de bouleversements sociétaux profonds, dès lors que ce modèle de développement-là ne correspond pas aux sociétés pastorales traditionnelles. Des risques de tensions durables apparaissent, au point qu’un scénario « à la nigériane », n’est pas à exclure.
Enfin, bien qu’il s’agisse d’une problématique moins centrale quant au propos de cette étude, vos rapporteurs doivent mentionner au titre des défis environnementaux du Kenya, celui du braconnage des rhinocéros et des éléphants qui atteint des proportions alarmantes : selon les informations qui ont été données par les responsables des ONG Save The Elephants et Elephant Watch 190, le braconnage des éléphants a doublé en 10 ans et le trafic d’ivoire a triplé ; celui des rhinocéros n’a jamais été aussi haut depuis 20 ans. La situation est telle que le Kenya, qui semble cependant prendre désormais conscience de la gravité du problème, a fait l’objet ces derniers mois, de vives critiques des organisations et des ONG internationales, se voyant reprocher son extrême laxisme. Dans la mesure où il apparaît désormais que des liens sont à établir entre revenus tirés du braconnage et financement du crime international et du terrorisme, la lutte contre ce fléau tend à prendre une dimension au moins régionale, si ce n’est internationale. 191
B. UN DYNAMISME REMARQUABLE, DES PERFORMANCES ÉTONNANTES
1. Des ressources naturelles, encore et toujours, comme point de départ
a. Les paradoxes pétroliers du Nigeria ne l’empêchent pas de faire la course en tête
Le Nigeria est depuis longtemps un poids lourd économique parmi les pays africains. Le graphique suivant montre qu’il représente à lui seul les deux tiers du PIB global de la région ouest-africaine, très loin devant ses voisins.
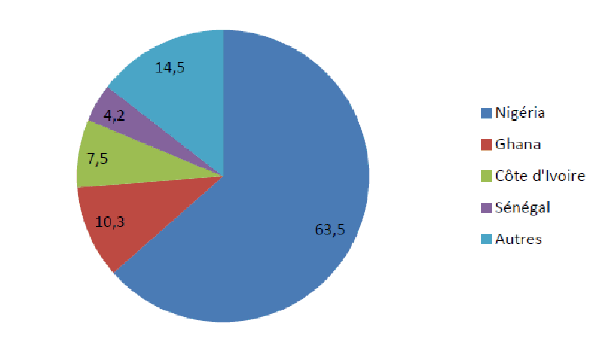
Les principales économies de l’Afrique de l’Ouest en 2010 (en % du PIB de la zone) 192
Plusieurs atouts jouent déjà en sa faveur : sa population, 400 millions d’habitants à l’horizon 2040, qui en fera le 3e pays le plus peuplé du monde, supérieur à lui seul à toute l'Afrique de l'Ouest. Un PIB en croissance forte, dans la moyenne supérieure de celle des pays africains sur les dernières années, de 7 à 8 %, nettement supérieure à celle de l'Afrique du Sud, ce qui devrait lui permettre, d’ici une dizaine d’années, de la dépasser et de s’imposer comme le pays le plus riche du continent. Certains experts estiment que le Nigeria pourrait dépasser en 2050 le Canada, l’Italie ou la Corée du sud. 193
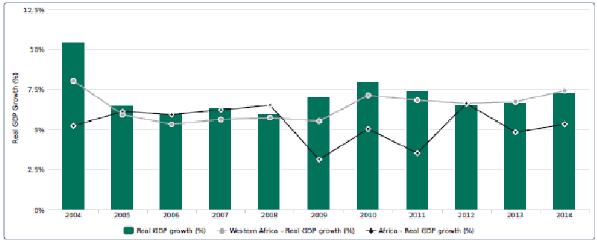
Nigeria, taux de croissance du PIB réel 194
On voit nettement sur le diagramme ci-dessus que non seulement la croissance du Nigeria est loin d’avoir chuté autant que celle de l'Afrique du Sud, qui était entrée en récession lors de la crise de 2009, mais que, depuis, elle est au moins égale et souvent supérieure à la croissance moyenne des pays d'Afrique de l'Ouest. Les prévisions pour 2014 sont nettement orientées à la hausse avec une croissance espérée de 7,3 %, après 6,7 % cette année.
Dans cette économie aux performances étonnantes, eu égard à l’environnement interne que vos rapporteurs ont décrit plus haut, le pétrole est au cœur de la richesse. Membre de l’OPEP, le Nigeria est en effet le plus important producteur de pétrole africain et occupe le dixième rang mondial. En termes de réserves, les données sont tout aussi exceptionnelles : avec quelque 5 300 milliards de m3, le pays dispose de la première réserve de gaz africaine, la septième mondiale. Avec 37,2 milliards de barils, il détient aussi la deuxième réserve prouvée de pétrole en Afrique, ce qui, pour l’heure, en fait incontestablement le plus puissant de la région malgré ses problèmes de gouvernance et de corruption, et lui assure, au rythme actuel de production, une rente pour les 34 ans à venir.
Mais le Nigeria est aussi un pays qui présente le paradoxe d’être en même temps dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins et d’importer de l’essence ! Sont mis ici en lumière à la fois le manque cruel d’infrastructures de raffinage et la corruption qui permet à certains, notamment des responsables militaires liés à des importateurs, d’entretenir une pénurie qui leur profite.
En premier lieu, la pauvreté et l’état des installations jouent un rôle dans cet état de fait. Ainsi que le rappelait une récente étude de l’International Crisis Group 195, « le Nigéria dispose de quatre raffineries, mais, en raison d’un manque d’entretien et d’une mauvaise gestion, celles-ci fonctionnent largement en-deçà de leurs capacités. Le pays se voit donc contraint d’importer la majeure partie de ses besoins en carburant. » Concrètement, ses infrastructures de raffinage laissées à l’abandon, et parfois même sabotées, tournent autour de 30 % de leur capacité. Elles sont très loin de couvrir les besoins, estimés à plus de 350 000 barils par jour, bpj, aujourd'hui, et les importations représentent 85 %. Cela étant, le « bunkering » et la piraterie que l’on a évoqués portent sur de telles quantités que l’impact sur la production de brut est également impressionnant. Comme on l’a vu, la piraterie ne concerne pas seulement le Nigeria mais la région et « est aussi organisée par des réseaux, avec des relais à l’intérieur du pouvoir nigérian. Cela concerne aussi les pays voisins comme la Côte-d’Ivoire, le Ghana, dont les raffineries utilisent du brut " illégal ". Le Cameroun et le Bénin connaissent, quant à eux, la contrebande organisée de brut raffiné nigérian par des petites unités clandestines, revendant le pétrole beaucoup moins cher et ruinant les stations-service locales, sans rapporter de taxe aux États. Sur une production journalière d’environ 2 millions de barils en 2008, on estime que le Nigeria a pu perdre jusqu’à 500 000 barils par jour (bpj), certaines semaines de septembre ou d’octobre, du fait du vandalisme d’installations d’extraction, de transport ou de stockage. En mars 2009, la production officielle de pétrole était de 1,6 million bpj alors qu’en 2006 elle se situait à 2,6 millions. Ces dégradations ou pillages ont d’ailleurs permis à l’Angola, à la fin de l’année 2008, de ravir au Nigeria la place de premier producteur africain de pétrole ». 196 Les choses ne se sont pas améliorées depuis la publication de cet article puisque, selon The Economist 197, le ministre des finances nigérian estimait les pertes journalières à 400 000 barils en avril 2012, avant de conclure que personne n’était en fait en mesure de dire quelle était la production du Nigeria compte tenu de la corruption, des vols et autres détournements, qui ont probablement coûté au pays quelque 400 milliards de dollars depuis l’indépendance…
La situation est telle que pour remplir son quota OPEP, de 2,3 millions de bpj, le Nigeria doit en produire actuellement 2,55. Ce sont donc environ 10 % de la production journalière qui disparaissent en fuites polluantes ou détournements divers, avec la complicité de personnalités proches. Cette situation contribue fortement au renchérissement des coûts d’exploitation, dans la mesure où les entreprises font face à des dépenses de sécurité considérables pour protéger leurs installations des actes de sabotage, de pillages, ainsi que leurs personnels des risques d’enlèvement. En quelques années, le coût de production du pétrole nigérian a de ce fait quintuplé ; une entreprise comme Total consacre à la sécurité quelque 100 millions de dollars par an.
Le manque à gagner est toujours considérable pour l'Etat fédéral. L’Agence internationale de l’énergie l’a estimé à quelque 7 Mds$ annuels. En outre, le coût des carburants s’en trouve renchéri et justifie l’existence d’importantes subventions pour le consommateur. Considérées comme excessives et même insoutenables pour le budget de l'Etat, représentant quelque 5 à 6 Mds$ en 2012 et 2013, le président Goodluck Jonathan a décidé de les supprimer au 1er janvier 2012, provoquant une levée de boucliers immédiate et une grève générale, durement réprimée par les forces de l’ordre, qui n’a cessé que lorsque l’augmentation des prix a été ramenée à des proportions plus acceptables pour la population.
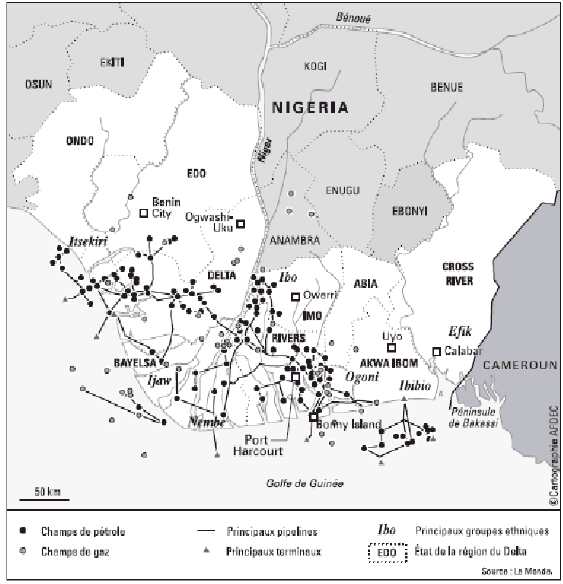
Production et exportation de pétrole dans le delta du Niger 198
Le Nigeria se trouve donc dans la situation étonnante d’un géant pétrolier dont la ressource ne contribue qu’à 15 % de son PIB, même si elle rapporte à l’État fédéral plus de 80 % de ses recettes fiscales, et représente la quasi-totalité de ses exportations. En d'autres termes, ce ne sont pas les richesses naturelles - le pétrole et le gaz sont loin d’être les seules dont il dispose abondamment - qui tirent la croissance du pays, mais plutôt la demande interne ; les Perspectives économiques en Afrique 2012, estimaient que les télécommunications, le bâtiment et les travaux publics (BTP), le commerce de gros et de détail, l’hôtellerie et la restauration, ainsi que les industries manufacturières et l’agriculture, étaient les secteurs qui participaient le plus à la croissance. L’agriculture contribue pour sa part à plus du tiers du PIB, elle emploie 70 % de la population active sur 70 millions d’hectares de terres agricoles.
À l’instar des pays africains, le Nigeria est aussi un pays dans lequel le manque d’infrastructures est une donnée cruciale. On a vu son impact sur le secteur pétrolier, mais il faut également savoir que le Nigeria produit 70 fois moins d’électricité que la France tout en étant trois fois plus peuplé... On imagine l’incidence d’un tel état de fait sur le développement économique ou l’attractivité des entreprises.
Consécutivement, la structure de cette économie la rend peu créatrice d’emplois : le chômage augmente malgré la croissance et la pauvreté reste endémique, à des niveaux très élevés : plus des deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. L’ambition des autorités est d’inscrire le pays dans les vingt premières économies mondiales d’ici à 2020 ; c’est l’objet de l’ « Agenda 20/2020 », récemment adopté, qui vise à développer les infrastructures, les capacités pétrolières et électriques et à attirer les IDE dans divers secteurs, notamment agroalimentaire. Selon la revue African Business 199, le Nigeria est devenu le principal récepteur d’IDE, dépassant l'Afrique du Sud, pour la première fois en dix ans ; le flux d’entrée était estimé à près de 9 Mds$, devant l'Afrique du Sud, 5,8 Mds$, et le Ghana, 3,2 Mds$. La revue faisait notamment état d’intérêts canadiens et américains, exprimés par des entreprises comme General Electric, et par des autorités politiques et confirmés par des visites répétées, par la signature d’engagements, en particulier dans les secteurs énergétiques (électrique ou autre) et financiers, mais aussi d’infrastructures ferroviaires ou encore de biens de consommations ou industriels. Le fait que la moitié de la population ait moins de 18 ans oblige à une réorientation drastique de l’économie pour qu’elle puisse répondre d’urgence à ces défis. Cela suppose que le Nigeria effectue une véritable « révolution culturelle » en matière de gouvernance, de gestion des ressources pétrolières. Il n’est pas certain que les dirigeants y soient prêts, compte tenu des intérêts en jeu et de la corruption. De sources concordantes de vos rapporteurs 200, le président Goodluck Jonathan ne maîtrise pas les enjeux pétroliers dans son pays. Dans ces conditions, les tensions centrifuges auxquelles il doit faire face aux marches de son pays, au Nord avec Boko Haram et au Sud avec les revendications du MEND, ne facilitent en rien les velléités de réorientation économique.
Si les exportations du Nigeria augmentent régulièrement et si la balance commerciale est positive, pour autant, la situation ne laisse pas d’être préoccupante pour l’avenir. On peut notamment s’interroger sur la viabilité, dans les conditions économiques actuelles, de l’explosion démographique annoncée. Non seulement la croissance élevée ne permet pas de créations d’emplois, ni de diminuer la pauvreté, mais la révolution agricole ne s’est pas encore produite, un changement structurel et une diversification de l’économie sont pourtant essentiels pour réussir. Or, on estime que la politique industrielle du Nigeria est encore dans les limbes, que le niveau d’industrialisation du pays, déjà faible, est en diminution depuis quelques années. On a mentionné plus haut le problème du « torchage » du gaz comme facteur de pollution de la région du delta : il est en partie dû à la faiblesse de l’industrie pétrochimique, anormalement peu développée dans un pays producteur de pétrole ; la moitié du gaz nigérian disparaît ainsi au lieu d’être utilisée.
Si, comme le disent nombre d’experts, la corruption est redistributrice, si la transition démographique est néanmoins amorcée au sud du pays, si enfin l’économie informelle permet de faire vivre tout le monde, peut-on y voir pour autant des conditions optimales et durables pour que le Nigeria conserve sa position actuelle ? Il n’est aujourd’hui qu’un pré-émergent encore marqué par les stigmates du sous-développement.
b. En passe de réussir la diversification et la modernisation de son économie, le Kenya monte en puissance
Comme le montre le diagramme ci-dessous, les performances et perspectives attendues de l’économie kenyane sont des plus positives. Il est surtout intéressant d’en relever quelques particularités.
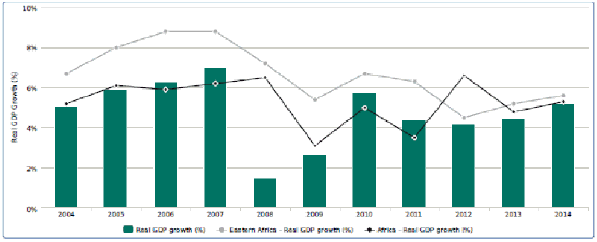
Kenya : taux de croissance du PIB réel201
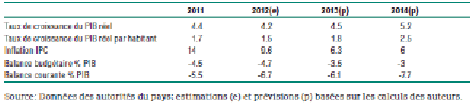
Kenya : indicateurs macro-économiques 202
A la différence notable du Nigeria, le Kenya est loin d’être un géant africain parmi les producteurs d’énergie. Si de récentes découvertes au nord du pays lui permettent d’espérer d’importantes réserves, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, et nul ne sait encore quelle pourrait être la rentabilité économique de ces gisements potentiels 203. Il s’agit cependant d’une perspective des plus intéressantes pour le pays et les experts que vos rapporteurs ont rencontrés estiment qu’il n’y a, sur un plan géologique, aucune raison pour que les sous-sols kényans, qui sont de même nature que ceux des autres pays riverains de l’Océan indien, ne soient pas aussi riches. Pour l’heure, le Kenya importe du pétrole brut qu'il raffine, d’abord pour son usage intérieur. On peut relever comme signe de la bonne tenue de son économie, que la consommation de carburants ne cesse de croître, mais à la différence notable du Nigeria, ses capacités de raffinage lui permettent aussi d’augmenter de manière régulière ses exportations.
Pour rester sur le terrain énergétique, il est important de souligner le compromis fort du Kenya en faveur des énergies renouvelables, comme le Premier ministre Raila Odinga l’avait mentionné lors de son audition devant la commission des affaires étrangères 204, son objectif étant alors de « produire au cours des trois années à venir 2000 mégawatts d’énergie propre, d’origine hydraulique, géothermique, éolienne, solaire, issue des biocarburants ou du nucléaire » Avec une production de 7560 MWh, le Kenya fait encore figure de nain en matière de production d’électricité, surtout si on le compare à l'Afrique du Sud, au Nigeria même, voire au Ghana, mais sa localisation lui permet d’envisager de continuer à l’augmenter pour arriver à un doublement, reposant essentiellement sur le géothermique et l’éolien, pour le moment marginaux. Ses capacités hydrauliques sont en revanche bien plus limitées et sujettes aux conditions climatiques. Lors de leur déplacement à Nairobi, il a été indiqué à vos rapporteurs que la répartition entre les trois sources pourrait à court terme être la suivante : 7000 MW de capacité géothermique ; 4400 MW d’énergie éolienne et 1500 MW d’énergie hydraulique. À plus longue échéance, les autorités kenyanes envisagent un équipement éolien permettant de produire quelque 30 000 MW d’ici 2030, et plusieurs sociétés kenyanes sont en train d’investir dans ce secteur 205. À l’heure actuelle, l'hydroélectricité représente encore la moitié de la production électrique totale, contre le tiers pour la production d'origine thermique et 20 % pour la production d'origine géothermique.
Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une dynamique que l’on retrouve dans d’autres secteurs de l’économie kenyane. Ainsi que le relèvent par exemple les Perspectives économiques en Afrique 2013, on assiste depuis quelques années au Kenya à « la réorientation des ressources économiques, qui se détournent des secteurs traditionnels (agriculture, sylviculture, pêche et chasse) au profit de secteurs plus avantageux sur le plan économique comme les carburants et l'énergie, les transports et l'éducation. » De sorte que, entre autres, « la contribution du secteur agricole dans l'emploi total au Kenya n'a fait que décroître de 18.46 % en 1998 à 16.25 % en 2011. En revanche, la part des secteurs lucratifs modernes (comme le bâtiment et la construction, les transports et la communication) a constamment progressé entre 1998 et 2011. » Pour sa stratégie de développement économique et social, le Kenya mise sur des secteurs aussi déterminants que l’éducation, les infrastructures ou l’énergie, en se détournant des secteurs les plus traditionnels. Il reçoit aujourd'hui plus de 10 % des IDE destinés à l'Afrique, contre 20 % pour l'Afrique du Sud.
Comme les entrepreneurs kenyans le soulignent eux-mêmes 206 : le Kenya est aujourd'hui dans une phase historique d’ouverture et « tout va dans le bon sens » ; cela est d’autant plus remarquable que, à la différence de beaucoup de pays, ce ne sont pas les matières premières qui tirent la croissance du pays, mais une conjoncture favorable, une classe moyenne, ici aussi émergente, une vision du futur du pays partagée dans le cadre d’un plan de développement économique et social, à échéance de 2030, et une démocratie apaisée. A ces propos unanimes du patronat kenyan, font écho les analyses des experts internationaux, pour lesquels « La transformation économique du Kenya est remarquable » 207. Sans doute le Kenya est-il aidé par la qualité unanimement vantée de son éducation, ce qui le distingue de ses pairs et notamment de l'Afrique du Sud, avec laquelle le contraste est saisissant. Tous les interlocuteurs soulignent le bon niveau général d’éducation, l’excellente formation de la nouvelle jeune classe politique, formée aux meilleures universités occidentales, Harvard, notamment.
c. Le Ghana est entré en piste à son tour
Comme le rappelait Geneviève Tsegah, ambassadrice à Paris 208, après avoir connu une période d’instabilité à partir des années 1960, avec le renversement du président Nkrumah en février 1966, premier des coups d’État dont le pays allait souffrir, le Ghana a réussi à entrer dans un cercle plus vertueux, notamment depuis le début des années 1990, pour devenir l’un des plus stables d'Afrique de l’Ouest, avec des consultations électorales apaisées, des alternances démocratiques, se voyant unanimement salué pour cela. Les élections sont transparentes, elles sont aussi respectées, dans la mesure où les contestations se déroulent devant les tribunaux et non par la violence, ainsi que les dernières élections législatives, en décembre 2012, l’ont encore montré.
Sur le plan économique, pour être incomparablement plus modeste en tous points de vue que les géants d'Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya, le Ghana n’en mérite pas moins de figurer au tableau d’honneur : il est tout d'abord de ceux qui affichent l’une des croissances économiques les plus élevées du continent, entre 7 et 8 % en moyenne au cours de la dernière décennie, ayant même frôlé les 14 % en 2011. Avec une croissance à 13,7 %, il réussit la deuxième performance mondiale de l’année, après la mise en l’exploitation de ses ressources pétrolières. L’économie ghanéenne se porte bien, et cette situation devrait perdurer dans la mesure où l’on estime que les revenus pétroliers devraient représenter entre 1 et 2 milliards de dollars, une fois le rythme de croisière atteint. Avant même les découvertes de pétrole et de gaz, l’économie présentait depuis plusieurs années des performances systématiquement meilleures que celles de la moyenne des pays africains, au point que le pays n’a plus accès aux prêts concessionnels attribués par les bailleurs internationaux de l'APD. Il est désormais considéré comme un pays à revenu intermédiaire.
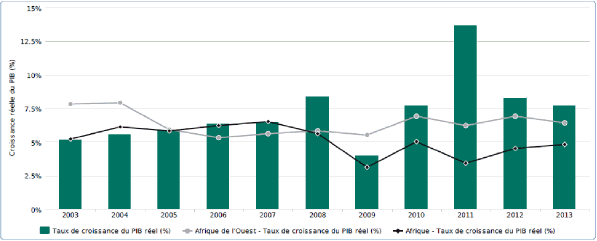
Taux de croissance du PIB réel du Ghana 209
Mieux, ce n’est pas seulement au plan macroéconomique que la situation est bonne : les problématiques sociales sont traitées au Ghana d’une manière qui tranche avec d’autres pays africains : le « Better Ghana Agenda » du président Atta-Mills, qui a été repris par son successeur, le président Mahama, a mis en place de mesures visant à une répartition plus équitable des revenus du pays. Ses nombreuses ressources naturelles, or, cacao, pétrole, gaz, manganèse, aluminium, lui assurent des revenus conséquents et croissants, et permettent des politiques budgétaires saines, grâce à des recettes publiques en augmentation… L’or et le cacao, longtemps premiers produits d’exportation du pays, seront prochainement dépassés lorsque les revenus tirés de l’exploitation pétrolière, qui a débuté il y a peu, auront atteint leur vitesse de croisière. La production de gaz permettra ensuite de fournir le Ghana en électricité et consécutivement, d’accroitre son indépendance énergétique.
Les flux d’IDE sont, année après année, en constante augmentation, preuve de la confiance dont jouit le pays, qui permettent de conforter les recettes de l'État, cependant que le gouvernement ne cesse d’œuvrer à l’amélioration du climat des affaires. Selon la CNUCED, le Ghana a ainsi reçu 3,2Mds$ en 2011, soit 5 % du flux d'IDE vers l’Afrique subsaharienne. Les Perspectives économiques rappellent, par exemple, que « à deux reprises, le Ghana s’est retrouvé parmi les dix pays ayant mis en œuvre le plus de réformes dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. » Il est classé 7e sur 52 pays africains, dans l’indice Mo Ibrahim, en progrès régulier sur les six dernières années 210, avec une note de 66,3 aujourd'hui, supérieure à la moyenne globale africaine et à la moyenne régionale des pays d’Afrique de l'Ouest. Transparency International classe pour sa part le Ghana au 64e rang sur 176 pays analysés, devant l'Afrique du Sud, 69e, et très loin devant le Nigeria et le Kenya, à égalité au 139e rang.
Ces données remarquables ne signifient pas pour autant que le Ghana soit exempt de difficultés : comme nombre de pays africains, il connaît un taux de croissance démographique élevé et son économie, pour performante qu’elle soit, ne réussit cependant pas à créer suffisamment d’emplois dans le secteur formel, qui ne concerne qu’un peu plus de 11 % de la population active. Ainsi plus du quart des jeunes de 15 à 24 ans, qui forment aussi le tiers de la population du pays (25 millions d’habitants), sont-ils au chômage. Cette proportion de chômeurs est deux et trois fois plus forte que le taux de chômage touchent les classes d’âge supérieures. Le Ghana ne réussit pas à intégrer sa jeunesse dans les circuits économiques, alors que l’agriculture, évidemment peu rémunératrice, occupe encore près de 60 % de la population active. Cette situation n’est pas sans incidence sur l’exode rural vers Accra, sur la montée de la délinquance juvénile et même de la violence urbaine, qu’elle soit politique, sociale ou ethnique, comme le relevaient les Perspectives économiques en Afrique 2012. Comme maints autres pays du continent, le Ghana souffre du même manque d’infrastructures, par exemple en matière de production d’électricité, ce qui handicape son secteur industriel. Les délestages sont fréquents depuis quelques années : le niveau du lac Volta a fortement baissé, essentiellement pour des raisons tenant au changement climatique, et le fonctionnement de la centrale hydroélectrique d’Akosombo en est sérieusement affecté.
Sur un autre plan, le Ghana se montre également soucieux du rôle qu’il lui est possible de jouer sur la scène africaine et il participe depuis longtemps aux OMP qui sont décidées dans le cadre de l'ONU, de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Dans son environnement immédiat, il participe notamment à l’ONUCI en Côte d'Ivoire et, plus récemment, a été l’un des contributeurs africains importants de la MINUSMA. Sur des terrains plus éloignés, il contribue aussi aux opérations engagées au Soudan, en RDC ou au Liban, pour ne citer que ces quelques cas.
2. Des ambitions régionales qui s’affirment aussi
Sans doute moins tapageurs que l'Afrique du Sud, les plus prometteurs des futurs émergents n’en sont pas moins très présents.
a. Le Nigeria, acteur diplomatique important
Fort de son poids économique, d’une armée considérée comme étant parmi les plus puissantes et les mieux organisées d’Afrique, le Nigeria mène une diplomatie, qui est considérée comme positive, en tout cas à la mesure de sa position régionale. Depuis longtemps, il n’hésite pas à montrer que ses ambitions ne sont pas moindres que celles de l'Afrique du Sud et qu’il convient de compter avec lui.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il cherche à jouer un rôle régulateur, notamment dans les crises régionales, mais pas exclusivement. Le Nigeria a ainsi participé à de très nombreuses opérations de maintien de la paix au cours des dernières décennies : on recense sa participation à 45 OMP dans le passé, qu’elles aient été conduites sous l’égide des Nations Unies ou de l’OUA, puis aujourd'hui de l’Union africaine, ou de la Cédéao, dont le Nigeria héberge le siège. À l’heure actuelle, il participe à huit opérations en cours. 5180 militaires nigérians y sont en tout déployés, en particulier dans la sous-région. Cela a par exemple été le cas dès le début des années 1990, lorsqu’il a été appelé pour mener des opérations au Libéria ou en Sierra Leone, où il a effectué des missions de contrôle et d’imposition de cessez-le-feu, ainsi qu’en d’autres occasions dans les années suivantes. Comme le précisent les chercheurs du Réseau de recherche sur les opérations de paix 211 , « le Nigéria de par sa capacité militaire demeure la principale force ouest-africaine capable de prendre en charge unitairement une mission de maintien de la paix dans la sous-région. Les opérations au Libéria, en Sierra Léone, en Côte d'Ivoire et au Soudan lui offrirent l'occasion de se poser en véritable leader africain du maintien et de la consolidation de la paix. » D’une manière générale, le Nigeria est en mesure de mettre à disposition des troupes nombreuses, ainsi que des ressources logistiques et financières, comme dans le cas des opérations de l’ECOMOG : au Liberia, par exemple, il a ainsi apporté les trois quarts de troupes et 90 % des fonds. Sa participation aux diverses opérations des Nations Unies et de l'Union africaine au Soudan, sur la crise du Darfour, a également été conséquente et se poursuit.
En parallèle, le Nigeria s’est aussi montré actif sur un certain nombre de dossiers africains, multipliant « les réunions de médiation et de facilitation pour aider à résoudre d'autres crises frappant le continent, telles que celles du Soudan, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Zimbabwe, du Togo et aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Même s'il ne s'agit que d'actions diplomatiques dans lesquelles le Nigéria est un acteur parmi tant d'autres, ces réunions ont néanmoins le mérite de montrer que le pays (de ce point de vue) sait utiliser d'autres ressources que celles de la force armée pour œuvrer à la stabilisation et à la pacification du continent noir. » 212 Cette implication régionale en faveur de la stabilité et du développement de l'Afrique se traduit enfin dans le fait que le Nigeria est le premier contributeur du fonds concessionnel de la BAD.
On ne s’étonne pas dans ces conditions que les relations bilatérales avec l'Afrique du Sud soient parfois tendues : les deux grands ont les mêmes aspirations à jouer le rôle de chefs de file sur le continent et rivalisent sur les mêmes enjeux. Chacun sait aussi que le Nigeria aspire depuis la fin du siècle dernier à un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, considérant qu’il est « injuste et intenable », comme le président Goodluck Jonathan l’a redit à Ban Ki-moon lors de la visite que le Secrétariat général des Nations Unies a effectué en mai 2011 à Abuja, qu’aucun pays africain n’ait ce statut. Déjà membre non permanent à quatre reprises par le passé, le Nigeria a de nouveau été élu le 17 octobre dernier par l’Assemblée générale des Nations Unies pour un mandat de deux ans, 2014-2015213. Le fait que le siège de la CEDEAO, instance qu’il promeut sur la scène internationale, cf. la dernière crise malienne, soit à Abuja lui permet d’avoir à sa disposition un instrument d’influence majeur, tant en Afrique que dans sa relation internationale, par exemple avec l’Union européenne, comme le souligne le MAEE, rappelant que, « en 2007, le Nigéria a pesé de tout son poids au sein de cette organisation pour que celle-ci refuse de signer dans les délais impartis un Accord de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne. »
b. Les visées économiques du Kenya
Le Kenya accorde une importance majeure aux technologies de l’information dans ses stratégies publiques et privées. Ainsi, lors de la réforme constitutionnelle de 2010, l’un des seuls ministères à avoir conservé l’ensemble de son périmètre est celui de l’information et de la communication. De fait, un effort considérable est mis en œuvre pour que la montée en puissance des TIC devienne l’un des piliers de la stratégie 2030 pour le développement du Kenya qui a été récemment adoptée 214. Ainsi, un projet de « techno-cité », la Konza Technology City » sera mis en chantier d’ici la fin de l’année 2013 pour être inauguré en 2017. Il a pour ambition de constituer un pôle majeur d’attractivité pour les IDE, dans le secteur des technologies de l’information, destiné à faire du Kenya dans les prochaines décennies le leader continental incontestable en la matière. Sur plus de 2000 hectares, des entreprises, des pôles universitaires seront hébergés, qui bénéficieront de la position géographique idéale du Kenya pour se développer dans un hub spécifique. Déjà cinq « villages digitaux », expérimentaux, ont été installés dans le pays afin de réduire la brèche entre les grandes villes et les provinces, en matière de connexions informatiques et d’accès aux services. De nombreux partenaires internationaux sont sur les rangs et ont déjà investi. Ils ont montré leur intérêt de travailler avec le Kenya sur cette initiative ou d’autres, qui sont parallèles : le Royaume-Uni, avec Vodafone, l’Inde, avec l’entreprise IndiaCom, ou encore Singapour, sur les aspects de e-gouvernement. Les américains IBM, SISCO, Oracle, sont également présents, comme des entreprises chinoises qui se montrent intéressées par des réseaux de fibres optiques. Dans le même esprit, le nouveau président de la République a fait campagne sur le thème « un ordinateur par élève ». En avril, lors du déplacement de vos rapporteurs, la Corée s’était déjà montrée intéressée pour la fourniture de ces équipements.
Outre l’ambition du projet, il est aussi remarquable de relever que, même si des partenaires internationaux sont appelés à investir dans cette « Silicon Valley » kenyane, ce projet est d’abord prévu pour fonctionner sur la base de recrutements locaux, profitant du fait que le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a fortement augmenté au cours des dernières années et que des personnels kenyans de bonne qualité sont disponibles.
En d'autres termes, ce pays est sans doute l’un des rares en Afrique à avoir misé autant sur les technologies du futur, à monter des partenariats internationaux pour ce faire. Ainsi que vos rapporteurs ont pu le constater sur place, l’application des technologies de l’information a déjà connu des développements remarquables, en matière bancaire notamment, avec l’introduction de systèmes de paiements et de transferts bancaires via la téléphonie mobile. Bob Collymore, président de SafariCom, entreprise kenyane à capitaux britanniques, confirmait ainsi 215 que le développement des TIC au Kenya était sur une tendance très positive, pour sa société comme pour d’autres, parce que les développements répondent aux besoins tout en étant adaptés à toutes les catégories de populations, y compris les illettrés. L’excellence des ressources humaines, est un atout considérable, de même que le dynamisme de la jeunesse, fortement motivée.
LE POSITIONNEMENT DE LA FRANCE ET LES PERSPECTIVES QUI S’OFFRENT
I. LE CONSTAT D’UNE PRÉSENCE MODESTE
Il revient à présent à vos rapporteurs d’entonner à leur tour la litanie que l’on ne cesse d’entendre depuis des années, vers quelque horizon qu’on se tourne : celle de la faiblesse de notre présence économique, de la perte de parts de marché, de notre indifférence, même. Tout cela est vrai et fondé, on le verra. Pour autant, il n’est pas dit que la tendance ne puisse s’inverser. Quelles que soient les difficultés - vos rapporteurs ne les ont pas cachées - qui risquent longtemps encore de marquer d’incertitude le futur de ces pays, il est indispensable que la France n’en soit pas absente et rééquilibre ses relations africaines. Cela est d’autant plus opportun que nous avons des atouts à faire valoir. Aux constats feront donc suite quelques pistes de réflexion pour tenter de redresser une situation que l’on peut qualifier de préoccupante.
A. L’ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX
Si la France n’est pas totalement invisible dans cette région de l’Afrique, ses positions ne sont pas au mieux et la question de leur évolution, du niveau de notre présence, mérite d’être posée. Trois aspects sont à considérer.
1. C’est de loin en Afrique francophone que la France a ses parts de marché les plus importantes
Dans les pays de la zone franc, la France réussit encore à faire quasiment jeu égal avec la Chine, et elle continue même de se placer parfois devant elle. Sans surprise, le poids de l’histoire commune pèse toujours dans la relation commerciale entre la France et ses anciennes colonies africaines : sur l’ensemble de la zone franc, la France détient une part de marché de 17,2 %, contre 17,7 % pour la Chine. Elle est encore mieux placée dans des pays comme la Côte d'Ivoire, (14 % de parts de marché), le Sénégal (17 %), ou surtout le Gabon (33 %), devant la Chine, qui a acquis respectivement 6 %, 10 % et 8 % des parts de marché. Dans d’autres pays, tel le Congo, les performances sont « historiques » : en 2012, les exportations françaises, portées par la croissance du pays, y ont dépassé pour la première fois les 500 M€ (589 M€ exactement). Elles ont permis à la France de rester le premier fournisseur du pays, devant le Brésil et la Belgique, même si la Chine monte en puissance.
Un récent sondage, commandé par la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux sur la perception des entrepreneurs français vis-à-vis de l’Afrique, confirme leur relative inappétence pour des terres africaines lointaines, en tous sens du terme ; les zones dans lesquelles ils indiquent avoir le plus de facilités à travailler sont l'Afrique francophone et le Maghreb, pour des raisons de proximité géographique, culturelle et linguistique. Ils privilégient par conséquent l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, devant l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale : « La barrière linguistique et les différences de culture, la mainmise sur les anciennes colonies anglaises et portugaises par leurs anciens colonisateurs ou par la Chine, la pauvreté, les difficultés administratives (en particulier dans les pays du Maghreb), les prises de risques financières, en particulier dans les pays hors CFA (communauté financière d’Afrique), avec des difficultés pour se faire payer, la corruption, l’absence de l’État français (qui pénalise les PME), une instabilité politique, les freinent. » 216
Pour autant, les positions, encore bonnes, de notre pays ne sont pas inexpugnables : entre 2005 et 2011, la part de marché de la France a ainsi diminué de 18 % en Côte d’Ivoire, de 6 % au Sénégal et de 8 % au Gabon. Plus préoccupant, ce recul est plus rapide que celui constaté dans le reste de l’Afrique.
Dans les pays de la zone franc, le nombre d’entreprises exportatrices est nettement plus important que dans le reste de l’Afrique subsaharienne. C’est particulièrement vrai au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon qui ont attiré entre 5300 et 5600 entreprises exportatrices en 2012 ; elles sont aussi plus de 4000 à exporter vers le Congo. L’Afrique du Sud et le Nigéria, qui sont les deux principaux clients de la France en Afrique subsaharienne, ne figurent qu’à la 5e et 13e places, avec environ 4300 entreprises exportatrices vers l’Afrique du Sud et moins de 1800 vers le Nigéria. Elles sont quelque 700 à exporter vers le Kenya. On ne s’étonnera pas de savoir que le Nigeria, par exemple, n’attire que modérément les PME françaises, qui peuvent raisonnablement trouver brutal l’environnement des affaires qui y règne, indépendamment des conditions de sécurité qui ont conduit des entreprises autrement plus aguerries à l’international, telles Michelin ou Peugeot, à quitter le pays ou à réduire fortement leur présence.
2. Des positions en revanche généralement faibles en Afrique anglophone et fréquemment en diminution
Pour reprendre les informations que les conseillers des ministres de l’économie et des finances, d’une part 217, et du commerce extérieur, d’autre part 218, ont données à vos rapporteurs, il apparaît tout d'abord que la part de marché des entreprises françaises dans les grands pays anglophones est faible.
a. L’évolution de nos parts de marché : le verre à moitié vide ou à moitié plein
Pour se limiter aux trois pays qui ont été au cœur de cette analyse, on relève ainsi que les entreprises françaises ne détiennent aujourd'hui qu’une part de marché de 3,6 % au Nigéria, de 2,8 % en Afrique du Sud, et de 1,5 % au Kenya. Ainsi, notre pays, 3e fournisseur européen de l'Afrique du Sud, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni, ne se situait-il qu’au 9e rang en 2011 des fournisseurs de la principale puissance économique du continent. Les tableaux présentés ci-dessous illustrent la modestie de notre présence comme partenaire commercial de l'Afrique du Sud 219, la France n’apparaissant plus en 2012 ni dans les principaux clients, ni dans les principaux fournisseurs.
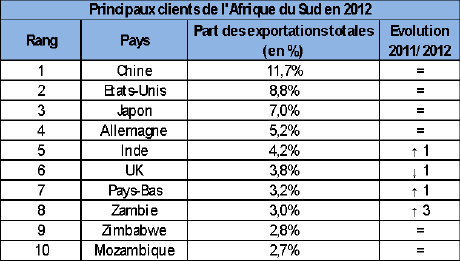
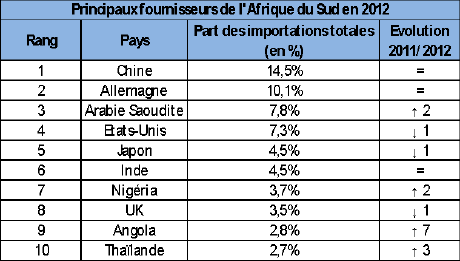
C’est évidemment peu, notamment par comparaison avec la part qu’occupent nos principaux concurrents sur ces mêmes marchés : au Nigeria par exemple, la Chine en détient 18,5 %, les États-Unis 8,2 % et le Royaume-Uni 4,3 %. Au Kenya, l’Inde et la Chine font jeu égal, avec respectivement 17,9 % et 17,6 % des parts de marché, loin devant l’Allemagne, qui se contente de 2,3 %, modestes mais néanmoins nettement mieux que la France. La situation est comparable en Afrique du Sud où la Chine emporte 15,1 % des parts de marché, pour 10,7 % pour l’Allemagne, loin devant la France. En d'autres termes, les positions commerciales de la France ne sont pas bonnes dans les principaux pays émergents africains anglophones.
Comme le montre le tableau ci-dessous, en ce qui concerne les trois principaux pays de l'Afrique anglophone, l’évolution des parts de marché, certes négative, n’est jamais aussi brutale que ce que l’on constate dans les pays francophones, même s’il faut relever que le recul sur la dernière décennie est plus accentué qu’au cours de la précédente dans chacun des trois pays. Ce n’est pas le cas de l’Allemagne ou du Royaume-Uni dont les parts de marché continuent de décroître très sensiblement, mais à un rythme désormais moins élevé.
|
Kenya |
Nigéria |
Afrique du Sud | ||||||
Parts de marché |
1990 |
2000 |
2011 |
1990 |
2000 |
2011 |
1990 |
2000 |
2011 |
France |
5,5 |
3,7 |
1,5 |
10,0 |
7,6 |
3,6 |
3,6 |
3,9 |
2,8 |
Évolution |
|
-1,8 |
-2,1 |
|
-2,4 |
-4,0 |
|
0,3 |
-1,1 |
Allemagne |
8,0 |
3,5 |
2,3 |
13,4 |
7,1 |
3,1 |
19,2 |
12,6 |
10,7 |
Évolution |
|
-4,5 |
-1,2 |
-6,3 |
-4,0 |
|
-6,6 |
-1,9 | |
Royaume-Uni |
16,1 |
8,6 |
3,7 |
16,0 |
10,0 |
4,3 |
12,4 |
8,0 |
4,7 |
Évolution |
|
-7,4 |
-4,9 |
|
-6,0 |
-5,7 |
|
-4,4 |
-3,3 |
États-Unis |
5,0 |
8,1 |
2,9 |
10,2 |
8,8 |
8,2 |
10,9 |
10,7 |
10,7 |
Évolution |
|
3,1 |
-5,2 |
|
-1,3 |
-0,6 |
|
-0,2 |
0,0 |
Parts de marché de la France, de l’Allemagne, du Kenya et des États-Unis au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud, et évolution (en %) 220
Mais la situation est plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord et tout n’est pas négatif : en effet, si les parts de marché de la France reculent, les exportations augmentent en volume. C’est le cas au Nigeria, où elles sont en progression assez rapide : elles ont atteint 1,3 Md€ en 2012 (2e pays en Afrique subsaharienne), et ont doublé depuis 2000. Le déficit de notre balance de paiement tient au poids du pétrole dans ces échanges.
Dans le cas du Kenya, si elles restent modestes, nos exportations progressent également : elles ont atteint 171 M€ en 2011, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente, cependant que nos importations croissaient dans le même temps de près de 14 %. La France n’est que le 15e fournisseur du Kenya, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne notamment. De même, s’agissant de l'Afrique du Sud, notre balance commerciale est en excédent et nos exportations en augmentation constante depuis plusieurs années : 1,32 Md€ en 2009 ; 1,74 Md€ en 2010 et 2,29 Md€ en 2012. Dans le cas d’un pays comme la Tanzanie, notre solde est également positif, mais le volume d’échanges est modeste, de l’ordre de 70 M€ en année normale, hors grand contrat.
Si l’on élargit le regard et que l’on se penche sur quelques autres pays anglophones également prometteurs, on s’aperçoit que la situation n’est pas meilleure, le contraire eut d’ailleurs étonné, dans la mesure où il s’agit de pays plus petits, et par conséquent, moins attractifs pour nos entreprises, et depuis moins longtemps. C’est par exemple le cas du Ghana, avec lequel nous commerçons peu : à mesure que la présence des BRICS se renforce, la nôtre régresse ; nous avons perdu des parts de marché, passant de 4,3 % en 2008 à 2,6 % en 2011, cependant que la Chine en détient 19 %, que l’Inde est à 4,6 % et que l'Afrique du Sud est à égalité avec la France. Notre balance commerciale est devenue déficitaire, compte tenu de nos importations de pétrole, mais nos exportations sont en croissance régulière.
C’est aussi le cas de l’Éthiopie, malgré l’amitié ancienne qui a toujours lié les deux pays, avec laquelle nous avons des échanges modestes : Addis Abeba n’est que notre treizième client en Afrique subsaharienne et onzième fournisseur ; les montants de nos exportations, comme de nos importations, sont faibles : respectivement 81 M€ et 52 M€. Notons que, si une baisse conséquente est intervenue en 2012, la hausse était continue avant cette date : la relation commerciale bilatérale avait quadruplé sur la décennie, nos exportations étant notamment portées par les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques, les produits agroalimentaires, la chimie, les parfums et cosmétiques et les matériels de transport. Quand à nos importations de produits agricoles, elles se concentrent à 95 % sur le café. Avec le Ghana, notre 5ème client et notre 3ème fournisseur parmi les membres de la CEDEAO, nos échanges se caractérisent par une croissance modérée de nos exportations.
b. Quelques caractéristiques de nos exportations vers l’Afrique anglophone
Si l’on regarde quels sont les principaux postes sur lesquels se concentre l’essentiel de nos exportations, on relève quelques constantes 221.
S’agissant du Kenya, les principales exportations portent sur les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les cosmétiques, l’agroalimentaire. Nos importations sont à 97 %, des produits agricoles ou provenant de l’industrie agroalimentaire, ce qui met en relief la faible diversité de l’offre de notre partenaire. Compte tenu des perspectives de développement de ce pays, la France ne peut que renforcer ses positions qui la placent actuellement au 15e rang de ses fournisseurs et au 22e rang de ses clients. Quoi qu’il en soit, selon le ministère du commerce extérieur, les perspectives à court terme restent modestes : en 2017, nos exportations pourraient dépasser les 300 M€ et approcher les 400 M€ en 2022.
S’il est un partenaire commercial majeur en Afrique subsaharienne pour notre pays, avec des échanges qui dépassent les 5 Mds€, le Nigeria n’est que le 46e client de la France, et nos importations portent presque exclusivement, à 90 %, sur un seul produit : le pétrole brut. Nos exportations (1,3 Md€ en 2012) reculent de 9 % par rapport à 2011. Ce recul est principalement imputable à la chute des ventes d’équipements de télécommunications ainsi qu’à nos exportations de machines industrielles, qui consistent essentiellement en biens d'équipement mécaniques, électriques et électroniques, en machines industrielles et agricoles, en produits pharmaceutiques, matériel de transport, produits agro-alimentaires (vins et spiritueux), etc., ainsi qu’en produits pétroliers raffinés, dans la mesure où, comme on l’a souligné plus haut, le Nigéria ne dispose pas des capacités de raffinage idoines. En contrepartie, nous avons importé pour plus de 3,7 Mds€ en 2012, contre 4,3 Mds€ l’année précédente. Pour le ministère du commerce extérieur, les perspectives sont telles que la France devrait exporter pour 1,8 Md€ en 2017 et 2,3 Md€ en 2022.
En ce qui concerne l'Afrique du Sud, la situation n’est pas forcément négative. C’est tout d'abord notre premier partenaire commercial en Afrique subsaharienne, notre premier client devant le Nigeria et le Sénégal, et notre cinquième fournisseur, derrière le Nigeria, le Ghana, l’Angola et le Congo. Malgré la baisse continue de nos parts de marché, l'Afrique du Sud se montre préoccupée par la détérioration de la balance commerciale bilatérale et souhaite vivement réduire ce fossé 222. De fait, notre excédent, supérieur à 1,3 Md€ en 2011, était dû à un contrat portant sur la vente d’Airbus ; il est néanmoins resté supérieur à 1 Md€ en 2012. Les grands contrats restent un pôle majeur de la relation commerciale entre nos pays : Airbus est en négociation pour de nouvelles acquisitions par la South African Airways et, en marge de la visite du Président de la République, Alstom, à la tête d’un consortium franco-sud-africain, vient de finaliser un contrat de près de 5 Mds€ pour l’équipement de trains de banlieue : la fourniture de quelque 600 trains 223, représentant quelque 3600 wagons, entre 2015 et 2025 et leur maintenance pendant 18 ans, représente le plus gros contrat de l’histoire de l’entreprise. Le secteur des transports se révèle donc essentiel dans la structure de nos exportations, et permet des excédents exceptionnels, même si ce sont les équipements mécaniques, électriques et informatiques qui constituent notre premier poste d’exportation, avec 30 % du total en moyenne, devant les produits chimiques, parfums et cosmétiques, qui représentent le troisième poste. Les secteurs de la communication et de l’agroalimentaire viennent ensuite, même s’ils portent sur des volumes encore faibles. Nos exportations ne représentent toutefois aujourd'hui que 0,4 % des exportations françaises totales, ce qui situe l'Afrique du Sud au même niveau dans notre commerce extérieur que l’Égypte ou Taïwan. Inversement, les exportations sud-africaines vers la France ne représentent que 0,2 % de nos importations totales. Selon les projections du ministère du commerce extérieur, nos exportations devraient continuer de croître pour atteindre 2,1 Mds€ en 2017 et 2,5 Mds€ en 2022. Cela étant, sur le court terme, les perspectives sont moins optimistes, compte tenu des prévisions de croissance de l'Afrique du Sud revues à la baisse par le FMI pour cette année 2013. En outre, le fort contenu local, de l’ordre des deux-tiers, désormais exigé par les autorités sud-africaines, devrait peser sur l’entraînement que les grands projets d’infrastructures peuvent avoir sur les exportations françaises : à titre d’exemple, 65% des trains du contrat d’Alstom seront fabriqués en Afrique du Sud, l’entreprise s'étant engagée à créer une usine dans la banlieue de Johannesburg pour cela, les vingt premiers trains étant par ailleurs construits au Brésil, en attendant la mise en service de l’usine. Il faut cependant souligner que ce contrat ne porte que sur la moitié du renouvellement du parc, puisque, au total, ce sont plus de 7200 wagons qui devront être changés. Le positionnement de l’entreprise française sur ce premier volet lui permet par conséquent d’envisager les futures étapes avec optimisme.
Si l’on se penche sur d’autres pays, les comparaisons produisent des conclusions à peu près identiques : ainsi, de la Tanzanie, avec laquelle nos échanges sont modestes où nos exportations sont concentrées sur les secteurs des produits pharmaceutiques, les biens d’équipement mécaniques, électriques, électroniques et informatiques, ainsi que sur les biens de consommation, cependant que nous en importons des produits agricoles et agro-alimentaires, des métaux précieux, des produits manufacturés, à base de ciment, d’acier, de fer ou de plastique.
B. LA FAIBLESSE DES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS
1. Vue d’ensemble sur des IDE encore modestes et concentrés
Si notre commerce extérieur est souvent porté par de grands contrats et de ce fait relativement concentré sur un certain nombre de secteurs, les investissements français présentent de leur côté des similitudes.
Ainsi, comme le relèvent les responsables du CIAN 224, il y a encore relativement peu d’IDE français en Afrique anglophone, pour des raisons en partie historiques, dans la mesure où il était évidemment plus facile aux entreprises françaises de s’implanter en Afrique francophone. Mais les choses commencent à changer et un certain nombre de pays, comme le Nigéria, le Ghana, la Tanzanie, le Kenya et l’Éthiopie, sont aujourd'hui considérés comme intéressants par les investisseurs. Sur la dernière période, on y constate un dynamisme des affaires que l’Afrique francophone n’a plus forcément. L’amélioration des conditions générales de gouvernance, d’environnement des affaires, est perçue par le CIAN comme généralement meilleure que dans la plupart des pays d’Afrique francophone. Ce sont autant de facteurs qui contribuent à atténuer les barrières initiales, linguistiques ou culturelles, et qui peuvent avoir un impact sur les projets. À titre d’exemple, l'Afrique du Sud figure au 39e rang du classement 2013 Doing Business de la Banque mondiale, à peine derrière la France, 34e 225. C’est pourquoi, si les IDE français vers l’Afrique francophone stagnent, ce qui est compréhensible eu égard à l’ancienneté de leur implantation et à la difficulté de faire plus, ceux en direction des nouvelles destinations anglophones ont désormais tendance à augmenter. Mais ils restent concentrés sur le pétrole. A l’exception de Total et Areva, la France est à peu près absente du secteur minier et des matières premières en Afrique anglophone.
Les principaux investissements français se trouvent être les domaines agricole et industriel, la santé, avec l’industrie pharmaceutique, ainsi que les services aux municipalités, dans lesquels les entreprises françaises ont un savoir-faire valorisé en matière de traitement des eaux, des déchets, etc. Si les grandes entreprises françaises sont relativement à leur aise dans ces pays et sur les créneaux dans lesquelles elles sont reconnues, les choses sont en revanche plus difficiles pour les PME et les PMI, compte tenu de la faiblesse et aux capacités de notre tissu, de nos méthodes, par comparaison avec celles des entreprises allemandes qui sont considérées ici comme « chassant en meute » avec leur efficacité coutumière… Même si l’ambassadrice d’Allemagne au Kenya disait à vos rapporteurs que ce n’était les grandes entreprises qui venaient sur le marché kenyan, mais plutôt les PME-PMI spécialisées sur des créneaux précis. 226
À titre de comparaison générale, quelques indices sur les intérêts de nos concurrents sont intéressants. Ainsi, sur la période 2001-2007, la Chine a-t-elle consacré le tiers de ses IDE africains au Nigeria et le dixième à l’Éthiopie. Elle ne détient pour l’heure que 3,7 % du stock d’IDE en Afrique du Sud mais monte fortement en puissance puisqu’elle est désormais au 6e rang des investisseurs étrangers, alors qu’elle n’était qu’au 25e rang en 2007. Beijing diversifie ses IDE dans de très nombreux secteurs : le BTP, les télécoms, l’automobile, les transports et les mines, mais aussi les secteurs financiers ou l’énergie. De son côté, l’Inde privilégie toujours la Tanzanie et le Kenya, pour des raisons historiques qui tiennent principalement à l’implantation de sa diaspora sur le continent. Ses principaux groupes industriels, Tata, Arcelor Mittal ou Aditya sont présents et se développent aussi fortement en Afrique du Sud, que ce soit dans la pétrochimie, l’acier, l’énergie ou le pétrole, tout comme la pharmacie ou les biens de consommation.
Les investisseurs britanniques en Afrique anglophone interviennent dans le secteur des infrastructures, des industries de consommation qui se développent concomitamment à l’émergence des classes moyennes, c'est-à-dire les télécoms, les services financiers, la distribution ou les produits manufacturés. Ainsi, Vodafone détient-il aujourd'hui 40 % du marché kenyan de la téléphonie mobile via sa filiale SafariCom ; il développe une stratégie régionale qui lui a permis de capter plus de 4 millions de clients en RDC. Le secteur bancaire britannique est aussi très présent : Absa, implantée dans dix pays africains, est la filiale sud-africaine de Barclays. Par ce biais elle réalise sur le continent un chiffre d’affaires équivalent à celui de son groupe en Europe. Plus du tiers des dépôts en Afrique du Sud et dans quelques pays d’Afrique australe sont, de fait, gérés par des institutions financières du Royaume-Uni.
Enfin, l’Italie est également un partenaire important de l’Afrique subsaharienne. La diaspora en Afrique du Sud est la cinquième communauté italienne du monde et un réseau important de PME-PMI italo-sud-africaines existe. L’Afrique australe représente à peu près la moitié des échanges commerciaux de l’Italie avec le continent, les principaux pays concernés étant l'Afrique du Sud puis le Nigeria. Le Kenya est également un pays fortement privilégié par les entrepreneurs italiens qui y voient sans surprise une tête de pont technologique en Afrique. Cela étant, les IDE italiens se trouvent essentiellement en Afrique du Sud mais, pour le reste, ils sont peu élevés, n’étaient les opérations dans le domaine de l’énergie et des infrastructures, avec la présence de l’ENI et de CMC.
2. Coup de projecteur sur les investissements français
a. Les investissements français en Afrique du Sud
Pour près des deux-tiers, les investissements français en Afrique du Sud sont encore réalisés dans le secteur industriel, - l’aéronautique ou l’automobile -, les mines, la pharmacie, le pétrole et la chimie, l’électronique, les équipements électriques, les matériaux de construction et le BTP, ou encore dans les services, hôtellerie, ingénierie, services financiers, média, télécommunications ou transports urbains. Dans l’ensemble, les investissements français en Afrique du Sud sont assez peu en phase avec les quatre axes prioritaires récemment définis dans la stratégie élaborée par le ministère du commerce extérieur 227.
Logiquement, on retrouve donc les plus grands groupes français : 29 sociétés du CAC40 sont présentes. Ainsi Total, présent depuis 1954, qui est le cinquième distributeur pétrolier du pays, grâce aux 528 stations-service qu’il détient, ce qui représente son plus important réseau hors d’Europe ; le groupe est également distributeur de GPL, exportateur de charbon et il vient d’annoncer 228 avoir obtenu l’accord des autorités sud-africaines pour l’acquisition d’une participation de 50 % d’un permis de prospection en off-shore dans le bassin de l’Outeniqua, à environ 175 km au sud des côtes sud-africaines, étendu sur une superficie de 19 000 kilomètres carrés, par des profondeurs d’eau de 200 à 1 800 mètres. Le groupe intervient aussi dans les mines. Areva est présent dans le nucléaire, depuis la production d’uranium jusqu’à l’ingénierie et la maintenance des centrales locales ; EDF, présent en Afrique du Sud depuis 1978, est depuis longtemps à ses côtés sur ce créneau. Dans la pharmacie, Sanofi-Aventis, qui dispose en Afrique du Sud depuis 2006 d’un site devenu une plateforme mondiale de recherche, de production et de distribution de traitements antituberculeux ; cette unité sud-africaine de Sanofi, qui produit 350 millions de comprimés par an, détient 95 % du marché dans le pays et exporte sur l’ensemble du continent, ainsi qu’en Amérique latine et en Asie ; elle produit également 12 millions de paquets antirétroviraux par an. On relève aussi la présence de Ceva, Virbac, Merial, dans ce secteur. Air Liquide est implanté en Afrique du Sud depuis 1948, dans le secteur des gaz industriels et médicaux. Les turbines et générateurs d’Alstom, en Afrique du Sud depuis un siècle, équipent les trois-quarts des centrales électriques de l’opérateur national, Eksom. Avec d’autres, Schneider Electric est sur le secteur des équipements électriques, comme Alcatel-Lucent et Thalès sont présents parmi les entreprises qui ont investi dans le secteur électronique sud-africain. Le secteur des matériaux de construction intéresse Saint Gobain, Lafarge, Colas, le BTP, Bouygues, qui a travaillé sur la ligne de chemin de fer du Gautrain en 2010 et intervient aujourd'hui sur la réhabilitation de tronçons routiers ; Dura Solétanche-Bachy, Vinci, la Sogea ou Spie. Renault, suivi de divers équipementiers (Faurecia, Valeo, Inergy, Plastic Omnium Capag), est présent dans la construction automobile. L’Oréal dans son secteur, ainsi que Danone, en agroalimentaire, comme Turbomeca et Eurocopter en aéronautique ou encore Bic, Essilor, Zodiac, dans les biens de consommation, sont également sur place. A noter aussi qu’un certain nombre de ces groupes ont parfois des activités mondiales depuis leur base sud-africaine,
Une évolution commence à être notée avec la progression des IDE dans les services, notamment les services financiers, les assurances, l’hôtellerie, avec Accor et Sodexo, les transports urbains (RATP), la logistique (Bolloré, AGS, Geopost), l’eau et l’environnement, avec Suez et Veolia, les télécommunications (Orange), le secteur des medias, de la publicité du marketing et de la communication intéresse des groupes comme Lagardère, Publicis, Ipsos, Decaux, entre autres. Selon la Banque de France, les services attiraient en 2009 plus du quart des IDE français.
La présence des entreprises françaises, encore modérée, n’augmente que très lentement sur les dernières années. Elle est relativement récente puisque, mises à part les exceptions que représentent les grands groupes qu’on a cités, elle remonte pour l’essentiel à l’après-apartheid, à compter de 1994 : c’est le cas de 79 % des implantations, plus du quart des entreprises françaises, résultant de la création de filiales ou du rachat de sociétés locales, s’étant même installées au cours des cinq dernières années, traduisant l’attractivité actuelle du pays pour les investisseurs, et au-delà, de la région australe. Selon les données communiquées par le service économique régional, basé à Pretoria, elles sont aujourd'hui 277 et emploient plus de 28 000 personnes 229. Elles sont néanmoins assez fortement concentrées, puisque dix groupes seulement regroupent près de la moitié des emplois concernés. Une comptabilisation plus large, intégrant les participations minoritaires, permet de chiffrer à 380 le nombre de sociétés en lien avec des entreprises françaises. L'Afrique du Sud accueille près de 9 % de l’ensemble des filiales françaises dans les BRICS.
En outre, le volume des IDE français en Afrique du Sud est en progression constante, puisqu’il a été multiplié par quatre en une décennie, pour atteindre aujourd'hui quelque 1800 M€. Pour autant, la part de notre pays est assez faible : la France est au neuvième rang des investisseurs étrangers, loin derrière le Royaume-Uni qui détient 45 % du stock des IDE et les Pays-Bas (18 %) ; les Etats-Unis (7,6 %), l’Allemagne (5 %), la Suisse, la Chine, qui a multiplié par 70 son stock d’IDE en quelques années, le Japon, la Malaisie ou le Luxembourg, sont également mieux positionnés. La France ne détenait que 0,9 % du stock contre 1,2 % en 2009. En d'autres termes, si les volumes augmentent, le poids tend à diminuer.
C'est la raison pour laquelle Henri de Villeneuve 230, représentant du MEDEF international en Afrique du Sud et conseiller du commerce extérieur, juge la présence française en Afrique du Sud très faible et tend même à considérer que depuis 2001 le nombre d’entreprises implantées dans le pays stagne. La raison principale tiendrait à la frilosité des entrepreneurs eux-mêmes, très attentistes, et dont la perception des risques de la région – la criante d’un scénario du type Zimbabwe, le sida, le risque sécuritaire – est très négative. Les exigences sud-africaines liées au BEE (Black Economic Empowerment), à la responsabilité sociale des entreprises, seraient en outre vécues par les investisseurs comme des contraintes particulières à l'Afrique du Sud.
b. Regard sur les investissements dans les autres pré-émergents anglophones
Au Nigeria, la présence française est plus que centenaire, puisque la Compagnie française d’Afrique occidentale, CFAO, s’y est installée dès 1902. Le stock d’investissements français y aujourd'hui assez important. Plus de 100 entreprises de notre pays sont présentes et il s’agit désormais d’un marché où elles ont su s’implanter avec un succès durable.
Sans surprise, Total joue un rôle majeur dans les secteurs pétrolier et gazier. Le Nigeria fournit au groupe 12 % de sa production mondiale et représente 10 % de sa capitalisation boursière. Total investit dans le pays entre 1 et 2 Mds$ par an et emploie 3300 personnes. S’il est le troisième producteur nigérian, derrière Shell et Exxon Mobil, Total est cependant le premier distributeur du pays, avec un réseau représentant près de 15 % du marché national. Dans son sillage, d’autres acteurs du secteur parapétrolier sont présents, tels Technip, Vallourec, Ponticelli.
Dans les secteurs productifs, certains groupes ont dû réduire leurs activités. Ainsi en est-il de Michelin qui s’est séparé de son usine de fabrication de pneus de Port-Harcourt, ou de Peugeot : dans son usine de Kaduna, qui était alors sa plus importante chaine d’assemblage en Afrique subsaharienne, elle produisait au début des années 1980 près de 100 000 véhicules tant pour l’exportation que pour le marché nigérian qui, à l’époque, était le premier marché de Peugeot à l'exportation ; « Peugeot avait même bâti un pont aérien pour alimenter l'usine en pièces mécaniques : deux fois par semaine, un 747 Jumbo d'UTA décollait de Lyon à destination de Kaduna. » 231 D’autres groupes importants sont présents tels Lafarge, devenu les deuxième producteur de ciment du pays, avec 40 % du marché derrière le groupe nigérian Dangote, premier industriel africain. À l’instar de Total, qui prévoit d’investir 15 Md$ dans l’exploitation off-shore, le groupe a de fortes ambitions dans le pays, avec la perspective de doubler la capacité de production de son usine de Calabar. Schneider Electric est sur une tendance comparable. Des groupes intervenant dans le développement des infrastructures, Bouygues, Eiffage, Alstom, Areva, entre autres, sont sur place, comme les acteurs du secteur des télécommunications Alcatel et SAGEM, respectivement actifs dans la téléphonie et dans la réalisation des cartes d’identité nationales sécurisées. Le secteur des services avec SDV-Bolloré, Accor, Sodexho ou Air France, premier transporteur aérien pour les liaisons internationales ; la compagnie nationale assure le tiers des liaisons avec l’Europe en partenariat avec KLM et Alitalia, occupe aussi une place conséquente parmi les IDE français au Nigeria.
Au total, les entreprises françaises ont investi fortement pour représenter un stock de quelque 5,9 Md€ aujourd’hui, soit plus que dans tout le reste de l’Afrique occidentale, et notre pays apparaît au deuxième rang en termes d’IDE, juste derrière les États-Unis et devant la Grande-Bretagne. Le stock d’IDE français au Nigeria représente entre 8 % et 12 % du total des IDE dans le pays ; le flux est de quelque 1,7 Md€, ce qui en fait notre première destination africaine.
Au Kenya, second des pays visités par vos rapporteurs, le stock des IDE détenus par les entreprises françaises atteignait quelque 200 M€ en 2010. On y trouve de manière classique la présence de grands groupes français, dans les secteurs classiques : Lafarge, Total, Orange, Bolloré Africa, notamment. Les secteurs du transport et de la logistique sont concernés, avec AGS, Air France KLM, Air France Cargo, de la distribution (CFAO), de la pharmacie (Sanofi Aventis) et des équipements de télécommunications (Alcaltel-Lucent, Camusat, Sagem Communication, Thalès). Leurs investissements se traduisent parfois par des prises de participation ou de contrôle, comme celle de l’opérateur public historique Telkom Kenya par Orange, à hauteur de 51 %, ou la reprise du réseau de distribution pétrolière de Chevron par Total. Certaines entreprises se développent aussi dans le secteur de l’horticulture : Bigot-Fleurs, Meilland, ou encore Red Lands Roses, dont vos rapporteurs ont visité les installations.
Par rapport à d’autres destinations, le Kenya présente aussi l’avantage, de disposer d’installations logistiques de qualité. On a vu plus haut ses ambitions régionales, sinon continentales, en matière de TIC. Il faut rappeler que, sur le plan des infrastructures de transports ou de ses réseaux bancaires, le Kenya est déjà remarquablement positionné : ainsi, Kenya Airways relie-t-elle Nairobi à 46 destinations africaines différentes, une fois par semaine au moins, voire, pour certaines, plusieurs fois par jour. De sorte que les entreprises françaises sont aussi intéressées à y installer leur représentation régionale : c’est le cas de sociétés comme Danone, Alcatel, Alstom Grid, Sanofi, Veritas, Ceva Santé animale, Thalès, Michelin, Sagem, ou Egis groupe.
L’intérêt du Kenya pour les entreprises étrangères, et notamment françaises, ne réside pas seulement dans les opportunités liées à son taux de croissance actuel et à la montée de sa classe moyenne - qui amènent Pernod Ricard et L’Oréal à y investir aujourd'hui - mais tient aussi aux infrastructures tels que le port de Mombasa, demain celui de Lamu, qui constituent des voies d’entrée sur toute l’Afrique de l’Est. Le Kenya se présente comme un « hub » économique régional intéressant pour nos entreprises, indépendamment de son poids au sein de l’East African Community (EAC).
c. Quelques données sur d’autres destinations
On retrouve les mêmes grands groupes français sur le terrain économique éthiopien : le stock d’IDE détenu par les entreprises françaises est supérieur à 100 M€ ; deux secteurs de concentration dominent : la distribution de produits pétroliers, avec Total, et la viticulture, avec le groupe Castel. Selon les indications qui ont été données à vos rapporteurs, La France se place parmi les principaux investisseurs européens, derrière le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas. Outre Castel et Total, Alstom, Vergnet, Orange, Bolloré, Oberthur, sont également présents.
Les positions françaises au Ghana ont évolué ces dernières années à la faveur de la crise politique ivoirienne : des entreprises installées à Abidjan à s’y sont déplacées et ont profitées des perspectives offertes par la croissance du pays lui-même. On compte aujourd'hui une soixantaine d’entreprises françaises au Ghana, dont, sans surprise, nombre de filiales de grands groupes : Bolloré, CMA-CGM, CFAO, Société Générale, Total, Accor, Air Liquide, Alcatel, Gras Savoye etc. Elles côtoient une quarantaine d’entreprises locales, détenues par des capitaux français.
Ces mêmes grandes entreprises sont installées en Tanzanie, attirées par les perspectives que le pays offre, et qui suscitent aussi l’intérêt d’autres groupes. En matière d’hydrocarbures, de mines, la Tanzanie est en effet particulièrement attrayante : le pays est le 8ème producteur mondial d’uranium ; avec des réserves évaluées à 200 millions de tonnes, il sera prochainement le 7ème producteur de nickel au monde et possède certaines des plus hautes concentrations de terres rares au monde. Les découvertes de gaz en offshore sont également exceptionnelles et suscitent les convoitises de nombreux concurrents, chinois, indiens, russes, japonais, coréens.
Une vingtaine de filiales sont aujourd'hui présentes sur des secteurs particulièrement prometteurs : Maurel & Prom poursuit ses investissements d’année en année et exploite aujourd'hui l’un des deux gisements gaziers on-shore du pays, dans le champ de Mnazi Bay ; Total a récemment obtenu un permis d’exploration dans la partie Nord du lac Tanganyika ; Lafarge est devenu l’actionnaire majoritaire de l’entreprise tanzanienne Mbeya Cement ; CFAO a ouvert en 2008 le plus grand garage d’Afrique de l’Est ; Bolloré, intervient notamment dans la logistique portuaire et dispose d’un terminal lacustre à Kigoma ; le groupe a également investi en 2009 dans un port sec – Inland Container Deposit – pour décongestionner celui de Dar es Salam ; CMA-CGM, est actif dans le transport maritime et est aujourd'hui la seule compagnie du pays à offrir des liaisons régulières entre les quatre ports principaux du pays. Elle envisage d’ouvrir une cinquième ligne pour desservir l’île de Pemba dans l’archipel de Zanzibar. Alstom, Degrémont, Vinci, (construction), Veritas (certification) ou Morpho-Safran (biométrie), sont également présents.
3. Au fondement du constat, l’inadaptation aux marchés ?
Il importe d’analyser ce qui explique la faible position de la France, son recul en matière commerciale, ainsi que notre positionnement modeste en matière d’investissements. Spontanément, on pourrait penser que la conjoncture africaine devrait aujourd'hui nous permettre de renforcer nos parts de marché et notre présence sur place. Or, comme le rappelait Jean-Michel Severino, notre pays perd en fait 1 % de parts de marché par an en Afrique, alors que, dans le même temps, les importations de l'Afrique augmentent de 10 %. Cette situation est d’autant plus regrettable que 1 Md€ de commerce extérieur représente pour notre pays 10 000 emplois. Ce qui vaut sur ce plan pour l'Afrique francophone vaut aussi pour l'Afrique anglophone.
Pour Jean-Michel Severino, membre de la mission de réflexion sur la rénovation de la relation économique bilatérale entre la France et l’Afrique, instituée en avril dernier par le ministre de l’économie et des finances 232, l’évolution de nos positions tient d’abord au fait que notre offre n’est pas adaptée au marché africain d’aujourd'hui. À grands traits, ce qui reste aujourd'hui comme points forts se résume au BTP et aux grands équipementiers. Or, ces secteurs sont en concurrence frontale avec la Chine contre laquelle ils peuvent difficilement lutter, d’autant que celle-ci intervient aujourd'hui sur ces marchés avec des machines-outils performantes et bien moins onéreuses. Il est par exemple illusoire de penser que la France peut être compétitive sur le créneau des infrastructures routières. Certains interlocuteurs rencontrés lors des déplacements l’ont confirmé, mentionnant l’importance de l’activité chinoise au Kenya sur ce secteur spécifique, comme en matière ferroviaire ; cette concurrence étant de plus déloyale dans la mesure où les normes ne sont pas respectées. En plus de la concurrence chinoise, apparaît une concurrence africaine avec laquelle il faut aussi compter. Ainsi, lorsqu’Alcatel intervient aujourd'hui en Afrique pour installer des centraux téléphoniques, c’est via sa filiale chinoise ; en matière de turbines, la même comparaison peut être faite… S’agissant du BTP, il n’y a guère que le haut de gamme, qui ne représente que 1 % du secteur, sur lequel les entreprises françaises restent leaders.
Il serait donc aujourd'hui essentiel pour la France de se concentrer sur les secteurs où elle a conservé un avantage déterminant, tels que l’aviation, avec Airbus, les transports avec Alstom, comme on l’a vu en Afrique du Sud, ou la construction navale, - le contrat récemment signé avec le Mozambique, par exemple, prouve que la croissance africaine crée de l’emploi en France, ce dont il ne saurait être question de se priver compte tenu de la conjoncture atone 233. De même en est-il de l’agroalimentaire, niche classique sur les marchés de consommation, qui représente 80 % de l’emploi industriel en France. Pour Jean-Michel Severino, la montée des classes moyennes va inévitablement faire exploser ce secteur. Il est donc indispensable de prendre date dès aujourd'hui pour considérer le marché africain à échéance de 20-30 ans, et de renforcer nos positions dans les secteurs sur lesquels les entreprises françaises sont déjà bien placées.
En l’état actuel des choses, on peut craindre que la France soit mal partie pour profiter pleinement du décollage de l’Afrique et qu’elle rate encore plus particulièrement le redémarrage de l’Afrique anglophone. Un peu présente en Afrique du Sud et au Nigéria, elle est en grande partie absente d’Afrique de l’Est, alors que la région Kenya-Ouganda-Tanzanie-Éthiopie est l’une des grandes zones de demain, et devrait être considérée comme prioritaire. Cela étant, d’autres facteurs jouent également un rôle important dans l’évolution de nos positions africaines, sur lesquelles on doit porter un regard attentif. Il est donc indispensable que l'Afrique anglophone, en premier lieu les pays pré-émergents, soient au cœur de nos priorités africaines.
II. FAIRE DE L’AFRIQUE ANGLOPHONE UNE PRIORITÉ : LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Globalement, la présence de la France en Afrique anglophone n’est pas particulièrement bonne ni, surtout, bien assurée pour l’avenir. Cela justifie en conséquence que l’on s’interroge sur les raisons de cet état de fait et que l’on propose quelques pistes de réflexion.
A. RECENTRER NOS DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Tout se passe comme si la situation présente résultait d’un certain manque d’ambition, d’intérêt ou de moyens, peut-être un peu de tout cela. Il est à espérer que les révisions de nos dispositifs de commerce extérieur et l’accent porté par le MAEE sur les exigences de la diplomatie économique, portent leurs fruits, non seulement sur les zones traditionnelles d’exportation et d’implantation de nos entreprises, mais aussi, sur ces nouvelles destinations que sont les pays émergents ou pré-émergents, d’Afrique et notamment d’Afrique anglophone.
1. La discrétion de nos instruments en Afrique anglophone
La situation suppose aussi que le secteur privé prenne conscience des enjeux. Nombreux sont les interlocuteurs rencontrés, Jean-Michel Severino entre autres, qui ont souligné que nombre d’entreprises s’étaient retirées dans les années 1980 et 1990. C’est une période au cours de laquelle l’accent a été mis sur les investissements en Europe de l’Est, sur l’Asie bien sûr, un peu sur l’Amérique latine. Le retour en Afrique, à partir des années 2000, ne s’est pas réalisé dans de bonnes conditions, d’autant que le secteur bancaire français avait entretemps décidé de se retirer totalement du continent, le considérant trop risqué. Une stratégie trop centrée depuis toujours sur l'Afrique francophone a conduit au manque d’une vision panafricaine qui aurait permis une approche plus globale et dynamique. Cette question particulière, parmi d’autres, mérite qu’on s’y arrête. C’est l’une des raisons pour lesquelles, malheureusement, la France est en train de rater le décollage de l’Afrique anglophone, sauf au Nigeria et en Afrique du Sud. Pour Jean-Michel Severino, les autres pays sont sans doute déjà hors de portée de nos opérateurs économiques, alors que s’y trouvent les marchés de demain. Cela suppose aussi une démarche déterminée en direction de ces pays. Or, si l'Afrique francophone est toujours un terrain naturellement plus facile pour nous que l'Afrique anglophone, nos mécanismes de soutien commercial extérieur ont diminué dans les années 1980 et 1990. Ils font aujourd'hui défaut.
a. L’incidence de la désertion des banques françaises
Il y a quelques années, en effet, la présence bancaire de la France en Afrique était forte. Avec la Société générale, la BNP ou le Crédit agricole, elle détenait aussi une partie du capital de la Bank of Africa. Aujourd’hui, la BNP a disparu du paysage, comme le Crédit agricole, qui a quitté l’Afrique du Sud en 2011 après 60 ans de présence ! En parallèle, la BoA a été rachetée par la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) et la Société générale a considérablement réduit sa surface africaine au point de n’avoir plus les moyens de son expansion régionale. Le seul grand réseau francophone restant est l’Ecobank, panafricain, qui rayonne aujourd'hui sur plus de 33 pays d’Afrique subsaharienne, depuis le Togo, mais qui devrait passer prochainement sous contrôle anglo-saxon ou chinois. À l’inverse, les États-Unis et le Royaume-Uni, conservent une forte présence bancaire en Afrique, via par exemple la banque HSBC. La nature ayant horreur du vide, d’autres réseaux bancaires ont évidemment profité du départ des institutions françaises pour se développer, comme la BMCE ou l’Ecobank, ainsi que les réseaux sud-africains, que les Chinois n’ont pas laissé seuls, en entrant par exemple à hauteur de 25 % dans le capital de la Standard Bank. La France n’est alliée stratégiquement à aucun d’entre eux.
Aujourd'hui, les banques françaises sont, au mieux, marginalisées, au pire absentes de leur propre fait. Consécutivement, nos entreprises manquent de soutien financier national dans leur développement africain : le fait qu’il n’y ait pas une seule banque française au Kenya est un facteur qui pèse lourd dans leur possibilité d’expansion. Pour le directeur général de Proparco 234, filiale secteur privé de l'AFD, on est ici au cœur de la problématique de la faible présence des entreprises françaises en Afrique et de leurs difficultés à y travailler dans des conditions optimales.
Comme le faisait justement remarquer Jean-Michel Severino, compte tenu de notre positionnement historique en Afrique, la place financière de référence devrait être Paris, mais c’est bien sûr Londres ou Johannesburg, voire Casablanca. Demain, ce sera aussi Lagos. La Société générale, la seule à avoir maintenu un petit dispositif, est ainsi bien modeste dans un pays comme le Ghana. Cette absence de grand réseau financier français, capable d’accompagner et de soutenir nos entreprises sur place, pose tout particulièrement problème pour les PME-PMI : à l’inverse des pratiques traditionnelles des entreprises allemandes avec leurs sous-traitants, elles ne sont pas portées par les grands groupes. Souhaitent-elles investir en Afrique, francophone ou anglophone, qu’elles sont d’entrée de jeu défavorisées par rapport aux compétiteurs britanniques. Ajouté à des environnements parfois démotivants et coûteux, ce facteur ne peut que peser négativement sur notre capacité à tirer profit de la croissance africaine.
b. Des mécanismes de soutien suffisamment présents ?
Dans le même esprit, nos instruments de soutien au commerce extérieur ne semblent pas suffisamment implantés dans les pays anglophones, si on les compare à ceux mis en place par nos concurrents européens. Si la diplomatie économique, aujourd'hui réévaluée, n’est pas chose nouvelle, dans la mesure où le ministère des affaires étrangères a toujours eu à accompagner les grands contrats qui supposent des accords internationaux, comme en matière d’armements ou de nucléaire, la structure de notre dispositif de soutien sur le terrain a longtemps été faible, que ce soit au niveau du pilotage des ambassadeurs, ou au niveau de l’appareil commercial public, que d’aucuns jugent avoir été démantelé. La couverture de cette zone spécifique de l’Afrique pose donc problème. Dans le cadre de cette étude, il n’appartient pas à vos rapporteurs d’analyser en détail les forces et faiblesses des divers acteurs ; mais, leurs interlocuteurs, de tous horizons, se sont livrés à une telle critique des mécanismes existant et ont été si nombreux et concordants dans leurs propos qu’on ne peut que les soumettre à la réflexion.
En premier lieu, la faiblesse d’UbiFrance en Afrique est relevée par la plupart des intéressés, avec un réseau composé, en tout et pour tout, de cinq bureaux en Afrique subsaharienne. Alors que certains estiment sa présence inutile en Afrique francophone là où, pourtant, elle se développe, elle est très limitée en Afrique anglophone. Ce n’est par exemple qu’en septembre dernier qu’une délégation de service publique d’UbiFrance a été inaugurée au Nigeria par Nicole Bricq, ministre de commerce extérieur, lors de sa visite. C’est le bureau de Côte d'Ivoire est compétent pour couvrir le Ghana. Celui de Johannesburg est le premier à avoir été ouvert en Afrique anglophone, avec une compétence régionale sur l’Ile Maurice, étendue à partir de cette année au Mozambique. Enfin, un bureau vient d’ouvrir à Nairobi, opérationnel depuis le 1er septembre dernier, avec une compétence régionale sur l’Ouganda et la Tanzanie.
On ne peut que se réjouir de ces ouvertures mais on conviendra que le dispositif sur l'Afrique anglophone est encore faible. Le dispositif en direction des pré-émergents reste modeste alors qu’il est objectivement plus dense sur l'Afrique francophone. La situation du bureau sud-africain reflète ce retard : nous n’avons pas de service économique au Mozambique, qui pèsera demain bien plus lourd que le Qatar, comme les autres pays riverains de l’océan. Pendant ce temps, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, le Portugal et d’autres encore, sont déjà présents en masse. Cette faiblesse est la conséquence d’un dispositif réorienté ces dernières années vers les grands émergents et vers les pays de l'OCDE. Il a permis d’accompagner les entreprises à l’export mais a aussi contribué à laisser le reste du monde en déshérence. Sans doute serait-il aujourd'hui avisé de réfléchir au dimensionnement du dispositif pour une répartition optimale des moyens dans des géographies nouvelles et à l’évidence porteuses, à l’instar de ce que font notamment les autres pays européens, nettement plus présents que nous, tels les pays nordiques. Des choix stratégiques sont donc à revoir.
Dans le même esprit, on relève que les chambres de commerce et d’industrie sont elles aussi peu nombreuses dans les pays d'Afrique anglophone : l’UCCIFE n’est présente que dans deux pays en tout et pour tout, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Sur les neuf chambres de commerce et d’industrie françaises en Afrique, seulement deux sont en Afrique anglophone.
Enfin, la France pourrait s’inspirer de ce qui existe par exemple en Allemagne en termes de soutien des entreprises à l’exportation. Il n’appartient pas à vos rapporteurs d’entrer dans le détail de ces questions qui excèdent les limites précises de ce rapport et relèvent plus de la politique générale de soutien au commerce extérieur. Néanmoins, nombre de leurs interlocuteurs ont noté qu’il manque à nos entreprises des outils tels que ceux dont dispose la KFW allemande. L’une de ses filiales, IPEX, est une banque spécialisée qui a pour mandat le financement des exportations ou des projets d´infrastructures à l´étranger impliquant des intérêts économiques allemands ou européens. Elle participe autant au financement de grandes infrastructures qu’au financement de PME allemandes exportatrices. Elle peut ainsi financer une entreprise qui remporte un appel d’offres sur la valeur technique de sa proposition sans craindre que son offre financière l’exclue du marché. En 2011, l’IPEX a engagé quelque 13,4 milliards d’euros. Ce sont des moyens considérables qui sont ainsi mis en œuvre pour le soutien des stratégies d’exportation des entreprises allemandes, qui font défaut dans la palette des instruments français. Ils expliquent en tout cas que, dans un pays comme l'Afrique du Sud, l’Allemagne a aujourd'hui une part de marché quatre fois supérieure à celle de la France.
On sait que la réflexion est engagée depuis quelques mois pour la réorganisation de nos dispositifs de soutien au commerce extérieur, en articulation avec la diplomatie économique que le ministre des affaires étrangères a promu au rang de priorité. Au mois de mars dernier, la ministre du commerce extérieur a ainsi lancé une évaluation des dispositifs de soutien apportés aux entreprises et elle a été destinataire du rapport « sur l’efficacité du dispositif d’appui à l’internationalisation de l’économie française » 235 quelques mois plus tard. Un rapprochement est en cours entre Ubifrance et la BPI qui, en parallèle, se structure afin de pouvoir soutenir les entreprises à l’exportation, (cf. le lancement de « Bpifrance export » en mai dernier), l’accent étant mis, en particulier, sur l’accès des PME-PMI aux mécanismes de soutien publics et à la meilleure coordination des instances. Si, les choses avancent sur la question, il conviendra de s’assurer que les zones géographiques sur lesquelles, nous étions absents jusqu’à ce jour ne soient pas oubliées puisque c’est là que se trouvent la croissance et les opportunités pour notre propre développement.
2. Aller plus loin dans la réaction bienvenue des pouvoirs publics
Si, le gouvernement a fait de la diplomatie économique une priorité, quelques aspects méritent néanmoins d’être discutés, au premier rang desquelles la stratégie pour le commerce extérieur.
a. Une stratégie pour le commerce extérieur qui n’est peut-être pas à la hauteur de l’analyse
En regard des réalités exposées, la stratégie présentée en décembre dernier 236 par le ministère du commerce extérieur mérite d’être examinée de près, eu égard à la hauteur des enjeux.
Cette stratégie est fondée sur une étude portant sur les 47 pays qui, ensemble, représentent 80 % des importations mondiales en 2012 et en 2022 :
• Pays développés : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Suède, Finlande, Autriche, Danemark, Pologne, Hongrie, République tchèque ; Suisse, Norvège ; États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Australie
• Grands émergents (BRIC) : Brésil, Russie, Inde, Chine
• Pays émergents de taille intermédiaire : Turquie, Ukraine, Kazakhstan ; Algérie, Égypte, Tunisie, Maroc ; Afrique du Sud, Nigéria, Côte d’Ivoire, Kenya ; Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis ; Mexique, Argentine, Chili, Colombie ; Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Philippines.
On considère qu’ils devraient générer un potentiel global d’importations de 12 000 Mds€ en 2022, contre 8 500 Mds€ aujourd'hui. S’agissant des seuls émergents et intermédiaires, leur potentiel représentera le tiers de ce total, plus précisément 2 400 Mds€ pour les BRIC et 1 900 Mds€ pour les autres.
Outre 21 pays développés, dont douze membres de l’UE, et les quatre BRIC, 22 pays émergents de taille intermédiaire figurent dans la liste. Quatre d’entre eux sont africains : l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Nigeria. On comprend en conséquence que les pays d'Afrique anglophone sont a priori perçus comme constituant le moteur principal du continent.
La stratégie affirme son objectif de « sortir du seul prisme des grands contrats et conquérir des parts de marché dans le commerce courant des pays émergents » ; il est précisé que « en Afrique subsaharienne, en Côte d’Ivoire mais aussi dans les pays non-francophones (Kenya, Nigéria, etc.), les besoins en infrastructures publiques sont majeurs, tandis que l’achat de biens de consommations devrait fortement y augmenter, il s’agira sans doute même de la hausse la plus importante, en pourcentage, au niveau mondial. »
On retrouve évidemment dans cette analyse les propos tenus devant vos rapporteurs par nombre d’interlocuteurs de tous bords, notamment quant à l’émergence des classes moyennes en Afrique. La conclusion est donc logique : il y a pour la France un « véritable enjeu de diversification des exportations », auquel la stratégie se propose de répondre « par une offre gagnante » en s’appuyant sur les atouts de notre tissu industriel « autour de quatre démarches qui correspondent à des besoins fondamentaux » :
• « mieux se nourrir » : ainsi qu’il est opportunément rappelé, la France possède dans le secteur agroindustriel des entreprises performantes, aptes à répondre à la demande de produits transformés qui ne manquera pas de croître. Les pays cibles, identifiés pour les produits agricoles et agroalimentaires sont les suivants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Pays Bas, Corée du sud, Pologne, Canada, Émirats Arabes Unis, Russie, Tunisie, Maroc, Algérie, Brésil, Singapour, Arabie Saoudite. S’agissant de l’équipement agricole, sont considérés comme des cibles prioritaires les pays suivants : Pologne, Russie, Kazakhstan, Ukraine, Maroc, Algérie, Chine et Mexique.
• « mieux se soigner » : la France possède une industrie pharmaceutique et cosmétique de pointe qui peut également répondre à la demande croissante qui viendra de quelques pays. Sont ciblés ici : la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du sud, la Pologne, la Russie, la Turquie, l’Algérie, le Brésil et l’Inde.
• « mieux communiquer » : la Chine, les États-Unis, la Corée du sud, l’Allemagne, le Royaume Uni, le Mexique, le Brésil, le Japon, la Russie, l’Inde et le Qatar sont les cibles de cette stratégie.
• « mieux vivre en ville » : il est précisé que cette thématique « regroupe tout ce qui touche à la ville durable », secteur sur lequel la France a déjà une expérience considérable à faire valoir, qu’elle exporte avec succès à l’étranger, notamment via les projets portés par l'AFD dans un certain nombre de pays émergents. Ici, les cibles identifiées sont les pays suivants : Chine, Inde, États-Unis, Indonésie, Vietnam, Brésil, Russie, Allemagne, Pologne, Algérie, Arabie Saoudite, Maroc, Turquie et Émirats Arabes Unis.
En d'autres termes, quelle que soit la thématique concernée, à aucun moment, ne figure comme cible un seul des quatre pays africains mentionnés en début d’analyse. Vos rapporteurs s’avouent surpris, car l’étude, les inclut tous dans les 47 pays prioritaires. On a vu plus haut que, malgré les difficultés présentes et sans doute futures, des pays africains anglophones, l’émergence des classes moyennes et supérieures, en Afrique du Sud et au Nigeria, notamment, est déjà une réalité : leur demande de meilleurs biens, de soins, d’environnement urbain est appelée à augmenter régulièrement. Quand bien même l’économie resterait encore longtemps majoritairement informelle, ces classes moyennes sont celles qui tirent la croissance : comme on le faisait remarquer 237 , quelque 12 millions de personnes en Afrique du Sud, soit l’équivalent de la Belgique, disposent déjà d’un bon pouvoir d’achat ; il en sera encore ainsi durablement. Comme le rappelle le document de stratégie dans les tableaux reproduits ci-dessous, la croissance de la population est une donnée majeure du futur proche de ces pays : le Nigeria gagnera plus de 47 millions d’habitants d’ici 2022, et le Kenya, plus de 12 millions.
On est donc étonné de voir figurer parmi les cibles des pays tels que le Maroc, la Tunisie, relativement peu peuplés, ou encore l’Ukraine, dont la croissance démographique est négative, sans que le Kenya, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, qui ont déjà des populations autrement plus importantes et des trajectoires plus fortes en termes d’urbanisation, le soient aussi.
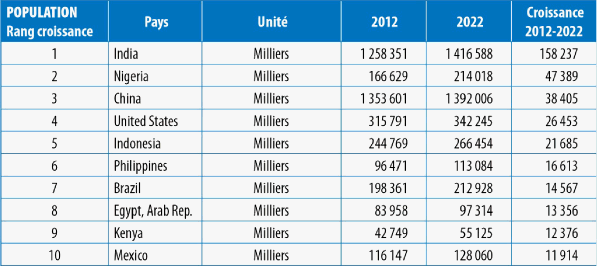
La même remarque peut être faite concernant le taux d’urbanisation : d'ores et déjà de plus de 50 % de la population, il sera proche de 60 % au Nigeria en 2022, cette croissance représentant plus de 38 millions d’urbains en plus en dix ans.
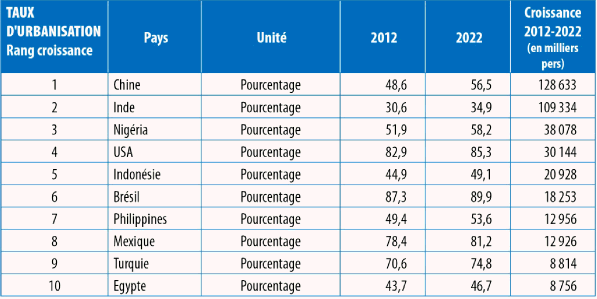
Le silence de la stratégie ministérielle est d’autant plus surprenant que l’étude qui a servi de base pour en définir les axes 238 a précisément mis en évidence tout le potentiel des émergents africains anglophones : s’agissant de l’agroalimentaire, par exemple, elle indique que la Chine sera le pays dont les importations agroalimentaires croîtront le plus sur la décennie concernée, de quelque 10 % par an en moyenne, et que « le Kazakhstan, le Nigéria et le Kenya seront également des marchés très dynamiques 239, avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 5 % sur la période ». Dans le secteur ferroviaire, on prévoit que c’est en Arabie Saoudite et en Russie que la croissance des importations, avec plus de 5 % par an en moyenne sur cette décennie, sera la plus forte, mais que « l’Égypte, la Tunisie et le Maroc, où la France est bien positionnée, seront également des marchés très dynamiques, avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 4 % sur la période, tout comme le Nigéria ». Dans le secteur mécanique/machines, derrière le Kazakhstan et parmi d’autres, une fois encore, le Nigéria et le Kenya sont cités comme étant « également des marchés dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 5 % sur la période ». En matière énergétique, et précisément dans le secteur du nucléaire, des dérivés pétroliers et du coke, il est indiqué que « sur les quatre pays les plus porteurs identifiés par les SE (États-Unis, Chine, Singapour et Nigéria), la France est relativement mieux positionnée que ses voisins européens. » Dans une autre rubrique, que « Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits électroniques sera la plus forte sur la période 2012-2022 sont les Philippines et le Nigéria avec des taux de croissance annuels moyens respectivement de 5,8 % et 5,7 %. ». On relève enfin dans cette étude que « les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits électriques sera la plus forte sur la période 2012-2022 sont l’Algérie et le Kenya avec des taux de croissance annuels moyens compris supérieurs à 7 %. »
Ainsi, l’étude considère de manière quasi systématique que le Nigeria, et parfois le Kenya, sont parmi les plus prometteurs pour un pays comme le nôtre ayant une vocation exportatrice puisque la croissance de leurs importations sera parmi les plus fortes de la décennie. Paradoxalement, la stratégie du ministère du commerce extérieur n’en tire aucune conclusion opérationnelle et semble les ignorer. Vos rapporteurs en sont quelque peu perplexes et ne peuvent que recommander qu’une réévaluation soit entreprise sans tarder afin de les inclure de manière résolue parmi les cibles privilégiées.
Certes, la ministre du commerce extérieur semble avoir pris la mesure de la question. Elle s’est rendue très récemment au Nigeria, après être allée en Afrique du Sud et au Kenya. Il serait opportun que cette démarche s’inscrive dans un projet de long terme comme prétend l’être la stratégie de décembre 2012.
b. Des premières mesures positives mais sans doute insuffisantes
Mise à part la stratégie pour le commerce extérieur, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qu’il convient de saluer, tout en regrettant peut-être leur manque d’ambition s’agissant de la zone géographique qui retient ici notre attention.
En appui à la diplomatie économique, le ministre des affaires étrangères a nommé sept représentants spéciaux pour accompagner le développement de nos entreprises dans les pays émergents. Selon le site du ministère, leur désignation « vise à développer nos relations économiques bilatérales avec quelques partenaires-clé que les représentants spéciaux connaissent particulièrement bien et avec lesquels ils entretiennent des relations privilégiées. » 240 Ce sont des personnalités reconnues qui sont chargées, en étroite collaboration avec les ambassadeurs, de travailler à la mobilisation des acteurs publics et privés pour la concrétisation de la diplomatie économique.
L’initiative est opportune. Ainsi, Martine Aubry, chargée dans ce cadre d’entretenir des relations plus étroites avec la Chine, a-t-elle eu l’occasion de souligner il y a quelques mois 241 que la France n’avait pas suffisamment fait de lobbying avec ce pays. Il est donc parfaitement justifié, aux yeux de vos rapporteurs que des personnalités se voient confier de telles fonctions, pour assurer nos partenaires de l’attention particulière que notre pays leur porte.
Ont ainsi été désignés :
• Martine Aubry, « très impliquée sur la projection en Chine de toutes les entreprises présentes dans la filière de la "ville durable" » ;
• Louis Schweitzer, « plus particulièrement sur les investissements croisés avec le Japon et la place des PME dans les échanges commerciaux qui constituent une priorité pour nos deux pays. » ;
• Philippe Faure, « sur la mise en place d’un conseil de haut niveau franco-mexicain, à même d’identifier des propositions concrètes et opérationnelles pour bâtir un partenariat économique fructueux. Il explore également la possibilité de créer un fonds franco-mexicain d’investissement dans le secteur des hautes technologies. » ;
• Jean-Pierre Raffarin, sur « la résolution de contentieux économiques franco-algériens. » ;
• Jean-Pierre Chevènement, pour « hisser à haut niveau le dialogue économique bilatéral avec la partie russe. » ;
• Pierre Sellal, pour « le dialogue stratégique avec les Émirats Arabes Unis. » ;
• Paul Hermelin, enfin, pour le « développement des exportations françaises en Inde dans les domaines du développement durable, (transport ferroviaire, énergies renouvelables, nouvelles technologies et services) »242.
Cependant, même si l'Afrique est devenue prioritaire pour le gouvernement, notamment l'Afrique anglophone, des pays aussi importants que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, restent encore hors cadre et ne bénéficient pas d’une telle attention. Vos rapporteurs le regrettent et invitent vivement à ce qu’un huitième représentant spécial soit rapidement désigné pour couvrir la zone de l'Afrique anglophone. Nos partenaires européens l’ont bien compris : Martine Aubry rappelait dans son entretien au journal Le Monde que l’une des raisons pour lesquelles les performances allemandes étaient meilleures que les nôtres sur les mêmes destinations, tenait à cela : « L’Allemagne accompagne politiquement ses entreprises, ce que nous qualifions parfois de lobbying. Ce travail, nous ne l’avons pas assez fait. ». Ce que confirmait indirectement l’ambassadrice d’Allemagne à Nairobi en indiquant à vos rapporteurs que l'Afrique n’était pas une terre de conquête pour les entreprises allemandes et qu’il fallait les y pousser. Raison pour laquelle, le Kenya étant désormais considéré comme la zone privilégiée d’Afrique de l’Est pour les investissements allemands, de nombreuses visites ministérielles et parlementaires se succèdent.
On peut aussi rappeler de la même manière que, traditionnellement, au Foreign Office comme au Département d'État américain, des ministres délégués ou des sous-secrétaires d'État géographiques assistent le ministre, qui sur l’Amérique latine, qui sur l’Asie, qui sur l'Afrique, dans cette optique. Au Foreign Office, un secrétaire d'État à l'Afrique auprès du ministre des affaires étrangères, est par exemple chargé du suivi de la région, ce qui assure une présence continue du Royaume-Uni avec les autorités des différents pays. À l’heure où cette tradition a enfin été adoptée par la France, avec la nomination des représentants spéciaux, il serait heureux que l’oubli de l'Afrique anglophone soit rapidement réparé par la nomination d’une personnalité chargée de relever le défi.
3. Réévaluer des relations généralement bonnes
Au plan politique, la relation bilatérale de la France avec ses différents partenaires est généralement bonne, et notre pays est constant dans son discours : la France veut une relation avec toute l’Afrique, pas uniquement avec l’Afrique francophone.
a. Des relations politiques avec l'Afrique anglophone qui tournent au ralenti
Cela ne va pas sans quelques frictions parfois. Ainsi de l'Afrique du Sud, avec laquelle le dialogue se révèle souvent tendu sur le terrain africain : comme on l’a évoqué, s’agissant des politiques d’influence ou de la gestion des crises, Pretoria est prompte à soupçonner la France d’avancer dans ses interventions sur le continent sur la base d’un agenda masqué, aux relents colonialistes. Ainsi en a-t-il été pour la Côte d'Ivoire et en Centrafrique. La relation bilatérale apparaît à la fois de partenariat et de compétition, mais vos rapporteurs ont aussi perçu chez leurs interlocuteurs politiques sud-africains 243 la volonté de maintenir une relation positive, articulée sur un partenariat au bénéfice de l’une et l’autre partie : l'Afrique du Sud a une vision très claire des nécessités de l'Afrique, et de son futur. Ce sont les Africains qui font l’Afrique de demain, hors de toute intervention extérieure et ce qui se joue depuis quinze ans est de leur fait. Dans ce contexte, la relation bilatérale doit évoluer vers des perspectives différentes de ce qu’elles ont été jusqu’à aujourd'hui, afin que les tensions ne se répètent pas. Les opportunités sont nombreuses pour cela, qu’elles se situent sur le terrain de la relation avec l’Union européenne ou sur l’appui que la France pourrait donner au processus d’intégration régionale. Le moment est bon pour essayer de forger des alliances, dans un intérêt commun, au bénéfice de chacun.
Cela étant, on ne peut s’empêcher de constater qu’un fort déséquilibre persiste dans la relation de la France avec ses partenaires africains, où l'Afrique francophone apparaît encore nettement privilégiée. Pour certains, comme Laurent Fourchard 244, la situation est telle que nos relations diplomatiques peuvent être qualifiées de marginales. En conséquence, on ne sait pas tirer parti des opportunités qui se présentent, faute d’avoir pu travailler en amont avec nos partenaires. Si le Nigeria, par exemple, est notre premier partenaire, c’est avant tout par la taille considérable de son marché, plus que le résultat d’une stratégie déterminée. Malgré le potentiel du pays les entreprises françaises y restent très peu nombreuses.
Le premier indicateur tient à nos représentations diplomatiques. À cet égard, les observations de la Cour des Comptes soulignent que les objectifs de réorientation du réseau en direction des pays émergents, fixés par le Premier ministre en 2006, qui prévoyaient le redéploiement à leur profit de 1500 emplois, n’aient finalement été que très partiellement remplis. Certains postes ont effectivement été étoffés, mais d’autres sont restés à la marge. Ainsi des effectifs en Afrique du Sud, diminués de 8 % sur la période ! 245 Plusieurs personnalités rencontrées par vos rapporteurs ont insisté sur la faible visibilité de nos postes, qui donne une mauvaise image de notre pays. Si ce n’est pas le cas de l'Afrique du Sud et du Kenya, en revanche, l’ambassade française au Nigeria est peu visible, tant du point de vue de ses locaux que de ses moyens humains. Une rapide visite sur le site du MAEE 246 montre, par exemple, que le poste diplomatique de Cotonou, au Bénin voisin, est doté de ressources humaines plus importantes que ceux du Nigeria ou d’Afrique du Sud. De même, certains observateurs insistent-ils sur le renforcement du réseau consulaire dans certaines destinations d’avenir. Enfin, la cartographie des lycées français traduit, elle aussi, la cristallisation de notre dispositif sur une situation datée, ainsi que son manque de souplesse et de réactivité. Par exemple, on compte 17 établissements à Madagascar contre deux, en tout et pour tout, au Nigeria comme en Afrique du Sud et un seul au Kenya... 247
Cela étant, en marge de nos représentations diplomatiques, la France entretient en Afrique anglophone un réseau de centres de recherche relevant du CNRS : l’Institut français de recherche en Afrique, IFRA, basé à Ibadan, au Nigeria, fondé en 1990 ; l’Institut français d’Afrique du Sud à Johannesburg, IFAS, créé en 1995, ainsi que l’Institut français de recherche en Afrique, IFRA, basé à Nairobi, qui existe depuis 1980. Vos rapporteurs, qui ont eu l’occasion de visiter ceux de Nairobi et de Johannesburg et de s’entretenir avec leurs équipes de chercheurs, peuvent témoigner de leur valeur et de l’importance que les uns et les autres jouent dans les échanges scientifiques et dans la visibilité qu’ils offrent à notre pays sur place. Il y a là, de toute évidence, des instruments d’influence tout à fait remarquables qu’il est à l’honneur de notre pays d’avoir su installer.
Un second indicateur de notre faible intérêt pour la partie anglophone de l'Afrique se retrouve dans le petit nombre de visites des autorités politiques de notre pays. La comptabilisation des voyages et réceptions présidentiels et ministériels en Afrique le démontre 248 : entre mai 2007 et juillet 2013, 73 déplacements ministériels ont été effectués dans les sept pays d’Afrique francophone sélectionnés, dont 13 par le seul ministre des affaires étrangères. Dans le même temps, on ne compte que 36 voyages dans les sept pays d’Afrique anglophone, dont 14 effectués par le ministre des affaires étrangères. Les déplacements de membres de l’exécutif français sont donc deux fois plus fréquents vers les pays d'Afrique francophone que vers les pays d'Afrique anglophone et, de leur côté, les ministres de pays francophones sont reçus à Paris bien plus fréquemment que leurs homologues anglophones. Pour nombre d’interlocuteurs rencontrés au long de cette mission, tout se passe comme si la France faisait preuve d’un manque de perception des enjeux politiques et économiques de long terme dans cette partie du continent.
Si l’on affine l’observation, on ne comptait jusqu’à ces jours-ci qu’une visite présidentielle dans un pays d'Afrique anglophone, l’Afrique du Sud, contre huit dans des pays d’Afrique francophone ; durant la même période, sept présidents de pays d'Afrique anglophone sont venus en France 249, contre 31 présidents francophones. Pour rester sur le cas de l'Afrique du Sud, le ministre des affaires étrangères s’y rend également peu souvent : Laurent Fabius y est allé en juillet dernier, mais la visite précédente remontait à novembre 2011. Entretemps, seuls deux ministres délégués ont fait le déplacement au cours de l’année 2012, ceux chargés de la francophonie et des français de l’étranger.
Pire, notre pays ne sait pas tirer profit de ses propres initiatives comme il le pourrait, et le devrait. Comment ne pas être choqué en effet que le gouvernement n’ait délégué en Afrique du Sud qu’un seul de ses membres, la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, à l’occasion de l’inauguration de la saison française en 2012 ? Tout au long de cette manifestation de plusieurs mois, pourtant majeure pour la visibilité de notre pays, parrainée et sponsorisée par les grands groupes installés dans le pays, aucun autre déplacement ministériel n’a eu lieu… Certains des interlocuteurs de vos rapporteurs en Afrique du Sud ont même indiqué n’avoir jamais eu connaissance que 2012 avait été l’année de la France en Afrique du Sud ! Pourtant plus de 150 000 personnes, à un titre ou à un autre, ont participé ou assisté aux activités et aux événements programmés à cette occasion. Quant à la saison d'Afrique du Sud en France, lancée en mai dernier par Laurent Fabius pour s’achever le mois prochain, elle se révèle singulièrement discrète ; il serait opportun de se pencher sur la question de la médiatisation de ces événements et sur leur visibilité.
Une politique africaine globale est aujourd'hui indispensable, dans laquelle la dimension francophone aura un rôle fondamental à jouer, en raison d’un patrimoine culturel commun qu’il faut impérativement entretenir et développer dans toute la région. Les entreprises, qui ont sans doute leur part de responsabilité dans la situation présente, ont déjà une vision panafricaine intégrale. Si la France entend continuer à peser sur le cours des choses, il est indispensable qu’il en soit de même au niveau institutionnel.
Cet aspect relativise peut-être les axes et modalités que notre pays a semblé privilégier jusqu’à ces derniers temps : comme d’autres pays européens, tel le Royaume-Uni, la France a conclu avec ses partenaires africains, comme avec d’autres sur d’autres continents, des partenariats stratégiques ambitieux. C’est notamment le cas avec le Nigeria 250, l'Afrique du Sud 251 et le Kenya 252.
Ces partenariats se déclinent selon des règles à peu près immuables : la reconnaissance par la France que le pays a acquis une position stratégique régionale appelée à se développer, la volonté commune d’intensifier le dialogue politique, de conduire des échanges réguliers sur les enjeux régionaux, de promouvoir leur coopération dans un certain nombre de domaines militaire, environnemental, économique et commercial, scientifique, culturel et éducatif. Ce partenariat est quelquefois accompagné d’une feuille de route devant faire l’objet d’une évaluation régulière. C’est par exemple le cas de la « Déclaration pour un partenariat renforcé France – Kenya » signée le 20 avril 2011 entre les Premiers ministres François Fillon et Raila Odinga, qui prévoit que « par cette déclaration, la France et le Kenya marquent leur volonté mutuelle d’approfondir leurs relations et leur coopération en se fondant sur des valeurs communes (…) d’intensifier leur dialogue politique par l’organisation de réunions régulières de haut niveau (au moins une fois par an en France ou au Kenya) (…), [d’échanger et de coopérer] sur les enjeux régionaux de paix et de sécurité (en particulier sur les Grands Lacs, le Soudan/Soudan du Sud et la Somalie), sur la promotion de la dimension politique de la Communauté de l’Afrique de l’Est et sur la lutte contre la criminalité internationale (piraterie, terrorisme, drogues, trafic d’êtres humains, corruption, blanchiment d’argent). Les deux pays s’engageront à soutenir la présence de l’Afrique dans les forums et discussions internationales concernant les enjeux mondiaux et soutiendront la création d’une organisation mondiale de l’environnement. La France apportera enfin son soutien à la mise en œuvre de la nouvelle Constitution kenyane adoptée en août 2010 par référendum. Afin de mettre en œuvre les principes contenus dans cette Déclaration, la France et le Kenya se sont entendus sur une feuille de route dont la mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation régulière dans le cadre du dialogue politique bilatéral. »
Pourtant, selon les indications données à vos rapporteurs, il semble que cet accord n’a pas fait l’objet de mesures concrètes d’application. Non plus que les deux autres d’ailleurs. En d'autres termes, pour utiles qu’ils soient au plan de la relation politique bilatérale, ces partenariats s’apparentent plus à des déclarations de bonnes intentions qu’à de véritables feuilles de route sur lesquelles chacun s’engagerait de manière concrète. Ce n’est donc pas le socle sur lequel fonder l’amarrage de notre pays à l'Afrique anglophone.
b. Une demande et une nécessité : l’exemple venu de l’étranger
La comptabilisation des déplacements présidentiels est un indicateur forcément limité. Il permet néanmoins d’illustrer ou de confirmer des propos que vos rapporteurs ont entendu sur la faiblesse d’une relation politique en déshérence. Ainsi, l’ambassadrice du Ghana soulignait-elle 253 que la visite du Premier ministre en 2011 était évidemment positive, qu’elle marquait la bonne disposition de la France, mais qu’elle était néanmoins insuffisante. Le Ghana est demandeur d’une relation bilatérale plus intense, parce qu’il est immergé dans un environnement francophone.
Ainsi en est-il aussi des représentants du CIAN 254 ou du MEDEF international 255, qui ont regretté, unanimes, le manque de soutien de la part des pouvoirs publics français. À les entendre, les gouvernements brésilien, italien, norvégien, pour ne pas parler des Britanniques et des Chinois, interviennent au contraire très fortement en appui de leurs entreprises dans les nouvelles destinations où il faudra être présent demain, et pour lesquelles il faut déjà prendre date, comme au Mozambique. Le soutien des pouvoirs publics est d’autant plus crucial dans la réussite que la composante publique est la plupart du temps déterminante dans les projets d’infrastructures, par exemple, et que la décision est de nature politique. Dans des pays où le Royaume-Uni envoie les membres de la famille royale en tournée régionale, la France se contente de rares visites épisodiques de secrétaires d'État… Sans parler des visites royales, le Premier ministre britannique s’est rendu en Afrique du Sud et au Nigeria en 2011, accompagné d’une forte délégation d’hommes d’affaires de haut niveau.La chancelière allemande a fait de même au Nigeria, et son ministre des affaires étrangères en Afrique du Sud, Au-delà, c’est avec l’Afrique australe que Berlin soigne sa relation politique : Guido Westerwelle s’est rendu six fois dans la région depuis sa nomination en octobre 2009.
Dans le même esprit, la carte ci-dessous montre que les autorités brésiliennes font de l’Afrique une véritable terre de mission : en huit ans, le président brésilien s’est rendu à plus de trente reprises dans les pays africains les plus importants. Ce n’est pas seulement l’Afrique lusophone qui retient surtout leur attention, même si à l’évidence l’Angola et le Mozambique sont privilégiés regorgeant d’hydrocarbures, mais aussi l'Afrique du Sud et nombre d’autres pays, de la sphère anglophone comme francophone, de la façade méditerranéenne comme indienne. La relation dense qui se développe entre le Brésil et les différents pays qui bordent le Golfe de Guinée montre, si besoin était, que Brasilia semble plus particulièrement entretenir ses relations avec des pays stables offrant des potentialités fortes, ce que confirme, a contrario, son absence des pays de l’arc sahélien ou de RDC. La politique initiée par le président Lula da Silva a été poursuivie par la présidente Dilma Roussef qui s’est rendue en Afrique à plusieurs reprises : dès octobre 2011, en Afrique du Sud, au Mozambique et en Angola ; en février 2013, au Nigeria 256. Ces déplacements confirment la dimension stratégique de l'Afrique pour le Brésil, qui a considérablement amplifié son dispositif diplomatique en une décennie, en ouvrant 19 ambassades nouvelles sur le continent, cependant que ses échanges commerciaux quintuplaient, de 5 Mds$ en 2000 à plus de 26 Mds$ en 2012, ses entreprises ayant investi plus de 10 Mds$ depuis 2003. 257
Les entrepreneurs français l’ont dit à vos rapporteurs, de même que des experts, tel Jean-Michel Severino : il est indispensable que le ministre des finances et le ministre du commerce extérieur voyagent eux-mêmes, plutôt que leurs directeurs d’administration, qu’ils reçoivent leurs pairs, et que le niveau de notre dialogue économique, industriel et commercial avec l'Afrique soit plus élevé. La situation est telle que nos partenaires économiques africains n’ont aujourd'hui pas d’interlocuteurs, à la différence des responsables politiques qui sont tous systématiquement reçus au Quai d’Orsay. Ainsi, depuis 2007, selon le recensement effectué par vos rapporteurs, le ministre de l’économie a effectué en tout et pour tout deux déplacements en Afrique : le premier en novembre 2012, en Côte d'Ivoire ; le second en avril dernier, au Sénégal. Une réarticulation politique aura inévitablement un effet positif sur les entreprises qui avouent pâtir « cruellement », selon les termes employés par certains, de la faiblesse du dialogue politique avec cette partie de l’Afrique et font état du sentiment de délaissement ressenti par les pays concernés.
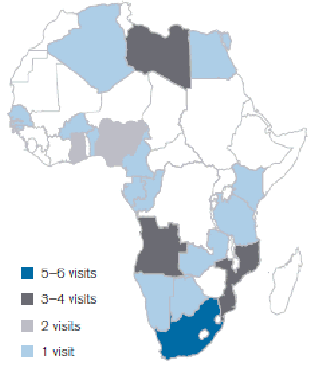
Les visites du président brésilien en Afrique (Janvier 2003- Décembre 2010) 258
Les choses semblent heureusement en voie d’amélioration : après avoir concentré ses premiers voyages vers des terres « classiques » en termes d’exportations pour notre pays, Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur, a effectué un déplacement au Kenya, puis tout dernièrement, en septembre, au Nigeria. Jusqu’ici ce sont ses seuls déplacements en Afrique subsaharienne, les autres ayant eu lieu au Maroc à trois reprises, et en Algérie à deux reprises 259 Certes, le positionnement de la France dans un pays comme le Kenya peut difficilement rivaliser avec le Royaume-Uni : le pays est anglophone et tous les dirigeants kenyans ont leur famille ou des intérêts à Londres. Le Royaume-Uni compte encore quelque 20 000 résidents permanents dans son ancienne colonie, auxquels il faut ajouter 20 000 « Kenyans blancs », pour la plupart descendants d’ancêtres britanniques. Avec 1400 résidents français, pour la grande majorité à Nairobi, les autres étant installés à Mombasa, notre pays est donc très loin derrière en termes de présence. Mais c’est précisément la raison pour laquelle un travail présentiel de la part des pouvoirs publics n’en est que plus nécessaire, d’autant que la concurrence ne cesse de croître dans cette région de toutes les convoitises.
Enfin, le Président de la République, accompagné d’une importante délégation ministérielle 260, et économique, s’est rendu en Afrique du Sud en visite d'État. Ce déplacement, les 14 et 15 octobre dernier, a traduit la volonté des deux parties de renforcer leurs partenariats dans tous les domaines. La dimension économique a occupé une place centrale dans les échanges. Cela s’est notamment traduit par la signature du contrat historique au profit d’Alstom, déjà mentionnée, et de perspectives également intéressantes pour d’autres groupes présents dans le pays, qui devraient voir leurs positionnements consolidés dans leurs secteurs respectifs, tel GDF SUEZ, qui a conclu un important accord pour la construction de centrales thermiques pour un montant de 1,6 Md€. À la demande de l'Afrique du Sud, un forum des affaires, bilatéral, s’est tenu à cette occasion, auquel participaient le Medef International, d’une part, et les milieux d’affaires sud-africains, autour de la BUSA, Business Unity South Africa, et le BBC, Black Business Council ; une soixantaine d’entreprises françaises, dont une douzaine de grands groupes industriels ainsi qu’une dizaine de PME, venues dans le sillage du Président de la République, étaient conviées aux échanges qui ont permis d’approfondir les thématiques d’intérêt commun, dans l’optique de renforcer les conditions de succès des relations d’affaires et de cerner les opportunités ouvertes. Les secteurs du tourisme, des mines, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, des énergies renouvelables – un projet de centrale solaire sera développé sur financement de l'AFD -, et des infrastructures ont été priorisées, compte tenu des besoins du pays et des orientations définies dans le plan national de développement à l’horizon 2030.
Au-delà de la dimension économique, le dialogue politique bilatéral s’est trouvé approfondi, non seulement quant aux questions continentales, sur lesquelles les deux chefs d'État partagent les mêmes analyses et conceptions, mais aussi quant aux perspectives de rapprochement et de partenariat dans divers domaines. Ainsi, les problématiques agricoles, pour lesquelles deux accords bilatéraux ont été signés qui couvrent divers aspects, la sécurité alimentaire, la qualité de l’alimentation, mais aussi la lutte contre la volatilité des prix. De même, la coopération scientifique et technologique pour laquelle la partie sud-africaine souhaite un renforcement de la participation de notre pays qui est déjà son 4e partenaire scientifique : de nombreuses collaborations existent, qui se traduisent par des copublications 261, par l’existence de plusieurs programmes aujourd'hui en cours, qui associent de nombreux chercheurs, - 19 scientifiques français présents en Afrique du Sud -, mais aussi des universités, des instituts de recherche, que ce soit en sciences sociales ou exactes, comme en témoigne la participation du CNRS et l’Observatoire de Paris au consortium international qui développe le projet de radio-téléscope international SKA.
« Le temps de l'Afrique est arrivé ». Les observateurs les plus attentifs ne sont pas les seuls à le clamer. Les entreprises des pays de l'Afrique anglophone ne cessent aussi de le dire. S’il reste des difficultés - et elles sont nombreuses ! - les marchés sont néanmoins porteurs, les investissements affluent malgré tout, les échanges croissent, l’environnement des affaires s’améliore, comme le pouvoir d’achat, et les barrières tombent. C’est donc aujourd'hui, et non demain, que les entreprises étrangères doivent saisir les opportunités qui leur sont offertes. Beaucoup sont déjà arrivées ; les françaises semblent en revanche un peu attentistes, sans que l’on sache trop pour quelles raisons, comme le remarque, entre autres, Andrew Golding, président de Palm Golding Properties, leader sur le marché d’Afrique australe de l’immobilier de luxe, qui vend chaque année un millier de propriétés dans la région à des acquéreurs étrangers, pour l’essentiel britanniques (50 %) et allemands (20 %). 262
B. L’IMPÉRATIF POUR LA FRANCE D’ÊTRE PRÉSENTE
Comme on le verra dans les développements suivants, la demande de France est unanime de la part des pays de l'Afrique anglophone. C’est tout d'abord le cas en matière politique. La France apparaît d’une manière générale bien perçue dans la région, son image est bonne, voire excellente, malgré la distance, et le renforcement des liens et des relations est souhaité de toute part. C’est ensuite le cas de la part des milieux d’affaires des différents pays concernés qui expriment, unanimes, leur attente de relations plus denses avec les investisseurs français.
Deux éléments peuvent être avancés pour un rééquilibrage de nos relations avec les pays d’Afrique anglophone. La réalité des nombres plaide en ce sens : ces pays ont encore devant eux de multiples problèmes à résoudre, mais on ne peut nier qu’ils sont aujourd'hui sur des trajectoires ascendantes, favorisées par des populations élevées, à la différence des pays d'Afrique francophone, ouvrant des perspectives de marchés importants à plus ou moins long terme. Le Nigeria n’est pas le seul pays dans ce cas. Citons l'Afrique du Sud : 51 millions d’habitants ; la Tanzanie : 47,8 millions ; le Kenya : 43 millions ; l’Ouganda : 36 millions ; le Ghana : 25 millions ; l’Éthiopie, qui dépasse déjà les 92 millions d’habitants et devrait atteindre 150 millions au milieu du siècle. Mise à part la RDC, qui a dépassé les 71 millions d’habitants, les pays de l'Afrique francophone sont donc plus petits par leur superficie et leurs populations : seule la Côte d'Ivoire est en passe d’atteindre prochainement 20 millions d’habitants, la plupart des autres se situant dans une fourchette de 10 millions à 15 millions : Bénin, Tchad, Guinée, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, voire beaucoup moins, dans le cas du Gabon ou du Congo. Les pays anglophones présentent à l’inverse une masse critique qui leur permet d’être des acteurs avec lesquels il faut compter sur des marchés essentiels pour un pays comme le nôtre. Ainsi de l’achat par Ethiopian Airlines, en 2009, de douze Airbus A350, ou la commande de vingt autres appareils la même année par South African Airways.
D’autre part, la découverte récente d’hydrocarbures et de gaz dans l’ensemble des pays de la façade océanique va bouleverser la donne : les économies de ces pays vont en être radicalement transformées. Le Mozambique, certes non anglophone, est déjà le douzième producteur mondial, il sera demain le troisième. Ses réserves de charbon sont également colossales. Il en est de même de l’Ouganda et de la Tanzanie cependant que le Kenya fait porter son effort sur les énergies renouvelables : géothermie, éolien et solaire. Les pays nordiques ont mieux compris que nous les enjeux du futur : le Danemark et la Norvège sont déjà présents, que ce soit sur des activités de prospection ou de conseils en gestion durable des ressources énergétiques.
Comme le soulignait Yves Boudot, directeur Afrique de l'AFD 263, il est indéniable que le « booster » de l'Afrique dans l’avenir sera encore l’énergie et que, pour l’heure, c’est la partie anglophone du continent qui se trouve favorisée par rapport aux pays francophones. Parmi ces derniers, les « locomotives » sont le Cameroun et surtout la Côte d'Ivoire où la reprise rapide de croissance, après une décennie de crise majeure, permet aujourd'hui un resserrement des écarts. Néanmoins, l’analyse des fondamentaux économiques montre que ce n’est pas du côté d’Abidjan que les meilleures perspectives se situent : le manque d’investissements dans le secteur agricole qui lui est essentiel, conduit au vieillissement des plantations de cacao, de café et, consécutivement, à terme, à une diminution de la productivité et des recettes nationales, qui ne seront pas compensées par une industrialisation du pays qui fait encore défaut ou tarde à s’instaurer. Des problématiques de vieillissement de la population, d’exode rural et d’émigration, sont évidemment à craindre, faute d’une agriculture attractive pour les jeunes actifs. Si les politiques d’annulation de dettes des bailleurs internationaux, multilatéraux et bilatéraux, ont permis provisoirement à des pays de faire face à de tels enjeux, cela semble plus temporaire que durable, et l’avenir risque de se révéler délicat, à la différence de l'Afrique anglophone.
Il faut donc sortir de la facilité qui a conduit notre pays à rester trop longtemps concentré sur l’Afrique francophone, où la concurrence est faible pour nos entreprises.
2. Un constat partagé par les entreprises françaises
Le second élément à mettre en avant est la confiance des entreprises françaises elles-mêmes. Celles qui sont sur place confirment de bonnes perspectives.
C’est le cas des entreprises implantées au Kenya. Si Orange, présent depuis 2007, n’est pas encore rentable, elle a ajouté récemment quelque 300 à 400 millions à ses investissements initiaux. C’est une marque de confiance en l’avenir du pays. Total, présent depuis 1955, est leader de la distribution de carburant et se positionne aujourd'hui sur les activités d’exploration. Ses dirigeants jugent positif l’environnement des affaires et montrent un réel optimisme autour la dynamique régionale qui se dessine au Kenya, porte ouverte sur l'Afrique de l’Est. En témoigne le rachat de Chevron, malgré les difficultés conjoncturelles en 2011 et 2012. Au-delà du seul Kenya, Total considère l’Est de l’Afrique comme particulièrement prometteur dans son champ d’activité, notamment après les découvertes de pétrole et de gaz au large des côtes mozambicaines : de Maputo à l’Éthiopie, voire jusqu’à la Somalie, la zone est désormais considérée comme d’un intérêt majeur, y compris les gisements du Kenya et de l’Ouganda. Thalès présent au Kenya depuis 35 ans partage ces appréciations. Dans un autre domaine, Air France, qui ne dessert plus Nairobi depuis 2000, date du partage de son réseau avec KLM, n’exclut pas de rouvrir une ligne sur la destination si le potentiel continue de croître. Une réflexion est en en cours au niveau régional, compte tenu du développement rapide de l’Éthiopie et des capacités encore limitées de l’aéroport de Nairobi. Quelle que soit la décision finale de la compagnie nationale, cette réflexion confirme l’intérêt des entreprises françaises pour le Kenya et la région est-africaine.
De l’autre côté du continent, des appréciations comparables sont portées sur le Nigeria. Les difficultés y sont extrêmes et la « jungle nigériane » n’est évidemment pas un terrain pour les PME-PMI, mais c’est néanmoins un Eldorado. La situation est telle, sur le plan de la sécurité par exemple, que Michelin a dû se retirer, après y avoir investi dans une usine de pneus à Port-Harcourt. Cela étant, les sommes considérables que Total consacre aux mesures de protection ne l’empêchent pas de continuer à y investir. De la même manière que l’investissement dans l’économie kenyane ne doit pas être envisagé comme un « coup », ceux qui sont réalisés au Nigeria doivent se concevoir sur la longue durée, à savoir 30 ans et plus. Ils se révèlent particulièrement rentables, à condition d’avoir les moyens et les capacités indispensables. C'est la raison pour laquelle les PME-PMI ne peuvent envisager de s’y aventurer sans le soutien des grands groupes. Ce que fait Total avec ses sous-traitants. À la corruption et au racket s’ajoutent le maquis juridique et le manque d’infrastructures qui aggravent les conditions d’installation, notamment pour certains secteurs : ainsi, dans un pays qui produit 70 fois moins d’électricité que la France, pour une population triple, la garantie de la chaîne du froid est évidemment des plus problématique pour un groupe comme Carrefour qui a planifié son entrée sur le continent en 2015. Malgré tout, le Nigeria figure parmi les huit premiers pays dans lesquels il a prévu de s’installer. 264
Enfin, les entreprises françaises installées depuis longtemps en Afrique du Sud regrettent de n’être pas rejointes par de nouveaux investisseurs. Comme le soulignait Henri de Villeneuve 265, le nombre d’entreprises françaises sur place n’a pas vraiment évolué depuis 2001, comme si les entrepreneurs français restaient attentistes, comme s’ils n’avaient pas vu changer les capitales africaines dans lesquelles l’avenir se jouera, et l’Afrique émerger. Selon cet interlocuteur, la perception du risque était exagérée alors que l'Afrique du Sud n’était en rien plus dangereuse que le Brésil ou la Russie ou, pour rester sur le continent, que le Kenya ou le Mozambique. À condition de respecter quelques règles, notamment de travailler en partenariat avec des Sud-africains, de prendre en compte certains coûts, en matière de formation, par exemple, un investisseur a toutes les garanties d’un succès durable. Il faut donc s’intéresser aux pays dans lesquels on investit. Ajoutons que l'Afrique du Sud est non seulement une porte d’entrée sur l’Afrique australe, mais aussi, dans la mesure où elle s’intéresse au continent, sur le Sahel.
Les représentants du MEDEF international que vos rapporteurs ont également rencontrés à Paris 266, partagent ces impressions : l'Afrique anglophone, l'Afrique du Sud en particulier, est une terre d’investissement de long terme. C’est la vision partagée par les entreprises françaises qui s’y intéressent, à la différence des entreprises chinoises qui sont plutôt dans une démarche de « coups ». Ainsi s’explique la présence des entrepreneurs français dans les townships. Il s’agit de répondre principalement à des besoins en infrastructures auxquels notre pays peut apporter des solutions pertinentes avec les acteurs locaux, via les partenariats public-privé, par exemple,. Les représentants du CIAN, pour leur part, voient aussi dans l'Afrique anglophone une dynamique d’affaires plus visible que dans les pays francophones. Sans doute la liaison avec la City de Londres et la proximité juridique avec le monde anglo-saxon y sont-elles pour quelque chose, mais il n’est pas indispensable d’être soi-même anglo-saxon pour réussir !
En conséquence, l'Afrique anglophone doit être une priorité de notre diplomatie et de notre commerce extérieur. Vos rapporteurs ici proposent un certain nombre de recommandations, tant sur le terrain politique qu’économique.
Comme le soulignait récemment Ngozi Okonjo-Iweala, ministre nigériane des finances 267, « Tout le monde investit des milliards ici. Sauf les Français, qui sont un peu lents, un peu timides. Qu’ils viennent voir quel esprit nouveau souffle chez nous. Car s’ils ne sont pas au Nigeria, ils ne sont pas en Afrique ! ».
C. RÉPONDRE AUX DIVERSES ATTENTES
1. Être attentif à la demande politique
Dans la totalité des pays anglophones sur lesquels vos rapporteurs se sont penchés, la France est demandée et attendue. Cette demande se décline sur plusieurs niveaux et traduit la considération qui est portée quant à la place et au rôle historique de la France en Afrique.
a. Une Afrique anglophone en attente de dialogue et de partenariat politique avec la France
En premier lieu, notre pays est à juste titre perçu par ses partenaires d'Afrique anglophone comme ayant une connaissance de l'Afrique unique, reposant sur une histoire coloniale pluriséculaire. L’empreinte qu’elle a tracée sur le continent est par conséquent vue comme un atout considérable pour notre pays, dont il ne devrait pas hésiter à mieux jouer comme passerelle intra-africaine entre des mondes qui se connaissent finalement assez mal. D’où l’insistance marquée à l’approfondissement des relations bilatérales, dans leurs diverses modalités. Bertrand Badie insiste 268 en ce sens sur l’intérêt pour la France de profiter de cette image forte afin de répondre à cette attente et de travailler directement avec ces pays, pour lui permettre à la fois de continuer à montrer une capacité d’action transcontinentale et de conforter ses partenaires dans leur émergence.
Il est essentiel de comprendre ce qu’est un pays émergent : avant tout un pays qui n’a jamais joué de rôle diplomatique mondial, marqué par une histoire d’humiliation, parce que marginalisé : par les États-Unis, comme ce fut le cas du Brésil avec la doctrine Monroe ; colonisé, comme ce fut le cas de l’Inde ou de l’Afrique du Sud ; dominé sous une autre forme, comme ce fut le cas de la Chine. En d'autres termes, pour Bertrand Badie, un émergent aspire à une reconnaissance mondiale et veut être associé à la gouvernance mondiale, à une époque où le système international ne peut plus être géré par les seules puissances occidentales qui l’ont humilié. A peu de choses près, c’est très précisément ce discours que vos rapporteurs ont entendu en Afrique du Sud lorsque leurs interlocuteurs ont souligné que les BRICS se sont construits en réaction à l’Ouest et à l’Europe et sur la diminution de leur influence. Pour eux, l’heure est au repositionnement géopolitique, dans lequel la France doit jouer un rôle de médiateur.
En ce sens, l'Afrique du Sud ne masque pas ses ambitions continentales. Dans cette perspective, la relation bilatérale entre Paris et Pretoria pourrait avantageusement reposer sur un dialogue fluide. La France y aurait d’autant plus intérêt que, en parallèle, la Chine, quoi qu’on puisse en dire, mène une politique de coopération dans tous les secteurs aux effets plus immédiatement visibles. La France devrait savoir jouer de ses nombreux atouts, pour susciter des partenariats qui peuvent lui être extrêmement bénéfiques, tant au plan politique qu’économique. Son approche devrait être inclusive, abordant l’ensemble des problématiques pour promouvoir le renforcement de la relation bilatérale.
Les interlocuteurs sud-africains 269 de vos rapporteurs ont confirmé ce que Bertrand Badie avait tenu à souligner devant eux, à savoir que les émergents perçoivent la France différemment des autres pays européens. S’il existe aujourd’hui des tensions, des problèmes de compréhension entre les deux pays, le sentiment général est à un retour de l’influence de la France dans la région qui a très tôt entretenu d’excellentes relations avec la nouvelle Afrique du Sud qui n’ont jamais cessé. Si le « Forum pour le dialogue politique » institué entre les deux pays, n’empêche pas les incompréhensions et frictions sur quelques questions diplomatiques touchant au continent et au rôle que Pretoria prétend y jouer, pour autant, et pour critiques qu’ils aient pu être vis-à-vis de la France en Afrique 270, les représentants et chercheurs du think tank géopolitique MISTRA, très proche de l'ANC, ont laissé la porte ouverte : pour eux si la Chine est aujourd'hui dans le jeu, ce n’est en rien un renversement d’alliances ou de partenariat. C’est la prise en compte d’une nouvelle réalité qui a changé l’équilibre mondial, dans lequel chacun doit trouver sa place et la France, en particulier, doit dire quel est et sera son rôle vis-à-vis des BRICS. La présence de la Chine sur certaines thématiques ne signifie donc en rien une quelconque exclusivité, tout au contraire, le terrain reste ouvert à qui le veut. L’histoire africaine de la France la destine, plus que tout autre, à continuer de jouer un rôle majeur dans l’accompagnement vers la démocratie et le développement du continent et spécialement de sa partie francophone.
b. Le levier de la francophonie politique
Dans cet ordre d'idées, le fait francophone doit évidemment être considéré comme un atout de poids pour la France en Afrique, non seulement, avec nos partenaires traditionnels que sont nos anciennes colonies, mais surtout, dans le cadre des problématiques qui intéressent le présent rapport. La manière dont les émergents, ou pré-émergents, africains anglophones appréhendent cette réalité ouvre des perspectives économiques considérables sur l’ensemble de la région.
En effet, la France n’a pas toujours une excellente image sous les latitudes africaines. Son passé colonial est parfois mal vu dans la partie anglophone du continent, que les péripéties de la Françafrique n’ont pas atténué. Par exemple, les représentants des milieux d’affaires évoquent encore les dégâts causés en Angola, où notre pays, et surtout ses entreprises, victimes collatérales, ne se sont pas encore remis de l’Angolagate.
Le fait que l'Afrique anglophone soit plus difficile d’accès pour notre pays et ses entreprises que l'Afrique francophone justifie que l’on utilise au mieux les divers leviers à notre disposition. Parmi les cartes à jouer dans cette perspective, l’environnement francophone est essentiel. Nos partenaires anglophones plaident pour que la France joue pleinement son rôle de passerelle entre deux mondes africains qui se connaissent mal. Comme le disait Marc-Antoine Pérouse de Montclos, il faut que la France ait conscience qu’elle dispose en cela d’un capital unique. Certains pays, comme le Nigeria ou le Ghana, sont immergés dans un environnement francophone, d’autres, comme l'Afrique du Sud, sont dans une position ambivalente vis-à-vis des pays d’Afrique francophone. C’est surtout le cas de l'Afrique du Sud, qui, schématiquement, les considère comme inféodés et manipulés par Paris, selon le point de vue exprimé par divers interlocuteurs. Cela justifie d’élever encore plus le dialogue politique bilatéral, en abordant les questions sur un plan régional et continental, inclusif quant au rôle et à la place de chacun.
À cet égard, l’ambassadeur de France au Nigeria, Jacques de Labriolle 271, soulignait de son côté la volonté du Nigeria de développer un partenariat avec la France, et plus largement avec les pays d’Afrique francophone. Il s’agit pour la France de chercher les moyens d’équilibrer sa relation avec ses partenaires anglophones, le Nigéria et l'Afrique du Sud en particulier, et notamment de corriger le déséquilibre causé par son héritage colonial. Ce rééquilibrage doit permettre de ressouder la fracture linguistique et de travailler en commun sur des sujets d’intérêt régional mutuel, telle que la question sahélienne, sur laquelle des approches communes doivent être définies, compte tenu des proximités géographiques et des responsabilités partagées.
Ce regard porté sur l’importance du fait francophone et sur le levier qu’il représente entre les mains de notre pays est constant et unanime A quelque horizon qu’ils appartiennent, les interlocuteurs anglophones de vos rapporteurs l’ont exprimé avec la même conviction. Tim Harris, par exemple, jeune député de l’opposition libérale au gouvernement de l'ANC, se félicite que la France ait su garder aussi longtemps les contacts qu’elle a encore avec ses anciennes colonies. Il y voit un atout majeur dans son positionnement, non seulement sur la partie francophone du continent, mais aussi, plus largement, en termes géopolitiques et géoéconomiques, dont elle doit savoir jouer pour le bénéficie de ses entreprises 272.
c. Une aide au développement heureusement conséquente
Enfin, il ne saurait être question d’oublier le rôle que joue notre politique d’aide au développement dans notre relation bilatérale avec les différents pays concernés, même si la zone de solidarité prioritaire, ZSP, n’existe plus depuis sa dissolution par le dernier CICID, en juillet dernier. Certes, les subventions bilatérales que la France consacre à l’aide en faveur de ces pays n’ont jamais été très conséquentes, tant celles du ministère des affaires étrangères que de l'AFD, et elles ont été prioritairement destinées aux pays francophones. À noter que, le Ghana fait toujours partie des 16 pays pauvres prioritaires de notre APD, c’est le seul pays anglophone dans ce cas 273. Sur la période récente, il a été destinataire de quelque 35 à 50 M$ d’aide bilatérale nette, toutes modalités confondues, cependant que l’APD multilatérale imputée lui revenant, via l’action des institutions de développement, oscille entre 80 et 100 M$.
S’agissant de la politique menée en faveur de pays plus riches que le Ghana, comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, l’intervention de la France se fait, de manière logique, essentiellement au moyen de prêts accordés par l'AFD. Compte tenu de la solvabilité des pays de l’Afrique anglophone, l'AFD y intervient finalement bien plus, toutes modalités d’intervention confondues, que dans les pays d'Afrique francophone.
L'AFD a remarquablement développé ses activités dans ces pays. Au Kenya, par exemple, son agence locale, présente depuis 1997 qui a compétence régionale sur cinq pays voisins, intervient principalement dans le secteur énergétique - 50 % de son portefeuille - dans l’adduction d’eau, dans les infrastructures de base (électricité, routes notamment, aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi), ainsi que l’environnement et les aires naturelles protégées. Dans le cadre d’un document cadre, un partenariat a été conclu entre les deux pays en 2006, et renouvelé il y a deux ans. Il s’inscrit dans la lignée des objectifs définis par la stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement kenyan, dite « Vision 2030 ».
Selon les informations qui ont été communiquées à vos rapporteurs par Yves Terracol, directeur de l’agence régionale 274, 27 projets de l'AFD sont en cours d’exécution. On estime à près de 2,5 millions le nombre de personnes qui ont pu bénéficier de services d’eau améliorés à Nairobi, Kisumu et Mombasa, les trois principales villes du pays ; 400 000 personnes ont été connectées au réseau électrique en zones rurales et 1 million d’autres bénéficient de services d’électricité améliorés. Ces projets contribuent à réhabiliter 1 500 km de routes rurales, touchant plus de 1,5 million de personnes. Dans un autre registre, les actions de l'AFD ont soutenu 80 000 clients d’institutions de micro finance et 300 000 personnes vivant sur les 4 000 km² d’aires protégées, concernées par les projets de préservation et de réhabilitation de l’environnement. Enfin, 45 sociétés ont bénéficié directement ou indirectement, des interventions de Proparco, d’autant plus active qu’il n’y a pas de banque française installée au Kenya. En parallèle, l’ambassade de France à Nairobi mène des actions de coopération qui se concentrent sur quatre secteurs : coopération culturelle et audiovisuelle, enseignement en français et du français, via un FSP dédié « Appui au développement de l’enseignement du français au Kenya », coopération scientifique et universitaire et appui aux politiques de développement.
Dans une zone qui n’est pas traditionnellement prioritaire en matière d’aide au développement, la France, grâce à l’action de l'AFD, a réussi à développer une remarquable activité et à assurer une présence influente, à la fois visible et efficace. En témoigne le financement de plusieurs tranches de la centrale géothermique d’Olkaria, que vos rapporteurs ont eu l’occasion de visiter, opération d’autant plus valorisante pour l’agence et la France qu’aucun autre bailleur ne s’était montré intéressé.
L’activité de l'AFD en Afrique du Sud est aussi très développée, ainsi que son directeur, Jean-Michel Debrat, a pu l’expliquer à vos rapporteurs 275, même si l'Afrique du Sud ne souscrit pas d’emprunts souverains. Les partenaires de l’agence sont les collectivités locales, les banques, le secteur social. Ici comme au Kenya, on atteint les limites imposées par les règles prudentielles, avec quelque 1,4 Md€ d’engagements cumulés entre l'AFD et Proparco, ce qui n’est pas sans poser de problème pour le financement de futurs projets sur lesquels la présence de notre pays est souhaitée. L’agence peut néanmoins continuer ses engagements à hauteur de 50 M€ annuels, contre 200 précédemment, tout en intervenant sur les mêmes secteurs qui permettent de mener une action remarquable, telle la réhabilitation de logements sociaux à Johannesburg, l’assainissement et l’adduction d’eau à Soweto, en plus de projets relatifs aux infrastructures. Lors de sa visite, le Président de la République a eu l’occasion de souligner que l'AFD pouvait continuer, voire amplifier, son action en Afrique du Sud, en envisageant son rôle comme « facteur de développement de partenariats économiques entre nos deux pays » au-delà son soutien traditionnel au développement, et a souhaité « que ses modes d'intervention puissent être déployés aussi bien avec le gouvernement sud-africain ou avec les collectivités locales qu'avec le secteur privé. » 276
Au-delà, les centres de formation et universités françaises sont particulièrement recherchés par les autorités sud-africaines. La question de la formation des cadres est cruciale. On l’a vu, les questions touchant à la formation professionnelle sont fréquemment inclues dans les appels d’offre, pour répondre au cadre de la politique nationale de localisation. Les grandes entreprises françaises participent ainsi activement à la formation de promotions de techniciens supérieurs appelés à gérer les installations qu’elles construisent ou équipent. Ainsi en est-il d’Areva, d’Alstom ou de Dassault. Les entreprises sud-africaines défendent une approche comparable, articulée sur l’avantage comparatif de la France par rapport à certains compétiteurs, notamment la Chine, à laquelle il est reproché d’investir et d’occuper des créneaux économiques sans autres soucis que la rentabilité. Parmi les idées avancées par certains interlocuteurs de vos rapporteurs, les partenariats et les rapprochements « triangulaires » entre entreprises, universités et centres de recherche. Certaines universités sud-africaines sont de très bon niveau. La France, via ses entreprises implantées dans le pays, pourrait participer au développement de fondations de recherche appliquée, ce qui serait mutuellement bénéfique, améliorerait l’expertise et participerait de la politique d’influence de la France.
Enfin, au Nigeria, trois FSP sont ou ont été conclus avec la France. Le premier a porté sur l’appui au développement du français, il a été prolongé jusqu’en décembre 2012 ; un autre a été récemment approuvé, sur l’appui à la société civile nigériane, pour répondre aux besoins des plus vulnérables, plus des deux-tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Le dernier projet porte sur la sûreté aérienne.
2. Répondre à la demande économique
a. La francophonie comme levier économique intra-africain
On touche ici un autre point essentiel : comme on le sait, les principaux pays africains anglophones sont en effet en contact avec les pays francophones, directement, dans le cas du Nigeria ou du Ghana, ou de manière plus médiate mais réelle, dans le cas de l’Afrique du Sud, avec la RDC ou d’autres, plus lointains. Dans la mesure où l’Afrique du Sud entend jouer un rôle continental, cette interface lui est aussi essentielle. Ce n’est pas un hasard si les diplomates sud-africains ont l’obligation d’apprendre le français ou si l’ambassadrice du Ghana en France insistait sur plusieurs aspects de la relation franco-ghanéenne qu’il conviendrait de renforcer. L’environnement du Ghana est francophone, entouré par la Côte d'Ivoire à l’Ouest, le Burkina Faso au Nord et le Togo sur son flanc Est. Il lui est donc indispensable de mieux s’insérer dans cet espace francophone. Il fait ce qu’il faut pour cela, ayant été admis en 2006 à l’Organisation internationale de la francophonie, OIF, comme membre associé.
Indépendamment du fait que pendant longtemps, beaucoup d’entreprises françaises se sont limitées à l’Afrique francophone, où elles sont aujourd'hui en perte de vitesse, force est de constater leurs difficultés à s’implanter en Afrique anglophone. Les intérêts croisés de nos grandes entreprises et des grandes entreprises d'Afrique anglophone justifient que notre diplomatie économique s’attelle à favoriser les relations intra-africaines. Comme le soulignait très justement Dominique Lafont, président de Bolloré Africa Logistics et du conseil de chefs d'entreprise France-Afrique de l'Est du MEDEF International 277, il importe de tenir compte de cette ambition des entreprises sud-africaines qui veulent conquérir le reste de l’Afrique, bien qu’elles rencontrent des problèmes linguistiques, culturels et autres, liés à la séparation entre Afrique blanche et Afrique noire. Des partenariats sont à inventer qui pourraient être utiles aux entreprises françaises, dont l’aide aux entreprises sud-africaines notamment, serait fortement valorisée.
Les entrepreneurs sud-africains rencontrés sur place 278 ont également avancé cette suggestion : les IDE de la France en Afrique francophone ont été fructueux grâce à sa connaissance du terrain, à son expertise incomparable. Il est important que les entrepreneurs sud-africains, très désireux d’investir dans toute l'Afrique subsaharienne, puissent trouver des partenaires sur lesquels s’appuyer, dans le cadre d’opérations qui seraient mutuellement bénéfiques.
De son côté, Joanmariae Fubbs, présidente de la commission du commerce et de l’industrie du parlement sud-africain 279, a dressé devant vos rapporteurs le catalogue des secteurs dans lesquels l'Afrique du Sud est désireuse de développer des partenariats avec notre pays. Par exemple, les problématiques énergétiques sont en cours de réflexion, diverses options sont à l’étude, qui portent à la fois sur l’éolien et le solaire d’un côté - ils ne pourront représenter que des parts modérées de la production - les gaz de schiste et le nucléaire de l’autre, qui, du point de vue sud-africain, sont également à étudier autant pour des raisons de coûts que de perspectives à long terme. Dans ces secteurs, les acteurs sud-africains examinent les offres et les avantages des uns et des autres. Sur ces questions comme sur de multiples autres opportunités, telles les industries productives, la France est particulièrement bienvenue, compte tenu de la qualité de ses industries et de l’ampleur des besoins à satisfaire.
La France pourrait également devenir un partenaire majeur de l'Afrique du Sud si elle pouvait aussi travailler avec elle sur la qualité de ses ressources humaines, pour laquelle la multiplication de partenariats et d’échanges universitaires est vivement souhaitée. Il en est de même des coopérations industrielles qu’il faudrait explorer ainsi que de l’articulation de la relation entre l'Afrique du Sud et l'Afrique francophone sur laquelle la France serait une alliée des plus apprécié. D’autant que l’Afrique du Sud possède un programme commercial intra-africain et qu’elle commerce à la fois avec les pays d’Afrique de l’Ouest comme avec ceux d’Afrique de l’Est. La médiation de la France renforcerait opportunément ses facilités.
b. Entendre la demande de France pour elle-même
Au-delà du rôle de passerelle que la France peut jouer entre les Afriques, que de nombreux acteurs souhaitent lui voir jouer, vos rapporteurs ont aussi rencontré des interlocuteurs soucieux du renforcement des liens économiques bilatéraux. C’est ce qu’avait déjà exprimé en son temps le Premier ministre kenyan, Raila Odinga, auditionné par la commission des affaires étrangères en 2009 280. Il avait notamment souligné que « L’enseignement du français s’est développé fortement au Kenya depuis que l’Alliance française a ouvert des bureaux à Nairobi, et il continue sa progression. Entre 5 000 et 7 000 Kenyans apprennent le français ; l’Association des professeurs de français regroupe 400 membres, dont vingt se sont récemment rendus en France. Enfin le français est à présent enseigné dans toutes les universités publiques sur tout le territoire. Nous nous félicitons de voir la France développer depuis vingt ans des liens avec d’autres pays d’Afrique qu’avec ses anciennes colonies, car nous ne devons pas rester prisonniers de notre passé colonial : il nous faut diversifier nos relations. ». Vos rapporteurs n’ont pu rencontrer beaucoup d’autorités politiques lors de leur déplacement car le gouvernement n’avait pas encore été nommé par le nouveau Président de la République. 281 Néanmoins, le nouveau gouverneur de Nairobi, Evans Kidero 282, n’a pas manqué de souligner le souhait de voir des programmes d’accueil de jeunes Kenyans se développer pour qu’ils puissent poursuivre leurs études en France. L’attente est également insistante concernant les investissements privés.
Les avantages comparatifs de la France sont perçus comme remarquables, notamment par rapport à la Chine, que ce soit en matière de formation, d’environnement ou d’approche sociale. Elle doit savoir les mettre en avant. D’une certaine manière, la balle est dans son camp. À elle de dire aux Sud-africains ce qu’elle propose, ce qu’elle est prête à investir dans le partenariat bilatéral, pour que l'Afrique du Sud, ouverte à toutes les opportunités pour continuer à aller de l’avant et à résoudre ses défis, puisse les saisir. Pour rester sur le plan économique, les interlocuteurs de vos rapporteurs s’étonnent, par exemple, du fait que la France n’ait pas investi dans le secteur minier, comme le Canada, ou dans le secteur énergétique, que ce soit en éolien, solaire ou hydraulique, alors qu’elle aurait la possibilité de faire la différence 283. Il en est de même en matière agricole ou agroalimentaire : des terres immenses sont encore inexploitées, notamment autour des zones minières, dont l’utilisation permettrait l’emploi de populations locales pour des productions destinées aux marchés locaux et à l’exportation. Des joint-venture pourraient utilement être envisagées qui associeraient entreprises sud-africaines et françaises. La question du développement agricole est une problématique majeure, en Afrique du Sud comme en Afrique australe, et le fort positionnement des entreprises françaises du secteur constitue une autre des opportunités sur lesquelles elles pourraient investir. Ainsi des céréales : la région australe dispose de tous les atouts, - terres en abondance, populations disposées à travailler -, pour venir concurrencer les producteurs australiens ou ukrainiens sur les marchés internationaux. Seuls manquent encore le savoir-faire et l’évolution de l’approche pour aborder les problématiques en termes globalisés. La France pourrait développer de nouveaux lieux de production et aussi répondre aux aspirations locales grâce à son expertise reconnue.
Comme vos rapporteurs l’ont constaté 284, la « demande » de France est tout aussi forte chez les entrepreneurs kenyans. Ils se montrent optimistes sur l’avenir de leur pays, sont unanimes à saluer les progrès en matière de gouvernance et de démocratie. Pour eux, le Kenya apparaît comme le microcosme des émergents, qui fait figure d’exception, dans la mesure où son développement n’a pas été principalement soutenu par ses matières premières. Il présente une histoire positive sur laquelle des opportunités d’affaires se sont greffées. Malgré des handicaps, telles la question énergétique et les délestages dans la fourniture d’électricité ou la corruption, une classe moyenne émerge, la croissance est durable et stabilisée pour investir : les IDE européens et français sont d’autant plus bienvenus qu’ils contribueront élever les standards kenyans en matière de management, de règles sociales. Il ne faut donc pas commettre l’erreur de considérer le Kenya comme un marché de dumping, de « coups » de court terme, mais plutôt comme une base arrière permettant une implantation réussie au niveau régional, Nairobi faisant office de hub en ce sens. Il faut considérer le Kenya, dans la perspective régionale d’une zone de libre-échange.
Pour les entrepreneurs kenyans, les entreprises françaises sont bienvenues pour plusieurs raisons : en premier lieu, elles tiennent déjà certaines positions non négligeables et travaillent selon des standards élevés. La réputation de certaines d’entre elles est avantageuse depuis longtemps. Il faut qu’elles sachent capitaliser sur cet acquis initial pour aller de l’avant. C’est par exemple le cas dans les secteurs automobile 285, de la santé, de la distribution.
S’agissant de l'Afrique du Sud, le propos est absolument identique. Lors d’une table ronde organisée par Stefan Sakoschek, président de la chambre de commerce et d’industrie franco-sud-africaine, la FSACCI 286, qui réunissait un grand nombre d’entrepreneurs sud-africains, plusieurs messages ont été transmis à vos rapporteurs, à quelque secteur qu’appartiennent les participants. Il en ressort la volonté unanime de renforcer les liens entre entreprises françaises et sud-africaines. Trois niveaux d’approches peuvent être ici distingués.
En premier lieu, on considère la présence des grands groupes français en Afrique du Sud comme une chance pour le pays, compte tenu de ses besoins, par exemple en matière d’infrastructures, ferroviaires ou autres. La relation bilatérale doit être renforcée pour soutenir la croissance sud-africaine ; elle offre des opportunités importantes dont les entreprises françaises doivent savoir tirer profit, l’ancienneté des relations leur donne un avantage. Les entreprises françaises ne doivent pas être frileuses et il ne faut pas que l’arbre cache la forêt des avantages que l'Afrique du Sud peut offrir : s’il y a des problèmes quant à la formation des ressources humaines, l’essentiel est qu’elles acquièrent de l’expérience et travaillent. La qualité des infrastructures du pays, même s’il reste d’importantes améliorations à apporter quant à la fourniture d’électricité par exemple, est d’un niveau tel que toutes les conditions sont réunies pour des affaires rentables.
Au-delà de la croissance sud-africaine, les partenariats qui peuvent être noués seront bénéfiques au plan régional, les entreprises sud-africaines et françaises pouvant s’épauler quant aux opportunités offertes par les pays environnants.
Parmi les partenariats internes à l'Afrique du Sud ou circonscrits à la région de l'Afrique australe, l’aspect le plus intéressant, de l’avis de vos rapporteurs, porte sur la perception de la France comme ouverture vers le continent. On retrouve ici la perception du rôle que notre pays peut jouer au plan politique et diplomatique, en tant que facilitateur de dialogue intra-africain. Les entrepreneurs sud-africains sont des plus désireux de réussir à monter des partenariats gagnants-gagnants avec les sociétés françaises pour partir à la conquête de l’Afrique, notamment francophone.
Sur toutes ces questions, les entrepreneurs sud-africains sont sur la même ligne que les autorités politiques du pays.
Au-delà de ce rôle de passerelle de la France, qui bénéficierait aussi à l’implantation de nos entreprises en Afrique anglophone, il faut tenir compte de l’ambition des plus grandes entreprises des principaux pays de la zone, de l'Afrique du Sud en tout premier lieu. Comme les diplomates en poste à Paris l’ont indiqué, l'Afrique du Sud n’a pas pour seul objectif la croissance des échanges économiques et le rééquilibrage de sa balance des paiements bilatérale. Un certain nombre de ses entreprises sont intéressées par la France et « l’Afrique du Sud aimerait elle aussi marquer son empreinte en France au travers d’investissements. » 287 Cela commence à être le cas, Conforama ayant été rachetée en mars 2011 par le groupe sud-africain Steinhoff. Cette préoccupation rejoint celle de la France : le Président Hollande soulignait lors de son déplacement la volonté notre pays d’accueillir des entreprises sud-africaines. La réciprocité doit être désormais un pivot sur lequel articuler la relation bilatérale avec l'Afrique du Sud et, au-delà, avec les différents pays de l'Afrique anglophone.
Au lendemain de la visite du Président de la République en Afrique du Sud, le supplément géopolitique du journal Le Monde titrait : « Vers la Frenchafrique ». 288 Avec des mots plus durs que ceux qu’ils ont employés durant leurs auditions, les mêmes interlocuteurs que ceux que vos rapporteurs ont rencontrés y dénonçaient, qui l’aberration, qui la très grave erreur d’appréciation, qui l’effondrement, qui, enfin, la déconnection de l’administration française des réalités africaines d’aujourd'hui. Certains parlaient du naufrage de la diplomatie française vis-à-vis de l’Afrique. D’où qu’ils s’expriment, tous plaidaient pour un profond aggiornamento de la stratégie africaine de la France, pour en finir avec la déshérence dans laquelle se trouve notre relation avec la partie anglophone du continent.
Les partenariats stratégiques bilatéraux signés ces dernières années avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria témoignent cependant qu’il est excessif de dire que notre pays ne s’est jamais intéressé qu’à l'Afrique francophone. Mais qu’ils soient restés lettre morte jusqu’à présent montre aussi que les initiatives pour s’écarter du pré carré ont du mal à dépasser le stade des velléités.
On peut espérer que l’on est enfin au début de cette réorientation nécessaire. Le succès de la récente visite de François Hollande en Afrique du Sud doit être l’occasion de relancer des relations avec des pays qui sont d'ores et déjà les locomotives de l’Afrique.
Car, comme la mission l’a constaté, la France est attendue à bras ouverts : quel que soit le terrain, politique, économique, culturel ou scientifique, il n’est pas un domaine dans lequel la présence de notre pays n’est souhaitée par les pays d’Afrique anglophone. Nos entreprises comme nos chercheurs sont bienvenus ; on souhaite que nos échanges, qu’ils soient commerciaux, politiques, culturels, universitaires, se développent. Notre connaissance de l'Afrique est perçue comme une valeur ajoutée sans équivalent, qui peut permettre à notre pays de jouer un rôle unique dans l’intérêt de tous, de passerelle entre deux Afriques qui se connaissent mal et doivent se rapprocher. L'Afrique anglophone a encore des besoins innombrables à satisfaire, de nombreux défis à surmonter pour conforter son cheminement vers le développement et vers l’émergence. Elle attend la France pour l’y aider, et elle le fait savoir.
Il nous appartient d’y répondre. Rapidement, car la concurrence est rude et, malgré quelques succès spectaculaires comme celui d’Alstom, nous ne sommes pas les mieux placés. Et cela est de notre seule responsabilité. Il nous faut pour cela prendre enfin conscience que notre pays ne peut que tirer des avantages d’une relation mieux équilibrée avec l’ensemble du continent. Il ne s’agit pas de nous détourner de l'Afrique francophone, mais de prendre en compte l’ensemble de nos intérêts : la France peut-elle envisager se passer plus longtemps d’un partenariat plus étroit avec des pays qui sont les seuls sur ce continent en mesure de fournir de l’emploi à son industrie pour plusieurs années ? Notre pays ne peut donc rester à la marge de ce dynamisme.
Des choix politiques sont sans doute à faire. Certaines décisions ont été prises il y a déjà des années, qui n’ont pas été mises en œuvre, ou mal, sur lesquelles il est urgent de revenir, notamment concernant les divers volets de notre dispositif, qui doit être renforcé en direction de ces nouvelles destinations. Contraintes budgétaires obligent, des arbitrages seront à faire.
Mais si l’on veut que notre pays puisse continuer à jouer le rôle qui peut être le sien sur ce continent d’avenir et qu’il en tire les fruits, c’est maintenant qu’il doit donner l’impulsion politique nécessaire.
Résumé des recommandations de la mission vis-à-vis des pays d’Afrique anglophone Renforcer la relation politique Développer les relations bilatérales de niveau présidentiel et ministériel Approfondir le dialogue politique avec nos partenaires anglophones sur les problématiques continentales Donner à notre diplomatie africaine un contenu global Renforcer notre réseau diplomatique, notamment en Afrique du Sud et au Nigeria Recentrer la diplomatie économique et renforcer nos soutiens Faire du ministre de l’économie un acteur majeur de la relation de la France avec l'Afrique anglophone Nommer un représentant spécial du ministre des affaires étrangères chargé des pays d'Afrique anglophone émergents Renforcer l’accompagnement politique de nos entreprises dans leurs stratégies commerciales, de partenariats et d’investissements Favoriser les relations intra-africaines dans l’intérêt réciproque des grandes entreprises françaises et africaines Assurer un suivi attentif des priorités et besoins des pays partenaires pour mieux positionner et soutenir nos entreprises Redéployer le réseau UbiFrance vers les pays d'Afrique anglophone S’assurer du volontarisme de « BPIfrance export » sur l'Afrique anglophone et des moyens qui y seront consacrés Réviser la stratégie pour le commerce extérieur Profiter de l’extension géographique du mandat de l'AFD pour lui donner les moyens de développer son activité dans les pays d’Afrique anglophones Répondre aux attentes Capitaliser sur la bonne image de marque de notre pays et notamment sur les aspects sur lesquels la France est perçue comme présentant une forte valeur ajoutée par rapport à ses concurrents : savoir-faire, approches sociales, environnementales, etc. Savoir tirer profit des dimensions de la francophonie en Afrique et notamment soutenir les pays anglophones dans leur relation avec leur voisinage francophone pour leur meilleure insertion Soutenir la demande de partenariats politiques et économiques bilatéraux Développer des partenariats en matière de formation de ressources humaines en Afrique du Sud Appuyer l’ambition continentale des entreprises des pays émergents de l’Afrique anglophone Soutenir nos dispositifs culturels Répondre à la demande de français dans les pays anglophones Étoffer l’offre de formation en France, notamment professionnelle Soutenir le développement de partenariats universitaires Soutenir les rapprochements entre entreprises, centres de recherche et universités sur des problématiques linguistiques et culturelles Veiller au maintien des moyens des IFRE du Nigeria, du Kenya et d’Afrique du Sud Donner plus de visibilité et de suivi à nos initiatives, notamment les « Saisons » |
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 6 novembre 2013.
Après les exposés des co-rapporteurs, un débat a lieu.
Mme la Présidente Elisabeth Guigou. Je crois que votre rapport donne tout d'abord un éclairage intéressant sur les perspectives économiques du continent et des pays d’Afrique anglophone. Vous montrez bien les changements majeurs qui sont en train de s’opérer et le fait qu’une partie importante de l’Afrique est sur une dynamique nouvelle qui invite à porter un regard totalement différent de celui que l’on avait jusqu’à présent. Lionel Zinsou, qui fait partie des experts que vous avez rencontrés, est particulièrement enthousiaste sur le futur de l'Afrique et fait partie des « afro-optimistes » résolus. Cela étant, il serait sans doute prématuré de dire que l'Afrique est tirée d’affaire et je note que les experts eux-mêmes sont partagés sur les perspectives, puisque certains mettent en doute le fait que l'Afrique serait émergente, et argumentent que tout le monde se fourvoie, compte tenu de l’absence de fiabilité des appareils statistiques africains.
Ce que l’on note aussi, ce sont les ambitions régionales, et même internationales, des pays les plus importants, l'Afrique du Sud, en premier lieu. C’est un peu la revanche des anciens colonisés, ce qui peut susciter quelques frictions, vous en avez parlé, notamment avec notre pays, mais aussi avec leurs voisins immédiats qui ont tendance à trouver dans l’attitude de Pretoria une volonté d’hégémonie parfois un peu pesante.
Mais vous montrez surtout dans la dernière partie de votre rapport qu’il y a de la part de l’ensemble des pays que vous avez étudiés, une volonté forte, unanime, de voir les relations avec notre pays se développer : l’Afrique anglophone souhaite que la France continue à être présente sur le continent, qu’elle investisse davantage, qu’elle commerce davantage et qu’elle tire profit de sa connaissance unique de la région pour jouer un rôle d’interface entre Afrique francophone et Afrique anglophone, pour le bénéfice de tous. C’est une très bonne nouvelle et cela n’est pas incompatible avec le maintien de nos relations, plus traditionnelles, avec les pays d’Afrique francophone, même si cela suppose un rééquilibrage de nos moyens, pour lequel vous plaidez.
M. Jean-Paul Bacquet. Je remercie les rapporteurs pour leur exposé. Je souhaiterais formuler plusieurs remarques. D’abord, c’est une belle leçon de philosophie politique et d’analyse politique dans le temps. Noël Mamère a cité René Dumont, selon lequel l’Afrique noire était mal partie, et qui pensait que l’Afrique dépérirait, ce qui prouve que même un écologiste peut se tromper... Lorsque l’on lit Jean-Michel Severino ou Serge Michailof, ils sont pleins d’optimisme sur l’avenir du continent. Certes, il y a des problèmes de sécurité et d’instabilité politique, mais la démocratie progresse en Afrique et la population a atteint 900 millions de personnes et devrait passer à 2 milliards en 2050, ce qui posera des problèmes de migrations, externes mais aussi internes.
Ensuite la France apparaît timide. Au cours d’une mission que j’avais effectuée avec Michel Terrot et Jean-Louis Christ, nous avions pu constater notre désengagement partout, sous l’effet d’un complexe néo-colonialiste, d’une démarche culpabilisée et culpabilisante. C’est une erreur manifeste. On voit aujourd’hui au Mozambique et en Angola l’arrivée d’immigrants portugais, alors que ce sont leurs anciennes colonies. L’exemple de la téléphonie et du numérique est judicieux. Il y a plus de portables par habitant qu’en Europe.
Vous avez parlé de l’insuffisance de notre présence. Le Nigéria a inscrit le français parmi les langues qui vont devenir obligatoires à l’école. Ce n’est pas parce qu’ils sont demandeurs d’une présence française, mais parce qu’ils ont conscience du potentiel que constituent les pays francophones d’Afrique, qui sont des marchés pour eux, et ils s’y implantent d’ailleurs à notre détriment.
Sur la question des PME françaises, nous sommes des rigolos par rapport aux Allemands, nous le savons. En revanche, l’accompagnement peut exister. Ubifrance a ouvert une agence au Kenya ; la France n’avait pas vu avant l’intérêt d’y être présente. Il y a une délégation de service public au Nigéria à la chambre de commerce franco-nigériane.
Les anglophones n’ont pas la même approche que nous. Ils ne voient aucun problème à faire de l’aide liée, alors que nous sommes puritains et travaillons donc au bénéfice des anglophones et des Chinois, en République démocratique du Congo en particulier. Les autres pays font du commerce.
Enfin, il est vrai que nous devons structurer notre accompagnement. Rapprocher Ubifrance et la Banque publique d’investissement va de soi, mais il faut aller plus loin et regrouper l’action d’Ubifrance, des Chambres, de la Sopexa… Ce mouvement semble amorcé, même si la ministre du commerce extérieure, Nicole Bricq, a fait, à tort à mon avis, du rapprochement entre Ubifrance et l’Agence française des investissements internationaux, une priorité. Ce sont deux métiers différents.
M. Michel Terrot. Je partage le constat de Jean-Paul Bacquet. La France régresse partout en Afrique tant anglophone que francophone. Nos parts de marché diminuent. Notre présence politique est faible. Tout est à concevoir. La difficulté majeure vient de l’extrême faiblesse de nos moyens bilatéraux. Si nous continuons à faire passer notre aide par des canaux multilatéraux, la France sera absente de l’Afrique. Nous allons disparaitre au détriment d’autres partenaires.
J’ai une question sur le niveau de la dette publique dans les pays émergents. Quelle est son évolution récente ? Avez-vous regardé si le niveau scolaire a suivi un peu la progression des économies ?
M. Paul Giacobbi. J’ai quelques remarques. D’abord, nous devons tous nous intéresser à l’Afrique car, historiquement, nous venons tous de ce continent.
En 1981, alors élève à l’ENA, mon séminaire devait répondre à la question : « la France doit-elle avoir une zone d’action privilégiée en Afrique ? » Ni les élèves, ni la République n’ont tranché et pour éviter d’avoir à y répondre, on s’est retiré de tout.
Je partage ce qui a été dit sur le décollage de l’Afrique qui reste un décollage lié aux minéraux, à la terre agricole. C’est une économie qui reste primaire.
L’accaparement des terres est très sensible en Afrique de l’Est, notamment par les Indiens qui achètent des champs et les transforment massivement avec des entreprises puissantes. C’est un phénomène majeur et massif.
L’AFD ne doit pas se détourner des pays émergents. Nous devons suivre attentivement le prochain contrat d’objectifs et de moyens de l’AFD.
Je partage aussi ce qu’a dit Jean-Paul Bacquet sur la fusion de l’AFII et d’Ubifrance. Ça n’a rien à voir ! L’une accueille l’investissement étranger en France, l’autre pousse les exportations.
La grande question qui se pose est de savoir ce que veut la France. Rester dans un entre soi où la francophonie n’est plus un vecteur pour notre pays ? Ou veut-on aller vers le mainstream international ?
Actuellement, à force de ne pas répondre à ces questions, on se retire de tout et on est ridicule en tout. Le jour où la Chine et l’Inde seront les seules puissances en Afrique francophone, on aura l’air malins !
M. Jacques Myard. Enfin nous nous intéressons à l’Afrique ! La question fondamentale est de savoir quels sont les choix stratégiques que nous faisons vu nos moyens limités. Bruxelles, c’est fini ! Il faut savoir que les ruptures géostratégiques sont sur notre flanc sud et en Afrique. Les moyens que nous mettons en Europe doivent être redirigés vers l’Afrique dans une politique du « multi-bi ». Le multilatéral est paralysant et anonyme.
Par ailleurs, comme les États-Unis ou d’autres États, il nous faudrait trois secrétaires d’État : un pour l’Asie, un pour l’Afrique et l’autre pour l’Amérique latine. Nous avons des stratégies d’influence à porter. Le ministre des affaires étrangères ne peut aller partout.
Monsieur Mamère, j’ai passé trois ans de ma vie au Nigéria. C’est un pays très violent. Il y a une césure entre le nord et le sud. Les massacres sont quotidiens. Mais c’est vrai que c’est un État où l’on fait beaucoup d’argent avec une forte rente pétrolière. Toutefois, si les projections à 400 millions d’habitants se révèlent exactes, je crains fort qu’il y ait des tensions très fortes. Ce sont des États d’avenir mais qui posent beaucoup de questions.
M. Jean-René Marsac. Je souhaite revenir sur la question de la répartition des aides multilatérales et bilatérales et sur la présence et l’éventuel rôle à jouer de l’Union européenne sur le continent africain. Par ailleurs, j’ai noté que vous n’aviez pas évoqué les sous-ensembles économiques qui se construisent en ce moment, comme la communauté des États d’Afrique de l’est. Ce sont des voies qui permettent d’organiser autrement le développement économique de ces territoires et les relations entre la France et ces territoires.
M. Jean-Louis Christ. Je tiens à féliciter les rapporteurs. La qualité des travaux démontre que c’est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Mais, cela fait maintenant douze années que je suis là, et j’entends toujours les mêmes choses sur l’Afrique. Avec plusieurs de mes collègues nous avons eu l’occasion de travailler sur ces questions et nous en revenons toujours au manque de présence de la France sur le continent. Sortons de l’angélisme consistant à dire que nous avons un rôle à jouer dans les domaines de la santé et de l’humanitaire. Cela est tout à fait insuffisant et nous devons désormais adopter une autre approche de notre aide sur place au travers d’autres thèmes comme, par exemple, la formation professionnelle. Je regrette que rien ne soit dit dans les OMD sur ces questions de formation professionnelle qui sont pourtant les éléments de décollage économique d’un pays en ce qu’ils permettent l’émergence d’une classe moyenne. Or, la France est cruellement absente dans ce domaine-là et je souhaite que d’autres travaux soient lancés car je regrette de constater que nous n’avançons pas dans cette direction.
Mme Chantal Guittet. En ce qui concerne le tableau sur les parts de marché détenus dans les pays étudiés par la France, l’Allemagne, le Royaume Uni et les États-Unis, je m’étonne de ne pas voir apparaître la Chine qui est pourtant, je crois, le deuxième investisseur après les États-Unis. La Chine fait beaucoup d’investissements en Afrique et essaye d’étendre sa puissance. Quel est votre avis, messieurs les Rapporteurs, sur le phénomène chinois. Elle investit beaucoup en Afrique anglophone et francophone sans demander beaucoup de contrepartie et cela plait aux autorités africaines.
M. André Schneider. Je félicite la précision du rapport et son analyse. Je pense également que le 21ème siècle doit être africain, au risque que nous ne rations un rendez-vous historique. Je n’étais guère trop au courant de la situation en Afrique anglophone, mais je constate que le problème est le même. A savoir, que la Chine a créé beaucoup de désillusions, notamment au travers la question du rachat des terres. Il est temps pour nous de nous débarrasser de notre complexe colonial et de marquer notre présence. Il y’a des compagnies consulaires qui n’attendent qu’un petit coup de pouce. Je propose que nous fassions un partenariat avec des centres de formation permanente. Nous pourrions faire des échanges qui ne coûteraient pas grand-chose. De nombreux États africains disposent d’un équipement extraordinaire mais pas du personnel compétent pour l’exploiter. Je propose, par exemple, un échange de formateurs ou professeurs de lycées professionnels pour une durée de trois mois, cela serait bénéfique pour tous, d’un moindre coût et pourrait énormément changer les choses. Je demande aux rapporteurs, si dans les pistes explorées, ils n’ont pas senti le besoin de travailler davantage sur les petits dossiers car les petits ruisseaux peuvent donner de grandes rivières.
M. Didier Quentin. Cette histoire de réorientation de la Diplomatie française sur l’Afrique francophone est une problématique bien connue vieille de 40 ans ! Cela fait des décennies que l’on parle de tout ça et peu de choses se passent en réalité. Pour cultiver la pensée positive, je souhaite demander à nos deux rapporteurs s’ils ont retenu quelques initiatives positives et majeures de notre diplomatie en Afrique anglophone ou bien notre diplomatie est-elle fossilisée ?
Mme Seybah Dagoma. A quelques jours du Sommet de l’Élysée, je crois qu’il faut saluer ce rapport.
Je partage l’avis de Jean-Paul Bacquet et de Jacques Myard sur la nécessité de secrétaires d’État par zones géographiques.
Vous avez évoqué la forte ambition diplomatique de l’Afrique du Sud. Qu’en est-il du développement des relations économiques et commerciales ? Le ministre de l’industrie et du commerce sud-africain a très clairement dit que l’Afrique constituait sa priorité stratégique. Ces propos font écho à ceux de Mme Zuma, présidente de la commission de l’Union africaine, pour qui il conviendrait de développer davantage les transports interafricains, évoquant même des zones de libre-échange au plan régional et, à terme, continental. Votre rapport fait part de l’hostilité des pays voisins, ce qui m’a beaucoup étonnée. Pour aller souvent en Afrique, notamment au Nigeria, je crois plutôt comprendre que l’Afrique du Sud est un modèle. La jeunesse la considère comme un Eldorado.
Vous n’avez pas évoqué le Sida en Afrique du Sud. Quel pourrait être son impact à moyen et à long terme selon vous ?
S’agissant de l’Éthiopie, la délocalisation de H&M a fait couler beaucoup d’encre. Pour certains analystes, l’Afrique pourrait se transformer un jour en usine du monde. Qu’en pensez-vous ?
M. Pierre Lequiller. Je fais mien, bien sûr, tout ce qui a été dit sur la nécessité d’être présent en Afrique francophone et je voudrais apporter une note positive : la coopération décentralisée s’est beaucoup développée. Beaucoup de régions et de départements réalisent un travail très concret pour aider à la construction d’écoles et d’équipements. Mon département consacre ainsi un euro par habitant à la coopération décentralisée. Jean-Philippe Mallé et Jacques Myard, ici présents, pourront témoigner de cet effort en direction de l’Afrique.
M. François Loncle. Voilà un excellent débat, lancé par des analyses et des recommandations excellentes de nos deux rapporteurs.
Ne versons pas dans le déclinisme ! Il y a en Afrique une présence française encore forte, un désir de France encore plus grand, et des acteurs qui travaillent.
La coopération décentralisée, évoquée par Pierre Lequiller, a cependant été singulièrement freinée par les problèmes de sécurité et par le classement stupide, par le Quai d’Orsay, d’une partie immense de l’Afrique en « zone rouge ». Le « grand parapluie » est l’instrument préféré de cette administration !
Par ailleurs, comment progresser avec un budget en recul depuis 1994, qu’il s’agisse de celui des affaires étrangères ou de la coopération, alors que les autres budgets progressaient dans le même temps ? Nous le dénonçons chaque année.
Je note, malgré tout, un fait nouveau très positif : la volonté de la plupart des pays africains de prendre leur destin en main. En témoigne la montée en puissance des organisations régionales, en particulier l’Union africaine, qu’il faut aider davantage. Il faut trouver un équilibre pour ne pas gêner cette aspiration.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je crois qu’il serait utile de faire un point systématique sur la coopération décentralisée dans nos rapports. C’est un vecteur important que l’on ignore trop.
J’ai été très sensible, par ailleurs, aux remarques sur la formation professionnelle. C’est un démultiplicateur peu coûteux d’influence.
M. Noël Mamère. Ce rapport n’a pas pour objectif de montrer la faiblesse de nos relations avec l’Afrique ou nos inquiétudes concernant son développement. Au contraire, nous souhaitons que l’on renforce les liens et que l’on accompagne le « décollage ».
L’intégration régionale est essentielle. La France est sans doute le seul pays qui peut jouer un rôle de passerelle entre l’Afrique francophone et l’Afrique anglophone. Du fait du développement des classes moyennes et de l’élévation du niveau de vie, l’Afrique francophone devient un marché en matière de biens, mais aussi d’exploitation d’un certain nombre de ressources. Ce n’est pas un hasard si le Nigeria a consacré le français : c’est un pays frontalier de l’Afrique francophone, comme le Ghana, qui est en pleine expansion et compte des gisements pétroliers « offshore » très importants. Par ailleurs, bien souvent, les échanges n’ont pas lieu en anglais, mais dans les langues des ethnies qui se trouvent de part et d’autre des frontières.
Il faut faire très attention avec les projections démographiques. Contrairement à ce que certains prétendent, ce n’est pas une « grève du troisième ventre » qui s’impose. Ce serait ridiculement malthusien. Il faut plutôt miser sur l’éducation. Partout où le niveau d’éducation a progressé, les femmes font moins d’enfants. L’éducation n’est pas seulement une affaire de béni-oui-oui ou de droits-de-l’hommistes !
Si le niveau d’éducation est plus élevé au Zimbabwe qu’en Afrique du Sud, malgré la dictature exercée par Mugabe, c’est parce que l’Afrique du Sud est victime de la « Bantu Education ». On a sous-éduqué les Noirs, auxquels on n’enseignait qu’un certain de nombre de disciplines, les seules jugées utiles pour qu’ils puissent occuper la place qui leur était assignée dans une société d’apartheid. Et cet héritage perdure. C’est un handicap considérable pour le pays. Même si de nombreuses élites africaines rêvent de ce pays, son taux de croissance est inférieur à ceux du Kenya, du Mozambique, de l’Angola et même de l’Éthiopie. Il risque de perdre son leadership.
S’agissant de Mme Zuma, il faut dire aussi que son élection a été difficile et que si beaucoup de pays africains regardent avec envie l’Afrique du Sud, la relation est faite d’attraction et de répulsion. On supporte mal son hégémonie politique, notamment ses pressions pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Et je ne reviens pas sur la présence de troupes sud-africaines en Centrafrique, qui a d’ailleurs suscité des problèmes importants de politique intérieure.
Le pétrole est à la fois la richesse et le cauchemar du Nigeria. Il y a des atteintes insupportables aux droits de l’homme et des inégalités considérables dans la partie du pays où le pétrole est extrêmement important. Le Nord a nourri des groupes séparatistes et terroristes.
M. Jacques Myard. Le problème est plus ancien ! Il y a aussi des rivalités religieuses…
M. Noël Mamère, rapporteur. Et ethniques. Oui, bien sûr. Mais n’oublions pas Ken Saro-Wiwa, l’un des leaders de l’opposition démocratique au Nigeria, qui luttait notamment contre certaines formes d’exploitation du pétrole, et qui a été assassiné en 1995. Je vous invite à lire l’ouvrage de sa fille, Transwonderland.
Le Nigeria est une métaphore de l’Afrique. Son potentiel de richesse est considérable, mais il y a encore beaucoup de corruption et d’inégalités, et en même temps, aussi, des gens très compétents. Lisez aussi la récente interview de la ministre des finances du Nigeria dans Le Monde.
Ce que nous avons essayé de démontrer, c’est qu’il n’y a pas de fatalité à ce que la France soit absente de ce continent et de cette partie du continent. Il suffit de mettre en place un certain nombre d’outils, je pense en particulier à la nomination d’un secrétaire d’État ou d’une personnalité, d’un exécutif, dédié spécifiquement à ces pays. Pour répondre à Paul Giacobbi, il ne faut bien sur jamais oublier que l’Inde est extrêmement présente sur toute la côte est, sur l’Océan Indien, de par sa tradition. Mais il n’y a pas que l’Inde qui procède à l’accaparement des terres mais aussi l’Indonésie, avec l’huile de palme.
Pour répondre à la question sur l’AFD, il n’est pas question pour l’AFD de remettre en cause son aide aux pays émergents mais de revoir une partie de sa politique en direction notamment des pays les moins avancés et des pays qu’on appelle « prioritaires ». Comme vous le savez, nous n’avons pas du tout la même manière de participer à l’aide au développement que la Grande-Bretagne puisque nous le faisons sous forme de prêts alors que les Britanniques le font sous forme de dons. Cela implique des grosses différences, ce qui ne veut pas dire pour autant que la Grande-Bretagne soit plus efficace dans son aide. Nous avons aujourd’hui à la tête de cette agence deux femmes de grande valeur et compétentes : Mme Paugam, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Severino, et Mme Tubiana, qui connaît extrêmement bien ses dossiers.
C’est vrai que la France, vous l’avez dit, s’est complétement désintéressée de l’Afrique et notamment le secteur bancaire, très peu présent. Dans les années 1980-90, ce secteur s’est tourné principalement sur l’Amérique latine. On paie aujourd’hui ce retard, cette absence très fortement. Sur la formation professionnelle, le MEDEF que nous avons auditionné est très demandeur de cela. C‘est un outil qui n’est pas très couteux mais qui est absolument utile à notre façon de contribuer au développer de ces pays. Sur la question qui a été posée du niveau de la dette publique des émergents, il est difficile de répondre puisque l’Afrique du Sud, par exemple, ne demande pas d’aide d’États : cela ne se passe qu’avec des privés.
M. Michel Zumkeller, rapporteur. L’essentiel a été dit. Le message n’est pas simplement pessimiste car la France a un certain nombre d’atouts et de valeurs de qualité. D’après les personnes que nous avons rencontrées, principalement des chefs d’entreprises de PME, pour ne pas parler des grands groupes, il y a des réussites françaises dans ces pays mais je crois que ce sont des réussites individuelles. A l’inverse, les réussites allemandes dans ces pays sont collectives. L’ambassadrice d’Allemagne au Kenya elle-même nous l’a dit : les PME allemandes ont une capacité à s’organiser collectivement pour conquérir les marchés quitte après à être concurrentes sur ce même marché. Il y a toutefois de beaux succès français et de nombreux Français sont installés dans ces pays. Les raisons de ce constat sont peut-être culturelles, ou dues à notre faiblesse en matière de taille de PME.
L’idée d’avoir un représentant, secrétaire d’État ou peu importe son nom, est très intéressante pour avoir une personne identifiée qui viendrait souvent en Afrique. Je pense que cela changerait beaucoup pour un coût modéré. Le représentant nous permettrait d’être beaucoup plus présents sur ce continent. Sur la question de la formation professionnelle, cela nous a frappé en Afrique du Sud : il y a une vraie demande et les entreprises françaises pourraient être des partenaires privilégiés. Il y a enfin une relation très particulière avec l’Afrique du Sud : la France est le pays qu’ils aiment détester. Ils aiment nous détester mais ils aiment aussi bien nous voir à proximité.
Il y a un espoir certain dans nos propos et je pense qu’il suffit de nous retrousser les manches pour obtenir beaucoup de ces pays africains émergents.
Mme la Présidente Elisabeth Guigou. Je remercie les rapporteurs pour leur très bon rapport, informateur, précis et concis.
La commission autorise la publication du rapport d’information.
ANNEXE N° 1 :
CARTE DE L’AFRIQUE
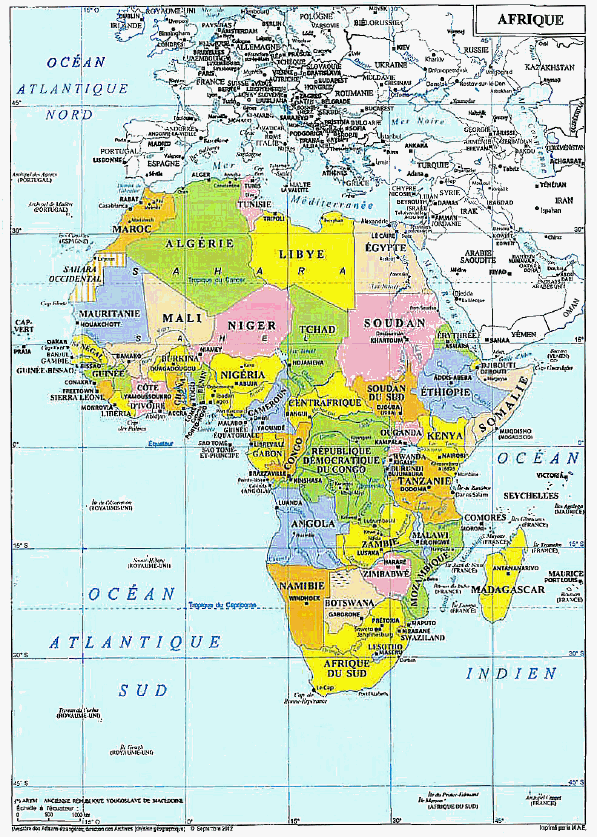
ANNEXE N° 2 :
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
1) A Paris
- M. Jean-Christophe Belliard, directeur Afrique et Moyen orient, et M. Camille Grousselas, chargé de mission, direction Afrique, MAEE
- M. Bertrand Badie, professeur, Sciences Po Paris
- M. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, IRD, CEPED
- M. Jean-Bernard Véron, rédacteur en chef d’Afrique contemporaine
- M. Benjamin Augé, IFRI
- M. Laurent Fourchard, IEP de Bordeaux, co-rédacteur en chef de Politique africaine
- Son Exc. M. Jacques Champagne de Labriolle, ambassadeur de France au Nigéria
- M. Henri de Villeneuve, président de la section Afrique du Sud des conseillers du commerce extérieur, et M. Guillem BATLLE, chargé de mission senior Afrique sub-saharienne et Océan Indien, Medef international
- Son Exc. Mme Geneviève Tsegah, ambassadrice du Ghana en France, et M. Akwasi ADOMAKO, conseiller
- M. Patrick Lucas, président de Gras Savoye, président du comité Afrique du MEDEF International
- M. Dominique Lafont, président de Bolloré Africa Logistics, président du conseil de chefs d'entreprise France-Afrique de l'Est, MEDEF International,
- M. Gérard Wolf, vice-président d'EDF, président du conseil de chefs d'entreprise France-Afrique Australe, MEDEF International
- M. Maurice Ekpenyong, fondateur de POLAF, « Political Africa Initiative »
- Mme Corinne Brunon-Meunier, sous-directrice d'Afrique orientale et M. Samuel Gourgon, rédacteur Kenya, MAEE
- M. Michael Roux, sous-directeur d'Afrique australe et de l'Océan indien et M. Xavier Brun, rédacteur Afrique du Sud, MAEE
- M. Lionel Zinsou, président de PAI Partners
- Mme Linda Shongwe, ministre plénipotentiaire, Mme Lindi Mminele, conseillère affaires bilatérales, et Mme Laroushka Reddy, troisième secrétaire, ambassade de l'Afrique du Sud en France
- Mme Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures et M. Pierre Albrieux
- Mme Béatrice Néré, responsable relations extérieures et affaires politiques pour la France à la Fondation Bill Gates
- M. Jean-Michel Severino, ancien vice-président de la Banque mondiale, ancien directeur général de l’AFD
- Melle Folashadé Soulé-Kohndou, doctorante en sciences politiques/relations internationales, CERI-Sciences Po Paris
- M. Eric Duédal, chef du service économique régional, ambassade de France au Kenya
- M. Jacques Marraud des Grottes, directeur Afrique (exploration-production), et M. Momar Nguer, directeur Afrique (marketing), TOTAL
- M. Yves Boudot, directeur Afrique de l'AFD, Mme Marie Odile Watty, correspondante régionale Kenya, M. Adrien Haye, coordonnateur régional Afrique australe et M. Hervé Gallèpe, chargé des relations parlementaires
- M. Anthony Bouthelier, président délégué du CIAN, M. Stephen Decam, secrétaire général, M. Jacques Manlay, président de la commission Afrique anglophone, Mme Alix Camus, adjointe secrétaire générale, et M. Laurent Padoux, expert Afrique australe
- M. Claude Périou, directeur général de Proparco, Mme Marie Hélène Loison, directrice générale déléguée, Mme Colette Grosset, directrice générale déléguée
- M. Henri-Bernard Solignac-Lecomte, chef de l’unité Afrique, Europe & Moyen-Orient, OCDE
- M. Jacques Maire, directeur des entreprises et de l’économie internationale, MAEE
- M. Jonathan Gindt, conseiller relations bilatérales, cabinet de Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur, accompagné de Mme Sanaa Tahir
- M Julien Denormandie et M. Maurice Braud, conseillers, cabinet de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances
2) Au Kenya, du 14 au 17 avril 2013
- Son Exc. M. Etienne de Montaigne de Poncins, ambassadeur de France
- Mme Stéphanie Seydoux, première conseillère
- M. Yves Terracol, directeur de l’AFD
- M. Éric Duédal, chef du service économique régional
- M. Pascal Carrère, chef adjoint du service économique régional
- M. Pierre Séjourné, conseiller économique, service économique régional
- M. Jérémie Blin, conseiller de coopération et d’action culturelle
- M. Thierry Vincent, conseiller régional santé
- M. Jean-Michel Crovesi, stagiaire ENA
- M. Guédi Ainaché, Proparco
- Son Exc. Mme Margit Hellwig-Boette, ambassadrice d’Allemagne
- M. Mickael Ghossein, directeur exécutif d’Orange
- M. Christian La Marre, directeur général Total Kenya
- M. Jean Lemazurier, directeur régional, Thalès
- M. Samir Azzouzi, directeur régional, Air France
- Mme Sylviane Balustre, l’Oréal
- Mme Catherine Ngahu, présidente de l’Autorité kenyane des TIC, (ICT Authority)
- Bob Collymore, président exécutif de SafariCom, et M. Thibaut Rerolle, directeur de la technologie
- M. Hervé Braneyre, directeur de l’Alliance française
- M. Aldric Spindler et Mme Isabelle Spindler, Red Lands Roses
- M. Paul Chemng’orem, président de Kenya Domaine, producteur et importateur de vins au Kenya
- Mme Carole Kariuki, secrétaire générale de KEPSA (Kenya Private Sector Alliance)
- M. Jonathan Chifallu, directeur relations publiques d’EPZA
- M. Aly-Khan Satchu, président du groupe Satchu
- M. Iain Douglas-Hamilton, fondateur de l’ONG « Save the Elephants » et Mme Oria Douglas-Hamilton, ONG « Elephant Watch »
- M. William Kibet Kiprono, directeur du Kenya Wildlife Service
- Mme Joyce Laboso, vice-présidente de l’Assemblée nationale, M. Victor Munyaka, député, M. Nicholas Gumbo, député, M. David Were, député et M. Hassan Omar Hassan, sénateur.
- M. Evans Kidero, gouverneur de Nairobi
- M. Christian Thibon, directeur de l’IFRA, M. Hervé Maupeu, Mme Stéphanie Duvail, chercheurs et divers autres chercheurs français et de kenyans
- M. Geoffrey G. Muchemi, directeur du développement géothermique, KenGen (compagnie kényane d’électricité)
3) En Afrique du Sud (du 17 au 22 avril 2013)
- Son Exc. Mme Elisabeth Barbier, ambassadrice de France
- M. Olivier Brochenin, premier conseiller
- Mme Marie-Laure Desjonquères, deuxième conseillère
- M. Jean-Michel Debrat, directeur régional de l'AFD
- M. Nicolas Amar, Stagiaire ENA
- M. Dominique Lebastard, chef du service économique régional,
- M. Jacques Torregrossa, directeur Ubifrance
- M. Antoine Michon, consul de France au Cap
- Son Exc. M. Bene M’Poko, ambassadeur de RDC en Afrique du Sud, Son Exc. M. Koffi Amos Djadan, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et Son Exc. M. Mahomed Ismaël Dossa, ambassadeur de Maurice en Afrique du Sud
- M. Joel Khathu Netshitenzhe, directeur exécutif, M. Sibusiso Vil-Nkomo président du conseil d’administration, Mme Brigitte Mabandla, ancienne ministre de la justice, M. Yacoob Abba Omar, directeur des opérations, ancien ambassadeur ; think tank MISTRA (Mapungubwe Institute for Strategic Reflection)
- M. Nick Kotch, journaliste au Business Day
- M. Jean-Jacques Cornish, journaliste, à Talk 72, président du conseil d’administration de l’Alliance française
- Mme Liesl Louw-Vaudran, journaliste
- Son Exc. M. Roland Van de Geer, ambassadeur, chef de la délégation de l’UE en Afrique du Sud, M. Axel Pougin de la Maisonneuve, chef de la section politique et économique et M. Igor Driesmans, conseiller politique
- M. Andrew Golding, CEO Palm Golding Immobilier
- M. Mills Soko, professeur à l’Université du Cap
- M. Charles Courdent, attaché culturel, directeur-adjoint de l’IFAS
- M. Thierry Arnaud, vice-président – SODEXO
- M. Pascal Asin, directeur Afrique, Moet & Chandon/Hennesy
- M. Stéphane Kacedan, PDG African Eagle
- M. Christophe Viarnaud, PDG Methys
- M. Kevin Minkoff, directeur EDF énergies nouvelles
- M. Tim Harris, député, porte-parole pour les affaires économiques de l’Alliance démocratique (DA, opposition)
- Mme Joanmarie FUBBS, députée, présidente de la commission du commerce et de l’industrie de l’Assemblée, M. James Wilmot, député, membre de la commission et M. André Hermans, secrétaire de la commission
- M. Edwin T Smith, director Mamelodi Campus of University of Pretoria
- Dr Pierre Lemonde, conseiller culturel a.i., attaché pour la science et la technologie, ambassade de France
- Prof. Sergio Colafrancesco, université de Witwatersrand, Johannesburg, (projet radio-téléscope SKA)
- M. Stefan Sakoschek, président de la chambre de commerce et d’industrie franco-sud-africaine, en compagnie de nombreux entrepreneurs
- M. Marius Fransman, vice-ministre des affaires étrangères
*
Remerciements
Les membres de la Mission d’information souhaitent adresser leurs plus sincères remerciements à l’ensemble des personnalités et experts français et étrangers qu’ils ont rencontrés au long de leurs travaux.
Ils remercient aussi très chaleureusement les diplomates qui les ont assistés dans l’organisation de leurs différents déplacements au cours de cette mission et en ont permis le succès :
- Son Exc. M. Etienne de Montaigne de Poncins, ambassadeur de France au Kenya,
- Son Exc. Mme Elisabeth Barbier, ambassadrice de France en Afrique du Sud.
1 Joseph Ki-Zerbo, « A quand l'Afrique ? », entretien avec René Holenstein, 2003
2 Source : Perspectives monde, université de Sherbrooke ; http://perspective.usherbrooke.ca/bilan
3 Audition du 11 décembre 2012
4 Michel Adam, « Guerres africaines ; de la compétition ethnique à l’anomie sociale », in Etudes rurales, Editions de l’EHESS, juillet-décembre 2002, page 167
5 Soit les conflits qui ont concerné l’Afrique du Sud, le Kenya, la Rhodésie du sud, l’Angola, le Mozambique et la Namibie
6 op. cit., page 167 et annexe : Inventaire des principaux conflits en Afrique depuis les indépendances, pages 185-186
7 op. cit., page 172
8 « Perspectives économiques en Afrique 2013 » ; BAD, Centre de développement (OCDE), PNUD et Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies), page 98
9 « Perspectives économiques en Afrique 2013 », page 102
10 Le Prix pour un leadership d'excellence en Afrique (www.moibrahimfoudation.org)
11 http://www.afrik.com/le-prix-mo-ibrahim-sans-vainqueur-pour-la-quatrieme-fois; 15 octobre 2013
12 Le jury du prix est composé des personnalités suivantes : Salim Ahmed Salim, diplomate tanzanien, ancien Secrétaire général de l’OUA ; Martti Ahtisaari, ancien Président de la République finlandaise, prix Nobel de la paix ; Aïcha Bah Diallo, ancienne ministre de l’éducation de Guinée, ancienne présidente du comité de l’UNESCO pour l’éducation en Afrique ; Mohamed El Baradei, ancien directeur général de l’AIEA, prix Nobel de la paix ; Graça Machel, ancienne ministre de l’éducation du Mozambique ; Festus Gontebanye Mogae, ancien Président de la République du Botswana ; Mary Robinson, ancienne Présidente de la République d’Irlande, ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme
13 Cité par Florence Baugé, in « Mo Ibrahim ou la corruption mise à prix », Le Monde, Géo et Politique, 26 avril 2013
14 « Perspectives économiques en Afrique 2013 », op. cit., page 100
15 Source : Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012
16 Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-OHRLLS) « Pays les moins avancés – Ce qu’il faut savoir et ce qu’il faut faire », page 2
17 ONU, Rapport 2012, « Objectif 4, Réduire la mortalité des enfants », page 27
18 « Vers une nouvelle économie africaine », Investisseurs et Partenaires, novembre 2012.
19 « Les situations d'urgence humanitaire qui ont dominé l'environnement opérationnel en Afrique en 2012 devraient continuer à mobiliser une part importante des ressources du HCR en 2013. En raison des nouvelles crises qui ont causé des déplacements massifs et de situations plus anciennes concernant des populations réfugiées de longue date, le chiffre prévisionnel relatif au nombre de personnes relevant de la compétence du HCR sur le continent a atteint plus de 13 millions. » Source : www.unhcr.fr ; in « Aperçu opérationnel régional 2013 – Afrique »
20 Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « Le temps de l’Afrique », Editions Odile Jacob, mars 2010, page 23
21 « The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It », Paul Collier, 2007
22 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013, page 23
23 Source : Rapport économique sur l’Afrique 2012, « Libérer le potentiel de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale », Commission économique pour l’Afrique, pages 67 et suiv.
24 Source : « Perspectives économiques en Afrique 2013 » ; Banque africaine de développement, Centre de développement (OCDE), PNUD, Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies) ; page 18
25 Source : FMI, « Perspectives de l’économie mondiale, espoirs, réalités, risques », avril 2013, page 7
26 www.infolatam.com, « FMI baja cuatro décimas revisión crecimiento en Latam », 9 juillet 2013
27 www.infolatam.com, « Analistas recortan previsión de crecimiento en 2013 al 2,34% », 8 juillet 2013
28 Source : « Vers une nouvelle économie africaine », op. cit.
29 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013
30 Audition du 4 juin 2013
31 FMI, « La transformation de l'Afrique : la montée de la classe moyenne », Finances et développement, décembre 2011, volume 48, n° 4, page 8
32 Comme le faisaient remarquer les auteurs d’une étude publiée par l'AFD, la notion de classe moyenne en Afrique subsaharienne est difficile à saisir et d’autant plus fragile que de nombreux facteurs jouent, au premier rang desquels l’importance du secteur informel. Elle regroupe des « populations en cours d’" enrichissement ", mais aussi l’ensemble des individus (et non pas une catégorie particulière) qui émergent de la précarité (c’est-à-dire qui satisfont de manière structurelle aux dépenses contraintes et disposent d’un revenu arbitrable minimal), sans être pour autant à l’abri d’un déclassement rapide. » ; Dominique Darbon et Comi Toulabor, « Quelle(s) classe(s) moyenne(s) en Afrique ? », AFD, Document de travail n° 118, décembre 2011
33 http://www.jeuneafrique.com/Videos/362/lionel-zinsou-l-afrique-a-un-carnet-de-commandes-pour-30-ans-de-croissance.html ; entretien de Lionel Zinsou à Jeune Afrique TV, 22 novembre 2012
34 Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, in « Le réveil de l’Afrique : vers des transformations structurelles » ; disponible sur le site http://www.geopolitique-africaine.com/auteur/carlos-lopes
35 Lionel Zinsou : « L’Afrique est la nouvelle frontière », www.jeuneafrique.com ; 4 avril 2012
36 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013
37 Données CNUCED 2011
38 Op. cit., page 110
39 « Afrique subsaharienne :, créer une dynamique dans une économie mondiale à plusieurs vitesses », FMI, mai 2013, page 19
40 Source : Rapport Doing Business 2013, page 8
41 Sources : Perspectives économiques en Afrique 2013 ; (e) : estimations ; (p) prévisions
42 Source : FMI, « Perspectives de l’économie mondiale, espoirs, réalités, risques », avril 2013, page 71
43 Selon les statistiques de la BAD, le différentiel de croissance entre pays producteurs et pays importateurs de pétrole est parfois considérable : en 2011, les exportateurs de pétrole ont eu un taux de croissance moyen de 2,8 %, contre 4,3 % pour les importateurs ; en 2012, les taux étaient respectivement de 8,7 % et de 3,9 %. Les prévisions pour 2013 et 2014 sont les suivantes : 5,2 % contre 4,3 % et 5,6 % contre 4,8 %. Données citées dans les Perspectives économiques en Afrique 2013, page 32
44 Audition du 4 juin 2013
45 Source : http://www.les-ernest.fr/lionel_zinsou ; École normale supérieure, 3 mai 2010
46 Lionel Zinsou : « l'Afrique vous salue bien », entretien avec Philippe Bernard et Frédéric Lemaître, Le Monde, 1er octobre 2007
47 Michel Camdessus : « L’Afrique est en décollage économique comme la Chine il y a 30 ans », entretien au journal Les Afriques, n° 161, http://www.lesafriques.com/l-africain-de-la-semaine/michel-camdessus-l-afrique-est-en-decollage-economique-comme-la-chine-il-y-a-30-2.html?Itemid=308?articleid=28849
48 « Perspectives économiques en Afrique 2013 », op. cit., page 58
49 Ibid
50 Entretien de Lionel Zinsou à Jeune Afrique TV précité
51 Jean-Paul Carteron, président du Forum Crans Montana, entretien au journal Les Afriques, n° 234, 27 mai 2013
52 “Why Africa Will Rule the 21st Century” ; http://www.africanbusinessmagazine.com
53 Foreign Policy, Charles Robertson et Michael Moran, “Sorry, but Africa’s rise is real”29 mai 2013
54 Ernst & Young’s Attractiveness Survey, Africa 2013, Getting down to business,
55 Steven Radelet, Georgetown University, “Emerging Africa: How 17 countries are leading the way”, Center for Global Development, 2010
56 Par ordre alphabétique : Afrique du sud, Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, Éthiopie, Ghana, Lesotho, Mali, Maurice, Mozambique, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Tanzanie et Zambie
57 Benin, Liberia, Kenya, Malawi, Sénégal et Sierra Leone
58 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013, page 55
59 CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde 2012, vue d’ensemble, page 13
60 CNUCED, Worl Investment Report 2013, page 38 (non encore traduit)
61 Voir supra, page 28
62 Op. cit., page 50
63 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013, page 50
64 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013, page 50
65 Audition du 26 juin 2013 de MM. Anthony Bouthelier, président délégué, Stephen Decam, secrétaire général, Jacques Manlay, membre du comité directeur, expert Afrique anglophone, Laurent Padoux, membre du comité directeur, expert Afrique australe et Mme Alix Camus, secrétaire générale adjointe
66 L’Africa Progress Panel (APP) est un groupe de dix personnalités issues du secteur privé et public, qui se mobilisent en faveur de problèmes importants pour l’Afrique et le monde. Présidé par Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies et Prix Nobel de la paix, il est composé de Michel Camdessus, Peter Eigen, Bob Geldof, Graça Machel, Olusegun Obasanjo, Linah Mohohlo, Robert Rubin, Tidjane Thiam et Mohammed Yunus
67 Auditions des 4 juin et 10 juillet 2013 respectivement
68 Voir « L’Afrique et les grands émergents », Jean-Raphaël Chaponnière, Dominique Perreau et Patrick Plane, AFD, A savoir n° 19, avril 2013, page 34
69 « Afrique, un regard sur l’avenir : à quoi ressemblera le continent dans 50 ans ? », in « Finances et développement », FMI, décembre 2011, pages 24 et 25
70 FMI, Perspectives économiques régionales, Afrique subsaharienne : créer une dynamique dans une économie mondiale à plusieurs vitesses, mai 2013, page 20
71 « Transition démographique et emploi en Afrique subsaharienne : comment remettre l’emploi au cœur des politiques de développement », Raphaël Beaujeu, Michael Kolie, Jean-François Sempere et Christine Uhder, Collection A savoir, n 5, page 137
72 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013
73 « Même les États-Unis, où la densité de population est relativement faible, ont un kilomètre de voies pour 43 kilomètres carrés de superficie. En revanche, le Nigéria, qui compte un cinquième de la population d’Afrique subsaharienne et en est l’un des pays les plus peuplés, n’a qu’un kilomètre de voies pour 262 kilomètres carrés. » Paul Collier : « Mettre l’Afrique sur les rails », in « Finances et développement », FMI, décembre 2011, page 18
74 Entretien à Jeune Afrique TV, 22 novembre 2012
75 FMI, « Finances et développement », décembre 2011, page 10 ; (souligné par vos rapporteurs)
76 Axelle Kabou, « Le temps de l'Afrique n’est pas encore venu », entretien à jeuneafrique.com, 4 avril 2012, à propos de son livre « Comment l’Afrique en est arrivée là »
77 Morten Jerven, « We have no idea if Africa is rising », Foreign Policy, 28 janvier 2013
78 « L’Afrique et les grands émergents », op. cit., page 108
79 Ibid., page 87
80 Source : « l'Afrique et les grands émergents », op. cit. page 58
81 Source : Ibid, page 59
82 Chatham House, Briefing paper, “Brazil in Africa: Just Another BRICS Country Seeking Resources?” Christina Stolte, novembre 2012, pages 3-5 notamment
83 Agnès Chevallier, « La présence chinoise en Afrique », in La lettre du CEPII, (centre d’études prospectives et d’informations internationales), n° 328, 20 décembre 2012,
84 « Chine : les " trente glorieuses " sont finies », Le Monde, Géopolitique, 5 septembre 2013
85 Audition du 15 janvier 2013
86 Cela étant, la densité de sa population est à peine supérieure à la moyenne continentale
87 Source : « Poids et influence de l’Afrique du Sud au sein de l'Afrique subsaharienne », Service économique régional en Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
88 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
89 Ambassadeurs de divers pays d’Afrique subsaharienne, déjeuner à la résidence de France, 18 avril 2013
90 Source : Service économique régional
91 L’article 9.2 de la constitution de 1996 prévoit la possibilité de mesures, législatives ou autres, pour corriger les inégalités liées aux discriminations passées
92 A noter que le concept de « personnes historiquement défavorisées » ne s’est pas fondé initialement sur des considérations de couleur de peau : elle a inclus jusqu’aux femmes blanches dans les premières années
93 Source : Service économique régional
94 Voir infra page 108
95 Source : Rapport mondial 2013 sur l’investissement, CNUCED
96 Source : service économique régional, Pretoria, mars 2011
97 Source : Service économique régional en Afrique australe, juin 2012
98 Derrière le Botswana et la République démocratique du Congo
99 Derrière la Namibie et le Niger
100 Derrière la Zambie et la République démocratique du Congo
101 Derrière le Maroc
102 Source : ibid
103 Source : Service économique régional en Afrique australe, juin 2012
104 Standard Bank Group, Standard Bank of South Africa, ABSA Group, Nedbank Group, Firstrand Banking Group
105 Source : www.lesafriques.com, « l'Afrique nouvelle prend son envol : après les BRICS, voici le MANGANESE », n° 237, juillet 2013
106 Rapport annuel 2012 de l’agence française pour les investissements internationaux, AFII, page 60
107 Bilan annuel AFII 2010
108 Par exemple Henri de Villeneuve, président de la section Afrique du sud des conseillers du commerce extérieur, audition du 12 février 2013
109 « The BRICS against the West ? », Zaki Laïdi, CERI Strategy Papers, Science Po CNRS, n° 11, Hors série, novembre 2011
110 Voir Javier Santiso, « Les pays émergents et l’investissement de long terme », Politique internationale, n° 126, hiver 2010
111 Entretien du 22 avril 2013, Le Cap
112 Les crises africaines ne sont pas le seul terrain sur lequel la diplomatie de Pretoria se montre active : elle a ainsi récemment pris l’initiative d’une médiation pour la reprise du dialogue politique à Sri Lanka
113 Certaines sources ont fait état de la possibilité d’une cinquantaine de tués
114 Voir « Impériale Afrique du Sud », Anne-Cécile Robert, Le Monde diplomatique, décembre 2012
115 Déjeuner de la résidence de France, 18 avril 2013
116 « Union africaine : fin de l’état de grâce pour Dlamini-Zuma », Jeune Afrique, 10 juin 2013
117 Ainsi que l’indique le département de l’information de l'ONU, le 24 septembre dernier à New York, lors de son intervention devant l’Assemblée générale des Nations Unies, « Le Président sud-africain a (…) vivement critiqué le caractère non démocratique et injuste de la composition du Conseil de sécurité. "Nous ne pouvons rester tributaires de la volonté d’une minorité non représentative pour tout ce qui concerne les grands défis de la sécurité internationale", (…) avant de plaider pour une réforme approfondie de cet organe des Nations Unies. » Source : http://www.un.org/fr/ga/68/meetings/gadebate/24sep/southafrica.shtml
118 Créée en 1910, la « Southern African Customs Union » est la plus ancienne des unions douanières au monde ; elle regroupe l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland
119 Rencontre du 18 avril 2013 avec des chercheurs de MISTRA (Mapungubwe Institute for Strategic Reflection)
120 Rencontre à Pretoria avec des journalistes sud-africains, le 19 avril 2013, ou au Cap avec Tim Harris, député de l’Alliance démocratique, (opposition), le 22 avril 2013
121 Thierry Vircoulon, « De la citadelle assiégée à une vision continentale : la pensée stratégique sud-africaine », Revue internationale et stratégique, 2011/2 n° 82, p. 155-157
122 The Economist, “Sad South Africa: Cry, the Beloved Country”, n° 950, 20 octobre 2012; http://www.economist.com/news/leaders/21564846-south-africa-sliding-downhill-while-much-rest-continent-clawing-its-way-up
123 Alan Paton, “Cry, the Beloved Country”, 1948; (en Français : « Pleure, Ô pays bien-aimé »)
124 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, novembre 2012
125 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013.
126 Supra, pages 16 et suiv.
127 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013 ; http://www.africaneconomicoutlook.org ; (2010 : estimations ; 2011 et suiv : prévisions)
128 Le Soudan du Sud est devenu indépendant le 9 juillet 2011
129 http://www.lesafriques.com/2000-2010-la-decennie-de-la-croissance/les-meilleures-croissances-de-la-dec-3.html?Itemid=308 ;
130 Curieusement, le Kenya ne figure pas dans les données publiées par le journal www.lesafriques.com
131 Le Monde, 28 août 2013, « Chute des devises, fuite des capitaux : les BRICS dans le viseur des marchés »
132 Pour sa part, selon ce qui a été indiqué à vos rapporteurs, le gouvernement avait même établi les siennes à 3,6 % en 2013 et 4,2 % pour 2014
133 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
134 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
135 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
136 Source : Service économique régional pour l’Afrique australe, Direction générale du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur, avril 2013
137 Source : Ibid
138 Abebe Aemro Selassie, sous-directeur au département Afrique du FMI, « Les handicaps de l'Afrique du Sud », in « Finances et développement », décembre 2011, pages12-14
139 Entretiens des 18 et 19 avril
140 « Les handicaps de l'Afrique du Sud », op.cit.
141 Audition du 30 janvier 2013
142 Audition du 9 avril 2013
143 L'Afrique du Sud consacre depuis 1995 entre 5 et 7 % de son PIB à l’éducation, plus que le Brésil
144 Fabrice Murtin, “Improving Education Quality in South Africa”, OCDE, Département économique, Working Papers, n° 1056, 6 juin 2013, http://dx.doi.org/10.1787/5k452klfn9ls-en (non traduit)
145 Source : Fabrice Murtin, op. cit.
146 Fabrice Murtin, op. cit., page 9
147 Universitaire, ancienne directrice exécutive de la Banque mondiale pour le développement humain, Manphela Ramphele est spécialiste des questions d’éducation ; elle est célèbre en Afrique du Sud pour son engagement politique et social de toujours contre l’apartheid, notamment aux côtés de Steve Bicko, dont elle était la compagne. “The alarming collapse of education represents a grave danger to our economy, (…) We inherited a dysfunctional system, and we have made it worse.” Entretien à www.ft.com/wealth, mars 2013.
148 Audition d’une délégation du MEDEF International, le 19 février 2013,
149 Patricia Huon, « Où va l'Afrique du Sud ? », le Journal du dimanche, 8 janvier 2012
150 Voir « Une tuerie comme au temps de l’apartheid », Greg Marinovitch, Le Monde diplomatique, octobre 2012 et « Le régime arc-en-ciel discrédité ; trois émeutes par jour en Afrique du Sud », Sabine Cessou, Le Monde diplomatique, mars 2013
151 Audition du 30 janvier 2013
152 Sabine Cessou, « l'Afrique du Sud, une jeune démocratie en crise », Etudes, mars 2013, Tome 418, page 307
153 « Un système de "corruption légalisée" », Sabine Cessou, Le Monde diplomatique, mars 2013
154 The Economist estime que le taux réel est plus proche de 40 %
155 « En Afrique du Sud, les grèves font craindre une hausse du coût du travail », Sébastien Hervieu, Le Monde, Économie et entreprises, 30 août 2013
156 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, 2011, rapport mondial sur les homicides : 2011 Global Study On Homicide, Trends, Contexts, Data
157 Dû aussi au ralentissement de la demande externe
158 Sébastien Hervieux, Ibid.
159 André Brink, « La longue marche de l'Afrique du Sud », entretien avec Sabine Cessou, Politique internationale, n° 128, été 2010
160 Par exemple, M. Roland Van de Geer, Ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Afrique du Sud, Pretoria, 18 avril 2013
161 Sabine Cessou, op. cit.
162 Notamment Marc-Antoine Pérouse de Montclos, le 18 décembre 2012 ; Jean-Bernard Véron, le 15 janvier 2012 ; Benjamin Augé, le 29 janvier 2013 ; Laurent Fourchard, le 30 janvier 2013 ; Jacques Champagne de Labriolle, le 14 février 2013
163 923 769 km2 exactement
164 185 habitants par km2 ; à titre de comparaison, avec 22 millions d’habitants sur plus de 320 000 km2, la Côte-d’Ivoire est 7 à 8 fois moins peuplée, avec une densité de quelque 70 habitants au km2
165 http://www.nigeria.gov.ng/index.php/2012-10-29-11-05-46/people
166 Source : Le Monde diplomatique
167 Audition du 15 janvier 2013
168 Source : Le Monde diplomatique
169 « Nigeria : Boko Haram exige le départ des chrétiens du Nord », Jean-Philippe Rémy, Le Monde, 4 janvier 2012
170 « Nigeria : pas de catastrophisme ! », Le Monde, 17 janvier 2012
171 Voir par exemple Human Rights Watch, « Spiraling Violence: Boko Haram Attacks and Security Forces Abuses in Nigeria”, octobre 2012
172 Si trois principaux groupes Hausa-Fulani, Igbo, Yoruba, dominent le pays, le Nigeria compte quelque 200 ethnies différentes
173 Il ne faut pas oublier que ce n’est pas sur des thématiques religieuses que Boko Haram est apparue en 2003. Il y a près de dix ans maintenant, la secte islamiste Boko Haram a commencé de mener des actions contre l’Etat central laïque, avec des attentats contre les forces de police ou l’armée, avant de s’orienter vers d’autres cibles. Ce n’est que parce que les pouvoirs publics ont décidé de changer de stratégie et de l’attaquer frontalement qu’elle s’est radicalisée
174 Jeffrey Sachs, « Les entreprises face au défi du respect de l’environnement », Les Echos, 29 novembre 2012 ; dénonçant l’impunité des entreprises (Shell, Exxon ou Chevron) en matière de pollution au Nigeria, sur fond de corruption, l’auteur indique que le total des fuites de pétrole dans le delta du Niger en cinquante ans est estimé à 10 millions de barils, soit deux fois plus que la marée noire de BP dans le Golfe du Mexique en 2010
175 Après avoir longé les côtes du Ghana, du Togo et du Benin…
176 Comfort Ero, « Boko Haram, reflet d’un profond malaise au Nigeria », Le Figaro, 22 février 2012
177 De son côté, dans son évaluation de la gouvernance, la Fondation Mo Ibrahim a classé le Nigéria au 43e rang sur 52 pays en 2012 ; le Nigeria obtient la note de 42/100 dans l’indice, soit nettement moins que la moyenne des autres pays, qui s’établit à 51,2. Le pays le mieux classé est Maurice, qui obtient la note de 82,8, le dernier est la Somalie, 7,2. L'Afrique du Sud est de son côté classée 5e, avec une note de 70,7.
178 http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Nigeria.html (souligné par vos rapporteurs)
179 On sait par exemple que sous la dictature, les militaires étaient en relation avec le trafic de drogue et les choses ne changent pas
180 Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « Le Nigeria est très loin de la guerre civile », Libération, entretien avec Quentin Girard, 14 janvier 2012
181 Voir notamment http://www.rfi.fr/fichiers/mfi/politiquediplomatie/741.asp, qui indique entre autres que, selon The Economist, en 2002 le Kenya était cinq fois plus pauvre qu’au début de la présidence de Daniel arap Moi
182 Qui ne seront pas retenues comme ayant été de nature à perturber le scrutin
183 Audition de Raila Odinga, Premier ministre du Kenya, 21 octobre 2009
184 Le procès du vice-président Ruto a débuté à La Haye en septembre 2013
185 Entretien du 15 avril 2013, à Nairobi
186 En 2012, 30 attaques terroristes ont été recensées au Kenya, soit une tous les douze jours. Elles sont souvent le fait de commandos nombreux, parfois d’une centaine d’hommes, et lourdement armés, qui interviennent sur les principales villes du pays, Nairobi et Mombasa, mais aussi en province, dans des zones plus proches de la frontière nord avec la Somalie, et font des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ils ciblent des objectifs officiels, fréquemment des postes de police, mais aussi civils : arrêts de bus, écoles, hôtels, églises ou mosquées, commerces, etc. Entre janvier et septembre de cette année, il y en a eu moins, dix « seulement », mais celle menée contre le centre commercial Westgate Mall le 21 septembre a été la plus meurtrière depuis quinze ans, avec un bilan de 72 tués et au moins 175 blessés.
187 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/10/12/l-union-africaine-demande-le-report-du-proces-kenyatta-a-la-cpi_3494827_3212.html
188 Entretien du 15 avril 2013 à Nairobi
189 LAPPSET : Lamu Port and Lamu-Southern Sudan-Ethiopia Transport
190 Entretien avec Oria et Iain Douglas-Hamilton, Nairobi, le 17 avril 2013
191 Voir Catherine Vincent, « La fin des éléphants d'Afrique d’ici dix ans ? », Le Monde, environnement & Sciences, 16 mars 2013, page 8
192 Source : Banque mondiale
193 www.lesafriques.com, « L'Afrique nouvelle prend son envol : après les BRICS, voici le MANGANESE », n° 237, juillet 2013
194 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013
195 ICG, « Le golfe de Guinée : la nouvelle zone à haut risque », Rapport Afrique n° 195, 12 décembre 2012
196 Benjamin Augé, op. cit., page 154
197 « A desperate need for reform: Goodluck Jonathan says he wants to reform the oil industry. Really? »; The Economist, 20 octobre 2012
198 Source : Benjamin Augé, « Pillage et vandalisme dans le delta du Niger », Hérodote n° 134, troisième trimestre 2009, page 153
199 « Nigeria is top FDI destination in Africa », African Business, 18 mars 2013
200 Audition de Benjamin Augé, par exemple, le 29 janvier 2013
201 Source : Perspectives économiques en Afrique 2013
202 ibid
203 Deux puits ont été creusés fin 2012
204 Audition du 21 octobre 2009
205 Sources : www.lesafriques.com
206 Rencontre du 17 avril 2013, résidence de France
207 Perspectives économiques en Afrique 2013
208 Audition du 13 février 2013
209 Source : Perspectives économiques de l'Afrique 2012
210 A la différence par exemple de l'Afrique du Sud, en baisse sur les 6 dernières années
211 Source : http://www.operationspaix.net/130-toutes-les-participations-de-l-etat-nigeria.html
212 Ibid
213 Le Nigeria a été membre du Conseil de sécurité en 1966-167, 1978-1979, 1994-1995 et 2010-2011. Le Kenya l’a été deux fois : en 1973-1974 et 1997-1998. L'Afrique du Sud ne l’a été qu’une fois, en 2008-2009. Le Ghana l’a été trois fois : 1962-1963 ; 1986-1987 ; 2006-2007.
214 Entretien avec Catherine Ngahu, présidente de l’Autorité kenyane des TIC, ICT Authority, le 15 avril 2013, à Nairobi
215 Entretien du 15 avril 2013, à Nairobi
216 Source : www.lesafriques.com : « L'Afrique vue par les patrons français »
217 Audition de Julien Denormandie et Maurice Braud, le 17 septembre 2013
218 Audition de Jonathan Gindt et Sanaa Tahir, le 10 septembre 2013
219 Source : ambassade de France à Pretoria
220 Source : Direction générale du Trésor
221 Sources : service économique régional, ambassade de France en Afrique du Sud
222 Audition de Linda Shongwe, vice-ambassadrice d’Afrique du Sud, 9 avril 2013
223 Source : http://www.alstom.com/press-centre/fr/2013/10/prasa-et-gibela-menee-par-alstom-signent-un-accord-historique-pour-la-fourniture-de-trains-periurbains-modernes/
224 Audition du 25 juin 2013
225 A noter que Maurice est au premier rang des pays africains : 19e
226 Entretien avec Margit Hellwig-Boette, du 15 avril 2013 à Nairobi
227 Voir infra, pages 118 et suiv.
228 « Total entre dans l’exploration off-shore en Afrique du Sud », communiqué de presse du 30 septembre 2013 ; http://total.com/fr/medias/actualite/communiques/30-09-2013-Total-entre-dans-lexploration-offshore-en-Afrique-du-Sud
229 A moyen terme, le contrat remporté par Alstom pour la fourniture de 600 trains va évidemment bouleverser la donne sur ce plan, compte tenu de la construction d’une usine sur place qu’il prévoit
230 Audition du 12 février 2013
231 Jeune Afrique, 27 février 2007
232 Cette mission, composée de Hubert Védrine, Jean-Michel Severino, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam et Hakim El Karoui a été chargée par Pierre Moscovici d’une mission de réflexion sur la rénovation de la relation économique bilatérale entre la France et l’Afrique, sur la base d’un partenariat économique mutuellement bénéfique
233 Le 5 septembre, a été annoncée une commande du Mozambique portant sur la construction de 24 chalutiers et de six patrouilleurs, pour une valeur totale de 200 millions d'euros, garantissant un plan de charge de deux ans pour les chantiers navals de Normandie.
234 Audition de Claude Périou, du 3 juillet 2013
235 Rapport de Alain Bentejac et Jacques Desponts, juin 2013
236 « Coupler l’offre française à la demande des pays, stratégie pour le commerce extérieur de la France », 3 décembre 2012
237 Audition du conseiller économique régional, Pretoria, 18 avril 2013
238 Direction générale du trésor, Analyse prospective des marchés à l’export, par secteur et par pays, Résultats de l’analyse des couples pays/secteurs porteurs en faveur du commerce extérieur de la France, octobre 2012
239 Souligné par vos rapporteurs
240 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/soutenir-les-entreprises
241 Le Monde, 23 avril 2013
242 L’Amérique latine non plus, d’ailleurs
243 Entretien avec Marius Fransman, ministre délégué auprès du ministre des relations internationales et de la coopération, le 22 avril 2013, à Pretoria
244 Audition du 30 janvier 2013
245 Référé sur l’évolution du réseau diplomatique depuis 2007, n° 65294, 13 février 2013
246 Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
247 Source : www.aefe.fr
248 Source : site du ministère des affaires étrangères et européennes ; comparaison des déplacements effectués dans les pays suivants : Afrique du Sud, Kenya, Ghana, Nigeria, Éthiopie, Tanzanie et Ouganda, s’agissant des anglophones, avec ceux réalisés dans les pays francophones suivants : RDC, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Cameroun
249 Sans distinguer entre visites d'État, officielles ou de travail
250 Partenariat stratégique entre la France et le Nigeria, 12 juin 2008
251 « Déclaration conjointe des présidents Nicolas Sarkozy et Thabo Mbeki » 28 février 2008
252 « Déclaration pour un partenariat renforcé France-Kenya », 20 avril 2011
253 Audition du 13 février 2013
254 Audition du 25 juin 2013
255 Audition du 19 février 2013
256 En outre, la présidente brésilienne participe évidemment aux rencontres régionales : sommet Amérique latine – Afrique, dont la troisième édition s’est tenue en Guinée équatoriale en février 2013 ; cinquantenaire de l’Union africaine, en mai 2013. Elle est également venue au sommet des BRICS de Durban.
257 Voir divers articles de www.infolatam.com; entre autres, “África, la última frontera de Brasil”, 21 mai 2013
258 Source: Christina Stolte, “Brazil in Africa: Just Another BRICS Country Seeking Resources?” Chatham House, Africa Programme and Americas Programme, Briefing Paper, Novembre 2012, AFP/AMP BP 2012/01
259 Des déplacements de Nicole Bricq sont également annoncés en Côte d'Ivoire en novembre et en Éthiopie en décembre
260 La délégation ministérielle était composée de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur, Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Victorin Lurel, ministre des outre-mer, Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, Frédéric Cuvellier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche et Hélène Conway, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger
261 Plus de 600 articles ont cosignés en 2012 par des scientifiques des deux pays
262 Entretien du 22 avril 2013, Cape Town
263 Audition du 18 juin 2013
264 Le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la République démocratique du Congo et le Sénégal sont les autres pays. Ciblant les nouvelles classes moyennes, le groupe prévoit d’y ouvrir plusieurs dizaines de centre commerciaux, accompagnés ou non de supermarchés ou d’hypermarchés, d’ici une dizaine d’années.
265 Audition du 12 janvier 2013
266 Audition du 19 février 2013
267 Le Monde, 17 septembre 2013,
268 Audition du 11 décembre 2012
269 Audition de Linda Shongwe, vice-ambassadeur d’Afrique du Sud, le mardi 9 avril
270 Entretien du 18 avril 2013, à Pretoria
271 Audition du 12 février 2013
272 Entretien du 22 avril 2013, Cape Town
273 Alors même qu’il appartient aux pays à revenu intermédiaire, selon la liste des pays bénéficiaires de l’aide au développement établie par le CAD de l'OCDE, cependant que les 15 autres pays prioritaires de la France relèvent tous de la catégorie des pays les moins avancés
274 Entretien du 15 avril 2013, à Nairobi
275 Entretien du 18 avril 2013, à Johannesburg
276 Discours du Président de la République François Hollande, intervention lors de la clôture du forum économique de Pretoria, 15 octobre 2013
277 Audition du 19 février 2013
278 Table ronde de la Chambre franco-sud-africaine de commerce et d’industrie, 19 avril 2013
279 Entretien du 22 avril 2013, Cape Town
280 Audition du 21 octobre 2009
281 Au demeurant, compte tenu de son inculpation pour crimes contre l’humanité par la CPI, la position de la communauté internationale s’en tenait à un prudent attentisme et limitait les contacts au strict nécessaire.
282 Audience du 17 avril 2013
283 On a vu que ce sujet avait été abordé lors de la visite de François Hollande en Afrique du Sud et que l'AFD participera au financement d’un projet solaire
284 Rencontre à la résidence de France le 17 avril 2013 avec Carole Kariuki, secrétaire générale de KEPSA, Julius Riungu, secteur de l’énergie, Bob Collymore, télécommunication, Dr Laila Macharia, juridique et réforme de la propriété, Walter Ookok, santé, Richard Muteti, MSE, Jonathan Chifallu, directeur relations publiques d’EPZA, Aly-Khan Satchu, président du groupe Satchu
285 Il fut un temps où Peugeot équipait toutes les administrations kenyanes…
286 Le 19 avril, à Johannesburg
287 Audition du 9 avril 2013
288 17 octobre 2013, article de Serge Michel
© Assemblée nationale