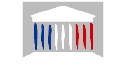______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 novembre 2013
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 14 novembre 2012 (1)
sur les Révolutions arabes
Président
M. Jacques MYARD
Rapporteur
M. Jean GLAVANY
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur les révolutions arabes est composée de : M. Jacques Myard, président ; M. Jean Glavany, rapporteur ; Mme Sylvie Andrieux, M. Jean-Louis Destans, Mme Marie-Louise Fort, MM. Lionnel Luca, Jean-Philippe Mallé, Michel Vauzelle.
SOMMAIRE
___
PRÉAMBULE 7
INTRODUCTION 13
I. UN « RÉVEIL ARABE » INATTENDU ET TRÈS HÉTÉROGÈNE 17
A. LE DÉPÉRISSEMENT DE MODÈLES QUE L’ON AVAIT FINI PAR CROIRE INDÉPASSABLES 17
1. Un tournant historique 17
a. Des peuples aspirant à reprendre en main leur destin 17
b. Une phase nouvelle, encore empreinte d’une grande incertitude 19
2. Des causes profondes, qui apparaissent a posteriori au grand jour 21
a. Un autoritarisme de plus en plus pesant 22
b. Des frustrations persistantes et très vives au plan socio-économique 24
c. Une population plus jeune et plus éduquée 25
3. L’étincelle de 2011 27
a. Un déclenchement inattendu 27
b. Les facteurs de la cristallisation en 2011 28
i. La dégradation de la situation économique 28
ii. L’entrée en scène d’une jeunesse révolutionnaire 28
iii. Le rôle des nouvelles technologies 29
iv. Un effet de souffle au plan régional 30
B. UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ « DU GOLFE À L’OCÉAN » 31
1. Des pays relativement à l’écart du mouvement 32
a. Pays du Golfe, Maroc, Jordanie : des monarchies préservées 32
i. Les monarchies du Golfe 32
ii. Maroc : le choix de la réforme 34
iii. La Jordanie : des tensions accrues, mais sans déstabilisation de la monarchie 36
b. Algérie : des troubles violents restés pour l’instant sans lendemain 37
c. Territoires palestiniens, Liban et Irak : des cas manifestement à part 38
2. Des soulèvements inaboutis 40
a. Bahreïn : un soulèvement maté dans le sang et l’indifférence générale 40
b. Syrie : de la contestation au bain de sang 41
3. La transition politique négociée, mais encore fragile, du Yémen 42
4. De véritables « révolutions arabes » en Tunisie, Egypte et Libye 43
a. La Tunisie 43
b. L’Egypte 45
c. La Libye 47
II. TUNISIE, EGYPTE, LIBYE : QUEL BILAN PROVISOIRE ? 49
A. DES ACTEURS, DES ACQUIS ET DES DÉFIS EN COMMUN 49
1. De nouveaux acteurs 49
a. Un islam politique puissant 50
b. Des forces politiques « non islamistes » divisées 54
c. Une société civile active 56
2. L’épreuve de la transition démocratique 57
a. Des avancées immédiates 57
b. Des défis communs 59
i. Un nouveau pacte national à définir 59
ii. La condition des femmes 61
iii. L’urgence économique et sociale 64
B. DES SITUATIONS TRÈS HÉTÉROGÈNES ET ENCORE INDECISES 72
1. La Tunisie 72
a. La « troïka » : une expérience sans équivalent 72
b. Un chemin long et semé de difficultés 74
c. Un exemple potentiel pour les autres « révolutions arabes » ? 77
2. L’Egypte 79
a. L’échec de la première transition 79
i. 17 mois sous l’égide de l’armée 79
ii. Une année avec les Frères musulmans 80
b. Nouvelle transition, nouvelle impasse ? 83
c. La situation des Coptes 88
3. La Libye 90
a. Un Etat à construire 91
b. Un état de faiblesse préoccupant au plan politique et institutionnel 97
c. La force des identités tribales et régionales 99
III. QUELLES TRADUCTIONS CONCRÈTES EN MATIÈRE D’ACTION EXTÉRIEURE ? 103
A. PROPOSITIONS DE LIGNES D’ACTION POUR LA FRANCE 103
1. Faire de la Méditerranée une priorité 103
2. Assurer un pilotage fin 104
3. Développer nos réseaux 105
4. Défendre des principes et des valeurs avec efficacité et cohérence 107
B. RECOMMANDATIONS AU PLAN EUROPÉEN 108
1. Mobiliser davantage nos partenaires européens en faveur de la Méditerranée 108
2. Un bilan en demi-teintes qui doit pousser à faire preuve de « patience stratégique » et à s’engager sur le long-terme 108
3. Mettre la jeunesse au cœur du projet euro-méditerranéen 110
4. Pour un arrimage économique du Sud de la Méditerranée 111
CONCLUSIONS 117
EXAMEN EN COMMISSION 121
ANNEXES 137
ANNEXE 1 - PRINCIPAUX SIGLES 139
ANNEXE 2 - CHRONOLOGIE 141
ANNEXE 3 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET DES VISITES EFFECTUÉES 145
ANNEXE 4 - CARTES GÉOGRAPHIQUES DE L’AFRIQUE DU NORD ET DU MOYEN-ORIENT, DE LA TUNISIE, DE L’EGYPTE ET DE LA LIBYE 151
« La victoire est là : une révolution naturelle, à l’image d’un fruit qui a tant mûri qu’un jour d’hiver il tombe tout seul, entraînant avec lui d’autres fruits : les arbres se sont mis à danser comme dans un temps de festivité heureuse. Personne ne peut s’emparer de ce mouvement dont l’onde de choc s’est propagée très loin ».
Tahar Ben Jelloun, L’étincelle, révoltes dans
les pays arabes, Gallimard, 2011.
La mission que nous avons menée sur les « révolutions arabes » n’est pas une commission d’enquête qui nous conduirait, comme s’il s’agissait d’une sorte d’instruction judiciaire, à émettre des jugements ou, a fortiori, des condamnations.
Il s’agit d’une mission d’information. Nous avons ainsi travaillé depuis décembre 2012 dans une double optique : apprendre et comprendre. Dans le cadre des très nombreuses auditions réalisées à l’Assemblée nationale, comme lors de nos déplacements dans la région, nous n’avons été motivés que par cette double démarche : apprendre ces pays, ces peuples, leurs situations politiques, économiques et sociales, et comprendre les mouvements en profondeur qui les animent depuis le début de ce que certains ont appelé « les printemps arabes » et que nous préférons nommer ici des « révolutions arabes ».
Dans cette perspective, nous nous sommes efforcés de nous départir de tout préjugé, de tout a priori. Cela n’a pas toujours été facile, non seulement parce qu’un passé « colonial », fût-il apaisé, nous unit à tel ou tel de ces pays – on pense en particulier à la Tunisie, bien sûr –, mais aussi parce que notre mission étant plurielle, de tels préjugés nous auraient probablement divisés.
C’est pourquoi, en préambule, il nous paraît important de préciser les erreurs qu’il paraît nécessaire d’éviter pour appréhender ces processus révolutionnaires.
1. Une première erreur consisterait à sous-estimer l’importance, pour la région elle-même et pour la France, des événements en cours dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée.
Malgré l’incertitude des trajectoires et les crises, qui ne sont pas propres aux seules révolutions dans le monde arabe, c’est à la fin d’un cycle historique que l’on assiste, celui de la « stabilité autoritaire », dont la chute brutale de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi a montré l’inanité.
Ne cédons pas à l’indifférence, une fois que l’enthousiasme initial pour le changement est retombé. Les pays concernés sont nos voisins, nos partenaires naturels, presque obligés.
Ceux à qui nous lie une communauté d’intérêt politique, diplomatique, économique et culturelle, si incontournable que le partenariat « euro-méditerranéen » devrait faire l’objet d’un consensus dynamique, créatif et mobilisateur.
C’est le cas, à peu près, en France.
Mais pas encore en Europe, hélas. Seule l’Europe du Sud semble être convaincue d’une telle nécessité.
Quant aux initiatives, plus ou moins concertées, pour dynamiser ce partenariat, du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée, elles ont connu tant de formes, si diverses, qu’elles mériteraient d’être sérieusement remises à flot… et en route !
En tout état de cause, les responsables français ont, bien sûr, intérêt à ne pas sous-estimer cet enjeu.
2. Une deuxième erreur à éviter est de considérer les pays de la rive Sud de la Méditerranée avec les yeux de notre politique intérieure.
Car ces pays sont d’identité arabo-musulmane et, à ce titre, ils symbolisent cette « altérité » si difficile à accepter comme une richesse dans notre pays. C’est-à-dire « l’autre », objet de tous les fantasmes, de toutes les angoisses, de toutes les formes de rejet, surtout en temps de crise.
Qui plus est, ces pays ont été – et ils le sont même encore, à des degrés divers – des terres d’émigration vers l’Europe – et donc vers la France. Ce n’est donc plus seulement « l’autre » qui est en cause, mais l’immigré, l’étranger venu chez nous. Considérer ces pays avec le regard que nous portons sur notre politique intérieure, ce serait prendre le risque de n’y voir que des pays d’émigration et, indirectement, des pays qui nous posent problème.
3. Une troisième grande erreur consisterait à rechausser, peu ou prou, nos lunettes de vue d’ancienne puissance coloniale, en portant des jugements ou en émettant des conseils à caractère néo-colonialiste. Pour la France, cela vaut en particulier dans l’approche de la Tunisie.
Il en résulterait irrémédiablement une vive réaction de rejet et une accusation d’ingérence, toutes deux bien compréhensibles. Nos voisins n’ont nul besoin de nos conseils et, encore moins, de nos consignes.
Leurs opinions publiques sont, de tradition et de culture, fortement structurées par un nationalisme identitaire. Elles ne le dépassent que pour repousser toute influence occidentale, dans un élan « pan-arabique », et bien sûr pour faire front commun derrière la Palestine et contre Israël.
La meilleure preuve en est peut-être l’attaque contre l’ambassade d’Israël au Caire, au mois de septembre 2011 : elle n’a pas été menée par des islamistes, mais par des « ultras », ces supporters de football très violents et si peu cultivés.
4. La quatrième erreur serait d’alimenter le mythe de la puissance manipulatrice en entretenant l’illusion que nous aurions des leviers à notre disposition pour influer, de manière déterminante, sur le cours des événements. Comme l’a dit Hubert Védrine à la mission d’information, il faut « nous désintoxiquer de l’idée que nous pourrions tirer les ficelles au Maghreb ».
Là où les régimes autoritaires ont été renversés, en Tunisie, en Egypte et en Libye, nous avons assisté au triomphe d’une immense aspiration populaire à reprendre en main un destin collectif jusque-là confisqué. Il en suit une allergie naturelle à toute tentative d’influence.
Ailleurs, sans renier nos valeurs, ni dissimuler notre sympathie pour les mouvements démocratiques, il faut éviter de produire le sentiment, inutile et contreproductif, que nous encourageons, voire soutenons la contestation des pouvoirs établis.
Il reste à ajuster, entre ces deux bornes que sont l’indifférence et l’ingérence, notre action extérieure…
5. Une cinquième erreur, tout aussi magistrale, serait de considérer ces processus révolutionnaires avec notre culture, de les penser avec les acquis de notre expérience et d’en parler avec nos qualificatifs.
C’est le cas, en particulier, de la référence à notre héritage révolutionnaire. Allez dire aux révolutionnaires du Caire, d’Alexandrie, de Tripoli ou de Tunis que la France a mis près d’un siècle avant de stabiliser sa révolution de 1789 et d’inscrire la République dans la durée ! Ils vous répondront, excédés, qu’il n’a fallu que six ou sept ans après la « révolution des œillets » pour que le Portugal accède à la démocratie et que, de toute façon, eux-mêmes n’attendront jamais aussi longtemps à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux.
Quant à nos mots, nos qualificatifs, ils doivent être employés avec la plus grande prudence. Songeons, en particulier, au beau mot de « laïcité », au substantif « laïque », belles inventions françaises dont nous pensons, chez nous, qu’elles désignent une valeur dont la vocation est aussi universelle que la démocratie et les droits de l’homme.
Qualifier certains des partis de Tunisie, d’Egypte ou de Libye de « partis laïques » reviendrait pourtant à leur porter préjudice.
Ce serait leur appliquer une étiquette « occidentale », les assimiler au « Parti de la France » ; ce serait évoquer un modèle importé.
Ou, pire, ce serait assimiler ces partis aux anciens régimes dictatoriaux qui se réclamaient souvent – et abusivement – de la laïcité et menaient, en tout cas, une lutte farouche contre les forces politiques se réclamant de la religion…
Même en Tunisie, où l’amitié avec la France est profonde et où les liens avec notre pays sont très étroits, il vaut mieux qualifier ces forces politiques de « démocrates » ou de « républicaines », voire de « progressistes » ou de « libérales ».
6. La sixième erreur est celle de l’amalgame, ou plutôt des amalgames.
Tout d’abord, celui entre les pays concernés. Certes, ces révolutions ont de nombreux « points communs » – on observe des soulèvements contre des régimes dictatoriaux autant que contre la misère économique et sociale, mais aussi une position hégémonique des partis se réclamant de l’islamisme, une atomisation des partis progressistes ou démocrates, une libération de la presse, de la parole et de l’expression, ainsi qu’une éclosion d’un multipartisme « échevelé ». Chacun de ces pays et de ces processus révolutionnaires conserve pourtant son « caractère propre ». Quoi de commun entre un pays comptant 85 millions d’âmes, l’Egypte, et un pays peuplé de seulement six millions d’habitants et disposant d’importantes ressources pétrolières, tel que la Libye ?
Amalgame, surtout, dans l’approche de l’Islam.
Contrairement à ce que croient trop de nos compatriotes, il n’existe pas « un » Islam monolithique et cohérent – et donc pas, soit dit en passant, « une » menace islamique ou islamiste.
L’Islam n’a pas de chef, de « grand imam » jouant un rôle dirigeant et disposant d’une puissance d’influence comparable à celle du pape pour la religion catholique.
L’Islam a « des » chefs, autant de chefs qu’il existe de mosquées et, par conséquent, d’imams. Certains exégètes avisés du Coran affirment même qu’il existe autant d’Islams que de musulmans, dans la mesure où le Coran est source d’interprétations diverses et qu’une des caractéristiques de cette religion est de confier à chacun la liberté de choisir son « mode de croyance ».
Quel rapport, par exemple, entre le grand imam de la Mosquée d’Al-Azhar au Caire, le cheikh Tayeb, modèle de modération et d’ouverture, et Yasser Bourhami, l’imam de la prédication d’Alexandrie, pourtant pédiatre de formation, créateur du parti salafiste Al Nour, ou encore Abou Ismaïl, salafiste révolutionnaire, incarnations presque caricaturales, l’un et l’autre, du conservatisme échevelé et de la réaction la plus extrémiste ?
Et même, s’agissant des forces politico-religieuses, il faut se garder de tout amalgame. En évoquant les « salafistes » par exemple, nous pouvions avoir le sentiment de désigner un mouvement bien précis… du moins jusqu’à notre rencontre – très étonnante – avec des responsables du parti Al Nour au Caire, qui ont exposé en détail ce que sont, pour eux, « les cinq écoles du salafisme, différentes et à bien des égards opposées entre elles ».
Vient ensuite le risque d’amalgame entre des partis et des forces politiques qui ont, tous et toutes, leur identité particulière. Même les salafistes égyptiens sont bien différents des salafistes tunisiens.
Si le monde est complexe, le monde arabo-musulman l’est plus encore. Tâchons donc d’éviter les amalgames et les raccourcis.
7. Enfin, la septième et dernière erreur à ne pas commettre est celle des conclusions hâtives. Depuis presque trois ans, des processus au long cours se sont engagés. Ils sont loin, très loin même, d’être achevés.
En tirer des conclusions immédiates, et a fortiori définitives, serait un non-sens et une imprudence, tant les situations sont évolutives. Si une sorte de « glacis » paraît s’être installée en Egypte – mais pour combien de temps ? –, qui aurait pu imaginer, il y a encore un mois, le début d’un « dialogue national » en Tunisie et le départ – à confirmer – d’Ennahda du Gouvernement, ou encore l’enlèvement, ahurissant mais si révélateur de la situation en Libye, du Premier ministre Ali Zeidan ?
La fin de l’année 2010 a été marquée en Tunisie par le retentissement tragique de deux suicides, d’abord celui d’un jeune marchand ambulant, Mohamed Bouazizi, qui s’immole par le feu à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010, puis celui de Houcine Nejid, un jeune chômeur qui se jette du haut d’un pylône électrique, cinq jours plus tard. L’émotion suscitée par ces actes de désespoir, l’indignation devant la violence de la répression et la solidarité envers ses victimes – et contre le pouvoir – se conjuguent alors pour déclencher une vague de contestation qui s’étend progressivement à l’ensemble du pays.
Si la suite est aujourd’hui connue, il faut admettre que nul ne l’avait anticipée. Moins d’un mois après l’immolation de Mohamed Bouazizi, le 14 janvier 2011, le président Ben Ali, en place depuis près de 25 ans et manifestement prêt à tout pour y rester – de la manipulation à la répression la plus brutale en passant par l’intimidation –, finit par trouver refuge en Arabie saoudite.
Personne n’avait imaginé non plus que le tour de l’Egypte viendrait ensuite – et si vite. Le soulèvement commence au Caire le 25 janvier, avec le succès inattendu d’une manifestation contre le régime, le jour de la « fête de la police ». Cet embrasement soudain conduit, en une quinzaine de jours, à la chute du président Moubarak, poussé à la sortie par l’armée, le 11 février. Qui aurait pu sérieusement croire que ce dictateur en apparence « indéboulonnable » finirait par comparaître devant un tribunal, vêtu d’un simple pyjama ?
Le mouvement qui gagne ensuite la Libye, quatre jours après le départ de Moubarak, est plus long et beaucoup plus douloureux, mais tout aussi radical dans ses conséquences. Kadhafi finit par être tué le 20 octobre 2011, au terme d’affrontements qui auraient fait 22 000 morts et 40 000 blessés, sans compter de nombreux disparus.
Entretemps, le Maroc avait adopté une nouvelle Constitution, le 1er juillet 2011. Quant à l’Algérie voisine, elle était secouée au début de l’année par une vague d’immolations par le feu, comme en Tunisie, et par des émeutes particulièrement violentes. Plus à l’Est, un mouvement protestataire avait pris naissance au Yémen fin janvier ; en Jordanie, des manifestations avaient commencé quelques jours plus tôt ; la contestation a aussi gagné Oman en janvier, le Bahreïn en février et la Syrie au cours du mois de mars.
Les rives Sud et Est de la Méditerranée, que d’aucuns croyaient figées par des décennies d’autoritarisme, se sont ainsi mises en mouvement fin 2010 et tout au long de l’année 2011, faisant remonter jusqu’à la surface – et à notre conscience – une ébullition des sociétés qui était restée jusque-là à bas bruit et à laquelle bien peu d’observateurs avaient réellement prêté attention. C’est pour prendre la mesure de ces « révolutions arabes », si inattendues, que notre mission d’information a été créée, le 14 novembre 2012, par la Commission des affaires étrangères.
Si le terme de « révolutions » a été choisi d’emblée, c’est tout d’abord parce qu’il a semblé préférable d’écarter la métaphore saisonnière, pourtant très répandue, qui voit dans les événements de la fin 2010 et de l’année 2011 un « printemps » arabe, en référence au « printemps des peuples » de 1848 ou encore au « printemps de Prague » de 1968.
L’impression initiale qu’un « printemps arabe » était enfin advenu correspondait à la perception, erronée, que tout se mettait à bourgeonner, pour donner ensuite des fruits que l’on pensait devoir être nécessairement démocratiques et pourvoyeurs de « bonheur des peuples ». Près de trois ans plus tard, les situations demeurent en fait très contrastées, très sinueuses et très conflictuelles au plan interne.
Le terme de « révolutions », qui a été choisi pour désigner d’une manière générique ces bouleversements, peut bien sûr être discuté, lui aussi. Certains l’emploient au singulier, parlant de « la » révolution arabe, quand d’autres évoquent plutôt de simples « transformations arabes ». Il a semblé à la mission d’information que les changements intervenus étaient suffisamment brutaux et importants pour justifier l’emploi d’un terme aussi radical que celui de « révolutions », au moins dans le champ politique et là où les régimes dictatoriaux sont tombés.
Sans se désintéresser des évolutions en cours dans l’ensemble de la zone, la mission a choisi de concentrer ses travaux sur trois pays qui ont connu de telles « révolutions » ayant conduit à la chute du pouvoir : la Tunisie, l’Egypte et la Libye, la Syrie étant toujours, pour sa part, en proie à un conflit dramatique qui prend de plus en plus l’apparence d’une guerre civile et qui fait, par ailleurs, l’objet d’un groupe de travail spécifique de la Commission des affaires étrangères, lui aussi constitué en novembre 2012.
La mission a pu rencontrer de très nombreux interlocuteurs à Paris, au Caire, à Alexandrie, à Tunis et à Tripoli. Des responsables politiques, des chercheurs travaillant dans des disciplines variées – afin de croiser les approches (relations internationales, bien sûr, mais aussi histoire, économie, droit, sociologie ou encore islamologie) –, des diplomates et des acteurs de la société civile (1)… La mission d’information tient à remercier chacun d’entre eux pour sa contribution.
La mission a d’abord cherché à comprendre les ressorts de ces bouleversements historiques, sans précédent depuis la chute de l’empire ottoman et la période de l’indépendance, que la Tunisie, l’Egypte et la Libye viennent de connaître, en commençant par replacer ces évolutions dans leur contexte régional. La mission s’est interrogée à la fois sur l’existence d’une logique et d’une dynamique communes à la zone et sur la divergence manifeste des situations. La mission d’information en a tiré la conclusion qu’un mouvement d’ensemble était à l’œuvre, un « réveil arabe » global, mais connaissant des traductions différenciées selon les contextes, qui restent nationaux.
Une fois ce cadre posé, le présent rapport s’efforce de dresser un premier bilan, nécessairement provisoire, des révolutions tunisienne, égyptienne et libyenne. Plusieurs angles d’approche ont semblé devoir être combinés : le respect des principes démocratiques, la question des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation des femmes, ainsi que les évolutions économiques et sociales. Malgré la présence d’acteurs communs, dont la plupart sont nouveaux sur le devant de la scène, tels que les islamistes, les forces dites « libérales » et les acteurs de la société civile, malgré l’apparition concomitante de défis identiques à relever – un nouveau « pacte national » à définir, la situation des femmes et une urgence économique qui appelle des réponses –, la mission a été frappée par la diversité et l’instabilité des trajectoires de chacun des pays concernés.
Enfin, ce contexte changeant sur la rive Sud de la Méditerranée a conduit la mission d’information à s’interroger sur les conséquences qu’il convient d’en tirer pour l’action extérieure de la France et de l’Union européenne, afin de dégager un certain nombre de pistes d’action et de recommandations générales.
I. UN « RÉVEIL ARABE » INATTENDU ET TRÈS HÉTÉROGÈNE
A. LE DÉPÉRISSEMENT DE MODÈLES QUE L’ON AVAIT FINI PAR CROIRE INDÉPASSABLES
La mission d’information a constaté que tous ses interlocuteurs s’accordaient sur la portée globale du bouleversement engagé en 2011. Il a ainsi été comparé à l’effondrement du bloc soviétique, du fait de son caractère imprévu, de sa radicalité et de sa vitesse, même si les mécanismes à l’œuvre diffèrent bien sûr profondément (2). Ce bouleversement a aussi été mis en parallèle avec la chute de l’Empire ottoman, comme avec la période de la décolonisation.
Pour M. Joseph Bahout, chercheur à l’Académie diplomatique internationale et consultant permanent au Centre d’analyse, de prospective et de stratégiedu Ministère des affaires étrangères, il s’agit de l’un de ces très rares bouleversements historiques auxquels on n’assiste qu’une à deux fois par siècle dans une zone géographique donnée (3).
a. Des peuples aspirant à reprendre en main leur destin
Ces différents mouvements de contestation traduisent des aspirations semblables, exprimées avec de mêmes slogans libérateurs : « le peuple veut la chute du régime » ou bien, là où la contestation se fait plus modérée en 2011, notamment en Jordanie : « réformer le régime ». Ces aspirations mêlent des revendications politiques – le refus de l’arbitraire et de la confiscation des libertés –, des appels à une plus grande justice sociale – on s’insurge contre des conditions de vie perçues comme profondément injustes, contre un horizon qui paraît obstrué pour la jeunesse, ainsi que contre la corruption et la prédation exercée par des cercles très restreints associés au pouvoir et bien décidés à s’enrichir à tout prix –, à quoi s’ajoutent aussi des revendications éthiques. La dignité (« Karama ») est ainsi l’un des mots clefs des révolutions de 2011. Comme l’a rappelé le Professeur Henry Laurens devant la mission d’information, cette aspiration à la dignité est bien différente de celle, collective, des révolutions des années 1950 et 1960, qui ont vu des peuples lutter pour leur émancipation vis-à-vis de puissances extérieures (4). Il s’agit en 2011 d’une « transformation de sujets en citoyens, c’est-à-dire de victimes en acteurs qui prennent en main leur histoire et leur destin » (5) en s’affranchissant des régimes en place.
Le tournant de 2011 voit ainsi le champ politique, jusque-là bloqué par le pouvoir, se rouvrir spectaculairement, à rebours de la prétendue « exception arabe » dont beaucoup avaient fini par penser qu’elle vouait cette partie du monde à rester à l’écart des différentes « vagues de démocratisation » qui se sont succédé en plusieurs temps. Depuis les travaux de Samuel Huntington sur ce sujet (6), on distingue en effet trois « vagues de démocratisation », qui n’avaient jamais touché le monde arabe jusque-là. La première aurait commencé dans les démocraties fondatrices que sont la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, avant de toucher une partie de l’Amérique latine, se poursuivant jusqu’à la première guerre mondiale ; la seconde aurait pris son essor en 1945 dans des pays tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Japon ou encore l’Inde ; quant à la « troisième vague », elle aurait commencé en Europe du Sud – Portugal, Grèce, Espagne – avant de gagner l’Amérique latine et les anciens pays du bloc de l’Est, liste à laquelle il faut probablement ajouter désormais les pays ayant connu une « révolution de couleur » dans les années 2000, notamment la Géorgie et l’Ukraine. A la surprise générale, c’est une nouvelle « vague démocratique » qui touche les pays arabes en 2011.
Pour Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou (7), ce bouleversement inattendu, qui est la première grande caractéristique du « réveil arabe » « désarçonne les schémas de pensée immuables longtemps avancés à l’égard de cette partie du monde », à savoir les représentations orientalistes – au mauvais sens du terme – d’un monde arabe voué à l’immobilisme, au fatalisme et à l’archaïsme. Plusieurs explications essentialistes ont en effet été mobilisées pour expliquer ce que l’on percevait comme une divergence du monde arabe, en particulier une soumission à l’autorité qui serait traditionnelle en terre d’islam, ou encore une structure sociale fondamentalement patriarcale, elle aussi perçue comme peu favorable à une expression démocratique, et reposant sur des solidarités de nature tribale ou confessionnelle – à savoir l’« Assabiya », ou « esprit de corps particulier » (8), théorisée par le grand penseur arabe du XIVe siècle Ibn Khaldoun. S’il est vrai que les scènes politiques arabes étaient souvent dominées, jusqu’en 2011, par la figure du « Zaïm », version arabe du chef charismatique, ce dernier a fini par être pris pour cible par les manifestants, sous ses différentes incarnations – Ben Ali, Moubarak, Kadhafi –, et directement sommé de « dégager ».
La première victoire remportée en 2011, quelles que soient les évolutions ultérieures, est par conséquent de nature hautement significative. Elle marque la fin de cette impuissance que Samir Kassir, assassiné à Beyrouth en 2005, décrivait en ces termes : « L’impuissance, incontestablement, est l’emblème du malheur arabe aujourd’hui. Impuissance à agir pour affirmer votre volonté d’être, ne serait-ce que comme une possibilité, face à l’Autre qui vous nie, vous méprise et, maintenant, de nouveau vous domine. Impuissance à faire taire le sentiment que vous n’êtes plus que quantité négligeable sur l’échiquier planétaire, quand la partie se joue chez vous » (9).
On peut estimer, à l’instar de Jean-Pierre Filiu (10) et à l’inverse de la prétendue exception arabe, qu’il s’agit d’une « seconde renaissance ». Le monde arabe renouerait ainsi avec la « Nahda » (renaissance) engagée au XIXe siècle et dont Jean-Pierre Filiu rappelle que la Tunisie et l’Egypte était déjà aux avant-postes. Comme l’a indiqué M. Beligh Nabli à la mission d’information, cette seconde renaissance se différencie de la précédente par son absence de force idéologique inspiratrice et d’intellectuels à sa tête (11). N’étant pas menée par des élites politiques et culturelles, mais par le peuple, elle constitue à la fois une « Nahda » et une « Intifada » (soulèvement).
b. Une phase nouvelle, encore empreinte d’une grande incertitude
Si les événements de 2011 ouvrent à l’évidence un chapitre nouveau, la mission d’information a aussi été frappée, au cours de toutes ses auditions et de ses différents déplacements, par l’état d’indécision extrême, voire de confusion, qui persiste à ce stade, là où des révolutions se sont produites. La seule certitude qui paraît se dégager est que l’apparente « stabilité autoritaire » dont les régimes se prévalaient pour justifier la confiscation des libertés qu’ils organisaient, comme pour obtenir le soutien général de l’autre rive de la Méditerranée, au nom du contrôle de l’immigration, de la sécurité des approvisionnements en hydrocarbures et de la coopération contre le terrorisme, est désormais une figure appartenant au passé. L’année 2011 a révélé à quel point cette « stabilité » avait été fragilisée de l’intérieur pour des raisons sur lesquelles il faudra revenir par la suite.
Dans deux pays qui ont connu des « révolutions arabes » victorieuses, à savoir l’Egypte et la Tunisie, trois phases distinctes se sont déjà succédé, selon le Professeur Gilles Kepel (12) : un premier temps, empreint d’euphorie, qui voit la chute des dictateurs sous la pression populaire ; ensuite, l’arrivée au pouvoir de forces politiques islamistes à la faveur des premiers scrutins réellement libres et sincères dans l’histoire de ces pays ; puis leur échec manifeste, d’une part en raison de leur incurie au plan économique et de l’absence de toute réforme sociale susceptible de répondre aux aspirations profondes au changement qui se sont manifestées en 2011, sans doute en l’absence de véritable programme, hormis le slogan « l’islam est une solution », qui n’a d’efficacité que pendant une phase de contestation et non d’exercice du pouvoir, et d’autre part en raison de leur crispation sur des sujets identitaires, tels que la place de la charia ou la complémentarité entre les hommes et les femmes, qui ont suscité de graves tensions et une très forte polarisation du champ politique, en Egypte comme en Tunisie.
Comme l’a souligné M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prospective et de stratégie du Ministère des affaires étrangères (13), les « révolutions arabes » se déroulent par phases successives, comme la révolution française de 1789, sans que l’on sache a priori où celles-ci vont conduire. Tout paraît possible, y compris un retour à l’autoritarisme, du moins temporairement, comme lors du « printemps des peuples » que l’Europe a connu en 1848. Il avait alors fallu plusieurs décennies pour que les aspirations démocratiques qui avaient vu le jour finissent par l’emporter durablement, à l’issue d’un cycle révolutionnaire à la fois long et complexe. L’éviction des Frères musulmans du pouvoir en Egypte, au mois de juillet 2013, suivie d’une reprise en main de la situation par l’armée, pourrait accréditer, à ce stade, un tel scénario. Pour Antoine Basbous, que la Commission des affaires étrangères a entendu le 10 juillet 2013 sur la situation en Egypte, le cours des événements s’apparente, depuis le « tsunami initial » de 2011, à une succession de répliques sismiques, désormais probables mais difficilement prévisibles, du moins au plan temporel.
Il reste aussi à savoir si les changements réalisés depuis 2011 suffiront à combler les aspirations profondes qui sont à l’origine du mouvement de contestation. Si les dictateurs sont tombés en Tunisie, en Egypte et en Libye, aucun changement notable n’a eu lieu, pour le moment, au plan économique et social, contrairement à ce qui s’était passé à l’occasion des révolutions de 1789 et de 1917. Si les frustrations actuelles persistaient, en s’aggravant même du fait de l’impéritie manifeste des autorités de transition, un « second tour » révolutionnaire, lancé par une nouvelle « révolte des ventres », ne paraît pas exclu. L’Egypte a déjà connu une telle révolte en 1977. Toutefois, pour qu’une deuxième révolution se produise de la sorte, plusieurs interlocuteurs de la mission ont insisté sur le fait qu’une éventuelle « révolte des ventres » devrait prendre une dimension politique et mobiliser au-delà des seules fractions de la population directement touchées, ce qui n’avait pas été le cas en 1977.
Que ce scénario se réalise ou non, l’analogie avec la chute des régimes communistes d’Europe de l’Est en 1989, qui avait vu une stabilisation rapide et relativement linéaire de la situation politique, paraît devoir être écartée. Comme le note Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff, « alors que l’objectif des bouleversements de 1989 était clairement fixé, instaurer la démocratie représentative (ainsi que l’économie de marché), l’horizon de la vague de protestation entamée en 2011 est beaucoup plus brouillé : certains veulent établir une démocratie libérale ; d’autres rêvent d’un Etat islamique, les derniers aspirent avant tout à plus de justice sociale » (14). Seul un principe d’action aussi vague que le « dégagisme » a pu fédérer, dans un moment libérateur initial, des acteurs dont les objectifs divergent aussi profondément à terme. Ainsi que l’a rappelé Gilles Kepel (15), Marx définit à juste titre la révolution, dans Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, comme un moment d’enthousiasme où les antagonismes sont passagèrement oubliés.
Une autre incertitude concerne l’évolution des pays qui ont certes été touchés par la vague de contestation née en Tunisie, mais qui n’ont pas vu le renversement des régimes en place. Au Maroc, par exemple, selon Khadija Mohsen-Finan, chercheuse à l’IRIS (16), le « Palais » est parvenu à conduire la révolution « par le haut », en prenant l’initiative d’une nouvelle Constitution qui modifie les équilibres institutionnels, sans instaurer pour autant une véritable monarchie parlementaire, à la différence de la Tunisie voisine, où la révolution s’est déroulée « par le bas ». Il reste à savoir si cette « chorégraphie » nouvelle, après celle orchestrée par Hassan II sous la forme de l’alternance politique, est de nature à apaiser durablement les tensions qui sont apparues au grand jour au Maroc au cours de l’année 2011. La même question peut se poser en Jordanie, où la Constitution a aussi été révisée en 2011. Enfin, dans le reste du monde arabe, on peut se demander dans quelle mesure – ou pour combien de temps –, les mêmes causes peuvent être appelées à ne pas produire les mêmes effets qu’en Tunisie, en Egypte et en Libye. On y retrouve en effet des caractéristiques communes dont on peut penser qu’elles sont les raisons de fond des secousses actuelles : un autoritarisme de plus en plus pesant, d’importantes frustrations économiques et sociales, ainsi que l’apparition d’une population plus jeune et plus éduquée.
2. Des causes profondes, qui apparaissent a posteriori au grand jour
Rétrospectivement, même s’il faut se garder des interprétations téléologiques, la vague de contestation qui vient de secouer le monde arabe peut être perçue comme la résultante de nombreuses et violentes tensions accumulées depuis des années au plan politique, économique et social. Tahar Ben Jelloun y voit ainsi « une révolution naturelle, à l’image d’un fruit qui a tant mûri qu’un jour d’hiver il tombe tout seul, entraînant avec lui d’autres fruits : les arbres se sont mis à danser comme dans un temps de festivité heureuse » (17). Il paraît donc utile de présenter brièvement les principales caractéristiques des régimes et des sociétés arabes à la charnière de l’année 2011.
a. Un autoritarisme de plus en plus pesant
Les différents Etats dont se compose le monde arabe en 2011 présentent des visages en apparence bien différents. Il s’agit, d’une part, de monarchies ou d’émirats, reposant sur un principe dynastique, dans le Golfe, mais aussi en Jordanie et au Maroc ; d’autre part, de républiques nées après l’indépendance, notamment en Egypte, en Syrie, en Libye, en Tunisie et en Algérie.
Malgré cette différence, tous ces Etats, exception faite du Liban sans doute, sont en réalité fondés sur un principe autocratique. Lorsqu’un certain pluralisme politique existe, par exemple en Tunisie et en Egypte, il n’est pas poussé jusqu’à son terme naturel : certains partis, notamment ceux à référence religieuse, ne sont pas autorisés, le découpage électoral peut permettre d’influencer les résultats, diverses pratiques d’intimidation sont mises en œuvre pour dissuader des candidatures non souhaitées, et les résultats des élections sont parfois tout simplement truqués. Malgré les espoirs suscités lorsque Ben Ali succède à Bourguiba en 1987, ou lorsque l’Algérie se libéralise à la même période, jusqu’à ce que l’armée décrète que la victoire électorale probable des islamistes n’est pas acceptable et qu’elle suspende le second tour des élections législatives en 1991, on n’observe pas de réelle évolution démocratique avant le tournant de 2011. Cette logique autoritaire commune est progressivement mise à nu, du moins dans les républiques arabes, en raison de l’affaiblissement des différents modes de légitimité sur lesquelles elles s’appuient.
Une première source de légitimité était issue de la lutte contre les ingérences extérieures. Elle justifiait un Etat « fort », garant de l’unité nationale et des intérêts supérieurs du pays. En Tunisie, par exemple, le bénalisme se présentait comme un héritier du bourguibisme et du Destour, qui avait conduit le pays à l’indépendance. Mais cette légitimité historique s’est considérablement affaiblie. Tout d’abord, le nationalisme arabe a été douloureusement mis en échec dès la déroute militaire des armées égyptienne, syrienne et jordanienne de juin 1967 contre Israël, qui a laissé un traumatisme profond. En Egypte, Sadate a alors laissé la société s’islamiser, encourageant même cette évolution afin de combler le vide idéologique laissé par le nationalisme arabe et d’enrayer les risques de contestation islamiste. De plus, la génération qui a vingt ou trente ans dans les années 2010 n’a pas connu la période de l’indépendance et ne se sent pas redevable au pouvoir à ce titre.
Quant à la légitimité modernisatrice des régimes, elle a été mise à mal par la remise en cause de l’orientation socialisante dont s’entouraient à l’origine les républiques arabes, et qui s’était notamment traduite par des nationalisations, des réformes agraires, des politiques de grands travaux, des aides sociales et des mesures redistributives et égalitaristes. A partir du tournant néolibéral des années 1970 et plus encore des années 1980, sous la pression des institutions internationales, ce modèle s’épuise. En Libye, par exemple, après une première expérience de libéralisation de certains secteurs d’activité au milieu des années 1990, le régime se lance au début des années 2000 dans un tournant « libéral » plus prononcé, marqué par un encouragement du secteur privé, par une ouverture aux investisseurs étrangers, mais aussi par une réduction du subventionnement des produits de consommation de base et par un démantèlement du système de redistribution. L’« Infitah » (libéralisation) accroît ainsi les clivages sociaux, fragilise une partie des soutiens du régime, et conduit à l’apparition d’un « capitalisme de copinage » (« crony capitalism »).
La corruption de plus en plus visible au sommet de l’Etat joue aussi un rôle dans la déconsidération croissante du pouvoir : alors qu’un Bourguiba ou un Nasser avaient une réputation de sobriété, l’ascension du « clan Trabelsi » en Tunisie – autour de la belle famille de Ben Ali –, ou en Egypte celle du fils de Moubarak, Gamal, voient l’apparition de trains de vie bien plus ostentatoires et d’un comportement de prédation sur l’activité économique qui devient insupportable. On passe ainsi « d’une économie du plan à une économie du clan » (18).
La transmission dynastique du pouvoir, avérée en Syrie, où Bachar Al-Assad a succédé à son père, et de plus en plus probable en Egypte, en faveur de Gamal Moubarak, ou encore au Yémen, pour le fils du président Saleh, contribue aussi à alimenter le ressentiment à l’égard de régimes qui donnent l’impression de renier leurs principes fondateurs. Si le principe dynastique reste manifestement accepté dans les monarchies arabes, il n’en va pas de même dans les républiques, où cette dérive paraît scandaleuse. En Egypte, par exemple, elle contribue à détacher l’armée du président Moubarak, qui est pourtant l’un des siens. Au Yémen, le président Saleh a perdu le soutien d’autres dirigeants qui l’avaient fait « roi » – tel Ali Mohsen, un officier devenu l’exécutant de ses basses œuvres, ou encore Abdullah Al Ahmar, chef de la confédération tribale des Hached –, parce qu’il a rompu le pacte fondateur de son pouvoir en montrant au grand jour son ambition de céder la place à son fils, alors à la tête de la Garde républicaine.
Il reste à savoir pourquoi les monarchies arabes sont manifestement moins touchées que les autres régimes de la même zone. Une première explication générale pourrait être leur capacité à présenter au moins la perspective, sinon la réalité, d’une transformation de l’intérieur – ce que les républiques ayant basculé dans la tentation dynastique ne peuvent plus faire. Le Maroc et, à un moindre degré, la Jordanie, s’engagent ainsi sur le chemin qui mène à la monarchie constitutionnelle. Les marges de manœuvre financières sans équivalent des monarchies du Golfe, hormis en Algérie, offrent une autre explication. On observe d’ailleurs que ces pays ne s’engagent pas sur le même chemin de réforme interne que le Maroc et la Jordanie, qui sont dépourvus de telles capacités d’anesthésie sociale de la contestation.
b. Des frustrations persistantes et très vives au plan socio-économique
Le bilan économique reste assez flatteur, du moins en apparence, puisque l’ensemble de la zone connaît une phase de croissance soutenue avant le déclenchement des révolutions arabes. Selon la Banque mondiale, la croissance du PIB dans les Etats de la ligue arabe oscille ainsi entre 4,6 et 7,7 % de 2003 à 2008, résultat qu’il faut mettre en regard du taux de croissance de la population, estimé à un peu plus de 2 % par an. Le FMI évoque même à cette époque un « miracle tunisien ». En apparence, la situation s’améliore en effet : la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, Oman et l’Arabie saoudite font partie des dix pays du monde qui enregistrent la plus forte augmentation de leur indice de développement humain entre 1970 et 2010 (19). Cette situation s’accompagne toutefois de frustrations graves et persistantes.
Le niveau de chômage est ainsi très préoccupant. Il s’élevait en 2005 à environ 15 % dans les pays arabes, d’après les chiffres officiels, contre 6,3 % en moyenne au plan mondial (20). D’ici à 2020, on estime ainsi qu’il faudrait créer 51 millions d’emplois dans l’ensemble de la zone pour absorber les entrées sur le marché du travail, y compris en Arabie Saoudite, dont seule la situation financière est plus favorable (21). Dans les pays du Golfe, les tentatives de « nationalisation » d’emplois occupés par des ressortissants étrangers ne sont guère couronnées de succès, en raison de la faible productivité des nationaux. Cette situation globale peut s’expliquer par plusieurs raisons : le rétrécissement du secteur public dans les pays qui ont connu des « réformes structurelles » au cours des années 1980 ; les faibles performances d’un secteur privé de petite taille et faiblement pourvoyeur d’emplois ; et enfin, un système éducatif qui néglige des compétences techniques et professionnelles pourtant nécessaires (22).
Un facteur particulièrement important de frustration économique et sociale, dans ce domaine, est la grande difficulté pour les jeunes diplômés d’accéder à l’emploi. Bien souvent, les chances d’obtenir un travail sont même inversement proportionnelles au niveau des études suivies. En Tunisie, par exemple, qui a pourtant massivement investi dans l’enseignement, il serait plus de trois fois plus difficile pour un jeune de trouver un travail quand il est diplômé. Le taux de chômage des jeunes est globalement estimé à 30 ou 40 % dans certains pays de la zone. C’est un dysfonctionnement majeur du marché du travail et surtout un facteur de blocage de sociétés qui ne parviennent pas à insérer économiquement une fraction importante de leur jeunesse.
En 2005, par ailleurs, environ 20 % de la population du monde arabe se trouvaient en dessous du seuil international de pauvreté de 2 dollars par jour, soit environ 35 millions de personnes. Ce phénomène s’est certes réduit, puisque 32 % de la population était touchée en 1981 dans la zone, et il n’est pas aussi élevé qu’il peut l’être ailleurs – il concerne 38,7 % de la population en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, ou encore 73 % de la population en Afrique subsaharienne –, mais il demeure toutefois massif. Et si l’on prend en compte le seuil national supérieur de pauvreté, son incidence est encore plus élevée : elle touchait 30 % de la population syrienne en 2004, 41 % de la population égyptienne en 2005 – soit 30 millions de personne – et 60 % de la population au Yémen au cours de la même année (23).
A cela s’ajoutent d’importantes inégalités territoriales. En Tunisie, par exemple, le bassin minier de Gafsa, à la frontière algérienne, connaissait des taux de chômage compris entre 30 et 40 %, contre 14 % en moyenne nationale, lorsqu’une révolte s’y est déroulée, pendant six mois, au cours de l’année 2008 (24). En Egypte, les zones industrielles traditionnelles sont également en crise, comme le montrent les troubles qui éclatent, à la même époque, à Mahalla El-Kubra. En décembre 2010, c’est à Sidi Bouzid, territoire défavorisé au centre de la Tunisie, que se produit l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, à l’origine de la vague de contestation qui gagne l’ensemble de la zone.
c. Une population plus jeune et plus éduquée
Cette brève description de ce qu’est le monde arabe en 2011 serait incomplète sans une présentation des données démographiques. Tous les facteurs semblent en effet réunis pour une « crise de transition », même s’il est évidemment impossible d’en déduire qu’elle prendra nécessairement une forme révolutionnaire. On assiste ainsi à une réduction du taux de fécondité, à un accroissement de la part des jeunes dans la population et à une augmentation massive du taux d’alphabétisation. Objectivement, les sociétés du monde arabe sont de facto entrées dans ce que l’on peut considérer comme une certaine forme de modernité.
Tout d’abord, elles connaissent toutes une transition démographique, qui se traduit par une baisse du taux de fécondité à partir du milieu des années 1960 en Egypte et en Tunisie, depuis 1975 au Maroc, et depuis 1985 en Libye, en Jordanie et en Syrie (25). Le nombre d’enfants par femme est globalement passé de 6 ou 7 à 2 ou 3 dans l’ensemble de la zone, malgré des variations locales : en 2005, il était à peu près égal à 2 en Tunisie, proche de 2,5 en Algérie et au Maroc, voisin de 3,5 en Egypte, en Libye et en Arabie Saoudite, mais encore supérieur à 6 au Yémen. Or, bien souvent, on estime que la réduction de la taille des familles, conjuguée à la baisse du taux d’endogamie, également bien réelle dans le monde arabe, permet une émancipation de l’individu par rapport au groupe (26).
A ce stade de la transition démographique, il en résulte aussi un accroissement massif de la part des 14-25 ans au sein de la population, phénomène que Jean-Pierre Filiu appelle « effet chebab » (27). En 2009, entre 45 et 60 % de la population avait ainsi moins de 25 ans dans la zone. Au plan politique, comme l’a également indiqué Jean-Pierre Filiu, cette fois devant la mission d’information, ceux qui ont connu la période de l’émancipation à l’égard des puissances occidentales, ou qui peuvent éprouver une forme de reconnaissance à l’égard des anciens régimes, pour des raisons sociales ou économiques, sont désormais minoritaires. En outre, il n’est pas besoin de rappeler l’effet qu’a produit le « Baby Boom » dans les sociétés occidentales à la fin des années 1960.
On observe par ailleurs un taux d’alphabétisation très élevé dans les sociétés arabes contemporaines, y compris chez les femmes. Chez les hommes jeunes, en 2007, il est supérieur à 95 % partout dans la zone – il atteint même un seuil de 99 % en Jordanie et de 98 % en Libye – exception faite de l’Egypte, où il est néanmoins de 90 %, et du Yémen, où il ne s’élève qu’à 59 % (28). Il s’agit là aussi, bien sûr, d’un facteur potentiellement déterminant au plan politique. Comme l’indique Emmanuel Todd, « la Révolution française s’est produite quand 50 % des hommes du bassin parisien savaient écrire » (29). La mobilisation de la jeunesse arabe, qu’elle appartienne aux classes moyennes urbaines ou aux catégories défavorisées, jouera de fait un rôle essentiel dans le déclenchement de la vague de contestation de 2011.
A terme, si l’on en croit les projections démographiques actuelles, la situation risque d’être encore plus explosive dans les pays qui n’en sont qu’à un stade intermédiaire de leur transition démographique. Selon l’Institut national des études démographiques (INED), si la population de la Tunisie ne devrait ainsi passer que d’environ 11 millions d’habitants mi-2013 à 13 millions en 2050, celle de l’Egypte pourrait s’élever à 126 millions à cet horizon, contre 85 millions aujourd’hui (30). Les conséquences qui pourraient s’ensuivre au plan économique et social dépendront notamment du taux de croissance, de la répartition des richesses et de l’évolution du marché du travail, mais on ne peut nullement exclure à ce stade qu’il puisse en résulter des tensions importantes, notamment en matière de ressources, dans un pays dont la population a déjà doublé depuis les « émeutes de la faim » de 1977, qui est par ailleurs le plus grand importateur de céréales au monde, et où le chômage des jeunes est particulièrement élevé. Si certains évoquent à ce titre une possible « huitième plaie d’Egypte » (31), une telle explosion démographique pourrait aussi concerner d’autres pays de la région. D’ici à 2050, la population irakienne pourrait passer de 35 à 83 millions d’habitants, celle de la Jordanie de 7,3 à 13 millions, et celle de la Syrie de 21,9 à 37 millions (32).
Malgré l’accumulation de ces différents facteurs, la quasi-totalité des interlocuteurs rencontrés par la mission d’information a mis en avant le caractère imprévu de la vague de contestation qui a touché d’abord la Tunisie en décembre 2010, avant de s’étendre à l’ensemble de la zone sous des formes diverses. Dans l’ensemble, ni le monde académique, ni les gouvernements américain ou français, manifestement, ni même les forces politiques islamistes sur le terrain –puisqu’elles sont restées à l’écart du mouvement dans un premier temps –n’avaient vu venir les événements. Les difficultés étaient pourtant connues des spécialistes de ces pays. Quant à ceux des chercheurs, beaucoup plus rares, qui ont indiqué avoir anticipé cette vague de changement, parce que la situation politique, économique et sociale ne leur paraissait plus tenable au regard des frustrations et des tensions qui s’accumulaient depuis si longtemps, ils ont reconnu que la date de son déclenchement était imprévisible.
M. Tewfik Aclimandos, chercheur au Collège de France et spécialiste de l’Egypte, a ainsi déclaré aux membres de la mission d’information (33) qu’il avait certes pensé à plusieurs reprises, au cours des années 2000, que le régime égyptien allait tomber, mais qu’en revanche il n’avait pas anticipé sa chute en 2011. Jean-Noël Ferrié, lui aussi spécialiste de l’Egypte, écrivait pour sa part en 2008, après avoir présenté en détail la situation du pays, que « l’Egypte est indéniablement à la veille d’un changement, dont on ne peut prédire exactement ce qu’il sera » (34). Il semblerait que même les organisateurs de la manifestation du 25 janvier, point de départ de la révolution en Egypte, aient été surpris par l’ampleur du mouvement. En Tunisie, c’est un événement critique non majeur en apparence, l’immolation d’un jeune marchand ambulant, qui a mis le feu aux poudres.
En vérité, comme l’a rappelé M. Henry Laurens, professeur au Collège de France, les événements qui se sont produits en 2011 constituent aussi une « révolte des objets d’analyse contre les auteurs » (35). Le monde arabe paraissait inerte et comme figé dans l’autoritarisme, au point que l’on en était venu à développer des modèles d’analyse pour expliquer, dans cette partie du monde, la résilience de ce que l’on a pu appeler le « modernisme autoritaire ». La fin de cette résignation que l’on croyait définitivement acquise est le principal élément de la surprise historique produite par les événements de 2011. Pour M. Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne, le processus relève en réalité de la volcanologie : « tout s’est passé à la manière d’une éruption volcanique. Pendant le temps interminable de la léthargie, la pression augmentait inexorablement et en silence dans la chambre magmatique. Puis ce fut l’explosion, qui a rendu visible à tous ce que seuls les fins vulcanologues voyaient sous le calme trompeur » (36).
b. Les facteurs de la cristallisation en 2011
i. La dégradation de la situation économique
Les économies de la zone, étant globalement moins intégrées que d’autres aux marchés financiers, ont d’abord fait preuve d’une certaine résilience à la crise économique qui s’est déclenchée en 2008 (37). La crise s’est toutefois transmise par divers canaux : la baisse des transferts de fonds des migrants, la réduction des exportations, en raison de la crise économique qui affecte notamment l’Europe, la chute des revenus tirés du tourisme, et l’augmentation du prix des produits de base.
On observe ainsi un décrochage très net du taux de croissance du PIB. Entre 2007 et 2010, il passe notamment de 6 à 3 % en Tunisie, de 8,2 à 2,3 % en Jordanie, de 7,1 à 5,1 % en Egypte, de 3,3 à 1,4 % aux Emirats arabes unis, de 8,3 à 4,5 % au Bahreïn et de 5,7 à 3,2 % en Syrie (38). En Libye, il passe aussi de 6 à 2,1 % entre 2007 et 2009.
Si les effets de la crise ont pu être atténués dans les pays exportateurs d’hydrocarbures, qui bénéficiaient d’importantes réserves de change, notamment grâce au subventionnement des biens de consommation de base, de créations d’emplois nombreuses et de diverses autres mesures budgétaires, les capacités plus limitées du reste des pays de la zone ne leur ont pas permis d’ « accompagner » ainsi la crise.
ii. L’entrée en scène d’une jeunesse révolutionnaire
La jeunesse est le fer de lance des révolutions en Tunisie, en Egypte et en Libye, étant porteuse d’une forte exigence démocratique et d’un rejet des cadres d’autorité, y compris au plan religieux, ce qui ne signifie pas qu’elle ait basculé dans l’athéisme, bien au contraire. Elle joue un rôle de précurseur, avant que les acteurs sociaux (39) et politiques, notamment islamistes, ne jettent eux aussi leurs forces dans la bataille. En Tunisie, les partis politiques mettent ainsi très longtemps avant d’appeler, à leur tour, au départ de Ben Ali, et l’on observe en Egypte un très net clivage générationnel, les jeunes Frères musulmans se joignant plus vite au mouvement que le reste de l’appareil.
Des acteurs issus de tous les milieux sociaux et de tous âges se joignent ensuite au mouvement, comme la place Tahrir l’a montré au monde entier. La jeunesse urbaine et éduquée est alors très vite dépassée, et elle ne parvient pas non plus à prendre en charge l’après-révolution, faute d’arriver à convertir sa légitimité révolutionnaire en force politique, par l’intermédiaire de partis la représentant ou incarnant son engagement. En Egypte, par exemple, les partis se réclamant de la révolution n’obtiendront que quelques pourcents des voix aux élections législatives, et c’est sous l’égide de l’armée que la première phase de transition est conduite.
iii. Le rôle des nouvelles technologies
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication – téléphones portables, Internet, réseaux sociaux –, déjà massivement utilisées au cours des « révolutions orange » des années 2000, ont joué un rôle déterminant en 2011. Leurs usages sont multiples. Elles ont permis de mobiliser contre le régime, notamment en Egypte où les appels à la manifestation du 25 janvier, qui inaugure le processus révolutionnaire, se font sur la Toile, grâce à des pages Facebook. Le président Moubarak ne s’y trompe d’ailleurs pas, puisqu’il décide de couper l’accès à l’Internet dans les jours qui suivent. L’administrateur du groupe « Nous sommes tous des Khaled Saïd » (40), qui est en pointe dans le déclenchement de la révolution égyptienne, Wael Ghonim, est quant à lui arrêté. L’armée égyptienne, en revanche, choisit d’investir la Toile en ouvrant un site Internet pour communiquer à son tour.
Mais les nouvelles technologies de l’information ne servent pas seulement de relais pour organiser la contestation ; elles permettent aussi de contourner, par leur mode de diffusion réticulaire, le monopole de l’information de l’Etat, aidant ainsi la mobilisation à changer d’échelle et à devenir nationale. Les vidéos amateurs tournées pendant les manifestations sont reprises sur les réseaux sociaux, puis par les grandes chaînes d’information internationales, qui ne disposent pas – ou peu – de correspondants sur place. Les événements – et la répression – sont ainsi largement médiatisés. Les images et les récits qui sont diffusés contribuent alors à renforcer le mouvement, la sphère médiatique servant de caisse de résonance à la contestation. D’une certaine manière, l’Internet s’est transformé en « agence de presse » des révolutions.
Il convient toutefois de ne pas surestimer le rôle des nouvelles technologies. Ce n’est pas l’Internet qui a fait la révolution, laquelle n’est pas virtuelle, sauf en Arabie saoudite où précisément elle ne se concrétise pas. L’idée, très vite apparue, qu’il s’agirait de « révolutions Facebook » ou « Twitter », méconnaît la dimension réelle de la mobilisation. Elle se fait au contact des forces de la répression et occasionne de nombreuses victimes – elles sont estimées à 300 en Tunisie, où la révolution passe pour avoir été la plus pacifique. Voir dans les événements de 2011 de simples « révolutions 2.0 » reviendrait à en faire une lecture déterministe et techniciste, confondant la mobilisation et l’un de ses instruments. « A-t-on jamais parlé de « révolution ronéo » ou d’« intifada des fax ? », se demande ainsi à juste titre Jean-François Legrain (41). Au demeurant, en Tunisie, les populations qui se sont révoltées en premier, dans les marges du pays, étaient loin d’être bien connectées à Internet.
De plus, les médias classiques, notamment la chaîne de télévision Al Jazira, jouent eux aussi un rôle essentiel de catalyseur dans la vague de contestation. L’Iran aurait d’ailleurs brouillé à titre préventif les émissions de cette chaîne. Les médias arabes, tels Al Jazira et Al Arabiya, avaient déjà brisé la chape de plomb que les régimes tentaient d’imposer, en faisant découvrir aux Tunisiens, avant la révolution, les opposants et les militants des droits de l’homme que le pouvoir voulait leur cacher.
Enfin, comme l’a rappelé M. Jean-Pierre Filiu (42), il convient de ne pas surestimer la figure du « blogueur révolutionnaire » : il y a probablement plus de contenu réactionnaire, islamiste, voire jihadiste, que progressiste sur la Toile. Pour M. Karim Emile Bitar, « les autoroutes de l’information » ne sont donc pas « des autoroutes de la liberté » (43).
iv. Un effet de souffle au plan régional
L’examen de la chronologie accrédite l’idée d’une « contagion » ou d’un « effet domino ». La révolution tunisienne se déroule ainsi entre décembre 2010 et janvier 2011, elle commence fin janvier en Egypte, pour s’y achever début février, et elle se déclenche dans la deuxième moitié du mois de février en Libye. On observe aussi de nombreux points communs : un même slogan, « Dégage », est scandé, et l’occupation de la place Tahrir, au Caire, est imitée ailleurs, place de la Perle à Manama, ou encore place du changement à Sanaa.
Toutefois, même s’il existe manifestement un effet d’entraînement au plan régional, le mouvement de 2011 a des ressorts nationaux et obéit une dynamique interne de confrontation avec le pouvoir. Comme l’a rappelé devant la mission d’information M. Beligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS, la chute des autorités dans un pays ne conduit pas mécaniquement à celle du régime voisin (44). M. Pascal Boniface (45), directeur de la même institution, a lui aussi insisté sur la différence fondamentale entre les révolutions arabes de 2011 et l’effondrement des régimes communistes d’Europe de l’Est en 1989 : dans le second cas, le pouvoir ne tenait que par la présence soviétique ; c’est une fois que s’est évanouie la menace d’utiliser cette force militaire, issue de l’extérieur, que les régimes se sont effondrés comme des châteaux de cartes ; dans le monde arabe, rien de similaire ne s’est produit en 2011.
En revanche, bien que le projet de « grande nation arabe » ne fasse manifestement plus guère rêver, et que la région demeure culturellement hétérogène et politiquement fragmentée, les événements de 2011 tendent à démontrer l’existence d’un véritable espace public arabe, où les informations, les images, les idées et les émotions collectives circulent à grande vitesse et avec force. C’est ainsi que la révolution tunisienne a probablement joué un rôle d’exemplarité en montrant que le dictateur pouvait être défié et poussé au départ, malgré la violence de la répression ; elle a, de la sorte, fait chuter le « mur de la peur » dans les pays voisins. Cette émulation ne s’est d’ailleurs pas limitée à la seule phase de déclenchement des révolutions. On a ainsi observé en Tunisie, au milieu de l’année 2013, une tentative d’imitation du mouvement « Tamarrod » né en Egypte et à l’origine de la chute du président islamiste Morsi.
B. UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ « DU GOLFE À L’OCÉAN »
Le « réveil arabe », dont les premiers signes se manifestent à la fin de l’année 2010 en Tunisie, prend des formes différentes et connaît un destin variable dans l’ensemble du monde arabe. Plusieurs interlocuteurs de la mission d’information ont insisté sur le fait que, malgré la dimension générale du mouvement, un cadre national et des temporalités distinctes prédominaient. Si l’ensemble de la région a été touché par ce que l’on peut considérer comme une véritable vague de fond, c’est avec une amplitude, un rythme et des conséquences distinctes.
L’étude au cas par cas qui va suivre permet de dégager un ensemble de facteurs dont la pondération, très différente selon les pays, permet d’expliquer les variations que l’on observe dans la zone :
– le contexte financier qui permet ici ou là d’acheter la paix sociale plus ou moins durablement, en augmentant le subventionnement des produits de base, ainsi que les salaires et les pensions ;
– la forme des institutions et leur ancrage historique et religieux (46), les monarchies paraissant moins frontalement contestées que les républiques constituées après l’indépendance ;
– des circonstances politiques spécifiques, qui peuvent porter l’attention sur d’autres enjeux, notamment au Liban, dans les Territoires palestiniens, en Irak et, dans une certaine mesure aussi, en Jordanie ;
– les données historiques, un passé traumatisant récent pouvant conduire à redouter par-dessus tout les risques de troubles violents et de déstabilisation du pays, comme c’est le cas en Algérie ;
– la capacité du pouvoir à désamorcer la crise au plan politique en accompagnant le changement sans remise en cause fondamentale, en particulier au Maroc où le Roi parvient à reprendre la main et à imposer son propre agenda ;
– le comportement du noyau dur de l’armée, tantôt capable de se détacher de la personne du chef d’Etat, comme en Egypte, tantôt prétorien et « idéologique », comme en Syrie ;
– la composition de la population – seuls le dictateur et son système de pouvoir sont en jeu là où elle est très homogène, notamment en Tunisie, tandis que les équilibres confessionnels ou tribaux du pays sont remis en cause en Syrie et en Libye ;
– le contexte régional, la Tunisie, la Libye et l’Egypte évoluant selon des dynamiques principalement internes, alors que la crise en Syrie fait intervenir différents acteurs régionaux ou internationaux, comme l’Iran, le Qatar, l’Arabie Saoudite et la Russie.
1. Des pays relativement à l’écart du mouvement
a. Pays du Golfe, Maroc, Jordanie : des monarchies préservées
A l’exception notable du Bahreïn, point chaud de la région avec le Yémen, qui est au demeurant une république, le Golfe reste globalement peu touché par les événements de 2011, sans être pour autant à l’écart du mouvement.
Les autorités saoudiennes ont traité avec une grande fermeté les manifestations du mois de février dans la Province orientale à majorité chiite, dans le contexte des événements du Bahreïn, puis l’agitation récurrente qui s’ensuit dans cette partie du Royaume. Quant aux tentatives de rassemblements pacifiques dans les grandes villes au début de cette année 2011, seule une personne se serait finalement présentée après l’appel à manifester à l’occasion d’une « journée de la colère » à Riyad, et elle aurait été arrêtée.
Dans le même temps, un train de mesures sociales de plus de 100 milliards de dollars a été décidé en février et mars de la même année. Au plan politique, des changements sont à l’œuvre, comme la possibilité pour les femmes d’être nommées au sein du Conseil consultatif, le Majlis al-Chourah, ou encore l’octroi du droit de vote et de candidature à ces dernières pour les élections municipales prévues en 2015, mais ces évolutions ne se font qu’au rythme voulu par les autorités et demeurent limitées. Reste à savoir si ce sont les oulémas qui font obstacle à une réelle volonté de réforme du roi Abdallah, ou au contraire s’il instrumentalise leur opposition pour se donner l’image d’un réformateur en l’absence de tout changement réel (47).
L’Arabie saoudite, bien qu’elle soit globalement restée à l’écart de l’effervescence régionale, reste toutefois exposée à plus d’un titre : par son évolution démographique – les deux tiers de la population ont moins de trente ans –, par les performances médiocres de son système éducatif au regard des attentes du marché du travail, ainsi que par l’ampleur du chômage – officiellement de 10 % de la population active, il touche en particulier les jeunes et pourrait atteindre en réalité un seuil de 30 % (48). La parole s’est par ailleurs libérée dans le pays, notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux (49). De nombreux signes témoignent d’une montée préoccupante des frustrations au sein de la jeunesse saoudienne.
A l’échelle du Golfe, le Royaume se positionne comme un pôle de stabilité, au cœur d’un Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui s’est mué en une sorte de « sainte alliance » conservatrice, dirigée contre des risques de déstabilisation avant tout perçus comme chiites et iraniens. C’est dans le cadre du CCG qu’ont ainsi lieu l’intervention du « bouclier de la Péninsule » à Bahreïn, l’annonce de plans de soutien de 20 milliards de dollars sur cinq ans pour Oman et le Yémen (50), qu’un des interlocuteurs de la mission d’information a éloquemment qualifié de « confiture saoudienne épaisse », et la transition politique dans ce dernier pays.
Aux Emirats arabes unis, les turbulences du début de l’année 2011 sont restées très limitées, prenant essentiellement la forme de deux pétitions qui demandent l’élection du Conseil national fédéral au suffrage universel. Les autorités y ont répondu par un mélange de répression contre des blogueurs, de concessions politiques limitées, telles que l’élargissement du collège électoral chargé de désigner la moitié de l’assemblée consultative, et de nouvelles mesures sociales, à quoi s’ajoutent des aides massives en faveur des émirats les moins développés de la fédération, au Nord.
Le Koweït, en proie, depuis 2006, à une crise politique à répétition, qui se traduit notamment par un affrontement entre l’exécutif et le pouvoir législatif, marqué par des dissolutions fréquentes du Parlement, est resté relativement à l’écart du mouvement général, probablement grâce à la vitalité de sa vie politique et parlementaire. Les tensions ont pu trouver d’autres exutoires que la rue et les réseaux sociaux pour s’exprimer, bien avant 2011, et les autorités ont adopté de généreuses mesures socio-économiques dans ce pays dont plus de 85 % des citoyens sont des fonctionnaires. L’agitation des « bidoun », résidents arabes non nationaux, qui seraient au nombre de 100 000 environ, se poursuit néanmoins.
En Oman, des manifestations ont commencé dès le mois de janvier dans les grandes villes du sultanat, avec des demandes modérées, essentiellement de nature socio-économique. Ce mouvement de contestation, dont l’ampleur est restée limitée et qui est demeuré relativement pacifique, malgré quelques morts dans la ville industrielle de Sohar, n’a pas réellement ébranlé l’autorité du sultan Qabous. Le pouvoir omanais est parvenu à réduire la pression, malgré la persistance d’une contestation limitée, par un remaniement du cabinet, par l’annonce de mesures sociales estimées à plusieurs milliards de dollars et enfin par le renforcement des pouvoirs du Conseil consultatif, sans aller toutefois jusqu’à l’établissement d’un exécutif politiquement responsable.
Contrairement à ses voisins du Golfe, le Qatar n’a pas traversé de véritables remous, la contestation se limitant à des publications sur les réseaux sociaux, soupçonnées d’être réalisées depuis l’étranger. Le contraste entre la situation politique interne de l’Emirat et son engagement en faveur des révolutions arabes hors de ses frontières, notamment en Tunisie, en Libye et en Syrie, peut s’expliquer par la très faible importance numérique de la population nationale, laquelle ne dépasserait pas 14 % des deux millions d’habitants du pays, et par les réformes déjà actées avant 2011, notamment l’élection d’un Conseil municipal central (51) et l’octroi d’une Constitution en 2003.
ii. Maroc : le choix de la réforme
Comme ses voisins libyens et tunisiens, le Maroc traverse une phase de mobilisation intense au début de l’année 2011. La plateforme militante du « Mouvement du 20 février » lance ainsi, par le biais des médias sociaux, un appel à manifester qui ne réunit que 50 000 personnes sur l’ensemble du territoire, mais qui est suivi dans de nombreuses villes. Comme ailleurs, les participants sont essentiellement des jeunes, mais ils bénéficient rapidement d’un soutien apporté par des partis de gauche ou encore par l’Association marocaine des droits de l’homme. Les manifestants réclament plus de démocratie, dénoncent la corruption et le clientélisme, sans appeler à la fin de la monarchie. Le roi tire en effet une légitimité particulière de son titre de « Commandeur des croyants », qui fait de lui la première autorité religieuse du pays et tend à le placer au-dessus de la mêlée politique et institutionnelle (52).
Mais surtout, le Palais reprend très vite la main grâce à un discours solennel prononcé par le roi dès le 9 mars. Trois semaines seulement après le déclenchement des manifestations, il annonce sa volonté de réviser la Constitution afin de rééquilibrer les pouvoirs en faveur du chef du Gouvernement, qui deviendrait alors le chef de l’exécutif. Bien que ce discours soit presque unanimement salué par la presse et par la classe politique, la mobilisation ne cesse pas immédiatement : 100 000 personnes se mobilisent ainsi le 20 mars pour « maintenir la pression ». Le mouvement du 20 février, qui refuse de participer aux consultations politiques et qui organise des manifestations chaque dimanche, voit sa base s’éroder progressivement. En revanche, les grèves et les manifestations catégorielles se multiplient dans différents secteurs, les troubles sociaux dégénérant parfois dans certaines villes de province, notamment à Khouribga, cité minière qui connaît des violences conduisant à la destruction de biens publics et faisant de nombreux blessés.
La nouvelle Constitution, élaborée par une commission consultative nommée par le roi et censée représenter la société marocaine, offre comme principal changement la désignation d’un chef du Gouvernement issu de la formation politique arrivée en tête lors des élections législatives. Mais ce rééquilibrage institutionnel ne marque pas un véritable passage à la monarchie constitutionnelle : dans les faits, le roi demeure le maître du jeu dans les domaines régaliens et conserve un pouvoir d’arbitrage, exercé avec l’aide de ses propres conseillers. Le nouveau chef du Gouvernement ira jusqu’à déclarer à la presse que le roi est son « chef ». Mais la Constitution comporte aussi d’autres avancées : une liste détaillée de droits et libertés – dont la liberté de conscience est absente, les forces islamistes s’y étant opposées ; le principe d’égalité entre les hommes et les femmes ; la lutte contre les discriminations ; la reconnaissance du berbère comme seconde langue officielle. Le référendum organisé le 1er juillet, quatre mois seulement après les premières manifestations, tourne au plébiscite : la nouvelle Constitution est adoptée avec 98 % des voix et un taux de participation de 2/3 du corps électoral.
L’ouverture politique se poursuit ensuite avec la tenue d’élections législatives anticipées, le 25 novembre 2011. Le parti islamiste Justice et Développement (PJD) étant arrivé en tête, avec 27 % des voix, son secrétaire général Abdelilah Benkirane est nommé au poste de chef du Gouvernement, à la tête d’une coalition ministérielle hétéroclite.
Le changement, conduit par le haut au Maroc, mais sous une pression populaire naissante, s’inscrit dans la continuité de la transition vers la démocratie qui avait été engagée par Hassan II à la fin des années 1990, lorsque la gauche marocaine avait accédé au pouvoir, à la faveur d’une alternance décidée par le Palais, tandis que le PJD était reconnu. L’une des grandes forces de ce changement mené tambour battant est que le Palais peut se targuer de n’avoir fait qu’une « offre », certes nouvelle, mais consentie librement, puisqu’inscrite dans le droit fil de l’ouverture engagée par Hassan II puis par Mohammed VI au début de son règne, notamment lorsqu’il avait mis en place l’Instance Equité et Réconciliation pour lever le voile sur la répression des « années de plomb ». Certains iront même jusqu’à évoquer une « révolution du roi et du peuple » au Maroc.
Dans le même temps, des mesures sont adoptées en urgence pour éviter l’incendie social qui couve : les autorités annoncent pêle-mêle l’embauche de 4 000 « chômeurs diplômés » dans la fonction publique, la généralisation du régime d’assistance médicale des démunis, une enveloppe complémentaire de 1,3 milliard d’euros pour la caisse de compensation qui subventionne les produits pétroliers, le gaz butane à usage domestique, la farine ou encore le sucre, ainsi que l’accélération du programme « Ville sans bidonville », destiné à lutter contre l’habitat insalubre et à créer des logements sociaux. Objectivement, la situation est en effet délicate : le Maroc a l’un des PIB les plus faibles de la région – 3 000 dollars par habitant ; les écarts de revenus se sont accrus ; le taux de pauvreté a certes reculé de 15 à 9 % dans les années 2000, mais 25 % de la population sont considérés comme pauvres ou vulnérables ; le taux de chômage officiel des jeunes s’élève à 18 % ; enfin, seuls 30 % de la population bénéficient d’une protection sociale.
Les mesures adoptées au plan constitutionnel, politique et social semblent avoir donné à la majorité de l’opinion le sentiment que ses aspirations ont été effectivement entendues. La contestation politique reste marginale et, malgré des difficultés persistantes, une reprise du mouvement de contestation sociale paraît peu probable à court terme. Reste à savoir si le Maroc est réellement parvenu à ouvrir une troisième voie durable, celle de la « révolution tranquille », évitant aussi bien l’immobilisme que la violence.
iii. La Jordanie : des tensions accrues, mais sans déstabilisation de la monarchie
Le mouvement de protestation a commencé dès la mi-janvier 2011, sous la forme de manifestations dénonçant la détérioration des conditions de vie, en particulier du fait de l’inflation, la corruption ainsi que l’affairisme qui s’est développé autour du Palais, et demandant aussi la démocratisation de la vie publique, notamment grâce à une meilleure représentativité de la chambre des députés et à un Gouvernement issu de la majorité parlementaire. Un tabou est par ailleurs tombé avec la banalisation de slogans visant la personne du roi et la monarchie, malgré des rappels à l’ordre réguliers visant des journalistes ou des manifestants.
Même si la contestation n’a pas pris de dimension massive en Jordanie – le pic de personnes manifestant de manière concomitante dans le pays ne dépassant pas quelques dizaines de milliers de personnes –, le mouvement ne s’est jamais réellement interrompu, malgré des phases de décrue, et il a gagné une partie des tribus transjordaniennes, principal soutien de la monarchie hachémite. Des manifestations se déroulent ainsi tous les vendredis dans le pays, avec une affluence variable. Les autorités jordaniennes, qui ont déjà connu d’autres défis, sont parvenues à ne pas se laisser déstabiliser, sans verser pour autant dans une répression massive, mais les concessions qui ont été réalisées sont probablement restées trop limitées pour enrayer la contestation.
La Constitution a ainsi été révisée en août 2011 pour renforcer les pouvoirs du Parlement et les droits fondamentaux, mais l’équilibre des pouvoirs n’a pas fondamentalement évolué, et surtout la loi électorale n’a toujours pas mis fin à la surreprésentation des populations d’origine transjordanienne par rapport à celles arrivées depuis 1948. Au plan politique, après avoir changé cinq fois de Premier ministre depuis 2011, le roi ne semble plus disposer de fusible, et les Frères musulmans ont boycotté les deux dernières élections législatives. Malgré les critiques, l’institution monarchique semble pourtant demeurer, pour une majorité de la population, une garantie essentielle de la stabilité du pays, traversé par de nombreuses divisions, notamment entre Transjordaniens et Jordaniens d’origine palestinienne, et très angoissé par la crise syrienne qui se déroule à ses portes.
Au plan socio-économique, le pouvoir jordanien a d’abord adopté des mesures d’urgence en 2011, en subventionnant des produits alimentaires de base, en augmentant les salaires et les pensions dans la fonction publique, et en gelant le prix de l’essence à la pompe, sans parvenir pour autant à acheter la paix sociale. Ces mesures pesant lourdement sur un budget contraint par d’importantes difficultés financières, les autorités ont dû se résoudre à réaliser des économies, suscitant alors de nouvelles levées de boucliers, notamment lors de la suppression des subventions aux hydrocarbures en novembre 2012.
b. Algérie : des troubles violents restés pour l’instant sans lendemain
L’augmentation des prix de l’huile et du sucre provoque en janvier 2011 de véritables émeutes, lesquelles s’accompagnent de scènes de pillage et d’immolations par le feu. Une coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD) appelle ensuite à organiser des manifestations tous les samedis. Cependant, en dépit de la situation économique et sociale, qui conduit à des jacqueries sporadiques, et malgré la désespérance d’une grande partie de la jeunesse, la contestation sociale ne prend pas une dimension de masse et ne dure pas.
Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer cette relative démobilisation de la société algérienne, malgré le profond malaise que connaît le pays (53). Outre le fait qu’il a pu compter sur l’efficacité de ses forces de sécurité et de renseignement, le pouvoir algérien a annoncé quelques réformes politiques, telles que l’abrogation de l’état d’urgence, lancé quelques rumeurs et ballons d’essai, et surtout adopté des mesures sociales, autorisées par la « cagnotte » des revenus gaziers et si généreuses que le niveau des dépenses publiques a été relevé de 25 % dans une loi de finances rectificative pour 2011. Enfin, les 100 000 morts et les quelque 10 000 ou 15 000 disparus de la longue guerre civile qui a suivi le « printemps algérien » de 1988 ont laissé un traumatisme profond dans le pays.
Paradoxalement, l’ampleur de la désespérance pourrait « immuniser » en partie le régime, la société étant bloquée au point que la jeunesse ne paraît plus faire de projets à l’intérieur du pays, mais plutôt à l’étranger, par la voie de l’émigration. Les dernières visites d’Etat de Présidents français en Algérie ont ainsi été marquées par ce slogan révélateur : « Des visas ! ». Enfin, si le Président et le Gouvernement ne sont pas visés par le même slogan « Dégage » qu’en Tunisie et en Libye, c’est probablement aussi parce que la population est bien consciente que la réalité du pouvoir n’est pas entre leurs mains.
c. Territoires palestiniens, Liban et Irak : des cas manifestement à part
Un autre groupe de pays, formé par les Territoires palestiniens, le Liban et l’Irak, demeure relativement peu touché par la vague de fond qui a gagné l’ensemble du monde arabe. Là aussi, des manifestations mêlant des revendications économiques, sociales et politiques se sont déroulées, mais plusieurs facteurs communs et atypiques dans la région ont limité leurs effets.
Tout d’abord, à la différence des pays voisins, les institutions ne reposent pas sur un principe d’autorité, mais sur ceux du pluralisme politique et de la démocratie – avec cependant des limites, notamment le blocage issu de la scission entre la Cisjordanie et Gaza en 2007, après les élections de 2006 qui avaient vu la victoire du Hamas, l’obstacle que posent le confessionnalisme et le clientélisme au Liban, ou encore la dérive autoritaire croissante en Irak et le sentiment de marginalisation éprouvé par de nombreux sunnites dans ce pays.
Ensuite, d’autres questions que l’ouverture du jeu politique tendent à occuper le devant de la scène (54). Pour les Palestiniens, l’aspiration à la paix, à la liberté et à la dignité s’exprime essentiellement dans le cadre des relations avec Israël. Les mobilisations sociales demeurent catégorielles – il s’agit par exemple de fonctionnaires qui s’insurgent contre le non-versement régulier de leurs salaires, et de mobilisations politiques qui restent segmentées, contre la construction du Mur ou dans les colonies (55). Au Liban, la scène politique demeure clivée entre pro-Syriens et « souverainistes », comme l’a montré la « révolution du Cèdre » de 2005, dirigée contre la domination syrienne. En Irak, la reconstruction économique et politique ne semblait pas avancer en 2011, malgré la perspective du retrait des troupes américaines à la fin de l’année, la situation sécuritaire restait aussi très dégradée, les attentats et les assassinats ciblés se multipliant, tandis que le rapport très centralisateur et autoritaire au pouvoir du Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, polarisait de plus en plus violemment la scène politique, avec une dimension interconfessionnelle croissante.
Des manifestations, d’ampleur limitée, se déroulent en 2011 dans les Territoires palestiniens, où un « Mouvement des jeunes du 15 mars » s’est constitué, mais cette effervescence porte la marque de circonstances particulières. Les revendications sont alors moins dirigées contre les autorités, dont les mains sont liées par l’occupation israélienne, que contre la division politique entre la Cisjordanie, dirigée par le Fatah, et Gaza, contrôlé par le Hamas, ou encore pour une réforme de l’OLP et l’élection directe du Conseil national palestinien. En revanche, la troisième « Intifada » contre Israël, que d’aucuns prédisaient dans le sillage des révolutions arabes, ne voit pas le jour. C’est devant l’Assemblée générale des Nations Unies que le président Abbas plaidera pour « un printemps palestinien » en septembre 2011. Quant à l’accord de réconciliation signé le 14 mai 2011 au Caire, il reste sans suites concrètes jusqu’à présent, bien qu’il ait été renouvelé et complété à plusieurs reprises. La situation demeure tendue, comme le montre la « colère sociale » qui se déclenche fin août 2012, avec des appels à la démission du premier ministre Salam Fayyad, à la suite d’une hausse des prix du gaz, du pétrole et des denrées alimentaires.
Le Liban connaît lui aussi des manifestations au début de l’année 2011. En l’absence de Gouvernement – de janvier à juin –, les revendications de nature politique ne visent pas tant les autorités que le système. Des manifestants demandent ainsi la fin du confessionnalisme, en vigueur depuis l’indépendance. Mais la principale conséquence au Liban de l’effervescence générale qui saisit le monde arabe est en réalité importée. Des affrontements interconfessionnels reprennent sporadiquement, notamment à Tripoli, la grande ville du Nord, sans toutefois se généraliser. Et en dépit de la politique de « distanciation » officiellement prônée par le Gouvernement et soutenue par tous les partis, le Hezbollah apporte un soutien de plus en plus massif et visible au régime de Damas, tandis que des sunnites aident l’opposition armée. Les clivages politiques se renforcent, chaque camp attendant l’issue du conflit syrien, qui paralyse le jeu. Faute d’accord sur la loi électorale, le Parlement libanais finit ainsi en mai 2013 par proroger son mandat de 17 mois.
En Irak, les appels à manifester contre le chômage, la corruption, le manque de services publics et l’inefficacité du gouvernement, accusé de ne pas avoir réalisé les réformes nécessaires malgré le potentiel économique considérable du pays, culminent le 25 février 2011 dans de nombreuses villes du pays, rassemblant des Irakiens de toutes confessions, ethnies et catégories sociales (56). Elles poussent le Premier ministre Nouri al-Maliki à donner cent jours à son gouvernement pour améliorer les services publics et lutter contre la corruption, puis à s’engager dans une intense campagne de communication à l’expiration de ce délai, les membres de son Gouvernement venant présenter et défendre publiquement leur bilan dans les médias. En décembre 2012, la contestation visant le Premier ministre prend un tour plus massif et plus confessionnel. L’arrestation des gardes du corps du ministre – sunnite – des finances, accusés d’actes de terrorisme, conduit à un mouvement de révolte durable dans les provinces sunnites du pays, où le mécontentement va croissant à l’égard d’un pouvoir accusé de les marginaliser et de faire le jeu de l’Iran.
a. Bahreïn : un soulèvement maté dans le sang et l’indifférence générale
Dans ce petit archipel traversé depuis longtemps par des clivages politiques et sociaux, qui suivent en grande partie une ligne de fracture entre la majorité chiite – 70 % des nationaux –, laquelle s’estime gravement marginalisée, et la minorité sunnite, une grave crise politique s’est durablement installée depuis le 14 février 2011, après une importante mobilisation qui aurait réuni jusqu’à 150 000 manifestants, place de la Perle, sur une population nationale de 600 000 personnes. Le 14 février était le jour anniversaire du référendum de 2001 sur une Charte d’action nationale qui avait conduit à une frustration d’autant plus grande que les espoirs initiaux, suscités par l’abrogation de la loi sur la sécurité de l’Etat et par la reconstitution d’un Parlement suspendu en 1975, avaient finalement été déçus.
Les autorités ont réagi à la contestation en demandant l’intervention de militaires saoudiens et de policiers émiriens, le 14 mars, et en rejetant la responsabilité des troubles sur l’Iran, accusé de manipuler les clivages confessionnels pour déstabiliser le pays. La commission d’enquête internationale sur les événements du début de l’année 2011 et sur leurs conséquences, mandatée par le roi et présidée par l’éminent juriste américano-égyptien Mahmoud Chérif Bassiouni, a par la suite récusé toute ingérence directe de l’Iran, mais confirmé un usage excessif de la force.
Le rapport Bassiouni recense 35 morts, essentiellement des civils, entre le 14 février et le 15 avril 2011, 2 300 arrestations sur le fondement de la déclaration de l’état d’urgence, en particulier des leaders des manifestations et des responsables politiques, de nombreuses perquisitions nocturnes et des traitements inhumains et dégradants manifestement destinés à faire régner la terreur, au moins 30 lieux de culte chiite détruits, environ 2 300 personnes licenciées dans le secteur public et près de 2 500 autres dans le secteur privé, pour avoir participé aux grèves ou pour les avoir soutenues, ainsi que 500 étudiants ayant fait l’objet de procédures disciplinaires.
Les recommandations du rapport ont été partiellement mises en œuvre au plan technique, notamment par une réforme de l’appareil sécuritaire, par l’abandon d’un certain nombre de poursuites, par la réintégration de personnes licenciées pour des raisons politiques, ou encore par l’installation d’un Ombudsman et d’une Haute autorité des médias, mais la réconciliation nationale prônée par la commission Bassiouni n’a pas réellement eu lieu. Les autorités continuent à user de la manière forte contre des activistes appartenant à l’opposition, et les clivages confessionnels, loin de s’être apaisés, se sont plutôt renforcés.
Le parti chiite Wifaq continue ainsi à boycotter le Parlement depuis deux ans, tandis que le « dialogue national » engagé en juillet 2011, puis réactivé au début de l’année 2013, n’est pas vraiment parvenu à avancer sur les questions de fond au moment où ces lignes sont écrites. Un clivage générationnel entre, d’une part, le Premier ministre, oncle du souverain et en poste depuis 1971, et d’autre part le roi Hamad et le prince héritier Salman, lesquels passent pour être favorables à davantage d’ouverture, semble compliquer encore la situation. L’opposition, comme d’ailleurs les forces soutenant le pouvoir, a en outre connu une radicalisation qui tend à la fragmenter.
b. Syrie : de la contestation au bain de sang
La parole se libère en Syrie au début de l’année 2011, dans le sillage des révolutions en Tunisie et en Egypte, sous la forme de pétitions et d’appels à manifester, mais ce bouillonnement intérieur reste contenu jusqu’à ce que la colère explose le 18 mars 2011, lorsque des manifestants, venus demander justice à Deraa après des actes de torture commis contre des jeunes gens auteurs de slogans appelant à la chute du régime, sont eux-mêmes violemment réprimés. La contestation prend ensuite de l’ampleur dans le pays : des dizaines de milliers de personnes se mobilisent pacifiquement à Damas, Deraa, Hama ou Homs pour demander des réformes.
Le régime fait alors le choix de recourir à la force en multipliant les arrestations, les actes de torture et les opérations militaires contre les populations civiles, et en n’engageant en parallèle que des réformes creuses, sans dialoguer avec l’opposition – il aurait fallu, pour cela, que le sang cesse de couler et que les prisonniers politiques soient libérés. Contrairement aux armées tunisienne et égyptienne, les forces de sécurité syriennes, appuyées par des milices (« chabbiha »), demeurent par ailleurs, dans leur grande majorité, fidèle au pouvoir.
Cette impasse s’accompagne d’une intensification dramatique des affrontements, dont le bilan était déjà supérieur à 100 000 morts au mois d’octobre 2013, à cinq millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et à deux millions de réfugiés dans les pays voisins. Au regard de l’évolution de la situation en Syrie, la Commission des affaires étrangères a décidé de créer un groupe de travail spécifique sur ce pays. La mission d’information a donc estimé qu’elle n’avait pas vocation à élargir davantage ses propres travaux à la Syrie, afin de pas empiéter sur ceux du groupe de travail.
3. La transition politique négociée, mais encore fragile, du Yémen
Le Yémen se distingue des autres pays du Golfe à plus d’un titre, ne serait-ce que par son appartenance au cercle des républiques arabes, contrairement aux monarchies ou émirats voisins, dirigés par des dynasties régnantes. De plus, bien que le Yémen dispose de ressources pétrolières, le très faible niveau de vie de sa population – dont le PIB par habitant ne dépasse pas 1 470 dollars en 2012 – le différencie très nettement des autres sociétés du Golfe. A cela s’ajoute une situation sécuritaire très dégradée du fait de la rébellion des Houthis au Nord du pays, d’une contestation irrédentiste au Sud, qui s’estime marginalisé, et de la menace posée par Al Qaïda, dont des éléments ont trouvé refuge au Yémen.
C’est dans ce contexte déjà très tendu qu’une crise politique de grande ampleur se noue en 2011, contrairement à ce que l’on observe dans les autres pays du Golfe arabo-persique, exception faite du Bahreïn. Le mécontentement prend forme publiquement à partir du mois de janvier à Sanaa et dans plusieurs autres villes du pays, à l’initiative d’étudiants et d’une partie de la société civile, bientôt rejoints par l’opposition parlementaire. Dès le mois de mars, après la répression violente de manifestations qui fait des dizaines de morts à Sanaa et Taëz, une escalade de la violence se produit et une partie de l’armée se rallie à la contestation, autour du général Ali Mohsen, commandant de la première division blindée et pourtant issu du premier cercle du pouvoir. L’épreuve de force s’accompagne de violents affrontements dans la capitale en mai et d’une tentative d’assassinat du président Ali Abdallah Saleh début juin.
Comme en Tunisie, en Egypte et en Libye, la crise de 2011 conduit à un changement au sommet de l’Etat au Yémen, le président Saleh, au pouvoir depuis 33 ans, finissant par accepter une solution négociée en novembre 2011, sous l’égide du Conseil de coopération du Golfe et sous la pression internationale, notamment celle de la résolution 2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu’il avait précédemment refusé à trois reprises de signer un plan de règlement de la crise. En échange d’une immunité juridique, il cède l’essentiel de ses prérogatives à son vice-président, Abderrabbo Mansour Hadi. Ce dernier est élu à la présidence de la République en février 2012, étant alors le seul candidat en lice. Une seconde phase du plan de transition a vu l’ouverture d’une conférence de « dialogue national », qui doit permettre d’élaborer une nouvelle Constitution, avant l’organisation de nouvelles élections prévues pour le mois de février 2014.
Malgré cette solution négociée, la transition yéménite demeure fragile. Les négociations piétinent dans le cadre du « dialogue national », l’ancien président Saleh n’a manifestement pas renoncé à jouer un rôle sur la scène politique nationale, et surtout, si une revendication populaire a été satisfaite avec le départ du Président, la situation n’a pas réellement changé pour la population, qu’il s’agisse de la structure tribale du pouvoir, des conditions socio-économiques ou de la situation sécuritaire. Par ailleurs, le pays reste encore loin d’un consensus national qui permettrait d’écarter les risques de fragmentation au Sud comme au Nord.
4. De véritables « révolutions arabes » en Tunisie, Egypte et Libye
Dans trois pays, la Tunisie, l’Egypte, puis la Libye, des soulèvements populaires ont fini par conduire à la chute des dictateurs. Malgré l’immobilisme ambiant, qui avait fini par faire croire au caractère immuable des régimes en place, ce n’est pas la première fois que des dirigeants arabes sont renversés dans ces mêmes pays, mais ils ne l’avaient encore jamais été sous la pression populaire. C’est en cela que l’année 2011 est marquée par une nouveauté radicale.
Toutefois, même si la révolution a été conduite par les masses populaires, coalisées dans un grand moment libérateur, l’issue de la crise est aussi redevable à d’autres acteurs – l’armée régulière qui fait comprendre en Egypte et en Tunisie (57) au dictateur qu’il est temps de partir, une fois que la situation est devenue incontrôlable ; une coalition internationale en Libye, dont l’intervention permet d’éviter l’écrasement du soulèvement par des unités demeurées loyales.
Il n’en reste pas moins vrai que l’armée ne se serait certainement pas impliquée dans la chute du régime en Tunisie et en Egypte, et qu’une coalition internationale n’aurait pas non plus été formée en Libye, sans un soulèvement populaire suffisamment puissant pour ébranler le pouvoir. De plus, les événements ne se résument pas au seul départ des dictateurs.
Tout d’abord, le renouvellement du personnel politique ne se limite pas aux seules figures les plus visibles : de nouveaux acteurs, jusque-là exclus du pouvoir, se trouvent désormais sur le devant de la scène, notamment les tenants de l’islam politique et les acteurs de la société civile. Au plan institutionnel, le choix a été fait d’engager un processus constituant à partir d’une page blanche. Bien que l’ampleur des changements demeure encore incertaine au plan économique et social, le terme de « révolution » ne semble donc pas usurpé.
La vague de contestation qui finit par emporter Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, commence le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, petite ville du centre du pays, après l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant de légumes dont la marchandise avait été confisquée par la police. La mobilisation qui s’en suit, réunissant des proches de la victime, des syndicalistes et des jeunes, tourne à la confrontation avec les forces de l’ordre, et elle est amplifiée par un second suicide, celui de Houcine Neji, un jeune chômeur qui se jette du haut d’un pylône électrique quelques jours plus tard.
Malgré la répression qui s’abat immédiatement, le mouvement prend de l’ampleur et s’étend géographiquement, d’abord au plan régional, avec l’appui des branches locales de l’UGGT (58) et de l’Ordre des avocats, puis dans tout le pays, cette fois avec le ralliement des instances nationales de la centrale syndicale. Jusqu’à son départ pour l’Arabie saoudite, le 14 janvier 2011, Ben Ali n’a consenti que des gestes limités et tardifs, à l’occasion de ses interventions télévisées successives, notamment la création de 300 000 emplois et la promesse de son départ à l’issue du mandat en cours.
Certains ont vu dans sa fuite une ruse – il aurait espéré revenir très vite, une fois le pays en proie au chaos –, d’autres le résultat d’une révolution de palais favorisée par l’armée, qui avait été marginalisée sous Ben Ali et qui a refusé de participer à la répression pendant les derniers jours du régime. C’est en tout cas dans le cadre des institutions et avec le concours d’une partie de l’élite dirigeante que le changement s’opère dans un premier temps. Conformément à la Constitution, c’est le président de l’Assemblée nationale, Fouad Mebazaa, qui est nommé président par intérim, et un gouvernement d’union nationale est formé.
Sous la pression de la rue – des « caravanes populaires » sont ainsi organisées depuis le centre de la Tunisie jusqu’à la place de la Kasbah à Tunis –, mais aussi sous celle qui est exercée par un Conseil national pour la protection de la révolution, rassemblant notamment des représentants de l’UGTT, de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, de partis de gauche et du parti islamiste Ennahda, le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi (59), finit par se séparer des ministres issus du RCD, l’ancien parti hégémonique, puis par démissionner lui-même. Il est alors remplacé par Beji Caïd Essebsi, ancien ministre de Bourguiba et ancien président de la Chambre des députés sous Ben Ali, puis la Constitution est suspendue.
Une première étape démocratique est ensuite franchie avec l’élection d’une Assemblée nationale constituante, le 23 octobre 2011. Ennahda, arrivée en tête avec environ 40 % des voix, le parti de gauche nationaliste Congrès pour la République (CPR) et Ettakatol s’associent alors pour former un gouvernement de coalition et se partager les plus hautes responsabilités : le secrétaire général d’Ennahda, Hamadi Jebali, devient le Premier ministre (60), Mustapha Ben Jaafar (Ettakatol) Président de l’Assemblée nationale constituante (ANC), et Moncef Marzouki (CPR) Président de la République.
En revanche, bien que le décret portant convocation des électeurs ait prévu un délai d’un an pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, celui-ci n’est finalement pas respecté, en partie parce que l’ANC ne se limite pas à son rôle de Constituante, se considérant comme une Assemblée parlementaire de plein exercice, habilitée à légiférer et à contrôler l’action du Gouvernement, ce qui lui prend beaucoup de temps, mais aussi en raison de divergences de fond sur des sujets essentiels, tels que la place de la charia et l’équilibre des institutions. Dans l’attente d’une nouvelle Constitution, le fonctionnement des institutions est réglé par une loi du 10 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, autrement appelée « petite Constitution ».
Le soulèvement contre le régime dirigé et incarné par Moubarak commence le 25 janvier 2011, 11 jours seulement après la fuite de Ben Ali, avec la réussite inattendue d’un appel à manifester le jour de la fête officielle de la police. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent alors au Caire, comme dans d’autres villes du pays. Trois jours plus tard, lors d’un « vendredi de la colère », ils sont probablement des centaines de milliers. Puis un nouveau changement d’échelle se produit le 1er février, avec l’appel couronné de succès à une « marche du million ».
Comme en Tunisie, le régime se désagrège à une vitesse stupéfiante pour les observateurs extérieurs comme pour les acteurs les plus impliqués dans le déroulement des événements. L’ampleur croissante des manifestations conduit en effet à un effondrement rapide de la police, dont de nombreux commissariats sont incendiés au Caire et dans les grandes villes.
Les Frères musulmans égyptiens, d’abord absents de ce processus révolutionnaire, probablement par crainte d’un nouveau tour de vis sécuritaire, finissent par rejoindre massivement le mouvement. Les salafistes demeurent beaucoup plus longtemps en retrait, dénonçant notamment un « complot sioniste » et appelant à obéir au pouvoir pour éviter la « fitna » (guerre civile) (61). Les principales autorités religieuses, Al-Azhar et le patriarcat copte, appellent également au calme – ce qui n’empêche pas des jeunes Coptes de participer.
Face au soulèvement, le régime tente de résister par tous les moyens : la répression, qui s’appuie d’abord sur la police, jusqu’à son effondrement, puis sur des partisans armés (les « baltagiyya ») qui s’attaquent aux manifestants pour faire régner la terreur ; la manipulation de l’opinion au moyen d’une intense campagne de presse, qui tend à discréditer le mouvement en le faisant passer pour un complot étranger ou islamiste ; mais aussi quelques concessions accordées du bout des lèvres par Moubarak lors de ses différentes interventions télévisées,et plusieurs tentatives de négociations rejetées par la rue.
Quant à l’armée, appelée à se déployer en remplacement de la police, le 29 janvier, elle déclare officiellement deux jours plus tard qu’elle considère les demandes populaires comme étant « légitimes », et finit par asséner le coup de grâce à Moubarak en lui retirant son soutien. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ce revirement : contrairement à d’autres armées de la région, intimement liées à la personne du chef de l’Etat ou au régime, l’armée égyptienne se conçoit et se présente elle-même comme le rempart ultime des intérêts et de la stabilité de l’Egypte, ce que la mission d’information a pu constater, en effet, en rencontrant deux généraux au Caire, l’un membre du Conseil suprême des forces armées (CSFA), l’autre en retraite et issu des services de renseignement ; elle se serait par ailleurs progressivement sentie écartée du pouvoir au profit de la police et des ploutocrates, et passait pour tenir en horreur la transition dynastique qui se profilait en faveur du fils du Président ; enfin, on peut penser que l’armée égyptienne a finalement décidé de sacrifier l’un des siens, le général Moubarak, pour préserver ses intérêts institutionnels et économiques considérables.
Dès le retrait de Moubarak, le 11 février 2011, c’est une instance militaire jusque-là peu connue et réputée ne s’être réunie que deux fois depuis sa création – lors des guerres de 1967 et de 1973 (62) –, le CSFA, qui prend les commandes, initialement en dehors de tout cadre légal, puis avec la légitimité conférée par le référendum tenu en mars 2011 sur des amendements constitutionnels. Le CSFA, composé d’une vingtaine de généraux et alors dirigé par le maréchal Tantaoui, suspend la Constitution, dissout le Parlement issu des élections très contestées de 2010, et s’arroge les pouvoirs exécutifs et législatifs.
Cette première phase de la transition s’achève le 30 juin 2012, lorsque le pouvoir revient à Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans tout juste élu à la présidence de la République. Un Parlement avait déjà été reconstitué quelques mois plus tôt, en janvier pour l’Assemblée du peuple et en février pour le Conseil de la choura (chambre haute). La prise en charge du pouvoir par des institutions civiles dominées par le parti Justice et Liberté, émanation politique de la Confrérie, se traduit très concrètement dès août 2012 par un rajeunissement spectaculaire de la composition du CSFA, et surtout par la mise à l’écart du maréchal Tantaoui, remplacé par le général Abdel Fattah Al-Sissi, à la suite d’une attaque terroriste spectaculaire dans le Sinaï, qui fragilise la position de l’armée.
La deuxième phase de la transition, réalisée sous la conduite des Frères musulmans, est interrompue le 3 juillet 2013, lorsque le président Morsi est déposé par l’armée à l’issue d’un nouveau cycle de manifestations massives, lancées par le mouvement « Tamarrod » (rébellion), à l’origine d’une campagne qui aurait réuni 22 millions de signatures pour le départ de Mohamed Morsi – soit plus que le nombre d’électeurs ayant voté en sa faveur au second tour de l’élection présidentielle, un an plus tôt. Les Frères musulmans avaient cristallisé les mécontentements par leur exercice très contesté du pouvoir et par leur incapacité à apporter des solutions aux problèmes concrets de la population, notamment au plan économique. Cette fois, ce sont des autorités intérimaires civiles qui sont mises en place pour engager ce qui est présenté comme une seconde transition. L’intérim de la Présidence de la République revient au Président de la Haute cour constitutionnelle, Adly Mansour, et un gouvernement provisoire, rassemblant pour l’essentiel des technocrates, est formé. Mais personne n’est dupe : ce sont les militaires qui tirent les ficelles.
Quatre jours après le départ de Moubarak, la vague initialement venue de Tunisie touche aussi la Libye, malgré quelques tentatives de Kadhafi pour désamorcer la protestation, notamment la suppression des taxes sur les produits alimentaires (63). L’impulsion vient en particulier de la Cyrénaïque, province marginalisée et privée d’investissement, étant perçue comme foncièrement rebelle, mais le mouvement gagne très vite l’essentiel des villes et des provinces. La brutalité de la répression, qui aurait fait entre 100 et 200 morts dès les trois premiers jours des manifestations (64), débouche sur des émeutes et des soulèvements locaux, avec l’aide d’une partie de l’armée régulière et des tribus ralliées au mouvement.
Victorieux à Benghazi et à Misratah, le soulèvement est en revanche écrasé dans la capitale. Kadhafi, qui a publiquement voué les insurgés à l’extermination, « ruelle après ruelle, demeure après demeure », lance début mars une vaste contre-offensive avec des unités d’élite restées loyales, afin de reprendre l’Est libyen. Devant la progression des forces loyalistes, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte, le 17 mars, la résolution 1973 qui autorise « toutes mesures nécessaires (…) pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque (…), tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit » (65). Benghazi est ainsi sauvée à la dernière minute par les airs, puis les frappes d’une coalition internationale permettent de renverser l’équilibre des forces au profit de la rébellion, qui reconquiert progressivement le terrain. Après avoir connu un deuxième soulèvement, fin août, la capitale finit par être libérée elle aussi, et les derniers bastions kadhafistes de Syrte et de Bani Walid, au Sud de Misratah, tombent à la fin du mois d’octobre.
Trois jours après la mort de Kadhafi, survenue le 20 octobre 2011, le Conseil national de transition (CNT) proclame la libération du pays. Un gouvernement de transition, essentiellement composé de techniciens et censé représenter l’ensemble du territoire, est nommé fin novembre, puis un Congrès général national (CGN) est élu le 7 juillet 2012. Le succès des élections, qui est fêté par la population, est d’autant plus remarquable que la grande majorité des électeurs n’avait aucune expérience en la matière, le dernier scrutin datant de 1964 en Libye.
Cependant, contrairement à ce que prévoyait la « feuille de route » adoptée par le CNT dès le mois d’août 2011, aucun projet de Constitution n’a encore été soumis à référendum au moment où ces lignes sont écrites – le travail de rédaction du texte n’a d’ailleurs pas commencé. Après de longs débats, il a finalement été décidé qu’un comité ad hoc de 60 membres serait élu au suffrage universel direct, et la loi relative à son élection n’a été adoptée que le 16 juillet 2013. Cette élection pourrait avoir lieu, au mieux, en décembre 2013, ou bien au début de l’année 2014.
II. TUNISIE, EGYPTE, LIBYE : QUEL BILAN PROVISOIRE ?
Le succès des mouvements révolutionnaires qui sont parvenus à abattre trois dictateurs jusque-là perçus comme inamovibles, Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, ne fait que décapiter les Etats, sans entraîner l’avènement immédiat de sociétés et d’Etats démocratiques et perçus comme plus justes. D’où la nécessité d’engager ensuite des « transitions », qui ont fait l’objet de toute une littérature scientifique – la « transitologie » –, afin de poursuivre et de parachever ce moment révolutionnaire initial.
L’expérience des deux années et demie qui se sont écoulées depuis le départ de Ben Ali et de Moubarak, comme celle des deux ans qui ont suivi la chute de Kadhafi, ont montré qu’il s’agissait de transitions longues, complexes, très évolutives et parfois sinueuses, parsemées de risques et de crises brûlantes. Cette partie du rapport a donc pour objet de présenter la situation actuelle en Tunisie, en Egypte et en Libye dans le domaine des institutions, en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, ainsi qu’au plan économique et social.
Afin de dresser ce bilan provisoire des « révolutions arabes » dans les trois pays où elles ont permis de renverser l’ordre ancien, il paraît utile de commencer par un état des forces dont la libération est l’un des principaux acquis des révolutions de 2011, et dont l’interaction « produit » les transitions en cours, puis d’établir un panorama des avancées et des défis à relever.
A. DES ACTEURS, DES ACQUIS ET DES DÉFIS EN COMMUN
Ce sont pour l’essentiel des masses populaires coalisées, par-delà les barrières sociales et les clivages politiques, dans un grand moment d’unité nationale, qui sont à l’origine du renversement de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi en 2011. Une fois qu’il s’est révélé à lui-même, ce « peuple-acteur » peut se remobiliser, comme ce fut le cas en Tunisie contre le premier Gouvernement de transition, en février 2011, mais aussi en Egypte fin-juin et début-juillet 2013 contre les autorités dominées par les Frères musulmans. De plus, certains acteurs continuent à se revendiquer de lui, notamment les Ligues de protection de la révolution en Tunisie, qui apparaissent pourtant de plus en plus comme des milices moins « populaires » et spontanées que manipulées par des forces conservatrices. Mais ce sont principalement les nouvelles forces politiques qui ont émergé au lendemain des révolutions de 2011, ainsi que les acteurs d’une société civile désormais en plein essor, qui participent au « moment d’institutionnalisation du changement » qui succède au « moment révolutionnaire » (66).
a. Un islam politique puissant
– Le premier constat est que la recomposition de la scène politique, longtemps dominée par un parti hégémonique et des formations de second rang cooptées, se traduit d’abord par la montée en puissance d’acteurs à référentiel islamiste, jusque-là réprimés et/ ou partiellement tolérés, à condition de limiter leurs ambitions, comme c’était le cas en Egypte sous Moubarak.
De l’avis unanime des interlocuteurs rencontrés par la mission d’information, si le déclenchement des révolutions était difficilement prévisible, les forces politiques se réclamant de l’islam semblaient en revanche vouées à accéder au pouvoir dès lors que la parole était donnée au peuple, à l’occasion d’élections relativement libres et non faussées.
Il s’est dégagé des auditions un large consensus sur les raisons de ce succès enregistré au lendemain des révolutions de 2011. Tout d’abord, les Frères musulmans ont pu compter sur leur image historique d’opposants et de victimes des régimes autoritaires, malgré certains accommodements. Sous Moubarak, les Frères musulmans n’étaient pas autorisés, mais tout de même tolérés tacitement, et ils pouvaient présenter des candidats « indépendants » aux élections. En Libye, une campagne de « réconciliation » avait été engagée par Seif al-Islam Kadhafi à partir de 2005. Les émanations politiques locales de la Confrérie étaient par ailleurs les seules forces bien structurées, dotées de cadres disciplinés et présentes sur l’ensemble du territoire, y compris en Tunisie, malgré l’« éradication » complète décidée par Ben Ali. A ces raisons s’ajoutent les ressources financières importantes des Confréries, qui rassemblent notamment de nombreux hommes d’affaires et bénéficient vraisemblablement de dollars venus en abondance du Golfe.
Un autre facteur déterminant, à plus long terme, est sans doute la « résurgence islamique » que l’on a observée au cours des dernières décennies, sous différents aspects – une piété individuelle en hausse, un intérêt croissant pour l’islam, y compris au sein des élites, une visibilité publique qui s’affirme par la barbe chez l’homme et la tête couverte pour la femme (67). On peut aussi penser que la communication généralement soignée et volontairement apaisante des Frères musulmans a permis de ne pas braquer une partie de leur électorat potentiel, au prix cependant d’un « double discours » sur lequel il faudra revenir.
Ce constat de succès mérite cependant d’être nuancé. L’Egypte a effectivement connu un véritable raz-de-marée islamiste lors des élections législatives de janvier 2012, qui ont vu le parti Justice et Liberté (PLJ), bras politique des Frères musulmans, remporter plus de 43 % des sièges, et les salafistes environ 25 %. En Tunisie, l’émanation politique des Frères musulmans, Ennahda, est également arrivée très largement en tête aux élections législatives, avec 40 % des voix et des sièges, mais sans obtenir la majorité absolue. Quant au Parti Justice et Construction libyen, vitrine politique locale de la Confrérie, il n’a en revanche obtenu que 17 sièges sur les 80 à pourvoir au scrutin de liste, contre 39 pour la coalition « libérale », l’Alliance des Forces Nationales de Mahmoud Jibril. Ce score doit cependant être relativisé : l’alignement des 120 membres « indépendants », élus au scrutin uninominal sur leur propre nom, est assez variable au sein du Congrès Général National (68). Plusieurs interlocuteurs que la mission a rencontrés à Tripoli ont estimé qu’un grand nombre de parlementaires « indépendants » penchaient souvent du côté des Frères musulmans.
Il reste à savoir si les scores enregistrés par la mouvance islamiste sont appelés à se maintenir durablement au même niveau là où ils sont particulièrement élevés. En Egypte, on observait déjà une décrue des islamistes à l’élection présidentielle de juin 2012 : leur score cumulé n’était plus que d’environ 40 % au premier tour, et le candidat des Frères musulmans, Mohamed Morsi, ne l’a finalement emporté qu’avec 51,7 % des voix, face à un ancien général, qui plus est dernier Premier ministre de Moubarak. Depuis, la popularité des Frères musulmans s’est certainement érodée du fait de leur mauvais bilan au plan socio-économique, mais la répression très musclée organisée par l’armée après le renversement du président Morsi, en juillet 2013, pourrait contrebalancer à terme cette désaffection probable, en contribuant à redorer leur image d’opposants et de victimes historiques, au grand dam de ceux qui pouvaient souhaiter les voir chuter « naturellement », à l’issue d’un scrutin, après s’être épuisés au pouvoir. En Tunisie, des sondages – mais sont-ils fiables ? – réalisés en mai donnaient en tête le parti de Beji Caïd Essebsi, Nida Tounes, qui incarne manifestement un certain désir de retour de l’ordre. Et l’assassinat d’une seconde figure de l’opposition, Mohamed Brahmi, en juillet, après celui de Chokri Belaïd, au mois de février, n’a fait que cristalliser la colère d’une partie de la population contre les autorités tunisiennes, dominées par Ennahda.
– Le deuxième constat que l’on peut dresser est celui des divisions de la mouvance islamiste.
En Egypte, elle est formée d’une constellation d’une quinzaine de partis, assez hétéroclites et minoritaires, exception faite du PLJ et des salafistes. Se situant à gauche des Frères musulmans, le Courant égyptien, créé par de jeunes Frères dissidents, marqués par la révolution de janvier 2011, a par exemple remporté 8 sièges aux élections législatives ; au centre, comme son nom l’indique, Al Wassat, qui est perçu comme un parti islamiste modéré, n’a obtenu que 3 sièges en 2012. Ce sont les salafistes qui se sont imposés comme la seconde force politique à référentiel islamiste en Egypte. Le parti Al Nour, bras politique de la « da’wa salafiya », qui est l’institution religieuse « mère », a obtenu 22 % des voix aux élections législatives de 2012, score auquel il faut ajouter les 2,6 % obtenus par deux micro-partis salafistes. Un autre parti de la même tendance, Al Watan, est ensuite né en janvier 2013 d’une scission d’Al Nour. Si le choix des Frères musulmans de s’inscrire dans le jeu politique est ancien, celui d’une partie de la mouvance salafiste est en revanche une petite révolution. En Tunisie, une dizaine de partis islamistes se sont eux aussi présentés aux élections en 2011, mais aucun n’a rencontré de véritable écho politique, hormis Ennahda. Les salafistes, quant à eux, avaient appelé au boycott du scrutin ; depuis, plusieurs partis salafistes ont en revanche été formés et autorisés. En Libye, qui n’avait pas la même tradition d’islam politique que l’Egypte avant la révolution de 2011, même si les islamistes étaient là de manière sous-terraine, les salafistes se font aujourd’hui de plus en plus présents sur le terrain social, et les groupes radicaux prennent de l’importance, en particulier à l’Est du pays.
Schématiquement, les salafistes se divisent désormais en trois catégories : les salafistes « scientifiques » quiétistes, tournés vers la prédication, prônant un changement de mentalités dans la société et ne s’engageant pas dans le champ politique ; les salafistes « politiques », participant désormais au jeu démocratique ; et enfin, les salafistes jihadistes, partisans de la violence pour imposer leurs valeurs.
S’il semble exister une division réelle au sein de la nébuleuse islamiste, c’est que les diverses émanations des Frères musulmans et des salafistes ne sont pas nécessairement engagées dans une relation de complémentarité, malgré leur convergence idéologique de fond autour de valeurs morales conservatrices d’inspiration religieuse. C’est même l’un des principaux enseignements des deux années et demie qui viennent de s’écouler depuis l’effondrement des régimes autoritaires.
En Egypte, alors que les salafistes avaient soutenu les Frères musulmans lorsque le président Morsi s’était arrogé les pleins pouvoirs, en novembre 2012, puis au moment de la rédaction de la Constitution, immédiatement après, Al Nour a renversé ses alliances début 2013 en se joignant aux critiques d’une opposition non islamiste réunie au sein du Front de Salut National, avant de soutenir officiellement la « feuille de route » présentée postérieurement à la destitution du président Morsi. Si l’on raisonne en termes de tactique, ce positionnement pourrait permettre à Al Nour de devenir la principale force politique islamiste lors des prochaines élections, si les Frères musulmans n’y participaient pas ou, dans l’hypothèse contraire, si la dégradation de leur image au cours de l’année écoulée se traduisait par un recul électoral très net.
En Tunisie, Ennahda se trouve dans une position quelque peu différente, puisque les salafistes « politiques » restent marginaux. Même s’il est souvent difficile de se faire une idée précise de la vie intérieure des mouvements islamistes, il est probable qu’Ennahda soit traversée par deux courants, l’un plutôt réformateur, et l’autre plus fondamentaliste et proche des salafistes. L’essor d’un salafisme bruyant et parfois violent a cependant vu le jour sur la scène tunisienne, avec notamment des actions spectaculaires contre des manifestations culturelles jugées « impies », des destructions de mausolées, ou encore l’attaque de l’ambassade américaine en septembre 2012. Ennadha, pour sa part, a d’abord été accusée d’adopter une position laxiste, voire complaisante, à l’égard de ces violences. Dans une vidéo qui a fait scandale, son chef, Rached Ghannouchi, avait conseillé la patience aux jeunes salafistes, envers lesquels il semblait témoigner d’une certaine compréhension. Après les graves événements qui se sont produits dans le djebel Chaambi et l’assassinat de Mohamed Brahmi, le gouvernement conduit par Ennahda s’est toutefois décidé à adopter une position plus offensive, d’abord en interdisant le rassemblement annuel d’Ansar Al-Charia, puis en accusant ce groupe salafiste d’être impliqué dans des actes de terrorisme.
– Le troisième constat est l’existence d’un débat persistant sur l’acceptation des règles du jeu démocratique par les forces politiques islamistes.
Leurs opposants les plus virulents les accusent, d’une part, d’entretenir un « agenda caché » qui consisterait à vouloir islamiser l’ensemble de la société une fois le pouvoir conquis, malgré des discours publics volontairement apaisants, et d’autre part à ne vouloir accéder aux responsabilités que pour y rester ensuite par tous les moyens – c’est-à-dire de n’accepter du jeu électoral que la possibilité d’accéder au pouvoir, et non celle de l’alternance démocratique. D’autres s’appuient au contraire sur la participation des acteurs islamistes au jeu politique pour défendre l’idée d’une « normalisation » (69) de leur comportement et de leur idéologie, qui insiste désormais sur les thèmes de la liberté, de la justice, du développement de la démocratie et de l’Etat civil, entendu comme un Etat ni théocratique ni militaire, mais aussi sur ceux des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et du management. Il existerait désormais au sein de cette mouvance une tendance émergente, pour laquelle « la norme religieuse ne définit pas une politique » (70), mais constitue une source plus lointaine d’inspiration pour l’action. On passerait ainsi du régime de la norme à celui de la valeur.
Ce débat est notamment alimenté par ce qui peut être perçu comme un « double langage » chez un certain nombre d’acteurs politiques islamistes. Le discours public, qui est en particulier celui des programmes politiques, est généralement parsemé de professions de foi en faveur de la démocratie et d’engagements solennels à respecter tant les libertés publiques que les droits des femmes (71), comme la mission d’information a pu le constater au Caire chez des représentants des Frères musulmans et de partis salafistes, comme à Tunis chez des dirigeants d’Ennahda. Mais on entend aussi, parfois, des références au califat – ce fut notamment le cas en 2011 dans la bouche de Hamadi Jebali, qui n’était pas encore Premier ministre, mais secrétaire général d’Ennahda –, des dénonciations du sionisme, ou encore des appels à lutter contre le blasphème, ce qui est évocateur d’un univers conceptuel bien différent.
Il reste à savoir comment interpréter le décalage entre ces différents types de discours. Leurs auteurs avancent-ils masqués, dissimulant leurs intentions véritables ? Faut-il plutôt y voir la conséquence d’un clivage entre la tête des partis, qui ferait attention à sa communication, et une base plus virulente ? Ou bien entre deux courants différents, l’un modéré (72) et l’autre plus radical ? Ou alors, les positions n’évoluent-elles pas au gré d’une confrontation avec les exigences démocratiques et, pour tout dire, avec le réel, dans un sens plus pragmatique ? Ces interrogations ne pourront être résolues qu’en observant le comportement dans la durée des forces politiques concernées. Organiseront-elles les conditions de possibilité d’une alternance démocratique ? L’accepteront-elles ? Le renversement du président Morsi en dehors d’un processus électoral normal n’a pas permis de répondre à cette question pour les Frères musulmans égyptiens, et l’attention se tourne donc maintenant vers la Tunisie. Seul l’avenir permettra de dire avec certitude si les acteurs de l’islam politique ont connu, connaissent ou sont susceptibles de connaître une évolution semblable à celle qui a conduit à l’apparition de la démocratie chrétienne.
b. Des forces politiques « non islamistes » divisées
La disparition de la chape de plomb imposée jusqu’au succès des révolutions de 2011 ne s’est pas seulement traduite par l’émergence d’un islam politique puissant. Elle s’est aussi accompagnée de la naissance de centaines d’autres formations politiques, qui sont très fragmentées.
Cette fragmentation résulte d’une grande diversité au plan idéologique. En Egypte, par exemple, quoi de commun entre le Courant populaire, de tendance nassérienne, de Hamdine Sabbahi, le parti libéral Al-Dostour de Mohamed El-Baradeï, le parti du Congrès fondé par Amr Moussa, ancien ministre des affaires étrangères de Moubarak, ou encore le néo-Wafd, héritier du parti, fondé en 1924, qui avait mobilisé les Egyptiens contre l’occupant britannique ?
Le paysage est également morcelé en Libye, mais selon des lignes moins marquées qu’en Tunisie ou en Egypte, même s’il existe une bipolarisation. Lors des élections de juillet 2012, la plupart des programmes suivaient ainsi une sorte de consensus mou, alliant une approche modérée de l’islam et sa reconnaissance dans la Constitution, la décentralisation, mais sans remise en cause de l’unité nationale, ou encore une libéralisation économique n’allant pas jusqu’au démantèlement des services sociaux. Ensuite, peu de mouvements vraiment nationaux ont vu le jour, seule une poignée d’entités politiques présentant des listes dans au moins la moitié des circonscriptions. Enfin, le découpage électoral a été conçu pour permettre une représentation des différentes composantes géographiques et tribales du pays, plutôt qu’une expression politique.
En Egypte et en Tunisie, des tentatives de rassemblement ont vu le jour, en dépit des divergences qui se sont traduites en Egypte par l’incapacité à présenter un candidat de rassemblement à l’élection présidentielle. C’est dans ce pays qu’un premier Front de Salut National (FSN) s’est constitué, après l’adoption d’une déclaration constitutionnelle très controversée du président Mohamed Morsi. Avant sa destitution, le FSN défendait un certain nombre de revendications communes, notamment la révision de la Constitution tout aussi controversée de décembre 2012, la formation d’un gouvernement de coalition nationale, et le remplacement d’un Procureur général contesté lui aussi. De même en Tunisie, après l’assassinat de Mohamed Brahmi, en juillet 2013, un autre Front de Salut National a vu le jour pour rassembler une trentaine de partis, dont le Front Populaire et Nida Tounes, mais aussi des associations et des coordinations de la société civile, tous unis autour de revendications telles que le retrait d’Ennahda du Gouvernement et la dissolution de l’Assemblée nationale constituante.
La présence en force des acteurs islamistes sur la scène politique et leur mode d’exercice du pouvoir depuis leur élection ont en effet conduit à une bipolarisation et à des tensions croissantes en Egypte comme en Tunisie. D’où le positionnement politique d’une grande partie des autres acteurs comme « non islamistes ». Le terme peut sembler très générique, mais il paraît préférable, en français, à celui de « laïque », non seulement parce qu’il est souvent et abusivement assimilé à l’athéisme, qui fait l’objet d’un profond rejet dans les pays concernés, mais aussi parce qu’un grand nombre de laïques étaient compromis dans la répression anti-islamiste des dictatures ; il paraît également préférable à celui de « libéral », trop équivoque au regard des divergences entre ces différents acteurs au plan économique.
Par ailleurs, il décrit bien l’hétérogénéité persistante d’un mouvement qui se définit avant tout par son hostilité aux forces islamistes. En Egypte, le Front de Salut National s’est ainsi formé sans entente sur un programme commun, ni sur des actions conjointes, hormis une abstention probable aux élections législatives qui se dessinaient alors. Ses principales figures de proue, Amr Moussa, Hamdine Sabbahi et Mohamed El-Baradeï, se livraient par ailleurs à une intense guerre des chefs. En Tunisie, malgré la création d’un Front de Salut National, là aussi, les principaux partis de l’opposition se partagent entre deux grandes coalitions, elles-mêmes assez composites : d’une part, « l’Union pour la Tunisie », qui rassemble notamment la formation bourguibienne Nida Tounes, le Parti Républicain et El Massar, héritier de l’ancien parti communiste tunisien ; d’autre part, le Front populaire, qui rassemble onze partis tournés vers un électorat radicalement contestataire.
En Libye, en revanche, aucun véritable bloc politique n’a vu le jour, du fait de la faible politisation du Congrès, dont les membres manquent souvent d’expérience politique. Il demeure très fragmenté, avec des alliances changeantes suivant les sujets. Quant au Premier ministre Ali Zeidan, il est parvenu à former un gouvernement d’union nationale, composé de technocrates, pour la plupart issus de l’administration.
– Les organisations de la société civile, qui étaient étouffées avant les révolutions de 2011, à moins d’accepter leur « domestication » par le pouvoir, connaissent elles aussi un essor considérable.
C’est en Tunisie que cette société civile est manifestement la plus vigoureuse. Les ONG historiques dites « de plaidoyer » (73), telles que la Ligue tunisienne des droits de l’homme et l’Association tunisienne des femmes démocrates, peuvent aujourd’hui déployer leurs activités librement ; dans le même temps, on assiste à l’éclosion de nombreuses autres associations, de tous types et notamment actives au plan local. Une société civile à tendance islamiste se développe aussi, en particulier au plan caritatif, le clivage entre islamistes et « non islamistes » parcourant aussi le milieu associatif.
La société civile tend également à se développer en Libye, malgré des difficultés dont ont témoigné plusieurs représentantes d’associations qu’une délégation de la mission d’information a eu l’occasion de rencontrer lors d’un déplacement à Tripoli. Elles ont dit souffrir d’un manque d’expérience très handicapant, ainsi que de problèmes de sécurité et de liberté de mouvement – en tant que femmes.
En Egypte, lorsqu’une délégation de la mission d’information s’est rendue au Caire et à Alexandrie, au mois de février 2013, c’était plutôt sur le cadre juridique des ONG que l’attention a été appelée. Une loi de 2002, toujours en vigueur, place en effet les associations sous le contrôle de l’Etat, par l’intermédiaire d’un agrément préalable pour toute activité et d’une autorisation, elle aussi préalable, de tout financement étranger – les ONG aux activités « sensibles » n’étant alors que tacitement autorisées et donc particulièrement en situation de vulnérabilité.
– Bien que les organisations de la société civile n’aient pas joué un rôle déterminant dans la conduite des révolutions de 2011, pas plus d’ailleurs que les partis politiques existants, exception faite de la Tunisie où les branches locales de l’UGTT et de l’Ordre des avocats ont accompagné l’essor du mouvement sur l’ensemble du territoire, de nombreux acteurs de la société civile entendent peser sur les transitions en cours.
Leur action peut consister à porter des revendications, à sensibiliser l’opinion, bref à « travailler la société », mais elle peut aussi aller jusqu’à s’impliquer très directement et très activement sur la scène politique. En Tunisie, par exemple, l’UGTT, qui est la force majeure oeuvrant pour le progrès et la stabilité dans le pays, l’organisation patronale UTICA, l’Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l’homme se sont engagés dans le bras de fer entre le Gouvernement et l’opposition qui a suivi l’assassinat de Mohamed Brahmi, en proposant leur médiation. L’influence de la société civile ne se limite pas, naturellement, aux acteurs sans référence islamique. En Egypte, le grand imam d’Al-Azhar, institution sunnite de référence, défend ainsi une vision modérée de l’islam et a engagé un dialogue avec les principales Eglises du pays, dans le cadre de la « Maison de la famille égyptienne ».
Par leur vigueur, certains acteurs de la société civile, notamment les associations de défense des droits de l’homme et des femmes, ou encore les organisations syndicales, peuvent constituer de puissants « anticorps » contre les risques de détournement des révolutions par un acteur dominant. En Egypte, le mouvement « Tamarrod », qui a conduit à l’éviction du président Morsi, a ainsi été lancé par des acteurs de la société civile, notamment le Mouvement du 6 avril et « Kefaya » (74), avant d’être rejoint, dans un second temps, par le Front de Salut National. Il faudra maintenant être attentif à la manière dont la situation évolue en Egypte sous la férule de l’armée. Mais c’est surtout au sein de la société tunisienne que ces « anticorps » paraissent particulièrement forts : conjugués à l’action des forces politiques « non islamistes », ils ont obtenu un recul d’Ennahda sur certains points, notamment la place de la charia dans la Constitution et la « complémentarité » entre les hommes et les femmes, qui sont pourtant des marqueurs idéologiques très forts pour les islamistes.
2. L’épreuve de la transition démocratique
Avant même de parvenir à « dégager » Ben Ali, Moubarak et Kadhafi, réalisant ainsi le vœu le plus immédiat des foules qui s’étaient rassemblées contre eux, les révolutions de 2011 se sont d’abord caractérisées par l’effondrement du « mur de la peur » que le pouvoir s’était efforcé d’ériger pour se protéger de sa propre population.
La libération de la parole en est la première et la plus éclatante des traductions, dans ces sociétés longtemps bâillonnées. Elle prend les formes les plus diverses – dans les manifestations de rue, la presse écrite, les réseaux sociaux ou encore le rap –, avec une insolence parfois extrême, dont les chefs d’Etat, hier intouchables, peuvent faire les frais. Des sujets jusque-là difficiles, tels que la place de la charia ou celle des militaires dans la vie politique et l’économie de l’Egypte, font désormais l’objet de débats publics, parfois virulents, les non-dits refaisant surface.
Ce vent de liberté sans précédent se manifeste aussi par une libération de l’espace public, précédemment occupé par la célébration du pouvoir et par le culte du Président ou du « Guide », dont les moindres faits et gestes à portée politique étaient relatés par les médias, pour masquer le vide ou détourner l’attention, selon les périodes. L’organisation d’élections libres, pour la première fois, et l’éclosion de centaines de partis politiques participent à l’essor d’un véritable pluralisme démocratique, avant cela étouffé par différentes tactiques – répression pure et dure, cooptation de certains partis, ou bien constitution de formations politiques artificielles, afin de procurer l’illusion d’une relative marge démocratique. Le développement d’une société civile vivante et diverse, aussi bien « progressiste » qu’islamiste, qui a déjà été abordé dans ce rapport, contribue aussi au renouveau.
Il n’en reste pas moins des « lignes rouges » manifestement dangereuses à franchir, notamment l’atteinte au sacré. En Tunisie, des salafistes ont ainsi multiplié les attaques, en particulier contre une exposition jugée impie à la Marsa, en juin 2012, dans le cadre du « Printemps des arts », et la jeune « Femen » Amina Sboui a fait l’objet de poursuites pour avoir tagué le muret d’un cimetière musulman. Quant à la chaîne Nessma TV, ses locaux ont été pris d’assaut après la diffusion du film « Persépolis », qui montre Dieu sous les traits d’un vieil homme, ce qui paraît suffisamment inadmissible à certains pour justifier des violences contre les biens. En Tunisie encore, le rappeur Weld El 15 a été condamné pour sa chanson « Boulicia Kleb » (« Les policiers sont des chiens »), tandis qu’un jeune blogueur, Jabeur Mejri, l’était pour avoir publié des caricatures du Prophète – la peine prononcée étant alors de 7 ans et demi de prison. De même en Egypte, lorsque les Frères musulmans étaient encore au pouvoir, le présentateur d’une célèbre émission de télévision satirique, Bassem Youssef, a fait l’objet de poursuites pour insulte à l’islam et au président Mohamed Morsi. Son émission, après avoir repris le 25 octobre dernier, après quatre mois d’interruption, a de nouveau été suspendue, quelques jours plus tard, alors qu’une nouvelle enquête était déclenchée.
Plus encore, la libération de la parole et de l’espace public a fait l’objet de graves remises en cause en Egypte après la destitution du président Morsi : des centaines de dirigeants appartenant au premier cercle de la Confrérie, mais aussi de second rang, ont été arrêtés au Caire comme dans les gouvernorats de province, et font l’objet de poursuites judiciaires. De plus, le 3 septembre dernier, la justice égyptienne a ordonné la fermeture définitive de la chaîne des Frères musulmans, d’une filiale égyptienne d’Al-Jazira, ainsi que de deux autres chaînes jugées islamistes. Il faut souhaiter que les acquis de la révolution de 2011, que l’on espère irrémédiables, ne sont que provisoirement suspendus dans le contexte extrêmement tendu du bras de fer qui s’est engagé entre les nouvelles autorités égyptiennes et les Frères musulmans, chassés du pouvoir par les masses populaires et par l’armée.
i. Un nouveau pacte national à définir
L’idée a souvent été avancée que les régimes renversés en 2011 reposaient aussi, en complément de leur politique de répression et/ou de domestication de l’opposition, sur un pacte implicite : la confiscation des libertés, malgré une façade constitutionnelle et démocratique, en échange d’un certain développement économique et de la sécurité, c’est-à-dire une forme de « servitude volontaire ». Quelle qu’ait été l’influence de ce pacte, le renversement du pouvoir en 2011 nécessite de définir de nouveaux équilibres et de nouvelles règles du jeu dans un cadre renouvelé, car désormais démocratique. Le peuple « quittant son état révolutionnaire », c’est un moment crucial d’institutionnalisation du changement qui s’ouvre (75).
Cette phase qui tend à façonner les nouveaux contours de l’Etat et de la société est tout aussi cruciale que difficile, car elle concerne potentiellement, à des degrés divers selon le pays considéré, mais de manière simultanée, des sujets de fond tels que l’équilibre des institutions, l’organisation de l’Etat, la place de l’islam, la définition d’une identité nationale, ainsi que les principaux paramètres socio-économiques.
Au plan constitutionnel, la question des institutions n’est sans doute pas la plus polarisante : après des décennies de dictature, la volonté d’éviter un pouvoir exécutif trop fort est assez partagée, mais des considérations socio-politiques peuvent se mêler à la question. Si Ennahda préfère une démocratie parlementaire en Tunisie, c’est sans doute aussi parce qu’elle pense avoir la force du nombre, tandis que d’autres acteurs peuvent espérer plutôt un équilibrage par l’intermédiaire de la Présidence de la République. L’organisation de l’Etat est un autre paramètre à revoir, surtout quand la force des identités régionales s’accompagne d’un long et vif sentiment de délaissement, comme en Libye. Mais la question de la décentralisation se pose aussi en Tunisie après la révolution de 2011.
La question de la place qui doit être réservée à la religion – et de son rapport avec le droit positif – fait aussi l’objet de débats, souvent beaucoup plus vifs que les précédents.
La référence à l’islam au sein de la Constitution paraît s’imposer aujourd’hui, de facto et pour ainsi naturellement, dans des pays très imprégnés de culture musulmane, souvent très pieux et en grande partie « réislamisés », comme cela a été indiqué précédemment. En Tunisie, d’ailleurs, la Constitution antérieure à la révolution de 2011 consacrait déjà l’islam, et l’article 2 de la Constitution égyptienne de 1971, révisée en 2007, reconnaissait les « principes de la charia » comme « la principale source de la législation ».
Mais cette dimension en apparence consensuelle est trompeuse. La question du rapport entre la religion, la démocratie et les libertés, longtemps mise sous le boisseau par les régimes autoritaires, est loin d’être réglée. Il reste à savoir quelles conclusions concrètes en seront désormais tirées en matière de droits civils et de libertés, notamment pour la liberté de conscience et la liberté d’expression, cette dernière pouvant être limitée par la reconnaissance de l’atteinte au sacré.
Deux visions de la société s’affrontent, l’une attachée à une approche contractualiste et « libérale », l’autre voyant dans la religion une source normative transcendante qui doit primer pour l’organisation de la société. Cette ligne de faille peut se retrouver dans les mouvements islamistes eux-mêmes, notamment au sein d’Ennahda, en Tunisie, entre les partisans d’un islam modéré, qui se présente comme ouvert sur les questions de démocratie, de droits de l’homme et de libertés fondamentales, et les tenants d’un projet d’islamisation de la société que l’on pourrait sans doute qualifier de totalitaire.
Cette confrontation autour de la place de l’islam conduit à une très forte polarisation de la scène politique et de la société, qui est l’un des facteurs ayant conduit en Egypte, outre l’impéritie manifeste des Frères musulmans au plan économique, à la destitution du président Morsi. Les islamistes sont en effet passés en force pour faire adopter la Constitution de décembre 2012. En Tunisie, au contraire, où la Constitution n’a pas encore été adoptée au moment où ces lignes sont écrites, Ennahda a déjà fait de nombreuses concessions, en renonçant notamment à l’inscription de la charia dans la Constitution et à celle de la « complémentarité » entre les hommes et les femmes. Le travail sur le projet de Constitution passait pour être quasiment achevé fin juillet, juste avant l’assassinat du député Mohamed Brahmi, qui a déclenché un séisme politique. Le vote, article par article, sur une quatrième version du texte était sur le point de commencer.
La redéfinition du pacte national a par ailleurs une dimension sociale. S’il y a globalement une majorité qui semble se dessiner aujourd’hui en faveur de politiques plutôt libérales, en particulier chez les Frères musulmans, se pose la question du niveau et de la forme des subventions aux biens de consommation et à l’énergie, qui représentent encore une part considérable du budget de l’Etat. La question est d’autant plus pressante en Egypte et en Tunisie qu’elle conditionne l’aide du FMI, laquelle sert de signal pour le déblocage de fonds multilatéraux complémentaires, ainsi que pour les investissements. La difficulté réside dans le coût social de ces mesures pour des responsables qui doivent réussir la transition politique dans le même temps, en évitant de trop fortes turbulences.
Au plan économique, de nouvelles orientations s’esquissent au moins dans deux domaines : tout d’abord, libérer les forces vives, dans le même temps que les forces politiques, mais en procédant d’une autre manière que les régimes tout juste renversés – ils avaient en réalité privatisé une partie de l’économie au profit d’une clique ou d’une mafia ; corrélativement, réduire significativement le niveau de corruption, non seulement autour des élites associées au pouvoir, mais aussi plus largement autour de l’Etat et plus généralement encore dans la société, ce qui implique entre autres de nouveaux modes de régulation.
L’importance extrême de certains de ces enjeux impose de procéder en recherchant sinon le consensus, du moins un compromis aussi large que possible. La Constitution adoptée en Egypte au mois de décembre 2012, sans négociation avec les forces non islamistes, mais avec toutes les apparences d’un coup de force, a ainsi cristallisé le mécontentement à l’égard du mode de gouvernance des Frères et polarisé encore plus douloureusement la scène politique et la société égyptiennes, jusqu’aux manifestations de masse et à l’intervention de l’armée qui ont renversé, une seconde fois depuis 2011, le pouvoir. En Tunisie, pays pourtant très divisé lui aussi entre « traditionnalistes » et « modernistes », on s’achemine au contraire vers une Constitution de compromis. L’issue n’est pas encore certaine, mais les concessions réalisées peu à peu ont déjà permis de lever des blocages. Si l’on peut ainsi éviter une déchirure brutale entre les deux Tunisie qui se distinguent aujourd’hui, le processus a aussi pour inconvénient de prendre beaucoup de temps, au risque d’exaspérer une grande partie de la population, et d’aboutir à un texte juridiquement ambigu, ouvert à une interprétation comme à son contraire, au gré des rapports de force.
Les femmes ont été très visibles pendant les révolutions de 2011, malgré un conservatisme social souvent assez prononcé et des violences commises contre elles, notamment des agressions sexuelles place Tahrir au Caire.
Acteurs à part entière du changement en Tunisie et en Egypte – et à un moindre degré peut-être en Libye –, les femmes sont ensuite devenues, bien malgré elles, l’un des « sujets » les plus brûlants des transitions en cours : les acteurs relevant de la mouvance islamiste font notamment la promotion d’une « complémentarité » entre les hommes et les femmes qui tend à ne les considérer que comme des mères et des épouses, gardiennes des valeurs islamiques traditionnelles de la famille.
Les révolutions de 2011 ont également révélé au grand jour l’écart grandissant entre la façade juridique des régimes et la réalité sociétale, non seulement moins avancée que l’état du droit mais connaissant aussi en parallèle diverses formes de recul.
Dans le même temps, comme l’a rappelé Mme Claude Guibal, ancienne correspondante de Radio France en Egypte, lors d’une audition de la Commission des affaires étrangères (76), si la situation des femmes connaît une régression dans leur vie quotidienne, on peut penser que leur cause progresse au contraire, car « un nombre considérable de femmes lutte au premier plan, jouant un rôle moteur dans le débat politique, dans l’action sociale et dans l’activité économique ».
– En Tunisie, pays arabe le plus avancé en ce qui concerne les droits des femmes, depuis Bourguiba, aucun retour en arrière ne s’est produit au plan légal. Dès 1956, le code du statut personnel avait consacré l’égalité devant le mariage et le divorce, ainsi que l’interdiction de la polygamie. Le « devoir d’obéissance » a ensuite été supprimé, tandis que les violences conjugales faisaient leur apparition dans le code pénal – en revanche, l’égalité n’est toujours pas reconnue, pour des motifs religieux, en matière d’héritage. Depuis la révolution, le seul changement notable au plan normatif a été positif – il s’agit de l’adoption d’une loi sur la parité pour l’élection de l’Assemblée nationale constituante. Les femmes étant rarement en tête des listes, elles ne représentent toutefois que 27 % de ses membres.
En dépit de ce tableau rassurant dans l’ensemble, plusieurs évolutions alimentent l’inquiétude au sein de la société civile tunisienne. La pression sociale s’accroît, dans un sens conservateur et antérieurement à la révolution de 2011. De plus en plus de femme portent ainsi le voile islamique, et le « niqab » fait son apparition, déclenchant des incidents au sein des universités, notamment dans la faculté des lettres de la Manouba, dont le doyen était opposé au port du voile intégral à l’intérieur de son établissement. Les inquiétudes proviennent aussi de l’évolution du débat public, qui voit apparaître de nouveaux sujets : la question de la « complémentarité » de la femme par rapport à l’homme, déjà évoquée, que défendait initialement Ennahda avant de battre en retraite devant la vigueur des protestations, ou encore celle de la reconnaissance du mariage coutumier, moins protecteur pour la femme. Dans le même temps, les salafistes commencent à remettre en cause publiquement l’interdiction de la polygamie et à se saisir de la question de l’âge légal du mariage.
– En Egypte, la question du statut des femmes a aussi fait l’objet d’une vive controverse au sein de l’Assemblée constituante, mais le débat s’est conclu, contrairement à ce qui s’est passé en Tunisie, par un recul dans le dispositif de protection des droits par rapport à la Constitution de 1971. Le corps de la Constitution, adoptée fin 2012 mais désormais suspendue, ne comportait plus aucun article garantissant explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est vrai que le préambule de la Constitution consacrait l’égalité devant la loi et l’égalité des chances entre « les citoyens et les citoyennes », mais le statut normatif de ce préambule n’était pas défini, et il était précisé par ailleurs que les femmes devaient être honorées, étant « les sœurs des hommes et les gardiennes de la maternité, la moitié de la société ». Toutefois, aucune mesure tendant à remettre en cause concrètement leurs droits n’a été adoptée depuis la révolution, hormis la suppression du quota de 64 femmes au Parlement, abrogé par le Conseil suprême des forces armées – en conséquence, seules dix femmes ont été élues au sein de l’Assemblée du peuple, aujourd’hui dissoute.
En l’état actuel du droit, le code pénal est très peu protecteur pour les femmes – il est très laxiste en ce qui concerne les violences domestiques, dont une Egyptienne sur quatre aurait pourtant été victime, la qualification de harcèlement sexuel n’existe pas, le violeur n’est pas poursuivi s’il épouse sa victime, et les auteurs de « crimes d’honneur », qui ne sont pas spécifiquement incriminés, bénéficient souvent de circonstances atténuantes. En ce qui concerne la famille, malgré quelques avancées, notamment en 2001 avec la réforme du statut personnel, qui reconnaît la pratique du « Kuhl », divorce par consentement mutuel, et interdit le mariage avant 18 ans, l’inégalité entre les hommes et les femmes perdure : une femme qui demande le divorce sans faute doit renoncer à ses droits financiers et perd la garde des enfants en cas de remariage de son ancien époux ; le témoignage de deux femmes équivaut en outre à celui d’un homme devant les tribunaux de la famille.
Par ailleurs, après la révolution de 2011, des débats ont eu lieu à l’Assemblée du peuple et à l’Assemblée constituante sur le divorce sans faute pour la femme, qu’il était envisagé de remettre en cause, sur l’âge légal du mariage pour les filles, ou encore sur l’excision, condamnée par les autorités religieuses musulmanes et coptes, interdite par la loi, mais subie par 95 % des femmes égyptiennes. En réalité, il reste encore beaucoup à faire au plan social pour améliorer la situation : l’Egypte a été classée à la 126e place sur 135 pays, dans le Gender Gap Index de 2012, en ce qui concerne les inégalités entre les hommes et les femmes. En matière d’éducation, par exemple, l’analphabétisme s’élève à 38 % chez les femmes, contre 20 % chez les hommes, l’écart s’accroissant encore en milieu populaire ou rural. Et les progrès réalisés en matière d’éducation – les femmes représentent désormais 49 % des étudiants à l’université – n’ont pas eu d’effet très net sur l’accès des femmes au marché du travail, ni sur l’accès aux responsabilités. En 2010, le Conseil d’Etat égyptien s’est par exemple opposé à la nomination de femmes en son sein. Les ONG et les associations égyptiennes font par conséquent de la présence des femmes dans les postes de décision un cheval de bataille.
– En Libye, la « grande Charte verte des droits de l’homme » de 1988 consacrait le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout en interdisant les mariages forcés et le divorce sans consentement ou jugement. La polygamie, très peu pratiquée, était également condamnée par un Kadhafi qui poussait le féminisme de façade jusqu’à autoriser l’admission des femmes dans l’armée et la police (77). Mais en Libye comme ailleurs, la révolution de 2011 a mis à nu la réalité de la société. Les représentantes d’ONG et d’associations de femmes rencontrées à Tripoli par la mission d’information ont ainsi témoigné des pressions de toutes sortes qui s’exercent sur les femmes qui s’aventureraient à prendre seules le bus ou leur véhicule. Malgré les avancées affichées par Kadhafi, les relations entre les hommes et les femmes sont restées sous l’emprise de la religion et de la tradition patriarcale. Le conservatisme ambiant se traduit notamment par une grande pudeur pour les femmes – elles sortent peu, et le port du voile est quasiment généralisé.
Pour autant, les femmes sont très actives au sein de la société civile libyenne, comme la délégation qui s’est rendue à Tripoli a également pu le constater, et l’on trouve de nombreuses femmes hautement qualifiées sur le marché du travail. Elles demandent aujourd’hui l’ancrage de leurs droits dans la Constitution et une meilleure protection par la loi. Un projet de loi sur le viol, utilisé massivement comme une « arme » à l’époque de Kadhafi et souvent considéré comme une atteinte à l’honneur du groupe – famille ou tribu – plutôt que comme une atteinte à la personne de la victime, a ainsi été déposé au Congrès. Il ferait du viol un crime de guerre s’il est commis dans le cadre d’un conflit armé, et accorderait des compensations financières aux victimes.
Des vents contraires soufflent cependant : le grand mufti Ghariani, autoproclamé, a ainsi déclaré qu’il n’était plus besoin d’avoir l’autorisation de sa première femme pour en épouser une deuxième et que le mariage d’une Libyenne avec un étranger devait désormais être considéré comme interdit.
iii. L’urgence économique et sociale
La situation économique est une donnée essentielle pour mesurer le chemin parcouru depuis le renversement de Ben Ali, de Moubarak et de Kadhafi, ainsi que le chemin restant à parcourir. En effet, le déclenchement de la révolution n’était pas seulement lié à des attentes démocratiques, mais aussi à des frustrations socio-économiques très vives, et le changement de régime a fait naître des attentes légitimes. Les populations aspirent à une amélioration concrète de leurs conditions de vie en Tunisie, en Egypte, comme en Libye, de même qu’à de véritables perspectives d’avenir, dans des sociétés dont le blocage était l’un des principaux dysfonctionnements, avec le détournement des ressources par les milieux directement liés au pouvoir. C’est donc aussi sur le terrain économique et social que les nouvelles autorités sont jugées par la population.
Les problèmes à régler sont d’autant plus délicats que les révolutions de 2011 se sont accompagnées d’une grande désorganisation, et que les transitions en cours ne se déroulent pas dans des conditions favorables pour l’activité économique. La situation politique se caractérise par des incertitudes graves et persistantes sur le calendrier des transitions, voire sur leur issue. La situation reste dégradée au plan sécuritaire, ce qui conduit les acteurs économiques à faire preuve d’un certain attentisme, et nuit aussi au tourisme, secteur pourtant vital en Tunisie comme en Egypte. Dans le même temps, le niveau des tensions sociales demeure élevé, surtout si on le compare à la période antérieure. En Egypte, les acteurs économiques rencontrés par la mission d’information n’ont pas seulement fait état de contestations sociales locales, mais aussi de séquestrations de cadres d’entreprises étrangères.
Même si le constat doit être nuancé par pays, le bilan des autorités de transition n’est manifestement pas à la hauteur des espérances au plan économique et social, et l’on observe une corrélation entre ce bilan et la montée du mécontentement d’une partie de la population. Ce phénomène est particulièrement net en Egypte, où le soulèvement massif de mi-2013 contre les Frères musulmans, arrivés au pouvoir l’année précédente, résulte d’une exaspération croissante, alimentée par le comportement des Frères dans le domaine politique, mais aussi par leur piètre gestion économique. Elle s’est notamment traduite par l’incapacité des autorités à signer un emprunt avec le FMI, par de fréquentes coupures d’électricité, ainsi que par des pénuries de gazole handicapantes en milieu rural.
Plusieurs tendances communes se dégagent en Egypte, en Tunisie et en Libye : un manque de vision d’avenir ; à court terme, une absence de réformes économiques et sociales pour améliorer la situation de l’emploi en général, mais aussi celle des populations les plus défavorisées, celle des jeunes diplômés et celle des zones déshéritées ; l’absence d’investissements publics significatifs, pourtant nécessaires pour améliorer le niveau des infrastructures et des services publics ; l’augmentation, en revanche, des dépenses publiques en matière de rémunérations et de subventionnement de l’énergie et des biens de consommation, afin d’acheter la « paix sociale » ; concomitamment, enfin, une dégradation inquiétante des finances publiques.
Dans ces trois pays, la relance de la machine économique reste visiblement à l’arrière-plan, dans le contexte politique difficile des transitions engagées. Une des principales raisons que l’on peut avancer pour expliquer cette situation est la focalisation constante des acteurs politiques et du débat public sur les questions institutionnelles, au détriment des fondamentaux économiques et de la situation sociale.
– C’est en Egypte que la situation paraît la plus grave. Tous les observateurs que la mission d’information y a rencontrés jugent catastrophique le bilan économique de la transition conduite sous l’égide de l’armée dans un premier temps, puis sous celle des Frères musulmans.
En l’absence de toute mesure pour redresser la situation à court terme et pour fixer un cap au-delà, l’économie égyptienne tourne au ralenti, avec un taux de croissance du PIB en volume à peine supérieur à celui de la population, qui s’élevait à 1,7 % en 2012. Pour la période budgétaire 2012-2013 (78), le FMI estime le taux de croissance à 1,8 %, ce qui signifie un retour à la période de fort ralentissement qui avait suivi la révolution (79). L’économie égyptienne n’avait enregistré que de faibles signes de reprise en 2011-2012, avec un taux de croissance limité à 2,2 %. Pour la période 2013-2014, le FMI prévoyait au mois d’octobre une croissance de seulement 2,8 %, bien en-deçà des prévisions initiales des autorités.
Les acteurs économiques français qu’une délégation de la mission d’information a pu rencontrer au Caire, au mois de février 2013, s’accordaient tous sur le caractère très préoccupant des perspectives économiques, en raison du manque de visibilité politique, des tensions sociales, accentuées par la révolution comme par la faiblesse des syndicats, et de la baisse du tourisme, principalement en provenance d’Europe, dans le contexte politique et sécuritaire dégradé qui prévalait déjà. Un risque de pénuries alimentaires ne paraissait pas non plus devoir être écarté, à cette époque, si aucune devise ne rentrait dans le pays.
A ce bilan déjà peu flatteur, il faut ajouter la volteface sur le prêt de 4,8 milliards d’euros demandé au FMI en août 2012, et alors considéré comme essentiel pour le redémarrage de l’économie, ce prêt étant non seulement attendu comme un signal par les investisseurs, mais également susceptible de débloquer des crédits supplémentaires de la part d’autres organisations multilatérales, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l’Union européenne. Alors que l’examen du prêt par le FMI devait avoir lieu mi-décembre, la partie égyptienne a fini par demander son report au dernier moment. La décision de réduire le subventionnement de l’énergie et d’augmenter la taxe générale sur les ventes, dans le cadre du programme envisagé pour obtenir l’accord du FMI, a été retirée par la Présidence de la République juste après son annonce, probablement au regard de la proximité du référendum sur le projet très controversé de Constitution. Les autorités égyptiennes ont ensuite demandé au FMI de reprendre les discussions, là encore sans aboutir, probablement parce que les élections qui devaient suivre l’adoption de la Constitution paraissaient proches. A cela pouvait sans doute s’ajouter, dans certains esprits, l’idée que l’Egypte était de toute façon trop importante pour que le monde puisse la laisser s’effondrer (suivant ce principe probablement fallacieux : « too big to fail »).
Le revirement soudain des autorités égyptiennes, puis leur incapacité persistante à conclure les négociations avec le FMI, témoignent d’une grande incohérence des politiques publiques. Elle a contribué à augmenter les incertitudes et à dégrader encore la confiance des acteurs économiques et financiers, déjà ébranlée au début du mois d’octobre 2012 par un discours du président Morsi qui remettait en cause les privatisations précédemment menées. On peut aussi s’interroger sur l’incapacité des Frères musulmans à présenter des réformes destinées à répondre aux attentes économiques et sociales de la population, alors que la Confrérie a bâti sa réputation sur son action caritative de terrain. Certains voient dans cette inaction au plan économique le signe d’une adhésion aux thèses libérales, d’autres la simple conséquence d’un manque de programme, l’alignement sur les exigences du FMI se faisant en quelque sorte par défaut, afin d’obtenir le concours des institutions financières internationales.
Depuis le renversement du président Morsi, la négociation avec le FMI ne paraît plus d’actualité. Tout d’abord, les aides apportées ou promises par les pays du Golfe depuis juillet 2013, pour un montant d’au moins 16 milliards d’euros à l’heure actuelle, sous la forme d’une aide financière, mais aussi en nature – en gaz, en pétrole et en produits raffinés –, permettent à l’Egypte d’éviter de passer sous les fourches caudines du FMI. Le niveau des réserves de change, qui avait atteint un niveau inquiétant, est notamment remonté début août. Le nouveau gouvernement de transition a aussi annoncé, fin septembre, un plan de relance de 3,2 milliards de dollars d’investissements supplémentaires sur 9 mois, afin de traduire concrètement une priorité donnée à la croissance économique. Il devrait notamment s’agir d’opérations concernant des infrastructures de transports, des stations d’eau potable et d’épuration, le réseau électrique et celui du gaz naturel, ou encore la construction de 50 000 nouveaux logements. Un second plan, d’un montant légèrement supérieur, a été annoncé pour l’année 2014. Dans le même temps, les principales mesures envisagées dans le cadre d’un éventuel accord avec le FMI, mais jamais mises en œuvre pour l’instant, à savoir la réforme des subventions à l’énergie et la hausse de la taxe sur les ventes, ne sont plus mises en avant.
Le soutien des pays du Golfe a redonné une certaine visibilité aux agents économiques, comme en témoignent l’appréciation de l’indice boursier EGX 30 depuis la fin du moins de juin, la réduction des taux d’intérêt des titres publics, ainsi que celle du « spread » associé aux CDS à cinq ans, mais l’Egypte continue à vivre sous une perfusion extérieure, et le répit n’est que très artificiel pour le moment. La situation politique est loin d’être réglée, la paix civile n’étant pas revenue, et la situation sécuritaire s’est dégradée : les violences politiques se poursuivent sporadiquement, ainsi que des attentats, tandis que le Sinaï continue à échapper au contrôle des forces de sécurité, malgré les opérations militaires qui ont été lancées. Dans ces conditions, les incertitudes demeurent sur le déroulement de la transition, ce qui pousse les acteurs économiques à une grande prudence, et il paraît difficile de tabler dans l’immédiat sur une reprise du tourisme en Egypte.
On peut même se demander si l’amélioration actuelle de la situation ne risque pas de repousser à plus tard l’adoption d’un certain nombre de mesures qui restent tout aussi nécessaires aujourd’hui qu’avant la déposition de Mohamed Morsi. C’est notamment le cas des subventions, dont le coût a augmenté de 26 % entre l’année fiscale 2011/2012 et celle 2012/2013. Dans le domaine de l’énergie, les subventions aux produits pétroliers représentaient 13 milliards d’euros en 2012/2013, soit 21 % des dépenses de l’Etat et deux fois plus que les dépenses d’éducation. Jusqu’à présent, la seule réforme engagée consiste à mettre progressivement en place des cartes à puce pour la distribution de l’essence, d’abord afin de mieux connaître la réalité du marché – quantités et localisation –, et ensuite de pouvoir verser une quantité bien définie d’essence subventionnée à un public ciblé, cette mesure douloureuse étant remise à plus tard. Dans l’immédiat, les prix des produits de base vendus dans les magasins publics ont, au contraire, été réduits de 10, voire 15 %, et le système des cartes de rations alimentaires a été étendu à 3,8 millions de personnes supplémentaires.
Dans le même temps, l’évolution inquiétante des comptes publics et de la dette domestique se poursuit. Le déficit public est passé de 10,8 % du PIB à 14,1 % entre l’année fiscale 2011/2012 et celle 2012/2013, tandis que les intérêts de la dette ont augmenté de 40 %. Quant à la dette publique interne brute, son stock est passé de 70,5 % du PIB en juin 2012 à 78,4 % au mois de juillet suivant. Le poids des intérêts représentait alors 25 % des dépenses de l’Etat, en hausse de plus de 40 % par rapport à l’exécution budgétaire de l’année précédente. Quant à la dette publique totale, qui comprend aussi la dette publique externe brute, elle est estimée à 81,1% du PIB sur l’année fiscale 2012-2013.
– La situation est moins dégradée en Tunisie, qui a connu une nette reprise économique en 2012, après un recul de 1,9 % du PIB en 2011. La croissance s’est élevée à 3,6 % l’année dernière, mais elle pourrait passer en dessous de 3 % en 2013. Les prévisions initiales ont en effet été révisées à la baisse dans le contexte de la crise très grave déclenchée par l’assassinat de Mohamed Brahmi. En outre, le rebond de l’activité par rapport à 2011 traduit en grande partie un simple rattrapage statistique, notamment dans le secteur industriel, et les acteurs économiques continuent à faire preuve d’un certain attentisme. Comme en Egypte, on reste en dessous de la moyenne des dix années précédant la révolution.
S’il est vrai que la consommation interne reste vive, elle est fortement tirée par la hausse des salaires, par les recrutements dans la fonction publique – au moins 30 000 postes supplémentaires depuis la révolution – et par une politique de subventions accrues – elles ont augmenté de 25 % pour les produits de base, représentant désormais 5 % du PIB. L’accord de confirmation approuvé par le FMI en juin 2013, pour un montant de 1,75 milliard de dollars mobilisables sur deux ans, pousse pourtant à une plus grande maîtrise des salaires publics et à une baisse des subventions, y compris à court terme pour les carburants.
Quant au commerce extérieur, majoritairement réalisé avec l’Union européenne, qui reçoit les ¾ des exportations tunisiennes, il pâtit du ralentissement de la croissance de l’autre côté de la Méditerranée. Le tourisme reste par ailleurs en berne, malgré une reprise par rapport à 2011 – le niveau des recettes est encore en baisse de 10 % par rapport à la période antérieure à la révolution. Le nombre des touristes français, qui représentent 1/6e du total, est d’environ 1 million, contre 1,3 million avant la révolution. Enfin, au plan qualitatif, la Tunisie pourrait espérer drainer un tourisme plus haut de gamme et moins concentré géographiquement.
Malgré l’annonce d’un programme important de projets prioritaires, début 2012, pour un montant de 78 milliards de dollars (80), les investissements publics et privés qui s’imposent pour relancer l’économie, tout en améliorant les infrastructures et les services publics, n’ont pas encore été engagés. Dans un rapport d’août 2013, intitulé « L’économie tunisienne : état des lieux et plan pour une sortie de crise », la centrale patronale UTICA relevait en particulier le niveau stationnaire des dépenses publiques d’investissement, dont le montant est d’environ 2,3 milliards d’euros par an. Depuis 2010, le poste « rémunérations publiques » a en revanche augmenté de près de 50 %, et celui des « transferts et subventions » de 113 %.
Quant aux réformes structurelles annoncées, souvent à l’instigation des bailleurs de fonds multilatéraux, force est de constater qu’elles tardent encore à se concrétiser, qu’il s’agisse de la refonte globale du Code de l’investissement, prévue depuis le début de l’année 2012, du projet de loi-cadre sur les partenariats publics-privés, ou encore de la réforme des marchés publics. L’objectif était initialement de rassurer les investisseurs, mais les retards accumulés tendent plutôt à accroître leur pessimisme, désormais, et à retarder le lancement de certains projets, notamment en matière d’investissement.
Le taux de chômage a officiellement reculé, passant de 18,9 % fin juin 2011 à 16,5 % en mars 2013, mais le taux de croissance reste en deçà du seuil de 7 % souvent considéré comme nécessaire pour fournir du travail à tous ceux qui entrent sur le marché du travail tunisien. Le chômage des jeunes demeure très élevé – il dépasserait 43 % pour les jeunes femmes diplômées et 21 % pour les hommes –, et les disparités régionales ne se sont pas atténuées depuis la révolution. Le taux de chômage atteindrait ainsi 30 % dans la région défavorisée de Kasserine. Les régions de l’intérieur, où le soulèvement tunisien a pris naissance, souffrent encore d’un manque d’infrastructures et se considèrent à juste titre comme délaissées.
Afin d’apprécier l’évolution de la situation économique et sociale, il faut aussi prendre en considération le niveau de l’inflation, qui pourrait atteindre 6 % en glissement annuel. Le pouvoir d’achat des ménages s’en trouve réduit, en particulier pour les plus démunis, qui subissent de plein fouet l’inflation des produits alimentaires de base, supérieure à 8 %.
La question de la corruption continue également à se poser en Tunisie. Elle n’a certes plus la même échelle que sous Ben Ali, elle est moins spectaculaire, mais la corruption endémique qui persiste suscite toujours un vif ressentiment au sein de la population. Selon l’ONG Transparency International, qui réalise chaque année un baromètre de la corruption du secteur public dans le monde, la Tunisie était le 75e pays le moins corrompu en 2012, sur 176 pays ou territoires, alors qu’elle se classait au 59e rang en 2010 sur 178 pays et territoires.
Dans son rapport précité, l’UTICA s’inquiète enfin de la situation des comptes publics. Le déficit budgétaire s’est élevé à 5,4 % en 2012 – contre 1,5 % en 2010, avant la révolution. S’agissant de la dette, la loi de finances initiale pour 2013 reposait sur une estimation d’environ 47 %, mais elle pourrait atteindre près de 50 % en 2014, selon le FMI. Libellée pour moitié en euros, la dette est sensible aux variations de change, et son service aborbe environ 20 % du budget de l’Etat. La notation souveraine du pays ayant été dégradée par plusieurs agences depuis le début de l’année 2013 (81), la Tunisie peine à mobiliser des ressources extérieures – pour environ 3 milliards d’euros –, aussi bien auprès des marchés financiers que des bailleurs internationaux.
– En Libye, la situation économique se présente sous un jour nettement plus favorable en apparence, mais en grande partie trompeur.
En 2012, le taux de croissance a atteint un niveau record, estimé à 116 %, principalement par un effet de rattrapage, comme en Tunisie, mais dans des proportions bien supérieures. Pour 2013, le FMI prévoyait en juin une croissance proche de 16,5 %, mais les performances économiques risquent d’être très affectées par la crise durable du secteur des hydrocarbures, qui représente plus de 95 % des ressources de l’Etat.
Alors que la production était revenue très rapidement à son niveau antérieur à la révolution, soit environ 1,6 million de barils par jour, les installations pétrolières sont désormais fréquemment occupées ou bloquées à la suite de troubles sociaux multiples, auxquels se greffent des revendications politiques. On a assisté à des grèves d’employés, à des manifestations locales pour demander des emplois, ainsi qu’à des mouvements d’occupation déclenchés par la Petroleum Facility Guard, pourtant créée pour assurer la protection des installations. A cela s’ajoutent des actions menées par un bataillon autoproclamé « force d’autodéfense de Cyrénaïque », lors de la proclamation d’un Etat régional – question sur laquelle il faudra revenir –, par des groupes constitués d’Amazighs (Berbères), réclamant une meilleure protection de leurs droits politiques et culturel, ou encore par des Touaregs, suivant leur exemple. La production avait ainsi chuté à 100 000 barils par jour en septembre, avant de remonter à environ 250 000 barils à la fin du 3e trimestre 2013, le niveau étant variable depuis des mois.
En dépit de ces incertitudes, et contrairement à ses voisins, dont les ressources sont beaucoup plus limitées, le pays dispose au moins potentiellement d’une rente pétrolière considérable, pour une population de seulement 6,5 millions de personnes, ce qui fait de la Libye le pays le plus riche d’Afrique du Nord en revenu par habitant – avec 11 230 euros par tête en 2012. Elle peut aussi compter sur des avoirs financiers estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars au total. L’Etat libyen a donc les moyens d’acheter la paix sociale et il ne s’en prive pas. Les traitements ont ainsi augmenté de 64 % en moyenne dans la fonction publique depuis 2010 – des salaires sont notamment versés à 140 000 anciens révolutionnaires –, de nombreuses primes récurrentes ont été allouées, par exemple pour les ex-révolutionnaires célibataires, et de nouvelles mesures sociales ont aussi été instaurées, telles que des allocations familiales pour tout citoyen de moins de 18 ans.
D’après l’un des spécialistes de la Libye rencontrés par la mission d’information, le pays dispose de « carburant » pour continuer à aller de l’avant en dépit de son état avancé de fragmentation au plan sécuritaire et de la force des identités tribales et régionales. Mais c’est une facilité dangereuse, dans la mesure où elle n’incite pas à remédier aux faiblesses de l’économie libyenne, inchangées depuis l’époque de Kadhafi.
– Tout d’abord, l’usage de la rente pétrolière, outre le fait qu’il est peu transparent, reste faiblement axé vers le développement du pays. Seuls 30 % des 40 milliards d’euros de crédits votés au mois de mars pour l’année 2013 doivent ainsi être consacrés à des investissements, l’essentiel des moyens budgétaires allant au paiement des salaires de la fonction publique (30 % du total), aux dépenses de subvention et de stabilisation des prix (16 %), ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement (16 %) ;
– La dépendance aux hydrocarbures reste massive dans ce pays qui fait partie des Etats pétroliers les moins diversifiés au monde, faute de véritable programme de développement sous Kadhafi, mais aussi par la volonté qui était probablement la sienne de pas développer le secteur privé (82), afin de maintenir la population dans une situation de dépendance, notamment via des emplois publics en grande partie fictifs ;
– le secteur public, qui emploierait 1,3 million de fonctionnaires, pour une population active de 2,1 millions de personnes, est à la fois inefficace et massif. Le secteur privé dit « formel » ne compterait que 100 000 salariés et le secteur parapétrolier fournirait 40 000 emplois. Le taux de chômage, quant à lui, s’élève officiellement à 30 % (83).
Si le secteur privé commence, malgré tout, à se développer dans certains domaines, notamment le négoce, la restauration, la distribution automobile, la grande distribution, la construction et les petites industries, les projets d’investissement peinent à avancer du fait de la situation sécuritaire inquiétante du pays, des changements fréquents des interlocuteurs institutionnels et de l’absence de perspectives, aussi bien au plan économique que politique. Les autorités actuelles ne sont en place que pour une période transitoire, que la déclaration constitutionnelle de 2011 a théoriquement limitée à 18 mois, et elles n’ont pas développé de vision d’avenir pour le pays. Par ailleurs, on peut observer que tous les crédits du budget voté pour l’année 2012 n’ont pas été consommés, faute de capacité des institutions à mettre en œuvre des projets d’investissement.
Le chantier de la reconstruction de la Libye est pourtant immense, notamment dans le secteur des hydrocarbures, qui n’a pas encore été remis à niveau (84). Les infrastructures étant pour l’essentiel restées en jachère sous Kadhafi¸ hormis quelques réalisations dans les années 1970, la Libye reste sous-équipée. Ce n’est donc pas seulement la reconstruction du pays, mais plutôt sa construction, qui devrait être à l’ordre du jour en matière d’infrastructures et de services publics – routes, aéroports, électricité, transports, télécoms, santé ou encore éducation.
Notre pays est bien placé pour y participer, mais il ne faudrait pas entretenir d’illusions pour autant : le soutien déterminant de la France pendant la révolution libyenne ne lui accorde aucune « prime » particulière dans le domaine économique. Ce sont les prix et la réactivité qui jouent un rôle déterminant, et de nombreux concurrents sont déjà très présents sur le terrain, notamment la Chine et la Russie, mais aussi l’Italie, qui a réalisé 1,7 milliard d’euros d’exportations pendant les trois premiers trimestres 2013, et la Turquie, qui bénéficie notamment de l’absence de visas.
B. DES SITUATIONS TRÈS HÉTÉROGÈNES ET ENCORE INDECISES
En Tunisie, en Egypte et en Libye, ce sont des processus révolutionnaires autonomes qui se sont engagés fin 2010 et début 2011, avec des spécificités, des acquis, mais aussi des difficultés propres. Les situations aujourd’hui très différenciées que connaissent ces trois pays en portent naturellement la marque.
a. La « troïka » : une expérience sans équivalent
La Tunisie est aujourd’hui encore dirigée par une « troïka » constituée du parti islamiste Ennahda, du Congrès pour la République (CPR), que l’on peut classer du côté de la gauche nationaliste, et d’Ettakatol, qui se réclame de la social-démocratie (85). Cette alliance autour d’un parti islamiste est sans équivalent en Libye et en Egypte. Elle est certes le fruit de l’arithmétique parlementaire, Ennahda n’ayant pas la majorité absolue à l’Assemblée nationale constituante, mais elle résulte aussi d’une histoire commune avant la révolution de 2011 : une partie de l’opposition islamiste et une partie de l’opposition séculière s’étaient rapprochées dans l’adversité, à l’époque de Ben Ali, jusqu’à adopter en juin 2003 une « déclaration de Tunis », dans laquelle les islamistes tunisiens reconnaissaient le principe de la démocratie, l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les libertés publiques.
Moncef Marzouki, l’un des principaux acteurs de la « troïka » tunisienne, en sa qualité de Président de la République, présente cette alliance entre partis islamistes et non islamistes comme un effort pour réaliser un « compromis historique », acceptable par les deux principales composantes de la société tunisienne : une Tunisie côtière, occidentalisée et francophile, qui tient à l’héritage historique du bourguibisme, et une Tunisie certes moins influente, mais plus nombreuse, qui est plutôt tournée vers l’Orient et se reconnaît davantage dans la référence à l’islam. Ce compromis concerne d’abord la Constitution. Contrairement à l’Egypte, où les islamistes sont passés en force, la Tunisie avance lentement dans la rédaction de sa Constitution, laquelle doit être adoptée dans son ensemble par l’ANC à la majorité des deux tiers, ou bien par référendum. On en était à une quatrième version du projet de texte avant la crise politique déclenchée par l’assassinat de Mohamed Brahmi, le 25 juillet dernier, et la suspension des travaux de l’ANC qui a suivi.
Par son existence, la « troïka » pousse au compromis entre forces politiques d’inspirations différentes, avec l’idée que la remise à plat des institutions et la redéfinition de la trajectoire du pays après la chute de l’ancien régime ne doivent pas être monopolisées par l’acteur politique le plus fort. De fait, Ennahda a fait des concessions, notamment sur la « complémentarité » entre les hommes et les femmes, qui est pourtant un marqueur idéologique fort. D’autres points semblent plus difficiles à trancher, en particulier en matière institutionnelle, Ennahda étant en faveur d’un régime parlementaire, alors que ses partenaires défendent un régime présidentiel ou mixte. Sur le fond, le président Marzouki a déclaré au Rapporteur, en mai dernier, que les véritables différends avec Ennahda ne concernaient pas l’islam – il y aurait en réalité un consensus autour de la notion d’Etat « civil », c’est-à-dire ni théocratique, ni militaire ; les sujets les plus durablement et douloureusement clivant seraient plutôt économiques et sociaux. Conservatrice au plan social, Ennahda a en effet une vision libérale, voire ultralibérale de l’économie, hostile par exemple à la réforme agraire et à la révision du système fiscal défendues par Moncef Marzouki (86).
Dans une certaine mesure, la « troïka » contribue à limiter la polarisation du champ politique. On trouve ainsi des islamistes, des socialistes et des nationalistes dans la coalition au pouvoir comme dans l’opposition. Mais la polarisation est, de fait, importante au plan sociétal et idéologique, et elle gagne aussi le champ politique. Comme en Egypte pendant la transition menée sous la conduite des Frères musulmans, l’opposition tunisienne se définit avant tout contre Ennahda : elle dénonce sa domination sur la coalition au pouvoir, qui ne fonctionnerait pas véritablement comme une « troïka » ; elle accuse le parti islamiste de chercher à noyauter l’Etat en plaçant des fidèles aux postes stratégiques afin de renforcer son emprise ; elle a aussi dénoncé son laxisme à l’égard des gesticulations et des actes de violence des salafistes. Les partis alliés à Ennahda en paient d’ailleurs chèrement le prix : le CPR et Ettakatol sont critiqués par leur base électorale, au motif qu’ils cautionnent la politique d’Ennahda, et ont connu d’importantes défections parmi leurs propres élus, ce qui tend de facto à renforcer la place d’Ennahda au sein de la coalition.
Malgré les ambitions et les espoirs placés dans la « troïka », beaucoup ont fini par juger négativement son bilan dans tous les domaines. Au plan économique et social, l’absence de changement véritable conduit à d’intenses frustrations, qui se traduisent périodiquement par de nouveaux troubles sociaux dans les régions déshéritées de l’intérieur de la Tunisie, notamment à Sidi Bouzid, d’où était partie la « révolution de la dignité » fin 2010, ou encore à Siliana. Autre signe de cette exaspération, cette fois en raison de la situation au plan sécuritaire, les trois présidents – celui de la République, celui de l’ANC et celui du Gouvernement – ont été obligés de quitter sous les huées et aux cris renouvelés de « Dégage ! », un hommage funèbre à deux gardes nationaux tués lors d’affrontements avec des terroristes dans le gouvernement de Béja. Au plan politique, un climat de défiance profonde s’est installé. Il est alimenté par une succession de crises, mais aussi par la lenteur du processus de transition et par une situation sécuritaire qui suscite des inquiétudes croissantes.
b. Un chemin long et semé de difficultés
A la différence de la transition politique égyptienne, dont on ne sait pas encore si elle vient de repartir à zéro après la destitution du président Morsi ou de se terminer brutalement par une reprise en main autoritaire, contrairement aussi à la transition libyenne, qui semble paralysée depuis le mois d’octobre 2012, l’expérience tunisienne se poursuit sur le fil du rasoir, malgré des incidents et un malaise politique grandissant.
La situation intérieure de la Tunisie se caractérise en effet par une succession de crises et de phases de répit, récemment marquée par l’assaut contre l’ambassade américaine de septembre 2012, par les violences politiques de la fin de la même année contre des membres de Nida Tounes et contre l’UGTT, puis par l’assassinat de Chokri Belaïd, figure charismatique de l’opposition de gauche, en février 2013. Le pays est maintenant sous le choc de l’assassinat du député Mohamed Brahmi, fin juillet. A chaque fois, la Tunisie a semblé être au bord de la rupture, mais le pire a finalement été évité.
La crise politique de février 2013 avait ainsi cristallisé le ressentiment contre le gouvernement et accentué la polarisation de la scène politique, comme la mission d’information avait pu le constater à Tunis même. Mais elle a finalement pu être dépassée grâce à la constitution d’un nouveau gouvernement, conduit par Ali Larayedh, dans lequel les portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Défense ont été confiés à des personnalités alors globalement jugées indépendantes et compétentes, satisfaisant ainsi une des revendications de l’opposition. L’annonce d’un nouveau calendrier, prévoyant l’adoption de la Constitution au mois de juillet, puis des élections avant la fin de l’année, a également contribué à réduire la tension.
L’assassinat d’une autre figure de l’opposition de gauche a déclenché une nouvelle onde de choc à la fin du mois de juillet, alors que le climat politique semblait s’être apaisé. Des rassemblements quotidiens, réunissant parfois entre 40 000 à 100 000 personnes, selon les estimations, ont demandé le départ d’Ennahda, avec des slogans tels que « Ghannouchi dégage ! », directement calqués sur ceux de la révolution de 2011, la constitution d’un gouvernement de compétences, jusqu’aux prochaines élections, voire la dissolution de l’Assemblée nationale constituante. Celle-ci a d’ailleurs vu ses travaux suspendus au début du mois d’août par son président, Mustapha Ben Jaafar, qui appelait alors à des négociations pour sortir le pays de la crise politique. Bien que le dialogue entre les parties en présence soit manifestement complexe et difficile dans le contexte délétère qui s’est installé en Tunisie, les jours de la « troïka » paraissaient comptés au moment où ce rapport est écrit.
Mi-novembre 2013, la crise ouverte par l’assassinat du député Mohamed Brahmi semblait ainsi en voie d’être surmontée dans le cadre d’un « dialogue national » entre les principales forces politiques, qui a officiellement commencé le 25 octobre, après bien des difficultés, et qui s’est notamment traduit par la reprise des travaux de l’Assemblée nationale constituante. Selon la « feuille de route » élaborée sous l’égide de l’UGTT, de la centrale syndicale UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et de l’Ordre des avocats, pour fixer les conditions de sortie de crise, mais aussi des modalités pratiques devant permettre d’achever en bon ordre la transition, Ennahda et ses alliés devaient se retirer du Gouvernement au profit d’un cabinet de compétences, jusqu’aux élections, la Constitution devant être adoptée en parallèle, dans un délai théorique de trois semaines.
Jusqu’à présent, ces montées brutales et récurrentes de la tension n’ont pas fait dérailler la transition démocratique tunisienne, car ses différents acteurs, notamment ceux au pouvoir, ont fait la preuve d’une certaine capacité de compromis et de résilience devant la pression populaire, attitude bien différente de celles des acteurs de la transition égyptienne. Mais ces convulsions ont considérablement aggravé les fractures politiques en Tunisie et alimenté un malaise croissant. Les deux assassinats politiques qui se sont suivis en février puis en juillet 2013 tétanisent d’autant plus l’opinion publique tunisienne qu’ils sont perçus comme totalement étrangers à la culture politique du pays.
Le malaise qui s’installe durablement résulte aussi de la longueur de la transition, qui paraît interminable. Les calendriers annoncés n’étant pas tenus, l’achèvement du processus a été repoussé à plusieurs reprises. Cette lenteur peut s’expliquer par l’ampleur de la tâche à réaliser – rien de moins que réaliser un compromis « historique » et durable entre ces deux Tunisie qui tendent à s’opposer socialement et idéologiquement. Mais un sentiment d’impatience gagne. Le fait que la transition traîne en longueur peut être d’autant moins difficile à accepter que la révolution de 2011 a été d’une extrême rapidité, tout en étant relativement pacifique – on évoque généralement le nombre de 300 morts. D’où l’attente et l’espoir, déçus, d’une transition elle aussi rapide. On peut également penser que le développement des réseaux sociaux a en partie modifié, par l’immédiateté qui les caractérise, le rapport à la temporalité politique, accentuant l’impatience de la population.
Ce sentiment de malaise est renforcé par la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire depuis 2011. La délinquance et la criminalité ordinaires, dont le niveau était relativement faible jusqu’à la révolution, ont considérablement augmenté du fait de l’incapacité des forces de l’ordre, durablement démotivées et mal considérées, mais aussi de la libération ou de l’évasion de milliers de criminels de droit commun en janvier et février 2011, à quoi s’ajoutent peut-être les effets d’un climat général plus permissif depuis la chute de Ben Ali. En revanche, jusqu’au dernier assassinat commis au mois de juillet, les violences politiques dont s’était accompagnée la polarisation de la vie politique tendaient finalement à décroître par rapport au niveau atteint à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013. Mais les Ligues de protection de la révolution n’ont pas disparu du paysage. Ces groupes qui se sont notamment signalés par des agressions contre des partis de l’opposition, des syndicalistes de l’UGTT et des journalistes, ont été créés dans la foulée de la révolution en 2011. Plutôt teintés originellement de sensibilités d’extrême gauche, ils se sont transformés en incluant de plus en plus de proches d’Ennahda et de la mouvance salafiste.
La porosité des frontières et l’évolution du Sud tunisien sont une autre source d’inquiétude. Le développement des trafics d’armes, de drogue et de biens de consommation en provenance ou à destination de l’Algérie et de la Libye est désormais exposé au grand jour. Les récents événements du djebel Chaambi, qui ont vu des affrontements entre terroristes et forces de l’ordre, témoignent de l’existence de cellules jihadistes dans le Sud. En conséquence, le ministère de la défense tunisien a annoncé fin août la création de « zones militaires tampons » aux frontières avec la Libye et l’Algérie, afin de mieux lutter contre les trafics d’armes et le terrorisme. Cette mesure implique notamment des autorisations spéciales pour se rendre dans les zones concernées. Des incidents ont aussi eu lieu, plus récemment, dans d’autres parties du territoire tunisien, nourrissant la crainte d’une extension géographique du péril extrémiste. Le 23 octobre 2013, jour anniversaire des élections de 2011, plusieurs membres des forces de sécurité étaient tués près de Sidi Bouzid. Une semaine plus tard, les zones touristiques de Sousse et de Monastir faisaient l’objet de tentatives d’attentats. Le nombre des jihadistes est estimé par certains observateurs à 5 000, voire 10 000 activistes, la frontière entre les différents types de salafisme étant parfois difficile à évaluer, et l’on redoute par ailleurs un reflux d’extrémistes depuis le Sahel.
Officiellement, la Tunisie reste une terre de prédication et non de « Jihad » armé, la mouvance salafiste ayant plutôt choisi de faire campagne sur le terrain pour gagner les cœurs et les esprits, notamment à travers l’action caritative et le contrôle des mosquées. Les caches d’armes découvertes dans de nombreux points du pays sont toutefois inquiétantes et les autorités ont désormais adopté une position de fermeté à l’égard des groupes salafistes violents. L’interdiction du congrès d’Ansar Al-Charia a ainsi provoqué des heurts au mois de mai et un bref appel au « Jihad » contre les forces de sécurité et l’armée. L’évolution de la position du Gouvernement, jusque-là assez tolérante, s’est poursuivie fin août dans le contexte de la crise politique déclenchée par l’assassinat de Mohamed Brahmi, le Premier ministre tunisien ayant fini par accuser publiquement Ansar Al-Charia d’être lié à Al-Qaida et d’être à l’origine des violences politiques graves qui secouent le pays. Depuis l’été, les forces de sécurité ont alors été engagées dans d’importantes opérations contre des groupes armés. Le pouvoir tunisien, parfois soupçonné de complaisance, s’est donc orienté dans un sens beaucoup plus « anti-salafiste », en se distanciant nettement de ce mouvement, ce qui pourrait aider à régler le débat sur la place de l’islam dans le cadre du débat sur la Constitution, en mettant fin à ce qui était perçu comme une ambiguïté lourde d’implications.
c. Un exemple potentiel pour les autres « révolutions arabes » ?
Malgré cette montée des périls, la Tunisie pourrait constituer une référence pour les révolutions arabes, pourvu que les forces politiques, conjointement avec des acteurs de la société civile tels que l’UGTT, qui s’est impliquée dans les tentatives de dialogue entre Ennahda et l’opposition pendant la crise de l’été 2013, parviennent à s’entendre pour mener la transition jusqu’à son terme d’une manière pacifique et ordonnée. Il faut espérer que la Tunisie puisse montrer que les « révolutions arabes » sont capables de réussir sans passer par une phase d’explosion du pays, comme en Syrie, de décomposition avancée, comme en Libye, ou de reprise en main par l’Etat profond, comme en Egypte. De même que la Tunisie a donné l’exemple avec la chute de Ben Ali au début de l’année 2011, suscitant une onde de choc qui a gagné l’ensemble de la zone, elle peut continuer à jouer un rôle d’exemplarité à l’heure où le doute s’installe dans l’opinion publique occidentale – et arabe – sur les bénéfices des révolutions enclenchées en 2011.
Le premier atout « comparatif » de la Tunisie est lié au déroulement de sa révolution. Elle a été rapide et ne s’est accompagnée que de 300 morts. C’est un prix certes élevé en soi, mais tout de même modeste par rapport à la taille du pays, et le fait que la révolution ait été relativement pacifique a permis de limiter les fractures. Par ailleurs, même si la présence des Ligues de protection de la révolution constitue une difficulté indéniable, l’absence de conflit armé pendant la révolution tunisienne a permis d’éviter l’émergence de brigades révolutionnaires puissantes et déterminées à continuer à jouer un rôle actif dans la transition, comme en Libye. Quant à l’armée, qui jouit d’un certain prestige parce qu’elle a refusé de participer à la répression engagée contre la révolution, elle est de taille beaucoup plus modeste que son équivalent égyptien et s’est toujours tenue à l’écart du jeu politique. On imagine mal à l’heure actuelle qu’elle puisse se sentir investie de la même mission que l’armée égyptienne.
Par ailleurs, si l’Etat a été décapité par la révolution, il est malgré tout resté en place et demeure fonctionnel. Il y a encore une administration assez puissante, qui plonge ses racines assez loin dans l’histoire, puisqu’elle remonte à l’empire ottoman. Certains acteurs considèrent que cette pérennité de l’Etat tunisien limite singulièrement la rupture avec le régime précédent, mais on peut aussi considérer qu’il s’agit d’un atout, à la double condition toutefois que le renouvellement des cadres corrompus ou trop impliqués dans la politique de répression de Ben Ali soit suffisamment bien mené pour être considéré comme satisfaisant, sans déstructurer pour autant l’Etat, et que ce renouvellement s’accompagne d’une réforme de la police et de la justice, aujourd’hui discréditées et peu efficaces. Pour être légitime, cette reconstruction démocratique qui se fait en quelque sorte sur les vestiges de la dictature doit naturellement s’accompagner d’une « justice transitionnelle » crédible sous ses différentes formes – reconnaissance des crimes commis et action pénale contre leurs auteurs, réparation financière et symbolique pour les victimes, mais aussi action mémorielle.
La Tunisie se différencie également par l’ampleur de sa classe moyenne, même s’il faut se méfier des statistiques dithyrambiques publiées sous Ben Ali, qui faisait du développement considérable – quoique probablement exagéré – de la classe moyenne un titre de gloire. En tout état de cause, la société tunisienne est beaucoup moins violemment fragmentée que la société égyptienne, où une large partie de la population vit à proximité ou en dessous du seuil de pauvreté, avec une couche supérieure très fine au dessus. C’est important, car l’existence d’une classe moyenne fournie est généralement considérée comme un atout pour la réussite des transitions démocratiques partout dans le monde.
La taille et la vitalité de la société civile tunisienne constituent bien sûr un autre facteur positif. L’UGTT, principale centrale syndicale du pays, joue un rôle de premier plan dans cette puissante société civile. Seul acteur susceptible de faire descendre les Tunisiens en masse dans la rue à son appel (87), elle constitue, du fait de son positionnement éclairé, l’un des principaux « anticorps » contre toute dérive du processus de transition.
L’UGTT : une force de stabilité essentielle dans le paysage tunisien
Depuis sa création en 1946 par Farhat Hached, grande figure de la lutte pour l’indépendance du pays, l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) joue un rôle double dans la « lutte nationale et sociale » (88) en Tunisie : celui, classique, d’une centrale syndicale revendiquant entre 750 000 et un million d’adhérents (89) et tenant un discours « responsable » dans le contexte de crise multiple de la Tunisie, mais aussi celui d’un acteur politique qui a participé à la lutte contre la décolonisation et à la construction de la Tunisie indépendante.
Après avoir joué un rôle de contre-pouvoir sous l’ancien régime tunisien, qui avait réprimé dans le sang la grève générale du « jeudi noir » – le 26 janvier 1978 –, ainsi que les « émeutes du pain » de janvier 1984, l’UGTT a progressivement été mise au pas sous Ben Ali, du moins pour ce qui est de sa direction, la centrale syndicale ayant toujours été un ensemble composite, formé d’unions régionales et locales, d’organisations sectorielles et de syndicats de base. La direction de l’UGTT avait appelé à voter en faveur de l’ancien Président tunisien en 2005 et en 2009, et Abdessalem Jrad, secrétaire général de l’UGTT entre 2001 et 2011, a été l’une des dernières personnalités à assurer Ben Ali de son soutien, la veille de son départ précipité en Arabie saoudite.
L’UGTT a ensuite très largement restauré sa légitimité historique et politique par sa participation à la « révolution de la dignité » tunisienne, en décembre 2010 et janvier 2011, d’abord par le biais de ses relais locaux, qui ont efficacement contribué à l’extension géographique du soulèvement, puis au plan national par la mobilisation de ses instances dirigeantes et par un appel à la grève générale, quelques jours avant la fuite de Ben Ali. Sa direction a été largement renouvelée lors de son 22e Congrès, organisé à Tabarka du 25 au 29 décembre 2011, sous la devise : « Ô, Peuple, je t’aime », citation emblématique de Farhat Hached. Un nouveau secrétaire général, Houssine Abbassi, ancien instituteur et secrétaire général de l’Union régionale du travail de Kairouan, a été élu. Depuis la révolution de 2011, l’UGTT continue à jouer un rôle de premier plan en Tunisie et entend manifestement peser sur la transition démocratique en cours.
Sa particularité, en tant qu’acteur de la scène politique, est de ne pas concevoir son rôle comme étant de même nature que celui des partis. Si l’UGTT ne vise pas à exercer le pouvoir ou à participer au Gouvernement, elle ne renonce pas, en revanche, à intervenir pour exercer une influence, de nature stabilisatrice, sur le processus démocratique. En octobre 2012, l’UGTT a ainsi lancé une « initiative de dialogue national », boycottée par Ennahda et le CPR, en vue de préparer une feuille de route pour la suite de la transition. Devant la crise politique suscitée par l’assassinat du député Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013, l’UGTT a entrepris un nouvel effort de médiation entre la « Troïka » au pouvoir et l’opposition, conjointement avec le syndicat patronal UTICA – Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat –, l’Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l’homme, qui ont formé un « quatuor » atypique rassemblant les principales forces de la société civile.
En parallèle de ce rôle de médiation entre les parties (90), l’UGTT s’est positionnée de facto en contre-pouvoir à Ennahda, avec laquelle les relations s’étaient d’ailleurs très sensiblement dégradées à la fin de l’année 2012. Le bras de fer s’était alors accompagné d’attaques violentes contre des syndicalistes dans la région déshéritée de Siliana au mois de novembre, dans des circonstances contestées, mais aussi devant le siège de la centrale syndicale à Tunis en décembre, au moment de la commémoration de l’assassinat de Farhat Hached. Au-delà de ces violences et quelles qu’aient été les responsabilités dans leur déclenchement, le rôle politique de l’UGTT est critiqué de manière récurrente par les islamistes, qui préféreraient voir la centrale tunisienne se cantonner à une vocation strictement syndicale et dénoncent un positionnement de l’UGTT qu’ils jugent ambigu, à la fois dans le camp de l’opposition et dans celui des médiateurs.
Si la Tunisie a servi de berceau aux « révolutions arabes » de 2011 et pourrait continuer à jouer un rôle déterminant d’exemple, étant le pays où la transition démocratique paraît avoir le plus de chances de réussir aujourd’hui, l’Egypte occupe aussi une place centrale et très symbolique, ne serait-ce que parce qu’elle rassemble un Arabe sur trois.
a. L’échec de la première transition
i. 17 mois sous l’égide de l’armée
De l’aveu même de la haute hiérarchie militaire, la conduite du pays par le Conseil suprême des forces armées (CSFA), depuis la déposition de Moubarak, le 11 février 2011, jusqu’à l’investiture du président Morsi, mi-2012, a constitué une épreuve douloureuse. Lorsqu’une délégation de la mission d’information s’est rendue au Caire, au mois de février 2013, les généraux égyptiens affirmaient leur intention de se tenir désormais à l’écart du pouvoir, sauf péril imminent et irrémédiable pour la stabilité du pays, mise en garde dont les événements du 3 juillet suivant ont ensuite permis de prendre la pleine mesure.
Au plan économique, alors que le pays était entré dans une phase de sortie de crise à la fin de l’année 2010, les nouvelles autorités de transition ont dû faire face à un fort ralentissement de l’activité en raison des fermetures d’usines et de banques pendant les troubles, de la chute durable du tourisme, de la multiplication des mouvements de grève et, plus généralement, des incertitudes politiques qui ont fragilisé les perspectives économiques. Cette situation s’est accompagnée d’une dégradation des comptes publics et des comptes extérieurs, principalement du fait du tarissement des investissements étrangers, de la chute des revenus liés au tourisme, première source de devises pour le pays et premier employeur, ainsi que des sorties de capitaux.
Dans le même temps, la situation demeurait aussi très dégradée au plan sécuritaire, la police, honnie de tous et démoralisée, restant souvent aux abonnés absents, alors que l’armée n’avait ni l’expérience ni la vocation pour assurer les mêmes missions de maintien de l’ordre. Le fait que de nombreuses armes soient désormais en circulation, notamment à la suite du pillage des commissariats de police pendant les troubles révolutionnaires, a aussi contribué à la dégradation de la situation sécuritaire. Il faut noter par ailleurs que certaines manifestations ont particulièrement mal tourné pendant cette période, notamment en septembre 2011, lorsque l’ambassade israélienne a été assaillie, ou au mois d’octobre, quand une manifestation organisée devant le bâtiment de la radio et de la télévision, après des attaques d’églises coptes, s’est terminée par plus de vingt morts. En raison du vide sécuritaire général et malgré des opérations militaires spectaculaires mais probablement peu efficaces, des troubles ont également éclaté dans le Sinaï.
Au plan politique, l’image positive dont les autorités bénéficiaient à l’origine, du fait du prestige historique de l’armée et de son attitude pendant la révolution, s’est progressivement ternie. Les critiques se sont multipliées devant les incertitudes persistantes du calendrier politique de la transition, et des manifestations massives ont repris fin 2011, avec des affrontements violents, contre la tentative de faire adopter des principes supraconstitutionnels pour encadrer la future loi fondamentale, initiative perçue comme une manœuvre pour limiter les pouvoirs des institutions démocratiques à venir, en étendant le pouvoir de contrôle de l’armée. A la fin de l’année 2011, des manifestants ont ainsi fini par réclamer le départ du maréchal Tantaoui et le transfert immédiat du pouvoir à des autorités civiles élues.
ii. Une année avec les Frères musulmans
Le bilan du président Morsi et des Frères musulmans au pouvoir n’est guère plus flatteur que celui du CSFA au cours de la période précédente. La polarisation de la scène politique, qui avait commencé dès le second tour de l’élection présidentielle, n’a fait que s’accroître dans des proportions inquiétantes jusqu’au 3 juillet 2013. L’image des autorités s’est également trouvée ternie par la situation très dégradée du pays au plan économique comme en matière de sécurité et de droits de l’homme.
La polarisation politique de plus en extrême entre les Frères musulmans et ce qu’il faut appeler les forces « non islamistes », faute de terme plus adéquat, a conduit à des tensions de plus en plus vives entre les deux camps. Deux Egypte, viscéralement hostiles et irréconciliables, ont fini par s’opposer, les autorités ayant manqué de nombreuses occasions d’associer les autres forces politiques à la transition. Au contraire, plusieurs décisions ont alimenté le soupçon grandissant, dans les partis hostiles à la Confrérie et dans une fraction croissante de la population, que les Frères avaient un agenda caché d’islamisation de la société, sous des dehors volontairement rassurants, et qu’ils cherchaient en réalité à « frériser » autant que possible l’appareil d’Etat pour rester aux commandes coûte que coûte.
Une première occasion a ainsi été manquée juste après l’élection présidentielle. Contrairement à ses promesses d’être le Président de tous les Egyptiens et de nommer en particulier des chrétiens et des femmes à des postes de premier plan, le président Morsi a manifestement eu tendance à se reposer sur des Frères musulmans ou des sympathisants. Beaucoup estiment que la Confrérie n’est pas parvenue à se défaire d’une logique de repli sur soi héritée de décennies de répression à son égard, voire à sortir d’une certaine forme de paranoïa. Le président Morsi et les Frères musulmans auraient pourtant gagné à s’allier avec d’autres forces politiques, afin de partager la responsabilité d’un éventuel échec, et à s’adjoindre des compétences qui leur faisaient probablement défaut dans un certain nombre de domaines.
La déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012, destinée à protéger de toute décision de la justice, considérée comme politique, le Comité constituant, l’Assemblée de la Choura et les décrets adoptés jusque-là, a ensuite catalysé l’hostilité à l’égard du président Morsi et des Frères. Des partis d’opposition jusque-là très désunis ont alors constitué un Front de Salut National, et de nouvelles manifestations ont commencé à rassembler des foules importantes sur la place Tahrir, aux cris de « Morsi dégage ! », directement inspirés de 2011. Le 25 janvier 2013, jour symbolique, car celui de l’anniversaire de la révolution, les foules réunies au Caire, à Alexandrie, dans la ville de Suez, ou encore à Port-Saïd, ont d’ailleurs repris les anciens slogans : « Pain, liberté, justice sociale », ou encore « le peuple veut la chute du régime ».
De même, l’adoption de la nouvelle Constitution, en toute hâte et sans compromis, n’a fait qu’aggraver la situation, alors que l’occasion aurait pu être saisie alors d’associer les autres forces politiques. Le texte a ensuite été soumis à référendum dans un délai particulièrement bref de 15 jours. Bien que son contenu n’ait pas comporté de régression notable, plusieurs articles ont nourri les peurs, notamment ceux rendant la protection des droits de l’homme conditionnelle, prohibant les insultes aux prophètes, ou conférant à Al-Azhar un rôle consultatif obligatoire sur toute affaire liée à la Charia.
La responsabilité de cette tension politique de plus en plus extrême incombe naturellement au premier chef au président Morsi et à la Confrérie. Etant au pouvoir, il leur revenait de tendre la main à leurs adversaires, afin de les associer à la transition et de réduire ainsi les tensions politiques à un niveau acceptable. Mais les forces d’opposition ont aussi leur part de responsabilité. Beaucoup n’ont jamais accepté la légitimité du président Morsi et doutaient de la capacité des Frères musulmans, dépourvus de toute expérience préalable en matière de gouvernance, à diriger le pays. Les forces d’opposition ont aussi décliné les offres de négociation adressées à plusieurs reprises par les autorités, en posant comme préalables des exigences allant peut-être au-delà du raisonnable, et en tout cas maximalistes – la constitution d’un gouvernement de coalition nationale excluant le Premier ministre de l’époque, ainsi que les ministres de la justice, de l’intérieur et de la communication, dans la perspective des élections ; le renvoi d’un Procureur général très décrié et nommé dans des conditions juridiques douteuses ; la rédaction d’une nouvelle loi électorale plus consensuelle ; enfin, la révision des articles les plus contestés de la Constitution.
Au plan économique, le président Morsi et les Frères musulmans ne sont pas parvenus à redresser une situation déjà très dégradée au cours de la période précédente. La croissance du PIB n’a pas dépassé 1 ou 2 % du PIB, soit un niveau inférieur ou à peine égal à la croissance démographique. Cette situation économique peu glorieuse, surtout si l’on prend comme référence les taux de croissance de la décennie précédente, s’est accompagnée d’une dérive des finances publiques, tandis que les réserves de change se réduisaient dans des proportions inquiétantes. Beaucoup ont incriminé l’absence de compétence économique des Frères musulmans. Le contexte a également joué : la proximité des élections législatives, d’abord annoncées pour le début de l’année 2012, puis repoussées à l’automne en raison de décisions de justice, ne se prêtait guère à l’adoption de mesures économiques courageuses. Dans ces conditions, il était difficile de conclure avec le FMI un accord qui aurait pourtant permis d’apporter 4,8 milliards de dollars à l’Egypte, puis de débloquer environ 10 milliards supplémentaires en provenance d’autres institutions financières internationales.
Néanmoins, contrairement aux prédictions les plus pessimistes, l’économie ne s’est pas effondrée, sans doute en partie grâce au secteur informel, mais aussi à la hausse des revenus du Canal de Suez, malgré la crise, et à celle des transferts d’argent depuis l’étranger. Enfin, l’Egypte a bénéficié d’un filet de sécurité extérieur. Le Qatar a ainsi apporté une contribution de 8 milliards de dollars aux autorités égyptiennes, la Libye a consenti 2 milliards de dollars de prêts sans intérêts sur 5 ans, et la Turquie a aussi promis de prêter jusqu’à deux milliards de dollars.
Enfin, la situation s’est dégradée de manière inquiétante en matière d’ordre public et de droits de l’homme. Les signes en sont nombreux : des violences interconfessionnelles, notamment devant la cathédrale Saint-Marc du Caire en avril 2013 ; des poursuites judiciaires intentées contre des enseignants coptes pour « diffamation à l’égard de la religion » en Haute-Egypte ; des témoignages troublants de détentions illégales, de violences abusives contre des manifestants et d’actes de torture commis par les forces de sécurité ; des lynchages dans le Delta du Nil et la constitution de milices locales sous l’égide de groupes islamistes après un appel du Procureur général autorisant les citoyens à s’arrêter entre eux ; des poursuites judiciaires engagées contre des journalistes, notamment le célèbre satiriste Bassem Youssef ; ou encore des réticences visibles à enquêter sur les violations des droits de l’homme.
b. Nouvelle transition, nouvelle impasse ?
Jusqu’à la destitution du président Morsi par l’armée, le 3 juillet 2013, la transition égyptienne paraissait en voie d’achèvement : un Parlement bicaméral avait été reconstitué en janvier-février 2012 (91), un président de la République avait été élu au mois de juin, puis une nouvelle Constitution avait été adoptée par référendum en décembre de la même année. Le renouvellement démocratique des institutions égyptiennes devait s’achever au second semestre 2013, avec l’organisation de nouvelles élections législatives qui auraient marqué la fin du processus de transition politique.
Le président Morsi et les Frères musulmans semblaient l’avoir emporté. L’opposition, en proie à une guerre des chefs durable et divisée politiquement, était manifestement en difficulté. Quant à l’armée, elle semblait peu désireuse de revenir au premier plan pour des raisons nombreuses – les risques de sanctions américaines et européennes en cas de coup d’Etat ; le douloureux souvenir laissé par la première phase de la transition, conduite sous l’égide du CSFA ; la situation catastrophique du pays au plan économique et sécuritaire, qui ne paraissait pas devoir inciter l’armée à en assumer la responsabilité, à moins de s’exposer au risque de dégrader à nouveau son image et sa crédibilité.
Mais la donne a changé avec la campagne de signatures lancée pour exiger le départ du président Morsi et l’organisation d’élections anticipées. Bien que le nombre réel des signatures soit probablement appelé à rester inconnu, la mobilisation a été incontestablement massive, et une jonction capitale s’est opérée entre l’armée, la jeunesse révolutionnaire, l’opposition politique et le principal parti salafiste, Al-Nour, avec la bénédiction des plus hautes autorités religieuses du pays, sunnites et coptes.
Les conditions dans lesquelles le processus en cours s’est interrompu présentent un point commun avec la chute de Moubarak en 2011 : elles combinent une mobilisation massive de la rue et une intervention militaire, qualifiée par les uns de « coup de pouce » et par les autres de « coup d’Etat » (92). Il y a néanmoins une différence notable : le président destitué est le premier de toute l’histoire égyptienne à avoir été élu dans des conditions démocratiques. Il est donc difficile de ne pas voir une régression dans sa mise à l’écart, en dépit des précautions adoptées par l’armée, qui s’est abritée derrière un ultimatum demandant aux autorités civiles de répondre à des aspirations populaires, dont témoignaient d’ailleurs la campagne de signatures pour la destitution du président Morsi, puis les manifestations massives de la fin du mois de juin. Devant la résistance des autorités civiles, l’armée a justifié son intervention par la nécessité d’éviter une guerre civile, présentée comme étant sur le point d’éclater. Le général Al-Sissi a ensuite annoncé la destitution du président Morsi en présence des plus hautes autorités religieuses du pays, sunnites mais aussi coptes, ainsi que de représentants de l’opposition non islamiste et de salafistes « politiques ».
Par ailleurs, contrairement à la phase de la transition conduite sous l’égide du CSFA en 2011-2012, l’armée s’est montrée soucieuse de ne pas apparaître au premier plan, bien que le général Al-Sissi, ministre de la défense et désormais vice-premier ministre en charge de la sécurité nationale, soit très certainement le nouvel homme fort du pays. C’est un civil, Mansour Adly, jusque-là président de la Haute Cour constitutionnelle, qui est devenu Président par intérim, tandis qu’un gouvernement a été constitué sur la base des compétences, en rassemblant des personnalités non-islamistes.
La « feuille de route » consacrée par la déclaration constitutionnelle du 9 juillet a pour ambition de réaliser au plus vite un retour à la normale au plan institutionnel, en engageant une nouvelle transition à partir de zéro. Cette « feuille de route » prévoyait ainsi la rédaction en plusieurs étapes d’une nouvelle Constitution, d’abord par des experts, universitaires et magistrats, puis par une Assemblée constituante de 50 membres, avant son adoption par référendum, et enfin l’organisation d’élections législatives et présidentielles dans un délai de neuf mois à compter du début du processus. Mi-novembre 2013, le calendrier était le suivant : un référendum au mois de décembre, des élections parlementaires en février ou en mars 2014, et l’élection présidentielle au début de l’été.
Dans les circonstances actuelles, il reste à savoir non seulement dans quelle mesure et à quel rythme cette feuille de route pourra être appliquée jusqu’à son terme, mais aussi avec quels résultats. Jusqu’à présent, les Frères musulmans campent officiellement sur des positions qui paraissent irréalistes, exigeant que le président Morsi soit rétabli, et ils ont choisi de rassembler leurs partisans en masse – mais en nombre décroissant au fil du temps –, afin de démontrer leur détermination à ne pas céder. Quant à l’armée, elle s’est finalement décidée à passer en force en délogeant les manifestants, le 14 août, des campements qu’ils occupaient à Rabiya Al-Adawiya et place Al-Nahda au Caire, quitte à déclencher un bain de sang immédiatement dénoncé dans les termes les plus vigoureux par les chancelleries occidentales, qui avaient déjà mis en garde contre le placement en détention de nombreux responsables des Frères musulmans, dont le président déchu (93), et contre les poursuites judiciaires engagés à l’égard de certains d’entre eux. De nouveaux incidents particulièrement violents ont eu lieu en octobre, lors de la commémoration de la guerre de 1973.
Les efforts de médiation menés au mois d’août par l’Union européenne et les Etats-Unis, qui continuent d’appeler à un processus politique inclusif, ont manifestement échoué à rapprocher les deux camps et à éviter la confrontation. Il est vrai que la tâche s’annonçait difficile d’emblée, après l’éviction du président Morsi en dehors de toute procédure légale, puis l’arrestation de nombreux dirigeants de la Confrérie. Depuis, il paraît significatif que Mme Ashton, qui continue à se rendre en Egypte et à s’entretenir avec les deux parties, ne présente plus ses efforts comme une « médiation », ce qui a été dûment noté et localement apprécié. En réalité, les stratégies des acteurs concernés demeurent très divergentes, et l’on voit mal ce qui pourrait infléchir leurs trajectoires respectives dans l’immédiat.
Outre le fait qu’il est difficile pour les Frères musulmans de s’engager dans un dialogue ou une négociation avec les autorités, car cela impliquerait pour eux d’admettre leur échec aux affaires, ainsi que la légitimité de leur destitution, on peut penser que la situation actuelle leur permet de se poser en résistants, victimes d’une répression semblable à celle qu’ils ont déjà connue sous l’ancien régime ; elle pourrait aussi leur permettre de pousser le camp adverse, qui est assez hétéroclite, étant composé de libéraux, d’hommes politiques de gauche, de conservateurs, de membres de l’ancien Establishment et d’hommes d’affaires, à se diviser entre tenants de la méthode forte et partisans de la négociation (94).
L’autre partie a manifestement cherché à tirer profit très rapidement d’un rapport de forces qui lui est aujourd’hui favorable, en faisant le pari que sa politique va continuer à trouver grâce aux yeux d’une majorité de la population, qui serait désormais foncièrement hostile aux Frères musulmans. Le général Al-Sissi est allé jusqu’à appeler, le 26 juillet, à des manifestations aussi massives que possible pour lui donner un mandat de lutte « contre la violence et l’extrémisme », les nouvelles autorités plaçant les affrontements avec une partie des forces islamistes dans une perspective générale de lutte contre le terrorisme, ce qui peut paraître abusif. Bien que la popularité du pouvoir actuel soit difficile à évaluer précisément, tout laisse à penser qu’il jouit toujours d’un très large soutien de la population.
Quant au parti salafiste Al-Nour, il est fort possible qu’il souhaite, à court terme, ne pas subir la même répression que les Frères musulmans, qui pourraient finir par être complétement interdits, et qu’il espère ainsi, à moyen terme, occuper une place plus centrale dans l’offre politique islamiste, si la Confrérie restait durablement mise hors-jeu. Il n’est toutefois pas certain que la base électorale des salafistes restera indifférente au sort des Frères si la répression se poursuit.
Cette situation fait courir le risque d’un nouveau blocage politique durable, alors que l’interruption de la première transition, conduite sous l’égide des Frères musulmans, était précisément justifiée par l’incapacité de ces derniers à engager un dialogue avec le Front de Salut National et à privilégier des solutions de compromis. On pourrait alors se retrouver à fronts renversés : si la nouvelle transition, telle qu’elle est prévue dans la « feuille de route » du mois de juillet, était menée à son terme par un camp contre l’autre, sans compromis ni rapprochement, la situation pourrait devenir encore plus tendue et plus instable qu’à la fin de la présidence Morsi, dans un pays encore plus divisé.
La répression dont les Frères musulmans font l’objet risque aussi de faire basculer une partie des forces islamistes dans une opposition radicale. Au demeurant, un attentat contre le ministre de l’Intérieur, non revendiqué à ce stade, a été commis le 5 septembre au Caire – un tel attentat ne s’était pas produit depuis la lutte sanglante des années 1990. Le cycle de violence qui pourrait être en train de s’engager entre le pouvoir et la Confrérie, avec notamment des attaques menées en représailles contre des églises, des citoyens coptes et des commissariats, fait planer le spectre d’un retour à la chasse aux Frères musulmans et aux affrontements sanglants de la première moitié des années 1990.
Enfin, on ne peut pas exclure qu’une dislocation du camp qui a soutenu l’interruption de la transition conduite par le président Morsi et les Frères musulmans se dessine partiellement à terme. Le grand imam d’Al-Azhar a ainsi pris ses distances avec la répression sanglante des manifestations, de même que Mohamed El-Baradeï, principale figure de l’opposition libérale, qui a démissionné de son poste de vice-président après l’attaque contre les campements du Caire. Quant aux salafistes d’Al-Nour, leur position de soutien sans participation aux autorités civiles de transition risque de devenir de plus en plus intenable malgré le bénéfice qu’ils peuvent en tirer par la suite.
L’armée : un acteur incontournable
Longtemps pilier principal du régime égyptien – de 1952 à 2012, tous les Présidents étaient d’ailleurs issus du corps des officiers –, mais quelque peu marginalisée à la fin de la période Moubarak, au profit des forces de police et des hommes d’affaires, l’armée égyptienne a retrouvé un rôle de premier plan sur la scène intérieure depuis 2011.
Au plan politique, l’armée égyptienne s’est ainsi placée en arbitre pendant la révolution, d’abord en refusant de tirer sur les manifestants lorsque la police s’est effondrée, puis en poussant Moubarak à la sortie, avant d’assumer le pouvoir pendant la première phase de la transition, jusqu’à l’entrée en fonction du président Morsi fin juin 2012. Rentrée dans ses casernes et théoriquement en retrait avant sa participation décisive à la destitution de Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, l’institution militaire égyptienne a veillé à entretenir son mythe d’armée du peuple, ne faisant qu’une avec lui. Lors des manifestations organisées contre la déclaration constitutionnelle du 22 novembre 2012, par laquelle le président Morsi s’était attribué quasiment tous les pouvoirs, l’armée avait ainsi fait savoir, par la voix du ministre de la défense, que sa loyauté allait au peuple égyptien et qu’elle ne s’opposerait pas aux manifestants. Elle avait même offert ses services pour organiser une médiation sous ses auspices et dans une enceinte militaire.
Au plan institutionnel, les prérogatives de l’armée égyptienne n’ont pas été remises en cause pendant la phase de transition conduite sous l’égide des Frères musulmans, sans doute parce qu’ils ne s’estimaient pas en mesure, à ce stade, d’entrer en conflit ouvert avec une institution si puissante. Tout au plus le président Morsi avait-il renouvelé les principaux responsables militaires en août 2012, en tirant parti d’un attentat meurtrier commis dans le Sinaï pour rajeunir la pyramide des âges. Quant à la Constitution que les islamistes avaient fait adopter à la fin 2012, à leur main, elle maintenait la possibilité de traduire des civils devant des tribunaux militaires, qui avaient joué un rôle clef au sein de l’appareil répressif sous le régime de Moubarak, et consacrait la pratique selon laquelle le ministre de la défense devait être issu de l’armée. De même, l’armée gardait la haute main sur son propre budget, qui représenterait environ 10 % du budget de l’Etat, sans compter l’aide américaine, et elle jouissait d’un droit de regard, par l’intermédiaire du Conseil de défense nationale, sur les dispositions législatives la concernant.
L’armée égyptienne est également un acteur de premier plan en matière économique. Son « poids » réel, qui fait l’objet de nombreuses spéculations, est estimé entre 10 et 50 % du PIB, ces deux chiffres paraissant l’un sous-évalué, l’autre exagéré. L’armée égyptienne gère notamment des infrastructures routières et de traitement des eaux, produit des biens de consommation, en particulier du pain et du textile, et s’est lancée dans de nombreuses activités commerciales, comme le tourisme et la distribution d’essence au détail. La constitution de ce patrimoine économique considérable est officiellement justifiée par la nécessité, pour l’armée, de subvenir à ses propres besoins et de réaliser des économies d’échelle. Son immense capital foncier, qui comporte notamment la majorité des terrains situés entre le Nil, le canal de Suez et la Mer rouge, constitue son principal atout, outre sa main d’œuvre pléthorique, jeune et bon marché. Ces activités économiques civiles doivent être distinguées du champ couvert par le complexe militaro-industriel, même si certaines usines d’armement, telles que l’Arab Organization for Industrialisation, initialement à vocation panarabe et désormais propriété de la seule Egypte, fabriquent aussi des biens majoritairement destinés au marché civil.
Sociologiquement, les officiers égyptiens passent pour être très conservateurs et très pieux, dans leur écrasante majorité, à l’image de leur chef actuel, le général Abdel Fatah Al Sissi, sans être proches pour autant des Frères musulmans. L’accès de ces derniers aux académies militaires était au demeurant interdit jusqu’à la révolution de 2011, et les renseignements militaires avaient notamment pour mission de préserver l’armée de toute influence islamiste. L’idée avait certes pu se répandre que Sissi, choisi par Morsi pour remplacer le maréchal Tantaoui, ancien compagnon de route de Moubarak, était proche des Frères musulmans, mais cette thèse a été violemment démentie par le rôle clef que la hiérarchie militaire a joué dans la destitution du Président islamiste en 2013.
Si l’armée égyptienne demeure la structure la mieux organisée, hiérarchisée et disciplinée du pays, seuls les Frères musulmans pouvant prétendre à rivaliser avec elle, dans une certaine mesure, les forces armées ont toutefois connu, sur un plan strictement militaire, une trentaine d’années d’apathie dans tous les domaines, qu’il s’agisse des équipements, pléthoriques mais disparates et peu modernes, des personnels – un demi-million de soldats au total, dont 10 % d’officiers, 20 % de sous-officiers et 70 % de conscrits, ces derniers étant mal rémunérés, très peu formés et mal considérés, de même que les sous-officiers –, mais aussi de la doctrine d’emploi, encore fortement marquée par le modèle soviétique. Confrontée à une dégradation inquiétante de la situation dans le Sinaï, devenu une zone de non-droit depuis la révolution et théâtre de nombreuses attaques attribuées à des groupes jihadistes depuis la destitution du président Morsi, l’armée égyptienne paraît en difficulté pour lutter contre ces actes de terrorisme et contre les trafics de toutes sortes qui s’y sont développés, malgré des opérations de grande envergure faisant notamment intervenir des chars et des avions de combat.
Les liens avec les Etats-Unis, qui ont accueilli des dizaines de milliers d’officiers égyptiens depuis les années 1980, notamment le général Sissi, sont traditionnellement forts. Ils reposent en particulier sur une aide bilatérale de 1,5 milliard de dollars par an, dont 85 % sont destinés à l’armée et qui avait été maintenue sous la présidence Morsi. En réaction aux événements récents en Egypte, Washington a cependant annoncé la suspension provisoire d’une partie de cette aide – des livraisons de matériels lourds (F16, hélicoptères Apache, missiles ou encore pièces de chars d’assaut Abrams), ainsi qu’un prêt de 260 millions de dollars. Cette décision, bien qu’elle soit mesurée et présentée comme provisoire, a suscité de vives réactions en Egypte, où le sentiment anti-américain connaît un pic. La visite du secrétaire d’Etat américain, John Kerry, le 3 novembre, a cependant donné l’impression, sinon d’un retour à la normale, du moins d’un apaisement très net dans la relation bilatérale, dont l’importance essentielle pour l’Egypte a été confirmée, malgré ce que certaines déclarations du ministre égyptien des affaires étrangères avaient pu laisser entendre précédemment.
La présence d’une importante communauté non musulmane, devenue très visible du fait des violences qu’elle subit depuis le 3 juillet dernier, est une spécificité de l’Egypte par rapport à la Tunisie et à la Libye, même s’il existe aussi des groupes « minoritaires » dans ces deux pays – Amazighs (ou Berbères), Juifs et Noirs tunisiens (95) ; Toubous, Touaregs et Amazighs, là aussi, en Libye (96). En Egypte, les Coptes représentent entre 4 et 6 %, voire 10 ou 12 % de la population, si l’on retient d’un côté les estimations officielles et, de l’autre, celles de leurs Eglises. Ils sont répartis de manière assez homogène sur l’ensemble du territoire, malgré une concentration plus importante en Haute Egypte, ainsi que dans plusieurs quartiers du Caire – ils sont ainsi majoritaires dans les quartiers de Choubra et des chiffonniers. Au plan social, les Coptes sont présents à tous les niveaux, de même que dans de nombreux secteurs de l’économie égyptienne, des chiffonniers du Caire aux capitaines d’industrie de la famille Sawiris.
Pour autant, malgré des démonstrations rituelles d’unité nationale, les Coptes demeurent parfois victimes d’ostracisme. Ils subiraient notamment une discrimination officieuse dans la fonction publique, où l’accès aux plus hautes responsabilités leur serait bloqué. Dans l’armée, s’ils ont accès au grade d’officier général, ils ne sont pas représentés au Conseil suprême des forces armées, et les services de renseignement ne leur seraient pas ouverts. Dans un autre domaine, le clergé copte dit éprouver des difficultés pour obtenir l’autorisation de construire des lieux de culte. Enfin, des tensions interconfessionnelles éclatent parfois au grand jour, notamment en milieu rural, autour de questions de propriété. A cela s’ajoutent des flambées de violence sporadiques, en particulier contre des églises. Sous le régime de Moubarak, le dernier attentat majeur contre une église copte avait fait 23 morts et 79 blessés en 2011 à Alexandrie, à la sortie de la messe du Nouvel an.
Si les autorités religieuses se sont tenues à distance de la révolution de 2011, de nombreux Coptes y ont participé à titre individuel, comme le reste de la population, au-delà des frontières confessionnelles. Ce moment de communion nationale, qui s’est notamment traduit par des prières collectives sous la conduite d’imams et de prêtres coptes, n’a pourtant été que de brève durée. Les tensions interconfessionnelles sont réapparues au grand jour dès mars 2011, sous la forme d’attaques contre des églises et de heurts sanglants avec l’armée. On a ainsi compté de nombreuses victimes en octobre 2011, lors d’une manifestation organisée devant Maspero, le bâtiment de la radio et de la télévision, en réaction à l’incendie d’une église copte dans la région d’Assouan.
La situation s’est encore dégradée après le 3 juillet 2013, et surtout depuis la dispersion sanglante des partisans du président Morsi, le 14 août. Les autorités religieuses coptes ayant publiquement apporté leur soutien au brusque retournement de la situation politique, par l’intermédiaire du pape Tawadros II, patriarche de l’Eglise copte orthodoxe, les attaques se sont multipliées contre les personnes et les biens – églises, écoles, maisons et commerces appartenant aux Coptes. Le grand imam d’Al-Azhar, qui représente la plus grande institution sunnite du pays, avait pourtant apporté lui aussi sa caution aux événements. Selon le pape copte Tawadros II, plus de 200 biens fonciers appartenant à des chrétiens ont été attaqués le 14 août dernier, et 43 églises entièrement détruites ; un récent rapport fait aussi état de quatre Coptes tués, dans des violences interconfessionnelles, les 14 et 15 août (97). Fin octobre, des quotidiens égyptiens avançaient des chiffres plus élevés encore, allant jusqu’à 17 Coptes assassinés et 85 églises brûlées.
Même si les tensions interconfessionnelles sont anciennes en Egypte, elles ont manifestement franchi un seuil. Cette explosion brutale et massive de violence est généralement imputée aux Frères musulmans, des prédicateurs fondamentalistes et une partie de la base de la Confrérie accusant les chrétiens d’avoir contribué à la destitution du président Morsi, voire dénonçant un complot copte dirigé contre les Frères musulmans. Les forces de sécurité ont également été mises en cause pour leur manque d’anticipation de ces violences et pour leur inaction, coutumière en la matière et diversement interprétée. Ces attaques ont été officiellement condamnées par le Gouvernement, qui présente, de manière générale, les affrontements intervenus depuis juillet sous un angle purement terroriste.
Que les récentes attaques aient été spontanées ou provoquées afin de semer le chaos dans le pays, en manipulant une question sensible à l’étranger, elles suscitent en tout cas des craintes très vives dans la communauté copte, en particulier au sein de la diaspora, déjà nombreuse. Les récits d’exode, dont l’ampleur réelle est difficile à évaluer, contribuent ainsi à étayer l’idée que la présence copte en Egypte pourrait connaître un sort comparable à celle de la communauté chrétienne en Irak.
Les efforts de réconciliation nationale, qui seront particulièrement nécessaires du fait de la gravité des violences actuelles, ne concerneront donc pas seulement la sphère politique ou partisane, mais aussi les relations interconfessionnelles. A terme, l’accès des Coptes à une pleine citoyenneté implique aussi la construction d’institutions judiciaires et policières dignes d’un Etat de droit. Le règlement du « problème copte » demanderait enfin une lutte de plus longue haleine, sur le terrain et notamment dans le domaine de l’éducation, contre les pratiques discriminatoires dont cette partie de la population égyptienne peut être victime.
Leurs représentants religieux et leurs élus ne demandent pas aujourd’hui de garanties spécifiques en tant que minorité, approche qu’ils rejettent, comme la mission d’information a pu le constater à l’occasion d’une réunion à Paris avec une délégation de l’Assemblée de la Choura – ils demandent le traitement dû à des citoyens égyptiens à part entière. C’est bien l’une des attentes légitimes que l’on peut placer dans le nouveau pacte national qui doit voir le jour après la révolution de 2011.
Pays alliant des ressources pétrolières importantes, des avoirs financiers considérables (98) et une population peu nombreuse, la Libye n’a pas à affronter le même « fardeau social » que d’autres – c’est du moins l’expression utilisée par Mohamed Megarief, alors Président du Congrès général national et chef de l’Etat, devant une délégation de la mission d’information. Mais il reste à solder les comptes des 42 années passées sous Kadhafi, qui « considérait les Libyens comme des animaux et la Libye comme sa ferme », selon un autre interlocuteur rencontré à Tripoli, et à se défaire d’un héritage encombrant laissé par la révolution : les « katibas », ces brigades qui ont profité du vide institutionnel pour prendre en main la sécurité.
Tous les interlocuteurs de la mission d’information, à Paris comme à Tripoli, ont insisté sur le fait que les nouvelles autorités libyennes, contrairement aux autorités égyptiennes et tunisiennes, ne pouvaient pas s’appuyer sur les structures d’un Etat qu’elles auraient reçu en héritage. Kadhafi avait organisé une sorte de dépérissement des institutions centrales (la « Jamahiriya » ou « massocratie »), au profit de structures pseudo décentralisées – congrès populaires ou encore comités révolutionnaires. En réalité, le pouvoir se trouvait entre les mains de réseaux informels autour de Kadhafi et des clans ou tribus alliés à lui. Après plusieurs tentatives de coup d’Etat, l’armée avait elle aussi été marginalisée au profit de divers bataillons de sécurité et gardes prétoriennes. Aujourd’hui, ce qui reste de l’appareil d’Etat ne paraît pas réellement en mesure de faire fonctionner la Libye comme les autorités politiques le souhaiteraient.
S’il existe une fonction publique, au demeurant très nombreuse – puisqu’elle pourrait compter jusqu’à 1,3 million de fonctionnaires (99), dont beaucoup sont des fonctionnaires « virtuels » –, il semble qu’elle ne compte guère de services efficaces, capables d’exercer partout les fonctions régaliennes. L’administration a notamment vu des agents, pourtant compétents, partir en exil après la révolution, et l’action publique souffre d’un certain nombre de dysfonctionnements : un manque réel de coordination interministérielle, voire des conflits internes au sein du Gouvernement, y compris entre le Premier ministre et les ministères techniques ; un défaut de coordination avec les échelons locaux, qui échappent en très grande partie à l’emprise du pouvoir central ; un défaut général d’autorité sur le « pays réel », dans une très large mesure en situation d’autogestion, le « pays légal » tournant alors de plus en plus à la fiction.
Faute de disposer d’une administration efficace et surtout d’une véritable armée et d’une véritable police susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du territoire pour assurer leurs missions, les autorités ne disposent pas des moyens nécessaires pour appliquer leurs politiques publiques et pour asseoir l’autorité de l’Etat. Cette situation de grande faiblesse a de multiples conséquences.
– Tout d’abord, les ressources du « pouvoir central » – ou des institutions qui devraient en tenir lieu – ne sont pas fermement assurées en Libye, comme l’a montré la crise des installations pétrolières, déjà présentée dans le cadre de ce rapport.
– Ensuite, cette situation ne permet pas d’exercer un véritable contrôle sur les frontières (100), qui s’impose pourtant comme une nécessité dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et la dissémination des armes, mais aussi la gestion des flux migratoires, comme l’a récemment montré le drame de Lampedusa (101). Une mission de formation et de conseil de l’Union européenne, EUBAM Libye (102), a certes été déployée mi-2013, mais les conditions de sécurité entravent son activité sur le terrain. Les conseillers européens ne pourraient guère quitter leur hôtel, qui aurait lui-même été visé par une attaque au mortier, fin juillet.
– Plus généralement, les capacités très réduites de l’Etat libyen rendent difficile tout projet de coopération. On peut s’efforcer de signer des accords, tâche parfois longue et incertaine, les interlocuteurs changeant souvent et étant parfois en désaccord avec les orientations directement fixées par le Premier ministre, mais surtout la question se pose ensuite des moyens et des interlocuteurs disponibles pour assurer leur mise en œuvre. C’est notamment le cas, dans le domaine des frontières, pour les accords qui ont été conclus afin d’organiser des patrouilles conjointes et des échanges d’information.
– Au plan intérieur, l’absence d’autorité de l’Etat conduit à privilégier systématiquement l’achat de la paix sociale par la redistribution des ressources financières, qu’il s’agisse de tempérer les anciens révolutionnaires, les « fédéralistes » qui contestent le pouvoir central, ou encore les forces chargées de veiller sur les installations pétrolières.
– Enfin, la sécurité demeure très largement entre les mains des brigades armées, apparues depuis la révolution et constituées sur des bases locales et tribales. Ces milices (ou « katibas ») sont à la fois le principal outil disponible pour assurer la sécurité et souvent aussi l’origine de violents incidents au plan local. Ces groupes sont très divers : il peut s’agir de brigades directement issues des combats menés pendant la révolution, de milices de quartier, de milices islamistes, ou encore de bandes impliquées dans des opérations de nature criminelle de toutes sortes – trafics de cigarettes, de drogue, d’alcool, de produits pharmaceutiques, de bien subventionnés (103) ou encore d’êtres humains.
Malgré les annonces successives de démantèlement de ces « katibas » et d’actions de réintégration de leurs membres, les brigades ne se sont pas réellement affaiblies depuis la révolution – elles se sont plutôt ancrées dans le paysage libyen. Ne pouvant compter, pour l’essentiel, que sur des forces spéciales issues de l’ancienne armée et présentant le défaut d’être à la fois peu nombreuses et faiblement équipées, le Gouvernement a délégué des missions à certaines milices, agissant officiellement sous l’égide des ministères de l’intérieur ou de la défense, afin de garantir un minimum de sécurité, tout en essayant d’intégrer les milices à des structures étatiques, sans véritable succès jusqu’à présent.
Des milices omniprésentes en Libye
Le nombre exact des anciens révolutionnaires libyens (les « Thuwars ») qui seraient toujours en armes est souvent estimé à 200 000 ou 250 000 hommes, mais ce chiffre reste indicatif, malgré la constitution d’une « Warriors Affairs Commission » qui s’est efforcée de les recenser. Certaines sources évoquent un total de 300 unités, de taille et de dénominations diverses – bataillons, compagnies, brigades –, quand d’autres placent la barre jusqu’à 1 500, voire 2 000 groupes.
Le fait que ces brigades demeurent les maîtres du jeu au plan sécuritaire, deux ans après la proclamation officielle de la libération du pays, le 23 octobre 2011, a été récemment démontré par le bref enlèvement du Premier ministre Ali Zeidan, le 10 octobre dernier, dans des circonstances qui ne sont pas entièrement élucidées. Cet enlèvement a d’abord été revendiqué par le « centre d’opération des révolutionnaires », créé en juillet 2013 par le Président du Congrès général national (CGN), pour rassembler des milices officiellement placées sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur. Cette structure a ensuite démenti son implication dans l’enlèvement, attribué à des branches dissidentes. Quelques jours après cet événement, Ali Zeidan a reconnu que la Libye n’était pas un Etat « au sens normal du terme ».
Ne disposant pas des moyens de coercition nécessaires pour imposer le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des milices, le Gouvernement a poussé à leur rassemblement sous l’égide des autorités légales. Un « bouclier libyen » (« Libyan Shield Forces »), qui pourrait regrouper 70 000 hommes, a ainsi été constitué et placé sous l’autorité nominale du chef d’Etat-major, quand d’autres brigades, qui pourraient compter un nombre d’hommes au moins égal, ont été placées sous l’autorité théorique du ministère de l’intérieur, dans le cadre du « Supreme Security Committee » (SSC), d’abord constitué à Tripoli pour assurer la sécurité à titre transitoire, puis élargi au plan national. Mais ces milices ont été enrôlées collectivement, avec leur hiérarchie, et elles ont conservé une importante autonomie d’action, comme l’a montré la participation de certains éléments relevant du « Bouclier Libyen » et du SSC au siège des ministères régaliens organisé en mai 2013 pour faire adopter la loi sur l’isolement politique (104).
L’absence de contrôle réel sur les milices, qui se partagent le terrain, se traduit par de multiples incidents, y compris dans la capitale. Au mois de juin, des affrontements violents ont ainsi opposé pendant deux jours des brigades issues de Zintan, qui ont joué un rôle important dans la libération de Tripoli et qui sont théoriquement affiliées au ministère de la défense, et d’autres groupes relevant du SSC et théoriquement placées sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Ces affrontements, qui ont fait au moins dix morts, ont conduit au remplacement du ministre de la défense, Mohamed Al-Barghati. Quelques jours plus tôt, à Benghazi, des manifestations contre la présence d’unités affiliées au « Bouclier libyen » avaient fait au moins trente morts et poussé à l’intervention des forces spéciales « Al-Saeqa ».
A la suite de ces graves affrontements à Benghazi, le Congrès général national a adopté une Décision n°53 demandant au Premier ministre de présenter une proposition pour l’intégration des brigades armées dites « légitimes » au sein des forces de sécurité régulières et le démantèlement de celles considérées comme « illégitimes ». En octobre 2013, ces milices étaient toujours implantées dans le paysage libyen. Pour de nombreuses raisons, le démantèlement des « katibas » ou leur intégration, pour une partie d’entre elles, dans les forces de sécurité, demeure une perspective probablement encore lointaine.
– Tout d’abord, de nombreux révolutionnaires refusent de rendre leurs armes à des institutions qu’ils considèrent comme n’étant pas réellement légitimes, alors qu’eux-mêmes se sentent investis d’une mission depuis leur participation à la révolution, dont ils s’estiment être les seuls véritables dépositaires. Leur défiance à l’égard du Gouvernement et du Congrès général national ne paraît pas reculer, bien au contraire.
– Ensuite, malgré la constitution d’un Haut comité des « Thuwars », à l’initiative du Premier ministre, les anciens révolutionnaires se sentent exclus du processus de transition, sans qu’ils envisagent pour autant de constituer un mouvement politique les représentant au plan national. Même s’ils en avaient la tentation, ils seraient probablement trop divisés pour s’unir. Les armes restent donc leur seul levier pour continuer à peser, comme ils le souhaitent, sur un avenir de la Libye qui peine encore à se dessiner.
– A cela s’ajoutent non seulement une hostilité manifeste à l’égard d’un embryon d’armée nationale jugée insuffisamment épuré, mais aussi la crainte, au demeurant probablement fondée, que la haute hiérarchie militaire, déjà pléthorique à partir du grade de colonel, ne fasse que peu de place aux chefs actuels des milices, dont les unités sont souvent jugées trop politisées, trop islamistes et trop peu disciplinées.
– Enfin, les autorités libyennes demeurent trop faibles pour imposer, si nécessaire par la force, l’intégration d’une partie des effectifs des « katibas » dans les forces de sécurité régulières – l’armée, la police ou une « garde nationale » qui pourrait être créée en tant que force supplétive –, ainsi que le démantèlement des unités qui n’auraient pas vocation à perdurer. Fox News a ainsi révélé qu’un camp où les forces spéciales libyennes suivaient une formation dispensée par des Américains a été attaqué, le 4 août dernier, par une milice qui se serait alors emparée d’équipements « très sensibles ».
Afin de reprendre la main, les autorités libyennes ont annoncé un plan de formation à l’étranger d’une vingtaine de milliers de soldats, appelés à constituer un nouveau corps (« General Purpose Force »). Plusieurs Etats auraient accepté d’y participer, notamment les Etats-Unis, mais ce plan reste à mettre en œuvre effectivement, ce qui n’est pas encore certain et ce qui prendra de toute façon du temps. Une telle force pourrait être utile pour « convaincre » les milices de rendre leurs armes ou de s’intégrer dans les forces régulières, mais certains redoutent qu’une confrontation ne plonge le pays dans une crise sécuritaire plus grave encore, ou bien que cette future nouvelle force ne se transforme en une milice supplémentaire dans un paysage sécuritaire déjà très fragmenté, voire en une garde prétorienne si son contrôle était défaillant.
En tout état de cause, les défis sont multiples et nécessiteront une action de longue haleine. Il faudra corrélativement améliorer l’équipement et la formation des forces de sécurité nationales, les doter d’objectifs et d’une architecture clairement définis, assurer au moins une parité de rémunération avec les milices, afin d’attirer des recrues de bon niveau ; intégrer dans les forces de sécurité les miliciens qui peuvent l’être, en créant un corps semblable à une gendarmerie ou à une garde nationale, tout en veillant à assurer une certaine diversité géographique au sein des futures unités, afin d’éviter la reconstitution de milices ; démobiliser et désarmer les brigades qui ne pourront pas être intégrées dans les nouvelles forces de sécurité ; offrir des perspectives aux éléments démobilisés (emploi ou formation), remédier à ce qui est perçu comme un manque de légitimité des institutions sécuritaires et politiques du pays, mais aussi assurer un développement social et territorial plus équitable, afin de contrer l’autonomisation dont la montée en puissance des milices s’est accompagnée – Zintan, Misratah ou encore Benghazi sont ainsi devenues des sortes de « principautés » échappant au contrôle du Gouvernement.
Il résulte de cette impuissance de l’Etat une situation sécuritaire très dégradée et fort inquiétante, qui se manifeste notamment par des attaques contre des représentations diplomatiques – ce fut ainsi le cas pour le consulat des Etats-Unis à Benghazi, le 11 septembre 2012 (105) et pour l’ambassade de France le 23 avril 2013, au moment où une délégation de la mission d’information se trouvait d’ailleurs à Tripoli (106). On assiste aussi à des affrontements sporadiques entre groupes armés dans les principales villes du pays. Quant à l’assassinat d’Abdessalam al-Mismari, avocat qui avait été très impliqué dans la révolution libyenne, il a suscité au mois de juillet un mouvement de colère qui montre l’exaspération croissante de la population à l’égard de cette impuissance de l’Etat.
La situation est particulièrement dégradée en Cyrénaïque, où de nombreux attentats ont eu lieu contre des responsables des forces de sécurité et contre des postes de police ou des institutions judiciaires. Le mouvement extrémiste Ansar al-Charia a pignon sur rue à Benghazi, où il développe ses activités caritatives et de prosélytisme, et où il est soupçonné de servir de plateforme pour l’accueil, l’entraînement et l’envoi en Syrie de volontaires pour le « Jihad ». Par ailleurs, cette ville qui fut le berceau de la révolution se vide progressivement de toute présence occidentale. Le consul général de Malte, évacué mi-octobre après un attentat contre le consulat honoraire de Suède, aurait été le dernier diplomate occidental demeurant encore à Benghazi. Notre consul honoraire avait pour sa part été victime d’un mitraillage sur son véhicule au mois de juillet, et l’Institut français avait été « gelé » dès le mois de janvier. A Derna, c’est la brigade islamiste des martyrs d’Abou Salim qui fait régner l’ordre jusqu’à présent.
En Tripolitaine, outre des actions terroristes contre des représentations occidentales, commises là aussi, on constate une montée en puissance de la délinquance et de la criminalité de droit commun, profitant du vide sécuritaire et se traduisant par des vols en tous genres, notamment de voitures avec menaces ou violences contre le conducteur, par des cambriolages, ou encore par des trafics de toutes natures. La situation peut occasionnellement dégénérer en affrontements violents entre bandes armées et forces de l’ordre, parfois pendant plusieurs heures, voire plus d’une journée. Comme indiqué précédemment, la capitale n’est pas non plus épargnée par les heurts sporadiques entre milices rivales, notamment celles de Zintan et de Misratah.
Quant au Sud libyen, territoire désertique comprenant le Fezzan et le Sud de la Cyrénaïque, dont la superficie équivaut à celle de la France, mais qui n’est peuplé que de 500 000 ou 1 million de personnes, tout au plus, et qui est isolé du reste de la Libye à tous égards, plusieurs facteurs concourent à sa déstabilisation croissante depuis 2011 :
– le développement de trafics multiples, notamment de drogue (héroïne, cocaïne, cannabis), de biens subventionnés et d’armes en provenance des arsenaux considérables que Kadhafi avait accumulés ;
– les risques de reflux et d’implantation d’extrémistes depuis le Mali, qui pourraient tendre à faire du Sud libyen une zone de refuge, tout en tissant des liens avec les islamistes de Benghazi et de Derna ;
– des troubles fomentés par d’ex-kadhafistes, à qui est notamment imputée la responsabilité de plusieurs attaques à Sebha en 2013 ;
– enfin, des tensions entre groupes d’origines diverses, notamment entre des communautés arabes et des Toubous (107) ou Touaregs, les rivalités autour des flux transfrontaliers ayant notamment fait 300 morts à Koufra.
Bien que les autorités aient fait du Sud libyen, de l’Algérie à l’Egypte, une zone militaire, l’armée libyenne n’exerce pas un contrôle effectif sur le terrain. Elle se contente généralement de quelques survols et de quelques frappes sur des convois de trafiquants identifiés. Même avec les meilleurs équipements possibles, les conditions difficiles qui y règnent, l’absence d’infrastructures et la nature du terrain en feraient de toute manière un espace difficile à contrôler. Le Gouvernement s’en remet à une sorte d’équilibre entre « katibas » d’origines touboues, touaregs et arabes, ainsi qu’à des milices originaires de Zintan.
Les autorités se sont par ailleurs efforcées de développer des coopérations avec les pays frontaliers, où le Premier ministre Zeidan s’est rendu régulièrement dès son entrée en fonction, mais ces efforts peinent à se concrétiser, notamment en raison du manque de capacités des autorités libyennes, qui a été présenté plus haut. A la suite d’une première conférence ministérielle régionale sur la sécurité aux frontières, organisée à Tripoli en mars 2012, une nouvelle conférence devait se tenir mi-novembre 2013 à Rabat.
Au plan national, il manque probablement une approche intégrée, combinant d’une part le développement socio-économique, qui pourrait reposer sur le désenclavement des zones frontalières et sur une réorientation des importantes ressources financières du pays en faveur d’un « plan Marshall » pour le Sud, afin de lutter contre sa marginalisation, propice à une implantation de groupes extrémistes, et d’autre part une meilleure association économique et politique des minorités touboues et touaregs – il faudrait notamment veiller à ce qu’elles disposent de ressources ne provenant pas des flux transfrontaliers et favoriser leur accès à la nationalité libyenne.
b. Un état de faiblesse préoccupant au plan politique et institutionnel
Les difficultés que connaissent les institutions au plan matériel et sécuritaire se doublent d’un conflit de légitimité. Les instances issues du scrutin de juillet 2012, Congrès général national (CGN) et Gouvernement, voient en effet leur autorité contestée par d’anciens révolutionnaires, dont les milices sont une émanation puissante sur la scène intérieure libyenne. Mis à l’écart du processus démocratique en cours depuis l’organisation des élections, ils estiment avoir encore un rôle à jouer, en particulier lorsque leurs propres intérêts sont en jeu. A cela s’ajoutent des loyautés tribales encore très fortes, qui peuvent venir contrecarrer les logiques politiques.
Ce conflit de légitimité s’est notamment traduit par l’occupation des locaux du Congrès par des acteurs peu embarrassés à l’idée de faire adopter des dispositions législatives en recourant à des méthodes d’intimidation. Ce fut le cas pour l’indemnisation des blessés de la révolution, mais aussi pour la loi d’isolement – ou d’exclusion – politique. Des individus lourdement armés sont allés jusqu’à tirer sur le véhicule du président Megarief et à encercler le Parlement et les principaux ministères, afin qu’un texte soit adopté, début mai 2013, pour exclure tous ceux ayant exercé des responsabilités sous le régime précédent, c’est-à-dire depuis 1969.
Beaucoup ont vu dans ce coup de force politique une manœuvre des exclus des élections de juillet 2012 – les forces qui se parent aujourd’hui d’une légitimité révolutionnaire pour exercer une influence sur le cours de la transition démocratique –, mais aussi des battus du suffrage, notamment les grands perdants de l’élection que sont les forces islamistes. Cette loi, qu’un des interlocuteurs de la mission d’information n’a pas hésité à qualifier de « loi des suspects », répond à une demande de justice légitime, présentée par ses partisans comme une simple continuation de la révolution, mais elle pourrait aussi créer un vide politique dangereux si elle avait pour effet de congédier les responsables politiques qui ont joué un rôle éminent dans la transition, notamment Mahmoud Jibril, l’ancien président du CNT – c’est d’ailleurs probablement l’un des buts de ceux qui ont fait pression sur le Congrès pour qu’il adopte le texte. On notera en particulier le rejet d’une disposition qui aurait pu introduire une certaine flexibilité en permettant de ne pas appliquer la loi à ceux qui auraient soutenu précocement la révolution.
Il est sans doute encore trop tôt pour apprécier les conséquences de cette loi, malgré la démission rapide du président Mohamed Megarief, qui a devancé son application, ayant été ambassadeur de Kadhafi en Inde, avant de faire défection en 1980 pour devenir l’un des principaux opposants au régime. D’autres démissions, présentées sous divers motifs, ont suivi, notamment celles du premier vice-Président du CGN, Juma Attiga, ainsi que celles de plusieurs ministres. La loi d’exclusion politique, qui pèse aujourd’hui comme une épée de Damoclès, pourrait avoir des conséquences non seulement absurdes, mais aussi particulièrement désastreuses pour la suite de la transition politique. Elle risque en effet de décapiter le fragile Etat libyen en le privant des compétences qui lui sont nécessaires pour parvenir à s’affirmer dans un contexte globalement peu favorable. Si une application maximaliste de cette loi devait être retenue, l’actuel Premier ministre, Ali Zeidan, qui se signale par sa grande lucidité politique, pourrait lui-même être écarté. Beaucoup pensent que le texte pourrait en réalité être utilisé à terme par les islamistes comme instrument pour accroître leur influence d’une manière déterminante.
A ces faiblesses d’ordre politique, les unes avérées et les autres potentielles, s’ajoute une double faiblesse institutionnelle.
Le Congrès général national, qui est politiquement peu structuré, en particulier chez les « indépendants » – 80 des 200 sièges étaient réservés aux partis politiques et les 120 autres aux candidats « indépendants » – fonctionne assez mal. La coalition des Forces nationales est certes arrivée en tête pour les sièges attribués aux partis, mais elle ne forme pas un bloc solide, et les majorités sont en réalité très fluctuantes et difficilement prévisibles selon les sujets. Deux camps semblent toutefois se dessiner progressivement : d’un côté, ceux qui estimeraient que la révolution est allée suffisamment loin, notamment les « libéraux » des « Forces nationales », qui ont annoncé un boycott du CGN après l’adoption de la loi d’isolement politique ; de l’autre, des acteurs qui aspirent à un changement plus profond, en particulier du côté des Frères musulmans.
Ensuite, les rapports entre l’exécutif et le pouvoir législatif sont assez conflictuels. Certains estiment que le législateur, prenant trop à cœur sa fonction de contrôle, demande excessivement des comptes au Gouvernement, ne facilitant pas la tâche, déjà redoutable, de ce dernier, alors qu’il ne parvient pas lui-même à exercer pleinement sa fonction législative. De fait, le bilan du CGN est assez mince, 15 mois après son élection, hormis l’adoption de la loi très controversée sur l’exclusion politique et de celle relative aux élections constituantes. Il faut ajouter que la position des Frères musulmans est relativement complexe : ils participent au gouvernement d’union nationale, mais ils le critiquent au sein du Congrès, allant jusqu’à demander la démission du Premier ministre, qu’ils accusent d’être incapable de rétablir la sécurité et de lutter contre la corruption.
Il en résulte manifestement des difficultés pour continuer la transition. Alors que la première phase du processus avait vu des avancées régulières – proclamation de la libération en octobre 2011, constitution d’un gouvernement de transition en novembre, élections en juillet 2012, puis formation d’un nouveau gouvernement de transition conduit par Ali Zeidan en octobre 2012 –, la situation évolue beaucoup plus difficilement depuis cette dernière date. Au moment où ce rapport est écrit, il n’y a plus de calendrier connu pour l’adoption de la Constitution, ni pour les prochaines élections. Or, même si les calendriers ne sont pas toujours tenus, ils ont au moins l’avantage d’offrir un peu de visibilité et de pousser à avancer.
On s’approche maintenant du terme des 18 mois, à compter de l’entrée en fonction du Congrès général national, qui a été fixé par la Déclaration constitutionnelle d’août 2011, sans que rien n’ait été prévu pour organiser une troisième période transitoire, après le CNT de la période révolutionnaire, puis l’actuel CGN. Plusieurs hypothèses sont envisagées au-delà du 7 février 2014 : la prorogation du mandat du CGN ; le transfert des pouvoirs au futur Comité constituant, dès qu’il aura été élu ; un intérim exercé par le président de la Cour suprême ; voire la dissolution des pouvoirs constitués au profit des « thuwars », ce qui reviendrait à saborder la transition telle qu’elle s’est engagée jusqu’à présent.
Quoi qu’il en soit, deux ans après la proclamation officielle de la libération nationale, c’est le scepticisme qui prévaut au sein de la population, voire un rejet du processus politique. Quant au Premier ministre Ali Zeidan, il a d’ailleurs fait savoir après son bref enlèvement, début octobre, qu’un certain nombre de milices, mais aussi de forces représentées dans l’administration et au Congrès, notamment des islamistes, s’efforçaient par tous les moyens d’empêcher le Gouvernement de reconstruire l’appareil sécuritaire et de stabiliser le pays.
c. La force des identités tribales et régionales
Outre la segmentation sécuritaire du pays et la concurrence entre plusieurs modes de légitimité, l’un démocratique et l’autre tiré de la révolution, la situation libyenne présente une troisième spécificité par rapport celles de la Tunisie et de l’Egypte : même s’il existe un sentiment national, selon les interlocuteurs de la mission d’information, la force des identités « primaires », notamment tribales et régionales, rend particulièrement difficile la « reconstruction nationale » qui s’impose en Libye, comme partout ailleurs au demeurant, après la révolution.
Le tribalisme, plus ou moins prononcé – il est moins fort dans la Libye côtière et des villes que dans le Sud du pays – mais réel, n’a pas attendu la révolution de 2011 pour devenir une force structurante et régulatrice en Libye. Il a été mis de côté par Kadhafi dans les premières années, révolution socialiste et arabe oblige, avant d’être ouvertement récupéré et exploité par le système, qu’il s’agisse de répartir les responsabilités, d’organiser les forces paramilitaires, de redistribuer la rente pétrolière ou plus généralement d’attribuer des ressources et des monopoles, en faisant passer en premier des tribus jusque-là moins importantes que d’autres dans l’histoire du pays, les Qadadfa et leurs alliés, les Magariha et les Warfalla. Le Livre vert va jusqu’à consacrer deux sections entières à la tribu et à ses « avantages », décrits par Kadhafi comme ceux d’un « parapluie social naturel assurant la sécurité dans la société ».
Avec la disparition de la « régulation » qu’assuraient malgré tout Kadhafi et sa mafia, les modes de coexistence sont à redéfinir et il n’est pas étonnant que les liens tribaux soient sollicités pour combler le vide. Reposant sur une appartenance commune à un ancêtre éponyme, ces liens recouvrent des relations de solidarité à l’intérieur du groupe, dont le représentant (le « cheikh ») assure un rôle de représentation vis-à-vis de l’extérieur et de médiation, à l’intérieur du groupe comme à l’égard des autres groupes, grâce à son autorité de nature morale – et non hiérarchique. A la négociation sous la tente de Kadhafi se substituent d’autres formes de négociation, faisant appel aux anciens réunis en conseils, afin d’assurer le retour au calme après une explosion de violence.
Malgré des incidents sérieux et répétés, il convient en effet de ne pas noircir le tableau : la violence reste plus ou moins contenue en Libye grâce à ce type de médiation, qui empêche le pays de sombrer dans un scénario à l’irakienne ou à la somalienne, alors que les ferments sont en partie réunis. Par ailleurs, ce repli sur les identités primaires paraît moins grave pour l’avenir que dans un pays comme la Syrie, toute la population libyenne ou presque étant sunnite, même si tous ne sont pas arabes – le pays compte ainsi des Berbères au Nord, mais aussi des Touaregs et des Toubous au Sud.
Cette mobilisation des loyautés tribales, en parallèle de la fragmentation sécuritaire du pays, s’accompagne d’un essor des identités régionales. Elles aussi sont antérieures à la révolution – la rivalité entre la Tripolitaine romaine et la Cyrénaïque de culture grecque remonte à l’antiquité, et la monarchie senoussie s’était d’abord constituée à l’indépendance sous une forme fédérale pour réunir la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan. Sous Kadhafi, la Cyrénaïque jusque-là dominante, et jugée frondeuse, a été délibérément délaissée et défavorisée par « le Guide de la révolution », qui a symboliquement déplacé de Benghazi à Tripoli le siège de la compagnie pétrolière nationale – la National Oil Corporation (NOC) (108).
Là aussi, la révolution libyenne a vu le renforcement des identités infranationales, en l’occurrence régionales. Misratah, qui relève traditionnellement de la Tripolitaine, a ainsi tiré de son rôle pendant la révolution une ambition de grandeur, et il est désormais question d’une nouvelle région « centre », englobant Syrte. Quant au Sud, destinataire de grands projets de développement sous Kadhafi et grand bénéficiaire des trafics à la frontière, dont la gestion était abandonnée à des tribus qui ne manquaient pas de prélever leur part au passage, il est resté longtemps fidèle à Kadhafi et concevrait une rancœur de son actuelle mise à l’écart. La Cyrénaïque, pour sa part, tire une assurance et une légitimité nouvelles de son rôle de berceau de la révolution.
A la chute de Kadhafi, de surcroît, l’habitude a vite été prise de se gérer soi-même, au plan local, le CNT n’étant qu’une sorte de coalition des villages, des villes et des tribus, malgré le rôle de représentation au plan international qui lui était dévolu. Cette fragmentation s’accompagne en Cyrénaïque d’une revendication d’autonomie, voire d’indépendance, ancrée sur un fort sentiment identitaire, un rejet de la capitale et un désir de contrôler l’affectation de ses propres ressources, en particulier celles tirées du pétrole. Le mois de mars 2012 a ainsi vu la proclamation de l’autonomie de la « Barqa » – nom donné à la Libye orientale – par un Congrès réunissant plusieurs milliers de délégués tribaux et militaires ; un Conseil de transition de la Cyrénaïque a ensuite été proclamé au mois de juin, et l’Est de la Libye a été déclaré unilatéralement région fédérale dans le cadre de la Constitution de 1951 ; au mois de juillet 2012, les « fédéralistes » ont ensuite appelé au boycott des élections, afin d’empêcher l’établissement d’institutions nationales.
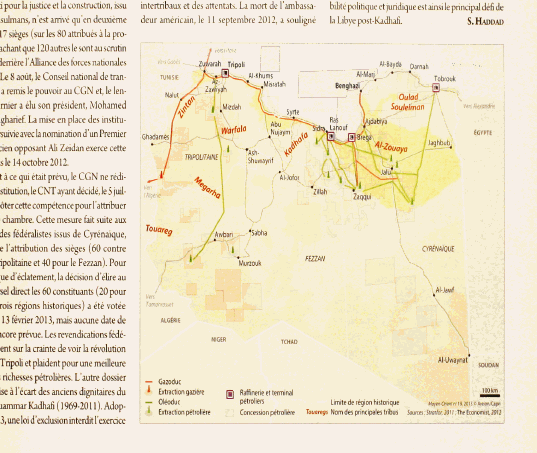
Source : Moyen-Orient, n°19, juillet-septembre 2013.
On estime souvent que seule une fraction de la population de l’Est soutiendrait réellement les thèses « fédéralistes », dont les tenants et les institutions autoproclamées n’auraient d’ailleurs pas plus de moyens de contrôle du territoire que le gouvernement central. Certains y voient, non pas de réelles velléités autonomistes, voire séparatistes, mais plutôt l’usage d’un levier commode pour obtenir des concessions du Gouvernement et des dividendes de la révolution, en suivant une méthode déjà pratiquée par les milices ou par les acteurs de la crise du pétrole : saisir des gages, afin de contraindre le pouvoir, dépourvu de véritables moyens de coercition, à acheter la « paix sociale ». Pour autant, on peut penser que le débat sur l’organisation de l’Etat sera probablement l’une des principales questions que le pouvoir constituant devra trancher en Libye.
Toutes les hypothèses sont envisageables, bien que celle d’un Etat unitaire et centralisé ne paraisse pas nécessairement la plus probable après l’expérience de Kadhafi, la centralisation étant devenue synonyme de prédation au profit du clan, mais aussi du fait de l’émancipation qui a suivi la chute du « Guide de la révolution ». Il semblerait par ailleurs que l’hypothèse d’un Etat fédéral, ou très fortement décentralisé, suscite en Tripolitaine la crainte de voir la Cyrénaïque s’échapper définitivement. Il resterait également à savoir comment les ressources seraient réparties : environ 70 % du pétrole libyen est produit à l’Est, où se trouve également une grande partie des ressources en eau du pays.
En tout état de cause, plusieurs concessions ont déjà été faites, à commencer par le principe d’une représentation égale des trois grandes régions historiques au sein du futur comité constituant, sans prise en considération des différences de poids démographique. Le comité constituant comptera ainsi 60 membres – 20 pour la Tripolitaine, 20 autres pour la Cyrénaïque et autant pour le Fezzan. Par extrapolation à partir du recensement de 2006, le calcul a été fait que la Tripolitaine aurait ainsi un représentant pour 190 000 habitants, la Cyrénaïque un pour 85 000, et le Fezzan un pour 25 000. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé en 2013 le déplacement de plusieurs sièges d’entreprises publiques à Benghazi, notamment celui de la NOC.
III. QUELLES TRADUCTIONS CONCRÈTES EN MATIÈRE D’ACTION EXTÉRIEURE ?
Les changements engagés dans le monde arabe en 2011 n’ont pas seulement constitué un bouleversement interne, qui a vu des sociétés apparemment bloquées se mettre en mouvement, et certains régimes, que l’on s’était habitué à penser immuables, par erreur d’analyse ou par facilité, s’effondrer brutalement sous la pression populaire ; ces « transformations arabes » nous concernent aussi directement, car elles nous obligent à nous repositionner dans un contexte méditerranéen nouveau.
Tout d’abord, la fin du modèle de « stabilité autoritaire », qui avait cours jusqu’à présent, impose d’inventer de nouvelles relations avec les pays arabes ; ensuite, l’irruption de la société civile et de la jeunesse implique de ne plus se contenter des logiques institutionnelles et des liens d’Etat à Etat, voire des relations personnelles entre dirigeants ; enfin, la tentative de reprise en main de leurs destins par les peuples frappe de caducité la démarche très largement « surplombante », du Nord vers le Sud, qui prévalait jusque-là.
L’enjeu, essentiel, consiste à s’adapter pleinement à cette nouvelle donne, en évitant, à l’avenir, des à-coups aussi brusques et dommageables pour notre image, comme pour notre influence dans la zone, que les revirements de dernière minute de l’année 2011. Disons simplement, sans esprit de polémique, mais pour essayer de tirer quelques leçons, qu’on est passé assez brutalement, en Tunisie, d’un dialogue « privilégié » avec Ben Ali à un dialogue respectueux avec le chef du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, et qu’il serait sans nul doute édifiant de déterminer avec précision, dans le cas de la Libye, le délai entre les dernières offres de coopération avec les forces de sécurité de Kadhafi et… les premières frappes aériennes françaises : se mesure-t-il en semaines, en jours, ou en heures ?
A. PROPOSITIONS DE LIGNES D’ACTION POUR LA FRANCE
1. Faire de la Méditerranée une priorité
La première recommandation relève presque de l’évidence : nous n’avons été ni les instigateurs, ni les acteurs, ni même les bénéficiaires des transformations qui se sont engagées dans le monde arabe, mais nous avons un intérêt majeur à ce que les révolutions qui se sont produites dans quelques pays, ainsi que les évolutions qui se dessinent ailleurs, soient couronnées de succès.
De fait, l’environnement est devenu plus instable, les coopérations sont parfois plus difficiles, au moins transitoirement, et de nouveaux problèmes sont apparus, tels que la porosité de certaines frontières et la circulation des armes dans la zone maghrébo-sahélienne. Mais nous avons aussi une opportunité historique à saisir : celle de voir la rive Sud de la Méditerranée adopter un autre modèle de stabilité, plus durable et plus profitable pour une plus grande partie des populations, car fondé sur un principe démocratique et non plus autoritaire, tout en prenant le chemin d’un développement économique et territorial plus harmonieux.
Il ne faut toutefois pas se leurrer : il existe aussi de puissants courants qui sont manifestement hostiles, voire contraires, aux valeurs universelles dont nous souhaitons légitimement le succès. L’émergence de sociétés démocratiques avancées, dont nous mesurons les bienfaits, ne sera probablement ni rapide ni mécanique. L’issue des processus engagés en 2011 demeure en effet très largement ouverte. Nous n’avons donc pas intérêt à nous limiter au registre du commentaire des transformations en cours dans le monde arabe. Il faut plutôt s’interroger sans cesse sur ce que la France peut faire de plus pour accompagner ces évolutions, voire pour les soutenir, en étant conscient que nous ne détenons pas les clefs. Le changement est porté par une dynamique endogène, par la « fermentation » de la société, et la désastreuse expérience de l’Irak montre à quel point les solutions importées et imposées sont vouées à l’échec. Nous n’aurions d’ailleurs pas les moyens de céder à la tentation de « plaquer » nos modèles, faute de relais suffisants… Mais cela ne doit pas nous empêcher d’être à la fois réactifs et proactifs vis-à-vis des difficultés dont les « transformations arabes » s’accompagnent.
L’impossibilité d’élaborer des solutions générales et globales est une deuxième conséquence manifeste des transformations en cours. Les situations sont très différentes du Maroc aux pays du Golfe, les contextes politiques, économiques et sociaux ne sont pas comparables, et les trajectoires divergent fortement. Il faut donc un pilotage aussi fin que possible, à la fois très pragmatique et très politique, ajusté en fonction des situations locales et des demandes – ici faire preuve d’une plus grande souplesse en matière de visas, là délivrer des formations pour constituer de véritables forces de sécurité nationales, indispensables pour assurer l’autorité de l’Etat, ailleurs développer des coopérations décentralisées pour accompagner le développement territorial, mettre à disposition un constitutionnaliste au Yémen, ou encore fournir des hélicoptères pour surveiller les frontières dans la zone maghrébo-sahélienne.
Au fil de ses auditions à Paris et de ses déplacements dans la région, la mission d’information a acquis le sentiment qu’il ne saurait être question d’élaborer un « plan d’action » général pour accompagner le changement dans le monde arabe ou, plus modestement, pour s’y adapter. Il faut se contenter d’agir, pour l’essentiel, en réponse à des demandes précises (109), après les avoir évaluées rigoureusement. Quel soutien apporter, par exemple, aux « Femen » en difficulté avec la justice tunisienne après leurs actions volontairement provocatrices (110) ? Au-delà de la nécessaire défense de leurs droits et libertés, un engagement trop appuyé à leur côtés ne risque-t-il pas de rendre un mauvais service à la cause des femmes tunisiennes ? Par ailleurs, ne court-on pas un risque inutile en soutenant ouvertement une partie de la société civile contre les autorités légales ? Ces questions doivent être posées systématiquement avant toute décision d’action ou d’abstention.
Pour la mission d’information, un principe semble acquis : notre appui et les coopérations dans lesquelles nous pouvons nous engager, notamment en faveur de la société civile (111), ne doivent pas nous conduire à nous ingérer dans le combat politique. En Tunisie, la diplomatie française a ainsi raison de ne pas prendre parti dans le bras de fer entre Ennahda, principale composante de la « troïka » au pouvoir, et l’opposition qui réclame son départ du Gouvernement jusqu’à l’organisation des prochaines élections. Le soutien politique que nous pourrions apporter se retournerait en effet comme un piège sur ses bénéficiaires. Dans de nombreux pays, donner l’impression que l’on appartient au « parti de la France » n’est pas exactement un avantage.
Là où un engagement direct de l’Etat paraîtrait dangereux ou contreproductif, d’autres vecteurs peuvent être envisageables : les Assemblées parlementaires, les collectivités locales françaises, ou encore la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l’homme et les syndicats.
Il faut également prendre acte du fait que les transformations en cours dans le monde arabe ont vu l’émergence d’acteurs avec lesquels nous n’avions pas l’habitude – et, bien souvent même, pas la possibilité – d’entretenir un dialogue soutenu avant 2011 : des blogueurs et des cyberactivistes, des supporteurs de clubs de football très engagés dans la révolution en Egypte, plus généralement une jeunesse capable de changer le cours des événements en se mobilisant, des forces politiques à référentiel islamiste, qui n’ont certes pas été à l’origine des événements de 2011, mais qui se sont ensuite trouvées en position de force, dès lors que des élections ont été organisées, ainsi que les organisations et les associations d’une société civile désormais beaucoup plus active.
Jusqu’en 2011, la confiscation du pouvoir par les régimes autoritaires se traduisait notamment par une forte restriction du champ des interlocuteurs possibles, souvent imposés et uniques – ou presque. Cette dépendance est une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas vu venir les bouleversements récents. Afin d’anticiper les évolutions et de passer les messages nécessaires, il faut désormais s’adresser systématiquement à tous les interlocuteurs, sous réserve bien sûr de deux conditions : le respect des règles du jeu démocratique et le refus du recours à la violence pour imposer ses vues.
La recherche d’une pluralité aussi large que possible des interlocuteurs est d’autant plus nécessaire que l’évolution des situations dépend de l’interaction entre des acteurs nombreux. En Egypte, par exemple, tout dépendra de la partie complexe qui s’est engagée entre l’armée, les forces politiques « libérales » qui la soutiennent aujourd’hui, le camp islamiste, dans sa diversité, et la société civile, qui est à l’origine de la campagne de signatures et de la mobilisation contre le président Morsi, déchu au début du mois de juillet. Il est d’autant plus nécessaire de parler à tout le monde que les situations sont très évolutives. L’exemple égyptien démontre à quel point et à quelle vitesse les interlocuteurs peuvent maintenant changer dans la région. Il convient de ne pas se piéger soi-même en nouant des relations exclusives avec des interlocuteurs perçus – à tort – comme stables.
Il faut en particulier accepter le dialogue avec les forces islamistes, longtemps maintenues à l’isolement, a fortiori depuis le 11 septembre 2001, mais désormais dotées d’une légitimité électorale réelle qui en fait des interlocuteurs incontournables. Mais cela ne signifie pas nécessairement une coopération directe et un soutien matériel. Il s’agit très simplement d’appliquer une règle à laquelle il ne semble pas utile de déroger : la France démocratique parle avec les forces politiques qui participent aux processus démocratiques, et a fortiori à celles qui ont remporté les élections.
Il faut aussi prendre acte de la dynamique nouvelle de la société civile, qui est un des moteurs du changement, sans s’appuyer uniquement sur les organisations de défense des droits de l’homme ou les associations féministes, malgré leur rôle essentiel d’« anticorps » contre les risques de confiscation des libertés. Il faut également miser sur les forces syndicales, qui jouent notamment un rôle clef en Tunisie, avec l’UGTT, et qui rassemblent très largement.
Au-delà, dans la situation encore confuse qui prévaut aujourd’hui, c’est un véritable suivi et une cartographie, dans la durée et en profondeur, des positions des uns et des autres, des rapports de force et des jeux d’influence qui s’impose, y compris pour les acteurs ne respectant pas les deux conditions précitées et avec lesquels un dialogue ne peut pas s’engager. Une proximité culturelle supposée, notamment au Maghreb, vaut d’autant moins connaissance que le jeu s’est profondément renouvelé. En Tunisie, par exemple, s’il n’est pas envisageable d’engager des échanges avec les salafistes qui ne rejettent pas la violence, pour les raisons mentionnées plus haut, il est vital de les connaître au mieux. Il faut mesurer leur influence réelle dans le pays, mais aussi essayer d’évaluer le degré de porosité d’Ennahda, principal courant de l’islam politique en Tunisie, en particulier celui du courant le moins « moderniste » en son sein.
Afin de tisser des liens utiles et de contrer la perte d’influence de la France, qui était déjà manifeste au Maghreb en matière commerciale et linguistique avant 2011, mais qui s’est accentuée depuis lors en matière politique, la mission d’information estime qu’il faudrait aussi développer une politique plus volontariste et plus ciblée en matière d’accueil d’élèves et d’étudiants issus de la région, sans nécessairement infléchir la situation au plan quantitatif. Il s’agirait d’assurer en France, autant que possible, la formation des futures élites économiques, sociales et politiques. Cela n’implique pas seulement une attitude bienveillante envers les demandes qui pourraient être formulées, mais aussi un effort de repérage et de prospection.
4. Défendre des principes et des valeurs avec efficacité et cohérence
Nos prises de position en matière de droits de l’homme, d’égalité entre les hommes et les femmes, de libertés publiques, mais aussi de respect des règles du jeu démocratique et de protection des minorités, sont d’autant plus sensibles que l’on a souvent reproché à la France de tenir un discours variable selon les situations et les interlocuteurs.
Notre image et nos intérêts ont beaucoup souffert du fait que nous nous sommes longtemps accommodés, comme beaucoup, bien que cela ne constitue pas une excuse valable, de la « stabilité autoritaire » que les régimes en place pouvaient offrir, au nom de la lutte contre le terrorisme, du contrôle des flux migratoires et de la mise à distance des forces politiques islamistes, comme s’il fallait choisir entre la dictature et le fondamentalisme religieux. Les événements de 2011 ont montré que cette « stabilité autoritaire » présentait en réalité un coût caché important, car elle conduisait à la stagnation sur tous les plans et s’accompagnait de tensions croissantes dans la société, jusqu’à l’explosion.
Nous devons désormais faire preuve d’une vigilance sans faille en ce qui concerne nos valeurs et nos principes fondamentaux. Afin d’être cohérents avec nous-mêmes et de préserver la crédibilité et la force de notre parole publique, il faut bien sûr ne pas s’interdire de prendre position publiquement, lorsque cela peut être utile, et de développer des actions concrètes en direction des autorités comme de la société civile. Mais comment éviter de se prêter aux accusations d’ingérence et de paraître donner des leçons ? Afin de ne pas être inaudible, il faut parvenir à convaincre nos interlocuteurs que nous ne défendons pas seulement nos propres valeurs, mais aussi celles qui sont au cœur des protestations et des révolutions de 2011, en s’efforçant d’être en synergie avec les aspirations populaires à la liberté, à l’égalité et à la dignité.
B. RECOMMANDATIONS AU PLAN EUROPÉEN
1. Mobiliser davantage nos partenaires européens en faveur de la Méditerranée
L’ampleur des défis à relever au plan politique, économique, social et sécuritaire impose de mobiliser autant que possible l’Union européenne en faveur de son voisinage méditerranéen. Même si la France se sent particulièrement concernée, du fait de sa proximité géographique, historique et culturelle avec une partie de la zone, essentiellement le Maghreb, ce qui vaut pour notre pays vaut aussi pour l’Europe. Elle a, tout autant que nous, un intérêt majeur à voir la démocratie se développer sur son flanc Sud et à s’engager dans des relations plus dynamiques avec des économies plus solides et plus inclusives aussi bien au plan social que territorial.
Une priorité doit donc être donnée aux efforts réalisés pour convaincre l’Allemagne et les pays d’Europe centrale et du Nord de rehausser les questions méditerranéennes sur leur agenda et sur celui de l’Union européenne. Un test révélateur sera notre capacité à maintenir la répartition actuelle des crédits entre le voisinage méditerranéen (112) – 2/3 du total – et le voisinage oriental (113) –1/3 des crédits – pour la période 2014-2020, contrairement à ce que souhaiteraient certains de nos partenaires, désireux de réorienter le soutien européen vers le voisinage oriental.
2. Un bilan en demi-teintes qui doit pousser à faire preuve de « patience stratégique » et à s’engager sur le long-terme
Il est vrai qu’un « aggiornamento » a eu lieu dans le sillage des transformations qui se sont engagées en 2011 chez nos voisins méditerranéens : un représentant spécial de l’Union européenne pour le Sud de la Méditerranée, M. Bernardino León, a été nommé en juillet 2011 ; la Haute-Représentante et la Commission ont présenté deux communications destinées à donner une nouvelle impulsion à la politique européenne de voisinage (PEV) en direction du Sud de la Méditerranée (114) ; des crédits supplémentaires ont été alloués à hauteur de 350 millions d’euros pour 2012-2013 pour le programme SPRING (115), tandis que le plafond de la Banque européenne d’investissement (BEI) était augmenté d’un milliard d’euros en faveur de la Méditerranée du Sud, pour laquelle le mandat de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a également été élargi. Plus récemment, en mai 2013, une mission européenne d’assistance aux frontières (EUBAM) a été autorisée en Libye dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
La révision de la PEV s’est accompagnée de la promotion d’un principe de conditionnalité pour le soutien apporté par l’Union européenne (« plus pour plus »), les pays avançant davantage sur la voie des réformes devant bénéficier d’une coopération financière accrue, d’un accès renforcé aux marchés européens et d’une plus grande mobilité pour les personnes. Si le principe de conditionnalité a fait l’objet d’un accord au plan européen, certains pays plaident pour une application stricte, laquelle pourrait signifier la réduction du soutien européen le cas échéant, quand d’autres pays, comme la France, veulent y voir d’abord et surtout un facteur incitatif. La question est de savoir si l’absence de progrès, voire une régression, doit conduire à un désengagement de l’Union, au risque d’accentuer des évolutions jugées insuffisantes ou négatives, et de céder le terrain à d’autres acteurs dont l’agenda pourrait être différent du nôtre. S’y ajoute le risque d’être perçu comme plus exigeant qu’envers les anciens régimes qui ont été renversés. Il faut donc trouver un équilibre entre prévisibilité et différenciation pour la partie variable des crédits alloués, en plaçant le curseur au bon endroit entre le soutien dans le temps et la vigilance.
Malgré ces inflexions positives, force est de constater que le bilan de la PEV révisée est concrètement assez limité. Les transitions demeurent difficiles et incertaines en Tunisie, en Libye et en Egypte, de nombreux indicateurs étant d’ailleurs passés au rouge dans ce dernier pays. Par ailleurs, peu de progrès ont été réalisés sur les principaux axes de travail identifiés au plan européen, qu’il s’agisse de l’accès aux marchés ou des questions de mobilité des personnes. On ne peut pas dire que l’espace euro-méditerranéen se soit renforcé depuis 2011, soit spontanément, par le développement de solidarités de facto, soit grâce à l’engagement et à l’action de l’Union européenne. Dans un récent rapport, la Cour des comptes européenne s’est même interrogée sur l’efficacité de l’aide financière apportée à l’Egypte, déplorant les très faibles résultats obtenus.
Le bilan est également en demi-teintes au plan institutionnel. Le développement de la PEV au Sud de la Méditerranée ne s’est pas accompagné d’un essor de la coopération au plan régional, alors qu’un « Partenariat oriental » a pu voir le jour à l’Est. L’Union pour la Méditerranée (UpM) (116), créée en 2008 à l’initiative de la France, reste en effet durablement bloquée en raison de conflits persistants – la question israélo-palestinienne, mais aussi celle du Sahara occidental, qui paralyse les relations entre le Maroc et l’Algérie, dont la frontière terrestre commune demeure fermée. A défaut de pouvoir servir d’enceinte multilatérale efficace en matière de dialogue et de concertation, l’UpM tend à se transformer en une agence de projets concrets autour de son Secrétariat général (117), afin de relancer « par le bas » ce qui est bloqué « par le haut », tout en essayant d’impulser une dynamique de coopération régionale grâce à des réunions ministérielles – le deuxième semestre 2013 devrait voir quatre réunions de ce type, respectivement consacrées au renforcement du rôle des femmes, au commerce, aux transports et à l’énergie. En parallèle, le dialogue « 5+5 », relancé au début des années 2000 et réunissant cinq pays du Nord de la Méditerranée et cinq autres du Sud (118), tend de plus en plus à former un « noyau dur » en matière de coopération régionale. L’inconvénient est que ce noyau dur, limité à la Méditerranée occidentale, est probablement trop restreint pour être perçu comme proprement méditerranéen et qu’il peut être considéré comme trop exclusif par certains pays de la région, comme l’Egypte.
Ce bilan ne doit pas conduire à un désengagement de l’Union européenne, bien au contraire. Il convient de faire preuve d’une certaine « patience stratégique » à l’égard de processus manifestement au long cours, non linéaires et commençant à peine dans le monde arabe. Il faut s’engager sur le long terme pour la réussite des transitions et des évolutions qui ont débuté en 2011, en explorant toutes les pistes d’action possibles, en particulier au plan économique, la réussite des « transformations arabes » dépendant en grande partie des réponses apportées dans ce domaine aux aspirations populaires. Les changements en cours au Sud de la Méditerranée sont une opportunité historique de l’amarrer à l’Union européenne.
3. Mettre la jeunesse au cœur du projet euro-méditerranéen
Afin de susciter une dynamique qui fait aujourd’hui encore cruellement défaut et de repositionner l’Europe dans son voisinage immédiat, il faut partir sur de nouvelles bases, celles des « transformations arabes », en s’appuyant en particulier sur la jeunesse. Elle peut devenir une pièce centrale et fédératrice dans les relations entre chaque pays du Sud de la Méditerranée et l’Union européenne, mais aussi au plan multilatéral dans l’ensemble de la région. Il pourrait s’agir de l’initiative phare qui manque aujourd’hui pour réduire le déficit de visibilité de la coopération régionale. L’enjeu est d’importance, puisque la jeunesse est à la fois l’un des principaux défis du Sud de la Méditerranée – en raison de son très faible taux d’emploi et du chômage de masse qui frappe les jeunes diplômés –, mais elle est aussi son principal atout pour l’avenir.
La France propose ainsi de créer une plateforme euro-méditerranéenne pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes. Elle constituerait un cadre d’échange pour améliorer l’articulation entre les différents programmes existants, pour mutualiser les expériences et pour soutenir les initiatives les plus efficaces au plus près des besoins. Une autre initiative utile et fédératrice consisterait à pérenniser et à renforcer l’Office méditerranéen de la jeunesse (OMJ), structure légère constituée à l’initiative de la France et visant à développer la mobilité des étudiants en master ou en doctorat, tout en promouvant la coopération entre établissements d’enseignement supérieur, afin de mettre les formations davantage en adéquation avec les besoins socio-économiques.
Plus globalement, il semble à la mission d’information qu’il pourrait être particulièrement utile de renforcer la mobilité étudiante en Méditerranée, afin de rapprocher la jeunesse de ses deux rives en multipliant les échanges, dans l’espoir de créer des liens et de susciter un sentiment concret d’appartenance à un espace commun. La création d’un programme « Erasmus pour tous », qui pourrait réunir tous les programmes en matière d’éducation, de jeunesse et de sport à partir de 2014, pourrait en offrir l’occasion. La coopération régionale en Méditerranée, si difficile à faire vivre et à incarner au plan institutionnel, pourrait trouver là une traduction très visible, mais aussi très utile.
4. Pour un arrimage économique du Sud de la Méditerranée
Le développement économique, social et territorial des pays du Sud de la Méditerranée doit constituer une autre priorité pour l’Union européenne. Il s’agit à la fois d’assurer la stabilité dans son voisinage méditerranéen, en aidant à répondre aux aspirations populaires, en grande partie économiques et sociales, qui se sont exprimées en 2011, mais aussi de rééquilibrer les rapports entre les deux rives de la Méditerranée. Même si un « plan Marshall » pour nos voisins paraît difficilement envisageable dans les circonstances budgétaires actuelles, mais aussi faute d’un véritable engagement de nos partenaires d’Europe centrale et du Nord, à l’heure actuelle, plusieurs pistes d’action peuvent être explorées.
Une première voie consisterait à s’inspirer de l’exemple du Japon et de l’Allemagne, qui ont su développer des stratégies de co-localisation et de coproduction en valorisant leurs propres avantages compétitifs et ceux de leur environnement – respectivement les pays qui sont ensuite devenus les « Tigres asiatiques » et les pays d’Europe centrale et orientale. Il s’agirait d’externaliser au Sud de la Méditerranée des fragments de la chaîne de la valeur là où les coûts sont moindres et les complémentarités économiques évidentes (119), tout en conservant la conception et l’assemblage sur la rive Nord, et en cherchant bien sûr un intérêt mutuel.
Alors que les délocalisations actuelles, qui font appel à la sous-traitance, tirent les coûts et la qualité vers le bas, et cantonnent les pays du Sud de la Méditerranée dans des fonctions d’assemblage à faible valeur ajoutée et à faible qualification, ce qui tend à déclasser les diplômés sur le marché du travail, ce modèle plus coopératif, reposant sur des partenariats productifs, serait « gagnant-gagnant ». Les pays du Nord pourraient importer des biens intermédiaires de qualité et bénéficieraient d’un avantage substantiel de coût, tandis que les pays du Sud pourraient intégrer les compétences locales, former des cadres qualifiés et monter progressivement en gamme.
Pour être réaliste, ce modèle implique de financer des projets de développement, notamment en matière d’infrastructures, de miser sur la formation à long terme, de restructurer le tissu industriel des partenaires du Sud, d’assurer la sécurité des investissements et, plus généralement, un certain degré de convergence réglementaire. Il ne s’agit donc pas d’investissements isolés, mais d’une démarche d’ensemble, qui doit reposer sur un climat de confiance et sur un certain nombre de politiques publiques bien conçues.
A moyen ou long terme, là encore, la réalisation d’une véritable communauté euro-méditerranéenne de l’énergie (120) offre un autre moyen de donner corps à un partenariat mutuellement bénéfique et équilibré pour le Nord et pour le Sud de la Méditerranée, en travaillant dans plusieurs directions présentant des intérêts communs : la sécurité énergétique, la lutte contre le changement climatique grâce aux énergies renouvelables, et enfin une plus grande efficacité énergétique pour réduire la consommation. Au surplus, la création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), dès 1951, a montré que le domaine de l’énergie pouvait constituer une première étape dans la constitution d’une intégration régionale plus ambitieuse.
Les principes de base pour le développement d’un tel partenariat sont d’une rare simplicité : tout d’abord, les ressources énergétiques sont pour l’essentiel situées au Sud de la Méditerranée, quand les capitaux et le savoir-faire se trouvent très majoritairement au Nord ; ensuite, il s’agirait de dépasser la logique actuelle de simples relations commerciales en matière d’énergie, afin de construire de véritables filières industrielles au plan régional.
Des progrès ont déjà été réalisés dans le cadre de plusieurs initiatives, notamment en matière de régulation – MEDREG (121) –, d’efficacité énergétique – MEDENER (122) – ou encore d’énergie solaire. Dans ce dernier domaine, un plan directeur devrait bientôt être adopté pour le plan solaire méditerranéen (PSM). Il s’agit de produire, d’ici à 2020, 20 000 MW de capacités additionnelles en matière d’électricité renouvelable, au Sud et à l’Est de la Méditerranée, et de développer des interconnexions, tout en améliorant l’efficacité énergétique dans la région.
Il faut continuer à mobiliser des ressources financières et techniques pour réaliser de grands projets de coopération régionale en matière d’énergie. Les enjeux sont, là encore, considérables. Les pays du Nord de la Méditerranée ont besoin de sécuriser leurs approvisionnements et de s’appuyer davantage sur des énergies renouvelables afin d’assurer un développement plus durable. Mais le défi énergétique concerne aussi la rive Sud. La Tunisie, par exemple, a perdu son indépendance énergétique et voit sa facture s’alourdir. On estime qu’il faudrait mobiliser, d’ici à 2030, entre 310 et 350 milliards de dollars d’investissement dans les pays du Sud de la Méditerranée (123).
des propositions de lignes d’action pour la France
et des recommandations au plan européen
A. Propositions de lignes d’action pour la France
1. Faire de la Méditerranée une véritable priorité, afin de relever des défis nouveaux apparus depuis 2011, tout en saisissant l’opportunité historique qui s’offre depuis lors.
2. Anticiper et s’adapter sans cesse pour éviter des à-coups aussi brusques et dommageables pour notre image, comme pour notre influence, que ceux de l’année 2011.
3. Loin de toute idée d’un « plan d’action global », assurer un pilotage aussi fin que possible, reposant sur une évaluation politique et pragmatique des demandes et des situations, pays par pays.
4. Apporter notre soutien aux processus démocratiques, sans s’ingérer dans le combat politique.
5. Dialoguer avec tous les acteurs acceptant le jeu démocratique et refusant le recours à la violence.
6. Etablir une cartographie et un suivi des positions, des rapports de force et des jeux d’influence.
7. Développer une politique plus volontariste et plus ciblée pour l’accueil de futures élites potentielles.
8. Défendre publiquement nos intérêts et nos valeurs en nous plaçant en synergie avec les aspirations populaires qui se sont exprimées en 2011.
B. Recommandations au plan européen
1. Convaincre nos partenaires européens de s’engager davantage pour la Méditerranée.
2. Préserver la répartition actuelle des crédits entre le voisinage méditerranéen et le voisinage oriental.
3. Faire preuve d’une « patience stratégique » et d’un engagement de long-terme, face à un bilan en demi-teintes.
4. N’appliquer le principe de conditionnalité du soutien européen que dans une perspective incitative, sans perspective de désengagement.
5. Créer une plateforme euro-méditerranéenne pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes.
6. Pérenniser et renforcer l’Office méditerranéen de la jeunesse.
7. Renforcer la mobilité étudiante en Méditerranée.
8. Développer des stratégies de co-localisations euro-méditerranéennes.
9. Créer une communauté euro-méditerranéenne de l’énergie.
Depuis le début de la mission d’information, en décembre 2012, il s’est produit des développements aussi difficiles à prévoir et aussi lourds de conséquences et de signification que le renversement du président Morsi en Egypte, le 3 juillet dernier, l’enlèvement du Premier ministre libyen, le 10 octobre, et la dégradation importante de la situation qui a suivi au cours des dernières semaines dans ce pays, ou bien la fin programmée, mais encore incertaine, de la « Troïka » tunisienne. Qui se serait risqué à prédire de telles évolutions ? De même que le déclenchement des « révolutions arabes » en Tunisie, en Egypte et en Libye, ces événements ne peuvent qu’inciter à une certaine forme de retenue.
Au terme des travaux de la mission d’information, il semble toutefois possible de présenter un certain nombre de conclusions, en appelant l’attention sur leur caractère probablement partiel, pour une partie d’entre elles, et parfois provisoire.
Première conclusion, malgré des différences considérables dans l’ampleur de la contestation et dans ses conséquences, puisqu’il n’y a eu pour l’instant de révolutions conduisant à un changement radical de régime politique que dans trois pays de la zone, la Tunisie, l’Egypte et la Libye, on observe un « réveil arabe » global, qui a démenti les thèses rabâchées, et souvent essentialistes, sur la prétendue « exception arabe ». Une exception acceptée et au moins tacitement soutenue par des pays tiers, dont la France faisait partie, pour qui la « stabilité autoritaire » des régimes en place jusqu’en 2011 offrait de nombreux intérêts, notamment en matière de sécurité des approvisionnements, de contrôle de l’immigration et de lutte contre le terrorisme.
Deuxième conclusion possible, même s’il existe des frustrations très largement communes, de la Tunisie à l’Arabie saoudite, au plan politique, économique et social, ainsi que d’autres traits communs, tels que l’émergence d’une jeunesse plus nombreuse et plus éduquée, ou encore la montée en puissance de forces politiques islamistes semblables – Frères musulmans et salafistes –, qui sont en position de force là où les révolutions ont eu lieu, mais également à l’œuvre ailleurs, le « réveil arabe » se déroule dans un cadre essentiellement national. En Egypte, Moubarak est tombé en 17 jours, tandis qu’en Libye, Kadhafi a fini par trouver la mort à l’issue d’un long conflit armé ; quant au Maroc, c’est le Roi qui s’est efforcé de mener une sorte de « révolution » par le haut, après avoir réussi à reprendre la main.
Troisième conclusion, on a observé un véritable « effet de souffle » lors du déclenchement de la révolution tunisienne, la chute de Ben Ali faisant manifestement tomber le « mur de la peur » dans les pays voisins et constituant une sorte d’exemple pour d’autres peuples désireux de se débarrasser de leurs chaînes et de reprendre en main leur destin. Malgré le rôle structurant des cadres nationaux, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, il existe une réelle circulation des idées, des affects et des impulsions dans ce qui constitue à l’évidence un véritable espace public arabe – alors qu’on était parfois arrivé à douter de son existence, notamment après l’échec des aspirations panarabes.
Quatrième conclusion, là où des révolutions ont conduit à un changement radical de régime, en Tunisie, en Egypte et en Libye, les transitions politiques se caractérisent par leur longueur, leur sinuosité et leur caractère encore très indécis, réduisant à néant l’espoir initial – et rétrospectivement naïf – d’un changement rapide et consensuel, à l’instar de ce qui s’était produit en Europe de l’Est après 1989.
Il existe certes des acquis et des défis en commun. D’une part, une libération considérable de la parole et de l’espace public, malgré l’existence de « lignes rouges » ; d’autre part, la nécessité de s’entendre sur un nouveau pacte national, de préserver, tout au moins, le statut des femmes, de répondre à l’urgence économique et sociale, ainsi que de résoudre le problème posé par une situation sécuritaire dégradée, qu’il s’agisse de la délinquance et de la criminalité de droit commun, ou des violences extrémistes. Mais il existe aussi des écarts importants entre les trajectoires de chacun de ces trois pays.
La Libye est manifestement celui qui dispose du plus grand nombre d’atouts au plan économique, grâce à ses ressources en hydrocarbures, à ses réserves financières accumulées et à sa population peu nombreuse. Mais la Libye est aussi le pays où l’Etat se trouve dans la plus grande situation de faiblesse, en l’absence d’armée et de police nationales efficaces, et où le défi sécuritaire paraît le plus difficile à relever, des groupes armés très largement autonomes occupant le terrain.
L’Etat est nettement plus structuré en Egypte, où l’armée et plus généralement l’administration ont survécu à la chute de Moubarak et constituent un « Etat profond » puissant, comme l’a montré sa réaction lorsqu’il est devenu manifeste que la manière d’exercer le pouvoir des Frères musulmans et leur bilan économique calamiteux n’étaient plus supportés par une grande partie de la population, voire par la majorité d’entre elle. La polarisation de la scène politique et de la société demeure toutefois très vive et inquiétante pour le déroulement de la nouvelle transition engagée à l’issue du renversement du président – islamiste – Morsi, le 3 juillet dernier.
Un esprit plus grand de compromis semble prévaloir en Tunisie, où l’expérience des islamistes d’Ennahda au pouvoir, au sein d’une « Troïka » réunissant d’autres acteurs issus d’horizons différents, n’est pourtant guère plus concluante. Malgré une polarisation là aussi intense, entre islamistes et « non islamistes », ainsi qu’une situation sécuritaire dégradée, même si c’est à un degré moindre qu’en Libye, on peut cependant garder espoir, à ce stade, que la crise finisse par se dénouer et que ce pays puisse servir de référence, voire d’exemple de réussite, pour les autres transitions, réfutant le pessimisme et parfois même la désillusion qui se sont installés à la place de l’enthousiasme initial.
Un cinquième et dernier domaine où des conclusions paraissent devoir être tirées de ces transformations concerne notre propre action extérieure. Les mutations déjà réalisées, ainsi que les évolutions en cours, constituent bien sûr des changements profonds pour les pays où elles se déroulent, mais aussi pour notre propre pays et pour l’Union européenne. Il faut continuer à ajuster notre regard, nos paradigmes et nos modes d’action, au cas par cas.
Nous devons tout d’abord être plus présents en Méditerranée, qui doit être traitée comme une priorité en France comme en Europe, ce qui implique de mobiliser davantage nos partenaires et de tisser des liens plus étroits entre les deux rives, au plan économique, mais aussi entre leurs jeunesses respectives.
Que peut-on faire de plus ? Malgré des sympathies naturelles et des attentes légitimes que l’on peut placer dans les processus actuels et dans certains de leurs acteurs, la prudence est de mise au regard des mutations qui peuvent être profondes et rapides au plan local, du danger fréquent d’être accusé d’ingérence, et du risque, par conséquent, d’apporter un appui en réalité contreproductif à ceux que vous voudrions soutenir. Seul un pilotage fin, à la fois pragmatique et politique, peut permettre d’éviter de tels écueils, ce qui ne permet malheureusement pas d’élaborer un quelconque plan d’action général, si séduisant qu’il pourrait être pour l’esprit.
Dans la perspective d’un tel pilotage fin et à vue, et tout en poursuivant le dialogue avec l’ensemble des acteurs qui acceptent les règles du jeu démocratique et qui récusent la violence, il convient avant tout de renforcer notre veille, laquelle doit être permanente et des plus actives, en direction des nouveaux acteurs, souvent changeants, qui émergent. Si nous voulons préserver notre place, qui tend à s’éroder, cela nécessite en particulier un suivi intense, la réalisation d’une véritable cartographie, ainsi qu’un effort déterminé pour maintenir et développer nos réseaux.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 20 novembre 2013.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Nous examinons le rapport de la mission d’information sur les « révolutions arabes », présidée par M. Jacques Myard, et dont le rapporteur est M. Jean Glavany. Font également partie de la mission d’information Mme Sylvie Andrieux, M. Jean-Louis Destans, Mme Marie-Louise Fort, M. Lionnel Luca, M. Jean-Philippe Mallé et M. Michel Vauzelle.
Je rappelle que nous avons déjà eu deux débats intermédiaires, en février et en mai, à la suite de vos déplacements successifs dans la région.
C’est un rapport très important que vous allez nous présenter, car les transformations en cours dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée nous concernent directement en raison des liens de tous ordres qui nous unissent et de l’importance du voisinage méditerranéen pour la France et pour l’Europe – je crois que Jacques Myard sera d’accord avec moi sur ce point.
M. Jacques Myard, président de la mission d’information. Je ne peux que souscrire à votre propos liminaire, Madame la présidente. Ce sujet est au cœur de l’avenir de notre pays, ainsi que des enjeux et des défis en Méditerranée.
Nous avons eu pas moins de 77 entretiens, à Paris comme à l’étranger, et la qualité était présente au rendez-vous, elle aussi. Nous avons essayé d’avoir une approche globale et de rencontrer les acteurs participant à ces mouvements, dans leur ensemble. C’était l’objet des trois déplacements que nous avons réalisés en Tunisie, en Egypte et en Libye, et je veux saluer bien sûr l’excellente préparation assurée par nos missions diplomatiques, qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et avec des moyens limités, mais qui ont su nous ménager des entretiens de haut niveau. Ce fut des échanges très enrichissants au plan humain et pour la vision politique que l’on peut avoir de ces pays.
En Egypte, nous avons notamment pu nous entretenir avec le cheikh Al Tayeb d’Al-Azhar, ainsi qu’avec des salafistes qui ont adopté une approche plutôt pacifique – nous n’avons pas tenté le diable en nous rendant dans le Sinaï pour rencontrer les djihadistes qui occupent actuellement la zone – et nous avons fait un voyage assez fort à Alexandrie, en empruntant depuis le Caire une route qui peut donner quelques sueurs froides. Nous y avons rencontré une personne dont j’espère que vous l’inviterez, Madame la présidente, à l’occasion d’un éventuel passage à Paris : Ismaïl Seragueldine, le directeur de la prestigieuse bibliothèque alexandrine. C’est un intellectuel de haute volée, qui a beaucoup à dire, dans une langue française d’ailleurs bien meilleure que la nôtre.
Nous avons aussi effectué deux séjours à Tunis, où nous nous sommes ensuite rendus à plusieurs reprises à titre personnel, Jean Glavany et moi-même. Nous y avons rencontré la plupart des partis, à un moment où le pays traversait déjà une crise politique aiguë. Nous nous sommes d’ailleurs entretenus avec le chef d’Ennahda, Rached Ghannouchi, qu’il faut entendre, en étant conscient de la différence entre le langage officiel et le discours caché. La situation n’est toujours pas stabilisée entre Ennahda, qui joue un jeu difficile, et des partis libéraux qui ne sont pas toujours très unis.
Nous avons failli revenir « en kit » de Libye, où nous nous trouvions à l’ambassade la veille de l’attentat qui l’a détruite entièrement. Il n’y a heureusement eu que deux blessés, dont un grave. Nous avons pu mesurer l’écart entre ce que demandait la communauté française, notamment le rétablissement d’une liaison aérienne directe, et la réalité qui a été révélée par l’attentat du mardi 23 avril. Nous avons notamment rencontré le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, ainsi que le président du Congrès général, qui a ensuite été débarqué sous la pression des « katibas » qui règnent en maîtres dans ce pays.
Notre approche n’a pas varié tout au long de nos travaux. Nous nous sommes demandé s’il s’agissait d’un mouvement global ou bien s’il existait des spécificités selon les pays, si l’on assistait à la naissance de la démocratie dans un cadre arabo-islamique, et dans quelles conditions, quelle était la place de l’islam, très prégnant, mais selon des degrés divers, quelle était la place de l’armée et de la police, souvent plus importante, notamment en Tunisie, et enfin ce que l’on pouvait en conclure pour notre propre action politique.
M. Jean Glavany, rapporteur de la mission d’information. Nous avons voulu insister, dans le préambule du rapport, sur les erreurs politiques et méthodologiques à ne pas commettre si l’on veut comprendre cet embrasement des pays du Sud de la Méditerranée – depuis la fin de l’année 2010, lorsqu’un jeune marchand ambulant s’est immolé à Sidi Bouzid en Tunisie. Beaucoup ont parlé de « printemps arabes », mais nous nous refusons pour notre part à employer ce terme, auquel nous préférons celui de « révolutions arabes ».
La première erreur consisterait à sous-estimer ce qui se passe actuellement sur la rive Sud de la Méditerranée. Comme le dit le président Vauzelle dans son rapport au Président de la République, il s’y déroule des événements très importants pour la Méditerranée elle-même, pour l’Europe et pour la France. Nous devons y porter un regard très attentif et très concerné.
Une autre erreur serait de considérer ces processus avec les yeux de notre politique intérieure, en voyant dans ces pays d’abord des terres d’émigration, en nous comportant comme une ancienne puissance coloniale qui porterait des jugements ou qui se croirait en mesure de manipuler des facteurs et des acteurs dans la région. Nous avons besoin de prudence et de précaution, y compris dans l’emploi de certaines notions, telles que cette grande valeur de notre République qu’est la laïcité. Parler de partis laïques reviendrait à déconsidérer ces forces politiques. Cela tendrait à en faire des partis de la France ou des forces se rattachant aux anciennes dictatures, qui ont utilisé la laïcité pour réprimer violemment les forces religieuses. Il vaut mieux parler de partis du progressisme, de partis démocratiques ou encore libéraux. Il faut pousser la prudence jusque dans notre langage.
Il faut aussi faire preuve de prudence afin d’éviter les amalgames. Personne ne pouvait prédire un tel embrasement, et aucun des experts que nous avons rencontrés ne l’a d’ailleurs prétendu. Beaucoup, en revanche, devinaient que s’il devait y avoir un jour des élections libres, les forces islamistes en seraient les premiers bénéficiaires. Ces forces, qui sont apparues de façon structurée un peu partout, sont extrêmement diverses, à l’image de l’islam. Il faut éviter les amalgames à propos de cette religion et de ses traductions politiques. Ces forces sont non seulement diverses, mais aussi traversées de courants différents, voire de contradictions parfois très puissantes.
Une dernière erreur serait de tirer des conclusions hâtives. Ces processus s’inscrivent dans une durée, que nul ne peut évaluer, et connaissent des rebondissements permanents. En Libye, même si la situation sécuritaire était déjà très chaotique auparavant, qui aurait pu prédire l’enlèvement du Premier ministre, pendant quelques heures, puis les affrontements très violents entre « katibas » auxquels on vient d’assister à Tripoli ? En Tunisie, qui aurait pu prédire, sinon le « dialogue national », car certaines forces y travaillaient depuis longtemps, du moins son accélération dans un premier temps, puis les coups de frein et les hésitations que nous connaissons aujourd’hui ? Personne ne peut dire quand le « dialogue national » va déboucher, ni selon quel calendrier. En Egypte, en revanche, depuis le retour de l’armée au pouvoir, une espèce de glacis s’est remis en place. La « stabilité autoritaire » a été réinstallée, ce qui a pour vertu, si j’ose dire, d’empêcher les rebondissements quotidiens dans ce pays.
J’en viens aux conclusions que l’on peut tirer, à ce stade.
Il s’agit tout d’abord d’un « réveil arabe global », qui porte en lui la fin de ce que des analystes et des diplomates appelaient la « stabilité autoritaire ». Le « réveil » a embrasé le monde arabe d’un bout à l’autre, même s’il a des traductions très différentes, par exemple au Maroc ou en Algérie, où les secousses ont été très atténuées, ici par une monarchie constitutionnelle qui avait déjà lâché beaucoup de lest, là par une expérience du terrorisme et de la guerre civile qui n’a pas donné envie d’y revenir. Le mouvement est allé jusqu’en Syrie, même s’il n’est pas certain que l’on puisse encore y parler de révolution, le pays étant désormais en pleine guerre civile, et jusqu’aux monarchies du Golfe, où une révolte a été matée dans le sang à Bahreïn. Nous étudions ce « réveil arabe global » dans notre rapport, avant de nous concentrer sur trois pays où des processus révolutionnaires sont en cours, la Tunisie, l’Egypte et la Libye.
Deuxième conclusion, sans prétendre qu’il s’agit de la fin du panarabisme, ce « réveil » s’est fait – et il continue à se dérouler – dans un cadre essentiellement national.
Pour autant, ce réveil arabe s’est accompagné d’un « effet de souffle » régional, bien que personne ne puisse préjuger des résultats auxquels il conduira.
Enfin, les transitions qui se sont engagées sont déjà longues, et elles continueront à l’être, elles sont sinueuses et durablement incertaines. Lorsque nous avons dit à certains de nos interlocuteurs que la stabilisation de la République avait pris beaucoup de temps en France, entre la Révolution de 1789 et les années 1870, tous nous ont répondu que les Portugais n’avaient mis que sept ans après la « révolution des œillets » et qu’eux-mêmes, à l’heure d’Internet, n’attendraient pas aussi longtemps. Mais ce ne sont peut-être que des vœux pieux.
J’ajoute que nous avons consacré des « focus » aux acteurs qui nous paraissent essentiels dans ces trois pays.
En Tunisie, nous avons choisi l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui est la grande force de stabilité et d’exigence démocratique dans ce pays. Ses dirigeants ont réussi l’exploit de s’imposer dans le cadre d’un « dialogue national » avec la « troïka » au pouvoir, qui réunit Ennahda, le Congrès pour la République et Ettakatol, en formant un quartette avec l’Ordre des avocats, l’union patronale UTICA et la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Il a été prévu le départ des islamistes du pouvoir, la formation d’un gouvernement dit de compétences, l’achèvement du processus constitutionnel, la fixation d’une date pour les élections, ainsi que des modalités de contrôle de ces élections. Si l’UGTT joue un tel rôle, c’est que la « troïka » au pouvoir a perdu beaucoup de points à cause de l’instabilité politique et des résultats économiques catastrophiques, qui suscitent un vrai mécontentement à l’égard du pouvoir, alors que l’opposition reste dans le même temps très morcelée. L’UGTT est un vrai pôle de stabilisation, jouissant d’une grande capacité de mobilisation.
En Libye, les « katibas », ces milices armées dont le nombre est estimé entre 300 et 2 000 et qui se répartissent les provinces dans les zones rurales ou les quartiers en milieu urbain, à coups d’agressions ou de règlements de compte, constituent la force centrale – et très dangereuse – du pays, face à un Etat qui s’est effondré. Il était en effet constitué autour de Kadhafi, de sa famille et de son clan. Avec leur départ, il ne reste rien. La situation, déjà chaotique et violente, s’est encore détériorée au cours des derniers jours. Ce pays aurait pourtant le plus de facilités pour s’en sortir, du fait de sa rente pétrolière considérable, pour une population de seulement 6,5 millions d’habitants. Mais il est privé d’Etat et de véritables forces de l’ordre.
En Egypte, la force centrale est évidemment l’armée, qui a repris le pouvoir après l’échec flagrant des islamistes au plan économique et social, dans ce pays où une « révolte des ventres » pourrait toujours avoir lieu dans certaines provinces et où le poumon économique du tourisme est quasiment à l’arrêt, mais aussi au plan politique. « L’islam est la solution », répétaient les Frères musulmans, mais il ne l’a été que pour promouvoir des amis du pouvoir à des postes de responsabilité civils et militaires, comme pour commencer à faire régner une sorte de chape de plomb en Egypte, mais certainement pas pour garantir les libertés ou pour donner à manger au peuple. D’où ce mouvement de révolte, « Tammarod », sans doute encouragé et soutenu par les militaires, et réciproquement, jusqu’au coup d’Etat qui a renversé le président Morsi et donné lieu à des actes de répression violents et inacceptables. Le fait que l’armée pouvait reprendre le pouvoir faisait partie des hypothèses de travail depuis le départ, y compris pour nous. Elle disait se tenir à l’écart, tout en précisant, comme nous l’a dit un général, que cela ne vaudrait pas en cas d’effondrement de l’Etat. L’armée a jugé qu’il en était ainsi, ce qui ne constituait sans doute pas un abus de pensée.
L’armée égyptienne est en outre une force économique et diplomatique. Par le biais de ses réseaux et de ses participations dans des entreprises, elle détient entre 20 et 40 % de l’économie égyptienne, et elle reçoit 1,3 milliard de dollars des Etats-Unis dans le cadre d’un pacte de stabilité régionale, qui repose en particulier sur le respect des accords avec Israël. Malgré certaines déclarations et l’annonce de la suspension d’une partie de l’aide américaine, la récente visite de John Kerry semble montrer que la situation rentre dans l’ordre. Au plan interne, le rejet de Morsi et des Frères musulmans est tel au sein de la population que l’armée reste relativement populaire et qu’il y a des forces souhaitant explicitement son succès.
Quelques recommandations nous semblent nécessaires pour anticiper davantage les changements, qui sont permanents, et pour mieux nous y adapter, en évitant les à-coups que nous avons connus. L’année 2011 a vu la diplomatie française passer, de manière assez brutale, de contacts avec le gouvernement de Kadhafi, je le dis sans esprit de polémique, aux premières frappes aériennes. En Tunisie, on est passé aussi très vite d’un dialogue avec Ben Ali, que je ne qualifierais pas de « privilégié », car il était classique et hérité, à une situation nouvelle de dialogue avec Ghannouchi, le chef d’Ennahda. Nous avons donc besoin d’observer aussi finement que possible les évolutions au jour le jour. Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe dans cette région, mais plutôt y porter une attention toute particulière. Il faut ainsi réaliser une cartographie quotidienne, sans chercher à élaborer dans le même temps, nous semble-t-il, un plan d’action global, les situations étant très différentes. Il faut aussi parler à tout le monde. Dans certains postes diplomatiques, il était pourtant impossible ou inimaginable, jusque-là, de parler aux islamistes. Comment le refuser maintenant qu’ils se présentent aux élections et qu’ils les gagnent ? Il faut parler à toutes les forces politiques qui acceptent le jeu démocratique et qui refusent la violence et le terrorisme.
Je voudrais enfin émettre un vœu. Au regard de la situation toujours très instable qui prévaut, je pense que notre Commission aurait tout intérêt à poursuivre le travail que nous avons entamé depuis un an, sans nécessairement continuer à entendre des dizaines d’experts comme nous l’avons fait. La moindre des choses serait tout de même de rester attentif aux évolutions qui se déroulent.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. C’est un rapport très fouillé, avec une grande finesse d’analyse et un apport très personnel. Nous avons besoin de telles contributions et je vous en remercie.
Ma première question concerne la situation économique et sociale. Après tout, c’est ce qui a déclenché les révolutions en Tunisie et en Egypte. Pourriez-vous revenir sur cette question ?
Vous nous avez dit, à juste titre, qu’on ne pouvait pas plaquer nos modes de raisonnement. Il faut ainsi prendre en considération le fait religieux, mais sans le surestimer. Qu’en pensez-vous ? Il existe une aspiration à un Etat de droit, qu’il appartient à chaque pays de définir, mais l’on voit bien que l’on se tourne aussi vers les références universelles – et européennes. Partagez-vous cette impression ?
Enfin, que pouvons-nous faire concrètement pour soutenir davantage les sociétés civiles ? Elles sont les gardiennes vigilantes de la révolution, notamment en Tunisie.
Mme Odile Saugues. Les Etats-Unis ont pris une position très critique vis-à-vis du récent soulèvement en Egypte, dont les autorités ont fait de même vis-à-vis de Washington. La France et l’Union européenne peuvent-elles en tirer bénéfice dans leur relation avec l’Egypte ? Par ailleurs, quelles sont les conséquences des flux de réfugiés en Jordanie en provenance de la Syrie ? Si la situation perdure, la Jordanie, qui a réussi à contenir les troubles sociaux par des réformes a minima, pourra-t-elle résister ? Le pays est déjà affaibli par une situation économique et sociale préoccupante.
Mme Marie-Louise Fort. Notre vision occidentale de la condition des femmes a du mal à se glisser dans le moule de ces pays. Nous avons rencontré des femmes qui ont été parties prenantes des révolutions et qui ont développé une certaine vision de leur rôle, sans être pour autant des révolutionnaires quant à leur propre condition.
J’ai aussi été frappée en Tunisie par la présence de députés binationaux, dont certains viennent de nos banlieues. Cela pose la question des relations qui peuvent se nouer entre ce qui se passe dans notre pays et les révolutions du monde arabe.
Autre constat, ces révolutions montrent bien à quel point les démocraties sont fragiles et difficiles à mettre en place. En Egypte, je suis très inquiète de la chute de l’économie. L’armée a repris le contrôle. Elle est financée par les Etats-Unis, mais il y a aussi de l’argent qui vient du Golfe, ce qui joue et continuera à jouer un rôle très important.
Enfin, la Méditerranée compte beaucoup et nous avons beaucoup à faire, mais il faudra commencer par changer en partie notre façon de voir. La situation a changé. Je souhaiterais d’ailleurs que l’on continue à suivre les évolutions en cours, dans les mois et même les semaines qui viennent, car tout change très vite et le jeu reste ouvert. On pourrait aussi élargir le champ à la Turquie.
M. Jean-Philippe Mallé. Je voudrais évoquer les Chrétiens d’Orient, notamment les Coptes d’Egypte, dont il n’a pas encore été question jusqu’à présent, même si le rapport en parle. Il s’agit d’une minorité très importante, qui représente environ 10 % de la population égyptienne et qui est là depuis fort longtemps. Quel est l’impact des révolutions arabes sur ces Chrétiens d’Orient ? Ils sont souvent discriminés, molestés et victimes de crimes ou de délits.
M. Michel Terrot. C’est un sujet que je souhaitais également évoquer.
Quel est votre sentiment sur l’importance de la revendication de la charia, particulièrement en Égypte et en Tunisie ? Est-elle majoritaire ou bien seulement un instrument mis en avant par les salafistes et les Frères musulmans, mais finalement assez minoritaire dans la société civile ?
M. Jean-Paul Dupré. Je voudrais vous adresser mes félicitations pour la qualité de votre travail, mais aussi pour votre intrépidité sur le terrain.
Quelles sont les perspectives de stabilisation au plan politique et d’amélioration de la situation économique et sociale ? On assiste au quotidien, en Égypte, en Libye, mais aussi hier au Liban, à des actions violentes et à des attentats kamikazes. Que deviennent les populations confrontées à ces crises ? N’y a-t-il pas un risque de réaction violente de leur part ?
M. Pierre Lellouche. Vous avez eu raison d’insister sur la nécessité d’éviter les à-coups et de réaliser un suivi fin, pays par pays, au lieu de se borner à une approche globale.
En revanche, je suis moins d’accord avec le rapporteur sur les précautions à prendre en matière de laïcité. On peut s’interroger sur la façon d’en parler – c’est le travail des diplomates, après tout –, mais c’est tout de même le point dur. On le voit en Tunisie, où la question est de savoir si l’on va ou non vers une séparation entre l’État et la religion, et la question se pose aussi en Turquie, qui connaît une lente islamisation et une remise en cause des acquis du kémalisme, c’est-à-dire la laïcité à la française. L’enjeu de ces révolutions est la réconciliation des pays arabes musulmans, au sens large du terme, avec la modernité et la globalisation. Cela passe inévitablement par un « aggiornamento » sur le rôle de la religion dans la société et la place des femmes. On le voit avec la toute première manifestation qui a eu lieu en Arabie saoudite pour le droit des femmes à conduire une voiture. Cela n’a peut-être l’air de rien, mais c’est fondamental.
Il me semble que nous sommes entrés dans une deuxième phase des révolutions arabes, avec l’ampleur que prend la guerre en Syrie. Elle change la donne dans tous les pays de la région, au Liban, en Jordanie, en Irak, qui est train d’imploser, en Iran en tant que pays en première ligne face au monde sunnite et désormais à Israël, mais aussi avec l’irruption des pays du Golfe qui financent chacun leur armée contre l’Iran. C’est un changement de dimension à prendre en compte dans le suivi que vous envisagez. Le paradigme israélo-arabe, même s’il reste important, est de plus en plus supplanté par la question de la recomposition de la région et par le conflit de moins en moins larvé et extrêmement dangereux entre sunnites et chiites, avec un risque de nucléarisation en parallèle. Si l’Iran accède à l’arme atomique, la Turquie ne pourra pas rester les bras croisés, pas plus que les pays du Golfe. C’est une menace existentielle.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. J’ai proposé au Bureau de la Commission de réaliser un suivi sous deux formes : d’abord la création d’un groupe de suivi des dossiers du Conseil de Sécurité ; ensuite par une mission d’information sur les nouvelles évolutions du Proche et du Moyen Orient. Comme nous mènerons moins de missions l’an prochain, nous pourrons dégager des moyens pour réaliser des points de situation, notamment en Afrique du Nord, où une délégation de cette commission pourrait se rendre au cours du premier semestre.
M. Philip Cordery. La stabilité, le développement et la démocratisation de la région passent par l’émergence de forces démocratiques nouvelles, représentatives de l’ensemble de la population. Or, nous avons affaire à des populations et à des classes politiques très clivées du fait d’une bipolarisation autour des forces islamistes et d’autres forces qui se disent démocratiques et laïques, mais qui se sont aussi beaucoup servies de la lutte contre l’islamisme pour imposer des dictatures dans toute la région, avec autrefois le soutien des puissances occidentales.
Si les révolutions ont suscité des espoirs, ils restent difficiles à mettre en œuvre, ce qui n’a rien de très anormal. Une révolution ne s’achève pas en un ou deux ans. Le risque le plus préoccupant est celui de la contre-révolution, comme en Égypte, où les forces anciennes sont revenues au pouvoir, là encore en réaction aux islamistes. Le salut viendra par la concorde nationale et vous avez eu raison d’insister sur le rôle potentiel d’exemple de la Tunisie. C’est le pays où le dialogue entre les forces islamistes modérées, qui veulent exercer le pouvoir et acceptent le jeu, et les forces laïques, qui ne veulent pas seulement un retour de l’ancien régime, a le plus de chances d’aboutir. Vous avez souligné à juste titre le rôle de l’UGTT, mais il ne faut pas sous-estimer pour autant celui du président de l’Assemblée nationale constituante, qui a constamment mis les différents acteurs autour de la table. Comment voyez-vous en Tunisie l’évolution de ce dialogue nécessaire pour arriver à une vie politique démocratique ?
M. Nicolas Dupont-Aignan. Quelle est l’influence de l’Arabie saoudite et du Qatar sur le fonctionnement des milices libyennes ?
En Tunisie, j’ai le sentiment que le fossé se creuse entre une classe sociale très occidentalisée, européanisée et proche de la France, qui craint de plus en plus l’emprise de l’islam, y compris au plan culturel, notamment sur le statut des femmes, et des masses qui, même si elles ont des réticences envers Ennhada, suivent une certaine évolution. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, comment peut-on apporter une aide par une coopération européenne, mais aussi française ? Comment renforcer des capacités économiques dont la faiblesse exacerbe les tensions au plan politique ?
M. Jean-Paul Bacquet. Jean Glavany a abordé la question sans vraiment y répondre : assiste-t-on à la montée de nationalismes forts ? Et le panarabisme a-t-il encore une chance d’exister ?
M. Jean-Claude Guibal. Vous avez évoqué les acteurs de ces révolutions sous un angle surtout institutionnel. Quelles catégories sociales représentent-ils ? Qui trouve-t-on à l’origine de ces mouvements ?
La question de fond est effectivement celle que pose la modernité au monde arabe. Quelles sont les interactions entre les trois révolutions dont vous avez parlé et les autres problématiques du monde arabe, notamment le conflit entre chiites et sunnites et celui entre Israël et la Palestine ? Entrevoit-on des évolutions plus nettes que le mouvement brownien actuel ?
M. François Loncle. Merci pour ce brillant rapport. Je souhaite formuler quelques observations sur la Libye. Vous avez fait état de l’effondrement de l’État et de l’instabilité qui règne. Au-delà du désordre intérieur – et le mot est faible –, cette situation a des conséquences sur l’ensemble de la région, dans les pays du Sahel, Niger, Tchad et Mali, mais aussi en Algérie. Ma seule interrogation, par rapport à ce que vous avez dit, concerne la prévisibilité de la situation actuelle. Nous avons été quelques-uns à ne pas voter la poursuite de l’intervention, qui devait avoir pour but de libérer Benghazi, mais qui a aussi visé la mort de Kadhafi et probablement aussi d’autres objectifs. Les conséquences étaient prévisibles dans ce pays qui n’était déjà pas un État. A-t-on maintenant une solution pour rétablir un minimum d’ordre et d’Etat en Libye ? A défaut, les effets de cette guerre risquent de s’accentuer.
M. Didier Quentin. Ma question fait suite à celle de François Loncle sur la Libye, dont vous avez dressé un tableau assez apocalyptique. Qu’en est-il d’une coopération militaire avec la France ? On a beaucoup dit au sujet du Mali que les armes venaient de Libye.
Vous avez certainement été attentifs au cours de vos travaux à la production d’une littérature abondante sur les révolutions arabes, notamment le livre de Gilles Kepel. Y a-t-il des ouvrages que vous recommanderiez ?
M. Jacques Myard, président de la mission d’information. Il faut se garder d’avoir des critères d’analyse exclusifs : tout est dans tout et réciproquement. Il faudrait presque une matrice à la Leontief pour bien comprendre. Il faut prendre en compte des questions très diverses – la modernité, l’islam, les forces politiques en présence, l’économie, la démographie – avant d’essayer d’apporter des éléments de réponse, en étant bien conscient des incertitudes qui persistent.
Il y a une aspiration à la démocratie et à plus de liberté, qui a conduit à l’explosion de la chape de plomb et des dictatures, notamment grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Il ne faut pas sous-estimer cet élément, y compris dans les événements récents en Egypte, pour lesquels je n’emploierai d’ailleurs pas le terme de contre-révolution ni celui de coup d’Etat. Il y a eu un soulèvement populaire, « Tamarrod », qui s’est aussi fait avec les réseaux sociaux. Et il n’y aura pas de retour en arrière, qu’il s’agisse de la circulation des idées, du dialogue qui s’est considérablement développé ou de la contestation.
Les enjeux économiques sont divers. En Egypte, le problème est durable et il risque de conduire au rejet du Gouvernement, quel qu’il soit, car il ne pourra pas résoudre les problèmes économiques majeurs de ce pays. Si l’on se projette à 25 ans, on est face à des perspectives démographiques plus qu’inquiétantes : en 1970, la population égyptienne était de 35 millions d’habitants ; elle est de 85 millions aujourd'hui et elle pourrait s’élever à 140 millions d’habitants dans 25 ou 30 ans ! Tout le monde est d’accord pour dire que l’on est à la veille d’une « révolution des ventres ». C’est la raison pour laquelle les Etats-Unis continuent à apporter leur aide. Et le ministre égyptien du tourisme, que j’ai pu rencontrer à Paris, nous supplie de lever les zones rouges sur la carte des « Conseils aux voyageurs » du Quai d’Orsay, afin de permettre le retour du tourisme, vital pour ce pays.
La place des femmes est également diverse, et je maintiens que le terme de laïcité est impropre. Il signifie quasiment l’athéisme, ce qui n’est pas acceptable dans ces sociétés très musulmanes, que les islamistes veulent islamiser davantage. En Tunisie, la société civile a refusé que la charia soit inscrite dans la Constitution et elle a gagné sur ce point, ainsi que sur la « complémentarité » entre l’homme et la femme. Il y a des forces puissantes qui pensent comme nous dans ce pays, mais qui restent musulmanes. En Egypte, la Constitution impose que les lois soient compatibles avec la charia, comme c’était déjà le cas sous Moubarak, et qu’Al-Azhar doit y veiller.
Enfin, il n’y a pas un islam, mais des islams. La situation est d’une extrême diversité. Les salafistes égyptiens ont juré la perte du cheikh Al Tayeb, grand imam d’Al-Azhar, qui a créé une « Maison de la famille égyptienne » pour dialoguer avec les Coptes. Au risque de parler crûment, ces derniers sont une variable d’ajustement, en fonction du degré de colère des extrémistes islamistes. Quant à l’athéisme, aucun candidat à des élections ne pourra dire qu’il refuse l’islam.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Il y a quand même le cas de la Turquie.
M. Jacques Myard, président de la mission d’information. Il y a d’abord eu la volonté très forte d’un homme dans ce pays, mais la situation a changé. De même, un Bourguiba qui buvait un verre d’eau à la télévision pendant le ramadan serait impensable aujourd'hui. Plaquer nos propres éléments d’analyse serait une erreur.
Dans la situation en Syrie, il y a bien sûr un conflit entre sunnites et chiites, mais aussi une lutte d’influence entre l’Arabie saoudite et l’Iran, sans oublier le Qatar. L’effondrement de l’État est aussi une réalité.
Pour répondre à Jean Glavany, ces crises soulignent la capacité de notre diplomatie à s’adapter très vite aux nouvelles donnes politiques. Il y a eu un beau revirement, en particulier s’agissant de la Libye, ce qui prouve que l’instrument diplomatique français demeure aux ordres du politique, fort heureusement d’ailleurs.
S’agissant de Kadhafi, on peut effectivement s’interroger sur le revirement étonnant qui avait eu lieu précédemment en sa faveur, malgré de très vieux ressentiments. L’homme considérait la Libye comme sa « ferme », comme cela nous a été dit. Et comme il avait détruit l’Etat, tout est à construire après son départ. Cela ne se fera pas en un jour.
M. Jean Glavany, rapporteur de la mission d’information. Si je puis répondre à la pique de Jacques Myard, ce n’est pas sous cette majorité que l’on a reçu Kadhafi, qu’il a planté sa tente à l’hôtel de Marigny, qu’il a assisté au défilé du 14 juillet et qu’on lui a proposé des coopérations militaires jusque quelques semaines avant de lui envoyer notre aviation.
La situation économique et sociale est évidemment l’une des causes de ces révolutions et révoltes. En Egypte, le taux de croissance serait un peu inférieur à 2 % alors que le potentiel de croissance est de l’ordre de 5 % et que le taux nécessaire pour réduire le chômage s’élèverait à 7 %. La situation financière est également très difficile, les Egyptiens vivant sous la perfusion des monarchies du Golfe. Il y a d’ailleurs eu un épisode assez marquant, il y a quelques mois, au sujet du prêt longuement négocié avec le FMI : le président Morsi lui-même a annulé au dernier moment, alors que le prêt était sur le point d’être signé, les réformes qui avaient été adoptées dans cette perspective. Nous avons retiré de nos entretiens sur place que nos interlocuteurs avaient souvent l’impression que l’Egypte était trop importante au Proche-Orient pour qu’on la laisse tomber.
Vous avez entièrement raison, Madame la Présidente, quand vous dites qu’il faut prendre acte du fait religieux sans le surestimer. Les processus démocratiques, en Egypte et en Tunisie, ont donné des majorités relatives mais confortables aux islamistes, qui ont ensuite voulu s’enraciner au pouvoir. Il en a résulté, non pas des sentiments antireligieux, mais des mouvements de défense des droits en Egypte face à une emprise totalitaire qui se mettait en place, ainsi qu’en Tunisie sur la place de la charia et sur celle des femmes. Le Président tunisien Moncef Marzouki nous a toutefois expliqué que nous avions une vision déformée de ses relations avec Ennahda. Ce n’est pas sur la religion qu’il a le plus de difficulté, mais en matière économique. A chaque fois, Ennahda a dû reculer sur les femmes et sur la charia. Le Président Marzouki est, en revanche, favorable à un Etat plus interventionniste et plus régulateur, alors que les membres d’Ennahda sont en général libéraux. Il y a bien eu une « poussée » islamiste, notamment des violences à l’université contre des professeurs refusant des femmes voilées en cours, des agressions contre des acteurs de la société civile, et des rappeurs emprisonnés. Mais cela ne veut pas dire que ces femmes et ces hommes qui défendent une société plus libérale au sens politique du terme rejettent la religion. Ils sont évidemment d’obédience musulmane.
La question qu’il faut se poser, lorsque l’on évoque la question de la modernité et de la pratique religieuse, est de savoir si en Europe aussi, la religion catholique ou protestante n’a pas accompagné l’instauration de la démocratie. N’y a-t-il pas même des partis chrétiens au pouvoir dans certaines grandes puissances ? La religion, lorsqu’elle s’exprime dans le cadre de partis démocratiques, a un pouvoir d’influence que l’on ne peut pas refuser à d’autres si on l’a accepté chez nous. Il me semble que le protestantisme, plus encore peut-être que le catholicisme, a accompagné l’émergence de la démocratie en Europe et sa consolidation. Il reste maintenant à démontrer qu’il peut y avoir des partis islamiques participant au progrès démocratique. Ils l’ont fait en prenant part à des processus électoraux, mais pas encore dans l’exercice même du pouvoir, comme le montre l’exemple égyptien et peut-être aussi tunisien, même si la question n’est pas encore tranchée.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Et au Maroc ?
M. Jean Glavany, rapporteur de la mission d’information. Au Maroc, oui, mais l’expérience est différente, car il s’agit d’une monarchie constitutionnelle.
Qu’il y ait une aspiration à des valeurs universelles, c’est évident, et certaines avancées sont irréversibles. On constate une libération de la parole et de l’expression, pas seulement des réseaux sociaux, mais aussi de la presse. Certains journaux d’opposition français n’oseraient pas être aussi virulents à l’égard du pouvoir. Il y a aussi une aspiration très forte de la jeunesse à la liberté et aux droits individuels et collectifs.
Que pouvons-nous faire pour soutenir la société civile ? Il faut que nous soyons à l’écoute de toutes ses formes d’expression. Nous avons rencontré à la résidence de France à Tunis des jeunes d’univers très divers que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer dans les ambassades, et qui venaient nous dire leur appréciation, elle aussi très diverse, de la situation politique. Il faut encourager nos postes diplomatiques à continuer sur cette voie.
S’agissant des relations entre les Etats-Unis et l’Egypte, les Etats-Unis se sont vite efforcés de confirmer leur partenariat stratégique après le départ de Moubarak et l’installation du régime islamiste. Comme toutes les démocraties occidentales, les Etats-Unis ont pris leurs distances après le coup d’Etat militaire du mois de juillet dernier contre le président Morsi, et ils ont même suspendu une partie de leur aide, mais la situation est en train de rentrer dans l’ordre. Les Etats-Unis ont demandé un gouvernement civil et l’organisation rapide d’élections libres.
Les réfugiés en Jordanie n’entraient pas précisément dans le cadre de notre mission d’information. Il y aurait à ce stade plus de 2 millions de réfugiés syriens, dont plus de 500 000 en Jordanie, et l’onde de choc des révolutions arabes a, par ailleurs, touché ce pays. Des secousses se sont produites, sous une forme atténuée, mais sans que le pouvoir jordanien soit totalement épargné.
En Tunisie, le statut personnel des femmes, qui est avancé et que l’on doit à Bourguiba, tient bon. Les organisations féministes ont bien résisté, malgré les agressions des islamistes, et le projet de rédaction de la Constitution ne présenterait pas de menaces particulières.
Nous avons eu la chance de rencontrer un responsable copte à Alexandrie. Il est vrai que les Chrétiens d’Orient se trouvent actuellement dans un état de grande inquiétude. Les menaces et les attaques auxquelles ils font face sont malheureusement des manifestations classiques de l’extrémisme religieux. Les djihadistes perçoivent les Coptes comme l’expression d’une culture étrangère, voire de puissances étrangères, sur leur territoire. Il faut continuer à demander aux autorités de les aider à sauvegarder leur identité.
La charia est-elle majoritaire ou minoritaire ? Tout dépend de ce que l’on entend par là. Il n’y a pas un islam, mais des islams. Il y en a presque autant que de musulmans. Il y a des islamiques modérés qui seraient des centristes chez nous, d’autres qui le sont un peu moins et que l’on peut qualifier des conservateurs, et il y a les salafistes. Eux-mêmes sont très divers, comme nous l’ont expliqué les représentants de l’un de ces partis en Egypte – il y aurait selon eux cinq écoles du salafisme. Il faut regarder la situation de très près, en fonction des comportements précis des uns et des autres, sans porter de jugements a priori.
S’il y a un pays qui a des chances de s’en sortir, c’est bien la Tunisie. Ou, pour le dire autrement, si cela ne marche pas en Tunisie, on imagine difficilement comment cela pourrait être le cas ailleurs. Pourrait-il y avoir, de même qu’il y a eu un effet de souffle parti de Tunisie en 2010, une « contagion » des bonnes pratiques tunisiennes ? Il faut l’espérer, mais je crois qu’il faut rester prudent sur cette hypothèse.
Il ne s’agit pas de dire que la question de la laïcité n’est pas centrale, mais de ne pas faire de provocation inutile en mettant en avant des concepts au nom desquels des régimes autoritaires ont brimé leurs opposants. Il faut s’abstenir d’utiliser ce terme car il peut susciter de fortes réactions.
La question israélo-palestinienne demeure un bruit de fond continu, et l’irruption des forces islamistes ne change rien de ce point de vue. Lors de l’attaque de l’ambassade israélienne au Caire, les assaillants n’étaient pas des djihadistes, mais des supporters de football qui cherchaient à s’en prendre aux symboles israéliens. Le conflit israélo-palestinien reste extrêmement prégnant dans les consciences, au-delà des seules forces politiques conservatrices, et joue encore un rôle fédérateur.
Il y a aussi, bien sûr, la fracture entre sunnites et chiites, et la rivalité entre l’Arabie Saoudite et le Qatar. On peut avancer, quitte à faire un raccourci, que l’Arabie Saoudite soutient plutôt les salafistes, et le Qatar les Frères musulmans. Tous deux se livrent une guerre de position.
Les « katibas » libyennes pourraient être au nombre de 300. Elles suivent des logiques, notamment tribales, dont il faut avouer qu’elles sont difficiles à décrypter. Et qui aurait pu prévoir qu’une « katiba » puisse enlever le Premier Ministre, voire le numéro deux des renseignements ? En revanche, oui, nous aurions pu anticiper les conséquences de la fin de Kadhafi pour le nord Mali, le sud algérien, le sud libyen et désormais, de façon inquiétante, le sud tunisien, où des affrontements ont lieu entre des terroristes et une armée peu préparée à de telles situations. La circulation des armes dans le sud libyen est un enjeu majeur.
Une conférence ministérielle régionale sur les frontières vient d’ailleurs de se tenir à Rabat. Alors que certains pays souhaitaient visiblement axer la déclaration finale sur la Lybie, qui aurait été pour ainsi dire mise en position d’accusé, elle concerne finalement l’ensemble de la zone sahélo-saharienne. La création d’un centre régional de formation pour les officiers en charge des frontières est notamment prévue. Tout cela peut aider les Etats à se coaliser contre un fléau commun.
La Tunisie est effectivement divisée. Il y a une Tunisie urbaine et éduquée, et une Tunisie rurale, croyante et conservatrice. Il faut faire en sorte qu’elles ne se déchirent pas. Quant à la situation économique, elle est en effet déplorable, notamment en raison de la baisse de l’économie touristique.
Qu’en est-il du panarabisme et des nationalismes ? Il n’y a pas aujourd’hui de panarabisme affiché et, si les événements se déroulent actuellement dans un cadre national très fort, ils ne relèvent pas du nationalisme traditionnel. Jusqu’à présent, il n’y a pas de force nationaliste s’exprimant en tant que telle.
S’agissant des acteurs de ces mouvements, nous avons assisté à l’irruption soudaine d’une société civile jusque-là étouffée. Une grande partie de la population tunisienne s’exprime désormais avec des moyens nouveaux, notamment les réseaux sociaux, mais il y a aussi une presse qui a retrouvé sa liberté d’expression. Il faut y être très attentif.
Nous n’en sommes pas encore à des conjectures militaires entre la France et la Libye, mais il était question, lorsque nous étions à Tripoli, de la négociation d’un contrat pour la formation de policiers libyens. Il vient d’être signé, pour 1 000 policiers, alors qu’il était en souffrance depuis des mois.
M. Jacques Myard, président de la mission d’information. Je conclurai par deux observations.
La première pour insister sur la véracité d’un propos tenu par Hubert Védrine, pour qui aucun pays occidental ne contrôle plus rien dans le monde arabe. Nous pouvons encore exercer une influence, mais même les Etats-Unis ont renoncé à la prétention de contrôler les évolutions qui sont des données internes.
Ma seconde observation porte sur le mode de relations que nous devons privilégier : je plaide pour le « multi-bilatéral ». Nous devons agir pays par pays et avec nos propres moyens. Car les autres pays européens sont nos concurrents, il ne faut pas l’oublier. Une action commune de l’Europe est possible, mais sur des sujets tels que le conflit israélo-palestinien.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Merci pour ces réponses très détaillées.
La commission autorise la publication du rapport d’information.
ANC : Assemblée nationale constituante (Tunisie)
CCG : Conseil de coopération du Golfe
CGN : Congrès général national (Libye)
CNT : Conseil national de transition (Libye)
CPR : Congrès pour la République (Tunisie)
CSFA : Conseil suprême des forces armées (Egypte)
EUBAM : EU Border Assistance Mission (Libye)
FSN : Front de salut national (Egypte)
NOC : National Oil Corporation (Libye)
OLP : Organisation de Libération de la Palestine
PEV : Politique européenne de voisinage
PJC : Parti Justice et Construction (Libye)
PJD : Parti de la Justice et du Développement (Maroc)
PLJ : Parti Liberté et Justice (Egypte)
SCC : Supreme Security Committee (Libye)
UGTT : Union générale tunisienne du travail (Tunisie)
UpM : Union pour la Méditerranée
UTICA : Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Tunisie)
17 décembre 2010 : immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, en Tunisie.
Début janvier 2011 : émeutes en Algérie.
14 janvier 2011 : fuite du président tunisien Ben Ali.
14 janvier 2011 : manifestations de plusieurs milliers de personnes dans plusieurs villes de Jordanie.
17 janvier 2011 : « Marche verte » à Mascate (Oman).
25 janvier 2011 : première manifestation sur la place Tahrir au Caire.
27 janvier 2011 : premières mobilisations dans la capitale yéménite, Sanaa.
Février 2011 : manifestations dans la province de l’Est, à majorité chiite, d’Arabie saoudite.
11 février 2011 : le président égyptien Hosni Moubarak quitte le pouvoir.
12 février : marche organisée à Alger par la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD).
14 février 2011 : des milliers de manifestants se rassemblent sur la place de la Perle dans la capitale du Bahreïn, Manama.
15-16 février 2011 : premières émeutes à Benghazi, en Libye.
20 février 2011 : Manifestations de milliers de Marocains dans plusieurs villes du pays.
25 février 2011 : manifestations à Kirkouk, Mossoul, Hawija, Bagdad et Bassorah en Irak.
27 février 2011 : formation d’un Conseil national de transition (CNT) à Benghazi.
9 mars 2011: Discours du roi Mohammed VI, qui annonce une réforme constitutionnelle au Maroc.
14 mars 2011 : des renforts du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) entrent au Bahreïn.
15 mars 2011 : premier rassemblement à Damas après un appel lancé sur Facebook.
15 mars 2011 : appel à manifester « pour la fin de la division » dans les Territoires palestiniens.
17 mars 2011 : résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le recours à la force pour protéger les populations civiles en Libye.
18 mars 2011 : répression sanglante à Deraa en Syrie.
15 avril 2011 : le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonce la tenue de consultations en vue de réformes politiques.
25 avril 2011 : l’armée syrienne entre à Deraa (Syrie), causant au moins 25 morts.
1er juin 2011 : levée de l’état d’urgence au Bahreïn, annonce d’un « dialogue national » et instauration d’une commission d’enquête indépendante, dirigée par le juriste Chérif Bassiouni.
3 juin 2011 : le président yéménite Saleh est blessé dans un attentat à Sanaa.
27 juin 2011 : la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité à l'encontre de Mouammar Kadhafi, de son fils Seif el-Islam et du chef des services de renseignements Abdullah al-Senoussi.
1er juillet 2011 : adoption par référendum de la nouvelle constitution marocaine (avec plus de 98 % des voix en sa faveur).
Juillet 2011: ouverture officielle d’un « dialogue national » au Bahreïn.
29 juillet 2011 : création de l’Armée Syrienne Libre (ASL).
3 août 2011 : ouverture du procès de Hosni Moubarak.
21 août 2011 : les insurgés libyens entrent dans Tripoli.
10 septembre 2011 : attaque de l’ambassade israélienne au Caire.
15 septembre 2011 : création d’un Conseil national syrien, destiné à rassembler l’opposition.
20 octobre 2011 : mort du colonel Mouammar Kadhafi.
23 octobre 2011 : élection de l’Assemblée nationale constituante en Tunisie.
Novembre 2011 - janvier 2012 : élections législatives en Egypte.
22 novembre 2011 : formation d’un premier gouvernement de transition, dirigé par Abderrahman al-Kib, en Libye.
23 novembre 2011 : le président Saleh signe un accord de transfert du pouvoir au Yémen, sous l’égide du Conseil de Coopération du Golfe.
25 novembre 2011 : victoire du parti islamiste de la justice et du développement (PJD) aux élections législatives anticipées au Maroc.
10 décembre 2011 : adoption de la « petite Constitution » tunisienne, portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
21 février 2012 : Abderrabo Mansour Hadi, candidat unique, est élu Président du Yémen.
Mars 2012 : proclamation de l’autonomie de la « Barqa » (Libye orientale).
10 mai 2012 : victoire du FLN et de ses alliés aux élections législatives en Algérie.
24 juin 2012 : Mohammed Morsi est proclamé vainqueur de l’élection présidentielle en Egypte.
7 juillet 2012 : élection du Congrès général national (CGN) en Libye.
8 août 2012 : le CNT remet officiellement ses pouvoirs au CGN libyen.
14 août 2012 : le président égyptien Morsi limoge le maréchal Hussein Tantaoui, ministre de la défense et chef du Conseil suprême des forces armées.
11 septembre 2012 : attaque du consulat américain à Benghazi, en Libye (quatre morts, dont l'ambassadeur Christopher Stevens).
20 octobre 2012 : formation d’un nouveau gouvernement de transition, dirigé par Ali Zeidan (Libye).
11 novembre 2012 : création de la Coalition nationale des forces de l'opposition syrienne et de la révolution à Doha.
22 novembre 2012 : déclaration constitutionnelle par laquelle le président égyptien Morsi s’attribue l’essentiel des pouvoirs.
25 décembre 2012 : ratification d’une nouvelle Constitution égyptienne, adoptée par référendum les 15 et 22 décembre.
6 février 2013 : assassinat par balles de Chokri Belaïd en Tunisie.
20 février 2013 : démission de Hamadi Jebali, chef du gouvernement tunisien, remplacé par Ali Larayedh, jusqu’alors ministre de l'Intérieur.
7 mars 2013 : le Congrès général national et son président, Mohamed Megarief, sont attaqués par des hommes en armes (Libye).
23 avril 2013 : attentat contre l’ambassade de France à Tripoli.
Mai 2013 : début des incidents sécuritaires dans le djebel Chaambi en Tunisie.
5 mai 2013 : adoption de la loi d’isolement politique en Libye.
29 mai 2013 : démission de Mohammed Megarief, président du Congrès Général national.
16 juillet 2013 : adoption de la loi relative à l’élection des 60 représentants chargés de préparer la nouvelle Constitution libyenne.
25 juillet 2013 : assassinat du député tunisien Mohamed Brahmi.
3 juillet 2013 : déposition du président égyptien Mohamed Morsi.
14 août 2013 : évacuation par la force des campements organisés par les partisans de Mohammed Morsi au Caire.
5 septembre 2013 : tentative d’assassinat du ministre de l’intérieur égyptien.
10 octobre 2013 : enlèvement du Premier ministre libyen, Ali Zeidan, pendant quelques heures.
25 octobre 2013 : début officiel du « dialogue national » en Tunisie.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET DES VISITES EFFECTUÉES
1) A Paris
– M. Mathieu Guidère, professeur d'islamologie et de pensée arabe à l’Université de Toulouse II-Le Mirail (Mercredi 12 décembre 2012) ;
– M. Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (Mardi 22 janvier 2013) ;
– M. Karim Emile Bitar, directeur de recherche à l’IRIS (Mercredi 6 février 2013) ;
– M. Henry Laurens, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe (Mardi 19 février 2013) ;
– M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au Centre national de recherches scientifiques (CNRS) (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) (Mardi 26 février 2013) ;
– Membres du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme (REMDH) (Mardi 5 mars 2013) ;
– M. Bernard Rougier, directeur du Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales du Caire (Mardi 12 mars 2013) ;
– M. Beligh Nabli, directeur de l’Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe (Mercredi 13 mars 2013) ;
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères (Mardi 26 mars 2013) ;
– M. Gilles Kepel, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris (Mardi 2 avril 2013) ;
– M. Joseph Bahout, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, chargé de mission à l’Académie diplomatique internationale ; (Mardi 9 avril 2013) ;
– M. Jean-François Daguzan, directeur-adjoint à la Fondation pour la recherche stratégique (Mardi 16 avril 2013) ;
– Mme Khadija Mohsen-Finan, chercheure associée à l’IRIS (Mardi 14 mai 2013) ;
– M. Samir Aïta, président du cercle des économistes arabes, rédacteur en chef et directeur de l’édition arabe du Monde diplomatique (Mardi 28 mai 2013) ;
– M. Jean-Pierre Filiu, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (Mardi 4 juin 2013) ;
– M. Jean-Louis Guigou, délégué général de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED) (Mardi 4 juin 2013) ;
– M. Alexis Le Cour Grandmaison, sous-directeur Egypte-Levant au ministère des affaires étrangères, accompagné de M. Samuel Jacquin, rédacteur Egypte (Mardi 11 juin 2013) ;
– M. Patrick Haimzadeh, consultant, ancien diplomate (Mercredi 12 juin 2013) ;
– Délégation de l’Assemblée de la Choura égyptienne (Mardi 18 juin 2013) ;
– M. Saïd Haddad, maître de conférences aux écoles de Saint-Cyr – Coëtquidan, chercheur associé à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) (Mardi 18 juin 2013) ;
– Mme Fatiha Dazi-Héni, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (Mercredi 19 juin 2013) ;
– M. Tewfick Aclimandos, chercheur associé au Collège de France (Mardi 25 juin 2013) ;
– M. Luis Martinez, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) de l’Institut d’études politiques de Paris (Mardi 25 juin 2013) ;
– M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie au ministère des affaires étrangères (Mercredi 10 juillet 2013) ;
– Son Exc. M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France, accompagné de M. Zvi Tal, ministre plénipotentiaire, et de Mme Ruthy Said Nedjar, chargée de mission (Mardi 16 juillet 2013) ;
– M. Jonathan Cohen, ministre conseiller (affaires politiques) de l’Ambassade des Etats-Unis, accompagné de M. Jay Munir, conseiller pour le monde arabe (Mercredi 17 juillet 2013) ;
– Mme Bénédicte de Villardi de Montlaur, sous-directrice Afrique du Nord au ministère des affaires étrangères, accompagné de M. Luciano Rispoli, rédacteur Tunisie (Jeudi 18 juillet 2013) ;
– Son Exc. Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en France, accompagné de M. Patrick Haughey, conseiller Affaires étrangères et stratégiques, et de M. Aurélien Gamet, conseiller Affaires politiques (Mercredi 24 juillet 2013) ;
– M. Jean-François Girault, directeur Afrique du Nord - Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères (Mercredi 24 juillet 2013) ;
– M. Serge Telle, ambassadeur, délégué interministériel pour la Méditerranée (Mardi 10 septembre 2013).
2) A l’occasion du déplacement en Egypte et en Tunisie de MM. Jacques Myard, Jean Glavany, Mme Marie-Louise Fort et M. Jean-Philippe Mallé
a. En Egypte (du 10 au 14 février 2013)
Dimanche 10 février 2013 :
– Son Exc. M. Nicolas Galey, ambassadeur de France en Egypte ;
– M. Bernard Regnault-Fabre, consul général ; M. Nicolas Kassianides, premier conseiller ; Mme Ahlem Gharbi, première secrétaire ; M. Gurvan Lebras, premier secrétaire ; M. Franc Secula, chef du service économique régional ; colonel André Valette, attaché de défense ; M. Arif Daood, attaché de sécurité intérieure ; M. Jean-Pierre Marcelli, directeur de l’AFD en Egypte ; M. Hassan Behnam, chef du bureau d’Ubifrance ; M. Fabien Bouvet, stagiaire ENA.
Lundi 11 février 2013 :
– M. Nasser Kamel, assistant du ministre des affaires étrangères pour les affaires arabes ; M. Ali El Hefny, assistant du ministre pour les affaires parlementaires ; M. Omar Youssef, adjoint de l’assistant du ministre pour la coopération entre l’UE et l’Egypte ;
– Général Sameh Seif Al Yazal (en retraite), directeur de la société de sécurité « 4S » Egypte ;
– Général Mohamed Al Assar, conseiller du ministre de la défense, membre du Conseil suprême des forces armées (CSFA) ;
– Dr Emad Abdel Ghaffour, président du parti Al-Watan, conseiller du Président de la République pour le dialogue social ;
– M. Amr Darrag, président du comité chargé des relations internationales du parti Liberté et Justice (PLJ), ancien secrétaire général de l’Assemblée constituante ;
– M. Amr El Mekky, vice-président du parti Al-Nour, chargé des médias ; M. Amr Gad, secrétaire du comité des affaires étrangères ; M. Amr Adam, membre du comité des affaires étrangères ;
– Mme Magda Boutros, chargée du programme sur la justice criminelle à l’Egyptian Initiative for Personal Rights ; Mme Stéphanie David, responsable du bureau de la Fédération internationale des droits de l’homme ; Mme Sanne Von Den Bergh, Fondation Carter.
Mardi 12 février 2013 :
– M. Yves Gauthier (Mobinil), M. Daniel Leroux (Kadco), M. Nicolas Miegeville (Saint-Gobain), M. Maqsood Sher (Gaz de France), M. Philippe Trapp (Accor), M. Adrien Pinelli (Banque mondiale), M. Halim Assem (Thalès), M. Stéphane Campedelli (Vinci-Bouygues), M. Sibry Tapsoba (Banque africaine de développement) ;
– Dr Omar Mohamed Mohamed Salem, ministre des affaires juridiques et parlementaires ;
– Grand Imam Ahmed Al Tayed, cheikh d’Al Azhar ;
– M. Mounir Abdelnour, vice-président du parti Wafd et ancien ministre de la culture ; M. Ossama Ghazali Harb, président du Front démocratique ; M. Amr Hamzawi, président du parti Masr al-horiyya ; M. Mohamed Orabi, ancien ministre des affaires étrangères ;
– M. Khaled Al Khamissi, écrivain ; M. Alaa Al Aswani, écrivain ; M. Samar Al Gamal, journaliste ; M. Hicham Mourad, rédacteur en chef d’El Ahram hebdo ; M. Hassan Khairallah, président de l’Université française d’Egypte ; M. Bernard Rougier, directeur du CEDEJ ; M. Jean-Jacques Pérennès, Directeur de l’Institut dominicain d’études orientales ;
Mercredi 13 février 2013 :
– M. Mohamed Soudan, secrétaire aux relations extérieures à la section du Parti Liberté et Justice d’Alexandrie ;
– Père Abraham Emile, adjoint de Mgr Louis Morcos, vice-patriarche de l’Eglise copte orthodoxe ;
– Son Exc. M. Aly Maher, ancien ambassadeur d’Egypte en France ; Mme Nivine Khaled, vice-doyenne du département de français ; Mme Lana Habib, professeure d’arabe ; M. Patrick Mansour, président de l’entreprise GIVREX Usine ; M. Hichem Aboul-Ela, secrétaire général adjoint de l’Alexandrian Businessmen Association ;
– M. Ismail Seragueldine, directeur de la Bibliotheca Alexandrina ;
– Mme Candace Putnam, consule générale des Etats-Unis ;
– M. Haitham El Hariri et M. Mohamed Mansour (parti Al Doustour).
b. En Tunisie (du 14 au 16 février 2013)
Jeudi 14 février 2013 :
– Son Exc. M. François Gouyette, ambassadeur de France en Tunisie ;
– M. Michel Tarran, ministre conseiller ; Mme Marilyne Olszak, première secrétaire ; M. Etienne Chapon, premier secrétaire ;
– M. Hamma Hammami, Secrétaire général du Parti des Travailleurs, porte-parole du Front populaire ;
– M. Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda ;
– M. Béji Caïd Essebsi, président de Nida Tounès ;
– Rencontre avec des jeunes Tunisiens issus du milieu associatif ;
– Mme Ouided Bouchamaoui, présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ; M. Tarek Cherif, président de la Confédération nationale des entreprises citoyennes (CONECT) ; M. Jamaleddine Gharbi, ministre du développement régional et de la planification ; M. Abderrazak Zouari, ancien ministre du développement régional, président de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) ; M. Hichem Elloumi, président-directeur général du groupe Coficab ; M. François Cherpion, président-directeur général de la société des ciments d’Enfidha ; M. Jaafar Khatteche, président-directeur général de la Banque nationale agricole ; M. Loïc Letierce, directeur général d’AGROLITO ; M. Abdelwahed Ben Ayed, président du groupe Poulina ; M. Tahar Benlakhdar, président-fondateur de l’université ESPRIT ; Mme Christel Péridon, chef du service économique régional ; Mme Michèle Feki, directrice de la mission économique Ubifrance ; M. Cyrille Berton, directeur de l’AFD en Tunisie.
Vendredi 15 février 2013 :
– M. Nejib Chebbi, président du Parti républicain ;
– M. Kacem Afaya et M. Anouar Ben Gaddour, secrétaires généraux adjoints de l’UGTT ;
– M. Mustapha Ben Jaafar, président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) ;
– Mme Maherzia Labidi, vice-présidente de l’ANC ; Mme Souad Abderrahim, présidente de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures ;
– M. Yadh Ben Achour, constitutionnaliste, ancien président de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ;
– Mme Dora Bouchoucha, cinéaste ; Mme Faouzia Charfi, universitaire, ancienne secrétaire d’état auprès du ministre de l’enseignement supérieur du gouvernement tunisien ; Mme Emna Mnif, professeure de médecine, présidente de l’association Kolna Tounes ;
– M. Zied Ladhari, M. Selim Abdesselem et M. Moncef Cheikhrouhou, membres de l’Assemblée nationale constituante ; M. Zied Krichen, rédacteur en chef du journal Le Maghreb ; M. Ridha Kefi, essayiste et journaliste ; M. Mohamed Haddad, universitaire, président de l’Observatoire arabe des religions et des libertés.
3) A l’occasion du déplacement en Lybie et en Tunisie de MM. Jacques Myard et Jean Glavany (du 21 au 23 avril 2013)
a. En Libye
Dimanche 21 avril 2013
– Son Exc. M. Antoine Sivan, ambassadeur de France en Libye ;
– M. Hédi Picquart, premier conseiller ; M. Philippe Rousselin, deuxième conseiller ; M. Emmanuel Rimbert, premier secrétaire ; M. Marc Deballon, conseiller économique ; colonel Hervé Cherel, attaché de défense ; M. Fouad Al-Khatib, attaché de défense adjoint (armement) ; M. Sébastien Lesage, attaché de sécurité intérieure adjoint ; M. Payam Shahrjerdi, attaché de coopération ; M. Igor Chlapak, délégué Ubifrance en Libye ; M. Bernard Goislard, consul ;
– M. Georg Charpentier, adjoint au chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) ;
– M. Khaldoun Sinno, chargé d’affaires a.i. de la délégation de l’Union Européenne ;
– Mgr Giovanni Martinelli, évêque de Tripoli.
Lundi 22 avril 2013 :
– M. Ali Zeidan, Premier Ministre ;
– M. Mohamed Abdelaziz, ministre des Affaires étrangères ;
– M. Mohamed Megarief, président du Congrès général national ;
– M. Hemeida el-Dali, président de la commission des affaires étrangères du Congrès général national, Mme Amina Emtair et M. Akram al-Janin, membres de la commission ;
– Mme Béatrice Bertrand, directrice de l’Institut français ;
– Dr Rida A. Al Tubuly (Together We Build It) ; Mme Nisreen Adham (National Support Group, Women’s Team Coordinator) ; Mme Hiba Khalil (1 Libya Foundation) ; Mme Barbara Neault (Reporters sans Frontières) ; Mme Myriam Zekagh (ACTED) ; Mme Emmanuelle Talon (CFI) ;
– Rencontre avec la communauté française.
b. En Tunisie (le mardi 23 avril 2013)
– Son Exc. M. François Gouyette, ambassadeur de France en Tunisie ;
– Colonel Michel Ravet, attaché de défense ;
– M. Othman Jarandi, ministre des Affaires étrangères ;
– Mme Ahlem Belhaj, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), et Mme Bochra Belhaj Hmida, avocate et ancienne présidente de l’ATFD ;
– M. Ali Larayedh, chef du Gouvernement.
Cartes géographiques de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de la Tunisie, de l’Egypte et de la Libye
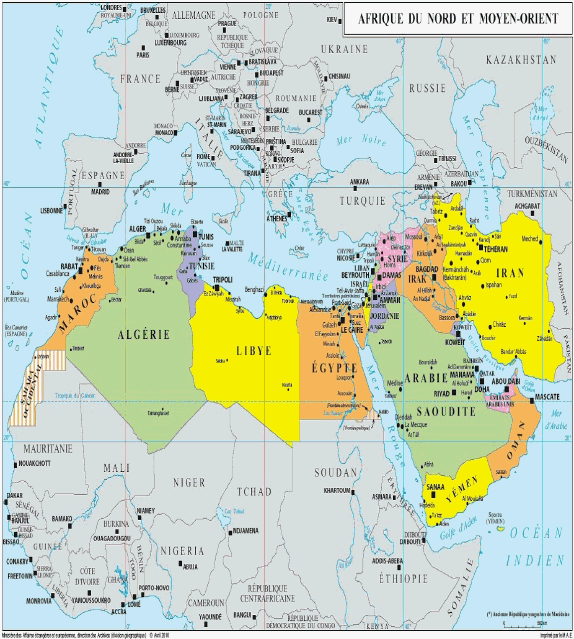
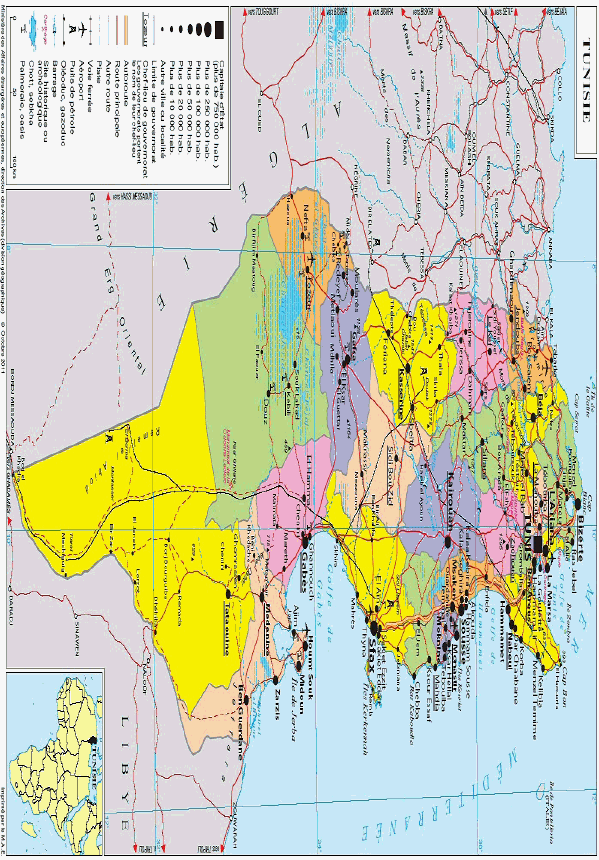
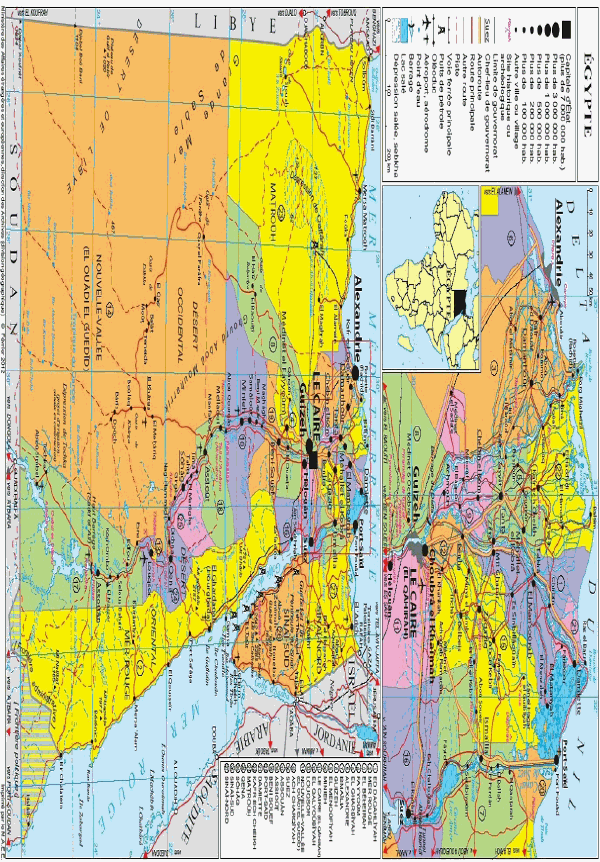
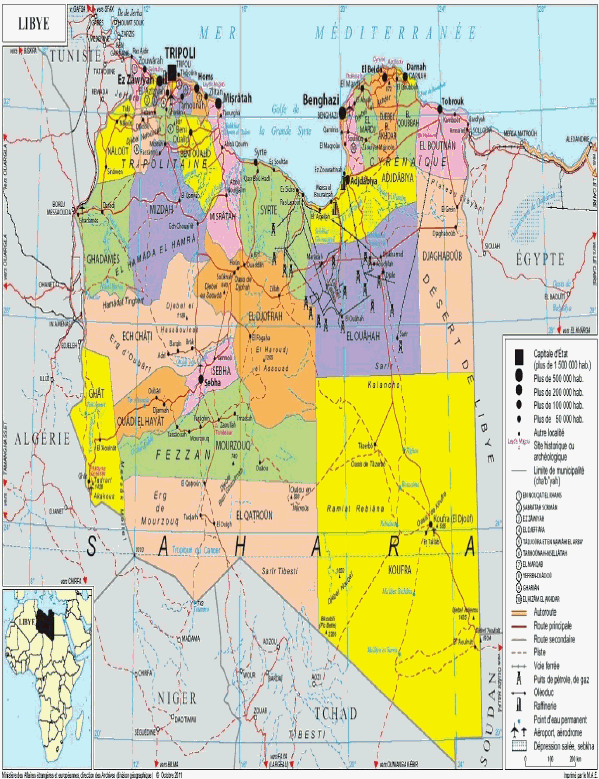
1 () La liste des personnes auditionnées figure en annexe au présent rapport.
2 () Il n’est pas lié à la disparition d’une contrainte extérieure.
3 () Audition du 9 avril 2013.
4 () Audition du 19 février 2013.
5 () Eberhard Kienle, « Les « révolutions » arabes », Critique internationale, n°54, janvier-mars 2012.
6 () Samuel Huntington, Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991.
7 () Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, « La démocratie arabe au regard du néo-orientalisme », Revue internationale et stratégique, 2001, n°3.
8 () Bichara Khader, Le « printemps arabe : un premier bilan », Centre Tricontinental et Editions Syllepse, 2012.
9 () Samir Kassir, Considérations sur le malheur arabe, Actes Sud - Sindbad, 2004.
10 () Jean-Pierre Filiu, La Révolution arabe : Dix leçons sur le soulèvement démocratique, Fayard, 2011.
11 () Audition du 13 mars 2013.
12 () Audition du 2 avril 2013.
13 () Audition du 10 juillet 2013.
14 () Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff, « Printemps arabe : un premier bilan », Afrique du Nord Moyen-Orient, Edition 2012-2013, La Documentation française.
15 () Audition du 2 avril 2013.
16 () Audition du 14 mai 2013.
17 () Tahar Ben Jelloun, L’étincelle, révoltes dans les pays arabes, Gallimard, 2011.
18 () Bichara Khader, Le « printemps arabe : un premier bilan », Centre Tricontinental et Editions Syllepse, 2012.
19 () El Mouhoub Mouhoud, « Economie politique des révolutions arabes : analyse et perspectives », Maghreb Machrek, n°210, hiver 2011-2012.
20 () PNUD, Rapport arabe sur le développement humain, 2009.
21 () Ce pays est traversé d’une scission très forte entre, d’une part, les élites économiques, les classes moyennes et les classes supérieures, et d’autre part les masses qui connaissent un taux de chômage important.
22 () PNUD, Rapport arabe sur le développement humain, 2009.
23 () PNUD, Rapport arabe sur le développement humain, 2009.
24 () Larbi Chouikha et Eric Gobe, « La Tunisie entre la « révolte du bassin minier de Gafsa » et l’échéance électorale de 2009, L’année du Maghreb, V, 2009.
25 () Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations, Seuil, 2007.
26 () Emmanuel Todd, Allah n’y est pour rien, sur les révolutions arabes et quelques autres, Edition Arrêt sur image.net, 2011.
27 () Jean-Pierre Filiu, La Révolution arabe : Dix leçons sur le soulèvement démocratique, Fayard, 2011.
28 () Youssef Courbage, Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations, Seuil, 2007.
29 () Emmanuel Todd, Allah n’y est pour rien, sur les révolutions arabes et quelques autres, Edition Arrêt sur image.net, 2011.
30 () INED, Population & Sociétés, n°503, septembre 2013.
31 () Préface de Youssef Courbage, in Elena Ambrosetti, Égypte, l’exception démographique, Les cahiers de l'INED, n°166, 2011.
32 () INED, Population & Sociétés, n°503, septembre 2013.
33 () Audition du 25 juin 2013.
34 () Jean-Noël Ferrié, L’Egypte entre démocratie et islamisme, le système Moubarak à l’heure de la succession, Editions Autrement, 2008.
35 () Audition du 19 février 2013.
36 () Moncef Marzouki, L’invention d’une démocratie, les leçons de l’expérience tunisienne, Editions La Découverte, 2013.
37 () El Mouhoub Mouhoud, « Economie politique des révolutions arabes : analyse et perspectives », Maghreb Machrek, n°210, hiver 2011-2012.
38 () Source : Banque mondiale.
39 () L’Egypte connaît ainsi des grèves importantes à compter du 25 janvier, notamment à Suez, à Port Saïd et à Mahalla El-Kubra.
40 () Nom choisi en hommage à un cybermilitant battu à mort par la police en 2010 à Alexandrie.
41 () « Facebook et la fin de la division palestinienne », article mis en ligne sur le site Le Monde.fr le 11 avril 2011.
42 () Audition du 4 juin 2013.
43 () Audition du 6 février 2013.
44 () Audition du 13 mars 2013.
45 () Audition du 22 janvier 2013.
46 () Le roi du Maroc, « Commandeur des croyants », passe pour descendre du Prophète, de même que le roi de Jordanie.
47 () Hugh Eakin, «Will Saudi Arabia ever change ? », New York Review of Books, 10 janvier 2013.
48 () Mansouria Mokhefi, « Le Golfe arabo-persique, quelle puissance arabe ? », Moyen Orient, juillet-septembre 2012.
49 () Le pays compterait 6 millions d’abonnés à Facebook et trois millions d’utilisateurs de Twitter.
50 () Antoine Babsous, Le Tsunami arabe, Fayard, 2011.
51 () Conseil consultatif regroupant les représentants de toutes les municipalités du pays.
52 () Bien qu’elle fasse désormais l’objet de critiques, la cérémonie d’allégeance au roi, annualisée en 1962 par Hassan II, se poursuit ainsi avec un simple allégement du protocole.
53 () L’Algérie fait l’objet d’une mission d’information spécifique de la Commission des affaires étrangères.
54 () Frédéric Charillon, « Printemps arabe : un premier bilan » Afrique du Nord Moyen-Orient, édition 2012-2013, La Documentation française.
55 () Aude Signoles, « Palestine : vers une Intifada sociale », Afrique du Nord Moyen-Orient, édition 2013-2014, La Documentation française.
56 () Myriam Benraad, « Irak, la révolution en attente », Moyen-Orient, n°11, 2011.
57 () En Egypte, le maréchal Tantaoui aurait fini par signifier à Moubarak qu’il devait renoncer au pouvoir ; en Tunisie, selon certaines sources, le général Rachid Ammar aurait fait de même.
58 () Union Générale Tunisienne du Travail.
59 () Il ne doit pas être confondu avec son quasi homonyme, Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahada.
60 () Il sera remplacé par Ali Larayedh à la suite de la crise politique qui s’est déclenchée après l’assassinat de Chokri Belaïd, en février 2013.
61 () Antoine Basbous, Le Tsunami arabe, Fayard, 2011.
62 () Vincent Romani, « Egypte 2010 : fin de régime ou fin de règne ? », Afrique du Nord Moyen-Orient, Révolutions civiques, bouleversements politiques, ruptures stratégiques, La Documentation française, édition 2011-2012.
63 () Saïd Haddad, « La fin de l’Etat des masses ou les incertitudes libyennes », L’année du Maghreb, VIII, 2012.
64 () Gilbert Achcar, Le peuple veut, Actes Sud, février 2013.
65 () Le fait que l’intervention en Libye soit allée au-delà de la seule protection des civils, dans la mesure où elle a fini par conduire au renversement de Kadhafi – par la rébellion, mais avec l’appui des bombardements aériens de la coalition internationale –, n’est pas étranger aux réserves d’un certain nombre de pays, en particulier la Russie et la Chine, quant à l’application de la « responsabilité de protéger » à d’autres situations, telles que celle de la Syrie.
66 () Philippe Bas, « Le peuple est-il soluble dans la Constitution ? Leçons tunisiennes », L’année du Maghreb, VIII, 2012.
67 () Mark Tessler, « L’islam dans les sociétés arabes, hier et aujourd’hui », Afrique du Nord Moyen-Orient, Révolutions civiques, bouleversements politiques, ruptures stratégiques, 2010-2011, La Documentation française.
68 () Il compte 200 membres, dont 80, représentant les partis, sont élus au scrutin de liste, et 120 autres, censés être « indépendants », sont élus au scrutin uninominal.
69 () Olivier Roy, « L’entrée dans une ère postislamiste », Esprit, décembre 2011.
70 () Patrick Haenni, « Le rôle des islamistes dans les révolutions arabes », Esprit, décembre 2011.
71 () Alexandre del Valle, « Printemps arabe, hiver islamiste ? », Politique internationale, hiver 2012.
72 () En Tunisie, cette tendance serait historiquement incarnée par Abdelfattah Mourou, co-fondateur et vice-président d’Ennahda, qui s’autorise une grande liberté de ton à l’égard de son propre parti, mais dont beaucoup pensent qu’il est désormais marginalisé en son sein, et aujourd’hui par l’ancien chef du Gouvernement Hamadi Jebali.
73 () Visant à transformer les politiques, les attitudes et les pratiques sur un sujet donné.
74 () « Kefaya » (« ça suffit ») est un rassemblement de militants qui a notamment appelé au boycott des élections présidentielles de 2005.
75 () Jean Philippe Bras, « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », L’année du Maghreb, VIII, 2012.
76 () Réunion, ouverte à la presse, sur la situation en Egypte avec M. Antoine Basbous, directeur de l’Observatoire des pays arabes et Mme Claude Guibal, journaliste à France Culture, ancienne correspondante de Radio France en Egypte (10 juillet 2013).
77 () Patrick Haimzadeh, Au cœur de la Libye de Kadhafi, JC Lattès, avril 2011.
78 () L’exercice fiscal égyptien porte sur la période comprise entre juillet et juin.
79 () Le taux de croissance s’élevait à 5,1 % en 2010.
80 () Il s’agit notamment des projets suivants : la modernisation du port de Rades, un port en eaux profondes à Enfidha, des centrales solaires, la mise à niveau du réseau de transport d’électricité, le renforcement de la sécurité du réseau ferroviaire, la construction de lignes intérieures de train et de deux lignes à grande vitesse, notamment afin d’améliorer les interconnexions régionales, ainsi que la création d’hôpitaux polyvalents et de collèges.
81 () L’agence Fitch Ratings l’a ramenée à « BB- », le 30 octobre 2013, principalement en raison de la situation sécuritaire et de l’incertitude de la transition politique.
82 () Beaucoup d’entreprises privées ont d’ailleurs été éliminées dans les années 1970.
83 () Saïd Haddad, « La fin de l’État des masses ou les incertitudes libyennes », L’année du Maghreb, VIII, 2012.
84 () Si la production est revenue au volume antérieur à la révolution, il reste inférieur à celui des années 1970 – environ 3 millions de barils par jour.
85 () Ce parti est d’ailleurs membre de l’Internationale socialiste.
86 () Moncef Marzouki, L’invention d’une démocratie, La découverte, avril 2013.
87 () Faculté utilisée avec discernement, l’UGTT ayant par exemple suspendu en décembre 2012, à l’issue de négociations avec Ennahda, un appel à la grève générale.
88 () Samir Cheffi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, en mai 2012 – cité par Helà Youfi, « Tunisie : ce syndicat qui incarne l’opposition tunisienne », Le Monde diplomatique, novembre 2012.
89 () Malgré la création de deux autres centrales depuis 2011, la CGTT (Confédération générale tunisienne du travail) et l’UTT (Union des travailleurs de Tunisie), l’UGTT demeure sans véritable rival syndical.
90 () Qui voit l’UGTT combiner offres de bons offices, propositions concrètes et menaces d’action syndicale.
91 () L’Assemblée du peuple a cependant été dissoute en juin 2012 à la suite d’une décision de la Haute cour constitutionnelle.
92 () Les chancelleries occidentales, quant à elles, ont choisi de ne pas qualifier immédiatement les événements, notamment parce que la référence à un coup d’Etat aurait conduit les Etats-Unis à interrompre leur important soutien financier.
93 () La première audience de son procès pour incitation au meurtre lors des manifestations de décembre 2012, qui avaient vu des affrontements sanglants avec ses partisans, s’est tenue le 4 novembre devant un tribunal du Caire ; la suite a été renvoyée au mois de janvier 2014. L’ancien Président fait l’objet d’autres enquêtes en parallèle.
94 () « Marching in Circles: Egypt’s Dangerous Second Transition », Middle East/North Africa Briefing, n°35, International Crisis Group, 7 août 2013.
95 () La population tunisienne est toutefois à 98 % musulmane sunnite de rite malékite.
96 () Six sièges leur ont d’ailleurs été attribués au sein du futur « comité des 60 », qui aura une fonction constituante, ce qui n’a pas empêché le lancement d’une campagne de désobéissance civile et de boycott du Congrès général national.
97 () « Egypt: « How long are we going to live in this injustice ? »: Egypt’s Christians caught between sectarian attacks and state inaction », Amnesty International, 9 octobre 2013.
98 () En 2012, la Banque centrale passait ainsi pour détenir 120 milliards de dollars en réserves de change.
99 () Sur environ 6,5 millions d’habitants.
100 () Environ 4 000 kilomètres de frontières terrestres et 2 000 kilomètres de côtes.
101 () Un navire en provenance de Libye, où se trouvaient plusieurs centaines de migrants – érythréens et somaliens – s’est retourné le 3 octobre dernier au large de l’île de Lampedusa, faisant de très nombreuses victimes.
102 () EU Border Assistance Mission.
103 () On estime qu’un tiers de ces biens ferait l’objet de contrebande, ce qui occasionnerait une perte de 8,6 milliards de dollars par an.
104 () Frederic Wehrey et Peter Cole, « Building Libya’s security sector », Policy Outlook, Carnergie Endowment for International Peace, août 2013.
105 () Quatre personnes y ont perdu la vie, dont l’ambassadeur Christopher Stevens.
106 () Deux gardes de sécurité de la gendarmerie nationale ont été blessés lors de l’explosion.
107 () Dispersés entre la Libye, le Niger, le Tchad et l’Algérie, les Toubous contrôlent une grande partie des zones frontalières entre ces pays. Kadhafi les avait marginalisés, après avoir formé des alliances temporaires avec certains de leurs dirigeants pendant la guerre contre le Tchad, en privant un grand nombre d’entre eux de leur nationalité libyenne.
108 () Luis Martinez, « Libye : une transition à l’épreuve du legs de la Jamarhiriyaa », Les études du CERI, juillet 2013.
109 () Portant, par exemple, sur la gouvernance, le développement économique et territorial, ou encore la formation.
110 () En Tunisie, après avoir posé seins nus sur Facebook, Amina Sboui a ainsi fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir tagué le muret d’un cimetière à Kairouan.
111 () L’ambassade de France en Tunisie, après avoir organisé plusieurs forums tuniso-français – très réussis – de la société civile, a ouvert une « Maison des associations », qui accueille notamment un « Bureau des associations conseil », visant au renforcement des capacités des associations tunisiennes.
112 () Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël, Autorité palestinienne, Liban, Jordanie, Syrie (dont la participation est suspendue).
113 () Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan.
114 () « Un Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée » (8 mars 2011) ; «Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation » (25 mai 2011).
115 () Support for Partnership, Reforms and Inclusive Growth.
116 () Qui rassemble les 28 Etats-membres de l’Union européenne, la Commission européenne et 15 Etats riverains de la Méditerranée - l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, l’Autorité palestinienne, la Syrie (dont la participation est suspendue), la Tunisie et la Turquie.
117 () Tels que l’Université euro-méditerranéenne de Fès, l’achèvement de l’axe autoroutier transmaghrébin ou le plan solaire méditerranéen.
118 () France, Espagne, Italie, Malte, Portugal ; Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
119 () « Pour une stratégie euro-méditerranéenne de colocalisation », Amal Chevreau (coordination), Etudes et analyses, IPEMED, décembre 2012.
120 () Perspective évoquée en 2011, pour la première fois, par la Commission européenne dans une communication conjointe avec la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
121 () MEDREG (Mediterranean Energy Regulators), qui rassemble 23 régulateurs de l’énergie, promeut un cadre transparent, stable et harmonisé dans la région méditerranéenne, pour favoriser l’intégration régionale, les investissements dans les infrastructures, la protection du consommateur et les coopérations dans le domaine de l’énergie.
122 () L’Association méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l'énergie a pour but de renforcer le partenariat interrégional par l'échange d'expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques.
123 () « Vers une Communauté euro-méditerranéenne de l’énergie, passer de l’import-export à un nouvel modèle énergétique régional », IPEMED, mai 2013.
© Assemblée nationale