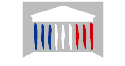
N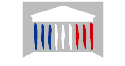
° 1598
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
en conclusion des travaux d’une mission d’information
sur la révision des condamnations pénales,
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Alain TOURRET et Georges FENECH
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : DEUX PROCÉDURES DISTINCTES POUR REVENIR SUR UNE DÉCISION PÉNALE DÉFINITIVE 19
I. LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES : UN RECOURS EXCEPTIONNEL DESTINÉ À RÉPARER LES ERREURS DE FAIT 19
A. DES DEMANDES STRICTEMENT ENCADRÉES PAR LA LOI 19
1. Des conditions préalables de nature à limiter l’accès à ce recours 19
a. Une procédure limitée à certaines décisions judiciaires 19
b. Une liste restreinte de requérants 21
2. Des critères de fond rarement réunis 22
a. Quatre cas d’ouverture prévus par la loi 22
b. L’appréciation rigoureuse du quatrième cas d’ouverture 25
B. UNE PROCÉDURE EN PLUSIEURS ÉTAPES CONFIÉE À LA COUR DE CASSATION 34
1. La commission de révision, préalable obligatoire 34
a. Une commission juridictionnelle instituée en 1989 34
b. Une procédure faiblement formalisée 35
c. Un filtrage sévère des demandes 38
2. La Cour de révision, juridiction de jugement 40
a. La chambre criminelle statuant comme Cour de révision 40
b. Une procédure inspirée de celle de la Cour de cassation 41
c. Une décision d’annulation qui peut faire intervenir une nouvelle juridiction 41
3. Les conséquences juridiques de la révision 45
a. Le droit à une réparation intégrale du préjudice 45
b. Des mesures complémentaires de publicité 46
II. LE RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES : UNE PROCÉDURE RÉCENTE ASSURANT LA RÉOUVERTURE DES PROCÈS EN CAS DE VIOLATION DES DROITS ET LIBERTÉS DU CONDAMNÉ 47
A. LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES : UNE EXIGENCE EUROPÉENNE 47
1. La procédure de réexamen: la réparation d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 47
a. L’approche européenne du réexamen 47
b. Le choix français de distinguer le réexamen de la révision 49
2. Des emprunts nombreux à la procédure de révision 50
a. Une commission de réexamen inspirée de la commission de révision 50
b. Une procédure proche de celle mise en œuvre par la Cour de révision 51
B. UN RECOURS PARTICULIÈREMENT OUVERT 52
1. Des possibilités de recours plus étendues qu’en matière de révision 52
a. La totalité des décisions de condamnation susceptibles de recours 52
b. Un recours introduit par un ensemble plus vaste de personnes et d’autorités 53
c. Un délai d’un an pour former la demande en réexamen 54
2. L’application souple des termes de la loi par la jurisprudence 54
a. Une violation de la Convention européenne des droits de l’homme 54
b. Des conséquences dommageables pour le condamné 55
C. UN RECOURS SOUVENT FAVORABLE AU REQUÉRANT, MAIS PEU UTILISÉ 57
1. Une remise en cause quasi automatique de l’autorité de la chose jugée 57
2. Un recours paradoxalement peu utilisé par les condamnés 58
SECONDE PARTIE : VINGT PROPOSITIONS POUR ENTOURER LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION PÉNALE DE GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES 61
I. CRÉER UNE COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION 61
A. UNE JURIDICTION UNIQUE POUR ASSURER LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES DÉFINITIVES 62
1. Une composition prévue par la loi 62
a. Une cour représentant toutes les chambres de la Cour de cassation 62
b. Un nombre fixe de magistrats 63
c. Des fonctions limitées dans le temps 63
2. Un examen impartial et concret de chaque demande 64
a. Assurer à la Cour une parfaite impartialité 64
b. Donner à la Cour les moyens de juger le fait 64
3. L’harmonisation des pouvoirs décisionnels 65
a. Généraliser la possibilité d’annuler une décision pénale 65
b. Assurer l’effacement de la condamnation du casier judiciaire du requérant 66
B. UNE COMMISSION D’INSTRUCTION INTERNE POUR FILTRER LES DEMANDES EN RÉVISION ET EN RÉEXAMEN 67
1. Une formation interne à la Cour dédiée à l’instruction des demandes en révision et en réexamen 67
2. Un rôle centré sur l’examen de la recevabilité des demandes 68
3. Donner une base légale claire aux pouvoirs d’investigation de la commission 69
C. LES DROITS DES PARTIES PLUS CLAIREMENT DÉFINIS 70
1. Donner des droits au condamné qui demande la révision ou le réexamen de sa condamnation 70
a. Codifier les prérogatives procédurales du requérant 71
b. Affirmer le caractère contradictoire de l’audience 71
c. Assurer au requérant l’assistance d’un avocat 71
2. Clarifier la place de la partie civile devant la Cour de révision et de réexamen 72
II. FAIRE ÉVOLUER LES CONDITIONS DU RECOURS DE RÉVISION 73
A. CONSERVER LE CHAMP ACTUEL DE LA RÉVISION 73
1. Maintenir les contraventions en dehors du champ de la révision 73
2. Ne pas permettre la révision des décisions d’acquittement 74
B. OUVRIR LA RÉVISION À DE NOUVEAUX REQUÉRANTS 76
1. Élargir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins et aux petits-enfants 76
2. Offrir au parquet la faculté de demander la révision d’une condamnation 77
C. CLARIFIER LA RÉDACTION DES CAS D’OUVERTURE 78
1. Qualifier, dans la loi, le doute nécessaire à l’aboutissement d’une demande en révision 78
2. Préserver la nature du recours en révision en renonçant à réparer le "mal-jugé" 79
3. Maintenir tous les cas d’ouverture dans un souci de sécurité juridique 80
III. AMÉNAGER LA PROCÉDURE CRIMINELLE POUR GARANTIR L’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION 81
A. CONSERVER LES SCELLÉS PENDANT UNE DURÉE PROPRE À ASSURER UNE ÉVENTUELLE RÉVISION 82
1. Des progrès scientifiques qui rendent indispensable la conservation des scellés 82
2. Une destruction des scellés qui intervient six mois après la condamnation définitive 83
3. Conserver les scellés criminels à la demande du condamné 85
B. PERMETTRE AU CONDAMNÉ DE DEMANDER LA RÉALISATION D’ACTES D’INVESTIGATION APRÈS SA CONDAMNATION 86
C. DONNER À LA JUSTICE LES MOYENS D’APPRÉCIER LE CARACTÈRE NOUVEAU OU INCONNU D’UN FAIT OU D’UN ÉLÉMENT 88
1. Assurer la mémoire de l’audience par l’enregistrement des débats des cours d’assises 88
a. Une faculté laissée à la libre appréciation du président de la cour d’assises 88
b. La nécessité de prévoir l’enregistrement obligatoire de l’ensemble des débats criminels 89
2. Parvenir à une meilleure motivation des arrêts de cours d’assises 89
a. La motivation minimale des arrêts de cours d’assises introduite par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 90
b. Une motivation qui demeure insatisfaisante au regard des enjeux de la révision 92
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 95
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 103
LISTE DES AUDITIONS CONDUITES PAR LA MISSION D’INFORMATION 106
ANNEXE 1 : CONDAMNATIONS CRIMINELLES AYANT ÉTÉ ANNULÉES DEPUIS 1989 109
ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS DE RÉVISION DEPUIS 1989 110
ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DE RÉEXAMEN DEPUIS 2000 111
ANNEXE 4 : LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES DANS LES PAYS EUROPÉENS 112
CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES PERSONNES ENTENDUES 123
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a décidé de créer, le 24 juillet 2013, une mission d’information sur la révision des condamnations pénales. Cette mission est la première de la législature à être composée de deux membres, l’un et l’autre rapporteurs. Fort de leurs expériences professionnelles passées, respectivement en tant qu’avocat et magistrat, vos rapporteurs ont souhaité évaluer le dispositif législatif actuel.
Vos rapporteurs ont décidé de conduire leurs travaux, ouverts à l’ensemble des membres de la commission des Lois, en toute transparence. C’est pourquoi les auditions ont été ouvertes à la presse et retransmises sur le site internet de l’Assemblée nationale, à l’exception de celles pour lesquelles les personnes ont souhaité être entendues à huis clos. De nombreuses contributions écrites, d’une très grande qualité, ont été remises à vos rapporteurs (1).
Vos rapporteurs ont reçu 49 personnes, parmi lesquelles quatre anciens gardes des Sceaux, les plus hauts magistrats de la Cour de cassation, ainsi qu’un très grand nombre de praticiens, magistrats et avocats, mais aussi des chercheurs, juriste et sociologue. Les condamnés et les victimes, par le biais de l’audition d’associations, ont également été entendus. La commission nationale consultative des droits de l’Homme, comme la ligue des droits de l’homme, ont fait valoir leurs points de vue. Sur les aspects plus scientifiques de cette question, un laboratoire d’expertises médico-légales et la sous-direction de la police technique et scientifique ont pu contribuer à la réflexion de vos rapporteurs sur la conservation des scellés. En outre, vos rapporteurs ont tenu à donner une réalité plus concrète à leurs travaux, en recevant des journalistes, ainsi que des personnes directement impliquées dans ces procédures, comme MM. Denis Seznec et Roland Agret. Ils ont également été accueillis au sein de la commission de révision des condamnations pénales. Enfin, leurs réflexions se sont nourries de la lecture des décisions judiciaires les plus marquantes, dont le rapport se fait d’ailleurs l’écho (2). Vos rapporteurs ont également souhaité rassembler, dans le présent rapport, les éléments statistiques épars qui ont pu leur être transmis, ainsi que des éléments de droit européen comparé (3).
La richesse de ces auditions comme la qualité des intervenants ont donné un éclairage inestimable aux travaux de la mission. Tous ont pu s’exprimer avec franchise et liberté et beaucoup ont eu le sentiment, partagé par vos rapporteurs, de participer à un moment important de l’histoire judiciaire.
*
* *
Une fois que la justice s’est prononcée sur le sort d’un accusé ou d’un prévenu, la condamnation est considérée comme définitive, dès lors que les voies de l’appel et de la cassation ne peuvent plus être empruntées. Cette caractéristique essentielle des décisions judiciaires porte un nom : l’autorité de la chose jugée. Sans elle, les décisions judiciaires seraient sans cesse remises en cause et les procès se multiplieraient. L’autorité de la chose jugée, en éteignant les litiges, est une condition essentielle de la paix sociale, mais elle est aussi indispensable à l’ordre juridique. En effet, quelle autorité aurait une décision qui pourrait être perpétuellement combattue ?
Mais, comme le professeur Henri Motulsky l’affirmait, « l’institution de l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas moins entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de la sécurité juridique sur la valeur de la justice » (4). D’ailleurs, la chambre civile de la Cour de cassation ne dit pas autre chose lorsqu’elle juge que le principe de l’autorité de la chose jugée « est général et absolu et [qu’il] s’attache même aux décisions erronées » (5). L’autorité de la chose jugée protège, en temps normal, l’ordre juridique et social ; mais ce principe ne tient plus face à une erreur judiciaire qui fragilise la vérité judiciaire et trouble parfois profondément la société, comme en témoigne l’impact des affaires Calas, Sirven, de La Barre ou Dreyfus.
La procédure de révision constitue précisément cette soupape de sécurité dont tout système judiciaire a besoin pour contrebalancer le principe de l’autorité de la chose jugée. Affirmer que la justice commet des erreurs ne doit pas conduire à jeter le discrédit sur l’institution ; l’erreur judiciaire est inhérente à la fonction de juger. Elle est d’ailleurs rarement fautive, le jugement n’étant que le résultat des éléments fournis, au moment du procès, à l’appréciation des magistrats. Tout l’enjeu de la révision repose d’ailleurs sur la survenance d’éléments nouveaux, à même de changer le verdict s’ils étaient à nouveau soumis aux juges. Dès lors, la procédure de révision peut être considérée comme un « facteur d’ennoblissement de la justice », car « une justice qui reconnaît ses erreurs et les corrige, sans s’efforcer de les maintenir et de les dissimuler par de vaines formules, est une justice édifiante, qui ne peut inspirer que de la confiance et du respect » (6).
Toute la difficulté de la révision tient à la nécessité de concilier deux exigences apparemment contradictoires : d’une part, les impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qui doivent limiter les exceptions au principe de l’autorité de la chose jugée ; d’autre part, la nécessité de réparer l’erreur judiciaire qui a conduit à la condamnation d’une personne innocente, mais également, dans certains cas, à l’impunité du coupable. L’une comme l’autre sont indispensables au bon fonctionnement de notre État de droit.
C’est donc un véritable dilemme qui est posé au législateur, que rappelle M. Henri Angevin, conseiller honoraire à la Cour de cassation : « Entre les deux impératifs que constituent le respect de l’autorité de la chose jugée et la nécessité de réparer l’erreur judiciaire, la marge de manœuvre des législateurs est étroite. S’il est indispensable qu’une soupape de sûreté soit prévue pour permettre de réexaminer une décision répressive définitive lorsqu’il existe, sinon une certitude, du moins de suffisantes présomptions qu’elle a été prononcée à la suite d’une erreur de fait, l’exercice de ce recours exceptionnel doit, sous peine de ruiner le principe de l’autorité de la chose jugée, être subordonné à des conditions strictement déterminées » (7).
*
* *
La nécessité de concilier l’autorité de la chose jugée avec la reconnaissance de l’innocence de personnes injustement condamnées est une préoccupation ancienne, ainsi qu’en témoigne l’histoire de la révision des condamnations pénales.
La France de l’Ancien régime connaît déjà la révision. Prévue par l’ordonnance criminelle du 26 août 1670, cette procédure permettait aux personnes injustement condamnées d’obtenir du Conseil du Roi des « lettres de révision ». Aux termes de l’article VIII (8) du titre XVI de cette ordonnance, la procédure de révision était ainsi organisée : le condamné ou ses parents adressaient une requête circonstanciée au Conseil du Roi ; celle-ci était examinée par le chancelier, qui pouvait solliciter l’avis des maîtres des requêtes du Roi. L’affaire était ensuite examinée par le Conseil du Roi qui, s’il estimait la demande fondée, délivrait une lettre de révision qui devait, en application de l’ordonnance, être adressée aux juges à l’origine de la condamnation en cause. Néanmoins, il semble que cette dernière disposition n’ait pas été strictement appliquée et que les procès en révision se soient plutôt tenus devant de nouveaux juges. En effet, comme l’indiquait Guy du Rousseaud de La Combe, avocat au Parlement de Paris, dans son Traité des matières criminelles de 1762, « on a peine à détruire son propre ouvrage, ce qu’il faut éviter, principalement en matière criminelle, où il s’agit quelquefois de la vie ».
La procédure de révision de l’Ancien régime comportait donc des traits communs avec la procédure actuelle. Outre qu’elle ne pouvait qu’être favorable au condamné, et n’était dès lors pas ouverte aux parties civiles, la procédure de révision était conçue comme une procédure exceptionnelle. Comme l’indiquait Guy du Rousseaud de La Combe dans l’ouvrage précité, « à cause des conséquences, par rapport à la force des choses jugées, les lettres de révision ne s’obtiennent pas aisément, il faut de grands et puissants moyens, soit dans la forme, soit au fond ; dans la forme, des nullités essentielles de la procédure ; au fond, une iniquité évidente dans la condamnation par l’innocence du condamné sur le crime qui lui était imputé ». Si le Conseil du Roi ne statuait pas sur le fond de l’affaire, son arrêt était, comme celui de la Cour de révision actuelle, presque synonyme de reconnaissance de l’innocence du condamné.
Cette procédure disparut lors de la Révolution, l’instauration du jury populaire et l’octroi de certaines garanties aux prévenus et accusés rendant inutile une procédure de révision qui permettait auparavant de réparer les errements d’un système corrompu, guidé par le régime des preuves légales et riche d’erreurs judiciaires. Néanmoins, en 1793, la révision des condamnations pénales fut de nouveau admise, mais dans des hypothèses extrêmement limitées. Un décret (9) fut ainsi pris le 15 mai 1793 afin de remédier à une erreur judiciaire flagrante : deux personnes distinctes avaient été condamnées à 16 ans de travaux forcés pour un même vol de mouchoir. C’est là une première brèche ouverte dans le droit révolutionnaire, qui ne cessera de s’élargir par la suite.
En effet, alors qu’en 1795, la révision était absente du code des délits et des peines du 3 Brumaire an IV, elle fut rétablie par la Cour de cassation au tournant du siècle, par une décision du 9 vendémiaire an IX. Dans l’affaire qui a conduit à cette décision, le tribunal du Haut-Rhin avait prononcé deux condamnations distinctes pour un seul et même fait de vol. Un recours en révision, fondé sur le décret du 15 mai 1793, avait été intenté, mais son auteur avait été débouté par la Cour de justice criminelle, qui avait jugé que le recours en révision créé en 1793 avait été implicitement abrogé par l’adoption du code de l’an IV. La Cour de cassation, en indiquant que ce code ne faisait pas obstacle à l’application dudit décret, rétablit ainsi la procédure de révision dans le cas de deux jugements inconciliables.
Par la suite, le premier Empire mit en place une procédure de révision plus complète à l’occasion de la rédaction du code d’instruction criminelle de 1808. Si la volonté du législateur est encore timide, la croyance en l’infaillibilité du jury populaire et la sacralisation de ses décisions commencent à se fissurer, comme en témoignent les propos du comte Berlier, orateur du Gouvernement, au cours de la séance du 30 novembre 1808 : « Longtemps, Messieurs, on a cru que toute révision, quelque plausible qu’en fût le motif, était incompatible avec l’institution du jury (…) en admettant des causes de révision, l’on eût craint d’attaquer la base même sur laquelle repose tout le système de notre procédure criminelle. Sans doute cette crainte eût été et serait encore légitime, s’il s’agissait de généraliser la révision et de l’appliquer hors du petit nombre de cas où il y a, soit erreur évidente, soit du moins une juste présomption d’erreur (…) Toutefois, et bien que les condamnations erronées doivent être rares dans un tel système, il sort de la main des hommes, et sa perfection n’est pas telle que l’erreur n’y puisse pénétrer jamais ».
Toutefois, afin de préserver l’autorité de la chose jugée, seuls trois cas peuvent conduire, en 1808, à une nouvelle instruction et à la révision d’une condamnation pénale confiée à la Cour de cassation. Les deux premiers cas d’ouverture sont la simple traduction du bon sens. Lorsque deux personnes sont condamnées pour un même crime par deux jugements différents, que ces deux jugements ne peuvent se concilier – les personnes, par exemple, ne peuvent être complices – et qu’ils sont nécessairement la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre, alors l’article 443 du code d’instruction criminelle prévoit que les deux jugements sont cassés et qu’une nouvelle instruction est ouverte afin d’établir l’identité du coupable réel. Par ailleurs, lorsqu’une personne a été condamnée pour un homicide commis sur une prétendue victime qui se révèle vivante, alors « l’individu supposé mort (…) efface, par sa seule présence, toute idée du crime » (10) et l’article 444 assure la révision de la condamnation. Le cas d’ouverture prévu par l’article 445, qui réside dans la condamnation d’un témoin à charge pour faux témoignage, est moins évident que les deux premiers. En effet, il est possible que ce faux témoignage ne soit pas seul à l’origine de la condamnation, auquel cas de nouveaux débats sont nécessaires pour établir la culpabilité ou l’innocence du condamné.
Les dispositions du code d’instruction criminelle, dont la procédure actuelle de révision est l’héritière, ouvrent de façon volontairement limitée le recours en révision, comme l’indiquent les propos tenus par l’orateur du Gouvernement lors la présentation du texte au corps législatif : « C’est ici qu’une grande circonspection est nécessaire, car tout excès serait nuisible, et, sans les limites tracées avec sagesse et précision, ce ne serait plus la justice appliquée à quelques espèces, mais l’arbitraire planant sur toutes, et tendant, sous de frivoles prétextes, à tout remettre en question » (11).
Toutefois, le caractère restrictif du code d’instruction criminelle devait conduire à l’introduction, en 1813, d’une procédure de révision gracieuse, ordonnée par l’Empereur lui-même, en dehors des cas prévus par le code.
Une affaire particulière est à l’origine de ce nouvel élargissement de la procédure. Sébastien Ellenbergh, condamné en 1806 pour s’être rendu complice d’un vol commis par Gérard Garçon, est finalement innocenté par de nouveaux juges d’instruction ; le vrai coupable, dénoncé par Gérard Garçon, ne peut cependant plus être poursuivi, l’affaire étant prescrite. Le cas de Sébastien Ellenbergh, dont l’innocence est pourtant évidente, n’entre pas dans les dispositions du code d’instruction criminelle : aucune autre condamnation ne peut effacer la sienne, aucun faux témoignage n’a été produit. Certes, Sébastien Ellenbergh aurait pu bénéficier d’une grâce, prérogative impériale. Néanmoins, la grâce a un sens bien différent de la révision, puisqu’elle conduit à reconnaître indirectement la culpabilité du condamné. C’est pourquoi, par une lettre-patente du 10 décembre 1813, Napoléon enjoint à la Cour de cassation de réviser l’arrêt en cause.
D’autres affaires conduiront à plusieurs évolutions de la procédure de révision au cours du XIXe siècle. L’affaire dite du courrier de Lyon de 1796 est notamment à l’origine de la modification intervenue en 1867. En 1796, une diligence est attaquée entre Paris et Lyon ; une somme importante est dérobée et le postillon, assassiné. Plusieurs hommes sont arrêtés dans les jours qui suivent ; l’un d’entre eux, le sieur Guénot, est relâché, mais ses papiers lui sont confisqués. En allant les récupérer au tribunal, il rencontre Joseph Lesurques, un ami d’enfance, qui accepte de l’accompagner. Alors qu’ils attendent le juge, deux témoins qui devaient déposer les identifient comme étant les auteurs du crime. Joseph Lesurques, qui clame son innocence, est condamné à mort la même année. En 1801, un autre homme, condamné pour ce même crime, confirme, avant son exécution, l’innocence de Joseph Lesurques. En 1864, alors que la famille de Joseph Lesurques demande le remboursement des frais de justice qu’elle a injustement payés, le Gouvernement s’engage à modifier le code d’instruction criminelle.
En 1867, une loi est votée qui, si elle ne modifie pas les trois cas d’ouverture prévus par le code d’instruction criminelle, ouvre le recours en révision à la matière correctionnelle et aux décisions de toutes les juridictions, y compris militaires. Par ailleurs, pour permettre à la famille Lesurques de demander la révision du procès de Joseph Lesurques, la loi du 29 juin 1867 ouvre à la famille du condamné décédé la possibilité de demander une révision. Jusqu’alors, une telle révision, posthume, n’était possible que dans le cas de l’homicide inexistant. Néanmoins, cette loi ne suffit pas à assurer la révision de la condamnation de Joseph Lesurques, qui l’avait pourtant motivée. En effet, en 1868, la Cour de cassation rejette la demande de la famille, puisque la condamnation incriminée n’est pas strictement inconciliable avec celles des autres auteurs de l’infraction…
Lors de l’examen de ce texte, le député Louis Martel avait déposé un amendement tendant à créer un quatrième cas d’ouverture, reposant sur la notion d’erreur de fait, qu’il défendait ainsi : « au lieu de circonscrire d’une façon extrêmement rigoureuse et limitative les cas dans lesquels la révision des procès pourra avoir lieu, on ouvre une voie qui donne toujours satisfaction à un innocent condamné » (12). Il avait également été question, pendant les débats, d’octroyer une réparation aux condamnés reconnus innocents. Mais il faudra attendre 1895 pour que le législateur fasse évoluer le droit sur ces deux points.
En effet, après l’émotion suscitée par deux condamnations non révisées, celles de Joseph Borras (13) et Pierre Vaux (14), le législateur, par la loi du 8 juin 1895, organisa la possibilité d’une réparation tant pécuniaire que morale du préjudice subi et ajouta le « fait nouveau » aux trois cas d’ouverture existants. Néanmoins, il ne donna le pouvoir de demander la révision sur le fondement d’un fait nouveau de nature à établir l’innocence du condamné, ou de la production de pièces inconnues lors des débats, qu’au ministre de la justice, limitant ainsi fortement son emploi.
Le code de procédure pénale adopté en 1958 reprend, pour l’essentiel, les dispositions du code d’instruction criminelle. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’une nouvelle évolution législative se dessine, dans le cadre cette fois de l’affaire Mis et Thiennot (15). En octobre 1983, M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, dépose devant le Parlement un projet de loi modifiant le code de procédure pénale, le code pénal et le code de l’organisation judiciaire et relatif à la personnalisation et à l’application des peines, ainsi qu’à la révision des condamnations pénales. Si ce projet de loi n’a jamais pu être examiné, la proposition de loi de M. Michel Sapin, qui en reprenait les principaux éléments, a, quant à elle, débouché sur la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales.
La loi du 23 juin 1989 a apporté d’importantes modifications à la procédure de révision des condamnations. S’inspirant d’une jurisprudence quasi centenaire de la Cour de cassation (16), la modification de l’article 622 du code de procédure pénale a conduit à n’exiger qu’un doute sur la culpabilité du condamné, au lieu de la certitude de son innocence, pour examiner la demande de révision. La loi a également permis aux condamnés, et non plus seulement au ministre de la justice, de demander la révision d’une condamnation sur le fondement d’un fait nouveau. Enfin, le filtre jusqu’alors exercé par le garde des Sceaux a été confié à une juridiction nouvelle, la commission de révision des condamnations pénales.
Ainsi, depuis 1989, la procédure de révision est mise en œuvre par deux juridictions spécifiques. Le recours est d’abord introduit auprès de la commission de révision des condamnations pénales, chargée du filtrage et de l’instruction des demandes. Si elle estime que la demande répond à l’un des quatre cas de figure prévus par la loi, elle saisit alors la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision, qui a seule le pouvoir d’annuler une condamnation pénale, avec ou sans renvoi à une juridiction de fond.
En 2000, l’affaire Hakkar a conduit le législateur à faire à nouveau évoluer le contentieux des décisions pénales définitives. Alors que la France est condamnée, en 1995, par le juge européen pour ne pas avoir offert au condamné un procès équitable, la réouverture du procès est impossible au regard du droit français. Pour remédier à cette situation choquante, le Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la présomption d’innocence, crée une procédure distincte de la procédure de révision : la procédure de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) (17), mise en œuvre par une commission unique rattachée à la Cour de cassation.
Depuis 1989, le droit français connaît donc deux procédures distinctes, ouvertes aux condamnés (18), permettant de revenir sur une condamnation pénale définitive : la révision des condamnations pénales mentionnée aux articles 622 à 626 du code de procédure pénale, et le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH prévu aux articles 626-1 à 626-7 du même code.
Depuis 1989, 3 358 demandes ont été présentées à la commission de révision, qui a rendu, pour l’heure, 3 171 décisions (19). Parmi ces demandes, 2 122 ont été jugées irrecevables, 965 ont été rejetées et 84 seulement ont conduit à la saisine de la Cour de révision. Au total, depuis 1989, 84 décisions ont été prises par la Cour de révision, dont 51 décisions d’annulation et 33 décisions de rejet. En matière de réexamen, la commission de réexamen n’a été saisie que de 55 demandes depuis sa création, en 2000, et elle a fait droit à 31 d’entre elles (20). Ces procédures ont un taux de succès radicalement opposé : alors qu’une demande en révision a 1,5 % de chances d’aboutir, une demande en réexamen aboutit dans 56 % des cas.
Enfin, à titre anecdotique, il convient de noter qu’une troisième voie de réformation extraordinaire existe, dont le champ est cependant limité aux condamnations pour outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre. Instauré par la loi du 25 septembre 1946 (21), ce recours ne peut être mis en œuvre que par la Société des gens de Lettres. C’est grâce à cette procédure que, par exemple, la condamnation de Charles Baudelaire pour son ouvrage Les Fleurs du Mal a pu être révisée en 1949. Néanmoins, l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs ayant été supprimée depuis le 1er mars 1994 et le recours ne pouvant être exercé que dans un délai de vingt années, cette procédure est vouée à s’éteindre très prochainement.
*
* *
Pour certains, le temps d’une réforme de grande ampleur serait dépassé, l’instauration d’un appel des décisions de cour d’assises et les développements de la police technique et scientifique limitant fortement le risque d’une erreur judiciaire. Au contraire, pour vos rapporteurs, la qualité du système judiciaire se mesure à l’aune de sa capacité à réparer ses erreurs, aussi rares soient-elles. Dès lors, même si l’on doit se réjouir du tarissement théorique des erreurs judiciaires, il est nécessaire de mener à bien cette évaluation du droit existant, afin de formuler, le cas échéant, des recommandations propres à en assurer le perfectionnement. Les auditions conduites par vos rapporteurs ont rapidement fait apparaître le caractère perfectible des procédures de révision et de réexamen et certains aspects de la question les ont particulièrement interpellés.
En premier lieu, comment expliquer que seules 8 condamnations criminelles (22) aient été révisées depuis 1989 ? Le faible nombre de décisions d’annulation en matière criminelle doit être mis en regard avec les résultats de l’introduction, depuis le 1er janvier 2001, de l’appel des décisions des cours d’assises. Entre 2003 et 2005, 1 262 condamnés ont été rejugés en appel ; les cours d’assises d’appel ont prononcé un acquittement dans 64 cas, soit 5 % (23). Même s’il est difficile de comparer ces données, les décisions rendues en appel étant le fruit de l’appréciation nouvelle portée par une autre juridiction sur un même dossier, elles témoignent néanmoins du fait que le nombre de révisions est probablement inférieur au nombre d’erreurs judiciaires.
Par ailleurs, comment est-il possible qu’en dépit des progrès scientifiques importants intervenus ces dernières décennies, dans l’analyse des informations génétiques, des traces papillaires, des écritures, des voix ou des odeurs, dont on aurait pu s’attendre à ce qu’ils entraînent un accroissement significatif des révisions fondées sur l’émergence de faits nouveaux, aucune évolution significative ne semble être intervenue ?
Enfin, pour quelles raisons la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales n’a-t-elle entraîné aucune modification substantielle dans l’examen des demandes en révision ? En effet, la saisine de la juridiction de révision est demeurée stable depuis la réforme : alors que le garde des Sceaux adressait environ 3,2 saisines par an à la Cour de cassation, la commission de révision saisit la Cour de révision de 3,4 demandes par an en moyenne. La commission de révision joue donc tout autant son rôle de filtre que ne le faisaient assurément, avant 1990, les services de la Chancellerie. De la même façon, le nombre de décisions d’annulation rendues par la Cour de cassation n’a pas réellement évolué depuis 1989. En moyenne, entre 1983 et 1988, la Cour de cassation a prononcé, par an, 1,83 décision d’annulation et une décision de rejet ; depuis 1989, la Cour de révision a rendu, en moyenne, par an, deux décisions d’annulation et 1,32 décision de rejet, soit des ordres de grandeur très proches. Enfin, la jurisprudence de la Cour de révision n’a pas évolué malgré les modifications législatives ; il semble qu’un doute sérieux sur la culpabilité du condamné soit toujours nécessaire à la révision.
Entre ces deux impératifs contradictoires que sont la préservation de l’ordre juridique et la réparation d’une erreur judiciaire, le choix est aisé, tant est insupportable la pensée que des innocents puissent subir les effets d’une condamnation pénale. Pour autant, il ne saurait être question de faire des procédures de révision et de réexamen des voies de recours ordinaires, assimilables à l’appel. C’est pourquoi ces recours doivent nécessairement être entourés de certaines conditions. Mais, si ces procédures doivent demeurer exceptionnelles, elles doivent également aboutir toutes les fois que la demande est légitime. Si la voie du législateur est étroite, vos rapporteurs sont convaincus, comme Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, que la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ne peut qu’être renforcée par la correction des erreurs judiciaires.
Afin d’évaluer l’opportunité d’éventuelles modifications législatives, il convient, dans une première partie, d’analyser le fonctionnement des procédures de révision et de réexamen ; ensuite, dans une seconde partie, vos rapporteurs, se faisant l’écho de la Cour de cassation et de la quasi-totalité des personnes entendues par la mission, proposent que soient apportées certaines modifications au droit existant.
PREMIÈRE PARTIE : DEUX PROCÉDURES DISTINCTES POUR REVENIR SUR UNE DÉCISION PÉNALE DÉFINITIVE
La procédure pénale offre aujourd’hui deux moyens aux personnes condamnées de soumettre à nouveau à la justice une affaire sur laquelle elle s’est pourtant définitivement prononcée : la révision et le réexamen. Ces deux procédures ont pour effet commun de permettre la réouverture du procès dans le cas où une erreur, de fait ou de droit, vicie profondément la décision judiciaire. D’ailleurs, certains condamnés actionnent la procédure de réexamen concomitamment ou ultérieurement à une demande en révision, dans l’unique but d’accéder à un nouveau procès.
I. LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES : UN RECOURS EXCEPTIONNEL DESTINÉ À RÉPARER LES ERREURS DE FAIT
Les statistiques disponibles montrent que la révision des condamnations pénales définitives est extrêmement rare (cf. supra), notamment en matière criminelle, avec seulement 8 révisions depuis 1989 (24). Cependant, ces chiffres sont susceptibles d’être interprétés de façon radicalement opposée : ils peuvent être révélateurs du bon fonctionnement d’un système judiciaire qui ne connaîtrait qu’un très faible taux d’erreur ou, à l’inverse, indiquer que la procédure de révision telle qu’elle existe aujourd’hui est trop restrictive pour assurer la réparation de l’intégralité des erreurs judiciaires potentiellement commises.
A. DES DEMANDES STRICTEMENT ENCADRÉES PAR LA LOI
Afin de prévenir toute utilisation dilatoire de la procédure de révision et de lui conférer un caractère exceptionnel, les demandes en révision font l’objet d’un encadrement légal et d’une interprétation jurisprudentielle qui limitent son usage.
1. Des conditions préalables de nature à limiter l’accès à ce recours
Des conditions préalables tenant à la nature de la décision attaquée comme à la qualité du requérant permettent de cerner les contours de la révision telle qu’elle existe aujourd’hui en France.
a. Une procédure limitée à certaines décisions judiciaires
Seules certaines décisions judiciaires sont susceptibles de faire l’objet d’une révision. En effet, l’article 622 du code de procédure pénale dispose que « la révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit ».
–– Une décision ayant acquis un caractère définitif
Seules les décisions définitives, passées en force de chose jugée, peuvent faire l’objet d’un recours en révision. Ainsi, la révision ne peut être mise en œuvre qu’une fois les voies de recours classiques définitivement fermées. Dans le cas contraire, il existerait une confusion néfaste entre les voies de recours habituelles que sont l’appel et la cassation, et la procédure exceptionnelle que constitue la révision.
Une décision encore susceptible d’appel ou de cassation, une décision frappée d’un appel dont l’issue est encore inconnue, une condamnation contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé et qui n’a pas encore été rejeté, ou encore une condamnation par défaut contre laquelle l’opposition est encore possible ne sauraient donc être révisées.
Il importe peu que ces voies de recours aient été empruntées, ou non, par le requérant : la demande sera déclarée irrecevable toutes les fois qu’un recours ordinaire est encore possible ou en cours d’examen. Toutefois, il convient de noter que le caractère définitif d’une décision pénale est apprécié au jour où la commission de révision statue, et non au jour du dépôt de la demande (25), selon une interprétation jurisprudentielle favorable au condamné.
–– Une décision pénale portant reconnaissance de la culpabilité
En premier lieu, seules les décisions émanant des juridictions répressives peuvent faire l’objet d’une requête en révision. Bien que la rédaction actuelle soit plus laconique que celle qui avait cours avant 1989 – la loi indiquait alors que la révision d’une décision était possible « quelle que soit la juridiction qui [avait] statué » –, il est clair que les juridictions pénales de droit commun comme celles d’exception peuvent voir leurs décisions révisées. D’ailleurs, en janvier 1990, la Cour de cassation a annulé la condamnation à mort par contumace prononcée, en 1952, par le tribunal militaire de Metz à l’encontre d’un ressortissant allemand (26).
Mais il ne suffit pas que la décision ait été prononcée par une juridiction répressive ; il faut également qu’elle soit de nature pénale. Ainsi, la décision qui émanerait d’une juridiction répressive statuant sur les seuls intérêts civils ne pourrait pas faire l’objet d’un tel recours.
En second lieu, l’article 622 du code de procédure pénale impose que la décision dont la révision est demandée reconnaisse la culpabilité du requérant. Cela ne signifie pas pour autant qu’une condamnation à une peine soit nécessaire ; la simple reconnaissance de la culpabilité d’une personne, dans un jugement accordant une dispense de peine ou reconnaissant l’existence d’une cause d’exemption de peine suffit. De la même façon, le jugement ou l’arrêt appliquant à un mineur des mesures éducatives est susceptible de recours.
En outre, tant que la reconnaissance de la culpabilité persiste, le recours en révision est possible. Il est donc recevable après que la peine a été exécutée, que le condamné a été gracié ou que sa condamnation a été amnistiée. En effet, si la grâce a longtemps été perçue comme susceptible de remédier aux erreurs de fait entachant les décisions pénales, elle n’est en rien équivalente à la révision puisque, par définition, elle n’est qu’une mesure de clémence à l’égard d’une personne reconnue coupable d’une infraction. La même logique conduit à assurer la recevabilité du recours en révision en cas d’amnistie car, si les faits ne sont plus constitutifs d’une infraction, le condamné amnistié est réputé les avoir commis tant que sa condamnation n’est pas révisée. C’est pourquoi les lois d’amnistie passées ont généralement précisé que leur application ne faisait pas obstacle à une action en révision.
A contrario, les décisions pénales n’emportant pas reconnaissance d’une quelconque culpabilité, comme les décisions d’acquittement ou de relaxe, ne sont pas susceptibles d’être révisées. Cette disposition interdit donc toute révision in pejus, défavorable à la personne acquittée ou relaxée, et cela quand bien même celle-ci serait confondue, par la suite, par de nouveaux éléments. Cette rédaction conduit également à écarter, par exemple, une décision ordonnant la révocation d’un sursis, qui n’emporte pas reconnaissance de la culpabilité.
–– Une condamnation pour un crime ou un délit
L’article 622 du code précité n’ouvre le recours en révision qu’aux condamnations pour crime ou délit, les contraventions se trouvant de facto exclues du champ de la révision. En 2009, dernière année pour laquelle des statistiques consolidées sont actuellement disponibles, 2 842 personnes ont fait l’objet d’une condamnation criminelle en première instance, et 522 en appel (27). En outre, en 2009, en matière délictuelle, les tribunaux correctionnels ont condamné 536 326 personnes (28).
b. Une liste restreinte de requérants
La liste des personnes susceptibles d’introduire un recours en révision a été progressivement élargie au cours des deux derniers siècles. À partir de 1867, les membres de la famille du condamné ont pu demander la révision d’une condamnation, dans tous les cas de figure, lorsque l’intéressé n’était plus en mesure de le faire du fait de son décès. Surtout, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales, le condamné peut saisir la justice d’une demande fondée sur l’apparition d’un fait nouveau, cas d’ouverture qui était auparavant exclusivement confié au garde des Sceaux.
Désormais, aux termes de l’article 623 du code de procédure pénale, trois catégories d’autorités et de personnes peuvent, sur un strict pied d’égalité, demander la révision d’une condamnation. Ce sont :
– le ministre de la justice ;
– le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;
– après la mort ou l’absence déclarée (29) du condamné, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel et ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Depuis 1989, les personnes condamnées sont naturellement celles qui saisissent le plus la commission de révision des condamnations pénales. En effet, sur les 84 saisines de la Cour de révision intervenues depuis cette date, seules 9 requêtes émanaient du garde des Sceaux. Par ailleurs, la possibilité offerte au condamné de désigner expressément la personne qui pourra, après sa mort, engager une procédure de révision, n’a jamais été utilisée à ce jour.
Cette liste est considérée par la jurisprudence comme étant limitative, ce qui conduit au rejet d’un certain nombre de requêtes. Ainsi, les descendants d’un condamné, notamment ses petits-enfants, ne sont pas recevables à former une requête en révision une fois le condamné décédé s’ils n’entrent dans aucun autre des cas prévus par la loi. C’est pour cette raison que le petit-fils de Gaston Dominici n’a pu introduire lui-même un recours en révision. De la même façon, en 2001, c’est par le biais de la garde des Sceaux que la commission de révision a été saisie de l’affaire Seznec. La Cour de révision, après avoir constaté que M. Denis Seznec n’avait pas qualité pour agir, a néanmoins accepté qu’il puisse s’associer à la demande présentée par le ministre de la justice (30).
2. Des critères de fond rarement réunis
Au-delà des critères relatifs à la qualité du requérant et à la nature de la décision attaquée, la loi prévoit des conditions de fond pour accorder la révision d’une condamnation pénale.
a. Quatre cas d’ouverture prévus par la loi
En l’état du droit, une demande de révision n’est recevable que si elle prend appui sur au moins un des quatre cas d’ouverture prévus par l’article 622 du code de procédure pénale.
Les trois premiers cas d’ouverture définis par le code de procédure pénale correspondent à des situations extrêmement circonscrites. Ils existaient déjà sous l’empire du code d’instruction criminelle de 1808 et ont traversé les siècles sans être réellement modifiés.
● Le premier de ces cas dits « déterminés » vise la présentation de « pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ». Si, après une condamnation pour homicide, des éléments indiquent que la prétendue victime était vivante après la condamnation du requérant, alors la Cour de révision doit être saisie. C’est là une hypothèse d’école et aucune décision connue n’a été prononcée sur ce fondement.
● Le deuxième cas prévu par l’article 622 du code de procédure pénale, dont l’existence remonte à 1793, porte sur l’existence de condamnations inconciliables. En effet, si deux condamnations sont prononcées à l’encontre de deux personnes distinctes pour un même fait et qu’il est inenvisageable que ces deux personnes aient commis ensemble cette infraction, alors, de façon logique, cela signifie que l’un des deux condamnés est en réalité innocent.
Peuvent ainsi donner lieu à révision deux décisions définitives condamnant deux personnes pour un vol dont il est certain qu’il n’a été commis que par un seul individu ; il en va de même lorsque plusieurs individus ont été condamnés pour un même fait alors qu’un nombre inférieur d’auteurs est établi. En revanche, dès lors que les deux décisions ne sont pas parfaitement inconciliables, la révision ne saurait être admise. Depuis 1989, cinq annulations sans renvoi, qui concernaient toutes des décisions correctionnelles, ont été prononcées par la Cour de révision sur ce fondement.
● Enfin, le 3° de l’article 622 du code de procédure pénale prévoit que la révision peut être demandée lorsqu’« un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ».
La condamnation du faux témoin constitue un préalable indispensable à l’aboutissement de la demande en révision. Ainsi, si le témoin a été relaxé parce que l’imprécision de son témoignage ne procédait pas d’une intention coupable, la révision ne peut être mise en œuvre sur le fondement du 3° de l’article 622 du code de procédure pénale (31). En revanche, il importe peu qu’une peine ait été prononcée à l’encontre du faux témoin dès lors qu’il est reconnu coupable. Par ailleurs, la jurisprudence a depuis longtemps assimilé la subornation d’un témoin au faux témoignage.
Ce cas d’ouverture a donné lieu, en 1999, à la révision partielle de la condamnation d’un homme pour le viol de sa belle-fille et pour un attentat à la pudeur commis à l’encontre d’une amie de cette dernière (32). Celle-ci ayant été condamnée pour faux témoignage, la condamnation relative à l’attentat à la pudeur n’était plus justifiée. En revanche, la Cour de révision a considéré que le faux témoignage n’avait pas eu d’influence sur la condamnation pour viol et que celle-ci devait dès lors être maintenue.
Ces trois cas d’ouverture sont donc extrêmement difficiles à mettre en œuvre et ne peuvent en réalité aboutir que lorsque l’innocence du condamné est certaine. Notamment, la formulation des deux premiers cas d’ouverture ne laisse pas place à l’appréciation : c’est seulement si la victime de l’homicide supposé est vivante après la condamnation ou que les deux condamnations sont parfaitement inconciliables que la révision peut être accordée.
● Pour pallier le caractère fermé de ces cas originels, un quatrième cas d’ouverture, qualifié d’« indéterminé » par la doctrine, a été introduit en 1895. Jusqu’en 1989, lorsqu’un fait venait à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats étaient présentées, et qu’ils étaient « de nature à établir l’innocence du condamné », la révision pouvait être accordée. Cette formulation était cohérente avec l’économie générale du texte comme avec les exigences fixées pour les autres cas d’ouverture en matière d’innocence du condamné. Toutefois, après avoir fait une application stricte de la loi, la jurisprudence avait rapidement admis qu’un doute sérieux sur la culpabilité du condamné pouvait suffire à ordonner la révision d’une condamnation.
En 1989, le législateur, souhaitant ouvrir le recours en révision, a retenu une formulation qui devait laisser toute sa place au doute, aussi infime soit-il. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales, l’article 622 du code de procédure pénale rend la révision possible lorsqu’« après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Le législateur n’a volontairement pas retenu la notion de « doute sérieux » qu’employait alors la jurisprudence (33). Ce faisant, il a clairement indiqué au juge qu’un doute simple devait a priori suffire à assurer une révision.
Au-delà du fait que la preuve de l’innocence n’a plus à être apportée, cette nouvelle rédaction pourrait, d’après M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, « permettre à la Cour de révision d’annuler une décision de condamnation justifiée en fait mais mal fondée en droit », par exemple lorsqu’il apparaît, dans le cas d’une condamnation pour meurtre, que l’intention homicide que l’on a prêtée au requérant est infondée. Le condamné n’est certes pas innocent, puisqu’il a commis des faits – il n’aurait dès lors pas pu obtenir la révision sous l’empire de la rédaction antérieure –, mais il n’est pas coupable de l’infraction précisément reprochée. Dans l’exemple évoqué, la révision de la condamnation peut permettre de modifier la qualification retenue au profit des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Toutefois, il semble que les pratiques anciennes de la Cour de cassation aient perduré en dépit de ce changement législatif et qu’un doute sérieux soit, dans les faits, toujours nécessaire (cf. infra).
Ce cas d’ouverture est, de loin, celui qui est le plus utilisé aujourd’hui, puisqu’il a été invoqué à titre exclusif dans 88 % des demandes qui ont conduit au prononcé d’une annulation par la Cour de révision depuis 1989. De fait, même lorsqu’un autre cas d’ouverture est avancé par le condamné, il n’est pas rare que ce cas indéterminé vienne également à l’appui de la demande pour mieux se prémunir contre tout risque de rejet (34).
b. L’appréciation rigoureuse du quatrième cas d’ouverture
Une demande en révision fondée sur le 4° de l’article 622 du code de procédure pénale doit être articulée autour d’un « fait nouveau » ou d’un « élément inconnu de la juridiction au jour du procès » qui soit « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Si la jurisprudence accepte d’examiner toutes les formes de faits ou d’éléments qui lui sont soumis, elle retient en revanche une définition plus stricte de leur nouveauté et plus encore, du doute qu’ils doivent susciter pour que la révision aboutisse.
–– Un fait ou un élément
La terminologie législative semble particulièrement large et susceptible d’accueillir un vaste ensemble de situations. Si le « fait » renvoie à un événement, un phénomène, un acte objectif, la notion d’« élément » comprend à la fois des choses plus impalpables et subjectives, mais également les « pièces » qu’elle a remplacées dans la loi, en 1989. Ainsi, certains analysent la notion d’élément comme un synonyme d’éléments de preuve, au sens matériel. À l’inverse, pour Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’homme, la notion d’ « élément » serait si large qu’elle engloberait la notion de « fait ».
Pour l’heure, la jurisprudence ne semble pas opérer de distinction entre le « fait » et l’« élément ». Elle a cependant interprété de façon très extensive la notion de « fait », qui peut être une décision de condamnation postérieure au jugement, la découverte d’une cause légale d’irresponsabilité pénale telle que le trouble psychique ayant aboli le discernement du condamné, l’hospitalisation du condamné dans un lieu très éloigné de celui du crime, les découvertes permises par de nouvelles techniques scientifiques, la déclaration d’un tiers ou la rétractation de la victime, etc.
–– Un caractère nouveau ou inconnu
En revanche, le caractère « nouveau » ou « inconnu » du fait ou de l’élément qui « vient à se produire ou à se révéler » constitue un critère plus déterminant.
La jurisprudence considère comme « nouveau » le fait qui n’était pas connu lors de l’instruction et des débats devant la juridiction qui a prononcé la condamnation dont la révision est demandée. Il importe peu que le fait en question ait préexisté à la condamnation ou même qu’il ait été connu du condamné : il peut indifféremment, aux termes de la loi, être « produit » ou « révélé » (35). Mais, si le fait ou l’élément invoqué a été soumis aux débats et était connu des juges ayant prononcé la condamnation, alors la demande doit être rejetée.
De façon concrète, la nouveauté du fait ou le caractère inconnu de l’élément sont examinés à l’aune des informations dont les magistrats de la commission et de la Cour de révision disposent, qu’elles proviennent du dossier d’instruction, des notes d’audience prises par les greffiers pendant le procès, de témoignages ultérieurs, voire de simples coupures de presse.
Or, dans le cas d’affaires criminelles, il n’est pas toujours aisé de savoir si tel fait était connu de la cour d’assises, la procédure suivie devant cette juridiction étant essentiellement orale et ses décisions n’ayant pas, jusqu’en 2012, à être motivées. Ainsi, la commission de révision fait régulièrement état des problèmes qu’elle rencontre dans ce domaine dans le cadre des rapports annuels de la Cour de cassation. Par exemple, en 2011, elle indiquait : « la commission rencontre des difficultés pour se prononcer sur les demandes de révision en matière criminelle. L’absence de notes d’audiences détaillées et de motivation des arrêts des cours d’assises rend difficile l’appréciation de la nouveauté des faits ou des éléments invoqués à l’appui de la demande ainsi que l’impact qu’ils auraient pu avoir dans l’appréciation de la culpabilité du requérant ».
Les obstacles rencontrés par les juridictions de révision semblent avoir des effets préjudiciables pour les requérants. En effet, comme l’a indiqué Me Dominique Foussard lors de son audition, l’incapacité de la commission comme de la Cour de révision à acquérir la certitude qu’un fait n’était pas connu de la juridiction de fond conduit à présumer qu’il l’était, et donc à rejeter un certain nombre de demandes faute d’information suffisante.
La révision des condamnations pénales adossées
à des actes administratifs
La confrontation du droit pénal au droit administratif a, en matière de révision, des effets particuliers. Lorsqu’une condamnation pénale est adossée à un acte administratif – par exemple, une condamnation pour ne pas avoir quitté le territoire français après un arrêté d’expulsion, ou le fait de conduire un véhicule après s’être fait retirer son permis par l’autorité administrative –, sa révision n’est pas accordée lorsqu’elle s’appuie sur l’annulation de l’acte administratif en question du fait de son illégalité. En effet, la commission de révision considère que « si l’annulation d’un acte par la juridiction administrative prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte, elle ne peut avoir d’effet sur une condamnation passée en force de chose jugée, le juge répressif étant compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal » (décision de la commission de révision du 13 octobre 2008, n° 8REV043).
–– Un doute sur la culpabilité du condamné
Enfin, point essentiel, l’impact de ce fait nouveau sur l’appréciation de la culpabilité du condamné semble interprété de façon particulièrement restrictive par la jurisprudence. En effet, l’examen des cas de rejet, comme des affaires dans lesquelles la révision a été acceptée (cf. infra), révèle que la notion de doute, telle qu’elle est comprise par la jurisprudence, est différente de la façon dont on l’appréhende en général. Deux conceptions du doute sont en effet apparues au cours des travaux conduits par vos rapporteurs :
– d’une part, le doute comme opposé de l’intime conviction et de la certitude qui l’accompagne ; selon cette conception, deux postures seulement sont possibles : soit le fait nouveau ne remet clairement pas en cause l’intime conviction, et la révision est rejetée ; soit le fait nouveau soulève un doute qui, même infime, doit conduire à ordonner la révision, sans préjuger de l’issue du procès ;
– d’autre part, le doute concret, gradué, étudié à l’aune de l’économie générale d’un dossier, et combattu jusqu’ici par d’autres éléments de preuve ; dans ce contexte, seul un doute net, sérieux, raisonnable, faisant vaciller tout l’édifice intellectuel qui a conduit à la condamnation est admis ; dans ce cas, seul peut assurer la révision de la condamnation l’élément qui, s’il avait été connu des juges, aurait vraisemblablement conduit à une décision différente.
Force est de constater que le législateur et le juge n’entendent pas le doute de la même façon. Là où le législateur conçoit abstraitement les situations, le juge doit appliquer la loi à des cas concrets, ce qui affecte nécessairement la façon dont il interprète la volonté du législateur.
D’ailleurs, les magistrats de la Cour de révision ne s’en cachent pas : M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa contribution écrite aux travaux de la mission, indique clairement qu’un « doute raisonnable » sur la culpabilité du condamné est nécessaire à la révision. Ainsi, les faits ou éléments nouveaux doivent être « suffisamment probants pour fragiliser la décision de culpabilité rendue par les juges de condamnation ». Or, le doute raisonnable ne saurait être équivalent au doute sans qualificatif qui est prévu par la loi et qui est, dès lors, un doute simple. L’analyse des décisions d’annulation intervenues en matière criminelle montre que ce « doute raisonnable » est en réalité proche du « doute sérieux » qu’exige la jurisprudence depuis le tournant du XXe siècle.
Le doute peut être qualifié de « sérieux » lorsqu’un autre coupable est désigné. Dans l’affaire Dils, c’est la probabilité élevée de la culpabilité d’une autre personne, déjà condamnée pour des faits similaires et présente sur les lieux du crime, qui conduit la Cour de révision à ordonner l’annulation avec renvoi en avril 2001. La décision de révision est d’ailleurs éclairante dans sa construction même, en ce qu’elle ne s’appuie, pour statuer, que sur les éléments à charge établis contre l’auteur véritable des assassinats d’enfants (36). Dans l’affaire Machin, c’est également la certitude, fondée sur de multiples éléments probants, que les faits reprochés au condamné ont en réalité été commis par une autre personne, qui a conduit à l’annulation de la condamnation avec renvoi, comme en témoigne la décision de la Cour de révision (cf. infra).
L’affaire Machin
En décembre 2001, le corps d’une femme est découvert à proximité du pont de Neuilly. Au cours de l’enquête de voisinage menée par les services de police, il apparaît qu’une autre femme a été agressée verbalement par un homme à proximité du lieu du crime et à une heure proche de l’heure présumée du décès de la victime. Très vite, les soupçons se portent sur un homme qui a déjà été condamné pour une agression sexuelle dont le mode opératoire rappelle l’infraction dont le témoin a été victime. Le témoin le désigne, sur photographie, comme étant son agresseur, et la description qu’elle fait de ses vêtements correspond à des effets personnels retrouvés à son domicile. Celui-ci est alors placé en garde à vue et, au bout de plusieurs heures, il déclare être l’auteur des faits. Ses déclarations ne sont toutefois pas cohérentes avec la scène de crime et aucun matériel génétique ou empreinte papillaire lui appartenant n’est retrouvé sur le corps de la victime. En dépit de ses rétractations ultérieures, il est condamné en 2004 à 18 ans de réclusion criminelle, peine confirmée en appel, en 2005. Alors qu’il était en détention provisoire, en 2002, un second meurtre est commis sur une femme, au même endroit. Ni les enquêteurs ni les juges n’établissent alors de lien entre les deux affaires, qui présentent malgré tout des similitudes. Faute de pistes, l’enquête sur ce second meurtre s’arrête, jusqu’au jour où, en 2008, un homme se présente au commissariat de la Défense, avouant être l’auteur des deux meurtres. Ses déclarations sont extrêmement détaillées et circonstanciées. De nouvelles analyses génétiques sont ordonnées sur les scellés du premier homicide qui n’avaient pas été exploités auparavant ; les traces génétiques correspondent à l’ADN de l’homme en question. Peu de temps après, la ministre de la justice elle-même saisit la commission de révision qui, très vite, saisit à son tour la Cour de révision. En 2010, celle-ci prononce l’annulation de la condamnation avec renvoi, aux motifs que : « Attendu que, dans la nuit du 3 au 4 mars 2008, D... C... s’est présenté au commissariat de police du quartier de La Défense en s’accusant des meurtres de M... B... et M... "D...", qui s’est avérée être M... Y..., divorcée D..., en vue, disait-il, de soulager sa conscience dans une démarche religieuse ; Attendu que, dès ses premières déclarations, il a décrit de manière très circonstanciée l’agression commise par lui sur M... Y... ; qu’il a précisé avoir réussi à la déséquilibrer en tirant sur son sac de sport, avant de la précipiter sur les marches de l’escalier où il lui avait porté plusieurs coups avec un couteau à pain dérobé dans l’institution religieuse qui l’hébergeait ; que, toujours selon son récit, la victime s’était défendue, et il avait dû lui mordre la main droite pour qu’elle lâche prise ; qu’après lui avoir porté le coup mortel et procédé, sur son corps, à un rituel de nature sexuelle et sanglante, il l’avait laissée couchée sur le ventre et s’était enfui en emportant son sac de sport dont il avait ultérieurement inventorié le contenu ; Attendu qu’à l’exception d’une seule rétractation, lors d’une audition en garde à vue, D... C... a ensuite réitéré ses aveux et les a maintenus tout au long de la nouvelle information ouverte sur ces faits ; Attendu que ses déclarations circonstanciées, tant sur le déroulement de l’agression et du meurtre que sur la tenue vestimentaire de la victime, la manière dont elle s’était défendue, l’arme qu’il avait utilisée, sont apparues compatibles avec les constatations des enquêteurs et des médecins légistes ; qu’il en va ainsi de l’indication donnée par lui de la morsure qu’il avait infligée à M... Y..., de nature à expliquer les constatations faites, lors de l’autopsie, sur la main droite de la victime ; Attendu que ces aveux sont corroborés par les traces de l’empreinte génétique de D... C..., relevées sur le ciré et sur le collant de M... Y..., puis sous l’un des ongles de la victime qui avait été prélevé ; que la présence de cette dernière empreinte génétique établit un contact physique entre D... C... et M... Y..., alors que ceux-ci ne se connaissaient pas ; qu’à l’inverse, aucune empreinte génétique de M... X... n’a été identifiée à l’occasion de ces nouvelles expertises effectuées avec des moyens techniques améliorés ; Attendu que s’ajoutent à ces indices matériels les précisions apportées par D... C... qui n’apparaissaient pas dans le dossier de l’information suivie contre M... X..., concernant le contenu du sac de sport, disparu, de la victime ; que, d’une part, selon D... C..., il avait pu retenir le nom de “D...”, par la mention figurant sur la carte d’identité de M... Y..., antérieurement à son divorce ; que, d’autre part, d’après D... C..., le lecteur de compact-disc, contenait un disque “Johnny River”, affirmation qui a été vérifiée postérieurement à ses dires, par la découverte de la pochette vide de ce même disque dans les affaires de la victime, récupérées par son frère ». En décembre 2012, la cour d’assises de Paris acquitte le requérant.
Il en va de même dans l’affaire Abdelkader X. et Abderrahim Y. qui a donné lieu à la décision d’annulation la plus récente. Le caractère circonstancié et concordant des déclarations des deux nouveaux accusés, leur renvoi en cour d’assises par le juge d’instruction, de même que l’absence de traces génétiques appartenant aux condamnés, poussent la Cour de révision à ordonner la révision de la décision de condamnation le 15 mai 2013 (37). Dans cette affaire, qui n’a pas encore été rejugée, le doute est, semble-t-il, des plus sérieux.
L’affaire Abdelkader X. et Abderrahim Y.
En 1997, le corps d’un trafiquant de drogue, tué à l’arme blanche, est retrouvé à Lunel, dans l’Hérault. Deux autres trafiquants sont rapidement soupçonnés, sur le fondement d’un témoignage. Ils affirment avoir remis cinq kilos de cannabis à la victime qui, après les avoirs livrés à d’autres personnes, devait revenir avec la somme due aux deux condamnés pour l’acquisition du produit stupéfiant. Ils sont condamnés en 2004 à vingt ans de réclusion criminelle, sans preuve matérielle formelle. Dès 2007, les deux condamnés, qui n’ont eu de cesse de clamer leur innocence, font un premier recours en révision, rejeté par la commission. En 2009, une nouvelle information judiciaire est ouverte à la demande de la commission, à l’occasion de laquelle tous les scellés prélevés sur la scène de crime sont cette fois analysés. Leur expertise génétique révèle la présence d’un autre homme, jusqu’alors inconnu de fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Mais, quelques mois après, il est inscrit par hasard dans ce fichier : la supérette dans laquelle il travaille a été victime d’un vol et tous ses employés sont inscrits au fichier. Convoqué par la gendarmerie nationale, il avoue les faits et fournit l’identité de son complice, disculpant ainsi les condamnés. Les deux hommes auraient assassiné la victime pour lui dérober les cinq kilos de résine de cannabis que celui-ci devait leur remettre contre de l’argent.
Dans les affaires Guilherme X. et Rida X., moins médiatiques, le doute qui permet la révision est également plus que sérieux : le fait nouveau rend impossible la commission de l’infraction. Dans l’affaire Rida D., le requérant affirme, certificat à l’appui, s’être trouvé hospitalisé dans un centre psychiatrique au moment de la commission des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lesquelles il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle (38). Dans l’affaire Guilherme X., le requérant demande la révision du jugement par lequel il a été reconnu complice d’une importation illicite de cocaïne depuis le Brésil. En effet, l’acquittement ultérieur des auteurs de l’infraction principale, qui avaient, eux, fait appel du jugement de 2003, remet clairement en cause la complicité reprochée au requérant. C’est pourquoi la Cour de révision a été amenée à considérer comme un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné la reconnaissance, par la justice, de l’inexistence d’un fait principal punissable (39). Dans les deux cas, ce sont des éléments extrêmement probants, mettant en œuvre une impossibilité pratique – Rida X. n’a pas pu commettre l’infraction reprochée, puisqu’il était hospitalisé au moment des faits – ou juridique – il ne saurait y avoir de complicité sans infraction principale –, qui ont appuyé les demandes en révision.
Les mêmes observations peuvent être faites sur les décisions d’annulation intervenues en matière correctionnelle. Ainsi, la condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour une infraction à la législation sur les chiens dangereux est annulée par la Cour de révision lorsqu’une expertise vétérinaire démontre que le chien en question n’appartenait pas à une espèce soumise à cette législation, car proche du labrador et non du rottweiller (40). De la même façon, la rétractation d’une prétendue victime d’agression sexuelle, qui avait dénoncé des faits imaginaires et désigné le requérant parmi les personnes que les services de police lui avaient présentées au cours d’une parade, corroborée par une enquête du parquet de Paris, a conduit la Cour de révision à renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction (41).
À l’inverse, l’examen de certaines décisions de rejet de la Cour de révision montre qu’un doute simple ne suffit pas à assurer la révision d’une décision pénale.
Dans l’affaire Leprince, le requérant est accusé en septembre 1994 du meurtre extrêmement brutal et violent de la famille de son frère. Dénoncé par sa femme, sa fille et l’enfant de deux ans rescapée du massacre, il avoue le meurtre de son frère en garde à vue, puis devant le juge d’instruction, avant de se rétracter. Aucun élément matériel ne vient étayer la thèse de l’accusation. Comme le note la commission de révision, « les principaux éléments à charge retenus contre Dany X… sont les accusations portées contre lui par sa femme Martine C… et sa fille Célia, âgée de 16 ans à l’époque des faits, ainsi que par les propos de Solène, âgée de 26 mois lors du drame » (42). Déjà, au moment du procès, les déclarations de la mère et la fille n’étaient pas tout à fait cohérentes – « la mère et la fille déclarent avoir vu la même scène au même moment, sans s’être vues réciproquement » (43) – et les souvenirs flous de la principale accusatrice ont évolué au cours de l’instruction.
Pourtant, l’accusé est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en décembre 1997. À partir de 2005, le condamné saisit la commission de révision de plusieurs faits parmi lesquels, après des investigations poussées, certains sont considérés par elle comme pertinents. Notamment, la commission tire des résultats de l’expertise médicale ordonnée sur Martine C. que « les importantes pertes de mémoire dont Martine C… fait état et ses nouvelles déclarations concernant les faits dont elle disait avoir été témoin et auxquels elle n’exclut pas d’avoir aujourd’hui pris part, constituent un élément nouveau au regard des charges qui ont été retenues contre Dany X… ». De la même façon, les vérifications de la commission de révision, qui n’avaient pas été faites pendant l’instruction, ont conforté la chronologie trouble des événements.
Alors que la commission de révision avait considéré disposer d’éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, allant jusqu’à ordonner la suspension de la peine du requérant, la Cour de révision a rejeté la requête en révision. Elle a considéré, d’une part, « qu’on ne saurait accorder aucune valeur probante à de simples "fragments de récits" (…) recueillis dans le cadre d’une relation de confiance d’ordre médical » et que « s’il demeure une interrogation sérieuse sur le délai dans lequel les crimes ont pu être commis, il importe de constater que cette interrogation a existé dès le début des investigations, et était parfaitement connue de la juridiction au jour du procès » (44).
Il faut admettre qu’au regard des autres affaires qui ont pu conduire à une révision, les faits avancés par la défense, pourtant soutenus par la commission de révision, n’ont pas le caractère éclatant du faux témoignage de la victime ou de la révélation de l’identité d’un autre coupable potentiel. Néanmoins, il est clair qu’il existe, pour reprendre les termes de la Cour de révision, une « interrogation sérieuse » sur les circonstances exactes du crime et, partant, sur la décision de condamnation. Mais, pour la Cour de révision, les éléments apportés par les investigations de la commission de révision n’ont ni la force probante, ni le caractère nouveau nécessaire à la révision.
Dans l’affaire Seznec, la commission comme la Cour de révision ont analysé de façon approfondie la thèse de la défense, selon laquelle Guillaume Seznec aurait été victime d’une machination policière. Elles ont, dans le cadre de l’examen de la requête présentée par Mme Marylise Lebranchu, alors garde des Sceaux, procédé au réexamen de nombreux témoignages intervenus depuis les faits. Si la commission a reconnu l’existence d’éléments troublants – notamment, la personnalité de Boudjema X., vendeur de voitures que devaient rencontrer Guillaume Seznec et Pierre Quémeneur mais qui n’avait pas été retrouvé à l’époque du procès, et ses possibles liens avec l’inspecteur Pierre Bonny qui avait participé à l’enquête –, la Cour de révision a invalidé l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, considérant qu’aucun n’avait de force probante suffisante, du fait de leur caractère indirect, très différé ou de la santé mentale de leur auteur, pour bouleverser le dossier soumis, en 1924, aux jurés. Le doute, il est vrai léger (45), qu’a pu avoir la commission de révision n’a pas été partagé, à l’incompréhension de beaucoup d’observateurs, par la Cour de révision.
L’affaire Seznec
Le 25 mai 1923, Guillaume Seznec, maître de scierie à Morlaix et Pierre Quémeneur, conseiller général et négociant en bois, se rendaient ensemble à Paris, dans la Cadillac de Guillaume Seznec, pour y conclure une affaire d’achats et de revente de véhicules américains d’occasion. Guillaume Seznec revenait à Morlaix le 28 mai 1923, mais Pierre Quémeneur disparaissait à jamais. Le 13 juin, sa famille recevait un télégramme du Havre, signé de la victime, indiquant qu’il rentrerait dans quelques jours et que tout allait pour le mieux. Le 20 juin, les effets personnels de la victime étaient trouvés dans la gare du Havre, avec notamment une promesse de vente, datée du 22 mai, par laquelle Pierre Quémeneur s’engageait à vendre une propriété à Guillaume Seznec. Le 30 juin, un réquisitoire était délivré contre Guillaume Seznec pour assassinat et faux en écritures. Celui-ci niait les faits, indiquant qu’il avait laissé Pierre Quémeneur à Dreux, pour qu’il rejoigne Paris par le train, du fait des pannes fréquentes de sa Cadillac, et qu’il ne l’avait pas revu depuis.
Mais, pour la cour d’assises du Finistère, qui condamna Guillaume Seznec aux travaux forcés à perpétuité en 1924, le voyage à Paris était un prétexte inventé par Guillaume Seznec, l’homme qu’ils étaient supposés rencontrer n’existant pas ; Guillaume Seznec aurait assassiné Pierre Quémeneur et réalisé un faux au moyen d’une machine achetée au Havre le jour même où il aurait également envoyé un télégramme apocryphe à la famille Quémeneur. Guillaume Seznec fut finalement libéré en 1947.
Entre 1926 et 2000, Guillaume Seznec et sa famille ont présenté treize demandes au garde des Sceaux, toutes rejetées. En 2001, Mme Marylise Lebranchu, alors ministre de la Justice, saisit la commission de révision. Plusieurs éléments viennent à l’appui de la demande en révision. D’une part, l’homme que Guillaume Seznec et Pierre Quémeneur devaient rencontrer pourrait être Boudjema X. Celui-ci a été entendu à plusieurs reprises par la justice, en 1926 puis en 1956. Il a à chaque fois indiqué avoir rencontré Pierre Quémeneur lors d’une exposition, pour la vente, de voitures américaines, mais il a situé cette rencontre à une date antérieure à mai 1923. Mais, quand bien même ce rendez-vous aurait bien eu lieu, il ne remet pas en cause, pour la Cour de cassation, la culpabilité de Guillaume Seznec. Cependant, en 2001, un élément nouveau apparaît sur la personnalité de cet homme : Mme D. affirme le reconnaître comme étant celui qui l’a dénoncée à la Gestapo. La requête affirme également que Boudjema B. aurait été un agent de la Gestapo travaillant notamment avec Pierre Bonny, inspecteur stagiaire affecté auprès du commissaire Vidal qui a mené l’enquête. Il aurait truqué l’enquête pour assurer la condamnation de Guillaume Seznec. Deux témoignages, recueillis en 1948 et en 1956, indiquent que Pierre Bonny aurait révélé avoir lui-même déposé la machine à écrire dans l’atelier de Guillaume Seznec et que le témoignage prouvant l’achat de ladite machine au Havre par Guillaume Seznec en 1923 serait faux. Par ailleurs, en 2001, d’autres éléments sont avancés à l’appui de la requête : deux témoignages prouveraient que Pierre Quémeneur aurait été vu vivant après la date supposée de son assassinat ; Guillaume Seznec se serait trouvé à Saint-Brieuc le jour où il était supposé acheter la machine à écrire au Havre ; enfin, la machine présentée au procès de Guillaume Seznec ne serait pas la même que celle qui a été saisie dans son atelier. Ces éléments sont supposés confirmer la thèse d’une machination policière, orchestrée par Pierre Bonny pour couvrir un vaste trafic de voitures américaines, avancée depuis toujours par la défense.
La commission de révision a écarté, en avril 2005, un certain nombre de ces éléments, mais a toutefois considéré que la découverte de Boudjema X. remettait en cause le fait que Guillaume Seznec ait menti sur le but de son voyage à Paris et donc « l’appréciation globale de la crédibilité de ses propos » qu’a eue la cour d’assises. Par ailleurs, le lien qui aurait pu exister entre Boudjema B. et Pierre Bonny conduit la commission à s’interroger sur de possibles failles dans la conduite de l’enquête. Mais, pour la Cour de révision, rien ne prouve que Pierre Bonny ait pris une part importante dans l’enquête ; les témoignages situant Guillaume Seznec et Pierre Quémeneur à Houdan, non à Dreux, et indiquant qu’ils en sont repartis ensemble, contrairement aux dires du condamné, ne sont pas remis en cause par des éléments nouveaux ; la présence de Guillaume Seznec le 13 juin 1923 à Brest n’est pas invalidée par un quelconque élément nouveau ; divers témoignages indiquant que Guillaume Seznec n’aurait jamais été en possession de la machine à écrire saisie chez lui sont trop indirects et différés pour avoir une portée révisionnelle ; enfin, l’hypothèse selon laquelle Boudjema X. et Pierre Bonny se seraient connus à l’époque des faits n’est pas vérifiée, de même que celle selon laquelle les policiers auraient eux-mêmes fabriqué les faux en écriture. Elle rejette donc la requête en décembre 2006.
Au stade de la révision, le condamné n’a plus à bénéficier de la protection offerte par la présomption d’innocence. Pour autant, le doute devrait encore lui bénéficier et assurer la réouverture d’un procès. Or, la manière dont la jurisprudence conçoit le doute laisse apparaître que le condamné doit combattre, par le fait nouveau, les fondements mêmes de sa condamnation. Dans la procédure de révision telle qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui, la charge de la preuve est renversée : c’est au condamné d’apporter la preuve de son innocence.
B. UNE PROCÉDURE EN PLUSIEURS ÉTAPES CONFIÉE À LA COUR DE CASSATION
La procédure de révision d’une condamnation pénale, pour aboutir, fait au minimum intervenir deux organes juridictionnels distincts, sinon plus. La demande est d’abord adressée à la commission de révision des condamnations pénales qui se prononce sur le fait de savoir si la requête lui paraît pouvoir être admise. Si tel est le cas, elle saisit alors la Cour de révision, qui examine à nouveau les éléments du dossier et peut annuler la décision de condamnation en renvoyant le condamné devant une juridiction pénale de fond, qui le jugera à l’aune de l’ensemble des faits. Ainsi, si un condamné a utilisé toutes les voies de recours à sa disposition, il se peut qu’il soit passé, en tout, devant une demi-douzaine de juridictions différentes avant de voir la condamnation initiale révisée.
1. La commission de révision, préalable obligatoire
En application du 5e alinéa de l’article 623 du code de procédure pénale, la requête en révision doit être adressée à une commission de cinq magistrats de la Cour de cassation qui dispose d’importants pouvoirs d’investigation pour évaluer la recevabilité de la demande.
a. Une commission juridictionnelle instituée en 1989
C’est seulement depuis 1989 que le filtrage des requêtes est opéré par un organe juridictionnel. Avant cette date, en effet, la loi confiait au garde des Sceaux le soin de saisir, par l’intermédiaire du procureur général, la Cour de cassation d’une requête en révision. Lorsque le condamné invoquait un cas d’ouverture dit « déterminé », le ministre de la justice était dans l’obligation de saisir la Cour de cassation. En revanche, lorsqu’un fait nouveau motivait la requête, la transmission de la demande était laissée à l’entière appréciation du garde des Sceaux, qui devait malgré tout prendre l’avis d’une commission mixte composée de trois magistrats professionnels et de trois directeurs du ministère, magistrats ou non, avant de saisir la Cour de cassation.
À partir des années 1980, l’important pouvoir de filtrage accordé au garde des Sceaux a paru susceptible de faire obstacle à des demandes en révision ; par ailleurs, la présence de directeurs d’administration centrale au sein de la commission n’a plus semblé opportune. L’ambition de la proposition de loi présentée par M. Michel Sapin était donc de procéder à une juridictionnalisation complète de la procédure de filtrage, en confiant à une commission de révision exclusivement composée de magistrats le soin d’instruire les requêtes et d’écarter « celles qui [étaient] manifestement irrecevables ou non fondées » (46).
La loi n° 89-431 du 23 juin 1989 a donc institué une commission nouvelle, composée de cinq magistrats issus de la plus haute juridiction judiciaire, et à laquelle le ministère public participe par le biais du procureur général près la Cour de cassation ou de ses avocats généraux. Les membres de la commission de révision sont, depuis cette date, désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Celle-ci dispose de toute latitude pour choisir les membres au sein de toutes les chambres de la Cour, le président de la commission de révision étant toutefois nécessairement choisi parmi les magistrats de la chambre criminelle.
b. Une procédure faiblement formalisée
Le code de procédure pénale décrit peu la procédure applicable devant la commission et la façon dont elle peut mettre en œuvre ses pouvoirs d’investigation. En l’absence de précision législative, la commission de révision a déterminé elle-même les règles procédurales gouvernant l’examen des demandes et le déroulement de l’audience.
Dès réception de la demande en révision, la commission se fait communiquer le dossier de la procédure par le greffe de la juridiction dont la décision est attaquée et, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la loi, son président nomme un rapporteur parmi ses membres, chargé d’examiner le dossier.
–– L’examen de la recevabilité de la demande
La commission de révision des condamnations examine, en premier lieu, la recevabilité de la demande. La décision d’irrecevabilité peut être prise à plusieurs stades de la procédure devant la commission de révision. Elle peut notamment intervenir ab initio. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le président de la commission ou son délégué peuvent, par une ordonnance motivée, écarter les demandes manifestement irrecevables (47). Comme l’indique la commission de révision dans le dernier rapport annuel de la Cour de cassation, « des décisions d’irrecevabilité “ab initio” sont prises lorsque la demande porte sur une décision qui n’est pas une condamnation pénale définitive (arrêt de la chambre de l’instruction, arrêt de la Cour de cassation, condamnation civile...), lorsque le demandeur se borne à reprendre exactement la même argumentation que celle déjà rejetée à l’occasion d’une précédente demande ou à contester sa condamnation au motif qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable ».
Lorsque la demande n’est pas manifestement irrecevable, la commission procède à son instruction. À l’issue de celle-ci, si le demandeur ne s’est pas désisté, la commission dans son ensemble peut déclarer la demande irrecevable. C’est notamment le cas lorsque la décision attaquée n’est pas définitive à la date de l’audience de la commission, lorsque le demandeur n’a pas qualité pour agir, que la demande ne se fonde sur aucun des quatre cas d’ouverture prévus par la loi ou qu’elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de la demande.
–– D’importants pouvoirs confiés à la commission
Le rôle de la commission de révision ne se limite pas à l’examen de la recevabilité de la demande. Ses pouvoirs d’instruction lui permettent également de vérifier si les conditions de fond posées par le législateur sont réunies. Le code de procédure pénale ouvre de très larges pouvoirs à la commission de révision, puisque le sixième alinéa de l’article 623 dispose qu’elle peut procéder, directement ou par commission rogatoire, « à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles ». Dans l’affaire Raddad, par exemple, la commission de révision a conduit des investigations extrêmement poussées : commission de trois experts pour déterminer la date de la mort, audition de nombreux protagonistes, commission d’experts en écritures pour déterminer si les inscriptions « Omar m’a tuer » pouvaient effectivement être le fait de la victime, analyses génétiques, etc. La commission a également pu procéder, dans le silence de la loi, à des écoutes téléphoniques.
Toutefois, toutes les affaires dont est saisie la commission de révision ne font pas l’objet d’autant de mesures d’instruction. Par exemple, en 2012, celle-ci n’a ordonné que 6 suppléments d’information parmi les 220 requêtes qu’elle avait à examiner (48), dont la nature est, qui plus est, variable. Comme l’a indiqué Mme Délou Bouvier, membre du Syndicat de la magistrature et ancien membre de la commission de révision, cet organe met assez rarement ses pouvoirs en œuvre. Par ailleurs, si la commission de révision dispose de pouvoirs d’investigation proches de ceux d’un juge d’instruction, elle ne saurait en revanche mettre en œuvre de pouvoirs coercitifs, tels que la délivrance d’un mandat de dépôt ou d’amené, ou encore la mise en examen d’une personne.
La commission de révision dispose également du pouvoir de suspendre l’exécution de la peine du condamné, en application de l’article 624 du code de procédure pénale. Cette mesure est mise en œuvre avec parcimonie par la commission de révision, qui ne suspend la peine d’un condamné que lorsque son innocence ne lui semble faire, en réalité, guère de doute. Dans l’affaire d’agression sexuelle imaginaire précédemment évoquée, la commission de révision a ordonné la suspension de la peine d’emprisonnement du requérant, comme elle l’a fait dans l’affaire Machin. Elle a également pu ordonner la suspension d’une peine d’emprisonnement avec sursis et du versement des réparations civiles (49) d’une peine de suspension d’un permis de conduire (50), d’une peine d’amende (51) ou encore de la confiscation d’un animal (52). D’après les informations transmises par Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, celle-ci n’a mis en œuvre son pouvoir de suspension que neuf fois depuis 1989, dont deux fois en matière criminelle.
La commission de révision peut également, depuis la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, assortir la suspension de la peine d’un certain nombre d’obligations que le condamné observera sous le contrôle d’un juge de l’application des peines. Il peut notamment s’agir, comme cela a été le cas dans l’affaire Leprince, d’établir sa résidence chez une personne désignée, de répondre aux convocations judiciaires, de s’abstenir de paraître dans certains lieux et d’entrer en relation avec certaines personnes (53). Le condamné peut également être soumis, comme l’indique l’article 624, au port d’un bracelet de surveillance électronique mobile.
–– L’audience de jugement de la commission de révision
Une fois l’instruction de la demande achevée, la demande est présentée au cours d’une audience réunissant les cinq magistrats membres de la commission de révision, le représentant du parquet et, le cas échéant, le condamné et son conseil, à l’issue de laquelle la requête sera transmise à la Cour de révision, rejetée ou déclarée irrecevable (cf. supra).
Là encore, la procédure est définie de façon laconique par l’article 623 du code de procédure pénale qui dispose qu’« après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique ».
En pratique, le magistrat en charge du dossier présente son rapport aux membres de la commission ; les observations orales du requérant ou de son conseil sont recueillies ; enfin, l’avocat général fait ses réquisitions. Dans le silence du texte, c’est un débat contradictoire qui s’instaure entre la commission de révision, le requérant et son conseil ; lorsqu’ils sont présents à l’audience, ils prennent la parole en dernier. De la même façon, même si la partie civile n’est pas avisée de la tenue de l’audience par la commission, celle-ci a pu accepter, par le passé, qu’une partie civile indirectement informée de la date de l’audience y participe. Dans les faits, il est rare que le requérant, la partie civile et leurs conseils participent à cette audience.
Ces débats se tiennent en chambre du conseil, c’est-à-dire à huis clos, et le délibéré de la commission est nécessairement secret. En outre, comme le prévoit l’article 623, la décision – et elle seule – peut être rendue en séance publique lorsque le requérant le demande. En 2012, seules deux décisions ont fait l’objet d’une telle demande (54).
c. Un filtrage sévère des demandes
La commission de révision est chargée, en application de la loi, du nécessaire filtrage des demandes destiné à ne soumettre à la Cour de révision que les demandes vraisemblablement fondées. En effet, en application de l’article 623 du code de procédure pénale, la commission saisit la Cour de révision « des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises ». Si l’on s’en réfère au rapport établi en 1988 par M. Philippe Marchand au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, cette formulation doit uniquement permettre à la commission instituée en 1989 d’écarter les requêtes « manifestement irrecevables ou mal fondées ». Dès lors, la commission de révision ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation aussi grand que la Cour de révision et doit uniquement instruire et filtrer les demandes.
Il n’est donc pas anormal que la Cour de révision, qui se prononce in fine sur les demandes qui lui sont renvoyées par la commission, en rejette certaines que la commission de révision avait, elle, jugées admissibles. Étant un organe de filtrage, la commission doit avoir une appréciation plus large que la Cour ; si cette dernière ne rejetait jamais les demandes transmises, cela signifierait que l’analyse de la commission serait trop restrictive. Le parallèle peut d’ailleurs être fait avec l’instruction ordinaire. En effet, « de même qu’il appartient au juge d’instruction d’ordonner le renvoi d’une personne mise en examen devant la juridiction lorsqu’il estime que les faits qui lui sont reprochés "constituent un délit" (…) ou "constituent une infraction qualifiée crime par la loi" (…), il appartient à la juridiction de jugement de se prononcer, en dernier lieu, sur la réalité de ces infractions. En conséquence, la commission de révision doit se borner à transmettre les requêtes qui lui paraissent devoir être admises, à savoir celles pour lesquelles une décision de rejet n’est pas évidente » (55).
Cependant, il est clair que c’est là une situation difficilement compréhensible pour les condamnés qui, passant le filtre de la commission, sont ensuite déboutés. Une ambiguïté existe dans ce texte, puisque, dans l’esprit des requérants et de leurs conseils, si la commission de révision a saisi la Cour de révision, c’est que leur demande paraît pouvoir être « admise » et « que dans l’esprit de ses membres, il faudrait aller à la révision » (56). Plusieurs affaires, notamment les affaires Seznec et Leprince, ont donné lieu à de vives critiques de la Cour de révision, tant les médias étaient acquis à la cause des condamnés, aidés en cela par la décision positive de la commission de révision. Il faut admettre que la rédaction de la loi laisse entendre que la demande est examinée successivement par deux organes distincts de révision, mais selon des critères identiques. Une clarification de l’article 623 serait donc nécessaire pour distinguer plus nettement le rôle de la commission de celui de la Cour (cf. infra, deuxième partie).
Dans les faits, la rédaction actuelle de l’article 623 du code de procédure pénale a conféré à la commission de révision un pouvoir de filtrage particulièrement important, qui va au-delà du simple examen de recevabilité. D’ailleurs, comme l’a indiqué Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, « le tri opéré par la commission prend de plus en plus d’importance et cette dernière, avant de prendre la décision de transmettre ou de ne pas transmettre le dossier à la cour, ne se borne pas à vérifier la nouveauté et la réalité du fait ou de l’élément invoqué mais elle recherche quelle aurait pu être son influence au regard des éléments existant au dossier qui avaient fondé la déclaration de culpabilité » (57).
À titre d’illustration, en 2012, seules 1,44 % des demandes ont passé son filtre : sur les 139 demandes ayant fait l’objet d’une décision cette année-là, la commission de révision en a déclaré 112 irrecevables, dont 38 ab initio, en a rejeté 25 et a saisi la Cour de révision de deux demandes en révision. Le constat est identique lorsque l’on observe les décisions rendues par la commission de révision depuis 1990. Depuis cette date, la commission de révision a rendu 3 171 décisions. Elle a déclaré 2 122 demandes irrecevables, en a rejeté 965 et a saisi la Cour de révision de 84 demandes (cf. tableau ci-dessous), ce qui fixe son taux de saisine de la Cour de révision à 2,65 %.
RÉPARTITION DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE RÉVISION DEPUIS 1990
Nombre de décisions rendues……………………………………………………. 3 171
Nombre de décisions irrecevables……………………………………………….. 2 122
Pourcentage de demandes irrecevables sur le total des demandes .…… 67 %
Nombre de décisions de rejet……………………………………………………… 965
Pourcentage des demandes rejetées sur les demandes recevables ……. 92 %
Nombre de demandes transmises à la Cour de révision……………………….. 84
Pourcentage des demandes transmises sur le total des demandes…… … 2,65 %
L’importance de ce pouvoir de filtrage se trouve renforcée par le fait que la décision de la commission de révision n’est pas susceptible de recours. Si l’appel de la décision de la commission était possible, alors cela reviendrait à priver le dispositif général du filtre qui existe aujourd’hui. Cependant, l’absence de recours est tempérée par le fait que le dépôt des demandes n’est pas limité dans le temps, ce qui permet à certains requérants, en cas de rejet par la commission ou la Cour, de soumettre à nouveau à l’avis de la commission leur dossier, complété ou non par de nouveaux éléments. Du reste, la commission de révision prend le soin de réétudier, à chaque saisine, l’ensemble des faits que le requérant a pu éventuellement lui soumettre au cours de ses requêtes passées, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 623.
2. La Cour de révision, juridiction de jugement
Une fois saisie par la commission de révision des condamnations pénales, la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, se prononce sur la nécessité d’annuler la condamnation prononcée à l’encontre du requérant.
a. La chambre criminelle statuant comme Cour de révision
Le code de procédure pénale est presque muet en ce qui concerne la composition de la Cour de révision. Son article 623 indique que la commission de révision « saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision », sans pour autant préciser la formation de la chambre criminelle dont il peut s’agir. Dès lors, la chambre criminelle peut siéger en formation plénière, mais elle n’y est nullement tenue. D’ailleurs, il semble que la Cour de révision ne réunisse, le plus souvent, qu’une partie des magistrats de la chambre criminelle.
De fait, la pratique des présidents successifs de la chambre criminelle a, semble-t-il, varié. Si certains avaient établi des règles tenant à la complexité du dossier – les affaires simples étaient traitées au sein de la section de la chambre criminelle dédiée aux décisions des cours d’assises, tandis que les affaires complexes relevaient de l’assemblée plénière –, d’autres ont préféré procéder au cas par cas ou laisser siéger les membres de la chambre criminelle qui le souhaitaient. Ainsi, la composition de la Cour de révision varie d’une affaire à l’autre (58).
Pour certains, la liberté laissée à la Cour de révision porterait atteinte à l’impartialité de la juridiction. Qui plus est, pour Me Yves Baudelot, la collégialité de la Cour de révision ne serait qu’une collégialité de façade en raison du fait que seul le magistrat rapporteur désigné par elle aurait une réelle connaissance du dossier avant l’audience. Si vos rapporteurs ne peuvent s’associer à de telles appréciations, il est clair que l’imprécision du texte ne peut que favoriser les soupçons de partialité à l’égard de cette juridiction.
b. Une procédure inspirée de celle de la Cour de cassation
La Cour de révision, comme la commission de révision, dispose de pouvoirs d’investigation, qu’elle peut mettre en œuvre lorsque l’affaire n’est pas en état. Elle désigne alors un de ses membres pour procéder aux actes d’investigation nécessaires. La Cour met cependant rarement en œuvre ces pouvoirs, sauf lorsqu’elle souhaite approfondir les investigations menées par la commission – la Cour a, par exemple dans l’affaire Rida X., vérifié l’authenticité du certificat d’hospitalisation –, ou lorsque des éléments, non invoqués devant la commission, le sont devant elle.
Lorsque l’affaire est en état, la Cour de révision doit se prononcer, à l’issue d’une audience publique, sur la demande qui lui est soumise. L’article 625 du code de procédure pénale fixe les grandes lignes de la procédure suivie devant la Cour : au cours d’une audience publique « sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat ». Outre la publicité de l’audience, la place de la partie civile diffère également de celle qui lui est reconnue devant la commission de révision : la partie civile est obligatoirement avisée de l’audience et peut y intervenir.
Comme la procédure suivie devant la commission de révision, la procédure de la Cour est essentiellement écrite, très éloignée d’une procédure d’assises. Notamment, les témoins, les experts, les services de police n’interviennent pas au cours de cette audience, alors même que leurs déclarations peuvent être d’une importance capitale pour resituer le fait nouveau par rapport au dossier que les premiers juges ont eu à juger. Le caractère essentiellement écrit de la procédure explique également que les débats de la Cour de révision soient relativement brefs par rapport aux débats des cours d’assises.
Enfin, comme la commission de révision, la Cour de révision peut prononcer la suspension de l’exécution de la peine du requérant, sans qu’un recours contre un éventuel refus soit possible.
c. Une décision d’annulation qui peut faire intervenir une nouvelle juridiction
À l’issue de l’audience publique, la Cour de révision statue sur la demande, qu’elle peut rejeter ou annuler (cf. schéma infra). Dans cette dernière hypothèse, l’annulation fait parfois intervenir une juridiction du fond, devant laquelle l’affaire est renvoyée par la Cour de révision.
–– Le rejet de la demande en révision
La Cour de révision peut, en premier lieu, « rejeter la demande si elle l’estime mal fondée » (59). Depuis 1990, la Cour de révision a rejeté 33 des 84 demandes en révision qu’elle a examinées, soit 39 %. Parmi les 84 demandes examinées par la Cour de révision depuis 1990, 15 portaient sur des condamnations criminelles ; la Cour en a rejeté 5 ; elle doit encore se prononcer sur les deux demandes transmises, en juillet 2013, par la commission de révision.
–– L’annulation sans renvoi de la condamnation
Lorsqu’elle estime la demande fondée, la Cour de révision prononce l’annulation de la décision. L’article 625 du code de procédure pénale lui permet, dans certains cas de figure, de mettre directement un terme à la procédure de révision (cf. schéma infra).
Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à de nouveaux débats – par exemple, en cas de décès du condamné, d’amnistie ou de prescription de l’action publique –, la Cour de révision statue elle-même au fond. Dans cette hypothèse, les exigences de la Cour de révision en matière de doute sont extrêmement élevées et ce n’est que lorsqu’elle est absolument persuadée de l’innocence du condamné qu’elle annule sa condamnation.
L’annulation est également prononcée sans renvoi lorsqu’elle ne laisse rien subsister à la charge du condamné qui puisse être pénalement qualifié. C’est par exemple le cas lorsque le requérant a été condamné pour une infraction qui n’a pas été commise, que le condamné bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale découverte a posteriori et, de façon générale, lorsque le fait nouveau remet clairement en cause l’existence matérielle de l’infraction ou l’implication de son auteur. Dans un tel cas de figure, de nouveaux débats seraient parfaitement inutiles, puisque l’innocence découle directement de la reconnaissance, par la Cour de révision, de la réalité du fait nouveau invoqué.
La faculté qu’a Cour de révision de juger elle-même au fond est largement utilisée, puisque 65 % des décisions d’annulation ne donnent pas lieu à renvoi. C’est plus souvent le cas en matière correctionnelle, où les trois quarts des décisions sont annulés sans renvoi, comme le montre le tableau ci-après.
RÉPARTITION DES DÉCISIONS D’ANNULATION DE LA COUR DE RÉVISION DEPUIS 1990
Nombre de décisions d’annulation rendues……………………….…………….. 51
Dont condamnations criminelles…..………………………………… .……… 8
Dont condamnations correctionnelles………………………………………… 43
Nombre de décisions d’annulation avec renvoi…………………………………. 18
Dont renvoi vers une cour d’assises………………………………… .……… 6
Dont renvoi vers une juridiction correctionnelle..…………………… .……… 12
Nombre de décisions d’annulation sans renvoi ………………………………… 33
Dont condamnations criminelles……………………………………… .…….. 2
Dont condamnations correctionnelles……………………………………..….. 31
Taux de renvoi en matière criminelle…………………………………………….. 75 %
Taux de renvoi en matière correctionnelle………………………………………. 28 %
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION
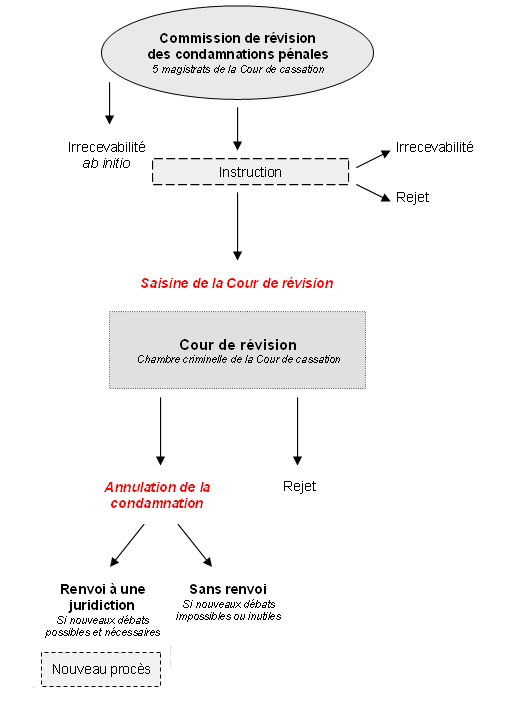
–– L’annulation avec renvoi de la condamnation
La Cour de révision renvoie l’affaire devant une juridiction du fond, de même ordre et de même degré, mais différente de celle qui a prononcé la décision annulée lorsqu’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires.
En matière criminelle, le renvoi est quasi systématique. En effet, depuis 1989, huit condamnations criminelles ont été annulées, dont deux seulement sans renvoi (60). Dans les affaires criminelles, la Cour de révision semble faire montre d’une certaine prudence en renvoyant à une juridiction de fond le soin d’établir l’innocence du condamné. En réalité, renvoyer l’affaire la décharge d’un poids, et peut permettre aux éléments qui l’ont convaincue de gagner en force, en n’étant pas remis en cause, entre-temps, par une contre-expertise ou une rétractation postérieurement à sa décision. Au-delà, le renvoi de ces affaires peut permettre de comprendre comment l’erreur judiciaire s’est construite, comme l’a souligné Mme Valérie Mahaut, journaliste ; le nouveau procès est un moyen pour la justice de remettre les choses dans l’ordre, par l’établissement d’un parallélisme des formes entre la condamnation et l’acquittement.
La juridiction de fond a alors pour tâche de rejuger le requérant à l’aune des éléments mis en lumière par la commission et la Cour de révision. Dans ce cas, la règle prohibant la réformation in pejus interdit à la nouvelle juridiction de condamner le requérant à une peine plus élevée que celle prononcée par la décision annulée. Pour le reste, la juridiction de renvoi dispose de toute latitude pour juger le requérant. Elle peut donc le déclarer à nouveau coupable des faits qui étaient à l’origine de la décision annulée par la Cour de révision. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans l’affaire Dils : en 2001, devant la cour d’assises de la Marne, statuant sur renvoi de la Cour de révision, le requérant a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, et ce alors même que l’avocat général avait requis son acquittement. Ce n’est qu’en 2002 qu’il sera définitivement acquitté, en appel.
Cependant, si l’on observe les condamnations correctionnelles et criminelles qui ont fait l’objet d’une annulation avec renvoi depuis 1990, il est clair que la décision de la Cour de révision conduit le plus souvent à une relaxe ou à un acquittement. Ainsi, sur les six affaires criminelles renvoyées, cinq requérants ont été acquittés à l’issue de la procédure judiciaire. Quant aux affaires correctionnelles renvoyées devant les juges du fond, au nombre de douze, six d’entre elles ont d’ores et déjà été rejugées, et cinq relaxes ont été prononcées.
La révision, une procédure relativement longue
La procédure de révision est relativement longue. D’une part, l’élément éventuellement déclencheur de la procédure, le fait nouveau, apparaît bien souvent par hasard et longtemps après les faits. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette procédure n’est enserrée dans aucun délai légal, contrairement à la procédure de réexamen. Dans l’affaire Agret, le fait nouveau n’est révélé que dix ans après la condamnation, en 1973, de M. Roland Agret pour avoir commandité le meurtre d’un garagiste et de son employé : c’est en effet en 1983 que l’auteur direct du crime, qui avait dénoncé le requérant aux autorités, est condamné pour subornation de témoin dans la même affaire. D’autre part, même lorsque l’élément déclencheur de la procédure intervient dans des délais brefs, la procédure de révision est, en elle-même, relativement longue, du fait des délais d’instruction et des étapes successives qu’elle connaît. Dans l’affaire Machin, il s’écoule ainsi près de quatre ans entre la dénonciation du véritable coupable, en 2008, et l’acquittement du requérant, la justice ayant attendu la condamnation du vrai coupable pour ouvrir le procès en révision. Ainsi, ce dernier, condamné en 2004, n’est acquitté qu’en 2012. Dans l’affaire Dils, le fait nouveau se produit en 1997, lorsque la présence d’un coupable potentiel sur les lieux du crime est révélée au hasard d’une audition datant de 1992, soit 8 ans après la condamnation du requérant ; mais celui-ci n’est acquitté que 5 ans plus tard, notamment du fait d’une nouvelle condamnation par la cour d’assises de renvoi, dont il a dû faire appel. Il en a été de même dans l’affaire Sécher, le requérant ayant été acquitté 11 ans après les faits et deux ans et demi après les rétractations de la plaignante.
3. Les conséquences juridiques de la révision
Si la procédure de révision est difficile à mettre en œuvre, ses effets juridiques sont complets en cas d’annulation de la condamnation. Outre l’anéantissement de la décision de condamnation, qui est réputée n’avoir jamais existé et disparaît donc du casier judiciaire, un véritable droit à réparation est organisé par l’article 626 du code de procédure pénale, qui couvre tant les aspects matériels de la détention injuste que le préjudice moral causé au condamné et à sa famille.
a. Le droit à une réparation intégrale du préjudice
Jusqu’en 1989, la réparation du préjudice causé par une condamnation injuste était facultative et devait être expressément demandée par le requérant. La réforme de la procédure de révision de 1989 en a opportunément fait un droit, tout en prévoyant une exception relative à « la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile » lorsqu’il est prouvé qu’elle « est imputable en tout ou partie » au condamné.
Ainsi, en 1998, lorsque Rida X., condamné pour un homicide qu’il n’a pas pu commettre puisqu’il était, au moment des faits, hospitalisé dans un établissement spécialisé, demande à être indemnisé pour les quatre années pendant lesquelles il a été incarcéré à tort, la commission d’indemnisation lui refuse toute indemnisation, au motif que ses déclarations erronées sur son emploi du temps n’ont pas permis au juge d’instruction d’établir la vérité et qu’il n’a pas été capable de donner en temps utile le bulletin d’hospitalisation qui aurait permis de l’innocenter. Or, dans les faits, il ne semble pas que le requérant ait volontairement omis de mentionner son internement à la date des faits reprochés.
Pour remédier à ce qui est apparu comme une disposition restreignant excessivement le droit à réparation, une modification a été introduite par la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale. Notamment, l’exception relative à la non-représentation de la pièce ou la non-révélation de l’élément inconnu a été supprimée au profit d’une rédaction moins pénalisante : l’indemnisation est désormais refusée lorsque « la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites ». Seul ce cas de figure très particulier justifie aujourd’hui que l’on prive une personne injustement condamnée de son droit à réparation.
Cette loi a également conduit à l’harmonisation de la procédure d’indemnisation d’un condamné reconnu innocent avec celle qui est mise en œuvre dans le cas d’une détention provisoire suivie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Désormais, le condamné reconnu innocent a le choix entre, d’une part, demander directement à la juridiction prononçant la décision l’innocentant de lui accorder cette indemnisation ou la demander, dans les six mois qui suivent la décision, au premier président de la cour d’appel du ressort de son lieu de résidence. Un recours contre la décision du premier président est alors possible devant la commission nationale de réparation des détentions.
Depuis la loi du 30 décembre 2000 précitée, la réparation du préjudice matériel et moral du condamné doit être « intégrale ». Ainsi, outre le salaire non perçu du fait de la détention et les frais d’avocat engagés pendant la procédure judiciaire, la dégradation de l’état de santé du condamné du fait des épreuves traversées pendant la détention est indemnisée. Quant au préjudice moral, il prend en compte, outre les effets psychologiques de la détention, les répercussions de la condamnation sur la vie sociale du condamné. Par ailleurs, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation peut demander réparation dans les mêmes conditions. Dans les faits, il s’agit principalement du conjoint et des enfants du condamné, mais la rédaction du texte est suffisamment large pour inclure tout tiers qui aurait également eu à subir les conséquences directes de la condamnation.
C’est en application du principe de réparation intégrale qu’un requérant récemment acquitté a reçu la somme de 197 352 euros au titre du préjudice matériel, 600 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre des frais engagés, pour sept années passées en prison. La réparation intégrale s’applique également aux condamnations correctionnelles. Ainsi, une femme initialement condamnée pour dénonciation calomnieuse – elle avait accusé l’époux de sa sœur d’abuser de ses enfants –, qui a finalement vu sa condamnation annulée par la Cour de révision – l’homme en question a été reconnu coupable des faits sept ans après la dénonciation –, a obtenu de la commission nationale de réparation des détentions la somme de 45 000 euros pour quatre mois d’emprisonnement avec sursis (61).
b. Des mesures complémentaires de publicité
Outre la réparation du préjudice moral, physique et matériel, le législateur a prévu des mesures de réparation à même d’assurer la réhabilitation sociale du condamné innocenté par les voies d’information que représentent les autorités administratives locales, les publications légales et les médias. Ainsi, en application du sixième alinéa de l’article 626, si le condamné le demande, la décision l’innocentant peut être affichée « dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ». La décision peut également être insérée in extenso au Journal Officiel, à la demande du requérant, ou encore être publiée, par extraits, dans cinq journaux nationaux ou locaux choisis par la juridiction qui, dans les faits, tient compte des souhaits formulés par le condamné.
II. LE RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES : UNE PROCÉDURE RÉCENTE ASSURANT LA RÉOUVERTURE DES PROCÈS EN CAS DE VIOLATION DES DROITS ET LIBERTÉS DU CONDAMNÉ
La procédure de réexamen, mise en place par la loi du 15 juin 2000 à la suite d’une recommandation européenne, permet la réouverture d’une instance judiciaire lorsque la décision attaquée a été rendue en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle a vocation à réparer les violations de la Convention ayant porté préjudice à un condamné en le replaçant dans la situation qui était la sienne avant que ne se déroule la procédure judiciaire à l’origine de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, selon le principe de restitutio in integrum.
A. LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES : UNE EXIGENCE EUROPÉENNE
Contrairement à la procédure révision, la procédure de réexamen d’une décision pénale définitive a été introduite récemment en droit français, sous l’influence directe des institutions européennes.
1. La procédure de réexamen: la réparation d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
L’introduction de la procédure de réexamen est liée à l’adhésion de la France à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : elle doit permettre de tirer les conséquences, en droit interne, d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme.
a. L’approche européenne du réexamen
Une affaire particulière est à l’origine de l’introduction, en droit français, d’une voie de recours parallèle à la révision des condamnations pénales. La France avait été condamnée, en 1995, par ce qui était alors la commission européenne des droits de l’Homme, pour n’avoir pas respecté le droit au procès équitable lors d’un procès qui s’était tenu en 1989. En effet, le requérant, accusé du meurtre d’un policier et de vol à main armée, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans avoir assisté à l’ensemble des débats et sans y avoir été représenté par un avocat (62). Mais, en dépit du constat d’une violation grave des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il était juridiquement impossible, en droit français, d’ouvrir un nouveau procès.
Par une recommandation n° R(2000)2 du 19 janvier 2000, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe enjoignit donc aux États parties à la Convention de créer les conditions, en droit interne, d’un réexamen des condamnations viciées par une violation de la Convention (cf. infra). Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe souhaitait rendre le réexamen de l’affaire possible dans deux cas de figure : d’une part, lorsque la condamnation était contraire, sur le fond, à la Convention ; d’autre part, lorsque la décision attaquée était profondément viciée par la violation d’un droit procédural garanti par la Convention. Tel que le Comité des ministres l’avait envisagée, la violation devait être d’une gravité telle qu’elle jetait un « doute sérieux » sur la condamnation prononcée.
Recommandation n° R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres)
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») ;
Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution ;
Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention (restitutio in integrum) ;
Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’État défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national ;
Ayant toutefois à l’esprit que - ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour - il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum,
I. Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum.
II. Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque :
(i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et
(ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que
(a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou
(b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. »
b. Le choix français de distinguer le réexamen de la révision
La mention, par la recommandation européenne, d’un « doute sérieux (…) jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée » n’est pas sans rappeler les termes de la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation en matière de révision. En effet, si l’on considère que les règles de la procédure pénale sont conçues pour permettre à la vérité judiciaire d’émerger, alors leur non-respect peut conduire à douter du bien-fondé de la décision de la juridiction. La formulation de la recommandation européenne aurait dès lors pu justifier la simple extension de la procédure de révision au cas d’une violation de la Convention.
L’amendement initialement déposé par M. Jack Lang, alors député, au cours de la seconde lecture du projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes prévoyait d’ailleurs la création d’un cinquième cas de révision, formulé de la sorte : « 5° Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu’une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision » (63).
Cependant, c’est un dispositif distinct que le Parlement, sur proposition du Gouvernement, a créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. La procédure de réexamen fait l’objet d’un titre propre au sein du livre du code de procédure pénale consacré aux voies de recours extraordinaires, au sein duquel figure notamment la procédure de révision. En application de l’article 626-1 du code de procédure pénale, le réexamen d’une condamnation est acquis lorsque « par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme ».
2. Des emprunts nombreux à la procédure de révision
Comme la procédure de révision, le réexamen est une voie de recours exceptionnelle destinée à remettre en cause une décision définitive de condamnation. Ainsi, bien qu’il s’agisse de deux procédures distinctes, le législateur s’est largement inspiré de la procédure de révision pour mettre en place une procédure propre à assurer le réexamen d’une décision pénale définitive à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.
a. Une commission de réexamen inspirée de la commission de révision
La juridiction de réexamen apparaît directement inspirée de la commission de révision. En effet, le choix a été fait de confier le réexamen d’une décision pénale définitive à un organe similaire, dans sa nature et sa dénomination : une « commission » rattachée à la Cour de cassation dont la présidence est assurée par un magistrat de la chambre criminelle.
Plus encore, la commission de réexamen, dans sa composition, peut être analysée comme un perfectionnement de la commission de révision. En effet, aux termes de l’article 626-3 du code de procédure pénale, cette commission est « composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la commission » (64). Ainsi, alors que toutes les chambres de la Cour de cassation peuvent être représentées au sein de la commission de révision, elles le sont nécessairement au sein de la commission de réexamen.
Cette composition, précisément fixée par la loi, a été unanimement saluée par les personnes entendues par vos rapporteurs. Elle assure en effet une certaine mixité à cette commission, en réunissant de hauts magistrats aux horizons divers et aux méthodes différentes. De fait, toutes les chambres de la Cour de cassation sont directement concernées par l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Lorsque le droit au procès équitable n’a pas été respecté, peu importe qu’il s’agisse d’une instance criminelle ou civile. L’aspect pénal des dossiers traités semble finalement secondaire, la légère sur-représentation dont bénéficie la chambre criminelle au sein de la commission assurant une coloration pénale suffisante à cette dernière.
b. Une procédure proche de celle mise en œuvre par la Cour de révision
La procédure de réexamen partage également avec la procédure de révision une certaine imprécision législative. En effet, la procédure suivie devant la commission n’est guère décrite par la loi, à l’exception de la mention, à l’article 626-3, du caractère public de son audience, qui la rapproche de la Cour de révision : « la décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ».
Pour le reste, la pratique de la commission de réexamen est venue combler les silences d’un texte laconique en ce qui concerne l’application du principe du contradictoire. Ainsi, en pratique, ce dernier est respecté et lorsque le condamné, ou son avocat, est présent à l’audience – ce qui est rarement le cas –, il prend la parole en dernier, après les conclusions de l’avocat général.
Par ailleurs, lorsque la commission a été saisie de l’affaire Papon, en 2003, plusieurs parties civiles ont souhaité être associées à la procédure de réexamen. La commission s’est alors appuyée sur l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose notamment que la procédure pénale doit « préserver l’équilibre des droits des parties » pour accorder aux parties civiles une place qui n’était pas prévue par la loi (65). Depuis, la commission avise systématiquement les parties civiles de la date de l’audience, mais également de la possibilité qui leur est laissée de faire des observations écrites ou orales, à l’instar de ce que prévoient les dispositions relatives à la Cour de révision.
Le fonctionnement interne de la commission de réexamen est identique à celui des juridictions de révision. Lorsqu’elle est saisie d’une demande, la commission de réexamen nomme, en son sein, un rapporteur qui sera chargé d’examiner la demande et d’analyser, en premier lieu, sa recevabilité, avant d’étudier la nécessité de prononcer le renvoi de l’affaire devant une juridiction de fond.
En outre, la commission de réexamen dispose de pouvoirs proches de ceux de la Cour de révision. Lorsque la commission décide que l’affaire doit être réexaminée, elle peut soit la renvoyer à l’assemblée plénière de la Cour de cassation – lorsque la violation concerne la procédure devant la Cour de cassation, mais aussi lorsqu’elle nécessite une prise de position jurisprudentielle de sa part –, soit à une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée. Mais elle est tenue, comme la Cour de révision, de réexaminer elle-même l’affaire lorsqu’il n’est pas possible de procéder à de nouveaux débats du fait, notamment, du décès du condamné ou de la prescription de l’action publique. D’ailleurs, l’article 626-4 du code de procédure pénale renvoie à l’article 625, relatif à la révision, pour donner ces pouvoirs à la commission de réexamen. Dans ce cas seulement, la commission de réexamen détient le pouvoir d’annuler la condamnation.
Enfin, la commission de réexamen peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine du requérant en application de l’article 626-5 du code précité. Il convient ici de noter le caractère très protecteur des dispositions relatives à l’exécution de la peine au cours d’une procédure de réexamen. En effet, hormis le cas où la commission prononce d’elle-même la suspension de l’exécution de la peine, un mécanisme de remise en liberté automatique est prévu par le deuxième alinéa de l’article 626-5. Ainsi, lorsque la commission de réexamen a renvoyé l’affaire à la Cour de cassation ou à une juridiction de fond, la personne dont la peine n’a pas été suspendue est nécessairement libérée si la décision de la juridiction de renvoi n’est pas intervenue dans un délai d’un an, sauf si elle est détenue pour d’autres motifs. Du reste, avant l’expiration de ce délai, la personne est considérée comme étant placée en détention provisoire, ce qui lui permet de formuler des demandes de remise en liberté. Là encore, les règles relatives au réexamen semblent plus abouties qu’en matière de révision.
B. UN RECOURS PARTICULIÈREMENT OUVERT
La rédaction retenue par le législateur, comme l’interprétation des dispositions des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale, permettent, contrairement à la procédure de révision, de faire droit à de nombreuses demandes.
1. Des possibilités de recours plus étendues qu’en matière de révision
Si le champ d’application de la procédure de réexamen est relativement large, la mise en œuvre de cette procédure est enserrée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme.
a. La totalité des décisions de condamnation susceptibles de recours
Aux termes de l’article 626-1 du code de procédure pénale, toute décision pénale définitive reconnaissant la culpabilité du requérant peut faire l’objet d’un recours en réexamen. La rédaction retenue est très proche de celle qui régit le recours en révision, mais son application diffère en plusieurs points.
La décision doit, comme en matière de révision, avoir été prononcée par une juridiction pénale à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction. Cependant, il convient de noter que, si la révision d’un arrêt de la Cour de cassation est impossible, puisque, par définition, celui-ci n’est porteur d’aucune condamnation, le réexamen d’une telle décision est possible. En effet, l’examen des débats parlementaires a conduit la commission de réexamen à considérer comme recevable une demande de cette nature (66).
Par ailleurs, comme en matière de révision, la décision doit être définitive, et les voies de recours internes épuisées. Il convient de noter que cette condition est automatiquement satisfaite en matière de réexamen, puisque c’est également une condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Enfin, le champ du réexamen s’étend à toutes les infractions. Ainsi, de simples contraventions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen (67). À l’inverse, la révision n’accueille les contraventions que lorsqu’elles sont indissociables de la commission d’un crime ou d’un délit (68).
b. Un recours introduit par un ensemble plus vaste de personnes et d’autorités
Le recours en réexamen peut être introduit par un plus grand nombre d’acteurs que le recours en révision. En effet, en application de l’article 626-2 du code de procédure pénale, le réexamen peut être demandé par :
– le ministre de la justice ;
– le procureur général près la Cour de cassation ;
– le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;
– les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
Ainsi, alors que la révision ne peut être demandée, au titre des autorités publiques, que par le garde des Sceaux, le procureur général près la Cour de cassation peut également introduire un recours en réexamen. Cependant, ni le ministre de la Justice, ni le procureur général près la Cour de cassation n’ont jamais saisi la commission de réexamen d’une telle demande.
Par ailleurs, alors que la révision est ouverte aux conjoint, enfants, parents, légataires universels ainsi qu’à ceux qui en ont reçu la mission expresse, le réexamen peut être mis en œuvre à titre posthume par les ayants droit du condamné, terme potentiellement très large. Toutefois, il convient de noter que le recours en réexamen n’est pas ouvert en cas d’absence déclarée du condamné.
c. Un délai d’un an pour former la demande en réexamen
Aux termes de l’article 626-3 du code de procédure pénale, la demande de réexamen doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Certains observateurs, comme Me Sylvie Noachovitch, ont considéré que ce délai était trop court pour permettre le dépôt des demandes. Il est vrai que certains pays européens connaissent des délais de recours nettement plus longs. En Finlande, par exemple, le requérant dispose d’un délai de cinq ans pour entamer cette démarche.
Toutefois, il semble, en pratique, que le délai prévu par le texte français ne constitue nullement un frein aux demandes. D’une part, aucune décision d’irrecevabilité n’a été prise en raison d’un dépassement du délai, ce qui témoigne de la bonne connaissance qu’ont les requérants des dispositions légales. D’autre part, les demandes sont généralement déposées très peu de temps après la décision de la CEDH, le recours devant la CEDH étant bien souvent directement motivé par la perspective du réexamen.
Ainsi, dans l’affaire Agnelet, le requérant a saisi la commission dans les trois jours qui ont suivi la décision de la CEDH, alors que celle-ci n’était pas encore définitive et que le Gouvernement français pouvait encore saisir la grande chambre de la Cour pour y renvoyer l’affaire. La commission de réexamen, ayant appris que le Gouvernement n’avait pas l’intention de saisir la grande chambre, a considéré que la décision de la CEDH était définitive par anticipation, afin de rendre la demande recevable. Ainsi, le délai d’un an semble suffisant pour permettre à toutes les demandes d’être formulées en temps utile.
2. L’application souple des termes de la loi par la jurisprudence
L’article 626-1 du code de procédure pénale pose plusieurs conditions cumulatives pour accorder le réexamen d’une décision pénale définitive. Une demande en réexamen ne peut aboutir que « lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme ».
La jurisprudence a retenu une interprétation relativement souple des termes de la loi, rendant ce recours particulièrement ouvert.
a. Une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme
En premier lieu, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) doit constater que la condamnation dont le réexamen est demandé a été prononcée en violation des dispositions de la Convention. Ainsi, une demande qui se contenterait d’évoquer des violations de la Convention, sans que ces violations aient été constatées, en l’espèce, par la CEDH, ne serait pas recevable (69). Il en va de même de la demande qui invoquerait un arrêt de la CEDH qui ne reconnaîtrait pas de violations de la Convention (70), la commission de réexamen n’ayant pas le pouvoir de soulever elle-même d’éventuels manquements aux stipulations de la Convention.
Les violations de la Convention peuvent concerner tant les articles de la Convention portant sur des garanties procédurales, comme l’article 6, que d’autres articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels conférant aux citoyens des garanties de fond. Ainsi, l’article 7 de la Convention, posant le principe de légalité des délits et des peines, et l’article 10 relatif à la liberté d’expression ont pu être invoqués à l’appui de demandes en réexamen.
La loi précise toutefois que seules les violations d’une certaine nature et gravité peuvent fonder une demande en réexamen. La jurisprudence a interprété de façon large ces dispositions. Ainsi, seule la violation du principe du délai raisonnable n’est pas, par nature, susceptible d’être réparée par le réexamen de l’affaire puisqu’un nouveau procès ne ferait qu’aggraver la situation et qu’elle est, en tout état de cause, sans lien avec la condamnation. Dans ce cas, la satisfaction équitable octroyée par la CEDH suffit à réparer le préjudice (71). En revanche, lorsqu’une cour d’assises n’a pas vérifié si sa composition en faisait un tribunal impartial, alors qu’une demande sérieuse émanait en ce sens du condamné, la commission de réexamen a estimé que cette violation, par sa gravité, ne pouvait être réparée autrement que par un réexamen de l’affaire en question (72). En l’espèce, le requérant, d’origine maghrébine, et son conseil avaient transmis à la cour d’assises une déclaration écrite faite par une tierce personne qui attestait avoir entendu l’un des jurés déclarer qu’il était raciste. La cour d’assises avait rejeté la demande de donner acte en considérant qu’elle ne pouvait le faire pour des faits qui s’étaient déroulés hors de sa présence (73).
b. Des conséquences dommageables pour le condamné
La loi exige que le requérant ait subi les conséquences négatives de la violation constatée par la CEDH, notion interprétée de façon extensive par la jurisprudence puisque ces conséquences concernent l’emprisonnement, mais également les effets de la condamnation elle-même. Ainsi, une décision de condamnation avec dispense de peine peut donner lieu à réexamen, car l’existence même de la condamnation peut avoir eu des conséquences importantes sur la vie du condamné. Il en est de même des condamnations à des peines prononcées avec sursis, non encore mises à exécution, voire d’ores et déjà exécutées. De la même façon, de simples peines d’amende, délictuelles ou contraventionnelles, pourraient également constituer des « conséquences dommageables », s’il ne pouvait y être parfaitement remédié par l’octroi d’une « satisfaction équitable ».
L’article 41 de la Convention stipule que la CEDH accorde une « satisfaction équitable », sous la forme d’une indemnisation, à la partie lésée lorsque le droit interne de l’État membre ne permet pas d’effacer parfaitement les conséquences de la violation. À première vue, cette formulation semble difficilement conciliable avec la rédaction de l’article 626-1 du code de procédure pénale, qui ne semble permettre le réexamen que si cette indemnisation ne peut mettre un terme aux conséquences de la violation. En interprétant à la lettre ces dispositions, si la CEDH rejette une demande de satisfaction équitable, cela signifie qu’il n’y a pas de conséquences dommageables et que le réexamen n’a pas de raison légitime d’être demandé. Certains commentateurs ont même vu dans l’allocation d’une satisfaction équitable une condition de recevabilité du recours en réexamen, alors même que celle-ci peut ne pas avoir été demandée par le requérant.
Afin de ne pas fermer le recours en réexamen, la commission de réexamen a estimé que la satisfaction équitable ne devait pas être entendue comme une condition et que la demande en réexamen était recevable, qu’une satisfaction équitable ait été accordée ou non, dès lors que la violation, par sa nature et sa gravité, a eu des conséquences auxquelles seul le réexamen de l’affaire peut remédier.
Enfin, la loi exige l’existence d’un lien de causalité entre la violation et les conséquences dommageables dont le condamné peut pâtir : la violation de la Convention, par sa nature et sa gravité, doit avoir « entraîné » ces conséquences dommageables. Toutefois, ce lien est interprété de façon très large par la commission de réexamen, qui statue de façon favorable dès lors qu’une décision est entachée d’une violation de la Convention reconnue par la CEDH. Ses décisions se bornent généralement à rappeler la violation constatée par la CEDH en y ajoutant la formule suivante : « Attendu que ces violations, par leur nature et leur gravité, entraînent pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l’affaire peut mettre un terme ». De fait, pour Mme Magali Lafourcade, magistrate et docteur en droit, cette conception exclusivement matérielle du lien de causalité conduit à ce qu’« une violation du droit au procès équitable [induise] de façon quasi automatique une décision de réexamen » (74).
C. UN RECOURS SOUVENT FAVORABLE AU REQUÉRANT, MAIS PEU UTILISÉ
Le réexamen est très souvent accordé par la commission de réexamen, dès lors que des conditions minimales sont remplies. Cependant, le recours en réexamen semble peu utilisé par les condamnés.
1. Une remise en cause quasi automatique de l’autorité de la chose jugée
Après avoir prononcé un certain nombre de décisions d’irrecevabilité dans les années qui ont suivi sa création, la commission de réexamen a par la suite, par un effet d’apprentissage, reçu nettement moins de demandes ne respectant pas les prescriptions légales.
DÉCISIONS RENDUES DE LA COMMISSION DE RÉEXAMEN DEPUIS 2000
Nombre total de décisions rendues 55
Nombre de décisions d’irrecevabilité 16
Nombre de décisions de rejet 7
Nombre de décisions de réexamen 31
Autres 1
Passé le stade de la recevabilité, le rejet des demandes est relativement rare. Ainsi, la commission de réexamen n’a pris, depuis 2000, que 7 décisions de rejet sur 38 requêtes jugées recevables. Elles concernent dans plusieurs cas une violation du principe du délai raisonnable de jugement, ce que la commission ne considère pas comme un motif de réexamen. Il est également arrivé qu’elle rejette les demandes pour lesquelles la satisfaction équitable accordée par la CEDH lui semblait suffisante pour mettre un terme aux conséquences dommageables de la violation (75). Ces décisions, insusceptibles de recours, ferment donc définitivement la voie au réexamen de l’affaire.
Depuis sa création, la commission de réexamen a rendu 31 décisions dans lesquelles elle a conclu à la nécessité d’un réexamen, ce qui représente 82 % des demandes recevables et démontre le caractère particulièrement ouvert de ce recours par rapport au recours en révision. L’affaire est ainsi réexaminée lorsque le condamné n’a pas été à même de préparer sa défense, soit qu’il ait été privé d’avocat, qu’il n’ait pas pu interroger le témoin ou la victime dont les déclarations ont conduit à sa condamnation ou qu’il n’ait pas pu se prononcer sur la requalification de l’infraction qui lui était reprochée (76). Il en est de même lorsque le requérant a été condamné sur la seule base d’aveux formulés pendant sa garde à vue, en dehors de la présence de son avocat, celui-ci n’ayant pu légalement intervenir avant la 20e heure de ladite garde à vue. D’autres affaires ont été réexaminées lorsque le principe d’égalité des armes n’avait pas été respecté. Notamment, la longueur excessive des débats devant la cour d’assises, plongeant le condamné et son conseil dans un état de fatigue avancé – l’avocat de la défense avait commencé sa plaidoirie à 4 h 25 du matin, après quinze heures de débats –, constitue une violation qui doit être réparée par le réexamen (77). Le fait de ne pas avoir pu introduire de recours en cassation ou de ne pas avoir été en mesure d’interjeter appel de la décision de condamnation du fait d’un internement psychiatrique sont également considérés comme des moyens de réexamen par la commission. Enfin, lorsque le condamné n’a pas été en mesure de comprendre la décision faute de motivation de l’arrêt de la cour d’assises, le réexamen est ordonné, comme ce fut récemment le cas dans l’affaire Agnelet (78).
2. Un recours paradoxalement peu utilisé par les condamnés
Bien que ce recours soit largement ouvert et qu’il conduise fréquemment à la réouverture du procès, il n’a été paradoxalement que peu utilisé par les condamnés et leurs conseils depuis sa création. En effet, la commission de réexamen n’a été saisie que de 55 requêtes au cours des quatorze dernières années. Ainsi, en moyenne, la commission de réexamen est saisie de moins de 4 requêtes par an. Qui plus est, les recours en réexamen ont nettement diminué depuis 2008 et il est arrivé que la commission ne soit saisie que d’une seule demande, ainsi que le montre le graphique ci-après.
ÉVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DE REQUÊTES REÇUES PAR LA COMMISSION
DE RÉEXAMEN (2000-2013)
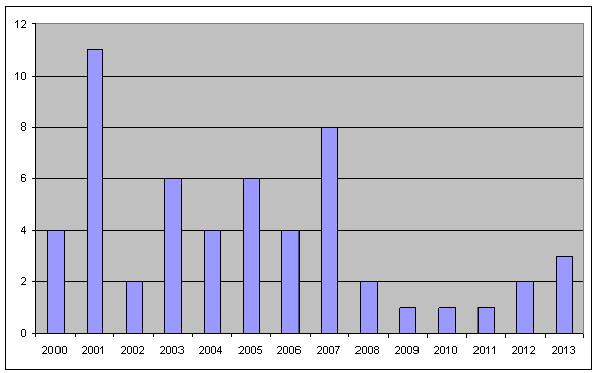
Certes, saisir la commission de réexamen suppose d’avoir auparavant saisi la CEDH et obtenu d’elle qu’elle constate une violation de la Convention. Cependant, dans certains cas où la commission s’attendait à être saisie après une condamnation de la France par la CEDH, le condamné n’a pas demandé le réexamen de l’affaire, comme l’a noté M. Philippe Castel, président de la commission de réexamen. Alors que certains commentateurs avaient craint, initialement, un engorgement de cette procédure, cette hypothèse ne s’est nullement réalisée.
Il peut sembler paradoxal que cette procédure, qui permet généralement la tenue d’un nouveau procès dès lors que certaines conditions préalables sont remplies, soit si peu utilisée par les condamnés, tandis que la procédure de révision, qui donne très rarement des résultats, fait l’objet de nombreuses demandes. Plusieurs raisons tendent à expliquer ce désintérêt :
● Tout d’abord, il convient de noter que la procédure est relativement longue car même si une instance unique décide du réexamen et qu’elle le fait dans des délais brefs, deux procédures, en amont – devant la CEDH – et en aval
– devant une nouvelle juridiction de jugement – sont nécessaires au réexamen. Dans l’affaire qui a motivé la création du recours en réexamen, il s’est ainsi écoulé plus de dix ans entre la première condamnation, en 1989, du requérant, et le nouveau procès, qui s’est tenu en 2003 après que la commission de réexamen a décidé, en 2000, de renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction.
● Par ailleurs, si le recours est très ouvert, le réexamen permet rarement au condamné de voir la condamnation substantiellement modifiée. Dans de nombreux cas, la sentence initialement prononcée n’est pas atténuée ou dans des proportions qui ne satisfont pas les requérants. Il convient cependant de distinguer les violations qui portent sur des droits substantiels de celles qui concernent des droits procéduraux. Dans le premier cas, la relaxe ou l’acquittement paraît acquis en cas de réexamen, comme ce fût par exemple le cas de M. Noël Mamère, condamné pour diffamation publique en violation de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression (79), comme dans celui d’un requérant condamné pour un délit d’exécution de travaux sans permis de construire préalable, alors qu’il ne lui était pas possible de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et de savoir que les faits commis pouvaient entraîner une sanction pénale (80).
Il en va autrement des cas où le réexamen est demandé sur le fondement de violations procédurales. Seules deux affaires pour lesquelles la condamnation était viciée par une violation procédurale ont donné lieu à une relaxe depuis la création de ce recours. Notamment, dans une affaire où le requérant avait été condamné en 1998 à six ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, il avait obtenu la condamnation de la France par la CEDH en 2003, pour ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ses accusateurs. L’affaire a été renvoyée, en 2005, pour réexamen et le requérant a finalement été relaxé, en 2007, grâce à la rétractation de ses accusateurs.
La procédure de réexamen est, en réalité, mal comprise. L’objet de cette procédure de réexamen n’est pas la modification, au fond, de la décision. Comme le note Mme Magali Lafourcade, magistrate et docteur en droit, « un quiproquo s’est niché au cœur de la procédure de réexamen. Elle vise une juste, efficace et complète réparation, dans le souci d’assurer la restitutio in integrum. Elle n’implique pas nécessairement une issue différente au procès réexaminé. Par exemple, le fait d’avoir été défendu par tel avocat de son choix ne garantit en effet pas une sentence plus clémente. Mais pour le condamné, il s’agit avant tout de réduire la sentence prononcée, voire d’obtenir la relaxe ou l’acquittement. Or, les décisions pénales obtenues à l’issue du nouveau procès déçoivent les condamnés qui en attendent plus que ce que la pratique du réexamen leur offre réellement » (81).
● Bien plus, faire réexaminer son affaire présente le risque majeur de voir la juridiction de renvoi aggraver la sentence initiale. S’il est admis, en matière de révision, que la reformatio in pejus est prohibée, comme elle l’est dans tous les cas où le recours est formé dans le seul intérêt du condamné, il en va autrement du réexamen. En effet, cette procédure trouve son sens dans le réexamen lui-même, tandis que la révision tend nécessairement à la disparition de la condamnation ou, du moins, à son adoucissement. La Cour de cassation a d’ailleurs clairement indiqué, en 2005, « qu’aucune disposition légale ou conventionnelle [n’interdisait] d’aggraver le sort de l’accusé lors du réexamen d’une décision pénale, la cour d’assises de renvoi disposant, comme au cas de renvoi après cassation, de la plénitude de juridiction pour juger à nouveau l’accusé » (82). La commission de réexamen y voit une explication du faible nombre de requêtes dont elle est saisie : « le petit nombre des requêtes dans les dernières années, alors que la France a fait l’objet de plusieurs condamnations en matière pénale par la Cour européenne des droits de l’homme, peut s’expliquer de plusieurs manières: les requérants obtiennent satisfaction sur le plan financier, ou se contentent d’une victoire morale, ou encore redoutent un nouveau procès qui leur fait courir le risque d’une aggravation de la peine » (83).
SECONDE PARTIE : VINGT PROPOSITIONS POUR ENTOURER LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION PÉNALE DE GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES
La quasi-totalité des personnes entendues par la mission d’information a conclu à la nécessité d’apporter à la procédure de révision et, plus marginalement, à la procédure de réexamen, certaines modifications législatives. Si les suggestions n’étaient pas toutes identiques, vos rapporteurs ont néanmoins acquis la conviction qu’un changement législatif était nécessaire sur plusieurs points. Notamment, il est apparu que la création d’une juridiction unique statuant sur la révision et le réexamen des décisions pénales définitives était à même de répondre aux critiques adressées par beaucoup au système actuel. Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement la procédure de révision, une clarification des termes de la loi semble indispensable pour permettre à une demande en révision d’aboutir toutes les fois qu’elle est légitime. Enfin, une réflexion doit être menée sur la procédure criminelle elle-même qui, en l’état actuel du droit, fait à plusieurs égards obstacle au travail des juridictions de révision.
I. CRÉER UNE COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Les appréciations portées sur la Cour de révision par les personnes entendues par vos rapporteurs ont été très variables. Deux affaires, en particulier, ont alimenté de vives critiques à l’égard de la chambre criminelle statuant comme Cour de révision : l’incompréhension face au rejet de la demande de la ministre de la justice, dans l’affaire Seznec, n’a eu d’égal que les mouvements de l’opinion publique face à la réincarcération du requérant dans l’affaire Leprince. Cependant, cela ne doit pas conduire à jeter aveuglément l’opprobre sur la Cour de révision qui, dans ces deux affaires, a fait son travail avec toute la rigueur attendue. En réalité, ce sont les médias qui, en donnant le verdict pour acquis, sans livrer les éléments susceptibles d’invalider l’hypothèse de l’innocence, entretiennent l’incompréhension de l’opinion publique.
Pour autant, vos rapporteurs estiment que certaines pistes doivent être explorées qui permettraient de répondre aux critiques qui pèsent actuellement sur la Cour de révision et d’assurer une plus grande acceptation de ses décisions. Afin d’éviter, à l’avenir, tout hiatus entre la commission de révision et la Cour de révision, une cour unique, réunissant en son sein l’instruction et le jugement des demandes en révision, pourrait être créée. Ensuite, pour tirer les conséquences de la nette filiation qui existe entre les procédures de révision et de réexamen, cette cour pourrait également avoir pour tâche d’examiner les demandes en réexamen. Au final, la mise en place d’une Cour de révision et de réexamen permettrait de donner une cohérence certaine à la réformation des décisions pénales définitives.
A. UNE JURIDICTION UNIQUE POUR ASSURER LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES DÉFINITIVES
La Cour de révision et de réexamen, dont la composition précise serait déterminée par la loi, aurait pour fonction d’examiner les demandes en révision et en réexamen. Elle remplacerait ainsi les trois juridictions qui interviennent aujourd’hui : la commission de révision, la Cour de révision et la commission de réexamen d’une décision pénale définitive consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Des propositions novatrices, reposant sur la création d’une « juridiction nationale spécialisée […] composée pour partie d’un jury sélectionné sur une base nationale et de magistrats spécialement désignés » (84) ou sur la participation majoritaire de personnalités qualifiées extérieures à la magistrature (85) ont été évoquées devant vos rapporteurs. Ils ont toutefois souhaité que le nouvel organe demeure rattaché à la Cour de cassation : la remise en cause de l’autorité de la chose jugée devant rester exceptionnelle, c’est à la plus haute juridiction judiciaire qu’il revient d’en assumer, comme aujourd’hui, la responsabilité.
1. Une composition prévue par la loi
Pour éviter toute accusation relative à la partialité de la juridiction, la composition de l’organe unique de révision et de réexamen devrait être déterminée, à l’avance, par la loi.
a. Une cour représentant toutes les chambres de la Cour de cassation
La composition de la commission de réexamen, assurant la représentation de toutes les chambres de la Cour de cassation, est, de l’avis de tous, particulièrement opportune (cf. supra).
En assurant la participation à la Cour de révision et de réexamen de magistrats aux horizons variés, une telle composition permettrait de remédier aux critiques adressées à la chambre criminelle. Pour beaucoup, le fait que la chambre criminelle ait le monopole de la révision jette le doute sur sa capacité à remettre en cause des décisions pénales. Cette impression est alimentée, comme l’a souligné Me Valérie Rosano, par un taux de cassation nettement plus faible que les autres chambres (86). Aussi vos rapporteurs souhaitent-ils que la Cour de révision et de réexamen soit ouverte à l’ensemble des chambres de la Cour de cassation et que la répartition du nombre de magistrats par chambre soit fixée à l’avance.
La présidence de la Cour de révision et de réexamen pourrait être obligatoirement confiée au président de la chambre criminelle, qui en serait ainsi membre de droit, afin de lui assurer une coloration pénale en lien avec la nature des décisions qu’elle réforme.
b. Un nombre fixe de magistrats
Comme l’a indiqué M. Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire et membre du Conseil supérieur de la magistrature, l’indétermination de la composition de l’actuelle Cour de révision érode son impartialité objective. C’est pourquoi vos rapporteurs proposent que la Cour de révision et de réexamen soit composée d’un nombre fixe de magistrats.
Quant à leur nombre, il semble qu’un juste milieu doive être trouvé entre la taille des commissions de révision et de réexamen et l’assemblée plénière de la Cour de cassation. En effet, comme l’a indiqué M. Jean-Luc Moignard, président de la commission de révision, on ne délibère pas dans de bonnes conditions à quarante personnes, l’idéal s’établissant, selon lui, à une cour réunissant entre 10 et 15 magistrats.
Afin de permettre une représentation équitable de chaque chambre de la Cour de cassation, la Cour de révision et de réexamen compterait 18 membres, à raison de trois magistrats par chambre, désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Parmi ces 18 membres, 5 magistrats seraient désignés pour siéger au sein d’une commission interne d’instruction des demandes en révision et en réexamen (cf. infra). Les 13 autres membres formeraient la formation de jugement, qui statuerait en révision ou en réexamen selon la nature de la demande soumise.
Proposition n° 1
Créer, auprès de la Cour de cassation, une Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, composée de 18 magistrats désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation et dont la présidence serait assurée par le président de la chambre criminelle, et nommer, en son sein, 5 magistrats qui formeraient une commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.
Pour chaque titulaire, un suppléant serait désigné dans les mêmes conditions ; parmi les 18 suppléants, 5 auront vocation à assurer la suppléance des magistrats de la commission d’instruction, tandis que les 13 autres participeront à la formation de jugement en cas besoin.
c. Des fonctions limitées dans le temps
Les fonctions de membre de la Cour de révision et de réexamen devraient être limitées dans le temps. Cela permettrait d’assurer le renouvellement des magistrats siégeant au sein de cette juridiction et limiterait autant que possible les cas dans lesquels des demandes successives sont examinées par les mêmes personnes. Toutefois, afin de permettre aux membres de la Cour d’acquérir l’expérience nécessaire à l’examen des demandes, une durée minimale pourrait également être prévue. Vos rapporteurs s’associent donc à l’idée de Mme Monique Radenne, ancien membre et ancienne présidente de la commission de révision, de nommer les membres de la Cour pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Une telle durée semble à même de concilier les exigences d’impartialité objective de la Cour avec la nécessité d’une spécialisation minimale des magistrats.
Proposition n° 2
Fixer à trois ans renouvelables une fois la durée des fonctions de membre de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
2. Un examen impartial et concret de chaque demande
Il importe de répondre aux deux critiques qui sont aujourd’hui formulées à l’encontre du fonctionnement de la Cour de révision : l’examen des demandes serait, d’une part, trop subjectif et, d’autre part, relativement abstrait.
a. Assurer à la Cour une parfaite impartialité
L’impartialité de la Cour serait, en premier lieu, assurée par la séparation stricte des fonctions d’instruction et de jugement (cf. infra).
Par ailleurs, même si cette règle est appliquée de facto par les hauts magistrats, il semble opportun d’inscrire dans la loi qu’aucun membre de la Cour de révision et de réexamen ne peut instruire, rapporter ou participer au jugement d’une affaire qu’il aurait déjà eu à connaître dans l’exercice de ses fonctions passées ou présentes, les membres de la Cour exerçant ces fonctions en plus de leurs fonctions habituelles à la Cour de cassation. La règle devrait être étendue aux avocats généraux qui représentent le parquet au cours de l’instruction et du jugement des demandes en révision et en réexamen.
Proposition n° 3
Fixer, dans la loi, les règles assurant l’impartialité des magistrats de la Cour de révision et de réexamen comme du parquet intervenant devant cette juridiction.
b. Donner à la Cour les moyens de juger le fait
Des critiques ont pu être adressées à la Cour de révision en ce qui concerne le déroulement de son audience. Dans la mesure où elle n’entend pas les témoins ou experts de l’affaire, il peut être difficile, pour les conseils des requérants, de donner un caractère vivant à certains éléments du dossier qu’ils estiment importants, mais qui, par écrit, n’ont pas le même poids. Pour Me François Saint-Pierre, c’est précisément le caractère oral et contradictoire des débats d’assises qui permet de faire émerger certaines vérités.
Il est vrai que les magistrats sont placés dans une situation particulière : habituellement juges de la cassation, ils doivent ici se prononcer sur des éléments de fait à l’issue d’une procédure essentiellement écrite, ce qui relève, pour Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, d’une « mission impossible ».
Afin de donner les moyens à la Cour de révision et de réexamen de juger en fait, à l’issue d’une procédure plus orale, et d’encourager les hauts magistrats à donner un tour plus concret à l’audience, la loi pourrait expressément donner à la Cour de révision et de réexamen, statuant en révision, la faculté d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
Proposition n° 4
Donner à la Cour de révision et de réexamen statuant en révision la faculté expresse d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
3. L’harmonisation des pouvoirs décisionnels
Le rapprochement de la Cour de révision et de la commission de réexamen au sein d’une cour unique conduit également à harmoniser les pouvoirs décisionnels aujourd’hui à la disposition de ces deux juridictions.
a. Généraliser la possibilité d’annuler une décision pénale
La commission de réexamen ne dispose pas, à l’heure actuelle, de la faculté d’annuler une décision pénale définitive, sauf lorsque de nouveaux débats sont impossibles. Le code de procédure pénale renvoie alors aux dispositions relatives à la révision pour conférer à la commission de réexamen un pouvoir d’annulation. Pour M. Jean-Olivier Viout, il s’agit là d’une simple erreur rédactionnelle, qu’il appartient au législateur de corriger.
Cependant, il ne semble pas opportun de permettre l’annulation de la décision pénale dans tous les cas de figure. Notamment, lorsque la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales porte sur l’accès au pourvoi en cassation – comme ce fut notamment le cas dans l’affaire Papon (87) –, la commission de réexamen renvoie à l’assemblée plénière de la Cour de cassation le soin de se prononcer, comme elle aurait dû le faire, sur le pourvoi en question. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’un nouveau procès puisse avoir lieu : si la Cour de cassation rejette le pourvoi, il n’y a aucune raison d’annuler la décision pénale prise à l’issue d’une procédure contraire à la Convention.
En revanche, lorsque l’affaire est renvoyée à une juridiction de fond afin qu’un nouveau procès, respectueux des règles posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ait lieu, la décision attaquée devrait, en toute logique, être préalablement annulée, comme c’est le cas en matière de révision.
Proposition n° 5
Permettre à la Cour de révision et de réexamen statuant en réexamen d’annuler la décision attaquée lorsqu’elle renvoie l’affaire devant une juridiction de fond.
b. Assurer l’effacement de la condamnation du casier judiciaire du requérant
Afin de prolonger les effets de l’annulation de la décision par la Cour de révision et de réexamen, il serait nécessaire d’assurer l’effacement de la condamnation du casier judiciaire du requérant.
À l’heure actuelle, si la décision d’annulation par la Cour de révision entraîne cet effacement, il n’en va pas de même en matière de réexamen. En effet, la condamnation rendue en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’étant pas annulée, elle continue d’exister dans l’ordre juridique et de produire des effets. Elle demeure donc inscrite au sein du casier judiciaire jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de condamnation la remplace, comme l’a souligné M. Philippe Castel, président de la commission de révision. Mais, lorsque le requérant est finalement acquitté ou relaxé, le casier judiciaire, qui est uniquement destinataire des décisions de condamnation, n’en est pas informé.
Dans le silence de la loi, le service du Casier judiciaire n’est donc pas en mesure d’effacer la condamnation injustifiée. Sauf à ce que le parquet général lui demande expressément de procéder à l’effacement de la condamnation, il est possible que celle-ci demeure inscrite au casier judiciaire. L’intervention du requérant peut s’avérer nécessaire pour assurer l’effacement de la décision infondée.
Afin que le service du Casier judiciaire national soit systématiquement informé de ces décisions et qu’il puisse procéder à l’effacement de la condamnation, il conviendrait prévoir que l’annulation de la décision par la Cour de révision et de réexamen entraîne la suppression de la fiche correspondante au sein du casier judiciaire.
Proposition n° 6
Prévoir que l’annulation de la décision par la Cour de révision et de réexamen entraîne la suppression de la fiche correspondante au sein du casier judiciaire.
B. UNE COMMISSION D’INSTRUCTION INTERNE POUR FILTRER LES DEMANDES EN RÉVISION ET EN RÉEXAMEN
La Cour de révision et de réexamen comporterait, en son sein, une commission d’instruction destinée à filtrer les demandes en révision et en réexamen. Composée de cinq magistrats désignés par l’ensemble des membres de la Cour, cette juridiction aurait pour tâche de s’assurer de la recevabilité des demandes adressées à la Cour et de la mise en état des dossiers.
1. Une formation interne à la Cour dédiée à l’instruction des demandes en révision et en réexamen
Au lieu de former une juridiction à part, exerçant dans des locaux éloignés et ne communiquant que peu avec la Cour de révision, la commission d’instruction qu’il est envisagé de créer serait interne à la Cour de révision et de réexamen. Cela permettrait de créer une certaine synergie entre ces magistrats qui participent à la même mission : assurer la réformation des condamnations pénales injustifiées. Il est également probable qu’une telle réforme conduirait à l’harmonisation des pratiques.
Pour des raisons de clarté et d’intelligibilité, vos rapporteurs n’ont pas jugé opportun de reprendre l’appellation de « commission de révision des condamnations pénales », qui entretient la confusion actuelle entre les fonctions des différentes juridictions de révision. Ainsi, une autre dénomination a fait consensus parmi les personnes entendues par la mission : celle de « commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ».
Pour autant, vos rapporteurs ont conscience des règles relatives à la stricte séparation des fonctions d’instruction et de jugement, récemment rappelées par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le tribunal pour enfants (88). Ainsi, il devrait être prévu une stricte incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et celle de membre de la formation de jugement. Les cinq magistrats chargés de l’instruction des demandes en révision et en réexamen, comme leurs suppléants, n’exerceront aucune autre fonction au sein de la Cour de révision et de réexamen.
2. Un rôle centré sur l’examen de la recevabilité des demandes
Il existe aujourd’hui un malentendu fondamental, dans l’esprit des requérants et de leurs conseils, sur le rôle joué par la commission de révision des condamnations pénales. En effet, le sentiment d’un doublon entre les deux juridictions de révision prédomine. Cette ambiguïté est alimentée par la dénomination de la commission, à laquelle vos rapporteurs se proposent de répondre (cf. supra), mais également par la mission assignée à la commission par l’article 623 du code de procédure pénale, aux termes duquel celle-ci transmet à la Cour de révision les « demandes qui lui paraissent pouvoir être admises ». De fait, la rédaction du texte conduit à ce que la commission de révision s’interroge, de la même façon que la Cour de révision, sur l’existence d’un fait nouveau comme sur le doute qu’il est susceptible de faire naître sur la culpabilité du condamné.
Afin de différencier le rôle de chaque organe, vos rapporteurs proposent de confier à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen la mission d’examiner la recevabilité de la demande – nature de la décision, caractère définitif de la décision, qualité du requérant, existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation, existence d’un cas d’ouverture, etc. – en utilisant, au besoin, ses pouvoirs d’investigation (cf. infra).
Lors de l’examen d’une demande en révision fondée sur l’inexistence de l’homicide, la commission devra vérifier que la victime supposée a bel et bien été vivante après la condamnation du requérant ; dans le cas du faux témoignage, elle aura pour tâche de vérifier la réalité de la condamnation du témoin ; dans le cas de condamnations inconciliables, la commission déterminera le caractère réellement inconciliable des deux décisions pénales.
Cependant, en ce qui concerne le cas d’ouverture « indéterminé », la commission devra uniquement se pencher sur la réalité de fait nouveau ou de l’élément inconnu invoqué par le requérant. En effet, comme le notait le professeur Wilfrid Jeandidier, « dès que la commission prend parti sur l’incidence du fait nouveau sur la culpabilité, elle s’empare de l’intégralité du contentieux de la révision, avec le risque soit de court-circuiter la chambre criminelle, soit de rendre une décision ambiguë de saisine de cette chambre. Pour éviter le chevauchement entre les compétences de la commission et de la cour de révision, l’appréciation du doute sur la culpabilité devrait être l’apanage de la cour de révision, juge de la valeur du fait nouveau et aussi de sa définition. Quant à la commission, elle devrait avoir pour seule tâche de contrôler la recevabilité de la demande, ce qui implique l’appréciation du caractère nouveau ou non du fait invoqué » (89). Il appartiendra donc à la Cour de révision et de réexamen de déterminer si les éléments mis en lumière par la commission d’instruction sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Le rôle de la commission d’instruction sera évidemment moins important en matière de réexamen. Dans ce domaine, aucune instruction n’est, à proprement parler, nécessaire ; les demandes irrecevables pourront néanmoins être écartées par la commission d’instruction, qui ne transmettra à la Cour que les demandes en réexamen qui respectent les prescriptions légales.
En d’autres termes, la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen serait chargée de mettre les dossiers en état et de transmettre à la Cour de révision et de réexamen les demandes qui ne sont pas irrecevables. Elle disposerait donc de deux options : déclarer la demande irrecevable, ab initio ou après une instruction, ou la transmettre à la Cour de révision et de réexamen.
Proposition n° 7
Indiquer que la commission d’instruction transmet à la Cour de révision et de réexamen les demandes qu’elle juge recevables et, en ce qui concerne les demandes en révision fondées sur l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu, préciser que la commission transmet à la Cour les demandes pour lesquelles un tel fait ou élément a effectivement été produit ou révélé postérieurement à la condamnation.
3. Donner une base légale claire aux pouvoirs d’investigation de la commission
La commission de révision dispose, en théorie, de vastes pouvoirs puisqu’elle peut, aux termes de l’article 623 du code de procédure pénale, procéder « directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles ». Pourtant, en pratique, la mise en œuvre de ces pouvoirs d’investigation ne semble pas toujours aisée. Si la commission de révision a, par exemple, considéré qu’elle pouvait ordonner des écoutes téléphoniques, elle s’est en revanche refusée à comparer l’ADN relevé sur un scellé aux profils inscrits au fichier national automatisé des empreintes génétiques. De la même façon, la rédaction elliptique de l’article 623 l’a empêchée de conduire l’audition de certains protagonistes de façon aussi poussée qu’aurait pu le faire un juge d’instruction en présence d’un avocat.
Pour mettre fin à cette forme d’autocensure, aisément compréhensible, de la commission de révision et répondre à ce que le Syndicat de la magistrature perçoit comme un « vide juridique sidérant et sidéral », il conviendrait se référer à l’article 81 du code de procédure pénale, qui définit les pouvoirs d’investigation du juge d’instruction qui « procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Cette solution semble préférable à celle qui consiste à ajouter explicitement de nouveaux pouvoirs, tels que les perquisitions et saisies, à la liste existante, qui présente toujours le risque d’être incomplète.
Proposition n° 8
Confier à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen les mêmes pouvoirs d’investigation que ceux du juge d’instruction.
Par ailleurs, pour pallier l’absence de pouvoirs coercitifs propres à la commission d’instruction, une procédure nouvelle pourrait être créée, qui permettrait à la commission de demander l’ouverture d’une information judiciaire au parquet. Un tel dispositif serait particulièrement utile lorsque la commission, au cours de son instruction, en vient à soupçonner une tierce personne d’avoir commis les faits en question. Lorsque la commission de révision a été confrontée à de tels cas de figure, il semble que les parquets se soient parfois montrés réticents à ouvrir une nouvelle information judiciaire. Et, lorsque la demande de la commission a été acceptée, la nouvelle enquête a été confiée au même magistrat instructeur ou aux mêmes services enquêteurs que la première investigation… Encore une fois, l’impartialité du système judiciaire exige que la nouvelle information soit confiée à un juge d’instruction et à un service de police ou de gendarmerie qui n’ont pas eu à connaître du dossier.
Proposition n° 9
Permettre à la commission d’instruction de transmettre au parquet les éléments susceptibles de justifier l’ouverture d’une information judiciaire, lorsqu’il apparaît qu’un tiers est impliqué dans la commission de faits. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à la suite de cette transmission, les investigations ne sont pas confiées à un magistrat instructeur et à un service de police ou de gendarmerie ayant déjà eu à connaître de l’affaire.
C. LES DROITS DES PARTIES PLUS CLAIREMENT DÉFINIS
Dans le silence de la loi, certains droits ont été accordés de façon prétorienne dans le cadre de procédures de révision ou de réexamen. Ces droits, qui concernent aussi bien le requérant que la partie civile, devraient être codifiés et harmonisés.
1. Donner des droits au condamné qui demande la révision ou le réexamen de sa condamnation
Afin d’aller au bout de la juridictionnalisation débutée en 1989, il serait opportun de préciser, dans la loi, la nature des droits du condamné au cours de la procédure de révision ou de réexamen.
a. Codifier les prérogatives procédurales du requérant
Dans le silence de la loi, la commission de révision a conféré certains droits aux requérants et à leur conseil. Comme l’a affirmé Me François Saint-Pierre, la commission de révision a d’ores et déjà admis certaines pratiques, comme la transmission d’une copie du dossier à l’avocat, et s’est montrée particulièrement diligente à accéder aux demandes d’auditions de témoins du requérant.
Vos rapporteurs estiment qu’il serait préférable d’inscrire ces droits dans la loi, d’autant plus que, dans le cadre de la procédure de révision, le condamné a été reconnu coupable par une décision judiciaire et, ne pouvant se prévaloir de la présomption d’innocence, il doit assumer seul la charge de la preuve.
Afin de lui permettre de bénéficier des moyens publics d’investigation, le requérant devrait, en premier lieu, pouvoir demander la réalisation d’actes d’investigation à la commission, comme sa propre audition, l’audition d’un témoin, l’organisation d’une reconstitution, la réalisation d’une expertise, la production d’une pièce, etc. La commission d’instruction aurait alors un mois pour statuer sur la demande d’acte, à l’instar du juge d’instruction en application de l’article 82-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, l’avocat du requérant devrait avoir accès au dossier dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’information judiciaire. Notamment, une copie de tout ou partie des pièces de procédure pourrait lui être délivrée selon les règles fixées par l’article 114 du code de procédure pénale.
b. Affirmer le caractère contradictoire de l’audience
Lorsque le requérant ou son conseil est présent à l’audience, les juridictions de révision et de réexamen lui permettent, dans les faits, de prendre la parole en dernier, après les réquisitions du parquet. Là encore, la codification de cette pratique serait souhaitable et conférerait à l’audience devant la Cour de révision et de réexamen un caractère indéniablement contradictoire.
c. Assurer au requérant l’assistance d’un avocat
Le requérant devrait également être assisté, le plus souvent possible, par un avocat. En effet, actuellement, les articles 625-1 et 626-6 du code de procédure pénale n’offrent au requérant que la faculté d’être assisté par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, ou par tout avocat régulièrement inscrit à un barreau. S’il n’en connaît pas mais qu’il souhaite en avoir un, aucun avocat n’est cependant désigné d’office pour défendre son dossier.
Dans les faits, bien que l’aide juridictionnelle puisse être accordée en matière de révision et de réexamen, certains requérants ne font pas appel à un avocat, ce qui peut nuire à la qualité et à l’intelligibilité de la demande en révision ou en réexamen. Pour permettre aux requérants de bénéficier de l’assistance d’un avocat, vos rapporteurs proposent de rendre possible la commission d’office d’un avocat à la demande du requérant. Afin de rendre ce droit tout à fait opérant, le requérant doit en être informé, par la Cour de révision et de réexamen, après le dépôt de sa demande en révision ou en réexamen.
Proposition n° 10
Permettre au condamné qui demande la révision ou le réexamen d’une condamnation pénale d’accéder au dossier, de demander des actes à la commission d’instruction, de prendre la parole en dernier à l’audience et d’être assisté par un avocat, au besoin commis d’office.
2. Clarifier la place de la partie civile devant la Cour de révision et de réexamen
La place de la partie civile diffère aujourd’hui selon qu’il s’agit de la procédure suivie devant la commission de révision, la Cour de révision ou la commission de réexamen. Si la place des parties civiles est explicitement reconnue devant la Cour de révision par l’article 625 du code précité, tel n’est pas le cas devant les commissions de révision et de réexamen : aucune place particulière n’y est faite à la victime et, plus largement, à la partie civile.
En pratique, la commission de réexamen, depuis 2003, avise systématiquement la partie civile des demandes dont elle est saisie, de sorte que celle-ci peut formuler des observations écrites ou orales et être présente à l’audience. À l’inverse, la commission de révision ne fait qu’accepter que les parties civiles indirectement informées de l’audience s’y présentent.
Une harmonisation des dispositions légales semble s’imposer, tant la partie civile joue un rôle croissant dans notre procédure pénale.
La partie civile devrait être systématiquement avisée par la Cour de révision et de réexamen des demandes qui lui sont adressées. Cependant, il n’apparaît pas opportun, dans le cas de la révision, d’aviser la partie civile dès le dépôt de la demande. En effet, la commission de révision est aujourd’hui saisie d’un certain nombre de demandes manifestement irrecevables, qui n’ont aucune chance d’aboutir et raviveraient inutilement la douleur de la victime ou de ses proches. Vos rapporteurs suggèrent donc que la partie civile ne soit avisée de l’existence d’une demande en révision ou en réexamen que lorsque la demande est renvoyée devant la formation de jugement de la Cour.
Au-delà, la partie civile devrait, au même titre que le requérant, être assistée d’un avocat, éventuellement commis d’office, et accéder au dossier (90). Vos rapporteurs estiment que la partie civile devrait également intervenir dans le cadre de l’examen d’une demande de suspension de peine, de la même façon qu’elle intervient aujourd’hui au stade de l’exécution de la peine. Elle devrait ainsi pouvoir déposer des observations écrites ou orales auprès de la commission d’instruction ou de la Cour de révision et de réexamen en réponse à une demande de suspension de peine émanant du requérant.
Proposition n° 11
Aviser de façon systématique la partie civile des demandes en révision ou en réexamen examinées par la Cour de révision et de réexamen, afin qu’elle puisse présenter des observations écrites ou orales, y compris sur une demande de suspension de peine, et lui permettre d’accéder au dossier et d’être assistée par un avocat, au besoin commis d’office.
II. FAIRE ÉVOLUER LES CONDITIONS DU RECOURS DE RÉVISION
Sans remettre en cause l’économie générale du recours en révision, il apparaît que plusieurs améliorations pourraient être apportées au dispositif actuel, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, bien qu’il ne semble pas opportun de modifier le champ actuel de la révision, vos rapporteurs estiment que le recours en révision pourrait être étendu à de nouveaux acteurs, notamment pour prendre en compte certaines évolutions familiales et sociales. En outre, la rédaction des cas d’ouverture mériterait d’être clarifiée.
A. CONSERVER LE CHAMP ACTUEL DE LA RÉVISION
Le champ actuel des décisions pénales susceptibles de faire l’objet d’une révision apparaît satisfaisant. Notamment, vos rapporteurs ne sont pas favorables, pour des raisons tant pratiques que juridiques, à l’extension de la révision aux contraventions et aux décisions d’acquittement.
1. Maintenir les contraventions en dehors du champ de la révision
Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, ainsi que M. Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire et membre du Conseil supérieur de la magistrature, ont respectivement proposé que la révision soit étendue aux contraventions de la 5e classe voire à toutes les catégories de contraventions. Comme l’a indiqué M. Jean-Olivier Viout, rien ne justifie, au plan des principes, qu’une condamnation pénale ne puisse pas être révisée, quelle que soit sa nature, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
En outre, pour Mme Christine Lazerges, l’adage latin de minimis non curat praetor (91) ne saurait être objecté à raison, tant il est vrai que certaines contraventions sont quasi-délictuelles : « la condamnation à une amende élevée pour une contravention de la 5ème classe (mentionnée au casier judiciaire) supporte bien la comparaison avec une décision de dispense de peine, contre laquelle un recours en révision est recevable ; elle ne saurait être assimilée aux "menus litiges" et autres "bagatelles" que vise l’adage évoqué ». Qui plus est, l’extension de la procédure de révision aux contraventions assurerait une harmonisation certaine de ce dispositif avec la procédure de réexamen.
Cependant, vos rapporteurs estiment qu’il serait inopportun d’élargir le champ de la révision aux contraventions. En effet, les contraventions ne revêtent a priori pas le caractère infamant ou déshonorant des condamnations criminelles et délictuelles. Lorsqu’une amende contraventionnelle est injustement prononcée, le trouble qu’en conçoit la société est sans commune mesure avec celui qui résulte de l’emprisonnement d’un innocent.
En outre, comme l’ont indiqué à la mission M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, et M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle, les modes de constatation et de preuve de ces infractions laissent une moindre marge d’appréciation au juge et limite donc le risque d’une décision erronée. Par ailleurs, dans le domaine contraventionnel, en particulier pour les contraventions de la 5e classe, les voies de recours communes que sont l’appel et la cassation doivent suffire à faire réparer une éventuelle erreur.
Enfin, une attention particulière doit être portée aux capacités de la Cour de révision et de réexamen à traiter une forme de contentieux qui sera nécessairement nettement plus important, au plan quantitatif, que les demandes en révision criminelles et correctionnelles. Comme l’a indiqué M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, la pugnacité des requérants serait telle, en matière de contraventions, que la juridiction de révision, qui doit déjà répondre aux demandes en révision en matière d’urbanisme et d’excès de vitesse délictuel, serait probablement noyée par l’afflux de demandes.
Ainsi, le caractère exceptionnel de la procédure de révision semble devoir être préservé par la limitation de son champ d’application aux infractions les plus graves.
2. Ne pas permettre la révision des décisions d’acquittement
La question a également été soulevée d’étendre la procédure de révision aux décisions d’acquittement, lorsque la certitude de la culpabilité est acquise ultérieurement au jugement. M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, a été le premier à émettre cette idée, ensuite évoquée par un certain nombre de personnes parmi lesquelles plusieurs représentants du parquet, Mme Michèle Alliot-Marie mais également l’Institut pour la Justice. Lorsqu’il apparaît qu’une personne acquittée a bel et bien commis le crime qu’on lui reprochait, on peut légitimement souhaiter qu’il existe un moyen légal de rouvrir l’enquête et de faire triompher la vérité car, comme l’a souligné le syndicat Force Ouvrière Magistrats, un acquittement erroné constitue aussi une injustice.
Cependant, pour vos rapporteurs, plusieurs raisons justifient que l’on n’ouvre pas la procédure de révision aux décisions d’acquittement.
Tout d’abord, la règle non bis in idem s’oppose à ce qu’une même personne soit jugée une seconde fois pour des faits identiques : en effet, « une fois le procès pénal achevé, la décision définitivement rendue, qu’elle soit de relaxe, d’acquittement ou de condamnation, la personne poursuivie est quitte. Elle ne doit pas vivre sous la menace permanente d’un second procès à raison des mêmes faits. Il serait injuste qu’elle soit exposée à subir une seconde condamnation à raison de ces faits » (92). La possibilité d’une révision, même limitée aux cas où la culpabilité est certaine, conduirait à ce que les personnes acquittées vivent dans la crainte perpétuelle de la découverte d’un élément les accablant à nouveau, à tort ou à raison.
Vos rapporteurs ont également été sensibles à l’argument développé par Mme Marylise Lebranchu, entendue en tant qu’ancienne garde des Sceaux : ouvrir la révision aux décisions d’acquittement conduirait les victimes et les parties civiles qui seraient persuadées de la culpabilité d’une personne acquittée à rechercher sans fin les preuves de celle-ci. Quel apaisement assurerait une justice qui mettrait les victimes dans une telle situation ?
En outre, la procédure criminelle actuelle, en ouvrant au parquet la possibilité de faire appel d’une décision d’acquittement, permet déjà de réparer une éventuelle erreur judiciaire en faveur de la personne jugée ou, à l’inverse, de s’assurer que le premier verdict était justifié au regard des éléments du dossier. Lorsque la justice s’est prononcée par deux fois en faveur de l’acquittement, à l’issue d’une procédure longue où chaque élément a été passé au crible de l’accusation, il semble inopportun de permettre la réouverture dudit procès.
Enfin, même si l’on admettait le principe d’une réouverture des instances criminelles après une décision d’acquittement, la révision ne serait pas la procédure la plus appropriée tant son histoire est étrangère à la réformation in defavorem. La réouverture d’un procès criminel après acquittement, sur le fondement d’éléments nouveaux, a bien plus à voir avec la réouverture pour charges nouvelles qui est déjà possible après une décision de non-lieu rendue par la juridiction d’instruction. En effet, comme l’a indiqué à la mission Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, c’est l’action publique qui devrait alors être mise en branle, non pas pour revenir sur une décision pénale définitive, mais pour poursuivre l’œuvre de la justice. Or, cette question semble excéder le champ de la mission qui a été confiée à vos rapporteurs.
B. OUVRIR LA RÉVISION À DE NOUVEAUX REQUÉRANTS
Certaines évolutions démographiques, sociales et juridiques devraient être prises en compte par la loi en ce qui concerne la détermination des personnes susceptibles d’introduire une demande de révision.
1. Élargir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins et aux petits-enfants
Comme l’a suggéré M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, la révision pourrait être ouverte aux partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS), de la même façon qu’elle est actuellement ouverte aux personnes mariées. Enfin, comme l’a suggéré le Syndicat de la magistrature, le recours en révision pourrait également être ouvert aux concubins. Ces modifications permettraient de tenir compte des évolutions juridiques et sociologiques du couple.
Par ailleurs, à l’exception des enfants du condamné, les descendants de personnes injustement condamnées ne sont pas admis à demander eux-mêmes la révision d’une condamnation pénale (cf. supra). Une telle règle peut se comprendre : seuls les contemporains du condamné – parents, conjoint, enfants, héritiers, proches qui auraient reçu de lui la mission expresse de demander une révision – pâtissent avec lui de sa situation et ont, dès lors, directement intérêt à agir, tandis que la nécessité de la révision peut sembler a priori moins pressante pour les descendants plus éloignés.
Vos rapporteurs considèrent cependant qu’il serait opportun d’ouvrir la révision, non pas à l’ensemble des descendants du condamné – cela conduira à ce que des procès puissent être théoriquement révisés des centaines d’années après –, mais à ses petits-enfants. Au-delà de la deuxième génération, si la condamnation litigieuse produit encore des effets sur la famille du condamné ou sur la société, il y a lieu de considérer que l’introduction d’une demande en révision par le garde des Sceaux ou le procureur général (cf. infra) permettrait de répondre à une éventuelle demande de révision de la part des descendants du condamné.
Proposition n° 12
Ouvrir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins ainsi qu’aux petits-enfants.
L’ouverture du recours en révision aux petits-enfants pose, plus largement, la question de la justice mémorielle. Notamment, certains interlocuteurs ont attiré l’attention de vos rapporteurs sur la question de la réhabilitation des soldats fusillés pour l’exemple pendant la première Guerre Mondiale. L’ouverture du recours en révision aux petits-enfants conduira probablement à ce que leurs descendants utilisent cette voie afin de permettre la révision des condamnations à mort prononcées par les tribunaux militaires entre 1914 et 1918. Mais il est clair que, dans un tel cas de figure, la révision des condamnations pénales ne sera pas aisée, les preuves de l’innocence des soldats fusillés, si tant est qu’elles aient existé, ayant probablement été détruites.
2. Offrir au parquet la faculté de demander la révision d’une condamnation
Le procureur général près la Cour de cassation n’a pas la possibilité, à l’heure actuelle, d’introduire un recours en révision. En revanche, il peut demander le réexamen d’une condamnation après le prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette asymétrie peut s’expliquer par le fait que le procureur général près la Cour de cassation est nécessairement informé des décisions de la Cour de Strasbourg ; il lui appartient, dès lors, d’en tirer toutes les conséquences. Au contraire, dans le cas d’une révision, le fait nouveau n’est pas nécessairement d’ordre juridique.
Cependant, afin d’harmoniser les deux dispositifs, le recours en révision pourrait être ouvert au procureur général près la Cour de cassation, ainsi qu’aux procureurs généraux près les cours d’appel. Au-delà de la cohérence de la procédure pénale, cela permettrait de favoriser les demandes émanant des autorités judiciaires elles-mêmes. Aujourd’hui, le ministre de la justice étant seul dépositaire de ce pouvoir, le parquet est contraint de passer par le garde des Sceaux pour demander une révision. Dans les faits, les services de la chancellerie n’ont jamais refusé à un procureur général l’exercice d’un tel recours ; par exemple, dans l’affaire Marc Machin, la révision a, en réalité, été demandée par le procureur général près la cour d’appel de Versailles. Cependant, le principe de séparation des pouvoirs serait mieux respecté si le recours du garde des Sceaux n’était conservé qu’à titre historique et exceptionnel.
En outre, les attributions du parquet, qui représente l’intérêt de la société, qu’il s’agisse de condamner ou d’innocenter, justifient cette modification de l’article 623 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il serait également plus aisé, pour celui qui aurait intérêt à agir sans faire partie de la liste des requérants, de recourir au procureur général plutôt qu’au ministre lui-même, sans que le recours en révision ne s’en trouve exagérément ouvert. Enfin, cette proposition est cohérente avec celle qui consiste à permettre au condamné de demander au procureur de réaliser des actes d’investigations (cf. infra). En effet, si ceux-ci ont abouti à la révélation d’un fait nouveau, comme l’identité du vrai coupable, il n’est pas illogique que le procureur général près la cour d’appel en soit informé et puisse en tirer les conséquences.
Proposition n° 13
Élargir la liste des autorités susceptibles d’introduire un recours en révision au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu’aux procureurs généraux près les cours d’appel.
Certains se sont interrogés, au cours des auditions conduites par la mission, sur la nécessité de continuer à confier cette prérogative au garde des Sceaux. En effet, comme l’a fait remarquer M. Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire et membre du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des Sceaux ne peut plus adresser d’instructions aux magistrats du parquet dans des affaires individuelles depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique. Le principe de séparation des pouvoirs commanderait donc que le garde des Sceaux, membre de l’exécutif, ne puisse plus interférer avec le cours de la justice en demandant la révision d’une condamnation.
Pour vos rapporteurs, la possibilité d’introduire un recours en révision ne saurait être analysée comme une instruction individuelle donnée par le garde des Sceaux. Bien plus, ils estiment que la conservation de cette prérogative historique présente l’intérêt d’ouvrir le recours en révision à une autorité supplémentaire, sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs. Par ailleurs, comme l’a souligné le syndicat Force Ouvrière Magistrats, la responsabilité de l’État fait qu’il est difficile d’exclure le garde des Sceaux de la liste des personnes susceptibles de demander la révision d’une condamnation.
C. CLARIFIER LA RÉDACTION DES CAS D’OUVERTURE
Les dispositions actuelles, en matière de révision des condamnations pénales, sont le fruit d’une évolution historique de plusieurs siècles. C’est pourquoi elles doivent être aujourd’hui modifiées, tant sur le fond que sur la forme.
1. Qualifier, dans la loi, le doute nécessaire à l’aboutissement d’une demande en révision
Vos rapporteurs ont acquis la conviction que la loi du 23 juin 1989 n’a pas changé les pratiques judiciaires en matière de révision : c’est toujours un doute sérieux qui, depuis le début du XIXe, est en réalité exigé des juges (cf. supra).
Il est vrai que la notion de « doute » n’est pas des plus claires, comme en témoignent les innombrables débats philosophiques qui l’entourent. D’autres juridictions ont d’ailleurs choisi des formulations moins floues pour encadrer la révision de leurs décisions, comme l’a souligné M. Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et juge à la Cour pénale internationale. Il a ainsi indiqué à la mission que le statut du tribunal pénal international pour la Yougoslavie disposait, dans son article 26, que la révision d’une décision peut être demandée « s’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision » ; de la même façon, l’article 84 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que la révision de ses décisions peut intervenir lorsqu’un fait nouveau est avancé qui, « s’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent ».
Telle est bien la question posée à la Cour de révision : l’élément nouveau aurait-il pu conduire à une issue différente, à un acquittement ou une relaxe, voire simplement à une peine moins sévère ? Au-delà de la déclaration d’innocence, c’est le droit à un nouveau procès, qui prenne en compte tous les éléments du dossier, y compris ceux qui sont apparus postérieurement, qui est en jeu dans la révision. Dès lors qu’il n’est pas certain que l’issue du procès n’aurait pas été modifiée par l’élément nouveau, la révision devrait être engagée. Sans bouleverser la rédaction actuelle, vos rapporteurs suggèrent de modifier la loi de sorte à ce que le « moindre doute » puisse donner lieu à une révision du procès en cause.
Proposition n° 14
Prévoir que la révision peut être demandée lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu est de nature à faire naître le « moindre doute » sur la culpabilité du condamné.
Certaines personnes entendues par vos rapporteurs se sont opposées à cette qualification législative du doute. M. Robert Badinter, citant le doyen Carbonnier, a vu dans l’adjectif une forme d’ « acné du style juridique ». Pour M. Pascal Clément, entendu en tant qu’ancien garde des Sceaux, un doute simple conduirait à remettre toutes les décisions judiciaires en cause. Pour l’Union syndicale des magistrats, qualifier le doute constituerait même un obstacle à l’appréciation in concreto du dossier. En outre, pour d’autres, la qualification serait inutile car le doute exigé par la loi est d’ores et déjà, par son absence de précision, un doute simple. Pointant la difficulté même de concevoir une échelle du doute, M. Bruno Cotte, dans sa contribution écrite, a souligné que « quand on doute, on doute et l’on en tire les conséquences, a fortiori lorsque l’on est juge, et, si l’on ne doute pas, c’est que l’on est certain ! ». Certains se sont même montrés pessimistes quant à l’efficacité d’une telle modification ; notamment, pour les représentants du Syndicat de la magistrature, il n’y aura pas plus de révision sans doute « sérieux » car « si le terme n’est pas dans la loi, il est dans les têtes ». Pour mettre un terme à ce débat, et considérant que le droit pénal est familier de la gradation, vos rapporteurs estiment nécessaire de préciser l’intention du législateur sur ce point.
2. Préserver la nature du recours en révision en renonçant à réparer le "mal-jugé"
À l’heure actuelle, la révision nécessite que soit avancé un fait nouveau ou un élément inconnu par le condamné. Or, il peut théoriquement arriver qu’un élément déterminant du dossier passe inaperçu, soit que le juge d’instruction ne l’ait pas trouvé pertinent, que les avocats de la défense ne l’aient pas vu ou qu’il ait échappé à la vigilance des magistrats professionnels. Dans un tel cas de figure, l’élément en question n’est pas porté à la connaissance du jury. Celui-ci n’ayant pas accès au dossier d’instruction et prenant sa décision sur la seule base des débats oraux qui se sont tenus devant lui, il peut donc être amené à voter en se fondant sur un ensemble non exhaustif d’éléments à charge et à décharge.
Au contraire, la commission de révision se fonde, entre autres, sur le dossier d’instruction pour déterminer le caractère inconnu d’un élément soumis à son analyse. Si l’élément figure au dossier, peu importe qu’il n’ait pas été soulevé pendant les débats : il n’est pas considéré comme « inconnu de la juridiction au jour du procès» par la commission, puisque les magistrats professionnels ont, quant à eux, accès au dossier. Mais, dans cette hypothèse, l’actuelle rédaction de l’article 622 conduit à rejeter la demande. C’est pourquoi certains ont proposé, à l’instar de Me Jean-Marc Florand et de M. Philippe Bilger, magistrat honoraire, que l’élément « non débattu » puisse, aux côtés du fait nouveau et de l’élément inconnu, donner lieu à révision.
Plusieurs raisons conduisent vos rapporteurs à estimer cette réforme inopportune. En premier lieu, une telle modification fait craindre qu’un nombre important de condamnés parvienne à extraire de leur dossier un quelconque élément non débattu, mais pas nécessairement pertinent, entraînant ainsi une forte augmentation du contentieux. Ce serait, en particulier dans les affaires financières, une « source de difficultés inextricables » d’après M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.
Par ailleurs, l’introduction de l’élément non débattu rapprocherait fortement la révision de l’appel, en ce qu’elle permettrait de remédier, à l’instar d’une voie de recours ordinaire, au « mal-jugé ». Or, la révision comme le réexamen ne sauraient constituer une troisième voie de recours. Enfin, il appartient aux acteurs du procès, notamment à l’avocat de la défense, d’analyser finement le dossier pour porter à la connaissance de la cour tout élément pertinent en faveur de l’accusé ou du prévenu.
3. Maintenir tous les cas d’ouverture dans un souci de sécurité juridique
Vos rapporteurs sont conscients de la nécessité de modifier les dispositions relatives à la révision des condamnations pénales avec la plus grande prudence. Notamment, si l’idée de fusionner les quatre cas d’ouverture a paru intéressante, il leur semble, après un examen approfondi, qu’il soit plus sage de conserver le dispositif actuel. À première vue, les trois cas d’ouverture dits « déterminés » peuvent sans difficulté être inclus dans le dernier cas, « indéterminé » : la preuve de l’inexistence de l’homicide, la condamnation pour faux témoignage ou la découverte d’une condamnation inconciliable constituent autant de faits nouveaux ou d’éléments inconnus.
Cependant, il serait risqué de fusionner les quatre cas d’ouverture. De fait, si les trois cas d’ouverture déterminés semblent ouvrir automatiquement droit à l’annulation de la décision – avec, le cas échéant, un renvoi devant une juridiction de fond dans le cas du faux témoignage, pour apprécier l’impact de celui-ci sur la condamnation –, le cas d’ouverture indéterminé nécessite qu’une appréciation soit portée, par la juridiction de révision, sur la possible innocence du condamné. La disparition des trois premiers cas d’ouverture pourrait priver les requérants qui s’en réclament de la quasi-automaticité de l’annulation de leur condamnation. Par ailleurs, il est possible que la disparition de ces cas déterminés conduise à ce que certains condamnés n’aient pas conscience de la possibilité qu’il leur est offerte de faire réviser leur condamnation lorsqu’ils se trouvent dans ces cas de figure particuliers.
Il apparaît pourtant nécessaire de mieux articuler ces quatre cas d’ouverture, tant les trois premiers apparaissent comme des déclinaisons du quatrième. Vos rapporteurs proposent ainsi d’inverser l’ordre de présentation des cas d’ouverture en plaçant le cas indéterminé en premier. Qui plus est, ce cas étant le plus utilisé, il n’est pas anormal de le faire figurer en premier au sein de l’article 622.
Proposition n° 15
Faire figurer le cas indéterminé avant les cas déterminés au sein de l’article du code de procédure pénale présentant les cas d’ouverture à révision.
Dans un même souci de sécurité juridique, vos rapporteurs ont été sensibles à la proposition de Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, de rétablir la mention de l’innocence du condamné. Ce motif de révision a disparu, en 1989, au profit de la notion de doute ; mais il aurait dû être conservé. Ainsi, le fait nouveau ou l’élément inconnu donnerait lieu à révision lorsqu’ils établiraient l’innocence du condamné ou qu’ils feraient naître un doute sur la culpabilité du condamné. Une telle rédaction permettrait à la Cour de révision et de réexamen de justifier pleinement une décision d’annulation sans renvoi.
Proposition n° 16
Prévoir que la révision peut être demandée lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu établit l’innocence du condamné ou est de nature à faire naître le moindre doute sur la culpabilité du condamné.
III. AMÉNAGER LA PROCÉDURE CRIMINELLE POUR GARANTIR L’EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION
La faiblesse du nombre de révisions criminelles s’explique par la difficulté de faire émerger, parfois longtemps après le procès, un fait nouveau ou un élément inconnu. La destruction légale des scellés, dans de nombreuses affaires, ne permet pas de confronter les éléments matériels recueillis pendant l’enquête aux évolutions de la science. Et, en l’absence d’un véritable service public d’enquête, il est difficile, pour les condamnés parfois incarcérés, de mettre au jour un élément à l’appui de leur requête en révision. Par ailleurs, l’absence d’enregistrement des débats comme de motivation des décisions de cour d’assises font obstacle à la juste évaluation du caractère « nouveau » du fait et de sa portée sur l’équilibre général du dossier par les juridictions de révision. Vos rapporteurs suggèrent certaines modifications des règles de procédure pénale afin de donner tous les moyens à la justice de réparer une éventuelle erreur.
A. CONSERVER LES SCELLÉS PENDANT UNE DURÉE PROPRE À ASSURER UNE ÉVENTUELLE RÉVISION
Actuellement, la très fréquente destruction des scellés en application de la loi entrave considérablement la procédure de révision, en empêchant la réalisation de nouvelles analyses qui, eu égard aux avancées scientifiques des dernières décennies, auraient peut-être permis de lever le doute sur la culpabilité du condamné.
1. Des progrès scientifiques qui rendent indispensable la conservation des scellés
La recherche scientifique a connu, ces dernières décennies, d’immenses progrès qui, appliqués aux investigations policières et judiciaires, ont permis à plusieurs personnes condamnées d’obtenir la révision de leur condamnation. Dans l’affaire Machin, les nouvelles analyses ordonnées par la commission de révision ont permis de disculper le requérant : l’ADN d’un autre homme qui avait ultérieurement avoué le crime a été retrouvé sur des scellés qui n’avaient pas été examinés lors de la première enquête. Dans cette affaire, c’est parce que les scellés n’ont, par hasard, pas été détruits, que leur analyse a pu confirmer l’innocence du requérant. C’est également la conservation des scellés judiciaires qui a permis, dans la dernière affaire criminelle renvoyée par la Cour de révision en mai 2013 (cf. partie I, supra), de mettre en évidence la participation au crime de personnes autres que les deux condamnés.
À l’inverse, la destruction des scellés peut constituer un obstacle insurmontable à la manifestation de la vérité. Ainsi, dans l’affaire Leprince, la destruction des scellés, en particulier l’arme du crime, a pu faire obstacle à la manifestation de la vérité, la quasi-totalité des scellés ayant été détruits sur ordre du procureur, en juillet 2001, quatre ans après la décision de condamnation. La destruction des scellés judiciaires a d’ailleurs motivé la mise en cause de la responsabilité de l’État par le condamné, qui invoquait, à l’appui de son recours, une faute lourde du procureur qui l’aurait privé d’une chance de voir son procès révisé. Cependant, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, en juillet dernier, qu’il avait été fait une correcte application de la loi et qu’il n’y avait dès lors pas de faute lourde imputable à l’État dans ce dossier.
Les avancées scientifiques, en particulier dans le domaine génétique (cf. encadré ci-après), rendent indispensable la conservation des scellés judiciaires des affaires définitivement jugées.
Les progrès scientifiques réalisés dans le domaine génétique
L’ADN, molécule présente dans chaque cellule du corps humain, est le support de l’information génétique qui définit chaque individu. En 1990, alors que les empreintes génétiques commençaient à être exploitées dans un cadre judiciaire en France, d’importantes quantités de matériel biologique – plusieurs milliers de cellules – étaient nécessaires à l’identification, après plusieurs semaines d’analyse, d’un profil génétique. À partir des années 2000, quelques centaines de cellules suffisent à l’analyse, à condition toutefois que l’ADN ne soit pas dégradé par son environnement. En effet, la lumière, la chaleur et l’humidité nuisent à la qualité et donc à l’exploitation de l’ADN, bien que de nombreux progrès aient été réalisés, au cours des dernières années, dans ce domaine. Il est désormais possible d’identifier une personne au travers de quelques cellules, de simples traces de contact ou d’infimes quantités de salive et ce, en quelques heures seulement. Par ailleurs, des tests d’orientation géogénétique permettent, même s’ils ne sont pas pratiqués en France, de connaître l’origine géographique de l’ADN analysé ou certains détails physiques génétiquement déterminés, appelés informations phénotypiques, comme le décollement des oreilles, la couleur des yeux, ou l’existence de fossettes.
Dans un futur proche, il sera possible de construire de véritables portraits-robots des individus à partir de leur ADN, de conduire plusieurs tests différents sur une même trace biologique, de dater les traces, d’identifier plusieurs ADN sur une même trace, et de travailler sur des ADN plus dégradés encore, comme l’ont indiqué à vous rapporteurs les directrices générales déléguées de l’Institut génétique Nantes Atlantique. De la même façon, des évolutions scientifiques interviennent sans cesse dans le domaine des analyses de voix ou d’écritures. L’analyse des odeurs prélevées sur une scène de crime a ainsi acquis une valeur probante indéniable, comme l’a souligné M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique et scientifique à la direction de la police judiciaire. Ainsi, des scellés, mêmes anciens, pourront livrer de nouvelles vérités grâce aux futures techniques scientifiques.
2. Une destruction des scellés qui intervient six mois après la condamnation définitive
Cependant, une large partie de ces progrès scientifiques reste inexploitée en raison de la destruction des scellés qui intervient, en application de la loi, six mois après qu’une condamnation est devenue définitive.
Le délai de conservation des scellés judiciaires est défini par l’article 41-4 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que « si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers ». Ne relevant plus de l’autorité judiciaire, les scellés appartiennent alors à l’État, qui peut les vendre par l’intermédiaire des services du Domaine – s’ils revêtent une valeur marchande et que leur vente n’est pas prohibée – ou les détruire, en particulier lorsqu’il s’agit d’une arme (93). Le procureur dispose en outre de la faculté de détruire les scellés dangereux, nuisibles ou illicites.
Le délai légal de conservation des scellés n’a pas toujours été aussi court. Avant la loi du n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, le délai de conservation était de trois ans. Mais l’afflux croissant de scellés déposés aux greffes des tribunaux et les capacités limitées de l’immobilier judiciaire ont conduit à chercher, dans la réduction de ce délai, une certaine rationalisation.
Le code de procédure pénale ménage cependant quelques exceptions au principe de la destruction des scellés judiciaires. Notamment, les enregistrements des auditions de mineurs (94) et de personnes placées en garde à vue pour des faits criminels (95) sont conservés pendant cinq ans à compter de l’expiration de l’action publique. Par ailleurs, les scellés à partir desquels un profil ADN inconnu a été enregistré au fichier national automatisé des empreintes génétiques sont conservés par un service spécialisé, le service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB), pendant une durée de quarante ans (96).
Pour pallier une destruction trop rapide d’éléments de preuve importants qui empêche toute nouvelle exploitation dans le cadre d’une procédure de révision, le ministre de la Justice a adressé, le 16 mars 2011, une dépêche à l’ensemble des parquets tendant à encourager ces derniers à conserver les scellés au-delà du délai de six mois prescrit par la loi. Les magistrats y sont invités à conserver les scellés dans les affaires « les plus délicates », notamment lorsque la perspective d’une demande en révision ou en réexamen ne peut être exclue. Par ailleurs, la dépêche précise que « parmi ces scellés, il est recommandé qu’une attention toute particulière soit portée à ceux qui sont rattachés à des procédures relatives à une atteinte grave aux personnes, et consistent en des restes humains et, sous réserve des circonstances de l’espèce, des armes, ou des documents, ou encore des objets et prélèvements, conservés dans les greffes ou les laboratoires, susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non » (97).
Cette dépêche est la traduction inachevée d’une demande récurrente de la commission de révision, qui constate chaque année, dans les rapports de la Cour de cassation, « la destruction de plus en plus fréquente et de plus en plus rapide, des pièces à conviction, après décision définitive, en application des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, interdisant toute expertise complémentaire qui aurait pourtant pu être utile en raison notamment des progrès scientifiques » (98). La commission de révision avait d’ailleurs invité la Chancellerie, dès 2007, à prendre une circulaire enjoignant aux parquets de « conserver les scellés dans les affaires les plus lourdes et délicates » (99), mais également dans celles « où la culpabilité du condamné est contestée » (100) et « tout particulièrement quand le condamné ou son avocat en font la demande » (101).
Cependant, comme l’indique Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, dans sa contribution écrite aux travaux de la mission, une dépêche ne constitue pas un instrument juridique adéquat, mais au contraire « un fondement textuel extrêmement fragile pour prévoir une dérogation à un article du code de procédure pénale ». Qui plus est, cette dépêche ne fait que recommander la conservation des scellés dans certains cas particuliers : elle n’a pas force obligatoire. Dès lors, vos rapporteurs souhaitent allonger la durée légale de conservation des scellés dans certains cas bien définis.
3. Conserver les scellés criminels à la demande du condamné
Pour permettre la conservation des scellés pendant une durée adéquate, plusieurs solutions sont envisageables. D’une part, en ce qui concerne la durée de conservation, certains ont proposé, à l’instar de M. le sénateur Jean-Pierre Michel, que les scellés soient conservés pendant une durée fixe de trente ans (102) ou, comme M. Roland Agret, pendant celle de la prescription de la peine ; d’autres, comme Me Sylvie Noachovitch, ont fait observer qu’une durée plus courte, de quelques années, mais renouvelable sans limite, permettrait de concilier la nécessité de la conservation et les contraintes liées à la gestion des scellés.
Il a également été proposé de ne conserver les scellés que si le condamné en fait la demande ; au contraire, Me Sylvain Cormier a suggéré de laisser la décision au seul procureur de la République, afin de ne pas permettre à un individu qui se laisserait accuser à la place d’un autre d’empêcher la manifestation ultérieure de la vérité. Enfin, il a également été suggéré, notamment par les services de la Chancellerie, de limiter cette dérogation aux cas où le requérant a clamé son innocence.
Vos rapporteurs estiment nécessaire de prendre en considération le coût lié à la conservation des scellés – 48,2 millions d’euros ont été consacrés, en 2012, aux honoraires juridiques qui comprennent les frais liés à la gestion des scellés –, et, partant, de limiter autant que possible le champ de cette dérogation. Ainsi, il semble préférable de permettre la conservation des scellés pendant une durée de cinq ans renouvelable, si le condamné, informé par le procureur de leur destruction programmée, souhaite assurer leur conservation. Si le procureur n’accède pas à la demande du condamné, ce dernier pourra faire un recours contre la décision auprès de la chambre de l’instruction. Par ailleurs, afin de limiter le dispositif aux cas où la conservation est strictement nécessaire, seuls les scellés d’affaires criminelles devraient être conservés.
En revanche, vos rapporteurs ne sont pas favorables à ce que la conservation des scellés soit subordonnée à l’affirmation par le condamné de son innocence ou au fait qu’il ait fait appel de la décision de condamnation. Outre le fait que des personnes innocentes sont parfois amenées à avouer des faits qu’elles n’ont pas commis, plaider coupable relève parfois uniquement, dans les dossiers difficiles, d’une stratégie visant à limiter autant que possible une peine qui paraît inéluctable.
Proposition n° 17
Permettre la conservation des scellés criminels pour une période de cinq ans renouvelable lorsque le condamné, préalablement informé, s’oppose à la destruction des scellés ordonnée par le procureur conformément à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Plusieurs personnes entendues, notamment Mme Michèle Alliot-Marie, ancienne garde des Sceaux, ont suggéré que le procureur puisse opérer un tri dans les scellés, afin de distinguer ceux dont la conservation serait inutile, notamment s’il s’agit de scellés encombrants. Vos rapporteurs estiment qu’il serait difficile d’inscrire une telle pratique dans la loi, mais qu’en revanche une circulaire pourrait utilement indiquer qu’un tel tri, fait avec l’accord du condamné, est possible.
Enfin, cette proposition a vocation à être affinée au vu des résultats de l’étude menée par les services de la Chancellerie, à la demande de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur le volume et la nature des scellés criminels actuellement conservés.
B. PERMETTRE AU CONDAMNÉ DE DEMANDER LA RÉALISATION D’ACTES D’INVESTIGATION APRÈS SA CONDAMNATION
Pour entamer une procédure de révision, il est nécessaire de soumettre un fait nouveau ou un élément inconnu à l’appui de sa demande. Or, bien souvent, les condamnés, notamment lorsqu’ils sont détenus, disposent de ressources insuffisantes pour bénéficier des services d’avocats ou d’enquêteurs privés et mener à bien des investigations susceptibles de faire apparaître un tel fait ou élément. Dans l’affaire Marc Machin, par exemple, l’absence de recours en révision avant 2008 s’explique principalement par le fait que le condamné ne disposait pas du moindre élément nouveau à l’appui d’une requête. De fait, clamer son innocence ne suffit pas à ce qu’une demande soit examinée par la commission.
Et, lorsque le condamné dispose du conseil d’un avocat, ce dernier ne saurait, sans enfreindre une règle déontologique et procédurale fondamentale, conduire de lui-même une enquête approfondie. Comme l’a indiqué Me François Saint-Pierre, il arrive que l’avocat acquière la connaissance d’un élément nouveau, comme un témoignage innocentant son client, sans pouvoir lui-même interroger le témoin et sans que ce témoignage, dont il ignore s’il est réellement solide, puisse, en l’état, être soumis à la commission de révision. De fait, il existe une méfiance légitime, en France, face aux enquêtes privées : entendre soi-même un témoin est rapidement associé à une tentative de subornation et fait perdre toute validité au témoignage.
Ainsi, sauf à attendre que le fait nouveau « tombe du ciel », selon les mots de M. Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et juge à la Cour pénale internationale, le condamné est rarement en mesure de faire émerger le fait nouveau par lui-même. C’est pourquoi plusieurs personnes entendues, comme Me Sylvain Cormier et M. François Fournié, magistrat, ont suggéré de permettre au condamné de demander au procureur la réalisation d’actes d’investigation complémentaires qui, par exemple, n’auraient pas été effectués lors de la première enquête ou qui, du fait des évolutions scientifiques, seraient susceptibles de donner des résultats inédits ou différents.
D’autres personnes entendues, notamment les représentants du Syndicat de la magistrature et Me Valérie Rosano, ont estimé préférable de présenter ces requêtes à la juridiction de révision elle-même, considérant que le procureur ne dispose pas d’une indépendance suffisante pour rendre ce droit nouveau tout à fait effectif. Le Syndicat de la magistrature a même souhaité confier la réalisation de ces investigations à un service policier spécialisé, sur le modèle des offices centraux de la police judiciaire, afin de créer un service public d’enquête au soutien de la révision et de confier ces investigations à un service différent de celui qui a mené la première enquête.
Pour vos rapporteurs, ce droit doit être préalable et extérieur à la procédure de révision. Il a pour vocation d’offrir une chance supplémentaire aux requérants injustement condamnés et de les mettre sur un pied d’égalité sans considération de leurs ressources personnelles ou de leur potentiel médiatique. Il doit également permettre de faire parvenir à la commission de révision des dossiers plus étayés – à l’inverse des faux et des éléments construits de toutes pièces qu’elle reçoit parfois, comme l’a souligné M. Guy Hugnet, journaliste –, mais aussi de décourager les recours qui n’ont aucune chance d’aboutir. Dès lors, si ce droit devait être invoqué devant la juridiction de révision elle-même, cela aurait pour effet d’enclencher, en quelque sorte, la procédure et de contraindre la juridiction de révision à préjuger de la recevabilité de la demande. Quant à la création d’un service central dédié à la conduite des investigations, il semble préférable, pour l’heure, de permettre au procureur de confier l’enquête à un service de police ou de gendarmerie de son choix, sous réserve qu’il ne s’agisse pas du service ayant conduit l’enquête à l’origine de la condamnation.
Proposition n° 18
Permettre au condamné, préalablement à la saisine de la Cour de révision et de réexamen, de demander au procureur de la République la réalisation d’actes d’investigation.
C. DONNER À LA JUSTICE LES MOYENS D’APPRÉCIER LE CARACTÈRE NOUVEAU OU INCONNU D’UN FAIT OU D’UN ÉLÉMENT
Le succès d’une requête dépend notamment de l’appréciation que la juridiction de révision fera du caractère nouveau ou inconnu de l’élément invoqué à l’appui de la demande. Or, en l’absence d’un compte rendu intégral des débats ou d’une motivation précise de la décision de condamnation, il est souvent très difficile d’acquérir la certitude que le fait ou l’élément invoqué était bien inconnu des premiers juges.
1. Assurer la mémoire de l’audience par l’enregistrement des débats des cours d’assises
Il apparaît aujourd’hui indispensable de procéder à l’enregistrement systématique des débats des cours d’assises, cette faculté étant aujourd’hui très peu utilisée par leurs présidents.
a. Une faculté laissée à la libre appréciation du président de la cour d’assises
En l’état actuel du droit, l’enregistrement audiovisuel et sonore des débats des cours d’assises est prohibé par l’article 308 du code de procédure pénale. Cependant, ce même article permet au président de la cour d’assises d’ordonner l’enregistrement sonore de tout ou partie des débats. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner l’enregistrement audiovisuel des dépositions de cette dernière. Les enregistrements sont ensuite placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises.
Dans les faits, il semble que cette disposition pourtant ancienne ne soit guère utilisée par les présidents de cour d’assises, alors que les micros et caméras ont d’ores et déjà une place reconnue dans les cabinets des juges d’instruction ainsi que dans les juridictions pour mineurs. Cet état de fait est d’autant plus dommageable que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la commission de révision dispose d’un accès libre à ces enregistrements. D’ailleurs, elle rappelle fréquemment qu’il serait souhaitable que cet enregistrement soit rendu obligatoire, au minimum lorsqu’une partie le demande.
b. La nécessité de prévoir l’enregistrement obligatoire de l’ensemble des débats criminels
Il apparaît indispensable que les débats des cours d’assises soient intégralement enregistrés. En effet, à l’heure actuelle, les notes d’audience sont trop minces pour déterminer si un élément a été débattu par la cour d’assises et porté à la connaissance des jurés, tandis que les coupures de presse auxquelles la commission de révision est contrainte de recourir ne constituent pas une base parfaitement fiable.
Dès lors, vos rapporteurs sont favorables à l’extension de l’enregistrement des débats devant les cours d’assises qui, contrairement à la sténotypie, permet de restituer les propos de chacun dans le respect du principe d’oralité qui gouverne la procédure criminelle. Qui plus est, les salles d’audience étant d’ores et déjà sonorisées, une telle mesure n’entraînerait pas de coûts excessifs, contrairement à la réalisation d’un compte rendu intégral des débats de la cour d’assises qui nécessiterait la mobilisation de nombreux effectifs de greffiers.
En ce qui concerne la nature de l’enregistrement, les représentants de l’Union syndicale des magistrats ont attiré l’attention des rapporteurs sur le caractère potentiellement perturbateur d’une caméra. En outre, cette technologie serait soumise à un plus grand nombre d’aléas pratiques que l’enregistrement sonore. À l’inverse, Me Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, s’est déclaré plutôt favorable à un enregistrement audiovisuel, plus adapté pour assurer une retranscription fidèle du déroulement parfois houleux des débats criminels. Vos rapporteurs proposent que les débats soient obligatoirement et systématiquement enregistrés, de façon sonore ou audiovisuelle, ce choix étant laissé à la libre appréciation du président de la cour d’assises en fonction, notamment, des moyens techniques disponibles ou de la sensibilité des débats.
Proposition n° 19
Enregistrer systématiquement les débats des cours d’assises, en laissant au président de la cour le choix d’ordonner un enregistrement sonore ou audiovisuel.
2. Parvenir à une meilleure motivation des arrêts de cours d’assises
Si les arrêts des cours d’assises sont, depuis le 1er janvier 2012, motivés, il apparaît que cette motivation est encore insatisfaisante au regard notamment de la révision des condamnations pénales.
a. La motivation minimale des arrêts de cours d’assises introduite par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
Depuis l’avènement du jury populaire consécutif à la Révolution française, les décisions des cours d’assises ne sont pas motivées autrement que par la réponse aux questions posées, par le président de la cour d’assises, aux jurés. L’émergence de l’intime conviction, mais aussi la solitude des jurés populaires qui jugeaient sans magistrat professionnel à leurs côtés jusqu’en 1941, rendaient en effet vaine toute tentative de motivation.
Depuis toujours et jusqu’à une date récente, la Cour de cassation a considéré que la reprise, dans l’arrêt, des réponses à ces questions satisfaisait toutes les exigences constitutionnelles et conventionnelles et tenait même lieu de motifs aux arrêts des cours d’assises. D’ailleurs, à l’occasion d’une série de questions prioritaires de constitutionnalité (103), le Conseil constitutionnel a été amené à constater, lui aussi, que l’absence de motivation ne contrevenait nullement aux principes du procès équitable et que la procédure devant la cour d’assises comportait suffisamment de garanties contre l’arbitraire pour que l’absence de motivation ne soit pas, en elle-même, inconstitutionnelle.
Cependant, sous l’influence de la jurisprudence européenne (cf. encadré ci-après), la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a introduit une exigence de motivation des arrêts de cours d’assises.
La motivation des arrêts criminels dans la jurisprudence européenne
La jurisprudence européenne considère depuis longtemps que l’absence de motivation d’un arrêt criminel n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cependant, en 2009, l’une des chambres de la Cour a tenté de faire évoluer la jurisprudence européenne qui, jusqu’alors, considérait que les questions posées par le président pouvaient constituer une trame sur laquelle se fondait la décision et compensaient ainsi adéquatement l’absence de motivation. Dans cet arrêt, la chambre en question indique qu’« une évolution se fait sentir tant sur le plan de la jurisprudence de la Cour que dans les législations des États Contractants. Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d’affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l’arbitraire » (104). C’est cependant une position plus nuancée que prend la Cour européenne dans son ensemble à la suite du renvoi, en grande chambre, de l’affaire Taxquet, tout en confirmant les conclusions rendues par la chambre sur la violation de la Convention par la Belgique. En effet, en 2010, elle indique que la Convention ne requiert nullement des jurés populaires qu’ils motivent leur décision ; le droit au procès équitable exige simplement que le condamné soit en mesure de comprendre sa condamnation : « Devant les cours d’assises avec participation d’un jury populaire, il faut s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (…) la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas, en soi, violation du droit de l’accusé à un procès équitable. Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation » (105).
L’article 365-1 du code de procédure pénale tel qu’issu de la loi du 10 août 2011 indique que le président, ou l’un de ses assesseurs, rédige la motivation de l’arrêt. Celle-ci consiste, en application de la loi, « dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ». Ces éléments, indique le texte, sont ceux qui ont été exposés au cours de la délibération des jurés qui a précédé le vote. La motivation, qui figure sur une « feuille » annexée à la feuille des questions, est rédigée séance tenante ou, dans le cas d’affaires complexes, dans les trois jours qui suivent le prononcé de la condamnation, laissant ainsi le temps au condamné de comprendre le verdict avant de saisir la cour d’appel ou la Cour de cassation. Ces dispositions s’appliquent aux décisions rendues depuis le 1er janvier 2012.
Rétrospectivement, il semble que le législateur ait procédé à une réforme tout à fait nécessaire. En effet, la CEDH a récemment eu à se prononcer sur cinq affaires dans lesquelles la procédure judiciaire française telle qu’elle s’appliquait avant 2012 était mise en cause par les requérants. Pour ne prendre que cet exemple, dans l’affaire Agnelet, le requérant, accusé du meurtre de sa compagne, avait été acquitté en 2006, avant d’être condamné, en appel, l’année suivante, à vingt ans de réclusion criminelle. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le condamné avait saisi la CEDH au motif que l’absence de motivation l’avait privé de son droit au procès équitable. La Cour de Strasbourg, en janvier dernier (106), lui a donné raison, considérant que l’examen combiné de l’acte d’accusation et des questions posées au jury n’avait pas permis au requérant de comprendre sa condamnation, et ce d’autant plus que celle-ci, extrêmement lourde, avait fait suite à un acquittement (107).
La Cour, dans son arrêt, salue d’ailleurs l’initiative du législateur français, dont la réforme « semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé » (108). Toutefois, il ne saurait être affirmé que la réforme intervenue en 2011 met la France à l’abri de nouvelles condamnations, tant la motivation actuellement exigée apparaît encore faible au regard des exigences européennes. La Cour analysant les affaires qui lui sont soumises in concreto, il est toujours possible qu’elle condamne à nouveau la France, comme le laisse entendre l’usage du terme « a priori ».
b. Une motivation qui demeure insatisfaisante au regard des enjeux de la révision
En dépit de ce progrès certain, la motivation actuellement exigée par la loi apparaît particulièrement succincte, comme le suggèrent d’ailleurs les modèles mis à la disposition des magistrats (cf. infra). En effet, les termes de la loi trahissent la faible ambition qui animait le législateur en 2011 : dans le cas d’une condamnation (109), seuls les « principaux » éléments à charge ayant motivé la décision de la cour d’assises doivent être mentionnés. Comme l’indique la circulaire (110) prise pour l’application de cette loi, la motivation exigée consiste seulement en une « mise en forme synthétique et succincte » des éléments à charge les plus importants, c’est-à-dire ceux qui semblent avoir emporté la conviction d’un grand nombre de jurés, voire une « simple énumération de ces éléments », qui doit, de plus, être « beaucoup plus concise si l’accusé a reconnu les faits » ; au contraire, elle n’implique nullement « ni la démonstration de la culpabilité de l’accusé, ni l’exposé de l’ensemble des éléments à charge retenus contre lui », ni « la liste de l’ensemble des éléments à décharge que la cour n’aura, par définition, pas retenus » en cas de condamnation.
En outre, comme cela a été indiqué à vos rapporteurs, les dispositions législatives relatives à la motivation criminelle connaissent une application variable. Si certains magistrats se conforment a minima aux prescriptions légales, parfois par des formules sibyllines ou en établissant, en quelques lignes, les principaux éléments à charge, d’autres reproduisent partiellement la décision de renvoi émanant de la juridiction d’instruction, nettement plus détaillée quant aux circonstances et aux faits susceptibles d’établir la culpabilité de l’accusé. Ni l’une ni l’autre de ces solutions n’apparaissent tout à fait satisfaisantes, bien qu’il faille reconnaître que, dans le délai imparti par la loi, il soit difficile de faire autrement. Comment expliciter, dans le détail, l’intérêt présenté par chacun des éléments à charge au regard du verdict final, quand la motivation doit être rédigée immédiatement à l’issue du délibéré, après de longues heures de débat et sous la pression légitime d’un condamné dans l’attente de son verdict ? Certes, la loi prévoit que la rédaction peut être différée ; mais cette faculté doit être réservée aux affaires les plus complexes et revêt en réalité un caractère exceptionnel.
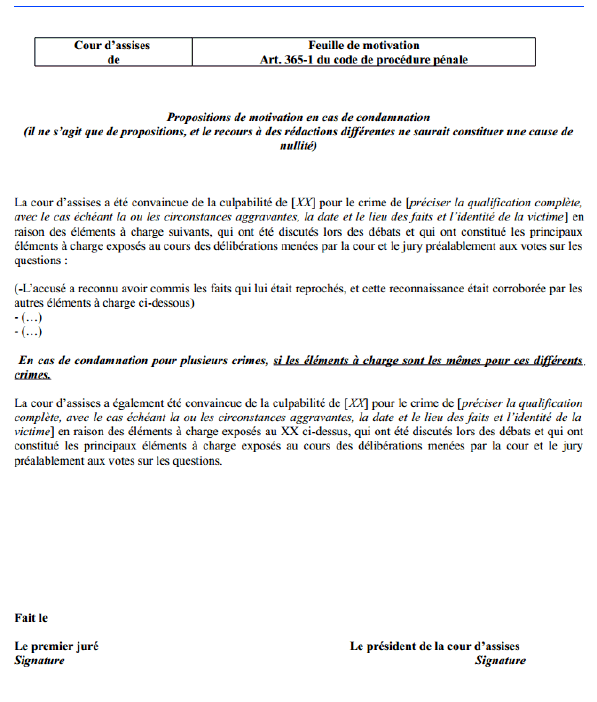
La motivation actuelle des décisions des cours d’assises ne répond que modérément aux besoins de connaissance inhérents à la procédure de révision. La détermination du caractère nouveau ou inconnu d’un élément pourrait en effet bénéficier d’une motivation détaillée et complète portant sur l’ensemble des éléments à charge. Par ailleurs, si les exigences de motivation étaient renforcées, la juridiction de révision serait à même d’apprécier la portée de tel élément sur la décision de condamnation et, partant, de savoir si l’élément fait, ou non, naître un doute sur la culpabilité du condamné.
D’autres raisons, plus générales, militent également pour la mise en place d’une réelle exigence de motivation. D’une part, la différence de traitement qui existe entre les décisions correctionnelles et criminelles demeure difficilement compréhensible, les décisions les plus graves étant paradoxalement nettement moins motivées que les autres. D’autre part, la mise en place de l’appel criminel, en 2000, doit être parachevée par la réforme de la motivation des cours d’assises. En effet, il semble difficile, tant pour le procureur que pour le condamné, d’apprécier l’opportunité de faire appel d’une décision sans en connaître la motivation. Enfin, la nécessité de mettre en œuvre toutes les garanties possibles pour limiter l’incompréhension à l’égard des décisions les plus graves doit conduire à renforcer les exigences législatives en matière de motivation.
Une motivation plus détaillée des arrêts des cours d’assises, portant à la fois sur l’intégralité des éléments à charge ayant conduit à la décision de culpabilité, sur les raisons ayant permis d’écarter les éléments à décharge, mais également sur la nature et le quantum de la peine serait donc tout à fait souhaitable. Néanmoins, l’introduction d’une exigence de motivation est très récente ; il est clair que la loi n’a pas encore déployé tous ses effets. Avant d’imposer une motivation plus détaillée, il semble nécessaire de laisser au monde judiciaire le temps de faire évoluer ses pratiques et de dresser un bilan exhaustif de l’application de la loi du 10 août 2011, ce qui excède manifestement le champ de la mission confiée à vos rapporteurs.
Proposition n° 20
Réaliser un bilan de l’application de la loi du 10 août 2011 en matière de motivation.
*
* *
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 4 décembre 2013, la Commission procède à l’examen du rapport d’information présenté par MM. Alain Tourret et Georges Fenech, rapporteurs.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La mission d’information sur la révision des condamnations pénales, dont nous examinons aujourd’hui le rapport, a été conçue selon un format allégé, puisqu’elle n’est composée que de deux membres, tous deux rapporteurs. Cette mission, créée sur proposition du bureau de la commission des Lois le 24 juillet dernier, a travaillé à un rythme soutenu, comme en témoignent les vidéos des auditions que certains ont pu regarder. Si j’ai pu être initialement sceptique quant au thème de cette mission, tant il semblait à la fois ardu et balisé d’histoires douloureuses et ardu, j’ai constaté, en écoutant une grande partie de ces témoignages, que la démarche des rapporteurs faisait consensus. Une proposition de loi pourrait être bientôt déposée par les rapporteurs, qui reprendrait leurs propositions ; son adoption permettrait de faire évoluer le droit et d’assurer une plus grande fluidité à la procédure de révision.
M. Alain Tourret, rapporteur. Je tiens à souligner que nous avons travaillé depuis juillet dernier, mon collègue Georges Fenech et moi-même, dans une parfaite complémentarité. C’est la première fois, au cours de cette législature, qu’une mission est confiée à deux membres, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition. Nos expériences professionnelles passées, respectivement en tant que magistrat et avocat, nous ont permis d’aborder le sujet avec deux visions différentes mais complémentaires. Depuis longtemps, nous réfléchissons à la révision des condamnations pénales. Je rappelle d’ailleurs que Georges Fenech est l’auteur d’une intéressante proposition de loi, déposée en 2007, sur laquelle nous nous sommes appuyés.
Qu’est-ce que l’État de droit, dans le domaine judiciaire ? Il répond à deux impératifs contradictoires : d’une part, préserver l’ordre juridique par l’autorité de la chose jugée ; d’autre part, éviter l’erreur judiciaire et la réparer lorsqu’elle survient. Notre histoire est marquée par des erreurs judiciaires, comme en témoignent les affaires Calas, Dreyfus, et, plus récemment, Machin et Sécher, et par d’autres affaires pour lesquelles la justice s’est prononcée contre la révision (Seznec, Dominici, Raddad). La valeur de la sécurité juridique l’emporte actuellement sur la valeur de justice. Il y a vraisemblablement plusieurs dizaines d’innocents qui se trouvent aujourd’hui emprisonnés, ce qui ne peut que terrifier chacun d’entre nous.
Il existe deux procédures distinctes pour remédier à une erreur judiciaire, de fait ou de droit : d’une part, la révision des condamnations pénales ; d’autre part, le réexamen d’une décision pénale consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. La procédure de révision est ancienne et existait déjà sous l’Ancien régime. Elle a été modifiée en 1989 et repose principalement sur l’existence d’un fait nouveau susceptible de créer un doute sur la culpabilité du condamné. La procédure de réexamen a, quant à elle, été votée en 2000. Je me souviens des interventions de M. Jack Lang, alors député, et de notre collègue Philippe Houillon. Le réexamen d’une décision pénale vise à réparer les conséquences d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en cas de non respect du droit au procès équitable.
De l989 à 2013, 3 358 demandes de révision ont été déposées, parmi lesquelles 8 ont pu aboutir en matière criminelle, et 43 en matière correctionnelle. De 1945 à nos jours, nous avons connaissance de 10 cas de révision en matière criminelle. En ce qui concerne la procédure de réexamen, les chiffres sont beaucoup importants : sur 55 demandes en réexamen déposées depuis 2000, 31 ont conduit au réexamen de la décision pénale en cause. Ces chiffres démontrent, à l’évidence, que toute la machine législative et judiciaire est plus favorable au statu quo qu’à la révision.
Tous les ans, la Cour de cassation, dans ses rapports annuels, appelle de ses vœux une réforme du système actuel. Les 49 personnes que nous avons entendues nous ont indiqué, presque de façon unanime, qu’il était nécessaire de changer la législation. Dans les autres pays européens, une place plus large est faite à la révision.
À l’heure actuelle, la personne condamnée doit faire la preuve de son innocence, non pas seulement apporter des éléments susceptibles de faire naître un doute sur sa culpabilité. Ce fut le cas, en particulier, dans l’affaire Machin, où un autre coupable a été désigné.
Nos travaux nous ont conduits à entendre la Chancellerie, la haute magistrature, mais aussi des avocats, des juristes, la commission nationale consultative des droits de l’homme ou encore M. Roland Agret, qui a été jusqu’à l’automutilation pour faire entendre sa cause. Nous avons également reçu M. Bruno Cotte, qui présidait la chambre criminelle lors de l’examen de la demande en révision de la garde des Sceaux dans l’affaire Seznec, le procureur général près la Cour de cassation, d’anciens procureurs généraux, l’actuel président de la chambre criminelle, le président de la commission de révision ainsi que deux anciennes présidentes de cette juridiction. C’est un travail immense que nous avons accompli avec notre foi et notre passion d’humanistes.
Nous ne souhaitons nullement créer un troisième degré de juridiction. En revanche, il nous paraît indispensable de remédier à l’erreur judiciaire. Il nous est insupportable de penser que le système actuel conduit des innocents en prison. L’analyse des décisions criminelles rendues en appel entre 2003 et 2005 est particulièrement éclairante. Sur les 1 262 personnes rejugées en appel d’une condamnation, 64 ont finalement été acquittées. Il y avait donc eu une erreur dans 64 dossiers. C’est beaucoup en comparaison des 8 condamnations criminelles qui ont été révisées depuis 1989.
Par ailleurs, l’extraordinaire évolution de la police technique et scientifique, en particulier dans le domaine de l’ADN – on peut connaître l’identité d’une personne à partir de traces biologiques infimes –, mais aussi dans le domaine de l’expertise en écritures, de l’analyse des voix et des odeurs, aurait dû conduire à plus grand nombre de décisions de révision, comme cela a été le cas aux États-Unis.
Un consensus s’est établi sur la nécessité de modifier les dispositions relatives à la révision des condamnations pénales. Nous nous félicitons également de l’accueil très favorable que nous ont réservé les magistrats. Je tiens à souligner que ces erreurs judiciaires ne sont pas fautives : nous sommes persuadés que le monde judiciaire travaille avec toute la rigueur nécessaire. M. le premier président de la Cour de cassation nous a d’ailleurs reçu longuement pour que nous trouvions, ensemble, des solutions qui respectent le monde judiciaire. Le chemin était étroit, comme l’a dit la garde des Sceaux elle-même ; les propositions que nous formulons vont permettre, à l’avenir, d’améliorer le fonctionnement de ces procédures.
M. Georges Fenech, rapporteur. Je suis particulièrement heureux de soumettre à votre approbation, au nom de la commission de Lois et pour le compte de l’opposition, ce rapport sur la réforme des procédures de révision et de réexamen des condamnations pénales définitives. Notre approche commune a été saluée, quelles que soient leurs sensibilités et leurs appartenances, par l’ensemble des personnes que nous avons rencontrées. Je tiens tout particulièrement à remercier le président Jean-Jacques Urvoas, qui nous a accordé une totale confiance, ainsi que mon collègue Alain Tourret pour son engagement, son écoute et son humanisme.
La confiance dans la justice passe aussi par la capacité du système judiciaire à rectifier et réparer une erreur judiciaire sans chercher à toujours s’abriter derrière le sacrosaint principe de l’autorité de la chose jugée. Certes, la paix sociale et le respect dû aux décisions des cours et tribunaux impose que la voix révisionnelle soit strictement encadrée. Dans le même temps, l’idée qu’un innocent continue à subir les effets d’une condamnation heurte notre conscience et, par le sentiment d’injustice qu’elle répand, trouble fortement et durablement l’opinion publique, parfois même à travers les siècles. Les affaires Calas et Dreyfus sont toujours présentes dans la mémoire collective. Ne dit-on pas qu’il vaut mieux avoir dix coupables en liberté plutôt qu’un seul innocent en prison ?
Or, le très faible nombre de révisions – une dizaine ont été admises depuis 1945, chiffre pour lequel nous n’avons d’ailleurs pas de certitude – est-il le signe d’une justice infaillible ? Je ne le crois pas. Cela démontre plutôt que la procédure actuelle doit être modifiée dans un sens favorable aux victimes d’erreurs inhérentes à la fonction de juger. Toutes les personnes entendues, ainsi que les rapports annuels de la Cour de cassation, nous ont convaincus de la nécessité de modifier le système issu de la loi du 23 juin 1989.
En ce qui me concerne, je soumettrai à votre approbation les deux éléments centraux de ce rapport : d’une part, la nécessité de créer une cour unique de la révision et du réexamen ; d’autre part, la nécessité de qualifier le doute permettant d’ouvrir un recours en révision.
L’organisation actuelle est éclatée, complexe, source de décisions en apparence contradictoires. Ces dernières années, deux affaires ont suscité une incompréhension légitime : l’affaire Leprince et l’affaire Seznec. La commission de révision avait estimé que ces deux requêtes devaient être admises ; la Cour de révision les a rejetées. Ces appréciations contradictoires viennent du fait que la commission comme la Cour peuvent vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d’instruction, décider de suspendre la peine du requérant, et surtout, se prononcer sur le fond du dossier, donnant ainsi le sentiment d’un véritable doublon judiciaire, sentiment renforcé par le fait que ces deux juridictions sont toutes deux composées de magistrats de la Cour de cassation.
Le système actuel présente un autre inconvénient majeur : la loi ne décrit que sommairement la procédure applicable devant la commission de révision, ainsi que ses pouvoirs d’investigation. Par ailleurs, la loi est muette sur la composition même de la Cour de révision. L’article 623 du code de procédure pénale dispose en effet que la commission de révision saisit la chambre criminelle qui statue comme Cour de révision. Elle peut donc siéger en formation plénière, mais n’y est nullement contrainte ; de fait, la pratique a varié. Cette liberté donnée à la Cour de fixer elle-même sa composition porte une indéniable atteinte à son impartialité. Enfin, la présence de seuls magistrats issus de la chambre criminelle crée des suspicions, fondées ou non, de corporatisme et donc de partialité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de créer une cour unique de révision et de réexamen afin d’éviter tout hiatus et de lever toute suspicion. Cette cour sera composée de dix-huit magistrats, à raison de trois magistrats élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation au sein de chacune de six chambres qui composent actuellement la Cour. La présidence en sera confiée au président de la chambre criminelle. Chaque titulaire aura un suppléant désigné dans les mêmes conditions, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Cette même cour statuera en matière de réexamen, en cas de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme. En assurant ainsi la participation de magistrats aux horizons variés à la cour de révision et de réexamen, cette composition la fera définitivement échapper aux critiques.
Il appartiendra à la cour de révision et de réexamen de désigner, en son sein, les cinq magistrats qui composeront une commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Par cette nouvelle dénomination, nous évitons également la confusion actuelle entre la commission de révision et la Cour de révision : comment voulez-vous que les justiciables saisissent la différence qui existe entre ces deux instances ? La commission de révision, qui est en réalité une juridiction d’instruction, doit donc être rebaptisée. Bien entendu, les magistrats qui composeront cette juridiction ne siègeront pas au sein de la Cour ; nous respecterons en cela le principe constitutionnel et européen de séparation des fonctions d’instruction et de jugement.
Par ailleurs la commission d’instruction verra ses pouvoirs clairement définis, ce qui n’est pas le cas actuellement. Elle aura pour tâche de s’assurer de la recevabilité des demandes, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais la nouveauté que nous souhaitons introduire réside dans le fait qu’après la mise en état du dossier, la commission se contentera de transmettre le dossier à la Cour. Seule celle-ci prendra la décision définitive d’acceptation ou de rejet, évitant ainsi tout risque de confusion voire de contradiction.
J’ajoute que les droits du requérant seront clairement définis : accès au dossier, demande d’acte, assistance d’un avocat. Il en sera de même pour la partie civile. Enfin, nous proposons d’élargir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins, aux petits-enfants, mais aussi au procureur général près la Cour de cassation comme aux procureurs près les cours d’appel. Le garde des Sceaux conservera cette prérogative, qui n’entre nullement en contradiction avec la fin des instructions individuelles récemment adoptée.
J’en viens au second point de la réforme, qui est probablement le plus difficile. Nous proposons de qualifier, dans la loi, la nature du doute permettant la révision. La grande avancée de la loi du 23 juin 1989, outre le fait qu’elle a judiciarisé le filtrage des demandes auparavant effectué par le garde des Sceaux, a déjà modifié cet élément. Auparavant, il fallait établir l’innocence du condamné, ce qui restreignait considérablement les chances de succès d’une requête en révision. Le législateur de 1989 a rendu la révision possible lorsqu’« après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».
Je précise que le législateur n’a volontairement pas retenu la notion de « doute sérieux » jusqu’ici employée par la jurisprudence. Ce faisant, il a clairement indiqué au juge qu’un doute simple devait conduire à la révision. Or, force est de constater que le législateur et le juge n’entendent pas le doute de la même façon. D’ailleurs, M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle, a clairement indiqué, dans sa contribution écrite, qu’un doute « raisonnable » sur la culpabilité est nécessaire à la révision. Or, le doute raisonnable n’est pas équivalent au doute sans qualificatif actuellement prévu par la loi, qui est de fait un doute simple.
Dans les faits, lorsqu’on examine la dizaine de cas dans lesquels la révision a été admise, on constate que, chaque fois, la preuve de l’innocence a été rapportée. Dans l’affaire Machin, il a fallu qu’un second individu récidive, en tuant à nouveau une femme près du pont de Neuilly, et qu’il s’accuse du meurtre pour que la révision de la condamnation ait lieu. Il en va de même dans une affaire où un bulletin d’hospitalisation psychiatrique a été fortuitement découvert qui innocentait le condamné. À chaque fois, c’est la preuve de l’innocence qui est rapportée. D’ailleurs, comme nous l’ont fait remarquer les représentants du Syndicat de la magistrature, si le terme « sérieux » a disparu de la loi, il est toujours présent dans la tête des juges. Ainsi, depuis 1989, aucun dossier n’a été soumis à une nouvelle cour d’assises sur le fondement d’un doute simple. C’est pourquoi, avec mon collègue Alain Tourret, nous avons la conviction qu’il faut qualifier ce doute. Du reste, le droit pénal est familier de la gradation.
Pour être tout à fait honnête, plusieurs personnes entendues ont soutenu que cette modification était inutile, le doute exigé par la loi étant d’ores et déjà un doute simple. Nous souhaitons mettre un terme à ce débat et préciser, dans la loi, que le moindre doute doit entraîner la révision. Un doute ne se dissèque pas : il y a doute, ou il n’y a pas doute. Dès qu’un doute apparaît, quelle que soit sa force, il doit bénéficier au condamné, comme il profite à l’accusé. J’espère que vous partagerez notre conviction. Ainsi, sans bouleverser la rédaction actuelle du texte, nous vous proposons que le moindre doute puisse donner lieu à la révision de la condamnation ; il appartiendra bien entendu à la cour d’assises désignée pour rejuger l’affaire de dire si ce doute est suffisant pour modifier l’issue du procès.
Je conclus en vous faisant part d’une conviction profonde : il nous revient de décider, je l’espère unanimement, de cette avancée du droit, de la vérité et de la justice. Nous aurons ainsi participé, ensemble, à un moment de l’histoire judiciaire.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous remercie, Monsieur le député. Vous avez manifestement su captiver votre auditoire. Nous sommes convaincus qu’en réfléchissant à l’amélioration de la procédure de révision des condamnations pénales, nous contribuons à l’ennoblissement de la justice, tant l’idée de réviser les décisions pénales, notamment celles rendues par un jury, n’est pas évidente.
Mme Colette Capdevielle. Je remercie les rapporteurs pour cette présentation très synthétique. Il s’agit d’un rapport très complet qui est de nature à favoriser d’importants changements législatifs.
La remise en cause de la chose jugée doit rester exceptionnelle et très encadrée. Mais on ne saurait tolérer d’erreur judiciaire « à perpétuité ». Votre travail nous fait avancer sur une question très difficile. Nous revenons en effet de très loin : il n’y a pas si longtemps, la possibilité d’un appel n’existait pas en matière criminelle et l’on pouvait être condamné à perpétuité sans que la décision soit motivée.
La création d’une cour de révision et de réexamen constitue une proposition très intéressante, à condition qu’elle soit expressément rattachée à la Cour de cassation et que ses membres soient recrutés parmi les magistrats de toutes les chambres de la Cour de cassation et pas seulement parmi ceux de la chambre criminelle, trop impliquée dans les affaires pénales.
Il faut également accorder davantage de place à l’oralité des débats afin de mieux appréhender la réalité et, par conséquent, de parvenir plus aisément à la vérité. Me Henri Leclerc ne cesse de le dire depuis des décennies : l’oralité sert souvent de révélateur, ainsi que l’ont démontré des affaires célèbres. Il ne s’agit pas refaire l’audience ; mais l’audition des témoins apparaît indispensable.
En définitive, l’une des propositions qui me paraît la plus intéressante est celle relative à l’enregistrement systématique des débats des cours d’assises, l’enregistrement pouvant être sonore ou visuel et conservé sans délai, ce qui me semble fondamental et, en tout état de cause, indispensable pour les crimes. Pour les délits, il pourrait être envisagé d’organiser un enregistrement non systématiques mais à la demande des parties, sur requête motivée. Quoi qu’il en soit, l’enregistrement constitue un moyen de conservation des preuves et permet de connaître le déroulement d’un procès. Dans votre rapport, vous avez évoqué le caractère éventuellement perturbateur de la présence de caméras dans les procès. Nous sommes bien placés ici pour savoir qu’on les oublie bien vite. De même, lorsque des auditions devant un juge d’instruction ou des confrontations sont filmées, le naturel reprend assez vite le dessus ; on s’aperçoit que rien ne vaut le « parler vrai », qui est bien plus utile que la seule lecture d’un procès-verbal.
Nous pouvons également retenir la proposition qui porte sur la motivation des décisions rendues par les cours d’assises. Il est étonnant de constater qu’aujourd’hui, un arrêt prononçant une condamnation peut de manière succincte – avec trois lignes sur la culpabilité, voire des formules toutes faites sinon indigentes – répondre à un arrêt de renvoi devant la cour d’assise quant à lui très motivé, avec l’exposé des faits, des éléments à charge et parfois à décharge. Vous avez raison de constater que cela n’est pas satisfaisant. Il n’est pas acceptable dans un État de droit qu’une condamnation pénale puisse être motivée par des formules aussi succinctes. Pour être acceptée, une décision doit être particulièrement motivée. Cela vaut en matière pénale comme en matière civile.
M. Dominique Raimbourg. Je partage l’appréciation flatteuse faite sur ce rapport mais je souhaiterais faire deux remarques. La première porte sur le doute. Si le doute est simple et que l’introduction d’un élément nouveau n’est pas nécessaire pour le nourrir, ne sommes-nous pas en présence d’un troisième degré de juridiction ? Par ailleurs, je suis sensible à l’ensemble de vos arguments à l’exception d’un seul : votre refus de permettre la révision en cas d’acquittement. Cette position ne pourra pas résister longtemps face à d’éventuels nouveaux éléments venant asseoir la culpabilité d’une personne acquittée. Cela me rappelle le débat que nous avions eu au moment de l’introduction de l’appel des décisions de cour d’assises. Certains avaient souhaité que cet appel ne soit possible qu’en cas de décision de culpabilité et non pas en cas d’acquittement. Finalement, l’appel a été ouvert tant à l’accusé qu’au procureur, mais pas à la partie civile.
Mme Cécile Untermaier. Je m’associe volontiers aux propos élogieux qui viennent d’être exprimés sur le rapport de la mission. Je focaliserai mon intervention sur la conservation des scellés, essentielle à la manifestation de la vérité. Il s’agit d’une question majeure, même si elle est d’ordre matériel. Depuis 2011, l’enregistrement des scellés est informatisé. Si cela constitue un progrès, il convient de rester vigilant et d’appeler l’attention du ministère de la Justice sur les registres qui assurent encore la traçabilité des anciens scellés, dont certains sont sinon perdus, du moins égarés. Une gestion informatique des scellés anciens, avec possibilité de consultation, pourrait permettre de rassurer les familles qui s’inquiètent de leur éventuelle disparition.
S’agissant de la durée de conservation des scellés, une harmonisation à l’échelle nationale est nécessaire. Vos propositions me semblent aller dans le bon sens ; une attention particulière doit être accordée aux scellés portant sur les traces génétiques : vos propositions me semblent de nature à atteindre cet objectif.
De manière subsidiaire, l’aménagement des locaux pour la bonne conservation des scellés doit constituer une priorité pour le ministère de la Justice. On ne peut se contenter d’un placard pour entreposer des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité ! Il faudrait sans doute que nous réfléchissions à des dispositifs moins coûteux, par exemple grâce à des partenariats.
M. Alain Tourret, rapporteur. Ces questions sont très intéressantes, et j’en remercie leurs auteurs. Je rappelle qu’un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est nécessaire à l’aboutissement d’une demande en révision. C’est seulement lorsque ce préalable est établi que la question du doute que le fait ou l’élément fait naître sur la culpabilité se pose. Si ce fait ou cet élément fait naître un doute sur la culpabilité du condamné, alors il faut renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction ou annuler directement la condamnation.
Le président de la cour d’assises peut ordonner, de façon dérogatoire, l’enregistrement des débats. J’ai été choqué d’entendre des avocats dire qu’ils ne demandaient pas cet enregistrement au président de la cour d’assises afin de ne pas entrer en conflit avec lui au moment où ils doivent assurer la défense de l’accusé. Nous estimons que l’enregistrement doit, en matière criminelle, devenir obligatoire. Comment peut-on établir que le fait est nouveau alors que l’oralité des débats y fait obstacle ? La situation actuelle est intenable. Nous nous sommes assurés auprès de la garde des Sceaux qu’elle soutenait ces dispositions.
Quant à la question de la motivation, je tiens à vous faire part de mon malaise. L’Assemblée nationale, en 2011, a déjà traité le sujet. Si elle ne l’avait pas fait, nos propositions auraient été au-delà de ce qu’elles sont aujourd’hui. La loi du 10 août 2011 a fixé, à compter de 2012, une exigence minimale de motivation. Je constate que la Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est « a priori » suffisant : cela signifie qu’elle peut à nouveau condamner la France. En outre, la motivation ne porte pas sur le quantum de la peine. Il est extrêmement difficile d’expliquer au justiciable pourquoi les jugements correctionnels sont parfois longuement motivés quand les arrêts criminels le sont en seulement quelques lignes. Plus vous avez commis une infraction grave, moins les magistrats ont à motiver leur décision ! Notre collègue Georges Fenech vous fera part, à ce propos, des entretiens qu’il a eus avec des présidents de cour d’assises, qui démontrent qu’il est possible d’aller au-delà de ce qui est prévu actuellement. Est-il souhaitable de modifier une disposition légale deux ans à peine après son entrée en vigueur ? Telle est la question.
En ce qui concerne la conservation des scellés, dans l’affaire Leprince, tous les scellés, sauf un, avaient disparu ! Les scellés cessent généralement d’être conservés six mois après la condamnation définitive. Leur conservation au-delà de ce délai représente un coût indéniable. Là encore, nous nous sommes entretenus avec la garde des Sceaux en vue d’une conservation raisonnable des scellés. Une proposition de loi de M. le sénateur Jean-Pierre Michel, récemment déposée, prévoit une conservation des scellés pendant trente ans. Cela nous paraît excessif ; c’est pourquoi nous avons proposé que le condamné puisse se prononcer en faveur de la conservation des scellés, tous les cinq ans, lorsque le procureur envisage de les détruire, notamment lorsqu’ils sont encombrants. En cas de désaccord, la chambre de l’instruction se prononcera. Cela nous semble être une position réaliste. Il n’y a rien de pire que de faire des propositions maximalistes qui ne sont ensuite pas suivies par la Chancellerie.
Pour ce qui est de la révision des acquittements, je suis en désaccord complet avec notre collègue Dominique Raimbourg. Certaines personnes entendues, en particulier issues du parquet, nous ont fait part de cette proposition ; tous les autres l’ont, comme nous, rejetée. La possibilité de remettre en cause un acquittement sur la base d’un fait nouveau portera assurément atteinte à la paix sociale ; la vie deviendra insupportable pour les personnes acquittées. En l’absence de délai, des requêtes pourront être déposées en ce sens en permanence. Nous nous sommes convaincus qu’il ne fallait pas ouvrir la révision aux acquittements.
Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’homme, a suggéré que l’on permette la révision des contraventions de la 5e classe. Nous ne le souhaitons pas, pour ne pas risquer de faire exploser la machine. L’honneur et la considération ne sont pas fondamentalement mis en cause par une contravention.
M. Georges Fenech, rapporteur. En ce qui concerne la motivation des arrêts de cour d’assises, je partage votre avis et regrette que nous ne puissions, dès aujourd’hui, aller jusque-là. La difficulté d’une telle motivation résiderait dans le caractère secret du vote de chaque juré ; en réalité, c’est un faux obstacle. Pour en avoir discuté avec des présidents de cour d’assises, il est tout à fait possible d’associer les jurés à la rédaction même de la motivation. Il faut laisser mûrir la loi du 10 août 2011 ; je ne doute pas que nous parviendrons tôt ou tard à une motivation complète et détaillée des arrêts de cours d’assises.
En matière de scellés, je suis entièrement d’accord avec notre collègue Cécile Untermaier. Pour répondre à notre collègue Dominique Raimbourg, il faut nécessairement un fait nouveau ou un élément inconnu à l’appui de la révision ; il ne saurait être question de réviser une décision sur la seule base d’un doute. Le fait ou l’élément doit provoquer un doute sur la culpabilité du condamné, qu’il reviendra à la juridiction de renvoi d’évaluer.
L’acquittement est un vrai sujet. Je ne crois pas souhaitable de revenir sur les décisions d’acquittement. Nous avons également été convaincus que cela relevait plutôt de l’action publique que de la révision. On pourrait imaginer donner au parquet le pouvoir de déclencher une nouvelle enquête dans le délai de prescription.
M. Guy Geoffroy. Je souhaiterais faire une remarque sur la question du caractère définitif des jugements d’acquittement. Je rejoins ce qu’ont dit nos deux rapporteurs – et je les remercie pour la clarté et la force de leurs convictions à ce sujet.
J’ai toujours considéré que la décision d’acquittement était le corollaire – et même le corollaire puissant – du principe fondamental de la présomption d’innocence. Remettre en cause, après une décision d’acquittement devenue définitive, l’idée que la personne ait été acquittée est, d’une certaine manière, une remise en cause de l’existence même du principe de présomption d’innocence.
Si je le dis, c’est parce que j’ai le souvenir très amer de ce qui a pu être dit après le procès en appel de l’affaire d’Outreau. J’étais membre – comme, peut-être, d’autres dans cette salle – de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, qui fut un très grand moment de vie parlementaire et un grand moment de vie tout simplement pour tous ceux qui ont revisité cette affaire terrible tant pour les victimes que pour ceux qui ont failli être victimes de la justice et pour la justice dans son ensemble. J’avais été frappé par l’idée qu’on puisse dire qu’il y a la vérité judiciaire d’une part, et la « vraie » vérité d’autre part. Cela revient à dire que la justice a dit le droit mais que cela n’était que sa vérité et qu’il demeure possible de penser que ce n’est pas la « vraie » vérité. C’est un vrai problème de puissance de l’autorité de la justice dans la société.
À l’issue de la présentation du rapport, la Commission autorise le dépôt du rapport de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales en vue de sa publication.
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
Proposition n° 1
Créer, auprès de la Cour de cassation, une Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, composée de 18 magistrats désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation et dont la présidence serait assurée par le président de la chambre criminelle, et nommer, en son sein, 5 magistrats qui formeraient une commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.
Proposition n° 2
Fixer à trois ans renouvelables une fois la durée des fonctions de membre de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.
Proposition n° 3
Fixer, dans la loi, les règles assurant l’impartialité des magistrats de la Cour de révision et de réexamen comme du parquet intervenant devant cette juridiction.
Proposition n° 4
Donner à la Cour de révision et de réexamen statuant en révision la faculté expresse d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
Proposition n° 5
Permettre à la Cour de révision et de réexamen statuant en réexamen d’annuler la décision attaquée lorsqu’elle renvoie l’affaire devant une juridiction de fond.
Proposition n° 6
Prévoir que l’annulation de la décision par la Cour de révision et de réexamen entraîne la suppression de la fiche correspondante au sein du casier judiciaire.
Proposition n° 7
Indiquer que la commission d’instruction transmet à la Cour de révision et de réexamen les demandes qu’elle juge recevables et, en ce qui concerne les demandes en révision fondées sur l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu, préciser que la commission transmet à la Cour les demandes pour lesquelles un tel fait ou élément a effectivement été produit ou révélé postérieurement à la condamnation.
Proposition n° 8
Confier à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen les mêmes pouvoirs d’investigation que ceux du juge d’instruction.
Proposition n° 9
Permettre à la commission d’instruction de transmettre au parquet les éléments susceptibles de justifier l’ouverture d’une information judiciaire, lorsqu’il apparaît qu’un tiers est impliqué dans la commission de faits. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à la suite de cette transmission, les investigations ne sont pas confiées à un magistrat instructeur et à un service de police ou de gendarmerie ayant déjà eu à connaître de l’affaire.
Proposition n° 10
Permettre au condamné qui demande la révision ou le réexamen d’une condamnation pénale d’accéder au dossier, de demander des actes à la commission d’instruction, de prendre la parole en dernier à l’audience et d’être assisté par un avocat, au besoin commis d’office.
Proposition n° 11
Aviser de façon systématique la partie civile des demandes en révision ou en réexamen examinées par la Cour de révision et de réexamen, afin qu’elle puisse présenter des observations écrites ou orales, y compris sur une demande de suspension de peine, et lui permettre d’accéder au dossier et d’être assistée par un avocat, au besoin commis d’office.
Proposition n° 12
Ouvrir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins ainsi qu’aux petits-enfants.
Proposition n° 13
Élargir la liste des autorités susceptibles d’introduire un recours en révision au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu’aux procureurs généraux près les cours d’appel.
Proposition n° 14
Prévoir que la révision peut être demandée lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu est de nature à faire naître le « moindre doute » sur la culpabilité du condamné.
Proposition n° 15
Faire figurer le cas indéterminé avant les cas déterminés au sein de l’article du code de procédure pénale présentant les cas d’ouverture à révision.
Proposition n° 16
Prévoir que la révision peut être demandée lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu établit l’innocence du condamné ou est de nature à faire naître le moindre doute sur la culpabilité du condamné.
Proposition n° 17
Permettre la conservation des scellés criminels pour une période de cinq ans renouvelable lorsque le condamné, préalablement informé, s’oppose à la destruction des scellés ordonnée par le procureur conformément à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Proposition n° 18
Permettre au condamné, préalablement à la saisine de la Cour de révision et de réexamen, de demander au procureur de la République la réalisation d’actes d’investigation.
Proposition n° 19
Enregistrer systématiquement les débats des cours d’assises, en laissant au président de la cour le choix d’ordonner un enregistrement sonore ou audiovisuel.
Proposition n° 20
Réaliser un bilan de l’application de la loi du 10 août 2011 en matière de motivation.
LISTE DES AUDITIONS CONDUITES PAR LA MISSION D’INFORMATION
Jeudi 19 septembre 2013
— M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation
— Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l’Homme
Lundi 23 septembre 2013
— Me Dominique Inchauspé, avocat
— Mme Sandrine Zientara, conseillère chargée de la législation pénale au cabinet de la garde des Sceaux
— Mme Lucie Jouvet, docteur en sociologie
— Me Jean-Yves Le Borgne, avocat
— M. Denis Seznec, président de l’association France Justice, et Me Jean-Marc Florand, avocat
— Me Sylvain Cormier, avocat
Jeudi 3 octobre 2013
— M. Philippe Castel, président de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
— M. Philippe Bilger, magistrat honoraire
— Mme Magali Lafourcade, magistrate, docteur en droit
— Me Dominique Foussard, avocat
— M. Pascal Clément, ancien garde des Sceaux
Jeudi 10 octobre 2013
— M. Roland Agret, président de l’association Action Justice
— Me Yves Baudelot, avocat
— Mme Soizic Le Guiner et Mme Marie-Noëlle Le Pajolec, directrices générales déléguées de l’Institut génétique Nantes-Atlantique
— M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation
— Me Sylvie Noachovitch, avocate
— M. Bruno Cotte, magistrat à la Cour pénale internationale, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
— Mme Monique Radenne, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales
Jeudi 17 octobre 2013
— M. Guy Hugnet, journaliste
— Mme Valérie Mahaut, journaliste
— M. Jean-Luc Moignard, président de la commission de révision des condamnations pénales
— M. François Fournié, magistrat
— Me Héliane de Valicourt de Seranvillers, avocate
— M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
— Me Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme
Jeudi 24 octobre 2013
— Me François Saint-Pierre, avocat
— Mme Michèle Alliot-Marie, ancienne garde des Sceaux
— M. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux
— Mme Virginie Valton, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats et Mme Céline Parisot, secrétaire nationale
— M. François Capin-Dulhoste, sous-directeur de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces, et Mme Line Bonnet, chef du bureau de l’exécution des peines et des grâces
Jeudi 31 octobre 2013
— M. Xavier Gadrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature, et Mme Délou Bouvier, membre
— M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire
–– M. Alexandre Giuglaris, délégué général de l’Institut pour la Justice, et M. Jean Pradel, professeur des universités
— M. Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire, membre du Conseil supérieur de la magistrature
— Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, ancienne garde des Sceaux
Jeudi 7 novembre 2013
— M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation
— Mme Martine Anzani, magistrate honoraire, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales
— Me Valérie Rosano, avocate
— M. Emmanuel Poinas, secrétaire général de Force Ouvrière Magistrats, et Mme Béatrice Brugère, membre du conseil national
Mercredi 27 novembre 2013
— Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice
ANNEXE 1 : CONDAMNATIONS CRIMINELLES AYANT ÉTÉ ANNULÉES DEPUIS 1989
Huit condamnations pénales, concernant neuf personnes, ont été annulées depuis 1989 :
– Le 29 janvier 1990, sur une requête présentée par le garde des Sceaux, la Cour de cassation a annulé sans renvoi la condamnation à mort par contumace de Kurt X. par le tribunal militaire de Metz du 28 mai 1952 (n° 81-94.006) sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale ;
– Le 14 octobre 1998, la Cour de révision a annulé la condamnation à 14 ans de réclusion criminelle de M. Rida X. intervenue le 12 avril 1994 (n° 96-85.082) sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’assises ;
– Le 14 avril 1999, la décision du 17 décembre 1993 condamnant X. à quinze ans de réclusion criminelle a été partiellement annulée, sans renvoi, par la Cour de révision (n° 98-87055), sur le fondement du 3° de l’article 622 du code de procédure pénale ;
– Le 3 avril 2001, la Cour de révision a annulé la décision du 27 janvier 1989 condamnant M. Patrick Dils à la réclusion criminelle à perpétuité sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale (n° 99-84.584) et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’assises ;
– Le 24 mai 2006, l’arrêt du 3 juillet 2003 condamnant M. Guilherme X. à dix ans de réclusion criminelle a été annulé par la Cour de révision sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale (n° 05-86.081) ; l’affaire a été renvoyée devant une nouvelle cour d’assises ;
– Le 13 avril 2010, la Cour de révision a annulé la condamnation du 26 mai 2004 de M. Loïc Sécher à seize ans de réclusion criminelle sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale (n° 10-80.196) et a renvoyé l’affaire devant une nouvelle cour d’assises ;
– Le 13 avril 2010, la condamnation de M. Marc Machin à dix-huit ans de réclusion criminelle, prononcée le 30 novembre 2005, a été annulée, sur une requête conjointe du garde des Sceaux et du condamné, sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale (n° 09-84.531) ; l’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’assises ;
– Le 15 mai 2013, la Cour de révision a annulé la décision du 25 juin 2004 condamnant MM. Abdelkader X. et Abderrahim Y. à vingt ans de réclusion criminelle sur le fondement sur le fondement du 4° de l’article 622 du code de procédure pénale (n° 12-84.818) ; l’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’assises.
ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS DE RÉVISION DEPUIS 1989
Année |
Saisines de la commission de révision |
Décisions de la commission de révision |
Décisions de la Cour de révision | ||||
Irrecevabilité |
Rejet |
Saisine |
Autres |
Annulation |
Rejet | ||
1989 |
51 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1990 |
160 |
51 |
19 |
5 |
2 |
– | |
1991 |
100 |
63 |
70 |
4 |
8 |
6 |
– |
1992 |
95 |
41 |
50 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1993 |
74 |
30 |
31 |
5 |
1 |
1 |
– |
1994 |
143 |
76 |
60 |
4 |
2 |
5 |
2 |
1995 |
114 |
81 |
46 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1996 |
130 |
76 |
42 |
7 |
– |
1 |
– |
1997 |
142 |
86 |
56 |
3 |
3 |
3 |
5 |
1998 |
130 |
67 |
50 |
5 |
3 |
3 |
– |
1999 |
142 |
67 |
39 |
3 |
2 |
3 |
– |
2000 |
174 |
112 |
46 |
3 |
4 |
1 |
6 |
2001 |
180 |
98 |
58 |
6 |
2 |
1 |
2 |
2002 |
142 |
132 |
47 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2003 |
136 |
102 |
33 |
0 |
4 |
2 |
1 |
2004 |
146 |
98 |
30 |
2 |
4 |
– |
– |
2005 |
167 |
110 |
36 |
3 |
8 |
2 |
– |
2006 |
188 |
136 |
40 |
8 |
5 |
3 |
3 |
2007 |
156 |
121 |
42 |
2 |
3 |
4 |
– |
2008 |
143 |
110 |
27 |
4 |
2 |
1 |
3 |
2009 |
135 |
100 |
34 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2010 |
133 |
74 |
29 |
4 |
2 |
3 |
– |
2011 |
124 |
121 |
36 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2012 |
139 |
112 |
25 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2013 (janv.-oct.) |
114 |
58 |
19 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Total |
3358 |
2122 |
965 |
84 |
51 |
33 | |
84 | |||||||
ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DE RÉEXAMEN DEPUIS 2000
Année |
Requêtes |
Décisions |
Reste à juger | ||||||
Reste à juger |
Reçues |
Total |
Irrecevabilité |
Autre |
Rejet |
Renvoi |
Total | ||
2000 |
– |
4 |
4 |
0 |
1 |
1 |
3 | ||
2001 |
3 |
11 |
14 |
4 |
3 |
1 |
8 |
6 | |
2002 |
6 |
2 |
8 |
2 |
1 |
5 |
8 |
0 | |
2003 |
– |
6 |
6 |
0 |
1 |
1 |
5 | ||
2004 |
5 |
4 |
9 |
2 |
2 |
3 |
7 |
2 | |
2005 |
2 |
6 |
8 |
1 |
5 |
6 |
2 | ||
2006 |
2 |
4 |
6 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 | |
2007 |
1 |
8 |
9 |
2 |
3 |
5 |
4 | ||
2008 |
4 |
2 |
6 |
2 |
4 |
6 |
0 | ||
2009 |
– |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 | |||
2010 |
– |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 | |||
2011 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 | ||
2012 |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 | ||
2013 |
– |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
0 | ||
Total |
55 |
16 |
1 |
7 |
31 |
55 |
|||
ANNEXE 4 : LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS PÉNALES DANS LES PAYS EUROPÉENS
Les procédures de révision des condamnations pénales en Europe
(Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni)
Étude réalisée par le Bureau du droit comparé du Service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice – février 2013
Selon les pays, les cas de révision d’une condamnation pénale peuvent être étendus (Allemagne, Italie) ou restreints (Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni). Le plus souvent, la révision d’une condamnation ne peut être réalisée qu’en faveur du condamné. Toutefois, certains pays prévoient aussi des hypothèses de révision au détriment du condamné (Allemagne, Pays-Bas (111), Royaume-Uni).
Parmi les cas de révision, figurent le plus souvent dans les législations, l’existence d’un faux témoignage rendu lors du précédent procès ou bien la révélation de faits nouveaux ou de moyens de preuve inédits.
Dans l’ensemble des pays, le ministère public (112), et presque toujours aussi la personne condamnée (113), sont habilités à introduire une requête en révision d’une condamnation pénale. Selon les législations, d’autres personnes encore, de l’entourage du condamné, peuvent être autorisées par la loi à introduire cette action.
Plusieurs modèles procéduraux existent. La requête en révision peut être examinée par filtres successifs, éventuellement par une commission consultative, jusqu’à une Cour de révision, qui peut être la Cour suprême (Pays-Bas). Elle peut encore être examinée directement par des juridictions ordinaires (Allemagne, États Unis, Italie), qui sont dans certains systèmes, saisies par un service des poursuites (Royaume-Uni) ou par le ministre de la justice (Canada). De façon générale, dans les pays de Comon Law, un filtrage important des requêtes est exercé par le service des poursuites ou le ministère de la justice.
Seront examinés successivement les cas de révision (1), les personnes habilitées à introduire une requête en révision (2) et les procédures (3).
1- Les cas de révision
Les cas dans lesquels des révisions des condamnations pénales sont possibles sont le plus souvent énumérés dans les codes criminels des différents pays.
En Allemagne, il existe 6 cas d’ouverture de la procédure de révision dans l’intérêt du condamné, et 4 cas d’ouverture au détriment de la personne poursuivie (dont les 3 premiers ne sont que la transposition mutatis mutandis des dispositions prévues en cas de condamnation.)
La révision dans l’intérêt du condamné est possible, selon les termes de l’article 359 du code de procédure pénale allemand (« StPO »), dans 6 cas limitativement énumérés :
- si un document produit comme vrai lors des débats, au désavantage du condamné, ne l’était pas ou était falsifié;
- si le témoin ou l’expert a été reconnu coupable d’avoir, volontairement ou par une faute d’imprudence, au désavantage du condamné, violé son serment lors du témoignage fait ou du rapport déposé ou d’avoir volontairement, hors serment, fait une fausse déclaration;
- si un juge ou un juré qui a pris part au jugement s’est rendu coupable d’un manquement pénalement punissable aux devoirs de sa charge, en rapport avec l’affaire, dans la mesure où ce manquement n’a pas été provoqué par le condamné lui-même;
- si un jugement civil, sur lequel le jugement pénal s’est fondé, a été annulé par un autre jugement qui a acquis autorité de chose jugée;
- si de nouveaux faits ou moyens de preuve sont produits qui, seuls ou en liaison avec les preuves antérieurement administrées, sont propres à justifier l’acquittement de l’accusé ou, par l’application d’une loi pénale plus douce, une condamnation pénale moins sévère ou une décision substantiellement différente concernant une mesure de rééducation et de sûreté.
- lorsque la Cour européenne des droits de l’Homme a constaté une violation de la Convention européenne pour la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de ses Protocoles et que le jugement repose sur cette violation.
La révision au détriment de la personne poursuivie peut avoir lieu, selon les termes de l’article 362 StPO, dans 4 cas, dont les trois premiers correspondent, avec les adaptations nécessaires dans leur rédaction, à ceux déjà prévus par l’article 359 StPO.
- si un document produit comme vrai lors des débats, à l’avantage de la personne poursuivie, ne l’était pas ou était falsifié;
- si le témoin ou l’expert s’est rendu coupable d’avoir, volontairement ou par une faute d’imprudence, à l’avantage de la personne poursuivie, violé son serment lors du témoignage fait ou du rapport déposé ou d’avoir volontairement, hors serment, fait une fausse déclaration;
- si le juge ou le juré qui a participé au jugement s’est rendu coupable d’un manquement aux devoirs de sa charge pénalement punissable, en rapport avec l’affaire;
- si un aveu crédible de l’infraction est fait par l’acquitté, qu’il ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire.
En Italie, le code pénal (articles 629 et suivants) vise quatre cas d’admissibilité : les faits fondant la condamnation sont inconciliables avec une autre décision pénale définitive ; la décision de condamnation a retenu que l’infraction était caractérisée sur la base d’une décision du juge civil ou administratif alors que cette décision a été révoquée ou remise en cause suite à une question préjudicielle ; ultérieurement à la condamnation de nouvelles preuves sont découvertes démontrant que la personne condamnée doit être déclarée non coupable ; il peut être démontré que la condamnation a été prononcée sur la base d’un faux ou d’une infraction (114).
En Espagne, la révision des jugements définitifs peut avoir lieu dans les cas suivants (article 954 et suivants) :
- quand deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour les mêmes faits, par deux jugements contradictoires, qui n’ont pu être commis que par une seule personne.
- quand une personne a été condamnée comme auteur ou complice d’un homicide d’une personne dont l’existence est confirmée après la condamnation.
- quand une personne est condamnée en vertu d’un document, d’un témoignage déclarés faux (par décision définitive), ou si les aveux lui ont été arrachés par la violence ou par quelque fait punissable commis par un tiers (condamnés par décision définitive)
- quand, après le jugement survient la connaissance de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve dont la nature rend évidente l’innocence du condamné.
Aux Pays-Bas, il existe trois motifs de révision : une contradiction des jugements ou arrêts ; l’existence d’un fait nouveau ; le fait qu’une réclamation ait pu avoir été introduite avec succès auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (115).
En Roumanie, en vertu de l’article 394 du code pénal, la révision peut être demandée si :
a) sont découverts des faits ou des circonstances qui n’étaient pas connus par la juridiction au moment de la décision ;
b) un témoin, un expert ou un interprète a commis l’infraction de faux témoignage dans l’affaire dont la révision est demandée ;
c) un écrit qui a servi de fondement à l’arrêt dont la révision est demandée, a été déclaré faux ;
d) un membre de la formation de jugement, le procureur ou un enquêteur a commis une infraction en relation avec l’affaire dont la révision est demandée ;
e) deux ou plusieurs arrêts définitifs ne peuvent être conciliés ;
Le cas prévu au a) constitue un motif de révision, si, sur la base des faits ou des circonstances nouvelles, peut être prouvé le caractère non fondé de l’arrêt d’acquittement, de cessation du procès pénal ou de condamnation. Les cas des b), c) et d) constituent des raisons de révision s’ils ont conduit au prononcé d’un arrêt illégal ou non fondé.
Dans le cas prévu au e), tous les arrêts qui ne peuvent être conciliés sont soumis à la révision.
L’article 408 du code pénal traite du cas de révision en cas d’arrêt de la CEDH ou d’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Les arrêts définitifs prononcés dans les affaires où la CEDH a constaté une violation d’un droit prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales peuvent être soumis à la révision, si cette violation continue de produire des conséquences graves auxquelles il ne peut être remédié que par une telle révision. Peuvent demander la révision, la personne dont le droit a été violé ; l’époux et les parents proches du condamné, même après le décès de celui-ci ; le procureur, d’office.
Une décision définitive prononcée dans une affaire dans laquelle la Cour Constitutionnelle a admis une exception d’inconstitutionnalité peut faire l’objet d’une révision si cette décision s’est fondée sur la disposition légale déclarée non conforme à la Constitution ou sur une autre disposition qui lui est nécessairement indissociable. Les parties et la procédure sont les mêmes que pour la révision après arrêt de la CEDH. La juridiction compétente est celle qui a prononcé la décision restée définitive.
La révision peut être sollicitée dans les 3 mois de la publication de la décision de la Cour Constitutionnelle au Journal Officiel de la Roumanie.
Au Royaume-Uni, la loi de 2005 modifiant le Criminal justice Act 2005 ne permet la révision que des affaires les plus graves et pour lesquelles de nouveaux éléments de preuve sont réunis. Ces éléments doivent être fiables, substantiels et d’une valeur probante indiscutable (116).
2- Les personnes habilitées à introduire une requête en révision
Les personnes autorisées à introduire une requête en révision ne sont pas les mêmes selon les systèmes juridiques.
En Allemagne, l’action est intentée par le condamné, et après sa mort par son conjoint, un ascendant ou descendant, un frère ou une sœur, ou encore par le ministère public. En Espagne, peuvent agir le condamné, son conjoint, un ascendant ou descendant, un frère ou une sœur, ainsi que le ministère public. En Italie, peuvent agir le condamné, son conjoint, le tuteur, l’héritier ou le ministère public (117) (procureur général près la Cour d’appel au sein de laquelle a été prononcée la décision critiquée). Aux Pays-Bas, peuvent agir le condamné ou le procureur général de la Cour de cassation. Ce dernier peut, à la demande du condamné, et avant même qu’une demande de révision n’ait été introduite, effectuer une enquête approfondie sur les faits en faisant éventuellement intervenir une commission consultative et une équipe d’enquêteurs (118). Au Royaume-Uni, c’est le service des poursuites pénales (CPS) qui peut agir. En Roumanie, toute partie au procès ainsi que l’époux et les parents proches du condamné, même après sa mort, peuvent demander la révision. Le procureur peut d’office initier la procédure de révision.
3- La procédure
Dans certains pays d’Europe continentale, s’applique parfois le principe des filtres successifs. L’organe saisi procède à une vérification préliminaire, puis décide de rejeter la requête ou de l’accueillir. Si la requête est accueillie, elle est déférée à une Cour de révision qui entend parties et témoins pour finalement trancher au fond. Parfois aussi, une commission peut être saisie aux fins de formuler un avis ou de réaliser un complément d’enquête. Par exemple, aux Pays-Bas, une commission consultative peut – et même doit lorsque le condamné a été condamné à plus de 10 ans de réclusion – être saisie aux fins de procéder à un complément d’enquête. Une fois l’enquête achevée, la Cour de cassation est saisie et peut décider, soit que la demande en révision est fondée, ou non fondée. Dans la seconde hypothèse, la haute juridiction peut statuer elle-même sur la demande ou renvoyer devant une Cour d’appel. Si la condamnation est maintenue, la peine peut être modifiée (119).
Dans d’autres pays d’Europe continentale la requête en révision peut être examinée, selon un modèle différent, directement par des juridictions ordinaires. En Allemagne, la juridiction compétente est en principe une juridiction de même nature située dans la même Cour d’appel que celle ayant rendu le jugement contesté, la répartition du contentieux de la révision étant effectuée chaque année par la commission de direction de la Cour d’appel. La désignation d’un défenseur pour le condamné qui n’en a pas est obligatoire dès le dépôt de la requête en révision, mais elle peut également avoir lieu avant même que la requête soit déposée, pour la préparation de celle-ci, lorsque la juridiction compétente l’estime nécessaire (120). L’examen de la recevabilité de la requête en révision a lieu sur dossier, au vu de la requête et des conclusions du parquet. Si la requête a été déclarée recevable, elle doit être signifiée aux autres parties au jugement contesté, un délai étant fixé à celles-ci pour qu’elles présentent leurs observations. Commence alors l’instruction du dossier par un juge désigné par le tribunal, qui peut procéder de lui-même à la collecte des preuves (121). À l’issue de l’instruction, la juridiction compétente se prononce par décision motivée sur la nécessité de rejuger ou non l’affaire. Si la juridiction compétente estime avoir déjà recueilli des preuves suffisantes, elle peut –mais uniquement avec l’accord du ministère public-, acquitter immédiatement le condamné sans renvoyer l’affaire à une audience de jugement. Si l’affaire est renvoyée en audience de jugement, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent. Les décisions qui ont été rendues en première instance par le tribunal à l’occasion d’une requête en révision peuvent être attaquées par un pourvoi immédiat. En Italie, la requête est encore examinée directement par une juridiction. La juridiction compétente pour examiner la demande de révision est la cour d’appel désignée conformément aux règles du code de l’organisation judiciaire, qui peut accueillir ou bien rejeter la requête. En cas de recours en révision fondé, la décision critiquée est annulée, les biens saisis et les amendes payées restitués, le dommage causé réparé (durée de détention, prise en compte des conséquences personnelles et familiales nées de la condamnation). En cas de rejet de la requête, la condamnation litigieuse est confirmée, la suspension de la peine ou de la mesure de sûreté cesse et le requérant est condamné au paiement des frais de justice. La décision sur le fond de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Une décision de rejet ne fait pas obstacle à une requête fondée sur des faits différents. En Roumanie, c’est la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance qui est compétente pour juger la requête en révision (art 401) (122). La requête en révision est adressée au procureur du parquet près la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance. La juridiction, après avoir entendu les conclusions du procureur et des parties, apprécie si la requête en révision est introduite dans les conditions de la loi et s’il résulte des preuves réunies au cours de l’enquête effectuée par le procureur suffisamment d’éléments propres à la rendre recevable en principe. La juridiction, si elle constate que la requête en révision est fondée, annule la décision et en prononce une nouvelle. La juridiction décide, le cas échéant, la restitution de l’amende payée et des sommes confisquées, ainsi que la restitution des frais de justice au bénéficiaire de la révision, et pour les condamnés à une peine d’emprisonnement avec exécution sur le lieu de travail, la restitution du montant versé au budget d’Etat et la prise en compte de la durée de la peine exécutée comme ancienneté et continuité dans l’emploi. Lorsque la juridiction constate que la requête en révision n’est pas fondée, elle la rejette. Les décisions de la juridiction de révision, prononcées conformément à l’art. 403 al 3 et à l’article 406 al 1, sont soumises aux mêmes voies de recours que les arrêts auxquels la révision fait référence, en ce qui concerne les décisions d’appel, elles sont soumises au pourvoi.
Dans les Pays de Common law, la matière fait l’objet de règles différentes et confère à d’autres acteurs de la procédure, le service des poursuites ou le ministre de la justice, un rôle essentiel en matière de filtrage des requêtes. En Angleterre, le service des poursuites (CPS) peut faire une demande « application for retrial » auprès de la Cour d’appel avec l’accord préalable du « Director of public prosecutions, aux fins de réviser la condamnation, ou même, d’annuler l’acquittement d’une personne ayant fait l’objet d’un procès antérieur. Cette demande et cet accord doivent être transmis à la Cour d’appel pour que celle-ci rende une ordonnance annulant la décision originale et ordonne un nouveau procès. La personne mise en cause est alors considérée comme innocente. Elle peut être laissée libre, placée sous caution ou sous détention. Son procès a ensuite lieu selon les règles habituelles. Au Canada, l’article 690 du code criminel permet à l’individu qui a épuisé tous les recours judiciaires de présenter une demande au ministre de la justice aux fins de revoir le cas. Le ministre peut après instruction de la requête, rejeter la demande, prescrire un nouveau procès ou renvoyer devant la Cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel régulier.
Aux États-Unis, s’appliquent des règles encore plus particulières. Dans les deux ans qui suivent un verdict de culpabilité, l’avocat de l’accusé peut présenter une requête en nouveau procès en invoquant l’existence de preuves nouvelles à décharge et en démontrant que ces preuves étaient inconnues jusque-là et qu’elles sont de nature à renverser le verdict. Le juge apprécie le bien fondé de la requête et s’il l’estime bien fondée, annule le verdict. Mais la procédure peut recommencer si le poursuivant lance de nouvelles poursuites pour le même fait.
4-Statistiques
En Allemagne, curieusement, il n’existe aucune statistique sur le nombre des révisions effectivement prononcées en matière pénale. Les seules données fiables concernent le nombre des requêtes en révision examinées en 2011, le "taux de succès" effectif des requêtes présentées étant inconnu, même si le taux de 3 % est parfois utilisé, de manière empirique, dans les articles rédigés par les avocats spécialisés (123). Cette absence totale de données disponibles a été confirmée publiquement par le Premier Président de la Cour de cassation allemande (124).
En 2011, selon les chiffres du Statistisches Bundesamt (Fachserie 10, Reihe 2.3), ont été traitées :
- devant les tribunaux d’instance statuant en matière pénale, c’est-à-dire lorsque la peine encourue ne dépasse pas 4 années d’emprisonnement, 1580 requêtes en révision (886 dans l’intérêt du condamné, et 694 au détriment de la personne poursuivie). Encore faut-il en déduire, pour permettre une comparaison utile, les affaires ne portant que sur une condamnation à une amende contraventionnelle (« Bußgeldverfahren »), au nombre de 336.
- devant les tribunaux de grande instance statuant en matière pénale (y compris en matière criminelle), 193 requêtes en révision (160 dans l’intérêt du condamné, et 33 au détriment de la personne poursuivie)
En ne retenant, aux fins de comparaison avec la situation française, que les procédures de révision dans l’intérêt du condamné devant les tribunaux de grande instance statuant en matière pénale (crimes inclus), et en appliquant le « taux de succès » empirique de 3 % avancé par les avocats pénalistes au chiffre de 160 pour l’année 2011, on peut estimer de manière très approximative à 4,8 par an le nombre des révisions prononcées au bénéfice du condamné (125).
Tous les dossiers de révision n’étant pas médiatisés, en particulier lorsqu’il s’agit de délits, on peut penser - sur la base de ces observations – que le nombre des révisions dans l’intérêt du condamné, s’agissant des procédures devant les tribunaux de grande instance statuant en matière pénale (y compris en matière criminelle), se situe actuellement entre deux et quatre par an.
Ces statistiques incluent les cas des procédures de révision entrant dans le cadre du réexamen d’une décision après arrêt de la CEDH (126).
En Italie, la Cour de cassation a prononcé 124 décisions en 2012 portant sur un arrêt d’appel en matière de révision. Nous ne disposons pas de statistiques relatives au nombre de décisions rendues au niveau des Cours d’appel (127).
Aux Pays-Bas, certains éléments statistiques sont contenus dans le rapport de la Cour suprême pour l’année 2012.
Le nombre de jugements rendus par la Cour de cassation en matière de révision était de: 103 en 2008, 100 en 2009, 65en 2010, et 50 en 2011.
S’agissant du nombre de révisions accordées, il est assez variable selon les années : 22 en 2008, 44 en 2009, 7 en 2010, 14 en 2011, et 14 en 2012.
Les décisions ayant donné lieu à un refus étaient de : 70 en 2008, 43 en 2009, 40 en 2010, 17 en 2011 et 22 en 2012.
Les requêtes déclarées irrecevables étaient au nombre de : 11 en 2008, 13 en 2009, 18 en 2010, 19 en 2011 et 22 en 2012 (128).
Sur l’ensemble des requêtes en révision, seuls trois cas concernent des révisions consécutives au prononcé d’un arrêt de la CEDH :
- une révision en 2005 : amende réduite par le Hoge Raad après violation de l’article 8 de la Convention
- une révision en 2009 : peine réduite par le Hoge Raad après violation de l’article 8 de la Convention
-une révision en 2013 (129).
En Roumanie, les éléments statistiques sur le nombre de révisions apparaissent dans le tableau ci-dessous.
À noter que la compétence de la Haute Cour pour les révisions consécutives aux arrêts de la CEDH et de la Cour Constitutionnelle roumaine est trop récente (2011) pour que des procédures aient atteint ce stade (130).
2010 |
2011 |
2012 | |||||||
Stock |
Nvx |
Décisions |
Stock |
Nvx |
Décisions |
Stock |
Nvx |
Décisions | |
Tribunal |
375 |
2222 |
2225 |
369 |
2398 |
2365 |
380 |
2512 |
2560 |
Tribunal de grande instance |
384 |
1666 |
1678 |
356 |
1319 |
1503 |
173 |
1209 |
1218 |
Cour d’Appel |
122 |
696 |
677 |
141 |
1179 |
1128 |
196 |
902 |
872 |
Au Royaume-Uni, le rapport de la Cour d’appel fait état d’un seul jugement en révision « retrial » pour l’année 2011/2012.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES PERSONNES ENTENDUES
Contribution de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation 125
Contribution de Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 137
Contribution de Me Dominique Inchauspé, avocat 157
Contribution de Me Jean-Yves Le Borgne, avocat 165
Contribution de Me Jean-Marc Florand, avocat 167
Contribution de M. Roland Agret, président de l’association « Action Justice » 171
Contribution de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation 181
Contribution de Me Sylvie Noachovitch, avocate 193
Contribution de M. Bruno Cotte, magistrat à la cour pénale internationale, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation 199
Contribution de Mme Monique Radenne, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales 213
Contribution de M. Jean-Luc Moignard, président de la commission de révision des condamnations pénales 221
Contribution de M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation 227
Contribution de M. Jean-Olivier Viout, membre du Conseil supérieur de la magistrature 241
Contribution de M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation 253
Contribution de Mme Martine Anzani, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales 263
Contribution de Me Valérie Rosano, avocate 273
Contribution de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation
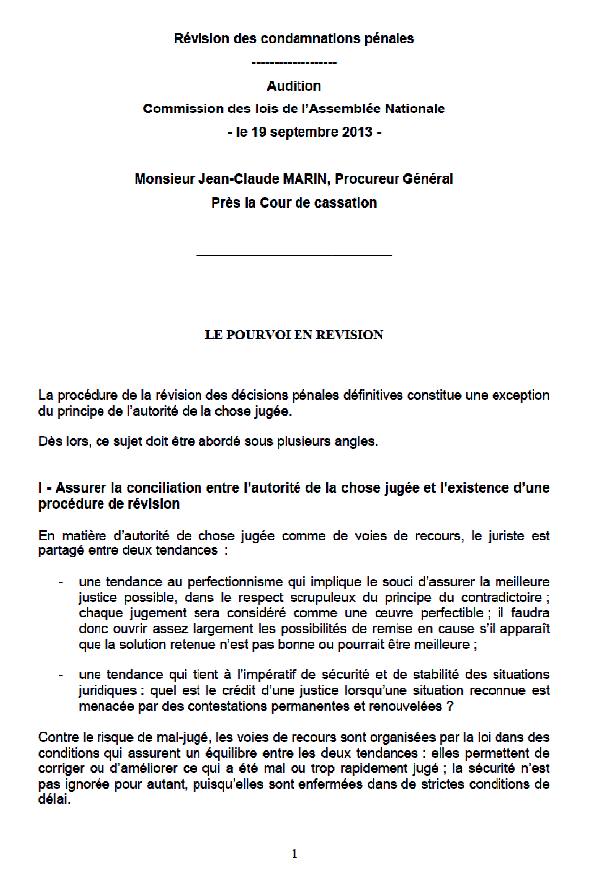
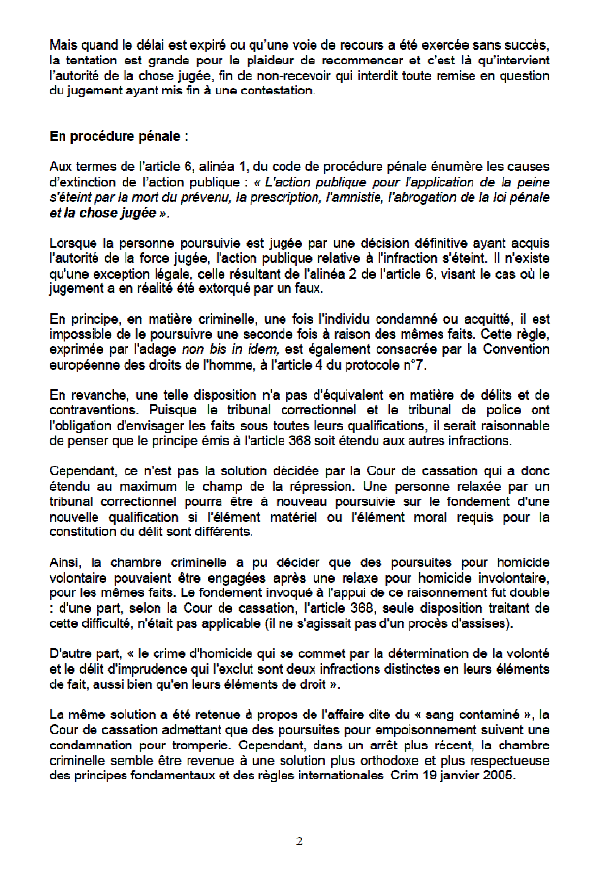
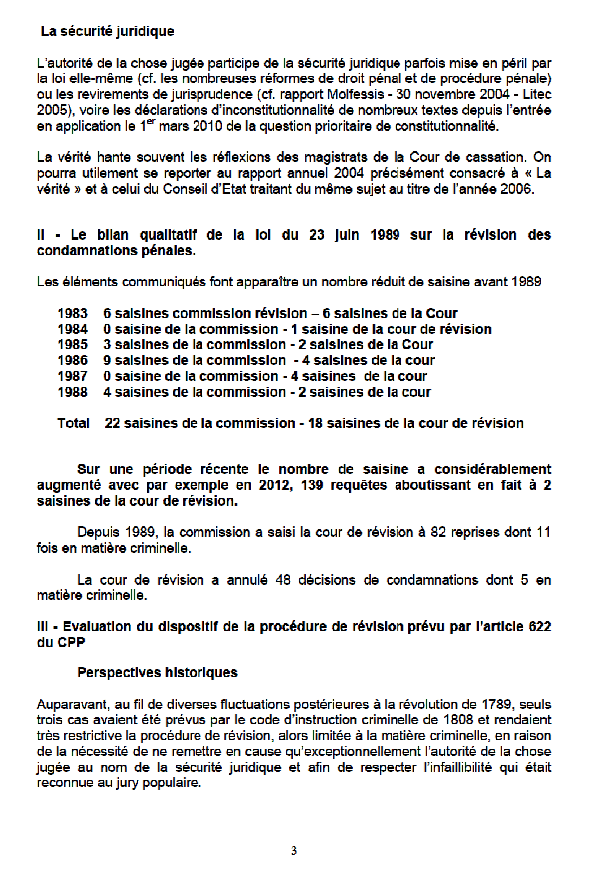
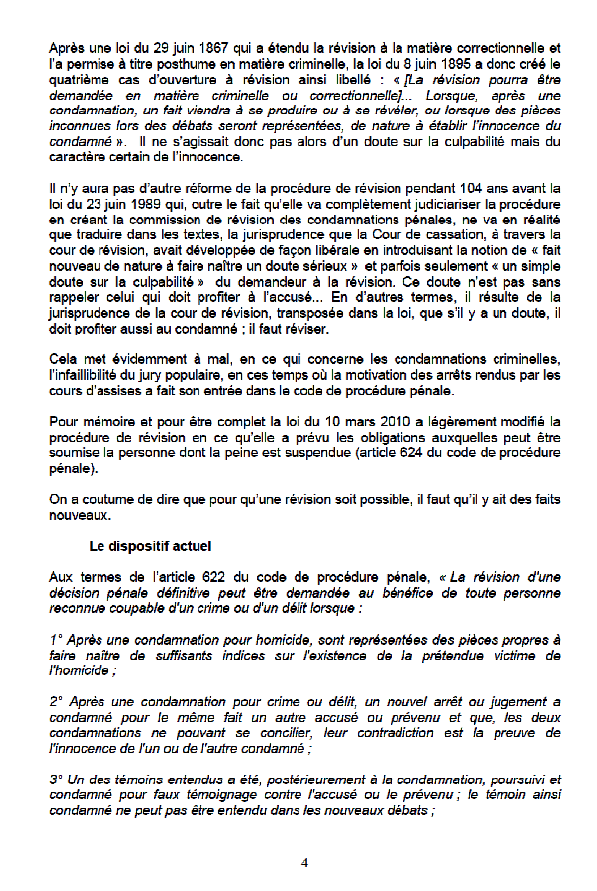
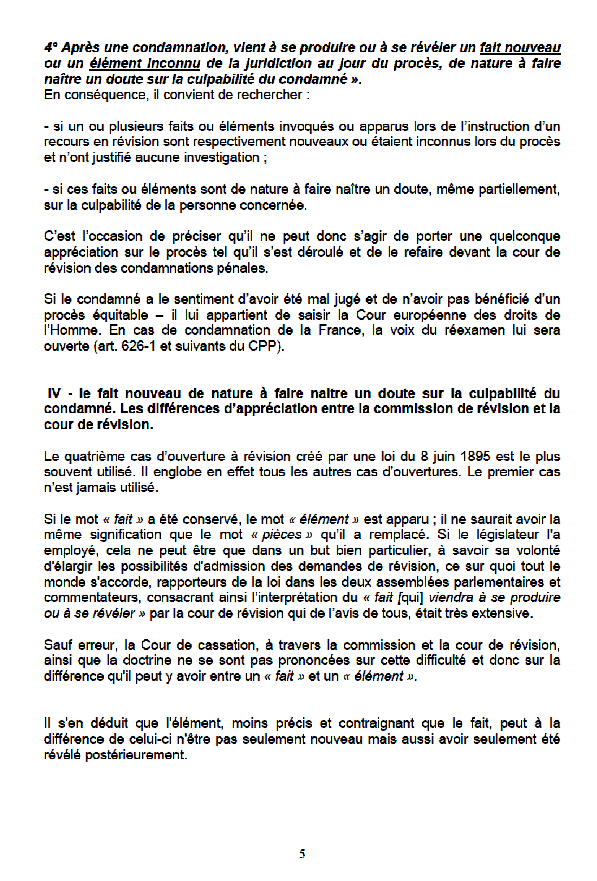
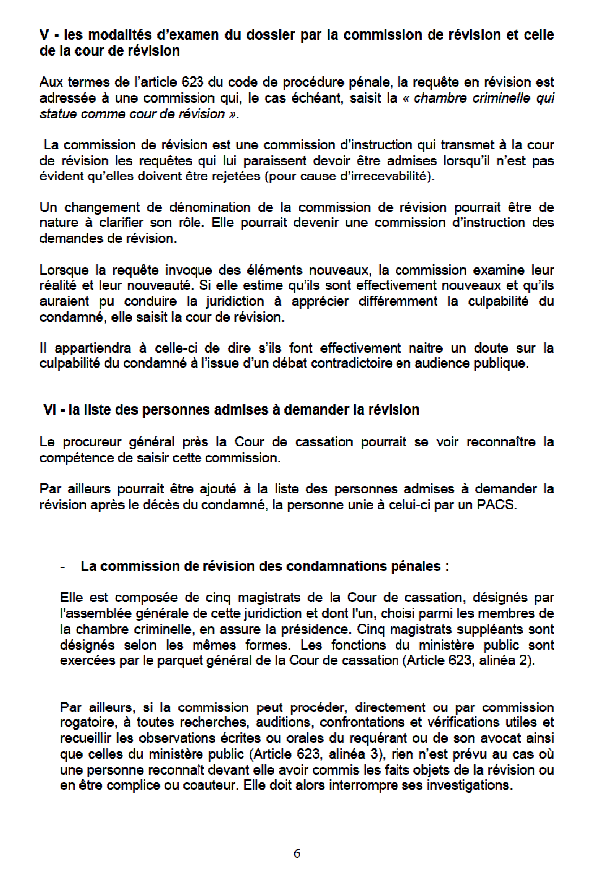
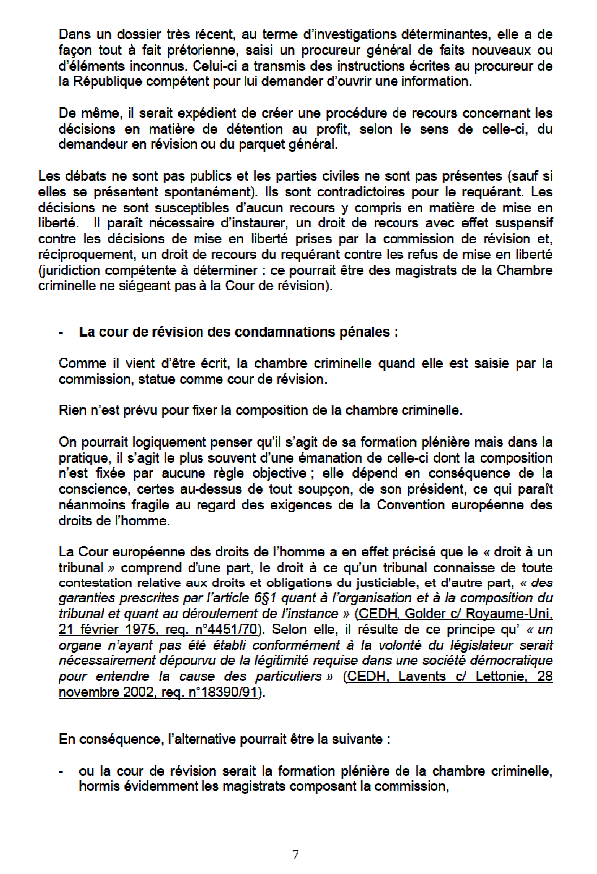
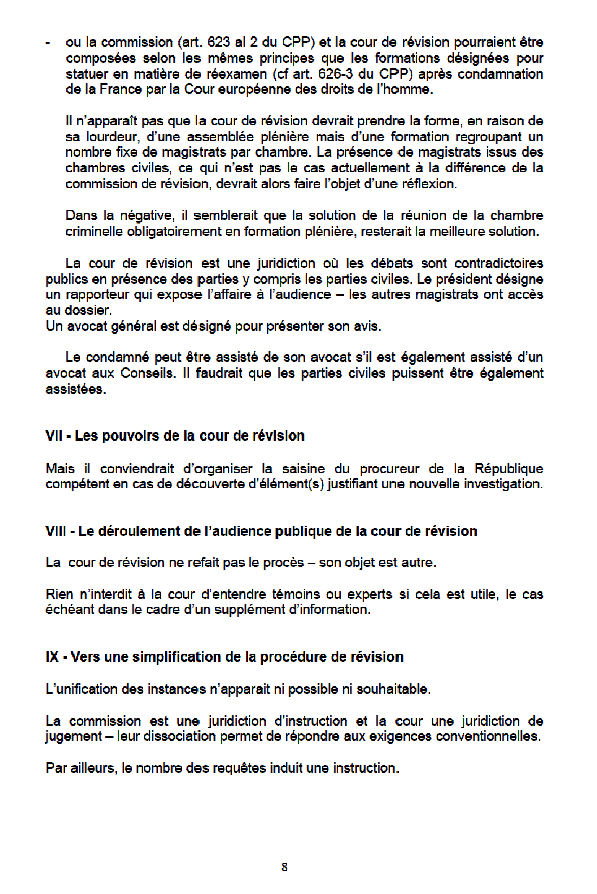
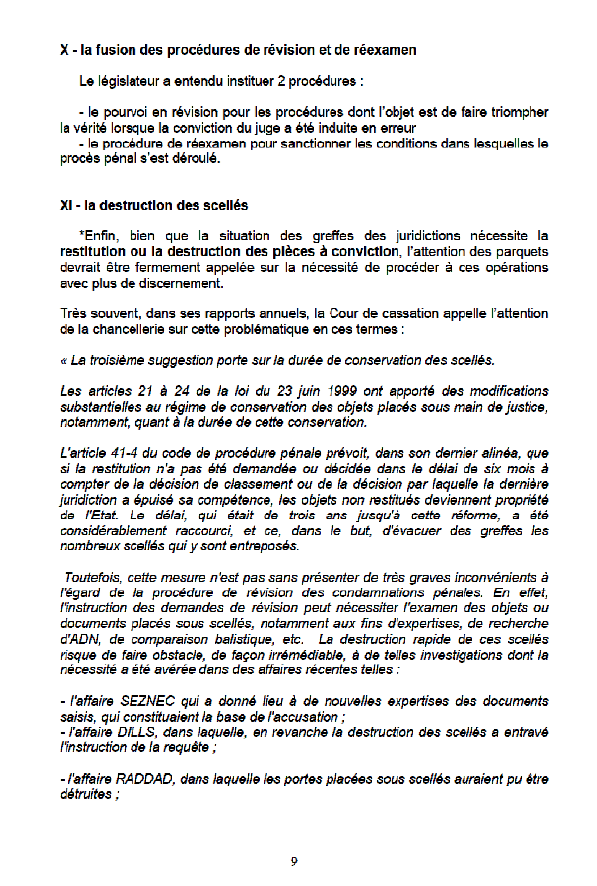
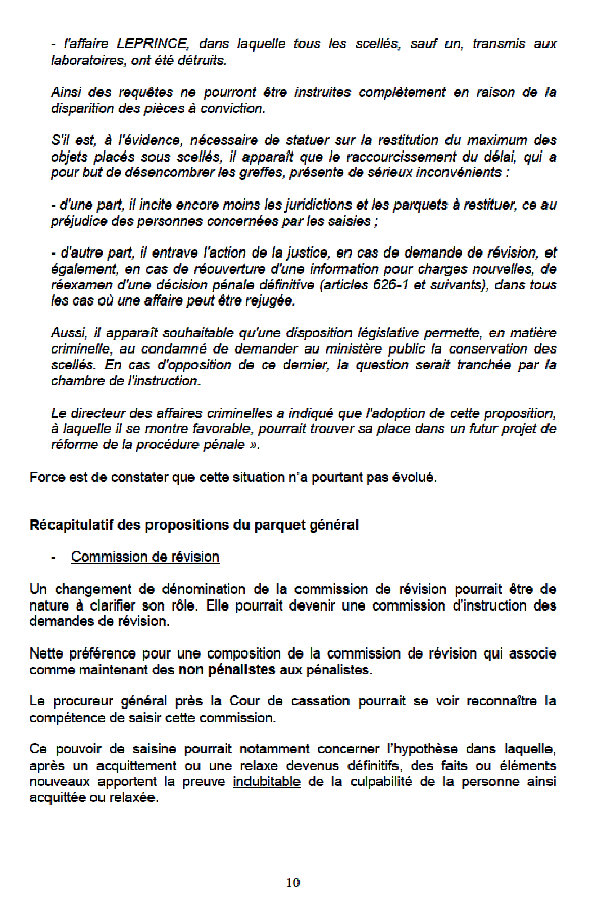
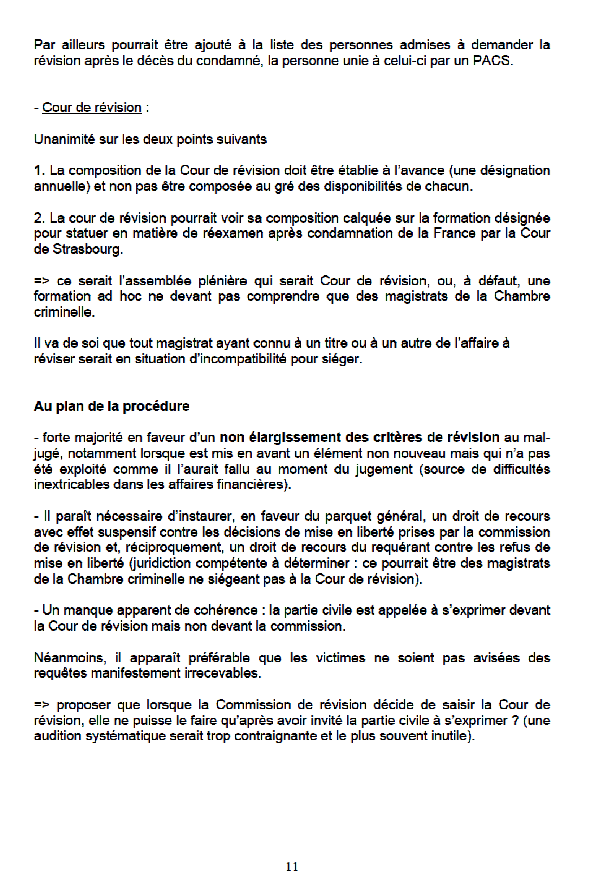
Contribution de Mme Christine Lazerges, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
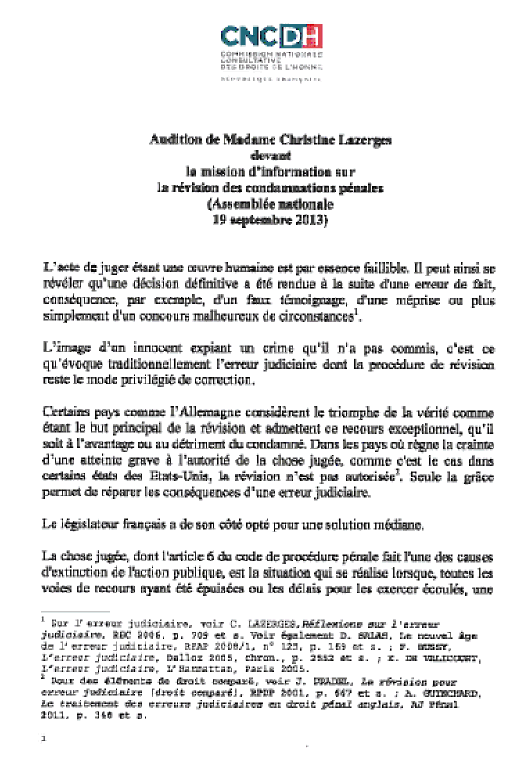
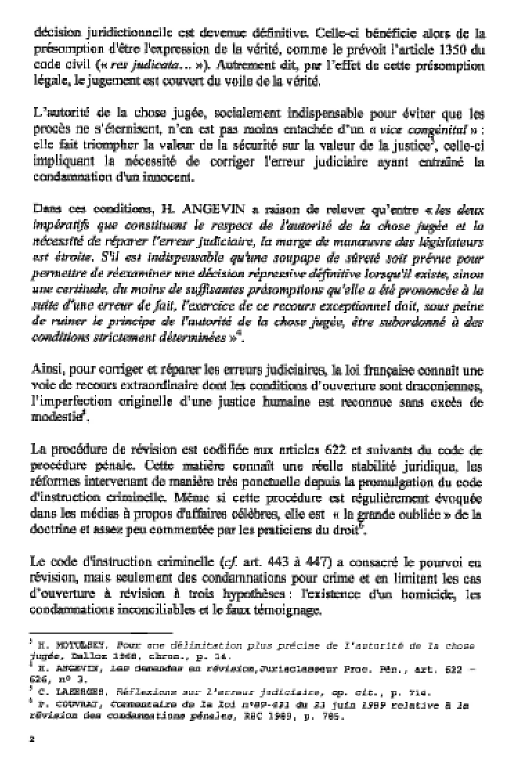
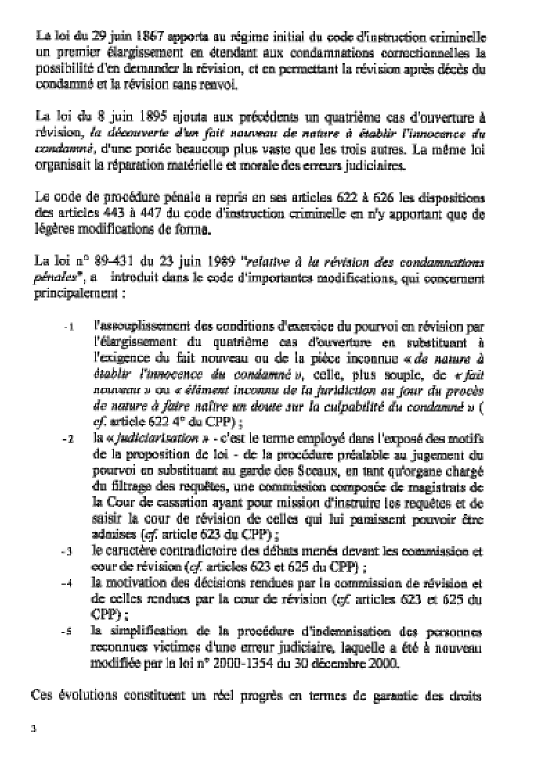
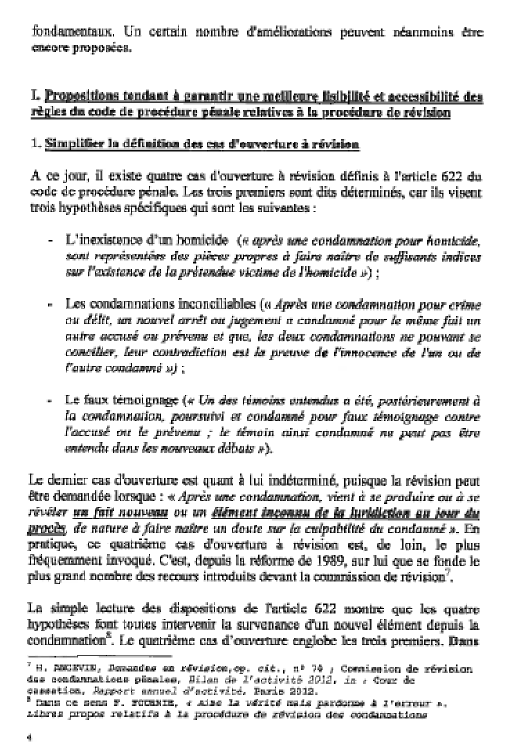
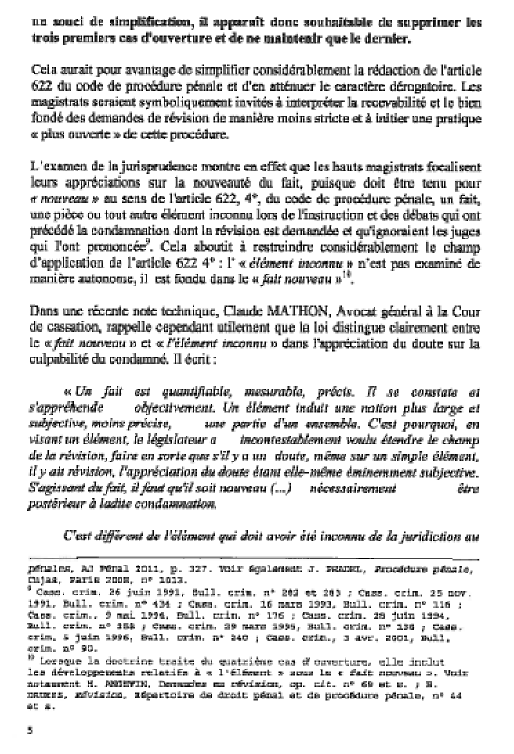
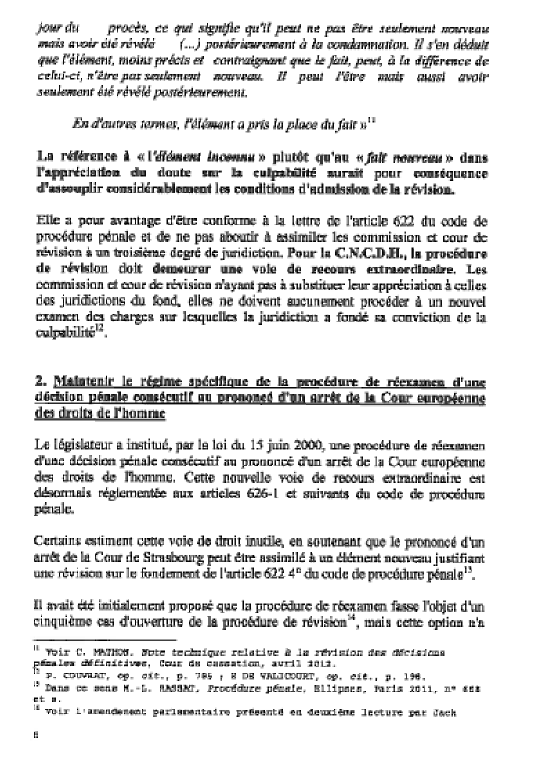
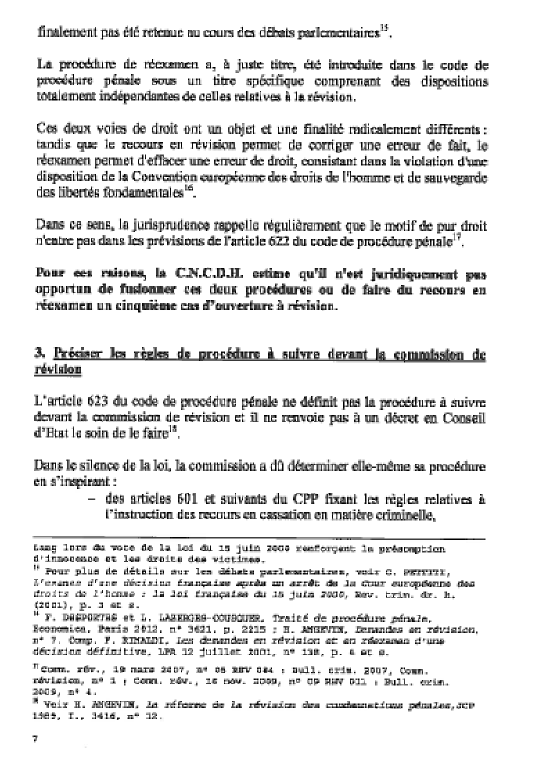
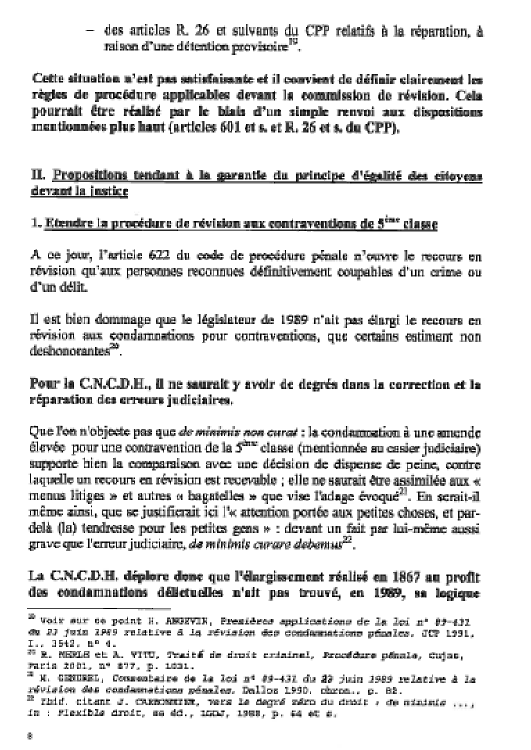
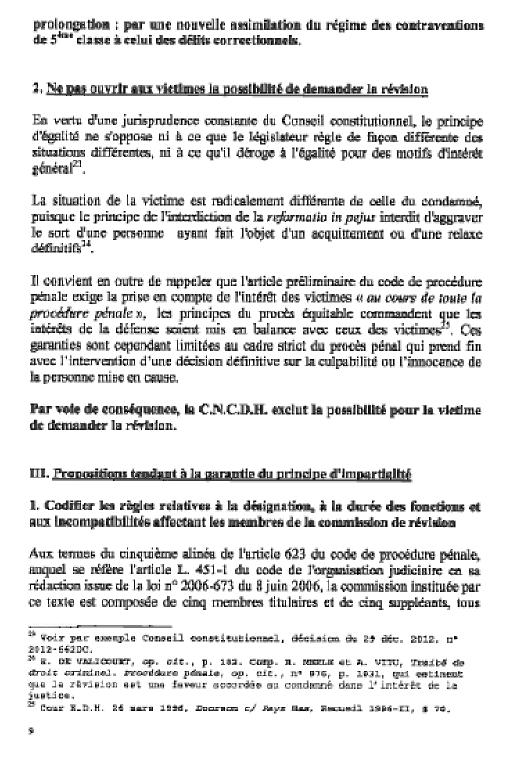
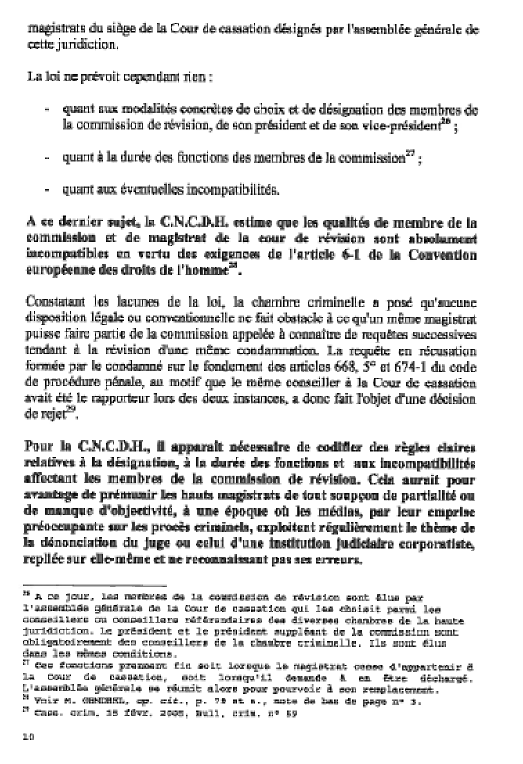
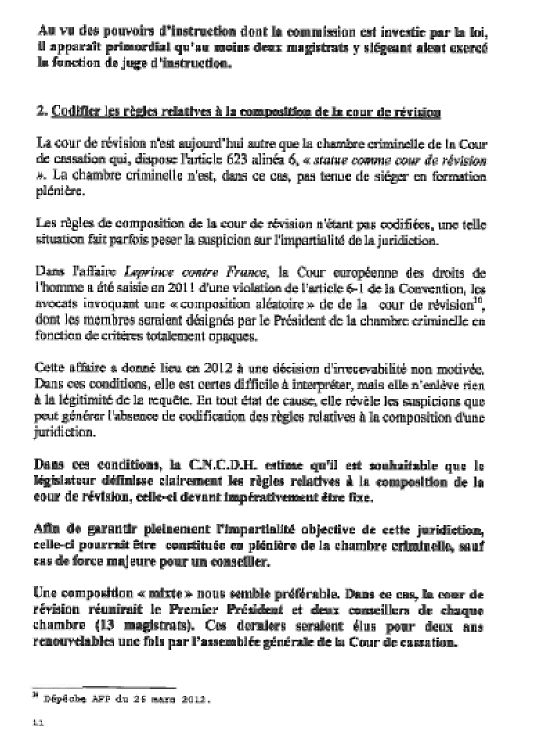
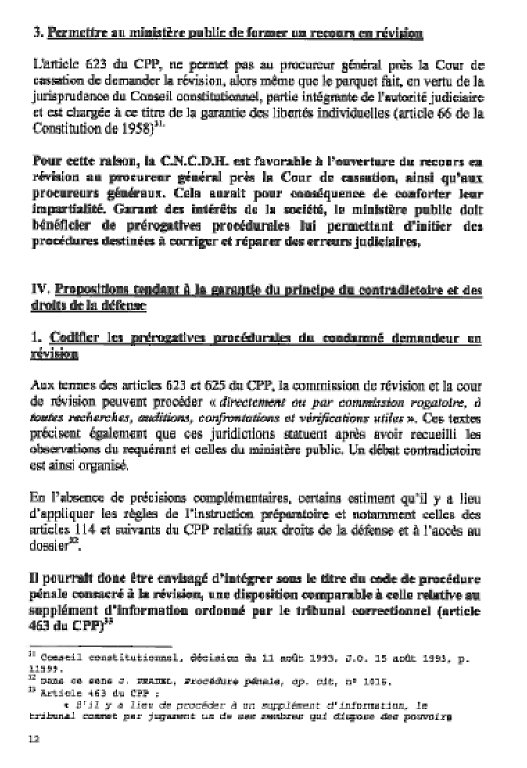
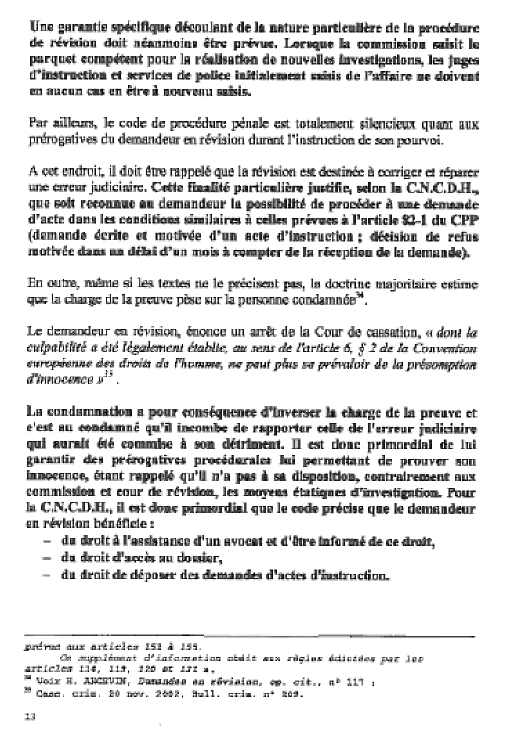
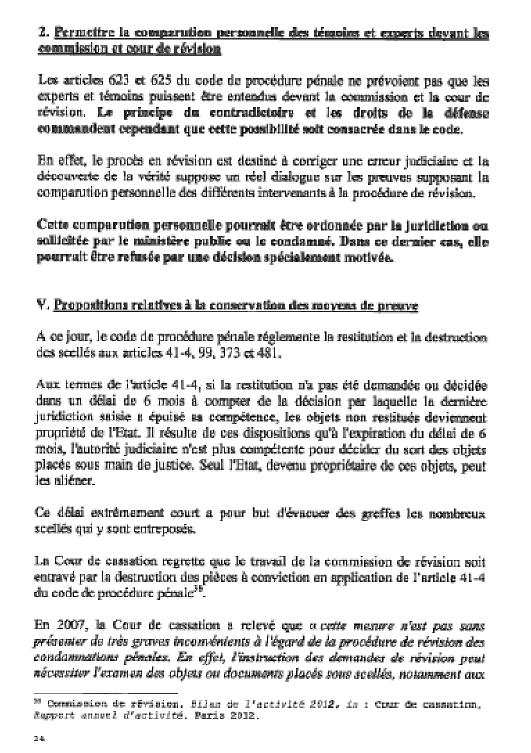
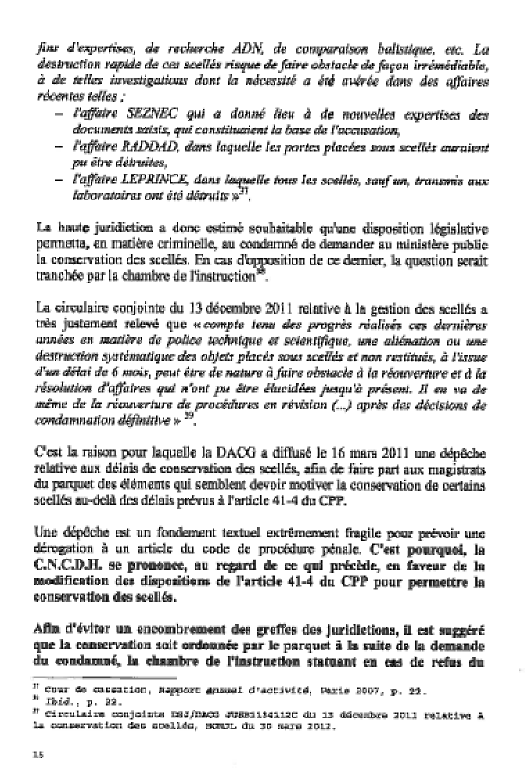
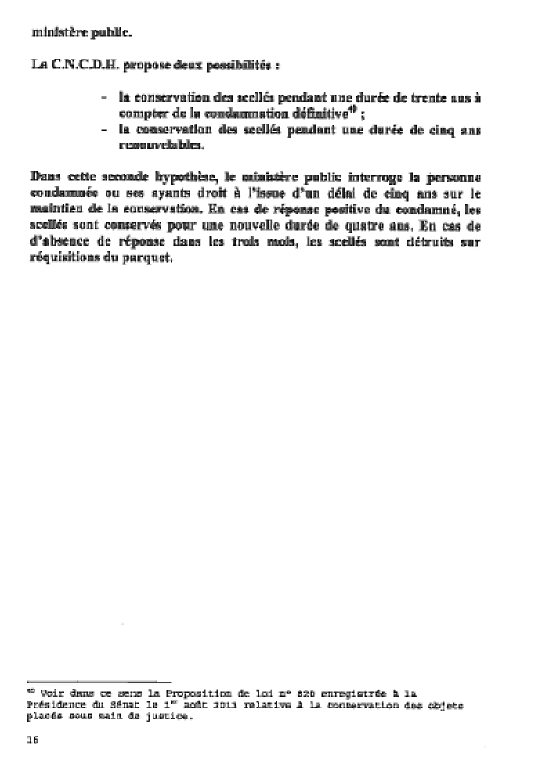
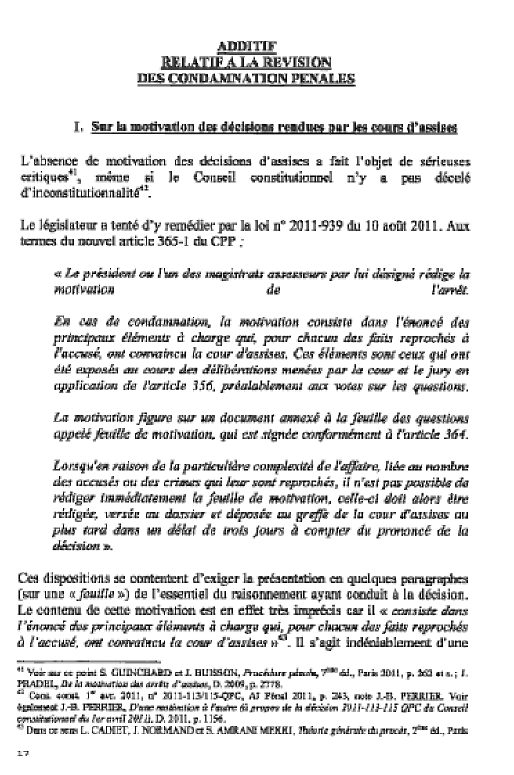
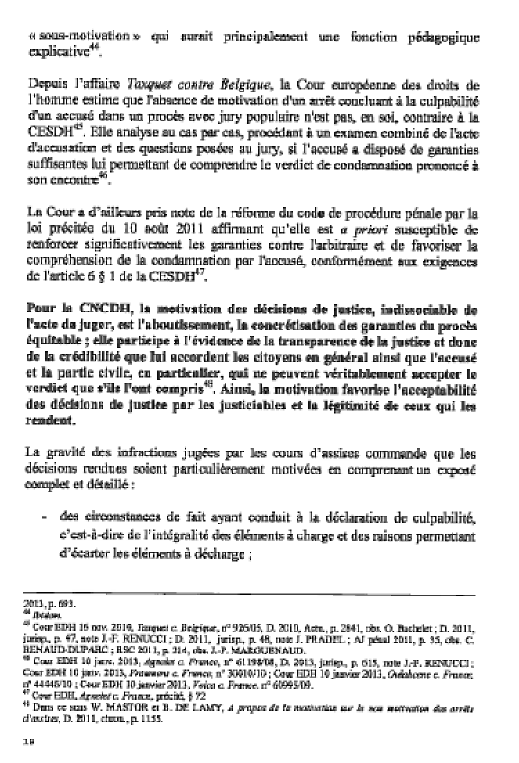
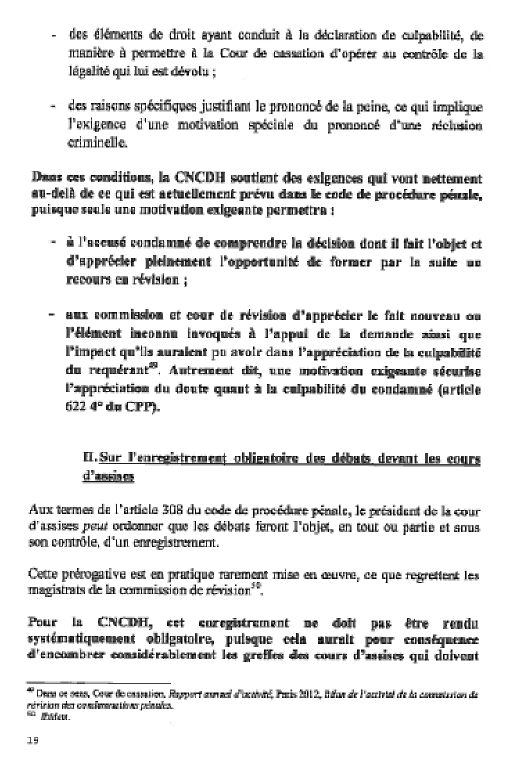

Contribution de Me Dominique Inchauspé, avocat

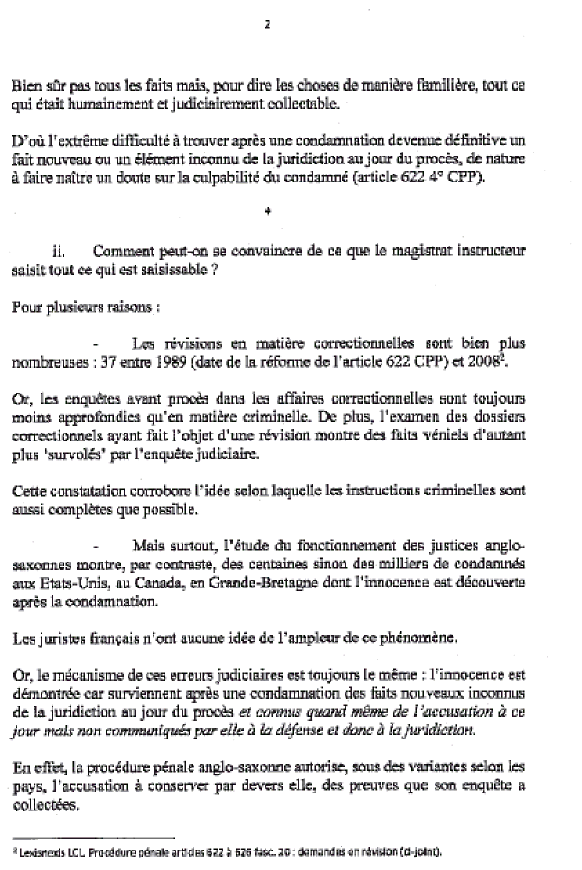

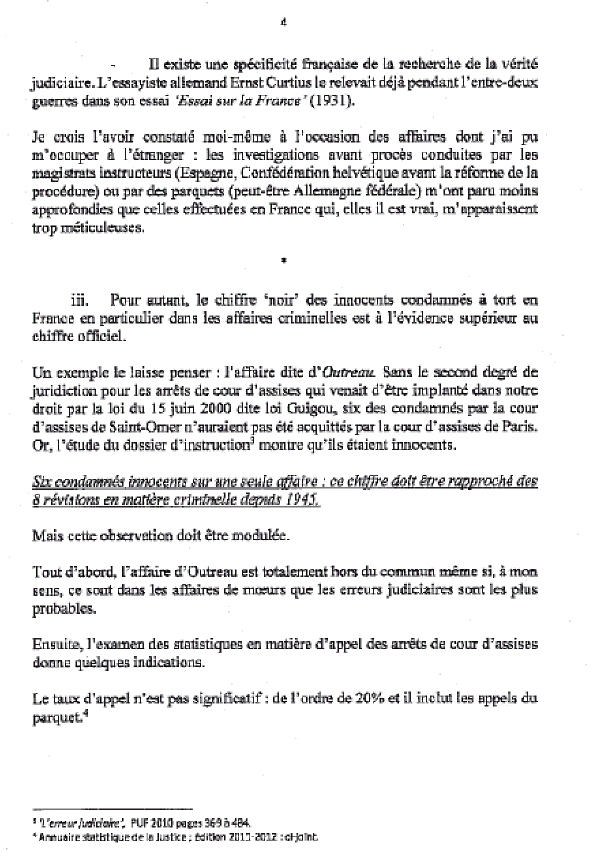
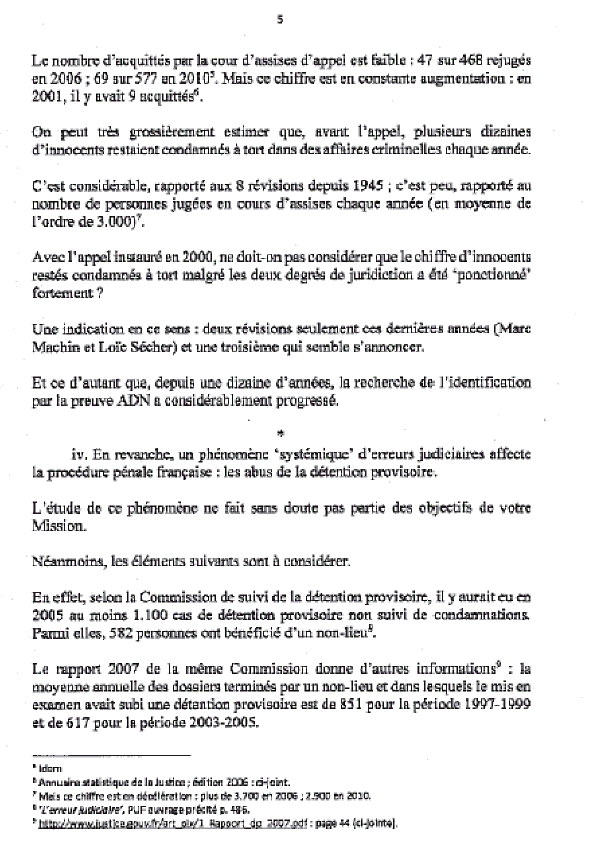
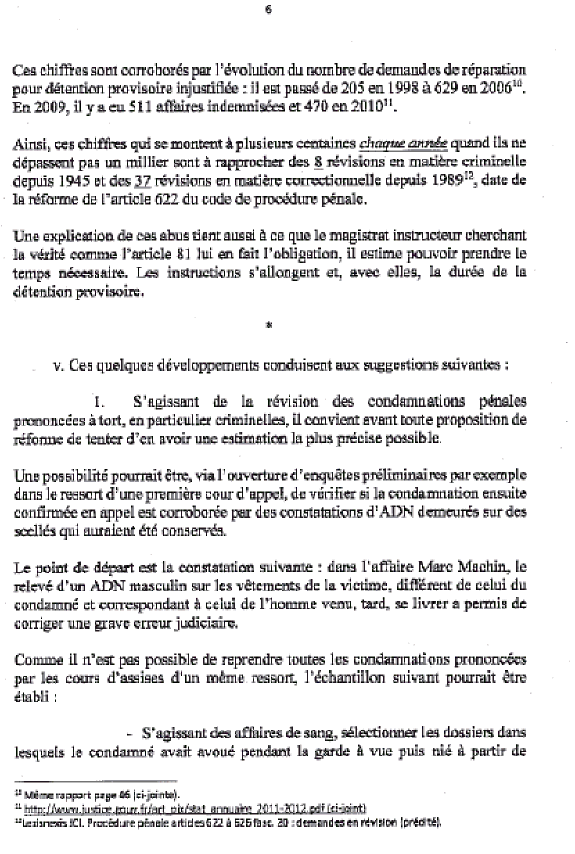
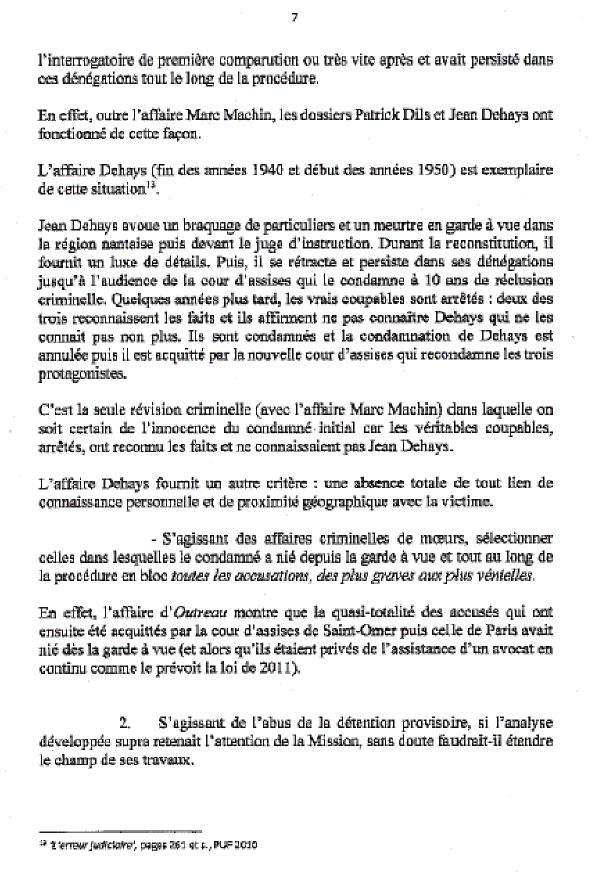

Contribution de Me Jean-Yves Le Borgne, avocat
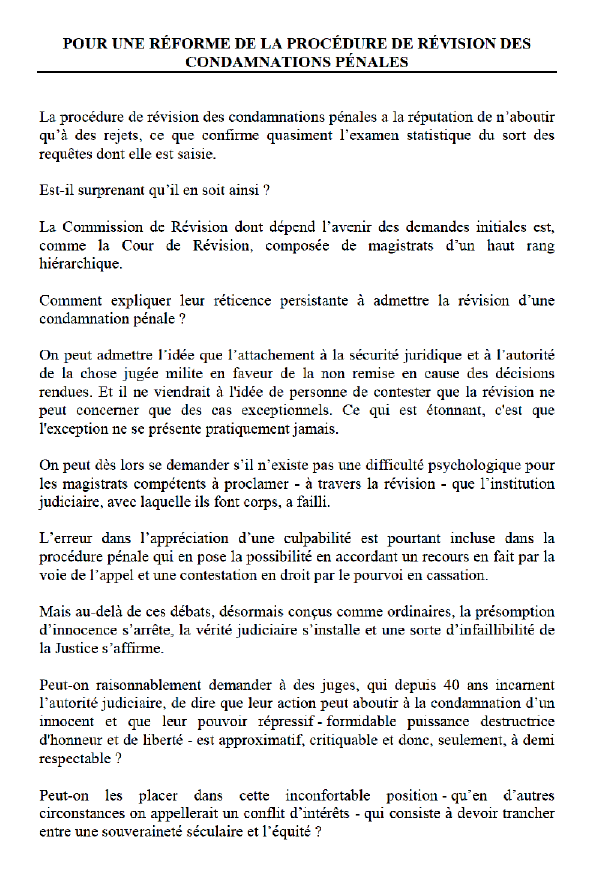
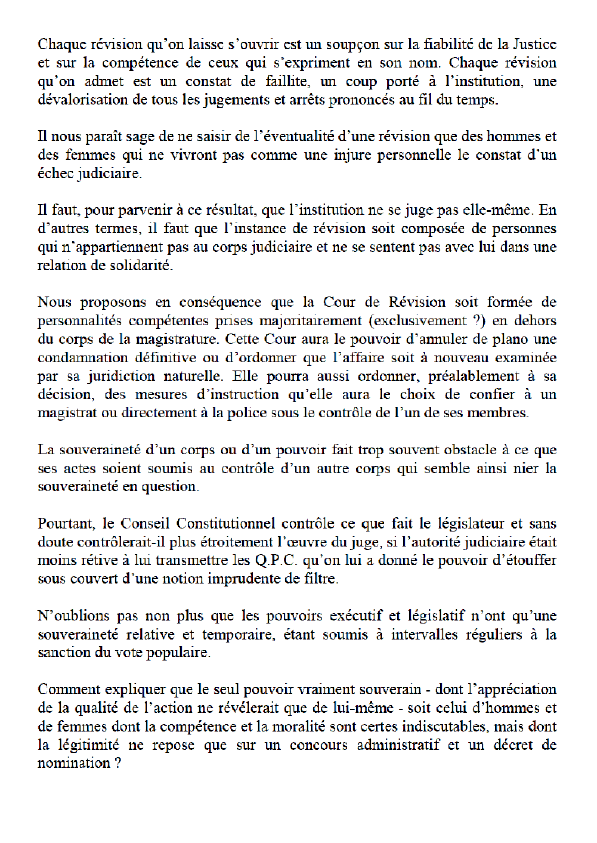
Contribution de Me Jean-Marc Florand, avocat
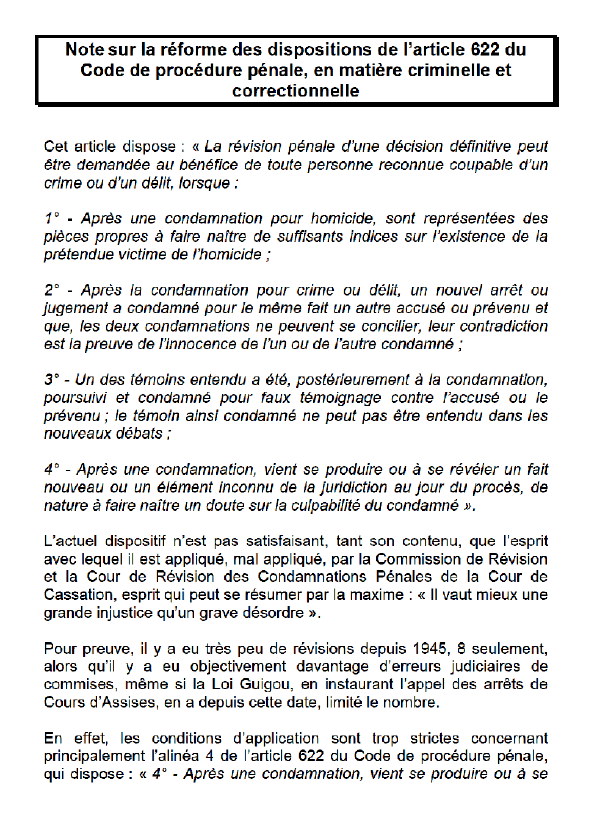
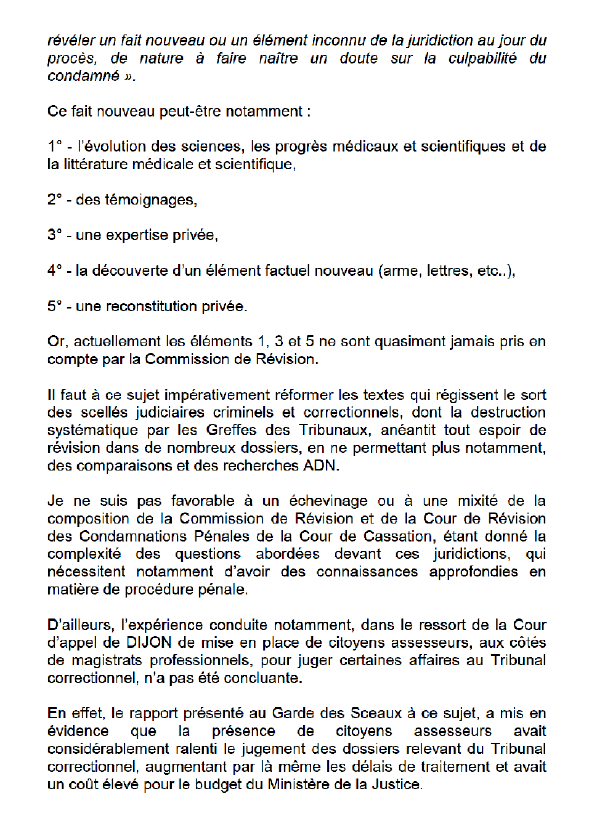
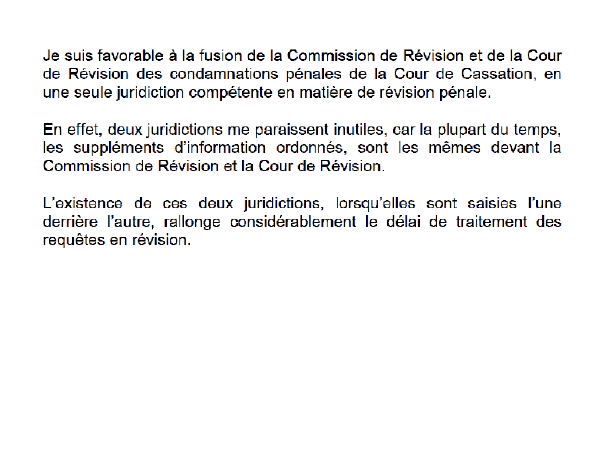
Contribution de M. Roland Agret, président de l’association « Action Justice »
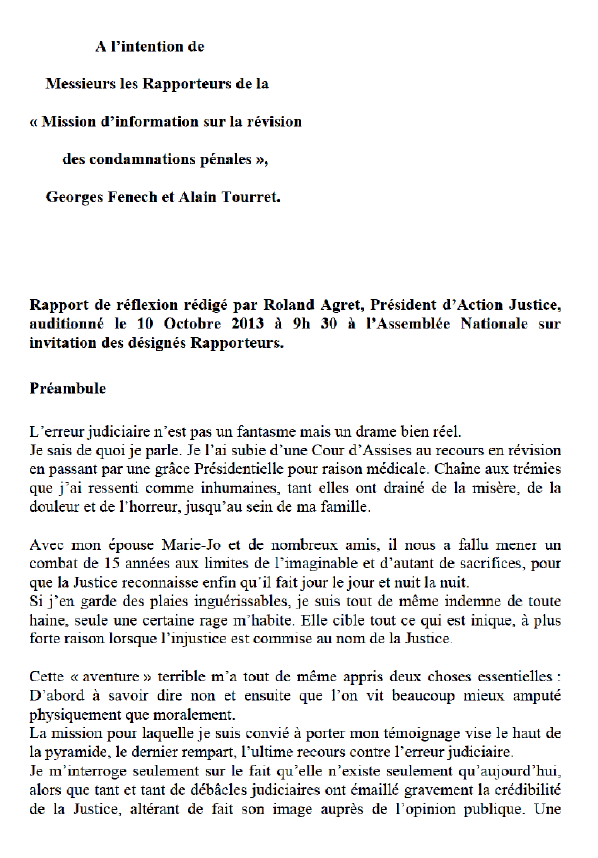
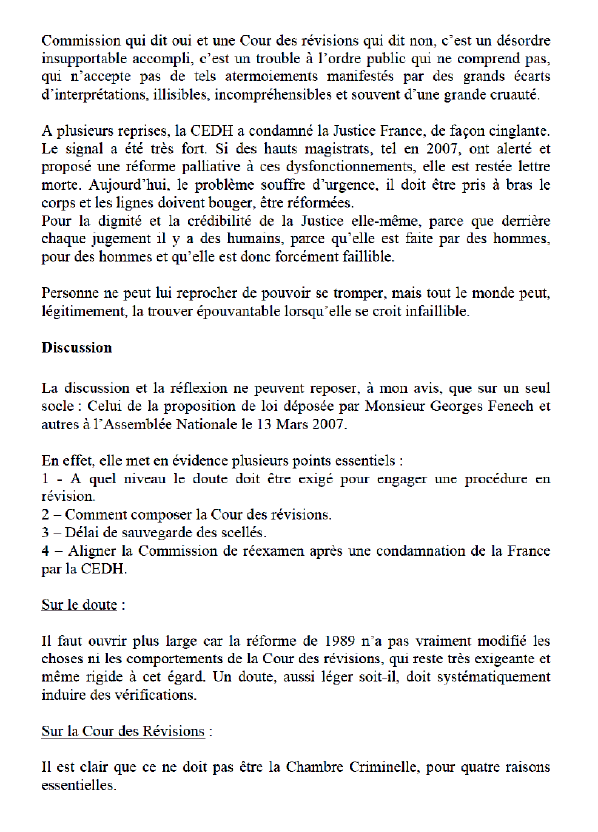
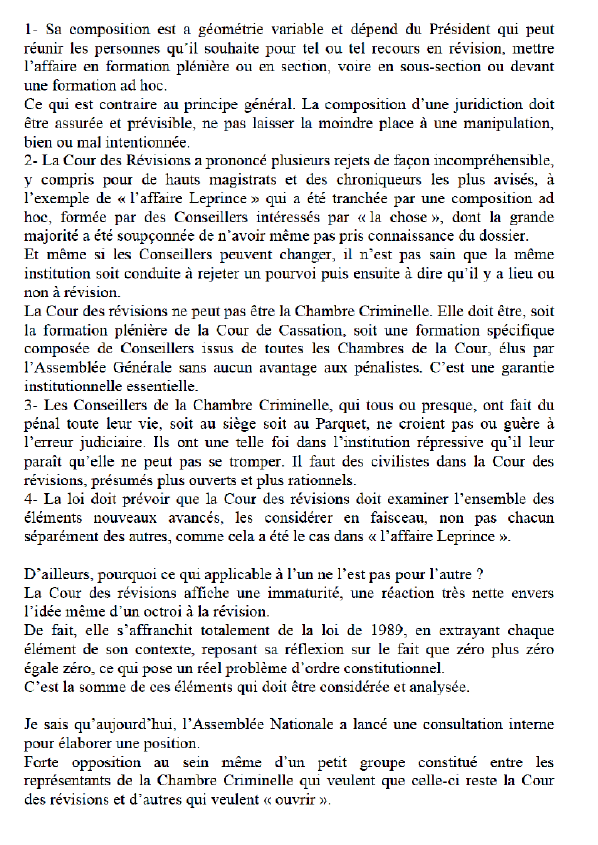
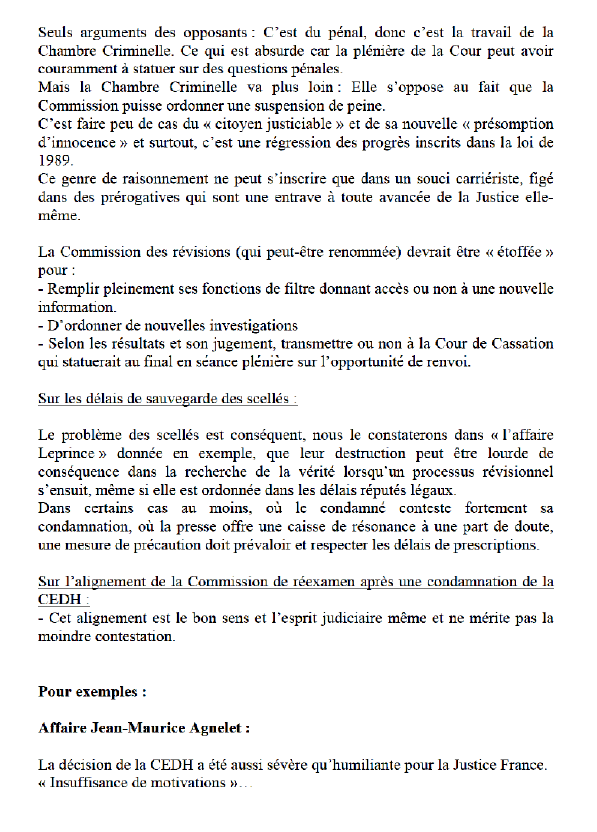
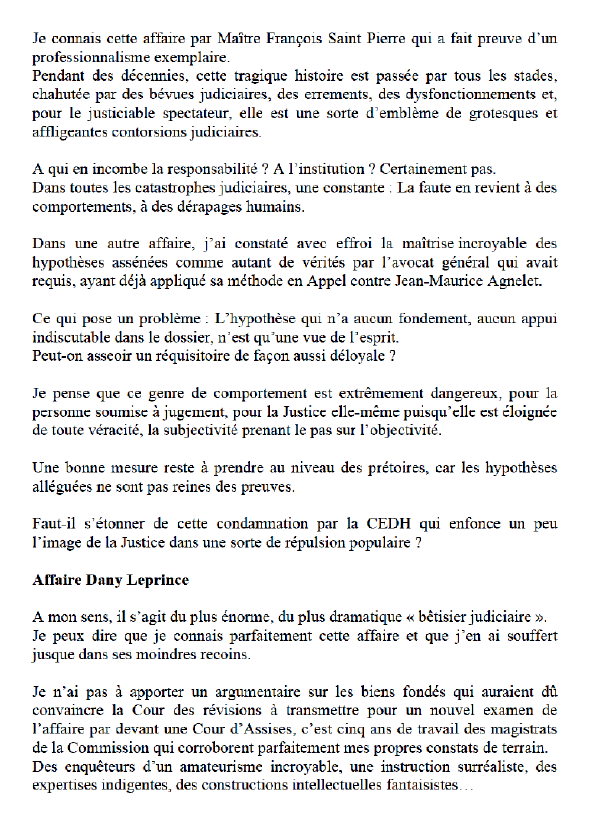
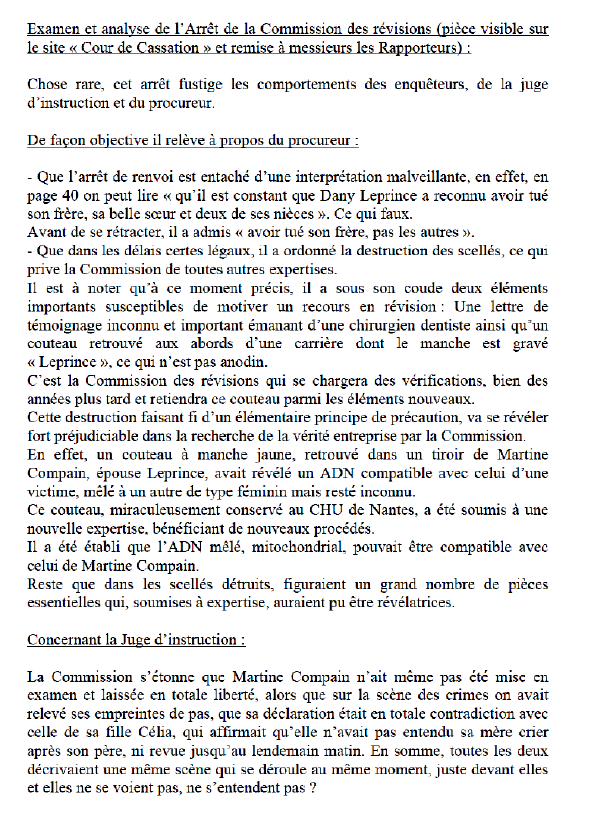
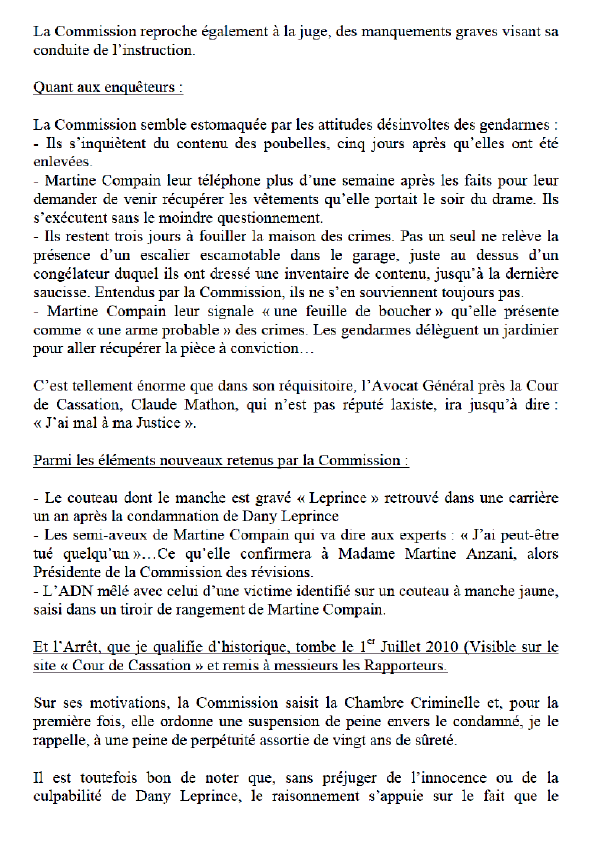
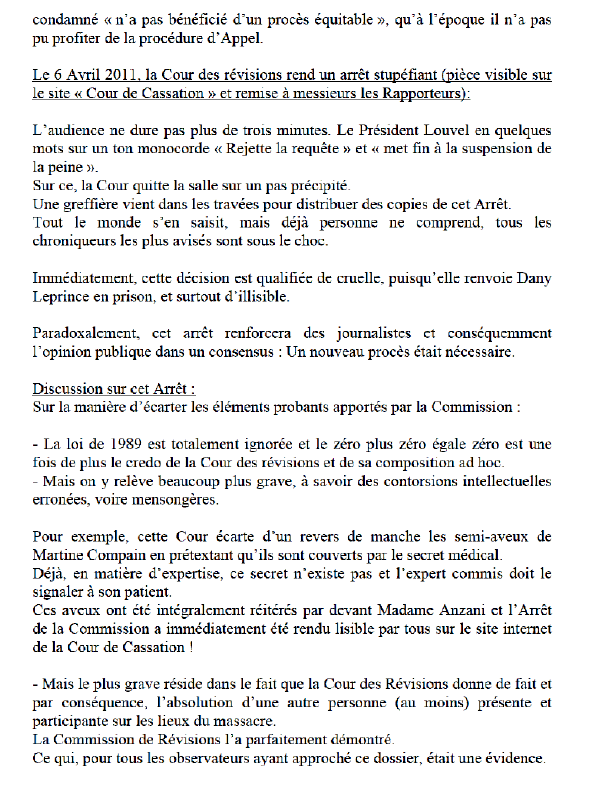

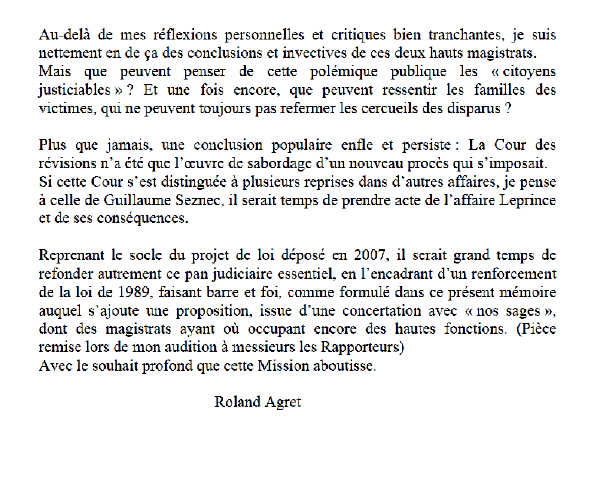
Contribution de M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation
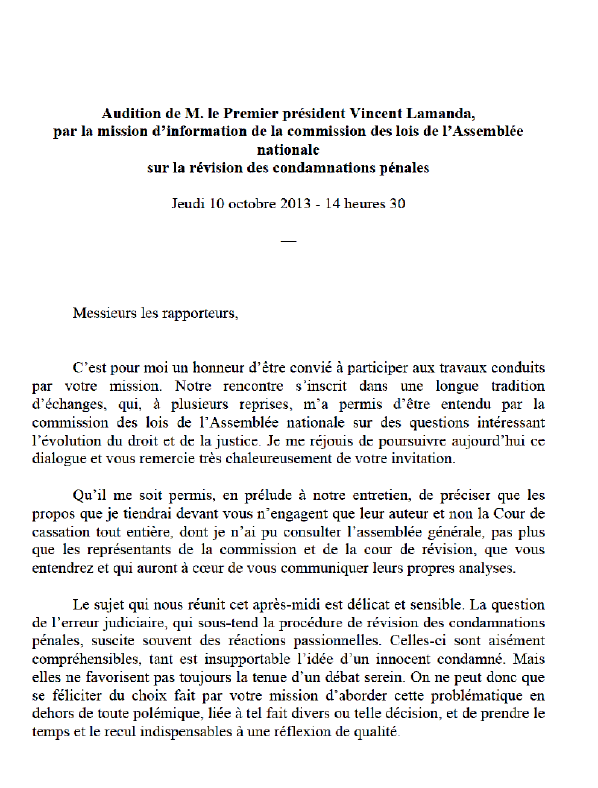
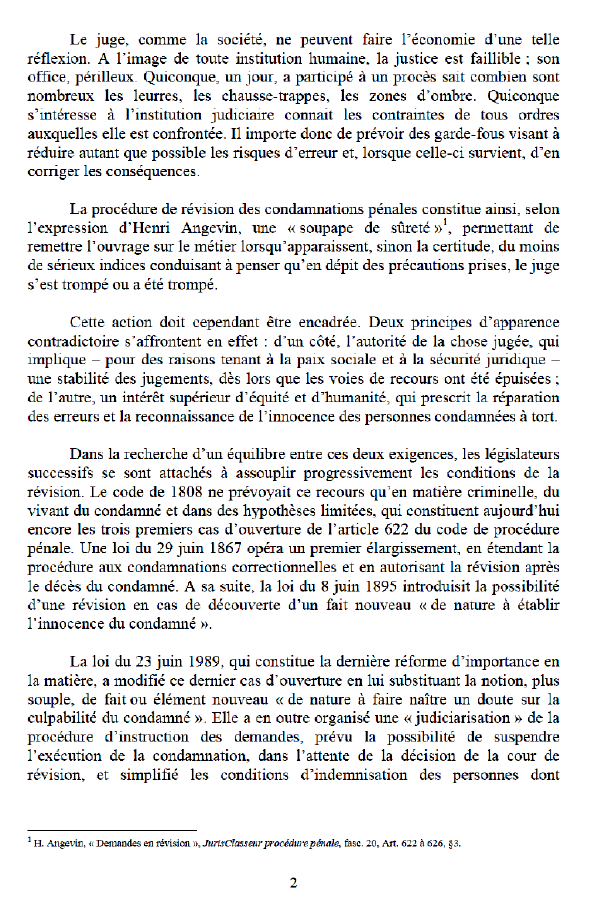
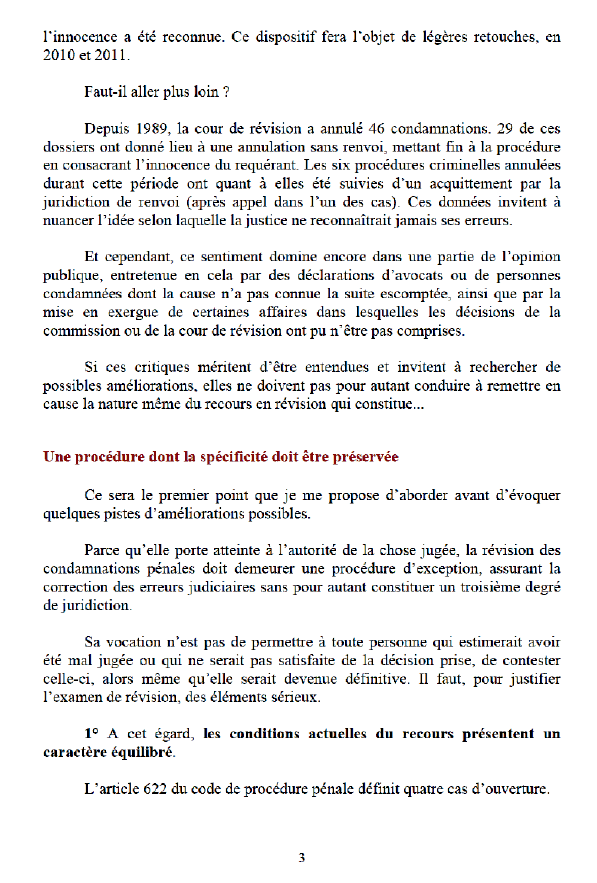
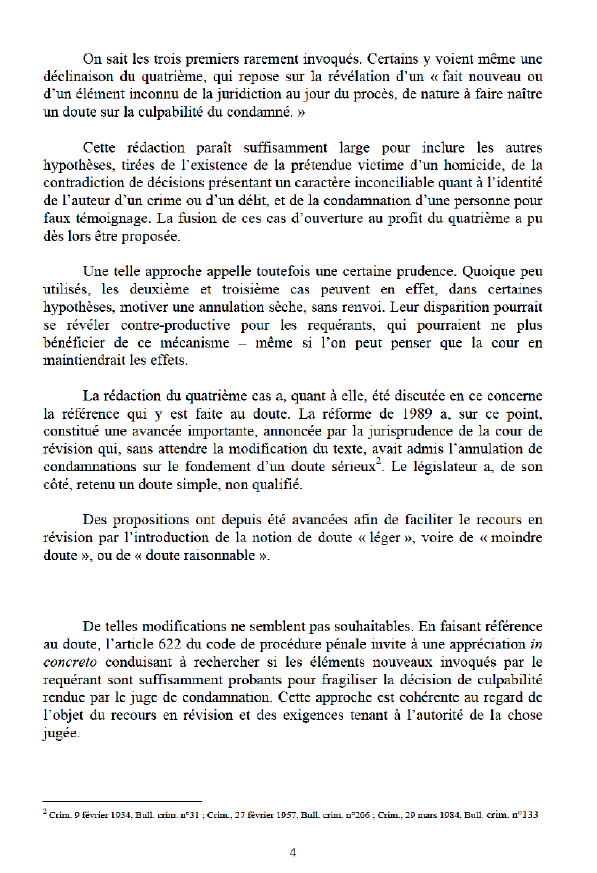
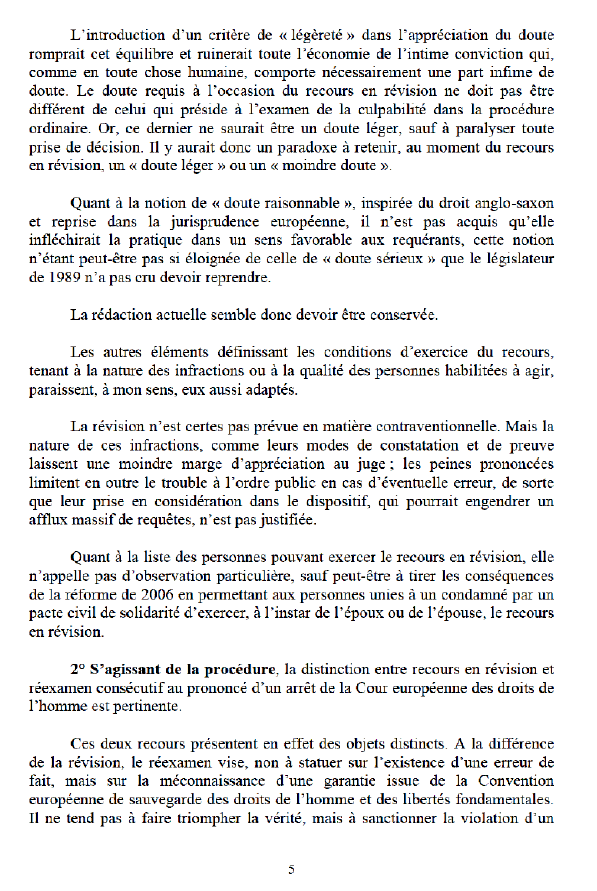
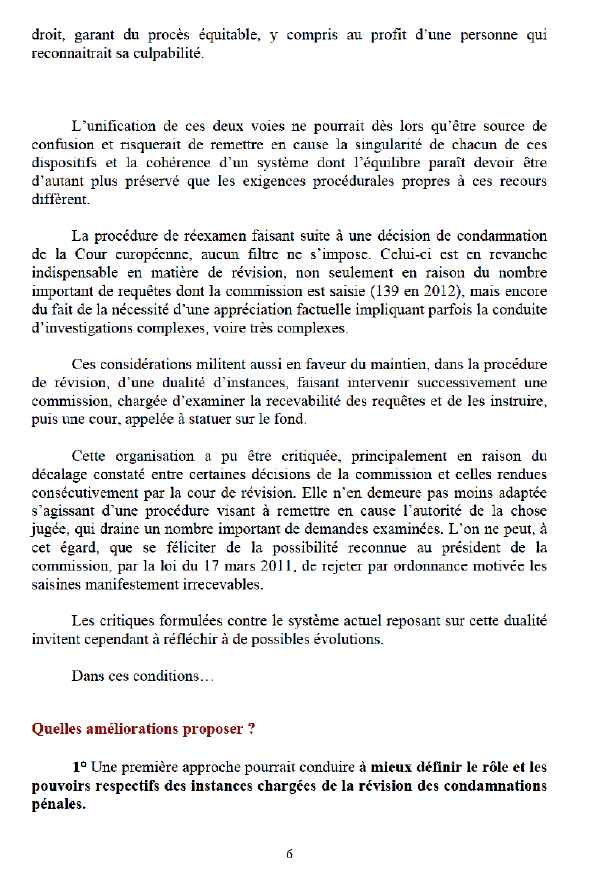
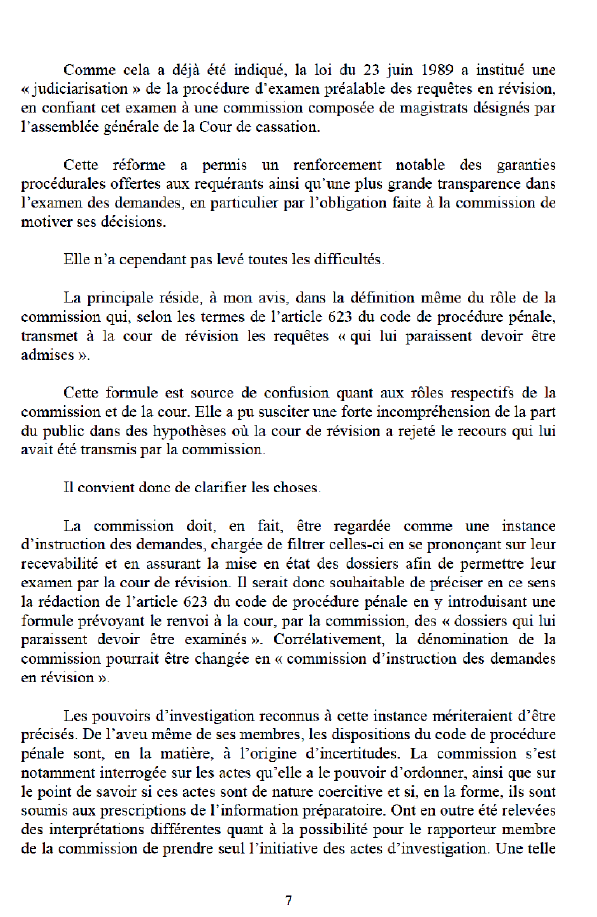
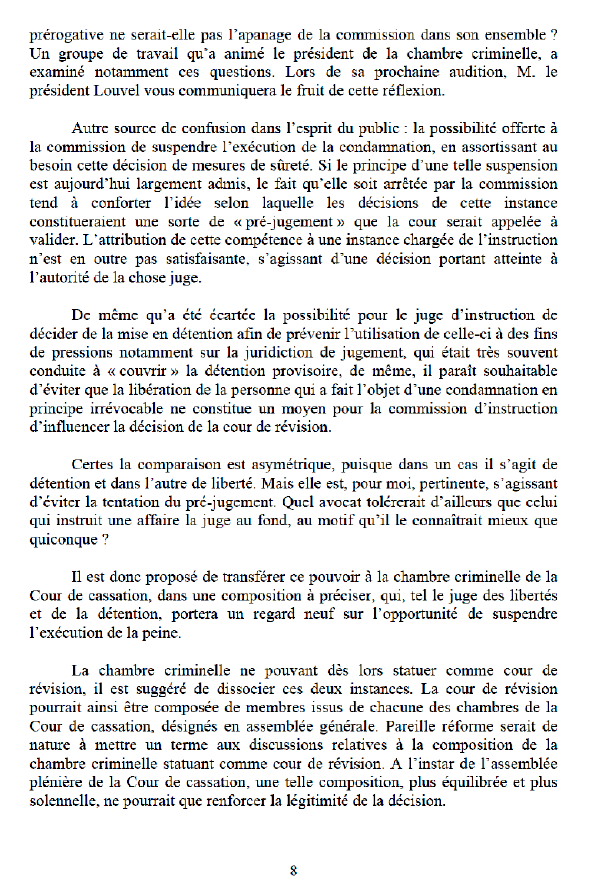
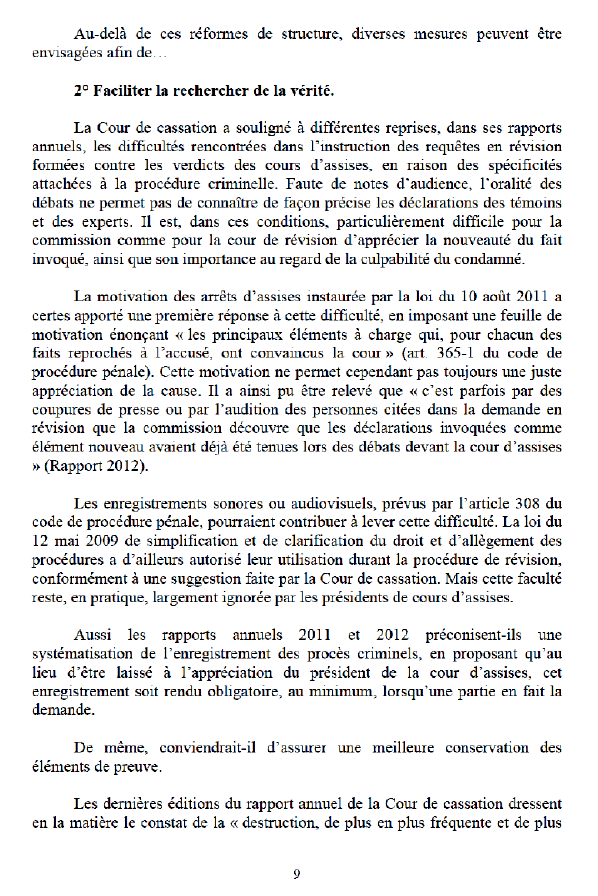
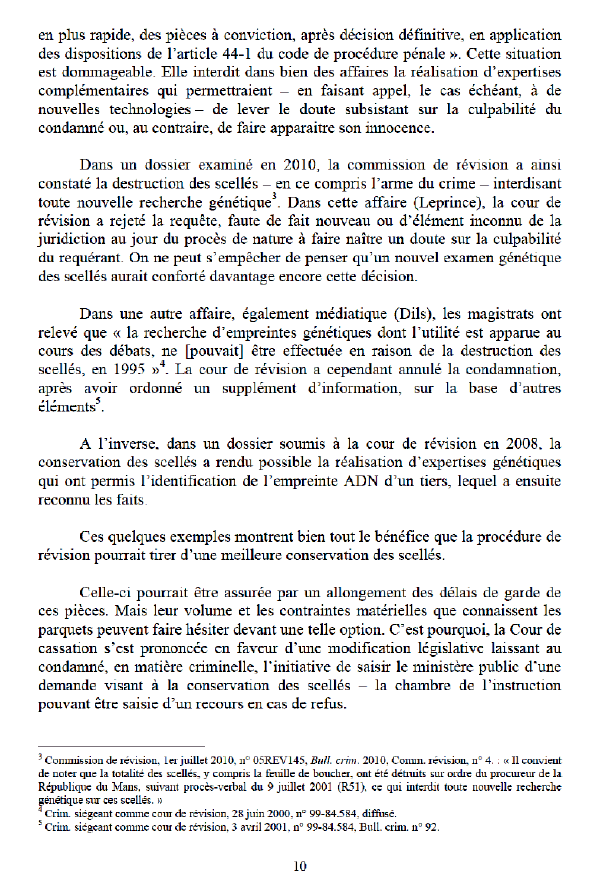
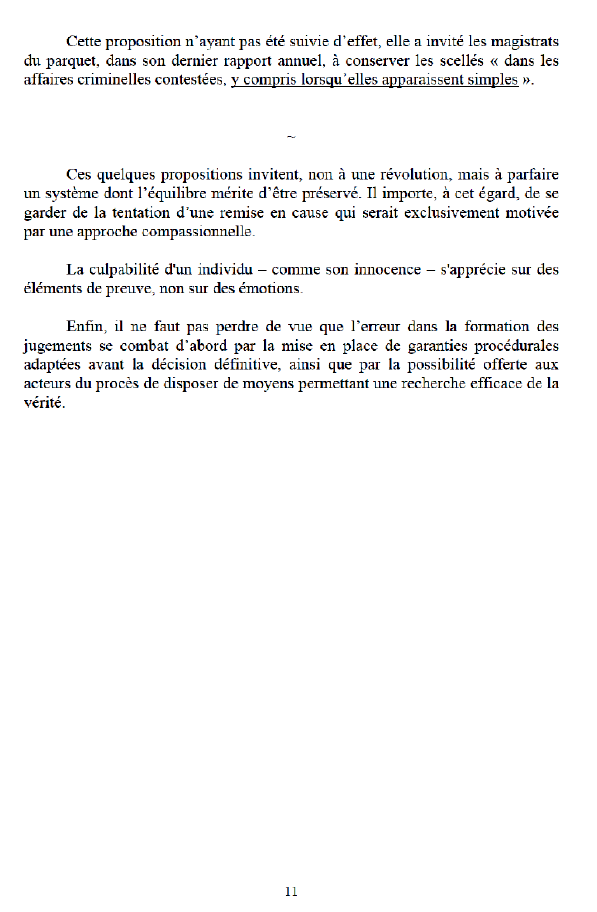
Contribution de Me Sylvie Noachovitch, avocate
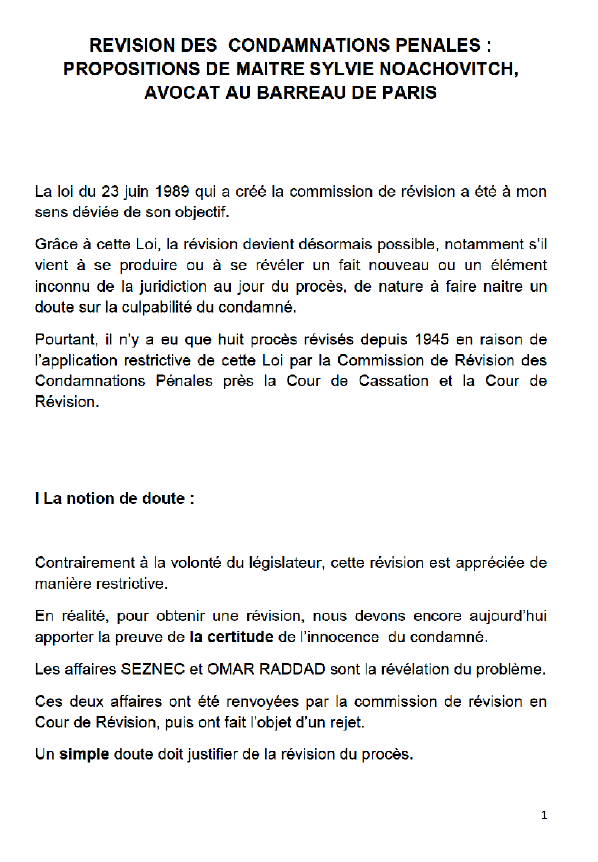
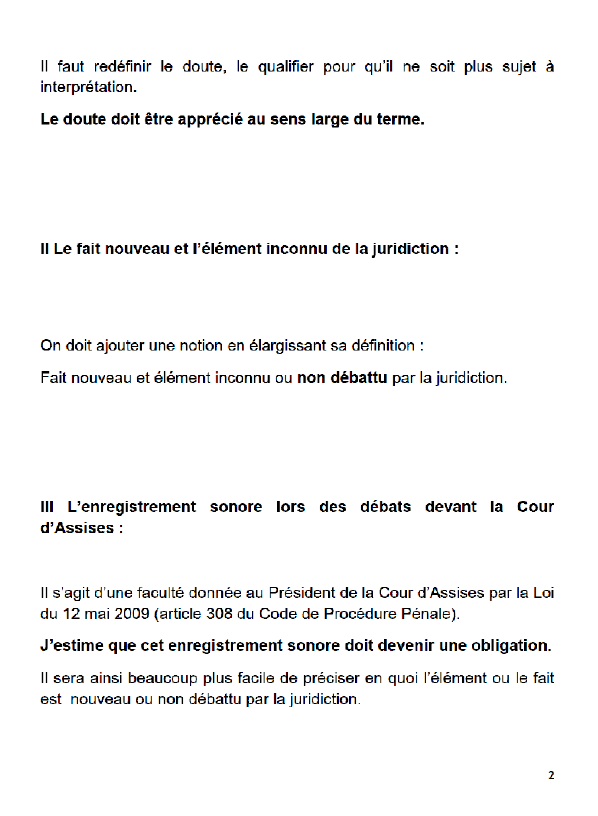
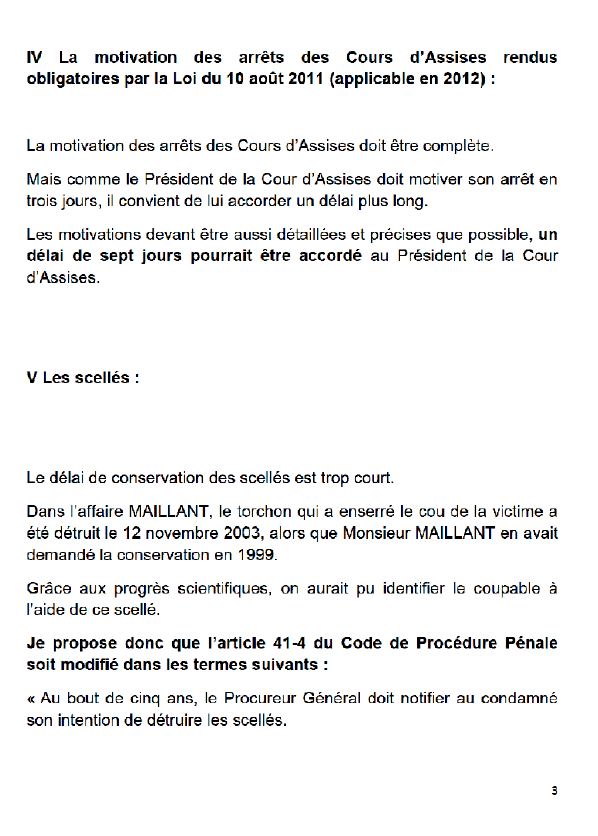
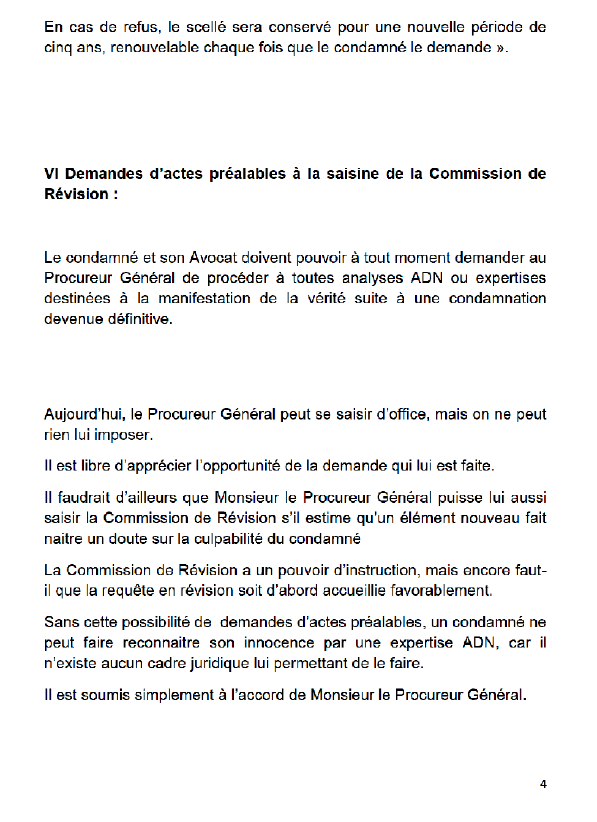
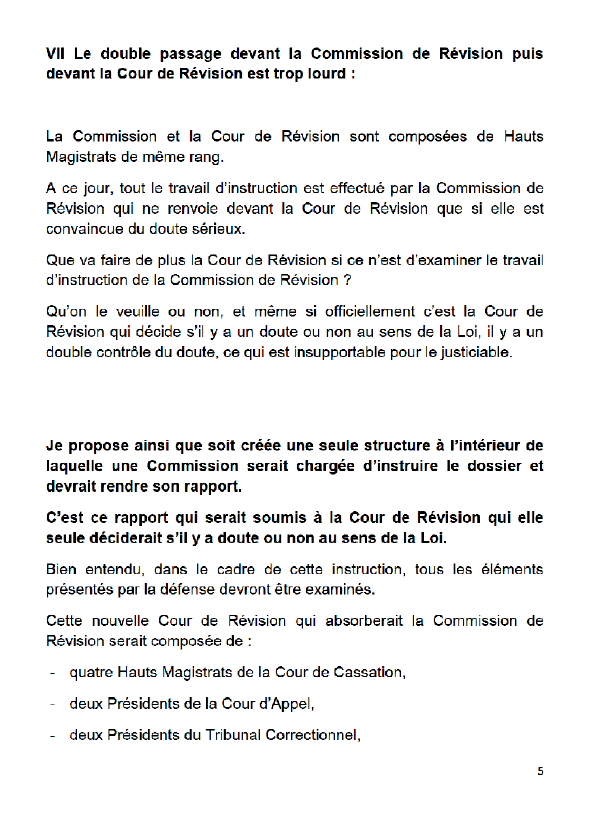
Contribution de M. Bruno Cotte, magistrat à la cour pénale internationale, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
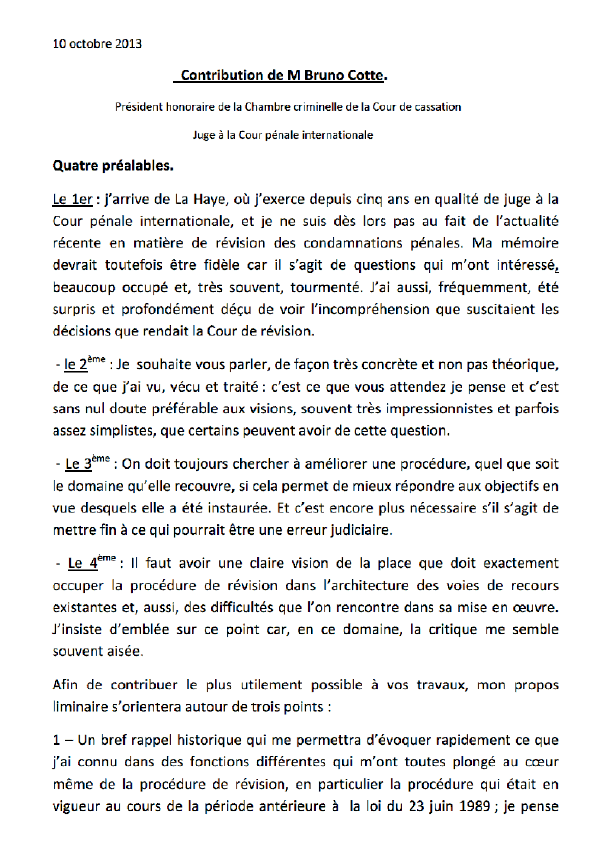
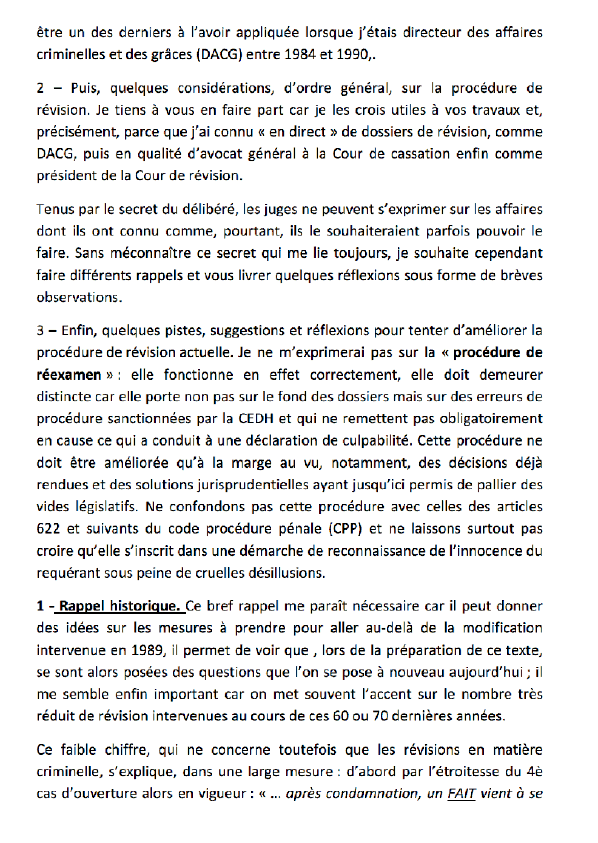
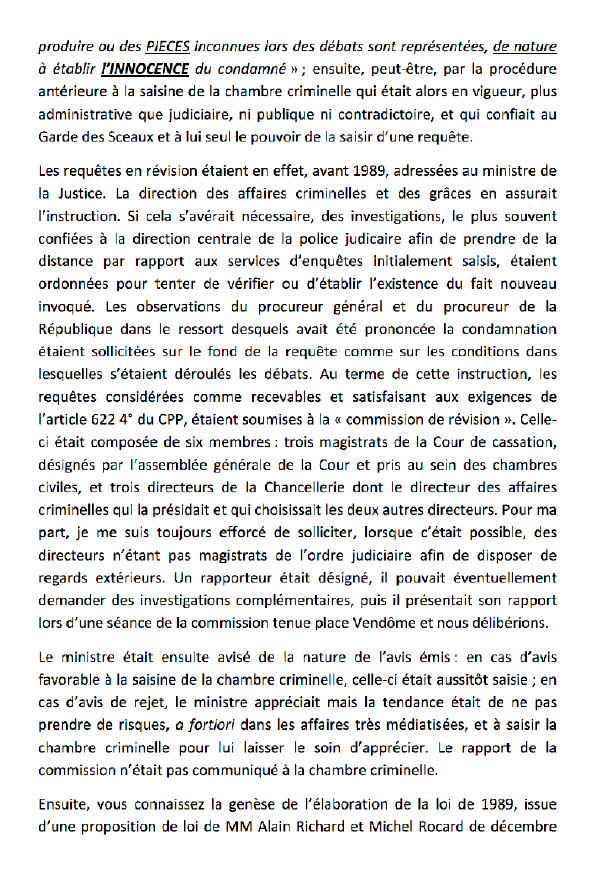
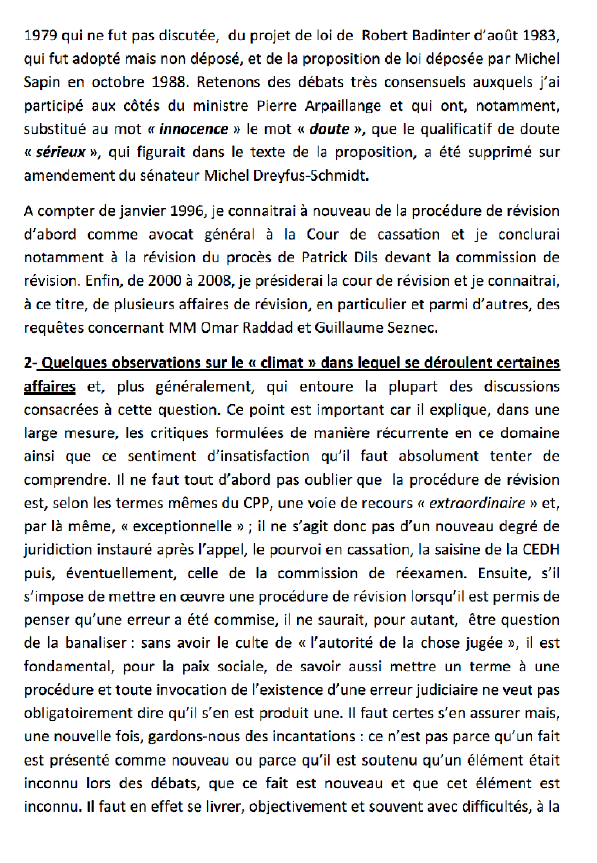
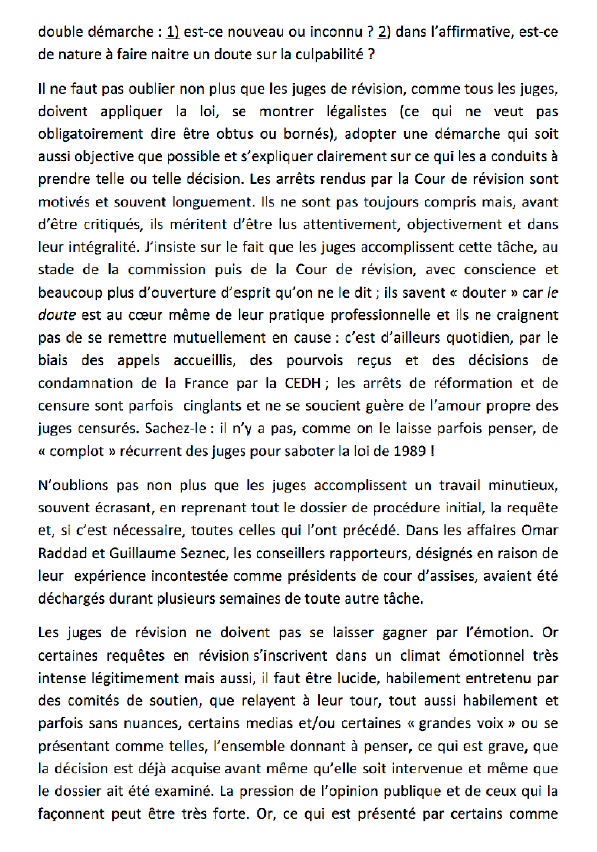
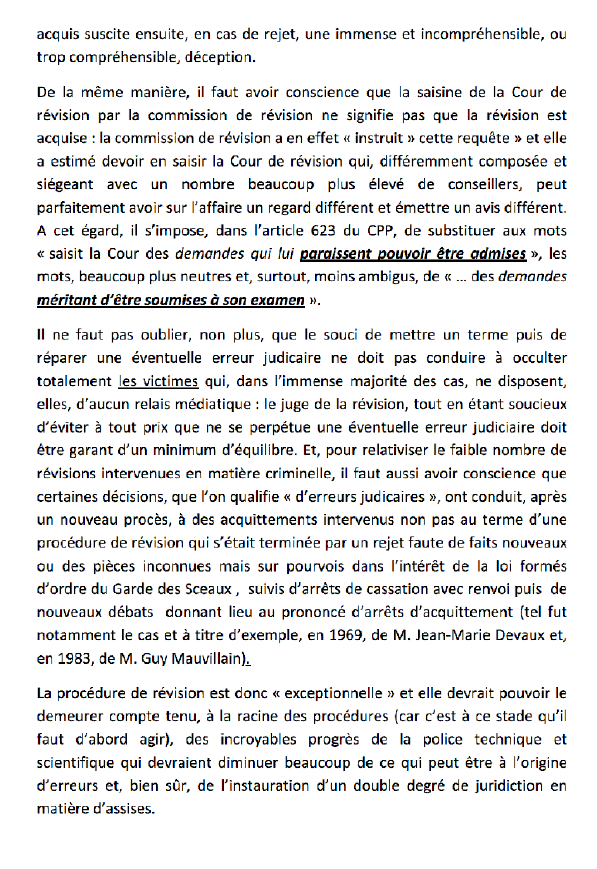

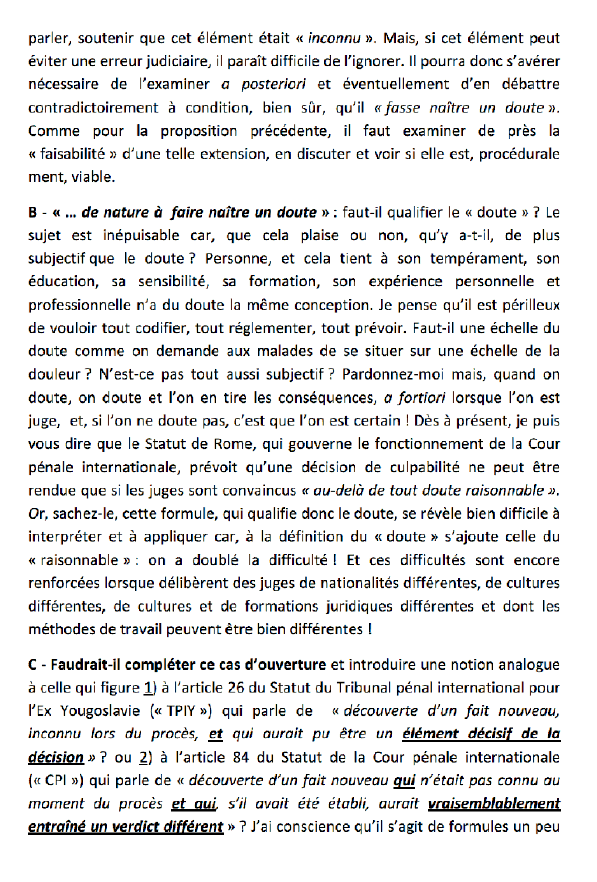
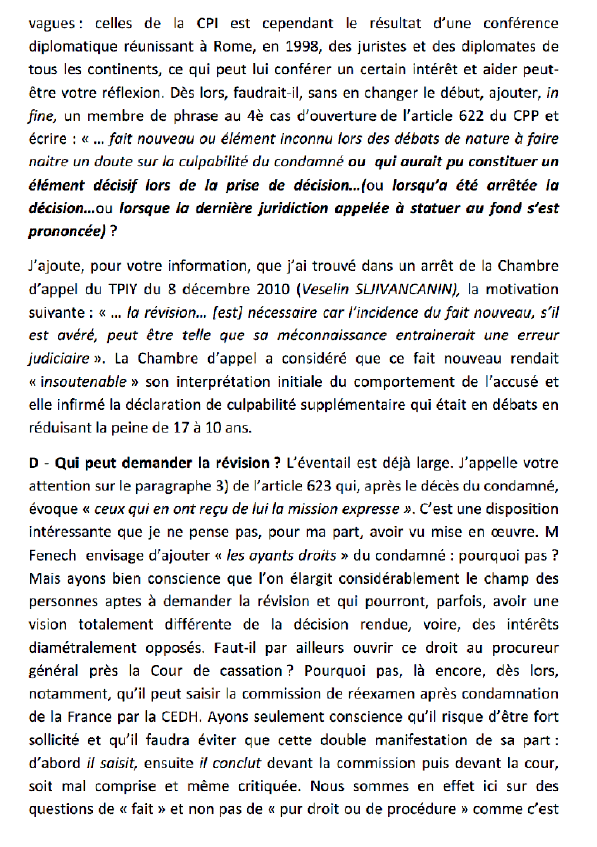
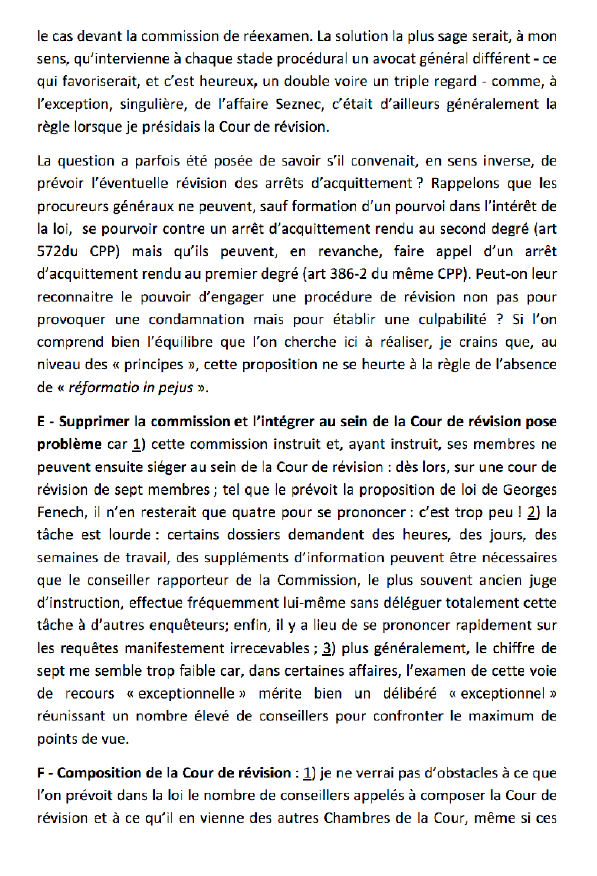
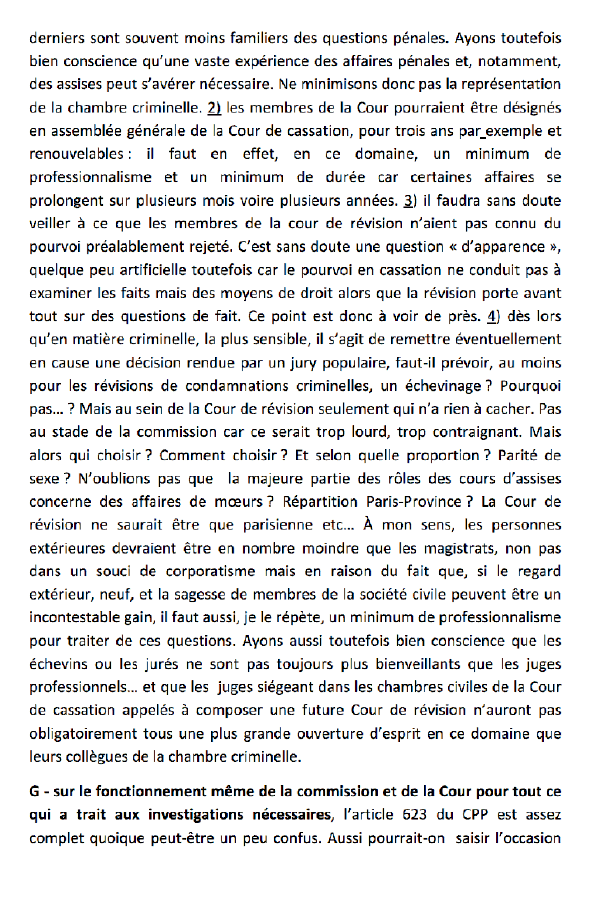
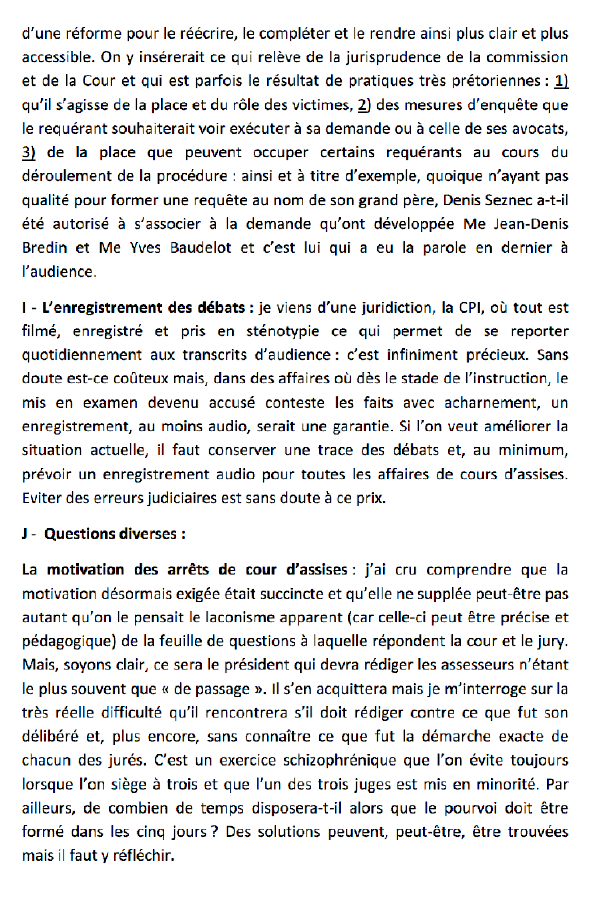
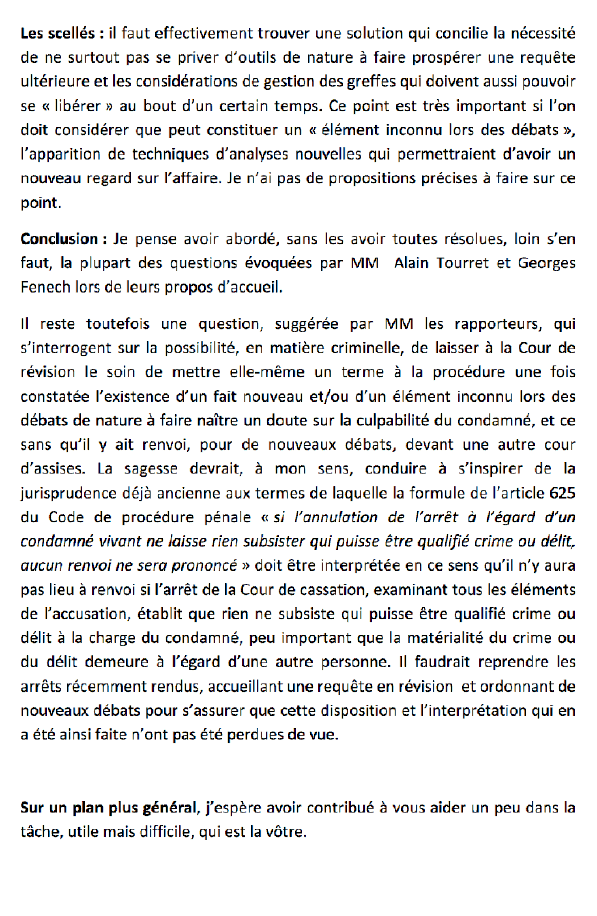
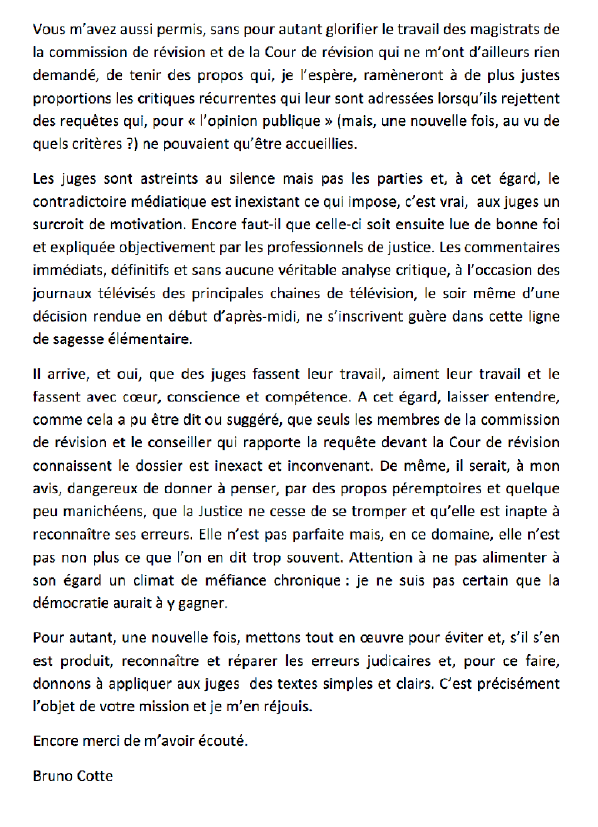
Contribution de Mme Monique Radenne, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales
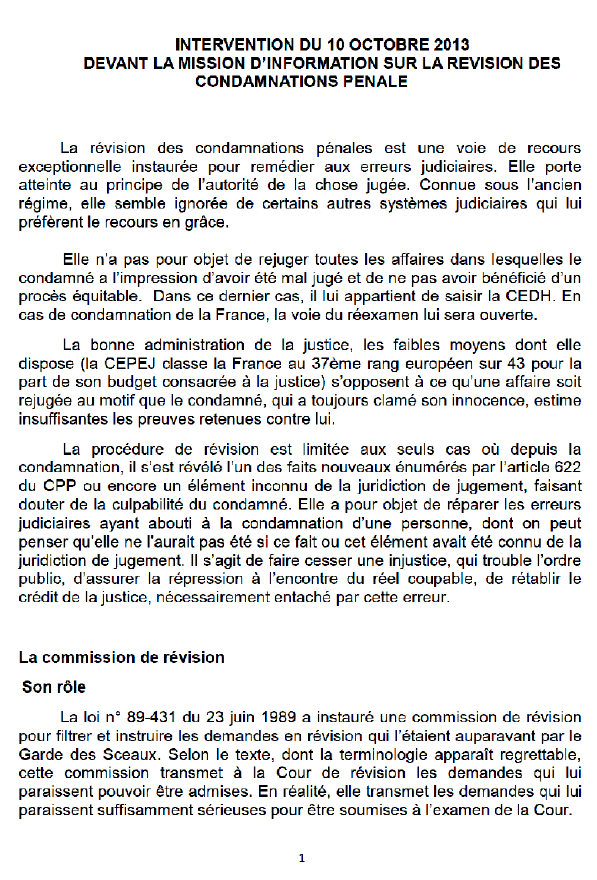
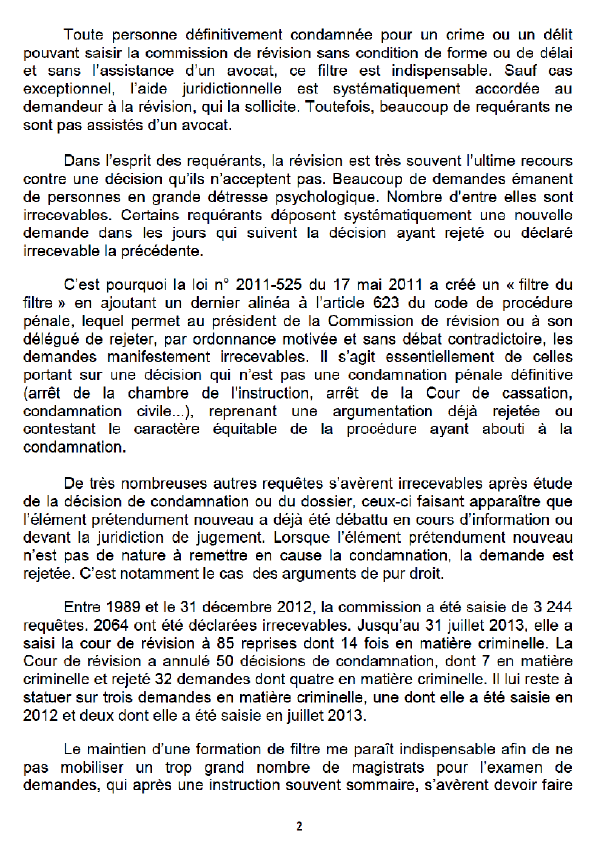
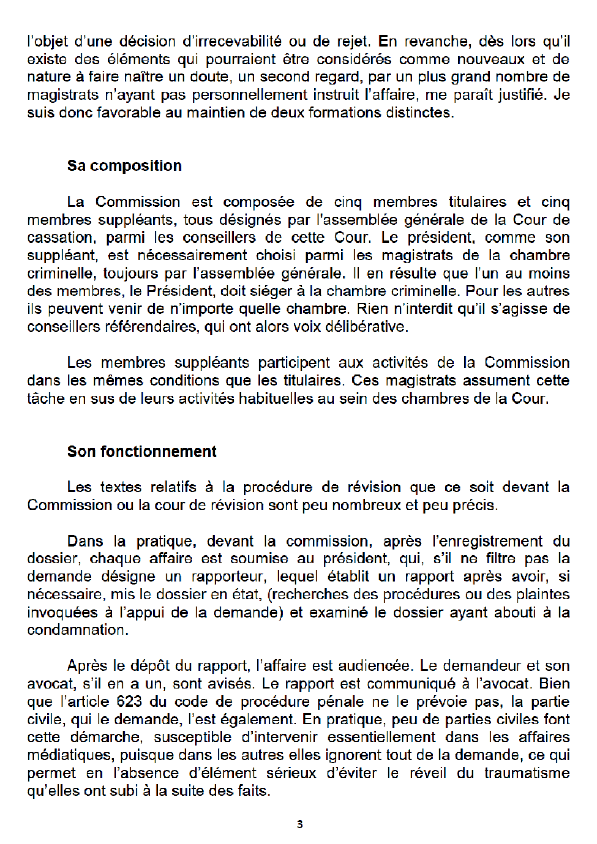
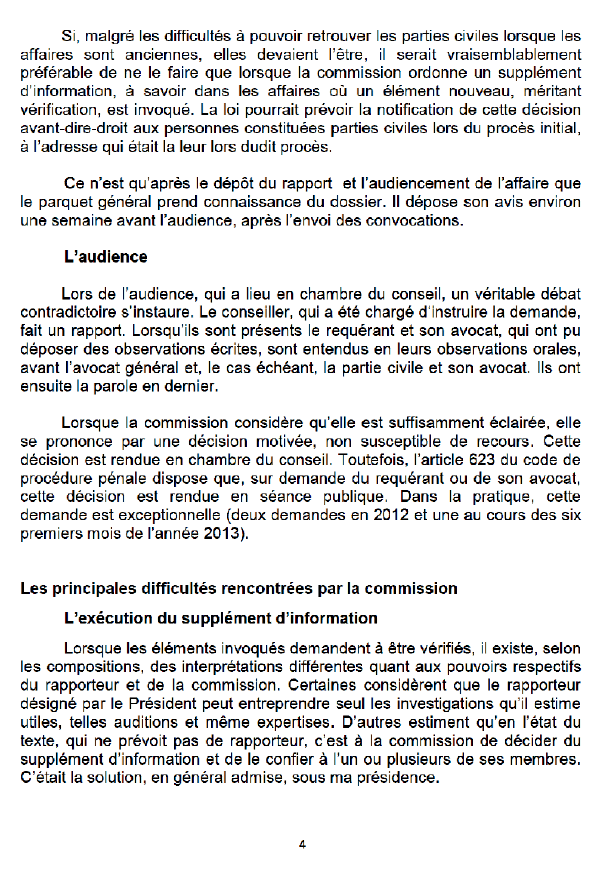
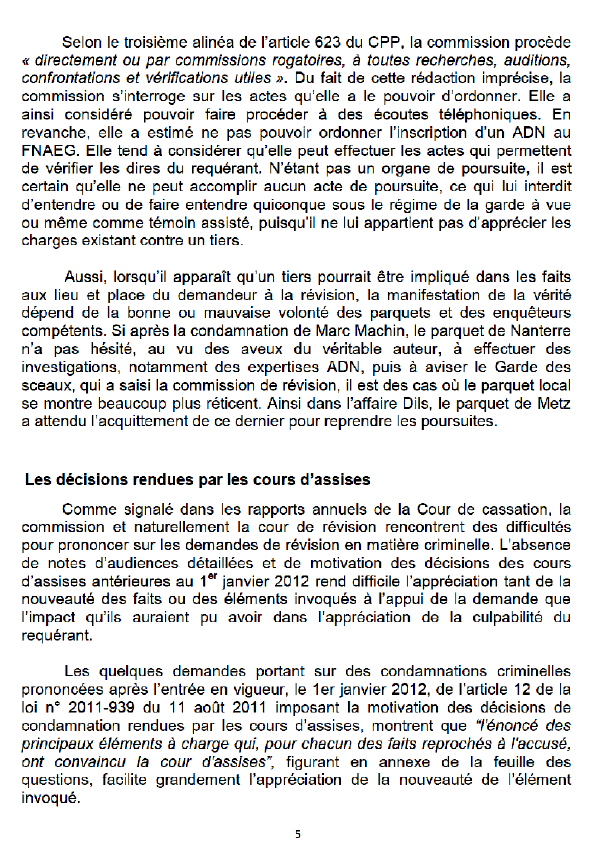
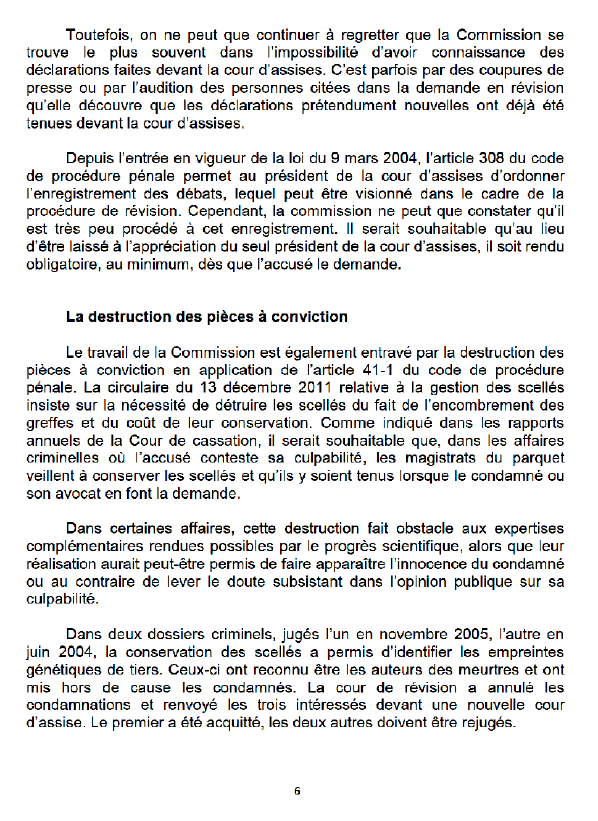
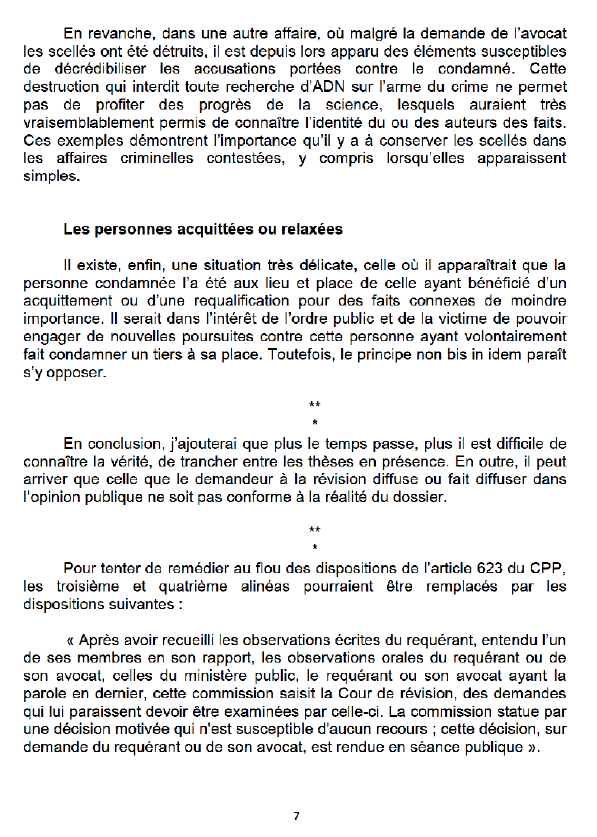
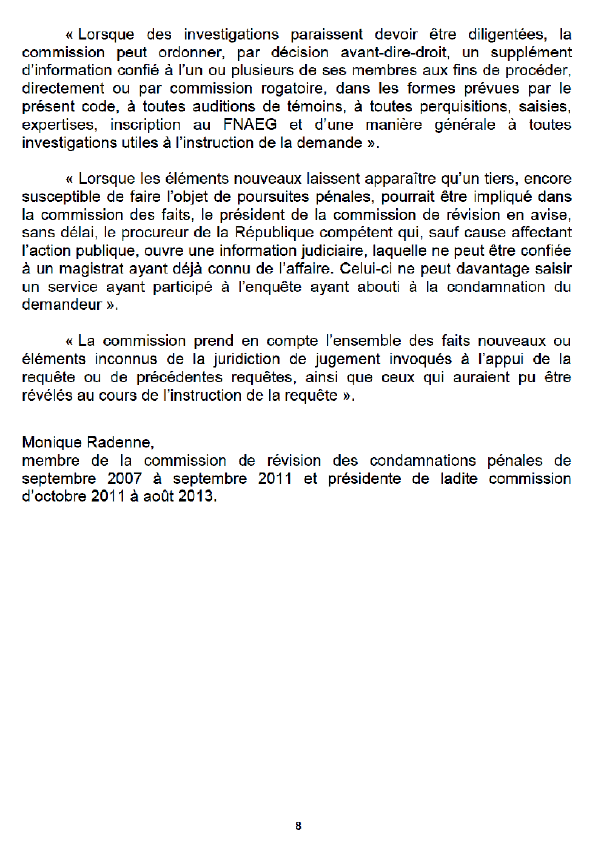
Contribution de M. Jean-Luc Moignard, président de la commission de révision des condamnations pénales
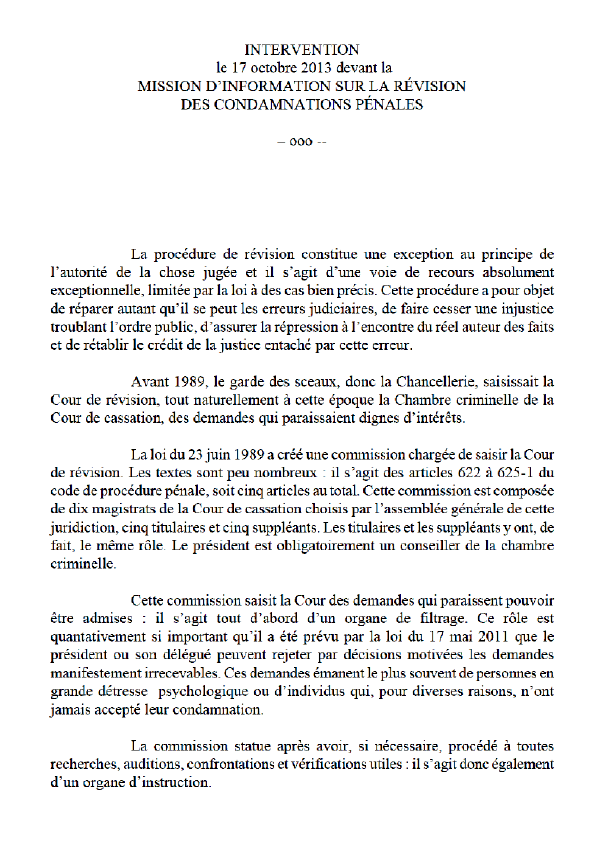
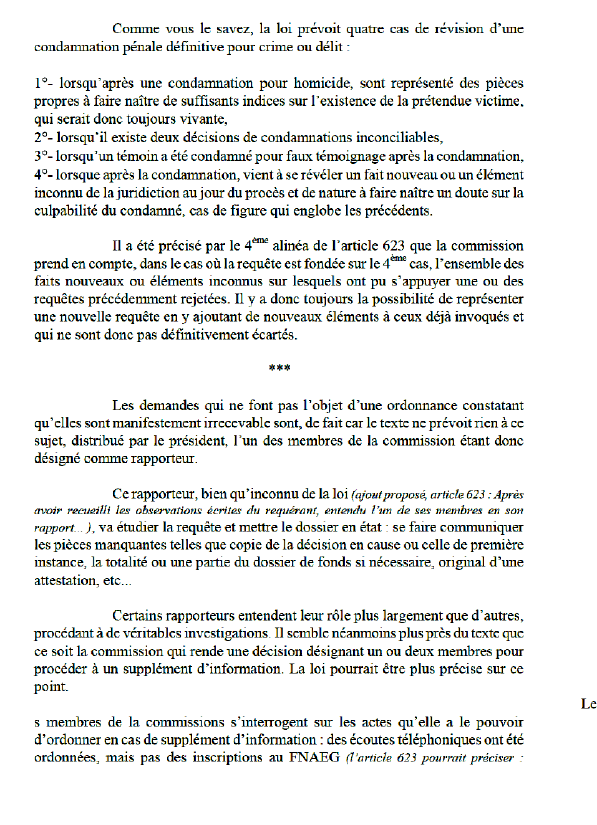
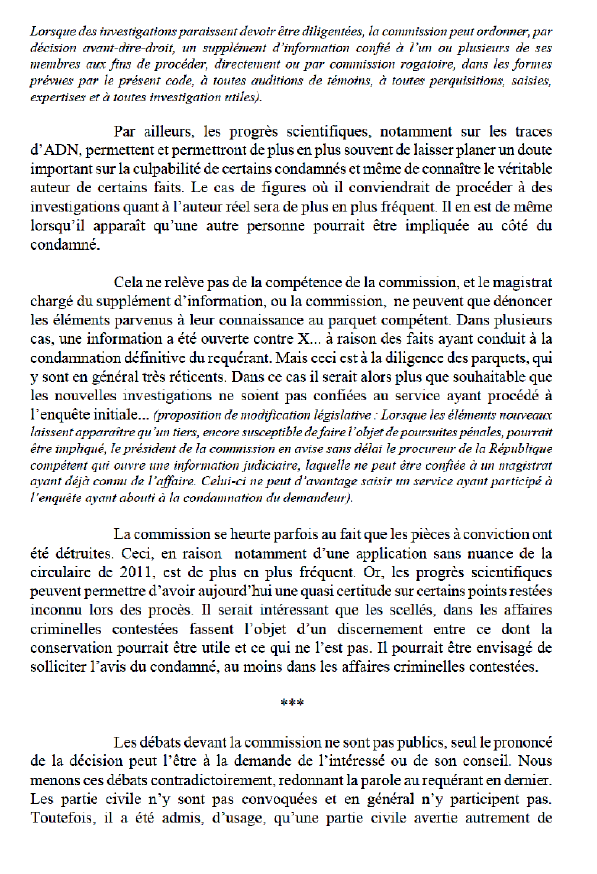
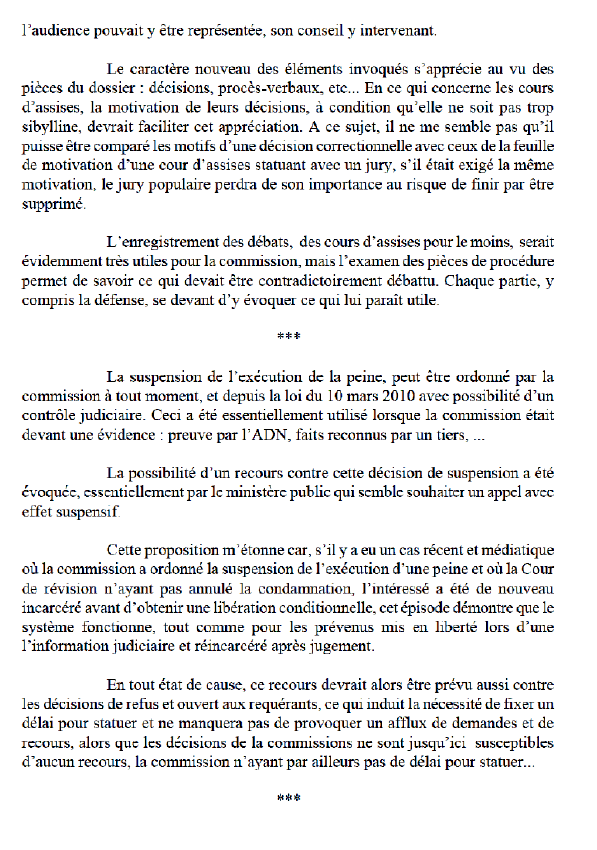
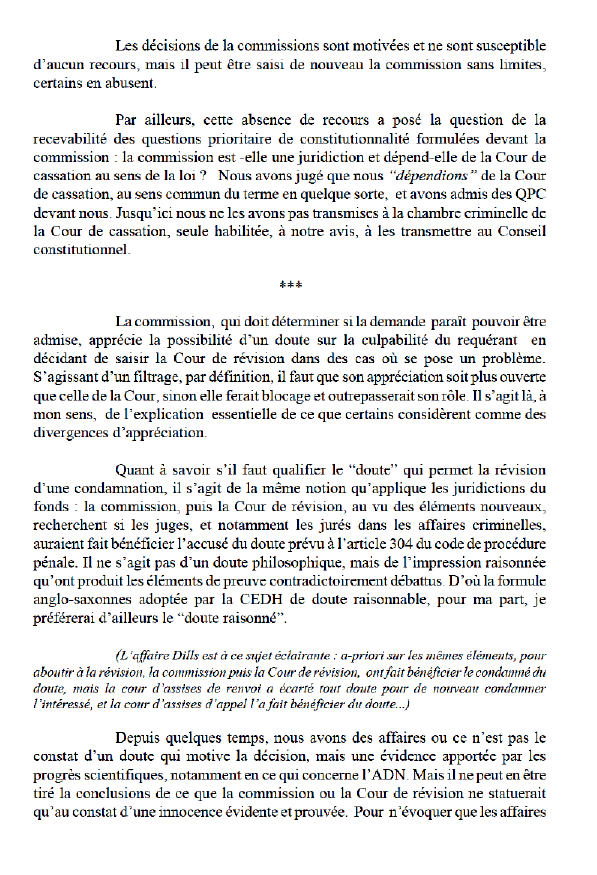
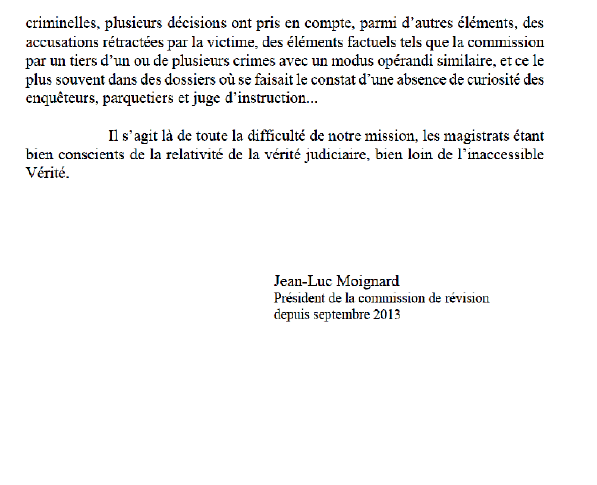
Contribution de M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
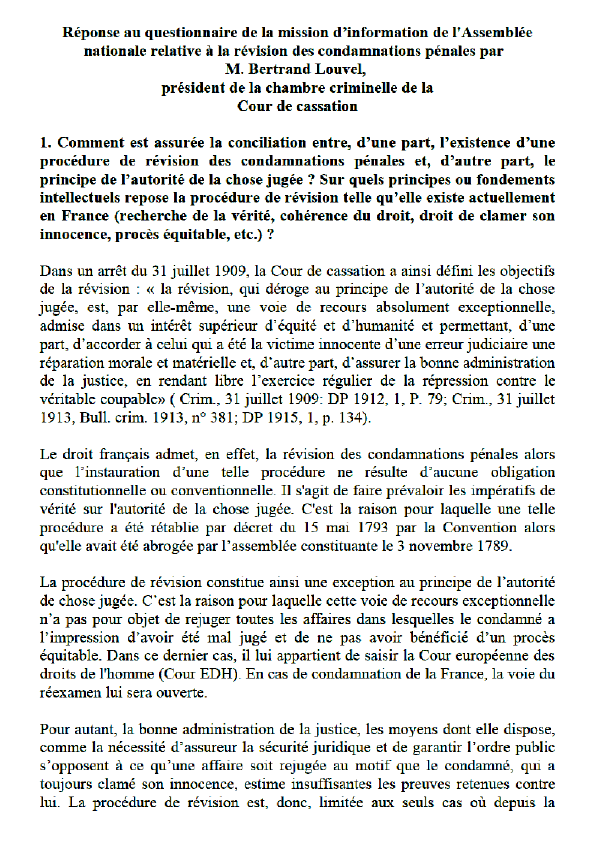
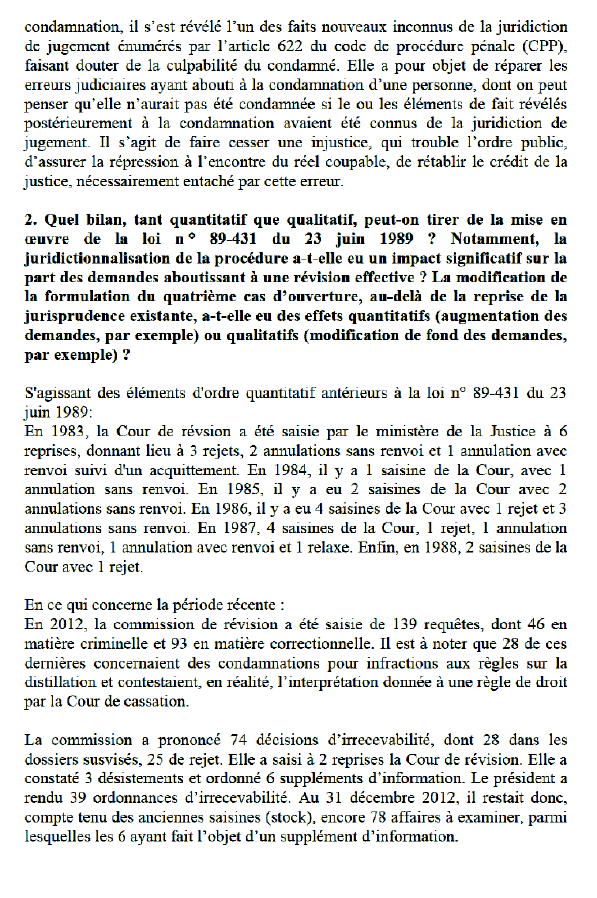
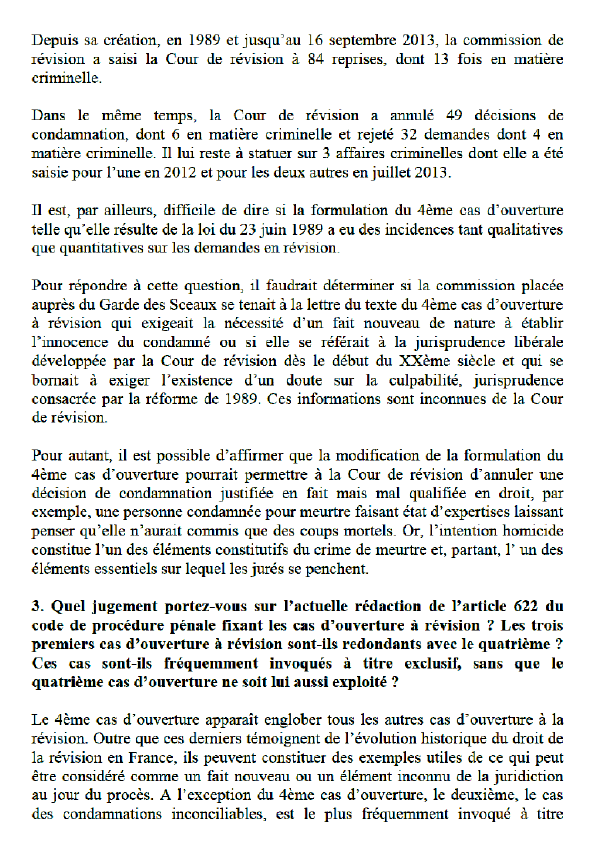
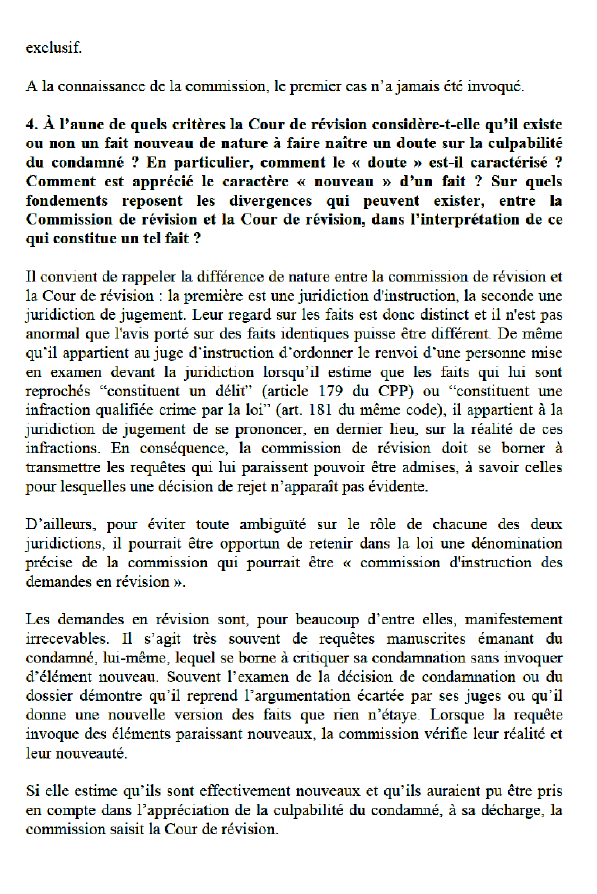
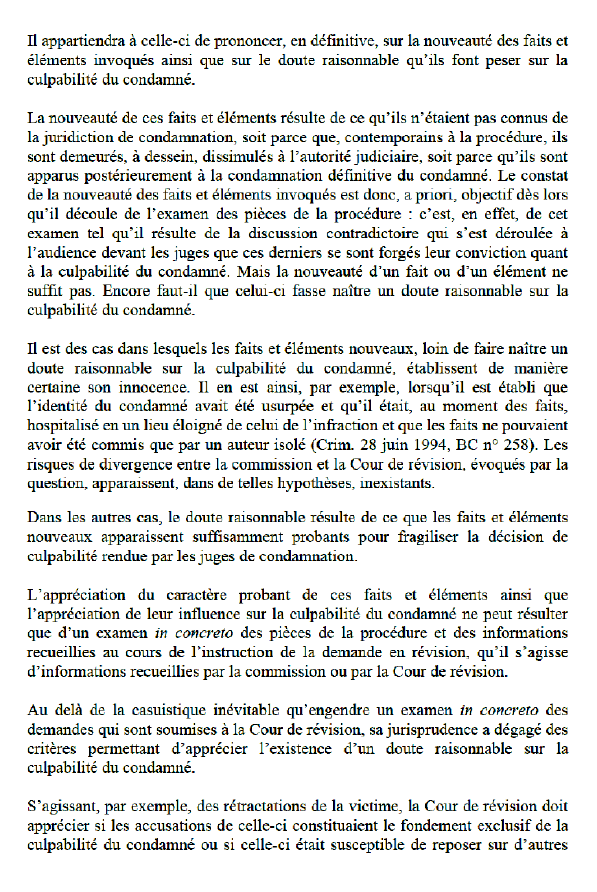
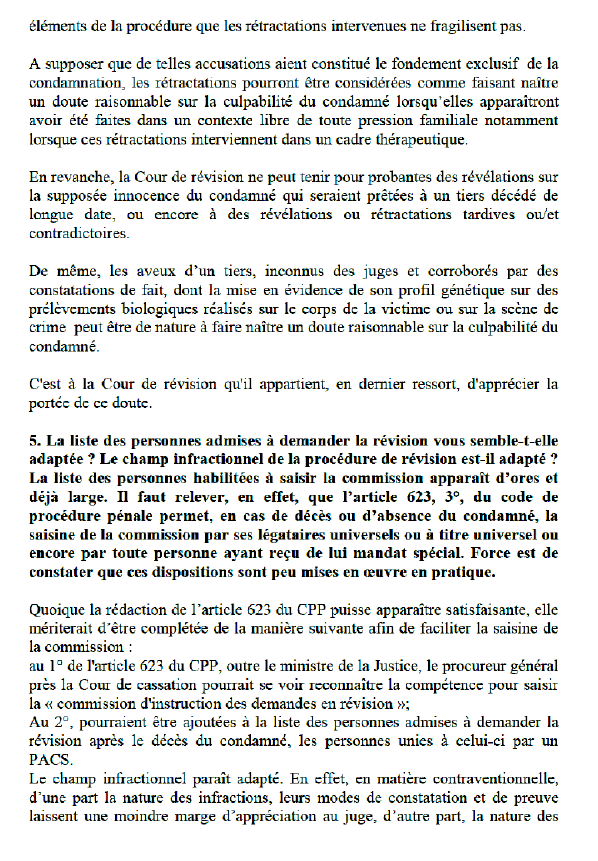
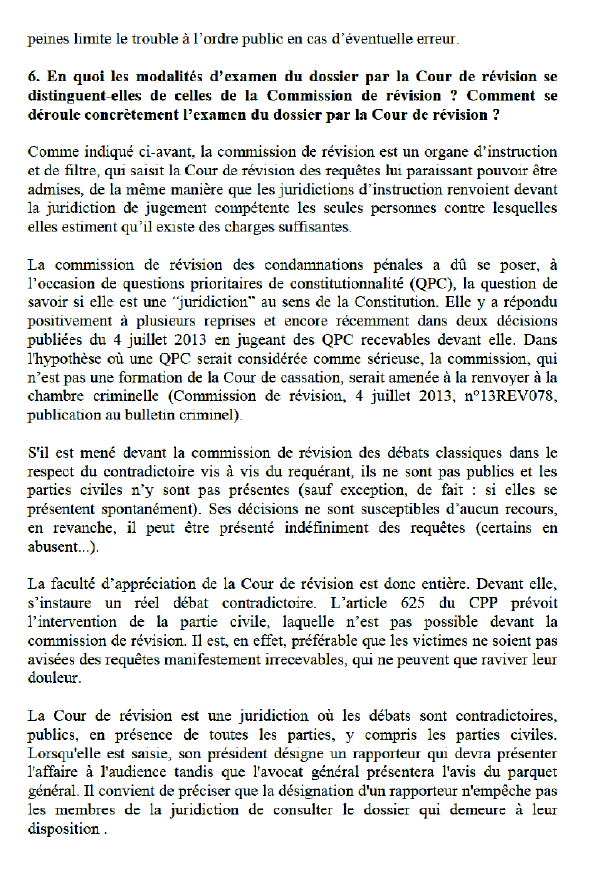
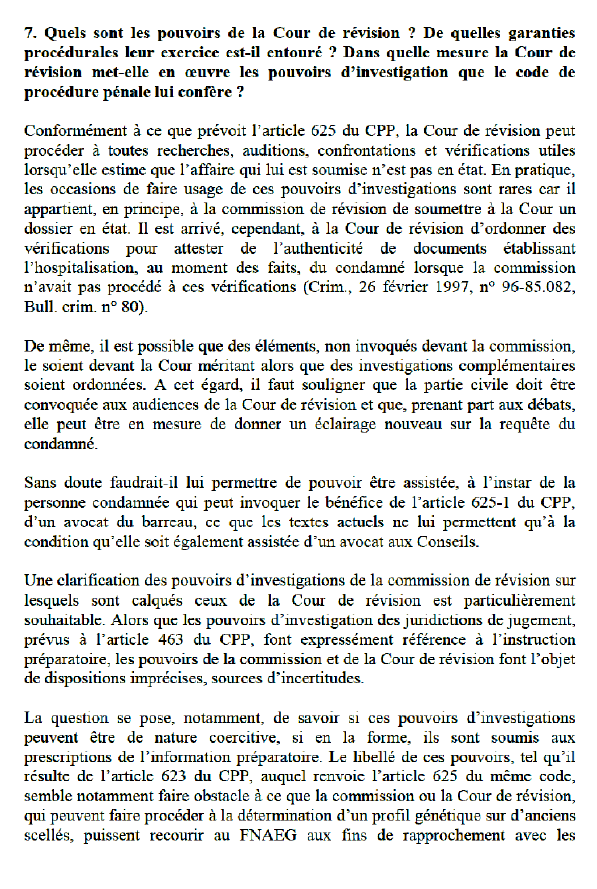
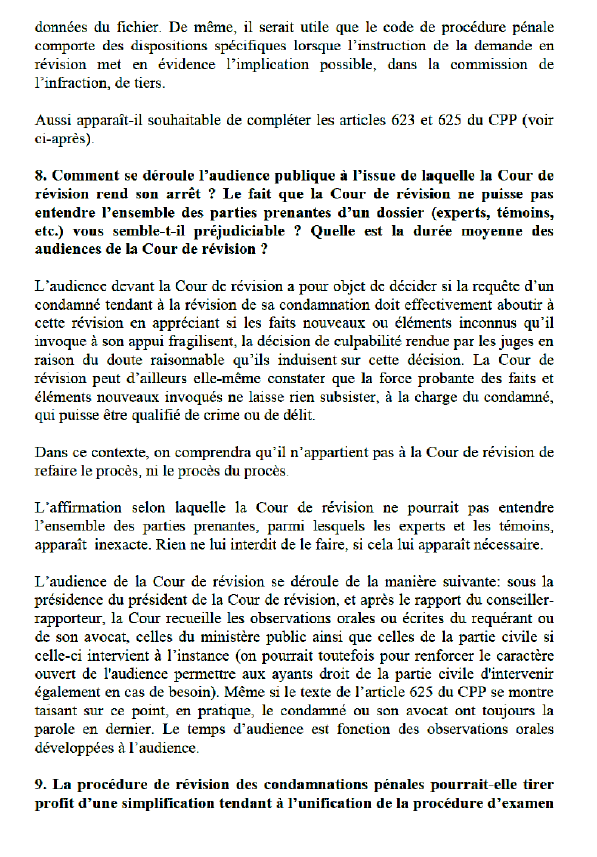
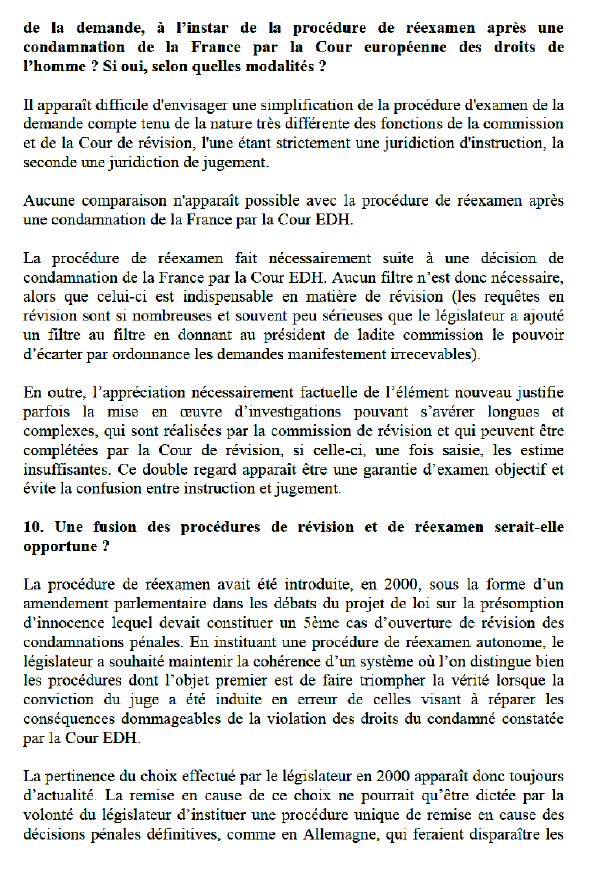
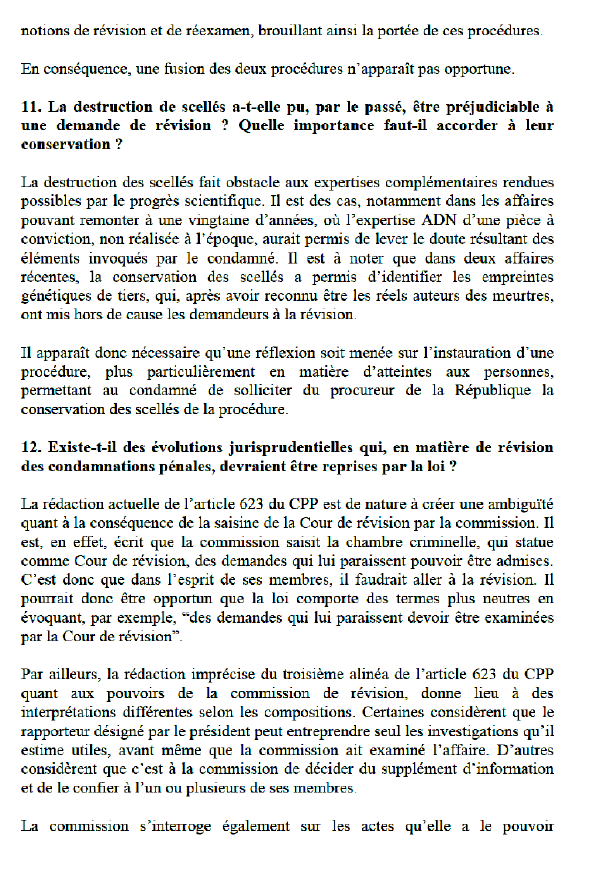
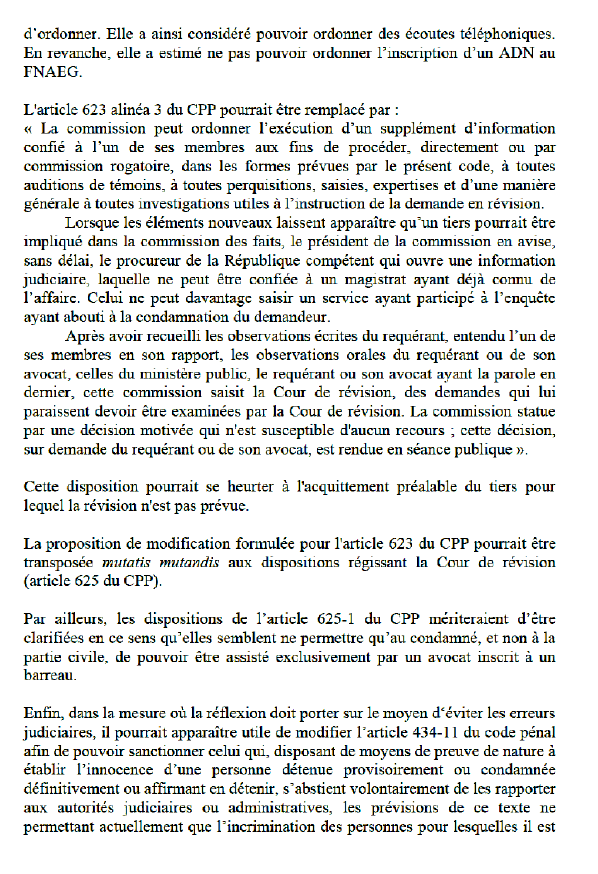
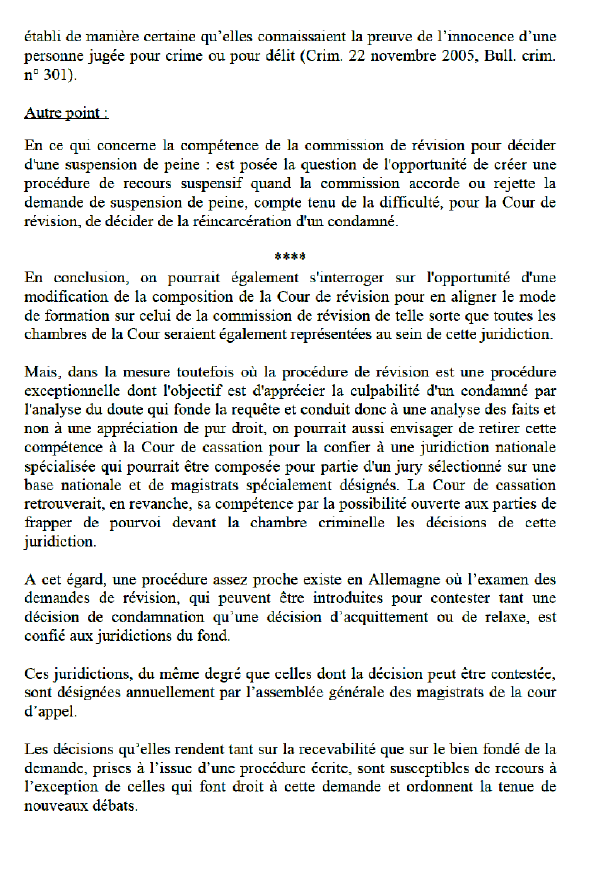
Contribution de M. Jean-Olivier Viout, membre du Conseil supérieur de la magistrature
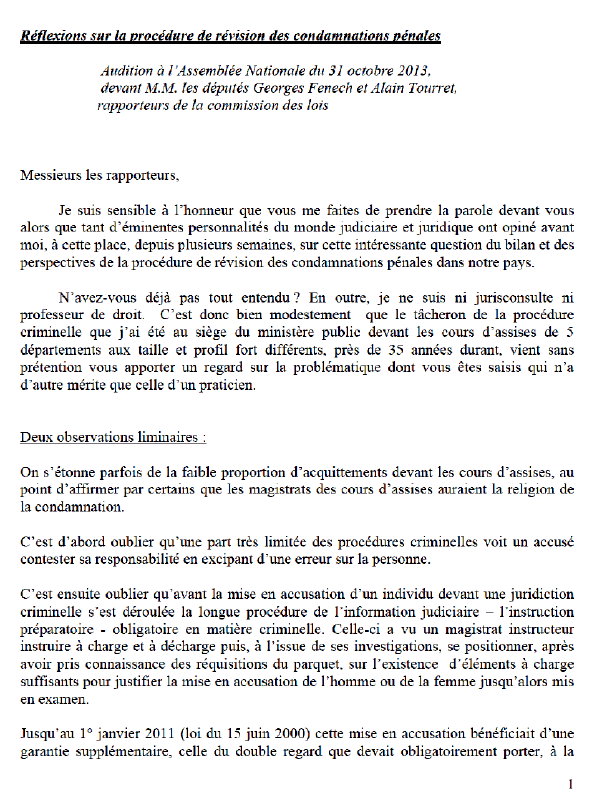

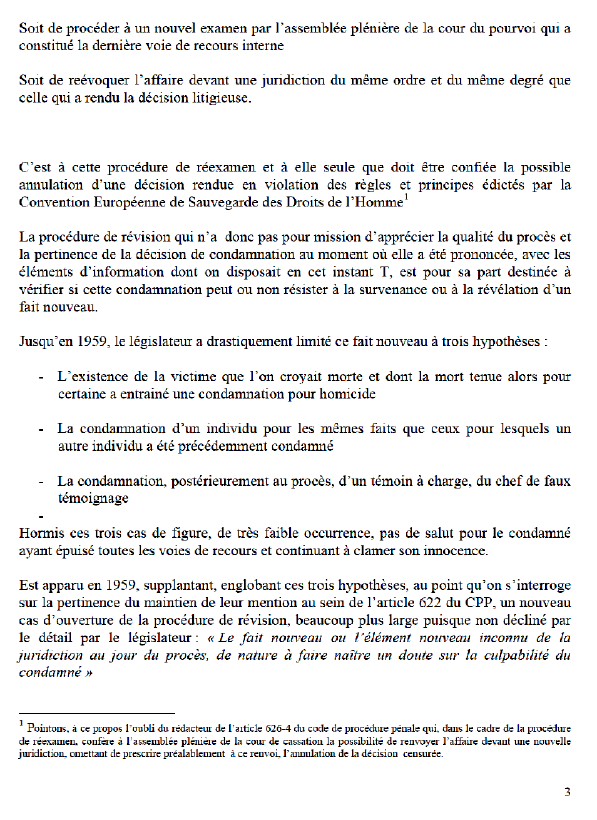
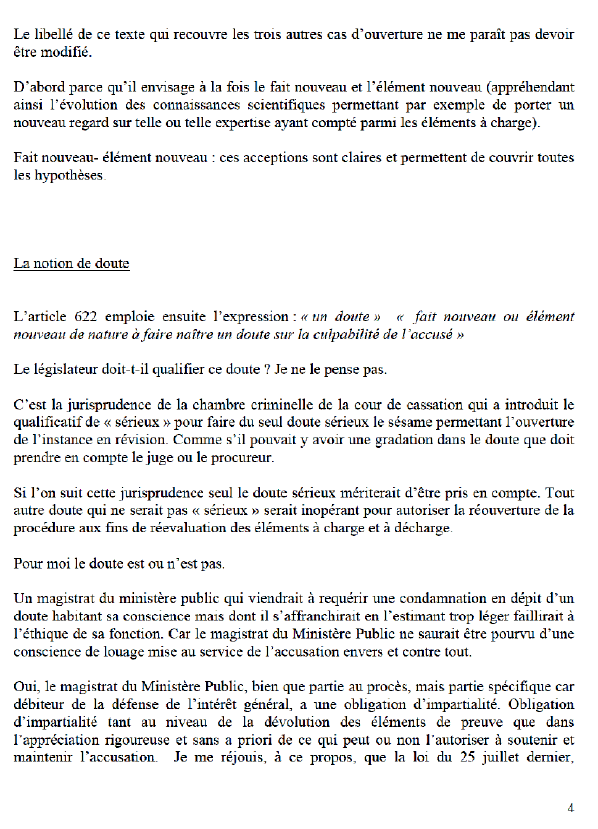
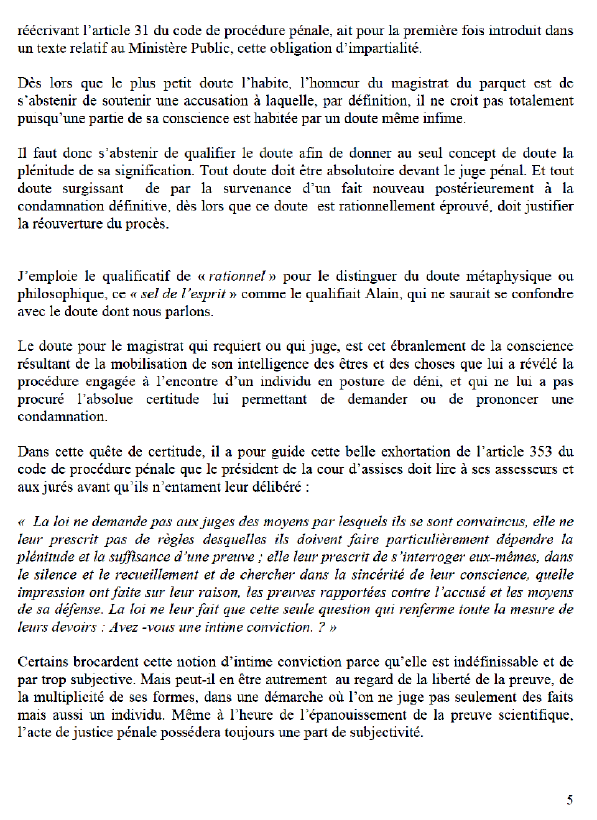
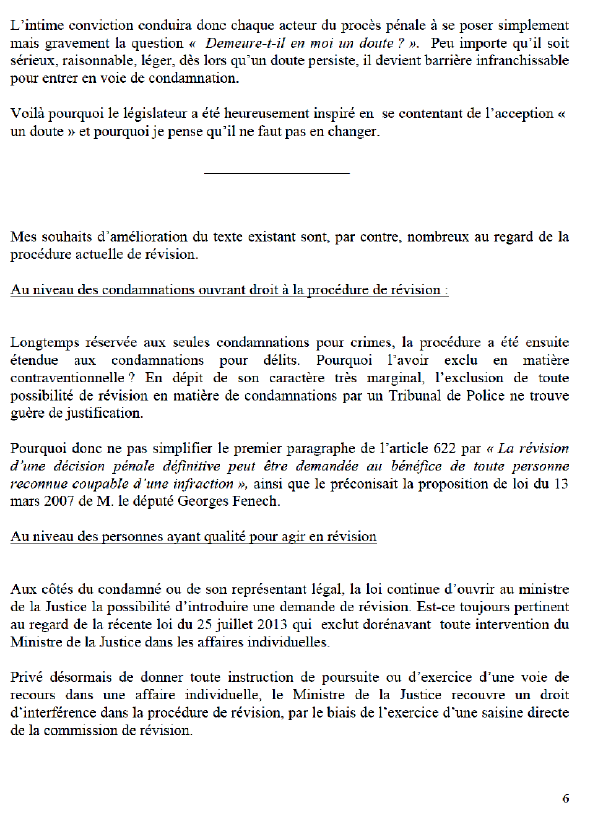
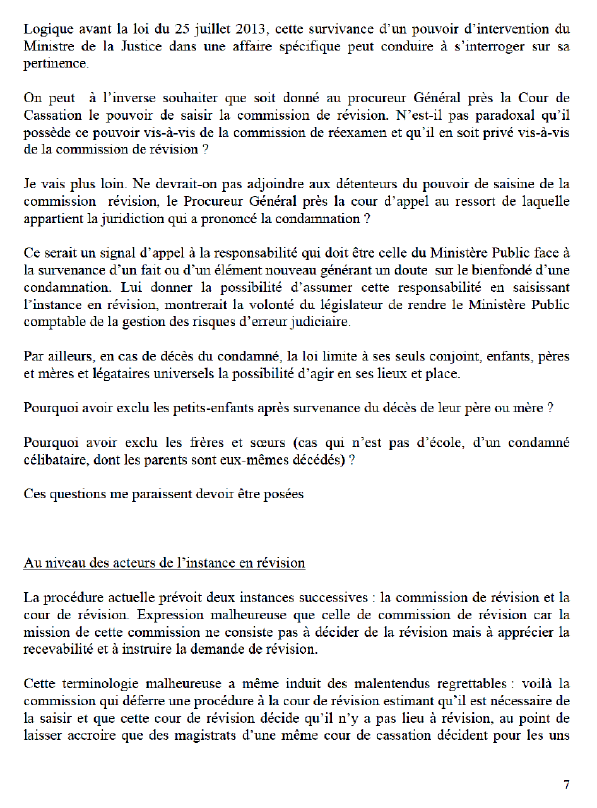
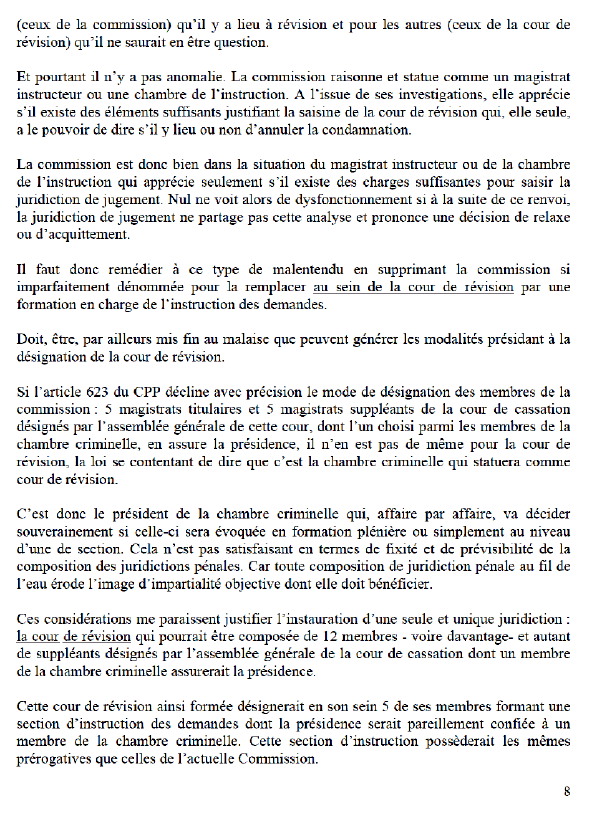
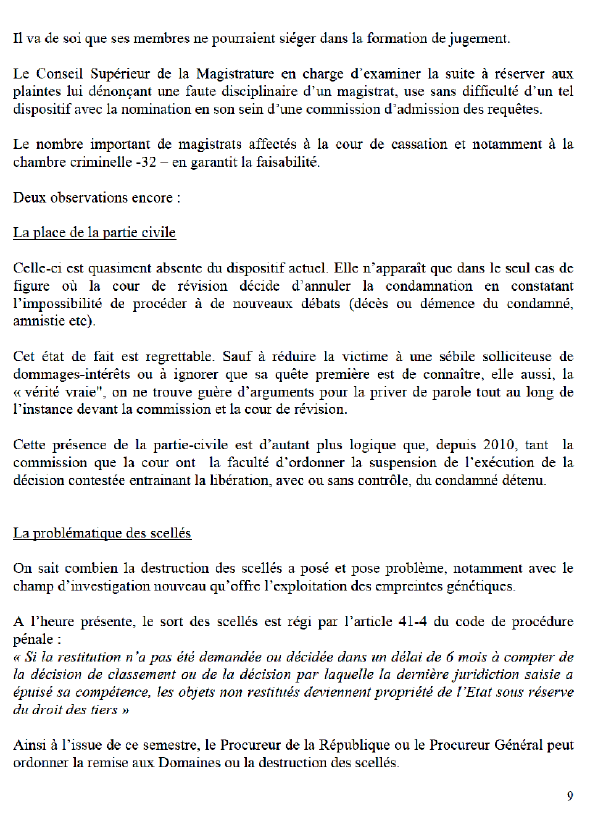
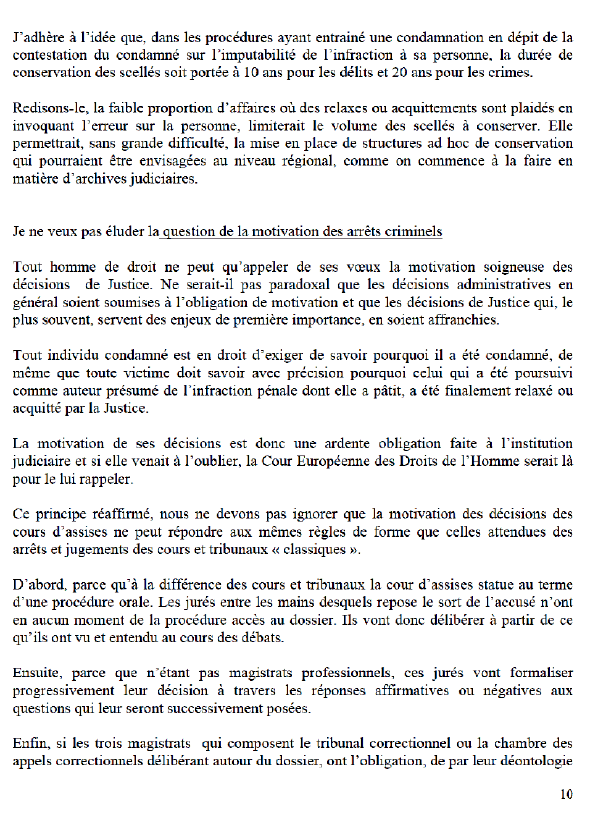
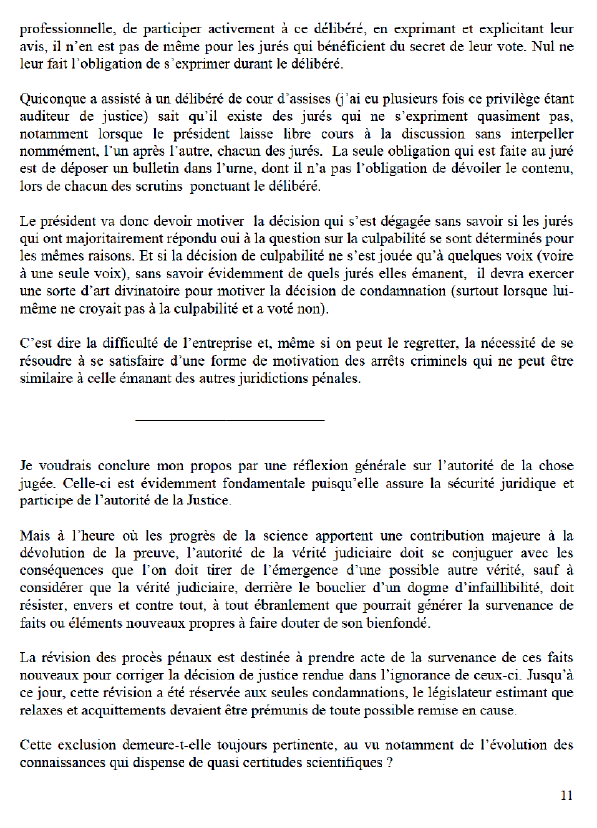
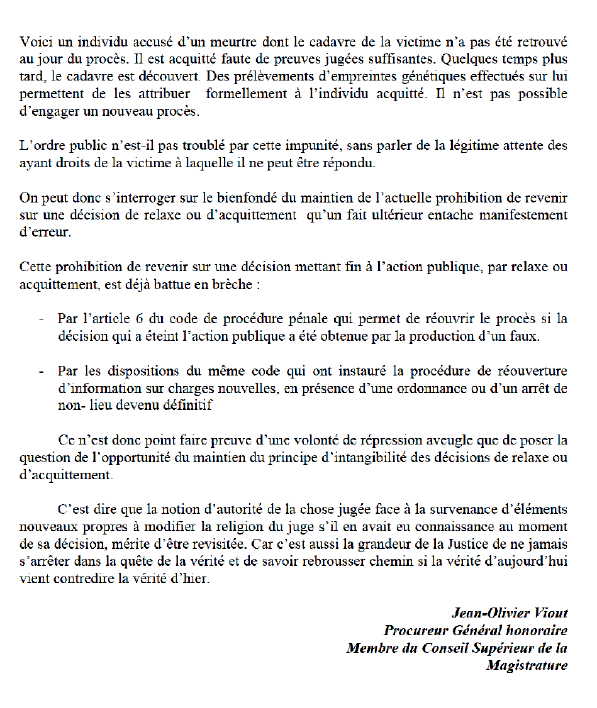
Contribution de M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation
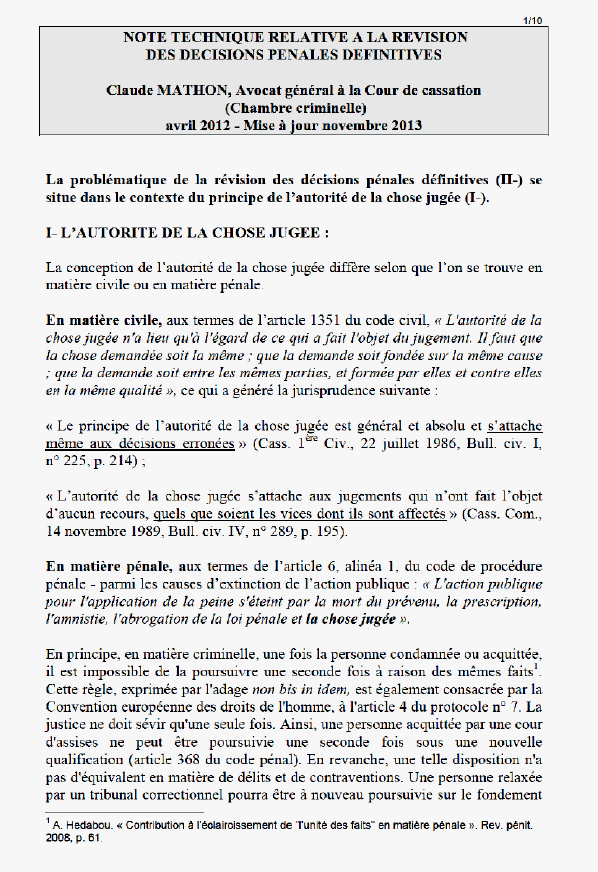
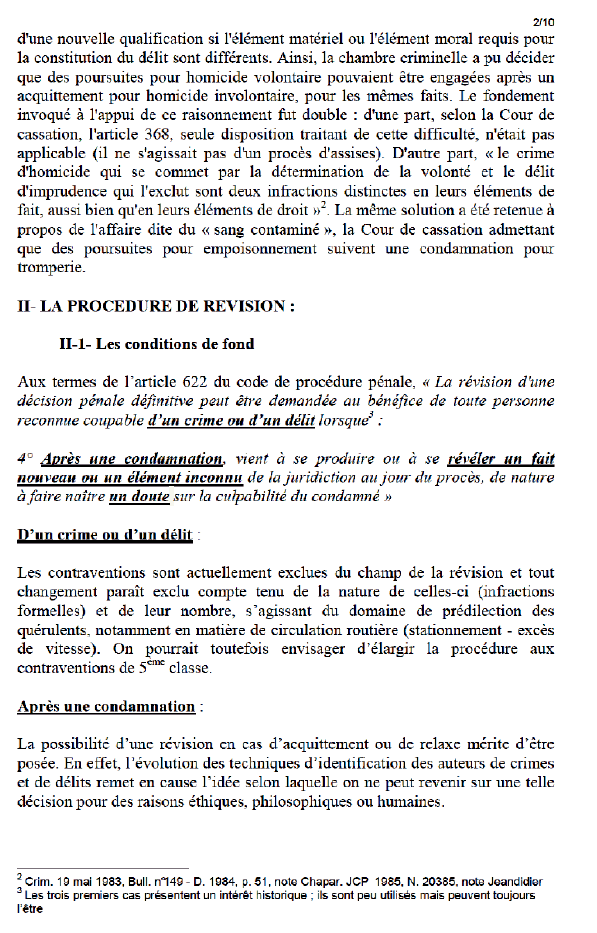
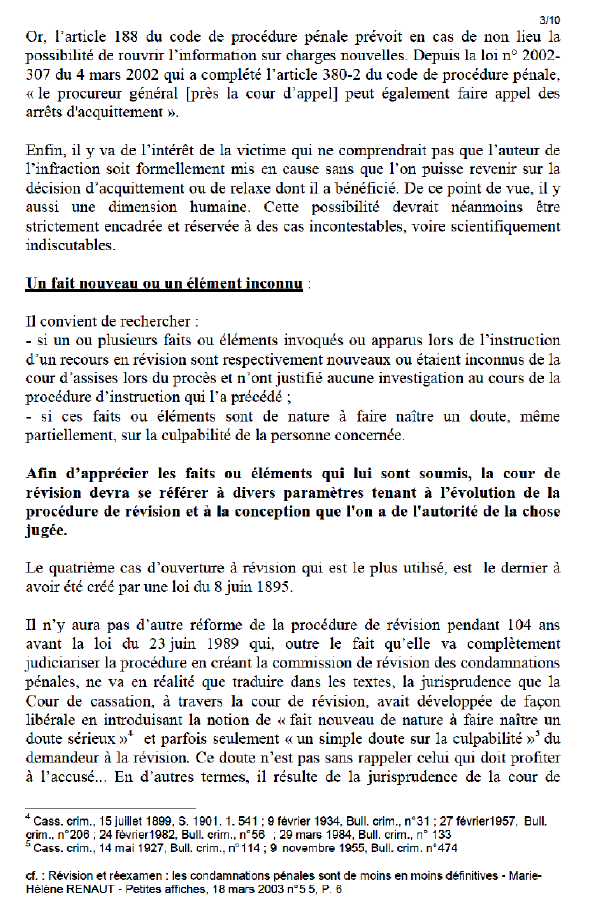
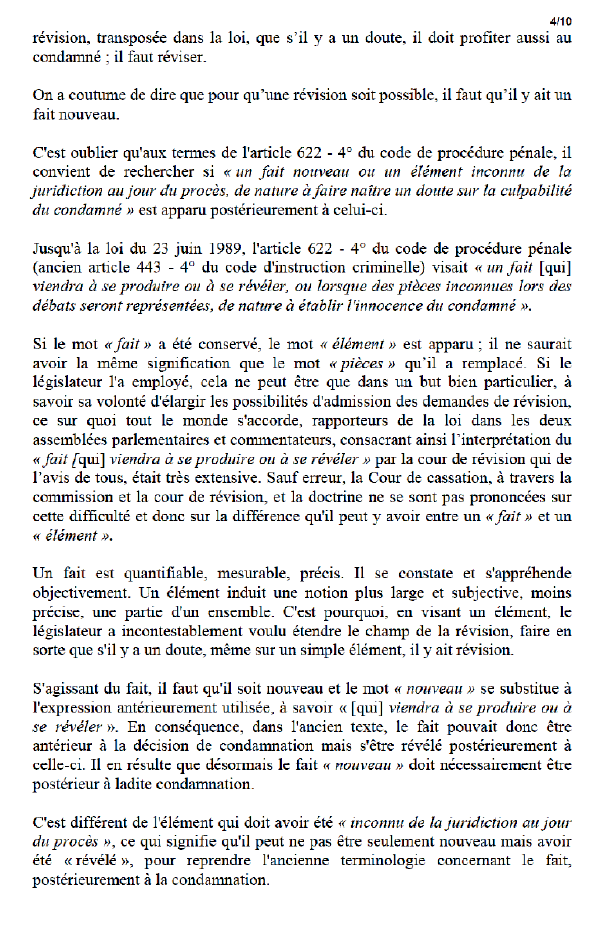
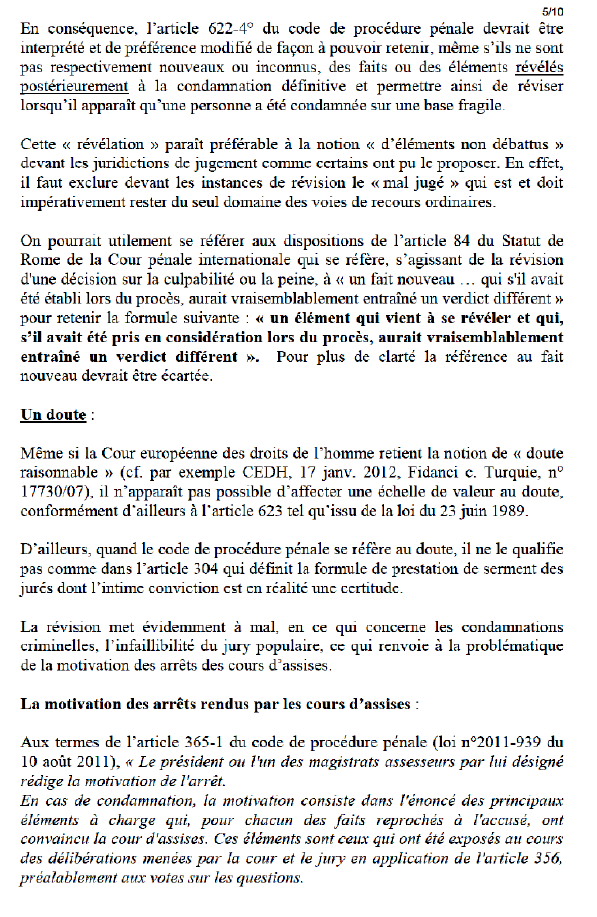
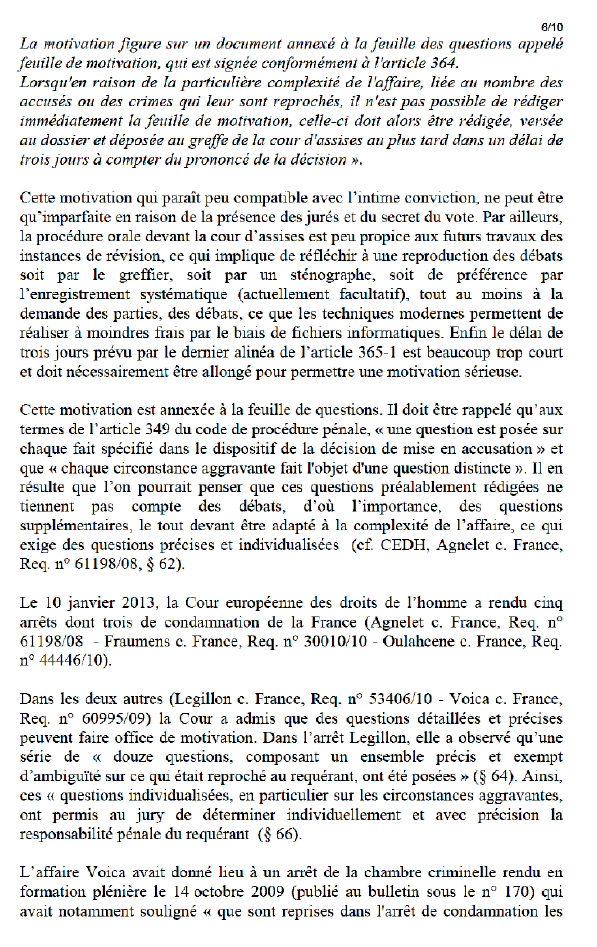
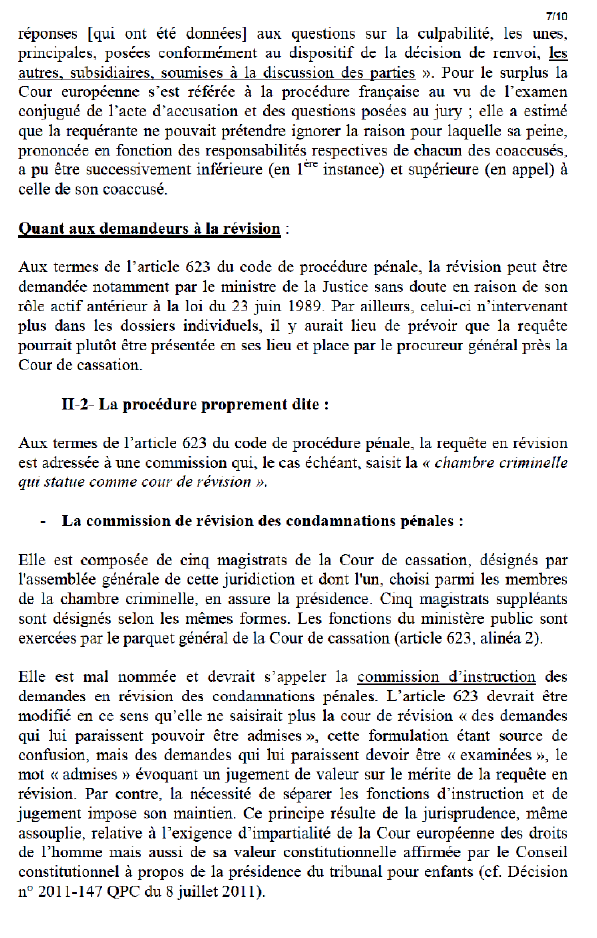
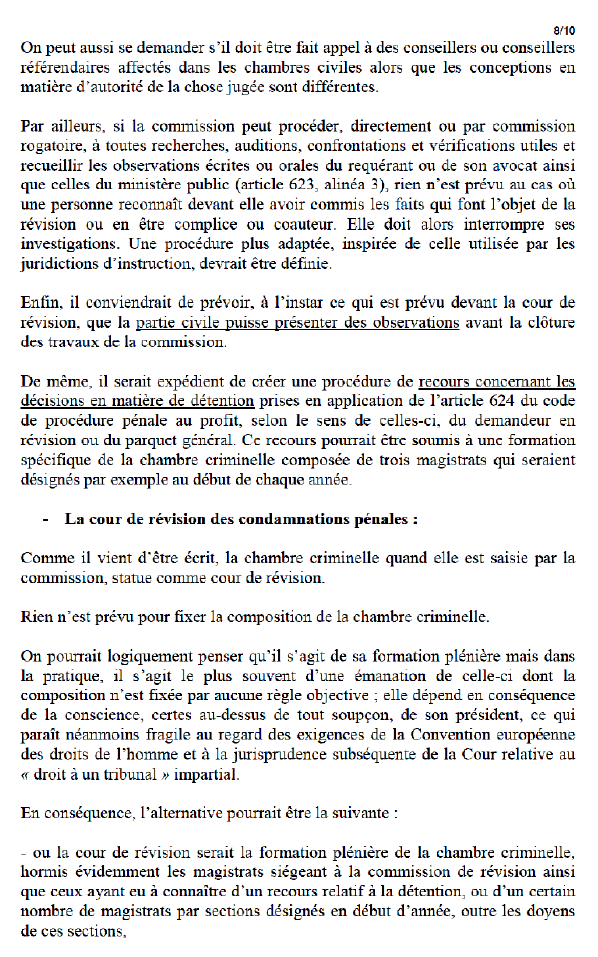
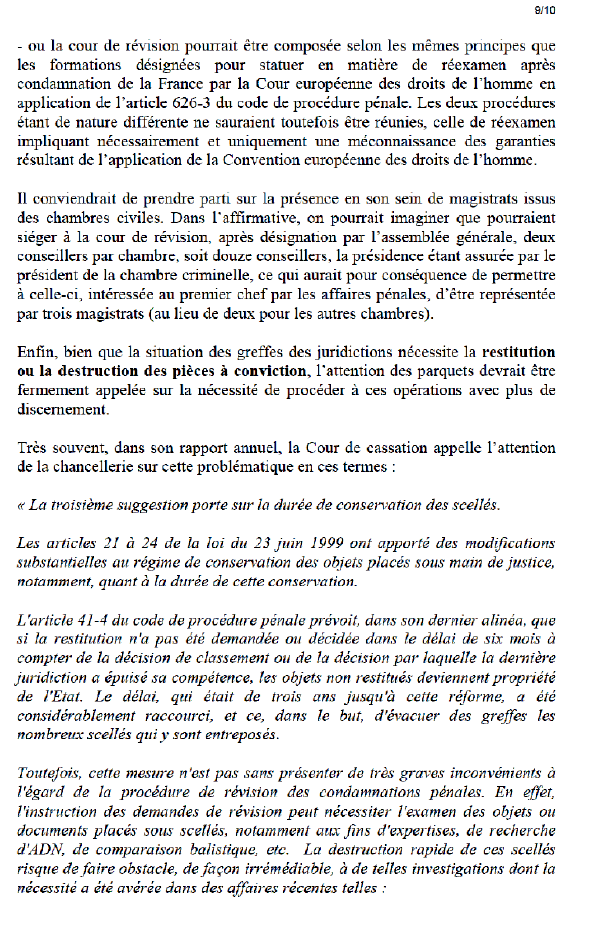
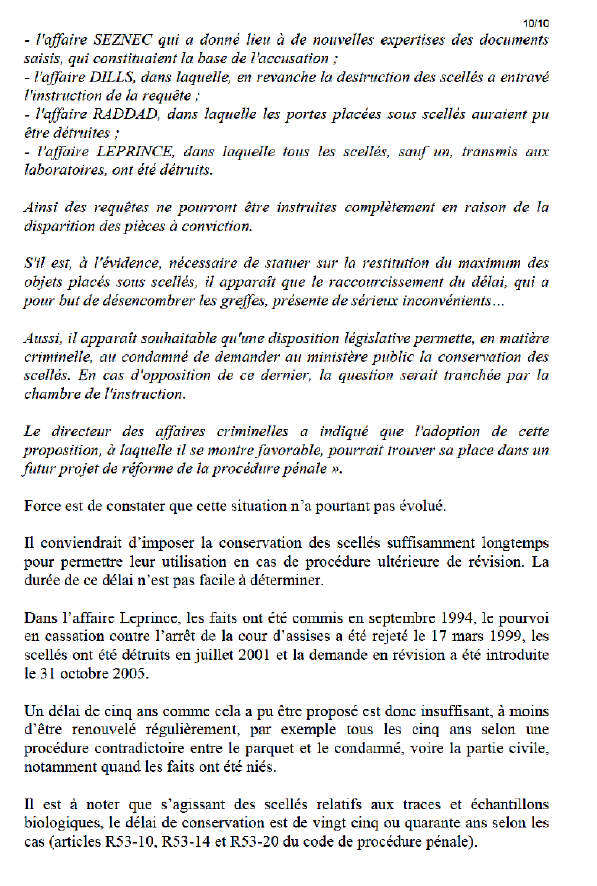
Contribution de Mme Martine Anzani, ancienne présidente de la commission de révision des condamnations pénales
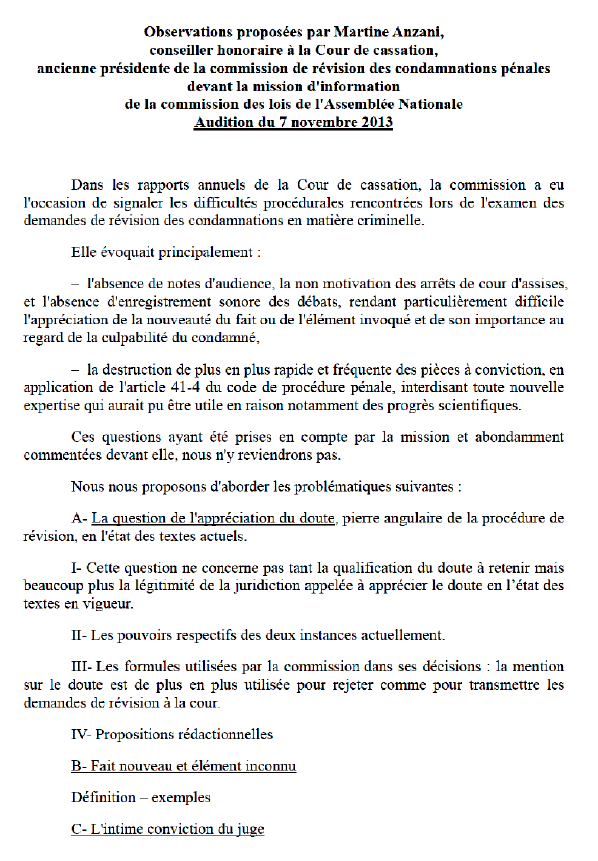
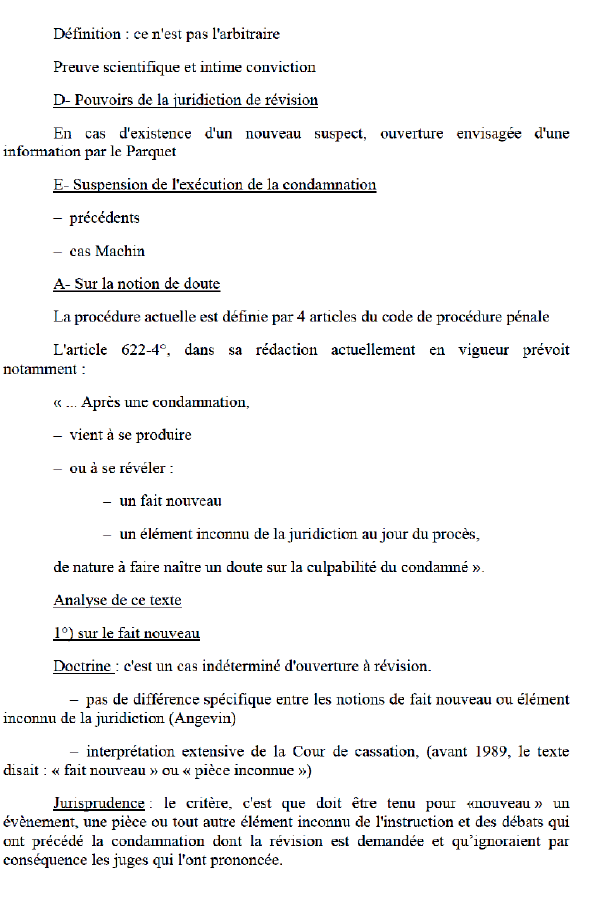
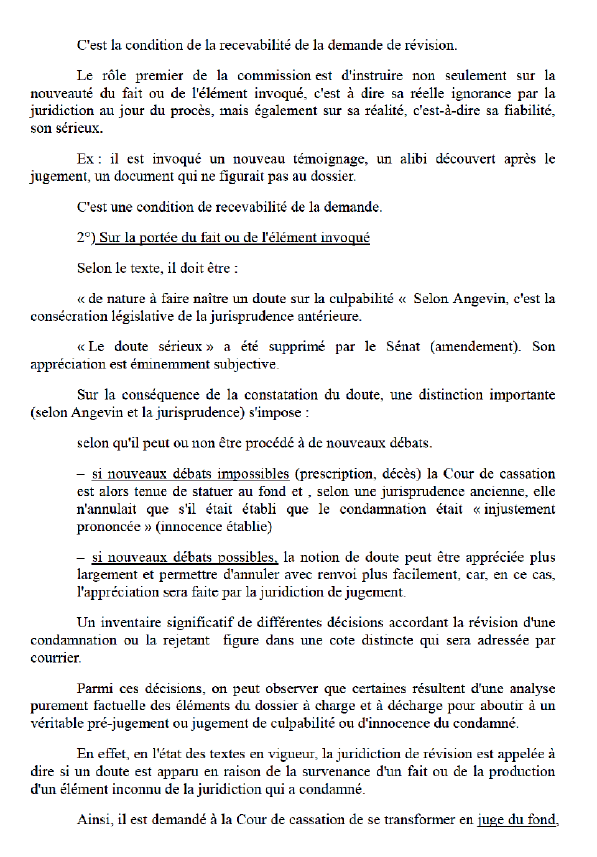
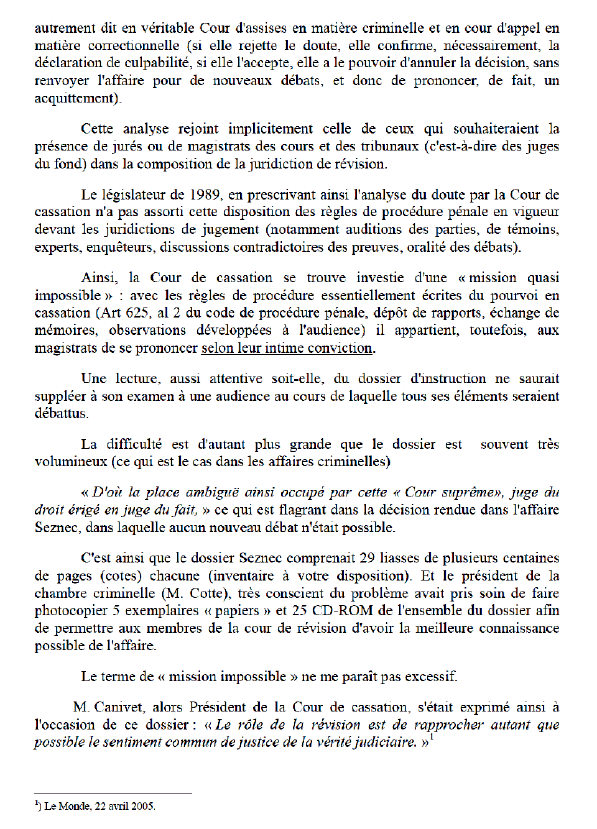
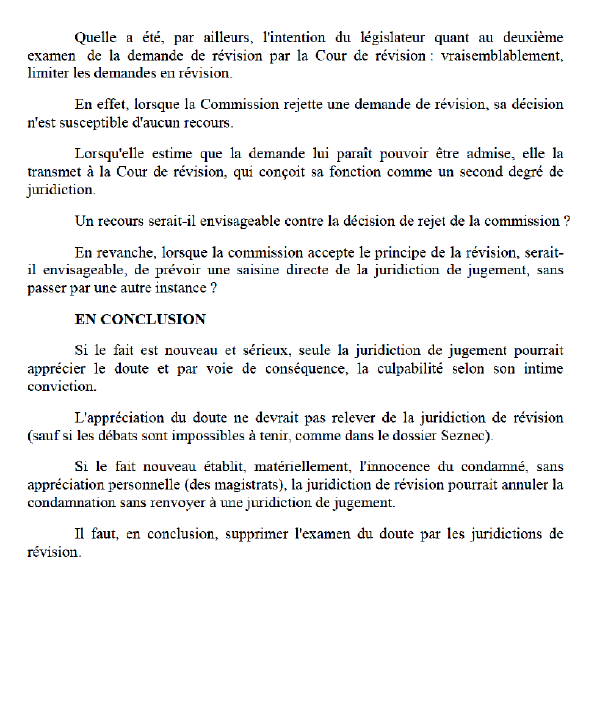
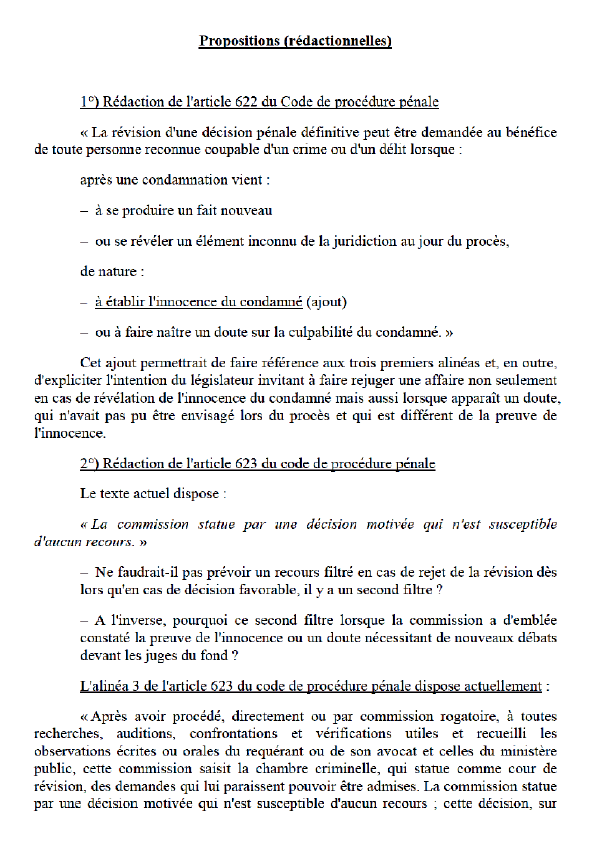
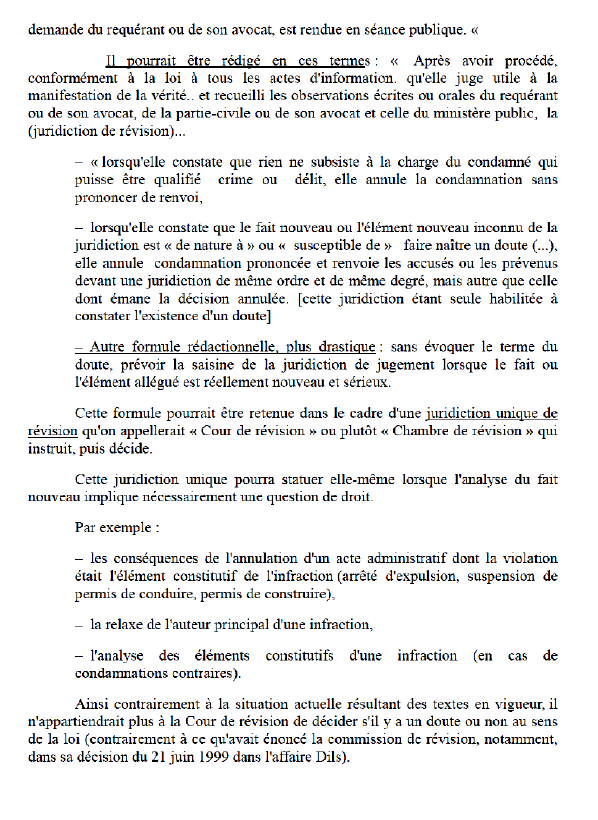
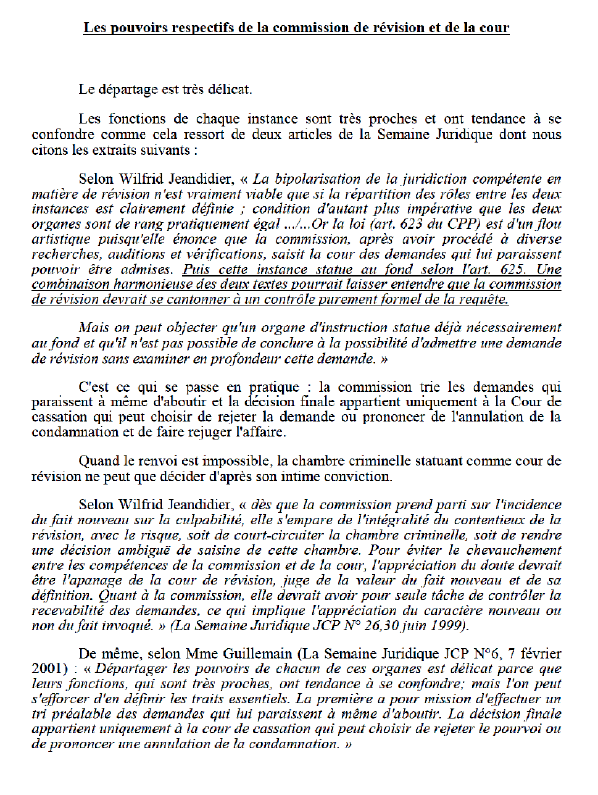
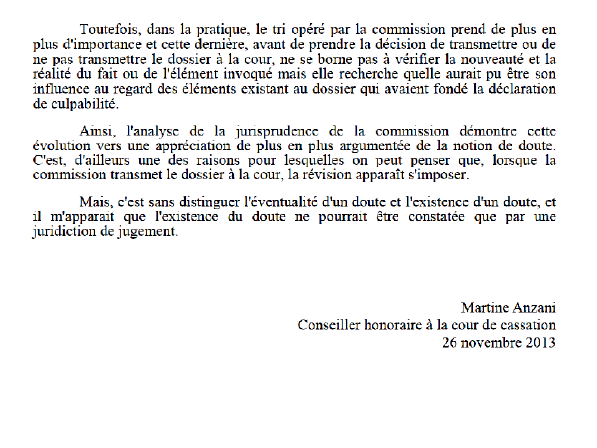
Contribution de Me Valérie Rosano, avocate
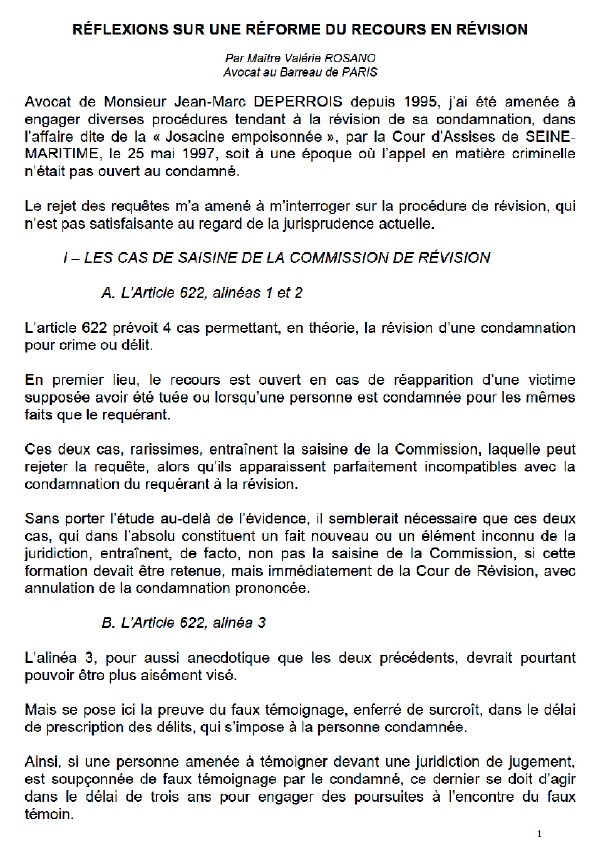
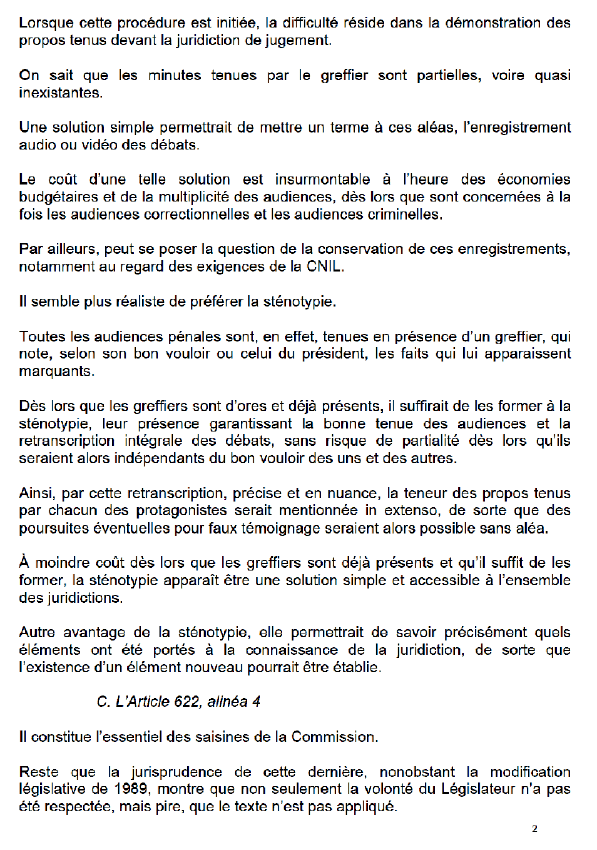
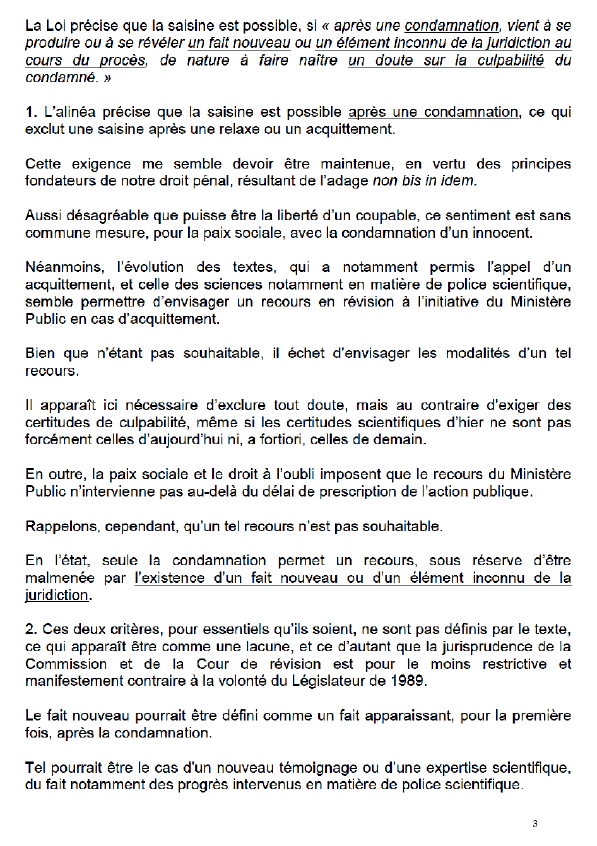
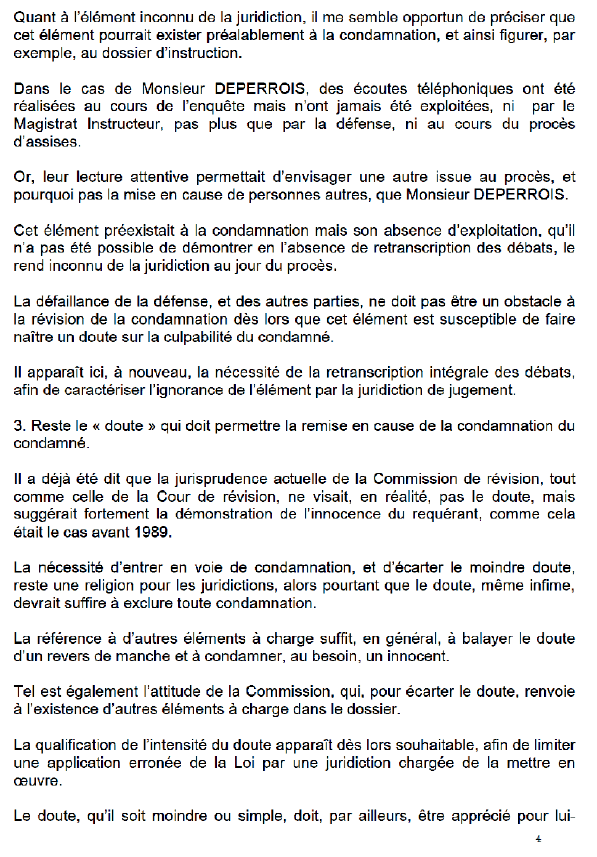
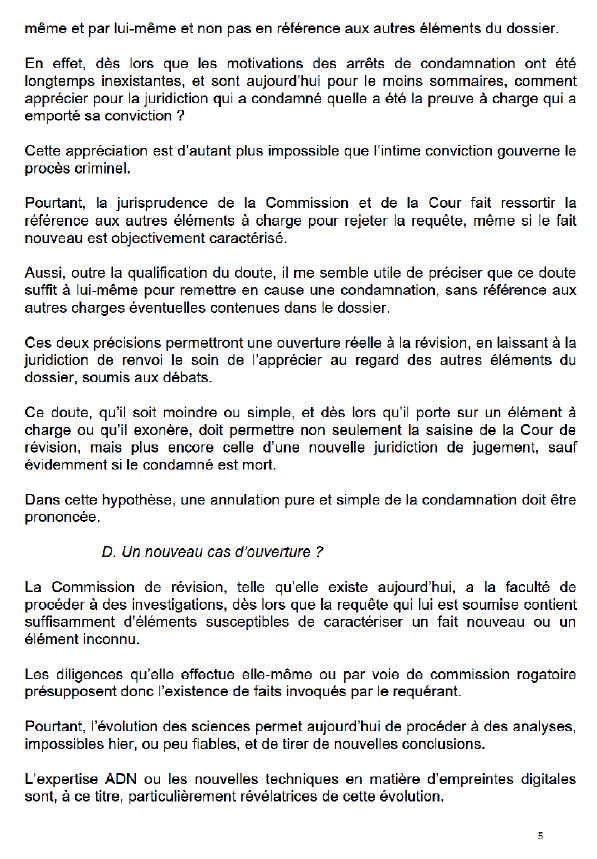
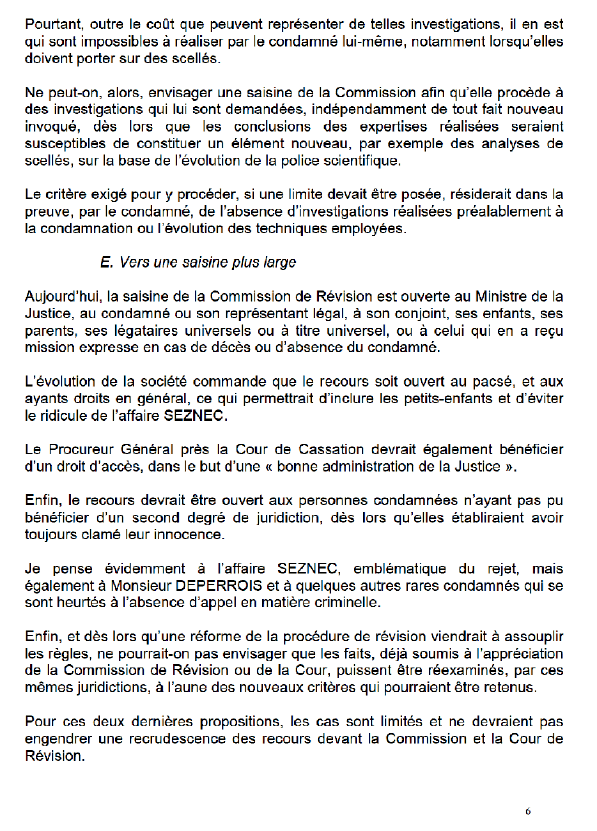
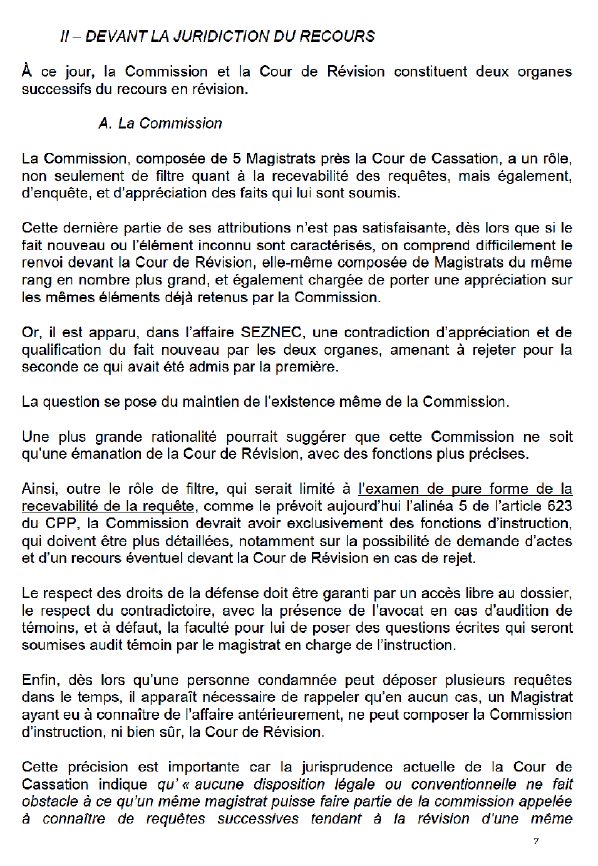
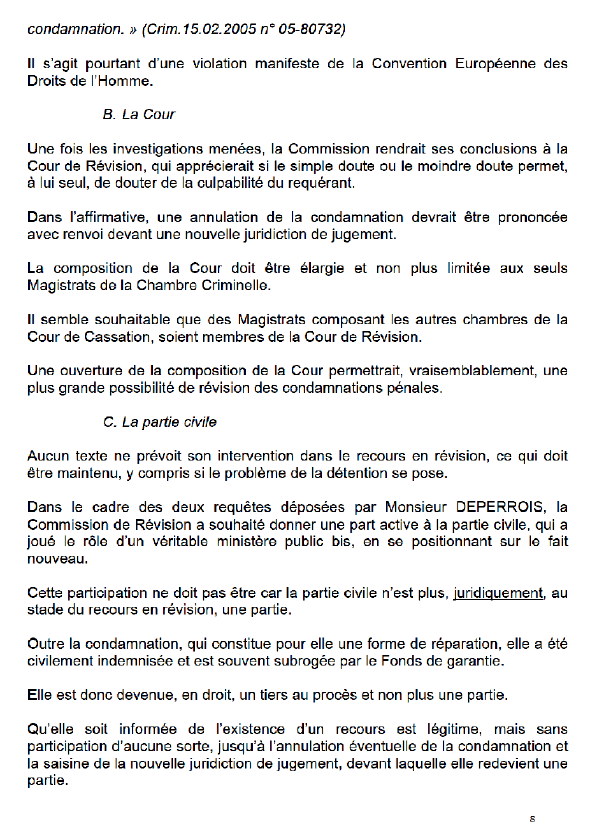
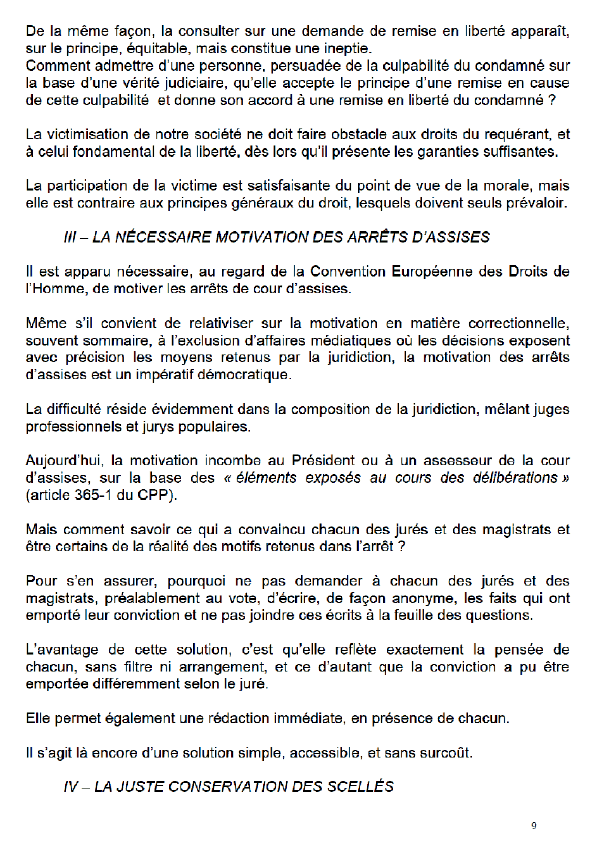
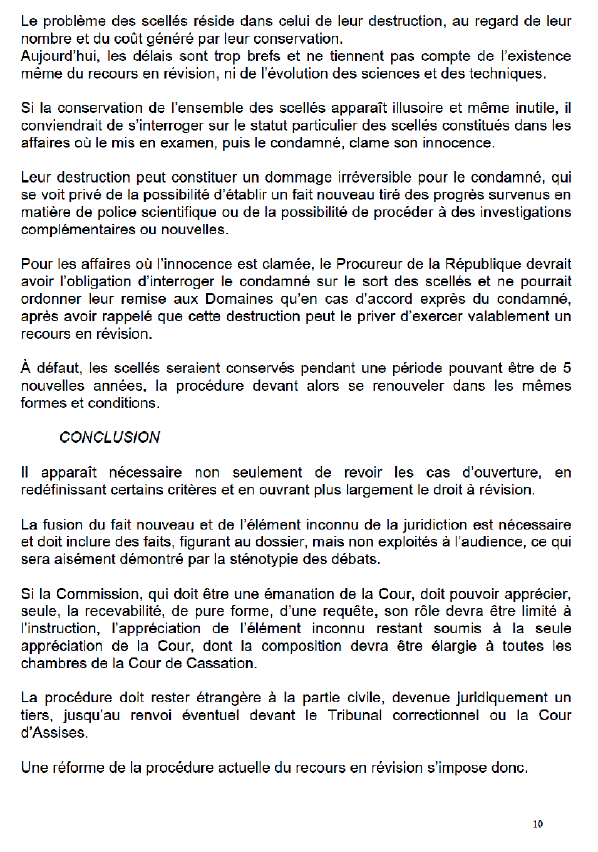
1 () Ces contributions figurent en annexe au présent rapport.
2 () Le choix a été fait de mentionner l’identité complète des parties lorsque celle-ci avait été préalablement révélée par la presse.
3 () Cf. Annexe n° 4.
4 () H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Dalloz, Chroniques, 1968, page 14.
5 () Décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 juillet 1986, n° 83-13359.
6 () J. A. Romeiro, « La révision comme facteur d’ennoblissement de la justice », Revue de science criminelle, 1970.
7 () H. Angevin, Jurisclasseur Procédure pénale, Art. 622 à 626, fascicule n° 20.
8 () « Pour obtenir des lettres de révision de procès, le condamné sera tenu d’exposer le fait, avec ses circonstances par requête qui sera rapportée en notre Conseil, et renvoyée, s’il est jugé à propos, aux maîtres des requêtes de notre hôtel, pour avoir leur avis, que nous voulons ensuite être rapporté à notre Conseil ; et si les lettres sont justes, il sera ordonné qu’elles seront expédiées et scellées ; et pour cet effet, elles seront signées par un Secrétaire de nos commandements ».
9 () Décret du 15 mai 1793 relatif aux accusés condamnés comme auteurs du même délit, et dont les condamnations ne peuvent se concilier, et font la preuve de l’innocence de l’une ou l’autre partie.
10 () Motifs du Livre II, Titre III, chapitre I à IV du code d’instruction criminelle présentés par le comte Berlier, orateur du Gouvernement, au corps législatif lors de la séance du 30 novembre 1808, p. 99.
11 () Ibid, p. 98.
12 () Cité par F. Hélie dans son Traité de l’instruction criminelle, 1867, p. 523.
13 () En 1886, dans l’Aude, un régisseur et sa femme sont assassinés par trois hommes. Des témoins désignent notamment Joseph Borras comme étant l’auteur des faits. Il est condamné en 1887. Le véritable auteur des faits est arrêté peu après, mais bénéficie d’un non-lieu. Joseph Borras est finalement gracié par le Président de la République mais ne sera jamais innocenté, le cas d’ouverture relatif au caractère inconciliable de deux condamnations n’ayant pas été admis par la Cour de cassation.
14 () Lorsque des incendies criminels éclatent à Longepierre, Pierre Vaux, conseiller municipal en opposition au maire Henri Gallemard, est dénoncé par ce dernier et accablé par le témoignage de Balleaut, l’homme de main du maire. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1852. Quelques mois plus tard, de nouveaux incendies sont perpétrés, pour lesquels Henri Gallemard et son complice Balleaut sont arrêtés. Ce dernier avoue être l’auteur des premiers incendies, mais n’est cependant condamné que pour des faits postérieurs à la condamnation de Pierre Vaux. Ce dernier meurt en 1884 au bagne. Ses enfants introduisent un recours en révision, repoussé en 1886 au motif que les deux condamnations ne sont pas inconciliables.
15 () En 1946, le corps d’un garde-chasse est retrouvé dans un étang de l’Indre. Deux jeunes chasseurs sont soupçonnés, Raymond Mis et Gabriel Thiennot. Ils avouent leur crime sous la torture, avant de se rétracter quelques semaines plus tard. Ils sont néanmoins condamnés, en 1947, à quinze ans de travaux forcés. Graciés en 1954 par le Président Coty, ils ont formé plusieurs recours en révision depuis cette date, qui ont tous échoué. Pour la Cour de cassation, les éléments nouveaux à l’appui des demandes de révision n’étaient pas de nature à établir l’innocence des condamnés.
16 () Dès 1899, la Cour de cassation accède à des demandes de révision lorsqu’un « doute sérieux » sur la culpabilité du condamné existe.
17 () Article 89 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence.
18 () Si les procédures de révision et de réexamen sont également ouvertes aux autorités judiciaires, elles se distinguent d’autres voies de réformation exceptionnelles qui ne sont pas ouvertes aux condamnés. Notamment, les dispositions de l’actuel article 620 du code de procédure pénale permettent au garde des Sceaux, par l’intermédiaire du procureur général, de dénoncer à la Cour de cassation des arrêts ou jugements contraires à la loi. D’ailleurs, cette procédure a pu être utilisée, par le passé, pour remédier à des erreurs judiciaires. C’est le cas, par exemple, des affaires Mauvillain et Deveaux. Dans les deux cas, de simples irrégularités de procédure ont permis d’assurer la réouverture d’un procès, là où la révision avait échoué à le faire faute d’éléments nouveaux.
19 () Cf. Annexe n° 2.
20 () Cf. Annexe n° 3.
21 () Loi n° 46-2064 du 25 septembre 1946 ouvrant un recours en révision contre les condamnations prononcées pour outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre.
22 () Cf. annexe n° 1.
23 () L. Chaussebourg et S. Lumbroso, « Les décisions des cours d’assises d’appel : conséquence sur la déclaration de culpabilité », Infostat Justice, n° 100, mars 2008.
24 () L’annexe n° 1 présente la liste des décisions de révision intervenues en matière criminelle depuis 1989.
25 () Décision de la commission de révision du 24 septembre 2001, n° 01-99046.
26 () Décision de la Cour de révision du 29 janvier 1990, n° 81-94.006.
27 () Annuaire statistique de la Justice, 2011-2012, p. 127.
28 () Ibid., p. 129.
29 () En application de l’article 122 du code civil, la personne qui a cessé de paraître à son domicile sans que l’on en ait eu de nouvelles pendant dix ans est déclarée absente et considérée comme décédée au regard de la loi.
30 () Décision de la Cour de révision du 14 décembre 2006, n° 05-82.943.
31 () Dans un tel cas de figure – le témoignage était faux, mais l’infraction de faux témoignage n’est pas constituée –, le cas dit « indéterminé » (cf. infra) peut cependant permettre au condamné de demander la révision.
32 () Décision de la Cour de révision du 14 avril 1999, n° 98-87.055.
33 () Un amendement du Sénat a supprimé le mot « sérieux » qui existait dans la version initiale du texte.
34 () Voir notamment la décision de la Cour de révision du 26 janvier 1994, n° 91-81552.
35 () Il convient de noter que, selon une certaine interprétation, les mots « vient à se produire ou à se révéler » ne seraient pas mis en facteur commun : le fait nouveau se produirait, tandis que l’élément inconnu se révélerait. La rédaction actuelle de l’article 622 ne permet ni d’infirmer, ni de confirmer cette interprétation.
36 () Décision de la Cour de révision du 3 avril 2001, n° 99-84584.
37 () Décision de la Cour de révision du 15 mai 2013, n° 12-84818.
38 () Décision de la Cour de révision du 14 octobre 1998, n° 96-85082.
39 () Décision de la Cour de révision du 24 mai 2006, n° 05-86081.
40 () Décision de la Cour de révision du 8 février 2005, n° 04-85708.
41 () Décision de la Cour de révision du 24 juin 2009, n° 08-86070.
42 () Décision de la commission de révision du 1er juillet 2010, n° 05-REV145.
43 () Ibid.
44 () Décision de la Cour de révision du 6 avril 2001, n° 10-85247.
45 () La motivation de la décision de la commission de révision du 11 avril 2005 est extrêmement modérée en ce qui concerne l’appréciation du fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné : « Que, si la Commission de révision a plénitude de juridiction pour estimer que les conditions de la loi ne sont pas remplies et rejeter les requêtes qui lui sont soumises, elle a également pour mission de saisir la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, " des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises " ; que tel apparaît être le cas en l’espèce ; attendu que la découverte de la personnalité de Boudjema B..., identifié comme pouvant être l’homme avec lequel Guillaume X... et Pierre Y... avaient rendez-vous à Paris le 26 mai 1923, et les soupçons portant sur les relations que cet homme a pu avoir avec l’inspecteur de police Pierre B... au sein de la Gestapo en 1944 constituent des éléments nouveaux dont l’appréciation ne saurait relever de la seule Commission de révision ; attendu que, l’arrêt de la cour d’assises, non motivé, ne permettant pas de savoir sur quels éléments les jurés ont fondé leur intime conviction, il appartient à la chambre criminelle statuant comme Cour de révision d’apprécier si ces éléments nouveaux sont de nature, au regard des charges résultant du dossier, à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume X... ; ».
46 () Rapport n° 404 de M. Philippe Marchand fait au nom de la commission des Lois, novembre 1988, p. 6.
47 () Dernier alinéa de l’article 623 du code de procédure pénale.
48 () Rapport annuel 2012 de la Cour de cassation.
49 () Dans l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de la Cour de révision du 29 février 2000, n° 98-87887.
50 () Dans l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de la Cour de révision du 5 janvier 2000, n° 99-83560.
51 () Dans l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de la Cour de révision du 17 janvier 2007, n° 06-87833.
52 () Dans l’affaire ayant fait l’objet d’une décision de la Cour de révision du 8 février 2005, 04-85708.
53 () Décision de la commission de révision du 1er juillet 2010, n° 05-REV145.
54 () Ibid.
55 () Contribution écrite de M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux travaux de la mission.
56 () Ibid.
57 () Contribution écrite de Mme Martine Anzani, magistrate honoraire et ancienne présidente de la commission de révision, aux travaux de la mission.
58 () Dans l’affaire Leprince, la Cour de révision était composée de dix-sept magistrats, contre une quarantaine dans l’affaire Seznec.
59 () Article 625 du code de procédure pénale.
60 () Il s’agit de l’annulation d’une décision, en 1990, visant une personne décédée depuis et de l’annulation partielle, en 1999, d’une condamnation pour attentat à la pudeur fondée sur un faux témoignage.
61 () Décision de la commission de réparation des détentions du 5 décembre 2005, n° 05-CRD-026.
62 () En l’espèce, le requérant avait souhaité obtenir le conseil d’un avocat qui n’avait pas pu se rendre disponible le jour de l’audience. Il avait alors demandé le report de l’audience, ce qu’avait refusé le président de la cour d’assises. M. Hakkar refusant d’être assisté par un avocat commis d’office, le procès eut lieu sans qu’il dispose d’un avocat.
63 () Amendement n° 219, discuté au cours de la seconde lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, le 10 février 2000.
64 () La Cour de cassation comporte trois chambres civiles, une chambre commerciale, financière et économique, une chambre sociale et une chambre criminelle.
65 () Décision de la commission de réexamen du 16 octobre 2003, n° 03-RDH005.
66 () Décision de la commission de réexamen du 15 février 2001, n° 00RDH002.
67 () Ibid.
68 () Décision de la commission de révision du 12 juin 2006, n° 05REV071 : la commission a considéré que la contravention de défaut de maîtrise était indivisible du délit d’homicide involontaire et que, partant, la Cour de révision devait être saisie de l’ensemble de ces infractions.
69 () Décision de la commission de réexamen du 15 février 2001, n° 00RDH002.
70 () Décision de la commission de réexamen du 4 octobre 2001, n° 01-00001.
71 () Décision de la commission de réexamen du 30 novembre 2000, n° 00RDH003.
72 () Décision de la commission de réexamen du 6 décembre 2001, n° 01-00002.
73 () Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 avril 1996, Remli c. France.
74 () Thèse de M. Lafourcade, La réouverture des procédures juridictionnelles consécutive à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, l’éclairage français, 2012, p. 455.
75 () Décision de la commission de réexamen du 15 février 2001, n° 00RDH002.
76 () Décision de la commission de réexamen du 11 octobre 2007, n° 07RDH004.
77 () Décision de la commission de réexamen du 24 novembre 2005, n° 05RDH003.
78 () Décision de la commission de réexamen du 31 janvier 2013, n° 13RDH001.
79 () M. Noël Mamère avait été condamné en 2001 par la cour d’appel de Paris pour des faits de complicité de diffamation envers un fonctionnaire. Il avait, en 1999, sur le plateau d’une émission télévisée, accusé le directeur du Service central de protection contre les rayons ionisants d’avoir menti sur la dangerosité réelle du nuage de Tchernobyl. La CEDH avait condamné la France, en 2006, pour violation de l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression, estimant qu’eu égard « à l’extrême importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour "nécessaire" "dans une société démocratique" au sens de l’article 10 de la Convention ». Le réexamen de l’affaire avait été ordonné, en 2008, par la commission de réexamen et la juridiction de renvoi avait alors, de façon logique, relaxé M. Noël Mamère.
80 () Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 octobre 2006, Pessino c. France.
81 () Thèse de M. Lafourcade, La réouverture des procédures juridictionnelles consécutive à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, l’éclairage français, 2012, p. 408.
82 () Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 décembre 2005, n° 05-80.988.
83 () « Activités 2011 de la commission de réexamen », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2011.
84 () Contribution de M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle, aux travaux de la mission.
85 () Contribution de Me Jean-Yves Leborgne aux travaux de la mission.
86 () En 2012, d’après le rapport annuel de la Cour de cassation, le taux de cassation de la chambre criminelle s’établissait à 6,6 %, contre 37 % pour les chambres civiles.
87 () Maurice Papon avait été déchu de son droit à former un recours en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde qui l’avait condamné, en 1998, pour complicité de crimes contre l’humanité. À l’époque, il était en effet obligatoire de se constituer prisonnier pour former un pourvoi en cassation. En 2002, la Cour européenne des droits de l’Homme avait condamné la France pour violation de la Convention, au motif que la déchéance de ce droit constituait une entrave excessive au droit d’accès à un tribunal. La commission de réexamen, saisie par Maurice Papon, a fait droit à sa demande et a renvoyé l’affaire, en 2004, à la Cour de cassation, qui a finalement rejeté le pourvoi formé par le requérant.
88 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147, QPC du 08 juillet 2011, considérant n° 11 : « Considérant que le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ».
89 () W. Jeandidier, « Révision de la condamnation du complice après relaxe de l’auteur principal », La Semaine Juridique Édition Générale, n° 26, 30 Juin 1999.
90 () Un tel droit a déjà été accordé, par le passé, aux parties civiles dans le silence de la loi. Dans l’affaire Marc Machin, les parties civiles ont pu, par une décision de la commission de révision, accéder au dossier.
91 () Littéralement, le prêteur ne s’occupe des choses sans importance.
92 () F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 2009, p. 289.
93 () Circulaire conjointe du ministre de la Justice et des libertés du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, NOR : JUSB1134112C.
94 () Article 706-52 du code de procédure pénale et article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
95 () Article 64-1 du code de procédure pénale.
96 () Article R.53-20 du code de procédure pénale.
97 () Réponse du 26 février 2013 de la garde des Sceaux à la question n° 12574 de Mme Cécile Untermaier.
98 () Rapport annuel 2009 de la Cour de cassation.
99 () Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation.
100 () Rapport annuel 2011 de la Cour de cassation.
101 () Ibid.
102 () Proposition de loi de M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues relative à la conservation des objets placés sous main de justice, enregistrée à la présidence du Sénat le 1er août 2013.
103 () Voir notamment la décision n° 2011-113/115 QPC du 01 avril 2011, M. Xavier P. et autres.
104 () CEDH, Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009.
105 () CEDH, Taxquet c. Belgique, 2010, paragraphes 92 et suivants.
106 () CEDH, Agnelet c. France, 10 janvier 2013.
107 () De fait, seules deux questions, jugées « non circonstanciées et laconiques », avaient été posées au jury : l’accusé a-t-il, volontairement ou non, donné la mort à la victime présumée ? A-t-il prémédité son acte ? Par ailleurs, comme l’indique la Cour, « les raisons et les modalités de la disparition d’A.R., y compris la thèse de l’assassinat, ne reposaient que sur des hypothèses, faute de preuves formelles, qu’il s’agisse par exemple de la découverte du corps ou d’éléments matériels établissant formellement les circonstances de lieu, de temps, ainsi que le mode opératoire de l’assassinat reproché au requérant ». Faute de références à des circonstances concrètes, le requérant n’a pas pu comprendre le verdict de la cour d’assises.
108 () Ibid., paragraphe 72.
109 () La motivation est également exigée en cas d’acquittement ou de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
110 () Circulaire du 15 décembre 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs relatives à la cour d’assises applicables au 1er janvier 2012, NOR : JUSD1134281C.
111 () Aux Pays-Bas, la révision d’une condamnation au détriment du condamné n’est encore qu’à l’état de projet de loi.
112 () Ou bien le CPS (service des poursuites pénales) au Royaume-Uni.
113 () Ce n’est toutefois pas le cas au Royaume-Uni.
114 () Une amende peut être infligée à l’encontre d’un requérant qui ne fonderait pas sa requête sur l’un de ces quatre critères.
115 () Un projet de loi, non encore voté définitivement, prévoit aussi deux cas de révision défavorable : de nouveaux éléments de preuve découverts (par de nouvelles preuves techniques ou l’aveu crédible d’un ancien prévenu) font sérieusement présumer que si le tribunal en avait eu connaissance, le prévenu/accusé aurait été condamné ; existence d’une grave irrégularité de procédure. Ce type de révision n’est possible que pour les crimes graves réprimés par une peine de réclusion à perpétuité.
116 () Ces nouveaux éléments de preuve peuvent consister en des échantillons ADN, des empreintes digitales ou un nouveau témoignage capital au procès.
117 () La Cour d’appel saisie peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine ou de la mesure de sureté en la substituant le cas échéant à une mesure restrictive de liberté. Cette décision est également susceptible d’un recours devant la Cour de cassation.
118 () Dans le projet de réforme introduisant la révision défavorable, l’initiative de la révision appartient au collège des procureurs généraux, instance qui coiffe le ministère public néerlandais.
119 () Dans le projet de réforme introduisant la révision défavorable, c’est encore la Cour de cassation qui statue. Si la demande en révision est fondée, l’affaire est transmise à un tribunal avec possibilité d’appel et de pourvoi en cassation. En principe, le ministère public ne peut demander à plusieurs reprises une révision défavorable.
120 () La requête peut être déposée au greffe de la juridiction compétente pour la procédure de révision, ou bien au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, qui la transmettra à la juridiction compétente. Elle doit préciser le motif légal de révision de la procédure alléguée ainsi que les moyens de preuve invoqués.
121 () Le juge qui effectue l’instruction du dossier ne participe pas ensuite aux délibérations de la juridiction.
122 () Lorsque la révision est consécutive à une décision de la CEDH, elle est de la compétence de la haute Cour de Cassation et de Justice (art 408-1). Lorsqu’elle est consécutive à une décision de la Cour Constitutionnelle, elle est de la compétence de la juridiction qui a prononcé la décision restée définitive (art 408-2).
123 () Les membres du ministère fédéral de la justice consultés, sans pouvoir contester cette estimation qui leur paraît raisonnable, ne sont pas en mesure de la confirmer officiellement faute de statistiques sur ce point.
124 () ("Bundesgerichtshof"), Klaus Tolksdorf, dans une interview du 4 novembre 2012 au journal « Stuttgarter Zeitung ». http://m.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.interview-zu-fehlurteilen-kein-mensch-wuerde-richter.16065407-e8a5-4097-bc7a-17c455f1f010.html
125 () Des recherches effectuées dans la presse pour la période 2001-2012 ont permis d’identifier avec certitude les 12 cas suivants de révision dans l’intérêt du condamné :
- Dossier Huy P. (révision en janvier 2012 et déclaration d’irresponsabilité pénale de l’accusé pour des faits de meurtre)
- Dossier Horst A. (révision en juillet 2011, acquittement des faits de viol)
- Meurtre de Rudolf Rupp (révision en février 2011, acquittement des accusés)
- Dossier Ralph et Karl-Heinz W- (révision en septembre 2010, acquittement des faits de viol)
- Dossier Harry Wörz (révision en octobre 2009, acquittement des faits de tentative de meurtre)
- Dossier Gregor H. (révision en octobre 2009, acquittement des faits d’incendie volontaire et tentative de meurtre)
- Dossier Horst Arnold (révision en mars 2008, acquittement des faits de viol)
- Dossiers Adolf S et Bernhard M (révision en décembre 2005 et octobre 2006, acquittement des faits de viol)
- Dossier Günther Kaufmann (révision en janvier 2005, acquittement des faits d’extorsion de fonds)
- Dossier Richard S. (révision en février 2002, acquittement des faits de viol et de meurtre)
- Dossier Anton W. (révision en mars 2001, acquittement des faits de viol)
- Dossier Donald Stellwag (révision en 2001, acquittement des faits de vol à main armée et prise d’otages)
126 () Il n’est pas possible de connaître exactement le nombre des procédures de révision entrant dans le cadre du réexamen d’une décision après arrêt de la CEDH puisque la procédure de révision en Allemagne est :
- entièrement décentralisée
- exactement la même quel que soit le cas d’ouverture.
127 () En l’absence de magistrat de liaison en Italie, il ne nous a pas été possible de connaître le nombre exact de procédure de révision entrant dans le cadre du réexamen d’une décision après arrêt de la CEDH.
128 () Affaires emblématiques aux Pays-Bas:
- Affaire Putten (1994) : à la suite du meurtre de Christel Ambrosius, la police arrêta quatre personnes qui se trouvaient, ce week- end là dans les bois jouxtant les lieux du meurtre (maison de la grand mère de la victime). Deux des personnes arrêtées furent condamnées à 10 ans d’emprisonnent alors même que l’Adn retrouvé ne correspondait pas à l’Adn des suspects .En avril 2002, la Cour de Cassation accepta la révision. En 2007, un suspect fut arrêté dont l’Adn correspondait à celui retrouvé sur les lieux du crime.
- Affaire du meurtre du parc de Schiedam (2000) : meurtre d’une enfant de 10 ans dans un parc et condamnation de Cees Borsboom à 14 ans d’emprisonnement. Un certain Wik Haalmeijer, arrêté pour d’autres faits, avoua en 2004 le meurtre et ses aveux furent corroborés par l’Adn et par les déclarations de l’enfant accompagnant la victime.
Cette affaire fit grand bruit et entraina la révision de la condamnation par la Cour de Cassation.
- Affaire Lucia de Berk (2003) : Cette infirmière en pédiatrie fut condamnée en 2003 à une peine de réclusion à perpétuité pour quatre meurtres et trois tentatives de meurtres sur des patients qu’elle suivait dans le cadre de ses activités professionnelles.
En 2008, le dossier a été ré ouvert par la Cour de Cassation néerlandaise à la suite de la découverte de nouveaux faits (travail d’experts sur les dossiers médicaux des victimes concluant à des morts naturelles). Elle a été rejugée et acquittée en avril 2010.
129 () Pas de précisions communiquées sur cette affaire.
130 () Affaires emblématiques : l’affaire Ţundrea – qualifiée de « plus grave erreur judiciaire dans l’histoire de la justice roumaine »
Marcel Ţundrea a été condamné en 1997 à 25 ans d’emprisonnement dont il a purgé 12 ans. Il a toujours contesté les faits de viol et meurtre pour lesquels il a été condamné et lutté pour voir reconnue son innocence. Le 16 juin1992. Mioara Gherasie, âgée de 14 ans, est violée et tuée à Pogojeni, département de Gorj. Elle est décédée d’une asphyxie provoquée par des cailloux enfoncés dans son œsophage.Les soupçons du parquet se portent sur Marcel Ţundrea, un voisin de Mioara, hospitalisé peu de temps après les faits pour des examens psychiatriques. Le 13 juillet 1992 Marcel Ţundrea est mis en examen pour viol et meurtre par le procureur Ion Diaconescu. La principale preuve contre Ţundrea est son groupe sanguin A-II, identique à celui trouvé sur les prélèvements effectués dans le vagin de la jeune fille.Une des dernières personnes ayant vu Mioara avant sa mort, Gheorghe Avram, n’a pas été entendue, en revanche, un témoin a déclaré avoir vu Ţundrea aux cotés de la victime à la date du viol et du meurtre. La procédure de révision a établi que le Procureur, Ion Diaconescu aurait influencé ce témoin à cette fin.
Ţundrea est condamné par le Tribunal de Gorj le 18 mai 1993 pour viol et meurtre, condamnation devenu définitive le 27 novembre 1997 lorsque la Haute Cour de Cassation et de Justice ordonne sa condamnation définitive.
À partir de 2002, les premiers test ADN officiels sont effectués dans les affaires pénales en Roumanie. Un test ADN effectué en 2004 révèle que Ţundrea n’était pas l’auteur du viol qui avait en réalité été commis par le nommé Gheorghe Avram, originaire du même village et ayant partagé pendant un certain temps la même cellule que Marcel Ţundrea. Gheorghe Avram était incarcéré pour des crimes avec violence, y compris homicide, perpretrés après l’incarceration de Ţundrea. Marcel Ţundrea avait d’ailleurs désigné Gheorghe Avram à plusieurs reprises comme étant le vrai coupable, se fondant sur les discussions qu’il avait eu avec Avram pendant leur incarcération et sur le fait que jusqu’à l’arrestation d’Avram d’autres crimes avec violence, y compris des homicides, avaient été commises dans cette commune, les faits ayant cessé après la condamnation de ce dernier à 25 ans d’emprisonnement. Le 17 septembre 2004, le Tribunal de Braşov admet la demande de révision formulée par Ţundrea (il avait formulé 80 demandes de révision), annule la décision du Tribunal de Gorj et ordonne son acquittement pour les faits de viol seulement. Marcel Ţundrea décède le 18 janvier 2007 à l’âge de 57 ans, d’une infection pulmonaire. Il est acquitté le 23 aout 2009 à titre posthume, pour les faits de meurtre.
Une fois la décision d’acquittement définitive, le dossier revient au Parquet de Gorj pour la reprise de l’enquête. En juin 2010 le Procureur Général de la Roumanie ordonne le transfert du dossier au Parquet général. Le 14 mars 2011 Gheorghe Avram est renvoyé en jugement pour le meurtre mais pas pour les faits de viols, qui se trouvent prescrits du fait de la prescription spéciale. Selon les enquêteurs, ni la responsabilité du procureur ni celle des juges ayant condamné Marcel Ţundrea ne peut plus être engagée car la fille de Ţundrea a engagé tardivement l’action en justice à l’encontre de l’État roumain.
© Assemblée nationale