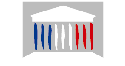
N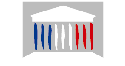
° 1613
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2013.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 146-3, alinéa 6, du Règlement
PAR LE COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
sur l’évaluation des politiques publiques en faveur
de la mobilité sociale des jeunes
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Régis JUANICO et Jean-Frédéric POISSON
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE : PRÉSENTATION PAR LES RAPPORTEURS 13
INTRODUCTION 25
PREMIÈRE PARTIE : MALGRÉ LA MOBILISATION DE MOYENS PUBLICS IMPORTANTS, LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES RALENTIT 29
I. LE MODÈLE FRANÇAIS DE MOBILITÉ SOCIALE A TENDANCE À SE GRIPPER 29
A. L’ÉTAT DES LIEUX DE LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES EN FRANCE 29
1. Égalité des chances ou mobilité sociale ? Une question de mesure 29
2. Les résultats en termes d’égalité des chances 31
3. Les résultats en termes de mobilité sociale 33
a. De nouvelles variables explicatives de la mobilité sociale 34
b. Une dynamique d’ascension sociale soutenue par la croissance du nombre d’emplois supérieurs 36
c. L’importance des trajectoires intergénérationnelles descendantes et du phénomène plus global de déclassement 38
4. Des perspectives plus favorables pour les années à venir 43
B. LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE FRANÇAIS 45
1. Entre familialisme et encouragement à l’autonomie précoce des jeunes, la transition vers l’âge adulte est marquée en France par la place centrale de la scolarité 46
a. Trois repères étrangers : Danemark, Royaume-Uni et Espagne 46
b. Des politiques publiques françaises en direction des jeunes entre politiques familiales et aides directes à l’autonomie 47
c. La place centrale du système scolaire français dans les destins sociaux 47
d. Questionnements issus des comparaisons internationales 48
2. Malgré une réelle démocratisation de l’accès aux diplômes dans le secondaire et le supérieur, le système éducatif français demeure marqué par la différenciation sociale des performances des élèves 48
3. Le système scolaire français marque durablement les destins et les esprits 49
a. Un grand nombre de sorties sans diplôme et sans qualification du système éducatif 49
b. Quel regard porté sur notre système éducatif ? 51
C. L’APPARITION DE FREINS À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES 53
1. Depuis une vingtaine d’années, la mobilité sociale intergénérationnelle progresse moins, voire régresse selon certains indicateurs 53
a. Les enseignements de la dernière enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) de l’INSEE (2003) 53
b. Le recul des résultats scolaires et de l’accès au bac des enfants des classes sociales les plus défavorisées 55
c. La mobilité sociale freinée en France par le niveau croissant des inégalités sociales ? 56
2. La « situation sociale » des jeunes en France est nettement défavorable par rapport aux autres classes d’âge, ce différentiel allant en s’accroissant pour certains indicateurs 59
a. Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté et la précarité 59
b. Les jeunes sont plus souvent au chômage, a fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 62
c. Les jeunes disposent de revenus et de patrimoines plus faibles 63
II. LES POLITIQUES PUBLIQUES CONCOURANT À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES : UN EMPILEMENT DE DISPOSITIFS SANS GOUVERNANCE D’ENSEMBLE 66
A. DES MOYENS BUDGÉTAIRES CONSÉQUENTS, MAIS DES DISPOSITIFS PEU LISIBLES 66
1. La mobilité sociale des jeunes dans le budget de l’État : 9 missions, 17 programmes et plusieurs dizaines de milliards d’euros 66
a. La mission « Enseignement scolaire » 66
b. La mission « Recherche et enseignement supérieur » 68
c. La mission « Sports, jeunesse et vie associative » 70
d. La mission « Travail et emploi » 72
e. La mission « Égalité des territoires, logement et ville » 74
2. Une action publique difficilement lisible 75
a. L’action publique en faveur de la mobilité sociale des jeunes manque d’objectifs clairs et d’une définition de l’effort collectif souhaitable en direction de la jeunesse 75
b. Certains dispositifs publics apparaissent segmentés et partiels – l’exemple des internats d’excellence 77
c. L’instabilité et la complexité des dispositifs dégradent la crédibilité de l’action publique : l’exemple des aides à l’emploi 80
B. DES ACTEURS MULTIPLES MAL PILOTÉS 82
1. La faiblesse de l’organisation de l’État sur les questions relatives aux jeunes 82
a. Une administration centrale limitée et un renforcement récent de l’interministérialité à conforter 82
b. Une administration déconcentrée diluée 83
c. Certaines politiques publiques à destination des jeunes doivent se renouveler : l’exemple de l’information jeunesse 84
d. L’intervention décentralisée dans les politiques de jeunesse : qualité et complexités ? 87
2. Quelle voix des jeunes dans les lieux qui les concernent et dans notre société ? 89
a. Pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes sur les sujets qui les concernent 89
b. Pour un plus grand nombre de jeunes dans les lieux de décision 90
C. UNE EFFICACITÉ INÉGALE ET INSUFFISAMMENT ÉVALUÉE 93
1. Une évaluation encore insuffisante de l’impact des différents dispositifs concourant à la mobilité sociale 93
a. Un suivi de la performance des dispositifs pour le moins inégal et parfois peu lisible dans les documents budgétaires 93
b. Plus largement, des travaux d’évaluation qui pâtissent de la dispersion de l’expertise, avec des lacunes à combler dans plusieurs domaines 96
2. Une démarche expérimentale à poursuivre en développant la capitalisation de leurs résultats 99
a. Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) : de nombreux projet soutenus dans le cadre d’un dispositif inédit et ambitieux 100
b. Une phase de capitalisation essentielle : améliorer la capacité des expérimentations à préfigurer des politiques publiques innovantes 102
ANNEXE N° 1 : L’IMPACT DE L’ÉCOLE SUR LA MOBILITÉ SOCIALE DES ÉLÈVES : LES LIENS ENTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET LES PERFORMANCES SCOLAIRES 111
ANNEXE N° 2 : LES DISPOSITIFS PUBLICS CONCOURANT À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES 149
DEUXIÈME PARTIE : MOBILITÉ SOCIALE ET FORMATION INITIALE : RÉFORMER L’ORIENTATION ET ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION 165
I. AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES DANS LEUR ORIENTATION 165
A. L’ORIENTATION À LA FIN DU COLLÈGE DOIT S’APPUYER DE FAÇON CROISSANTE SUR UNE ANTICIPATION PÉDAGOGIQUE DE CETTE ÉTAPE FONDAMENTALE 166
1. La procédure d’orientation et d’affectation des élèves à l’issue de la troisième 166
a. Le fonctionnement d’Affelnet, basé sur l’équité et la transparence, n’évite pas tout risque d’orientation subie pour des élèves fragiles 166
b. Quelle est la satisfaction des élèves et de leur famille quant à la procédure d’orientation et d’affectation à la fin du collège ? 168
2. La préparation de l’orientation à l’issue du collège fait concrètement l’objet de pratiques très inégales 169
a. Le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) au collège mis en place depuis 2008 169
b. Les leçons à tirer de certaines initiatives locales 170
c. La question de l’aide à la mobilité géographique rendue nécessaire par certains vœux d’orientation 171
B. LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS DOIT ÊTRE PLACÉ AU CœUR DE LA SCOLARITÉ AU COLLÈGE 173
a. Instaurer un travail partenarial : le rôle central du chef d’établissement 173
b. Valoriser la cheville ouvrière du travail en équipe : le professeur principal 174
c. Associer résolument les conseillers d’orientation-psychologues au travail de l’établissement concernant l’orientation 175
d. Former les équipes pédagogiques pour présenter clairement aux élèves ce que sont les métiers et la vie professionnelle 177
C. LE COLLÈGE UNIQUE DOIT ADAPTER SON OFFRE ÉDUCATIVE À LA VARIÉTÉ DES ÉLÈVES, NOTAMMENT QUAND CEUX-CI SONT EN DIFFICULTÉ 179
1. L’offre scolaire du collège unique n’est pas adaptée aux élèves qui n’auront pas vocation à intégrer la voie générale après la 3ème 179
2. Cette offre doit être adaptée pour les élèves en difficulté 180
a. Des exemples sur le terrain à Saint-Étienne et Saint-Malo 180
b. Pour une diversification de l’offre d’enseignement au collège en direction des jeunes en difficulté 181
D. LA PRÉPARATION DE L’ORIENTATION POST BAC DOIT CONTRIBUER À LIMITER L’ÉCHEC DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 182
1. L’orientation post bac, en principe préparée dès la seconde, s’organise autour d’un dispositif en ligne qui place le futur étudiant en responsabilité 182
a. Le PDMF se poursuit au lycée de la classe de seconde jusqu’à la fin de la terminale et prépare l’orientation post bac 182
b. La préparation à l’orientation peut prendre la forme de mesures concrètes de transition entre le lycée et l’enseignement supérieur 184
c. Le dispositif en ligne Admission Post Bac (APB), renseigné directement par l’élève, s’inscrit dans la démarche « d’orientation active » 185
2. Quelle efficacité de la démarche d’orientation au lycée professionnel ? 187
a. Des appréciations positives sur l’action des personnels en charge de mettre en œuvre le PDMF 187
b. Sur le terrain, en lycée professionnel, le regard assez sévère porté sur le dispositif APB 188
II. REDONNER DE LA VISIBILITÉ AUX FILIÈRES PROFESSIONNELLES 190
A. QUEL OBJET, QUELLE IDENTITÉ POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL ? 190
B. L’APPRENTISSAGE COMME FACTEUR DE MOBILITÉ SOCIALE CONNAÎT AUJOURD’HUI DES RÉSULTATS RÉELS MAIS SANS DYNAMIQUE DE PROGRESSION 193
1. Des effectifs en baisse pour les bas niveaux de qualification et le risque d’un apprentissage à deux vitesses 193
a. La baisse des effectifs d’apprentis, confirmée en 2013, a des causes conjoncturelles et structurelles 193
b. Le développement récent de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur offre-t-il des garanties en termes de mobilité sociale ? 195
2. Des difficultés structurelles pesant sur le développement de l’apprentissage en France 196
a. L’orientation à la française et la dichotomie du système de formation professionnelle donnent à l’apprentissage une image paradoxale 196
b. Les modalités de financement sont complexes et mettent en jeu de nombreux acteurs 197
3. Un taux d’échec non négligeable, mais une contribution réelle à l’insertion professionnelle sinon à la mobilité sociale des jeunes 199
a. La proportion d’échec des contrats d’apprentissage pèse sur la mobilité sociale 199
b. L’apprentissage demeure une voie efficace pour l’insertion des jeunes qui vont au bout de la démarche 201
C. DONNER À L’APPRENTISSAGE L’IMAGE QU’IL MÉRITE ET LES MOYENS DE SON DÉVELOPPEMENT 202
1. Fixer et tenir des objectifs ambitieux quantitatifs en termes d’apprentissage 202
a. L’objectif de 500 000 apprentis en 2017 nécessite une augmentation régulière du nombre d’apprentis 202
b. Une attention particulière doit être portée à l’apprentissage infrabac, tout en veillant à répondre aux besoins de l’économie 204
2. Clarifier et améliorer la gouvernance et le financement de l’apprentissage 205
a. Un rapprochement entre lycées professionnels et CFA doit pouvoir pallier une dichotomie surannée 205
b. Le financement de l’apprentissage devrait être résolument simplifié dans le contexte d’un chef-de-filat exercé par les régions 206
3. Contribuer à développer encore l’apprentissage : lutte contre les freins relatifs aux besoins financiers des jeunes et à leur orientation au sein du système scolaire 206
a. Modifier résolument les pratiques d’information et d’orientation pour donner à l’apprentissage le reflet qui devrait être le sien : une modalité efficace et appréciée de formation professionnelle 206
b. Mieux prendre en compte les difficultés culturelles, matérielles et financières des jeunes liées à l’apprentissage 207
III. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LES DISPOSITIFS DE SECONDE CHANCE 209
A. LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EST UN PHÉNOMÈNE D’AMPLEUR SUBSTANTIELLE EN FRANCE 209
1. L’ampleur du décrochage scolaire en France 209
a. Définition et recensement du décrochage scolaire 209
b. L’ampleur de l’absentéisme et du décrochage scolaires 209
2. Quel impact du système scolaire français sur le décrochage ? 211
a. Existe-t-il un ou des « profils » de décrocheurs ? 211
b. Certaines caractéristiques du système éducatif français contribuent sans doute à l’ampleur du décrochage scolaire 213
B. LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DOIT ÊTRE ACCENTUÉE 214
1. Accroître la prévention pour atteindre l’objectif gouvernemental d’une baisse de moitié du nombre des décrocheurs d’ici 2017 214
a. Les objectifs et les moyens prévus par la loi sur la refondation de l’école de la République 214
b. Aller plus loin dans la prévention du décrochage 215
2. Améliorer le fonctionnement du dispositif de suivi et d’appui aux décrocheurs 216
a. La mise en place et le fonctionnement du dispositif 216
b. Quels résultats nationaux et locaux du traitement du décrochage scolaire ? 219
C. L’OFFRE DE SECONDE CHANCE, SUBSTANTIELLE ET DIVERSIFIÉE, DOIT MIEUX RÉPONDRE À LA RÉALITÉ DU DÉCROCHAGE 222
1. L’offre de l’Éducation nationale : entre retour dans le système scolaire de droit commun et innovations pédagogiques 222
a. Les places vacantes dans les lycées 222
b. Les micro-lycées, un exemple à suivre 223
c. Le partenariat entre l’Éducation nationale et l’Agence du service civique (ASC) en faveur des décrocheurs 224
2. Les formations professionnelles en alternance, l’exemple des écoles de la deuxième chance (E2C) 225
a. Présentation des E2C 225
b. Les enjeux du développement des E2C 227
3. L’offre issue de l’armée et de la police 228
a. Présentation de l’établissement public d’insertion de la défense (Épide) 228
b. Les enjeux propres à l’Épide 231
c. Les cadets de la République de la police nationale et les gendarmes adjoints volontaires (GAV) 231
4. Quelle cohérence d’ensemble des dispositifs de seconde chance ? 233
IV. FAVORISER LA RÉUSSITE DANS LES PARCOURS UNIVERSITAIRES 234
A. L’ENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DOIT ÊTRE À LA FOIS ENCOURAGÉE ET MIEUX PRÉPARÉE 234
1. Les cordées de la réussite contribuent à la démocratisation de l’accès aux filières sélectives de l’enseignement supérieur mais demeurent un dispositif partiel 234
a. Principes, ampleur et modalités de mise en œuvre 234
b. Un dispositif efficient, des questions sur son ciblage et son équité 236
2. Il convient de mieux préparer, voire de baliser l’accès des lycéens professionnels à l’enseignement supérieur 239
a. Orientation et parcours des bacheliers professionnels 239
b. Difficultés des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur 242
c. Quelles mesures pour faciliter le parcours des bacheliers professionnels ? 243
B. DES MARGES DE PROGRESSION EXISTENT POUR UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES ÉTUDIANTS DANS LEUR CURSUS UNIVERSITAIRE 245
1. La réussite des étudiants dans l’enseignement supérieur est globalement élevée mais inégale selon les filières d’origine des bacheliers 245
2. Certaines mesures pourraient conforter la réussite dans l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des étudiants 248
a. Le dispositif des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 248
b. Améliorer l’aide apportée aux étudiants en matière d’insertion professionnelle 249
V. VALORISER LES COMPÉTENCES DANS LA FORMATION INITIALE 251
A. LE SOCLE COMMUN A INITIÉ UNE VALORISATION DES COMPÉTENCES DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 251
1. Le socle selon les lois de 2005 et de 2013 251
2. L’articulation des disciplines, des programmes et des compétences dans le socle 252
B. LA RÉFORME DU SOCLE DOIT PERMETTRE DE CONFORTER SA PLACE DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE ET D’Y METTRE EN VALEUR LES COMPÉTENCES NON ACADÉMIQUES 253
TROISIÈME PARTIE : MOBILITÉ SOCIALE ET TRANSITION VERS L’ÂGE ADULTE : FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES À L’EMPLOI ET À L’AUTONOMIE 255
I. SOUTENIR PLUS EFFICACEMENT L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIÉS ET OPTIMISER LES OUTILS EXISTANTS 256
A. CLARIFIER LA GOUVERNANCE ET MIEUX FÉDÉRER LES ÉNERGIES 257
1. Les jeunes peu ou pas qualifiés : une cible prioritaire de l’action publique 257
a. Des difficultés d’insertion se concentrant sur les peu ou pas qualifiés et un nombre important de jeunes sans emploi et sans formation 257
b. Enjeux prioritaires et champ de l’évaluation 261
2. Renforcer la coordination des acteurs et le pilotage partenarial des politiques en direction des jeunes peu ou pas qualifiés 263
a. Développer les dynamiques partenariales au niveau territorial et renforcer l’échelon régional 263
b. Adapter les missions et la composition des instances au niveau national 268
3. Développer la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux 273
a. Une mobilisation importante des partenaires sociaux dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels (ANI) conclus en 2011 273
b. Un dialogue social à développer dans les branches et les entreprises 274
B. AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES JEUNES LES MOINS DIPLÔMÉS ET SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS 277
1. Les missions locales : un acteur pivot de l’accompagnement des jeunes dont les moyens doivent être renforcés 277
a. Renforcer de manière ciblée les moyens du service public de l’emploi sur les jeunes peu qualifiés et clarifier les relations avec Pôle Emploi 278
b. Développer l’évaluation et le pilotage des missions 289
2. Simplifier progressivement les dispositifs et rapprocher les parcours d’accompagnement 293
a. Les emplois aidés et le déploiement en cours des emplois d’avenir en direction des jeunes peu ou pas qualifiés 294
b. Renforcer et simplifier progressivement les dispositifs d’accompagnement en direction des jeunes en difficulté d’insertion 302
3. Accompagner les entreprises et soutenir la diffusion des bonnes pratiques 308
a. Mieux faire connaître les aides et les dispositifs publics 309
b. Capitaliser et soutenir la diffusion des bonnes pratiques des entreprises 310
C. FAVORISER L'ACCÈS À LA QUALIFICATION ET MIEUX VALORISER LES COMPÉTENCES ACQUISES : DES PARCOURS MOINS LINÉAIRES 312
1. Favoriser l'accès des jeunes à la qualification tout au long de leur parcours, par la formation et la reconnaissance de l’expérience 313
a. Faciliter l’accès à la formation et à la qualification tout au long de la vie, en particulier pour les moins diplômés 313
b. Simplifier la validation des acquis de l’expérience (VAE) en améliorant le suivi, l’accompagnement et l’accès à la certification 317
2. Au-delà des titres et diplômes, soutenir et valoriser l’acquisition de compétences susceptibles d'accroître l'employabilité des jeunes 325
a. Conforter le rôle du service civique en termes de mobilité sociale 325
b. Soutenir l’emploi étudiant sous certaines conditions 331
II. RENFORCER L’AUTONOMIE DES JEUNES 339
A. LE FINANCEMENT DE L’AUTONOMIE 339
1. Les principales problématiques relatives au financement de l’autonomie des jeunes 339
2. Les jeunes et les allocations de logement 343
a. Les jeunes allocataires bénéficient en règle générale de l’allocation de logement sociale (ALS) 343
b. Les situations respectives des jeunes allocataires qui ne sont plus en formation initiale et des étudiants sont très contrastées 343
c. Un effort pour relever les allocations des jeunes qui ne sont plus en formation initiale doit être envisagé 345
d. Une répartition plus équitable des aides en faveur des étudiants doit être mise en œuvre 348
3. La situation difficile des jeunes au regard de l’offre de logements et du marché locatif 350
a. Les jeunes occupent une situation très défavorable sur le marché du logement français 350
b. Cette situation fortement dégradée nécessite de réserver un accès au logement social en faveur des jeunes et de mettre en place des dispositifs innovants 353
4. Améliorer le dispositif des bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux 354
a. Les bourses étudiantes sont notamment attribuées en fonction du revenu des parents 354
b. La réforme de l’été 2013 renforce les montants de bourse des étudiants les plus démunis et ouvre des droits nouveaux en faveur des étudiants des classes moyennes les moins aisées 356
c. Le prolongement de cette réforme doit permettre de revaloriser l’ensemble des bourses, d’étendre la proportion d’étudiants boursiers et de maintenir un dispositif de bourse au mérite 358
B. LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET INTERNATIONALE 360
1. Renforcer l’ampleur et la cohérence des dispositifs de mobilité internationale 360
a. L’offre de mobilité internationale est segmentée entre des opérateurs aux statuts différenciés 360
b. L’augmentation des moyens en faveur de la mobilité internationale doit être plus particulièrement orientée vers les jeunes « ayant moins d’opportunités » 363
2. Conforter l’accès des jeunes au permis de conduire 367
a. Le permis de conduire : examens, professionnels et principaux éléments statistiques 367
b. Améliorer la formation et les procédures 369
EXAMEN PAR LE COMITÉ 373
ANNEXE N° 1 : PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 389
ANNEXE N° 2 : ÉTUDE DE L’IMPACT DE PLUSIEURS DISPOSITIFS CONCOURANT À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES, RÉALISÉE PAR LE GROUPEMENT KPMG-EURÉVAL 403
SYNTHÈSE :
PRÉSENTATION PAR LES RAPPORTEURS
Avant d’en venir aux principales conclusions de ce rapport, quelques mots tout d’abord sur la méthode. Nous avons mobilisé différents outils d’investigation, avec notamment :
– 31 auditions et tables rondes : plus d’une centaine de personnes ont été entendues dans ce cadre (usagers, acteurs de la mise en œuvre et experts) ;
– nous avons par ailleurs effectué des déplacements dans deux régions (Rhône-Alpes et Bretagne), afin de croiser l’approche nationale avec la prise en compte de la diversité des situations territoriales et des réalités de terrain ;
– pour resituer l’analyse dans une perspective internationale et pouvoir s’inspirer, le cas échéant, de « bonnes pratiques » dans certains pays comparables, nous avons choisi de nous rendre en Allemagne et au Danemark ;
– des questionnaires écrits ont également été adressés à différents acteurs (en particulier, le ministère de l’Éducation nationale) et une enquête sur l’apprentissage a été réalisée dans cinq régions (auprès des CFA, des conseils régionaux et des préfets).
Au-delà de ces outils traditionnels du contrôle parlementaire, nous avons également pu nous appuyer sur une étude réalisée par KPMG/Euréval (le CEC disposant en effet d’un accord-cadre avec plusieurs structures de recherche et de conseil). Il s’agissait ainsi d’étudier l’impact de 3 dispositifs concourant à la mobilité sociale des jeunes dans 4 bassins de vie : l’orientation des jeunes vers les filières professionnelles, les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs et le CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale). Cette enquête de qualité, qui sera annexée à notre rapport, s’est avérée riche d’enseignements, s’agissant notamment de la perception des bénéficiaires et acteurs de terrain. Elle a aussi permis d’ouvrir des pistes de réflexion fécondes quant aux améliorations à apporter aux dispositifs actuels.
Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur du sujet et du caractère extrêmement touffu et disparate des politiques concernées, nous avons décidé de concentrer nos travaux sur un nombre limité de dispositifs, à certaines étapes clés du parcours d’un jeune :
– concernant tout d’abord le système éducatif, qui constitue pour les jeunes issus de milieux modestes une « première chance » de s’élever socialement, par leur travail et leurs compétences, il s’agit principalement de l’orientation, des filières professionnelles et des actions de lutte contre le décrochage ;
– nous avons examiné, d’autre part, le rôle des acteurs et l’efficacité des dispositifs visant à favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie ainsi que l’insertion professionnelle des peu ou pas qualifiés. Quelles que soient les difficultés qu’ils ont pu rencontrer dans leur parcours scolaire, ces jeunes doivent en effet avoir des possibilités effectives de rebondir et de saisir une, ou plutôt des « secondes chances », et ce, tout au long de leur parcours.
Il s’agissait ainsi d’envisager les moyens de permettre au système éducatif de contribuer plus efficacement à l’égalité des chances, mais aussi de veiller à ce que l’école ne soit pas la seule voie de mobilité sociale, afin de ne pas figer les destins précocement et de soutenir la construction de parcours de progression sociale pour et avec les jeunes. Lever les freins à la mobilité sociale suppose toutefois, au préalable, de réformer la gouvernance des politiques en direction des jeunes, afin de mieux fédérer les énergies, améliorer le pilotage et ainsi renforcer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de l’action publique.
Au préalable, nous rappellerons très brièvement la définition que nous avons retenue quant à l’objet même de l’évaluation.
La « mobilité sociale » désignant le passage des individus d’une position sociale à une autre, nous nous sommes principalement fondés sur l’analyse de la mobilité intergénérationnelle, présentée par l’Insee, qui en constitue la mesure la plus précise et permet de suivre les évolutions de la société française sur longue période. En effet, cette notion met en regard la catégorie socio-professionnelle occupée par les adultes au milieu de leur parcours professionnel à celle de leur père (enquêtes sur la formation et la qualification professionnelles dites « FQP », dont la dernière date de 2003). Autrement dit, dans quelles conditions les individus peuvent-ils effectivement cheminer dans l’espace social et s’élever au-dessus de la condition de leurs parents ?
Il est toutefois apparu nécessaire d’approfondir cette analyse, en prenant également en compte l’évolution de la structure des emplois (notion de « mobilité structurelle » et de « mobilité nette »), et surtout les débuts de carrière et les changements de catégorie socio-professionnelle au cours de celle-ci, à travers l’étude de la « mobilité professionnelle » (ou intra-générationnelle).
S’agissant des « jeunes », l’évaluation a principalement porté sur les 16-25 ans, soit 8,2 millions de personnes (12,7 % de la population).
La première partie du rapport comporte une analyse approfondie de l’état des lieux de la mobilité sociale des jeunes et de ses freins, ainsi que des spécificités du système français. Nous n’y reviendrons pas dans le détail, sinon pour souligner les quelques points.
Le modèle français présente incontestablement des atouts à valoriser, qui sont liés en particulier à son dynamisme démographique, avec une proportion de jeunes supérieure à celle de nombreux pays voisins.
La reproduction des inégalités sociales reste toutefois importante. Ainsi, selon l’enquête FQP de 2003, 52 % des hommes de 40 à 59 ans fils de cadres supérieurs étaient eux-mêmes cadres supérieurs (seuls 10 % des fils d’ouvriers du même âge occupant ce statut) et 46 % des fils d’ouvriers étaient eux-mêmes ouvriers. Par ailleurs, on comptait seulement 6 % de fils d’ouvrier en classe préparatoire aux grandes écoles. C’est dire combien les jeunes générations sont confrontées aux pannes prolongées de « l’ascenseur social ».
Au-delà de la mobilité sociale ascendante, on observe également une faible « mobilité horizontale », au sens où les parcours sont encore assez linéaires, avec la prégnance du paradigme « se former d’abord, travailler ensuite », et une place démesurée accordée au diplôme obtenu à l’issue de la formation initiale. À l’inverse, dans certains pays comme le Danemark, il est beaucoup plus fréquent de travailler ou de faire des césures pendant ses études, ou encore de revenir en formation en cours de carrière professionnelle.
Le système éducatif occupe aujourd’hui une place centrale dans les destins sociaux. Nous connaissons la célèbre formule de Bourdieu, pour qui « l’école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent », et celle-ci apparaît excessive au regard de la réelle démocratisation de l’accès aux diplômes dans le secondaire et le supérieur (depuis la seconde moitié du XXème siècle).
Cependant, les comparaisons internationales montrent que le système éducatif conduit à l’échec scolaire et à la précarité une grande partie des élèves moyens ou faibles issus de familles modestes. La toute dernière enquête PISA souligne ainsi qu’en France, la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus marquée que dans la plupart des pays de l’OCDE. On observe en effet une différenciation sociale des performances des élèves, ce qu’illustrent notamment :
– le recul des résultats scolaires dans l’éducation prioritaire (maîtrise des compétences de base en fin de CM2 et en fin de 3ème) et de l’accès au bac des enfants des catégories socialement défavorisées ;
– la spécialisation socio-économique des filières de l’enseignement secondaire, la voie professionnelle devenant un peu plus au fil du temps celle des enfants d’inactifs et d’ouvriers non qualifiés – ce qui peut accréditer l’image de l’école comme une « machine à trier » la jeunesse.
Des moyens importants sont consacrés aux politiques publiques en faveur des jeunes, qui représentent de l’ordre de 80 milliards d’euros s’agissant des seuls crédits d’État (répartis sur une vingtaine de missions budgétaires). La performance des politiques publiques est toutefois affaiblie par le foisonnement des acteurs et l’empilement des dispositifs, avec aussi un ciblage parfois insuffisant sur les jeunes les plus en difficulté d’insertion. Par exemple, depuis 1977, plus de 80 dispositifs de la politique de l’emploi ont été mis en œuvre en direction des jeunes (selon un rapport récent de l’OCDE), ce qu’illustre le schéma présenté dans notre rapport.
Par ailleurs, un pilotage performant de l’action publique suppose de pouvoir s’appuyer sur une analyse robuste de l’efficacité et de l’efficience des différents leviers susceptibles d’être mobilisés (autrement dit, les objectifs fixés ont-ils été atteints et à quel coût ?), pour pouvoir mesurer la valeur ajoutée d’une nouvelle mesure, et surtout « corriger le tir », au fil de l’eau, autant que nécessaire. Or, l’efficacité des différents dispositifs apparaît inégale et insuffisamment évaluée en dépit de progrès réels dans certains domaines. C’est par exemple le cas en matière d’orientation.
Il est donc nécessaire d’adapter les compétences des acteurs et de déployer les outils nécessaires (aux niveaux national et territorial) pour assurer une conception, une mise en œuvre et une évaluation efficaces des politiques publiques en faveur de la jeunesse.
Afin de mieux associer les principaux acteurs et parties prenantes, en particulier les jeunes, nous proposons de :
- créer, un Conseil d’orientation des politiques de jeunesse associant des représentants de l’État, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales, des associations et des mouvements de jeunes, en lien avec l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) ;
- assurer une représentation et une participation effective des jeunes dans tous les dispositifs qui les concernent, avec notamment un renforcement de leur présence dans les conseils d’administration des missions locales et des CFA, ainsi que dans les CESER.
Nous proposons également de créer trois portails en direction des jeunes (pour lesquels les entrées se feraient sur un mode numérique, avec la garantie, si un jeune en fait la demande, de pouvoir entrer en « contact humain » avec un professionnel pour débuter un accompagnement) pour :
- l’orientation des jeunes vers les acteurs en charge de leur information et de la gestion de leurs droits, construit à partir du réseau d’information-jeunesse existant et dans lequel s’inscrirait le service public de l’orientation ;
- l’accompagnement des jeunes peu qualifiés, construit à partir des missions locales ;
- la mobilité géographique (internationale ou rendue nécessaire par l’orientation choisie dans la formation ou l’emploi) regroupant les opérateurs concernés (Agence Europe-éducation-formation France - « A2E2F », Agence du service civique…).
Institué par loi de 2008 sur le RSA, le Fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes – FEJ – finance des actions « visant à favoriser la réussite scolaire des élèves » et à « améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans » (au total, plus de 550 projets soutenus sur des thématiques diverses). Ce dispositif inédit et ambitieux a ainsi permis de tester des innovations sociales à petite échelle, avec une évaluation rigoureuse de leurs effets, afin d’en mesurer les avantages et les inconvénients et, le cas échéant, les généraliser ou, au moins, susciter une inflexion des pratiques.
Il convient cependant de renforcer les expérimentations afin de préfigurer des politiques publiques innovantes, et pour cela capitaliser rapidement les résultats des expérimentations, c’est-à-dire en tirer toutes les conséquences pour l’action publique. C’est également le cas en matière de simplification du permis de conduire pour les jeunes. En particulier, deux expérimentations méritent d’être citées : « La Mallette des parents » en classes de sixième et de troisième, et celle sur le permis de conduire, qui fait notamment apparaître l’intérêt d’une simplification.
Au-delà de l’évaluation ex ante (dans le cadre des expérimentations), il faut aussi améliorer, ex post, l’information du Parlement, en complétant les documents budgétaires.
S’agissant plus particulièrement des politiques d’insertion et de formation, le système de décision relève d’une gouvernance partagée entre de nombreux acteurs, puisqu’il fait intervenir l’État, les collectivités territoriales (régions, départements, communes), mais aussi les partenaires sociaux, qui jouent un rôle important dans ce domaine (exemple des ANI jeunes de 2011). À cet égard, il nous semble essentiel que la question de l’emploi des jeunes devienne un thème régulier de la négociation collective, au niveau interprofessionnel, mais aussi des branches et des entreprises.
De fait, comme cela a été souligné à plusieurs reprises au cours de nos travaux, le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes est probablement le plus complexe. Aussi proposons-nous plusieurs mesures pour simplifier le dispositif actuel et développer les dynamiques partenariales :
– en favorisant la contractualisation au niveau local par une convention pluriannuelle État-région avec les missions locales à l’horizon 2014 ;
– en renforçant la coordination des principaux acteurs, en confortant l’échelon régional par l’élaboration d’une convention stratégique (entre l’État, la région et l’union régionale des missions locales).
J’ajouterai que ces propositions (qui se concentrent sur les principaux acteurs concernés par l’insertion des jeunes peu qualifiés) n’épuisent naturellement pas une réflexion plus générale appelée à se poursuivre dans le cadre de l’ « acte III » de la décentralisation, quant à la nécessaire clarification de l’articulation des compétences dans les territoires.
Le deuxième axe de réforme concerne l’adaptation de l’offre de formation (essentiellement dans le cadre du système éducatif), avec trois priorités :
– promouvoir une orientation mieux choisie,
– redonner de la visibilité aux filières professionnelles,
– renforcer la lutte contre le décrochage scolaire et les dispositifs de seconde chance.
Le sentiment d’être "enfermé" dans des choix d’orientation souvent contraints et mal préparés en amont figure parmi les principales causes d’absentéisme, qui peut ensuite préfigurer des situations de décrochage.
Pour promouvoir des parcours d’orientation mieux choisis, nous proposons tout d’abord de construire un accompagnement tout au long du cursus secondaire en vue de l’élaboration par chaque élève d’un parcours choisi et valorisé :
– en proposant à chaque élève, en y associant ses parents, un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations (PDMF) à partir de la 6ème ;
– en diversifiant l’offre scolaire au sein du collège unique en faveur des élèves en difficulté ou dont le projet nécessite une attention particulière (classe relais, 3ème alternative…) ;
– en favorisant l’articulation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, notamment par la validation des crédits d’enseignement d’étude supérieure (ECTS) pour les périodes d’immersion des lycéens dans un établissement d’enseignement supérieur.
Par ailleurs, afin de favoriser la réussite dans les parcours universitaires, nous souhaitons :
– conforter et généraliser les dispositifs de tutorat et de parrainage, comme les « Cordées de la réussite », pour développer l’ambition et faciliter la transition vers l’enseignement supérieur ;
– développer une offre d’accompagnement en direction des étudiants titulaires d’un bac professionnel pour conforter leur chance de réussite dans les filières courtes (sections de technicien supérieur notamment…) ;
– renforcer le dispositif des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) des universités, notamment en inscrivant un volet « orientation et insertion professionnelle des étudiants » dans les contrats liant l’État et les établissements d’enseignement supérieur.
L’apprentissage comme facteur de mobilité sociale connaît aujourd’hui des résultats réels, mais sans dynamique de progression, avec des effectifs en baisse pour les bas niveaux de qualification et le risque d’un apprentissage à deux vitesses. De plus, il connaît depuis longtemps une situation paradoxale : alors qu’il est une voie d’accès efficace à l’emploi durable et qu’il a permis en France la formation d’un chef d’entreprise sur deux (porté par l’artisanat), l’apprentissage souffre d’une mauvaise image. Le choix de cette formation initiale est en effet souvent assimilé à l’incapacité pour les jeunes à demeurer au sein du système scolaire traditionnel.
En vue de réhabiliter l’apprentissage et de garantir les moyens de son développement, nous préconisons de :
– respecter l’objectif de 500 000 apprentis en 2017, en s’appuyant sur une croissance des effectifs pour les niveaux inférieurs au baccalauréat, garantie par une augmentation des financements publics en faveur de ce segment de l’apprentissage ;
– favoriser les partenariats et les passerelles entre les lycées professionnels et les centres de formation des apprentis (CFA) ;
– lever les freins à l’apprentissage en matière de double logement, de permis de conduire et d’insuffisance dans la maîtrise des compétences de base (illettrisme).
Le décrochage est un phénomène d’ampleur substantielle en France, avec de 130 000 à 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme (soit environ 17 % d’une classe d’âge). Le Gouvernement s’est fixé deux objectifs clairs dans ce domaine : diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif d’ici 2017 (prévention du décrochage), et, pour les jeunes ayant déjà décroché, offrir une solution de retour en formation à 20 000 d’entre eux d’ici fin 2013. Par ailleurs, l’offre de seconde chance est importante et diversifiée, mais doit mieux répondre à la réalité du décrochage.
Au regard de l’importance de ces enjeux, la lutte contre le décrochage doit être une priorité pour l’action publique, et il faut adapter l’offre de seconde chance :
– en renforçant les moyens et la dimension partenariale des plateformes d’aide et de suivi aux décrocheurs ;
– en inscrivant rapidement au programme de la MAP (modernisation de l’action publique) la simplification de l’offre globale de seconde chance ;
– en utilisant les ressources de l’Éducation nationale (places vacantes dans les lycées professionnels et internats, développement des structures alternatives de type micro-lycées) ;
– et enfin en améliorant la couverture du territoire par les écoles de la deuxième chance (E2C), en concertation avec les régions, et en augmentant le nombre de jeunes bénéficiaires.
Pour faire progresser la mobilité sociale des jeunes, les efforts doivent aussi porter sur la période de transition vers l’âge adulte, dont les marqueurs traditionnels sont l’entrée dans la vie active et l’autonomie financière et résidentielle (quitter le foyer parental). Dans ce sens, il convient :
– d’agir plus efficacement en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, s’agissant en particulier des peu ou pas qualifiés, et ce non seulement au moment de leur entrée dans la vie active, mais aussi tout au long de leur parcours ;
– d’améliorer les conditions de vie des étudiants (bourses, logement et mobilité).
Ces deux problématiques ne sont évidemment pas sans lien, dans la mesure où l’emploi reste la meilleure voie d’accès à l’autonomie, et où, en sens inverse, les difficultés sociales et matérielles, en matière de logement ou de mobilité par exemple, peuvent constituer autant de freins à l’emploi des jeunes. En tout état de cause, il apparaît, là encore, nécessaire de simplifier les dispositifs et d’améliorer l’accompagnement proposé, en veillant à ce qu’il soit assorti de contreparties de la part des jeunes.
Le constat est connu : les jeunes sont plus exposés aux difficultés d’insertion sur le marché du travail, et le fait d’être diplômé ainsi que le niveau de diplôme ont un fort impact sur les conditions d’accès à l’emploi. Ainsi, trois ans après la fin des études, le taux de chômage des non diplômés s’élève à 40 %. Par ailleurs, le taux d’emploi des 15-24 ans en France est inférieur de plus de 4 points à la moyenne de l’Union européenne en 2012. La spécificité française tient également à la durée des études et à la fréquence moindre du travail pendant celles-ci, contrairement à certains de nos voisins, comme le Danemark où les transitions entre l’emploi et le système éducatif sont plus développées.
Des moyens important sont aujourd’hui dégagés en faveur de l’emploi des jeunes (avec récemment le lancement des emplois d’avenir et de la Garantie jeunes). Au total, près de 650 000 jeunes occupaient ainsi un emploi bénéficiant d’une aide de l’État fin 2012 (soit 25 % des emplois occupés par des jeunes).
Pour mieux mobiliser les politiques d’emploi en faveur de la mobilité sociale des jeunes, l’enjeu est finalement moins d’inventer des solutions nouvelles que d’optimiser, de mieux assembler et de piloter différemment les initiatives et les outils existants.
Acteurs reconnus du service public de l’emploi, les missions locales proposent aux jeunes un accompagnement global, qui est apprécié des bénéficiaires, comme le fait ressortir l’enquête réalisée par KPMG. Cofinancées par l’État et les collectivités locales, elles jouent un rôle essentiel d’ensemblier de politiques publiques dans les territoires. Compte tenu des insuffisances actuelles (avec par exemple un taux d’encadrement de l’ordre de 100 jeunes par conseiller et des disparités parfois significatives entre les missions locales en termes de moyens et de résultats), il est capital d’améliorer l’accompagnement vers l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, en confortant les missions locales.
Ainsi, les moyens du service public de l’emploi doivent être renforcés de manière ciblée sur les jeunes les moins diplômés :
– en augmentant les dotations aux missions locales, afin de rendre l’accompagnement plus intensif dans le cadre du CIVIS en particulier ;
– en encourageant les bonnes pratiques (développement du parrainage, des réseaux avec les entreprises, partenariats et détection des jeunes en difficulté, etc.).
Parallèlement, l’évaluation et le pilotage des missions locales doivent aussi être améliorés dans le cadre du dialogue de gestion avec l’État, et nous formulons plusieurs propositions précises en ce sens.
Face au constat d’un chômage élevé et persistant, plusieurs mesures se sont succédées pour favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail, s’agissant en particulier des moins diplômés. Ces mesures visent principalement à accroître la qualification des jeunes pour améliorer leurs chances d’accès à l’emploi, à réduire le coût du travail pour les employeurs, ainsi qu’à apporter un accompagnement individualisé dans la recherche d’emploi. En excluant les mesures d’allègement de charges (non spécifiquement ciblées sur les jeunes), on peut ainsi distinguer schématiquement : les emplois aidés et les dispositifs d’accompagnement (le CIVIS par exemple), qu’il nous apparaît nécessaire de simplifier.
Alors qu’il faudrait s’adapter à la diversité des besoins des publics cibles, le système actuel manque de lisibilité, non seulement auprès des jeunes et des entreprises, mais aussi des acteurs chargés de leur la mise en œuvre. Ceci peut d’ailleurs expliquer que certaines aides soient peu mobilisées. En outre, l’accompagnement proposé se fonde trop souvent sur une approche par « dispositifs prescrits », qui conduit à « faire rentrer les jeunes dans des cases », selon l’expression employée par une conseillère de mission locale, alors qu’il faudrait plutôt partir des profils et des besoins spécifiques des jeunes pour construire un parcours d’insertion. Enfin, la logique de contrat, qui implique nécessairement des engagements réciproques, autrement dit des droits et des devoirs, n’est pas toujours bien comprise par les jeunes.
Nous préconisons par conséquent de simplifier les dispositifs, en créant une aide à l’insertion professionnelle contractualisée (« contrat de réussite ») pour les jeunes sans emploi, composée d’un socle commun et de prestations supplémentaires personnalisées.
Pour accroître l’employabilité des jeunes et démultiplier les opportunités de seconde chance dans le cadre de parcours moins linéaires, nous proposons de favoriser l’accès des jeunes à la qualification tout au long de leur parcours, en particulier pour les moins diplômés et les anciens décrocheurs :
– cela passe d’abord par la formation, en instituant pour chaque jeune une garantie d’accès à la formation et à la qualification par la création d’un droit de tirage dans le cadre du compte personnel de formation ;
– cela passe également par la reconnaissance de l’expérience, en valorisant mieux les compétences acquises par les jeunes, dans un cadre professionnel ou associatif, ce qui suppose de :
- simplifier la VAE, qui reste un vrai parcours du combattant, et rendre plus lisible le système de certifications ;
- améliorer l’information (notamment dans les établissements d’enseignement et les missions locales) et l’accompagnement (référent unique), diminuer les délais de traitement et adapter les modalités de validation ;
- enfin, développer les pratiques de reconnaissance des compétences non formelles.
Au-delà des titres et diplômes, nous préconisons de soutenir et valoriser l’acquisition de compétences et d’expériences susceptibles d’accroître l’employabilité des jeunes.
À cette fin, il faut conforter le rôle du service civique en faveur de la mobilité sociale des jeunes :
- en poursuivant sa montée en charge, afin d’accroître le nombre d’offres combinées service civique-formation en direction des décrocheurs scolaires, ainsi que le nombre de volontaires non bacheliers ;
- en diversifiant le financement de l’Agence du service civique entre les différents ministères concernés.
Il faut également soutenir l’emploi étudiant dans des conditions compatibles avec la réussite universitaire :
- en apportant un accompagnement adapté à la recherche d’emploi et aux stages dans les universités, à travers les BAIP (cf. les résultats intéressants de l’expérimentation « Améliorer la qualité des emplois exercés par les étudiants » dans la Sarthe, avec la mise en place d’une cellule de placement par l’université, en partenariat avec le tissu local d’entreprises et les collectivités) ;
- en promouvant le développement des stages dans les cursus de formation et en adaptant l’organisation des études universitaires au travail étudiant (aménagements des horaires, outils numériques) ;
- en demandant aux partenaires sociaux d’ouvrir une négociation sur l’emploi étudiant (lors de la prochaine conférence sociale de 2014).
Enfin, nous préconisons de mieux valoriser dans la formation initiale les compétences non académiques en leur donnant toute leur place au sein du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et en soutenant le tutorat ou le parrainage d’élèves ainsi que les semestres ou années de césure.
Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté et la précarité. Les jeunes en emploi sont plus souvent en CDD (à 23 ans, le taux d’emploi en CDI n’est que de 33 %). De même, les délais d’accès des jeunes à un emploi stable sont plus longs (au cours des trois années suivant la sortie de formation, la durée moyenne d’emploi des jeunes reste très faible : elle atteint un an pour les jeunes sortis de formation avant 18 ans ; elle atteint 2 ans et demi pour les jeunes sortis de formation après 18 ans).
Les jeunes sont également dans une situation difficile au regard de l’offre de logements et du marché locatif. Ainsi, les 25-29 ans consacrent 18,7 % de leurs ressources pour le financement de leur logement (ce taux d’effort est d’environ 10 % toutes classes d’âge confondues). En outre, entre 1984 et 2006, le taux d’effort net pour le logement a augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, et de 6 points pour les 25-29 ans (sur la même période, ces taux n’ont augmenté que de 1,5 point pour l’ensemble de la population).
Des moyens importants sont aujourd’hui mobilisés, à travers :
– les allocations de logement aux étudiants (1,3 milliard d’euros, 702 000 étudiants bénéficiaires),
– la demi-part fiscale liée au rattachement des jeunes de moins de 25 ans au foyer de leurs parents (2,2 milliards d’euros, 1,73 million de foyers bénéficiaires),
– les bourses sur critères sociaux (1,8 milliard d’euros, près de 500 000 boursiers).
La réforme de l’été 2013 renforce les montants de bourse des étudiants les plus démunis et ouvre des droits nouveaux en faveur des étudiants des classes moyennes les moins aisées.
L’analyse des effets redistributifs cumulés de ces trois aides montre clairement que la répartition de leur montant par décile de revenus donne « une courbe en U ».
Pour améliorer le financement de l’autonomie, nous préconisons de :
– compléter les aides au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux allocataires âgés de 18 à 25 ans qui ont achevé leur formation initiale ;
– réformer les aides fiscales allouées aux parents d’étudiants afin que les aides au financement des études (aides fiscales, bourses et allocations de logement) augmentent en fonction des charges supportées par la famille et diminuent en fonction de ses revenus ;
– prévoir un pourcentage d’attribution des logements sociaux en faveur des jeunes, en veillant à la construction de logements adaptés permettant une colocation institutionnalisée ;
– s’agissant des bourses sur critères sociaux, revaloriser toutes les bourses, atteindre l’objectif de 50 % d’étudiants boursiers et maintenir un dispositif de récompense des étudiants particulièrement méritants.
Enfin, parce qu’il peut s’agir d’un frein en termes d’accès à l’emploi ou à la formation, et plus largement, à l’autonomie, nous proposons de simplifier le permis de conduire afin de faciliter l’accès des jeunes à la conduite :
– en relançant la conduite accompagnée, notamment dans les entreprises, et en adaptant la durée de la formation pratique aux aptitudes de chaque candidat ;
– en établissant la transparence sur les taux de réussite propres à chaque école de conduite ;
– et enfin en anticipant la formation théorique dans le cadre scolaire et auprès des conducteurs de « deux roues » à compter de l’âge de 14 ans.
Pour conclure, au terme de ces travaux passionnants, nous mesurons l’ampleur de la tâche pour « relancer l’ascenseur social » ! Il s’agit là d’un défi majeur pour l’action publique, qui appelle une approche d’ensemble (pour agir simultanément sur tous les leviers d’action) et qui s’inscrit nécessairement dans la durée. C’est donc un formidable défi qu’il nous faut relever, mais aussi un projet de société essentiel, porteur de progrès et de justice sociale. Pour reprendre la formule utilisée par Camille Peugny, « dans une démocratie moderne, un enfant doit pouvoir faire sa vie avec d’autres cartes que celles qu’il a trouvées dans son berceau ».
Le 18 octobre 2012, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale a inscrit à son programme de travail, à la demande du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC), une évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes.
Le 13 décembre 2012, le CEC a désigné les deux rapporteurs de cette étude :
– M. Régis Juanico, membre du groupe SRC, membre de la commission des Finances ;
– M. Jean-Frédéric Poisson, membre du groupe UMP, membre de la commission des Lois.
En application de l’article 146-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, a été constitué un groupe de travail désigné par les commissions des Affaires culturelles, des Affaires sociales et des Affaires européennes, et composé de Mmes Sandrine Doucet (SRC) et Virginie Duby-Muller (UMP), de MM. Jean-Patrick Gille (SRC) et Michel Piron (UDI) et de Mme Sylvie Tolmont (SRC).
Cette évaluation a commencé par une phase de cadrage, à la suite de laquelle le projet d’évaluation a été défini et présenté par les rapporteurs au groupe de travail composé des députés issus des commissions concernées par la thématique. Ensuite, plusieurs outils ont été mobilisés : pour partie des outils traditionnels du contrôle parlementaire – auditions et tables rondes, déplacements –, et pour partie un nouvel outil auquel le CEC peut recourir : des études externalisées.
Le cadrage de l’évaluation revêtait une importance particulière pour principales raisons :
– une population très large : on compte 8,2 millions jeunes de 16 à 25 ans sur 65,3 millions d’habitants recensés en 2011, soit 12,7 % de la population ;
– des moyens hétérogènes et disséminés : 20 missions du budget de l’État contribuent aux politiques publiques en faveur des jeunes pour un total de crédits de paiement de 80,4 milliards d’euros.
Compte-tenu de l’ampleur du sujet et de ces difficultés, il a fallu donc définir un angle d’analyse. Une « revue de littérature » a été réalisée pour faire un état des lieux de la mobilité sociale des jeunes en France, mettre en exergue les spécificités du modèle français et identifier les freins à la mobilité sociale. Les rapporteurs ont organisé un premier cycle d’auditions sur deux mois, pour mieux comprendre les enjeux transversaux relatifs à la mobilité sociale des jeunes, identifier les dispositifs publics clés mis en œuvre et définir les questions évaluatives.
À l’issue de cette phase de cadrage, les rapporteurs ont fait le choix de traiter les politiques publiques concourant à la mobilité sociale des jeunes en six « compartiments » qui ont fait l’objet d’auditions successives :
– l’enseignement scolaire élémentaire : la brique originelle de l’égalité des chances ;
– l’enseignement secondaire : la première grande étape de l’orientation ;
– les universités et les grandes écoles : une étape décisive de l’orientation professionnelle ;
– les politiques en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes : assurer l’entrée rapide et durable dans la vie active ;
– les dispositifs « deuxième chance » : des moyens pour pallier l’échec scolaire et universitaire ;
– l’autonomie des jeunes : moyens déployés pour contribuer à l’équité face aux coûts des études et face aux périodes de précarité à l’entrée dans la vie active.
Parallèlement, les questions évaluatives ont été définies autour de trois angles :
– examiner, à tous les niveaux, la qualité de la gouvernance des politiques publiques. La pluralité des acteurs – l’État, les collectivités territoriales, l’Union européenne – et des dispositifs publics impliquait en effet que soit porté un regard, tout au long de l’évaluation, sur l’accessibilité de ces dispositifs, leur lisibilité et leur cohérence (en mettant en évidence d’éventuels doublons, redondances, angles morts ou défauts d’articulation entre acteurs publics) ;
– articuler la prise en compte de la diversité des situations territoriales et une approche nationale « classique ». Il convenait, entre autres, de juger de la capacité des dispositifs nationaux à rendre compte des contrastes territoriaux et à les prendre en compte ;
– comparer la situation française à celle d’autres pays. Il s’agissait tout à la fois de replacer les constats faits en France dans un panorama international, d’appréhender les politiques publiques mises en œuvre à l’étranger et, le cas échéant, de proposer de s’inspirer de « bonnes pratiques » ou de principes pertinents identifiés dans certains pays comparables à la France
À l’issue des différents cycles d’audition, l’évaluation a été centrée sur plusieurs dispositifs clés : l’accompagnement des élèves dans leur orientation, la place des filières professionnelles, la lutte contre le décrochage scolaire et des dispositifs de seconde chance, les moyens déployés pour favoriser la réussite universitaire, la valorisation des compétences, l’accompagnement des jeunes peu ou pas qualifiés et les aides à l’autonomie des jeunes (allocations logement, bourses d’étude et la promotion de la mobilité géographique et internationale).
Les « parties prenantes » entendues par le groupe de travail peuvent schématiquement être divisées en trois groupes :
– les usagers et leurs représentants (organisations professionnelles syndicats, associations) ;
– les acteurs de la mise en œuvre des politiques (administrations centrales, opérateurs, collectivités territoriales) ;
– les experts (économistes, sociologues, fonctionnaires de la DARES, auteurs de rapport…).
Les auditions et tables-rondes menées par les rapporteurs avaient pour objectifs d’établir un diagnostic partagé en respectant le pluralisme et d’identifier les positions des acteurs face aux propositions de réforme. Au total, 114 personnes ont été entendues au cours de 17 auditions et 14 tables rondes.
Deux déplacements à l’étranger ont eu lieu, à Copenhague et à Berlin. Ils ont permis de mieux comprendre les spécificités du pays considéré et de nuancer certains constats issus de la littérature académique. Plusieurs informations ont pu ainsi être actualisées, notamment sur les réformes en cours ou les projets à venir. Deux déplacements ont été organisés en région afin de rencontrer sur le terrain les acteurs des dispositifs évalués, le premier à Lyon et à Saint-Étienne, le second en Ille-et-Vilaine. Au total, 146 personnes ont été rencontrées au cours de ces déplacements.
Un appel d’offres a été lancé afin de réaliser une étude, dans quatre sites, de l’impact de trois dispositifs concourant à la mobilité sociale des jeunes : l’orientation des jeunes vers les filières professionnelles ; les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs scolaires ; les contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS). Le CEC dispose en effet d’un accord-cadre avec plusieurs structures de conseil ou de recherche. Les prestataires présélectionnés spécialistes des politiques sociales ont été remis en concurrence sur la base d’un cahier des charges. Leurs mémoires ont ensuite été comparés sur la base de critères financiers et techniques. Le marché a été attribué au groupement KPMG – Euréval dont l’étude est annexée au présent rapport.
Enfin, quatre questionnaires écrits ont été adressés :
– un questionnaire au ministre de l’éducation nationale relatif à l’impact de l’école sur la mobilité sociale des élèves. Il s’agissait de recueillir les principaux résultats des enquêtes dont dispose la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance sur les liens entre inégalités sociales et performances scolaires ;
– un questionnaire au ministre du travail sur les dispositifs d’accompagnement des jeunes peu ou pas qualifiés ;
– un questionnaire à Pôle Emploi sur le suivi des jeunes chômeurs ;
– et une enquête sur l’apprentissage dans une sélection de cinq régions dans lesquelles ont été interrogés les préfets, les conseils régionaux et les principaux centres de formation d’apprentis.
PREMIÈRE PARTIE :
MALGRÉ LA MOBILISATION DE MOYENS PUBLICS IMPORTANTS, LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES RALENTIT
I. LE MODÈLE FRANÇAIS DE MOBILITÉ SOCIALE A TENDANCE À SE GRIPPER
A. L’ÉTAT DES LIEUX DE LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES EN FRANCE
1. Égalité des chances ou mobilité sociale ? Une question de mesure
Notion classique de la sociologie, la mobilité sociale a pour objet de déterminer le degré d’indépendance entre les positions occupées dans la société par les individus et le milieu social d’origine de ces derniers.
L’étude de la notion de mobilité sociale et des concepts qui lui sont liés fait partie du programme officiel du ministère de l’Éducation nationale pour les enseignements de sciences économiques et sociales des classes de terminales (1). On peut trouver sur le site internet de l’INSEE les données statistiques permettant de construire les tables de mobilité pour la société française (2), ainsi qu’un outil didactique mis en ligne par le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) présentant, à partir des données sociales collectés par l’INSEE, une illustration des différentes instruments de mesure associés à la notion de mobilité sociale (3).
En France, la mesure de la mobilité sociale est basée sur la connaissance des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) qui constitue le principal indicateur de position sociale. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles distingue à son degré d’agrégation le plus élevé quelques grands « groupes socioprofessionnels », qui ne sont pas en principe hiérarchisées entre eux : agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures (CPIS), professions intermédiaires, employés (en distinguant employés qualifiés et non-qualifiés), ouvriers (en distinguant ouvriers qualifiés et non qualifiés).
Mises à disposition par l’INSEE dans le cadre d’enquêtes nationales périodiques sur la formation et l’emploi des français (enquêtes décennales dites FQP), les données collectées sur l’appartenance aux différentes groupes socioprofessionnels conduisent à distinguer la mobilité dite intergénérationnelle, qui compare les positions sociales respectives occupés par les pères et les fils au même âge, et la mobilité intragénérationnelle, qui décrit pour sa part les changements de groupe socioprofessionnel au cours de la carrière professionnelle et qui se trouve assimilée à une mobilité professionnelle (ascendante, descendante ou horizontale) dans les publications de l’INSEE :
– les données visant à la mesure de la mobilité intergénérationnelle correspondent à une question posée aux adultes âgés de plus de 40 ans : « quelle est votre profession et qu’elle était la profession de votre père à votre âge ? » ;
– les données visant à la mesure de la mobilité professionnelle correspond une seconde question posée à l’ensemble des personnes interrogées : « quelle était votre profession il y a cinq ans et au moment de l’entrée dans la vie active ? ».
Les données de mobilité intergénérationnelle se trouvent rassemblées dans une table de mobilité, qui met en correspondance le groupe socioprofessionnel des pères et de leurs enfants.
DONNÉES ISSUES DE L’ENQUÊTE FQP DE 2003 RELATIVES AUX GROUPES SOCIOPROFESSIONNELS DES HOMMES EN FONCTION DE CELUI DE LEUR PÈRE
Enquête concernant 7 millions d’hommes français, actifs ou anciens actifs, âgés de 40 à 59 ans, en milliers de personnes
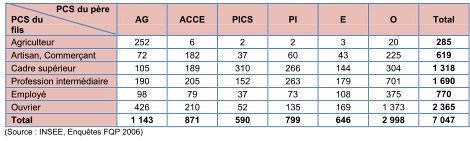
![]()
La table de mobilité ainsi construite peut être lue dans le sens horizontal, correspondant à celui des destinées (suivant l’exemple : « Que sont devenus les fils d’employés ? »), autant que dans le sens vertical, correspondant aux recrutements (suivant l’exemple « Quelle origine sociale ont les agriculteurs ? »).
La diagonale de cette table de mobilité indique les situations de reproduction sociale où les pères et les fils relèvent de la même catégorie. Les sociologues ont accordé historiquement une grande importance à cette diagonale de la table de mobilité, employant le terme d’immobilité sociale pour désigner l’ensemble de ces situations de reproduction sociale (4). Comme le rappelle Louis Chauvel, si l’on suppose que l’immobilité sociale est le signe de la capacité des classes sociales à organiser collectivement la protection de leur position dans la société, plus le poids des situations d’immobilité est important dans la structure des emplois, plus la société étudiée apparaît comme une société de caste. Plus le nombre de situations d’immobilité sociale diminue, plus la société apparaît comme une société « ouverte », où l’inégalité entre les classes sociales demeure mais où la circulation des individus entre les classes sociales interdit à celles-ci de constituer en système. Plus que l’atteinte d’un minimum fixé de manière absolue, l’important apparaît alors que les sociétés étudiées connaissent un pourcentage de situations d’immobilité sociale en constante diminution, signe de la circulation croissante entre les différentes positions sociales et donc de leur « degré d’ouverture » croissant.
L’usage des instruments d’analyse de la mobilité sociale repose donc sur des présupposés théoriques. Sans chercher à expliciter l’ensemble de ces présupposés, il est important de souligner qu’il existe aujourd’hui, au sein de la sociologie quantitative, deux écoles distinctes dont les méthodes d’analyses et le regard sur la mobilité sociale au sein de la société française sont divergents (5) :
– une école qualifiée d’anglo-saxonne, qui privilégie l’analyse des circulations ascendantes et descendantes dans la table des mobilités sociales intergénérationnelles ;
– une école davantage préoccupée par l’égalité des chances entre les personnes de différentes catégories sociales et dont les outils sont davantage tournés vers l’analyse de l’évolution des rapports de concurrence dans l’accès aux positions sociales supérieures.
Ces deux courants d’analyse sont à l’origine de travaux et d’investigations statistiques de nature très différentes, mais fournissent en définitive des résultats complémentaires pour la compréhension des évolutions de la mobilité sociale.
2. Les résultats en termes d’égalité des chances
Selon les données les plus récentes issues de l’enquête FQP de 2003, 52 % des hommes âgés de 40 à 59 ans fils de cadres supérieurs sont devenus eux-mêmes à cette date des cadres supérieurs, alors que 10 % des fils d’ouvriers sont devenus à la même date cadres supérieurs.
Aussi suggestives soient-elles, ces données ne sauraient résumer à elles seules la situation de la mobilité sociale en France à cette date, pour deux raisons :
– d’une part, ces chiffres doivent être analysés en tenant compte de la répartition des effectifs entre les différentes catégories sociales. Par exemple, le fait que les emplois de cadres (15 % des actifs) soient moins nombreux que les emplois d’ouvriers (24 % des actifs) limite les débouchés offerts à tous les jeunes et plus particulièrement aux enfants d’ouvriers qui sont plus nombreux que les enfants de cadres ;
– d’autre part, les trajectoires d’ascension sociale courtes apparaissent plus nombreuses. Par exemple, plus d’un tiers des hommes dont le père avait une profession intermédiaire sont devenus cadres, soit plus que les fils d’employés (22 % de l’effectif de cette catégorie) ou que les fils d’ouvriers (10 % de l’effectif de cette catégorie. Par ailleurs, les fils d’employés sont 28 % à exercer une profession intermédiaire, supérieure à leur catégorie socioprofessionnelle d’origine.
En ce qui concerne la répartition des effectifs selon l’origine sociale, le ministère de l’Éducation nationale publie les statistiques officielles de réussite au brevet en fonction de l’origine sociale (6), dont la lecture confirme les tendances tirées de l’évolution des catégories sociales, à savoir une forte baisse des effectifs d’ouvriers et d’agriculteurs, concomitante à une croissance régulière du nombre de cadres, de professions intermédiaires et d’employés.
Les calculs réalisés par Stéphanie Dupays, chargée de recherche à l’INSEE, montrent qu’entre 1977 et 2003, la probabilité pour un fils de cadre d’atteindre une positon sociale supérieure à celle d’un fils d’ouvrier, d’un fils d’employé ou du fils d’une personne exerçant une profession intermédiaire, a augmenté :
CHANCES, POUR UN FILS DE CADRE, D’OCCUPER UN EMPLOI SUPÉRIEUR À CELUI OCCUPÉ PAR UN FILS D’OUVRIER, UN FILS D’EMPLOYÉ OU UN FILS DE PROFESSION INTERMÉDIAIRE.
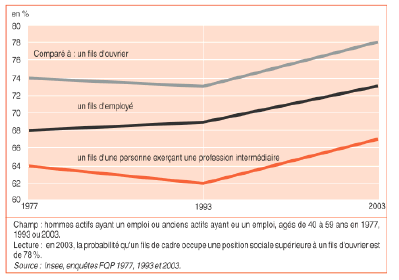
Source : "En un quart de siècle, la mobilité sociale a peu évolué", Stéphanie Dupays, France Portrait social, édition 2006, p 343
Ces résultats, issus de l’exploitation des données disponibles des enquêtes FQP les plus récentes indiquent clairement une dégradation des chances de mobilité ascendante offerte aux catégories socioprofessionnelles inférieures.
Ce constat en termes d’égalité des chances peut utilement être complété par l’analyse des mobilités sociales intergénérationnelles qui en identifiant une mobilité sociale structurelle, liée à l’évolution de la structure des emplois, permet de mieux comprendre les éléments du contexte économique qui exacerbent ou au contraire apaisent la concurrence entre les différentes catégories sociales.
3. Les résultats en termes de mobilité sociale
L’histoire économique récente montre à quel point l’évolution de la structure socioprofessionnelle des emplois est un facteur clé pour la compréhension des phénomènes de mobilité sociale. Au cours des Trente glorieuses, la pénurie de cadres était telle qu’un fort mouvement d’aspiration vers le haut a bénéficié aux enfants de toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris les plus basses, car les enfants de cadre ne pouvaient y répondre à eux seuls, quelle que soit l’intensité de la reproduction sociale. Quelle que soit la réalité statistique de l’égalité des chances « nette » des effets de la modification de la structure des emplois, les Trente glorieuses sont « ressenties » en tout état de cause comme une période de fonctionnement efficace de l’ascenseur social.
Les travaux d’analyse les plus récents de la mobilité sociale (parmi lesquels les travaux du sociologue Camille Peugny, reprenant notamment les résultats de la thèse de doctorat en sociologie obtenu par ce dernier en 2007, occupent une place éminente), reprenant les données des enquêtes FQP, ont approfondi l’effort de modélisation des mobilités sociales, pour permettre de quantifier et de suivre dans le temps l’évolution des trajectoires ascendantes, descendantes ou horizontales dans la société française entre 1983 et 2003.
a. De nouvelles variables explicatives de la mobilité sociale
La méthode d’investigation choisie se base sur une nouvelle exploitation du tableau des mobilités sociales, qui repose sur la construction d’une « matrice de mobilité sociale » dans laquelle est définie arbitrairement une hiérarchie interne entre les groupes sociaux. Cette matrice, qui se trouve reproduite ci-dessous, permet de déterminer, outre les situations d’immobilité sociale déjà identifiées par le passé, des trajectoires sociales intergénérationnelles qui soient qualifiées d’ascendantes ou de descendantes.
EXEMPLE DE MATRICE DE MOBILITÉ SOCIALE
Sens des trajectoires intergénérationnelles
ARRIVÉE | |||||||
CPIS (1) et gros indépendants |
Professions intermédiaires |
Artisans, commerçants |
Agriculteurs |
Employés et ouvriers qualifiés |
Employés et ouvriers non qualifiés | ||
ORIGINE |
CPIS et gros indépendants |
Immobiles |
Descendants |
Descendants |
Descendants |
Descendants |
Descendants |
Professions intermédiaires |
Ascendants |
Immobiles |
Descendants |
Descendants |
Descendants |
Descendants | |
Artisans, commerçants |
Ascendants |
Ascendants |
Immobiles |
Descendants |
Descendants |
Descendants | |
Agriculteurs |
Ascendants |
Ascendants |
Ascendants |
Immobiles |
Ascendants |
Immobiles | |
Employés et ouvriers qualifiés |
Ascendants |
Ascendants |
Immobiles |
Descendants |
Immobiles |
Descendants | |
Employés et ouvriers non qualifiés |
Ascendants |
Ascendants |
Ascendants |
Immobiles |
Ascendants |
Immobiles | |
(1) Cadres et professions intellectuelles supérieures. | |||||||
Lecture : les hiérarchies choisies dans cet article s’inspirent de la matrice définie par Erikson et Goldthorpe (1992) et des travaux français récents (Chenu, 1990 ; Chenu et Burnod, 2001 ; Amossé et Chardon, 2006).
Source : « Éducation et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées dans les années 1960 », Camille Peugny. Économie et statistique n° 410, 2007.
En appliquant les relations définies dans la matrice de mobilité sociale aux résultats des enquêtes FQP depuis 1983, Camille Peugny parvient à dénombrer le nombre total de trajectoires intergénérationnelles ascendantes, descendantes ou horizontales pour l’ensemble des actifs.
Il observe alors que le rapport entre le nombre de trajectoires ascendantes et le nombre de trajectoires descendantes a régulièrement décru depuis 1960, passant de 2 à 1,77, ce qui traduit une dégradation des conditions de mobilité sociale pour les actifs concernés.
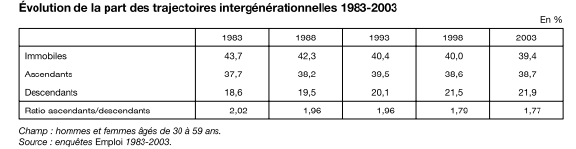
Tableau extrait de "Éducation et mobilité sociale : la situation paradoxale des générations nées dans les années 1960. Camille Peugny. Économie et statistique n° 410, 2007.
Si l’interprétation de ces résultats n’est pas toujours aisée (du fait des effets mécaniques, non quantifiés, liés à la transformation de la structure socioprofessionnelle des emplois (7)), l’approche suivie a permis de mettre l’accent sur deux nouvelles variables expliquant de manière pertinente l’état de la mobilité sociale intergénérationnelle : l’évolution (en l’occurrence positive) des mobilités ascendantes et le développement des mobilités descendantes.
b. Une dynamique d’ascension sociale soutenue par la croissance du nombre d’emplois supérieurs
Les résultats issus de l’enquête FQP confirment que la tertiairisation de l’économie française a permis une poursuite de la croissance du nombre d’emplois qualifiés, et, partant, le maintien d’un flux de trajectoires d’ascension sociale satisfaisant, dans un contexte économique mais aussi démographique moins favorable, où les actifs ayant une origine sociale élevée sont plus nombreux.
Cette situation résulte avant tout de l’augmentation du nombre d’emplois de catégorie supérieure dans la société française.
Dans son rapport de 2009 sur la mobilité sociale (8), le Centre d’analyse stratégique souligne que la dynamique des créations d’emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures, loin de se tarir, se prolonge depuis les années 1960.
Ainsi, le pourcentage d’emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures a connu un quasi doublement depuis le début des années 1980, pour atteindre près de 15 % des emplois : selon l’INSEE, les cadres et professions intellectuelles étaient en 2007 environ 4 millions, dont 2,5 millions d’hommes (soit 18 % des hommes en emploi) et 1,5 million de femmes (13 % des femmes en emploi).
Si l’on ajoute les personnes des professions intermédiaires, qui viennent immédiatement en second après les cadres et professions intellectuelles dans la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles, les effectifs des classes sociales supérieures représentent 38 % des actifs en 2005, alors qu’ils ne représentaient que 23 % du même champ en 1975.
![]()
![]()
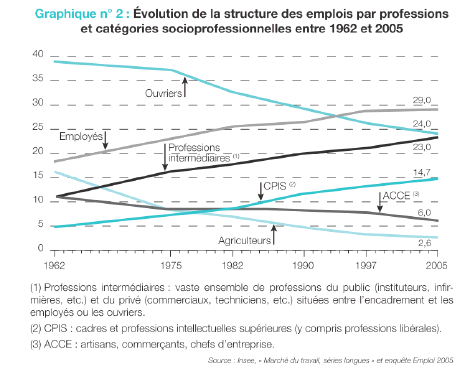
![]()
![]()
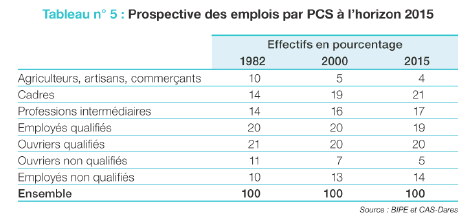
L’effet sur le nombre de trajectoires d’ascension sociale est cependant plus limité : selon les traitements statistiques des données FQP présentés par Camille Peugny, les situations d’ascension sociale concernaient 38,7 % des actifs âgés entre 30 et 59 ans en 2003, contre 37,7 % des actifs de la même classe d’âge en 1983.
L’explication de la différence de dynamique entre le rythme de création des emplois supérieurs et la stagnation du nombre de trajectoires d’ascension sociale semble devoir être trouvée dans un effet dit « de plafond » résultant de la croissance sur longue période des effectifs des catégories socioprofessionnelles supérieures : au terme de cette transformation de la structure des emplois de l’économie française, un plus grand nombre de personnes ayant une origine sociale élevée ne peuvent connaître de situation d’ascension sociale, au sens statistique du terme, car elles ont « déjà atteint le plafond ».
c. L’importance des trajectoires intergénérationnelles descendantes et du phénomène plus global de déclassement
L’analyse des trajectoires intergénérationnelles a permis également de pointer l’ampleur nouvelle du déclassement social parmi les générations arrivées le plus récemment sur le marché du travail.
Auteur d’une thèse de sociologie sur le thème du déclassement social (9), Camille Peugny a récemment montré une augmentation significative du nombre trajectoires descendantes : selon ses évaluations, 22 % et 25 % des trentenaires et quadragénaires se trouveraient aujourd’hui plus bas dans l’échelle sociale que ne l’étaient leurs parents, alors qu’on en dénombrait environ 18 % au début des années 1980.
Ainsi que le souligne le Centre d’analyse stratégique dans un rapport consacré à ce sujet (10), le déclassement n’est pas une notion récente (11), mais les transformations du marché du travail et le caractère pluridimensionnel du phénomène, qui élargit indirectement le champ d’investigation à la question du déclassement scolaire, en ont fait ressortir l’actualité.
Le phénomène de déclassement concerne plus particulièrement les personnes ayant une origine sociale élevée, par un mécanisme inverse à l’effet plafond, désigné par les termes « d’effet plancher » : plus le groupe socioprofessionnel d’origine est inférieur, plus les perspectives de trajectoires sociales sont ascendantes. Le déclassement se révèle être une maladie qui touche dans une certaine mesure davantage les sociétés aisées que les économies en voie de développement.
Toutefois, si l’augmentation du nombre d’actifs ayant une origine sociale supérieure explique en partie la croissance du nombre de trajectoires sociales descendantes, les raisons du phénomène de déclassement peuvent également être recherchées dans les évolutions du marché du travail, caractérisées par une plus grande précarité des situations professionnelles et le développement des formes atypiques d’emploi, synonymes de dégradation de la qualité des emplois non qualifiés (12).
S’il est difficile d’évaluer la part respective des effets de la transformation du marché de travail et celle des effets plus mécaniques de la transformation de la structure socioprofessionnelle des emplois, dans l’augmentation du nombre de trajectoires intergénérationnelles descendantes, cette approche permet de mieux appréhender différents phénomènes, propres aux trajectoires descendantes, susceptibles d’avoir un impact sur la mobilité sociale des jeunes : il s’agit du desserrement du lien diplôme-emploi parmi les jeunes générations (également évoqué par les termes de déclassement scolaire), des facteurs d’inégalité face au risque de déclassement au sein d’une même classe sociale et d’un phénomène temporaire de « sur-déclassement » identifié au début de la vie active et partiellement compensé par une plus grande mobilité professionnelle dans les premières années d’activité.
● La question du déclassement scolaire
Bien que la notion de déclassement s’apparente à celle de trajectoire descendante dans le champ socioprofessionnel, elle peut avoir un sens différent dans un autre contexte : on parle ainsi souvent de déclassement (implicitement scolaire), pour désigner « la situation des personnes qui possèdent un niveau de formation supérieur à celui normalement requis pour l’emploi qu’elles occupent » (13).
Les travaux de l’INSEE confirment l’hypothèse du desserrement du lien diplôme-emploi au début de la vie active. Selon les travaux de Jean-François Giret, Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini (14) sur le déclassement des jeunes, les perspectives qu’ont les nouvelles générations d’actifs arrivant sur le marché du travail de trouver un emploi correspondant à leur niveau de diplôme se sont sensiblement dégradées au cours des années 1990.
La lecture du graphique ci-dessous montre que le phénomène de déclassement est très accusé pour les jeunes professionnels travaillant depuis moins de quatre ans (courbe en pointillé), qu’il subsiste pour les jeunes professionnels expérimentés (ayant entre 5 et 9 ans d’expérience professionnelle) mais qu’il n’est plus perceptible parmi les professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience.
![]()
![]()
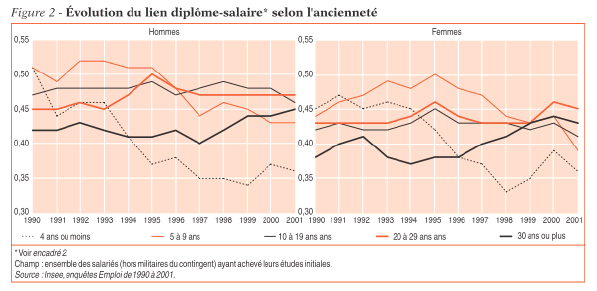
Les investigations statistiques de ces chercheurs sur les facteurs de risque de déclassement confirment l’analyse « triangulaire » du Centre d’analyse stratégique selon laquelle, si l’expansion scolaire a provoqué un desserrement du lien entre origine sociale et niveau d’éducation (voir figure précédente), elle n’a pas eu d’effets sensibles sur le lien entre origine sociale et position sociale du fait du desserrement concomitant du lien entre diplôme et position sociale. À niveau d’éducation égal, les enfants des classes supérieures sont plus armés pour trouver un emploi à hauteur de leurs diplômes malgré l’accroissement de la concurrence. Jean-François Giret, Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini notent, en commentaire de leurs calculs sur les différentiels de risque en matière de déclassement que « les fils de cadre ont plus souvent un emploi dont la qualification et le salaire sont en adéquation avec leur diplôme. Ils ont sans doute une meilleure connaissance des règles de négociation salariale, ou ils bénéficient d’un réseau relationnel plus étendu. Ils s’orientent aussi plus fréquemment vers des filières de l’enseignement supérieur plus sélectives et plus porteuses en termes de débouchés professionnels. Enfin, ils peuvent prolonger également plus longtemps leur recherche d’emploi, pour trouver un emploi plus en adéquation avec leur formation ». (15)
● L’absence de ressources culturelles comme facteur d’exposition au déclassement
Camille Peugny a mis ainsi en évidence que, pour des enfants de cadres, le lien entre leur niveau de diplôme et celui de leurs parents est étroit : « 40 % des individus dont le père est un cadre détenant un diplôme inférieur au baccalauréat sont ouvriers ou employés à l’âge de 40 ans, contre 31 % pour ceux dont le père possède un diplôme de niveau Bac + 2 et 21 % pour ceux dont le père a effectué un deuxième ou un troisième cycle universitaire ». La prise en compte du diplôme de la mère permet de préciser le sort de ces individus puisque, à niveau de diplôme du père équivalent, plus le diplôme de la mère est élevé, plus la probabilité d’être déclassé diminue.
● Un début de carrière plus difficile, mais auquel répond plus souvent une mobilité professionnelle en début de carrière
Si les jeunes générations subissent une forme de déclassement à l’entrée dans la vie active, la portée de ce phénomène est toutefois atténuée par les possibilités plus grandes de promotion en début de carrière. Pour un certain nombre de personnes, le développement de la mobilité professionnelle fait du déclassement scolaire un phénomène temporaire, dont les conséquences à long terme peuvent être limitées.
Les données des enquêtes FQP de l’INSEE montrent ainsi que la plus grande instabilité dans les relations du travail depuis les années 1980 n’a pas fait obstacle au développement des parcours professionnels ascendants, en particulier pour les ouvriers et employés non qualifiés.
MOBILITÉ PROFESSIONNELLE SELON LES GROUPES SOCIOPROFESSIONNELS
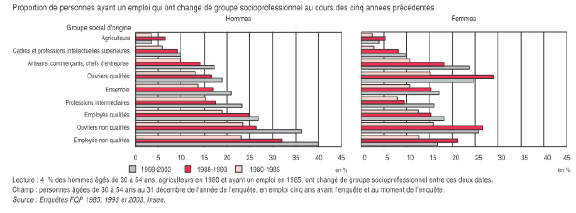
Source : Changer de groupe social en cours de carrière, Olivier Monso, division de l’emploi, Insee, Insee Première n°1112, 2006
Les données de mobilité professionnelle montrent également que les jeunes sont aujourd’hui les principaux bénéficiaires de l’amélioration des perspectives de mobilité professionnelle en cours de carrière. Les jeunes trentaines (30-34 ans) sont les plus nombreux à faire des mobilités professionnelles, ainsi que le montre le graphique suivant.
PROPORTION D’INDIVIDUS AYANT CONNU UNE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES, SELON LA TRANCHE D’ÂGE
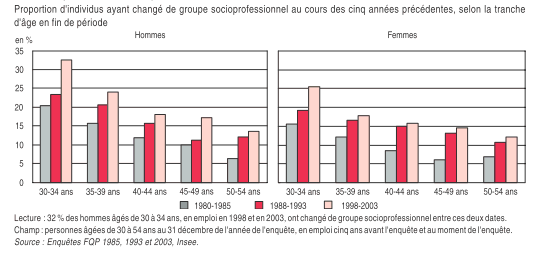
Source : Changer de groupe social en cours de carrière, Olivier Monso, division de l’emploi, Insee, Insee Première n°1112, 2006
Un autre traitement des données FQP, présenté par Camille Peugny, indique plus nettement comment la mobilité professionnelle vient atténuer l’importance des trajectoires intergénérationnelles descendantes en début de carrière.
Sur le graphique ci-dessous, on voit que le nombre des trajectoires intergénérationnelles descendantes recensées pour les hommes âgés de 27 ans est nettement supérieur au nombre de trajectoires intergénérationnelles descendantes qui peuvent être identifiées lorsque l’on s’intéresse à des hommes plus âgés.
PROPORTION D’ENFANTS DE CADRE CONNAISSANT UNE TRAJECTOIRE INTERGÉNÉRATIONNELLE, PAR GROUPE D’ÂGE
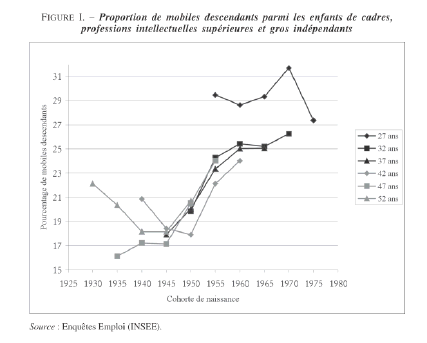
Source : La mobilité sociale descendante et ses conséquences politiques, Camille Peugny, la revue française de sociologie, 47-3, 2006, pg 445
4. Des perspectives plus favorables pour les années à venir
Ainsi que le souligne le Centre d’analyse stratégique dans son rapport sur le déclassement, les variables démographiques qui ont joué jusqu’à présent un rôle défavorable envers la mobilité sociale devraient devenir dans les prochaines années un facteur favorable à celle-ci, du fait du renouvellement d’un grand nombre d’emplois de cadres consécutif au départ à la retraite des générations du baby-boom.
Malgré la création d’un nombre croissant d’emplois supérieurs, l’économie française n’a pu éviter un vieillissement de la population active occupant ce type d’emploi, défavorable à l’accès à ces emplois pour les générations plus jeunes.
![]()
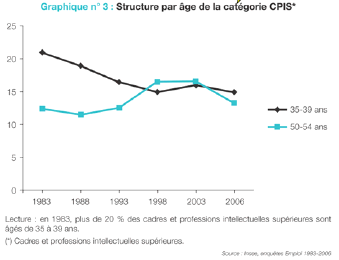
Source : Le déclassement, Rapport du Centre d’analyse stratégique, 2009
Cet état de fait devrait s’inverser rapidement dans les années à venir en raison de l’augmentation rapide des effectifs des générations d’actifs atteignant l’âge de la retraite. Selon le Centre d’analyse stratégique, la taille des générations atteignant l’âge de la retraite s’est accrue de 70 % entre 1995 et 2005, passant de 500 000 personnes pour la génération née en 1940 à une moyenne de 850 000 pour les générations nées après 1950 et offrant ainsi de nouvelles opportunités de mobilité professionnelle aux actifs plus jeunes.
![]()
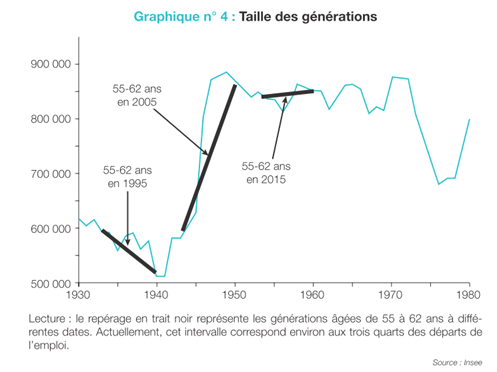
Source : Le déclassement, Rapport du Centre d’analyse stratégique, 2009
L’influence de ce facteur démographique est d’autant plus importante à signaler que son impact sur la segmentation du marché du travail, et au final sur la mobilité intergénérationnelle, reste pour l’essentiel à venir. Le facteur démographique intervient donc en complément des analyses de la mobilité sociale basées sur des données reflétant l’évolution passée de la structure des emplois, et devrait, par l’ouverture de nouvelles mobilités professionnelles, limiter la dégradation de la mobilité sociale intergénérationnelle.
B. LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE FRANÇAIS
La France dispose de l’atout considérable de pouvoir s’appuyer sur une jeunesse nombreuse pour affronter les défis à venir – communs à de nombreux pays occidentaux – de la capacité d’activité économique et de l’innovation en matières économique, sociale et sociétale.
En 2011, l’indice conjoncturel de fécondité se maintient à 2,01 enfants par femme en France, seulement dépassé dans l’Union européenne par celui constaté en Irlande (2,05). Pour la même année, il s’établit à 1,36 en Allemagne et en Espagne, 1,75 au Danemark et 1,96 au Royaume-Uni.
La population vieillit en France. La proportion des moins de 20 ans a baissé de façon continue depuis 1970, passant de 33,1 % à 24,3 %. Toutefois, la proportion de personnes jeunes demeure plus élevée en France que dans beaucoup de pays comparables. Comme l’illustre le tableau suivant, l’évolution pourrait être légèrement positive sur la période la plus récente pour les moins de 15 ans, contrairement à certains pays européens.
PROPORTION DES MOINS DE 15 ANS DANS LA POPULATION TOTALE
En pourcentage
2008 |
2010 | |
France |
18,3 |
18,4 |
Allemagne |
13,7 |
13,4 |
Belgique |
16,9 |
16,8 |
Italie |
14,0 |
14,0 |
Pologne |
15,5 |
15,0 |
Royaume-Uni |
17,5 |
17,3 |
Source : Eurostat
La France – sa société, ses pouvoirs publics – parvient-elle à valoriser l’atout que constitue son dynamisme démographique, en réservant une place convenable à sa jeunesse ? Mme Cécile Van de Velde – sociologue et maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – souligne, dans un article de juillet 2008 s’appuyant sur sa thèse intitulée « Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe », qu’« en fonction des modes d’intervention étatique, des systèmes éducatifs et des cultures familiales qui s’y agencent, chaque société tend à institutionnaliser différentes formes de passage à l’âge adulte, engendrant des expériences spécifiques de ce parcours de vie ».
Autrement dit, la situation concrète des jeunes dans une société résulte de façon combinée à la fois des politiques publiques – transferts sociaux et système éducatif – et des pratiques et représentations culturelles « en vigueur ».
Les développements suivants ont pour objet de faire le point sur les principales caractéristiques en France de ces « déterminants » de la jeunesse.
1. Entre familialisme et encouragement à l’autonomie précoce des jeunes, la transition vers l’âge adulte est marquée en France par la place centrale de la scolarité
a. Trois repères étrangers : Danemark, Royaume-Uni et Espagne
L’ouvrage issu de la thèse de Mme Cécile Van de Velde (16) associe à chacun des pays étudiés des éléments caractérisant sa jeunesse, sous-tendus par des politiques publiques, ainsi que par des représentations et pratiques collectives et individuelles propres à chacun de ces pays.
Se basant sur l’exemple du Danemark, Cécile Van de Velde décrit une « configuration nordique » caractérisée par des trajectoires de jeunesse longues et exploratoires. Le départ du domicile parental y est relativement précoce, autour de la 20ème année. L’« arrivée » à l’âge adulte est tardive, après une période de mobilité personnelle, professionnelle, ainsi qu’en matière de formation. Cette initiation à la vie adulte par l’expérimentation n’est pas associée à la précarité. Ces parcours sont rendus notamment possibles par le système danois de bourses universelles d’études, généreux (environ 900 euros par mois), sans considération du revenu des parents et sans limite d’âge.
Au Royaume-Uni, le départ du domicile parental est également précoce, constituant le premier pas d’une logique émancipatrice qui valorise l’autofinancement par le travail salarié ou le recours au prêt durant la période d’étude ou de formation, puis – dès que possible – l’accès à l’autonomie financière par l’intégration sur le marché du travail. Il n’y a pas d’aides publiques au financement des études et les familles encouragent la quête « self made » et rapide de l’autonomie dans chacun des aspects de la vie.
En Espagne, les jeunes quittent tardivement le domicile familial, car la logique sociale dominante est qu’il faille « avant de partir » obtenir un emploi stable, devenir propriétaire et se marier. Le taux de chômage des jeunes très élevé en Espagne et la précarité qui caractérise leur situation sur le marché du travail repoussent la perspective de l’émancipation jusqu’à des âges élevés, bien au-delà des âges moyens constatés au Danemark et au Royaume-Uni. Il n’existe pas de soutiens publics aux jeunes pour financer leurs études et leur insertion sur le marché du travail, ce qui a pour conséquence de consacrer l’emprise financière et matérielle de la famille sur les jeunes jusqu’à des âges avancés.
b. Des politiques publiques françaises en direction des jeunes entre politiques familiales et aides directes à l’autonomie
La situation française n’est pas le décalque d’un des trois exemples précédents. Les jeunes en France quittent précocement le domicile familial, en s’appuyant notamment sur des aides publiques dont ils peuvent directement bénéficier – les allocations logement et, le cas échéant, les bourses d’études attribuées sur critères sociaux aux étudiants de l’enseignement supérieur.
Certains éléments de « familialisme » caractérisent toutefois la situation française : les jeunes Français ne peuvent bénéficier jusqu’à 25 ans du revenu de solidarité active (RSA) (17) et sont de fait en grande partie exclus du bénéfice de l’assurance-chômage lié à des périodes d’activité professionnelles rarement observées avant cet âge. Les avantages familiaux et fiscaux dont bénéficient les familles dans certains cas au titre de leurs enfants de plus de 18 ans maintiennent, voire confortent, le lien financier et matériel entretenu avec leurs parents.
Au total, ce modèle « hybride » d’aides publiques, dans un contexte de chômage élevé des jeunes, tend à accorder un positionnement social dégradé à la jeunesse française au regard des autres classes d’âge (cf. infra les développements relatifs à l’apparition de freins à la mobilité sociale des jeunes).
c. La place centrale du système scolaire français dans les destins sociaux
Le « modèle français » des politiques publiques à l’égard de la jeunesse s’inscrit dans une logique où le mérite scolaire – matérialisé par le diplôme obtenu – influence de façon décisive, tout au long de la vie, le destin professionnel et matériel des jeunes puis des adultes. En découle la place centrale occupée dans les politiques publiques et les représentations collectives par le système scolaire français, pourvoyeur de ces diplômes, qui tend structurellement à produire une hiérarchie des placements – des statuts – professionnels et sociaux.
Les modèles sociologiques n’étant jamais purs, la conquête de l’autonomie par les jeunes en France peut relever, le cas échéant, d’un tâtonnement initiatique comme au Danemark, d’une nécessité financière incontournable comme au Royaume-Uni ou de l’acquisition d’une « panoplie » sociale complète (travail, logement, foyer) comme en Espagne. Ce processus est toujours en France grandement impacté par l’obtention du diplôme et son niveau, correspondant à un statut social qui définit de façon durable les modalités de l’intégration sociale et professionnelle.
d. Questionnements issus des comparaisons internationales
Le tableau suivant retrace pour le Danemark, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni les principales modalités de la transition vers l’âge adulte des jeunes, évoquées supra.
CARACTÉRISTIQUES PAR PAYS DÉFINISSANT L’« HORIZON »
DE LA JEUNESSE
Danemark |
« Se trouver » |
Développement personnel |
Espagne |
« S’installer » |
Installation matrimoniale |
France |
« Se placer » |
Intégration sociale |
Royaume-Uni |
« S’assumer » |
Émancipation individuelle |
Source : thèse de Mme Cécile Van de Velde « Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe ».
Si l’on écarte le « modèle espagnol », marqué par un accès difficile des jeunes au marché du travail et plus largement à l’autonomie, ce tableau doit conduire à nous interroger en France sur au moins deux questions :
– si le modèle français est caractérisé par son objectif d’intégration sociale, le permet-il pour chacun et dans quelles conditions d’équité au sein du système scolaire ? Autrement dit, l’Éducation nationale permet-elle à chacun, au-delà des déterminismes sociaux, de parvenir à cette intégration sociale selon ses mérites et ses talents ? Ces questions sont abordées ci-après, sur la base d’une annexe au présent rapport consacrée à un état des lieux en la matière ;
– comment valoriser en France des modalités de transition vers l’âge adulte – comme le développement personnel, l’émancipation individuelle – rendues secondaires, voire impraticables, par un modèle valorisant l’acquisition « sous pression », au plus vite et de façon linéaire d’un diplôme et donc d’un statut social, d’autant plus fondamentaux qu’ils apparaissent quasi définitifs ?
2. Malgré une réelle démocratisation de l’accès aux diplômes dans le secondaire et le supérieur, le système éducatif français demeure marqué par la différenciation sociale des performances des élèves
Les rapporteurs ont souhaité en annexe I au présent rapport établir un point sur la contribution du système scolaire français à la mobilité sociale des jeunes en France. Les principaux enseignements sont les suivants :
– durant la seconde moitié du XXème siècle, l’accès de tous les enfants au collège et la démocratisation de l’obtention du bac et de l’accès à l’enseignement supérieur ont conduit à un réel renforcement de la mobilité sociale, via la hausse des qualifications des enfants des catégories sociales défavorisées, mesurée par le niveau des diplômes obtenus par eux ;
– la période plus récente, depuis quinze à vingt ans, est marquée par un recul de l’accès au bac des enfants des catégories socialement défavorisées. Ce constat alarmant se double d’une tendance à la spécialisation socio-économique des filières de l’enseignement secondaire, la voie professionnelle devenant un peu plus au fil du temps celle des enfants d’inactifs et d’ouvriers non qualifiés ;
– le lien entre les résultats scolaires et l’environnement social, économique et culturel des élèves est établi avant l’entrée au CP. Ce lien s’intensifie tout au long de la scolarité dans le primaire, puis encore au collège ;
– à l’issue du collège, les choix d’orientation socialement marqués – à performances scolaires pourtant comparables – pèsent de façon significative sur les cursus et les destins scolaires, de façon au moins aussi significative que la différenciation sociale des résultats scolaires ;
– les enquêtes PISA (pour Program for International Student Assessment) menées par l’OCDE tendent à montrer que notre système scolaire ne parvient pas, bien au contraire, à tirer vers le haut les élèves moyens ou faibles des classes populaires, nombre d’entre eux se retrouvant handicapés – à la fin de la scolarité obligatoire – par des niveaux de compétences si faibles qu’ils rendent problématique le succès de tout effort ultérieur de formation, d’accompagnement ou de seconde chance. À l’inverse, notre système scolaire ne « produit » pas moins de bonnes performances qu’ailleurs, y compris en valorisant les capacités d’un nombre significatif d’élèves issus de ces classes populaires.
In fine, le constat le plus alarmant s’agissant des performances de notre système éducatif est le suivant : caractérisé dans l’ensemble par des résultats socialement très différenciés, il conduit à ce qu’un nombre élevé d’élèves – en très grande partie issus des catégories sociales les plus défavorisées – en sortent avec un niveau scolaire très faible, souvent sans qualification ni diplôme, en position fortement et durablement précaire sur le marché du travail.
Certaines études montrent que les sorties de l’enseignement secondaire sans diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges concernent en France la moitié des enfants d’inactifs et plus d’un tiers des enfants d’ouvriers non qualifiés, pour une moyenne un peu inférieure à 20 % toutes catégories sociales confondues.
3. Le système scolaire français marque durablement les destins et les esprits
a. Un grand nombre de sorties sans diplôme et sans qualification du système éducatif
Le tableau suivant retrace pour certaines années depuis 1998 le plus haut diplôme obtenu par les jeunes sortant du système scolaire au cours de chacune de ces années.
RÉPARTITION DES GÉNÉRATIONS
SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU À LA SORTIE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
En pourcentage
1998 |
2001 |
2004 |
2007 |
Proportion de femmes en 2007 | |
Sans diplôme |
17 |
17 |
17 |
18 |
38 |
CAP ou BEP |
14 |
18 |
17 |
17 |
41 |
Bac professionnel ou technologique |
21 |
18 |
19 |
17 |
44 |
Bac général |
6 |
7 |
6 |
6 |
58 |
Bac+2 |
18 |
18 |
18 |
16 |
55 |
Licence |
7 |
6 |
7 |
8 |
60 |
Bac+4 |
7 |
6 |
5 |
4 |
63 |
DEA, DESS, Mastère 2 |
5 |
5 |
6 |
8 |
57 |
École d’ingénieurs ou de commerce |
3 |
3 |
3 |
4 |
27 |
Doctorat |
2 |
2 |
2 |
2 |
53 |
Ensemble |
100 |
100 |
100 |
100 |
47 |
Source : Enquêtes génération du Céreq 1998, 2001, 2004 et 2007
La proportion de jeunes qui sortent sans diplôme du système scolaire est considérable en France. Elle connaît une légère augmentation pour la génération 2007 des jeunes sortant du système scolaire, atteignant 18 % – dont 62 % de garçons. Il est difficile de penser que le système scolaire français est efficace, au regard du poids de cette frange de la jeunesse française pour laquelle l’investissement public en primaire puis dans le secondaire – 10 années au moins de scolarité obligatoire – n’aura abouti à aucune qualification sanctionnée par un diplôme.
L’interrogation sur l’efficience de l’investissement consenti via le système scolaire est renforcée par la situation des jeunes sortis sans diplôme sur le marché du travail. Le tableau suivant présente le taux de chômage des jeunes sortis en 2007 du système scolaire, selon leur niveau de qualification.
PROPORTION DE CHÔMEURS DES GÉNÉRATIONS 2004 ET 2007 TROIS ANS APRÈS LA FIN DES ÉTUDES SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU À LA SORTIE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
En pourcentage
2004 |
2007 | |
Sans diplôme |
33 |
40 |
CAP ou BEP |
17 |
24 |
Bac professionnel ou technologique |
13 |
15 |
Bac général |
14 |
19 |
Bac+2 |
7 |
9 |
Licence |
7 |
11 |
Bac+4 |
10 |
8 |
DEA, DESS, Mastère 2, école d’ingénieurs ou de commerce |
5 |
9 |
Doctorat |
7 |
5 |
Ensemble |
14 |
18 |
Source : Enquêtes génération du Céreq 2004 et 2007
Ce tableau montre, pour toutes les catégories de diplômes, un effet sévère de la crise économique de 2008, la situation des jeunes ayant été constatée en 2007 pour la génération sortie du système scolaire en 2004, puis en 2010 pour celle sortie en 2007. En tout état de cause, la proportion des jeunes non diplômés au chômage trois ans après leur sortie du système scolaire est nettement plus élevée que celles constatées pour toutes les autres catégories de diplômes, y compris les qualifications infra-bac et le bac.
b. Quel regard porté sur notre système éducatif ?
Le lien intense en France entre performances scolaires et catégories sociales, ainsi que le poids des sorties sans diplôme du système scolaire, ont conduit certains observateurs à des jugements sévères sur celui-ci. Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg – dans leur ouvrage de 2011 intitulé Comment la France divise sa jeunesse, la machine à trier (18)–, interpellant à la fois notre système scolaire et la société française, considèrent que la réalité est la suivante : « un système éducatif qui fait émerger une petite élite sans se soucier vraiment de ceux qui restent sur le bord de la route, une société qui se pense plus juste et plus égalitaire que beaucoup d’autres, alors qu’elle est restée élitiste et inégalitaire. »(19)
Un récent sondage (20) a montré que 56 % des enseignants interrogés considéraient que l’école jouait de moins en moins son rôle de promotion sociale, 12 % d’entre eux seulement considérant qu’elle jouait de plus en plus ce rôle.
En tout état de cause, les élèves français ne semblent pas les plus à leur aise dans notre système scolaire. L’OCDE a publié en 2009 des indicateurs de bien-être des enfants, relatifs à certaines actions des pouvoirs publics. Le tableau suivant retrace le classement de la France pour chacun de ces indicateurs, ainsi qu’une appréciation sur l’écart français à la moyenne des pays de l’OCDE.
MESURES DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS CENTRÉES SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS – CLASSEMENT DE LA FRANCE
Intitulé de l’indicateur |
Bien-être matériel |
Logement et environnement |
Bien-être éducationnel |
Santé et sécurité |
Comportements à risques |
Qualité de la vie scolaire |
Classement de la France |
10ème |
10ème |
23ème |
20ème |
12ème |
22ème |
Appréciation sur l’écart français à la moyenne des pays de l’OCDE |
Performance bien supérieure à la moyenne |
Performance proche de la moyenne |
Performance proche de la moyenne |
Performance proche de la moyenne |
Performance proche de la moyenne |
Performance très inférieure à la moyenne |
Source : OCDE dans Assurer le bien-être des enfants, chapitre II Comparaison du bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE, 2009.
Dans un ensemble moyen – voire médiocre – de classements pour la France, les plus mauvais classements français concernent précisément l’éducation et la scolarité. S’agissant de la qualité de la vie scolaire, la performance française est de surcroit très inférieure à la moyenne.
Plus précisément, les deux indicateurs relatifs à l’éducation et à la scolarité sont ainsi composés :
– Bien-être éducationnel : a) scores dans les enquêtes PISA en lecture et compréhension de l’écrit, b) inégalités de ces scores et c) proportion de jeunes NEET – pour « not in employment, education or training », c’est-à-dire proportion de jeunes sans emploi et qui ne sont ni scolarisés, ni en formation (cf. infra) ;
– Qualité de la vie scolaire : a) brimades, b) proportion d’enfants aimant l’école.
S’agissant de la proportion des enfants aimant l’école, l’étude utilisée par l’OCDE indique qu’ils sont 21,4 % en France, pour une moyenne au sein de 25 pays de l’OCDE s’élevant à 27,2 %. Ces résultats sont décomposés par âge dans le tableau suivant.
PROPORTION D’ENFANTS DÉCLARANT AIMER L’ÉCOLE
En pourcentage
Enfants de 11 ans |
Enfants de 13 ans |
Enfants de 15 ans | ||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles | |
France |
29 |
41 |
13 |
19 |
11 |
13 |
OCDE |
32 |
42 |
22 |
29 |
17 |
21 |
Source : OCDE, adapté de Currie et al. (2008), Inégalités en matière de santé chez les jeunes, rapport international « Health Behaviour in School-aged Children » (HBSC) de l’enquête 2005/2006, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Copenhague.
Peu éloignées de la moyenne de l’OCDE à l’issue de l’enseignement primaire, les proportions d’enfants français déclarant aimer l’école baissent sensiblement au cours du collège, de façon nettement plus accentuée que dans les autres pays de l’OCDE concernée par l’étude.
C. L’APPARITION DE FREINS À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES
1. Depuis une vingtaine d’années, la mobilité sociale intergénérationnelle progresse moins, voire régresse selon certains indicateurs
a. Les enseignements de la dernière enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) de l’INSEE (2003)
L’INSEE réalise à intervalles réguliers une enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) qui compare notamment la catégorie socio-professionnelle des hommes actifs de 40 à 59 ans avec celle de leur père. À défaut de disposer des résultats de l’enquête FQP dont la réalisation et l’exploitation sont en cours, des enseignements peuvent être tirés des enquêtes réalisées en 1977, 1993 et 2003.
Les enquêtes FQP permettent de mesurer l’évolution du poids respectif de chaque catégorie socio-professionnelle, en comparant fils et pères. Le tableau suivant retrace cette évolution pour l’enquête FQP 2003.
COMPARAISON DES EFFECTIFS DES FILS ET PÈRES EN 2003
PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
Milliers de personnes
Catégorie socio-professionnelle |
Effectifs des pères |
Effectifs des fils |
Évolution intergénérationnelle des effectifs | ||
En milliers de personnes |
En pourcentage |
En milliers de personnes |
En pourcentage | ||
Agriculteur |
1143 |
16,2 |
285 |
4,0 |
– 75,1 % |
Artisan, commerçant, chef d’entreprise |
870 |
12,3 |
619 |
8,8 |
– 28,9 % |
Cadre et profession intellectuelle supérieure |
591 |
8,4 |
1317 |
18,7 |
+ 122,8 % |
Profession intermédiaire |
800 |
11,4 |
1690 |
24 |
+ 111,2 |
Employé |
644 |
9,1 |
770 |
10,9 |
+ 19,6 % |
Ouvrier |
2998 |
42,6 |
2364 |
33,6 |
– 21,2 % |
Ensemble |
7045 |
100 |
7045 |
100 |
– |
Source : INSEE, enquête FQP 2003
Le tableau montre en 2003, entre la génération des hommes actifs de 40 à 59 ans et celle de leur père, un changement en profondeur du poids respectif des catégories socio-professionnelles. La proportion des agriculteurs baisse très fortement. Celle des cadres et professions intermédiaires (21) fait plus que doubler. Le poids des ouvriers baisse nettement, même s’ils constituent de loin en 2003 la catégorie la plus importante.
Cette évolution de la structure des emplois implique à soi seule une mobilité sociale dite structurelle. L’INSEE indique, pour l’enquête FQP 2003, qu’« entre la génération des pères et celle des fils, 1,8 million de changements de groupe social au minimum auraient été nécessaires compte tenu de la chute du nombre d’agriculteurs et du déclin de l’emploi industriel, et de la croissance du salariat et du secteur tertiaire » (22).
La mobilité sociale dite nette résulte de la différence entre le nombre des fils ayant une position sociale différente de celle de leur père et le nombre des changements de groupe social induits par l’évolution de la structure des emplois – c’est-à-dire la mobilité sociale structurelle.
Pour les trois enquêtes FQP 1977, 1993 et 2003, le tableau suivant présente le poids respectif des mobilités sociales structurelle et nette.
MOBILITÉ SOCIALE STRUCTURELLE ET NETTE EN 1977, 1993 ET 2003
En pourcentage
1977 |
1993 |
2003 | |
Proportion d’hommes ayant une position sociale différente de celle de leur père (mobilité sociale totale) |
57 |
65 |
65 |
dont proportion minimum de mouvements permettant de passer de la structure sociale des pères à celle des fils (mobilité dite structurelle) |
20 |
22 |
25 |
dont proportion de mouvements supplémentaires (mobilité dite nette) |
37 |
43 |
40 |
Part de la mobilité sociale nette dans la mobilité sociale |
65 |
66 |
62 |
Source : INSEE, enquêtes FQP 1977, 1993 et 2003
On constate que la mobilité sociale nette a baissé en valeur absolue en 2003 par rapport à 1993. En proportion de la mobilité sociale totale, la mobilité sociale nette est par ailleurs plus faible en 2003 qu’en 1993 et 1977.
Pour illustrer le recul en 2003 de la mobilité sociale nette mesurée par les enquêtes FQP, l’INSEE indique qu’« en considérant deux hommes pris au hasard, l’un issu d’une famille de cadre, l’autre d’origine ouvrière, le premier a huit chances sur dix d’occuper une position sociale supérieure ou égale à celle du second. Cet avantage du fils de cadre est supérieur à ce qu’il était il y a dix ans ou vingt-cinq ans […] L’accès à la catégorie des cadres n’est guère plus facile pour les fils d’employés ou de personnes exerçant une profession intermédiaire. En 25 ans, l’avantage relatif des fils de cadre sur les fils d’ouvrier, d’employé ou de personnes exerçant une profession intermédiaire s’est accentué. » (23)
b. Le recul des résultats scolaires et de l’accès au bac des enfants des classes sociales les plus défavorisées
Certains éléments de l’annexe I au présent rapport montrent que la contribution du système scolaire français à la mobilité sociale des jeunes s’est amenuisée durant la période récente :
– toutes filières confondues, l’accès au bac des enfants d’inactifs, d’ouvriers non qualifiés et d’employés de service a reculé entre 1996 et 2002, alors que les enfants de ces catégories socio-professionnelles étaient ceux qui dès 1996 parvenaient le moins à obtenir le bac. Ce constat est plus accentué pour les bacs de la voie générale – a fortiori le bac S –, considérés comme les plus sélectifs et ouvrant sensiblement plus que les autres à l’opportunité d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur (24) ;
– la proportion des élèves scolarisés dans les établissements des réseaux Éclair de l’éducation prioritaire maitrisant à la fin de la 3ème les compétences de base – notamment en français et dans une moindre mesure en mathématiques – a connu un décrochage significatif entre 2007 et 2012, bien plus accentué que la baisse observée pour les élèves scolarisés hors éducation prioritaire (25).
– les enquêtes PISA réalisées par l’OCDE tous les trois ans révèlent pour la France un accroissement significatif entre 2000 et 2009 de la proportion des élèves de 15 ans dont les compétences pour la lecture et la compréhension de l’écrit sont très faibles. La proportion des élèves se situant à des niveaux de compétences inférieurs à 1 – soit des niveaux très faibles de compétences scolaires – a doublé sur cette période en France, devenant supérieure à la moyenne observée au sein de l’OCDE. Les enquêtes PISA montrent en outre que le lien entre compétences scolaires et environnement social, économique et culturel est particulièrement intense en France. Il est donc probable que parmi le nombre croissant des jeunes de 15 ans dont les compétences se situent à un niveau faible ou très faible, beaucoup d’entre eux soient issus en France des catégories sociales défavorisées.
c. La mobilité sociale freinée en France par le niveau croissant des inégalités sociales ?
Certains observateurs économiques ont tenté d’établir une corrélation négative entre le niveau des inégalités sociales et l’intensité de la mobilité sociale. Le graphique suivant a été rendu public en 2012 aux États-Unis d’Amérique par le comité économique – placé auprès du Président fédéral (Council of economic advisers) – dans le cadre de son rapport annuel au Congrès.
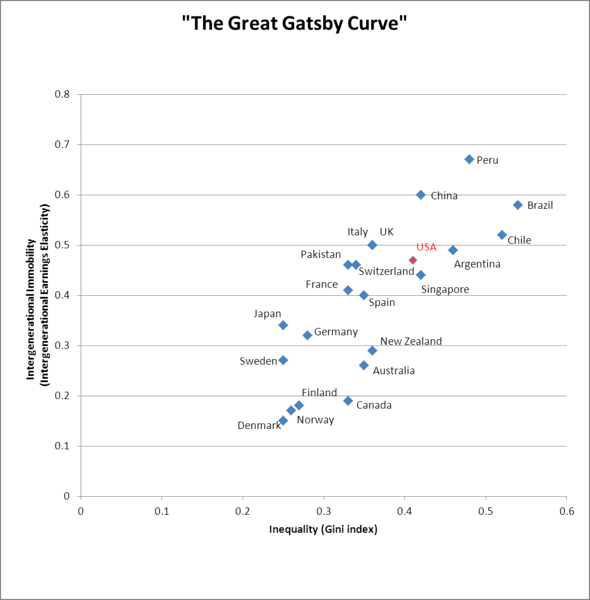
Source : Miles Corak, économiste du travail
Dans ce graphique, sont mises en relation :
– en abscisses, les inégalités de revenus dans chaque pays, via le coefficient de Gini variant de 0 à 1. Plus le coefficient est proche de 1, plus les inégalités de revenus sont fortes ;
– en ordonnées, la mobilité intergénérationnelle, via l’élasticité intergénérationnelle des revenus. Plus l’élasticité est élevée, plus on constate que les inégalités de niveau de revenus constaté entre parents ont tendance à se transmettre entre enfants.
Les enseignements qu’il serait possible de tirer de ce graphique demeurent controversés. Il semble néanmoins patent que la mobilité intergénérationnelle est plus forte dans les pays dans lesquels les inégalités de revenus sont plus faibles. Intuitivement, il semble en effet logique qu’un système de formation puisse « rebattre les cartes » d’autant plus intensément que les différences de capital social, humain, économique et culturel – en partie lié aux revenus – sont faibles entre les ménages.
La France occupe une position globalement médiane dans ce graphique. On observe que la mobilité intergénérationnelle est moins intense qu’en France dans 10 pays de l’échantillon. S’agissant des inégalités de revenus, elles sont supérieures à celles mesurées en France dans 13 pays. On pourrait en conclure qu’au regard des inégalités de revenus constatées en France, la mobilité sociale intergénérationnelle y est faible. Autrement dit, notre système de formation – initiale et continue – connaît peut-être plus de difficultés qu’ailleurs pour « changer la donne » issue des statuts économiques des ménages.
En tout état de cause, la modération des inégalités de revenu constitue sans doute un élément causal de l’intensité de la mobilité sociale. Les inégalités de revenus constatées en France apparaissent effectivement relativement modérées. Elles sont par ailleurs stables depuis 30 ans, alors qu’elles ont augmenté durant la même période dans de nombreux pays de l’OCDE. Le tableau suivant retrace leur évolution depuis 1985 en France et dans certains pays aux profils variés, en considérant le coefficient de Gini propre à chacun d’eux.
ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DE REVENUS AU SEIN DES PAYS DE L'OCDE
Valeur du coefficient de Gini
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2008 | |
Allemagne |
0,25 |
0,26 |
0,27 |
0,26 |
0,30 |
0,30 |
Danemark |
0,22 |
0,23 |
0,21 |
0,23 |
0,23 |
0,25 |
États-Unis |
0,34 |
0,35 |
0,36 |
0,36 |
0,38 |
0,38 |
Italie |
0,31 |
– |
0,34 |
0,35 |
0,34 |
0,35 |
France |
0,30 |
0,29 |
0,28 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
Source : OCDE
Depuis 2008 et le début de la crise économique actuelle, les inégalités de revenus en France ont toutefois peut-être augmenté. La position française sur la grande « courbe de Gatsby » ci-dessus présentée a été établie sur la base d’un coefficient de Gini supérieur à 0,3 en 2012. En outre, d’autres indicateurs montrent une augmentation des inégalités de revenus en France pour la période récente. Le tableau suivant retrace l’évolution depuis environ vingt ans pour les pays pris en compte dans le tableau précédent – du ratio entre le revenu disponible du décile des plus aisés et du décile des plus modestes.
RAPPORT ENTRE LE REVENU DISPONIBLE MOYEN
DES 10 % LES PLUS RICHES ET DES 10 % LES PLUS PAUVRES
Milieu des années 1990 |
Milieu des années 2000 |
Fin des années | |
Allemagne |
6 |
6,6 |
7,1 |
Danemark |
4 |
4,6 |
5,2 |
Etats-Unis |
12,5 |
15,5 |
15,1 |
Italie |
11,5 |
10,7 |
9,7 |
France |
6,1 |
6,6 |
6,8 |
Source : OCDE
Cet indicateur tend à montrer que la France connaît un accroissement des inégalités de revenus depuis le milieu des années 1990, selon une évolution comparable à l’Allemagne. Cette évolution a pu défavorablement peser sur l’évolution de l’intensité de la mobilité sociale au cours des périodes récentes dans notre pays.
2. La « situation sociale » des jeunes en France est nettement défavorable par rapport aux autres classes d’âge, ce différentiel allant en s’accroissant pour certains indicateurs
a. Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté et la précarité
Le tableau suivant retrace par catégorie d’âge les taux de pauvreté – entendue comme concernant les personnes disposant d’un revenu inférieur à 50 % du revenu médian – constatés pour certaines années depuis 1996 en France.
TAUX DE PAUVRETÉ DES INDIVIDUS AU SEUIL DE 50% DU NIVEAU DE VIE MÉDIAN SELON L'ÂGE DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE
En pourcentage
1996 |
2000 |
2003 |
2006 |
2010 | |
Moins de 30 ans |
10,0 |
9,1 |
8,6 |
13,1 |
14,1 |
30 à 39 ans |
7,1 |
6,9 |
7,0 |
6,4 |
8,5 |
40 à 49 ans |
9,7 |
8,2 |
8,1 |
8,4 |
8,3 |
50 à 59 ans |
11,3 |
9,0 |
8,6 |
7,2 |
8,1 |
60 à 69 ans |
5,3 |
4,5 |
4,7 |
4,1 |
5,2 |
70 ans ou plus |
3,1 |
3,8 |
3,1 |
3,8 |
4,0 |
Ensemble |
8,1 |
7,2 |
7,0 |
7,0 |
7,8 |
Écart entre moins de 30 ans et l’ensemble en proportion de l’ensemble |
+ 23 |
+ 26 |
+ 23 |
+ 87 % |
+ 81 % |
Source : INSEE
Le taux de pauvreté des moins de 30 ans est demeuré supérieur au taux constaté pour l’ensemble des classes d’âge sur l’ensemble de la période considérée. Cet écart, en pourcentage du taux de pauvreté constaté pour cet ensemble, a toutefois augmenté dans des proportions considérables à compter du milieu des années 2000. En 2010, le taux de pauvreté pour les moins de 30 ans est de loin le plus élevé des taux constatés par classe d’âge, ce qui n’était pas le cas en 1996. En matière de pauvreté, les jeunes sont donc confrontés à une situation plus dégradée que l’ensemble de la population, dans des proportions accrues de façon alarmante depuis un peu moins de 10 ans.
Le tableau suivant permet de caractériser plus précisément la situation de la jeunesse française au regard de la pauvreté, en considérant certaines statistiques européennes.
TAUX DE PAUVRETÉ AU SEUIL DE 60 %(*) DU REVENU MÉDIAN
EN FRANCE ET DANS L’UNION EUROPÉENNE EN 2011
En pourcentage
France |
Union européenne | |
Personnes de 18 à 24 ans |
22,4 |
21,7 |
Ensemble de la population |
14 |
16,9 |
(*) Les données du présent tableau sont donc sensiblement différentes de celles du tableau précédent établies sur la base d’un calcul du taux de pauvreté au seuil de 50 % du revenu médian.
Source : Eurostat
Ce tableau montre que le taux de pauvreté en France des jeunes est un peu plus élevé, au seuil de 60 % du revenu médian, que dans l’Union européenne, alors que pour l’ensemble de la population, la situation est plus favorable en France que dans l’UE. Ce constat illustre la position dégradée de la jeunesse française au sein de la population en terme de pauvreté monétaire.
S’agissant de la précarité sociale et économique des jeunes, on observe que la baisse des périodes effectives d’emploi avant 30 ans concerne principalement les moins diplômés, à la fois sur longue période et pour les périodes récentes.
Les jeunes accèdent plus tard à l’emploi en premier lieu parce qu’ils sortent plus tard du système éducatif. L’âge moyen de sortie d’études s’est établi en 2006 à un peu plus de 21 ans. Cet âge moyen a augmenté de 1,5 an depuis le milieu des années 1980. Cette moyenne masque une évolution différenciée sur longue période, selon le plus haut diplôme obtenu.
Entre les générations nées de 1934 à 1938 et celles nées de 1969 à 1973, l’âge de fin des études est passé pour les non diplômés d’un peu plus de 14 ans à 17 ans. Pour les mêmes générations, cet âge est passé pour les détenteurs d’un diplôme inférieur au bac d’un peu moins de 17 ans à 18 ans. L’âge moyen de sortie d’études des bacheliers et des détenteurs d’un diplôme de niveau bac+2 a également augmenté d’un an pour les mêmes générations, atteignant respectivement un peu plus de 20 ans et de 22 ans. Seul l’âge de sortie d’études des diplômés de l’enseignement supérieur pour des diplômes au-delà de bac+2 est resté stable, à 24 ans.
L’allongement de la durée des études ne relève donc pas uniquement d’une augmentation de la proportion de jeunes qui atteignent le bac ou un diplôme de l’enseignement supérieur, il a également pour origine, sur longue période, une durée plus longue d’études pour un même niveau niveau de qualification, a fortiori pour les personnes qui sortent du système éducatif sans diplôme.
Dans la période récente, les jeunes non diplômés cumulent également les durées d’emploi les plus faibles dans les années postérieures à la sortie des études. L’enquête du Céreq portant sur la génération des jeunes sortis du système scolaire en 2004 montre que la durée médiane d’emploi des non diplômés dans les 36 mois suivant cette sortie est de 20 mois. Elle s’établit en revanche autour de 30 mois pour tous les jeunes diplômés, du CAP au doctorat.
La précarité professionnelle à l’entrée sur le marché du travail – notamment pour les personnes non diplômées – s’est renforcée sur la période récente, comme l’illustre le tableau suivant qui, pour les générations sorties du système scolaire en 2004 et 2007, mesure le taux d’emploi observé trois ans après cette sortie, en fonction du diplôme obtenu.
TAUX D’EMPLOI DES JEUNES AU BOUT DE TROIS ANS DE VIE ACTIVE
En pourcentage
Année de sortie du système éducatif | ||
2004 |
2007 | |
Sans diplôme |
56 |
48 |
CAP/BEP |
76 |
70 |
Bac professionnel ou technologique |
78 |
75 |
Bac général |
62 |
55 |
Bac+2 |
88 |
86 |
Licence |
83 |
80 |
M1 (bac+4) |
91 |
88 |
M2 (Bac+5) |
91 |
92 |
Doctorat |
87 |
85 |
Ensemble |
77 |
73 |
Source : Enquêtes générations du Céreq 2004 et 2007
Ce tableau montre que la baisse du taux d’emploi entre les générations sorties du système scolaire en 2004 et 2007 est générale. Elle est plus aiguë pour les catégories de jeunes pour lesquels le taux d’emploi était initialement le plus faible, notamment pour les non diplômés (26).
L’ensemble de ces éléments montrent que la baisse des durées moyennes d’emploi avant 30 ans sur longue période – que l’on peut considérer comme une mesure de la précarité sociale et professionnelle en début de carrière – a notamment concerné les jeunes sans diplôme, du fait à la fois – au regard des jeunes diplômés – de l’allongement substantiel de leur scolarité, de leur faible taux d’emploi et de l’influence importante de la conjoncture économique sur ce taux d’emploi.
b. Les jeunes sont plus souvent au chômage, a fortiori dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Le tableau suivant retrace les taux de chômage pour l’ensemble de la population et pour les jeunes, ainsi que l’évolution du différentiel de ces deux taux, constatés pour les mois de janvier 2005 à 2013.
TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE
En pourcentage
01-2005 |
01-2006 |
01-2007 |
01-2008 |
01-2009 |
01-2010 |
01-2011 |
01-2012 |
01-2013 | |
Ensemble de la population active |
9,1 |
9,5 |
8,8 |
7,6 |
8,6 |
10,0 |
9,6 |
9,9 |
10,8 |
Jeunes (moins de 25 ans) |
19,8 |
22,1 |
20,6 |
17,3 |
22,5 |
22,9 |
22,7 |
22,5 |
26,2 |
Écart* |
+ 118 % |
+ 133 % |
+ 134 % |
+ 128 % |
+ 162 % |
+ 134 % |
+136 % |
127 % |
+ 143 % |
* cet écart résulte de la différence des taux constatés pour les jeunes et l’ensemble de la population active, rapportée à ce dernier taux.
Source : OCDE
Ce tableau montre la persistance en France d’un écart considérable entre taux de chômage des jeunes et taux de chômage concernant l’ensemble de la population. Cet écart apparaît relativement stable depuis un peu moins de 10 ans.
Dans les zones urbaines sensibles (ZUS), le chômage des jeunes s’élève en 2010 et 2011 à 41,5 % et 40,4 % de la population active, soit presque deux fois plus que les taux constatés ces deux années sur l’ensemble du territoire pour cette classe d’âge.
Le chômage des jeunes est par construction élevé dans une société où une partie importante d’entre eux poursuivent des études supérieures. Les étudiants ne font statistiquement pas partie de la population active ; à ce titre ils ne figurent ni au numérateur (parce qu’ils rechercheraient un emploi), ni au dénominateur (parce qu’ils rechercheraient un emploi ou en occuperaient un) du ratio de calcul du taux de chômage. En 2011, le taux d’activité des 15-24 ans s’élève ainsi à 38,4 % – cette proportion s’élevant à 89,1 % pour les 25-49 ans. Le taux de chômage des jeunes concernait ainsi en janvier 2011 22,7 % des 38,4 % de jeunes actifs. Autrement dit, 8,7 % de la totalité des jeunes – actifs et inactifs – étaient au chômage en 2011. Sans relativiser le niveau du chômage des jeunes dans notre pays, on peut considérer que dans un pays comme la France où le taux de scolarisation des jeunes est élevé, à l’âge d’entrée sur le marché du travail, il est logique qu’une proportion importante de jeunes actifs soient – encore – sans emplois.
En revanche, la statistique du chômage des jeunes ne prend pas totalement en compte la situation de la frange des jeunes qui à la fois sont sans emploi – voire n’en recherchent pas – et ne sont pour autant plus dans le système scolaire ni dans un autre cursus de formation. Pour identifier ces situations, certains observateurs utilisent l’acronyme anglo-saxon NEET, pour « not in employment, education or training ».
Selon, l’OCDE, la proportion de NEET en France s’élevait à 12 % de la population des jeunes de 18 à 24 ans en 2011 (y compris les jeunes en étude), dont deux tiers environ de jeunes chômeurs et un tiers de jeunes à la fois inactifs (ne recherchant pas d’emplois) et ne poursuivant pas de formation initiale ou continue. Ce taux est inférieur à ceux recensés par l’OCDE pour l’ensemble de l’Union européenne (13,2 %). Plus précisément, la France semble caractérisée par rapport au reste de l’Union européenne par une proportion de jeunes chômeurs élevée, et par une proportion modérée de jeunes inactifs ne suivant pas de formation. Il convient néanmoins, du point de vue de la conception et de l’objet des politiques publiques, de garder à l’esprit la situation de ces jeunes en grande difficulté, très éloignés de l’emploi, et qui ne figurent pas dans les statistiques du chômage puisqu’ils ne recherchent pas d’emploi.
c. Les jeunes disposent de revenus et de patrimoines plus faibles
Le tableau suivant retrace les niveaux de vie moyen – pour certaines années depuis 1996 – pour chaque tranche d’âge, ainsi que l’écart entre les niveaux de vie moyens des 18-24 ans et de l’ensemble de la population française rapporté à celui-ci.
ÉVOLUTION DES NIVEAUX DE VIE MOYEN PAR TRANCHE D’ÂGE EN FRANCE
En euros 2011 par an
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2011 | |
Moins de 18 ans |
17 240 |
18 450 |
19 320 |
20 920 |
20 920 |
19-24 ans |
16 330 |
17 890 |
18 960 |
19 980 |
20 040 |
25-34 ans |
18 380 |
19 360 |
20 540 |
21 690 |
21 570 |
35-44 ans |
19 040 |
20 330 |
21 140 |
22 950 |
23 070 |
45-54 ans |
22 210 |
23 530 |
23 500 |
24 930 |
24 600 |
55-64 ans |
21 250 |
23 800 |
25 470 |
27 140 |
27 600 |
65-74 ans |
19 700 |
21 340 |
21 980 |
24 120 |
25 750 |
Plus de 75 ans |
19 340 |
20 440 |
20 870 |
22 410 |
22 280 |
Ensemble |
18 980 |
20 480 |
21 330 |
22 950 |
23 130 |
Écart entre les 19-24 ans et l’ensemble |
– 9,2 % |
– 9,9 % |
– 9,4 % |
– 8,8 % |
– 9,6 % |
Le niveau de vie moyen, selon l’INSEE, « est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans »
Source : INSEE
Le niveau de vie moyen des jeunes de 19 à 24 ans est en France :
– inférieur à la moyenne d’un peu moins de 10 % depuis 1996 ;
– le plus faible constaté de toutes les tranches d’âge depuis un peu moins de 20 ans.
Ces constats sont relativement logiques, tant la tranche d’âge 19-24 ans est souvent celle à la fois de l’émancipation individuelle et des rémunérations les plus faibles, du fait de la durée des études, des rémunérations de début de carrière et des périodes de précarité professionnelle.
Beaucoup d’observateurs mettent toutefois en regard le faible niveau de vie des jeunes et la faiblesse des transferts sociaux dont ils bénéficient. Selon un ouvrage récent – cité supra – dénonçant à la fois les fractures sociales de la jeunesse française et la position dégradée des jeunes dans leur ensemble dans la société française, la particularité française « est que les transferts [sociaux] bénéficient aux familles plus que dans n’importe quel autre pays de l’OCDE. […] La part destinée aux jeunes adultes est […] particulièrement modeste. Ainsi, un jeune de 18 à 25 ans ayant de faibles revenus et ne vivant plus chez ses parents reçoit une aide égale à la moitié de celle perçue par la moyenne de la population. » (27)
Les jeunes sont au demeurant dans l’incapacité, pour la plupart d’entre eux, de s’appuyer sur un patrimoine, alors que les patrimoines constatés pour certaines autres tranches d’âge dont les revenus sont également plus faibles que la moyenne, sont nettement plus élevés que ceux détenus par les jeunes. Le tableau suivant présente pour l’année 2010 les patrimoines bruts globaux moyens et médians selon la tranche d’âge de la personne de référence des ménages
MONTANTS DE PATRIMOINE BRUT GLOBAL
En euros
Moyen |
Médian | |
Moins de 30 ans |
53 900 |
10 400 |
De 30 à 39 ans |
188 400 |
105 900 |
De 40 à 49 ans |
292 100 |
186 100 |
De 50 à 59 ans |
334 600 |
226 600 |
De 60 à 69 ans |
358 900 |
219 200 |
Plus de 70 ans |
261 300 |
149 200 |
Ensemble |
259 000 |
150 200 |
Source : INSEE, enquête patrimoine 2010
Le patrimoine brut global est, selon l’INSEE, constitué du « montant total des actifs détenus par un ménage. Il inclut son patrimoine financier, immobilier et professionnel, mais aussi les biens durables (voiture, équipement de la maison, ...), les bijoux, les œuvres d’art et autres objets de valeurs..., soit tout ce qui relève du patrimoine matériel, négociable et transmissible des ménages. Deux composantes du patrimoine ne sont pas prises en compte […] : les droits à la retraite - présente ou future - et le capital humain des membres des ménages. Par capital humain, on entend l’ensemble des connaissances ou savoir-faire acquis par un individu. Celui-ci conditionne ses capacités productives et ses revenus et fait donc partie intégrante du patrimoine d’une personne. »
Ce dernier point montre à nouveau l’importance de la réussite et de la qualité de la formation initiale pour les jeunes, c’est-à-dire leur capital humain au sens de l’INSEE. Les jeunes sont souvent dépourvus de patrimoines financier, immobilier et professionnel, le capital humain est la seule composante du patrimoine global pour laquelle les jeunes disposent le cas échéant d’un avantage à faire fructifier. S’il en était besoin, ce constat renforce encore la nécessité d’éviter autant que faire se peut toute sortie du système scolaire avec une formation ou une qualification insuffisante, et d’aider les jeunes à faire valoir leurs compétences en les accompagnant de façon efficiente.
II. LES POLITIQUES PUBLIQUES CONCOURANT À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES : UN EMPILEMENT DE DISPOSITIFS SANS GOUVERNANCE D’ENSEMBLE
A. DES MOYENS BUDGÉTAIRES CONSÉQUENTS, MAIS DES DISPOSITIFS PEU LISIBLES
1. La mobilité sociale des jeunes dans le budget de l’État : 9 missions, 17 programmes et plusieurs dizaines de milliards d’euros
Selon l’annexe au présent rapport recensant les dispositifs publics concourant à la mobilité sociale des jeunes portés par le budget de l’État, ces dispositifs relèvent de 9 missions.
Les développements ci-après retracent les principaux dispositifs financés par les missions budgétaires relatives à l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur, la jeunesse, l’emploi, le logement et la politique de la ville. Ces dispositifs se rattachent aux principales modalités d’intervention publique en faveur de la mobilité sociale des jeunes :
– donner à chaque enfant une première chance par l’enseignement scolaire de préparer son émancipation en s’appuyant sur ses talents et mérites ;
– donner une seconde chance aux jeunes qui sortent de leur scolarité dans une position difficile, à tout le moins leur proposer des outils pour se former et se qualifier ;
– apporter des aides financières aux jeunes, dans leur période de formation ou d’insertion.
a. La mission « Enseignement scolaire »
La vocation de l’Éducation nationale est de contribuer à la mobilité sociale des jeunes, en gommant autant que faire se peut – par la valorisation des mérites et des talents – une reproduction sociale qui serait induite par les données sociales, économiques, culturelles et humaines qui caractérisent les élèves via le foyer dans lequel chacun d’entre eux est élevé.
Dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2014, les crédits de paiement qu’il est proposé d’ouvrir pour cette mission s’élève à 64,918 milliards d’euros, soit 15,9 % des crédits de paiement qu’il est proposé d’ouvrir au titre du budget général de l’État. Ces crédits permettent le financement de l’enseignement scolaire aux niveaux primaire (écoles maternelles et élémentaires) et secondaire (collège, lycées des voies professionnelle, générale et technologique). Ils couvrent les moyens supplémentaires dont bénéficient les établissements relevant de l’éducation prioritaire, notamment dans les zones urbaines socialement les plus défavorisées.
L’annexe I au présent rapport – dont les principaux enseignements sont mentionnés supra – présente des éléments d’analyse permettant de mesurer la contribution de l’enseignement scolaire des niveaux primaire et secondaire à la mobilité sociale des jeunes.
En plus de l’action principale d’enseignement – et de « sanction » des enseignements par l’attribution de diplômes –, la mission « Enseignement scolaire » comprend plusieurs dispositifs tournés vers l’activation de la mobilité sociale. On peut notamment citer :
– l’information et l’orientation scolaires, via notamment les centres d’information et d’orientation (CIO) auxquels sont rattachés les conseillers d’orientation-psychologues (copsy). Il est proposé de financer ces actions – mises en œuvre par l’État et ses personnels – dans le PLF pour2014 à hauteur de 303,14 millions d’euros, en quasi-totalité afin de financer les rémunérations de 3 768 copsy et 534 directeurs de CIO répartis sur l’ensemble du territoire ;
– les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs, auxquelles sont liés des dispositifs de signalement et de repérage des décrocheurs (via le système interministériel d’échange d’informations – SIEI), et de formation afin de « faciliter l’entrée, le maintien ou le retour de l’élève dans une formation qualifiante et diplômante » (28). En 2014, les crédits consacrés à ces actions devraient être ouverts à hauteur de53,98 millions d’euros ;
– les bourses et aides de l’enseignement secondaire attribuées sur critères sociaux, pour un montant global de 523,5 millions d’euros à la rentrée scolaire 2012. Le tableau suivant retrace les principaux dispositifs concernés.
BOURSES ET AIDES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FINANCÉES PAR LE BUDGET DE L’ÉTAT
Dispositif |
Élèves concernés à la rentrée 2012 |
Taux annuel de l’aide à la rentrée scolaire 2013 |
Coûts évalués dans le PLF 2014 |
Bourses de collège |
736 267, soit 28,5 % des élèves |
Trois montants d’un barème selon les ressources des parents : 81,69 – 226,35 – 353,49 euros |
151,7 millions d’euros |
Bourses de lycée |
421 182, soit 25,8 % des élèves |
45 euros « par part » – un lycéen bénéficie en moyenne de 9 parts sur l’année |
173,4 millions d’euros |
Primes(*) : – à la qualification – d’entrée en classe de seconde, première et terminale – d’équipement |
Bénéficiaires des bourses de lycée, selon leur filière ou spécialité |
Entre 217,06 et 435,84 euros, selon la filière ou spécialité |
180,6 miilions d’euros |
Bourses au mérite |
83 500 bénéficiaires « méritants » des bourses des lycées, notamment ceux ayant obtenu la mention bien ou très bien au diplôme nationale du brevet |
800 euros | |
Prime d’internat, exonération de frais de pension, bourses d’enseignement d’adaptation |
46 864 internes boursiers de collège et lycée |
254,70 euros |
14,9 millions d’euros |
* : Les primes à la qualification sont versées aux lycéens boursiers de seconde professionnelle ou préparant un CAP ; les primes d’entrée en classe de seconde, première et terminale sont versées aux lycéens boursiers des élèves des lycées de la voie générale et technologique, ainsi qu’aux élèves de première et de terminale de la voie professionnelle ; la prime d’équipement est versée aux lycéens boursiers de certaines spécialités professionnelles.
Source : PAP 2013, mission interministérielle « Enseignement scolaire »
Versée par les CAF, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), versée sous condition de ressources à chaque rentrée scolaire, constitue un dispositif se rapprochant des bourses des collèges et des lycées. Selon l’âge de l’élève scolarisé, l’ARS varie à la rentrée 2013 entre 360,47 euros et 393,54 euros. À la rentrée 2012, l’ARS a été versée à 2,86 millions de foyers (5,055 millions d'enfants concernés), pour une dépense de 1,870 milliard d'euros.
b. La mission « Recherche et enseignement supérieur »
L’enseignement supérieur a, comme l’enseignement scolaire, vocation à contribuer à la mobilité sociale des jeunes, tant il a principalement pour objet de contribuer en son sein à la réussite – par l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification – de tous les étudiants, quel que soit leur environnement social, économique, culturel et humain. Les 31,383 milliards d’euros de crédits de paiement que le PLF pour 2014 propose d’ouvrir pour la mission « Recherche et enseignement supérieur » se rattachent ainsi directement à l’objectif de mobilité sociale des jeunes.
Se différenciant de l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur ne s’inscrit toutefois pas dans la scolarité obligatoire, creuset dans lequel la puissance publique organise le fondement pratique de la mobilité sociale des jeunes. L’accès à l’enseignement supérieur relève au demeurant d’une sélection « minimale », basée sur l’obtention du baccalauréat. Cet accès relève en tout état de cause du choix du jeune concerné.
En conséquence, les rapporteurs ont choisi dans le présent rapport de concentrer leurs observations et réflexions sur les dispositifs périphériques à l’enseignement qui tendent à renforcer la position relative des étudiants les plus fragiles, via notamment les aides financières ou les actions d’aide à l’insertion professionnelle.
Parmi ces dispositifs, on peut noter :
– les actions conduites par les universités relatives à l’orientation des étudiants, à l’élaboration de leur projet professionnel, au tutorat, à l’aide à la réorientation, au développement des stages et du partenariat avec le monde économique, ainsi qu’au fonctionnement des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP). Ces actions sont mises en œuvre par les universités dans le cadre de leur autonomie légale, via leur budget et leur personnel. En conséquence, les crédits correspondants ne sont pas identifiés au niveau du budget de l’État et sont fondus dans les subventions pour charges de service public versées aux universités. En outre, si les BAIP sont prévus par l’article L. 611-5 du code de l’éducation (29) – et si l’État a encouragé au moins initialement, par des moyens financiers, leur mise en place et a incité les universités à les pérenniser – les universités sont libres de fixer les moyens qu’elles consacrent à leur mise en place et à leur activité ;
– les bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux. Dans le PLF 2013, leur coût a été évalué à 1 762,31 millions d’euros. Ce montant ne tenait pas compte de la réforme – étudiée plus précisément infra dans la 3ème partie du présent rapport – mise en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2013-2014. Cette réforme consiste à créer a) un échelon, avec un montant de bourses réévalué (5 500 euros par an), pour les étudiants dont les parents disposent de revenus très faibles et b) un échelon, avec une bourse de 1 000 euros par an, pour certains des étudiants boursiers qui bénéficiaient uniquement de l’exonération des frais d’inscription et de la cotisation finançant la sécurité sociale étudiante. En conséquence, le PLF pour 2014 prévoit d’inscrire 1 864,4 millions d’euros pour le financement des bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux ;
– les aides au mérite versées pendant trois ans aux étudiants boursiers ayant obtenu une mention « très bien » au bac et aux étudiants en master ayant obtenu de très bons résultats en licence. Cette aide, d’un montant annuel de 1 800 euros, a été budgétée dans la loi de finances pour 2013 à hauteur de 39,2 millions d’euros. Maintenue à l’identique dans le PLF pour 2014 sous le nom d’« aide au mérite », le Gouvernement indique qu’elle pourrait faire l’objet d’une « réforme d’ampleur » à compter de la rentrée 2014-2015 (30) ;
– les aides versées par les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS) au titre du fond national d’aide d’urgence, qui devrait être abondé par l’État en 2014 à hauteur de 44,4 millions d’euros. Ces aides ont été versées en 2012 – pour les trois quarts de ce montant – à des élèves en situation de précarité financière sans pour autant répondre aux critères permettant le bénéfice des bourses attribuées sur critères sociaux (31). Le quart restant a été attribué sous forme d’aides ponctuelles et urgentes à des étudiants boursiers ou non, pour des montants plafonnés à 1 650 euros.
c. La mission « Sports, jeunesse et vie associative »
Au sein de cette mission, une grande partie des crédits du programme « Jeunesse et vie associative » contribue à différents aspects de la mobilité des jeunes. Ce programme, placé sous la responsabilité de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), comprend notamment les actions suivantes (sur la base du PAP relatif à cette mission annexé au PLF 2014) :
– le financement du service civique, à hauteur de 146 millions d’euros pour 30 000 volontaires prévus en 2014. Il s’agit en premier lieu d’une subvention pour charge de service public en faveur de l’Agence du service civique (ASC), pour 121,2 millions d’euros, qui permet notamment « de prendre en charge l’indemnité mensuelle versée au volontaire (465 euros), éventuellement augmentée d’une bourse sur critères sociaux (106 euros), l’aide versée aux associations qui accueillent un volontaire (100 euros), la formation civique et citoyenne des jeunes (150 euros), celle des tuteurs, une part des cotisations sociales afférentes aux indemnités versées ainsi que les coûts de fonctionnement de l’ASC ». Par ailleurs, 24,8 millions d’euros sont versés directement à « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) [au titre de] la partie des cotisations permettant la couverture sociale des volontaires qui n’est pas versée par l’agence de services et de paiements [ASP] pour le compte de l’agence du service civique, soit 198 euros par mois par engagé ou par volontaire de service civique. Il s’agit principalement des cotisations nécessaires pour valider des trimestres pour la retraite. » ;
– le soutien aux associations de jeunesse et d’éducation populaire, à hauteur de 34 millions d’euros. Ces crédits sont soit directement engagés par la DJEPVA en faveur de certaines têtes de réseau associatives nationales (9,13 millions d’euros), soit via le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep – le Fonjep est une structure elle-même associative) à hauteur de 24,88 millions d’euros ;
– le soutien à certains dispositifs historiques de mobilité internationale, à hauteur de 12,82 millions d’euros. Les deux organismes bénéficiaires sont l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ – 10,55 millions d’euros) et l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ – 1,96 million d’euros) ;
– le financement de l’établissement public Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) – lié à l’État par un contrat pluriannuel de performance – à hauteur de 3,3 millions d’euros ;
– le financement du réseau information jeunesse, pour 8,11 millions d’euros, dont 2,51 millions d’euros en faveur de l’association « tête de réseau » Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ – dans le cadre d’un plan d’action pluriannuel auquel l’État est partie prenante) et 5,6 millions d’euros en faveur des 30 centres régionaux d’information jeunesse (CRIJ – les CRIJ financent les bureaux et points d’information jeunesse, BIJ et PIJ).
Le PLF 2014 prévoit la création d’un programme nouveau « Projet innovant en faveur de la jeunesse » dans le cadre du nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) qui sera piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et dont l’opérateur, en l’espèce, sera l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Doté de 100 millions d’euros, il pourrait donner lieu à des paiements effectifs à compter de 2015 (20 %), puis en 2016 et 2017 (40 % pour chacune de ces années).
Selon le PAP 2014 de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », les crédits seront répartis, suite à un appel à projets, afin de favoriser « l’émergence de politiques de jeunesse intégrées, qui permettent de traiter les problématiques de jeunes de façon globale et cohérente à l’échelle d’un territoire, en évitant l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non harmonisées. ». L’appel à projets sera lancé pour les quatre thématiques suivantes :
– l’information et l’orientation ;
– l’employabilité et la lutte contre le décrochage scolaire et universitaire ;
– le développement d’une offre éducative, culturelle et sportive innovante, en complément de l’école ;
– l’émergence d’une culture de l’entreprenariat.
d. La mission « Travail et emploi »
À l’issue de la formation initiale, l’aide apportée aux jeunes sur le marché du travail pour s’y insérer constitue la principale modalité d’action de l’État pour contribuer à leur mobilité. Les rapporteurs ont évoqué supra dans quelle mesure les jeunes les plus concernés par le chômage et la précarité sur le marché du travail sont non-diplômés ou, dans une moindre mesure, s’appuient sur de bas niveaux de qualification.
En plus des financements attribués à Pôle emploi pour la part de son activité consacrée aux jeunes, l’action publique en direction de ces jeunes prend trois formes principales.
En premier lieu, il s’agit d’accompagner le jeune par des contacts réguliers établis avec des professionnels du travail social, dans une période délicate psychologiquement et matériellement, afin d’élaborer un projet professionnel et d’identifier les étapes intermédiaires et les freins à leur atteinte. Durant cette période d’accompagnement, le jeune bénéficie parfois d’une allocation. Pour ce faire, l’État subventionne :
– à hauteur de 178,8 millions d’euros dans le PLF 2014, le réseau des 466 missions locales et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), qui accueillent environ 720 000 jeunes éloignés de l’emploi par un défaut de formation mais également par des difficultés spécifiques de nature sociale ou culturelle. Selon les documents budgétaires du Gouvernement, les missions locales et les PAIO – financées majoritairement par les collectivités territoriales et dont la gouvernance relève en grande partie de celles-ci – avaient en 2013 « pour objectif l’entrée de 160 000 nouveaux jeunes en CIVIS dont 50 % doivent être de niveau infra V et V » (32). Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) constitue la principale modalité d’accompagnement des jeunes concernés par les missions locales. Il n’est pas rare que les jeunes pris en charge par les missions locales soient dirigés vers elles par Pôle emploi, suite à un diagnostic portant sur l’existence de difficultés sociales à traiter dans le cadre de la recherche d’emplois ;
– pour 50 millions d’euros dans le PLF 2014, l’État verserait des montants variables d’allocation en 2014 aux jeunes signataires d’un CIVIS. Ce montant devrait permettre de verser un montant moyen de 370 euros par an à 135 000 bénéficiaires d’un CIVIS ;
– dans le cadre du fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ), l’État finance (via les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – Direccte) des mesures ponctuelles – préparation à un concours, participation à un forum formation ou emploi, prise en charge d’une garde d’enfants, de certaines dépenses de transport – d’accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi. Dans le PLF 2014, ces mesures sont budgétées à hauteur de 22 millions d’euros.
En second lieu, il peut être proposé aux jeunes de se former, pour valoriser leur position sur le marché du travail. Il existe des formations dites de « seconde chance » pour les jeunes les plus en difficulté à l’issue de la scolarité obligatoire, qui doivent permettre une remise à niveau concernant les compétences, savoir-faire et savoir-être « de base ». Il existe également des formations professionnelles prodiguées dans une optique « métier ». De formes très diverses, les dispositifs concernés sont notamment :
– l’exonération de cotisations sociales des rémunérations associées aux contrats d’apprentissage, ainsi qu’aux contrats de professionnalisation signés par les jeunes. La mesure d’exonération portant sur les contrats d’apprentissage donne lieu en 2013 à compensation au bénéfice des entreprises à hauteur de 1401 millions d’euros. Ce montant est calculé sur la base de 448 000 contrats en cours environ en 2014 et d’une exonération moyenne de 260,2 euros par mois et par contrat ;
– l’établissement public d’insertion de la défense (Épide) financé à hauteur de 67,1 millions d’euros par l’État (45 millions d’euros issus de la mission « Travail et emploi » et 22,1 millions d’euros provenant du programme « Politique de la ville »). L’Épide accueillait fin 2012 environ 2000 jeunes très éloignés de l’emploi dans 18 centres, en internat, dans un encadrement d’inspiration militaire ;
– les écoles de la deuxième chance (E2C), réseau labellisé de formation professionnelle prodiguée sur le modèle de l’alternance. Au nombre de 107 en 2012 et réparties dans certaines régions du territoire métropolitain, les E2C accueillent environ 12 000 jeunes par an. L’État les finance à hauteur de 24 millions d’euros en 2014, dont 3 millions d’euros versés par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ). La majorité des financements des E2C relève des régions dans le cadre de leurs compétences en matière de formation professionnelle ;
En dernier lieu, les « contrats aidés » s’appuient sur une subvention publique permettant à des personnes éloignées de l’emploi de se faire embaucher, dans les secteurs marchand ou non marchand. Il s’agit de faire bénéficier ces personnes d’une activité leur permettant de se rapprocher autant que possible de la réalité du marché du travail et de bénéficier d’une rémunération. Les jeunes constituent une partie importante des bénéficiaires des contrats aidés :
– ils sont la cible unique des emplois d’avenir, budgétés en crédits de paiement dans le PLF 2014 à hauteur de 1 291,3 millions d’euros. L’objectif de faire entrer en 2013 100 000 jeunes sans emploi et sans qualification dans ce dispositif étant en passe d’être atteint, le PLF 2014 prévoit la conclusion de 50 000 nouveaux contrats en 2014 ;
– ils constituaient en 2011 – année la plus récente pour laquelle cette statistique est disponible – 28,2 % des personnes embauchées via le contrat unique d’insertion du secteur non marchand – le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). Le PLF pour 2014 prévoit des crédits de paiement à hauteur de 1 807,9 millions d’euros pour financer la conclusion de 340 000 nouveaux contrats au cours de cet exercice;
– ils constituaient en 2011 32,8 % des bénéficiaires des contrats uniques d’insertion du secteur marchand – les contrats initiative emploi (CUI-CIE). Le PLF pour 2014 prévoit des crédits de paiement à hauteur de 135,6 millions d’euros pour financer la conclusion de 40 000 nouveaux contrats au cours de cet exercice
e. La mission « Égalité des territoires, logement et ville »
Cette mission contribue en premier lieu à la mobilité sociale des jeunes via une contribution forfaitaire aux allocations de logement dont les personnes âgées de 18 à 25 ans sont bénéficiaires. La subvention de l’État au bénéfice du Fonds national d’aide au logement (FNAL) s’élèverait en 2014 à 5 048 millions d’euros. Le montant des aides au logement versé par les caisses d’allocations familiales devrait s’élever à environ 16 578 millions d’euros pour l’exercice 2013.
Il est au demeurant difficile de connaître avec précision quelle proportion de ce dernier montant sera versée à de jeunes ménages. Ainsi qu’il sera détaillé par les rapporteurs dans la troisième partie du présent rapport, en 2011, 820 000 étudiants ont bénéficié d’une allocation de logement. Alors que les jeunes de moins de 25 ans ne bénéficient pas en France du revenu de solidarité active (RSA) et que les jeunes disposent de revenus moins élevés que toutes les autres classes d’âge (cf. supra), le transfert social dont certains d’entre eux bénéficient au titre des allocations de logement apparaît fondamental pour contribuer au financement de leurs périodes de formation et plus largement à leur émancipation.
Au sein de la même mission, la part des crédits du programme 177 « Politique de la ville » dédiée à des actions en faveur de jeunes résidant dans les quartiers prioritaires a pour objectif de contribuer à leur mobilité sociale. Souvent de montants modestes, ces crédits financent des actions supplémentaires aux dispositifs de droit commun, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ) est l’opérateur national par lequel transitent la quasi-totalité des crédits du programme 177, in fine attribués à des opérateurs locaux, associatifs pour beaucoup d’entre eux.
Outre les crédits évoqués ci-dessus pour les financements de l’Épide et des écoles de la deuxième chance, le programme 177 doit financer en 2014 notamment :
– les programmes de réussite éducative, à hauteur de 76 millions d’euros. Selon le Gouvernement dans la documentation budgétaire publique, « la construction de parcours individualisés d’accompagnement social et éducatif pour les enfants (2 à 16 ans) vise à surmonter ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui s’opposent à la réussite scolaire et éducative des jeunes concernés. 530 programmes de réussite éducative sont déployés dans toute la France (718 communes et 1 436 quartiers prioritaires sont couverts par le dispositif). Ces programmes s’appuient sur 1 714 équipes pluridisciplinaires de soutien. Depuis la création du dispositif en 2005, ce sont 630 030 enfants qui en ont bénéficié dont 122 148 enfants en 2011 » (33). En matière éducative, l’ACSÉ finance en outre des actions de lutte contre le décrochage scolaire à hauteur de 2 millions d’euros ;
– le programme Ville, vie, vacances, à hauteur de 9 millions d’euros en 2014, qui permet le financement d’actions éducatives et de loisir dans certains quartiers prioritaires pendant les périodes de vacances scolaires ;
– les internats d’excellence, à hauteur de 6,7 millions d’euros en 2013, étant précisé que ces internats sont également financés par le programme « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire » à hauteur de 53,5 millions d’euros en 2013 et 2014 (cf. infra). 11 500 élèves ont été accueillis à la rentrée 2012 au titre de cette action, soit dans des internats d’excellence proprement dit, soit dans des places labellisées se situant dans des internats « classiques ». L’ACSÉ contribue au financement d’une partie du coût de la prise en charge en place d’internat d’excellence assumé par les familles des internes issus de quartiers prioritaires (34) ;
– les cordées de la réussite, dispositif de tutorat exercé par des élèves de l’enseignement supérieur à destination d’élèves de l’enseignement secondaire pour préparer ces derniers à l’accès à des études supérieures ambitieuses. Il s’agit, pour le site internet de l’Onisep, de contribuer à « lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui freinent les ambitions et parfois empêchent une poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur ». À hauteur de 4,4 millions d’euros en 2013, le financement de l’ACSÉ bénéficie à celles des cordées de la réussite qui concernent les élèves résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est complété par des financements à hauteur de 1,5 million d’euros issus de la mission « Recherche et enseignement supérieur » et 0,5 million d’euros issus de la mission « Enseignement scolaire ».
2. Une action publique difficilement lisible
a. L’action publique en faveur de la mobilité sociale des jeunes manque d’objectifs clairs et d’une définition de l’effort collectif souhaitable en direction de la jeunesse
L’annexe I au présent rapport montre que la contribution de l’Éducation nationale à la mobilité sociale des jeunes – au sens a) d’un effacement des déterminants socio-culturels caractérisant les familles des élèves et b) de la valorisation de leurs talents et mérites comme fondement de leurs résultats scolaires – n’est pas satisfaisante et semble s’être dégradée dans la période récente. Il semble pourtant qu’il ait fallu devoir observer les résultats des enquêtes PISA à compter de 2000 pour que la question de la qualité de cette contribution soit posée publiquement, au-delà des travaux et des discussions des experts et statisticiens.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République – après la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui a institué le socle commun de compétences – doit pouvoir conduire à renforcer la clarté des objectifs de mobilité sociale assignés à l’Éducation nationale et à définir les moyens financiers et pédagogiques permettant de les atteindre (Cf. infra). Trop souvent, manque encore dans notre débat public la lucidité nécessaire sur le trop grand nombre des élèves qui sortent sans qualification du système scolaire, mais également sans espoir et sans énergie.
L’« investisseur » qu’est la collectivité publique devrait plus nettement s’interroger sur le rendement pour l’élève et pour la société de 10 années de scolarité obligatoire, ayant notamment mobilisé les compétences et l’énergie des personnels éducatifs de l’État, pour aboutir à l’absence de toute qualification et de tout diplôme. Ce gâchis est d’autant plus grave qu’il se traduit par des coûts considérables supplémentaires via des politiques publiques onéreuses de « réparation sociale », s’agissant par exemple des politiques publiques de l’emploi, d’accompagnement ou de seconde chance. Trop souvent, les politiques publiques en faveur des jeunes les plus éloignés de l’emploi – indispensables et à optimiser – semblent considérées avec fatalité, alors qu’elles devraient susciter une véritable mobilisation.
Il n’est donc pas aisé de surmonter le passif originel de notre système de formation initiale, dans un contexte où la place des jeunes est en tout état de cause moins bien établie ou défendue que d’autres classes d’âge, sur le marché du travail comme dans le débat public.
Preuve en est que les politiques publiques issues du budget de l’État – ci-dessus passées en revue et figurant dans l’annexe II au présent rapport – ne répondent pas à une définition publiquement établie, assumée et mesurée de ce que devrait être l’effort collectif en faveur des jeunes de 18 à 25 ans. Objet des politiques de l’emploi du fait de leurs difficultés à s’insérer sur le marché du travail, les jeunes bénéficient de transferts sociaux quand ils ont un logement, mais sans définition de ce que devrait être leurs ressources minimales – sauf quand ils sont étudiants (via les bourses attribuées sur critères sociaux). Certes, les ascendants des jeunes sont parfois aidés pour subvenir aux besoins de ces derniers, fiscalement et par les allocations familiales. Ces « aides indirectes » à la jeunesse – aussi légitimes soient-elles – opacifient encore la réflexion sur le niveau du soutien que la collectivité souhaite lui attribuer.
In fine, comme les rapporteurs l’ont évoqué supra, ce manque de vision et de cohérence va de pair avec un taux de chômage plus élevé que dans les autres classes d’âge, un taux de pauvreté nettement supérieur, des revenus nettement plus faibles. À l’image de ce qui a été progressivement mis en œuvre, avec succès, pour élever le niveau de vie des seniors en France depuis 30 à 40 ans, il convient de donner de la visibilité, de la cohérence et une meilleure répartition des moyens existants aux politiques publiques en faveur des jeunes.
b. Certains dispositifs publics apparaissent segmentés et partiels – l’exemple des internats d’excellence
Les « établissements-internats » d’excellence constituent une tentative réelle d’offrir un environnement favorable aux élèves des classes sociales défavorisées, pour autant que ces élèves présentent un niveau scolaire minimal et une véritable motivation de progresser. L’objectif poursuivi par les internats d’excellence apparaît ainsi indiscutable du point de vue de la mobilité sociale des jeunes, tant il est vrai – les rapporteurs l’évoquent à plusieurs reprises dans le présent rapport – que notre système éducatif éprouve des difficultés à donner leur chance à de nombreux élèves moyens, ou faibles, issus des catégories sociales les plus défavorisées.
La mise en place des internats d’excellence a constitué une des mesures de la « dynamique espoir banlieues » de 2008. Dès la rentrée 2009, le premier internat d’excellence a été ouvert à Sourdun (Seine-et-Marne). 11 500 places d’internat d’excellence – dans 46 internats dédiés ou via des places labellisées dans des internats classiques – étaient disponibles pour la rentrée 2012-2013. Toutes ces places ne relèvent pas des « établissements internats » de Sourdun, Montpellier et Douai, qui ont constitué des expériences pédagogiques « à part ».
Au mois d’avril 2013, une évaluation portant sur l’expérience de l’« établissement-internat » d’excellence de Sourdun – celui pour lequel le recul était le plus important – a été rendue publique au titre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) par quatre chercheurs – avec le concours de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale (35). Les chercheurs ont comparé les résultats obtenus par les élèves de l’internat (au nombre de 258) à ceux d’un groupe témoin (137 élèves) à des tests de niveau, les échantillons étant au départ comparables en termes de résultats scolaires et d’environnement social, économique et culturel. Les élèves admis à Sourdun et ceux du groupe témoin, ainsi que leurs familles, ont également été interrogés à plusieurs reprises, au cours d’un travail qui a duré deux ans.
Du point de vue de leur environnement social, économique et culturel, les 395 élèves suivis sont ainsi décrits par les évaluateurs : « un peu moins de la moitié d'entre eux sont boursiers, soit le double de la moyenne nationale. Un tiers d'entre eux appartiennent à une famille monoparentale, et plus de la moitié parle une autre langue que le français à la maison. Leurs parents sont plus nombreux à être au chômage que ceux des autres élèves de l'académie de Créteil ». S’agissant de leurs résultats scolaires, « en termes de niveau scolaire, ce sont d'assez bons élèves par rapport aux camarades de classe des établissements dont ils sont issus, mais des élèves intermédiaires comparés à la moyenne nationale. » (36)
Après deux ans, les résultats des élèves de l’internat sont nettement meilleurs que ceux des élèves du groupe témoin en mathématiques, mais pas en langue française. S’agissant des progrès des élèves de l’internat en mathématiques, les chercheurs notent qu’« on peut […] comparer l'impact de Sourdun à celui que l'on obtiendrait si on divisait par deux la taille des classes, puisque cela conduirait également à doubler la dépense par élève [ce qui est le cas à Sourdun]. Les études disponibles montrent que cette politique aurait un impact sur les résultats scolaires des élèves similaire à celui de Sourdun. » (37)
Les chercheurs montrent aussi que la motivation et l’ambition pour les études ultérieures sont substantiellement majorées pour les élèves de l’internat, et pour leurs familles. Il apparaît clairement que les conditions de travail à Sourdun – classes de faibles effectifs, émulation entre élèves motivés, encadrement induit par la vie dans l’internat – ont été bénéfiques pour les internes, tant pour les résultats scolaires que pour la confiance en soi et en l’avenir.
Hormis les fortes contraintes de l’internat qu’il est difficilement envisageable de généraliser, l’« écosystème » scolaire créé à Sourdun constitue sans doute un quasi modèle de ce qu’il pourrait être souhaitable d’offrir en termes d’« ambiance » et de conditions de travail à tous les élèves ; même si les chercheurs émettent des avertissements sur la portée des résultats de leur évaluation (38), ceux-ci sont assez nettement positifs.
La difficulté du dispositif des internats d’excellence vient précisément de ce qu’il diffère du « droit commun », en laissant la quasi-totalité des élèves – y compris des élèves en tout point comparables à ceux sélectionnés pour devenir internes – dans un système « normal », considéré suffisamment déficient pour qu’il ait été considéré pertinent de créer ces internats. Les chercheurs notent que les résultats obtenus sont très ciblés et que le dispositif n’est peut-être pas à la mesure des difficultés scolaires d’élèves plus faibles que ceux de Sourdun : « les résultats de l'internat d'excellence de Sourdun montrent qu'il est possible, par un dispositif ciblé, d'accroître significativement les compétences et l'ambition scolaires d'élèves d'origine modeste, battant ainsi en brèche l'image selon laquelle les politiques scolaires seraient impuissantes face aux inégalités.
« Il n'en reste pas moins que cette politique fait aussi un choix : celui de concentrer des ressources importantes sur des élèves motivés et de niveau scolaire médian. Notre évaluation ne permet pas de dire si ce qui réussit avec eux réussirait aussi bien avec des élèves plus faibles ou moins motivés. Mais elle pose en creux la question des actions à mener auprès de ces derniers, dans un contexte où différents travaux montrent que, contrairement à ce qui se passe à Sourdun, les ressources supplémentaires par élève affectées à l'éducation prioritaire sont aujourd'hui très limitées. »
Les rapporteurs considèrent que toutes les expériences et réalisations qui conduisent à constater des résultats bénéfiques doivent être encouragées. Le succès du dispositif partiel et limité des « établissements-internats » ne doit toutefois pas justifier l’inaction ou le découragement s’agissant des difficultés aiguës de bon nombre d’élèves – relevant notamment de l’éducation prioritaire – écartés dudit dispositif. Il importe également de s’interroger, dans un contexte de rareté de la ressource publique, sur les moyens qu’il est légitime de consacrer à ce type de dispositif, concernant peu d’élèves.
Le Gouvernement propose en 2014 une reconduction des crédits de 2013, soit des crédits de paiement d’un montant de 53,49 millions d’euros, en faveur des internats d’excellence – notamment les « établissements-internats » de Sourdun, Montpellier et Douai –, l’action correspondante s’intitulant désormais « Politiques de l’internat et établissements à la charge de l’État ». Il indique toutefois que « leur coût doit être réduit et ils doivent s’inscrire dans une politique plus globale au bénéfice de tous les élèves internes. » (39). Le Gouvernement ne précise pas à ce stade dans quelle mesure la réduction des crédits affectés aux « établissements-internats » modifiera les pratiques pédagogiques qui y sont aujourd’hui en application, et qui ont fait l’objet de l’évaluation ci-dessus évoquée.
Dans le même temps, le Gouvernement propose la création d’un programme nouveau « Internats de la réussite », doté de 150 millions d’euros, dans le cadre du nouveau programme des investissements d’avenir (PIA). Outre la création de 6 000 nouvelles places d’internat confiée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le Gouvernement indique qu’il s’agit de « permettre d’une part de développer la réussite d’élèves motivés et ne disposant pas d’un environnement propice aux études et, d’autre part, un effet d’entraînement sur tous les internats existants afin qu’ils améliorent leurs pratiques éducatives et pédagogiques pour tous les élèves qu’ils accueillent. […] Il ne saurait s’agir de sélectionner les jeunes sur seuls critères scolaires : tout élève motivé, quels que soient ses résultats, doit pouvoir bénéficier de l’internat. Toutefois, une priorité sera donnée aux jeunes de familles socialement défavorisées notamment issues des territoires prioritaires de la politique de la ville et de l’éducation prioritaire, ainsi qu’à ceux dont la famille réside loin du lieu d’études, notamment en milieu rural ou ultra-marin. » (40)
Le recrutement des internats de la réussite serait ainsi ouvert à tous les élèves motivés, quels que soient leurs résultats scolaires – ce qui différerait de la « doctrine » de recrutement des internats d’excellence, qui a ciblé des élèves dont le niveau scolaire était au minimum moyen, voire élevé.
S’agissant des pratiques pédagogiques, le Gouvernement indique que la future charte des internats de la réussite prévoira « l’absence de distinction entre les internes, notamment en matière de projet pédagogique et éducatif. [Ce dernier] ne saurait se limiter à un projet d’hébergement mais […] constituera un projet global intégré et lié au projet du ou des établissements. [Il] doit notamment intégrer des actions visant à mieux articuler travail en classe et travail personnel après la classe, proposer des activités complémentaires à caractère culturel et sportif, développer la mutualisation entre pairs, et développer la fonction éducative dans une perspective de suivi individualisé » (41). La principale différence avec les internats d’excellence – qui prévoient une action pédagogique spécifique dans les « établissements-internats », différente de celle mise en œuvre pour les autres internats ou places labellisées – serait l’homogénéité des moyens consacrés aux projets pédagogiques établis dans les internats de la réussite.
c. L’instabilité et la complexité des dispositifs dégradent la crédibilité de l’action publique : l’exemple des aides à l’emploi
Le tableau suivant, issu d’une publication de l’INSEE, retrace l’évolution des dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes depuis 1975 jusqu’en 2011, que ces dispositifs leur soient spécifiquement dédiés ou non.
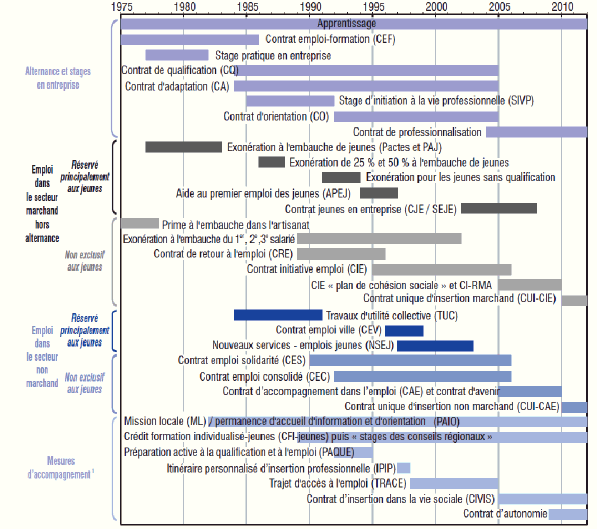
On pourrait aujourd’hui compléter ce schéma par les emplois d’avenir (contrats aidés dans les secteurs marchands et non marchands), les contrats de génération (dans le secteur marchand) et le dispositif d’accompagnement mis en œuvre par les missions locales suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi.
La période actuelle n’apparaît pas au demeurant comme la plus complexe. Entre 1995 à 2005, on comptait 4 dispositifs en matière d’alternance et jusqu’à 8 contrats aidés ou dispositifs d’exonération en vigueur dans les secteurs marchand et non marchand.
Les rapporteurs ont pu constater – par exemple lors de leur déplacement dans les locaux de la mission locale de Redon (Ille-et-Vilaine) – que la variété des acronymes, des régimes d’aide, des initiateurs des dispositifs et des allocations qui leur sont parfois liées constituaient une difficulté à la fois pour les travailleurs sociaux et les jeunes accueillis. Ceux-ci signent des contrats en s’engageant sur des bases si complexes qu’elles ne peuvent pas leur être raisonnablement explicitées. Les travailleurs sociaux « jonglent » dans un paysage incohérent de dispositifs, dont les points communs sont la difficulté des procédures de mise en œuvre (parfois uniquement afin de verser quelques subsides très limités aux jeunes) et l’exigence fastidieuse de remplir des tableaux de bord très détaillés à destination de chacun des « donneurs d’ordre ».
Pourquoi une mission locale peut-elle proposer un CIVIS à un jeune mais ne peut lui garantir le bénéfice de l’allocation qui lui est parfois liée ? Pourquoi les dispositifs du programme personnalisé d’accompagnement dans l’emploi (PPAE), du CIVIS et de l’ANI jeunes du 7 avril 2011 ne sont-ils pas toujours cumulables, mais le sont néanmoins dans certains cas ? Dans une période où les missions locales sont soumises à un flux accru de jeunes en grande difficulté, ces éléments pèsent sur l’énergie que les travailleurs sociaux peuvent déployer, sur leur efficacité du point de vue des jeunes et sur la crédibilité de l’action publique.
B. DES ACTEURS MULTIPLES MAL PILOTÉS
1. La faiblesse de l’organisation de l’État sur les questions relatives aux jeunes
a. Une administration centrale limitée et un renforcement récent de l’interministérialité à conforter
La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) est de taille modeste et dispose de moyens limités. La loi de finances initiale pour 2013 a ouvert des crédits en faveur du programme « Jeunesse et vie associative » – dont le responsable est le directeur de la DJEPVA – à hauteur de 231,2 millions d’euros. Plus de la moitié de ces crédits financent le service civique. Comme les rapporteurs l’ont évoqué supra, le reste des crédits placés sous la responsabilité de la DJEPVA – moins de 100 millions d’euros – financent notamment certaines entités externes en matière d’information de la jeunesse (CIDJ et CRIJ), de mobilité internationale (OFAJ et OFQJ), et d’observation ou d’évaluation (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire – INJEP).
Ces actions, les rapporteurs y reviennent infra dans le présent rapport, sont importantes et méritent sans doute d’être redynamisées, notamment sous la forme de portails élaborés à l’aune des besoins et des attentes contemporaines des jeunes. Force est de constater qu’elles sont mises en œuvre à l’ombre des politiques publiques éducatives (mission « Enseignement scolaire ») et de l’emploi (mission « Travail et emploi »), dotées de moyens sans commune mesure avec ceux du programme « Jeunesse et vie associative ». Les enjeux politiques, médiatiques et financiers qui accompagnent le système scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes laissent dans l’ombre les autres politiques publiques en direction des jeunes – d’importance il est vrai plus modeste, mais qui ont le mérite de répondre à leurs intérêts et attentes en tant que classe d’âge.
Dans ce contexte, la réunion chaque année d’un Conseil interministériel de la jeunesse (CIJ) – dont le secrétariat est assuré par la DJEPVA – doit permettre de valoriser ces intérêts et attentes dans l’ensemble des politiques publiques. La mise en œuvre de la décision du CIJ du 21 février 2013 concernant la nomination d’un délégué – réellement (42)– interministériel à la jeunesse, assumant également la direction de la DJEPVA, permettrait de conforter à la fois le rythme des réunions du CIJ et le travail interministériel à réaliser entre celles-ci – la préparation du CIJ du 21 février 2013 a ainsi mobilisé 24 ministères pendant 5 mois au sein de groupes de travail ad hoc.
Dans son discours tenu devant le Forum français de la jeunesse (FFJ) le 19 septembre 2013, Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a précisé préparer en amont du prochain CIJ la tenue d’une « conférence jeunesse » qui réunirait « pour la première fois autour de la table, l’État, les partenaires sociaux, les collectivités, les associations et bien entendu, en première ligne, les jeunes et leurs organisations. »
Afin de conforter l’interministérialité des politiques de jeunesse et l’ouverture des débats aux partenaires sociaux, aux collectivités territoriales et au mouvement associatif (notamment les mouvements de jeunes et de jeunesse), afin de fonder ces travaux sur une information de référence et afin de porter concomitamment un regard prospectif sur tous les sujets liés à la jeunesse, les rapporteurs proposent d’envisager la création d’un conseil d’orientation des politiques de jeunesse. Il serait l’interface sociétale naturelle des travaux interministériels en amont et en aval du CIJ. Il porterait un regard à la fois sur les mesures envisagées ou décidées par le CIJ et sur le long terme, selon un mode prospectif, en abordant des sujets plus larges. Ce conseil pourrait être chargé d’établir régulièrement un tableau de bord, ou un panorama, de l’état de la jeunesse en matières économique, social, sociétal et culturel. Il pourrait en outre proposer de lancer des expérimentations, voire être impliqué dans leur organisation, leur mise en œuvre et leur évaluation.
b. Une administration déconcentrée diluée
Les relais de l’État pour la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse se situent au niveau régional au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Les DRJSCS ont été créées, à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale (Réate), l’une des principales mesures de la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Elles traitent des missions et s’appuient sur les moyens relevant antérieurement du pôle social des directions régionales de l’action sanitaire sociale (DRASS) – notamment en matière d’hébergement d’urgence et de réinsertion –, des délégations régionales de l’ACSÉ et des directions régionales de la jeunesse et des sports.
La recherche d’économies d’échelle et d’une plus grande polyvalence des personnels a pu justifier la création d’un nombre réduit de directions régionales, dont les DRJSCS. Le traitement des dispositifs dédiés à la jeunesse s’en est trouvé associé à des dispositifs de solidarité envers des personnes ou des zones en difficulté ou en grande précarité, comme les personnes sans domicile ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapprochement tend toutefois à assimiler les politiques à l’égard des jeunes à des politiques de solidarité – voire les jeunes eux-mêmes à des personnes en grande difficulté. De façon pratique, au vue des difficultés à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces en matière d’hébergement des personnes sans abri ou mal logés – et ce malgré des moyens en nette croissance ces dix dernières années et largement supérieurs à ceux finançant les dispositifs dédiés à la jeunesse –, il est possible que la polyvalence des personnels des DRJSCS ne soit pas prioritairement mise au service des politiques publiques en faveur de la jeunesse.
Dans ce contexte, la décision du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ du 21 février 2013) de demander au préfet de région de réunir des « comités d’administration régionale (CAR) thématiques autour des questions de jeunesse, afin d’examiner et de suivre les modalités et l’effectivité de la mise en œuvre des mesures gouvernementales en faveur des jeunes, en liaison notamment avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les mouvements associatifs et les organisations de jeunes » doit permettre de contourner la difficulté de visibilité et de lisibilité de l’action de l’État déconcentrée. Il importe que le prochain CIJ fasse le bilan de l’organisation et du contenu de ces CAR – qui ont effectivement été réunis au moins une première fois dans la plupart des régions –, en veillant entre autres à la participation des jeunes à leurs travaux.
c. Certaines politiques publiques à destination des jeunes doivent se renouveler : l’exemple de l’information jeunesse
Le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) a été créé à l’initiative des pouvoirs publics en 1969, sous une forme associative qu’il a gardée depuis. Installé à Paris, il anime les réseaux « information jeunesse » (dit réseaux « IJ ») sur l’ensemble du territoire. En Île-de-France, le réseau comprend trois centres départementaux (à statut associatif), 50 bureaux information jeunesse (BIJ), 170 points (PIJ) ainsi qu’une antenne mobile. En province, le CIDJ anime le réseau des 26 centres régionaux (CRIJ). Les CRIJ animent dans leur ressort l’activité de 185 BIJ et 1078 PIJ. Les BIJ ont pour 50 % d’entre eux un statut associatif et constituent pour l’autre moitié des services municipaux.
Comme les rapporteurs l’ont évoqué supra, le programme « Jeunesse et vie associative » a permis l’attribution au CIDJ d’une subvention annuelle d’un montant de 2,51 millions d’euros en 2013 (43) et de 5,6 millions d’euros aux réseaux des CRIJ. Pour le CIDJ, l’aide de l’État a vocation à financer les actions inscrites dans le plan d’actions pluriannuel signé en 2009, notamment « l’animation nationale du réseau “Information jeunesse”, l’actualisation et le développement d’une base de données documentaires ou la diffusion d’informations relatives aux jeunes en direction des structures du réseau. »
Les ressources du CIDJ ont longtemps relevé pour moitié d’aides publiques (notamment celle de l’État) et pour moitié de ressources propres, notamment issues de la vente des classeurs papier « Actuel CIDJ » consacrés en grande partie à l’actualisation des informations relatives à l’orientation. Si la commande – notamment publique – de ces classeurs correspond à des recettes de 2,9 millions d’euros en 2013, celles-ci baissent régulièrement depuis plusieurs années, dans un contexte où les jeunes disposent pour la plupart d’entre eux d’un accès à l’information via le web. Le CIDJ cherche aujourd’hui à développer son activité en direction des entreprises, par des services de formation et d’organisation de rencontres entre offreurs et demandeurs d’emplois.
De fait, la recherche d’un nouveau modèle économique pour le CIDJ doit s’accompagner de la définition d’un nouveau modèle pour l’information jeunesse. M. Philippe Salles, directeur du CIDJ depuis août 2013 – fonction qu’il a également exercée de 1993 à 1996 – déclarait récemment qu’« aujourd’hui, le CIDJ reçoit annuellement près de 150 000 jeunes demandeurs d’information sur leur orientation. Lors de mon précédent mandat, ils étaient en moyenne 600 000 à se présenter au guichet… et force est de constater que ce ne sont plus les mêmes publics. Ceux que nous recevons aujourd’hui sont généralement davantage en situation de souffrance sociale que ne l’étaient leurs prédécesseurs des années 1990 ». Il précisait également qu’« il faut s’interroger sur l’identité des informateurs jeunesse, sur leur valeur ajoutée et ce qu’ils peuvent apporter aux jeunes, sachant qu’aujourd’hui, [le réseau IJ n’est] plus leur premier informateur. Il faut s’interroger aussi sur notre relation avec les usagers, que nous avons perdue, et pour cela comprendre comment les jeunes s’informent et la nature de leurs attentes. »
Ces propos soulignent la difficulté et la nécessité pour les dispositifs publics en faveur des jeunes de se renouveler, pour répondre efficacement aux jeunes tels qu’ils sont, en tenant compte de leurs modes de vie et des outils qu’ils privilégient désormais. La réforme réussie de l’INJEP montre qu’il est possible de répondre efficacement à cet impératif dans le domaine de la jeunesse. Car il est nécessaire – peut-être plus que par le passé – d’offrir une information générale, fiable, précise, accessible à tous les jeunes, concernant à la fois leurs droits et les opportunités qui s’offrent à eux à différents moments de la jeunesse, a fortiori en se tournant vers les jeunes en difficulté. S’appuyant sur son expérience au service de tous les jeunes, ainsi que sur la qualité et le dévouement de ses personnels, le réseau IJ – le CIDJ, les CRIJ, les bureaux et les points – doit savoir devenir, de nouveau, un acteur central en la matière.
Plus largement, les rapporteurs proposent que le renforcement et le renouvellement du lien entre la jeunesse et les dispositifs publics qui leur sont dédiés soit initié autour de trois « portails », pour lesquels les entrées se feraient sur un mode numérique, avec la garantie, si un jeune en fait la demande, de pouvoir entrer en « contact humain » avec un professionnel, un conseiller, un informateur pour débuter un accompagnement. Ces trois portails – que les rapporteurs évoquent infra – seraient les suivants :
– un portail pour l’orientation des jeunes vers les acteurs en charge de leur information et de la gestion de leurs droits, construit à partir du réseau IJ existant, qui a l’avantage de proposer un maillage fin – prêt à l’emploi – du territoire ;
– un portail pour l’accompagnement des jeunes peu ou pas qualifiés, construit à partir du réseau des missions locales, avec l’objectif de toucher autant que faire se peut, tous les jeunes concernés, même les plus discrets et isolés d’entre eux ;
– un portail pour la mobilité géographique – internationale ou rendue nécessaire par l’orientation choisie dans la formation ou l’emploi – ouvrant l’accès aux opérateurs concernés.
Plusieurs des développements du présent rapport précisent le contenu et la portée de ces portails.
S’agissant du premier d’entre eux, permettant l’orientation des jeunes vers les acteurs en charge de leur information et de la gestion de leurs droits, il doit constituer le dispositif dans lequel s’inscrit l’activité à l’égard des jeunes du service public de l’orientation (SPO), en tenant compte des huit expérimentations en cours.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a prévu à l’article L. 6111-5 du code du travail les modalités selon lesquelles les implantations locales de certains organismes pratiquant l’information et l’orientation sont considérés participer au SPO. Le SPO s’appuie sur un portail numérique, un accueil téléphonique et sur une démarche de labellisation – encadrée par l’État déconcentré – de ces implantations locales. Le principe est d’inscrire leurs activités – exercées selon des modalités différentes et par des personnels aux cultures et statuts professionnels divers – dans une démarche généraliste et homogène.
L’article L. 6111-5 du code du travail précise que peuvent prétendre à l’obtention du label SPO tout au long de la vie « les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
Il est difficile d’établir un état des lieux de cette démarche de labellisation. Au 31 août 2012, environ 10 % des BIJ et PIJ étaient labellisés. Un peu moins de 20 % des centres d’information et d’orientation (CIO – auxquels sont rattachés les copsy) et des antennes locales de Pôle emploi avaient obtenu ce label. Cette proportion s’élevait à presque 30 % pour le réseau des missions locales et des PAIO. D’un point de vue géographique, la démarche de labellisation était à la même date entamée dans quelques régions, notamment l’Aquitaine, l’Auvergne, la Bretagne et l’Île-de-France.
La démarche de labellisation « SPO tout au long de la vie » a été diversement appréciée sur le terrain, tant elle s’est adressée à des implantations considérant d’ores et déjà contribuer, sans label, en faveur du service public. Au demeurant, les rapporteurs ont pu constater en région Bretagne, les 13 et 14 juin 2013, la valeur ajoutée limitée de la labellisation achevée pour l’ensemble des implantations dans la région. Pour les acteurs locaux de l’orientation, le travail en réseau existant – fruit d’une démarche historique reconnue et efficace –, a certes permis d’obtenir aisément le label, mais son obtention n’a en rien modifié leur action (44).
Au total, cette démarche a peut-être manqué d’un objet fédérateur, d’un renouvellement mobilisateur du sens de l’activité d’orientation et d’information. L’information de la jeunesse sur les métiers, les droits, les associations de jeunesse – via un portail composé à la fois d’une entrée numérique et de la garantie sur demande d’un contact humain – pourrait constituer, sur la base du maillage du réseau IJ existant, cet objet et ce renouvellement.
d. L’intervention décentralisée dans les politiques de jeunesse : qualité et complexités ?
Lors de leur déplacement en Ille-et-Vilaine les 13 et 14 juin derniers, les rapporteurs ont pu mesurer l’énergie déployée localement par l’État et les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des jeunes.
En matière de formation professionnelle, la région Bretagne – mettant en œuvre la compétence qui lui a été attribuée par la loi – propose un dispositif de préparation à la formation qualifiante. Le dispositif régional pour l’insertion professionnelle (DRIP) doit permettre la validation d’un projet professionnel et la préparation de l’entrée en formation qualifiante. Selon le profil du bénéficiaire du DRIP, lui est proposée l’une des quatre prestations que la région a élaborées. Ces prestations relèvent en grande partie d’actions de formation – financées par la région en 2012 à hauteur de 18,6 millions d’euros. Si le DRIP n’est pas exclusivement dédié aux jeunes peu ou pas qualifiés, la région a choisi de largement les en faire bénéficier. En 2012, la région Bretagne a financé 7 167 parcours au titre du DRIP.
Une fois le DRIP achevé, la personne âgée de moins de 26 ans, en principe désormais prête à intégrer une formation qualifiante, peut bénéficier d’un contrat d’accès à la qualification (CAQ), via une action complémentaire servie par l’organisme de formation qui a suivi cette personne durant le DRIP. Dans le cadre d’un partenariat entre cet organisme de formation et la mission locale qui assure l’accompagnement du jeune, il s’agit de lui garantir une continuité dans l’accompagnement public vers la formation qualifiante. S’agissant d’un dispositif en cours de mise en œuvre, la région prévoit que « 1 600 jeunes bretons pourront être accompagnés dans [le] cadre [du CAQ], soit environ 25 % des jeunes intégrant une prestation DRIP ».
Pour proposer de façon équitable ces prestations sur l’ensemble du territoire régional, le conseil régional a mis en place un réseau des maisons de la formation professionnelle, qui s’appuie sur les implantations locales des réseaux partenaires de la région : Pôle emploi, le CRIJ, le Fongecif, les missions locales et les centres d’information et d’orientation (CIO – dont la tutelle est assurée par le rectorat).
Ce travail partenarial est remarquable, d’autant plus qu’il s’inscrit géographiquement dans chacun des 21 pays bretons et dans le réseau des villes moyennes qui « maille » la région – c’est-à-dire dans les points de repère usuels de la population. Cette coopération ne semble pas buter sur la diversité des tutelles, des cultures professionnelles et des axes prioritaires d’action.
Dans le même temps, le conseil général d’Ille-et-Vilaine propose depuis le début de l’année 2013 un nouveau contrat d’accompagnement renforcé et sécurisé, dit CARES 35, proposé à certains jeunes bénéficiaires du RSA (45), en contact à ce titre avec le département, et à certains jeunes sortis du dispositif départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE). Le département envisage de s’appuyer sur les missions locales pour procéder à la passation du contrat avec les jeunes concernés. En cas de besoin, notamment quand les jeunes concernés ne bénéficient pas du RSA, le CARES 35 pourra comprendre, selon la documentation transmise aux rapporteurs, « une aide financière dite “bourse à l’autonomie” pour leur permettre de faire face aux besoins essentiels de la vie quotidienne (hébergement, alimentation, hygiène…). »
De façon légitime, le département d’Ille-et-Vilaine s’engage ainsi pour la mise en œuvre d’une mesure d’urgence sociale, pour laquelle ils demandent aux missions locales « d’accompagner les jeunes identifiés par le département vers une insertion professionnelle dans le cadre d’un parcours formalisant un ou des objectifs à atteindre et les étapes nécessaires pour y parvenir. Le contrat est prioritairement axé vers l’accès à l’emploi et à la qualification. »
On attend au demeurant de la décentralisation à la française de telles initiatives, adaptées aux besoins locaux et souples s’agissant de leur processus décisionnel et de leur mise en œuvre. On mesure également la difficulté pour les publics concernés de saisir ce fonctionnement d’ensemble, dans lequel – selon que l’on réside ou non en Ille-et-Vilaine –, on peut cumuler un DRIP et un CARES 35, ou pas (46), dont les objets sont différents mais se recouvrent partiellement s’agissant de l’accès à l’emploi des jeunes les plus en difficulté. In fine, il reviendra à la mission locale de mettre en œuvre un contrat nouveau, dans le contexte d’un portefeuille de dispositifs parmi lesquels on compte le PPAE, le CIVIS ou les prestations prévues par l’ANI jeunes du 7 avril 2011.
2. Quelle voix des jeunes dans les lieux qui les concernent et dans notre société ?
a. Pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes sur les sujets qui les concernent
Un interlocuteur régulier des rapporteurs au cours de leur mission, acteur de l’observation de la jeunesse et des jeunes, leur a indiqué qu’« il y a toujours quelque chose à gagner à entendre les jeunes et à susciter leur participation ». Les rapporteurs ont souhaité que des jeunes participent aux travaux du groupe de travail qu’ils ont animé, dès les tables rondes introductives organisées en février 2013, via une représentation du Forum français de la jeunesse (FFJ). Par la suite, de nombreux jeunes ont été interrogés, entendus et accueillis par les rapporteurs et les membres du groupe de travail, au cours des auditions, tables rondes et déplacements effectués. Dans le cahier des charges du prestataire choisi par l’Assemblée nationale pour évaluer certains dispositifs dédiés aux jeunes – dont le rapport figure en annexe au présent rapport –, de nombreux entretiens en face-à-face avec des jeunes ont été prévus et des questionnaires papier ou en ligne leur ont été adressés.
La prise en compte de la parole des jeunes sur les sujets qui les concernent doit se poursuivre et s’amplifier. Il serait pertinent de prévoir une représentation systématique des jeunes dans les conseils d’administration des centres de formation pour apprentis (à l’instar des lycées) et des missions locales. Il est fondamental que l’engagement de ces jeunes dans ces instances soit facilité par une formation gratuite ad hoc. Ils ne sont pas toujours les mieux préparés à intégrer – et à s’intégrer dans – les enjeux institutionnels, financiers, pratiques, ou le langage propres à ces lieux où se joue, à tout le moins se gère, ce qui peut les concerner à un moment ou un autre de leur jeunesse.
b. Pour un plus grand nombre de jeunes dans les lieux de décision
Les rapporteurs considèrent fondés les récents propos de M. Bertrand Coly, représentant national du FFJ, revenant sur les raisons pour lesquelles a été créé ce forum en 2012 : « ce qui manque, ce n’est pas une parole des jeunes pour les jeunes, mais une parole des jeunes pour tout le monde. Les jeunes sont sous-représentés dans les lieux de décision, mais en plus, au fur et à mesure qu’avancent les crises économiques et écologiques il apparaît que ce sera à la jeunesse d’assumer les choix faits aujourd’hui. Donc la prise en compte des avis émis par les jeunes est un enjeu de société qui dépasse les questions d’âge de la vie. » (47)
Le risque d’un maintien des jeunes à l’écart des lieux où les décisions sont prises pour l’ensemble de la société a été souligné dans un ouvrage récent de quatre économistes – ouvrage évoqué supra. Se fondant sur des enquêtes internationales, ils observent que « les jeunes ont un civisme moins affirmé que leurs parents dans nombre de pays européens ; néanmoins cet écart est particulièrement marqué en France où le civisme des jeunes se situe très en dessous de celui de leurs parents […] les jeunes non diplômés apparaissent sensiblement plus inciviques que leurs homologues diplômés » (48).
Les auteurs de cet ouvrage font un lien entre cette forme de rejet des règles de vie en société et l’échec scolaire – situation dans laquelle se sont trouvés de nombreux jeunes non diplômés –, qui se traduirait par une défiance à l’égard des institutions dans leur ensemble. Les auteurs considèrent également que l’éloignement des jeunes des lieux de décision implique l’incivisme et in fine constitue une menace sur le lien social. Ils indiquent que « le déficit de confiance dans les institutions publiques fait mauvais ménage avec la démocratie […] la moindre confiance des jeunes n’engage pas à l’optimisme. Elle est susceptible de fragiliser, à terme, le soutien à la démocratie et de favoriser des mouvements xénophobes. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les jeunes sans diplôme […] les jeunes peu diplômés sont aussi plus nombreux à ne se positionner ni à droite, ni à gauche […] laisser ces jeunes à l’écart de la société est non seulement moralement condamnable, c’est certainement aussi un pari dangereux. »
Les rapporteurs constatent à quel point la marge de progression concernant la représentation des jeunes dans les assemblées délibérantes est importante, voire presque totale dans certains cas. Le sujet est difficile car – pour les assemblées délibérantes politiques – il en va de la liberté des électeurs de choisir leurs représentants. Les partis politiques, qui accordent les investitures aux élections, devraient être les lieux où les jeunes incarnent l’espoir et peuvent prétendre aux responsabilités.
En amont, la participation et la prise de responsabilité dans les organisations de jeunesse doivent être encouragées. Dans l’interview évoquée supra, M. Bertrand Coly précise que « les organisations de jeunes répondent à un besoin pour les jeunes d’avoir un marchepied, de se retrouver entre pairs pour investir d’autres lieux d’expression politique ou sociale. On voit même qu’ailleurs, dans les pays scandinaves par exemple, les jeunes sont bien plus présents dans l’espace public notamment, parce que les organisations de jeunes sont particulièrement structurées. »
Lors de son intervention devant le FFJ le 19 septembre 2013, Mme Valérie Fourneyron, ministre chargée de la jeunesse, a annoncé la création d’« une cellule d’accompagnement de toutes les organisations de jeunes […] pour appuyer la création et le développement d’organisations de jeunes, dirigées par des jeunes, et pour consolider les structures existantes ». Mme Valérie Fourneyron a également annoncé à cette occasion le lancement d’un appel à projet – pour lequel 2 millions d’euros pourraient être réservés sur les crédits du ministère – à destination des organisations de jeunesse. Il s’agit de financer des initiatives innovantes pour « voir s’accroître l’engagement des jeunes et la consolidation des organisations de jeunes dans leur rôle de porte-voix. »
Le travail effectué par les jeunes au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE) constitue en tout état de cause un encouragement à leur faire confiance et à leur donner une place plus importante qu’aujourd’hui dans les débats et dans la prise de décision. En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, le CESE compte, parmi ses 233 membres, « quatre représentants des jeunes et des étudiants […] au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ». Ces quatre représentants sont actuellement M. Azwaw Djebara (désigné par l’Union nationale des étudiants de France – UNEF), M. Antoine Dulin (désigné par les scouts et guides de France), Mme Claire Guichet (désignée par la Fédération des associations générales étudiants – FAGE) et Mme Marie Trellu-Kane (désignée par l’association Unis-Cité). Les travaux de M. Antoine Dulin et de Mme Claire Guichet – concernant respectivement l’accès des jeunes aux droits sociaux et l’accès des jeunes au logement – constituent désormais des références. Ces exemples légitiment l’action actuelle du Gouvernement tendant à ce que des jeunes soient désignés prochainement en plus grand nombre dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Le nombre de ces « places jeunes » pourrait s’élever à 150 pour l’ensemble des CESE régionaux (qui comptent environ 2 250 conseillers).
● Mettre en place des outils, compétences et acteurs aux niveaux national et territorial pour assurer une conception, une mise en œuvre et une évaluation efficaces des politiques publiques en faveur de la jeunesse :
– créer un conseil d’orientation des politiques de jeunesse, interface sociétale naturelle des travaux interministériels en amont et en aval de la réunion annuelle du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ). Ce conseil pourrait être chargé, en collaboration avec l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), d’établir et d’analyser régulièrement un tableau de bord de l’état de la jeunesse. Il pourrait être impliqué dans le lancement et la mise en œuvre d’évaluations. Outre l’État, le conseil serait constitué de représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales et du mouvement associatif – notamment les mouvements de jeunes et de jeunesse ;
– Établir lors du prochain CIJ un bilan des comités d’administration régionale (CAR) thématiques autour des questions de jeunesse ;
– réaliser plus régulièrement des enquêtes, notamment sur la mobilité sociale (de type enquête Cereq de 2003), pour améliorer la conception et le pilotage des politiques publiques en direction des jeunes.
● Assurer une représentation et une participation effectives des jeunes dans tous les dispositifs qui les concernent, en prévoyant :
– de renforcer leur présence dans les conseils d’administration des CFA et des missions locales, ainsi que dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
– prévoir la délivrance d’une formation en direction des jeunes qui participent à ces instances.
● Améliorer la gouvernance des politiques en direction des jeunes en créant trois portails uniques :
– un portail pour l’orientation des jeunes vers les acteurs en charge de leur information et de la gestion de leurs droits, construit à partir du réseau d’information existant et dans lequel s’inscrirait le service public de l’orientation (SPO) ;
– un portail pour l’accompagnement des jeunes peu qualifiés construit à partir des missions locales, avec l’objectif de toucher tous les jeunes concernés,
– un portail pour la mobilité géographique des jeunes – internationale ou rendue nécessaire par l’orientation choisie dans la formation ou l’emploi – regroupant les opérateurs concernés (Agence Europe éducation formation France, Agence du service civique).
C. UNE EFFICACITÉ INÉGALE ET INSUFFISAMMENT ÉVALUÉE
Un pilotage performant de l’action publique suppose de pouvoir s’appuyer sur une analyse robuste de l’efficacité et de l’efficience des différents leviers susceptibles d’être mobilisés (autrement dit, les objectifs fixés ont-ils été atteints et à quel coût ?), pour pouvoir notamment mesurer la valeur ajoutée d’un nouveau dispositif, et surtout « corriger le tir », au fil de l’eau, autant que nécessaire.
S’agissant des dispositifs concourant à la mobilité sociale des jeunes, il s’agit là d’un impératif au regard de l’importance des financements publics et des enjeux pour la collectivité, mais aussi du foisonnement complexe qui les caractérise (cf. supra), d’autant que de nouvelles mesures ont été adoptées récemment, en particulier dans le domaine de l’emploi (49).
Pourtant, en dépit de progrès réels dans certains domaines, leur évaluation, mais aussi l’exploitation qui peut en être faite, présentent encore de nombreuses insuffisances, et ce aussi bien ex post, c’est-à-dire pour le suivi des moyens mis en œuvre et de leur impact, qu’ex ante, s’agissant des expérimentations et de la capitalisation de leurs résultats, en vue de leur éventuelle généralisation.
Alors que la jeunesse constitue la priorité de la présente législature, il convient dès lors d’en tirer toutes les conséquences en termes de suivi et d’évaluation. L’adoption de plusieurs mesures correctrices dans ce sens pourrait en effet permettre de renforcer sensiblement l’efficacité des politiques publiques visant à favoriser la mobilité sociale des jeunes.
1. Une évaluation encore insuffisante de l’impact des différents dispositifs concourant à la mobilité sociale
De manière apparemment paradoxale, de nombreux organismes participent aujourd’hui à l’évaluation des politiques et dispositifs en direction des jeunes, mais leur impact, voire même des données de pilotage aussi élémentaires que le nombre de bénéficiaires ou le coût précis de certains d’entre eux, demeurent encore mal connus.
a. Un suivi de la performance des dispositifs pour le moins inégal et parfois peu lisible dans les documents budgétaires
Pour la représentation nationale, les projets annuels de performance (PAP), qui sont annexés aux projets de loi de finances (PLF), constituent les documents de référence pour apprécier l’efficacité et l’efficience de l’action publique.
En effet, ces annexes explicatives doivent en principe comporter, aux termes de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), « la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ».
S’agissant par exemple des bourses sur critères sociaux et des aides au mérite, ces documents précisent ainsi le nombre de bénéficiaires et les crédits alloués, avec une série d’indicateurs visant à en mesurer l’impact, tels que l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20 ans, selon leur origine sociale, et le ratio de réussite comparé des boursiers par rapport aux non boursiers (50).
De même, dans le domaine de l’emploi, ces annexes comportent une présentation des objectifs généraux et du coût des principaux dispositifs, avec des indicateurs visant à suivre leur efficacité en termes de ciblage (objectif chiffré de jeunes non qualifiés ou résidant dans les quartiers parmi les bénéficiaires), mais aussi d’impact (taux d’insertion dans l’emploi), du moins pour trois d’entre eux (CIVIS, emplois d’avenir et, de façon toutefois moins précise, EPIDE).
TAUX D’INSERTION DANS L’EMPLOI ET PROFIL DES JEUNES BÉNÉFICIAIRES D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE (CIVIS, EPIDE ET EMPLOIS D’AVENIR)
Un suivi pertinent de l’efficacité et du ciblage de trois dispositifs en faveur des jeunes
2012 |
2013 Prévision |
2014 Prévision |
2015 Cible | ||
EMPLOIS D’AVENIR |
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie |
- |
- |
70 % |
75 % |
dont taux d’insertion dans l’emploi durable |
- |
- |
50 % |
55 % | |
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées |
80 % |
80 % |
80 % | ||
Jeunes résidant en zone urbaine sensible (ZUS) dans les entrées |
15,5 % |
25 % |
30 % | ||
CIVIS |
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie |
40 % |
42 % |
43 % |
44 % |
dont taux d’insertion dans l’emploi durable |
24,4 % |
27 % |
28 % |
29 % | |
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées |
45,5-50 % |
50 % |
50 % |
50 % | |
Jeunes des ZUS dans le total des entrées |
14,2-17 % |
17 % |
18 % |
20 % | |
EPIDE |
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie* |
44 % |
- |
- |
- |
dont taux d’insertion dans l’emploi durable* |
- |
- |
- |
- | |
Jeunes non qualifiés dans le total des entrées |
63-93 % |
- |
- |
- | |
Jeunes des ZUS dans le total des entrées |
35,7-40 % |
42 % |
46 % |
50 % | |
EPIDE : établissement public d’insertion de la défense. CIVIS : contrat d’insertion dans la vie sociale.
* L’indicateur n’est plus exploité.
Source : d’après les indicateurs 3.2 et 3.5 du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » annexé au PLF pour 2014
Au-delà des crédits d’État, des annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) s’inscrivent par ailleurs dans cette démarche « objectifs-résultats », s’agissant notamment des exonérations de charges (« niches sociales »), par exemple pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les stagiaires en entreprise et le service civique (51).
Toutefois, l’analyse du contenu des documents budgétaires pour 2013, présentée dans l’annexe n° 2 du présent rapport pour ce qui concerne les dispositifs identifiés comme concourant à la mobilité sociale des jeunes, fait apparaître le caractère pour le moins hétérogène de leur suivi. Outre la disparité des dispositifs en termes de coût (de 400 000 à plus de 4 milliards d’euros) et de calibrage (de 4 000 à 2,3 millions de bénéficiaires), il en ressort en effet que :
– plus de 20 % ne précisent pas le nombre de bénéficiaires, par exemple pour les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), les aides à la mobilité internationale des étudiants, les contrats « pactes junior (52) », ou encore le nombre de consultations des centres d’information et d’orientation (CIO) ;
– dans près d’un quart des cas, le coût des dispositifs n’est pas précisé, et lorsqu’il l’est, le chiffrage indiqué peut appeler certaines réserves ; par exemple pour l’information et l’orientation scolaires (303 millions en 2013 s’agissant de l’enseignement secondaire), la Cour des Comptes a souligné récemment (53) qu’ « au total, comme pour de nombreuses autres politiques scolaires, le coût global réel des procédures d’orientation apparaît (…) très mal connu » ;
– enfin, les indicateurs de résultats sont parfois insuffisants, sinon absents.
Concernant par exemple les internats d’excellence (cf. supra), un rapport d’inspection établi en 2011 (54) avait relevé que « les objectifs ambitieux qui [leur] sont assignés (…) comme les financements importants (55) mis en jeu, rendent impérative la mise en place, sans tarder, d’une évaluation des résultats de ce dispositif pour pouvoir en mesurer la valeur ajoutée. Au regard des exigences de la LOLF, l’inscription des internats d’excellence dans le programme 324 impose d’ailleurs de justifier au premier euro les sommes dépensées. Or (…) une évaluation tant interne qu’externe reste largement à construire ». En juin 2012, les ministres chargés de l’éducation nationale et de la réussite éducative avaient par ailleurs indiqué qu’une évaluation serait faite de ces internats, « notamment sur leur rapport coût/amélioration de la réussite », afin de disposer « des éléments d’appréciation permettant d’orienter efficacement les moyens pour la réussite du plus grand nombre (56) ».
Pourtant, deux ans après la publication du rapport précité, et alors que près de 53 millions d’euros étaient prévus à ce titre pour 2013, le seul indicateur du programme « Politique de la ville » relatif à ce dispositif portait sur la « proportion des places d’internat d’excellence occupées par des enfants originaires des quartiers prioritaires ». En dépit de ce que pouvait laisser penser l’intitulé de l’indicateur concerné (« efficience de l’allocation de moyens consacrés à la réussite éducative et aux internats »), ce sous-indicateur se limitait donc, en fait, au suivi de leur ciblage en termes de publics, sans apporter d’information sur leur impact en termes de réussite éducative, non plus que sur le coût moyen par élève comparativement aux internats traditionnels. Publié en avril 2013, le rapport sur l’internat de Sourdun évoqué plus haut (57) a toutefois permis de mesurer les effets d’un dispositif ciblé sur les compétences et l’ambition scolaire d’élèves d’origine modeste.
Enfin, les nombreuses informations figurant dans les milliers de pages de documents budgétaires, transmis chaque année à la représentation nationale, ne font pas toujours ressortir très clairement l’essentiel, c’est-à-dire, aux termes mêmes de la LOLF, la présentation des objectifs fixés, des moyens alloués et des résultats obtenus. Des améliorations s’imposent donc dans ce domaine.
b. Plus largement, des travaux d’évaluation qui pâtissent de la dispersion de l’expertise, avec des lacunes à combler dans plusieurs domaines
Au-delà de l’analyse de la performance à travers le suivi des principaux indicateurs chiffrés, de nombreux organismes (58) participent à l’évaluation des politiques publiques, et notamment celles en direction des jeunes. Certains instruments en faveur de la mobilité sociale ont ainsi récemment fait l’objet d’évaluations approfondies, par l’exemple l’orientation scolaire (59) ou les aides à l’emploi des jeunes (60). En particulier, comme l’a souligné justement le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) dans un rapport récent sur les aides aux entreprises, « des progrès ont été faits depuis 2006 en matière d’évaluation des politiques de l’emploi, avec la réalisation de nombreux travaux d’évaluation ».
L’expertise apparaît toutefois dispersée entre les différents organismes concernés, ce qui peut nuire à l’identification et à la diffusion des travaux d’évaluation concernant notamment la mobilité intergénérationnelle et, plus largement, la jeunesse. Il manque en effet un organisme susceptible d’être une « tour de contrôle » pour améliorer la diffusion et l’exploitation de l’ensemble des travaux sur ces questions et l’identification des besoins en matière d’évaluation.
D’autre part, indépendamment de la qualité de ces travaux, ils ne peuvent, par nature, que compenser partiellement les insuffisances évoquées plus haut, dans la mesure où ils ne font pas nécessairement l’objet d’un suivi régulier, et en tout cas pas annuel, quant à l’efficacité des dispositifs étudiés à un moment donné.
Par ailleurs, ces publications en arrivent parfois à la conclusion que d’autres travaux d’évaluation doivent être menés, compte tenu des limites identifiées dans certains domaines, par exemple :
– l’étude réalisée par KPMG/Euréval, dont un extrait est présenté ci-dessous, fait apparaître plusieurs limites en matière d’orientation ; à cet égard, le rapport précité de la Cour des Comptes a d’ailleurs préconisé d’ « évaluer, au regard de l’objectif de la maîtrise par tous les élèves du socle commun à la fin de la scolarité obligatoire, les dispositifs spécifiques (sections d’enseignement général et professionnel adapté, découverte professionnelle 6 heures, dispositif d’initiation aux métiers en alternance, 3ème d’insertion, 3ème en alternance, etc.) et [de] ne conserver que ceux qui répondent effectivement à cet objectif, en excluant d’en faire des filières de pré-orientation », ce qui suggère donc que cette évaluation n’est pas actuellement réalisée de façon pleinement satisfaisante ;
Une évaluation des pratiques d’orientation présentant plusieurs limites : extrait de l’enquête réalisée par KPMG/Euréval
« L’évaluation n’est pas une pratique répandue dans les CIO et parmi les COP (conseillers d’orientation psychologues). Ils privilégient le suivi d’activité en recensant le nombre d’entretiens effectués, de bilans ou le nombre d’actions collectives. Ils estiment tous être efficaces (moyenne de 3,8/5) au regard des moyens qui leur sont accordés. Cette appréciation repose sur leur ressenti et non pas sur des indicateurs objectifs. Ils soulignent en effet qu’ils ne sont pas seuls à intervenir auprès d’un jeune et que, par conséquent, il est délicat d’établir la contribution de chaque acteur sur l’appréciation portée par les bénéficiaires. La pratique du questionnaire de satisfaction n’est pas répandue auprès des COP. »
Source : étude réalisée par KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)
– s’agissant des écoles de la deuxième chance (E2C), un rapport récent de l’OCDE (61) soulignait que s’ils obtiennent des résultats prometteurs en termes d’insertion, « l’efficacité réelle de ces programmes n’a jamais vraiment été évaluée, ce qui en limite le développement (62) » ; une évaluation est cependant actuellement en cours au ministère du travail ;
– concernant les contrats aidés, qui mobilisent chaque année des moyens importants (63), s’il est vrai qu’ils ont fait l’objet de plusieurs travaux d’évaluation sur la dernière décennie, le COE n’en a pas moins souligné récemment plusieurs limites ; dans le rapport précité, qui a été publié en avril 2013, il préconise en effet d’ « approfondir le travail d’évaluation des contrats aidés marchands afin de mieux cerner les effets différenciés de ce dispositif par sous-catégorie de population », s’agissant notamment des jeunes, et « d’améliorer le ciblage des contrats en fonction de ces résultats (64) », mais aussi « de mieux prendre en compte les effets structurels des contrats aidés sur le marché du travail (capital humain, impact du financement sur l’économie…) dans les évaluations » ;
– le même rapport observait qu’« il n’existe pas d’étude portant sur l’effet propre des aides en faveur de l’alternance », qui représentent pourtant des montants importants et, concernant l’incidence des formations sur les parcours professionnels, que « les études sont plus rares s’agissant du contrat de professionnalisation ».
Les rapporteurs n’ignorent naturellement pas les difficultés inhérentes à l’évaluation des différents dispositifs concernés, au demeurant nombreux. Ces limites peuvent tenir notamment à des contraintes de temps et de coût (par exemple, pour des suivis de cohortes, des enquêtes qualitatives auprès des bénéficiaires, etc.), à l’éclatement des responsabilités entre les acteurs et, corrélativement, l’existence de ressources parfois nombreuses, mais cloisonnées (c’est par exemple le cas pour la validation des acquis de l’expérience, cf. infra), ou encore à des objectifs peu clairs, voire contradictoires (65). Dans certains cas, cela peut aussi être lié à la nature même des dispositifs : ainsi, l’évaluation est sans doute plus complexe lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’initiatives locales diverses, de type cordées de la réussite.
Les rapporteurs n’en jugent pas moins nécessaire de tracer, pour l’avenir, quelques lignes directrices en termes de méthode.
En amont, il est tout d’abord essentiel de veiller, dès l’adoption d’une mesure en direction des jeunes, à fixer des objectifs clairs et assortis, autant que possible, d’indicateurs chiffrés. Sur la méthode, le plan d’action pour la jeunesse, adopté en février 2013, prévoit d’ailleurs plusieurs améliorations dans ce domaine, avec notamment la mise en place annoncée d’un tableau de bord (cf. l’encadré ci-après).
Il convient cependant de prolonger cette démarche, en vue de se doter d’instruments adaptés pour renforcer le pilotage de l’action publique, mais aussi l’information du Parlement. Dans ce sens, les documents budgétaires doivent être non seulement étoffés, compte tenu des limites évoquées récemment, mais aussi rendues plus lisibles, en prévoyant la présentation d’un tableau de bord synthétique des politiques de la jeunesse.
Des mesures prévues par le comité interministériel (CIJ) de février 2013 pour améliorer l’évaluation et le pilotage des politiques de jeunesse
« Les indicateurs. Savoir évaluer la politique de la jeunesse ». De nombreuses informations sur les jeunes et les politiques de jeunesse sont aujourd’hui disponibles. Issues de travaux de recherche ou de données administratives, notamment statistiques, celles-ci restent néanmoins trop dispersées, pas toujours connues et peu mobilisées par les acteurs des politiques de jeunesse. Un tableau de bord, rassemblant une série d’indicateurs statistiques sur la situation de la jeunesse en France, sera constitué pour élaborer désormais les politiques en matière de jeunesse. Pour finaliser, suivre et actualiser ce tableau de bord, un groupe interministériel permanent placé auprès de l’INJEP est créé. [Il] est chargé : de la mise en place et de l’actualisation du tableau des indicateurs mesurant l’impact sur l’état de la jeunesse des actions retenues dans le cadre du CIJ ; d’étudier la faisabilité de tout autre indicateur nécessaire à l’observation de la jeunesse ou l’évaluation des politiques de jeunesse ; le cas échéant, de piloter et valider des enquêtes thématiques complémentaires.
Source : rapport du Comité interministériel de la jeunesse (21 février 2013)
Sans qu’il besoin de modifier la LOLF (66), celui-ci pourrait figurer dans le document de politique transversale (DPT) « Jeunesse », annexé chaque année au projet de loi de finances. Ce tableau synthétique présenterait, de façon simple, pour chaque dispositif (a minima, pour les principaux en termes de coût ou du nombre de bénéficiaires), une sélection restreinte d’indicateurs, avec par exemple trois colonnes sur les objectifs, les moyens (nombre de bénéficiaires, coût total et coût par jeune) et les résultats (par exemple, le taux de sortie vers l’emploi). Concrètement, cela permettrait par exemple d’appréhender plus aisément le coût et les résultats comparés de dispositifs voisins, voire concurrents.
D’autre part, la création d’un Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, comme le préconisent les rapporteurs (cf. supra), pourrait contribuer à renforcer l’évaluation sur ces questions, dans le cadre d’une nouvelle instance de concertation et d’expertise, en améliorant la visibilité et l’exploitation des différents travaux réalisés par ailleurs, mais aussi, en identifiant les besoins et, le cas échéant, en approfondissant l’analyse sur des sujets encore peu explorés.
2. Une démarche expérimentale à poursuivre en développant la capitalisation de leurs résultats
En matière d’évaluation de politiques publiques, l’expérimentation consiste à tester une innovation sociale à petite échelle, dans des conditions qui permettent d’en évaluer les effets, pendant une durée limitée, afin d’en mesurer les avantages et les inconvénients, l’améliorer et, le cas échéant, la généraliser ou, plus modestement, susciter un essaimage ou une inflexion des pratiques.
Pour la jeunesse, un instrument spécifique été mis en place à cette fin, dont il apparaît nécessaire de dresser le bilan en vue d’améliorer la capacité des expérimentations à préfigurer des politiques innovantes dans ce domaine.
a. Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) : de nombreux projet soutenus dans le cadre d’un dispositif inédit et ambitieux
Institué par loi du 1er décembre 2008 portant généralisation du revenu de solidarité active (RSA), le fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes « est doté de contributions de l'État et de toute personne morale de droit public ou privé qui s’associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans (67) ».
Avec le lancement de seize appels à projets, le fonds a soutenu au total plus de 550 projets divers, aussi bien par les questions traitées, que par les bénéficiaires et les acteurs impliqués. 163 millions d’euros ont été engagés à ce titre, selon le dernier rapport d’activité du FEJ (septembre 2013), et au total, 497 975 bénéficiaires étaient recensés en décembre 2012. Directement inspirés du « Livre vert de la jeunesse (68) », les appels à projet du FEJ ont ainsi permis de couvrir un large champ, comme l’illustre le graphique ci-après.
Concrètement, le fonds développe simultanément une double approche :
– d’une part, il suscite l’initiative de multiples acteurs (associations, communes, etc.), qui doivent proposer des programmes originaux sur un thème d’intervention donné, à travers des appels à projets ; le FEJ encourage ainsi l’innovation et la mobilisation des acteurs autour de dispositifs qui, sans son appui, et les éléments objectifs d’évaluation qui en résultent, resteraient isolés et méconnus ; c’est par exemple le cas des multiples initiatives de lutte contre le décrochage scolaire, portées par des associations, des établissements ou des collectivités, et méritant, pour plusieurs d’entre elles, d’être mieux connues, reprises par d’autres ou encouragées par l’État et les collectivités (69) ;
– d’autre part, le FEJ accompagne, sur le plan financier et technique, la mise en place expérimentale de dispositifs conçus par les services de l’État qu’il est nécessaire de tester, leur efficacité pouvant être difficile à établir a priori ou encore en raison des conditions complexes de leur déploiement (70).
LE FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR LA JEUNESSE (FEJ) : RÉPARTITION DU NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS PAR THÉMATIQUE
Plus de 550 projets couvrant l’ensemble du champ des politiques de la jeunesse
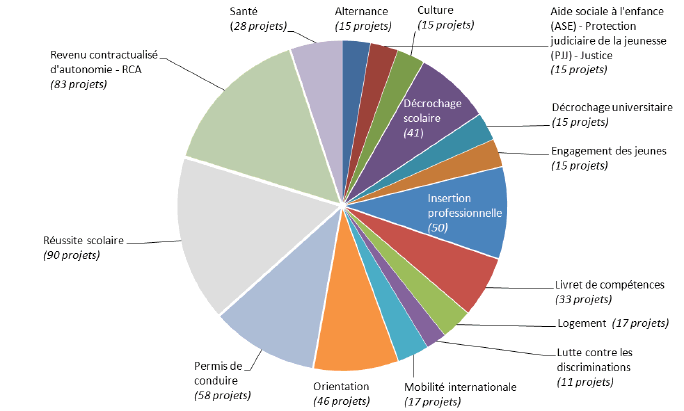
Source : graphique réalisé d’après les données présentées dans le rapport d’activité 2012 du FEJ (septembre 2013)
Par ailleurs, l’évaluation externe et scientifique de ces projets fait partie intégrante des conditions de sélection des projets financés. À cet égard, le FEJ accorde une importance particulière – et relativement nouvelle dans ce domaine – à la connaissance des effets des projets sur les bénéficiaires et la mesure statistique de leur impact. À cette fin, il s’appuie notamment sur la méthode d’évaluation d’impact avec assignation aléatoire des bénéficiaires (groupe test et groupe témoin), pour sa solidité méthodologique et la fiabilité des résultatsLe PAP du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » précise à cet égard que, « fonctionnant principalement sur appels à projets portant sur des thématiques ciblées prévoyant une évaluation externe et scientifique, si possible contrôlée, intégrée au projet dès sa conception, le fonds n’a pas vocation à assurer le fonctionnement pérenne des projets soutenus à titre expérimental. »
Le FEJ a ainsi permis de soutenir et d’évaluer, selon des modalités rigoureuses, des dispositifs innovants concourant à l’autonomie des jeunes, dans l’optique de la mise en place de nouvelles politiques publiques. Près de cinq ans après son institution, la question se pose toutefois de l’utilisation de ce matériau très riche, en termes de capitalisation (71) des résultats des expérimentations – autrement dit, des conditions dans lesquelles elles ont été, ou doivent être, mieux valorisées au mieux en vue de réorienter l’action publique.
b. Une phase de capitalisation essentielle : améliorer la capacité des expérimentations à préfigurer des politiques publiques innovantes
Sur la période récente, plusieurs expérimentations soutenues par le FEJ ont pu trouver un prolongement sous diverses formes :
– la poursuite du projet (par exemple, le projet sur le logement des apprentis chez des particuliers a été pérennisé par son porteur, le conseil régional d’Aquitaine, en vue de sécuriser les parcours des jeunes en alternance) ainsi que la consolidation des pratiques professionnelles expérimentées (72) ;
– le développement de dispositifs à plus grande échelle, à l’issue de l’expérimentation, , par exemple le portefeuille d’expériences et de compétences, avec l’extension, selon des modalités différenciées, d’un outil créé par un petit groupe d’universités à un nombre croissant d’établissements ;
– enfin, les enseignements des expérimentations peuvent alimenter la réforme des politiques publiques ; cela a récemment été le cas pour les expérimentations du revenu contractualisé d’autonomie (RCA), sur les résultats desquelles la conception de la « Garantie Jeunes » a pu s’appuyer, ou encore des actions visant à préparer la réinsertion des jeunes après leur sortie de prison.
Les suites positives d’une série d’expérimentations visant à préparer la réinsertion des jeunes à la sortie de prison : le renforcement des partenariats avec les missions locales
Un ensemble d’expérimentations menées dans le cadre du FEJ a porté sur le renforcement des liens entre les services pénitentiaires et de probation (SPIP) et les missions locales. C’est par exemple le cas de l’expérimentation « Réussir sa sortie », portée par la mission locale des Ulis, qui visait à préparer la sortie de prison des jeunes, favoriser leur retour à l’emploi grâce à l’élaboration d’un projet professionnel et lutter contre la récidive par un accompagnement global. Cette expérimentation a reposé sur un partenariat entre 9 missions locales, le SPIP, la Dirrecte et le juge d’application des peines. Elle visait des jeunes sous main de justice incarcérés à Fleury-Mérogis, âgées de 18 à 25 ans et de faible niveau scolaire (V, V bis).
La diffusion des résultats de l’expérimentation a permis aux acteurs de disposer d’éléments sur les modes de coopération envisageables et leur efficacité. Ces résultats s’inscrivent dans le prolongement de coopérations initiées localement entre acteurs de l’insertion et de la probation, les pratiques expérimentées trouvant aujourd’hui leur place dans une réflexion menée à l’échelle nationale. Ainsi, le ministère de la Justice, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et le Conseil national des missions locales (CNML) ont annoncé la signature d’une convention qui donnera un cadre national à cette démarche de partenariat, afin d’aider les jeunes incarcérés à mieux préparer leur sortie et à retrouver un emploi. Cette action a été inscrite dans le Plan d’action en faveur de la jeunesse (CIJ du 22 février 20123, mesure n° 22).
En tout état de cause, pour apporter aux décideurs des éléments de réflexion utiles dans le cadre de l’élaboration des politiques de jeunesse, les résultats des expérimentations soutenues par le FEJ doivent être disponibles et accessibles ; leur mise en ligne constitue donc un enjeu important.
Or, en octobre 2012, selon l’indicateur retenu pour mesurer la diffusion des résultats des expérimentations, la proportion de celles ayant fait l’objet d’un objet d’un rapport d’évaluation traité et publié n’était que de 32 % (73), et ce n’est qu’en 2015 qu’il était prévu que cette proportion atteigne 85 %.
ÉVOLUTION DE LA PART DES EXPÉRIMENTATIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN RAPPORT D’ÉVALUATION (EN OCTOBRE 2012)
2012 Prév. |
2013 Prév. |
2015 Cible | |
Part des expérimentations ayant fait l’objet d’un rapport d’évaluation traité et publié / nombre total d’expérimentations financées (74) |
32 % |
60 % |
85 % |
Part des rapports finaux d’évaluation traités et publiés dans l’année / nombre total de rapports attendus dans l’année |
60 % |
68 % |
70 % |
Source : PAP du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » annexé au projet de loi de finances pour 2013
Cela peut notamment s’expliquer par la durée des expérimentations (plusieurs sont encore en cours) mais aussi leur nombre, et donc les délais nécessaires pour produire les évaluations et traiter cette masse d’informations. Au total, plus de 480 rapports finaux remis par les porteurs de projets et les évaluateurs ont ainsi été analysés par la mission d’animation du fonds (MAFEJ). De ce point de vue, peut-être eût-il été préférable de renforcer la sélection des projets en amont, avec un nombre plus limité d’expérimentations, pour consacrer davantage de moyens à cette seconde phase d’analyse et de diffusion des résultats, afin de les exploiter au mieux et dans des délais aussi brefs que possibles.
En tout état de cause, le ministère chargé de la jeunesse indiquait, à l’automne 2012, qu’« en 2013, il s’agi[ra] d’assurer la transition vers le droit commun, l’objectif majeur sera donc de capitaliser les résultats probants des expérimentations en vue de leur essaimage dans les collectivités ou promoteurs volontaires (75) ». Dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, « la capitalisation des enseignements des expérimentations menées depuis 2009 (76) » est présentée comme ayant « été réalisée en 2013 » et devant se poursuivre pour les expérimentations qui ne sont pas encore arrivées à terme.
À cet égard, il est certes positif que le FEJ ait récemment publié des notes thématiques présentant les premiers enseignements des expérimentations dans certains domaines, à partir des rapports finaux remis par les porteurs de projets et les évaluateurs. Ces « notes de capitalisation » portent sur la réinsertion des jeunes sous main de justice, l’orientation scolaire et professionnelle, l’alternance, la mobilité internationale, ou encore l’insertion professionnelle (septembre 2013). Au cours des prochains mois, sont par ailleurs prévues d’autres actions de capitalisation et de communication, présentées dans le tableau ci-après.
PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE DES ACTIONS DE CAPITALISATION ET DE COMMUNICATION DU FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR LA JEUNESSE (FEJ)
Echéances |
Actions |
Septembre 2013 |
Notes de synthèse (insertion professionnelle, logement, décrochage universitaire). Appel d’offres communication. |
Octobre 2013 |
Notes de synthèse (décrochage scolaire, réinsertion des jeunes sous-main de justice, mobilité internationale). 4 pages (décrochage scolaire). Atelier insertion professionnelle. Séminaire européen Transition (projet partenarial européen de partage des pratiques et des connaissances) – France. |
Décembre 2013 |
4 pages (alternance). Atelier Culture. |
1er semestre 2014 |
Publication ouvrage collectif. 4 pages. Ateliers de restitution (santé, discriminations). Séminaire européen Transition. |
2ème semestre 2014 |
4 pages. Ateliers de restitution (mobilité internationale, engagement des jeunes). Séminaire européen et conférence de clôture Transition. |
Source : ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (FEJ, plan de programmation stratégique 2013-2015)
Il n’en reste pas moins nécessaire de poursuivre et d’amplifier les actions dans ce domaine, afin de pouvoir rapidement identifier les bonnes pratiques et les enseignements utiles, ainsi que les possibilités de généralisations.
Il est en effet important de « concevoir une dispositif de capitalisation à la hauteur des enjeux », ainsi que l’a souligné un rapport d’inspection établi en 2012 (77), d’autant que le temps de la communication et de la diffusion des résultats risque de nuire aux dynamiques engagées par les expérimentations. En effet, « plusieurs de ces porteurs déjà placés dans cette situation attendent des réponses à leur questionnement sur le devenir de l’expérimentation car si aucun signe ne se manifeste, les dynamiques peuvent s’émousser et la mobilisation des acteurs retomber. Ils seront très attentifs à ce que leur investissement ne tombe pas " aux oubliettes" ». Les financeurs susceptibles de prendre le relais, notamment les collectivités territoriales, attendent également de connaître la décision des pouvoirs publics quant à leur généralisation éventuelle, avant de s’engager pour l’avenir.
Cela serait d’autant plus opportun que plusieurs expérimentations se sont révélées particulièrement riches d’enseignements, en versant au débat des éléments d’analyse robustes quant à l’intérêt d’infléchir certaines pratiques, voire politiques, en direction des jeunes.
C’est le cas notamment, comme l’ont souligné plusieurs personnes entendues par la mission, des expérimentations relatives aux livrets et portefeuilles de compétences ou encore à l’emploi étudiant et la conciliation emploi-formation (en particulier, le dispositif « Améliorer la qualité des emplois exercés par les étudiants (78) » dans la Sarthe). En matière d’orientation et de lutte contre le décrochage, l’expérimentation de « la Malette des parents », dans les académies de Créteil et Versailles, réalisée selon une méthode rigoureuse (avec un groupe test et un groupe témoin), s’est également avérée particulièrement intéressante.
Implication des parents et lutte contre le décrochage scolaire : les résultats intéressants de deux expérimentation soutenues par le FEJ (« La malette des parents »)
● La « malette des parents » en classe de 6ème, portée par le rectorat de Créteil, visait à lutter contre le décrochage scolaire et les violences à l’école par la consolidation du lien entre le collège et les parents d’élèves volontaires. Cette expérimentation a consisté en la mise en place de trois réunions-débats réunissant des parents d’élèves de sixième et des acteurs du collège. Elles sont axées sur l’aide que les parents peuvent apporter aux enfants, les relations avec le collège et la compréhension de son fonctionnement. Des formations complémentaires axées sur les mêmes thèmes sont également été proposées aux parents.
L’évaluation du dispositif a montré plusieurs effets importants. Le premier est une plus forte implication des parents volontaires auprès de l’institution scolaire dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Ce surcroît d’implication s’est également traduit par une amélioration très sensible du comportement des enfants : une diminution de l’absentéisme et du nombre d’exclusions temporaires et d’avertissements ainsi qu’une plus grande fréquence des distinctions lors du conseil de classe, telles que les félicitations ou les encouragements.
● Cette première expérimentation et ses enseignements ont inspiré une nouvelle expérimentation : la « Malette des parents – orientation en 3ème » développée dans 52 collèges, dans l’académie de Versailles. Il s’agit d’un programme d’information et de rendez-vous individualisés proposé aux familles d’élèves de 3ème en classe de difficulté scolaire, afin de les aider dans leur choix d’orientation. Le rapport d’évaluation montre que les deux réunions organisées par les chefs d’établissement en direction des parents des élèves les plus en difficulté (52 % d’entre eux assistent au moins à l’une des deux réunions) permettent de réduire la proportion de décrocheurs à l’issue de la classe de troisième de 8,8 % à 5,1 % des élèves, soit une baisse de plus de 40 %.
Ce projet illustre par ailleurs la dimension cumulative des enseignements des expérimentations lorsqu’elles font l’objet d’une évaluation rigoureuse. Ainsi, dans le cadre de l’évaluation de la malette des parents en 6ème, un volet de l’étude avait porté sur la comparaison entre différentes manières d’inviter les parents à un moment d’échange avec les équipes d’éducatives. Cette étude a montré qu’une invitation formulée par téléphone était perçue comme plus personnelle qu’une invitation par courrier et conduisait à une augmentation du nombre de parents présents. Cette façon de procéder a été mise en œuvre dans le cadre de la « Malette des parents en 3ème »et a permis d’obtenir un taux de participation important.
Source : FEJ et rapports d’évaluation de l’École d’économie de Paris de décembre 2011 et février 2013
C’est aussi le cas en matière d’aides à la mobilité. Ainsi, l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir » a eu pour objet d’aider financièrement et d’accompagner l’accès au permis de conduire de 10 000 jeunes en difficulté d’insertion, et de mesurer l’impact de cette aide sur l’évolution de leur situation sociale et professionnelle.
Les résultats de l’évaluation quantitative montrent que le dispositif augmente l’accès aux auto-écoles, la réussite au code, la réussite au permis et le fait de disposer d’un véhicule (avec une augmentation de près de 50 % des chances d’obtention du permis à un horizon de 24 mois). En revanche, il n’a pas d’effet notable sur les chances d’accéder à un emploi et la qualité des emplois occupés.
Au-delà, les résultats de cette série d’expérimentations sur la mobilité illustrent la grande difficulté que représente en France l’accès à la conduite pour les jeunes en insertion. Deux ans après l’entrée dans le dispositif, plus d’un jeune sur deux n’a pas réussi à obtenir le permis de conduire et près de deux jeunes sur trois n’ont pas encore de véhicule. Les aides financières accordées aux jeunes pour faciliter le passage du permis ont des effets de long terme positifs, mais au prix d’effets de court terme défavorables du point de vue de l’insertion professionnelle et de l’intégration sociale des jeunes.
Ces travaux mettent ainsi en évidence l’intérêt que présenterait une simplification du passage du permis de conduire pour les jeunes, en vue de favoriser l’accès à l’emploi, l’insertion sociale et l’autonomie des jeunes. L’évaluation quantitative remise en 2012 (79) conclut ainsi qu’ « il conviendrait de réexaminer les conditions d’une simplification du passage du permis de conduire pour les jeunes, afin d’en réduire le coût financier mais aussi la durée et la difficulté. (…) Simplifier les épreuves du permis sur le modèle de beaucoup d’autres pays produirait un triple dividende sur l’aptitude à la mobilité des jeunes, sur leur accès à l’emploi et sur leur intégration sociale ». L’atelier thématique sur le permis de conduire, organisé en 2012 par la mission d’animation du FEJ, a également permis d’identifier les difficultés rencontrées (l’effort nécessaire pour le passage du permis pouvant être un obstacle important au maintien d’une activité salariée pour les jeunes), mais aussi d’avancer des propositions, telles qu’une combinaison de l’autoformation avec les cours en face-à-face.
À présent que la majorité des expérimentations sont achevées, et que leurs résultats sont connus et étayés par des évaluations rigoureuses, il faut donc en tirer toutes les conclusions qui s’imposent, c’est-à-dire réformer en conséquence les politiques concernées, en prévoyant les moyens nécessaires pour le déploiement des dispositifs les plus probants. En particulier, une réforme du permis de conduire doit rapidement être engagée (80). De même, si « La malette des parents en classe de 6ème » semble avoir fait l’objet d’un essaimage dans un certain nombre de collèges, il est particulièrement important que les bonnes pratiques repérées dans le cadre de la seconde expérimentation (en classe de troisième) se développent dans d’autres académies, y compris sous des formes un peu différentes, au regard de l’intérêt qu’elles peuvent présenter en termes d’orientation, de lutte contre le décrochage, voire de développement de l’alternance.
À l’avenir, les rapporteurs jugent essentiel de poursuivre le recours à l’expérimentation pour renforcer l’efficacité de l’action publique et faire progresser la mobilité sociale des jeunes, en posant des questions nouvelles et en mettant en débat certains verrous, tabous ou réalités. Ce levier présente aussi l’avantage, particulièrement bienvenu dans un pays encore marqué par une longue tradition centralisatrice, de repérer et soutenir des initiatives de terrain, qui peuvent être des « boîtes à idées » très précieuses pour le décideur national, en les déployant éventuellement ensuite à une plus grande échelle, dans le cadre d’une approche ascendante et partenariale de l’action publique (« bottom-up »).
Dans ce sens, il est d’ailleurs encourageant, sur le plan de la méthode, que le Plan d’action en faveur de la jeunesse, adopté en février dernier, ait prévu le recours à plusieurs expérimentations, dont les principales sont rappelées ci-après.
Principales expérimentations prévues dans le cadre du CIJ de février 2013
– Expérimentation de la possibilité de laisser aux parents le choix de la décision d’orientation en fin de troisième
– Mise en place d’une « CVthèque » pour lutter contre la discrimination à l’embauche (81)
– Expérimentations visant à réduire le taux de rupture des contrats d’apprentissage pour les jeunes les plus fragiles, centrées sur le principe de l’accompagnement et du soutien du jeune mais aussi de son employeur
– Expérimentation des emplois francs en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires en vue de lutter contre les discriminations
– Lancement de la « Garantie jeunes » dans dix territoires pilotes en septembre 2013
Source : rapport du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ), février 2013
Le FEJ ne doit donc pas être lui-même une expérimentation et, du moins, quelle que soit la forme ou l’organisation administrative retenue (82), le recours au levier de l’expérimentation doit se poursuivre au cours des prochaines années.
Selon le rapport spécial sur les crédits du sport, de la jeunesse et de la vie associative pour 2014 (83), le FEJ devrait pouvoir utiliser, jusqu’en 2015 des crédits non consommés de précédentes lois de finances, pour un montant de 12,4 millions d’euros. Ces fonds devraient être répartis de la manière suivante :
– 3,5 millions d’euros en faveur de plateformes nationales et régionales de la mobilité ;
– 3 millions d’euros en faveur de la promotion d’outils d’éducation populaire pour les jeunes (outils numériques et médiatiques notamment) ;
– 2,5 millions d’euros pour mener des évaluations et diffuser les résultats obtenus par le FEJ ;
– 2 millions d’euros en faveur du développement des organisations de jeunes dirigées par des jeunes ;
– 0,8 million d’euros pour mettre en évidence les discriminations envers les jeunes ;
– 0,6 million d’euros pour informer et accompagner les jeunes dans le service public régional de l’orientation.
Par ailleurs, il est à noter que les crédits prévus pour le service civique en 2014 seront complétés par une contribution du FEJ, qui s’élèvera à 3 millions d’euros, en portant ainsi le total des crédits destinés au service civique à 149 millions d’euros.
En outre, le Gouvernement a souhaité traduire la priorité jeunesse au sein du nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI). Il aura vocation à amorcer de nouveaux projets en proposant des partenariats innovants, à grande échelle, entre acteurs publics et privés. Pour 2014, la mission Sport, jeunesse et vie associative intègre ainsi un nouveau programme 411, intitulé Projets innovants en faveur de la jeunesse et doté de 100 millions d’euros. Il vise à favoriser l’émergence de politiques de jeunesse intégrées, en développant une stratégie globale et cohérente à l’échelle d’un territoire, qui fédère et décloisonne les interventions des nombreux partenaires impliqués, qu’ils relèvent de la sphère publique ou privée (84).
Le PAP de ce nouveau programme précise à cet égard que « l’appel à projets tirera les enseignements des pratiques antérieures, notamment celles du fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Cependant, les projets retenus, en nombre restreint, devront avoir une taille critique, s’appuyer sur des préfigurations permettant un essaimage dont le résultat peut être présumé. Une attention particulière sera apportée aux dispositifs d’évaluation et de retour d’expérience, qui devront faire partie intégrante des projets. » Il est également précisé que « l’intervention du PIA se distingue nettement de l’expérimentation en définissant un nombre restreint de projets auxquels il est donné l’occasion de changer d’échelle. Elle est conçue comme une phase aval permettant de préparer la généralisation de projets, de dispositifs ou de modes de collaboration à grande échelle et qui ont le cas échéant fait l’objet d’une première évaluation positive. » Il conviendra donc de veiller à ce que les projets sélectionnés dans le cadre du FEJ s’articulent de manière cohérente avec le PIA.
En outre, s’agissant de thématiques et de politiques publiques par nature transversales, il est important qu’il puisse s’appuyer sur un portage interministériel fort, en lien avec le comité interministériel de la jeunesse (CIJ), mais aussi avec le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, nouvelle instance d’expertise et de concertation que les rapporteurs préconisent d’instituer et dont le FEJ pourrait très utilement éclairer les travaux.
Enfin, au-delà du FEJ et au vu notamment des initiatives intéressantes qu’ils ont pu observer au cours de leurs déplacements, les rapporteurs soulignent toute l’importance de diffuser les bonnes pratiques et développer des dispositifs qui fonctionnent bien sur le terrain.
● Développer l’évaluation et poursuivre la démarche expérimentale :
– étoffer les documents budgétaires, à travers la présentation d’un tableau de bord synthétique de la performance des politiques de jeunesse ;
– capitaliser rapidement les évaluations des expérimentations soutenues par le FEJ et en tirer toutes les conclusions utiles dans la mise en œuvre des politiques (en prévoyant le financement de projets dont les résultats sont les plus probants, en réformant le permis de conduire et en généralisant des pratiques telles que « la malette des parents » notamment) ;
– à l’avenir, poursuivre le recours à l’expérimentation pour faire progresser la mobilité sociale des jeunes, et mettre en débat certains verrous, tabous ou réalités.
Cette première vision « panoramique » de la mobilité sociale des jeunes, fait ainsi apparaître le caractère extrêmement vaste et touffu des politiques publiques concernées ainsi que la très grande diversité des dispositifs actuels.
C’est pourquoi les rapporteurs ont souhaité concentrer leurs travaux sur un nombre limité d’entre eux, à certaines étapes clés du parcours d’un jeune :
– concernant le système éducatif, qui constitue pour les jeunes issus de milieux modestes une « première chance » de s’élever socialement, par leur travail et leurs compétences, principalement : l’orientation, les filières professionnelles et les actions de lutte contre le décrochage ;
– les acteurs, en particulier les missions locales, et les outils visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, s’agissant essentiellement des peu ou pas qualifiés qui, quelles que soient les difficultés qu’ils ont peu rencontrer dans leur parcours scolaire, doivent avoir ensuite des opportunités de rebondir et de saisir une, ou plutôt des « secondes chances », et ce, tout au long de leur parcours – autrement dit, tout ce qui peut contribuer à ce que l’école ne soit pas la seule voie de mobilité sociale, sinon une « machine à trier » et figer les destins ;
– enfin, dans cette période de transition vers l’âge adulte, au-delà de l’accès à l’emploi qui « reste la meilleure voie d’accès à l’autonomie », comme cela a été souligné dans le rapport du comité interministériel de la jeunesse (CIJ) de février dernier, les actions visant à favoriser celle-ci, concernant les conditions de vie des jeunes, soit : les bourses, le logement et la mobilité.
Sur ces questions, les rapporteurs présentent plusieurs propositions visant à desserrer l’étau de la reproduction sociale, ce qui représente un défi mais aussi un projet de société essentiel, « qu’il s’agisse, dans une optique libérale, de récompenser le mérite individuel (et non l’héritage) ou, dans une optique socialiste ou social-démocrate, de favoriser la justice sociale en brisant la reproduction des inégalités (85) ».
ANNEXE N° 1 :
L’IMPACT DE L’ÉCOLE SUR LA MOBILITÉ SOCIALE DES ÉLÈVES : LES LIENS ENTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET LES PERFORMANCES SCOLAIRES
La croissance des effectifs de l’enseignement secondaire en France a été spectaculaire depuis le début du XXe siècle. En allant au plus loin que les données statistiques permettent de remonter, on sait que seulement 15 % des hommes, nés entre 1920 et 1922 avaient pour diplôme le plus élevé le baccalauréat ou un titre de l’enseignement universitaire. L’obtention de ces diplômes par les femmes nées au cours des mêmes années était plus rare encore. Un demi-siècle plus tard, « être bachelier » est devenu la situation majoritaire au sein d’une génération : parmi les jeunes nés entre 1974 et 1976, 67 % des femmes et 60 % des hommes ont un titre de niveau égal ou supérieur au bac, tandis que 22 % des femmes et 18 % des hommes sont titulaires d’un titre égal ou supérieur à la licence.
Toutefois, dès la massification de l’enseignement secondaire – acquise au milieu des années 80 – les sociologues de l’éducation ont mis en doute que ce phénomène signifie pour autant la réduction des écarts de réussite scolaire entre groupes sociaux. À partir d’une reconstitution du parcours scolaire de plusieurs générations d’élèves des établissements orléanais entre 1947 et 1981, l’historien Antoine Prost remet en cause à cette époque l’idée que la généralisation de l’accès à l’enseignement secondaire soit une véritable « démocratisation ». Il introduit une distinction entre une « démocratisation quantitative », c’est-à-dire une expansion des effectifs globaux – et une démocratisation « qualitative » qui consisterait en une réduction des écarts de réussite scolaire associés aux différences sociales. Antoine Prost précise que « la démocratisation [quantitative] ainsi entendue ne supprime pas les inégalités, elle les déplace seulement » (86).
Jusqu’au début des années 2000, ainsi que l’explique Pierre Merle dans un retour rétrospectif en 2002 sur les termes du débat (87), les données et modalités de traitement statistique disponibles ne permettaient pas de dégager des résultats utiles pour déterminer si les progrès quantitatifs de la scolarisation s’étaient accompagnés d’une réduction effective des inégalités sociales au regard des résultats scolaires et de l’obtention des diplômes. Les données recueillies sur les niveaux de diplômes, dans le cadre notamment des enquêtes Formation et Qualification Professionnelle (FQP) et Emploi réalisées par l’INSEE, ont montré l’existence d’une tendance sur longue période à la réduction des inégalités sociales en termes d’accès aux diplômes, mais les résultats obtenus demeuraient discutés (88).
À partir des années 2000, le développement des tests de niveau standardisés soumis aux élèves à tous les stades de la scolarité a permis de mieux caractériser la dispersion « sociale » des résultats scolaires. La mesure de cette dispersion, longtemps réduite à la comptabilisation des effectifs atteignant les différents seuils de scolarité, prend désormais en compte les scores obtenus par les élèves aux tests de niveaux, ce qui a permis l’élargissement des moyens d’analyse à des méthodes permettant de traiter simultanément des effectifs et des scores (89). Les tests de niveau les plus connus sont ceux réalisés depuis 2000 par l’OCDE auprès des élèves âgés de 15 ans dans le cadre du programme PISA (Program for International Student Assessment), dont les résultats font l’objet d’une exploitation statistique spécifique par cette organisation internationale, prenant en compte notamment l’origine sociale des élèves. D’autres évaluations, de dimensions internationale ou nationale, nourrissent également les analyses statistiques actuelles (90) :
– le programme international de recherche en lecture scolaire (Pirls), réalisé depuis 2001 en CM1 ;
– les évaluations nationales à l’entrée en CE2 et en sixième, et notamment les évaluations « lire, écrire, compter » ;
– le « cycle d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons » (CEDRE), mis en œuvre depuis 2003 à la fin du cycle primaire et en fin de collège.
Ces données peuvent être utilement complétées par l’exploitation des résultats des panels d’élèves constitués par le ministère de l’Éducation nationale pour suivre la trajectoire scolaire des élèves depuis leur entrée à l’école primaire ou au collège.
L’ensemble de ces éléments permet de porter un regard plus analytique sur le lien en France entre inégalités sociales et performances scolaires. On peut ainsi évaluer le poids des inégalités sociales rapportées aux résultats scolaires d’un point de vue rétrospectif et global (A), et – pour la période récente – dans le cycle primaire (B), au collège (C), à l’issue du collège (D) et au niveau du bac et dans l’enseignement supérieur (E).
A. LE RECUL DES INÉGALITÉS SOCIALES DANS L’ACCÈS AUX DIPLÔMES A BÉNÉFICIÉ À DES GÉNÉRATIONS DÉSORMAIS ANCIENNES
En 1936, sous le ministère de Jean Zay, eut lieu la première enquête exhaustive sur l’origine sociale des élèves de sixième des lycées de l’enseignement public (91). Certains résultats de cette enquête – présentés dans le tableau ci-dessous – témoignent de la faiblesse des effectifs de l’enseignement secondaire à cette époque, plus particulièrement s’agissant des enfants d’agriculteurs et d’ouvriers, pourtant majoritaires dans la France de l’entre-deux guerres.
PREMIER RECENSEMENT DE L’ORIGINE SOCIALE DES ÉLÈVES DE SIXIÈME
DES LYCÉES PUBLICS CLASSIQUES ET MODERNES
EN 1936-1937
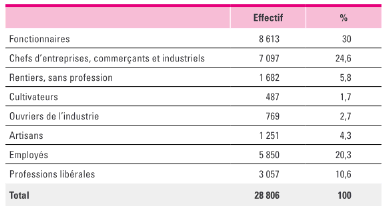
Source : Quelques repères historiques, Françoise Œuvrard, Revue Éducation et formation n° 74, avril 2007
L’ouverture de l’enseignement secondaire au plus grand nombre – et désormais à la totalité des enfants – est le fruit d’une volonté politique dont les prémices se manifestèrent à partir des années 30 avec la gratuité des études secondaires et qui s’affirma au début de la Ve république par une série de décrets réorganisant les écoles publiques. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont mis progressivement en œuvre la fusion des réseaux d’établissements primaires et secondaires qui scolarisaient séparément les enfants des classes sociales modestes ou supérieures et dispensaient des éducations aux visées divergentes. L’expansion démographique du système éducatif français, retracé en particulier par les travaux de M. Antoine Prost (92), est un mouvement protéiforme traversant la seconde moitié du XXe, au cours duquel ont alterné des étapes de maturation institutionnelle et des phases de croissance démographique. Ce mouvement n’est arrivé que récemment à son terme pour les niveaux les plus élevés de l’enseignement.
L’évolution des conditions de scolarisation au cours du XXe siècle a produit un mouvement puissant de réduction des inégalités sociales face à l’école, mouvement qui semble s’être arrêté depuis le milieu des années 90.
a. Une croissance massive des effectifs scolarisés portée par une mobilisation exceptionnelle des moyens publics
M. Antoine Prost souligne l’ampleur de la croissance des effectifs scolarisés depuis 1945, par laquelle, selon lui, « la démographie a peu pesé » : alors que le nombre des élèves scolarisés en cycle élémentaire (de 6 à 10 ans) n’est passé que de 3,4 à 4,1 millions entre 1948 et 2007, le nombre d’élèves scolarisés dans le premier degré du cycle (collège actuel) a doublé, passant de 1,45 à 3,1 millions ; il a quintuplé pour le deuxième degré du secondaire (lycée général et professionnel), passant de 440 000 à 2,2 millions d’élèves. Le nombre d’étudiants poursuivant des études après le baccalauréat a été multiplié par quinze sur la même période (2,2 millions d’étudiants aujourd’hui contre 150 000 en 1945) (93).
Les facteurs multiplicatifs sont analogues pour la croissance des effectifs du corps enseignant : on comptait en 2000 six fois plus de professeurs dans le second degré qu’au sortir de la guerre (400 000 professeurs au lieu de 60 000) et dix fois plus d’enseignants dans l’enseignement supérieur (50 à 70 000 enseignants au lieu de 6 200). Au total, indique M. Antoine Prost, alors que les effectifs scolarisés sont passés en un demi-siècle de 6,4 millions d’élèves ou d’étudiants à 13,4 millions, le poids de l’Éducation nationale, qui représentait 7,5 % du budget de l’État en 1952, double en 1966, dépasse 19 % en 1977 et atteint 20 % à la fin du siècle.
Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée et d’un retard français en matière de scolarisation, les pouvoirs publics ont engagé en 1959 une série de réformes des institutions scolaires visant à ouvrir plus largement l’accès aux différents degrés de l’enseignement secondaire. Ces réformes sont menées à leur point d’arrivée par l’inscription dans la loi d’orientation sur l’école du 11 juillet 1989 de l’objectif de conduire en dix ans 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat.
Les premiers progrès de la scolarisation dans le secondaire, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sont rapides : alors que moins de 10 % d’une classe d’âge entrait en classe de sixième en 1948, cette proportion atteint 40 % dès 1955 (94).
En 1962, un an avant la création des collèges d’enseignement secondaire dans le cadre de la réforme Capelle-Foucher, une des premières enquêtes scolaires réalisée par l’Institut national des études démographiques (INED) fait apparaître que 55 % des enfants d’une classe d’âge entraient en classe de sixième.
Cette enquête montrait par ailleurs que les taux d’admission au collège variaient fortement selon la catégorie sociale : 95 % pour les enfants de cadres supérieurs, 67 % pour les enfants d’employés, 45 % pour les enfants d’ouvriers et 32 % pour les enfants de salariés agricoles (95).
Ce mouvement pluri-décennal de « démocratisation » de l’accès au collège est parachevé par la création du collège unique par la loi du 11 juillet 1975 – dite loi Haby – qui prévoit l’entrée de tous les enfants en classe de 6e.
La généralisation de l’accès en classe de 3e est acquise à partir de 1990, à la suite de la suppression du palier d’orientation en classe de 5e : à compter de cette date, la quasi-totalité ou presque d’une classe d’âge parvient en classe de 3e, contre deux jeunes sur trois en 1985 (cf. le graphique ci-dessous).
ÉVOLUTION DU TAUX D’ACCÈS EN CLASSE DE TROISIÈME
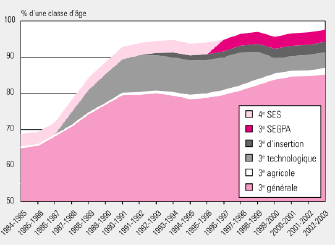
Source : Formation initiale, orientations et diplômes de 1985 à 2002, Sébastien Durier, Pascale Poulet-Coulibando, Revue Éducation et formation n°74
Au niveau du lycée, l’arrivée d’élèves plus nombreux en provenance du collège et la croissance de la filière professionnelle ont conduit à un doublement du taux d’accès au baccalauréat entre 1985 et 1995.
TAUX D’ACCÈS AU BACCALAURÉAT, EN % DE L’EFFECTIF D’UNE CLASSE D’ÂGE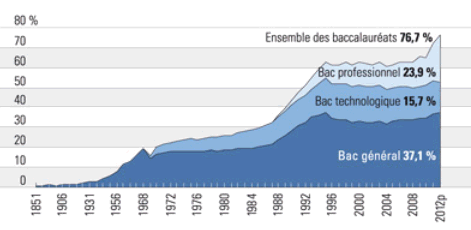
Source : ministère de l’Education nationale
Dans l’enseignement supérieur, l’afflux de nouveaux étudiants apparaît comme une conséquence directe de l’augmentation du nombre de bacheliers : entre 1990 et 1993, le nombre total d’étudiants passe de 1,6 à 2,1 millions. Une croissance plus lente est observée par la suite, dont les causes peuvent toutefois être plus indirectes (comme l’allongement de la durée des études en réaction à la crise économique).
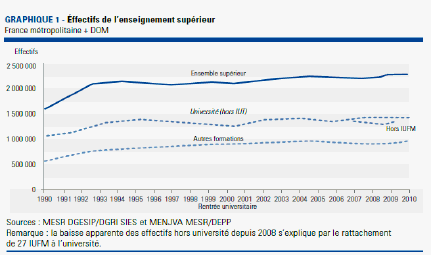
2. Le mouvement de réduction des inégalités sociales dans l’accès aux diplômes
Les statistiques d’obtention des diplômes scolaires et universitaires permettent une analyse des inégalités à l’école. Leur ancienneté permet d’établir des comparaisons sur des périodes longues. Ces données sont issues principalement des enquêtes nationales Formation et qualification professionnelle (FQP) conduites par l’INSEE à intervalles réguliers depuis les années 60 selon un protocole très stable (96), et de l’enquête Emploi qui contient également des données relatives à la profession exercée.
Un travail d’analyse, compilant les données de sept enquêtes nationales FQP et INSEE et s’appuyant sur les trajectoires de 240 000 personnes nées entre le début du XXe siècle et les années 70, a montré que la réduction des inégalités sociales d’accès aux diplômes a été progressive.
Deux chercheurs en sociologie quantitative, MM. Claude Thélot et Louis-André Vallet, ont établi que la force du lien entre l’origine sociale et le plus haut diplôme obtenu a diminué d’un tiers en soixante ans, la dynamique temporelle s’étant principalement déclenchée avant les réformes scolaires de la Ve république – évoquée supra – consacrant l’ouverture de l’enseignement secondaire (97).
Le graphique ci-dessous montre que les premières générations pour lesquelles on note un affaiblissement substantiel du lien entre leurs origines sociales et leur accès aux diplômes sont nées dans les années 1935-1937.
DYNAMIQUE DES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX DIPLÔMES EN FONCTION
DE L’ORIGINE SOCIALE – ANALYSE TOUS DIPLÔMES CONFONDUS
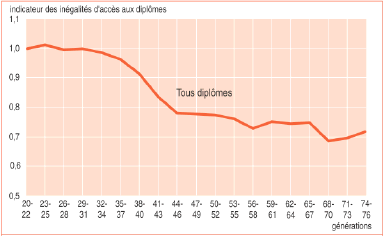
Source : Évolution historique de l’inégalité des chances devant l’école : des méthodes et des résultats revisités, M. Selz et L.A. Vallet, Éducation et formations n° 74, avril 2007
Commentaire : l’indicateur statistique élaboré par les auteurs pour rendre compte des inégalités d’accès de l’ensemble de la population aux diplômes de l’Éducation nationale baisse de 33 % lorsque l’on compare les valeurs de l’indicateur pour les personnes nées en 1923-1925 et pour les personnes nées en 1968-1970.
Selon ces travaux, on observe bien un mouvement de réduction des inégalités sociales pour les personnes nées avant 1977 dans l’accès à tous les diplômes, y compris – dans des proportions moindres mais significatives – aux diplômes de niveau supérieur, ainsi que l’illustre le graphique suivant :
DYNAMIQUE DES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX DIPLÔMES EN FONCTION DE L’ORIGINE SOCIALE – ANALYSE POUR LES DIPLÔMES ÉGAUX OU SUPÉRIEURS AU BACCALAURÉAT
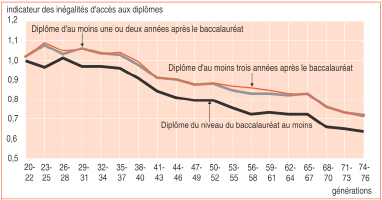
Source : Évolution historique de l’inégalité des chances devant l’école : des méthodes et des résultats revisités, M. Selz et L.A. Vallet, Éducation et formations n° 74, avril 2007
Commentaire : l’indicateur statistique utilisé par les auteurs pour rendre compte des inégalités d’accès de l’ensemble de la population aux diplômes de niveau baccalauréat baisse de 35 % lorsque l’on compare les valeurs de l’indicateur pour les personnes nées en 1923-1925 et pour les personnes nées en 1974-1976.
3. L’interruption depuis presque 20 ans du rattrapage de l’accès au bac par les enfants des catégories populaires
Pour les générations d’élèves plus récentes, il est plus difficile de procéder à une mesure de l’évolution des inégalités car les jeunes concernés n’ont pas tous terminé leur formation initiale. Par ailleurs, l’enquête FQP de 2003 – la plus récente – permet d’apprécier le niveau de formation des seules personnes âgées de plus de 24 ans à cette date.
Toutefois, les données issues des panels 1989 et 1995 établies par le ministère de l’Éducation nationale permettent d’apprécier la dynamique d’accès au baccalauréat eu égard aux origines sociales pour les années 2000.
L’observation de l’évolution comparée du taux d’accès des enfants de cadres et d’ouvriers (graphique ci-dessous) fournit de premiers éléments confirmés par les données issues des panels concernant l’accès au bac eu égard à la catégorie sociale du chef de famille (tableau ci-dessous).
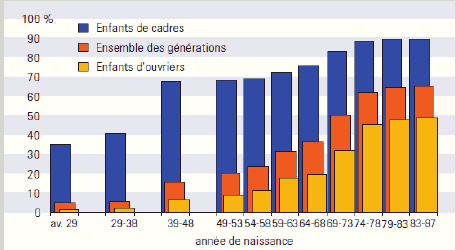
Source : ministère de l’Éducation nationale
PROPORTION D’ACCÈS AU BAC
EN 1996 ET 2002 PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
|
Tous types de bac (1996) |
Tous types de bac (2002) |
Bac géné. et techno. (1996) |
Bac géné. et techno. (2002) |
Bac S (1996) |
Bac S (2002) |
Agriculteurs |
70,5 |
69,7 |
52,8 |
53,7 |
24,1 |
17,7 |
Artisans commerçants |
57,4 |
63,5 |
46,0 |
53,6 |
12,5 |
13,4 |
Chefs d’entreprise |
74,0 |
83,9 |
65,6 |
76,7 |
21,7 |
29,6 |
Enseignants |
86,7 |
90,6 |
84,2 |
86,6 |
44,8 |
40,2 |
Cadres supérieurs |
87,7 |
87,6 |
83,9 |
84,2 |
42,4 |
41,0 |
Professions intermédiaires |
74,0 |
76,7 |
65,5 |
66,6 |
21,7 |
22,9 |
Employés de bureau |
59,1 |
62,1 |
49,7 |
50,5 |
13,8 |
11,0 |
Employés de commerce |
55,7 |
58,8 |
39,4 |
44,5 |
9,7 |
10,4 |
Employés de service |
43,4 |
38,0 |
29,4 |
26,6 |
7,0 |
2,7 |
Ouvriers qualifiés |
50,8 |
52,9 |
37,9 |
39,1 |
8,7 |
8,7 |
Ouvriers non qualifiés |
42,4 |
40,7 |
30,4 |
27,7 |
6,4 |
4,6 |
Inactifs |
29,9 |
27,6 |
22,1 |
17,6 |
4,0 |
3,7 |
Ensemble |
61,0 |
62,9 |
51,0 |
52,2 |
17,4 |
16,6 |
Source : Panels 1989 et 1995 du ministère de l’Éducation nationale
Le graphique montre que l’accès au bac des enfants d’ouvriers a enregistré un rattrapage par rapport aux enfants de cadre, notamment entre les générations 64-68 et 74-78. La plupart des jeunes issus de ces générations ont passé le bac entre 1982 et 1996, soit la période pendant laquelle le taux d’accès au baccalauréat par classe d’âge est passé de moins de 30 % à un peu plus de 60 %. Le même graphique montre également une interruption de ce processus de rattrapage pour les générations nées après 1974. Le mouvement de réduction des inégalités sociales d’accès au diplôme du baccalauréat s’est interrompu une fois atteints les pleins effets du processus de démocratisation de l’enseignement secondaire présenté supra.
Le tableau révèle des éléments plus inquiétants : toutes filières confondues, l’accès au bac des enfants d’inactifs, d’ouvriers non qualifiés et d’employés de service a reculé entre 1996 et 2002, alors que les enfants de ces catégories socio-professionnelles étaient ceux qui dès 1996 parvenaient le moins à obtenir le bac. La période récente est donc marquée par un recul de l’accès au bac des enfants des catégories socialement défavorisées.
Ce constat alarmant est plus marqué encore quand on observe le recul de l’accès aux bacs généraux et technologiques – a fortiori au bac S – des enfants de ces catégories sociales entre 1996 et 2002. Il convient de s’interroger sur une tendance à la spécialisation socio-économique des filières du baccalauréat, la voie professionnelle devenant un peu plus au fil du temps celle des enfants d’inactifs et d’ouvriers non qualifiés quand ceux-ci – plus rarement qu’avant – parviennent au niveau du bac.
B. LE LIEN ENTRE PERFORMANCES SCOLAIRES ET CATÉGORIES SOCIALES EST SOLIDEMENT ÉTABLI DÈS LE CYCLE PRIMAIRE
Il est possible d’établir et de mesurer le lien – établi dès l’école maternelle et croissant tout au long du cycle élémentaire – entre l’environnement social, économique et culturel des élèves et leurs résultats scolaires, via notamment l’observation des établissements relevant de l’éducation prioritaire et l’étude des redoublements dans le cycle primaire.
Le ministère de l’Éducation nationale, en réponse aux questions des rapporteurs, note – en s’appuyant sur les travaux de deux de ses chercheurs concernant les panels de 1995 et 1997 – que « dès l’entrée au cours préparatoire, les élèves présentent des niveaux d’acquis qui différent sensiblement selon leur origine sociale et le diplôme le plus élevé détenu par leur mère. À caractéristiques démographiques et familiales comparables, un enfant d’enseignant réussit 7 items sur 100 de plus qu’un enfant d’ouvrier non qualifié et 9 items de plus qu’un enfant d’inactifs. Par ailleurs, un écolier dont la mère est diplômée de l’enseignement supérieur réussit 6 items de plus que celui dont la mère est sans diplôme. Ces écarts sont deux fois plus élevés que ceux associées à la taille de la famille ou au fait d’être issu d’une famille immigrée » (98) (99)
Le poids du lien mis en évidence avant l’entrée au cours préparatoire entre les origines sociale des élèves, le meilleur diplôme obtenu par la mère et les performances scolaires, doit être mis en perspective en considérant le devenir des élèves concernés (100). Le chercheurs du ministère de l’Éducation nationale ont étudié le parcours des 10 % d’élèves ayant obtenu les résultats les plus faibles aux résultats des tests d’évaluation à l’entrée au cours préparatoire. Toutes catégories sociales confondues, un élève de ce décile n’a qu’une chance sur deux d’arriver sans redoublement au CE2 et une sur trois d’atteindre dans les mêmes conditions la sixième. À l’opposé, les 40 % meilleurs élèves à l’entrée du cours préparatoire parviennent en sixième sans redoublement.
Par ailleurs, les mêmes travaux font apparaître des parcours socialement différenciés à niveau donné à l’entrée au cours préparatoire :
– parmi les élèves du décile le plus faible à l’entrée au cours préparatoire, 27 % des enfants de cadres ou de professions intermédiaires et seulement 7 % des enfants d’ouvriers sont parvenus à retrouver par la suite un « meilleur » niveau scolaire (101) ;
– inversement, les élèves des familles défavorisées sont plus exposés au risque d’une régression de leurs performances scolaires. Parmi les 10 % meilleurs élèves de l’échantillon à l’entrée au cours préparatoire, 18 % des élèves de familles ouvrières et 3 % des élèves de familles de cadres ou de professions intermédiaires connaissent par la suite une baisse de leurs performances scolaires de nature à les faire figurer dans la moitié inférieure des élèves aux évaluations nationales en français, au moment de l’entrée en sixième.
Au total, le lien établi dès l’entrée au cours préparatoire est durable et s’amplifie par la suite. Si 50 % des disparités sociales dans les résultats scolaires sont déjà présentes avant l’entrée à l’école élémentaire, « chaque année, les écarts entre enfants de cadre et enfants d’ouvriers se creusent de près de 10 % » indiquent les mêmes chercheurs. Ainsi, 65 % des enfants de cadres, d’enseignants ou de chefs d’entreprises parviennent en sixième sans redoublement et en se classant dans la moitié supérieure des élèves aux évaluations nationales en français à l’entrée en sixième alors qu’ils ne sont que 24 % dans le même cas parmi les enfants d’ouvriers ou d’inactifs. Les mêmes travaux montrent que « sur les 41 points qui séparent les deux groupes, 21 points (51 %) s’expliquent par les différences de compétences à l’entrée en CP, 7 points (16 %) reflètent des disparités apparues entre le cours préparatoire et l’entrée au CE2 et 14 points (33 %) résultent de différences qui se sont manifestées entre le CE2 et l’entrée en sixième ».
Ces éléments sont significatifs car le niveau en sixième préfigure fortement le destin scolaire des élèves. Le ministère de l’Éducation nationale souligne que « toutes les études montrent que le niveau scolaire de l’élève à l’entrée en sixième a une forte valeur prédictive sur ses chances de devenir bachelier ou ses risques de redoublement ou de sortie précoce du système. »
a. La spécificité des caractéristiques sociales, économiques et culturelles des familles des élèves relevant de l’éducation prioritaire
Du point de vue des catégories sociales, du niveau de pauvreté, des structures familiales, ainsi que du capital culturel et humain, les familles des élèves relevant de l’éducation prioritaire présentent des caractéristiques moyennes nettement différenciées de celles propres aux familles des élèves scolarisés hors éducation prioritaire. Le ministère de l’Éducation nationale dispose en outre de nombreux indicateurs de réussite et de niveaux scolaires mesurés dans les établissements qui relèvent de l’éducation prioritaire et dans ceux qui n’en relèvent pas. L’éducation prioritaire – par comparaison au reste du territoire – permet de contribuer à la mesure de lien entre l’environnement social, économique et culturel des élèves et leur réussite scolaire.
S’agissant des caractéristiques socio-économiques des familles des élèves relevant de l’éducation prioritaire, le ministre relève que :
– « les élèves de RAR (102) sont 73 % à avoir un père ouvrier, chômeur, inactif ou sans profession renseignée (ce qui signale généralement une famille monoparentale) contre 41 % hors RAR. Pour les mères, l’écart est du même ordre : 52 % en RAR contre 21 % hors RAR. […] plus qu’ailleurs, l’appartenance au milieu populaire [dans les RAR] en termes de profession va s’accompagner d’un faible niveau d’études et de difficultés financières. Ainsi, hors RAR, quand le père est ouvrier, il est en emploi dans 82 % des cas, il a au moins un CAP ou un BEP dans 67 % des cas et le ménage n’appartient au quart des ménages les plus pauvres que dans 32 % des cas. En RAR, un père ouvrier ne sera en emploi que dans 62 % des cas, n’aura un CAP ou un BEP que dans 44 % des cas et le ménage appartiendra au quart le plus pauvre dans 67 % des cas. » ;
– « Les élèves de RAR vivent plus souvent en famille monoparentale (26 % contre 14 % hors RAR) et ont plus de frères et de sœurs : la moitié en a au moins 3 contre un cinquième hors RAR. » ;
– « Les deux tiers des élèves de RAR se trouvent dans le quart le plus pauvre de la population. Ils habitent des logements plus petits (avec moins de 5 pièces dans 62 % des cas contre 36 % hors RAR), ce qui, compte tenu de la taille plus importante de la fratrie, crée des situations de surpeuplement. » ;
– « Le “capital culturel” des familles de RAR est aussi moins élevé. Pour deux cinquièmes des élèves, le père a au mieux le brevet des collèges comme diplôme (contre deux fois moins hors RAR). Cette proportion dépasse la moitié pour les mères en RAR. Presque 60 % des élèves de RAR vivent dans un logement avec moins de 30 livres, alors qu’ils ne sont qu’un quart à être dans cette situation hors RAR (103). Trois quarts des élèves de RAR disposent d’un ordinateur à la maison contre plus de 90 % des élèves hors RAR. »
Le ministère de l’Éducation nationale a transmis aux rapporteurs les graphiques suivants, indiquant par catégorie d’établissements scolaires la proportion d’élèves maitrisant les compétences de base en français et mathématiques à l’issue de la scolarité élémentaire.
Évolution de la proportion d’élèves qui maîtrisent, en fin de CM2,
les compétences de base en français et en mathématiques (en %)
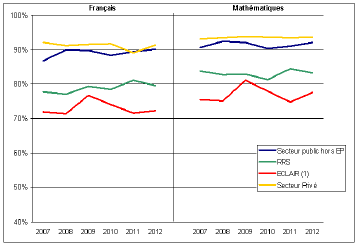
Dans ce graphique, l’éducation prioritaire est représentée à travers les deux réseaux qui le structurent actuellement :
– les réseaux « Éclair », acronyme de « écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite ». Ils ont pris la suite à compter de la rentrée scolaire 2012-2013 des réseaux ambition réussite (RAR). Les réseaux Éclair rassemblaient, à la rentrée 2012-2013, 2 096 écoles (dont 951 maternelles et 1 145 élémentaires), 333 établissements publics locaux d’éducation (EPLE – dont 301 collèges, 14 lycées et 18 lycées professionnels) et 4 internats d’excellence. Selon le site du ministère, les réseaux Éclair rassemblent « un public issu majoritairement des catégories sociales scolairement défavorisées » ;
– les réseaux de réussite scolaire (dits « RSS »), créés en même temps que les RAR. Les RSS rassemblaient à la rentrée 2012-2013 4 676 écoles maternelles et élémentaires, et 782 collèges. Pour le ministère de l’Éducation nationale, le public des RSS « est généralement plus hétérogène » que celui des réseaux Éclair.
En commentaire des graphiques ci-dessus, le ministère note un « écart compris entre 10 et 15 points entre le hors éducation prioritaire et l’éducation prioritaire », cet écart demeurant globalement constant entre 2007 et 2012 (104). Ce constat est corroboré par les « cycles d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons » (CEDRE) par le ministère de l’Éducation nationale. Dans ses réponses aux questions des rapporteurs, celui-ci indique, pour la compréhension de la langue française en fin d’école primaire, que « les écoliers en éducation prioritaire sont surreprésentés dans le groupe des 15 % des élèves les plus faibles : ils sont deux fois plus présents que les autres élèves dans ce groupe », dans un contexte de stabilité des résultats entre 2003 et 2009, voire d’« une très légère progression en compréhension de l’écrit » entre ces deux dates.
3. La confirmation du lien par l’observation des redoublements
Moins nombreux que dans le secondaire, les redoublements avant la classe de sixième sont un révélateur et un marqueur très explicite de difficultés scolaires (105) : selon les résultats de l’enquête génération 2004 réalisée par le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), 13 % des jeunes interrogés dans le cadre de cette enquête ayant déjà un an de retard en classe de sixième ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur – contre 42 % pour l’ensemble des écoliers de cette classe d’âge – et 70 % ont quitté le système scolaire avec au plus un CAP ou un BEP (106). Par ailleurs, seul 1 % des élèves ayant redoublé dans le cycle primaire obtiennent un baccalauréat scientifique (107).
Si les redoublements touchent aujourd’hui en moyenne 12,3 % des élèves du cycle primaire, la proportion d’élèves « en retard » à l’entrée en sixième varie fortement en fonction de l’origine sociale, de 2 % pour les filles d’enseignants ou de cadres à 17 % pour les filles d’ouvriers, et de 4 % pour les fils d’enseignants ou de cadres à 18,5 % pour les fils d’ouvriers (cf. le graphique ci-dessous).
PROPORTION D’ÉLÈVES EN RETARD À L’ENTRÉE EN SIXIÈME SELON LE SEXE
ET L’ORIGINE SOCIALE
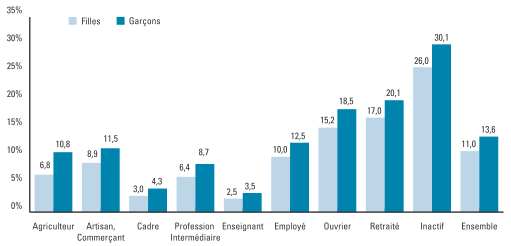
Source : Repères et références statistiques (RERS), ministère de l’Éducation nationale 2012
La structure de ces inégalités a peu évolué au cours du temps. En particulier, elle ne s’est pas trouvée réduite par la politique de limitation du nombre des redoublements engagée par les pouvoirs publics depuis les années 80, ainsi qu’ont permis de l’établir les travaux de deux chercheurs du ministère de l’Éducation nationale, Jean-Paul Caille et Fabienne Rosenwald (108). On observe une baisse en valeur absolue du taux de redoublements pour toutes les catégories sociales – le nombre total de redoublement ayant été divisé par 2 en 20 ans –, mais aucune variation statistiquement significative des rapports entre les taux de redoublement des enfants des différentes catégories sociales (109).
C. LE LIEN ENTRE PERFORMANCES SCOLAIRES ET CATÉGORIES SOCIALES EST RENFORCÉ AU COLLÈGE
1. Une tendance inquiétante illustrée par l’éducation prioritaire
Dans ses réponses aux rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale présente le tableau suivant, retraçant entre 2007 et 2012 les proportions d’élèves par catégorie de collèges (privés sous contrat, publics hors éducation prioritaire, RSS et Éclair – cf. supra pour la signification de ces deux derniers acronymes propres à l’éducation prioritaire) maitrisant les compétences de base en français et mathématiques à la fin de la troisième.
ÉVOLUTION DE LA PROPORTION D’ÉLÈVES QUI MAÎTRISENT, EN FIN DE TROISIÈME,
LES COMPÉTENCES DE BASE EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUES (EN %)
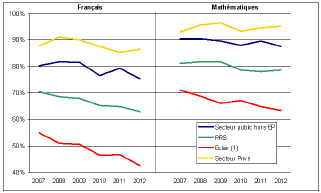
On constate que les différences de résultats selon la catégorie de collèges considérée est plus forte à la fin de la troisième qu’à l’issue du CM2 (cf. supra). Ces différences sont observées dans un contexte de dégradation des résultats des élèves à la fin de la troisième, très marquée s’agissant de la maîtrise des compétences de base en français.
Cette dégradation est particulièrement préoccupante dans les réseaux de l’éducation prioritaire, notamment les réseaux Éclair. Au total, le ministère de l’Éducation nationale relève que « le principal enseignement de ces évaluations concerne l’augmentation de l’écart entre le hors éducation prioritaire et l’éducation prioritaire, et l’accroissement de cet écart durant ces 5 années […]en 2007, 55 % des élèves [des réseaux Éclair] maîtrisent les compétences de base en français en fin de troisième ; ils ne sont plus que 42 % en 2012. L’écart avec les collèges publics hors éducation prioritaire est passé de 25 à 33 points. ».
Le constat d’un « décrochage » des élèves relevant de l’éducation prioritaire pour les compétences acquises à l’issue de la scolarité au collège semble confirmé par les constats établis par le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre des « cycles d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons » (CEDRE). S’agissant de l’évolution des résultats entre 2003 et 2009 obtenus par les élèves de troisième en matière de « compétences générales », le ministère observe « une baisse générale et une grande hétérogénéité des performances, qui s’accroît. En éducation prioritaire, la proportion d’élèves dans les groupes les plus faibles augmente plus fortement. »
Il convient de rester prudent sur les raisons de cet accroissement de l’écart de performances scolaires entre élèves relevant de l’éducation prioritaire et ceux qui n’en relèvent pas. Ce constat inquiétant peut documenter – avec d’autres observations faites dans la présente annexe concernant l’accès au bac et certains résultats des enquêtes PISA mises en œuvre par l’OCDE (cf. infra) – une dégradation récente des résultats scolaires moyens des élèves de parents ouvriers non qualifiés ou inactifs.
Au demeurant, les années récentes ont pu voir certains établissements relevant de l’éducation prioritaire être quittés par certains « bons » élèves, dans le contexte de l’assouplissement de la carte scolaire. Ce phénomène a pu priver certains établissements de « bons » résultats de façon significative d’un point de vue statistique. Empêcher la formation des ghettos scolaires et relever le défi d’un enseignement efficace dans les établissements évités par les familles qui ont pu s’en donner les moyens constituent au demeurant deux défis majeurs pour l’Éducation nationale dans la période qui s’ouvre. Dans ses réponses aux rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale précise que la mixité sociale des établissements scolaires est un facteur de réussite pour les élèves les plus faibles ou pour ceux dont l’environnement social, économique et culturel constitue a priori un handicap : « la concentration des populations en difficulté potentielle au même endroit tend à accroître ces difficultés, selon un effet “ghetto”. […] un enfant d’ouvrier entouré d’enfants d’ouvrier a moins de chance d’avoir le bac qu’un enfant d’ouvrier entouré d’enfants de cadres. »
2. Des résultats au diplôme national du brevet (DNB) nettement différenciés socialement
À l’issue de la scolarité au collège, les résultats au diplôme national du brevet apparaissent très liés à l’origine sociale des élèves. Comme l’indiquent les graphiques ci-dessous, le taux de réussite à ce diplôme variait en 2009 de 68,4 % à 94,9 % selon la catégorie sociale des élèves concernés.
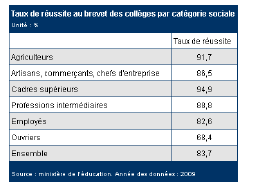
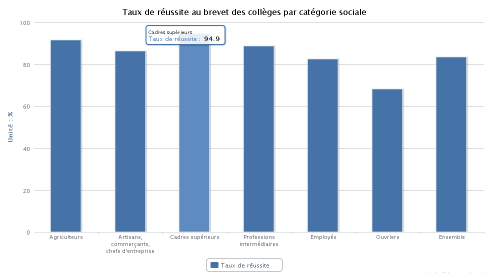
De même, les chances d’obtenir une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet variaient de un à trois selon le milieu social : 44 % des enfants de cadres ont obtenu en 2009 l’une de ces mentions, contre seulement 14 % des enfants de personnes inactives.
D. À L’ISSUE DU COLLÈGE, UN NOMBRE IMPORTANT D’ÉLÈVES DES CATÉGORIES POPULAIRES EST HANDICAPÉ PAR UN NIVEAU SCOLAIRE TRÈS FAIBLE ET L’ORIENTATION ACCROÎT LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE DES DESTINS SCOLAIRES
Du point de vue de l’étude des inégalités sociales, le passage au lycée est la première transition au cours de laquelle sont constatés – s’ajoutant aux différences de performances scolaires – des effets mesurables concernant les choix d’orientation.
Ce passage se produit autour de la quinzième année, âge retenu par l’OCDE (110) pour mesurer – dans le cadre de l’enquête mondiale PISA concernant 65 pays et s’appuyant sur des tests effectués par 470 000 élèves – les compétences acquises par les élèves dans les différents systèmes éducatifs. Cette enquête ne se borne pas à comparer l’efficacité du système éducatif français et des systèmes propres à chacun des 64 autres pays concernés. Elle permet également de mesurer l’influence du milieu familial, dans ses différentes composantes, sur les performances des écoliers.
1. À la fin de la troisième, les inégalités sociales d’orientation s’ajoutent aux différences sociales de performances scolaires
Pour la plupart des élèves, les inégalités socialement différenciées à l’école relèvent jusqu’au brevet des collèges des performances scolaires. Après la troisième, apparaissent des « inégalités d’orientation » tenant au fait que le choix entre les différentes filières (générale et technologique, professionnelle, vers l’apprentissage, etc.) est lié au milieu social à résultats scolaires comparables.
Plusieurs travaux ont permis de constater l’existence d’une segmentation sociale des classes dès le collège, via le choix des options ou des langues vivantes, à profil scolaire comparable. Seul le lien entre le choix des filières après la troisième et les catégories sociales des familles des élèves a fait l’objet d’études statistiques.
Un certain nombre de sociologues de l’éducation voient dans ce lien un phénomène majeur, auquel Pierre Merle a donné le nom de « démocratisation ségrégative » : l’accès d’un très grand nombre d’élèves au lycée s’accompagnerait d’un maintien – voire d’un renforcement – du lien entre performances scolaires et catégories sociales, induit par une spécialisation sociale – peut-être – croissante des filières.
Mathieu Ichou et Louis-André Vallet ont analysé le phénomène d’éviction des enfants de catégories populaires au cours des transitions entre les compartiments successifs du système éducatif, en comparant les cursus scolaires de deux cohortes : celle de l’Institut des études démographiques (Ined) de 1962 – constituée de 17 500 enfants nés autour de 1951 –, et le panel 1995 du ministère de l’Éducation nationale – constitué de 18 800 élèves nés autour de 1984 et quittant l’école élémentaire pour la classe de sixième en 1995 (111).
Ils soulignent l’existence de plusieurs transitions par l’orientation aux âges de 11, 15 et 18 ans pour la cohorte de 1962 et aux âges de 15 et 18 ans pour la cohorte de 1995, transitions au cours desquelles a lieu l’éviction des enfants des classes populaires.
Analysant le parcours scolaire des écoliers de la cohorte de 1962, les auteurs soulignent que « les enfants d’ouvriers [qui formaient dans cette cohorte] presque la moitié de la population soumise à la première transition [à 11 ans, à l’entrée en sixième], ne représentent plus qu’un cinquième environ de l’ensemble des élèves confrontés à la troisième transition [à 18 ans, à l’issue du cursus secondaire] ». À l’entrée en sixième les différences d’orientation scolaire entre classes sociales étaient fondées pour un tiers sur la performance scolaire des écoliers (effet primaire de l’origine sociale) et pour deux tiers par des décisions d’orientation différenciées socialement à niveaux de performance comparable (effet secondaire de l’origine sociale). Pour les transitions ultérieures (à 15 et 18 ans), les inégalités sociales mesurées au sein de la cohorte de 1962 se résumaient à des inégalités d’orientation, sans prise en compte statistiquement mesurable des résultats scolaires.
Cette situation contraste avec celle observée dans la cohorte des élèves du panel de 1995. En premier lieu, la transition à 11 ans n’existe plus, en raison de l’accès au collège de la totalité de cette classe d’âge. Les inégalités apparaissent donc à 15 ans – après la troisième – et se poursuivent après le bac. Pour ces transitions, les auteurs indiquent qu’« inégalité de réussite et inégalité d’orientation à réussite donnée, jouent à parts égales dans la création de l’inégalité totale entre enfants de la classe supérieure et enfants d’ouvriers ».
Selon Mme Marie Duru-Bellat, sociologue, ce constat est loin d’être une spécificité française et se trouve « régulièrement avéré dans la sociologie européenne » (citant en exemple des travaux en Grande-Bretagne et en Suède). Les raisons de ce phénomène, dans un contexte où la capacité de décision en matière d’orientation relève, en partie et de façon croissante, des familles, font l’objet de recherches sociologiques qui étudient les phénomènes « d’auto-sélection » ou « d’auto-censure » par lesquels les familles ajustent leurs ambitions pour leurs enfants en fonction de l’utilité qu’elles attribuent aux études envisagées et de la crainte que celles-ci leur inspirent (112).
Mme Marie Duru-Bellat précise que « les demandes sont marquées par une auto-sélection inégale selon les milieux sociaux : quand l’élève est très bon, ou très faible, les vœux des familles sont uniformément ambitieux, ou au contraire modestes ; mais une forte diversité caractérise les vœux des élèves plus moyens, structurée avant tout par l’origine sociale ».
En réponses aux questions des rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale confirme ce constat en indiquant notamment que les « analyses réalisées à partir [des panels de sa direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance – DEPP] mettent en évidence d’importantes disparités sociales de choix d’orientation, à notes comparables parmi les élèves aux résultats moyens ou faibles. Ainsi, parmi les élèves entrés en sixième en 1995 ayant obtenu au contrôle continu du brevet une note entre 10 et 12, la seconde générale ou technologique est demandée par 94 % des enfants de cadres et d’enseignants mais seulement par les deux tiers des enfants d’agriculteurs ou d’ouvriers. La variabilité de demande est aussi très forte parmi les élèves qui obtiennent entre 8 et 10 : dans cette situation, les trois quart des enfants de cadres et d’enseignants et seulement le tiers des enfants d’ouvriers expriment un vœu d’orientation en seconde générale et technologique. »
Le tableau suivant appuie ces constations et montre de surcroît que la différenciation sociale des vœux d’orientation n’est pas nulle, même pour les meilleures et plus basses notes constatées au contrôle continu du brevet.
VŒUX D’ORIENTATION EN SECONDE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE SELON LE MILIEU SOCIAL ET LES NOTES AU CONTRÔLE CONTINU DU BREVET DES COLLÈGES
(élèves parvenus en troisième générale sans ou après un redoublement)
(en %)
Note au contrôle continu du brevet |
Ensemble |
Agriculteur |
Artisan, commerçant |
Cadre et enseignant |
Profession intermédiaire |
Employé |
Ouvrier |
15 et + |
99,5 |
ns |
ns |
100,0 |
99,6 |
98,9 |
98,9 |
Entre 12 et 15 |
95,6 |
90,9 |
93,0 |
99,3 |
97,6 |
94,8 |
92,1 |
Entre 10 et 12 |
77,2 |
63,6 |
84,2 |
94,0 |
84,0 |
77,2 |
64,6 |
Entre 8 et 10 |
46,2 |
ns |
46,1 |
74,2 |
55,4 |
44,0 |
35,7 |
Moins de 8 |
13,9 |
ns |
ns |
ns |
15,3 |
15 |
8,2 |
Ensemble |
71,2 |
68,1 |
80,5 |
93,0 |
80,4 |
66,8 |
55,6 |
Lire ainsi : lorsqu’ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 15 au contrôle continu du brevet et sont parvenus en 3e générale, 99,5 % des jeunes formulent un premier vœu d’orientation en 2de générale et technologique.
Source : panel d’élèves du second degré recruté en 1995. Enquête Jeunes 2002 (DEPP)
Le lien entre catégories sociales des familles et choix d’orientation des élèves – à résultats scolaires comparables – est donc patent. Pour autant qu’il puisse être mesuré, son influence sur le sort scolaire des élèves semble au moins aussi forte que celle des résultats scolaires eux-mêmes. Ce lien apparaît d’autant plus fondamental qu’il est souvent voilé par celui entre catégories sociales des familles et résultats scolaires des élèves. Il interroge en tout état de cause fortement les mécaniques institutionnelles, professionnelles, culturelles et individuelles en action autour des vœux, des choix et des décisions d’orientation.
2. La France semble caractérisée par un nombre important d’élèves de niveau très faible issus des catégories populaires
Par son ampleur et son caractère systématique, l’enquête Program for International Student Assessment (PISA) constitue une base de données sans équivalent sur le niveau de compétences réelles acquises par les écoliers dans le cadre de leur scolarité (indépendamment du niveau académique ou de diplôme usuellement employé dans les enquêtes statistiques) ainsi que sur les variables d’environnement susceptibles d’influer sur cette scolarité (catégorie sociale, niveau d’études des parents, conditions matérielles des ménages…)
PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans 31 pays partenaires. Dans chacun des pays participants, entre 4 000 et 10 000 élèves (4 300 pour la France) passent des tests écrits avec des questions ouvertes ou à choix multiples et fournissent par ailleurs des informations sur leur environnement familial en réponse à un questionnaire. Ces élèves sont choisis à partir de la construction d’un échantillon aléatoire d’établissements scolaires (publics ou privés), ainsi que sur un critère d’âge (entre 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois au début de l’évaluation), et non en fonction de lieu de scolarisation.
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DE 15 ANS NÉS EN 1993
AYANT PARTICIPÉ À L’ÉVALUATION PISA EN 2009, EN FRANCE
Classe fréquentée |
Répartition (en %) | |
En avance |
1re générale et technologique |
2,5 |
« À l’heure » |
2de générale et technologique 2de professionnelle |
51,4 9,2 |
En retard |
3e 4e |
31,9 3,6 |
Autre ou inconnu |
1,4 |
Lecture : 51,4 % des élèves de l’échantillon sont en 2de GT
Source : MEN-DEPP/OCDE
L’approche propre à l’enquête PISA est l’évaluation des compétences des élèves indépendamment de tout programme d’enseignement spécifique. Il s’agit d’évaluer l’aptitude des élèves à appréhender et résoudre des problèmes décrits dans le cadre d’une situation de vie quotidienne. Les tests sont mis au point par un groupe d’experts internationaux et rédigés dans deux langues internationales – le travail d’adaptation des questionnaires aux contextes locaux est limité à une simple traduction.
EXEMPLE DE TEST PISA MESURANT LES COMPÉTENCES DE BASE
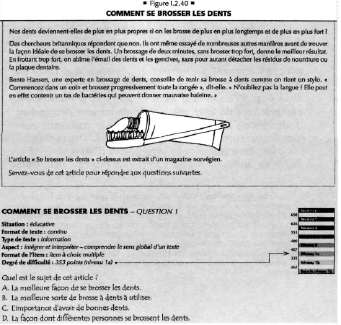
Source : Que sais-je ?
Bien qu’elles rassemblent de nombreuses données, l’enquête PISA se caractérise par la simplicité d’expression de ses résultats. Les scores réalisés par chacun des élèves retenus dans l’échantillon sont agrégés au niveau national pour former un score moyen, comparable en valeur absolue aux scores moyens dans les autres pays participants. Trois scores PISA par pays sont rendus publics, un pour chaque domaine éducatif évalué (lecture et compréhension de l’écrit, mathématique, science). L’OCDE ne publie pas de moyenne des trois indicateurs. Les observateurs se réfèrent principalement à l’indicateur Lecture et compréhension de l’écrit.
Le ministère de l’Éducation nationale, en réponse aux rapporteurs, considère que la méthode et les résultats des enquêtes PISA sont pertinents et à prendre en compte. La réserve qu’il émet concerne les conclusions tirées de ces enquêtes par certains observateurs, notamment les préconisations d’importation « clés en main » de modèles étrangers. Le ministère indique qu’« on peut toujours émettre des réserves sur tel ou tel aspect méthodologique d’une enquête mais, globalement, les enquêtes PISA sont de grande qualité même si elles sont toujours perfectibles sur certains points sur lesquels la France travaille en s’impliquant le plus possible dans les travaux de l’OCDE pour faire entendre la voix de ses experts et améliorer la qualité des évaluations. Au-delà des résultats, il est, bien sûr, toujours possible d’émettre des réserves sur l’interprétation parfois simpliste qui peut être faite des résultats, notamment de leur mise en relation avec les caractéristiques des systèmes éducatifs ou économiques et les modèles mis en avant comme exemples de bonnes pratiques ».
a. Les élèves français obtiennent aux tests internationaux PISA un score moyen quasiment égal à la moyenne des scores des pays participants à l’enquête
Au regard des derniers tests PISA rendus publics (PISA 2009, les résultats PISA 2012 n’étant pas connus), les scores moyens obtenus par les élèves français placent la France en 19e position parmi les 35 pays de l’OCDE participants.
SCORES PISA DE LA FRANCE ENTRE 2000 ET 2009
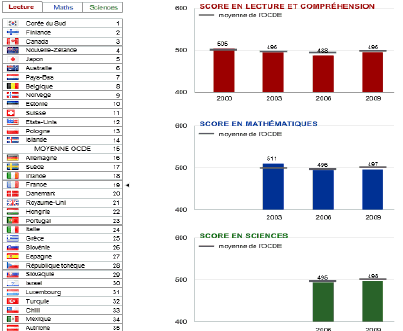
Source : OCDE - PISA
Les élèves français obtiennent des scores de niveau moyen, peu différents de leurs homologues britanniques ou allemands. Les scores français sont considérés comme globalement stables par l’OCDE, hormis en mathématiques où un mouvement de baisse a été observé en 2006 par rapport à 2003, mais ne s’est pas poursuivi. Dans ce domaine, le score obtenu par les élèves de l’échantillon français – de 511 points en 2003 –, se situait au-dessus de la moyenne de l’OCDE (500 points). Il s’est établi en 2009 à 497 points, soit un niveau proche de la moyenne des pays de l’OCDE (499 points) (113).
Comme l’illustre le tableau ci-après, la France partage sa position médiane en lecture et en compréhension de l’écrit au sein des pays de l’OCDE avec une quinzaine d’autres pays dont les scores varient entre 488 et 503 points.
LISTE DES PAYS DONT LE SCORE EN LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
SE SITUE AUTOUR DE LA MOYENNE DES PAYS DE L’OCDE

b. Les élèves français les plus faibles obtiennent des résultats plus mauvais en moyenne que les élèves les plus faibles des autres pays de l’OCDE
Les indicateurs de répartition des scores PISA montrent que les élèves les plus faibles connaissent en France des difficultés scolaires plus élevées que dans les pays ayant des performances comparables, y compris des pays dont les résultats moyens sont plus faibles qu’en France.
Le graphique ci-dessous illustre pour les pays de l’OCDE les écarts de scores PISA entre élèves classés par centile en fonction de leurs résultats. Dans ce même graphique, les pays sont classés entre eux en fonction du score du groupe d’élèves occupant une médiane au sein de la distribution – au 50e percentile, à stricte égalité entre les deux extrémités de la distribution des scores.
ÉCHELLE DES SCORES DANS LES PAYS PARTICIPANTS À PISA
OBTENANT LES SCORES MÉDIANS LES PLUS ÉLEVÉS
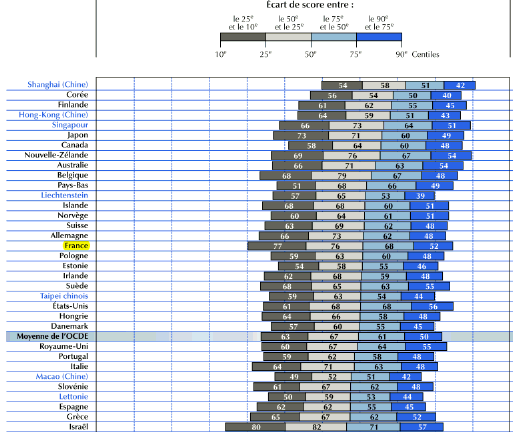
Source : PISA 2009 : Surmonter le milieu social. L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage, volume II, p. 27, OCDE, 2011
Un premier enseignement de ce graphique est que la modalité de classement des pays qui le caractérisent– s’appuyant sur le score PISA obtenu par les élèves se situant au 50e percentile – donne à la France une place plus avantageuse que celle issue du classement des scores moyens (cf. le a. ci-dessus). Le rang de classement au titre du score PISA des « élèves médians » place la France au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. On peut sans doute en conclure que le score moyen français est « lesté » vers le bas par les scores des élèves dont les résultats sont inférieurs à ceux des « élèves médians » se situant au 50e percentile. Il s’agit d’un premier indice de l’existence d’un volant d’élèves français dont les scores sont très faibles.
En second lieu, l’éventail des scores obtenus par les élèves français est nettement plus large que dans la plupart des pays recensés par ce graphique. Mis à part Israël dont la position semble atypique, la différence des scores PISA entre élèves des 25e et 10e percentiles est élevée en France comme dans aucun autre pays (77 points de différence). Le même constat est valable pour les écarts des scores PISA entre élèves des 50e et 25 e percentiles, ainsi qu’entre élèves des 75e et 50e percentiles : ces écarts sont en France nettement supérieurs à la moyenne de l’OCDE, et sont souvent les plus importants de tous les pays classés (114). Enfin, on note des écarts de score PISA entre élèves des 90e et 75e percentiles plus élevés qu’en France dans peu de pays (115).
Au total, on constate que :
– le score PISA des élèves français du 10e percentile est nettement plus faible que celui de tous les pays recensés dans le tableau (hormis Israël), y compris les pays moins bien classés que la France. Ce constat confirme l’existence en France d’une frange d’élèves dont les résultats sont très faibles, c’est-à-dire dont les perspectives scolaires, de formation et professionnelles sont sombres ;
– le score des élèves français du 90e percentile est relativement élevé, plus élevé que celui des élèves du 90e percentile de six pays mieux classés que la France dans ce graphique (116).
Le système scolaire français semble ainsi caractérisé à la fois par une capacité certaine à valoriser les bons élèves et par une incapacité inquiétante à proposer une chance de progrès aux élèves les plus faibles.
c. Les performances des élèves français les plus faibles ont tendance à fléchir
Depuis 2003, l’OCDE rassemble les élèves dans plusieurs groupes de niveau en fonction de leurs scores PISA et compare les effectifs de chaque groupe dans les pays participant à l’enquête. Ces groupes de niveau sont réalisés dans les trois domaines d’enquête – lecture et compréhension de l’écrit, mathématiques, sciences – et correspondent à des savoir-faire ou des compétences scolaires définis, par exemple pour la lecture et la compréhension de l’écrit, comme l’indique l’encadré suivant.
DÉFINITION DES GROUPES DE NIVEAU DANS LE DOMAINE DE LA LECTURE
ET DE LA COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
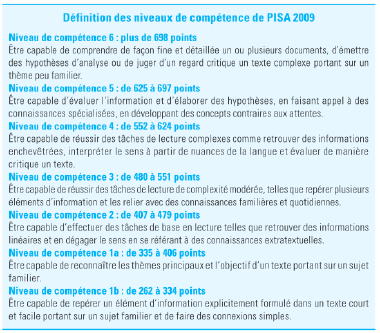
Source : note d’information 10.24 de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale.
L’analyse des résultats des enquêtes PISA selon les groupes de niveau fait apparaître que les proportions d’élèves ayant des compétences particulières sont très différents selon les pays. Ainsi, comme le montre le graphique suivant s’agissant de la compréhension de l’écrit (pour l’enquête PISA 2009), la proportion des élèves que leur score PISA situe dans les groupes de niveau 2 ou inférieurs peut varier entre environ 5 % et plus de 80 %. Les proportions des élèves se situant dans un groupe de niveau 3 ou supérieur varient d’environ 5 % à plus de 90 %.
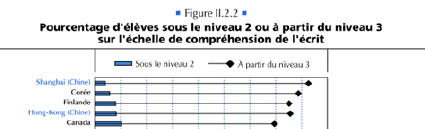
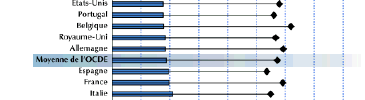
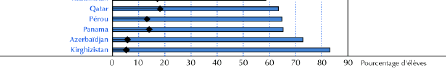
Source : PISA 2009 : Surmonter le milieu social. L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage, volume II, p. 41, OCDE, 2011
Ce graphique montre que la France compte parmi ses élèves de 15 ans une proportion d’élèves faibles (situés dans les groupes de niveaux 2 et inférieurs) supérieure à la moyenne constatée dans les pays de l’OCDE.
En tendance, le ministère de l’Éducation nationale souligne – considérant le tableau suivant transmis en réponse aux questions des rapporteurs – une baisse de 15 points du score moyen obtenu par les élèves garçons français, observée entre 2000 et 2009 pour la lecture et la compréhension de l’écrit.
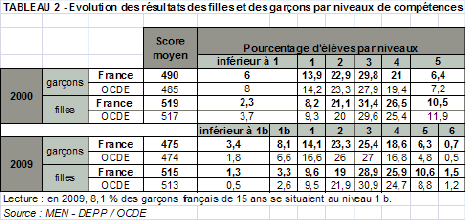
Selon les deux enquêtes 2000 et 2009 prises en compte dans ce tableau, l’effectif des garçons se situant à des niveaux inférieurs au niveau 1 – soit des niveaux très faibles de compétences scolaires – a doublé, passant de 6 % à 11,5 % de l’effectif. Cette proportion est ainsi désormais supérieure à la moyenne constatée dans les pays de l’OCDE (8,4 % en 2009). Sur la même période, la proportion des filles françaises situées à des niveaux inférieurs au niveau 1 a elle aussi dépassé la proportion constatée pour les pays de l’OCDE (en 2009, ces proportions s’élèvent à 4,6 % en France et 3,1 % dans l’OCDE).
Sur la même période 2000-2009, la proportion d’élèves français se situant aux niveaux les plus élevés (niveaux 6 et 5 – permettant selon l’OCDE de poursuivre des études supérieures et d’intervenir dans la recherche et l’innovation) a augmenté et est devenue supérieure à celle de la moyenne des pays de l’OCDE (9,5 % des élèves français et 7,6 % en moyenne dans l’OCDE). Cette proportion demeure toutefois nettement inférieure aux taux observés en Finlande (21 %), en Nouvelle-Zélande (18 %), au Japon, au Canada ou en Australie (15 %).
Ces éléments relatifs au poids en France des groupes d’élèves les plus faibles et les plus forts confirment que les scores moyens français masquent une grande hétérogénéité des performances des élèves, nettement plus accentuée que dans la plupart des pays de l’OCDE. On constate ainsi l’existence en France – plus qu’ailleurs – de nombreux élèves en très grande difficulté scolaire, de telle façon que leur situation les handicapera pour la poursuite de leur formation initiale, leur insertion sur le marché du travail et l’évolution de leur carrière professionnelle.
d. En France, le lien entre les performances scolaires et l’environnement social, économique et culturel des élèves est particulièrement important pour ceux d’entre eux obtenant des scores faibles
Afin d’apprécier l’environnement familial des élèves, l’OCDE a établi un indicateur composite dénommé l’indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC). L’indice SESC est la synthèse de plusieurs variables, recueillies auprès des élèves participant à l’enquête, caractérisant : plus haut niveau d’étude atteint par les parents (117), statut socioprofessionnel le plus élevé des parents (118), quantité de biens culturels – par exemple les livres – possédés dans la famille (119) (120)… Après traitement de ces variables, est attribuée à chaque élève une valeur de l’indice SESC, qui varie entre les bornes - 4 et + 4.
Dans chaque pays, l’OCDE définit un groupe d’« élèves favorisés » du point de vue de l’indice SESC ; ce sont ceux qui appartiennent au quartile supérieur de la répartition SESC de leur pays. De la même façon, les « élèves défavorisés » appartiennent au quartile inférieur au regard de l’indice SESC. Dans chaque pays, l’OCDE définit également – via la constitution de quartiles –, des groupes d’élèves « peu performants » et « performants », sur la base des scores PISA obtenus par eux.
L’OCDE établit pour chaque pays le degré de corrélation entre les scores PISA des élèves et leur environnement socio-culturel, mesuré par l’indice SESC. Il s’agit de déterminer quelles sont les caractéristiques des systèmes éducatifs pour lesquels cette corrélation est faible, c’est-à-dire dans lesquels la mobilité sociale semble la plus forte.
Plusieurs éléments issus de ces études donnent à penser qu’en France les différences de performances entre les élèves aux tests PISA sont davantage liées à leur statut socio-culturel que dans les autres pays de l’OCDE, et ce plus particulièrement s’agissant des élèves qui obtiennent les scores de compétences les plus faibles.
En premier lieu, l’OCDE calcule dans chaque pays la variation moyenne de score PISA lorsque l’on progresse d’une unité sur l’échelle de l’indice SESC. Le graphique suivant retrace la valeur de ce « gradient socio-économique » dans les pays de l’OCDE.
GRADIENT SOCIO-ÉCONOMIQUE PISA POUR L’ENSEMBLE DES PAYS DE L’OCDE
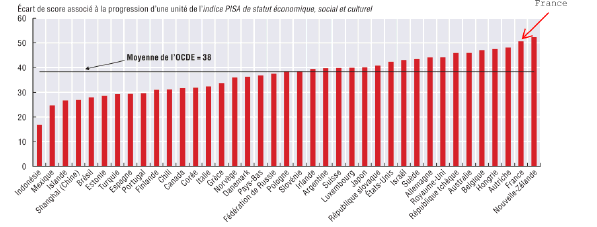
Lecture : lorsque l’indice SESC des élèves de l’échantillon français varie de un point (par exemple de +2 à +3), leur score PISA augmente en moyenne de 51 points.
La pente du gradient socio-économique est positive dans tous les pays de l’OCDE et s’établit en moyenne à 38 points de score PISA par augmentation d’une unité de l’indice SESC. Le lien entre performances scolaires et environnement socio-culturel est donc vérifié dans chaque pays. Pour la France, la valeur du gradient socio-économique s’élève à 51 points de score PISA par augmentation d’une unité de SESC en France, soit une valeur parmi les plus élevées, nettement au-dessus de la moyenne constatée au sein de l’OCDE.
La portée de ce résultat en France doit être précisée, en posant la question de la constance de ce lien pour chacun des niveaux de performances scolaires. Le graphique suivant précise, pour un certain nombre de pays de l’OCDE, quelles sont les valeurs des indices SESC constatées pour les élèves performants (se situant au niveau 4 pour les résultats PISA) et pour les élèves les plus performants (situés aux niveaux 5 et 6).
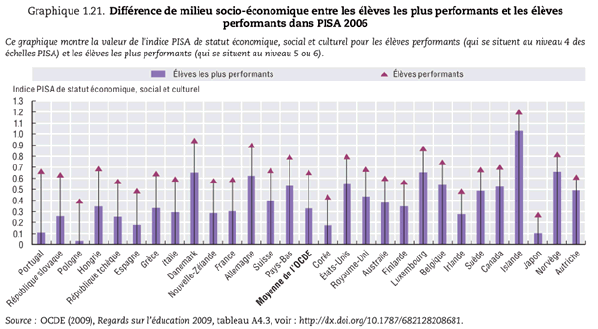
Il faut noter en premier lieu que, dans tous les pays recensés, l’indice SESC moyen des élèves performants est plus élevé que celui associé aux élèves les plus performants. L’environnement socio-culturel aurait moins d’impact au sommet de l’échelle des résultats scolaires, c’est-à-dire à des niveaux de compétences où les capacités cognitives s’expriment et se manifestent en tout état de cause ou malgré tout.
Dans ce graphique, la position de la France – proche de la moyenne de l’OCDE – n’est pas remarquable. S’il faut relativiser la portée de ce graphique, qui peut être interprété comme une simple comparaison des niveaux socio-culturels des familles des meilleurs élèves dans les pays de l’OCDE, les résultats pour la France contrastent avec ceux constatés précédemment, pour lesquels sa position était atypique, s’agissant notamment de la forte dispersion des résultats aux tests PISA et de la forte intensité du lien global entre performances scolaires et environnement socio-culturel.
On peut précisément déduire de ce contraste que, si ce lien global est intense en France, c’est parce qu’il est très fortement marqué – plus que dans la plupart des pays de l’OCDE – pour les élèves les plus faibles. Au demeurant, ce constat est confirmé par les calculs de l’OCDE. Le gradient socio-économique français n’est pas linéaire. Ce gradient est dans notre pays accentué bien plus pour les élèves les plus faibles, qui se trouvent donc être en moyenne, plus souvent que dans les autres pays de l’OCDE, des élèves moins favorisés par leur environnement socio-culturel.
D’autres études de l’OCDE montrent que 30 % des élèves français de milieux sociaux défavorisés obtiennent des résultats PISA meilleurs qu’attendus au regard de cet environnement socio-culturel. Cette proportion, qui correspond à la moyenne observée dans les pays de l’OCDE, est supérieure à celle observée au Danemark, en Allemagne ou au Royaume Uni, pays pour lesquels elle s’établit de 22 % à 24 % (121).
Au total, le résultat le plus significatif – inquiétant – issu des enquêtes PISA est le suivant : notre système scolaire ne parvient pas, bien au contraire, à tirer vers le haut les élèves moyens ou faibles des classes populaires, nombre d’entre eux se retrouvant handicapés – à la fin de la scolarité obligatoire – par des niveaux de compétences si faibles qu’ils rendent problématique le succès de tout effort ultérieur de formation, d’accompagnement ou de seconde chance.
À l’inverse, notre système scolaire ne « produit » pas moins de bonnes performances qu’ailleurs, y compris en valorisant les capacités d’élèves disposant au départ de peu de « ressources socio-culturelles ». Il n’est cependant pas envisageable de se satisfaire d’un système scolaire qui ne saurait s’occuper que des « bons » élèves.
E. AU FINAL, L’ACCÈS AU BAC ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES DEMEURE SOCIALEMENT TRÈS DIFFÉRENCIÉ
1. Malgré la forte augmentation du nombre de bacheliers, les inégalités d’accès au baccalauréat persistent
Le tableau suivant présente, pour les élèves du panel de ceux entrés en sixième en1995 étudié par le ministère de l’Éducation nationale, leur trajectoire scolaire globale au regard de leur origine sociale.
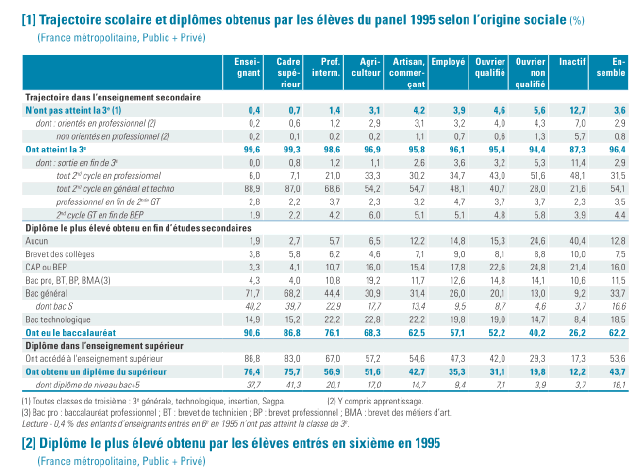
Source : Panel 1995, ministère de l’Éducation nationale
Ce tableau retrace in fine le cumul des différences des parcours scolaires aux niveaux secondaire et supérieur, en considérant les origines sociales des élèves. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés, dont certains ont été documentés supra :
– la première grande « césure sociale » des parcours scolaires est l’orientation à l’issue de la classe de troisième (122). Les enfants d’ouvriers qualifiés et non qualifiés et les enfants de personnes inactives sont beaucoup plus nombreux qu’en moyenne à intégrer la voie professionnelle. À l’inverse, une proportion très faible des enfants d’enseignants et de cadres supérieurs n’intègrent pas une classe de seconde générale ou technologique ;
– les différences sociales sont très marquées ensuite s’agissant des sorties de l’enseignement secondaire sans diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges. Cette situation concerne la moitié des enfants d’inactifs et plus d’un tiers des enfants d’ouvriers non qualifiés, pour une moyenne d’environ 20 % toutes catégories sociales confondues ;
– le taux d’accès au bac demeure très différencié socialement, s’échelonnant de plus de 90 % pour les enfants d’enseignants à 40,2 % et 26,2 % respectivement pour les enfants d’ouvriers non qualifiés et de personnes inactives. Ces taux globaux masquent par ailleurs des différences sociales marquées concernant la filière suivie pour obtenir le bac. En relevant seulement deux exemples, on constate que 40 % environ des enfants d’enseignants et de cadres supérieurs obtiennent un bac S, alors que cette proportion s’élève en moyenne à 16,6 % pour l’ensemble du panel. Un tiers des enfants d’ouvriers non qualifiés qui obtiennent le bac ont suivi une filière générale, cette proportion s’élevant à nettement plus de 50 % en moyenne pour l’ensemble du panel ;
– l’enseignement supérieur accentue encore la différenciation sociale d’accès aux diplômes : 84 % des enfants d’enseignants ayant obtenu le bac accèdent à un diplôme de l’enseignement supérieur, cette proportion étant inférieure à 50 % pour les bacheliers dont les parents sont ouvriers non qualifiés ou inactifs.
2. Les classes préparatoires aux grandes écoles, point culminant de la différenciation sociale des parcours scolaires
Plus de 80 000 étudiants étaient en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) à la rentrée 2011-2012. Sélectionnés sur dossier, ces élèves se distinguent par leurs performances scolaires : près des trois quarts des nouveaux bacheliers présents en CPGE ont réussi leur baccalauréat avec au moins une mention assez bien. Le destin professionnel des élèves des CPGE est tout aussi spécifique. Un grand nombre des anciens élèves des CPGE occupent des postes de travail pour lesquels les responsabilités, les rémunérations et les perspectives de carrière se situent à un niveau très supérieur à la moyenne.
Le tableau suivant, s’appuyant sur le panel établi par le ministère de l’Éducation nationale d’élèves entrés en sixième en 1995, indique que les CPGE constituent le point d’arrivée du processus français de différenciation sociale des parcours scolaires.
CONSTRUCTION DES DISPARITÉS SOCIALES DES ÉLÈVES ENTRANT EN CPGE EN 2002 DEPUIS L’ENTRÉE EN 6e EN 1995
En %
1995 |
1999 : secondes |
2001 : terminales |
2002 | |||||
Catégories socio-professionnelles |
6e |
2de gén. et techn. |
2de prof. |
S |
L |
ES |
Techn. |
CPGE |
Agriculteurs |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Artisans, commerçants |
8 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
8 |
7 |
Professions libérales, |
12 |
20 |
4 |
29 |
20 |
21 |
11 |
42 |
Professions intermédiaires (2) |
15 |
18 |
12 |
19 |
18 |
19 |
17 |
14 |
Enseignants |
3 |
5 |
1 |
8 |
8 |
5 |
2 |
12 |
Employés |
16 |
17 |
17 |
13 |
17 |
17 |
19 |
9 |
Ouvriers |
32 |
22 |
41 |
15 |
18 |
20 |
29 |
6 |
Retraités |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
Sans activité, chômeurs n’ayant jamais travaillé |
11 |
6 |
14 |
4 |
6 |
5 |
8 |
3 |
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
(1) hors professeurs
(2) hors instituteurs
Source : DEP, ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la recherche
La référence à la classe de sixième permet de fixer la réalité de la dispersion sociale de la société française en 1995, puisque tous les élèves des écoles primaires accèdent à cette classe. Le point d’arrivée dans les CPGE est frappant par la radicalité de la distorsion sociale de leur composition par rapport à la référence de la classe de sixième. Dans les CPGE, La proportion d’enfants d’ouvriers est divisée par plus de 5 par rapport à la sixième. À l’inverse, les proportions d’enfants d’enseignants et de professions libérales et cadres supérieurs sont multipliées d’un facteur 3 à 4 entre la sixième et les CPGE. Ils sont d’ailleurs majoritaires dans ces classes, alors qu’ils ne représentaient que 15 % des effectifs en sixième.
La sélection des élèves des CPGE approfondit le processus de « sélection sociale » interne au lycée, dans lequel la voie d’excellence est la série S. Beaucoup des élèves des CPGE sont des bacheliers des séries S, parce que la majorité des effectifs des CPGE préparent les écoles d’ingénieurs et parce qu’une proportion non négligeable des effectifs des CPGE littéraires et économiques est recrutée parmi les bacheliers de la série S. La distorsion sociale des effectifs des CPGE est nettement plus forte que celle de la série S, ce qui laisse penser que se déroule au moment de l’orientation en terminale un processus analogue à celui décrit supra à la fin de la troisième, mêlant à la fois sélection via les résultats scolaires et auto-censure.
ANNEXE N° 2 :
LES DISPOSITIFS PUBLICS CONCOURANT
À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES
Le présent tableau retrace les dispositifs identifiés comme concourant à la mobilité sociale des jeunes et financés sur le budget de l'État.
Les indicateurs disponibles sont ceux figurant dans les projets annuels de performance des missions correspondantes (PAP), annexés au projet de loi de finances pour 2013.
Intitulé du dispositif |
Coût |
Nombre de bénéficiaires |
Acteurs et partenaires |
Indicateurs d’efficacité disponibles |
1. Mission : Enseignement scolaire 1.1. Programme : Enseignement scolaire public du premier degré | ||||
Programme personnalisé de réussite éducative |
Absence de données sur les moyens mis en place |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
Établissements scolaires du primaire |
* INDICATEUR 1.3 : Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard ; * INDICATEUR 1.4 : Taux de redoublement. |
1.2. Programme : Enseignement scolaire public du second degré | ||||
Orientation scolaire |
303 millions d'euros en LFI 2013 |
Le nombre de consultations des centres d'information et d'orientation n'est pas connu (pour une population de 2,7 millions d'élèves scolarisés entre la 3e et la terminale) |
* Acteurs : - 527 centres d'information et d'orientation * Partenaires : - Onisep, pour la fourniture des informations relatives aux métiers - branches professionnelles, dans le cadre de relations contractuelles avec le ministère de l'éducation nationale - collectivités locales (départements et régions) pour le financement du fonctionnement de la moitié des CIO environ et d’actions spécifiques |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs |
54 millions inscrits en LFI 2013 |
35 000 élèves |
* Préfet de région et recteur (pour le périmètre d'intervention) * Préfet de département, pour la mise en œuvre opérationnelle * Centre d'information et d'orientation (CIO) et missions locales, pour l'animation |
* INDICATEUR 1.3 Proportion des jeunes âgés de 20 à 24 ans possédant au moins un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement secondaire * INDICATEUR 1.4 Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation |
Éducation prioritaire |
1,2 milliard d'euros pour la LFI 2009, selon une estimation de la Cour des Comptes dans un rapport consacré à ce sujet (écoles primaires, collèges et lycées) |
– 515 000 collégiens – absence de données sur le nombre de lycéens concernés |
Établissements scolaires publics |
* INDICATEUR 2.1 : Réussite des élèves issus de familles appartenant aux PCS défavorisées * INDICATEUR 2.2 : Écarts des pourcentages d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les compétences 1 et 3 du socle commun (palier 3) entre ECLAIR et hors Éducation prioritaire et entre Réseaux de réussite scolaire et hors Éducation prioritaire * INDICATEUR 2.3 : Écart des taux de réussite au brevet, en ECLAIR - hors EP et en RRS - hors EP * INDICATEUR 2.4 : Écart des taux d’encadrement en collège (Élèves par division) en ECLAIR - hors EP et en RRS - hors EP |
Formation professionnelle alternée sous statut scolaire |
4,1 milliards d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
550 000 élèves |
* Établissements scolaires professionnels * Entreprises privées et employeurs publics |
* INDICATEUR 1.10 Taux d’accès à un bac professionnel des élèves de seconde professionnelle * INDICATEUR 1.7 : Taux d’accès à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un BTS des élèves et apprentis de 1ère année des cycles de formation correspondants * INDICATEUR 4.3 Taux de poursuite des bacheliers professionnels vers un BTS * INDICATEUR 4.4 : Écarts de pourcentage entre les jeunes en situation d’emploi 7 mois après leur sortie du lycée (hors ceux qui poursuivent des études) - selon le diplôme - et les 25-49 ans en situation d’emploi [programme 139] |
Programme personnalisé de réussite éducative |
Absence de données sur les moyens mis en place |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
Établissements scolaires du premier degré du secondaire |
INDICATEUR 1.9 : Taux de redoublement. |
1.3. Programme : Enseignement privé premier et second degrés | ||||
Formation professionnelle alternée sous statut scolaire |
760 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
150 000 élèves |
* Établissements scolaires privés professionnels * Entreprises privées et employeurs publics |
* INDICATEUR 2.8 Taux d’accès à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un BTS des élèves et apprentis de 1ère année des cycles de formation correspondants * INDICATEUR 4.3 Taux de poursuite des bacheliers professionnels vers un BTS * INDICATEUR 4.4 : Écarts de pourcentage entre les jeunes en situation d’emploi 7 mois après leur sortie du lycée (hors ceux qui poursuivent des études) - selon le diplôme - et les 25-49 ans en situation d’emploi [programme 139] |
Programme personnalisé de réussite éducative |
Absence de données sur les moyens mis en place |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
Établissements scolaires privés |
* INDICATEUR 1.3 : Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard ; * INDICATEUR 1.4 : Taux de redoublement. |
1.4. Programme : Vie de l’élève | ||||
L’accompagnement éducatif |
94 millions d'euros inscrits en LFI 2013 (non comprise la part de l'activité des personnels d'assistance éducative consacrée l'accompagnement éducatif, soit une fraction indéterminée du coût de ces personnels, inscrit à hauteur de 1,28 milliard d'euros en LFI 2013) |
950 000 élèves |
* Enseignants titulaires, dans le cadre d'heures supplémentaires * Personnels d'assistance éducative, recrutés et employés directement par les établissements scolaires * Associations |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Emplois d’avenir professeurs |
13 millions d'euros inscrits en LFI |
4 000 étudiants |
Ministère de l'Éducation nationale |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Bourses nationales de collège et de lycée |
347 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
1 150 000 élèves |
Ministère de l'Éducation nationale |
* INDICATEUR 5.1 : Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale * INDICATEUR 5.2 : Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation |
Aides au mérite |
66,8 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
83 500 lycéens |
Ministère de l'Éducation nationale |
* INDICATEUR 5.1 : Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale * INDICATEUR 5.2 : Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation |
Primes à l’internat |
2,2 millions d’euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
8 800 internes |
Ministère de l'Éducation nationale |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Fonds sociaux |
3 millions d’euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
Ministère de l'Éducation nationale |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
2. Mission : Recherche et enseignement supérieur 2.1. Programme : Formations supérieures et recherche universitaire | ||||
Orientation des étudiants (généralisation du dossier unique d’accès à l’enseignement supérieur) |
Pas d'individualisation des crédits sur ce thème dans les documents budgétaires (mobilisation des fonds propres universitaires) |
1,4 million d’étudiants en université |
Universités et établissements assimilés |
* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés (BTS, DUT, Licence professionnelle, Master, Doctorat) |
Professionnalisation des enseignements (généralisation du projet personnel et professionnel de l’étudiant, mise en place d’unités d’enseignement professionnalisantes) |
Pas d'individualisation des crédits sur ce thème dans les documents budgétaires (mobilisation des fonds propres universitaires) |
1,4 million d’étudiants en université |
Universités et établissements assimilés |
* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés (BTS, DUT, Licence professionnelle, Master, Doctorat) |
Soutien aux étudiants en difficulté (tutorat, aides à la réorientation) |
Pas d'individualisation des crédits sur ce thème dans les documents budgétaires (mobilisation des fonds propres universitaires) |
1,4 million d’étudiants en université |
Universités et établissements assimilés |
* INDICATEUR 2.2 : Réussite au DUT et BTS * INDICATEUR 2.3 : Réussite en Licence |
Développement des stages et du partenariat avec le monde économique |
Pas d'individualisation des crédits sur ce thème dans les documents budgétaires (mobilisation des fonds propres universitaires) |
1,4 million d’étudiants en université |
Universités et établissements assimilés |
* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés (BTS, DUT, Licence professionnelle, Master, Doctorat) |
Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle |
Pas d'individualisation des crédits sur ce thème dans les documents budgétaires (mobilisation des fonds propres universitaires) |
1,4 million d’étudiants en université |
Universités et établissements assimilés |
* INDICATEUR 1.2 Taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés (BTS, DUT, Licence professionnelle, Master, Doctorat) |
2.2. Programme : Vie étudiante | ||||
Bourses sur critères sociaux |
1,76 milliard d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 auxquels s’ajoutent : - 25 millions d'euros au titre du programme 224 (Transmission des savoirs et démocratisation de la culture) - 4,6 millions d'euros au titre du programme 192 (Recherche et enseignements supérieur en matière économique et industrielle). |
498 500 boursiers |
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, opérateurs |
* INDICATEUR 1.1 Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale * INDICATEUR 1.2 Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation * INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers * INDICATEUR 1.4 Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles * INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur |
Aides au mérite |
40 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
30 000 étudiants |
* Rectorats, services instructeurs * Centres des œuvres universitaires et scolaires, services payeurs. |
* INDICATEUR 1.1 Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale * INDICATEUR 1.2 Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation * INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers * INDICATEUR 1.4 Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles * INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur |
Fonds national d’aide d’urgence |
40 millions d'euros de crédits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
* Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (opérateurs) |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Fonds de garantie de prêts bancaires aux étudiants |
1 million d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
6 000 prêts étudiants par an |
* OSEO, gestionnaires du fonds de garantie * Réseaux bancaires, partenaires (Société générale, Crédit Mutuel, C.I.C., Caisses d'épargne) |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Réseau des œuvres universitaires et scolaires |
264 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013, auxquels s'ajoutent : - 26 millions d'euros pour le programme 141 (Enseignement scolaire du second degré), - 23 millions d'euros pour le programme 224 (transmission des savoirs et démocratisation de la culture) |
2,3 millions d'étudiants |
* Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
* INDICATEUR 1.1 Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale * INDICATEUR 1.2 Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation * INDICATEUR 1.3 Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers 26 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 * INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur |
Aides à la mobilité internationale des étudiants |
26 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
* Établissements d'enseignement supérieur, opérateurs |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
3. Mission : Sports, jeunesse et vie associative Programme : Jeunesse et vie associative | ||||
Réseau d’information jeunesse |
8 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
* Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) et centres régionaux d’information jeunesse (CRIJ), association structurant un réseau de 1 600 organismes locaux |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Service civique |
160 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 (correspondant à un objectif de 30 000 jeunes) |
14 000 jeunes |
* Agence du service civique * Employeurs agréés par l'agence du service civique (associations, collectivités locales...) |
* INDICATEUR 1.1 Proportion des missions de service civique réalisées par rapport aux missions agréées * INDICATEUR 1.2 Part des jeunes engagés dans le service civique et peu ou pas diplômés |
Offices franco-allemand et franco-québécois pour la jeunesse |
13 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
200 000 jeunes |
* Offices franco-allemand et franco-québécois pour la jeunesse |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse |
5 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
Ministère de la jeunesse |
INDICATEUR 1.1 : Part des expérimentations ayant fait l’objet d’un rapport d’évaluation |
4. Mission : Travail et emploi 4.1. Programme : Accès et retour à l’emploi | ||||
Missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) |
180 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
160 000 jeunes accueillis chaque année |
Collectivités locales (Communes et Conseils régionaux) |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) |
50 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
135 000 jeunes |
Missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation, opérateurs |
INDICATEUR 3.2 : Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique |
Contrats uniques d’insertion |
Les jeunes représentent près de la moitié des bénéficiaires des contrats uniques d’insertion-contrats initiative emploi (CUI-CIE) et 25 % des contrats uniques d’insertion-contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), bénéficiant ainsi de 900 millions d'euros des crédits inscrits au titre des contrats uniques d'insertion |
213 000 jeunes |
Réseau des missions locales |
* INDICATEUR 3.1 : Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat unique d’insertion |
Emplois d’avenir |
2 320 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 466 millions d'euros de crédits de paiement inscrits en LFI 2013 |
33 000 jeunes au 30 juin 2013 |
* Pôle Emploi, les missions locales et Cap emploi (opérateurs) * Associations, collectivités locales et établissements publics (employeurs du secteur non-marchand) |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Fonds d’insertion professionnelle des jeunes |
22 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
15 000 jeunes |
Réseau des missions locales |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Actions de parrainage pour l’accompagnement personnalisé |
4 millions d'euros inscrits en LFI 2013 auxquels s'ajoutent 1,9 millions d'euros au titre du programme 147 (Politique de la ville) |
20 000 personnes |
Réseau des missions locales |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
Établissements publics d’insertion de la défense (EPIDe) |
45 millions inscrits en LFI 2013 auxquels s'ajoutent 22,6 millions d'euros de crédits au titre du programme 147 (Politique de la ville) |
2 000 jeunes |
* Ministère de la Défense, opérateur ; * Secrétariat Général du Comité Interministériel à la Ville |
* INDICATEUR 3.2 : Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique |
Écoles de la deuxième chance |
21 millions d'euros inscrits en LFI 2013, auxquels s'ajoutent 2,7 millions au titre du programme 147 (Politique de la ville) |
13 000 jeunes |
* Réseau des établissements de la 2e chance * Secrétariat Général du Comité Interministériel à la Ville |
* INDICATEUR 3.2 Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique |
4.2. Programme : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | ||||
Contrats d’apprentissage |
1,250 milliard d'euros de crédits, auxquels s'ajoutent : - 850 millions d'euros en LFI 2013 au titre des programmes 787,788 et 789 ; - 7,7 millions d'euros de crédits. |
425 000 jeunes |
* Centres de formation des apprentis ; * Entreprises ; * Conseils régionaux, principaux financeurs. |
INDICATEUR 4.1 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage * INDICATEUR 1.1 : Effectif d’apprentis au 31 décembre de l’année considérée [programme 788] ; * INDICATEUR 1.1 : Taux moyen d’alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus [programme 789] * INDICATEUR 2.1 : Part des entreprises de plus de 250 salariés employant plus de 4 % d’alternants [programme 789] |
Contrats de professionnalisation |
Les contrats de professionnalisation signés par des jeunes de moins de 26 ans ne donnent pas tous lieu à une exonération spécifique de cotisation sociale compensée à la sécurité sociale à partir des crédits du programme 103 |
140 000 jeunes |
* Entreprises privées ; * Organismes paritaires collecteurs agréés, pour le financement des formations ; * Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi |
INDICATEUR 4.2 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation |
5. Mission : Égalité des territoires, logement et ville 5.1. Programme : Aide à l’accès au logement | ||||
Aides personnelles au logement |
Fraction non-individualisée de la contribution du budget de l'Etat au financement du fonds national d’aide au logement (4,8 milliards d'euros) |
700 000 étudiants |
Fonds national d’aide au logement |
* INDICATEUR 1.1 Taux d’effort net moyen des ménages en locatif (avec charges) sur trois catégories de ménages : bénéficiaires de minima sociaux, salariés et étudiants (dont boursiers et non boursiers) |
Garantie des risques locatifs |
Fraction non-individualisée de la contribution du budget de l'Etat au financement du fonds de garantie universelle des risques locatifs (10 millions d'euros) |
Fraction non- déterminée des bénéficiaires du fonds de garanti universelle (250 000 personnes) |
Union d’économie sociale pour le logement (UESL- opérateur) |
* INDICATEUR 1.1 Taux d’effort net moyen des ménages en locatif (avec charges) sur trois catégories de ménages : bénéficiaires de minima sociaux, salariés et étudiants (dont boursiers et non boursiers) |
5.3. Programme : Politique de la ville | ||||
Programme de réussite éducative |
81 millions d'euros |
130 000 élèves pour des actions collectives et 70 000 pour des actions individuelles |
Établissements scolaires publics |
* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés en ZUS * INDICATEUR 2.2 Efficience de l’allocation de moyens consacrés à la réussite éducative et aux internats d’excellence |
Cordées de la réussite |
4,5 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013, auxquels s'ajoutent 2,5 millions d'euros au titre du programme 141 et 1,5 millions au titre du programme 150 |
320 cordées labellisés |
* Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé- opérateur) * Associations de soutien scolaire * Etablissements d'enseignement scolaire |
* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés en ZUS |
Accès aux classes préparatoires aux grandes écoles |
0,4 million d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
Elèves de 15 classes préparatoires |
* Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé - opérateur) * Etablissements scolaires |
* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés en ZUS
|
Internats d’excellence |
6,7 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013, auxquels s'ajoutent 45 millions d'euros au titre du programme 230 (vie de l'élève) |
11 500 élèves |
*Acteurs : -les internats, pour la labellisation de leur établissement ; -le préfet de région et le recteur ; - ANRU, pour le financement le programme d'investissement. *Partenaires : - collectivités territoriales ; - Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), pour le financement de l'accueil des internes issus des territoires de la politique de la ville ; |
* INDICATEUR 2.1 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés en ZUS * INDICATEUR 2.2 Efficience de l’allocation de moyens consacrés à la réussite éducative et aux internats d’excellence |
6. Mission : Solidarité, insertion et égalité des chances Programme : Actions en faveur des familles vulnérables | ||||
Points d’accueil et d’écoute jeunes |
5 millions d'euros de crédits inscrits en LFI 2013 |
42 000 jeunes |
Points d’accueil et d’écoute des jeunes (350 PAEJ) |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
7. Mission : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 7.1 Programme : Liens entre la Nation et son armée | ||||
Journée défense citoyenneté |
95 millions d'euros, inscrits dans la LFI 2013 |
750 000 jeunes adultes |
Ministère de la Défense |
* INDICATEUR 1.1 Taux de satisfaction de l’"usager" de la JDC * INDICATEUR 1.2 Coût moyen par participant |
7.2 Programme : Soutien de la politique de la défense | ||||
Contrats « Pacte Junior » (Parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'Etat) |
530.000 euros inscrits en LFI 2013 |
Absence de données sur le nombre de bénéficiaires |
* Pôle emploi * Missions locales et Permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), pour la diffusion des offres d'emploi * Employeurs des trois fonctions publiques |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
8. Mission : Sécurité 8.1. Programme : Gendarmerie nationale | ||||
Gendarmes adjoints volontaires |
347 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
12 500 agents |
Ministère de l'intérieur |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
8.2. Programme : Police nationale | ||||
Adjoints de sécurité et Cadets de la République |
269 millions d'euros inscrits en LFI 2013 |
12 000 jeunes adultes (dont un millier de cadets de la République, chiffre officieux, non disponible dans les documents budgétaires) |
Ministère de l'intérieur |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
9. Mission : Action extérieure de l’État Programme : Français à l’étranger et affaires consulaires | ||||
Programme vacances-travail |
Non indiqué (faible) |
30 000 jeunes, dont 28 000 ressortissants français |
Ministère des affaires étrangères et services consulaires des pays partenaires |
Absence d'indicateur de performance dans le projet annuel de performance 2013 de la mission |
DEUXIÈME PARTIE :
MOBILITÉ SOCIALE ET FORMATION INITIALE : RÉFORMER L’ORIENTATION ET ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION
I. AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES DANS LEUR ORIENTATION
Dans l’annexe I au présent rapport, les rapporteurs évoquent la différenciation sociale des vœux d’orientation à la fin du collège. À résultats scolaires comparables – et a fortiori quand ces résultats scolaires sont moyens – les enfants des classes sociales défavorisées, et leur famille, souhaitent dans des proportions notablement plus importantes s’orienter dans une voie professionnelle. On constate au demeurant un accroissement de la proportion des fils et filles d’ouvriers non qualifiés et inactifs dans la voie scolaire professionnelle.
Cette « spécialisation sociale » de la voie professionnelle montre que le travail réfléchi de détermination par l’élève de ses vœux d’orientation pèse moins, dans un nombre de cas non négligeables, que certains préjugés ou réflexes culturels à l’œuvre dans les familles et, sans doute, dans une partie du monde éducatif. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval indique que les professeurs principaux d’un des sites étudiés considèrent, s’agissant des problématiques générales relatives à l’orientation, qu’« un effort plus particulier doit être engagé auprès des élèves issues des familles plus défavorisées. Il est parfois nécessaire de convaincre les familles que leur enfant est en capacité de poursuivre des études. »
La réflexion des rapporteurs ne consiste pas à trouver les moyens d’envoyer plus de filles et fils des catégories sociales défavorisées en seconde générale. L’étude du Céreq portant sur le panel de jeunes sortis du système éducatif en 2007 montre que le taux de chômage des jeunes en 2010 dont le plus haut diplôme est un bac général est nettement supérieur à celui des jeunes sortis de leur scolarité avec un bac professionnel ou technologique – 19 % contre 15 %. Il s’agit en revanche de donner à chaque élève, ainsi qu’à sa famille, un « bagage » de qualité – contenant notamment ce type d’informations statistiques – pour construire des vœux pensés, personnels et motivés, s’appuyant sur l’ébauche d’un projet professionnel et de vie.
A. L’ORIENTATION À LA FIN DU COLLÈGE DOIT S’APPUYER DE FAÇON CROISSANTE SUR UNE ANTICIPATION PÉDAGOGIQUE DE CETTE ÉTAPE FONDAMENTALE
1. La procédure d’orientation et d’affectation des élèves à l’issue de la troisième
a. Le fonctionnement d’Affelnet, basé sur l’équité et la transparence, n’évite pas tout risque d’orientation subie pour des élèves fragiles
Affelnet (123) est une application informatique qui permet de générer automatiquement l’affectation des élèves, après la classe de 3ème. L’affectation d’un élève comprend l’établissement scolaire public (124) dans lequel il sera inscrit et la formation précise qu’il y suivra. Pour effectuer ces affectations, Affelnet est renseigné au préalable par deux éléments :
– les vœux d’affectation émis par chacun des élèves et sa famille. Ces vœux, remis aux instances de direction du collège via un dossier d’affectation, font l’objet d’une saisie informatique dans Affelnet « par les services de la scolarité de chaque établissement », comme l’indique le ministère de l’Éducation nationale dans ses réponses adressées aux rapporteurs (autrement dit, Affelnet « n’est pas directement accessible aux élèves ou à leur famille »). Les vœux émis identifient la filière et l’établissement souhaités. Ces vœux doivent être cohérents avec la décision préalable d’orientation, qui « est prise par le chef d‘établissement d’origine de l’élève et concerne les voies d’orientation définies par décret (après la 3ème : 1ère année de CAP, 2nde professionnelle, 2nde générale et technologique) ». Plus précisément, un élève orienté vers une seconde professionnelle ne pourra pas émettre de vœux portant sur une classe de seconde générale et technologique (125) ;
– un barème basé, selon le ministère de l’Éducation nationale, sur « plusieurs éléments paramétrables académiquement : les avis des équipes pédagogiques, des critères géographiques, des notes et/ou des compétences, des critères sociaux (bourses par ex.). Le poids de ces différents éléments est fixé dans le cadre d’une politique nationale déclinée localement par le recteur en fonction du type de formation demandée et de la scolarité d’origine de l’élève ». Dans un cadre académique, le chef d’établissement est en mesure d’attribuer un certain nombre de points à chaque vœu émis, mesurant la motivation de l’élève. Les notes de l’élève en 3ème sont également prises en compte, également sous forme de points. Pour chaque vœu émis, l’élève se voit ainsi attribué un certain nombre de points sur la base de ces critères. Le ministère indique que « les critères pris en compte dans l’affectation sont communiqués à l’ensemble des parties concernées afin de contribuer à la pédagogie et à la connaissance des procédures indispensables pour aider les élèves à construire leurs choix. »
Affelnet affecte ensuite les élèves selon « un algorithme [qui] a pour objectif de favoriser l’affectation sur le 1er vœu demandé par l’élève tout en optimisant l’utilisation des capacités d’accueil dans les formations ». À une formation sont en premier lieu affectés les élèves dont il s’agit du premier choix, dans l’ordre du nombre de points associé pour chacun d’entre eux à ce choix.
Cette procédure est marquée par sa clarté et son équité de principe, d’autant plus que les notes prises en compte dans le barème font l’objet d’une harmonisation académique au regard des écarts à la moyenne constatés.
On note toutefois que le dispositif peut poser les difficultés suivantes :
1.– La décision préalable d’orientation du chef d’établissement apparaît comme le moment fondamental où se joue l’essentiel de la suite de la scolarité de l’élève, peut-être de façon plus décisive encore que la procédure Affelnet – qui consiste à déterminer l’établissement dans lequel cette décision d’orientation va être mise en œuvre. La décision d’orientation du chef d’établissement se fait au terme d’un échange qui associe également la famille – dont l’élève – et le conseil de classe.
Quand une famille conteste la proposition d’orientation émise par le conseil de classe, il lui est parfois possible de s’adresser directement au chef d’établissement, qui in fine prend la décision – en considérant également la compatibilité de ses choix à l’échelle de l’établissement avec la carte des formations présentée par sa hiérarchie académique. Des familles impliquées, ayant saisi le rôle tenu par chacun, peuvent le cas échéant obtenir en fin de processus une décision que l’équipe éducative n’avait pas envisagé de prendre. Il est probable que ces familles « combatives » appartiennent plus souvent aux classes sociales les plus favorisées et qu’elles souhaitent l’orientation de leurs enfants en seconde générale.
Si ces hypothèses étaient vérifiées, on pourrait en partie expliquer pourquoi à résultats égaux et moyens, les enfants des classes sociales plus favorisées sont plus souvent orientées vers la seconde générale et technologique. Une orientation peu préparée et pertinente pour une seconde générale et technologique peut au demeurant être très handicapante pour les élèves concernés. Le taux de redoublement en seconde générale et technologique s’élevait à presque 10 % en 2011, en baisse par rapport aux années antérieures, mais toujours à un niveau bien plus élevé qu’au collège et en première. Ce constat correspond sans doute à un « forçage » de l’orientation vers cette classe, en grande partie dû aux familles.
L’élève en difficulté à l’issue d’une seconde générale et technologique peut, via Affelnet, demander une nouvelle orientation dans la voie professionnelle. Il ne bénéficiera pas dans ce cas des points supplémentaires attribués par les principaux de collège aux élèves de 3ème au titre de la motivation dont il aurait fait preuve. Il aura donc moins de chance qu’un an auparavant d’obtenir la formation souhaitée dans la voie professionnelle, avec le handicap supplémentaire d’avoir été mis en difficulté dans un univers scolaire inadapté pendant un an.
2.– L’équité d’Affelnet repose sur la transparence des critères pris en compte pour associer à chaque vœu un nombre de points. Encore faut-il, bien entendu, que ces informations soit accueillies et comprises dans chaque foyer.
3.– Le risque existe de se voir affecté à une formation de second choix – émise parce qu’il le faut mais nettement moins souhaitée que le premier choix – pour les filières professionnelles, très diverses et très sélectives pour certaines d’entre elles puisque le nombre d’élèves admis est limité. Ce risque est plus important pour les élèves les plus faibles scolairement, le nombre de points associés à leur premièr choix étant négativement impacté par leurs résultats scolaires. S’il est difficile d’imaginer, pour ces formations professionnelles sélectives, en revenir à une affectation par une commission examinant les dossiers des élèves souhaitant s’y inscrire, Affelnet comporte le risque d’en écarter certains élèves – de façon « anonyme », sans explication et sans appel – qui ont longtemps imaginé en être et ont pu y placer beaucoup de leur motivation. Ce risque n’existe pas pour l’élève formant un ensemble de vœux exclusivement pour des secondes générales et technologiques (126).
Au total, l’orientation relève largement d’un processus antérieur – marqué par la décision d’orientation prise par le chef d’établissement – au « moment » Affelnet. Équitable et transparente, l’usage de cette application comporte néanmoins des risques de mise en œuvre non optimale et de déception pour des élèves fragiles et faibles scolairement. Ces risques doivent être un point d’attention, car une orientation considérée comme subie relève le risque d’échec scolaire, de décrochage et donc d’achever une scolarité en l’absence de qualification ou de diplôme.
b. Quelle est la satisfaction des élèves et de leur famille quant à la procédure d’orientation et d’affectation à la fin du collège ?
Il est difficile, 5 ans seulement après la création d’Affelnet, de mesurer la satisfaction des élèves et de leur famille à l’égard du processus d’orientation dans son ensemble, dont l’achèvement est marqué par l’affectation générée via cette application.
Les rapporteurs ont demandé au prestataire désigné par l’Assemblée nationale de recueillir des éléments sur cette satisfaction. S’agissant de la compréhension de la hiérarchisation des vœux par les élèves et leurs familles, les prestataires constatent, au regard de l’échantillon des professionnels qu’ils ont interrogés sur 4 sites, que « 25 % des professeurs principaux et 33 % des principaux estiment qu’elle n’est “pas du tout” ou “plutôt pas” comprise ». À la question de savoir s’il y a des « orientations qui s’avèrent ne pas correspondre aux souhaits de l’élève faute pour l’élève d’avoir bien ordonné ses vœux », 70 % des professeurs principaux interrogés ont répondu « parfois » et 5 % « souvent ».
S’agissant des élèves de seconde professionnelle qu’ils ont interrogés, les prestataires concluent que « 25% des élèves estiment ne pas avoir intégré la formation de leur choix », ce taux s’élevant à 33 % dans 2 sites sur 4. La question posée porte toutefois sur la satisfaction de l’élève quant à la formation qu’il poursuit après la 3ème, et moins sur le fonctionnement d’Affelnet. Ces résultats permettent en tout état de cause de constater qu’une proportion minoritaire mais non négligeable des élèves des lycées professionnels interrogés, comprise entre 15 % et 35 % selon les sites, considère ne pas suivre la formation qui constituait leur premier choix.
Au total, ces résultats donnent le sentiment d’une approbation nettement majoritaire à la fois du fonctionnement et des résultats du dispositif d’affectation Affelnet. Le manque de discernement dans l’ordonnancement des vœux semble toutefois conduire ponctuellement mais régulièrement à des résultats peu satisfaisants. Une frange d’élèves minoritaire mais néanmoins conséquente ne suit pas la formation souhaitée en premier lieu.
2. La préparation de l’orientation à l’issue du collège fait concrètement l’objet de pratiques très inégales
a. Le Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) au collège mis en place depuis 2008
La circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008 du ministre de l’Éducation nationale (127) a instauré dès la rentrée 2008 un parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) dans les établissements volontaires, généralisé à compter de la rentrée 2009. Mis en place pour l’ensemble de l’enseignement secondaire (cf. infra pour la partie concernant le lycée), il débute au collège à partir de la classe de 5ème.
La circulaire du 11 juillet 2008 précise que le PDMF correspond à l’acquisition, au sein du socle commun, des compétences sociales et civiques, et de celles relatives à l’autonomie et à l’initiative. En conséquence, le PDMF peut et doit s’inscrire dans l’ensemble des enseignements disciplinaires. Il se rattache toutefois logiquement à certains éléments existants qui leur sont distincts, ou périphériques : l’option facultative de découverte professionnelle en 3ème, les heures de vie de classe, les modalités de contact avec le monde de l’entreprise et du travail.
La circulaire du 11 juillet 2008 indique que les élèves « sont invités à passer une journée dans un lycée, un lycée professionnel ou un CFA », durant la classe de 4ème. En 3ème, le moment fort est « la séquence d’observation en milieu professionnel » de 5 jours, rendue obligatoire par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège. La même circulaire indique que cette séquence peut être complétée par « la participation à des salons, des forums et toute autre activité pédagogique permettant d’informer sur les métiers et les formations pour faciliter la démarche de choix qui s’opère à ce niveau. »
L’ensemble des activités effectuées par l’élève dans le cadre du PDMF s’achève par un entretien personnalisé d’orientation en 3ème, dont le principe est prévu depuis la rentrée 2006, avec son professeur principal. La circulaire conclut que « sur la totalité de sa scolarité en collège, un élève aura passé au moins 10 jours dans une entreprise ou en relation avec des acteurs du monde professionnel (dont 5 jours pour la séquence d’observation de troisième). »
b. Les leçons à tirer de certaines initiatives locales
Lors de leur déplacement à Saint-Étienne et dans la Loire le 14 mars 2013, les rapporteurs ont rencontré le principal et les équipes du collège Jacques Prévert à Andrézieux-Bouthéon. L’échange a donné lieu à la présentation des modalités de mise en œuvre du PDMF dans ce collège.
Dès la sixième, les élèves participent par groupe de deux ou trois à des interviews des personnels exerçant au collège, ce qui représente un panel de 27 métiers. Les élèves peuvent procéder à ces interviews accompagnés de leur famille.
En classe de 5ème, les élèves entrent en contact avec des entreprises constituées en réseau. Des représentants de ces entreprises viennent au collège et présentent leurs métiers, activités et personnels aux élèves. Par ailleurs, tous les élèves se déplacent dans une entreprise du réseau et chacun d’entre eux réalise à l’issue de la visite un dossier « coup de cœur » de 2 pages.
En 4ème, les contacts avec les entreprises s’intensifient, via notamment un club d’entreprises, que les élèves sont invités à rencontrer. Concrètement, l’activité pédagogique mise en œuvre autour de ces visites, qui s’adressent à tous les élèves, peut consister en la recherche des définitions et caractéristiques des métiers découverts sur place. Dans le cadre de ces initiatives, le collège doit gérer un grand nombre de sollicitations d’entreprises – qui se placent dans une démarche pro-active. Elles souhaitent au moins s’informer puis, le cas échéant, participer aux initiatives du collège. Les moyens nécessaires aux déplacements des élèves sont financés par les entreprises elles-mêmes. La classe de 4ème est également le moment où sont fixés les principaux enjeux de l’orientation qui aura lieu à la fin de la classe de 3ème. Pour ce faire, les élèves entrent en contact en 4ème avec un lycée général et technologique et un lycée professionnel.
En classe de 3ème, le collège a choisi de mettre l’accent sur la préparation à la réussite de l’orientation, notamment en direction d’élèves présentant – dès la fin de la 4ème – des lacunes pédagogiques, des difficultés d’attention ou dont le projet d’orientation n’est pas établie ou semble fragile. Ces élèves sont regroupés dans une troisième alternative, avec un effectif allégé de 20 élèves. Il s’agit de mettre en œuvre une pédagogie par le projet, en simulant, par exemple, au sein de la classe la création d’une entreprise, afin de redonner goût aux apprentissages. Les élèves de la 3ème alternative effectuent par ailleurs un stage en entreprises de trois semaines. La direction du collège veille à ce que la troisième alternative ne devienne pas une « classe ghetto », étant précisé qu’elle est demandée en fin de 4ème par un nombre d’élèves supérieur à sa capacité d’accueil.
Pour les rapporteurs, les initiatives du collège d’Andrézieux-Bouthéon autour du PDMF présentent plusieurs éléments à généraliser pour renforcer celui-ci et le rendre plus opérationnel :
– il est légitime de commencer dès la classe de 6ème une action pour préparer l’orientation. Il est possible dès ce niveau, sans dramatisation, au sein de l’établissement scolaire, de présenter la diversité des métiers, via des échanges avec les personnes qui les exercent ;
– un PDMF doit s’inscrire dans un territoire, avec ses activités dominantes, ses entreprises, son marché de l’emploi. Il revient à la direction du collège, soutenue par ses personnels, de créer et d’entretenir le réseau des entreprises et acteurs professionnels qui seront les interlocuteurs des élèves pour leurs activités de découverte et d’études ;
– les actions portant sur la découverte et l’observation des métiers et du monde du travail doivent être complétées par des mesures pédagogiques en direction des élèves en difficulté à l’approche de la fin de la 3ème. Le collège unique peut être un lieu de diversité pédagogique, permettant notamment d’apporter aux élèves en difficulté des méthodes adaptées d’enseignement, un projet positif et une confiance en soi. Une orientation réussie en 3ème s’appuie sur une maturité, une lucidité et une culture acquises en observant et s’appropriant des réalités professionnelles, mais également sur un niveau scolaire convenable et une motivation minimale.
c. La question de l’aide à la mobilité géographique rendue nécessaire par certains vœux d’orientation
Certains enseignements professionnels spécialisés ne sont prodigués que dans un nombre limité d’établissements du niveau secondaire. Pour certains élèves, l’éloignement géographique du foyer parental par rapport à ces établissements constitue un obstacle rédhibitoire à l’accès aux formations qui y sont enseignées. Il n’est facile pour personne, à 15 ans environ, de quitter le domicile familial pour devenir interne d’un établissement éloigné – quand un internat existe. L’internat est au demeurant une solution coûteuse. S’orientant vers les filières professionnelles, les élèves confrontés à ce type de dilemme sont sans doute plutôt issus de familles socialement défavorisées peut-être dubitatives – voire craintives – au regard des sacrifices financiers et organisationnels induits par la perspective de l’éloignement géographique.
De nombreux interlocuteurs des rapporteurs ont souligné ce frein à la mobilité sociale qu’est la mobilité géographique induite par certains souhaits d’orientation scolaire professionnelle après la troisième. Les mêmes interlocuteurs soulignent au demeurant, pour le déplorer, que le premier choix d’orientation est trop souvent celui de l’établissement le plus proche du domicile familial, quelles que soit la ou les spécialités professionnelles qui y sont enseignées.
Les prestataires KPMG et Euréval soulignent également ce point à de nombreuses reprises dans leur rapport. Pour les principaux de collège qu’ils ont interrogés, « les choix de formation restent conditionnés par l’offre existant à proximité du lieu de vie des élèves ». Dans un des sites, « les acteurs évoquent les réticences des élèves à se rendre en internat. »
Dans la voie professionnelle, le succès scolaire est en partie lié à l’envie d’exercer un ou des métiers précis. Il importe en premier lieu, par un PDMF réussi, de déterminer avec le plus de précision possible, pour chaque élève s’orientant en CAP ou en seconde professionnelle, quels sont ces métiers dont l’exercice est désiré.
Il est également nécessaire que les pouvoirs publics incitent les élèves à émettre les vœux de formation correspondants, même quand les établissements scolaires visés sont éloignés du domicile familial, en valorisant la mobilité géographique envisagée. Pour ce faire, des aides financières et matérielles suffisantes doivent être prévues en faveur des familles pour lesquelles cette mobilité géographique constitue un coût trop élevé. Après le bac, les étudiants peuvent bénéficier de bourses attribuées sur critères sociaux (d’ailleurs majorées quand le lieu des études supérieures est éloigné du domicile familial), d’allocations de logement et d’opportunités pour occuper un logement étudiant. Des aides doivent également être prévues en faveur des élèves des filières professionnelles au niveau infra-bac. S’agissant des places d’internat qui peuvent leur être proposées :
– 20,7 % des places d’internat dans l’enseignement secondaire sont vacantes, soit 47 000 places à pourvoir (128) ;
– le nouveau programme « Internats de la réussite », doté de 150 millions d’euros dans le cadre du nouveau programme des investissements d’avenir (PIA) prévoit la construction de 6 000 places nouvelles.
L’existence de ces aides, dont il reste à déterminer l’ampleur et la nature, constituerait l’une des principales informations accessibles via le portail, évoqué supra, dédié aux mobilités géographiques internationales ou induites par les choix d’orientation. Ce portail permettrait en outre de sensibiliser les élèves et leur famille à l’intérêt de ces mobilités, qui, de l’avis de tous les interlocuteurs – spécialisés ou non en la matière – des rapporteurs, changent les destins en les « bonifiant », a fortiori pour les jeunes qui disposent de moins d’opportunités.
B. LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS DOIT ÊTRE PLACÉ AU CœUR DE LA SCOLARITÉ AU COLLÈGE
Placer le PDMF à la hauteur de l’enjeu qu’est l’orientation à la fin de la 3ème nécessite selon les rapporteurs qu’il soit placé au cœur de la scolarité au collège, et ce dès la 6ème. Pour ce faire, les rapporteurs proposent ci-après des éléments d’évolution de ses modalités de mise en œuvre et d’encadrement.
a. Instaurer un travail partenarial : le rôle central du chef d’établissement
La circulaire du 11 juillet 2008 instaurant le PDMF évoque l’engagement de chaque établissement dans son élaboration et sa mise en œuvre. Le PDMF est un programme d’actions « inscrit dans le projet d’établissement […] et soumis au conseil d’administration. L’équipe éducative doit élaborer un programme d’activités fixant des objectifs à chaque niveau articulé selon une continuité qui donne au parcours tout son sens. […] Les interventions des conseillers d’orientation-psychologues sont intégrées dans le » PDMF. Il s’agit de mettre en œuvre un réel travail collectif.
Le rôle d’impulsion de l’équipe de direction du collège est fondamental. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval souligne que « la dynamique de l’établissement en matière d’orientation repose principalement sur le rôle du chef d’établissement. »
Ces prestataires ont constaté l’hétérogénéité de l’implication du chef d’établissement dans l’élaboration et la mise en œuvre du PDMF :
– dans l’un des sites, « le chef d’établissement du collège s’est fortement investi sur l’orientation à son arrivée et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du dispositif d’orientation tout en incitant les autres acteurs à s’impliquer. Aujourd’hui, le dispositif fonctionne naturellement et les objectifs sont partagés par chacun des acteurs » ;
– dans un autre site, « il n’existe pas de dynamique collective portée par le chef d’établissement et les enseignants en ce sens. […] L’absence de toute mention relative à l’orientation dans le projet d’établissement illustre l’importance accordée par l’ensemble de l’équipe pédagogique à cette priorité. Il convient en outre de souligner que la principale de l’établissement fait preuve d’une grande fatalité face à cette situation et reconnaît n’avoir aucune influence, ni aucune autorité sur le corps enseignant. »
Pour ces prestataires, le caractère fondamental du rôle du chef d’établissement implique une intervention académique en cas de carence : « en cas de défaillance de l’établissement, l’autorité de tutelle devrait pouvoir disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard du chef d’établissement afin de garantir aux élèves et à leurs parents un accompagnement réel sur ce sujet majeur ». Pour éviter d’en arriver à cette situation, les prestataires émettent deux préconisations susceptibles, selon les rapporteurs, de conduire chaque chef d’établissement à s’impliquer dans une démarche ambitieuse en matière d’orientation. Ces deux préconisations concernent les déroulements de carrière des principaux de collège et la publicité du projet porté par le chef d’établissement : « l’atteinte des objectifs [du PDMF] pourrait être prise en compte dans l’évaluation du chef d’EPLE. Développer une culture par l’exemple : présenter le projet d’EPLE [pour établissement public local d’enseignement] et les résultats sur le site académique. »
Les rapporteurs considèrent en outre qu’il appartient au chef d’établissement – au sein du bassin de vie et d’emplois de l’établissement scolaire – de créer et d’entretenir le réseau des entreprises et des professionnels (y compris du secteur public) susceptibles de participer au PDMF. Ce rôle d’entrainement s’étend aux personnels du collège, dont les enseignants bien entendu, mais pas seulement. L’un des points forts du dispositif mis en place au collège Jacques Prévert d’Andrézieux-Bouthéon est l’implication de tous les personnels de l’établissement, a minima en présentant leurs métier et activités aux élèves de 6ème. Le rapport des prestataires décrit à titre d’exemple une pratique établissant un lien entre établissements scolaires, entreprises et acteurs externes à l’Éducation nationale. Sur l’un des sites, « le directeur [de la mission locale] rencontre les représentants de l’Éducation Nationale au sein des comités de liaison-écoles-entreprises (CLEE). Ces rencontres permettent d’initier un travail d’orientation auprès des jeunes en leur apportant des informations sur les caractéristiques du bassin économique de la région. »
Il appartient aux autorités académiques d’assurer la valorisation de cette partie de l’activité des principaux de collège, y compris en repérant les bonnes pratiques et en suggérant aux principaux de s’y référer dans l’établissement du projet de chaque établissement.
b. Valoriser la cheville ouvrière du travail en équipe : le professeur principal
Le professeur principal joue un rôle central dans la mise en œuvre du PDMF. Il est le référent de proximité de l’élève – parce que l’un de ses professeur. Il est également le mieux placé pour apprécier la situation propre à chaque élève, compte tenu et au-delà des disciplines qui lui sont enseignées. Il doit être à ce titre la cheville ouvrière du PDMF, entre le principal et ses collègues enseignants.
L’importance de cette tâche s’accompagne de sujétions horaires et de l’exercice d’une responsabilité en matière de conseil et d’accompagnement exigeant tact et clairvoyance – notamment en classe de 3ème. Le rapport des prestataires relève au demeurant qu’il est « de plus en plus difficile de recruter des professeurs principaux, la mission de celui-ci étant devenue plus complexe et plus large qu’auparavant ». Il importe que l’activité de professeur principal soit valorisée à la hauteur de son importance, par exemple du point de vue indemnitaire.
Les enquêtes réalisées sur les 4 sites par les prestataires les amènent à constater que « les élèves émettent un avis très positif sur l’accompagnement prodigué par leur professeur principal » au collège.
c. Associer résolument les conseillers d’orientation-psychologues au travail de l’établissement concernant l’orientation
Le rôle pivot du professeur principal pour la mise en œuvre du PDMF ne l’exonère pas de sa charge de travail en tant qu’enseignant. Pour appuyer et renforcer la qualité de l’activité des enseignants, et notamment du professeur principal, dans le cadre du PDMF – dans le respect du projet défini par le principal –, l’enseignement secondaire français a la chance de pouvoir s’appuyer sur un corps de conseillers d’orientation-psychologues (copsy ou COP – au nombre de 3 768 en 2013), dont les supérieurs hiérarchiques sont les directeurs des 535 centres d’information et d’orientation (CIO) placés sous la tutelle académique.
Le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 précise que les copsy :
– exercent à la fois au sein des CIO et des établissements de l’enseignement secondaire ;
– assurent, pour toute personne, un premier accueil et offrent un premier conseil personnalisé au sein du service public de l’orientation (SPO) défini à l’article L. 6111-4 du code du travail ;
– « assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé : Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté […] des jeunes adultes [et] des étudiants en formation initiale » ;
– assistent les élèves « dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle » ;
– contribuent à l’observation des élèves et à la mise en œuvre des mesures devant conduire à leur réussite « en complément des équipes éducatives » ;
– « participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification » ;
– « contribuent à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle. »
Hormis celle qui concerne le SPO défini par la loi, chacune des missions des copsy peut se rattacher à la mise en œuvre du PDMF au sein des collèges : soutien accordé en priorité aux élèves en difficulté, contribution à l’élaboration par les élèves de leurs parcours, observation des élèves, prévention de l’échec, apport à la partie du projet d’établissement relative à l’information et à l’orientation. Sans doute serait-il pertinent d’expliciter réglementairement la mission d’appui des copsy en faveur de la mise en œuvre du PDMF au collège.
Sans remettre en cause la faculté pour les copsy d’exercer à la fois dans les CIO et dans les établissements scolaires et de s’adresser directement à chaque élève ou jeune, il importe d’orienter résolument leurs activités d’expertise, de conseil, d’accompagnement et d’information vers la principale démarche de l’établissement en matière de préparation à l’orientation – le PDMF –, mission pour laquelle est bien entendu requise leur qualification en matière de psychologie.
Cette évolution permettrait de renouveler le sens et la portée de l’action des copsy – ce qui est à la fois urgent et nécessaire.
Une mission interministérielle d’inspection de janvier 2013 concernant la mise en place du service public de l’orientation (SPO) (129) a repris, s’agissant des copsy et des CIO, des constats faits dès 2005 par une mission propre aux inspections rattachées au ministère de l’éducation nationale : « un réseau (des directeurs de CIO et des copsy) dans une situation d’abandon plus ou moins critique […] des missions multiples non priorisées […] des personnels jamais évalués, décidant sans contrainte et sans contrôle de l’utilisation d’une partie de leur service, mal perçus par les usagers (parents, élèves), par leur environnement (collectivités, entreprises), des textes officiels ajoutant régulièrement les missions prioritaires aux missions essentielles » (130). Le rapport des prestataires KPMG et Euréval relève qu’« il n’existe aucune homogénéité dans les activités menées par les différents COP. […] La mise en œuvre, le pilotage et la gouvernance des CIO au sein des quatre territoires observés n’apparaissent pas satisfaisants. Dans chaque centre, l’accumulation de missions et d’exigences administratives vient, en l’absence de moyens adaptés et de définition de priorités, handicaper l’exercice de la mission de service public. Ce contexte de moyens réduits et de renforcement des missions rend plus difficile le pilotage des centres et le management des équipes. »
Le rapport des prestataires montre que l’action des copsy recueille aujourd’hui une approbation mitigée – voire le scepticisme – de la part des principaux des collèges et des professeurs principaux. Les élèves interrogés ont une opinion des copsy relativement bonne. Il est cependant alarmant de constater qu’il existe des établissements où une proportion non négligeable d’élèves – pouvant atteindre la moitié – déclare n’en avoir jamais rencontrés.
Dans la synthèse du rapport d’inspection de janvier 2013, il est précisé que les CIO et COP « n’ont pas été pris en considération depuis de nombreuses années par leur ministère de tutelle […] la prochaine loi de décentralisation et la refonte du SPO sont une opportunité historique de moderniser et mobiliser ces services d’orientation, en leur donnant toute leur place dans la mise en œuvre du service public de l’orientation. »
Les rapporteurs considèrent que c’est au sein des établissements scolaires, auprès des élèves, dans le cadre de démarches renouvelées et élargies de ces établissements en matière d’orientation que le recentrage, la modernisation et la mobilisation de ces services peut avoir lieu. L’évolution vers un travail d’équipe au sein des établissements – et partenarial avec certains acteurs extérieurs – est nécessaire, possible et sans doute d’ores et déjà partiellement mise en œuvre. Le rapport des prestataires indique que dans un site « des réunions de concertation sont […] organisées au sein des établissements avec le conseiller principal d’éducation, les professeurs principaux, l’assistante sociale et le COP. Elles contribuent à la mise en place d’une stratégie globale d’accompagnement. Les liens entre le directeur du CIO et les établissements sont réguliers, tout comme ceux avec les missions locales. »
Cette évolution engagée partout et de façon coordonnée, il serait possible d’examiner l’éventuel renforcement de la présence des copsy dans les établissements pour mettre en œuvre – dans des conditions convenables – les missions qu’il leur appartiendrait de mener à bien dans ce cadre renouvelé. Le rapport des prestataires propose deux mesures en la matière :
– « augmenter la présence du COP dans les établissements : 1 COP par » collège. Sur 3 des 4 sites observés par les prestataires, les copsy exercent dans 2 à 3 établissements ;
– « augmenter, sur les territoires en tension, le nombre de COP afin que ces derniers n’aient pas plus de 1 000 élèves à charge ». Ce taux est dépassé dans 3 des 4 sites faisant l’objet de l’étude.
d. Former les équipes pédagogiques pour présenter clairement aux élèves ce que sont les métiers et la vie professionnelle
Il est primordial que la formation initiale et continue des enseignants les prépare à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PDMF, dans l’optique d’un apport éclairé à l’orientation des élèves et à l’émission de leurs vœux préalablement au processus d’affectation. Les formations prodiguées par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) doivent résolument prendre en compte cet impératif.
L’article L. 721-2 du code de l’éducation, issu de l’article 70 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, n’évoque pas ce point parmi les missions des ESPE. Toutefois, dans la partie de l’annexe à cette loi consacrée à la refondation de la formation initiale et continue des enseignants, il est précisé qu’en constitue l’un des éléments les « problématiques liées à l'orientation, à l'insertion professionnelle et à la connaissance du marché du travail ».
Le rapport des prestataires indique qu’au collège, bon nombre des professeurs principaux interrogés reconnaissent la nécessité d’améliorer leur formation : « 25 % d’entre eux estiment ne pas être suffisamment formés sur les filières d’enseignement et les débouchés professionnels. 50 % des professeurs principaux jugent être suffisamment formés mais ils reconnaissent néanmoins qu’ils aimeraient actualiser leurs connaissances. 75 % des répondants soulignent en effet qu’ils n’ont pas suivi de formations régulières sur l’offre de formations et ses débouchés. La grande majorité d’entre eux (90 %) ne participe pas à des réseaux ou groupes de travail traitant de cette thématique ». Le constat fait par ces prestataires s’agissant des copsy est analogue : les copsy interrogés « reconnaissent que leurs connaissances [ne] sont [pas] abouties sur les filières de formation, les débouchés professionnels, les métiers en tension. »
Les éléments que l’équipe éducative – peut-être surtout le professeur principal et les copsy – doit être à même de présenter et transmettre aux élèves sont multiples :
– une connaissance du bassin d’emploi local, portant à la fois sur le secteur marchand et le secteur public. Ces éléments doivent être mis en relation avec la carte des formations initiales – dans les filières générales, technologiques, professionnelles et d’apprentissage – que les élèves ont vocation à désigner dans leurs vœux ;
– ce rapprochement entre le bassin d’emploi et la carte des formations doit être accompagné d’une description pratique des métiers correspondants, y compris en abordant les aspects liés aux conditions de travail qui leur sont associées, aux sujétions (par exemple horaires) que leur exercice impose, aux rémunérations envisageables et aux débouchés des formations qui conduisent à leur pratique. Il importe aussi que les élèves soient sensibilisé à la voie de la création d’entreprise ;
– il est nécessaire que les élèves soient dotés au plus tôt d’une culture générale de base portant sur l’existence et le contenu du droit du travail et de la protection sociale. Il est également important qu’ils soient sensibilisés à la question de la compétitivité internationale, dans le sens où le niveau de vie et de protection sociale en France impliquent de la part des salariés de faire preuve d’un niveau de compétences – théoriques, techniques, ainsi qu’en matière de savoir-être, niveau qu’il leur faudra impérativement atteindre.
Lors de leur déplacement au lycée Pierre Mendès-France à Rennes le 14 juin 2013, les équipes éducatives ont confié aux rapporteurs leur surprise eu égard à la naïveté de certains jeunes – parfois majeurs – face à la réalité du monde du travail et à la technique de la recherche d’emplois. Il est impératif que les personnels éducatifs soient en mesure – pendant le temps scolaire nécessaire –, dès le début du collège, de fournir aux élèves des connaissances minimales en la matière, sans dramatisation, et sans préjudice des autres enseignements nécessaires à la maîtrise du socle commun de compétences. Les travaux du Conseil national éducation économie (CNEE), installé le 18 octobre 2013, pourraient utilement contribuer à élaborer le contenu de ces connaissances.
In fine, à l’issue d’un PDMF de quatre ans qui aura mis en perspective les enjeux de ses vœux d’affectation au regard de son niveau scolaire et de sa motivation, chaque élève pourrait – dans un premier temps sous la forme d’une expérimentation – devoir venir « défendre » son projet et ses vœux devant le conseil de classe à la fin de la 3ème.
C. LE COLLÈGE UNIQUE DOIT ADAPTER SON OFFRE ÉDUCATIVE À LA VARIÉTÉ DES ÉLÈVES, NOTAMMENT QUAND CEUX-CI SONT EN DIFFICULTÉ
1. L’offre scolaire du collège unique n’est pas adaptée aux élèves qui n’auront pas vocation à intégrer la voie générale après la 3ème
Lors de son audition par le groupe de travail animé par les rapporteurs le 20 mars 2013, M. Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire (Dgesco), a indiqué que la difficulté du système scolaire français à valoriser les capacités des élèves issus des classes sociales défavorisées avait en partie pour origine – à tout le moins était entretenue – par une mauvaise organisation du collège unique. Celui-ci a été créé en 1975 sur le modèle d’un « petit lycée » – d’enseignement général.
Le collège et le lycée d’enseignement général partagent, en grande partie, les mêmes enseignements disciplinaires, délivrés par les mêmes personnels. En conséquence, le collège, comme le lycée d’enseignement général, propose un enseignement assez élitiste et plutôt abstrait, qui mènerait au décrochage « à bas bruit » de la frange des élèves pour lesquels ce type d’enseignement n’est pas adapté. Inversement, les enseignants du collège, face aux difficultés insurmontables de ces élèves, seraient amenés à penser que ces derniers n’y ont pas leur place. In fine, le découragement est partagé et l’incompréhension réciproque.
M. Jean-Paul Delahaye invite à réfléchir à un collège unique différent du modèle du lycée d’enseignement général. Sans remettre en cause l’idée que le collège unique est un tronc commun d’enseignements proposé à tous les élèves, il s’agirait d’accorder une place réelle à l’enseignement via le projet, l’objet et le concret, pour atteindre dans un second temps l’abstraction.
L’éducation manuelle et technique (EMT), instaurée dans les années 1970 et confortée dans les années 1980, correspondait au collège à ce type d’enseignement. Il est significatif que cette matière ait été abandonnée sous sa forme historique au milieu des années 2000 (131), comme s’il était difficile de parvenir à pérenniser – ou à ne pas remettre en cause – tout enseignement qui se différencierait des disciplines traditionnelles de la culture éducative française.
2. Cette offre doit être adaptée pour les élèves en difficulté
Dans l’attente d’une réforme approfondie des programmes au collège afin qu’ils constituent un tronc commun préparant de façon équitable à toutes les voies de formation ouvertes après la 3ème, il importe d’établir une offre adaptée en direction des élèves en difficulté scolaire au collège, et dont le projet d’orientation doit être soigneusement définie afin d’être praticable. Pour ne pas conduire à la création de voies de relégation discriminantes, la diversification de cette offre doit s’accompagner d’une attention particulière portée à l’orientation des élèves concernés.
a. Des exemples sur le terrain à Saint-Étienne et Saint-Malo
Les rapporteurs ont évoqué supra la 3ème alternative du collège Jacques Prévert d’Andrézieux-Bouthéon, qui s’appuie sur des éléments répondant à une diversification réussie de l’offre scolaire au collège :
– la 3ème alternative s’insère en fin d’un PDMF qui a commencé dès la 6ème, au cours duquel il a été possible d’identifier les élèves pour lesquels une attention particulière devait être portée en dernière année de collège quant à leur orientation ;
– elle prévoit des enseignements comprenant un projet collectif, des mises en pratique techniques et une mise en situation professionnelle plus longue que celle prévue pour la mise en situation d’observation obligatoire en 3ème ;
– elle fait l’objet d’une attention particulière de la part de la direction de l’établissement quant à son statut et son intégration au sein du collège.
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo abrite une classe relais accueillant des élèves en difficulté issus des classes de 6ème à 3ème de ce collège et d’autres établissements situés dans le pays de Saint-Malo (132). À la mi-juin 2013, 36 élèves avaient été accueillis dans cette classe relais depuis la rentrée 2012, en principe pour une durée de six semaines, souvent renouvelée. La classe relais a été configurée pour accueillir 12 élèves au plus à la fois, mais son effectif réel a pu atteindre 20 élèves. L’objectif du passage par la classe relais est à la fois une remise à niveau – notamment en français et en mathématiques – et une mise en confiance.
Ce dispositif s’adresse aux décrocheurs dont les lacunes scolaires sont importantes, à l’exception des profils psychiatriques les plus lourds et des élèves ayant vocation à intégrer une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) en raison de difficultés d’apprentissage graves et durables. L’objectif de la classe relais est le retour de l’élève dans sa classe et son établissement d’origine, afin d’y poursuivre sa scolarité dans des conditions normales. Les admissions en classe relais sont actées par l’inspection académique, après le travail d’une commission qui étudie les dossiers en tentant d’anticiper pour l’élève la valeur ajoutée de la démarche. L’accord des parents, ou de l’un d’entre eux, est requis.
L’emploi du temps hebdomadaire d’un élève comprend une journée dans son établissement d’origine et quatre journées au collège Chateaubriand de Saint-Malo, avec des enseignements le matin et des activités l’après-midi. Ces enseignements sont assurés par une professeure des écoles et les activités, encadrées par des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la police nationale, relèvent par exemple de la pratique de la menuiserie ou de la boxe. La ville de Saint-Malo met une salle à disposition pour la pratique de certaines activités, ouvre les portes du club municipal de plongée et offre le bénéfice d’un réseau d’entreprises volontaires pour envisager des stages. Le conseil général est également un acteur financier du dispositif. Enfin, des associations locales contribuent à la diversité des activités proposées.
Les acteurs de ce dispositif témoignent de son efficacité pour redonner l’estime de soi aux élèves concernés et le désir de préparer un avenir. Car le passage en classe relais est également l’occasion de faire émerger un projet professionnel et de préciser le chemin à emprunter par l’élève pour le réaliser. En l’espèce, il s’agit souvent de prévoir une orientation vers l’apprentissage, en définissant le secteur professionnel souhaité par l’élève.
b. Pour une diversification de l’offre d’enseignement au collège en direction des jeunes en difficulté
Les rapporteurs considèrent que l’expérience de la classe relais du collège Chateaubriand de Saint-Malo est exemplaire. Elle montre que l’Éducation nationale est capable de s’adapter en faveur des élèves en difficulté, de décloisonner les établissements, de modérer quand cela est nécessaire le principe des enseignements disciplinaires, de passer des partenariats fructueux avec d’autres administrations de l’État et avec les collectivités territoriales, de donner un sens à l’enseignement scolaire combinant la réussite éducative, l’estime de soi et la définition d’un projet personnel.
Les bases juridiques du développement de ces dispositifs existent :
– l’article D. 332-5 du code de l’éducation dispose que « le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences […]. Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements » ;
– l’article D. 332-6 du même code précise que « des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes » peuvent être mis en œuvre afin d’apporter une aide « aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun. »
Une fois que l’autorité académique a vérifié leur bienfondé, elle doit encourager ces initiatives – qui viennent souvent « d’en bas » et reposent sur l’énergie, le désintéressement et l’ingéniosité de certaines personnes –, les mettre en valeur et les soutenir, en simplifiant résolument les conditions quotidiennes de mise en pratique, les procédures et les financements (notamment quand ils sont complexes, avec l’intervention des collectivités territoriales). Il importe également, autant que faire se peut, de récompenser et gratifier les personnels concernés. Une mobilisation accrue des moyens de l’Éducation nationale en faveur de ces dispositifs pourraient au préalable utilement s’appuyer sur un examen des pratiques actuelles, des moyens qui leur sont accordés et des résultats constatés dans le cadre de leur mise en œuvre.
D. LA PRÉPARATION DE L’ORIENTATION POST BAC DOIT CONTRIBUER À LIMITER L’ÉCHEC DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. L’orientation post bac, en principe préparée dès la seconde, s’organise autour d’un dispositif en ligne qui place le futur étudiant en responsabilité
a. Le PDMF se poursuit au lycée de la classe de seconde jusqu’à la fin de la terminale et prépare l’orientation post bac
La circulaire du 11 juillet 2008 du ministère de l’Éducation nationale relative au PDMF indique que celui-ci se poursuit au lycée, en prenant « en compte l’articulation collège- lycée ». Cette continuité peut en principe s’appuyer sur un « livret personnel de suivi [de l’élève], distinct du livret de connaissances et de compétences, [qui] comprend l’historique des activités, de ses expériences, des compétences et connaissances acquises tout au long de sa scolarité au regard de son parcours et de son projet, ainsi que des étapes-métiers qui lui ont été proposées. »
La circulaire du 11 juillet 2008 prévoit que les équipes éducatives du lycée intègrent, dans l’accompagnement pédagogique qu’elles mettent en place en direction des élèves, l’élaboration et la formulation de leur projet, le ou les parcours de formation correspondants et les débouchés professionnels constatés suite à la formation envisagée. La même circulaire indique que le plan issu de ce travail de maturation et d’information effectué dans le cadre de l’accompagnement pédagogique est complété par les actions suivantes :
– « une journée est effectuée par chaque lycéen de classe de première dans une université, un institut universitaire de technologie [IUT], une section de technicien supérieur [BTS] ou une classe préparatoire aux grandes écoles [CPGE] ». La circulaire insiste sur la nécessité de préparer soigneusement cette visite, via les échanges préalables entre les équipes pédagogiques du lycée et de l’établissement d’enseignement supérieur concerné. La visite s’effectuant dans un établissement d’enseignement supérieur relevant d’une seule catégorie, l’élève est tenu de faire un choix entre université, IUT, BTS ou CPGE. Sans « dramatiser » ce choix portant sur une visite effectuée en classe de première – qui ne constitue donc en rien un engagement d’orientation –, il convient qu’il soit effectué de façon éclairée au cours de l’accompagnement pédagogique au lycée ;
– « des entretiens personnalisés d’orientation sont offerts » en classes de première et de terminale ;
– dans le cadre de l’accompagnement personnalisé – intégré à l’emploi du temps des élèves à raison de 72 heures par an en lycée général et technologique et de 210 heures sur les trois ans du cursus du bac professionnel – une aide à la définition et à la mise en œuvre du projet d’orientation est possible. La circulaire du 11 juillet 2008 indique que cette aide peut, « pour les élèves qui le souhaitent, être l’occasion d’apprendre à rédiger un CV, à passer un entretien d’embauche et à se préparer à l’insertion professionnelle en coopération avec le service public de l’emploi. »
Le PDMF doit en outre s’appuyer sur les statistiques que certains établissements d’enseignement supérieur sont tenus de rendre publiques en application de la loi, en matière de succès de leurs élèves pour l’obtention du ou des diplômes qui y sont préparés et pour l’insertion professionnelle :
– l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation – issu de l’article 21 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche – prévoit que « les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur (133) rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent » ;
– l’article L. 611-5 du même code – dans sa version issue de l’article 24 de la loi du 22 juillet 2013 – précise que sont rendues publiques par les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) des universités « les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme. »
In fine, les affectations communiquées aux élèves via le dispositif en ligne Admission post bac (APB) s’inscrivent dans le PDMF et en constituent l’achèvement.
b. La préparation à l’orientation peut prendre la forme de mesures concrètes de transition entre le lycée et l’enseignement supérieur
Au-delà de la préparation à l’orientation post bac, il existe des initiatives locales permettant un « tuilage » des scolarités secondaire et supérieure. Lors de leur déplacement à Rennes le 14 juin 2013, les rapporteurs ont été informés d’un partenariat entre l’université de Rennes I et certains lycées, dont le lycée Pierre Mendès-France dans lequel ils se sont rendus. Ce dispositif, intitulé « À la fac avant ton bac », consiste à proposer à des élèves de terminale scientifique une période d’immersion totale à l’université en cours d’année scolaire, afin de suivre certains des cours qui y sont donnés. En contrepartie, ils peuvent obtenir des crédits ECTS, à condition qu’ils s’orientent effectivement l’année suivante à l’université de Rennes I.
Ce type d’initiative locale n’a que des avantages : les élèves de terminale sont mis réellement en contact avec ce qui les attend dans l’enseignement supérieur, ils bénéficient d’un vrai « coup de pouce » pour l’accomplissement futur de leurs études et les personnels éducatifs des niveaux secondaire et supérieur sont parties prenantes d’un partenariat pédagogique.
Les équipes rencontrées par les rapporteurs soulignent également le faible coût de ce type de mesure – mise en œuvre sur le temps de l’accompagnement personnalisé prévu en terminale – et son fort rendement pédagogique. L’autorité académique doit encourager ce type d’initiative, voire programmer leur essaimage.
Dans le même esprit, l’université Jean Monnet de Saint-Étienne souhaite organiser à compter de l’année scolaire 2013-2014 des cours assurés en terminale par des enseignants du supérieur, et à l’université par des professeurs de lycée. Il s’agit, selon les responsables de l’université de Saint-Étienne, de « permettre aux enseignants du secondaire et du supérieur de renforcer leur connaissance réciproque des publics scolaire et universitaire, de mieux appréhender les exigences du lycée et de l’université, et d’enrichir leurs pratiques pédagogiques respectives pour mieux répondre aux besoins de formation des jeunes lycéens amenés à devenir des étudiants ». Pour 2013-2014, 260 heures de cours seraient dispensées selon ces modalités par 33 enseignants, à parité en lycée (dans 4 établissements) et à l’université.
« Expérimenter des échanges de service entre lycées et université pour mieux préparer les élèves à devenir étudiants »
Ces actions s’inscrivent notamment dans le contexte du renforcement du continuum de formation du secondaire au supérieur (circulaire du 18 juin 2013), et de la charte d’engagement « Pour une meilleure articulation de la transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies ».
L’objectif est de permettre aux enseignants du secondaire et du supérieur de renforcer leur connaissance réciproque des publics scolaire et universitaire, de mieux appréhender les exigences du lycée et de l’université et d’enrichir leurs pratiques pédagogiques respectives pour mieux répondre aux besoins de formation des jeunes lycéens amenés à devenir des étudiants. En d’autres termes, il s’agit de nourrir la construction d’une « communauté d’échange de pratiques pédagogiques autour du -3/+3 ».
Les principes retenus pour construire les échanges sont les suivants : un cadre administratif simple (une heure en lycée = une heure à l’université) ; rester sur des volumes horaires raisonnables ainsi que dans le contenu prévu par les cadres pédagogiques des filières concernées ; travailler avec des établissements et des enseignants volontaires ; bâtir des projets d’échanges communs permettant une véritable coopération pédagogique entre les enseignants et laissant place à une grande liberté pédagogique ; possibilité d’avoir plus de deux enseignants concernés par projet.
Dans ce cadre, l’enseignant du secondaire intervient en L ou DUT (plutôt L1 et DUT1) et les enseignants de l’université interviennent en classe de première ou de terminale, avec des fiches projets validées par les chefs d’établissement côté lycée et par le directeur de composante côté université, et un appui possible du conseiller académique en recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE). Une évaluation est prévue en avril 2014.
Pour 2013-2014, 13 projets impliquent quatre lycées et six composantes de l’université. Au total, ce sont 130 heures d’enseignement qui seront échangées (130 en lycée et 130 à l’université Jean Monnet), avec la participation de 33 enseignants du secondaire et du supérieur. Les projets se caractérisent par une grande diversité, s’agissant des filières concernées (classes de premières et de terminales, dont deux de la filière technologique, et, côté université, des DUT1 et L1 principalement), des disciplines (espagnol, mathématiques, économie, biologie, sociologie, physique-chimie, etc.) et des actions pédagogiques (des conférences thématiques, des travaux pratiques, des séances de soutien, de l’accompagnement personnalisé, des préparations d’exposés, des cours-TD, etc.).
Source : université Jean Monnet de Saint-Etienne
c. Le dispositif en ligne Admission Post Bac (APB), renseigné directement par l’élève, s’inscrit dans la démarche « d’orientation active »
L’« orientation active » consiste à accompagner l’élève de lycée – dès la classe de première puis en terminale – pour l’élaboration de son projet d’orientation et la définition des vœux correspondants. Sur la base du temps utilisé pour le PDMF et l’accompagnement personnalisé, il s’agit, selon le site en ligne du ministère de l’Éducation nationale, d’organiser « une orientation plus progressive, plus ouverte et plus juste. Être bien informé sur les contenus des formations, les taux de réussite aux examens, l’existence de passerelles et les débouchés, permet aux futurs étudiants de formaliser un choix réfléchi ». Les informations correspondantes figurent en partie sur le site en ligne http://www.admission-postbac.fr/ (APB), par lequel l’élève émet également ses demandes d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur qu’il souhaite intégrer et reçoit leur réponse quant à son admission ou non à s’y inscrire.
Ce volet informatif est complété par certaines étapes :
– un entretien de chaque élève en classe de première avec son professeur principal, portant sur son orientation ;
– un conseil de classe au cours du premier trimestre de la classe de terminale, qui – avant la procédure de pré-inscription post bac – émet un avis sur le ou les projets d’orientation de chaque élève et, le cas échéant, lui adresse des conseils en la matière ;
L’orientation active s’achève par l’émission par chaque potentiel futur bachelier de ses vœux d’inscription sur le site en ligne APB.
S’agissant de la gestion des vœux d’inscription, le ministère de l’Éducation nationale, en réponse aux questions des rapporteurs, indique que « les candidats classent leurs vœux par ordre de préférence selon leur projet de poursuite d'études, l'ordre étant modifiable jusqu'à fin mai. Pour chacune des formations sélectives les établissements classent les dossiers reçus en fonction de critères pédagogiques, sans connaître l'ordre de préférence des candidats. La période d'admission comporte plusieurs phases. À chacune d’elles, il n’est possible d’obtenir qu’une seule proposition d’admission, la meilleure possible en fonction de l'ordre de préférence indiqué et du rang de classement dans les différentes formations sollicitées, ceci pour éviter que plusieurs places ne soient bloquées par un candidat aux dépens des autres. Par ailleurs, lorsqu'une proposition d'admission est faite, les vœux classés après celui pour lequel existe une proposition d'admission, s'annulent. Ainsi, la satisfaction de l'un des vœux annule les demandes moins bien classées, au profit d'autres candidats en attente d'admission sur ces mêmes formations. » (134)
Pour les élèves qui désirent s’inscrire dans une formation sélective – en BTS, IUT et CPGE – ce fonctionnement implique, en amont, un choix réfléchi, sans erreur ou hésitation, sur l’ordre des vœux émis. Obtenir le droit à une inscription conduit en effet à l’annulation des demandes de rangs inférieurs. Il importe également, pour les élèves qui souhaitent en tout état de cause poursuivre des études dans l’enseignement supérieur, de prévoir une inscription à l’université dans le cas où les formations sélectives souhaitées ne seraient pas obtenues. Ces éléments justifient, au-delà de l’aide à la maturation du projet d’orientation, que les élèves soient accompagnés au lycée pour préparer l’issue de l’« orientation active ».
2. Quelle efficacité de la démarche d’orientation au lycée professionnel ?
a. Des appréciations positives sur l’action des personnels en charge de mettre en œuvre le PDMF
Le rapport des prestataires KPMG et Euréval montre que les constats établis pour le collège s’agissant des personnels éducatifs sont valables pour le lycée professionnel.
L’action des professeurs principaux est majoritairement appréciée par les élèves. L’enquête en ligne des prestataires montre « que les anciens élèves de terminale sont plus de 65% à déclarer être satisfaits de l’accompagnement reçu par leur professeur principal ».
En revanche, la formation des professeurs principaux est souvent considérée insuffisante, notamment de leur propre point de vue. S’appuyant sur les entretiens réalisés sur les différents sites, les prestataires observent que « le professeur principal s’estime insuffisamment informé sur les filières professionnelles. Les offres de formation dispensées sur le territoire sont insuffisamment connues des professeurs principaux, notamment en BTS. [Sur un autre site] Les professeurs principaux […] entretiennent très peu de liens avec les entreprises du territoire. Rares sont ceux qui se déplacent dans les entreprises pour rendre visite aux élèves en stage et rencontrer leurs tuteurs ». Toutefois, dans l’un des sites, « la formation des professeurs principaux est un axe prioritaire du lycée professionnel […]. Cette formation porte sur deux thèmes, d’une part, l’accompagnement personnel des élèves et d’autre part, la connaissance des formations professionnelles, réalisée à travers des demi-journées ou journées passées au sein des lycées professionnels. »
S’agissant des copsy, le relevé des entretiens et réponses obtenus sur 2 des 4 sites souligne l’insuffisance de leur présence en général dans le lycée professionnel et du temps qu’il consacre en particulier au travail d’équipe dans l’établissement concernant l’orientation : « le temps de présence du COP est jugé insuffisant au regard des besoins de l’établissement. La COP consacre son temps à l’accueil de jeunes en entretiens individuels et n’a pas de disponibilité pour travailler collectivement avec les équipes pédagogiques qui ignorent parfois quel est son rôle exact. [Sur un autre site] Le COP réalise uniquement des entretiens individuels et prend rarement part aux actions ». Toutefois, sur un autre site, « la coordination entre les acteurs se passe mieux : le professeur principal considère le COP, […] comme son principal relais. Il n’hésite pas à orienter un élève vers le COP lorsque celui-ci rencontre des difficultés ou pose des questions pointues. Le COP intervient également lorsqu’un élève ne se satisfait pas dans l’orientation qu’il a choisie, et ceci afin de trouver une solution alternative. »
b. Sur le terrain, en lycée professionnel, le regard assez sévère porté sur le dispositif APB
L’un des intérêts du rapport des prestataires est de porter un focus sur les lycées professionnels. Comme les rapporteurs l’évoquent infra, l’enjeu de la poursuite des études – et d’une orientation réussie en la matière – est majeur pour les bacheliers professionnels, plus exposés à l’échec dans l’enseignement supérieur et sans doute plus fragiles face à l’outil en ligne APB qui implique que ses utilisateurs non seulement émettent des vœux, mais élaborent également une stratégie de classement entre ceux-ci.
Sur les 4 sites, le regard des acteurs et utilisateurs sur le dispositif APB est assez sévère, plus que sur Affelnet. Même sur un site où APB est jugé « performant », les acteurs « soulignent néanmoins qu’il nécessite une attention forte de l’élève sur son premier vœu qui est décisif ».
Sur les autres sites, l’accompagnement renforcé des élèves est considéré comme indispensable, alors même que certaines démarches entreprises pour ce faire rencontrent difficilement leur public :
– sur l’un des sites, les acteurs du lycée professionnel considère qu’« il y a encore trop d’erreurs dans la hiérarchisation des vœux par manque de compréhension du processus. […] L’établissement convie chaque année parents et élèves à une réunion annuelle d’information sur APB qui rencontre peu de succès : 10 familles en 2013. Il ressort de ces éléments que la voie la plus efficace pour les élèves exprimant un besoin d’accompagnement reste l’accompagnement individuel. » ;
– dans le lycée professionnel situé sur un autre site, « le dispositif est qualifié par le principal “d’usine à gaz, super complexe qui laisse trop de gens sur le carreau”. Il ne permet pas aux élèves d’ordonner facilement leurs souhaits de formation et de hiérarchiser facilement leurs vœux. Si les élèves ne sont pas aidés, ils peuvent ne pas aller au bout de la démarche […]. L’outil est ainsi considéré comme discriminant par le principal car certains élèves ne trouvent aucune aide auprès de leur proche ». Le principal évoque également les difficultés de certains élèves pour financer l’envoi des nombreux dossiers de candidatures – composés de photocopies de documents nombreux et divers – et les difficultés d’accès de certains élèves à l’outil numérique ;
– les acteurs du lycée professionnel du dernier site portent un regard sur APB très proche du précédent, qualifiant ce dispositif : « “d’usine à gaz ; de machine à démobiliser les parents, à éliminer. Si les jeunes ne sont pas aidés, c’est infaisable ! Et les parents n’y comprennent rien !”. Il est jugé compliqué par les élèves qui reconnaissent la nécessité d’un accompagnement. »
Ces éléments justifient un accompagnement renforcé des lycéens professionnels, et de leur famille, pour qu’ils se saisissent efficacement d’APB. Les lycées professionnels doivent élaborer une offre en la matière, mais l’enjeu justifie que les autorités académiques vérifient la pertinence du service proposé par les établissements.
Il faut également noter que sur tous les sites, le rapport des prestataires souligne l’« enfermement […] géographique trop prégnant qui limite les poursuites d’étude post-bac ». Sur un site, le rapport relève « des décisions d’affectation conditionnées par la carte des formations existantes : les contraintes géographiques et de déplacement constituent un frein important à la mobilité. Le cadre de vie reste un élément déterminant dans le choix du futur établissement ». Ces éléments justifient que soit prise une initiative sur cette question – les rapporteurs proposent supra la création d’un portail sur le sujet des mobilités induites par les choix d’orientation – valorisant la mobilité géographique induite par les études et évoquant les moyens mis à disposition des jeunes pour la mettre en œuvre.
● Construire un accompagnement multiforme tout au long du cursus secondaire en vue de l’élaboration par chaque élève d’un parcours choisi et valorisé :
– sous la responsabilité du chef d’établissement, offrir à chaque élève, en y associant ses parents, un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations (PDMF), à partir de la 6ème, qui comprenne :
a) une présentation des métiers, des professions, des secteurs d’activité, en abordant les perspectives d’avenir propres à chacun de ces secteurs, les rémunérations pratiquées, les conditions de travail associées et les sujétions professionnelles particulières ;
b) des connaissances sur le fonctionnement du marché du travail, de la protection sociale et de l’économie mondialisée ;
c) des échanges et des mises en pratique avec des professionnels – entreprises, administrations, tiers secteur – dans l’établissement scolaire et sur les lieux de travail ;
d) un panorama précis de la carte locale des formations et des principales activités du bassin d’emploi dans le ressort duquel se situe l’établissement scolaire ;
– rendre public le détail du PDMF de chaque établissement scolaire du second degré ;
– expérimenter la défense argumentée par l’élève de son projet d’orientation/professionnel en conseil de classe aux moments clés (fin de 3ème, terminale).
● Valoriser financièrement et dans le déroulement des carrières les personnels exerçant des responsabilités pour l’élaboration et la mise en œuvre du PDMF.
● Offrir dans chaque établissement, sous le contrôle de l’autorité académique, un accompagnement renforcé pour la compréhension et l’utilisation des dispositifs en ligne Affelnet et APB, notamment dans les lycées professionnels pour ce dernier dispositif.
● Orienter résolument l’activité des copsy vers le travail d’équipe au sein des établissements scolaires pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions de définition de son orientation par chaque élève.
● Adapter la formation initiale et continue des enseignants du secondaire et des copsy à l’exercice de leur responsabilité concernant l’accompagnement des élèves pour leur orientation et l’élaboration de leur projet professionnel, s’agissant notamment des connaissances qu’il leur faut transmettre sur le monde du travail, la protection sociale et l’économie.
● Favoriser les mobilités géographiques nécessaires aux choix d’orientation après la 3ème, notamment dans les filières professionnelles, par des moyens nouveaux – financiers et d’accompagnement – ainsi que par la redynamisation et l’extension du parc des internats.
● Favoriser l’articulation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur en développant, par exemple, la validation en faveur de lycéens de crédits d’enseignement d’étude supérieure (ECTS) après une période d’immersion dans un établissement d’enseignement supérieur.
● Diversifier l’offre scolaire au sein du collège unique (classe relais, 3ème alternative…) en faveur des élèves en difficulté ou dont le projet d’orientation/professionnel nécessite une attention particulière.
II. REDONNER DE LA VISIBILITÉ AUX FILIÈRES PROFESSIONNELLES
A. QUEL OBJET, QUELLE IDENTITÉ POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL ?
Les rapporteurs ont résolument mis le lycée professionnel au cœur de leur rapport :
– une grande partie des développements supra concernant l’orientation lui sont consacrés. Préparer une orientation réussie au lycée professionnel – composé de nombreuses sections très diverses – est complexe, d’autant plus que les élèves de collège qui s’apprêtent à y entrer sont en règle générale plus fragiles et obtiennent des résultats scolaires moins bons qu’en moyenne ;
– les développements de la présente partie, surtout consacrés à l’alternance et à l’apprentissage, interrogent le lycée professionnel, ne serait-ce que pour comparer les fonctionnements, les caractéristiques, les résultats des deux voies de la formation professionnelle initiale, respectivement sous statut scolaire et en alternance ;
– le décrochage scolaire est un phénomène logé en premier lieu au lycée professionnel. Les développements infra concernant les décrocheurs, la prévention du décrochage et les dispositifs de seconde chance concernent en grande partie le lycée professionnel et ses élèves ;
– la question de la réussite des parcours universitaires (cf. infra) a également rapport avec le lycée professionnel. Un nombre important de bacheliers professionnels souhaitent engager des études supérieures et les réussissent moins bien que les autres bacheliers. Il convient de s’interroger sur les outils à leur procurer – ou les places à leur réserver – pour réussir ce projet.
Ce panorama du lycée professionnel, dessiné en creux, peut paraître sombre. Le lycée professionnel est effectivement l’un des lieux où se manifeste de façon aiguë la faible capacité du système scolaire français à donner leur chance aux enfants issus des familles socialement et culturellement défavorisées. Il faut toutefois rappeler que le lycée professionnel est la meilleure voie d’orientation pour un grand nombre d’élèves, y compris pour certains d’entre eux orientés aujourd’hui en seconde générale et technologique. C’est également un lieu où de nombreux élèves apprennent, découvrent, réussissent, préparent efficacement leur avenir. C’est un lieu où la collectivité publique investit de façon opportune et où l’énergie déployée par ses personnels donne des résultats.
Pour autant, 5 ans après la réforme de la voie professionnelle, qui a notamment conduit à ce que les candidats au bac professionnel préparent désormais leur examen en 3 ans et non plus 4, il convient sans doute de mener de nouveau une réflexion approfondie sur le lycée professionnel, son objet et son identité.
Les rapporteurs considèrent que cette réflexion pourrait utilement aborder certains éléments abordés au cours de leur mission :
1.– Certains bacs professionnels ne semblent pas – ou plus – permettre d’accéder à l’emploi. Dans une publication récente, le Céreq indique « que la question de la pérennité de certaines filières professionnelles dans l’enseignement secondaire mérite d’être tranchée. Si les métiers du tertiaire administratif recrutent des sortants de l’enseignement supérieur – ce qui est très majoritairement le cas – quel peut être le sens d’un diplôme de niveau inférieur supposé conduire à l’insertion ? Quel est en corollaire l’intérêt du maintien d’une filière professionnelle parallèle à la filière technologique préparant beaucoup mieux aux poursuites d’études dans l’enseignement supérieur spécialisé ? Le mouvement qui conduit à la disparition de ces formations dans l’enseignement professionnel est d’ailleurs engagé sur le terrain : entre 1997 et 2008, le nombre de jeunes inscrits en année terminale d’une formation de la spécialité comptabilité a chuté de 38 % et celui des inscrits de la spécialité secrétariat bureautique de 28 %. Parallèlement, les formations en alternance recrutant des bacheliers pour les conduire à un BTS ou un DUT du tertiaire administratif se sont multipliées sous contrat de professionnalisation et sous contrat d’apprentissage – la part des apprentis dans ces formations de l’enseignement supérieur a ainsi plus que doublé en onze ans. La véritable entrée dans ces métiers est à ce niveau, et l’architecture générale de l’enseignement secondaire mérite d’être clarifiée en conséquence. » (135)
La difficulté pour les pouvoirs publics consiste à proposer – pour l’enseignement professionnel secondaire – une carte des formations adaptée « en temps réel » à la réalité du marché du travail. En tout état de cause, la persistance de filières secondaires professionnelles sans débouchés directs post bac conduit à une impasse pédagogique majeure. Les élèves qui quittent le collège pour intégrer ces formations savent – peu ou prou – que leurs efforts pour obtenir le bac ne leur permettront que difficilement d’obtenir un travail. Dès lors, ces filières sont progressivement désertées – comme l’illustrent les travaux du Céreq. Une partie importante des élèves s’y retrouvent par défaut, en second choix, ou suite à un non choix. Ces élèves – certainement les plus fragiles et les plus faibles scolairement au départ – peuvent alors devenir des candidats sérieux au décrochage, eu égard au découragement produit par une formation suivie sans motivation, qui n’offre la perspective que de devoir suivre des études supérieures lointaines et ardues pour pouvoir être valorisée sur le marché du travail.
2.– Un lycée professionnel doit-il préparer à l’exercice d’un métier ? La réponse positive semble assez naturelle ; la réalité semble plus complexe. Que doit être l’enseignement professionnel alors que – comme le montre une étude du Céreq de décembre 2012 – sur le marché du travail, la moitié des jeunes diplômés exercent un métier pour lequel ils n’ont pas été formés ? La spécialisation de l’enseignement dans certaines sections professionnelles de lycée constitue-t-elle un atout ou un handicap ? Pourquoi former des jeunes à exercer un métier via le bac professionnel, si une grande part d’entre eux souhaitent poursuivre leurs études ?
3.– Est-il possible de « revaloriser les filières professionnelles » ? Selon Mme Patricia Loncle, sociologue reçue par le groupe de travail animé par les rapporteurs le 6 février 2013, la vision dégradée de ces filières est partagée par les jeunes dans de nombreux pays d’Europe, y compris par les jeunes qui y poursuivent leurs études. On peut invoquer et mettre en valeur les débouchés, les rémunérations, la noblesse du travail manuel et technique… Mais que faire contre un biais culturel largement répandu, pas seulement en France ? Il s’agit d’une question ardue, dans une société qui, de surcroit, constate aujourd’hui le déclin de son industrie et ne s’est pas – encore – organisée collectivement pour développer à grande échelle les métiers des services à la personne.
Le rapport des prestataires KPMG et Euréval semble toutefois indiquer certaines évolutions en la matière. Évoquant un site où l’organisation et la préparation de l’orientation à l’issue de la 3ème donne satisfaction, il indique, s’agissant de la filière professionnelle, que « les représentations que s’en font parents et élèves changent aussi, ces derniers préférant s’orienter vers des formations professionnelles porteuses d’emploi plutôt que vers des formations plus généralistes et théoriques dont les chances d’insertion professionnelle sont plus incertaines ». Le même rapport, évoquant cette fois l’apprentissage, évoque une modification mesurée mais réelle des représentations et des choix quant aux filières professionnelles : « le choix d’intégrer une formation en apprentissage apparaît de plus en plus comme une orientation choisie et non subie même si, comme l’indique [la direction d’un CFA], l’entrée en CFA n’est pas l’aboutissement d’un parcours d’orientation préparé en amont mais souvent un choix arbitré à la fin du collège. [Sur un autre site] certains bénéficiaires vont jusqu’à demander à intégrer le CFA alors que le conseil de classe s’est prononcé en faveur d’un passage en section générale. » Des politiques publiques peuvent-elles contribuer à ce que ces évolutions localisées se généralisent ?
B. L’APPRENTISSAGE COMME FACTEUR DE MOBILITÉ SOCIALE CONNAÎT AUJOURD’HUI DES RÉSULTATS RÉELS MAIS SANS DYNAMIQUE DE PROGRESSION
L’apprentissage, alternative aux formations scolaires, bénéficie à plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année par le biais de contrats d’apprentissage (443 000 apprentis en 2012). Initialement mis en œuvre dans certaines branches professionnelles – comme la restauration ou le bâtiment – pour les bas niveaux de qualification, l’apprentissage est aujourd’hui une voie de formation pratiquée aux niveaux infrabac (IV et V) et dans l’enseignement supérieur (en particulier le niveau Master, ou niveau I).
Il connaît depuis longtemps une situation paradoxale : alors qu’il est une voie d’accès efficace à l’emploi durable et que, porté par l’artisanat, il a permis en France la formation d’un chef d’entreprise sur deux, l’apprentissage souffre d’une mauvaise image. Le choix de cette formation initiale est en effet souvent assimilé à l’incapacité pour les jeunes apprentis à demeurer au sein du système scolaire traditionnel.
Au demeurant, le taux de satisfaction est élevé à la sortie de l’apprentissage, alors même qu’à l’entrée de celui-ci, de nombreux jeunes admettent s’y retrouver par défaut.
Moyen efficace d’accès à l’emploi, l’alternance est également une formation civique et sociale pour les jeunes, en matière de savoir-être et de reconnaissance de leur utilité sociale.
Au total, l’apprentissage a un rôle majeur à jouer en termes de mobilité sociale, à la condition qu’il ne soit pas considéré comme la « voie de garage » promise aux élèves dans l’incapacité de « rester » à l’école, et également à la condition qu’il demeure largement ouvert aux élèves des catégories sociales les plus défavorisées.
1. Des effectifs en baisse pour les bas niveaux de qualification et le risque d’un apprentissage à deux vitesses
a. La baisse des effectifs d’apprentis, confirmée en 2013, a des causes conjoncturelles et structurelles
On constate une stagnation depuis 2010 des effectifs des apprentis préparant un diplôme de niveau IV et une baisse importante depuis 2008 des effectifs d’apprentis de niveau V (50 000 élèves en moins en 5 ans). Parallèlement, le nombre d’apprentis des niveaux I et II a considérablement augmenté, de façon particulièrement marquée pour les niveaux I. Ainsi, comme l’illustre le tableau suivant, les apprentis de niveau V, qui représentaient 56 % des effectifs en apprentissage en 2007-2008, n’en représentent plus que 43,4 % en 2011-2012, alors que la proportion des apprentis de niveaux I et II a augmenté sur la même période de 8,1 % à 12,8 %.
NOMBRE D’APPRENTIS DEPUIS LA RENTRÉE 2004,
PAR NIVEAUX DE QUALIFICATION
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 | |
Niveau V |
225 274 |
228 613 |
235 391 |
239 394 |
231 659 |
209 767 |
191 857 |
189 560 |
Niveau IV |
80 623 |
86 609 |
91 951 |
95 753 |
98 470 |
111 900 |
123 018 |
123 888 |
Niveau III |
39 560 |
44 233 |
50 316 |
55 577 |
58 572 |
59 532 |
62 074 |
67 193 |
Niveau II & I |
23 531 |
26 404 |
30 151 |
34 538 |
38 949 |
43 543 |
49 331 |
55 693 |
TOTAL 1 |
368 988 |
385 859 |
407 908 |
425 162 |
427 650 |
424 742 |
426 280 |
436 334 |
Pré-apprentis |
9 771 |
9 718 |
9 936 |
8 547 |
7 583 |
7 344 |
7 243 |
6 919 |
TOTAL 2 |
378 759 |
395 577 |
417 745 |
433 709 |
435 233 |
432 086 |
433 523 |
443 253 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale. Repères et statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, 2013.
Concernant la baisse des effectifs des niveaux IV et V, plusieurs explications sont évoquées par les conseils régionaux et les préfectures interrogés par les rapporteurs :
– la réforme de la voie professionnelle induit la raréfaction des contrats d’apprentissage en deux ans liés au BEP. Cette évolution n’a pas été à ce stade compensée par une augmentation des effectifs d’apprentis préparant le bac professionnel en 3 ans (136). Certains employeurs semblent réticents à engager un jeune pour une durée augmentée d’un an par rapport à l’ancien BEP. Cette année supplémentaire va-t-elle augmenter de moitié la compétence des jeunes par rapport à la formation antérieure en 2 ans ou, au contraire, le niveau du bac professionnel va-t-il baisser puisque préparé en trois ans et non plus quatre ? Sur cette question de l’allongement de la durée d’apprentissage de 2 à 3 ans induite par la disparition du BEP au bénéfice de la montée en puissance du bac, peut-être faut-il examiner attentivement la préconisation du rapport KPMG et Euréval, tendant à « instaurer un bac professionnel en trois ans dont seules les deux dernières années seraient en apprentissage, la première se déroulant intégralement au CFA afin de créer un “sas” de préparation aux attentes du monde de l’entreprise. »
– l’offre d’apprentissage évolue vers des métiers qui requièrent des compétences de plus haut niveau. Cette élévation générale des qualifications requises semble marquée en Île-de-France ;
– de façon conjoncturelle, la crise économique a des effets négatifs depuis 2008 en premier lieu sur les offres d’apprentissage de niveaux V et IV. Les petites entreprises, qui recourent plus souvent aux apprentis de niveaux IV et V, sont celles qui disposent de moins de ressources internes pour faire face aux aléas de la conjoncture. Elles ont tendance plus que les autres à supprimer les postes d’apprentis.
Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP (CCCA-BTP) a prévu pour 2013 une baisse de 8 % du nombre d’apprentis formés dans le secteur du bâtiment, après une baisse de 15 % constatée entre 2008 et 2012. Cette baisse touche en premier chef les niveaux IV et V, les plus courants dans ce secteur professionnel.
L’artisanat, secteur également formateur d’un grand nombre d’apprentis de niveaux IV et V, subit l’incertitude économique, comme en témoigne le CFA vendéen des MFR (Maisons familiales rurales) interrogé par les rapporteurs, dont les effectifs ont chuté de 12 % au premier semestre 2013. Ce CFA indique que « Les patrons sont bien convaincus qu’il faut former des apprentis, mais le manque de visibilité de leurs carnets de commande les fait hésiter à en prendre. »
b. Le développement récent de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur offre-t-il des garanties en termes de mobilité sociale ?
L’augmentation du nombre d’apprentis de niveaux I et II est constante depuis une dizaine d’années : entre 2004 et 2012, leurs effectifs sont ainsi passés de 23 000 à 56 000, soit une augmentation de 138 % en 8 ans (+ 17 % par an). Cette augmentation massive s’explique également par des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles :
– les écoles de commerce et les écoles d’ingénieurs recourent de façon croissante à l’alternance. Elles ont pu être encouragées en ce sens par certains documents territoriaux d’orientation stratégique (Les conseils régionaux ont adopté en 2006 des stratégies régionales emploi/formation, avant l’adoption des contrats de plan régionaux pour le développement des formations professionnelles en 2011) ;
– le poids des métiers requérant des qualifications de niveaux I et II s’accroît. En région Île-de-France, le nombre des apprentis de niveau I est passé de 6 123 en 2006 à 16 549 en 2012, soit une augmentation de 270 %.
L’appropriation de l’apprentissage par l’enseignement supérieur n’est pas en soi une difficulté du point de vue de la mobilité sociale, pour autant qu’elle ne se fait pas au détriment du volume de l’apprentissage aux niveaux plus faibles de qualification et que l’apprentissage dans le supérieur concerne en grande partie des jeunes issus des classes sociales défavorisées.
Or, en réponse aux rapporteurs, le conseil régional de Bretagne reprend les conclusions du rapport de 2010 de M. Prisca Kergoat, économiste (137) : « L’apprentissage est aujourd’hui une stratégie qui tend progressivement à devenir l’apanage des classes intermédiaires contribuant à détourner sa vocation première, celle de permettre à des jeunes d’acquérir un titre de l’enseignement supérieur ce qu’ils n’auraient sans doute jamais pu acquérir autrement ».
Quatre des cinq conseils régionaux interrogés par les rapporteurs notent que l’apprentissage dans le supérieur tend à être plus efficace pour les jeunes des classes intermédiaires et supérieures, en partie parce qu’ils peuvent bénéficier de réseaux personnels déjà existants pour trouver une entreprise. Seule la région Île-de-France constate une « réelle hausse consensuelle de la mobilité sociale » grâce à l’apprentissage dans le supérieur, qui conduit à de « belles success stories ». Cette région est aussi caractérisée par une forte offre d’emploi de niveaux I et II.
Comparant deux moyens contribuant à la mobilité sociale dans l’enseignement supérieur, la région Poitou-Charentes indique que « l’apprentissage ne corrige pas particulièrement les inégalités sociales ; les bourses attribuées aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières ont certainement plus d’efficacité dans ce domaine ».
2. Des difficultés structurelles pesant sur le développement de l’apprentissage en France
a. L’orientation à la française et la dichotomie du système de formation professionnelle donnent à l’apprentissage une image paradoxale
Les acteurs de l’apprentissage interrogés par les rapporteurs sont unanimes : l’existence de deux filières de formation professionnelle (voie scolaire et apprentissage) est une bonne chose pour les jeunes, car elle leur permet de bénéficier d’une alternative et de faire ainsi un choix qui correspond à leurs attentes.
Certains jeunes mineurs ne sont en effet pas prêts pour entrer dans le monde de l’entreprise et l’enseignement scolaire est alors une voie pertinente qui ne les empêche pas d’acquérir en lycée professionnel des compétences qui leur seront directement utiles en entreprises. Pour d’autres jeunes, la découverte du monde de l’entreprise est une révélation, leur permettant d’acquérir des compétences de savoir-être et de prendre confiance et conscience de leur utilité sociale.
Cette offre diversifiée conduit toutefois à la persistance d’un certain nombre de stéréotypes sur l’apprentissage, lequel ne serait pas une voie de formation d’excellence, mais celle qui sanctionne l’échec scolaire.
Le problème de la coexistence de l’apprentissage et de la filière professionnelle scolaire tient à une hiérarchie implicite « dans le bas du classement », qui associe – encore plus que pour le lycée professionnel – l’apprentissage et l’échec scolaire antérieur. L’absence de passerelles, de complémentarité et de liens entre les deux filières, sont également notés par la plupart des acteurs interrogés par les rapporteurs.
b. Les modalités de financement sont complexes et mettent en jeu de nombreux acteurs
De façon schématique, le financement de l’apprentissage s’appuie à la fois sur les entreprises (42 %), l’État (27 %) et les régions (24 %), pour un total de 8 milliards d’euros en 2010 (138).
Les éléments suivants, issus des travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV), retracent les modalités par lesquelles chaque acteur finance l’apprentissage, ainsi que les montants en jeu.
Les entreprises participent au financement de l’apprentissage, via :
– la rémunération des apprentis ;
– la taxe d’apprentissage (TA) (139), la contribution au développement de l’apprentissage (CDA) (140), ainsi que, pour certaines d’entre elles, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) (141) ;
– les cotisations spécifiques à certaines branches professionnelles (BTP par exemple).
Les régions participent au financement de l’apprentissage, via :
– les subventions aux centres de formation des apprentis (CFA) ;
– les aides aux apprentis (logement, transport, restauration…).
L’État participe au financement de l’apprentissage, via :
– les exonérations de cotisations sociales pour les apprentis et/ou les entreprises employant des apprentis ;
– l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), supprimée en juillet 2013 (142) ;
– des exonérations d’impôts spécifiques.
Le CNFPTLV, dans son rapport de 2012, indique les données financières de 2010 de l’apprentissage en fonction des différents acteurs. Le tableau suivant retrace ces données.
ORIGINE DU FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE EN FRANCE
Entreprises |
Entreprises |
État |
Régions |
Organismes gestionnaires |
Apprentis |
Autres |
TOTAL |
2 360 M€ |
992 M€ |
2 143 M€ |
1 967 M€ |
87 M€ |
58 M€ |
422 M€ |
8 029 M€ |
29% |
13 % |
27 % |
24 % |
1 % |
1 % |
5 % |
100 % |
Source : CNFPTLV
En période de difficultés économiques, les dépenses liées à l’apprentissage ont augmenté plus rapidement (+ 50 % entre 2004 et 2010) que le nombre d’apprentis (+ 15 % sur la même période).
En 2010, un apprenti représentait un coût d’environ 18 500 euros, dont 13 100 euros hors rémunération. Sur ces 13 100 euros, on compte :
– de la part des financeurs de l’offre de formation (c’est-à-dire, notamment, le fonctionnement du CFA), 6 800 euros répartis entre les régions (3 200 euros) et les entreprises (2 300 euros), plus un financement résiduel de 1 300 euros (notamment à la charge des familles) ;
– de la part des pouvoirs publics au titre du soutien aux employeurs et aux apprentis, 6 300 euros, dont 5 000 euros par l’État et 1 300 euros par les régions.
Depuis dix ans, cette répartition des dépenses a changé : alors qu’en 2004, l’offre de formation représentait 41 % des financements, cette proportion est de 35 % en 2010. Dans le même temps, les dépenses pour le soutien aux employeurs et aux apprentis ont considérablement augmenté. Pour le CNFPTLV, la taxe d’apprentissage, qui finance majoritairement l’offre de formation, remplit aujourd’hui avec difficulté cette tâche, car les besoins ont considérablement augmenté (agrandissement et complexification de la carte des formations, augmentation du nombre de CFA, élargissement de l’apprentissage vers l’enseignement supérieur). Ainsi le CNFPTLV précise-t-il que : « Le financement par la taxe d’apprentissage approche de ses limites ».
3. Un taux d’échec non négligeable, mais une contribution réelle à l’insertion professionnelle sinon à la mobilité sociale des jeunes
a. La proportion d’échec des contrats d’apprentissage pèse sur la mobilité sociale
Le taux d’échec en apprentissage – c’est-à-dire le taux de rupture des contrats – est variable selon les régions et selon les branches professionnelles, se situant entre 10 et 35 %. Dans l’ensemble des régions, ce taux d’échec est d’autant plus important que le niveau de l’apprentissage est bas.
Le tableau suivant retrace les taux d’échec constatés dans l’un des CFA interrogés par les rapporteurs, qui a pour particularité de proposer des formations pour chaque niveau de qualification.
TAUX DE RUPTURE CFA DE L’IFAI (RÉGION RHÔNES-ALPES) PAR NIVEAUX, 2012
En pourcentage
Niveau I & II |
2.91 % |
Niveau III |
12.60 % |
Niveau IV |
13.04 % |
Niveau V |
30.00 % |
TOTAL |
9.89 % |
Source : CFA de l’IFAI
Par ailleurs, le taux de rupture est plus important lorsque les contrats sont de longue durée : il est ainsi deux fois plus élevé en région Île-de-France pour des contrats de deux ans que pour des contrats d’un an.
S’agissant du taux de réussite au diplôme, on note un avantage comparatif de la voie scolaire sur l’apprentissage – en partie lié au volume des ruptures de contrat d’apprentissage –, comme le montre le tableau ci-dessous.
TAUX DE RÉUSSITE AU DIPLÔME
En pourcentage
BRETAGNE |
FRANCE | |||
Apprentissage |
Voie scolaire |
Apprentissage |
Voie scolaire | |
Niveau Bac |
88,70 % |
93,20 % |
81,80 % |
88,10 % |
Niveau BEP/CAP |
82,60 % |
87,50 % |
78,70 % |
78,10 % |
Ensemble |
84,10 % |
89,20 % |
79,60 % |
80,80 % |
Source : Préfecture de Bretagne et région Bretagne
On constate les éléments suivants :
– plus le niveau de qualification est bas, plus le taux de réussite est faible à la fois pour l’apprentissage et pour la voie scolaire ;
– la différence de taux de réussite entre le niveau bac et le niveau BEP/CAP est moins importante pour l’apprentissage que pour la voie scolaire.
In fine, de ce point de vue, la voie de l’apprentissage semble plus pertinente pour les diplômes les moins qualifiants. Cette donnée pourrait justifier un usage plus intense de l’apprentissage pour les plus bas niveaux de qualification.
Les causes des ruptures de contrat semblent de deux ordres, aux termes des réponses adressées aux rapporteurs :
– la qualité du travail des jeunes est parfois jugée insuffisante par les employeurs : manque de connaissances directement liées au métier ; manque de motivation ; lacunes sur les compétences de savoir-être en entreprise ; passivité et manque de « proactivité » ;
– un manque de liens pour les apprentis entre leur formation en CFA et l’activité qu’ils mènent dans leur entreprise.
Le dispositif expérimental « Citoyenneté et vivre ensemble » a été développé en 2012 dans trois CFA de la région de Bretagne. Face au constat que de nombreuses ruptures proviennent de mauvaises relations entre apprentis et formateurs – par manque de confiance réciproque ou, parfois, par une méconnaissance des règles du vivre ensemble de la part de certains jeunes –, ce projet développe par une formation en milieu associatif des compétences sociales de savoir-être.
Les missions locales peuvent également jouer un rôle important de suivi des « décrocheurs apprentis ». En région Île-de-France, des jeux de rôle sont organisés par elles au sein des CFA pour préparer les jeunes au monde de l’entreprise. La région Île-de-France note par ailleurs que la formation des formateurs de CFA est un point essentiel dans l’amélioration du lien entre CFA et entreprises. Depuis 13 ans dans cette région, 2 000 d’entre eux ont été formés à l’Institut pour la professionnalisation des acteurs de l’apprentissage (IP2A), en partenariat avec le Centre national des arts et métiers (CNAM). Pour les formateurs déjà confirmés, des formations continues régulières y sont proposées.
b. L’apprentissage demeure une voie efficace pour l’insertion des jeunes qui vont au bout de la démarche
L’accès à l’emploi des apprentis est meilleur que celui des jeunes formés en milieu scolaire. Les apprentis semblent également connaître de meilleurs développements de carrière. Le tableau suivant l’atteste pour tous les niveaux de formation.
TAUX D’EMPLOI COMPARÉS ENTRE LES APPRENTIS ET LES LYCÉENS, SEPT MOIS APRÈS LA FIN DE LEUR FORMATION
En pourcentage
CAP-BEP |
Bac professionnel |
BTS | |
Apprentis |
62 % |
78 % |
76 % |
Lycéens |
38 % |
57 % |
69 % |
Source : Insee
PAYS DE LA LOIRE
En pourcentage
CAP-BEP |
Bac professionnel |
BTS | |
Apprentis |
66 % |
83 % |
93 % |
Lycéens |
39 % |
60 % |
70 % |
Source : Région Pays-de-la-Loire, année 2011
L’enseignement scolaire professionnel semble, par certaines évolutions – par exemple la requalification des stages en « période de formation en milieu professionnel » –, prendre acte des bénéfices qu’apporte la proximité du lieu de la formation théorique et de l’entreprise. Légitimés par ces évolutions, les CFA interrogés par les rapporteurs se réjouissent de ce rapprochement du monde professionnel de l’entreprise et du monde scolaire.
Les régions interrogées par les rapporteurs notent que les apprentis sont mieux préparés que les lycéens notamment au marché du travail – par une meilleure connaissance des gestes techniques et du fonctionnement de l’entreprise –, réalité confortée par les résultats des Olympiades des métiers depuis plusieurs années.
C. DONNER À L’APPRENTISSAGE L’IMAGE QU’IL MÉRITE ET LES MOYENS DE SON DÉVELOPPEMENT
1. Fixer et tenir des objectifs ambitieux quantitatifs en termes d’apprentissage
a. L’objectif de 500 000 apprentis en 2017 nécessite une augmentation régulière du nombre d’apprentis
L’apprentissage connaît une croissance à peu près constante de ses effectifs depuis une dizaine d’années. Entre 2005 et 2012, le nombre d’apprentis est passé de 379 000 jeunes à 443 000, soit une augmentation de 17 % en sept ans, et de 2,4 % par an. Cette croissance modérée est relativement cohérente avec l’objectif gouvernemental actuel de 500 000 apprentis en 2017. En effet, le maintien d’une augmentation de 2,4 % par an des effectifs correspondrait à l’atteinte d’un effectif de 496 000 apprentis en 2017.
L’objectif des 500 000 apprentis en 2017 apparaît ainsi raisonnablement ambitieux, dans la mesure où l’atteindre ne nécessite pas d’accélération du rythme de croissance récent des effectifs.
L’objectif de 500 000 apprentis en 2017 doit être accompagné d’un « sous-objectif » d’évolution positive du nombre des apprentis des niveaux IV et V. En poursuivant par hypothèse les évolutions récentes de la distribution des apprentis par niveaux de qualification, la répartition des 500 000 apprentis en 2017 pourrait être marquée par une baisse continue de la proportion d’apprentis de niveaux IV et V et par une augmentation de ceux de niveau I et II, dans des proportions évoquées par le tableau ci-dessous.
PROPORTION DES NIVEAUX IV/V ET I/II ENTRE 2008 ET 2012 - HYPOTHÈSE POUR 2017
En pourcentage
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
… |
2016/2017 | |
Proportion de niveau IV et V |
78,83 % |
77,19 % |
75,73 % |
73,86 % |
71,83 % |
… |
64,83 % |
Proportion de niveau I et II |
8,12 % |
9,09 % |
10,25 % |
11,57 % |
12,76 % |
… |
17,52 % |
Source : prolongement des données 2008-2012 du ministère de l’Éducation nationale
Les premiers éléments concernant les signatures de contrats d’apprentissage pour le premier semestre 2013, rendus publics par le ministère du travail, sont assez alarmants puisqu’ils témoignent d’une baisse globale des entrées dans l’apprentissage. Sur les sept premiers mois de 2013, 62 561 contrats d’apprentissage ont été signés, contre 76 000 pour la même période en 2012 – soit une baisse d’environ 13 500 contrats, et un recul de 18 %. Dans ce contexte, il convient d’évaluer les effets de l’annonce de la suppression de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) pour les entreprises de plus de dix salariés (143). Il faut également considérer les raisons pour lesquelles le nombre des entrées en contrat de professionnalisation (144) a lui augmenté de 2,9 % sur les sept premiers mois de 2013, avec 55 064 contrats signés.
S’agissant des éventuels freins « techniques » au développement de l’apprentissage, les rapporteurs ont été alertés à plusieurs reprises au cours de leur mission sur la question des jeunes ayant achevé leur scolarité dans le secondaire et qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans à la rentrée scolaire. En application de l’article L. 6222-1 du code du travail dans sa version issue de l’article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces élèves ne peuvent pas entrer en apprentissage, alors qu’ils le pouvaient précédemment pour autant qu’ils atteignaient 15 ans durant l’année civile en cours. De nombreux acteurs locaux ont témoigné de la difficulté de la situation pour certains des jeunes concernés, motivés pour entrer en apprentissage, ayant parfois trouvé à la fois le CFA et l’entreprise susceptibles d’assurer leur formation, et qui sont dans l’impossibilité de la démarrer, au risque de la démotivation et du décrochage.
La circulaire n° 2013-143 du 9 septembre 2013 du ministère de l’Éducation nationale traite de cette difficulté – relativement tardivement eu égard à la date de la rentrée scolaire – en précisant que la disposition législative nouvelle « suscite, dans une phase de transition, des interrogations de la part des familles et de différents acteurs de l'apprentissage ». Les dispositions de cette circulaire sont les suivantes :
– de façon générale, les élèves ayant terminé leur scolarité au collège, qui atteindront l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et la fin de l’année civile, et qui disposent d’un projet d’apprentissage précis comprenant une promesse d’inscription en CFA et une promesse écrite d’embauche par une entreprise, bénéficieront d’une période préparatoire à l’apprentissage jusqu’à leurs 15 ans, en lycée professionnel ou en CFA ;
– les contrats d’apprentissage signés antérieurement à la promulgation de la loi du 8 juillet 2013 et qui concernent des jeunes qui n’avaient pas 15 ans à la rentrée 2013 sont considérés comme valables et, en conséquence, s’appliquent sans délai (145).
Il convient de veiller à ce que cette circulaire permette effectivement à tous les jeunes ayant dûment achevé leur scolarité au collège d’entrer sans délai dans la démarche d’apprentissage s’il le souhaite, dans le respect du choix du législateur de fixer à 15 ans l’âge plancher après lequel l’alternance proprement dite est effectivement possible (146). Il convient de prêter une attention particulière à ce point, car le public des CFA connaît un rajeunissement constaté par l’ensemble des interlocuteurs des rapporteurs. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval souligne que « le jeune âge des bénéficiaires est […] une caractéristique observée dans l’ensemble des territoires. Le redoublement au collège ayant diminué, les élèves arrivant dans les CFA sont plus jeunes que par le passé. »
b. Une attention particulière doit être portée à l’apprentissage infrabac, tout en veillant à répondre aux besoins de l’économie
Les difficultés de l’apprentissage pour les qualifications les moins élevées (baisse en volume, persistance d’un taux d’échec élevé) témoignent de la nécessité de concentrer une partie des aides financières pour ces niveaux de qualification, en agissant à la fois sur les aides aux apprentis et aux entreprises. La substitution à l’ICF d’une aide aux entreprises de moins de dix salariés constitue peut-être un pas dans ce sens. La préconisation d’une concentration des aides publiques à l’apprentissage est également faite dans le rapport de l’OCDE d’avril 2013 sur le système éducatif français (147).
Une telle concentration des aides ne peut être efficace que si l’apprentissage dans son ensemble – les apprentis et leur formation – correspond aux besoins des entreprises en termes de main d’œuvre. Plusieurs CFA, en réponse aux questions des rapporteurs, placent résolument leurs offres de formation prioritairement en réponse aux besoins des entreprises, avant la prise en compte des désirs des futurs apprentis. Le CFA « Campus des métiers et de la formation » en Île-de-France précise ainsi avoir « décidé de privilégier l’accès à l’emploi en fonction du besoin de main d’œuvre plutôt que de la formation choisie par le candidat ».
Certains secteurs semblent toutefois touchés par un manque de main d’œuvre en apprentis, en particulier la métallurgie, le bâtiment ou l’industrie agroalimentaire. La région Nord-Pas-de-Calais a réalisé en 2012, avec le soutien de l’État, une étude prospective pour le développement de l’apprentissage sur les territoires de la Côte d’Opale dont l’une des conclusions est que « les entreprises et les formations sont là, mais pas les jeunes ». Ce constat nécessite une réflexion sur les réticences des jeunes face à l’apprentissage, souvent relatives à la pénibilité – supposée ou avérée – des métiers proposés ou aux difficultés matérielles et financières qu’ils rencontrent durant leur formation, ainsi que sur le niveau de leur motivation et de compétence à la sortie du système scolaire.
2. Clarifier et améliorer la gouvernance et le financement de l’apprentissage
a. Un rapprochement entre lycées professionnels et CFA doit pouvoir pallier une dichotomie surannée
Il faut faire en sorte que les avantages respectifs de la voie scolaire professionnelle et de l’apprentissage profitent aux jeunes formés dans les deux voies. L’encadrement scolaire est propice, pour certains élèves, pour mener et achever une formation. L’apprentissage apporte une valeur ajoutée en terme d’insertion professionnelle. Les échanges peuvent intervenir à trois niveaux :
– les CFA et les conseils régionaux interrogés par les rapporteurs se font l’écho de la mise en place de plateaux techniques communs aux lycées professionnels et aux CFA. Rencontre des publics et des cultures de formation vont ainsi de pair avec la mutualisation des coûts ;
– il faut encourager la mise en place de passerelles efficaces et simples qui permettent aux jeunes de passer d’un système à l’autre sans difficulté, et ainsi de s’orienter, voire de se réorienter aisément. Pour les CFA interrogés par les rapporteurs, ces passerelles sont aujourd’hui théoriquement possibles, mais difficiles en pratique, notamment dans le sens de l’apprentissage vers le lycée professionnel. Il pourrait pourtant s’agir d’une réponse efficace aux ruptures de contrats d’apprenti ayant pour cause la difficulté à entrer dans l’entreprise ;
– un fonctionnement mixte de certaines formations, à l’instar de l’expérimentation de « classes mixtes scolaire – apprentissage » à compter du second semestre 2013 en Île-de-France.
Le rapprochement entre l’apprentissage et l’enseignement scolaire ne saurait servir à réapprovisionner en effectifs des secteurs en crise de l’enseignement professionnel scolaire. Un des acteurs de l’apprentissage interrogé par les rapporteurs note – avec sévérité – que « l’intégration des formations en apprentissage dans les lycées n’a été mise en œuvre dans la plupart des cas que pour être éligibles à la part quota de la taxe d’apprentissage et sauver des postes et des sections moribondes sous statut scolaire ». Ce constat corrobore celui établi par les prestataires KPMG et Euréval, qui indiquent dans leur rapport qu’« une concurrence existe entre les CFA et les établissements scolaires, ces derniers ayant des difficultés à accepter que les jeunes s’orientent vers des CFA car ces départs entraînent une baisse des effectifs qui peut conduire à la fermeture de certaines classes ». Lors de l’audition le 17 juillet 2013 par le groupe de travail des organisations syndicales représentant les employeurs, M. Pierre Burban, représentant l’Union professionnelle artisanale (UPA), a au demeurant émis une interrogation analogue.
b. Le financement de l’apprentissage devrait être résolument simplifié dans le contexte d’un chef-de-filat exercé par les régions
Pour la région Poitou-Charentes, « la grande complexité des circuits de financement, la multiplicité des acteurs ne contribuent pas à faciliter [le] développement [de l’apprentissage]. La réelle reconnaissance du rôle de la région en matière de financement serait certainement source de simplification et d’une plus grande efficience ». La nécessité d’une autonomie accrue des régions en matière de financement de l’apprentissage est aujourd’hui reconnue par beaucoup des acteurs du secteur.
Pour les rapporteurs, le renforcement de la décentralisation doit s’accompagner d’une orientation prioritaires des aides financières, y compris de l’offre de formation, vers les plus bas niveaux de qualification. Il est impératif que toute réforme à venir de la taxe d’apprentissage, des autres aides financières à l’apprentissage – et tout transfert de compétences aux régions – soient effectués dans le respect de la garantie du développement de l’apprentissage pour ces bas niveaux de qualification.
3. Contribuer à développer encore l’apprentissage : lutte contre les freins relatifs aux besoins financiers des jeunes et à leur orientation au sein du système scolaire
a. Modifier résolument les pratiques d’information et d’orientation pour donner à l’apprentissage le reflet qui devrait être le sien : une modalité efficace et appréciée de formation professionnelle
Selon le CFA « Campus des métiers et de l’entreprise » en région Île-de-France, « la majorité des jeunes candidatant pour une formation en apprentissage le font par défaut. Leur candidature est vécue comme une marque d’échec. Cette vision se dissipe avec les premiers résultats et l’identification de leur capacité ».
Le rôle « re-mobilisateur » de l’apprentissage – initialement appréhendé comme le prolongement de l’échec scolaire – est décrit par le CFA de Ploufragan en ces termes : « l’entreprise apporte à l’apprenti des compétences de savoir-être et de motivation que les apprentis, dans de nombreux cas, n’ont pas acquis à l’école. L’apprentissage joue un rôle “social” pour les jeunes qui ne se reconnaissaient pas dans le système scolaire : “l’entreprise est leur école de prédilection”. C’est la raison pour laquelle le système dual enseignement professionnel / apprentissage a une raison d’être, précisément pour ces jeunes qui ne se reconnaissent pas dans l’offre et le modèle scolaire ». Le rapport des prestataires KPMG et Euréval est plus explicite encore : « l’obligation, pour les élèves n’ayant pas la “fibre” scolaire d’attendre quatre ans avant de pouvoir intégrer une voie d’enseignement moins théorique génère une importante démotivation et complexifie la tâche des CFA. »
Ce déficit d’image initial de l’apprentissage, aux yeux mêmes des apprentis, n’existe toutefois plus à partir d’un certain niveau de qualification. Le CFA du Cipecma de Châtelaillon-Plage précise qu’ « il y a une évolution du choix de l’apprentissage par les jeunes et les familles, pour les niveaux IV, le choix est encore par défaut, à l’inverse, à partir du niveau III, c’est un choix volontariste et une voie d’excellence pour l’insertion et reconnue comme telle ».
Les développements supra des rapporteurs sur l’orientation l’ont montré. La revalorisation des voies professionnelles passe par une orientation préparée en amont, et accompagnée par des personnels réellement formés sur leur réalité. Tout doit être connu et mis sur la table, face aux élèves et leur famille : l’exigence incontournable d’un niveau général au moins correct, la difficulté de l’alternance, les taux d’insertion professionnelle, les rémunérations…
b. Mieux prendre en compte les difficultés culturelles, matérielles et financières des jeunes liées à l’apprentissage
Trop souvent, la rupture du contrat d’apprentissage a pour cause des difficultés matérielles et financières principalement liées au logement et au transport.
La première difficulté est celle du transport et du double logement pour les périodes d’alternance, quand l’entreprise et le CFA sont éloignés l’un de l’autre. Les régions jouent un rôle crucial sur ce sujet, via leur participation aux frais de transport, d’hébergement et de restauration (THR), à hauteur de 85 millions d’euros en 2010 (sur 1 967 millions d’euros accordés à l’apprentissage par les régions, soit un peu plus de 4 % de ces crédits). Il faut sans doute inciter les régions à consacrer plus de moyens en la matière. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval précise que les jeunes apprentis pâtissent d’« un manque de mobilité “physique”, dû notamment au coût du transport et à des réseaux de transports en commun mal adaptés aux horaires des cours. »
En tout état de cause, il faut prêter une attention accrue, personnalisée, aux situations de double logement, qui fragilisent la démarche d’apprentissage. Dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir en faveur de l’alternance (doté de 500 millions d’euros) (148), 250 millions d’euros ont été prévus au titre de l’action pour l’hébergement des apprentis. L’objectif était la création de 10 000 places d’hébergement. En 2013, seuls 65,8 millions d’euros (26 % de l’enveloppe allouée) avaient été répartis, ce qui devrait proportionnellement représenter entre 2 500 et 3 000 places d’hébergement. Il faut mener ce plan à terme, en ciblant les zones dans lesquelles il est le plus nécessaire.
Une deuxième difficulté peut être l’accès au permis de conduire, pour des raisons de coûts ou pour la trop grande difficulté des épreuves théoriques ou pratiques du permis. La CAPEB (artisanat du bâtiment) et l’UPA (Union professionnelle des artisans) mettent actuellement en œuvre une aide à la mobilité – la conduite accompagnée des apprentis en entreprise – afin que l’apprenti obtienne son permis de conduire dans le cadre à la fois de son entreprise et du CFA. Le code est préparé en auto-école, mais également au CFA. La partie pratique est menée d’abord en auto-école (20h), puis, comme pour la conduite accompagnée classique, avec un accompagnateur – qui est en général le chef d’entreprise. Ce dispositif entre par ailleurs dans le cadre du permis à 1 euro par jour. Il montre également de façon pratique comment peut être envisagée une plus grande proximité entre le CFA et l’entreprise.
Il importe également de ne pas sous-estimer le problème de l’illettrisme pour certains apprentis. L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCA-BTP) ont signé une convention en 2012. L’ANLCI fournit aux formateurs de CFA une aide méthodologique pour aider les jeunes apprentis et, au préalable, pour que les CFA puissent déceler et évaluer les cas d’illettrisme dans le secteur du bâtiment.
L’ANLCI indique que l’illettrisme – qui touche 7 % de la population en 2011 et 4,5 % des 18-24 ans – concerne pour une bonne part des actifs : 50 % des personnes illettrées sont en emploi. La proportion de personnes illettrées atteindrait 30 % chez les apprentis du BTP, chiffre substantiel qui a conduit l’ANLCI à proposer cette convention avec le CCA-BTP. L’illettrisme est de fait une cause courante – mais pas toujours explicite – de rupture de contrats d’apprentissage.
● Engager une réflexion sur le bac professionnel : pertinence et adaptabilité de la carte des formations, vocation professionnalisante, revalorisation réelle de la filière et des métiers techniques et manuels.
● Respecter l’objectif de 500 000 apprentis en 2017, en s’appuyant sur une croissance des effectifs d’apprentis pour les niveaux inférieurs au bac, garantie par une augmentation des financements publics en faveur de ce segment de l’apprentissage.
● Favoriser les partenariats et les passerelles entre les lycées d’enseignement professionnel et les centres de formation des apprentis (CFA).
● Favoriser la levée des freins à l’apprentissage en matière de double logement, de permis de conduire et d’insuffisance dans la maîtrise des compétences de base (notamment en matière d’illettrisme).
III. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LES DISPOSITIFS DE SECONDE CHANCE
A. LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EST UN PHÉNOMÈNE D’AMPLEUR SUBSTANTIELLE EN FRANCE
1. L’ampleur du décrochage scolaire en France
a. Définition et recensement du décrochage scolaire
L’article L. 313-7 du code de l’éducation donne une définition du décrochage scolaire et précise les modalités de son recensement. Dans un objectif de mobilisation des acteurs de la formation professionnelle initiale et continue, cet article précise que « chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, [notamment aux plates-formes de suivi et d'appui aux jeunes décrocheurs – PSAD, et aux missions locales ou, à défaut, à Pôle emploi] les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire. »
Ce niveau de qualification minimale est défini à l’article D. 313-59 du code de l’éducation. Il s’agit soit du baccalauréat général, soit du CAP, du BEP ou du baccalauréat professionnel, selon la filière dans laquelle l’élève était inscrit.
Le décrochage est donc défini par une absence de diplôme à l’issue de la scolarité obligatoire. Avant la fin de celle-ci à 16 ans, chaque jeune est tenu par une obligation légale d’assiduité scolaire (149). Il peut être, le cas échéant, considéré comme « absent » de l’établissement dans lequel il est inscrit, ce qui peut préfigurer un futur décrochage.
Il résulte de la mise en œuvre de l’article L. 313-7 du code de l’éducation – via le système interministériel d’échanges d’informations (SIEI) – une liste départementale des supposés décrocheurs, y compris ceux avec lesquels les missions locales ont pu entrer en contact. Cette liste est adressée aux parties prenantes de la PSAD locale (Cf. infra), qui doivent ensuite entrer en contact avec les jeunes concernés. La prise de contact permet de déterminer leur situation exacte au regard du décrochage. Un jeune peut avoir quitté le système scolaire sans diplôme, ne pas être en formation et avoir trouvé un emploi, auquel cas il n’est plus en situation de décrochage.
b. L’ampleur de l’absentéisme et du décrochage scolaires
Les pouvoirs publics ne rendent pas publiques les statistiques précises issues des listes départementales. Le chiffre de 140 000 décrocheurs par an est celui le plus souvent repris dans le débat public. Il a été confirmé aux membres du groupe de travail par M. Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire (Dgesco), lors de son audition le 20 mars 2013.
Si on rapporte ce chiffre à l’effectif d’une génération annuelle comportant entre 700 000 et 800 000 jeunes, le ratio de décrocheurs s’élèverait ainsi de 17,5 % à 20 % d’une classe d’âge. Ces proportions correspondent aux constats – évoqués supra – établis par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) dans le cadre d’enquêtes sur les générations de jeunes sortis de formation initiale au cours de certaines années. Selon le Céreq, la proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et sans qualification en 1998, 2001 et 2004 s’est établie à 17 %. Elle s’est élevée à 18 % en 2007. Les enquêtes Emploi de l’INSEE conduisent à des résultats analogues. Pour les années 2007 à 2009, elles indiquent que 120 000 jeunes sont sortis du système de formation initiale sans diplôme, soit 17 % des 700 000 jeunes sortis en moyenne de ce système chacune de ces trois années (150).
L’absentéisme chronique de certains élèves, soumis pour beaucoup à l’obligation scolaire avant 16 ans, préfigure leur décrochage ultérieur. Le tableau ci-dessous retrace pour le mois de janvier 2011 certains éléments statistiques relatifs à l’absentéisme des élèves scolarisés en collège, lycée de la voie générale et technologique et lycée professionnel.
DISTRIBUTION DE LA PROPORTION
D’ÉLÈVES ABSENTÉISTES (*) EN JANVIER 2011
En pourcentage
Premier quartile |
Médiane |
Dernier quartile |
Dernier décile | |
Collège |
0,0 |
1,1 |
3,4 |
8,3 |
Lycée d’enseignement général et technologique |
0,5 |
2,8 |
6,0 |
14,3 |
Lycée professionnel |
2,9 |
9,3 |
19,9 |
42,2 |
Ensemble |
0,3 |
1,6 |
5,7 |
13,4 |
(*) Pour le ministère de l’Éducation nationale, « un élève est considéré comme absentéiste dès qu’il a cumulé quatre demi-journées ou plus d’absences non justifiées par mois. »
Source : ministère de l’Éducation nationale, dans Repères et références statistiques sur les enseignants, les formations et la recherche – RERS 2012, page 65.
Dans le dernier décile des lycées professionnels, l’absentéisme concerne au moins 42,2 % des élèves. Cette proportion est considérable. Elle révèle, s’il en était besoin, l’enkystement du découragement scolaire, de l’absentéisme et in fine du décrochage, dans la voie professionnelle. Dans certains établissements particulièrement touchés, c’est la crédibilité de l’obligation scolaire et de l’effort collectif en faveur de la formation initiale des jeunes qui est atteinte (151).
Les taux d’absentéisme du dernier décile respectivement des lycées d’enseignement général et technologique et des collèges, respectivement supérieurs à 14,3 % et 8,3 %, sont également alarmants.
2. Quel impact du système scolaire français sur le décrochage ?
a. Existe-t-il un ou des « profils » de décrocheurs ?
En 1997, MM. Michel Janosz et Marc Le Blanc – chercheurs de nationalité canadienne en psychoéducation – ont proposé une typologie des décrocheurs. Les chercheurs ont associé à chaque catégorie décrite la part qu’elle pouvait représenter, selon leurs travaux, dans les effectifs de décrocheurs. Ces éléments figurent dans le tableau suivant.
TYPOLOGIE DES DÉCROCHEURS SCOLAIRES
Catégorie de décrocheurs |
Description sommaire |
Proportion dans l’effectif des décrocheurs |
Inadaptés |
Élèves ayant un profil scolaire et psychosocial fort négatif, où les échecs scolaires et les problèmes de comportement se multiplient. Le faible soutien familial et les nombreuses difficultés qu’ils expérimentent les mènent très souvent vers la trajectoire de la délinquance. On remarque chez ces jeunes que les difficultés surviennent vers l’âge de 15 ans, au deuxième cycle du secondaire. Ils présentent des comportements d’indifférence, de négativisme, d’absentéisme et font une consommation exagérée d’alcool et de drogues. |
40 % |
Discrets |
Élèves démontrant un profil analogue à celui des futurs diplômés. Ils aiment l’école, se sentent engagés dans leur scolarisation et ne présentent aucun problème de comportement apparent. Ils affichent cependant un rendement scolaire un peu faible. Souvent, ces élèves viennent d’un milieu socioéconomique plus favorisé, mais traînent malgré tout des difficultés depuis le primaire ou le début du secondaire. Dans leur cas, un suivi psychopédagogique aura manqué. |
40 % |
Désengagés |
Élèves parvenant à obtenir des résultats scolaires dans la moyenne et n’affichant aucun problème de comportement. Se disent néanmoins très désengagés de leur scolarisation. |
10 % |
Sous-performants |
Élèves aux prises avec des problèmes d’apprentissage, se disant très désengagés de leur scolarisation, mais ne présentant aucun problème de comportement. Ces élèves fréquentent l’école pour « faire du temps » en restant à l’affût de la première porte de sortie qui se présentera à eux. |
10 % |
Source : Michel Janosz, Marc Le Blanc, Les décrocheurs potentiels au secondaire : prévalence, facteurs de risque et dépistage, revue Prisme, été 1997.
Cette typologie a sans doute ses limites. Elle est assez ancienne. Il est néanmoins significatif qu’elle ait été présentée aux rapporteurs au collège Chateaubriand de Saint-Malo par l’équipe en charge de la classe relais dans laquelle sont provisoirement scolarisés des élèves issus de plusieurs établissements, afin de les aider à continuer et achever leur scolarité sans décrocher (cf. supra). Cette typologie constitue ainsi une base de travail utilisée par des professionnels de la prévention du décrochage pour comprendre et lutter contre les mécanismes à l’œuvre dans les processus qui y conduisent. À Saint-Malo, ces professionnels ont souligné que le décrochage était en tout état de cause souvent lié aux éléments suivants : proximité de l’élève avec des pairs déviants (parfois situés au sein de la famille, notamment dans la fratrie), désinvestissement des parents à l’égard de la situation de l’enfant et échec scolaire. Ils ont indiqué aux rapporteurs que le premier de ces éléments était le plus difficile à contourner ou surmonter.
La typologie présentée dans le tableau précédent ne fait pas de lien entre le décrochage scolaire et les politiques publiques. Elle est donc à la fois significative et insuffisante. Si le décrochage scolaire est un phénomène individuel qui lie un jeune à son environnement, il n’est pas pour autant infondé de s’interroger sur l’impact des politiques publiques sur ce lien.
b. Certaines caractéristiques du système éducatif français contribuent sans doute à l’ampleur du décrochage scolaire
Plusieurs développements du présent rapport montrent que certaines caractéristiques de notre système éducatif ne contribuent pas au maintien dans l’univers scolaire de certains élèves.
À la fin du CM2, les proportions d’élèves ne maîtrisant pas les compétences de base s’élevaient en 2011 à 12,1 % et 9,9 % respectivement en français et en mathématiques. Ces proportions s’élevaient pour la même année à 22,3 % pour le français et 11,5 % pour les mathématiques à la fin de la 3ème. Ces élèves – directement concernés par l’échec scolaire – courent le risque de décrocher. D’autant plus, sans doute, dans le cadre de notre collège unique, qui les confronte, de façon quasi exclusive, à un « petit lycée » d’enseignement général de disciplines abstraites. Dans la description du profil des décrocheurs qu’ils ont rencontrés, les prestataires KPMG et Euréval indiquent leur difficultés scolaires précoces, « à cause d’un mode d’enseignement qu’ils jugent trop théorique. »
Les modalités d’organisation de l’orientation des élèves à la fin de la troisième accroissent les risques de décrochage. En premier lieu, le parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) n’est sans doute pas mis en œuvre dans tous les établissements au point de permettre à tout élève d’émettre à la fin de la 3ème des vœux éclairés, matures et correspondant à une réelle motivation.
Pour les élèves souhaitant poursuivre leur scolarité secondaire dans l’enseignement professionnel, le dispositif d’affectation Affelnet – aussi équitable et transparent soit-il – fait courir le risque d’une forte déception, sans recours possible, quand la spécialité souhaitée n’est pas obtenue. La déception peut conduire au découragement quand le même élève doit suivre une formation qu’il n’a demandée que par souci de se garantir un point de chute.
Affelnet peut avoir en outre pour issue la non affectation d’un élève. Évoquant des profil de décrocheurs atypiques – qui n’ont pas « choisi » de décrocher –, les prestataires KPMG et Euréval mentionnent des « jeunes qui n’ont pas été affectés à l’issue de la 3ème, [ou des] élèves souhaitant poursuivre leurs études en apprentissage, mais qui n’ont pas eu l’opportunité de signer un contrat, et ainsi de continuer, leur scolarité. »
Enfin, l’existence au sein de la carte scolaire de collèges et lycées « ghettos », fuis par leurs meilleurs éléments, contribue également à renforcer le décrochage. Au regard des statistiques ci-dessus présentées relatives à l’absentéisme dans certains établissements, il apparaît qu’il n’y est plus considéré comme une extrémité dommageable mais peut-être comme une option parmi d’autres (152).
B. LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DOIT ÊTRE ACCENTUÉE
1. Accroître la prévention pour atteindre l’objectif gouvernemental d’une baisse de moitié du nombre des décrocheurs d’ici 2017
a. Les objectifs et les moyens prévus par la loi sur la refondation de l’école de la République
L’annexe à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République prévoit l’affectation de 4 000 emplois supplémentaires d’ici 2017 dans les « collèges en difficulté et les lycées professionnels » pour y lutter contre le décrochage scolaire. Ils devront contribuer à atteindre « l’objectif […] de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification ». La même annexe évoque d’autres moyens devant contribuer à l’atteinte de cet objectif :
– la mobilisation des équipes pédagogiques du secondaire, via les projets d’établissement, « autour d'objectifs précis de réduction de l'absentéisme, premier signe du décrochage » ;
– « dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé », un référent est chargé – en principe depuis la rentrée 2013 – de la prévention du décrochage, et également de traiter les cas avérés, en prévoyant et préparant le retour en formation des élèves concernés (153) ;
– chaque jeune sorti du système scolaire sans diplôme « doit pouvoir disposer d'une durée complémentaire de formation qualifiante, qu'il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret, et d'une attestation de son parcours et des compétences acquises ». Cette disposition, fondamentale, ne relève pas – il est vrai – de la prévention du décrochage, mais de son traitement a posteriori. Les questions de la « seconde chance », du droit tout au long de la vie à la formation et à la qualification, et de la prise en compte des compétences dans les parcours des jeunes sont abordées infra par les rapporteurs ;
– eu égard à la compétence de la région en matière de formation professionnelle, des partenariats État-région seront recherchés afin d’« établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les modalités d'atteinte de ces objectifs. »
b. Aller plus loin dans la prévention du décrochage
La gravité du phénomène du décrochage scolaire et son ampleur en France doivent conduire à une réflexion approfondie concernant certains nœuds de notre système éducatif et à envisager des mesures innovantes (154).
Il ne relève pas de la mission des rapporteurs de traiter des modalités d’établissement de la carte scolaire, de son niveau de souplesse – ou de rigidité – au regard des souhaits des usagers du service public, ou encore de la faculté d’effectuer des choix stratégiques en matière d’implantation des établissements scolaires et de localisation de l’offre de formation. Le traitement de ces questions est pourtant nécessaire pour aborder le sujet des ghettos scolaires – collèges ou lycées – où se concentrent exclusivement ou presque des élèves cumulant tous les handicaps conduisant en règle générale à l’échec scolaire et au décrochage. La mixité sociale – mais également la mixité des horizons, des parcours et des ambitions – sont des facteurs de lutte contre le décrochage scolaire.
L’aide à la mobilité géographique peut contribuer à prévenir le décrochage. La mobilité est parfois la condition d’une orientation choisie et réussie. Comme il a été indiqué supra, certaines formations professionnelles sont rares et il importe qu’une aide soit apportée afin que les élèves qui souhaitent la suivre n’en soient pas empêchés pour des raisons d’éloignement géographique du domicile familial. La mobilité – notamment quand elle conduit à vivre en internat – peut également contribuer à éloigner l’élève de situations ou de relations personnelles constituant une entrave à la poursuite d’une formation. Il faut donc optimiser les nombreuses places d’internat vacantes dans les lycées. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval préconisent à ce titre « un accueil le dimanche soir dans les internats pour les élèves le désirant », afin d’éviter que certains jeunes décrochent en raison des difficultés qu’ils rencontrent pour effectuer les trajets nécessaires entre leur domicile familial et leur établissement scolaire.
2. Améliorer le fonctionnement du dispositif de suivi et d’appui aux décrocheurs
a. La mise en place et le fonctionnement du dispositif
Par la mise en place du service interministériel d’échanges d’informations (SIEI) et des plateformes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs (PASD) en 2011, et puis par la création des réseaux « Formation, qualification, emploi » (Foquale) en 2013, les pouvoirs publics ont élaboré progressivement le dispositif – complet, sinon complexe (155) – présenté dans le tableau ci-dessous.
PROCESSUS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU
DISPOSITIF D’APPUI ET DE SUIVI DES DÉCROCHEURS
Action |
Acteurs |
Moyens |
Établissement des listes départementales de décrocheurs |
Chefs d’établissements, directeurs de CFA, directeurs de mission locale, rectorat |
Système interministériel d’échanges d’informations (SIEI) (156) |
Prise de contact avec les décrocheurs |
Plateforme d’appui et de suivi aux décrocheurs (PASD – 360 sur l’ensemble du territoire) |
Listes départementales de décrocheurs |
Entretien avec le décrocheur et élaboration de son projet de formation ou d’insertion |
PASD et/ou Réseaux Foquale (Un réseau dans le ressort de chaque PASD) |
Solutions recensées d’action de formation initiale ou continue |
Actions de formation ou d’insertion |
Acteurs et moyens de la formation initiale ou continue dans ou hors de l’Éducation nationale | |
Source : Notamment la circulaire n° 2013-035 du 13 avril 2013 sur les réseaux Formation, qualification, emploi (Foquale), signé par M. Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire, par délégation du ministre de l’Éducation nationale.
Les PASD ont été créées suite à la circulaire n° 2011-08 du 9 février 2011. Celle-ci indique que « sans constituer une structure juridique supplémentaire, la plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs a vocation à rassembler [au] niveau [adéquat] (département, bassin d'emploi, district de formation, etc.) les responsables relevant notamment : de l'Éducation nationale (établissements, CIO, MGI (157)), de l'enseignement agricole (établissements, correspondants insertion pour l'enseignement agricole), des centres de formation d'apprentis, des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), du service public de l'emploi (SPE), du réseau d'information jeunesse, ainsi que des collectivités territoriales compétentes. [Les PASD] doivent s'appuyer sur les dispositifs de droit commun (MGI, Civis, écoles de la deuxième chance, contrat d'autonomie, EPIDe, alternance, dispositifs régionaux spécifiques, etc.) portés par les partenaires de la coordination locale ». On relève la vocation authentiquement partenariale des PSAD, au-delà de l’Éducation nationale. Le représentant de l’État dans le département est le coordonnateur des PASD. Il désigne le ou les responsables des plateformes auxquels sont transmises les coordonnées des supposés décrocheurs recensés via le SIEI (158).
Parmi les partenaires réunis au sein de la PASD, la mission générale d’insertion (MGI) est un service de l’Éducation nationale, doté de personnels dédiés, créé au début des années 1990, suite à la loi d'orientation du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, dont l’article 1er prévoyait que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre […] de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle […] ». La MGI est devenue depuis peu la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Les personnels de la MLDS ont vocation à intervenir tout au long de la chaîne de prévention et de traitement du décrochage (159).
Selon la circulaire du 13 avril 2013, les réseaux Foquale « rassemblent, dans le périmètre d'action d'une [PASD], les établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale et susceptibles d'accueillir les jeunes décrocheurs. Les réseaux Foquale doivent développer des mesures de remédiation au sein de l'Éducation nationale et en renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser toutes les solutions existantes et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils s'intègrent pleinement dans les réseaux constitués autour des [PASD] placés sous l'autorité des préfets. Ils interviennent en complémentarité avec les partenaires sollicités dans le cadre des plateformes ». Les réseaux Foquale, s’ils sont présentés comme complémentaires de l’action des collectivités territoriales et s’insérant dans les pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes (160), sont donc spécifiques à l’Éducation nationale dans son action de prévention et de traitement du décrochage scolaire, tout en s’intégrant dans l’action partenariale des PASD.
Il est légitime que l’Éducation nationale s’organise contre un phénomène qui la concerne tout particulièrement. Le décrochage scolaire est en partie son problème – pour ne pas dire son échec – et il importe que le système scolaire ne se contente pas de renvoyer les élèves concernés à une seconde chance organisée et financée par d’autres, notamment les acteurs de la formation professionnelle. L’Éducation nationale doit prévoir le retour, autant que faire se peut, des décrocheurs dans l’enseignement scolaire secondaire, alors que 40 000 places d’élèves sont vacantes dans l’enseignement professionnel. Elle doit aussi innover pour répondre aux besoins et aux spécificités de ces élèves.
Pour autant, il importe tout autant de veiller à l’articulation – en bonne intelligence – des PASD et des réseaux Foquale, notamment du point de vue du contact pris avec l’élève et de la façon dont lui est proposée une solution de retour à la formation. La circulaire du 13 avril 2013 – très complète s’agissant des modalités d’organisation interne du réseau Foquale – prévoit qu’« après un contact personnalisé dans le cadre de la [PASD], un bilan est réalisé par les conseillers d'orientation-psychologues et les personnels de la MLDS. Cet entretien permet d'évaluer les besoins du jeune, ses compétences et son niveau scolaire. À l'issue de cette première phase de positionnement, une solution de retour en formation lui est proposée, soit dans un établissement scolaire, notamment une structure innovante de type « micro-lycée », soit dans un CFA public ou une unité de formation par apprentissage. D'autres solutions, hors du champ de l'Éducation nationale, peuvent également être envisagées, en lien avec les acteurs interministériels et associatifs de la plateforme. »
Ce passage prévoit clairement que la solution interne à l’Éducation nationale doit être privilégiée, par rapport aux « autres solutions ». L’encadrement par l’Éducation nationale en matière de lutte contre le décrochage s’appuie également, désormais, sur l’accompagnement de l’élève par un « tuteur de l'Éducation nationale tout au long du parcours de formation […]. Un contrat “Formation Qualification Emploi” signé entre le tuteur, le jeune et sa famille, formalise le sens et les modalités du parcours personnalisé de retour en formation. »
Les PASD sont une démarche innovante, parce que partenariale. Il convient de maintenir résolument cette caractéristique – ne serait-ce que pour mettre à disposition des jeunes concernés une offre la plus large possible de retour en formation ou d’activité –, même s’il est légitime que l’Éducation nationale affine son organisation interne pour prévenir la prévention et le traitement du décrochage scolaire.
La détection du décrochage est au demeurant également mise en œuvre de fait via la journée « défense et citoyenneté » (JDC). La totalité de chaque classe d’âge, soit environ 760 000 jeunes, est concernée par ce dispositif – dans environ 200 centres répartis sur l’ensemble du territoire national –, pour lequel il est prévu de mobiliser 93,93 millions d’euros dans le PLF pour 2014 (161).
Le PAP annexé au PLF pour 2014 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » précise que la JDC « permet de sensibiliser les jeunes aux droits et aux devoirs du citoyen et aux différentes formes de solidarité. C’est aussi l’occasion de détecter les jeunes en situation d’échec » (162). La JDC permet de facto d’établir un diagnostic à la fois sur les insuffisances de chaque jeune au regard des compétences de base – y compris en détectant les cas d’illettrisme –, et sur le décrochage scolaire. Les jeunes concernés par ces difficultés lors de la JDC, notamment le décrochage, sont dirigés vers les (PASD) ou vers des solutions de seconde chance (cf. infra). Il convient de maintenir et de conforter cette action complémentaire de repérage du décrochage et de « première prescription » d’une solution, mise en œuvre dans le cadre de la JDC.
b. Quels résultats nationaux et locaux du traitement du décrochage scolaire ?
Il est indéniable qu’une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics a lieu depuis 2011 pour recenser les décrocheurs et leur offrir des solutions de formation. La circulaire du 13 avril 2013 relative aux réseaux Foquale précise qu’ « en 2012, 9 500 jeunes accompagnés dans le cadre [du] dispositif [des PASD] ont bénéficié d'un retour en formation ». En 2013, l’objectif est de ramener en formation 20 000 décrocheurs via l’activité des réseaux Foquale.
La visite des rapporteurs au collège Chateaubriand à Saint-Malo a été l’occasion d’échanger avec les responsables locaux de la PASD couvrant les territoires de Combourg, Dinan et Saint-Malo. S’agissant du repérage des décrocheurs, l’usage du logiciel SIEI semble donner globalement satisfaction. Les prises de contact sont majoritairement fructueuses, peu de jeunes refusent de répondre ou d’être suivis – la mission locale de Saint-Malo est très impliquée dans la mise en œuvre de ce suivi.
Les personnels de la MLDS – 3 personnes – sont avant tout mobilisés à Saint-Malo sur la prévention du décrochage. 100 à 150 élèves – pré-repérés – font l’objet d’une action combinant un diagnostic, des cours de remise à niveau en français et en math assurés par des enseignants (via des vacations), des offres de stage en entreprise – voire d’apprentissage –, ou encore une orientation vers des formations régionales via les missions locales. Il s’agit donc de prévenir le décrochage, ou de préparer dans de bonnes conditions le départ, sans décrochage, de l’établissement. Les élèves concernés sont parfois des mineurs migrants isolés ou des jeunes pour lesquels le français est une langue étrangère au mieux mal maîtrisée.
Les prestataires KPMG et Euréval ont relevé un dispositif mis en place dans un lycée professionnel : « le lycée a créé une équipe pluridisciplinaire en charge de la lutte contre le décrochage scolaire, les EPARED (équipe pluridisciplinaire d’aide et de remobilisation des élèves en difficulté) ont été mises en place. Ces équipes sont composées du professeur principal, du COP, d’une assistance sociale, d’une infirmière, du CPE [conseiller principal d’éducation] et d’un membre de la direction ». Cette « bonne pratique », selon les prestataires, peut constituer une source de réflexion pour les établissements souhaitant organiser en leur sein une organisation renforcée de la prévention du décrochage.
Pour autant, le rapport de ces prestataires souligne les disparités de qualité de l’organisation partenariale de la lutte contre le décrochage :
– pour 2 sites étudiés, il indique que « le CIO, la mission locale et les personnels de la MLDS constituent les acteurs clés de la plate-forme. Ce cercle d’acteurs est élargi à de nombreux partenaires qui sont mobilisés, en cas de besoin. Cette dynamique de travail commune assure aux PSAD un rôle préventif et curatif en faveur du décrochage. Les acteurs clés se contactent et se réunissent fréquemment. L’ensemble des acteurs est convié deux fois par an pour une présentation du bilan de la plate-forme. » ;
– pour les 2 autres, il précise que « la dynamique de travail peine à s’installer. Des partenariats ont été noués au lancement de la plate-forme mais ils se sont essoufflés depuis. Le cloisonnement des acteurs, le manque de communication avec les chefs d’établissements, l’absence de remontées d’informations ou de travail commun entre les acteurs en charge du co-pilotage de la structure, et même, la taille du territoire seraient en cause. »
Le tableau suivant retrace l’activité et certaines des actions menées par les PASD, les réseaux Foquale et les acteurs du « raccrochage » dans les 4 départements dans lesquels se situent les sites étudiés par les prestataires.
PRISE DE CONTACT AVEC LES DÉCROCHEURS
DANS 4 DÉPARTEMENTS (*)
Creuse |
Oise |
Haute-Savoie |
Seine-Saint-Denis | |
Effectifs des élèves du second degré |
7 600 |
28 100 |
42 700 |
41 100 |
Nombre de décrocheurs potentiels (estimation du taux de décrocheurs) |
321 |
2 500 |
964 |
7 419 |
Proportion des jeunes décrocheurs pour lesquels une tentative de prise de contact a été effectuée |
63 % |
51 % |
83 % |
78 % |
(*) : ce tableau ne tient pas compte des jeunes décrocheurs repérés hors les listes établies par les SIEI. Les effectifs correspondants ne sont pas négligeables. Pour les prestataires, « les nombreux primo-arrivants […] peuvent expliquer, en partie, ces chiffres élevés. Il peut également s’agir de décrocheurs pris en charge à titre préventif ». Il s’agit là, toutefois, d’hypothèses.
Source : Rapport des prestataires KPMG et Euréval. Les données sur les effectifs du second degré ont pour origine l’INSEE en 2011-2012. Les données sur le nombre des décrocheurs ont pour origine les PSAD pour la campagne juillet 2012-juin 2013. Le pourcentage de décrocheurs constitue donc une estimation.
Ce tableau montre qu’une proportion importante des décrocheurs – jusqu’à la moitié dans un des départements pris en compte – dûment recensés par les listes établies par le SIEI n’est pas contactée par les PASD.
Cette situation est regrettable, d’autant plus que les prestataires montrent que la proportion des jeunes qui refusent la prise en charge parmi ceux pour lesquels une tentative de prise de contact a été effectuée est faible – entre 2 % et 3 % selon le département. Quand un jeune est contacté, il y a donc de grande chance pour qu’il accueille avec intérêt ou bienveillance la proposition qui lui est faite.
Les prestataires montrent également que la proportion des jeunes qui demeurent injoignables parmi ceux pour lesquels une tentative de contact a été effectuée varie de 18 % à 32 % selon le département.
Afin d’améliorer la proportion des jeunes décrocheurs pour lesquels une tentative de prise de contact est effectuée et de limiter la proportion des jeunes décrocheurs qui demeurent injoignables, les prestataires proposent « d’allouer des moyens supplémentaires » au PASD afin « d’améliorer les taux de contacts des décrocheurs ». L’inquiétude portant sur la capacité des PASD à contacter chaque décrocheur identifié les conduit également à proposer de « responsabiliser chaque acteur sur l’atteinte d’objectifs chiffrés en matière de taux de contacts, […] ».
In fine, il est encore tôt pour apprécier le degré d’efficacité et d’efficience de l’activité des PSAD. Au-delà des éléments chiffrés – qui montrent qu’il a été proposé à au moins plusieurs milliers de jeunes dans l’ensemble du pays une prise en charge et une solution de retour vers la formation – les prestataires notent que les bénéficiaires « se révèlent très satisfaits de leur prise en charge […] cette grande satisfaction peut [toutefois] être biaisée car les décrocheurs rencontrés n’ont pas été choisis au hasard » par les structures académiques qui les ont adressés aux prestataires.
C. L’OFFRE DE SECONDE CHANCE, SUBSTANTIELLE ET DIVERSIFIÉE, DOIT MIEUX RÉPONDRE À LA RÉALITÉ DU DÉCROCHAGE
Les jeunes décrocheurs ont naturellement vocation à entrer en contact avec le service public de l’emploi, a fortiori avec les missions locales. Les partenaires sociaux ont ainsi décidé, via l’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 relatif aux jeunes décrocheurs, de mettre à disposition du réseau des missions locales une prestation d’accompagnement vers l’emploi en leur faveur. Ce dispositif est détaillé infra dans le cadre des développements relatifs à l’action des missions locales. Au demeurant, l’accompagnement et la médiation que celles-ci mettent en œuvre peuvent conduire à proposer aux décrocheurs – qui constituent naturellement une partie importante de leur public – certaines des solutions présentées ci-après.
À titre liminaire, il convient également de préciser que les dispositifs ci-après présentés ne s’adressent pas uniquement aux décrocheurs tels que définis dans la présente partie, c’est-à-dire aux jeunes sans diplôme et sans qualification à l’issue de leur scolarité obligatoire. Certains de ces dispositifs, comme les E2C et les cadets de la République, « recrutent » – en petits nombres et toujours de façon minoritaire – des jeunes diplômés, parfois détenteurs du bac. Leur vocation demeure néanmoins de constituer une seconde chance pour les jeunes peu ou pas formés à l’issue de la scolarité.
1. L’offre de l’Éducation nationale : entre retour dans le système scolaire de droit commun et innovations pédagogiques
Dans les 4 départements dans le ressort desquels sont situés les bassins de vie objets de leurs travaux, les informations recueillies par les prestataires KPMG et Euréval montrent que l’offre de seconde chance de l’Éducation nationale, notamment via les réseaux Foquale, est majoritaire dans l’ensemble des propositions de prise en charge émises par les PASD. L’offre de l’Éducation nationale s’appuie sur l’activité des MLDS, le retour à la scolarité et des solutions innovantes. Certains de ces éléments font l’objet des développements ci-après.
a. Les places vacantes dans les lycées
L’action des réseaux Foquale a pour objet, comme évoqué supra, d’optimiser l’usage des ressources propres de l’Éducation nationale comme offre de seconde chance. Selon la circulaire du 13 avril 2013, ces ressources mobilisables sont les « places disponibles dans les formations des trois voies – professionnelle, générale et technologique [et] les structures innovantes pour les jeunes en situation de décrochage avec l'objectif de favoriser l'existence d'au moins une structure par académie comme le micro-lycée […]. »
Les rapporteurs ont évoqué supra les 40 000 places vacantes dans les lycées professionnels, qui constituent une offre « naturelle » en direction des décrocheurs. Il convient d’utiliser cette ressource avec précaution. L’inscription d’un jeune décrocheur dans une spécialité professionnelle qu’il vient d’abandonner comporte des risques de réitération du décrochage. Les équipes éducatives, soutenues par les personnels de la MLDS et – le cas échéant – les référents chargés de la prévention du décrochage dans l’établissement, doivent porter une attention particulière à l’accompagnement des « raccrocheurs », notamment en lycée professionnel.
b. Les micro-lycées, un exemple à suivre
Lors d’une table ronde réunissant des représentants d’associations de jeunes et de jeunesse le 10 juillet 2013, M. Thibault Renaudin, secrétaire général de l’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), a évoqué le succès, selon lui, des micro-lycées – en prenant l’exemple de l’établissement implanté en Seine-Saint-Denis dans deux antennes à la Courneuve et au Blanc-Mesnil (163). Ce micro-lycée accueille des jeunes de 16 à 25 ans, décrocheurs depuis quelques semaines à plusieurs années. Il appartient au décrocheur de prendre contact avec l’équipe pédagogique du micro-lycée et de justifier auprès d’elle son souhait d’y être admis – ce qui est possible à tout moment de l’année. Il prépare l’obtention des bacs L et ES.
La charte des micro-lycées précise que le taux d’encadrement ne peut être inférieur à 1 adulte pour 7 à 8 élèves. Au demeurant, cette charte décrit des modalités de fonctionnement semblant souvent manquer, pour certaines d’entre elles, dans l’Éducation nationale :
– « une scolarité spécifique : favoriser les souplesses : libre orientation, aménagement du temps, changement de niveau en cours d’année, … […] Accompagner la construction du projet personnel de formation de chaque élève » ;
– « des moyens humains particuliers : une équipe recrutée par cooptation avec des possibilités de dé-cooptation » ;
– « un travail en équipe éducative : la charge et la nature du travail des enseignants sont définies moins par le statut ou la discipline à enseigner que par la globalité du projet pédagogique et éducatif : moins d’heures de cours et davantage de présence hebdomadaire dans l’établissement. […] Une pratique de la collégialité et de la co-responsabilité » ;
– « une redéfinition de la mission d’enseignant : tenir compte des besoins des élèves en maintenant une approche exigeante des savoirs ; favoriser des approches diversifiées des savoirs : inter et trans-disciplinarité, pédagogie différenciée, … Faire de l’évaluation un moteur d’apprentissage et non sa sanction : des temps et des formes d’évaluation multiples, faire refaire pour améliorer, etc. Assumer et partager un rôle éducatif » ;
– « des conceptions issues de “l’éducation humaniste” : une attitude bienveillante vis-à-vis des élèves : accueil, évaluation, … Des principes de confiance, d’empathie, de coopération et d’entraide ; un travail de co-construction de la scolarité entre professeurs et élèves ; une reconnaissance mutuelle de l’élève en tant que jeune et de l’enseignant en tant qu’adulte. »
Il est vrai que tout est plus simple quand un établissement scolaire peut compter sur des moyens supplémentaires – légitimes au regard des publics accueillis – et accueille un nombre modéré d’élèves. Il est néanmoins saisissant de lire en creux, dans cette charte, certaines des insuffisances les plus classiquement reprochées à l’Éducation nationale. Pourquoi faut-il attendre de constituer un public de décrocheurs pour en tenir compte ? À la session 2013, 95 % des élèves – pour un effectif d’environ 40 élèves – du micro-lycée de Seine-Saint-Denis ont obtenu leur baccalauréat.
Les rapporteurs souhaitent le développement des micro-lycées et plus largement des initiatives et expérimentations pédagogiques au sein de l’Éducation nationale. Ces dispositifs sont :
– équitables, car l’effort supplémentaire en moyens qu’ils constituent est directement destiné aux publics les plus en difficulté, qui ont connu l’échec scolaire ;
– justifiés, parce qu’ils sont une réponse de l’Éducation nationale aux difficultés qu’elle a connue antérieurement pour assurer la formation initiale de ces publics ;
– prometteurs, car ils portent un esprit pédagogique qui doit inspirer plus généralement notre système de formation et le rapport qu’entretient notre société à sa jeunesse (164).
c. Le partenariat entre l’Éducation nationale et l’Agence du service civique (ASC) en faveur des décrocheurs
Les rapporteurs consacrent des développements au dispositif du service civique dans la troisième partie du présent rapport.
Est présentement mentionné le partenariat entre l’Éducation nationale et l’Agence du service civique (ASC) évoqué par la circulaire du 13 avril 2013 relative aux réseaux Foquale. La circulaire évoque deux formules de service civique qui ont vocation à être proposées aux décrocheurs :
– dans la première d’entre elles, la mission classique de service civique est encadrée par un tuteur issu de l’Éducation nationale ;
– dans la seconde formule, l’engagé effectue sa mission de service civique durant 3 jours sur 5. Les 2 autres jours, il est accueilli dans un établissement scolaire. Durant ces deux jours, l’engagé consacre 1 heure d’activité au bilan de déroulement de la mission de service civique, 4 heures pour des enseignements de remise à niveau et 5 à 7 heures pour l’élaboration de son projet professionnel.
2. Les formations professionnelles en alternance, l’exemple des écoles de la deuxième chance (E2C)
La formation professionnelle constitue une offre substantielle en direction des jeunes décrocheurs. Les rapporteurs indiquent supra certains enjeux propres à l’apprentissage ; il importe que l’apprentissage demeure un facteur de mobilité sociale, en faveur des jeunes les plus en difficulté et pour lesquels la voie scolaire n’est pas adaptée. Il s’agit donc de protéger et développer l’apprentissage pour les plus bas niveaux de qualification, tout en tenant compte également de la demande accrue de qualification émise par les entreprises.
Les développements ci-après sont consacrés aux écoles de la deuxième chance (E2C), dispositif particulier de formation professionnelle en faveur des jeunes dont le parcours scolaire a été nettement insuffisant pour leur permettre de s’insérer efficacement sur le marché du travail.
La première E2C a été créée en 1997 à Marseille, suite aux recommandations du livre blanc « Enseigner et apprendre – Vers la société cognitive » présenté en 1995 à l’initiative de Mme Édith Cresson (165), alors commissaire européen chargé de la science, de la recherche et du développement. Ce modèle a ensuite progressivement essaimé, à l’initiative de certaines régions.
À compter de 2007 (166), l’État a commencé à accompagner financièrement et à encadrer le réseau des E2C, notamment en inscrivant son existence et certains de ses principes pédagogiques et de recrutement à l’article L. 214-14 du code de l’éducation. Cet article (167) dispose que :
« Les écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales. »
Les E2C sont créées sur le terrain à l’initiative des collectivités territoriales – notamment les régions qui en sont les principaux financeurs – et des organismes de la formation professionnelle. Elles sont regroupées au sein d’un réseau national, la qualité de membre du réseau E2C s’acquérant à la suite d’un processus de labellisation dont le cahier des charges a été approuvé par les ministères chargés de l’emploi et de l’éducation au début de l’année 2009.
Les écoles du réseau E2C étaient au nombre de 107 en 2012, réparties pour la plupart d’entre elles sur la partie est du territoire métropolitain. Si les E2C sont diverses du point de vue de leur statut et de leur organisation, leur appartenance au réseau s’appuie sur une certaine homogénéité des prestations fournies aux jeunes accueillis. Une brochure disponible en ligne sur le site du réseau E2C précise qu’« une relation privilégiée avec le monde de l’entreprise, la mise en place d’un parcours de formation individualisé, la délivrance d’une attestation de compétences acquises, sont des critères indispensables » pour rejoindre le réseau.
La même brochure résume de la façon suivante les pratiques pédagogiques des E2C :
« Les Écoles de la 2e Chance délivrent un enseignement initial, décalé dans le temps et dans l’espace qui a été défini par quatre fondamentaux :
« 1. Les E2C se situent délibérément hors des schémas scolaires classiques car [les] jeunes ont rejeté le système éducatif dans leur passé.
« 2. Le dispositif doit être institutionnalisé. L’appropriation du dispositif par les jeunes leur permet de se construire une référence d’appartenance en tant que citoyen.
« 3. Le parcours pédagogique doit être complet et unifié pour ne pas reproduire les tactiques de rupture déjà ancrées dans les habitudes de ces jeunes en voie d’exclusion.
« 4. L’alternance est la clé de voûte des E2C. La mission principale du dispositif est de jeter des ponts entre deux mondes, celui des entreprises et celui des jeunes. »
À l’E2C Loire – située à Saint-Étienne et dans les locaux de laquelle les rapporteurs se sont rendus le 14 mars 2013 –, le parcours pédagogique classique dure 7 mois, pour 900 heures de formation, dont 55 % à l’école et 45 % en entreprise. Toujours dans cette E2C, 62 % des candidatures ont été « adressées » en 2012 par les missions locales, 10 % par Pôle emploi et 22 % d’entre elles étaient spontanées.
Selon les « données annuelles du réseau E2C pour 2012 et perspectives » – publiées par ce réseau :
– « en 2012, 13 036 jeunes, sans qualification et sans emploi, d'un âge moyen de 20,4 ans, ont franchi les portes de » l’une des écoles de la 2ème chance ;
– il y avait en 2012 presqu’autant d’hommes (48 %) que de femmes (52 %) dans les écoles de la 2ème chance. 90 % des jeunes concernés y entrent sans une qualification de niveau V validé (c’est-à-dire un CAP). « Essentiellement positionnés par les missions locales, 35,5 % des jeunes sont issus des quartiers » prioritaires de la politique de la ville (168) ;
– en 2012, 58 % des jeunes sortis d’une école de la 2ème chance bénéficient d’une « sortie positive » (un tiers d’entre eux bénéficient d’un contrat de travail, un autre tiers d’une formation qualifiante, un peu plus de 20 % d’un contrat de travail en alternance et un peu moins de 10 % d’un emploi aidé). Les autres jeunes – soit 42 % d’entre eux – sont sortis du dispositif « sans solution connue ».
– « en 2011, le coût moyen d’un jeune accueilli dans le Réseau E2C France est estimé à 5 800 euros ». Ce coût est évalué à 6 000 euros dans la documentation budgétaire accompagnant le PLF 2014 (169).
b. Les enjeux du développement des E2C
Basé sur l’alternance et conduisant à la délivrance d’une attestation de compétences, le parcours de formation offert par les E2C se distingue nettement de l’offre scolaire. Les E2C s’adressent fondamentalement à des jeunes pour lesquels cette offre est inadaptée. Le taux de sortie positive (58 %) est substantiel. Il montre néanmoins, en creux, la difficulté à redonner une chance à des jeunes dont le niveau scolaire est très faible. Lors de sa participation à la table ronde consacrée à l’offre de seconde chance organisée le 29 mai 2013 par le groupe de travail animé par les rapporteurs, M. Alexandre Schajer, président du réseau E2C, a précisé que la moitié des jeunes accueillis par ces écoles ne maitrise pas les quatre opérations mathématiques de base.
M. Alexandre Schajer a également évoqué la question du développement du nombre des places en E2C, jugeant que leur doublement pouvait constituer un objectif ambitieux et raisonnable à moyen et long termes. La répartition territoriale actuelle des E2C conduit à constater des marges de manœuvre pour de nouvelles implantations dans de nombreuses régions. Il n’y a aucune E2C dans les régions Aquitaine, Bretagne, Limousin, Haute-Normandie et Basse-Normandie.
La « couverture complète et équilibrée du territoire » prévue par l’article L. 214-14 du code de l’éducation est loin d’être une réalité, précisément parce que « la concertation avec les collectivités territoriales » visée par le même article conduit à constater que ces régions ne souhaitent pas financer les E2C. Elles considèrent opportun d’exercer leur compétence en matière de formation professionnelle via d’autres dispositifs qu’elles définissent.
Lors de leur déplacement à Rennes le 13 juin 2013, les rapporteurs ont pu constater le désaccord de la région Bretagne et de l’État déconcentré sur ce point. Celui-ci considère au demeurant que les dispositifs régionaux (170) – alternatifs aux E2C – sont pertinents, même si la région a choisi d’accompagner les jeunes vers la formation professionnelle hors les murs d’une école proprement dite. En tout état de cause, la règle que l’État s’est imposée du financement d’un tiers des coûts de fonctionnement des E2C – le reste étant principalement à la charge des régions volontaires – et la liberté d’action régionale en matière de formation professionnelle constitueront des obstacles au développement du nombre des E2C et des effectifs qu’elles accueillent.
Le fait que les E2C délivrent au jeune accueilli, à l’issue de sa scolarité, une attestation de ses compétences – et non un diplôme – est audacieux sur un marché du travail où le diplôme demeure le principal point de repère des employeurs et demandeurs d’emploi. La valorisation des compétences, au cœur du dispositif des E2C, doit être encouragée.
3. L’offre issue de l’armée et de la police
a. Présentation de l’établissement public d’insertion de la défense (Épide)
Créé, sur le modèle du service militaire (SMA) adapté outre-mer (cf. l’encadré ci-après), par l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères de la défense, de l’emploi et de la ville, l’Épide – établissement public administratif de l’État – accueille des jeunes dans 18 centres situés en France métropolitaine (dont 15 dans une moitié nord).
Le service militaire adapté (SMA)
Le SMA est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle destiné aux jeunes volontaires – de 18 à 26 ans – les plus éloignés de l’emploi au sein des Outre-mer français. Créé en 1961, il a concerné 3 000 jeunes ultra-marins en 2009 dans 7 implantations situées outre-mer et un site métropolitain. Le dispositif accueillera 4 200 jeunes en 2014 et doit en accueillir 6 000 en 2016. 60 % des stagiaires n’ont pas le brevet des collèges et plus de 30 % d’entre eux sont en situation d’illettrisme. 83 % des stagiaires obtiennent le certificat de formation générale et 70 % le permis B. Le SMA recrute les jeunes volontaires notamment via les prescripteurs classiques des dispositifs de seconde chance : Pôle emploi, les missions locales et certains réseaux associatifs. Dans le contexte d’un encadrement militaire, les volontaires suivent des enseignements de remise à niveau et apprennent un métier. En 2014, les crédits consacrés au SMA devraient s’élever à environ 220 millions d’euros, dont plus de la moitié est consacrée à la rémunération des volontaires.
Le PLF pour 2014 prévoit que l’État accorde à l’établissement public une subvention de 67,15 millions d’euros (45 millions d’euros issus de la mission « Travail et emploi » et 22,15 millions d’euros issus du programme « Politique de la ville »).Jusqu’en 2013, l’Épide a bénéficié de 10 millions d’euros attribués par le Fonds social européen (FSE).
Selon l’article L. 3414-1 du code de la défense, l’Épide « a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale ». Le même article précise que l’Épide « organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire [et] accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations. »
Les jeunes accueillis, âgés de 18 à 25 ans passent un contrat (171) – qui n’est pas un contrat de travail – avec le centre dans lequel ils sont hébergés au titre de l’internat et y portent une tenue vestimentaire commune. Les volontaires bénéficient d’une rémunération de 300 euros par mois, dont une partie est capitalisée pour versement à l’issue de la formation.
Les « volontaires à l’insertion » bénéficient dans les centres d’un enseignement à la fois comportemental, général et professionnel. Cet enseignement a pour objet de contribuer à l’orientation du volontaire, à sa formation professionnelle, son insertion sociale et – in fine – son insertion professionnelle. L’Épide a passé des conventions avec un certain nombre de ministères et d’entreprises, afin que les volontaires puissent bénéficier de présentations des métiers qu’ils pourraient y exercer à l’issue de leur cursus.
L’Épide propose des démarches relevant de la levée des freins périphériques à l’emploi (accès au permis de conduire), de l’accès aux droits (démarches pour obtenir un logement social et le bénéfice de la couverture maladie universelle – CMU et CMU complémentaire) et de l’accompagnement médico-social (en matière de traitement des addictions).
Dans le rapport d’activité de L’Épide pour l’année 2011 et en s’appuyant sur certains éléments disponibles pour 2012, on note que :
– « le nombre moyen de places occupées sur l’année est passé de 1 896 à 2 047 de décembre 2009 à décembre 2011 (+ 8 %), parallèlement le taux de « rendement » (nombre de sorties positives sur 12 mois/moyenne des places occupées sur 12 mois) est passé, sur la même période, de 50 % à 69 % ». On observe que les centres Épide accueillent un nombre de jeunes assez peu élevé en valeur absolue, autour de 2 000 en 2011 (172) ;
– « le phénomène d’attrition des promotions stabilisées a été fortement endigué. Depuis 2009, le nombre des départs prématurés a enregistré un reflux de 6 points (de 38 % à 32 %) […] Le taux d’absences irrégulières, qui est également un indicateur de fidélisation dans le parcours, est passé entre janvier et décembre 2011 de 11,2 à 8,7 % ». Pour l’année 2012, le taux d’abandon a substantiellement augmenté à 47 %, proportion élevée qui pose de nouveau la question de la capacité du modèle de l’Épide à amener des jeunes en grande difficulté à s’inscrire durablement dans un cursus de remise à niveau et de formation.
Le tableau suivant, issu du rapport d’activité pour l’année 2011 de l’Épide, permet de mesurer le nombre, le poids et la répartition des « sorties positives » du cursus proposé par l’établissement.
OBSERVATION DES RÉSULTATS DES SORTIES POSITIVES/ENSEMBLE DES SORTIES ARRÊTÉES AU 31 DÉCEMBRE 2011 – ÉVOLUTION SUR LA PÉRIODE 2009-2011
Total des sorties |
Sorties positives |
Sorties en emploi durable |
Sorties en emploi de moins de 6 mois |
Sorties formations qualifiantes | |
Résultats opérationnels 2010 |
3 270 |
1 243 |
732 |
190 |
321 |
Résultats opérationnels 2011 |
3 202 |
1 408 |
718 |
254 |
436 |
Évolution 2011/2010 |
- 2 % |
+ 6 % |
+ 0,1 |
+ 2,2 |
+ 3,7 |
Source : Bilan d’activité de l’Épide pour 2011
En 2012, le nombre des sorties positives a baissé à 1 293. Le taux de sortie en emplois durables a également baissé à 19 %. La dégradation de ces résultats – qui s’ajoutent à l’augmentation évoquée ci-dessus du taux d’abandon – questionne la capacité de l’Épide à surmonter durablement des débuts difficiles, qui ont pu justifier pendant un temps des résultats mitigés.
On note également qu’en 2011, 73 % des volontaires sont des hommes et 74 % d’entre eux ont abandonné leur scolarité à 16 ans sans diplôme à l’issue de la scolarité obligatoire. Conformément à la convention d’objectifs et de moyens qui lie l’établissement à ses ministères de tutelle, plus d’un tiers des volontaires accueillis sont issus de quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (ZUS ou quartiers relevant d’un contrat urbain de cohésion sociale – CUCS).
b. Les enjeux propres à l’Épide
L’Épide a fait l’objet de vives critiques – depuis sa création et jusqu’à une période récente – concernant son coût et ses modalités de gestion, au regard de ses résultats. Le PLF 2014 prévoit que l’Épide dispose de 938 ETPT (173) (dont environ un tiers d’anciens militaires), pour assurer l’accueil d’environ 3 000 jeunes en flux annuel.
Dans son rapport public annuel de 2011 – qui faisait suite à un référé du 14 février 2008 –, la Cour des comptes précisait que « la différence de coût unitaire, liée au mode de fonctionnement de l’Épide (internat avec un encadrant pour 40 jeunes), est considérable. Le coût annuel d’un CIVIS pour l’État ressort à 900 euros tandis que celui d’une place occupée (par 1,2 volontaire pour l’insertion en moyenne) dépassait 45 000 euros par an en 2008, et atteignait encore près de 40 000 euros en 2009. Le contrat d’objectifs et de moyens fixe pour 2011 un objectif de 35 000 euros, qui ne pourra être atteint sans une maîtrise rigoureuse des charges de fonctionnement. »Cet objectif n’a pas été atteint en 2012, le coût de la prise en charge d’un jeune s’élevant à 41 290 euros, alors qu’il avait atteint 39 424 euros en 2011, après s’être élevé à 40 754 euros en 2010 (174). L’Épide n’a donc pas été en mesure d’atteindre l’objectif fixé par les pouvoirs publics en la matière. Il est vrai que ce coût unitaire de la prise en charge doit être rapporté au niveau scolaire des jeunes qui entrent dans le dispositif – tous ont des difficultés lourdes ou très lourdes en lecture. Le choix d’un dispositif comprenant l’hébergement et un encadrement resserré de type militaire a également un coût, qui peut être justifié par les caractéristiques du public accueilli. L’Épide accueille des jeunes de très faible niveau scolaire, pour lesquels sont nécessaires une vraie coupure avec leur environnement et une solide reprise en main. Il conviendra néanmoins de s’interroger très prochainement sur le modèle de l’Épide, qui, 8 ans après sa création, semble « stagner » – voire régresser – s’agissant de son efficacité et de son efficience.
c. Les cadets de la République de la police nationale et les gendarmes adjoints volontaires (GAV)
La police et la gendarmerie nationales ont mis en œuvre des dispositifs d’embauche à durée déterminée associant formation, emploi et préparation à une entrée définitive dans les cadres. Ils ciblent un public peu ou pas diplômé et constituent à ce titre des vecteurs non négligeables de mobilité sociale.
Le dispositif des cadets de la République, issu du décret n° 2004-1415 du 23 décembre 2004, s’insère dans celui des adjoints de sécurité de la police nationale (ADS), recrutés – en application de l’article 2 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 – afin de « faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. »
Le cadet de la République a pour caractéristique de suivre une partie de sa formation initiale de 12 mois – pour devenir ADS – dans un lycée professionnel (12 semaines), dans le cadre d’une convention à laquelle l’Éducation nationale est partie prenante. La formation initiale des cadets de la République a également lieu en école de police (28 semaines) et sous forme de stages pratiques dans les services actifs. Cette préparation renforcée à l’exercice des fonctions d’ADS – qui passe notamment par une remise à niveau en français, mathématiques et histoire-géographie – est accompagnée d’une rémunération d’un montant d’un peu moins de 500 euros, qui s’ajoutent aux prestations en nature d’hébergement et de couvert.
La police nationale recrute 900 cadets de la République par an. 60 % d’entre eux obtiennent in fine un emploi pérenne et 43 % deviennent gardien de la paix.
Le dispositif des gendarmes adjoints volontaires (GAV) est ouvert aux jeunes de 17 à 26 ans et leur permet, en tant qu’agent de police judiciaire adjoint, l’exercice de missions sur le terrain auprès des sous-officiers de la gendarmerie. Le contrat liant le GAV et la gendarmerie est signé pour 2 ans, renouvelable une fois pour 3 ans. Le GAV bénéficie d’une formation initiale en école de gendarmerie d’une durée de 12 semaines, puis d’une formation complémentaire de 13 semaines dans son unité d’affectation. En sortie d’école, il est rémunéré à hauteur de 1 100 euros par mois environ. Il est logé en caserne et bénéficie du tarif propre aux militaires pour les trajets en train.
En 2010, 54 % des sous-officiers de gendarmerie recrutés étaient d’anciens GAV. En tout état de cause, le GAV bénéficie, à l’issue de son contrat, d’un dispositif d’aide au retour à la vie civile, qui s’appuie notamment sur la faculté de bénéficier d’un congé de reconversion pris en charge (au moins partiellement) par la gendarmerie nationale, sur l’aide à la validation des acquis de l’expérience, sur le bénéfice des allocations chômage et sur la prise en compte dans des fonctions civiles ou militaires ultérieures des années passées en tant que GAV pour l'affiliation à la sécurité sociale et le calcul des droits à pension. En 2010, 40 % des 12 937 GAV recrutés avaient un père employé ou ouvrier et 10 % avaient un père au chômage.
4. Quelle cohérence d’ensemble des dispositifs de seconde chance ?
Les initiatives prises par les pouvoirs publics depuis la fin des années 2000 – et plus encore depuis 2011 – concernant le repérage des décrocheurs et la mise en ordre d’une offre partenariale de raccrochage, contribuent à ce que ce sujet soit désormais appréhendé sous l’angle de la satisfaction d’une demande par une offre de secondes chances.
Cette logique doit être résolument poursuivie, sous la réserve qu’il convient de réduire ab initio la demande, par la prévention du décrochage.
L’offre de seconde chance est aujourd’hui diversifiée. Est-elle pour autant suffisante ? Sa segmentation en dispositifs répond-elle à la diversité des profils des décrocheurs ? Quel doit être l’investissement financier collectif pour répondre aux besoins des différentes catégories de décrocheurs, qu’ils soient très éloignés de toute forme de sociabilité, aptes à raccrocher dans le système scolaire, intéressés par une formation en alternance… ?
Pour répondre à ces questions, il faudrait connaître finement la demande, puis – en conséquence – définir et établir soigneusement l’offre. Les dispositifs de seconde chance, issus d’initiatives diverses toutes justifiées, n’ont pas été créés selon cette logique. Ils constituent aujourd’hui un paysage complexe, dont il n’est pas possible de déterminer jusqu’à quel point il est adapté qualitativement et quantitativement à la demande.
Les PASD et le réseau Foquale sont l’occasion d’établir un examen complet du décrochage et de mener une réflexion approfondie concernant les besoins nécessaires à son traitement via les dispositifs de seconde chance. Il s’agit d’un préalable pour affiner et simplifier l’offre actuelle en la matière. Pour engager l’ensemble de cette action dans des délais rapides, il pourrait être inscrit au programme de travail de la modernisation de l’action publique (MAP) lors du plus prochain Conseil interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP).
● Renforcer les moyens et la dimension partenariale des plateformes d’aide et de suivi aux décrocheurs (PASD).
● Afin qu’il soit proposé des solutions adaptées aux différents profils et besoins des décrocheurs, inscrire rapidement au programme de la MAP la mise en ordre et la simplification de l’offre globale de seconde chance, en appuyant ce travail sur le recensement des décrocheurs et les contacts pris avec chacun d’eux.
● Optimiser les ressources de l’Éducation nationale (places vacantes dans les lycées professionnels, dans les internats, personnels) pour organiser et accompagner de près le retour des décrocheurs en formation initiale scolaire.
● Favoriser le développement de l’expérience des micro-lycées en direction des décrocheurs.
● Améliorer la couverture du territoire par les écoles de la deuxième chance (E2C), en concertation avec les régions, et augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires.
IV. FAVORISER LA RÉUSSITE DANS LES PARCOURS UNIVERSITAIRES
A. L’ENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DOIT ÊTRE À LA FOIS ENCOURAGÉE ET MIEUX PRÉPARÉE
Le souhait d’effectuer des études dans l’enseignement supérieur est un choix personnel du bachelier et doit le demeurer. Encore faut-il que ce choix soit éclairé. Du point de vue de la mobilité sociale, il convient :
– de lever les barrières psychologiques, sociales et financières à l’accès à l’enseignement supérieur ;
– de préparer l’accès à l’enseignement supérieur des bacheliers les plus fragiles.
Répondre à ces enjeux nécessite – en amont et en aval de l’accès à l’enseignement supérieur – la mise en place de dispositifs relevant de l’accompagnement, de l’information et du soutien scolaire.
1. Les cordées de la réussite contribuent à la démocratisation de l’accès aux filières sélectives de l’enseignement supérieur mais demeurent un dispositif partiel
a. Principes, ampleur et modalités de mise en œuvre
Les cordées de la réussite constituent un dispositif de tutorat exercé par des élèves de l’enseignement supérieur à destination d’élèves de l’enseignement secondaire pour préparer ces derniers à l’accès à des études supérieures ambitieuses. Il s’agit, pour le site internet de l’Onisep, de contribuer à « lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui freinent les ambitions et parfois empêchent une poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. »
Les cordées de la réussite s’appuient sur des partenariats passés entre établissements du supérieur « têtes de cordées » et établissements de l’enseignement secondaire, ces partenariats faisant l’objet d’une labellisation par l’État. Érigé en politiques publiques par le ministère chargé de la ville en 2008 dans le cadre de la « Dynamique espoir banlieues », ce dispositif a repris et étendu une mesure développée précédemment par certaines grandes écoles, dans la foulée de l’initiative originelle de 2002 « Une grande école ; pourquoi pas moi ? » mise en œuvre par l’Essec. L’origine « politique de la ville » des cordées de la réussite en tant que dispositif national a laissé une trace s’agissant de son financement : le principal financeur public (5 millions d’euros sur 6,5 millions d’euros) des cordées de la réussite est l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), sur la base de crédits du programme « Politique de la ville ».
Selon le site internet de l’Onisep, en 2012, « dans l’ensemble des académies, on compte […] plus de 2 000 établissements scolaires et près de 50 000 collégiens et lycéens concernées ». Le bilan des cordées de la réussite pour l’année scolaire 2011-2012 établi par les ministères de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur évoque les points suivants :
– le dispositif touche « 20 % des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) de France ; 13 % des collèges ; 50 % des lycées généraux et technologiques (LGT) ; 7 % des lycées professionnels (LP) ; 34 % des établissements relevant de l’éducation prioritaire ; 8 % des EPLE situés en commune rurale ou ville isolée ; 47 % des EPLE situés en ZUS » ;
– 226 établissements – notamment des grandes écoles, mais aussi des universités et des lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles – sont « têtes de cordée », c’est-à-dire scolarisent des élèves tuteurs (dont le nombre total s’élève à 6 100). Le nombre des cordées labellisées s’élève à 326 (175). Les actions de tutorat d’un petit nombre d’entre elles sont exercées par d’autres personnes que des élèves des établissements têtes de cordées : enseignants, salariés du secteur privé… 80 % des cordées proposent des actions allant au-delà du tutorat : « les domaines d’action les plus fréquemment cités sont l’éducation artistique et culturelle, la découverte du monde de l’entreprise, l’aide à l’orientation et l’éducation scientifique et technique » ;
– « 7 % des tuteurs étudiants ont reçu une formation par la tête de cordée ou une association et 29 % ont bénéficié d’un accompagnement par l’équipe pédagogique de l’établissement “source” dans lequel ils assuraient leur tutorat […] 146 établissements [têtes de cordées] prévoient la valorisation de l’engagement des étudiants assurant des actions de tutorat. Les modes de valorisation les plus cités sont l’attribution de crédits ECTS (176), l’attribution de bonifications et la mention de cet engagement sur le supplément au diplôme. En revanche, l’attribution d’une unité d’enseignement n’est pratiquée que par 18 établissements » ;
– il semble que des difficultés de couverture du territoire aient été identifiées : « plus de 2/3 des référents académiques chargés du suivi des “cordées de la réussite” considèrent que le réseau des établissements impliqués dans le dispositif n’est pas encore optimal. Les raisons les plus fréquemment évoquées sont l’absence de couverture de certains territoires et l’implication insuffisante des lycées professionnels. »
Un autre bilan, récemment rendu public par l’ACSÉ, permet de compléter utilement ce tableau :
– La cordée « médiane » de la réussite touche 92 élèves bénéficiaires (177). Le tutorat est à la fois individuel et collectif – par petit groupe – sur la base d’une rencontre hebdomadaire. Le tutorat est assuré par un étudiant, parfois appuyé par un enseignant. Le coût moyen annuel d’une cordée de la réussite s’élève à 270 euros par élève concerné ;
– les élèves bénéficiaires d’une cordée de la réussite relèvent en moyenne de 8,4 établissements sources (c’est-à-dire leur lycée ou collège). L’action d’un tuteur concerne en moyenne un groupe de moins de 10 élèves, et de moins de 4 élèves dans 40 % des cas ;
– environ 54 % des bénéficiaires du dispositif relèvent d’un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville ;
– en 2011/2012, 37 % des élèves ayant l’année précédente bénéficié d’une cordée de la réussite ont intégré une filière longue de l’enseignement supérieur (grandes écoles, universités…), 35 % une filière courte (DUT, BTS…), 19 % une classe préparatoire aux grandes écoles, 7 % sont élèves de lycée et 1 % sont sortis de l’enseignement supérieur.
b. Un dispositif efficient, des questions sur son ciblage et son équité
Les cordées de la réussite sont incontestablement un progrès du point de vue de la mobilité sociale des jeunes et du développement du lien social au sein de la jeunesse :
– elles sont une création « du terrain » et s’appuient sur l’énergie des personnes volontaires qui choisissent de les mettre en œuvre. Les pouvoirs publics, via la politique de la ville, ont su en détecter l’intérêt et en proposer un encadrement national souple, sans remettre en cause le lien fondateur de la cordée entre un établissement d’enseignement supérieur et des établissements de l’enseignement secondaire.
– elles sensibilisent et mobilisent les établissements d’enseignement supérieur, notamment les filières sélectives, s’agissant de l’équité et de la diversité de leurs recrutements ;
– elles créent de la solidarité dans la société civile, au sein même de la jeunesse, dans un but de mobilité sociale – pour valoriser les parcours de formation professionnelle de jeunes disposant de moins d’opportunités, notamment les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les tuteurs étudiants de l’enseignement supérieur bénéficient pour leur part d’une expérience complémentaire aux enseignements, pour la réussite de laquelle ils ont à faire preuve de compétences non uniquement scolaires ;
– elles contribuent à la coopération des établissements d’enseignement supérieur et secondaire et aux échanges entre leurs personnels respectifs ;
Il n’existe pas d’évaluation globale des cordées de la réussite, difficilement praticable au demeurant du fait de la multiplicité des acteurs, des pratiques et des lieux qui les caractérisent.
L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) a fait réaliser deux évaluations concernant la cordée de la réussite – intitulée « Une grande école, pourquoi pas moi ? » (« PQPM ») – dont elle est la « tête de réseau » et qui fut au demeurant la première d’entre toutes (178). Ces deux études, réalisées en 2012, ont porté sur les dix années d’existence de la cordée de la réussite PQPM. Les principaux résultats en sont les suivants :
– à niveau scolaire comparable (obtention d’une mention au baccalauréat général), les étudiants PQPM ont autant de chances d’accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) que les enfants de cadres ;
– les étudiants PQPM réussissent deux fois plus les concours ou examens pour intégrer les filières dites sélectives (Grandes écoles, Sciences-Po, deuxième cycle des études médicales, université Paris-Dauphine) et ont deux fois plus de chances d’obtenir un niveau de diplôme Bac+5 que les étudiants qui leur sont comparables mais qui n’ont pas suivi le programme;
– les étudiants tuteurs de l’ESSEC ont acquis certaines compétences managériales de manière significativement plus importante que les étudiants de l’ESSEC n’ayant pas été tuteurs au sein du programme. Une fois leurs études finies, ils s’engagent davantage que les autres étudiants dans des actions solidaires, alors même qu’ils étaient paradoxalement moins engagés avant d’intégrer le programme PQPM ;
– sur la base d’une méthode de calcul du « retour social sur investissement », le cabinet Accenture considère que le dispositif PQPM a permis de créer une « valeur ajoutée sociale » positive. Celle-ci est calculée en valorisant financièrement les avantages induits par le dispositif pour chacune des catégories d’acteurs et en établissant par ailleurs les montants nécessaires à l’obtention des mêmes avantages selon des voies et moyens plus classiques que le dispositif PQPM. Au total, 1 euro public investi dans le dispositif PQPM permet la mobilisation de 2 euros d’origine privée pour le mettre en œuvre, et conduit à une valeur ajoutée de 9 euros répartis sur l’ensemble des acteurs (dont 70 % en faveur des lycéens ayant bénéficié du tutorat) (179).
Sur le terrain, les rapporteurs ont pu constater la satisfaction donnée par le dispositif. Le rectorat de Rennes précise que le bilan des cordées de la réussite en région Bretagne « reste clairement positif. Le dispositif fonctionne, est apprécié et permet par des résultats visibles de valoriser les établissements, les élèves et les étudiants volontaires y participant, tout en leur ouvrant le champ des possibles via une ouverture d’esprit et un parcours de réussite plus ambitieux vers le supérieur. »
Toutefois, certains éléments évoqués supra doivent conduire à une réflexion approfondie sur le modèle des cordées de la réussite et son avenir.
L’équité territoriale et par filière de l’implantation des cordées de la réussite dans les établissements de l’enseignement secondaire reste à démontrer. Créées initialement par de grandes écoles afin de donner leur chance à d’assez bons élèves situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les cordées de la réussite sont peu implantées dans les établissements scolaires de la voie professionnelle et dans ceux situés dans les communes rurales et les villes isolées.
L’action de tutorat en faveur de lycéens des séries générales a été décisive dans de nombreux cas d’élèves accompagnés par les cordées de la réussite, pour qu’ils émettent des vœux ambitieux et intègrent les cursus correspondants. Du point de vue de l’équité des politiques publiques, une action analogue – de même ampleur – en faveur, par exemple, de lycéens professionnels souhaitant poursuivre en BTS serait sans doute tout aussi pertinente.
Au total, il est difficile de justifier ces différences de traitement, dès lors que les cordées de la réussite sont devenues une politique publique. Au demeurant, aucune mesure de ces disparités n’est disponible. Pour ce faire, il faudrait comparer l’efficience des cordées de la réussite avec celle d’un dispositif virtuel tendant à proposer, au même coût, une offre équitable de tutorat répartie sur l’ensemble du territoire en direction de tous les élèves du secondaire considérés comme cibles pertinentes.
On ne peut pas pour autant regretter que les cordées de la réussite ne soient pas ce dispositif virtuel, c’est-à-dire une planification « qui viendrait d’en haut ». Elles sont précisément un succès parce qu’elles sont issues et s’appuient sur l’énergie et la souplesse des initiatives locales. Les rapporteurs ont souligné supra, s’agissant de la diversification de l’offre scolaire en 3ème en direction des élèves en difficulté, à quel point les pouvoirs publics devaient encourager, conforter et faciliter ces initiatives locales qui répondent à des objectifs d’utilité publique et d’équité. Les nombreuse success stories auxquelles les cordées de la réussite ont contribué ne doivent toutefois pas occulter une réflexion sur un équilibre à déterminer et mettre en œuvre entre le respect de leurs fondamentaux « locaux » et la nécessaire recherche de l’équité des politiques publiques.
2. Il convient de mieux préparer, voire de baliser l’accès des lycéens professionnels à l’enseignement supérieur
a. Orientation et parcours des bacheliers professionnels
Le bac professionnel est conçu comme devant directement permettre l’insertion sur le marché du travail. Pourtant, 42 % des bacheliers professionnels poursuivaient en 2010 leurs études dans l’enseignement supérieur – sous statut scolaire, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Le tableau suivant retrace pour 2010 la répartition des étudiants bacheliers professionnels selon chacune des différentes modalités de formation supérieure choisie par eux.
TAUX DE POURSUITE DES BACHELIERS PROFESSIONNELS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 2010
En pourcentage du nombre des bacheliers professionnels
Enseignement long sous statut scolaire |
Enseignement court sous statut scolaire |
Total statut scolaire |
Contrats d’apprentissage et de qualification |
Total général | ||||
Institut universitaire technologique (IUT) |
Section de technicien supérieur (STS) production |
STS services |
Santé social |
Total enseignement court | ||||
7,4 |
0,7 |
7,7 |
9,7 |
0,1 |
18,3 |
25,6 |
16,4 |
42 |
Source : Note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 12-04 du 26 juin 2012 – Les bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, page 2
Ce tableau peut être complété par les éléments suivants (toujours pour l’année 2010) :
– la proportion de bacheliers professionnels poursuivant leurs études dans l’enseignement sous statut scolaire est passée de 17 % en 2000 à presque 26 % en 2010 ;
– les bacheliers professionnels ayant obtenu leur bac en alternance et s’engageant dans des études supérieures le font en quasi-totalité en alternance. Un tiers des bacheliers professionnels ayant obtenu le bac en lycée professionnel poursuivent dans le supérieur en alternance, les deux autres tiers le font sous statut scolaire ;
– sous statut scolaire ou en alternance, 78 % des bacheliers professionnels s’engagent dans des études supérieures afin d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS). Cette proportion est proche de celle des vœux émis – via l’application en ligne Admission post bac – par les futurs bacheliers professionnels pour intégrer les STS ;
– 27 % des bacheliers professionnels poursuivant des études supérieures sous statut scolaire sont inscrits dans une filière générale de l’université, notamment en lettres, langues, sciences humaines et sociales, arts, droit et sciences politiques.
– la part des bacheliers professionnels augmente considérablement depuis 10 ans dans toutes les filières de formation de l’enseignement supérieur. Pour les STS, cette part est passée d’un peu plus de 15 % à la rentrée 2005 à 25 % à la rentrée 2011, soit désormais plus que la part des bacheliers généraux. 7,8 % des inscrits en L1 à la rentrée 2011 étaient des bacheliers professionnels ;
Le tableau suivant retrace le sort des bacheliers à l’issue de la première année en STS et en licence.
DEVENIR DES BACHELIERS LA DEUXIÈME ANNÉE DE LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES SELON LEUR ORIENTATION
En pourcentage
Orientation après le bac |
Situation la 2ème année |
Bac professionnel |
Bac technologique |
Bac général |
Ensemble |
STS sous statut scolaire |
Passent en 2ème année |
72 |
83 |
87 |
82 |
Redoublent |
9 |
8 |
6 |
8 | |
Se réorientent |
5 |
4 |
5 |
5 | |
Arrêtent leurs études |
14 |
5 |
2 |
5 | |
STS en alternance |
Passent en 2ème année |
75 |
75 |
– |
76 |
Redoublent |
10 |
15 |
– |
12 | |
Se réorientent |
1 |
2 |
– |
2 | |
Arrêtent leurs études |
14 |
8 |
– |
10 | |
Licence |
Passent en 2ème année |
14 |
21 |
59 |
53 |
Redoublent |
40 |
30 |
21 |
22 | |
Se réorientent |
22 |
38 |
16 |
19 | |
Arrêtent leurs études |
24 |
11 |
4 |
6 | |
Ensemble des bacheliers inscrits dans le supérieur |
Passent en 2ème année |
66 |
67 |
64 |
65 |
Redoublent |
12 |
13 |
17 |
15 | |
Se réorientent |
6 |
13 |
17 |
15 | |
Arrêtent leurs études |
16 |
7 |
2 |
5 |
Source : Note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 12-04 du 26 juin 2012 – Les bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, page 5.
S’agissant de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur, le tableau suivant retrace, par filière de bacheliers, les taux de réussite en 2010 en licence après 3 ou 4 années d’études.
RÉUSSITE À LA LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Pour les cohortes des inscrits en L1 en 2007 et 2006 selon le type de baccalauréat
En pourcentage
2007-2010 |
2006-2010 | |||
Série du baccalauréat |
Réussite en 3 ans |
Réussite en 3 ans |
Réussite cumulée en 4 ans | |
Général |
Littéraire |
30,8 |
32,4 |
44,9 |
économique |
33,3 |
35,5 |
49,5 | |
scientifique |
34,4 |
34,2 |
47,8 | |
Technologique STG |
6,3 |
6,1 |
11,6 | |
Autre technologique |
9,2 |
9,1 |
15,3 | |
Professionnel |
2,7 |
2,2 |
4,1 | |
Autres que bachelier |
27,0 |
27,9 |
39,3 | |
Source : Note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 12-04 du 26 juin 2012 – Les bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, page 6.
Dans la même publication que celle d’où sont tirés les tableaux ci-dessus, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indique que pour les filières STS, le « taux de réussite à l’examen [des bacheliers professionnels] a été de 51,3 %, soit 20,4 points de moins que les bacheliers technologiques, et 30,3 points de moins que les bacheliers généraux ». En revanche, s’agissant des licences professionnelles, le ministère précise que « les bacheliers professionnels ont un taux de réussite en deux ans de 87 %, soit 4 points de moins que les bacheliers généraux. Une fois arrivés au stade de la licence professionnelle, ce n’est plus le baccalauréat d’origine qui compte. » (180)
b. Difficultés des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur
Un nombre croissant de bacheliers professionnels souhaitent entamer des études supérieures. Comme évoqué supra dans la partie relative aux filières professionnelles, ce phénomène peut être en partie lié à l’obsolescence partielle de la carte des formations professionnelles secondaires : certains bacs professionnels n’offrent que peu d’opportunités d’intégrer le marché du travail et leurs détenteurs sont incités à poursuivre des études. Les bacheliers professionnels sont sans doute également sensibles au discours ambiant sur la « société et l’économie de la connaissance », qui conduit à prévoir dans la loi française un objectif de 50 % de diplômés de l’enseignement supérieur au sein de chaque classe d’âge. Il est en tout état de cause légitime – pour tous les bacheliers – de tenter d’élever leur niveau de qualification via l’enseignement supérieur.
L’investissement consenti par les bacheliers professionnels de poursuivre leurs études après le bac est-il rentable ? Plusieurs éléments statistiques évoqués supra constituent des alertes en la matière :
– les bacheliers professionnels qui s’inscrivent en licence ne l’obtiennent quasiment jamais – le taux de réussite n’atteint pas 5 % au bout de 4 ans. Les bacheliers professionnels choisissent minoritairement cette orientation, pour autant les effectifs concernés ne sont pas négligeables et s’accroissent(181). Il s’agit en tout état de cause d’un problème de principe majeur quant à l’orientation de ces bacheliers ;
– le taux de réussite des bacheliers professionnels en STS – la filière dans laquelle s’engagent presque 4 sur 5 d’entre eux poursuivant des études supérieures – avoisine 50 %, soit 20 à 30 points de moins que les taux de réussite constatés pour les autres bacheliers. Ces filières STS sont pourtant le débouché « naturel » des lycéens professionnels dans l’enseignement supérieur. Un nombre non négligeable de bacheliers professionnels s’y inscrivant n’ont sans doute pas les « armes » pour réussir ce cursus ;
– au bout d’un an d’études supérieures, en STS ou en licence, les bacheliers professionnels – à hauteur de 16 % d’entre eux – sont beaucoup plus nombreux que les autres à arrêter leurs études. On peut l’interpréter comme le reflet d’un certain découragement face à la réalité de l’enseignement supérieur, ce qui signifie également qu’il y a eu un problème d’orientation.
c. Quelles mesures pour faciliter le parcours des bacheliers professionnels ?
Les bacheliers professionnels sont libres de choisir de continuer leur formation dans l’enseignement supérieur. Il importe qu’ils puissent faire un choix éclairé, sur la base des réalités statistiques évoquées supra quant à leurs chances de réussite et en s’appuyant sur leur parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF).
Il importe également de les sensibiliser au caractère en principe « professionnalisant » de leur bac sur le marché du travail. Dans un lycée professionnel, les prestataires KPMG et Euréval ont relevé un dispositif innovant en la matière, intitulé « tremplin », qui « vise à améliorer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en accélérant le délai entre obtention du diplôme et entrée dans la vie active, faciliter la mobilité pour améliorer l’employabilité. En termes de moyens, un espace 1er emploi a été créé au sein de l’établissement qui regroupe des activités d’informations et de conseils, des ateliers de préparation à la recherche d’un emploi, des actions de sensibilisation du corps enseignant… »
Dès lors que la poursuite des études dans l’enseignement supérieur est engagée, il convient d’accompagner les bacheliers professionnels. Lors de la visite des rapporteurs effectués le 14 juin dernier au lycée Pierre Mendès-France à Rennes, un tel accompagnement leur a été présenté. Un dispositif de soutien en math et en français – 1h30 par semaine pour chacune de ces deux matières – est proposé aux bacheliers professionnels ayant intégré une STS. Les élèves de BTS concernés sont « repérés » au préalable via le dispositif en ligne Admission post bac (APB). Les enseignements sont prodigués à des petits groupes de 5 élèves par des enseignants de BTS. Pour les équipes pédagogiques concernées, ce « rattrapage » scolaire peut être efficace, même si le différentiel de niveau demeure un obstacle sérieux.
Les rapporteurs l’ont déjà évoqué dans le présent rapport à plusieurs reprises, ces initiatives doivent être encouragées, facilitées, financées par les autorités académiques. Elles contribuent à la mobilité sociale des jeunes. Pour autant, comme toutes les initiatives locales et partielles qui amendent un système, elles interrogent celui-ci. Dans ce système, les élèves des lycées professionnels sont fortement incités à obtenir le bac depuis la réforme de la voie professionnelle mise en œuvre à compter de 2008. Pour autant, ils ne sont pas bien préparés à la poursuite d’études supérieures, même en STS, alors que le bac leur ouvre la faculté d’intégrer ces sections.
C’est dans ce contexte qu’il conviendra d’examiner avec attention la mise en œuvre de quotas de bacheliers professionnels dans les STS – et de bacheliers technologiques dans les IUT. L’article L. 612-3 du code de l’éducation – issu de l’article 33 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche – prévoit qu’« en tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure [APB], le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. »
Ce dispositif pose la question, à terme, d’une compatibilité accrue de l’enseignement secondaire professionnel et des STS, qui reposerait sur une refonte des enseignements « de part et d’autre » du bac professionnel – et non plus seulement sur des initiatives locales de remise à niveau. Il convient également de veiller à ce que l’amorce d’une spécialisation « officielle » – par la mise en place de ces quotas – des STS en faveur des bacheliers professionnels ne rende pas ces filières inaccessibles pour les bacheliers de la filière générale qui souhaitent y accéder et qui n’ont pas tous vocation à intégrer les filières longues de l’enseignement supérieur.
B. DES MARGES DE PROGRESSION EXISTENT POUR UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES ÉTUDIANTS DANS LEUR CURSUS UNIVERSITAIRE
1. La réussite des étudiants dans l’enseignement supérieur est globalement élevée mais inégale selon les filières d’origine des bacheliers
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en réponse aux questions des rapporteurs, a fourni le tableau suivant, issu de l’exploitation de deux enquêtes réalisées sur des panels d’élèves entrés en 6ème en 1989 et 1995, qui retrace le bilan des parcours des bacheliers dans l’enseignement supérieur.
BILAN DU PARCOURS DES BACHELIERS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SELON LES PRINCIPALES ORIENTATIONS APRÈS LE BAC
En pourcentage
Diplômés de l’enseignement supérieur |
Sortis sans diplôme |
Rappel : Diplômés panel 1989 | ||||
Diplôme bac +2 |
Diplôme Bac +3/4 |
Diplôme bac +5 |
Ensemble | |||
Licence |
9 |
40 |
31 |
80 |
20 |
78 |
Dont bacheliers généraux |
8 |
43 |
35 |
86 |
14 |
85 |
Dont bacheliers technologiques |
17 |
26 |
10 |
53 |
47 |
41 |
Médecine – pharmacie |
5 |
30 |
56 |
91 |
9 |
92 |
Classes préparatoires aux grandes écoles |
1 |
15 |
82 |
98 |
2 |
96 |
Institut universitaire de technologie (IUT) |
26 |
29 |
38 |
93 |
7 |
92 |
Dont bacheliers généraux |
19 |
31 |
45 |
95 |
5 |
94 |
Dont bacheliers technologiques |
42 |
23 |
24 |
89 |
11 |
87 |
Section de technicien supérieur (STS) |
49 |
15 |
7 |
71 |
29 |
75 |
Dont bacheliers généraux |
48 |
25 |
17 |
90 |
10 |
85 |
Dont bacheliers technologiques |
52 |
16 |
6 |
74 |
26 |
76 |
Dont bacheliers professionnels |
43 |
3 |
2 |
48 |
52 |
44 |
Ensemble de ceux qui ont poursuivi dans le supérieur |
22 |
29 |
30 |
81 |
19 |
81 |
Source : Ensemble des élèves des panels 1989 et 1995 qui ont poursuivi des études supérieures après leur baccalauréat
Ce tableau montre que 19 % des bacheliers ayant opté pour des études dans l’enseignement supérieur en sortent sans diplôme. Si ce taux peut paraître élevé, l’investissement des bacheliers dans la poursuite des études conduit toutefois à ce que 4 sur 5 d’entre eux obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur. Ce taux de 81 % est en tout état de cause supérieur à celui constaté en moyenne pour les pays de l’OCDE, qui se situe à environ 70 %.
Cette « performance » du système d’enseignement supérieur français permet également de relativiser les faibles de taux de réussite constatés en première année de licence. La première année de licence constitue désormais, dans bien des cas, un sas d’orientation, ouvrant sur des réorientations. Le plan licence de 2007 en avait d’une certaine façon tiré les conséquences, en concevant – par filière – une première année pluridisciplinaire, avant une deuxième année marquant véritablement l’entrée dans la spécialisation disciplinaire.
Il reste que l’allongement des études issu de ces parcours non linéaires constitue un coût pour la collectivité publique. C’est aussi le prix à payer pour une vision de l’enseignement supérieur qui autorise chaque étudiant à prendre le temps nécessaire pour se trouver, identifier sa voie de formation et réussir. Il ne s’agit pas d’un « luxe » dans notre société, qui valorise de façon plus ou moins explicite la réussite scolaire sans délai, au point de rendre suspect tout laps de temps pris entre deux compartiments du cursus scolaire. Pour autant, peut-être serait-il opportun de mieux organiser ce temps « supplémentaire » donné à la formation initiale supérieure. Par une meilleure orientation préalable et un accompagnement personnalisé en licence – enseignant référent, tutorat, qui constituent des dispositifs également prévus par le plan pour la réussite en licence de 2007 – il doit être possible de relever les taux de réussite aux examens annuels et donc de « gagner » du temps susceptible d’être consacré à des semestres ou années de césure consacrés à un engagement, à une mission de volontariat ou à un séjour à l’étranger.
En tout état de cause, les difficultés précises que le tableau précédent fait apparaître portent sur deux éléments :
– comme les rapporteurs l’ont évoqué supra, seuls 50 % des bacheliers professionnels s’orientant vers les STS obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur. En réponse aux questions des rapporteurs, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche souligne la faiblesse de ce taux, tout en notant que « cette situation ne correspond cependant pas toujours à un échec à l’examen : un certain nombre abandonnent en effet leur formation parce qu’ils ont trouvé un emploi, parfois dans l’entreprise dans laquelle ils faisaient leur stage ou leur alternance » ;
– le taux des diplômés des bacheliers technologiques s’orientant initialement en STS s’établit à 74 %, mais a fléchi entre les résultats obtenus par les élèves des panels 1989 et 1995 ;
– le taux des diplômés parmi les bacheliers technologiques est faible pour ceux qui s’engagent initialement dans une licence. Il s’établit à 53 % pour le panel 1995, en nette progression toutefois par rapport au panel 1989 pour lequel il s’établissait à 41 %. Pour expliquer ce progrès, le ministère de l’Enseignement supérieur note qu’« inscrits en licence le plus souvent faute d’avoir été admis dans la filière qu’ils souhaitaient, [les bacheliers technologiques] parviennent de plus en plus souvent à se réorienter. 53 % d’entre eux ont quitté l’enseignement supérieur avec un diplôme : dans la moitié des cas ils ont obtenu ce diplôme ailleurs qu’à l’université. »
Il convient de porter les efforts d’accompagnement au cours des cursus universitaires sur ces publics « fragiles » de l’enseignement supérieur. Le ministère de l’Enseignement supérieur souligne la situation difficile des étudiants sortis sans diplôme de l’enseignement supérieur. Il précise que « près de 11 % des jeunes sortis de l’enseignement supérieur en 2007 sont au chômage en 2010, trois ans après leur sortie. C’est plus que leurs homologues sortis en 2004 (8 %) mais cette dégradation reste limitée en comparaison de celle dont ont pâti les sortants de l’enseignement secondaire dont le taux de chômage est passé de 21 % à 27 %. Ce sont les jeunes qui échouent dans l’enseignement supérieur qui connaissent des débuts sur le marché du travail les plus difficiles. Parmi eux, les non diplômés de l’université ont le plus fort taux de chômage (21 %) et le plus faible taux d’emploi à durée indéterminée (44 %) ». Logiquement, le taux de chômage des jeunes sortis sans diplôme de l’enseignement supérieur n’est pas éloigné de celui des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire.
2. Certaines mesures pourraient conforter la réussite dans l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des étudiants
a. Le dispositif des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP)
Depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités modifiée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, l’article L. 611-5 du code de l’éducation précise qu’« un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université ». Le BAIP a selon cet article plusieurs missions :
– s’agissant des stages, il favorise « un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. […] Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage » ;
– il a une fonction de conseil auprès des étudiants en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
– sur leur demande, le BAIP « prépare les étudiants […] aux entretiens préalables aux embauches » ;
– il établit un rapport annuel remis à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur les stages effectués par les étudiants et sur leur insertion professionnelle, et rend publiques des statistiques en la matière.
Dans la plupart des universités, la création des BAIP a posé la question de leur articulation avec les structures existantes, notamment les services communs universitaires d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP). Un rapport de mars 2010 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR) (182), analysant l’élaboration des schémas directeurs de l’aide à l’insertion professionnelle – effectuée par les universités à l’occasion de la création en leur sein des BAIP –, montre que les universités ont fait preuve d’autonomie en la matière. Certains BAIP ont intégré les SCUIO, à l’inverse, dans certaines universités, les BAIP constituent l’un des éléments des SCUIO-IP. Dans d’autres configurations, les BAIP et les SCUIO-IP coexistent au sein d’une structure-mère ou sont rassemblés au sein du « portefeuille » d’un vice-président de l’université.
S’agissant des partenariats sur lesquels l’activité du BAIP doit s’appuyer, le rapport de mars 2010 du MESR note que de nombreuses universités ont, antérieurement à la création de ces bureaux, noué des liens étroits avec des entreprises. Le même rapport semble déplorer à l’inverse une faible culture du partenariat public : « les relations avec les employeurs sont donc plébiscitées, de même que celles avec les spécialistes de l’insertion (APEC, Pôle emploi). Inversement, la construction de partenariats avec les collectivités territoriales n’est pas une priorité dans plus de 50 % des cas. Il en va de même pour ce qui est des collaborations avec les acteurs de la sphère éducative qui, pour un gros tiers des établissements, ne sont au mieux évoquées que pour les besoins de la cause. » (183)
b. Améliorer l’aide apportée aux étudiants en matière d’insertion professionnelle
Les avantages de la démarche lancée en 2007 autour des BAIP sont patents. Les universités ont été conduites, à cette occasion, à traiter globalement la question de l’insertion professionnelle des jeunes qu’elles forment – question qu’elles avaient, il est vrai, souvent abordé antérieurement, mais dans des conditions plus empiriques et moins homogènes. Les BAIP constituent par ailleurs un service utile pour les étudiants « sans réseau » ou avec moins d’opportunités, pour trouver un stage ou élaborer un curriculum vitae.
Évoquant ces éléments positifs, M. Khaled Bouabdallah, président de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et vice-président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence des présidents d’université (CPU), précisait toutefois devant le groupe de travail animé par les rapporteurs que les BAIP demeuraient un dispositif limité. Les moyens qu’une université peut affecter au fonctionnement des BAIP sont nécessairement restreints, quelques personnes pour, souvent, plusieurs milliers d’étudiants. Par ailleurs, une action d’ampleur à l’université tournée vers la question de l’insertion professionnelle nécessite l’implication des enseignants, à tout le moins que ceux-ci s’emparent de cette problématique.
Le rapport ci-dessus évoqué du MESR de mars 2010 propose, parmi les pistes de travail à explorer pour l’avenir des BAIP, d’« intégrer les résultats de l’action d’aide à l’insertion professionnelle dans la réflexion sur l’évolution de l’offre de formation ». Cette préconisation pourrait constituer un point de départ pour associer les personnels enseignants à l’action des BAIP. Il pourrait être également envisagé d’inciter les enseignants – dûment formés – à participer à des modules d’insertion professionnelle associés aux enseignements fondamentaux, afin de contribuer à l’acquisition par les élèves de compétences liées à l’insertion professionnelle (rédaction de curriculum vitae, lettres de motivation, préparation à des entretiens d’embauches).
Les rapporteurs considèrent également que ces bureaux pourraient utilement s’appuyer sur l’expérience, les compétences et l’expertise des associations d’étudiants en matière d’insertion professionnelle, s’agissant notamment des services rendus aux étudiants. Cette évolution pourrait s’appuyer au demeurant sur l’inscription systématique dans les contrats pluriannuels d’établissement prévus par l’article L. 711-1 du code de l’éducation d’un volet concernant l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants.
● Conforter et généraliser les dispositifs de tutorat et de parrainage – comme les cordées de la réussite – pour développer l’ambition et faciliter la transition vers l’enseignement supérieur, en veillant à l’équité de leur déploiement.
● Développer une offre d’accompagnement scolaire en direction des étudiants titulaires d’un bac professionnel pour conforter leur chance de réussite dans les filières courtes (sections de technicien supérieur…).
● Engager une réflexion sur les moyens d’améliorer l’adéquation entre l’enseignement professionnel secondaire et la filière technique courte de l’enseignement supérieur.
● Développer, au sein des parcours universitaires, des semestres ou années de césure en faveur de l’accomplissement d’un engagement, d’une mission de volontariat ou d’une mobilité internationale.
● Renforcer le dispositif des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) des universités :
– en y associant le personnel enseignant des universités, par exemple en les chargeant d’élaborer et mettre en œuvre des modules de préparation à l’insertion professionnelle au sein des cursus de formation, destinés à l’acquisition de compétences liées à l’insertion professionnelle (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation à des entretiens d’embauches) ;
– en y associant les associations d’étudiants qualifiées en matière d’accompagnement et d’insertion professionnelle des jeunes ;
– en inscrivant un volet « orientation et insertion professionnelle des étudiants » dans les contrats liant l’État et les établissements d’enseignement supérieur.
V. VALORISER LES COMPÉTENCES DANS LA FORMATION INITIALE
Plusieurs développements du présent rapport concernent la valorisation des compétences initiales dans la formation initiale :
– les rapporteurs proposent ainsi que la diversification de l’offre scolaire au collège en faveur des élèves en difficulté – et dont le projet d’orientation doit faire l’objet d’une attention soutenue – passe par la mise en valeur d’éléments moins académiques, plus transversaux, basés sur le projet, l’étude d’un objet concret ou la mise en situation. Cette diversification apparaît indispensable en faveur des élèves pour lesquels la confrontation trop directe avec l’abstraction et la multiplicité des disciplines érodent leur motivation et leur confiance. Elle serait au demeurant sans doute un bienfait pour l’ensemble des élèves de collège ;
– ils notent que les tuteurs des cordées de la réussite bénéficient dans certains cas, au titre de cet engagement, de crédits ECTS ou d’une mention ajoutée au diplôme. Ces modalités de valorisation dans la scolarité d’engagements périphériques ou externes au système scolaire pourraient être étendues, sous réserve de s’assurer qu’ils correspondent à une utilité sociale et sociétale réelle et qu’ils impliquent de faire effectivement preuve de compétences en termes d’organisation, de communication, de travail en équipe et de savoir être. Une expérimentation pourrait être menée pour valoriser ce type d’engagement dans les cursus scolaires du niveau secondaire ;
– ils évoquent le partenariat entre l’Éducation nationale et l’Agence du service civique (ASC) pour proposer des missions de volontariat aux jeunes décrocheurs, parfois en alternance avec la scolarité. Plus largement, le service civique peut être un facteur de mobilité sociale pour les jeunes, via la valorisation des compétences mises en œuvre par le volontaire au cours de sa mission.
D’autres progrès pour la valorisation des compétences non académiques sont envisageables autour du code commun de compétences, notamment à l’occasion de sa prochaine modification.
A. LE SOCLE COMMUN A INITIÉ UNE VALORISATION DES COMPÉTENCES DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
1. Le socle selon les lois de 2005 et de 2013
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au socle commun – dont la scolarité obligatoire doit garantir l’acquisition – dans les lois de 2005 et de 2013 relatives à l’école.
CONTENU ET OBJECTIFS DU SOCLE COMMUN
Art. 9 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école |
Art. 13 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République | |
Intitulé |
socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences |
socle commun de connaissances, de compétences et de culture |
Objectifs du socle |
indispensable de le maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société |
permet la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et prépare à l'exercice de la citoyenneté |
Contenu |
1.– la maîtrise de la langue française 2.– la maîtrise des principaux éléments de mathématiques 3.– une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté 4.– la pratique d'au moins une langue vivante étrangère 5.– la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication |
Non précisé |
Dispositions réglementaires |
Annexe au décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006. Aux 5 items légaux, cette annexe ajoute : - les compétences sociales et civiques - l'autonomie et l'initiative |
Non publiées – dans l’attente, le décret du 11 juillet 2006 demeure en vigueur |
2. L’articulation des disciplines, des programmes et des compétences dans le socle
L’annexe au décret du 11 juillet 2006 précise la portée du socle commun au regard des programmes d’enseignement et des disciplines de la scolarité obligatoire : « le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. »
Les connaissances et les compétences du socle ont ainsi vocation à donner du sens à l’enseignement disciplinaire. Par ailleurs, les deux items ajoutés par le décret du 11 juillet 2006 – les compétences sociales et civiques, ainsi que l’autonomie et l’initiative – ne sont pas directement liées aux disciplines enseignées aux niveaux primaire et secondaire. L’annexe au décret du 11 juillet 2006 indique que ces deux compétences, moins académiques, « ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire [, alors que les 5 premières prévues par la loi] font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement. »
Que les compétences soient directement ou non rattachées à des disciplines scolaires, la même annexe précise que chacune d’entre elle « est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité. »
La notion de compétence renvoie ainsi à la fois à un savoir théorique, une capacité de mise en pratique et à ce qui relève du savoir être. Il ne fait pas de doute que notre système scolaire valorise les savoirs théoriques et académiques, surtout dans l’enseignement secondaire. Y valoriser des « compétences » dans leur ensemble consiste donc à équilibrer les enseignements au bénéfice de la mise en pratique et du savoir être.
Depuis les rentrées 2008 (en primaire) et 2009 (au collège), la scolarité de chaque élève est accompagnée d’un livret de compétences qui atteste de son acquisition progressive du socle commun. L’évaluation des compétences acquises relève de l’ensemble de l’équipe pédagogique au collège. Cette évaluation implique un travail partenarial associant a) les niveaux primaire et secondaire et b) au collège, les enseignants des disciplines.
B. LA RÉFORME DU SOCLE DOIT PERMETTRE DE CONFORTER SA PLACE DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE ET D’Y METTRE EN VALEUR LES COMPÉTENCES NON ACADÉMIQUES
La modification – introduite par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République – de la définition et du contenu du socle commun conduira à la révision du décret du 11 juillet 2006 dans la période à venir. Cette modification est au programme du nouveau Conseil supérieur des programmes, installé le 10 octobre 2013, dont l’une des missions consiste à émettre des avis et à formuler des propositions concernant le socle commun (184).
La modification de la loi a supprimé la hiérarchie implicite des compétences du socle entre les 5 compétences légales – directement rattachées aux enseignements – et les 2 compétences réglementaires – plus proches peut-être des aptitudes à la mise en pratique et de ce qui relève du savoir être. La future définition réglementaire du socle doit tenir compte de cette évolution, en confortant les éléments du socle commun qui portent sur les compétences sociales et civiques, ainsi que sur l’autonomie et l’initiative. Ces modifications pourraient promouvoir l’enseignement de la capacité d’expression orale en public, ainsi que de la participation à une équipe et à son animation.
Les futurs écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), créées par la loi du 8 juillet 2013 ont, entre autres, pour mission de préparer « les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie ». Les ESPE devront contribuer à inscrire plus profondément qu’aujourd’hui dans notre système scolaire le socle dans son ensemble, et, a fortiori, parmi les compétences qui le composent, celles qui ne sont pas directement liées aux disciplines académiques.
● Valoriser dans la formation initiale les compétences non académiques :
– donner aux compétences « moins académiques » toute leur place au sein du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
– faire en sorte que les futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) confortent la place du socle au sein du système scolaire et, a fortiori, parmi les compétences qui composent ce socle, de celles qui ne sont pas directement liées aux disciplines académiques ;
– généraliser la valorisation dans les cursus de l’enseignement supérieur de l’engagement dans le tutorat ou le parrainage d’élèves et, sous réserve de la vérification de leur utilité publique ou sociale, des engagements périphériques ou externes au système universitaire. Expérimenter une telle valorisation pour les cursus de l’enseignement secondaire.
TROISIÈME PARTIE :
MOBILITÉ SOCIALE ET TRANSITION VERS L’ÂGE ADULTE : FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES À L’EMPLOI ET À L’AUTONOMIE
« Pour la société française, qui a fait de l’école la principale voie de mobilité sociale, c’est un constat d’échec : le déclin de l’immobilité sociale demeure extrêmement modeste au regard de l’effort consenti pendant le dernier demi-siècle (185) ». De fait, dans un pays où l’on accorde tant d’importance au diplôme obtenu à l’issue de la formation initiale, les parcours scolaires restent fortement influencés par l’origine sociale. L’adaptation du système éducatif constitue donc un premier levier d’action pour mieux favoriser l’égalité des chances.
Toutefois, comme le souligne le sociologue Camille Peugny, « à l’heure où les carrières s’allongent et où l’exigence de mobilité ne cesse d’être affirmée, il est inacceptable que le destin des individus soit figé si tôt. Une société fragilisée par la mondialisation ne peut s’estimer quitte de son travail d’égalisation des conditions à l’issue de la formation initiale (et ce, même si l’école devenait moins injuste et plus méritocratique) ». Il faut en effet multiplier les moments de formation, et au-delà, quelles que soient les difficultés que les jeunes ont pu rencontrer dans leur parcours scolaire, leur donner des possibilités de rebondir et de saisir une, ou plutôt des « secondes chances » et ce, tout au long de la vie.
De ce point de vue, l’image de l’ « ascenseur social », qui exprime l’idéal méritocratique d’une société dans laquelle chacun doit pouvoir s’élever dans la hiérarchie sociale par son travail et ses mérites, peut apparaître trompeuse. Elle figure en effet une ascension rapide, sinon immédiate et sans effort, comme l’a observé l’une des personnes entendues par la mission, et évoque également une trajectoire linéaire. Or, il serait plus pertinent de raisonner en termes de parcours susceptible de se construire pas à pas, avec des étapes, voire des tâtonnements et des expériences diverses (par exemple des va-et-vient entre emploi et formation), ce dont rendrait mieux compte l’image d’un « escalier » ou de « passerelles sociales ».
Pour les jeunes, les efforts en ce sens doivent d’abord porter sur la période de transition vers l’âge adulte, dont les marqueurs traditionnels sont l’entrée dans la vie active et l’autonomie financière et résidentielle (quitter le foyer parental) mais aussi la mobilité (passer son permis de conduire, voire partir à l’étranger), avant d’envisager éventuellement de fonder à son tour un foyer.
Quelque contradictoire que cela puisse paraître, l’accès des jeunes à l’autonomie peut nécessiter qu’ils soient aidés, ou plutôt accompagnés, et particulièrement ceux issus de milieux modestes, qui sont aussi, pour les raisons évoquées plus haut, plus fortement représentés parmi les jeunes peu ou pas qualifiés rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. En vue de soutenir la mobilité sociale des jeunes, il convient donc d’analyser successivement les voies et moyens :
– d’agir plus efficacement en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, s’agissant en particulier des peu ou pas qualifiés, et ce non seulement au moment de leur entrée dans la vie active, mais aussi tout au long de leur parcours ;
– d’améliorer les conditions de vie des étudiants et de favoriser l’accès à l’autonomie (bourses, logement et mobilité).
Pour autant, on aurait tort de distinguer trop nettement, sinon d’opposer, l’une et l’autre de ces problématiques, dans la mesure où l’autonomie s’acquiert d’abord et surtout par l’emploi. En sens inverse, les difficultés sociales et matérielles, en matière de logement, de santé ou de mobilité par exemple, peuvent constituer autant de freins à l’emploi des jeunes.
En tout état de cause, il apparaît, là encore, nécessaire de simplifier les dispositifs, de renforcer la coordination et le pilotage de l’action publique et d’améliorer l’accompagnement proposé, en veillant à ce qu’il soit aussi assorti de contreparties.
I. SOUTENIR PLUS EFFICACEMENT L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIÉS ET OPTIMISER LES OUTILS EXISTANTS
Des efforts importants sont consentis en faveur de l’insertion des jeunes, mais l’efficacité des politiques publiques est affaiblie par le foisonnement des acteurs et l’empilement des dispositifs, avec aussi un ciblage parfois insuffisant sur les jeunes les plus en difficulté d’insertion.
Pour mieux mobiliser les politiques d’emploi en faveur de la mobilité sociale des jeunes, il convient dès lors d’adapter simultanément :
– la gouvernance des politiques (coordonner les acteurs) ;
– les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (améliorer les outils) ;
– la valorisation des compétences au sens large, acquises par l’expérience ou par la formation, dans le cadre de parcours diversifiés et moins linéaires (promouvoir la qualification et l’acquisition de compétences tout au long de la vie).
En définitive, l’enjeu est finalement moins d’inventer des solutions nouvelles que d’optimiser, de mieux assembler et de piloter différemment les initiatives et les outils existants.
A. CLARIFIER LA GOUVERNANCE ET MIEUX FÉDÉRER LES ÉNERGIES
Pour répondre à l’enjeu prioritaire que constitue l’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés, il faut tout d’abord créer les conditions d’une gouvernance partenariale plus efficace :
– en renforçant, d’une part, la coordination des acteurs publics, en particulier au niveau régional ;
– en confortant, d’autre part, le rôle des partenaires sociaux, à travers le développement de la négociation collective sur ces questions.
Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence, la complémentarité et donc l’efficacité de l’action publique, avant d’envisager une adaptation des outils et des moyens en faveur des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
1. Les jeunes peu ou pas qualifiés : une cible prioritaire de l’action publique
a. Des difficultés d’insertion se concentrant sur les peu ou pas qualifiés et un nombre important de jeunes sans emploi et sans formation
Pour cerner les principaux enjeux actuels en matière d’insertion des jeunes, l’analyse doit s’appuyer sur la lecture croisée de trois indicateurs : le taux d’emploi, le taux de chômage, mais aussi le nombre des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation.
● Un taux d’emploi des jeunes plus faible que dans plusieurs pays voisins
En France, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est inférieur à la moyenne européenne et à celui de plusieurs pays voisins, comme l’Allemagne ou le Danemark, où il est près de deux fois plus élevé. Indépendamment de la question particulière des jeunes inactifs (cf. infra), ceci tient notamment à la durée des études et la fréquence moindre du travail pendant celles-ci, que ce soit dans le cadre de l’alternance ou de l’emploi étudiant. A contrario, les transitions entre l’emploi et le système éducatif sont plus développées au Danemark notamment.
TAUX D’EMPLOI DES JEUNES EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2012
Taux d’emploi |
France |
Danemark |
Allemagne |
Royaume-Uni |
Pays-Bas |
Europe (UE à 27) |
15-29 ans |
44 % |
60,2 % |
57,7 % |
57,8 % |
70 % |
46,7 % |
15-24 ans |
28,4 % |
55,5 % |
46,6 % |
46,9 % |
63,3 % |
32,9 % |
Source : dossier thématique de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013
● Un chômage qui se concentre sur les jeunes peu ou pas qualifiés
Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, qui rapporte le nombre de chômeurs aux seuls actifs, représentait près de 24 % en 2012.
TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES DANS LES PAYS DE L’OCDE EN 2011 (EN %)
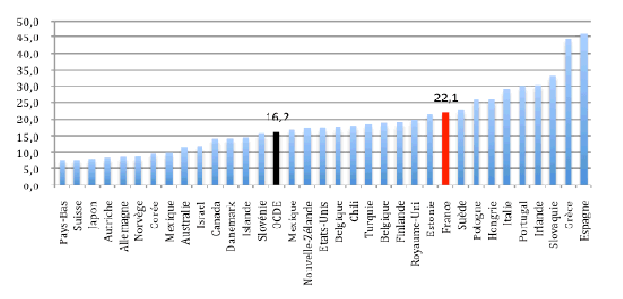
Source : OCDE (Cour des comptes, « Marché du travail, face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques », janvier 2013)
En incluant la tranche d’âge des 25 à 29 ans, les indicateurs sont toutefois proches de la moyenne européenne (186). Il reste que le taux de chômage des jeunes, qui par construction ne prend pas en compte les inactifs qui ne recherchent pas activement un emploi, est très supérieur à celui d’autres classes d’âge (9,9 % pour les actifs de 15 à 64 ans en 2012). Cette moyenne recouvre par ailleurs des situations très contrastées, qui dépendent essentiellement du niveau de qualification, comme l’illustre le graphique ci-dessous. Les difficultés peuvent aussi se concentrer sur certains territoires : le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans résidant dans les zones urbaines sensibles (ZUS) s’élève ainsi à plus de 40 % (187).
TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE SELON L’ÂGE ET LE DIPLÔME
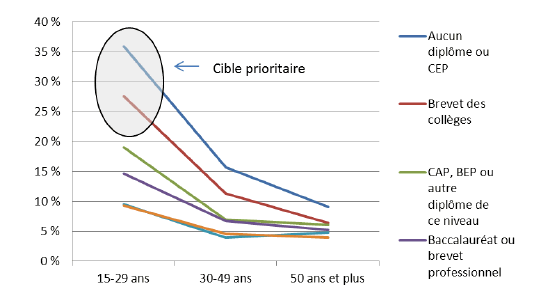
Source : graphique réalisé d’après les données de l’Insee (2010)
● Le défi des « NEET (188) » : près d’un million de jeunes « à la dérive » ?
Début 2013, près de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans n’étaient ni à l’école, ni en emploi, ni en formation, soit près de 17 % de la tranche d’âge, selon une note récente du Conseil d’analyse d’économique (CAE), dont la mission a entendu l’un des auteurs (189). Sur la dernière décennie, cette proportion est en moyenne la quatrième plus élevée des pays de l’OCDE ci-dessous. En particulier, « environ 20 % de jeunes de 20-24 ans en France sont NEET et donc structurellement en risque de marginalisation sociale », selon l’OCDE (190).
EN FRANCE, UN JEUNE SUR SIX N’EST NI EN EMPLOI, NI EN ÉDUCATION, NI EN FORMATION
Part des 15-29 ans « NEET », moyenne 2002-2010 (en pourcentage)
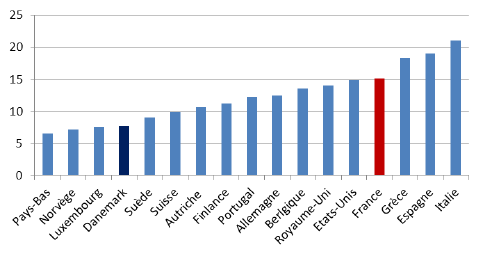
Source : d’après les statistiques de l’OCDE présentées dans la note du CAE précitée sur l’emploi des jeunes (avril 2013)
La note précitée du CAE indique que « plus grave encore, environ la moitié de ces jeunes, soit 900 000, ne cherchent pas d’emploi. Ils sont à la dérive ». Il existe des sources et des modes de calculs différents sur ce sujet. Selon la Dares (191), parmi les jeunes de 15 à 29 ans faisant partie du groupe des NEET, 57 % sont au chômage, tandis que 43 % sont inactifs.
En tout de cause, ces jeunes inoccupés, « laissés pour compte », selon la typologie établie par l’OCDE (192), ont majoritairement un faible niveau éducatif : ainsi, 85 % des jeunes inactifs ou au chômage (NEET) n’ont pas dépassé le lycée et 42 % le collège selon la note précitée. Alors que plus de 130 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, aider ces jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle constitue donc un défi majeur.
Plus souvent issus de foyers modestes, même s’il semble qu’il n’y ait pas d’étude très précise sur ce point, et avec une proportion plus importante dans les quartiers (193), ces jeunes sont aussi , selon M. Joaquim Timoteo, chercheur à l’INJEP, « en perte de confiance dans les institutions censées les aider » et « ont intégré une espèce de fatalité de la précarité (194)
Ainsi, 470 000 de ces jeunes de 16 à 25 ans sortis de formation initiale sans diplôme ou avec le seul brevet ne sont ni en emploi ni en formation. Ces jeunes se retrouvent trop souvent livrés à eux-mêmes, n’étant plus pris en charge par le système éducatif et pas nécessairement suivis en tant que demandeurs d’emploi.. Seule la moitié d’entre eux se déclare en effet inscrits à Pôle emploi. Par ailleurs, l’insertion des peu diplômés est encore plus sensible aux aléas conjoncturels (195), avec aussi une plus forte précarité dans l’emploi (CDD, interim…).
SITUATION DES JEUNES NI EN EMPLOI NI EN FORMATION AYANT AU PLUS UN BEP/CAP
Sans diplôme (1) |
CAP-BEP (2) |
Total (1+2) | |
Chômeurs au sens du BIT |
53 % |
69% |
58 % |
Inactifs |
47 % |
31 % |
42 % |
Inscrits à Pôle Emploi |
50 % |
66 % |
55% |
Non inscrits à Pôle Emploi |
50 % |
34 % |
45% |
Total ni en emploi, ni en formation |
470 000 |
238 000 |
708 000 |
Champ : jeunes de 16 à 25 ans inclus sortis de formation initiale ou d’apprentissage et ayant au plus un CAP ou un BEP
Source : étude d’impact du projet de loi portant création des emplois d’avenir (août 2012)
En définitive, les parcours d’insertion dans l’emploi stable peuvent être longs et difficiles pour les jeunes, et particulièrement les moins qualifiés d’entre eux : seuls 29 % des 16-25 ans sans diplôme accèdent rapidement et durablement à un emploi (196). Or ce constat est d’autant plus préoccupant que :
– au lieu de corriger les inégalités liées à la formation initiale et l’origine sociale, le fonctionnement du marché du travail a plutôt tendance à les accentuer par la suite ; c’est du moins clairement le cas en matière d’accès à la formation professionnelle, trop souvent concentrée sur les plus qualifiés (cf. infra) ;
– ce déficit d’emploi a un impact sur la richesse nationale (perte de croissance potentielle) et les finances publiques (du fait notamment des dépenses de réparation sociale) : s’agissant des NEET en Europe, les pertes économiques imputables au désengagement des jeunes par rapport au marché du travail ont ainsi été estimées à environ 153 milliards d’euros par l’agence Eurofound de Dublin. Cela a aussi des répercussions durables sur les trajectoires professionnelles des jeunes, ce que des observateurs ont pu qualifier d’ « effet de scarification (197) ».
b. Enjeux prioritaires et champ de l’évaluation
Selon une estimation récente de l’Igas (198), l’ordre de grandeur des dépenses susceptibles de relever du champ de la politique de l’emploi s’élève à plus de 160 milliards d’euros, avec un nombre très important de dispositifs (au minimum de 160, auxquels s’ajoutent tous ceux n’ayant pas pu être unitairement identifiés par la mission, cette impossibilité constituant en soi une source d’enseignements, comme le souligne ce rapport).
COMPARAISON DES DÉPENSES SUSCEPTIBLES DE RELEVER DU CHAMP DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI PAR CHAMP DE DÉPENSES
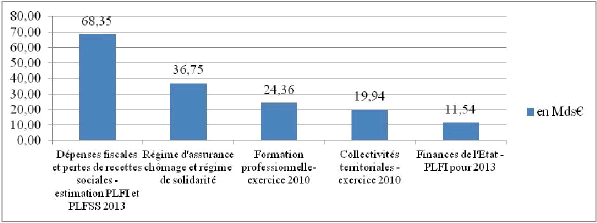
Compte tenu de ce champ extrêmement large, les rapporteurs ont souhaité circonscrire le champ de l’évaluation aux principaux dispositifs publics en direction des jeunes « peu ou pas qualifiés », tels que définis ci-après, et relevant des finances de l’État et des collectivités territoriales. C’est par exemple la raison pour laquelle les mesures générales de baisse du coût du travail (allègement de charges), qui peuvent avoir un impact sur l’emploi des jeunes, mais ne sont pas spécifiquement ciblés sur ceux-ci, ne seront pas évoquées dans le présent rapport.
Il a également été tenu compte des travaux récents du CEC sur la création d’entreprises (199) : ne seront donc pas évoquées les actions mises en œuvre par les missions locales et d’autres acteurs pour inciter et accompagner les jeunes dans leur projet entrepreneurial.
NIVEAUX DE FORMATION ET NOTION DE JEUNES « PEU OU PAS QUALIFIÉS »
Niveau I et II |
Diplômés des premier et deuxième cycles de l’enseignement supérieur (licence universitaire ou davantage), d’une école de commerce ou d’ingénieur. | |||
Niveau III |
Diplômés d’une formation de niveau bac+2 : premier cycle de l’enseignement supérieur (DEUG, BTS…), de formations du secteur de la santé, paramédical, social. | |||
Niveau IV |
Sorties de terminale ou d’un niveau équivalent avec ou sans baccalauréat, de l’enseignement supérieur sans diplôme, de classes préparatoires sans avoir réussi à intégrer une école de commerce ou d’ingénieur. | |||
Niveau V |
Sorties à l’issue de la dernière année de CAP ou BEP (avec ou sans diplôme) ou d’une classe de seconde ou de première. |
Jeunes « peu ou pas diplômés » | ||
Niveau V sans diplôme. |
Jeunes « peu ou pas qualifiés » | |||
Niveau V bis |
Sorties du système éducatif avant la dernière année de CAP ou de BEP, après une classe de 3ème générale ou une classe de 4ème ou de 3ème d’enseignement non général. |
Jeunes sans qualification (200) | ||
• Niveau VI |
Sorties du système éducatif avant une classe de 3ème générale ou avant une classe de 4ème non générale. | |||
Par ailleurs, au regard des difficultés particulières d’accès des jeunes à l’emploi durable, du lien très fort entre qualification et insertion ainsi que des enjeux liés aux jeunes NEET, il est apparu plus particulièrement nécessaire :
– de concentrer l’analyse sur les peu qualifiés, sans occulter pour autant les difficultés que peuvent aussi rencontrer des jeunes diplômés issus de milieux modestes, du fait notamment de leur lieu de résidence, d’un plus faible tissu relationnel, voire de discrimination (201) ; en effet, comme l’a observé le rapporteur du CESE sur l’emploi des jeunes (202), « les inégalités sociales ont des effets importants non seulement en termes de ressources financières permettant la poursuite d’études dans des conditions satisfaisantes mais aussi de réseaux relationnels favorisant l’entrée sur le marché du travail ou l’accès à des stages » ;
– d’examiner le rôle, les moyens et l’efficacité du service public de l’emploi, s’agissant en particulier des missions locales, en prenant également en compte la nécessité de repérer et d’aller au-devant des jeunes actifs inoccupés ;
– de ne pas limiter le champ de l’analyse à la période d’entrée dans la vie active, autrement dit l’accès au premier emploi, pour envisager, plus largement, les différentes possibilités de rebondir et de valoriser au mieux les compétences acquises, tout au long d’un parcours, parce qu’un échec en formation initiale ne doit pas obérer l’ensemble de la vie professionnelle.
Cela nécessite au préalable de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique, par une coordination accrue des acteurs.
2. Renforcer la coordination des acteurs et le pilotage partenarial des politiques en direction des jeunes peu ou pas qualifiés
Le pilotage des politiques d’emploi et de formation, en direction notamment des jeunes peu ou pas qualifiés, souffre aujourd’hui d’une gouvernance complexe, et ce aussi bien au niveau territorial que national.
a. Développer les dynamiques partenariales au niveau territorial et renforcer l’échelon régional
Le système de décision en matière de formation et d’emploi relève d’une gouvernance partagée entre de nombreux acteurs, puisqu’il fait intervenir l’État, les régions, les départements et les communes (203) ainsi que les partenaires sociaux. De fait, « le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes est probablement le plus complexe », comme l’a souligné à très juste titre le COE (204).
UNE GOUVERNANCE COMPLEXE DES POLITIQUES D’EMPLOI ET D’INSERTION
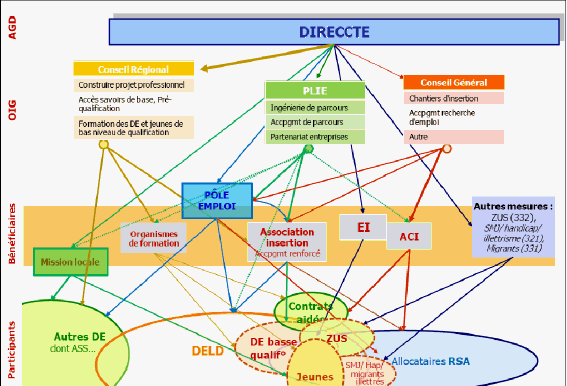
Cartographie de l’offre d’insertion soutenue par le Fonds social européen (FSE). DE : demandeurs d’emploi.
Source : rapport d’évaluation thématique FSE, L’offre d’insertion dans les territoires, Amnyos-Edater (octobre 2010)
S’agissant des principaux acteurs concernés par l’insertion des jeunes peu qualifiés, deux séries de mesures devraient être envisagées pour simplifier le pilotage et développer les dynamiques territoriales, sans que cela n’épuise pour autant, loin s’en faut, une réflexion plus générale appelée à se poursuivre, dans le cadre de l’ « acte III » de la décentralisation, quant à la nécessaire clarification de l’articulation des compétences dans les territoires.
● Assurer le déploiement et le suivi des « Pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle »
Les pouvoirs publics consacrent des moyens importants en faveur de l’accès à la qualification professionnelle de jeunes, avec un effort global supérieur à 24 milliards d’euros par an (205) et la mobilisation de réseaux dédiés pour les jeunes rencontrant en difficulté d’accès à la formation et à l’emploi (les 460 missions locales et la mission générale d’insertion – MGI – pour les décrocheurs). Les partenaires sociaux se sont également mobilisés sur cet enjeu, à travers notamment l’ANI du 7 avril 2011 sur les jeunes décrocheurs (cf. infra).
Cependant, la situation des jeunes sur le marché du travail et la multiplicité d’acteurs et de dispositifs nécessitent de renforcer la coordination et la complémentarité de l’action publique.
Dans ce sens, et suite à la grande conférence sociale de juillet 2012, qui a prévu l’élaboration d’un plan d’action en faveur de l’accès à la qualification des jeunes, les régions ont ainsi été invitées à élaborer des « pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes », susceptibles d’être articulés autour de deux grands volets :
– renforcer les différentes voies de formations par alternance sur les premiers niveaux de qualification (lycée professionnel, apprentissage, contrats de professionnalisation) ;
– permettre à l’ensemble des jeunes sans qualification, de la fin de la scolarité obligatoire à 25 ans révolus, de redémarrer un parcours d’accès à la qualification, en mobilisant de manière coordonnée l’ensemble des outils existants : CIVIS, formations financées par les régions, écoles de la deuxième chance (E2C), EPIDE, mission générale d’insertion (MGI), etc.
Plusieurs régions se sont ainsi appuyées sur ces orientations ministérielles pour relancer une dynamique partenariale dans ce domaine. Il semblerait cependant que cette démarche soit moins bien engagée dans certains territoires, du fait notamment de la mobilisation des acteurs concernés sur d’autres sujets, par exemple les emplois d’avenir, ou encore dans l’attente de la prochaine étape de décentralisation.
« Une solution pour chaque jeune sans qualification » : l’un des objectifs des pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes
« Orientation choisie, lutte contre le décrochage, accès différée à la formation qualifiante pour les jeunes actifs, promotion de l’alternance notamment au niveau V : ces différents enjeux sont déterminants et doivent être abordés de manière complémentaire afin de mettre en œuvre une action plus efficace en faveur de l’insertion professionnelle durable des jeunes.
C’est pourquoi il est proposé que soit élaboré dans chaque région un « Pacte régional pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes », qui établirait des objectifs conjoints et chiffrés de réduction du nombre de jeunes sortants de formation initiale, ainsi que de ceux présents sur le marché du travail, sans qualification. Élaborés à l’initiative des régions dans le cadre de concertation que constituent les CCREFP (206) et destinés à constituer une déclinaison opérationnelle des CPRDFP (207), ces pactes seront signés par le préfet, le recteur, le président de région et proposés à l’approbation des partenaires sociaux. Ils capitaliseront les démarches contractuelles et les plans d’action déjà engagés qui ont permis, sur certains territoires, de progresser sur cet enjeu.
Dans le cadre de l’élaboration du pacte, il est proposé que les acteurs concernés partagent les données disponibles sur les jeunes décrocheurs et les jeunes sans qualification, au chômage, en situation d’emploi précaire, et puissent les mettre en regard avec le nombre de jeunes bénéficiant d’une mesure concourant à leur insertion professionnelle. Parallèlement, il importe que les acteurs recensement collectivement les mesures accessibles sur le territoire.
Outre les contrats d’alternance pour l’accès auxquels la marche à franchir est parfois trop haute, il existe une multitude de dispositifs permettant de construire des parcours d’accès à la qualification : place vacante au lycée professionnel, accompagnement global du jeune vers l’insertion à travers le CIVIS, actions de formation continue centrées sur les compétences-clefs, la découverte des métiers, la pré-qualification ou la qualification financées par les régions, POE (préparation opérationnelle à l’emploi) individuelle ou collective initiées par les partenaires sociaux ; établissements spécifiques concourant à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes très éloignés de l’emploi, tels que les écoles de la deuxième chance (E2C) ou les EPIDE. Les partenaires sociaux se sont également engagés sur cet enjeu depuis les ANI du printemps 2011, (…) en créant une prestation d’accompagnement renforcé dont les objectifs de déploiement sont aujourd’hui atteints. Il convient également de prendre en compte dans la « boîte à outils disponibles » les emplois d’avenir, destinés aux jeunes sans qualification, qui incluront un volet formation mobilisable durant et après l’emploi.
Ce recensement devra s’opérer sur une logique dynamique et opérationnelle : chaque dispositif sera ainsi positionné dans un continuum de solutions pour les jeunes en correspondance avec la nature et le degré de difficultés rencontrées par ceux-ci. Sur la base du diagnostic et de l’ordonnancement de la boîte à outils, un plan d’action, assorti d’objectifs quantitatifs annuels, sera défini, pour réduire le nombre de jeunes sans qualification sur le territoire. Il constituera le cœur opérationnel du « Pacte régional pour la réussite éducative et professionnelle. »
Source : document-cadre relatif à l’accès des jeunes à la qualification, ministère du travail (octobre 2012)
Il conviendrait dès lors de poursuivre l’élaboration de ces pactes régionaux et d’en assurer le suivi régulier, au regard de leur intérêt potentiel en termes de décloisonnement, de complémentarité et donc de renforcement de l’efficacité de l’action publique en direction des jeunes peu qualifiés. Plus largement, les rapporteurs soulignent l’intérêt des démarches partenariales, quelles qu’en soient les formes, comme par exemple les contrats territoriaux emploi formation (CTEF), mis en place dans la région Rhône-Alpes, où ils se sont rendus en mars dernier (208).
● Réformer les modalités de conventionnement des missions locales
Aux termes de la loi (209), des « missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes » peuvent être constituées entre l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Ce réseau associatif a évolué dans son rôle d’accompagnement global des jeunes les plus en difficulté d’insertion pour devenir une composante essentielle du service public de l’emploi (SPE).
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DES MISSIONS LOCALES EN 2011
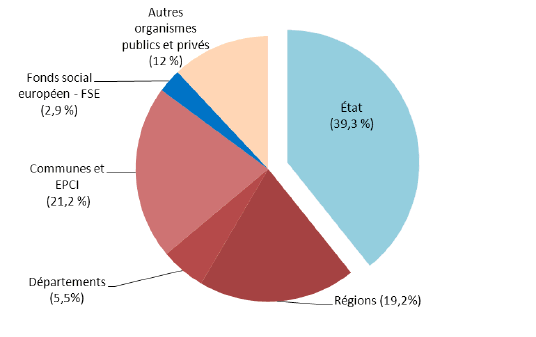
Source : graphique réalisé d’après les données du dernier rapport annuel du Conseil national des missions locales (2013)
Les différents financeurs peuvent contractualiser avec chaque mission locale, distinctement, en fonction des objectifs qui leur sont propres. La région Limousin a par exemple signé une convention triennale sur la période 2008-2010 avec les missions locales de la Creuse, selon le rapport de KPMG/Euréval.
Depuis 2008, l’État (DGEFP) dispose d’un instrument contractuel de pilotage des missions locales – les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) – qui permettent, sur la base d’un diagnostic territorial partagé, de mettre en rapport les objectifs et les moyens qui leurs sont confiés, avec les résultats des actions favorisant l’accès des jeunes à l’emploi. Le dispositif conventionnel demeure toutefois d’une grande complexité, comme l’illustre le schéma ci-après.
PRINCIPALES CONVENTIONS CONCLUES DANS LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES
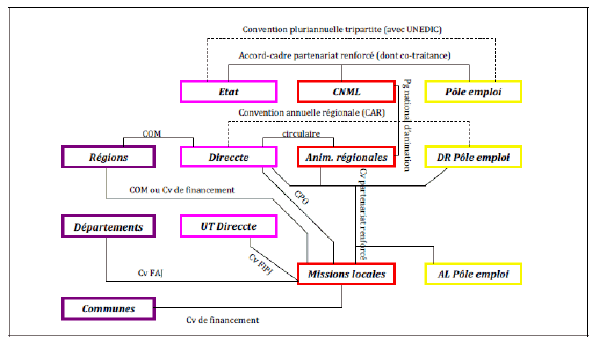
Source : inspection générale des finances (2010)
De fait, la limitation du dialogue de gestion à l’État (Dirrecte) et aux missions locales dans le cadre des CPO limite la possibilité d’un diagnostic partagé et d’un accord sur les objectifs avec les autres financeurs. Selon les régions, la mise en cohérence peut s’exercer dans le cadre de conférences de financeurs ou au travers des contrats d’objectifs et de moyens en matière d’insertion professionnelle des jeunes (« COM-IPJ »).
Toutefois, si le code du travail (210) prévoit des dispositions relatives à ces contrats d’objectifs et de moyens, associant notamment l’État et les collectivités territoriales et précisant les engagements réciproques sur une période pluriannuelle , il s’agit uniquement d’une possibilité. De surcroît, leur application semble inégale, même s’il n’a été possible d’obtenir plus de précisions sur ce point de la part du ministère chargé de l’emploi.
Ainsi, « les financements sont apportés par chaque financeur selon sa logique propre et ne font pas l’objet d’une coordination (en particulier entre l’État et la région, sous la forme d’un conventionnement multipartite, à de rares exceptions territoriales près », comme l’a souligné un rapport d’inspection récent (211) dont l’un des auteurs a été entendu par la mission, ce qui renvoie de fait le rôle d’ensemblier aux missions locales elles-mêmes. Source de lourdeur administrative pour les acteurs, le système actuel peut aussi entraîner des incohérences, et donc une perte d’efficacité pour l’action publique, par exemple lorsque les objectifs assignés aux missions locales par les financeurs sont distincts, sinon contradictoires.
« Une gouvernance lourde et complexe » des missions locales
«Les objectifs peuvent être contradictoires : l’État veut améliorer la lutte contre l’illettrisme, alors que ce point n’est pas une priorité pour la région. Les objectifs ne sont pas harmonisés. La mission locale de Méru établit chaque année établit deux rapports d’activité : l’un pour l’État et l’autre pour la région, ce qui est source de lourdeur. Cette lourdeur administrative est également dénoncée par Montreuil. (…)
Recommandation n° 18 : harmoniser les objectifs définis par l’État et les conseils régionaux.
Source : enquête réalisée par KPMG/Euréval, étude annexée au présent rapport (octobre 2013)
Il faudrait donc tendre vers une contractualisation commune, au moins entre l’État et le conseil régional. Dans le prolongement des conclusions de la mission d’inspection précitée, les rapporteurs proposent ainsi :
– de prévoir l’obligation d’une convention-cadre stratégique entre la région, l’État (Dirrecte) et l’union régionale des missions locales (URML), destinée à succéder aux « COM-IPJ », et d’inscrire ces dispositions dans la loi (212) ;
– de décliner ensuite ce conventionnement au niveau local, à l’occasion de la prochaine génération de CPO (à l’horizon 2014) avec des conventions État-région conclues avec les missions locales, et qui pourraient être complétées par des conférences de financeurs (avec la commune, le département ou Pôle Emploi par exemple) pour traiter des divergences stratégiques, en tant que de besoin.
UNE ORGANISATION SIMPLIFIÉE
Dispositif actuel |
Réforme proposée |
Avantages |
– Un dispositif complexe de conventions parallèles – Des objectifs multiples assignés aux missions locales. – Une lourdeur administrative pour les acteurs (missions locales) |
Au niveau régional, une convention-cadre stratégique entre l’État, la région et l’union régionale des missions locales (URML) |
– Meilleure articulation entre les deux principaux financeurs du réseau – Plus de visibilité stratégique, financière et opérationnelle du réseau (avec un cadre pluriannuel) – Renforcement du rôle de l’URML (structuration du réseau des missions locales au niveau régional). – Maintien des missions locales en tant que structures autonomes |
Au niveau local, une convention État-région avec la mission locale + conférence de financeurs en tant que de besoin. |
La coordination des acteurs doit aussi être renforcée au niveau national.
b. Adapter les missions et la composition des instances au niveau national
Il existe aujourd’hui de nombreuses instances d’expertise et de concertation en matière d’emploi, notamment le Conseil d’orientation des politiques de l’emploi (COE), le Conseil national de l’emploi (CNE), le Conseil national des missions locales (CNML) ou encore le Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV). S’agissant des questions d’insertion professionnelle et sociale des jeunes peu et pas qualifiés, qui relèvent en premier lieu du réseau des missions locales, les instances actuelles pourraient être adaptées sur les deux points suivants.
● Modifier dans un premier temps la composition du CNML pour permettre la représentation de jeunes, voire des partenaires sociaux
Le Conseil national des missions locales (CNML) est une instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales, placée auprès du Premier ministre. Le CNML, qui n’est pas un conseil de la jeunesse ou de l’emploi des jeunes, est chargé de formuler des recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) du droit à l’accompagnement vers l’emploi et du CIVIS. Il délibère sur les propositions d’orientation du programme national d’animation et d’évaluation du réseau des missions locales , en constituant « un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales », qui « peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (213) ».
Présidé par un élu local, président de mission locale, le CNML comporte en son sein trois collèges réunissant des représentants de collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des différents ministères compétents en matière d’insertion des jeunes, ainsi que des présidents de mission locales et des représentants. Peuvent également y participer, avec voix consultative, les directeurs de l’AFPA et de Pôle Emploi, ainsi que trois personnalités qualifiées.
Les jeunes suivis par des missions locales ne sont pas représentés au sein de cette instance, ni d’ailleurs, es qualité, le président de l’Union nationale des missions locales (UNML), non plus que les partenaires sociaux, alors que ceux-ci se sont mobilisés récemment pour l’insertion des jeunes, à travers notamment la mise en place d’une prestation d’accompagnement renforcé des jeunes décrocheurs, confiée aux missions locales. Cette question a d’ailleurs été soulevée par le Premier ministre, lors de l’installation du CNML le 26 avril 2013, en souhaitant qu’il « puisse intégrer des jeunes suivis par les missions locales » et en demandant « à Michel Sapin d’engager une consultation des partenaires sociaux, afin d’envisager leur entrée au CNML, au titre de leur rôle dans l’insertion professionnelle des jeunes ». Le Premier ministre a par ailleurs jugé « important de clarifier sa gouvernance et le rôle respectif de l’UNML et du CNML ».
En tout état de cause, comme les rapporteurs l’ont souligné précédemment, de manière générale, il est essentiel que les jeunes puissent participer à la conception et à l’évaluation des politiques qui les concernent. La composition du CNML doit donc être modifiée dans ce sens.
Pour les mêmes raisons, il conviendrait de renforcer la représentation des jeunes et des partenaires sociaux dans les missions locales. En effet, selon une enquête réalisée par l’inspection générale des finances (IGF) en 2010 (214) , seuls 4,6 % des conseils d’administration des missions locales interrogées comportaient des représentants des jeunes.
● Clarifier l’articulation et la gouvernance des instances nationales compétentes en matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Pour l’essentiel, la gouvernance nationale du réseau des missions locales relève de trois acteurs : le CNML, la DGEFP (responsable de la politique en direction des missions locales depuis la disparition de la Délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en 2002) et l’UNML, union représentative du réseau des missions locales, des PAIO et d’autres organismes d’insertion, et syndicat d’employeurs de la branche (11 000 salariés).
Comme le souligne l’étude réalisée par KPMG/Euréval, « les instances fédératrices au niveau national des missions locales sont nombreuses : coexistent ainsi le CNML au niveau de l’État, l’UNML au niveau syndical, l’Association nationale régionale des directeurs des missions locales (ANDML) et l’Association régionale des directeurs des missions locales (ARDML) ». Or « ces instances en charge de représenter et défendre l’intérêt des missions locales ne parlent pas toutes d’une même voix ».
RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES : ACTEURS, ANIMATION ET REPRÉSENTATION
État |
Le CNML est un conseil des missions locales placé près du Premier ministre et chargé d’une mission de recommandation sur tout sujet en lien avec l’insertion des jeunes. Son bureau joue un rôle d’interface avec les administrations, les collectivités territoriales (ARF, ADF, AMF), les présidents et directeurs des missions locales ou encore Pôle emploi. |
Associations |
L’Union nationale des missions locales (UNML) est une association exerçant une double fonction de représentation du réseau national et de syndicat d’employeur ; elle regroupe les présidents des missions locales. L ANDML représente une partie des directeurs de missions locales. L’APAR est une association professionnelle regroupant les animateurs régionaux des missions locales (ARML) et leurs assistants techniques régionaux « parcours 3 » (ATR) présents dans les structures d’animation régionale. |
Collectivités territoriales |
Collectivités membres du CNML et notamment cosignataires du protocole 2010 des missions locales : l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Association des régions de France (ARF). |
Partenaires sociaux |
« Internes » au réseau : une convention collective des missions locales et PAIO a été signée le 21 février 2001 (les syndicats des salariés participent à quatre commissions paritaires nationales). « Externes », notamment signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) « jeunes décrocheurs » du 7 avril 2011. |
Dans le même sens, l’IGF a dressé le constat d’« une articulation peu claire entre des instances multiples », en pointant également, dans son rapport précité de 2010, « une animation régionale hétérogène aux objectifs mal définis ».
MISSIONS LOCALES : PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES
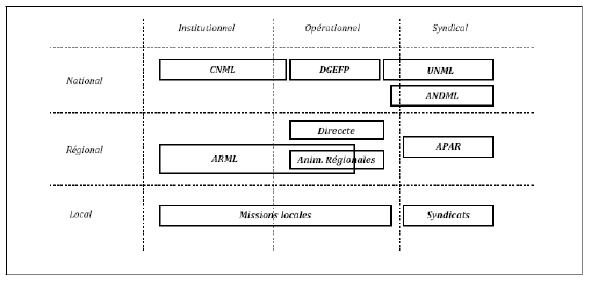
Source : inspection générale des finances (2010)
Le rapport récent de la mission d’information sur Pôle Emploi et le service public de l’emploi (215) souligne par ailleurs « la grande incohérence que présentent aujourd’hui les diverses instances représentatives des acteurs de l’emploi », en estimant que « cet éclatement ne permet pas aux acteurs de l’insertion professionnelle de parler d’une seule voix et d’apparaître comme un interlocuteur crédible face au Gouvernement ». Il y est en conséquence préconisé « de fusionner les instances représentatives des opérateurs locaux de l’emploi au sein d’une " Union nationale des services publics d’insertion pour l’emploi " regroupant les missions locales, les écoles de la deuxième chance (E2C) et les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), et où seraient présents l’État, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. »
Sans aller jusque-là, compte tenu notamment des différences de moyens et de positionnement entre les missions locales et les E2C, les rapporteurs n’en partagent pas moins la volonté de clarifier le rôle des instances et d’améliorer le dialogue institutionnel au niveau national, et ce, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les différents organismes compétents en matière d’emploi. À cet égard, l’UNML, présidée par M. Jean-Patrick Gille, Député et membre de la mission, a proposé récemment (216) la création d’un « Conseil national de l’insertion des jeunes », qui aurait vocation à engager la réflexion, la coordination et l’évaluation des politiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Instituer un Conseil national d’insertion des jeunes : la proposition de l’UNML
L’Assemblée générale de l’UNML, réunie le 4 juillet 2013, a donné mandat au conseil d’administration pour « proposer la création d’un Conseil national de l’insertion des jeunes (CNIJ) pour favoriser le développement d’une approche interministérielle et transversale des politiques de jeunesse ».
« À l’instar de la composition des conseils d’administration des missions, un outil interinstitutionnel et interministériel des politiques d’insertion des jeunes doit être institué. (…) Le CNIJ, au sein duquel les missions locales seraient largement représentées pourrait assister de ses avis le Gouvernement sur toutes les questions de portée générale qui concernent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en concertation avec le Délégué interministériel à la jeunesse et les différents départements ministériels concernés. Il serait un lieu d’échanges, de réflexion et de concertation des missions locales avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les partenaires socioéconomiques qui agissent pour l’insertion des jeunes. Il pourrait, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui lui paraissent pouvoir améliorer les conditions de l’insertion des jeunes et de leur accès au droit commun. Les jeunes devront être partie prenante de la réflexion et de la concertation du CNIJ (…). Il devra être un Conseil national au service de l’action des missions locales et des structures d’accompagnement des jeunes (…) rompant avec la segmentation des interventions et l’empilement des dispositifs. »
Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, que les rapporteurs préconisent d’instituer, s’inscrit dans cette volonté de développer une approche transversale de l’action publique, en concertation avec l’ensemble des acteurs, et notamment les jeunes. Il serait d’ailleurs envisageable de prévoir la constitution de plusieurs commissions en son sein, dont l’une sur l’emploi des jeunes, où les missions locales seraient largement représentées.
À court terme, il convient en tout état de cause de clarifier les rôles respectifs du CNML et de l’UNML et d’ouvrir une large réflexion sur les missions et le positionnement des différents organismes d’expertise et de concertation en matière d’emploi et instances de représentation et d’animation du réseau des missions locales.
● Renforcer la coordination des principaux acteurs en matière d’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés, en confortant l’échelon régional :
– au niveau national : prévoir la représentation des jeunes et des partenaires sociaux au sein du CNML et clarifier le rôle des instances de représentation et de concertation en matière d’emploi des jeunes ;
– au niveau régional : prévoir une convention stratégique entre l’État, la région et l’union régionale des missions locales et assurer le déploiement et le suivi dans les régions des pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes ;
– au niveau local : prévoir une convention pluriannuelle État-région avec les missions locales à l’horizon 2014 et encourager la représentation des jeunes au sein des missions.
3. Développer la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux
a. Une mobilisation importante des partenaires sociaux dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels (ANI) conclus en 2011
En 2011, les partenaires sociaux ont signé quatre accords nationaux interprofessionnels (ANI) pour soutenir l’accès des jeunes à l’emploi, en mobilisant les fonds paritaires (Unedic, Apec et Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels - FPSPP) à hauteur de 135 millions d’euros (217).
Les quatre ANI sur l’emploi des jeunes de 2011
Face au constat alarmant et partagé de la situation de l’emploi des jeunes, la négociation interprofessionnelle sur l’emploi des jeunes a été jugée prioritaire dans l’agenda social du premier semestre 2011. L’objectif des partenaires sociaux était d’aboutir à des mesures rapidement applicables en faveur des jeunes, en matière d’accès à l’emploi, mais aussi de maintien dans l’emploi et d’accompagnement matériel (logement, transport et restauration).
Accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi. L’ANI du 7 avril 2011 visait à « aider les jeunes à accéder au marché du travail, à la suite des difficultés conjoncturelles récentes », avec « des mesures concrètes et temporaires », dont « certaines sont financées, à titre exceptionnel, par le FPSPP ». Il concerne trois publics cibles : 20 000 jeunes sortis du système éducatif sans aucune qualification professionnelle ou diplôme (article premier sur les décrocheurs), 20 000 jeunes de niveau bac ou infra bac ayant une qualification reconnue mais rencontrant des difficultés récurrentes pour accéder à un emploi durable, et 25 000 jeunes ayant intégré un cursus dans l’enseignement supérieur et rencontrant des difficultés à s’insérer professionnellement (soit 65 000 jeunes au total). Un cahier des charges précise les modalités de mise en œuvre pour les trois opérateurs responsables des dispositifs d’accompagnement : les missions locales, l’Apec et Pôle emploi (218).
Accompagnement des jeunes dans leur accès au logement. Pour pallier les difficultés de logement qui peuvent entraver fortement l’accès à l’emploi et la mobilité professionnelle, l’ANI du 29 avril 2011 prévoit une série de mesures afin d’aider les jeunes dans leur accès au logement. Il prévoit notamment la construction de 15 000 logements par an, dès 2012 et pendant 3 ans, à destination des jeunes, en mobilisant une partie des fonds d’action logement.
Alternance et stages en entreprise. L’ANI du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprises prévoit notamment un objectif chiffré de progression des contrats en alternance par branche professionnelle ainsi qu’un meilleur encadrement des stages en entreprise. Certaines dispositions de l’accord ont été reprises dans la loi pour le développement de l’alternance adoptée le 13 juillet 2011.
Maintien dans l’emploi. L’ANI du 11 juillet 2011 porte sur l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur maintien dans l’emploi. Il comporte deux volets : l’accueil en entreprise (parcours d’entrée, livret et référent d’accueil, échange de compétences, fonction tutorale) et un dispositif exceptionnel de soutien financier pour faire face aux frais de mobilité, de restauration et de matériel ou de tenue vestimentaire liés à l’emploi.
En particulier, des moyens significatifs ont été consacrés à la prestation d’accompagnement renforcé des décrocheurs, assurée par les missions locales (30 millions d’euros au titre du FPSPP, soit environ 1 500 euros par jeune), avec des résultats encourageants à ce stade (cf. infra). Les rapporteurs se félicitent naturellement de cet engagement important des partenaires sociaux, qui mérite d’être poursuivi, en soulignant plus largement l’importance du dialogue social pour renforcer l’efficacité des politiques d’emploi, comme ils ont pu le constater en Allemagne et au Danemark par exemple.
b. Un dialogue social à développer dans les branches et les entreprises
Dans un rapport sur l’emploi des jeunes publié en septembre 2012 (219), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a souligné qu’en dépit d’une mobilisation récente des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, « l’emploi des jeunes ne constitue pas encore un thème privilégié et régulier du dialogue social » et qu’en tout état de cause, il ne s’inscrivait pas dans une problématique plus globale de la gestion des âges dans l’entreprise. Il préconisait par conséquent de développer le dialogue social, à tous les niveaux, par l’instauration d’une obligation légale de négocier.
« Faire de l’emploi des jeunes un thème régulier du dialogue social » : la recommandation du rapport du CESE sur l’emploi des jeunes de septembre 2012
« Les partenaires sociaux ont signé quatre ANI sur l’emploi des jeunes en 2011. (…). Pour autant, l’urgence de la situation et l’importance de l’enjeu, nécessitent d’inscrire ce dialogue social dans la durée, et de le diffuser au niveau des branches et des entreprises. (…) Le CESE estime nécessaire de faire de l’emploi des jeunes un thème régulier du dialogue social, à tous les niveaux, par l’intermédiaire de l’instauration d’une obligation légale de négocier :
– soit en intégrant cette question aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire (…) ;
– soit en instituant dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans les branches, une obligation de conclure un accord collectif relatif à l’emploi des jeunes avant une date butoir, sous peine de sanction financière, à l’image de ce que la LFSS pour 2009 avait imposé aux entreprises sur l’emploi des seniors en 2010. Les accords sur l’emploi des jeunes pourraient à titre d’exemple porter sur l’entrée des jeunes dans l’entreprise : objectifs de recrutements en CDI, part des CDI dans les recrutements de jeunes, objectifs d’accueil d’alternants et place des alternants ayant réussi leur diplôme dans les recrutements, modalités d’accueil des stagiaires, modalités d’intégration des jeunes dans l’entreprise, politique de formation des jeunes recrutés dans l’entreprise. Afin de lutter contre les discriminations, ces accords devraient également aborder la question de la diversité tant sociale que géographique dans les pratiques de recrutement. Cela suppose d’élaborer des outils de mesure de la diversité, fondés sur un critère territorial, qui pourraient être intégrés dans le bilan social. »
En 2011, cette question de l’emploi des jeunes n’était d’ailleurs même pas identifiée dans le bilan annuel de la négociation collective établi par le ministère du travail. De même, si la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est souvent évoquée à propos des sujets environnementaux, elle l’est beaucoup plus rarement en matière d’emploi. Par exemple, une enquête récente de l’Insee, réalisée auprès d’entreprises de plus de 50 salariés (220), souligne qu’« en l’absence de négociation annuelle obligée, les discriminations envers les jeunes ou liées à l’origine ethnique, sociale et culturelle font moins souvent encore l’objet de politiques spécifiques : ce type d’action ne concerne en effet qu'un tiers des sociétés, et passe clairement en dessous de 50 % pour les tenants de la RSE. Par ailleurs, la mise en place d'une formation aux discriminations ou l'adoption de la charte de la diversité (221) ne concerne pas même un sixième des sociétés de 50 salariés ou plus. »
En tout état de cause, au-delà du niveau interprofessionnel, il est important que le dialogue social sur les questions d’insertion des jeunes se développe également au niveau des branches et des entreprises.
Dans ce sens, la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, faisant suite à l’ANI du 19 octobre 2012, signé par l’ensemble des organisations syndicales et patronales, comporte également plusieurs dispositions relatives à la négociation collective. Selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi, « l’emploi des jeunes et des seniors, la gestion des compétences et la transmission des savoirs doivent en effet devenir des enjeux centraux de la négociation collective ». Issu du dialogue social national et interprofessionnel dans sa conception, le contrat de génération reposera ainsi également sur le dialogue social pour sa mise en œuvre dans les entreprises ou les branches.
Le dispositif prend en compte le fait que les petites entreprises ne disposent pas toujours d’un délégué syndical ; la négociation sera donc encouragée chaque fois qu’elle est possible, mais ne sera nécessaire que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les entreprises de moins de 300 salariés, qui emploient près des deux tiers des salariés et dont les capacités en termes de gestion prospective des ressources humaines sont parfois limitées, bénéficieront d’une incitation pour mettre en œuvre le contrat de génération (aide de 4 000 euros par an, soit 12 000 euros sur trois ans). Les plus grandes entreprises sont également incitées à conclure des accords collectifs, concernant notamment l’insertion des jeunes, à défaut de quoi elles s’exposent à des pénalités financières.
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI DU 1ER MARS 2013 SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES (ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D’ACTION)
Moins de 50 salariés |
Entreprises de 50 à 299 salariés |
Plus de 300 salariés |
41 % des salariés |
15 % des salariés en France |
44 % des salariés en France |
98 % des entreprises |
1,5 % des entreprises |
0,5 % des entreprises |
Entreprise éligible à l’aide sans accord de branche |
Eligible à l’aide avec accord collectif ou de branche (diagnostic sur la situation des jeunes et des seniors, puis négociation d’un accord d’entreprise, sinon établissement d’un plan d’action ; en l’absence d’accord ou de plan, possibilité d’être couverte par un accord de branche). |
Accord collectif fixant des objectifs jeunes et seniors, à défaut pénalités financières* (établissement d’un diagnostic sur la situation des jeunes et des seniors dans l’entreprise) Pas d’aide financière. |
* Négociation d’un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou, à défaut de négociation conclusive, mise en place d’un plan d’action sur le contrat de génération (échéance du 30 septembre 2013). En cas d’absence d’accord ou de plan d’action, la pénalité peut aller jusqu’à 1 % de la masse salariale ou 10 % des allègements.
Dans ce cadre, la loi prévoit que l’accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche, applicable pour une durée maximale de trois ans, devra notamment comporter « des engagements en faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans l'emploi, de l’emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences », associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés. L’accord doit comporter des objectifs chiffrés en matière d’embauche de jeunes en CDI et « préciser les modalités d’intégration, d’accompagnement et d’accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés (…) au plan de formation » ainsi que le calendrier de mise en œuvre des engagements et les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation. Dans le cadre de son objet tel que défini par la loi, il assure la réalisation des objectifs « d’égalité d’accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière ».
Toutefois, comme l’a souligné la feuille de route établie à l’issue de la seconde conférence sociale de juin 2013, le déploiement du contrat de génération repose sur une phase de négociation qu’il est nécessaire d’intensifier dans les branches, les grandes entreprises et les entreprises de 50 à 300 salariés.
Il convient également de procéder à un suivi régulier du contenu de ces accords, y compris sur le plan qualitatif. L’article 7 de la loi du 1er mars 2013 précitée prévoit d’ailleurs qu’à compter du 30 juin 2014, un rapport du Gouvernement est déposé chaque année au Parlement sur la mise en œuvre du contrat de génération. Il devra préciser le nombre d’accords d'entreprise, de groupe et de branche conclus, de plans d’action élaborés et d’entreprises n’étant couvertes ni par un accord ni par un plan d'action. Ce rapport devra également évaluer le nombre de créations d’emploi qui en résultent et analyser les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises et l’administration.
Au regard de l’importance des enjeux, et afin notamment d’identifier les adaptations le cas échéant nécessaires, un premier bilan d’étape pourrait toutefois être réalisé avant cette échéance, par exemple en janvier prochain. Par ailleurs, il est important que ces accords et plans d’action ne fassent pas seulement l’objet d’un suivi quantitatif et qu’une analyse approfondie de leur contenu et de leur impact soit également réalisée dès que possible.
● Faire de l’emploi des jeunes un thème régulier du dialogue social, au niveau interprofessionnel, mais aussi des branches et des entreprises :
– en intensifiant les négociations dans les branches et les entreprises de plus de 50 salariés concernant les accords collectifs (ou à défaut plans d’action) prévus par la loi du 1er mars 2013 et portant notamment sur l’insertion des jeunes dans l’emploi ;
– en assurant un suivi régulier des accords collectifs et plans d’action, sur le plan quantitatif mais aussi qualitatif (analyse de leur contenu et de leur impact) et en complétant le bilan annuel de la négociation collective établi par le ministère du travail sur les aspects relatifs à l’insertion professionnelle des jeunes pour inciter au développement du dialogue social sur ces questions.
B. AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI DES JEUNES LES MOINS DIPLÔMÉS ET SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS
Au-delà de l’amélioration de la gouvernance des politiques, indispensable pour mettre davantage en synergie l’ensemble des acteurs, l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en difficulté d’insertion doit être renforcé.
En effet, cet accompagnement souffre aujourd’hui « d’un manque cruel de moyens et d’un déficit de pilotage », comme l’ont souligné les auteurs de la note du CAE précitée. En outre, l’empilement des dispositifs est source de complexité et nuit à la lisibilité de l’action publique.
Les rapporteurs formulent en conséquence trois séries de propositions concernant le pilotage et les moyens des missions locales, les dispositifs publics d’accompagnement vers l’emploi des moins qualifiés, mais aussi les bonnes pratiques des entreprises qu’il conviendrait de mieux faire connaître.
1. Les missions locales : un acteur pivot de l’accompagnement des jeunes dont les moyens doivent être renforcés
Créées en 1982, les missions locales constituent aujourd’hui un pivot de l’accompagnement des jeunes, placé au cœur des politiques publiques d’insertion. S’il apparaît nécessaire de renforcer leurs moyens et de clarifier le cadre de la « cotraitance » avec Pôle Emploi, cela suppose aussi, au préalable, d’améliorer leur pilotage.
a. Renforcer de manière ciblée les moyens du service public de l’emploi sur les jeunes peu qualifiés et clarifier les relations avec Pôle Emploi
Avec environ 460 structures réparties sur l’ensemble du territoire, le réseau des missions locales et PAIO a pour missions « d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d'accompagnement (222) ». Elles sont reconnues comme un acteur du service public de l’emploi (SPE) depuis 2005.
Contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’« une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes », elles favorisent la concertation entre les différents partenaires (223) en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, « notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale ».
Leur rôle d’ensemblier de politiques publiques se traduit par leur caractère doublement intégrateur de moyens et de services :
– cofinancées par l’État et les collectivités locales, elles font la synthèse des forces économiques, associatives et sociales locales pour mettre en œuvre les politiques d’insertion en direction des jeunes dont elles sont l’instrument ;
– elles s’attachent aussi à intégrer l’ensemble des services locaux pour proposer un accompagnement global (emploi, formation, mais aussi logement, santé, mobilité, voire culture), en entretenant des relations partenariales avec tous les acteurs locaux d’insertion des jeunes (Pôle Emploi par exemple).

Les missions locales sont chargées de la gestion exclusive du CIVIS, qui est un contrat d’accompagnement vers l’emploi durable visant à suivre de manière renforcée les moins qualifiés. Celui-ci peut être comparé, sur certains points, à d’autres types de dispositifs.
CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS) ET DISPOSITIFS VOISINS
Dispositif « État » exclusivement géré par les missions locales |
• Le CIVIS, créé en janvier 2005 dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, piloté par la DGEFP et dont la finalité est l’insertion professionnelle des jeunes. • Par ailleurs, le revenu contractualisé d’autonomie (RCA) est expérimenté dans le cadre du FEJ et la Garantie Jeunes, s’appuyant sur le CIVIS, est actuellement en cours de déploiement dans 10 territoires pilotes (commission multi-acteurs). |
Dispositif « État » hors missions locales ou hors gestion exclusive |
• Le contrat d’autonomie, déployé par les opérateurs privés de placement pour accompagner les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville (zones CUCS) avec l’objectif affiché de réduire les écarts de taux de chômage entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires urbains (dispositif expérimental non reconduit). • L’ÉPIDE, le dispositif deuxième chance Défense (20 établissements sur le territoire qui offrent 2 300 places pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus sans diplôme, sans qualification ou en voie de marginalisation, et reçoit également des mineurs délinquants depuis 2012), en internat, avec une formation comportementale, générale et professionnelle (stages en entreprise). |
Dispositifs « Collectivités territoriales » notamment pris en charge par les missions locales* |
• Les collectivités territoriales, qui concourent elles aussi au SPE, ont pu confier aux missions locales le soin de prescrire leurs dispositifs contractuels propres et d’assurer l’accompagnement correspondant (par exemple, le contrat d’accès à la qualification créé notamment en Bretagne, Haute-Normandie et PACA, ou les « emplois-tremplin » pour des personnes de bas niveau de qualification). • Les Écoles de la deuxième chance (E2C) organisant des parcours individualisés en alternance et en groupes restreint, ayant pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, ont été créées à l’initiative des conseils régionaux avec l’appui de l’État à compter de 2009. La participation de l’État au fonctionnement s’inscrit dans une logique de co-financement avec les collectivités, le FSE et l’ACSé. |
Source : d’après un document transmis par la DGEFP
● Des moyens aujourd’hui insuffisants pour assurer un accompagnement intensif des jeunes les plus en difficulté d’insertion
En 2011, les 11 816 professionnels des 454 missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) ont accueilli près de 1,4 million de jeunes (jeunes « en contact (224) » ), dont une partie significative de jeunes peu ou pas qualifiés (225) S’agissant des jeunes reçus en entretiens (226), leur nombre s’élève à 1 146 000 la même année. Le réseau a bénéficié de 523,9 millions d’euros de financements (dont 39 % apportés par l’État et 46 % par les collectivités territoriales), ce qui représente un coût pour la collectivité de 457 euros par jeune accompagné (227).
S’agissant de la contribution de l’État, le projet de loi de finances pour 2014 prévoyait initialement une dotation de 178,8 millions d’euros aux missions locales (228). La commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a cependant adopté, le mercredi 31 octobre 2013, un amendement de M. Christophe Castaner, rapporteur spécial, visant à renforcer les moyens confiés aux missions locales. Selon l’auteur de l’amendement (229), « celles-ci connaissent une évolution budgétaire positive de 25 millions d’euros en 2014, mais cet effort pourrait être renforcé, notamment pour l’accompagnement des emplois d’avenir, et à condition de leur donner des objectifs précis ». Il était dès lors proposé « de majorer de 10 millions d’euros les moyens à disposition des missions locales », cette mesure pouvant être financée par « le dispositif des contrats de génération dont l’enveloppe est manifestement surdimensionnée en 2014 ».
Ce montant peut apparaître assez modeste par rapport à d’autres prestations d’accompagnement et, au-delà, à la nécessité d’apporter un accompagnement intensif aux jeunes les plus en difficultés d’insertion. Par ailleurs, comme le souligne l’étude réalisée par KPMG/Euréval, « la mise en œuvre de nouveaux dispositifs est confiée aux missions locales, les emplois d’avenir par exemple, sans que les CPO soient revues en conséquence. Les missions locales sont dans l’obligation en conséquence d’arbitrer leurs priorités budgétaires ».
De fait, malgré les efforts et le dynamisme des conseillers des missions locales, l’accompagnement pourrait être plus intense, si l’on juge tout d’abord par le nombre d’entretiens individuels des jeunes suivis : de l’ordre de 40 % des jeunes peu ou pas qualifiés n’ont ainsi eu qu’un ou deux entretiens dans l’année.
MISSIONS LOCALES : NOMBRE D’ENTRETIENS INDIVIDUELS DANS L’ANNÉE
SUIVANT LE PREMIER ACCUEIL EN 2011
Nombre d’entretiens individuels dans les 12 mois |
Niveau de formation à la sortie du système scolaire | |||||||
Au moins Bac + 2 (niveaux I, II ou III) |
Diplôme du Bac (IV diplômé) |
Niveau Bac (IV sans diplôme) |
Diplôme de CAP ou BEP (V diplômé) |
Niveau CAP ou BEP, 1ère, 2nde (V sans diplôme) |
Sortie avant dernière année CAP-BEP (V bis) |
Sortie avant 3e générale ou 4e non générale (VI) |
Ensemble | |
1 |
35 % |
27 % |
24 % |
24 % |
22 % |
22 % |
22 % |
24 % |
2 |
22 % |
20 % |
19 % |
18 % |
18 % |
16 % |
17 % |
18 % |
3 |
13 % |
13 % |
13 % |
13 % |
13 % |
13 % |
12 % |
13 % |
4 |
9 % |
10 % |
9 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
5 |
6 % |
7 % |
8 % |
8 % |
8 % |
8 % |
8 % |
8 % |
6 à 9 |
11 % |
15 % |
17 % |
17 % |
18 % |
19 % |
18 % |
17 % |
10 et plus |
4 % |
8 % |
10 % |
10 % |
11 % |
12 % |
13 % |
10 % |
Lecture : 22 % des jeunes de niveau I, II ou III reçus en premier accueil ont bénéficié de deux entretiens individuels dans l’année qui a suivi leur premier accueil (en grisé : les jeunes peu ou pas qualifiés.) Champ : jeunes accueillis pour la première fois par le réseau des ML/PAIO entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011.
Source : Chiffres d’activité des missions locales 2011 – Conseil national des missions locales, rapport annuel 2011 (2013)
Le taux d’encadrement de l’ordre de 100 jeunes par conseiller (230) semble trop important pour permettre un suivi personnalisé et intensif, en particulier pour les jeunes les plus en difficulté d’insertion. L’étude réalisée par KPMG/Euréval indique que « Méru et surtout la MIEJ 4-93 [Montreuil] sont largement au-dessus de ce ratio » avec pour celle-ci 156 jeunes en demande d’insertion (231) (JDI) par conseiller.
Plusieurs rapports récents ont relevé des insuffisances en matière d’accompagnement des jeunes les plus en difficulté d’insertion.
Des moyens inadaptés pour l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté : l’analyse convergente de trois rapports récents
Selon le CESE, « le service public de l’emploi (SPE) auquel appartiennent les missions locales manque de moyens pour suivre et accompagner les jeunes les plus en difficulté. Le réseau des missions locales pâtit de moyens insuffisants et hétérogènes. » Il souligne aussi que l’aggravation de la crise de l’emploi ces dernières années rend nécessaire un « renforcement des moyens des missions locales, notamment des moyens humains », dans le cadre de conventions d’objectifs avec l’État et les collectivités territoriales, comme l’État l’a fait pour Pôle emploi les mois précédents (rapport sur l’emploi des jeunes, 2012).
La note du CAE précitée sur l’emploi des jeunes peu qualifiés (avril 2013) évoque « un système défaillant », en matière d’accompagnement vers l’emploi et la nécessité de « renforcer l’accompagnement des jeunes en difficulté ». S’agissant des missions locales et PAIO, il souligne notamment que « l’accompagnement est loin d’être intense : en 2008, seuls 11 % des non-qualifiés ont eu au moins un entretien par mois et 50 % d’entre eux n’ont eu que trois entretiens sur 12 mois. C’est très insuffisant pour établir une relation de confiance ». Les auteurs pointent plusieurs autres insuffisances et notamment « l’absence d’un système fiable permettant d’atteindre tous les jeunes en déshérence » et qu’avec environ 12 000 conseillers pour 1,2 million de jeunes, il est difficile aux missions locales et aux PAIO d’assurer un suivi véritablement personnalisé. En définitive, « les structures et les moyens dédiés à l’accompagnement des jeunes en difficulté sont encore trop parcimonieux pour remettre sur les rails les plus défavorisés », les auteurs soulignant qu’il est « urgent de donner au service public de l’emploi les moyens de prendre en charge de manière ciblée et intensive les jeunes laissés pour compte ». Pour qu’une relation personnelle englobant tous les aspects de l’insertion puisse s’établir, « le taux d’encadrement ne doit guère être inférieur à un conseiller pour trente jeunes en difficulté, comme c’est le cas dans les meilleures expériences d’accompagnement renforcé en France ou à l’étranger, et non un conseiller pour 100 jeunes comme on le constate aujourd’hui en France ». Préconisant un renforcement ciblé de l’accompagnement des jeunes sur les moins diplômés qui pourrait être financé par des économies (232), les auteurs de cette indiquent que « la dotation de l’État pour les missions locales est d’environ 180 millions d’euros en 2012, soit 40 % du total (un triplement de cette dépense afin d’améliorer l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté coûterait 360 millions supplémentaires) ».
L’OCDE a souligné qu’en France « une enveloppe budgétaire de 419 millions d’euros a été consacrée par l’État en 2012 à la mise en œuvre de l’accompagnement (allocation CIVIS, FIPJ, E2C, EPIDE et contrat d’autonomie) », mais que « signe d’une mauvaise allocation des ressources, cela représente en pourcentage du PIB (0,02 %) environ le sixième des dépenses publiques annuelles moyennes engagées depuis environ quarante ans dans les contrats aidés hors alternance », dont l’efficacité est jugée « très faible (233) ». L’OCDE préconise notamment d’améliorer la coordination entre les nombreux acteurs de l’insertion professionnelles, de rationaliser l’accompagnement des jeunes vers l’emploi en limitant le nombre des dispositifs et de faire remonter au niveau régional le pilotage des missions locales.
A contrario, il est intéressant de relever qu’avec des moyens significatifs (de l’ordre de 1 500 € par jeune, avec des entretiens réguliers), la prestation d’accompagnement renforcé des jeunes décrocheurs prévue par les partenaires sociaux, a permis d’obtenir des résultats très encourageants.
La prestation d’accompagnement renforcé des jeunes décrocheurs, assurée par les missions locales dans le cadre de l’ANI du 7 avril 2011
Les partenaires sociaux se sont mobilisés pour aider les jeunes à accéder au marché du travail, et notamment ceux qui sont en situation de décrochage scolaire, par des mesures concrètes et temporaires qu’ils ont inscrites dans l’ANI du 7 avril 2011.
● Une prestation d’accompagnement vers l’emploi en faveur des jeunes « décrocheurs » assurés par les missions locales. L’ANI prévoyait la mise en œuvre, pour 20 000 jeunes décrocheurs, d’un accompagnement individuel renforcé vers l’emploi sur la base d’un cahier des charges élaboré paritairement, le FPSPP devant passer une convention avec l’État dans la limite de 30 millions d’euros, pour allouer aux missions locales le financement de ces opérations spécifiques d’accompagnement. Le rôle pivot des missions locales dans l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle a ainsi été affirmé. Elles sont en charge d’articuler leurs objectifs avec le partenariat à mettre en place pour la lutte contre le décrochage scolaire.
● Le contenu de la prestation attendue prévoit : un repérage via les plateformes d’appui aux décrocheurs ou les listes de jeunes connus des missions locales mais non suivis ; la signature d’un contrat d’engagement pour entrer dans un parcours de 18 mois maximum ; un accompagnement en trois phases (un diagnostic, un accompagnement renforcé et individualisé ainsi qu’un suivi dans l’emploi) ; un référent unique et des entretiens avec le jeune une fois par semaine durant les trois premiers mois, puis deux fois par mois, et une fois par mois en phase 3 ; des partenariats à développer avec les entreprises.
● Les résultats : au 31 mai 2012, 17 852 jeunes étaient entrés en phase 2 (« contrat signé et accompagnement intensif validé »), soit 89 % de l’objectif des 20 000 jeunes, et 751 jeunes en phase 3 (« entrées en emploi ou formation qualifiante, retour en formation initiale »). Les jeunes en phase 2 sont à 42 % orientés vers une solution « emploi », à 20 % en formation qualifiante et à 5 % en retour en formation initiale. Selon un bilan actualisé au 31 janvier 2013, parmi les 20 800 jeunes entrés en accompagnement, 65 % des jeunes ont accédé à un emploi ou une formation (27 % des jeunes ont accédé à un CDD, 5 % à un CDI, 40 % à une formation et 10 % à un contrat en alternance, dont plus de 80 % en apprentissage(234)).
Dans le même sens, les rapporteurs ont pu observer des pratiques intéressantes en Allemagne en direction de certains publics (235).
En tout état de cause, les objectifs fixés en termes de sortie vers l’emploi des jeunes bénéficiaires du CIVIS n’ont pas été atteints, comme l’indique le tableau ci-après, avec également des disparités territoriales sensibles (cf. infra). Outre la conjoncture économique, ceci peut sans doute s’expliquer également, en partie, par les insuffisances de l’accompagnement évoquées plus haut.
TAUX DE SORTIE VERS L’EMPLOI DES JEUNES BÉNÉFICIAIRES DU CIVIS
Objectifs fixés en 2011 |
Réalisations 2012 | |
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie d’un CIVIS |
50 % |
40 % |
Dont sorties en emploi durable |
40 % |
24,4 % (données provisoires) |
Source : circulaire DGEFP du 19 janvier 2011 et PAP du programme « Accès et retour à l’emploi » annexé au PLF 2014
● Une amélioration nécessaire de l’accompagnement, sur le plan quantificatif (moyens des missions locales) et qualitatif…
Le service public de l’emploi (SPE) doit avoir les moyens de prendre en charge de manière plus intensive les jeunes les plus en difficulté d’insertion, ce qui implique d’accroître les dotations de l’État aux missions locales. Dans le contexte budgétaire actuel, les rapporteurs n’en appellent naturellement pas à une augmentation inconsidérée de la dépense publique, mais jugent nécessaire d’améliorer l’allocation des ressources, en ciblant davantage les moyens du SPE sur les jeunes les moins diplômés.
Ces moyens doivent permettre un suivi plus intensif et personnalisé des jeunes demandeurs d’emploi et de concourir à renforcer l’efficacité du CIVIS, notamment par des entretiens plus réguliers et un portefeuille par conseiller permettant mieux d’établir une relation recouvrant tous les aspects de l’insertion (formation, recherche d’emploi, logement, transport, confiance en soi).
Au-delà des moyens financiers, l’amélioration de l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion implique également d’adapter les pratiques, avec notamment la mobilisation plus forte de l’ensemble des outils disponibles, et notamment l’immersion en entreprise ou le parrainage (voir l’encadré ci-après), dont les rapporteurs ont pu constater tout l’intérêt lors de leur déplacement à la mission locale de Redon. Plus largement, le développement des relations des missions locales avec les entreprises doit être encouragé. Sur le territoire d’Annecy par exemple, la mission locale dispose d’un important réseau auprès d’entreprises (900 environ) et d’organismes de formation, selon l’étude annexée au présent rapport.
Les différents outils mobilisés par les missions locales pour l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en difficulté
Les missions locales peuvent tout d’abord recourir aux dispositifs usuels de la politique de l’emploi (contrats aidés, contrats en alternance, stages de formation, des conseils régionaux notamment, etc.), mais aussi mobiliser différents outils d’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion, tels que le CIVIS (cf. infra) ainsi que les mesures suivantes.
● L’immersion en entreprise est un stage en entreprise non rémunéré s’adressant aux jeunes de plus de 16 ans ou aux adultes chômeurs. Des périodes d’immersion en entreprise sont aussi possibles au cours de contrats aidés du secteur non marchand. L’objectif est de découvrir une entreprise, d’explorer un ou plusieurs métiers, de confirmer un projet professionnel, de repérer ses capacités ou les compétences nécessaires. Le stage, d’une durée de 1 à 3 semaines, s’inscrit dans un parcours de formation qui permettra d’obtenir un diplôme ou dans un parcours d’insertion visant à accéder à l’emploi.
● Le parrainage permet à des jeunes en insertion de profiter de l’expérience, du savoir-faire et de la disponibilité de bénévoles retraités ou actifs, pour la recherche d’un emploi, d’un contrat en alternance ou d’un stage. En lien avec le conseiller de la mission locale, le parrain apporte son soutien et des conseils pour aider le jeune à mieux connaître les filières et les métiers de l’entreprise et préparer une candidature ou un entretien d’embauche. Expérimentées dès 1993 par quelques missions locales, les actions de parrainage se sont étendues progressivement à tous les territoires avec le soutien du ministère de l’emploi et des conseils régionaux. Aujourd’hui, certains employeurs s’engagent aussi dans le dispositif pour permettre à leurs salariés de parrainer des jeunes pendant leur temps de travail (GDF-Suez, Carrefour, Mediapost,…).
● Les partenariats. Pour permettre l’accès à l’entreprise des jeunes peu ou pas qualifiés, en particulier ceux résidant en ZUS et bénéficiaires du CIVIS, les missions locales développent depuis 2006 des partenariats avec de grandes entreprises (groupe Carrefour, SNCF, Veolia Environnement…). L’objectif est de favoriser le recrutement des jeunes accompagnés par les missions locales en répondant aux besoins de l’entreprise et de mieux informer les jeunes et leurs conseillers sur les métiers et les filières qui recrutent.
● Les plateformes de vocation. En partenariat avec Pôle emploi, il s’agit de permettre aux entreprises de recruter dans les métiers en tension, par une méthode de mise en situation, plus favorable aux jeunes en échec scolaire. Pour l’entreprise, l’avantage est d’élargir la recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés nécessaires au poste de travail proposé.
Source : d’après une présentation de la DARES dans « L’activité des missions locales et PAIO en 2011 » (juin 2013)
Il est également important que l’accompagnement ne se limite pas à l’information ou la prescription de dispositifs, sinon de « parcours normés » : les conseillers doivent en effet aider les jeunes à définir eux-mêmes leur projet d’insertion. Au-delà des jeunes chômeurs ou inactifs, il pourrait également être intéressant de développer l’accompagnement des jeunes accédant à l’emploi dans des conditions de précarité (accompagnement dans l’emploi ou entre les missions d’intérim, etc.).
Par ailleurs, le réseau des missions doit être à l’interface des acteurs de l’emploi et de la formation, initiale et continue. Les liens avec les partenaires des missions locales, notamment l’Éducation nationale, pourraient ainsi être renforcés. À cet égard, selon l’étude réalisée par KPMG/Euréval, « les missions locales observent qu’elles ont peu de relations avec les établissements scolaires. Selon la mission locale d’Annecy : “On est en contact avec certains établissements, mais ça reste très ponctuel. On est pour eux un révélateur d’échec” ». Il en va de même pour les partenariats conclus avec les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés), les branches et les entreprises, en vue notamment de développer l’alternance.
Par exemple, dans l’un des quatre bassins de vie étudiés (étude annexée au présent rapport), « le directeur [de la mission locale] rencontre les représentants de l’Éducation nationale au sein des comités de liaison écoles-entreprises (CLEE). Ces rencontres permettent d’initier un travail d’orientation auprès des jeunes en leur apportant des informations sur les caractéristiques du bassin économique de la région. Des contacts réguliers sont assurés par des organismes de formation comme le GRETA ou l’AFPA ».
Enfin, alors que plus de 40 % des jeunes en difficulté d’insertion mettent plus d’un an avant de franchir le seuil d’une mission locale, il conviendrait d’intensifier les efforts pour repérer et aller au-devant des jeunes non suivis par les missions locales (jeunes inactifs ni emploi, ni en formation). À l’occasion de la prochaine génération de CPO qui doit être mise en œuvre d’ici 2014, ce point pourrait être plus clairement souligné.
● … qui doit s’accompagner d’une clarification du cadre de la « cotraitance » avec Pôle Emploi
La « cotraitance » désigne le contrat par lequel Pôle Emploi délègue à un organisme, pour le public spécifique dont il a légalement la charge, l’exécution de tout ou partie de ses missions pour la mise en œuvre jusqu’à leur terme des projets personnalisés d’accès à l’emploi (PPAE) des demandeurs d’emploi (236), et en contrepartie de laquelle il verse à cet organisme une participation financière. C’est le cas des personnes en situation de handicap (suivies dans le réseau des Cap Emploi) ainsi que des jeunes dont le suivi est délégué aux missions locales.
Pôle Emploi verse ainsi une subvention forfaitaire de 34,5 millions d’euros aux missions locales (la dotation n’est pas corrélée à l’atteinte d’objectifs de retour à l’emploi), à laquelle il convient d’ajouter la mise à disposition gracieuse de personnels (325 ETP), qui représenterait 14,62 millions d’euros, selon les informations recueillies auprès de Pôle Emploi. Au total, la contribution de Pôle Emploi aux missions locales représente donc de l’ordre de 49 millions d’euros.
En 2010, un accord-cadre de partenariat renforcé a été signé entre l’État, Pôle emploi et le CNML pour une durée de 5 ans. Il prévoit que les missions locales accueillent chaque année, un effectif total de 150 000 jeunes en cotraitance (237). Ces objectifs sont toutefois dépassés régulièrement : en 2010 par exemple, le nombre de jeunes « cotraités » était de près de 183 000, soit 122 % de l’objectif conventionnel.
RÉALISATION DES OBJECTIFS DE COTRAITANCE ET FINANCEMENT DE PÔLE EMPLOI EN 2011 : UNE DIFFICILE MAÎTRISE DES FLUX DE COTRAITANCE
Nombre de jeunes |
2010 |
2011 |
Jeunes suivis dans le cadre du PPAE |
219 198 |
201 074 |
Dont conventionnés |
182 919 |
166 196 |
Objectif conventionnel (nombre de jeunes) |
150 000 |
150 000 |
Taux de réalisation (dépassement) |
122 % |
111 % |
Source : rapports annuels du Conseil national des missions locale
Ces dépassements conduisent à interroger les critères d’orientation des jeunes, sinon la nature même de la cotraitance : s’agit-il d’abord d’apporter un accompagnement global et renforcé aux jeunes en difficulté d’insertion (cotraitance de spécialité) ou bien, plus prosaïquement, de « décharger » en tant que de besoin l’opérateur Pôle Emploi (cotraitance de volume) ?
Par ailleurs, comme l’avait justement observé le rapport précité de l’Igas sur l’emploi des jeunes des quartiers (2010), la cotraitance ne donne lieu à aucun cahier des charges précis – la mission locale appliquant de fait son offre de droit commun – et demeure sous-dotée par Pôle Emploi, avec un coût estimé alors à 230 euros par jeune par la mission d’inspection.
L’actualisation et la consolidation de ces estimations, aboutissent à un financement de Pôle emploi de l’ordre de 290 euros par jeune suivi dans le cadre de la cotraitance.
FINANCEMENTS DE PÔLE EMPLOI AU TITRE DE LA COTRAITANCE
(en millions d’euros)
Financements de Pôle Emploi au titre de la cotraitance (1) |
33,323 M€ en 2011 |
Mise à disposition de personnels (325 ETP) par Pôle Emploi dans les missions locales (2) |
14,625 M € |
Total (1+2 = 3) |
47,948 M € |
Nombre de jeunes suivis dans le cadre de la cotraitance conventionnés (4) |
166 196 en 2011 |
Soit financement total par jeune suivi dans le cadre du PPAE (5 = 3/4) |
Soit près de 290 € / jeune accompagné |
Source : réponse au questionnaire des rapporteurs (2), calculs missions (3 et 5) et rapport du CNML d’avril 2013 (1 et 4)
Ce montant apparaît relativement modeste par comparaison avec d’autres types de prestations d’accompagnement, auxquelles la cotraitance vers les missions locales pourrait être comparée, comme le fait apparaître le tableau ci-après.
COÛT DE DIFFÉRENTES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN 2012
OU DERNIÈRE ANNÉE DISPONIBLE
(en millions d’euros)
Prestations d’accompagnement |
Nombre de bénéficiaires (1) |
Coût total (2) |
Coût unitaire par bénéficiaire (1/2) |
Partenaires : cotraitants de Pôle Emploi | |||
Missions locales |
165 000 |
49,125 M € |
297 €* |
Cap Emploi |
72 900 |
26,95 M€ |
385 € |
APEC (cadres, de janvier à avril 2010) |
12 000 |
15,6 M€ |
1 300 € |
Prestations externes de Pôle Emploi | |||
Cible Emploi |
30 696 |
13,690 416 M€ |
446 € |
Mobilisation vers l’emploi |
50 861 |
40,180 190 M€ |
790 € |
Sources : réponse de Pôle Emploi au questionnaire adressé par les rapporteurs (juillet 2013) et calcul mission (*)
S’agissant du contrat d’autonomie, lancé dans le cadre du plan « Espoir banlieues » de 2008 (prestation d’accompagnement renforcé à destination des jeunes de moins de 26 ans dans les quartiers qui pouvait être confiée à des organismes privés de placement), selon un rapport sénatorial (238), le coût unitaire était « de l’ordre de 8 500 euros (…) avec un taux de sortie positive (en emploi ou en formation) de seulement 42 % ». Ces dotations couvraient toutefois aussi le versement d’une allocation mensuelle de 300 euros par mois aux jeunes suivis.
Le financement de la cotraitance apparaît ainsi en décalage avec le niveau d’accompagnement renforcé qui justifie en théorie le dispositif. Il convient donc d’accroître la dotation de Pôle Emploi aux missions locales, mais aussi de clarifier le cadre de la cotraitance, avec un cahier des charges précis concernant l’accompagnement des jeunes suivis dans le cadre du PPAE. Parallèlement, les critères d’orientation des jeunes suivis par les missions locales, devraient être précisés dans la perspective du prochain accord-cadre tripartite (239) qui doit entrer en vigueur à partir de janvier 2015.
S’agissant plus généralement des relations entre l’opérateur et les missions locales, l’étude réalisée par KPMG/Euréval recommande de « partager un outil commun avec Pôle Emploi sur les offres d’emploi disponibles », en relevant également certaines pratiques intéressantes : ainsi, « sur le territoire de Montreuil, des collaborations actives ont été mises en place entre la mission locale et Pôle Emploi : un référent de Pôle Emploi est désigné à la mission locale et inversement un référent mission locale à Pôle Emploi pour assurer le suivi du partenariat. Le directeur [de la mission locale] invite des représentants des partenaires lors des réunions de l’équipe de la mission locale ».
b. Développer l’évaluation et le pilotage des missions
Les auditions de la mission ainsi que l’enquête de terrain réalisée dans quatre bassins de vie ont souligné l’intérêt de cet accompagnement global, qui fait l’objet d’appréciations positives de la part des jeunes suivis par les missions locales.
Une appréciation positive des jeunes suivis sur l’accompagnement des missions locales : les enseignements de l’enquête de terrain réalisée dans quatre bassins de vie
« Il ressort de l’étude réalisée sur les quatre bassins de vie que les missions locales ont un rôle déterminant dans l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. D’après les témoignages recueillis auprès des jeunes bénéficiaires, ils trouvent auprès des missions locales un accueil personnalisé, un référent unique et des conseillers qui prennent le temps de mettre en place un programme de réinsertion. La mission locale, par son rôle fédérateur, traite de nombreux sujets et apporte une réponse globale aux difficultés rencontrées par les jeunes bénéficiaires. Pour certains jeunes qui ont connu des parcours difficiles et chaotiques, cette attention particulière a souvent fait défaut auprès d’autres institutions qu’ils ont pu côtoyer antérieurement (établissements scolaires, Pôle Emploi). Il n’existe pas d’institution qui leur offre une qualité d’accueil et une attention équivalentes. Pour beaucoup de jeunes, la mission locale apparait comme « leur dernière chance d’insertion professionnelle et sociale ». L’autonomie des missions locales vis-à-vis des autres institutions apparaît comme un élément particulièrement important et doit être préservé. (…)
Les bénéficiaires soulignent, pour ceux qui ont été en contact avec d’autres structures de services publics de l’emploi (Pôle Emploi, par exemple) la différence dans l’accueil, l’écoute particulière et attentive qui leur est portée. Un jeune bénéficiaire a employé les mots « d’espoir retrouvé, de possibilités qui existent et qui l’ont rassuré ». Beaucoup de jeunes citent spontanément le contre-exemple de Pôle Emploi pour témoigner de la qualité de l’accompagnement qui leur est offert par les missions locales. « À Pôle Emploi, le conseiller change tout le temps, il faut refournir les documents qu’on a déjà donnés ». « J’espère que la mission locale ne fusionnera pas avec Pôle Emploi », « La mission locale, c’est une chance unique de se réorienter vers un emploi, une formation mais aussi un suivi individualisé vers l’emploi qu’on ne trouve pas ailleurs ».
Source : étude de KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)
Le réseau des missions locales présente toutefois plusieurs faiblesses liées :
– à leur statut associatif (structures autonomes juridiquement), qui présente des avantages mais aussi certaines limites, par exemple pour la mutualisation des moyens ou la transmission de données : dans son rapport précité d’avril 2013 sur la France, l’OCDE a par exemple relevé qu’en matière d’accompagnement des jeunes, « les intervenants mal coordonnées (…) sont parfois pilotés à des niveaux territoriaux différents, rencontrent des problèmes d’échange de données (…), y compris entre missions locales limitrophes de départements différents, voire se trouvent en concurrence. Pour les missions locales par exemple, l’obstacle à la transmission de données est avant tout juridique car chaque mission locale est une entité propre, d’où l’avantage que procurerait leur rassemblement au sein d’une même structure » ;
– aux disparités en termes de moyens, d’effectifs (240), mais aussi de pratiques et de résultats : l’évaluation de la performance du CIVIS a ainsi montré de grandes disparités entre les régions (241), avec notamment des taux de sorties en emploi variant d’un peu moins de 20 % à 57,9 % en 2011 (et de 6,3 % à 47,4 % pour les sorties en emploi durable), et un nombre de jeunes sans proposition depuis plus de 3 mois (« stock dormant ») allant de 5,6 % à 30,3 %, or le taux de chômage de la zone d’emploi n’explique que partiellement l’hétérogénéité des résultats (242) ;
Les disparités entre missions locales : l’exemple de quatre bassins de vie
« Les moyens financiers et humains alloués aux missions locales sont inégaux selon les territoires. Les moyens financiers par jeune accompagné varient de 21 % entre la mission locale la plus dotée et celle la moins dotée. Le montant alloué par jeune accompagné (JDI) s’élève à 325 euros à Méru contre 203 euros à la MIEJ 93-3 (Montreuil).
En termes de ressources humaines, l’écart est beaucoup plus significatif : un conseiller en insertion suit deux fois plus de jeunes demandeurs d’insertion à la mission locale de Montreuil qu’à celle de Guéret. Le taux d’accompagnement des jeunes actifs inoccupés est également très différent d’un territoire à l’autre: il s’élève à 65,8 % à Méru contre 95 % à Guéret. (…) Environ 80 % des jeunes ont reçu au moins une proposition « emploi » à Guéret, Méru et Annecy contre 67 % à la MIEJ 4-93. Entre 46 % et 56 % d’entre eux ont reçu au moins une proposition « formation ».
En termes de résultat, les écarts sont contrastés selon les missions locales : sur le total de jeunes ayant reçu au moins une proposition « emploi », 70 % représentait un emploi durable à la MIEJ 4-93 (Montreuil) contre 32 % et 34 % respectivement à Méru et Guéret. (…) Les sorties en emplois durables sont très inégales d’un territoire à l’autre. Elles sont deux fois moins importantes à Guéret et Méru qu’à Annecy, Montreuil se situant derrière Annecy en termes de performances. »
Source : étude de KPMG/Euréval annexée au présent rapport (octobre 2013)
– enfin, ces faiblesses tiennent aussi aux conditions de leur pilotage, en dépit de progrès tout à fait significatifs, sous l’impulsion de la DGEFP.
L’État s’implique en effet de plus en plus dans la définition des objectifs des missions locales, en s’appuyant sur un instrument très structurant (les conventions pluriannuelles d’objectifs, CPO). Selon la DGEFP, les financements apportés par le ministère sont de plus en plus liés à la performance de ces structures en matière d’accès à l’emploi. Avec les CPO, la direction dispose depuis 2008 d’un instrument contractuel de pilotage des missions locales permettant de contextualiser, sur la base d’un diagnostic territorial partagé, leurs performances respectives. Il s’agirait ainsi de mettre en rapport les objectifs et les moyens qui leur sont confiés avec les résultats des actions favorisant l’accès des jeunes à l’emploi. . À cet égard, il convient de rappeler que la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (243) prévoyait que « les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
Cette évolution n’est d’ailleurs pas sans susciter certaines réserves. Le directeur d’une mission locale indique ainsi à ce sujet que « les missions locales sont passées d’un financement d’un service public à un subventionnement de l’activité. La mission locale reçoit une part variable de son financement en fonction de la réalisation de ses objectifs. Cependant, les financements n’augmentent pas en conséquence. Les financements ne peuvent être basés uniquement sur un objectif quantitatif. Le directeur de la mission locale exprime également cette inquiétude : les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) créent une course à la productivité, incompatible avec la mission de service public des missions locales » (étude annexée au présent rapport).
En tout état de cause, il existe des marges de progrès dans ce domaine. La note du CAE précitée souligne ainsi que « le système de suivi des performances mis en place par l’État a permis de mettre en évidence une grande hétérogénéité des performances des missions locales sur le territoire qui ne peut être expliquée par le contexte économique local, mais il n’a pas la capacité de résorber les inégalités qui en résultent. Sans pilotage efficace des performances, les nouveaux outils de l’accompagnement des jeunes auront peu de chance d’aboutir à une meilleure sécurisation des parcours ».
Évoquant un « financement opaque et en diminution », l’enquête réalisée par KPMG/Euréval indique par ailleurs que « certaines incohérences ont été relevées : la dotation de l’État par nombre de jeunes est fonction du nombre de jeunes de 16 à 25 ans inscrits à Pôle Emploi sur le territoire. Ainsi, à titre d’illustration, les missions locales couvrant la région de Basse-Normandie ont reçu en 2012 une enveloppe budgétaire de 5,7 millions d’euros pour 10 496 jeunes bénéficiaires tandis que les missions locales du département de Seine-Saint-Denis, pour 85 228 jeunes accueillis ont reçu 24 millions d’euros. Soit un budget de 281 euros par bénéficiaire en Seine-Saint-Denis contre 543 euros en Basse-Normandie ».
S’agissant du suivi du CIVIS, cette étude souligne également que la fixation d’objectifs chiffrés s’est traduite par la mise en place de tableaux de bord et que « des conseillers ont été formés sur le dispositif et le logiciel (Parcours 3) qui l’accompagne », mais ce dernier ne permet pas de saisir facilement des données qualitatives. Il est donc proposé de l’adapter en conséquence. En matière de pilotage, l’étude préconise également de clarifier les modalités de participation des instances représentant l’État et, afin de garantir une meilleure transparence, de « certifier l’activité des missions locales (combien de jeunes accueillis, combien de contacts avec les conseillers, d’ateliers individuels ou collectifs suivis et pas seulement se limiter à certifier les comptes de l’association) ».
Pour améliorer le dispositif actuel, et en contrepartie d’une augmentation des subventions allouées aux missions locales, les rapporteurs préconisent :
– de développer l’audit régulier des missions locales, en concertation et si possible conjointement avec les régions, comme l’a préconisé l’Igas en 2010 (244) ;
– d’étudier les possibilités de mutualisation des moyens au sein du réseau (fonctions support), ce qui peut présenter un intérêt particulier pour les petites missions locales ;
– de s’appuyer sur un outil d’analyse contextualisé de leur activité et de leurs résultats, pour tenir compte des spécificités de bassins d’emploi, ainsi que sur le bilan de la deuxième génération des CPO (2011-2013), pour poursuivre le chantier de la modernisation de l’offre de service et des financements des missions locales, dans une perspective d’amélioration de leur performance ;
– de développer une part variable dans l’allocation des ressources en fonction des résultats et des pratiques et en tenant compte du contexte économique et social des territoires, parallèlement à l’augmentation de leurs moyens ;
– de soutenir une structuration accrue du réseau au niveau régional, ce à quoi pourra notamment contribuer l’élaboration d’une convention-cadre stratégique au niveau régional, comme l’ont préconisé les rapporteurs ;
● Renforcer l’évaluation et le pilotage des missions locales dans le cadre du dialogue de gestion, en tenant compte des spécificités des bassins d’emploi :
– évaluer régulièrement l’action des missions locales (procédure d’audit régulier, en concertation avec les collectivités) et enrichir le logiciel Parcours 3 en permettant d’y renseigner des données qualitatives ;
– poursuivre le chantier de la modernisation de l’offre de service et des financements des missions locales, en s’appuyant sur un outil d’analyse contextualisé de leur activité et de leurs résultats et sur le bilan de la deuxième génération des CPO, et développer une part variable dans l’allocation des ressources en fonction des pratiques et des résultats, tenant compte des spécificités des bassins d’emploi ;
– encourager le développement de la structuration du réseau au niveau régional et étudier les possibilités de mutualisation des ressources entre les missions locales.
● Renforcer les moyens des missions locales et clarifier la cotraitance avec Pôle Emploi :
– augmenter la dotation de l’État et de Pôle emploi aux missions locales afin de rendre l’accompagnement plus intensif pour les moins diplômés dans le cadre du CIVIS ;
– renforcer la détection des jeunes en difficulté et encourager le développement des réseaux des missions locales avec les entreprises (parrainage, immersion en entreprise…) et des partenariats, à l’occasion de la préparation de la prochaine génération de CPO ;
– clarifier les relations avec Pôle Emploi, par l’établissement d’un cahier des charges précis concernant le suivi des jeunes dans le cadre du PPAE, le réexamen des critères d’orientation des jeunes suivis par les missions locales et le partage d’un outil commun avec Pôle Emploi sur les offres d’emploi disponibles.
2. Simplifier progressivement les dispositifs et rapprocher les parcours d’accompagnement
Face au constat d’un chômage élevé et persistant, plusieurs mesures se sont succédées pour favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail, s’agissant en particulier des peu ou pas qualifiés.
Ces mesures visent principalement à accroître la qualification des jeunes pour améliorer leurs chances d’accès à l’emploi, à réduire le coût du travail pour les employeurs afin notamment de compenser le déficit d’expérience des jeunes, ainsi qu’à apporter un accompagnement individualisé dans la recherche d’emploi.
Si l’on exclut les mesures d’allègement de charges, non spécifiquement ciblées sur les jeunes, on peut ainsi distinguer schématiquement les emplois aidés (contrats de travail) et les dispositifs d’accompagnement (le CIVIS par exemple) qu’il apparaît particulièrement nécessaire de simplifier.
a. Les emplois aidés et le déploiement en cours des emplois d’avenir en direction des jeunes peu ou pas qualifiés
En 2012, environ un quart des emplois occupés par les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d’une aide de l’État (25,3 %, soit près de 645 000 jeunes), dont une très large majorité correspond aux contrats d’alternance (près de 590 000).
LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS DANS LES MESURES D’AIDE À L’EMPLOI EN 2012
Alternance |
587 000 |
Apprentissage |
432 000 |
Contrat de professionnalisation |
154 000 |
Emploi marchand hors alternance Contrat initiative emploi (contrat unique d’insertion, CUI- CIE) |
8 000 |
Emploi non marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi, CUI-CAE) |
48 000 |
Ensemble |
643 000 |
Part des emplois aidés parmi les emplois occupés par des jeunes (La part des emplois aidés, tous publics, dans l’emploi total est de 3,3 %) |
25,3 % |
Champ : France métropolitaine, hors abattement temps partiel, ACCRE et insertion par l’activité économique (IAE)
Hors emplois d’avenir
Source : d’après un document de la Dares (juin 2013)
Cette proportion a sensiblement augmenté au cours des dernières décennies, comme l’illustre le graphique ci-après. Les non diplômés représentent une proportion significative des bénéficiaires de ces dispositifs (245).
ÉVOLUTION DE LA PART DES EMPLOIS AIDÉS PARMI LES EMPLOIS OCCUPÉS PAR DES JEUNES SELON LA CATÉGORIE DE MESURE (ALTERNANCE ET CONTRATS AIDÉS)
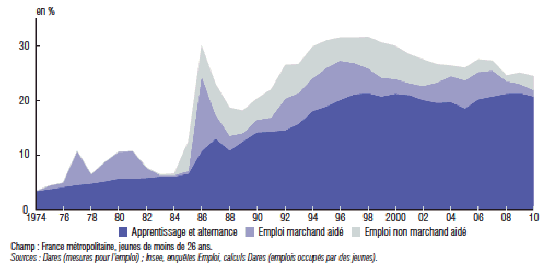
● Les contrats d’alternance
Les contrats d’apprentissage (évoqués dans la deuxième partie du présent rapport) et les contrats de professionnalisation constituent les deux principaux supports de formation en alternance.
Créé en 2004, le contrat de professionnalisation a permis de substituer à plusieurs contrats préexistants un contrat unique, commun aux jeunes ainsi qu’aux adultes demandeurs d’emploi. En 2012, ce dispositif comptait près de 155 000 jeunes de moins de 26 ans.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRÉES EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION ENTRE 2006 ET 2011
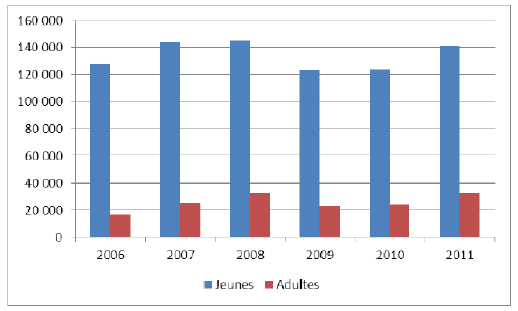
Source : rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) sur les aides aux entreprises en faveur de l’emploi (avril 2013)
S’inscrivant en principe dans des logiques distinctes (la formation initiale pour l’apprentissage et la formation professionnelle continue pour le contrat de professionnalisation), les deux types de contrat présentent des caractéristiques différentes, dont les principales sont présentées ci-dessous.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX CONTRATS DE FORMATION
EN ALTERNANCE
Contrat d’apprentissage |
Contrat de professionnalisation | |
Bénéficiaires |
Jeunes de 16 à 25 ans ayant satisfait à l’obligation scolaire |
Jeunes (16-25 ans révolus) ou demandeurs d’emplois de plus de 26 ans (81 % des entrées concernent les jeunes) |
Date de mise en place et texte porteur |
Premier contrat écrit 1928 puis loi Walter et Paulin du 10 mars 1937 |
2003-2004 (accord national inter-professionnel du 5 décembre 2003 et loi du 24 mai 2004) ; ce dispositif s’est substitué aux contrats d’insertion en alternance pour les jeunes (qualification, adaptation, orientation) et au contrat de qualification adulte |
Descriptif |
Objectif de complément de formation et d’insertion professionnelle pour les jeunes |
Objectif de formation souple permettant d’acquérir une qualification professionnelle (ou un complément de formation) en alternance |
Lieu de la formation |
CFA (centre de formation des apprentis), programme relève du ministère de l’Éducation nationale |
Différents prestataires publics ou privés. Possibilité de faire effectuer une partie de la formation dans l’entreprise d’accueil |
Financement de la formation |
via la taxe d’apprentissage ; régions et État |
Tout ou partie pris en charge par l’OPCA dont relève l’employeur |
Contrat de travail |
CDD uniquement ; 1 – 3 ans |
CDD/CDI ou temps partiel ; durée 6 mois-2 ans |
Rémunération |
Progressive en fonction de l’âge et de l’année d’apprentissage concernée (minima 25-78 % SMIC) |
55-80 % SMIC pour les moins de 26 ans ; 85 % salaire conventionnel sans pouvoir être inférieur au SMIC (plus de 26 ans) |
Source : rapport de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur « Les aides financières à la formation en alternance (juin2013)
Il existe toutefois une certaine porosité entre les deux dispositifs, s’agissant notamment des publics : ainsi, 81 % des contrats de professionnalisation concernent des jeunes de moins de 26 ans (246) (qui auraient pour beaucoup également pu avoir avoir recours au contrat d’apprentissage). En outre, il est à noter que 32 % des personnes entrant en contrat de professionnalisation sont directement issues du système scolaire (247).
En 2011, les aides à l’embauche en alternance s’élevaient à plus de 2,5 milliards, dont près de deux milliards attribués par l’État (exonérations de cotisations sociales, crédit d’impôt, mesurs temporaires pendant la crise), selon la ventilation présentée dans le tableau ci-après. L’essentiel de ces aides bénéficie aux employeurs d’apprentis.
AIDES EN FAVEUR DES EMBAUCHES EN ALTERNANCE EN 2011
(en millions d’euros)
État |
Exonération de cotisations patronales et salariales pour les embauches en apprentissage |
1 360 |
Crédit d’impôt apprentissage |
470 | |
Exonérations de cotisations sociales sur les embauches en contrat de professionnalisation |
28 | |
Mesures du Plan d’urgence pour les jeunes et du Plan de mobilisation pour l’emploi |
113 | |
Pôle emploi |
Aide forfaitaire aux employeurs |
8 |
Régions (versée par les régions et compensée par l’État) |
Indemnité compensatrice forfaitaire |
(environ) 550 |
Total des aides |
2 529 | |
Les mesures temporaires (financées par l’Etat et versées par Pôle Emploi) ont représenté 113 millions d’euros en 2011, dont notamment 1,6 millions pour le dispositif zéro charge apprenti, 32,5 millions pour l’aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire et 28,5 millions pour la prime à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation.
Source : Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), « Les aides aux entreprises en faveur de l’emploi. Évaluation des principaux dispositifs » (avril 2013)
Le soutien apporté par l’État au financement des aides au contrat de professionnalisation est estimé au total à près de 20 millions d’euros (248).
Elles se composent d’une aide directe versée à l’employeur pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans et plus (12 millions d’euros), d’une aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, ainsi que d’exonérations de cotisations sociales spécifiques réservées à certains cas particuliers (249), à hauteur de 14,6 millions d’euros, en plus des exonérations de droit commun (allégements généraux pour les bas salaires). Ces exonérations ont été réduites en 2007 et 2008 (250) avec la suppression notamment des exonérations en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, entraînant une forte diminution de leur coût, qui est passé de 464 millions d’euros en 2008 à 28 millions d’euros en 2011 (251).
En outre, des aides temporaires ont été mises en place dans le cadre du « Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes » présenté au printemps 2009, dont les principales dispositions, pour ce qui concerne le contrat de professionnalisation, sont présentées dans l’encadré ci-après. Le plan de mobilisation pour l’emploi, annoncé en mars 2011, prévoyait par ailleurs une compensation pendant six mois des cotisations sociales patronales pour l’embauche d’un jeune supplémentaire en alternance dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Une volonté de mobilisation des contrats de professionnalisation : les mesures mises en œuvre en 2009
Dans le cadre du « Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes » annoncé au printemps 2009, des mesures de soutien au contrat de professionnalisation ont été prévues. Une prime de 1 000 euros a ainsi été attribuée à partir du 1er juillet 2009 aux entreprises qui concluaient avec un salarié de moins de 26 ans un contrat de professionnalisation de plus d’un mois ou qui transformaient en contrat de professionnalisation à durée indéterminée un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu antérieurement. Cette prime était doublée lorsque le salarié embauché avait un niveau de qualification inférieur au baccalauréat.
Par ailleurs, la loi du 24 novembre 2009 a créé un « contrat de professionnalisation renforcé » au bénéfice de publics identifiés comme prioritaires : bénéficiaires de certains minima sociaux, personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion, personnes peu qualifiées. Ce contrat renforcé présente plusieurs spécificités par rapport aux contrats de professionnalisation de droit commun : il peut être porté à 24 mois sans accord de branche et la prise en charge des actions de formation et du tutorat par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) obéit à des règles plus favorables.
Source : rapport public thématique de la Cour des Comptes (janvier 2013)
En définitive, en dépit d’une politique continue sur le long terme de soutien au développement de l’alternance, « les modalités des aides aux entreprises ont connu une réelle instabilité », comme l’a souligné le Conseil d’orientation pour l’emploi, dans son rapport précité d’avril 2013.
S’agissant de l’efficacité des aides, son évaluation requiert d’examiner à la fois les effets de l’alternance sur l’emploi des personnes qui en ont bénéficié et leur capacité à augmenter le nombre d’embauches en alternance.
– Sur le premier point, les études et données disponibles mettent en évidence un effet positif de l’alternance sur l’insertion professionnelle. En particulier, une étude récente de la DARES (252) montre que deux tiers des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation étaient en emploi dès l’issue du contrat, dont près des trois quarts chez le même employeur (la proportion des personnes en emploi à l’issue du contrat est de 65,4 % chez les moins de 26 ans).
– Sur le second point, l’augmentation des effectifs en apprentissage semble correspondre avec le renforcement des aides en faveur de celui-ci, sans toutefois qu’une causalité soit établie scientifiquement ; la mise en évidence d’un lien entre les aides aux entreprises et l’évolution du nombre d’entrées en contrat de professionnalisation est en revanche beaucoup plus incertaine, selon le COE.
Par ailleurs, la mobilisation des contrats de professionnalisation pendant la crise s’est accompagnée d’une évolution du profil des bénéficiaires, avec une diminution de la part des salariées les moins qualifiés. Ainsi, les personnes de niveau CAP ou BEP (niveau V) ont vu leur part se réduire de 24,6 % à 20,3 % entre 2008 et 2011, et les personnes de niveau V bis et VI sont passées de 9,1 % du total à 7,1 % sur la même période (253).
En particulier, alors que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 mentionnait les jeunes sans qualfiication professionnelle au premier rang des bénéficiaires potentiels du contrat de professionnalisation, « force est de constater que la proportion de ces derniers n’a cessé de se réduire depuis l’introduction de ce dispositif, cette tendance s’étant encore aggravée à l’occasion de la crise », ainsi que l’a observé récemment la Cour des Comptes (254).
Ainsi, comme d’autres dispositifs de la politique de l’emploi, les contrats de professionnalisation ne sont pas suffisamment ciblés sur ceux qui en auraient le plus besoin. En particulier, l’aide versée par l’État pour inciter les entreprises à conclure des contrats de professionnalisation, qui prévoyait pourtant une majoration en cas d’embauche de jeunes ayant un niveau de qualfication inférieur au baccalauréat, « à échoué à orienter les employeurs vers les jeunes moins diplômés » selon la Cour.
D’autres intruments pourraient toutefois être mobilisés par l’État pour orienter les contrats de professionnalisation vers les moins qualifiés, comme le relève ce rapport. C’est notamment le cas des conventions d’objectifs et de moyens (COM) passés entre l’Etat et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) financeurs de ces contrats, qui pourraient ainsi comporter des dispositions par lesquels ces derniers s’engageraient sur des objectifs de ciblage des différents dispositifs de la formation professionnelle.
En matière d’alternance, il conviendrait enfin de remédier aux « insuffisances réelles de l’évaluation de l’impact des aides elles-mêmes », soulignées par le Conseil d’orientation pour l’emploi (255), qui relève notamment que les études sont plus rares (comparé à l’apprentissage) s’agissant des effets sur l’emploi des contrats de professionnalisation, et qu’il n’existe pas en particulier « d’évaluation de l’effet net du dispositif ».
● Les autres emplois bénéficiant de l’aide de l’État
Environ 57 000 jeunes bénéficient d’un contrat aidé, essentiellement dans le secteur non marchand (49 000 jeunes pour les CUI-CAE et emplois d’avenir). Les jeunes constituent ainsi une part significative des bénéficiaires de contrats aidés, même s’ils ne leur sont pas réservés, à l’exception des emplois d’avenir et des emplois francs lancés récemment (cf. infra).
On peut observer, là encore, la succession de différents types de contrats aidés, comme l’illustre le schéma relatif aux aides à l’emploi des jeunes présenté dans la première partie du présent rapport.
Les évaluations réalisées semblent toutefois converger sur trois points (256). Tout d’abord, si l’on compare à ceux du secteur non marchand, les contrats aidés du secteur marchand sont plus souvent un tremplin vers l’emploi stable (257). Par ailleurs, les contrats aidés de courte durée, dans le secteur marchand ou non marchand, ne facilitent pas l’accès à l’emploi stable. En outre, le rôle de la formation et de l’accompagnement, au sein du dispositif de contrat aidé, est favorable à une issue positive.
Ce dernier point a d’ailleurs été pris en compte dans la conception des emplois d’avenir, qui font partie des nouveaux emplois aidés lancés depuis 2012, avec les contrats de génération et, d’abord à titre expérimental, les emplois francs. Leurs principales caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après. Compte tenu du caractère très récent de ces dispositifs et, corrélativement, des difficultés de procéder à l’évaluation de leur impact, la mission a plutôt concentré ses travaux sur les dispositifs d’accompagnement individualisé vers l’emploi, tels que le CIVIS.
Il a aussi été tenu compte des travaux engagés dans le cadre de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les emplois d’avenir (258), qui a formulé une trentaine de propositions, parmi lesquelles :
– augmenter les moyens de certaines missions locales, particulièrement dans les zones défavorisées, et d’avancer dans l’intégration informatique de Pôle emploi et du réseau des missions locales, s’agissant en particulier des offres d’emploi, en rejoignant ainsi le constat dressé précédemment ;
– laisser aux conseillers des missions locales la latitude nécessaire pour assurer le suivi des jeunes en emploi d’avenir, pour permettre un suivi renforcé des jeunes qui rencontreraient des difficultés et un suivi plus souple des jeunes pour lesquels aucun obstacle n’est rencontré en emploi ;
– au-delà des emplois d’avenir, afin d’éviter les effets de seuil et les sentiments d’injustice, « réfléchir à des systèmes d’aides financières à l’emploi qui évoluent de manière décroissante avec les difficultés d’accès à l’emploi, potentielles (diplôme) ou effectives (ancienneté au chômage) » ;
LES NOUVEAUX DISPOSITIFS D’EMPLOIS EN DIRECTION DES JEUNES, BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE DE L’ÉTAT
Création |
Publics prioritaires |
Nature de l’aide |
Objectifs s |
Moyens | |
Emplois d’avenir |
Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir |
Jeunes de moins de 25 ans peu ou pas qualifiés et jeunes de moins 30 ans reconnus travailleurs handicapés |
L'employeur perçoit une aide financière des pouvoirs publics : – 75 % du Smic brut, s'il appartient au secteur non marchand, public ou associatif (soit 1 069,25 € pour un temps plein) – 47 % du Smic brut, s'il appartient au secteur de l'insertion par l'activité économique (soit 670,06 € pour un temps plein), – 35 % du Smic brut, s'il appartient au secteur marchand, industriel ou commercial (soit 498,98 € pour un temps plein). L'employeur du secteur non marchand est en outre exonéré de certaines taxes ou cotisations sociales. |
100 000 emplois d’avenir prévus en 2013, et 50 000 nouveaux en 2014 Objectif d’entrée de 30 % pour les jeunes des ZUS (259) Taux d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires : cible 2015 de 75 % |
1 215,9 M€ en AE 1 291 M € en CP |
Contrats de génération |
Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération |
Pas de ciblage des jeunes concernés Entreprises de moins de 300 salariés |
Aide financière aux entreprises de 4 000 euros par an pendant 3 ans, dès lors qu’elles embauchent en CDI un salarié d’au moins 26 ans (ou moins de 30 ans pour les jeunes reconnus handicapés) tout en conservant un salarié de 57 ans et plus |
500 000 contrats d’ici 2017, soit 100 000 par an Nouvelles entrées 2014 : 100 000 |
390 M€ en CP, 1,2 Md € en AE |
Emplois francs |
CIJ de février 2013 Décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs |
Jeunes des quartiers (40 agglomérations) |
Prime de 5000 euros en faveur des entreprises recrutant en CDI à temps plein un jeune de moins de 30 ans résidant dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. |
5 000 contrats en 2014 |
25,5 M€ en en AE (PLF 2014) |
– de revaloriser l’aide financière de l’État à destination des employeurs du secteur marchand pour l’embauche de jeunes issus de ZUS (de cinq à dix points) et de fixer à chaque mission locale, qu’elle soit située en ZUS ou hors ZUS, un objectif précis de proportion de jeunes issus de zone urbaine sensible (ZUS).
b. Renforcer et simplifier progressivement les dispositifs d’accompagnement en direction des jeunes en difficulté d’insertion
Au-delà des contrats de travail bénéficiant d’aides de l’État, différentes mesures d’accompagnement ont été mises en place afin d’aider les jeunes, en particulier les moins diplômés, à s’insérer sur le marché du travail, comme l’illustre le schéma synoptique des aides à l’emploi des jeunes présenté dans la première partie du présent rapport (dispositifs TRACE, PAQUE, CIVIS, etc.). Dans ce domaine, les principaux dispositifs en vigueur (260) sont les suivants :
– l’accompagnement de droit commun par les missions locales (avec le cas échéant des aides du Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (261), FIPJ), et le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), qui est le plus important en nombre de bénéficiaires (environ 213 000 entrées en 2010 et, en cumulé, plus de 800 000 jeunes sortis de ce dispositif entre 2005 et 2012) ;
– le plan personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) pour les jeunes suivis par Pôle Emploi ou les missions locales, dans le cadre de la cotraitance ;
– les dispositifs de « deuxième chance » (E2C, EPIDE, SMA), qui accueillent des jeunes en grande difficulté d’insertion ;
– la prestation d’accompagnement renforcé pour les jeunes décrocheurs mise en place suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) d’avril 2011 ;
– à titre expérimental, dans le cadre du FEJ, le revenu contractualisé d’autonomie (RCA), qui associe accompagnement et versement d’une allocation (le rapport final d’évaluation devrait être remis d’ici la fin de l’année) ;
– la « Garantie Jeunes », nouvelle mesure lancée dans dix territoires pilotes en octobre 2013, qui devrait bénéficier à 10 000 jeunes sur un an, puis à 100 000 jeunes d’ici 2016. Ce dispositif a pour objet « d’amener les jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la formation (262) ». Elle comporte à la fois une garantie de ressources et un accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales, permettant l’accès à une pluralité d'expériences professionnelles et de formation (programme fondé sur le principe de « l’emploi d’abord »), en vue de construire ou de consolider un projet professionnel. Comme le RCA, la Garantie jeunes est adossée au CIVIS. En intégrant ce dispositif expérimental, le jeune s’engage dans une démarche active vers l’emploi, pouvant intégrer des formations qualifiantes, et la mission locale doit l’accompagner de façon intensive et personnalisée.
La « Garantie Jeunes » lancée en octobre 2013 dans dix territoires pilotes
La Garantie Jeunes s’adresse prioritairement aux jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET), en situation de grande précarité et dont les ressources ne dépassent pas le plafond du revenu de solidarité active (RSA, 493 € pour une personne seule). Des situations dérogatoires pour les mineurs, les jeunes non NEET ou dont les ressources dépassent le plafond mais dans une situation présentant un risque de rupture peuvent être étudiés par la commission locale d’attribution et de suivi.
Ce dispositif se compose d’une garantie à une première expérience professionnelle (accompagnement dans un parcours dynamique et multiplication de périodes de travail ou de formation), ainsi que d’une garantie de ressources en tant qu’appui de cet accompagnement. Elle ne se substitue pas aux prestations sociales existantes et n’est pas un droit ouvert mais un programme d’accompagnement ciblé et contractualisé. L’allocation forfaitaire mensuelle est d’un montant de 433,75 € auquel s’ajoute l’aide au logement dont peut bénéficier le jeune. Elle est cumulable avec les revenus d’activité jusqu’à 300 euros et dégressive ensuite. Le parcours proposé doit organiser un accompagnement continu, enchaînant les actes nécessaires à l'accès à l'emploi, dans le cadre d'un contrat d’engagements réciproques entre le jeune et le référent de la mission locale qui le suit. Le socle de l’engagement initial du jeune consiste à accepter de prendre des engagements au cours de son parcours, de lui-même ou sur proposition de son conseiller, et à les tenir. Il s’engage également à déclarer chaque mois à son conseiller tous ses revenus d’activité. L’allocation sera suspendue en cas de manquement aux engagements.
L'accompagnement se déroulera sur une période d'un an renouvelable, en principe par tranche de 12 mois, mais la commission pourra décider d'une durée plus courte si le parcours du jeune le justifie. Le rythme, la durée et la forme de l'accompagnement doivent s'adapter à la situation et à l'évolution du jeune dans son parcours d'insertion. La mission locale devra présenter à la commission multi-acteurs locale (263) un bilan des actions engagées dans les six premiers mois.
Elle visera 10 000 jeunes sur 10 territoires pilotes pendant un an, avant une montée en charge progressive (20 000 jeunes supplémentaires à compter d’octobre 2014) sur l’ensemble du territoire national, d’ici 2016, pour 100 000 jeunes par an en rythme de croisière. 30 millions d’euros sont prévus à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2014, avec éventuellement des financements européens en complément. Les crédits d’accompagnement attribués à chaque mission locale représentent 1 600 euros par jeune et par an.
Source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Sur la période récente, d’autres mesures d’accompagnement avaient été mis en place, comme le contrat d’autonomie, qu’il a été décidé de ne pas reconduire en 2013, ainsi que le contrat d’accompagnement formation, qui avait été lancé, pour 50 000 jeunes, dans le cadre du cadre du plan de mobilisation pour l’emploi des jeunes en 2009 (264). D’une autre nature, le « RSA jeune actif », entré en vigueur en 2010, peut bénéficier aux jeunes susceptibles de justifier de deux années d’activité professionnelle pendant les trois ans précédant la demande, mais le nombre de bénéficiaires est relativement faible par rapport aux objectifs initiaux, comme l’ont observé plusieurs auditionnées. En effet, si une cible potentielle de 160 000 bénéficiaires avait pu être évoquée lors du lancement du dispositif, le nombre de bénéficiaires du RSA jeune représentait de l’ordre 8 000 foyers en 2012 (265).En matière d’accompagnement vers l’emploi, l’offre de services apparaît ainsi très diversifiée, mais aussi pour le moins complexe, comme l’illustre le schéma ci-après.
S’il est naturellement important de pouvoir s’adapter à la diversité des besoins des publics cibles, le système actuel n’en présente pas moins plusieurs inconvénients, et tout d’abord un manque de lisibilité, non seulement auprès des jeunes et des entreprises, mais aussi des acteurs chargés de leur la mise en œuvre, ce qui doit aussi conduire à s’interroger sur la formation et l’accompagnement dont ils peuvent eux-mêmes bénéficier.
Le CIVIS, « un dispositif qui s’ajoute à ceux existants » : le point de vue de conseillers de missions locales
« Les conseillers rencontrés ne traitent pas le dispositif CIVIS comme un dispositif particulier. Beaucoup considèrent que ce dispositif est venu compléter ceux qui existaient déjà. La conseillère l’exprime ainsi : « pourquoi avoir créé un nouveau dispositif ? On a déjà le PPAE, l’ANI (…). Tout un tas de programmes où l’on doit faire rentrer les jeunes dans des cases. Alors que la problématique, c’est l’insertion du jeune (…). Recommandation n° 20 : Ne pas multiplier les dispositifs et rationaliser ceux existants.»
Source : enquête réalisée par KPMG/Euréval annexée au présent rapport
Ceci peut également expliquer que certaines aides soient peu mobilisées : cela a par exemple été le cas pour les aides prévues par l’ANI du 11 juillet 2011 visant à lever certains freins matériels à l’emploi des jeunes, et pour lesquels des moyens pourtant substantiels avaient été prévus.
D’autre part, l’accompagnement proposé se fonde trop souvent sur une approche par « dispositifs prescrits », qui conduit à « faire rentrer les jeunes dans des cases », selon l’expression employée par une conseillère de mission locale, alors qu’il faudrait plutôt partir des profils et des besoins spécifiques des jeunes pour construire un parcours d’insertion.
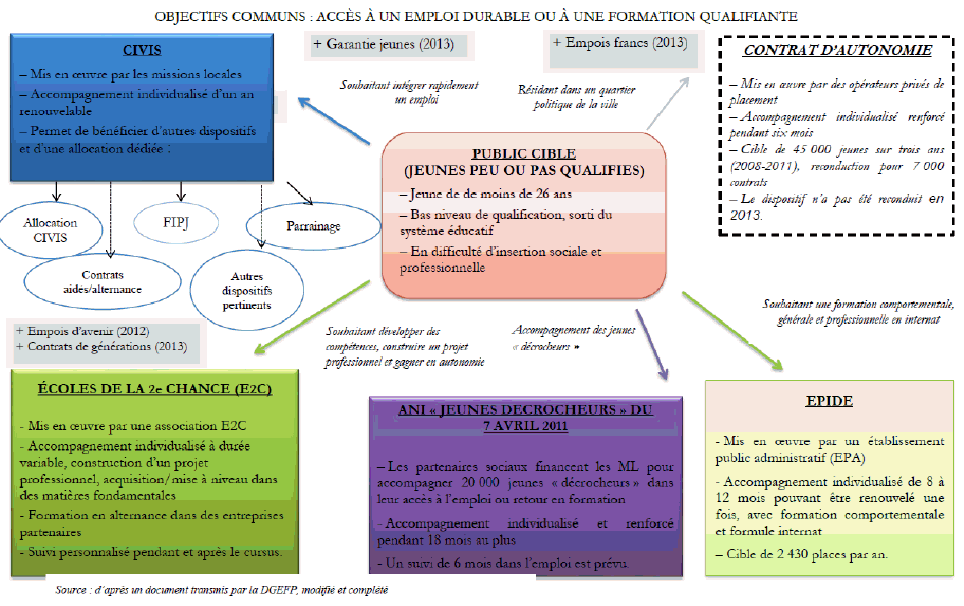
Par ailleurs, la logique de contrat, qui implique nécessairement des engagements réciproques, autrement dit des droits et des devoirs, n’est pas toujours bien comprise par les jeunes. L’étude réalisée KPMG/Euréval souligne ainsi que « les conseillers remarquent qu’un nombre important de jeunes s’affranchissent plus aisément de leur engagement qu’auparavant ; ils ne se rendent pas à l’entretien d’embauche que la mission locale est parvenue à organiser pour eux. Certains estiment qu’ils ont tous les droits ».
Les dispositifs prévoient parfois une allocation selon des modalités diverses. C’est par exemple le cas des jeunes en EPIDE (266), des bénéficiaires du RCA (267) ou du contrat d’autonomie (268). Le FIPJ finance également des aides directes (3,6 millions d’euros pour 2014) pour des actions visant la sécurisation des parcours des jeunes (logement, transport, achat de vêtements de travail, alimentation, garde d’enfant).
S’agissant du CIVIS, il peut être assorti d’une allocation d’un montant maximum de 450 euros mensuels et plafonné à 1 800 euros annuel. Pour 2014, 50 millions d’euros de crédits sont prévus à ce titre. Ainsi que le précise le PAP du programme n° 102, « le PLF 2014 repose sur une hypothèse de 135 000 bénéficiaires du CIVIS en 2014 et d’un montant moyen de 370 euros par an. »
Selon l’étude réalisée par KPMG/Euréval, l’allocation est versée « sans qu’il existe de critères d’attribution précis » et en fonction de la participation active du jeune dans la démarche engagée pour son insertion professionnelle Plutôt considérée comme un « coup de pouce » pour un besoin particulier dans une mission locale, cette allocation peut contribuer à lever certains freins à l’emploi. Ainsi, la conseillère d’une autre mission locale souligne que « l’avantage du CIVIS, c’est que l’on peut mobiliser une aide financière, versée directement sur le compte du jeune (…). Elle peut être sollicitée pour des dépenses de santé, de logement, d’assurance du véhicule, d’équipement en vêtements de travail ou de travail. Mais attention, il faut que ça rentre dans le projet professionnel, et aucune marge de manœuvre n’est possible… ils n’ont pas tous besoin d’être financés ». L’étude de KPMG/Euréval préconise à cet égard de clarifier et harmoniser les règles d’attribution de l’allocation financière du CIVIS, en soulignant également quelques rigidités dans le fonctionnement du dispositif (269).
Enfin, indépendamment de son impact sur l’insertion des jeunes, le déploiement de la « Garantie jeunes » ne contribuera pas, du moins à court terme, à clarifier l’offre de services des missions locales, puisqu’elle coexistera de fait avec les dispositifs existants. Or, si les efforts entrepris par la DGEFP pour améliorer le suivi de dispositifs tels que CIVIS (y compris en termes de performances) méritent d’être salués, il est bien évident que le nombre important des différentes mesures d’accompagnement des jeunes n’est pas de nature à faciliter leur pilotage par les services de l’État, cette difficulté étant également accrue par la multiplicité des acteurs concernés.
L’articulation de la Garantie Jeunes avec les autres dispositifs
« Si les modalités d’accompagnement associées à la Garantie jeunes font leurs preuves, elles ont vocation à devenir à terme les modalités d’accompagnement de droit commun des jeunes en difficulté suivis par les missions locales. La spécificité de la Garantie jeunes résidera alors seulement dans l’allocation. Dans l’attente d’une unification progressive des modalités d’accompagnement des jeunes, les parcours existants proposés par les missions locales (CIVIS, PPAE, ANI) subsisteront. Les règles d’articulation avec le contrat jeune majeur seront définies localement avec le conseil général. Les aides ou allocations, complémentaires ou non à ces dispositifs (FIPJ, FAJ, FSL..), mobilisés pour couvrir, de manière ponctuelle, des besoins financiers d’insertion, de santé, de logement ou de mobilité resteront disponibles pour les autres jeunes et pourront être cumulées, le cas échéant, à la Garantie jeunes. »
Source : rapport du groupe de travail présidé par Emmanuelle Wargon (DGEFP) et Marc Gurgand (CNRS), juin 2013
Les rapporteurs proposent par conséquent de simplifier les principaux dispositifs et d’engager un rapprochement progressif des modalités d’accompagnement.
Sur la méthode, il conviendra tout d’abord d’ouvrir une large concertation, et de confier à des acteurs de terrain (des missions locales en particulier) ainsi qu’au Conseil d’orientation des politiques de jeunesse une mission de réflexion sur les conditions de simplification des dispositifs d’accompagnement. Ce travail devra permettre de préparer le lancement d’une expérimentation dans quelques territoires volontaires.
Concrètement, cette expérimentation pourrait consister à mettre en œuvre une aide à l’insertion professionnelle contractualisée, que l’on pourrait par exemple dénommer « contrat de réussite ». Il s’agirait de proposer aux jeunes sans emploi un seul dispositif « socle », susceptible d’être complété par différentes options, à travers des prestations supplémentaires personnalisées.
Ces options seraient proposées en fonction du profil des jeunes. L’intensité de l’accompagnement proposé serait adapté en fonction de leurs difficultés d’accès à l’emploi effectives (durée du chômage) ou potentielles (faible niveau de qualification). Pôle Emploi distingue d’ailleurs aujourd’hui trois types de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un suivi plus ou moins intense, selon le profil (« accompagnement renforcé », « guidé » ou « suivi »). Il pourrait ainsi être envisagé d’adopter une approche différenciée en identifiant quelques grandes catégories de jeunes demandeurs d’emploi.
Parmi les options mobilisables, il pourrait ainsi y avoir une prestation spécifique en direction des jeunes NEET, qui correspondrait au périmètre de la Garantie Jeunes, avec un accompagnement assorti dans ce cas d’une allocation.
Les prestations complémentaires pourraient par ailleurs s’appuyer sur le droit à la formation différée (ou « droit de tirage ») dont bénéficierait le jeune dans le cadre du compte personnel de formation (cf. infra). L’étude de KPMG/Euréval préconise à cet égard d’offrir à chaque bénéficiaire d’un contrat de CIVIS l’opportunité de suivre une formation. L’accès à la qualification doit en tout état de cause être renforcé pour les jeunes en difficulté d’insertion.
S’agissant du champ du contrat « socle », il aurait vocation à porter sur les principaux parcours proposés par les missions locales (ANI, PPAE, CIVIS), et pourrait aussi être étendu aux contrats de volontaires en EPIDE ainsi qu’aux écoles de la deuxième chance, en concertation avec les collectivités. Ceci pourrait d’ailleurs être de nature à faciliter le pilotage, d’autant qu’actuellement, il n’existe pas, par exemple pour les E2C, de dispositif analogue aux conventions pluriannuelles d’objectifs comme c’est le cas pour le CIVIS.
Cela serait enfin de nature à favoriser un rapprochement progressif des modalités d’accompagnement. Sur ce point, l’étude réalisée par KPMG/Euréval (tableau présenté page 71) fait par exemple apparaître des pratiques diverses, selon les missions locales, en matière de parrainage, d’immersion ou de visite en entreprise (270).
● Simplifier progressivement les principaux dispositifs et rapprocher les modalités d’accompagnement vers l’emploi, en créant une aide à l’insertion professionnelle contractualisée (« contrat de réussite »)
En concertation avec l’ensemble des acteurs (mission de préfiguration confiée à des acteurs de terrain et au Conseil d’orientation des politiques de jeunesse), créer, en matière d’accompagnement des jeunes sans emploi, une aide à l’insertion professionnelle unifiée et contractualisée (« contrat de réussite ») composée d’un dispositif socle et de prestations supplémentaires personnalisées, et rapprocher progressivement les modalités d’accompagnement.
3. Accompagner les entreprises et soutenir la diffusion des bonnes pratiques
Au-delà des mesures prises par les pouvoirs publics pour favoriser l’entrée des jeunes sur le marché du travail, les entreprises jouent naturellement un rôle important dans leur insertion professionnelle et sociale, à travers non seulement les conditions dans lesquelles elles mobilisent des dispositifs publics, mais aussi certaines bonnes pratiques, qu’il conviendrait de mieux valoriser et faire connaître.
a. Mieux faire connaître les aides et les dispositifs publics
En matière d’emploi des jeunes, les premiers concernés, c’est-dire leurs employeurs potentiels, ne sont pas toujours bien informés des différents dispositifs, voire des aides dont ils pourraient bénéficier.
Selon une enquête réalisée en 2010 à l’initiative de l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH), dont la mission a entendu des représentants, il apparaît en effet que les DRH sont très sensibilisés aux dispositifs d’insertion avec incitation (par exemple, l’aide à l’embauche en contrat de professionnalisation), mais beaucoup moins sur d’autres, tels que les E2C, le CIVIS ou le CUI-CIE (contrat aidé dans le secteur marchand).
DES DISPOSIITFS PUBLICS PEU CONNUS DES DRH : LES RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE (2010)
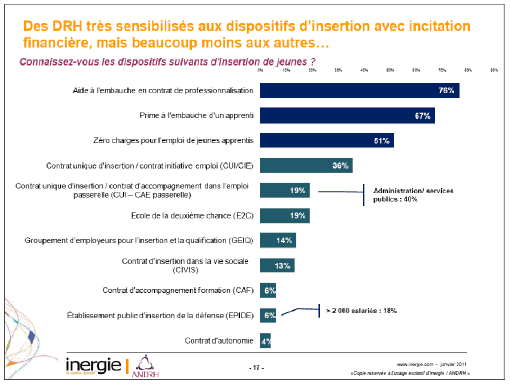
Source : étude ANDRH – Inergie, sur l’insertion des jeunes (pratiques des entreprises en matière de recrutement et d’intégration des jeunes), janvier 2011
C’est sans doute plus particulièrement le cas dans les petites et moyennes entreprises (PME). En avril 2013, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a d’ailleurs souligné (271) que le système des aides publiques aux entreprises en faveur de l’emploi demeure trop complexe et insuffisamment lisible, notamment pour les plus petites d’entre elles, et se caractérise en outre par une trop grande instabilité.
Dans le même sens, une enquête d’opinion réalisée en 2010 sur l’apprentissage dans les PME (272) relevait « un véritable déficit d’information » parmi les chefs d’entreprise interrogés, dont beaucoup confondent par exemple le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, comme cela a d’ailleurs également été relevé au cours des travaux de la mission (273). Or ce manque d’information peut être un facteur aggravant de la situation de l’apprentissage en entreprise, ainsi que le souligne cette étude.
Cette méconnaissance peut sans doute s’expliquer en partie par le nombre important des dispositifs concernés. Dans ce sens, un responsable de recrutement rencontré par les rapporteurs a d’ailleurs estimé que, pour le jeune comme pour l’entreprise, il peut y avoir un manque de lisibilité et un risque de confusion, avec certains dispositifs ou acteurs pouvant même se concurrencer entre eux.
Outre la simplification des dispositifs publics que les rapporteurs préconisent, il convient dès lors d’améliorer l’information des entrepreneurs, ce qui pourrait être fait dans le cadre d’actions visant, plus globalement, à accompagner les entreprises et à mieux capitaliser et diffuser les bonnes pratiques.
b. Capitaliser et soutenir la diffusion des bonnes pratiques des entreprises
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont eu connaissance de plusieurs démarches très positives et intéressantes, notamment :
– la méthode de recrutement par simulation (MRS), qui permet d’aborder autrement le recrutement : fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail, cette méthode, développée par Pôle Emploi, consiste à repérer l’ensemble des capacités nécessaires pour réaliser un travail lors d’analyses de postes en entreprise, puis à construire des exercices permettant de les évaluer chez les candidats, en dépassant ainsi les critères traditionnels de recrutement (diplôme, expérience) qui pénalisent de fait les jeunes peu ou pas qualifiés ;
– le dispositif « 100 chances – 100 emplois », initié par le groupe Schneider Electric (274), vise à permettre à des jeunes des zones urbaines sensibles d’acquérir des compétences et une expérience et de promouvoir l’égalité des chances par une parcours personnalisé d’insertion professionnelle ; il s’appuie notamment sur des partenariats intéressants entre acteurs publics et privés (entreprises, Dirrecte, rectorat, ville, Pôle Emploi, mission locale, etc.) ;
– le tutorat en entreprise ainsi que le parrainage, dans le cadre notamment d’associations (« Nos quartiers ont du talent ») ou de missions locales, par exemple à Redon (275), où des personnes bénévoles (salariés ou retraités) parrainent un jeune demandeur d’emploi, avec une proportion significative de sorties positives sur le territoire (entre 70 et 75 %) : il s’agit là d’un dispositif peu coûteux, qui permet de donner des conseils pratiques, faire des simulations d’entretien, solliciter des connaissances, et redonner ainsi confiance aux jeunes ;
– l’initiative du ministère délégué à la ville et du Sénat, « Talents des cités », qui récompense chaque année, depuis 2002, des entrepreneurs des quartiers, avec plusieurs entreprises partenaires ;
– les actions mises en œuvre par le groupe Casino (276), par exemple, outre le recours à la MRS évoquée plus haut : la mise en place d’un forum de recrutement sur Internet et d’un site sur l’alternance et les stages, avec des témoignages et des fiches métiers notamment, une page facebook pour permettre un échange plus direct avec les jeunes publics, des actions de proximité (informations métiers dans des CFA, lycées, collèges et universités, mais aussi des interventions pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi : CV, parrainage, simulations d’entretiens), l’accueil d’enseignants et de proviseurs au sein de l’entreprise, l’organisation de Trophées des apprentis, label diversité (277), etc.
Il conviendrait de mieux valoriser et faire connaître ce type d’actions positives, en s’inspirant par exemple du groupe de travail mis en place avec plusieurs entreprises (278) ainsi que Pôle Emploi et le CNML, et qui a conduit en 2010 à l’élaboration d’un guide « Tous gagnants ! Réussir ensemble l’intégration et la professionnalisation des jeunes en entreprise ». En associant les principaux acteurs publics et plusieurs entreprises, un document analogue pourrait ainsi être élaboré d’ici 2014 avec :
– les principaux outils de la politique de l’emploi, y compris les aides et nouveaux dispositifs déployés depuis 2012, les étapes du processus de recrutement et d’insertion des jeunes, en privilégiant le point de vue de l’entreprise ;
– des exemples de bonnes pratiques identifiées dans plusieurs entreprises ou missions locales, pour les capitaliser et encourager leur développement ;
– une large diffusion de ce guide, régulièrement actualisé, sur internet et auprès d’organisations professionnelles, entreprises, acteurs de l’emploi, etc.
Il conviendra par ailleurs de suivre attentivement les résultats de l’expérimentation annoncée, lors du comité interministériel (CIJ) de février 2013 en vue de lutter contre la discrimination à l’embauche. Le ministère en charge de l’Économie sociale et solidaire a en effet lancé un site internet présentant les CV de jeunes diplômés issus de quartiers défavorisés afin de les aider à surmonter les discriminations à l’embauche. Cette « CVthèque » dispose de 800 profils et la base de données est gratuite pour les TPE-PME et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Après évaluation, ce dispositif pourrait être généralisé.
D’autres pistes pourraient également être étudiées pour mieux valoriser les bonnes pratiques d’entreprises. Dans le cadre des travaux préparatoires à la conférence de lutte contre la pauvreté de fin 2012, et concernant plus globalement les questions d’insertion, un rapport (279) avait par exemple envisagé la possibilité de délivrer un label de « Haute qualité sociale », en s’inspirant du label HQE dans le domaine de l’environnement qui a contribué à faire évoluer les pratiques en matière de construction.
● Soutenir la diffusion des bonnes pratiques des entreprises susceptibles de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, en particulier peu qualifiés ou issus des quartiers (élaboration d’un guide avec des entreprises pour informer et capitaliser les bonnes pratiques, méthodes de recrutement, parrainages, etc.).
L’accès au premier emploi constitue une étape essentielle dans les parcours d’insertion : c’est pourquoi l’efficacité du service public de l’emploi et l’accompagnement apporté en particulier aux jeunes peu qualifiés doivent être améliorés. Mais au-delà, avant et après cette phase d’insertion des jeunes sur le marché du travail, il faut aussi développer les possibilités de se former et de valoriser au mieux les compétences acquises, dans le cadre de parcours diversifiés.
C. FAVORISER L'ACCÈS À LA QUALIFICATION ET MIEUX VALORISER LES COMPÉTENCES ACQUISES : DES PARCOURS MOINS LINÉAIRES
En France, les parcours d’insertion peuvent apparaître relativement linéaires (schématiquement, « se former d’abord, travailler ensuite ») par rapport à d’autres pays européens, tels que le Danemark.
Pour favoriser la mobilité sociale des jeunes, en encourageant notamment les allers et retours entre emploi et formation, il convient de faciliter l’accès des jeunes à la qualification, que ce soit par la formation professionnelle ou la reconnaissances des acquis de l’expérience, mais aussi de mieux valoriser les compétences susceptibles d’accroître leur employabilité, qu’elles soient acquises dans le cadre d’un service civique ou d’un emploi étudiant.
1. Favoriser l'accès des jeunes à la qualification tout au long de leur parcours, par la formation et la reconnaissance de l’expérience
Depuis plusieurs années, la notion de « formation tout au long de la vie » tend à se substituer à celles de formation initiale et de formation professionnelle continue, en soulignant la nécessité de dépasser le cloisonnement par statut (scolaire, demandeur d’emploi, actif, etc.) et, d’une certaine manière, de reconnaître l’égalité dignité des voies et des moments de formation, y compris « sur le tas ».
La possibilité de se former ou d’acquérir un diplôme à tout âge participe de la sécurisation des parcours professionnels, en favorisant la promotion sociale, en particulier pour les jeunes peu ou pas qualifiés. Il convient dès lors d’améliorer leur accès à la formation ainsi qu’à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
a. Faciliter l’accès à la formation et à la qualification tout au long de la vie, en particulier pour les moins diplômés
Depuis la loi fondatrice de 1971 (280), le dispositif français de formation professionnelle s’est construit en partie sur un idéal de promotion sociale.
Aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une « obligation nationale », qui vise à « permettre à chaque personne d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ». Il s’agit d’« un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés ».
Toutefois, si la formation professionnelle continue mobilise des financements considérables (281), et en dépit de plusieurs réformes, en particulier la loi du 24 novembre 20092009 (282), elle bénéficie de manière très inégale aux différentes catégories de la population. Le système actuel a même tendance à amplifier les inégalités engendrées par le fonctionnement du marché du travail : un cadre ou un ingénieur a ainsi une probabilité deux fois plus grande qu’un ouvrier d’avoir accès à une formation au cours d’une année.
En effet, le système actuel ne repose pas sur un ciblage des bénéficiaires par niveau de qualification ou sur une appréciation systématique de l’intensité des besoins en matière de formation. Les dispositifs existants sont de fait gérés par les différents financeurs de façon indépendante. Schématiquement, les régions financent la plus grande partie des formations destinées aux apprentis, les entreprises interviennent essentiellement pour les salariés en activité, tandis que l’État, les régions et Pôle emploi interviennent parallèlement pour financer la formation des différentes catégories de demandeurs d’emploi.
De ce fait, comme l’a souligné récemment la Cour des Comptes (283), « les personnes sans qualification à l’issue de leur formation initiale, estimées à 130 000 par an » et « les personnes peu formées ne constituent pas les principaux bénéficiaires et, pour certains dispositifs, n’appartiennent pas au public cible. Ce système de formation ne fournit donc aux salariés peu formés, ni la possibilité de saisir une " seconde chance" à travers la formation, ni les instruments adéquats pour se maintenir dans l’emploi ».
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu observer que dans certains pays voisins, en particulier le Danemark, il est plus fréquent de revenir en formation en cours de carrière afin d’élever son niveau de qualification et pouvoir évoluer professionnellement, ce que confirme également les données présentées ci-après.
Un accès plus fréquent aux formations certifiantes dans des pays voisins : peu de salariés français présentent un diplôme ou un titre en cours de carrière
Les salariés français accèdent plutôt davantage que la moyenne des salariés européens à la formation, mais ils sont très peu nombreux à tenter un diplôme ou un titre au cours de leur carrière. Ainsi, environ 1 % des salariés accèdent à une formation certifiante chaque année (Bonaïti, Viger, 2008). L’offre de formations certifiantes accessibles en parallèle à une activité professionnelle (comme par exemple les cours du soir) est faible en France. Ce constat est relativement paradoxal dans un pays où la détention d’un diplôme conditionne fortement les carrières professionnelles. Les personnes ayant eu de longues périodes sans emploi ont davantage de chances d’accéder à une formation certifiante. L’introduction du droit individuel à la formation (DIF) n’a pas sensiblement changé à cet état de fait. La plupart des formations qu’il a suscitées restent courtes. Les pays scandinaves ou le Royaume -Uni se caractérisent par une bien plus forte présence de formations certifiantes en cours de carrière : 8 à 9 % des actifs accèdent chaque année à de telles formations.
Sur la période récente, des évolutions importantes sont toutefois intervenues dans le domaine de la formation professionnelle.
Tout d’abord, l’ANI du 11 janvier 2013 a prévu la création d’un compte personnel de formation (CPF), dont les principes sont désormais inscrits dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Celle-ci prévoit ainsi qu’ « afin de favoriser son accès à la formation tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation (284)». Le CPF doit être alimenté, entre autres, « par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l'accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 [dont le texte est reproduit ci-dessous] en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. »
Le droit de progresser d’au moins un niveau de qualification par la formation :
le principe posé par la loi (article L. 6314-1 du code du travail)
« Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP); 2° soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP). »
Les modalités de mise en œuvre du CPF doivent être précisées dans le cadre de la négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle et de la concertation quadripartite entre l’État, les régions et les partenaires sociaux, qui sont actuellement en cours (285).
D’autre part, la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République pose le principe selon lequel « tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire (286). »
Par ailleurs, il a été évoqué à plusieurs reprises au cours des travaux de la mission la question d’une forme de droit à l’éducation-formation tout au long de la vie, préconisée notamment par la plateforme associative « Pour un big bang des politiques de jeunesse (287)», l’UNML ou encore le sociologue Camille Peugny.
En tout état de cause, le dispositif de formation professionnelle doit être mieux mobilisé pour permettre aux salariés les plus fragiles d’accéder à la qualification, et donc d’avoir des possibilités d’évolution professionnelle et de mobilité. Il s’agit en particulier de donner aux jeunes peu ou pas qualifiés des possibilités effectives de seconde chance. Ainsi, comme l’indique le texte de la plateforme précitée, « les jeunes qui quittent précocement le système scolaire sauront que tout n’est pas joué et qu’ils pourront par la suite mobiliser leur capital pour reprendre une formation. »
Éduquer pour s’insérer durablement, un droit à l’éducation-formation tout au long de la vie : la proposition de la plateforme « Pour un big bang des politiques de jeunesse »
« Dans le cadre du droit à l’éducation-formation tout au long de la vie, chaque jeune dispose à l’entrée dans le système scolaire d’un capital initial de formation de vingt années, garanti par l’État. Ce capital assure à chacun un volume minimal de formation, qui sera donc égal à la durée moyenne actuelle des études. Il sera utilisable dans le cadre de la formation initiale ou pourra être mobilisé ultérieurement (augmenté des droits supplémentaires constitués au travers de l’exercice d’une activité professionnelle) pour suivre une formation, reprendre des études, acquérir des compétences par d’autres voies.
Le premier objectif visé est de réduire les inégalités entre les jeunes en ouvrant plus largement à chaque jeune, quelles que soient les ressources de ses parents, le choix d’un parcours de formation. Beaucoup trop de jeunes renoncent à s’engager dans certaines filières pour des raisons financières. Le deuxième objectif est de rendre effectif ce que l’on appelle la seconde chance. Les jeunes qui quittent précocement le système scolaire sauront que tout n’est pas joué et qu’ils pourront par la suite mobiliser leur capital pour reprendre une formation. Le troisième objectif est de faciliter des parcours de qualification alternant formation, activités, emploi en sécurisant ces parcours. Au plan collectif, l’ambition est bien de franchir une nouvelle étape dans le relèvement du niveau de qualification des nouvelles générations, notre écart en la matière avec les pays nordiques ou le Japon est encore considérable. »
Texte à l’initiative de la FNARS, du CNAJEP, de l’UNML, Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), UNIOPSS, MRJC, UNHAJ, ANACEJ, ANMDA, GNDA. En avril 2012, 67 organisations nationales et 17 organisations régionales et locales en étaient signataires.
Source : « Pour un big bang des politiques de jeunesse », plateforme présentée par 38 organisations en novembre 2011
Dans le prolongement de cette proposition, et en tenant par ailleurs compte des évolutions législatives récentes et des négociations en cours, il pourrait être institué une forme de droit à la formation différée ou « droit de tirage », qui serait modulé en fonction du niveau de formation initiale. À l’occasion de la prochaine loi sur la formation professionnelle, et dans le cadre du compte personnel de formation, sur lequel les négociations pourraient se conclure en décembre prochain, il conviendrait d’étudier la possibilité de :
– doter chaque jeune d’un droit à un quota de formation, dont le nombre précis serait à définir en concertation avec l’ensemble des acteurs, en imputant sur ce droit les périodes de formation initiale (y compris celles de l’enseignement scolaire et universitaire) et continue ;
– à compter de l’entrée sur le marché du travail, de verser sur le compte personnel de formation la part de ce droit de tirage non utilisée.
● Instituer pour chaque jeune une garantie d’accès la formation et à la qualification par la création d’un droit de tirage, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et en tenant compte des résultats de la négociation en cours :
– qui consisterait à doter chaque jeune d’un droit à un quota de formation, en imputant sur ce droit les périodes de formation initiale et de formation continue ;
– à compter de l’entrée sur le marché du travail, verser sur le compte personnel de formation la part de ce droit de tirage non utilisée.
b. Simplifier la validation des acquis de l’expérience (VAE) en améliorant le suivi, l’accompagnement et l’accès à la certification
Avec la formation (scolaire ou continue), la validation des acquis de l’expérience (VAE) constitue une troisième voie d’accès aux diplômes et aux titres professionnels depuis la loi modernisation sociale du 17 janvier 2002.
● Des enjeux importants en termes d’accès à la qualification, de sécurisation des parcours et de promotion sociale
Aux termes de l’article L. 900-1 du code du travail, « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ».
Certifications professionnelles : diplômes, titres et CQP
La VAE permet d'obtenir, sur la base de son expérience professionnelle ou de ses activités, tout ou partie d’une certification à finalité professionnelle dès lors qu'elle est enregistrée au RNCP (288). Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury indépendant et incluant des professionnels. Chaque ministère ou chaque organisme certificateur concerné organise la délivrance de ses propres certifications par la VAE. On distingue trois grandes catégories de certification :
– les diplômes : ils sont délivrés par l'État, notamment les ministères chargés de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, de la jeunesse et des sports, de la santé et des affaires sociales ; en particulier, l'Éducation nationale reçoit près de 30 000 dossiers de VAE par an (le plus important des certificateurs en volume) et délivre les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel classés au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation (du CAP au BTS).
– les titres professionnels : certains sont également délivrés par l'État, notamment par le ministère en charge de l’emploi ; il s'agit principalement des titres mis en œuvre par l'AFPA, d’autres organismes que l'État pouvant aussi être certificateurs à condition que leurs titres soient enregistrés au RNCP ;
– les certificats de qualification professionnelle (CQP) : ils sont délivrés par les branches professionnelles (regroupement d'entreprises relevant d'un même secteur d'activité et d'un même accord collectif) qui les ont créés. Les CQP sont accessibles par la VAE dès lors qu'ils sont inscrits au RNCP.
Source : ministère de l’Éducation nationale
La VAE constitue ainsi un outil d’accès à la qualification, qui permet de concilier la reconnaissance des savoir-faire professionnels avec une culture encore très marquée par le poids des diplômes. Il constitue aussi « l’un des outils de promotion sociale », comme l’a justement souligné le CESE (289).
Une qualification reconnue par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP, présenté dans l’encadré ci-après) constitue un gage de lisibilité des compétences, susceptible de renforcer l’employabilité, la mobilité et la sécurisation des parcours professionnels. C’est la raison pour laquelle le ministère chargé de l’emploi pilote des plans concertés de développement de la VAE au niveau territorial en s’appuyant, selon les régions, sur des conférences de financeurs et des diagnostics territoriaux.
S’il s’agit d’un droit individuel, l’employeur peut décider d’inscrire des actions de VAE dans le plan de formation de l’entreprise (290). À la demande du salarié, un congé de VAE peut lui être accordé, dans la limite de 24 heures.
● Un dispositif toutefois peu mobilisé, s’agissant en particulier des jeunes
La VAE est un droit ouvert à tous (salariés, agents publics, bénévoles, personnes ayant exercé des responsabilités syndicales, etc.), à la condition de pouvoir justifier de trois années d’activité en rapport avec le diplôme, titre ou certificat visé (291). Les périodes de formation initiale et continue ainsi que les stages et périodes de formation en milieu professionnel accomplis n’entrent pas compte dans la durée d’expérience requise pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre.
Cette condition contribue sans doute à expliquer, au moins en partie, la faible part des jeunes parmi les candidats à la VAE, comme l’illustre le tableau ci-après pour ce qui concerne la VAE dans les ministères certificateurs en 2011.
PROFIL SELON L’ÂGE DES CANDIDATS PRÉSENTÉS À LA VAE EN 2011
DANS LES MINISTÈRES CERTIFICATEURS
Moins de 30 ans |
De 30 à 39 ans |
De 40 à 49 ans |
50 ans ou plus | |
Ministère de l’Éducation nationale |
9,9 % |
35,6 % |
40,5 % |
14,0 % |
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche |
6,4 % |
36,8 % |
39,7 % |
17,1 % |
Ministère chargé de l’agriculture |
14,2 % |
40,9 % |
32,8 % |
12,2 % |
Ministères chargés de la santé et des affaires sociales |
7,9 % |
25,3 % |
41,9 % |
24,9 % |
Ministère chargé de l’emploi (hors centres agréés) |
20,3 % |
28,4 % |
34,2 % |
17,1 % |
Ministère de la défense |
2,2 % |
41,2 % |
40,0 % |
16,6 % |
Ministères chargés des affaires maritimes |
1,1 % |
17,8 % |
64,4 % |
16,7 % |
Ensemble |
10,2 % |
31,4 % |
40,1 % |
18,4 % |
NB : Pour des raisons de disponibilité, le bilan de la Dares ne porte que sur les certifications des ministères accessibles par la VAE, hors ministère de la jeunesse et des sports. S’agissant du tableau ci-dessus, les données du ministère de la culture ne sont pas disponibles et, pour les ministères des affaires sociales et de la santé, les données sont hors CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social ou sde ervice d’intervention sociale).
Source : DARES (« La VAE en 2011 dans les ministères certificateurs», Dares Analyses n° 91, décembre 2012
Les ministères ne sont toutefois pas les seuls à permettre l’accès par cette voie à leurs diplômes ou titres professionnels. Les branches professionnelles ont ainsi rendu leurs certificats de qualification professionnelle (CQP) accessibles à la VAE (292). Il en va de même pour les organismes consulaires (chambres de commerce et d’industries, chambres de métier et de l’artisanat et chambres d’agriculture) et certains organismes privés.
La dispositif de VAE fait également intervenir de nombreux acteurs en matière d’information sur la démarche. En particulier, les centres et points information conseil (PIC) sont placés sous la responsabilité des conseils régionaux, qui définissent également les priorités relatives à la VAE (293) dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF). Les certificateurs, qui peuvent être de statut public ou privé, contribuent toutefois également à l’information sur ce dispositif.
Or cette multiplicité d’acteurs, illustrée dans le schéma ci-après, pose une première difficulté en termes de centralisation des données, et donc de suivi et de pilotage des actions de VAE, comme cela a été évoqué au cours de la table ronde organisée sur ce sujet. En effet, il n’existe pas aujourd’hui de système d’information unique pour suivre les candidats dans leur globalité, chaque certificateur étant responsable des données relevant de son autorité.
LES ACTEURS DE LA VAE (2008)
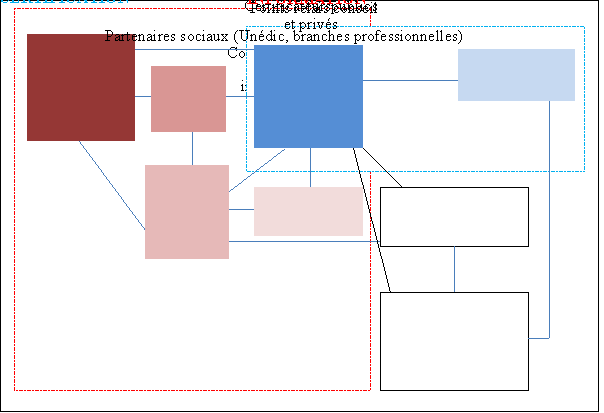
Source : d’après le rapport « Valoriser l’acquis de l’expérience : une évaluation du dispositif de VAE », rapport d’Eric Besson, Secrétariat d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques (septembre 2008).
● Une procédure lourde et complexe : le « parcours du combattant » des candidats à une VAE
Le nombre de certifications délivrées au nom de l’État (environ 25 000 en 2012) peut apparaître assez faible rapportée à l’ensemble de la population active (28,4 millions), et plus particulièrement à la population cible de bénéficiaires potentiels pour la VAE, qui avait été estimé à 6 millions d’actifs en 2008 par le rapport précité du secrétariat d’État chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques. Celui-ci relevait d’ailleurs que « seuls 26 000 [avaient] été certifiés par cette voie en 2006, loin de l’objectif de 60 000 affiché par le plan de développement gouvernemental », en déplorant une procédure « trop longue, peu lisible et dissuasive ».
NOMBRE DE CERTIFIÉS (TOUS MINISTÈRES) PAR LA VOIE DE LA VAE
2011 Réalisations |
2012 Réalisations |
2013 Prévision PAP 2013 |
2013 Prévision actualisée |
2014 Prévision |
2015 Cible |
29 813 |
25 502 |
32 000 |
31 000 |
32 000 |
34 000 |
Il s’agit de certifications délivrées au nom de l’État (les certifications paritaires et privées ne sont pas comptabilisées). La notion de certification est entendue au sens strict d’une certification obtenue par un candidat après validation complète du titre ou du diplôme visé (exclusion des validations partielles). Hors périmètre : ministères de la jeunesse et des sports, de la culture et de l’enseignement supérieur.
Source : indicateur 4.4 « Accès à la VAE » du PAP du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » annexé au projet de loi de finances pour 2014
Rejoignant cette analyse, le Conseil économique, social et environnemental a également observé, dans un rapport paru fin 2011 (294), que le dispositif « n’est pas encore parvenu à maturité avec seulement 32 000 titres ou diplômes obtenus, en 2009, par la VAE ». En outre, « sa mise en œuvre reste perfectible. L’obtention d’une certification, souvent complexe et longue, est encore trop fréquemment décrite comme un " parcours du combattant " par les candidats ». Ce constat reste largement valable, compte tenu des différentes démarches nécessaires dans le cadre d’une procédure de VAE.
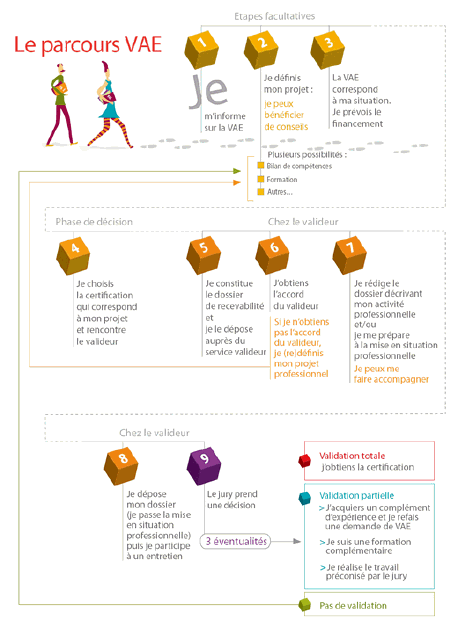
Source : CARIF Ile de France (Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation)
Comme l’ont souligné plusieurs personnes entendues par la mission, on observe ainsi une « déperdition des candidats » tout au long du parcours, ce qu’illustre le graphique ci-après, du fait notamment d’un manque d’information mais aussi d’accompagnement. Or celui-ci est d’autant plus nécessaire que les dossiers peuvent être difficiles à constituer : en particulier, une faible maîtrise de l’écrit est susceptible d’être un vrai frein pour certains candidats. De même, il peut être difficile de repérer la bonne certification correspondant à son expérience, compte tenu du nombre très important de titres et diplômes accessibles par la VAE.
NOMBRE DE CANDIDATS RECEVABLES, PRÉSENTÉS ET REÇUS EN 2011
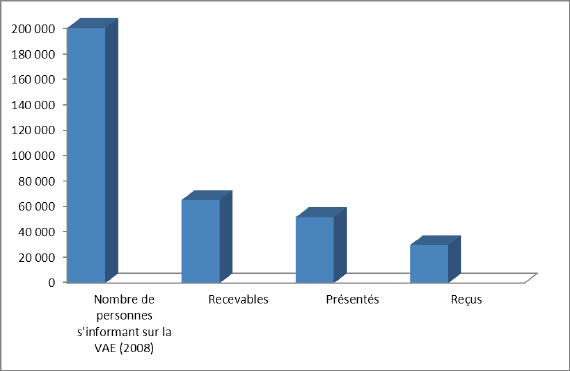
Source : graphique réalisé d’après les données de la Dares sur la VAE dans les ministères certificateurs (Dares analyses, décembre 2012) et l’estimation du nombre de personnes s’informant sur la VAE présentée dans le rapport précité de 2008
Le Forum français de la Jeunesse préconise à cet égard de développer l’accompagnement, mais aussi de renforcer l’information et de simplifier les démarches, en soulignant que le dispositif « reste très méconnu des jeunes ».
Les recommandations du Forum français de la jeunesse (FFJ) concernant la VAE et la reconnaissance de l’action associative, syndicale et politique des jeunes
« Proposition 12 : Reconnaître l’action associative, syndicale et politique des jeunes. Alors que nous fêtons les 10 ans de la VAE, ce dispositif reste très méconnu des jeunes. La loi de 2002 sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) a reconnu pour la première fois l’expérience bénévole comme une composante d’un parcours, au même titre que l’expérience professionnelle. Cette disposition doit être généralisée dans sa mise en œuvre. Il conviendrait notamment de renforcer l’information, simplifier les démarches et développer l’accompagnement. Cette reconnaissance de l’engagement doit aussi s’inscrire dans le cadre de formation (lycéenne, universitaire, en apprentissage, etc.) comme partie intégrante des cursus »
Source : Avis n°2 du Forum français de la jeunesse (FFJ), « De nouvelles politiques en direction des jeunes » (2013)
Une remobilisation de ce dispositif est toutefois attendue, suite au chantier lancé par le Gouvernement à l’issue de la seconde conférence sociale de juin 2013. En effet, constatant également que la VAE « est encore trop peu mobilisée dix ans après sa création », la feuille de route sociale de juin 2013 a prévu la mise en place d’un groupe de travail interministériel « afin d’examiner les voies et moyens d’en élargir l’accès (modalités de validation, condition de mobilisation des jurys…). Plus largement, il fera des propositions visant un accès plus fluide à la certification afin de renforcer les possibilités d’individualisation des parcours ».
● Les voies d’amélioration
La question de la VAE soulève des enjeux qui dépassent très largement le champ du présent rapport et, là encore, justifierait, à elle seule, de faire l’objet d’une mission d’évaluation. Les principaux rapports publiés sur ce sujet il y a quelques années (295) l’ont d’ailleurs été au terme de plusieurs mois d’investigations.
Toutefois, au regard de ses enjeux en termes d’élévation des niveaux de qualification et de mobilité sociale, les rapporteurs souhaitent formuler quelques orientations stratégiques afin de redonner un nouvel élan à la VAE. Pour cela, les efforts doivent être intensifiés dans trois directions :
– Renforcer la visibilité et favoriser un plus large accès au dispositif.
Une stratégie nationale d’information pourrait tout d’abord être déployée, avec des actions ciblées sur certains publics, en particulier dans les établissements d’enseignement et les missions locales. En outre, les possibilités d’assouplissement de la durée et des modalités de prise en compte de l’expérience requise mériteraient d’être examinées attentivement, compte tenu des trajectoires professionnelles plus instables des jeunes, mais en veillant aussi à ce que le diplôme obtenu par cette voie ne puisse être considéré comme un « diplôme au rabais ».
Par ailleurs, l’existence de plus de 15 000 titres et diplômes, délivrés au nom de l’État ou d’institutions privées, peut dérouter des candidats à la VAE et rend par ailleurs plus complexe le travail des personnels chargés de les accueillir et de les orienter. Il faudrait donc réduire le nombre de certifications, et sans doute aussi, revoir leur articulation, pour en améliorer la lisibilité.
– Améliorer l’accompagnement et simplifier les démarches.
Pour mieux accompagner les jeunes dans ces démarches, il serait tout d’abord souhaitable qu’ils puissent disposer d’un référent unique tout au long de leur parcours. En outre, certaines démarches pourraient être adaptées, par exemple en accordant une part moins importante à l’écrit pour des titres concernant des métiers manuels.
Il conviendrait également de raccourcir les délais de traitement des dossiers (à la fois pour l’examen de la recevabilité et pour la réunion du jury) et d’envisager, par exemple, l’élaboration d’une charte de l’accompagnement, voire une démarche qualité avec un label susceptible d’être accordé aux organismes. Les démarches de VAE en entreprise doivent également être soutenues. Des actions intéressantes dans ce domaine ont par exemple été mises en œuvre par le groupe Mc Donald’s.
– Renforcer le suivi et le pilotage.
Pour renforcer l’efficacité de l’action publique, un préalable doit être d’améliorer le recueil des données et le suivi des parcours des candidats, afin de mieux identifier les freins et les situations d’abandons, et de renforcer également la coordination des acteurs. Dans ce sens, le déploiement d’un système d’information commun aux administrations et principaux organismes concernés permettrait d’assurer un suivi statistique coordonné par le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, en lien avec les observatoires régionaux emploi formation (OREF).
Enfin, si les compétences acquises au cours d’une expérience associative peuvent d’ores et déjà être reconnues dans le cadre de la VAE, et ainsi donner lieu à la délivrance d’un titre, il est également important d’aider les étudiants à mieux valoriser les compétences acquis dans ce cadre, en termes de savoir-faire et savoir-être, qui peuvent leur être utiles dans leur parcours d’insertion professionnelle.
Dans ce sens, l’association Animafac, dont un représentant a entendu par la mission, a par exemple développé en 2009 des actions très intéressantes, dans le cadre du programme « Bénévolat et compétences », qui a été expérimenté pendant deux ans avec le soutien du FEJ. Il avait pour objet de permettre aux étudiants de valoriser les compétences acquises au cours de leur expérience associative, à travers la mise à disposition d’un portfolio de compétences et des actions de sensibilisation auprès des entreprises (296). Au cours des auditions de la mission, ont également été évoquées des expérimentations du FEJ concernant le portefeuille d’expériences et de compétences (PEC) (297).
Pour encourager le développement de ces pratiques, qui concourent, de même que la VAE, au signalement de compétences sur le marché du travail, et faire ainsi un atout professionnel d’une expérience associative, il conviendrait notamment d’élaborer et de diffuser largement un guide méthodologique pour capitaliser sur ces diverses expériences et bonnes pratiques en matière de reconnaissance des compétences non formelles.
● Mieux valoriser les compétences acquises par les jeunes, dans un cadre professionnel ou associatif, et simplifier la VAE :
– renforcer la lisibilité et favoriser un plus large accès à la VAE, par le développement de l’information sur la VAE (notamment dans les établissements d’enseignement et les missions locales), la simplification du système des certifications et l’examen approfondi des possibilités éventuelles d’assouplissement des dispositions relatives à la durée d’expérience ;
– simplifier les démarches et améliorer l’accompagnement, par l’institution d’un référent unique tout au long du parcours, la diminution des délais de traitement des dossiers et l’adaptation des modalités de validation ;
– renforcer le pilotage, par un meilleur suivi du dispositif (système d’information avec un suivi statistique coordonné), pour mieux identifier les freins et les situations d’abandons ;
– diffuser un guide pour capitaliser et développer les bonnes pratiques de reconnaissance des compétences non formelles (portefeuilles de compétences, etc.).
2. Au-delà des titres et diplômes, soutenir et valoriser l’acquisition de compétences susceptibles d'accroître l'employabilité des jeunes
S’il est important de favoriser l’accès des jeunes à la formation et à la VAE, qui peuvent leur permettre d’obtenir un diplôme en cours de carrière, il faut aussi pouvoir « sortir des logiques d’âge et de qualification », comme le souligne l’étude réalisée par KPMG/Euréval, dans la mesure où il peut être parfois « plus utile de raisonner en termes d’employabilité que de qualification »
De ce point de vue, les expériences acquises lors d’un engagement lors d’un service civique, d’un emploi à temps partiel pendant les études ou même d’un « job d’été » peuvent aussi concourir à l’insertion professionnelle et la mobilité sociale des jeunes.
a. Conforter le rôle du service civique en termes de mobilité sociale
Institué par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 (298), le service civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée de six à douze mois pour une mission d’intérêt général dans le cadre d’une association, d’un établissement public ou d’une collectivité. Il s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans et donne droit à une indemnisation de 573 euros par mois pour une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures. L’organisme d’accueil assure au jeune un tutorat, une réflexion sur son projet d’avenir et une formation civique et citoyenne.
Le service civique a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale des jeunes. Entendue au sens large, la mixité sociale comprend à la fois la diversité des profils des jeunes et des missions, ainsi que le « brassage » social et culturel que permet l’exécution de l’engagement citoyen. Cet engagement permet notamment aux volontaires d’effectuer une mission dans un environnement différent de celui où ils évoluent habituellement, au contact de publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés.
Le service civique
Mis en œuvre par l’Agence du service civique (ASC), le service civique a vocation à faire émerger une génération de personnes engagées en leur permettant de consacrer du temps au service de la collectivité à travers une expérience reconnue et valorisée dans leur parcours. Il s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent ainsi bénéficier d’un engagement citoyen, d’une chance de vivre de nouvelles expériences et d’une opportunité de se rendre utile. En 2011, 13 400 jeunes ont été concernés. En 2012, ils devraient être 20 000 et à terme 100 000 d’entre eux devraient bénéficier de ce dispositif, financé par l’État et développé en lien étroit avec les associations et les collectivités territoriales. L’objectif 2013 est d’accueillir 30 000 jeunes dans le dispositif.
La principale forme d’engagement volontaire du service civique est l’engagement de service civique ; réservé à des jeunes de 16 à 25 ans, il donne droit à une indemnisation directement versée par l’État, abondée en espèces ou en nature par la structure d’accueil et à une couverture sociale (y compris vieillesse) intégralement prise en charge par l’État. Une aide financière au titre de l’accompagnement du jeune en service civique est en outre servie à la structure d’accueil s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif (association sans but lucratif régulièrement déclarée, fondation reconnue d’utilité publique …).
La seconde forme de service civique est le volontariat de service civique, d’une durée de 6 à 24 mois ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans auprès d’associations ou de fondations agréées mais dont seule une partie de la couverture sociale est prise en charge par l’État.
La mise en œuvre de ce projet est confiée par la loi à une structure dédiée : l’Agence du service civique. Structure de gestion, d’animation et de communication, elle s’appuie sur le réseau des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), le service civique étant également un enjeu de proximité et de mixité sociale locale.
Source : PAP pour 2013 du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative »
● Engagement volontaire au service de l’intérêt général, le service civique peut également favoriser l’insertion professionnelle des jeunes…
S’il n’a pas été pas été conçu à cette fin, l’engagement en service civique peut être de nature à favoriser l’insertion professionnelle. Cela ne signifie pas pour autant que le service civique est un palliatif à l’emploi ou une formation professionnelle dérivée. Il doit ainsi correspondre à une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles, sans s’y substituer. Cela illustre aussi la complémentarité de l’insertion sociale et professionnelle : en favorisant l’acquisition de compétences, y compris en termes de savoir-être, et la participation des jeunes à des projets d’utilité sociale, les missions de service civique sont susceptibles de leur redonner confiance et de renforcer leur employabilité future ou leur capacité de reprendre leurs études.
Au cours des travaux de la mission, il a ainsi été indiqué que si 40 % environ des jeunes sont demandeurs d’emplois à l’entrée du service, de l’ordre 20 % d’entre eux le sont encore six mois après leur sortie.
Le décret n° 2011-1009 du 24 août 2011 prévoit la valorisation du service civique dans les formations post baccalauréat ainsi que dans la validation des acquis de l’expérience. Une attestation de service civique est délivrée à la personne volontaire à l’issue de sa mission. Cette attestation est accompagnée d’un document complémentaire décrivant les activités exercées, les aptitudes recensées, les connaissances et les compétences acquises par le volontaire pendant la durée de son service civique.
… et contribue à améliorer la prise en charge des décrocheurs.
Présenté en décembre 2012 par le ministre de l’Éducation nationale, le dispositif « objectif formation-emploi » pour les jeunes décrocheurs vise à permettre à 20 000 jeunes sortis sans diplôme du système éducatif de raccrocher de manière effective d’ici fin 2013. Plusieurs mesures étaient prévues, notamment « des offres combinées service civique/formation » en partenariat avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et l’Agence du service civique, pour permettre à des jeunes décrocheurs d’acquérir une expérience professionnelle tout en construisant un projet de formation.
Service civique et lutte contre le décrochage scolaire
Le service civique permet aux jeunes en situation de décrochage scolaire de construire, pendant leur mission, un projet personnel ou professionnel.
– L’option « service civique à plein temps ». Un jeune en situation de décrochage scolaire se voit proposer un service civique à temps plein avec en parallèle, un accompagnement pendant toute cette période par un référent de l’Éducation nationale. En bénéficiant de cette première expérience, il peut reprendre confiance et s’investir dans un projet personnel ou professionnel.
– L’option « en alternance ». Un jeune en situation de décrochage scolaire se voit proposer une alternance entre une mission de service civique et une formation au sein d’un établissement scolaire. C’est un service civique de trois jours par semaine autour de missions identiques à celles d’un volontaire engagé à temps plein. Les deux autres jours, le jeune bénéficie d’un parcours personnalisé dans un établissement scolaire où il est pris en charge pour une remise à niveau, des activités d’enseignement orientées sur la découverte des différents secteurs, un temps de travail sur la construction de son projet personnel et professionnel et un bilan du déroulement de son service civique.
À l’issue de celui-ci, une solution est proposée à chacun d’entre eux : reprise d’une scolarité, apprentissage, contrat de professionnalisation ou emploi.
Source : Agence du service civique (2013)
Selon le rapport du comité interministériel (CIJ) de février dernier, l’objectif fixé pour l’année 2013 est de 3 000 jeunes décrocheurs bénéficiaires d’une offre combinée service civique – formation. Dans le cadre de la montée en charge du service civique au cours des prochaines années, il conviendrait d’accroître le nombre de jeunes concernés par ce dispositif, étant précisé que son coût pourrait être modulé pour les volontaires à temps partiel (cf. infra). La ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a d’ailleurs indiqué récemment (299) qu’ « en 2014, 5 000 services civiques seront consacrés aux décrocheurs scolaires ».
● La montée en charge du service civique doit dès lors se poursuivre…
En concertation avec les partenaires du service civique, associatifs notamment, sa montée en charge doit se poursuivre au cours des prochaines années . Le PAP du programme n° 163 Jeunesse et vie associative indique à cet égard que « la montée en charge pour atteindre l’objectif de 100 000 jeunes dans le dispositif en 2017 se poursuit à un rythme crédible et soutenable pour les finances publiques. C’est ainsi que 30 000 jeunes devraient avoir bénéficié du dispositif en 2013, avec un objectif supérieur, à 31 000, pour 2014. »
Il convient toutefois de préciser que l’évolution du nombre de bénéficiaires peut être appréciée différemment selon les modalités de décompte retenues (en flux ou en stock notamment). Des acteurs associatifs ont estimé à cet égard que les objectifs fixés ne pourront être atteints en 2013 (300). En tout état de cause, si l’on veut parvenir à l’objectif de 100 000 jeunes en service civique à l’horizon 2017, il conviendra d’éviter les gels et surgels de crédits en cours d’année, qui se sont traduits en 2013 par des refus de demandes de missions et des durées moyennes plus faibles. Ces gels ont rendu plus difficile l’engagement des structures associatives qui accueillent les volontaires. Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de consacrer 146 millions d’euros aux « Actions particulières en direction de la jeunesse », contre 144,95 millions d’euros en 2013, ce qui correspond à une progression de 0,7 %. Dans le contexte budgétaire actuel, la légère augmentation de ces crédits, exclusivement affectés au service civique, témoigne de la volonté gouvernementale de permettre à celui-ci de poursuivre sa montée en charge, après une année 2013 marquée par un gel de 23 millions d’euros. Les crédits confortés en 2014 seront, en outre, complétés par une contribution du fonds d’expérimentations pour la jeunesse (FEJ), qui s’élèvera à 3 millions d’euros, portant le total des crédits destinés au service civique l’an prochain à 149 millions d’euros.
De manière générale, les rapporteurs ont privilégié la recherche d’une optimisation des financements, plutôt qu’une augmentation systématique de ceux-ci. En l’occurrence, dans la mesure où l’objectif de 100 000 jeunes nécessite une montée en puissance importante du dispositif, une augmentation des financements est souhaitable, mais devrait être accompagnée par une diminution du coût unitaire du service civique. Au cours des travaux de la mission, plusieurs pistes ont été évoquées en ce sens, concernant notamment :
– d’une part, l’adaptation des indemnisations en fonction des situations (en particulier, les jeunes décrocheurs en service civique à temps partiel) : celui-ci pourrait ne pas être forfaitaire, mais dépendre en partie du nombre d’heures effectuées par le volontaire en service civique ;
– d’autre part, le réexamen des conditions d’assujettissement aux cotisations sociales (qui représenteraient de l’ordre de 380 euros par rapport à un coût unitaire du service civique de 1 000 €). Dans ce cas, il conviendrait toutefois de veiller à ce que cela n’entraîne pas de diminution des droits sociaux des volontaires, comme l’a observé l’une des personnes.
Le rapport spécial sur les crédits de la mission « Jeunesse, sports et vie associative » pour 2014 (301) indique à cet égard que « grâce à une optimisation du dispositif de cotisations sociales résultant des nouvelles dispositions législatives applicables en matière de retraite, le coût moyen du service civique pour l’État a pu être abaissé cette année de 1 000 à 800 euros par mois et par volontaire, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d’extension du nombre de bénéficiaires au cours des prochaines années ». Cette baisse du coût unitaire du service civique pourrait ainsi permettre d’atteindre plus facilement l’objectif de 31 000 pour 2014.
Par ailleurs, si le programme n° 163 doit demeurer le socle du financement du service civique et si l’on veut assurer sa montée en charge financière sans remettre en cause les autres politiques relevant de la jeunesse et de la vie associative, une réflexion pourrait être menée, dans la perspective du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ), sur la diversification du financement de l’Agence du service civique, avec la participation d’autres ministères comme l’éducation nationale ou l’emploi.
● … en veillant à soutenir l’accès des jeunes de niveau infra bac au dispositif.
En novembre 2011, un rapport de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur le service civique (302) avait déploré « une mixité sociale encore imparfaite », avec une population essentiellement féminine et diplômée.
Depuis lors, la part des jeunes peu ou pas diplômés a toutefois progressé, comme l’indique le tableau ci-dessous, cet indicateur visant « vise à vérifier que des jeunes peu ou pas diplômés bénéficient de ce dispositif dans des proportions un peu supérieures à leur part dans la classe d’âge correspondante sans que cette proportion ne conduise à évincer les volontaires plus diplômés », selon une annexe au projet de loi de finances pour 2014 précise. En dépit de cette évolution positive, on peut relever une différence de cinq points entre la prévision initiale (30 %) et la réalisation pour 2012 (25 %).
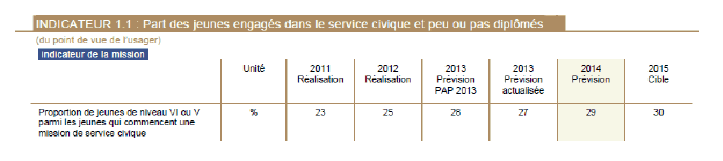
Source : indicateur 1.2 du PAP du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » annexé au PLF pour 2014
Tout en préservant le principe d’ouverture à tous du dispositif, il convient d’encourager l’engagement des jeunes peu ou pas diplômés dans des missions de service civique (niveau inférieur au baccalauréat), mais aussi des jeunes résidant dans les quartiers par exemple. De ce point, l’étude des profils et de l’origine sociale des jeunes volontaires mériterait d’être approfondie, s’agissant en particulier des jeunes résidant dans des zones urbaines sensibles (ZUS) ou d’éducation prioritaire (ZEP). Il serait également intéressant d’engager des travaux d’évaluation pour mieux connaître le parcours et le devenir des anciens bénéficiaires.
En octobre 2013 (303), la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a indiqué à cet égard que « même s’il ne s’agit pas d’un emploi mais d’un engagement volontaire, celui-ci conduira un certain nombre de jeunes, qui ont besoin d’être réorientés, à s’engager. La part des non diplômés, ou infra-bac, est, elle, passée de 26 % à 27,5 % : c’est une petite progression et il faudra aller plus loin. »
Enfin, la souplesse du dispositif est un point important du fonctionnement de l’Agence du service civique. Toutefois, au cours des travaux de la mission, il a été souligné l’existence d’inégalités entre les opérateurs (une association atteignait ainsi plus de 40 % d’infra bac, tandis que dans d’autres, cette proportion ne représentait que 10 % de leurs effectifs), mais aussi que les objectifs devraient être portés, plus globalement et de façon contractuelle, par chacun des opérateurs, et non uniquement par l’agence, pour éviter de trop grandes disparités. L’une des personnes entendues par la mission a également regretté que des prérequis ou compétences particulières soient demandés dans le cadre d’offres de volontariat.
● Conforter le rôle du service civique en faveur de la mobilité sociale des jeunes :
– poursuivre la montée en charge du service civique et accroître le nombre d’offres combinées service civique-formation en direction des décrocheurs scolaires ;
– dans la perspective du prochain comité interministériel sur la jeunesse, diversifier le financement de l’Agence du service civique entre les ministères concernés ;
– fixer un objectif de volontaires non bacheliers en veillant à ce que l’effort nécessaire pour atteindre cet objectif soit réparti entre les structures accueillant les volontaires ;
– engager des travaux d’évaluation pour mieux connaître le parcours et le devenir des anciens bénéficiaires.
b. Soutenir l’emploi étudiant sous certaines conditions
● De façon générale, le cumul emploi-études (y compris l’alternance) a progressé, mais reste moins développé que dans certains pays européens
Du fait notamment du développement de l’apprentissage, la proportion de jeunes cumulant emploi et études a sensiblement progressé en France au cours de la dernière décennie, comme l’illustre le graphique ci-après.
DÉVELOPPEMENT DU CUMUL EMPLOI ET ÉTUDES EN FRANCE ENTRE 1991 ET 2007
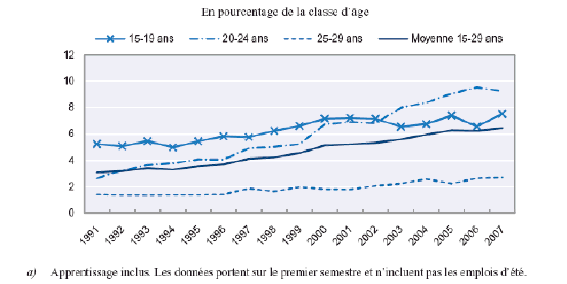
Source : OCDE (Des emplois pour les jeunes, rapport France, 2009)
S’agissant des jeunes inscrits dans l’enseignement supérieur, il ressort d’une enquête réalisée par l’Observatoire de la vie étudiante (304) en 2010 que près des trois quarts des étudiants déclaraient exercer au moins un emploi pendant l’été et/ou l’année universitaire. En excluant les emplois exercés uniquement pendant les grandes vacances (« jobs d’été »), la proportion d’étudiants exerçant une activité rémunérée au cours de l’année universitaire représentait environ la moitié, comme l’illustre le graphique ci-après, et parmi ces derniers, il s’agissait, dans 68% des cas, d’une activité non liée aux études.
La principale motivation mise en avant reste d’ordre financier. 43 % voient le travail comme un moyen de financer leurs études et 40 % déclarent que le revenu du travail leur est indispensable pour vivre, ce qui soulève la question de son impact sur la réussite académique, en particulier pour les jeunes issus de milieux modestes, qui peuvent être contraints d’exercer une activité sans lien avec leurs études, et finalement incompatible avec la poursuite de celles-ci.
Par ailleurs, cette enquête suggère que la réalisation d’un stage durant les études supérieures se généralise, puisque 70 % des étudiants de master déclaraient au moins une période de stage pendant l’année universitaire 2009-2010. On observe toutefois des différences assez sensibles en fonction des sections (88 % pour les ingénieurs, 80 % en management, 63 % en droit et économie et seulement 51 % en lettres et sciences humaines et sociales).
ÉTUDIANTS ET EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE EN 2010
![]()
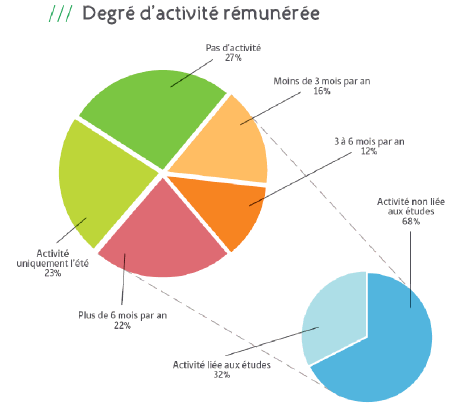
L’enquête interroge des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, y compris ceux en formation continue ou en apprentissage. Le travail étudiant, quelles qu’en soient la nature et l’ampleur, est ici recensé dans une acception large.
Source : Observatoire de la vie étudiante (2011, enquête Conditions de vie des étudiants)
En comparaison internationale, le taux d’emploi des jeunes de moins de trente ans apparaît plus faible que dans plusieurs pays voisins, comme cela a été souligné précédemment.
L’OCDE a ainsi souligné récemment (305) que le taux d’emploi pour la tranche d’âge des 15 à 24 ans est « faible » en France (légèrement inférieur à 50 %), mais aussi que « le cumul emploi-étude est peu développé ». Celui-ci est revanche plus fréquent dans d’autres pays européens notamment au Danemark ou en Allemagne, où les rapporteurs se sont rendus au printemps dernier.
TAUX D’EMPLOI DES JEUNES DE 15-29 ANS COMPARÉ À CELUI DES 20-54 ANS
(Pourcentage de la population de référence, moyenne 2001-2012)
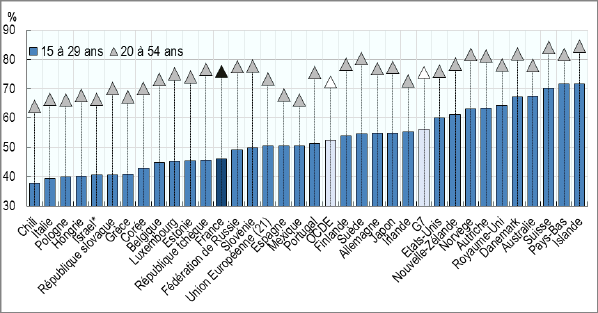
Source : OCDE (présentation de M. Stefano Scarpetta, directeur général de l’emploi et des affaires sociales en juin 2013)
Au-delà de la question de l’alternance et de la formation professionnelle, l’emploi étudiant semble en particulier plus fréquent dans le système danois, alors même qu’y existe un système d’allocation étudiante pour le moins généreux.
CUMUL EMPLOI-ÉTUDES EN 2010 EN FRANCE ET DANS PLUSIEURS PAYS DE L’OCDE
(en pourcentage de la population de 20 à 24 ans)
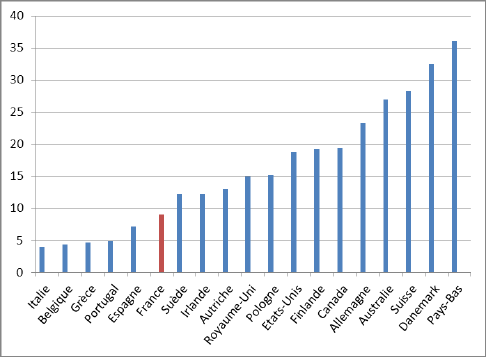
Source : graphique réalisé d’après les données présentées dans le rapport précité de l’OCDE d’avril 2013 (bases de données des statistiques de la population active 2012 et de l’Éducation 2012)
● Faire de l’emploi étudiant un atout, pour favoriser l’insertion des jeunes
Le modèle « étudier d’abord, travailler ensuite » semble trop abrupt pour permettre une permettre une transition fluide de l’école à l’emploi. Or, comme l’a observé l’OCDE, c’est « particulièrement le cas dans certains pays doté d’un système éducatif élitiste où des diplômes sélectifs sont très prisés par les employeurs, comme c’est le cas en Corée, en France ou au Japon (306) »
En effet, si dans les pays nordiques et au Canada notamment, les jeunes effectuent de nombreux va-et-vient entre études et emploi, avant de se stabiliser définitivement dans l’emploi, c’est moins le cas en France, où les périodes de « tâtonnement » avant l’entrée dans la vie active ne sont pas toujours bien vues.
Elles peuvent pourtant permettre d’acquérir une expérience et des compétences susceptibles d’accroître l’employabilité et de construire, pas à pas, un projet professionnel solide. Au-delà du diplôme, l’expérience acquise au cours des stages ou des emplois étudiants peut ainsi favoriser l’insertion et la mobilité des jeunes issus de milieux modestes ou peu diplômés. Pour cela, il peut être nécessaire d’améliorer l’accompagnement des jeunes et de simplifier les démarches. Pour autant, il ne saurait être question d’encourager le développement de l’emploi étudiant à n’importe quelle condition, la première étant de veiller à ce qu’il ne porte pas préjudice à la poursuite des études.
● Les conditions : des emplois compatibles avec la réussite universitaire
Alors que 23 % des étudiants salariés déclarent concilier difficilement études et travail, et ce d’autant plus que l’activité rémunérée est exercée durablement au cours de l’année universitaire, selon l’enquête précitée de l’OVE, plusieurs personnes entendues par la mission ont évoqué un seuil de 15 heures par semaine, au-delà duquel le travail étudiant risque plus fortement de pénaliser la poursuite des études.
Ainsi, selon le directeur de l’Institut de recherche sur l’éducation (IREDU), M. Jean-François Giret, entendu par la mission, « l’existence d’un seuil au-delà duquel le travail en cours d’études augmente considérablement les risques d’échec, en général évalué à 15 heures ou 20 heures par semaine, relève d’un consensus international validé par de nombreuses enquêtes dans plusieurs pays de l’OCDE. En France, les enquêtes montrent que le dépassement de ce seuil, tout au long de l’année, dans l’exercice d’un travail peu qualifié et sans lien avec la formation suivie, a toutes les chances de perturber le bon déroulement des études, de conduire à l’échec et à l’abandon des études plus tôt que prévu ». En deçà de ce seuil, l’effet du travail sur la scolarité semble ambigu. Plus que le nombre d’heures, c’est le type d’activité exercée qui s’avère déterminant sur le bon déroulement des études et il semblerait qu’en général l’effet négatif de l’activité professionnelle sera d’autant plus faible que celle-ci est plus ou moins directement liée aux études.
Plus largement, une importance particulière doit être accordée à la qualité de l’emploi exercé, notamment pour l’accompagnement apporté aux étudiants à la recherche d’un emploi. De ce point de vue, l’expérimentation « AQ3E », évoquée au cours des travaux de la mission, qui a été lancée dans l’université du Maine avec le soutien du FEJ, présente des résultats particulièrement intéressants.
« Améliorer la qualité des emplois exercés par les étudiants (AQ3E) » : une expérimentation intéressante dans la Sarthe en matière de conciliation emploi-formation
Projet porté par l’université du Maine, l’expérimentation part du constat que les étudiants travaillant plus de 15 heures par semaine ont des résultats en moyenne moins élevés que les autres et ont un taux de réussite inférieur de 40 points, alors que sous ce seuil, l’effet de l’emploi sur les étudiants n’a pas d’impact significatif sur la réussite. L’expérimentation prévoit la mise en place d’une cellule de placement par l’université, en partenariat avec le tissu local d’entreprises, les intermédiaires du marché du travail et les collectivités territoriales, et organise la rencontre entre ces offres et les demandes des étudiants, en fonction de leurs contraintes.
L’évaluation repose sur la mise en place d’un protocole d’expérimentation avec constitution d’un groupe de bénéficiaires et d’un groupe témoin (par assignation aléatoire). L’objectif est d’évaluer l’effet du placement par la cellule sur le taux d’abandon de l’emploi (hors embauche) d’une part, et le taux de succès aux examens d’autre part, selon la durée du travail hebdomadaire du poste occupé et la date d’entrée dans le dispositif. Cette expérimentation a été évaluée par l’Université Paris-Est Marne la Vallée. Trois résultats majeurs en ressortent :
– tout d’abord, le dispositif de mise en relation des étudiants et des professionnels par l’université augmente la probabilité pour un étudiant d’occuper un emploi salarié ;
– cet emploi est, ensuite, mieux rémunéré en moyenne, avec un volume horaire hebdomadaire moins important et des horaires plus compatibles avec les emplois du temps ;
– enfin, on trouve peu ou pas d’effet du dispositif sur la réussite universitaire. De tels résultats suggèrent que l’effet négatif de l’augmentation du nombre des étudiants employés a été compensé par la meilleure qualité des emplois occupés. De plus, au sein du groupe test, les étudiants ayant décroché un emploi grâce au dispositif décrochent moins fréquemment de l’université que ceux qui ont trouvé leur emploi par leurs propres moyens, suggérant que « l’intensité de contact avec la cellule AQ3E diminue le risque de décrochage des étudiants ».
Source : FEJ (note sur les premiers enseignements 2013)
Il conviendra par ailleurs de suivre attentivement les résultats d’une autre expérimentation soutenue par le FEJ, visant à améliorer l’insertion professionnelle des étudiants boursiers inscrits en master 2, dont les résultats seront disponibles au premier semestre 2014 (307).
● Quelles voies d’amélioration ?
Concernant tout d’abord la question des stages, il a notamment été décidé, lors du comité interministériel sur la jeunesse de février 2013, d’améliorer le statut des stagiaires et d’encadrer le recours excessif à ceux-ci. Il était aussi proposé de « développer les stages dans le maximum de cursus de formation (308) », dans le cadre de la mesure relative au partenariat renforcé entre les établissements d’enseignement supérieur et le service public de l’emploi (SPE) pour anticiper la recherche d’emploi.
Compte tenu de ces travaux en cours, mais aussi des dispositions récentes de la « loi Fioraso » de juillet 2013 (309), la mission a plutôt concentré ses travaux sur les emplois salariés, tout en notant l’intérêt des stages pour la professionnalisation des jeunes et la construction de leur parcours. Ceci suppose toutefois qu’ils reçoivent une aide adaptée, notamment dans les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) des universités, ce qu’illustrent notamment les résultats d’une expérimentation soutenue par le FEJ, pour des étudiants en lettres et sciences humaines.
Le projet « ELITE- expérimentation locale pour l’insertion territorialisée des étudiants » porté par l’Université de Provence (étudiants en langues, lettres et sciences humaines)
Ce projet s’appuie sur la création par l’université de Provence d’un diplôme universitaire d’aide à l’insertion professionnelle (DUIP), qui offre un cadre universitaire aux étudiants en voie d’insertion. Ce diplôme est constitué de modules d’enseignement et d’accompagnement. Il mobilise conjointement des acteurs de l’insertion et des enseignements universitaires. Le projet touche les étudiants en langues, littérature et sciences humaines, à qui l’université propose de suivre le DUIP. Les modules d’enseignement procurent aux étudiants des bilans de connaissances et de capacités, ainsi qu’une aide à l’élaboration d’un projet professionnel. L’accompagnement vise à rapprocher les étudiants des acteurs de l’insertion, tels que l’Observatoire régional des métiers ou les missions locales. En parallèle, les missions locales concourent à la mise en œuvre d’un système de parrainage par des professionnels expérimentés bénévoles. Enfin, le diplôme impose aux étudiants un stage conventionné en entreprise. De l’évaluation réalisée, trois enseignements peuvent notamment être tirés sur :
– les obstacles à l’insertion professionnelle et le manque d’outils de professionnalisation à disposition des jeunes, notamment au sein de certaines filières de l’Université : le projet « ELITE » vise ainsi à remédier à cette difficulté dans la filière Langues, littérature et sciences Humaines (LLSH) dont le diplôme n’impose pas de stage. Beaucoup d’étudiants « affirment dans l’enquête de rentrée que cette possibilité de pouvoir effectuer un stage constitue pour eux un véritable atout du diplôme universitaire d’insertion professionnelle, venant combler une lacune de l’université [et de leur filière] dans ce domaine ».
– l’accompagnement : les entretiens avec les bénéficiaires et partenaires du projet « ELITE » montrent une adhésion des jeunes au dispositif assez encourageante, en partie liée au fait que la participation au dispositif relève d’un enseignement supplémentaire de l’université, à l’issue duquel les étudiants bénéficient d’un diplôme. Le programme proposé comporte différents niveaux d’action, de l’enseignement informatif au stage en entreprise locale ;
– le parrainage : l’évaluation du projet « ELITE » contient de nombreux témoignages de jeunes bénéficiaires qui attribuent au dispositif la création de leur réseau professionnel et l’obtention de leur stage. Les étudiants « expliquent que le diplôme universitaire leur a permis de commencer à se constituer un réseau grâce à la complémentarité de l’ensemble du dispositif, c’est-à-dire : la réalisation de l’enquête métier, le parrainage, les intervenants venus présenter leur secteur d’activité, la conseillère assurant le suivi individualisé, les stages, ainsi que les rencontres faites au cours de forums ». Les étudiants ont semblé apprécier la convergence des informations délivrées par les nombreux acteurs de l’insertion et du monde professionnel : ils disent avoir appris à rester en contact avec les professionnels rencontrés à de diverses occasions. Les entretiens montrent également que pour certains étudiants, les parrains et les conseillers d’insertion rencontrés dans les missions locales leur ont permis de s’améliorer lors des entretiens d’embauche. Le rapport suggère enfin que la qualité des rapports entre parrains et étudiants a été permise par le bon déroulement global du projet et par l’habitude qu’ont ces professionnels expérimentés à dialoguer avec les jeunes.
Source : FEJ et rapport d’évaluation (2013)
S’il est essentiel de préparer l’insertion après la formation, il convient également d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes étudiants pendant leurs formations. Différentes propositions pourraient être étudiées dans ce sens, par exemple une meilleure adaptation des études universitaires au travail étudiant (aménagements des horaires, cours en ligne, attribution de crédits ECTS dans le cursus d’études, développement du « supplément au diplôme » avec la mention des compétences professionnelles acquises, développement des emplois étudiants au sein des universités, etc.).
En outre, à l’occasion par exemple de la prochaine conférence sociale, les partenaires sociaux pourraient être invités à négocier sur l’emploi étudiant, s’agissant notamment des possibilités d’adaptation du code du travail ou de simplification des démarches pour l’emploi ponctuel des étudiants, à titre expérimental. Les bonnes pratiques des entreprises, en matière notamment d’adaptation des horaires de travail, pourraient aussi être mieux valorisées.
D’autres pistes encore pourraient être explorées. Par exemple, l’OCDE avait préconisé, dans le rapport précité de 2009, de « subventionner modérément le travail étudiant pour le faire décoller. Les étudiants à plein temps qui travaillent toute l’année pourraient par exemple bénéficier d’une subvention, sous forme d’une allocation ou d’un complément de salaire, pour un maximum de 15 heures de travail par semaine. Une telle mesure devrait toutefois être évaluée après quelque temps pour s’assurer de son efficacité en termes d’insertion. »
Par ailleurs, il est à noter que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Geneviève Fioraso, a présenté le mardi 22 octobre 2013 un plan d’actions en quatre points en faveur de l’entrepreneuriat étudiant, avec notamment le lancement d’un appel à projet pour la constitution d’une trentaine de « Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat » (PEPITE). Cette politique en faveur de l’entrepreneuriat articule formation à l’entrepreneuriat, reconnaissance des parcours entrepreneuriaux dans les cursus, et accompagnement de la démarche entrepreneuriale des étudiants et jeunes diplômés. Elle vise plusieurs objectifs :
– atteindre 20 000 créations ou reprises d’entreprises par des jeunes issus de l'enseignement supérieur, en quatre ans ;
– renforcer le nombre et l’ampleur des actions engagées dans les écoles et universités ;
– faire de l’entrepreneuriat un levier de changement pédagogique dans l’enseignement supérieur en développant la culture entrepreneuriale et toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de projets innovants, en valorisant la prise de risque, le travail en équipe, l’alternance, les stages encadrés, l'interdisciplinarité...
Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement des annonces faites par le Président de la République lors des Assises de l’entrepreneuriat, qui se sont tenues à l’initiative du Gouvernement en avril 2013.
En outre, un plan numérique pour l’enseignement supérieur a été présenté très récemment par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (« France université numérique : construire l’université de demain »). L’accent est mis sur trois mesures prioritaires : la mise en place d’un agenda numérique comprenant 18 actions, la création d’une fondation pour coordonner le volet formation de l’agenda ainsi que l’ouverture de la première plateforme française de cours en ligne fin octobre 2013.Plus de 12 000 personnes se sont déjà inscrites pour suivre les 25 premiers « MOOCs » (massive open online courses) qui débuteront début 2014. Dès janvier, les étudiants, mais également les lycéens, les salariés, toutes les personnes désireuses d’apprendre et de se former, pourront ainsi suivre gratuitement, à leur rythme, des cours du Cnam, de l’École Centrale Paris, de l’École Polytechnique, de l’Institut Mines-Télécom, de Sciences Po, de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, de l’Université Montpellier 2, de l’Université Panthéon-Assas – Paris II, de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense notamment. Alors que l’offre mondiale de formations en ligne est en plein essor, cette plateforme expérimentale vise à héberger les MOOCs proposés par les établissements d’enseignement supérieur français afin de permettre à tous les publics d’accéder à des cours variés et de qualité où qu’ils soient dans le monde.
● Soutenir l’emploi étudiant dans des conditions compatibles avec la réussite universitaire :
– apporter un accompagnement adapté à la recherche d’emploi et de stage dans les universités (BAIP), en tirant tous les enseignements de l’expérimentation « Améliorer la qualité des emplois exercés par les étudiants », et promouvoir le développement des stages dans les cursus de formation ;
– encourager l’adaptation de l’organisation des études universitaires au travail étudiant (aménagements des horaires, outils numériques, etc.) ;
– demander aux partenaires sociaux d’ouvrir une négociation sur l’emploi étudiant dans le cadre de la prochaine conférence sociale.
En tout état de cause, la question de l’emploi étudiant doit être examinée dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la sécurisation des parcours professionnels, d’une part (VAE, formation professionnelle, etc.) mais aussi l’accès des jeunes à l’autonomie.
II. RENFORCER L’AUTONOMIE DES JEUNES
A. LE FINANCEMENT DE L’AUTONOMIE
1. Les principales problématiques relatives au financement de l’autonomie des jeunes
Deux questions « occupent » classiquement le débat relatif à l’autonomie financière des jeunes.
La première concerne l’ouverture du droit au RSA pour les 18-25 ans. Les rapporteurs ont évoqué supra leur souhait d’une simplification de l’offre des contrats et des aides proposés aux jeunes éloignés de l’emploi et pas ou peu qualifiés, via notamment l’activité des missions locales. Ils proposent qu’un contrat unique de réussite soit proposé à chacun de ces jeunes, susceptible d’être complété selon leur profil et leur besoin spécifique par une allocation inspirée – s’agissant entre autres de son montant proche du RSA – de celle prévue dans le cadre de l’actuelle expérimentation de la « garantie jeunes ».
Ce dispositif présenterait l’avantage de cibler le bénéfice de l’allocation sur les jeunes dont la situation matérielle et familiale la rend pertinente et qui sont pris en charge par la mission locale dans un cadre contractuel définissant un chemin vers la qualification et l’insertion sur le marché du travail. Pour améliorer l’autonomie des jeunes en difficulté, les rapporteurs proposent en outre, infra, que soit envisagée une revalorisation des allocations de logement perçues par les jeunes qui ne sont pas en formation initiale.
Le second débat porte sur une hypothétique refonte de l’aide au financement du cursus des étudiants dans l’enseignement supérieur, souvent envisagée via la création d’une allocation d’études équitablement répartie et qui rassemblerait les 3 principales aides actuelles :
– les bourses attribuées sur critères sociaux ;
– les allocations de logement ;
– l’avantage fiscal issu du rattachement jusqu’à 25 ans de l’étudiant au foyer fiscal de ses ascendants ou de leur capacité à lui verser une pension alimentaire déductible.
Le graphique ci-dessous est issu d’un document d’expertise interne de janvier 2012 rendu public par la Conférence des présidents d’université (CPU). Il présente les effets redistributifs cumulés de ces trois aides, en considérant le pourcentage de leur montant attribué à chaque décile de revenus.
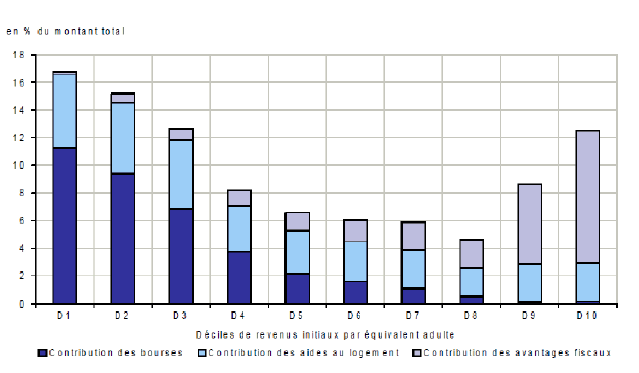
Les dispositions mises en œuvre depuis 2012 concernant le quotient familial ont affecté et affecteront le poids de la composante « contribution des avantages fiscaux » du graphique ci-dessus, sans modifier la « forme en U » de la courbe qu’il révèle, qui demeure ainsi structurée :
– les bourses et – dans une moindre mesure – les allocations de logement ont un effet redistributif fort en faveur des trois premiers déciles ;
– en revanche, les avantages fiscaux ont un effet « anti redistributif » d’une telle ampleur que les déciles 9 et 10 sont, toutes aides confondues, nettement mieux dotés que les déciles 4 à 8 ;
– chacun des déciles 4 à 8 – où se situent les « classes moyennes » – est destinataire d’un montant global d’aide inférieur à la moyenne (310).
– le décrochage de redistribution entre les déciles 3 et 4 est particulièrement marqué, au détriment des classes moyennes les moins aisées.
Les rapporteurs présentent infra des éléments pour rendre la redistribution de ces aides plus équitable.
Les rapporteurs notent, tant pour la question du RSA que pour celle du financement des études, que la difficulté consiste à définir l’équité des transferts sociaux en direction des jeunes, dans le contexte des liens qu’ils entretiennent avec leur famille. Une solution simple et radicale consisterait à ne pas tenir compte de ces liens et à supprimer en conséquence toutes aides versées aux familles au titre des jeunes majeurs qui en sont issus. En contrepartie de cette « défamilialisation », chaque jeune serait considéré comme tout autre adulte au titre des droits sociaux ou bénéficierait de transferts ad hoc sous la forme de politiques publiques nouvelles et générales en direction des jeunes.
Les rapporteurs s’interrogent sur l’équité réelle d’une défamilialisation des politiques publiques en France. Elle n’empêchera ni les rapports familiaux, ni les libéralités financières versées, en règle générale, par les parents aux enfants. N’est-il pas tout aussi pertinent, eu égard à ces capacités financières de transfert, de les amodier par des politiques publiques prenant en compte les conditions de ressources des familles et la réalité des rapports qu’elles entretiennent avec leurs descendants majeurs ?
En matière d’autonomie des jeunes, il a été évoqué, au cours des travaux de la mission, le système public d’aide aux étudiants (« SU ») mis en place au Danemark, où l’un des rapporteurs s’est rendu en avril dernier, et dont les principales caractéristiques sont présentées ci-dessous.
Le système public d’aide aux étudiants au Danemark (State educational grant and loan scheme, « SU »)
Créé dans les années 1970 afin de permettre aux jeunes d’accéder à la formation, après 18 ans, sans considération de la situation matérielle de leurs parents, et d’améliorer l’égalité des chances, le programme de bourses et de prêts pour l’éducation (education grants and loan scheme, « SU ») est administré par une agence publique (Danish educational support agency), opérant sous la tutelle du ministère de l’éducation. Les aides sont distribuées par l’agence en collaboration avec les établissements de formation.
Ce système comporte des aides pour les jeunes de plus de 18 ans suivant un programme d’éducation des jeunes (study grants – SU – for youth education programs, soit une formation de niveau secondaire supérieur, générale ou professionnelle, ou un programme d’enseignement et de formation professionnelle), ainsi que pour les étudiants suivant des études supérieures (SU for higher education programs). Le dispositif danois d’allocations étudiantes mis en place au Danemark est forfaitaire et généreux :
– il permet à des jeunes de 18 à 19 ans, vivant chez leurs parents et qui suivent des formations (youth education program), de bénéficier d’une aide de base de 171 euros par mois, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 213 euros selon le revenu des parents (soit un maximum de 384 euros) ;
– au-delà de 20 ans, ce montant est de 772 euros pour les jeunes suivant ce type de formations qui n’habitent plus chez leurs parents ; de même, un étudiant suivant une formation supérieure peut bénéficier d’une aide de 772 euros par mois pour financer ses études, indépendamment de l’âge, dès lors qu’ils ne vit plus chez ses parents (311) (dans le cas contraire, le montant mensuel de la bourse s’élève à 384 euros) ; cette aide constitue l’élément central du dispositif danois d’allocations en faveur des étudiants ;
– des suppléments à ces aides sont notamment prévus pour les jeunes handicapés (1 097 euros) ou ayant un ou des enfants à charge ;
– des prêts étudiants ont également été mis en place.
Il convient toutefois de préciser que les revenus de l’étudiant ont un impact sur les aides (lorsque les revenus mensuels dépassent un certain montant, une partie de la bourse doit être remboursée). Par ailleurs, selon les interlocuteurs rencontrés par la mission, le fait d’étudier activement constitue l’une des conditions requises pour percevoir la SU (312).
En 2011, environ 400 000 Danois bénéficiaient de ce dispositif (393 4000), sur une population totale de 5,5 millions d’habitants. Son coût pour les finances publiques s’élevait à 2,5 milliards d’euros (dont 2,1 milliards au titre des bourses et 0,4 milliard d’euros au titre des prêts), soit 0,85 % du produit intérieur brut (PIB). Cette proportion est à peine inférieure à celle des allocations françaises de logement versées à l’ensemble de la population sous conditions de ressources.
Selon une contribution de l’ambassade de France au Danemark datant de 2009 (313), « pour les étudiants suivant des études supérieures, la durée maximale de versement des aides est de 70 mois. En règle générale, les étudiants ne peuvent cependant toucher d’aide que pendant la durée de la formation en question auxquels peuvent s’ajouter 12 mois (par exemple, pour une formation d’une durée de 34 mois, l’étudiant peut toucher son aide pendant 34+12 mois). Si l’étudiant a plus de 12 mois de retard dans son parcours universitaires par rapport au nombre de mois où il a touché des subventions, les aides peuvent être supprimées jusqu’à ce qu’il ait de nouveau rempli les critères requis. Le système utilise une sorte de carte « à poinçonner » qui permet aux étudiants de choisir assez librement à quel moment et à quel rythme ils perçoivent les aides. Ce système n’incite pas véritablement les étudiants à accélérer leurs études, ce qui est perçu comme un problème ».
La crise économique qui a débuté en 2008, la progression des dépenses publiques liées à ce système d’aides ainsi que le constat d’une durée sensiblement longue des études au Danemark ont conduit les pouvoirs publics à envisager en 2013 une réforme du dispositif, sans remettre en cause toutefois l’idée originelle, qui demeure solidement consensuelle au Danemark, d’une aide forfaitaire devant permettre à chaque jeune de financer la formation qu’il a choisie. La réforme consisterait notamment à inciter les étudiants à effectivement effectuer la formation choisie, dans des délais raisonnables. Par ailleurs, il est prévu de limiter les aides versées aux jeunes qui habitent chez leurs parents et d’indexer les allocations sur l’évolution de l’indice des prix et non plus sur celle du pouvoir d’achat.
2. Les jeunes et les allocations de logement
a. Les jeunes allocataires bénéficient en règle générale de l’allocation de logement sociale (ALS)
Les allocations de logement sont une prestation sociale universelle au sens où tout locataire peut bénéficier, sous conditions de ressources, d’une des trois allocations suivantes :
– l’aide personnalisée au logement (APL), quand le logement fait l’objet d’une convention entre l’État et le propriétaire « fixant, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d’entretien et les normes de confort », selon le site en ligne de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF – les CAF sont les organismes qui gèrent et versent les allocations de logement). Les logements éligibles à l’APL sont situés en quasi-totalité dans le parc locatif social ;
– l’allocation de logement familiale (ALF), quand le logement n’est pas éligible à l’APL et que a) le locataire a des enfants – nés ou à naître – ou certaines autres personnes à charge ou b) les locataires sont mariés (depuis moins de 5 ans, en ayant moins de 40 ans). L’ALF est donc surtout versée dans le parc locatif privé ;
– l’allocation de logement sociale (ALS), dans tous les autres cas de figure.
Les jeunes bénéficient en règle générale de l’ALS. Ils sont souvent sans personne à charge, rarement mariés, et classiquement locataires dans le parc privé (Cf. infra pour une description de la situation des jeunes au regard du marché du logement). Au demeurant, les résidences universitaires et foyers de jeunes travailleurs ne sont pas des logements conventionnés et ouvrent donc droit à l’ALS.
b. Les situations respectives des jeunes allocataires qui ne sont plus en formation initiale et des étudiants sont très contrastées
Les situations respectives des étudiants et des autres jeunes allocataires sont assez différentes (314). Les jeunes qui ne sont pas en formation initiale sont allocataires selon des modalités équivalentes à celles s’appliquant aux autres ménages. Un rapport de 2012 de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale décrit le profil des allocataires, de tous âges, par les éléments suivants (315) :
– Le revenu au-delà duquel les allocations de logement ne sont pas versées « est au voisinage du SMIC pour un isolé et de 2 SMIC pour un couple avec deux enfants » ;
– « les ménages bénéficiaires appartiennent tous aux trois premiers déciles de revenus » ;
– « les aides personnelles bénéficient de fait majoritairement s’agissant des locataires, à des ménages dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté » ;
– « seuls 33,7 % des allocataires sont en emploi, 12,4 % sont au chômage et 26,1 % des locataires sont bénéficiaires de minima sociaux. Les aides personnelles au logement sont donc aujourd’hui la principale prestation versée aux ménages modestes et pauvres. »
Les jeunes bénéficiaires des allocations de logement qui ne sont pas en formation initiale sont donc des ménages modestes, sans doute souvent précarisés. Contrairement aux allocataires de plus de 25 ans, ces jeunes ne peuvent pas, dans la plupart des cas, bénéficier du RSA, dont le montant est partiellement cumulable avec celui de l’allocation de logement (316)(317). Même éligibles aux allocations de logement, les jeunes sans revenus ou très précarisés sont donc encore moins en mesure de se loger de façon autonome que les plus de 25 ans se trouvant dans des situations analogues.
La situation des étudiants est nettement différente. Le rapport de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale souligne que « les ressources des étudiants, essentiellement des libéralités familiales, ne sont pas connues des services fiscaux et de la CNAF ; la grande majorité des étudiants remplissent donc les conditions de ressources, indépendamment de leur situation réelle et du niveau de revenu de leur famille. Afin de contenir l’avantage ainsi conféré, un plancher de ressources (318) leur est appliqué pour le calcul de l’aide. Les étudiants représentent aujourd’hui 11,9 % des bénéficiaires dans le secteur locatif (700 000 allocataires)(319) pour un coût de 1,34 milliard d’euros en 2010 et moins d’un tiers d’entre eux [30,8 %] sont boursiers […] le statut d’enfant à charge fiscalement n’exclut pas le bénéfice des aides. En conséquence, puisque la charge d’entretien de l’étudiant est assumée par la famille, l’aide versée, qui atténue les charges de logement, est indirectement versée à la famille sans conditions de ressources. Ce cumul, dont 65,3 % des étudiants et leurs familles bénéficient, constitue une aide aux ménages imposables incohérente au regard du caractère très ciblé des aides personnelles [au logement]. »
On note que le taux d’étudiants boursiers allocataires parmi les étudiants allocataires est un peu plus faible que la proportion d’étudiants boursiers. Autrement dit, les allocations de logement ne ciblent pas les étudiants dont la situation financière – personnelle ou familiale – est plus difficile.
Au total, alors que les allocations de logement constituent une prestation sociale universelle dont les conditions d’attribution les destinent en principe aux personnes les plus modestes, elles ont des effets paradoxaux sur les jeunes :
– elles ne permettent que très difficilement l’accès à un logement autonome pour les jeunes les plus précarisés qui ne sont plus en formation initiale ;
– elles bénéficient à tous les étudiants bénéficiant d’un logement autonome, sans prise en compte de leurs ressources réelles, notamment les aides qu’ils perçoivent de leur famille. A fortiori quand le foyer familial est imposable à l’impôt sur le revenu – ce qui constitue une preuve relative d’aisance financière –, il peut de surcroît bénéficier à la fois de la part ou demi-part fiscale de l’étudiant qui lui est rattaché – ou de la déductibilité de la pension alimentaire dont celui-ci bénéficie – et de l’allocation de logement.
c. Un effort pour relever les allocations des jeunes qui ne sont plus en formation initiale doit être envisagé
Plusieurs élément montrent que la situation financière des jeunes au regard du logement s’est détériorée depuis 10 à 20 ans.
Mme Claire Guichet, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), indique – dans le rapport sur le logement autonome des jeunes qu’elle a présenté en janvier 2013 au nom de la section de l’aménagement durable des territoires du CESE – que dans la période récente, les 25-29 ans « consacrent […] 18,7 % de leurs ressources [pour le financement de leur logement], tandis que ce taux d’effort (320) est d’environ 10 % toutes classes d’âge confondues. […] Entre 1984 et 2006, le taux d’effort net pour le logement a augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, et de 6 points pour les 25-29 ans ; sur la même période, ces taux n’ont augmenté que de 1,5 point pour l’ensemble de la population. »
Le cahier des données sociales (CDS) 2011 édité par la CNAF contient des informations sur le taux d’effort des ménages après prise en compte des allocations de logement et sur l’impact de celles-ci sur ce taux d’effort, en fonction de la configuration des ménages. Le tableau suivant – qui concerne et prend en compte uniquement les ménages bénéficiant d’une allocation logement – retrace ces informations.
COMPARAISON DES TAUX D’EFFORT SELON LA CONFIGURATION FAMILIALE DES FOYERS ALLOCATAIRES
En pourcentage
Configuration |
Taux d’effort net médian 2011 |
Impact des allocations logement sur le taux d’effort 2011 (en %) |
Reconstitution du taux d’effort brut médian |
Isolés (sans enfant) |
25,40 |
- 51 |
51,80 |
Familles monoparentales : |
|||
avec 1 enfant |
18,50 |
- 56 |
42,00 |
avec 2 enfants |
15,90 |
- 61 |
40,80 |
avec 3 enfants ou plus |
8,50 |
- 78 |
38,60 |
Couples : |
|||
sans enfant |
21,00 |
- 47 |
39,60 |
avec 1 enfant |
17,80 |
- 44 |
31,80 |
avec 2 enfants |
17,50 |
- 39 |
28,70 |
avec 3 enfants ou plus |
13,50 |
- 49 |
26,50 |
Total |
19,20 |
- 51,9 |
39,92 |
(*) : Cette colonne est reconstituée à partir des deux précédentes.
Source : CNAF, cahier des données sociales pour 2011.
Même si ces informations ne sont pas établies par groupe d’âge, les jeunes relèvent – pour une très grande part d’entre eux – de la ligne « isolés (sans enfant) ». Or, les personnes concernées par cette ligne sont celles pour lesquelles les taux d’effort brut et net sont les plus élevés. Le taux d’effort brut médian de ces personnes est supérieur de 30 % à celui constaté pour l’ensemble des allocataires (ligne « Total »). Le taux d’effort net médian est supérieur de 32 % à celui de la ligne « Total ». Ainsi, malgré un impact des allocations logement sur le taux d’effort 2011 substantiel (- 51 %), il demeure inférieur à celui observé pour l’ensemble des allocataires (- 51,9 %).
Le rapport de 2012 de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de la sécurité sociale contient d’autres éléments tendant à montrer une dégradation relative de l’apport des allocations de logement pour les jeunes. Ce rapport souligne que depuis 2001, la part des allocations de logement dans le PIB est restée stable, alors que le nombre des bénéficiaires a considérablement augmenté.
Cette évolution a été rendue possible par la revalorisation très partielle des paramètres des allocations, par exemple le montant des loyers maximums (dits « loyers plafonds ») pris en compte pour le calcul de l’allocation, quel que soit le montant réel des loyers payés par les locataires. La sous-indexation de ces paramètres « a eu pour effet de diminuer le “pouvoir d’achat” de l’aide qui s’est progressivement déconnectée des dépenses de logement ». Le tableau suivant illustre ce constat, en comparant l’évolution :
– des loyers plafonds à celle des loyers réels ;
– du « forfait charges » compris dans l’allocation de logement à l’évolution des prix et dépenses classiquement intégrés dans les charges locatives.
COMPARAISON DES REVALORISATIONS DU BARÈME ET DE L’ÉVOLUTION DES PRIX DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ENTRE 2000 ET 2010
Loyers plafonds des allocations |
Loyers moyens des bénéficiaires des aides |
Forfaits charges |
Dépenses d’énergie et d’eau |
Autres charges |
Indice des prix à la consommation | |
2000-2010 |
+ 16,3 % |
+ 32,3 % |
+ 12 % |
+ 39 % |
+ 29,8 % |
+ 19 % |
Source : Rapport de membres de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sur l’évaluation des aides au logement, n° RM2012-054P pour l’IGAS et n° 05-2012 pour la mission nationale.
Ce différentiel d’évolution a eu pour effet une « augmentation générale du taux d’effort des ménages [allocataires] qui est passé de 16,5 % à 19,5 % entre 2001 et 2010 pour le paiement du seul loyer ». Les jeunes, souvent allocataires de l’ALS, ont sans doute été concernés plus que d’autres segments de la population par ces évolutions. Le même rapport précise ainsi que l’augmentation du taux d’effort « a été particulièrement prononcée pour les bénéficiaires de l’ALS », le taux d’effort net médian pour ces allocataires s’élevant à 34,4 % en 2010, contre 27,5 % en 2001. La moitié des allocataires de l’ALS subit un taux d’effort supérieur à un tiers pour le loyer seul, le paiement des charges s’imputant encore en plus sur le budget des ménages concernés. Plus précisément s’agissant des jeunes, le même rapport montre que le taux d’effort net médian s’établit à 39,1 % pour les 20-24 ans, le plus élevé de toutes les classes d’âges d’allocataires (321).
Si ce constat est « trompeur » s’agissant de ceux des jeunes, notamment les étudiants, qui bénéficient de libéralités versées par leurs ascendants, il caractérise assez précisément la situation des jeunes qui ont achevé leur formation initiale et dont la situation financière est très précaire.
L’ensemble des éléments ci-dessus concourt pour montrer que leur situation est particulièrement difficile et dégradée au regard de leur capacité à se loger. Ils ne peuvent bénéficier ni du RSA, ni d’une bourse attribuée sur critères sociaux, ni, dans la plupart des cas, d’une allocation de chômage, et la « valeur » de leur allocation de logement a considérablement baissé. Les rapporteurs considèrent qu’une revalorisation ciblée des aides au logement pour ces jeunes est justifiée, et qu’elle peut être financée par une rationalisation du cumul des aides au logement et fiscales dont bénéficient les ménages des déciles les plus aisés au titre de « leurs » jeunes étudiants installés dans un logement autonome.
Une telle mesure de revalorisation ciblée des aides au logement doit prendre en compte la question du lien éventuel entre l’évolution des allocations et le niveau des loyers dans le parc privé. La revalorisation des allocations de logement a-t-elle tendance à être « absorbée » par celle des loyers ?
Dans son rapport pour le CESE de janvier 2013, Mme Claire Guichet souligne que la question est controversée. Certaines expertises montrent que les réformes de 1991 et 1993, qui ont notamment permis d’ouvrir le bénéfice des allocations de logement aux étudiants, ont eu un effet inflationniste sur les loyers. Elle précise ainsi que « l’examen des enquêtes Logement de l’INSEE révèle que les loyers versés par les locataires du premier quartile (principaux bénéficiaires de la réforme des aides) ont progressé plus vite que les locataires du deuxième quartile (peu concernés par la réforme). Entre 1993 et 2002, les loyers auraient donc augmenté plus vite que l’inflation, et ceux des ménages aux revenus les plus faibles, encore plus vite. D’après ces calculs, 78 % de l’augmentation des aides au logement auraient été absorbés par la hausse des loyers. » (322)
Selon le même rapport, une part minoritaire de cette absorption peut être justifiée par une amélioration de la qualité des logements. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le propriétaire « capte » une partie de la revalorisation des allocations de logement par l’augmentation des loyers, celles-ci n’en demeurent pas moins indispensables pour rendre solvable la relation locative – et donc la rendre possible.
La mesure de revalorisation ciblée des allocations de logement proposée par les rapporteurs en faveur des jeunes qui ne sont plus en formation initiale interviendrait sans doute à un moment favorable pour qu’elle bénéficie directement et pleinement aux locataires. Dans le contexte des décrets pris depuis l’été 2012 pour encadrer l’évolution de certains loyers, on observe que l’évolution à la hausse de l’indice de référence des loyers s’est modérée depuis la mi-2012. Les mesures prévues en la matière par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) pourraient conforter cette tendance.
d. Une répartition plus équitable des aides en faveur des étudiants doit être mise en œuvre
Dans un contexte où le « pouvoir d’achat » des allocations de logement s’est dégradé depuis 2001 et où les destinataires de ces aides sont majoritairement des ménages vivant sous le seuil de pauvreté monétaire, le rapport de 2012 de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sur l’évaluation de ces allocations souligne qu’« il est nécessaire de rappeler le droit des étudiants à bénéficier des aides personnelles mais il est non moins important de souligner qu’il n’est ni équitable ni légitime que les aides personnelles versées aux étudiants viennent en réalité aider leurs familles sans condition de ressources. » (323)
Le même rapport propose en conséquence de « poser le principe que le choix de demander une aide personnelle au logement exclurait pour les parents la possibilité de rattacher le bénéficiaire à son foyer fiscal ou de déduire les pensions qui lui sont versées » (324). Ce rapport propose que ce principe du non cumul des aides au logement et fiscales souffre deux exceptions, en faveur :
– des étudiants dont la décohabitation dans une autre agglomération que celle dans laquelle se situe le domicile des parents est rendue nécessaire par leur choix d’orientation ;
– des étudiants boursiers. Dans leur cas, le principe du non cumul pourrait conduire à devoir opérer un arbitrage entre l’autonomie du logement et le fait que le foyer fiscal de leurs parents demeure non imposable.
Les rapporteurs considèrent que la situation actuelle ne peut pas perdurer. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le système en vigueur – caractérisé par un effet « redistributif » en U illustré supra – apporte plus à ceux qui ont moins, mais également plus à ceux qui ont plus. La préconisation faite par l’IGAS constitue un scénario parmi d’autres.
D’autres solutions de redistribution des avantages fiscaux entre les familles des étudiants ont été évoquées, comme la création d’un crédit d’impôt au bénéfice de tous les foyers fiscaux – y compris les foyers non imposables –, en substitution de la capacité à rattacher un étudiant au foyer fiscal de ses parents ou à déduire la pension qu’ils lui versent de leur revenu imposable.
Pour les rapporteurs, ce qui importe est de parvenir à une solution qui permette :
– une capacité maintenue pour chaque étudiant à prétendre personnellement aux allocations de logement de droit commun ;
– une réforme portant sur la capacité du rattachement d’un étudiant au foyer fiscal de ses parents ou sur la déduction des pensions alimentaires qu’ils lui versent afin de mettre fin à la courbe en U. Cette réforme doit aboutir à une redistribution d’une partie des montants correspondants à ces dispositifs fiscaux entre toutes les familles d’étudiants, de telle façon que le cumul des aides aux étudiants (bourses sur critères sociaux, aides fiscales et allocations de logement) progresse en fonction des charges supportées par la famille et diminue en fonction de ses revenus ;
– le dégagement d’une capacité à financer une mesure de revalorisation des allocations de logement des jeunes qui ont achevé leur formation initiale.
Le rapport précité de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale relève que la direction du budget avait en 2010 évalué à 400 millions d’euros le bénéfice pour les finances publiques de l’interdiction d’un cumul entre allocations de logement et avantage fiscal (rattachement au foyer fiscal des parents ou déduction de leur revenu imposable de la pension alimentaire versée à l’étudiant). Le dégagement d’un tel montant, même minoré si un dispositif moins strict était mis en œuvre, serait susceptible d’aboutir à des effets substantiels dans l’équité de la distribution des aides à la poursuite des études. L’abandon en 2010 de la réforme envisagée de l’interdiction stricte du cumul montre toutefois la difficulté de la tâche.
3. La situation difficile des jeunes au regard de l’offre de logements et du marché locatif
Les rapporteurs considèrent qu’un relèvement des allocations en faveur des jeunes de moins de 25 ans qui ne sont plus en formation initiale est aujourd’hui justifié (cf. supra).
La pertinence de cette mesure est renforcée par la situation générale des jeunes sur le marché du logement. Alors qu’ils bénéficient de moins de revenus qu’en moyenne, ils paient plus cher leur logement, notamment parce qu’ils sont de fait largement exclus du parc locatif social.
a. Les jeunes occupent une situation très défavorable sur le marché du logement français
Les rapporteurs ont évoqué supra le fait que les jeunes constituent la classe d’âge qui, en moyenne, bénéficie des revenus les plus modérés et s’appuie sur des patrimoines faibles, dépourvus dans la plupart des cas de composante immobilière. À cette capacité financière limitée, les jeunes cumulent une position structurellement défavorable sur le marché locatif du logement, qui les cantonne sur le segment des logements les plus chers.
La modification rapide des modes de cohabitation au cours de la jeunesse et les changements d’adresse fréquents des jeunes pour étudier et travailler conduisent à une forte mobilité résidentielle des jeunes. Dans son rapport pour le CESE sur le logement autonome des jeunes – évoqué supra –, Mme Claire Guichet précise que « le taux de mobilité résidentielle annualisé était en 2006 de 28 % pour les ménages de moins de 30 ans, de 16 % pour les 30-39 ans, de 7 % pour les 40-49 ans, de 4 % pour les 50-54 ans et de 2 % pour les personnes de 65 ans et plus. » (325)
Cette forte mobilité éloigne mécaniquement les jeunes de l’accès au parc social, dans lequel les délais d’attente pour obtenir un logement sont longs, a fortiori dans les principales métropoles françaises, précisément dans lesquelles les jeunes poursuivent en règle générale leurs études (326) . Les jeunes occupent donc en plus grande proportion le parc privé, leur forte mobilité y engendrant au demeurant des occasions plus fréquentes d’augmentation des loyers. Du côté des dépenses de logement, les jeunes sont donc structurellement confrontés à des loyers élevés : ils accèdent peu au parc social et résident dans d’importantes proportions dans les villes dans lesquelles la situation du parc locatif privé est tendue, en raison de l’attractivité qu’elles exercent en matière de formation et d’emplois.
Comme les rapporteurs l’ont évoqué supra, ces difficultés sont accrues pour les apprentis : ils doivent souvent financer deux logements, ce qui fragilise leur capacité à achever avec succès leur formation. Malgré les aides régionales en la matière, cette contrainte conduit sans doute de nombreux candidats à l’apprentissage à renoncer, ab initio ou en cours de cursus, à ce type de formation. De même, il est probable que certains emplois soient non pourvus en France du fait de la difficulté à se loger pour les jeunes candidats potentiels.
Mme Claire Guichet note dans son rapport qu’« avec 26,3 millions de logements en 2006, les résidences principales représentent plus de 80 % du parc total, part stable depuis 20 ans. Leur nombre s’est accru de 6 millions d’unités depuis 1984, soit une augmentation de 30 % environ, comme le parc lui-même. […] Cette augmentation de 30 % entre 1984 et 2006 du nombre de logements total et des résidences principales est très supérieure à l’accroissement de la population, qui n’a été que de 13 % sur la même période » (327).
L’augmentation plus forte du nombre des résidences principales par rapport à la population s’est en revanche sur la même période accompagnée :
– d’une baisse prononcée de la taille moyenne des ménages : « sur les 27,5 millions de ménages qui résident en France en 2009, un tiers se compose d’une seule personne, un tiers de deux personnes et le dernier tiers de trois personnes au moins. Si, depuis 1999, le nombre des ménages a augmenté au total de 3,2 millions, celui des ménages d’une personne s’est accru d’1,7 million et celui des ménages de deux personnes d’1,5 million, tandis que le nombre de ménages de trois personnes ou plus est resté stable. » (328) ;
– d’une augmentation relativement faible du nombre des logements de petite taille : « entre 1970 et 2006, celui des une pièce a augmenté de 11,5 % et celui des deux pièces de 8,7 %. Dans le même temps, le nombre des logements de trois pièces augmentait de 31 %, celui des quatre pièces de 67 %, celui des cinq-pièces était multiplié par plus de 2 et celui des 6 pièces et plus par près de 3. » (329)
Les jeunes sont l’une des populations au cœur de cette évolution parallèle – et contradictoire – de la taille des ménages et de la structure du parc des logements : ils font plus souvent partie que le reste de la population de petits ménages d’une ou deux personnes, alors que l’évolution du parc est marquée par le développement du nombre des logements de grande taille.
D’autres paramètres conduisent à l’inadéquation de l’évolution du parc des logements aux besoins des jeunes. Au sein de la catégorie des résidences principales, la forte augmentation du nombre des logements constatée depuis 1970 s’explique par le dynamisme de l’évolution du nombre des résidences dont les habitants sont propriétaires et des logements du parc locatif social – et beaucoup moins par les évolutions propres au parc locatif privé : « le nombre de résidences principales louées dans le secteur libre est […] passé d’un peu plus de 5 millions en 1970 à un peu moins de 5,4 millions en 2006, soit une hausse limitée à 7 % en 35 ans. À l’inverse, le nombre des résidences principales possédées par leur habitant (propriétaire résident) est passé de 7,35 millions d’unités en 1970 à 15 millions en 2006, soit plus qu’un doublement (augmentation de 103,5 %), le parc locatif social passant pour sa part d’1,6 million en 1970 à 4,5 millions en 2006, soit un quasi triplement. »
Or, les jeunes sont logiquement propriétaires de leur résidence principale dans des proportions nettement moindres que les autres classes d’âge et ils sont sont sous-représentés dans le parc locatif social.
Plusieurs éléments expliquent ce dernier constat – évoqué supra – a priori surprenant, tant il apparaitrait logique que les ménages jeunes – souvent dotés de ressources modestes – puissent prétendre louer un logement social :
– les logements sociaux demeurent insuffisamment implantés et construits dans les zones tendues privilégiées par les jeunes ;
– comme évoqué supra, plus souvent mobiles, les ménages jeunes constituent également une « clientèle » peut-être moins attractive que beaucoup de ménages plus âgés, plus souvent durablement solvables et qui ont vocation à demeurer au moins plusieurs années dans un logement social ; privilégier ces derniers coûtent moins cher en gestion et en prise de risque pour les bailleurs sociaux et les autorités qui disposent d’un pouvoir d’attribution ;
– le taux de rotation des bénéficiaires des logements sociaux s’est par ailleurs considérablement réduit ces dernières années, étant précisé que l’offre nouvelle de location sociale vient en bien plus grande partie du « turn over » sur les logements existants que de la livraison de nouveaux logements. Le différentiel de prix à la location entre le parc privé et le parc social constituera au demeurant un obstacle au relèvement de ce taux de rotation dans les prochaines années, le passage d’un parc à l’autre signifiant une perte substantielle de pouvoir d’achat, même pour des revenus relativement élevés.
b. Cette situation fortement dégradée nécessite de réserver un accès au logement social en faveur des jeunes et de mettre en place des dispositifs innovants
La situation des jeunes par rapport au logement est préoccupante. À titre illustratif, M. Jean-François Brégou, représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) lors de la table ronde du 19 juin 2013 organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs, a indiqué que les 18-25 ans représentaient 25 % des personnes accueillies au titre des dispositifs d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, soit environ 10 points de plus que la proportion de cette classe d’âge dans la population.
Les rapporteurs considèrent que les jeunes doivent pouvoir bénéficier du parc locatif social, qui a précisément vocation, entre autres, à permettre le logement des ménages en début de parcours, dotés de ressources modestes. Les jeunes sont aujourd’hui en grande partie des outsiders du parc locatif social. Quelles qu’en soient les modalités, un système simple doit être mis en place pour permettre l’accès d’un quota minimal de jeunes ménages au logement social, réparti sur l’ensemble des logements sociaux à affecter.
Il importe également que les logements neufs, notamment les nouveaux logements sociaux, soient adaptés aux besoins et aux ressources des jeunes. Pour beaucoup des intervenants lors de la table ronde du 26 juin, il faut sans doute construire plus de logements petits, ou permettant des colocations institutionnalisées – avec des pièces communes « de service » entourées d’un certain nombre de chambres. En la matière, l’État doit être en mesure d’influer sur les constructions neuves de logements sociaux, mais également d’inciter à la transformation des logements – notamment sociaux – existants.
Au demeurant, la colocation institutionnalisée doit être rendue plus attractive pour les bailleurs, via un bail spécifique, qui pourrait faire l’objet, dans un premier temps, d’une expérimentation. La colocation est aujourd’hui un outil « sous employé » en matière de logement des jeunes, alors qu’elle est particulièrement adaptée à leurs modes de vie et à leur capacité financière. Elle doit devenir attrayante pour les promoteurs et les bailleurs.
Enfin, l’intermédiation locative, y compris dans le parc locatif social, devrait être utilisée au service des jeunes locataires. Elle constitue en soi une assurance financière pour le bailleur et permet dans le même temps une gestion souple de la sous-location en faveur des jeunes, selon des rythmes qui sont adaptés à leur mobilité résidentielle. Pour assurer à la fois la professionnalisation des intermédiaires locatifs et leur solidité financière, la puissance publique devrait veiller à l’émergence d’acteurs de taille suffisante, ce qui contribuerait en outre à la visibilité du dispositif par les jeunes et les bailleurs.
4. Améliorer le dispositif des bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux
a. Les bourses étudiantes sont notamment attribuées en fonction du revenu des parents
Le dispositif en vigueur des bourses universitaires (330) fonctionne sur la base du croisement :
– du revenu global brut des parents de l’étudiant figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 pour une demande de bourse effectuée pour l’année n. L’étudiant peut faire valoir des revenus plus récents, quand ceux-ci – nettement plus bas que ceux de l’année n-2 – sont de nature à lui ouvrir des droits ou à améliorer ses droits ;
– du nombre des « points de charge » correspondant à différents aspects de la situation de l’étudiant : l’éloignement de l’établissement d’enseignement supérieur avec le domicile familial (0 à 2 points de charge), l’éventuel handicap de l’étudiant (2 points de charge), son statut éventuel de pupille de la Nation (1 point attribué), la situation familiale de l’étudiant (marié ou pas, nombre d’enfant(s) à charge – 1 point de charge pour chacun d’entre eux), la situation familiale de ses parents (a. nombre d’enfants étudiants dans l’enseignement supérieur – 3 points pour chacun d’entre eux, b. nombre des autres enfants à charge – 1 point attribué pour chacun d’entre eux, c. père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants).
Plus les points de charge attribués à un étudiant sont nombreux, plus le revenu global brut de ses parents peut être élevé pour bénéficier d’un même échelon du barème des bourses.
À titre d’exemple, le tableau ci-après reprend le barème en vigueur pour la rentrée universitaire 2012-2013 pour des situations allant de 0 à 2 points de charge, étant précisé que les arrêtés annuels fixant les barèmes applicables prévoient des situations allant jusqu’à 17 points de charge. Le tableau indique également, entre parenthèse après le numéro d’échelon, le montant annuel de bourse associé à chaque échelon.
PLAFONDS DES REVENUS GLOBAUX BRUTS
POUR LE BÉNÉFICE DES BOURSES ÉTUDIANTES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013
Points de charge |
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé | ||||||
0* |
1 (1 640 €) |
2 (2 470 €) |
3 (3 165 €) |
4 (3 858 €) |
5 (4 430 €) |
6 (4 697 €) | |
0 |
33 100 € |
22 500 € |
18 190 € |
16 070 € |
13 990 € |
11 950 € |
7 450 € |
1 |
36 760 € |
25 000 € |
20 210 € |
17 850 € |
15 540 € |
13 280 € |
8 370 € |
2 |
40 450 € |
27 500 € |
22 230 € |
19 640 € |
17 100 € |
14 600 € |
9 220 € |
(*) : L’échelon 0 n’ouvre pas droit au versement d’un montant de bourse, mais permet le bénéfice de l’exonération a) des droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et b) de la cotisation finançant la sécurité sociale étudiante.
Source : Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2012-2013
Au total, plus de 644 000 des 1,8 millions d’étudiants – soit une proportion un peu supérieur à un tiers – sont boursiers. Parmi les boursiers, un peu moins de 500 000 étudiants bénéficient d’une bourse d’étude, au titre des échelons autres que l’échelon 0 pour lequel les droits associés sont les exonérations des droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de la cotisation finançant la sécurité sociale étudiante.
Le dispositif des bourses sur critères sociaux – très redistributif – n’évite sans doute pas toute forme de situation abusive, en concernant dans certains cas des étudiants qui n’ont pas réellement l’intention ni d’être assidus et attentifs en cours, ni sans doute d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur. Il prévoit néanmoins un certain nombre de « garde-fous ». Un étudiant peut utiliser 7 droits à bourse durant la totalité de ses études supérieures (331). La bourse est accordée chaque année en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation dans les conditions suivantes :
– le 3ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits ECTS, 2 semestres ou 1 année ;
– le 4ème ou 5ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années ;
– le 6ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 180 crédits ECTS, 6 semestres ou 3 années.
Les étudiants admis par leur établissement d'inscription à passer en année supérieure bénéficient d'un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, semestres ou années d'études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus). Par ailleurs, les 7 droits sur l’ensemble des études supérieures se répartissent ainsi, dans le cadre de 2 cursus distincts :
– le cursus licence, ou tout cursus d'une durée égale, ne peut donner lieu à plus de 5 droits à bourse ;
– au-delà du cursus licence, ou de tout cursus d'une durée égale, l'étudiant bénéficie de 3 droits s'il a utilisé moins de 5 droits dans le cursus licence ; et de 2 droits s'il a utilisé 5 droits dans le cursus licence.
b. La réforme de l’été 2013 renforce les montants de bourse des étudiants les plus démunis et ouvre des droits nouveaux en faveur des étudiants des classes moyennes les moins aisées
La rentrée 2013-2014 a donné lieu à deux modifications importantes dans le barème d’attribution des bourses attribuées sur critères sociaux :
– un échelon 7 a été créé en faveur des étudiants dont les parents disposent d’un revenu très faible, voire quasi-nul. 31 900 étudiants seraient concernés, selon le Gouvernement, par l’échelon 7, pour lequel le montant de bourse s’élèvera à 5 500 euros par an, soit 15 % de plus que la bourse correspondant à l’échelon 6 ;
– un échelon 0 bis a été créé afin d’ouvrir, en faveur de 52 600 étudiants concernés par l’échelon 0 dans le barème antérieur, le droit à un montant annuel de bourse de 1 000 euros. Les étudiants concernés – soit, selon le Gouvernement, 40 % de l’ensemble des étudiants bénéficiant jusqu’ici de l’échelon 0 – sont ceux dont les parents bénéficient d’un revenu inférieur à 26 500 euros par an pour 0 point de charge.
Pour la rentrée universitaire 2013-2014, en application de l’arrêté interministériel du 6 août 2013, le barème d’attribution des bourses universitaires est le suivant – s’agissant des situations allant de 0 à 2 points de charge :
PLAFONDS DES REVENUS GLOBAUX BRUTS
POUR LE BÉNÉFICE DES BOURSES ÉTUDIANTES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014
Points de charge |
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé | ||||||||
0 |
0 bis (1 000 €) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
0 |
33 100 € |
26 500 € |
22 500 € |
18 190 € |
16 070 € |
13 990 € |
11 950 € |
7 540 € |
250 € |
1 |
36 760 € |
29 000 € |
25 000 € |
20 210 € |
17 850 € |
15 540 € |
13 280 € |
8 370 € |
500 € |
2 |
40 450 € |
31 500 € |
27 500 € |
22 230 € |
19 460 € |
17 100 € |
14 600 € |
9 220 € |
750 € |
Source : Arrêté du 6 août 2013 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2013-2014
Le tableau suivant retrace pour chaque échelon de bourse les effectifs prévisionnels d’étudiants concernés à compter de la rentrée 2013-2014.
EFFECTIFS PRÉVISIONNELS D’ÉTUDIANTS PAR ÉCHELON DE BOURSE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2013-2014
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé |
0 |
0 bis |
1 |
2 |
3 |
Effectifs prévisionnels d’étudiants |
90 332 |
52 600 |
107 269 |
56 513 |
63 844 |
Échelon de bourse et montant annuel du versement associé |
4 |
5 |
6 |
7 |
Total 0 à 7 |
Effectifs prévisionnels d’étudiants |
55 405 |
96 847 |
89 603 |
31 900 |
644 313 |
Source : PAP 2014 mission « Recherche et enseignement supérieur »
La création des échelons 0 bis et 7 constituent les principales dispositions d’un plan correspondant à un coût supplémentaire de 118 millions d’euros en 2013. Outre la création de ces échelons, ce plan prévoit pour la rentrée universitaire 2013-2014 l’attribution de 1 000 bourses supplémentaires – en sus des 6 000 existantes – à des étudiants au titre de leur « autonomie avérée ». Sans pouvoir prétendre à des bourses sur critères sociaux du fait des revenus de leurs parents, les étudiants concernés sont souvent en rupture avec ceux-ci et font face à des situations financières difficiles. Ils bénéficient ainsi d’un montant annuel de bourse compris entre 4 000 et 5 500 euros.
Ce plan s’ajoute au versement d’un 10ème mois de bourse à compter de la rentrée universitaire 2012-2013, pour un coût de 140 millions d’euros.
Ce plan – approuvé par les principales organisations syndicales étudiantes – constituerait la première étape d’un investissement de 200 millions d’euros, sans qu’il soit possible de préciser à ce stade dans quelles proportions ce montant relèverait en 2014 de la mise en œuvre :
– en année pleine des mesures entrant en vigueur lors de la rentrée universitaire 2013-2014 ;
– de dispositions nouvelles pour la rentrée 2014-2015, dont le contenu n’aurait à ce stade pas été fixé.
Le PAP annexé au projet de loi de finances pour 2014 indique que « la réforme du dispositif des aides aux étudiants sera poursuivie à la rentrée universitaire 2014-2015. À ce titre, les mesures constitutives de la réforme seront arrêtées au vu des conclusions et recommandations de la mission d’évaluation de la politique de vie étudiante constituée par le Premier ministre en 2013 dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP) ». Ces conclusions et recommandations ne sont pas connues à ce jour.
Au total, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit un montant de 1 864,4 millions d’euros pour le financement des bourses étudiantes.
c. Le prolongement de cette réforme doit permettre de revaloriser l’ensemble des bourses, d’étendre la proportion d’étudiants boursiers et de maintenir un dispositif de bourse au mérite
Pour les rapporteurs, le prolongement de la réforme des bourses étudiantes attribuées sur critères sociaux doit poursuivre plusieurs objectifs.
1. Alors que la première phase de 2013, par la création des échelons 0 bis et 7, a permis d’améliorer substantiellement la situation des boursiers issus des milieux les plus modestes et de certains des boursiers issus des classes moyennes, une part de l’effort supplémentaire prévu par le Gouvernement pour la rentrée 2014-2015 pourrait concerner une revalorisation de l’ensemble des bourses.
En 2014, leur montant sera revalorisé de 0,8 % « pour tenir compte de l’inflation constatée entre les deux dates d’élaboration des arrêtés relatifs aux taux des bourses (+ 0,8 % de mai 2012 à mai 2013) » (332). Une mesure améliorant le « pouvoir d’achat » de toutes les bourses étudiantes pourrait être prise dans le projet de loi de finances pour 2015, au-delà de l’inflation constatée. Le relèvement de 1 % du montant des bourses constitue un coût pour les finances publiques d’un montant de 19 millions d’euros environ.
2. Il serait pertinent d’atteindre à terme une proportion d’étudiants boursiers de 50 %. L’objectif est de contribuer à améliorer la position relative des déciles 4 et 5 de revenus au regard de la répartition des aides au financement des études, déciles qui bénéficient aujourd’hui de moins de 10 % de ces aides (cf. la courbe en U reproduite supra).
Une première étape pourrait être envisagée dans le cadre de la partie du plan gouvernemental de revalorisation des bourses qui sera mise en œuvre à compter de la rentrée universitaire 2014-2015. Atteindre cet objectif nécessitera sans doute plusieurs étapes. Il ne peut s’agir uniquement d’étendre jusqu’à la moitié des effectifs d’étudiants le bénéfice de l’échelon 0, auquel n’est attaché aucun montant de bourse. L’extension de la proportion des étudiants boursiers doit être accompagnée d’une modification progressive du barème des échelons afin d’augmenter concomitamment la proportion des étudiants bénéficiant d’un montant de bourse.
3. Les « bourses au mérite », devenues les aides au mérite à compter de la rentrée 2013-2014, sont attribuées à des étudiants boursiers sur critères sociaux particulièrement méritants :
– les bacheliers boursiers ayant obtenu la mention « très bien » au bac la perçoivent pendant trois ans à compter de leur entrée dans un établissement relevant du ministère de l’Enseignement supérieur ;
– les détenteurs boursiers de la licence, s’ils font partie des meilleurs lauréats de ce diplôme, perçoivent l’aide pendant deux ans à la condition qu’ils poursuivent leurs études en master.
Avant la présentation en juillet 2013 du plan gouvernemental de réforme des bourses attribuées sur critères sociaux, une suppression progressive des « bourses au mérite » a été annoncée. Sous la forme des « aides au mérite », elles sont toutefois maintenues sans modification dans le projet de loi de finances pour 2014. D’un montant annuel de 1 800 euros, elles seront attribuées en 2014 à environ 27 400 étudiants, soit environ 4,2 % des effectifs des étudiants boursiers. Le PAP annexé au projet de loi de finances pour 2014 précise que cette aide est « reconduite pour l’année 2013-2014 à l’identique de l’année 2012-2013, étant précisé qu’une réforme d’ampleur est envisagée pour l’année 2014-2015. »
Pour les rapporteurs, cette réforme « d’ampleur » ne doit pas conduire à la disparition totale d’une incitation à l’excellence venant s’ajouter aux bourses attribuées sur critères sociaux. La perspective de son bénéfice peut constituer une motivation pour certains étudiants disposant de faibles ressources. Elle peut donc être un facteur contribuant à la mobilité sociale au sein de la jeunesse étudiante.
● Compléter les aides au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux allocataires âgés de 18 à 25 ans qui ont achevé leur formation initiale.
● Réformer les aides fiscales dont bénéficient les familles au titre de leurs enfants étudiants afin :
– que les aides au financement des études (aides fiscales, bourses sur critères sociaux et allocations de logement) progressent en fonction des charges supportées par la famille et diminuent en fonction des revenus des parents ;
– de financer le supplément d’allocations de logement prévu ci-dessus en faveur des jeunes qui ont achevé leur formation initiale.
● Prévoir un pourcentage d’attribution des logements sociaux en faveur des jeunes.
● Utiliser l’intermédiation locative – mise en œuvre à grande échelle par des opérateurs de taille suffisante – pour augmenter la part des jeunes dans le parc locatif social et baisser leur taux d’effort dans le parc privé.
● Encourager – afin d’adapter les parcs de logements aux besoins des jeunes – la construction de logements adaptés, permettant une colocation institutionnalisée et composés de chambres individuelles autour de parties communes (cuisine, pièce à vivre, bureaux…). Prévoir la restructuration de logements existants selon cette configuration.
● Expérimenter un bail spécifique sécurisé de colocation entre jeunes, susceptible de « rassurer » les propriétaires des parcs locatifs sociaux et privés.
● Dans le cadre de la suite – à la rentrée 2014-2015 – du plan gouvernemental en faveur des bourses attribuées sur critères sociaux, revaloriser toutes les bourses, franchir une étape pour atteindre l’objectif d’une proportion d’étudiants boursiers de 50 % et maintenir un dispositif de récompense des étudiants boursiers particulièrement méritants.
B. LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET INTERNATIONALE
Les rapporteurs ont évoqué supra à plusieurs reprises la question de l’apport de la mobilité géographique à la mobilité sociale des jeunes :
– dans la filière scolaire professionnelle, où certaines formations sont rares, et dans l’apprentissage, où la mobilité est un impératif quand les formations théorique et pratique sont éloignées l’une de l’autre, la capacité de mobilité dont disposent les jeunes contribue au succès de leur formation initiale. Sur ce sujet, les rapporteurs ont notamment proposé d’optimiser l’usage des places existantes d’internat dans les lycées ;
– la mobilité peut également être nécessaire pour s’éloigner d’un environnement propice au décrochage ou qui y a conduit ;
Les rapporteurs proposent qu’un portail, dédié aux jeunes, soit consacré à la promotion de la mobilité et à la présentation des dispositifs, de tous ordres et de toutes origines, dont l’objet est de contribuer à la mettre en œuvre. Ce portail numérique constituerait le point d’entrée pour les jeunes pour assurer leur information. L’usage de ce portail leur garantirait, sur leur demande, d’obtenir un contact avec un conseiller ou un professionnel pour se renseigner plus précisément ou commencer d’élaborer un projet.
Les rapporteurs souhaitent que ce portail traite de toutes les mobilités, qu’elles soient liées pour le jeune à son orientation, à son émancipation professionnelle ou à son souhait d’effectuer une mobilité internationale. Un portail unique pour toutes les mobilités devrait pouvoir à la fois valoriser la mobilité en soi – ce qui est hautement souhaitable tant elle constitue une valeur ajoutée « à vie », selon la totalité des acteurs et bénéficiaires rencontrés par les rapporteurs – et procurer des idées nouvelles à ceux qui étaient venus sur le portail avec une raison, une question ou un projet particulier en tête.
1. Renforcer l’ampleur et la cohérence des dispositifs de mobilité internationale
a. L’offre de mobilité internationale est segmentée entre des opérateurs aux statuts différenciés
Le tableau suivant constitue un panorama des principales caractéristiques (statuts, missions, dispositifs et publics concernés) des opérateurs français de la mobilité internationale.
CARACTÉRISTIQUES ET ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS INSTITUTIONNELS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Opérateur |
Statut |
Objet |
Dispositifs et actions |
Publics pris en charge |
Agence Europe – éducation – formation France (2E2F) |
GIP placé sous la tutelle des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle |
Mise en œuvre du programme communautaire pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) |
Comenius (coopération et échanges scolaires aux niveaux primaire et secondaire) |
Nombre des mobilités En 2012 prises en charge par 2E2F : |
l’Agence française du programme européen « jeunesse en action » (AFPEJA) |
Un des services de l’établissement public « Institut nationale de la jeunesse et de l’éducation populaire » (INJEP) |
Mise en œuvre du programme communautaire « jeunesse en action » de mobilité internationale dans le champ de l’éducation non formelle |
Échanges et mobilité internationale pour des jeunes et acteurs de jeunesse hors du cadre scolaire. |
Échanges en 2012 : SVE : |
Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) |
Organisation internationale, Traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963 |
Resserrement des liens entre les jeunesses allemande et française et promotion des échanges collectifs |
Échanges concernant des jeunes et groupes de jeunes |
En 2011 : |
Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) |
Organisation internationale, Protocole du 9 février 1968 |
développement des relations entre les jeunesses française et québécoise et promotion des rencontres et échanges de jeunes |
Conseil et soutien à la mobilité professionnelle (banque de stages, accompagnement sur le marché du travail québécois, soutien financier) |
10 000 jeunes chaque année |
(*) Le programme européen EFTLV comprend également le dispositif Grundtvig, programme d’éducation pour adultes.
Le tableau suivant retrace pour chacun de ses opérateurs les crédits dont il bénéficie ainsi que leur origine.
MOYENS FINANCIERS DES OPÉRATEURS INSTITUTIONNELS DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE EN FRANCE
Opérateurs |
Financeurs |
Référence |
Financements |
Objets des financements |
2E2F |
Union européenne |
2011 |
95,2 M€ Prévision 2012 : 106 Md€ |
Pour 2011(*) : – 13,2 M€ pour Comenius Partie des charges de personnel et de fonctionnement |
Budget de l’État français |
2011 |
1,6 M€ |
Partie des charges de personnel et de fonctionnement | |
AFPEJA |
Union européenne |
2012 |
2012 : |
Mobilité internationale et SVE Fonctionnement et partie des charges de personnel |
Budget de l’État français |
Partie de la subvention annuelle de fonctionnement de l’INJEP |
Rémunérations de certains agents |
Parties des charges de personnel | |
OFAJ |
Budget de la République fédérale d’Allemagne |
Financement bilatéral paritaire |
11,55 M€ |
Charges de personnel, fonctionnement et toute action de l’office |
Budget de l’État français |
PLF 2014 |
11,55 M€ | ||
OFQJ |
Budget du Gouvernement du Québec |
Financement bilatéral paritaire |
1,96 M€ |
Charges de personnel, fonctionnement et toute action de l’office |
Budget de l’État français |
PLF 2014 |
1,96 M€ |
(*) En 2011, l’agence E2EF finance également le programme Grundtvig à hauteur de 3,6 millions d’euros. Un reliquat est consacré à l’organisation de visites d’études.
Des modifications institutionnelles et de programmation auront lieu à compter de 2014 dans le panorama des opérateurs en France de la mobilité internationale :
– le programme communautaire EFTLV deviendra « Erasmus + » et sera décliné en compartiments analogues au programme actuel – enseignement scolaire, enseignement universitaire, formation professionnelle et éducation des adultes. Dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle de l’Union européenne pour les années 2014-2020, selon les informations rendues publiques par l’agence 2E2F, Erasmus + sera doté à l’échelle de l’Union européenne de « 14,5 milliards d’euros pour 7 ans soit 40 % de plus que les programmes actuels ». Dans le contexte de cette nouvelle étape pour les programmes communautaires de mobilité internationale, l’agence 2E2F pourrait prochainement s’intituler « Erasmus France » ;
– dans le contexte à la fois du lancement d’Erasmus + et du projet de rattachement de l’INJEP au futur délégué interministériel à la jeunesse, l’AFPEJA pourrait être prochainement rapprochée de l’Agence du service civique.
b. L’augmentation des moyens en faveur de la mobilité internationale doit être plus particulièrement orientée vers les jeunes « ayant moins d’opportunités »
L’Union européenne a décidé une augmentation substantielle des crédits consacrés à la mobilité internationale sur la période 2014-2020, qui va impacter les programmes aujourd’hui gérés par l’agence 2E2F et l’AFPEJA. Dans une moindre proportion, les crédits de l’OFAJ ont été augmentés de deux millions d’euros en 2013 et 2014, dans le contexte du cinquantième anniversaire en 2013 du Traité de l’Élysée.
Il importe que ces moyens supplémentaires soient l’occasion d’orienter résolument les politiques publiques en faveur de la mobilité internationale vers les jeunes les plus en difficulté. Jusqu’à maintenant, les dispositifs de mobilité internationale ont pu concerner de façon plus marquée des jeunes issus de milieux aisés. Le programme EFTLV est majoritairement (333) mis en œuvre via son dispositif emblématique et historique Erasmus, qui promeut des mobilités internationales dans un cadre universitaire. Les étudiants en France, et sans doute en Europe, sont, moins que pour l’ensemble de leur classe d’âge, issus de familles modestes.
Les étudiants issus des classes sociales défavorisées sont en outre moins que d’autres en capacité de compléter une bourse Erasmus – dont le montant, variable selon le pays de destination, est souvent inférieur à 200 euros par mois – avec des « fonds propres ». Ils peuvent toutefois bénéficier d’autres aides pour financer un tel projet (334) :
– s’ils sont boursiers, ils peuvent pendant leur séjour à l’étranger cumuler leur bourse attribuée sur critères sociaux en France et la bourse Erasmus ;
– les étudiants boursiers peuvent bénéficier d’une bourse spécifique pour financer leur mobilité internationale, d’un montant de 400 euros par mois, versée pendant 2 à 9 mois. Les crédits correspondants sont portés par la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour un montant prévisionnel de 25,7 millions d’euros dans le PLF 2014 (335). Les établissements d’enseignement supérieur décident de l’attribution de cette bourse spécifique au cas par cas ;
– un étudiant séjournant à l’étranger via Erasmus paie les droits d’inscription dus au titre de son établissement d’origine. Cette règle avantage beaucoup d’étudiants français, car les droits d’inscription aux universités françaises sont modérés au regard de beaucoup des tarifs pratiqués au sein de l’Union européenne. Elle constitue un avantage accru pour les étudiants boursiers qui sont exonérés des droits d’inscription dans les universités françaises.
Ces aides illustrent un souci croissant d’équité dans la répartition des moyens publics contribuant à la mobilité internationale des étudiants. Le développement du dispositif Leonardo au sein du programme EFTLV, destiné notamment à permettre à des jeunes en formation professionnelle initiale sous statut scolaire ou en alternance d’effectuer des mobilités internationales, permet également d’ouvrir celles-ci à des publics disposant de moins de moyens et d’opportunités.
Lors de leur déplacement au Danemark du 17 au 19 avril 2013, les rapporteurs ont rencontré de jeunes Français, ainsi que leur accompagnateur, en stage dans ce pays via le dispositif Leonardo, dans le cadre de leur formation en apprentissage pour obtenir le brevet professionnel d’électricien. Ce séjour de trois semaines se déroulait en alternance, une semaine à l’école et deux semaines en entreprise. Le CFA de ces apprentis, situé à Rouen, s’appuie en outre sur le dispositif Leonardo et l’aide de la région Haute-Normandie pour développer des échanges d’apprentis avec l’Allemagne, le Danemark et la Finlande.
Ce CFA accompagne la valorisation de cette expérience en requérant des apprentis la rédaction d’un rapport de stage et en leur accordant en contrepartie un certificat de mobilité associé à leur diplôme. Pour l’accompagnateur des apprentis, une telle expérience constitue une réelle valeur ajoutée sur le marché du travail. Au vue des échanges entre les apprentis français et les rapporteurs, il s’agit en tout état de cause d’un apport sans équivalent, en direction de jeunes ayant de façon générale peu voyagé auparavant, s’appuyant sur la découverte et la comparaison des cultures professionnelles et des modes de vie.
L’OFAJ a historiquement conduit des actions en direction de jeunes en grande partie issus des classes sociales favorisées ; l’apprentissage de la langue allemande demeure en France un choix opéré par – ou pour – des élèves de bon niveau scolaire général et dont les familles prêtent une attention soutenue au cursus de leurs enfants. Or, les élèves français germanistes sont par construction la cible privilégiée des activités de l’office.
Mme Béatrice Angrand, secrétaire générale française de l’OFAJ (336) – que le groupe de travail animé par les rapporteurs a reçue le 26 juin 2013 lors d’une table ronde consacrée à la mobilité internationale – a considéré que l’élitisme souvent attaché à l’image de l’office constituait une façade que la réalité démentait désormais au moins en partie. Elle a souligné l’effort particulier réalisé par l’OFAJ depuis quelques années pour favoriser les mobilités des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés et de l’immigration :
– une démarche volontariste a été initiée pour que des échanges plus nombreux soient effectués concernant des élèves relevant de l’éducation prioritaire ;
– des projets pilotes entre les villes de Hambourg et Marseille, et également de Neukölln et Clichy-sous-Bois, ont été mis en œuvre pour favoriser les échanges de jeunes issus des quartiers populaires de ces villes ;
– un poste de chargé de mission à l’intégration et à l’égalité des chances a été créé au sein de l’équipe de l’OFAJ.
Mme Béatrice Angrand, à l’instar des autres intervenants lors de la table ronde du 26 juin 2013, a souligné la valeur ajoutée considérable d’une mobilité internationale réussie pour des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés, en termes de sentiment d’appartenance à la société – ainsi qu’à la communauté nationale –, de confiance en soi et de déplacement, voire de rupture, des horizons personnels et géographiques. Ces mobilités et ces échanges nécessitent une préparation et une ingénierie particulières pour garantir leur succès, qui font désormais l’objet de formations ad hoc à destination des accompagnants. L’une des clés du succès réside en outre dans la participation des jeunes à l’élaboration et le déroulement des modalités de leur séjour et dans la capacité des organisateurs et accompagnants à leur faire confiance.
L’apport majeur de la mobilité internationale pour les jeunes les plus éloignés de ce type d’opportunité fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’agence française pour le programme européen « jeunesse en action » (AFPEJA). Ce programme s’adresse potentiellement à tous les jeunes, qu’ils soient scolarisés ou non et quel que soit leur niveau de qualification. L’agence utilise largement le concept des « jeunes avec moins d’opportunités » – JAMO – selon la terminologie proposée par l’Union européenne pour désigner des jeunes en situation de handicap et des jeunes issus d'un milieu social défavorisé ou d'une région moins dynamique que les autres (337). Dans ses rapports d’activité, l’AFPEJA quantifie la part des actions qu’elle conduit, finance et soutient qui concernent des JAMO.
L’Assemblée nationale a adopté le 17 juillet 2013, notamment à l’initiative de notre collègue Sandrine Doucet – membre du groupe de travail animé par les rapporteurs –, une résolution européenne sur la démocratisation du programme Erasmus, à l’occasion des négociations communautaires relatives aux modalités de mise en œuvre du programme Erasmus + pour les années 2014 à 2020 (338). Notre assemblée a ainsi fait valoir son attachement à une démocratisation accrue des outils communautaires de mobilité internationale. Cette résolution européenne précise notamment que l’Assemblée nationale :
– « demande que le renforcement de la fongibilité entre les différents types de programmes ne se traduise pas par une asymétrie au détriment d’actions en faveur des publics les moins enclins, pour des raisons sociales et économiques, à la mobilité européenne et internationale » ;
– « demande également, afin de répondre à l’objectif d’une démocratisation du programme Erasmus pour tous, que […] la part de l’enveloppe budgétaire consacrée aux mobilités destinées à la formation professionnelle et à la formation technique, notamment à la formation en alternance, soit augmentée » ;
– « souhaite également que les États membres développent une politique plus volontariste, notamment par la modulation des bourses allouées aux étudiants en fonction de critères socio-économiques. »
Le souci croissant de développer la mobilité internationale en direction des jeunes issus des milieux sociaux défavorisés – pour lesquels elle permet de constater une valeur ajoutée visiblement considérable – pourrait également s’appuyer sur des lignes directrices communes portant sur la définition des publics cibles (catégories socio-professionnelles des familles, jeunes chômeurs, élèves relevant de l’éducation prioritaire, élèves des voies professionnelles en alternance ou sous statut scolaire, publics accueillis par les missions locales…), les objectifs quantifiés à atteindre en la matière, les modalités d’organisation des mobilités et échanges internationaux, les moyens de les valoriser et l’évaluation de cette valeur ajoutée.
L’élaboration et la mise en œuvre de ces lignes directrices pourraient faire l’objet d’un travail en commun – avec les pouvoirs publics – des opérateurs évoqués précédemment, ainsi que des acteurs non publics concernés (339). Ce travail serait également consacré aux modalités de participation et de présentation de ces acteurs au sein du portail numérique, consacré à toutes les mobilités des jeunes – internationales, mais également induites par leurs choix d’orientation et professionnels –, qu’il est souhaitable, selon les rapporteurs, de créer. Ce travail entre acteurs publics et privés de la mobilité internationale serait sans doute susceptible de faire apparaître d’autres champs de rapprochements, d’échanges et de mises en pratique partenariales.
2. Conforter l’accès des jeunes au permis de conduire
a. Le permis de conduire : examens, professionnels et principaux éléments statistiques
Le permis de conduire est une autorisation délivrée par l’administration de circuler dans certains véhicules sur des voies ouvertes au public. Au préalable, chaque candidat à l’examen – par lequel cette délivrance est jugée opportune ou non – doit avoir été formé par une ou des personnes exerçant, dans une école de conduite, la profession réglementée d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
L’administration autorise l’exercice de cette profession à condition, notamment, que la personne souhaitant enseigner soit titulaire du brevet pour l’exercice de l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPACASER). Environ 28 000 enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière exercent dans 11 250 écoles de conduite en France, dans lesquelles est également prodiguée la formation nécessaire à l’examen théorique du code de la route, dont l’obtention est un préalable nécessaire au passage de l’examen pratique du permis de conduire. Ces enseignants constituent le « vivier » dans lequel sont recrutés :
– les formateurs de ces mêmes enseignants, via l’obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) ;
– les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), suite à la réussite d’un concours administratif de la fonction publique d’État. Ce concours est ouvert à tout candidat titulaire d’un diplôme de niveau bac. Les 1 282 IPCSR (en 2013) jugent des capacités des candidats au permis de conduire lors d’un examen pratique dont le passage est gratuit (340).
L’examen pratique du permis de conduire de catégorie B, ouvrant droit à la conduite des voitures de tourisme, est passé 1,7 million de fois par an. Chaque année, 1 million de personnes nouvelles passent cet examen, dont une grande partie des personnes qui ont atteint récemment l’âge de 18 ans. Les taux de réussite en 2012 s’établissement à environ 70 % pour l’examen théorique (le « code ») et à un peu moins de 60 % pour l’examen du permis de conduire proprement dit – 58,49 % (341) au total et 59,13 % pour les candidats se présentant à l’examen pour la première fois.
Lors de la table ronde du 11 septembre 2013 sur l’accès des jeunes au permis de conduire organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs, le « coût » du permis de conduire, c’est-à-dire le coût de la formation, puisque l’examen lui-même est gratuit, a été estimé par M. Pierre Ginefri – sous-directeur de l’éducation routière au sein de la délégation à la sécurité et à la circulation routières – à 1 500 euros en moyenne, chiffre qui masque des disparités régionales parfois marquées (342) .
Depuis quelques années, des aides sont proposées aux candidats à l’examen du permis de conduire :
– le dispositif du permis dit « à 1 euro par jour » s’appuie sur l’octroi d’un prêt bancaire au candidat pour financer sa formation. Son remboursement est effectué sur la base de mensualités d’un montant maximum de 30 euros par mois – soit 1 euro par jour. Le prêt, à taux zéro, est en principe cautionné par la Caisse des dépôts et consignations dès lors que le bénéficiaire ne peut présenter la caution de ses parents ou d’un tiers. Le montant du prêt est versé directement par la banque à l’école de conduite choisie par le bénéficiaire. Le montant du prêt s’établit à environ 1 000 euros. Ce dispositif est assez largement utilisé, puisque 87 000 prêts ont été attribués en 2012 ;
– Pôle emploi a financé en 2010 30 000 aides plafonnées à 1 200 euros à des chômeurs, souvent des jeunes, afin de financer leur formation à la conduite.
Les collectivités territoriales proposent d’autres aides, parfois en contrepartie de travaux d’intérêt collectifs que le candidat s’engage à effectuer à leur profit.
Le dispositif le plus efficace pour augmenter les chances de succès à l’examen et baisser le coût de la formation demeure la conduite accompagnée, à compter de 16 ans, par laquelle le jeune se forme par une pratique minimale de 3 000 kilomètres par an de conduite avec un tuteur, qui est souvent l’un de ses parents. Les rapporteurs ont évoqué supra l’expérience en 2010 tendant à mettre en œuvre le modèle de la conduite accompagnée au bénéfice d’apprentis dans le secteur du bâtiment, le chef d’entreprise étant lui-même le tuteur. Si les entreprises étaient en l’espèce peu outillées pour garantir le succès de la démarche, il convient sans doute d’explorer à nouveau la voie de l’implantation de la conduite accompagnée au sein de l’entreprise, notamment au bénéfice d’apprentis.
b. Améliorer la formation et les procédures
L’accès des jeunes au permis de conduire est fondamental pour leur autonomie personnelle, a fortiori sans doute dans les zones rurales. Il constitue un enjeu cardinal pour leur insertion professionnelle dans de nombreuses zones géographiques et de nombreux secteurs d’activité. Les jeunes éloignés de l’emploi et peu ou pas formés sont souvent dépourvus du permis de conduire : un tiers seulement des jeunes pris en charge au titre du CIVIS par les missions locales en disposent.
Comme l’évoquent les rapporteurs dans la première partie du présent rapport, ces constats ont conduit le FEJ à financer depuis 2009 58 projets (sur 550 au total) d’expérimentation concernant l’accès au permis de conduire. Beaucoup de ces expérimentations, à destination des jeunes en difficulté, ont consisté en une aide financière, parfois couplée à un accompagnement personnalisé – via par exemple les conseillers des missions locales. Les objectifs étaient la constatation d’un progrès à la fois dans l’accès au permis et à l’emploi.
Les évaluations de ces expérimentations ont tenté de mesurer ce progrès, pour autant qu’il était constaté. Dans une note thématique d’août 2013, le FEJ montre que les résultats quantitatifs portant sur l’accès au permis sont réels, bien que les taux de succès demeurent modérés : « le dispositif augmente l’accès aux auto-écoles, la réussite au code, la réussite au permis et le fait de disposer d’un véhicule. Le taux d’obtention du permis de conduire est ainsi de 25,2 % dans le groupe test à 12 mois et de 44,8 % à 24 mois, contre 13,6 % et 29,8 % dans le groupe témoin. Le dispositif augmente donc de près de 50 % les chances d’obtention du permis à un horizon de 24 mois. 2 ans après l’aide attribuée à 10 000 jeunes, on peut dire que 1 500 n’auraient pas eu le permis sans elle. Cet effet positif n’est pas lié à l’augmentation des taux de réussite aux examens mais à la capacité donnée aux jeunes de pouvoir tenter plusieurs fois les épreuves. » (343)
S’agissant de l’accès à l’emploi, le bilan est plus nuancé encore, même s’il « finit », pour les jeunes qui accèdent au permis de conduire, par être en moyenne positif. Le FEJ indique ainsi, dans le même document, que « le dispositif n’a, en revanche, pas d’effet notable sur les chances d’accéder à un emploi et sur la qualité des emplois occupés (salaire, type de contrat de travail, durée du travail et statut d’emploi), à court terme comme à long terme. Lorsqu’ils préparent leur permis de conduire, les jeunes sont moins mobiles géographiquement, recherchent moins activement un emploi, une formation ou un emploi de meilleure qualité que celui qu’ils occupent. Une fois le permis de conduire acquis, ces caractéristiques s’inversent. Les jeunes gagnent en mobilité résidentielle et l’emploi devient plus accessible. »
Au total, le FEJ considère que le « retour sur investissement » des aides aux jeunes en difficulté pour passer le permis de conduire n’est pas satisfaisant, ce qui pose la question de la pertinence de l’organisation même de la formation et de l’examen : « deux ans après l’entrée dans le dispositif, plus d’un jeune sur deux n’a pas réussi à obtenir le permis de conduire et près de deux jeunes sur trois n’ont pas encore de véhicule. Les aides financières accordées aux jeunes pour faciliter le passage du permis ont des effets de long terme positifs, mais au prix d’effets de court terme défavorables du point de vue de l’insertion professionnelle et de l’intégration sociale des jeunes. Pour ces raisons, l’évaluation quantitative conclut qu’“il conviendrait de réexaminer les conditions d’une simplification du passage du permis de conduire pour les jeunes, afin d’en réduire le coût financier mais aussi la durée et la difficulté” ».
Ces constats ne condamnent pas les aides financières dont peuvent – dont doivent – bénéficier les jeunes en difficulté pour tenter d’obtenir le permis de conduire, ils montrent qu’un dividende supérieur en serait tiré si certains éléments propres au système de formation étaient améliorés.
La table ronde organisée par le groupe de travail animé par les rapporteurs a fait émerger plusieurs pistes pour simplifier et améliorer l’accès des jeunes au permis de conduire, au-delà de celle évoquée supra concernant le développement de la conduite accompagnée, notamment au sein des entreprises :
– l’obligation de suivre un minimum de 20 heures de cours pratique augmente inutilement la durée et le coût de la formation pour les candidats rapidement aptes à passer et réussir l’examen. Pour les autres candidats, ce minimum peut leur donner le sentiment qu’il est en tout état de cause suffisant et qu’il existe un droit à passer l’examen à l’issue de ces 20 heures de pratique. Il est sans doute pertinent de lever ce verrou des 20 heures et de charger les écoles de conduite d’adapter la durée de formation au cas par cas ;
– le candidat au permis de conduire devrait pouvoir commencer sa formation en s’inscrivant lui-même auprès de la préfecture à l’examen (344). Il pourrait recevoir à cette occasion une liste des écoles de conduite se situant à proximité de son domicile, auxquelles serait associé leur taux de réussite respectif aux examens. Cette préconisation a une portée plus importante que celle que lui confère apparemment sa simplicité. Il s’agit d’assurer une certaine transparence s’agissant des « quelques établissements d'enseignement de la conduite peu scrupuleux [qui] ternissent l'image de la profession car ils font l’essentiel de leurs bénéfices sur les échecs des candidats aux examens »(345) ;
– sous réserve de parvenir à ne pas augmenter le volume des programmes et des enseignements au niveau secondaire, certains éléments fondamentaux de formation théorique pourrait être prodiguée pendant le temps scolaire. Il pourrait également être exigé des conducteurs de deux-roues à partir de 14 ans qu’ils soient détenteurs de l’examen théorique du permis de conduire, c’est-à-dire du code de la route. L’accidentologie des deux-roues suffit à justifier la pertinence de cette mesure, qui permettrait également de lisser sur une période plus longue les apprentissages et le coût du permis dans son ensemble.
Aides existantes, modalités de passage des examens, procédure à suivre, coordonnées des professionnels : le permis de conduire doit en tout état de cause se situer au centre des informations mises à la disposition des jeunes sur les portails, dont les rapporteurs souhaitent la création, relatifs à leur mobilité et à leur information.
● Engager les opérateurs de la mobilité internationale des jeunes autour de l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices, concernant notamment :
– la proportion, les modalités et l’évaluation des mobilités offertes aux jeunes les plus éloignés de ce type d’opportunités ;
– la participation de ces opérateurs au portail consacré aux mobilités des jeunes ;
– tout élément permettant de renforcer les pratiques partenariales de ces opérateurs.
● Simplifier le permis de conduire afin de faciliter l’accès des jeunes à la conduite, notamment en :
– relançant la conduite accompagnée, notamment dans les entreprises ;
– adaptant la durée de formation pratique aux aptitudes de chaque candidat ;
– établissant la transparence sur les taux de réussite propres à chaque école de conduite ;
– anticipant la formation théorique dans le cadre scolaire et auprès des conducteurs de deux-roues à compter de l’âge de 14 ans.
Au cours de sa séance du 5 décembre 2013, le Comité examine le présent rapport.
M. le président Claude Bartolone. Nous allons aujourd’hui examiner le rapport d’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, réalisé à la demande du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC). Nos deux rapporteurs sont Régis Juanico, pour la majorité, et Jean-Frédéric Poisson, pour l’opposition. Le groupe de travail désigné par les commissions était composé de Sandrine Doucet, Virginie Duby-Muller, Jean-Patrick Gille, Michel Piron et Sylvie Tolmont.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Je présenterai d’abord la méthode et le cadre général de notre travail.
La question qui nous a été posée par le Comité, à l’initiative du groupe SRC, était simple : comment se fait-il que la France, qui consacre chaque année près de 85 milliards d’euros aux politiques en direction des jeunes, se caractérise par un ascenseur social sinon en panne, du moins très grippé ?
Face à un problème aussi vaste, nous avons dû choisir des angles d’attaque. Nous avons d’abord décidé de ne pas procéder à un audit de l’Éducation nationale, préférant nous concentrer sur le problème de la mobilité sociale, c’est-à-dire sur la possibilité offerte aux jeunes de voir leur sort personnel s’améliorer par rapport à celui des générations précédentes, ce qui soulève la question de leur accès à l’autonomie et de ses moyens.
Les services de l’Assemblée, que je remercie de leur travail et de leurs efforts, nous ont d’abord fourni une note de cadrage, après quoi nous est venue l’idée saugrenue de leur demander une liste des dispositifs d’aide à l’autonomie des jeunes ainsi qu’une fiche de synthèse. Un premier jet a permis d’énumérer 37 dispositifs différents, répartis entre 11 ministères, mais, dans un second temps, ce sont 42 mécanismes qui ont été identifiés. Il a semblé préférable d’arrêter là les recherches, de peur de voir encore apparaître des dispositifs supplémentaires ! Nous ne sommes donc même pas sûrs que la liste à laquelle nous sommes parvenus soit exhaustive. Dès lors, il est peu probable que l’on puisse trouver une seule personne qui connaisse tous ces dispositifs et leur fonctionnement ; à supposer même que ce soit le cas, il n’est pas certain qu’elle puisse aider efficacement un jeune à repérer parmi eux celui qui lui convient.
En somme, et sans mettre en cause la bonne volonté des acteurs, non seulement l’on dépense une somme considérable pour une efficacité réduite, mais le système est d’une terrible complexité, typiquement française en ce qu’elle résulte d’un empilement de dispositifs. Nous avons donc travaillé dans deux directions, cherchant d’une part à optimiser l’utilisation des ressources très importantes mises à la disposition des jeunes, d’autre part à clarifier, simplifier, rationaliser autant que possible l’organisation des différentes aides.
À cette fin, nous avons entendu plus d’une centaine de personnes au cours de 31 auditions et tables rondes. Nous nous sommes rendus à Copenhague et à Berlin, en Rhône-Alpes et en Bretagne. Nous avons adressé des questionnaires à plusieurs ministères ainsi qu’à Pôle emploi. Les questeurs de l’Assemblée nous ont autorisés à commander à KPMG/Euréval une étude spécifique portant sur différents territoires et fondée sur un cahier des charges détaillé. Les nombreux acteurs que nous avons rencontrés sur le terrain ont en commun une détermination absolue, qui leur permet de faire des miracles avec des bouts de ficelle, dans un complet désert réglementaire : ils expérimentent de tous côtés, probablement sans que l’on en sache grand-chose au plus haut niveau de l’État. L’intérêt de leur démarche nous a incités à encourager l’expérimentation dans notre rapport.
M. Régis Juanico, rapporteur. La première partie de notre rapport est consacrée à la gouvernance des politiques de jeunesse.
Compte tenu de l’ampleur du sujet, nous avons décidé de concentrer nos travaux sur un nombre limité de dispositifs, à certaines étapes clés du parcours d’un jeune.
Concernant tout d’abord le système éducatif, qui constitue pour les jeunes issus de milieux modestes une première chance de s’élever socialement par leur travail et leurs compétences, nous nous sommes principalement intéressés à l’orientation, aux filières professionnelles et aux actions de lutte contre le décrochage. Nous avons par ailleurs examiné le rôle des acteurs et l’efficacité des dispositifs visant à favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie ainsi que l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés. Quelles que soient les difficultés qu’ils ont pu rencontrer dans leur parcours scolaire, ces jeunes doivent avoir des possibilités effectives de rebondir et de saisir des « deuxièmes chances », tout au long de leur parcours.
Il s’agissait ainsi non seulement de permettre au système éducatif de contribuer plus efficacement à l’égalité des chances, mais aussi de veiller à ce que l’école ne soit pas la seule voie de mobilité sociale, afin de ne pas figer précocement les destins et de soutenir la construction de parcours de progression sociale pour et avec les jeunes – une expression que nous devrions reprendre dans le titre définitif de notre rapport.
Lever les freins à la mobilité sociale suppose toutefois, au préalable, de réformer la gouvernance des politiques destinées aux jeunes, afin de mieux fédérer les énergies, d’améliorer le pilotage et de renforcer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de l’action publique.
La mobilité sociale, objet de notre évaluation, désigne le passage des individus d’une position sociale à une autre. Nous nous sommes principalement fondés sur l’analyse de la mobilité intergénérationnelle, qui en constitue la mesure la plus précise et permet de suivre les évolutions de la société française sur une longue période. Cette notion compare la catégorie socioprofessionnelle occupée par les adultes au milieu de leur parcours professionnel, vers quarante ans, à celle à laquelle appartenait leur père. Tel est l’objet de l’enquête dite FQP, sur la formation et la qualification professionnelle, dont la dernière date de 2003, la prochaine devant paraître en 2014. Dans quelles conditions les individus peuvent-ils effectivement cheminer dans l’espace social et s’élever au-dessus de la condition de leurs parents ?
Nous avons approfondi l’analyse en prenant aussi en considération l’évolution de la structure des emplois – la mobilité structurelle, à distinguer de la mobilité nette – et les changements de catégorie socioprofessionnelle au cours de la carrière, par l’étude de ce que l’on appelle la mobilité professionnelle.
La première partie du rapport comporte une analyse approfondie de la mobilité sociale des jeunes et de ses freins, ainsi que des spécificités du système français. Sans y revenir en détail, soulignons que le modèle français présente incontestablement des atouts à valoriser, liés en particulier à son dynamisme démographique. Les jeunes de 16 à 25 ans représentent environ 13 % de la population française, ce qui nous place au deuxième rang européen, derrière l’Irlande et devant de nombreux pays voisins, dont l’Allemagne. C’est un formidable atout pour l’avenir.
La reproduction des inégalités sociales reste toutefois marquée. Ainsi, selon l’enquête FQP de 2003, 52 % des hommes de 40 à 59 ans fils de cadres supérieurs étaient eux-mêmes cadres supérieurs, contre 10 % seulement des fils d’ouvriers du même âge, et 46 % des fils d’ouvriers étaient eux-mêmes ouvriers. En somme, on observe aux deux extrémités de l’échelle sociale un puissant déterminisme social et une faible mobilité sociale nette. Chiffre révélateur, on ne comptait en 2003 que 6 % de fils d’ouvriers en classes préparatoires aux grandes écoles, ce qui confirme que les jeunes générations sont confrontées à des pannes prolongées de l’ascenseur social.
On observe également une faible mobilité horizontale ou professionnelle : les parcours restent assez linéaires, dominés par le modèle qui veut que l’on se forme d’abord, que l’on travaille ensuite, et par la place démesurée accordée au diplôme obtenu à l’issue de la formation initiale. Au Danemark, par exemple, il est beaucoup plus fréquent de travailler ou de faire des césures pendant ses études, ou encore de revenir en formation au cours de la carrière professionnelle.
Bref, notre système éducatif occupe une place centrale dans les destins sociaux. Si la célèbre formule de Bourdieu, selon laquelle « l’école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent », paraît excessive au regard de la réelle démocratisation de l’accès aux diplômes dans le secondaire et le supérieur, les comparaisons internationales montrent que le système éducatif conduit à l’échec scolaire et à la précarité une grande partie des élèves moyens ou faibles issus de familles modestes. La toute dernière enquête PISA souligne ainsi que la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus marquée en France que dans la plupart des pays de l’OCDE. La forte différenciation sociale des performances des élèves est illustrée par deux phénomènes : le recul des résultats scolaires dans l’éducation prioritaire, qui affecte notamment la maîtrise des compétences de base en fin de CM2 et en fin de troisième, et l’accès au bac des enfants des catégories socialement défavorisées ; la spécialisation socio-économique des filières de l’enseignement secondaire, la voie professionnelle étant de plus en plus réservée aux enfants d’inactifs et d’ouvriers non qualifiés – ce qui peut accréditer l’image de l’école comme « machine à trier » la jeunesse, pour reprendre le titre d’un ouvrage publié récemment par plusieurs sociologues.
![]()
Les politiques publiques en faveur des jeunes bénéficient de moyens importants, environ 80 milliards d’euros pour les seuls crédits d’État. Mais l’on peut se demander si leur performance n’est pas affaiblie par le foisonnement des acteurs et l’empilement des dispositifs, insuffisamment ciblés sur les jeunes qui connaissent les plus grandes difficultés d’insertion. Plus de 80 dispositifs de la politique de l’emploi ont ainsi visé les jeunes depuis 1977.
Par ailleurs, un pilotage performant de l’action publique suppose de pouvoir s’appuyer sur une analyse robuste de l’efficacité et de l’efficience des différents leviers susceptibles d’être mobilisés : les objectifs fixés ont-ils été atteints, et à quel coût ? Or, en dépit de progrès réels dans certains domaines, l’efficacité des différents dispositifs apparaît inégale et insuffisamment évaluée. C’est par exemple le cas en matière d’orientation.
Il est donc nécessaire d’adapter les compétences des acteurs et de déployer les outils nécessaires, au niveau national et territorial, pour assurer une conception, une mise en œuvre et une évaluation efficaces des politiques publiques en faveur de la jeunesse.
À cette fin, nous proposons de mieux associer les principaux acteurs et parties prenantes, en particulier les jeunes, à la conception et au suivi des politiques, en créant un Conseil d’orientation des politiques de jeunesse associant représentants de l’État, partenaires sociaux, collectivités territoriales, associations et mouvements de jeunes, en lien avec l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, l’INJEP. Nous préconisons également d’assurer une représentation et une participation effective des jeunes au sein de tous les dispositifs qui les concernent, notamment en renforçant leur présence dans les conseils d’administration des missions locales et des centres de formation d’apprentis, ainsi que dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Nous proposons enfin de créer trois portails à l’intention des jeunes, qui y accéderaient sur un mode numérique mais seraient assurés, s’ils le demandent, de pouvoir entrer en contact « humain » avec un professionnel chargé d’amorcer l’accompagnement. Le premier portail permettrait d’orienter les jeunes vers les acteurs chargés de les informer et de gérer leurs droits ; il serait construit à partir du réseau information jeunesse existant et intégrerait le service public de l’orientation, dont la déclinaison régionale fait actuellement l’objet de huit expérimentations. Le deuxième, construit à partir des missions locales, serait consacré à l’accompagnement des jeunes peu qualifiés. Le troisième favoriserait la mobilité géographique, nationale et internationale, et regrouperait les opérateurs concernés : l’Agence Europe-Éducation-Formation France (A2E2F) et l’Agence du service civique (ASC).
Plusieurs politiques publiques lancées à partir de 2008 et 2009 ont été évaluées grâce au Fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes, le FEJ. Il faudrait tirer les conséquences de certaines expérimentations menées dans les territoires, en particulier la « Mallette des parents », qui permet d’associer davantage les parents à l’éducation de leurs enfants en sixième et en troisième, et une expérimentation sur l’accès au permis de conduire.
La gouvernance des politiques d’insertion et de formation est aujourd’hui partagée entre l’État, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, lesquels ont signé en 2011 les « accords nationaux interprofessionnels (ANI) jeunes », bon modèle de négociation. Il nous semble d’ailleurs que l’emploi des jeunes devrait devenir un thème régulier de la négociation collective, au niveau interprofessionnel comme au sein des branches et des entreprises.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Pour vous convaincre de la nécessité d’optimiser, de simplifier et de clarifier le système actuel, il vous suffit, mes chers collègues, de consulter le schéma extrêmement complexe de la gouvernance des politiques d’emploi et d’insertion qui figure dans notre rapport.
Nous proposons de conforter l’échelon régional, selon une démarche déjà entamée et par contractualisation avec l’État, les missions locales et d’autres partenaires – la liste que nous dressons n’étant pas exhaustive. Car tant qu’il n’y aura pas un seul pilote dans l’avion, nous ne sortirons pas de cette organisation, si incompréhensible que l’on ne peut que douter de son efficacité.
Nous souhaitons pousser le plus loin possible la contractualisation permise par le code général des collectivités territoriales, en encourageant les régions à passer des conventions d’objectifs avec l’État et les missions locales – associées à notre travail dès l’origine, notamment par l’intermédiaire de Jean-Patrick Gille, président de l’Union nationle des missions locales.
J’en viens à l’orientation et à l’offre de formation, objet de la deuxième partie du rapport. Il nous est apparu nécessaire d’abord d’accompagner les jeunes, ensuite de renforcer les filières professionnelles, en particulier l’apprentissage, enfin de renforcer les dispositifs de seconde chance et de lutte contre le décrochage scolaire.
Quelle que soit la difficulté à laquelle sont confrontés les jeunes, quels que soient le lieu où ils vivent, leur âge, leurs intentions, il est absolument nécessaire de les accompagner pour développer leur autonomie. L’accompagnement individualisé – par exemple par l’intermédiaire du maître d’apprentissage, ou de l’enseignant qui aide les lycéens à s’acclimater à l’Université pour faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur – n’est qu’une modalité parmi d’autres de cette démarche. Elle peut débuter très tôt, par l’élaboration dès la sixième d’un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations (PDMF). En effet, plus tôt les collégiens sont familiarisés avec l’environnement économique, la diversité des métiers, le fonctionnement des entreprises, plus ils feront preuve de discernement dans leur orientation.
Nous souhaitons également diversifier l’offre scolaire en faveur des élèves en difficulté ou dont le projet personnel requiert une attention particulière. Cela confirme la nécessité, sur laquelle s’accordent nos interlocuteurs, d’introduire de la souplesse dans le fonctionnement actuel des collèges.
Nous proposons enfin de favoriser l’articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, sur le modèle de l’expérience menée dans un lycée de Rennes, où les élèves de terminale peuvent suivre, pendant le temps d’accompagnement scolaire, des cours en première année de faculté de sciences et commencer à valider des crédits ECTS (european credits transfer system). Sans bouleverser l’ordre pédagogique, un élève de terminale scientifique peut par exemple suivre un cours d’histoire de la cosmologie à l’Université. Les lycéens prennent ainsi de l’avance sur leur cursus, se familiarisent avec un nouvel environnement et trouvent les moyens de s’y adapter.
Pour faciliter ensuite le parcours universitaire, il faut que tous ceux qui doivent être accompagnés puissent l’être, que ce soit par les « Cordées de la réussite » – tutorat assuré par des établissements d’enseignement supérieur et destiné à des collégiens issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires –, par des dispositifs destinés aux étudiants titulaires d’un bac professionnel ou en renforçant les bureaux d’aide à l’insertion professionnelles (BAIP) des universités, notamment par le biais, là encore, d’une contractualisation entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur sur ces sujets d’intérêt général.
S’agissant des filières professionnelles, nous n’avons évidemment rien contre l’apprentissage mais il y a manifestement beaucoup à faire dans ce domaine. L’objectif affiché de 500 000 apprentis en 2017 doit être atteint. Il faut favoriser les passerelles entre les lycées professionnels et les CFA, toujours par la voie de l’expérimentation et de la contractualisation car les situations sont très variables d’un département ou d’une ville à l’autre. Il importe enfin de lever les freins objectifs à l’apprentissage, circonstanciels, sociaux, structurels ou éducatifs, qui résultent des difficultés à se loger, à obtenir le permis de conduire et de l’insuffisante maîtrise des fondamentaux scolaires.
Le décrochage scolaire, dont nous avons notamment débattu dans l’hémicycle à propos du projet de loi de refondation de l’école, concerne 120 000 à 150 000 jeunes, ce qui est de toute façon beaucoup trop. Nous préconisons d’accroître les moyens alloués à la lutte contre ce phénomène, et notamment aux plateformes d’aide et de suivi aux décrocheurs, en travaillant avec les acteurs de terrain et dans le cadre de partenariats, car à la terrible complexité du système s’ajoute un cloisonnement néfaste entre les opérateurs. Nous suggérons également d’utiliser les ressources de l’éducation nationale, dont les places vacantes dans les lycées professionnels, et d’améliorer la couverture du territoire par les écoles de la deuxième chance. D’une manière générale, nous invitons les pouvoirs publics à poursuivre de manière plus offensive l’objectif de « raccrochage », de retour des décrocheurs en formation.
M. Régis Juanico, rapporteur. Venons-en à l’accès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie. Le taux de chômage des jeunes non diplômés atteint 40 % trois ans après la fin de leurs études, contre 10 à 11 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur. À nos yeux, la lutte contre ce décrochage et le « raccrochage » doivent être la première priorité des pouvoirs publics, qu’ils passent par l’Éducation nationale ou par les dispositifs de deuxième chance ; dans les deux cas, il faut intervenir très vite après seize ans. Il ne suffit pas d’attendre de l’Éducation nationale qu’elle « raccroche » 20 000 jeunes par an : il faut être beaucoup plus ambitieux. Jean-Frédéric Poisson a cité plusieurs pistes pour y parvenir.
Le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans place la France à la remorque de l’Europe : il est inférieur de plus de quatre points à la moyenne de l’Union européenne. Cette spécificité française s’explique notamment par la durée des études, ainsi que par la rareté et la forte précarité du travail étudiant. Notre système de transition vers l’âge adulte pose ainsi un véritable problème politique.
Les missions locales proposent aux jeunes un accompagnement global, plutôt apprécié des bénéficiaires – comme cela ressort de l’enquête réalisée par KPMG –, mais qui montre ses limites. Ainsi, le taux d’encadrement est aujourd’hui d’un conseiller pour 100 jeunes environ et les disparités territoriales peuvent être significatives. Nous préconisons donc de renforcer les moyens du service public de l’emploi, notamment ceux qui sont alloués aux jeunes les moins diplômés, en augmentant les dotations aux missions locales – selon une évolution entamée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 – et en encourageant les bonnes pratiques expérimentées au sein des missions locales : le parrainage, les réseaux tissés avec les entreprises, la détection des jeunes en difficulté. Il faut améliorer en parallèle et en contrepartie l’évaluation et le pilotage des missions locales dans le cadre du dialogue de gestion avec l’État. Jean-Patrick Gille nous confirmera sans doute qu’en la matière, on peut faire mieux.
Nous souhaitons favoriser l’accès à la qualification et mieux valoriser les compétences acquises, grâce à des parcours moins linéaires. Pour permettre aux jeunes, en particulier aux moins diplômés et aux anciens décrocheurs, d’accéder plus facilement à la qualification tout au long de leur parcours, nous formulons cette importante proposition : instituer une garantie d’accès à la formation et à la qualification par la création d’un droit de tirage, dans le cadre du compte personnel de formation dont les modalités de vont être précisées par la loi sur la formation professionnelle. C’est aux partenaires sociaux d’en discuter, mais l’on pourrait par exemple imaginer qu’un jeune qui quitte le système scolaire à seize ans obtienne des crédits équivalents à quatre ans de droit à la formation ou à la qualification, qu’il pourrait utiliser immédiatement.
Parce que l’amélioration de la qualification passe aussi par la reconnaissance de l’expérience et des compétences acquises, il faut simplifier la validation des acquis de l’expérience, qui reste un véritable parcours du combattant, améliorer l’information et l’accompagnement, et mieux reconnaître les compétences non formelles.
Nous souhaitons également conforter le rôle du service civique pour favoriser la mobilité sociale des jeunes, en poursuivant sa montée en charge afin d’accroître le nombre d’offres combinant service civique et formation à l’intention des décrocheurs scolaires, ainsi que le nombre de volontaires non bacheliers, qui représentent aujourd’hui 25 à 30 % des volontaires. Je le dis en tant que rapporteur spécial des crédits du sport, de la jeunesse et de la vie associative, il faudra sans doute diversifier le financement du service civique, qui doit reposer sur l’ensemble des ministères concernés – dont le ministère de l’éducation nationale –afin de respecter l’objectif présidentiel de 100 000 jeunes volontaires à la fin du quinquennat, contre 25 000 seulement aujourd’hui et peut-être 30 000 l’an prochain.
Nous formulons ensuite plusieurs recommandations visant à soutenir l’emploi étudiant dans des conditions compatibles avec la réussite scolaire, notamment en aménageant les horaires, et nous confions aux partenaires sociaux le soin d’ouvrir une négociation sur le sujet.
Nous préconisons enfin de mieux valoriser les compétences non académiques au cours de la formation initiale.
S’agissant de l’autonomie des jeunes, nous montrons que ces derniers sont plus touchés que les autres par la pauvreté et la précarité. Leur taux de pauvreté avoisine 25 %, deux fois plus que dans la population moyenne, et, à 23 ans, le taux d’emploi en CDI ne dépasse pas 33 %. Au cours des trois années suivant la sortie de formation, la durée moyenne d’emploi des jeunes reste très faible et il leur faut attendre environ cinq ans, quel que soit leur diplôme, pour obtenir un emploi stable. Nous devons résoudre ce problème spécifiquement français de la transition vers l’âge adulte.
L’un des points forts de notre rapport est notre approche du problème du logement. Ce problème concerne en particulier les jeunes qui, n’étant pas en formation initiale, relèvent du droit commun en ce qui concerne les aides au logement. Les 25-29 ans consacrent 19 % de leurs ressources au financement de leur logement, soit près du double du taux d’effort consenti toutes classes d’âge confondues. Entre 1984 et 2006, le taux d’effort net pour le logement a augmenté de 10 points pour les moins de 25 ans, et de 6 points pour les 25-29 ans ; sur la même période, ces taux n’ont augmenté que de 1,5 point pour l’ensemble de la population. Pourtant, d’importants moyens sont mobilisés : au total, le système d’aides à l’autonomie représente 5 à 5,5 milliards d’euros si l’on additionne les allocations de logement aux étudiants – 1,3 milliard d’euros, pour 700 000 étudiants bénéficiaires –, la demi-part fiscale liée au rattachement des jeunes de moins de 25 ans au foyer de leurs parents – 2,2 milliards d’euros, pour 1,8 million de foyers bénéficiaires – et les bourses sur critères sociaux – 1,8 milliard d’euros pour près de 500 000 boursiers. Si l’on représente par un graphique les effets redistributifs cumulés de ces trois aides, l’on constate que la répartition de leur montant par décile de revenus présente une courbe en U : les bourses sur critères sociaux vont aux catégories les plus défavorisées, les aides fiscales – demi-part, déduction de la pension alimentaire – aux catégories les plus favorisées, et les classes moyennes bénéficient très peu de l’ensemble des aides au regard de leur poids dans la population.
Pour mieux financer l’autonomie, nous préconisons de compléter les aides au logement par un « supplément jeunes » ouvert aux allocataires de 18 à 25 ans ayant achevé leur formation initiale et de prévoir un pourcentage d’attribution des logements sociaux aux jeunes, en veillant à la construction de logements adaptés permettant une colocation institutionnalisée, car la proportion de jeunes qui accèdent au parc de logements sociaux est très faible au regard de la part de la population totale qu’ils représentent. Nous proposons également de réformer les aides fiscales allouées aux parents d’étudiants afin que les aides au financement des études – aides fiscales, bourses et allocations de logement – augmentent en fonction des charges supportées par la famille et diminuent avec la hausse de ses revenus. Nous fixons un objectif volontariste de 50 % d’étudiants boursiers, contre 35 % aujourd’hui, et souhaitons que soit maintenu le dispositif de récompense des étudiants particulièrement méritants. Je songe aux bourses attribuées aux bacheliers ou aux licenciés qui ont obtenu des mentions bien ou très bien, un temps menacées alors qu’elles contribuent à la méritocratie et à la mobilité sociale des jeunes.
Enfin, pour lever un frein à l’accès à l’emploi ou à la formation et, plus largement, à l’autonomie, nous proposons de simplifier le permis de conduire en relançant la conduite accompagnée, notamment pour les apprentis dans les entreprises, et en adaptant la durée de la formation pratique aux aptitudes de chaque candidat. Nous souhaitons également que la transparence soit faite sur les taux de réussite propres à chaque école de conduite. En outre, il convient à nos yeux d’anticiper la formation théorique dans le cadre scolaire, en particulier auprès des conducteurs de « deux roues », à partir de quatorze ans. Enfin, il importe de mieux cibler les aides financières au permis de conduire, dont les effets positifs sont attestés s’agissant de la réussite à l’examen et de l’acquisition d’un véhicule, mais non de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Au terme de ces travaux passionnants, nous mesurons l’ampleur de la tâche qui nous attend pour relancer l’ascenseur social, défi majeur pour l’action publique. Il faudrait sans doute une dizaine de séances pour détailler toutes nos propositions ; je me contenterai pour conclure de reprendre la formule du sociologue Camille Peugny : « Dans une démocratie moderne, un enfant doit pouvoir faire sa vie avec d’autres cartes que celles qu’il a trouvées dans son berceau ».
M. le président Claude Bartolone. Merci pour ce rapport très intéressant, qui révèle un aspect essentiel des blocages de notre société et mériterait d’être inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine semaine de contrôle.
Mme Martine Pinville. Je salue moi aussi la qualité et la précision de ce rapport ; il ouvre des pistes qu’il serait en effet intéressant de prolonger.
Je suis un peu surprise qu’il ne soit pas question d’inclure le monde économique – chambres de commerce, de métiers, etc. – dans le service public de l’orientation, qu’il ne suffit pas de régionaliser.
Les missions locales constituent un relais identifié sur lequel nous devons pouvoir nous appuyer, mais elles devraient être plus présentes sur le terrain afin de mieux connaître le public, au lieu d’attendre que celui-ci vienne à elles.
Les Canadiens, qui ont beaucoup travaillé sur ce que nous appelons le décrochage scolaire, préfèrent désormais l’expression, moins dévalorisante, de « persévérance scolaire ». Cessons de parler d’enfant en difficulté ou d’enfant décrocheur : pour différentes raisons – sociales, économiques, etc. –, le parcours d’un enfant est ce qu’il est, et nous devons l’accompagner.
M. Jean-Christophe Fromantin. Je remercie nos deux rapporteurs, qui ouvrent de nombreuses pistes, pour la plupart très intéressantes, et nous éclairent sur la complexité et l’illisibilité de notre système au regard des moyens qui lui sont alloués et des attentes qu’il suscite.
Je suis d’accord avec ma collègue. Vous partez fort logiquement des problèmes des jeunes pour proposer des solutions, mais il faudrait aussi mieux identifier les besoins des entreprises et leurs perspectives d’évolution sur un territoire donné afin d’en tenir compte dans l’orientation des jeunes. Les missions locales, qui s’occupent surtout d’organiser des séminaires, des ateliers et des conférences, devraient également y contribuer.
Vous avez montré la complexité du système et l’enchevêtrement des acteurs – État, département, région, missions locales, intercommunalité parfois. Ne faudrait-il pas assumer un chef de file clair, susceptible d’arbitrer, de supprimer des dispositifs, d’en développer d’autres ? Qu’elle soit située au niveau régional, comme vous le proposez, ou à un autre échelon, cette autorité est indispensable.
L’idée d’un crédit de formation souple et valable à long terme me paraît excellente.
Quant au permis de conduire, c’est le nombre insuffisant d’inspecteurs qui explique son coût et les délais d’attente avant l’examen. Je propose donc que les organismes certificateurs privés viennent en renfort des inspecteurs, ce qui permettrait de passer un permis probatoire pour le prix d’une heure de conduite.
Mme Jeanine Dubié. On ne trouve plus aujourd’hui de maîtres d’apprentissage, de sorte que des jeunes restent privés de lieu d’accueil. L’accompagnement dont vous parlez devrait d’ailleurs être étendu aux employeurs.
Au cours de la jeunesse, qui n’est pas une période homogène, le moment charnière me semble se situer entre seize et dix-huit ans. Or vous parlez beaucoup des études, de l’insertion professionnelle, mais guère de la famille, alors que les difficultés d’un jeune peuvent être liées à son milieu familial, par exemple lorsqu’il a vu ses parents perdre leur emploi ou recourir eux aussi aux services sociaux. Les services du conseil général, qui accompagnent les familles, ne devraient-ils pas être associés aux démarches que vous préconisez ? Avez-vous étudié spécifiquement la tranche d’âge des seize à dix-huit ans, notamment du point de vue de l’action des missions locales ?
Sur ces dernières, je serai plus indulgente que mes collègues. J’ai pu constater que c’est à cet échelon que s’opère le lien entre accompagnement professionnel et accompagnement social. Ainsi, un jeune en contrat d’insertion dans la vie sociale bénéficie du tutorat d’un agent de la mission locale, et son employeur, évalué, est plus impliqué. Il est donc légitime de donner plus de moyens aux missions locales.
M. le président Claude Bartolone. Je suis de plus en plus persuadé que le contrôle est l’avenir du travail parlementaire. La faible affluence de nos collègues ce matin doit nous inciter à réfléchir à la composition et au fonctionnement du Comité. Il n’est en tout cas pas question que nous en restions là sur un sujet d’une telle importance.
Malgré les conclusions du rapport PISA, l’école de la République fait son travail, et le fait toujours aussi bien, mais pour une partie seulement de la population et de nos territoires. Soyons clairs : pour les enfants pauvres, elle ne fonctionne pas, ou pas de la même manière. Le travail entrepris par Jean Pisani-Ferry sur ce que sera la France dans dix ans confirme que cette question est essentielle. Notre modèle républicain qui, comme le montrent tous les sondages, continue de séduire mais dont nos jeunes, en particulier, se sentent exclus, parviendra-t-il à se ressourcer ? À la différence d’autres politiques publiques, celle-ci, vous l’avez dit, ne manque pas d’argent. Or bon nombre de nos compatriotes ne rejettent pas le service public, mais ils veulent en avoir pour leur argent ; dans ce domaine, le moins que l’on puisse dire est que ce n’est pas le cas.
On parle d’amener 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat, mais les promotions dans les universités – sauf à Sciences Po – comptent toujours le même nombre d’étudiants, alors qu’aux États-Unis, pour tenir compte de la démocratisation de l’enseignement supérieur, on a multiplié par quatre le nombre de jeunes accueillis à l’Université. C’est donc toute la chaîne qu’il faut repenser.
Il en va de même de notre modèle d’intégration, à la lumière des discriminations. C’est non pas par racisme, mais par facilité que bien des chefs d’entreprise cherchent à reproduire la « souche ». Dans les quartiers, les discriminations visent les enfants de pauvres, y compris lorsqu’ils sont issus de familles ultramarines par exemple, qui sont françaises depuis très longtemps – bien plus longtemps que ma propre famille ! Nous devons mettre des mots sur leurs souffrances car, n’étant pas évoqués, ils peuvent avoir l’impression de ne pas exister.
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Notre rapport part d’un constat et d’un choix de méthode. Le constat, le voici : il y a trente ans, il était possible de faire des études à l’Université et de se payer un logement à Paris grâce à un petit boulot. En gagnant deux tiers du SMIC de l’époque, soit entre 2 000 et 3 000 francs, et en payant 600 à 800 francs de loyer mensuel pour une chambre de bonne, c’était faisable. Aujourd’hui, c’est impossible. Les étudiants ne peuvent donc accéder à l’autonomie sans aides. Voilà pourquoi nous proposons d’accroître les moyens qui permettent de financer ces aides. Voilà aussi pourquoi nous souhaitons que les partenaires sociaux négocient sur les conditions d’emploi des étudiants : aujourd’hui, il n’y a guère que McDonald’s pour leur proposer un cadre adapté à leur situation. C’est donc sur le processus d’acquisition de l’autonomie, qui consiste à quitter sa famille et à entrer dans l’âge adulte, que nous nous sommes concentrés ; raison pour laquelle nous ne parlons pas davantage de la famille.
En ce qui concerne la place du monde économique, nous encourageons à développer les partenariats partout où cela est possible. Les différentes expériences que nous avons observées, où qu’elles soient menées, ne fonctionnent que lorsque les responsables de la formation des jeunes sont en contact avec le monde économique, soit parce qu’ils en viennent, soit parce qu’ils ont compris qu’il était avantageux d’en comprendre le fonctionnement. C’est aussi le cas de certaines équipes d’enseignants, même si elles ne sont pas aujourd’hui majoritaires. Dès lors, le monde économique est présent dans toutes nos propositions : l’élaboration du PDMF au collège, la découverte par les collégiens et les lycéens de l’éventail des métiers disponibles, la familiarisation des enseignants et des formateurs avec ce monde, etc.
À nos yeux, l’échelle pertinente pour le dialogue et la gestion est sans aucun doute la région, du point de vue stratégique et organisationnel. Mais pour nous, qui sommes deux fervents défenseurs du dialogue social territorial, ce niveau de pilotage doit être complété par l’échelon des bassins d’emploi, où les interlocuteurs naturels sont les partenaires sociaux. Ce dialogue social territorial inclut par définition les maisons de l’emploi lorsqu’elles sont présentes, donc les missions locales ; là où il existe une mission locale mais pas de maison de l’emploi, les acteurs du réseau sont généralement très actifs et disposés à conclure des partenariats spontanés. Le pilotage doit donc s’opérer à deux niveaux : la région, garante de la cohérence territoriale et capable de soutenir financièrement des dispositifs complexes en attendant leur simplification ; les acteurs sociaux du territoire, qui, connaissant le bassin d’emploi, peuvent définir de manière pertinente les aides, leurs bénéficiaires et le calendrier opportun. En d’autres termes, il faudra intégrer un volet territorial aux futurs textes sur le dialogue social, puisque les partenaires sociaux ne proposent pas spontanément de ce genre de dispositif.
M. Régis Juanico, rapporteur. Le Comité doit pouvoir faire vivre les rapports qui lui sont présentés, très denses, très riches en propositions qui concernent de nombreux ministères et missions budgétaires, et que nous n’avons pas le loisir d’approfondir aujourd’hui. Ainsi, dans notre rapport, nous préconisons une meilleure couverture territoriale des écoles de la deuxième chance, que nous jugeons efficaces, et une augmentation du nombre de leurs bénéficiaires, mais nous nous interrogeons sur le coût des centres de l’Établissement public d’insertion par la défense (EPIDE) et leurs résultats, le tout sans avoir pu procéder à une analyse détaillée. Voilà pourquoi nous proposons que les dispositifs de la deuxième chance soient inscrits au programme de travail de la modernisation de l’action publique (MAP).
S’agissant de l’orientation et de l’ouverture à l’environnement économique et professionnel, nous insistons fortement sur la nécessité de diversifier, au sein du collège unique, l’offre scolaire destinée aux élèves le plus en difficulté. À cette fin, nous pourrions nous inspirer des nombreuses expériences réussies un peu partout en France : les classes relais, qui permettent de récupérer les élèves décrocheurs dès la sixième ou la cinquième ; les troisièmes alternatives, qui réunissent en troisième les élèves en difficulté, auxquels sont proposés un encadrement et un accompagnement spécifiques. Sur ce sujet également, on pourrait aller plus loin.
Il est d’autres questions cruciales que nous n’avons pas pu étudier en détail : l’ouverture des droits sociaux aux jeunes dès dix-huit ans, sur le modèle d’autres pays dont le Danemark ; l’ouverture sociale des grandes écoles ; l’accès à la santé ; les discriminations ; les effets de la carte scolaire sur la mixité sociale dans certains collèges. Nous espérons que ces différents sujets pourront être approfondis dans le cadre du CEC, des missions d’information parlementaires ou des missions MAP du Gouvernement.
S’agissant de l’apprentissage, le nombre de contrats de niveau V recule alors qu’il augmente aux niveaux I et II. Ce phénomène s’explique en grande partie par la crise économique qui a débuté en 2008, les TPE hésitant à recruter des apprentis à cause de la conjoncture, mais aussi par l’évolution des besoins. Nous invitons donc les pouvoirs publics non seulement à respecter l’objectif de 500 000 contrats d’apprentissage en 2017, mais à rééquilibrer leur répartition en faveur du niveau V et à lever les freins que constituent les problèmes de double logement, l’accès au permis de conduire et l’illettrisme, lequel ne concerne pas moins de 30 % des apprentis dans le bâtiment, contre 4,5 % pour l’ensemble des jeunes.
Enfin, les missions locales doivent être confortées dans le cadre d’un pilotage régional, ce qui implique qu’elles s’équipent de nouveaux outils au niveau de l’union régionale et qu’elles dialoguent avec les services de l’État et les conseillers régionaux. Il faut simplifier les dispositifs existants, beaucoup trop nombreux. Nous proposons donc à tous les jeunes concernés une base, le contrat de réussite, qui constituerait une aide unique à l’insertion professionnelle, mais permettrait aussi de proposer des prestations personnalisées, s’appuyant sur le point fort des missions locales : leur ancrage territorial et leur connaissance des jeunes. La garantie jeunes, qui est en cours d’expérimentation, pourrait faire partie de ces prestations personnalisées.
M. Jean-Patrick Gille. Je salue ce vaste travail qu’il faudrait prolonger et dont j’approuve les conclusions. J’aimerais que l’enquête KPMG qui l’a nourri soit directement accessible.
La réflexion sur la gouvernance et l’organisation est en train de mûrir. Je défends pour ma part le projet d’un Conseil national de l’insertion des jeunes, qui ressusciterait la délégation interministérielle supprimée en 2002. Nous avons d’un côté un conseil des missions locales, de l’autre des dispositifs de la deuxième chance, mais la dimension interministérielle a disparu ; bref, il nous manque un instrument de pilotage des politiques destinées à la jeunesse – priorité du Gouvernement – qui réunirait les ministères et les régions, déjà responsables de la formation.
Le pilotage doit également s’exercer au niveau local, à l’échelle du bassin d’emploi. Nous en avons parlé lors du débat budgétaire à propos des maisons de l’emploi. Au-delà de l’aspect financier, qui va mettre en œuvre ce pilotage, discuter avec les entreprises ? Les partenaires sociaux auxquels en appelait Jean-Frédéric Poisson ne sont pas organisés au niveau du bassin d’emploi ; ils l’étaient au niveau de la région, mais la réforme de Pôle emploi les a en quelque sorte « débarqués ». Quoi qu’il en soit, le débat est presque mûr sur cette question transpartisane qui touche à la décentralisation.
Sur ces questions, il faut tenir compte de la spécificité de la région parisienne, liée à l’ampleur des flux et de l’offre. Paradoxalement, les missions locales franciliennes sont sous-dotées. Elles sont aussi plus difficiles à coordonner dans une région qui ne compte pas moins de 80 bassins d’emploi. L’hésitation entre pilotage départemental et pilotage régional est donc récurrente.
Tous sont désormais conscients de la nécessité de ne pas multiplier les dispositifs. La garantie jeunes, qui est plus qu’une expérimentation, en prend acte : cette solution de compromis bien française, qui, sans étendre le bénéfice du RSA aux moins de dix-huit ans, leur assure un revenu équivalent à condition qu’ils s’engagent dans un processus d’insertion, est aussi une manière de réunir les différents dispositifs existants en un seul.
Le droit à une deuxième chance, autre enjeu majeur à propos duquel nous pouvons également progresser dans les mois qui viennent, s’appuie sur les écoles de la deuxième chance, assez structurées, dotées de leur propre processus de labellisation, et d’initiative locale, ce qui explique les disparités territoriales. Le compte personnel de formation donnera son contenu à ce droit déjà inscrit dans la loi. Encore faut-il que ses bénéficiaires y croient. Alors même que des expérimentations très intéressantes sont menées, que de nombreux dispositifs existent, les jeunes en apprentissage sont persuadés que leur destin est joué à quinze ou seize ans.
Faut-il accorder immédiatement quatre ans de droit à la formation ? Je défends en tout cas l’idée, suggérée par le Livre vert de Martin Hirsch sur la jeunesse, d’une obligation de former jusqu’à dix-huit ans, sur le modèle de l’obligation scolaire jusqu’à seize ans ; ou d’une obligation de garantir l’accès au premier niveau de qualification, sans lequel il est impossible de s’en sortir dans le monde du travail.
M. Michel Issindou. Je remercie et je félicite les rapporteurs pour ce travail très complet, qui confirme la complexité des dispositifs existants comme de la vie des jeunes dans tous ses aspects – études, emploi, logement.
Les jeunes sont-ils ou non disposés à la mobilité géographique ?
Peut-on établir un lien entre le maintien des seniors dans l’emploi et les délais d’accès des jeunes au marché du travail ?
M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur. Je rappelle à Jean-Patrick Gille qu’il y a aussi des zones rurales en Île-de-France ! La mission locale de Rambouillet ne compte pas moins de neuf circonscriptions rurales. La zone de Rambouillet ressemble bien plus à Sainte-Maure-de-Touraine, cher Jean-Patrick Gille, ou à Sassenage, cher Michel Issindou, qu’à La Plaine Saint-Denis ou à Pantin, monsieur le président ! Notre mission locale est plus proche de celles de Rodez ou de Mende que de celles de la région parisienne.
S’agissant de la mobilité géographique, il y a bien un blocage : certains jeunes ont du mal à sortir de leur quartier, sans même parler de leur ville ou de leur département, à cause de problèmes matériels de transport ou de logement, mais tout aussi souvent, voire davantage, pour des raisons culturelles, par manque de confiance en soi, par sentiment de relégation – autant de raisons bien réelles même si elles sont difficiles à comprendre de l’extérieur.
Les Allemands cherchent actuellement à attirer chez eux les jeunes Européens, en particulier d’Europe du Sud – Espagne, Portugal, Grèce et, dans une moindre mesure, Italie –, pour qu’ils y achèvent leur apprentissage. Les jeunes Allemands eux-mêmes ne voient rien à y redire, car la mobilité géographique est pour eux assez naturelle. Également sollicités, les Français répondent en revanche moins favorablement que les autres.
Ce blocage a également été souligné par les professionnels de l’insertion que nous avons rencontrés à Saint-Étienne.
Quant au lien entre le maintien des seniors dans l’emploi et les difficultés des jeunes à accéder au marché du travail, nous n’avons pas d’éléments à apporter dans le cadre du présent travail.
M. le président Claude Bartolone. Je remercie les rapporteurs. Mes chers collègues, sauf objection, je vous propose d’autoriser la publication du rapport.
Le Comité autorise la publication du présent rapport.
ANNEXE N° 1 :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
1. Auditions
– M. Jean-Robert Pitte, délégué interministériel à l’information et à l’orientation (DIO) et M. François Hiller, adjoint au délégué interministériel.
– Mme Cécile Van de Velde, sociologue (13 mars 2013).
– M. Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO), et Mme Hélène Ouanas, sous-directrice du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation (20 mars 2013).
– M. Éric Piozin, chef de service, adjoint à la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP), Mme Christine Bruniaux, chef du département de la stratégie de la formation et de l'emploi, M. Jean-Yves de Longueau, sous-directeur de l'égalité des chances et de la vie étudiante, Mme Hélène Michaudon, responsable du département des études statistiques, et Mme Rachel-Marie Pradeilles-Duval, adjointe du chef de service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (20 mars 2013).
– M. Gilles Roussel, président de l’université de Marne la Vallée et président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence des professeurs d’université et M. Khaled Bouabdallah, président de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et vice-président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence des professeurs d’université (27 mars 2013)
– M. Pierre Tapie, président de la conférence des grandes écoles, et M. Pierre Aliphat, délégué général (27 mars 2013).
– Mme Isabelle Eynaud-Chevalier, cheffe du service des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Frédérique Racon, cheffe de la mission politiques de formation et de qualification, et Mme Florence Gelot, adjointe au chef de la mission insertion des jeunes, à la DGEFP, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (10 avril 2013).
– M. Laurent Caillot, membre de l’Inspection générale des affaires sociales (15 mai 2013).
– M. Jean-Patrick Gille, président de l’Union nationale des missions locales (UNML), M. Hervé Hénon, président de la mission locale de Boulogne-sur-Mer et membre du bureau de l’UNML et M. Serge Kroichvili, délégué général de l’UNML (29 mai 2013).
– M. Yann Dyèvre, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Mme Catherine Lapoix, sous-directrice des politiques de jeunesse, adjointe au directeur, et Mme Isabelle Defrance, chef du bureau des actions territoriales et interministérielles de la sous-direction des politiques de jeunesse (5 juin 2013).
– M. Olivier Toche, directeur de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et Mme Candice de Laulanié, déléguée générale de l’Agence française du programme européen « jeunesse en action » (Afpeja) (5 juin 2013).
– M. Thomas Cazenave, directeur général adjoint pour la stratégie, la coordination et les relations institutionnelles de Pôle emploi, Mmes Dominique Delaite, directrice de la sécurisation des parcours professionnels et Firmine Duro, direction de la stratégie et des relations extérieures (6 juin 2013).
– Mme Naïma Charaï, présidente du conseil d'administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ), Mme Laurence Girard, directrice générale et M. Jean-Pierre Papin, directeur de l'emploi, du développement économique, de l'habitat et de la médiation (12 juin 2013).
– M. Stéfano Scarpetta, directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, de M. Éric Charbonnier, expert à la direction de l’éducation, et de Mme Pauline Musset, analyste et co-auteur du rapport « Équité et qualité dans l’éducation - Comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés ».
– Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, (accompagnée de Mme Florence Gelot, adjointe à la chef de mission insertion des jeunes et de M. Laurent Duclos, adjoint au chef de département des synthèses) et de M. Marc Gurgand, directeur de recherche au CNRS, École d’économie de Paris, présidents du groupe de travail sur la « Garantie jeunes » (rapport de juin 2013) (25 juin 2013).
– M. Martin Hirsch, président de l’Agence du service civique (3 juillet 2013).
– M. Hervé Fernandez, directeur, de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et de M. Éric Nédélec, coordonnateur national (11 septembre 2013).
2. Tables rondes
● « Où en est la mobilité sociale des jeunes en France ? » (6 février 2013)
– M. Pascal de Cazenove et M. Ivan Dementhon représentants du Forum français de la jeunesse.
– Mme Patricia Loncle, enseignante et chercheure à l’École des hautes études en santé publique ;
– M. Joaquim Timoteo, chargé d’étude à l’INJEP ;
● « L’État et les mutations de la jeunesse : quelles conséquences sur les politiques publiques ? » (13 février 2013)
– M. Louis Chauvel, docteur en sociologie et chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris ;
– M. Bertrand Coly, représentants du forum français de la jeunesse (FFJ).
– Mme Francine Labadie, cheffe de projet de l’observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse (INJEP) ;
– M. Yannick L’Horty, professeur de sciences économiques à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée et directeur de la fédération de recherche du CNRS « Travail, emploi et politiques publiques » ;
– Mme Nicole Roth, cheffe du département de l’emploi et des revenus à l’INSEE ;
● « La place du diplôme dans la société française : comment améliorer la reconnaissance des mérites et des compétences des jeunes ? » (20 février 2013)
– M. Stéphane Carcillo, professeur en sciences économiques au Centre d’économie de la Sorbonne ;
– M. Régis Cortesero, chargé d’études à l’INJEP ;
– Mme Marie Duru-Bellat, sociologue ;
– M. Alexis Pierrot et M. Pascal de Cazenove, représentants du forum français de la jeunesse (FFJ).
– M. José Rose, professeur de sociologie à l’Université de Provence ;
● « Les dispositifs de diversification des recrutements des grandes écoles » (3 avril 2013)
– M. Pascal Bernard, vice-président de l’association des directeurs des ressources humaines (ANDRH), directeur des ressources humaines et des affaires générales de l’ARS d’Île-de-France ;
– M. Michel Bouchaud, proviseur du lycée Louis-le-Grand, président de l’association des proviseurs de lycées à classes préparatoires aux grandes écoles (APLCPGE) ;
– Mme Chantal Dardelet, animatrice du groupe ouverture sociale de la conférence des grandes écoles, directrice exécutive de ESSEC IIES (institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social), responsable du pôle égalité des chances de l’ESSEC ;
– Mme Bénédicte Humbert, déléguée à la diversité du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) Institut des sciences et technologies de Paris, ParisTech ;
– M. Ramzi Ben Kheder, élève de l’ESCE (école supérieure de commerce extérieur), bénéficiaire du dispositif « pourquoi pas moi ? » mis en place par l’ESSEC ;
– Mme Rachel-Marie Pradeilles-Duval, adjointe du chef de service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ministère de l’enseignement supérieur (3 avril 2013).
● « L’attractivité et la performance de l’enseignement scolaire professionnel » (3 avril 2013)
– M. Pascal Bernard, vice-président de l’association des directeurs des ressources humaines (ANDRH), directeur des ressources humaines et des affaires générales de l’ARS d’Île-de-France ;
– M. Jean-Pierre Davasse, proviseur adjoint du lycée professionnel Romain Rolland à Goussainville ;
– M. Jean-Marc Huart, sous-directeur des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie (Dgesco A2) ;
– Mme Hélène Ouanas, sous-directrice du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation (Dgesco A1).
● « Dispositifs de reconnaissance des savoir-faire et des compétences hors le système scolaire (VAE) » (10 avril 2013)
– M. Bastien Engelbach, chargé de mission à l’association Animafac, responsable du programme Bénévolat et compétences ;
– M. Vincent Merle, professeur au Conservatoire national des Arts et métiers (CNAM) et président de l’association du réseau des CARIF-OREF (Centres d’information, de ressources et d’information sur la formation – Observations régionaux de l’emploi et la formation) ;
– M. Hubert Mongon, membre du bureau national de l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH), senior vice-président ressources humaines de McDonald’s France et Europe du Sud ;
– Mme Frédérique Racon, adjointe au chef de la mission Politiques de formation et de qualification, de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
– Mme Jacqueline Rageot, responsable de l’antenne de conseil en VAE de Paris (BIOP, centre d’orientation scolaire et professionnelle de la Chambre de commerce et d’industrie de région de Paris Île de France).
● « Les dispositifs publics d’insertion professionnelle des jeunes » (24 avril 2013)
– M. Yves Auton, chargé de mission au secrétariat général du Conseil national des missions locales ;
– M. Patrick Pommier, adjoint au chef du département de la formation professionnelle et de l’insertion professionnelle des jeunes (DARES) ;
– Mme Fabienne Schrempp, directrice de la mission locale VitaCité ;
– Mme Brigitte Ustal Piriou, présidente de la commission intergénérationnelle et gestion des âges/emploi des jeunes de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH).
● « La formation en alternance » (15 mai 2013)
– Mme Carole Aboaf, conseillère technique au Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– M. Gilles Langlo, vice-président de la Fédération nationale des associations régionales des directeurs de centre de formations d’apprentis (FNADIR) et directeur du CFA de la chambre de métiers d’Indre et Loire ;
– Mme Manuèle Lemaire, vice-présidente de la FNADIR et directrice du CFA - institut de l’environnement urbain à Jouy-le-Moutier ;
– Mme Colette Lucien, vice-présidente de la FNADIR et directrice du CFA Léonard de Vinci à la Défense ;
– M. Morgan Marietti, président de l’Association nationale des apprentis de France ;
– Mme Delphine Pelade, directrice de l’apprentissage au Conseil régional d’Île de France ;
– M. Jean-Christophe Sciberras, président de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines.
● « Les dispositifs de seconde chance » (29 mai 2013)
– Mme Maria-Julia Aranda, commissaire divisionnaire, chef du département du recrutement et de l'égalité des chances, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de la formation et du développement des compétences au ministère de l'Intérieur ;
– M. Charles de Batz de Trenquelléon, directeur général de l’établissement public d’insertion dans la Défense (EPIDe) ;
– Mme Patricia Kuhn, chef du bureau des adjoints de sécurité, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de l'administration des ressources humaines au ministère de l'Intérieur ;
– M. Vincent Terrenoir, commissaire divisionnaire, chef de la mission de reclassement et de reconversion professionnelle, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel au ministère de l'Intérieur ;
– M. Didier Quenelle, général de brigade, sous-directeur des compétences de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale de la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur ;
– M. Alexandre Schajer, président, et M. Adil Lamrabet, chargé de développement et communication, du Réseau des écoles de la 2e chance
● « Poursuite des études supérieures et activité professionnelle » (12 juin 2013)
– M. Laurent Bérail, fondateur et dirigeant de SkillsCenter, cofondateur de La Manu, rapport du CESE emploi et études ;
– Mme Christine Bruniaux, chef du département de la stratégie de la formation et de l’emploi (DGESIP) ;
– M. Jean-François Giret, ![]() directeur de l’Institut de recherche sur l’éducation (IREDU), maître de conférences à l’Université de Bourgogne ;
directeur de l’Institut de recherche sur l’éducation (IREDU), maître de conférences à l’Université de Bourgogne ;
– Mme Elise Verley, chargée de mission à l’Observation de la vie étudiante (OVE) et maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne.
● « Le logement des jeunes » (19 juin 2013)
– M. Alexandre Aumis, sous-directeur de la contractualisation et de l’immobilier du Centre national des œuvres scolaires et universitaires (CNOUS) ;
– M. Feres Belghith, chargé d’études à l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) ;
– M. Jean-François Brégou, chargé de mission à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
– Mme Claire Guichet, représentante de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) au Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;
– M. Frédéric Milhiet, président de l’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ), et Mme Ahmel Djioui, animatrice du réseau ;
– M. Éric Thuillez, membre du directoire de l’UESL-action logement.
● « Les dispositifs de soutien et de financement de l’autonomie et des études des jeunes » (26 juin 2013)
– M. François Brégou, chargé de mission à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;
– M. Vincenzo Cicchelli, maître de conférences à l’Université Paris Descartes, auteur de l’ouvrage L’autonomie des jeunes. Questions politiques et sociologiques sur les mondes étudiants (2013) ;
– M. Rémy Guilleux, vice-président de l’UNAF, président du département Éducation et jeunesse, Mme Patricia Humann, coordonnatrice du pôle éducation, et Mme Claire Ménard, chargée des relations avec le Parlement ;
– Mme Monique Ronzeau, présidente de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
● « Les dispositifs de mobilité internationale des jeunes » (26 juin 2013)
– Mme Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ;
– M. Pascal Bonnetain, secrétaire général, et Mme Armelle Dugué, directrice de la mobilité et des partenariats, Office franco-québecois pour la jeunesse (OFQJ) ;
– M. Olivier Flury, secrétaire général de l’association Itinéraire international ;
– M. Antoine Godbert, directeur de l’Agence Europe éducation formation.
● Table ronde avec les représentants d’organisations de jeunesse (10 juillet 2013).
– M. Stephen Cazade, directeur national d’Unis-cité ;
– M. Antoine Dulin, délégué national Scouts et guides de France, auteur d’un rapport pour le CESE : « Droits formels/ droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes » (juin 2012) ;
– M. Bastien Engelbach, chargé de mission à l’association Animafac, responsable du programme Bénévolat et compétences ;
– M. Thibault Renaudin, secrétaire général de l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) ;
– M. Gwendal Ropars, secrétaire national à la communication et aux relations extérieures de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
● Table ronde avec les représentants de syndicats et mutuelles lycéens et étudiants (10 juillet 2013)
– M. Julien Blanchet, président de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) ;
– M. Vincent Bordenave, délégué général de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) ;
– M. Steven da Cruz, président de Promotion et défense des étudiants (PDE) ;
– Mme Margot Perez, déléguée nationale adjointe de l’Union nationale inter-universitaire- Mouvement des étudiants (UNI-MET) et M. Cyprien Feilhès, délégué national adjoint de la section étudiante de l'UNI-MET ;
– M. Karl Stoeckel, secrétaire général de La Mutuelle des étudiants (LMDE).
● Table ronde avec des représentants d’organisations syndicales représentatives de salariés (17 juillet 2013)
– MM. Mohammed Oussedik, secrétaire confédéral de la Confédération générale du travail (CGT), et Jean-Philippe Revel, secrétaire fédéral de la fédération des organismes sociaux ;
– M. Thiébaut Weber, secrétaire confédéral de la Confédération française du travail (CFDT), en charge de la politique revendicative en faveur des jeunes et président du comité des jeunes de la confédération européenne des syndicats ;
– Mme Chantal Guiolet déléguée nationale de la Confédération française de l’encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC) à l’emploi des jeunes et M. Franck Boissart, conseiller technique au secteur emploi formation ;
– un représentant de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), sous réserve de confirmation.
● Table ronde avec des représentants d’organisations syndicales représentatives d’employeurs (17 juillet 2013)
– M. Francis Petel, membre de la commission de la formation et de l’éducation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
– M. Pierre Burban, secrétaire général de l’Union professionnelle artisanale (UPA) et Mme Caroline Duc, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement ;
– Mme Sandrine Javelaud, directrice de mission formation initiale, et Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (17 juillet 2013).
– « L’accès des jeunes au permis de conduire » : M. Pierre Ginefri, sous-directeur de l’éducation routière, de la délégation à la sécurité et à la circulation routières, ministère de l’Intérieur ; M. Loïc Turpeau, président de l’Association nationale pour la promotion de l’éducation routière (ANPER) ; M. Ivan Candé, secrétaire général du Syndicat national des personnels techniques administratifs et de service de l’équipement et de l’environnement-Confédération générale du travail (SNPATS-CGT), et Mme Laurence Réthoré, secrétaire nationale ; Mme Pascale Maset, secrétaire générale du Syndicat national Force Ouvrière des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière (SNICA-FO), et M. Thomas Knecht, secrétaire général adjoint ; M. Christophe Nauwelaers, secrétaire général du Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière (UNSA-SANEER) (11 septembre 2013).
3. Déplacement des rapporteurs
À Saint-Étienne
● Centre de formation des apprentis (CFA) :
– Mme Sophie Luquet, responsable filière, M. Guy Montérémal, responsable filière, et M. Éric Szymakowski, responsable de la filière productique ;
– Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de la Loire : M. Christophe Boujeau, directeur de la formation, M. Nicolas Cavrois, secrétaire général, M. François Méon, président, M. Daniel Roché, délégué général
– M. Alain Sowa, président du CFAI-AFPI, UIMM
● Groupe Casino : M. Claude Risac, directeur des relations extérieures, et M. Thomas Vilcot, directeur du recrutement groupe ;
● Préfecture : M. Serge Clément, directeur académique départemental, M. Jean-Daniel Cristoforetti, directeur départemental de l’unité territoriale de la Direccte M. Patrick Férin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. Bruno Feutrier, directeur départemental de la cohésion sociale ;
● Collège Jacques Prévert, à Andrézieux-Bouthéon : Mme Christine Audouard, enseignante CLLIS, Mme Delphine Barlerin, principale adjointe, M. Christian Laurenson, principal, M. Raymond Lefebvre, directeur-adjoint, chargé des SEGPA ;
● École de la deuxième chance (E2C) : M. Bruno Feutrier, directeur départemental, M. Gilles Gallet, président EDC Loire, Mme Houria Gamara, directrice E2C Loire, M. Florian Mouchel, responsable E2C en Champagne-Ardenne ;
● Table ronde à la maison de l’emploi :
– M. Nicolas Bometon, directeur de la mission locale ;
– M. Pierre Joassard, directeur du CIO de Saint-Étienne ;
– Mme Aline Bourrat, chargée de mission insertion professionnelle, à l’AFIJ-Loire (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés) ;
– M. Patrick Desprez, chef du service académique information et orientation du rectorat de l’académie de Lyon, M. Mohamed Mahi, coordonnateur Groupe Solidarité Emploi, M. Franck Masse, directeur de la maison de l’emploi et de la formation, Mme Béatrice Ryckewaert, responsable d’animation de la maison de l’emploi et de la formation, Mme Marie-Odile Sasso, vice-présidente de la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole, chargée de l’insertion, de l’emploi et de la politique de la ville ;
À Lyon
● Lycée des métiers Jacques de Flesselles : M. Mohamed Ambri, enseignant en électronique, Mme Jocelyne Barjon, enseignante en administration, M. Jacques Blanchard, conseiller principal d’éducation, Mme Dominique Chavant, enseignante gestion, coordonnatrice tertiaire, Mme Annie Chassagneux, responsable de la formation continue au GRETA-GIAL (groupement d’établissements Greta Industriel de l’Agglomération Lyonnaise), Anne-Marie Ellul, enseignante en administration, M. Éric Gros, proviseur-adjoint, M. Frédéric Maillon, enseignant formateur, Mme Laurie-Anne Laire, coordonnatrice, au GRETA-GIAL (groupement d’établissements Greta Industriel de l’Agglomération Lyonnaise), Mme Claude Rousset, conseillère d’orientation-psychologue au CIO, M. Armand Urvoy, chef de travaux et un groupe d’élèves
● Table ronde au rectorat :
– Mme Florianne Buisson, directrice adjointe du pôle universitaire de proximité, université Jean Moulin, Lyon 3 ;
– Mme Florence Fioriti, chargée de mission égalité des chances, rectorat ;
– M. Yves Jamet, professeur à l’Institut national des sciences appliquées, Mme Françoise May-Carle, adjointe au directeur régional, Mme Yveline Mermilliod, conseillère d’orientation, psychologue, au SAIO du rectorat ; M. Bernard Riban, proviseur du lycée Branly,
● Déjeuner à la préfecture de région, sous la présidence de Mme Aimée Dubos, préfète déléguée pour l’égalité des chances :
– M. Laurent Willeman, chargé de mission auprès du préfet de région ; M. Alain Parodi, directeur régional jeunesse et sports ; M. Eric Gounel, directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Rhône-Alpes-Auvergne ; M. Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) à Lyon ; M. Eric Nédélec, agence nationale de lutte contre l'illettrisme de la Loire ; Mme Anne Mességué, chargée de mission pour la lutte contre l'illettrisme au SGAR ; M. Jacky Darne, président de l'union régionale des missions locales Rhône-Alpes ; M. Laurent Barraud, président de Unis-Cité ; Mme Sonia Bouzerda, responsable du développement des partenariats privés-publics, région Rhône-Alpes Nos quartiers ont du talent ; M Christophe Tezenas du Moncel, président de emplois Loire Observatoire École de la 2e chance ; Mme Marie-France Vieux Marcaud, présidente de l'association Vaulx agglo 2e chance ; M. Christian Mistral, président de Vaulx-en-Velin entreprises, association parrainage jeunes emploi
● Table ronde avec les services déconcentrés :
– M. Jean-Pierre Berthet, Direccte par intérim ;
– M. Alain Parodi, directeur régional de la DRJSCS ;
– M. Jacques Riboulet, responsable du département accès à l’emploi, Direccte ;
– Mme Annick Taton, adjointe au chef de pôle 3 E, chef du département mutations de l’emploi et compétences, Direccte ;
– M. Laurent Willeman, chargé de mission cohésion sociale, égalité des chances, culture, SGAR Rhône-Alpes.
● Conseil régional :
– Mme Sarah Boukaala, conseillère régionale, déléguée à la jeunesse ;
– Mme Chantal Bunel-Delarche, directrice de la formation continue ;
– M. Benjamin Coppe, conseiller technique à l’emploi et à la formation, cabinet du président ;
– M. Thomas Senn, directeur adjoint sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire ;
– Mme Laure Vidal, conseillère technique à la jeunesse.
Au Danemark (17 au 19 avril 2013).
– M. Peter Grønnegård, vice-Directeur, Danish Agency for Higher Education and Educational Support (ministère de la Recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur) ;
– MM. Leif Christian Hansen et Jan Hendeliowitz consultants en chef à la direction du marché du travail, ministère de l’Emploi ;
– M. Lennart Damsbo-Andersen, Président de la commission emploi du Parlement, M. Alex Ahrendtsen et Mme Louise Schack Elholm, membres de la commission éducation du Parlement ;
– M. Morten Smistrup, consultant auprès de LO, première confédération syndicale danoise, et Mme Karen Roiy, consultante auprès de DA (patronat) ;
– Mme Karin Olsen, chef du jobcenter pour les jeunes, et M. Anders Stub, Mme Tina Christian, Mme Frederikke Jensen et M. Jesper Hansen, chargés de mission ;
– Table ronde avec des représentants de la Chambre de commerce franco-danoise et des conseillers du commerce extérieur (CCEF).
– Mme Véronique Bujon-Barré, ambassadrice de France au Danemark ;
– M. Benny Wielandt, conseiller d'orientation professionnelle du centre de formation professionnelle TEC Frederiksberg.
En Allemagne (2 et 3 mai 2013)
– Mme Anne Orain, proviseure du lycée français de Berlin ;
– Mme Christina Ramb, chargée du bureau « marché de l’emploi » et Mme Barbara Dorn, chargée du bureau « éducation et formation professionnelle » Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)(Confédération des organisations patronales allemandes) ;
– M. Christoph Schwamborn, ministère fédéral de la Famille, des personnes âgées, de la femme et de la Jeunesse (BMFSFJ) ;
– Mme Jacqueline März, service de coordination « Formation professionnelle sans frontières », fédération allemande des chambres de commerce et d'industrie (DIHK)
– M. Matthias Anbuhl, chargé du service « Politique de l’enseignement et éducation » et M. Florian Haggenmiller, chargé du service « politique de la jeunesse, finances et service volontaire civique », Deutscher Gewerschaftsbund (DGB) (Confédération allemande des syndicats) ;
– M. Roland Schauer, chef du service « orientation professionnelle, accompagnement à l’insertion professionnelle, bourses de formation » et M. Mathias Scholz, chef du service « insertion professionnelle des jeunes » ministère fédéral des affaires sociales (BMAS) ;
– M. Hans-Ortwin Nalbach, chef du service « orientation professionnelle et égalité des chances pour les jeunes », ministère fédéral de l’Éducation et de la recherche (BMBF)
À Rennes et en Ille-et-Vilaine (13 et 14 juin 2013)
● Conseil régional :
– Mme Georgette Bréard, vice-présidente, M. Henri Simorre, directeur de la formation professionnelle, et M. Jacques Mikulovic, directeur de la formation initiale, , M. Emmanuel Mourlet, directeur du centre régional information jeunesse, M. Philippe Lecoq, directeur de Pôle emploi, M. Thierry Cormier, directeur du Fongecif ;
● Services déconcentrés de l’État :
– M. Dominique Théfioux, directeur régional adjoint, Direccte, Mme Elisabeth Maillot-Bouvier, Direccte, M. Christian Caradec, DRJSCS ;
● Rectorat de l’académie :
– M. Michel Quéré, recteur, M. Laurent Blanes, DAFPIC
● Préfecture de région :
– M. Michel Cadot, préfet de la région Bretagne et M. Serge Agreke, chargé de mission SGAR ;
● Mission locale pour l’emploi de Redon :
– M. Pascal Duchêne, président de la mission locale pour l’emploi, maire-adjoint de Redon, Mme Sylvie Lefebvre, directrice de la mission locale pour l’emploi, M. Gilles Mathel, directeur UT 35, DIRECCTE, Mme Annie Gourraud directrice agence de Redon de Pôle emploi, Mme Emmanuelle Castelain, présidente de l’Association régionale des missions locales (ARML), M. H. Civel, vice-président de la ML et de l’ARML
● Fédération d’animation rurale en Pays de Vilaine :
– Mme Pascale Petit-Sénéchal, chef de service de la DRJSCS, Mme Marion Danièle MLE Redon, Mme Claire Duprec, volontaire, M. Bruno Chéron, Fédération d’animation rurale en Pays de Vilaine : directeur, M. Marco Felez, directeur des Articulteurs du Pays de Redon et Vilaine, Mme Corinne Hervieux, coordinatrice du mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC Bretagne) et M. Etienne Le Paven, volontaire
● Collège Chateaubriand, Saint-Malo :
– Mme Raymonde Rouzic, chef du service académique de l'information et de l'orientation (rectorat), Mme Evelyne Laporte, directrice du CIO de Saint-Malo, Mme Yasmina Khellaf, principale du collège Chateaubriand, M.Gilles Nottebart, principal du collège Surcouf, M. Dominique Bachelot, proviseur du Lycée Maupertuis, M. Ch. Ferron, directeur de mission locale pour l’emploi ;
● Lycée Mendès-France, Rennes
– M. Bertrand Elise, proviseur du lycée Mendès-France, M. Philippe Debray, proviseur du Lycée Descartes, M. Gérald Moënner, DEAE (rectorat), Mme Cécile Lecomte, Université Rennes 1, M. Jean-Christophe Clapson, directeur du Pôle emploi de Rennes.
● Les formations par alternance en Bretagne :
– M. Luc Vivier directeur du CFA CCI, campus des métiers de Ker Lann, M. Guillaume. Baudet, attaché de direction ; Mme Isabelle Guée, directrice des études ; Mme Nelly Garnier enseignante.
ANNEXE N° 2 :
ÉTUDE DE L’IMPACT DE PLUSIEURS DISPOSITIFS CONCOURANT
À LA MOBILITÉ SOCIALE DES JEUNES, RÉALISÉE PAR LE GROUPEMENT KPMG-EURÉVAL
Cette annexe peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1613.pdf
1 () Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
2 () http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-fqp03&page=irweb/fqp03/dd/fqp03_ir3.htm#FQP03_IR3P2 .
3 () http://www.statapprendre.education.fr/insee/mobilite/default.htm .
4 () En 1997, par exemple, le sociologue Michel Forsé a confirmé empiriquement la théorie de Raymond Boudon sur l’invariance de l’inégalité des chances dans la France des Trente glorieuses, à partir d’une analyse des mobilités intergénérationnelles faisant apparaître une constance sur la période étudiée du pourcentage de situations d’immobilité sociale (Vallet Louis-André. Quarante années de mobilité sociale en France. L’évolution de la fluidité sociale à la lumière de modèles récents. Revue française de sociologie. 1999, 40-1, pp. 5-64).
5 () Pour davantage d’information, se référer à "Quarante années de mobilité sociale en France. L’évolution de la fluidité sociale à la lumière de modèles récents". Vallet Louis-André Revue française de sociologie. 1999, 40-1, pp. 5-64.
6 () Repères et références statistiques, ministère de l’éducation nationale, 2012, p 236.
7 () L’augmentation régulière sur longue période du nombre d’emplois supérieurs prive un nombre croissant de personnes de perspectives d’ascension sociale ("effet plafond").
8 () La mesure du déclassement, rapport du Centre d’analyse stratégique, 2009.
9 () La mobilité sociale descendante, Camille Peugny, doctorat de sociologie, 2007.
10 () La mesure du déclassement, rapport du Centre d’analyse stratégique, 2009.
11 () Le CAS remarque que « de nombreux auteurs et chercheurs en sciences sociales issus d’horizons divers ont tenu à le faire figurer parmi les facteurs explicatifs de mai 1968. »
12 () « En 2007, 12,3 % des actifs occupés étaient en contrat de travail à durée déterminée, en mission d’intérim ou encore en stage, en contrat aidé ou en apprentissage, contre 8,2 % en 1993 et 5,4 % en 1982 », selon le rapport du CAS (p 46).
13 () Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet, Madga Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
14 () Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet, Madga Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
15 () Le déclassement des jeunes sur le marché du travail, Jean-François Giret, Emmanuel Nauze-Fichet, Madga Tomasini, Insee, France Portait social 2006.
16 () pour la réalisation de laquelle elle s’est appuyée sur 135 entretiens de personnes âgées de 18 à 30 ans au Danemark, en Espagne, en France et au Royaume-Uni réalisés en 2000 et 2001 ainsi que sur les 6 premières vagues du panel européen des ménages 1994-1999.
17 () Sauf dans certains cas : après trois ans d’activité professionnelle – situation très rare avant 25 ans – ou quand l’allocataire est parent isolé.
18 () Éditions Eyrolles, collection La nouvelle société de l’emploi.
19 () Cf. cet ouvrage, page 85.
20 () Sondage Ipsos/Logica Business Consulting, réalisé selon la méthode des quotas, du 4 au 11 août 2011 auprès de 399 enseignants constituant un échantillon national représentatif des enseignants en primaire et secondaire de l’enseignement public et privé.
21 () Pour l’INSEE, deux tiers des actifs classés dans les professions intermédiaires occupent « effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés […]. Les autres […] travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social ; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. »
22 () INSEE, Données sociales – La société française, édition 2006, page 346.
23 () INSEE, Données sociales – La société française, édition 2006, pages 347 et 348.
24 () Ces éléments sont issus de l’étude par le ministère de l’Éducation nationale de deux panels d’élèves entrés en classe de 6ème en 1989 et 1995.
25 () La baisse plus accentuée des résultats dans les établissements de l’éducation prioritaire est confirmée pour la classe de 3ème par la comparaison des « cycles d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons » en 2003 et 2009, s’agissant notamment des compétences générales.
26 () Ce constat est également valable pour les détenteurs d’un bac général.
27 () Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg, Comment la France divise se jeunesse, la machine à trier, 2011, éditions Eyrolles, collection La nouvelle société de l’emploi, pages 116 et 118.
28 () Projet annuel de performance (PAP) de la mission interministérielle « Enseignement scolaire » annexé au PLF pour 2013, page 121.
29 () Issu de l’article 21 de la loi n° 2007–1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
30 () Cf. le PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
31 () En pratique, il s’agit souvent de situations de rupture familiale.
32 () PAP annexé au PLF 2014 de la mission interministérielle « Travail et emploi », page 59.
33 () PAP de la mission interministérielle « Égalité des territoires, logement, ville » annexé au PLF pour 2014, page 159.
34 () Selon le Comité interministériel de villes (CIV) du 18 février 2011, la moitié des places en internat d’excellence doit en principe être occupée par des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
35 () Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin, Axelle Charpentier et Marc Gurgand, les effets de l’internat d’excellence de Sourdun sur les élèves : résultats d’une expérience contrôlée, 11 avril 2013.
36 () Cf. cette évaluation, pages 3 et 4.
37 () Idem, page 5.
38 () Idem, page 7 : selon les chercheurs, il n’est pas possible de transposer à d’autres internats les résultats constatés à Sourdun, dont l’internat a bénéficié de l’énergie des pouvoirs publics induite par la mise en valeur d’une première expérience, et d’une équipe pédagogique particulièrement motivée. Par ailleurs, la question reste en suspens de savoir quel sera le devenir – au-delà des deux ans sur lesquels l’étude a porté – du bénéfice constaté pour les internes de Sourdun.
39 () Cf. le PAP annexé au PLF pour 2014 de la mission « Enseignement scolaire », page 183.
40 () Cf. le même PAP, page 328.
41 () Cf. le même PAP, page 329.
42 () Le rapport du CIJ du 21 février 2013 précise que le délégué interministériel à la jeunesse sera « placé auprès du ministère chargé de la jeunesse ». Un délégué interministériel doit être placé, par définition, auprès du Premier ministre, y compris dans le cas présent où il est également et légitimement au service du ministère chargé de la jeunesse par ses fonctions de directeur de la DJEPVA.
43 () Le PAP de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » annexé au PLF 2014 prévoit l’attribution au CIDJ d’un montant identique pour 2014.
44 () Un rapport d’inspection de janvier 2013 précise que « selon les territoires, la démarche volontariste de labellisation a tantôt accompagné des partenariats existants ou en développement, tantôt ignoré voire concurrencé des démarches régionales très avancées […] En définitive, de l’avis général des acteurs de terrain rencontrés, la labellisation n’a pas apporté de valeur ajoutée en termes de services aux usagers ». Cf. M. Laurent Caillot, (membre de l’inspection générale des affaires sociales – IGAS), MM. Aziz Jellab et Didier Vin-Datiche (inspecteurs généraux de l’éducation nationale – IGEN), Mme Hélène Bernard et M. Jean-François Cervel (inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche – IGAENR), Le service public de l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. Ce rapport porte les numéros RM 2013-020P pour l’IGAS et 2013-008 pour l’IGEN et l’IGAENR. En l’espèce, cf. la synthèse de ce rapport.
45 () Il s’agit notamment des jeunes qui bénéficient du RSA au titre de leur situation de famille (parents isolés) ou qui sont sans emploi après une période d’activité de plus de trois ans.
46 () Il n’est au demeurant pas exclu que d’autres conseils généraux en Bretagne aient pris une initiative de la même nature que le CARES 35 de l’Ille-et-Vilaine.
47 () Interview en ligne sur le site de l’INJEP de M. Bertrand Coly et Mme Janie Morice, à l’occasion de la journée de réunion du FFJ le 19 septembre 2013, un an après sa création.
48 () MM. Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland et André Zylberberg, Comment la France divise sa jeunesse, la machine à trier, 2011, éditions Eyrolles, collection La nouvelle société de l’emploi. Cf. pages 38 et 39.
49 () Notamment les emplois d’avenir, les contrats de génération, les emplois francs et la « Garantie Jeunes ».
50 () Voir sur ce point le tableau présenté dans l’annexe n° 2 du présent rapport.
51 () Outre les programmes de qualité et d’efficience (annexe n° 1 du PLFSS), qui constituent l’équivalent des PAP dans le champ de la protection sociale, l’annexe n° 5 relative aux exonérations de cotisations ou contributions sociales présente ainsi, sous forme de fiche par dispositif, les principaux éléments disponibles concernant notamment leur coût, le nombre de personnes concernées et leur évaluation.
52 () Parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’État.
53 () L’orientation à la fin du collège, communication à la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale (décembre 2012).
54 () La mise en place des premiers internats d’excellence, inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) et inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), juin 2011.
55 () Selon le rapport précité, le coût d’un interne d’excellence pouvait représenter jusqu’à 10 000 euros.
56 () Lettre de M. Vincent Peillon et de Mme George-Pau Langevin aux personnels de l’Éducation nationale.
57 () Les effets de l’internat d’excellence de Sourdun sur les élèves : résultats d’une expérience contrôlée, rapport pour le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin, Axelle Charpentier et Marc Gurgand, École d’économie de Paris (11 avril 2013).
58 () En particulier, la DARES, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), le Centre d’études de l’emploi (CEE), les différents corps d’inspection, les équipes constituées dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), etc.
59 () Le service public de l’orientation (SPO) : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, rapport conjoint de l’IGAS, de IGAENR et de l’IGEN (avril 2013), dont les rapporteurs ont entendu l’un des auteurs, et le rapport précité de la Cour des Comptes (décembre 2012).
60 () L’emploi des jeunes peu qualifiés, note du Conseil d’analyse économique (CAE) publiée en avril 2013, dont les rapporteurs ont entendu l’un des auteurs, M. Stéphane Carcillo, rapports du Conseil d’orientation sur l’emploi (COE) sur Les aides aux entreprises en faveur de l’emploi (avril 2013) et L’emploi des jeunes (2011), rapport du CESE sur L’emploi des jeunes (septembre 2012), par exemple.
61 () « Améliorer la situation économique des jeunes », Études économiques de l'OCDE : France, OCDE (2013).
62 () La machine à trier. Comment la France divise sa jeunesse, Stéphane Carcillo, Pierre Cahuc, Olivier Galland et André Zylberberg (2011).
63 () Les crédits prévus pour 2014 s’élèvent par exemple à près de 2,2 milliards d’euros pour le contrat unique d’insertion dans le secteur non marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi ou « CUI-CAE »).
64 () La plupart des évaluations se sont limitées à l’étude des effets « moyens » de ces dispositifs, or les effets des politiques sociales, et de l’emploi en particulier, varient souvent en fonction des populations bénéficiaires.
65 () Par exemple, les contrats aidés ont pour objectif premier de faciliter l’insertion professionnelle de certaines catégories de population éloignées de l’emploi mais, de fait, les pouvoirs publics les utilisent également afin d’atténuer la hausse du chômage en période de crise. Or ces objectifs peuvent être contradictoires dès lors que l’objectif conjoncturel conduit à donner plutôt la priorité à la quantité de contrats aidés, au détriment du ciblage sur les personnes les plus en difficulté, voire de la qualité de l’accompagnement proposé.
66 () Il suffirait en effet pour cela de modifier l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, qui présente la liste des différents DPT ainsi que des éléments sur leur contenu.
67 () Article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion.
68 () Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert de la commission de concertation des politiques de la jeunesse présidée par M. Martin Hirsch, alors Haut commissaire à la jeunesse (juillet 2009).
69 () « Le FEJ et les politiques éducatives : premier retour d’expériences », Mathieu Valedenaire (FEJ, DJEPVA) et Marc Gurgand, CNRS (Éducations et formations n° 81, mars 2012).
70 () Dans ce cas, les porteurs de projets (établissements scolaires par exemple) répondent à des appels à candidature et les évaluateurs sont recrutés par appel d’offres sur des cahiers des charges précis. C’est par exemple le cas du « livret de compétences expérimental » qui vise à formaliser et valoriser tous les acquis des élèves, y compris ceux qui ne sont pas de nature scolaire.
71 () Cette démarche vise à identifier les enseignements exploitables en vue de fournir les éléments d’orientation innovants pour la conduite des politiques, donc à rendre lisibles les résultats et à permettre l’appropriation par les acteurs et les décideurs des bonnes pratiques et des outils transférables. Elle s’appuie sur l’ensemble des productions réalisées ainsi que sur l’organisation d’échanges avec les acteurs.
72 () C’est le cas de « l’atelier pédagogique de Nanterre » en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
73 () Cet indicateur ne figure plus dans le projet annuel de performances (PAP) du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative » annexé au projet de loi de finances pour 2014.
74 () Les expérimentations financées par le FEJ donnent lieu à la production systématique de rapports finaux d’évaluation qui doivent être transmis dans les trois mois suivant le terme de l'expérimentation (les premiers rapports finaux ont été produits fin 2011). Ces rapports sont analysés par l'équipe d'animation du FEJ avant d'être publiés sur le site internet.
75 () PAP « Jeunesse et vie associative » annexés aux projets de loi de finances pour 2013.
76 () PAP « Jeunesse et vie associative » annexés aux projets de loi de finances pour 2014.
77 () Rapport de la mission conjointe de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale jeunesse et sports(IGJS) sur le FEJ (2012).
78 () Sur les résultats de cette expérimentation, voir la dernière partie du présent rapport.
79 () « Faut-il subventionner le permis de conduire des jeunes en difficulté d’insertion ? », Yannick L’Horty, E. Duguet, P.Petit, B.Rouland, Y. Tao, 2012).
80 () Voir sur ce point la troisième partie du présent rapport sur la mobilité des jeunes.
81 () Le ministère en charge de l’Économie sociale et solidaire a lancé un site internet présentant les CV de jeunes diplômés issus de quartiers défavorisés afin de les aider à surmonter les discriminations à l’embauche. Cette « CVthèque » dispose de 800 profils et la base de données est gratuite pour les TPE-PME ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Après évaluation, ce dispositif pourrait être généralisé.
82 () Une réforme de l’administration centrale du ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a été annoncée (réorganisation de la DJEPVA, des opérateurs et structures associées, notamment le FEJ), l’objectif étant l’élaboration d’une feuille de route permettant un fonctionnement opérationnel dès 2014.
83 () Rapport sur le projet de loi de finances pour 2014 (annexe n° 46 « Sports, jeunesse et vie associative », présenté par M. Régis Juanico, rapporteur spécial, Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, Assemblée nationale (octobre 2013).
84 () Ces politiques de jeunesse intégrées devront notamment traiter des axes suivants qui sont autant de facteurs d’autonomie des jeunes : l’information et l’orientation ; l’employabilité et la lutte contre le décrochage scolaire et universitaire ; le développement d’une offre éducative, culturelle et sportive innovante, en complément de l’école ; l’émergence d’une culture de l’entreprenariat.
85 () Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Camille Peugny, La République des idées (2013).
86 () Jean-Michel Chapoulie, Antoine Prost, L’Enseignement est-il démocratisé ?, Paris, P.U.F., 1986, in Histoire de l’éducation, n° 34, 1987. pp. 110-113.
Voir également Évolution historique de l’inégalité des chances devant l’école : des méthodes et des résultats revisités, Louis-André Vallet et Marion Selz, Éducation & formations n° 74, avril 2007, ministère de l’Éducation nationale.
87 () Pierre Merle, Démocratisation ou accroissement des inégalités scolaires ?, Revue de l’INED, Population, 2002/4, Vol. 57, pp. 633 à 659.
88 () Louis-André Vallet, Expansion des systèmes éducatifs et dynamique des inégalités sociales devant l’enseignement : quelques jalons de la recherche comparative en sociologie, Économie et Statistique, INSEE, n° 433-434, 2010.
89 () Claude Thélot et Louis-André Vallet, La réduction des inégalités sociales devant l’école depuis le début du siècle, Économie et Statistique, INSEE, no 334, oct. 2000, p. 3-32.
90 () Cf. L’évolution du nombre d’élèves en difficultés face à l’écrit depuis une dizaine d’années, Jeanne-Marie Daussin, Saskia Kesbpaik, Thierry Rocher, France portrait social 2011, INSEE.
91 () La recherche historique fait aujourd’hui remonter les premiers jalons des travaux sociologiques sur les inégalités sociales à l’école à l’initiative en 1904 d’un élève d’Émile Durkheim, Paul Lapie, pour mesurer l’effet de l’école primaire obligatoire sur la mobilité social. Cf. Françoise Œuvrard, Quelques repères historiques, Revue Éducation et formation n° 74, avril 2007, ministère de l’Éducation nationale.
92 () Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France, Armand Colin, 1968. Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement en France, de 1945 à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points histoire », 1992.
Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France, t. IV, L’école et la famille dans une société en mutation (depuis 1930) Perrin, coll. « Tempus », 2004.
93 () Antoine Prost, Histoire du système éducatif français, les Notices, La documentation française, 2006.
94 () Alain Girard, L’origine sociale des élèves des classes de 6e, Population, 1962, vol. 17, n° 1, pp. 9 à 23.
95 () Camille Peugny, Le destin au berceau, Seuil, coll. La république des idées, p. 68.
96 () Les enquêtes FQP sont réalisées auprès d’un échantillon représentatif de 40 000 personnes âgées de 18 à 65 ans, interrogées – dans le cadre d’un entretien en face à face – sur les divers aspects de leur formation et de leur carrière professionnelles : l’origine sociale, la formation initiale (diplômes, niveau de formation et spécialités de formation), la formation continue, la mobilité professionnelle et géographique et les revenus salariaux. Les données les plus récentes datent de 2003, après cinq enquêtes conduites en 1964, 1970, 1977, 1985, et 1993. La prochaine enquête donnera lieu à des publications à compter de 2014.
97 () Louis-André Vallet commente ces résultats en y voyant une « confirmation de l’analyse historique de [Antoine] Prost (1997) [selon laquelle ce] serait la réforme de 1941 qui, en transformant les écoles primaires supérieures en collèges modernes et en les intégrant à l’enseignement secondaire, aurait conduit ce dernier à organiser l’accueil, dans son second cycle, des élèves auparavant formés par le primaire supérieur – très majoritairement des enfants du “peuple” ».
98 () Jean-Paul Caille, Fabienne Rosenwald, « Les inégalités de réussite à l’école élémentaire : construction et évolution », France Portrait Social, novembre 2006.
99 () On note l’importance associée au diplôme de la mère dans le lien établi avec les résultats scolaires. Le ministère de l’Éducation nationale a indiqué par ailleurs aux rapporteurs que « l’impact associé au diplôme maternel est toujours plus marqué que celui associé au diplôme du père. Cela peut être mis en relation avec le fait que les mères sont généralement plus impliquées que les pères dans le suivi de la scolarité de l’enfant. Ainsi, en fin de cours préparatoire, 80 % des élèves scolarisés dans cette classe en 2011-2012 sont aidés régulièrement par leur mère et seulement 37 % par leur père. »
100 () La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale a récemment publié les principaux résultats d’une étude portant sur les acquis et les compétences d’élèves entrés au cours préparatoire en 2011, réalisés dans les mêmes conditions que celle portant sur les élèves entrés en cours préparatoire en 1997. En 14 ans – de façon encourageante –, le ministère observe une élévation substantielle du niveau général des élèves et un resserrement des « écarts sociaux » de performance, même si ceux-ci persistent de façon statistiquement significative. La DEPP observe ainsi que « les dimensions qui enregistrent les progrès les plus importants sont la prélecture, l’écriture et la numération. Près d’un tiers de l’élévation du niveau des élèves est attribuable aux évolutions concernant le niveau de diplôme et la catégorie sociale des familles. De manière générale, les progrès observés sont plus importants pour les élèves issus des catégories sociales les moins favorisées. Les inégalités sociales ont ainsi tendance à se réduire à l’issue de l’école maternelle. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de performances des élèves est corroborée par les observations réalisées par les enseignants. »
101 () Défini comme leur permettant de figurer parmi les 50 % meilleurs élèves aux évaluations nationales en français à l’entrée en sixième.
102 () Les réseaux ambitions réussite (RAR) ont été créés en 2006 dans le cadre d’un plan de relance de l’éducation prioritaire destiné, entre autres, à accroître et concentrer les aides nationales allouées aux établissements qui en relèvent. 249 RAR ont été créés à cette occasion, chacun d’entre eux rassemblant un collège et des écoles primaires. Les établissements RAR cumulent les difficultés scolaires et sociales les plus importantes.
103 () Le nombre de livres à la maison – loin de constituer un détail – semble effectivement lié à la réussite scolaire des élèves. Dans ses réponses aux rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale précise, s’agissant de l’impact des conditions de vie matérielle des ménages sur la réussite scolaire, que « le nombre de livres possédés à la maison attire particulièrement l’attention. D’une part, les enquêtes PISA montrent de manière récurrente un lien très fort entre le nombre de livres à la maison et le niveau de performances scolaires des enfants dans la quasi-totalité des pays participants. D’autre part, les traitements réalisés sur les panels 2007 et 2011 tendent à suggérer que la corrélation entre réussite et nombre de livres ne relève pas d’un simple effet de structure. Une partie de l’effet demeure lorsqu’on contrôle simultanément dans une régression linéaire les autres caractéristiques des familles : PCS de la personne de référence, diplômes des deux parents, revenus, taille de la famille, structure parentale. Cette différenciation de réussite selon le nombre de livres détenus à la maison apparaît dès l’entrée au cours préparatoire et a tendance à être encore plus prononcée à l’entrée en sixième. Comme on pouvait s’y attendre, elle impacte plus les résultats en français qu’en mathématiques mais son effet est sensible sur les deux matières. »
104 () Le ministère de l’Éducation nationale note par ailleurs que les « résultats des élèves du secteur public hors éducation prioritaire […] se rapprochent de ceux des élèves du secteur privé, ceci malgré une proportion d’élèves issus de [professions et catégories socio-professionnelles – PCS] défavorisées moins importante dans le secteur privé ». Ce constat n’invalide pas le lien entre les PCS des familles et les performances scolaires des élèves. Il montre que ce lien peut être plus ou moins intense.
105 () Dans ses réponses aux rapporteurs, le ministère de l’Éducation nationale note toutefois qu’« il a […] été démontré par le passé que le redoublement est davantage lié aux pratiques des équipes pédagogiques qu’au niveau réel des élèves ». Le Gouvernement souligne ainsi les disparités de la pratique des redoublements aux niveaux géographiques, voire entre les équipes pédagogiques des établissements scolaires. Ce constat n’invalide pas pour autant les constats présentés par les rapporteurs sur le lien entre redoublement, origine sociale, économique et culturel des élèves et leur réussite durant leur cursus scolaire.
106 () Les enquêtes « génération » du CEREQ étudient l’accès à l’emploi des jeunes trois ans après l’année de leur sortie du système éducatif, tous niveaux de qualification confondus. En l’espèce, les informations reprises s’appuient sur le devenir d’un panel de jeunes sortis du système scolaire en 2004.
107 () Les bacheliers du panel 1995 : évolution et analyse des parcours, note d’information 10.13, revue du ministère de l’Éducation nationale, septembre 2010.
108 () Jean-Paul Caille, Fabienne Rosenwald, Les inégalités de réussite à l’école élémentaire : construction et évolution, France, portrait social, édition 2006.
109 () Parmi les élèves entrés au cours préparatoire en 1997, 97,3 % des enfants d’enseignants et 66,6 % des enfants d’ouvriers non qualifiés sont parvenus en sixième sans redoublement. Ces éléments peuvent être analysés de trois manières : la différence entre les deux proportions (rapport additif) est de 30,6 points ; les enfants d’enseignants atteignent 1,5 fois plus souvent la sixième sans redoublement que ceux d’ouvriers non qualifiés (rapport multiplicatif) ; le fait que les enfants d’enseignants parviennent au CE2 « à l’heure » ou en avance et pas les enfants d’ouvriers non qualifiés est un événement qui a 18,1 fois plus de chances de se produire que la situation contraire (odds-ratio ou rapport logistique). Les valeurs de ces différents rapports étaient – pour les élèves entrés en cours préparatoire en 1978 – respectivement de 46,2 (rapport additif – plus élevé qu’en 1997), 2,0 (rapport additif – plus élevé qu’en 1997), et 16,9 (odds-ratio – moins élevé qu’en 1997).
110 () Le choix de l’âge de 15 ans par l’OCDE est justifié par le fait que cet âge marque, dans la plupart des pays de l’OCDE, la fin de la scolarité obligatoire.
111 () Mathieu Ichou et Louis-André Vallet, Performances scolaires, orientation et inégalités sociales d’éducation. Évolution en France en quatre décennies, Éducation & formations n° 82, octobre 2012, ministère de l’Éducation nationale.
112 () Cf. par exemple la thèse de sociologie soutenue par Mme Nadia Nakhili portant sur les « aspirations scolaires différenciées » des étudiants (soutenue à Dijon, en 2007).
113 () Ces résultats peuvent être consultés en détail dans le document Résultats du PISA 2009 : Synthèse, page 9, téléchargeable sur le site de l’OCDE.
114 () Toujours mis à part Israël :
– l’écart des scores PISA entre élèves des 50e et 25e percentiles est plus élevé qu’en France uniquement en Belgique ;
– l’écart des scores PISA entre élèves des 75e et 50e percentiles est plus élevé qu’en France dans aucun pays recensé par le tableau.
115 () Dans l’ordre du classement du graphique : la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël.
116 () Dans l’ordre du classement du graphique : les Pays-Bas, le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège, la Suisse et l’Allemagne.
117 () Indice de niveau de formation le plus élevé des parents – PARED.
118 () Indice de statut professionnel plus élevé – HISEI.
119 () Indice de patrimoine familial – HOMEPOS.
120 () Pour connaître précisément les modalités de constitution de ces indices, voir l’annexe A (Cadre technique), du document Pisa 2009 : Surmonter le milieu social. L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage. Volume II, OCDE 2011.
121 () Pisa 2009 : Surmonter le milieu social. L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage. Volume II, p. 65, OCDE 2011.
122 () 3,6 % des enfants du panel n’ont pas atteint la troisième. L’écart supérieur à la moyenne est significatif pour les enfants d’ouvriers non qualifiés (5,6 %), mais surtout pour les enfants d’inactifs (12,7 %).
123 () Acronyme de « Affectation des élèves par le net ».
124 () Les affectations dans les lycées privés ne sont pas gérées par Affelnet.
125 () Alors que l’inverse est possible : des vœux portant sur des filières professionnelles peuvent être émis par les élèves orientés vers une seconde générale et technologique.
126 () Il est en revanche possible qu’un futur élève de seconde générale et technologique soit affecté dans un lycée qui n’était pas son premier choix, ce qui peut induire des difficultés en termes de vie scolaire, par exemple en matière de temps et de modalités de transport entre le domicile et l’établissement.
127 () Circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008, orientation – parcours de découverte des métiers et des formations, signée par M. Jean-Louis Nembrini, directeur général de l’enseignement scolaire, par délégation du ministre de l’Éducation nationale.
128 () Cf. PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Enseignement scolaire », page 333.
129 () M. Laurent Caillot, (membre de l’inspection générale des affaires sociales – IGAS), MM. Aziz Jellab et Didier Vin-Datiche (inspecteurs généraux de l’éducation nationale – IGEN), Mme Hélène Bernard et M. Jean-François Cervel (inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche – IGAENR), Le service public de l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. Ce rapport porte les numéros RM 2013-020P pour l’IGAS et 2013-008 pour l’IGEN et l’IGAENR.
130 () Cf. ce rapport page 82.
131 () Un enseignement disciplinaire en technologie lui a été substitué.
132 () Certains élèves de la classe relais peuvent être lycéens, pour autant qu’ils soient soumis à l’obligation scolaire.
133 () Il s’agit notamment des sections de technicien supérieur (STS), des instituts universitaires de technologie (IUT) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
134 () Le ministère de l’Éducation nationale indique également que la procédure en ligne APB conduit à ce que « 90% des élèves ont leur affectation définitive dès début juin ».
135 () Bref du céreq, n° 303, décembre 2012, S’insérer à la sortie de l’enseignement secondaire : de fortes inégalités entre filières, page 8.
136 () La réforme de la voie professionnelle, mise en place progressivement depuis la rentrée 2009 et achevée à la rentrée 2011, a vu la suppression du diplôme du BEP (2 ans), qui pouvait être prolongé par un bac professionnel (2 ans). Désormais, il n’existe plus que le bac professionnel, préparé en 3 ans.
137 () Prisca Kergoat (CERTOP – Université Toulouse 2 / Céreq) « L’apprentissage est-il un outil au service de la démocratisation de l’enseignement supérieur ? » (2010).
138 () Rapport du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, CNFPTLV, « Financement et effectifs de l’apprentissage en France – données 2010 », 2012.
139 () La TA est versée par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), qui distribuent le produit de la TA aux CFA. La TA concerne toutes les entreprises de plus d’un salarié, redevable de l’impôt sur les sociétés. L’assiette correspond à la rémunération versée ; le taux est fixé à 0,50 %.
140 () La CDA a été créée en 2005 pour financer les Fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Avec une même assiette que la TA, son taux est fixé à 0,18 %.
141 () La CSA a été créée en 2010 pour augmenter la proportion d’apprentis dans les sociétés de plus de 250 salariés. Calculée sur la base de l’assiette de la TA, elle a un taux variable dans la mesure où elle correspond au malus du dispositif de « bonus-malus » encourageant l’apprentissage. Ce malus ne concerne que les sociétés de plus de 250 salariés.
142 () Annoncée en juillet 2013, la suppression de l’ICF est prévue par l’article 77 du projet de loi de finances pour 2014. Le même article prévoit de lui substituer une prime à l’apprentissage pour « les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés […] le montant de cette prime […] ne peut être inférieur à 1 000 euros par année de formation ». L’article R. 6243-2 du code du travail fixe le montant de l’ICF à 1 000 euros. L’article 77 du PLF pour 2014 prévoit également une sortie progressive du dispositif de l’ICF sur trois ans à compter de 2014 pour les entreprises d’au moins 11 salariés.
143 () Il s’agit d’une aide versée aux employeurs qui embauchent une personne en contrat d'apprentissage. Cette aide, de minimum 1 000 euros par an, est financée par l'État et versée par les régions. La disparition de ce dispositif fait partie des mesures de « modernisation » et de « simplification » visant à réduire de 3 milliards d'euros le déficit de l'État en 2014. La suppression de l'indemnité doit rapporter 550 millions d'euros à l'État. Cependant, la suppression de cette aide serait compensée par une nouvelle aide pour les entreprises de moins de 10 salariés, dont les contours ne sont pas encore déterminés, mais qui devrait représenter un coût compris entre 250 et 300 millions d’euros par an.
144 () Tandis que les contrats d’apprentissage participent de la formation initiale, les contrats de professionnalisation (lancés en 2004) font partie de la formation continue.
145 () La circulaire incite également les autorités académiques, pour la rentrée 2013, à identifier les jeunes de moins de 15 ans qui n’auraient pas pris le soin de s’inscrire dans un établissement scolaire, pensant pouvoir compter sur la signature d’un contrat d’apprentissage au moment de la rentrée. Les autorités académiques sont invitées à proposer des solutions de formation aux jeunes concernés par ce cas de figure.
146 () L’article 56 de la loi du 8 juillet 2013 a également prévu que le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) soit désormais accessible aux élèves âgés d’au moins 15 ans.
147 () OCDE, France 2013, chapitre « Améliorer la situation économique des jeunes », avril 2013.
148 () Loi de finances rectificative du 9 mars 2010 relative aux investissements d’avenir.
149 () L’article L. 131-1 du code de l’éducation précise que « l'instruction est obligatoire pour les enfants […] entre six ans et seize ans. »
150 () Pour sa part, comme indiqué supra dans la première partie, l’Union européenne constate pour chaque pays membre la proportion de jeunes de 18 à 24 ans sortis du système scolaire, qui sont sans emploi et ne suivent pas de formation. En 2011, la proportion de ces jeunes s’élevait à 12 % en France, contre 13,2 % dans l’Union européenne. Ces jeunes peuvent être différents des décrocheurs de la statistique française, dans certaines configurations. Un jeune pris en compte par l’indicateur européen peut être diplômé, auquel cas il ne sera pas décrocheur en France. L’indicateur statistique communautaire est néanmoins évoqué par l’annexe à la loi du du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République dans sa partie relative à la lutte contre le décrochage scolaire.
151 () L’annexe à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République évoque une proportion de 25 % de décrocheurs au cours des deux premières années de scolarité en lycée professionnel.
152 () La qualité de la vie et de l’ambiance scolaires peut être un facteur clé. Dans un registre extrême, mais « parlant », le rapport des prestataires évoque à ce titre le cas d’un jeune décrocheur qui explique que son « affectation dans un établissement fréquenté par une bande rivale de son quartier […] menaçait sa sécurité et l’avait donc conduit à interrompre sa scolarité. »
153 () Y compris quand ces élèves sont passés par les plateformes d’appui et de soutien aux décrocheurs – PASD, et les réseaux « Formation, qualification, emploi » – Foquale. Cf. infra.
154 () On peut noter que la circulaire – évoquée supra – du 11 juillet 2008 relative à la mise en place du parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) dispose qu’en première année de cursus du CAP, du BEP ou du bac professionnel, « un entretien personnalisé permet, en phase d’accueil, d’identifier les besoins des élèves pour construire leur parcours. C’est aussi un moyen pour lutter contre le décrochage et pour éviter les sorties sans qualification. »
155 () Le rapport des prestataires KPMG et Euréval évoque « un système complexe, une kyrielle d’acteurs et des dispositifs difficilement identifiables ».
156 () Le rapport des prestataires KPMG et Euréval émet des préconisations techniques pour améliorer la fiabilité des listes départementales de décrocheurs établies via le SIEI. Il conviendrait que le ministère de l’Éducation nationale étudie leur pertinence et leur faisabilité.
157 () Mission générale d’insertion, service national de l’Éducation nationale.
158 () Le rapport des prestataires KPMG et Euréval témoigne, sur les 4 sites étudiés, de l’usage effectif par les acteurs territoriaux de la souplesse du dispositif quant à la définition du ressort géographique des PSAD et du profil des coordinateurs départementaux et responsables des plateformes. Pour ce rapport, « les PSAD s’adaptent à la réalité locale, et ainsi, aux coopérations préexistantes en matière d’orientation et d’insertion professionnelle. »
159 () La circulaire du 13 avril 2013 dispose que « les personnels de la MLDS développent au sein des réseaux Foquale une activité de conseil, d'expertise et d'ingénierie de formation. Ils contribuent à l'élaboration des bilans de positionnement et collaborent à la mise en place et au suivi des actions de formation et des parcours individualisés en lien avec les établissements d'accueil. Ils participent, en relation avec les centres d'information et d'orientation, à l'évaluation des besoins de formation et à l'accompagnement des jeunes vers les organismes les mieux adaptés. Ils permettent de clarifier l'offre de formation et de services auxquels les jeunes peuvent accéder. Ils sont en mesure de proposer des solutions dans le cadre des réseaux Foquale. »
160 () Le contenu et la portée de ces pactes régionaux sont évoqués infra. Le rapport des prestataires KPMG et Euréval précise qu’« aucune allusion à ces pactes régionaux n’a été faite par les acteurs rencontrés » de la lutte contre le décrochage scolaire.
161 () En application de l’article L. 114-2 du code du service national, chaque jeune est en principe tenu de participer à la JDC avant son 18ème anniversaire.
162 () Cf. le PAP de cette mission, page 34.
163 () Le micro-lycée est rattaché à un lycée d’enseignement général et technologique. Son budget de fonctionnement est financé par des subventions de collectivités territoriales, notamment la région.
164 () La charte des micro-lycées prévoit au demeurant qu’ils « sont des lieux de recherche-action suivis par des laboratoires universitaires en Sciences de l’éducation. »
165 () Mme Édith Cresson préside aujourd’hui la fondation des écoles de la deuxième chance.
166 () Cf. l’article 12 de la loi n° 2007-297 relative à la prévention de la délinquance.
167 () Dans sa version issue de l’article 38 de loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
168 () À l’E2C Loire de Saint-Étienne, 52 % des élèves en 2012 étaient issus de ces quartiers.
169 () PAP mission « Travail et emploi » annexé au PLF pour 2014, page 60.
170 () Ces dispositifs sont évoqués supra dans la première partie du présent rapport.
171 () La durée du contrat est de 8 mois renouvelable, sans pouvoir excéder au total 24 mois.
172 () Au demeurant, à la création de l’Épide en 2005, il était prévu d’accueillir jusqu’à 40 000 jeunes dans les centres à l’horizon 2007.
173 () Le nombre des ETPT à disposition de l’Épide s’élevait à 964 en 2012 et 953 en 2013.
174 () Selon les données chiffrées présentées dans le rapport n° 1428 sur le projet de loi de finances pour 2014 de (annexe n° 47 « Travail et Emploi : Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ») de M. Christophe Castaner, rapporteur spécial, commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale (octobre 2013).
175 () Il y a plus de cordées de la réussite que d’établissements tête de cordée parce qu’un même établissement « chapeaute » parfois plusieurs cordées. Quelques cordées relèvent de plusieurs établissements de l’enseignement supérieur à la fois.
176 () Les crédits ECTS – pour European credits transfer system – constituent le mécanisme par lequel sont attribués des points à toutes les composantes d'un programme d'études de l’enseignement supérieur en se fondant sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant. En France, un an d'études correspond à 60 crédits ECTS, soit entre 1 500 et 1 800 heures d'enseignements.
177 () Il s’agit d’une donnée médiane. Le nombre moyen d’élèves par cordée de la réussite est plus élevé, car un petit nombre de cordées s’adresse pour chacune d’elles à un nombre très élevé d’élèves, supérieur parfois à 1 000.
178 () Études réalisées par la société Accenture et par l’Essec Business school, transmises aux rapporteurs par Mme Chantal Dardelet, animatrice du groupe ouverture sociale de la conférence des grandes écoles (CGE), directrice exécutive de ESSEC IIES (institut de l’innovation et de l’entrepreneuriat social), responsable du pôle égalité des chances de l’ESSEC. Mme Chantal Dardelet a participé le 3 avril 2013 à la table ronde organisée par le groupe de travail sur la diversification des recrutements des grandes écoles.
179 () Du côté investissement, ont notamment été pris en compte les fonds publics affectés au dispositif, les fonds privés issus et du mécénat, le mécénat de compétences issu d’expertises privées et l’apport de l’ESSEC et des lycées en fonctionnement et personnels. Du côté valeur ajoutée, ont notamment été pris en compte la valeur en salaire des mois gagnés en temps d’embauche par les tutorés, le différentiel positif de salaire constaté à leur avantage et le coût d’une formation relative à la diversité au bénéfice des tuteurs leur apportant des compétences analogues à celles qu’ils ont développées dans l’exercice du tutorat.
180 () Note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 12-04 du 26 juin 2012 – Les bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, pages 6 et 7.
181 () Presque 9 000 étudiants en 2010. Le taux des bacheliers professionnels inscrits dans une filière longue de l’enseignement supérieur est passé de 6,4 % à 7,4 % de 2005 à 2010. À Rennes, les acteurs pédagogiques rencontrés par les rapporteurs ont souligné aux rapporteurs à la fois le nombre modéré des bacheliers professionnels inscrits en licence et le fait que ceux-ci s’exposaient presque systématiquement à l’échec.
182 () Rapport d’analyse des schémas directeurs d’aide à l’insertion professionnelle des universités, ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR), mars 2010.
183 () Cf. le même rapport, page 13.
184 () Cf. l’article L. 231-15 du code de l’éducation.
185 () Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Camille Peugny (2013).
186 () Entre 15 et 29 ans, le taux de chômage (18 % en France, 18,1 % dans l’UE 27 en 2012) et la part de chômage (9,7 % contre 10,3 %) sont ainsi légèrement inférieurs à la moyenne de l’Union européenne.
187 () Rapport 2012 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS).
188 () Acronyme anglais (neither in employment, nor in education or training) : jeunes ni emploi, ni en formation.
189 () Note n° 4 du CAE, L’emploi des jeunes peu qualifiés en France, Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Klaus F. Zimmermann, (avril 2013).
190 () « Améliorer la situation des jeunes », Études économiques : France (avril 2013).
191 () Dares Analyse n° 90, Emploi et chômage des 15-29 ans en 2011 (décembre 2012).
192 () L’OCDE distingue les « performants », les « débutants en mal d’insertion » et les « laissés pour compte ».
193 () La part des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation dans les ZUS est d’environ 25,2 % en 2010 soit un taux nettement supérieur à celui des zones urbaines environnantes (14,9 % en moyenne).
194 () Le Monde, 1er juin 2013.
195 () Depuis 2008, ce sont essentiellement les jeunes sans diplôme qui ont vu leurs perspectives d’emploi se dégrader, avec une chute du taux d’emploi de 10 points à la sortie de l’école.
196 () Selon l’étude d’impact du projet de loi relatif aux emplois d’avenir (août 2012).
197 () « Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l’ascenseur sociale », L. Chauvel, OFCE.
198 () Évaluation de la politique territoriale de l’emploi, MAP, IGAS (10 octobre 2013).
199 () « Trente propositions pour favoriser et accompagner la création d’entreprises », rapport n° 763 de M. Jean-Charles Taugourdeau et M. Fabrice Verdier, déposé au nom du CEC (février 2013).
200 () La notion de « jeunes sans qualification » (ensemble des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme autre que le brevet) doit être distinguée de celle des « décrocheurs » (notion de « flux »), soit les élèves inscrits au début d’une année scolaire qui le ne sont plus l’année suivante sans être titulaires d’un diplôme d’études secondaires et dont la grande proximité avec la formation initiale peut permettre de mobiliser des réponses spécifiques.
201 () Un jeune de moins de 30 ans résidant en ZUS a globalement 1,7 fois moins de chance d’accéder à l’emploi à caractéristiques égales de sexe, de qualification et de nationalité, selon un rapport de l’ONZUS (2009).
202 () L’emploi des jeunes, rapport du CESE (M. Jean-Baptiste Prévost), septembre 2012.
203 () En effet, même sans disposer de compétences spécifiques en matière d’emploi, les collectivités sont nombreuses à intervenir par leurs financements dans ce domaine. En outre, certaines des politiques qui leur sont confiées sont proches de cette compétence : formation professionnelle (régions), revenu de solidarité active (départements), action sociale (communes), etc.
204 () L’emploi des jeunes, Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), février 2011.
205 () Dont 15 milliards d’euros consacrés principalement par l’État et les régions à la formation professionnelle sous statut scolaire, 8 milliards consacrés par l’État, les régions et les partenaires sociaux à la formation par alternance (apprentissage et professionnalisation) et près d’un milliard d’euros consacré par les régions aux stages de formation continue pour les jeunes.
206 () CCREFP : comité de coordination régional emploi-formation.
207 () CPRDFP : contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
208 () Le CTEF définit la stratégie que les partenaires souhaitent adopter pour les cinq ans à venir, autour de 27 bassins, avec une structure porteuse (mission locale, maison de l’emploi, etc.) chargée du pilotage technique du CTEF. Le conseil régional a décentralisé un tiers des crédits emploi formation (30 M €).
209 () Article L. 5314-1 du code du travail.
210 () Le protocole 2010 des missions locales prévoyait que « les orientations de ce COM IPJ seront alimentées par le diagnostic et les orientations du CPRDFP, celui-ci constituant ainsi un levier privilégié de la stratégie d’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’accroissement de leur qualification ».
211 () Le service public de l’orientation (SPO) : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, rapport conjoint de l’Igas (Laurent Caillot), de IGAENR et de l’IGEN (avril 2013).
212 () À cet égard, l’article 9 du projet de loi de mobilisation des régions prévoit que le préfet de région et le président du conseil régional signent chaque année avec Pôle Emploi et les missions locales « une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ».
213 () Articles R. 5314-1 et suivants du code du travail.
214 () Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, rapport n° 2010-M-019-02, inspection générale des finances (juillet 2010).
215 () Rapport d’information n° 1107 sur Pôle Emploi et le service public de l’emploi, présenté par Mme Monique Iborra, rapporteure, commission des Affaires sociales, Assemblée nationale (juin 2013).
216 () L’Assemblée générale de l’UNML, réunie le 4 juillet 2013, a donné mandat au conseil d’administration pour « proposer la création d’un Conseil national de l’insertion des jeunes pour favoriser le développement d’une approche interministérielle et transversale des politiques de jeunesse ».
217 () Selon les données présentées dans le rapport du CESE sur l’emploi des jeunes (septembre 2012).
218 () En décembre 2012, un avenant a été signé pour prolonger jusqu’en juin 2013 l’ANI du 7 avril 2011. Ces mesures d’accompagnement devaient bénéficier à 20 000 jeunes supplémentaires au cours du premier semestre 2013, dont 10 000 accompagnés par Pôle emploi.
219 () L’emploi des jeunes, rapport du CESE, M. Jean-Baptiste Prévost, rapporteur (septembre 2012).
220 () La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une démarche déjà répandue, Émilie Ernst, division Enquêtes thématiques et études transversales, Insee, Yolan Honoré-Rougé, Ensa (novembre 2012).
221 () La charte de la diversité en entreprise a été créée en octobre 2004. En la signant, les entreprises s'engagent à lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité.
222 () Article L.5314-2 du code du travail.
223 () Pour remplir leur fonction d’accompagnement des jeunes pour une insertion durable, les missions locales développent des partenariats et les contractualisent avec les services et les institutions en charge des questions relatives à l’orientation, à la formation, à l'emploi, à la santé, au logement, à la mobilité, à la citoyenneté, aux sports, aux loisirs et à la culture.
224 () Les jeunes sont dits « en contact » une année donnée lorsqu’ils ont été en relation, au moins une fois dans l’année, avec une mission locale, éventuellement par l’intermédiaire d’un tiers, et ce par quelque moyen que ce soit (entretien individuel, atelier, information collective, téléphone, lettre, intermédiation…).
Les jeunes sont dits « reçus en entretien » lorsqu’ils ont bénéficié durant l’année d’au moins un entretien individuel, ou participé à un atelier ou une information collective.
225 () Le profil majoritaire des jeunes qui se présentent pour la première fois en mission locale de 18 à 21 ans (54 %) et de niveau Vbis à V (50 %).
226 () Les jeunes sont dits « reçus en entretien » lorsqu’ils ont bénéficié durant l’année d’au moins un entretien individuel, ou participé à un atelier ou une information collective.
227 () Selon le rapport d’activité 2011 du CNML, publié au premier semestre 2013.
228 () Selon le PAP du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi » annexé au PLF pour 2014, pour ce qui concerne les missions locales et PAIO, « les crédits prévus en PLF 2014 s’élèvent à 178,80 M € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour 466 structures ».
229 () Compte-rendu de la réunion de la commission des Finances de l’Assemblée nationale du mercredi 31 octobre 2013.
230 () S’agissant des « jeunes en demande d’insertion » (JDI, cf. infra), la moyenne s’établissait en 2008 à 94 jeunes par conseiller, le rapport précité de l’IGF de juillet 2010.
231 () L’indicateur « jeunes en demande d’insertion » (JDI) dénombre les jeunes ayant bénéficié d’au moins un entretien au sein du réseau des missions locales et PAIO, au cours des cinq derniers mois, qu’il s’agisse d’un entretien individuel, d’une information collective ou d’un atelier.
232 () Selon les auteurs de cette note, ce financement pourrait être assuré grâce à des économies réalisées sur le contrat de génération (ciblage des contrats).
233 () « Améliorer la situation des jeunes », Études économiques de l'OCDE : France 2013 (avril 2013).
234 () Il est normal que le total soit supérieur à 65 %, certains jeunes ayant accédé à plusieurs situations sur la période (1,6 contrat de travail ou formation par jeune pour ces 65 % de jeunes bénéficiaires).
235 () Par exemple, des programme de seconde chance, avec 15 jeunes par manager, avec de bons résultats selon les interlocuteurs grâce à l’intensité de la relation entretenue avec les jeunes, ou encore des actions développées en direction des NEET par les agences de compétence (40 jeunes par manager environ).
236 () Lors de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou au plus tard dans les 15 jours suivant celle-ci, un PPAE est élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou un organisme participant au SPE, et actualisé périodiquement. Il précise la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu, en tenant compte de plusieurs critères, notamment la formation du demandeur d’emploi, ses qualifications, sa situation personnelle et familiale, etc. Il précise également les actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité, dans l’objectif de permettre un retour à l’emploi dans les meilleurs délais.
237 () Pôle emploi a ainsi confié aux missions locales signataires d’une convention locale de partenariat renforcé la mise en œuvre du PPAE pour des jeunes demandeurs d’emplois.
238 () Avis n° 151 (2012-2013) de M. Claude Jeannerot, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2013 (22 novembre 2012).
239 () En 2010, l’accord-cadre de partenariat renforcé entre Pôle Emploi, le CNML et l’État a été conclu pour la période 2011-2014.
240 () La taille des structures varie de moins de 10 ETP, pour 12 % d’entre elles, à plus de 50 ETP (7%), les missions locales de 10 à 20 ETP étant les plus nombreuses (plus de 40 %).
241 () Présentation du DGEFP au Conseil d’orientation pour l’emploi (janvier 2011)
242 () Les facteurs de contexte expliqueraient de l’ordre de 40 % des résultats des missions locales en termes de retour à l’emploi.
243 () Aux termes de l’article L. 5314-2 du code du travail (dernier alinéa inséré par la loi du 24 novembre 2009), « les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions sont fixées par convention avec l’État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
244 () L’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville, Laurent Caillot, Agnès Jeannet, Yves Calvez, IGAS (octobre 2010).
245 () Sur un effectif total, estimé à 658 100 jeunes en mesure d’emploi en décembre 2011, le nombre des jeunes dépourvus de diplôme autre que le brevet des collèges représentait 194 800 (Dares, décembre 2012).
246 () Selon le rapport conjoint de l’Igas et de l’IGF précité (juin 2013).
247 () Cette proportion est de 64 % pour les contrats d’apprentissage.
248 () Selon le rapport conjoint de l’Igas et de l’IGF précité (juin 2013).
249 () Ces exonérations spécifiques concernent notamment les contrats d’employeurs signés avec des groupements d’employeur pour l’insertion et la qualification (GEIQ) pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans en difficulté.
250 () Depuis la loi de finances pour 2008 (article 128), le régime de exonérations de cotisations des contrats de professionnalisation a été aligné sur le droit commun ( « allègements Fillon »).
251 () Rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi précité (avril 2013).
252 () « Le contrat de professionnalisation : l’insertion des bénéficiaires varie surtout selon le métier préparé », R. Sanchez, Dares Analyses n° 100 (décembre 2012).
253 () Dares Analyses n° 21, « Le contrat de professionnalisation en 2011 : plus d’entrées qu’en 2010 et des contrats plus courts » (mars 2012).
254 () Rapport public thématique, « Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques », Cour des Comptes (janvier 2013).
255 () S’agissant de l’insertion des sortants de contrats de professionnalisation, le rapport du COE précité souligne par exemple que les études sont plus rares s’agissant des effets sur l’emploi de ces contrats et qu’il n’existe notamment pas d’évaluation de l’effet net du dispositif.
256 () Voir sur ce point le rapport précité de la Cour des comptes de janvier 2013 et les rapports du COE sur l’emploi des jeunes (février 2011) et les aides aux entreprises en faveur de l’emploi (avril 2013).
257 () Voir par exemple, l’étude de la Dares sur « L’insertion professionnelle des personnes sorties de contrat aidé en 2008 : un accès à l’emploi relativement peu affecté par la dégradation de la conjoncture », DARES-Analyses n° 078 (novembre 2010).
258 () Rapport d'information n°1362 en conclusion des travaux de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi portant création des emplois d’avenir présenté par M. Jean-Marc Germain (septembre 2013).
259 () Concernant les emplois d’avenir, la convention d’objectifs 2013-2015 pour les quartiers prioritaires signée entre le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé de la ville prévoit cet objectif d’entrée de 30 % de jeunes résidant en ZUS.
260 () Les mesures d’accompagnement ne sont pas en elles-mêmes des contrats de travail, mais peuvent mobiliser les dispositifs existants (dont les contrats aidés.
261 () Le FIPJ est destiné à financer des actions complémentaires à l’accompagnement personnalisé et renforcé des jeunes confrontés à des obstacles multiples qui peuvent être des freins à leur insertion professionnelle.
262 () Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « Garantie jeunes ».
263 () La situation du jeune doit être évaluée par une commission "multi-acteurs" locale comprenant notamment des représentants de l'État et du conseil général, ainsi que des membres désignés par le préfet en matière d’insertion des jeunes et les présidents des missions locales.
264 () S’adressant à des jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau VI (sans qualification) à II (bac + 3), inscrits à Pôle emploi ou en mission locale, rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, ce contrait visait à donner la possibilité à des jeunes d’accéder à un premier niveau de qualification ou de compléter leur formation initiale par des compétences leur permettant de s’intégrer au mieux sur le marché du travail, avec un accompagnement vers l’emploi lors du stage de formation.
265 () Chiffres concernant le RSA non majoré, évoqués dans la publication de la Cnaf, « Les foyers bénéficiaires du RSA fin juin 2013 » (septembre 2013).
266 () Les jeunes perçoivent une subvention de 300 euros par mois (dont une prime mensuelle de 210 euros, en particulier pour les frais de transports, et une prime mensuelle de 90 euros capitalisés).
267 () Lorsqu’ils ne disposent d’aucune ressource d’activité, les jeunes en RCA reçoivent chaque mois une allocation de 250 € pendant un an puis celle-ci est dégressive sur la deuxième année du contrat.
268 () Versement d’une bourse de 300 € pendant 6 mois au maximum au bénéficiaire respectant son contrat.
269 () En effet, « le renouvellement du contrat CIVIS n’est pas automatique ou tacite. Il faut être attentif à la date de renouvellement car si celle-ci est dépassée, le contrat ne peut être poursuivi. Il convient d’attendre un délai de 12 mois pour se réinsérer dans un nouveau contrat. Si le cas survient, le jeune doit être intégré dans un autre dispositif que le CIVIS.
270 () Cette étude souligne ainsi que « Le parrainage est très peu développé selon les données communiquées. Les périodes d’immersion en entreprise sont beaucoup plus utilisées à Guéret qu’à Méru ou à la MIEJ 4-93 ».
271 () L’un des deux rapports du COE sur les aides aux entreprises en faveur de l’emploi (avril 2013) comporte une évaluation des principaux dispositifs, concernant notamment les aides en faveur de l’alternance, les contrats aidés, les allègements généraux de cotisations patronales et les exonérations zonées (ZFU par exemple).
272 () Enquête sur l’apprentissage au sein des PME, réalisée auprès des dirigeants de PME de 10 à 499 salariés, Ipsos, Apprentis d’Auteuil (décembre 2010).
273 () Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer que les PME n’aient pas plus recours à l’apprentissage, 17 % des dirigeants interrogés évoquaient la méconnaissance qu’ont les entreprises de ce dispositif et 16 % la complexité administrative du recours à l’apprentissage. Par ailleurs, 51 % d’entre eux jugeaient pas ou peu claire la différence entre le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
274 () En juin 2008, 20 grandes entreprises et structures ont signé une convention pour développer « 100 chances- 100 emplois en France ».
275 () Déplacement des rapporteurs en Bretagne en juin 2013.
276 () Déplacement des rapporteurs à Saint-Etienne en mars 2013.
277 () Voulu par l’État et initié par l’ANDRH, ce label a été lancé officiellement en 2008. Délivré par AFNOR Certification, il témoigne de l’engagement d’un organisme pour promouvoir la diversité en prévenant les discriminations dans le cadre de sa gestion des ressources humaines.
278 () Notamment Areva, Groupe Casino, GDF Suez, Mc Donald’s, Renault et Scheiner Electric.
279 () « Un droit au parcours accompagné vers l’emploi », groupe de travail emploi, travail, formation professionnelle, rapport établi par Catherine Barbaroux et Jean-Baptiste de Foucauld (novembre 2012).
280 () Et même antérieurement, par exemple dans le cadre de la « loi de promotion sociale » de 1959 sur les centres de formation (« loi Debré »).
281 () La dépense nationale pour la formation professionnelle et l’apprentissage représentait 31,5 milliards d’euros en 2010 (Dares, novembre 2012).
282 () Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
283 () Cour des comptes, rapport public thématique, « Marché du travail, face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques » (janvier 2013).
284 () Article L. 6111-1 du code du travail tel qu’issu de l’article 5 de la loi du 14 juin 2013 précitée.
285 () À ce stade, le compte est alimenté à raison de 20 heures par an pour les salariés à temps plein, plafonné à 120 heures, et par des heures supplémentaires accordés par l’État ou la région.
286 () Article L. 122-2 du code de l’éducation.
287 () Les auteurs de cette plateforme regroupent des associations, fédérations et mutuelles, mouvements de jeunesse, organisations de jeunesse et d’éducation populaire, structures d’insertion, d’hébergement ou de santé. Ils accueillent, accompagnent et travaillent auprès de millions de jeunes chaque année.
288 () Le RNCP recense à la fois des diplômes d’Etat, certains CQP et des certifications d’organismes privés. La Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP), mise en place dans le cadre de la loi précitée de 2002, parallèlement à la VAE, est chargée d’établir et d’actualiser le RNCP. Elle est composée de représentants de l’État, des partenaires sociaux, des conseils régionaux et de personnalités qualifiées.
289 () 40 ans de formation professionnelle : Bilan et perspectives, rapport du CESE (décembre 2011).
290 () Le financement des actions de VAE organisées à l’initiative de l’employeur est assuré sur le budget formation correspondant ou par l’OPCA dont l’entreprise relève.
291 () L’article L. 6412-1 du code du travail prévoit ainsi que « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. »
292 () En 2011, environ 160 étaient inscrits au RNCP, contre une quarantaine en 2006.
293 () L’article L. 214-13 du code de l’éducation prévoit ainsi que le CPRDF « définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience ».
294 () 40 ans de formation professionnelle : Bilan et perspectives, rapport du CESE (décembre 2011).
295 () Rapport du groupe de travail sur la VAE, présidé par M. Vincent Merle (entendu par la mission), remis au secrétaire d’État à l’emploi (M. Laurent Wauquiez) en janvier 2009, rapport du CESE 2011) et de M. Éric Besson (2008) précités, rapport d’inspection (IGEN) sur le fonctionnement des jurys de VAE en 2011, etc.
296 () Cette initiative a bénéficié d’une évaluation externe qui a permis d’en mesurer les apports.
297 () Le PEC est un outil numérique et une démarche dont l’originalité repose sur une « démarche réflexive » devant permettre aux étudiants d’identifier leurs compétences à partir d’une réflexion sur leur parcours de formation et autres expériences pour construire, à l'aide de l'outil informatique, leur(s) portefeuille(s) de compétences (avec la formation de formateurs – accompagnateurs chargés ensuite de former et accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de la démarche).
298 () Articles L. 120-1 et suivants du code du service national.
299 () Compte-rendu de la commission élargie du 22 octobre 2013.
300 () Une association a ainsi indiqué que le nombre de services civiques représenterait de l’ordre de 10 000 la première année, de 19 000 en 2012 et 18 000 en 2013.
301 () Rapport de M. Régis Juanico, rapporteur spécial au nom de la commission des Finances, annexe n° 46, Sport, jeunesse et vie associative (octobre 2013).
302 () Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, présent par MM. Bernard Lesterlin et M. Jean-Philippe Maurer, Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (novembre 2011).
303 () Compte-rendu de la commission élargie du 22 octobre 2013.
304 () Enquête Conditions de vie des étudiants 2010, présentée dans la publication « La vie étudiante. Repères. Edition 2011 » de l’observatoire de la vie étudiante (OVE). L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’étudiants et d’élèves inscrits dans l’enseignement supérieur en 2009-2010 (plus de 33 000 étudiants ont répondu).
305 () « Améliorer la situation économique des jeunes », Études économiques de l’OCDE : France (avril 2013).
306 () Source : Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes, OCDE 2010.
307 () Ce projet vise à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants de master boursiers, par la mise en œuvre dans cinq universités d’un programme en trois axes. Les deux premiers correspondent à un coaching collectif et une animation de communautés d’étudiants, proposant des formations techniques interactives à la recherche d’emploi. Le troisième axe consiste en des parrainages individuels d’un étudiant par un jeune actif diplômé d’une filière similaire. L’évaluation de l’impact du programme sur ses bénéficiaires repose sur la constitution d’échantillons test et témoin parmi les étudiants volontaires. L’évaluation analyse le parcours des différents groupes d’étudiants, 6 mois puis 1 an après l’obtention du diplôme.
308 () La proportion d’étudiants effectuant un stage pendant leur cursus de formation constitue d’ailleurs l’un des indicateurs retenus pour le plan d’action pour la jeunesse).
309 () Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
310 () Par construction, cette moyenne s’établit à 10 % pour chaque décile.
311 () Ainsi, comme le souligne la contribution de l’ambassade de France au Danemark évoquée infra, « Le système ne prend pas en compte les éventuelles aides parents, mais les élèves ou étudiants vivant chez leurs parents reçoivent une bourse moins élevée que les personnes vivant en dehors du foyer ».
312 () S’agissant des bourses pour les programmes d’éducation pour les jeunes (niveau secondaire supérieur en particulier), le site internet du ministère précise ainsi que les étudiants doivent assister au cours, être présents aux examens et démontrer qu’ils sont actifs dans leurs formations. S’agissant des études supérieures, il peut s’agit de condition de progression dans les études.
313 () Contributions des ambassades présentées en annexe (pages 249 et suivantes) du rapport France, ton atout jeunes : un avenir à tout jeune, rapport d’information n° 436 de M. Christian Demuynck, fait au nom de la mission commune d'information du Sénat sur les jeunes (26 mai 2009).
314 () Au demeurant, certains étudiants ont plus de 25 ans et ne sont donc pas « jeunes » au sens où de nombreuses politiques publiques et expertises l’entendent.
315 () Rapport de synthèse sur l’évaluation des aides personnelles au logement, Mme Blanche Guillemot et M. Olivier Veber, membres de l’IGAS, et M. Maxime Guilpain, membre de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, mai 2012. Ce rapport a été rendu public sous le n° RM2012-054P pour l’IGAS et n° 05-2012 pour la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Cf. notamment, page 20.
316 () Les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier du RSA s’ils ont travaillé 3 214 heures – c’est-à-dire l’équivalent de 2 ans – sur les trois ans précédent la demande de RSA.
317 () La prise en compte de l’allocation de logement dans les revenus de la personne bénéficiant du RSA est effectuée sous la forme d’une réduction forfaitaire – tenant compte du nombre de personnes constituant le foyer – appliquée au montant du RSA : 59,15 euros pour un foyer composé d’une personne, 118,3 euros pour deux personnes et 146,39 euros pour un foyer de trois personnes ou plus (montants valables en septembre 2013).
318 () Ce plancher de ressources est minoré pour les étudiants boursiers ; ces derniers bénéficient ainsi d’un montant d’allocation supérieur au montant versé aux autres étudiants, toutes choses égales par ailleurs.
319 () la CNAF, dans le cahier des données sociales pour 2011 qu’elle a rendu public en 2012, constate un effectif de 820 928 étudiants allocataires, y compris les apprentis et étudiants salariés, publics non pris en compte par le rapport d’inspection présentement cité.
320 () Il s’agit, selon ce rapport, du « taux d’effort net : cet indicateur mesure le rapport entre les dépenses engagées pour l’habitation principale, notamment dépenses de loyer ou de remboursement d’emprunt, une fois déduites les aides au logement. »
321 () Rapport précité fait par des membres de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, n° RM2012-057A / MNC n° 02-2012, page 77.
322 () Rapport sur le logement autonome des jeunes du Conseil économique, social et environnemental (CESE), présenté par Mme Claire Guichet, pour la section de l’aménagement durable des territoires, janvier 2013, page 86.
323 () Rapport précité fait par des membres de l’IGAS et de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, n° RM2012-057A / MNC n° 02-2012, page 8.
324 () Cf. le même rapport, page 72.
325 () Rapport sur le logement autonome des jeunes du Conseil économique, social et environnemental (CESE), présenté par Mme Claire Guichet, pour la section de l’aménagement durable des territoires, janvier 2013, page 16.
326 () D’autres éléments expliquent la faiblesse de la présence des jeunes dans le parc social, présentés infra par les rapporteurs.
327 () Cf. son rapport sur le logement autonome des jeunes, page 27.
328 () Cf. le même rapport, page 28.
329 () Idem.
330 () Ce dispositif est ouvert aux étudiants âgés de moins de 28 ans.
331 () Des droits supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes :
– dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire est attribué aux étudiants en situation d'échec consécutive à une période de volontariat ou due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) ;
– pour la totalité des études supérieures, 1 droit annuel supplémentaire est attribué dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie, 3 droits annuels supplémentaires sont attribués aux étudiants souffrant d'un handicap et aux étudiants sportifs de haut niveau et 1 droit annuel supplémentaire est attribué pour la réalisation d'un stage intégré à la formation d'une durée d'un an.
332 () Cf. le PAP annexé au PLF 2014 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». En juillet 2013, le dossier de presse du Gouvernement présentant son plan d’action en faveur des bourses étudiantes prévoyait au demeurant une revalorisation de 1 % des bourses à la rentrée 2013-2014, « soit plus que l’inflation ».
333 () Cf. les éléments budgétaires du tableau précédent.
334 () Ces aides ciblent les étudiants issus des classes sociales défavorisées. Elles peuvent être cumulées, le cas échéant, avec des aides de droit commun mises en place par les départements et les régions.
335 () Cf. le PAP annexé au PLF pour 2014 de cette mission, pages 158 et 161.
336 () L’OFAJ est dirigé conjointement par deux secrétaires généraux – l’un allemand, l’autre français – en poste pour 6 ans. Ils sont nommés, sur proposition de leur pays d’origine avec l’accord de l’autre pays, l’un à la moitié du mandat de l’autre.
337 () En 2007, la Commission européenne a adopté la « stratégie d’inclusion des jeunes avec moins d’opportunités ». Elle y précise que les groupes cibles prioritaires des politiques d’inclusion, dont le programme jeunesse en action, « sont les jeunes des quartiers urbains sensibles, et de certaines zones rurales, et les jeunes handicapés, physiques ou mentaux ».
338 () Notre collègue Sandrine Doucet a présenté le 6 juin 2013 un rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes sur le programme Erasmus. Elle est également l’auteure de la proposition de résolution européenne sur la démocratisation du programme Erasmus, n° 1119, déposée et renvoyée le même jour à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Cette même commission l’a nommée rapporteur de cette proposition de résolution (cf. le rapport n° 1206, déposé le 26 juin 2013).
339 () Lors de la table ronde du 26 juin 2013 consacré à la mobilité internationale des jeunes, le groupe de travail a entendu M. Olivier Flury, secrétaire général de l’association Itinéraire international, qui promeut et appuie des projets de mobilité internationale concernant notamment des jeunes chômeurs ou sans qualification.
340 () Les IPCSR sont chargés d’autres missions réglementaires, comme le contrôle de la qualité de la formation dispensée dans les auto-écoles, le contrôle des centres de récupération des points du permis ou la participation à des actions relatives à la sécurité routière auprès des étudiants et des salariés. Pour le syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs Force ouvrière (SNICA-FO) dans la contribution écrite qu’il a fait parvenir aux rapporteurs, « depuis des années, l'essentiel, pour ne pas dire l'exclusivité des missions d'IPCSR se résume à la passation des examens du permis de conduire ».
341 () Ce taux a été amélioré de 7 points depuis 2006.
342 () Dans une enquête publiée en août 2013, l’association nationale de défense des consommateurs CLCV (« consommation, logement et cadre de vie ») précise par exemple que « le forfait le plus couramment proposé – avec 20 heures de conduite soit le minimum légal – est facturé du simple (780 euros à Lille) au double (1425 euros à Paris) ». Ces chiffres sont inférieurs à la moyenne de 1 500 euros car ils portent sur les 20 heures du forfait de base, insuffisant pour bon nombre de candidats pour obtenir le permis.
343 () Note thématique, premiers enseignements des expérimentations en matière d’insertion professionnelle, août 2013, Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), pages 11 et 12.
344 () Dans le dispositif actuel, c’est l’école de conduite qui procède à l’inscription des candidats à l’examen.
345 () Selon les termes de la contribution du SNICA-FO, syndicat des inspecteurs de la sécurité routière, dans la contribution écrite transmise aux rapporteurs suite à la table ronde du 11 septembre 2013.
© Assemblée nationale