______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2014.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
en conclusion des travaux d’une mission d’information (1)
sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Yves FROMION et Gwendal ROUILLARD,
Députés.
——
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours est composée de :
MM. Yves Fromion et Gwendal Rouillard, rapporteurs ;
MM. Jean-Jacques Candelier, Philippe Folliot, Charles de La Verpillière, Christophe Léonard, Philippe Meunier, François de Rugy et Jean-Michel Villaumé, membres.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE LA RÉORGANISATION ENGAGÉE DE NOS FORCES PRÉPOSITIONNÉES EN AFRIQUE : « POUR QUE TOUT RESTE COMME AVANT, IL FAUT QUE TOUT CHANGE » ? 13
I. NOTRE DISPOSITIF MILITAIRE EN AFRIQUE, QUI A FAIT LA PREUVE DE SON EFFICACITÉ LORS DES OPÉRATIONS RÉCENTES, EST EN COURS DE RESTRUCTURATION 15
A. UN DISPOSITIF MILITAIRE AUJOURD’HUI CONFIGURÉ POUR DEUX MISSIONS PRINCIPALES : OPÉRATIONS ET COOPÉRATION 15
1. Un réseau de points d’appui au service d’une double mission : opérations et coopération 15
a. Cartographie du dispositif militaire français en Afrique 15
i. Des bases permanentes : les prépositionnements de droit 16
ii. Des opérations extérieures qui s’installent dans la durée : les prépositionnements « de fait » 18
iii. Des opérations extérieures appelées à rester ponctuelles 23
iv. Des missions de permanence à la mer 23
b. La double vocation de notre dispositif permanent en Afrique : opérations et coopération 26
i. Une sectorisation du continent africain pour les actions de coopération 27
ii. Une sectorisation du continent africain pour la préparation et la conduite d’opérations 28
iii. Des missions parfois confondues 29
2. Les opérations Serval et Sangaris ont montré l’efficacité de cette architecture, en complément de capacités de projection rapide 31
a. L’importance des prépositionnements pour la réactivité des forces 31
i. Les prépositionnements ont joué un rôle clé dans le déclenchement des opérations Serval et Sangaris en 2013 31
ii. Les prépositionnements ne permettent toutefois d’intervenir dans une crise majeure que s’ils s’articulent avec un dispositif de projection rapide de forces 33
iii. Les opérations Serval et Sangaris ont montré l’importance d’une bonne articulation entre les forces conventionnelles et les forces spéciales 34
b. L’importance de liens étroits de partenariat pour susciter la mobilisation des États africains 38
B. UNE RESTRUCTURATION PLANIFIÉE DE NOTRE DISPOSITIF PERMANENT EN AFRIQUE 38
1. Le nouveau schéma de notre dispositif permanent en Afrique : maintien de toutes les implantations et déplacement du centre de gravité vers la bande sahélo-saharienne 41
a. Un réaménagement sans abandon de notre réseau de points d’appui permanents, marqué par la montée en puissance de la Côte d’Ivoire et la réduction envisagée de notre présence au Gabon et à Djibouti 41
i. L’orientation générale retenue par le Gouvernement : un maintien de la présence française sur tous ses principaux points d’appui actuels, au prix de réaménagements et d’une réduction globale d’effectifs 41
ii. Un déplacement, de Libreville à Abidjan, de la base opérationnelle avancée (BOA) chargée de la zone de responsabilité principale (ZRP) pour les opérations en Afrique de l’Ouest 44
b. La « régionalisation » de notre dispositif dans la bande sahélo-saharienne 47
i. Le schéma général : un maillage étroit dans une vaste région enclavée 48
ii. Le centre de gravité : N’Djamena au Tchad 50
2. L’ambitieuse manœuvre de restructuration a débuté, non sans se heurter aux difficultés liées aux opérations en cours 55
a. Planification et état d’avancement de la manœuvre de réaménagement 56
i. Au sein du dispositif permanent : une restructuration rapide des Forces françaises au Gabon, futurs Éléments français au Gabon 56
ii. Au sein de la bande sahélo-saharienne : consolidation des bases de Gao et de N’Djamena 60
b. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la manœuvre de restructuration du dispositif permanent et de régionalisation dans la bande sahélo-saharienne 62
i. D’inévitables réticences dans les bases permanentes appelées à subir une forte déflation 62
ii. La « régionalisation » du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne : un retard lié à la situation au Mali 65
3. Un point d’attention majeur : le sort de Djibouti 66
a. Un point d’appui du plus haut intérêt stratégique pour la France 66
i. Une situation géostratégique exceptionnelle 66
ii. Un point d’appui indispensable dans une zone de plus en plus instable en général, et de plus en plus menaçante pour les intérêts français en particulier 68
b. Un projet de déflation massif, qui repose à ce stade sur un objectif strictement quantitatif et non sur une analyse fonctionnelle préalable 79
i. Des plans de restructuration entièrement guidés par un objectif chiffré de déflation, sans analyse fonctionnelle préalable 79
ii. Un calendrier trop hâtif pour permettre une manœuvre habile 80
c. Un projet de déflation intenable à missions et responsabilités constantes, qui remet sérieusement en cause la crédibilité de notre dispositif en Afrique de l’Est 82
i. Quatre scénarios élaborés par les Forces françaises stationnées à Djibouti pour répondre à la commande qui leur a été adressée 82
ii. Dans toutes les hypothèses, des scénarios intenables à missions et responsabilités constantes 87
d. Un scénario alternatif, permettant de concilier la contrainte capacitaire générale et la crédibilité de nos forces 92
i. Un format minimal viable à 1 300 personnels 92
ii. Un calendrier à « desserrer » 94
II. LA RESTRUCTURATION PLANIFIÉE VISE À PERMETTRE À LA FRANCE DE CONSERVER SON INFLUENCE ET À SES FORCES LEUR RÉACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DANS UNE AFRIQUE QUI CHANGE 97
A. C’EN EST FINI DE « LA PRÉSENCE POUR LA PRÉSENCE » 97
1. Du point de vue des États africains : la présence de « bases » étrangères ne fait pas toujours l’objet d’un consensus national 97
a. Certaines réticences des opinions publiques africaines conduisent à privilégier une « empreinte » militaire légère et discrète 97
b. Les États africains tendent désormais à rechercher aussi d’autres contreparties à la présence française que la protection d’un pays (ou d’un régime) 99
2. Du point de vue de la France : nous n’avons plus ni les moyens, ni l’intérêt, de maintenir un fort volume de forces sur le continent africain 99
a. La France n’a plus les moyens d’entretenir l’« armée d’Afrique » 99
i. Des contraintes financières 99
ii. Des contraintes capacitaires 101
b. La France a-t-elle toujours intérêt à être présente sans avoir les moyens d’influer sur le cours des événements ? Le double risque de la présence militaire sans moyens conséquents d’intervention 110
i. Que la France soit accusée de ne pas prévenir toutes les crises : le « syndrome rwandais » 110
ii. Que les partenaires de la France se défaussent sur elle de leurs responsabilités 111
B. LE DISPOSITIF MILITAIRE FRANÇAIS EN AFRIQUE DOIT RÉPONDRE AVANT TOUT AUX BESOINS ET AUX DEMANDES DES ÉTATS AFRICAINS 111
1. Les menaces évoluent et appellent en conséquence une adaptation du dispositif français dans une logique de « défense de l’avant » 111
a. Des menaces de toute nature sur le continent africain, relevant des « risques de la faiblesse » 111
i. Des menaces clairement terroristes 114
ii. Des mouvements centrifuges à connotation ethnique 114
iii. Des organisations criminelles 116
iv. Des conflits communautaires non maîtrisés 116
v. Une tendance globale à l’affichage d’un islam de plus en plus radical 117
b. Des menaces essentiellement transfrontalières 118
i. Du fait de la porosité générale des frontières 118
ii. Du fait de la continuité des composantes ethniques de part et d’autre des frontières 119
iii. Du fait de l’existence de « sanctuaires » rebelles 119
iv. Pour les pays dotés d’une façade maritime, du fait de moyens très faibles au service de l’action de l’État en mer 122
v. Même Boko Haram semble porté à élargir sa zone d’action 122
c. Un risque de « jonction » entre les différents mouvements rebelles 125
d. Des menaces sur la stabilité de certains régimes et leurs conséquences sur la sécurité de l’ensemble de l’Afrique 127
i. Des fragilités tenant à la structure politique de certains États 127
ii. Des fragilités plus profondes, tenant à des déséquilibres sociaux que la croissance démographique risque d’aggraver 129
2. La coopération avec les États africains pour traiter ces menaces constitue désormais la principale source de légitimité de notre présence en Afrique 133
a. Les dirigeants des États de la région conscients de ces menaces 133
i. Dans les paroles : une prise de conscience 133
ii. Dans les actes : cette volonté politique se traduit par des efforts concrets, plus ou moins aboutis 136
b. Compte tenu de ses moyens plus limités que jadis, la coopération militaire française prend de nouvelles formes, marquées par une recherche d’efficience accrue 141
i. La coopération structurelle : un atout français en Afrique, désormais configuré dans une logique de partenariat plutôt que de substitution 143
ii. La coopération opérationnelle : la raison d’être des « pôles opérationnels de coopération à vocation régionale » 155
SECONDE PARTIE PRÉSENCE ET INTERVENTION MILITAIRES NE DOIVENT PAS RÉSUMER NOTRE POLITIQUE AFRICAINE 159
I. LE SUIVI DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES EN COURS MONTRE LES LIMITES DES CAPACITÉS FRANÇAISES D’INTERVENTION DANS LES CRISES AFRICAINES 159
A. L’OPÉRATION SERVAL AU MALI : UN SUCCÈS INDÉNIABLE, QU’IL EST URGENT D’EXPLOITER SUR LE PLAN POLITIQUE POUR NE PAS PERDRE L’AVANTAGE ACQUIS EN 2013 159
1. L’indéniable succès militaire de l’intervention française 159
a. Un défi logistique permanent 159
i. Dans la phase « aiguë » des opérations, en 2013 160
ii. Dans la phase actuelle des opérations, dont le pivot est la base de Gao 162
b. Une mission de contre-terrorisme qui est loin d’être achevée 167
2. Une prise de relais indéniablement insuffisante par les autorités maliennes et la communauté internationale – l’ONU et l’Europe 174
a. Un processus de « réconciliation nationale » en retard, si ce n’est en panne 174
i. Les avancées de juin 2013, avec l’accord de Ouagadougou 174
ii. Un processus électoral très satisfaisant 174
iii. Atermoiements et vicissitudes dans les discussions engagées depuis juin 2013 175
iv. La déconvenue des forces maliennes en mai 2014 179
b. Les lenteurs de l’Europe 181
i. Le Mali : un théâtre correspondant particulièrement bien aux savoir-faire et à la doctrine d’« approche globale » de l’Union européenne 181
ii. Les avancées réalisées par l’EUTM Mali 182
iii. Un bilan tout en contrastes de la formation des GTIA maliens avec la défaite des FAMa en mai 2014 185
c. Les inquiétantes difficultés rencontrées dans la montée en puissance de la MINUSMA 185
i. Un mandat assez robuste, quoi que feignent d’en croire certains 186
ii. Un déploiement largement facilité par la force Serval et la présence antérieure de la MISMA 186
iii. Une génération de forces assez décevante 187
iv. Un risque majeur : la « bunkerisation dans le luxe » (relatif) 188
d. Une conséquence regrettable : un frein au désengagement des forces françaises 189
B. L’OPÉRATION SANGARIS EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : UNE OPÉRATION DES PLUS DÉLICATES 190
1. La force Sangaris a fait au mieux avec les moyens qu’elle a en sa possession 191
a. Deux ennemis, peut-être sous-estimés ab initio : les « ex-Séléka » et les « anti-balaka » 191
i. Des ex-Séléka encore combatifs 191
ii. Des anti-balaka difficiles à contrôler 193
b. Une mission dont l’action est limitée par ses faibles moyens 195
i. Un concept d’opération calibré a minima, pour une opération « coup de poing » ponctuelle 195
ii. En dépit d’un renfort, des moyens limités pour un territoire difficile à contrôler 196
iii. Des contraintes liées indirectement au mode de financement des opérations extérieures 200
c. L’instrumentalisation confessionnelle du conflit : un épineux facteur de complication 201
d. Un résultat sécuritaire contrasté 201
i. Bangui est pacifiée, et relève désormais d’une opération de gendarmerie plutôt que d’une opération militaire 201
ii. La province échappe encore largement au contrôle de l’État 208
2. Une prise de relais indéniablement insuffisante par les autorités centrafricaines et la communauté internationale – la CEEAC, l’ONU et l’Union européenne 211
a. Un État qui tarde à se reconstituer 212
i. Les autorités de transition enregistrent quelques succès 212
ii. Les forces de sécurité centrafricaines restent très faibles 214
b. La désolante incurie de l’Europe 215
i. Une mission ambitieuse lancée à l’initiative de la France 215
ii. Une génération de force des plus poussives 216
c. Les difficultés rencontrées par les forces africaines 218
i. Des difficultés financières et capacitaires 219
ii. Le rôle du Tchad 221
d. Les grands défis qui se présentent pour une opération de maintien de la paix de l’ONU 223
i. Des attentes très importantes 223
ii. Des incertitudes pesant sur la génération de forces 225
II. NOTRE PRÉSENCE ET NOS INTERVENTIONS MILITAIRES GAGNERAIENT À S’INSCRIRE DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE AFRICAINE GLOBALE, PARTENARIALE, COHÉRENTE ET ASSUMÉE 227
A. LES ÉTATS AFRICAINS NE POURRONT ASSURER LEUR SÉCURITÉ QUE DANS LE CADRE DE COOPÉRATIONS, OÙ LA FRANCE PEUT JOUER UN RÔLE DE PREMIER PLAN 227
1. Des efforts substantiels de renforcement des forces armées et des forces de sécurité africaines, qui constituent autant d’occasions de partenariats « gagnant-gagnant » avec la France 227
a. La plupart des pays africains planifient le renforcement de leurs forces armées et leurs forces de sécurité 227
i. Des efforts de développement des effectifs des forces armées 227
ii. Des efforts de renforcement capacitaire 229
iii. Le renforcement de la fonction de renseignement 230
iv. Améliorer l’organisation de l’action de l’État en mer 231
b. La France dispose d’atouts de premier plan pour accompagner les États africains dans leurs efforts 233
i. Parce que la France peut « capitaliser » l’héritage de la coopération des années passées : les liens particuliers qui unissent les responsables militaires africains et français 233
ii. Parce que la France dispose d’atouts pour renouveler et enrichir cette relation particulière 233
2. Les États d’Afrique subsaharienne mettent l’accent sur la coopération internationale pour l’organisation de leur sécurité, et la France a un rôle à jouer dans cette organisation 240
a. L’Union africaine et les sous-régions sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans les opérations en Afrique 240
i. Un déploiement progressif des forces de l’Union africaine, dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité 240
ii. Un déploiement que la France peut accompagner 242
b. Des accords de périmètre plus réduit complètent utilement l’architecture africaine de paix et de sécurité 244
i. Une multiplication d’accords de coopération de défense 244
ii. Une occasion pour la France d’apporter un appui décisif 244
B. LA FRANCE A INTÉRÊT À METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE AFRICAINE GLOBALE, PARTENARIALE, COHÉRENTE ET ASSUMÉE 245
1. La France n’a ni les moyens ni l’ambition d’être le « gendarme de l’Afrique » : dès lors, son action doit s’articuler de façon pragmatique avec celle de ses partenaires 245
a. L’action de la France gagne à s’inscrire dans un cadre partenarial, si possible multilatéral 245
i. La stratégie politique générale : une approche multilatérale de la gestion des crises africaines 245
ii. Le cadre d’action pratique : une recherche pragmatique d’effets de levier au moyen de partenariats 250
b. Des partenaires européens à sensibiliser plus en amont aux enjeux de la sécurité en Afrique 251
i. Un défi difficile à relever, compte tenu du faible enthousiasme des Européens à prendre toutes leurs responsabilités en Afrique 251
ii. Un défi indispensable à relever compte tenu des moyens (notamment financiers) qu’il est possible de mobiliser par le biais de l’Union européenne 253
2. La présence et les interventions militaires de la France gagneraient à s’inscrire dans une approche plus globale, plus cohérente et mieux assumée d’une véritable politique africaine 254
a. Assurer le « service après-vente » des interventions, en développant une doctrine cohérente intégrant toutes les phases d’une crise : détection/intervention/stabilisation/normalisation 254
i. Intervenir suffisamment tôt : détecter précocement les crises 255
ii. Savoir passer de l’intervention à la stabilisation : le contre-exemple de la Libye, l’enjeu de Serval et de Sangaris 255
iii. De la stabilisation à la normalisation, savoir gérer les difficultés rencontrées en « sortie de crise » : le cas de la Côte d’Ivoire 255
b. Développer la connaissance de l’Afrique et les liens de solidarité 256
i. Entretenir les savoirs et les savoir-faire de personnels de la Défense « accoutumés » à l’Afrique 256
ii. Entretenir plus largement, une connaissance des sociétés et des systèmes politiques africains 258
c. Entretenir des liens institutionnels avec les forces de sécurité africaines 260
d. Mettre sans complexe en cohérence l’ensemble des outils de la coopération et de l’influence 261
TRAVAUX DE LA COMMISSION 263
CONTRIBUTION PRÉSENTÉE PAR M. YVES FROMION, RAPPORTEUR 283
ANNEXES 287
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS 287
ANNEXE 2 : LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES RAPPORTEURS 289
ANNEXE 3 : PRINCIPALES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES PRÉVUES EN AFRIQUE 297
La mission d’information dont le présent rapport présente les conclusions s’inscrit pleinement dans le cadre de l’exercice, par notre commission, de ses prérogatives de contrôle de l’action du Gouvernement.
En effet, le champ d’investigation fixé à cette mission comprend deux grands ordres de décisions prises par le Gouvernement, qui sont de la plus haute portée pour l’action et l’organisation de notre défense nationale :
– celle d’engager nos forces au Mali et en République centrafricaine, qui font de 2013 une des années où l’engagement de nos forces aura été des plus soutenu dans leur histoire récente ;
– celle de procéder à un remaniement complet et profond de notre dispositif militaire en Afrique.
Cette seconde décision vise à mettre en œuvre les orientations formulées en termes généraux par le Livre blanc de 2013 sur la défense et la sécurité nationale, qui prévoit qu’« une conversion de [nos] implantations sera réalisée afin de disposer de capacités réactives et flexibles, à même de s’adapter aux réalités et besoins à venir du continent ». Le rapport annexé à la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 apporte certaines précisions. Il prévoit ainsi une « réduction de 1 100 emplois dans les forces prépositionnées et les outre-mer engagée dès 2014 ». Il indique également qu’« en accord avec les États concernés, la France maintiendra en Afrique des forces déployées dans la bande sahélo-saharienne et sur les façades est et ouest africaines afin de contribuer activement à la sécurité de ce continent », précisant que « ces déploiements seront adaptés afin de disposer de capacités réactives et flexibles en fonction de l’évolution des besoins ». Il ajoute enfin que « des actions de coopération structurelle et opérationnelle permettront la consolidation des capacités militaires et des architectures de sécurité sous-régionales africaines dans le cadre de l’Union africaine et, le cas échéant, la mise en œuvre des résolutions des Nations unies et la protection des ressortissants français ».
Ces deux sujets sont intrinsèquement liés : nos interventions sur le sol africain s’appuient sur notre dispositif prépositionné, lequel en retour contribue à la prévention des crises dans le cadre de notre politique de coopération de sécurité et de défense. C’est la raison pour laquelle la mission d’information a fait le choix de les traiter conjointement. La première partie du présent rapport a ainsi pour objet d’analyser les vues et les dispositions du Gouvernement pour la réorganisation de notre dispositif africain à la lumière, d’une part, des premiers retours d’expérience et des perspectives d’évolution concernant nos opérations extérieures les plus récentes et, d’autre part, de l’évolution des menaces sur le continent africain.
Qu’il s’agisse de la présence ou de l’intervention des forces françaises ou bien de la coopération, les rapporteurs ont pu constater que l’on en revenait toujours à la question de savoir quelle est, aujourd’hui, la « politique africaine » de la France. Cette question principale renvoie en effet à plusieurs autres interrogations :
– quel rôle la France s’assigne-t-elle dans les différentes sous-régions de l’Afrique ? Quels intérêts doit-elle y défendre, et selon quelles modalités ?
– de quoi les Africains eux-mêmes sont-ils demandeurs, qu’il s’agisse des États, de l’Union africaine et de ses sous-régions ?
– quel est le jeu des autres acteurs s’intéressant à l’Afrique, qu’il s’agisse des Européens, de l’Union européenne et des États-Unis, de l’Organisation des Nations unies ou d’autres puissances, souvent qualifiées d’« émergentes » ?
La seconde partie du présent rapport a ainsi pour objet de contribuer à dresser un bilan aussi objectif que possible de l’état des forces en présence sur le continent africain, afin d’apprécier la place de la France dans ce jeu tantôt coopératif, tantôt concurrentiel. Seule une telle appréciation peut en effet donner une idée de ce que peut être, aujourd’hui, une véritable « politique africaine » pour la France.
PREMIÈRE PARTIE
LA RÉORGANISATION ENGAGÉE DE NOS FORCES PRÉPOSITIONNÉES EN AFRIQUE : « POUR QUE TOUT RESTE COMME AVANT, IL FAUT QUE TOUT CHANGE » ?
Pourquoi l’Afrique ? Plus de cinquante ans après l’accession des pays d’Afrique à l’indépendance, la France doit-elle encore y entretenir un dispositif militaire et y mener des interventions ? La réponse est assurément affirmative, mais pas pour n’importe quelles raisons.
La France a non seulement toute légitimité pour défendre en Afrique ses intérêts et ceux de ses amis et alliés. Plus encore, non seulement elle le peut, mais on pourrait même dire qu’elle le doit : elle le doit à elle-même, pour protéger ses ressortissants et assumer les responsabilités que lui confèrent son statut international et son aspiration à l’autonomie stratégique, comme elle le doit à ses partenaires africains.
Mais si la France a la responsabilité d’intervenir dans la gestion des crises africaines et d’entretenir un dispositif militaire permanent permettant soit de les prévenir, soit de les traiter de la façon la plus réactive, ce n’est :
– ni à raison du fait que certains pays africains se sont trouvés placés un temps sous sa souveraineté. Comme l’a fait observer aux rapporteurs le professeur Bertrand Badie : reconnaîtrait-on un droit de regard à la Russie sur les affaires des États qui se sont séparés d’elle en 1991 au seul motif de ce passé ?
– ni à des fins mercantilistes : il suffit pour s’en convaincre de se rappeler que même dans les grands pays africains francophones, les parts de marché de la France ont été divisées par deux en une quinzaine d’années (1).
En revanche, la légitimité de la présence de la France en Afrique et de ses interventions dans la gestion des crises africaines réside ailleurs :
– tel est l’intérêt de la France, pour sa propre sécurité et celle de ses ressortissants, y compris dans une logique de « défense de l’avant » contre la menace terroriste ;
– telle est la responsabilité de la France envers ceux de ses partenaires africains avec lesquelles elle a tissé, et continue d’entretenir sous des formes sans cesse renouvelées, d’étroits liens de coopération.
I. NOTRE DISPOSITIF MILITAIRE EN AFRIQUE, QUI A FAIT LA PREUVE DE SON EFFICACITÉ LORS DES OPÉRATIONS RÉCENTES, EST EN COURS DE RESTRUCTURATION
Sur la base des orientations très générales fixées par le Livre blanc, et dans le cadre des objectifs quantitatifs fixés par la loi de programmation militaire 2014-2019 – notamment en matière de déflation d’effectifs outre-mer et à l’étranger –, le Gouvernement a entamé une manœuvre de reconfiguration du dispositif militaire en Afrique.
Les rapporteurs se sont donc attachés à étudier l’état actuel de ce dispositif, à analyser son utilité au regard du déroulement des deux opérations extérieures les plus récentes – les opérations Serval au Mali et Sangaris en République centrafricaine –, à étudier le nouveau schéma proposé pour ce dispositif ainsi que ses modalités de mise en œuvre, pour évaluer son adéquation aux menaces actuelles et aux besoins de nos partenaires africains.
A. UN DISPOSITIF MILITAIRE AUJOURD’HUI CONFIGURÉ POUR DEUX MISSIONS PRINCIPALES : OPÉRATIONS ET COOPÉRATION
1. Un réseau de points d’appui au service d’une double mission : opérations et coopération
Pour apprécier l’état actuel de notre dispositif militaire en Afrique, on pourrait s’en tenir à une définition limitée de ce périmètre, correspondant aux seules bases permanentes établies sur le fondement d’accords de coopération de défense et où sont stationnées des forces prépositionnées.
Les rapporteurs ont préféré faire le choix de considérer la présence militaire française en Afrique dans son ensemble, comme un tout cohérent, qui comprend non seulement les prépositionnements, mais également les forces déployées au titre d’opérations extérieures, parfois depuis plusieurs décennies, ainsi que nos forces de souveraineté, les moyens consacrés par la Marine nationale à entretenir une présence à la mer au large des côtes africaines, ainsi que la base d’Abou-Dhabi, dont le fonctionnement est lié à celui de notre base de Djibouti.
a. Cartographie du dispositif militaire français en Afrique
Le dispositif militaire français en Afrique, ainsi compris, s’articule autour de quatre types de déploiements :
– des prépositionnements, que ce soit de droit ou de fait – tel est le cas lorsque des opérations extérieures se poursuivent dans le temps et que les forces qui y sont affectées voient leurs missions évoluer pour devenir assimilables à celles d’un prépositionnement « classique » ;
– des opérations extérieures appelées à rester ponctuelles ;
– des forces de souveraineté ;
– des missions de présence à la mer.
i. Des bases permanentes : les prépositionnements de droit
Aux termes des accords de coopération et de défense conclus avec plusieurs pays africains, la France entretient des forces prépositionnées au sein de bases permanentes en trois points du continent :
– au Sénégal, avec les Éléments français au Sénégal (EFS) basés à Dakar ;
– au Gabon, avec les Forces françaises au Gabon (FFG) basées pour l’essentiel à Libreville ;
– à Djibouti, avec les Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj).
Par ailleurs, comme les rapporteurs ont pu le constater sur place, la nouvelle base française d’Abou-Dhabi fonctionne « en vases communicants » avec, notamment, celle de Djibouti : leurs moyens peuvent basculer rapidement d’un point à l’autre. À ce titre, il est donc utile de prendre en compte les Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) dans l’analyse du dispositif africain.
Toutefois, ces forces prépositionnées n’ont ni les mêmes effectifs, ni exactement les mêmes missions. Le tableau ci-après présente leurs effectifs.
LES EFFECTIFS DES FORCES PRÉPOSITIONNÉES
Implantation |
Forces |
Effectif approximatif |
Libreville (Gabon) |
Forces françaises au Gabon |
900 |
Dakar (Sénégal) |
Éléments français au Sénégal |
350 |
Djibouti (Djibouti) |
Forces françaises à Djibouti |
1 900 |
Abou-Dhabi (Émirats arabes unis) |
Forces françaises aux Émirats arabes unis |
745 |
Source : informations recueillies par les rapporteurs lors de leurs déplacements.
S’agissant de leurs missions, il faut souligner que ces forces relèvent de deux catégories fonctionnelles de bases :
– soit des « bases opérationnelles avancées » (BOA), comme celles de Libreville, de Djibouti et d’Abou-Dhabi ;
– soit des « pôles opérationnels de coopération à vocation régionale » (POC), comme celui de Dakar.
La différence entre ces deux catégories est moins juridique – toutes deux reposent sur des accords de coopération en matière de sécurité et de défense prévoyant le stationnement de forces de présence – que fonctionnelle. Elle réside en effet dans l’activité des forces : celle des Éléments français au Sénégal est centrée « à plein-temps » sur la coopération, tandis que les FFG ont une mission d’intervention qui peut primer sur leurs activités de coopération (cf. l’encadré ci-après). Au demeurant, cette distinction est relativement récente, puisque ce n’est qu’à compter de 2011, lorsque les Forces françaises du Cap Vert (FFCV) sont devenues les Éléments français au Sénégal (EFS), que cette nouvelle dénomination a correspondu à un changement profond : ce qui était traditionnellement une force de présence a été converti en implantation militaire française consacrée principalement à la coopération. Cette restructuration a conduit notamment à la dissolution du 23e bataillon d’infanterie de marine (23e BIMa).
Les Forces françaises au Gabon : une base opérationnelle avancée (BOA)
Lors de leur déplacement au Gabon, les rapporteurs ont pu se rendre sur les différentes installations des Forces françaises au Gabon, pour en étudier la configuration, les missions et l’activité.
1. Un volume de forces limité
Avec un effectif d’environ 900 militaires, les FFG constituent le plus important « réservoir de capacités » de la France sur la côte occidentale de l’Afrique. Elles sont en effet armées principalement par :
– le 6e bataillon d’infanterie de marine (BIMa), qui comprend notamment une compagnie parachutiste, une compagnie amphibie (qui participe à des exercices dans le cadre de la mission Corymbe) et une composante blindée légère (avec six véhicules) ;
– un détachement de l’aviation légère de l’armée de terre, qui possède quatre hélicoptères de manœuvre Puma ;
– un détachement de l’armée de l’air, doté notamment d’un Transall et d’un CASA ;
– un groupement de soutien de base de défense ;
– un détachement logistique implanté au Cameroun, au port de Douala.
Comme le colonel Éric Rousselle, adjoint interarmées au commandant des FFG, l’a expliqué aux rapporteurs, les FFG constituent une base opérationnelle avancée dotée d’une panoplie complète de capacités en nombre juste suffisant dans une posture réellement opérationnelle, suivant une logique qu’il résume ainsi : « de tout, un peu ».
2. Des infrastructures intéressantes
Les FFG disposent de plusieurs infrastructures :
– une base principale située à Libreville : le camp « de Gaulle ». Lors de leur déplacement sur ce camp, les rapporteurs ont pu noter que si l’emprise avait l’inconvénient d’avoir une superficie relativement limitée – l’ambassadeur lui-même observe que les militaires y sont « un peu à l’étroit » –, elle n’en présentait pas moins l’avantage d’être peu coûteuse à entretenir. En effet, elle appartient au patrimoine de la République française – qui ne verse donc aucun loyer – et sa compacité en limite les coûts de fonctionnement ;
– sur l’aéroport de Libreville, la base aérienne « Guy Pidoux », qui accueille le détachement aérien des FFG. Les rapporteurs ont pu constater sur place le format très réduit de cette base, qu’il avait été envisagé en 2008 de développer ;
– non loin de Libreville, une installation d’entraînement au combat en forêt gabonaise relevant du centre d’aguerrissement outre-mer (CAOM) des FFG. Lors de leur déplacement sur ce site, les rapporteurs ont pu mesurer la qualité des installations et de la formation qui y est délivrée, tant à des militaires français qu’à des stagiaires africains entraînés par les FFG au titre de leur mission de coopération ;
– une base de format très limité, le camp N’Tchorere implanté à Port-Gentil dans le cadre de l’opération Requin visant à assurer la protection de 3 000 ressortissants français lors d’un épisode de tensions politiques et sociales locales. Aujourd’hui armée par 32 personnels, cette base assure une présence très réduite et sert d’installation d’aguerrissement au combat en mangrove ;
– une « mission logistique » (MISLOG) détachée au port de Douala, au Cameroun. Armée par dix militaires seulement, elle est configurée de façon à assurer le ravitaillement par la mer des FFG et des forces opérant en Afrique centrale – notamment la force Sangaris –, tout en assurant une certaine « discrétion » à cette présence française sur le sol camerounais : il a été indiqué aux rapporteurs que les accords conclus avec le Cameroun limitent à 16 personnels l’effectif de ce détachement, et leur interdisent le port de l’uniforme ;
– un complexe de manœuvre et de tir situé sur les monts Mokekou. Bien qu’il soit situé à seulement 380 km de Libreville, ce complexe est assez difficile d’accès : pour l’atteindre, il faut 10 heures de trajet en 4x4, et deux jours en convoi, et si sa piste d’atterrissage a pu être étendue à 1 000 mètres par le 25e régiment du génie de l’air, elle n’est pas extensible dans la mesure nécessaire pour l’accueil de l’A400M. Toutefois, ce complexe, partagé avec les forces armées gabonaises, est en voie de développement et présente l’intérêt d’offrir une zone de manœuvres et de tirs très étendue.
Comme l’ambassadeur de France l’a déclaré aux rapporteurs, l’intérêt de ces infrastructures tient à ce que « la France y est chez elle » : soit elles appartiennent en propre à l’État, soit elles sont mises à la disposition des FFG par les Gabonais, qui accordent de grandes facilités aux forces françaises. En effet, les accords de partenariat exemptent les FFG de toute taxe et de tout loyer ; de même, le commandement des FFG juge « très pratique » la facilité accordée par la partie gabonaise permettant aux Français de se déplacer armés sur le territoire gabonais. On notera par exemple que le Gabon n’exige aucune taxe assise sur les mouvements d’avions, alors que les Espagnols qui viennent renforcer les forces françaises (les rapporteurs ont d’ailleurs pu bénéficier du C-130 espagnol pour leurs propres déplacements de Libreville à Bangui) sont soumis à ces taxes.
3. Une présence appréciée des Gabonais, très attachés à la relation bilatérale
Tant les responsables politiques et militaires gabonais rencontrés par les rapporteurs que l’ambassadeur de France et le commandement des FFG ont insisté sur la grande qualité de la relation de coopération franco-gabonaise en matière de sécurité et de défense.
ii. Des opérations extérieures qui s’installent dans la durée : les prépositionnements « de fait »
Certaines forces françaises sont présentes depuis longtemps – parfois plusieurs décennies – sur le continent africain au titre d’opérations extérieures, tout en ayant vu leurs missions évoluer au point d’être assimilables à celles d’une base opérationnelle avancée accueillant les prépositionnements « de droit » précités. Tel est le cas notamment des forces des opérations Licorne en Côte d’Ivoire, et Épervier au Tchad.
La différence entre ces deux catégories de bases est ainsi d’ordre juridique, bien plus que fonctionnel. En effet, comme les rapporteurs ont pu l’observer lors de leur déplacement en Côté d’Ivoire, la force Licorne fonctionne aujourd’hui comme un prépositionnement « de fait ». Sa mission n’est plus limitée la sécurisation de la Côte d’Ivoire, et son activité est celle d’un prépositionnement classique : coopération, rôle de « réservoir de capacités » pour les opérations extérieures menées dans la région – à l’image de Serval –, etc. Comme il a été rappelé aux rapporteurs, en application du Livre blanc de 2013, les missions de l’opération Licorne ont d’ailleurs été expressément étendues à deux nouveaux domaines :
– « participer sur ordre aux opérations nationales dans la sous-région avec un volume d’une unité de combat » ;
– « contribuer au soutien des opérations dans la sous-région ».
Les cartes et le graphique ci-après illustrent l’évolution des activités et des moyens de l’opération Licorne.
LES ZONES D’INTERVENTIONS RÉCENTES DE LA FORCE LICORNE
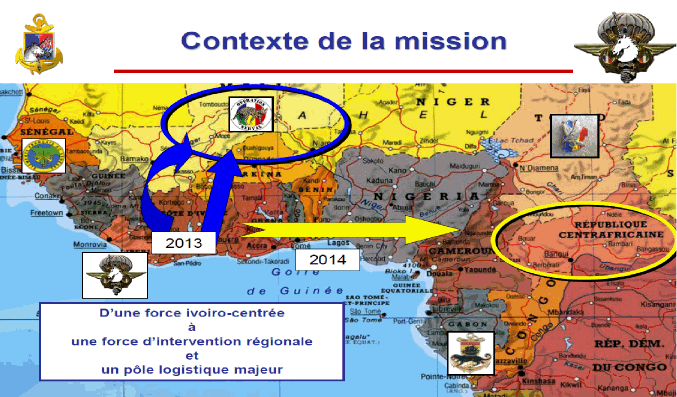
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
LE RÔLE DE LA FORCE LICORNE DANS L’OPÉRATION SERVAL
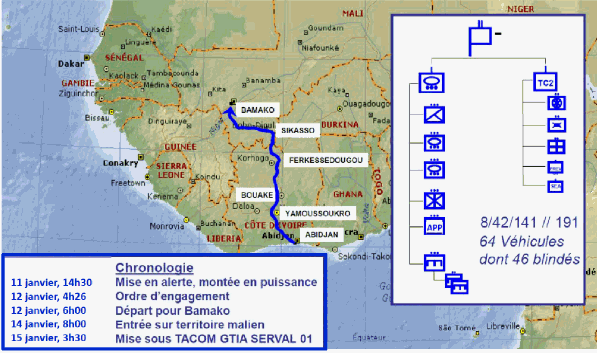 Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
L’ÉVOLUTION DES MOYENS DE LA FORCE LICORNE
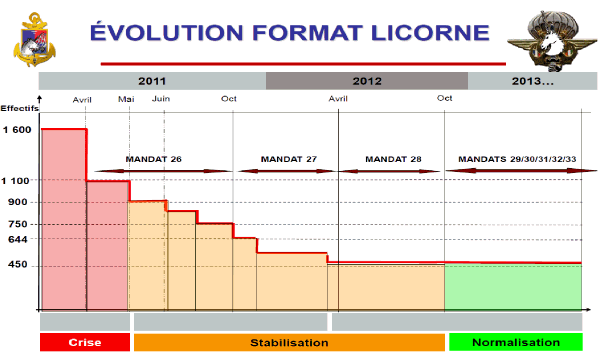
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
L’encadré ci-après présente l’organisation et les missions du second de ces prépositionnements « de fait » : l’opération Épervier au Tchad.
N’Djamena et ses « satellites » (Faya-Largeau et Abéché) :
la force Épervier, au Tchad
L’opération Épervier, opération extérieure en cours au Tchad depuis 1986, peut être vue comme un prépositionnement « de fait » au regard non seulement de sa durée, mais surtout du volume des forces, de ses missions et de son activité.
1. Les moyens de la force Épervier
● Ces moyens sont répartis sur trois sites principaux :
– l’essentiel des 950 personnels constituant l’effectif de la force est concentré sur la base Adji Kosseï à N’Djamena, sur laquelle les rapporteurs se sont rendus. Cette base est attenante à l’aéroport de N’Djamena, constituée d’une « zone de vie » placée sous le seul contrôle de la France, et d’une zone technico-opérationnelle partagée avec les forces armées tchadiennes ;
– 20 personnels sont présents en permanence à Faya-Largeau, au sein d’une concession séparée par une dune de la piste de l’aéroport local, dans une zone dont les rapporteurs ont pu apprécier sur place à la fois l’intérêt stratégique (du fait de sa position de « verrou » à l’est, vers la frontière du Tchad avec la Lybie) comme la rudesse des conditions d’installation et de vie. Ce détachement sert de simple point d’appui aux opérations menées par la force Épervier et il n’a pas la masse critique nécessaire pour mener seul des opérations ;
– 100 personnels sont affectés à Abéché, où une vaste concession sert à stocker les moyens logistiques (tentes, carburant, nourriture) nécessaires à l’accueil d’une compagnie renforcée (150 à 200 hommes) pour d’éventuelles opérations.
Encore placée sous le statut d’OPEX, cette force est armée par des détachements en mission de quatre mois, seul le commandant de la force et son adjoint restant un an sur place.
Organisation de la force Épervier
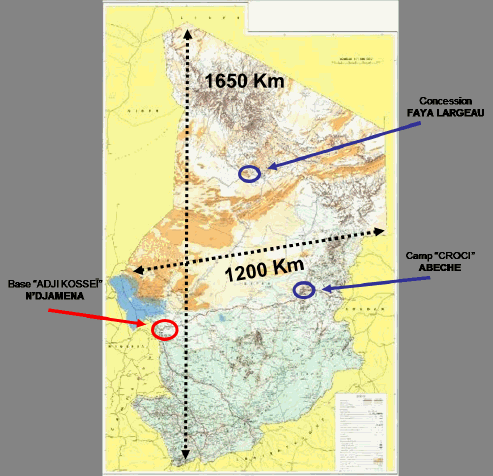
Source : EMA (commandement de la force Épervier).
● Le déplacement des rapporteurs sur différentes installations de l’opération Épervier leur a permis de relever plusieurs points d’attention concernant l’organisation de la base Kosseï :
– les accords de partenariat sur le fondement desquels cette base a été concédée à la France sont très succincts : de ce fait, les règles d’occupation des différents espaces de la zone technico-opérationnelle ne sont pas toujours claires. Si, comme le président de la République du Tchad Idriss Déby Itno en a émis le souhait, ces accords devaient être renégociés, cette discussion offrirait une occasion de clarifier ces règles ;
– avec la montée en puissance de l’armée de l’air tchadienne (qui dispose désormais de douze chasseurs, d’une dizaine d’hélicoptères et d’une flottille gouvernementale), certaines zones sont saturées. Tel est notamment le cas des parkings, pour l’occupation desquels le dialogue est parfois « tendu » entre Tchadiens et Français. Ce manque d’espace conduit à parquer parfois des avions de façon imbriquée, ce qui complique (et ralentit) considérablement les manœuvres nécessaires à leur mise en œuvre ;
– le président Déby a évoqué l’idée de construire un nouvel aéroport international à proximité de N’Djamena, et de fermer l’actuel. Cela aurait pour conséquence que la base Kosseï devrait déménager, ce qui entraînerait de très lourdes dépenses d’infrastructures.
2. Les missions de la force Épervier
La force Épervier a plusieurs missions :
● la défense des intérêts français au Tchad, et notamment l’évacuation des ressortissants français et européens en cas de nécessité. Le colonel Paul Peugnet, commandant de la force Épervier, a rappelé aux rapporteurs que cela avait été le cas en février 2008, et que cela pourrait l’être de nouveau dans l’hypothèse, qui n’est pas improbable, où la succession du président Déby ne serait pas parfaitement organisée ;
● le recueil du renseignement, notamment au moyen de patrouilles de recherche en profondeur depuis les trois emprises de la force, et grâce aux moyens de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) et de renseignement d’origine « image » (ROIM) offerts par l’utilisation de « pods reco » sur les Rafale de la force. De plus, la direction du renseignement militaire loue les services d’une société luxembourgeoise qui lui fournit des avions Cesna 208 Caravan – une offre alternative française pourrait utilement sécuriser cette opération d’externalisation, compte tenu de la sensibilité de la matière. Aux termes des accords franco-tchadiens de coopération technique, le renseignement recueilli est partagé avec les Tchadiens, et les Français mènent fréquemment des missions de reconnaissance et d’acquisition de renseignement à leur profit : lorsque la demande tchadienne est étayée par des indices suffisamment précis, les résultats peuvent être très substantiels. Ainsi, récemment, 3 000 orpailleurs ont été détectés ;
● l’appui aux opérations menées par la France dans la région. À ce titre, la force Épervier a contribué à armer les premiers éléments de la force Serval en 2013 (avec son groupement « terre »), ainsi que ceux de la force Sangaris (avec le même groupement, intégré au GTIA Dragon). En mai 2014, Épervier avait ainsi réalisé 800 missions de Rafale (4 500 heures), 220 missions de ravitailleur C 135 (1 300 heures) et 44 missions de C 130 (630 heures) au profit de Serval, et projeté au Mali un état-major tactique (du 21e RIMa), une compagnie motorisée (du 1er REC), un matériel de transport d’engin roues-canon (Pon-ERC - du 1er REC) et une section d’appui mortier (du 3e RAMa) ;
● la coopération avec les forces tchadiennes, qui se traduit notamment par un soutien en matière de transport et par des cessions de carburant (6 000 m3 par an) et de divers matériels au profit des Tchadiens.
iii. Des opérations extérieures appelées à rester ponctuelles
● Deux « véritables » opérations extérieures sont en cours, mobilisant 3 800 personnels environ à ce jour :
– l’opération Serval au Mali (depuis 2013), avec un effectif en décroissance, s’établissant aujourd’hui à 1 800 personnels mais appelé à se stabiliser autour d’un millier d’hommes, basés essentiellement à Gao et Tessalit ;
– les opérations Boali puis Sangaris en République centrafricaine : l’opération Boali avait été lancée en soutien à la mise en place de la force multinationale africaine en Centrafrique (FOMUC) avec 400 personnels environ, et Sangaris a pris son relais, avec 2 000 hommes à ce jour.
● Il faut également tenir compte de la présence des forces spéciales, déployées au Sahel dans le cadre de la task force Sabre, sur l’effectif desquelles le ministère de la Défense ne communique pas.
iv. Des missions de permanence à la mer
La France entretient actuellement une présence à la mer dans trois zones : la Méditerranée, l’océan Indien, et le Golfe de Guinée.
• La mission Corymbe dans le Golfe de Guinée
La mission Corymbe est un dispositif naval mis en place en 1990, qui assure la présence permanente d’un bâtiment français, au moins, dans le Golfe de Guinée.
Comme l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la marine, l’a indiqué aux rapporteurs, « Corymbe représente une mission prioritaire pour la France », compte tenu des enjeux maritimes qui s’y attachent, de l’influence qu’elle peut en tirer, du nombre de ressortissants « que l’on ne peut extraire que par la mer » ainsi que du caractère « crisogène » de la région. Surtout, « la mer est le milieu le plus adapté pour couper les flux de trafics de drogue, de cigarettes, d’armes etc. qui nourrissent les mouvements rebelles à terre ».
En effet, le Golfe de Guinée offre un « large panel de crises maritimes » : pêche illégale, drogue, et surtout la piraterie, phénomène de plus en plus prégnant et marqué par « des modes d’action de plus en plus violents, professionnels ». Ainsi, alors qu’auparavant, les attaques visaient surtout des supply ships et que les pirates s’en prenaient aux valeurs mais pas aux hommes, désormais, les pétroliers sont attaqués. Les trois attaques de pétroliers les plus récentes, avec transfert de la cargaison, provenaient du Nigéria, sans qu’il soit établi à ce stade si les pirates étaient en lien ou non avec Boko Haram. De plus, on compte 75 000 ressortissants français établis sur les côtes du Golfe de Guinée : les opérations d’évacuation des ressortissants (RESEVAC) constituent donc un enjeu maritime. Enfin, pour certaines opérations menées à terre, la seule voie de ravitaillement possible est la mer. Tel a été le cas par exemple en 2011 en Côte d’Ivoire, quand le président Laurent Gbagbo avait coupé les voies terrestres d’approvisionnement de la force française Licorne, déployée dans le pays.
Face à ces enjeux sécuritaires, l’objet principal de la mission Corymbe consiste à maintenir sur place une capacité d’évacuation immédiate. Mais la permanence à la mer permet de traiter aussi d’autres problèmes :
– la piraterie, avec des avions de patrouille maritime et des frégates ;
– l’alimentation logistique des troupes à terre, comme par exemple au Mali ou en République centrafricaine, via le port de Douala, par des bâtiments militaires ou des moyens civils affrétés mais escortés par la marine ;
– la lutte contre la drogue et l’immigration illégale ;
– la lutte contre la « pêche illégale intensive », pour laquelle les États côtiers ont besoin de nos moyens afin d’embarquer leurs inspecteurs, comme cela a été le cas par exemple pour l’arraisonnement récent d’un chalutier russe au large de Dakar.
Les enjeux sécuritaires de la zone ont ainsi conduit à renouveler la mission Corymbe – on en est à la 125e mission –, armée surtout de porte-hélicoptères et de bâtiments de projection et de commandement (BPC).
• La présence française dans l’Océan indien
Comme l’amiral Bernard Rogel l’a rappelé aux rapporteurs, l’océan Indien comprend « quatre des sept points obligés du trafic maritime », d’où une « forte mobilisation mondiale » que traduisent les opérations Ocean Shields, Atalanta, etc. La piraterie n’a pas disparu, mais elle est nettement réduite.
Dans cette zone, la France dispose :
– à Djibouti (au titre des forces de présence), d’un hub de renforcement logistique (armé par 60 personnels) et de commandos de marine, pour lesquels Djibouti est une « zone d’entraînement remarquable ». Le hub est ouvert à d’autres puissances, ce qui en renforce la capacité d’influence. Le tout combine ainsi un point d’appui efficace et une capacité d’aérolargage à la mer, qui fait de la France, parmi les puissances européennes, « le seul pays capable de traiter des cas comme ceux du Ponant, du Tanit et du Carré d’as » ;
– au sein des forces de souveraineté à Mayotte et à La Réunion, de points d’appuis « très limités », réduits à de « simples hubs logistiques et portuaires » (103 marins et 11 civils) ;
– à Abou-Dhabi (au titre des forces de présence), un hub logistique et portuaire armé par 14 marins.
Selon l’amiral Rogel, pour ce qui est des forces de souveraineté, « le dispositif français est insuffisant » au regard des « énormes enjeux » : une zone économique exclusive (ZEE) « immense », des pêches illégales, de la piraterie, de la prospection illégale de pétrole (2), etc. Compte tenu des moyens disponibles, « il nous est impossible de tenir la ZEE : on s’en tient à mener des opérations coup de poing » contre les thoniers notamment, mais cela laisse entier notre « vrai problème de surveillance des frontières maritimes ». Le dispositif est marqué par « des réductions temporaires de capacités partout » notamment concernant les patrouilleurs, ce que le report du programme BATSIMAR de 2014 à 2020 risque d’aggraver.
Ainsi, on peut présenter les effectifs complets de notre dispositif militaire en Afrique, compris au sens large, comme le fait le tableau suivant.
LES EFFECTIFS FRANÇAIS EN AFRIQUE
HORS OPÉRATIONS EXTÉRIEURES « PONCTUELLES »
Implantation |
Statut |
Effectif (environ) |
Libreville (Gabon) |
base opérationnelle avancée |
900 |
Dakar (Sénégal) |
pôle opérationnel de coopération à vocation régionale |
350 |
Djibouti (Djibouti) |
base opérationnelle avancée |
1 900 |
N’Djamena, Abéché et Faya-Largeau (Tchad) |
OPEX Épervier (depuis 1986) |
950 |
Abidjan (Côte d’Ivoire) |
OPEX Licorne (depuis 2002) |
450 |
sous-total |
bases permanentes + OPEX de longue durée |
4 550 |
Abou-Dhabi |
base opérationnelle avancée |
745 |
La Réunion et Mayotte |
forces de souveraineté (forces armées de la zone sud de l’océan Indien – FAZSOI) |
1 900 |
Golfe de Guinée |
mission Corymbe |
320 |
sous-total |
effectifs permanents autour de l’Afrique |
2 965 |
total |
tout compris |
7 515 |
NB : 260 marins français participent également à l’opération européenne Atalanta de lutte contre l’insécurité maritime au large de la Corne de l’Afrique.
Source : informations recueillies par les rapporteurs lors de leurs déplacements.
Il faut préciser que l’on ne peut pas additionner les effectifs des forces françaises établies en permanence en Afrique et ceux des forces qui y sont déployées en opérations extérieures « ponctuelles » – 3 800 personnels environ pour les opérations Serval et Sangaris. En effet, une partie des personnels déployés en opération extérieure est issue des forces prépositionnées. Ainsi, le lancement d’une opération nouvelle a pour effet de « dégarnir » les effectifs prépositionnés, tant « de droit » – par exemple, le groupement « terre » de Libreville a été envoyé en République centrafricaine – que « de fait » – par exemple, le groupement « terre » de N’Djamena envoyé lui aussi en RCA.
b. La double vocation de notre dispositif permanent en Afrique : opérations et coopération
Le dispositif militaire permanent de la France en Afrique, qui repose sur les prépositionnements, sert à mettre en œuvre deux politiques distinctes :
– une politique de coopération opérationnelle ;
– une politique de présence en vue d’éventuelles interventions.
À ce titre ont été identifiées deux structures administratives distinctes mais superposées :
– les « zones de responsabilité principale » (ZRP) au titre des interventions, dont les forces titulaires sont compétentes pour la préparation et la conduite d’opérations ;
– les « zones de responsabilité principale » au titre de la coopération, qui correspondent aux sous-régions africaines.
i. Une sectorisation du continent africain pour les actions de coopération
Au titre de la politique de coopération, le continent africain est sectorisé en zones de responsabilité principale correspondant aux sous-régions institutionnelles calquées largement sur les communautés économiques régionales. Pour l’Afrique francophone subsaharienne, il s’agit de :
– la Communauté économique du développement des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Afrique occidentale, la ZRP « coopération » concernée s’étendant toutefois aussi sur la Mauritanie, qui n’est pas membre de la CEDEAO ;
– la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) en Afrique centrale.
Cette sectorisation a été choisie et mise en œuvre entre 2005 et 2007 au motif qu’elle correspond presque exactement à l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), qui fait une large place aux structures sous-régionales.
L’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS)
L’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) a été créée en 2002, sous la tutelle de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales.
L’AAPS est un cadre constitué d’accords législatifs formels, d’institutions et de processus de décision, qui régissent ensemble la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. Ses composantes essentielles sont le Conseil de paix et de sécurité, le Groupe des sages, la Force africaine en attente, le Fonds africain pour la paix et le système continental d’alerte rapide.
Une évaluation de l’AAPS réalisée en 2010 a salué les progrès constants enregistrés depuis 2002. Cependant, le fonctionnement de certaines composantes reste partiel et l’architecture dans son ensemble demeure largement dépendante du financement extérieur.
Ainsi, depuis 2007, un commandement français a été désigné pour chaque ZRP « coopération », avec à sa tête un officier général. Comme le montre la carte ci-après, il a été choisi de confier ces fonctions :
– pour la ZRP « coopération » correspondant à la CEDEAO et à la Mauritanie, au commandement des Forces françaises du Cap Vert (FFCV), devenues en 2011 les Éléments français au Sénégal (EFS) ;
– pour la ZRP « coopération » correspondant à la CEEAC, au commandement des Troupes françaises au Gabon (TFG), devenues en 2007 les Forces françaises au Gabon (FFG).
LES ZONES DE RESPONSABILITÉ PRINCIPALE AU TITRE DE LA COOPÉRATION
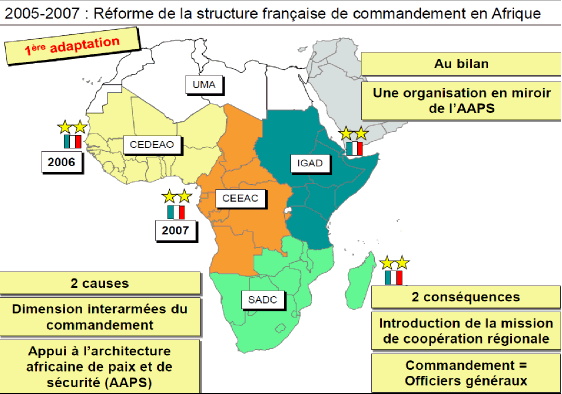
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises au Gabon).
ii. Une sectorisation du continent africain pour la préparation et la conduite d’opérations
Au titre de la préparation et de la conduite des interventions, des zones de responsabilité principale « intervention » ont été définies et attribuées aux forces de présence ou de souveraineté de la zone, comme le montre la carte ci-après.
Ainsi, une ZRP « intervention » couvrant à la fois la CEDAO et la CEEAC – ainsi que la Mauritanie – a été délimitée en 2011 dans le cadre de la restructuration des forces de présence programmée par le Livre blanc de 2008. Les Forces françaises au Gabon ont alors été choisies pour être la base opérationnelle avancée qui en constitue le pivot ; leurs missions ont été revues en ce sens.
LES ZONES DE RESPONSABILITÉ PRINCIPALE AU TITRE DES INTERVENTIONS
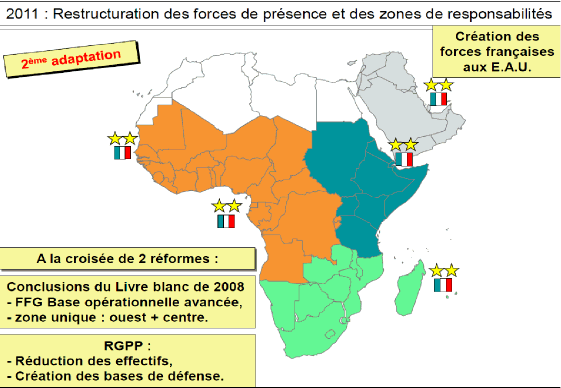
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises au Gabon).
iii. Des missions parfois confondues
La relative complexité de l’analyse de notre dispositif militaire actuel en Afrique, tient à ce que les mêmes bases peuvent cumuler une ZRP « coopération » et une ZRP « intervention ». Tel est le cas des Forces françaises au Gabon, dont les missions cumulent :
– des fonctions qui relèvent de la politique de coopération à l’échelle de la ZRP « coopération » correspondant à la CEEAC ;
– des fonctions qui relèvent de la préparation et de la conduite des opérations dans la ZRP « intervention » dans l’Afrique de l’Ouest. La carte ci-après illustre cette superposition de fonctions.
LES ZRP « COOPÉRATION » ET « INTERVENTION » EN AFRIQUE DE L’OUEST


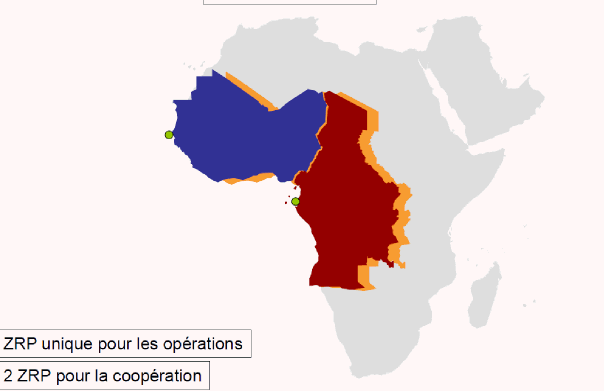
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises au Gabon).
Les missions des Forces françaises au Gabon
En plus des ZRP « coopération » et « intervention » dont elles sont le pivot, les Forces françaises au Gabon entretiennent et animent un Centre d’aguerrissement outre-mer (CAOM) qui sert à l’entraînement des forces françaises. Le schéma ci-après présente ainsi l’étendue de leurs missions actuelles :
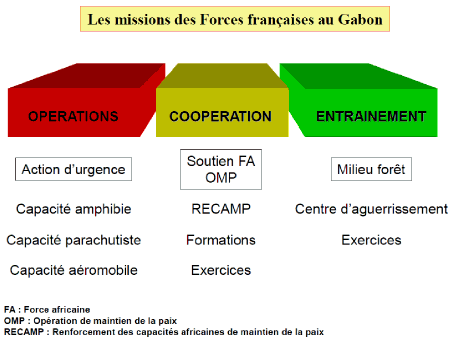
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises au Gabon).
Les différents déplacements des rapporteurs ont permis de mettre en lumière certaines limites dans la mise en œuvre pratique de l’articulation théorique des différentes zones de responsabilité actuelles :
● Lors de l’opération Serval, c’est l’état-major des Éléments français au Sénégal qui a armé le noyau de la force projetée, et non celui des Forces françaises au Gabon, alors même que le Mali relevait de leur ZRP « intervention ».
● Si le fait de confier aux mêmes forces une double mission de coopération et d’intervention est pleinement justifié par l’impératif d’optimisation des moyens militaires français présents sur le sol africain, il n’en demeure pas moins que l’une de ces missions peut prendre le pas sur l’autre. Ainsi, selon les indications fournies aux rapporteurs par le commandement des Forces françaises au Gabon, la mobilisation d’une large partie des capacités des FFG – y compris son état-major – au profit de l’opération Sangaris se traduit par une nette réduction du volume de formations offertes aux Gabonais et aux autres pays de la même ZRP « coopération ».
2. Les opérations Serval et Sangaris ont montré l’efficacité de cette architecture, en complément de capacités de projection rapide
Comme l’ont montré les opérations récentes, le dispositif prépositionné en Afrique n’offre à la France de capacités d’intervention dans des crises majeures que s’il est combiné avec des capacités de projection rapide et d’entraînement de nos partenaires africains.
a. L’importance des prépositionnements pour la réactivité des forces
i. Les prépositionnements ont joué un rôle clé dans le déclenchement des opérations Serval et Sangaris en 2013
Lors de son audition par les rapporteurs, le général Bertrand Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée de terre, a procédé à une analyse approfondie de l’utilité des prépositionnements pour la réactivité des forces françaises, c’est-à-dire pour leur capacité, d’une part, à intervenir « au coup de sifflet » dans une crise et, d’autre part, à accueillir des renforts dans des conditions les rendant opérationnels dans de très brefs délais.
Le chef d’état-major de l’armée de terre s’est exprimé dans les termes suivants : « j’observe, dans un cas comme dans l’autre, que ce sont des forces de présence de notre dispositif en Afrique qui sont intervenues en toute urgence, avec un certain succès d’ailleurs ». Pour l’opération Serval, à partir du 12 janvier 2013 du Tchad, de Côte d’Ivoire et du Sénégal, les unités qui y étaient prépositionnées ont convergé vers le Mali. Constituant un « groupement tactique de circonstance », en liaison avec les forces spéciales et avec le soutien de l’armée de l’air, elles ont « sécurisé les milliers de ressortissants français et étrangers et contribué à arrêter puis à repousser l’offensive djihadiste ». En République centrafricaine, « compte tenu de l’urgence de la situation humanitaire, c’est peu ou prou le même scénario qui s’est déroulé avec un succès comparable à celui obtenu au Mali ». Composée à partir du détachement présent dans le cadre de l’opération Boali, « agrégeant des unités venues de Libreville, du Tchad, puis un peu plus tard de Djibouti, et commandé par un état-major armé par les forces françaises du Gabon », l’opération Sangaris « a permis d’éviter que le pire ne se produise en Centrafrique ».
Il a aussi fait valoir que « cette liberté dont dispose la France de pouvoir agir avec ses forces terrestres partout où elle l’estime nécessaire, à partir de bases disséminées sur les points du globe qui lui sont stratégiques reste donc un atout de tout premier ordre, et même un facteur de puissance qui la caractérise et qui lui est envié par ses Alliés ».
Pour le chef d’état-major de l’armée de terre, « nos forces prépositionnées restent naturellement les mieux placées pour intervenir en premier, et faire face à l’urgence absolue car elles disposent pour cela d’atouts difficilement remplaçables », parmi lesquels il relève notamment :
– la stabilité de leur base logistique ;
– la permanence de leurs moyens de commandement ;
– et la présence en nombre adapté d’unités équipées et entraînées.
Ces avantages font de ces forces « des outils opérationnels à l’efficacité éprouvée ». L’expérience des opérations Serval et Sangaris montre ainsi à ses yeux que « l’excellente connaissance d’un milieu humain complexe et changeant et d’un environnement géographique exigeant, qu’elles acquièrent au fil du temps au contact du continent, constituent un gage d’efficacité inappréciable ».
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces forces prépositionnées ont été dans le passé, et continuent à être aujourd’hui, employées prioritairement pour réagir lorsque la situation sécuritaire d’un pays africain impose que nous mettions à l’abri nos ressortissants, avec ceux des pays qui nous le demandent. Et le général Bertrand Ract Madoux de conclure que « la protection des 270 000 citoyens français résidant sur le continent africain, et les obligations que nous avons dans ce domaine vis-à-vis des ressortissants étrangers, en particulier européens et nord-américains, imposent que nous disposions de forces implantées et structurées pour pouvoir assumer ce volet essentiel de notre défense ».
Lors de leurs déplacements auprès des forces prépositionnées, les rapporteurs ont pu étudier en détail la façon dont l’ensemble de ces forces ont contribué au lancement des opérations Serval et Sangaris.
Il en ressort que, dans le « fuseau ouest » de la bande sahélo-saharienne, les installations de la force Licorne ont indiscutablement joué un rôle crucial dans l’armement des premiers éléments de la force Serval, en raison des capacités du camp de Port-Bouët, véritable base logistique de la sous-région. Les installations de Dakar ont également servi, dans une moindre mesure. Selon l’état-major de l’armée de terre, Dakar en effet « offre une possibilité de variantement dans l’accès à la bande sahélo-saharienne avec des capacités un peu moindres », la « plateforme » étant jugée « moins pratique » que celle d’Abidjan. Par ailleurs, si les Forces françaises au Gabon n’ont pas été sollicitées, c’est parce qu’elles étaient alors utilisées alors comme réserve opérative de la sous-région, où la République centrafricaine était entrée dans sa phase d’instabilité.
Pour ce qui est du « fuseau est » de la bande sahélo-saharienne, le port de Douala au Cameroun est vu comme la meilleure « porte d’accès à l’Est de la bande sahélo-saharienne et à la République centrafricaine » ainsi que pour le Tchad, notamment car il existe une ligne de chemin de fer permettant de rallier N’Djamena. Pour l’état-major de l’armée de terre, « vu sous l’angle logistique et des voies de communication, Libreville est beaucoup moins pratique ».
S’agissant enfin de l’Afrique de l’Est, Djibouti constitue à l’évidence un point d’intérêt stratégique majeur.
ii. Les prépositionnements ne permettent toutefois d’intervenir dans une crise majeure que s’ils s’articulent avec un dispositif de projection rapide de forces
L’étude des mouvements d’unités nécessaires à la constitution des forces Serval et Sangaris montre clairement que toutes les forces prépositionnées en Afrique, si elles ont été et sont capables d’intervenir avec un élément de commandement et un élément de combat, ne permettent pas de constituer davantage qu’un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA), appuyé par l’armée de l’air et éventuellement les forces spéciales.
Les précisions fournies aux rapporteurs par l’état-major de l’armée de terre le confirment : « compte tenu des tâches ancillaires, aucun de ces théâtres ne peut projeter un groupement tactique interarmes (GTIA) complet sans renforcement d’unités de force-protection ». C’est pourquoi, devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de terre a estimé que l’action des unités prépositionnées « ne suffit cependant pas toujours à éteindre les foyers de crise les plus brûlants ». C’est là que réside tout l’intérêt d’une bonne articulation entre ces unités et le dispositif « Guépard nouvelle génération », « que le Livre blanc interarmise en échelon national d’urgence, ce qui consiste justement à mettre sur pied une capacité d’intervention rapide, capable dans des délais très brefs d’intervenir en premier ou de renforcer une force pré-déployée dans l’urgence ». Le général Bertrand Ract Madoux a fait valoir que « l’armée de terre consacre d’ailleurs des ressources substantielles pour conditionner les matériels, équiper le personnel, et surtout préparer à l’engagement ces unités constituées ».
Il en a conclu à la nécessité de conserver un équilibre satisfaisant entre le dispositif prépositionné et l’échelon national d’urgence : « ne pas utiliser à bon escient le Guépard nouvelle génération reviendrait presque à désoptimiser un système pourtant conçu pour rentabiliser au mieux l’emploi de ressources comptées », concluant : « je considère donc pour ma part que l’engagement de forces pré-positionnées est parfaitement complémentaire avec l’emploi du Guépard qui a vocation à être déclenché sitôt que la situation opérationnelle exige un renforcement ». L’équilibre de notre dispositif militaire en Afrique et sa crédibilité vis-à-vis des pays dans lesquels nos forces sont stationnées et avec lesquels nous avons des accords de défense repose d’ailleurs sur une certaine permanence de la présence de ces unités dans leur base.
Le chef d’état-major de l’armée de terre a fait observer aux rapporteurs que cette synergie a été « bien observée par nos alliés, en particulier britanniques mais aussi américains », qui voient qu’elle permet « d’augmenter la réactivité des forces (forces acclimatées et forces en alerte sont toutes disponibles à 48 heures) et d’atteindre rapidement la masse critique nécessaire pour obtenir un effet tactique ».
Le dispositif Guépard nouvelle génération
Preuve de sa pertinence, le dispositif Guépard nouvelle génération a été engagé huit fois, en tout ou partie, au cours de l’année 2013. La réactivité et la qualité du dispositif sont reconnues internationalement. Il garantit au CEMA des modules parfaitement cohérents (éléments numérisés au format organique, respect de la doctrine, données logistiques intégrées, stocks prêts, etc.), à 100 % de leur capacité opérationnelle et certifiés en ce sens par l’armée de terre, dans des délais contractuels. Véritable boîte à outils, le dispositif permet de choisir les modules adaptés aux besoins précis de l’opération (OAP, action amphibie, engagement blindé, chaîne logistique adaptée au type de manœuvre, etc.), ce dispositif couvrant l’ensemble du spectre des capacités opérationnelles disponible dans l’armée de terre. Le Guépard garantit ainsi à la fois des effectifs et des équipements efficaces, disponibles et soutenus. Le dispositif a été adapté aux nouveaux besoins de l’échelon national d’urgence, tout en conservant les principes qui en fondent l’efficacité.
Source : État-major de l’armée de terre.
iii. Les opérations Serval et Sangaris ont montré l’importance d’une bonne articulation entre les forces conventionnelles et les forces spéciales
L’articulation des forces spéciales – dont certains éléments sont déployés en Afrique dans le cadre de la task force Sabre – et des forces conventionnelles, y compris prépositionnées, ressort de l’expérience des opérations Serval et Sangaris comme l’un des éléments-clés de la réussite d’une opération en général, et de la réactivité des forces dans la première phase de l’opération en particulier.
En effet, ces deux composantes partagent le même théâtre, concourant à un objectif stratégique commun, même si elles agissent dans un référentiel de missions et de partenariats parfois différents. Et, comme l’état-major de l’armée de terre l’a indiqué aux rapporteurs, « dans les microconflits africains, les forces spéciales ont offert des capacités de réaction et des moyens complémentaires de ceux des forces conventionnelles, pour la sauvegarde de nos ressortissants, mais aussi par des actions multiformes allant du conseil et de la formation de troupes étrangères jusqu’à l’action coercitive ». Tel a été le cas en République démocratique du Congo, lors de l’opération Artemis, ou plus récemment en République de Côte d’Ivoire.
Il ressort des entretiens et des observations des rapporteurs que la coordination entre forces conventionnelles et forces spéciales n’a pas toujours été simple, mais qu’elle a atteint un haut degré d’efficacité avec les opérations Serval et Sangaris.
Ainsi, dans la bande sahélo-saharienne (BSS), les forces spéciales et conventionnelles font la démonstration de leur complémentarité :
– dans les objectifs tactiques : contre-terrorisme pour les forces spéciales, appui des forces africaines et gestion de l’environnement humain pour les forces conventionnelles ;
– dans les modes d’action : « effets de double lame », complémentarité logistique, partage de ressources matérielles, notamment pour ce qui concerne les moyens d’intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR) et d’aéromobilité.
Le général commandant des opérations spéciales (GCOS), Grégoire de Saint-Quentin, a d’ailleurs indiqué que cette articulation constituait l’un des sujets de réflexion les plus actuels ; un colloque se tiendra d’ailleurs bientôt sur le sujet. Pour lui, « le « fait forces spéciales » est avéré aujourd’hui » : la loi de programmation militaire 2014-2019 le prend en compte, il est intégré au dispositif général de défense, et le GCOS est consulté sur tous les déploiements opérationnels.
Le général Grégoire de Saint-Quentin a relevé que d’incontestables progrès ont été accomplis depuis quinze ans dans la conception et l’emploi de l’outil que constituent les forces spéciales, notamment au gré de leur utilisation sur le sol africain. On observe ainsi une « trajectoire ascendante dans la compréhension de ce que les forces spéciales apportent, ou ne sont pas faites pour apporter ». Pour lui, la relation entre forces spéciales et forces conventionnelles a « mûri sur le terrain », et l’opération Serval a marqué à cet égard « un tournant ». Le Mali constituait en effet un « contexte d’emploi idéal » : tous les modes d’action des forces spéciales ont été mis en œuvre, à l’exception des savoirs faire maritimes. Commandant de la force Serval, il a constaté qu’au début de cette opération, il y a eu un moment où forces spéciales et forces conventionnelles « se sont marchés sur les pieds », car le poste de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) n’était pas encore en mesure d’assurer la coordination – il avait à organiser en parallèle l’action militaire, le défi logistique et l’appui intense à fournir à la MISCA – mais peu à peu, l’articulation est devenue « totalement fluide ».
Selon le GCOS, l’articulation entre les forces spéciales et les forces conventionnelles ressort clarifiée de l’opération Serval :
– forces spéciales et forces conventionnelles ont des « modes d’emploi différents, pour des buts différents », tout en partageant un théâtre et un état final recherché. « Ce qui a pu semer le trouble dans le passé, c’est qu’on pensait que la force opérationnelle terrestre (FOT) et les forces spéciales étaient faites pour remplir la même mission ». Et ce n’est pas une question de valeur militaire : « la composante terrestre dans l’Amettetaï n’a pas été moins valeureuse que les forces spéciales ! » ;
– le cadre d’emploi des forces spéciales, leur « espace-temps » et les « partenariats noués » ne sont pas les mêmes que ceux de la force opérationnelle terrestre. Il faut « dépasser les chicailleries de villages gaulois » et éviter de « superposer les forces ». En vérité, le rôle des forces spéciales consiste à « ouvrir les portes » et celui de la force opérationnelle terrestre à « réduire l’adversaire » (au moins dans première phase d’une opération comme Serval) : « à partir du moment où l’on comprend cela, il n’y pas d’opposition entre forces spéciales et forces conventionnelles » ;
– loin d’être à opposer, forces spéciales et forces conventionnelles se sont révélées complémentaires au Mali, notamment parce que « l’action des forces spéciales en matière de contre-terrorisme ne serait pas possible sans Serval en back-up ». Certes, les forces spéciales sont « prioritaires dans l’allocation des moyens » (par exemple pour se faire attribuer un hélicoptère de combat quand un de ceux qu’elles ont en propre est indisponible), mais cela fonctionne « parfois dans les deux sens ». Serval fournit un soutien indispensable aux forces spéciales. La « clé du théâtre malien est en effet la rapidité », face à des groupes armés terroristes « furtifs » ; le rôle des forces spéciales est ainsi de « bondir de base en base pour s’approcher de la cible », ce qui suppose que Serval les accueille temporairement.
La montée en puissance des forces spéciales planifiée par le Livre blanc de 2013 offre ainsi une occasion historique d’aller plus loin encore dans la recherche d’une meilleure articulation entre forces spéciales et forces conventionnelles, articulation qui passe par la mise en place de partenariats étroits entre certaines unités conventionnelles – notamment celles qui opèrent le plus en Afrique – et les différentes composantes des forces spéciales. L’encadré ci-après présente le détail de ces enjeux.
L’articulation entre forces spéciales et forces conventionnelles, y compris sur le terrain africain, dans le cadre du renforcement de nos forces spéciales prévu par le Livre blanc
Le Livre blanc et la LPM prévoient de porter les effectifs des forces spéciales de 3000 à 4000 hommes. Pour le général Grégoire de Saint-Quentin, « une non-déflation dans la Défense aujourd’hui, c’est déjà de la discrimination positive, alors une augmentation, c’est vraiment bien ».
Pour conduire celle-ci, « on ne raisonne pas en termes de ressource à dépenser », mais suivant d’autres paramètres :
– « si on a obtenu cette reconnaissance, c’est que le saut qualitatif entrepris est réussi et qu’il a même créé des attentes : on ne va pas passer du qualitatif au quantitatif » : aussi, l’idée de « basculer une unité existante dans les forces spéciales » serait une erreur conduisant à une perte de qualité, « car il faut une génération pour acquérir la culture forces spéciales ». En outre, « il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes déjà pas totalement bien équipés : il ne servirait à rien de recruter sans délai 1 000 hommes de plus sans pouvoir les équiper de matériels adéquats » ;
– la ligne directrice consiste plutôt à « densifier ce que nous avons », et à « répondre à des capacités insuffisantes ». Il est ainsi prévu de :
1./ augmenter les moyens de commandement ;
2./ renforcer les unités de forces spéciales, notamment à travers un effort en ressources humaines qui devra être consacré également au soutien opérationnel. L’un des principaux points faibles actuels des forces spéciales réside en effet dans leur capacité à générer une bonne disponibilité technique de leurs hélicoptères, cet équipement étant indispensable pour créer l’effet de surprise sur grandes élongations- : l’effort portera ainsi, entre autres, sur le renforcement des maintenanciers du 4° régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4e RHFS).
3./ élargir le spectre des capacités utilisées en opérations spéciales ; Certaines capacités « n’ont pas besoin d’être détenus en propre par les forces spéciales ».
L’idée générale consiste donc à « abonner » des unités conventionnelles pour qu’elles travaillent régulièrement avec des unités appartenant aux forces spéciales. Les commandants des unités conventionnelles « jouent le jeu », car ces partenariats « tirent le niveau vers le haut ». L’intérêt, pour les forces spéciales, réside en ce qu’elles peuvent ainsi s’entraîner avec des personnels « dont elles ont besoin pour les opérations spéciales, mais qui n’ont pas besoin de faire partie des forces spéciales ».
Dans cette optique, il s’agit pour le COS d’identifier ce que les armées peuvent lui apporter comme compétences et comme capacités. Le COS n’a nullement l’intention de se poser en « 4e armée » – d’ailleurs, même aux États-Unis où les forces spéciales sont très autonomes, elles s’appuient sur les trois armées. Il faut également éviter un « risque de course à l’échalote », qui consisterait à ce que les unités qui coopèrent avec le COS deviennent déraisonnablement ambitieuses dans l’expression de leurs besoins d’équipements.
Autre enjeu : il faut progresser dans l’harmonisation des équipements entre les armées pour les unités qui participent aux forces spéciales : elles gagneraient à ce que leurs équipements entrent en dotation « de façon synchronisée », et qu’ils soient « interchangeables et interopérables ».
En outre, il ressort des observations des rapporteurs que l’un des grands progrès accomplis avec la task force Sabre tient à une meilleure articulation des forces spéciales et de la DGSE, avec un effort d’intégration et de partage du renseignement dans une dynamique contre-terroriste. Cette « dynamique interagences » a été l’un des grands enjeux de Sabre, et cet enjeu sera encore plus crucial avec le traitement des problèmes potentiels dans des zones de conflit où il y a beaucoup plus de nationaux français qu’au Sahel.
b. L’importance de liens étroits de partenariat pour susciter la mobilisation des États africains
Dans leur rapport sur l’opération Serval au Mali, nos collègues Christophe Guilloteau et Philippe Nauche (3) ont bien mis en exergue la capacité d’entraînement dont a fait preuve la France auprès de ses partenaires africains pour la génération, relativement rapide, de la force de la CEDEAO dite Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), ainsi que du Tchad, dont l’appui a été déterminant lors des combats dans l’Adrar des Ifoghas.
Les rapporteurs ont pu constater que l’implication de la France avait eu le même effet, dans une certaine mesure, en République centrafricaine pour la mise en place rapide de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), force de la CEEAC.
L’habitude qu’ont nos partenaires africains de travailler avec les forces françaises prépositionnées, ainsi que la longue histoire de coopération militaire entre la France et ces pays – qui fait qu’aujourd’hui encore, une grande part des responsables politiques et militaires africains ont été formés en France – ont été déterminantes dans cette mobilisation.
À ce titre, le déploiement de la MISMA et de la MISCA aux côtés, respectivement, des forces Serval et Sangaris au Mali et en République centrafricaine met en lumière un résultat particulier de notre longue tradition de coopération franco-africaine : la confiance entre nos forces armées.
B. UNE RESTRUCTURATION PLANIFIÉE DE NOTRE DISPOSITIF PERMANENT EN AFRIQUE
● Les deux déplacements en Afrique de l’Ouest ont permis aux rapporteurs de recueillir des informations concrètes sur les projets de réorganisation du dispositif militaire français en Afrique. Schématiquement, cette réorganisation s’analyse en deux manœuvres coïncidentes dans leur calendrier mais obéissant à deux logiques distinctes :
– une manœuvre de « régionalisation » du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne (BSS) ;
– une manœuvre de réorganisation des bases françaises établies à titre permanent sur la côte occidentale du continent.
● Au cours de leurs travaux, les rapporteurs se sont attachés à essayer de comprendre quelles caractéristiques font un « bon » prépositionnement. Ils ont ainsi passé en revue les sites possibles et leurs potentialités respectives. Il en ressort que si l’on devait résumer la principale caractéristique attendue d’un site de prépositionnement, la notion centrale serait celle de « réactivité ».
Pour qu’une base permette à une force prépositionnée d’être réactive, c’est-à-dire de pouvoir se déployer pour contribuer à la gestion d’une crise tout en accueillant, le cas échéant, des moyens de renfort projetés depuis la métropole ou transférés depuis d’autres prépositionnements, celle-ci doit réunir plusieurs conditions :
– une localisation permettant la projection dans les directions les plus probables des crises avec le minimum d’élongation ;
– des points d’entrée et de sortie du continent, voire de la sous-région, aisément accessibles, utilisables et sécurisés ;
– une acceptabilité politique de la présence française de la part du pays hôte et de la population locale ;
– des capacités d’entraînement ;
– des opportunités d’actions bilatérales ou multilatérales en matière de coopération : formation, entraînement, accompagnement en opérations ;
– un degré suffisant de stabilité politique.
Le chef d’état-major de l’armée de terre a résumé ces critères devant les rapporteurs dans les termes suivants : notre « dispositif de présence » doit être « articulé autour de bases opérationnelles avancées offrant à l’est, au centre et à l’ouest du continent de bons points d’entrée et de sortie de théâtres, qui soient stratégiquement bien positionnées pour couvrir nos zones d’intérêts et dont les implantations garantissent un emploi flexible et réactif des unités qui y sont déployées ».
● Au regard de ces critères, Abidjan présente aujourd’hui selon l’état-major de l’armée de terre « un maximum de garanties », dans la mesure où elle est « idéalement située à l’entrée de l’Afrique de l’Ouest, permettant à une force prépositionnée de pouvoir intervenir indifféremment au cœur de la bande sahélo-saharienne ou, en s’appuyant sur le dispositif Corymbe, dans tous les pays du golfe de Guinée, du Sénégal au Gabon ». De même, Dakar constitue également « un site favorable, même si notre liberté d’action y est plus contrainte politiquement ».
Suivant les mêmes critères, quatre sites avancés aux portes du Sahel permettraient « de se rapprocher notablement de la zone des probables opérations contre les groupes armés terroristes » même s’ils constituent « un défi logistique » : Néma (en Mauritanie), Gao (au Mali), Agadez ou Arlit (au Niger) et Zouar (au Tchad). Lors de son audition, le général Bertrand Ract Madoux a ajouté que « l’intérêt de conserver des forces terrestres à N’Djaména, au cœur de la bande sahélo-saharienne, et surtout à Djibouti, sur la façade est s’impose d’évidence » au regard des critères précités.
En Afrique centrale, Douala et Bangui représentent « un binôme de sites très complémentaires » permettant « un accès raisonnable » au cœur de cette sous-région « peu pénétrable ». Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de terre a également cité le site de Libreville parmi ceux qui « offrent des potentialités intéressantes ».
Enfin, Djibouti constitue pour nos armées le principal point accessible en Afrique de l’Est, très majoritairement anglophone. En outre les Forces françaises stationnées à Djibouti sont régulièrement mises à contribution en appui des pays de la sous-région engagés dans les opérations de maintien de la paix, notamment la mission de l’Union africaine en Somalie (généralement appelée AMISOM, acronyme de l’anglais African Union Mission in Somalia).
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de la marine a considéré que dans la réorganisation des prépositionnements, « l’important n’est pas toujours l’effectif de troupes maintenues, mais la conservation de points d’entrée qui permettent d’intervenir rapidement (« réussir la 1re intervention ») ». Selon lui, en effet, une projection immédiate suffit à assurer l’évacuation de nos ressortissants et à donner un coup d’arrêt au développement d’une crise, comme cela a été le cas au Mali. À cet égard, « Douala est plus pratique qu’Abidjan comme hub logistique car elle est reliée à un réseau ferroviaire satisfaisant, mais pas forcément pour les projections aériennes ».
Pour lui, de façon générale, notre « stratégie de multiplication des hubs » suppose d’avoir des capacités d’action : quelques compagnies présentes à terre, et un dispositif de renfort par projection. Il a souligné l’intérêt qu’il y a à pouvoir déployer de tels renforts par la mer, rappelant ce qui a été fait en la matière dans le cadre de l’opération Licorne en Côte d’Ivoire : « on a embarqué tout sur des bâtiments de projection et de commandement (BPC) et des bâtiments de transport et de soutien (BTS), ce qui a permis de renforcer le dispositif sans que cela puisse être vu par le président Laurent Gbagbo comme une provocation qu’il aurait pu saisir ». En tout état de cause, si l’on n’a pas de capacité de renforcement par mer ou par air, il faut « un gros dispositif à terre ». Or, en la matière, la France a l’avantage de disposer de points d’appui que les autres n’ont pas, à l’exception des Britanniques et des Américains à Diego Garcia – à ceci près néanmoins que leur base y est « très peu ouverte aux autres » puissances.
Comparant les avantages relatifs des différentes implantations, l’amiral Bernard Rogel a estimé que « si on avait eu à choisir entre Abou-Dhabi et Djibouti, on aurait préféré Djibouti », car Abou-Dhabi est « en zone de conflit potentiel » : « Djibouti est beaucoup plus intéressant, d’autant que la France y est accueillie dans des conditions favorables depuis très longtemps ».
1. Le nouveau schéma de notre dispositif permanent en Afrique : maintien de toutes les implantations et déplacement du centre de gravité vers la bande sahélo-saharienne
Les déplacements des rapporteurs au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon, ainsi qu’à Djibouti et aux Émirats arabes unis, leur ont permis d’étudier sur place l’organisation de tous les points d’appui des forces de présence françaises en Afrique et autour de l’Afrique, d’en observer l’organisation et le fonctionnement, afin d’analyser la portée et la cohérence d’ensemble des évolutions prévues.
a. Un réaménagement sans abandon de notre réseau de points d’appui permanents, marqué par la montée en puissance de la Côte d’Ivoire et la réduction envisagée de notre présence au Gabon et à Djibouti
i. L’orientation générale retenue par le Gouvernement : un maintien de la présence française sur tous ses principaux points d’appui actuels, au prix de réaménagements et d’une réduction globale d’effectifs
Selon les indications fournies sur le terrain aux rapporteurs, la réorganisation de notre dispositif militaire permanent en Afrique suivrait les grandes lignes suivantes :
– maintien du pôle opérationnel de coopération (POC) de Dakar et de sa zone de responsabilité principale (ZRP) au titre de la coopération ;
– transformation de la base opérationnelle avancée (BOA) de Libreville en « simple » POC, sur le modèle de Dakar, avec pour seule zone de responsabilité principale sa ZRP actuelle au titre de la coopération ;
– transfert de Libreville à Abidjan de la fonction de base opérationnelle avancée (BOA) pour la zone de responsabilité principale au titre des opérations, dont le périmètre est inchangé.
L’objectif de la manœuvre est donc triple :
– maintenir le réseau de nos points d’appui ;
– convertir certaines implantations ;
– réduire les effectifs de l’ensemble.
La carte ci-après représente l’état final recherché.
LE NOUVEAU SCHÉMA DE NOTRE DISPOSITIF MILITAIRE PERMANENT EN AFRIQUE
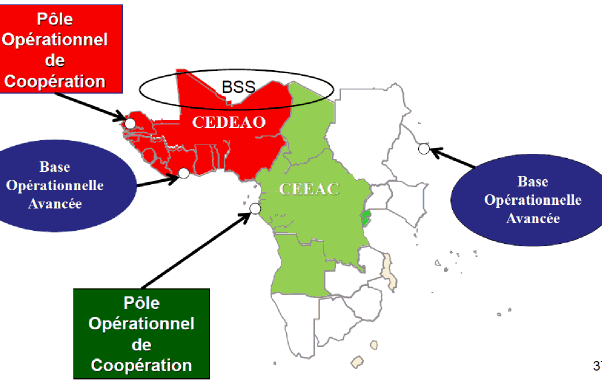
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises au Gabon).
Selon les informations fournies sur place aux rapporteurs, la manœuvre de réduction globale et de redéploiement des effectifs pourrait suivre le calendrier et les modalités potentielles décrites par le tableau ci-après.
LE SCÉNARIO ENVISAGÉ POUR LA RÉDUCTION GLOBALE ET LE REDÉPLOIEMENT DES EFFECTIFS
Libreville |
Dakar |
Djibouti |
Abidjan |
Abou-Dhabi |
Évolution pour l’ensemble des prépositionnements | ||
effectif |
évolution | ||||||
Statut avant la réforme |
|||||||
dénomination de la force |
Forces françaises au Gabon (FFG) |
Éléments français au Sénégal (EFS) |
Forces françaises à Djibouti (FFDj) |
(pas d’implantation permanente) |
Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) |
||
fonction |
BOA |
POC |
BOA |
BOA |
|||
Statut après la réforme |
|||||||
dénomination de la force |
Éléments français au Gabon (EFG) |
Éléments français au Sénégal (EFS) |
Forces françaises à Djibouti (FFDj) |
Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) |
Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) |
||
fonction |
POC |
POC |
BOA |
BOA |
BOA |
||
Évolution des effectifs |
|||||||
2013 |
900 |
350 |
1 950 |
0 |
750 |
3 950 |
|
2014 |
450 |
350 |
1 950 |
450 |
750 |
3 950 |
inchangé |
2015 |
450 |
350 |
1 600 |
550 |
750 |
3 700 |
– 250 |
2016 |
350 |
350 |
1 100 |
800 |
750 |
3 350 |
– 350 |
2017 |
350 |
350 |
950 |
800 |
750 |
3 200 |
– 150 |
évolution totale : |
– 550 |
inchangé |
– 1000 |
+ 800 |
inchangé |
– 750 | |
BOA : base opérationnelle avancée
POC : pôle opérationnel de coopération à vocation régionale
Source : informations recueillies par les rapporteurs lors de leurs déplacements et précisions fournies par le cabinet du ministre de la Défense.
ii. Un déplacement, de Libreville à Abidjan, de la base opérationnelle avancée (BOA) chargée de la zone de responsabilité principale (ZRP) pour les opérations en Afrique de l’Ouest
Le nouveau schéma de déploiement de notre dispositif permanent en Afrique prévoit la création d’une base opérationnelle avancée à Abidjan, chargée de la zone de responsabilité principale (ZRP) pour les opérations en Afrique de l’ouest, qui incombait jusqu’à présent aux Forces françaises au Gabon.
La nouvelle base opérationnelle avancée d’Abidjan n’est pas créée ex nihilo : elle reprend les installations utilisées aujourd’hui par l’opération Licorne. De même, les nouvelles Forces françaises en Côte d’Ivoire que l’on crée sont issues de la pérennisation de notre force déjà présente sur place, mais qui jusqu’alors ne relevait juridiquement que d’une opération extérieure, Licorne.
Pourquoi ce transfert de la base opérationnelle avancée de Libreville à Abidjan ? Deux principaux ordres d’arguments ont été avancés devant les rapporteurs pour justifier cette manœuvre :
– l’intérêt de conserver en Côte d’Ivoire un point d’appui important même après que la force Licorne a rempli l’essentiel de son mandat, compte tenu tant des potentialités offertes par le site d’Abidjan (port en eaux profondes, infrastructures aéroportuaires) que de la qualité retrouvée des relations franco-ivoirienne ;
– l’intérêt d’approfondir nos capacités de coopération, dont le modèle du pôle opérationnel de coopération créé à Dakar a montré qu’elles gagnaient à faire l’objet de structures plus spécialisées que les forces de présence classiques.
C’est en substance ce qu’a déclaré aux rapporteurs le chef d’état-major de l’armée de l’air, en expliquant qu’alors que le dispositif s’articulait principalement, pour l’armée de l’air, en deux points d’appui – Djibouti et le Gabon – et une opération extérieure – Épervier au Tchad –, « les relations avec la République de Côte d’Ivoire font qu’on déplace des capacités de Libreville vers Abidjan ».
Les cartes ci-après illustrent l’intérêt stratégique d’Abidjan.
L’INTÉRÊT STRATÉGIQUE D’ABIDJAN
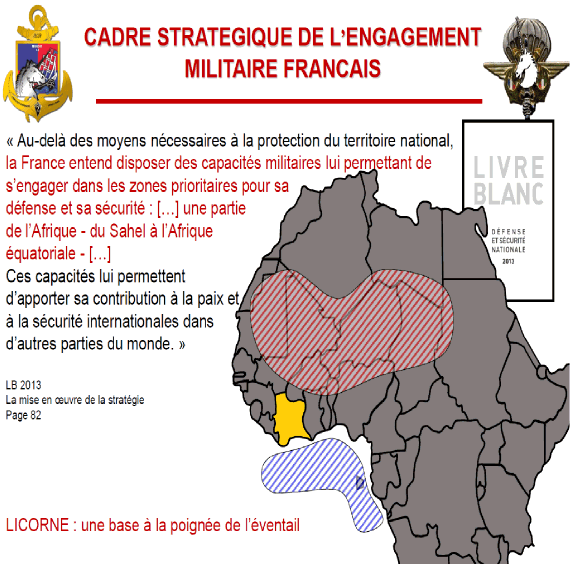
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
L’INTÉRÊT STRATÉGIQUE D’ABIDJAN
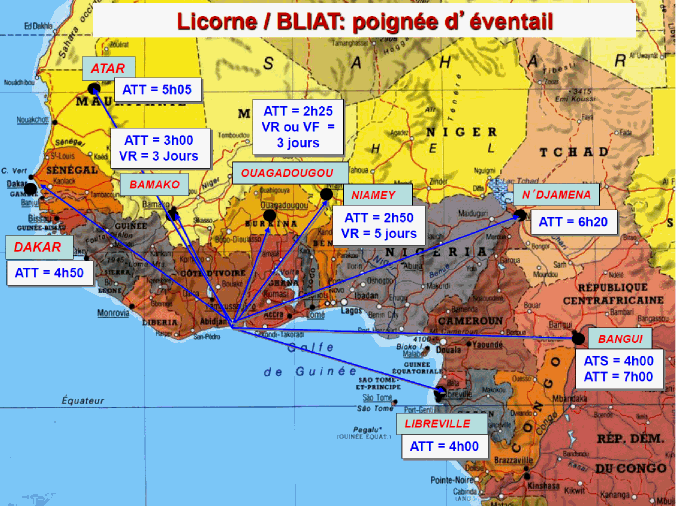
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
Par ailleurs, comme l’a bien souligné le général Denis Mercier, dans la déflation globale qui est planifiée « suivre une logique de réduction homothétique serait absurde : mieux vaut concentrer le dispositif ». D’où le choix, pour l’armée de l’air, de ne laisser au Gabon qu’un Fennec, qui peut servir à l’appui feu et à l’évacuation d’autorités, pour pouvoir se concentrer en une implantation légère en Côte d’Ivoire, et conserver à Dakar la petite escale que l’on y possède.
La réduction du format de la présence française au Gabon est le corollaire de la consolidation de notre présence en Côte d’Ivoire. Cette réduction est clairement assumée par le Gouvernement : il ne s’agit pas d’une simple réduction des moyens positionnés à Libreville, mais d’un transfert de compétence pour une zone de responsabilité principale « opérations », qui se traduit même par un changement de dénomination des Forces françaises au Gabon, qui deviennent de simples « Éléments français au Gabon » sur le modèle des Éléments français au Sénégal. Les missions de notre base de Libreville évoluent elles aussi explicitement : conformément à son nouveau statut de pôle opérationnel de coopération (POC), l’essentiel de leurs missions consistera désormais à offrir des programmes de coopération opérationnelle aux pays de sa zone de responsabilité principale « coopération », c’est-à-dire ceux de la CEEAC.
b. La « régionalisation » de notre dispositif dans la bande sahélo-saharienne
Les deux déplacements des rapporteurs en Afrique de l’Ouest leur ont permis de faire le tour de l’ensemble des implantations militaires françaises dans la bande sahélo-saharienne, d’étudier les modalités envisagées de leur reconfiguration et d’analyser, site par site, les potentialités de chaque point d’appui pour les forces françaises dans le nouveau schéma d’organisation régionale de ces forces.
À la différence du réseau de points d’appui côtiers présenté précédemment, le déploiement militaire français dans la bande sahélo-saharienne n’a pas vocation à être permanent : il reste et restera régi par le statut des opérations extérieures.
L’accent mis sur le Sahel dans le déploiement des forces françaises en opérations extérieures se justifie par les enjeux sécuritaires de la zone, qui constituent une menace directe pour les intérêts français. Le Sahel représente en effet, selon les termes de l’état-major de l’armée de terre, « une zone de confrontation, mais aussi un trait d’union ayant une incidence, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi économique et migratoire ». L’instabilité libyenne, les risques d’un « « arc terroriste » allant des Shebabs à Boko-Haram, de la corne de l’Afrique à la Mauritanie », montrent – malheureusement – la pertinence de l’accent mis par la France sur la bande sahélo-saharienne dans ses efforts de sécurisation de l’Afrique. Le Sahel représente ainsi « une zone d’effort en raison de la concentration des fragilités et des risques de débordement contraires aux intérêts français ». Devant les rapporteurs, le général Jacques Norlain a résumé la place du Sahel en ces termes : « le Sahel est aujourd’hui notre principale préoccupation car la menace islamiste y est, pour une partie, plus localisable et les derniers développements montrent que des résultats peuvent être obtenus ».
Pour autant, il est bon de souligner que l’accent mis sur la bande sahélo-saharienne ne doit pas être vu comme ayant pour corollaire un abandon des ambitions françaises dans le reste de l’Afrique. Comme le relève le général Jacques Norlain, nos succès au Sahel sont des « succès limités car les questions de fond ne sont pas en voie de solution et l’influence islamiste se développe dans des États comme le Sénégal ». Pour forcer le trait et bien marquer le caractère temporaire de la concentration de nos forces dans la bande sahélo-saharienne, il souligne que « le Sahel n’est qu’une péripétie », la menace ayant tendance à s’étendre au-delà de la bande sahélo-saharienne. C’est pourquoi les rapporteurs tiennent à souligner l’intérêt qu’il y a à ne pas délaisser les autres zones de crise, cette préoccupation étant partagée par les autorités militaires. Comme l’a précisé en effet l’état-major de l’armée de terre, notre effort particulier dans la bande sahélo-saharienne « ne signifie pas pour autant un abandon de l’Afrique centrale » : notre capacité d’intervention à partir du Gabon et de Djibouti, demain à partir de la Côte d’Ivoire, « reste importante ».
i. Le schéma général : un maillage étroit dans une vaste région enclavée
• L’état actuel des forces déployées en opération extérieure
Le dispositif français dans la bande sahélo-saharienne s’articule aujourd’hui autour de deux points d’appui principaux :
– Bamako puis Gao, où se concentrent les forces de l’opération Serval, dont l’effectif s’établissait à la date du passage des rapporteurs à 1 800 hommes environ ;
– N’Djamena, où est basé l’essentiel des forces de l’opération Épervier depuis 1986, avec près de 950 hommes.
Ces bases disposent d’un réseau de points d’appui « satellites », c’est-à-dire de bases de format réduit où la force est présente en permanence : Tessalit au Nord-Est du Mali (avec quelques dizaines de personnels), Faya-Largeau (20 hommes) et Abéché (100 militaires) respectivement au Nord et à l’Est du Tchad.
De plus, le dispositif français dans la bande sahélo-saharienne est complété par d’autres points d’appui de format moyen, mais essentiels à la conduite des opérations :
– un déploiement des forces spéciales dans le cadre de la task force Sabre, entrepris à la suite de la prise otage d’Arlit en 2010 en vue d’entretenir une « capacité de réponse dans la région » et dont les effectifs et les implantations ne font pas l’objet de communications publiques ;
– un déploiement (présenté comme temporaire) de l’armée de l’air sur l’aéroport de Niamey, au Niger, où quelques dizaines de personnels opèrent les drones français, y compris les deux premiers Reaper livrés à la France.
• La manœuvre de « régionalisation » de ces déploiements
1./ Le Gouvernement a annoncé, et commence à mettre en œuvre, une manœuvre dite de « régionalisation » de ce dispositif, consistant, globalement, à regrouper les différents déploiements actuels dans la bande sahélo-saharienne en une seule et même opération extérieure, avec un commandement unifié.
Cette manœuvre de régionalisation poursuit à un double objectif :
– adapter l’organisation des forces à une menace désormais transfrontalière et s’étendant à l’échelle de la bande sahélo-saharienne tout entière ;
– optimiser les moyens français déployés, pour tenir compte de la contrainte budgétaire et capacitaire découlant du Livre blanc de 2013.
2./ Comme le ministre de la Défense l’a déjà indiqué à la commission, le dispositif sahélo-saharien « régionalisé » comptera ainsi 3 000 hommes environ, incluant les forces spéciales. Schématiquement, ils seront répartis de la façon suivante :
– 1 300 personnels à N’Djamena au Tchad, qui armeront essentiellement un groupement « air » (doté de chasseurs et de tous les moyens nécessaires à la constitution d’un hub logistique aérien), un groupement « terre » renforcé, et un groupement de renseignement ;
– 1 100 personnels à Gao au Mali, armant principalement un groupement « terre » ;
– 250 à 300 personnels à Niamey, qui resterait un pôle de renseignement majeur, tout en devenant également un hub aérien utilisable tant par l’aviation de transport que par l’aviation de combat ;
– des effectifs réduits dans un réseau de points d’appui secondaires, avec notamment Tessalit au Nord-Est du Mali, Faya-Largeau et Abéché respectivement au Nord et à l’Est du Tchad ;
– des effectifs non-permanents sur d’autres points d’appui utilisés dans le cadre d’opérations ponctuelles menées en coopération avec les forces locales, tels qu’Arlit au Nord du Niger ou Zouar au Nord-Ouest du Tchad, à proximité des frontières nigériennes et libyennes.
L’intérêt d’un positionnement à Gao
Pour l’état-major de l’armée de terre, « Gao semble être le meilleur stationnement d’importance pour pouvoir durer dans la zone ».
● Le site présente « certaines aménités d’un point de vue opératif » :
– du point de vue géopolitique : il est « placé idéalement sur la ligne de fracture entre populations nomades et sédentaires » ;
– du point de vue politico-militaire : il s’agit d’un centre administratif d’importance dans le Nord du Mali ;
– du point de vue de la mobilité : le site constitue un « point clé » puisqu’il est le « verrou de la zone sud du Sahara ». Il est en effet situé sur l’une des deux voies d’accès du Sahara central vers l’Algérie (l’axe Bamako-Niamey-Gao-Reggane-Béchar-Oran / Gardhaia-Alger) avec l’axe Agadez-Tamanrasset-Alger. Il était d’ailleurs identifié comme tel durant le temps de la présence française où une Compagnie Saharienne stationnait à Gao ;
– du point de vue tactique : il est difficile d’envisager d’avoir des bases plus au nord sans tenir Gao, sauf à posséder immédiatement une flotte de vecteurs tactiques lourds (comme l’A400M) pouvant se poser à Tessalit ou à Kidal ;
– du point de vue logistique : Gao possède un aéroport tactique et il est desservi par la voie fluviale Bamako-Gao ainsi que par une route goudronnée depuis la capitale. De ce fait, « la comparaison de coût logistique avec une autre base est à évaluer mais il n’est pas certain que la différence soit fondamentale ».
● Ainsi, selon l’état-major de l’armée de terre, « Gao constitue précisément le meilleur compromis géographique entre les impératifs logistiques – éloignement du Sea Port Of Debarkation (SPOD) mais présence d’une piste en dur et d’infrastructures suffisantes – et les zones d’engagements opérationnels », principalement le Nord-Est malien.
Gao s’articule ainsi avec des points d’appui secondaires. Le maintien d’une base avancée à Tessalit (« une plateforme « relais » ») permet « d’agir efficacement dans la zone frontière avec l’Algérie ainsi que dans l’Adrar des Ifoghas avec des élongations raisonnables pour un soutien temporaire ». Cette base très avancée vers le nord ne permettrait d’y déployer durablement nos forces qu’au prix d’un investissement logistique important que les armées ne sont pas en mesure de supporter : multiplication des vecteurs logistiques aériens, des effectifs associés, création d’infrastructures d’accueil, de maintenance, renforcement notoire des moyens de sécurité dans une zone très instable.
Par ailleurs, étant donné le format extrêmement réduit de la force Serval aujourd’hui, « contrainte par un budget d’opérations extérieures en forte diminution », ce recentrage vers le nord induirait un vide sécuritaire dans les régions de Gao, Ansongo, Menaka et Tombouctou, que ni la MINUSMA ni les Forces armées maliennes « ne sont encore en mesure de contrôler de manière complètement autonome ».
De même, un redéploiement au plus près des points d’entrée côtier rendrait impossible toute action militaire efficace dans le Nord du Mali où se concentre la menace, « sauf encore une fois à un coût exorbitant en hommes et en moyens de projection, principalement aériens ».
● Le chef d’état-major de l’armée de l’air a précisé aux rapporteurs, concernant l’utilité de Gao, qu’« il ne faut certes pas multiplier les implantations », mais que « l’esprit de flexibilité commande de pouvoir disposer de plusieurs plots ». De toute façon, les distances sont tellement longues, « qu’il faut travailler sur plusieurs pays ».
3./ Ainsi, le dispositif « régionalisé » dans la bande sahélo-saharienne s’articulera en un réseau dense de points d’appui.
Comme l’a indiqué aux rapporteurs le chef d’état-major de l’armée de l’air, le corollaire de la mise en place d’un réseau de plots aériens, c’est une « logique de concentration des moyens à Lyon » pour les fonctions qui peuvent être assurées depuis la France. Ainsi, à Mont-Verdun, « la salle y a évolué, avec des gens qui font de la défense aérienne sous l’autorité du Premier ministre, et d’autres qui font de la gestion de théâtre sous l’autorité directe des postes de commandement interarmées de théâtre (PCIAT) de N’Djamena et de Bamako, ainsi que du poste de commandement de l’opération EUFOR RCA en Grèce ». « On optimise ainsi les moyens en jonglant avec les mêmes personnels pour gérer les mêmes moyens, au profit de plusieurs opérations » ; en effet, les chasseurs stationnés à N’Djamena opèrent autant au Mali, actuellement au profit de l’opération Serval, qu’en République centrafricaine, au profit de l’opération Sangaris.
ii. Le centre de gravité : N’Djamena au Tchad
Le choix a été fait de centraliser à N’Djamena le commandement du dispositif militaire français « régionalisé » déployé dans la bande sahélo-saharienne. Lors de leur déplacement au Tchad, les rapporteurs ont pu constater l’avancée des travaux entrepris à cette fin au sein de la base principale de l’actuelle opération Épervier, la base Kosseï à N’Djamena.
N’Djamena possède en effet une position stratégique : placée à l’est de la bande sahélo-saharienne, elle constitue un point de départ très utile pour les moyens aériens destinés à intervenir non seulement dans cette bande, mais aussi en Afrique centrale, comme le montrent l’encadré et la carte ci-après. À ce titre, il s’agit d’un prépositionnement des plus utiles.
« Régionalisation » ou « sahélisation » ?
Comme l’a très bien fait observer aux rapporteurs le colonel Paul Peugnet, commandant de la force Épervier, il ne faudrait pas confondre « régionalisation » et « sahélisation », or ces deux logiques sont à l’œuvre concomitamment dans la manœuvre en cours. En effet :
– la manœuvre prévue revient à organiser les forces terrestres suivant une zone de responsabilité correspondant bien à la bande sahélo-saharienne : on peut dans leur cas parler de « sahélisation » ;
– en revanche, s’agissant des forces aériennes ou du moins de l’aviation de combat, la logique suivie relève davantage d’une « régionalisation » au sens plus vaste renvoyant à l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne qu’à une stricte « sahélisation » du dispositif. En effet, la zone couverte par N’Djamena dépasse la bande sahélo-saharienne. C’est d’ailleurs là un de ses principaux avantages, qu’a fait valoir aux rapporteurs l’ambassadrice de France au Tchad : N’Djamena permet à l’aviation de combat de « traiter » à la fois la bande sahélo-saharienne et l’Afrique centrale, comme l’opération Sangaris l’a montré et comme la carte ci-après l’illustre.
N’Djamena, au carrefour de la bande sahélo-saharienne et de l’Afrique centrale
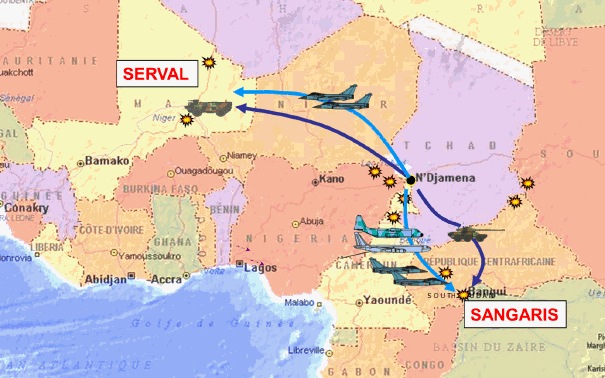
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Épervier).
Rayon d’action d’un Rafale couplé à un C 135 depuis N’Djamena
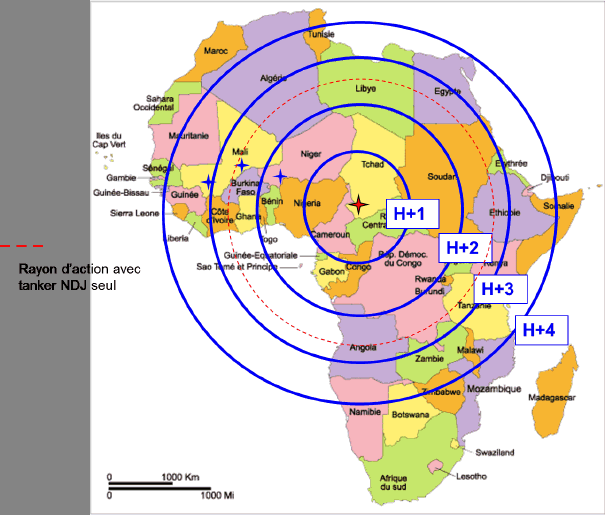
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Épervier).
Néanmoins, comme l’a fait valoir aux rapporteurs le chef d’état-major de l’armée de l’air, si Épervier constitue indéniablement « un point d’appui essentiel », N’Djamena n’est pas moins « loin du Mali : ce sont des missions de sept à neuf heures de Mirage ou de Rafale ».
D’où le choix d’une seconde implantation aérienne majeure dans la bande sahélo-saharienne, à Niamey au Niger, et ce d’autant que le président de la République nigérienne, Mahamadou Issoufou, s’est déclaré, lorsqu’il a reçu les rapporteurs, pleinement opposé aux groupes armés rebelles et ouvert à la coopération avec la France. Comme l’a précisé le général Denis Mercier, il est possible de déployer facilement trois avions de chasse à Niamey, le parking nouvellement construit permettant d’accueillir un ravitailleur en permanence et tous nos drones y étant concentrés (deux Harfang et deux Reaper). « Les Reaper y rendent d’ailleurs un formidable service ». Niamey peut ainsi accueillir deux composantes : d’une part, une composante chasse ; d’autre part, une composante dite ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) qui fait en quelque sorte sa « spécialité », avec non seulement les drones mais aussi les C160 Gabriel et les Atlantique 2, que la base peut accueillir.
Preuve supplémentaire de l’intérêt de cette base, le chef d’état-major de l’armée de l’air a fait valoir qu’il suffit pour s’en convaincre de rappeler que les Américains et les Britanniques cherchent à « s’y mettre dans nos chaussons ».
Ainsi, la bande sahélo-sahélienne sera couverte par deux hubs aériens équipés pour l’aviation de classe et la logistique :
– Niamey dans le « fuseau ouest » de la bande sahélo-saharienne, relié à la mer par Abidjan pour ses approvisionnements ;
– N’Djamena dans le « fuseau est » de la bande, relié à la mer par Douala.
En revanche, selon les précisions fournies aux rapporteurs, il n’est pas envisagé de transformer la piste d’aviation de Gao de sorte qu’elle puisse accueillir des chasseurs : tout au plus pourrait-elle être rallongée pour faciliter certaines opérations logistiques, notamment pour accueillir des A400M.
Lors de leurs déplacements, les rapporteurs ont pu constater avec quelle efficacité les forces françaises étaient capables de mettre en place les infrastructures nécessaires au déploiement des « plots » aériens indispensables pour la conduite des opérations. À cet égard, il y a lieu de saluer la qualité du travail accompli par le « groupement d’appui aux opérations » de l’armée de l’air basé à Bordeaux, le 25e régiment de génie de l’air (25e RGA) et le groupement tactique des communications (GTSIC). Selon les termes du général Denis Mercier, ce sont « trois unités de l’ombre, indispensables » : « ils sont partout, tout le temps déployés (un peu trop : c’est tendu) ».
Niamey : le pôle « renseignement » du dispositif sahélo-sahélien
Lors de leur déplacement au Niger, les rapporteurs ont pu se rendre sur la base française installée sur l’aéroport international de Niamey, pour en étudier la configuration et l’activité ainsi que les premiers résultats donnés par les drones Reaper récemment livrés à la France.
1./ Une implantation nouvelle, utilement placée au cœur de la bande sahélo-saharienne
La base aérienne française de Niamey est installée sur l’emprise de l’aéroport international de Niamey : elle est ainsi co-localisée avec une base militaire nigérienne et une base aérienne américaine. La base française a été initialement installée pour accueillir des drones, et elle est en cours de réaménagement en vue de pouvoir accueillir également des avions de chasse, des Atlantique 2 et des ravitailleurs C-135. Cette base accueillait, au jour du déplacement des rapporteurs, 270 personnels militaires français et 18 contractuels américains, employés en vue de permettre l’appropriation progressive des Reaper par les Français.
La dite base américaine, qui opère elle aussi des drones de surveillance, pourrait être déplacée au centre du pays, à Agadez. Comme le chargé d’affaires des États-Unis l’a indiqué aux rapporteurs, il s’agit en tout cas d’une demande des autorités nigériennes, qui y voient un moyen de développer des infrastructures dans une région centrale du pays. Si des discussions sont en cours entre les États-Unis et le Niger concernant les conditions de sécurisation de cette nouvelle base, les Français y voient un avantage : dans la lignée de l’excellente collaboration qu’ils entretiennent avec les Américains au Niger et compte tenu du fait que les deux forces sont armées de Reaper, il serait envisageable de rendre interopérables la base française de Niamey et une future base Américaine d’Agadez. Ainsi, un drone français pourrait, en cas de problème technique ou simplement afin de maximiser la distance qu’il peut couvrir en un vol (son playtime étant limité à 17 heures de vol), atterrir sur une base américaine – et vice-versa.
Contrairement aux Américains, qui opèrent un grand nombre de drones et ont donc centralisé une large partie des fonctions de pilotage et d’exploitation aux États-Unis, les Français opèrent à Niamey une structure dont il faut souligner la légèreté et la souplesse. En effet, les fonctions de pilotage, de guidage, de lecture, de description et d’analyse sont effectuées directement sur le théâtre. Il en résulterait pour les Français une réactivité supérieure à celle des Américains.
2./ Un équipement considérablement amélioré avec la livraison des Reaper
Les rapporteurs ont pu profiter de leur déplacement sur la base de Niamey pour étudier les avantages procurés par l’acquisition, un temps controversée, de deux drones Reaper livrés à Niamey et qui y ont effectué leur premier vol en condition opérationnelle le 19 janvier 2014. Leur mise en service opérationnelle a été validée le 23 février, et seules deux restrictions restent à lever, concernant l’utilisation de certaines technologies laser et de certains moyens de géolocalisation.
La comparaison des images fournies par le Reaper et par le Harfang suffit à convaincre de l’intérêt qu’il y avait, pour les forces, à s’équiper de drones modernes de moyenne altitude et de longue endurance (MALE).
Le commandement de la base comme les personnels qui opèrent ces systèmes de drones se sont dits très satisfaits de ce nouvel outil. Interrogés sur l’« européanisation » souvent évoquée des capteurs embarqués par ces vecteurs, ils se montrent sceptiques : selon eux, si l’on peut regretter que ce soient les Américains qui aient « fixé les standards » en la matière, aucun industriel européen ne maîtrise suffisamment ces technologies pour offrir aux forces les mêmes capacités. Le Reaper tel qu’il est équipé aujourd’hui permet en effet d’analyser très précisément des cibles à 11 kilomètres de distance.
Ils ont fait valoir également que les drones Reaper pourraient très aisément être armés, et donc très rapidement être employables si, un jour, les autorités politiques françaises décidaient de briser le « tabou » pesant sur les drones armés.
Avec l’achat de drones américains, armant une base co-localisée avec une base américaine qui, par ailleurs, emploie 18 contractuels américains, il n’était pas illégitime de se demander si les renseignements français étaient dûment protégés contre tout risque de captation – le principe d’autonomie stratégique exigeant une parfaite étanchéité dans la circulation des informations sensibles recueillies par les drones français. Les responsables français de la mise en œuvre de ces appareils ont assuré aux rapporteurs que les dispositifs techniques utilisés garantissaient la sécurité des données captées par ces deux drones.
3./ Une base dont l’aménagement et le fonctionnement sont relativement coûteux
Outre le coût des liaisons satellitaires nécessaires à l’exploitation des drones, la base de Niamey a un coût assez élevé, du fait :
– des importants travaux d’infrastructures réalisés au fur et à mesure de sa montée en puissance : construction d’une zone consacrée aux Reaper, construction d’un « plot chasse » pour accueillir les Mirage et les Rafale, construction de parkings, amélioration des « zones vies » initialement dimensionnées pour quelques dizaines de personnels seulement, etc.. Des « travaux de Romains », pour reprendre les termes utilisés devant les rapporteurs ;
– d’autres travaux d’infrastructures rendus nécessaires par la configuration des emprises concédées par le Niger. Les emprises françaises sont en effet « dispersées au sein d’une base poreuse », comme l’a expliqué le commandant du détachement français, du fait du souhait des autorités nigériennes que soient séparées les zones opérationnelles et les zones de vie. Il en résulte des coûts de surveillance et de sécurisation d’autant plus élevés que si les Nigériens sont censés assurer la défense de l’emprise militaire au sein de laquelle sont insérées les emprises françaises, il ressort des entretiens qu’ils sont parfois « lents » à réagir aux menaces. Les Français sont donc tenus d’entourer leurs emprises de systèmes défensifs propres.
Afin de réduire au maximum les coûts de fonctionnement et d’investissements afférents à cette base, une mutualisation de davantage de fonctions avec les Américains a été recherchée. D’ailleurs, ces derniers opéreraient certaines missions au profit de la direction du renseignement militaire (DRM) française.
4./ Un instrument de coopération opérationnelle poussée avec le Niger
La partie nigérienne trouve dans son accord avec la partie française des avantages substantiels, en matière de coopération opérationnelle notamment :
– le renseignement recueilli est systématiquement partagé avec les forces nigériennes. Les rapporteurs ont d’ailleurs pu constater que des officiers nigériens avaient leur poste auprès des officiers français et suivaient ainsi le processus de renseignement « en temps réel » ;
– la France s’est engagée à ce que le détachement français opère un vol de drone toutes les trois semaines au profit des Nigériens ;
– les forces françaises mènent des opérations conjointes avec les forces nigériennes ;
– si les accords franco-nigériens donnent à la France le droit de mener seule des opérations sur le territoire nigérien, y compris en y pratiquant des frappes, il a été indiqué aux rapporteurs que, dans la pratique, le commandement français se donne pour ligne de conduite de s’en tenir à une logique d’appui aux Nigériens. Il demande ainsi systématiquement l’avis des autorités militaires nigériennes avant d’engager une opération. Une « boucle courte » de concertation a été mise en place à cet effet avec le chef d’état-major général des armées du pays hôte.
Il est à noter qu’en cela, la coopération franco-nigérienne est nettement plus étroite que la coopération américano-nigérienne. En effet, comme l’a confirmé le chargé d’affaires des États-Unis, s’il arrive aux forces américaines de communiquer certaines informations aux Nigériens – parfois à leur demande –, le partage de renseignement n’a rien de systématique, et les officiers nigériens n’ont pas d’accès aux installations américaines d’opération des drones. Le chargé d’affaires y voit « un enjeu de protection des sources et des secrets, sur lequel la bureaucratie américaine est tatillonne ». Comme il l’a fait observer, « de toute façon, les États-Unis ont bien d’autres moyens de surveillance que les drones », et « en tout état de cause, la modeste capacité d’intervention des forces nigériennes ne leur permettrait certainement pas d’exploiter pleinement toutes les informations que les États-Unis seraient susceptibles de leur fournir ».
2. L’ambitieuse manœuvre de restructuration a débuté, non sans se heurter aux difficultés liées aux opérations en cours
Les déplacements effectués par les rapporteurs leur ont permis de faire le point de l’état d’avancement de la manœuvre de reconfiguration de notre dispositif permanent en Afrique ainsi que de la manœuvre de régionalisation de notre dispositif en opération extérieure dans la bande sahélo-saharienne.
a. Planification et état d’avancement de la manœuvre de réaménagement
i. Au sein du dispositif permanent : une restructuration rapide des Forces françaises au Gabon, futurs Éléments français au Gabon
• Le plan de restructuration des Forces françaises au Gabon : une mise en œuvre rapide
Le déplacement des rapporteurs à Libreville leur a permis de faire le point sur la planification de la manœuvre tendant à transformer les Forces françaises au Gabon, aujourd’hui base opérationnelle avancée (BOA) en Éléments français au Gabon tenant un pôle opérationnel de coopération (POC).
Il en ressort que dans la planification de cette manœuvre, a été retenu un calendrier très serré : l’essentiel des transformations seront opérées dès l’été 2014, alors même qu’une part conséquente des moyens des Forces françaises au Gabon arme encore la force Sangaris déployée en République centrafricaine. Le schéma ci-après présente la planification de cette manœuvre.
MANœUVRE DE TRANSFORMATION DES FORCES FRANÇAISES AU GABON
EN ÉLÉMENTS FRANÇAIS AU GABON
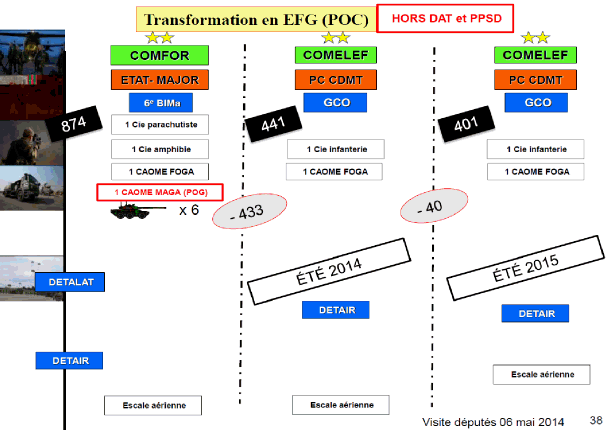
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
Les conséquences de cette manœuvre sur les ressources humaines en rendent la mise en œuvre complexe. En effet, comme l’a expliqué l’adjoint interarmées (AIA) du commandant des Forces françaises au Gabon, le « court préavis » laissé au commandement pour organiser cette manœuvre a conduit à modifier substantiellement le plan annuel de mutations pour 2014. Le tableau ci-après montre bien la rapidité de la déflation engagée.
DÉFLATIONS PLANIFIÉES DES EFFECTIFS DES FORCES FRANÇAISES AU GABON
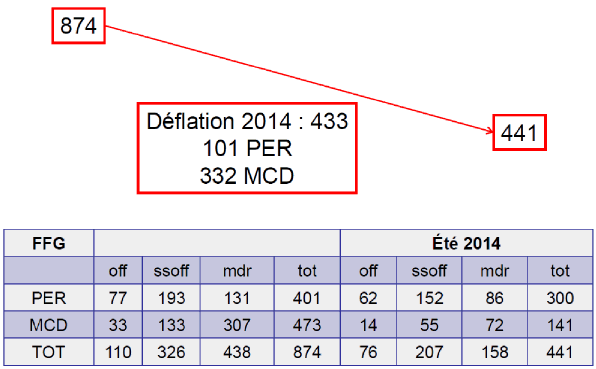
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
Il n’est prévu ni déflation pour les 11 personnels civils d’État de la base - les déflations portant uniquement sur les personnels militaires -, ni mouvement de « civilianisation » de postes : contrairement à ce qui a été fait à Dakar, il n’y a pas de transformation de postes de personnels militaires en postes civils. Il n’est pas prévu non plus de recourir massivement aux externalisations. Les effectifs de personnels civils de recrutement local seront réduits.
Fait notable, les Forces françaises au Gabon disposent aujourd’hui d’infrastructures qui, certes, appartiennent en propre à la France, mais que les responsables locaux jugent étroites – les rapporteurs ont d’ailleurs pu le constater sur place. En conséquence, la réduction de l’empreinte militaire française au Gabon n’aura que marginalement des conséquences sur les infrastructures : la petite base de Port-Gentil est appelée à être rétrocédée, ainsi que certaines installations de logements et de loisirs à Libreville, pour beaucoup louées par les Forces à des bailleurs locaux privés.
Le maintien de l’essentiel des infrastructures actuellement occupées par les Forces françaises au Gabon a plusieurs conséquences. Certaines sont à juger favorablement :
– à moyen ou long terme, il facilite une éventuelle remontée en puissance de cette base, si le besoin s’en faisait sentir dans les années à venir. Les rapporteurs jugent très favorablement le fait d’éviter des cessions d’emprises, souvent irréversibles, et toujours perçues comme des marques d’« abandon » ;
– à court terme déjà, l’absence d’opérations immobilières à mener constitue un facteur de complication en moins pour la conduite de la manœuvre de restructuration.
D’autres conséquences sont moins avantageuses :
– les économies dégagées n’en sont que plus limitées ;
– le maintien des infrastructures ne contribue pas à réduire la charge de travail du groupement de soutien de la base, alors que celui-ci devra réduire très significativement ses effectifs.
La mission logistique de Douala verra elle aussi ses effectifs légèrement réduits : elle emploie aujourd’hui 10 personnels civils de recrutement local et neuf militaires ; l’effectif de ces derniers devrait être ramené à huit. De plus, un projet d’externalisation à l’Économat des armées – établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Défense – est en cours d’examen. Compte tenu des accords de coopération et de défense passés entre la France et le Cameroun, qui prévoient que cette mission logistique a un caractère militaire, il faudra en tout état de cause y maintenir un personnel militaire.
• Les mesures prises à Abidjan pour accueillir la future base opérationnelle avancée : des travaux à moindre coût
Lors de leur déplacement sur les emprises de l’actuelle force Licorne, appelées à être dévolues aux futures Forces françaises en Côte d’Ivoire, les rapporteurs ont pu constater que les installations de la force Licorne – détenues pour la plupart par la France depuis l’indépendance du pays – étaient tout à fait adaptées à l’accueil d’une force plus importante.
La force Licorne dispose en effet d’installations intéressantes sur l’ensemble du territoire ivoirien, et particulièrement à Abidjan, au camp de Port-Bouët, dont les rapporteurs ont pu apprécier à la fois l’étendue et la localisation stratégique, dont témoignent les cartes ci-après. Ainsi, les travaux nécessaires à l’accueil de la nouvelle base opérationnelle avancée (BOA) d’Abidjan seront limités.
LES INSTALLATIONS DE LA FORCE LICORNE SUR LE TERRITOIRE IVOIRIEN
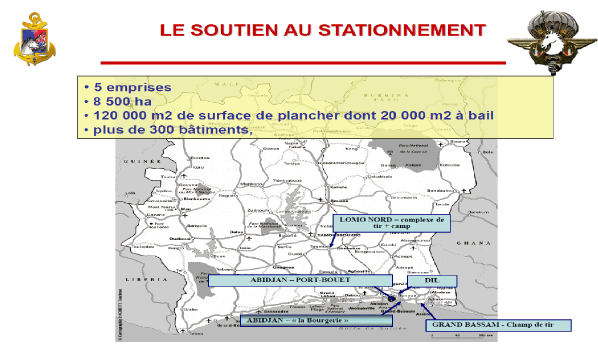
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
LES POTENTIALITÉS DU CAMP DE PORT-BOUËT – VUE D’ENSEMBLE
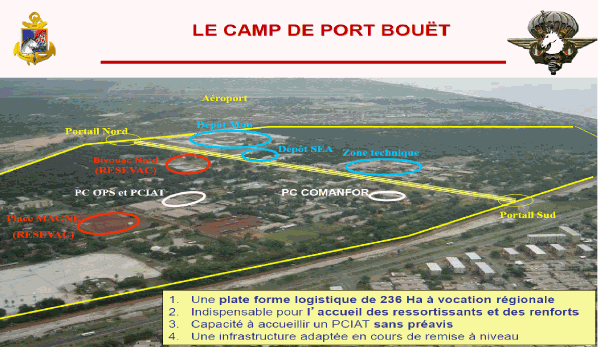
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
LES POTENTIALITÉS DU CAMP DE PORT-BOUËT – PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

Source : état-major des armées (commandement de l’opération Licorne).
ii. Au sein de la bande sahélo-saharienne : consolidation des bases de Gao et de N’Djamena
• Gao, un défi logistique
Lors de leur déplacement à Gao, les rapporteurs ont pu constater les efforts faits pour permettre l’installation dans la durée des forces françaises sur ce site dont l’intérêt stratégique a été démontré plus haut. La comparaison de ce qu’ils ont vu sur le terrain avec la description que faisaient de la même base nos collègues Christophe Guilloteau et Philippe Nauche dans leur rapport précité suffit à se convaincre de l’ampleur des progrès qui ont été réalisés en quelques mois dans l’aménagement de cette base.
Le principal défi, dans le fonctionnement de cette base, tient à l’organisation des flux logistiques, compliqués notamment par les élongations et les conditions de transport. La carte ci-après présente l’activité du bataillon logistique « Camargue » de la base de Gao.
L’ACTIVITÉ DU BATAILLON LOGISTIQUE « CAMARGUE » DE LA BASE DE GAO
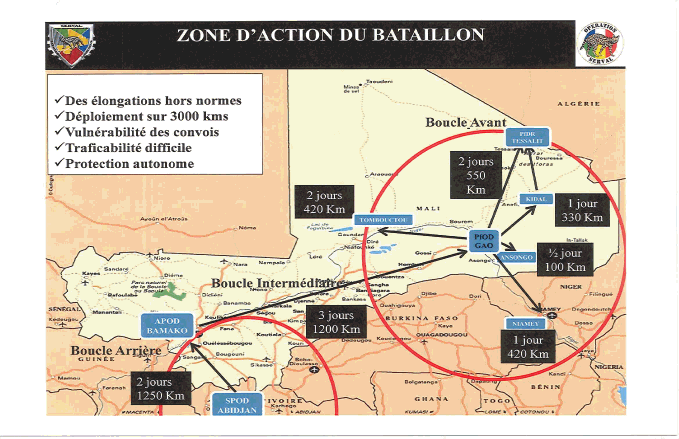
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Selon le chef d’état-major de l’armée de l’air, rien de concret n’est prévu à ce stade pour l’allongement de la piste de Gao : la France a construit une piste en latérite, qui ne permet aujourd’hui de poser que des avions de transport tactique et des hélicoptères. L’ONU aurait un projet d’allongement de la piste, mais rien ne semble décidé. « Les travaux seraient lourds : allongement, élargissement, protection, etc. ». Néanmoins, « cela nous aiderait… ».
• N’Djamena, un point d’appui central en cours de renforcement
À N’Djamena, les rapporteurs ont pu constater sur place que d’importants travaux d’infrastructures avaient été engagés sur la base Kosseï en vue de l’accueil des 300 personnels supplémentaires que cette emprise devrait recevoir en application du plan de « régionalisation » de notre dispositif sahélo-saharien.
Les rapporteurs ont porté une attention particulière à la question des approvisionnements des principaux points d’appui du futur dispositif sahélo-saharien unifié, Gao et N’Djamena. S’il est évident que N’Djamena offre une très appréciable possibilité de rayonnement à l’aviation de chasse, bien au-delà de la bande sahélo-saharienne, il n’en demeure pas moins que cette position est relativement enclavée.
En effet, il faut plus de 30 jours pour acheminer du fret par voie maritime depuis la France jusqu’à N’Djamena, comme le montre la carte ci-après. De ce fait, les liaisons par voie aérienne (militaire ou civile) sont indispensables pour l’acheminement du fret urgent.
DURÉE DES ACHEMINEMENTS STRATÉGIQUES POUR N’DJAMENA
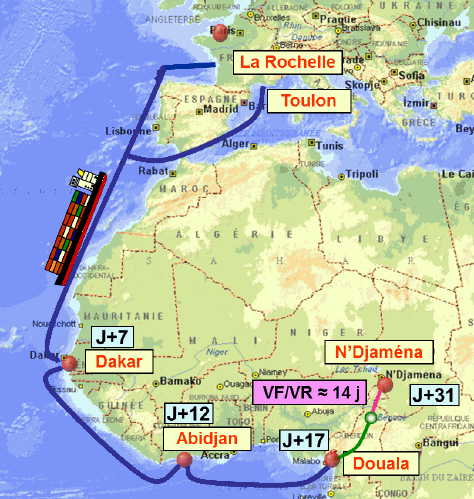
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Épervier).
b. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la manœuvre de restructuration du dispositif permanent et de régionalisation dans la bande sahélo-saharienne
i. D’inévitables réticences dans les bases permanentes appelées à subir une forte déflation
• Les difficultés rencontrées au Gabon
Le déplacement au Gabon a permis de faire le point sur la façon dont a été perçue, tant par les autorités gabonaises que par les militaires français, l’annonce de la réduction planifiée du format de notre présence militaire.
L’ambassadeur de France a exposé aux rapporteurs les trois principales « lignes rouges gabonaises » dans cette affaire :
– la première était d’ordre diplomatique : le Gabon tenait à ce que les forces françaises demeurent dirigées par un officier général, ce qui ne posait pas de problème particulier pour la partie française ;
– la deuxième était d’ordre économique : la forte réduction des effectifs français à Libreville n’est pas sans impact sur la vie économique locale, comme le décrit l’encadré ci-après. Des garanties auraient été fournies pour éviter le licenciement d’employés locaux de nationalité gabonaise ;
– la troisième était d’ordre opérationnel : les forces armées gabonaises craignaient de perdre un appui important pour la défense de leur pays et pour la modernisation de leurs armées. Toutefois, les nouvelles missions des Éléments français au Gabon, axées principalement sur la coopération opérationnelle, sont de nature à les rassurer.
Les rapporteurs ont pu approfondir la discussion sur ces thèmes avec le commissaire général Jean-Felix Sockat, secrétaire général du ministère gabonais de la Défense. Celui-ci leur a déclaré que les autorités gabonaises, bien entendu, « prenaient acte » de la décision française, tout en soulignant avec force qu’à son avis personnel, « ce n’est pas au détriment des armées qu’il faut faire des économies : la paix n’a pas de prix, mais elle a un coût ». Quoi qu’il en soit, et pour ce qui concerne la partie gabonaise, il a indiqué aux rapporteurs qu’« après cinquante ans de coopération avec le 6e bataillon d’infanterie de marine », ce n’était pas sans « nostalgie » qu’il voyait disparaître cette unité. Et de conclure toutefois avec une certaine philosophie : « mais après tout, qu’y a-t-il de plus permanent que le changement ? ».
Il a surtout souligné la « forte implication des Forces françaises au Gabon dans le tissu local », relevant au passage que le quartier qui environne le camp De Gaulle est communément appelé « quartier De Gaulle »… Il a salué toutefois le maintien d’une structure militaire française consacrée à la coopération opérationnelle, estimant qu’avec celle-ci, « on ne peut pas parler de désengagement ».
L’impact économique de la présence des Forces françaises au Gabon
Selon les évaluations fournies aux rapporteurs par le groupement de soutien des Forces françaises au Gabon, le budget annuel de fonctionnement des forces a un impact non négligeable sur la vie économique locale. Ce budget s’élève pour 2014 à 16,6 millions d’euros de dotation, auxquels il convient d’ajouter 20,2 millions d’euros au titre des opérations extérieures.
Certes, la totalité de ces fonds ne revient pas à l’économie gabonaise. Mais selon les évaluations du groupement de soutien, l’impact sur l’économie gabonaise peut être estimé en 2014 à 28,7 millions d’euros, au titre notamment des dépenses suivantes : les salaires des personnels civils de recrutement local – qu’ils soient employés par la base sur son budget ou par le Cercle Pompidou, qui les finance sur ses recettes propres – ; les loyers versés pour la location de 200 appartements ; les achats locaux effectués par la base ; les achats locaux effectués à titre privé par les personnels de la base et leurs familles ; une part des soldes des personnels en mission de courte durée ; et les achats locaux du Cercle Pompidou pour son approvisionnement et son soutien général.
En outre, le lycée français risque, selon l’ambassadeur, de perdre plusieurs professeurs car une part non négligeable d’entre eux sont recrutés parmi les conjoints des militaires français.
Surtout, la base fait vivre une communauté de 1 181 Français, dont 288 familles avec 473 enfants.
Plus généralement, un certain nombre des interlocuteurs des rapporteurs, à l’image du général Jacques Norlain, ont souligné « l’importance manifeste » de Libreville « dans une zone où l’avenir de certains pays, comme l’énorme République démocratique du Congo, reste plein de menaces ». En outre, comme les rapporteurs ont pu le constater eux-mêmes lors de leur déplacement au Centre d’aguerrissement outre-mer (CAOM) spécialisé en milieu forestier équatorial, le Gabon constitue un terrain idéal pour former les unités aux particularités au combat en zone de forêts profondes, qui, selon le général Jacques Norlain, constituent encore « des zones d’action possibles ».
• Les difficultés rencontrées à Djibouti
La déflation envisagée à Djibouti a un impact d’autant plus fort sur la vie locale qu’à la différence du Gabon, cet État dispose de peu de ressources par habitant, et que les FFDj n’en contribuent que davantage à la vie économique et sociale locale.
Le meilleur exemple de l’impact qu’aura leur forte déflation sur le contexte local est la rétrocession de l’hôpital Bouffard, dont l’encadré ci-après présente les enjeux. Dans un récent rapport public thématique, la Cour des comptes avait montré que le fonctionnement de cet hôpital en faisait un véritable outil d’aide au développement et de rayonnement, plutôt qu’une structure de soutien sanitaire strictement adaptée aux besoins des forces françaises. Dès lors, sa rétrocession prévue dès 2015 par le traité de coopération en matière de défense signé entre la France et Djibouti le 21 décembre 2011, entraîne la perte d’un avantage précieux pour la population djiboutienne.
Le cas particulier de l’hôpital Bouffard de Djibouti
Le service de santé des armées entretient à Djibouti le groupe médico-chirurgical Bouffard au profit des 3 000 militaires français basés dans cette République. Ce véritable centre hospitalier permanent, « en dur », de 56 lits, est le dernier des hôpitaux militaires actifs outre-mer. Avec un budget annuel de plus de 16 millions d’euros, il emploie 79 militaires (dont 45 permanents) et 75 civils de recrutement local. Il a produit près de 12 000 journées d’hospitalisation en 2008, soit un taux d’occupation des lits faible (54 %), comparable néanmoins à celui des hôpitaux militaires de métropole.
L’hôpital Bouffard consacre 20 % de son activité au soin des militaires français et de leurs familles. La plus grande partie est remboursée par la caisse de sécurité sociale militaire. 16 % de l’activité se font au profit des civils djiboutiens qui peuvent payer le tarif « adapté » mis en place en 2004 mais qui n’est que faiblement recouvré (0,35 million d’euros sur 1,7 million d’euros effectivement facturés, correspondant à une activité dont le coût réel est estimé à 2,6 millions d’euros).
Le solde reste à la charge du service de santé qu’il s’agisse de l’activité de l’hôpital consacrée aux forces armées djiboutiennes et de leurs familles qui sont soignées gratuitement (50 %) ou réalisée au profit de la population civile djiboutienne qui ne peut payer le tarif adapté (14 %).
L’hôpital Bouffard est donc avant tout une structure de coopération civile et militaire, qui s’inscrit dans un protocole diplomatique et financier entre la France et Djibouti. L’aide civilo-militaire réalisée au profit de la population civile djiboutienne est comptabilisée dans la contribution annuelle totale versée au gouvernement djiboutien. En revanche, les soins fournis gratuitement aux militaires et gendarmes djiboutiens et à leurs familles ne sont pas pris en compte, ni même portés à la connaissance des autorités djiboutiennes alors qu’ils peuvent être valorisés à plus de huit millions d’euros.
Le service de santé des armées ne doit pas supporter l’ensemble des coûts de fonctionnement de cette structure. D’un point de vue militaire en effet, un simple centre médical interarmées « renforcé », réservé aux seuls militaires français et à leurs familles, pourrait suffire.
Dès lors, les charges correspondant aux soins pour les militaires djiboutiens devraient faire l’objet d’une convention de remboursement avec le ministère français des Affaires étrangères, en raison de la dimension exclusivement politique de cette action. Les charges supportées au profit de la population civile djiboutienne (plus de 4,5 millions d’euros) pourraient faire l’objet d’une déclaration pour le calcul de l’aide publique au développement.
Cour des comptes, rapport public thématique « Médecins et hôpitaux des armées », octobre 2010.
ii. La « régionalisation » du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne : un retard lié à la situation au Mali
Après les événements survenus dans le Nord en mai 2014, qui ont vu le MNLA et d’autres groupes rebelles alliés prendre le contrôle de plusieurs localités du Nord, le désengagement de la force a été suspendu, et les effectifs présents à Gao ont même été renforcés par une centaine de personnels supplémentaires. Le ministre de la Défense s’en est d’ailleurs expliqué devant la commission (4).
De même, la « bascule » du poste de commandement interarmées de théâtre de l’opération Serval, planifiée pour la fin du premier semestre 2014, a été suspendue pour plusieurs semaines, sans qu’une nouvelle échéance précise soit explicitement fixée.
Ainsi, l’insécurité persistante dans le Nord du Mali a pour effet de retarder la manœuvre de régionalisation du dispositif français déployé dans la bande sahélo-saharienne.
3. Un point d’attention majeur : le sort de Djibouti
À l’occasion de leurs différents déplacements auprès de toutes les forces françaises stationnées en Afrique, les rapporteurs ont pu prendre la mesure des difficultés comme des opportunités que présente le vaste plan de réorganisation en cours. Mais si, dans la plupart des cas, les difficultés mises en lumières semblent pouvoir être réglées sans remettre en cause les lignes directrices de ce plan de restructuration, le cas de Djibouti leur est apparu tout à fait spécifique.
Il s’agit en effet – encore – aujourd’hui de notre principal point d’appui dans notre dispositif outre-mer et à l’étranger, et la déflation envisagée soulève de très réelles difficultés. De sérieux doutes sont exprimés, de façon argumentée, sur la crédibilité du dispositif qu’il est envisagé d’y maintenir, tant du point de vue de la protection des intérêts français dans une zone particulièrement dangereuse - l’attentat du 24 mai revendiqué par le groupe terroriste Shebab l’a montré -, que du point de vue de la capacité de la France à honorer sa signature, c’est-à-dire à mettre en œuvre les moyens militaires qu’elle s’est engagée à maintenir à Djibouti dans le cadre du nouvel accord de coopération en matière de défense
a. Un point d’appui du plus haut intérêt stratégique pour la France
i. Une situation géostratégique exceptionnelle
Tous les interlocuteurs des rapporteurs, tant à Paris qu’à Djibouti, se sont accordés à souligner l’intérêt stratégique d’une implantation à Djibouti.
Ainsi, pour l’amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère des Affaires étrangères, Djibouti est « un positionnement extraordinaire », qu’il n’est « pas imaginable de quitter », car « il a toujours été et restera stratégique ». Il a déclaré aux rapporteurs : « je ne connais pas d’autre endroit dans le monde où la gamme de nos intérêts soit aussi large pour un emplacement aussi réduit ». D’ailleurs, 95 % des échanges extracommunautaires français se font par voie maritime, et de plus en plus vers l’Asie, tandis que 30 % du pétrole transporté dans le monde passe au large de Djibouti, comme le montre la carte ci-après. De même, le général Jacques Norlain, ancien officier des troupes de marine et ancien conseiller pour les questions de sécurité à la présidence de Côte d’Ivoire et à celle du Gabon, a fait valoir aux rapporteurs que Djibouti était « la porte de l’océan Indien » et offrait « une possibilité d’agir rapidement dans une zone qui a toujours été fortement convoitée », et qui « reste une zone à risques ».
DJIBOUTI, UN POINT DE CONTRÔLE STRATÉGIQUE DU TRAFIC MARITIME MONDIAL
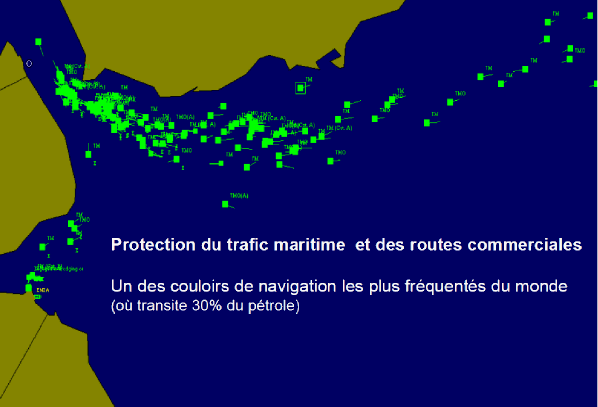
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
L’ambassadeur de France à Djibouti a ajouté devant les rapporteurs que l’intérêt d’une présence française devait s’apprécier à la lumière d’une analyse prospective portant sur les dix à quinze ans à venir. Or, à cet égard, Djibouti possède des atouts appréciables : si son territoire est exigu, son développement économique est rapide et il n’est pas improbable que des gisements d’hydrocarbures soient découverts dans la région. Il convient aussi de noter que c’est au large de Djibouti que se trouve le principal nœud de câbles sous-marins de télécommunications desservant l’Afrique de l’Est : presque tout Internet en Afrique de l’Est passe ainsi par Djibouti, ce qui constitue un enjeu autant économique que sécuritaire. En tout état de cause, selon l’expression employée plusieurs fois devant les rapporteurs, Djibouti dispose d’atouts qui lui permettraient d’être une sorte de « Singapour de l’Afrique de l’Est ». L’ambassadeur a d’ailleurs estimé que « Djibouti a toutes les cartes en main pour être la première puissance maritime de l’Est de l’Afrique », et que les autorités djiboutiennes, auparavant peu sensibles aux enjeux de défense maritime – on dit souvent que Djibouti était « un port qui regarde vers la terre » – sont « de plus en plus impliquées » dans les efforts faits pour sécuriser la région, notamment dans le cadre des opérations Atalanta et Ocean Shield. Pour l’ambassadeur, en outre, la dégradation de la situation sécuritaire dans le Golfe de Guinée plaide en faveur de la sécurisation d’une seconde voie, par l’Est de l’Afrique, pour assurer l’approvisionnement de l’Europe depuis l’Asie et le Moyen-Orient.
ii. Un point d’appui indispensable dans une zone de plus en plus instable en général, et de plus en plus menaçante pour les intérêts français en particulier
Djibouti a longtemps été présenté comme « un havre de paix dans une région instable ». Si l’instabilité générale de la région n’est pas à démontrer, l’attentat survenu le 24 mai 2014 contre un lieu fréquenté par les ressortissants occidentaux – notamment les Français – et revendiqué par les Shebabs conduit à penser que désormais, Djibouti comme le reste des pays voisins représente une zone de risques pour les intérêts et les ressortissants français. L’ambassadeur de France a d’ailleurs souligné que cette menace terroriste, « extrêmement présente », a ceci de particulier qu’elle « vise expressément la France, soit à travers ses implantations stratégiques, soit à travers ses intérêts et ses ressortissants ».
• Djibouti, pivot d’une région instable où les intérêts français sont particulièrement menacés
Dans la Corne de l’Afrique, la menace prend schématiquement deux formes principales :
– des groupes terroristes actifs notamment au Yémen (avec Al-Qaïda dans la Péninsule arabique) et en Somalie (avec notamment les Shebabs) ;
– les actes de piraterie perpétrés au large de la Corne de l’Afrique.
1./ La piraterie
Comme le montre la carte ci-après, la piraterie constitue une menace croissante au large de la Corne de l’Afrique depuis les années 2000.
ÉVOLUTION DU RAYON D’ACTION DES PIRATES ENTRE 2005 ET 2010
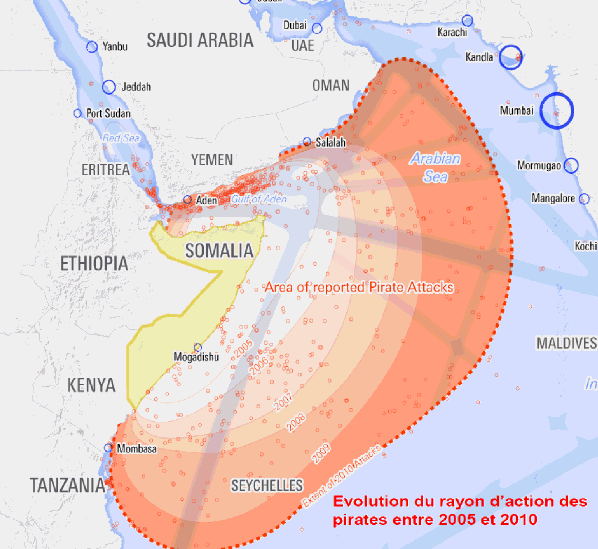
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
Plusieurs opérations internationales ont été menées en vue de maîtriser la menace maritime dans la Corne de l’Afrique. Il s’agit des opérations :
– Atalanta, première opération maritime de l’Union européenne, lancée le 11 décembre 2008 dans le Golfe d’Aden et le bassin somalien, en vue de « contenir » la piraterie ;
– EUCAP NESTOR, opération civile de l’Union européenne visant notamment à renforcer les capacités des États de la Corne de l’Afrique en matière de surveillance maritime ;
– Ocean Shield, contribution de l’OTAN aux activités internationales de lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique et dans le Golfe d’Aden.
Si, selon l’ambassadeur de France, ces opérations ont connu un succès incontestable, il est à craindre « qu’une réduction trop rapide de leur format ne conduise à une reprise de la piraterie ». Dès lors, Djibouti reste un point d’appui indispensable dans ce dispositif.
2./ La menace terroriste
Sans entrer dans une analyse détaillée des conflits dans la Corne de l’Afrique, les rapporteurs tiennent à souligner que cette zone devient une région à haut degré de risque, y compris terroriste. Les principales menaces sont les suivantes :
– Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), dont les bases principales se situent au Yémen, en face des côtes djiboutiennes ;
– les Shebabs, groupe armé djihadiste dont l’épicentre est la Somalie.
Au Yémen, comme le présente en détail l’encadré ci-après, la menace tient à la fois aux faiblesses de l’État central – encore marqué par la division du pays durant la guerre froide et les ambitions des tenants de l’ancien président Ali Abdallah Saleh –, les divisions tribales et les fortes positions d’AQPA. Selon les informations fournies à Djibouti par les autorités compétentes, la société Total a beaucoup investi au Yémen, et se trouve désormais en position de grande vulnérabilité : elle est désormais contrainte de passer des arrangements de toute nature avec certaines tribus pour éviter le sabotage de ses installations.
La situation sécuritaire au Yémen, face à Djibouti
1. Généralités
La culture tribale et le poids de l’histoire politique et religieuse yéménite ont forgé une situation extrêmement complexe. Les conflits d’intérêts claniques, les luttes d’influence, les dettes d’honneur, les revendications religieuses et une réunification pas encore finalisée dans un contexte de « printemps arabe » sont autant de facteurs de troubles et tensions qui rendent extrêmement difficile le règlement de la crise yéménite. Le 18 mars 2013 a été marqué par le début de la conférence pour le dialogue national et la rédaction d’une nouvelle Constitution, mais ses avancées sont lentes : six mois de retard, report des élections législatives de février 2014 repoussées à février 2015, et prorogation d’un an du mandat du président Hadi.
2. Situation sécuritaire actuelle
Les islamistes continuent à conquérir des territoires tout en maintenant la pression terroriste sur Aden. Le Sud indépendantiste manifeste régulièrement son opposition au pouvoir central. Ces manifestations mobilisent plusieurs milliers de personnes et sont souvent durement réprimées. De plus, ces deux menaces collatérales continuent à monter en puissance : les Houtistes étendent leur zone d’action en tentant de contrôler les accès vers l’Arabie et de gagner un accès à la mer.
La situation générale peut être caractérisée ainsi :
– islamisme radical, conflits tribaux (Nord, Saada), insurrections armées (Sud, Taez) ;
– activisme d’AQPA dans le Sud et Sud-Ouest ;
– affrontements chiites / sunnites dans le Nord.
– multiplication des assassinats, enlèvements et attaques à Sanaa, y compris contre du personnel diplomatique occidental et japonais ;
– sabotages contre des infrastructures gazières et électriques, y compris par des tirs de roquettes, ce qui conduit la société Total à déployer une « bulle de sécurité » mobilisant 1 500 hommes, selon les indications fournies aux rapporteurs ;
– manifestations des indépendantistes sudistes à Aden : répression lourde ;
– influence persistante du président Saleh, resté au pouvoir pendant 33 ans jusqu’au mouvement dit des « printemps arabes ». Il reste un acteur d’influence et aujourd’hui de déstabilisation interne à la vie du pays. Sa famille et ses alliés détiennent encore des postes clés du pays et compliquent la tâche du nouveau président, Abd Rabbo Mansour Hadi.
Malgré des influences extérieures reconnues (Iran, Irak, Arabie Saoudite), beaucoup de Yéménites considèrent qu’il s’agit avant tout d’un conflit privé au sein de la confédération Hacheb mettant en scène le chef de cette confédération tribale et les deux demi-frères (l’ex-président et le général Ali Moshem). Dans un contexte de printemps arabe, les jeunes et la rue ont cru profiter de l’occasion pour faire changer la situation, comme le prouvent les nombreuses manifestations parfois extrêmement violentes.
Les implications régionales et internationales de cette crise, essentiellement interne, sont telles que personne ne peut laisser le Yémen suivre la voie de la Somalie. La communauté internationale est donc très présente et ne ménage pas ses efforts pour trouver une solution acceptable par toutes les parties en présence qui s’évertuent à poser des conditions inacceptables par la partie adverse.
3. Rôle des forces françaises à Djibouti
– alerte RESEVAC, avec une attention particulière pour les employés de la société Total ;
– coopération avec les garde-côtes et, possiblement, avec les forces spéciales.
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
En Somalie, la déliquescence de l’État depuis une vingtaine d’années a laissé le champ libre au développement de groupes armés, parmi lesquels les Shebabs se distinguent aujourd’hui par la violence de leurs actions. Comme certains observateurs l’ont fait remarquer aux rapporteurs, le fait que les 20 000 hommes de l’AMISOM et les 26 000 hommes des forces armées somaliennes ne parviennent pas à venir à bout des Shebabs ne peut s’expliquer que par un soutien extérieur significatif apporté à ce mouvement. La provenance de ces soutiens reste à établir, la question pouvant être posée de savoir quelle puissance régionale a le moins intérêt à ce que la Somalie retrouve une stabilité qui lui rendrait son rayonnement régional.
La carte ci-dessous présente schématiquement cet environnement sécuritaire instable.
DJIBOUTI ET SON ENVIRONNEMENT
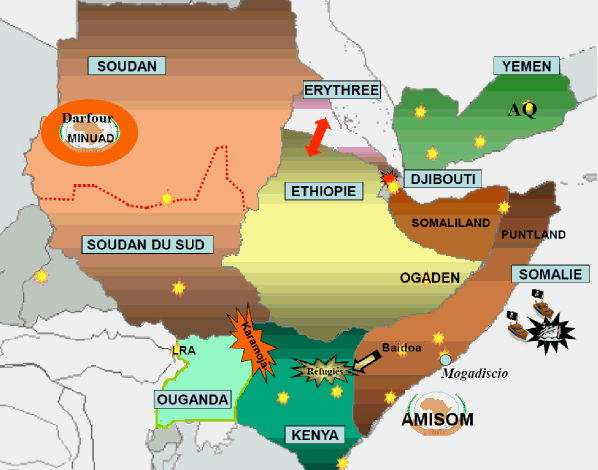
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
• Djibouti n’est plus un « havre de paix »
L’attentat déjà évoqué du 24 mai 2014 a montré que le territoire djiboutien était lui aussi touché par la vague d’insécurité qui frappe la région. Compte tenu de la concentration d’intérêts français à Djibouti et sur la rive opposée de la mer Rouge, il peut donc paraître imprudent de « baisser la garde ».
Tant le ministre djiboutien des Affaires étrangères que celui de la Défense, comme le chef d’état-major général des armées djiboutiennes et le directeur de la sécurité nationale se sont dits conscients du fait que la présence de forces étrangères sur leur sol présentait à la fois des avantages et des inconvénients. En effet, si ces forces contribuent à la défense du territoire, elles n’en constituent pas moins une cible privilégiée pour les groupes armés djihadistes qui présentent la République de Djibouti comme l’alliée privilégiée des Occidentaux. Toutefois, comme le ministre des Affaires étrangères l’a déclaré aux rapporteurs, « de deux maux, il faut choisir le moindre… ».
Selon les observateurs français et djiboutiens spécialisés, cet attentat porte la marque des Shebabs. Ceux-ci auraient fait de Djibouti une sorte de « sanctuaire », et il conviendrait de maintenir auprès des autorités djiboutiennes une présence suffisamment forte pour qu’elles ne soient pas incitées à adopter vis-à-vis des Shebabs une sorte de « posture ATT » (cf. supra).
Pour ces observateurs, la menace que représentent les Shebabs peut être caractérisée de la façon suivante :
– le groupe tend probablement à se servir de Djibouti comme d’une base arrière, tant pour sa logistique que pour l’organisation de son financement ;
– les combattants sont à la fois « furtifs et agressifs » : « la menace est bien réelle, il y a danger à Djibouti » ;
– le groupe est « imprévisible » : « on les attendait depuis deux ans, ils n’ont frappé que le 24 mai, et encore, avec peu d’efficacité » (outre les deux kamikazes, l’attaque a fait un mort et une vingtaine de blessés) ;
– les Shebabs « semblent rester dans une logique assez ethnique » : ils sont les héritiers des tribunaux islamiques de la guerre civile somalienne, qui s’érigeaient en « barrière » contre l’occidentalisation. Or il y a une forte communauté somalienne à Djibouti : une forme d’irrédentisme peut dès lors nourrir un nationalisme à connotation islamique.
La question de savoir si les Shebabs ont noué des liens avec les autres groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes de la région reste ouverte. Néanmoins, il ressort des informations fournies aux rapporteurs que :
– au Yémen, l’interconnexion entre les mouvements tribaux et Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA) est avérée ;
– les Shebabs et AQPA entretiennent des liens financiers, échangent des pratiques permettant de perfectionner leurs méthodes et coopèrent en matière de logistique ;
– le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux rapporteurs que les Shebabs auraient fait « allégeance » à Al-Qaïda ;
– les liens entre les Shebabs et les auteurs d’actes de piraterie sont moins clairs, les vues exposées devant les rapporteurs par les ministres djiboutiens des Affaires étrangères et de la Défense n’étant pas totalement concordantes sur ce point. Le ministre de la Défense, notamment a insisté sur le fait que les motivations des pirates seraient essentiellement financières, alors que celles des Shebabs seraient principalement idéologiques.
Il convient en outre de rappeler que la situation intérieure de Djibouti est encore marquée, parfois, par des incidents sérieux opposant des éléments du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie (FRUD) et l’armée nationale.
L’encadré ci-dessous relate le dernier de ces événements.
Troubles intérieurs à Djibouti
Au lendemain de la commémoration du 37e anniversaire de l’indépendance des violents affrontements ont eu lieu.
Selon des informations émanant du Front pour la restauration de l’unité et la démocratie (FRUD), plusieurs accrochages ont eu lieu entre l’armée gouvernementale et les combattants du FRUD dans la journée du 28 juin 2014, dans les Mablas (district de Tadjourah).
Le 1er accrochage a eu lieu vers 6 heures du matin, aux environs de Galeila où se trouve un camp militaire de l’AND ; un autre affrontement s’est déroulé à Débel, non loin de Garbanaba, un véhicule de l’armée a été détruit, deux morts et trois blessés parmi les soldats de l’AND.
Partis du Camp de Galeila, les militaires ont affronté les combattants du FRUD à Sismo toujours dans les Mablas de 14 heures à 18 heures, un soldat tué et quatre autres ont été blessés. Une vingtaine de militaires ont fui le combat et sont rentrés chez eux.
Le FRUD, de son côté, ne déplore aucune perte.
On apprend aussi que l’armée nationale djiboutienne a interrompu les festivités de la commémoration du 37e anniversaire de l’indépendance et a envoyé plusieurs détachements à Galeila pour faire face aux éléments du FRUD.
Source : dépêche présentée aux rapporteurs par le commandement des Forces françaises à Djibouti
• Les Forces françaises stationnées à Djibouti ne contribuent pas seulement à la sécurité de Djibouti, mais aussi à celle de toute la région
Le ministre djiboutien des Affaires étrangères a fait valoir aux rapporteurs que la présence des Forces françaises stationnées à Djibouti constituait un élément de stabilité qui bénéficie non seulement à la République de Djibouti - « peu de pays dans la région peuvent se targuer d’une telle protection que celle que la France fournit à Djibouti » -, mais également à l’ensemble de la région. Notamment, selon lui, le fait que les contingents djiboutiens déployés en Somalie dans le cadre de l’AMISOM soient généralement vus comme efficaces est à rapporter au fait qu’ils ont été formés et accompagnés sur le terrain par les Forces françaises à Djibouti, agissant au titre de leur mission de coopération. Il a ainsi conclu que « la présence militaire française à Djibouti est cruciale pour toute la région ».
Le ministre a également ajouté que cet élément de sécurité constituait un atout pour le développement de Djibouti et, partant, de son hinterland, notamment l’Éthiopie. Il a ainsi évoqué de grands projets d’infrastructures en cours d’étude - en matière de pipelines, de réseaux de fibres optiques, etc. -, soulignant que « la sécurité apportée par la France est un atout pour attirer des capitaux : cela fait partie d’un continuum entre sécurité et développement ».
Il n’est pas inutile de relever que sur les 51 opérations conduites par les forces françaises prépositionnées depuis 30 ans, 36 l’ont été avec une participation des FFDj.
• Une relation de complémentarité – et non de substituabilité – avec les Forces françaises aux Émirats arabes unis
Lors de son audition, l’amiral Marin Gillier – directeur de la coopération de sécurité et de défense et ancien commandant des Forces françaises aux Émirats arabes unis – a fait valoir aux rapporteurs que c’est Djibouti qui « donne de la profondeur stratégique aux Forces françaises aux Émirats arabes unis ».
Il a rappelé qu’« Abou-Dhabi, ce n’est pas la « base Sarkozy » que certains ont dite : l’idée d’une telle base remonte au président François Mitterrand ». C’est en effet à la suite de la Guerre du Golfe qu’a été entamée la négociation d’une implantation permanente dans la péninsule arabique. Il a fallu alors de longues négociations, mais trois raisons au moins militaient pour les conduire à leur terme : la région est une zone de développement, une zone de crispation, ainsi qu’une zone dont ne saurait se désintéresser une puissance qui a encore vocation à être mondiale.
S’installer à Abou-Dhabi est donc selon l’amiral une excellente idée d’un point de vue stratégique, qui ne remet pas en cause l’utilité de Djibouti, au contraire : « cette petite base a une vocation régionale, mais pas de profondeur stratégique : elle est à 15 minutes de vol des chasseurs iraniens... ». C’est une raison d’être supplémentaire de Djibouti : « les Forces françaises aux Émirats arabes unis ne tiennent qu’avec la profondeur stratégique offerte par Djibouti ».
La carte ci-après illustre cette position stratégique de complémentarité.
RAYON D’ACTION DEPUIS DJIBOUTI
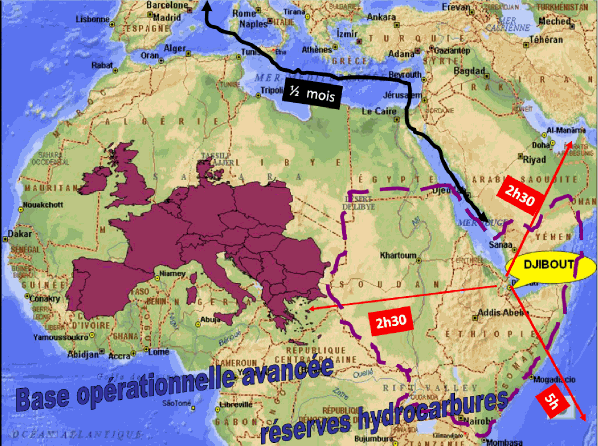
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de l’air a lui aussi souligné que s’il y a une « vraie cohérence » entre Djibouti et Abou-Dhabi, il y a quand même deux à trois heures de vol entre les deux bases : les deux dispositifs ne sont donc « pas totalement substituables ». Un Mirage et un Rafale peuvent dans certains cas assurer ce vol sans ravitaillement en vol, mais tout dépend de la configuration de l’avion.
• Une concurrence internationale dans laquelle la France perd du terrain au profit de puissances amies, mais aussi au profit de concurrents moins coopératifs
En se rendant sur place, les rapporteurs ont pu mesurer l’ampleur des convoitises que suscite l’implantation française à Djibouti – signe, s’il en fallait, de l’intérêt stratégique de cette position. Lors de son audition, le chef d’état-major de l’armée de l’air a d’ailleurs insisté sur la lutte d’influence, voire la concurrence, qui s’opère à Djibouti entre différentes puissances. Selon lui, « il faut bien voir la concurrence : Djibouti attire... Pourquoi s’en retirer ? ».
1./ Les Américains
D’ores et déjà, comme l’ambassadeur l’a souligné devant les rapporteurs, « nous ne sommes plus les plus nombreux à Djibouti : les Américains ont des effectifs supérieurs ». Ils entretiennent en effet un détachement à Djibouti depuis la guerre du Golfe, et ont installé leurs propres bases à partir de 2002, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Désormais, leurs forces comptent plusieurs milliers d’hommes, et ils utilisent la piste de détournement construite par les Français à Chabelley pour opérer notamment des drones. Cette coopération est appelée à s’intensifier : un récent accord américano-djiboutien pérennise la présence américaine pour vingt ans et permet l’extension des bases américaines, moyennant une redevance annuelle relevée de 38 à 68 millions de dollars – à comparer aux 30 millions d’euros versés par la France. Aujourd’hui, les deux tiers des mouvements aériens militaires dans le ciel de Djibouti sont le fait des Américains, et le tiers restant des Français ; il y a cinq ans, la proportion était inverse.
Certes, pour l’heure, il s’agit pour les Américains d’une simple base d’appui pour le combat contre Al-Qaïda au Yémen et dans une moindre mesure en Somalie, mais on note :
– que les forces américaines commencent à mener dans la région des actions de coopération opérationnelle, notamment au Somaliland et au Puntland ;
– que, selon les informations fournies aux rapporteurs, les Américains restent très discrets sur les activités de certaines de leurs bases implantées à Djibouti, même si la coopération franco-américaine sur le terrain djiboutien est par ailleurs d’excellent niveau.
Au demeurant, cette implantation s’inscrit dans un mouvement d’extension de la présence américaine en Afrique, que les rapporteurs ont pu constater également au Niger, ainsi que de façon moins visible mais tout aussi résolue dans d’autres pays. Selon les termes employés par le chef d’état-major de l’armée de l’air, les Américains le font certes, pour l’heure, « avec humilité, car ils la connaissent mal » et en s’appuyant sur le dispositif français. Mais leurs intentions à moyen terme sont claires : « ils ont tendance à développer les infrastructures » – par exemple sur le terrain de Chabelley, sur lequel la France les a accueillis, et qu’ils proposent aujourd’hui de développer –, alors que, « dans le même temps, nous-mêmes réduisons notre empreinte ». Aussi, « le risque est réel que dans dix ans, les Djiboutiens parlent non plus Français mais Anglais : l’ambassadeur américain en fait le pari... ».
Le commandement des Forces françaises stationnées à Djibouti a toutefois souligné que s’agissant des Américains, il serait réducteur de voir leur implantation à Djibouti comme une simple concurrence. En effet, des complémentarités peuvent être recherchées entre nos deux dispositifs, dans le cadre de notre partenariat stratégique. D’ores et déjà, des patrouilles aériennes mixtes sont organisées, et il serait envisageable d’entendre ce mode de fonctionnement à d’autres vecteurs – par exemple les moyens aéroterrestres ou le transport aérien tactique. De même, le partage de certaines bases serait à l’étude : sous réserve que toutes les garanties de notre autonomie puissent être réunies, ce co-basing représente pour le commandement des Forces françaises stationnées à Djibouti une « option intéressante » pour les deux parties.
2./ Les autres puissances
Selon les informations fournies aux rapporteurs, l’Italie aurait installé le 13 février 2014 une base « logistique » pouvant accueillir 300 personnels, destinée à soutenir l’action de gendarmes et de forces spéciales en Somalie notamment. Elle verserait pour cette implantation une redevance annuelle de 22 millions d’euros. Par ailleurs, le Japon entretient à Djibouti son unique déploiement militaire à l’étranger depuis 1945. Il se dit aussi que les Britanniques auraient engagé des discussions avec le gouvernement djiboutien.
Surtout, selon les informations fournies aux rapporteurs, la Russie, qui a signé en 2014 un traité de coopération avec Djibouti, chercherait « discrètement » à implanter une base aéroportuaire à Djibouti.
De même, la Chine aurait demandé au gouvernement djiboutien le bénéfice d’un quai à usage permanent et exclusif : il ne s’agit certes que de simples facilités portuaires, mais il convient de souligner que de telles facilités ne sont accordées jusqu’à présent qu’aux Français.
En tout état de cause, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a reconnu que son gouvernement cherchait à diversifier ses partenariats en matière de défense, et ce pour deux raisons principales :
– il observe que « la France se retire petit à petit » de Djibouti ;
– il souligne l’intérêt économique de tels partenariats : les redevances versées par les puissances étrangères représentent un montant conséquent au regard du budget de l’État, qui ne dépasse pas 380 millions d’euros par an. Il a résumé cette « rente géostratégique » en une formule : « nous n’avons pas de pétrole, mais nous sommes bien placés… ».
Selon lui, cette diversification des partenariats de défense s’est opérée en quatre temps :
– un point de départ : la lutte contre la piraterie et le terrorisme, dès le début des années 2000 ;
– puis un « temps d’évolution » des menaces qui, avec l’instabilité grandissante au Moyen-orient (le « Yémen en ébullition », les « printemps arabes », etc.), a conduit les puissances concernées à envisager une présence plus pérenne ;
– ensuite, un « phénomène d’émulation » : de nouvelles puissances s’intéressent à la région où les États-Unis commencent à s’implanter, et Djibouti s’impose comme une position stratégique d’autant plus intéressante, que les autres points d’appui envisageables dans la région sont soit instables (comme le Yémen ou l’Éthiopie), soit risquent de le devenir (comme Bahreïn pour les États-Unis). Pour le ministre, des puissances comme la Turquie ou la Chine voient dans une implantation à Djibouti un moyen d’ouvrir à leurs produits les marchés est-africains ;
– enfin, il a souligné l’importance des derniers accords passés avec les États-Unis, notant que la présence américaine y est mieux acceptée qu’à Bahreïn (où, selon son homologue, la présence de la 5e flotte américaine ne ferait pas l’objet d’un consensus national au sein d’une population majoritairement chiite), qu’au Qatar et même qu’en Arabie saoudite.
b. Un projet de déflation massif, qui repose à ce stade sur un objectif strictement quantitatif et non sur une analyse fonctionnelle préalable
Le déplacement des rapporteurs auprès des Forces françaises stationnées à Djibouti leur a permis d’étudier les différents scénarios envisagés pour leur restructuration, dans le cadre de la réorganisation générale de notre dispositif militaire permanent en Afrique.
Tous les scénarios en cours d’étude répondent à un objectif, fixé comme but à atteindre : réduire les effectifs de 1950 à 950 personnels. Pour les rapporteurs, quel que soit le nouveau format qui sera retenu pour les Forces françaises stationnées à Djibouti, la méthode retenue fait peser deux grands risques sur la cohérence opérationnelle du résultat obtenu :
– elle a pour point de départ un objectif chiffré de déflation, et non une analyse des besoins et des ressources disponibles ;
– son calendrier est particulièrement rapide, ce qui risque de conduire à des déflations relativement « faciles » à opérer, plutôt qu’à des choix efficients.
i. Des plans de restructuration entièrement guidés par un objectif chiffré de déflation, sans analyse fonctionnelle préalable
Le nouveau schéma retenu pour notre dispositif de présence prévoit une très forte réduction des effectifs des Forces françaises à Djibouti, qui passeraient de 1950 à 950 personnels, sans pour autant être transformées en simple pôle opérationnel de coopération (POC) comme c’est le cas pour les Forces françaises au Gabon. De plus, l’amiral Bernard Rogel a indiqué aux rapporteurs qu’en application des orientations du Livre blanc qui prévoient de réduire de trois à deux le nombre de zones de permanence à la mer, la marine nationale proposait de réduire le dispositif français dans la Corne est de l’Afrique plutôt qu’en Méditerranée ou dans le Golfe de Guinée. C’est pour lui un « risque prenable », d’autant que la marine marchande y applique désormais les techniques de risk management control.
Si l’objectif de déflation est clairement affiché, les choix quant à la composition des Forces françaises stationnées à Djibouti dans leur nouveau format n’ont pas encore été annoncés. Il semble acquis que les bases opérationnelles avancées de Djibouti et d’Abidjan comporteront des éléments des forces spéciales déployés à titre permanent, mais les autres éléments de la composition de ces bases restent à définir définitivement.
L’objectif consistant à réduire l’effectif des forces de présence en Afrique à 3 300 hommes découle du Livre blanc et de la loi de programmation militaire : on peut donc admettre qu’il n’est susceptible d’être modifié qu’à la marge. En revanche, à la connaissance des rapporteurs, la cible de déflation spécifique aux Forces françaises stationnées à Djibouti n’a pas fait à ce jour l’objet d’un arbitrage ministériel définitif : elle n’est donc en rien immuable. Il s’agit pour l’heure de simples hypothèses étudiées par les états-majors.
Or la méthode consistant à fixer d’abord la cible de déflation, pour n’étudier qu’ensuite les missions, les besoins et les ressources disponibles, est discutable, et ce à deux égards :
– ce que certains des interlocuteurs des rapporteurs ont appelé le « non-remplacement d’un militaire sur deux » ne saurait tenir lieu de réflexion sur les moyens que la France doit conserver dans la Corne de l’Afrique pour assumer ses responsabilités et préserver ses intérêts. C’est là, en quelque sorte, « poser l’équation à l’envers » ;
– les personnels servant à Djibouti, pourtant régulièrement engagés en opérations extérieures, ont le sentiment que leur force est, en quelque sorte, la « variable d’ajustement » dans la réorganisation de notre dispositif africain.
ii. Un calendrier trop hâtif pour permettre une manœuvre habile
• La mauvaise articulation du cadencement de la déflation avec le calendrier politique local comme avec le temps que nécessite une telle manœuvre
Le cadencement envisagé pour la réduction des effectifs des Forces françaises stationnées à Djibouti est très rapide : 350 suppressions de postes dès 2015, 500 en 2016 et 150 en 2017.
Ce calendrier paraît en décalage avec, à la fois :
– le calendrier électoral local, l’élection présidentielle d’avril 2016 étant susceptible de rendre nécessaire un certain relèvement du degré de vigilance des forces françaises, ne serait-ce que pour la protection de nos 6 000 ressortissants ;
– le temps nécessaire aux reconversions d’infrastructures, reconversions qui seraient indispensables pour réduire les coûts d’entretien et de gardiennage des dix emprises des Forces françaises stationnées à Djibouti. En effet, ces emprises s’étendent sur 400 hectares, 290 000 m² de surface hors œuvre développée (SHOD) active, et des projets majeurs sont indispensables à la conduite des réorganisations et des réductions d’effectifs. À titre d’exemple, la rétrocession de l’hôpital militaire Bouffard ne sera possible que lorsqu’un centre médico-chirurgical interarmées (CMCIA) aura été construit pour assurer le soutien médical des forces restantes ;
– le calendrier des manœuvres des ressources humaines. Ne serait-ce que pour opérer 350 déflations en 2015, il faut élaborer un référentiel des effectifs en organisation (REO) et adapter en conséquence le plan de mutation annuel de l’année 2014. Or, faute d’analyses fonctionnelles et de choix capacitaires préalables à la fixation des cibles de déflation, l’élaboration d’un tel REO est à peu près impossible, sauf à pratiquer des réductions homothétiques ou sans cohérence dans les effectifs. Aussi, comme l’on dit les gestionnaires de cette manœuvre aux rapporteurs, « une réforme ça se programme, et faute de savoir quelles fonctions supprimer, on est donc bloqués dans l’élaboration du REO ».
En somme, le calendrier retenu pour la déflation des effectifs peut être qualifié de hâtif, en ce qu’il risque de conduire à des choix sans cohérence.
• Le temps de la concertation n’est pas du temps perdu
Les rapporteurs soulignent que compte tenu de l’ancienneté, de la densité et de la qualité des liens qui unissent la France à la République de Djibouti, et qui ont été renouvelés par la signature d’un nouveau traité de coopération en matière de défense le 21 décembre 2011, il serait difficilement concevable qu’un plan définitif de déflation massive des effectifs des Forces françaises stationnées à Djibouti n’ait pas fait l’objet, à tout le moins, d’une information approfondie de la partie djiboutienne.
Or les rapporteurs n’ont pas tiré le sentiment de leurs entretiens avec les ministres djiboutiens des Affaires étrangères et de la Défense que les autorités djiboutiennes aient été étroitement associées aux discussions en cours.
Nonobstant l’intérêt qu’une telle association aurait pour la qualité des relations bilatérales, l’expérience des évolutions récentes des Forces françaises stationnées à Djibouti conduit à penser qu’une réforme est plus efficace si elle est préparée en amont avec notre partenaire africain. En effet, selon les informations recueillies par les rapporteurs aux Émirats arabes unis et à Djibouti, lorsqu’il s’est agi d’armer les nouvelles Forces françaises aux Émirats arabes unis, la partie française avait initialement fait le choix d’y transférer le 5e régiment interarmes d’outre-mer (5e RIAOM), historiquement implanté à Djibouti, sans mener suffisamment en amont de concertations avec la partie djiboutienne. C’est alors au dernier moment, qu’au plus haut niveau de l’État, la République de Djibouti a fait connaître ses vifs regrets de voir délocaliser ce régiment, dont est d’ailleurs issu son actuel chef d’état-major général des armées, et c’est ainsi dans une certaine impréparation que les plans français ont dû être modifiés, ce qui a finalement conduit à transférer la 13e demi-brigade de la Légion étrangère à Abou-Dhabi.
Il ressort de cette expérience que la bonne marche d’une manœuvre de restructuration de cette importance gagne à faire l’objet d’une concertation en amont avec notre partenaire africain.
c. Un projet de déflation intenable à missions et responsabilités constantes, qui remet sérieusement en cause la crédibilité de notre dispositif en Afrique de l’Est
i. Quatre scénarios élaborés par les Forces françaises stationnées à Djibouti pour répondre à la commande qui leur a été adressée
Plusieurs scénarios ont été élaborés par le commandement des Forces françaises stationnées à Djibouti pour répondre dans les délais impartis au scénario de déflation qui est envisagé pour ces forces. Ils ont été présentés en détail aux rapporteurs lors de leur déplacement à Djibouti.
• Quatre scénarios formalisés
L’état-major des Forces françaises stationnées à Djibouti, pour répondre à la commande qui lui a été passée, a élaboré quatre « modes d’action » différents, dont les encadrés ci-après présentent le détail :
– scénario n° 1 : maintien de l’équilibre interarmées qui fait aujourd’hui la cohérence et la crédibilité des Forces françaises stationnées à Djibouti ;
– scénario n° 2 : centrer l’activité des Forces françaises stationnées à Djibouti sur les forces spéciales, au détriment des autres composantes ;
– scénario n° 3 : préserver avant tout les capacités de « fulgurance aérienne » des Forces françaises stationnées à Djibouti, au détriment principalement de leur composante terrestre ;
– scénario n° 4 : préserver en priorité les capacités de « contrôle du terrain » des Forces françaises stationnées à Djibouti, au détriment principalement de leur composante aérienne.
Scénario n° 1 : maintien de l’équilibre interarmées
● Avantages :
– flexibilité
– polyvalence des capacités
– maintien du caractère interarmées des Forces françaises stationnées à Djibouti
– préservation, en mode très dégradé, de la plupart des capacités et du contrat opérationnel actuels
– plein emploi des facilités exceptionnelles d’entraînement pour tous
– maintien de la première place vis-à-vis des nouvelles nations présentes
● Inconvénients :
– dispersion des efforts
– risque de tensions entre les différentes composantes pour une ressource en effectifs extrêmement comptée
● Risques :
– limitation de l’efficacité du dispositif, résultant d’un « effet d’échantillonnage »
– sacrifice des acteurs de management et de support
Scénario n° 2 : des Forces françaises stationnées à Djibouti
centrées sur les forces spéciales
● Avantages :
– bon ratio effectifs / efficacité, du moins en apparence
– réactivité
– précision des effets
● Inconvénients :
– coûts d’entraînement plus élevés que pour les forces conventionnelles
– besoin de créer en parallèle un pôle de coopération, activité qui est très éloignée du cœur de métier des forces spéciales
– besoin d’un détachement de maintenance RECAMP - GUEPARD
● Risques :
– absences et activités « centripètes », du fait des projections régulières propres à l’activité des forces spéciales
– incapacité à assumer de manière robuste et permanente la « clause de sécurité » prévue par le traité de coopération en matière de défense
– insuffisance lors des RESEVAC
– risque de confusion, évoqué précédemment, entre le cœur de métier des forces spéciales et celui des forces conventionnelles, ce qui irait à rebours des efforts entrepris et des progrès accomplis en ce sens depuis quinze ans
Scénario n° 3 : priorité à la « fulgurance aérienne »
● Avantages :
– bon rapport effectif / efficacité
– rentabilisation de l’existant
● Inconvénients :
– faible capacité de coopération avec les Africains, leurs armées de l’air étant nettement moins développées que leurs armées de terre
– besoin d’un détachement de maintenance RECAMP - GUEPARD
● Risques :
– incapacité à assumer la clause de sécurité de manière robuste
– insuffisance lors des RESEVAC
– acceptabilité incertaine pour la partie djiboutienne
Scénario n° 4 : priorité aux capacités de « contrôle du terrain »
● Avantages :
– proximité des forces Épervier et Licorne
– conservation d’un ratio MCD (5)/MLD (6) économe
– capacités de RESEVAC immédiates
– mutualisations possibles avec les forces françaises aux Émirats arabes unis
– entretien du parc RECAMP garanti
● Inconvénients :
– besoin d’une patrouille opérationnelle (PO), ce qui suppose d’avoir des moyens de soutien, de guidage etc. qui dépassent 50 personnels de l’armée de l’air
– nécessité de coupler le dispositif avec des moyens aéromobiles
● Risques :
– « décrochage » par rapport aux capacités américaines présentes à Djibouti, essentiellement aéronavales
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
Les rapporteurs tirent en conclusion de l’étude de ces scénarios que le maintien d’un équilibre interarmées est particulièrement souhaitable, car il fait la spécificité de la présence française à Djibouti en comparaison des autres déploiements étrangers, ainsi que la crédibilité de notre seul point d’appui, relativement isolé, sur la côte est de l’Afrique.
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu constater que les Forces françaises stationnées à Djibouti étaient équipées de Mirage 2000, qui ne sont pas aussi polyvalents que les Rafale des Forces françaises aux Émirats arabes unis. De ce fait, les sept Mirage 2000 de Djibouti ne sont pas interchangeables : certains sont configurés pour l’appui au sol et d’autres pour la police de l’air. Cette spécificité réduit les marges de manœuvre dans la réduction de la flotte des Forces françaises stationnées à Djibouti, sauf à les remplacer par des Rafale.
• Une alternative fondamentale : « sacrifier » soit la composante aérienne, soit la composante terrestre
Comme l’a souligné le chef d’état-major de l’armée de terre, en règle générale pour toute base opérationnelle avancée, « l’enjeu consiste à pouvoir disposer d’unités de manœuvre dont la crédibilité et l’efficacité reposent sur leur composition ». C’est la raison pour laquelle l’état-major de l’armée de terre plaide en faveur du « prépositionnement dans chacune des bases opérationnelles avancées d’un groupement tactique interarmes constitué de son état-major et d’au moins deux unités de manœuvre avec leurs appuis ».
Tout en reconnaissant que « ce ne sera pas chose facile eu égard aux contraintes budgétaires actuelles et aux objectifs de déflation affichés par la loi de programmation militaire », le général Ract Madoux a jugé devant les rapporteurs qu’« une capacité inférieure fragiliserait la cohérence du dispositif de présence en sous-dimensionnant en deçà du raisonnable ses moyens d’agir ». Pour replacer la nouvelle déflation des effectifs outre-mer dans une perspective de plus grand recul historique, il a rappelé qu’il s’agit « d’un nouvel effort de réduction qui s’inscrit dans un processus débuté en 2008 et qui s’est déjà traduit pour l’armée de Terre par la diminution d’environ 50 % de ses forces de présence dont le volume est passé en six ans de 3 400 à 1 700 postes ».
Aussi, concernant Djibouti, l’armée de terre estime impératif de conserver une empreinte terrestre significative « au titre de la consolidation sous-régionale » – marquée notamment par l’instabilité en Somalie – et du maillage de la zone moyenne orientale, à laquelle participent également les Forces françaises aux Émirats arabes unis. La « transformation continue de Djibouti » participe également de la restructuration en cours au Proche et Moyen Orient ; elle « est pleinement partie prenante des planifications relatives au Golfe arabo-persique » et pour autant, les forces terrestres basées à Djibouti « sont plus que jamais investies dans la coopération opérationnelle régionale », voire dans l’engagement opérationnel en Afrique comme l’atteste la participation actuelle du 5e RIAOM à l’opération Sangaris. Et le chef d’état-major de l’armée de terre de conclure : « il me semble primordial de conserver à Djibouti une réelle capacité opérationnelle aéroterrestre qui complète le dispositif français en lui conférant sa cohérence et sa continuité jusqu’à l’extrémité est de l’arc sahélien ».
Or la réduction du 5e RIAOM d’un effectif de 709 personnels actuellement à un effectif de 290 militaires reviendrait à en faire, selon le commandement des Forces françaises stationnées à Djibouti, une « compagnie de type Vigipirate », ce qui présenterait plusieurs risques :
– une incapacité à un engagement opérationnel, y compris pour la défense de l’intégrité territoriale de la République de Djibouti ;
– la disparition de la puissance de feux moyenne et longue portée (mortiers et canons de 155 mm) ;
– le cantonnement du GTIA à des missions de sécurisation des emprises, qui nécessitent 70 personnels au minimum, et donc la perte de l’essentiel de ses capacités de réaction ;
– des délais de renforcement très longs (plusieurs semaines) ;
– une capacité d’évacuation des ressortissants qui serait, au mieux, « à peine suffisante ».
LE FORMAT DU 5e RIAOM DANS DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI LIMITÉES À 950 PERSONNELS
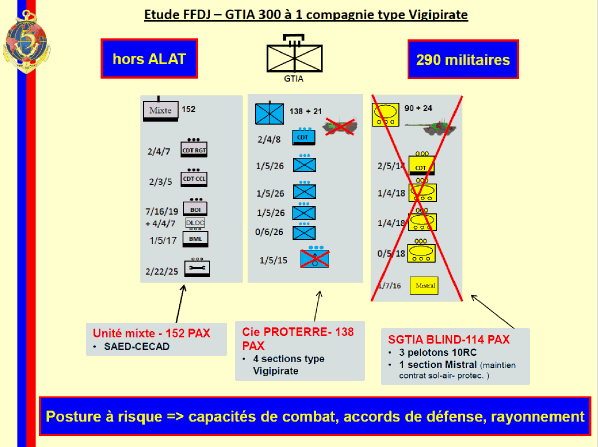
Source : Commandement des Forces françaises à Djibouti.
Le chef d’état-major de l’armée de l’air, quant à lui, a déclaré aux rapporteurs que le cas de Djibouti est une « source d’inquiétude » pour l’armée de l’air. En effet, la France est liée à Djibouti par des accords de défense, « y compris aérienne », récemment renégociés « et qui nous paraissent importants ». Or compte tenu de l’importante déflation planifiée, deux options sont selon lui envisageables :
– soit réduire le dispositif de l’armée de l’air et conserver un dispositif terrestre d’un volume important ;
– soit garder un « petit dispositif terrestre (300 personnels) » et conserver une présence aérienne significative.
En tout état de cause, l’armée de l’air réduira son dispositif à Djibouti : aujourd’hui, celui-ci combine des Mirage 2000 d’attaque au sol et de défense aérienne, mais demain, seule la capacité de défense aérienne sera maintenue. Si le choix est fait de conserver 275 aviateurs sur place, l’armée de l’air peut y maintenir quatre Mirage 2000, ce qui est suffisant pour « conserver nos capacités de police du ciel », y compris de Search and Rescue ainsi qu’il est prévu par les accords de défense. À l’inverse, si le dispositif aérien était réduit à 40 aviateurs, « on pourra seulement poser deux avions en escale ».
Pour l’armée de l’air, plusieurs raisons existent ainsi pour « conserver un bon point d’appui » à Djibouti :
– les accords de défense : avec moins de 275 aviateurs, on ne peut pas assurer la mission de défense aérienne prévue par les accords. Aussi, « renoncer à cette mission, c’est dénoncer le traité de défense ». C’est le seul endroit dans le monde où la France « assure la mission régalienne de défense aérienne en lieu et place du Gouvernement » de la nation hôte. Certes, le traité stipule désormais que la France « participe à » la mission de défense aérienne, et non plus l’« assure », mais ce changement sémantique n’a pour l’heure pas de portée concrète ;
– la qualité des pistes : la base a accès à une piste partagée avec les civils, mais a aussi construit (aux frais de la France) le terrain de Chabelley, sur lequel « lorgnent » les États-Unis (qui y ont déjà 10 drones), les Britanniques et les Italiens (qui voudraient y installer les leurs) ;
– l’accueil souhaitable de drones : lorsque la France se sera dotée de davantage de drones, « c’est à Djibouti qu’on les positionnera de préférence », car ils pourraient « rayonner sur une zone intéressante, y compris pour la lutte anti-piraterie ». Ces drones seraient utiles soit en mission de courte durée, dans une logique d’opération extérieure, soit en force prépositionnée ;
– le caractère stratégique de la région, qui plaide en faveur du maintien d’« un dispositif marin et aérien fort » ;
– pour les forces terrestres, « Djibouti a surtout l’intérêt de permettre l’entraînement ». Or avec l’A400M, « on pourra amener le personnel à former et le fret en un seul vol », ce qui permettrait de réduire le dispositif terrestre. Toutefois, pour les rapporteurs, cette hypothèse n’est envisageable que dans le long terme. En effet, comme le leur a fait observer le chef d’état-major des armées, du fait des réductions de cibles capacitaires et des décalages calendaires prévus dans les programmes d’armement par la loi de programmation militaire, ce n’est qu’à partir de 2025 que la France possédera une flotte suffisante d’A400M.
ii. Dans toutes les hypothèses, des scénarios intenables à missions et responsabilités constantes
Pour les rapporteurs, s’enfermer dans un objectif de déflation extrêmement ambitieux pour notre seul point d’appui sur la côte est de l’Afrique présente un double risque : d’une part, aviver des tensions entre les armées, alors même que l’interarméeisation est une tendance structurante de nos armées depuis deux décennies au moins ; et, d’autre part, en rester à un format de toute façon insuffisant pour respecter les engagements pris envers la République de Djibouti et protéger nos intérêts dans la région.
• Intenables pour le respect du traité liant la France à la République de Djibouti
Les rapporteurs ont mis à profit leur déplacement pour faire le point sur la mise en application du traité de coopération en matière de défense conclu entre la République française et la République de Djibouti le 21 décembre 2011 – l’encadré ci-après en précise les stipulations. Un récent échange de notes faisant office de notification des instruments de ratification a permis son entrée en vigueur. Il appelle la négociation de quatre accords techniques, dans l’attente de laquelle les conventions conclues en application du précédent accord de défense demeurent en vigueur.
Il en ressort une spécificité majeure : alors que, dans le mouvement de renégociation de ses accords de défense en Afrique, la France s’est fixé pour principe de ne plus conclure de clause de garantie automatique, Djibouti est le seul État avec lequel une telle clause existe encore. Ainsi, il est prévu que « la République Française s’engage à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale de la République de Djibouti ».
Cette stipulation peut faire l’objet d’exégèses diverses, plus ou moins éloignées de l’esprit du traité et des spécificités évidentes d’une telle clause dans l’évolution du droit international en la matière. En effet, pour justifier des déflations qui conduiraient à réduire au-delà du raisonnable notre dispositif, on pourrait arguer du fait que « contribuer à la défense » ne signifie pas « assurer seul la défense ». De même, si le traité comporte des stipulations expresses concernant la police du ciel, on ne saurait le lire comme restreignant à ce domaine les garanties offertes par la partie française : dès lors, il serait difficile d’invoquer ce traité pour justifier le maintien d’une composante aérienne des Forces françaises stationnées à Djibouti sans justifier dans le même mouvement celui d’une composante terrestre.
Mais pour les rapporteurs, pacta sunt servanda, et le traité ne peut être lu autrement que comme un engagement de la France à maintenir à Djibouti un volume de forces suffisant pour remplir sa mission. Les rapporteurs ont d’ailleurs noté que ni le ministre djiboutien des Affaires étrangères, ni son collègue chargé de la Défense et pas plus le chef d’état-major général des armées ne l’entendaient autrement.
Le traité de coopération en matière de défense
conclu entre la République française et la République de Djibouti
Signé le 21 décembre 2011 à Paris, conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction, il fait exception au principe d’abandon d’une garantie de sécurité de la part de la France en précisant les formes de la participation de la France à la défense de l’intégrité territoriale de Djibouti :
– contribution à la défense de l’intégrité territoriale de la République de Djibouti ;
– participation à la police de l’espace aérien djiboutien ;
– participation à la surveillance des eaux territoriales.
Le traité affirme notre engagement à aider au renforcement des forces armées djiboutiennes pour rendre, à terme, Djibouti moins dépendant de l’aide française pour défendre son propre territoire.
Il fixe les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées, qui constituent notre plus importante base militaire à l’étranger.
L’annexe II précise les conditions du soutien médical apporté par la partie française aux forces années djiboutiennes. L’emprise de l’hôpital médico-chirurgical Bouffard sera rétrocédée en 2015, en l’état, à la République de Djibouti dans des conditions déterminées d’un commun accord par les Parties.
L’annexe III concerne l’engagement financier de la France à l’égard de la République de Djibouti, au titre de la présence des forces françaises stationnées : une contribution forfaitaire de 30 millions d’euros par année civile, libératoire de tout impôt.
Il convient de rappeler que Djibouti demeure un partenaire incontournable en matière de coopération de sécurité et de défense compte tenu de sa position stratégique qui offre à la France une plate-forme unique dans la région. Le nouvel accord de partenariat de défense permet ainsi de consolider notre dispositif de coopération afin de répondre aux nouvelles ambitions djiboutiennes. D’une manière générale, le partenariat franco-djiboutien souffre d’un manque d’implication de la partie djiboutienne, tant sur le plan financier qu’humain. La dynamique d’appropriation des projets demeure assez lente mais l’équipe de coopérants s’efforce d’impliquer notre partenaire de façon plus concrète et énergique.
À cet effet, la nouvelle organisation des projets mise en place à l’été 2013, reposant sur trois pôles majeurs : la modernisation des armées, la formation des armées et le projet marine, donne entière satisfaction.
Il est à signaler que, nonobstant l’article 21 du Traité, les accords particuliers sur la surveillance maritime et la police du ciel signés en février 1991 ont été provisoirement maintenus en vigueur, dans l’attente de la conclusion de nouveaux accords ad hoc.
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
• Intenables pour la crédibilité de notre présence en Afrique de l’Est
Le contrat opérationnel des Forces françaises stationnées à Djibouti a été établi le 19 juillet 2012. Comme le présente l’encadré ci-après, il s’articule autour de quatre fonctions stratégiques principales :
– la connaissance et l’anticipation : recueil de renseignement dans la zone de responsabilité principale des Forces françaises stationnées à Djibouti en lien avec divers relais, ce que Djibouti assure aujourd’hui « sans difficulté » ;
– la protection : contribution à la défense du territoire de Djibouti, ce qui est assuré avec les moyens actuels, mais ne pourrait l’être dans la durée en cas d’aggravation de la situation sécuritaire qu’au prix d’un renforcement de la protection passive des infrastructures et des personnels ;
– la prévention : actions classiques de coopération opérationnelle et soutien aux forces djiboutiennes par le groupement de soutien de la base de défense, y compris en matière d’alimentation. Cette fonction est assurée avec les moyens actuels « sans trop de difficultés », mais la réduction des crédits de soutien pourrait créer des tensions en la matière ;
– l’intervention, que ce soit au profit de la République de Djibouti, en matière de protection des ressortissants français, ou en participant à des opérations françaises hors de Djibouti. Malgré leur caractère vieillissant, les matériels disponibles sont en nombre juste suffisant pour armer un GTIA, ce qui permet aux Forces françaises stationnées à Djibouti de remplir cette mission.
Les Forces françaises stationnées à Djibouti ont ainsi contribué à armer la force Sangaris, déployée en République centrafricaine, par un détachement du 5e RIAOM que les rapporteurs ont rencontré à Bambari. Ils ont ainsi pu constater à la fois que l’aguerrissement de ces troupes à Djibouti était très utile sur un théâtre comme la Centrafrique, et que cette projection ne remet pas en cause la capacité des Forces françaises stationnées à Djibouti à assurer les obligations découlant pour la France du traité de coopération en matière de défense.
Toutefois, ce contrat opérationnel impose de maintenir un minimum de forces sur le territoire djiboutien. Or, contrairement à ce que les rapporteurs ont pu constater à Abou-Dhabi, où le tissu industriel et commercial est robuste et où la nation hôte soutient les forces françaises, on ne peut pas miser à Djibouti sur une externalisation massive des fonctions de soutien pour réduire les effectifs.
Dès lors, il ressort clairement des évaluations présentées par l’état-major des Forces françaises stationnées à Djibouti qu’un effectif limité à 950 personnels, forces spéciales et soutiens compris, ne permettrait en aucun cas aux Forces françaises stationnées à Djibouti de remplir leur contrat opérationnel.
Le contrat opérationnel des Forces françaises stationnées à Djibouti
1./ La connaissance et l’anticipation
Mission permanente de recueil du renseignement d’intérêt militaire dans la zone de responsabilité principale (ZRP) :
– maintenir une veille-alerte renseignement en liaison avec les personnels français ;
– apporter l’expertise liée à la connaissance de l’environnement et de l’évolution des pays de la ZRP au moyen de reconnaissances et de contacts avec les organisations internationales et les personnels français.
Capacités requises : ROIM, ROEM, ROHUM.
Résultat : contrat tenu sans difficultés majeures.
2./ La protection :
– protection aérienne ;
– protection des zones aéronautiques ;
– protection du port de Djibouti ;
– protection de points sensibles ;
– protection du personnel ;
– soutien de la nation hôte.
Résultat : pour l’heure, contrat tenu sans difficultés majeures, mais mesures de renforcement nécessaires surtout en cas de dégradation sécuritaire.
3./ La prévention :
● Mission de présence dans la ZRP (et hors ZRP) et de coopération militaire opérationnelle régionale :
– soutien aux forces armées de la ZRP (DIO, DIT, expertise militaire) ;
– entraînement ;
– soutien à l’engagement opérationnel ;
– actions civilo-militaires (200 000 euros par an).
Le graphique ci-après en présente les résultats depuis plusieurs années.
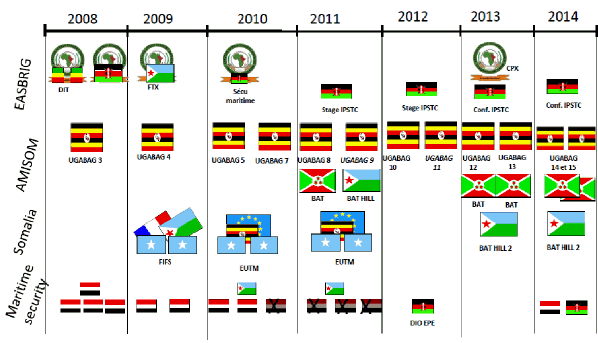
● Soutien des forces :
– participer à l’entraînement et à l’aguerrissement des forces françaises avec des capacités d’accueil et de soutien ;
– capacité alimentation :
- 4 000 personnels sur 20 jours en vivres
- 2 600 personnels supplémentaires avec le stock de sécurité sur 10 jours.
– capacité hébergement comprise entre 600 et 720 personnels, à laquelle s’ajoute une capacité de 450 personnels sous module 150 Guépard ;
– soutenir les forces françaises stationnées ou de passage (dans les mêmes volumes que détaillés ci-dessus) à Djibouti.
Résultat : contrat tenu avec difficulté du fait de tensions sur les crédits de soutien
4./ L’intervention
● Mission d’intervention dans la République de Djibouti :
– défendre les intérêts français et mettre en œuvre l’accord de partenariat défense ;
– concourir à la défense des intérêts français en RDD et en particulier à la sécurité des ressortissants français, UE ou ayants droit ;
– participer à la défense de l’intégrité territoriale de la RDD, dans le cadre de l’accord de défense entre la RDD et la République française, en y conduisant une opération limitée.
● Mission d’intervention hors de la République de Djibouti :
– participer à une opération limitée dans la sous-région ;
– constituer une réserve opérationnelle pour renforcer une opération existante.
Résultat : contrat tenu avec quelques ruptures
Source : état-major des armées (commandement des Forces françaises à Djibouti).
d. Un scénario alternatif, permettant de concilier la contrainte capacitaire générale et la crédibilité de nos forces
i. Un format minimal viable à 1 300 personnels
Tout en intégrant la contrainte d’optimisation des moyens clairement énoncée par le chef d’état-major des armées le jour même de son entrée en fonction, et rappelée par lui devant la commission lors de son audition du 1er avril dernier, l’état-major des Forces françaises stationnées à Djibouti a étudié le format minimal requis pour pouvoir continuer à remplir correctement son contrat opérationnel et les obligations découlant du traité de coopération en matière de défense, c’est-à-dire assurer une cohérence entre les missions, les capacités et les effectifs de la force.
Il en ressort que l’effectif minimal requis s’établit à 1 300 personnels.
Encore est-il à noter que dans ce scénario, les capacités des Forces françaises stationnées à Djibouti seraient sérieusement réduites. Les graphiques ci-après montrent, par exemple, les réductions de capacités que subirait le 5e RIAOM, perdant notamment toute capacité d’artillerie de longue portée.
STRUCTURE ACTUELLE DU 5e RIAOM
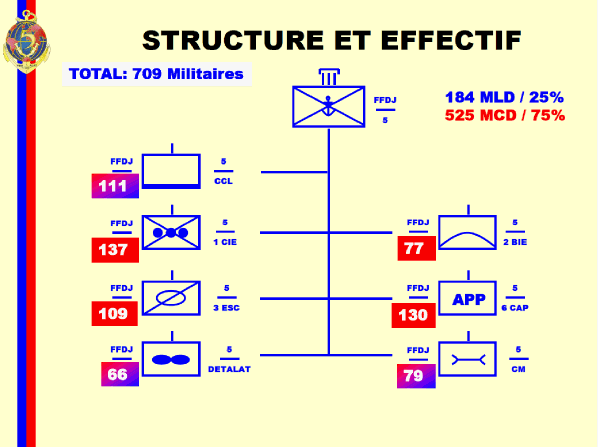
Source : commandement des Forces françaises à Djibouti.
STRUCTURE DU 5e RIAOM DANS L’HYPOTHÈSE D’UN FORMAT DE 1 300 HOMMES POUR FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI
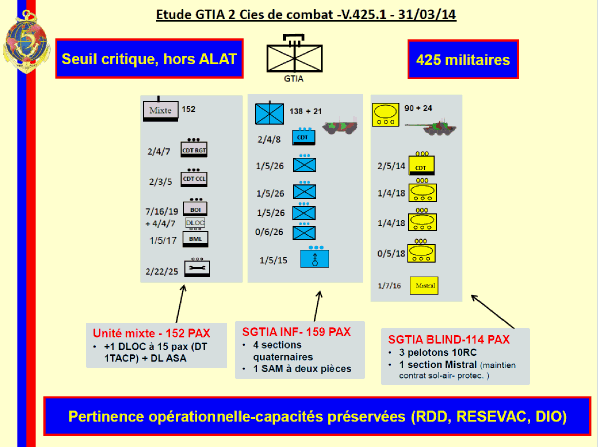
Source : commandement des Forces françaises à Djibouti.
ii. Un calendrier à « desserrer »
Afin de pouvoir mener de façon cohérente les opérations d’infrastructures nécessaires pour adapter les emprises au nouveau format des Forces françaises stationnées à Djibouti, de piloter de façon fine la manœuvre des ressources humaines, d’associer mieux le partenaire djiboutien à ces changements et faire face au regain de tensions que marque l’attentat du 24 mai dernier, l’état-major des Forces françaises stationnées à Djibouti considère qu’un cadencement de la réforme en trois temps serait avisé :
– temps 1 (2014-2015), temps de la conception : simultanément suivre le « chemin de ralliement » à la cible de 1900 personnels et participer à l’identification des pertes capacitaires ultérieures ;
– temps 2 (2016-2017), temps de la configuration (shaping) : consolider les composantes essentielles en faisant notamment effort sur la rationalisation des infrastructures et sur la manœuvre des ressources humaines ;
– temps 3 (2018-2019), temps de l’exécution : finaliser l’optimisation du soutien, diminuer les moyens spécialisés, poursuivre la recherche des mutualisations (notamment avec les Américains à Djibouti et avec les Forces françaises aux Émirats arabes unis).
Bien entendu, les rapporteurs ne possèdent pas les compétences spécialisées nécessaires pour émettre un avis technique qui relève de l’état-major des armées et de la décision du Gouvernement. Il n’en demeure pas moins que le schéma proposé ainsi décrit leur semble à la fois plus convaincant et plus prudent que la méthode consistant à fixer ab initio un objectif de déflation très massif pour notre principal point d’appui, relativement isolé dans une zone aussi sensible.
Les rapporteurs considèrent en outre que loin d’inciter à aller plus vite dans la déflation de Djibouti, la dégradation récente de la situation sécuritaire doit plutôt inciter à la prudence. En tout état de cause, elle rend parfaitement légitime une révision de l’objectif de déflation envisagé pour l’heure.
Il faut souligner qu’un tel ajustement resterait très marginal : il ne porterait que sur 350 personnels, soit à peine 1 % du nombre de déflations à opérer d’ici 2019. L’enjeu se situe, en quelque sorte, « dans l’épaisseur du trait ». La révision de la loi de programmation militaire prévue pour l’année 2015 pourrait d’ailleurs constituer l’occasion de prendre en compte cet ajustement.
II. LA RESTRUCTURATION PLANIFIÉE VISE À PERMETTRE À LA FRANCE DE CONSERVER SON INFLUENCE ET À SES FORCES LEUR RÉACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DANS UNE AFRIQUE QUI CHANGE
A. C’EN EST FINI DE « LA PRÉSENCE POUR LA PRÉSENCE »
Comme il a été rappelé aux rapporteurs lors de leur déplacement au Sénégal, Dakar comptait encore près de 20 000 militaires français pour une population de moins de 400 000 habitants en 1960 ; les Éléments français au Sénégal ont aujourd’hui un effectif de 350 personnels, et la ville compte plus d’un million d’habitants.
Cet exemple, certes particulièrement marqué, montre bien comment la présence française en Afrique a évolué avec le temps.
1. Du point de vue des États africains : la présence de « bases » étrangères ne fait pas toujours l’objet d’un consensus national
a. Certaines réticences des opinions publiques africaines conduisent à privilégier une « empreinte » militaire légère et discrète
Lors de leurs déplacements, les rapporteurs ont pu mesurer combien le déploiement de bases étrangères pouvait faire l’objet d’une approche politique très prudente dans certains pays, y compris parmi ceux qui sont résolument engagés dans la lutte contre les groupes armés terroristes.
Tel est par exemple le cas au Niger, où le déploiement français a été calibré suivant une logique d’« empreinte légère », cohérente avec la politique des autorités politiques nigériennes. Il ressort en effet des entretiens conduits sur place que si les autorités politiques et militaires nigériennes sont conscientes de l’intérêt de leur pays à coopérer de façon étroite avec la France, et donc d’accepter la présence de forces françaises sur son territoire, ils n’en restent pas moins très prudents sur le plan politique. L’impression générale pourrait être résumée ainsi : pour fructueuse qu’elle soit techniquement, la coopération militaire franco-nigérienne est encore en voie d’être assumée politiquement.
L’entretien des rapporteurs avec le président de l’Assemblée nationale était révélateur à cet égard. Le président a rappelé qu’il avait regretté publiquement que l’Assemblée nationale du Niger n’ait pas été consultée sur l’installation d’éléments militaires français sur le sol nigérien, ce qui a été « mal pris par l’exécutif ». Il s’agit, selon lui, d’une divergence portant sur des questions de transparence dans les procédures, plutôt que sur des questions de fond : estimant « qu’il faut préserver l’unanimité des forces politiques sur de tels sujets », il a affirmé que ni la majorité parlementaire ni l’opposition ne voyaient aucun inconvénient – au contraire – à la présence de détachements français et américains au Niger, ni n’avaient de « remontrances » à faire à la France. Il a ainsi déclaré : « le contexte nous oblige à accepter la présence et l’aide étrangère ». Pour lui, cependant, un débat parlementaire sur le déploiement d’éléments français et américains, au-delà même d’une vertueuse transparence démocratique, aurait permis « une meilleure appropriation des enjeux par les politiques et les militaires nigériens, rendant ainsi plus acceptable la présence des Français et des Américains ». Il a ainsi fait valoir que les parlementaires pouvaient jouer un rôle de relais entre les hautes autorités politiques du pays et l’opinion publique. Pour lui, « ce n’est pas la transparence mais au contraire la non-transparence qui crée des tensions inutiles », ce qui plaide en faveur de ce que les débats sur la sécurité et la défense « soient le plus publics possible ».
Un point particulier paraît focaliser les réticences : l’emploi du terme de « bases » pour désigner les implantations des détachements français et américains. Le secrétaire général du ministère de la Défense a reconnu que certains acteurs politiques « faisaient feu de tout bois » sur ce sujet, notant que la France n’était pas plus visée que les États-Unis.
En tout état de cause, les autorités nigériennes font preuve d’une grande discrétion quant à la coopération de défense qu’elles mènent avec la France et les États-Unis : les accords franco-nigériens en la matière sont tenus en partie secrets à la demande de la partie nigérienne, et le Niger s’est montré particulièrement vigilant à ce que les effectifs déployés demeurent à la fois :
– peu nombreux : un premier projet de formatage du détachement américain a ainsi été rejeté ;
– peu visibles, ce qui explique par exemple l’insertion des détachements étrangers dans une base nigérienne, et qui peut contribuer à expliquer que les Nigériens plaident en faveur du déplacement de la base américaine à Agadez, loin de la capitale.
Le chargé d’affaires des États-Unis a partagé cette analyse devant les rapporteurs, rappelant que le président Issoufou avait promis à l’opinion publique qu’il n’y aurait pas de « bases » étrangères, mais de simples déploiements de forces étrangères au sein de bases nigériennes. Pour lui, la présence militaire étrangère demeure une question sensible au Niger : même si l’opposition n’y est pas défavorable, et même s’il faut saluer la clairvoyance du président lorsque la crise libyenne a mis en lumière et aggravé la menace pesant sur le Niger, une « population peu éduquée est souvent sensible aux arguments de ceux qui dénoncent une « guerre des infidèles contre l’islam », menée à l’aide de « drones assassins » ». Une attention particulière mérite en effet d’être portée à tout élément susceptible d’affecter la stabilité politique du pays, pour deux raisons principales :
– le Niger a déjà une longue histoire d’instabilité politique, avec, en moyenne depuis son indépendance, une nouvelle Constitution tous les huit ans et un coup d’état tous les quatorze ans ;
– il est confronté à une véritable « bombe démographique » que les structures éducatives et le marché de l’emploi ne suffisent pas à contenir.
b. Les États africains tendent désormais à rechercher aussi d’autres contreparties à la présence française que la protection d’un pays (ou d’un régime)
Les accords de coopération en matière de défense conclus par la France avec ses partenaires africains ne prévoient pas tous les mêmes contreparties au déploiement ou au prépositionnement de forces françaises.
Ainsi, le traité franco-djiboutien de coopération en matière de défense stipule que « la partie française s’engage à verser à la partie djiboutienne, au titre de la présence des forces françaises stationnées, une contribution forfaitaire de 30 millions d’euros par année civile libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvement et redevances », cette contribution n’incluant pas toutefois certains droits particuliers, comme les redevances portuaires.
D’après les impressions recueillies sur place par les rapporteurs, les intentions exprimées par certains États, comme le Tchad, de renégocier les accords qui les lient à la France en matière de coopération de défense pourraient être motivées par un souci de « retour financier » plus important. Pour les rapporteurs, si de telles demandes devaient être adressées à la France, il conviendrait de faire le bilan des aides de toute nature fournies par la France aux forces armées des pays hôtes – il y a d’ailleurs presque à paradoxe à ce que la France fournisse encore 6 000 m3 de carburant par an à un État qui, comme le Tchad, est devenu entre-temps producteur de pétrole et dispose d’une raffinerie.
2. Du point de vue de la France : nous n’avons plus ni les moyens, ni l’intérêt, de maintenir un fort volume de forces sur le continent africain
a. La France n’a plus les moyens d’entretenir l’« armée d’Afrique »
i. Des contraintes financières
• Un objectif de déflation, découlant du Livre blanc de 2013 et de la loi de programmation militaire 2014-2019
Le Livre blanc de 2014 prévoit, « s’agissant de l’Afrique, une conversion de ces implantations [qui] sera réalisée afin de disposer de capacités réactives et flexibles ».
Le rapport annexé à la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a traduit cette orientation en objectif quantitatif de déflation : « une réduction de 1 100 emplois dans les forces prépositionnées et les outre-mer engagée dès 2014 ». Ainsi, les effectifs des forces de présence seront ramenés de 3 800 à 3 300 militaires. Selon les précisions fournies aux rapporteurs, cet objectif quantitatif intègrerait les personnels des forces spéciales appelés à être déployés au sein des bases opérationnelles avancées, mais pas ceux de la task force Sabre, qui demeure une opération extérieure.
Concernant les déploiements français dans la bande sahélo-saharienne, comme le commandement de la force Épervier l’a indiqué, il y a une véritable « pression sur les effectifs : réduire le dispositif sahélo-saharien à 3 000 personnels est difficile, compte tenu de la longue liste de missions qui seront assignées à cette force ».
C’est ce qui justifie, par exemple, la réduction du format de la concession d’Abéché, dont l’effectif passerait d’une centaine à une quarantaine de personnels et dont la superficie serait abandonnée pour moitié. L’idée directrice consiste à réduire l’emprise, aujourd’hui dimensionnée pour pouvoir accueillir des renforts significatifs, en renonçant à cette fonction – qui fait pourtant aujourd’hui une partie de l’intérêt de cette position à l’Est du Tchad, près de la frontière soudanaise. Les soixante effectifs ainsi économisés pourront être redéployés vers des fonctions de renseignement et de déminage.
Par ailleurs, le Livre blanc prévoit de réduire de trois à deux le nombre de zones de permanence à la mer. Comme l’a confirmé aux rapporteurs le chef d’état-major de la marine : « Méditerranée, océan Indien ou Golfe de Guinée : il y aura un choix à faire… », et ce d’autant qu’une permanence à la mer « mobilise trois frégates, or le format de la Marine est passé de 24 à 18 puis de 18 à 15 frégates ».
L’amiral Bernard Rogel a ajouté que par ailleurs, « l’action de l’État en mer n’a pas suffisamment été prise en compte dans les travaux de la commission du Livre blanc, axés sur la défense plutôt que sur la sécurité ».
• Des moyens limités pour l’accueil des élites africaines au sein de nos écoles militaires
Lors de leurs déplacements, les rapporteurs ont pu faire un double constat concernant la formation des officiers africains :
– dans les générations qui occupent actuellement ou ont occupé des postes élevés dans la hiérarchie militaire, la plupart des militaires ont été formés au sein des écoles françaises, à l’image du général Mouhamadou Lamine Keita, ancien chef d’état-major général des Forces armées sénégalaises, issu de la promotion Bir Hakeim de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Ces officiers ont souvent accédé à de hautes fonctions militaires et parfois politiques, tout en conservant un attachement particulier à la France, attachement qui constitue l’un de nos atouts majeurs sur le continent ;
– pour les générations les plus jeunes, en revanche, le nombre de places disponibles dans les écoles françaises a drastiquement diminué.
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de l’air a vivement regretté cette situation. Selon lui, notre « vraie plus-value », quand nos forces opèrent dans huit pays totalement souverains y compris en matière de maîtrise de l’air, c’est que tous les chefs d’état-major des armées de l’air de ces pays sont issus des rangs de notre École de l’Air. Cela joue surtout pour les officiers et les pilotes, « qui offrent un bon levier d’influence », laquelle a été « la clef du succès dans la bande sahélo-saharienne ». Mais aujourd’hui, « pour des économies de bouts de chandelle (quelques millions d’euros), on a réduit la voilure » : les budgets concernés ont été divisés par deux, car c’est la France qui prenait à sa seule charge les coûts afférents à la formation des officiers africains. Il en résulte un « effet d’éviction » : nombre d’Africains voudraient se former en France, mais faute de capacités d’accueil, ils vont en Chine... Pour le général Denis Mercier, « l’effet se fera sentir dans quelques années ».
Le chef d’état-major de l’armée de terre a fait le même constat devant les rapporteurs : « c’est pour des raisons d’économie que l’on accueille moins de stagiaires africains en France ». Pour lui, toutes les écoles nationales à vocation régionale n’ont pas encore atteint le même niveau de formation que les écoles françaises ou américaines, et en tout état de cause, accueillant des officiers de pays voisins, elles ne permettent pas, pour les Africains, le « grand brassage, enrichissant, que permet la formation dans les écoles françaises » et, pour la France, de développer des « relais d’influence » qui constituent un « atout construit dans la durée », « utile en cas de crise pour améliorer notre réactivité ». Pour le général Bertrand Ract Madoux, « il faut donc faire les deux : accueil et formation sur place », et faute de moyens suffisants, on pourrait se contenter d’un niveau de type « école d’état-major » en Afrique, et conserver des capacités d’accueil dans nos écoles, y compris au Centre des hautes études militaires (CHEM).
ii. Des contraintes capacitaires
Les rapporteurs ont pu observer que les femmes et les hommes qui ont participé aux opérations Serval et Sangaris se disent très satisfaits des équipements récents de l’armée de terre. Ce constat est partagé par le chef d’état-major de cette armée, qui a déclaré aux rapporteurs que « l’enseignement majeur réside dans la justesse et la pertinence des choix faits dans le domaine capacitaire ». Pour lui, ces opérations extérieures récentes montrent « que nous avons eu raison de préserver l’intégralité du spectre capacitaire. Au Mali par exemple, toutes les composantes ont été employées, depuis les plus légères parachutées pour saisir l’aéroport de Tombouctou jusqu’au plus blindées avec les VBCI et l’AMX 10 RC, l’effort tactique étant porté par le segment médian dont l’avenir dépend étroitement du lancement du programme SCORPION dès 2014. Notons également que les technologies modernes qui dotent nos matériels les plus récents apportent sur le terrain une supériorité tactique incontestable, déjà observée en Afghanistan ». Globalement, « en termes de performance intrinsèque, les matériels sont globalement bien adaptés aux terrains africains ».
Mais il n’en demeure pas moins que tant au Mali qu’en République centrafricaine, certains points d’attention concernant les matériels terrestres, aéroterrestres et aériens ont été mis en lumière ou confirmés lors des opérations Serval et Sangaris.
• Concernant les matériels terrestres et aéroterrestres des forces conventionnelles
1./ L’obsolescence bien connue de certains matériels, notamment au sein des unités prépositionnées
La plupart de ces limites sont bien connues : elles tiennent à la vétusté de certains matériels. Selon le général Bernard Barrera, commandant de la brigade Serval en 2013, les matériels anciens sont certes rustiques, mais leur maintien en condition opérationnelle est « de plus en plus exigeant ». Le CAESAR et le VBCI « ont très bien tenu », et le raid en VBCI sur la katibat du MUJAO à Aguelhoc aurait été impossible en véhicule de l’avant blindé (VAB). Le général était moins inquiet pour ses unités présentes dans le sud, car elles étaient équipées de VBCI, que pour celles présentes dans le nord, armées d’AMX 10 RC et de VAB. S’agissant de nos parcs blindés médians, le chef d’état-major de l’armée de terre a d’ailleurs estimé que ces capacités « atteignent d’ailleurs un seuil devenu critique ».
Il en va de même de l’ensemble des matériels d’ancienne génération, qui nécessitent des opérations de maintenance plus répétitives, ce qui limite la capacité opérationnelle en restreignant l’emploi des équipements. Sur un plan technique, les distances introduisent des ruptures de charges qui allongent les délais d’intervention et d’acheminement logistique, déjà grevé par les camions VTL (véhicule de transport logistique), objets de restrictions techniques d’emploi en vitesse et en charge, compte tenu de leur âge. Bien qu’appréciée pour leurs performances remarquables, les porteurs polyvalents terrestres (PPT) projetés au Mali ne couvrent pas encore tous les besoins compte tenu de leur faible nombre. La politique retenue par d’armée de terre est de relever systématiquement les VTL par des PPT au rythme des livraisons industrielles. Enfin, l’environnement très éprouvant de la bande sahélo-saharienne (sable, poussière, chaleur, etc.) « pousse le matériel à ses limites » et « révèle la faiblesse de conception de certains éléments », comme les hélicoptères Caracal.
Surtout, les récentes opérations ont montré la nécessité de rendre interopérables les équipements de forces prépositionnées et celles du dispositif Guépard nouvelle génération. Or, aujourd’hui, il ressort des observations des rapporteurs, confirmées par les précisions que leur a fournies l’état-major de l’armée de terre, que les forces prépositionnées ne bénéficient que de matériels anciens, voire obsolètes, y compris en matière de moyens de transmission et de véhicules. Il en résulte un frein à la numérisation des théâtres d’opération africains. Cette situation a conduit l’armée de terre à prendre la décision de numériser aussi ses forces prépositionnées, en planifiant le déploiement du système FELIN (fantassin à équipement et liaisons intégrés). Pour les rapporteurs, à terme, il serait logique d’appliquer également le programme SCORPION à ces forces prépositionnées, dans la mesure où elles ont vocation à armer des GTIA en complémentarité avec les forces assurant l’échelon national d’urgence.
Lors de son audition par les rapporteurs, le général Bernard Barrera a estimé que si le dispositif Guépard a fait la preuve de son efficacité, l’opération Serval avait aussi montré qu’il n’est pas « calibré pour tous les théâtres ». Par exemple, le système de radio HF CARTHAGE porte à 100 ou 200 kilomètres, ce qui est très nettement insuffisant pour des élongations telles que celles de l’opération Serval. Aussi, « on a dû compenser avec des moyens légers, nécessitant des « réflexes africains » : contact toutes les deux heures, mais pas de contact permanent ». La brigade Serval a aussi pu s’appuyer sur les moyens des unités aériennes, mieux équipées, mais sans que cela pallie tout à fait nos « défaillances claires en moyen satellitaires ». En quelque sorte, entre les unités de l’armée de l’air et la composante « terre » de la brigade Serval, « les uns manquaient de moyens radio et de systèmes d’information et de commandement (SIC), les autres de véhicules pour porter les leurs ! ». Une partie des difficultés a pu être levée en faisant venir des VAB ML et des VAB Vénus d’Afghanistan et en les employant plus près que d’habitude des zones de combat. Aussi, pour le général Bernard Barrera, l’expérience de l’opération Serval permet de penser qu’il faudrait centraliser les moyens SIC des forces d’alerte Guépard en France et permettre aux unités de s’entraîner avec, plutôt que les disperser en prépositionnement là où l’on n’interviendra peut-être pas. Cela correspond d’ailleurs au schéma retenu pour la préparation opérationnelle sur les VAB ML et Vénus, qui s’effectue en France. En tout état de cause, ces équipements sont « indispensables pour le résultat obtenu », et la « numérisation de l’espace de bataille » est « réussie au niveau de la brigade et du GTIA : elle a permis que l’on ne soit pas surpris ». Ce résultat est aussi à rapporter au fait que les personnels avaient certes été formés à ces matériels en Afghanistan mais que la brigade avait fait le pari judicieux de s’entraîner également à des configurations de théâtres différentes.
2./ Les difficultés rencontrées dans le déploiement des drones tactiques
Le général Bertrand Ract Madoux a également souligné l’insuffisance des moyens de renseignement, notamment en drones tactiques. Pour lui, « l’immensité des zones à couvrir pose également un défi en termes de renseignement, que le drone permet de relever ». Il relève que « dans ce domaine, les opérations en cours n’invalident absolument pas le besoin exprimé par l’armée de terre de déployer ses propres drones tactiques SDTI ; ceci pour garantir la satisfaction la plus complète possible d’un besoin de renseignement de portée tactique que les moyens actuels déployés sur les théâtres ne permettent de couvrir qu’à hauteur de 20 % ».
Cela plaide en faveur du renforcement et de la modernisation rapides de nos capacités en matière de drones tactiques. Le drone tactique a en effet une vocation différente de celle du drone MALE, et « au fond du désert, on a très rarement les drones de moyenne altitude et longue endurance (MALE) à disposition ».
Or notre système actuel de drone tactique, le SDTI, n’a pas été déployé au Mali, car « il fallait choisir des priorités », suivant une logique de gage : le déploiement d’un module de SDTI et des 40 personnels nécessaires devrait être compensé par le retrait d’une capacité du même volume. Pourtant, l’armée de terre dispose de quatre lanceurs et de 18 SDTI à Chaumont, dont un module prêt à partir, et « l’intérêt du drone tactique n’est pas à démontrer ». De même, l’armée de terre plaide depuis plusieurs semaines pour une meilleure surveillance de l’axe vital pour nos convois qui mène de Gao à Aguelhoc, où s’est produit récemment une attaque-suicide avec pour résultat quatre morts et 10 blessés dans le contingent tchadien d’Aguelhoc. Le chef d’état-major de l’armée de terre demande donc un module SDTI à Tessalit au moins. « Tout le monde est d’accord, mais on attend que ça se fasse, en partie à cause de cette logique du « gage » de chaque moyen nouveau par des suppressions ».
Le SDTI étant vieillissant, comme en témoignent ses coûts croissants de maintien en condition opérationnelle, il est prévu de le remplacer par un système plus moderne, pour lequel « tout est budgété ». Reste à en passer par une procédure d’appel d’offres, rendue obligatoire « du fait des règles européennes ».
On relèvera que, dans la perspective du remplacement du SDTI, a été mis en place un partenariat opérationnel franco-britannique autour du Watchkeeper. Dans ce cadre, quinze sous-officiers français ont déjà été formés au Watchkeeper aux côtés des britanniques en Afghanistan ; il serait d’ailleurs utile de répéter cet exercice au Mali, ce pour quoi le Royaume-Uni est « demandeur ». Les Britanniques sont en train de terminer le développement du Watchkeeper, et ils se montrent « très ouverts » : leur premier déploiement en Afghanistan se fait avec des équipes françaises. Ce partenariat opérationnel prend place dans un ensemble d’échanges franco-britanniques qui reposent sur les « intérêts croisés majeurs » qu’ont nos deux armées. Ainsi, un élément britannique vient en septembre se former au VBCI et au CAESAR au Mali : « les militaires britanniques aimeraient beaucoup en être dotés ».
3./ L’usure prématurée des matériels
Concernant les matériels, le général Bretrand Ract Madoux a expliqué aux rapporteurs que l’« on a du très moderne (par exemple : l’hélicoptère Tigre), et du très ancien (par exemple : le VAB, la Peugeot P4, etc.) ». Or les moyens modernes sont en « petit nombre », et sont donc sur-employés : « jusqu’à quatre fois leur potentiel annuel nominal ». Les armées sont donc confrontées à une « sur-usure rapide du matériel ». Les élongations, en outre, supposent de la mobilité, et donc des hélicoptères ; or ceux-ci sont sur employés. En Afrique « il n’y a pas de réserve » ; schématiquement, tous les hélicoptères sont soit en opération, soit en réparation. Ainsi, « l’équilibre est très instable ». De plus, les conditions d’emploi sont « très compliquées » : on parle de conditions « abrasives ». Même en République centrafricaine, le sable se double d’une pellicule de silice qui infiltre tous les équipements.
L’usure prématurée des équipements actuels « impose de ne pas perdre de temps dans les programmes de renouvellement ». Or l’opération d’ensemble SCORPION, dont c’est précisément l’objet, a déjà pris « plusieurs années de retard » : « il faut absolument le lancer cet été ». L’enjeu devient crucial : si « SCORPION n’est pas lancé cet été, c’est une trahison de toute la loi de programmation militaire pour l’armée de terre ». « Qui commande paie : quand on envoie des hommes, il faut les équiper ».
4./ Les difficultés de financement de la préparation opérationnelle des personnels aux opérations africaines, et les risques qui s’y attachent
Le général Bertrand Ract Madoux est revenu sur les enseignements des opérations Serval et Sangaris concernant la préparation opérationnelle des personnels aux opérations en Afrique. Le bilan qu’il en fait est contrasté : si nos forces ont atteint un niveau de professionnalisme excellent, les moyens consacrés à leur préparation sont à peine suffisants pour espérer maintenir ce niveau.
Selon lui, on constate aujourd’hui une « qualité de soldats que l’armée française n’a pas eue depuis très longtemps » : « les Américains et les Britanniques le reconnaissent ». On atteint « un niveau remarquable ». Les responsables militaires britanniques qui se sont déplacés au PCIAT Serval l’ont d’ailleurs dit : « nous vous admirons et nous vous envions ». Cela montre selon lui que malgré la contrainte financière, les forces ont réussi à mettre en place un système qui fonctionne parfaitement, de la formation à la préparation opérationnelle. Depuis l’Afghanistan, il y avait « un seul domaine dans lequel on piétinait un peu » : la manœuvre rapide, « qui frappe fort, par surprise » : Serval l’a exigé, « et on a réussi ».
Les mises en condition des forces
L’Afghanistan y a contribué, ainsi que les efforts de préparation et d’équipement de nos soldats. Les mises en condition avant projection pour les Opérations Serval et Sangaris ont été calquées sur celle mise en place pour l’Afghanistan. La préparation des troupes qui prennent l’alerte Guépard a été formalisée sur ces mêmes principes. La qualité de la préparation opérationnelle reste donc à un haut niveau d’exigence. Les mises en condition avant projection sont la priorité de la préparation opérationnelle car elles conditionnent la capacité de l’armée de terre à répondre au contrat opérationnel. L’effort est donc maintenu au niveau nécessaire.
Source : état-major de l’armée de terre.
Tout le paradoxe de la situation tient à ce qu’en matière de préparation des forces, les perspectives sont aussi inquiétantes que l’état des lieux est satisfaisant.
Pour le chef d’état-major de l’armée de terre, « des ressources comptées font que l’effort porté sur les stages de mise en condition avant projection (MCP), dans un contexte de fort engagement, dégrade la préparation opérationnelle générique des forces non projetées. Cela est significatif en ce qui concerne les crédits dédiés à l’entretien programmé des matériels mais aussi ceux consacrés aux munitions ». Le maintien de ces capacités et du niveau de savoir-faire « est placé au cœur des objectifs de la loi de programmation militaire : on ne cherche pas à faire mieux, on cherche à maintenir ce niveau malgré les contraintes budgétaires ». « On tire sur la ficelle en matière de conditions de vie, de tracasseries administratives (LOUVOIS...) et on atteint le moral par des dissolutions, mais les hommes se comportent extrêmement bien en OPEX ».
Le général Barrera a partagé ce constat, l’étayant d’observations concrètes. Il a fait observer aux rapporteurs que les parcs en service permanent (PSP) sont de plus en plus réduits, et ce d’autant que le meilleur matériel est systématiquement projeté en opération – ce qui est d’ailleurs « normal ». Ainsi, les unités s’entraînent sur des parcs centralisés, mais si le principe de centralisation concernait hier seulement les matériels « majeurs » (VAB, etc.), il s’étend aujourd’hui de plus en plus aux armes individuelles et autres équipements légers. Il en coûte donc de « grandes gesticulations pour arriver au minimum de préparation opérationnelle exigible », ce qui non seulement est lourd en « paperasserie », mais encore a un « impact sur le moral ». Pour le général, le niveau de prise de conscience de ces difficultés n’est « pas suffisant ».
• Concernant les matériels aériens
Si les opérations Serval et Sangaris avaient confirmé les insuffisances déjà connues de certaines de nos capacités aériennes, l’action des forces françaises dans la bande sahélo-saharienne a en outre mis en lumière de nouvelles insuffisances.
1./ L’aviation de transport
Parmi les insuffisances capacitaires déjà connues, la plus souvent mise en avant est celle qui concerne les capacités de notre aviation de transport.
Comme le chef d’état-major de l’armée de terre l’a noté, « l’immensité des zones à couvrir, qui s’impose comme un profond dénominateur commun sur [le] continent [africain], oblige nos forces à se scinder en de nombreux détachements qui doivent souvent opérer de façon autonome, loin les uns des autres ». Tel est par exemple le cas de l’opération Sangaris, comme les rapporteurs ont pu l’observer à Bangui et à Bambari : les 2 000 soldats français sont actuellement déployés sur onze sites répartis sur un territoire grand comme la France et la Belgique réunies, et dont le maillage routier est principalement composé par des chemins forestiers. « Cette réalité pose un défi colossal en termes de mobilité : compte tenu de la dispersion des unités, des élongations et de l’état du réseau routier, notre faculté à nous déplacer prend en Afrique une dimension bien plus importante que sur d’autres théâtres, au point qu’elle limite la manœuvre ».
Aussi, relever le défi de la conduite des opérations dans un milieu naturel aussi peu propice « impose de disposer de moyens de transport aérien et de vecteurs de transport terrestre en nombre. Ce constat est d’autant plus valable pour la logistique, dans laquelle le soutien sanitaire occupe une place centrale, tant son efficacité repose sur la permanence des moyens et la brièveté des délais d’intervention ». Ces limites se traduisent par des contraintes pesant sur l’agilité de la force : « nous devons admettre qu’au Mali comme en Centrafrique, la limite de nos moyens de transport aérien et de notre logistique terrestre contraint les choix opérationnels en tenant parfois le commandement militaire sur place à l’impossible ».
Le général Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air, a confirmé ce constat et souligné un facteur aggravant : la rénovation des avions de transport tactique C130 « immobilise des appareils ». Elle est nécessaire pour les mettre au niveau des normes aéronautiques internationales, ainsi que pour améliorer leur capacité tactique – elle doit permettre par exemple aux C130 de ravitailler en vol les hélicoptères Caracal, notamment pour les forces spéciales, car l’A400M, dont le cahier des charges prévoyait pourtant cette capacité, n’en sera pas capable pour des raisons techniques dirimantes. Or une telle capacité, « qui ne coûte que 30 millions d’euros », donnerait des élongations très supérieures aux opérations des forces spéciales, « qui sont aujourd’hui limitées et les groupes armés djihadistes le savent bien ! ». En outre, comme le relève le général Grégoire de Saint-Quentin, même si la rénovation des C130 ne doit être achevée qu’en fin de programmation, elle est indispensable pour disposer d’un avion de transport d’assaut utile sur de petits terrains, où l’A400M « ne fera pas le travail du Transall ou du C130 ».
Selon le général Denis Mercier, pour de grandes OPEX, la France aura toujours besoin d’affrètements (tel était le cas pour l’opération Serval, qui a nécessité 10 500 tonnes de fret), mais pour le volume moyen engagé dans les opérations extérieures « moyennes », « l’A400M améliorera d’autant plus les choses, qu’il partira de France et permettra d’acheminer de lourds frets ».
2./ Les capacités de ravitaillement en vol
Pour le chef d’état-major de l’armée de l’air, le « principal point de vigilance, ce sont les ravitailleurs ». Avec un nombre suffisant de ravitailleurs disponibles, « on pourrait supprimer trois chasseurs à N’Djamena et les laisser en alerte à St-Dizier, mais ils ne peuvent couvrir rapidement l’Afrique qu’avec des ravitailleurs ».
S’agissant du programme MRTT (multi-role transport tanker – avion multirôles de ravitaillement en vol et de transport) destiné à assurer le renouvellement de notre flotte de ravitailleurs, l’armée de l’air aurait obtenu l’engagement d’une commande ferme avant la fin de l’année 2014, avec donc deux livraisons à partir de 2018 – le général Denis Mercier faisant toutefois observer : « deux appareils seulement sur la période de programmation militaire en cours... ». L’armée de l’air a « accepté une configuration moins évoluée, en réduisant ses ambitions » notamment en matière de liaison satellitaire et de fonction cargo. « Mais il nous faut absolument la configuration « dissuasion », avec les capacités d’effacement des données qui correspondent ». L’armée de terre en a également grand besoin, dans un premier temps en configuration « palette », et avec un retrofit ultérieur en version cargo. Il est donc absolument nécessaire que les discussions commerciales engagées avec l’industriel aboutissent le plus rapidement possible.
3./ Les drones
Comme l’a déclaré aux rapporteurs le général commandant des opérations spéciales, « on rattrape le retard avec le Reaper », qui est un « game changer » et ce d’autant que cette technologie s’impose aujourd’hui comme un outil incontournable dans l’éventail des moyens de renseignement utilisés pour la préparation et le suivi de toute opération du type de celles que conduisent nos forces dans la bande sahélo-saharienne et en République centrafricaine.
En la matière, pour l’heure, la coopération avec les États-Unis est très utile : « les forces spéciales n’auraient pas pu mener toutes leurs opérations de l’hiver passé dans les mêmes conditions sans leur appui », qui prend la forme d’heures de vol de drones fournies aux Français. Cette coopération s’opère dans une « logique win-win », car les États-Unis y trouvent leur intérêt : d’une part, parce que les modalités de leur intervention sont ainsi « conformes aux orientations du discours de West Point du président Obama » et, d’autre part, parce que le partenariat franco-américain facilite le partage d’informations.
Mais il y a une « question d’indépendance nationale : il nous faut une plus grande capacité en matière de drones pour pouvoir mener une opération de type Sabre en autonome ».
4./ Les difficultés de l’hélicoptère Caracal en milieu sahélien
Les rapporteurs ont pu constater sur place que les hélicoptères Caracal supportent très mal les chaleurs et la poussière du climat sahélien, au point que leurs turbines, pourtant prévues pour durer 3 000 heures, doivent être changées beaucoup plus régulièrement. Il a ainsi été indiqué aux rapporteurs que leur « espérance de vie » observée dans la bande sahélo-saharienne était comprise entre 60 et 106 heures. Cette défaillance a un double prix :
– financier : chaque turbine coûtant 850 000 euros, le coût induit en maintien en condition opérationnelle est très élevé ;
– opérationnel : le rythme de ces opérations d’entretien pèse sur la disponibilité technique des appareils. À tout le moins, le marché de MCO de cet appareil mériterait d’être adapté en conséquence.
Le général Grégoire de Saint-Quentin a indiqué aux rapporteurs que ce problème n’avait pas été découvert au moment de l’opération Serval : il a été identifié dès 2006, et documenté par une fiche d’incident établie dans le cadre des opérations au Tchad en 2008.
Le chef d’état-major de l’armée de l’air a déclaré que ces défaillances ne devaient toutefois pas conduire à porter un jugement exagérément négatif sur la qualité de cet équipement, faisant valoir :
– que les hélicoptères lourds sont très utiles ;
– que le Caracal n’était pas prévu pour être utilisé dans ces conditions extrêmes de sable fin, et que les armées travaillent avec l’industriel concerné à un crash program ;
– que si l’on avait d’emblée mené ces programmes d’amélioration – « ce que l’on n’a pas fait pour des raisons financières de court terme » –, on aurait évité un coût important de renouvellement des turbines : « on aurait gagné de l’argent à investir plus tôt ! C’est l’effet paradoxal de la gestion actuelle » ;
– que le Caracal était conçu pour des missions de Search and Rescue, pas pour opérer en permanence. « C’est l’utilisation qui a changé : c’est naturel ». L’armée de l’air rencontre d’ailleurs actuellement le même problème avec l’ACCS (Air Command and Control System, système de commandement et de conduite OTAN qui est en cours d’acquisition) : « il était fait pour de la défense aérienne, mais on va l’utiliser aussi pour planifier et conduire les opérations aériennes, or ses bases de données n’intègrent pas toute l’Afrique et l’Afrique du Nord-Moyen Orient (ANMO) ».
• Concernant certains autres matériels des forces spéciales
Des discussions approfondies avec le commandement et les hommes du détachement de la task force Sabre ont permis de mettre en lumière les forces et les faiblesses du dispositif, notamment en matière d’équipements :
– les batteries équipant les véhicules de patrouille ont une faible autonomie, du fait d’un rythme d’utilisation très soutenu et de conditions climatiques extrêmes, avec des écarts de température de 50°C ;
– les procédures de validation des matériels entraînent des retards dans l’appropriation des matériels les plus récents, difficilement compatibles avec l’exigence de haute technicité qui est le propre des forces spéciales. Ainsi, 80 mitrailleuses MAG-58, pourtant en service depuis 56 ans dans 80 pays, sont en attente de validation auprès de la direction générale de l’armement (DGA) depuis 18 mois ; les personnels évoquent des retards du même ordre concernant un lance-grenades automatique de 40 mm, déjà en service dans plusieurs armées étrangères. Par ailleurs, certaines procédures conduisent à des incohérences : ainsi, un modèle récent de mitrailleuse à canons rotatifs est mis en dotation pour les fusiliers commandos marins, mais pas encore pour la composante « terre » des forces spéciales. Les personnels rencontrés par les rapporteurs ont regretté que la DGA n’ait pas mis en place des procédures plus souples pour les forces spéciales, soulignant que leurs homologues américains disposent d’une structure d’acquisition propre à ces forces ;
– la Peugeot P4 SAS présente deux faiblesses majeures : d’une part, elle est dotée d’une électronique fragile, ce qui fait qu’un tiers du parc est en permanence indisponible ; d’autre part, elle n’est pas assez rapide pour concurrencer les 4x4 Toyota utilisés par les groupes armés djihadistes ou terroristes, qui réussissent à atteindre une vitesse de 180 km/h dans le désert.
Le remplacement du VLTT P4 par le VPS (« véhicule patrouille spéciale » de Panhard) est programmé pour une durée couvrant deux périodes de programmation militaire, pour 165 exemplaires. Le lancement de l’appel d’offres serait « imminent ». Pour les rapporteurs, il convient toutefois de veiller à ce que les rythmes de livraison prévus soient tenus. En effet, ce type de programmes peu porteur en hautes technologies connaît parfois des décalages calendaires dus, au moins en partie, à une certaine inertie dans le suivi des programmes. Pourtant, les personnels des forces spéciales rencontrés par les rapporteurs estiment que le remplacement des P4 est « une urgence », car « l’usure des matériels actuels rend les choses inquiétantes ». Le GCOS a d’ailleurs consenti des efforts pour limiter le nombre de versions du VPS afin de réduire les coûts : on est passé de six à trois versions.
b. La France a-t-elle toujours intérêt à être présente sans avoir les moyens d’influer sur le cours des événements ? Le double risque de la présence militaire sans moyens conséquents d’intervention
i. Que la France soit accusée de ne pas prévenir toutes les crises : le « syndrome rwandais »
Vingt ans après l’opération Turquoise au Rwanda, qui a vu la France accusée – injustement – d’une coupable passivité face à une crise survenant dans un pays où elle entretenait un réseau de coopérants militaires, la question peut légitimement se poser de savoir s’il n’existe pas, au plan politique, des « risques de la présence ».
L’ambassadeur de France au Gabon a utilisé cette expression pour évoquer la situation du détachement des Forces françaises au Gabon installé à Port-Gentil. Il y avait été installé en 1992 en vue de protéger les ressortissants français, qui auraient pu être pris à partie violemment à l’occasion des turbulences sociales qui agitaient alors la région. Mais les effectifs actuels de ce détachement sont, selon l’ambassadeur, nettement insuffisants pour qu’il puisse avoir une action déterminante en cas de crise. Que se passerait-il alors si un événement sécuritaire se produisait à Port-Gentil ? Pour l’ambassadeur, le plus probable est que les quelques militaires français présents recevraient pour instruction de « se barricader », au risque d’être témoins d’exactions qu’ils n’auraient pas les moyens de faire cesser.
ii. Que les partenaires de la France se défaussent sur elle de leurs responsabilités
L’expérience de la gestion des crises malienne et centrafricaine de 2013 montre que si la France était indéniablement la mieux placée pour réagir en urgence à ces crises, grâce à son réseau de prépositionnements, on peut voir dans l’attitude des Européens une forme de désintérêt pour la sécurité de pays qu’ils considèrent comme relevant d’une zone d’influence strictement française, quelles que soient les menaces que la déstabilisation de ces pays fait peser pour l’Europe entière. À cet égard, le maintien de bases françaises peut apporter une explication – ou, tout du moins, servir de prétexte – au peu d’allant des Européens dans la gestion des crises africaines.
B. LE DISPOSITIF MILITAIRE FRANÇAIS EN AFRIQUE DOIT RÉPONDRE AVANT TOUT AUX BESOINS ET AUX DEMANDES DES ÉTATS AFRICAINS
La reconfiguration de notre dispositif permanent ainsi que la réorganisation de nos déploiements en opération extérieure dans la bande sahélo-saharienne doivent répondre, du point de vue opérationnel, à une double « nouvelle donne » :
– sur le continent africain, la menace évolue rapidement, à mesure que se révèlent ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « risques de la faiblesse » ;
– les États africains ne se placent plus, à l’égard de la France, dans une posture de demande de protection, mais d’expression de besoins de coopération, ce qui modifie profondément les modalités de la présence et des interventions françaises sur le continent.
1. Les menaces évoluent et appellent en conséquence une adaptation du dispositif français dans une logique de « défense de l’avant »
Comme la présidente de la commission de la Défense et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Burkina Faso l’a dit, en un mot, à la délégation : « la sous-région est dans une situation où, à tout moment, quelque chose peut arriver ».
a. Des menaces de toute nature sur le continent africain, relevant des « risques de la faiblesse »
Lors de son audition, M. Philippe Errera, directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques (DAS) du ministère de la Défense a estimé le concept de « risques de la faiblesse » est le plus pertinent pour l’analyse des crises africaines.
À court terme, la crise malienne illustre selon lui les vulnérabilités qui progressent avec les mutations de l’Afrique : expansionnisme religieux, explosion des trafics, djihadisme, etc. Ces phénomènes sont distincts mais s’articulent et interagissent. Ils se superposent à des faiblesses politiques et institutionnelles locales, concernant les États comme leurs organisations sous-régionales. Un continuum émerge dans ces différents types de menaces, du Golfe de Guinée jusqu’à la Libye, voire jusqu’en Irak et en Syrie. Soit un contexte « toujours crisogène ».
D’où « le risque réel pour les intérêts français et européens » de voir se constituer un État terroriste aux portes de l’Europe, qui a suffi en soi à justifier l’intervention au Mali. Il en va de même pour la sécurité maritime : il y a un « risque d’atteinte majeure aux intérêts européens, ignoré jusqu’à il y a cinq ans », car il s’agit d’axes d’approvisionnements vitaux pour l’Europe. Si le nombre d’incidents peut paraître stable depuis cinq ans, l’année 2013 a été marquée par un pic et l’année 2014 « a plutôt mal commencé ». Certes, dans la Corne de l’Afrique, une réponse militaire classique a amélioré la situation, mais elle n’est pas transposable au Golfe de Guinée, car les modes d’action des fauteurs de troubles sont différents – ils opèrent souvent dans les eaux territoriales, faisant fonds sur la « faiblesse des forces locales » et leur « corruption ».
À moyen terme, pour M. Philippe Errera, les « défis de l’émergence » vont accentuer les risques. Au nombre de ces défis, il cite notamment :
– l’urbanisation, qui devrait conduire à un accroissement de 300 millions du nombre d’urbains en Afrique à l’horizon 2030 ;
– les écarts de richesse intra et inter étatiques, avec toutes les conséquences qu’ont le chômage et les mouvements démographiques induits ;
– des systèmes politiques « usés par l’exercice du pouvoir » et « minés par corruption », l’amélioration en cours étant certes avérée, mais restant « trop lente » au regard des mouvements sociaux ;
– les risques de contestation sociale, du type des « printemps arabes », qui ne se traitent pas par une réponse militaire de notre part.
Le Livre blanc de 2013 avait d’ailleurs consacré des développements théoriques approfondis à ces « risques de la faiblesse ».
L’analyse du Livre blanc de 2013 sur les « risques de la faiblesse »
Que la faiblesse d’un État puisse devenir une menace est un fait nouveau d’importance stratégique : pendant des siècles, la faiblesse a d’abord été vue par les plus puissants comme une opportunité pour étendre leur territoire et accroître leur domination. Il n’en va plus de même dès lors que les progrès du droit et l’aspiration légitime des peuples à disposer d’eux-mêmes font de la souveraineté des États le principe organisateur de l’ordre international.
Que des États se révèlent incapables d’exercer leurs responsabilités régaliennes, et ce sont les bases mêmes de l’ordre international sur lequel nous fondons notre propre sécurité qui sont menacées. Les risques et les menaces auxquels ils ne savent pas faire face sur leur territoire peuvent rapidement déborder et affecter notre propre sécurité.
Un État qui ne contrôle plus ses frontières et son territoire peut devenir un sanctuaire pour des groupes criminels, un espace de transit des trafics, ou une base arrière de groupes terroristes permettant à ceux-ci de développer leur action à grande échelle. Alimentant la criminalité et les mouvements rebelles dans les zones où elles se développent, ces activités peuvent être à l’origine de conflits interétatiques. L’ordre international requiert de chaque État qu’il assure la garde du territoire sur lequel il exerce sa souveraineté non seulement pour le compte de son peuple, mais aussi pour celui de la communauté internationale.
La première décennie du XXIe siècle aura montré que la défaillance de nombre d’États à exercer les fonctions essentielles de la souveraineté est un phénomène durable et répandu. Cette défaillance concerne des États de niveau de développement et de taille diverse, sur la totalité ou sur une partie de leur territoire. Elle affecte par exemple des zones éloignées de la capitale échappant au contrôle du pouvoir central, comme au Sahel, au Yémen, au Pakistan et en Afghanistan.
Quand ces bouleversements frappent des pays à l’unité fragile, où les frontières issues de la décolonisation recouvrent une grande diversité ethnique, linguistique ou religieuse, sans qu’un projet national fort ait pris le relais de la lutte contre le colonisateur, la probabilité que survienne une guerre civile augmente encore. Pour l’Europe et la France, ce défi politique et humanitaire est aussi un enjeu stratégique. Beaucoup des États concernés se trouvent en effet aux portes de l’Europe, en Afrique, un continent qui est aujourd’hui à la croisée des chemins. Si l’Afrique subsaharienne confirme dans les prochaines décennies un décollage économique qui a été marqué, dans les cinq dernières années par une croissance annuelle de 5 %, le continent peut devenir un des moteurs de la croissance du monde et contribuer fortement à la prospérité européenne.
L’intérêt croissant de nombreuses puissances émergentes (Brésil, Chine, Inde et les pays du Golfe) pour l’Afrique - dont la population dépassera la population chinoise d’ici 2030 - ne se limite plus aux seuls produits énergétiques et aux matières premières. Il illustre cette prise de conscience du potentiel africain.
Cependant, l’Afrique subsaharienne est également une zone de grandes fragilités.
De 2003 à 2012, une dizaine de pays ont été secoués par des crises politiques ou des guerres civiles, et la majorité des casques bleus des Nations unies y sont déployés, parfois depuis plus de dix ans. Selon que les espaces non gouvernés ou à faible gouvernance reculeront ou au contraire s’étendront, ce sont deux avenirs bien différents qui se profileront à l’horizon des vingt prochaines années.
Nulle part, sans doute, l’éventail des possibles n’est aussi ouvert que sur le continent africain.
Les risques de la faiblesse sont plus insidieux que les menaces de la force, car ils n’ont pas le caractère tangible des conflits traditionnels de puissance et leur impact se manifeste tardivement, quand la communauté internationale est confrontée à un déficit d’ordre qu’elle doit tenter de combler dans l’urgence.
Elle est alors placée devant le dilemme de laisser le chaos s’installer, ou au contraire, en intervenant, de prendre le risque de focaliser sur elle les hostilités, sans pouvoir s’appuyer sur des partenaires nationaux solides. Dans le nouveau paysage stratégique, il est donc d’autant plus important d’identifier les risques de la faiblesse le plus tôt possible, afin d’y parer avant qu’ils n’aient produit leurs effets les plus dévastateurs.
i. Des menaces clairement terroristes
La menace terroriste est omniprésente, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Elle est d’autant plus complexe à traiter qu’elle est le fait de groupes armés terroristes, de groupes armés djihadistes et de groupes armés rebelles qui sont :
– de natures différentes : certains sont plus « professionnalisés » que d’autres, dont les moyens restent plus rudimentaires ;
– d’origines différentes : certains ont une base territoriale et ethnique clairement localisée, tandis que d’autres appartiennent à des mouvements djihadistes internationaux, dont les sources de financement, les bases d’entraînement et les approvisionnements sont allogènes à l’Afrique sub-saharienne ;
– porteurs de revendications différentes : djihadistes pour les uns, autonomistes voire indépendantistes pour d’autres ;
– plus ou moins « politisés », certains étant mus par un projet religieux ou politique clair, d’autres donnant davantage l’impression que le djihadisme sert parfois de « raison sociale » à des organisations intéressées surtout par des trafics en tous genres (narcotiques, biens de contrebande, êtres humains, etc.).
ii. Des mouvements centrifuges à connotation ethnique
Les ethnies les plus souvent présentées comme susceptibles de contester l’autorité de l’État dans la bande sahélo-saharienne sont les Touaregs et les Toubous.
Si les Toubous – ethnie nomade présente du Nord du Tchad au Nord du Niger, en passant par la Libye – ont pris part aux rébellions qu’a connues le Niger dans les années 1990, le déplacement des rapporteurs au Tchad a permis de constater que le président Idriss Déby Itno réussit, pour l’heure et par divers moyens, à s’assurer leur allégeance et à les faire contribuer au « verrouillage » de la frontière libyenne.
S’agissant des Touaregs, la présidente de la commission des Affaires étrangères et de la défense du Burkina Faso a déclaré que ce groupe ethnique portait de façon récurrente des revendications au moins autonomistes dans la plupart des États sur le territoire desquels il est implanté. Selon elle, c’est au Niger que leur cas doit être traité avec le plus d’attention, pour la double raison que c’est le pays où ils sont en plus grand nombre (deux à trois millions) et qu’ils occupent une région proche de la frontière sud de la Libye, particulièrement instable. Elle n’en a pas moins fait valoir que le danger qu’ils peuvent représenter n’est pas strictement proportionnel à leur nombre : même un groupe très minoritaire peut constituer une menace terroriste.
Le facteur ethnique dans la stabilité des États africains :
un rôle très variable d’un pays à l’autre
Il ressort des entretiens conduits dans l’ensemble des pays visités que le poids des divisions ethniques n’a pas la même importance dans la compréhension des différentes sociétés africaines et des conflits.
1. Un exemple de pays où le facteur ethnique semble jouer un rôle quasi-nul : le Sénégal
L’ambassadeur de France au Sénégal a insisté devant les rapporteurs sur le fait que, dans ce pays, la question ethnique constitue « totalement un non-sujet », estimant que le Sénégal n’est pas atteint par la « gangrène ethniciste que l’on rencontre ailleurs ».
2. Des pays où les fractures ethniques sont déterminantes dans l’équilibre (ou le déséquilibre) social et institutionnel : les cas du Mali et du Tchad
À l’inverse de ce qui est constaté au Sénégal, l’ambassadeur de France au Mali a souligné l’importance des fractures ethniques dans la vie sociale et politique malienne. Pour lui, « la grille de lecture la plus pertinente des problèmes du Mali est strictement ethnique, et non politique ». Cinquante ans de conflits ayant créé entre les Bambara et les Touaregs une sorte de haine réciproque et tenace. L’ambassadeur a d’ailleurs fait observer que le territoire malien se trouvait à cheval de part et d’autre de l’une des grandes fractures qui structurent la géographie humaine mondiale : celle qui sépare le monde arabo-musulman de l’Afrique noire, et qui suit une ligne ouest / est, de la Mauritanie au Tchad. Dans un tel contexte, si les mécanismes électoraux sont indéniablement indispensables à un fonctionnement démocratique des institutions, ils ne sont pas toujours suffisants à assurer le fonctionnement d’une société démocratique stable. En effet, les ethnies du Sud du Mali – composant le groupe des Bambaras – sont largement plus nombreuses que celles du Nord : il en résulte que les populations du Nord, ne représentant que 10 % environ du corps électoral même si elles occupent les deux tiers du territoire, peuvent se trouver marginalisées dans le jeu politique, ce qui ne va pas dans le sens de la résolution du conflit malien. Comme l’ambassadeur l’a fait observer, le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) s’est d’ailleurs appuyé essentiellement sur l’électorat du Sud pour assurer son élection ; on retiendra à cet égard qu’il a prononcé la plupart de ses discours électoraux en langue Bambara, ce qui ne peut pas être vu comme une façon de s’adresser à l’ensemble du corps électoral.
S’agissant du Tchad, l’attaché de défense a expliqué qu’en dépit de l’apparente solidité du régime en place, les logiques ethniques restent ainsi plus fortes que les logiques institutionnelles. Selon lui, certaines hautes autorités demeurent placées dans une « relation de vassalité » envers le clan noble des Zaghawas – il est à noter que le président Idriss Déby Itno lui-même provient lui-même d’un clan relativement moins bien considéré, celui des Bideyats. Cela contraint le pouvoir à entretenir des clientèles, ce qui limite la capacité de l’État à mettre en œuvre l’authentique ambition de développement économique qui anime le président.
3. Des pays qui essaient, parfois avec succès, de composer avec les divisions ethniques, voire de les dépasser, pour constituer un espace politique aussi cohérent que possible.
Le cas du Niger paraît aux rapporteurs particulièrement intéressant à cet égard. En effet, la composition ethnique de ce pays n’est pas moins fragmentée que celle du Mali, et il a lui aussi connu des rébellions touarègues. Mais, sans entrer ici dans une analyse très approfondie de sociologie politique du pays, il ressort des divers entretiens sur place que les autorités politiques du Niger ont mené une politique de réconciliation et d’intégration, plutôt que de clientélisme, pour juguler les tensions interethniques. L’action de la Haute Autorité pour la consolidation de la paix, comme la désignation de Touaregs à des postes importants - y compris à la primature - a permis, tout en respectant un fonctionnement démocratique, de trouver un équilibre interethnique viable. Les différentes autorités nigériennes rencontrées par les rapporteurs – tant au sein de l’exécutif que parmi les parlementaires – se sont montrées optimistes sur ce point, faisant valoir notamment que :
– l’urbanisation facilite les métissages ;
– l’ethnicisme est devenu « tabou » dans le discours politique.
iii. Des organisations criminelles
Trafics en tout genre, y compris d’humains, et « organisation » des migrations illégales vers l’Europe ont pris d’autant plus d’importance dans certaines régions sahéliennes, notamment au Niger, que l’instabilité de la Libye depuis 2011 a mis un terme aux flux traditionnels de travailleurs maliens et nigériens qui trouvaient à s’employer comme saisonniers dans ce pays.
On retiendra par exemple que selon l’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France au Niger, 70 % des migrants illégaux interpellés à Lampedusa sont passés par Agadez, au Niger, où le transit des clandestins constitue la principale activité économique locale – avec tout ce que cela implique : complicité de certains fonctionnaires, corruption, racket, etc.
iv. Des conflits communautaires non maîtrisés
Les déplacements des rapporteurs dans différents pays de la bande sahélo-saharienne leur ont permis de mesurer l’intensité des tensions résultant des difficultés de cohabitation de certaines ethnies. La véritable vendetta sévissant entre Touaregs et Peuls au Mali comme au Niger, liée à des conflits de territoires exacerbés par la pression démographique, en est un bon exemple.
Comme l’a expliqué le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger, la montée des tensions entre Peuls et Touaregs est en bonne partie liée à la croissance démographique du Niger – 3,3 % d’accroissement naturel par an, avec près de huit enfants par femme, ce qui constitue le taux de fécondité le plus élevé du monde.
En effet, à mesure que les Zarma et les Songhaï (ethnies sédentaires de cultivateurs) étendent leurs zones de cultures sur les territoires traditionnellement utilisés comme zones de pâturage par les Peuls (ethnie nomade de pasteurs), ceux-ci sont repoussés vers l’ouest, jusqu’au Mali, où ils ne peuvent assurer leur sécurité qu’en s’armant face aux Touaregs.
v. Une tendance globale à l’affichage d’un islam de plus en plus radical
Les interlocuteurs des rapporteurs dans l’ensemble des pays où ils se sont rendus s’accordent à constater une tendance globale à l’affichage d’un islam de plus en plus radical, moins « tolérant » que la pratique traditionnelle locale, notamment sous l’effet du prosélytisme wahhabite. Ce poids croissant du facteur religieux présente un risque majeur : celui d’ouvrir la voie à une instrumentalisation confessionnelle des conflits, déjà à l’œuvre en République centrafricaine.
En ont témoigné notamment les représentants et représentantes de la communauté française établie au Niger, pour certains depuis plusieurs décennies. Le président Mahamadou Issoufou, comme plusieurs interlocuteurs de la délégation, a d’ailleurs déclaré qu’il avait lui-même été surpris de la tournure interconfessionnelle soudainement prise par le conflit centrafricain.
Simple « retour du religieux » ou radicalisation islamiste ?
Comme l’ambassadeur de l’UE au Niger l’a fait observer, la démocratisation du Niger a produit à cet égard un effet paradoxal : le régime administratif de licence qui permettait d’encadrer les organisations religieuses ayant été supprimé, l’État est désormais « débordé » par la multiplication des associations islamiques, au point que l’on assiste à une sorte de « concurrence sonore » entre muezzins. Les autorités tiennent à dissocier deux tendances : d’une part, le retour du religieux dans la vie sociale et, d’autre part, la radicalisation de l’islam. Ils reconnaissent que la première existe, mais ont tendance à nier la seconde. Même si les renseignements généraux essaient de surveiller les mosquées, les moyens technologiques – prêches des imans « minoritaires » télévisés ou diffusés par téléphone portable – dépassent leurs capacités d’action. Il est à noter que le financement étranger de ses associations islamiques reste marginal, concentré sur quelques grands projets de bâtiments et travaux publics. Le ministre nigérien de l’Intérieur a d’ailleurs estimé devant la délégation que l’islam traditionnel, dont les imams sont nommés par les chefs de village, constituait le meilleur rempart du Niger contre l’islamisme radical et que s’il existe bien un islam wahhabite importé, il est cantonné aux villes et reste « marginal et contrôlé, moins par l’État d’ailleurs que par la société civile elle-même ».
Le discours est sensiblement le même au Burkina Faso, où le secrétaire général du ministère de la Défense a assuré que ses services « passaient au filtre » les prêcheurs venus de l’extérieur lors de l’examen des demandes de visas et les suivait assidûment – sans donner toutefois d’appréciation sur le nombre de prêcheurs qui pourraient passer clandestinement les frontières burkinabées, qui ne sont pas étanches – et qu’un dispositif administratif ad hoc avait été mis en place pour suivre les financements étrangers destinés à des organisations religieuses. Les services compétents de l’ambassade de France ont une appréciation moins optimiste de ce phénomène : tout en reconnaissant que l’adhésion à l’islam reste un peu « superficielle » dans un pays encore profondément marqué par l’animisme, ils relèvent que des financements saoudiens et qataris viennent irriguer les organisations islamiques, notamment en finançant la construction de mosquées, le fonctionnement d’écoles coraniques et une aide humanitaire particulièrement bien accueillie par une population majoritairement pauvre. Le président de la commission des Affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée nationale du Faso a confirmé aux rapporteurs l’existence de financements « occultes » pour certaines mosquées, tout en soulignant que les autorités s’attachaient « beaucoup à cultiver des liens entre les différentes communautés religieuses, afin qu’elles vivent en bonne intelligence ».
La menace que représente un certain prosélytisme islamiste radical est perceptible dans tous les pays de la bande sahélo-saharienne où se sont rendus les rapporteurs. Elle a été systématiquement mise en avant par leurs interlocuteurs, y compris au Sénégal, traditionnellement réputé pour sa grande tolérance religieuse. Comme le président du groupe d’amitié Sénégal-France à l’Assemblée nationale l’a rappelé aux rapporteurs, Léopold Sédar Senghor était chrétien, et si 95 % des Sénégalais sont musulmans, les mariages mixtes sont très fréquents, et d’autant plus aisés que ni la conversion du conjoint ni l’éducation musulmane des enfants ne sont obligatoires. La manœuvre d’approche des organisations islamiste est souvent la même : les quartiers pauvres et les jeunes urbains en situation de décrochage scolaire ou universitaire constituent une clientèle sensible à l’aide matérielle apportée par ces organisations, dont l’idéologie progresse d’autant plus facilement que les confréries structurant traditionnellement l’islam dans ces pays peuvent paraître en décalage par rapport aux grands changements sociaux à l’œuvre, explosion démographique et urbanisation aussi rapide que mal ordonnée.
Pour l’ambassadeur de l’UE au Niger, les représentations étrangères n’ont donc d’autre choix que de travailler avec les chefs religieux dans les domaines qui intéressent l’action extérieure des Européens – le mariage forcé, la scolarisation des filles, etc. – avec cette double difficulté que : 1./ l’islam sunnite étant peu hiérarchisé, les imams et les chefs de village qui détiennent un pouvoir religieux ne sont pas toujours sur la même ligne ; 2./ qu’en discutant avec les religieux, les Européens leur offrent une sorte de reconnaissance comme acteurs légitimes dans le jeu politique national.
L’ambassadeur des États-Unis au Niger s’est montré plutôt pessimiste sur la question. Pour lui, le salafisme progresse au Niger comme il le fait, à petits pas, dans l’ensemble du monde musulman depuis 40 ans, et si les vues d’Al-Qaïda sont globalement rejetées par la population, il suffit d’une poignée de radicaux déterminés et bien soutenus pour déstabiliser gravement un pays comme le Niger. En tout état de cause, tant les représentants diplomatiques que les représentants des Français établis au Niger s’accordent à dire que l’on voit de plus en plus de femmes voilées, que la prière de 16 heures est désormais admise comme une raison valable de refuser un rendez-vous de travail, et qu’un phénomène d’autocensure est observable parmi les femmes.
b. Des menaces essentiellement transfrontalières
Le Premier ministre du Niger – lui-même Touareg – a résumé la situation en ces termes : « on ne choisit pas ses voisins… ». Il apparaît en effet clairement qu’en Afrique, aujourd’hui, la menace n’est pas contenue par les frontières.
i. Du fait de la porosité générale des frontières
Les frontières interétatiques dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique sub-saharienne présentent la particularité d’être unanimement décrites comme « poreuses », en dehors de quelques check-points sur quelques pistes.
On relèvera à titre d’exemple que, selon les services de l’ambassade de France au Burkina Faso, une ligne de 500 kilomètres de la frontière malienno-burkinabée est dépourvue de tout poste frontière, et que les postes existants ne disposent pas de plus d’un litre d’essence par jour.
De même, le chef d’état-major de la MINUSMA a reconnu dès le mois de mars 2014 que la zone du Mali frontalière de l’Algérie constituait une « zone grise » du point de vue sécuritaire, car aucune force ne s’y projette. Pour lui, les raisons en sont diverses : manque de moyens adaptés aux distances en question, « manque d’envie », autres priorités, etc. Il reconnaissait néanmoins qu’une action le long de la frontière algérienne, était indispensable pour « couper les liens du « château fort » du Tigharghar avec le Nord ».
Cette porosité est mise à profit par les groupes armés djihadistes, terroristes ou rebelles. Au Niger, par exemple, les rapporteurs ont pu constater que les autorités locales étaient particulièrement préoccupées par l’implantation au Sud du pays des bases arrières de Boko Haram.
ii. Du fait de la continuité des composantes ethniques de part et d’autre des frontières
Le fait que les frontières étatiques recoupent rarement celles (d’ailleurs souvent floues, et fluctuantes au gré des évolutions démographiques) zones ethniques complique leur surveillance et contribue à internationaliser les problèmes sécuritaires.
Tel est le cas, par exemple, à la frontière nigéro-nigériane : même entre un pays francophone et un pays anglophone, la continuité de l’ethnie Haoussa entre le Nord du Nigeria, foyer de Boko Haram, et le Sud du Niger facilite les mouvements de Boko Haram. De même, les autorités nigériennes, tant civiles que militaires, ont insisté devant les rapporteurs sur le fait que de part et d’autre de leur frontière avec le Mali, on retrouvait les mêmes populations et les mêmes rivalités tribales.
Le cas le plus marquant de groupe ethnique présent sur plusieurs pays et ayant joué un rôle dans plusieurs rebellions est celui des Touaregs, auxquels les rapporteurs consacrent plusieurs développements infra.
iii. Du fait de l’existence de « sanctuaires » rebelles
Du fait de frontières poreuses, des groupes armés peuvent aisément opérer dans un pays depuis un autre – ou depuis une région mal contrôlée par un autre pays –, abritant des sortes de « sanctuaires » rebelles.
Deux types de pays ou de régions de ce type ont été mentionnés lors de leurs déplacements :
– des États qui présentent ce que l’on a défini plus haut comme les « risques de la faiblesse ». Les cas de la Libye et du Nord du Mali en constituent des exemples souvent cités. La République centrafricaine semble aussi avoir longtemps servi de refuge aux rebelles tchadiens ;
– des États qui, sans être dépourvus d’appareils de sécurité puissants, ont pu être vus comme ayant joué un rôle ambigu vis-à-vis de certains groupes armés rebelles, djihadistes ou terroristes : le cas de l’Algérie est le plus souvent cité (que ce soit à juste titre ou non) par plusieurs responsables civils et militaires de pays sub-sahariens.
• Les conséquences de la situation de la Libye sur la sécurité de la bande sahélo-saharienne
S’agissant du Sud de la Libye, les préoccupations sont particulièrement fortes au Niger. Le président Issoufou a rappelé aux rapporteurs qu’il avait – en vain – appelé l’attention des autorités française, lors du déclenchement de l’opération Harmattan, sur le double danger que faisait peser un renversement du régime Khadhafi sans solution de rechange viable :
– d’une part, la montée en puissance des salafistes ;
– d’autre part, la « somalisation » du pays, c’est-à-dire la dissolution complète de l’État.
Pour lui, ces deux dangers étaient plus graves que la menace que pouvait faire peser le régime du colonel Khadhafi ; et à son sens, ces deux risques se sont aujourd’hui réalisés. Les autorités nigériennes font valoir qu’un nombre important de cadres d’Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) sont issus de la région de Benghazi – les Cyrénéens étant selon lui le deuxième vivier de recrutement d’AQMI, après les Saoudiens – et seraient tentés par une politique expansionniste dans l’ensemble du Sahel s’ils prenaient le contrôle de la Libye.
Le directeur de cabinet du ministre nigérien des Affaires étrangères fait quant à lui remonter l’instabilité libyenne à une période antérieure au renversement du régime Khadhafi. Pour lui, l’État n’a jamais existé en Libye : des régions comme Mistrata ou la Cyrénaïque ont toujours joué un jeu politique assez autonome – développant des liens avec le Qatar et la Turquie notamment – et le Sud de la Libye a toujours été ouvert à tous types de trafics. Il ajoute d’ailleurs que les Libyens du Nord n’ont jamais considéré les populations du Sud de la Libye, notamment les Toubous, comme des Libyens à part entière, et que les populations issues du Niger et du Tchad qui avaient émigré de longue date en Libye et en sont revenues à la chute du régime Khadhafi ont de grandes difficultés d’assimilation, au point qu’elles sont considérées comme étrangères de chaque côté de la frontière. L’ambassadeur américain au Niger a en outre souligné le risque de tentation sécessionniste des Toubous en Libye, où ils sont moins intégrés qu’au Niger et moins liés au pouvoir central qu’au Tchad.
Aussi, la stratégie présentée à la délégation par le président Issoufou consiste-t-elle à essayer de « verrouiller » le principal corridor de passage entre le Sud de la Libye et le Niger – la passe de Salvador – afin de protéger de toute incursion massive non seulement le Niger, mais tous les États situés plus au sud.
Les responsables maliens rencontrés par les rapporteurs partagent les mêmes analyses. Selon le président de l’Assemblée nationale, l’instabilité de la Libye a « de grandes répercussions sur le Nord du Mali », où « ce sont, à tous moments, incursions et escarmouches ».
Le directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques s’est dit « très préoccupé » par la situation en Libye : selon lui, « il n’y a pas de solution immédiate ». Même si le général Haftar parvient à « construire quelque chose », « cela mettra beaucoup de temps », en dépit de l’appui de l’Égypte et de l’Algérie, car « la tâche est immense ».
En outre, la reconstitution d’un État – ou, du moins, d’un minimum viable d’autorité publique dans la « zone utile » du pays (la bande côtière de 100 kilomètres de profondeur où se concentrent 90 % de la population) ne règlera pas le problème du Sud de la Libye. Même sous le colonel Khadafi, ni l’État ni l’armée n’y étaient présents, et c’est aujourd’hui un havre pour les groupes armés djihadistes et les groupes armés terroristes.
Selon la délégation aux affaires stratégiques, Américains, Britanniques et Italiens sont « concentrés avant tout sur l’armée régulière », et portent donc leurs efforts sur Tripoli et Benghazi : « on a beaucoup de mal à les intéresser à ce qui se passe dans le Sud ». Ils sont conscients des menaces, mais dans l’allocation des ressources (heures de drones, etc.), « le Sud libyen passe toujours en arrière-plan, d’autant qu’ils ont l’impression que les Français peuvent traiter cela par le Niger et le Tchad ».
Le but poursuivi par la France consiste donc à « s’assurer d’un contrôle un peu meilleur des frontières ». Pour cela, les opérations françaises dans le Nord du Tchad permettent d’être au plus près, et plusieurs pays coopèrent : le Niger, la Tunisie (des coopérations ponctuelles se mettent en place avec leurs forces spéciales), l’Algérie, le Tchad, etc.
Les Occidentaux disposent de très peu de leviers qui pourraient être actionnés en vue de « responsabiliser » les Libyens : « nous n’avons aucun interlocuteur légitime et capable de s’engager pour les dizaines de groupes d’ex-miliciens ». Le même problème se pose d’ailleurs déjà pour nos programmes de formation : il est difficile de trouver un responsable ministériel stable, et plus encore d’identifier les soldats à former.
• Les conséquences du jeu de l’Algérie sur la sécurité de la bande sahélo-saharienne
Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger a également souligné le rôle clé de l’Algérie, estimant que « le vrai danger est là ».
Le directeur de cabinet du ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur est allé plus loin, en indiquant aux rapporteurs que du point de vue de la sécurité des frontières, l’évolution politique intérieure de l’Algérie est vue comme préoccupante par la plupart de ses voisins, qui auraient trouvé des avantages à un renouvellement plus rapide de la classe politique algérienne.
iv. Pour les pays dotés d’une façade maritime, du fait de moyens très faibles au service de l’action de l’État en mer
La faiblesse des moyens consacrés par les États côtiers à la surveillance de leurs façades maritimes – qui, selon les observateurs, était loin de constituer pour eux une priorité jusqu’à une date récente – laisse la voie largement libre à divers trafics. À titre d’exemple, on retiendra que faute de moyens consacrés à la police des mers, les pêches illégales au large du Sénégal sont évaluées à 400 000 tonnes par an, soit autant que les pêches légales : la surpêche ainsi induite conduit à l’épuisement de la ressource halieutique.
Plus largement, le chef d’état-major de la marine a expliqué que le Golfe de Guinée offre un « large panel de crises maritimes » : pêche illégale, drogue, et surtout la piraterie, phénomène de plus en plus prégnant et marqué par « des modes d’action de plus en plus violents, professionnels ». Les trois attaques de pétroliers les plus récentes, avec transfert du pétrole, provenaient du Nigéria, sans qu’il soit établi à ce stade si les pirates étaient en lien ou non avec Boko Haram.
v. Même Boko Haram semble porté à élargir sa zone d’action
Même dans le cas de Boko Haram, qui centrait initialement ses actions et ses revendications sur le seul Nord du Nigéria (l’État de Borno) et son fonctionnement fédéral, la menace est désormais perçue comme transfrontalière.
Le président Issoufou a évoqué sa « préoccupation » quant au risque de « contagion » de Boko Haram : le mouvement a établi des bases arrière dans les pays de la région et pourrait y nourrir des débordements. De même, le président de l’Assemblée nationale du Niger a décrit Boko Haram comme une organisation « insaisissable » : faute de chefs clairement identifiés et dotés d’une réelle autorité sur la nébuleuse de groupes se revendiquant du « label » Boko Haram, il est difficile de cerner les intentions de cette mouvance, et plus encore d’entamer des négociations. Reste cependant que, pour le président, la volonté de Boko Haram de « s’accaparer » une zone recouvrant le Nord du Nigeria, le Sud du Niger (notamment la région de Diffa), la corne nord du Cameroun et le lit du lac Tchad est manifeste.
Le ministre nigérien de l’Intérieur a partagé devant les rapporteurs cette préoccupation : pour lui, les 40 000 réfugiés nigérians qui ont franchi la frontière nigérienne – longue de 1 500 kilomètres et particulièrement poreuse – comptent parmi eux des éléments de Boko Haram qui se servent du Niger comme base arrière, mais selon lui, s’ils n’ont pas lancé d’attaque au Niger même, c’est plutôt parce qu’ils n’en ont pas encore la capacité que parce qu’ils n’en ont pas la volonté. Les forces de sécurité intérieure procèdent ainsi tous les jours à des arrestations. Les renseignements fournis à N’Djamena vont dans le même sens : Boko Haram a tendance à élargir sa zone d’opérations à l’ensemble de la région du lac Tchad, et plus seulement à y établir des bases arrière.
Les cartes ci-après illustrent le caractère régional de cette menace, dans la bande sahélo-saharienne et, plus largement, dans le reste de l’Afrique de l’Ouest.
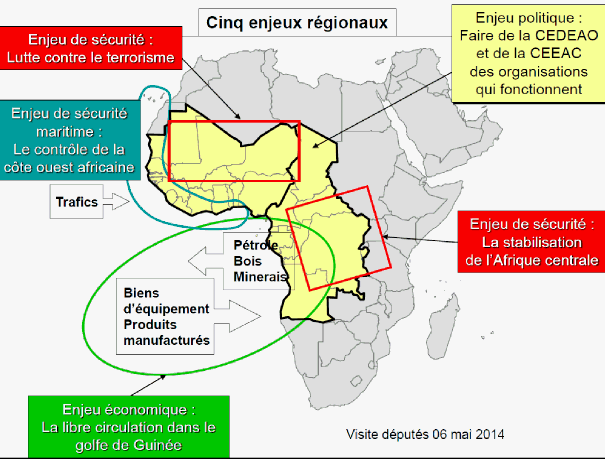
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
AFRIQUE DE L’OUEST : TURBULENCES POLITIQUES
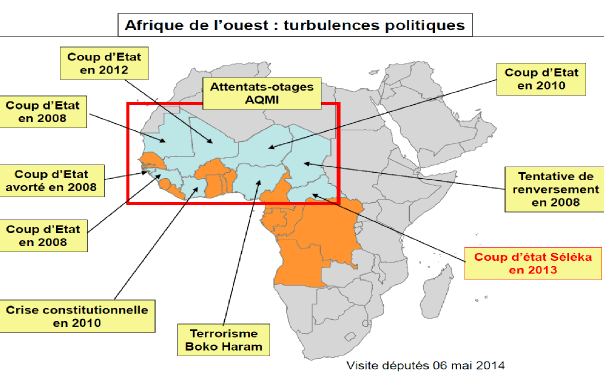
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
AFRIQUE CENTRALE : FRICTIONS AUX FRONTIÈRES
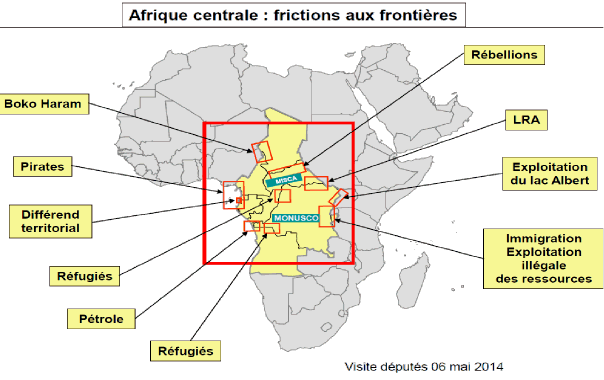
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
CENTRE DE GRAVITÉ DES OPÉRATIONS D’ÉVACUATION DE RESSORTISSANTS
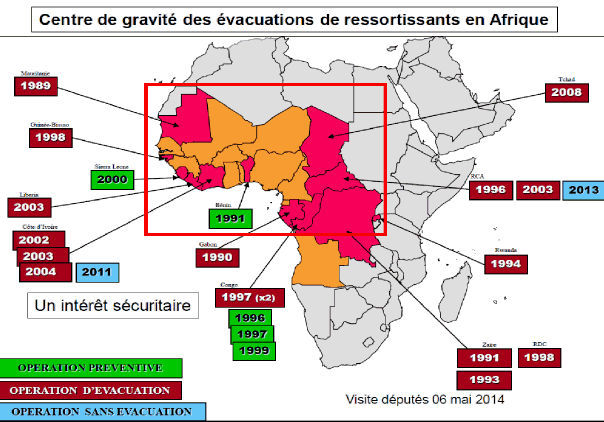
Source : commandement des Forces françaises au Gabon.
Ainsi, loin de contenir la menace, l’existence de frontières a donc plutôt tendance à compliquer l’organisation de la réponse à y apporter. Le ministre malien de la Défense a d’ailleurs déclaré que dans le Sahel, les zones frontalières sont les moins sûres : toutes les menaces et tous les trafics trouvent d’après lui des soutiens au sein des communautés habitant ces zones.
c. Un risque de « jonction » entre les différents mouvements rebelles
Même si les différents groupes rebelles ne font pas pleinement cause commune, il ressort des informations recueillies par les rapporteurs que la communauté d’intérêts qui les lie les conduit à se rapprocher de plus en plus, au gré d’alliances de circonstance faisant craindre une jonction des rébellions dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.
Certains des interlocuteurs rencontrés estiment que les différents groupes rebelles n’ont pas encore opéré de jonction opérationnelle, et qu’il existe des obstacles sérieux à leur rapprochement. Ainsi, les services compétents de l’ambassade de France au Tchad font valoir que les différents groupes rebelles d’Afrique de l’Ouest n’ont ni idéologie ni racines ethniques communes, et que leur recrutement fait une large place à des « bandits opportunistes » – donc potentiellement concurrents –, sur lesquels les chefs des groupes rebelles n’ont pas toujours une influence certaine. De même, leurs homologues au Niger estiment que la proximité entre Boko Haram et AQMI ne dépasse pas actuellement le stade de la communauté d’intérêts, et que si Boko Haram a une large assise sociale dans sa zone d’influence du fait de son action « caritative », AQMI y est vu comme un mouvement « importé » d’Algérie. Dans le même sens, toujours au Niger, le président Haute Autorité à la consolidation de la paix a estimé que pour l’heure, les divers trafiquants de la zone sahélo-saharienne ne font pas cause commune avec les djihadistes.
Toutefois, d’autres interlocuteurs des rapporteurs se sont montrés plus pessimistes. Ainsi, l’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France au Niger leur a indiqué que des complicités étaient avérées entre Boko Haram et le mouvement pour l’unicité du djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), qui mutualisent certains de leurs entraînements, opèrent des financements croisés, et se sous-traitent certaines opérations. Il ne faut pas non plus exclure l’hypothèse qu’un groupe composé d’éléments relativement autonomes, comme Boko Haram, puisse être instrumentalisé par des éléments extérieurs.
De même, pour le secrétaire général du ministère burkinabé de la Défense, on perçoit des tentatives de jonction entre AQMI et Boko Haram, ce qui constitue « un très mauvais signe ». Selon les services compétents de l’ambassade de France au Burkina Faso, un membre d’Ansaru (groupe affilié à Boko Haram) aurait participé aux attentats perpétrés le 23 mai 2013 par le MUJAO – alors allié à AQMI au Mali – à Agadez et Arlit sous le nom d’« opération Abou Zeid », en référence au chef militaire d’AQMI au Mali. De même, les groupes armés djihadistes actifs au Mali compteraient un nombre important de Nigérians. De plus, selon l’état-major de Serval, des mouvements de rapprochement ont été observés depuis le mois de janvier 2014 entre AQMI et Al-Mourabitoune au Mali. En outre, le président nigérien Issoufou a indiqué que, selon ses renseignements, des groupes armés djihadistes faisaient mouvement vers la République centrafricaine.
En tout état de cause, pour la plupart des interlocuteurs des rapporteurs, la communication entre les différents groupes armés terroristes (groupes armés terroristes) ou djihadistes (groupes armés djihadistes) est d’autant plus aisée que la région est traditionnellement le lieu :
– de trafics internationaux en tous genres : drogue, armes, cigarettes, etc.
– de conflits transfrontaliers entre différents groupes ethniques : Arabes, Touaregs, Toubous.
Comme le président de la commission de la Défense et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale burkinabée l’a fait valoir, même s’il n’y a pas encore de preuves d’une jonction entre Boko Haram et les mouvements touaregs au plan opérationnel, le risque d’une telle jonction devait être pris au sérieux :
– en mutualisant leurs capacités, les groupes armés rebelles, djihadistes ou terroristes verraient leur pouvoir de nuisance croître, ce qui compliquerait considérablement la lutte contre le terrorisme dans toute la sous-région ;
– l’internationalisation d’un conflit initialement circonscrit au Nigéria peut donner à Boko Haram une envie de « surenchère » : les services compétents de l’ambassade de France au Tchad ont d’ailleurs fait valoir aux rapporteurs que, de ce point de vue, Boko Haram avait réussi une sorte de « coup médiatique international » avec l’enlèvement de plus de 200 lycéennes. Dès lors, pour les pays occidentaux, le risque est de « mordre à l’hameçon » en prenant trop directement le contrôle de la lutte contre Boko Haram, car cela exposerait les ressortissants occidentaux à tous les risques imaginables.
Les « connexions » existant entre les différents groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes
« Aujourd’hui, l’ennemi de la bande sahélo-saharienne est affaibli et désorganisé.
Mais il n’est pas vaincu. Il reste déterminé et dangereux. Il s’est adapté, pour défier nos capacités de renseignement, de mobilité et d’action. Et la bande sahélienne ne devient qu’une partie d’un ensemble plus vaste, avec des ramifications au Nord et au Sud : du Sénégal à Djibouti en passant par le Mali, le Sud de l’Algérie, le Niger, le Sud de la Libye et le Tchad, cet autoroute du trafic en tout genre – narco, armes, êtres humains, prosélytisme – est aussi celui du djihadisme, qui se finance ainsi. La jonction opérationnelle avec Boko Haram, au Nigéria, ou les Shebabs somaliens qui frappent à Djibouti n’est pas avérée, mais les connexions existent. Nous sommes face à un défi majeur, qui concerne la sécurité de l’Europe ».
Général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, allocution aux auditeurs de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), 19 juin 2014
d. Des menaces sur la stabilité de certains régimes et leurs conséquences sur la sécurité de l’ensemble de l’Afrique
Si les rapporteurs n’ont pas consacré l’essentiel de leurs travaux à l’étude de la situation politique interne de chaque pays dans lequel ils se sont rendus - travail qui relève davantage de la compétence de la commission des Affaires étrangères -, ils ne sauraient ignorer les conséquences que pourraient avoir à court terme, sur la situation sécuritaire de l’ensemble de la région, les fragilités de certains régimes.
i. Des fragilités tenant à la structure politique de certains États
En la matière, les apparences peuvent être trompeuses : le cas du Tchad le montre. Il ressort des différents entretiens menés au Tchad que si le président Idriss Déby a réussi à assurer à son pays, depuis 2008, une période historiquement inédite de stabilité et de relative prospérité, il le doit à sa capacité à maintenir en permanence un équilibre subtil entre les différents groupes ethniques dans la répartition du pouvoir et des richesses du Tchad. Aussi, selon certains observateurs avisés, la stabilité du pays ne semble-t-elle pas assurée en cas de nouveau choc – déstabilisation consécutive à une crise dans un pays voisin, avivement de conflits ethniques, succession non préparée, etc.
Compte tenu de la porosité des frontières, du caractère transfrontalier de la menace et de l’utilisation par les groupes rebelles et les groupes armés djihadistes/groupes armés terroristes de bases arrière dans les pays voisins de leurs zones d’opérations, la déstabilisation d’un régime peut avoir des conséquences lourdes : 1./ sur la sécurité de l’ensemble des États de la région ; 2./ sur l’équilibre du dispositif militaire français en Afrique (notamment dans le cas du Tchad, point d’appui central pour toutes nos opérations aériennes). Pourtant, il n’est pas exagéré de dire qu’en Afrique francophone et dans la bande sahélo-saharienne, la stabilité de chacun intéresse la sécurité de tous.
La stabilité du Tchad
Tant au cours de leurs déplacements dans plusieurs pays que lors des auditions qu’ils ont menées à Paris, les rapporteurs se sont attachés à étudier les perspectives politiques du Tchad, appelé à accueillir le centre de gravité du dispositif français dans la bande sahélo-saharienne.
Il en ressort que le président Déby réussit à maintenir dans les cercles dirigeants un certain équilibre entre les différents groupes ethniques. Il est lui-même est issu des ethnies du Nord-Est, mais son chef d’état-major général est quant à lui Arabe, et le ministre délégué à la Défense vient du Sud du pays. Cependant, le programme de modernisation de l’Armée nationale tchadienne – mis en œuvre depuis 2011 avec l’appui de la France et poursuivi après une interruption lors de l’engagement des forces tchadiennes au Mali – n’a pas encore produit tous ses effets. Ainsi, l’organisation des forces armées serait encore largement guidée par des considérations ethniques, plus qu’opérationnelles. En témoigne le fait que la Direction générale du service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE), qui en constitue l’élite et possède l’essentiel des équipements et des compétences, est formée à partir des ethnies dont est issu le président, et que l’armée nationale tchadienne ne constitue pas un véritable « creuset » interethnique.
Par ailleurs, des rumeurs persistantes courent sur l’état de santé du président, même si celui-ci reste, selon l’ambassadrice de France, en pleine possession de ses grands moyens intellectuels, et que la délégation de la commission qu’il avait reçue en décembre 2013 l’avait même trouvé impressionnant par ses analyses claires, étayées et prospectives. Dans ces conditions, le risque ne peut pas être écarté qu’un groupe ethnique ou un autre soit un jour tenté de déposer le président Déby pour s’assurer de prendre une sorte de « revanche », ou de conserver le pouvoir à long terme. En tout état de cause, un régime dans lequel 2,5 % de la population domine le reste du pays doit consentir des efforts permanents pour assurer sa stabilité. Ainsi, le président de la République, les ministres, les parlementaires et même les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) consacrent une large part de leur temps à des tournées en province dont l’objet est de « verrouiller » les équilibres politiques.
En outre, les rapporteurs ont eu le sentiment que le président Déby ne tire pas autant d’avantages qu’il aurait pu l’escompter de sa politique étrangère, pour les raisons suivantes :
– son intervention au Mali, à l’appel de la France, est vue par une partie de l’opinion et des observateurs comme lui ayant procuré peu de « retours sur investissement », notamment en matière financière. La France a fourni un appui matériel mais pas d’aide financière à cette opération, et les retombées pour le Tchad de la conférence des bailleurs qui s’est tenue à Addis-Abeba peuvent à juste titre être vues comme très modeste, avec seulement six à sept millions d’euros de primes à l’homme, contre 50 millions d’euros pour les pays de la CEDEAO ;
– sa posture dans la crise centrafricaine a été contestée : s’il a bien adressé aux puissances régionales et occidentales des signaux visant à les alerter sur les risques pesant sur les musulmans du pays, ceux-ci n’ont pas été entendus. Le fait que les ex-Séléka ont été désarmés avant les milices chrétiennes, ainsi que les images télévisées de mosquées attaquées, ont marqué l’opinion publique tchadienne dans un sens peu favorable au président. Le risque, dans une telle situation, est qu’un chef d’État ne puisse plus justifier son action devant son opinion publique qu’en faisant porter la responsabilité des troubles à une puissance étrangère, par exemple à la France. Certains observateurs centrafricains se disent d’ailleurs « pas loin de croire » que la situation devenant intenable pour le contingent tchadien en République centrafricaine, le président Déby s’est saisi d’un prétexte pour le retirer du pays ;
– si ses relations avec le président soudanais Omar Hassan Ahmed el-Bechir se sont améliorées en apparence, le président Déby aurait de solides raisons de continuer à rester vigilant compte tenu du risque, plusieurs fois avéré dans l’histoire du Tchad, de voir des groupes armés prendre le contrôle du pays par l’est ;
– ses négociations avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme de réduction de dette des pays pauvres n’avancent pas rapidement. En effet, le FMI fixe une condition à son aide : l’interdiction pour les pays bénéficiaires de s’endetter à des taux « non-concessionnels » (c’est-à-dire aux conditions de marché). Or, en vue du sommet de l’Union africaine qui doit se tenir à N’Djamena l’an prochain, le président a trouvé auprès des Chinois ou des « pétromonarchies » du Golfe des fonds destinés à financer d’importants projets d’infrastructures, fonds alloués dans des conditions incompatibles avec les critères du Fonds monétaire international (FMI).
Pour toutes ces raisons, et compte tenu du poids de l’armée dans le fonctionnement du régime, certains observateurs tchadiens et étrangers ne se montrent guère optimistes sur la stabilité du Tchad en cas de départ du président Déby sans période de transition permettant d’« organiser la relève ». Le risque serait grand qu’une succession non préparée conduise à une « période de chaos ». Compte tenu de son implantation au Tchad, la France ne peut pas se désintéresser de cette question.
Ainsi, les autorités civiles et militaires des pays visités dans la bande sahélo-saharienne s’accordent à dire qu’ils font face à des groupes rebelles qui ont la double particularité :
– s’agissant de leurs motivations (leur « agenda ») : d’entremêler, dans des proportions variables, des revendications politiques (djihadisme international ou séparatisme local) et des préoccupations économiques (trafics en tous genres) ;
– s’agissant de leur organisation, de ne pas être suffisamment unifiés pour permettre l’établissement d’un dialogue entre les gouvernements et les mouvements rebelles. Tel est le cas, par exemple, les mouvements rebelles dans le nord du Mali comme des ex-Séléka en République centrafricaine.
ii. Des fragilités plus profondes, tenant à des déséquilibres sociaux que la croissance démographique risque d’aggraver
Sans chercher à entreprendre une étude approfondie des sociétés africaines, qui s’éloignerait du cœur de compétences de notre commission, les rapporteurs ont souhaité étudier les facteurs sociologiques qui peuvent expliquer la multiplication récente des crises en Afrique et les difficultés rencontrées dans leur règlement.
• La « décomposition des sociétés » en « sociétés guerrières »
Lors de son audition, le professeur Bertrand Badie a souligné d’emblée que « l’on a souvent une lecture complètement faussée des problèmes africains, d’où de mauvaises réponses » aux conflits africains. Une pente naturelle nous porte à projeter, par un réflexe de pensée, l’expérience longue de continent européen sur un autre continent. Or, s’il y a en Europe un lien intime entre guerre et construction de l’État, ce lien ne s’observe pas en Afrique.
1./ Les faiblesses du « lien social » dans les pays d’Afrique sub-saharienne
Comme M. Bertrand Badie l’a expliqué, « ce qui est belligène en Afrique, c’est la décomposition des sociétés », citant en exemple, notamment, les zones rurales du Niger et le Nord du Mali :
– si l’on entend par « lien social » tout ce qui crée de la solidarité, et permet des échanges entre individus se spécialisant dans une activité, force est de constater que « le lien social est faible en Afrique », à la différence de ce qui existe en Europe où les structures sociales sont depuis longtemps solides (émergence des villes surclassant les féodalités, creuset de la modernité, etc.). En l’absence de lien social, « des substituts se développent : les liens tribaux, le lien religieux, ou la relation de clientèle ». L’Afrique n’est en soi pas plus tribale que le reste du monde, mais faute de société, « il faut bien quelque chose pour faire ersatz de tissu social ». Le sous-développement en est le terreau : les différentes études sur les « enfants-soldats » ont bien montré que c’est là trop souvent le seul statut social accessible à enfants sans moyen de subsistance ;
– à de rares exceptions près, il n’y a pas de « contrat social », de « vouloir-vivre ensemble », en Afrique. Peut-on dès lors construire une démocratie sans contrat social ? Pour les analystes pessimistes cela, au mieux, demande beaucoup de temps. Pour les observateurs optimistes, des circonstances particulières peuvent créer un désir de vivre ensemble ;
– « la construction de l’État y a échoué » : l’Afrique est marquée par des situations presque généralisées d’États faillis. De ce fait, « l’autorité s’organise sur des modes de substitution » : soit la clientèle (le « donnant-donnant » comme structure d’autorité), soit, plus fréquemment, l’autoritarisme.
2./ La banalisation de la « société guerrière »
Pour le professeur Bertrand Badie, il y a un lien de plus en plus fort entre ces trois manquements et la banalisation de la « société guerrière » : « au lieu d’être un conflit qui oppose, la guerre crée des conditions de subsistance ».
Ainsi, la guerre crée des liens sociaux que le défaut de société et d’État ne permet pas de constituer, en instaurant :
– une économie de guerre ;
– un système d’ordre public ;
– une forme de protection sociale : la guerre est par exemple une « petite sécurité sociale » pour les enfants soldats ;
– un système d’intégration des flux transnationaux.
Il y a ainsi des liens entre structures mafieuses, structures de guerre, et structures d’autorité.
« Il en résulte une pente vers la guerre permanente ». Les cas de la République démocratique du Congo depuis son indépendance et de la Somalie depuis vingt-cinq ans en témoignent. M. Bertrand Badie a aussi souligné que même au Tchad, « si les événements se sont calmés, la société guerrière est là ». Au Tchad comme dans d’autres États, des chefs de guerre vainqueurs deviennent chef d’État : « il y a confusion totale entre société de guerre et État ».
3./ La « greffe » du facteur religieux
Le développement du djihadisme en Afrique peut se comprendre sous l’angle d’une recherche de substitution à un lien social défaillant. Les djihadistes - par exemple les associations wahhabites au Sud du Tchad - opèrent des distributions de richesses aux populations, en contrepartie de leur allégeance. « Le facteur religieux est certes un moteur, mais sans problème social sous-jacent, ce moteur n’irait pas très loin ! ».
• L’impact prévisible de la croissance démographique en Afrique
Lors de son audition, le professeur Jean-François Bayart a présenté aux rapporteurs des éléments d’analyse précis sur l’impact de la croissance démographique en Afrique.
Pour lui, avant tout, il faut prendre ses distances avec l’idée de « bombe démographique à retardement », pour plusieurs raisons :
– la démographie peut être aussi un facteur d’opportunité économique ;
– les prévisions démographiques ne se vérifient pas toujours : on prédisait un « naufrage démographique » du Maghreb au début du XXe siècle ! Pourtant, on a connu une transition démographique rapide dans trois régimes différents : 1./ le Maroc, avec une politique malthusienne en matière scolaire ; 2./ l’Algérie, avec un régime militaire ; 3./ la Tunisie, avec un régime autoritaire mais laïc et ouvert à l’éducation des femmes. Les démographes ont montré que cette transition démographique rapide est l’effet, entre autres, de l’émigration : elle permet l’importation rapide de modèles familiaux occidentaux ; a contrario, en Égypte, les migrants ont importé des modèles natalistes arabes ;
– contrairement à une idée souvent avancée, l’islam n’est pas toujours un frein à une politique de maîtrise des naissances : ce sont d’autres facteurs culturels qui jouent ;
– il y a un décalage de perception : « les Occidentaux pensent en termes d’insécurité démographique, les Nigériens – par exemple – pensent en termes de sécurité démographique ». En conséquence, les programmes de contraception sont vécus comme insécurisants, d’où des effets paradoxaux voire pervers.
La seule chose qu’on sache, c’est qu’il y a des phénomènes d’autorégulation des naissances avec quelques constantes :
– l’éducation des femmes (même en Iran) y contribue, or l’école en Afrique est « en voie de destruction » ;
– le développement d’infrastructures de santé publique, afin que l’enfant ne soit pas une garantie pour les vieux jours de ses parents.
En tout état de cause, quelle que soit l’évolution de la démographie africaine, il y aura peu d’impact sur les migrations : les flux migratoires d’Afrique vers la France sont « dérisoires », alors même que notre « politique de prohibition » de l’immigration nous coûte très cher. La croissance démographique peut constituer une « opportunité économique et culturelle, y compris sur le mode migratoire », mais ceux qui tentent « l’aventure » en Europe sont précisément ceux qui sont déjà bien formés.
L’immense masse des jeunes déscolarisés tentera d’autres aventures :
– militaire, car la guerre fournit un statut social : vie d’adulte, femmes, etc. autant d’éléments que la paix ne leur procure pas. « La guerre est pour eux un moyen d’affirmation sociale » ;
– migratoire, vers les pays africains qui possèdent davantage de ressources que les autres : le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, etc. Or ces flux suscitent des conflits sur la question de l’immigration, comme l’a montré le cas de la Côte d’Ivoire. Les migrations y ont « activé » la question foncière, et « embrayé » sur la crise ivoirienne, dont les ressorts tenaient aux questions de droit de propriété et de droit de vote – et non à des questions ethniques. On assiste à des phénomènes de « ruée vers la mine » : des camps de mineurs recréent des communautés économiques et sociales dont les anthropologues observent qu’elles transcendent les différences ethniques ou religieuses. Il en allait de même pour les Européens en Amérique, avec d’ailleurs des taux de retour à peu près constants, et assez importants (plus ou moins 25 %).
On peut donc s’attendre à une reconfiguration de l’Afrique, mais dans un cadre interétatique et non étatique comme cela a été le cas dans l’histoire des migrations en France. « Le Niger ou le Mali sont à l’Afrique ce que la Lozère ou la Corrèze ont été à la France ». La différence tient à ce que dans une France unifiée, existaient des mécanismes de redistribution et de péréquation. Il y a davantage de tensions à attendre lorsque ces migrations ont lieu dans un cadre interétatique, mais ces tensions peuvent aussi être créatrices : « il ne faut pas en avoir une vision misérabiliste ou passéiste ».
2. La coopération avec les États africains pour traiter ces menaces constitue désormais la principale source de légitimité de notre présence en Afrique
a. Les dirigeants des États de la région conscients de ces menaces
i. Dans les paroles : une prise de conscience
• Une prise de conscience de l’importance de politiques de sécurité, accrue depuis la crise malienne
L’ensemble des responsables politiques (membres de l’exécutif comme parlementaires) et militaires rencontrés par les rapporteurs ont clairement affirmé être conscients des menaces pesant sur la sécurité de leur pays, et décidés à lutter contre elles. Il ressort de l’ensemble des entretiens que la crise malienne a joué, à cet égard, un effet de déclencheur dans cette prise de conscience.
Tel est notamment le cas au Mali même, où M. Karim Keita, président de la commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile de l’Assemblée nationale, a déclaré que l’ensemble des parlementaires étaient désormais pleinement conscients de la réalité des menaces, et désireux de prendre leur part à une véritable politique de prévention des troubles. Le président de l’Assemblée nationale malienne a quant à lui saisi l’occasion de son entretien avec les rapporteurs pour formuler une demande d’assistance technique de l’Assemblée nationale française, faisant valoir que la nouvelle législature malienne compte une proportion très importante de nouveaux députés – environ 120 sur 147 –, qui sont soucieux d’exercer pleinement leurs fonctions, notamment en matière de défense et de sécurité intérieure, mais n’ont ni l’expérience et ni les savoir-faire nécessaires.
D’ailleurs, cette prise de conscience dépasse l’épicentre de la bande sahélo-saharienne : ainsi, au Sénégal, le ministre-conseiller diplomatique du président de la République a souligné que si son pays ne comptait pas parmi les cinq États les plus concernés par la menace terroriste – ceux du « G5 » : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad et Niger –, il n’en prenait pas moins au sérieux cette menace. Pour lui, si cette dernière ne doit pas être surestimée – pour éviter tout risque de psychose –, elle ne doit pas non plus être sous-estimée et appelle, au-delà des interventions ponctuelles comme l’opération Serval, « un combat de longue haleine » et des efforts de prévention auxquels son pays entend prendre toute sa part.
Le secrétaire général du ministère de la Défense du Niger a d’ailleurs déclaré aux rapporteurs que la prise de conscience des enjeux sécuritaires favorisée par la crise malienne avait permis d’améliorer encore la coopération de sécurité et de défense entre la France et le Niger.
Quant aux autorités centrafricaines rencontrées, elles ont paru tout à fait lucides sur l’état du pays et les causes de la déliquescence de l’État. La présidente Catherine Samba-Panza a semblé particulièrement volontaire dans son intention de redresser la structure étatique, militaire et administrative du pays. Sa lucidité, comme celles du Premier ministre et du ministre de la Défense, ne s’arrêtent pas au diagnostic et à la recherche des causes des maux qui frappent leur pays : ils se sont montrés tout à fait conscients des faibles moyens dont ils disposent pour redresser la situation.
• Une mobilisation politique de haut niveau
Les rapporteurs ont pu constater que dans la plupart des pays concernés, les enjeux de sécurité intérieure comme extérieure font l’objet d’une attention soutenue au plus haut niveau politique.
Le plus souvent, c’est la présidence de la République qui assure un pilotage direct et centralisé de ces questions. Ainsi, au Sénégal, il ressort des entretiens que le chef de l’État suit lui-même, à un niveau de détail très élevé, les projets de réforme des forces armées et des services de renseignement, le ministère de la Défense ayant davantage pour rôle d’assurer le lien entre l’état-major général des armées et le ministère en charge des finances.
On notera en revanche de l’implication des plus hautes autorités de l’État dans les affaires de défense et de sécurité est perçue comme moins marquée en Côte d’Ivoire. Si les observateurs rencontrés par les rapporteurs dans ce pays reconnaissent que le rythme très soutenu des sommets de la CEDAO - 16 sommets depuis janvier 2012 - a conduit le président Ouattara à s’investir davantage dans les affaires internationales, ils notent que son implication personnelle dans le processus de réforme du secteur de sécurité (RSS) est parfois vue comme moindre. Pourtant, le président est ministre de la Défense en titre, et les attaques simultanées des camps d’Akouedo (à l’ouest d’Abidjan) et d’Abengourou en août 2012 – perpétrées, selon l’ambassadeur de France, par des éléments liés au Front populaire ivoirien (FPI) et opérant à partir de bases arrière situées au Ghana – ont mis en évidence les menaces pesant encore sur la sécurité du pays. M. Guillaume Soro, actuel président de l’Assemblée nationale et ancien secrétaire général du mouvement rebelle des Forces nouvelles de Côte d’Ivoire, s’est montré quant à lui plus sensible aux questions de sécurité, et son appui en la matière est précieux au président Ouattara.
Il est également à noter que lors de leurs échanges avec les parlementaires africains membres des commissions chargées de la Défense, les rapporteurs ont pu constater une certaine unanimité des responsables politiques sur ces questions. Cette unanimité a été particulièrement soulignée par le président de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale malienne, qui a fait valoir que les membres de cette commission, y compris ceux qui sont élus dans le Nord, étaient unanimes sur les questions de « souveraineté nationale » et de Défense.
• Un dépassement de l’habitude qui consistait à opposer l’effort de développement à l’effort de défense
Sur place, les rapporteurs ont entendu, par exemple chez les Nigériens, un discours qui tend à réfuter toute opposition entre sécurité et développement : même si des arbitrages budgétaires doivent être faits entre les dépenses de politique de défense et de sécurité d’une part, et les dépenses liées au développement d’autre part, souvent au détriment de ces dernières, ces deux impératifs sont vus comme intrinsèquement liés. Le président Issoufou a résumé cette vision à peu près en ces termes : à court terme, pas de développement possible sans sécurité, et à long terme, pas de sécurité possible sans développement. Le président de l’Assemblée nationale du Niger a d’ailleurs ajouté que « sans forces armées, pas de consolidation possible de la démocratie ». Pour lui, il s’agit de « dépasser des clichés, et accepter qu’il faut d’abord renforcer l’État pour permettre le développement ». Le président de la République du Niger a résumé cette position politique en la présentant comme la « politique des « trois D » : défense, démocratie, développement ».
À cet égard, les Nigériens, les Burkinabés comme les Ivoiriens ont regretté que les politiques d’ajustement structurel qui leur ont été imposées dans les années 1990 les aient contraints à réduire les moyens alloués à leurs forces de sécurité. On note que cette réduction pouvait être motivée aussi par la crainte des gouvernants qu’une armée trop puissante soit tentée de renverser le pouvoir en place.
Le discours est sensiblement le même à Bamako, où le ministre de la Défense d’alors a déclaré qu’il serait bon, de son point de vue, d’articuler davantage les actions de coopération en matière économique et les actions de coopération en matière de sécurité. Réfutant toute opposition de principe ou toute hiérarchisation entre le renforcement de la sécurité et les nécessaires efforts de développement, il a fait valoir que de larges zones du Mali pourraient être mieux exploitées qu’aujourd’hui, et que c’est précisément l’insécurité qui empêche pour l’heure les entrepreneurs nationaux et internationaux d’y réaliser les investissements nécessaires – investissements qui sont lourds et coûteux, notamment dans les secteurs minier et gazier. Pour lui, il faut voir l’action de l’État comme visant à enclencher une dynamique de « cercle vertueux » : la sécurisation du territoire permettrait d’en exploiter mieux les ressources, et les revenus qui en découleraient pour les Maliens contribueraient à la stabilité du pays. Le ministre a d’ailleurs regretté que les industriels français ne répondent pas aux démarches d’approche que font auprès d’eux les autorités maliennes.
• Un renoncement – au moins affiché – à la « stratégie ATT » non-coopérative et contre-productive d’échange de bons procédés avec les rebelles
Il ressort des travaux des rapporteurs que certains responsables politiques, à la suite de la crise malienne, ont pu rompre avec la stratégie qui a pu être celle d’Amadou Toumani Touré au Mali en son temps : conclure un pacte tacite de non-agression avec des groupes armés présents sur leur territoire.
Ainsi, sans attendre que leur pays soit lui-même déstabilisé par les groupes armés venus de l’étranger, les autorités nigériennes ont engagé un vaste mouvement de repérage et d’arrestation des activistes de Boko Haram présents sur leur sol, même si ceux-ci n’y ont pas encore commis d’attentats (à ce stade, il s’agirait de simples « règlements de comptes » entre Nigérians présents au Niger).
ii. Dans les actes : cette volonté politique se traduit par des efforts concrets, plus ou moins aboutis
Dans plusieurs des pays dans lesquels les rapporteurs se sont déplacés, la volonté politique de renforcer l’appareil sécuritaire s’est traduite par des actes concrets, sur les plans financier, capacitaire, opérationnel ou politique.
• Des efforts financiers
1./ Des efforts budgétaires
Certains États ont consenti d’importantes ressources budgétaires en matière de défense. Ainsi, les autorités nigériennes ont fait valoir aux rapporteurs qu’elles avaient doublé le budget de la Défense nigérien en 2012 et 2013, soulignant que cet effort avait été fait au détriment d’autres postes de dépense.
Par ailleurs, le secrétaire général du ministère nigérien de la Défense a indiqué que ses services travaillaient à la mise en place d’un outil de programmation pluriannuelle des ressources et des dépenses affectées à la Défense, sur le modèle des lois de programmation militaire françaises. Des lois de ce type existaient au Niger avant 2013, mais le pays y avait renoncé car le dispositif s’était avéré peu opérationnel. La prise de conscience accrue de la menace a ainsi relancé l’idée de mettre en chantier une programmation militaire pluriannuelle cohérente et efficace.
2./ Des efforts de bonne gestion
Plus largement, dans l’ensemble des pays où se sont déplacés les rapporteurs, ils ont pu constater une sensibilité tout à fait aiguë des responsables politiques et militaires à l’intérêt qu’ont les États de payer correctement et régulièrement les membres de leurs forces de sécurité – ce qui n’avait pas toujours été le cas par le passé. L’enjeu est double :
– le bon fonctionnement de l’administration de la Défense contribue à rendre saine et efficace l’articulation entre le pouvoir politique et les autorités militaires, gage de stabilité pour les États concernés ;
– lorsque la composition ethnique des forces armées ne correspond pas à celle des régions où elles sont déployées, que ce soit en opérations intérieures ou extérieures, le risque est grand que des militaires mal (ou pas) payés aient tendance à trouver leurs moyens de subsistance dans des actions de prédation sur les ressources locales, ce qui ne peut être, in fine, que contre-productif, en rendant les populations locales hostiles aux forces armées.
Ainsi, selon les observateurs étrangers rencontrés par les rapporteurs au Niger, une part de l’effort budgétaire consenti au profit de la Défense dans ce pays est judicieusement consacrée à améliorer la « politique sociale » du ministère - paiement régulier des soldes, mais aussi amélioration des conditions de logement et du système de pensions. Cet effort est associé à la recherche d’une plus grande intégrité dans les pratiques du haut-commandement et du ministère en général. Les progrès seraient tout à fait appréciables depuis 2011, et le chef d’état-major général des armées est jugé « particulièrement intègre » par les observateurs étrangers avertis. Le cas du Niger est riche d’enseignements : en effet, la répression par l’armée de la dernière rébellion qui a sévi dans le Nord en 2009, menée par les Touaregs et les Toubous notamment, avait été jugée brutale et avait inspiré aux populations locales une défiance particulièrement vive vis-à-vis des militaires, au point que, selon les observateurs étrangers, les autorités nigériennes « en étaient venues à se méfier de leurs propres militaires, et à éviter de les envoyer dans le Nord ». La politique d’assainissement du fonctionnement et des pratiques des forces armées vise ainsi à améliorer les relations des militaires nigériens avec les populations du Nord. En cela, elle contribue directement à la stratégie nigérienne consistant à « verrouiller » la frontière avec la Libye et l’Algérie pour limiter les phénomènes de « contagion » terroriste. En effet, dans des zones vastes où les frontières sont poreuses, le concours des populations locales est indispensable.
3./ Des efforts de reconstruction des services de sécurité, même en République centrafricaine
Les rapporteurs ont pu constater qu’en dépit des immenses difficultés qu’elle traverse, la République centrafricaine elle aussi consent un certain effort budgétaire au profit de ses forces armées et de sécurité intérieure. En effet, le Premier ministre a présenté aux rapporteurs comme une priorité de la politique de son gouvernement la sécurisation de la route de Douala et la remise en état de marche de l’administration fiscale, à commencer par le guichet de douane centrafricain à Douala et les régies financières, afin que la République centrafricaine puisse bénéficier rapidement de rentrées fiscales douanières. Cet effort s’est traduit par un renouvellement complet des fonctionnaires occupant les postes concernés, leurs prédécesseurs ayant « trop de collusions avec divers groupes armés », et un renforcement des contrôles sur l’action des fonctionnaires nouvellement nommés. Selon les observateurs étrangers rencontrés par les rapporteurs, le paiement des soldes des militaires, des gendarmes et des policiers constitue la priorité des autorités de la transition en matière budgétaire.
Une instruction ministérielle a ainsi été prise pour organiser le déploiement de la police et de la gendarmerie à Bangui et, d’après le Premier ministre, l’État a consacré une part de ses faibles ressources à des dépenses de formation et d’équipement – notamment en uniformes – de ces forces. Les résultats sont toutefois limités : si la police et la gendarmerie ont réussi à reconstituer une force de 6 000 à 7 000 hommes, le général Francisco Soriano a indiqué que celle-ci montait en puissance à Bangui, mais de façon encore « trop lente », et restait « moins lisible » en province. La présidente Samba-Panza a elle-même reconnu que les forces armées centrafricaines (FACA) n’étaient encore déployées que « timidement ».
• Des efforts capacitaires et organisationnels dans les forces armées
Les pays où se sont déplacés les rapporteurs planifient tous un renforcement de leurs forces armées, que ce soit du point de vue des effectifs, ou de celui des équipements (cf. infra).
• Des efforts de projection des forces en opérations extérieures
La plupart des pays dans lesquels se sont rendus les rapporteurs, comme par exemple le Niger et le Burkina Faso, participent activement aux opérations multinationales menées dans la région, que ce soit sous la bannière de l’Union africaine et de ses sous-régions, ou sous celle de l’ONU. Ils y trouvent un double intérêt :
– ces engagements servent les intérêts de leurs forces armées, dans la mesure où ils contribuent à leur aguerrissement et ouvrent droit à des financements internationaux dont les montants sont très attractifs pour des armées disposant de faibles ressources (en valeur absolue) ;
– face à des menaces régionales, les responsables politiques et militaires conçoivent ces engagements comme des opérations de « défense de l’avant » pour le bénéfice de leur propre sécurité.
Interrogés sur les velléités que l’on a pu prêter au gouvernement nigérien de rappeler en 2012-2013 son contingent détaché à l’ONUCI, le Président de la République comme l’ensemble des responsables militaires nigériens ont déclaré que cette hypothèse avait été envisagée lorsque le Niger a accepté de participer à la MISMA, car l’effectif des forces nigériennes n’étant pas suffisant pour assurer ces deux missions à la fois. Toutefois, à la demande des Ivoiriens – selon lesquels les militaires nigériens sont appréciés dans le pays –, ainsi dans le souci de ménager le moral des troupes – pour lesquelles la participation à une opération de maintien de la paix procure de substantiels avantages –, le Niger a préféré augmenter l’effectif de ses forces armées que se désengager de Côte d’Ivoire.
Il faut noter que ces efforts conduisent certains États africains à des taux de projection de leurs forces très importants. Ainsi, à titre d’exemple, l’attaché de défense de l’ambassade de France au Gabon, le colonel Lionel Paillot, a fait valoir aux rapporteurs qu’avec 750 hommes en opération extérieure sur un effectif total de 12 000, les forces armées gabonaises affichent un taux de projection de 6 %, alors que ce taux, pour les armées françaises, ne dépasse pas 3,6 %. Pour lui « il faut rester conscient de ce que l’on demande au Gabon un effort de projection, en termes relatifs, supérieur au nôtre ».
• Des initiatives politiques
Plusieurs interlocuteurs ont également souligné les initiatives politiques prises par les États africains pour répondre aux menaces sécuritaires auxquelles ils sont confrontés.
1./ Des initiatives prises par les exécutifs
La mobilisation des chefs d’État et des gouvernements pour traiter la menace terroriste se traduit à la fois, au niveau national, par des efforts de consolidation de l’autorité de l’État et, au niveau international, par une intense activité diplomatique.
● Au niveau national, parmi les efforts présentés aux rapporteurs, on retiendra par exemple que le président de l’Assemblée nationale malienne a fait valoir que le président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) avait, dès sa campagne électorale, ouvert un dialogue avec les populations du Nord – il a notamment été le premier candidat à se rendre à Kidal. De façon plus convaincante, le président a également évoqué l’adoption d’une loi instituant une commission « vérité, justice et réconciliation » (7), soulignant que le processus de réconciliation doit permettre de « rendre compte des actes qui ont porté des dommages à l’honneur du pays ». L’appréciation de l’ambassadeur de France sur la portée des efforts de réconciliation entre le Nord et le Sud du Mali est toutefois plus modérée.
De même, la lutte contre la propagation de l’islamisme radical est également présentée comme étant à l’ordre du jour. Tel est le cas par exemple au Niger : comme l’a indiqué le ministre de l’Intérieur, le Niger a créé en 2013 un « conseil islamique », sur le modèle de ce qui existe en Mauritanie, avec pour objectif de mieux encadrer la pratique religieuse en consolidant l’organisation coutumière de cette religion au Niger.
Les rapporteurs ont toutefois été interpellés par certains de leurs interlocuteurs, qui estiment que l’action de certains États contre le danger islamiste reste insuffisante. Tel est le cas, par exemple, du président du groupe d’amitié Sénégal-France de l’Assemblée nationale du Sénégal, qui juge « tout à fait insuffisante » la vigilance de l’État et de la société civile vis-à-vis de cette menace, faisant valoir qu’en dépit du principe de laïcité inscrit dans la Constitution sénégalaise, une pratique « aussi inconstitutionnelle que dangereuse » veut que les réunions de commission commencent par la récitation de versets du Coran. Pour lui, de telles pratiques constituent « le vrai terreau de l’islamisme ».
● En matière internationale, l’implication des chefs d’État et des gouvernements est perceptible. Si certaines médiations ne donnent pas les succès escomptés – par exemple celle entreprise par le président burkinabé entre les parties du conflit malien –, et si le foisonnement des espaces de discussion – G5, dialogues bilatéraux, initiatives sous-régionales, etc. – peut donner une impression d’enchevêtrement parfois peu productif, il n’en demeure pas moins qu’aux yeux des observateurs étrangers, les autorités africaines s’impliquent de plus en plus dans la recherche d’un règlement sous-régional des problèmes sécuritaires. Et ce à tel point que, par exemple, certains acteurs et certains observateurs ont pu estimer que le président nigérien était de plus en plus perçu par l’opinion publique du Niger comme donnant une dominante très « sécuritaire » à l’exercice de son mandat ; quant au président du Burkina Faso, il a reconnu lui-même devant les rapporteurs être « accaparé » par la politique extérieure, notant au passage que l’unanimité politique de son pays sur ces questions lui confère à la fois une importante marge de manœuvre et une certaine obligation de résultat.
2./ Le rôle des parlementaires
● Au Mali, le président de la commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile de l’Assemblée nationale a déclaré que la commission qu’il préside entendait non seulement exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle sur les affaires de défense, mais également mener un travail de soutien à la refondation des forces armées.
À cette fin, il entend établir un cadre d’échanges constants avec le ministre de la Défense, et aller au contact des troupes, sur le terrain, afin de les assurer du soutien de la représentation nationale. Si ces déclarations restent à confirmer dans les faits et dans la durée, il n’en est pas moins qu’elles constituent la marque d’un changement de posture au regard du passé récent. Lorsque les rapporteurs ont rencontré les membres de la commission de la Défense et de la sécurité intérieure de l’Assemblée nationale nigérienne, ceux-ci leur ont déclaré leur intention d’intensifier leurs activités de contrôle parlementaire sur les questions de défense et d’organisation des forces armées, ne serait-ce que pour s’assurer de la bonne exécution d’un budget qui croît sensiblement – à la mesure des menaces.
Dans les pays où les parlementaires ont eu à se prononcer sur l’opportunité que leurs forces armées soutiennent ou non les opérations françaises au Mali, il n’est pas rare que les décisions aient été prises à l’unanimité, comme cela a été le cas, par exemple, au Niger.
● Le rôle que peuvent jouer les parlementaires dans la stabilisation des pays de la région a été souligné par les députés de plusieurs pays, et particulièrement au Burkina Faso – ce qu’a par ailleurs confirmé le secrétaire général du ministère de la Défense de ce pays. La présidente de la commission des Affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée nationale burbinabè a insisté sur le rôle des parlementaires dans la stabilisation de la sous-région, rôle qui selon elle est double :
– au niveau national, dans des États dont le maillage administratif territorial est souvent léger (voire insuffisant) et dont la composition ethnique est hétérogène et parfois marquée d’une dynamique centrifuge, les parlementaires assurent un lien entre, d’une part, le pouvoir central et, d’autre part, les différents territoires et les diverses populations ; en ce sens, « l’unité nationale en Afrique tient beaucoup aux parlementaires » et « le Parlement y a un rôle essentiel dans la construction de l’État » ;
– à l’échelle sous-régionale, la « diplomatie parlementaire » a selon elle un rôle déterminant à jouer dans la coordination des États de la sous-région. La présidente a indiqué que les parlementaires burkinabés s’attachaient à envoyer systématiquement des délégations auprès des autres Parlements de la sous-région à l’occasion de chaque ouverture de session, et à développer des contacts interparlementaires réguliers. Elle a regretté que ces contacts restent insuffisants aujourd’hui et plaidé en faveur de leur intensification. Elle a également estimé que le parlement de la CEDEAO et le Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), composés de représentants des parlements nationaux, avaient un rôle à jouer dans l’intensification de ces contacts.
b. Compte tenu de ses moyens plus limités que jadis, la coopération militaire française prend de nouvelles formes, marquées par une recherche d’efficience accrue
Comme l’ont souligné devant les rapporteurs les coopérants militaires français présents en Côte d’Ivoire, l’organisation de notre dispositif en Afrique doit concilier deux logiques différentes :
– une logique de coopération, dans le long terme, qui vise à rendre les États africains capables de maîtriser leurs territoires et d’agir ensemble contre les menaces transfrontières ;
– une logique d’intervention, qui doit mettre la France en mesure d’intervenir en urgence pour la gestion des crises (comme elle l’a fait avec les opérations Serval et Sangaris).
Pour eux, il ressort des interventions passées que si la coopération est largement acceptée par les pays hôtes et leurs opinions publiques, les interventions peuvent produire des effets plus contrastés : après une première phase de soulagement – que l’on a vu très démonstrative au Mali en 2013 –, la légitimité de la France, voire les buts qu’elle poursuit, ne tardent pas, parfois, à être remis en question par divers acteurs politiques, sincèrement ou non. À cet égard, le cas de Serval est éloquent : les parlementaires maliens se sont ouvertement interrogés devant les rapporteurs sur les motivations de la position française vis-à-vis des Touaregs et du contrôle de Kidal.
En outre, si l’opération Serval a été unanimement saluée par les responsables politiques rencontrés, on note que la crise malienne et l’indispensable recours à la France sont vus par de nombreux acteurs, notamment militaires, comme une preuve assez humiliante des faiblesses de leurs armées nationales et de leur capacité à réagir aux crises dans le cadre de la CEDEAO.
Chacun des États dans lesquels se sont déplacés les rapporteurs a la France pour partenaire privilégié pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique de défense. Cette coopération prend plusieurs formes :
– partout, des coopérants militaires français sont placés auprès des responsables locaux. Il ressort des discussions que ce dispositif est très apprécié des États hôtes, et constitue pour la France un moyen efficace et relativement peu coûteux d’influence et de connaissance des théâtres africains ;
– là où des forces françaises sont déployées, elles font bénéficier les forces armées locales de leur action. Tel est le cas, par exemple, du détachement de renseignement au Niger : des officiers nigériens sont intégrés aux équipes qui exploitent les renseignements produits par les drones. Tel est aussi le cas, plus largement, pour l’ensemble des forces prépositionnées ou en opération extérieure, qui participent à des exercices conjoints avec les forces locales, le cas échéant dans un cadre multinational plus large comme avec l’exercice Flintlock 2014 au Niger.
Comme le montre le schéma ci-après, la coopération prend ainsi deux formes :
– la coopération dite « structurelle », qui relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères et dont le pilotage est assuré, à Paris, par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) et, sur le terrain, par les attachés de défense ;
– la coopération dite « opérationnelle », qui, pour ce qui concerne sa dimension militaire, relève de la compétence du ministère de la Défense et dont le pilotage est assuré, à Paris, par le sous-chef d’état-major chargé des relations internationales et, sur le terrain, par les commandants des forces.
COOPÉRATION STRUCTURELLE ET COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE
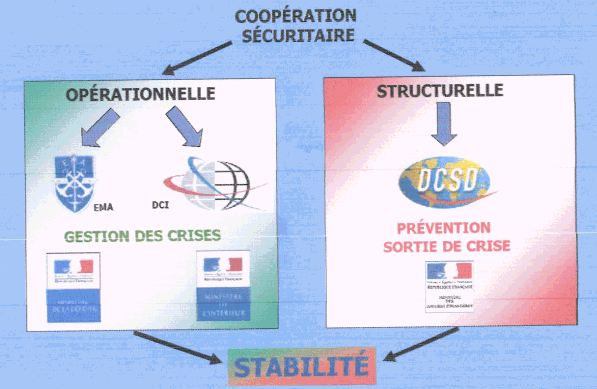
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
i. La coopération structurelle : un atout français en Afrique, désormais configuré dans une logique de partenariat plutôt que de substitution
Comme l’a souligné l’amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense, la coopération structurelle a pour but de renforcer les structures des États partenaires, dans une relation d’égal à égal : il ne s’agit pas de gestion de crise, mais de soutenir la mise en place « d’institutions régaliennes pérennes ». La direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) met en œuvre cette politique.
• Le réseau des coopérants animé par la direction de la coopération de sécurité et de défense
Les schémas ci-après rappellent que la DCSD a été créée, en 2009, dans le but de créer un continuum entre les actions de coopération menées en matière militaire et en matière de sécurité intérieure.
LA CRÉATION DE LA DCSD
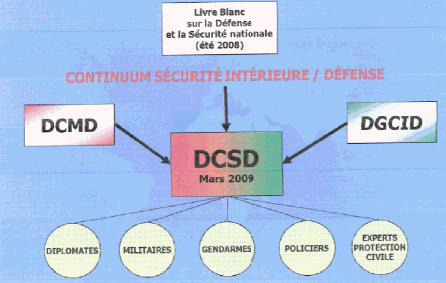
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
LES MOYENS DE LA DCSD (2012)
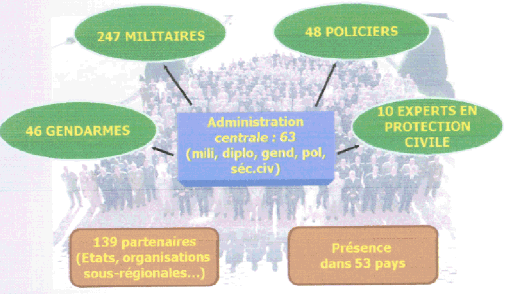
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
La DCSD a ainsi pour mission d’animer et de piloter les actions de coopération structurelle, dont la cohérence avec les autres actions de coopération doit être assurée par chaque ambassade, la plupart d’entre elles disposant à cette fin d’un attaché de défense et d’un attaché de sécurité intérieure. Ces actions de coopération structurelle, comme le montrent les schémas ci-après, prennent différentes formes : aide directe, conseil, formation, assistance dans le suivi des contrats d’armement, missions d’expertise, etc.
L’ACTIVITÉ DE LA DCSD

Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
LE RÉSEAU ANIMÉ PAR LA DCSD
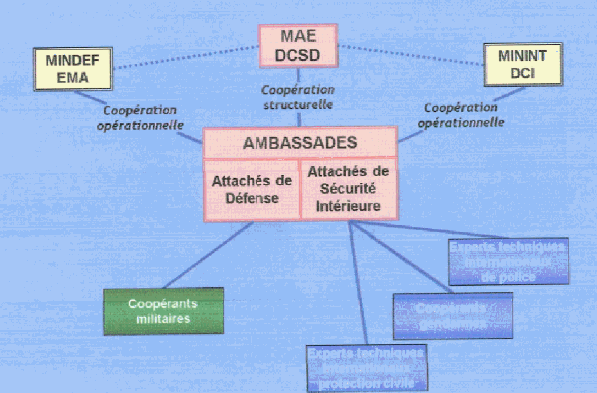
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
Il est à noter que les moyens alloués à la coopération structurelle sont concentrés aux trois quarts sur l’Afrique, tant du point de vue des dépenses engagées que des personnels déployés en mission de coopération.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MOYENS DE LA DCSD
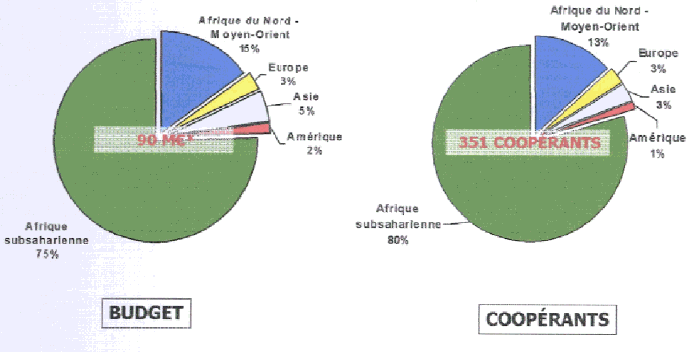
Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
• Les priorités de la politique de coopération structurelle concernant l’Afrique
Lors de son audition par les rapporteurs, l’amiral Marin Gillier a estimé que longtemps, la programmation annuelle de coopération structurelle pour l’Afrique a été assez routinière.
Deux raisons ont conduit la DCSD à « changer la donne » :
– la contrainte budgétaire : la DCSD disposait en 2014 de 89 millions d’euros sur le programme 105 « Action extérieure de l’État », contre 95 millions d’euros en 2013 ; et sur le programme 249 « Solidarité à l’égard des pays en développement », pour lequel « on ne connaît le total qu’en fin d’année, cela fluctue autour de cinq à sept millions d’euros par an ». Globalement, les crédits ont diminué de 50 % depuis la création de la DCSD en 2007, et l’effectif de la coopération structurelle a été divisé par deux depuis 1995 (la DCSD a aujourd’hui 278 coopérants militaires) ;
– les retours d’expérience du Mali et de la République centrafricaine.
En effet, le Mali était considéré comme « « la » démocratie du Sahel » et a reçu à ce titre plus d’un milliard d’euros en quelques années ; pourtant, en 2013, l’État s’est écroulé très rapidement. Pourquoi une aide aussi massive et diversifiée n’a-t-elle pas évité cet écroulement ? Quatre raisons principales sont avancées :
– la corruption : le népotisme, l’absence de volonté de réforme du régime, l’absence totale de soutien politique aux armées, voire une méfiance vis-à-vis de celles-ci, que l’on retrouve d’ailleurs dans plusieurs pays d’Afrique (on retiendra qu’en République centrafricaine, quatre des six derniers chefs d’État avaient été renversés par coup d’état militaire) ;
– des raisons administratives : les échelons de commandement « n’avaient ni l’envie ni les moyens d’intégrer les savoir-faire que l’on voulait leur enseigner » ; en outre, il y avait parfois, au sein des armées, des écarts de niveau de vie très élevés entre le commandement et les hommes, ce qui ne contribuait pas à la solidarité des forces ;
– des facteurs ethniques, qui ont poussé à surreprésenter certaines ethnies au sein des forces armées et de leur commandement, parfois pour des raisons ne tenant pas seulement à la qualité professionnelle des intéressés ;
– « la redondance de l’assistance internationale » : il y avait au Mali de multiples financements pour les mêmes projets, ce qui nourrissait la corruption. Par ailleurs, les Maliens mettaient en compétition des bailleurs internationaux. De plus, la coopération internationale a souvent un biais anti-sécuritaire voire antimilitaire (reposant sur l’idée que « tout cela est du néocolonialisme »).
Sur la base de ce constat, la DCSD a identifié quatre axes d’efforts concernant son action en Afrique :
1./ Un axe interne : la DCSD met en place une programmation budgétaire nouvelle. Elle a réuni les différentes directions géographiques du ministère des Affaires étrangères pour identifier leurs priorités (lutte antiterroriste ; renforcement d’un État qui entre dans un processus démocratique, comme la Guinée Bissau, etc.), et fait de même avec le ministère de la Défense et celui de l’Intérieur. Ensuite, une fois la synthèse faite de ces priorités, la DCSD envoie des télégrammes diplomatiques à tous les postes avec l’exposé de ces priorités et un appel à projets entrant dans ces priorités, sans dichotomie Intérieur / Défense. Ensuite, la DCSD arbitre. « C’est un processus vertueux du point de vue financier, mais aussi du point de vue politique : on intègre ainsi les priorités de tous les ministères ».
2./ Trois axes externes :
– « sollicitation » : il faut que le pays soit demandeur, faute de quoi, l’action de la France perdra en efficacité du fait d’effets d’aubaine ;
– « appropriation » : « la Françafrique, c’était de la coopération de substitution, qui arrangeait tout le monde ; la logique a totalement changé ». Et le but est de passer « de l’appropriation à l’autonomisation » : il faut qu’après la coopération dans un domaine, l’administration concernée soit autonome. C’est dans l’intérêt de la France que d’avoir des États africains autonomes : « on évitera des risques (terroriste, drogue) et on aura des opportunités économiques ; la France n’y perdra rien en influence ».
– « contractualisation » : avec des administrations « parfois corrompues et pas toujours imprégnées du sens de l’intérêt général », mieux vaut établir clairement un « contrat d’accompagnement, avec engagements réciproques et critères de gestion ». Tous les six mois, chaque projet fait l’objet d’un comité de pilotage : « quand le partenaire ne remplit pas les critères prévus, on l’évoque au plus haut niveau politique, et on fait valoir que si le projet n’est pas prioritaire pour l’État partenaire, il ne peut pas l’être pour la France ». Deux fois déjà, la DCSD s’est désengagée d’un projet. Elle fait toutefois preuve de la souplesse nécessaire, comme au Niger par exemple.
Particulièrement en Afrique, la DCSD essaie « d’avoir une vision globale, développant des liens entre sécurité, gouvernance et développement ».
L’amiral Marin Gillier a ainsi cité l’exemple du projet « Appui à la coopération transfrontalière au Sahel » (ACTS). Il s’agit d’un projet dual de gestion des frontières initié par le sommet de l’Élysée, avec le Mali, le Niger et le Burkina, avec l’appui du G5 (Mauritanie et Tchad seront ainsi impliqués), et la CEDEAO a été sollicitée mais s’est dite non intéressée. Le projet s’appuie beaucoup sur les populations, d’où un accent mis sur le développement, et d’où la mobilisation d’acteurs divers : États-Unis, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Banque mondiale, Japonais, Canadiens, Direction générale de la mondialisation, etc. En effet, les Japonais, du fait de règles constitutionnelles contraignantes, ne peuvent pas appuyer directement la France, mais ils contribuent au PNUD. Les Canadiens, eux, financent directement les actions de coopération menées par la DCSD : ils ont ainsi alloué 750 000 euros pour acheter des véhicules ACMAT pour la surveillance des frontières au Nord de la Mauritanie. Cet exemple est typique d’une coopération « qui est internationale et pas uniquement sécuritaire ».
• L’action des coopérants militaires français en Afrique
À chacun de leurs déplacements, les rapporteurs se sont attachés à entendre les coopérants militaires français en poste dans les pays concernés. Il en ressort que ce dispositif présente un indéniable caractère « gagnant-gagnant », tant pour la France que pour les pays hôtes.
En effet, il permet à la France :
– d’apporter aux États concernés un appui d’autant plus efficace que les coopérants sont insérés directement dans les cabinets, états-majors et services où ils sont affectés, sous l’uniforme du pays hôte ;
– de conserver ainsi des leviers d’influence à un coût très modéré ;
– de bénéficier d’un accès privilégié à la connaissance des pays concernés, tant pour ce qui concerne leurs dirigeants civils et militaires que pour ce qui est des caractéristiques de ces théâtres, et de « capitaliser » ainsi une connaissance de l’Afrique dont les rapporteurs souligneront plus loin l’importance.
Pour les pays hôtes, le fait de pouvoir bénéficier de l’expertise française constitue un indéniable bénéfice, et ce à deux égards :
– non seulement pour mener à bien les réformes qu’ils entreprennent dans leurs forces armées ;
– mais aussi pour progresser dans l’adoption de pratiques et d’habitudes communes, ce qui contribuera à améliorer la coordination et l’interopérabilité de leurs forces respectives au sein des forces multinationales auxquelles elles sont de plus en plus souvent appelées à contribuer.
L’encadré suivant présente l’action des coopérants français au Tchad, qui peut légitimement être présenté comme étant d’ores et déjà une réussite de notre politique de coopération. Il convient en effet de rappeler que l’armée nationale tchadienne, qui a largement fait la preuve de son efficacité lors des opérations qu’elle a menées au Mali en 2013, a bénéficié de façon continue du soutien de la coopération française pendant plusieurs décennies, et ce dans une logique d’appropriation progressive des compétences. En effet, comme l’attaché de défense à N’Djamena, le colonel Michel de Mesmay, l’a indiqué aux rapporteurs, la France entretenait il y a une vingtaine d’années 200 coopérants militaires au Tchad, qui assuraient jusqu’à l’instruction élémentaire des recrues ; aujourd’hui, cette présence a pu être réduite à un effectif de 14 coopérants, chargés de fonctions d’expertise dans des domaines que l’armée nationale tchadienne a identifiés comme recelant encore des marges de progression.
La coopération structurelle avec le Tchad
Comme l’attaché de défense au Tchad l’a rappelé aux rapporteurs, la coopération de défense avec le Tchad s’inscrit dans le temps long : elle remonte à plus d’un siècle. En outre, la coopération opérationnelle et la coopération structurelle s’y articulent particulièrement bien, dans la mesure où le Tchad intervient militairement de plus en plus fréquemment, et où les troupes françaises y sont déployées au titre de l’opération Épervier depuis 1986. Le but de la coopération y est clairement d’accompagner la montée en puissance des armées tchadiennes en diffusant la doctrine française, de façon à tisser des liens entre les deux armées. Le budget alloué à la coopération structurelle atteint 12 millions d’euros par an, auxquels on peut agréger les 53 millions d’euros de dons et d’aides diverses fournis par la force Épervier.
Les rapporteurs ont ainsi pu faire le point, avec chacun des coopérants, sur les principaux projets en cours, qui concernent :
– l’appui au pilotage des restructurations, assuré par un coopérant placé en qualité de conseiller chargé des restructurations auprès du chef d’état-major général des armées. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation des forces annoncé en 2011 par le président Déby, et se décline en six sous-projets : la logistique, le renseignement, la formation, la reconversion, la gestion des ressources humaines et l’appui au commandement ;
– en matière d’appui au commandement, l’effort est porté sur la formation (c’est-à-dire la sélection pour l’école de guerre et l’enseignement de la langue française), des études, et la liaison avec les armées. La principale difficulté, comme dans un certain nombre d’armées africaines, tient à ce que des réformes trop brutales aient des répercussions négatives sur la stabilité de l’outil de défense ;
– en matière d’armement, l’idée générale n’est pas de chercher à « placer » des matériels français à tout prix et ce, d’une part, parce que l’offre industrielle française est globalement trop sophistiquée pour les besoins tchadiens (sauf en matière de véhicules de type Bastion ou de porte chars) et, d’autre part, parce que certains industriels comprennent encore mal les besoins des Africains – ainsi, Eurocopter n’a pas réussi à vendre de Fennec, faute de pouvoir intégrer à son offre un volet de formation adapté ;
– en matière de renseignement, un coopérant français apporte une aide technique à la montée en puissance des deux principaux services de la direction générale du renseignement militaire tchadienne : le service action, et le service exploitation. Cela passe par des échanges quasi-quotidiens au plus haut niveau des autorités de l’État ;
– en matière de logistique, le coopérant français compétent a pour mission principale d’aider les responsables tchadiens à prendre pleinement conscience de l’importance de maintien en condition et du ravitaillement, ce qui est « encore très difficile », d’autant que la France pourvoi à un certain nombre de soutiens. Les deux principaux enjeux tiennent à la complexité des procédures de gestion des fonds publics tchadiens, et au suivi de l’utilisation « nominale » des matériels fournis au Tchad ou acquis par lui ;
– un coopérant aide à la restructuration de la garde nationale nomade tchadienne (GNNT). Forte de 4 000 hommes dotés de pick-up, de chameaux (pour les deux tiers des moyens de déplacement) et de chevaux, cette garde a longtemps été employée comme supplétive de l’Armée nationale tchadienne. Le but du projet de coopération consiste donc à la recentrer sur ses missions de sécurité intérieure, afin notamment de contribuer au règlement des conflits entre nomades et sédentaires, avivés par la pression démographique et la désertification ;
– en matière de coopération sanitaire, plusieurs projets sont en cours, consistant notamment à améliorer l’équipement de l’hôpital militaire tchadien. Ils se heurtent toutefois à plusieurs difficultés : le manque de moyens de télécommunication, qui limite le recours à la télémédecine et à la formation à distance (MOOC), ainsi qu’un taux de retour très faible des Tchadiens qui vont faire leurs études de médecine à l’étranger (10 % environ), ce qui prive le pays et ses forces armées d’une ressource en personnels médicaux qui leur serait utile. Une autre difficulté tient à ce que la partie tchadienne n’a pas encore l’habitude de programmer les dépenses nécessaires au maintien en condition opérationnelle des équipements sanitaires parfois complexes (tels les scanners) qui lui sont fournis, alors que la France a désormais pour politique de ne plus prendre à sa charge les contrats d’entretien de ces matériels ;
– concernant la formation, un coopérant appuie la restructuration de l’enseignement militaire. Sur les dix écoles militaires tchadiennes, cinq fonctionnent déjà de façon satisfaisante. L’enjeu de ce projet de coopération consiste principalement à mettre en place une école de spécialisation et de perfectionnement pour les officiers, afin d’améliorer la cohérence de l’encadrement, notamment après l’intégration d’anciens rebelles dans les forces armées. La France se trouve en la matière en concurrence avec les États-Unis, qui essaient eux aussi de développer leur influence par le biais de la formation des cadres, sans toutefois parvenir à ce jour à faire reculer l’influence française ;
– la réforme des forces armées passant par un processus de déflation appelé à concerner 5 000 personnels environ, un projet d’aide à la reconversion, notamment vers le secteur agropastoral, a été mis en place avec un certain succès, grâce à l’appui d’un coopérant français. 100 anciens militaires se sont ainsi reconvertis à ce jour. La principale difficulté rencontrée tient au financement de ce projet, assuré par l’Union européenne. En effet, sur les cinq millions d’euros promis, 86 % n’ont toujours pas été engagés, 13,8 % l’ont été en frais de fonctionnement, et 0,2 % seulement en actions concrètes de formation.
• Un outil majeur et prometteur : les écoles nationales à vocation régionale (ENVR)
À chacun de leurs déplacements, les rapporteurs se sont attachés à visiter les écoles nationales à vocation régionale (ENVR) déployées sur le continent avec l’appui de la France. La carte ci-dessous présente le réseau des ENVR.
LE RÉSEAU DES ENVR

Source : direction de la coopération de sécurité et de défense.
Ces écoles appartiennent à leurs pays hôtes, et sont soutenues par la France par deux biais :
– des contributions financières, qui alimentent le budget des écoles au même titre que d’autres contributions d’États africains, de partenaires étrangers ou d’organisations internationales ;
– la mise à disposition de quelques coopérants, placés à des postes-clés comme celui de directeur des études.
Les rapporteurs sont très convaincus de l’utilité et de l’efficience de l’outil que constitue ce réseau d’écoles nationales à vocation régionale, et ce pour plusieurs raisons :
– en accueillant des stagiaires de différents pays africains, il contribue à forger une culture commune parmi les cadres africains repérés comme prometteurs (ils sont recrutés aux ENVR sur concours, dans le cadre de quotas nationaux) ;
– cette formule permet à la France de conserver un levier d’influence appréciable et à moindre coût, à l’heure où elle n’a plus les moyens de former en masse les officiers africains dans ses propres écoles. D’ailleurs, avec 2 400 stagiaires par an, le réseau des ENVR permet de diffuser les doctrines et les savoir-faire beaucoup plus largement que la politique d’accueil d’officiers africains dans nos écoles ne le permettait, même au temps où les ressources disponibles étaient moins comptées qu’aujourd’hui ;
– en développant des stages d’étude en français, mais aussi dans d’autres langues (l’anglais et le portugais principalement), ce réseau d’école offre la possibilité à la France de rayonner au-delà des pays avec lesquels elle partage les liens historiques les plus étroits.
Les rapporteurs ont pu apprécier la qualité de l’enseignement dispensé au sein de ces écoles. Notamment, ils ont suivi les stagiaires d’une ENVR, l’École d’état-major de Libreville, qui ont effectué un déplacement à Saumur pour mettre en pratique leurs compétences sur le système de simulation de champ de bataille Janus – et ce, avec succès, selon le colonel Alexandre Maresca, directeur des études de l’école. L’expérience de l’École d’état-major de Libreville montre d’ailleurs la richesse de l’échange entre les écoles françaises et les ENVR. Ce sont en effet nos partenaires africains qui ont apporté à l’école de Saumur des scénarios tactiques correspondant à des zones d’engagement possibles en Afrique – comme la région des grands lacs –, alors que les Français utilisent encore, dans le cadre de Janus, des scénarios tactiques métropolitains, terrain sur lequel il est aussi probable que souhaitable qu’ils aient moins à intervenir dans un futur proche.
C’est donc avec satisfaction que les rapporteurs ont appris de l’amiral Marin Gillier que ce même système Janus allait pouvoir être installé au Gabon, possiblement au sein du nouveau pôle opérationnel de coopération des Éléments français au Gabon, avec le soutien d’un coopérant compétent pour l’exploitation et le soutien de ce système. Ce déploiement, d’ailleurs peu coûteux, contribuera à renforcer encore la qualité de la formation dispensée au sein de l’École d’état-major de Libreville, tout en offrant aux Éléments français au Gabon une capacité supplémentaire, cohérente avec leur nouvelle mission.
Les encadrés ci-après présentent le fonctionnent et l’activité des deux ENVR installées au Mali.
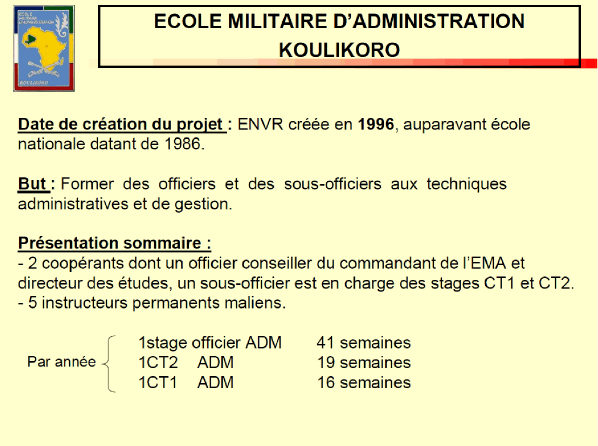
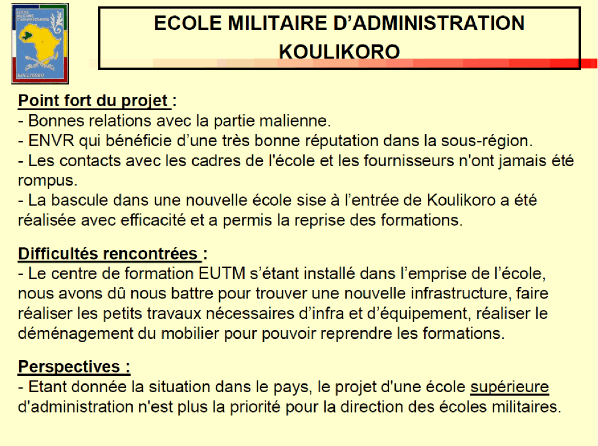
Source : ambassade de France au Mali, attaché de défense.
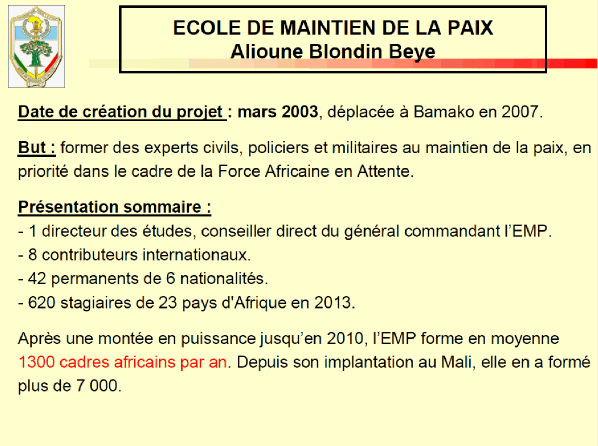
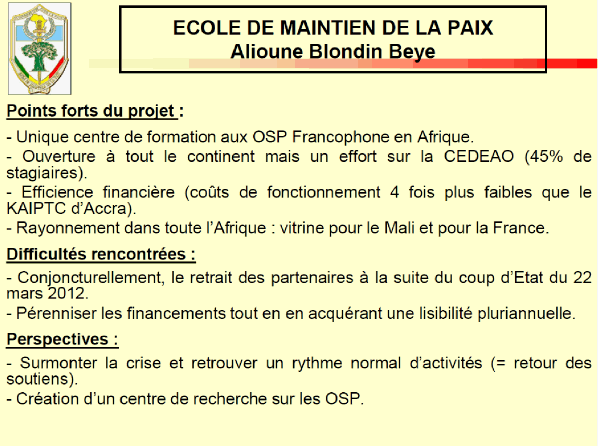
Source : ambassade de France au Mali, attaché de défense.
ii. La coopération opérationnelle : la raison d’être des « pôles opérationnels de coopération à vocation régionale »
Les déplacements des rapporteurs auprès des Éléments français au Sénégal – pôle opérationnel de coopération (POC) en activité – et des Forces françaises au Gabon – appelées à devenir un POC sous le nom d’Éléments français au Gabon – ont permis de faire le point sur cet outil nouveau qu’est le pôle opérationnel de coopération.
L’accent mis sur la coopération est cohérent avec les orientations du sommet de l’Élysée de décembre 2013 consacré aux relations de la France avec les pays d’Afrique : le développement des POC va donc dans le sens des orientations de ce sommet.
• L’intérêt de la formule du pôle opérationnel de coopération à vocation régionale
Comme le chef d’état-major de l’armée de terre l’a souligné devant les rapporteurs, dans le cadre des contraintes fixées par le Livre blanc, la transformation d’une base opérationnelle avancée telle que celle de Libreville en POC « est conforme au principe de strict besoin opérationnel sans perte irréparable du lien de coopération régionale et de la capacité d’influence militaire française ».
Ces structures spécialisées semblent donc « bien adaptées à l’objectif visé » : « à moindre coût, elles permettent d’entretenir un flux constant de formation au profit des armées africaines de proximité, de maintenir un contact soutenu avec les autorités militaires locales, tout en étant capables d’agréger les renforcements ponctuels venus de métropole ».
Concernant leur fonctionnement et sur un plan strictement militaire (hors contexte diplomatique ou politique), leur viabilité est conditionnée selon le général Bertrand Ract Madoux par un bon ratio permanents-tournants et par le maintien de capacités de préparation opérationnelle (les centres d’aguerrissement de l’outre-mer et de l’étranger - CAOME) au profit des armées africaines comme de nos propres forces.
• Une formule qui a montré son succès à Dakar
Le déplacement des rapporteurs leur a permis de mesurer, avec quelques années déjà de recul, l’impact de la transformation des Forces françaises du Cap Vert en Éléments français au Sénégal, étude d’autant plus intéressante que la même transformation est envisagée pour Libreville.
Il en ressort que le bilan de cette transformation est jugé positif. Certes, comme l’attaché de défense l’a indiqué aux rapporteurs, la dissolution du 23e bataillon d’infanterie de marine a été « vécu comme un désengagement, voire un traumatisme pour les officiers sénégalais qui étaient habitués à sa présence » : ils avaient avec les Forces françaises du Cap Vert un rapport « plus affectif ». L’ambassadeur de France a relevé lui aussi que le nouvel outil que constitue le pôle opérationnel de coopération demandait « un temps d’appropriation par nos partenaires ».
L’ambassadeur a toutefois jugé que le POC de Dakar constituait désormais « un très bel outil », et que les demandes de formation adressées par les États de la sous-région dépassaient même le volume d’offre disponible. Il a surtout souligné que, selon lui, la formule du POC avait fait ses preuves à plusieurs égards, notamment à la lumière de son rôle dans l’opération Serval :
– la transformation de forces de présence en simple pôle opérationnel de coopération n’a pas privé la France de capacités de réaction rapide. En effet, c’est depuis Dakar que les travaux sur la planification, la conduite et le commandement de cette opération avaient été menés en amont, et ce sont bien les EFS qui ont fourni à la force Serval son « noyau clé » ;
– dédié « à temps plein » à la coopération et forts de personnels spécialisés en la matière, la structure et les moyens du pôle opérationnel de coopération ont permis d’assurer un accompagnement des contingents africains de la MISMA en aval de leur formation à Dakar, comme cela a été le cas pour les contingents togolais, sénégalais, tchadiens, béninois et burkinabés. Pour ce faire, le pôle opérationnel de coopération a les moyens de mettre en place des détachements de liaison avancés (DLA) qui assurent trois missions : 1./ l’aide aux contingents africains pour certaines opérations techniques, comme le guidage aérien ou le réglage des tirs d’artillerie ; 2./ la coordination avec les unités françaises ; 3./ un retour d’informations utile pour les forces françaises ;
– le pôle opérationnel de coopération permet d’exploiter toutes les potentialités logistiques offertes par le site de Dakar, et notamment ses infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ainsi, l’ambassadeur a rappelé aux rapporteurs qu’une large part du matériel destiné à armer la force Serval a transité par le port de Dakar, et non par celui d’Abidjan. De plus, l’aéroport de Dakar s’est avéré utile lorsque ceux de Bamako et de Niamey ont été saturés, du fait de leur faible capacité d’accueil. Enfin, les infrastructures des EFS permettent de prépositionner des matériels, soit au titre du dispositif guépard pour ce qui est destiné aux forces françaises, soit au titre du processus de RECAMP pour ce qui est destiné aux forces africaines.
Ce constat a été pleinement partagé devant les rapporteurs par le général Louis Duhaut, commandant des Éléments français au Sénégal. Il leur a exposé les bénéfices du pôle opérationnel de coopération dans les termes suivants :
1./ Une nouvelle dimension opérationnelle qui privilégie le continuum coopération (formation) engagement opérationnel. Pour le pays-hôte, le partenariat de coopération opérationnelle avec la France prend une orientation différente et plus enrichissante, dédiée à la constitution et à la consolidation des capacités militaires locales. Pour les autres pays de la zone de responsabilité principale (ZRP), le pôle opérationnel de coopération augmente les capacités de coopération bilatérale. La composition interarmées du POC, à base essentiellement de cadres et de militaires du rang expérimentés, permet de délivrer des instructions à la carte dans la durée et en s’appuyant sur un catalogue de référence. Les interactions avec les forces armées de la ZR, sous couvert des missions diplomatiques et des attachés de défense sont nombreuses et variées (sous la forme de détachements d’instruction opérationnelle (DIO), de détachements d’instruction technique (DIT) et du soutien cadre aux exercices …).
La capacité à armer le noyau-clé d’un PCIAT est maintenue, ainsi que la capacité à prendre le commandement opératif d’une force venue en renfort. L’opération Serval a illustré cette capacité.
2./ Un échelon régional de la coopération opérationnelle qui facilite le continuum sécurité-défense porté par la CEDEAO. L’action du pôle opérationnel de coopération rayonne dans l’ensemble des pays de la zone de responsabilité du COMELEF, en soutien de l’implication des attachés de Défense et des missions de coopération militaire. Ce rayonnement bénéficie également au pays-hôte. La constitution d’un réseau de correspondants dans tous ces pays donne une véritable dimension d’échelon opératif de coopération au POC qui propose au niveau stratégique, notamment, les appréciations de synthèse pour la région et les points particuliers de renseignements collectés lors des détachements d’instruction.
De plus, le pôle opérationnel de coopération conduit son action selon une approche globale garantissant toute la cohérence et la coordination nécessaires avec la coopération structurelle (voire autres coopérations). Il apporte son concourt, en soutien des autorités civiles et des services de l’État vernaculaires (et non en complément ou en substitution). Ceci se fait notamment dans le domaine de « l’action de l’État en mer (AEM) » et dans le domaine de la sécurité civile (les pompiers des Éléments français au Sénégal interviennent régulièrement en soutien des forces de sécurité ivoiriennes, prioritairement dans les quartiers jouxtant les entreprises des EFS).
3./ Une présence militaire française maintenue, aussi bien sous la forme des bâtiments et aéronefs en relâche opérationnelle (capacité de transit), que sous la forme de capacités stationnées à demeure ou en alternance ; c’est le cas de l’Atlantique 2 placé sous contrôle opérationnel du commandant des Éléments français pour certaines missions. Par ailleurs, le pôle opérationnel de coopération fournit un point d’appui stratégique pour la mission Corymbe et pour la préparation opérationnelle des forces qui trouvent au Sénégal un terrain d’instruction et de manœuvre de qualité (par exemple, liens entre les écoles d’application de Thiès et de Draguignan).
4./ Une nouvelle économie. Le concept de pôle opérationnel de coopération s’inscrit dans la logique globale du dispositif permanent des forces armées en Afrique et contribue à l’effort budgétaire demandé aux armées. Dans le domaine des ressources humaines, son organisation doit notamment répondre au double compromis du volume seuil et de la répartition optimale entre les postes de longue et de courtes durées (sachant que la confiance et la connaissance réciproques nécessitent de maintenir, sans doute plus qu’ailleurs, certains personnels deux ou trois ans en poste).
SECONDE PARTIE
PRÉSENCE ET INTERVENTION MILITAIRES NE DOIVENT PAS RÉSUMER NOTRE POLITIQUE AFRICAINE
Comme le général Jacques Norlain l’a fait valoir devant les rapporteurs, « réfléchir sur le dispositif militaire et les interventions françaises en Afrique, c’est in fine réfléchir sur la politique africaine de la France ». C’est sous cet angle que les rapporteurs ont mené leurs travaux.
I. LE SUIVI DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES EN COURS MONTRE LES LIMITES DES CAPACITÉS FRANÇAISES D’INTERVENTION DANS LES CRISES AFRICAINES
Conformément au mandat que leur a confié la commission, les rapporteurs ont consacré une part importante de leurs travaux au suivi des deux opérations extérieures majeures en cours sur le sol africain : les opérations Serval au Mali et Sangaris en République centrafricaine. Ce suivi présente un double intérêt : d’une part, il s’inscrit dans le cadre du nécessaire contrôle parlementaire des opérations dont la prolongation a été votée par le Parlement ; d’autre part, l’expérience de ces opérations est riche d’enseignements, à la fois sur les capacités de nos armées et sur l’articulation de l’action de la France avec celle de ses partenaires sur le continent africain.
Comme le chef d’état-major de l’armée de terre l’a fait valoir aux rapporteurs, il s’agit de deux opérations « totalement différentes » : la mission des forces françaises diffère, et la nature de l’ennemi aussi. Au Mali, « l’ennemi veut nous porter des coups, et nous avons des partenaires ». En République centrafricaine, « nous cherchons à séparer deux camps, qui restent calmes en présence des soldats français (et relativement calmes en présence de la MISCA) ».
A. L’OPÉRATION SERVAL AU MALI : UN SUCCÈS INDÉNIABLE, QU’IL EST URGENT D’EXPLOITER SUR LE PLAN POLITIQUE POUR NE PAS PERDRE L’AVANTAGE ACQUIS EN 2013
1. L’indéniable succès militaire de l’intervention française
a. Un défi logistique permanent
Schématiquement, nos armées ont été conçues pendant plusieurs décennies en vue de mener des opérations de guerre de haute intensité avec des capacités massives sur des théâtres européens relativement compacts, la présence outre-mer et à l’étranger restant plus légère. Une opération comme Serval les place dans une position tout à fait différente : les forces françaises ont eu à mener des combats de haute intensité, notamment dans l’Adrar des Ifoghas, sur un théâtre immense et avec des capacités relativement limitées, donc dispersées. Il en ressort que la logistique prend une place cruciale dans le succès de ce type d’opérations, que ce soit dans la phase aiguë des combats, ou dans la phase de stabilisation qui s’ensuit.
i. Dans la phase « aiguë » des opérations, en 2013
Les rapporteurs ne reviendront pas en détail sur le déroulement de l’opération Serval, qui a déjà fait l’objet du rapport d’information précité de nos collègues Christophe Guilloteau et Philippe Nauche.
Ils soulignent que, comme ce rapport d’information le montrait en détail, l’opération Serval peut être vue comme l’archétype de ce que les militaires appellent une opération « log-driven », c’est-à-dire une action dans laquelle les moyens logistiques sont déterminants – il convient de souligner à cet égard que l’opération Serval peut être vue comme un grand succès logistique. Selon les explications fournies aux rapporteurs par l’adjoint aux soutiens interarmées du commandant de la force Serval, ce défi logistique a aujourd’hui quatre aspects majeurs :
– les élongations sont considérables, comme le montrent les cartes ci-après ;
– les conditions climatiques et météorologiques ont pour conséquence une usure très rapide des matériels et des personnels, ce qui appelle la mise en place de moyens de maintenance et de soutien de l’homme considérables par leur volume ;
– les ressources locales étant limitées, particulièrement dans le Nord, le dispositif de soutien ne peut pas être aussi largement externalisé que sur d’autres théâtres, et les possibilités d’approvisionnement local sont très réduites : les flux logistiques sont donc constants et intenses, au point que les logisticiens ont évoqué devant les rapporteurs des « flux d’entretien tyranniques pour l’eau et le carburant ».
LES ÉLONGATIONS AU MALI
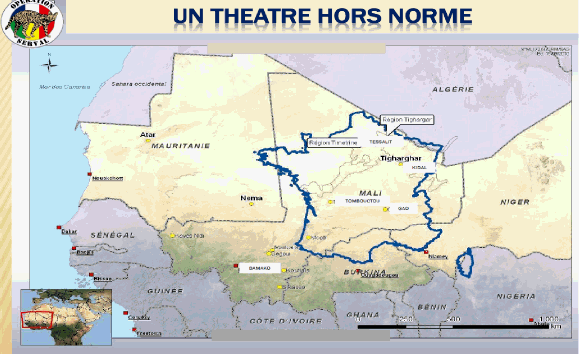
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Le général Bernard Barrera, qui commandait alors la brigade Serval, est revenu sur les conséquences que ces contraintes logistiques ont fait peser sur la conduite des opérations. Pour lui, Serval était marquée par un « déséquilibre avant » : dans la première guerre du Golfe, « on a attendu six mois pour se lancer », alors que la logique de Serval est totalement différente : « entrer en premier et foncer : on y est formés, c’est une belle opération, c’est le rêve de tous les officiers ».
La force a toutefois « eu de la chance : elle a eu une période d’échauffement, dans la mesure où Tombouctou a été libéré sans un coup de fusil ». Cette période a été « utile car on était très limite en eau, en carburant, en munitions, etc. ». Ainsi, les deux semaines sans combat ont permis de mettre en place les flux et d’acheminer depuis la France les approvisionnements nécessaires, en ajustant les dotations initiales.
Le général a lui aussi souligné que la logistique a été déterminante, et « au niveau des moyens logistiques stratégiques, la situation était tendue », car :
– la France manque de vecteurs aériens stratégiques ;
– le théâtre manquait aussi de plateformes : la première question que se posait le commandement était : y a-t-il une piste ? Comment assurer l’alimentation en carburant ? Il a donc fallu augmenter la capacité pétrolière locale dans certaines zones, et la créer ex nihilo à Tombouctou et Gao, où la piste était d’ailleurs « très difficile ». Le 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP) et le 25e régiment du génie de l’Air (25e RGA) ont réussi à remettre en état les pistes de Gao et de Tessalit.
Néanmoins, le commandement ne pouvait pas compter seulement sur les avions pour assurer la logistique : ceux-ci ont en effet connu des problèmes de disponibilité et des ruptures capacitaires. Dans le climat malien, il était impossible d’effectuer plus de six à sept vols par jour avec un Transall. D’où l’importance des trains de camions : « ils apportaient tout, sauf besoins d’urgence », comme, par exemple, lorsque menaçait un manque de munitions pendant la bataille de l’Amettetaï. Or, pour rallier Tessalit depuis Gao, il fallait trois jours… et ce d’autant que les camions de la logistique sont « à bout de souffle » : « les porteurs ont tenu en limite ». L’acheminement des approvisionnements et des pièces de rechange s’en est donc trouvé compliqué.
En outre, la chaleur n’était pas sans effet sur l’emploi des missiles, les températures maximales étant parfois proches d’être atteintes, ce qui imposait de prendre des mesures particulières d’aménagement des dépôts de munitions. Par ailleurs, le soutien sanitaire a « monopolisé tous les moyens disponibles », avec notamment quatre antennes chirurgicales avancées. Toutefois, si « personne n’est mort faute de soins », « la golden hour n’était pas assurée ». Ce qui vaut pour les moyens humains vaut aussi pour les approvisionnements en produits pharmaceutiques : « le premier mois, on était très légers… ».
ii. Dans la phase actuelle des opérations, dont le pivot est la base de Gao
Le déplacement des rapporteurs à Bamako et à Gao leur a permis d’étudier sur le terrain les contraintes logistiques pesant sur l’opération Serval dans sa phase actuelle, marquée à la fois par la poursuite de la lutte antiterroriste et la déflation progressive de la force. Ainsi, les logisticiens doivent assurer de manière concomitante le renouvellement des matériels et des hommes projetés dans le cadre de l’opération Serval, le soutien des opérations menées sur le vaste territoire du Mali, et le désengagement d’une partie des matériels et des effectifs conformément au plan de désengagement progressif de la force, dont le poids logistique est jugé « très important ».
• Une contrainte supplémentaire : assurer les rotations et le désengagement progressif de la force
Au moment du déplacement des rapporteurs au Mali, le désengagement de la force Serval était planifié avec précision, et déjà entamé, comme le montre le graphique ci-après. Conformément au mandat assigné à cette force par les résolutions des Nations unies, l’objectif fixé consistait à en stabiliser l’effectif autour de 1 100 personnels (hors forces spéciales) chargés de missions « coup de poing » de lutte antiterroriste, en complément de l’action des Forces armées maliennes (FAMa) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Ce contingent sera basé pour l’essentiel à Gao, les déflations devant peser principalement sur les effectifs encore présents à Bamako.
LA PROGRESSION DU DÉSENGAGEMENT DE LA FORCE SERVAL
AU PREMIER TRIMESTRE 2014 – EFFECTIFS
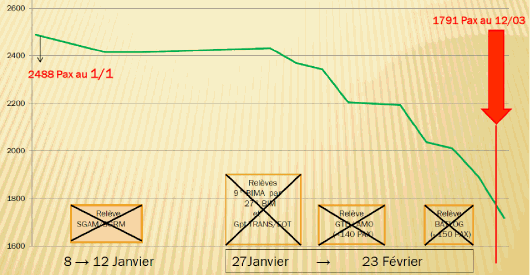
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Il faut insister sur l’importance logistique de cette manœuvre de désengagement : en mars 2014, 230 des 410 matériels dont l’évacuation était planifiée avaient déjà été retirés du théâtre malien, comme le montre le schéma ci-après. Majoritairement rapatriés depuis Gao, ces matériels parcourent 2 500 kilomètres par voie routière jusqu’au port d’embarquement d’Abidjan ; chaque convoi, essentiellement externalisé, dure 35 jours (aller – retour).
LA PROGRESSION DU DÉSENGAGEMENT DE LA FORCE SERVAL
AU PREMIER TRIMESTRE 2014 – MATÉRIELS
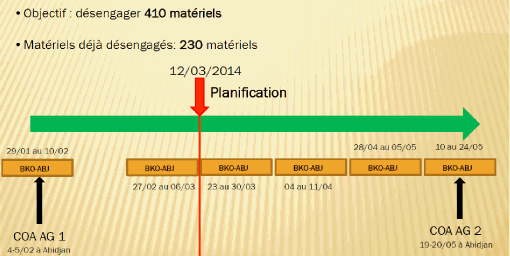
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
• Une conséquence notable : le coût humain et financier d’une logistique « hors normes » dans l’opération Serval
Les rapporteurs relèvent que les personnels du bataillon logistique de Gao (bataillon « Camargue ») qu’ils ont rencontrés jugent « extrêmement tendus » les flux logistiques, qui reposent principalement sur l’organisation de convois routiers. Il faut au minimum trois jours pour rallier Gao depuis Bamako, et les conditions de sécurité sur le territoire leur imposent de composer des « caravanes blindées autonomes pendant sept jours », constituées pour moitié de véhicules de commandement et de soutien. Comme le reconnaît le commandement de la force, « beaucoup repose sur l’endurance du soldat logisticien » ; à titre d’exemple, les rapporteurs relèvent que ceux qui assurent les convois de Bamako à Gao ne disposent que de quatre jours de temps de récupération sur la base de Gao – temps pendant lequel ils doivent par ailleurs assurer le maintien en condition opérationnelle de leurs matériels roulants – et que la tendance est à la baisse de la durée de ces temps de récupération.
Ces conditions particulières expliquent qu’une part très importante des effectifs déployés est constituée de logisticiens. Sur les 1 000 personnels environ de la base de Gao, le bataillon logistique en compte 400. Ce ratio « logisticiens / effectifs totaux » de 40 % est particulièrement élevé : pour l’opération Sangaris, il ne dépasse pas 12 %, selon les indications fournies aux rapporteurs à Gao. Et encore, l’effectif du bataillon logistique est jugé « minimal » par le commandement.
Pour répondre à ce défi, le dispositif logistique de la force Serval est majoritairement déployé à Bamako et Gao, comme le montre la carte ci-après. L’aéroport de Bamako permet de réceptionner les ressources destinées à la force : c’est ainsi le point d’appui logistique d’entrée de théâtre, de même qu’un hub qui permet de faire transiter des ressources vers les autres opérations de la sous-région (Épervier au Tchad, Licorne en Côte d’Ivoire, Sabre pour les forces spéciales dans la région). Le centre de gravité du contingent français est situé à Gao, plate-forme à partir de laquelle sont soutenues toutes les opérations de la force Serval. Le dispositif logistique est aussi composé de plots de ravitaillements dans la région de Gao ou vers la frontière algérienne. Ces plots sont destinés à assurer un soutien de proximité au profit des détachements isolés (8). Ils ont la particularité de disposer d’une piste, ce qui permet de procéder à des ravitaillements par voie aérienne ou d’effectuer des évacuations sanitaires par le CASA NURSE de l’armée de l’air. Chacun de ces plots est doté des diverses ressources (eau, carburant, etc.) leur garantissant une autonomie de fonctionnement d’au minimum quinze jours. Ils servent ponctuellement de point de ravitaillement aux forces spéciales, en particulier à Tessalit et à Tombouctou.
LE DISPOSITIF LOGISTIQUE DE SERVAL
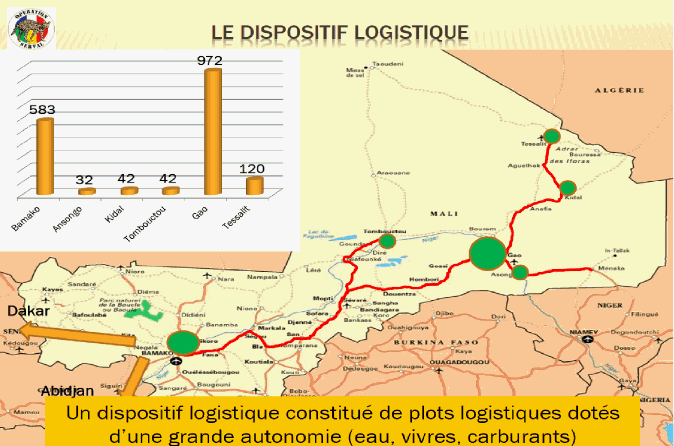
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Le déplacement des rapporteurs à Gao leur a également permis de faire le point sur les conditions de sécurisation des convois. En effet, les menaces existant sur les axes logistiques – qu’illustre la carte ci-après – contraignent la force à doter les convois logistiques d’un important élément de protection.
LA MENACE SUR LES AXES LOGISTIQUES
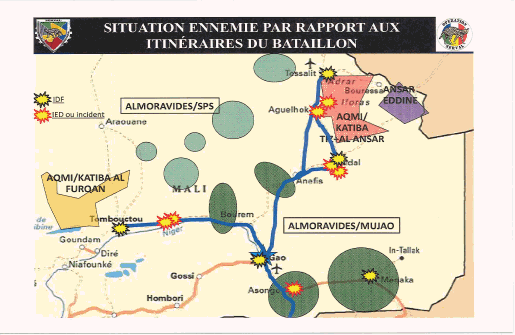
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
L’ARMEMENT DES CONVOIS ADAPTÉ À LA MENACE
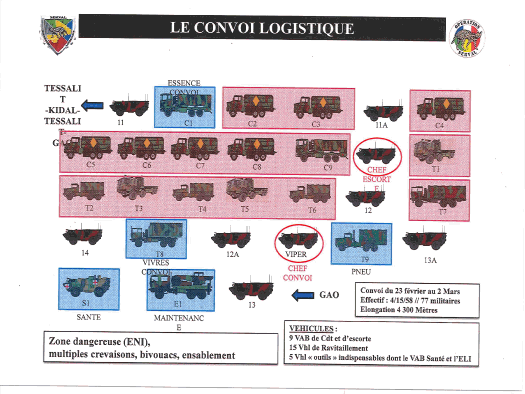
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Ces observations factuelles ne doivent pas être interprétées comme une remise en question des choix opérés.
En effet, comme le colonel Paul Peugnet, commandant de la force Épervier, l’a fait valoir aux rapporteurs, la comparaison des ratios soutenants / soutenus présente plusieurs limites méthodologiques, dans la double mesure où :
– ils sont commandés par les conditions du théâtre, qu’il s’agisse des conditions géographiques (les élongations, le climat, etc.) ou des conditions économiques, le tissu industriel et commercial local permettant ou non de procéder à des externalisations ;
– la logistique ne doit pas être vue comme une composante subalterne de la force, mais bien comme un « facteur de puissance » en projection.
Plus généralement, le chef d’état-major de l’armée de l’air a estimé que les fonctions de soutiens sont « très liées à l’opérationnel » et que si l’on a réduit les effectifs de personnels considérés comme des « soutiens » en France, cela a pour conséquence regrettable de réduire considérablement le vivier disponible pour les missions de courtes durées ou les projections en opérations extérieures en Afrique. Un juste équilibre reste à trouver, et « l’on arrive au bout de la logique permettant de réduire les effectifs en France pour les conserver en Afrique ».
b. Une mission de contre-terrorisme qui est loin d’être achevée
Le déplacement des rapporteurs au Mali leur a permis de faire le point sur la situation sécuritaire du Nord du pays un an après les principales actions de force de l’opération Serval, et six mois après l’élection d’Ibrahim Boubacar Keïta à la présidence de la République.
• Une situation sécuritaire marquée par une menace terroriste permanente
Tous les interlocuteurs rencontrés s’accordent sur un constat : la situation sécuritaire reste imprévisible dans le Nord du Mali, et la tendance est à la reprise des incidents. Pour le commandement de Serval, « la menace terroriste reste permanente ». En outre, comme l’a souligné le président de la commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, M. Karim Keita, la sécurité du territoire n’est que relative : en dehors des grandes villes, les forces de sécurité n’ont pas encore établi de maillage territorial conséquent. Ainsi, comme le général Vianney Pillet, chef d’état-major de la MINUSMA, l’a déclaré à la mission, il ressort des observations de l’ONU que le mois de février 2014 avait été le plus intense en incidents depuis la fin des opérations initiales de l’opération Serval.
PRINCIPAUX « ÉVÉNEMENTS SÉCURITAIRES » DU PREMIER TRIMESTRE 2014 AU MALI
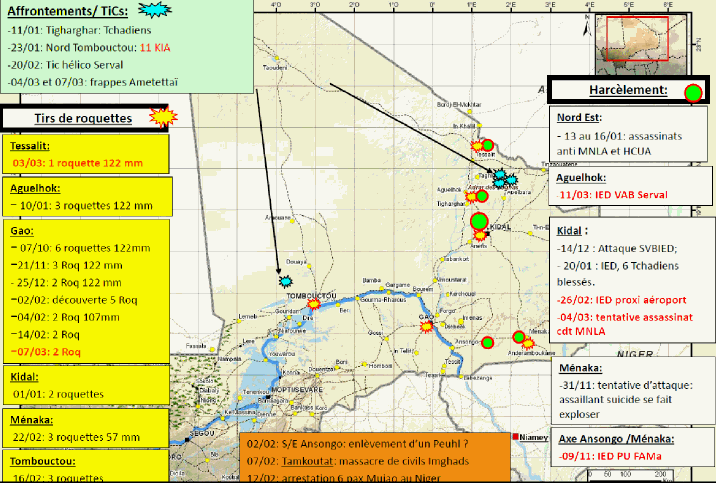
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Selon les renseignements fournis aux rapporteurs en mars 2014, tant par les forces de la MINUSMA que par celles de l’opération Serval et par les services compétents de l’ambassade de France, on observait déjà une aggravation de la situation sécuritaire avec le redéploiement de groupes armés djihadistes ou terroristes dans trois foyers principaux :
– près du Niger et autour de Gao : reconstitution du MUJAO autour d’un noyau d’une centaine de combattants qui se fondent trop aisément dans la population pour que le contingent de 850 militaires nigériens qui y stationne sous la bannière de la MINUSMA n’en vienne à bout ;
– dans le massif du Tigharghar : repositionnement d’éléments d’AQMI dans une zone qui constitue un véritable « château fort », très difficile d’accès pour la MINUSMA ;
– dans la région de Tombouctou et près de la frontière algérienne, divers groupes se constituent, et si la plupart sont en pourparlers avec Bamako, ils n’en représentent pas moins une menace.
L’effectif de ces groupes était alors évalué à un niveau relativement limité – 400 à 600 combattants selon le commandement de l’opération Serval – et ils étaient géographiquement circonscrits. Pour le chef d’état-major de la MINUSMA, des moyens du format de ceux de l’opération Serval auraient suffi à les détruire.
Toutefois, à défaut d’action d’envergure contre eux, ils restent imprévisibles, et selon le commandement de l’opération Serval, ils se sont adaptés en adoptant des modes d’action asymétriques – on retiendra notamment la croissance des occurrences de tirs de roquettes et de poses d’engins explosifs improvisés, que présente le graphique ci-après –, suivant une tactique de harcèlement face à la puissance de feu française. Il s’agit donc d’un ennemi furtif, pugnace et bien adapté, maintenant une pression forte sur la population.
LA MENACE DE PLUS EN PLUS PRÉGNANTE DE TIRS DE ROQUETTES
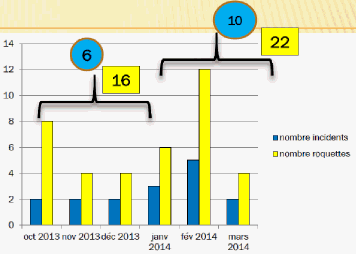
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
Selon les analyses de l’état-major de la force Serval présentées aux rapporteurs en mars 2014, les mois à venir devaient être marqués par la poursuite des tendances suivantes :
– la poursuite et une intensification des actions « asymétriques », avec une progression rapide des « savoir-faire » des groupes armés djihadistes / groupes armés terroristes : avec des techniques de plus en plus « militaires », cette menace ne peut être traités que par les forces armées ;
– une reconstitution progressive des groupes armés rebelles, djihadistes ou terroristes et leur rapprochement ;
– des tentatives de harcèlement des FAMa, de la MINUSMA et des forces de Serval, visant à les contraindre à se concentrer sur la protection de leurs emprises, au détriment de leur capacité de déploiement.
Cette analyse est largement confirmée par les événements qui se sont produits deux mois après le déplacement des rapporteurs, à Kidal et dans sa région, dont le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) ont pris le contrôle à la faveur d’une attaque concertée lors du premier déplacement dans cette ville du Premier ministre malien. Les événements de mai 2014 ont ainsi montré la capacité des groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes à reprendre du terrain.
• Une menace difficile à évaluer
La multiplicité des groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes opérant au Nord du Mali complique l’appréciation de la menace, comme en témoigne l’encadré ci-après.
« Cosmogonie » des groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes
opérant au Nord du Mali
D’après les renseignements fournis aux rapporteurs, les principaux groupes rebelles, terroristes ou djihadistes en présence sont les suivants :
1./ Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) est, schématiquement, travaillé par cinq tendances :
– une tendance pro-algérienne, représentée par Mohamed Ag Najim (lui-même possédant la nationalité algérienne), qui vit largement du trafic de drogue ;
– une tendance plus proche de Ouagadougou, représentée par Bilal Ag Acherif, qui joue actuellement la carte du Maroc et ne donne pas dans le trafic de drogue. Elle repose toutefois sur la même base tribale que le courant de Mohamed Ag Najim (la classe dominante des Ifoghas), ce qui évite entre eux toute hostilité marquée ;
– le clan de Menaka, dirigé par Bajan Ag Hamatou, particulièrement hostile au MUJAO (trois de ses fils ont été tués dans leurs luttes) et aux Peuls. Assez proche du pouvoir de Bamako, il nourrit une certaine rancœur envers les autres cadres du MNLA qui ne sont pas venus le soutenir quand celui-ci était en difficulté ;
– la branche des Imrad, tribu qui cherche à ravir aux Ifoghas le contrôle de Kidal. Cette branche est liée aux Forces armées maliennes (FAMa) et joue la carte de Bamako contre les Ifoghas et, accessoirement, contre les Peuls. C’est d’ailleurs un Imrad, le général Ag Gamou, qui a combattu le plus au sein des FAMa lors de la crise de 2012-2013 ;
– une tendance arabe, constituée de membres de tribus arabes inféodées à des Touaregs.
2./ Le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA), qui se structure en deux tendances :
– l’une, portant des revendications politiques classiques d’autonomie, est présente de Tombouctou à Gao ;
– l’autre, concentrée au nord de Tombouctou, est constituée d’ethnies différentes et tend à se radicaliser dans ses revendications politiques au contact du MNLA, ainsi qu’à développer diverses activités lucratives, qui vont du trafic de drogue à diverses actions de prédation – c’est, aux termes d’un observateur averti, le « clan du business ».
Le MAA dans son ensemble est plus éloigné du gouvernement de Bamako que ne l’est le MNLA et, au sein même du MAA, la faction du Nord l’est encore plus.
3./ Le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), issu d’une dissidence du MNLA et dirigé par Mohamed Ag Intalla avec le soutien de son père, l’Amenokal Intalla Ag Attaher, chef traditionnel des Touaregs Ifoghas. C’est ce mouvement qui, par peur de perdre le contrôle de la région de Kidal sous l’effet de ciseaux formé par les forces françaises d’une part, et par les ambitions des Imrads d’autre part, a retourné ses alliances pendant la campagne de 2013. Renonçant à toute revendication indépendantiste, il réclame aujourd’hui l’autonomie de l’Azawad et entretient des relations avec le gouvernement de Bamako.
4./ Al-Mourabitoune, qui résulte du rapprochement de deux mouvements :
– le MUJAO, pour ceux de ses éléments qui n’ont été ni détruits ni dispersés par l’opération Serval, jouissant d’une bonne implantation dans les populations locales (dont ils sont originaires) et vivant essentiellement de narcotrafics, pour lesquels ils auraient établi des liens d’affaires avec Boko Haram ;
– un groupe de dissidents d’AQMI, dénommé « El-Mouaguiine Biddam » emmenés par Mokhtar Belmokhtar.
5./ AQMI, mouvement « historique » qui demeure une référence idéologique clairement identifiée – ce qui lui permet de rallier d’anciens éléments d’Ansar Dine. Quoiqu’elle ait subi de lourdes pertes en hommes en en matériels lors de la campagne de 2013, AQMI reprendrait toutefois pied dans la vallée de l’Amettetaï.
Selon le commandement de l’opération Serval, les groupes armés djihadistes et les groupes armés terroristes ont tendance à intensifier leur coopération. Le début de l’année 2014 aurait notamment été marqué par un rapprochement entre AQMI et Al-Mourabitoune, héritier du MUJAO.
Il est également à noter que la perception de la menace diffère profondément selon que l’on se place du point de vue des autorités de Bamako ou de celui des autorités françaises ou internationales (MINUSMA).
Ainsi, le MNLA et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) sont considérés par les autorités politiques de Bamako – y compris les parlementaires – comme des « terroristes », ou à tout le moins comme le « cheval de Troie » des djihadistes au Mali. À l’inverse, mettant en avant le fait que ces mouvements sont signataires de l’accord de Ouagadougou du 18 juin 2013, la France et l’ONU ne les considèrent pas comme des ennemis, le chef d’état-major de la MINUSMA précisant néanmoins qu’ils sont envisagés comme une menace potentielle en cas d’échec des négociations.
Le commandement de l’opération Serval note toutefois que sur le terrain, il est « difficile de faire le tri » entre les signataires des accords de Ouagadougou et les autres groupes armés rebelles, djihadistes et terroristes.
• Un défi opérationnel pour la force Serval : la lutte contre les groupes armés terroristes
Comme l’a expliqué aux rapporteurs le commandement de la force Serval, l’objectif principal de celle-ci est désormais de maintenir sur les groupes armés terroristes une pression suffisante pour contenir leur tentative actuelle de reprise de terrain, les affaiblir et les « user ».
1./ À cette fin, la force conduit plusieurs types d’actions :
– des patrouilles permanentes autour des villes de Tombouctou, d’Asongo, de Gao, de Kidal et d’Aguelhok notamment, que ce soit de façon autonome ou en fournissant un appui français aux patrouilles menées par les FAMa et la MINUSMA, au moyen de détachements de liaison et d’appui (DLA) et de détachements d’appui opérationnel (DAO). Comme il a été expliqué aux rapporteurs, ces patrouilles ont un double intérêt : d’une part, elles permettent de sécuriser les zones concernées et, d’autre part, elles offrent des occasions de recueillir du renseignement d’origine humaine qui peut être précieux, ne serait-ce que pour la sécurisation des emprises françaises ;
– des « actions d’influence », qui prennent diverses formes : key leader engagement (c’est-à-dire : action d’influence auprès des personnalités locales) ; low level engagement (ce qui revient, schématiquement, à maintenir une présence légère auprès des populations afin de « couper leurs liens avec les groupes armés terroristes en luttant contre le « c’était mieux avant » »), et diverses actions de communication visant à faciliter l’acceptation de la présence française par les populations locales ;
– des actions ponctuelles, décrites aux rapporteurs comme « intel-led », c’est-à-dire consistant à exploiter rapidement un renseignement recueilli. À titre d’exemple, il leur a été présenté une action qui a consisté, en décembre 2013, à saisir plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium, composant chimique pouvant servir d’explosif ;
– de plus vastes « opérations d’ensemble », mettant en œuvre toute la gamme de moyens interarmées dont dispose la force Serval pour des actions de reconnaissance et/ou de frappe menées à l’échelle du sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) ou d’une section, pour 15 à 20 jours. De telles opérations sont menées notamment dans le massif du Tigharghar ;
– des « opérations ciblées », consistant le plus souvent à traiter une cible identifiée soit par les moyens de renseignement auxquels a accès la force Serval, soit par la DGSE.
2./ Le commandant de la force Serval a souligné devant les rapporteurs qu’un des défis dans la lutte antiterroriste tient à l’importance du renseignement, qu’il soit d’origine humaine (ROHUM) ou électromagnétique (ROEM), faisant systématiquement l’objet d’une vérification par des moyens de renseignement d’origine « image » (ROIM).
Afin d’optimiser l’emploi des moyens de renseignement et l’efficacité du traitement des informations, l’organisation de la force Serval repose sur une « boucle courte multicapteurs » mise en œuvre depuis Gao par un sous-groupement de renseignement multicapteurs (SGRM). Selon le commandement, cette organisation nouvelle « a fait toutes ses preuves », l’intégration du renseignement et de l’opérationnel au niveau du théâtre constituant une « nouveauté » qui « produit des résultats ». Cette « boucle courte » a pour principe :
– de piloter plusieurs capteurs au plus près du théâtre, les sources présentées aux rapporteurs étant les suivantes : 1./ des sources « 3D », avec notamment un drone tactique doté d’une autonomie d’une heure et d’une portée de 10 kilomètres ; 2./ des sources dites « 4D », c’est-à-dire des capteurs électromagnétiques (écoute de communications radios, détection de « bulles GSM », etc.) ; 3./ des moyens de recherche humaine, dits pour certains « 2D » (il s’agit notamment de patrouilles dans des zones désignées comme intéressantes), et pour d’autres « 5D », c’est-à-dire consistant à anticiper les actions des groupes armés terroristes en exploitant des sources humaines, y compris lors de l’interrogatoire des prisonniers ;
– de croiser ces informations afin d’identifier clairement la menace et de définir la réponse la plus efficiente à lui apporter.
Les entretiens conduits par les rapporteurs ont toutefois permis de mettre en lumière certaines limites et voies d’améliorations envisageables de ce dispositif :
– alors que 70 % des communications interceptées sont énoncées en langue Bambara, et une part significative en Tamachèque, la force ne dispose pas d’interprètes pour ces langues : l’intérêt des écoutes se limite dès lors à observer, d’une part, leur fréquence et les liens qui s’établissent et, d’autre part, « à observer l’ambiance, au ton de la voix »… Le commandement reconnaît que l’absence de locuteurs du Bambara et du Tamachèque constitue une « vraie contrainte ».
– le décloisonnement du renseignement n’est pas encore complet. S’il a été déclaré par le commandement que la situation s’était « améliorée », les responsables de l’intégration du renseignement n’en ont pas moins dit, en aparté aux rapporteurs, que certaines unités restaient « un peu cachottières ». Par ailleurs, il ressort des entretiens que la population du Nord du Mali reste « peu bavarde, par peur des représailles, les moins prudents d’entre eux ayant déjà été éliminés par les groupes armés terroristes ». De plus, le partage du renseignement avec les Maliens ne se heurte pas à une mauvaise volonté d’une partie ou d’une autre, mais aux techniques particulières des services compétents des FAMa qui, selon les responsables français compétents, font reposer leur dispositif sur l’exploitation de « rumeurs », méritant fréquemment d’être vérifiées avant de pouvoir être exploitées par les services français.
3./ Pour ce qui est du traitement des cibles ainsi désignées, le GTIA Vercors, basé à Gao, qui constitue le « fer de lance » de l’opération Serval, disposait de 553 personnels au jour où les rapporteurs sont allés à leur rencontre. Son commandement le décrit comme une « boîte à outils » dotée d’une gamme complète de capacités – une compagnie d’infanterie, un escadron blindé léger, un groupement de commandos parachutistes, etc. – mais en volume très compté. Le chef d’état-major de l’armée de terre a estimé que l’« on manque de certains moyens pour retrouver notre liberté d’action sans prise de risque pour nos soldats ». Outre le cas des drones tactiques déjà évoqué, le général Ract Madoux a jugé qu’il serait utile à la force Serval de disposer de capacités d’artillerie CAESAR : « en binôme avec un drone, on tire à 40 kilomètres avec un total effet de surprise, même de nuit ».
2. Une prise de relais indéniablement insuffisante par les autorités maliennes et la communauté internationale – l’ONU et l’Europe
a. Un processus de « réconciliation nationale » en retard, si ce n’est en panne
i. Les avancées de juin 2013, avec l’accord de Ouagadougou
Les autorités de Bamako avaient conclu le 18 juin 2013 avec deux groupes touaregs – le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) – un accord négocié à Ouagadougou, sous les auspices de M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Cet accord visait à pacifier la région – sans pour autant comporter d’engagement en matière de désarmement des rebelles – avant la tenue des élections et la conclusion d’un « accord global et définitif de paix ».
Aux termes de cet accord, les Forces armées maliennes devraient entreprendre « dans les meilleurs délais » un « déploiement progressif » dans la région de Kidal ; le gouvernement malien avait alors déployé près de 200 hommes au plus vite et avant les élections. L’accord prévoyait aussi que les forces rebelles touarègues seraient « cantonnées », mais cette notion de cantonnement, et l’implantation desdits cantonnements, restaient des points d’achoppement entre les parties, conduisant à un blocage de l’application de l’accord. Celui-ci stipulait qu’en tout état de cause la MINUSMA sera déployée dans la région de Kidal afin d’éviter toute confrontation entre les Forces armées maliennes et les rebelles.
ii. Un processus électoral très satisfaisant
La tenue d’élections présidentielles et législatives était au cœur de la stratégie de rétablissement de l’État malien, en ce qu’elle confère au président élu et à l’Assemblée nationale une légitimité incontestable pour conduire le nécessaire processus de réconciliation nationale.
Le déplacement des rapporteurs à Bamako et leurs entretiens avec les autorités politiques maliennes – non seulement les membres du Gouvernement, mais également les parlementaires de tous les groupes – leur ont permis de revenir sur les conditions dans lesquelles se sont tenues ces élections. Il apparaît que leur organisation a été largement satisfaisante.
En effet, les sociétés françaises Safran et Sagem ont été en mesure de fabriquer et de distribuer de nouvelles cartes électorales – dites NINA – qui, comportant une photo de leur détenteur, limitant grandement le risque de fraude électorale. 90 % des cartes disponibles ont été retirées, ce qui constitue un indéniable succès.
Par ailleurs, l’élection présidentielle a mobilisé près de 50 % du corps électoral, ce qui, selon l’ambassadeur de France, est « un record pour le Mali ». Son résultat confère une indéniable légitimité au nouveau président, élu avec 78 % des suffrages exprimés.
iii. Atermoiements et vicissitudes dans les discussions engagées depuis juin 2013
En dépit de la mise en place d’autorités politiques fortes d’une incontestable légitimité démocratique, le bilan des six premiers mois de la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta en matière de réconciliation nationale est perçu comme limité par la plupart des interlocuteurs maliens comme français des rapporteurs. L’actualité confirme ce que leur disait le président de l’Assemblée nationale du Mali : « dès que l’on a l’impression que le Mali trouve enfin un chemin vers la paix, certains la torpillent ».
• La difficulté pour Bamako de trouver un interlocuteur crédible
Un des obstacles à la reprise du dialogue national malien tient à la difficulté pour le gouvernement de Bamako et la communauté internationale de trouver des interlocuteurs crédibles, c’est-à-dire formulant des revendications claires et fédérant l’essentiel des rebelles.
Toutefois, sous les auspices du gouvernement algérien, les trois principaux mouvements rebelles du Nord du Mali – le MNLA, le HCUA et le MAA – ont publié le 9 juin 2014 une position commune, appelée « déclaration d’Alger ». Des discussions exploratoires se sont poursuivies avec trois autres mouvements politiques d’importance significative : la fraction du MAA présente dans la région de Gao et de Tombouctou, la Coordination pour le peuple de l’Azawad (CPA) et la Coordination des Mouvements et Fronts patriotiques de résistance (CM-FPR). Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Mali a participé à ces discussions, qui ont abouti à la signature le 14 juin dernier d’une « plate-forme » commune aux mouvements rebelles précités.
Selon les informations fournies aux rapporteurs, cette plate-forme formalise les « lignes de conduite » devant leur servir de base dans le cadre de « toute démarche visant la recherche d’une solution politique pacifique définitive à la crise du Nord avec le gouvernement malien ». Reste à espérer que le temps n’érode pas cette volonté d’œuvrer à la consolidation de la dynamique d’apaisement et de s’engager dans le dialogue intermalien « inclusif ».
• La difficulté de Bamako à prendre l’initiative d’un plan de paix viable
Au moment de leur déplacement au Mali, plusieurs observateurs jugeaient déjà qu’en quelque sorte, « la balle était dans le camp de Bamako », c’est-à-dire qu’il appartenait aux autorités maliennes de présenter un projet de résolution politique de la crise au Nord.
Pour plusieurs observateurs, la lenteur avec laquelle les autorités avançaient sur ce terrain faisait peser deux risques majeurs sur le règlement de la crise malienne :
– un risque de pourrissement, si certains à Bamako en venaient à estimer que le temps jouait en leur faveur, pourvu que Serval et la MINUSMA assurent la sécurité du Nord ;
– le risque d’un « mauvais compromis », c’est-à-dire d’un accord passé trop rapidement, sans accord politique de fond, en vue principalement de rassurer les bailleurs de fonds du pays.
Ce qui était perçu par nombre d’observateurs comme une forme d’attentisme peut s’expliquer par l’équilibre que le président Keïta cherche à maintenir entre deux courants dans l’opinion publique et la classe politique malienne :
– ceux qui, comme le président lui-même ou le ministre des Affaires étrangères, sont ouverts à plusieurs options politiques, pourvu que soit garantie l’intégrité territoriale du pays ;
– ceux qui, comme le ministre chargé de la réconciliation ou le Premier ministre, peuvent être tentés par une sorte de « surenchère nationaliste ». Cette tentation n’est pas seulement présente parmi les générations marquées par la culture politique anti-occidentale qui prévalait au Mali dans les années 1970 ; au contraire, cette tentation se retrouve aussi auprès de jeunes responsables politiques de la génération du Premier ministre Moussa Mara.
• Des médiations qui compliquent la donne : l’intervention de l’Algérie et du Maroc
Comme le président burkinabè Blaise Compaoré l’a déclaré aux rapporteurs, il n’est pas fréquent que les médiations internationales qui aboutissent à des résultats satisfaisants soient menées successivement voire concomitamment par plusieurs médiateurs.
Or les rapporteurs retirent de leurs entretiens dans les différents États de la sous-région qu’une certaine confusion a pu régner dans l’organisation de la médiation entre le gouvernement malien et les groupes politiques du Nord. En effet, c’est sous les auspices du Burkina Faso qu’ont été entreprises les premières négociations, mais très rapidement après l’élection présidentielle, l’implication des autorités maliennes dans la mission de bons offices du président Blaise Compaoré s’est trouvée très réduite. L’impression dominante était alors que le président nouvellement élu souhaitait donner au processus de réconciliation un caractère moins international, et davantage « intermalien ». Dans le même temps, d’autres puissances de la région ont entrepris de fédérer les groupes du Nord en vue de faciliter les discussions : il s’agit principalement de l’Algérie et du Maroc. Toutefois, pour les observateurs africains, les rivalités historiques entre ces deux puissances et leurs intérêts parfois divergents au Mali ne peuvent que compliquer les médiations.
C’est finalement l’Algérie qui semble s’imposer comme le médiateur principal dans le règlement politique de la crise malienne. En effet, lors de la quatrième réunion du Comité bilatéral stratégique algéro-malien, tenue à Alger les 14 et 15 juin 2014, les représentants du gouvernement malien ont donné leur accord pour qu’Alger poursuive ses entreprises de médiation au-delà de la phase exploratoire qui a conduit à l’élaboration de la plate-forme précitée. Dans le communiqué final de cette réunion, après que la partie algérienne présente les résultats positifs de ces démarches exploratoires, la partie malienne exprime « sa haute appréciation pour ces résultats, qui constituent une base effective et constructive pour le lancement rapide, à Alger, de la phase initiale du dialogue intermalien inclusif ». Les parties ont également invité leurs partenaires régionaux – le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso – et internationaux – principalement la MINUSMA et l’Union africaine – à soutenir la médiation algérienne. Ces partenaires s’y sont engagés lors d’une réunion à Alger tenue le 16 juin 2014.
Pour de nombreux observateurs, ces atermoiements dans l’organisation d’une médiation internationale, avec la relative marginalisation du Burkina Faso, n’ont pas contribué à amorcer le processus de réconciliation nationale malienne dans des délais aussi rapides qu’il eût été souhaitable au lendemain de la phase de combats de l’opération Serval. Mais le réalisme commande de laisser une place à l’Algérie dans ce dialogue, dont certains estiment que la capacité de nuisance serait grande si elle avait le sentiment d’être tenue « en dehors du jeu ».
Il est cependant à noter qu’après les événements survenus à Kidal en mai 2014, c’est le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, par ailleurs président de l’Union africaine, qui s’est rendu à Kidal pour y négocier un cessez-le feu entre les parties.
• La tentation de certains responsables maliens : trouver en Serval un bouc émissaire aux difficultés qu’ils rencontrent pour régler la question de Kidal
Lors de leur déplacement du mois de mars 2014, les rapporteurs ont pu constater que la situation sécuritaire à Kidal était déjà été évoquée avec vigueur par la plupart de leurs interlocuteurs maliens.
Ainsi, plusieurs parlementaires membres de la commission de la Défense nationale les avaient interpellés sur la question de savoir pourquoi la France cherchait – selon leurs analyses – à éviter que les Forces armées maliennes se déploient à Kidal. Ils faisaient valoir que tant que le détachement des FAMa resterait cantonné, l’administration malienne ne pourrait se déployer ni dans la ville ni dans sa région, empêchant de ce fait toute normalisation de la situation sécuritaire. Le président Karim Keita avait même indiqué que « le problème de Kidal est une pilule extrêmement difficile à avaler pour les Maliens », créant un profond « désenchantement » vis-à-vis de la France dans l’opinion publique. Il ajoutait que la population malienne aurait souhaité que la force Serval « aille jusqu’au bout » dans l’aide qu’elle a bien voulu apporter dans la lutte contre les groupes rebelles, en réduisant le MNLA comme elle a réduit le MUJAO et AQMI. Ils étaient unanimes à souhaiter que la France intervienne à Kidal, faisant valoir, dès le mois de mars 2014, que le MNLA et les groupes qui s’y rattachent avaient tendance à agréger les combattants des groupes rebelles défaits par la force Serval un an plus tôt, et que de ce fait, « la menace se renforçait de jour en jour ».
Si la suite des événements peut paraître donner rétrospectivement raison aux parlementaires maliens, il n’en demeure pas moins qu’au moment où les rapporteurs les rencontraient, plusieurs éléments plaidaient et plaident encore en faveur d’une approche prudente, au plan militaire, dans le traitement de la question de Kidal :
– la brigade Serval ne pouvait pas agir à Kidal comme elle l’avait fait à Sévaré : à Sévaré, le champ de bataille était un front, au sens classique du terme, tandis qu’à Kidal, il se serait agi d’une opération de contre-insurrection en milieu urbain, autrement complexe ;
– l’intervention française se place dans un cadre strictement défini par le droit international, établi en l’espèce par une résolution de l’ONU qui confie à la MINUSMA la mission d’aider les FAMa à maîtriser le territoire, Serval n’ayant plus à mener que des opérations « coup de poing » contre des terroristes ;
– dès lors que les Touaregs de Kidal sont de nationalité malienne, la question du statut de cette ville mérite d’être abordée en premier lieu dans le cadre d’un dialogue national malien, d’ailleurs engagé dès le 18 juin 2013 avec les accords de Ouagadougou, plutôt que par une intervention militaire étrangère ;
– le processus de cantonnement des membres du MNLA – préalable à leur désarmement –, que conduit la MINUSMA conformément à son mandat et aux accords de Ouagadougou, devait permettre de « faire le tri » entre, d’une part, les rebelles qui acceptent d’entrer dans une démarche de négociation avec le gouvernement malien et ne doivent pas en conséquence être traités en terroristes actifs et, d’autre part, ceux qui s’obstineraient à refuser le cantonnement, prenant de ce fait une posture hostile qui peut appeler une autre réponse ;
– la situation de Gao et de Tombouctou montre, comme le disait alors l’ambassadeur de France, que « les choses peuvent s’arranger », quand bien même la stabilisation puis la normalisation de la situation prendraient plus de temps à Kidal que dans d’autres villes du Nord ;
– par ailleurs, il y avait quelque chose de paradoxal à ce que les Maliens reprochent à la fois à la France d’avoir stationné dans Kidal pendant quelques mois et d’en avoir cédé le contrôle à la MINUSMA.
En outre, comme le chef d’état-major de la MINUSMA l’a reconnu devant les rapporteurs, le Nord du Mali est « tellement immense qu’il sera toujours impossible d’aller partout à la fois ».
En tout état de cause, il ressort des renseignements fournis aux rapporteurs que le cas de Kidal peut difficilement être abordé de la même façon que ceux de Tombouctou ou de Gao. En effet, la stabilisation de ces deux dernières villes a été accomplie au prix de mouvements de populations dans lesquels le degré de contrainte mériterait d’être étudié de façon approfondie : ceux que les Maliens appellent les « peaux claires » (Touaregs et Arabes) ont quitté ces zones, qui sont désormais très majoritairement occupées par des Sanghaï. De tels mouvements ne sont pas envisageables à Kidal, ville où les Touaregs sont nettement plus nombreux.
Les rapports entre la France, les Touaregs et les autres Maliens :
le poids de l’histoire
Appréhender la question touarègue dans le temps long incite également à la prudence.
Comme le général Jacques Norlain l’a noté devant les rapporteurs, l’opposition entre les Touaregs et les sédentaires est la survivance d’une histoire commune mouvementée, dans laquelle l’indépendance du pays n’a pas été l’occasion d’un examen de conscience mais plutôt une possibilité offerte à la majorité de régler des contentieux anciens – d’où un traitement inégal dans la répartition des ressources.
Les différents conflits ont été réglés par quelques combats, des postes accordés pour inclure chacun dans les circuits de redistribution, des intégrations dans l’armée, et tous autres moyens d’apaisement à court terme – et à court terme seulement.
« Ce qui est nouveau, c’est l’utilisation de ces tensions par les mouvements islamistes : la priorité est d’éviter que le Mali devienne leur refuge et qu’ils bénéficient du soutien d’une population où la fidélité tribale est une vertu ».
Il faut pourtant se souvenir que du temps de la colonisation, « les Touaregs ont toujours bénéficié d’une attitude très favorable de la France », ce dont témoigne par exemple le fait qu’en 1958, la France avait créé un poste de ministre du Sahara, autonome par rapport aux autres ministères, dont les compétences allaient de la Mauritanie au Tchad. Les Touaregs avaient été associés à ce projet, qui ne s’est jamais concrétisé en raison de l’opposition des responsables africains déjà investis de responsabilités par la mise en place de la loi-cadre de 1956 ouvrant la voie à la décolonisation de l’Afrique.
iv. La déconvenue des forces maliennes en mai 2014
• Une imprudente aventure de Bamako
Le mois de mai 2014 a été marqué par deux incidents majeurs dans la région de Kidal :
– le 17 mai, la visite à Kidal du premier ministre malien, M. Moussa Mara, a donné lieu à des manifestations qui ont dégénéré en affrontement armé et sanglant entre les FAMa et des groupes armés présents à Kidal, notamment le MNLA, le HCUA et le MAA. La confrontation tourne au désavantage des autorités de Bamako, et il faut l’intervention de la MINUSMA et d’éléments français pour imposer un cessez-le-feu ;
– le 21 mai, les FAMa tentent de reprendre le contrôle de la ville avec 1 500 à 2 000 hommes mais sont défaites par les groupes rebelles, qui lancent alors une contre-attaque et reprennent le contrôle d’un nombre important de localités du Nord du Mali.
Pour de nombreux observateurs, l’initiative des autorités maliennes découle d’une faute d’appréciation politique et militaire parfois qualifiée de « gravissime ». En effet, les FAMa ont perdu une large part de l’ascendant que leur formation par l’Union européenne leur avait permis de regagner, et ils ont perdu le contrôle de vastes zones du territoire.
Les informations dont disposent les rapporteurs ne leur permettent pas de se former un avis étayé sur les responsabilités respectives dans le déclenchement de cette aventureuse entreprise. Selon M. Nicolas de Rivière, directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, le président Keïta affirmerait ne pas avoir pris lui-même la décision de lancer cette opération. On notera d’ailleurs que le ministre malien de la Défense a présenté sa démission à l’issue de la défaite de ses forces.
Quoi qu’il en soit, il est certain que les autorités françaises ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali ont fortement déconseillé au Premier ministre malien de se rendre à Kidal, et ont renouvelé de façon appuyée leurs appels à la retenue après le 17 mai. Conformément à leurs mandats, Serval et la MINUSMA ont joué leur rôle sécuritaire dans tous ces événements, y compris pour évacuer le Premier ministre et récupérer les blessés ainsi que les militaires maliens prisonniers.
• « À quelque chose malheur est bon » : vers une reprise des négociations ?
Pour le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, la déconvenue des forces maliennes en mai 2014 pourrait, paradoxalement, relancer le processus de dialogue intermalien inclusif.
En effet, selon lui, depuis ces événements, le dialogue est devenu « un peu plus fluide » avec les autorités maliennes, qui pourraient renoncer à des postures trop nationalistes.
Surtout, la défaite des forces armées maliennes oblige Bamako à entrer dans un dialogue politique avec les groupes armés. Dès lors, pour les rapporteurs, la principale difficulté consiste à « mettre tout le monde autour de la table » dans des conditions qui soient à la fois transparentes – si possible davantage que les premières médiations entamées avant les événements du mois de mai – et de nature à donner confiance aux groupes rebelles.
En outre, ces événements pourraient utilement être pris en compte dans les travaux préalables au renouvellement du mandat de la MINUSMA, pour mettre l’accent sur la reconstruction de l’État dans le Nord et le lancement (attendu depuis longtemps) de projets de développement dans cette zone.
Le cas du Mali, avant même celui de la République centrafricaine, a montré à la fois l’intérêt et les limites de l’intervention de l’Union européenne, ce que les responsables politiques et militaires africains rencontrés par les rapporteurs n’ont jamais manqué de souligner.
i. Le Mali : un théâtre correspondant particulièrement bien aux savoir-faire et à la doctrine d’« approche globale » de l’Union européenne
Comme le montre un récent rapport d’information (9) sur l’Europe de la défense, « l’opération Serval est le type même d’opération que l’Union européenne ambitionne de pouvoir mener collectivement dans le cadre de la PSDC et une fois de plus, comme dans le précédent de la Libye, elle s’est avérée incapable de le faire ».
Surtout, comme le relevaient nos collègues Christophe Guilloteau et Philippe Nauche dans leur rapport précité sur l’opération Serval, « le traitement de la crise malienne, dont les causes sont à rechercher en partie dans les défaillances de la structure étatique et dans les nets écarts de développement d’une région à une autre, appelle des savoir-faire qui correspondent pleinement aux principes fondateurs de l’action de l’Union en matière extérieure ». Or, comme ils le soulignent, le Service européen d’action extérieure, chargé de la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), a développé « une doctrine d’action reposant essentiellement sur un concept d’« approche intégrée » – également appelée d’« approche globale » – consistant à piloter conjointement, pour une situation, une région ou une crise donnée, l’ensemble des moyens dont dispose l’Union au titre de ses différentes compétences : politique commerciale, actions de développement et de coopération, dispositifs humanitaires, action diplomatique, ou opérations militaires ». En outre, l’Union européenne avait déjà élaboré et commencé à mettre en œuvre « – certes laborieusement – une « stratégie pour la sécurité et le développement » dans la région du Sahel, dont l’objectif est de renforcer les capacités du Mali, de la Mauritanie et du Niger dans le cadre d’une coopération régionale approfondie ».
Pour les rapporteurs, l’intérêt d’une opération européenne, du point de vue de la France, est double :
– d’une part, l’étiquette « UE » confère à une opération une légitimité certaine, dans la mesure notamment où elle permet d’échapper à toute critique fondée sur les liens particuliers de la France avec l’Afrique (que ce soit sur le mode anti-néocolonial ou sur le mode de l’appel à la France au nom de « responsabilités » historiques supposées) ;
– d’autre part, lorsqu’une opération comme l’EUTM Mali est mise en œuvre sous l’impulsion de la France, voire sous son commandement, elle offre pour notre influence un appréciable effet de levier : ainsi, la France tire d’incontestables bénéfices d’avoir mobilisé l’Union européenne dans le cadre de l’opération EUTM Mali, tout en pouvant réduire sa participation à 70 hommes environ à compter de 2014.
ii. Les avancées réalisées par l’EUTM Mali
Le rapport précité de nos collègues Christophe Guilloteau et Philippe Nauche comportait une analyse détaillée des difficultés rencontrées dans le déploiement de l’opération de formation des forces armées maliennes lancées par l’Union européenne sous le nom d’EUTM Mali (European Union Training Mission), sur lesquelles il n’est pas utile de revenir ici.
L’entretien des rapporteurs avec l’état-major de la mission EUTM Mali à Bamako a permis de dresser un premier bilan de l’activité de cette mission, une fois surmontées ces difficultés initiales.
• Le format de la mission
Avec 570 personnels, la mission EUTM dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, même s’il reste 48 postes à pourvoir, ce qui marque la persistance d’un décalage entre le soutien affirmé des Européens à la mission EUTM Mali et leur engagement effectif. En outre, alors que son premier mandat prenait fin le 18 mai 2014, la mise en place d’institutions politiques investies d’une incontestable légitimité démocratique a « permis de s’inscrire dans la durée », en facilitant la prolongation de la mission, jusqu’en mai 2016, sans hiatus entre les deux mandats.
Selon les informations fournies sur place, le coût total de la mission atteint environ 80 millions d’euros pour le premier mandat, dont 30 millions ont été pris en charge par le mécanisme de financement Athéna au titre des coûts communs (infrastructures, transport aérien, etc.) ; sur ce dernier montant, environ 17 % sont à la charge de la France.
Pour l’état-major d’EUTM Mali, « la multinationalité est un atout ». Si les Européens ont d’abord été réticents à s’engager dans cette mission, 23 États membres y contribuent désormais, et plusieurs États tiers ont présenté des offres d’appui. Les quatre nations qui contribuent le plus à l’armement de la mission restent les mêmes : la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. Toutefois, avec le second mandat de la mission EUTM Mali, l’effectif allemand est appelé à passer de 60 à 100 personnels environ, ce qui permettra à la France de réduire sa contribution de 110 à 70 hommes. Quelle qu’en soit la lenteur, il y a donc une certaine prise de relais par les partenaires européens.
Selon les précisions fournies aux rapporteurs, les États contributeurs n’ont pas formulé de caveats – à l’exception de l’Italie, qui pourrait limiter l’activité de ses personnels aux activités d’entraînement sur le camp de Koulikoro. Mais il est à noter que toutes les décisions étant prises à l’unanimité, chaque État peut faire valoir ses intentions en amont de la mise en œuvre de la mission.
• Le bilan de son activité de formation
Les stages de formation durent dix semaines pour chaque GTIA pris en charge par la mission EUTM. L’état-major de cette mission reconnaît que « dix semaines, c’est peu », mais fait valoir que :
– la formation dispensée est intensive, avec un taux d’encadrement d’un instructeur pour trois stagiaires (sans compter les experts intervenant ponctuellement), ce ratio étant plus élevé que dans la plupart des écoles de formation militaire européennes ;
– c’est par un anglicisme mal à propos que l’on parle de « formation » des troupes : en théorie, les stagiaires maliens ont déjà reçu une formation initiale, l’enseignement délivré par l’EUTM Mali s’apparentant davantage à la notion française d’« entraînement ».
La doctrine enseignée est cohérente avec la doctrine malienne, elle-même issue de la doctrine française. À cet égard, l’état-major de la mission EUTM a fait valoir que le caractère multinational de la mission ne posait pas de problème de cohérence doctrinale, dans la mesure où, par un « effet de capitalisation d’expérience » dans le cadre des opérations de l’UE ou de l’OTAN, les armées européennes ont « presque toutes les mêmes standards ».
Le premier mandat aura permis de former quatre bataillons maliens. Si la sélection des candidats a été faite « dans l’urgence » pour le premier bataillon - celui actuellement en cours de « déconstruction » -, EUTM Mali est engagée dans « une dynamique de progrès dans la qualité de la formation dispensée ». Par respect de la souveraineté du Mali, la mission EUTM Mali s’en tient à une « sélection négative » des stagiaires : les candidatures sont présentées par le ministère malien de la Défense, et la mission EUTM Mali peut écarter certains candidats, soit à raison d’un niveau insuffisant, soit à raison d’antécédents de délits ou de crimes. Ainsi, la mission EUTM ne se fixe pas d’objectif particulier de brassage ethnique dans la composition des GTIA. En accord avec les autorités maliennes, et afin de constituer des unités aussi soudées que possible, les bataillons formés sont néanmoins recrutés de préférence sur une base régionale.
• Le bilan de son activité de conseil aux autorités maliennes
L’un des intérêts majeurs de la mission EUTM Mali tient à ce qu’elle ne se limite pas à des activités de formation des troupes maliennes : elle comporte aussi une « advisory task force » (ATF).
Selon les explications fournies aux rapporteurs à Bamako par l’état-major de la mission EUTM, cette ATF « fonctionne comme un cabinet de conseil » travaillant au profit du commandement malien. L’objectif poursuivi consiste à « éviter que les GTIA formés soient dilués ». Le cadre d’action de l’advisory task force a été résumé dans les termes suivants : « faire faire, sans laisser faire », cette volonté d’autonomisation de la partie malienne visant à « préparer la sortie de mission » sans perte de compétences pour les FAMa. L’advisory task force comprend 16 conseillers, tous francophones, dont trois Espagnols, un Roumain et un Britannique.
Cette advisory task force a ainsi pris le relais de l’équipe d’audit des FAMa déployées dès 2013, et poursuivi ses activités d’audit jusqu’à l’élection présidentielle. Après cette échéance, la nomination de M. Soumeylou Boubèye Maïga comme ministre de la Défense a « permis un changement de portage utile », soulignant l’« appui fort » et l’« engagement politique » dont a dès lors pu bénéficier le projet de réorganisation des FAMa. L’ATF a ensuite contribué à la rédaction du plan quinquennal d’action pour la réforme des FAMa et du projet de loi d’orientation militaire.
Les grands axes du futur format des FAMa qui en ressortent sont les suivants :
– une augmentation des effectifs des forces armées, qui pourraient compter 17 000 hommes (servant essentiellement dans l’armée de terre), répartis en 26 régiments (16 régiments d’infanterie, cinq de cavalerie et cinq d’artillerie) ;
– l’acquisition de moyens de projection (par exemple deux CASA) et de moyens d’appui air-sol.
• Les pistes d’améliorations possibles
Le mandat de la mission EUTM Mali ne permet pas aux personnels servant sous la bannière de l’Union européenne d’assurer, en quelque sorte, le « service après-vente » de l’entraînement qu’ils organisent.
Or il ressort des entretiens des rapporteurs avec les responsables militaires français, européens et maliens que les bataillons formés au sein de l’EUTM Mali ont un véritable besoin d’accompagnement sur le terrain. Pour l’heure, c’est donc à la France qu’il revient de placer auprès de chaque bataillon ainsi formé un détachement de liaison d’une vingtaine de personnels – comme elle le fait, d’ailleurs, avec les bataillons de la MINUSMA.
Pour davantage de cohérence et de suivi entre la formation et l’engagement sur le terrain, comme pour permettre à la force Serval de concentrer ses moyens sur les fonctions de lutte antiterroriste qui constituent désormais le cœur de son mandat, il serait utile que les forces européennes assurent elles-mêmes la transition entre le centre de formation et le théâtre d’engagement.
iii. Un bilan tout en contrastes de la formation des GTIA maliens avec la défaite des FAMa en mai 2014
Pour les rapporteurs, il serait aussi facile qu’injuste de mettre en doute la qualité de l’entraînement des forces maliennes par la mission EUTM Mali au vu de la défaite des FAMa en mai 2014.
En effet, lors de leurs entretiens à l’état-major de la mission EUTM Mali à Bamako, ils avaient pu recueillir des éléments d’évaluation du niveau tactique atteint par les forces formées. Si le bilan général de la formation était jugé globalement positif, plusieurs fragilités avaient d’ores et déjà été signalées aux rapporteurs :
– le premier bataillon pris en charge ayant été formé dans l’urgence, une « remise en condition » était jugée indispensable avant son renvoi dans le Nord ;
– les soldats maliens « partaient de loin » : l’entraînement ne faisait pas partie de la culture des FAMa ;
– si le niveau tactique des bataillons formés était jugé « comparable » à celui des autres armées africaines, leurs formateurs estimaient déjà au mois de mars qu’ils n’étaient « certainement pas prêts à entrer dans l’Amettetaï… » ;
– en outre, un effort restait à consentir en matière d’équipement et d’organisation, notamment pour ce qui concerne la logistique.
À la question de savoir quand les FAMa seraient autonomes, l’état-major de la mission EUTM Mali a répondu, avec prudence, que tout dépendait de la bonne mise en œuvre du projet quinquennal de réforme, notamment pour ce qui concerne les chaînes logistiques « sinon, les FAMa en reviendront à leurs errements antérieurs ». La formation dispensée par la mission européenne ne vise pas à les porter au même niveau que les soldats de la force Serval, mais plutôt à leur permettre de mener des missions de « contrôle de zones, en nénuphars, et de contrôle des voies de communication ».
c. Les inquiétantes difficultés rencontrées dans la montée en puissance de la MINUSMA
Les rapporteurs ont mis à profit leur déplacement à Bamako et à Gao pour étudier la montée en puissance de la MINUSMA, et les perspectives qu’elle offre pour le désengagement progressif de la force Serval.
i. Un mandat assez robuste, quoi que feignent d’en croire certains
Certains des interlocuteurs maliens des rapporteurs ont estimé que le mandat de la MINUSMA n’était pas suffisamment « robuste », en ce sens qu’il ne permettrait pas, selon eux, aux casques bleus de combattre effectivement les groupes armés rebelles.
Les observations faites sur place, confirmées par les explications fournies par le ministère des Affaires étrangères, conduisent les rapporteurs à réfuter cette idée : les difficultés de la MINUSMA ne tiennent pas à son mandat, mais à ses moyens. Ainsi, la direction générale des affaires politiques et de sécurité du Quai d’Orsay (DGP) estime qu’« à la lumière des récents événements de Kidal, notre analyse, qui rejoint celle de nos principaux partenaires au Conseil, est que la robustesse du mandat de la MINUSMA n’est pas en cause ».
En revanche, ces événements tendent à montrer que le déploiement de la mission vers le Nord et la posture des contingents mériteraient d’être renforcés. La DGP a indiqué aux rapporteurs que la France avait engagé des discussions en ce sens avec le Secrétariat général des Nations unies et les pays contributeurs de troupes, les travaux préparatoires au renouvellement du mandat de la MINUSMA constituant « l’occasion de passer ces messages ».
En tout état de cause, il faut rappeler que la MINUSMA est une opération de maintien de la paix, et non une force de guerre. Comme le note la DGP, « il faut garder à l’esprit que le mandat d’une opération comme la MINUSMA est multidimensionnel et repose sur deux piliers : sécuritaire et politique », auxquels contribuent les composantes militaire, policière et civile de la force. « Le succès d’une telle opération repose sur l’intégration de ces trois composantes » mais en l’espèce, « c’est sur le processus politique que l’effort doit porter ».
Comme l’a d’ailleurs résumé le chef d’état-major de l’armée de terre, « la mission première de la MINUSMA, c’est la stabilisation, pas l’engagement du combat vis-à-vis des adversaires dangereux ».
ii. Un déploiement largement facilité par la force Serval et la présence antérieure de la MISMA
L’essentiel des forces composant la MISMA a été intégré à la MINUSMA : ainsi, la MINUSMA pouvait « faire fonds » sur l’opération menée par l’Union africaine.
Le déploiement de la MISMA est également facilité par la présence au Mali de la force Serval. L’articulation de la MINUSMA et de Serval est définie de manière explicite dans le paragraphe 18 de la résolution 2100, dans lequel le Conseil de sécurité « autorise l’armée française dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, à user de tous moyens nécessaires, à partir du commencement des activités de la MINUSMA jusqu’à la fin du mandat autorisé par la présente résolution, d’intervenir en soutien d’éléments de la Mission en cas de danger grave et imminent à la demande du Secrétaire général ».
Selon la DGP, « l’ensemble des acteurs se félicite de cette articulation », dont les modalités pratiques ont été définies par un accord technique signé par le commandant de la composante militaire de la MINUSMA et l’état-major des armées. Des contacts réguliers et des échanges d’informations entre les deux chefs, le général Kazura et le général Foucault en facilitent la mise en œuvre.
Comme les rapporteurs ont pu l’observer, cette articulation se traduit sur le terrain par :
– la présence au sein de l’OMP d’officiers français à des postes choisis de l’état-major (opérations et renseignement) et notamment sur le poste clé de chef d’État-major en la personne du général Pillet, avec lequel les rapporteurs ont pu s’entretenir et qui sera prochainement relevé par le général Thiébault ;
– la présence dans chaque zone d’opérations de la MINUSMA de détachements de liaison et d’assistance opérationnelle (DLAO) sous commandement français, qui constituent les pivots de la coopération opérationnelle entre les bataillons de casques bleus et les unités de Serval.
iii. Une génération de forces assez décevante
Selon les données actualisées fournies aux rapporteurs par le ministère des Affaires étrangères, la MINUSMA compte aujourd’hui 8 300 militaires et un millier de policiers.
L’arrivée des contingents néerlandais et suédois a considérablement augmenté les capacités de la MINUSMA, notamment en matière d’aéromobilité (grâce aux hélicoptères d’attaque Apache, qui seront rejoints par des hélicoptères de transport Chinook en octobre) et en matière d’acquisition et d’analyse du renseignement ou encore de soutien sanitaire (hôpital de niveau II nigérian). À court terme (août, septembre ou octobre), la MINUSMA devrait recevoir :
– une unité d’hélicoptères de transport bangladeshis ;
– deux unités de protection ivoiriennes ;
– une unité néerlandaise d’hélicoptères de transport Chinook.
En dépit de ces nouveaux renforts, dont certains correspondent au déploiement de multiplicateurs de force importants, la MINUSMA ne devrait compter que 8 800 soldats jusqu’en octobre prochain et ne dépasser le seuil de 10 000 soldats déployés qu’en octobre ou novembre prochain, au mieux. De nouveaux retards ont en effet été enregistrés, dont les plus significatifs concernent :
– le bataillon burkinabé (850 soldats) et le bataillon de réserve guinéen (425 soldats), dont l’arrivée a été repoussée à octobre, sans garantie, notamment du fait des retards pris dans la livraison de véhicules financés par les États-Unis ;
– l’unité d’hélicoptères d’attaque salvadorienne, repoussée à décembre, sans garantie, du fait notamment d’un manque de pièces détachées, qui devaient être fournies par les États-Unis.
En outre, la génération de force de cette opération de maintien de la paix (OMP) a enregistré deux défections : celles du Nigeria, qui concentre ses moyens sur sa sécurité intérieure, et celle de la Mauritanie, pour des raisons qui, selon les explications fournies aux rapporteurs à Bamako, tiendraient à une dégradation des relations de ce pays avec le Mali.
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali, M. Albert Gerard Koenders, a jugé que « le contexte politique et sécuritaire général était globalement défavorable à la génération de force d’une opération de maintien de la paix », citant notamment les tensions financières que connaît le budget des Nations unies consacré aux OMP et la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord du Mali.
Pour la direction générale des affaires politiques et de sécurité, la génération de forces de la MINUSMA a connu « les difficultés inhérentes à la mise en place de toute opération de cette nature et de ce volume ». En effet, très peu d’armées ont les mêmes capacités de déploiement d’urgence que l’armée française, a fortiori parmi les contributeurs de troupes aux OMP : « les processus décisionnels sont plus longs et la préparation opérationnelle des unités nécessitent une période de mise à niveau ». Pour la DGP, au-delà de la génération de forces, « c’est surtout dans le domaine du soutien logistique que la MINUSMA a mis en lumière les faiblesses et les limites du découplage au sein du Siège entre le Département des opérations de maintien de la paix et celui de l’appui aux missions ».
iv. Un risque majeur : la « bunkerisation dans le luxe » (relatif)
Tant lors de leur déplacement au siège de la mission des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) qu’au quartier général de la MINUSMA, les rapporteurs ont eu le sentiment que n’était pas dépourvue de tout fondement la critique souvent faite à l’ONU par leurs interlocuteurs africains : les standards de l’ONU ne sont pas toujours adaptés aux réalités africaines.
Ces standards de l’ONU, techniquement exigeants, peuvent donner l’impression d’une « débauche de moyens » particulièrement surprenante dans des pays où les forces armées ont des moyens très contraints : « bunkerisation » dans des hôtels de luxe, parcs de véhicules pléthoriques au regard de l’emploi qui en est fait et des capacités locales, tendance des casques bleus à l’« hyper-protection », contraste saisissant entre le niveau de rémunération des casques bleus et celui des militaires locaux, moyens administratifs très importants (par exemple, l’ONUCI emploie 60 personnes au département « droits de l’homme »), etc. Le ministère des Affaires étrangères reconnaît que les standards opérationnels définis par l’ONU sont en effet « difficiles à atteindre par certains États contributeurs, notamment africains ». Ces derniers doivent souvent bénéficier du soutien de partenaires bilatéraux pour compléter leur formation, notamment en matière de droits de l’Homme, leur entraînement et leurs équipements.
Le ministère souligne que « ces standards constituent cependant une exigence de qualité et une garantie d’efficacité minimale et nous semblent tout à fait pertinents voire indispensables », jugeant qu’il serait « contre-productif voire dangereux de déployer sur le terrain des troupes mal formées, pas entraînées et qui ne seraient pas dotées du minimum de moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». La direction générale des affaires politiques et de sécurité souligne néanmoins que l’ONU a su (ou, peut-être, dû) se montrer ouverte à « une atteinte progressive de ces standards, comme ce fut le cas au Mali où les contingents de la MISMA ont pu bénéficier d’un « délai de grâce » ».
S’agissant en revanche du décalage souvent très perceptible entre les conditions de travail des services de l’ONU et ceux des administrations locales, la direction générale des affaires politiques et de sécurité déclare : « nous incitons les opérations à éviter qu’un contraste trop choquant ne devienne une contrainte majeure dans l’acceptation de la mission par l’État hôte ». Le cas de la MINUSMA, installée dans le seul hôtel de Bamako qu’il est possible de qualifier de luxueux, avait particulièrement frappé les rapporteurs ; pour la DGP, cette situation est « à cet égard éclairante ; il s’agissait dans un premier temps de pouvoir déployer l’OMP rapidement en s’appuyant sur les infrastructures existantes et les mieux adaptées, mais ce choix par défaut a eu des conséquences négatives en termes d’images ».
d. Une conséquence regrettable : un frein au désengagement des forces françaises
Les retards enregistrés dans le déploiement de la MINUSMA ont pour conséquence, au moins indirecte, que la France a dû retarder la réduction du volume de ses forces au Mali.
Dès le mois de mars 2014, il ressortait des entretiens des rapporteurs avec les responsables de la manœuvre logistique de désengagement partiel de la force Serval que la décroissance des effectifs était ralentie par l’absence de certaines capacités, notamment les capacités patrimoniales de transport. C’est ce qui a conduit la force à externaliser « de façon maîtrisée » une part du transport, dans la mesure où l’offre locale permettait de répondre à la demande. En effet, si les économies engendrées par cette opération sont réelles – avec un facteur de un à quatre, selon les logisticiens de Gao – et si les manœuvres de désengagement nécessitent un dispositif de sécurisation des convois plus léger que les manœuvres opérées dans les zones de tensions, il n’en demeure pas moins que l’offre malienne est limitée.
Surtout, après les événements survenus dans le Nord en mai 2014, qui ont vu le MNLA et d’autres groupes rebelles alliés prendre le contrôle de plusieurs localités du Nord, le désengagement de la force a été suspendu, et les effectifs présents à Gao ont même été renforcés par une centaine de personnels supplémentaires. Le ministre de la Défense s’en est d’ailleurs expliqué devant la commission (10). Ainsi, la force Serval est pour l’heure organisée comme le montre la carte ci-après.
LE DÉPLOIEMENT DE LA FORCE SERVAL AU MOIS DE MARS 2014
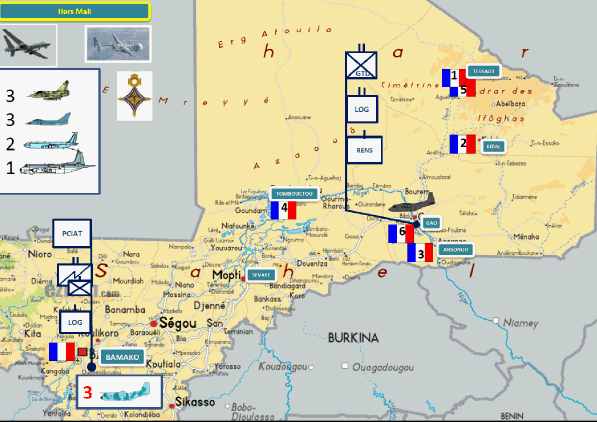
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Serval).
B. L’OPÉRATION SANGARIS EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : UNE OPÉRATION DES PLUS DÉLICATES
Les rapporteurs se sont rendus en République centrafricaine pour y rencontrer les autorités politiques et militaires françaises et centrafricaines à Bangui, ainsi que pour prendre la mesure, sur place, à Bambari, des difficultés de la mission confiée aux femmes et aux hommes de la force Sangaris.
1. La force Sangaris a fait au mieux avec les moyens qu’elle a en sa possession
Dans les grandes lignes, il ressort des entretiens conduits par les rapporteurs que :
– les ex-Séléka ont été globalement affaiblis par l’intervention française et la réaction des anti-balakas et désunis, en l’absence de chef, après les difficultés et finalement la démission de Michel Djotodia ; mais leur outil militaire demeure puissant dans le Nord-Est du pays ;
– les anti-balakas sont décrits par le général Francisco Soriano, qui commandait l’opération Sangaris au moment où les rapporteurs se sont déplacés en République centrafricaine, comme restant « des ennemis de la paix », qui se constituent en « pouvoir parallèle » et, par les pillages dont ils vivent, agissent en « fléau qui gangrène toute la société » ;
– la Lord’s Resistance Army (LRA), qui opérait dans l’extrême Est du pays, est avancée plus à l’ouest que les Français ne s’y attendaient.
a. Deux ennemis, peut-être sous-estimés ab initio : les « ex-Séléka » et les « anti-balaka »
i. Des ex-Séléka encore combatifs
• Un mouvement affaibli, sous le double effet de l’opération Sangaris et des milices anti-balaka, mais encore puissant dans ses bastions du Nord et de l’Est
Selon les renseignements fournis par l’état-major de la force Sangaris, on comptait au mois de mai 2 000 à 3 000 combattants de l’ex-Séléka, bien armés et aguerris. Au début du mois de janvier, le ministre avait déclaré à la commission que l’effectif des combattants Séléka s’établissait à 5 000 environ (11). La coalition ex-Séléka est donc globalement affaiblie depuis l’opération Sangaris et le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), mais repliée sur de solides positions dans l’Est de la République centrafricaine. Le ministre centrafricain de l’Administration territoriale a lui-même reconnu que de larges zones du centre et de l’Est du pays sont « aux mains » des ex-Séléka.
Le ministre centrafricain de la Défense a décrit aux rapporteurs les troupes de l’ex-Séléka dans les termes suivants :
– la plupart des soldats sont des gens « qui sont nés et ont grandi dans la guerre », et pour certains des enfants-soldats, parfois drogués ; « l’horreur est leur habitude » ;
– ils se réunissent moins autour des projets politiques de leurs dirigeants, que sur la base soit de logiques ethniques, soit d’une « économie de prédation » liée au sous-développement. C’est pourquoi, selon le ministre, la pauvreté du pays fait « qu’ils ne baisseront jamais tout à fait les armes » ;
– compte tenu de sa base ethnique, le mouvement de l’ex-Séléka est « un serpent à trois têtes » : une première au Soudan, une deuxième en République centrafricaine et une troisième au Tchad. De ce fait, les ex-Séléka pourront toujours trouver des zones de repli dans les pays voisins de la République centrafricaine, même si le Tchad les contient mieux.
• Un mouvement qui connaît une double évolution : fragmentation et radicalisation
Selon les analyses présentées aux rapporteurs, la coalition ex-Séléka est aujourd’hui « atomisée », c’est-à-dire divisée en une trentaine de groupes suivant deux lignes de clivages principales : l’origine ethnique et l’orientation politique. On distingue ainsi une trentaine de « généraux », agissant en véritables « seigneurs de guerre ».
Si certains acceptent de travailler avec le Gouvernement de transition, ce n’est pas le cas de tous. Ainsi, lors de la poussée du GTIA Scorpion vers l’Est du pays, notamment à Bambari – où se sont rendus les rapporteurs –, les trois principaux « seigneurs de guerre » se revendiquant du « label » ex-Séléka ont eu des attitudes différentes vis-à-vis des Français :
– le général Darasse (contrôlant la zone Ippy-Grimari-Bambari-Kouango) et le colonel Ousta (ancien militaire tenant un territoire dans la région de Bria) ont coopéré avec les Français, de façon attendue pour le premier, et moins attendue pour le second ;
– le général Damane (autre ancien militaire contrôlant lui aussi un territoire dans la région de Bria) a préféré se replier face à l’avance française.
Toutefois, selon le commandement de l’opération Sangaris, les postures individuelles de ces chefs de guerre restent à surveiller en permanence : soucieux de ne pas être marginalisés au sein de la coalition ex-Séléka et de composer avec certains éléments « radicaux » de leur entourage, certains d’entre eux – comme le général Darrasse – sont parfois tentés par des manœuvres de surenchère passant notamment par des attaques contre les éléments anti-balakas. Le Premier ministre a d’ailleurs attiré l’attention sur le fait que les ex-Séléka agissent de façon de plus en plus « professionnelle » : ils sont équipés de « dizaines de véhicules », ont pour la plupart conservé leur armement, et leurs actions s’apparentent désormais de plus en plus à des actes « classiques » de terrorisme (attaques à la grenade, éliminations ciblées).
Les ex-Séléka sont engagés sur la voie d’une unification incertaine. En mai 2014, au moment où les rapporteurs se trouvaient en République centrafricaine, s’est tenu à Ndélé un dénommé « congrès » des principaux cadres militaires et politiques du mouvement ex-Séléka qui avait notamment pour objet :
– d’unifier la représentation politique du mouvement ex-Séléka et de désigner un « état-major » ;
– de discuter des positions politiques de la coalition sur les questions d’une éventuelle partition de la République centrafricaine, sur la participation au processus de transition, ainsi que sur la posture « militaire » du mouvement.
Si, devant les rapporteurs, la présidente Samba-Panza elle-même a jugé « positif » que les ex-Séléka se réunissent, elle n’en a pas moins émis des doutes sur la capacité des chefs concernés à maîtriser leurs troupes. D’ailleurs, il ressort des informations fournies par le ministre de la Défense à la commission (12) que les éléments les plus radicaux et les plus partisans de la partition de la République centrafricaine semblaient avoir pris le dessus lors de ce congrès. En tout état de cause, la question est donc de savoir jusqu’à quel point l’« atomisation » de l’ex-Séléka est contrôlable.
ii. Des anti-balaka difficiles à contrôler
• Un mouvement complexe, en partie instrumentalisé
Le mouvement anti-balaka est, selon les analyses présentées aux rapporteurs, divisé en plusieurs tendances, dont certaines font l’objet de tentatives de « récupération » par les partisans du président déchu François Bozizé, par les anciens cadres des Forces armées centrafricaines (FACA), et par des groupes à vocation purement criminelle. Le général Francisco Soriano a ainsi présenté les différentes tendances structurant les mouvements anti-balakas en établissant la typologie suivante :
– une tendance « classique » constituée de villageois qui se sont armés plus ou moins spontanément pour lutter contre les exactions de la Séléka ;
– une tendance boziziste qui, comme le ministre de la Défense l’a estimé devant la commission, « mène une stratégie du chaos dans l’espoir d’obtenir la chute de la présidente Catherine Samba-Panza et de faire échouer la période de transition » (13) ;
– une tendance animée par les cadres des FACA et de la gendarmerie ;
– une tendance motivée essentiellement par le banditisme, pour laquelle l’étiquette « anti-balaka » n’est qu’un prétexte.
Les observateurs avec lesquels les rapporteurs se sont entretenus soulignent que le mouvement anti-balaka est encore peu représenté au sein des institutions de la transition :
– il compte un seul ministre au Gouvernement, et aucun député au Conseil national de transition ;
– il compte une seule figure marquante dans le paysage politique de Bangui : Patrice Édouard Ngaïssona, « coordonnateur politique » autoproclamé des anti-balakas, qui – quoi qu’interpellé en février 2014 – aurait une influence grandissante à Bangui. Cette influence était telle que, lors du déplacement des rapporteurs en République centrafricaine en mai 2014, l’idée circulait à Bangui que la présidente Samba-Panza pourrait être conduite à appeler M. Ngaïssona au Gouvernement, avec le leader ex-Séléka qui pourrait se dégager du congrès de Ndélé, à l’occasion d’un remaniement gouvernemental annoncé.
• Un mouvement difficile à contrôler, et qui tient une large partie du territoire
Les anti-balakas tiennent leurs positions les plus fortes dans l’Ouest du pays, où selon l’état-major de la force Sangaris, « rien ne peut se faire sans ce shadow government » qui jouit de fortes sympathies au sein de la population, des anciens des forces armées centrafricaines (FACA), des pouvoirs publics (mairies et préfectures) ainsi que de la gendarmerie.
Selon les informations fournies aux rapporteurs, certains éléments se revendiquant du mouvement anti-balaka tentent de progresser vers l’Est, en essayant notamment de se placer dans le sillage de la force Sangaris. Selon le général Francisco Soriano, le mouvement anti-balaka a ainsi été « importé » dans des zones de l’Est du pays où, avant la crise, cohabitaient chrétiens et musulmans. Il est toutefois à noter que selon le commandement du GTIA Savoie, la progression des Français vers l’Est n’a pas donné lieu à des soulèvements massifs de populations chrétiennes ou d’anti-balakas : tout au plus ceux-ci ont-ils essayé de déstabiliser Bambari, sans y parvenir – les Français les bloquant devant Grimari.
La frontière entre les zones d’influence respectives des anti-balakas et des ex-Séléka s’établissait, à la date de la visite des rapporteurs, dans la zone de Kaga-Bandoro / Sibut / Grimari. Sibut constitue un point de crispation particulier : la MINUSCA et le Gouvernement entendent y installer un campement de transit pour les ex-Séléka qui acceptent de participer au processus de désarmement-démobilisation-réinsertion (DDR), mais la population majoritairement chrétienne y est hostile. De plus, placée au carrefour de plusieurs voies de communication, Sibut pourrait constituer un objectif militaire intéressant pour les ex-Séléka, qui y affronteraient environ 300 anti-balakas.
b. Une mission dont l’action est limitée par ses faibles moyens
Les rapporteurs, lors de leurs déplacements à Bangui et à Bambari, ont pu étudier l’évolution du format de la force Sangaris et évaluer l’adéquation de ce format avec les besoins de la mission. Il apparaît que le volume et les perspectives d’évolution de cette opération extérieure ont dû être adaptés à une situation sécuritaire plus défavorable qu’on ne l’anticipait.
i. Un concept d’opération calibré a minima, pour une opération « coup de poing » ponctuelle
• Une opération calibrée a minima
Initialement, l’opération Sangaris a été conçue pour être brève et mobiliser peu de moyens, à l’image en quelque sorte de ce que l’on appelle communément les Light Footprint Operations.
Pour ce qui est de la durée de l’intervention, l’opération Sangaris devait être une opération brève. Ainsi, prononçant devant l’Assemblée nationale la déclaration du Gouvernement sur l’engagement des forces armées en République centrafricaine, M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, indiquait : « notre intervention sera rapide », soulignant qu’« elle n’a pas vocation à durer ». Il précisait alors que « le désengagement de nos forces commencera dès que la situation le permettra en fonction de l’évolution sur le terrain et de la montée en puissance des capacités opérationnelles des forces africaines », estimant expressément que « ce doit être l’affaire de quelques mois » (14).
Pour ce qui est du volume de l’intervention, la force Sangaris a été calibrée à un format initial de 1 600 hommes. Lors de son audition du 17 décembre 2013 devant la commission, audition commune avec la commission des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait déclaré : « ce sont désormais 1 600 soldats français qui sont engagés, et nous n’avons pas l’intention de dépasser ce nombre ».
Or, quelques semaines plus tard, cet effectif a dû être porté à 2 000, et les rapporteurs ont pu constater sur le terrain que les états-majors sont loin de planifier un retrait de l’opération Sangaris pour les semaines ou les mois à venir. Au contraire, les autorités centrafricaines, à commencer par la présidente Catherine Samba-Panza, ont également insisté, unanimement et vigoureusement, pour que le mandat de cette opération soit prolongé au moins jusqu’à l’élection présidentielle, dont la tenue est prévue (en théorie) en février 2015.
• Un déploiement rapide et efficace
Devant les rapporteurs, le général Francisco Soriano, alors commandant de l’opération Sangaris, a souligné l’« extrême rapidité » du déploiement de la force française, rendue possible par :
– la présence dans la région de moyens militaires français soit prépositionnés (notamment les Forces françaises au Gabon), soit projetés au titre d’opérations extérieures (notamment Épervier au Tchad et Serval au Mali) ;
– la réactivité du dispositif d’alerte Guépard ;
– l’arrivée rapide des moyens embarqués.
Le général Soriano a fait valoir qu’en outre, cette manœuvre logistique a été opérée sans pertes de matériels.
Plus largement, l’ensemble des interlocuteurs politiques et humanitaires des rapporteurs ont salué la rapidité de l’intervention française.
ii. En dépit d’un renfort, des moyens limités pour un territoire difficile à contrôler
• Un renfort décidé dès février 2014
La situation sécuritaire a conduit le Gouvernement à décider en février 2014 l’envoi d’un renfort de 400 hommes à la force Sangaris. Comme le chef d’état-major des armées l’a indiqué à la commission (15), il s’agit pour l’essentiel de forces combattantes, de moyens logistiques et de commandement et d’hélicoptères provenant des forces prépositionnées à Djibouti et au Tchad.
Le ministre de la Défense pour sa part a indiqué à la commission (16) que ce renfort visait à permettre l’organisation du dispositif Sangaris « en trois groupements tactiques : l’un se situe à Bangui, un autre contrôle l’axe logistique avec le Cameroun, le troisième se déploie à Ndélé au Nord et, à Bambari et Bria, à l’Est, où nous sommes depuis peu de temps ». En effet, « porter l’effectif à 2 000 hommes nous permet de mener de front ces trois missions malgré les élongations logistiques – 850 kilomètres séparent les points les plus éloignés de la présence française en RCA – et le début de la saison de pluies ».
• Des moyens qui restent très limités au regard de la géographie spécifique du théâtre
Les rapporteurs ont pu constater lors de leur déplacement en République centrafricaine que si le format de la force Sangaris, relevé à 2 000 personnels, permettait effectivement de mener simultanément les trois missions présentées par le ministre, il n’en demeure pas moins que les moyens restent, au mieux, à la limite de la stricte suffisance pour accomplir les missions qui sont assignées dans les difficiles conditions géographiques du théâtre.
1./ Des moyens trop faibles pour ne pas être dispersés
Ainsi, à titre d’exemple, pour sécuriser le principal axe routier d’approvisionnement de Bangui (et d’une large partie du pays) – dit MSR, Main Supply Road – par le port de Douala, au Cameroun, le GTIA Savoie ne dispose que d’une compagnie, « étirée » sur 450 kilomètres, comme le montre la carte ci-après.
LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION DE L’AXE ROUTIER VITAL POUR L’APPROVISIONNEMENT DE BANGUI
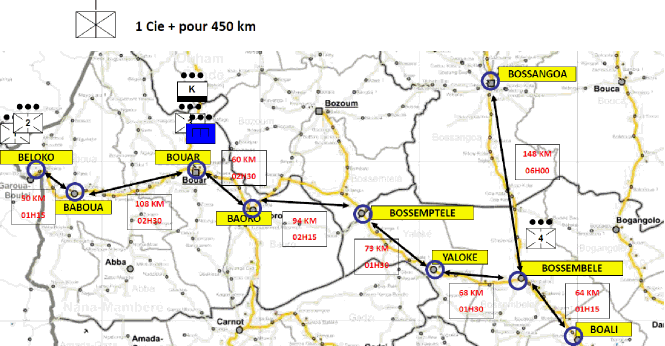
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
De même, lors de leur déplacement à Bambari au poste de commandement des éléments du GTIA Scorpion chargés de tenir les zones de déploiement des forces françaises dans l’Est du pays, entre Sibut et Bria – zones de tension entre anti-balakas et ex-Séléka, mais aussi entre nomades et sédentaires –, les rapporteurs ont pu constater que les mêmes phénomènes d’« étirement » extrême des forces françaises.
En effet, celles-ci sont réparties sur trois points d’appui principaux, avec des effectifs très réduits : 100 personnels à Bambari, 40 à Bria et 100 à Grimari. La difficulté principale tient à l’absence de voies de communication aisément praticables : il faut deux jours de convoi routier pour atteindre la zone depuis Bangui, 15 heures pour parcourir les 220 kilomètres qui séparent Sibut de Bambari, et sept à neuf heures pour aller de Bambari à Bria, qui n’en est pourtant distante que de 180 kilomètres. Les militaires français rencontrés sur place par les rapporteurs décrivent ainsi leurs déplacements comme de « véritables odyssées », et soulignent qu’avec la saison des pluies, les pistes seront quasiment impraticables. Les unités seront alors dans une situation qu’ils qualifient d’« archipellaire ».
Ces faibles effectifs disséminés dans un environnement aussi complexe contraignent largement les modes d’action de la force Sangaris, qui fait porter son effort sur les quatre axes suivants :
– une concentration de l’effort sur les zones de Sibut et de Bria, au prix d’une réduction de l’effort au centre de la zone ;
– des patrouilles nomades en véhicule (avec sept jours d’autonomie) ou à pied, visant à rayonner suivant la « logique aléatoire de la nomadisation » pour laisser l’ennemi dans l’incertitude. Pour pallier les faibles effectifs de forces terrestres disponibles, la force utilise au maximum les cinq hélicoptères de manœuvre disponibles, l’un d’entre eux étant toutefois réservé aux missions d’évacuation sanitaire. Toutefois, ces capacités disponibles en hélicoptères de manœuvre sont jugées « un peu courtes » au regard de l’étendue de la zone à couvrir ;
– des actions de dialogue, de conseil et d’appui aux autorités civiles, ainsi que de pression sur les chefs Sélékas en vue de l’application des « mesures de confiance » (cf. infra). Cette recherche d’« équilibre entre logique de force et logique d’influence » se heurte cependant, parfois, à la faible implication des autorités civiles locales. Ainsi, il a été indiqué aux rapporteurs que l’un des préfets de la zone, à l’arrivée des forces françaises, avait refusé de s’habiller pendant trois jours pour marquer son intention de ne pas exercer ses fonctions et de se faire évacuer vers Bangui… D’autres actions de type KLE (Key Leader Engagement) rencontrent plus de succès : des réunions sont ainsi organisées au moins quatre fois par semaine avec des personnes identifiées comme des relais d’opinion, afin de faire passer des messages à la population ;
– des chantiers de réhabilitation et d’intégration locale (CRIL), consistant à fournir à la population, notamment aux jeunes, des activités d’insertion à l’occasion desquelles ils peuvent recevoir une formation civique et technique de base (dans des domaines aussi variés que l’histoire, les institutions, le secourisme, la mécanique, etc. en fonction des compétences disponibles). Ces actions permettent de détourner les jeunes des bandes armées, en attendant qu’un processus de DDR plus structuré puisse être mis en place.
De même, les éléments français déployés dans la ville de Bangui, dont ils tiennent les quartiers où l’insécurité est la plus forte (le point kilométrique 12 – dit « PK 12 » – et le 3e arrondissement) ont fait valoir aux rapporteurs que les effectifs limités des forces françaises faisaient peser sur leurs manœuvres plusieurs contraintes :
– une articulation des SGTIA « changeante, sur très court préavis » ;
– une certaine difficulté à concentrer les efforts ;
– une difficulté à « concevoir une manœuvre des effets dans la durée ».
2./ Un déploiement prudent et encore incomplet à la veille de la saison des pluies
Devant les rapporteurs, le général Francisco Soriano a insisté sur le fait que le déploiement de la force Sangaris suivait le calendrier prévu, et que la concentration de son action dans la capitale jusqu’en mars était conforme aux plans, et non due à de quelconques retards. Le plan consistait alors à faire effort sur Bangui afin d’assurer la montée en puissance de la force, le désarmement des ex-Séléka et des anti-balakas, le cantonnement des ex-Séléka, de sécuriser la transition politique après l’élection de Catherine Samba-Panza, puis d’accompagner la montée en puissance des contingents Burundais et Rwandais de la MISCA.
D’ailleurs, dès que la situation sécuritaire s’est améliorée à Bangui, et que la « pleine capacité opérationnelle » de la MISCA y a été validée le 28 février, la force Sangaris s’est projetée en province. Selon les explications du général Francisco Soriano, l’effort a porté :
– en priorité à l’ouest, afin, d’une part, de rétablir la libre circulation sur l’axe routier vital à l’approvisionnement de la capitale (la MSR) et, d’autre part, s’interposer rapidement entre les anti-balakas et les ex-Séléka, en attendant d’être relevés par des contingents de la MISCA à Berberati, Carnot et Nola ;
– puis à l’est, pour contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État et éviter la partition du pays. Dans cette optique, les deux points clés à occuper étaient Bria et Ndélé.
Ainsi, comme l’a fait valoir le général Francisco Soriano, la force s’est même déployée plus loin de Bangui que ne le prévoyaient les plans initiaux, et ce afin d’occuper des positions clés pour éviter le risque de partition de la République centrafricaine.
Selon le commandement du GTIA Scorpion a fait le choix de marcher directement et aussi rapidement que possible de Bangui à Bria, du 28 mars au 7 avril, au prix d’un effort très conséquent mais en vue de « faire comprendre à l’ennemi la détermination de Sangaris ». Cette manœuvre a permis à chaque fois d’encercler rapidement les localités à contrôler, et après quelques accrochages le cas échéant, d’y entrer sans grandes difficultés.
La carte ci-après présente l’état du déploiement en province de la force Sangaris en mai 2014, à la date du déplacement des rapporteurs en République centrafricaine. Or cette période correspond précisément au début de la saison des pluies, qui rend toute avancée extrêmement compliquée, figeant ainsi les positions pour plusieurs mois. Il apparaît clairement que de vastes zones du Nord et de l’Est restaient encore à parcourir. Lors de son audition du 16 avril 2014 devant la commission, le ministre de la Défense avait présenté comme un « défi » la poursuite rapide du déploiement de Sangaris et de la MISCA sur le territoire centrafricain « avant la saison des pluies », afin que la présence physique des forces internationales « dans la majeure partie du pays » soit un « facteur de dissuasion pour les ex-Séléka qui ont la tentation de provoquer la partition du pays ».
DÉPLOIEMENT DE LA FORCE SANGARIS EN MAI 2014
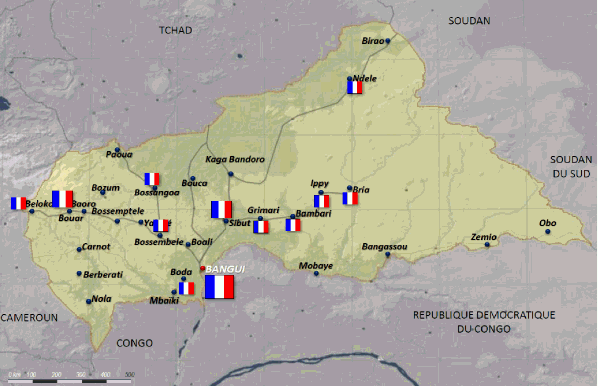
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
iii. Des contraintes liées indirectement au mode de financement des opérations extérieures
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de terre a souligné une contrainte nouvelle dans la conduite des opérations extérieures : « les mêmes responsables qui ont la charge de conduire les opérations (la « chaîne ops » de l’EMA) sont aussi responsables du surcoût des OPEX ». Ils sont donc dans une situation où ils doivent rendre compte à la fois de la bonne marche des opérations et de tout « dépassement des enveloppes », d’où une « pression budgétaire continue ».
Dès lors, chaque fois que les chefs d’état-major d’armée proposent un renforcement capacitaire, on leur demande de le « gager » par une diminution de même volume. Il y a donc de « fortes réticences à déployer de nouveaux moyens en cours d’opération ». Il peut ainsi être vu comme regrettable que « la contrainte économique descende à un tel niveau de détail : on parle de quelques milliers d’euros, alors que le surcoût lié aux opérations extérieures s’établit autour d’un milliard d’euros ».
Par ailleurs, l’état-major de l’armée de terre a précisé aux rapporteurs que le choix d’armer une force telle que Sangaris en priorité par des unités prépositionnées, plutôt que par des unités stationnées en métropole au jour du déclenchement de l’opération, pouvait aussi s’expliquer par un souci de gestion économe du budget opérationnel de programme (BOP) « opérations extérieures ». En effet, les personnels projetés en prépositionnements perçoivent quoiqu’il arrive des indemnités au titre de leur projection, indemnités que l’on évite ainsi de verser de façon redondante à des unités qui auraient été projetées depuis la métropole.
c. L’instrumentalisation confessionnelle du conflit : un épineux facteur de complication
L’ensemble des interlocuteurs des rapporteurs a insisté sur le fait que le conflit centrafricain n’avait pas, à l’origine, une dimension confessionnelle : on compte des chrétiens parmi les ex-Sélékas, et ceux-ci sont d’ailleurs les plus réticents à participer au processus de désarmement-démobilisation-réinsertion (DDR) mis en œuvre par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Centrafrique (MINUSCA) avec le Gouvernement, craignant d’être désormais assimilés à des traîtres par les autres chrétiens.
d. Un résultat sécuritaire contrasté
Le déplacement en République centrafricaine, tant à Bangui et dans ses faubourgs qu’à Bambari, a aussi permis de faire le point sur la situation sécuritaire dans le pays. La présidente Catherine Samba-Panza, chef de l’État de la transition, a estimé que la situation sécuritaire était fortement contrastée entre :
– Bangui, où elle tend à s’améliorer (sans en être pour autant au stade de la normalisation) ;
– la province, où l’on observe « un regain de violence », qu’elle attribue pour partie aux rivalités entre les différents groupes rebelles et, pour une autre partie, aux difficultés économiques qui créent les conditions d’une sorte d’« économie de prédation ».
i. Bangui est pacifiée, et relève désormais d’une opération de gendarmerie plutôt que d’une opération militaire
• Sangaris et la MISCA ont très nettement amélioré la situation sécuritaire à Bangui
Tous les interlocuteurs des rapporteurs s’accordent à saluer l’efficacité de l’action de la force Sangaris et de la MISCA dans la pacification de Bangui. Les rapporteurs eux-mêmes, qui s’y étaient rendus une première fois en février et une seconde en mai 2014, ont constaté que l’amélioration était perceptible. L’idée générale exprimée par les différents interlocuteurs sur le premier bilan de l’opération Sangaris est le suivant : l’intervention française a mis un terme au massacre des musulmans, mais n’a pas suffi à éviter leur exode.
1./ Une situation sécuritaire apaisée
L’intervention française a notamment permis de rétablir une situation sécuritaire viable à Bangui. Comme l’a expliqué le général Francisco Soriano, la sécurité de la ville est assurée conjointement par les contingents burundais et rwandais de la MISCA, la mission européenne EUFOR RCA et les forces françaises. Celles-ci ont concentré leur action sur les trois points les plus stratégiques de la ville :
– le 3e arrondissement, poumon économique de la ville partagé entre musulmans et chrétiens, qui est désormais une enclave musulmane entourée d’un « no man’s land » ;
– le 5e arrondissement, qui est proche de l’aéroport M’Poko et où les musulmans ont tendance à se concentrer, Sangaris ayant été relayée par la mission EUFOR RCA pour la garde de l’aéroport ;
– le point kilométrique 12 (PK12), principal point d’entrée dans la ville.
Non seulement le nombre d’actes de violence dans Bangui est très nettement orienté à la baisse depuis le déclenchement de l’opération Serval – avec un pic aux alentours du 10 janvier 2014, lors de la démission de Michel Djotodia –, mais mieux encore, comme le montrent les graphiques ci-après, de nombreux indicateurs montrent que le retour à la vie normale est engagé.
SIGNES DE « RETOUR À LA NORMALE » DE LA VIE DANS BANGUI
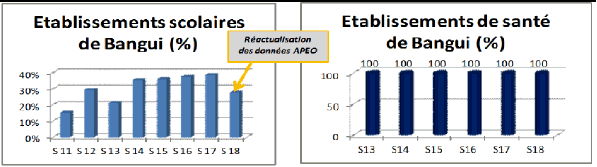
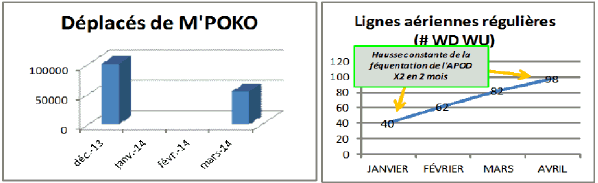
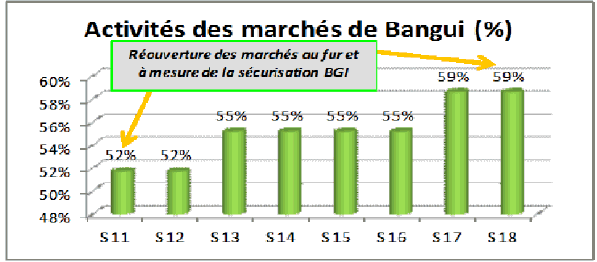
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
L’exode des populations musulmanes de Bangui, traditionnellement très actives dans le commerce de gros, ainsi que les difficultés de circulation sur la MSR, pouvait faire craindre une situation de pénurie alimentaire. L’évolution des prix des denrées montre que ceux-ci, après un pic aux alentours du mois de mars, sont désormais stabilisés, comme l’indique le graphique ci-après.
LE PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES À BANGUI
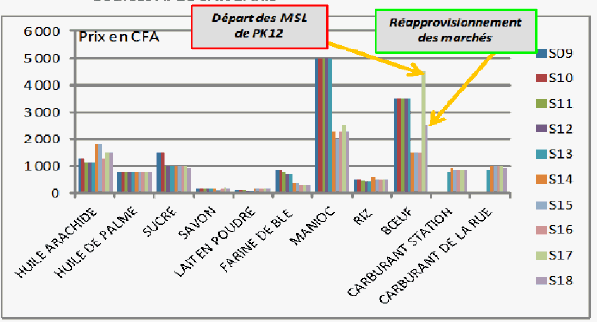
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
Pour aller plus loin dans le rétablissement d’une situation sécuritaire normalisée à Bangui, la force Sangaris mène différents types d’actions :
– des opérations de contrôle sur les zones de fracture entre quartiers chrétiens et musulmans, où les rapporteurs ont pu se rendre ;
– des opérations « pilotes » visant à inciter les musulmans à quitter les camps de déplacés (comme celui de l’aéroport M’Poko) pour retourner dans leurs quartiers. Ainsi, un « site pilote » d’hébergement de nuit est sécurisé par Sangaris et la MISCA dans un quartier dont les habitants avaient eu tendance à se réfugier dans ces camps. Partant du constat que l’insécurité sévissait surtout la nuit, et conduisait les civils à passer la nuit dans le camp de réfugiés installé à proximité de l’aéroport, les forces françaises, en lien avec les autorités centrafricaines et l’ONG ACTED, ont fait le choix de sécuriser en ville un site d’accueil de nuit (clos, ouvert sur inscription et gardé par des militaires), tout en visant à ne pas y « fidéliser » excessivement ses occupants (ils doivent quitter le centre d’accueil à 7 heures du matin, bénéficient de conditions sanitaires qui ne sont pas excessivement attractives, et n’ont pas le droit d’utiliser leurs effets personnels).
• La situation sécuritaire à Bangui appelle néanmoins à la vigilance
Le premier point de vigilance souligné devant les rapporteurs tient à la partition religieuse de fait qui semble s’installer dans la ville de Bangui. En effet, les informations recueillies sur place, y compris au sein de la population sur les marchés montrent que les tensions restent vives entre chrétiens et musulmans. Surtout, malgré l’exode de ces derniers – exode plus ou moins « encadré » par les forces tchadiennes –, une sorte d’« enclave » musulmane se constitue dans le 3e arrondissement de Bangui, ceint d’un « no man’s land » où les affrontements, certes sporadiques, sont encore fréquents. La carte ci-après présente cette partition religieuse de fait.
LA PARTITION RELIGIEUSE DE BANGUI, AVEC SON « ENCLAVE » MUSULMANE
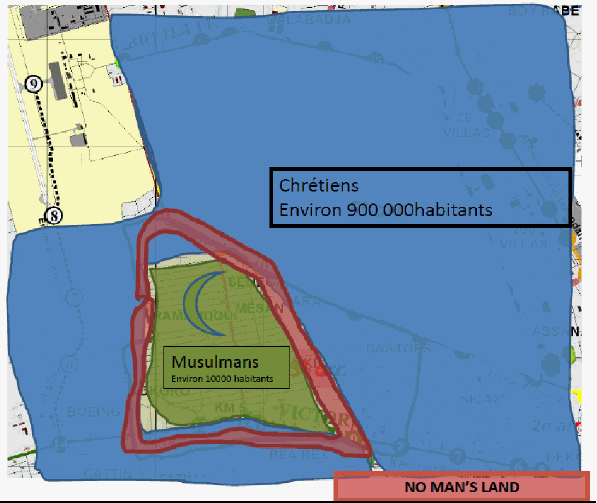
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
Les militaires français chargés de la sécurisation du 3e arrondissement de Bangui ont décrit la situation aux rapporteurs dans les termes suivants :
La situation sécuritaire à Bangui
Pendant les événements de décembre 2013, les anti-balaka (AB), de confession chrétienne mais souvent d’inspiration animiste, en réaction aux exactions commises par les ex-Seleka de l’ère Djotodjia sont entrés dans une logique de vengeance. Ils s’en sont pris aux personnes de confession musulmane et à leurs biens (nombreux magasins détruits, maisons brûlées, mosquées en ruine, etc.) à travers tout Bangui, et dans le 5e arrondissement plus particulièrement.
La population musulmane a alors déserté cet arrondissement (quartier Miskine notamment) pour aller se regrouper et se défendre dans le 3e arrondissement ou se réfugier dans le camp au nord de l’aéroport évacué le mois dernier par la MISCA.
Depuis, même si un calme relatif s’est installé dans Bangui, les tensions restent vives entre chrétiens et musulmans. Régulièrement, les uns et les autres mènent des raids furtifs sur l’autre communauté et s’accusent mutuellement d’être à l’origine des attaques !
Dans le but de rétablir les liens préexistants entre les deux communautés et sur la demande des protagonistes eux-mêmes, des opérations de sécurisation ou d’escorte ont été conduites. L’opération TAXI destinée à faire circuler librement les biens et les personnes sur l’avenue Boganda de PK0 au rond-point de la colombe en passant par le fameux marché de PK5 en est un bel exemple.
Après que certains habitants du 3e arrondissement ont voulu dans un premier temps quitter Bangui pour rejoindre le Nord et l’Est du pays, ils ont brutalement changé d’avis il y a trois semaines.
Alors qu’ils étaient sur un mode plutôt défensif jusqu’à ce moment, cette sédentarisation s’est accompagnée d’une attitude plus agressive de leur part. Depuis ce changement, ils sont même les principaux auteurs des attaques contre les quartiers chrétiens périphériques.
Dans le même temps, les anti-balakas ou les « Godobe » se retournent progressivement contre la population. Ils commettent exactions et pillages et font régner leurs propres lois, se substituant aux forces de l’ordre inefficaces et à une justice exsangue et quasi inexistante. Ils ont clairement pris la place des forces de sécurité, absentes depuis cinq mois. Une timide tentative de restauration de l’ordre public s’amorce de façon probante depuis l’arrivée du détachement de gendarmerie français dans le cadre de l’EUFOR-RCA.
En parallèle, les efforts de l’état pour reconstruire sa souveraineté, particulièrement dans le domaine judiciaire, doivent maintenant se traduire concrètement sur le terrain par l’application du triptyque arrestation- jugement-incarcération.
Un point positif est la réouverture des écoles (sauf dans le 3e arrondissement partie musulmane) avec cependant deux à trois mois d’arriérés de salaire pour les professeurs.
En conclusion :
● De l’explosion à la normalisation : après les luttes intenses multiconfessionnelles au début de l’action de la force l’équilibre s’est dessiné autour de la partie musulmane du 3e arrondissement et aujourd’hui les menaces d’un affrontement intercommunautaire majeur s’éloignent progressivement. Pour autant les tensions restent vives autour de ce quartier et la vigilance est de mise.
● Une demande forte de sécurité : la préoccupation de la population au-delà de l’aspect économique est d’échapper aux luttes intracommunautaires (guerres des chefs anti-balakas) et surtout de ne plus supporter le poids des prédations permanentes d’organisations multiples qui tendent de plus en plus vers le banditisme. La corruption d’État est de moins en moins acceptée, même si le traditionnel pot-de-vin reste institutionnalisé et accepté tant qu’il reste raisonnable.
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
Les cartes et schémas ci-après présentent le bilan fait par les forces françaises de l’évolution de l’autre point stratégique de Bangui qu’elles sont chargées de tenir : PK 12.
LA SITUATION AU PK 12
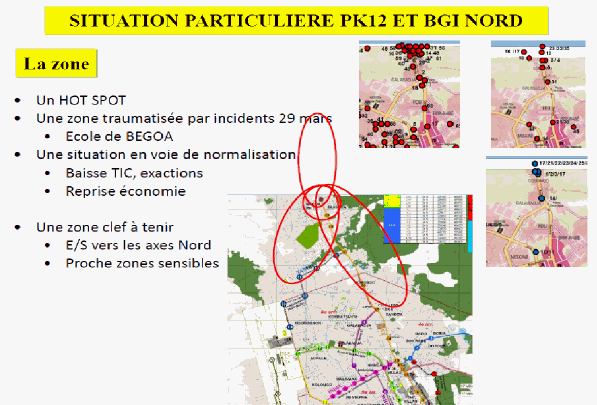
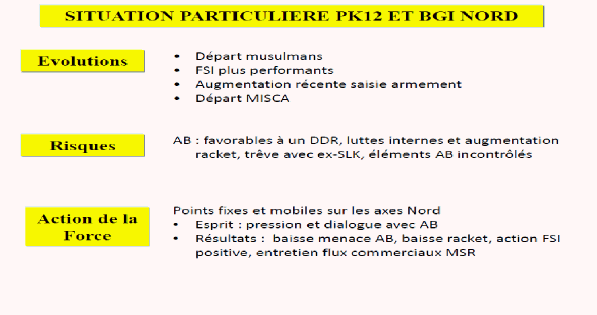
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
• La question du choix des moyens à employer pour le maintien de l’ordre dans Bangui peut désormais être posée
La pacification de la ville de Bangui marque pour la force Sangaris le passage d’une « séquence militaire » à une « séquence sécuritaire ». Dès lors peut se poser la question de savoir quel type d’unités est le mieux à même d’assurer l’ordre dans la ville.
Les rapporteurs ont noté que les Français avaient tendance à privilégier une approche prudente, mettant l’accent sur un haut niveau de blindage et de protection des éléments déployés.
Certains observateurs, comme le général Jacques Norlain, estiment au contraire que des moyens légers de patrouille seraient plus adaptés, la surprotection pouvant même s’avérer contre-productive : « en faisant cela, on fait monter la pression, et le soldat donne l’impression qu’il a peur, ce qui produit un effet désastreux sur les ennemis ». Ainsi, selon lui, « ce déséquilibre, cette surprotection, nous dessert en réalité ».
À la question de savoir si une approche plus légère (patrouilles à pied, moins de blindés, avec une composante gendarmerie plus étoffée) ne serait pas plus adaptée aux enjeux de sécurité à Bangui, l’état-major de l’armée de terre fait valoir que les risques d’accrochage justifient un certain niveau de protection : « la mise sous blindage des unités a été recherchée dès les premiers mois de l’engagement à cause de la permanence des tirs adverses lors des déplacements dans la capitale ». Rappelant que « deux soldats français ont été tués dans un accrochage lors d’une patrouille à pied menée le 9 décembre à quelques centaines de mètres de l’aéroport de Bangui » et que « les combats des 28 et 29 mai nous rappellent que la menace est toujours réelle », l’état-major de l’armée de terre souligne ainsi que « la question de l’allégement des patrouilles met donc dans la balance l’acceptabilité du risque de perte de nos soldats », estimant que « cette décision doit rester celle du chef tactique ». Il précise par ailleurs que « notre gendarmerie nationale n’est ni entraînée ni équipée pour faire face à une situation sécuritaire telle que celle de la République centrafricaine aujourd’hui, où l’on se bat à l’arme automatique et à l’arme lourde avec des volumes de combattants importants et organisés en bandes paramilitaires ». L’état-major des armées fait en effet valoir que la posture des groupes armés évolue : ceux-ci sont de plus en plus structurés, et de plus en plus lourdement armés, ce qui justifie le maintien d’une force armée pour assurer le maintien de l’ordre à Bangui.
En tout état de cause, il semble aux rapporteurs que la recherche d’une mixité des patrouilles entre la gendarmerie et les éléments d’infanterie est très appréciée sur le terrain. En effet, le détachement de 55 gendarmes français qu’ils ont pu rencontrer à Bangui fait un bilan très positif de son action aux côtés des forces armées. Bien acceptée par la population et jouissant d’une appréciable aura auprès de son homologue centrafricaine, la gendarmerie contribue ainsi, par sa présence auprès des autres militaires, à maintenir la sécurité tout en abaissant le niveau de tension ressenti.
ii. La province échappe encore largement au contrôle de l’État
• La principale route d’approvisionnement est à peu près sécurisée
Le général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, a souligné que la route reliant Bangui au port camerounais de Douala – la MSR – est aujourd’hui considérée comme à peu près sécurisée : elle est empruntée par 500 camions par semaine, contre à peine 150 lors du déclenchement de l’opération Sangaris. Selon les précisions fournies aux rapporteurs, les convois escortés ne sont désormais plus le seul mode possible de circulation sur cet axe vital.
Le graphique ci-après montre d’ailleurs une reprise du trafic sur cette voie.
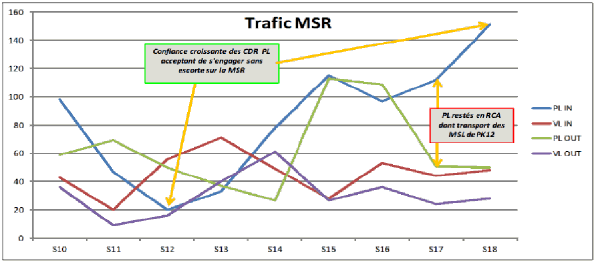
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
• Le reste du pays reste largement incontrôlé, et la saison des pluies risque de figer les positions
Selon les informations recueillies sur place par les rapporteurs, les anti-balakas dans certaines zones, les ex-Séléka dans d’autres, détiennent encore une autorité largement supérieure à celle de l’État, notamment dans les localités où ne stationnent ni détachement français, ni détachement de la MISCA.
Or, 2 000 Français et 6 000 Africains constituent un effectif trop limité pour pouvoir constituer un maillage sécuritaire dense sur un territoire grand comme la France et la Belgique réunies, tant que l’État ne redéploie pas ses administrations sur son territoire.
Dans l’attente du retour effectif d’une structure étatique crédible en matière de sécurité intérieure et/ou d’une opération de maintien de la paix robuste, les forces de Sangaris, avec l’appui de celles de la MISCA, ne peuvent guère mener que deux types d’action :
– contrôler les principaux points d’appui des groupes armés. À cet égard, Bria présente un intérêt stratégique : comme l’a expliqué le général Francisco Soriano, l’exploitation des ressources diamantifères, même sur un mode « artisanal », est effectuée depuis plusieurs années, à 80 % hors de tout cadre légal, et constitue ainsi une source de revenus considérable pour l’ex-Séléka ;
– « faire du pré-DDR » (selon les termes du général Francisco Soriano), principalement en imposant les « mesures de confiance » destinées à pacifier la situation dans l’attente du déploiement d’une opération de maintien de la paix, comme l’explique l’encadré ci-après.
Les « mesures de confiance »
1./ Caractéristiques :
- elles sous tendent les opérations de la force Sangaris conduites depuis le 9 décembre (ultimatum), en cours et à venir
- elles comprennent quatre volets : identification, désarmement, cantonnement et comportement
- elles garantissent en principe la liberté de mouvement des forces internationales
- elles établissent une interdiction générale de circuler armé
- elles favorisent le déploiement des forces internationales
2./ Application :
- bonne volonté initiale de l’autorité de transition
- selon le général Francisco Soriano, le comportement des acteurs n’est « ni hostile ni inamical envers la force » Sangaris, et « même s’il reste 2 500 ex-Séléka à Bangui, aucun ne circule avec armes », et il en va de même pour les 400 ex-Séléka présents à Bria
- contournements constatés
3./ intérêts :
- elles sont l’outil d’une « prise d’ascendant » de la force Sangaris sur les groupes armés
- elles constituent « l’acte fondateur d’un processus de DDR »
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
En effet, la mise en place d’un processus de DDR ne fait pas partie des missions de la force Sangaris, mais les bons offices du commandement de celle-ci ont été déterminants pour la conclusion le 22 avril d’un mémorandum d’entente entre la présidente Catherine Samba-Panza et les ex-Séléka de Bangui. Aux termes de celui-ci, les anciens rebelles sont invités à se faire enregistrer et à se désarmer, pour être cantonnés un temps dans Bangui (sous protection) avant d’être transférés soit sur un site de transit sécurisé, soit dans leur province d’origine, suivant les modalités décrites par le schéma ci-après.
L’AMORCE DU PROCESSUS DE DDR QU’APPUIE LA FORCE SANGARIS
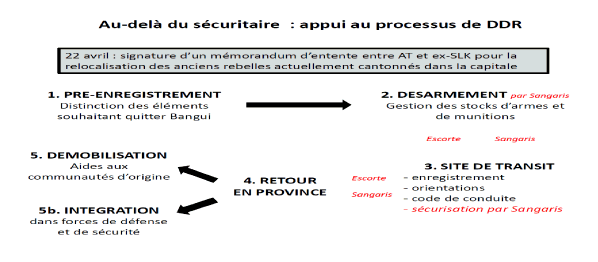
Source : état-major des armées (commandement de l’opération Sangaris).
Comme le chef d’état-major des armées l’a fait valoir aux rapporteurs, il est difficile à une force militaire telle que Sangaris de faire davantage en faveur de la reconstruction de la République centrafricaine. En effet, le traitement de la crise centrafricaine appelle une « approche globale », reposant sur trois piliers :
– la sécurisation du pays, à laquelle la force Sangaris peut effectivement contribuer, le niveau de sécurité atteint représentant selon lui « un plateau » que l’on ne saurait franchir sans actionner d’autres leviers utiles à la reconstruction de l’État ;
– la relance économique, qui doit permettre d’employer une main-d’œuvre abondante et majoritairement jeune, dont le désœuvrement actuel fait une « proie » facile pour les groupes armés de toutes natures. En la matière, une force militaire conçue pour l’intervention ne peut pas faire davantage que ce que fait déjà la force Sangaris : c’est à la communauté internationale d’en prendre le relais, avec les outils qui sont ceux de l’ONU et de l’Union africaine notamment ;
– la reconstruction d’une gouvernance efficace. Le fait d’avoir répondu favorablement à la demande de la présidente Catherine Samba-Panza visant à ce que la France place auprès d’elle un officier général au poste de conseiller militaire va dans ce sens. Mais là encore, les moyens à mettre en œuvre dépassent les compétences, le cœur de métier et les capacités des forces armées françaises.
2. Une prise de relais indéniablement insuffisante par les autorités centrafricaines et la communauté internationale – la CEEAC, l’ONU et l’Union européenne
Le Gouvernement avait présenté l’opération Sangaris comme une opération qui « n’a pas vocation à durer », sans bien évidemment pouvoir s’engager sur une date précise de fin de mission.
Par ailleurs, il convient de souligner que cette perspective concerne l’opération Sangaris et non la présence française en République centrafricaine : l’opération Boali était déployée avant la crise de 2012-2013 avec pour mission d’apporter son appui aux forces internationales chargées de soutenir le gouvernement centrafricain, et le Gouvernement français n’a jamais prétendu qu’une force d’une envergure comparable à celle de Boali – 400 hommes environ – n’aurait pas à poursuivre, après le pic d’insécurité de 2012-2013, le travail de fond qu’elle menait avant ces événements.
En tout état de cause, pour pouvoir réduire les effectifs français d’un format de type « Sangaris » à un format de type « Boali », un passage de relais doit pouvoir être opéré à d’autres forces de sécurité, qu’elles soient centrafricaines ou internationales. Tout l’enjeu, pour la fin de l’opération Sangaris, réside donc dans ce que le ministre de la Défense a appelé devant la commission (17) la « concrétisation du soutien international à notre action » que nous attendons, car c’est ce « soutien qui permet la mise en place des outils de sortie de crise ».
Or il ressort des observations des rapporteurs sur le théâtre centrafricain que ce passage de relais est encore loin d’être assuré.
a. Un État qui tarde à se reconstituer
i. Les autorités de transition enregistrent quelques succès
• D’indéniables progrès accomplis depuis janvier 2014
Entre les mois de février et de mai, les rapporteurs ont pu constater eux-mêmes une amorce de redémarrage de l’appareil d’État, y compris du système judiciaire, dont le bon fonctionnement est indispensable pour assurer la sécurité intérieure.
• Des incertitudes sur la durée de la transition
Par ailleurs, il convient de souligner que les autorités qui ont succédé au régime de Michel Djotodia présentent un caractère transitoire : le rétablissement de l’État, avec des institutions investies de la légitimité du suffrage universel, ne pourra pas être vu comme accompli avant la tenue d’élections organisées dans des conditions satisfaisantes.
Or il ressort des entretiens politiques conduits à Bangui que le calendrier électoral fixé par les accords de Libreville de janvier 2013 fait l’objet d’un scepticisme croissant. En effet, une élection présidentielle est censée avoir lieu en février 2015 au plus tard, mais la tenue d’élections ne pourra contribuer à la stabilisation durable du pays que si le résultat de celles-ci ne souffre pas de contestation, ce qui suppose qu’elles puissent être organisées dans un climat de sécurité acceptable sur l’ensemble du territoire centrafricain, rendu possible seulement par la présence de forces françaises capables d’intervenir rapidement en cas de troubles et d’exercer un effet dissuasif sur les fauteurs de troubles éventuels. Dans le même sens, le Premier ministre avait estimé devant une délégation parlementaire française en février 2014 que tenir des élections « n’aurait pas de sens tant que 90 % au moins du territoire national ne seraient pas sécurisés ».
La direction générale des affaires politiques et de sécurité reconnaît « un fort risque de glissement » du calendrier électoral. Selon les explications fournies aux rapporteurs, la mise en œuvre des conditions nécessaires à l’organisation d’élections est déjà en retard par rapport à la planification élaborée par l’ONU, qui évalue à 476 jours le délai incompressible avant leur tenue. Néanmoins, les rapporteurs partagent l’opinion des représentants de la France aux Nations unies selon laquelle il vaut mieux, à ce stade, ne pas repousser officiellement les échéances électorales car, selon les termes d’un observateur avisé du dossier, « si on lâche sur la date, on risque de relâcher l’effort ». Les représentants de l’ONU pour la République centrafricaine ont d’ailleurs fait passer aux rapporteurs, lors de leurs entretiens, le message suivant lequel il serait peut-être nécessaire de « déconnecter » le calendrier de sortie de l’opération Sangaris de la tenue des élections présidentielle et législatives.
• Un manque de leadership politique
Les rapporteurs, qui ont rencontré la chef de l’État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, n’ont pas de doute sur sa volonté de redresser son pays, sur l’énergie qu’elle y emploie, sur ses hautes qualités personnelles, ni sur son véritable charisme politique.
Il est malheureusement nécessaire de relever que ces qualités ne sont pas également partagées par l’ensemble de la classe politique centrafricaine.
Pour plusieurs observateurs de la crise centrafricaine, le problème ethnique et politique ne se réglera pas par une intervention française : désormais, le « problème n° 1 » à Bangui, « c’est une déception politique ». Certains vont même jusqu’à soutenir que la présidente a « freiné les choses » en annonçant un remaniement, ce qui « démobilise tous les membres du gouvernement ». En outre, l’action du Premier ministre, quelles que soient ses hautes compétences administratives attestées par sa brillante carrière dans les organisations financières internationales, est souvent vue comme moins adroite qu’il ne le faudrait sur le plan politique.
D’ailleurs, la mobilisation d’une classe politique nationale dans le sens de la reconstruction de l’État se heurte à un obstacle institutionnel : les accords de Libreville font interdiction aux responsables politiques des autorités de transition de présenter leur candidature aux élections à venir. Si cette règle a pour intérêt de garantir une certaine neutralité de ces responsables, elle n’en a pas moins un aspect contre-productif. En effet, elle tend à dissuader les principales autorités politiques du pays de s’engager dans le gouvernement de transition, et à les inciter à conserver une position d’attentisme, alors que la remise sur pied des institutions publiques appellerait plutôt une mobilisation de l’ensemble de la classe politique centrafricaine.
Aussi, le constat largement partagé est qu’il manque à la République centrafricaine un leadership politique. En effet, de nombreux outils sont d’ores et déjà disponibles pour contribuer à la reconstruction de l’État : les forces militaires françaises et africaines, une opération de maintien de la paix dotée d’une puissante composante civile, des crédits disponibles auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, etc. – la France a en effet mobilisé ces institutions, dont les engagements sont d’ores et déjà suffisants pour assurer le paiement des salaires des agents de l’État jusqu’à la fin de l’année 2014. Pourtant, selon l’expression employée par un haut responsable militaire, « on a mis tous les outils sur le terrain, il ne manque plus que quelqu’un pour les prendre et entamer le chantier ». À défaut de pouvoir être trouvé parmi la classe politique nationale, un tel leadership pourrait être suscité par les organisations internationales, comme cela a été le cas, par exemple, au Kosovo à partir de 1999. Or, selon les informations dont disposent les rapporteurs, le commissaire de l’Union africaine chargé de la paix et de la sécurité n’aurait effectué qu’un seul déplacement auprès de la MISCA en neuf mois, et la présidente de l’Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, n’en aurait effectué aucun. Ainsi, le commandement de la MISCA se trouve dans la situation, pour le moins paradoxale, où il rencontre plus fréquemment le ministre français de la Défense et les chefs d’état-major français que les responsables sous la tutelle desquels il est placé.
À défaut d’un fort appui panafricain ou sous-régional au gouvernement centrafricain, ce sont les voisins de la République centrafricaine qui s’impliquent le plus dans la gestion de la crise. Mais, comme le professeur Bertrand Badie l’a fait valoir aux rapporteurs, il est loin d’être certain que ce soit dans l’intérêt de la République centrafricaine que de voir sa présidente être « intronisée par les deux hommes forts de la sous-région : Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno », qui, ne serait-ce que du fait de la proximité géographique de leurs pays avec la République centrafricaine, peuvent difficilement exercer un leadership parfaitement neutre. Il est d’ailleurs regrettable à cet égard que lors de leur dernière rencontre à Luanda, dont l’ordre du jour était largement consacré à la situation en République centrafricaine, les principaux chefs d’État de la sous-région n’aient pas jugé nécessaire d’inviter Mme Catherine Samba-Panza.
ii. Les forces de sécurité centrafricaines restent très faibles
Le chef d’état-major des armées a souligné l’importance du « problème tactique » que posent, pour les forces françaises chargées de missions de contrôle de zone, les grandes faiblesses que présente à ce jour l’appareil judiciaire centrafricain. En effet, lorsqu’une patrouille française interpelle un individu armé dans une localité comme Bangui, où l’insécurité est désormais de nature davantage criminelle que véritablement militaire, à qui remettre le prisonnier ? La reconstruction d’une chaîne policière et judiciaire est donc indispensable à la sécurisation du pays, mais par nature, elle ne relève pas de l’action des forces armées françaises.
Par ailleurs, le général Francisco Soriano a estimé que si la montée en puissance de la police et de la gendarmerie centrafricaines était « réelle », elle n’en présentait pas moins deux limites :
– elle « reste trop lente » ;
– elle demeure circonscrite à Bangui, où 6 000 à 7 000 hommes sont identifiés, tandis qu’elle est « nettement moins visible » en province.
Le fait que le paiement des salaires des fonctionnaires soit encore erratique ne contribue pas à faciliter la montée en puissance des forces centrafricaines de sécurité intérieure.
b. La désolante incurie de l’Europe
Aux yeux des rapporteurs, le plus regrettable dans les insuffisances constatées en matière de prise de relais de l’intervention française par les forces internationales réside dans le spectacle décourageant que donne l’Union européenne en la matière.
i. Une mission ambitieuse lancée à l’initiative de la France
Comme le ministre de la Défense l’a indiqué à plusieurs reprises à la commission, c’est la France qui a cherché à mobiliser ses partenaires européens en vue du lancement d’une opération militaire en République centrafricaine sous la bannière de l’Union européenne.
L’encadré ci-après présente l’historique du déploiement de cette mission.
Principales étapes du lancement de la mission EUFOR-RCA
– 19/20 décembre 2013 : Conseil européen : mandat à la Haute représentante pour présenter des propositions en faveur de la stabilisation de la RCA ;
– 20 janvier 2014 : Conseil des Affaires étrangères (CAE) : approbation du Concept de Gestion de Crise (crisis management concept, CMC) ;
– 22 janvier 2914 : lettre à la HR de Mme Samba-Panza demandant l’appui de l’UE ;
– 28 janvier 2014 : CSNU: résolution 2134 autorisant l’opération de l’UE;
– 10 février 2014 : CAE : établissement de la mission ;
– 13 et 25 février, 4 et 13 mars 2014 : quatre conférences de génération de force ;
– 17 mars 2014 : le CAE appelle à la poursuite de la planification d’EUFOR République centrafricaine ;
– 27 mars 2014 : 5e conférence de génération de force - annonce française de combler les capacités indispensables pour le lancement de la mission ;
– 2 avril 2014 : lancement de la mission ;
– 30 avril 2014 : déclaration de capacité opérationnelle initiale (protection de Bangui — M’Poko) ;
– 15 juin 2014 : déclaration de pleine capacité opérationnelle.
Source : ministère de la Défense.
• Un mandat robuste
Le principe d’une telle opération a été approuvé lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne du 20 janvier 2014. L’objectif assigné à la force européenne consiste à assurer la sécurisation dans « la zone de Bangui », à assurer la protection des civils et à créer un espace sécurisé pour l’accès des humanitaires.
Devant les rapporteurs, le général français Thierry Lion, commandant tactique de l’opération EUFOR RCA, a jugé suffisamment « robuste » le mandat confié à la force, au regard des missions qui sont les siennes. Ce mandat s’inscrit d’ailleurs dans les lignes directrices fixées par la résolution 2134 du Conseil de sécurité des Nations unies, en date du 28 janvier 2014. Les forces européennes sont ainsi chargées d’une mission clairement définie de « contrôle de zone », d’appui à la gendarmerie centrafricaine pour le « rétablissement de l’ordre » et, le cas échéant, d’appui technique à la police judiciaire locale – par exemple en matière de police scientifique et de conduite d’enquête.
• Un objectif réaliste
Pour les rapporteurs, les tâches confiées à la mission EUFOR-RCA n’ont rien d’insurmontable pour les forces européennes qui composent cette mission. Il s’agit en effet non pas d’une mission de combat, mais d’une mission de contrôle de zone, limitée à trois points de la ville de Bangui :
– l’aéroport M’Poko, dont la garde est confiée à titre principal à la force européenne ;
– les 3e et 5e arrondissements de la ville, où les hommes de la mission EUFOR-RCA sont chargés seulement de « participer » au contrôle de la zone, aux côtés de la MISCA et des forces françaises.
Surtout, l’opération européenne n’a pas pour vocation de s’inscrire dans la durée : son mandat est explicitement celui d’une « bridging operation », c’est-à-dire qu’elle vise à assurer la transition entre le contrôle de la ville par les forces françaises et le déploiement de la MINUSCA. Ainsi, il est prévu que les forces européennes soient retirées du théâtre quatre à six mois exactement après la date à laquelle aura été notifiée leur pleine capacité opérationnelle. La déclaration de pleine capacité opérationnelle a été faite le 15 juin 2014 : ainsi, la mission prendra fin entre le 15 octobre au plus tôt et le 15 décembre au plus tard.
En outre, calibrée pour 770 personnels militaires, cette mission ne peut pas être présentée comme ayant un volume hors de la portée des puissances militaires européennes.
ii. Une génération de force des plus poussives
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major des armées a souligné qu’il avait fallu six tours de négociations de génération de forces pour amener les Européens à fournir à l’opération EUFOR-RCA les effectifs nécessaires. Et encore faut-il souligner que leur résultat ne permet pas de conclure que l’Union européenne s’est montrée au rendez-vous de ses responsabilités internationales – et c’est le moins que l’on puisse dire – :
– alors qu’il s’agissait de conduire les membres de l’Union européenne à armer une opération de transition venant en complément d’une intervention militaire française, plus de 50 % des effectifs de l’EUFOR-RCA sont fournis soit par la France, soit par des États qui ne sont pas membres de l’Union européenne ;
– même en ayant recours à des forces appartenant à des pays tiers, les effectifs théoriques de l’opération EUFOR-RCA restent incomplets.
• La criante absence de certains Européens
La France est la Nation cadre de l’opération et fournit le commandant de la force : le général de division Philippe Pontiès.
La force européenne est armée par vingt États, dont deux États qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Outre la France, il s’agit du Luxembourg, de la Grèce, de la Finlande, du Portugal, de la Géorgie, de l’Autriche, de la Bulgarie, des Pays-Bas, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Suède, de Chypre, de l’Italie, de la Roumanie, de l’Estonie, de la Lettonie et du Monténégro.
Pourtant, il ressort des entretiens conduits par les rapporteurs que les principales puissances européennes, tout au long du processus de génération de force de la mission EUFOR-RCA, ont marqué de grandes réticences à contribuer concrètement à l’armement de la force, et ce malgré la tenue en décembre 2013 d’un Conseil européen censé relancer l’Europe de la défense.
Aussi, l’architecture de l’EUFOR-RCA fait apparaître des lacunes : nombre de postes ne sont pas pourvus, principalement pour ce qui concerne les capacités de combat d’infanterie, comme le montre l’encadré ci-après. De sorte qu’il manquait encore, au mois de mai, une compagnie et deux sections d’infanterie – sur la fourniture desquelles le général commandant le Force Headquarters de l’EUFOR-RCA à Bangui s’est déclaré très pessimiste –, des moyens de commandement et des capacités médicales.
Il en résulte, selon les éléments fournis aux rapporteurs par le ministère de la Défense, que « si les contributions restent en l’état, il est probable qu’une redéfinition de l’ambition de la mission soit requise » – et ce alors même que l’ambition de cette mission était loin d’être hors de portée, vu sa relative modestie.
L’architecture de la mission EUFOR-RCA
EUFOR est commandée depuis l’OHQ (Operational Headquarter) de Larissa (Grèce) et un FHQ (Force Headquarter) à Bangui (RCA).
– OHQ armé à 90 %, soit 122 postes fournis par 12 états dont la Grèce (74 militaires) ;
– FHQ armé à 75 %, soit 66 militaires fournis par huit pays ;
– Deux compagnies et demie d’infanterie sur les quatre prévues : une compagnie française, une compagnie géorgienne, une section estonienne, une section lettone ;
– Une compagnie de gendarmerie (55 gendarmes français — Espagne — Pologne) ;
– Les forces spéciales (Espagne) ;
– Des capacités d’appui : Finlande (action civilo-militaire et déminage/dépollution), Italie (Génie) ;
– Le soutien médical : rôle 2 (France) + évacuation sanitaire (Allemagne)
– Le transport stratégique : Allemagne (SALIS) – Grande-Bretagne au profit des Géorgiens et Suède au profit des Estoniens.
Source : ministère de la Défense.
Il faut toutefois noter que la mission EUFOR-RCA est la première opération militaire de l’Union européenne à posséder un détachement entier de gendarmerie, formé et consacré à la pratique du maintien de l’ordre, d’interpellation et d’enquête. Le seul précédent en la matière est la mission EULEX au Kosovo, mais celle-ci était une mission de nature strictement civile. Ce détachement comprend deux pelotons français, un peloton de la Guardia civil espagnole et un peloton de Żandarmerii polonais, ainsi qu’une cellule de renseignement et d’investigation criminelle.
On notera en outre que, selon le général Thierry Lion, commandant de la force européenne à Bangui, le cadre réglementaire des opérations de l’Union européenne présente certaines rigidités, qui conduisent les Européens à préférer des accords de gré à gré pour leur participation à la mission EUFOR-RCA. Tel est le cas par exemple des arrangements conclus pour la mise à disposition d’avions, et ce en dépit de l’existence de l’EATC (European Air transport Command).
• La part prépondérante de la France au sein de l’EUFOR-RCA
La France a dû non seulement prendre l’initiative de l’opération EUFOR-RCA et entreprendre sans relâche de sensibiliser ses partenaires européens pour les conduire à surmonter en partie leurs réticences, mais elle a encore dû combler elle-même les plus importantes des lacunes résultant, dans l’architecture de la force européenne, de la très faible mobilisation des principales puissances européennes.
Ainsi, selon les informations fournies aux rapporteurs par le ministère de la Défense, la contribution française à la mission devait représenter initialement 29 % des effectifs (soit 290 personnels) pour un coût de 17 millions d’euros pour neuf mois. Mais in fine, la France aura fourni une grande partie des moyens logistiques indispensables, et sa participation représentera 42 % des effectifs militaires (soit 326 personnels), pour un coût de 36 millions d’euros sur neuf mois (soit 50 millions d’euros en année pleine). Il a été indiqué à Bangui que les Français représentaient même les deux tiers des effectifs militaires projetés sur le terrain, preuve supplémentaire de la « frilosité » de nos partenaires.
Les rapporteurs ont d’ailleurs pu constater sur place que la force européenne avait été en partie armée par des personnels militaires français précédemment déployés en République centrafricaine au titre de l’opération Sangaris : ainsi, dans nombre de cas, la manœuvre s’est limitée à un changement d’écusson… Cette situation n’est pas à l’honneur des Européens, et ne sert guère la France elle-même, qui n’a aucun intérêt à ce que la bannière européenne puisse être vue, sur le continent africain, comme le « faux nez » d’interventions françaises.
c. Les difficultés rencontrées par les forces africaines
L’Union africaine s’est très tôt impliquée dans la gestion de la crise centrafricaine et de son pic de 2012-2013. La France et l’ONU ont d’ailleurs veillé à l’associer à leurs entreprises en la matière. Pour la direction générale des affaires politiques et de sécurité du Quai d’Orsay, « l’étroite coordination entre le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine sur le dossier de la République centrafricaine est unanimement reconnue ». La préparation de la résolution 2149 a notamment été l’occasion d’un travail étroit avec l’Union africaine.
Les réticences initiales de celle-ci quant au déploiement rapide d’une opération de maintien de la paix en République centrafricaine paraissent directement liées à la gestion de la crise malienne. L’Union africaine a pu être affectée par le rapide transfert d’autorité entre la MISMA et la MINUSMA au Mali, qu’elle a interprété comme une marque de défiance à son égard et considéré comme un échec. Ceci peut expliquer son souhait que du temps soit laissé à la MISCA pour faire ses preuves. Ainsi, entre le déploiement de la MISCA en août 2013 et la date prévue pour son relais par la MINUSCA le 15 septembre 2014 – alors que la MINUSCA a été créée en avril –, un peu plus d’un an aura été offert à cet effet.
Toutefois, les observations faites sur le terrain par les rapporteurs tendent à montrer que si l’Union africaine a une véritable ambition d’appropriation par les Africains des enjeux de sécurité de leur continent, le déploiement de leurs forces reste compliqué.
i. Des difficultés financières et capacitaires
• Les fonds consentis à l’Union africaine tardent à arriver à Bangui
Le déplacement des rapporteurs à Bangui leur a permis de faire le point, avec le général camerounais Martin Tumenta Chomu, commandant de la MISCA, sur le déploiement de cette force placée sous la bannière de l’Union africaine.
La principale difficulté à laquelle elle est confrontée tient aux circuits financiers complexes de l’Union africaine. En effet, comme l’ont fait observer aux rapporteurs les responsables de la direction générale des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, si le sommet de l’Élysée a mis l’accent sur l’autonomisation des Africains, il n’en reste pas moins que l’« on doit constater la totale dépendance financière qui demeure, en partie parce que les États membres de l’Union africaine ne versent pas toujours toutes leurs contributions ». Aussi, le financement d’une opération telle que la MISCA repose-t-il in fine sur d’autres bailleurs de fonds : l’Union européenne pour le paiement d’une large partie des soldes des militaires déployés, et les États-Unis pour la fourniture de matériels.
Or ces circuits financiers présentent des dysfonctionnements manifestes. En effet, le général Martin Tumenta Chomu a indiqué qu’à la date du déplacement des rapporteurs à Bangui, ses hommes n’avaient pas été payés depuis quatre mois, alors qu’ils l’étaient lorsque les mêmes contingents relevaient de la MICOPAX, placée sous la tutelle de la CEEAC. Pourtant, selon les précisions fournies aux rapporteurs, les fonds engagés à ce titre par l’Union européenne auraient bien été transférés à l’Union africaine. Une partie au moins des dysfonctionnements semble donc résulter des procédures d’engagement et de décaissement des fonds de l’Union africaine. Le général Tumenta Chomu a d’ailleurs expliqué aux rapporteurs que ces procédures financières reposaient sur un principe de centralisation des engagements budgétaires à Addis-Abeba, siège de l’Union africaine : le commandant d’une force telle que la MISCA n’a ainsi de marges de manœuvre financières que très limitées. Certains observateurs civils estiment d’ailleurs que l’Union africaine fait montre d’une « grande désorganisation administrative » : récemment encore, sur 50 millions d’euros provisionnés par les bailleurs de fonds pour le financement de la MISCA, l’Union européenne n’aurait été en mesure de disposer des justificatifs de dépenses en bonne et due forme que pour cinq millions d’euros.
Que l’on ne se méprenne pas sur les vues des rapporteurs : il ne s’agit nullement pour eux de faire porter à l’Union africaine la responsabilité de ces dysfonctionnements, et ce pour deux raisons au moins :
– l’Union européenne elle-même, avec ses mécanismes extrêmement complexes de financement des opérations extérieures et ses règles très contraignantes en matière de financement des opérations et des équipements à caractère militaire, ne saurait être présentée en exemple de souplesse et de réactivité dans le financement des interventions militaires ;
– ces dysfonctionnements étant bien connus, rien n’interdirait à l’UE d’entreprendre des démarches auprès de l’Union africaine en vue de s’assurer d’un meilleur emploi des fonds qu’elle décaisse. Les Européens pourraient, par exemple, proposer une aide technique à l’administration de l’Union africaine pour la gestion de ces crédits. À la connaissance des rapporteurs, rien n’a été entrepris en ce sens à ce jour. Il ne faudrait pas que le fait de financer l’Union africaine soit perçu par les responsables compétents de l’Union européenne comme suffisant à assumer leurs responsabilités internationales ; ce serait, dans une certaine mesure, se défausser.
• Les forces africaines ont besoin d’appuis techniques pour combler leurs lacunes capacitaires
Lors de leur déplacement auprès de l’état-major de la MISCA, les rapporteurs ont pu prendre connaissance du bilan contrasté des capacités de cette force.
Le général Tumenta Chomu a en effet souligné la loyauté et le dévouement des soldats – d’autant plus remarquables qu’ils ne sont pas payés régulièrement –, tout en indiquant que la force manquait de moyens de planification et de commandement, ainsi que de moyens logistiques de projection.
Ces lacunes n’ont en soi rien de surprenant : les mêmes ont été observées au Mali dans le cadre de la MISMA, et s’expliquent par les capacités limitées des forces armées des principaux États contributeurs dans les domaines concernés.
Les déplacements des rapporteurs au Tchad et en République centrafricaine leur ont permis de prendre en considération le rôle joué par le Tchad dans la crise centrafricaine. La position du Tchad peut être vue sous deux angles très différents :
– certains observateurs, notamment à N’Djamena, soulignent que le Tchad se trouve en quelque sorte « victime » de la crise centrafricaine : une partie de la population de la République centrafricaine lui est devenue clairement hostile, et les moyens brutaux employés par les forces tchadiennes déployées en République centrafricaine ont été critiqués par une large part de la communauté internationale ;
– le sentiment qui semble prévaloir à Bangui est radicalement différent : le président Idriss Déby y est parfois présenté comme un « faiseur de roi » dont les liens avec la Séléka ne seraient pas totalement rompus, et certaines de ses décisions récentes ont été perçues comme des manifestations d’hostilité à l’égard des autorités centrafricaines de la transition, comme le rapatriement de ses ressortissants ou le retrait du Tchad de la MISCA.
Si les rapporteurs se gardent de trancher entre ces deux positions extrêmes, il leur semble néanmoins utile de relater ce qu’ils ont pu constater concernant l’impact de la politique du Tchad dans le règlement de la crise centrafricaine.
• Une relation particulière aux populations musulmanes de la République centrafricaine
Lors d’entretiens au Tchad avec différents observateurs internationaux, les rapporteurs ont pu recenser les signaux que le président Idriss Déby a adressés régulièrement à toutes les parties impliquées dans le règlement de la crise tchadienne depuis 2013.
Les inquiétudes formulées par la diplomatie tchadienne concernaient surtout le sort fait aux populations musulmanes, notamment le fait que les ex-Séléka ont été désarmés avant les anti-balakas, ainsi que les exactions commises par ces milices – dont la violence aurait été sous-estimée – contre des populations musulmanes de nationalité ou d’ascendance tchadienne.
Les Tchadiens ont le sentiment de ne pas avoir été entendus sur ce sujet, y compris par la France. C’est ce qui expliquerait notamment que le Tchad ait pris la décision de rapatrier, de façon parfois plus ou moins forcée, ses ressortissants de la République centrafricaine, et de retirer son contingent de la MISCA.
Les violences qui ont eu lieu le 29 mars 2014 à PK12, au passage d’un convoi tchadien de la MISCA chargé de rapatrier des ressortissants tchadiens de Bangui, ont contribué à durcir les oppositions, et restent décrites, à Bangui, comme un « traumatisme ». Le ministre de la Défense les a présentées à la commission dans les termes suivants (18) : « à la suite d’une provocation armée des anti-balaka, les Tchadiens ont riposté à l’arme lourde, causant vingt morts et une soixantaine de blessés dans la population ». Le ministre a qualifié la réaction tchadienne de « disproportionnée » et souligné qu’elle « a été condamnée par la communauté des ONG et des agences des Nations unies ». Pour lui, c’est là « ce qui a conduit le Président Déby à retirer en quelques jours le contingent tchadien de la MISCA ».
• Un retrait qui fragilise la MISCA
Le ministre de la Défense a estimé devant la commission que « ce départ n’est pas une bonne nouvelle car chacun sait le rôle central que joue le Tchad - par ailleurs actuel membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies - dans le règlement de cette crise ». Le retrait du contingent tchadien de la MISCA fragilise en effet le dispositif de pacification du pays à deux égards.
D’une part, à court terme, il a privé sans long préavis la MISCA de 850 hommes, parmi les plus aguerris que comptait la force. Le général Franciso Soriano a d’ailleurs estimé devant les rapporteurs que quels que soient les reproches que l’on peut faire aux Tchadiens, leur retrait a enlevé à la MISCA un « contingent solide dans le Nord », où il avait un « rôle stabilisateur ».
D’autre part, selon les observateurs, les relations que le Tchad avait su entretenir avec la Séléka faisaient du président Idriss Déby un interlocuteur incontournable dans le processus d’apaisement des tensions entre les ex-Séléka et les autres parties du conflit centrafricain. Dès lors, le retrait du Tchad et la distance qui s’est créée entre le président Idriss Déby et la présidente Catherine Samba-Panza – laquelle, dit-on, n’était pas la première candidate soutenue par le Tchad pour succéder à Michel Djotodia à la tête des autorités de la transition – n’ont pas contribué à faciliter la pacification de la République centrafricaine qui constitue le but recherché par l’Union africaine dans le déploiement de la MISCA.
Certains interlocuteurs des rapporteurs ont donc souhaité qu’une solution soit trouvée pour permettre au Tchad de s’impliquer de nouveau plus directement dans la résolution de la crise politico-militaire en République centrafricaine. Lors des entretiens, les autorités centrafricaines se sont d’ailleurs montrées très ouvertes à une réouverture du dialogue avec le Tchad. La présidente Catherine Samba-Panza a ainsi déclaré qu’elle regrettait le départ précipité du contingent tchadien et qu’elle avait donné pour instruction aux responsables de la transition de « se garder de tout commentaire susceptible d’attiser le feu ». Le Premier ministre est allé plus loin, soulignant qu’il n’y a « pas d’inimitié structurelle » entre Tchadiens et Centrafricains, et indiquant qu’en langue sango, les Tchadiens sont le seul peuple qui n’est pas désigné par son gentilé, mais par le terme de « frères ».
d. Les grands défis qui se présentent pour une opération de maintien de la paix de l’ONU
Comme l’a indiqué la direction des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, l’adoption, le 10 avril 2014, de la résolution 2149 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui crée la MINUSCA, « est l’aboutissement d’un long processus de mobilisation diplomatique impulsé par la France, dans le contexte d’une large indifférence et d’une méconnaissance de la République centrafricaine par la communauté internationale ». Dans ce processus, « l’intervention du président de la République à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2013, suivie de la coprésidence par le ministre d’un événement de haut niveau en marge de l’Assemblée générale, ont placé la situation en République centrafricaine au cœur de l’agenda aux Nations unies ». Cette implication du Conseil de sécurité s’est traduite par l’adoption en quatre mois de trois résolutions (2121, 2127 et 2134) jusqu’à l’adoption de la résolution 2149, toutes adoptées à l’unanimité, « avec un engagement croissant des États-Unis à nos côtés et une consultation large et constante avec l’Union africaine ».
Le tableau ci-après présente les grandes options retenues pour le dimensionnement de la MINUSCA.
LA MINUSCA
Forces françaises engagées (prévisions) |
6 |
Chef d’État-major |
Général Hingray |
RSSGNU et Chef de mission |
M. Babacar Gaye (Sénégal) |
Chef de la composante militaire |
Général Bella Keita (Sénégal) – à confirmer |
Effectif en uniforme / plafond au 15/09 |
11 820 (10 000 militaires et 1 820 policiers) |
Effectifs civils |
Non défini. Objectif de 400 au 15/09 selon le DOMP |
Budget approuvé |
313 M$ pour la période du 10 avril au 31 décembre 2014. |
Contributions obligatoires françaises |
22,5 M$ |
Mandat initial |
Résolution 2149 (2014) du 10 avril 2014 |
Mandat actuel |
Résolution 2149 (2014) du 10 avril 2014 |
Fin du mandat |
avril 2015 |
Source : direction des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères.
i. Des attentes très importantes
Mettre en place une opération de maintien de la paix (OMP) au sens de l’ONU présente de nombreux avantages : celle-ci finance une large partie des frais engagés, son périmètre multinational est cohérent avec la « responsabilité de protéger » qui incombe non à tel ou tel État mais à la communauté internationale dans son ensemble, et elle permet de mettre en œuvre des actions civiles et militaires pour lesquelles l’ONU dispose aujourd’hui d’une certaine expertise. Comme les rapporteurs ont pu le constater sur place, le déploiement de la MINUSCA, prévu pour le 15 septembre 2014, suscite donc de fortes attentes, tant pour son volet sécuritaire que pour son volet civil.
• Pour son volet sécuritaire, concernant la maîtrise du territoire
1./ Un mandat robuste
Le mandat de la MINUSCA peut légitimement être qualifié de « robuste ». Parmi les priorités énoncées, outre la protection des civils, la facilitation de l’acheminement de l’aide humanitaire, la protection des droits de l’Homme, figurent notamment l’extension rapide de l’autorité de l’État, le soutien à la lutte contre l’impunité et à l’État de droit et le soutien au processus de désarmement, démobilisation, réinsertion (DDR).
Surtout, le paragraphe 40 de la résolution 2149 prévoit que la MINUSCA peut, sur demande des autorités de transition, adopter des mesures temporaires d’urgence pour maintenir l’ordre public fondamental et lutter contre l’impunité. À ce stade, ces autorités n’ont pas formulé une telle demande.
2./ Un format important
La résolution 2149 autorise le déploiement d’une composante militaire de 10 000 hommes et d’une composante policière de 1 820 hommes.
En ce qui concerne la première, l’ONU envisage de s’appuyer essentiellement sur les contributeurs actuels de la MISCA. L’ensemble des contingents africains, à l’exception des Équato-Guinéens, devraient être repris sous casques bleus, soit les six bataillons du Congo Brazzaville, du Cameroun, du Burundi, du Rwanda, du Gabon et de la République démocratique du Congo.
La composante militaire de la MINUSCA devrait ainsi comprendre environ 5 000 militaires au 15 septembre, ceci sans compter les contingents de génie (environ 400 Indonésiens et Cambodgiens redéployés depuis Haïti et le Soudan du Sud). Le reste des effectifs sera complété par une génération de forces ad hoc. Selon les informations fournies par la direction des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, le Maroc pourrait augmenter sa contribution à hauteur d’un bataillon de 850 hommes, tandis que la Zambie, la Mauritanie, le Pakistan et le Bangladesh ont également été approchés. L’objectif est de disposer de neuf bataillons d’infanterie, plus un de réserve. L’ONU recherche également des hélicoptères, qui constituent une capacité critique pour les OMP : à ce stade, le Bangladesh et le Sri Lanka ont proposé des contributions en hélicoptères de transport. Un appel d’offres pour quatre appareils civils a également été lancé.
Pour la direction des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, l’analyse de la menace en République centrafricaine a conduit à définir une importante composante de police « afin de fournir au Représentant spécial les moyens de maintenir l’ordre public et d’agir le plus efficacement possible au sein de la population ». Six unités de police constituées (Formed Police Units, FPU) sont prévues. Les FPU de la MISCA seront reprises.
• Pour son volet civil : concernant la reconstruction de l’État
L’intérêt d’une OMP, dite « multidimensionnelle », tient aussi à sa composante civile, notamment pour un cas comme celui de la République centrafricaine, marquée par l’effondrement complet des structures étatiques et la dislocation du lien social. La résolution 2149 prévoit que la MISCA devra apporter son appui au processus politique – y compris à la préparation des élections.
ii. Des incertitudes pesant sur la génération de forces
• Des difficultés dans l’atteinte des standards de l’ONU
Il ressort des entretiens conduits par les rapporteurs, notamment avec le général Martin Tumenta Chomu, qu’à l’exception des contingents rwandais et burundais de la MISCA, « la montée aux standards onusiens constitue la principale difficulté » pour le transfert des forces de la MISCA à la MINUSCA, « notamment en termes d’équipements : véhicules et moyens de communication pour le commandement ». Ceux-ci doivent être complétés par différents partenaires, et le Secrétariat général des Nations unies a engagé des discussions à ce sujet avec les pays contributeurs et avec les pays donateurs, notamment les États-Unis.
La même difficulté se retrouve concernant la composante policière de la MINUSCA : la qualité des équipements est le principal problème. En outre, la recherche des 400 officiers de police est plus complexe – un seul est déployé dans le cadre de la MISCA –, et ce d’autant qu’il faut trouver des francophones, avec des formations précises. L’objectif est toutefois de déployer 125 officiers au 15 septembre.
• Des tensions budgétaires
Comme l’indique la direction des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, la question du budget de la MINUSMA s’inscrit dans une problématique plus large, celle de la soutenabilité du budget du maintien de la paix. Le budget 2013-2014 des OMP s’élève à 7,8 milliards de dollars (pour une contribution française d’environ 420 millions d’euros), mais selon les dernières prévisions de la Représentation permanente française à New York, le budget global des OMP pourrait atteindre 8,5 milliards de dollars en 2014-2015. C’est pourquoi plusieurs pays, comme la France, sont « particulièrement attentifs à maintenir ce budget sous contrôle afin de préserver notamment les capacités de lancement de nouvelles OMP ou d’extension d’opérations existantes ».
II. NOTRE PRÉSENCE ET NOS INTERVENTIONS MILITAIRES GAGNERAIENT À S’INSCRIRE DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE AFRICAINE GLOBALE, PARTENARIALE, COHÉRENTE ET ASSUMÉE
Les rapporteurs tirent de leurs travaux le sentiment général que, paradoxalement, c’est précisément au moment où l’Afrique est reconnue comme un continent dont le potentiel de développement est aussi élevé que les risques de déstabilisation – le continent « de toutes les chances et de tous les risques », pourrait-on dire – que la France voit son empreinte s’y réduire, et ce à tous égards : militaire, mais aussi économique, linguistique et politique.
Pourtant, la France possède de nombreux atouts à faire valoir pour conserver sa place en Afrique : en aidant ses partenaires à contrer les risques qui pèsent sur eux, elle pourra aussi bénéficier de leur grand potentiel de développement. Cela suppose une politique africaine globale, partenariale, cohérente et assumée.
A. LES ÉTATS AFRICAINS NE POURRONT ASSURER LEUR SÉCURITÉ QUE DANS LE CADRE DE COOPÉRATIONS, OÙ LA FRANCE PEUT JOUER UN RÔLE DE PREMIER PLAN
Malgré les efforts réels et substantiels consentis par la plupart des pays africains pour renforcer leurs systèmes de défense et de sécurité nationale, les menaces qu’ils doivent affronter et les ressources qu’ils peuvent mobiliser sont telles qu’ils ne peuvent le faire efficacement que dans le cadre de coopérations internationales. La France dispose d’un grand nombre d’atouts pour approfondir dans ce cadre ses partenariats africains.
1. Des efforts substantiels de renforcement des forces armées et des forces de sécurité africaines, qui constituent autant d’occasions de partenariats « gagnant-gagnant » avec la France
a. La plupart des pays africains planifient le renforcement de leurs forces armées et leurs forces de sécurité
Dans tous les pays où se sont déplacés les rapporteurs, les forces armées et les forces de sécurité font l’objet de programmes de renforcement.
i. Des efforts de développement des effectifs des forces armées
Un des traits communs à la quasi-totalité des États dans lesquels les rapporteurs se sont déplacés, à l’exception du Tchad, réside dans le format particulièrement réduit de leurs forces armées : les effectifs totaux des forces y dépassent rarement 12 000 ou 13 000 hommes, toutes armées et toutes armes confondues.
Ces États sont aujourd’hui conduits à planifier un développement conséquent des effectifs militaires. Ainsi, à titre d’exemple, le plan « Armées 2025 » au Sénégal vise à porter ceux des forces armées sénégalaises de 18 000 à 25 000 hommes. De même, au Niger, les effectifs des forces armées sont passés de 12 000 à 13 000 hommes au cours de la seule année 2013.
Le Tchad fait exception, avec 14 000 hommes servant au sein de l’Armée nationale tchadienne, et le même effectif servant au sein d’une sorte de garde présidentielle, la direction générale de service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE). Comme le détaille l’encadré ci-après, le Tchad est engagé dans une démarche de réduction de ses effectifs militaires et de modernisation de son outil de défense et de sécurité nationale.
La manœuvre de modernisation des forces armées tchadiennes
1./ Situation actuelle
Comme l’attaché de défense de l’ambassade de France au Tchad l’a expliqué aux rapporteurs, les forces armées tchadiennes peuvent aujourd’hui être vues comme une armée « à deux vitesses », divisée entre :
– la direction générale des services de sécurités des institutions de l’État (DGSSIE), garde présidentielle bien armée et bien entraînée (19), commandée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils du chef de l’État, forte de 14 000 hommes provenant pour l’essentiel des groupes ethniques du Nord-Est (notamment les Zaghawas), dont est issue la famille Déby ;
– l’armée nationale tchadienne (ANT), moins bien équipée et au sein de laquelle le régime indemnitaire est moins généreux (les écarts allant du simple au décuple), donc moins attractive pour l’élite militaire, ethniquement plus diversifiée et constituée largement par agrégation d’anciens groupes rebelles.
2./ Projet de modernisation initié en 2011
Selon l’attaché de défense, l’objectif de la réforme entreprise depuis 2011 par le président Déby consiste à moderniser les forces, afin d’amener aux standards internationaux une armée qui est faite, aujourd’hui, « plutôt de guerriers que de soldats ». Cet effort de modernisation présente un double intérêt :
– d’une part, pour l’efficacité opérationnelle des forces, ce qui passe par une modernisation de leur équipement, une réduction et un rajeunissement de leurs effectifs. Les conditions d’engagement des Tchadiens au Mali ont d’ailleurs montré que parfois, leurs techniques d’assaut, si elles ne manquent pas de panache, sont coûteuses en vies humaines ;
– d’autre part, pour faciliter leur insertion dans les forces multinationales, qui ne sont financées par l’ONU que dans la mesure où leur organisation répond à des critères internationaux (au nombre de 3 000 environ). Pour l’attaché de défense, si l’atteinte de ces critères suppose un investissement conséquent, elle n’en est pas moins « rentable » – ce que certains États africains ont bien compris.
Cet effort de modernisation passe ainsi, selon les informations fournies aux rapporteurs par les coopérants français insérés au sein des forces tchadiennes, par une déflation portant, à terme, sur 5 000 postes.
3./ Obstacles à surmonter
Cet effort de modernisation se heurte toutefois à différents obstacles :
– des obstacles culturels, certains militaires tchadiens semblant craindre que leurs armées « perdent leur âme » en s’alignant sur les standards de l’ONU ;
– des obstacles tenant aux structures, l’organisation des forces armées tchadiennes étant encore à raffermir. À titre d’exemple, on notera que pour la formation de différentes unités aux standards internationaux, le Tchad a récemment reçu deux offres de services – l’une d’une société privée française, l’autre du gouvernement américain – mais que la mise en œuvre de ce programme a connu de très importants retards, car le Tchad n’était pas en mesure de fournir un organigramme nominatif des commandants de bataillons - requis pour bénéficier de l’aide américaine -, et a considérablement tardé à débloquer les arrhes (20) nécessaires au lancement du programme de formation proposé par la société française.
ii. Des efforts de renforcement capacitaire
• Des plans ambitieux d’amélioration des équipements militaires
Plusieurs États mettent en œuvre d’ambitieux programmes d’amélioration de leurs équipements militaires :
– notamment terrestres et aéroterrestres, comme par exemple au Niger, au Burkina Faso ou au Mali ;
– navals, comme en Côte d’Ivoire et au Gabon ;
– mais aussi aérien, comme le Niger, qui a acquis récemment plusieurs avions Tétras de fabrication française pour améliorer ses capacités de surveillance des frontières, ou la Mauritanie, qui a acquis des avions Embraer EMB 314 Super Tucano modifiés en France pour d’appui aérien au sol.
L’objectif affiché est celui d’une « montée en gamme » technologique, parfois ambitieuse – ainsi, le chef d’état-major général des armées du Niger a évoqué la perspective de voir ses armées dotées de drones. Au Sénégal, l’accent est mis sur le développement des capacités de surveillance maritime. Dans les autres États où les rapporteurs se sont déplacés, ce sont plus fréquemment les moyens de contrôle des frontières terrestres qui constituent la priorité en matière d’investissements : acquisition de pick-up rapides par plusieurs États du Sahel, établissement d’un maillage territorial de casernes (avec les travaux que cela suppose : puits, ravitaillement en hydrocarbures, etc.) dans les zones du Nord et de l’Est du Niger, etc. Le ministre de l’Intérieur nigérien a insisté sur le caractère « immense » de l’investissement consenti au regard du niveau de richesse du pays : non seulement l’investissement en véhicules neufs est constant, mais un effort particulier est fait pour assurer leur maintenance et leur approvisionnement en carburant.
• Des obstacles à surmonter
Cette volonté connaît toutefois trois limites principales :
– financières, dès lors qu’il s’agit de matériels coûteux (notamment aériens et aéroterrestres) ;
– organisationnelles, les commandes passées n’étant pas toujours caractérisées par un souci suffisant de cohérence des matériels, pour des raisons tenant parfois au mode de passation des marchés publics, et le plus souvent au fait que les acquisitions se sont longtemps faites par cessions à titre gratuit en provenance de différentes puissances. Il en résulte que la plupart des pays africains possèdent des parcs hétéroclites de matériels, ce qui induit des besoins élevés en frais de maintien en condition opérationnelle, tant du point de vue des ressources financières que des ressources humaines ;
– culturelles, la plupart des observateurs interrogés sur ce point par les rapporteurs estimant que les forces armées africaines n’ont pas encore l’expertise nécessaire pour planifier et mettre en œuvre les indispensables programmes de maintenance des matériels. Tel est le cas, par exemple, au Niger où il a été indiqué aux rapporteurs que sur les six hélicoptères Gazelle cédés à titre gratuit par la France en 2012, une seule est en service aujourd’hui.
iii. Le renforcement de la fonction de renseignement
• Un processus indispensable, compte tenu des spécificités de la lutte antiterroriste
La prise en compte de la menace terroriste s’est traduite, dans plusieurs États africains, par un souhait de renforcement des services de renseignement. En effet, le renseignement – quelle que soit son origine – constitue un des principaux facteurs d’efficacité dans la lutte contre les groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes.
Ainsi, à titre d’exemple, au Sénégal, le président de la République en a fait une de ses priorités. Avec l’appui des services français compétents, les autorités sénégalaises ont entamé une profonde réorientation de leur système de renseignement, jusqu’alors concentré sur la surveillance des activités politiques intérieures. Cette politique s’est traduite par la rédaction d’un nouveau plan national de renseignement, inspiré des pratiques administratives françaises en la matière. L’objectif du président est, selon les informations des rapporteurs, de mettre en place une structure rassemblant les compétences qui sont en France celles de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ainsi qu’un coordinateur national du renseignement.
• Les limites financières
Au cours de leurs déplacements, les rapporteurs ont cherché à étudier la façon dont les différents États africains organisaient leurs services de renseignement. Dans la plupart des cas, l’accent est mis sur les capteurs les moins coûteux, pour d’évidentes raisons budgétaires.
iv. Améliorer l’organisation de l’action de l’État en mer
Dans les États côtiers dans lesquels les rapporteurs se sont déplacés, ils ont pu constater un effort de consolidation de l’action de l’État en mer.
Tel est le cas, par exemple, au Sénégal. L’arraisonnement d’un chalutier russe en situation illégale dans les eaux sénégalaises a, semble-t-il, entraîné une prise de conscience des autorités politiques sénégalaises. Jusqu’alors, l’organisation de l’action de l’État en mer avait été établie par des décrets de 2002 instituant une Haute autorité de la sécurité maritime – sur le modèle du Secrétariat général à la mer français –, mais ces dispositions n’avaient jamais été mises en œuvre, du fait de réticences émanant notamment de la marine nationale sénégalaise. L’impulsion présidentielle, bien relayée par l’état-major général des armées, a permis de mettre en œuvre les textes existants et de doter cette Haute autorité des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions de coordination interministérielle. Si les observateurs font valoir que des progrès restent à réaliser en matière de fluidité du travail interministériel et de développement des capacités judiciaires tant s’agissant d’action de l’État en mer que de la lutte antiterroriste, les rapporteurs ont pu constater que l’orientation prise était positive. Il n’est pas inutile de rappeler que la mise en place d’un dispositif efficace de coopération interministérielle autour de l’action de l’État en mer a pris une trentaine d’années en France… De même, le Sénégal tend à prendre une part active dans la mise en œuvre du projet d’appui à la réforme du système de sécurité maritime dans le golfe de Guinée (ASECMAR) financé par un fonds de solidarité prioritaire (FSP) français.
Tel est le cas, également, en Côte d’Ivoire. L’investissement consenti y est particulièrement significatif pour deux raisons : d’une part, selon les militaires français chargés de missions de coopération structurelles, parce que le pays n’a jamais eu de tradition forte de puissance maritime ; d’autre part, parce que la décennie de troubles qu’a traversée la Côte d’Ivoire dans les années 2000 l’a conduite à négliger l’entretien de sa modeste force navale. Ainsi, alors qu’elle compte 1 500 personnels environ, la marine ivoirienne ne disposait jusqu’en 2013 que de trois bâtiments, inutilisables – les rapporteurs ont même pu constater qu’ils faisaient l’objet d’un entretien « cosmétique » très minimal : ils sont peints du côté visible depuis les quais où ils restent amarrés, mais laissés à la rouille pour leur côté visible depuis la mer… Avec le soutien d’un coopérant français et du FSP ASECMAR, la marine a passé commande d’une quarantaine de bâtiments fournis par l’industrie française et a d’ores et déjà remis en état sa capacité d’intervention lagunaire, particulièrement utile dans un pays qui compte 515 kilomètres de côtes, mais aussi 1 400 kilomètres de réseaux lagunaires.
Les rapporteurs ont pu observer au Gabon une dynamique comparable. Selon le commissaire général Jean-Félix Sockat, le secrétaire général du ministère de la Défense, c’est un acte de piraterie survenu en 2013 au large des côtes gabonaises qui a conduit les autorités à prendre pleinement conscience du fait que la présence de l’État en mer n’était jusqu’alors pas aussi forte que nécessaire, en particulier pour un pays très dépendant de son commerce extérieur tant pour ses approvisionnements que pour l’exportation de ses hydrocarbures, principale source de revenus publics. La perception d’une menace jusqu’alors « sous-estimée », selon les termes du commissaire général, a conduit à une refondation complète de l’organisation de l’action de l’État en mer, suivant un modèle largement inspiré de l’organisation française.
Des efforts qui traduisent une inflexion dans la façon dont les États africains conçoivent et organisent leurs forces armées
Chaque État a sa conception du rôle de son armée. Elle peut être considérée comme un soutien inconditionnel de l’État donc fortement tribalisée avec des chefs choisis en fonction de leur fidélité politique plutôt que de leur compétence, et est en général correctement équipée pour cette seule mission ; elle peut être un simple outil de prestige donc sans finalité opérationnelle, ouverte à plusieurs ethnies mais avec un effort de l’État se limitant à payer les soldes, les matériels, les soutiens, avec des infrastructures qui ne sont pas à hauteur. Enfin, elle peut connaître toutes les situations intermédiaires entre les deux précédentes possibilités et passer d’une attitude à l’autre en fonction de la situation intérieure du pays, voire sombrer dans le désordre permanent et la privatisation de ses services, comme c’est le cas en République démocratique du Congo.
Beaucoup de pays sont dans la situation où le choix des chefs est plus souvent soumis à la faveur plutôt qu’à la compétence, ce qui crée des frustrations et des attitudes d’autorité peu favorables à l’engagement personnel des militaires. Souvent il n’existe pas de statuts qui définissent des conditions de carrière communes pour tous.
Certaines armées ont acquis une expérience opérationnelle sérieuse soit en raison de leur état de guerre pratiquement permanente, comme c’est le cas du Tchad (encore que pour ce pays le caractère interne des crises s’accompagne d’une remise en cause de l’organisation et du commandement), soit au travers de leur participation aux missions de l’ONU ou de l’Union africaine, comme le Sénégal. Il faut noter que la prise de conscience par les États africains de la nécessité de prendre en charge eux-mêmes leurs problèmes sécuritaires est en train de favoriser un nouveau climat de responsabilité qui devrait déboucher sur des politiques d’amélioration des armées. Les pays du Sahel viennent de décider de mener, de façon concertée des actions contre les islamistes, ce qui est un indice de l’évolution des esprits.
Source : général Jacques Norlain.
b. La France dispose d’atouts de premier plan pour accompagner les États africains dans leurs efforts
i. Parce que la France peut « capitaliser » l’héritage de la coopération des années passées : les liens particuliers qui unissent les responsables militaires africains et français
Lors de leurs déplacements en Afrique, les rapporteurs ont pu constater combien les années de coopération entre la France et ses partenaires africains ont tissé des liens, parfois quasiment affectifs, entre les officiers africains formés en France et les armées françaises.
Cette impression rejoint celle exprimée par le général Bertrand Ract Madoux, qui a déclaré : « Je reste intimement persuadé que lorsqu’il s’agit de l’Afrique, la voix de la France porte un peu plus haut que les autres et que ceci suscite des attentes fortes de la part de nos partenaires occidentaux, de la part de l’Europe mais également de la part de nos amis Africains. Tous nous reconnaissent sur ce continent une expertise certaine derrière laquelle ils se rangent volontiers pour gérer les situations difficiles et pour accompagner les sorties de crise. Dans ce domaine, l’excellence de notre armée y est d’ailleurs reconnue assez largement à un point tel qu’actuellement neuf officiers généraux de l’armée de terre sont déployés en Afrique, soit à la demande d’États africains pour conseiller leurs plus hautes autorités, soit à des postes de commandement dans des missions onusienne et européenne, soit comme commandant de forces françaises ».
Plusieurs des responsables politiques, diplomatiques et militaires rencontrés sur place ont également souligné le rôle de la francophonie dans ces liens. Pour le général Martin Tumenta Chomu, chef d’état-major de la MISCA, le simple fait que les contingents africains placés sous son autorité soient très majoritairement francophones contribue à favoriser l’intégration de cette force multinationale, « ne serait-ce que pour donner ordres et les exécuter de façon cohérente ». Les difficultés d’intégration du contingent fourni par la Guinée équatoriale dans cet ensemble tendent à confirmer a contrario cette idée.
ii. Parce que la France dispose d’atouts pour renouveler et enrichir cette relation particulière
• Par son expertise technique, dans le cadre de la coopération structurelle et de la coopération opérationnelle
L’expertise militaire française est, du point de vue unanime des observateurs, reconnue à sa juste valeur sur tout le continent africain, et la doctrine française demeure la référence pour les armées des pays francophones notamment. La France détient donc un atout en la matière, et a tout intérêt à conserver son influence doctrinale en apportant son expertise aux cadres africains. Ceux-ci en sont d’ailleurs d’autant plus demandeurs, que le nombre de places qui leur sont ouvertes dans nos écoles de formation a été considérablement réduit depuis une vingtaine d’années.
Ainsi, à titre d’exemple, le chef d’état-major de la marine nationale a indiqué que l’évolution des tâches assignées à la mission Corymbe, désormais chargée de missions de formation, répondait à une demande formulée en mai 2014 au sommet de Yaoundé par plusieurs États africains qui ont fait appel à la France pour soutenir leurs efforts de renforcement de l’action de l’État en mer, et font montre selon l’amiral Bernard Rogel d’« une vraie volonté de contrôler leurs 12 miles ».
• Par des actions de coopération à fort effet de levier en matière de formation : les ENVR
Les rapporteurs ont souligné précédemment le grand intérêt des écoles nationales à vocation régionale (ENVR), notamment en raison du fort effet de levier qu’elles offrent en matière de rayonnement pour la France.
Lors de leurs déplacements en Côte d’Ivoire et au Sénégal, ils ont pu étudier le projet d’implantation d’une nouvelle structure assimilable à une ENVR : un collège de l’action de l’État en mer, dont l’encadré ci-après présente les enjeux.
Une nouvelle structure consacrée à l’action de l’État en mer
Comme le chef d’état-major de la marine nationale l’a expliqué aux rapporteurs, Dakar et Abidjan sont en concurrence pour accueillir cette structure, qui pourrait être créée dans le cadre du projet d’appui à la réforme du système de sécurité maritime dans le golfe de Guinée (ASECMAR). Ce projet enregistre des « succès » : dernièrement, la Côte d’Ivoire ainsi que la Guinée, et bientôt le Togo, vont adopter une organisation « à la française » pour l’action de l’État en mer, modèle interministériel qui « est le meilleur modèle au monde ».
Comme l’a indiqué l’amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense, ses services ont étudié toutes les implantations possibles, suivant trois critères : le pays doit pouvoir fournir l’infrastructure, la ressource humaine pour le fonctionnement et une ligne budgétaire. Plusieurs pays ont alors été envisagés. Dès lors, un critère supplémentaire a été retenu : la proximité d’un hub aérien, pour minimiser les coûts de transport. Ne restaient alors en lice que Dakar et Abidjan.
Les deux sites présentent des potentialités très intéressantes, mais il semble que la balance tende à pencher en faveur d’Abidjan. En effet, d’après l’amiral Marin Gillier, Dakar possède déjà la plus haute densité de coopérants français au monde, et le Sénégal accueille déjà deux écoles nationales à vocation régionale ainsi qu’un pôle opérationnel de coopération. À l’inverse, la Côte d’Ivoire a vécu une transition politique au terme de laquelle elle s’impose de nouveau comme une puissance régionale de premier plan, et ne possède pas encore d’école nationale à vocation régionale. De plus, les Ivoiriens se sont montrés particulièrement réceptifs à la doctrine française en matière d’action de l’État en mer. Par ailleurs, la contrainte financière conduit à rechercher des financements auprès de pays ou d’organismes tiers ; or, selon l’amiral Marin Gillier, l’Union européenne pourrait être sollicitée pour financer ce projet dans le cadre de son programme CRIMGO (acronyme anglais pour : « routes maritimes critiques dans le golfe de Guinée ») qui couvre la Côte d’Ivoire mais pas le Sénégal, et les prospects auprès d’autres bailleurs sont plus favorables à Abidjan qu’à Dakar. Le chef d’état-major de la marine a d’ailleurs estimé que « les problèmes internes au golfe de Guinée sont plus importants que ceux dans la Corne ouest de l’Afrique », et qu’ainsi, « Abidjan est plus près de la zone de crise ».
Quel que soit le site retenu pour l’implantation de ce collège, un tel projet paraît particulièrement intéressant. Il serait donc regrettable que sa mise en œuvre soit mise en danger par des difficultés dans l’architecture financière du projet, que l’amiral Bernard Rogel a jugée « compliquée ».
Plus généralement, le chef d’état-major de la marine a appelé l’attention des rapporteurs sur le fait que « la France n’investit pas assez dans ce projet au regard de ses enjeux » : opportunités d’influence et de vente de matériels maritimes, que « l’on est en train de se faire souffler ça par les Anglo-saxons, et de surcroît, les Chinois vont arriver... ». Les pertes de parts de marché commencent certes par de petites vedettes de servitude, etc., mais « une fois qu’on aura perdu notre influence, on perdra nos points d’appui ».
Si la formule de l’ENVR est intéressante, c’est aussi parce qu’elle est relativement souple. Ainsi, d’autres projets inspirés du modèle des écoles nationales à vocation régionale méritent d’être soutenus, financièrement ou non. Ainsi, les rapporteurs ont pu prendre connaissance en Côte d’Ivoire d’un projet de création d’école de pilotage ayant pour pivot une société privée à capitaux français : IAS (International Aircraft Services), dont l’encadré ci-après présente les modalités.
Projet de création d’un centre ivoirien de formation de pilotes et de mécaniciens d’hélicoptères à vocation régionale
1./ Constat de départ
– Aucun centre de formation hélicoptère (pilotes et mécaniciens) adapté aux besoins étatiques en Afrique de l’Ouest
– Besoin évident et croissant de pilotes et de mécaniciens d’hélicoptères pour les administrations d’État
2./ Teneur du projet
– Création d’un pôle de formation hélicoptère dans le cadre d’un protocole d’accord privé/public entre le ministère de la Défense ivoirien et la société IAS
– Objectifs : proposer et mettre en œuvre des formations aéronautiques de pilote et de mécanicien d’hélicoptère au profit de personnel militaire où appartenant à d’autres ministères, en vue de les rendre aptes à mettre en œuvre dans un cadre opérationnel des aéronefs à voilure tournante
3./ Responsabilités qui seraient confiées à l’acteur privé
– Mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains, matériels et pédagogiques pour former tant au niveau théorique que pratique le personnel en formation
– Assurer une qualité de formation conforme aux exigences OACI
– Développer un esprit de sécurité des vols et maintenir une cohésion de stage par la sélection d’un encadrement d’instructeurs hautement qualifiés et justifiant d’une large expérience
4./ Points clés du Projet
– Répond directement aux besoins de formation et qualification de personnel dans le domaine aéronautique du continent africain
– Contribue au développement des pays de la région
– Sensibilise concrètement le personnel formé sur les risques et dangers environnementaux occasionnels et permanents liés au continent africain (terrain et conditions climatiques)
– S’adapte à l’environnement culturel par le biais d’une individualisation de la formation
– Encourage le transfert technologique et pédagogique France/Afrique
– Favorise le maintien des équipages qualifiés dans la région
– Dispense possible de la formation en langue française ou anglaise
Source : International Aircraft Services.
• Par des actions de coopération opérationnelle bien articulées avec les actions de coopération structurelle
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major de l’armée de terre a souligné « la contribution qu’apportent les forces de présence à la prévention des crises » à travers leurs actions de coopération opérationnelle, activité qui « complète le volet structurel de la coopération et apporte ainsi une contribution de premier ordre à cette politique qui permet de former chaque année plus de 20 000 soldats africains ». À titre d’illustration, il a cité « le rôle capital joué par les éléments français au Sénégal dans la formation des unités africaines participant à la MISMA puis à la MINUSMA », contribuant ainsi au renforcement des capacités de défense et de sécurité des États africains. Il a également fait valoir qu’« avec les détachements d’appui opérationnel, dont la présence est généralisée au Mali et en République centrafricaine, cette formation initiale des forces africaines se prolonge en accompagnement de proximité sur le terrain, où nos hommes remplissent avec leurs camarades africains, les mêmes missions au coude à coude ».
Qu’est-ce qu’une coopération réussie ?
Une coopération « réussie » est assurément la combinaison d’une coopération structurelle et opérationnelle selon une complémentarité à planifier finement. Au cours des dernières années, les effectifs globaux consacrés à la coopération de défense n’ont eu de cesse de baisser, conduisant les armées africaines à s’autonomiser et à se structurer (concept de forces africaines en attentes, etc.). La présence permanente auprès de nos alliés africains, le plus souvent intégrée au sein de leurs unités, est ainsi devenue de plus en plus épisodique. Pour pallier cette situation, le dispositif militaire français s’est progressivement restructuré en pôles de coopération.
Cette coopération opérationnelle est remarquable par sa réactivité, la connaissance du milieu et l’influence qu’elle nous procure, en comparaison avec l’effort humain, matériel et financier relativement limité qu’elle exige. Ainsi, les forces françaises font bénéficier les armées locales de leur expérience et de leur action par effet d’entraînement et de modèle.
Il convient cependant de constater que la coopération opérationnelle doit être de proximité et s’inscrire dans la durée pour obtenir des résultats pérennes. La réussite de la coopération de défense auprès des forces tchadiennes en est l’illustration, s’appuyant sur une coopération structurelle à plusieurs niveaux et profitant dans une moindre mesure de la présence du contingent « Épervier ».
Il est à noter également qu’au bout de la logique de coopération opérationnelle, le principe des DAMO (détachements d’assistance militaire opérationnelle), DLA (détachements de liaison et d’appui), puis enfin DLAO (détachements de liaison et d’appuis opérationnels), expérimentés en Afghanistan et généralisés au Mali, permet de compléter au combat la formation initiale assurée par la mission EUTM.
Source : état-major de l’armée de terre.
• Par une offre industrielle qui gagnerait à être mieux promue
Comme le montre la carte ci-après, les dépenses d’acquisition de matériels militaires sont très nettement orientées à la hausse en Afrique.
LES DÉPENSES MILITAIRES EN AFRIQUE
valeurs absolues : en milliards de dollars pour 2013
valeurs relatives : progression de 2004 à 2013

Source : Jeune Afrique n° 2789, juin 2014.
Le marché africain de l’armement offre ainsi un potentiel d’exportation appréciable pour les industriels français. Pourtant, les parts de marché de l’industrie française, très variables, ne sont pas toujours à la hauteur de ce que la France pourrait espérer compte tenu de la profondeur historique et de l’intensité de son engagement en faveur de la sécurité du continent. Ces parts de marché pourraient progresser, sous certaines conditions.
1./ Si davantage d’industriels adaptent leur offre aux besoins de ces marchés émergents
Une des raisons invoquées le plus souvent pour expliquer la part parfois très modeste des industriels français dans les marchés d’armement africains tient à la sophistication trop poussée des productions françaises. Cette sophistication a en effet un double coût : non seulement les produits sont plus chers à l’achat, mais leurs coûts de maintenance sont souvent plus élevés que pour des produits plus rustiques. Cela se vérifie particulièrement dans le domaine aéronautique, mais aussi sur le marché des véhicules terrestres – les pick-up de fabrication japonaise étant généralement préférés aux véhicules légers français.
Pourtant, certaines réussites – telle, à titre d’exemple, celle de l’industrie française de construction navale en Côte d’Ivoire – montrent que soutenus par les armées et les services diplomatiques, les industriels français peuvent nouer des partenariats très productifs avec les forces armées africaines, pour le plus grand bénéfice des deux parties.
2./ Si des solutions de financement innovantes sont trouvées
La vente de matériels onéreux se heurte souvent aux difficultés de liquidité des États africains. Pourtant, à plusieurs reprises, des responsables militaires africains ont indiqué aux rapporteurs que leur préférence irait aux productions françaises, même plus chères que les productions moins sophistiquées d’autres pays, pourvu que des conditions de financement adaptées soient trouvées.
Plusieurs options sont envisagées :
– au Mali, Airbus pourrait fournir cinq à six hélicoptères de type Superpuma et Cougar si un État tiers intervenait dans le financement du projet. Selon les informations fournies par le ministre malien de la Défense, le Qatar aurait été sollicité à cette fin. Le pays sponsor pourrait même mettre à disposition du Mali des hélicoptères qu’il possède déjà, afin de combler les lacunes des forces maliennes sans attendre les délais de fabrication des appareils. Ce type de montage « triangulaire » a des précédents, par exemple au Liban ;
– dans plusieurs pays africains, l’idée de constituer avec l’appui de la France des sociétés de projet ou des sociétés de leasing (dont l’encadré ci-après présente les principes de fonctionnement) est régulièrement avancée comme un moyen qui permettrait la vente de matériels français dans des conditions compatibles avec les flux de trésorerie des États africains concernés. Certes, le recours à un tel mécanisme pour assurer l’équipement des forces françaises suscite des réserves du ministère du Budget quant à sa compatibilité avec les règles comptables de l’Union européenne. Mais s’agissant d’exportations au profit d’États africains, les rapporteurs estiment qu’il serait intéressant d’étudier la possibilité de fournir à leurs armées les matériels propres à leur conférer une supériorité technologique dans la lutte contre les groupes armés rebelles, terroristes ou djihadistes.
L’intérêt d’une société de projet
L’idée de créer une société de projet (SPV – Special Purpose Vehicle) ou de leasing pour permettre l’acquisition de matériels militaires dans des conditions compatibles avec un volume de dépenses publiques de défense contraint a été envisagée dès le conseil de défense du 17 juillet 2013, en vue de maintenir le niveau de dépenses prévu par la loi de programmation militaire dans l’attente de la perception par l’État du produit de la cession de fréquences hertziennes. Si elle ne fait pas l’objet d’un consensus parmi les administrations françaises concernées, au motif qu’elle aurait pour effet une dégradation faciale du solde budgétaire national calculé selon les normes d’Eurostat, rien n’interdit d’envisager un montage financier de ce type au bénéfice des armées africaines.
Cette solution consisterait à ce qu’une société fasse l’acquisition de matériels militaires auprès d’industriels, pour les offrir ensuite à la location au bénéfice d’un ou de plusieurs États. La composition du capital d’une telle société, qui doit bien entendu faire l’objet d’une attention toute particulière, permet une certaine souplesse dans la mobilisation des capitaux – publics ou privés, nationaux ou internationaux.
En tout état de cause, les rapporteurs considèrent que dès lors que la France, comme l’a réaffirmé le Livre blanc, entend demeurer une puissance industrielle mais ne peut entretenir les savoir-faire de ses industries de défense qu’en augmentant ses exportations, il serait cohérent que l’État soit capable d’imaginer des solutions de financement innovantes.
Les rapporteurs tiennent à mentionner à ce titre l’action de la société DCI, créée à l’initiative du ministère de la Défense pour servir d’opérateur de référence du transfert de savoir-faire militaire français à l’étranger, en appui notamment des contrats d’exportation d’armement. Son activité permet de promouvoir les productions industrielles françaises, tout en offrant aux États africains des services garantissant un suivi robuste de leurs contrats d’armement. À ce titre, ces activités méritent d’être pleinement soutenues par l’ensemble des services français.
La société DCI
De par son partenariat étroit avec le ministère de la Défense, cette société de services bénéficie, à l’étranger, d’un « effet de label « armées françaises » » utile.
Son cœur de métier consiste à accompagner les programmes d’exportation d’armement tout au long de leur déroulement, ce qui intervient en plusieurs phases : assistance à l’expression de besoin, contrôle de programme, qualification, formation initiale, formation continue, externalisation du maintien en condition opérationnelle. L’activité de la société DCI s’est récemment élargie à d’autres domaines d’activité et de soutien des forces armées : ainsi, les rapporteurs ont pu constater qu’à Abou Dhabi, c’est DCI qui prend à bail le parc de logement des personnels militaires en mission de longue durée et en assure la gestion au bénéfice des Forces françaises aux Émirats arabes unis.
C’est ainsi que le ministre de la Défense a pu décrire la société DCI dans les termes suivants : « DCI est, de manière complémentaire à nos industriels de défense, un outil précieux pour notre politique d’exportation est un vecteur de notre stratégie d’influence » (20 décembre 2013).
Par ailleurs, il est regrettable que les substantiels crédits consacrés par l’Union européenne à la sécurité de l’Afrique ne puissent pas, pour des raisons tenant à la réglementation européenne, subventionner l’acquisition d’équipements dès lors que ceux-ci ont une vocation militaire.
2. Les États d’Afrique subsaharienne mettent l’accent sur la coopération internationale pour l’organisation de leur sécurité, et la France a un rôle à jouer dans cette organisation
a. L’Union africaine et les sous-régions sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans les opérations en Afrique
L’Union africaine s’organise en sous-régions :
– la CEDEAO, qui a fait un « bon travail » au Mali ;
– la CEEAC en Afrique centrale ;
– en Afrique de l’Est, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD, pour Intergovernmental Authority on Development), qui envisage de déployer une force au Soudan du Sud ;
– la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC, pour Southern African Development Community) en Afrique australe ;
– l’Union du Maghreb arabe (UMA), moins active.
i. Un déploiement progressif des forces de l’Union africaine, dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité
M. Philippe Errera, directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques, a indiqué que l’on observe une « conscience croissante des responsabilités africaines » : c’est une évolution lente, mais visible.
Pour le directeur de l’Afrique et de l’océan indien (DAOI) du ministère des Affaires étrangères, l’opération Serval est à ce titre une expérience ambivalente : l’Union africaine est reconnaissante à la France d’avoir géré la crise en premier, mais aurait préféré être en mesure de le faire elle-même.
Ses efforts en vue de développer ses capacités de gestion de crise sont pourtant réels :
– dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPSA), elle mène des travaux sur la Force africaine en attente (FAA). Selon la plupart des observateurs, si les cinq brigades en attente prévues par les accords ne sont pas encore opérationnelles, celle de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Sud sont en avance sur celles de la CEDEAO et de la CEEAC ; elles auraient d’ailleurs déjà effectué des exercices en relation avec les forces françaises stationnées à Djibouti et à la Réunion. Lors du sommet de l’Élysée de décembre 2013, la France s’est notamment engagée à soutenir les efforts de l’Union africaine pour parvenir à une pleine capacité opérationnelle de la Force africaine en attente et de sa Capacité de déploiement rapide à l’horizon 2015. Dans cette perspective, il a notamment été décidé que le dispositif français (forces pré-positionnées et système de coopération) soit réorienté en appui aux initiatives africaines en cours sur le continent. Dans ce cadre, la France mettra notamment l’accent sur la formation des cadres militaires et renforcera ses actions de coopération en matière de renseignement et d’équipements ;
– constatant ses difficultés à réunir des forces à projeter au Mali et les délais nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif aussi « lourd » que la FAA, l’Union africaine a décidé, en avril 2013, la création d’une sorte de « dispositif intermédiaire » dans l’attente de la pleine opérationnalité de la FAA : la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC). Selon les explications fournies aux rapporteurs, il s’agit d’un groupement tactique de 1 500 hommes déployable en dix jours, armé par un « groupe pionnier » de 13 États (francophones pour la moitié d’entre eux) disposant de capacités militaires plus solides que la moyenne des pays africains ;
– dans le même temps, lors de son 21e sommet en mai 2013, l’Union africaine a adopté le principe de l’instauration, d’ici 2015, d’une taxe de 10 dollars sur les billets d’avion et de deux dollars sur les séjours hôteliers, pour un rendement attendu de 763 millions de dollars par an, destinée à financer les opérations menées sous sa bannière dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité. La direction générale des affaires politiques et de sécurité du Quai d’Orsay note toutefois que le sommet de l’Élysée, tenu en décembre 2013, a montré que s’agissant de la mise en œuvre et du financement de ces initiatives, « on en est très loin » ;
– lors des crises malienne et centrafricaine, les organisations sous-régionales se sont mobilisées – certes, pas de façon parfaite en République centrafricaine, mais selon le directeur chargé de la Délégation aux affaires stratégiques, il y a encore cinq ans, la CEEAC n’aurait pas été en mesure à créer la MISCA dans des délais aussi courts.
Ainsi, pour M. Philippe Errera, la « volonté d’appropriation » des Africains est nette. En témoigne aussi le fait que les Sénégalais sont désormais désireux de prendre davantage de responsabilités dans l’organisation du prochain Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui avait été lancé à l’initiative de la partie française. Cela constitue d’ailleurs une bonne nouvelle, dans la mesure où cela permettra d’éviter « les crispations des Algériens et de l’Union africaine envers la France »
L’ensemble des responsables politiques et militaires rencontrés ont affirmé leur attachement à l’inscription de leur politique de défense dans le cadre sous-régional, sous l’égide de la CEDEAO. Certains acteurs politiques burkinabés vont jusqu’à entrevoir une mutualisation complète des forces armées des États membres, en vue de réduire les coûts, de faciliter le règlement sous-régional des crises, de mutualiser des capacités trop onéreuses ou trop complexes pour un État seul, et d’éviter que les armées aient un rôle trop important dans la stabilité politique des États concernés.
ii. Un déploiement que la France peut accompagner
Le professeur Jean-François Bayart a estimé que la France a fait des progrès dans l’appréhension de la dimension multilatérale de la défense : pour la première fois selon lui, la commission chargée de l’élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, en 2013, a pleinement pris en compte l’action de l’Union africaine et de ses sous-régions. « Quand on travaille sur l’Afrique, on pense encore instinctivement à un cadre bilatéral, alors que le cadre multilatéral émerge et est déjà incontournable ».
Le Livre blanc de 2013 met d’ailleurs l’accent sur le soutien à la formation d’une architecture de sécurité collective en Afrique, qui est ainsi une priorité de la politique de coopération et de développement de la France. Parallèlement, selon la direction de la coopération de sécurité et de défense, huit accords de partenariat de défense (21) et seize accords techniques de coopération comprennent des stipulations relatives à l’accompagnement des États africains dans l’appropriation et la maîtrise collective de leur sécurité.
Pour le directeur de l’Afrique et de l’océan Indien du ministère des Affaires étrangères (DAOI), si la volonté politique de l’Union africaine ne fait pas de doute, elle se heurte à un manque de moyens à la fois financiers et capacitaires. C’est pour prendre en compte cette réalité que la France a pris plusieurs initiatives récentes, telles que :
– le choix de consacrer un volet du sommet de l’Élysée de décembre 2013 au thème « comment aider l’Afrique à se doter de capacités d’intervention ? » ;
– l’accent mis sur l’aide capacitaire aux Africains dans le dialogue franco-britannique (c’est d’ailleurs un des grands points de convergence entre les deux parties), ainsi que dans le partenariat stratégique franco-américain ;
– les efforts français pour que dans le cadre du sommet Union européenne – Union africaine (UE-UA) des 2 et 3 avril 2014, les Européens envisagent de mobiliser la « facilité pour la paix » afin de financer du développement capacitaire, et plus seulement du paiement de soldes.
Le but est que, d’ici cinq ans, en cas de crise, le soutien français soit limité au transport, à la logistique et au renseignement, et que l’Union européenne soit mobilisée pour assurer le paiement des soldes des forces internationales.
Il faudrait pour cela pouvoir utiliser davantage les crédits européens pour la gestion des crises de l’Afrique francophone. Des progrès restent en effet à accomplir en ce sens : selon le directeur de l’Afrique et de l’océan Indien, au titre de la « facilité pour la paix », l’Union a dépensé 840 millions d’euros pour la Somalie sous l’impulsion du Royaume-Uni contre seulement 75 millions d’euros pour le Mali à l’initiative de la France. Cette situation peut être vue comme déséquilibrée (au détriment des intérêts de la France et de ses partenaires africains) à deux titres :
– la France finance 20 % de cette « facilité » contre 14 % seulement pour le Royaume-Uni ;
– les Britanniques n’ont pas mis « the boots on the ground » en Somalie, contrairement aux Français au Mali.
D’ores et déjà, selon la DAOI, la France veille à associer l’Union africaine à toutes ses initiatives, qu’elles soient :
– unilatérales : l’Union africaine a apprécié avoir été consultée avant le lancement de l’opération Serval ;
– multilatérales : la France veille à ce que ses initiatives à l’ONU aient l’accord de l’Union africaine, et ce parfois au prix de délais supplémentaires. Ainsi, il a fallu du temps pour aplanir les réticences de l’Union africaine au lancement d’une opération de maintien de la paix en République centrafricaine. Mais l’appui de l’Union africaine s’est avéré appréciable, par exemple lorsqu’il s’est agi de prendre des sanctions contre l’Erythrée, l’accord de l’Union africaine conduisant les Russes et les Chinois à s’abstenir lors du vote du Conseil de sécurité, alors qu’ils n’étaient pas initialement favorables au projet.
Enfin, il faut mentionner ici l’appui capacitaire appréciable que la France offre aux pays africains avec le dispositif RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix). Les moyens consacrés par la France chaque année à l’entretien de ce parc sont significatifs : en 2013, 1,2 million d’euros étaient programmés et 755 000 euros ont été engagés au titre du dispositif RECAMP sur le budget opérationnel de programme (BOP) Emploi des forces. En 2014 (au 1er juin), sur 1,28 million d’euros programmés, 70 000 sont d’ores et déjà engagés.
Ce dispositif a été mis en place en 1997. Il n’est pas illégitime de se demander s’il correspond toujours aux besoins des armées africaines et aux capacités des armées françaises. En effet, les rapporteurs ont été surpris de voir, sur les parcs de stationnement des Éléments français au Sénégal, un nombre conséquent de 4x4 Land Rover entretenus en parfait état positionnés au titre du dispositif RECAMP, alors que tous les véhicules terrestres que les rapporteurs ont pu voir lors de leurs déplacements auprès des forces Serval au Mali et Sangaris en République centrafricaine paraissaient loin d’être en aussi bon état. Lors de son audition, le général Bernard Barrera a paru partager leurs interrogations. Pour lui, l’idée de disposer de parcs de matériels destinés à être prêtés aux Africains était bonne, mais aujourd’hui, ce sont nos propres régiments qui connaissent parfois une « pénurie » de ces matériels.
Enfin, comme l’a suggéré le chef d’état-major des armées, il convient de s’interroger sur le caractère mesurable du « retour sur investissement » des efforts consentis en matière de coopération. Il a jugé qu’une attention plus soutenue devait être accordée au caractère mesurable de ce retour, citant en exemple le cas de la Mauritanie : celle-ci a bénéficié d’une action de coopération mobilisant 40 personnels français, et a accepté en contrepartie de contribuer à la MINUSMA.
b. Des accords de périmètre plus réduit complètent utilement l’architecture africaine de paix et de sécurité
i. Une multiplication d’accords de coopération de défense
• Une multiplication d’accords bilatéraux, notamment pour la surveillance des frontières
La coopération bilatérale constitue un axe majeur des politiques de défense des États du Sahel. Elle vise notamment :
– le partage d’informations ;
– la surveillance conjointe des frontières, le cas échéant par des patrouilles mixtes binationales.
À cet égard, on notera que le président malien Ibrahim Boubakar Keita, depuis son élection, a eu une politique active de tissage de liens bilatéraux.
• Le G5 et les diverses initiatives du même type
Lors de leurs entretiens, les rapporteurs ont pu constater que les responsables politiques et militaires africains plaçaient beaucoup d’espoirs dans la coopération qu’ils entretiennent dans le cadre du « G5 du Sahel » (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) constitué en février 2014. Ce groupe donne un cadre politique aux actions de coopération militaire entreprises entre les armées de ces cinq pays, suivant une démarche dite « bottom-up ».
Le chef d’état-major des armées a estimé que ce cadre constituait le périmètre le plus adapté pour coordonner la lutte contre les groupes armés terroristes sévissant au Sahel, pourvu que soient trouvées des modalités permettant d’associer le Sénégal à son action.
ii. Une occasion pour la France d’apporter un appui décisif
Le cas du G5 du Sahel est emblématique de ce que la France peut faire pour soutenir des initiatives de coopération entre pays africains dans le domaine de la défense et de la sécurité, et ce à deux titres :
– d’une part, en appuyant les actions de coopérations décidées dans ce cadre, où elle a un statut d’observateur, par des opérations conjointes sur le terrain, notamment dans les zones frontalières ;
– d’autre part, par un travail d’accompagnement diplomatique et de mise en cohérence des diverses initiatives prises, de façon à créer des « cercles concentriques de discussion » pour que des initiatives comme le G5 ne se heurtent pas aux réticences de pays qui, comme le Sénégal, pourraient s’en sentir exclus ou, comme l’Algérie, s’interroger sur l’articulation de ce cadre nouveau avec les espaces de coopération préexistants. La France a ainsi un rôle à jouer pour associer le Sénégal aux opérations du G5 qui peuvent le concerner, sans pour autant que celui-ci ait besoin d’être officiellement membre de ce groupe.
B. LA FRANCE A INTÉRÊT À METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE AFRICAINE GLOBALE, PARTENARIALE, COHÉRENTE ET ASSUMÉE
La présence et les interventions militaires de la France ne seront pleinement efficaces à long terme que si elles s’articulent avec celles de ses partenaires et s’inscrivent dans le cadre d’une politique africaine cohérente et assumée.
1. La France n’a ni les moyens ni l’ambition d’être le « gendarme de l’Afrique » : dès lors, son action doit s’articuler de façon pragmatique avec celle de ses partenaires
a. L’action de la France gagne à s’inscrire dans un cadre partenarial, si possible multilatéral
Comme le chef d’état-major des armées l’a estimé devant les rapporteurs, la contrainte budgétaire et les limites capacitaires qui pèsent sur les forces françaises doivent inciter au pragmatisme, et partant, à rechercher à optimiser l’effet de nos moyens en coopérant avec les autres forces en présence sur le sol africain, que ce soit dans la gestion des crises ou dans le fonctionnement du dispositif militaire permanent.
i. La stratégie politique générale : une approche multilatérale de la gestion des crises africaines
• Une préférence affirmée pour les interventions multilatérales
Le Livre blanc de 2013 met d’ailleurs l’accent sur l’intérêt qu’a la France, pour la légitimité de ses interventions, à ce que « les opérations auxquelles elle participera seront, autant que possible, menées dans des cadres multilatéraux », qu’il s’agisse de l’ONU, des organisations régionales ou des organisations sous-régionales, comme le montre l’encadré ci-après.
L’approche multilatérale, orientation stratégique fixée par le Livre blanc
L’ONU, mais également les organisations régionales et sous-régionales, sont appelées à jouer un rôle croissant dans la légitimité et la conduite stratégique des opérations extérieures. À cet égard le succès des opérations est souvent lui-même en partie lié à la légitimité de l’institution qui en est le support. Dans un monde où perdurent de très grandes inégalités de pouvoir et de ressources, les interventions extérieures ne doivent pas être soupçonnées d’être un nouvel instrument de projection abusive de puissance. Pour obtenir l’adhésion qui est une condition de leur succès, elles doivent répondre aux attentes des populations concernées et être portées par des organisations dans lesquelles ces populations se reconnaissent. En Afrique, l’Union africaine et les organisations sous-régionales sont ainsi devenues des acteurs de la sécurité du continent qui apportent une contribution importante à la paix et à la sécurité internationales.
La France tire toutes les conséquences de cette évolution et les opérations auxquelles elle participera seront, autant que possible, menées dans des cadres multilatéraux. Elle veillera à ce que ces opérations fassent l’objet, sous l’égide de l’ONU, d’un large accord sur leurs objectifs politiques et qu’elles relèvent d’une action convergente et coordonnée, associant les organisations multilatérales appropriées, en particulier les organisations régionales ou sous-régionales concernées.
Source : Livre blanc de 2013 sur la défense et la sécurité nationale.
Le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères a souligné devant les rapporteurs que l’approche multilatérale de la gestion des crises est une constante de la diplomatie française, notamment pour ce qui concerne l’Afrique.
Pour lui, même la gestion de la crise malienne procède de cette stratégie. En effet, la France n’a eu recours à une intervention organisée « en bilatéral » qu’en raison de « l’urgence absolue, à 24 heures de la chute de Bamako ». Mais :
– en amont, la France plaidait au Conseil de sécurité (CSNU) pour mandater une intervention de l’Union africaine, et auprès des instances européennes pour donner davantage de portée concrète à la stratégie européenne sur le Sahel en mettant rapidement en place la mission EUTM Mali ;
– en aval, le relais par une opération de maintien de la paix (OMP) a été « très rapide », dès le printemps 2013.
À cet égard, on pourrait presque voir, selon lui, la première phase de l’opération Serval comme une « super bridging operation » doublée d’un apport de compétences de pointe en matière de lutte antiterroriste. Il faut aussi souligner que la France a pris une part active dans l’organisation de conférences des donateurs, ainsi que dans la coordination avec l’action des États-Unis.
L’approche est la même en République centrafricaine :
– dès 1998, la France avait eu un rôle d’impulsion dans le lancement de la Mission des Nations unies en Centrafrique (MINURCA), puis « l’empreinte de l’ONU » dans le pays a baissé au fur et à mesure. La MINURCA a ainsi été remplacée en 2000 par une simple mission de politique (le « bureau de l’ONU »), investi d’un mandat de conseil aux autorités centrafricaines. Ce bureau est aujourd’hui dénommé bureau des Nations unies pour la Centrafrique (BINUCA) ;
– lors de la dégradation de la situation observée il y a deux ans, la France a mené une action de sensibilisation de la communauté internationale.
Ainsi, le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères a fait valoir qu’en la matière, avec une grande continuité politique, la France « ne s’est pas dérobée ». L’enjeu était alors d’obtenir un mandat pour intervenir puis « passer le relais ». En effet, le bureau des Nations unies « a fait son travail d’alerte », mais ce sont les États membres qui ont seuls le pouvoir de décider de passer d’une mission de conseil politique à une opération de maintien de la paix. Suivant cette logique, le déploiement la MINUSCA le 15 septembre prochain « ouvre la voie à une stratégie de sortie pour Sangaris ».
Pour les rapporteurs, il ressort de la gestion des dernières crises africaines que cette stratégie d’approche multilatérale de la gestion des crises ne doit pas être comprise de façon rigide du point de vue juridique : il ne s’agit pas de faire de l’obtention d’un mandat de l’ONU la condition sine qua non de toute intervention française. Sinon, compte tenu des délais nécessaires pour obtenir un tel mandat, les prépositionnements perdraient beaucoup de leur utilité, la réactivité qu’ils offrent aux forces françaises n’étant plus aussi utile compte tenu du rythme des négociations à l’ONU. Pire, certains observateurs estiment que l’entretien de prépositionnements par une puissance qui s’interdirait toute intervention sans mandat de l’ONU serait contre-productif, la puissance en question pouvant facilement être accusée de n’avoir rien fait dans le début d’une crise.
L’approche multilatérale doit être vue, comme l’indique le Livre blanc, comme la recherche d’une légitimité ressortant d’une action coordonnée avec les autres parties intéressées par la gestion d’une crise.
• Une articulation à trouver au cas par cas entre les différents types de forces dans la gestion d’une crise
1./ Des forces du type Serval ou Sangaris
Le fait de privilégier une approche multilatérale ne doit pas non plus être une raison – voire, pour certaines puissances européennes, un prétexte – pour ne pas intervenir militairement. En effet, l’engagement d’une force disposant de moyens plus sophistiqués que ceux des pays africains et de capacités de réaction plus rapides que celle de l’ONU paraît, à ce jour, indispensable.
2./ Des forces africaines ou sous-régionales
À cet égard, si l’expérience de la MISMA est vue comme largement positive, elle n’en a pas moins montré les limites inhérentes à la mise en place de ce type de missions :
– des moyens logistiques insuffisants, notamment pour le transport et le ravitaillement des troupes ;
– une expérience encore limitée des opérations sous commandement intégré (le « coalition building ») ;
– des capacités de pointe absentes : renseignement autre que d’origine humaine, appuis aériens, appuis feux.
Certes, le sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui s’est tenu à Paris les 6 et 7 décembre a mis en avant les initiatives entreprises par le continent ou ses sous-régions en vue d’apporter des solutions africaines aux problèmes africains, avec le cas échéant le soutien de la communauté internationale. Pour la direction générale des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, « c’est dans cet esprit que la France souligne auprès de ses partenaires internationaux l’importance de développer les capacités africaines de réaction aux crises ». Néanmoins, les expériences récentes de la MISMA et de la MISCA tendent à montrer que les forces sous-régionales ont pour l’heure une réactivité limitée, et ne peuvent être mises en place sans soutien international – notamment de la part de la France, mais aussi des États-Unis, qui ont largement financé la MISMA et disposent de capacités déployées en Afrique.
En outre, selon le directeur de l’Afrique et de l’océan Indien du ministère des Affaires étrangères, l’expérience de gestion des crises en République démocratique du Congo a montré qu’une articulation était à trouver au cas par cas entre l’action de l’Union africaine et celle de l’ONU. En effet, l’ONU y disposait d’une force de 17 000 hommes (la MONUSCO), peu efficaces (notamment car peu d’entre eux étaient francophones). La résolution 2098 du Conseil de sécurité a permis la création d’une brigade d’intervention composée de Tanzaniens et de Sud-Africains, qui seule a réussi à battre le mouvement rebelle M23.
3./ Les opérations de maintien de la paix
Dans le même ordre d’idées, le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères a souligné que l’on ne peut pas assigner à une opération de maintien de la paix menée sous l’égide de l’ONU les mêmes objectifs stratégiques ou tactiques qu’à une force de combat nationale ou multinationale. Pour lui, les OMP ne sont « pas conçues pour faire la guerre » - pour une opération de maintien de la paix, encore faut-il qu’il y ait une paix à maintenir -, même si l’ONU tend à intervenir depuis quelques années dans des environnements moins permissifs qu’auparavant. D’où les réticences de certains membres du Conseil de sécurité à lancer une opération de maintien de la paix dans un environnement « peu permissif et dangereux » tel que la République centrafricaine, et d’où des réticences à donner des missions offensives et létales aux OMP – ce qui constituera, selon le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, un enjeu des discussions préalables au renouvellement du mandat de la MINUSCA, enjeu sur lequel les vues de la France ne sont pas unanimement partagées.
Les rapporteurs ont eu toutefois l’occasion de constater, notamment au Mali, une certaine confusion dans l’opinion publique – voire chez certains responsables politiques – qui croient à tort – ou feignent de croire – que la MINUSMA devrait engager des combats contre les groupes rebelles du Nord.
Pour la direction générale des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères, l’ONU « a toute sa place aux côtés de ces initiatives africaines, avec lesquelles elle coopère d’ailleurs déjà sur de nombreux théâtres ». En matière de gestion des crises africaines, les opérations de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations unies « constituent, et pour longtemps, un outil irremplaçable ». Outre la légitimité du Conseil de sécurité dont elles reçoivent leur mandat et qui fixe le plus souvent le cadre du processus politique, « les OMP ont accès aux ressources (logistique, commandement, capacités critiques, multiplicateurs de forces) et à l’expertise acquise par le département des opérations de maintien de la paix (DOMP) – transition politique, DDR, soutien aux administrations notamment dans les secteurs de la sécurité et de la justice, soutien en matière de droits de l’Homme, accès humanitaire – que réclament les situations de crise les plus complexes ». En outre, elles disposent d’un mode de financement « par contributions obligatoires qui assure un certain partage du fardeau et la pérennité des ressources d’opération de stabilisation nécessairement longue ». L’action de l’ONU s’étend toutefois au-delà du rôle de ces opérations : action des agences, des fonds et programme, rôle politique (médiation et bons offices), mise en place d’un régime de sanctions, articulation avec les mécanismes relevant de la justice pénale internationale.
4./ Articulation des trois types de forces
Ainsi, compte tenu des faiblesses des forces africaines et de la complexité qui préside au déploiement des forces multinationales, la France est vue par la plupart des autorités africaines comme un acteur pour l’heure incontournable dans la gestion de crises du type de celle de 2013 au Mali, et le séquencement de la gestion d’une crise dans une zone d’intérêt prioritaire pour la France pourrait être résumé dans les termes suivants : réactivité et passage de relais. Dans cette optique, la logique de nos interventions en Afrique semble devoir être la suivante :
– appui aux forces locales pour la gestion des pics de crise, grâce à la réactivité que nous offrent nos prépositionnements et notre « boucle décisionnelle courte » en matière de projection des forces ;
– internationalisation de l’intervention le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour combler nos propres lacunes (ravitaillement en vol, transport stratégique, transport tactique), mais également pour couvrir l’action française d’une légitimité moins contestable ;
– passage de relais à une force internationale, la France n’intervenant plus qu’en appui de cette force ou pour des actions très ciblées (comme celles des forces spéciales ou les opérations ponctuelles de destruction de groupes armés menées aujourd’hui par Serval).
Comme le directeur de l’Afrique et de l’océan Indien du ministère des Affaires étrangères l’a relevé, certaines armées africaines sont à même de prendre le relais des forces françaises dans la gestion des crises : les Rwandais et les Burundais, par exemple, sont particulièrement aguerris et les Tchadiens ont fait la preuve de leur valeur militaire aux côtés des Français dans l’Adrar des Ifoghas. De plus, selon lui, les Africains ont un « seuil de tolérance plus élevé que nous aux pertes humaines » : on fait état de 2 000 Ougandais et Burundais tués en Somalie, sans que cela remette en cause l’engagement des pays concernés.
ii. Le cadre d’action pratique : une recherche pragmatique d’effets de levier au moyen de partenariats
Devant les rapporteurs, le chef d’état-major des armées a souligné que les déploiements français en Afrique tiraient une part de leur efficacité des partenariats noués avec d’autres puissances. Il a cité en exemple la coopération franco-américaine relative aux capacités ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), la coopération avec l’Algérie pour « verrouiller » le Nord-Ouest de la bande sahélo-saharienne, ou encore, dans le cadre du partenariat institué par les traités de Lancaster House, les coopérations possibles avec le Royaume-Uni, dont un volume significatif de forces et de capacités pourra être redéployé avec le retrait britannique d’Afghanistan.
Le chef d’état-major des armées a jugé qu’il fallait « aller plus loin » dans cette logique de partenariat, non seulement sur le plan militaire mais aussi dans les aspects économiques et politiques de la gestion des crises.
Il a souligné surtout que c’est avant tout le « pragmatisme » qui commande de nouer de tels liens. En effet, dans une période de forte contrainte pesant sur le budget de la Défense, les interventions françaises doivent être menées dans un constant souci d’optimisation des moyens. Or, si certaines coopérations n’ont pas permis de réaliser les économies escomptées – il suffit pour s’en convaincre de se rappeler le cas de l’A400M –, il y a des gisements d’économies conséquents à exploiter dans les partenariats que la France peut nouer sur une base bilatérale, sur une base multilatérale au périmètre de circonstance, ou dans le cadre d’organisations internationales telles que l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine ou ses sous-régions.
Le général Pierre de Villiers a précisé aux rapporteurs que cette approche valait tant pour les opérations extérieures que pour les déploiements permanents.
b. Des partenaires européens à sensibiliser plus en amont aux enjeux de la sécurité en Afrique
S’il y a un cadre dans lequel la France a vocation à nouer des partenariats, c’est celui de l’Union européenne. En effet, les menaces provenant du continent africain ne concernent pas seulement la France, mais bien l’Europe entière, pour laquelle le traité de Lisbonne a ouvert la voie à la construction d’une véritable Europe de la défense, même si les atermoiements européens dans la gestion de la crise centrafricaine montrent bien le caractère très inachevé de cette construction.
L’implication très limitée de l’Union européenne dans la gestion des crises africaines peut s’expliquer par deux fragilités dans les procédures qui encadrent la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune :
– un processus décisionnel européen qui repose in fine sur la volonté des États membres, sur leurs capacités militaires et financières, et sur leur degré de conscience des enjeux liés à la sécurité de l’Afrique ;
– des règles relatives à la politique européenne de coopération qui interdisent notamment de financer des équipements ayant une possible utilisation militaire.
De surcroît, selon le directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques, dans une grande part des États-membres, les ministères chargés de la Défense et des Affaires étrangères ont des moyens trop limités pour ne pas se focaliser sur les menaces prioritaires ; or l’Afrique leur semble éloignée de leurs préoccupations et la France leur paraît s’en occuper, tandis que leur attention est focalisée sur la résurgence qu’ils perçoivent d’une menace russe conventionnelle.
L’atonie européenne s’explique également par le fait que les budgets de défense sont partout limités, ce qui fait peser des contraintes importantes sur les capacités militaires des Européens. Ainsi, selon M. Philippe Errera, si les Espagnols partagent notre analyse sur les risques liés à l’Afrique, le seul apport d’un C130 Hercules pour faciliter les liaisons intrathéâtre de l’opération Sangaris représente déjà une part très conséquente de leurs capacités en matière de transport tactique aérien.
i. Un défi difficile à relever, compte tenu du faible enthousiasme des Européens à prendre toutes leurs responsabilités en Afrique
• Une réticence de l’Union européenne et des Européens à s’engager militairement en Afrique
L’amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense, a estimé que c’est seulement très récemment que l’Union européenne, active depuis plusieurs décennies en matière d’aide au développement, a commencé à tenir compte du fait qu’il y a un continuum entre sécurité et développement. Et encore, selon l’amiral, cette prise de conscience reste inégale d’un service à un autre de la Commission européenne.
D’ailleurs, même lorsqu’ils ont fourni un appui fourni aux dernières opérations françaises en Afrique, les Européens l’on fait de préférence sur la base d’arrangements bilatéraux plutôt qu’en utilisant les outils prévus par le traité de Lisbonne ou développés dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Ainsi, le chef d’état-major de l’armée de l’air a indiqué que l’appui aérien fourni par les Européens aux forces Serval et Sangaris n’avait pas été organisé par l’EATC (European Air Transport Command), qui se concentre sur les liaisons aériennes « interthéâtre », représentant peu de volume d’activité en cours d’opération, et non sur les liaisons « intrathéâtre ». Toutefois, l’aide apportée à la France par ses partenaires européens en la matière est parfois assortie de caveats : tel est notamment le cas des capacités fournies par les Allemands, qui, selon le général Denis Mercier, étaient très contraints pour transporter du matériel purement militaire.
Pour le directeur de la coopération de sécurité et de défense, les services de l’Union européenne ont parfois tendance à aborder les problèmes africains avec « une vision conceptuelle trop rigide », voire un « manque de pragmatisme ». D’ailleurs, la complexité qui caractérise la mise en œuvre de certaines politiques européennes se retrouve en matière de coopération. Ainsi, selon l’amiral, la Commission a dû commanditer récemment un audit pour faire le point sur ses propres programmes d’aide en matière d’action de l’État en mer.
Le jugement porté par la plupart des observateurs sur la politique européenne de coopération est assez défavorable, en raison notamment d’une excessive complexité des procédures, voire d’une certaine rigidité dans leur application. L’amiral Marin Gillier a cité en exemple les difficultés rencontrées dans le soutien au Centre de formation au déminage humanitaire (CPADD) du Bénin, qui fonctionne sur un mode comparable à celui d’une école nationale à vocation régionale et dont l’activité consiste à former des stagiaires aux techniques du déminage humanitaire en aval des conflits. L’Union européenne a accepté de soutenir l’initiative, mais sous deux conditions :
– que ses fonds transitent par la CEDEAO, et non par la France, qui soutient elle aussi le fonctionnement de cette école ;
– que les fonds ne soient définitivement engagés que lorsque la CEDEAO aura mis en œuvre des procédures financières agréées par l’Union.
Or, pour certains détails de contrôle de gestion, les fonds européens sont bloqués, ce qui selon l’amiral, compromet gravement le fonctionnement et même l’avenir de cette école. C’est là selon lui un effet pervers des règles européennes de bonne gestion : elles ne permettent pas la souplesse nécessaire dans le travail sur le continent africain, alors même qu’en l’espèce, les risques de mauvaise gestion étaient d’autant plus limités que gestion financière de l’école est assurée par un coopérant français…
• Une prise de conscience encore timide des enjeux africains
Le directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques a déclaré aux rapporteurs que si la position des Européens dans les crises malienne et centrafricaine peut nourrir des « frustrations », avec du recul, « on observe une disponibilité politique croissante des Européens pour aller sur le terrain en Afrique sub-saharienne ». Ainsi, dans la mise en œuvre de l’opération Artemis en 2003 en RDC, il avait fallu que le président de la République française entreprenne des démarches insistantes auprès du chancelier allemand pour obtenir de lui un apport ponctuel et limité d’effectifs allemands. Or aujourd’hui, la mission EUTM Mali compte davantage d’Allemands que de Français. De même, 400 Néerlandais vont intégrer la MINUSMA : cet apport de capacités est utile, et s’il est certes regrettable qu’il ne soit pas placé sous la bannière de l’Union européenne, cette contribution significative témoigne déjà d’une prise de conscience nouvelle.
ii. Un défi indispensable à relever compte tenu des moyens (notamment financiers) qu’il est possible de mobiliser par le biais de l’Union européenne
Pour le général Denis Mercier, l’expérience montre que l’Union européenne « ne se mobilise que s’il y a un effet d’entraînement », avec un leadership affirmé, et si les démarches procèdent d’une « démarche bottom-up » - le général a mis en avant le fait que c’est suivant une telle démarche que l’EATC a été créé, estimant que les choses auraient été plus compliquées si un tel projet avait été initié « par le haut ».
C’est pourquoi, comme le directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques l’a fait valoir aux rapporteurs, la France doit ainsi « continuer son travail de sensibilisation et d’échange » d’analyses et de renseignement avec les Européens. Pour nombre de pays, les retombées sécuritaires de la déstabilisation de la zone « Sud-Méditerranée » sont de plus en plus visibles, ne serait-ce que pour ce qui concerne l’immigration illégale et les trafics.
Pour M. Philippe Errera, il faut aussi que la France « montre qu’elle voit les menaces pour l’Europe de façon globale ». Il est bon à cet égard que la France ait été dans les premiers États-membres à proposer un renfort des « mesures de réassurance » envers les États baltes : cela rend justifiable et audible pour ces pays la demande qu’on leur adresse « de prendre des risques et de mettre des troupes sur des théâtres qui sont importants pour nous ». Il est d’ailleurs à noter que l’Estonie vient de décider l’envoi de soldats en Afrique, le ministre estonien des Affaires étrangères invoquant pour soutenir cette décision la solidarité dont fait preuve la France face à la Russie.
2. La présence et les interventions militaires de la France gagneraient à s’inscrire dans une approche plus globale, plus cohérente et mieux assumée d’une véritable politique africaine
Comme l’a déclaré aux rapporteurs le général Jacques Norlain, « réfléchir sur le dispositif militaire en Afrique, c’est réfléchir sur la politique africaine de la France ». Or, selon lui, ce dispositif a évolué sans que la doctrine française évolue explicitement : faute de consensus, les difficultés du moment ont été tranchées sans vision claire de l’adéquation de nos moyens et de nos ambitions en Afrique.
Dans le même ordre d’idées, le chef d’état-major des armées a souligné que notre dispositif militaire en Afrique n’avait fait l’objet de réorganisations que pour des raisons budgétaires, à l’exception de la réorganisation des commandements opérée en 2004 pour adapter les zones de responsabilité principale des forces françaises au découpage sous-régional de l’Afrique au titre de l’architecture africaine de paix et de sécurité.
Le professeur Jean-François Bayart a estimé que si l’on observe la politique africaine de la France depuis les années 1950, on constate que celle-ci a « perdu en cohérence », notamment à partir des années 1980, où les restrictions apportées à la circulation des personnes et la dévaluation puis la remise en cause de la convertibilité manuelle du franc CFA ont freiné les mécanismes d’intégration économique et culturelle mis en place en amont même des indépendances. Ainsi, pour lui, « stigmatiser la Françafrique, c’est un anachronisme, voire un contresens » ; il y voit une rémanence dans nos représentations.
a. Assurer le « service après-vente » des interventions, en développant une doctrine cohérente intégrant toutes les phases d’une crise : détection/intervention/stabilisation/normalisation
Le Livre blanc de 2013 explique que « la consolidation d’États fragiles ou le rétablissement de leur stabilité requièrent la mise en œuvre d’un ensemble d’actions complémentaires et cohérentes dans tous les domaines. Une coordination accrue est nécessaire dans le cadre d’une approche globale interministérielle et multilatérale, afin d’optimiser l’emploi de moyens comptés ». Il en conclut qu’« une capacité crédible de prévention et de gestion civilo-militaire des crises s’impose dans notre stratégie de défense et de sécurité nationale ».
L’enchaînement classique de la gestion d’une crise pourrait être résumé, schématiquement, en quatre phases : identification, intervention, stabilisation et normalisation. Les déplacements des rapporteurs au Mali et en République centrafricaine ont permis de recueillir d’utiles retours d’expérience concernant la façon dont les facteurs de crise peuvent être identifiés, les voies et moyens d’une intervention extérieure dans une crise africaine, ainsi que les conditions de stabilisation d’un pays après une crise.
i. Intervenir suffisamment tôt : détecter précocement les crises
Comme l’a relevé le général Jacques Norlain, les lenteurs des organisations internationales et les réticences françaises à intervenir « en autonome » ont pour conséquence que « les actions au début de la crise sont devenues pratiquement impossibles », alors même que plus le traitement d’une crise est précoce, moins ses conséquences sont graves pour la population qui la subit et moins le coût en est élevé pour le ou les pays qui la traitent.
Rappelons que le Livre blanc indique que la France doit se réserver la possibilité de mener des « opérations conduites de façon autonome, dont des évacuations de ressortissants français ou européens, des actions de contre-terrorisme ou de riposte ». Il précise également que « l’évolution du contexte stratégique pourrait amener notre pays à devoir prendre l’initiative d’opérations, ou à assumer, plus souvent que par le passé, une part substantielle des responsabilités impliquées par la conduite de l’action militaire ».
ii. Savoir passer de l’intervention à la stabilisation : le contre-exemple de la Libye, l’enjeu de Serval et de Sangaris
À l’instar du chef d’état-major des armées, tous les interlocuteurs des rapporteurs se sont accordés à considérer que l’instabilité de la Libye constituait un facteur majeur de déstabilisation de l’ensemble de la bande sahélo-saharienne. Pour le général Pierre de Villiers, « il n’y aura pas de solution aux problèmes d’insécurité dans la bande sahélo-saharienne sans solution du problème libyen ».
Le cas de la Libye tend ainsi à montrer qu’après une intervention, même couronnée de succès au vu des objectifs fixés, un effort de stabilisation du théâtre est indispensable. C’est là le sens des efforts consentis par la France pour maintenir dans la durée des forces de stabilisation au Mali et en République centrafricaine, que ce soit sous sa bannière ou, de préférence, sous celle de l’ONU.
iii. De la stabilisation à la normalisation, savoir gérer les difficultés rencontrées en « sortie de crise » : le cas de la Côte d’Ivoire
Leur déplacement en Côte d’Ivoire a permis aux rapporteurs de mesurer les difficultés qu’il y a à passer de la phase de stabilisation d’une situation de crise à la phase de normalisation de la vie sociale et politique après ladite crise.
À cet égard, il ressort de leurs entretiens avec les responsables militaires français de l’opération Licorne que si la crise post-électorale ivoirienne peut être considérée comme terminée – le président Alassane Dramane Ouattara s’étant imposé, et l’opposition gbagbiste semblant aujourd’hui très affaiblie – la situation sécuritaire n’est pas encore vue comme « normalisée ». La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou, a ainsi informé les rapporteurs de quelques attaques – de plus en plus rares – et de quelques mouvements d’hommes armés enregistrés près de la frontière du pays avec le Liberia. Surtout, pour le commandement de la force Licorne, le retour à la normale demande plus de temps que prévu, et le pays est encore « divisé par les conséquences des adversités passées ». Trois fragilités principales sont identifiées :
– une fragilité politique : la normalisation suppose la tenue d’élections libres, non contestées et tenues dans un climat serein. De ce point de vue, le problème récurrent des critères de nationalité dans le code électoral pourrait engendrer de nouveau des tensions (22), et la réélection du président ne saurait être perçue comme tout à fait légitime que si une véritable opposition parvient à émerger ;
– une fragilité sociale : si l’économie ivoirienne a connu un rebond avec la stabilisation du pays – la croissance atteignant 8 % par an environ –, les mécanismes de répartition des richesses ainsi créées restent très limités : les contrastes sociaux qui en résultent pourraient se traduire par des mouvements de mécontentement de nature à déstabiliser tout ou partie du pays ;
– une fragilité dans la reconstruction des forces de sécurité : le dispositif de désarmement – démobilisation - réintégration (DDR) mis en œuvre a suscité des effets d’aubaine, et si les anciennes forces belligérantes sont en voie d’être « ressoudées » avec l’intégration d’une part importante des anciens combattants dans les forces armées et dans les forces de sécurité civile, les coopérants militaires français estiment que ces forces ont encore besoin de réformes de fond pour être opérationnelles. L’accent doit selon eux être mis sur la formation des personnels, afin de « professionnaliser » ceux qui étaient des combattants plutôt que des soldats. En outre, tant que l’embargo établi par l’ONU sur les armes à destination de la Côte d’Ivoire n’est ni levé ni assoupli, il reste difficile d’équiper de façon satisfaisante les forces ivoiriennes.
b. Développer la connaissance de l’Afrique et les liens de solidarité
Comme l’a souligné le directeur chargé de la délégation aux affaires stratégiques, toutes ces menaces supposent un « investissement en connaissance et en anticipation ». Cet investissement peut prendre plusieurs formes.
i. Entretenir les savoirs et les savoir-faire de personnels de la Défense « accoutumés » à l’Afrique
• Une culture et des savoirs traditionnellement possédés par les troupes de marine
Lors de son audition, le général Jacques Norlain a insisté sur l’intérêt pour la France d’« entretenir les savoirs » concernant l’Afrique au sein de ses forces. Soulignant que « la réussite de la coopération repose sur la qualité des hommes, elle exige des compétences et un sens du relationnel développé », il plaide en faveur de processus de formation et de procédures d’affectation qui permettraient de conforter la spécialisation des troupes de marine dans la connaissance du milieu africain.
• La question de l’armement des forces déployées en Afrique, entre personnels « permanents » et personnels « tournants »
1./ Le dispositif actuel
Les forces françaises prépositionnées en Afrique sont armées par deux catégories de personnels :
– des personnels dits « permanents », en « mission de longue durée » (MLD), c’est-à-dire affectés à un poste pour trois ans ;
– des personnels dits « tournants », en « mission de courte durée » (MCD), c’est-à-dire relevés tous les quatre mois.
Par ailleurs, pour certaines fonctions nécessitant une plus grande continuité dans la tenue des postes (renseignement, commandement, etc.), le rythme de rotation peut être adapté en fonction des exigences du théâtre. Ainsi, certains postes à responsabilité (comme ceux de commandants de force en opération extérieure) s’exercent généralement pour un an.
2./ Avantages et inconvénients des MCD et des MLD
Le maintien, au sein de chaque unité prépositionnée, d’un noyau de personnel en mission longue durée (MLD), essentiellement centré sur les fonctions de commandement et de soutien, permet d’assurer une certaine permanence et de capitaliser ainsi une expérience et des contacts locaux que seul le temps permet d’acquérir.
Quant au système de rotation quadrimestriel en Afrique, l’état-major de l’armée de terre juge qu’il est « désormais éprouvé et présente un compromis très satisfaisant en termes de coût global, d’entraînement à la projection et d’aguerrissement ». Le recours à des MCD a en effet plusieurs avantages :
– il permet d’offrir au plus grand nombre les atouts de préparation opérationnelle des sites concernés, qui sont souvent comparables aux théâtres spécifiques d’engagement probables (désert, savane, forêt équatoriale) : adaptation au milieu, aguerrissement, cadre interarmes voire interarmées, culture de projection, cohésion ;
– cette durée permet de disposer de forces acclimatées, aguerries et réactives comme l’a montré l’engagement de forces de présence dans les opérations Serval et Sangaris ;
– il contribue à la polyvalence des unités, gage de l’aptitude de l’armée de terre à remplir son contrat opérationnel, compte tenu du volume de forces projetables ;
– la durée de quatre mois est adaptée aux climats éprouvants et aux opérations à fort niveau de stress lié à l’intensité des combats : cette durée de mandat offre le meilleur compromis entre le temps nécessaire à l’appropriation de la mission et du terrain d’une part et l’usure de la troupe d’autre part ;
– il est relativement peu coûteux : le coût salarial total pour un personnel en MCD est inférieur de moitié à celui d’un personnel en MLD, et ces écarts sont plus prononcés encore si l’on intègre dans ce calcul les coûts de fonctionnement et les frais afférents aux activités des personnels.
Le recours au MCD présente en revanche certains inconvénients :
– une faible insertion dans l’environnement local ;
– une augmentation de l’absentéisme et de la contrainte sur les familles ;
– une usure accrue des matériels.
3./ Le ratio MCD/MLD : où « placer le curseur » ?
Selon l’état-major de l’armée de terre, le Royaume-Uni a fait le choix d’affecter dans ses points d’appui des bataillons complets en MLD, avec les familles. Elle ne pratique le système des MCD qu’en opération extérieure. Les États-Unis arment leurs points d’appui par des MLD et leurs forces en MCD.
En France, à des fins d’économies, la tendance est à la réduction du nombre de postes de permanents. Ainsi, le ratio MLD/MCD pour l’armée de terre s’établissait en 2008 à 45/55, et s’établit désormais à 30/70. L’armée de terre fait valoir qu’elle « pourra difficilement aller au-delà de ce ratio sans mettre en danger la capacité des unités et la maîtrise du milieu », soulignant que des trois armées, elle possède le plus fort taux de « tournants ». Le chef d’état-major de l’armée de terre a ainsi déclaré aux rapporteurs : « pousser encore plus loin cette logique affaiblirait, pour des gains marginaux, l’efficacité opérationnelle des unités qui repose, pour bonne part, sur la connaissance de l’environnement humain ».
ii. Entretenir plus largement, une connaissance des sociétés et des systèmes politiques africains
Lors de son audition par les rapporteurs, le professeur Bertrand Badie a énuméré les « mirages » qui ont pu tromper à plusieurs reprises les diplomaties occidentales lorsqu’elles ont été confrontées aux crises africaines contemporaines.
1./ Le mirage du règlement militaire des crises
Les Européens se sentent obligés d’intervenir. Mais ils se heurtent souvent à un problème : « la société guerrière est une sorte de monstre que seule la guerre alimente : l’intervention militaire ne suffit pas ».
De plus, les sociétés guerrières produisent une classe politique qui a « des intérêts très particuliers, des rationalités très différentes » : soit une « rationalité de chef de guerre », ou une rationalité « de chef d’État qui entend se construire hors du paradigme de l’État (qui n’existe pas) et du contrat social (qui n’existe pas plus) ». Il faut donc se méfier de l’argument qui consiste à dire qu’il y a des souhaits de chefs d’État africains, ou des volontés politiques affirmées.
Lorsque la guerre est le produit d’une « pathologie sociale », elle appelle un traitement social et pas seulement un traitement militaire, qui peut s’avérer contre-productif (avec un risque de « retour de bâton »).
2./ Le mirage d’une politique africaine fondée sur un système d’échange de bons procédés
On prétend parfois que traiter avec ces chefs d’État serait un moyen de les contrôler : l’aide militaire de l’ancienne puissance tutélaire reviendrait à toucher un centre du système décisionnel. Les faits permettent de douter de la viabilité de ces procédés, qui reviennent en fait à renforcer des fauteurs de troubles.
3./ Le mirage de la construction d’un État dans une société guerrière
Une société guerrière est structurée en organisations de type « milices ». « Les milices ont une dimension sociale importante : elles assurent une protection à une population, et donnent un statut à des individus. » Mais leur moteur consiste à rentabiliser la détresse d’une population en « demande sociale de violence » : les milices deviennent vite des « entrepreneurs de violences », répondant à une demande sociale de violence – cf. AQMI, Mujao, LRA, anti-balakas, etc. L’enjeu est alors de tarir la demande sociale de violence.
Il y a une grande différence entre un État à l’européenne et une milice : un État a toujours intérêt à terminer la guerre, une milice jamais : elle perd alors toute raison d’être. D’ailleurs, la notion de victoire au sens clausewitzien est absente des conflits internes africains : « 87 % des guerres de ce type n’ont ni vainqueur ni vaincu » ; la guerre finit par extinction, épuisement des combattants, mais ne débouche que sur des paix fragiles (comme c’est le cas en Sierra Leone et au Liberia).
Il existe certes des contre-exemples (tel le Mozambique, où le chef de la mission de l’ONU a réussi un bon programme de DDR), mais souvent, le feu reprend rapidement.
On peut dès lors se poser la question de savoir si le discours, souvent tenu par des chefs d’État africains, sur leur volonté de reconstruire un État est factice ou non. Pour le professeur Bertrand Badie, les positions du président malien Ibrahim Boubacar Keita, « qui brouille le jeu en tournant le dos à la médiation burkinabè et en faisant entrer dans le jeu politique malien des facilitateurs aussi mal accordés que le Maroc et l’Algérie, peut le faire craindre ». D’autres cas sont plus nets, tel celui de Joseph Kabila au Congo, « qui ne semble concevoir sa survie politique que par la mise en pratique de la société de guerre. »
4./ Le mirage de la pacification sans construction d’une paix sociale
« On a mis une charge un peu naïve derrière la notion de pacification : il n’y a pas de véritable pacification sans paix sociale ». Le jeu politique se joue dès lors avec les ressources locales, c’est-à-dire celles de la société guerrière.
À très court terme, des interventions extérieures comme Serval sont « salutaires et efficaces », mais elles « ne règlent les problèmes que très temporairement ».
5./ Le mirage d’une conception de la guerre à la Carl Schmitt
La conception schmittienne de la guerre (fondée sur l’idée de frontalité, d’ennemis) est inadaptée à l’Afrique, au moins à deux titres :
– il s’agit de guerres sans batailles, ou presque : les groupes armés fuient dès que les armées occidentales arrivent, comme le montre par exemple la prise des villes du nord du Mali sans combats, ou presque ;
– la distinction amis/ennemis y est brouillée. Ainsi, le président tchadien Idriss Déby, selon le professeur Bertrand Badie, « soutenait des djihadistes opposants du président soudanais El-Béchir, puis en a combattus au Mali, pour enfin en récupérer et les intégrer dans la Séléka ».
c. Entretenir des liens institutionnels avec les forces de sécurité africaines
Il ressort des travaux des rapporteurs que les Africains sont relativement sous-représentés parmi les bénéficiaires de programmes français d’accueil de « personnalités d’avenir » :
– le programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA) piloté par le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères ;
– le programme d’influence « Personnalités d’avenir de la défense » géré par la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense.
Compte tenu du fait que nos capacités d’accueil d’élèves africains dans nos écoles de formation militaire tendent à se réduire, il pourrait être judicieux d’utiliser ces outils pour continuer à « investir » sur les futurs cadres dirigeants du continent africain.
d. Mettre sans complexe en cohérence l’ensemble des outils de la coopération et de l’influence
Coopération militaire, diplomatie économie, aide au développement et influence culturelle ne sont pas à opposer. Ainsi que l’a fait l’amiral Marin Gillier, directeur de la coopération de sécurité et de défense, les buts poursuivis par la France au moyen de son dispositif africain sont complémentaires :
– lutter contre le terrorisme (c’est-à-dire éviter que ne se constituent des sanctuaires terroristes) ;
– lutter contre les grands trafics transfrontaliers (drogue, êtres humains, etc.) : « ce sont les intérêts objectifs de la France, qui constituent autant de raisons légitimes pour qu’elle intervienne » ;
– aider ces États à se structurer : c’est là la vocation universaliste de la France, dont la coopération est une des formes actuelles ;
– mais également défendre la place et l’influence de la France, que ce soit du point de vue économique, culturel, linguistique, etc. : « il n’y a aucune raison de se laisser déloger par d’autres ».
Les rapporteurs partagent pleinement les vues de l’amiral : il existe pour eux un continuum très clair entre toutes les formes d’influence, et il n’y a pas de raison que la France, par une pudeur que ses rivaux n’ont pas, s’interdise de les exploiter dans une optique de partenariat, c’est-à-dire suivant une logique « gagnant-gagnant ».
L’accent mis sur la diplomatie économique, la vigilance des ambassadeurs sur la concurrence pour les parts de marché dans des pays où la France est intervenue – et a perdu des hommes – pour assurer leur stabilité, la défense de la francophonie constitue un tout, et il faut l’assumer.
Si la France ne met pas ses atouts à profit, d’autres puissances la supplanteront en influence sur le continent africain.
La Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours au cours de sa réunion du mercredi 9 juillet 2014.
Mme la présidente Patricia Adam. Nous examinons aujourd’hui le rapport de nos collègues Yves Fromion et Gwendal Rouillard en conclusion de la mission d’information sur l’évolution du dispositif militaire en Afrique et le suivi des opérations extérieures (OPEX) en cours. Leurs travaux les ont conduits dans plusieurs pays d’Afrique, et jusqu’aux Émirats arabes unis. J’ai moi-même participé à l’un de vos déplacements, particulièrement intéressant, au mois de mars. Ce rapport est particulièrement riche, non seulement parce qu’il fait la somme d’un grand nombre d’expériences, mais aussi parce qu’il intervient au moment où un certain nombre de décisions ne sont pas totalement prises. Il pourra donc être lu avec attention dans cette optique.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Le rapport que nous avons l’honneur de vous présenter aujourd’hui, mon cher collègue Yves Fromion et moi-même, vient conclure cinq mois de travaux que l’on peut, pour le moins, qualifier d’intenses.
Nous nous sommes en effet attachés à mener une étude vraiment approfondie du vaste champ d’investigation que vous nous avez confié : l’évolution de notre dispositif militaire en Afrique et le suivi des opérations extérieures en cours, à savoir Serval et Sangaris. Cet exercice de contrôle parlementaire méritait d’être mené d’autant plus sérieusement que nous n’arrivions pas, si je puis le dire ainsi, en « inspecteurs des travaux finis ». Et ce, d’une part, concernant les OPEX, parce que Serval et Sangaris ne sont pas terminées : dans un cas comme dans l’autre, les conditions d’un retrait sont loin d’être réunies à ce jour, et nous y reviendrons. Et d’autre part, concernant la grande manœuvre de restructuration de nos prépositionnements en Afrique, parce qu’elle est encore en cours : c’est donc en quelque sorte du contrôle parlementaire « en temps réel » que nous avons effectué. Et à cet égard, nous avons, je crois, certains messages à faire passer : il s’agit notamment de tirer la sonnette d’alarme concernant la déflation prévue à Djibouti, et là encore, nous y reviendrons.
Sans prétendre épuiser un sujet aussi complexe que l’Afrique, nous nous sommes quand même attachés à faire tout ce qui était en notre mesure pour en « faire le tour ». Nous avons bien sûr entendu, en audition, tous les responsables français concernés, militaires ou diplomates. Nous avons aussi cherché à croiser les regards, en entendant d’anciens responsables – parfois plus libres dans leurs propos – ainsi que des sociologues, des chercheurs spécialisés dans l’analyse des confits ou de l’Afrique. Bref, des discussions « tous azimuts ».
M. Yves Fromion, rapporteur. Nous sommes aussi allés sur le terrain, dans dix pays d’Afrique où notre empreinte militaire est significative : le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, les Émirats arabes unis, où notre base s’inscrit dans la cinématique générale de l’Afrique dans la bascule générale des moyens et fonctionne en quelque sorte « en vases communicants » avec notre dernière destination d’étude : Djibouti. Et quand je dis : sur le terrain, c’est que nous ne sommes pas restés barricadés dans des hôtels, des ambassades et des palais présidentiels ; nous sommes allés au plus près de nos militaires, partager leurs rations, partager leur hébergement, voir les sites d’entraînement ou d’opérations. En Centrafrique comme au Mali, au Tchad comme au Gabon, nous avons tenu à sortir des capitales quelles qu’aient été les réticences, pour aller dans le Nord du Mali et dans l’Est de la RCA, sur les centres d’aguerrissement à la forêt équatoriale ou sur les zones d’opérations tripartites dans les déserts du Nord du Tchad. Il n’a pas toujours été facile d’obtenir que les rapporteurs puissent aller le plus possible au contact de nos militaires, sur le terrain. Il y avait parfois de bonnes raisons : par exemple, la situation du Nord du Mali ne nous a pas permis de nous rendre à Tessalit ; dans d’autres cas, il a fallu être plus insistants. À chacun de nos déplacements, nous n’avons pas fait seulement la « tournée des popotes » : nous nous sommes attachés à comprendre les enjeux stratégiques dans lesquels entre la France quand elle s’implante ou s’engage militairement, en parlant directement aux plus hautes autorités civiles et militaires des nations hôtes. Nous nous sommes aussi intéressés à deux autres aspects de la présence française au sens large. D’une part, les retombées économiques de notre engagement militaire. N’ayons aucune pudeur à le dire : quand des Français ont versé leur sang pour préserver un pays de la guerre civile voire du djihadisme international, il y a quelque chose de troublant à voir qu’in fine, on « travaille pour le Roi de Prusse »… Et d’autre part, notre rayonnement global, c’est-à-dire l’ensemble des moyens d’influence par lesquels on peut faire en sorte qu’aujourd’hui encore et demain peut-être, la voix de la France, en Afrique, continue à porter un peu plus haut que celle d’autres puissances qui lorgnent sur les richesses et les intérêts stratégiques de ce continent.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Nous ne reprendrons pas ici tout ce qui est dans les 280 pages de notre rapport, et que vous pourrez lire très en détail dans les jours à venir. Nous nous concentrerons sur quelques points saillants.
D’abord, le suivi de l’opération Serval, au Mali. Nous ne reviendrons pas sur l’indéniable succès de la première phase de l’opération, la libération du Nord, qui a fait l’objet d’un excellent rapport de nos collègues Philippe Nauche et Christophe Guilloteau.
La situation, aujourd’hui, est loin d’être stabilisée, et la « déconvenue » – pour ne pas dire autre chose – des forces maliennes lors de l’aventureuse expédition qu’elles ont menée dans le Nord au mois de mai dernier, en dépit de toutes les mises en garde, suffit à le prouver. Notre force est engagée sur la voie d’un désengagement partiel, que les événements de mai nous ont forcé à suspendre. Ce qu’il reste de la force Serval a pour mandat, conformément aux résolutions de l’ONU, de se concentrer sur le haut du spectre des opérations, c’est-à-dire des opérations « coup de poing » contre les groupes armés rebelles, terroristes et djihadistes, dont notre rapport présente la « cosmogonie » ô combien complexe. La force s’est, pour ce faire, recentrée sur Gao : cette base que nous avons visitée se consolide, elle est située à la porte du Nord, mais il faut souligner que son fonctionnement repose sur ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler un « exploit logistique de tous les jours ». Les élongations, le climat, les faibles ressources locales et les menaces sur nos convois usent nos matériels… ainsi que nos femmes et nos hommes ! Il faut saluer l’endurance de nos soldats, qu’ils soient combattants ou logisticiens – nous avons en effet passé beaucoup de temps avec ces derniers, dont le rôle n’est pas toujours mis en lumière à sa juste valeur.
Nous avons encore 1 800 hommes au Mali ; quel est le scénario de sortie de crise ? Il est objectivement compliqué, pour deux raisons principales. La première, c’est que le « passage de relais » à d’autres forces paraît, pour le moins, compliqué. Les forces armées maliennes ? Leur reconstruction prendra du temps, surtout après leur défaite de mai dernier. La MINUSMA ? Nous avons pu observer sur le terrain les lenteurs et les lourdeurs de sa mise en place. Et de toute façon, une opération de maintien de la paix n’est ni conçue ni armée pour mener des actions d’antiterrorisme.
La deuxième raison, c’est que le dialogue intermalien, c’est-à-dire le processus de réconciliation entre Maliens, piétine. « À quelque chose malheur est bon » : avec la défaite des forces armées maliennes en mai, le Gouvernement malien n’a plus vraiment l’option de la force dans son jeu. Mais le risque n’est pas nul que certains préfèrent jouer le pourrissement, ou que comme trop souvent dans l’histoire du Mali, on se contente d’un arrangement politique si j’ose dire : « mal ficelé », qui débouche sur une paix fragile.
M. Yves Fromion, rapporteur. Conformément à notre mission de suivi des OPEX, nous avons aussi porté un regard attentif sur la RCA.
Les deux OPEX sont très différentes : au Mali, nous étions dans une logique de ligne de front, soutenant un État (présent au moins au Sud) contre un envahisseur. En RCA, l’ennemi est dans les deux camps : anti-balakas et ex-Séléka rivalisent de violence dans leurs exactions, de méfiance vis-à-vis de la force française et, il faut le dire, de confusion des genres entre lutte politique et banditisme avéré. L’intervention française a porté des coups sérieux aux ex-Séléka, mais ils restent forts dans leurs fiefs du Nord et de l’Est – notamment dans la « région des trois frontières » entre le Tchad, le Soudan et la RCA –, et si le mouvement se fragmente, la ligne radicale semble prendre le dessus. Quant aux anti-balakas, à défaut de véritable structure étatique, ce sont eux qui tiennent une large partie du pays, avec nombre de complicités dans ce qui est censé être la force publique et l’administration de l’État, et non sans être pour certains noyautés, voire instrumentalisés, par les partisans du président déchu François Bozizé. Dans les deux cas, la combativité et la résilience de l’ennemi ont été manifestement sous-estimées.
Sur le terrain, la force Sangaris a fait au mieux avec ce qu’elle avait : 2 000 hommes et peu d’appuis. L’armée centrafricaine n’est plus qu’une virtualité, et ni la police ni la gendarmerie nationales n’ont la moindre consistance en dehors de la capitale. Il n’y a plus d’État hors de Bangui. Quant à l’Europe, on touche le fond : la mission EUFOR-RCA n’a pas suscité l’enthousiasme de grand monde. Pour preuve : il a fallu six tours de génération de force pour constituer à peu près une mission de 800 personnels, et encore, la moitié d’entre eux sont fournis soit par la France, soit par des États qui ne sont pas membres de l’UE… Voilà ce qu’il reste de la virtualité européenne. Reste la MISCA, qui sera bientôt intégrée à la MINUSCA. Mais là encore, quels que soient le dévouement de ces soldats et l’implication politique de l’Union africaine, il faut être lucide : la MISCA est ce qu’elle est. Ses forces manquent cruellement de moyens de commandement et de projection. Le rôle ambigu du Tchad n’a rien facilité. Et les circuits financiers entre l’Union européenne – qui n’est pas un modèle de souplesse – et l’Union africaine - qui, inversement, n’est pas un modèle de rigueur - font que la MISCA n’est pas payée, et que tous les approvisionnements sont très compliqués. On mise donc beaucoup sur le déploiement, le 15 septembre, de la MINUSCA, qui aura également une composante civile chargée d’appuyer la RCA dans la reconstruction d’un État viable. Là encore, comme au Mali, le scénario de sortie d’OPEX est moins que clair. Depuis notre déplacement en RCA, la situation est toujours aussi tendue : autour de Bambari, où nous sommes allés, on assiste à des affrontements extrêmement violents. Or notre dispositif militaire y est extrême tendu, pour ne pas dire distendu. Ainsi, par exemple, nous n’avons à Bria, le principal centre de production diamantifère, que l’équivalent d’une section, alors qu’avec la saison des pluies, la mobilité des forces est considérablement réduite, ce qui place nos soldats dans des situations très inconfortables. Il faut saluer leur dévouement.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. D’ailleurs, l’expérience de nos OPEX en Afrique montre que l’on peut y être pour longtemps : Épervier, au Tchad, dure depuis 1986 et Licorne, en Côte d’Ivoire, depuis 2002… Rien d’étonnant à cela : pour résoudre une crise africaine -comme une crise en général, d’ailleurs - il ne suffit pas d’intervenir ponctuellement. Encore faut-il le faire assez tôt pour que la situation ne soit pas devenue inextricable, et encore faut-il en assurer le « service après-vente », c’est-à-dire passer de l’intervention à l’action de stabilisation – c’est là tout l’enjeu pour le Mali, et c’est là ce que l’on n’a pas fait assez tôt en Libye – puis passer de la stabilisation à la normalisation, ce qui prend de nombreuses années, comme le montre le cas de la Côte d’Ivoire. Un mot sur la Libye, sans intention polémique : beaucoup de nos interlocuteurs nous ont interpellés pour regretter que ce travail de stabilisation, puis de normalisation, n’ait pas été accompli.
M. Yves Fromion, rapporteur. Il convient néanmoins de souligner que l’intervention en Libye n’était pas une intervention française, mais internationale, et que le choix avait été fait, de façon délibérée, de ne pas « mettre les bottes sur le terrain » : on pensait alors, ce qui s’est avéré être une énorme erreur, que les révolutionnaires sauraient prendre et exercer le pouvoir.
Il faut en outre mentionner ici l’action de l’Union européenne. D’une part, elle a du mal à intervenir dans les crises : au Mali, il a fallu que la France mette tout son poids dans la balance pour obtenir un engagement de nos partenaires, et encore nombre d’entre eux se sont-ils fait attendre, et se font-ils pour certains toujours attendre… Mais en Centrafrique, il n’est pas exagéré de dire que l’on peut passer de la déception à la désolation : pour une opération tout à fait à la portée des Européens, personne ou presque ne répond à l’appel.
Mais ce n’est pas tout : même en matière de coopération, c’est-à-dire d’« approche globale », comme dit souvent Lady Ashton, l’Europe paraît bien souvent trop lourde, trop bureaucratique, trop éloignée des réalités du terrain africain. Elle multiplie les initiatives et dépense assez largement, surtout en zone anglophone d’ailleurs, sans toujours contrôler suffisamment le déroulement de ses programmes. Nous n’entrerons pas ici dans le détail des « histoires de chasse » que l’on peut collecter sur le terrain à propos des fonds européens : elles seraient plaisantes si ce n’était pas à la France qu’il revenait in fine de s’engager militairement, quand il le faut, pour protéger les populations ainsi que nos intérêts collectifs. Car, que l’on ne se leurre pas : qu’il s’agisse de trafics de drogue, de migrations clandestines, de trafics d’armes ou de sanctuaires djihadistes, ce qui menace la France menace l’Europe entière.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Cela nous conduit au second volet de notre mission : l’évolution de notre dispositif militaire en Afrique. Cela appelle avant tout une mise en garde : on lira, ici ou là, que la France a tant d’hommes en Afrique, tant d’hommes dans la bande sahélo-saharienne, etc. ; il faut savoir précisément ce que l’on compte.
Aujourd’hui, nous avons des effectifs prépositionnés à titre permanent, sous un statut ou sous un autre : 350 hommes à Dakar, notre point d’entrée historique en Afrique, 900 hommes à Libreville, 1 900 à Djibouti, 950 au Tchad et 450 en Côte d’Ivoire. On peut ajouter à cela les 745 hommes que nous avons à Abou-Dhabi, les 1 900 hommes que nous avons à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les 320, en moyenne, qui arment la mission Corymbe dans le Golfe de Guinée, où la France assure une permanence à la mer. Cela fait, en Afrique et autour de l’Afrique, 7 500 hommes environ. Mais prenons quelques précautions avant d’additionner les 1 800 hommes de Serval et les 2 000 de Sangaris : ces opérations sont appelées à rester ponctuelles, du moins dans leur forme actuelle.
En effet, la stabilisation de la bande sahélo-saharienne n’étant manifestement pas pour demain, il est prévu de « régionaliser » le dispositif militaire français dans cette zone. Cela revient en réalité à centraliser au Tchad le commandement des forces déployées à Gao, Niamey, N’Djamena et leurs bases « satellites » de Tessalit, Abéché et Faya-Largeau – où nous nous sommes rendus –, et contenir l’effectif de ce dispositif à 3 000 hommes. La détérioration de la situation au Mali a conduit à différer la manœuvre. Dans le fond, cette « régionalisation » est cohérente avec le caractère transfrontalier de la menace : celle-ci circule du Mali au Tchad, en passant par le Niger et en s’appuyant sur des sanctuaires en Libye.
M. Yves Fromion, rapporteur. Tout à fait. Le second volet de la réorganisation de nos forces concerne les forces prépositionnées, c’est-à-dire stationnées à titre permanent. Suivant les orientations du Livre blanc et de la LPM, le Gouvernement est en train de procéder à une vaste manœuvre de réorganisation de ce dispositif.
Ne nous racontons pas d’histoire : l’objectif principal de cette manœuvre, c’est de faire des économies, en réduisant le nombre de personnels déployés. L’idée est de la ramener de 3 800 à 3 300 pour les seules forces de présence – Dakar, Libreville, Djibouti, Abou-Dhabi.
Par ailleurs, la situation politique de la Côte d’Ivoire nous ouvre une opportunité qu’il faut savoir saisir pour y pérenniser notre implantation et profiter des grandes potentialités d’Abidjan.
Compte tenu de ces contraintes, le problème est alors de trouver le dispositif le plus cohérent. Celui qui est envisagé, et pas encore définitivement arbitré, l’est à une grande exception près : Djibouti.
Quelle est l’idée ? Il faut, pour la comprendre, bien saisir le fait que notre dispositif en Afrique est organisé autour de deux missions : les opérations et la coopération. Pour les opérations, nous disposons de deux réservoirs de forces, appelés « bases opérationnelles avancées » : l’un à l’est, c’est Djibouti. L’autre à l’ouest, c’est aujourd’hui Libreville. Pour la coopération, la précédente période de programmation avait créé un nouveau type de prépositionnement, plus léger que la base opérationnelle avancée : le « pôle opérationnel de coopération ». C’est la nouvelle vocation de Dakar, depuis 2010, et l’opération Serval a montré que cette formule permettait de développer nos liens de coopération, qui sont désormais la principale source de notre légitimité en Afrique – on n’en est plus à l’armée d’Afrique ! – sans perte de réactivité pour l’opérationnel. C’est bien l’état-major de Dakar qui a armé en urgence l’opération Serval.
L’idée qui sous-tend la manœuvre actuelle consiste ainsi à transférer de Libreville à Abidjan notre base opérationnelle avancée ouest-africaine, pour profiter des potentialités bien supérieures qu’offre cette dernière. On laisserait à Libreville un pôle opérationnel de coopération, construit sur le même mode que celui de Dakar. C’est une sorte de « révolution culturelle » pour une base française aussi bien intégrée dans le tissu local. Libreville passerait ainsi de 900 hommes à 350, tandis qu’on créerait ex nihilo une base permanente à Abidjan, armée par 950 personnels. Cette perspective n’est pas accueillie avec le sourire par nos partenaires gabonais, mais notre Gouvernement leur a fourni des explications.
Le problème est à l’est : c’est Djibouti. On a l’impression que Djibouti est la « variable d’ajustement » de ce dispositif : pour tenir dans « l’enveloppe » des 3 300 hommes, on propose de supprimer 1 000 postes à Djibouti, qui n’en aurait plus que 950.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Que l’on nous comprenne bien : il ne s’agit pas de refuser, par un réflexe défensif, tout changement pour ce qui concerne une de nos bases traditionnelles.
Mais il s’agit simplement d’une équation insoluble : faire la même chose avec deux fois moins d’hommes. Car le problème, à Djibouti, c’est que contrairement à Libreville, on réduit drastiquement les effectifs sans toucher au contrat opérationnel, ou du moins aux missions.
M. Yves Fromion, rapporteur. Et pour cause : ces missions, nous venons de les ratifier. Elles découlent en effet de notre traité de coopération en matière de défense, dont l’encre est à peine sèche. Djibouti est le dernier État africain avec lequel nous ayons encore une clause d’assistance : en termes clairs, nous assurons une large partie de la défense de Djibouti, en contrepartie des avantages que nous procure notre installation sur place. Et ce serait se bercer d’illusion que de penser que tout peut se faire depuis Abou-Dhabi ou par l’A400M : Abou-Dhabi est à près de trois heures de vol pour un chasseur, et nous n’avons pas pléthore de ravitailleurs en vol. Quant à l’A400M, la LPM est ainsi faite que nous n’aurons une flotte suffisante qu’en 2025…
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Il faut ajouter que l’on a très clairement intérêt à tenir Djibouti : c’est un point stratégique de premier ordre et il suffit pour s’en convaincre de voir que les Américains y renforcent leur base – nous l’avons vue –, que les Chinois négocient l’implantation d’une base et que les Russes cherchent également à le faire. Par ailleurs, les Italiens et les Japonais sont eux aussi présents : la position de Djibouti suscite toutes les convoitises. En outre, l’attentat du 24 mai dernier a bien montré que Djibouti et sa région – avec des voisins comme la Somalie ou l’Éthiopie – sont menacés, et avec eux tous nos intérêts dans ce couloir stratégique.
C’est pourquoi il nous paraît plus raisonnable, au moins dans un premier temps, de procéder autrement, et nous avons pu constater que le chef d’état-major des armées partage nos vues sur ce point. Plutôt que de partir du principe du « non-remplacement d’un militaire sur deux » à Djibouti, il s’agirait de s’appuyer sur une analyse pertinente des besoins et des ressources nécessaires. C’est ce qu’a fait l’état-major des Forces françaises stationnées à Djibouti, qui montre qu’il faut un minimum de 1 300 hommes pour rester crédible dans ce contexte géostratégique. Ils sont aujourd’hui 1 950 : le gain d’effectifs serait déjà substantiel. Et 350 hommes, c’est 1 % des déflations prévues d’ici 2019 ; autant dire qu’on est là « dans l’épaisseur du trait ».
Il convient d’ailleurs d’attirer l’attention sur l’actualité de ces derniers jours et de ces dernières heures dans la région. Elle est marquée par de violents affrontements entre des éléments d’Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA) et les forces saoudiennes, ainsi que par de nouveaux actes terroristes commis par les Chebabs au Kenya. Il faut bien prendre conscience de la gravité de la situation sécuritaire dans cette zone, et ne pas baisser la garde. La France a besoin de Djibouti, autant que Djibouti a besoin de la France.
M. Yves Fromion, rapporteur. Si l’effectif de nos forces à Djibouti devait être ramené à 950 hommes, il faudrait alors faire des choix irréversibles. Ces forces comprennent aujourd’hui, principalement, le 5e régiment interarmes d’outre-mer (RIAOM) et un détachement aérien armé de chasseurs Mirage. Or, à la différence du Rafale, le Mirage n’est pas polyvalent : aussi faut-il deux types de Mirage pour assurer les deux missions de ce détachement que sont la défense aérienne et l’appui au sol. Ainsi, sauf à sacrifier la composante terrestre du dispositif, le plafond de 950 hommes impose de renoncer à la capacité d’appui au sol pour la composante aérienne, car le maintien d’une capacité de défense aérienne découle du traité précité. Cela reviendrait à désarmer le dispositif français à Djibouti et à placer nos forces devant un dilemme intenable. Nous avons tous deux saisi de cette question le ministre de la Défense, ainsi que le chef d’état-major des armées. Il en ressort qu’une autre solution pourrait être trouvée. Nous militons donc pour le maintien d’une force de 1 300 hommes à Djibouti, ce point stratégique vers lequel se ruent d’autres puissances.
À titre personnel, j’aimerais conclure en évoquant trois points.
D’abord, je crois que ce qui se passe en Afrique est le révélateur de la situation de nos forces armées en général. C’est particulièrement frappant du point de vue des matériels et des équipements. La situation est extrêmement difficile. Depuis longtemps, les moyens ne suffisent même plus à maintenir le matériel à niveau : il est, pour une partie, en phase de délitement. Ce phénomène n’est pas très visible lorsque l’on se déplace auprès de nos forces en métropole, mais en Afrique, on est plongé dans la réalité de la vie militaire. On ne pourra pas laisser très longtemps nos matériels et nos équipements se déliter ainsi.
Ensuite, s’agissant des effectifs de nos forces, il faut souligner qu’ils sont déjà soumis à des tensions considérables. À l’évidence, la nouvelle réduction des effectifs, dans les conditions où elle est prévue, est fort peu opportune. Il faut se poser franchement la question de savoir ce que l’on veut pour nos forces armées, telles que l’on les voit en Afrique. Jusqu’à présent, on a joué sur les rotations des personnels, en privilégiant les personnels « tournants » plutôt que les personnels « permanents » à des fins d’économies. Mais ce système, poussé très loin, s’avère difficile à gérer, tant pour les commandants d’unités en Afrique que pour les commandants de leurs unités de rattachement en France.
Enfin, je tire de nos travaux le sentiment que le prépositionnement de nos forces a des avantages, mais aussi des inconvénients. Incontestablement, il constitue à certains égards un atout : en palliant en partie la faiblesse de nos moyens de projection stratégique, il donne de la réactivité à notre dispositif, et par l’existence d’installations d’entraînement variées ainsi que d’un système de relèves régulières, il contribue à l’aguerrissement de nos troupes. Il permet ainsi de mettre nos soldats en situation de combat, et ceux-ci suscitent l’admiration de nos grands alliés, à commencer par les Américains et les Britanniques. Mais ce système a également un inconvénient : il risque de nous entraîner dans des situations difficiles. En effet, personne ne pourrait comprendre que des soldats français restent barricadés dans leurs casernements quand un drame humanitaire se produit autour d’eux. Avec les prépositionnements, on perd une certaine capacité de recul, ce qui complique la gestion diplomatique des crises.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Je conclurai moi aussi par trois points.
Avant tout, je crois que la France fait les bons choix en ce qui concerne les structures et les organisations. En témoignent, par exemple, les complémentarités qui se développent entre la France et les pays africains en matière d’action de l’État en mer. Nos militaires le confirment : les progrès faits par les Africains en la matière sont notables, et la France a joué un rôle de premier plan dans cette évolution.
Deuxième point : nous avons observé, au gré de nos échanges avec les plus hautes autorités civiles et militaires africaines, une véritable prise de conscience du fait que la clé du développement, c’est en partie la défense et la sécurité, et qu’il faut désormais passer du discours aux actes. Les efforts consentis en ce sens par les États africains sont réels, que ce soit en matière de formation ou de développement capacitaire, et que ce soit au niveau national ou à l’échelle de l’Union africaine et de ses sous-régions. Bien entendu, ces efforts se heurtent à diverses limites, mais il appartient à la France de les soutenir. C’est dans cette optique nous nous avons consacré une large part de nos travaux à l’étude des dispositifs de coopération, parmi lesquels il faut citer le formidable outil que sont les écoles nationales à vocation régionale, qui forment chaque année des centaines d’officiers et de sous-officiers africains, avec l’appui de la France. C’est en soutenant de tels outils que notre dispositif militaire parvient à articuler de mieux en mieux ses deux missions principales : opérations et coopérations.
Enfin, il n’est pas de terme plus concret, plus vrai, pour vous dire le sentiment que m’inspirent nos militaires sur place que celui de fierté. Les femmes et les hommes de nos forces sont particulièrement impliqués, et il faut le saluer. Et à ceux qui me diraient qu’après tout, c’est là leur métier, je répondrais qu’ils l’exercent dans des conditions particulièrement difficiles. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler, par exemple, que lorsque nous sommes allés voir les légionnaires s’entraîner dans le désert émirien, il faisait près de 55 degrés à l’ombre.
Mme la présidente Patricia Adam. Je vous remercie pour la qualité de votre travail. Notre commission continuera à veiller de près sur l’évolution de notre dispositif en Afrique. Je tiens à vous remercier également d’avoir souligné la qualité des militaires français, qui est reconnue de tous. J’ai d’ailleurs pu constater, lorsque j’ai effectué un déplacement avec vous, qu’ils jouent un rôle de plus en plus important dans la formation des différents états-majors africains, au titre de leur mission de coopération. Et je crois que c’est une bonne chose qu’il y ait eu une prise de conscience de ce besoin de coopération en matière de formation.
M. Marc Laffineur. Je partage avec vous la fierté du travail de nos soldats sur place. Votre rapport est très sévère pour les décisions politiques prises par notre pays récemment. En Libye, nous sommes intervenus, avec nos alliés, au sein d’une coalition internationale, sans que nos soldats ne posent un pied sur le sol. En Afrique, je ne peux que regretter notre isolement. Nos soldats accomplissent certes un travail fantastique mais, au Mali, où nous nous étions rendus l’année dernière, nous avions pu constater par nous-mêmes, en visitant la structure européenne d’entraînement des forces armées maliennes, que l’armée malienne n’est pas prête à prendre le relais des Français. En Centrafrique, on constate qu’il est difficile de pacifier un pays sans se donner les moyens humains suffisants. Aujourd’hui notre action est donc celle d’un pays isolé, sans force politique.
Ma question porte sur nos forces à Djibouti : est-ce que les effectifs vont continuer de baisser ?
Mme la présidente Patricia Adam. Je vous rappelle que nous avons commencé à diminuer les effectifs à Djibouti lorsque le Gouvernement précédent a décidé d’ouvrir une base à Abou-Dhabi.
M. Philippe Folliot. Nous avions 30 000 hommes en Afrique dans les années 1960, nous avons 5 000 aujourd’hui. Ces chiffres résument bien l’évolution de notre dispositif. Dans votre intervention, vous avez additionné nos forces de souveraineté, à Mayotte et à la Réunion, par exemple, et nos forces de présence : il ne s’agit pas de la même chose !
Nous avons signé plusieurs accords de défense avec des pays africains récemment : avez-vous pu les consulter, notamment les éventuelles clauses secrètes ?
Sur les aspects budgétaires, nous sommes engagés dans des OPEX de longue durée, comme Épervier au Tchad ou Licorne en Côte d’Ivoire, or il est envisagé de transformer certaines de ces OPEX en prépositionnements. Cela n’est pas neutre pour le budget de la Défense, car à la différence du financement des prépositionnements, qui relève du seul budget de la Défense, celui des OPEX est assuré, en partie, par un mécanisme d’abondement interministériel. Le ministère devra donc, à l’avenir, supporter un certain nombre de coûts supplémentaires. Avez-vous pu analyser cela ?
M. Christophe Guilloteau. Je souhaiterais également m’associer aux félicitations adressées à nos deux rapporteurs. Il s’agissait d’une belle mission, qui s’inscrit dans la continuité de nos précédents travaux et qui relève parfaitement de notre rôle de contrôle. Les rapporteurs l’ont rappelé, il est un sujet essentiel auquel nous devrons sans doute continuer à réfléchir : il s’agit de la posture de l’Europe. À cet égard les déclarations des rapporteurs font froid dans le dos. C’est la confirmation de ce que nous constatons depuis longtemps, notamment en Afghanistan et en Afrique. On nous parle souvent d’Europe de la défense, mais dans les faits celle-ci ne progresse pas, ou avec difficulté.
Vous avez relativement peu parlé des forces spéciales. Intégrez-vous leurs effectifs dans le chiffre que vous avez évoqué de 7 500 militaires présents en Afrique ? Avez-vous pu les rencontrer ? Nous avons parfois des difficultés à rencontrer ces hommes. Nous devrions certainement analyser plus en profondeur le cas des forces spéciales, en veillant bien entendu à tenir compte de leurs spécificités.
Vous avez également fait part de vos observations quant aux conséquences des opérations sur l’usure du matériel. Il faudrait que nous nous intéressions à cette question car elle aura des conséquences dans le futur. La posture de défense peut se résumer à un choix politique qui entraîne un choix budgétaire, lequel entraîne à son tour un choix de moyens et d’effectifs, y compris en prépositionnement. C’est sans doute le grand défi du budget actuel de la Défense. Il ne s’agit pas ici de lancer d’anathèmes à qui que ce soit. Comme son nom l’indique, la défense nationale est l’affaire de tous, et il revient aux parlementaires de lui assurer les outils et les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
En tout état de cause je tiens encore une fois à remercier nos rapporteurs pour leur important travail !
M. Yves Fromion, rapporteur. M. Laffineur, nous nous sommes attachés à effectuer un travail aussi objectif que possible. Nous avons l’un comme l’autre évité de faire part d’états d’âme particuliers. Le rapport n’est pas sévère ; il est aussi objectif que possible et d’ailleurs, nous le cosignons. Nous n’avons pas cherché à nous faire plaisir ou à alimenter de vaines querelles. On peut effectivement penser que certains constats sont sévères. Nous le sommes par exemple vis-à-vis de l’Union européenne, mais ce qui nous a guidés, c’est l’objectivité. Les constats sur l’usure et l’attrition du matériel sont objectifs : la situation est difficile et va mériter une attention particulière. Ce rapport ne cherche pas autre chose qu’à dresser un bilan. Certains pourront le trouver sévère à leurs yeux, mais telle n’était pas notre intention.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Sur la Libye, nous ne cherchons pas à être polémiques mais à être lucides. Comment la France peut-elle concilier intervention, stabilisation et normalisation pour le Mali et pour la RCA, en tirant expérience de la réalité libyenne ? Pour être tout à fait précis et honnête, les difficultés – c’est un euphémisme – constatées au sud de la Libye ne datent pas de la fin de l’ère Kadhafi. Notre seule réflexion est la suivante : comment permettre à notre pays d’agir de manière plus efficace ?
Nous avons effectivement rencontré les forces spéciales, avec un angle d’analyse particulier : comment améliorer les complémentarités entre forces spéciales et forces conventionnelles. Vous trouverez dans le rapport des éléments de bilan, au vu de l’expérience dont nous ont fait part les généraux de Saint-Quentin, Barrera et Castres. Pour reprendre une formule utilisée par l’un d’entre eux, il s’agit de répondre à la question suivante : « comment ne pas se marcher sur les pieds ? », d’autant que les missions ne sont pas les mêmes. À partir du moment où les missions sont différentes, on peut construire des complémentarités. Ce qui est certain c’est que l’intervention au Mali a permis aux forces spéciales comme aux forces conventionnelles de progresser certes chacune de leur côté mais, surtout, ensemble.
M. Yves Fromion, rapporteur. Concernant les forces spéciales, je rappelle que nous sommes dans le « off » complet. Dans la mesure de ce qui peut être rendu public, le récent rapport de nos collègues sénateurs a apporté quelques éléments d’analyse intéressants. Les forces spéciales ont un rôle majeur à jouer en RCA, au Mali ou ailleurs, et méritent une attention particulière. Comme l’a rappelé mon collègue Gwendal Rouillard et comme nous l’a affirmé le général de Saint-Quentin, celles-ci ont réussi à trouver leur place, en complément des forces régulières. L’une et l’autre sont liées : elles ne peuvent ni se passer de l’autre, ni s’y substituer.
M. Folliot, il faut rappeler que les forces stationnées à Mayotte et à La Réunion sont intégrées au dispositif stratégique de la France en Afrique. En effet, elles ont notamment la responsabilité d’assurer les missions de coopération, par exemple en matière de formation, au bénéfice des États membres de la Communauté de développement d’Afrique australe – l’une des sous-régions constituant l’Union africaine – au même titre, par exemple, que les Éléments français au Sénégal pour les pays de la Communauté économique du développement des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il est d’ailleurs compliqué de tracer une limite absolue entre forces de présence et forces de souveraineté : compte tenu de la situation des effectifs, les armées prélèvent les forces là où elles sont, au mieux des possibilités.
Nous nous sommes effectivement interrogés sur les accords de défense. À cet égard la direction de la coopération de sécurité et de défense du Quai d’Orsay nous a fourni les éléments demandés, que vous retrouverez cités dans le rapport, notamment pour ce qui concerne Djibouti.
S’agissant du budget OPEX et des personnels qui émargent tantôt sur cette ligne budgétaire et tantôt sur le budget Défense, il s’agit d’un vrai sujet que nous évoquons dans le rapport, d’autant plus que cela pose un certain nombre de problèmes en particulier pour les personnels concernés. Notamment, selon qu’ils sont positionnés en OPEX ou placés en prépositionnement classique, les rémunérations ne sont pas les mêmes. Cette question fait débat au sein des armées. Toutefois je ne pense pas que l’impact global pour le budget de la Défense soit considérable. Seule l’imputation est différente, ce qui est certes important car comme vous le savez, lorsque le coût des OPEX excède 430 millions d’euros, on bascule sur le système de financement interministériel.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Je souhaite ajouter un mot sur l’Europe en reprenant les propos de mon collègue Yves Fromion. Notre rapport n’est pas sévère ; il est objectif et lucide. Quand quelque chose ne fonctionne pas ou fonctionne mal, il faut le dire. Telle est la réalité en RCA, quels qu’aient été les efforts de notre Gouvernement et du ministre de la Défense, en particulier pour entraîner nos partenaires européens. Inversement, quand quelque chose fonctionne, il faut le dire aussi. EUTM Mali fonctionne très bien. Je rappelle que le dispositif rassemble des militaires de 23 États membres avec une importante présence allemande. Plusieurs bataillons de l’armée malienne ont été formés – le cinquième est en cours de formation. Parallèlement, on a vu récemment un important renforcement du contingent néerlandais de la MINUSMA.
Certes, plusieurs lectures sont possibles. L’épisode dramatique du mois de mai pourrait amener à s’interroger sur le niveau de l’armée malienne formée par la mission européenne. Toutefois nos militaires nous assurent que le travail est fait et bien fait, que le niveau est bon et que, en tout état de cause, on constate une vraie progression en la matière. On pourrait également évoquer l’opération Atalante de lutte contre la piraterie dans l’océan Indien, qui est un succès européen. Quand cela fonctionne, il faut le dire, et quand cela ne fonctionne pas bien il faut interpeller, je l’espère de manière constructive, les responsables politiques. Je rappelle que l’on fait référence à l’Europe par commodité. Mais les premiers responsables des actions et inactions de l’Europe sont avant tout les États membres.
M. Alain Moyne-Bressand. La situation en Afrique est très difficile et nos rapporteurs en ont dressé un constat objectif. Mais le constat d’un jour est-il le constat de toujours ? Le réel problème dans ces territoires est celui des djihadistes. La France a-t-elle encore les moyens d’être le gendarme de l’Afrique et de continuer seule à les combattre ? C’est la grande inquiétude et le problème majeur auxquels nous sommes confrontés.
Je reviendrai sur Djibouti. Tous les grands États y sont présents, mais pour quelles raisons ? Pourquoi ne combattent-ils pas la menace djihadiste aux côtés de la France ? Sont-ils uniquement présents au titre de leurs intérêts économiques ? Cela peut se concevoir, mais il convient alors d’en prendre conscience, de réagir et de ne pas se laisser faire.
Mme Émilienne Poumirol. Je souhaite également remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail, qui est d’un grand intérêt en termes géostratégiques et politiques et qui souligne la difficulté de nos opérations en Afrique. Si on peut regretter l’absence de l’Union européenne, on ne peut pas pour autant en déduire que la France doit renoncer à s’engager en Afrique. Il me semble que nous avons fait le choix stratégique, rappelé par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, de continuer à mener des actions sur ce continent compte tenu des menaces à l’œuvre dans cette zone.
Je voudrais évoquer une question très pratique. Avec mon collègue Olivier Audibert Troin, nous avons récemment effectué un déplacement à Chypre où se trouve le sas de décompression qui accueille notamment nos soldats qui rentrent de RCA. Outre les difficultés dont ils ont pu nous faire part quant à cette mission très difficile et très différente de celle menée au Mali, plusieurs ont évoqué les problèmes de logistique au quotidien empêchant ou retardant l’acheminement d’équipements et de fournitures de base : vêtements, produits d’hygiène, etc. Lors de vos déplacements sur le terrain, avez-vous pu constater ce type de difficultés, qui pèsent beaucoup sur le moral de nos troupes ? Je précise que la question de l’imputation budgétaire se pose également concernant le sas de Chypre.
M. Olivier Audibert Troin. Dans la continuité des propos de ma collègue Émilienne Poumirol, je souhaiterais évoquer la question de la logistique et des matériels eu égard aux témoignages des 140 hommes du détachement que nous avons rencontré à Paphos. Mais je tiens tout d’abord à remercier nos rapporteurs. Nous saluons le travail que vous avez effectué et partageons les termes que vous avez utilisés. Vous avez évoqué le mot « fierté », parfois éculé mais qui, en l’espèce, est employé à bon escient. Je crois que ce sentiment est partagé par nos militaires qui se sentent utiles et qui portent haut et loin la voix de la France.
Les hommes que nous avons rencontrés au retour de quatre mois d’opérations en RCA reviennent épuisés, physiquement et moralement. Ils travaillent sept jours sur sept, sans un seul après-midi de repos. En matière d’équipement, seul un engin sur deux envoyés en RCA était blindé ce qui pose des problèmes majeurs aux responsables de mission compte tenu des dangers encourus. Il y a en outre peu d’avions disponibles. Autre élément surprenant : l’appareil qui amenait les hommes de Bangui à Paphos a dû faire escale à N’Djamena pour faire le plein de kérosène. Il n’y en avait pas en quantité suffisante à Bangui et l’avion a dû partir avec ses réservoirs à moitié vides. Encore un exemple : seulement 80 % des tentes sont équipées de la climatisation, ce qui pose de réelles difficultés du fait de la chaleur ambiante et de la fatigue accumulée.
Les Américains ont déserté le continent africain pour se redéployer en Asie ; l’Union européenne est relativement absente. Dans ces conditions, la France risque d’être seule en Afrique pendant encore des années. Je suis convaincu que l’état-major y réfléchit et envisage des mesures, mais il faut se poser la question de l’adaptation de notre matériel aux conditions africaines – le sable, la chaleur – en tenant compte du fait que notre pays y sera probablement seul présent pendant un certain temps.
M. Yves Fromion, rapporteur. Notre rapport comprend des considérations sur les conditions de vie de nos troupes sur le terrain. À Bambari, nous avons ainsi pu constater qu’elles ne disposaient que de campements de fortune, sans même parler d’une quelconque climatisation. Il en est largement de même à l’aéroport de M’Poko, où nos soldats ont amélioré eux-mêmes le campement, avec des moyens de fortune et des matériaux trouvés sur place. Ils font preuve d’une abnégation qui force le respect, la débrouillardise française palliant les insuffisances que l’on sait. Il est certain que nous sommes en la matière très loin des standards américains, mais aussi de ceux de bien des armées européennes, comme celle de l’Allemagne. Il faut donc veiller à ne pas laisser s’éterniser de telles situations, dont on peut comprendre qu’elles s’imposent parfois au début des opérations, mais auquel il faut remédier, lorsque l’on s’installe dans la durée, par un effort sur la logistique et les conditions de vie.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. S’agissant des menaces djihadistes auxquels nos forces font face, nous avons tenté de décrire la très grande diversité des réseaux terroristes et de leurs ramifications opérationnelles et financières. L’une des questions qui se pose est celle des connexions qu’ils entretiennent avec d’autres acteurs très préoccupants, comme Boko Haram au Nigéria ou les Shebabs somaliens. La France prend très au sérieux cette menace, en coopération avec nos alliés américains, et c’est l’une des raisons de nos propos précédents sur l’importance de Djibouti.
Nous n’avons plus vocation à être le gendarme de l’Afrique : nous sommes son allié, mais nous devons valoriser sans complexes nos atouts économiques, tout en assumant les responsabilités particulières liées au statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.
S’agissant des conditions de vie de nos militaires en opération, nous avons pu les constater sur place, mais nous avons aussi noté la mise en place d’un suivi psychologique individualisé, particulièrement en RCA, et les entretiens avec les généraux Francisco Soriano et Marc Foucault, commandant respectivement les opérations Sangaris et Serval, ont montré combien était sérieuse la prise de conscience en la matière, s’appuyant d’ailleurs utilement sur le retour d’expérience de l’Afghanistan. Je crois qu’il existe des marges de progression en s’inspirant mutuellement des bonnes pratiques au sein de chaque armée.
M. Yves Fromion, rapporteur. Le Parlement a fait preuve d’un très large consensus lors de l’engagement de nos forces dans les récentes opérations, certes avec des visions et des approches qui peuvent être différentes, mais sans que cela fasse vraiment débat. En revanche, il est loisible de s’interroger sur la réalité de la notion de partenariat lorsque le déséquilibre entre les acteurs est aussi patent. Il reste à l’évidence un immense chemin à parcourir, ce qui n’encourage pas nos partenaires européens à s’investir en Afrique et explique notre sentiment de solitude, qui est aussi une réalité. Il faut cependant relever la prise de conscience, encourageante, des Africains eux-mêmes s’agissant de la nécessité de prendre en main leur propre sécurité. Il reste que les carences en matière de capacités sont très importantes et que nous sommes appelés à demeurer encore longtemps à leurs côtés.
M. Joaquim Pueyo. Sur les opérations en cours, j’estime pour ma part que la question fait encore largement débat dans l’opinion publique. Nous avons naturellement bien fait de répondre à l’appel, mais à moyen terme nous n’avons pas vocation à intervenir seuls. De ce point de vue, l’apport européen n’est pas négligeable puisqu’au Mali la mission de formation donne des résultats et qu’en matière de lutte contre la piraterie, le bilan est des plus honorables. Restent donc les difficultés rencontrées concernant la sécurisation de l’aéroport de Bangui, sur lesquelles je souhaiterais avoir des précisions. Pourriez-vous fournir une évaluation du coût d’ensemble de la présence militaire française en Afrique au cours des cinq dernières années ? En ce qui concerne les projets de diminution des effectifs à Djibouti, pourriez-vous préciser qui est à l’origine de la proposition de les ramener à 950 personnels que vous avez mentionnée ? De manière plus générale, nous ne pourrons pas rester seuls à intervenir en Afrique dans les années à venir ; aussi est-il nécessaire de convaincre l’Europe qu’il s’agit d’une question de sécurité collective, ce dont les opinions publiques sont déjà, à mon sens, conscientes.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Je souhaiterais obtenir des précisions sur le sort des prisonniers faits en RCA et au Mali. Quels sont leur nombre et leur statut ? À quelles autorités ont-ils été remis ?
M. Philippe Vitel. Il faudra bien un jour arrêter de rêver et mettre en adéquation nos ambitions et nos moyens. Il convient à l’évidence de se préoccuper des conditions de vie de nos hommes, mais il ne faut pas oublier la question des matériels et du soutien. Dans le cadre des travaux que nous réalisons avec Geneviève Gosselin-Fleury pour la mission de contrôle de l’exécution des crédits de la Défense, nous avons entendu le chef d’état-major de l’armée de terre, qui a poussé un véritable cri d’alarme au sujet de l’ampleur du parc de 1 400 véhicules de retour d’OPEX à remettre en état. Il faut donc adapter les moyens de soutien et mettre en place une logistique intégrée. Les réductions budgétaires successives ont eu un effet certain sur nos capacités ; sur le terrain, avez-vous ressenti la crainte d’une rupture capacitaire ? Avons-nous encore les moyens d’engager autant d’opérations extérieures et d’entretenir autant de forces prépositionnées, et ne devons-nous pas aussi prendre en compte la priorité que peuvent constituer les forces de souveraineté, destinées à la protection directe des Français ?
M. François de Rugy. Vous avez traité à la fois des opérations et de la présence permanente. Cette dernière est-elle calculée prioritairement en fonction des premières, afin de les préparer, ou bien est-elle davantage organisée dans un but de coopération voire, selon les zones, de sécurité maritime ? Vous avez relevé que les conditions d’un retrait du Mali ou de la République centrafricaine étaient loin d’être réunies et qu’il convenait de passer d’opérations d’intervention à des actions de stabilisation. Or, nous avons vu en Libye que telle était bien la difficulté : quelles sont les forces politiques locales susceptibles d’assurer le relais ? Je n’y vois pas un risque d’enlisement, mais bien un risque d’effondrement en cas de départ de nos forces, nous ramenant en quelque sorte à la case départ. Vous avez relevé avec raison les ambiguïtés du Tchad, tout en indiquant que l’un des objectifs de l’évolution de notre dispositif était de centraliser davantage nos forces à N’Djamena. N’y a-t-il pas là une contradiction au vu de la fiabilité toute relative de ce partenaire ? Pensez-vous que la création d’une base permanente à Abou-Dhabi a constitué une erreur, en conduisant à réduire le format de nos forces à Djibouti ? S’agissant des enjeux maritimes, il faut relever qu’ils sont multiples, allant de l’océan Indien, avec la lutte contre la piraterie et la sécurisation des routes maritimes, jusqu’à la lutte contre la surpêche illégale sur les côtes atlantiques de l’Afrique. Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour y répondre ? Quant à la question de la mise en adéquation de nos ambitions avec la réalité de nos moyens, je rejoins d’autant plus la position de mon collègue Philippe Vitel que j’ai moi-même fait connaître mon point de vue sur ce sujet à de nombreuses reprises.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Pour répondre aux questions sur les lacunes capacitaires, je dirai que lorsque notre commission se bat pour défendre les grands programmes d’équipement, comme l’A400M ou SCORPION, elle a raison. Et les témoignages de nos militaires sur l’utilité du VBCI en opération au Mali confirment qu’il faut continuer à le faire. De ce point de vue, la réunion de notre commission hier et le communiqué commun avec la commission des Affaires étrangères et de la défense du Sénat sont des plus justifiés.
S’agissant de la base d’Abou-Dhabi, il s’agit d’un bon choix, tant d’un point de vue opérationnel que stratégique. Nos avions qui y sont stationnés peuvent intervenir et s’entraîner à Djibouti et, compte tenu du contexte en Syrie et en Irak, il est utile de disposer dans la région d’un relais pour notre renseignement et notre influence. En outre les complémentarités très positives entre les bases de Djibouti et d’Abou-Dhabi se sont bâties très rapidement et il ne me semble pas utile d’entrer dans une démarche qui opposerait ces deux implantations.
Le partenariat avec le Tchad est ancien et des plus précieux, ne serait-ce qu’en raison de la position géographique privilégiée de cet État. Aussi ne remettons-nous nullement en question la pertinence de la décision de centraliser le commandement des opérations dans la bande sahélo-saharienne à N’Djamena. Nous connaissons tous par ailleurs les fragilités de la situation politique intérieure du Tchad. Lorsque le président Déby a décidé de retirer ses troupes de la MISCA, il s’agissait d’une mauvaise nouvelle car nous avons besoin du Tchad dans cette région, et ce d’autant plus qu’il exerce actuellement la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Le ministre de la Défense a annoncé hier l’organisation fin juillet d’une réunion à Brazzaville de l’ensemble des États de cette sous-région, afin de trouver des solutions politiques pour la RCA ; il est de leur responsabilité de s’impliquer fortement en aidant la RCA, sinon ce pays ne se relèvera pas.
Enfin, je tiens à souligner l’étroitesse croissante de la coopération avec les États-Unis sur le continent africain. Nous avons pu le constater sur place, la décision d’acquérir des Reaper étant justifiée à la fois par la qualité opérationnelle de ce matériel et par l’amélioration qu’elle permet dans la coopération entre nos deux pays. Les États-Unis s’implantent très sérieusement en Afrique, en consacrant des centaines de millions de dollars à l’installation de bases dans plusieurs pays. Certes nous pouvons espérer davantage de nos partenaires européens, mais au vu de la qualité de notre partenariat avec les États-Unis, nous ne sommes d’ores et déjà pas seuls.
M. Yves Fromion, rapporteur. Il n’y a pas eu d’opération de maintien de la paix (OMP) en Libye contrairement au Mali et à la RCA, peut-être en raison des illusions nées du printemps arabe, et il est légitime de s’interroger sur la façon dont les institutions internationales pourraient agir aujourd’hui. La Libye n’est pas un pays pauvre qui manque de moyens et je pense, à titre tout à fait personnel, que l’embargo, qui a fait ses preuves dans d’autres circonstances, pourrait être un moyen de pression utile pour parvenir au rétablissement d’un état de droit. Une réduction modérée des achats de leur pétrole pourrait peut-être provoquer chez les Libyens un réveil de leur conscience et de leurs responsabilités. La Libye possède suffisamment de richesses en matière d’exportation de pétrole pour tenir sa place dans le concert international et il est temps pour elle de comprendre que l’accession à la liberté entraîne aussi des devoirs et notamment celui d’éviter de devenir un non-État source de problèmes dans l’ensemble de l’Afrique du Nord. La communauté internationale doit, elle aussi, cesser de baisser les bras en pensant qu’elle est impuissante.
Nous sommes, dans notre rapport, objectifs en ce qui concerne le MCO et indiquons avec mesure que la question n’est plus de maintenir nos capacités matérielles mais bien le fait que nous n’y parvenons plus. La flotte de MRTT et d’A400M est prévue pour 2025 et aucune commande n’est passée pour SCORPION. Il ne s’agit pas d’une critique mais d’un état des lieux et, entre la commande et le moment où le matériel est disponible, le creux se creuse, si je peux me permettre d’employer cette formule qui paraîtrait ridicule au sapeur Camember. Notre présence en Afrique est un révélateur cruel de la dégradation de nos équipements. Hormis le Reaper qui représente un apport considérable pour les capacités des forces, l’état d’attrition global de nos matériels est extrêmement préoccupant.
La situation des prisonniers en RCA est simple. Les portes des prisons sont ouvertes, la justice ne fonctionne pas, nos soldats et les gendarmes européens présents interpellent mais n’ont pas d’institution à laquelle remettre les prisonniers. La situation au Mali est différente : les prisonniers du Nord Mali ont été remis aux autorités maliennes, les quelques prisonniers français ont été extradés et remis à la justice française. Il n’y a plus d’État en RCA donc plus de fonction policière et judiciaire.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Il faut toutefois souligner la qualité de la chaîne logistique qui fonctionne bien. De grands progrès ont été réalisés au fil des mois et je tiens à féliciter nos logisticiens.
Les chiffres que nous évoquons à propos de Djibouti sont des hypothèses de travail en débat au sein de l’état-major et il nous a semblé nécessaire de les soumettre à la représentation nationale dans le respect d’un fonctionnement démocratique.
M. Yves Fromion, rapporteur. Ces chiffres circulent publiquement à Djibouti. Et le ministre djiboutien des affaires étrangères nous a accueillis par une boutade : « Alors, vous partez de Djibouti ! ». Il s’agit d’une hypothèse qui commence à avoir une certaine consistance en dehors de l’Îlot-Saint-Germain. Les autorités djiboutiennes ne s’en réjouissent évidemment pas.
M. Gwendal Rouillard, rapporteur. Au-delà du pays de Lorient qui m’est cher, le développement de l’action de l’État en mer au profit des partenaires africains est une belle mission pour la France. La menace maritime est aujourd’hui moins dans l’océan Indien que dans le golfe de Guinée où la piraterie prend un tour de plus en plus violent. La France, soutenue par l’Union européenne, finance le Projet d’appui à la réforme du système de sécurité maritime dans le golfe de Guinée (ASECMAR) et c’est là un révélateur des actions positives de notre pays sur le continent africain.
Yves Fromion, rapporteur. Je tiens à préciser, pour répondre à une question posée, que nos forces prépositionnées coûtent 430 millions d’euros par an.
Mme la présidente Patricia Adam. Il conviendra en effet que notre commission se penche à nouveau sur la question du MCO. S’agissant de la RCA, il serait nécessaire que la communauté internationale étudie la possibilité de mise en place d’une forme de tutelle, puisque l’État n’y existe plus. Pour revenir sur la question de l’action de l’État en mer, je note que l’IHEDN a organisé récemment à l’école militaire pendant une semaine une formation de très grande qualité à destination des états-majors de la marine des États africains.
*
* *
La Commission autorise à l’unanimité, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport de la mission d’information en vue de sa publication.
CONTRIBUTION PRÉSENTÉE
PAR M. YVES FROMION, RAPPORTEUR
La mise en œuvre du « volet africain » de la politique de Défense de la France a conduit la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée Nationale à s’interroger sur la cohérence entre les dispositions du Livre Blanc de 2013, la loi de programmation militaire 2014-2019 qui s’en inspire et la traduction effective sur le terrain qui en est faite.
Le rapport établi au terme de ce travail, conduit dans les dix pays africains (dont par extension les Émirats arabes unis), s’attache à donner une vision aussi précise que possible de la situation observée.
Au demeurant l’approche politique du sujet conduit à des différences de perception entre les rapporteurs sur quelques points particuliers qu’il apparaît normal de consigner.
1./ Si la politique de présence française en Afrique est dans son principe cohérente avec les enjeux auxquels notre pays est confronté, il est incontestable que notre capacité à assumer nos ambitions dans le cadre contraint du budget de la Défense pose question. À cet égard notre engagement en Afrique est un cruel révélateur des insuffisances grandissantes qui affectent notre outil de défense, situation qu’il est beaucoup moins aisé de percevoir dans le quotidien de nos forces en métropole.
La loi de programmation militaire 2014-2019 ne permet pas de maintenir un équilibre, pourtant vital, entre l’attrition des moyens dévolus (usure, vieillissement, déclassement…) et le maintien des fonctions capacitaires essentielles au niveau nominal pour répondre aux exigences du Livre blanc. Dans un tel contexte, où le rythme du renouvellement voire du maintien en condition opérationnelle des moyens en service s’affaiblit au point de conduire à des ruptures ou des quasi ruptures capacitaires, on ne peut manquer de s’alarmer. Les exemples sont multiples et bien connus : ravitaillement en vol, transport aérien logistique, aéromobilité de théâtre, dispositif satellitaire, matériels blindés, etc. Un point positif cependant, l’acquisition très opportune de drones Reaper qui comble une lacune calamiteuse. Or les fonctions ci-dessus énumérées sont essentielles à la mise en œuvre de nos plans d’actions en Afrique. Certes jusqu’à ce jour nos forces sont intervenues avec succès, notamment au Mali, mais il ne faut pas dissimuler le caractère très asymétrique de nos engagements, attesté par les pertes enregistrées dans chaque camp. Ce cadre d’emploi n’a pas forcément vocation à perdurer dans le temps, notamment face à un adversaire qui serait doté de capacités antiaériennes efficaces, assez facilement accessibles sur le marché… Les signaux d’alarme sur cette situation, qu’ils émanent des militaires eux-mêmes, des responsables politiques ou d’innombrables observateurs, ne font pas l’objet d’une prise en compte raisonnable. Il est du devoir de la représentation parlementaire de le rappeler avec force.
2./ Les personnels composant nos forces armées en Afrique, au titre des détachements permanents ou des forces prépositionnées mais aussi des détachements temporaires, sont d’une qualité remarquable comme chacun s’accorde à le reconnaitre. Leur professionnalisme, leur dévouement et lorsque c’est nécessaire leur abnégation forcent le respect. On doit particulièrement saluer les capacités d’adaptation de nos soldats, leur sens de l’initiative, leur « débrouillardise » lorsqu’il s’agit de trouver des palliatifs à certaines situations de carence. Si notre armée est capable d’obtenir les résultats que l’on sait dans les engagements au Mali ou en RCA, de surmonter des épreuves au-delà du supportable, c’est à nos hommes et à leurs chefs qu’en revient le mérite.
C’est la raison pour laquelle il paraît particulièrement mal venu de laisser entendre que de nouvelles contraintes budgétaires pourraient venir contraindre les moyens de nos forces armées. Comment faire entendre à nos forces déployées en Afrique dans un contexte de flux hypertendu, entraînant de fréquentes situations de rupture, qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles contractions d’effectifs ? À cet égard la situation observée à Djibouti est particulièrement illustrative. La technostructure parisienne a décidé que l’effectif présent sur cette base devrait passer de 1950 à 950. C’est un impératif budgétaire… Mais quel rapport avec la réalité ? La France vient de signer un accord de défense avec ce pays dont elle prétend assumer la sécurité et dans le même temps elle décide de retirer ses forces alors même qu’Américains, Britanniques, Italiens, Chinois et même Japonais prennent pied sur ce territoire stratégique. C’est l’incohérence la plus totale. Sans doute trouvera-t-on une solution de bon sens comme le préconisent les auteurs de ce rapport, mais cet exemple est emblématique des excès de la politique de déflation des effectifs programmée dans le Livre blanc de 2013. Les engagements au Mali et en RCA, qu’on nous avait présentés comme de courte durée, vont inévitablement se prolonger pendant des années. Ils sont exigeants en personnels et en moyens et ne sont pas compatibles avec une réduction inappropriée de nos effectifs. Et encore avons-nous fait l’économie d’un engagement supplémentaire en Syrie, fort hasardeux quant à ses conséquences, mais qui avait les faveurs du président de la République !
3./ L’isolement de la France en Afrique, plus précisément sur les théâtres d’opérations du Mali et de RCA, est un sujet de fortes préoccupations. Sans doute la mise en place, fort laborieuse, de la MINUSMA et de la MINUSCA sont-elles présentées comme l’amorce d’une rupture de cet isolement. Mais la vérité c’est que c’est la France qui constitue la colonne vertébrale de ces forces dites de stabilisation. L’absence de participation de nos partenaires européens est un échec diplomatique pour la France. Le constat est brutal mais il est pour l’heure sans appel. Plus grave encore on ne voit pas la moindre perspective d’un changement en la matière. « Les français y sont allés, qu’ils s’en débrouillent ».
Au-delà des considérations affligées sur l’évolution de la défense européenne, cette situation interroge quant aux effets induits du prépositionnement de nos forces sur le sol africain. Il est indéniable que ce prépositionnement, outre l’intérêt de « marquer » un territoire, favorise l’aguerrissement et l’adaptabilité de nos militaires. C’est aussi une posture indispensable pour pallier le manque de moyens suffisants et libres d’usage, nécessaires pour projeter sans délais excessifs une force équipée sur un site « en tension ». En contrepartie le prépositionnement lie la France et lui retire la capacité à prendre du recul face à une situation de crise. La présence d’un détachement à Bangui fin 2013, s’est révélée pour la France un facteur d’entraînement irrésistible dans une véritable guerre civile que l’on n’avait pas vu venir. Personne en effet n’aurait pu accepter que nos soldats se contentent d’assister l’arme au pied à d’horribles massacres, abondamment mis en scène par les médias du monde entier. La France s’est donc trouvée entraînée mécaniquement dans un conflit inextricable, ethnique, religieux, tribal, particulièrement lourd à porter et probablement long à supporter.
En RCA comme au Mali la France, une nouvelle fois dans l’illusion, croit pouvoir trouver une porte de sortie rapide par un processus politique mis en œuvre à la va-vite (élections présidentielle et législatives) dont on constate le caractère illusoire. Le Mali comme la RCA doivent conduire la France à une attitude plus modeste à l’égard de l’Afrique et surtout à une diplomatie plus subtile. Il faut, si l’on veut pouvoir partager avec les Européens la responsabilité et donc la charge du processus sécurité-développement en Afrique, que l’on cesse de faire valoir, notamment dans les affirmations du Livre blanc, que ces territoires sont notre arrière-cour et un espace marqué par nos intérêts nationaux. À cet égard il n’est que d’examiner les statistiques sur l’évolution de nos échanges commerciaux avec l’Afrique pour reprendre pied dans le réel. On peut être choqués par l’absence de coopération de nos partenaires européens, mais faut-il s’en étonner autant ?
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS
(par ordre chronologique)
Ø Général Jacques Norlain (2S), ancien conseiller pour les questions de sécurité à la présidence de la République de Côte d’Ivoire et à celle du Gabon ;
Ø Ministère des Affaires étrangères – M. Jean-Christophe Belliard, directeur de l’Afrique et de l’océan Indien ;
Ø Pr. Bertrand Badie – Professeur des universités en science politique à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) ;
Ø Pr. Jean-François Bayart, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ancien directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CERI), membre de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (2012-2013) ;
Ø État-major de la marine – amiral Bernard Rogel, chef d’état-major ;
Ø Commandement des opérations spéciales (COS) – général Grégoire de Saint-Quentin, commandant des opérations spéciales, ancien commandant de l’opération Serval ;
Ø Général Bernard Barrera, directeur adjoint de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICOD) et porte-parole adjoint du ministère de la Défense, ancien commandant de la brigade Serval ;
Ø État-major de l’armée de l’air – général Denis Mercier, chef d’état-major, général Thierry Caspar-Fille-Lambie, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, et colonel Thierry Garreta ;
Ø État-major de l’armée de terre – général Bertrand Ract Madoux, chef d’état-major, général Didier Brousse, sous-chef Opérations, lieutenant-colonel Franck Boudet, lieutenant-colonel Pierre Chareyron et commandant Pierre de Solages ;
Ø Délégation aux affaires stratégiques – M. Philippe Errera, directeur, Mme Patricia Lewin, chef de cabinet, colonel Xavier Collignon et MM. Romain Esmenjaud et Grégory Chauzal ;
Ø Ministère des Affaires étrangères – M. Nicolas de Riviere, directeur général des affaires politiques et de sécurité, Mme Nathalie Broadhurst, directrice des Nations unies, des organisations internationales, des Droits de l’Homme et de la Francophonie, M. Frédéric Danigo et Mme Mélanie Rosselet ;
Ø Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) – amiral Marin Gillier, directeur, colonel Bertrand de Reboul et lieutenant-colonel Tanguy Eon Duval ;
Ø État-major des armées – général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, général Didier Castres, sous-chef Opérations, M. Jean-Marie Magnien, conseiller diplomatique, colonel Pascal Ianni.
ANNEXE 2
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES RAPPORTEURS
Ø République du Niger (Niamey)
1./ Autorités politiques :
– le président de la République, M. Mahamadou Issoufou ;
– le Premier ministre, M. Brigi Rafini ;
– le président de l’Assemblée nationale, M. Hama Amadou ;
– le président et les honorables membres de la commission de la Défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale ;
– le ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassoumi Massaoudou ;
– le président de la Haute autorité à la consolidation de la paix, M. Mahamadou Abou Tarka ;
– le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur ;
– le secrétaire général du ministère de la Défense nationale ;
2./ Autorités militaires :
– le commandement et les personnels des forces françaises déployées à Niamey (« base 101 ») ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : la chargée d’affaires, Mme Brigitte Baley, l’attaché de défense, colonel Christophe Pitiot, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
– Délégation de l’Union européenne : l’ambassadeur, M. Raul Mateus Paula ; le chef de la section politique de la Délégation de l’Union européenne, M. Jean-Jacques Quairiat, le chef des opérations de coopération, M. Rafael Aguirre, et le chef de la mission Eucap Sahel-Niger, M. Philip de Ceuninck ;
– Ambassade des États-Unis : le chargé d’affaires ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– les responsables des associations représentatives des Français établis à l’étranger ;
– les conseillers du commerce extérieur français et les directeurs généraux des trois sociétés du groupe Areva (COMINAK, SOMAÏR et Imouraren SA).
Ø République du Burkina Faso (Ouagadougou)
1./ Autorités politiques :
– le président de la République, M. Blaise Compaoré ;
– le président de l’Assemblée nationale,
– la présidente, Mme Pascaline Tamini-Bihoun, et les membres de la commission des Affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée nationale ;
– le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Somda ;
– le secrétaire général du ministère de la Défense, colonel-major Mone ;
– M. Zéphirin Diabré, président de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) ;
2./ Autorités militaires :
– le commandement et les personnels du détachement d’instruction au profit des forces burkinabè ;
– le commandement, l’encadrement et les stagiaires de l’École militaire technique de Ouagadougou, école nationale à vocation régionale spécialisée en logistique ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Gilles Thibault, l’attaché de défense, lieutenant-colonel Jean-Jacques Luciani, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– Me Titinga Frédéric Pacere, avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre, avocat auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, fondateur du Musée de Manéga ;
– les représentants de la communauté française ;
– différents coopérants français.
Ø République de Côte d’Ivoire (Abidjan)
1./ Autorités politiques :
– le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Paul Koffi Koffi ;
– le président et des membres de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale ;
2./ Autorités militaires :
– le chef d’état-major général des Forces armées de Côte d’Ivoire ;
– le chef d’état-major de la marine ivoirienne ;
– le commandement et les personnels de la force Licorne ;
– le conseiller du président de la République de Côte d’Ivoire, général Claude Réglat, et les autres coopérants militaires français ;
– le chef d’état-major de l’ONUCI, général Muhammed Iqbal Asi ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Georges Serre, l’attaché de défense, colonel Benoist Clément, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
– la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire et chef de l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), Mme Aïchatou Mindaoudou ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– les conseillers des Français de l’étranger et les représentants de la communauté française en Côte d’ivoire ;
– les dirigeants de la société International Airport Services.
Ø République du Mali (Bamako, Gao) ;
1./ Autorités politiques :
– le président de l’Assemblée nationale, M. Issaka Sidibé ;
– le ministre de la Défense nationale, M. Soumeylou Boubèye Maïga ;
– le président, M. Karim Keita, et les membres de la commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile de l’Assemblée nationale ;
2./ Autorités militaires :
– le commandant de l’opération Serval, général Marc Foucault, et les personnels de la force Serval à Bamako et à Gao ;
– le chef d’état-major particulier du président de la République ;
– le conseiller militaire du Premier ministre ;
– le commandement de la mission EUTM Mali : l’adjoint au commandant de la mission, colonel Garcia Cortuo, le chef d’état-major de la mission, colonel Éric Lendroit, l’assistant militaire du commandant de la mission, lieutenant-colonel grégoire Potiron de Boisfleury, le chef de l’Advisory Task Force, lieutenant-colonel Boris Vallaud, le conseiller politique du commandant, M. François-xavier Delestre ;
– le commandant de la MINUSMA, général Jean Bosco Kazura ;
– le chef d’état-major de la MINUSMA, général Vianney Pillet ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Gilles Huberson, l’attaché de défense, colonel Jean-Paul Battesti, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
– le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali, M. Albert Gerard Koenders ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– différents représentants de la communauté française.
Ø République du Sénégal (Dakar, Gorée)
1./ Autorités politiques :
– le président du groupe d’amitié Sénégal-France à l’Assemblée nationale, M. Cheikh Diop Dionne ;
– le ministre-conseiller diplomatique du président de la République, M. Oumar Demba Ba ;
– le conseiller du président de la République en charge des affaires financières ;
– le conseiller du Premier ministre en charge des affaires économiques ;
2./ Autorités militaires :
– le commandant des Éléments français au Sénégal, général Louis Duhau, et les personnels de cette force ;
– l’ancien chef d’état-major général des forces armées sénégalaises, ancien ambassadeur de la République du Sénégal auprès de la République fédérale d’Allemagne, général Mouhamadou Lamine Keita ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Jean Félix-Paganon, l’attaché de défense, colonel Marc Conruyt, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– les conseillers des Français de l’étranger ;
– les conseillers du commerce extérieur français.
Ø République du Gabon (Libreville, Centre d’aguerrissement outre-mer au combat en forêt équatoriale du Gabon)
1./ Autorités politiques :
– le secrétaire général du ministère de la Défense, commissaire général Jean-Félix Sockat ;
– le conseiller du président de la République, M. Maxime Ngozo Issoundou, élu de la commune de Port-Gentil ;
2./ Autorités militaires :
– le commandement des Forces françaises au Gabon, colonel Éric Rousselle, adjoint interarmées, et les personnels de ces Forces à Libreville et au Centre d’aguerrissement outre-mer au combat en forêt équatoriale du Gabon ;
– le commandement, l’encadrement et les stagiaires de l’école d’état-major de Libreville (EEML), école nationale à vocation régionale ;
– le commandement, l’encadrement et les stagiaires de l’école d’application du service de santé militaire de Libreville (EASSML), école nationale à vocation régionale ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Jean-François Desmazières, l’attaché de défense, colonel Lionel Paillot, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure, le conseiller de coopération et d’action culturelle et le consul ;
– l’ensemble des attachés de défense français en poste en Afrique centrale, ainsi que leurs correspondants spécialisés dans les états-majors, directions et services du ministère de la Défense à Paris.
Ø République Centrafricaine (Bangui, Bambari)
1./ Autorités politiques :
– la Chef de l’État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza ;
– le Premier ministre, M. André Nzapayéké ;
– le ministre de la Défense, général Thomas Théophile Tchimangoua ;
– le ministre de l’administration du territoire, M. Aristide Soukambi ;
2./ Autorités militaires :
– le commandant de l’opération Sangaris, général Francisco Soriano, son état-major et les personnels de la force, à Bangui, dans ses faubourgs et à Bambari ;
– le commandant de l’opération EUFOR-RCA à Bangui, général Thierry Lion, son état-major, et les personnels de la force ;
– le commandant de la MISCA, général Jean-Marie Michel Mokoko, son état-major, et les personnels de la force ;
– le commandant de la MINUSCA, général Babacar Gaye ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Charles Malinas, l’attaché de défense, colonel Yves Dépit, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure ;
– Délégation de l’Union européenne : le délégué, M. Jean-Pierre Reymondet-Commoy ;
4./ Représentants de la société civile et acteurs économiques :
– les hautes autorités religieuses du pays ;
– les représentants d’organisations humanitaires.
Ø République du Tchad (N’Djamena, Faya-Largeau, Zouar) ;
1./ Autorités politiques :
– Derdeï, sultan et chef traditionnel des Toubous, M. Erzeï Barkaï ;
– le gouverneur de Faya-Largeau ;
– les préfets de Faya-Largeau et de Zouar ;
2./ Autorités militaires :
– le commandant de l’opération Épervier, colonel Paul Peugnet, son état-major et les personnels de la force, à N’Djamena, Faya-Largeau et Zouar ;
– l’ensemble des officiers français coopérants ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadrice, Mme Evelyne Descorps, l’attaché de défense, colonel Michel de Mesmay, et l’ensemble des chefs de services, notamment l’attaché de sécurité intérieure ;
– Ambassade des États-Unis : l’ambassadeur, M. James Knight ;
– Ambassade d’Allemagne : l’ambassadeur, M. Elmut Kulitz ;
– Délégation de l’Union européenne : l’ambassadeur, Mme Hélène Cavé.
Ø Émirats arabes unis (Abou-Dhabi, Al Dhafra, Zayed Military City)
1./ Autorités militaires :
– l’amiral commandant de la zone maritime de l’océan Indien et les forces maritimes de l’océan Indien (ALINDIEN), également commandant des Forces française aux Émirats arabes unis (COMFOR FFEAU), contre-amiral Antoine Beaussant, son état-major et les unités placées sous son autorité, à Abou-Dhabi, à Al Dhafra et à Zayed Military City ;
2./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Michel Miraillet, l’attaché de défense, colonel Philippe Douard, et l’ensemble des chefs de services intéressés ;
3./ Acteurs économiques du secteur de la défense :
– les responsables de la société DCI en charge de la gestion de l’hébergement des personnels des Forces française aux Émirats arabes unis ;
– le lieutenant-colonel Sébastien de Peyret, en charge pour la société DCI d’une mission de traitement des opérations urbaines pour Al Hamra Training City.
Ø République de Djibouti (Djibouti, centre d’entraînement) ;
1./ Autorités politiques :
– le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahamoud Ali Youssouf ;
– le ministre de la Défense, M. Hassan Darar Houffaneh ;
2./ Autorités militaires :
– le commandement des Forces françaises à Djibouti : l’adjoint interarmées, colonel Josselin Jonacovic, le commandant de la base aérienne 188, colonel Julien Sabene, le chef de corps du 5e régiment interarmes d’outre-mer, lieutenant-colonel Jérôme Mallard ;
– le chef d’état-major général des armées, général Fathi Ahmed Houssein ;
– le directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Kaireh ;
3./ Représentations diplomatiques :
– Ambassade de France : l’ambassadeur, M. Serge Mucetti, l’attaché de défense, colonel Denis Millot, et l’ensemble des chefs de services intéressés.
ANNEXE 3
PRINCIPALES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES PRÉVUES EN AFRIQUE
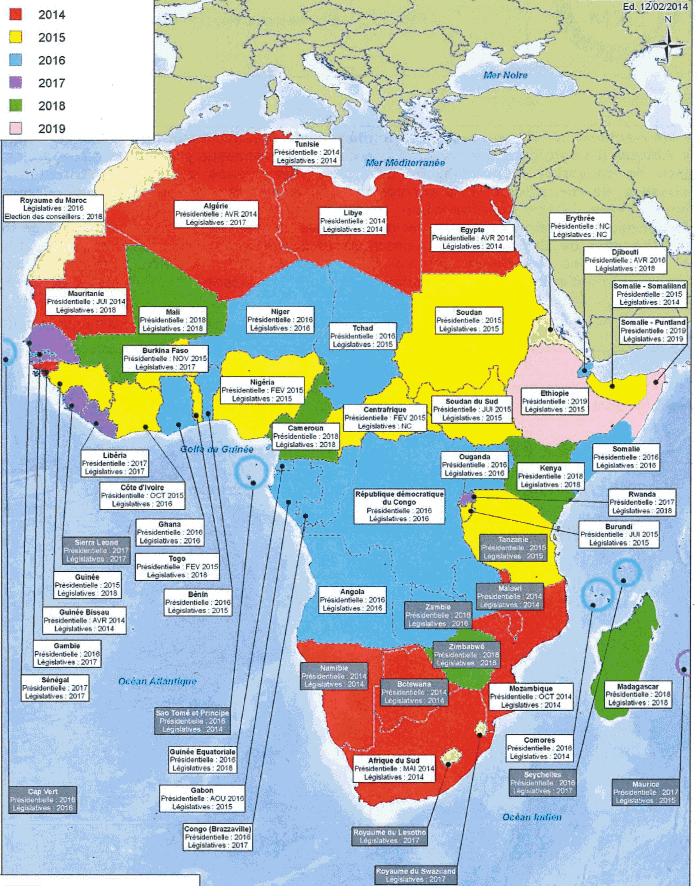
Source : ministère de la Défense
1 () Pour une analyse détaillée de l’érosion continue des parts de marchés des entreprises françaises en Afrique, notamment au profit de « grands pays émergents » comme la Chine, on pourra utilement se rapporter au rapport intitulé « L’Afrique est notre avenir », rédigé en 2013 par nos collègues sénateurs Jeanny Lorgeoux et Jean-Marie Bockel au nom du groupe de travail sur la présence de la France dans une Afrique convoitée.
2 () Le 9 septembre 2013, le « Pacific Falcon » navire de recherche sismique de pavillon singapourien et le navire de pêche « Storm West » de pavillon norvégien ont été interceptés par la frégate de surveillance « Nivôse » en ZEE Bassas da India / Europa. Ces deux navires travaillaient de concert, en exploration sismique, a priori pour une société de capitaux européens. Le « Pacific Falcon » a indiqué avoir demandé l’autorisation au Mozambique de mener ces explorations, prétextant ne pas connaitre la ZEE revendiquée française. Il n’a pu produire la preuve de ce qu’il avançait.
3 () Assemblée nationale, rapport d’information n° 1288 de MM. Christophe Guilloteau et Philippe Nauche en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’opération Serval au Mali, juillet 2013.
4 () Audition du 27 mai 2014.
5 () Missions de courte durée (quatre mois).
6 () Missions de longue durée (deux ou trois ans).
7 () Cette Commission est composée de 15 membres, élus pour un mandat de trois ans. Elle remplace l’ancienne Commission nationale « dialogue et réconciliation » (CDR).
8 () Notamment les détachements de liaison et d’appui (DLA) et les détachements d’appui opérationnel (DAO) français placés auprès des FAMa, de l’EUTM et de la MINUSMA, composés de 32 personnels français.
9 () Assemblée nationale, rapport d’information n° 911, présenté au nom de la commission des affaires européennes par MM. Joaquim Pueyo et Yves Fromion, 9 avril 2013.
10 () Audition du 27 mai 2014.
11 () Audition du 14 janvier 2014, compte-rendu n° 27.
12 () Audition du 27 mai 2014 du ministre de la Défense, compte rendu n° 52.
13 () Audition du 16 avril 2014, compte-rendu n° 45.
14 () Première séance du mardi 10 décembre 2013.
15 () Audition du 26 février 2014, compte-rendu n° 36.
16 () Audition du 16 avril 2014, compte-rendu n° 45.
17 () Audition du 16 avril 2014, compte-rendu n° 45.
18 () Audition du 16 avril 2014, compte-rendu n° 45.
19 () L’essentiel des forces tchadiennes d’intervention au Mali provenait de cette DGSSIE.
20 () 2,5 millions de dollars américains.
21 () Ceux conclus par la France avec le Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Sénégal et le Togo.
22 () Les critères légaux d’« ivoirité » restent stricts : tout candidat doit être né de deux parents nés eux-mêmes Ivoiriens, ce qui pose deux problèmes : 1./ pour les candidats : Alassane Dramane Ouattara ne remplit pas ces critères, sa candidature n’ayant été permise que de façon dérogatoire par les accords de Marcoussis ; 2./ pour les électeurs : un nombre important d’Ivoiriens sont nés de parents étrangers, notamment burkinabès, qu’il peut être mal avisé d’exclure du corps politique.
© Assemblée nationale
