QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant
de la mission Recherche et enseignement supérieur
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Alain CLAEYS et Patrick HETZEL
Députés
——
MM. Olivier CARRÉ et Alain CLAEYS
Présidents.
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Olivier Carré, Alain Claeys, présidents, M. Gilles Carrez, président de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, MM. Christophe Castaner, Charles de Courson, Marc Francina, Jean-Pierre Gorges, Laurent Grandguillaume, Patrick Hetzel, Jérôme Lambert, Hervé Mariton, Nicolas Sansu, Mme Eva Sas, MM. Pascal Terrasse, Philippe Vigier, Éric Woerth.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE : LE CONTENU ET LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE 13
I. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MIRES) 13
A. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR 13
B. LES FINANCEMENTS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR AFFECTÉS À LA MIRES 14
1. Des dotations élevées, des modes d’attribution novateurs 14
2. Des programmes et des actions nombreux 15
II. QUELLES MODALITÉS DE GESTION POUR LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR AFFECTÉS À LA MIRES ? 19
A. LA REVENDICATION D’UNE GOUVERNANCE PRÉCISÉMENT DÉFINIE ET TRANSPARENTE 19
B. DES PROJETS DÉSORMAIS CONTRACTUALISÉS, DES FINANCEMENTS EFFECTIVEMENT DÉCAISSÉS 22
1. Une contractualisation effectuée avec soin malgré des débuts difficiles 22
2. Des dotations désormais effectivement contractualisées et décaissées 23
C. L’ORGANISATION DU SUIVI DES PROJETS 24
1. Le suivi des projets dont l’opérateur est l’ANR 24
a. L’organisation du suivi par l’ANR 24
b. Le rôle des comités de pilotage et du CGI 25
2. Le suivi des autres projets 26
a. Les projets de recherche nucléaire 26
b. Les projets de recherche aéronautique 27
D. LES DÉCISIONS D’INFLEXION OU D’ARRÊT DES PROJETS 28
1. L’organisation de la prise des décisions 28
2. Quelques exemples de décisions 29
a. Les Idex 29
b. Les autres projets suivis par l’ANR 30
c. Les projets suivis par d’autres opérateurs 31
E. DES PROCÉDURES BUDGÉTAIRES QUI VISENT À GARANTIR LE CARACTÈRE ADDITIONNEL DES FINANCEMENTS DU PIA 31
F. LE RATTACHEMENT DU CGI AU PREMIER MINISTRE : UN STATUT SOLIDE 33
III. QUELLES LEÇONS TIRER DES PREMIÈRES ANNÉES DE GESTION DU PIA 1 ? 35
A. L’INSTRUCTION DES PROJETS 35
1. Conserver la gouvernance de la sélection des projets, réduire les délais de leur instruction et en simplifier les procédures 35
2. Laisser du temps à la maturation des projets 37
B. LE SUIVI DES PROJETS 38
1. Une organisation de la gouvernance jugée pertinente 38
2. Une simplification souhaitable des modalités du suivi 39
DEUXIÈME PARTIE : LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET CLINIQUE 41
I. DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES, DES ACTIONS NOMBREUSES, DES FINANCEMENTS ÉLEVÉS 41
A. DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 41
1. Le financement de l’excellence 41
2. Un objectif de structuration 42
B. LES ACTIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE FONDAMENTALE GÉNÉRALE 44
1. Des financements considérables désormais presque entièrement attribués 44
2. Les initiatives d’excellence (Idex) 46
3. Les laboratoires d’excellence (Labex) 48
4. Les équipements d’excellence (Equipex) 50
5. Les initiatives d’excellence en formations innovantes (Idefi) 51
6. Les actions « Opération Campus » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » 52
C. LES ACTIONS SPÉCIFIQUES À LA SANTÉ ET AUX BIOTECHNOLOGIES 53
1. Des dotations contractualisées en totalité 53
2. Les instituts hospitalo-universitaires (IHU) 54
3. L’action « Santé et biotechnologies » 56
II. D’INDÉNIABLES ÉLÉMENTS DE RÉUSSITE 58
A. LES IDEX : UN INSTRUMENT DE STRUCTURATION DES SITES 58
1. Des rapprochements effectifs entre universités, écoles et organismes de recherche 58
2. L’émergence d’une gouvernance des sites 60
a. La construction d’une gouvernance de site : une entreprise d’envergure 60
b. Des convergences entre Idex et nouveaux modèles de structuration (fusions et COMUE) 61
c. Un rôle pour les alliances de recherche ? 62
3. De premières répercussions positives 63
a. Une visibilité accrue et une meilleure lisibilité des diplômes 63
b. Les prémisses d’évolutions profondes 64
B. LES LABEX : DES LEVIERS POUR L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE 65
1. À l’échelle nationale, des éléments fédérateurs 65
2. Des instruments de coordination forts et porteurs de visibilité internationale 65
C. LES FINANCEMENTS DU PIA : DES EFFETS DYNAMISANTS 67
III. DE NOUVEAUX DÉFIS À SURMONTER 68
A. QUELLE PLACE POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? 68
1. L’aménagement du territoire, un non-critère pour les investissements d’avenir 68
a. La non-prise en compte de l’aménagement du territoire en tant que tel 68
b. Les Idex, des instruments valorisants pour les territoires 69
2. Prévenir les risques de déséquilibres 70
a. Les I-SITE, une première réponse pour les territoires sans Idex 70
b. Des méthodes renouvelées pour la création nécessaire d’Idex supplémentaires 70
B. QUELLE GOUVERNANCE PÉRENNE POUR LES SITES D’EXCELLENCE ? 72
1. Deux causes de fragilité pour les Idex 72
a. La gouvernance des universités 72
b. Le risque de dilution 73
2. La gouvernance des Idex via les COMUE : une solution praticable 74
3. La dévolution future des dotations non consommables : un enjeu pour la stabilisation des Idex 75
C. TRAITER LES DÉSÉQUILIBRES FINANCIERS 77
1. Des financements de projets seulement partiels 77
a. Un effet de levier pas toujours opérant qui imposera des revues de programmes 77
b. Un taux de prise en charge des coûts indirects à accroître 78
c. Aller vers le financement des projets à coût complet 79
2. Des financements dont la pérennité n’est pas assurée 80
a. Le financement des équipements 80
b. Les recrutements sur contrat pour la conduite des projets 81
D. MIEUX METTRE EN COHÉRENCE PIA ET POLITIQUE DE LA RECHERCHE 82
1. Le PIA 1 : des effets d’exclusion de certains projets de recherche 82
a. Des projets stratégiques sans financements 82
b. Des conséquences imprévues 84
2. Développer la coordination interministérielle 84
a. Mettre en place un dialogue suivi 84
b. De premiers progrès 86
c. Créer un outil interministériel spécifique ? 86
TROISIÈME PARTIE : LA VALORISATION DE LA RECHERCHE 89
I. LE DISPOSITIF DE VALORISATION 89
A. LA CHAÎNE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 89
B. LES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 91
C. LA MISE EN œUVRE FINANCIÈRE DE LA VALORISATION 92
II. LES SOCIÉTÉS D’ACCÉLÉRATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 93
A. UN OUTIL DÉFINI COMME STRATÉGIQUE 93
1. La valorisation de la recherche : un dispositif lacunaire 93
2. Les SATT : des structures de proximité au développement rapide 93
a. Un développement rapide 93
b. Le développement de structures régionales préexistantes 95
B. UN OUTIL CONTESTÉ 96
1. La dimension régionale, une dimension trop restrictive pour la valorisation de la recherche menée par les acteurs nationaux 97
2. La commercialisation des brevets, un mode de valorisation seulement partiel de la recherche 98
3. Des SATT rentables à horizon de 10 ans, un objectif déstructurant pour la valorisation de la recherche ? 99
C. QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES SATT ? 100
1. Le caractère régional des SATT : source de leurs succès et cause de leurs limites 100
2. Un nécessaire assouplissement du modèle qui préserve la liberté stratégique des partenaires 101
a. L’indispensable assouplissement du modèle 101
b. Le souhait d’un recentrage des SATT sur leur mission de maturation 102
c. Vers une articulation nouvelle entre SATT et grands organismes de recherche ? 103
3. La question de la rentabilité : un élément clé 104
4. Un dispositif qui doit évoluer et s’affiner 107
III. LES CONSORTIUMS DE VALORISATION THÉMATIQUE 108
A. DES INSTRUMENTS DESTINÉS À L’IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES VALORISABLES 108
B. DES ACTIONS DIVERSIFIÉES 109
IV. FRANCE BREVETS 110
1. Un modèle exigeant 112
2. Des modalités d’action différenciées 113
3. Des moyens en personnel pointus 114
C. FRANCE BREVETS ET LES AUTRES OUTILS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE : DES STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES 115
D. UN NOUVEAU MÉTIER POUR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 116
V. LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUES : LES IRT, ITE ET INSTITUTS CARNOT 117
A. LES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 117
1. Des débuts présentés comme encourageants 117
2. Un statut rigide facteur de difficultés 118
B. LES INSTITUTS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UNE MISE EN PLACE DIFFICILE 119
C. LES INSTITUTS CARNOT : UN PREMIER BILAN DÉCEVANT 120
D. DES DÉVELOPPEMENTS À SURVEILLER ET À RETRAVAILLER 121
QUATRIÈME PARTIE : LES FILIÈRES INDUSTRIELLES 123
I. DES PROJETS CHOISIS POUR LEUR CARACTÈRE PORTEUR 123
A. L’ACTION ESPACE 123
B. LE PROGRAMME RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L’AÉRONAUTIQUE 124
C. LE PROGRAMME NUCLÉAIRE DE DEMAIN 124
II. DES FINANCEMENTS DISCRIMINANTS 126
A. DES DOTATIONS RAPIDEMENT AFFECTÉES 126
B. DES FINANCEMENTS EN SUPPLÉMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 127
1. Des crédits indispensables 127
2. Les avances remboursables de l’Airbus A350 XWB : un cas spécifique 128
III. DES SPÉCIFICITÉS LIÉES À L’ORGANISATION DES FILIÈRES 128
A. DES FILIÈRES TRÈS BIEN STRUCTURÉES 128
B. L’ABSENCE D’APPELS À PROJETS SÉLECTIONNÉS PAR DES JURYS 129
C. L’ABSENCE DE RECOURS À LA CHAÎNE DE VALORISATION INSTAURÉE PAR LE PIA 130
IV. DES RÉSULTATS DÉJÀ POSITIFS 131
A. UN EFFET DE LEVIER RECHERCHÉ ET OBTENU 131
B. DES CONSÉQUENCES POSITIVES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 133
1. La filière spatiale 133
2. L’industrie aéronautique 134
3. La filière nucléaire 135
C. L’ATTENTE RAISONNABLE DE RETOURS SUR INVESTISSEMENT 135
V. LES LIMITES DES CHOIX OPÉRÉS 136
A. DES FINANCEMENTS TROP CENTRÉS VERS L’AVAL ? 136
B. UN RISQUE À LONG TERME POUR L’EXCELLENCE 137
C. LA NÉCESSITÉ D’UNE MEILLEURE CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE 138
CONCLUSIONS 139
PROPOSITIONS 145
EXAMEN EN COMMISSION 147
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 161
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LES RAPPORTEURS LE MARDI 1ER JUILLET 2014 À LA FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE CAMPUS PARIS SACLAY 297
ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DU SITE DE PARIS SACLAY 298
ANNEXE 3 : LISTE DES IDEX 302
ANNEXE 4 : LISTE DES LABEX INTÉGRÉS AUX IDEX 303
ANNEXE 5 : LISTE DES LABEX HORS IDEX 306
ANNEXE 6 : LISTE DES IDEFI 309
ANNEXE 7 : LISTE DES EQUIPEX 311
ANNEXE 8 : LISTE DES IHU, CHAIRES D’EXCELLENCES ET PHUC 314
ANNEXE 9 : LISTE DES SATT ET CVT 315
ANNEXE 10 : LISTE DES IRT, ITE ET INSTITUTS CARNOT 316
ANNEXE 11 : LISTE DES PROJETS VALIDÉS AU TITRE DES FILIÈRES SPATIALE ET AÉRONAUTIQUE 318
ANNEXE 12 : MONTANT DES DÉCAISSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE DU PIA 1 AU 31 DÉCEMBRE 2014 319
Créé par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, le programme d’investissements d’avenir (PIA) est un outil financier très spécifique de l’action publique. Il mobilise des crédits considérables (35 milliards d’euros), au statut très particulier. En effet, ces crédits sont issus pour leur plus grande part de l’emprunt. Ils ont vocation à être affectés exclusivement à l’investissement et ne doivent pas se substituer à des crédits budgétaires mais venir en supplément de ceux-ci. Ils relèvent dans les écritures publiques de procédures de gestion spécifiques. Enfin, certains de ces crédits, dits non consommables – ou non consumptibles – portent des intérêts et seuls ces intérêts annuels peuvent être affectés à des investissements.
Le PIA s’applique à des domaines aussi nombreux et divers que la transition énergétique (dans l’énergie, les transports…), le numérique, la santé, l’emploi, l’égalité des chances, l’urbanisme, le logement, les filières industrielles et le développement des PME.
Dans ces domaines, il finance des actions multiformes : la restructuration de l’enseignement supérieur et de la recherche, des laboratoires, des instituts de recherche appliquée, des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, des démonstrateurs industriels, des opérations de rénovation thermique des logements, des organismes de valorisation industrielle de la recherche.
Quatre ans après son lancement, il a donc paru utile à la Mission d’évaluation et de contrôle de la Commission des finances de s’intéresser à la mise en œuvre du PIA. Quel est l’état d’avancement des projets financés ? Sont-ils correctement financés ? Les projets conduits répondent-ils bien aux conditions fixées pour leur financement ? Comment l’État s’en assure-t-il ? Comment être sûr que les financements ne se substituent pas à des financements budgétaires ? Enfin, peut-on tirer un premier bilan de la mise en œuvre du premier PIA et donc des enseignements pour le PIA 2, lancé en 2013 ?
Eu égard à l’ampleur du champ couvert par le PIA, la Mission d’évaluation et de contrôle a décidé de limiter ses investigations aux crédits du PIA 1 attribués aux opérateurs relevant budgétairement – aux termes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) – de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES).
Ce choix avait l’avantage de réduire la multiplicité des actions à analyser et des acteurs à entendre, tout en préservant plus que l’essentiel. Les crédits du PIA affectés à des opérateurs relevant du champ de la MIRES représentent en effet près des deux tiers des fonds attribués par le premier PIA. Ils concernent à la fois l’un des plus forts enjeux assigné au PIA, c’est-à-dire l’avenir et l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche – recherche fondamentale et appliquée –, mais aussi des politiques de valorisation industrielle, voire d’excellence et d’innovation industrielle, les recherches civiles du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), celles du Centre national d’études spatiales (CNES) et les financements publics de la recherche aéronautique passant par le budget de la MIRES. Enfin, les actions financées par le PIA grâce à des crédits non consumptibles relèvent toutes du champ de la MIRES.
La Mission d’évaluation et de contrôle a chargé de l’élaboration de ce rapport l’un de ses présidents, Alain Claeys, par ailleurs rapporteur spécial des crédits de la MIRES, et Patrick Hetzel, membre de la commission des Affaires culturelles et rapporteur pour avis de ces crédits.
Enfin, les rapporteurs ont jugé que, eu égard à l’état d’avancement de ce programme, traiter de la conduite des actions relevant du PIA 2 aurait été prématuré. Seule donc la conduite des programmes et actions relevant du PIA 1 est analysée dans le présent rapport.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE : LE CONTENU ET LA GOUVERNANCE
DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR
DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
I. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MIRES)
A. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Le programme d’investissements d’avenir (PIA), décidé par le Président de la République en décembre 2009 – dit PIA 1 –, est un programme d’investissement de 35 milliards d’euros, qui vise à rendre le pays plus compétitif et à favoriser une croissance durable.
La création du PIA a fait suite aux propositions issues du rapport de la commission « Juppé-Rocard », commission présidée par ces deux anciens Premiers ministres qui avait été créée pour engager « le grand débat sur les priorités qui doivent préparer l’avenir de la France ». Afin d’assurer la transition vers un nouveau modèle de développement, le rapport, s’inscrivant dans une perspective de long terme, préconisait de renforcer la recherche et l’innovation, en particulier le lien entre la recherche amont et aval, et d’accélérer la mutation des secteurs porteurs de l’économie. À cette fin, il définissait sept axes stratégiques d’investissement. Il estimait le besoin d’investissement de l’État à 35 milliards d’euros et recommandait de financer ces investissements au moyen de l’emprunt. La ministre de l’économie de l’époque, Mme Christine Lagarde, avait déclaré que l’investissement opéré via ce « Grand Emprunt » devait permettre de générer en moyenne 0,3 % de croissance supplémentaire chaque année pendant dix ans. Aux termes de cette évaluation, basée sur des études de l’OCDE, du Conseil d’analyse économique et du ministère des finances sur l’impact d’un surcroît de dépenses de recherche et développement, d’enseignement supérieur et de développement des technologies de l’information, d’ici à 2020 le PIB serait ainsi dopé de 3 %, ce qui occasionnerait des recettes fiscales et sociales supplémentaires quasiment du montant des investissements initiaux, aboutissant à un autofinancement du Grand Emprunt.
Un Grand Emprunt de 22 milliards d’euros fut donc lancé sur les marchés financiers, les 13 milliards restants provenant du remboursement par les banques des fonds prêtés pendant la crise économique de 2008. La loi de finances rectificative du 9 mars 2010 a ensuite ouvert les crédits correspondants : 34,64 milliards de crédits budgétaires.
Pour assurer la gouvernance des crédits du programme d’investissements d’avenir, un décret du 22 janvier 2010 a créé les fonctions de commissaire général à l’investissement, placé directement sous l’autorité du Premier ministre, et de commissaire général adjoint.
Le PIA a alors été structuré autour de cinq priorités stratégiques déclinées en 35 actions : l’enseignement supérieur et la formation (11,9 milliards), la recherche (7,9 milliards), les filières industrielles et les PME (6,5 milliards), le développement durable (5,1 milliards) et le numérique (4,5 milliards).
Une partie des dotations (15,03 milliards) est dite « non consommable » ou « non consumptible », ce qui signifie que seuls les intérêts annuels de la dotation initiale, produits par la rémunération de celle-ci sur un compte du Trésor, peuvent être consommés. Le principe retenu est que les intérêts ne sont pas capitalisables.
B. LES FINANCEMENTS DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR AFFECTÉS À LA MIRES
1. Des dotations élevées, des modes d’attribution novateurs
Au titre du PIA 1 21,9 milliards d’euros ont été attribués à la Mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur (MIRES) par la loi de finances rectificative pour 2010.
Ces crédits présentent la particularité de ne pas être tous consommables. Le montant de 21,9 milliards d’euros se décompose en effet entre 6,87 milliards d’euros de crédits consommables, dont on verra plus loin qu’ils sont engagés et décaissés au fur et à mesure de l’avancement des projets, et 15,03 milliards d’euros de crédits non consommables, placés au taux de 3,413 %, et dont les intérêts sont versés, au rythme de deux fois par an, aux porteurs des projets sélectionnés.
En mai 2013, la Cour des comptes a élaboré un rapport intitulé « Le lancement des investissements d’avenir relevant de la MIRES (1)», rapport qui a été rendu public à la demande de la Commission des finances de l’Assemblée nationale et figure désormais sur le site internet de la Cour.
Dans ce rapport, la Cour a calculé les intérêts annuels que génèrent ces placements. En régime de croisière, ils sont de 518 millions d’euros par an environ. Selon la Cour, le total des intérêts, sur 10 ans (2010-2020) se monte à près de 5 milliards d’euros. Sur les années 2015-2020, ils se montent à 3,06 milliards d’euros.
Ainsi, toujours selon la Cour des comptes, eu égard aux modalités particulières de financement constituées par l’existence d’une dotation non consommable, les 21,9 milliards de crédits relevant de la mission MIRES correspondent, en équivalent budgétaire, à 11,81 milliards sur la période 2010-2020. Cette estimation est cependant une estimation basse : en effet elle ne tient pas compte des éventuels transferts, avant cette échéance, de tout ou partie des 15,03 milliards d’euros de dotations non consommables aux établissements de recherche et d’enseignement supérieur lauréats, à la suite d’évaluations positives, en 2016, des projets financés par celles-ci .
Les financements au titre du PIA 1 sont à mettre en regard du montant annuel des crédits budgétaires de la MIRES : avec une moyenne de 1,2 milliard d’euros par an, dont environ 1 milliard pour des actions de recherche, le PIA correspond à 7 % du financement annuel de la recherche opéré par la mission MIRES.
Ces crédits présentent par ailleurs la particularité de n’avoir été inscrits qu’une seule fois en loi de finances. Les montants ont été ensuite versés aux opérateurs, qui attribuent les fonds au fur et à mesure de la validation des étapes de chaque projet. Quoique versés chaque année, les intérêts des dotations consommables n’apparaissent pas non plus dans les comptes de la mission budgétaire MIRES. Les crédits de paiement qui leur correspondent figurent au programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’État.
2. Des programmes et des actions nombreux
Les crédits attribués à la MIRES ont été répartis en cinq programmes, eux-mêmes subdivisés en actions. Chaque action est pourvue d’un opérateur, chargé d’assurer le suivi des projets dont il a la charge. Ces opérateurs sont l’Agence nationale de la Recherche (ANR), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) et enfin l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
On trouvera ci-après la liste des programmes et actions, telle qu’elle se présentait au 31 juillet 2013 (2).
INVESTISSEMENTS D’AVENIR
AU TITRE DE LA MISSION « RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR »
(JUILLET 2013) (3)
(en milliards d’euros)
Programmes |
Actions |
Opérateur |
Dotation initiale |
Pôles d’excellence |
Initiatives d’excellence (Idex) (1) |
ANR |
7,7 |
Laboratoires d’excellence (Labex) (4) |
ANR |
1 | |
Initiatives d’excellence en formations innovantes – (Idefi) |
ANR |
0,15* | |
Fonds national de valorisation (8) |
ANR |
0,95 | |
France Brevets |
ANR/CDC |
0,05 | |
Instituts de recherche technologique (IRT) |
ANR |
2 | |
Instituts Carnot |
ANR |
0,5 | |
Instituts hospitalo-universitaires (IHU) |
ANR |
0,85 | |
Opération Campus et |
ANR |
1,3 | |
ANR |
1 | ||
Projets thématiques d’excellence |
Santé et biotechnologies |
ANR |
1,55 |
Équipements d’excellence (Equipex) |
ANR |
1 | |
Espace |
CNES |
0,5 | |
Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées (IEED) |
Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées (IEED) |
ANR |
1 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
ONERA |
1,5 |
Nucléaire de demain |
Réacteur de 4ème génération ASTRID |
CEA |
0,65 |
Réacteur Jules Horowitz |
CEA |
0,25 | |
Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs |
ANDRA |
0,1 | |
Recherche en matière de sûreté nucléaire |
ANR |
0,05* |
*Après redéploiement au sein des crédits du programme.
Source : Commission des finances, d’après les données des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir (« jaunes » budgétaires).
On le voit, les axes d’action décidés sont nombreux. Le programme Pôles d’excellence est particulièrement varié puisqu’il ne comprend pas moins de dix actions, consacrées les unes à l’enseignement supérieur et à la recherche proprement dits (Initiatives d’excellence, ou Idex, qui sont en fait des sites d’excellence regroupant enseignement supérieur et recherche, Laboratoires d’excellence, ou Labex , Initiatives d’excellence en formations innovantes, ou Idefi, Opération Campus et Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay), d’autres à la valorisation de la recherche (Fonds national de valorisation , société France Brevets), à la recherche appliquée et aux partenariats de recherche public-privé (Instituts de recherche technologique, Instituts Carnot, Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées), et enfin spécifiquement à la formation et aux soins de pointe en matière de santé (Instituts hospitalo-universitaires).
La recherche en matière de santé réapparaît dans le programme Projets thématiques d’excellence (action Santé et biotechnologies), où elle côtoie la recherche spatiale (action Espace) mais aussi l’équipement des laboratoires, sans mention de spécialités (action Équipements d’excellence – Equipex).
Enfin, le programme Recherche dans le domaine de l’aéronautique ne comprend qu’une seule action, du même nom, et le programme Nucléaire de demain en compte quatre (Réacteur de 4ème génération ASTRID, Réacteur Jules-Horowitz, Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs et Recherche en matière de sûreté nucléaire).
Dans son rapport sur « Le lancement des investissements d’avenir relevant de la MIRES, la Cour des comptes a classé les actions non par programme mais par opérateur.
La Cour a procédé ensuite à l’analyse de ces actions. Les actions relevant de l’ANR ont été regroupées selon trois thématiques, les projets d’excellence en matière d’enseignement supérieur et de recherche, les actions spécifiquement consacrées au secteur de la biologie et de la santé et les actions consacrées à la valorisation de la recherche et à son transfert vers l’industrie. Les actions relevant des autres opérateurs ont été quant à elles regroupées en un chapitre intitulé « filières industrielles ». C’est ce dernier classement qui a paru le plus pertinent aux rapporteurs pour évaluer les actions conduites en application du PIA. Il figure ci-après.
INVESTISSEMENTS D’AVENIR AU TITRE DE LA MISSION
« RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR »
RECOMPOSITION PAR AXES D’ACTION (4)
(en milliards d’euros)
Actions |
Opérateur |
Dotation initiale |
Programmes de rattachement |
Recherche fondamentale générale | |||
Initiatives d’excellence (Idex) (1) |
ANR |
7,7 |
Pôles d’excellence |
Laboratoires d’excellence (Labex) (4) |
ANR |
1 | |
Initiatives d’excellence en formations innovantes – (Idefi) |
ANR |
0,15 | |
Opération Campus et Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay (8) |
ANR |
1,3 | |
ANR |
1 | ||
Équipements d’excellence (Equipex) |
ANR |
1 |
Projets thématiques d’excellence |
Total |
12* |
||
Santé et biotechnologies | |||
Instituts hospitalo-universitaires (IHU) |
ANR |
0,85 |
Pôles d’excellence |
Santé et biotechnologies |
ANR |
1,55 |
Projets thématiques d’excellence |
Total |
2,4 |
||
Valorisation de la recherche | |||
Fonds national de valorisation |
ANR |
0,95 |
Pôles d’excellence |
France Brevets |
ANR/CDC |
0,05 | |
Instituts de recherche technologique (IRT) |
ANR |
2 | |
Instituts Carnot |
ANR |
0,5 | |
Instituts de transition énergétique (ITE) (ex-IEED) |
ANR |
1 |
IEED |
Total |
4,5 |
||
Filière spatiale | |||
Espace |
CNES |
0,5 |
Projets thématiques d’excellence |
Filière aéronautique | |||
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
ONERA |
1,5 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
Filière nucléaire | |||
Réacteur de 4ème génération ASTRID |
CEA |
0,65 |
Nucléaire de demain |
Réacteur Jules Horowitz |
CEA |
0,25 | |
Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs |
ANDRA |
0,1 | |
Recherche en matière de sûreté nucléaire |
ANR |
0,05 | |
Total |
1* | ||
Total général |
21,9* |
||
* Les crédits destinés aux IDEFI et à la recherche en matière de sûreté nucléaire ayant été dégagés par redéploiement au sein des dotations de leur programme respectif ne sont pas inclus dans ces totaux. Source : Commission des finances, d’après les données des rapports relatifs à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir | |||
Avec 18,9 milliards de crédits, dont l’intégralité des 15,03 milliards de crédits non consommables, les actions gérées par l’ANR représentent 86 % des crédits du PIA du périmètre de la MIRES. Au sein de ces crédits :
– 12 milliards d’euros (63,5 % des crédits gérés par l’ANR et 54,8 % des dotations affectées à la MIRES) sont consacrés à des actions en faveur de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur proprement dits ;
– 2,4 milliards d’euros (12,7 % des crédits gérés par l’ANR et 11 % des dotations affectées à la MIRES) sont consacrés à la filière santé et biologie ;
– et 4,5 milliards d’euros (23,8 % des crédits gérés par l’ANR et 20,5 % des crédits du PIA affectés à la MIRES) sont consacrés à des actions de valorisation de la recherche et de recherche appliquée et industrielle.
Les dotations affectées à des filières industrielles se montent quant à elles à 3 milliards d’euros, soit 13,7 % des crédits du PIA relevant du périmètre de la MIRES. Elles sont réparties à raison de 1,5 milliard d’euros pour la filière aéronautique, 500 millions d’euros pour la filière spatiale et 1 milliard d’euros pour la filière nucléaire.
II. QUELLES MODALITÉS DE GESTION POUR LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR AFFECTÉS À LA MIRES ?
A. LA REVENDICATION D’UNE GOUVERNANCE PRÉCISÉMENT DÉFINIE ET TRANSPARENTE
La gouvernance du programme d’investissement d’avenir consacré à la MIRES est organisée autour de cinq principes. Elle a été présentée à la Mission d’évaluation et de contrôle par M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement.
• Des appels à candidature
Le choix des projets relevant de l’ANR repose sur « le recours à des appels à projets sélectionnés par des jurys internationaux composés de personnalités ayant une expertise dans les domaines traités ». Le Commissariat général à l’investissement lance des appels à manifestations d’intérêt ou à projets, et réunit des jurys d’experts, parfois internationaux. Ainsi, le jury des initiatives d’excellence est composé de vingt membres, dont sept Français, et est présidé par M. Jean-Marc Rapp, professeur à l’université de Lausanne.
Cette approche par appels à candidature, qui permet de révéler les projets d’excellence à partir du terrain (approche dite bottom up), a été jugée dès le départ la meilleure pour permettre la formulation de choix particulièrement structurants et innovants.
• Un choix reposant sur des critères de qualité ou d’excellence
Le choix des projets s’opère « en fonction de critères de qualité ou d’excellence », et « non pas, a priori, selon une logique d’aménagement du territoire ». La répartition des crédits selon des critères d’aménagement du territoire a donc été exclue, même si M. Louis Gallois a précisé que cela ne signifiait pas que le Commissariat général à l’investissement se désintéressait de l’impact territorial.
De fait, outre un suivi par projet et une synthèse par action des suivis par projet, l’opérateur ANR assure également, dans une approche transversale, un suivi régional trans-actions. « Il s’agit là d’une dimension territoriale que j’ai entrepris de renforcer à la demande des régions, qui veulent légitimement connaître l’impact des investissements d’avenir sur leur territoire » a indiqué M. Louis Gallois. « Ces bilans régionaux permettent de mieux évaluer comment les investissements d’avenir s’inscrivent dans l’écosystème de la recherche territoriale, en perspective cohérente avec l’autonomie croissante des pôles universitaires, ainsi que dans l’écosystème des entreprises » a aussi exposé Mme Pascale Briand, directrice générale de l’ANR.
Il faut noter que les conventions qui fixent les modalités de l’appel à projets, préalablement à la soumission de ces projets aux jurys, font l’objet d’une préparation soigneuse et sont revêtues de l’autorité du Premier ministre. M. Louis Gallois les présente ainsi : « Le CGI signe des conventions avec l’opérateur
– l’Agence nationale de la recherche. Ces conventions ont été établies par lui en relation étroite avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les éventuels conflits étant arbitrés au niveau du Premier ministre et la décision alors figée sous forme de « bleu » du Premier ministre – en pratique, pratiquement toutes les conventions sont « bleuies ». (…) Matignon souhaite pouvoir bleuir les conventions. Le Premier ministre les signe. Le Commissariat général à l’investissement est en effet un outil du Premier ministre et n’a pas d’autonomie vis-à-vis de ce dernier. »
• Des financements additionnels
« Les financements accordés sont des financements additionnels aux crédits budgétaires, et non pas substitutifs ». M. Louis Gallois a souligné que c’était là le principe « le plus difficile à faire respecter », le Commissariat général à l’investissement subissant « une pression très forte pour faire des investissements d’avenir la session de rattrapage des crédits sollicités par les différents ministres auprès du ministre du budget ». Pour résister à cette pression, sa « meilleure défense » consiste à s’appuyer « sur le Premier ministre ». Cette situation justifie ainsi à elle seule le rattachement du Commissariat général à l’investissement au Premier ministre, plutôt que, par exemple, au ministère chargé de la recherche ou au ministère chargé de l’industrie.
• Un principe de transparence
Le quatrième principe exposé par M. Louis Gallois est celui de « la transparence ». « Nous disposons à cette fin d’un comité de surveillance, au sein duquel l’Assemblée nationale est représentée, et qui est coprésidé par les deux initiateurs des investissements d’avenir, M. Alain Juppé et M. Michel Rocard. Ce comité, qui se réunit régulièrement, nous est très utile » a-t-il poursuivi. Le Commissariat général à l’investissement intensifie ses relations avec ce comité, en organisant avec lui, afin qu’il soit très au fait de ses activités, des réunions thématiques sur des sujets tels que la transition énergétique ou la recherche technologique.
« Professant la transparence, a poursuivi M. Louis Gallois, nous informons régulièrement le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – de nos travaux. Nous lui adressons une documentation assez abondante. Je suis auditionné plusieurs fois par an par les différentes commissions des deux Assemblées. Le « jaune » relatif aux investissements d’avenir, joint au projet de loi de finances, est un document très complet, auquel nous envisageons d’adjoindre un document d’accès plus aisé. »
Les rapporteurs donnent acte au Commissariat général à l’investissement du caractère très précis et complet de l’information communiquée au Parlement sur l’exécution du PIA. La difficulté vient plutôt du caractère souvent très technique de cette information, qui demande une bonne connaissance préalable des objets du PIA pour être pleinement efficace.
Il faut préciser également que le comité de surveillance des investissements d’avenir comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs.
• Le suivi et l’évaluation
Selon M. Louis Gallois : « Le suivi, qui doit être systématique, porte sur le respect des engagements pris et des procédures. L’évaluation, qui consiste à formuler un jugement plus global sur l’impact des investissements d’avenir et leur capacité à opérer des transformations, est pour nous la tâche la plus difficile. »
*
La première question à laquelle devait répondre la Mission d’évaluation et de contrôle était donc, bien sûr de vérifier comment le respect de ces principes avait été assuré depuis le lancement du PIA. Autrement dit :
– Quel suivi de la mise en œuvre des décisions du jury est-il assuré et comment ?
– Les organismes assurant le suivi disposent-ils des moyens nécessaires à la réalisation des tâches qui leur sont confiées ?
– Des décisions concrètes de réorientation ou d’abandon des projets permettent-elles de valider l’effectivité du contrôle ?
– Peut-on être sûr que les crédits du PIA ne viennent pas en substitution de crédits budgétaires ?
La Mission d’évaluation et de contrôle s’est donc intéressée à l’ensemble de la mise en œuvre des décisions des jurys internationaux. Il faut cependant préciser que, si les projets dont l’opérateur est l’ANR relèvent tous bien de choix effectués par des jurys indépendants, on verra que ceux relevant des opérateurs des filières industrielles ont été sélectionnés non pas par des jurys internationaux, mais à partir de propositions des acteurs de chacune des filières, acteurs qui sont parfois – dans les secteurs spatial et nucléaire, par exemple – les opérateurs eux-mêmes.
B. DES PROJETS DÉSORMAIS CONTRACTUALISÉS, DES FINANCEMENTS EFFECTIVEMENT DÉCAISSÉS
1. Une contractualisation effectuée avec soin malgré des débuts difficiles
Après la phase de sélection des projets, ce sont les opérateurs qui sont chargés de contractualiser avec les porteurs de projets et d’en assurer le financement et le suivi. Les termes de « convention » et de « conventionnement » sont aussi utilisés pour cette phase.
Les conventions élaborées lors de la phase de contractualisation ont été rédigées avec la plus grande précision, de façon à permettre de poser très précisément les conditions, et notamment les critères, du suivi : « Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation, le travail préalable mené par l’Agence nationale de la recherche, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et nous-mêmes lors de l’établissement de la convention permet de définir le processus d’évaluation et les documents, les indicateurs et le calendrier du suivi » a exposé M. Louis Gallois à la Mission d’évaluation et de contrôle. Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR, a indiqué elle aussi que : « Lors du conventionnement, nous avons attaché beaucoup d’importance à ce que soient respectés les engagements déclarés dans le projet initial soumis au jury. »
Si les critères et les conditions posées pour le suivi ont été tout à fait précis, en revanche, la phase de conventionnement a connu un déroulement difficile. Compte tenu de la complexité des nouveaux instruments financés par le PIA, du nombre et de l’ampleur des appels à projets, et enfin de leur lancement simultané, cette phase a pris du retard. « Pendant deux ans, a indiqué Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes, l’ANR s’est trouvé submergée par les dossiers. ». Pour pallier l’engorgement des procédures normales, des systèmes d’avance de fonds ont dû être mis en place pour permettre la création de certains Labex.
La complexité des éléments à fournir a aussi contribué aux difficultés rencontrées. Lors de son audition, le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a exposé que : « Les lourdeurs les plus considérables venaient surtout de l’ANR ; lors de la passation des conventions avec l’ANR, il nous a été demandé de remplir des demandes de renseignements tellement vastes que nous n’en comprenions ni les tenants ni les aboutissants. » Mme Nadia Bouyer a cependant souligné que : « si c’est à l’ANR que les porteurs de projet avaient affaire, il faudrait analyser l’ensemble du système pour savoir si la complexité des demandes émanait vraiment de l’ANR elle-même : sa convention avec l’État la contraint elle aussi à un reporting extrêmement précis. »
L’ANR a cependant finalement réussi à faire face, au prix d’un travail considérable de réorganisation, notamment de ses circuits financiers et comptables. Tous les projets qui pouvaient l’être sont conventionnés à ce jour. M. Patrick Lefas, président de la troisième chambre à la Cour des comptes, a indiqué à la Mission d’évaluation et de contrôle que l’ANR « n’a pas démérité ».
2. Des dotations désormais effectivement contractualisées et décaissées
L’analyse des attributions, contractualisations et décaissements des crédits a fait apparaître dans un premier temps un très faible engagement des crédits du PIA. Cette situation tenait aux difficultés de l’ANR à opérer l’étape préalable à la dépense, c’est-à-dire la contractualisation des projets. L’ANR ayant réussi à surmonter les difficultés de cette étape, les dotations sont désormais normalement engagées et décaissées.
Le détail des attributions, contractualisation et décaissements des dotations sera examiné non pas dans la présente partie du présent rapport, mais dans celles consacrées aux axes thématiques du programme d’investissements d’avenir dans le périmètre de la MIRES. En effet, certaines des dotations initiales ont pu être redéployées d’une action sur une autre – ainsi, une partie de la dotation destinée aux Idex a été transférée à l’action Labex. La faiblesse de la dépense sur certaines dotations peut aussi avoir pour cause des retards spécifiques ou des difficultés particulières de réalisation des actions financées ; l’analyse de la dépense est alors indissociable de celle de la conduite de l’action elle-même.
De façon générale, au 31 juillet 2014, date d’arrêt des chiffres publiés au sein du « jaune » annexé au projet de loi de finances pour 2015, plus de 20 milliards d’euros sur les 21,9 milliards d’euros de dotations affectées au périmètre de la MIRES par le PIA, soit 91 % de leur montant, avaient été attribués.
Sue ce montant, près de 19,5 milliards d’euros avaient été contractualisés, soit 97,5 % des crédits attribués et 89 % des crédits attribués.
Enfin, 3,72 milliards d’euros avaient effectivement été décaissés.
La modestie des décaissements par rapport à l’ensemble des crédits du PIA affectés à la MIRES ne doit pas faire conclure à des difficultés d’ensemble.
Il ne faut pas oublier en effet que sur les 21,9 milliards d’euros de dotations destinées à la MIRES, 15,03 milliards d’euros sont des dotations non consumptibles, dont les bénéficiaires ne perçoivent que les intérêts.
En estimant, sur la base des calculs de la Cour des comptes, à 1,67 milliard d’euros les intérêts versés aux bénéficiaires au 31 juillet 2014, on peut considérer que c’est 2,05 milliards d’euros sur les 7,07 milliards d’euros de dotations consommables qui ont été décaissés.
Les dotations sont évidemment versées au fil de la réalisation des projets qu’elles financent. Si l’on tient compte du retard initial des contractualisations, on peut considérer que l’état des décaissements traduit désormais non pas des difficultés dans la procédure de versement mais l’état de l’avancement des projets eux-mêmes. Comme on le verra dans les parties suivantes du rapport, quelques-uns des projets financés par le PIA connaissent en effet de réels retards.
Cette analyse est confortée par l’état des décaissements actualisé au 31 décembre 2014, communiqué aux rapporteurs par le Commissariat général à l'investissement : il était de 4,57 milliards d’euros : en cinq mois, ce sont 850 millions d’euros supplémentaires qui ont été décaissés.
C. L’ORGANISATION DU SUIVI DES PROJETS
1. Le suivi des projets dont l’opérateur est l’ANR
a. L’organisation du suivi par l’ANR
La Mission d’évaluation et de contrôle a pu constater que, pour chaque action, un suivi était organisé.
Ce suivi est entièrement assuré par l’opérateur. Le Commissariat général à l’investissement ne dispose pas des ressources humaines pour le faire. Comme l’a exposé M. Louis Gallois lors de son audition : « C’est le maître d’œuvre, l’ANR, qui fait entièrement le travail d’évaluation et de suivi. Pour les universités, nous ne disposons au CGI que de deux personnes et il est donc hors de question que nous le fassions. »
L’ANR considère désormais être dotée des outils suffisants pour effectuer ce suivi. Lors de son audition, Mme Pascale Briand, qui était alors sa directrice générale, avait ainsi déclaré à la Mission d’évaluation et de contrôle : « Nous nous sommes progressivement dotés des outils nous permettant d’effectuer un suivi satisfaisant et de produire les synthèses en temps voulu. Nous avons mis au point un cadre pour la remontée systématique des informations et leur traitement annuel. Au sein de ce cadre, nous mettons en œuvre, au cas par cas, une multiplicité d’actions permettant d’affiner ce suivi, notamment grâce à des visites de site ». Elle avait aussi indiqué que l’ANR considérait comme « suffisants » les budgets de gestion.
En revanche, elle s’était inquiétée des moyens humains : « La situation est beaucoup plus tendue, en revanche, sur le plan des moyens humains, et ce d’autant plus que nous sommes à la veille du PIA 2. » Sur ce point les rapporteurs considèrent qu’on ne peut pas instaurer un système de suivi sans prévoir les moyens nécessaires à son efficience.
De même qu’elle a été très attentive à ce que les conventions signées par les porteurs de projets respectent les engagements pris par eux devant les jurys, l’ANR s’attache au respect, dans la conduite des projets, des conventions signées : « dans le suivi, nous sommes attentifs au respect des engagements pris lors du conventionnement » a exposé Mme Pascale Briand. Au bout du compte : « En tant qu’opérateur de l’État, l’ANR met en œuvre les orientations fixées par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). » a-t-elle conclu.
L’ANR n’effectue cependant pas entièrement seule ce suivi : « Pour ce suivi (…) l’ANR s’appuie sur le jury ayant procédé à la sélection initiale. Ce dernier apprécie le franchissement des étapes et la conformité de celles-ci aux engagements contenus dans le conventionnement. Si des écarts sont constatés, ils doivent être justifiés, au risque, dans le cas contraire, de voir le projet arrêté » a exposé Mme Pascale Briand.
b. Le rôle des comités de pilotage et du CGI
L’ANR ne décide pas non plus seule des suites à donner au suivi qu’elle assure. Ce suivi est en effet opéré, pour chaque action, sous l’autorité d’un comité de pilotage, présidé par un représentant du ministère chargé de la politique publique concernée. « À la gestion des programmes d’investissements d’avenir sont associées des procédures interministérielles, les comités de pilotage (COPIL), auxquels participent, outre le Commissariat général, des représentants de plusieurs ministères. » a déclaré le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer à la Mission d’évaluation et de contrôle. C’est à ce comité que l’opérateur, autrement dit l’ANR, fait rapport : « Nous effectuons donc un suivi rigoureux des engagements, qui se traduit par un point d’étape au bout d’un an, avec un retour d’information sur l’évolution du projet et ses aspects financiers. »
« Les avis des jurys, a confirmé M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, sont transmis chacun à un comité de pilotage – présidé, pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ou par ses représentants. C’est au sein de ces comités que s’organise la coordination entre l’action du ministère et celle au titre des investissements d’avenir. ». « Le CGI, qui n’est pas toujours membre de ces comités, y assiste et transmet leurs décisions au Premier ministre, avec pour seul droit celui d’émettre un avis sur ces décisions. » a-t-il poursuivi.
Le comité propose « de grandes orientations au Premier ministre », a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de la recherche, « sachant que nous essayons toujours d’aboutir à un consensus ; quand un sujet n’est pas assez mûr, on le réexamine jusqu’à ce qu’on y parvienne. Dans 95 % des cas, le CGI a relayé auprès du Premier ministre une position conforme à ce que le comité de pilotage avait proposé par consensus. »
Les pouvoirs du Commissariat général à l’investissement dépassent cependant largement celui d’un simple spectateur : « Lorsque nous sommes en désaccord avec un ministre, nous en informons le Premier ministre, à qui il revient de trancher. », a ajouté M. Louis Gallois.
Pour résumer, l’ANR effectue le suivi de fond de la conduite des actions. En cas de doute sur la conformité de la conduite d’une action par rapport à la convention signée en application de la décision du jury, elle demande à celui-ci son avis. Elle fait ensuite rapport au comité de pilotage de l’action, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant. Le Commissariat général à l’investissement assiste au comité. Lorsqu’il y a consensus, y compris avec le Commissariat général à l’investissement, celui-ci transmet au Premier ministre la décision du comité. Lorsque le Commissariat général à l’investissement n’est pas d’accord avec la décision prise, il informe le Premier ministre du désaccord. Le Premier ministre arbitre alors.
2. Le suivi des autres projets
Si les projets placés sous le contrôle d’autres opérateurs que l’ANR
– autrement dit les projets relevant des trois filières industrielles déjà évoquées – ont été sélectionnés non pas par des jurys internationaux, mais à partir de propositions des acteurs de chacune des filières, acteurs qui sont parfois, dans les secteurs spatial et nucléaire, par exemple, les opérateurs eux-mêmes, les systèmes de suivi et d’attributions des fonds suivent peu ou prou le même modèle.
a. Les projets de recherche nucléaire
Les projets ASTRID et RJH sont suivis, chacun, par un comité présidé par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et comprenant des représentants de la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), de la direction du budget (DB), de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), du contrôle général économique et financier (CGEFI) et du directeur de programme « Énergie, économie circulaire » du Commissariat général à l’investissement (CGI). « Lors des réunions des comités de suivi, qui se tiennent au moins deux fois par an et font l’objet d’un compte rendu validé par toutes les parties, le CEA présente l’état d’avancement technique et financier du projet considéré, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la tenue du calendrier d’exécution, a indiqué M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, lors de son audition.
« Ces comités, a confirmé le directeur général de l’énergie et du climat, M. Laurent Michel, suivent la conformité de la réalisation des programmes par rapport à leur objet et contrôlent l’utilisation concomitante des crédits. Ils émettent des avis et recommandations, notamment concernant les validations de versements, préparatoires à la décision des services du Premier ministre, en l’occurrence le CGI. » Ainsi, a-t-il conclu « ces projets sont suivis de près, même si c’est le CEA, qui en est le responsable et qui doit les conduire à terme, à charge pour le comité de suivi d’en valider le bon avancement et d’autoriser les versements de crédits. »
b. Les projets de recherche aéronautique
En matière aéronautique, là aussi, pour assurer le suivi de l’action, un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place. Selon M. Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile : « Le comité de pilotage assure l’essentiel du suivi et de l’évaluation. Il s’appuie sur le bras armé que représente la DGA (Direction générale de l’armement) et sa capacité d’ingénierie : c’est elle qui instruit les projets et suit les opérations. »
Selon M. Thierry Stoltz, « une description de l’avancement des projets est faite lors de chaque COPIL ». Par ailleurs « deux formats de COPIL alternent : un format de COPIL « étatique » – où sont présents DGA, DGAC – Direction générale de l’aviation civile –, ONERA – Office national d’études et de recherches aérospatiales – et DGCIS – et un format élargi, où les pilotes industriels des plateformes viennent détailler l’avancement des projets. Dans ce deuxième format, le CGI peut interroger les industriels pour s’assurer que les projets sont conformes au dossier que l’équipe programme mixte a pu présenter à l’origine au COPIL. Le suivi est donc à la fois financier et technique. »
Enfin, le directeur général de l’aviation civile a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle que : « Les décisions de ce comité de pilotage, qui s’est réuni à dix reprises, sont collégiales et consensuelles. Je n’ai pas le souvenir d’une quelconque tension nécessitant un arbitrage du Premier ministre car les membres partagent tous l’objectif de la réussite industrielle. »
D. LES DÉCISIONS D’INFLEXION OU D’ARRÊT DES PROJETS
1. L’organisation de la prise des décisions
La pierre de touche de la réalité opérationnelle du suivi est évidemment l’existence de décisions de réorientation, voire d’arrêt, de certains projets, après constatation par le comité de pilotage de leur impossibilité à se concrétiser ou encore de leur dérive par rapport au projet initialement validé par le jury.
Les interlocuteurs de la Mission d’évaluation et de contrôle ont souligné que le rôle de la chaîne de suivi n’était pas d’abord d’arrêter les projets mal engagés mais de les remettre sur les rails : « Notre mission n’est pas d’arrêter les opérations, mais d’abord de les remettre dans le droit chemin » a indiqué M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, lors de son audition ; « ce n’est que si nous constatons que ce n’est pas possible qu’il faudra arrêter » a-t-il poursuivi.
Les réunions du comité de pilotage peuvent permettre aussi d’accompagner l’inflexion d’un projet par rapport aux orientations initiales. « Ces réunions (de comités de pilotage) sont importantes pour ajuster le dispositif et répondre aux questions spécifiques, a exposé Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR. Chaque projet, voire chaque action peut, en effet, nécessiter des adaptations donnant lieu à des avenants. (…) Nous partageons avec le CGI le souci du respect de la logique de projet, quelle qu’en soit la durée. Il est essentiel, car, au fil du temps, cette logique a tendance à se perdre. Mais il ne faut pas non plus brider la possibilité de développement de la recherche en étant tatillon. C’est dans cet esprit qu’il nous a été demandé de travailler. Nous effectuons donc un suivi rigoureux des engagements, qui se traduit par un point d’étape au bout d’un an, avec un retour d’information sur l’évolution du projet et ses aspects financiers. Toutefois, ce suivi laisse le projet se dérouler, au rythme de ses échéances internes. »
Les conventionnements des projets prévoient en effet un financement de ceux-ci par étapes, et, en conséquence, des échéances donnant lieu à une revue d’ensemble du projet, à l’issue de laquelle est prise la décision soit de poursuivre son financement – et de débloquer les fonds afférents à l’étape suivante – soit d’arrêter le projet. Dans le langage particulier des investissements d’avenir, ces jalons sont dénommés procédures de « go/no go ».
Selon la nature des projets, de telles procédures sont prévues au bout de quatre ans (pour les Idex par exemple), trois ans ou encore deux ans. « Ces jalons, prévus dès l’origine, permettent d’évaluer si le projet conserve son intérêt et sa valeur ajoutée. » a exposé M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » de l’ANR, lors de l’audition de Mme Pascale Briand.
Les décisions d’arrêt des projets sont prises par le Premier ministre à la suite de l’élaboration par l’opérateur, après consultation du jury, d’un rapport à l’attention du comité de pilotage et de la formulation par celui-ci d’une proposition de décision. Évoquant l’arrêt d’un projet de nanobiotechnologies, M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » de l’ANR a indiqué que : « Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une décision unilatérale de l’ANR ou du CGI, même si nous avons le pouvoir de stopper les projets en cas de faute grave. Nous avons suivi la recommandation des pairs qui, lors de la phase de sélection, avaient inscrit dans les annexes à la convention une procédure de go/no go au bout de deux ans. Nous avons de nouveau contacté les membres du jury, un rapport a été demandé aux bénéficiaires et soumis, il y a huit jours environ, au comité de pilotage impliquant les différents ministères concernés. (…) J’insiste sur le fait que si la concertation implique l’ensemble des instances de copilotage, la décision finale revient au Premier ministre, et sur l’idée que l’application d’une procédure de go/no go constitue une précaution élémentaire compte tenu de l’ampleur des budgets en jeu et de la durée des projets. »
2. Quelques exemples de décisions
Outre ce projet précis, quels exemples peut-on citer d’exercice par la chaîne de suivi de ses pouvoirs de réorientation et d’arrêt des projets ?
L’exemple le plus emblématique est celui du rejet du premier projet d’Idex à Saclay, pour des raisons de gouvernance.
« Mon prédécesseur, M. René Ricol, a acquis ses lettres de noblesse le jour où le jury a refusé le projet de Saclay. » a exposé M. Louis Gallois. « C’est à partir de ce jour qu’on a commencé à prendre au sérieux les Idex. (…) Le jury qui, tout en reconnaissant l’excellence de Saclay, a critiqué sa gouvernance, a montré que nous prenions cet aspect au sérieux. ». L’actuelle Idex de Saclay est issue d’un second projet, présenté après l’échec du premier.
M. Louis Gallois a également cité le suivi de deux autres Idex. « Pour l’Idex de Toulouse, par exemple, étant donné que le programme initialement adopté ne faisait plus consensus après les changements de présidence intervenus dans l’université toulousaine, nous avons indiqué qu’il n’y aurait pas d’Idex tant que ce consensus n’aurait pas été reconstruit sur des bases respectant les principes des investissements d’avenir. »
Il a ensuite évoqué le travail mené avec l’Idex pour la remettre sur les rails : « Ce processus a pris un an et nous avons dû convaincre Toulouse de mettre en place un comité d’arbitrage totalement indépendant, ce qui n’était pas prévu au départ, et d’adopter une gouvernance stable. »
Il a conclu sur ce point en soulignant que le travail de suivi continuait : « Je ne suis pas certain que ce dernier objectif ait été rempli, car le conseil d’administration reste pléthorique, mais au moins ce conseil dispose-t-il d’un bureau à taille humaine, investi de pouvoirs de gestion. L’Idex de Toulouse doit être suivie avec le plus grand soin, car c’est celle qui nous pose le plus de problèmes pour ce qui est du respect de nos orientations. »
M. Louis Gallois a également indiqué que, à la suite du retrait de l’Université de Paris II de l’Idex Sorbonne Universités, le Commissariat général à l’investissement avait entrepris un audit de l’Idefi qui en dépendait et décidé de suspendre le versement d’une partie – 100 millions d’euros – de sa dotation : « Quant à l’Idex Sorbonne Universités, l’université de Paris II ayant décidé de s’en retirer, nous l’avons informée qu’elle ne pouvait plus avoir accès aux financements de l’Idex et que nous allions procéder à un audit de Prolex, l’initiative d’excellence en formations innovantes (Idefi) qu’elle avait constituée, pour savoir si elle méritait d’être soutenue. Nous avons parallèlement fait savoir à Sorbonne Universités que, la consistance de l’Idex ayant été modifiée par le retrait d’une université très importante dans le domaine juridique, nous réduisions sa dotation de 100 millions d’euros. Cette dotation ne sera cependant pas réutilisée jusqu’au réexamen des Idex auquel nous procéderons en 2016. Il reviendra alors à Sorbonne Universités de nous indiquer comment sera reconfiguré le périmètre de l’Idex afin d’assurer sa cohérence et son équilibre. En fonction des éléments qui nous seront fournis, nous déciderons de réaffecter à l’Idex tout ou partie de l’enveloppe de notre financement, soit de zéro à 100 millions d’euros. »
b. Les autres projets suivis par l’ANR
Dans le champ des investissements d’avenir dont l’ANR est l’opérateur, des cas d’arrêt de projets ont aussi été signalés à la Mission d’évaluation et de contrôle. Ainsi, à Toulouse encore, M. Louis Gallois a indiqué que le Commissariat général à l’investissement avait « mis fin au financement de l’Idefi FORMADIME, consacrée à la formation des maîtres, du fait d’une modification excessive de ses objectifs. »
Rappelant que « la remise en cause du versement des intérêts est prévue dans certaines actions, si, au bout de quatre ans, le jury qui a sélectionné le projet estime que l’écart constaté par rapport aux engagements initiaux ne peut être imputé à une réorientation logique du programme de recherche, Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR, a précisé : « Nous avons ainsi eu un cas de non-conventionnement d’un institut pour la transition énergétique et, dernièrement, l’arrêt d’un projet de nanobiotechnologie ». « Je viens ainsi, dans un autre domaine, de supprimer l’institut d’excellence des énergies décarbonées (IEED) Géodénergie, ce qui a provoqué de vifs soubresauts » a aussi indiqué M. Louis Gallois.
c. Les projets suivis par d’autres opérateurs
De tels arrêts ou réorientations de projets ont aussi été signalés pour des projets suivis par d’autres opérateurs.
Le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil, a ainsi cité deux cas d’arrêt ou de réorientation de projets conduits dans le domaine aéronautique : « Une seule opération a été remise en cause. Il s’agissait d’un projet de moteur de l’entreprise Turbomeca pour l’hélicoptère X4 dont le financement a été rejeté par la Commission européenne dans le cadre du contrôle des aides d’État. » « Par ailleurs, a-t-il ajouté, le comité de pilotage a examiné les possibilités de réaffectation d’une somme de 10 millions d’euros, correspondant à des travaux sur les moteurs jugés non nécessaires, à d’autres projets éligibles aux programmes d’investissements d’avenir. Il a choisi de la consacrer à des travaux complémentaires sur l’Open Rotor. »
Le directeur général de l’énergie et du climat, M. Laurent Michel, et l’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, ont aussi évoqué la conduite des projets de réacteurs nucléaires ASTRID et Jules-Horowitz. Ainsi, le calendrier du réacteur ASTRID a dû être allongé de deux ans, en décembre 2012 du fait d’« une difficulté d’ordre budgétaire : malgré la subvention prévue par le PIA, nous ne parvenions pas à suivre en termes de ressources humaines – en effet les investissements d’avenir ne prennent pas les salaires en charge » a déclaré M. Laurent Michel.
Quant au réacteur Jules Horowitz (RJH), les retards et les surcoûts du programme, les difficultés relationnelles entre le CEA et AREVA ont été décrites par le menu lors de leurs auditions aussi bien par le directeur général de l’énergie et du climat que l’administrateur du CEA. « À l’issue de réunions interministérielles, a exposé M. Laurent Michel, il a été décidé, en janvier 2014, de créer une revue de projet afin d’évaluer la pertinence des actions proposées par le CEA et AREVA pour aboutir et d’établir les surcoûts à terminaison. » L’affaire n’est du reste pas simple : « Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir de quelle manière répartir ces surcoûts, sachant que les investissements d’avenir ont une autre destination » a poursuivi le directeur général de l’énergie et du climat.
E. DES PROCÉDURES BUDGÉTAIRES QUI VISENT À GARANTIR LE CARACTÈRE ADDITIONNEL DES FINANCEMENTS DU PIA
Les personnalités rencontrées par la Mission d’évaluation et de contrôle ont été unanimes : les procédures adoptées pour l’attribution des fonds du PIA garantissent leur non fongibilité avec les crédits budgétaires. « À ma connaissance, il n’y a eu aucun effet de substitution », a ainsi exposé M. Alain Fuchs, président du CNRS. « Qu’il s’agisse du CNRS ou de nos partenaires, notamment des universités, les structures qui pilotent les programmes ont mis en place les processus comptables et financiers qui permettent de suivre les fonds relevant du PIA séparément des autres financements. » Dans ces conditions, a-t-il poursuivi : « Budgétairement et comptablement, il n’est pas possible que les financements relevant du PIA soient utilisés pour financer d’autres projets : les crédits ne sont pas fongibles, l’utilisation des fonds fait l’objet de reportings détaillés transmis par les porteurs à l’ANR. »
Lors de la visite des rapporteurs à la Fondation de coopération scientifique (FCS) Campus Paris Saclay, le 1er juillet 2014, M. Philippe Corréa, directeur administratif et financier de la Fondation a confirmé le caractère spécifique du circuit des fonds attribués au titre du PIA. Ainsi, les intérêts des dotations non consumptibles sont versés deux fois par an par l’ANR à la Fondation de coopération scientifique Paris Saclay. Celle-ci, après avoir vérifié l’éligibilité des dépenses, vire ces fonds aux Labex destinataires. Tous les ans, la FCS fournit à l’ANR les relevés des dépenses financées, détaillés et certifiés.
De même, M. Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm, a exposé, lors de son audition : « Les financements qui reviennent aux équipes Inserm sont fléchés par le projet ANR et gérés directement par l’organisme gestionnaire et le porteur de projet. Mais leur versement est encadré, avec un contrôle a posteriori par les services financiers de l’Inserm. Le rapport financier est associé à un rapport opérationnel et à un rapport scientifique. Enfin, il n’y a pas de substitution entre les crédits du PIA et le budget récurrent de l’Inserm. L’Inserm n’a absolument pas modifié ses règles de financement des budgets récurrents des équipes. Aucune règle n’a changé. »
L’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, a été tout aussi précis : « Les fonds affectés aux projets ASTRID et RJH ont été versés sur un compte spécifique ouvert au nom du CEA. (…) Leur déblocage est opéré après accord préalable du CGI, sur la base d’un rapport intermédiaire synthétique que lui envoie le CEA chaque trimestre pour chacun des deux programmes. Ce rapport, également remis au comité de suivi, comporte les informations suivantes : l’état d’avancement du programme concerné ; le calendrier actualisé de décaissement des fonds ; le bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés ; la valeur des indicateurs de résultat intermédiaire et d’avancement du projet tels qu’ils figurent dans les conventions.
« Cette procédure spécifique permet de s’assurer que les crédits sont utilisés de manière strictement conforme à leur destination initiale et qu’ils ne constituent en aucun cas une ressource complémentaire permettant au CEA de financer d’autres charges. »
M. Bernard Bigot a cependant fait remarquer que la gestion avait parfois permis des souplesses de trésorerie : « Les crédits accordés au titre du PIA ont parfois été consommés de manière anticipée par rapport aux crédits budgétaires que le CEA s’était engagé à affecter. Ils ont ainsi permis une gestion plus souple de la trésorerie. » Mais, a-t-il réaffirmé : « En revanche, en aucun cas ils n’ont été substitués aux crédits budgétaires initialement prévus, ni n’ont été attribués à d’autres projets. »
Lors de l’audition du commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, par la Commission des finances, le 14 janvier 2015, notre collègue Jean-François Lamour a évoqué un cas d’affectation de crédits du PIA au financement de dépenses budgétaires, en l’occurrence des dépenses de rémunération du CEA. Cet événement n’invalide cependant pas l’analyse des rapporteurs. D’une part, en effet, ces crédits ne relevaient pas du périmètre de la MIRES mais du programme 402, ouvert en faveur de la mission « Défense » notamment pour l’action « Maîtrise des technologies nucléaires », mission à laquelle concourt le CEA, et notamment sa direction des applications militaires (DAM). D’autre part. M. Louis Schweitzer a répondu à notre collègue : « Ces redéploiements font partie de ceux qui sont décidés au plus haut niveau de l’État et auxquels le CGI procède sans enthousiasme, pour employer une litote. » En indiquant ainsi que seule une décision prise au plus haut niveau de l’État peut ordonner un redéploiement des crédits du PIA, le commissaire général à l’investissement confirme, en quelque sorte, la solidité et la lisibilité des procédures d’emploi de ces crédits.
F. LE RATTACHEMENT DU CGI AU PREMIER MINISTRE : UN STATUT SOLIDE
Lors de son audition, M. Louis Gallois avait fait remarquer que c’est son rattachement au Premier ministre qui permettait au CGI de résister aux demandes des ministres d’obtenir par le biais des PIA des financements budgétaires refusés lors des arbitrages.
Lors de la constitution du premier gouvernement Valls, les dispositions du décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique disposant que « le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique a autorité sur (…) le Commissariat général à l’investissement, conjointement avec le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ce qui concerne les programmes relevant de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » avaient suscité une forte émotion. Elles avaient même provoqué la démission conjointe du comité de surveillance des investissements d’avenir des deux co-présidents de ce comité, MM. Alain Juppé et Michel Rocard. Dans une lettre adressée au Premier ministre le 18 avril 2014, les deux co-présidents soulignaient, pour justifier leur démission, que le PIA « possède une forte dimension interministérielle » dépassant le seul cadre de Bercy et exprimaient leurs craintes que le ministre de l’économie soit « beaucoup plus soumis que ne l’est le Premier ministre à la pression de ses collègues » pour puiser dans les deniers du PIA afin de compenser des mesures de réduction de la dépense publique au détriment de tel ou tel ministère.
Interrogé par les rapporteurs sur cet épisode lors de son audition, le nouveau commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, a indiqué que les conséquences étaient « plus limitées qu’on ne pourrait le penser – et qu’Alain Juppé et Michel Rocard ne le craignaient. »
Il a ainsi fait valoir que la mission du Commissariat, une petite structure d’une trentaine de personnes, était définie par « une loi de finances et un décret d’application ». Or, a-t-il analysé, « ces textes attribuent tous les pouvoirs de décision au Premier ministre, ce dernier ayant la possibilité de les déléguer, via une délégation de signature, au commissaire général ».
Ainsi, les actes les plus importants, comme la signature des conventions avec les opérateurs, ou encore les décisions d’attribution des aides d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, pour les fonds consommables, et à 20 millions d’euros, pour les fonds non consommables, relèvent du seul Premier ministre ; « l’attribution des aides d’un montant inférieur peut, en revanche, être déléguée au commissaire général ou au commissaire général adjoint. »
M. Louis Schweitzer a ensuite exposé que, eu égard au « cadre législatif précis » qui régit les investissements d’avenir et le Commissariat général à l’investissement lui-même, le fait que le Commissariat général ait été placé sous l’autorité d’un, voire, pour une partie de son activité, de deux ministres ne changeait « en rien cette structure de compétences juridiques. Toutes les décisions qui relèvent du programme des investissements d’avenir, qu’il s’agisse des conventions, des avenants aux conventions ou des décisions d’attribution d’aide, relèvent toujours soit du Premier ministre lui-même, soit, par délégation, du commissaire général. » Et, a-t-il poursuivi, « la décision finale est, comme autrefois, préparée par des réunions interministérielles à Matignon ». « La base juridique, a-t-il conclu, n’a donc pas été changée, non plus que les principes généraux de sélection : l’exigence d’excellence subsiste. » Du fait de cette base, le Premier ministre peut, « paradoxalement », déléguer au commissaire général à l’investissement « des pouvoirs qu’il ne peut déléguer aux deux ministres concernés. »
Après la démission de MM. Arnaud Montebourg et Bruno Hamon du Gouvernement , le Commissariat général à l’investissement est revenu sous la tutelle directe du Premier ministre. Lors de son audition par la commission des Finances de l’Assemblée nationale, le 14 janvier 2015, M. Louis Schweitzer a indiqué que MM. Michel Rocard et Alain Juppé avaient accepté de reprendre leur démission. Si la question a été réglée, la démonstration juridique du commissaire général à l’investissement méritait cependant d’être présentée dans la mesure où elle fait apparaître que les textes qui régissent le PIA empêchent de transférer réellement les décisions du CGI sous une autre tutelle que la tutelle directe de Matignon.
III. QUELLES LEÇONS TIRER DES PREMIÈRES ANNÉES DE GESTION DU PIA 1 ?
Au cours de ses auditions, la Mission d’évaluation et de contrôle s’est bien sûr vu présenter des propositions de réforme de la conduite et du suivi des PIA. Dans la mesure où un PIA 2 a été lancé, et où le commissaire général à l’investissement appelle de ses vœux un PIA 3, ces propositions méritent d’être exposées ici.
Elles portent sur deux phases distinctes de la conduite des PIA. Les premières propositions concernent le montage et l’instruction des dossiers des projets. Les secondes portent sur le suivi et la gestion courante de ces projets.
1. Conserver la gouvernance de la sélection des projets, réduire les délais de leur instruction et en simplifier les procédures
En matière d’instruction des projets, la première mesure à prendre est sans doute la réduction des délais d’instruction. Ceux-ci, a révélé le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, lors de son audition « pouvaient aisément atteindre dix-huit mois, même pour des dossiers ne présentant aucune difficulté ». Il est vrai que les premiers opérateurs concernés ne relevaient pas forcément du champ de la recherche, puisque M. Louis Schweitzer a ainsi poursuivi : « Un travail a été engagé avec nos deux principaux opérateurs hors du champ de la recherche, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Banque publique d’investissement, Bpifrance, pour ramener ces délais à une durée de trois à six mois. »
De l’avis général, cette réduction des délais passe par la simplification des procédures : « Dans un certain nombre de cas, on pourrait également simplifier les démarches, sans pour autant abaisser le niveau d’exigence. » a aussi indiqué M. Louis Schweitzer.
Il semble en effet que les procédures de conventionnement ont été particulièrement lourdes, complexes et tatillonnes. « Lors de la passation des conventions avec l’ANR, il nous a été demandé de remplir des demandes de renseignements tellement vastes que nous n’en comprenions ni les tenants ni les aboutissants, a exposé le président du CNRS, M. Alain Fuchs lors de son audition. L’administration du CNRS s’est mobilisée pour aider les porteurs à faire face à la multiplicité, à la précision et la complexité des demandes. Il était par exemple demandé aux porteurs de projets de Labex d’indiquer le nombre de chercheurs qu’ils prévoyaient d’employer sur une durée de 10 ans. »
En octobre 2013, le Commissariat général à l’investissement a demandé à l’ANR d’analyser la mise en place du PIA 1 et d’élaborer des propositions en conséquence.
Ces propositions ont été présentées à la Mission d’évaluation et de contrôle tant par Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR, que par le commissaire général à l’investissement, alors M. Louis Gallois. Elles tiennent en trois axes d’action principaux : recours systématique à des conventions de préfinancement, suppression de certains documents et annexes, suppression de certaines étapes de validation. « Dans le domaine qui vous intéresse, a exposé M. Louis Gallois, la simplification passe par un recours systématique à des conventions de préfinancement pour le PIA 2. L’expérience a également montré que l’on pouvait supprimer des documents conventionnels et des annexes n’ayant pas de véritable valeur ajoutée. On a enfin observé que l’on pouvait supprimer certaines étapes intermédiaires de validation des conventions et accélérer le processus de ces conventions pour nos principaux projets, soit quatre ou cinq Idex supplémentaires et quatre ou cinq initiatives structurantes innovation-territoires-économie (I-SITE). » Autrement dit, la réduction des délais passe par la simplification des procédures.
Des progrès notables sont déjà enregistrés : « Si la complexité des procédures a retardé les projets d’un an, a constaté Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes, les leçons de l’expérience ont bien été tirées, puisque les dossiers à fournir pour les Labex et les Equipex du PIA 2 ont été considérablement simplifiés. D’autres améliorations, comme l’infocentre que doit constituer l’ANR, devraient venir s’ajouter à ces évolutions. » Cet avis est partagé par le président du CNRS, M. Alain Fuchs : « La mesure des demandes a été prise. (…) La situation s’est bien améliorée aujourd’hui » a-t-il déclaré lors de son audition.
M. François Rosenfeld, directeur financier du Commissariat général à l’investissement, a indiqué lors de l’audition de M. Louis Gallois que : « Pour les projets structurants des pôles de compétitivité (PSPC), le délai d’instruction entre le dépôt du projet et la contractualisation est passé de pratiquement vingt mois pour les premiers projets, très collaboratifs et qui pouvaient réunir jusqu’à une vingtaine de partenaires, à trois mois tout compris aujourd’hui. »
Quelles sont les marges de progrès ? Lors de son audition par la Commission des finances, le 14 janvier 2015, le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, a indiqué que : « notre ambition est de limiter à moins de trois mois le délai entre le dépôt d’un projet et la contractualisation avec son auteur. »
En revanche, dans les propositions qu’elle a faites au Commissariat général à l’investissement, l’ANR a considéré que le dispositif d’appel à projets confiant la sélection à des jurys internationaux devait être maintenu, « car il avait donné satisfaction » a exposé Mme Pascale Briand. Le commissaire général à l’investissement a validé cette proposition : « Pour le PIA 2, le deuxième programme d’investissements d’avenir, qui prévoit, comme le premier, d’allouer des crédits à des institutions universitaires et de recherche, le jury qui sera mis en place sera exactement le même que celui qui avait été retenu pour le PIA 1 » a indiqué M. Louis Schweitzer. Lors de son audition, le président du CNRS, M. Alain Fuchs, avait quant à lui déclaré : « Le sujet, ce n’est pas la gouvernance. C’est la paperasserie extrêmement complexe qui a été mise en place en vue de la signature des conventions. »
2. Laisser du temps à la maturation des projets
Si les personnalités auditionnées par la Mission d’évaluation et de contrôle ont considéré que les délais d’instruction des projets devaient être réduits et les procédures simplifiées, elles ont en revanche jugé que les porteurs de projets devaient pouvoir mûrir leur projet sans être pris par des contraintes de temps. Lors de l’audition de M. Louis Gallois, le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, M. Patrick Lefas, a rappelé les conséquences négatives de la précipitation imposée aux porteurs de projets : « Les universités qui ont concouru au titre des Idex étaient confrontées à une opération complexe. C’était notamment la première fois qu’il leur fallait s’exprimer en anglais. Il leur a aussi fallu monter leurs dossiers dans des délais records, en passant par-dessus les structures de gouvernance et de consultation, ce qui n’a pas été sans conséquences : ainsi, le président Louis Vogel, héraut de l’Idex Sorbonne-Universités, n’a pas été suivi par sa propre université et a même été remplacé par un autre président. Les délais prescrits étaient très contraints ; sans doute faut-il laisser un peu plus de temps, tout en exerçant un suivi très vigilant. »
Lors de son audition, le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, a évoqué la confusion qu’une certaine précipitation avait pu provoquer : « Même s’il y a bien eu concertation entre les départements ministériels concernés au moment de l’élaboration du cahier des charges des appels d’offres de chacun de ces outils, des avis pas toujours convergents ont pu être donnés aux porteurs de projets – qui les ont sollicités – pendant la phase de montage des projets. »
Lors de l’audition de M. Louis Gallois, le Commissariat général à l’investissement s’est montré ouvert sur la nécessité de laisser aux porteurs de projets le temps nécessaire pour élaborer un projet de qualité, y compris en intégrant des variantes aux schémas initiaux proposés par le CGI : « Si les délais convenus (pour la labellisation des nouvelles Idex) doivent être respectés, nous ne souhaitons pas accélérer la procédure : il importe de laisser du temps aux structures candidates pour préparer un dossier susceptible d’être présenté devant un jury international » a ainsi exposé M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement. Lors de son audition par la Commission des finances, le 14 janvier 2015, le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, a confirmé cette position : « Bien entendu, ce délai (de trois mois) ne s’applique pas au financement des instituts d’excellence universitaire, lourd et complexe, qui fait l’objet d’une procédure spécifique. »
La doctrine du Commissariat général à l’investissement a ainsi été bien résumée par M. François Rosenfeld lors de l’audition de M. Louis Gallois : « Il s’agit donc, en fonction des enjeux tant financiers que scientifiques ou économiques, d’adapter le processus d’instruction afin de répondre aussi efficacement que possible aux préoccupations des porteurs de projets. En effet, tandis que les dix-huit mois qui s’écoulent entre le dépôt de leur dossier et l’attribution du financement permettent à certains de mûrir leur projet, ce délai est inacceptable pour d’autres, par exemple dans le domaine du numérique, qui progresse très vite et où l’enjeu est d’être le premier sur le marché. »
Autrement dit, un pilotage clair, s’exerçant dans des conditions de délai adaptées et selon des procédures rationnelles, l’octroi aux porteurs de projets du temps nécessaire au mûrissement de ceux-ci et de la possibilité de négocier des conditions spécifiques, s’ils le souhaitent, sont les éléments de progression dans la constitution des dossiers qui ressortent des auditions auxquelles la Mission d’évaluation et de contrôle a procédé.
En matière de gestion courante, les débuts du suivi des projets n’ont pas, là non plus, été marqués par la simplicité.
« Le triangle constitué par l’ANR, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Commissariat général à l’investissement nous a souvent laissé un peu perplexes. On ne peut pas dire que c’est la simplicité qui a été recherchée » a ainsi déclaré à la Mission d’évaluation et de contrôle le président du CNRS, M. Alain Fuchs. Ce qu’a confirmé M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement, lors de l’audition de M. Louis Gallois : « Pour l’ANR, le principal enjeu en matière de délais porte, non pas sur les grandes décisions d’engagement, mais sur les relations courantes avec les organismes bénéficiaires. Le dispositif actuel est extrêmement complexe. Un travail est en cours. (…) Par exemple, comme il s’agit d’argent public, nos règlements financiers sont parfois trop tatillons, ce qui ralentit la procédure. Aujourd’hui, on sait mieux ce qui compte. On pourrait concentrer les demandes sur l’essentiel et raccourcir les délais de paiement. »
1. Une organisation de la gouvernance jugée pertinente
Pour autant, il n’est pas demandé de réforme de la gouvernance proprement dite. Avec la pratique, les relations entre les acteurs du suivi se sont progressivement mises en place. Lors de son audition, le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, a ainsi pu déclarer : « Quant au rôle du comité de pilotage, et à celui de chacun de ses participants, il s’est beaucoup clarifié. »
Le président du CNRS, M. Alain Fuchs a estimé quant à lui que : « Aujourd’hui, les structures sont en place et le système tourne. Il n’est pas nécessaire de refaire l’histoire. (…). Globalement, les équipes de chercheurs relevant du CNRS n’ont pas à se plaindre de l’ANR. »
Dans ces conditions, les propositions de réforme faites par l’ANR à la suite de la réflexion que lui a demandée le Commissariat général à l’investissement ne portent pas sur la gouvernance des projets, mais plutôt sur la systématisation de cette gouvernance aux projets auxquels elle ne serait que partiellement appliquée, notamment en matière de jalons, ces échéances de « go/no go » qui rythment la progression des projets les plus importants. La directrice générale de l’ANR, Mme Pascale Briand, a ainsi exposé qu’après la sélection des projets par des jurys internationaux le dispositif de suivi de ces projets par des comités de pilotage devait lui aussi « être maintenu, car il avait donné satisfaction », et qu’il importait « d’étendre à toutes les actions le recours aux jalons permettant de rediriger ou d’arrêter certains projets. »
Cette position sur le maintien de la gouvernance actuelle et la généralisation des échéances de « go/no go » rejoint celle exprimée par M. Louis Schweitzer devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « D’aucuns ont suggéré, pour réduire les délais, de déléguer la décision elle-même à nos opérateurs, comme l’ADEME, Bpifrance ou l’Agence nationale de la recherche (ANR). Je n’y suis pas favorable ; je pense qu’il est important que le CGI, qui est responsable du bon emploi des crédits du PIA, prenne la décision finale ou, si cela dépasse ses attributions, transmette le dossier au Premier ministre. Je me suis engagé, en revanche, sur deux points : premièrement, lancer les éventuelles contre-expertises suivant une procédure parallèle, et non séquentielle ; deuxièmement, faire en sorte que le CGI rende ses décisions rapidement, dans les cinq jours suivant l’avis positif du comité de pilotage interministériel (COPIL). »
2. Une simplification souhaitable des modalités du suivi
En revanche, Mme Pascale Briand a appelé, dans ce cadre de gouvernance, à « une conception simplifiée du suivi, reposant sur la responsabilisation des acteurs, dont nous souhaitons qu’ils soient eux-mêmes porteurs des alertes, afin de diminuer les contrôles a priori au profit d’un contrôle a posteriori. » Elle a exposé au passage que cela valait aussi « pour les appels à projets gérés par l’ANR sur crédits budgétaires. »
Cette position rejoint les propos tenus par le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, lors de son audition, en faveur de la capacité d’initiative des opérateurs : « Le retour d’expérience du PIA 1 nous montre encore une fois qu’une caporalisation du système n’est pas souhaitable et qu’il faut laisser de la souplesse aux opérateurs dans la mise en œuvre, même si nous devons avoir un regard acéré sur leurs propositions. »
Parallèlement au maintien voire à la généralisation du dispositif de suivi qui s’est progressivement mis en place, le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, a indiqué qu’il souhaitait organiser un meilleur suivi des situations identifiées comme à risque à un moment ou un autre du développement des projets : « Par ailleurs, le CGI est en train de mettre en place le « management des risques », qui n’est pas une démarche de suivi, mais une évaluation des risques que certaines opérations pourraient faire courir à nos dotations. L’innovation est un domaine risqué et s’il faut certes accepter une certaine part de risque, il existe des dangers qui tiennent à un défaut de management ou au fait que les acteurs ne s’entendent plus, auxquels il faut pouvoir parer assez tôt. J’ai donc demandé que les opérations qui nous sont présentées par les préfets comme étant en difficulté fassent l’objet d’un suivi individuel afin que nous puissions traiter le problème dès le début du processus. Il n’y a pas de raison pour que le CGI ne puisse pas mettre en œuvre cette démarche, pratiquée par les entreprises. »
Maintien voire généralisation de la gouvernance actuelle – suivi par l’opérateur, développement des « jalons », ou étapes de « go/no go », prise des décisions stratégiques sur les projets par un comité de pilotage, ou, en cas de désaccord au sein de celui-ci, par le Premier ministre –, allégement des contrôles a priori au profit de procédures a posteriori, dans le cadre d’une plus grande autonomie des acteurs, et enfin meilleur suivi individuel des situations à risque sont ainsi les propositions faites en matière de suivi de la conduite des projets relevant du PIA.
DEUXIÈME PARTIE :
LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET CLINIQUE
I. DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES, DES ACTIONS NOMBREUSES, DES FINANCEMENTS ÉLEVÉS
Avec 12 milliards d’euros de dotation initiale, les actions du programme d’investissements d’avenir consacrées à la recherche fondamentale générale représentent plus de la moitié des crédits du périmètre de la MIRES attribués à ce titre.
L’ampleur de ces crédits – dont le détail sera examiné à l’occasion de la présentation des actions – se justifie, qu’il s’agisse des dotations consommables ou des dotations non consommables, par la spécificité des objectifs poursuivis : il s’agit de financer non seulement l’excellence existante mais aussi une nouvelle structuration de la recherche, susceptible par elle-même de sublimer un potentiel d’excellence contraint par des structures inadaptées.
À cette fin, cinq actions ont été créées : les « initiatives d’excellence » (Idex) – qu’il serait plus juste, pour la compréhension, d’appeler « sites d’excellence » – les « laboratoires d’excellence » (Labex), les « équipements d’excellence » (Equipex), les « initiatives d’excellence en formations innovantes » (Idefi) et enfin deux actions gérées de façon conjointe, l’opération Campus (sur Paris et Saclay) et l’action « développement scientifique et technologique du plateau de Saclay ».
L’opérateur de chacune de ces actions est l’ANR.
Relèvent par ailleurs aussi, au moins en partie, de cette même double logique les deux actions « santé » et « biotechnologies », dont l’essentiel des projets relève de la recherche fondamentale, et surtout l’action « instituts hospitalo-universitaires », les IHU présentant nombre de similitudes avec les Idex. Ces deux actions représentent ensemble un montant de dotations de 2,4 milliards d’euros. L’opérateur en est également l’ANR.
1. Le financement de l’excellence
Dans le domaine de la recherche fondamentale, les investissements d’avenir ont poursuivi deux objectifs.
Le premier est le financement de l’excellence. Comme le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle, « leur objectif premier est la recherche de l’excellence sur des critères non seulement nationaux mais aussi internationaux, avec une volonté de favoriser les transferts de la recherche vers l’industrie. »
Ce parti pris a été précisé par Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR : « La valeur ajoutée des investissements d’avenir par rapport au dispositif national en faveur de la recherche réside dans la particularité des actions mises en œuvre : l’ambition de ces investissements est d’améliorer les chances de réussite de laboratoires ou de sites dont l’excellence est déjà avérée. Il s’agit bien de renforcer leurs atouts.
« Pour les Labex, les investissements d’avenir s’adressent aux laboratoires ayant fait leurs preuves ; pour les Idex, aux sites ayant fait leurs preuves et étant en capacité de présenter des projets alliant l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur avec des capacités de valorisation ; pour les Equipex, aux équipes qui ont besoin de nouveaux équipements ou d’équipements plus performants ; pour Santé-biotechnologies, ils permettent de doter le secteur d’éléments structurants ou de composantes manquantes – je pense notamment aux cohortes qui n’avaient jamais trouvé les financements adaptés à leurs caractéristiques. »
Il s’agit donc bien, non pas d’aider des sites, des laboratoires ou des filières scientifiques qui seraient en retard à rejoindre les standards internationaux, mais d’aider les meilleurs à progresser encore plus vers l’excellence. Comme l’a précisé là encore Mme Pascale Briand : « Les investissements d’avenir sont conçus pour accroître les chances d’équipes déjà reconnues. (…) Je considère que la recherche doit aller vers l’excellence. (…) Les investissements d’avenir ont marqué une rupture avec les dispositifs antérieurs qui tendaient à octroyer une rente aux équipes supposées d’excellence, reconnues par les grands établissements et portées par des personnalités scientifiques. Le mode de sélection, qui a parfois choqué – le cas de Saclay est souvent cité comme exemple –, a permis de retenir les projets sur d’autres critères. »
2. Un objectif de structuration
L’octroi de ces financements poursuivait, tout aussi ouvertement, un second objectif. Comme le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer l’a exposé lors de son audition : « À cela s’est ajoutée une seconde spécificité, qui est de placer l’exigence non seulement sur le projet, mais aussi sur les structures qui le présentent. Nous avons ainsi utilisé le PIA comme un levier pour inciter les établissements universitaires et de recherche à ne pas travailler à l’excellence chacun de son côté, mais à créer pour cela des structures communes. »
M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire au Commissariat général à l’investissement, a très clairement précisé cet objectif lors de l’audition de M. Louis Gallois : « Les crédits des investissements d’avenir sont massifs, s’inscrivent dans la durée et ont un très fort effet de labellisation ou de reconnaissance. Autrement dit, ce sont des crédits particulièrement incitatifs.
« Pourquoi a-t-on besoin de crédits incitatifs ? La réponse apportée par les pouvoirs publics, avant et après l’alternance, est que le système n’est pas dans l’état où il devrait être et que certains problèmes ne sont pas encore résolus, ce qui suppose de faire bouger certaines lignes. Autrement dit, si nos universités étaient plus stables, à l’instar du modèle international, peut-être n’aurions-nous pas besoin de ce dispositif. »
Et M. Jean-Pierre Korolitski de conclure : « L’un des points sur lesquels les crédits incitatifs peuvent faire bouger les lignes est la fameuse coupure entre universités et grandes écoles, d’une part, et entre enseignement supérieur et organismes de recherche, d’autre part. »
La nécessité d’une telle structuration ressort bien des propos tenus devant la Mission d’évaluation et de contrôle par le président du CNRS, M. Alain Fuchs. Celui-ci a en effet souligné plusieurs éléments de la situation compliquée qu’il avait trouvée lors de son arrivée à la présidence du CNRS.
Le principal problème résidait dans les relations difficiles du CNRS avec les universités, « alors même que les laboratoires soutenus par le CNRS, les Unités mixtes de recherche (UMR), étaient pour l’essentiel hébergées par les universités et les écoles. » Le président du CNRS a attribué cette difficulté non seulement à « la double distinction qui marque l’enseignement supérieur et la recherche français : celle entre universités et grandes écoles, d’une part, et celle entre université et grandes écoles confondues et recherche, de l’autre », mais aussi à « la très grande dispersion des structures d’enseignement supérieur, voire de recherche, y compris au sein de ce que nous avons très vite appelé des sites, un site étant, pour parler vite, un grand ensemble métropolitain académique, au sein duquel établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche sont présents. »
Or, a fait aussi remarquer M. Alain Fuchs : « Aujourd’hui, la mission de recherche des universités est très importante. Dans les dernières décennies du XXe siècle, il a été recruté dix fois plus de maîtres de conférences ayant aussi une fonction de chercheur que de chercheurs proprement dits. Eu égard à la puissance de recherche désormais présente au sein des universités, il n’y a plus lieu de maintenir cette forte distinction. »
On ne saurait expliquer plus clairement que l’actuelle structuration du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur entrave en réalité l’expression du potentiel de la recherche française, la force de recherche se trouvant non seulement inégalement répartie entre organismes de recherche et établissements d’enseignement supérieur, mais, pour ce qui est de la recherche universitaire, dispersée entre de trop nombreuses structures.
Il est aussi intéressant de remarquer que, sur les questions de structure, l’analyse du président du CNRS rejoint celle du Commissariat général à l’investissement.
Dans ces conditions, une analyse de l’efficacité des investissements d’avenir en matière de recherche fondamentale ou clinique doit porter sur les deux objectifs poursuivis – l’excellence et la structuration –, sachant qu’il ressort des propos du président du CNRS qu’ils vont nécessairement interagir l’un avec l’autre. Le caractère essentiel de l’objectif de structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les investissements d’avenir a du reste été rappelé avec force par M. Louis Schweitzer lors de son audition : « En résulte-t-il (des rapprochements, suscités par le PIA) des structures toujours parfaitement lisibles et efficaces ? C’est ce que nous devrons évaluer en 2016, à l’occasion du réexamen après quatre ans de l’affectation des dotations non consumptibles, qui sont notre principal mode d’intervention en direction des établissements d’enseignement et de recherche. Dans un esprit d’indépendance et sous l’autorité du jury, nous vérifierons alors que les rapprochements structurels et les réorganisations annoncés n’ont pas été de pure forme. »
B. LES ACTIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE FONDAMENTALE GÉNÉRALE
1. Des financements considérables désormais presque entièrement attribués
Avant de présenter successivement les actions conduites au titre du PIA 1 en matière d’enseignement supérieur et de recherche, les rapporteurs ont souhaité présenter un tableau de la répartition des financements entre elles et établir un point de l’attribution de ceux-ci.
Comme on peut le voir, au 31 juillet 2014, la quasi-totalité des financements prévus était non seulement attribuée mais contractualisée. La différence entre le total des dotations initiales et celui des dotations attribuées est quasi intégralement due au retard de l’Opération Campus – dont une partie est régie par les règles du plan Campus et non par celles du PIA –, dont les 1,3 milliard d’euros de crédits initiaux ne sont contractualisés qu’à hauteur de 207,7 millions d’euros (soit 16 %).
RECHERCHE FONDAMENTALE GÉNÉRALE :
SITUATION DES DOTATIONS AU 31 JUILLET 2014
(en millions d’euros)
Dotation | ||||
initiale |
attribuée |
contractualisée |
décaissée | |
Initiatives d’excellence (Idex) (1) dont DC dont DNC |
7 700 |
6 848,9 (2) 160,9 6 688,0 |
6 848,9 160,9 6 688,0 |
667,2 |
Initiatives d’excellence en formations innovantes – (Idefi) |
150 * |
149 (3) |
149 |
48,9 |
Laboratoires d’excellence (Labex) (4) dont DC dont DNC |
1 000 |
1 932,4(5) 130,5 1 801,9 |
1 932,4 130,5 1 801,9 |
237,9 |
Opération Campus dont DC dont DNC et (6) Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay |
1 300 |
207,7 (7) 167,7 40 |
169,6 129,6 40 |
72,7 |
1 000 * |
768,9(8) |
735,5 |
59,9 | |
Équipements d’excellence (Equipex) dont DC dont DNC |
1 000 |
851,0(9) 465,7 385,3 |
851,0 465,7 385,3 |
384,6 |
Total dont DC dont DNC |
12 000 ** |
10 757,9 1 842,7 8 915,2 |
10 686,4 1 771,2 8 915,2 |
1 471,2 |
(1) Les 11 projets Idex se décomposent entre :
- 8 Idex proprement dites ;
- 2 « projets spécifiques »
- le projet national Istex de constitution d’un patrimoine de documentation numérique
(2) La différence entre dotation initiale et dotation attribuée est due au transfert de crédits Idex vers le financement des Labex et Idefi hors Idex.
(3) Pour 29 projets hors Idex (8 autres Idefi étant incluses dans des Idex, et financées pour 13 millions d’euros sur fonds Idex).
(4) Les Labex sont au nombre de 171, répartis entre :
- 77 intégrés aux 8 Idex
- 19 intégrés aux deux projets supplémentaires
- 75 hors Idex
(5) Ne concerne que les financements de 75 Labex hors Idex (les dotations des Labex et Idefi intégrés aux pôles lauréats des projets Idex sont assurés sur financement Idex). La différence par rapport à la dotation initiale est due au déversement de crédits attribués initialement aux Idex.
(6) L’opération Campus conduite sur le plateau de Saclay relève d’une gouvernance commune avec l’action « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay ».
(7) Pour 31 projets, à Saclay et Paris.
(8) Pour 19 opérations. Parmi les objectifs de l’action Saclay figure la cohérence des dispositifs PIA présents sur le Plateau (Idex, SATT, IEED et IRT).
(9) Pour 93 projets retenus, dont 52 en vague 1 (Equipex 1) et 41 en vague 2 (Equipex 2).
* Dotations consommables exclusivement
**Ce total n’inclut pas les crédits destinés aux Idefi, qui ont été dégagés par redéploiement des dotations initiales.
DC : dotation consommable
DNC : dotation non consommable
Source : Commission des finances, d’après les données des rapports relatifs à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir, annexés aux projets de loi de finances (« jaunes »).
S’agissant des décaissements, il ne faut pas oublier, d’une part qu’ils se font au rythme de la réalisation des projets – un projet peut être lancé mais non achevé – et d’autre part que, jusqu’en 2016 au moins, seuls les intérêts des dotations non consommables sont versés aux bénéficiaires, sur un rythme semestriel.
Par ailleurs, la remarque faite en première partie sur la progression des décaissements s’illustre également ici : entre le 31 juillet et le 31 décembre 2014, 234,8 millions d’euros supplémentaires ont été décaissés pour la recherche fondamentale générale, portant le total des décaissements à 1,706 milliards d’euros.
2. Les initiatives d’excellence (Idex)
Avec 6,85 milliards d’euros de dotations attribués et contractualisés, dont 6,69 milliards d’euros de dotations non consommables, les Idex sont, de loin, la première action en volume du PIA dans le périmètre de la MIRES.
Selon les termes de la convention du 23 septembre 2010 entre l’État et l’ANR relative au programme d’investissement d’avenir, « l’action « initiatives d’excellence » (Idex) vise, en faisant de la recherche de niveau international un levier et un moteur, à faire émerger cinq à dix pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire français.
« Ces pôles seront organisés sous la forme de regroupements territorialement cohérents d’établissements d’enseignement supérieur, universités et écoles, impliquant des organismes de recherche, et en partenariat avec des entreprises, autour de forces scientifiques d’excellence, pluridisciplinaires et reconnues au niveau international, et d’activités de formation innovantes ».
La convention précise que « cette action a une vocation structurante et intégratrice pour les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elle s’inscrit dans la durée et dans une dynamique d’évolution et de transformation du système d’enseignement supérieur et de recherche ».
« Elle vise à doter les regroupements qui auront été sélectionnés (constitués pour l’occasion ou préexistants) de moyens significatifs leur permettant de développer et mettre en œuvre leur politique d’excellence, tant scientifique que de formation, de nourrir leur interaction avec leur environnement économique, social et culturel et, enfin, de développer leur attractivité internationale, notamment en attirant des chercheurs et des équipes de renommée mondiale. ».
Les objectifs de l’action « Initiatives d’excellence » sont donc clairement exprimés dans la convention – et repris dans l’appel à projets. Il s’agit de faire naître des regroupements territoriaux d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche capables de rivaliser avec les grandes universités sur le plan international, c’est-à-dire avec une offre de formation et un potentiel de recherche de haut niveau. Afin d’atteindre cet objectif, en revanche, aucun statut spécifique n’était défini pour ces regroupements. Aucun objectif de fusion des universités, ou de rapprochement entre universités et grandes écoles n’était clairement affiché. Une grande liberté était donc laissée aux porteurs, la seule contrainte étant de former des regroupements « territorialement cohérents ».
En revanche, chaque projet devait définir son « périmètre d’excellence », c’est-à-dire l’ensemble des laboratoires ou des équipes de recherche pris en compte dans le projet et sur lequel devrait se concentrer les financements de l’Idex. Les projets n’ont donc sélectionné que certaines équipes ; en général seules les équipes notées A+ ou A par l’AERES ont été retenues.
L’action a fait l’objet de deux appels à projets successifs, chacun composés d’une phase de présélection et d’une phase de sélection. Pour la première vague des initiatives d’excellence, un jury international a proposé de sélectionner trois projets (Paris Sciences et Lettres, Unistra et Bordeaux), ce qui a été confirmé par le comité de pilotage du 1er juillet 2011. A aussi été retenu un programme transversal d’acquisition de ressources scientifiques visant à créer une bibliothèque numérique aux meilleurs standards internationaux, accessible à distance à tous les membres des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dénommée Istex (Initiative en Information Scientifique et Technique d’Excellence), porté notamment par le CNRS, l’ABES (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur) et l’université de Lorraine.
Pour la deuxième vague des initiatives d’excellence, le jury a proposé de sélectionner cinq projets : Idex Paris Saclay, Sorbonne Université, Sorbonne Paris Cité, A-M*IDEX et UNITI (Toulouse). Cette proposition a été confirmée par le comité de pilotage du 2 février 2012.
Par ailleurs, deux projets non lauréats de la deuxième vague ont été retenus avec une dotation financière moindre. Il s’agit des projets portés par l’Université de Lyon et le PRES HESAM (pôle de recherche et d’enseignement supérieurs Hautes Études–Sorbonne–Arts et métiers). Cette possibilité était ouverte par l’avenant n° 2 de la convention qui prévoit « un soutien financier spécifique aux projets non labellisés « Initiatives d’excellence » mais dont le jury reconnaît le potentiel pour atteindre le niveau nécessaire pour justifier ce label à moyen terme. ».
Les décisions du Premier ministre correspondant aux huit Idex, aux deux projets spécifiques et au projet documentaire d’intérêt national, prises en 2011 et 2012, sont récapitulées dans le tableau suivant :
INITIATIVES D’EXCELLENCE
(en millions d’euros)
Projet IDEX (vagues 1 et 2) |
Bénéficiaire |
Dotation non consommable |
A-M*IDEX |
Université d’Aix-Marseille |
750 |
Université PARIS SACLAY |
FCS Campus Paris Saclay |
950 |
IDEX BORDEAUX |
PRES Université de Bordeaux |
700 |
Paris Sciences et Lettres |
FCS Paris Sciences et Lettres |
750 |
Sorbonne Universités (SUPER) |
FCS Sorbonne Université |
900 |
Sorbonne Paris Cité |
PRES Sorbonne Paris Cité |
800 |
UNISTRA |
Université de Strasbourg |
750 |
Université de Toulouse |
PRES Université de Toulouse |
750 |
Autres projets distingués |
Bénéficiaire |
Dotation consommable sur 3 ans |
Lyon – Saint-Étienne (LSE) |
PRES Université de Lyon |
27 |
Paris Nouveaux Mondes |
PRES HESAM |
18 |
Projet complémentaire |
Bénéficiaire |
Dotation consommable |
ISTEX |
CNRS |
60 |
Source : Cour des comptes.
La quasi-totalité des dotations des Idex sont des dotations non consommables. Pendant une période probatoire de quatre ans, seuls les intérêts issus du placement de cette dotation seront versés aux initiatives d’excellence. Ils sont versés bi-annuellement aux porteurs de projet depuis deux ans. Tous les projets ont démarré leurs plans d’action et font l’objet d’un suivi régulier.
Le dispositif de l’évaluation intermédiaire de chaque projet, prévue en 2016, est en cours de construction. D’ores et déjà, le jury international et son président, M. Jean-Marc Rapp, ont été reconduits pour mener cette évaluation. Un travail préparatoire entre le président du jury, le CGI, le MESR et l’ANR a démarré, en lien avec celui entrepris pour le déploiement de l’action Idex du PIA 2.
3. Les laboratoires d’excellence (Labex)
L’action « laboratoires d’excellence » vise à constituer des laboratoires à visibilité internationale et à les doter de moyens significatifs leur permettant de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et enseignants-chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau.
L’action « laboratoires d’excellence » fait l’objet de la convention État-ANR du 3 août 2010 modifiée par l’avenant n° 1 du 18 mai 2011.
Les dossiers labellisables avaient vocation à être présentés par :
• des entités de recherche de très grande qualité scientifique (d’un niveau équivalent à la notation A+ de l’AERES), de taille significative pour la discipline considérée, rassemblant, sur leur aire géographique, la plus grande partie des forces sur leur thématique de recherche, et présentant un projet qui affiche une évolution innovante de leurs recherches ;
• des réseaux thématiques de recherche – réseaux thématiques de recherches avancées (R.T.R.A.) – de très grande qualité scientifique (d’un niveau équivalent à la notation A+ de l’AERES), regroupant, sur un projet scientifique commun, un potentiel significatif de recherche pour les champs disciplinaires concernés ;
• à titre exceptionnel, des instituts scientifiques thématiques accueillant des chercheurs de renommée mondiale.
Compte tenu des exigences d’excellence, il est par ailleurs fréquent que seules les meilleures équipes d’une unité de recherche donnée soient sélectionnées, les équipes n’étant pas notées A+ ou A par l’AERES n’ayant pas été présentées dans le projet de Labex.
En pratique, les laboratoires d’excellence sélectionnés sont majoritairement des regroupements d’unités ou d’équipes de recherche.
Ces regroupements sont de dimensions très importantes. Par exemple, le Labex « Amadeus » regroupe des équipes appartenant à 12 laboratoires de Bordeaux, rattachées à cinq tutelles directes, deux universités, l’Inserm, le CNRS et l’Institut polytechnique de Bordeaux. Il repose sur un potentiel mobilisable de 130 chercheurs et enseignants-chercheurs. Les rapporteurs ont rencontré à la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay des coordinateurs de Labex plus importants encore.
Au sein des Labex, des sous-regroupements sont opérés dans les mêmes conditions – avec des chercheurs appartenant à différentes unités de recherche elles-mêmes rattachées à différents établissements – à des niveaux plus fins encore, pour constituer des équipes de recherche dont les travaux portent sur un thème de recherche commun.
Les Labex sont au nombre de 171. Ils sont financés selon deux modalités différentes.
Les Labex appartenant à des Idex, soit 77 Labex intégrés aux 8 Idex de plein exercice et 19 Labex intégrés aux deux projets Lyon-Saint-Étienne et Paris Nouveaux Mondes, sont financés sur les crédits réservés à ceux-ci.
Les 75 Labex hors Idex sont financés à partir de l’action Labex du PIA. Le montant des crédits, initialement de 1 milliard d’euros, a été quasiment doublé, passant à 1,93 milliard d’euros, pour tenir compte du nombre de Labex sélectionnés hors Idex, la différence par rapport aux crédits initialement prévus ayant été prélevée sur les dotations initialement affectées aux Idex. Sur ces crédits, 130,5 millions d’euros seulement sont des crédits consommables et 1,8 milliard d’euros des crédits non consommables.
Tous les projets ont démarré, les dernières conventions ayant été signées courant 2013. Comme les Idex, les projets reçoivent leurs financements de manière semestrielle, selon un échéancier planifié sur l’ensemble de la durée du projet. Au bout de quatre ans, les dotations non consommables sont susceptibles d’être définitivement acquises aux Labex ayant satisfait aux conditions de probation.
4. Les équipements d’excellence (Equipex)
Aujourd’hui, toutes les activités de recherche se structurent autour d’équipements de pointe. Si l’on peut d’abord citer les sciences de la modélisation, pour lesquelles des moyens de calcul de plus en plus puissants sont requis, les sciences de la terre, les sciences de la vie et la technologie s’organisent désormais aussi autour de plates-formes expérimentales ; il n’est pas jusqu’aux sciences humaines et sociales qui nécessitent bibliothèques et bases de données.
Or l’expérience a fait apparaître une lacune entre les équipements de recherche conçus et financés dans le cadre des très grands équipements disposant de feuilles de route (Très grandes infrastructures de recherche – TGIR) ou institués par des accords internationaux (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) et les équipements financés par les organismes et les établissements de recherche sur leurs budgets récurrents.
En pratique, cette lacune concerne des équipements mi-lourds de pointe, d’un coût d’acquisition compris entre 1 à 20 millions d’euros. Elle est d’autant plus invalidante pour la recherche française que ce type d’équipement est structurant au niveau national et n’existe généralement pas sur étagère mais nécessite au contraire une phase de développement ou d’intégration.
C’est cette lacune que l’action Equipex, engagée par une convention État-ANR du 16 juin 2010 vise à combler. Le cahier des charges insiste sur le caractère structurant que les équipements retenus devront présenter pour la recherche : « Ces équipements doivent jouer un rôle important dans la structuration des secteurs scientifiques, et favoriser les synergies entre les équipes de recherche ».
Répondant à un besoin jusqu’ici mal couvert par les instruments de financement du ministère, l’action Equipex a rencontré un grand succès auprès de la communauté scientifique.
L’action Equipex a fait l’objet de deux vagues d’appels à projets, en 2010 et 2011.
La vague d’appels à projets Equipex 1 s’est déroulée du 18 juin 2010 au 15 septembre 2011. Les décisions du Premier ministre du 21 février 2011 ont retenu 52 projets, pour un montant de dotations consommables de 260 millions d’euros et de dotations non consommables de 236,4 millions d’euros, produisant 80,4 millions d’euros d’intérêts sur 10 ans. Les conventions entre l’ANR et les porteurs de projets ont été signées entre juillet 2011 et mai 2012.
La vague d’appels à projets Equipex 2 s’est déroulée du 24 juin au 12 septembre 2011. Les décisions du Premier ministre du 16 mars 2012 ont retenu 41 projets pour un montant de crédits d’investissement de 180 millions d’euros, issus de la dotation consommable, et de crédits de fonctionnement de 56,75 millions d’euros (11,17 millions d’euros issus de la dotation consommable et le solde issu des intérêts produits par une dotation non consommable de 148,9 millions d’euros).
C’est ainsi 93 projets qui ont été retenus – 52 en vague 1 (Equipex 1) et 41 en vague 2 (Equipex 2) – pour une dotation totale prévue par la convention de 1 milliard d’euros, se décomposant entre 400 millions d’euros de dotations consommables affectées au financement de l’investissement matériel et 600 millions d’euros de dotations non consommables dont les intérêts sont destinés à financer les frais de fonctionnement des équipements et pourront contribuer au financement de vagues ultérieures de sélection d’Equipex.
Au 31 juillet 2014, 851 millions d’euros de dotations avaient été attribués et contractualisés, dont 465,7 millions d’euros de dotations consommables et 385,3 millions d’euros de dotations non consommables.
Tous les projets Equipex sélectionnés, à quelques exceptions près, se terminent en décembre 2019.
Mis à part deux à trois projets connaissant quelques difficultés dans leur démarrage ou dans l’acquisition et la mise en service de leurs équipements, les Equipex connaissent un niveau d’avancement satisfaisant : au 31 juillet 2014, 25 % des équipements acquis étaient déjà en cours d’utilisation.
5. Les initiatives d’excellence en formations innovantes (Idefi)
L’action « Initiatives d’excellence en formations innovantes (Idefi) » n’était pas originalement prévue au PIA. Elle y a été introduite par l’avenant n° 1 du 26 octobre 2011 à la convention du 23 septembre 2010 entre l’État et l’ANR, qui concernait les Idex.
L’action Idefi a pour objet de soutenir des initiatives ambitieuses visant à renouveler l’offre d’enseignement supérieur dans le sens de l’excellence, notamment à travers l’élaboration, à tous les niveaux de formation, de véritables « démonstrateurs » préfigurant les formations universitaires de demain, et incluant donc de nouvelles démarches de formation, de nouveaux dispositifs, de nouveaux contenus et de nouvelles méthodes.
37 projets ont été sélectionnés par le jury international en mars 2012, 8 inclus dans les Idex et 29 hors Idex.
Une dotation consommable de 150 millions d’euros a été décidée ; 149 millions d’euros ont été attribués et contractualisés. Comme dans le cas des Labex, cette dotation est destinée aux seules Idefi hors Idex. Les 8 Idefi intégrées aux Idex sont financées sur les crédits des Idex. Ces financements se montant au total à 14 millions d’euros, c’est donc 163 millions d’euros de crédits consommables qui sont consacrés aux Idefi.
Sur les 37 Idefi sélectionnées, 36 ont connu un démarrage satisfaisant. Un seul projet, l’Idefi FORMADIME, intégrée à l’Idex « Université de Toulouse » et consacrée à la formation des maîtres, n’a finalement pas pu démarrer et a été arrêté, du fait, a expliqué M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, lors de son audition « d’une modification excessive de ses objectifs. »
6. Les actions « Opération Campus » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay »
Les actions « Opération Campus » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » du programme « Pôles d’excellence » visent principalement à constituer un des meilleurs centres mondiaux de recherche et d’innovation. Dans ce but, elles devront permettre aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui souhaitent rejoindre Saclay de s’y implanter, et à ceux déjà présents de s’y renforcer.
L’action « Opération Campus » du PIA a pour objet le financement de 31 projets Campus, à Paris et sur le campus du plateau de Saclay. 1,3 milliard d’euros de dotation initiale y ont été affectés, sur lesquels 207,7 millions d’euros avaient été attribués au 31 juillet 2014, 167,7 en dotations consommables et 40 en dotations non consommables.
Comme son nom l’indique, l’action « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » est quant à elle spécifique au développement du campus de Saclay. Elle prévoit à cet effet une dotation consommable de 1 milliard d’euros, pour le financement de 19 opérations. Parmi les objectifs de l’action Saclay figure la cohérence des dispositifs PIA présents sur le plateau (Idex, SATT, IEED et IRT).
Les projets parisiens de l’action « Opération Campus » s’inscrivent dans la gouvernance habituelle du plan Campus. À ce titre, ils ne donnent lieu dans le « jaune » budgétaire consacrés aux investissements d’avenir qu’à un reporting purement financier.
Au contraire, les projets financés par l’Opération Campus sur le plateau de Saclay relèvent d’une gouvernance commune avec l’action « Développement scientifique et technologique du Plateau de Saclay » qui est, quant à elle, propre au PIA. C’est pourquoi les deux actions sont présentées conjointement.
L’action « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay » et la partie de l’action « Opération Campus » relative au plateau de Saclay sont opérationnelles depuis le début de l’année 2011. L’instruction des dossiers est réalisée par le service des grands projets immobilier (SGPI) du MESR, qui s’appuie sur les études menées par la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay et l’Établissement public du plateau de Saclay (EPPS).
Comme le montre la situation des dotations, les projets liés au développement du Campus de Saclay progressent rapidement. Au 31 juillet 2014, 768,9 millions d’euros avaient déjà été attribués et 735,5 contractualisés, soit les trois quarts de la dotation environ.
Le plateau de Saclay a vu récemment l’implantation de l’École Nationale Supérieur des Techniques Avancées (ENSTA), d’entreprises et de centres de recherche (Danone, Thales, PCRI, Horiba, Digitéo, Nano-Innov 1, 2, 3) ainsi que de nouvelles résidences étudiantes.
Les premières livraisons ont été réalisées. Elles concernent les rénovations de restaurants et Nano-Innov 3.
Les consultations de maîtrise d’œuvre du Learning Center sous maîtrise d’ouvrage de la Fondation de coopération scientifique (déléguée à l’EPPS) et du bâtiment d’enseignement mutualisé sous maîtrise d’ouvrage de l’école Polytechnique ont été lancées.
Rappelons que le coût total de l’opération du plateau de Saclay était estimé, en juillet 2009, à 4,1 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 300 millions d’euros de voirie et réseaux divers.
C. LES ACTIONS SPÉCIFIQUES À LA SANTÉ ET AUX BIOTECHNOLOGIES
1. Des dotations contractualisées en totalité
Les dotations initiales destinées à la recherche en matière de santé et de biotechnologies se montent à 2,4 milliards d’euros, réparties entre 850 millions d’euros pour les IHU et 1,55 milliard d’euros pour l’action « Santé et biotechnologies » proprement dite.
L’avancement de leur attribution a été particulièrement rapide : aujourd’hui, toutes les dotations sont contractualisées.
SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES : SITUATION DES DOTATIONS AU 31 JUILLET 2014
(en millions d’euros)
Dotation | ||||
initiale |
attribuée |
contractualisée |
décaissée | |
Instituts hospitalo-universitaires dont DC dont DNC |
850 |
869,9(1) 189,9 680,0 |
869,9 189,9 680,0 |
206,7 |
Santé et biotechnologies dont DC dont DNC |
1 550 |
1 536,8(2) 437,3 1 099,5 |
1 536,8 437,3 1 099,5 |
298,9 |
Total dont DC dont DNC |
2 400 |
2 406,7 627,2 1 779,5 |
2 406,7 627,2 1 779,5 |
505,6 |
(1) 134,9 millions d’euros de dotations consommables et 680 millions d’euros de dotations non consommables pour 6 IHU, 35 millions d’euros de dotations consommables pour 6 chaires d’excellence (projets retenus classés B) et 20 millions d’euros de dotations consommables pour 2 projets hospitalo-universitaires en cancérologie (PHUC).
(2) 1 536,8 millions d’euros, répartis en 437,3 millions d’euros de dotations consommables et 1 099,5 millions d’euros de dotations non consommables. L’action compte 11 sous-actions.
DC : dotation consommable
DNC : dotation non consommable
Source : Commission des finances, d’après les données des rapports relatifs à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir, annexés aux projets de loi de finances (« jaunes »)
Là aussi, l’analyse des décaissements doit tenir compte du fait que les bénéficiaires des dotations non consommables n’en perçoivent actuellement que les intérêts annuels.
Par ailleurs, les décaissements continuent. Au 31 décembre 2014, le total en était passé à 602,5 millions d’euros contre 505,6 au 31 juillet.
2. Les instituts hospitalo-universitaires (IHU)
L’objectif de l’action « instituts hospitalo-universitaires » est de financer des pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé. À cette fin, chaque IHU associe, autour d’une spécialité, une université, un établissement de santé et des établissements de recherche, et, bien sûr leurs équipes de chercheurs et de médecins, français et étrangers, travaillant dans cette spécialité.
La mise en place de ces pôles vise à renforcer la compétitivité internationale des équipes sur le plan scientifique, à créer, grâce à la fédération des organismes, une attractivité accrue pour ceux-ci auprès des industriels de la pharmacie, des biotechnologies et des technologies pour la santé, et enfin à accroître les potentiels de valorisation et de transfert des résultats de la recherche vers le patient.
La mise en place des IHU s’inscrit dans la continuité du rapport présenté en février 2010 par la commission sur les instituts hospitalo-universitaires (IHU) présidée par le professeur Jacques Marescaux, rapport qui faisait suite au rapport sur l’avenir des CHU de mai 2009 qui avait été demandé par le Président de la République.
Le PIA avait prévu 850 millions d’euros pour l’action IHU. La convention du 27 juillet 2010 entre l’État et l’ANR (opérateur de l’action IHU) relative à la mise en place des IHU précisait que les bénéficiaires pouvaient être soit des fondations de coopération scientifique, soit des fondations hospitalières.
L’appel à projet a abouti à la création de 6 IHU, couvrant les domaines des neurosciences, des maladies génétiques, des maladies du cardio-métabolisme, des maladies infectieuses, des maladies du rythme cardiaque et enfin de la chirurgie mini-invasive. Ces 6 IHU ont été conventionnés entre octobre 2011 et mars 2012.
Les 6 IHU sont de maturités différentes puisque trois d’entre eux, MIX-Surg, Imagine et ICM, ont pris le relais de structures préexistantes, tandis que les trois autres, ICAN, POLMIT et LIRYC, ont été conçus en réponse à l’appel à projets. Leurs organisations et leurs dispositifs de pilotage sont cependant tous en place aujourd’hui, et aucun IHU n’affiche de retard par rapport à son programme prévisionnel. Les dotations attribuées et contractualisées se montent à 814,9 millions d’euros, répartis entre 134,9 millions d’euros de dotations consommables et 680 millions d’euros de dotations non consommables.
Le jury a classé en rang B 6 autres projets d’IHU. S’ils n’ont pas été érigés en IHU, ces 6 projets ont cependant été labellisés « chaires d’excellence » et ont reçu à ce titre 35 millions d’euros de dotations consommables. Conventionnées entre juillet et décembre 2012, les « chaires d’excellence » ont entamé en 2013 leur mise en œuvre avec le lancement de chaque projet et l’équipement de plateformes techniques. Les 35 millions d’euros de dotations ont elles aussi été attribuées et conventionnées.
Les 850 millions d’euros de dotations prévues pour l’action IHU sont ainsi désormais intégralement contractualisés.
Deux projets hospitalo-universitaires en cancérologie (PHUC) ont aussi été créés. Ces projets présentent les caractéristiques d’un IHU en matière de recherche, mais ne sont pas soumis à une logique de site unique. L’action a été dotée d’une dotation consommable de 20 millions d’euros (soit 10 millions d’euros par PHUC) entre novembre et décembre 2012. Les deux projets PHUC ont commencé à se structurer en 2013.
Au bout du compte, sont financés au titre de l’action IHU 14 projets, soit 6 IHU proprement dits, 6 chaires d’excellence et 2 PHUC, pour un total, entièrement contractualisé, de 869,9 millions d’euros, répartis entre 680 millions d’euros (78 %) de dotations non consommables et 189,9 millions d’euros (22 %) de dotations consommables.
3. L’action « Santé et biotechnologies »
L’action « Santé et biotechnologies » vise à financer des projets dans le domaine des sciences du vivant. Pour être sélectionnés, les projets devaient répondre à plusieurs défis majeurs concernant la santé, l’alimentation, l’énergie ou la chimie. Les appels à projets portaient sur la création et le suivi de cohortes de population, ainsi que sur des projets d’infrastructures nationales en biologie et santé, en biotechnologies, bioressources, nanobiotechnologies et bioinformatique.
Suite à la signature le 14 juillet 2010 entre l’État et l’ANR de la convention relative à l’action « santé et biotechnologies », onze appels à projets ont été lancés (6 en 2010 et 5 en 2011). Ils ont abouti à la sélection par des jurys internationaux de 70 projets. 69 de ces projets sont en cours de réalisation, un projet (en nanotechnologie) ayant été arrêté après avis d’experts extérieurs, suite à un jalon technique non atteint.
Le montant alloué à cette action était de 1,55 milliard d’euros, réparti entre 450 millions d’euros de crédits consommables et 1,1 milliard d’euros de dotations non consommables, au sein desquels une enveloppe de 200 millions d’euros était réservée pour les cohortes.
La totalité des 70 projets sélectionnés a été contractualisée, de même que celle des crédits (1 536,8 millions d’euros, répartis en 437,3 millions d’euros de dotations consommables et 1 099,5 millions d’euros de dotations non consommables).
Le suivi des projets est à présent en place, et les premiers rapports annuels ont été élaborés au printemps 2013.
On trouvera ci-après la répartition des crédits entre les 11 appels à projets.
ACTION « SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES » :
ATTRIBUTIONS ET DÉCAISSEMENTS AU 31 JUILLET 2014
(en millions d’euros)
Montant attribué (décidé) |
Décaissement au 31/07/2014 | ||
Consommable |
Non consommable | ||
Cohortes |
10 |
200 |
20 |
Infrastructures nationales en biologie et santé 1ère vague |
166 |
158 |
104,8 |
Infrastructures nationales en biologie et santé 2ème vague |
169,8 |
381,5 |
93,9 |
Démonstrateurs préindustriels en biotechnologies 1ère vague |
18 |
64 |
20,4 |
Démonstrateurs préindustriels en biotechnologies 2ème vague |
18,0 |
65,2 |
9,8 |
Biotechnologies et bioressources 1ère vague |
12 |
77,7 |
18,2 |
Biotechnologies et bioressources 2ème vague |
7,5 |
153,2 |
12,9 |
Nanobiotechnologies 1ère vague |
15,1 |
- |
8,3 |
Nanobiotechnologies |
3,7 |
- |
1,1 |
Bioinformatique 1ère vague |
10 |
- |
6,26 |
Bioinformatique 2ème vague |
7,1 |
- |
3,2 |
Total |
437,3 |
1 099,5 |
298,86 |
Source : Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir (annexe au projet de loi de finances pour 2015).
II. D’INDÉNIABLES ÉLÉMENTS DE RÉUSSITE
Quel premier bilan peut-on établir aujourd’hui des programmes d’investissements d’avenir dans le domaine de la recherche académique ?
A. LES IDEX : UN INSTRUMENT DE STRUCTURATION DES SITES
1. Des rapprochements effectifs entre universités, écoles et organismes de recherche
Les auditions des dirigeants de grands organismes de recherche comme de responsables d’Idex montrent la réalité de la structuration des sites érigés en Idex par le PIA.
M. Alain Fuchs a ainsi exposé, lors de son audition, que l’orientation de politique scientifique qu’il voulait donner au CNRS, lors de son accession à la présidence de celui-ci, et qu’il avait présentée à la ministre de l’époque, était « celle d’un rapprochement stratégique avec les universités, avec lesquelles les relations du CNRS étaient globalement difficiles. »
Le CNRS, qui, couvrant presque toutes les disciplines, est de ce fait lié par des conventions avec pratiquement tous les établissements de chaque site, a proposé « l’établissement de conventions de sites, liant plusieurs établissements d’un site et le CNRS, pour réfléchir à des projets partagés, interdisciplinaires et comportant des aspects de mutualisation. »
« Le programme d’investissements d’avenir a été une aubaine pour le CNRS, a déclaré son président alors de son audition ; en effet, ce qu’on pouvait considérer comme son objectif de territorialisation de la recherche et de l’enseignement supérieur – à travers les structures qu’il mettait en place – allait dans le même sens que l’action conduite par le CNRS. (…) Le concours des Idex a donc permis au CNRS de développer une véritable politique de sites et des partenariats étroits avec ses partenaires universitaires.(…) Le CNRS a donc été très présent dans le montage des Idex – y compris lorsque des réorientations se sont avérées nécessaires pour répondre aux demandes du jury international, comme à Paris-Saclay »
Aujourd’hui, le CNRS participe à la gouvernance de sept des huit projets qui ont été couronnés, son absence de celle de Sorbonne Paris Cité ne tenant, selon son président « qu’à des raisons conjoncturelles – le CNRS est aujourd’hui membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Sorbonne Paris Cité. »
Et M. Alain Fuchs d’ajouter que le CNRS « est aujourd’hui d’ores et déjà sollicité par des sites candidats aux nouvelles Idex et aux I-SITE (initiatives science-innovation-territoires-économie) du PIA 2. »
Le président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy, témoigne du même effet structurant du PIA et de la même participation massive de l’Inserm.
L’Inserm, a-t-il déclaré, est associé à l’ensemble des Idex et tout particulièrement à celles qui comportent un volet biologie-santé. Les laboratoires de l’Inserm participent aussi aux 6 IHU, aux 6 IHU classés « prometteurs » (dits aussi « chaires d’excellence »), et aux deux PHUC (projets hospitalo-universitaires en cancérologie).
« Le PIA, a-t-il poursuivi, a eu indéniablement, en matière de biologie-santé, un effet structurant. Les financements au titre du PIA d’Equipex, de cohortes ou de structures à grande échelle ont comblé des trous technologiques. »
Enfin, pour citer un troisième dirigeant d’organisme de recherches entendu par la Mission d’évaluation et de contrôle, l’administrateur du CEA, M. Bernard Bigot, a indiqué que « malgré une certaine complexité, les Idex, les Labex et les Equipex s’avèrent bénéfiques, car ils permettent de travailler en commun. »
Par ailleurs, les rapporteurs se sont rendus le 1er juillet 2014 à la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, qui porte l’Idex Paris Saclay. M. Dominique Vernay, président de la Fondation, leur a exposé que celle-ci était constituée de 19 membres : deux universités – l’université de Paris Sud, dite encore Paris-Orsay, et l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sept organismes de recherche – le CNRS, le CEA, l’INRA, l’INRIA, l’Inserm, l’ONERA et l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) –, une école normale supérieure – l’ENS Cachan – et neuf grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce – l’École Polytechnique, l’École Centrale de Paris, l’ENSAE Paris Tech, l’ENSTA Paris Tech, HEC et l’Institut d’optique graduate school (IOGS), Agro Paris Tech, Supélec et Télécom Paris Tech. S’y ajoutent, en tant qu’associé ou partenaire de l’Idex, un pôle de compétitivité – Systematic Paris Région – et un grand équipement, le synchrotron SOLEIL.
Les financements du PIA au titre des Idex ont ainsi permis de réels rapprochements, conformément à leur vocation. M. Louis Gallois s’en est du reste félicité lors de son audition, en citant précisément l’exemple de l’Idex de Paris Saclay : « Les Idex constituent un levier pour le regroupement, comme le montre bien l’exemple de Saclay, où il est stupéfiant de voir l’École polytechnique travailler avec Paris-Sud. L’effet transformant de l’Idex est évident et aurait été inimaginable du temps où cohabitaient Paris Tech et les universités » – Paris Tech étant alors un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) regroupant les grandes écoles du plateau.
2. L’émergence d’une gouvernance des sites
a. La construction d’une gouvernance de site : une entreprise d’envergure
Les auditions de la Mission d’évaluation et de contrôle lui ont aussi permis de constater les réels effets transformants des rapprochements constitués pour la création des Idex.
Un tel effet transformant suppose d’abord une gouvernance solide. La gouvernance a fait l’objet de toute l’attention du Commissariat général à l’investissement. L’exemple qui a le plus frappé les esprits est bien sûr celui de l’Idex de Paris Saclay, puisque, malgré la qualité des porteurs du projet, celui-ci avait été refusé par le premier commissaire général à l’investissement, M. René Ricol.
M. Dominique Vernay, président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, a volontiers reconnu devant les rapporteurs les difficultés qu’avait eues la Fondation pour faire valider son projet d’Idex. Il faut dire que la structuration ne pouvait pas être facile. Non seulement il s’agissait de regrouper une vingtaine de structures de base – écoles, universités, organismes de recherche – de cultures extrêmement différentes, voire opposées, mais il existait déjà des structurations partielles. En 2007 en effet avaient été créés deux réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), Digiteo et Triangle de la Physique. Par ailleurs, les établissements d’enseignement et de recherche présents sur le Plateau de Saclay s’étaient regroupés en deux pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), Saclay et Paris Tech, dont l’un – Paris Tech – comprenait également des établissements non présents sur le plateau. Il était finalement assez logique que, créée en 2011 pour regrouper cet ensemble aussi impressionnant que disparate, la FCS ait été jugée insuffisamment solide en termes de gouvernance pour porter une Idex.
Le système d’alliances entre les établissements a donc dû être entièrement refondu pour donner à la gouvernance de la FCS une robustesse suffisante pour porter une Idex. Les deux PRES ont ainsi été dissous, tandis que les RTRA ont disparu de l’organigramme de la FCS, et surtout de celui du comité Idex, dont les 21 membres représentent, outre un représentant de l’État, directement soit la FCS elle-même, soit les écoles, universités et organismes de recherche qui la composent, mais pas les regroupements intermédiaires. Il faut noter que cette réorganisation a amené aussi la sortie du périmètre de la FCS de Mines Paris Tech, qui reste membre de Paris Tech.
S’il existe d’autres cas où la structuration des Idex paraît solide, notamment lorsque l’Idex a regroupé des organismes moins nombreux qu’à Saclay, et, sur la base d’un projet de regroupement robuste, voulu par les acteurs indépendamment des crédits incitatifs de l’Idex – c’est le cas par exemple pour Unistra, à Strasbourg –, l’établissement d’une gouvernance solide pour chaque site sélectionné ne va pas forcément de soi. Lors de son audition, M. Louis Gallois n’a pas dissimulé les difficultés que pouvait rencontrer l’institution d’une gouvernance solide des Idex. Après s’être félicité de la transformation à l’œuvre à Saclay, il a ajouté : « Je suis plus inquiet pour l’Idex de Toulouse, où je n’ai pas senti de véritable affectio societatis. Il en va de même à Montpellier, où le niveau scientifique est tout à fait adapté, mais où, faute d’entente entre les universités, il sera très difficile de constituer une Idex. En effet, nous ne pouvons pas accepter une gouvernance insuffisante. »
b. Des convergences entre Idex et nouveaux modèles de structuration (fusions et COMUE)
Il faut noter qu’en matière de structuration, la politique des Idex est désormais relayée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Le président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy, a ainsi présenté les deux modalités d’association de l’Inserm aux Idex : « L’Inserm est associé à l’ensemble des Idex et tout particulièrement à celles qui comportent un volet biologie-santé. L’Inserm a dû s’adapter au modèle particulier de gouvernance des Idex ou trouver un modèle adapté avec les acteurs locaux, en fonction des thématiques.
« Il y a deux modes de gouvernance. Lorsque sur le site il y a eu une fusion des universités – comme par exemple à Aix-Marseille, Bordeaux ou Strasbourg –, un comité de pilotage associant l’université, le ou les organismes de recherche auxquels participent l’Inserm et les écoles membres de ces Idex a été mis en place.
« Lorsque le portage de l’Inserm passait par un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et que ce PRES, du fait de la loi du 22 juillet 2013, a évolué vers une communauté d’universités et d’établissements (COMUE), l’Inserm est membre de la COMUE et est donc associé à la gouvernance de l’Idex ; c’est le modèle des Idex parisiennes, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université et Sorbonne Paris Cité notamment. »
Les modèles ainsi présentés sont tout simplement les deux modèles de rapprochement prévus par la loi du 22 juillet 2013. Et, en réponse à une question de l’un des rapporteurs, M. Yves Lévy, a ensuite précisé que ces modèles de gouvernance étaient satisfaisants.
Autre illustration de cette convergence entre la politique des Idex et la loi du 22 juillet 2013, le président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, M. Dominique Vernay, a exposé aux rapporteurs que la FCS avait vocation à se transformer en COMUE. Cette transformation a été effectuée par un décret du 29 décembre 2014.
c. Un rôle pour les alliances de recherche ?
Enfin, il a été rapporté à la Mission d’évaluation et de contrôle que l’action des alliances de recherche pouvait faciliter la gouvernance des Idex, et même des Labex.
Les alliances de recherche sont des structures légères regroupant les organismes de recherche sur la base de thématiques de recherche. Elles ne sont pas pourvues d’un budget. Elles n’ont pas vocation à s’immiscer dans la gestion des organismes ou à interférer dans les relations entre ceux-ci et leur tutelle. Du fait de la pluralité de leurs champs de recherches, certains organismes sont du reste membres de plusieurs alliances. Ce sont des instances de concertation qui permettent de dégager des axes pour le développement de la recherche et constituent donc des lieux de rationalisation de l’expression des choix. Il faut noter que le CNRS, du fait de l’extrême expansion du champ de compétences qui est le sien, a été positionné comme un interlocuteur de même rang que les alliances.
Cinq alliances fédèrent chacune les opérateurs d’un champ de la recherche. Aviesan est l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, Ancre l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie, Allistene l’Alliance des sciences et technologies du numérique, AllEnvi l’Alliance dans le domaine de la recherche environnementale et enfin Athena l’Alliance nationale des humanités, sciences humaines et sciences sociales.
Les alliances de recherche « facilitent la gouvernance » a ainsi exposé, lors de son audition, le président directeur de l’Inserm, M. Yves Lévy : « Les deux organismes de référence en matière de recherche biomédicale, le CNRS et l’Inserm, font ensemble des visites de site, et discutent ensemble des politiques de site avec les acteurs de ceux-ci. Il est habituel que ces déplacements soient dénommés « Aviesan ».
« Concernant la gestion et la visibilité des Labex, il a été mis en place au niveau d’Aviesan un comité de coordination qui s’implique complètement, y compris dans les structures qui ne sont pas gérées directement par un organisme désigné tel que l’Inserm ou le CNRS.
M. Thierry Damerval, directeur général délégué de l’Inserm, a ajouté, quant à lui, que : « L’existence d’Aviesan a été absolument déterminante pour notre positionnement et notre organisation en matière d’infrastructures nationales en biologie-santé. »
Lors de son audition, la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, Mme Geneviève Fioraso, a été plus catégorique encore : « Le PIA est un levier, mais la vraie structuration passe par les alliances thématiques ».
3. De premières répercussions positives
a. Une visibilité accrue et une meilleure lisibilité des diplômes
L’un des premiers objectifs recherchés à travers la constitution des Idex était une amélioration de la visibilité, et notamment la visibilité internationale, des institutions d’enseignement supérieur et de recherche françaises.
Or, la séparation entre organismes de recherche et établissements d’enseignement supérieur contrarie fortement celle-ci. Cette faible visibilité est assez facilement symbolisée par la place médiocre des universités françaises au sein du célèbre « classement de Shanghai », puisqu’en 2010 seuls trois établissements, l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), l’Université de Paris Sud et l’École normale supérieure figuraient parmi les 100 premiers établissements classés.
Le monde de la recherche se structurant au-delà des frontières, la visibilité internationale est essentielle pour constituer des équipes de chercheurs de niveau mondial, et de contracter relativement facilement des partenariats de toutes sortes.
De ce point de vue, avec 10 500 chercheurs, 300 laboratoires et 60 000 étudiants dont 5 700 doctorants, l’université de Paris Saclay – la COMUE a été créée par décret du 29 décembre 2014 – apparaît comme un ensemble de classe mondiale. Selon le président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, M. Dominique Verlay, une simulation a fait apparaître que, l’université Paris-Saclay devrait être, à condition que tous les établissements qui la constituent acceptent de ne pas être classés individuellement, classée 19ème ou 20ème au classement international de Shanghai.
Au-delà de la masse critique ainsi créée, la visibilité passe aussi par la labellisation des formations et des recherches.
S’agissant des recherches, un premier exemple des effets bénéfiques de la structuration recherchée par la politique des Idex peut être fourni par la nouvelle université de Strasbourg, qui, grâce à la fusion de ses composantes, a pu entrer dans le « top 100 » du classement de Shanghai.
La mise en cohérence des diplômes délivrés au sein d’une même Idex est aussi un objectif essentiel de la politique des Idex. Lors de son audition, M. Louis Schweitzer l’avait évoquée ces termes : « Si les réorganisations suscitent quelques protestations – c’est une litote ! –, c’est qu’elles changent réellement les choses, notamment pour les formations doctorales. »
Le président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, M. Dominique Vernay, a quant à lui indiqué aux rapporteurs lors de leur visite que l’objectif d’une telle rationalisation avait bien été présent dans la création de l’Idex. Cependant, a-t-il ajouté, alors que cet objectif était d’une mutualisation de 100 % des doctorats et de 30 % des masters, la quasi-totalité des masters est désormais mutualisée, à la surprise générale : il y a bien un effet spontanément structurant des Idex.
À partir de septembre 2015, 49 mentions de master mutualisées, couvrant l’ensemble des champs disciplinaires de l’Université Paris-Saclay, seront proposées par les établissements partenaires.
b. Les prémisses d’évolutions profondes
Ces premiers éléments positifs font cependant apparaître par eux-mêmes l’ampleur et la profondeur des évolutions à conduire. Ainsi, à Saclay, la mutualisation des diplômes a fait apparaître deux difficultés, qui concernent principalement les universités membres.
En effet, si le fait qu’un diplôme délivré par une grande école membre de la COMUE de Saclay porte à la fois le label de Saclay et celui de l’école qui le délivre ne comporte que des avantages (attestant en quelque sorte à la fois de la visibilité du diplôme et de la qualité du diplômé), les dirigeants de la FCS ont attiré l’attention des rapporteurs sur les risques de confusion qui pourraient naître d’un double label universitaire, Paris Saclay et Paris Orsay, par exemple. En filigrane se pose alors la question de la fusion des universités inscrites dans le périmètre du campus de Saclay, ou au moins de la disparition de leur label au profit de celui de Saclay – le label des laboratoires pouvant, lui, subsister comme celui d’une des composantes, parfois prestigieuse, de la COMUE.
La mutualisation rend aussi particulièrement sensible les différences de financement. Ainsi HEC fait payer des droits d’inscription spécifiques pour suivre l’un de ses masters. L’université de Paris Sud n’en a pas le droit ; en revanche, elle reçoit du ministère chargé de la recherche des dotations qu’HEC ne perçoit pas.
Enfin, à l’échelle mondiale, les rémunérations des chaires universitaires ou des directions de laboratoires ne se limitent pas toujours à celles que permettent les grilles indiciaires de rémunération des professeurs d’université ou des directeurs de recherches au CNRS. Sur ce plan, M. Claude Chappert, directeur général de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, chargé de l’Idex Paris Saclay, a fait part des difficultés rencontrées pour construire une chaire de niveau international – y compris en matière de rémunération – avec les outils administratifs et statutaires actuels de l’université française.
Ainsi, si les perspectives ouvertes par le début de la structuration liée au statut d’Idex sont jugées extrêmement stimulantes à Saclay par les interlocuteurs des rapporteurs, elles s’accompagnent cependant d’autant de difficultés et d’obstacles qui nécessiteront chaque fois des analyses et des solutions spécifiques pour les surmonter, un par un.
B. LES LABEX : DES LEVIERS POUR L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE
1. À l’échelle nationale, des éléments fédérateurs
Les Labex représentent eux aussi un double élément stratégique à la fois pour la promotion de l’excellence et pour la structuration de la recherche.
Les dirigeants du CNRS et de l’Inserm entendus par la Mission d’évaluation et de contrôle ont évoqué les effets d’intégration des Labex entre équipes de recherches relevant des universités et des grands organismes.
Ainsi, le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a exposé que, dans la continuité des unités mixtes de recherche (UMR) associant universitaires et chercheurs du CNRS, « les équipes labellisées CNRS participent à 164 Labex sur 171, soit à 96 % d’entre eux, et à 97 % des Equipex. Autrement dit, (…) le CNRS participe, à travers ses structures propres ou à travers des structures auquel il est associé, à la quasi-totalité des projets, même lorsque ceux-ci sont dirigés par un enseignant-chercheur. »
Quant au président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy, il a indiqué que ses laboratoires participaient à 52 Labex et à 19 Equipex.
2. Des instruments de coordination forts et porteurs de visibilité internationale
Soucieux de s’informer au plus près du terrain, les rapporteurs, lors de leur déplacement à Saclay, ont rencontré les coordinateurs de deux Labex, Mme Christine Paulin-Mohring, professeur à l’Université Paris-Sud et coordinatrice du Labex DigiCosme, et M. Loïc Lepiniec, directeur de recherches à l’Inra et coordinateur du Labex SPS – Sciences des Plantes de Saclay.
M. Loïc Lepiniec a exposé que le Labex qu’il coordonne regroupait 700 enseignants-chercheurs, cinq laboratoires et six institutions.
Il a insisté sur l’effet structurant du Labex. Son existence est créatrice de décloisonnements : le nombre de laboratoires va passer de cinq à deux. L’existence du Labex permet aussi une gestion plus globale et rationalisée des fonds : le regroupement des budgets aboutit pour le Labex à un budget annuel de 1 million d’euros ; il permet aussi une action plus rationnelle en matière d’infrastructures, et offre plus de souplesse pour le financement de la venue de chercheurs étrangers.
L’existence du Labex offre aussi une meilleure visibilité aux travaux des chercheurs qui y travaillent : alors qu’auparavant ils publiaient sous le timbre de leur laboratoire de rattachement, ils utilisent désormais le label du Labex pour publier leurs travaux. Le résultat est que le Labex fait désormais partie des cinq premiers mondiaux de sa spécialité par le nombre de publications, alors que les cinq laboratoires qu’il fédère étaient auparavant beaucoup moins visibles et puissants.
Enfin, M. Loïc Lepiniec a évoqué l’effet favorable du Labex sur la qualité de la formation : la recherche apporte des moyens aux universités.
Par ailleurs – tel ne semble pas être le cas partout – la création du Labex a été transparente en termes de nombre d’emplois contractuels.
Mme Christine Paulin-Mohring, professeur à l’Université Paris-Sud et coordinatrice du Labex DigiCosme a elle aussi souligné l’effet de rationalisation et de valorisation que permettait le cadre du Labex qu’elle coordonne. Constitué à partir de l’ancien réseau thématique de recherche avancée (RTRA) Digiteo, il fédère 300 chercheurs répartis en 14 laboratoires. Le nombre de ces laboratoires va être réduit à 4 ou 5, par intégration de petits groupes de chercheurs, présents dans les écoles, qui n’avaient pas en réalité la masse critique pour développer leurs travaux de façon satisfaisante. Les candidatures aux projets sont désormais effectuées au niveau du Labex : une seule candidature est effectuée, alors que les laboratoires qui en sont membres pouvaient se trouver à en proposer chacun une. La liaison établie entre chercheurs de cadres différents permet aussi d’enrichir le niveau de l’offre du Labex. C’est ainsi le cas lorsqu’une offre réunit le niveau scientifique mondial d’équipes de Paris Sud et les excellentes capacités de relations avec l’industrie d’équipes du CEA.
Les descriptions effectuées confortent ainsi la présentation générale faite à la Mission d’évaluation et de contrôle par le président du CNRS, M. Alain Fuchs : « L’envergure des projets de Labex finançables au titre du PIA est, pour l’essentiel, sans comparaison avec celle des projets financés par l’ANR. Les projets Labex font coopérer non pas deux ou trois équipes, comme c’est le cas pour des projets ANR, en biologie par exemple, mais cinq, voire dix équipes, relevant de plusieurs UMR, avec un fonctionnement en mode projet. Beaucoup de Labex deviennent eux-mêmes des systèmes de recrutement de chercheurs post-doctorat, notamment par des appels d’offres internes. Beaucoup d’entre eux fonctionnent comme les anciens réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA). »
Les Labex deviennent même un cadre d’ensemble pour des équipes qui soumissionnent aux appels à projet de l’ANR. Toujours selon M. Alain Fuchs : « On a vu des chercheurs seniors, bien installés dans le monde de la recherche, porter des projets de Labex assez importants, tandis que, dans les laboratoires de ces chercheurs, des chefs d’équipe continuaient à aller présenter des projets à l’ANR. De ce que j’ai pu voir, la création des financements du PIA pour la création de Labex n’a pas du tout eu pour conséquence une diminution des projets standards soumis à l’ANR. »
La directrice générale de l’ANR, Mme Pascale Briand, s’est du reste félicitée de cette situation : « Il est très intéressant qu’un même établissement ait à gérer à la fois les investissements d’avenir et le financement sur projet. (…) Qu’un site ayant bénéficié des investissements d’avenir rencontre plus de succès lors des appels à projets conventionnels serait un bon signe, car ce serait la preuve de l’effet structurant des investissements d’avenir. »
Ainsi les Labex, a souligné le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet « ont donné beaucoup de flexibilité aux équipes pour lancer des appels à projet et attirer des chercheurs réputés. »
C. LES FINANCEMENTS DU PIA : DES EFFETS DYNAMISANTS
Au bout du compte, les premières conclusions des interlocuteurs de la Mission d’évaluation et de contrôle sur les effets des PIA dans le domaine de la recherche académique sont positives.
« Quel est l’apport à la recherche des structures créées par le PIA ? s’est interrogé le président directeur de l’Inserm, M. Yves Lévy. Dans le domaine de la santé, les infrastructures nationales et les financements qui y sont attachés ont été essentiels. Ils ont permis d’accroître le niveau technologique d’un certain nombre d’équipes, la structuration de la recherche à un niveau beaucoup plus large que celle du simple laboratoire – notamment en matière de recherche biomédicale – et enfin la participation de la France à certains projets européens ou, pour certains projets européens, la constitution du nœud français. »
Lors de son audition, M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, a insisté sur la satisfaction des acteurs de la recherche bénéficiaires des PIA en matière d’équipements, de notoriété et de recrutement : « J’ai notamment réuni les Idex, les instituts hospitalo-universitaires (IHU) et les instituts de recherche technologique (IRT) pour leur demander comment ils imaginaient l’évaluation de la valeur ajoutée des PIA. Pratiquement tous les patrons d’IHU ont répondu que cette dernière se traduisait par une notoriété internationale accrue, par une capacité à attirer des chercheurs de meilleur niveau grâce à des bourses spéciales permettant de les payer et par une accélération de la publication des recherches permettant à des chercheurs français d’accomplir des premières dans un environnement très compétitif. Les IHU ont également pu créer des plates-formes de moyens communs dans des domaines tels que l’informatique, la simulation ou les tests, pour lesquels il était auparavant très difficile de trouver des financements. »
Le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, a quant à lui insisté sur l’intérêt des PIA pour la structuration de la recherche, notamment sur les territoires, et donc sur leur insertion dans le cadre d’une politique de longue haleine : « Les politiques de sites, celles des Idex, des I-SITE et des Labex, favorisent un dialogue entre tous les acteurs de l’écosystème enseignement supérieur–formation–recherche–innovation (écoles, universités, organismes nationaux, sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT), instituts de recherche technologique (IRT), pôles de compétitivité, collectivités locales et État) sur un territoire et donnent des moyens pour créer une politique scientifique territoriale cohérente, à partir d’une mise en commun des diagnostics des forces et des faiblesses. La politique de sites a prolongé l’initiative prise par le ministère dans les années 2007-2008 pour établir un diagnostic et une stratégie territoriaux, qui soient un outil de dialogue entre la région et l’État et de mise en œuvre entre les acteurs. »
Pour montrer la réalité de l’effet structurant de la démarche des PIA, le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a pris l’exemple de sites ou d’équipes qui ont échoué à obtenir des financements ou n’ont pas envisagé de constituer de dossiers : « Si certains sites (accompagnés par le CNRS) n’ont pas été retenus comme Idex, nous constatons a posteriori que le simple fait d’avoir présenté un projet a permis par lui-même une meilleure structuration du site ou des réflexions sur la façon dont il pourrait être construit – je pense notamment à Bourgogne-Franche Comté ». Et inversement : « Aujourd’hui, certains sites qui n’avaient pas jugé leurs chances assez fortes pour construire un projet regrettent souvent de ne pas l’avoir fait, du fait de l’effet de structuration qu’ont créé le montage d’un projet et les échanges avec un jury international. »
III. DE NOUVEAUX DÉFIS À SURMONTER
Quelle que soit leur évidence, les éléments de réussite ci-dessus exposés s’accompagnent cependant de plusieurs difficultés d’exécution.
A. QUELLE PLACE POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ?
1. L’aménagement du territoire, un non-critère pour les investissements d’avenir
a. La non-prise en compte de l’aménagement du territoire en tant que tel
La première concerne l’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire n’est pas un critère, même secondaire, pour la répartition des crédits du PIA. M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, a été très clair sur ce point : « Notre charte ne comprend pas d’objectifs relatifs à l’aménagement du territoire. (…) Ma mission n’est pas de mener vingt-deux programmes d’investissements d’avenir – elle y perdrait beaucoup de son intérêt. » Cette position a été réaffirmée par l’actuel commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, lors de son audition par la Commission des finances le 14 janvier 2015 : « Par ailleurs, nous considérons que nous n’avons pas de mission d’aménagement du territoire en matière d’enseignement supérieur et de recherche ; nous visons l’excellence. » Lors de son audition, Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR, n’avait pas dit autre chose : « En aucun cas le critère d’excellence ne doit être atténué par un souci d’aménagement du territoire. »
M. Louis Schweitzer a cependant ajouté que le Commissariat général à l’investissement ne se désintéressait pas de l’impact territorial : « Ensuite, ce n’est pas parce que nous n’avons pas de mission d’aménagement du territoire que nous ne mesurons pas l’impact régional de nos crédits. En effet, une mission dirigée par un préfet de région surveille, au sein du CGI, la répartition territoriale de nos crédits. Nous travaillons d’ailleurs avec des commissions régionales de suivi du PIA. »
M. Louis Schweitzer a également indiqué que le Commissariat général à l’investissement avait par ailleurs créé, « à titre expérimental, dans le PIA 2, une enveloppe de 50 millions d’euros dont l’attribution des crédits sera codécidée par le CGI et les régions, qui l’abonderont de 50 millions d’euros ».
La directrice générale de l’ANR, Mme Pascale Briand, avait évoqué, au profit des territoires, des maillages en réseau : « La question de l’émergence des équipes me semble pouvoir être posée aux organismes de recherche et aux universités, l’émergence de sites pouvant être envisagée à partir de sites d’excellence, capables d’établir des maillages en réseau avec des sites plus isolés. »
b. Les Idex, des instruments valorisants pour les territoires
Si, de premier abord, une telle méthode, qui tirerait les sites non distingués vers le haut en les aidant à remplir les conditions d’accès aux financements du PIA, ne peut que susciter l’approbation, elle se heurte cependant à la répartition des crédits entre les actions du PIA, autrement dit, pour être clair, au poids des Idex dans le dispositif.
Un tableau réalisé par le ministère chargé de la recherche et comparant, par région, la part du PIA attribuée, la part de la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) réalisée en 2009 et la part du nombre d’étudiants inscrits en 2010, et publié dans son rapport par la Cour des comptes, fait apparaître que la part des financements du PIA n’est supérieure aux deux autres critères que pour quatre régions seulement, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi Pyrénées, Aquitaine et Alsace. Si l’on veut bien se souvenir que ce sont les seules régions – outre l’Île-de-France où, malgré son volume, la part des financements au titre du PIA reste inférieure à la DIRD –, où se trouve implantée une Idex, on voit bien que l’obtention d’une Idex est le critère discriminant de la répartition régionale des crédits du PIA.
Or les crédits du PIA ne concernent pas seulement le financement des laboratoires. Ils provoquent une amélioration de la gouvernance et de l’offre de formation – à travers le regroupement des masters, par exemple. Dans ces conditions, on peut réellement s’interroger sur un éventuel effet déséquilibrant du PIA, les sites d’Île-de-France, de Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille et Strasbourg acquérant grâce à celui-ci une attractivité spécifique, qui pourrait être encore accrue par la nouvelle carte régionale.
2. Prévenir les risques de déséquilibres
a. Les I-SITE, une première réponse pour les territoires sans Idex
Pour remédier aux déséquilibres latents, une première réponse consiste à réduire le degré de polyvalence exigé. Elle produirait ses effets d’autant plus vite que des projets jugés excellents mais insuffisamment polyvalents existent déjà. Le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, l’a reconnu devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « Dans le premier appel d’offres concernant les regroupements universitaires et les initiatives structurantes innovation-territoires-économie (I-SITE), le jury international avait jugé excellents au moins deux projets qu’il n’avait toutefois pas pu retenir, car les organismes concernés ne présentaient pas le degré de polyvalence exigé par le cahier des charges. »
Soucieux d’un meilleur maillage du territoire dans le respect de l’excellence, le Commissariat général à l’investissement a donc décidé « qu’à l’avenir des projets qui seraient excellents, comporteraient la dimension structurelle que nous demandons, mais ne seraient pas totalement pluridisciplinaires, pourraient être retenus », a poursuivi M. Louis Schweitzer.
Ces projets prendront le nom d’initiatives structurantes innovation-territoires-économie (I-SITE). Ces I-SITE, a indiqué M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement, « permettront à des pôles d’excellence implantés dans des territoires qui ne disposent pas d’une offre scientifique complète de faire acte de candidature. Une certaine souplesse est introduite dans le cahier des charges à cette fin ; en revanche, l’exigence d’excellence reste la même. »
« L’enjeu des I-SITE, a-t-il poursuivi, est, comme pour les Idex, le regroupement d’organismes à la fois d’enseignement et de recherche, à des fins, par exemple, de concentration ou de rationalisation des masters. »
Selon M. Louis Gallois, quatre ou cinq I-SITE devraient ainsi « compléter » les Idex, qui ne permettaient pas à certaines universités et établissements à spectre moins large de se regrouper.
b. Des méthodes renouvelées pour la création nécessaire d’Idex supplémentaires
Il n’est cependant pas certain que cet élargissement suffise à lui seul à remédier aux déséquilibres géographiques créés par l’actuelle carte des Idex. Celle-ci laisse en effet sans Idex les territoires s’étendant au nord et à l’ouest de Paris, à l’est de Paris jusqu’à Strasbourg et au sud jusqu’à la Gironde et à la Méditerranée.
Une meilleure répartition des Idex passe alors par une seule solution : un accroissement du nombre d’Idex de façon à ce qu’ils maillent mieux le territoire. Lors de son audition, M. Louis Gallois a ainsi évoqué la création de quatre ou cinq Idex supplémentaires.
Une telle solution suppose une nouvelle levée de fonds, qui permettra de doter les nouvelles Idex des mêmes dotations que les Idex du PIA 1.
Par ailleurs, la méthode de création des nouvelles Idex devra sans doute évoluer par rapport à la méthode de sélection du PIA. Lors de l’audition de M. Louis Gallois, M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire au Commissariat général à l’investissement, a exposé que : « Il a finalement été décidé que les dossiers de candidature au titre des Idex seraient constitués ultérieurement (après l’année 2014, consacrée à la mise en application de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche) sur la base de ce que les acteurs auraient décidé de faire ensemble. Ce calendrier permet de réguler l’un des problèmes rencontrés dans le cadre du PIA 1, où l’Idex était constituée sur la base d’une « déclaration d’amour » et était immédiatement applicable, ce qui a causé certains décalages. Dans le nouveau calendrier, il faudra donner d’abord une « preuve d’amour », c’est-à-dire définir préalablement quelles compétences les partenaires décident d’exercer en commun et quelle configuration ils adoptent à cette fin. »
Si cette méthode permet un examen approfondi des candidatures et garantit une mise en œuvre aussi sincère et solide que possible des orientations proposées au financement du PIA, il n’en reste pas moins que ce sont désormais les sites universitaires et de recherche dont le projet de gouvernance ou l’affectio societatis n’avaient pas été jugés assez solides pour qu’ils soient sélectionnés qui ont vocation à constituer les nouvelles Idex.
Le risque est alors que, le principe d’un maillage du territoire posé, on assiste à un simple financement de pôles régionaux, sans conséquences sur les structures de gouvernance ni sur l’excellence.
Éviter ce risque suppose sans doute un engagement beaucoup plus fort du Commissariat général à l’investissement et du ministère chargé de la recherche auprès des porteurs de projets pour que les nouvelles Idex puissent voir le jour dans des conditions qui satisfassent aux critères fixés par le Commissariat général à l’investissement. Un travail itératif intense, avec la mise en place de propositions d’organisation issues de l’expérience des premières Idex sera sans doute nécessaire.
La situation actuelle de l’Idex de Toulouse, présentée par M. Louis Gallois, illustre assez bien le type de travail qui attend le Commissariat général à l’investissement : « Pour l’Idex de Toulouse, par exemple, étant donné que le programme initialement adopté ne faisait plus consensus après les changements de présidence intervenus dans l’université toulousaine, nous avons indiqué qu’il n’y aurait pas d’Idex tant que ce consensus n’aurait pas été reconstruit sur des bases respectant les principes des investissements d’avenir. Ce processus a pris un an et nous avons dû convaincre Toulouse de mettre en place un comité d’arbitrage totalement indépendant, ce qui n’était pas prévu au départ, et d’adopter une gouvernance stable. Je ne suis pas certain que ce dernier objectif ait été rempli, car le conseil d’administration reste pléthorique, mais au moins ce conseil dispose-t-il d’un bureau à taille humaine, investi de pouvoirs de gestion. L’Idex de Toulouse doit être suivie avec le plus grand soin, car c’est celle qui nous pose le plus de problèmes pour ce qui est du respect de nos orientations. »
Le mode d’attribution des financements devra peut-être aussi évoluer. Certains projets devront mûrir plus longuement que d’autres. Leur réussite sera cependant peut-être cruciale en termes d’aménagement du territoire. Dès lors, sans doute faudra-t-il prévoir des financements, mais ne prévoir leur déblocage qu’une fois le projet jugé satisfaisant en termes d’excellence et de gouvernance. Le site de Montpellier, évoqué là aussi par M. Louis Gallois, fournit un bon exemple de cette situation : « À Montpellier, le niveau scientifique est tout à fait adapté, mais, faute d’entente entre les universités, il sera très difficile de constituer une Idex. En effet, nous ne pouvons pas accepter une gouvernance insuffisante. »
Dès lors, le volume des financements incitatifs que proposerait un éventuel PIA 3 deviendrait encore plus stratégique que pour le PIA 1 puisque ce nouveau PIA serait l’instrument qui permettrait aux nouveaux sites labellisés de ne pas voir leurs moyens décrocher par rapport à ceux des sites sélectionnés lors du PIA 1.
B. QUELLE GOUVERNANCE PÉRENNE POUR LES SITES D’EXCELLENCE ?
1. Deux causes de fragilité pour les Idex
a. La gouvernance des universités
Les Idex ont été constituées en tant que regroupements d’entités d’excellence réunies autour d’une gouvernance commune en vue de la réalisation d’un programme d’excellence.
La pérennité de leur gouvernance sur la base des principes sur lesquels elles sont fondées doit donc surmonter deux obstacles.
Le premier tient à la démocratie universitaire elle-même.
Comme M. Louis Gallois l’a exposé : « La démocratie universitaire fonctionne de telle sorte que les présidents d’université changent tous les quatre ans, non parce que certaines équipes seraient meilleures que d’autres, mais pour des raisons politiques, au sens noble du terme : tous les quatre ans s’affrontent des visions d’ensemble de ce que doit être l’université ». Or, a-t-il poursuivi : « Le fait que les présidents d’université changent tous les quatre ans, et avec eux les orientations fondamentales des universités, peut déstabiliser les communautés universitaires ». Le fait s’est produit en septembre 2013 avec la sortie de l’Université de Paris-Assas du PRES Sorbonne Universités. Or, ce PRES était aussi Idex.
Si, on l’a vu, le Commissariat général à l’investissement a pu gérer cette évolution, il n’en reste pas moins qu’il y a là une fragilité pour les Idex : « Je souhaite, a déclaré M. Louis Gallois, que les Idex soient assez solides pour ne pas être trop perturbées par ces événements. Elles ont assez bien tenu jusqu’ici, mais des difficultés sont inévitables. »
La deuxième difficulté tient aux regroupements eux-mêmes.
Sur un site donné, les Idex et Labex ne regroupent que les éléments d’excellence du site.
Or, depuis la création des Idex a été votée la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui a institué trois modes de regroupement des organismes universitaires et de recherche sur un même site : la fusion de plusieurs établissements d’enseignement supérieur en un seul, le rattachement, pur et simple, d’établissements ou organismes à un établissement d’enseignement supérieur existant, et enfin, la création d’une communauté d’universités et d’établissements (COMUE) destinée à assurer la coordination des politiques de ses membres, par l’exercice des compétences que ses membres lui transfèrent.
Autrement dit, après le vote de la loi se pose la question de la présence, sur les sites labellisés Idex, de deux gouvernances simultanées, celle de l’Idex et celle, par exemple, de la COMUE.
Le risque d’une dilution des Idex au sein des nouveaux modes de regroupements institués par la loi n’a pas échappé au Commissariat général à l’investissement. Lors de son audition, M. Louis Gallois, alors Commissariat général à l’investissement, avait ainsi déclaré : « Pour ce qui est de la structuration des blocs universitaires, je m’interroge quant à la possibilité d’avoir à la fois des communautés d’universités et des Idex. L’Idex est un périmètre d’excellence qui ne doit pas perdre sa spécificité et qui fait précisément l’objet d’un suivi sur ce point de l’excellence et sur sa gouvernance. Or on observe dans le milieu universitaire une tendance à penser que l’existence des communautés d’universités rendrait caduc le modèle de l’institution Idex en tant que tel. »
M. Louis Gallois a illustré ce risque en prenant l’exemple de l’université de Toulouse : « Le comité d’arbitrage a été plus difficile à mettre en place à Toulouse qu’ailleurs, car une université y était très opposée. Il a donc fallu de la persuasion, fondée notamment sur l’argument que, si les choses continuaient ainsi, il n’y aurait pas d’Idex. Cela signifie en tout cas que cette opération doit être suivie de très près, car nous pourrions revenir en arrière et noyer les spécificités de l’Idex dans la communauté d’universités, où il n’y aurait plus qu’à procéder à une équirépartition de l’enveloppe entre les différentes universités. »
Or, les bonus qualité recherche (BQR) attribués dans les universités se sont bel et bien achevés par l’équirépartition, au point que certains patrons de laboratoires dynamiques refusaient d’y candidater, sachant qu’il n’y avait plus de bonus à attendre au-delà de l’équirépartition.
Idéalement, les Idex devraient donc conserver des principes et des instances de gouvernance distincts de ceux des COMUE, même si ces instances sont composées des mêmes acteurs.
2. La gouvernance des Idex via les COMUE : une solution praticable
On peut cependant s’interroger sur la viabilité à terme de deux gouvernances des Idex et des COMUE totalement séparées. À ce propos, il faut noter qu’en Allemagne, il n’a pas été jugé possible de dissocier au sein d’un même site – de l’équivalent d’une COMUE, par exemple – les laboratoires ou organismes d’excellence et les autres. Pour la définition des universités d’excellence allemandes, il a été considéré que l’intégralité d’un établissement était éligible au financement de l’initiative d’excellence, et pas seulement une partie de celui-ci. Ce point mériterait d’être revu en France.
Lors de son audition, le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, a insisté sur la cohérence entre les Idex et les deux formes de regroupements instaurés par la loi du 22 juillet 2013 : « La politique des Idex, qui consistait à faire émerger des pôles d’enseignement supérieur et de recherche au meilleur niveau international, trouve tout à fait son prolongement dans la loi du 22 juillet 2013 avec la mise en place des politiques et des contrats de sites. »
Par ailleurs, lors de leur visite sur le campus de Saclay, les rapporteurs ont pu constater les liens étroits entre l’Idex et la Fondation de coopération scientifique, qui a depuis été transformée en COMUE. La composition des assemblées et des conseils des deux institutions est très proche. Ne manquent à la FCS, par rapport à l’Idex, que trois acteurs, le pôle de compétitivité – sachant que ces pôles ont vocation à se rapprocher des COMUE –, le synchrotron Soleil et l’Inserm, pour des raisons purement historiques, la FCS ne s’étant intéressée que tardivement aux sciences de la vie. Par ailleurs, c’est le directeur général de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, M. Claude Chappert, qui est chargé de l’Idex Paris Saclay.
Faut-il donc en conclure que la dilution des Idex au sein d’instances qui en oublieraient les principes est inévitable ?
Les Idex sont constituées par des conventions. L’attribution des fonds est régie par des règles spécifiques ; leur versement effectif est subordonné au respect de ces conditions ; l’exemple de Saclay montre qu’une structure de regroupement (ici, la FCS) peut parfaitement être en situation de gérer une convention Idex.
Enfin, la gouvernance d’une COMUE n’est pas celle d’une université. La présence de grands organismes de recherche, voire de pôles de compétitivité pèse sur la définition de ses règles de fonctionnement : les statuts de la COMUE ne peuvent être adoptés sans leur signature. Or, ils n’ont aucune raison de brader celle-ci. Le président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, M. Dominique Vernay, a exposé aux rapporteurs que lorsqu’il avait consulté les organismes de recherche sur la perspective de la transformation de la FCS en COMUE dont ils seraient membres, ceux-ci lui avaient répondu qu’ils conditionneraient leur accord à deux conditions, d’une part que la COMUE soit dotée d’une vraie gouvernance, et de l’autre que le président de la COMUE dispose d’une expérience et d’une légitimité reconnue. Les statuts de la COMUE ont finalement été adoptés à l’unanimité moins une abstention. Il apparaît ainsi clairement que la présence des grands organismes de recherche dans les COMUE a vocation à peser sur leur gouvernance.
On doit donc considérer qu’il y a non pas opposition mais cohérence entre Idex et COMUE, et que les règles de dévolution des fonds du PIA sont suffisamment précises pour qu’une COMUE puisse gérer une Idex sans en dissoudre la spécificité.
Telle est en tout cas la position de la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche. Lors de son audition par la Mission d’évaluation et de contrôle, Mme Geneviève Fioraso a en effet déclaré : « Je fais le pari que les Idex seront naturellement absorbées dans les COMUE et serviront à accroître le niveau de qualification global : comme c’est déjà le cas à Toulouse, elles seront des locomotives et non pas des poches d’excellence isolée. (…) Ce sentiment est partagé par les acteurs territoriaux. »
Lors de son audition par la Commission des finances le mercredi 14 janvier 2015, le Commissariat général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, semble de reste s’être rallié à cette position : « Nous ne finançons que des projets d’excellence, mais nous nous efforçons de favoriser également une meilleure structuration de l’activité économique. Ainsi, dans le domaine universitaire, nous encourageons le développement des communautés d’universités et d’établissements – COMUE » a-t-il exposé.
3. La dévolution future des dotations non consommables : un enjeu pour la stabilisation des Idex
Un enjeu majeur du PIA concerne l’avenir des dotations non consommables, dont les bénéficiaires ne perçoivent dans un premier temps que les intérêts, mais qui doivent, en cas de succès, leur être attribuées définitivement.
Leur montant est considérable. Les dotations non consommables représentent plus de la moitié des financements attribués à la MIRES au titre du PIA. Elles se montent en effet à 11,25 milliards d’euros, réparties entre 6,69 milliards d’euros pour les Idex, dont elles constituent la quasi-totalité des dotations, 1,8 milliard d’euros pour les Labex, 1,5 milliard d’euros pour les IRT, 655 millions d’euros pour les ITE, 385 millions d’euros pour les Equipex, 183 millions d’euros pour les Instituts Carnot et enfin 40 millions d’euros pour l’Opération Campus.
Les rapporteurs ont interrogé à plusieurs reprises leurs interlocuteurs sur l’avenir de ces dotations. Il ressort des réponses obtenues que les décisions n’ont pas encore été prises. « Le travail engagé avec le CGI et la DGRI sur les dotations non consomptibles n’a pas encore abouti ; nous sommes en train de réfléchir aux critères et aux indicateurs » a ainsi exposé la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, Mme Geneviève Fioraso, lors de son audition.
Le seul élément qui semble acquis est la dévolution définitive aux Idex, en cas de succès aux évaluations de 2016, des dotations non consommables qui leur ont été affectées. Lors de l’audition de la ministre, M. David Philipona, directeur de cabinet adjoint a ainsi exposé : « Cette question renvoie au débat sur l’avenir des Labex et surtout des Equipex, dont une partie des dotations ne sont pas consomptibles. Une réflexion sera nécessaire sur les stratégies de site s’agissant des Idex et des Equipex. Les dotations non consomptibles des Idex leur seront acquises à l’issue des évaluations de 2016 ; rien n’est prévu à ce stade pour les Equipex, mais la réflexion stratégique avec le CGI nous permettra de nous pencher sur le sujet à partir de cas concrets. »
Les rapporteurs ont aussi demandé si une réflexion avait été engagée sur le maintien ou non du caractère non consommable de ces dotations (les bénéficiaires ne pouvant alors en utiliser chaque année que les intérêts) et sur la fixation de quelques règles d’utilisation, à l’instar de ce que peuvent prévoir aux États-Unis les fondations pour l’utilisation des fonds dont elles font don aux universités.
Lors de son audition, M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, avait déclaré que les dotations non consommables avaient vocation à le demeurer. Lors de l’audition du directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, l’adjoint au directeur général, M. Pierre Valla, a indiqué que : « Le modèle retenu en la matière est le financement dont bénéficient les universités américaines grâce aux fondations. Si les donateurs peuvent en l’espèce livrer des indications sur les modalités d’emploi, ils n’exercent pas de contrôle au cas par cas des décisions d’achat ou de lancement de missions. »
Par rapport à leurs homologues anglo-saxonnes, les universités françaises présentent la particularité de ne pas disposer de capital dont elles pourraient tirer des revenus pour effectuer des travaux de restructuration ou même créer des chaires. Les dotations non consommables des Idex sont donc un élément stratégique pour la stabilisation de celles-ci. En conséquence, la plus grande attention doit être portée aux règles de dévolution des dotations non consommables qui seront transférées aux Idex, de façon à ce qu’elles puissent servir durablement de support à leur développement.
C. TRAITER LES DÉSÉQUILIBRES FINANCIERS
1. Des financements de projets seulement partiels
Une autre difficulté soulevée par les interlocuteurs de la Mission d’évaluation et de contrôle a été celle de la quantité en réalité insuffisante des financements par les PIA des projets, Labex ou Equipex, sélectionnés à ce titre. Le financement nécessaire pour faire fonctionner un Labex ou un Equipex est toujours supérieur au financement qui peut être obtenu à la suite de la présentation et de la validation du dossier. Dans ces conditions, un projet lauréat du programme d’investissements d’avenir génère des coûts de structure pour l’établissement au sein duquel il est inséré. C’est notamment l’analyse du président de l’université de Strasbourg, Monsieur Alain Beretz.
Lors de son audition, le directeur général de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, M. Roger Genet a bien volontiers confirmé cette analyse, s’agissant des Equipex : « les fonds apportés ne couvrent pas l’intégralité des besoins, laissant à la charge des budgets de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) et des opérateurs une dépense de fonctionnement importante. »
a. Un effet de levier pas toujours opérant qui imposera des revues de programmes
Cette situation a deux origines. La première a été exposée par M. Roger Genet : « L’idée initiale du PIA était bien d’orienter les budgets de base grâce à l’effet de levier généré. Mais la question est de savoir si nos établissements, eu égard à leurs budgets, sont capables de suivre : ils doivent tenir compte de leurs contraintes de gestion ! » La notion d’effet de levier est en effet omniprésente dans le PIA. Simplement, si, on le verra plus loin, l’effet de levier a pu jouer pleinement en matière de recherche industrielle, où les co-investisseurs anticipaient un retour sur leur investissement du fait de l’avantage donné sur la concurrence par un produit innovant, en matière de recherche académique, les seuls crédits disponibles pour faire fonctionner l’effet de levier sont les crédits budgétaires du ministère, dont les rapports spéciaux sur les projets de lois de finances montrent chaque année toutes les limites. Dans ces conditions, les crédits qui devaient servir de leviers… ont souvent été les seuls crédits disponibles.
Sur ce point, il paraît indispensable qu’une revue des programmes financièrement les plus fragiles soit opérée, de façon à ce qu’ils puissent être développés dans la durée par les équipes chargées de les conduire compte tenu des financements disponibles. Comme l’a indiqué M. Roger Genet : « Si les programmes sélectionnés sont d’un très bon niveau et suivent les recommandations du rapport Juppé-Rocard, notre ministère appelle, afin d’assurer leur pérennité, à une meilleure définition des axes stratégiques, permettant de les réorienter de manière à ce qu’ils soient mieux réappropriés par les acteurs de la recherche, qui devront les financer sur le moyen et le long terme et les intégrer dans leurs politiques et leurs contrats d’objectifs et de performance (COP). »
b. Un taux de prise en charge des coûts indirects à accroître
La deuxième cause de cette situation tient aux particularités de la prise en compte des coûts indirects dans le financement de la recherche sur projet en France. Héberger un laboratoire lauréat d’un projet coûte à la structure qui l’héberge : en frais de gestion, en frais d’accueil des contractuels recrutés au titre du projet, etc. C’est ce qu’on appelle les coûts indirects.
Comme l’a exposé le président du CNRS, M. Alain Fuchs, lors de son audition, ces coûts indirects sont « ce qu’on appelle dans tous les pays overheads – frais généraux – et qu’on a traduit en France par préciput, ce terme ayant vocation à désigner en quelque sorte des overheads à la française, c’est-à-dire des overheads de bien moindre montant qu’à l’étranger. » Alors que « certaines universités privées américaines pratiquent des taux d’overheads allant jusqu’à 50 % », ce taux, pour les projets financés par l’ANR, est de 15 %, soit 4 % de frais de gestion et 11 % de préciput, autrement dit de couverture de charges pour l’établissement hébergeur.
Or, sans aller jusqu’aux taux américains, les coûts indirects sont estimés en moyenne, selon M. Roger Genet, « à un montant compris entre 25 % et 35 % des coûts directs ».
On peut donc considérer que près de la moitié des coûts indirects des projets lauréats de l’Agence nationale de la Recherche hors PIA – soit 10 % à 15 % du coût de chaque projet – doivent être financés par les établissements hébergeurs.
Au titre des investissements d’avenir seuls 4 % de frais de gestion étaient prévus pour les projets financés, les autres coûts devant être justifiés. M. Roger Genet a indiqué que : « La ministre a souhaité qu’ils soient portés à 8 %. Le CGI a accepté, mais cela ne concerne que les Idex et les Labex : pour les Equipex, l’investissement étant directement gagé sur des infrastructures, on ne pouvait augmenter les coûts de gestion. »
Le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a développé ce point : « La question est difficile. Selon le CGI, le raisonnement ne peut être identique pour tous les outils. La notion de préciput ne peut se calculer de manière identique pour un Equipex, un équipement lourd qui sera acheté par une structure, et un Labex, au sein duquel seront embauchés des doctorants ou des post-doc, dont la présence va entraîner la consommation de fluides – eau, électricité – ou encore de consommables. C’est plutôt dans ce cas que la notion de préciput a un sens ». Cette différenciation a été l’un des éléments sur lesquels le CGI s’est appuyé pour refuser la mise en place de préciputs, les calculs étant, selon lui, trop compliqués. Il reste que certains coûts indirects sont incontestables. Ainsi, l’augmentation du nombre de contrats à durée déterminée (CDD) provoquée par le succès à des appels à projet conduit les établissements à régler des frais proportionnels au nombre de contractuels pour couvrir l’assurance chômage, ce qui constitue des charges supplémentaires non couvertes.
M. Alain Fuchs est donc fondé à conclure que, même si « elle doit être traitée outil par outil, voire au cas par cas », « la question du préciput au sein du PIA se pose ».
Dans ces conditions, le PIA a donc bien un effet d’exclusion de la recherche hors PIA, puisqu’une partie des crédits des opérateurs qui pourraient être consacrée par ceux-ci à de la recherche propre doit être utilisée en soutien aux projets conduits au titre du PIA.
Pour remédier à cette situation, qui, si elle dépasse le seul PIA, le concerne cependant directement, deux voies sont possibles : l’accroissement du volume des coûts indirects pris en charge, mais aussi le calcul des projets à coûts complets.
Désormais, à l’initiative de la France, a exposé M. Roger Genet, pour un laboratoire public lauréat d’un de ses projets, « l’Europe paie 100 % des coûts directs et 25 % en plus forfaitairement au titre des coûts indirects (overheads). »
Il n’y a pas de raison qu’ayant défendu cette position au niveau européen, la France ne fasse pas de même au niveau national. De fait M. Roger Genet a considéré qu’il faudrait « que l’on puisse couvrir au moins l’équivalent de 25 % des coûts directs. »
On pourrait penser que ce type de solution devrait également valoir, sauf exception, pour les projets relevant du PIA, tels que les Labex. Il reste que la position du CGI a été réaffirmée par le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer lors de son audition par la Commission des finances le 14 janvier 2015 : « Nous finançons, au sein des universités, des laboratoires et des équipements. Toutefois, une part des crédits, nommée le préciput, qui a été portée de 4 % à 8 %, est destinée au financement des frais d’accompagnement engagés par l’établissement. Ce taux est parfois considéré comme insuffisant par les établissements de recherche, mais il faut bien voir que si l’on augmente le préciput, on diminue d’autant les crédits alloués au laboratoire et aux chercheurs. Pour le moment, le chiffre de 8 % nous paraît adéquat. »
c. Aller vers le financement des projets à coût complet
L’autre piste est celle du financement des projets à coûts complets.
Si les interlocuteurs de la Mission d’évaluation et de contrôle se sont tous déclarés favorables à cette solution, ils ont aussi exposé que l’équipement comptable des opérateurs, et encore plus des universités, était l’obstacle qui s’y opposait aujourd’hui.
Ainsi, a déclaré M. Alain Fuchs : « la situation idéale à la fois pour le calcul du coût du projet et pour des raisons de comptabilité pratique serait évidemment de travailler à coûts complets » ; mais, a-t-il poursuivi : « Je crois que la difficulté est que l’effort à produire est extrêmement important, en énergie comme en moyens financiers. »
Le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, a été encore plus clair : « Je rappelle que la France est en retard en matière de coûts complets. Nous devons avoir une vision d’ensemble de ceux-ci pour toutes nos opérations, et ce même si les financements ne couvrent pas la totalité de leurs coûts. Nous demandons depuis longtemps à nos opérateurs d’être capables d’établir leurs coûts complets. »
Ce retard, a-t-il poursuivi, « tient à nos outils de gestion. Certes les systèmes de gestion des universités, qui étaient en retard, progressent. Mais, pour autant, aujourd’hui, les grands établissements de recherche ne disposent pas tous d’une comptabilité analytique. Il faudrait arriver à ce que ce soit le cas. Cette « vérité des prix » permettrait un meilleur équilibre de nos financements. »
Les rapporteurs considèrent que doter les universités et les organismes de recherche d’une capacité à calculer les coûts complets d’un projet est un axe d’action essentiel. On peut même se demander s’il ne devrait pas s’agir là d’une priorité d’action pour les Idex.
2. Des financements dont la pérennité n’est pas assurée
a. Le financement des équipements
Une autre difficulté concerne la pérennité des équipements et des actions financés par le PIA.
La première préoccupation concerne le renouvellement des équipements. « Les équipements d’excellence (Equipex), a indiqué le président général de l’Inserm, M. Yves Lévy, ont représenté un apport fondamental pour la biologie-santé. Ils permettent des avancées technologiques des laboratoires et des plateformes ; ce sont de très lourds investissements en matériel (…) qui sont ainsi financés. « Cependant tous les 3 à 5 ans, de tels matériels demandent un renouvellement ou une jouvence. La question du financement du renouvellement de ces Equipex, et donc de la pérennité de ces équipements, va donc se poser. Si le problème a été identifié, il n’est pas réglé aujourd’hui. »
Et M. Roger Genet de préciser que : « Il sera difficile, dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, de dégager sur les budgets de base de la MIRES les moyens de garantir la pérennité de ces infrastructures. »
La pérennité des actions peut être aussi en cause. Le directeur général de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, M. Roger Genet, a ainsi fait remarquer que : « Les financements apportés par le PIA ne couvrent pas non plus toujours la durée de vie du projet financé. Ainsi, le PIA n’a apporté de financement que sur 5 ans à certaines cohortes qui supposent un suivi longitudinal sur 30 ans. »
Ces cohortes – une dizaine –, qui ont pu être mises en place grâce au financement du PIA, permettent de générer des données à très grande échelle, soit de personnes en bonne santé, soit de pathologies particulières. Porteuses d’un fort potentiel d’innovation car elles représentent une valeur supplémentaire par rapport aux essais cliniques, elles présentent une forte attractivité industrielle : les industriels sont intéressés par les données générées.
Pour assurer la pérennité des cohortes, ainsi que celle des bio-banques qui leur sont associées, l’Inserm a entrepris d’organiser des actions permettant l’implication de l’industrie dans leur financement. Il reste que si, selon M. Yves Lévy, « la première initiative lancée a été un succès du fait de l’implication de l’industrie et de l’intérêt qu’elle y a porté », « le modèle n’est pas réglé sur le long terme.
Ces exemples montrent la nécessité d’une meilleure complémentarité entre la politique à long terme menée au travers du financement de la MIRES et les incitations portées par le PIA. Comme l’expose M. Roger Genet, « les financements supplémentaires ne doivent pas être un facteur de déstructuration. »
Le caractère limité des crédits de la MIRES doit donc amener à tenir compte de l’état d’avancement – ou de difficulté – des projets du PIA 1 pour l’attribution des fonds du PIA 2. Il ne faudrait pas que des projets prometteurs mais en difficulté de financement s’arrêtent avec la fin du PIA 1. Il faudra tenir compte du retour d’expérience du PIA 1 pour que le PIA 2 soit vraiment un outil de renforcement de la structuration, notamment, de ce qui a déjà été financé dans le cadre du PIA 1.
b. Les recrutements sur contrat pour la conduite des projets
Une troisième difficulté tient aux personnels contractuels recrutés pour la réalisation de projets financés par le PIA. Les financements ne sont accordés que pour une durée de 10 ans. Par ailleurs le renouvellement des personnels est limité par le droit du travail pour les fondations de coopération scientifique et par la loi dite Sauvadet pour le secteur public.
Cette situation pose une double difficulté. La première concerne le devenir et la situation de ces contractuels associés au PIA et qui, dans certains cas, devront, eu égard à leur statut, partir au bout de quatre ou six ans du fait des dispositions de la loi Sauvadet. La deuxième concerne l’avenir des projets eux-mêmes. Comme le président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy, l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle : « Ces personnels sont des personnels-clés pour les projets auxquels ils participent, du fait de l’expertise scientifique acquise. Souvent, ils ont été indispensables pour le démarrage et la conduite des projets, dans la réalisation desquels ils sont donc complètement impliqués. » Les porteurs de projets « ont une inquiétude légitime sur la mise en danger de leurs projets qui pourrait être causée par la perte d’expérience et d’expertise consécutive au départ des personnels qui les ont accompagnés. »
Selon M. Yves Lévy, en 2013, les contrats à durée déterminée liés aux projets du PIA et gérés directement par l’Inserm représentaient 113 personnes, soit 5 % des 2 113 personnes en CDD à l’Inserm.
« Une réflexion doit avoir lieu à l’Inserm sur la vague d’emplois contractuels liée au PIA, a conclu M. Yves Lévy. Cette réflexion doit s’inscrire dans un cadre beaucoup plus large, légal et réglementaire, et impliquer les autres partenaires – le Commissariat général à l’investissement et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
Les rapporteurs considèrent que cette réflexion ne doit pas avoir lieu seulement à l’Inserm. La problématique va se poser dans l’ensemble des grands organismes de recherche. Elle devra être mise en lien avec l’évolution des départs à la retraite, dont le nombre, particulièrement faible pour les prochaines années, devrait cependant s’accroître à partir de 2020.
D. MIEUX METTRE EN COHÉRENCE PIA ET POLITIQUE DE LA RECHERCHE
1. Le PIA 1 : des effets d’exclusion de certains projets de recherche
a. Des projets stratégiques sans financements
Les auditions auxquelles ont procédé les rapporteurs montrent enfin que la pression du PIA sur les recherches non financées par ce moyen ne se limite pas aux montants nécessaires pour couvrir l’insuffisante prise en charge des coûts indirects.
Lors de son audition, le directeur général de l’énergie et du climat, M. Laurent Michel, a fait remarquer que « le PIA a pris une importance volumique qui n’était pas prévue » et que « certains domaines, sans le PIA, se trouveraient dans une impasse ». Mais dès lors que, toujours selon ses propos, le PIA « n’a pas « arrosé » de façon uniforme tous les domaines de recherche », on peut se demander si l’importance volumique du PIA n’a pas justement mis certains domaines dans une impasse.
De fait, le directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère chargé de la recherche, M. Roger Genet, a présenté deux de ces domaines.
Le premier est celui de la spallation nucléaire (production de neutrons à partir d’un accélérateur de particules et d’une cible) : « Nous avons un accord avec une nouvelle organisation internationale en Suède destiné à gérer le programme ESS – European Spallation Source – dont le budget global d’investissement est de 1,843 milliard d’euros, a-t-il exposé. La part de la France, qui représente 8 % du budget de construction, ne peut être couverte par la subvention : celle-ci permet seulement aujourd’hui d’assurer la phase d’exploitation qui sera financée par nos opérateurs. »
Le deuxième est celui de l’océanographie : « La France est dotée d’un outil, étroitement lié à notre industrie – et très utilisé par nos industriels –, dont peu de pays européens disposent : notre flotte océanographique, qui a été un des fleurons de notre recherche. Cet outil nécessite un budget de 600 millions d’euros, amortissable sur 30 ans. Cela signifie que, pour pérenniser cette flotte, il nous faudrait être en mesure de provisionner 20 millions d’euros par an pour assurer le renouvellement et la jouvence de ses bâtiments. Le financement de la flotte s’est toujours effectué par abondement exceptionnel des crédits de la MIRES. Aujourd’hui, ces financements exceptionnels passent entièrement dans le PIA, et pas par les programmes budgétaires. »
Autrement dit, la combinaison d’un processus de sélection par le PIA d’appels à projet lancés selon la méthode « bottom-up » à partir des propositions des laboratoires et du fait que, toujours selon M. Genet, « le financement récurrent de la MIRES permet d’assurer le fonctionnement, mais non les investissements des grandes infrastructures de recherche » aboutit à priver de financement des équipements d’une durée de vie de quinze à vingt ans pourtant considérés comme structurants par le ministère chargé de la recherche.
Le PIA a donc bien un effet, a priori imprévu, de réorientation des axes de la recherche en France, en faisant oublier le financement d’équipements financés formellement sur des crédits budgétaires annuels mais en réalité assuré par des dotations exceptionnelles accordées sur demande du ministère chargé de la recherche et après arbitrage interministériel.
Cette situation pose dès lors la question des modalités de définition des stratégies en matière de recherche.
Le Commissariat général à l’investissement a été créé pour identifier des investissements d’avenir finançables par l’emprunt parce que productifs d’autant, voire de plus, de revenus que le montant des intérêts versés pour le service de cet emprunt. La procédure mise en place pour financer ces investissements d’avenir est totalement dérogatoire à la procédure budgétaire annuelle. Le caractère stratégique du PIA comme les procédures financières spécifiques qui s’y appliquent non seulement justifient mais imposent que le Commissariat général à l’investissement soit placé auprès du Premier ministre.
Cependant, le programme d’investissement d’avenir a bien été institué pour financer des projets de recherche définis en supplément de la politique de recherche conduite avec les moyens budgétaires, et non pour la réorienter en profondeur. Pour reprendre les propos tenus par Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, lors de son audition : « Le PIA n’a pas vocation à restructurer le paysage de la recherche : il accompagne, dans ses domaines d’intervention, des politiques publiques nationales et territoriales. »
Le risque d’une réorientation de fait a été perçu jusqu’au sein du Commissariat général à l’investissement lui-même. Lors de l’audition de M. Louis Gallois, M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire au Commissariat général à l’investissement, a rappelé que « une fois le PIA 2 entré en régime de croisière, en 2014 ou 2015 par exemple, les moyens de l’ANR issus du PIA représenteront probablement plus des deux tiers des moyens répartis par l’ANR une année donnée. » ; autrement dit, les deux tiers des crédits destinés à la recherche sur projet auront pour origine les dotations du PIA.
2. Développer la coordination interministérielle
a. Mettre en place un dialogue suivi
Dans ces conditions, M. Jean-Pierre Korolitski a lui-même reconnu la nécessité d’une meilleure écoute des acteurs de la recherche par le Commissariat général à l’investissement en amont des décisions de financement des projets : « Lors du lancement du PIA 1 (…) il s’agissait de donner aux meilleures équipes françaises des moyens supplémentaires pour être à armes égales dans la compétition internationale, et donc de faire sortir ces équipes pour toutes les thématiques, sans limitation. C’est aujourd’hui que se posent des problèmes prégnants de programmation thématique. (…) En prévision du nouvel appel à projets pour Equipex qui sera lancé en 2015, la loi de finances prévoit tout au long de l’année 2014 une concertation en amont, notamment avec les alliances, afin de définir les thématiques sur lesquelles il convient désormais de mettre l’accent. » Et M. Korolitski de poursuivre : « Ce travail est d’autant plus important que devraient être publiées en 2014 les priorités de la stratégie nationale de recherche. »
Dans la mesure où elle amène à prendre en compte l’expression des opérateurs de la recherche, l’intégration des alliances de recherche dans la détermination des projets de recherche à financer à travers les crédits du PIA ne peut aller que dans le sens d’une meilleure cohérence du financement de la recherche. Elle n’en laisse pas moins à l’écart les financeurs récurrents de ces opérateurs, autrement dit les ministères dont relèvent les dotations budgétaires qui composent les crédits de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », auxquels – dans la mesure où le PIA finance également des actions dans ce domaine – il faut ajouter le ministère chargé de la santé.
Or, c’est avec ces ministères que les opérateurs de la recherche, comme le CEA ou l’Inserm, négocient et signent leurs contrats d’objectifs. Dès lors si l’on veut établir une cohérence entre les politiques scientifiques, ce que l’on inscrit dans les contrats d’objectifs des opérateurs et les financements, on voit mal comment les ministères financeurs de la recherche et assurant la tutelle des grands organismes de recherche pourraient être tenus à l’écart des décisions de financement de la recherche au titre du PIA. Comme M. Roger Genet l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle, « il nous faut avoir des discussions interministérielles étroites pour éviter des politiques séparées. » Ou encore : « Il faut donc une meilleure complémentarité entre la politique à long terme menée au travers du financement de la MIRES et les incitations portées par le PIA. Les financements supplémentaires ne doivent pas être un facteur de déstructuration. » Or, « jusqu’à présent, il n’y a pas eu de discussions d’ensemble sur les priorités stratégiques en matière de recherche. »
Lors de son audition, la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, Mme Geneviève Fioraso, a carrément lié l’efficacité de la procédure des PIA à l’inscription du PIA dans la même stratégie de recherche que celle de la dévolution des crédits budgétaires : « Le PIA et l’enseignement supérieur et la recherche doivent s’inscrire dans une même stratégie. C’est nécessaire pour que les actions du PIA soient efficaces et qu’elles servent à faire évoluer le système de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est nécessaire pour que ce dernier soit stimulé, qu’il apporte toute sa compétence et qu’il renouvelle l’innovation. Par exemple, sans financement par les crédits récurrents, il n’y aura pas de renouvellement de la recherche technologique, clinique ou translationnelle dans le domaine de la santé. »
Le caractère très spécifique des crédits du PIA et des procédures de leur gestion, l’existence même du Commissariat général à l'investissement, doivent donner les garanties qu’une stratégie intégrant l’affectation des crédits du PIA soit définie à l’échelon interministériel.
Lors de son audition, la secrétaire d’État a souligné les progrès effectués dans le sens d’une meilleure concertation entre le Commissariat général à l’investissement et le ministère chargé de la recherche : « Lors de mon arrivée, en 2012, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas suffisamment d’interactions entre le CGI et les services des ministères. Cette situation pouvait même susciter des difficultés entre les services des différents ministères, les acteurs de l’enseignement supérieur de la recherche et le CGI. (…)
« Depuis deux ans, nous avons tout fait pour parvenir à un fonctionnement intégré au lieu de fonctionnements parallèles. (…)
« Le dialogue entre le CGI et les ministères, et d’abord le secrétariat d’État que je dirige, s’est nettement amélioré. »
Elle a aussi donné à la Mission d’évaluation et de contrôle quelques exemples des premiers résultats de ce dialogue : « Il y avait une marche forcée vers les procédures uniques, et un monolithisme intellectuel incompatible avec la dynamique plurielle des écosystèmes. Le cahier des charges du PIA 2 a donc été conçu différemment ; le secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche a été davantage associé à sa rédaction, et la mise en œuvre des I-SITE permet une meilleure irrigation territoriale ».
« Nous avons demandé au CGI de s’adjoindre les compétences d’un président d’université pour décider sur les Idex et les I-SITE. Nous en sommes à un stade de négociations avancées » et, a-t-elle ajouté, « cette audition va peut-être permettre de concrétiser cette demande. »
c. Créer un outil interministériel spécifique ?
Une telle concertation interministérielle paraît d’autant plus justifiée que, en application de la loi du 22 juillet 2013, a été élaborée cette année une « stratégie nationale de la recherche ».
Aux fins de coordonner son élaboration, la direction générale de la recherche et de l’innovation a mis en place un comité opérationnel, qui réunit, d’un côté, les directeurs d’administration centrale des huit ministères porteurs de politiques de recherche – dont notamment ceux de la défense, de la santé, de l’agriculture, de l’écologie et de la culture –, le commissariat général à l’investissement (CGI), le commissariat général à la stratégie et à la prospective, la délégation à l’intelligence économique, et, de l’autre, les présidents d’alliances, le président de la Conférence des présidents d’université, celui de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, le CNRS, le CEA, l’ANR, le CNES, deux représentants des pôles de compétitivité et deux représentants des industriels.
Ainsi, a été créé, toujours selon M. Genet, « un outil de dialogue entre les attentes en matière de politique de recherche et les opérateurs de recherche qui permette au ministère chargé de la recherche non pas d’imposer sa vision, mais de coordonner l’action des acteurs de la recherche de façon à ce que la France ait non pas plusieurs mais une politique de recherche, qui réponde aux attentes de l’ensemble des acteurs publics. »
Un tel outil a déjà des équivalents à l’étranger. Ainsi le CSTP japonais réunit tous les mois autour du Premier ministre les ministres en charge de l’industrie, de l’éducation et de la recherche, « ce qui permet, selon M. Roger Genet, une véritable approche interministérielle, absolument nécessaire, du financement de la recherche. »
Un tel outil apparaît comme indispensable pour éviter à la fois les doublons et les impasses en matière de choix stratégiques et de financements de la recherche.
De façon générale, pour les rapporteurs, aussi bien l’organisation de la recherche que la réalité des crédits budgétaires de la MIRES et les premiers bilans de la mise en œuvre du PIA justifient une plus grande interministérialité, les spécificités de la conduite du PIA n’étant pas touchées puisque l’arbitrage reviendra toujours au Premier ministre.
TROISIÈME PARTIE : LA VALORISATION DE LA RECHERCHE
I. LE DISPOSITIF DE VALORISATION
M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, l’a expliqué à la MEC lors de son audition, « l’une des tâches essentielles des programmes d’investissements d’avenir est d’assurer le flux qui va de la recherche à la mise sur le marché et d’éviter qu’il y ait des « vallées de la mort ». En particulier, ce flux s’arrête s’il n’y a pas de valorisation après la publication. »
Eu égard à la faiblesse française dans ce domaine, le dispositif mis en place est très complet. 4,5 milliards d’euros y sont consacrés par le PIA.
A. LA CHAÎNE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
L’action « Fonds national de valorisation » est l’épine dorsale du dispositif. Elle a été dotée de 950 millions d’euros, dont 900 millions pour 14 sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) et 50 millions pour 6 consortiums de valorisation thématique (CVT). Selon M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT et président de la SATT Sud-Est, c’est là « une somme sans équivalent dans le monde pour un dispositif de maturation. Aujourd’hui, les tech transfer offices étrangers nous envient les sociétés d’accélération du transfert de technologies. »
● Selon la convention du 29 juillet 2010, les SATT ont « vocation à regrouper l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et la valeur économique créée. Elles devront conduire à une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et renforcer les compétences. »
Toujours selon les termes de la convention, l’activité principale des SATT est consacrée au financement des phases de maturation des inventions. Il s’agit de remédier au problème récurrent, et non spécifiquement français, de la « vallée de la mort », c’est-à-dire du comblement de l’écart entre le résultat de la recherche juste issu du laboratoire et le produit qu’attend l’entreprise pour investir. En sortie de maturation, les SATT peuvent participer à l’incubation et à la création de sociétés, mais seulement par des apports en nature, et jamais en numéraire.
La convention prévoit une deuxième activité, consacrée à la prestation de services de valorisation auprès des acteurs locaux de la recherche et développement ; cette activité inclut la détection et la gestion de la propriété intellectuelle.
Pendant la phase d’appel à projets, il a été précisé que les SATT devaient tirer leurs revenus de la vente de prestations et d’une partie des revenus de licence générés par leurs activités, dont notamment leurs activités de maturation. Les porteurs devaient présenter un projet atteignant l’équilibre financier à horizon de 10 ans, lorsque les financements de l’État au titre du PIA s’arrêteront.
Les SATT sont constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées.
Chaque SATT est dotée au départ d’un capital d’un million d’euros, dont l’État apporte un tiers par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, le reste étant réparti entre les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)
– aujourd’hui, de plus en plus, les communautés d’universités et d’établissements (COMUE) – et les grands organismes de recherche.
Le conseil d’administration reflète le plus fidèlement possible l’actionnariat de la SATT. L’État jouit d’un droit de veto sur les décisions.
À la dotation en capital de départ s’ajoutent des dotations ultérieures en compte courant. Le montant de celles-ci est calculé en fonction du potentiel de recherche du territoire sur lequel la SATT est implantée – mesuré en dépense intérieure de recherche et développement des administrations (DIRDA) ou de dépense intérieure en recherche et développement des entreprises (DIRDE) –, mais aussi en fonction du succès des brevets déposés sur ce territoire.
Les dotations en compte courant varient de 30 à 70 millions d’euros sur dix ans. Tous les trois ans, une nouvelle tranche est versée, à l’issue d’une revue vérifiant la satisfaction de critères de poursuite de l’activité (go-no go). Les cinq premières SATT créées en décembre 2012 (Conectus, Sud-Est, Ile-de-France, Lutech et Toulouse) ont ainsi reçu un total de 104 millions d’euros de dotations nouvelles après une évaluation positive conduite fin 2014.
● Aux termes de la convention du 29 juillet 2010, les consortiums de valorisation thématiques (CVT) doivent proposer « des services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de valorisation de site sur des thématiques données ». Ils doivent être portés par des organismes publics nationaux de recherche, par leurs filiales de valorisation ou par une alliance.
● Pour prolonger l’action des SATT en aval, une action France Brevets a prévu la création et le financement d’une société par actions simplifiée du même nom.
France Brevets a vocation à acquérir des droits sur les brevets et les autres titres de propriété intellectuelle issus de la recherche publique et privée, à les regrouper en grappes technologiques et à les licencier, à des conditions de marché, auprès des entreprises.
Le capital de France Brevets est actuellement de 50 millions d’euros. Le financement est opéré par son actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, qui intervient à 50 % pour son propre compte et à 50 % pour le compte de l’État, soit pour 25 millions d’euros chacun à la fin de 2014. Il est prévu que le capital de France Brevets atteigne 100 millions d’euros, ce qui explique le fait que la dotation initiale de la SAS prévue au titre du PIA soit de 50 millions d’euros.
A. LES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
À cette chaîne de valorisation s’ajoutent trois types d’instituts.
● Les « Instituts de recherche technologique » (IRT) ont pour objectif, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales, de constituer un nombre restreint de campus d’innovation technologique de dimension mondiale. Ils regroupent sur un même site des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée, publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle et enfin des acteurs industriels.
Les IRT sont au nombre de 8.
Alors que les dotations des structures de la chaîne de valorisation sont exclusivement constituées de dotations consommables, le financement des IRT, de 1 971 millions d’euros, se répartit entre 471 millions d’euros de dotations consommables et 1,5 milliard d’euros de dotations non consommables. On retrouve ainsi le mode de fonctionnement des Idex, dont les IRT sont en quelque sorte le pendant technologique.
● Le PIA a attribué aux « Instituts Carnot », organismes de recherche technologique qui lui préexistaient, une dotation initiale de 500 millions d’euros. Il s’agit de renforcer de façon pérenne leurs ressources financières et de leur permettre de développer des actions de recherche contractuelles avec les TPE, PME et ETI et de porter leur recherche partenariale au niveau des meilleurs standards internationaux notamment grâce au développement de leurs relations avec des organisations de recherche et des universités étrangères, en particulier européennes, menant des activités de recherche technologique. Les Instituts Carnot sont au nombre de 33.
● Enfin, l’action « Instituts de transition énergétique » (ITE) initialement dénommée « Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées » (IEED) consiste à créer un nombre restreint d’instituts au sein de campus d’innovation technologique de taille mondiale regroupant des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, le cas échéant des moyens de prototypage et de démonstration industrielle, et enfin des acteurs économiques, de façon à renforcer les écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité.
Le PIA a prévu 1 milliard d’euros de crédits pour les ITE. Là aussi, ces crédits se ventilent en dotations consommables et non consommables. Les 876 millions d’euros actuellement attribués se répartissent entre 12 ITE, à raison de 221,4 millions d’euros de dotations consommables et 655 millions d’euros de dotations non consommables.
Il faut aussi noter que l’action ITE ne fait pas partie du programme « pôles d’excellence », mais d’un programme spécifique.
A. LA MISE EN œUVRE FINANCIÈRE DE LA VALORISATION
L’opérateur de chacune de ces actions et sous-actions, ITE compris, est l’Agence nationale de la recherche.
La situation des dotations aux actions de valorisation au 31 juillet 2014 est retracée dans le tableau ci-dessous. Les fonds étant débloqués par étapes, l’écart entre dotation contractualisée et dotation décaissée n’est pas forcément – même si ce peut être le cas – le signe de difficultés dans la mise en œuvre des actions. Ainsi, il faut ajouter désormais aux dotations décaissées en faveur des SATT les 104 millions d’euros récemment attribués.
CRÉDITS CONSACRÉS À LA VALORISATION DE LA RECHERCHE AU 31 JUILLET 2014
(en millions d’euros)
Dotation | ||||
initiale |
attribuée |
contractualisée |
décaissée | |
Fonds national de valorisation (1) dont SATT dont CVT |
950 900 50 |
905,4 856 49,4 |
905,4 856 49,4 |
248,05 240,1 7,95 |
France Brevets(1) |
50 |
50 |
25 |
25 |
Instituts de recherche technologique (IRT) dont DC dont DNC |
2 000 |
1 971 471 1 500 |
1 971 471 1 500 |
166 |
Instituts Carnot dont DC dont DNC |
500 |
203,7 22,1 181,6 |
188,7 7,1 181,6 |
22 |
Instituts de transition énergétique (ITE) (ex-IEED) dont DC dont DNC |
1 000 |
876,4 221,4 655 |
876,4 221,4 655 |
40,3 |
Total |
4 500 |
3 956,5 |
3 941,5 |
476,35 |
(1) Dotations consommables exclusivement.
DC : dotation consommable
DNC : dotation non consommable
Source : Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir, annexé au projet de loi de finances pour 2015 (« jaune »).
II. LES SOCIÉTÉS D’ACCÉLÉRATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
Tant au regard des dotations qui y sont consacrées qu’à la nouveauté qu’elles représentent, les SATT constituent le cœur du nouveau dispositif de valorisation.
A. UN OUTIL DÉFINI COMME STRATÉGIQUE
1. La valorisation de la recherche : un dispositif lacunaire
La création des SATT est née de la constatation des lacunes françaises en matière de valorisation de la recherche. Comme M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, l’a exposé à la mission d’évaluation et de contrôle : « Les SATT comblent une lacune béante en matière de valorisation. »
Cette situation a une double origine, d’une part les réflexes de l’industrie, dont la culture est moins celle des chercheurs – les docteurs y sont beaucoup moins nombreux qu’en Allemagne, par exemple – que celle des ingénieurs, et de l’autre l’attitude des chercheurs eux-mêmes, historiquement peu soucieux de la valorisation financière de leurs recherches. Comme l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de France Brevets, « le portefeuille de brevets d’une équipe de recherche française n’est pas toujours en rapport avec son expertise. Aux États-Unis, quand un chercheur a un soupçon d’idée, il dépose dix brevets alors qu’en France il faut que dix chercheurs aient une petite idée pour voir déposer un brevet. » Cette approche a eu aussi pour conséquence le très faible développement, au sein des universités et des laboratoires, de structures dédiées à la valorisation des travaux des chercheurs.
La création des SATT vise à remédier à cette situation. Mme Pascale Briand, alors directrice générale de l’ANR, l’a exposé lors de son audition : « La constitution de sociétés d’accélération du transfert technologique (SATT) apporte la concentration et la mutualisation nécessaires au développement des stratégies de valorisation de la recherche des universités ou des grands établissements de recherche. »
1. Les SATT : des structures de proximité au développement rapide
Les SATT se sont rapidement développées puisque, selon le « jaune » annexé au projet de loi de finances pour 2015, en mai 2014, elles employaient déjà 358 personnes spécialisées en propriété intellectuelle, en ingénierie de projets technologiques, en droit, marketing et développement commercial – chaque SATT emploie quelques dizaines de salariés permanents – et pouvaient faire état de 2 300 projets détectés et analysés, 372 brevets prioritaires déposés, 48 millions d’euros d’investissement en projets de maturation, 86 licences signées et 22 start-up créées. Fin 2014, ces chiffres seraient passés à 2 900 projets, 540 brevets, 140 licences et 40 start-up.
Selon M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT et président de la SATT Sud-Est, « grâce à la mutualisation des moyens, mais aussi à la mise en place d’interlocuteurs uniques, les SATT ont simplifié le paysage de la valorisation : cent cinquante établissements de recherche, dont la très grande majorité des universités, ont confié l’exclusivité de leur transfert de technologie aux douze sociétés d’accélération du transfert de technologies. ».
« Les sociétés d’accélération du transfert de technologies, poursuit Mme Maylis Chusseau, présidente de la SATT Aquitaine Sciences Transfert, sont la structure de valorisation des laboratoires d’excellence (Labex) et des équipements d’excellence (Equipex) et s’articulent avec les Idex, qui font partie de leurs actionnaires. Grâce aux collaborations et aux partenariats avec ces acteurs dans leur territoire, les SATT protègent le patrimoine intellectuel issu du programme d’investissements d’avenir »
Les SATT ont également établi des coopérations avec les instituts hospitalo-universitaires (IHU), les consortiums de valorisation thématiques (CVT), les instituts de recherche technologique, les instituts de transition énergétiques (ITE) et les instituts Carnot, pour des prestations de services, des actions de valorisation, des investissements en commun ou la location de moyens scientifiques.
« Si, poursuit M. Olivier Fréneaux, la confiance a mis du temps à s’instaurer, pour les cinq premières sociétés créées – et bientôt pour les douze premières – toutes les conventions entre les actionnaires et les sociétés sont désormais signées, les procédures établies et les comités d’investissement, comités indépendants qui rendent un avis consultatif sur l’ensemble des projets financés, constitués. Le lancement est donc terminé. »
Les SATT se sont ainsi insérées dans l’écosystème dans lequel elles baignaient, a expliqué M. Vincent Lamande, président de la SATT Ouest Valorisation : « Il va de soi, en effet, que le transfert de technologies, qui débouche sur la création d’entreprises, n’est possible qu’en partenariat avec les technopoles, les incubateurs et les investisseurs en capital-risque – la SATT Ouest Valorisation a ainsi signé une convention avec le fonds Grand Ouest Capital Amorçage. L’insertion se traduit aussi dans l’organisation concrète : les structures de l’écosystème siègent dans les SATT, notamment au sein des comités d’investissement où elles accompagnent nos laboratoires partenaires dans la conduite de projets de transferts de technologies ou de création d’entreprises. »
« En moins de deux ans, a souligné le directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère chargé de la recherche, M. Roger Genet, le modèle économique des SATT est en train de se formaliser. La dynamique a donc été très forte ».
L’insertion des SATT a du reste été si réussie que les régions, entités oubliées du modèle original, ont souhaité disposer d’un poste d’observateur dans leur conseil d’administration. À Conectus Alsace, un siège d’administrateur de plein exercice est même réservé à la Région.
À ce propos, M. Roger Genet, évoquant la probable nécessité de rapprocher plus encore les SATT des incubateurs (une étude pilote fait apparaître que tel est notamment le souhait des acteurs en Aquitaine et Languedoc-Roussillon) a souhaité l’élargissement de la participation des régions aux SATT : « Il est d’autant plus légitime que les collectivités locales, notamment les régions, soient représentées au sein des SATT qu’elles contribuent largement au financement des incubateurs. Si elles peuvent déjà être observatrices dans les conseils d’administration des SATT, il faudrait qu’elles y prennent un rôle plus large. »
b. Le développement de structures régionales préexistantes
La rapidité de ce développement a pour origine le fait que les SATT ont pris le relais de structures qui leur préexistaient, notamment les dispositifs mutualisés de transfert de technologie (DMTT). Comme l’expose encore M. Roger Genet : « Les SATT ne sont pas parties de rien. Elles se sont inspirées notamment de Bretagne Valorisation, située dans une région ne bénéficiant pas des grands acteurs que j’ai mentionnés (les grands organismes nationaux de recherche), et qui s’est prise en mains pour réfléchir à la meilleure façon de structurer sa valorisation, en partant de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et en fédérant les organismes nationaux implantés sur le territoire. »
« La différence entre les SATT et Bretagne Valorisation, a-t-il poursuivi, c’est qu’au-delà de la compétence de gestion de la propriété intellectuelle, on les a dotées d’un milliard d’euros de fonds d’émergence pour financer notamment la création de start-up. »
Ainsi, afin de rapprocher le plus possible les travaux de recherche de leur mise en œuvre par l’industrie, les SATT ont été organisées sur une base régionale.
Plaidait également en faveur d’un maillage du territoire le fait que, selon M. Roger Genet : « La SATT a en outre un rôle d’acculturation des acteurs à la gestion de la propriété intellectuelle. Il est donc essentiel que, dans chaque regroupement au sein d’un territoire, dans chaque site, il y ait une compétence de valorisation. »
L’ensemble du territoire métropolitain est ainsi, en principe, doté d’une SATT. Fait exception la Normandie, dont les acteurs de la recherche ne s’étaient pas mobilisés pour répondre à l’appel à projets. En sens inverse, l’Île-de-France voit son territoire couvert par deux SATT.
Alors que le CNRS s’est doté de dispositifs de valorisation, son président lui-même, M. Alain Fuchs, a souligné l’intérêt du caractère régional du dispositif lors de son audition : « Ce qui constitue tout l’intérêt des SATT, c’est le contact sur place. Nous savons qu’aujourd’hui, pour valoriser une innovation, il ne faut pas tarder. La rapidité du temps de passage au marché peut être discriminante. Ce temps doit être le plus court possible.
« Or, le type d’innovation avec lequel le CNRS est le plus familier, c’est l’invention majeure et structurante, comme en pharmacie le blockbuster, que le CNRS a bien connu avec le Taxotère. Dans ce type de cas, l’invention est telle qu’elle demande encore un travail considérable en aval avant de pouvoir être mise en œuvre par le marché. Ce travail de valorisation sera fait en commun avec un grand groupe – pharmaceutique par exemple – qui pourra y mettre le prix. La rapidité de l’arrivée sur le marché n’est alors pas le plus déterminant.
« À mon sens, il faut être pragmatique. Leur implantation régionale permettra aux SATT de trouver sur place les éléments permettant la valorisation et la maturation d’une découverte dans de bonnes conditions de rapidité. »
Et, de fait, le CNRS a fait le choix d’être actionnaire de toutes les SATT.
Le rapide développement des SATT n’en a pas moins entraîné un certain nombre de réticences, voire de franches oppositions.
Celles-ci sont principalement venues des grands organismes nationaux de recherche, et surtout de ceux qui s’étaient déjà dotés de filiales de valorisation, comme le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), avec CEA Tech, ou l’Inserm, avec Inserm Transfert, mais aussi l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou l’Institut national de recherche en informatique en automatique (INRIA).
1. La dimension régionale, une dimension trop restrictive pour la valorisation de la recherche menée par les acteurs nationaux
Il a été exposé aux rapporteurs que le caractère régional des SATT les rendait peu aptes à valoriser des recherches conduites dans un cadre national.
Ont ainsi été évoquées les limites de la visibilité des SATT par rapport à celle des structures de valorisation des grands organismes mondialement connus. M. Alain Fuchs, président du CNRS, a lui-même soulevé ce point : « La structure de valorisation du CNRS, qui est une structure nationale, a ses forces et ses faiblesses. Parmi ses forces figure sa visibilité nationale, notamment pour les réseaux de recherche. Ceux-ci peuvent être constitués d’équipes présentes dans plusieurs régions. Pour de tels réseaux, confier au CNRS la valorisation de leurs innovations, la construction puis la gestion de la propriété intellectuelle qui y sera attachée, a du sens. »
Mais les difficultés deviennent aussi très vite d’ordre technique. Comme l’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle : « Les organismes partenaires d’une SATT doivent lui transférer la totalité de leur propriété intellectuelle. Ce système nous pose plusieurs problèmes sérieux. D’abord, les SATT sont régionales ou locales, alors que le CEA est un organisme national. Ce n’est pas une seule entité locale ou une équipe donnée qui est porteuse du brevet. D’autant que plusieurs d’entre elles peuvent être impliquées. Ainsi, la direction de l’énergie nucléaire du CEA dispose de différentes équipes, localisées à Marcoule, à Cadarache ou à Saclay. »
L’affaire se complique encore lorsque les brevets sont valorisés non pas à l’unité, mais réunis, sous formes de grappes de brevets. C’est aussi le président du CNRS, M. Alain Fuchs, qui soulève ce point : « On n’imagine pas aujourd’hui que des grappes de brevets constituées de façon multi-territoriale et souvent aussi multidisciplinaire se retrouvent dispersées dans différentes SATT. Il y a des sujets qui ne se déclinent pas en logiques territoriales. Il y a un véritable intérêt à avoir sur certains axes stratégiques, que nous appelons des axes stratégiques d’innovation, et que nous définissons, une vision et une capacité de gestion de la propriété intellectuelle nationales. »
Et, bien sûr, on arrive à une complexité maximale lorsque le brevet relève de plusieurs organismes inventeurs. M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du CEA, a ainsi déclaré à la Mission d’évaluation et de contrôle que : « les SATT cherchent à se positionner en tant que mandataire et négociateur unique. Les difficultés s’accumulent dans les cas où le CEA est détenteur de droits de propriété intellectuelle en commun avec d’autres organismes dans le cadre d’unités mixtes de recherche (UMR), la plupart du temps sur le background – propriété intellectuelle en amont d’une découverte –, mais parfois aussi sur le foreground – droits sur ce qui sera découvert ultérieurement. De plus, l’introduction d’un nouvel acteur en France – la SATT – a considérablement compliqué le travail au niveau européen. Au sein des consortiums européens, le nombre de partenaires par pays peut être un facteur discriminant. » Sur ce dernier point, l’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, ajoute que : « Auparavant, lorsqu’une personne souhaitait obtenir une licence pour exploiter une invention dont le CEA et un ou plusieurs autres établissements étaient copropriétaires, il était généralement admis que le CEA joue le rôle de négociateur pour compte de tiers. Désormais, cela ne fonctionne plus. »
1. La commercialisation des brevets, un mode de valorisation seulement partiel de la recherche
Mais les critiques les plus aiguës portent sur le mode de valorisation de la recherche par les SATT. En effet, la valorisation de la recherche ne passe pas toujours par la voie de la commercialisation de brevets.
L’industrie aéronautique en fournit un exemple bien connu. Le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil, l’a exposé lors de son audition : « L’idée géniale d’un inventeur n’a presque aucune chance d’aboutir car il faut trouver l’avion qui la portera. » Eu égard aux contraintes de certification, de sécurité et aux contraintes techniques, « chaque produit est donc spécifique et ne convient qu’à un aéronef déterminé ». Dans ces conditions, « dans la mesure où les produits sont destinés à un seul avionneur, l’industrie aéronautique ne se préoccupe pas d’élaborer des brevets pour les vendre. L’élaboration de brevets n’est importante que dans un but défensif et non pas commercial. »
L’industrie du vivant dispose également de son propre modèle de valorisation des découvertes. Ainsi, le directeur général de France Brevets, M. Jean-Charles Hourcade, a-t-il déclaré lors de son audition : « En ce qui concerne toutes les technologies dites « rouges » – santé humaine, thérapeutique et médicaments –, nous n’interviendrons pas du tout du fait du type des relations entre universités, start-up biotech et grande industrie, fondées sur des modèles de préfinancement et d’exclusivité – domaines où, en effet, nous n’apporterons pas de valeur ajoutée particulière. »
Le CEA a quant à lui développé un modèle de valorisation spécifique comme l’a exposé son administrateur général, M. Bernard Bigot : « L’obligation de transférer la propriété intellectuelle aux SATT casse le modèle du CEA en la matière. En effet, le CEA mutualise lui-même la propriété intellectuelle des inventions dont il est l’auteur ou le coauteur. Lorsqu’un partenaire industriel contribue à la mise au point d’une invention avec le CEA, il lui en laisse la propriété intellectuelle. En retour, le CEA lui délivre une licence exclusive pour exploiter l’invention dans son cœur de métier. Mais l’industriel accepte que cette propriété industrielle puisse être déclinée au profit d’autres, ceux-ci devant alors payer des droits pour bénéficier de la licence. Symétriquement, les partenaires industriels du CEA bénéficient d’un droit particulier lorsqu’ils souhaitent exploiter un des 5 200 brevets ou familles de brevets dont le CEA est détenteur.
« Si le CEA venait à éclater son capital de propriété intellectuelle, son modèle serait détruit. D’autant que, dans le domaine de la recherche technologique, le CEA doit faire appel pour 80 % à des ressources externes, qui proviennent de fonds européens, d’agences de financement nationales ou de partenaires industriels. »
1. Des SATT rentables à horizon de 10 ans, un objectif déstructurant pour la valorisation de la recherche ?
En parallèle à ces critiques a aussi été évoquée la capacité des SATT à établir leur équilibre économique en dix ans.
La Cour des comptes, dans son rapport, cite les doutes du jury sur ce point : « Le modèle d’une SATT totalement financée par le marché d’ici dix ans nous semble « utopique ». Le transfert de technologies n’est pas un business en soi (la lecture des comptes d’Imperial College, société anglaise de transfert de technologie cotée en bourse, montre bien qu’il s’agit plus de valeur immatérielle que de résultats de vente). Nous n’avons pas tenu compte de ce point dans nos évaluations. »
Le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a exprimé les mêmes doutes devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « À mon sens, c’est une erreur de penser que la maturation de projets risqués va permettre systématiquement d’équilibrer les comptes des SATT à dix ans. »
Le risque est alors que, pour tenter d’équilibre au plus vite leurs comptes, les SATT privilégient dans leur activité la revente de brevets au développement du territoire sur lequel elles sont implantées. À travers l’exemple de la SATT alsacienne Conectus, M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » de l’ANR, a évoqué ce risque : « Cette société peut bien parvenir à l’équilibre financier en 2020, une fois épuisés les financements liés au PIA, et rapporter alors des dividendes à l’État actionnaire ; mais, s’il s’avère que 90 % de ses clients sont implantés hors de France et que notre appareil productif n’a pas bénéficié du transfert de connaissances de la recherche publique, l’opération aura été un échec. »
A. QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES SATT ?
1. Le caractère régional des SATT : source de leurs succès et cause de leurs limites
Les difficultés signalées, notamment par le CEA, en matière d’articulation de l’action de valorisation des grands organismes nationaux de recherche et les SATT portent sur des points trop importants pour être ignorées.
Il n’est pas exclu que leur cause soit à rechercher dans les éléments mêmes qui ont fait le succès initial des premières SATT. Ce succès a été lié au fait qu’elles s’inscrivaient dans le prolongement des DMTT, créés après la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche. Après M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère, M. Nicolas Carboni, président de la SATT Conectus Alsace, a confirmé ce point lors de son audition : « Le premier facteur de facilitation est la confiance générée par l’ancienneté des relations entre les acteurs de recherche publique sur un territoire donné ; depuis 2006, ces relations pouvaient s’inscrire dans le cadre d’un dispositif mutualisé de transfert de technologies, un DMTT : les SATT qui ont pu s’appuyer sur les équipes ainsi mises en place sont parties avec une longueur d’avance. L’interaction des partenaires du DMTT avec les autres acteurs de l’écosystème, tels que les incubateurs, les pôles de compétitivité ou les agences de développement, a pu jouer un rôle similaire : dans ce cas aussi, la SATT a relayé, sous une forme plus élaborée, une dynamique préexistante. »
Cependant face à la lacune en matière de valorisation constatée en 2006, les grands organismes de recherche n’étaient pas restés inactifs. C’est ainsi qu’ont été créés CEA Tech et Inserm Transfert. Depuis 2006, ce n’est donc pas un type de structure de valorisation (les DMTT) qui a été créé, mais bien deux et les SATT ne sont le prolongement que d’un seul de ces deux dispositifs.
Or, créée en 2006, Inserm Transfert a atteint l’équilibre financier en 2012. Par ailleurs, si, aux termes du « jaune » budgétaire pour 2015, les SATT ont déposé 186 brevets entre mai 2013 et mai 2014, le CEA en a déposé 756 en 2013, soit quatre fois plus à lui tout seul. On comprend bien que réorganiser la valorisation de la recherche française autour des SATT reviendrait à défaire ce qui a été construit par les grands organismes, non seulement en termes de valorisation de leurs recherches – laquelle ne passe pas seulement par la commercialisation des brevets – mais aussi de gestion des brevets.
Les limites des SATT sont désormais admises au Commissariat général à l’investissement. Ainsi, lors de son audition, M. Louis Schweitzer a déclaré : « La difficulté des SATT, c’est qu’elles constituent des sortes de coopératives de brevets. Or, ce mode d’organisation n’est pas forcément très pertinent pour réunir des fournisseurs de tailles très inégales. L’intérêt d’une participation à une coopérative n’est pas évident pour un très gros fournisseur. »
M. Louis Gallois avait exposé quant à lui : « elles (les SATT) n’ont pas vocation au monopole : d’autres institutions, comme Inserm Transfert, font bien leur travail. Je souhaite une coordination entre ces institutions et les SATT. » Et encore : « La vocation essentielle des SATT est de travailler avec les universités, qui ont les plus grands problèmes de valorisation – ce qui n’est évidemment pas le cas du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ni de l’INSERM. »
1. Un nécessaire assouplissement du modèle qui préserve la liberté stratégique des partenaires
a. L’indispensable assouplissement du modèle
En réalité, la principale critique des grands organismes de recherche porte moins sur l’existence des SATT elles-mêmes, qui peut être perçue comme positive, que sur la rigidité du dispositif en matière de propriété industrielle.
Ainsi, M. Thierry Damerval, directeur général délégué de l’Inserm a-t-il déclaré devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « Nous n’avons jamais été partisans du maintien de l’existant ; depuis l’origine, nous sommes partisans d’accompagner les SATT ».
De même, l’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, a-t-il exposé : « Dans certaines régions, nous travaillons avec des acteurs qui déposent entre un et dix brevets par an. Je ne peux donc que souscrire à l’idée de mutualiser et d’amplifier cette ressource. »
En revanche, poursuit-il, « les règles doivent être plus flexibles. Le transfert de la totalité de la propriété intellectuelle – sans lequel on ne peut pas être partenaire d’une SATT – constitue une exigence trop rigide. (…) Dans certains cas, il serait possible au CEA de transférer la propriété intellectuelle, par exemple dans le domaine de la chimie, lorsqu’un laboratoire bien précis crée une molécule qui a des applications médicales. Dans d’autres domaines, c’est quasi impossible : en matière de microélectronique, les inventions sont mises au point par des partenaires multiples et donnent lieu au dépôt non pas de brevets distincts, mais de portefeuilles de plusieurs centaines de brevets. »
De fait, dès lors que des assouplissements peuvent être obtenus, on voit le CEA devenir partenaires de SATT. M. Bernard Bigot poursuit : « Nous avons sollicité et obtenu des aménagements, qui nous permettront d’être partenaires des SATT « Paris-Saclay » et « Grenoble Alpes Innovation Fast Track ». Nous ne participons à aucune autre SATT. » Or ces deux SATT dotées d’un mode de fonctionnement dérogatoire au modèle initial sont situées sur les deux territoires les plus riches en institutions de recherche, et aussi en entreprises innovantes.
S’il s’est montré plus ouvert que le CEA à une coopération avec les SATT, l’Inserm a néanmoins choisi de nouer, à travers Inserm Transfert, des accords au cas par cas avec chaque SATT, sur la base de modèles de répartition des actions et des terrains respectifs d’intervention. « L’objectif de l’Inserm, a déclaré M. Yves Lévy, son président-directeur général, est d’être partenaire de l’ensemble des SATT à travers Inserm Transfert. Il y aura ainsi un accord, une lettre d’intention et une discussion avec chaque SATT en vue d’en être partenaire et/ou actionnaire. Pour chacune des SATT, la discussion porte ou a porté sur la répartition des tâches, des activités et éventuellement des retombées entre Inserm Transfert et ses partenaires. »
Désormais, a-t-il poursuivi, « L’Inserm a réglé les problèmes de convention et de lettre d’intention avec sept d’entre elles ; il en est désormais actionnaire, avec un niveau de partenariat qui varie de 1 % à 13 %. » Il est remarquable que le chiffre de 13 %, le plus élevé, concerne la SATT Île-de-France INNOV (Idfinnov) – l’une des deux SATT partenaires du CEA –, malgré son périmètre et son type de portefeuille par rapport au terrain d’activité d’Inserm Transfert, qui est celui de la biologie santé.
b. Le souhait d’un recentrage des SATT sur leur mission de maturation
L’assouplissement en matière de propriété intellectuelle, condition sine qua non de la participation du CEA aux SATT, s’accompagne aussi visiblement, de la part des grands organismes de recherche, d’une demande de recentrage des SATT sur leur principale mission, la maturation des projets.
Ainsi, lors de son audition, le président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy a proposé le modèle suivant de relations entre l’Inserm et les SATT. « Un premier modèle consiste à garder les missions de chacune des structures. Les SATT doivent alors jouer le rôle pour lequel elles ont été créées, c’est-à-dire celui de la maturation des projets. Il y a alors une complémentarité évidente entre les SATT et une structure comme Inserm Transfert qui a une expérience, depuis sa création en 2002, de proximité avec les chercheurs pour faire remonter les brevets, défendre les accords de consortium et travailler à la valorisation de ces brevets.
« De plus, une troisième composante, Inserm Transfert Initiative (ITI) est liée au PIA, et a bénéficié de financements du fonds national d’amorçage.
« Un processus vertueux peut donc se mettre en place : la répartition du portfolio de la propriété intellectuelle et académique avec Inserm Transfert, l’intervention du fonds d’amorçage, et enfin celle de fonds de maturation, avec la SATT, lorsqu’il existe des accords à cette fin. »
Les propos tenus devant la mission par M. Christian Estève, secrétaire de l’association des SATT et président de la SATT Île-de-France Innov, s’avèrent en phase avec ceux du président-directeur général de l’Inserm : Même un an et demi après, nous ne couvrons réellement que la moitié de notre territoire : le potentiel est donc considérable. Par ailleurs, nous intervenons très en amont, dès la maturation des projets. Enfin, on s’est aperçu que la dispersion des efforts faisait perdre du temps ; or la vitesse d’exécution est essentielle aux projets. Au-delà de nos objectifs respectifs, il fallait trouver de nouvelles formules pour réaliser notre objectif global : la multiplication des brevets, des maturations et des projets, et ce dans les temps les plus courts possibles. Tels sont les éléments qui ont permis de corriger le tir et de créer une véritable affectio societatis. »
Dans ce schéma, les SATT sont recentrées sur la maturation des projets. L’activité de gestion de brevets devient une activité secondaire.
M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA a lui aussi insisté sur la mission de maturation des SATT : « Sur les SATT, je crois que la bonne approche consiste à être pragmatique, en fonction de la dynamique que l’intervention d’une SATT peut apporter à la maturation d’un projet. Le conseil d’administration de l’ONERA a ainsi récemment autorisé une concession de licence en s’appuyant sur la SATT de Toulouse, en considérant que celle-ci était sûrement l’outil le plus actif dans la région toulousaine pour porter le projet qui lui était présenté. »
M. Thierry Damerval, directeur général délégué de l’Inserm a ainsi conclu devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « Nous arrivons dans une phase où les bases sont clarifiées. Elles seront certes différentes selon les SATT mais comporteront une réelle répartition du travail et seront porteuses d’une réelle plus-value, au lieu de constituer un simple transfert d’activité ou de complexifier la situation des laboratoires. Désormais, il faut montrer aux laboratoires la plus-value apportée par chacun des différents partenaires ».
c. Vers une articulation nouvelle entre SATT et grands organismes de recherche ?
La participation des grands organismes de recherche aux SATT semble cependant porteuse de changements nettement plus significatifs que de simples dérogations au modèle pour les SATT auxquelles ils adhéreront, comme partenaire ou actionnaire.
Le président du CNRS, M. Alain Fuchs, a ainsi esquissé la mise en place d’une relation globale : « La première question est celle de l’articulation du national et du régional. Nous devons trouver la bonne articulation entre les SATT sur le territoire, les services de partenariat et de valorisation de nos délégations régionales, qui existent et n’ont pas démérité, notamment en ce qui concerne les start-up, et la gestion nationale. Il ne faut pas que tous les dossiers des SATT que le CNRS souhaite examiner remontent à l’échelon national. Des décisions doivent pouvoir être prises sur place. » et, a-t-il conclu : « Il y a, pour y arriver, un important travail à conduire ; l’installation des SATT dans le paysage de la valorisation de la recherche prendra du temps. »
Répondant à une question de Mme Laure Fau, conseillère référendaire à la Cour des comptes, M. Nicolas Carboni, président de la SATT Conectus Alsace a indiqué que cette organisation était déjà effective : « Non seulement l’articulation a été définie dans les accords-cadres, mais elle prend désormais vie au quotidien : au sein de chaque SATT a été mis en place un comité qui examine toutes les déclarations d’invention et les brevets, en associant, dans la SATT concernée, le CNRS et l’Inserm. C’est la première fois que l’ensemble des acteurs de la recherche publique, sur un territoire donné, voient passer tout le flux de brevets.
« À l’issue de cet examen, les SATT identifient les opérateurs susceptibles, au vu de leur capacité d’expertise, de prendre un mandat de valorisation. En Alsace comme ailleurs, la SATT investit dans des programmes de maturation dont la gestion du titre et la valorisation seront assurées par tel ou tel de ces opérateurs – le CNRS ou l’Inserm, par exemple – en fonction de son expertise ou d’une grappe de brevets qu’il détient déjà. Bref, cette articulation entre un acteur de terrain, en contact quotidien avec les équipes de recherche, et une logique stratégique de priorités définie par un opérateur national est aujourd’hui effective. »
Le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet enterre lui aussi le modèle unique : « On a sans doute eu tort de vouloir au départ imposer un modèle. On voit bien que des adaptations sont nécessaires aujourd’hui. » Il dessine deux modèles d’action pour les SATT en fonction de leurs interlocuteurs, la gestion de la propriété intellectuelle par délégation et une action plus en subsidiarité quand leurs interlocuteurs sont de grands organismes nationaux : « Les SATT vont travailler soit en recevant une délégation de gestion de la propriété intellectuelle, soit dans un cadre de mutualisation des moyens pour prospecter dans les laboratoires en cohérence avec les organismes de valorisation des grands organismes nationaux ; la subsidiarité est en train de mettre en place. »
Rappelant que les SATT sont des sociétés anonymes, il indique même que le sens de l’action des SATT doit être déterminé par leurs actionnaires : « L’appropriation par les acteurs est une clé. Si l’État a aujourd’hui une minorité de blocage de 30 %, il ne faut pas que sa présence empêche cette appropriation. Les SATT vivront si ces sociétés anonymes sont considérées comme des filiales communes des membres fondateurs et si ceux-ci les reprennent à leur compte et équilibrent leur budget. L’État n’est là que pour accompagner le développement et vérifier la bonne utilisation des fonds. »
Autrement dit, le modèle de travail des SATT va très vraisemblablement encore évoluer par rapport au modèle initial. La constitution des SATT en fédération nationale est sans doute aussi un élément important de cette évolution.
1. La question de la rentabilité : un élément clé
L’une des clés des conditions d’évolution des SATT dépend, cependant, de l’objectif de rentabilité qui leur est imposé.
Le jury qui a examiné les projets de SATT avait lui-même considéré que la maturation, c’est-à-dire l’accompagnement d’une découverte jusqu’à sa transformation en élément utilisable par un industriel, était une activité à faible rentabilité. Reprenant cette analyse, M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT et président de la SATT Sud-Est, a exposé que : « La maturation juridique, commerciale, économique et technologique d’une découverte prend du temps et elle n’atteint pas toujours le niveau suffisant pour permettre à une entreprise de prendre le relais. » Dès lors, pour assurer leur équilibre, les SATT doivent se doter de portefeuilles de brevets monnayables. Et c’est bien leur activité en matière de propriété intellectuelle qui les met en conflit avec les grands organismes de recherche nationaux.
À travers l’exemple de la SATT alsacienne Conectus, M. François Rosenfeld, directeur financier du Commissariat général à l’investissement a évoqué lors de l’audition de M. Louis Gallois ce que pourrait être une gestion équilibrée de son portefeuille par la SATT : « Dans le cas de Conectus, par exemple, il est avantageux pour la SATT de gérer un portefeuille assez large pour, selon les résultats de ce travail d’analyse, se ménager, sur certains projets, par le transfert de brevets ou de licences à des acteurs étrangers, un important retour purement économique lui permettant de financer son activité, et pour d’autres projets, d’accepter un moindre impact économique pour elle-même et de privilégier des effets socio-économiques plus importants en termes d’emploi aux niveaux local et national et de développement de filières. Le système de crible mis en place par Conectus pour gérer son portefeuille et analyser les dossiers selon le triple critère du niveau de risque, de l’engagement financier et des bénéfices socio-économiques est donc particulièrement intéressant. »
Il reste que Conectus n’est pas l’une des SATT les plus concernées par les rapports avec les grands organismes de recherche nationaux. Par ailleurs, la formalisation du modèle d’action de Conectus et de son système de crible, ainsi que son éventuelle généralisation aux autres SATT, passe par la définition des critères appliqués lors des bilans triennaux de go-no go. Les indicateurs de performance des SATT devront tenir compte de l’impact économique de celles-ci dans leur bassin d’emploi d’implantation et plus spécifiquement de leurs succès en matière de maturation, y compris si ces succès se sont faits au détriment de leurs profits, et éventuellement de leur équilibre. Comme l’a exposé le président du CNRS, M. Alain Fuchs : « Si, à l’approche d’un horizon de 10 ans, on constate que de très beaux projets ont été maturés, qu’ils ont réussi à passer la « vallée de la mort » avec des entreprises qui y ont cru, on pourra déjà considérer qu’un résultat est là. »
Or, M. Vincent Lamande, président de la SATT Ouest Valorisation a rappelé que de tels indicateurs n’existaient pas forcément aujourd’hui : « La finalité des SATT n’étant pas de réaliser des profits, d’autres indicateurs sont à prendre en compte, comme le pourcentage de transfert de technologies en région ou, comme vous venez de le suggérer, la création d’emplois directs ou indirects, via le transfert de technologies vers des PME existantes ou des start-up naissantes. De tels indicateurs ne sont pas constitutifs de notre feuille de route aujourd’hui, mais pourront l’être dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux actionnaires, au premier rang desquels les collectivités. »
Les rapporteurs se réjouissent donc des propos de M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » de l’ANR : sur l’importance de parvenir à un équilibre entre les indicateurs de production et de performance de la SATT – autrement dit, son chiffre d’affaires et son taux de retour sur investissement – et l’indicateur d’impact fourni par son portefeuille de clients : « L’évaluation triennale des SATT, sur laquelle nous travaillons actuellement avec le CGI, le ministère de la recherche et la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), tiendra ainsi compte de l’impact de leur action sur les PME et les ETI de l’écosystème. » L’importance de ce critère devra croître parallèlement au développement de la maturité des SATT.
Il faut noter que cette optique fait porter une réelle responsabilité sur les actionnaires des SATT. En cas de déséquilibre des comptes à dix ans, la logique de l’actionnariat veut que ce soit eux les premiers concernés par leur comblement.
Cet élément n’a pas échappé à M. Vincent Lamande : « La raison d’être des SATT, au fond, est de contribuer à la compétitivité des entreprises. Pour concilier ces deux objectifs, nous devons trouver un équilibre dans notre portefeuille de projets. Certains d’entre eux auront une faible rentabilité mais un impact économique sensible sur le territoire ; pour les financer, et afin de partager les risques, les SATT feront appel aux collectivités ou à des investisseurs privés. D’autres projets, à rentabilité plus élevée, permettront quant à eux un retour sur investissement accru. »
Cette situation doit évidemment aussi amener les actionnaires à avoir un regard sur les recrutements des SATT, surtout lorsque les compétences dont celles-ci ont besoin peuvent être trouvées auprès d’eux, sous forme de prestations de services. Sur ce point, il faut rappeler que 5 % des 900 millions d’euros dédiés aux SATT a été réservé à l’achat par celles-ci de prestations.
À ce propos, il faut rappeler que l’État est non seulement l’évaluateur des SATT, mais aussi leur premier actionnaire. Son rôle dans l’orientation de leur action est donc crucial. M. Roger Genet l’a rappelé devant la Mission d’évaluation et de contrôle : « Il n’empêche que toutes les missions prévues doivent être remplies, et l’État doit y veiller. Je rappelle que le ministère détient, avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque publique d’investissement (BPI), 30 % des droits de vote des SATT. L’État est représenté au conseil d’administration de chaque SATT par un représentant de la DGRI et un représentant de l’administration en région. La cohérence est assurée au niveau national dans le cadre de la relation que la DGRI entretient avec les présidents de SATT, qui sont en train de se structurer en association. Elle l’est également, au niveau territorial, par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie, qui sont nos relais en région et la voix de l’État dans les conseils d’administration. La cohérence résulte donc simplement de l’exercice de la tutelle, avec des acteurs qui sont des sociétés anonymes. »
2. Un dispositif qui doit évoluer et s’affiner
Les SATT constituent, par leur objet, un élément essentiel de la chaîne de valorisation de la recherche mise en place par le PIA.
Les montants qui y ont été consacrés – près de 1 milliard d’euros – justifient qu’une attention toute particulière soit portée à leur évolution et à leurs actions.
Les rapporteurs considèrent que les critères de réussite des SATT doivent être affinés et faire l’objet d’une pondération qui mette au cœur de leur succès l’action de développement économique que chacune aura permise.
Le modèle sur lequel elles se sont développées doit être assoupli pour permettre une collaboration plus harmonieuse avec les grands organismes de recherche et leurs filiales de valorisations.
En particulier, les grands organismes nationaux doivent pouvoir conserver, dans les domaines où ils le souhaitent, la maîtrise du mode de valorisation de leurs découvertes. La richesse des compétences qui s’y exercent, leur notoriété scientifique et leur masse financière sont, à cette fin, des atouts qui ne doivent pas être bridés. Il faut aussi tenir compte de ce que la commercialisation des brevets n’est pas le seul mode de valorisation de la recherche, ni toujours le plus porteur.
Les rapporteurs souscrivent à l’idée que les SATT doivent finalement être chacune l’outil de leurs actionnaires.
Sur cette base, une région doit pouvoir, si elle-même et la SATT en sont d’accord, devenir actionnaire d’une SATT opérant sur son territoire, de façon notamment à pouvoir rapprocher la SATT des incubateurs.
Enfin, la fédération des SATT en association nationale doit permettre la diffusion des bonnes pratiques et la circulation de l’information.
Dans ce cadre, l’action de l’État, actionnaire principal de chaque SATT, évaluateur de celles-ci et attributaire des fonds régulièrement débloqués au fur et à mesure des étapes d’évaluation, est essentielle. Son action de contrôle et d’attribution des fonds doit permettre d’orienter l’action des SATT au bénéfice de l’intérêt général, de vérifier que cette action s’exerce bien dans le cadre des objectifs généraux fixés et d’intervenir au cas où une SATT n’arriverait pas à satisfaire à la feuille de route qui lui a été fixée.
III. LES CONSORTIUMS DE VALORISATION THÉMATIQUE
A. DES INSTRUMENTS DESTINÉS À L’IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES VALORISABLES
Aux termes de la convention du 29 juillet 2010, les consortiums de valorisation thématiques (CVT) doivent proposer « des services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de valorisation de site sur des thématiques données ». Ils doivent être portés par des organismes publics nationaux de recherche, par leurs filiales de valorisation ou par une alliance. 50 millions d’euros sont prévus pour leur financement.
En pratique, six CVT ont été constitués, cinq adossés aux cinq alliances de recherche, un sixième CVT, le CVT « Valorisation Sud » ayant été créé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), l’Institut Pasteur, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et les quatre universités d’outre-mer (La Réunion, Antilles-Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) pour assurer la valorisation et le transfert des technologies issues des laboratoires de recherche publique français présentant un intérêt socioéconomique sur les marchés des pays du Sud. Chaque CVT doit recevoir un financement de 8 à 9 millions d’euros environ, débloqué par étapes, après procédure de revue. La première dotation en assure le financement pour deux ans.
L’adossement des CVT aux alliances leur donne les meilleures conditions d’efficacité pour offrir « des services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de valorisation de site sur des thématiques données ». Cet adossement leur donne en effet une vision d’ensemble pour identifier des thématiques porteuses de valorisation à l’attention des SATT, de France Brevets, et des filiales de valorisation des grands organismes. Comme l’expose M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation, « Nul n’est mieux placé que les acteurs de la recherche pour voir ce qui peut être le mieux valorisé. ». Les CVT, « très utiles » permettent ainsi « aux opérateurs de recherche regroupés par grandes alliances thématiques d’avoir une action de type cartographique sur les marchés et les compétences, au service des SATT. »
Leur utilité est aussi démontrée par le fait que, avant même le lancement du PIA, certaines alliances de recherche avaient déjà créé des structures destinées à remplir la mission finalement confiée aux CVT. « Pour montrer l’intérêt porté par l’alliance Aviesan à la valorisation, a indiqué le président-directeur général de l’Inserm, M. Yves Lévy, j’ajoute qu’il existait une structure qui mettait en interaction l’ensemble des structures de valorisation des partenaires de l’alliance et qui s’appelait Covalliance. Cette structure a été la base du CVT Aviesan, financé par le PIA à hauteur de 9,3 millions, lors de la création de celui-ci. »
Pour accomplir les missions qui leur sont imparties, les CVT ont mis en place plusieurs types d’actions.
« Les CVT fonctionnent de façon différente en fonction des besoins, a indiqué M. Roger Genet devant la Mission d’évaluation et de contrôle. L’alliance Allistène, dans le domaine du numérique, a surtout des actions en matière de formation des chercheurs à la valorisation, notamment sur le droit d’auteur, alors que les CVT d’Aviesan ou d’AllEnvi sont plutôt tournés vers des cartographies des domaines de valorisation stratégique, un peu à l’image du bureau marketing du CEA. Le financement des CVT, qui est restreint, est très utile. Jusqu’ici, aucun organisme autre que le CEA n’avait la capacité de faire ce type d’études. »
Peut-être parce qu’il succède à une structure préexistante, le CVT le plus actif semble être le CVT Aviesan. Pour les rapporteurs, son action illustre assez bien l’apport qui peut être celui des CVT à la valorisation de la recherche.
M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique au CGI explique ainsi : « Le métier de cette alliance (Aviesan) est de veiller, avec l’ensemble de ses membres, à la cohérence de la programmation de la recherche dans le domaine de la santé. Nous avons couplé à l’alliance un consortium de valorisation thématique (CVT) à compétence nationale, qui veille, lui, à la cohérence des politiques de valorisation des différents membres de l’alliance. »
« Le CVT Aviesan est un élément de valorisation important du fait de son rôle de fédérateur, détaille le président-directeur général de l’Inserm – et président d’Aviesan –, M. Yves Lévy. Il vient en complément du travail de coordination et de mise en cohérence des programmes scientifiques. Enfin, il donne un bon reflet de la propriété intellectuelle académique puisqu’il concerne l’ensemble des acteurs académiques de l’alliance. […] ; 16 industries reconnaissent le CVT Aviesan et en sont partenaires. »
« Le CVT Aviesan fonctionne sur des domaines de valorisation scientifique spécifiques sur lesquels l’ensemble des partenaires mettent leurs compétences et leurs brevets afin d’en assurer la lisibilité au niveau industriel. Cinq domaines de valorisation ont été définis, dont trois sont gérés par Inserm Transfert – vaccinologie, cancer et biomarqueurs. Il existe ainsi une réelle production du CVT Aviesan, production qui a été formalisée grâce au financement du PIA. »
Cette orientation stratégique en matière de valorisation de la recherche dans le domaine de la santé a également des répercussions sur les SATT. Le CVT Aviesan a ainsi lancé avec les SATT un appel à manifestation d’intérêt national en épigénétique et cancer, après avoir défini ce domaine comme stratégique au niveau national. Plus largement, poursuit M. Claude Girard : « Celles-ci (les SATT), qui sont par définition plurithématiques, peuvent, en matière de santé, inscrire leurs brevets et les fruits de leur valorisation dans un domaine stratégique perçu au niveau national par l’alliance. C’est là une bonne articulation en termes d’orientation de la valorisation dans le domaine de la santé. »
Le CVT Ancre travaille lui aussi à l’identification de pistes stratégiques de valorisation. M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a ainsi présenté son activité : « Le CVT Ancre tâche de mener une réflexion stratégique d’intelligence scientifique, technique et économique mutualisée. Identifier les grands déterminants technologiques et économiques de tel ou tel sujet, en termes d’analyse stratégique, apparaît intéressant pour des établissements comme l’Institut français du pétrole-énergies nouvelles (IFP-EN), le CEA, le CNRS, qui font déjà beaucoup de valorisation. Nous avons fait savoir que nous étions très preneurs d’une poursuite des discussions sur les études en cours, pour en connaître les résultats, et sur les futurs programmes d’études, pour lesquels nous envisageons aussi de faire des propositions. ». Depuis février 2014 en effet, la direction générale de l’énergie et du climat participe au comité de coordination de l’alliance, à l’invitation de celle-ci. Une étape supplémentaire de renforcement des échanges et de la coordination sur la recherche a ainsi été franchie.
En tout état de cause, les CVT font l’objet d’une « revue » régulière de la direction générale de la recherche et de l’innovation, les premiers financements n’ayant été attribués que pour deux ans.
Pour les rapporteurs, l’adossement des CVT aux alliances de recherche en fait inévitablement des structures porteuses de valeur ajoutée, d’autant plus précieuses qu’elles ne représentent qu’un faible engagement financier. Il conviendra simplement de vérifier régulièrement la qualité de leur engagement dans l’action.
La société par action simplifiée France Brevets est le troisième élément de la chaîne de valorisation instituée par le PIA.
Le coût pour l’État de la constitution de France Brevets est sans commune mesure avec celui des SATT. Alors que le PIA consacre 900 millions d’euros aux SATT, il n’est prévu au titre de France Brevets que 50 millions d’euros. Par ailleurs son insertion au sein du PIA relève d’une politique incitative : aux 50 millions d’euros de capital prévu pour France Brevets au titre de l’État s’ajoutent 50 autres millions d’euros versés par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci assure l’intégralité du pilotage de France Brevets, les 50 millions d’euros de l’État étant versés à France Brevets par le canal de la Caisse. Actuellement, seule la moitié du capital a été libérée, soit 50 millions d’euros, répartis entre 25 millions d’euros investis par la Caisse des dépôts et 25 millions d’euros versés au titre du PIA.
France Brevets a vocation à acquérir des droits sur les brevets et les autres titres de propriété intellectuelle issus de la recherche publique et privée, à les regrouper en grappes technologiques et à les licencier, à des conditions de marché, auprès des entreprises.
Ainsi, dans la logique du PIA, France Brevets est un outil de valorisation de la recherche complémentaire aux SATT et situé en aval de celles-ci.
À ce titre, le 2 juillet 2013, France Brevet a signé une convention avec l’ensemble des SATT. Cette convention constitue un cadre contractuel commun pour faciliter les échanges d’informations entre chacune des parties et rechercher les meilleures solutions de valorisation économique des brevets issus de la recherche française. Elle permet aux SATT de devenir apporteuses d’affaires pour des opérations d’agrégation de brevets. La société Ouest Valorisation a ainsi coopéré avec France Brevets pour le transfert d’un titre.
Mais France Brevets est bien plus qu’un outil de valorisation des brevets détenus par les SATT.
Comme l’a expliqué à la Mission d’évaluation et de contrôle le directeur général de France Brevets, M. Jean-Charles Hourcade, « la Caisse des dépôts et consignations (CDC) souhaitait développer des opportunités d’investissements sur un temps long. Or la propriété intellectuelle relève de la catégorie d’actifs à cycle long : la durée de vie d’un brevet est de vingt ans. (…) La CDC a jugé qu’il pouvait y avoir là une opportunité intéressante pour un investisseur, comme elle, patient, d’intérêt général, et de temps long. » Ce souhait a rencontré la volonté de l’État « d’assurer la cohérence du PIA et en particulier du Fonds national de valorisation de la recherche, lequel articule trois composantes : les sociétés d’accélération du transfert de technologies – SATT –, les consortiums de valorisation thématique – CVT – et France Brevets – censée garantir, tel un filet de sécurité, un retour sur l’investissement en matière de recherche et corriger la situation actuelle où la valorisation des brevets issus de la recherche publique reste en deçà de ce qui serait possible. » Et c’est ainsi que France Brevets a été insérée dans le PIA.
France Brevets est donc une société destinée non seulement à améliorer la valorisation des brevets issus de la recherche publique, mais aussi à gagner de l’argent, sur le temps long, par la valorisation des brevets.
Si, toujours selon M. Jean-Charles Hourcade, la création d’une « structure d’intervention dédiée aux spécificités du marché international du brevet, à savoir une structure connaissant parfaitement les règles du jeu, capable d’interventions, dotée des moyens nécessaires, et réunissant l’expérience – qui ne s’acquiert qu’au niveau international – de la négociation sur les grandes affaires de brevet. » est une première en France, ce n’en est pas une dans le monde. « Si France Brevets est une première en Europe, a poursuivi le directeur général de France Brevets, il s’agit du quatrième fonds d’intervention sur les brevets à capitaux publics dans le monde après le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, trois pays où la notion de politique industrielle est une réalité forte et où, sous des formes variables, l’intervention de l’État est une composante du dispositif. C’est particulièrement vrai en Corée du Sud où le fonds brevets, Intellectual Discovery, est doté de 400 millions de dollars, financés par le gouvernement, et associe les grands noms de l’industrie coréenne à travers des conseils stratégiques. »
Il a aussi fait remarquer que des centaines de milliers de brevets étaient déposés chaque année, et que, rien qu’aux États-Unis, « environ 10 milliards de dollars ont été investis dans la défense de droits de propriété intellectuelle sous des formes diverses et variées. Il s’agit par là d’obtenir des retours sur investissements dans les nouvelles formes de l’économie des brevets. »
B. LE CHOIX D’UNE ACTION DE LONG TERME
● France Brevets souhaite se singulariser des patents trolls – ou chasseurs de brevets – à l’américaine par trois spécificités.
Il s’agit d’abord de travailler sur la base de stratégies de long terme. M. Jean-Charles Hourcade a été très clair sur ce point : « J’ai dirigé cette activité chez Thomson pendant presque dix ans. Quand la Caisse des dépôts et consignations m’a proposé de créer France Brevets, j’ai répondu par l’affirmative ; si la proposition avait émané d’une banque privée je l’aurai refusée car je n’aurais pas cru à son engagement sur la durée. »
Ce « court-termisme » de la finance a été souligné par M. Pascal Asselot : « Ceux qui seraient plus ou moins nos homologues aux États-Unis sont financés par des capitaux privés et recherchent des retours sur investissement excessivement courts-termistes sur les brevets, ce qui les conduit à avoir une activité très contentieuse et complètement coupée de la recherche. Ils achètent des brevets et les revendent juste après » – ce sont ces sortes de sociétés qui sont appelées patent trolls. »
Ensuite, France Brevets souhaite organiser les retours d’investissement et de cash vers la recherche, publique ou privée. Selon M. Jean-Charles Hourcade : « Il nous importe que la part la plus importante possible des montants collectés revienne bien à la recherche, compte tenu bien sûr du respect de l’équilibre économique de l’opération, ce qui n’est pas du tout le cas dans l’approche américaine de type patent troll ».
Enfin, France Brevets souhaite se fixer des critères déontologiques exigeants : « Nous ne nous intéresserons qu’à des brevets dont nous sommes convaincus de la valeur, de la pertinence, de la solidité. Nous menons les négociations avec les licenciés potentiels dans une approche amicale afin de trouver un juste équilibre entre les besoins de financement de la recherche et les contraintes économiques », expose M. Jean-Charles Hourcade.
2. Des modalités d’action différenciées
Les modalités d’intervention envisagées sont de trois types. Le premier, qui se situe le plus en amont de la génération d’un brevet, est le patent factory, la génération de brevet. Le patent factory, expose M. Jean-Charles Hourcade, est la modalité d’intervention « par le biais de laquelle nous allons accompagner des détenteurs de brevets – en général des structures de recherche publique – afin d’enrichir leur portefeuille de brevets. »
C’est ce mode d’action qui impose d’agir dans la durée. « Sont en effet nécessaires, explique M. Jean-Charles Hourcade, trois années de procédures pour faire déposer un brevet, puis au moins trois à cinq années de maturation et d’efforts « d’évangélisation » pour que les technologies brevetées finissent, si tout se passe bien, par s’imposer, et enfin plusieurs années pour le développement du marché. Il faut donc compter une dizaine d’années avant la génération de revenus. »
Il s’agit donc, à terme de mettre en place « des cercles vertueux où le processus de recherche et développement va pouvoir être partiellement – voire, à terme, totalement – autofinancé par les retours de dividendes sur brevets. » « Mais insiste M. Jean-Charles Hourcade, il faut dix ans pour amorcer le cycle. »
Le deuxième mode d’action, porteur de financements à plus court terme pour les partenaires de France Brevets, est l’alliance en propriété intellectuelle - ou IP Alliance. Selon M. Jean-Charles Hourcade, ce type d’action vise « des technologies relativement matures dont certaines peuvent d’ores et déjà connaître un début d’adoption sur le marché. » Il s’agit alors de « regrouper des portefeuilles pour constituer des portefeuilles de brevets puissants qui vont faciliter la négociation et la prise de licence. »
M. Jean-Charles Hourcade a cité un exemple en matière de communication sans contact, ou near field communication (NFC), technologie au début d’une phase massive d’adoption – environ 50 % des smartphones de la dernière génération l’incorporent – pour laquelle France Brevets a réuni les portefeuilles de deux sociétés françaises, une PME, Inside Secure, basée à Aix-en-Provence, qui a fait partie des inventeurs de la NFC, et Orange, ainsi que, par acquisition, des brevets provenant d’un industriel étranger dans le secteur des semi-conducteurs.
Il faut noter que ce type d’action correspond à un axe de développement de France Brevets souhaité par le Commissariat général à l’investissement : « J’ai indiqué au patron de France-Brevets, a exposé M. Louis Gallois lors de son audition, le 19 février 2014, que la France ne devrait pas seulement vendre des grappes de brevets à l’étranger, mais aussi en acheter, car ces achats ouvrent, dans certains domaines, un raccourci. Il ne s’agit pas de transformer France-Brevets en un organisme spéculant sur les brevets, comme il en existe aux États-Unis, mais d’assurer une gestion et une valorisation des portefeuilles de brevets. »
Le troisième mode d’intervention est l’expertise financière des brevets de façon à rassurer le prêteur sur la qualité du portefeuille de brevets de la PME emprunteuse et permettre à celle-ci des « financements à taux préférentiel, en arguant de ce que ces portefeuilles de brevets vont réduire le risque de l’investisseur ou du prêteur. »
Le mode de rémunération fixé par France Brevets est non pas la rémunération à la prestation, mais la participation aux bénéfices. « Nous ne facturons jamais aux entreprises ou aux laboratoires de recherche pour qui nous travaillons, expose M. Jean-Charles Hourcade. Nous convenons en revanche de la part qui nous reviendra sur les revenus futurs. Nous ne sommes donc rémunérés qu’en cas de succès. Nous cherchons une rémunération à même de garantir l’équilibre économique de France Brevets sur l’ensemble de ses opérations : celles couronnées de succès doivent financer celles qui n’ont pas abouti. »
3. Des moyens en personnel pointus
Pour mener sa stratégie, France Brevets s’est dotée d’une équipe d’une quinzaine de personnes réparties en trois catégories réunissant des compétences en matière de technologie, droit des brevets, procédures et économie.
La première catégorie est celle des stratèges. Composant une équipe d’une demi-douzaine de négociateurs seniors, « ils possèdent une double culture, technologique et juridique, à l’instar de la nature du brevet, d’essence hybride, mi-technique, mi-juridique. »
La deuxième est celle des économistes. Leur tâche est de s’attacher à répondre à la question – très difficile – de savoir combien vaut un brevet. « D’un point de vue financier, la valeur d’un brevet correspond à la valeur actuelle nette du flux de redevances futures. Il s’agit ensuite d’appliquer cette définition en établissant des projections du développement du segment de l’industrie concerné dans le futur. »
La troisième traite de la compréhension de l’objet brevet lui-même qui a ses spécificités en tant qu’actif.
M. Jean-Charles Hourcade a insisté sur le fait que tous les collaborateurs de France Brevets ont été recrutés dans l’industrie, sachant « qu’en Europe, les experts pointus dans les domaines qui nous intéressent se comptent sur les doigts de quelques mains. »
C. FRANCE BREVETS ET LES AUTRES OUTILS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE : DES STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES
Le positionnement de France Brevets, société créée par la Caisse des dépôts pour exercer une activité de marché dans un domaine qu’elle a identifié comme un axe de développement pour elle, avec des équipes rompues à ce métier, n’a évidemment aucune raison de s’effectuer dans un cadre conflictuel, ni avec les autres objets du PIA, ni avec les filiales de valorisation des grands organismes de recherche. France Brevets est en effet clairement située en aval des SATT et est avec les organismes de recherche dans une relation d’offre d’affaires.
Sur les rapports entre France Brevets et les SATT, les rapporteurs ont déjà cité Mme Maylis Chusseau, présidente de la SATT Aquitaine Sciences Transfert. M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de France Brevets présente les relations de cette dernière avec cette SATT : « Prenons l’exemple du projet en cours avec l’Université européenne de Bretagne – UEB – et la SATT Ouest. Le métier de cette dernière consiste à transférer la technologie issue de l’UEB vers le premier adoptant ; France Brevets intervient bien plus tard dans le cycle pour valoriser et défendre les droits une fois que la technologie a été massivement adoptée. Un travail de fond sur la constitution du portefeuille est bien sûr nécessaire et c’est ce à quoi nous nous employons de conserve avec la SATT Ouest et l’UEB, autour d’une équipe de recherche de renommée internationale. Il s’agit en l’occurrence des codes correcteurs qui permettent une bonne réception du réseau sur les téléphones portables, et qui relèvent d’une technologie de rupture.
« C’est donc sur la constitution de ce portefeuille de brevets que nous allons travailler dans la durée avec l’UEB, afin que, une fois fournis les efforts de développement et achevé le transfert de technologie par la SATT, nous puissions défendre les droits dans une démarche de licensing.
« L’articulation est par conséquent très naturelle entre la SATT et France Brevets. »
S’agissant des relations avec les organismes de recherche, les informations communiquées à la Mission d’évaluation et de contrôle montrent que celles-ci sont particulièrement apaisées. « Le CNRS, a exposé son président, M. Alain Fuchs, travaille avec la société France Brevets sans souci particulier. Nous avons signé une convention avec elle. Nous avons passé un contrat de licence sur une technologie particulière. Des relations se mettent en place graduellement. Il y a, je pense, complémentarité. »
Le CNES, a indiqué son président, M. Jean-Yves Le Gall, lors de son audition, a lui aussi signé, en 2012, une convention avec France Brevets pour la valorisation de ses brevets liés au programme Galileo.
D. UN NOUVEAU MÉTIER POUR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Dans son rapport sur le lancement du programme des investissements d’avenir relevant de la mission recherche et enseignement supérieur, la Cour des comptes s’est montrée quelque peu inquiète sur l’avenir de France Brevets. « C’est une initiative unique en Europe, qui repose sur un modèle économique difficile à valider aujourd’hui et qui nécessite des investissements importants avant les premiers retours financiers, écrit-elle ; compte tenu du caractère risqué du modèle économique, l’État doit suivre de près cette nouvelle structure qui sera dotée de 50 millions d’euros de crédits des investissements d’avenir. L’investissement devra pouvoir être arrêté si les premiers programmes de « licensing » ne procurent pas les revenus attendus. »
Les rapporteurs voudraient à ce propos rappeler trois éléments.
D’abord, la création de France Brevets est avant tout de l’initiative de la Caisse des dépôts, pour laquelle France Brevets constitue un investissement délibérément de long terme. Les rapporteurs croient ainsi discerner une réelle divergence entre l’analyse de la Cour et la stratégie de la Caisse.
Ensuite, ce type de fonds d’investissement dans la gestion de brevets existe à l’étranger.
Par ailleurs, avec 50 millions d’euros (25 seulement libérés à ce jour) France Brevets constitue pour l’État, au titre du PIA, un risque financier infiniment plus faible que les SATT, ou que d’autres investissements.
Enfin, et surtout, l’industrie connaît bien ce type d’activité, et M. Jean-Charles Hourcade tout particulièrement : « J’ai eu l’honneur de diriger cette activité au sein du groupe Thomson, a-t-il indiqué à la Mission d’évaluation et de contrôle. Grâce à plusieurs décennies de travail et d’investissements patients, il a été possible de générer quelque 400 millions d’euros de redevances par an en moyenne, à partir d’un portefeuille d’environ 7 000 familles de brevets. Philips a la même expérience. Le groupe Ericsson génère pour sa part 1 milliard de dollars par an qui viennent en contribution directe de son budget de recherche et développement. Ce sont là les modèles qui permettent de pérenniser des activités de recherche et développement intenses dans la longue durée. »
À vrai dire, s’agissant du groupe Thomson Multimédia – devenu aujourd’hui Technicolor – ce sont les revenus tirés des brevets gérés par sa filiale Thomson Licensing qui ont assuré sa pérennité jusqu’ici, ces revenus compensant des résultats de ses autres activités souvent beaucoup plus incertains.
Entrant dans le détail du métier, M. Jean-Charles Hourcade précise : « Dès lors qu’un grand programme comme NFC est lancé, c’est-à-dire dès lors que nous avons réuni la masse critique de brevets nécessaire et que le début d’adoption par le marché a eu lieu, il n’y a plus vraiment d’incertitude sur les montants de revenus qui seront générés (…).
« À partir du moment où certains programmes ont passé les seuils de constitution de portefeuille de brevets et où les inventions brevetées ont passé les seuils de l’adoption par les marchés, nous sommes, si je puis dire, dans le domaine de la balistique : si l’on ignore le moment où des revenus seront produits, en revanche, on connaît leur montant. Je me fais fort de communiquer cette conviction aux magistrats de la Cour des comptes »
En conclusion, les rapporteurs considèrent qu’au-delà des 50 millions d’euros prévus par le PIA pour le lancement de France Brevets, cette société est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Il revient donc à la Caisse d’effectuer son travail d’actionnaire et de prendre les décisions qui s’imposeront dans la vie de France Brevets.
II. LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUES : LES IRT, ITE ET INSTITUTS CARNOT
A. LES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
Comme l’introduction à la présente partie l’a mentionné, les huit « Instituts de recherche technologique » (IRT) ont pour objectif, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales, de constituer un nombre restreint de campus d’innovation technologique de dimension mondiale. Ils disposent d’un financement de 1,971 milliard d’euros qui se répartit entre 471 millions d’euros de dotations consommables et 1,5 milliard d’euros de dotations non consommables. On retrouve ainsi le mode de fonctionnement des Idex, dont les IRT sont en quelque sorte le pendant technologique.
1. Des débuts présentés comme encourageants
Les éléments fournis par le « jaune » budgétaire pour 2015 indiquent que les conventionnements ont bien été effectués.
Les IRT sont maintenant entrés dans leur phase de déploiement opérationnel et de suivi par l’État. Les premières réunions de bilan annuel notent la capacité des IRT à attirer de nouveaux partenaires privés et la réalisation très rapide de plates-formes de R&D dont les équipements sont couverts par des apports industriels en numéraire. Des premières réalisations en matière d’ingénierie de formation ont été constatées. Concernant la valorisation de la recherche, des premiers brevets ont été déposés, signal très positif pour des structures nouvellement créées.
L’avancement des IRT permet maintenant d’établir de premiers vrais bilans de leur fonctionnement. Ainsi, a exposé M. Louis Gallois lors de son audition : « Nous avons entrepris d’établir un bilan permettant de savoir lesquels fonctionnent bien ou mal. Ainsi, nous avons invité Bioaster à avancer plus vite et l’avons menacé, dans le cas contraire, de fermer le robinet ».
Ces outils présentent aussi l’avantage de disposer d’homologues dans les pays voisins, comme l’a noté M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement, lors de l’audition de M. Louis Schweitzer : « Les outils créés par le PIA, comme les SATT ou les IRT, se sont progressivement construit une image internationale. Alors que le poids des organismes de recherche constituait une spécificité française, ces outils trouvent souvent leur équivalent dans les pays européens, ce qui facilite les partenariats. L’IRT Jules Vernes de Nantes a ainsi pu signer, en mars dernier, un accord de collaboration internationale avec une Fraunhofer Gesellschaft allemande ». Certains Instituts se seraient déjà pleinement inscrits dans les communautés de la connaissance des Instituts européens de technologie et en deviendraient des acteurs incontournables.
1. Un statut rigide facteur de difficultés
Il reste que le choix d’attribuer la personnalité juridique aux IRT semble avoir créé de réelles difficultés.
« Contrairement au souhait de notre ministère, a exposé le directeur général de la recherche et de l’innovation, M. Roger Genet, et alors que tout le monde convenait qu’on avait trop de structures et que le système était complexe et illisible, il a finalement été décidé de conférer la personnalité morale aux IRT et aux ITE. Cela a beaucoup compliqué les choses, notamment en termes d’aides d’État : il a fallu réaliser des expertises approfondies au regard de la réglementation européenne et de la propriété intellectuelle. »
L’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, précise quelques-unes des difficultés rencontrées : « Le CEA est responsable de certains IRT et ITE, notamment de l’IRT « Nanoélectronique ». Ces instruments ont posé d’emblée des difficultés au CEA, les engagements demandés par le CGI n’étant guère compatibles avec son mode de fonctionnement. Ainsi, le CEA devait transmettre à l’IRT « Nanoélectronique » des droits de propriété intellectuelle et même des équipements, en particulier des grandes salles blanches fonctionnant en continu. Or nous étions déjà engagés avec des partenaires tiers sur l’utilisation de ces salles ». Une fois de plus : « Nous avons donc dû obtenir une dérogation pour l’IRT. D’une manière générale, la mise en place et la gestion des IRT se sont révélées très complexes. (…) Nous avons dû, à chaque fois, jongler avec les règles ou retarder les processus. L’IRT « Jules Verne », dans lequel nous sommes partenaire associé, semble avoir trouvé son point d’équilibre ; il est sans doute celui qui fonctionne le mieux. Les autres IRT où nous sommes impliqués - « SystemX », « Bioaster » – nous ont posé de réelles difficultés. »
Et M. Bernard Bigot de conclure : « D’ailleurs, il n’est pas certain que les industriels soient satisfaits du résultat : plusieurs d’entre eux ont souhaité se désengager compte tenu de la complexité des procédures ; il a fallu les mobiliser à nouveau. »
La situation des dotations des IRT paraît traduire ces difficultés de mise en œuvre : alors que la quasi-totalité de la dotation initiale a été contractualisée, seulement 166 millions d’euros, soit 8,4 % de la dotation contractualisée (1,971 milliard d’euros) avaient été décaissés au 31 juillet 2014. S’ils sont en progression, les décaissements au 31 décembre 2014 ne se montent toujours qu’à 199,2 millions d’euros (10,1 % de la dotation contractualisée).
A. LES INSTITUTS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UNE MISE EN PLACE DIFFICILE
Le lancement des instituts de transition énergétique, équivalents dans ce domaine des IRT, et pour lesquels 1 milliard d’euros de crédits a été prévu, semble avoir été plus difficile encore. Certes, là aussi, les conventionnements sont pour l’essentiel réalisés, puisque 876 millions d’euros (221,4 millions d’euros de dotations consommables et 655 millions d’euros de dotations non consommables) ont été attribués, pour douze ITE.
Il reste que le président du comité de pilotage, M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle que : « Pour les ITE, la nouveauté des actions s’est accompagnée d’un niveau d’exigence qui, s’il s’est révélé positif en matière de structuration, d’ambition économique, a pris un caractère un peu contradictoire, avec une demande de projets innovants mais dont on voulait être sûr qu’ils permettraient un bon retour sur investissement. »
Par ailleurs, poursuit-il, « Si certains projets se sont caractérisés par la part de risque financier prise par des initiateurs bien préparés, d’autres projets ont souffert d’un sous-investissement industriel ».
Au bout du compte, a-t-il exposé : « La création de deux instituts a dû être abandonnée faute de combattants, ou d’une définition pertinente du projet »
M. Louis Gallois a lui aussi exposé ces difficultés : « Nous avons rencontré de grandes difficultés avec les instituts pour la transition énergétique (ITE), dont j’ignore même s’ils sont désormais tous stabilisés et que nous allons suivre de très près. Bon nombre de ces difficultés tenaient à la complexité des procédures européennes, mais aussi à l’affectio societatis : si beau que soit un projet, si chacun tire la couverture à soi, il ne marchera pas. »
Comme dans le cas des IRT, la situation des dotations traduit bien les difficultés de mise en place des ITE puisque seulement 40,3 des 876,4 millions d’euros contractualisés (soit 4,6 %) avaient été décaissés au 31 juillet 2014, montant porté à 62,2 millions d’euros seulement (7,1 %) au 31 décembre 2014.
Dans ces conditions, il convient de suivre d’extrêmement près la mise en place des ITE, et de prendre les mesures qui s’imposent en cas d’échec. Lors de son audition, M. Laurent Michel en a d’ailleurs convenu : « En ce qui concerne les ITE, nous nous tenons à l’objectif que nous avons affiché depuis plusieurs années : rapprocher de manière pérenne – sans toutefois créer des dinosaures administratifs – des consortiums industriels et le secteur public. L’ambition était grande et tous les ITE n’étaient pas prêts. Au bout d’un an de contractualisation, les premiers comités de suivi commencent à se tenir. L’essai reste donc à transformer et nous y veillons de près. »
A. LES INSTITUTS CARNOT : UN PREMIER BILAN DÉCEVANT
Les Instituts Carnot préexistaient au PIA. Ils sont le fruit d’une politique plus ancienne visant à récompenser et soutenir les universités ou les autres établissements publics qui réalisent de la recherche appliquée, en leur attribuant ce qu’on appelle des subventions de ressourcement. Il s’agit de mettre en exergue l’importance de la valorisation par rapport aux autres critères d’évaluation des établissements de recherche que sont, par exemple, les publications.
Au sein du PIA, l’action « Instituts Carnot » vise prioritairement à renforcer de façon pérenne les ressources financières des Instituts Carnot déjà labellisés, à déployer des actions spécifiques visant à développer la recherche contractuelle des instituts Carnot avec les très petites entreprises (TPE), les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et à porter les pratiques de recherche partenariale des instituts Carnot au niveau des meilleurs standards internationaux.
500 millions d’euros de dotations ont été réservés aux Instituts Carnot par le PIA. L’examen du sort de ces dotations montre que des difficultés se sont posées : au 31 juillet 2014, sur ces 500 millions d’euros, 203,7 millions d’euros seulement avaient été attribués, 188,7 millions d’euros (37,8 %) contractualisés et seulement 22 millions d’euros décaissés. « Après une phase de concertation, expose le « jaune » budgétaire pour 2015, « une nouvelle action spécifique pour accroître les collaborations entre recherche publique et PME-ETI dans une logique de filières industrielles a été engagée et fait l’objet d’un appel à projets qui sera clôturé le 30 octobre 2014. »
Lors de l’audition de M. Louis Gallois, alors commissaire général à l’investissement, le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, M. Patrick Lefas, avait plus crûment évoqué « l’échec des instituts Carnot » sur ce point. En réponse, M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique au Commissariat général à l'investissement, avait convenu des difficultés du programme : « Nous avions lancé deux appels à projets pour les instituts Carnot : l’un à l’international et l’autre pour favoriser la relation entre les instituts Carnot et les petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI). Un bilan dressé après cinq ans d’existence faisait apparaître une faiblesse des instituts Carnot sur ces deux plans. Peut-être avons-nous été trop ambitieux en lançant l’appel à projet trop tôt, confirmant ainsi la faiblesse des instituts dans leurs relations avec les PME et ETI. »
Depuis lors, les instituts ont travaillé sous la direction de l’Association des instituts Carnot de façon à se constituer en filières industrielles pour cibler les PME et ETI. Un nouvel appel à projets a été lancé cette année pour permettre aux instituts Carnot, organisés cette fois par filière industrielle, de répondre aux PME et ETI. « Nous espérons qu’ils seront désormais mieux organisés et plus à même de reprendre la balle au bond » a conclu M. Claude Girard.
Les rapporteurs doivent cependant constater que, avec 23,81 millions d’euros au 31 décembre 2014, les décaissements n’ont progressé à cette date que de 1,81 million d’euros par rapport au 31 juillet 2014.
A. DES DÉVELOPPEMENTS À SURVEILLER ET À RETRAVAILLER
L’examen des trois actions du PIA consacrées à la recherche et au transfert technologique laisse les rapporteurs interrogatifs.
Dans son rapport, la Cour des comptes s’est montrée assez sévère sur la mise en œuvre des actions IRT et Instituts Carnot. Sur les IRT, elle note que, conçus pourtant dans la logique d’un co-investissement public-privé, ils ne remplacent aucune des structures préexistantes soutenues par des fonds publics, que leur mise en place s’est trouvée contrariée par des difficultés « sur les plans juridique, managérial et fiscal qui ne sont pas toutes résolues », et que leur modèle est « fortement remis en cause par différents acteurs. »
De même, elle note la gestion peu satisfaisante de l’action « Instituts Carnot » « alors même que l’ambition du programme était de renforcer la recherche partenariale réalisée par ces instituts. »
L’ensemble de ces critiques trouvent leur écho dans les propos tenus par les personnalités auditionnées par les rapporteurs.
On peut, sans doute, au vu des avis recueillis par les rapporteurs, dresser un constat similaire pour les ITE.
Une fois de plus, il semble que la volonté d’aller vite, trop vite, a sa part de responsabilité dans cette situation. Des solutions trop rigides, tenant insuffisamment compte des préoccupations des grands acteurs de la recherche, ainsi que, le cas échéant, la surestimation des capacités des porteurs de projets peuvent y avoir aussi contribué.
« Le retour d’expérience du PIA 1 nous montre encore une fois qu’une caporalisation du système n’est pas souhaitable et qu’il faut laisser de la souplesse aux opérateurs dans la mise en œuvre, même si nous devons avoir un regard acéré sur leurs propositions. » a exposé M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation.
Les dotations initiales de ces trois actions se montent à 3,5 milliards d’euros. En ces temps de contraintes budgétaires, les rapporteurs demandent donc instamment au CGI et au ministère chargé de la recherche d’assurer avec beaucoup de soin le pilotage et le contrôle de l’évolution des projets, de façon à donner à ce qui peut réussir les conditions de souplesse nécessaires, et, le cas échéant, à mettre fin aux projets trop compromis et à envisager le redéploiement de leurs dotations.
QUATRIÈME PARTIE : LES FILIÈRES INDUSTRIELLES
I. DES PROJETS CHOISIS POUR LEUR CARACTÈRE PORTEUR
Outre un dispositif de valorisation des découvertes scientifiques à l’attention de l’industrie, il était logique que le programme d’investissements d’avenir comporte des actions à l’attention de filières industrielles dont le développement repose sur l’excellence scientifique.
Trois de ces filières relèvent de la MIRES : la filière spatiale, la filière aéronautique et la filière nucléaire. La logique de ce rattachement est commandée par la tutelle des crédits de recherche récurrents qui leur sont attribués. Ainsi, les crédits de l’espace figurent au programme 193, géré par le ministère chargé de la recherche, ceux de la recherche aéronautique au programme 190, qui relève du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et ceux de la recherche nucléaire civile au même programme 190 ainsi qu’au programme 172, qui relève du ministère chargé de la recherche.
Les opérateurs du PIA pour ces trois filières sont le CNES pour l’espace, l’ONERA pour la recherche aéronautique et, pour le nucléaire, le CEA, l’ANDRA et l’ANR.
Dotée de 500 millions d’euros, l’action Espace comporte deux volets, consacrés l’un au futur lanceur européen (Ariane 6) et l’autre à trois projets de développement de satellites à forts enjeux applicatifs : la mission franco-américaine SWOT pour l’océanographie opérationnelle et l’hydrologie continentale ; le développement d’une plateforme compétitive de microsatellites, Myriade Evolution, notamment pour le marché à l’export des satellites d’observation de la terre à haute résolution ; et un projet de Satellite du futur préparant une nouvelle génération de plateformes compétitives, destinées en particulier aux satellites géostationnaires de télécommunication.
La convention entre l’État et le CNES a été signée le 5 août 2010. Elle a été remplacée par celle du 18 juin 2014 pour intégrer le projet de satellite à propulsion électrique – les plateformes actuelles doivent en effet être adaptées à la propulsion tout électrique – et l’augmentation du volume sous coiffe d’Ariane 5. Cinquante millions d’euros supplémentaires sont prévus pour ce qui constitue l’un des trente-quatre projets de la Nouvelle France industrielle.
Hors MIRES, le projet Très haut débit par Satellite, dit « THD Sat » a fait l’objet d’un contrat entre le CNES et la Caisse des dépôts et consignations, opératrice de l’action pour le développement de l’économie numérique du PIA. Enfin, toujours au titre du PIA mais hors du champ de la MIRES, le CNES travaille sur la composante spatiale optique de la prochaine génération de satellites d’observation militaire Musis.
A. LE PROGRAMME RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L’AÉRONAUTIQUE
Doté de 1,5 milliard d’euros, le programme Recherche dans le domaine de l’aéronautique comporte également deux volets, le volet « Aéronef du futur » et le volet « Démonstrateurs technologiques aéronautiques ». La convention entre l’État et l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales) a été signée le 29 juillet 2010 et modifiée par avenant du 20 mai 2011. De par leurs compétences dans le domaine, la DGAC (direction générale de l’aviation civile) et la DGA (direction générale de l’armement) apportent leurs expertises à l’opérateur.
Le volet « Aéronef du futur » est le volet le plus en aval. Il consiste en un soutien sous forme d’avances remboursables aux programmes d’avions et d’hélicoptères de nouvelle génération (l’Airbus A350 XWB et l’hélicoptère X4). Devrait s’y ajouter le nouveau cœur de turbine aéronautique TPH (Turbo-Propulseur Hybride). Un montant de 700 millions d’euros a été attribué à ce volet.
Le volet « Démonstrateurs technologiques » est le plus en amont. Ces démonstrateurs, au nombre de six, ne sont liés à aucun aéronef précis – ils concernent par exemple l’usine du futur, l’avion composite du futur, l’avionique du futur. Sur ce volet, les financements du PIA interviennent sous forme de subventions. Les démonstrateurs ont reçu une dotation de 766 millions d’euros.
A. LE PROGRAMME NUCLÉAIRE DE DEMAIN
Le programme Nucléaire de demain comporte quatre actions.
Le programme de réacteur de quatrième génération ASTRID – Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration, dont la convention a été signée le 9 septembre 2010, – a pour objectifs la poursuite des progrès en compétitivité et en sûreté atteints sur les réacteurs à eau de génération III, une forte économie des ressources en uranium, la minimisation de la production de déchets radioactifs et enfin une plus grande résistance à la prolifération nucléaire.
Une partie de la dotation initiale de 651,6 millions d’euros, (25 millions d’euros) a été redéployée pour financer, suite aux événements survenus à Fukushima, une action spécifique de soutien à la recherche en matière de sûreté nucléaire.
Le réacteur de recherche Jules-Horowitz (RJH), dont la convention a été signée le 14 juillet 2010, et en cours de construction sur le centre du CEA de Cadarache, est un réacteur de recherche dédié aux études de comportement sous irradiation des combustibles et des matériaux pour les différentes générations de réacteurs nucléaires (génération 2, génération 3, systèmes du futur). Outre ses capacités de qualification de combustibles et matériaux, il permettra, dans un contexte de rareté de l’offre, de produire des radionucléides utilisés par le secteur médical – notamment les éléments de diagnostic au technétium 99m. Il pourra subvenir à 25 % en moyenne annuelle des besoins de l’Union européenne, voire temporairement à 50 %.
Le RJH assurera la relève du parc européen de réacteurs de test sous irradiation, actuellement vieillissant. Il a ainsi vocation à devenir un pôle d’attraction à l’échelle européenne en matière de soutien aux performances et d’amélioration de la sûreté de l’industrie nucléaire.
Un budget initial de 250 millions d’euros a été attribué au RJH. Comme l’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, l’a exposé à la Mission d’évaluation et de contrôle, le RJH a connu un retard important, pour des raisons liées notamment à la conception et à la fabrication du bloc-pile, engendrant de réels surcoûts. La fin de sa construction est désormais prévue pour la fin de l’année 2019.
L’action Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs a pour objets d’une part la mise en place de filières de valorisation pour les déchets métalliques très faiblement radioactifs issus du démantèlement d’installations nucléaires, et de l’autre la mise au point de procédés ou de technologies innovantes de traitement des déchets radioactifs chimiquement réactifs, en vue de faciliter leur stockage. L’opérateur de cette action est l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Jusqu’ici, un seul projet a été contractualisé, avec AREVA NC, pour le développement d’un procédé d’incinération-vitrification (PIVIC) des déchets contaminés en émetteurs alpha,. Ce projet implique aussi le CEA.
Une partie de la dotation initiale de 100 millions d’euros (25 millions d’euros) a, là aussi, été redéployée pour financer, suite aux événements survenus à Fukushima, une action spécifique de soutien à la recherche en matière de sûreté nucléaire.
Enfin, l’action Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (RSNR), lancée par le Gouvernement, toujours à la suite de l’accident de Fukushima, a pour objet de relancer la R&D sur les problématiques d’accidents graves. De nouvelles pistes sont explorées afin de garantir l’absence de radioactivité à l’extérieur des sites nucléaires en toutes circonstances. Des recherches sont notamment effectuées sur la mitigation des effets de la fusion du cœur et sur les diagnostics utiles à la gestion de crise. Les résultats des études conduites devraient notamment permettre de rapprocher le référentiel de sécurité des réacteurs de deuxième génération de celui des réacteurs de troisième génération. Ils seront également utiles au développement de nouveaux modèles de réacteurs.
Cette action, dont l’opérateur est l’ANR, est dotée de 50 millions d’euros ; 49,6 millions d’euros de dotations consommables ont été attribués, et 21 projets acceptés.
I. DES FINANCEMENTS DISCRIMINANTS
A. DES DOTATIONS RAPIDEMENT AFFECTÉES
Le tableau ci-après récapitule les financements attribués aux trois filières industrielles relevant de la MIRES.
Les dotations initiales se montent à 3 milliards d’euros, réparties entre 500 millions d’euros pour l’espace, 1,5 milliard d’euros pour la filière aéronautique et 1 milliard d’euros pour la filière nucléaire. Ces dotations sont toutes composées de crédits consommables. Au 31 juillet 2014, les attributions avaient été effectuées pour 2,91 milliards d’euros, soit97 % des dotations prévues. La somme de 1,27 milliard d’euros avait déjà été décaissée, représentant plus du tiers des dotations prévues.
CRÉDITS CONSACRÉS AUX FILIÈRES INDUSTRIELLES (au 31 juillet 2014)
(en millions d’euros)
Opérateur |
Dotation | ||||
initiale |
attribuée |
contractualisée |
décaissée | ||
Filière spatiale | |||||
Espace |
CNES |
500 |
500 |
284,7 |
198,1 |
Filière aéronautique | |||||
Recherche dans le domaine de l’aéronautique dont « Aéronef du futur » dont « Démonstrateurs technologiques aéronautiques » |
ONERA |
1 500 |
1 466 700 766 |
1 184,9 596 588,9 |
689,6 499,7 189,9 |
Filière nucléaire | |||||
Réacteur de 4ème génération ASTRID |
CEA |
625(1) |
626,6 |
(626,6) |
230 |
Réacteur Jules Horowitz |
CEA |
250 |
248,4 |
(248,4) |
137,2 |
Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs |
ANDRA |
75(1) |
19,7 |
19,7 |
5,9 |
Recherche en matière de sûreté nucléaire |
ANR |
50 |
49,6 |
49,6 |
4,9 |
Total filière nucléaire |
1 000 |
944,3 |
(944,3) |
378 | |
Total filières industrielles |
3 000 |
2 910,3 |
(2 413,9) |
1 265,7 | |
Les dotations sont exclusivement composées de dotations consommables.
(1) Après prélèvement de 25 millions d’euros pour constituer la dotation de l’action « Recherche en matière de sûreté nucléaire ».
Source : Commission des finances, d’après les données du rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir, annexés aux projets de loi de finances (« jaunes »).
Les décaissements se poursuivent : au 31 décembre 2014, ils étaient passés à 1,65 milliard d’euros, soit plus de la moitié des dotations prévues, grâce notamment à une progression de 325 millions d’euros des décaissements en faveur de la recherche aéronautique, qui atteignent désormais 1,01 milliard d’euros (les deux tiers des dotations prévues). Autrement dit, les actions du PIA sont rondement conduites par les acteurs des filières industrielles.
A. DES FINANCEMENTS EN SUPPLÉMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES
L’impact positif du PIA sur le développement des projets identifiés par les filières et ainsi financés est évident.
L’administrateur général du CEA, M. Bernard Bigot, a ainsi exposé que : « Si ces moyens issus du PIA n’avaient pas été attribués au CEA, les projets ASTRID et RJH n’auraient tout simplement pas pu être mis en œuvre. »
M. Thierry Michal, directeur technique général de l’ONERA, a formulé les mêmes constatations pour le domaine de l’aéronautique : « Mon expérience de terrain m’amène à considérer que des projets (de démonstrateurs) de l’ampleur d’EPICE (Engin Propulsif Intégrant des Composantes Environnementales) ou de l’avion composite n’auraient pas pu être menés dans un délai aussi resserré en s’appuyant sur les seuls financements, récurrents et annuels, dévolus à la DGAC – et ce même dans ses années les plus fastes. »
Dans le domaine spatial, l’analyse est la même. À l’un des rapporteurs lui demandant comment il aurait pu procéder sans les financements du PIA, le président du CNES, M. Jean-Yves Le Gall, a ainsi répondu : « Nous n’aurions pas trouvé de financements équivalents. En passant par des crédits budgétaires classiques, un financement spécifique aurait au mieux connu une lente montée en puissance sur plusieurs années. Les 500 millions du programme d’investissement d’avenir représentent une masse de manœuvre sans égale dans le domaine spatial. »
Et M. Le Gall de préciser : « Le PIA ne permet d’abonder le budget du CNES que de moins de 10 % par an. En revanche, pour les projets ciblés éligibles au PIA, cet abondement est crucial car nous n’avons pas dans notre budget les lignes correspondantes. »
Plus généralement, le directeur général de l’énergie et du climat, M. Laurent Michel, a pu conclure en ces termes : « certains domaines, sans le PIA, se trouveraient dans une impasse. »
1. Les avances remboursables de l’Airbus A350 XWB : un cas spécifique
Un cas de substitution des crédits du PIA a été cependant parfois mis en avant : celui du financement de l’Airbus A 350 XWB.
En effet, le protocole d’accord entre l’État et la société Airbus relatif à ce programme ayant été signé six mois avant l’adoption de la loi instaurant les PIA, le soutien à l’A350 était alors uniquement du ressort du programme 190 en titre 7.
L’inscription au PIA de ce programme a entraîné un mode de financement spécifique : alors que le financement des autres programmes n’apparaît plus dans les lois de finances annuelles, celui de l’A 350 est assuré par l’abondement annuel du programme 190 depuis le PIA par la voie d’un fonds de concours. Dans son rapport, la Cour des comptes a considéré que ce mode de financement officialisait l’effet de substitution des investissements d’avenir.
Cependant, lors de son audition, le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil, a soutenu la position exactement inverse : c’est faute d’un financement adapté qu’il avait d’abord été recouru à des crédits budgétaires : « Le projet aurait été pris en charge par un PIA s’il avait été décidé un ou deux ans plus tard : sa nature est en effet analogue à celle de l’hélicoptère X4 ou X6. (…) Des autorisations d’engagement ont permis de lancer le projet et 30 millions de crédits de paiement budgétaires ont été trouvés la première année. Mais il fallait atteindre la somme de 1,4 milliard : j’ai donc été soulagé par l’arrivée du PIA ! »
En tout état de cause, s’agissant d’avances remboursables, l’utilisation du PIA paraît justifiée aux rapporteurs : le recours au PIA a permis de sécuriser le financement de l’A 350 XWB sur la durée contractuelle prévue. Ce qui peut paraître plus curieux, c’est que le versement des fonds continue à passer par le budget annuel. Mais la cause la plus vraisemblable est sans doute celle-ci : « Si le dispositif du fonds de concours a été maintenu, c’est dans le dessein de ne pas avoir à réviser entièrement le dispositif contractuel : c’était la solution la plus simple », a également exposé M. Patrick Gandil.
L’affaire paraît ainsi relever, aux yeux des rapporteurs, beaucoup plus de questions de procédure que d’une question de fond.
II. DES SPÉCIFICITÉS LIÉES À L’ORGANISATION DES FILIÈRES
A. DES FILIÈRES TRÈS BIEN STRUCTURÉES
Les trois filières industrielles relevant de la MIRES concernées par des financements au titre du PIA présentent une particularité commune : leur très forte structuration.
Ainsi, la filière nucléaire française n’est composée que d’un petit nombre d’acteurs. Le CEA y tient une place historique. Sa place dans la détermination des axes de travail de recherche de la filière nucléaire est bien connue.
De même, le CNES structure la recherche spatiale française, et même européenne. La décision récente de l’Union européenne de financer le lanceur Ariane 6 est l’aboutissement d’un long travail de conviction du CNES, d’autres partenaires de l’Agence spatiale européenne ayant plutôt préconisé des évolutions du lanceur Ariane 5.
Enfin, la structuration de la filière aéronautique n’est plus à démontrer. Elle s’appuie sur un syndicat professionnel très actif, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Il faut également souligner le rôle d’une structure consultative mise sur pied avant les PIA, le Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC), qui associe services de l’État (DGAC, DGA, DGCIS), grands industriels, transporteurs aériens, contrôle aérien – la DGAC – et aéroports. M. Louis Gallois a pu exposer à la Mission d’évaluation et de contrôle que : « Avec un syndicat professionnel (le GIFAS), un Conseil pour la recherche aéronautique civile française (CORAC), qui réunit tous les acteurs et qui a l’efficacité d’un véritable bulldozer, et avec l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), l’industrie aéronautique est unie et déterminée. Elle s’est dotée de programmes et sa capacité à déposer des dossiers n’est plus à démontrer. »
La structuration de ces trois filières a abouti à une première particularité au sein des procédures du PIA : l’absence d’appels à projets ouverts et soumis à des jurys internationaux.
A. L’ABSENCE D’APPELS À PROJETS SÉLECTIONNÉS PAR DES JURYS
Cette absence d’appels à projets vaut pour l’action « Espace », les actions de recherche aéronautique et les deux actions confiées au CEA, ASTRID et le RJH. Seules les actions « Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » et « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection », correspondant à 10 % des dotations attribuées à la filière nucléaire, ont donné lieu à appels à projet en bonne et due forme.
Inversement, non seulement le projet de réacteur Jules Horowitz n’a pas été soumis à compétition, mais il était dans les cartons du CEA depuis 2005.
S’agissant de l’industrie aéronautique : « La façon dont notre industrie aéronautique est structurée et organisée lui a permis de proposer rapidement des projets en phase avec les préoccupations des autorités publiques et des utilisateurs » a indiqué le président-directeur-général de l’ONERA, M. Bruno Sainjon.
Et, de fait, « Cette structure (le CORAC) avait identifié le besoin de produits destinés à éviter les risques considérables que génère la construction sans étapes intermédiaires d’aéronefs très innovants. Les démonstrateurs technologiques – puisque tel est le nom de ces produits – ont émaillé toute l’histoire de l’aviation. Or, aucun financement n’était prévu à cette fin. L’arrivée des PIA a résolu ce problème » a indiqué le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil. On ne saurait expliquer plus clairement que, même s’il a existé « en interne à chaque projet, un appel d’offres pour sélectionner les meilleurs contributeurs » (M. Bruno Sainjon), c’est bien l’industrie elle-même qui a fixé le type de recherche sur lequel devaient porter les financements du PIA.
« En résumé, conclut M. Patrick Gandil, le CORAC identifie le besoin en démonstrateurs, le programme d’investissement d’avenir prend en charge leur financement et le comité de pilotage suit le développement de leurs programmes. »
En ce qui concerne l’action Recherche dans le domaine de l’aéronautique, dont l’opérateur est l’ONERA, l’instruction des projets, déposés par les industriels, est effectuée par une « équipe programme mixte » composée de la DGAC, de la DGA et de l’opérateur de l’action, l’ONERA. Selon M. Thierry Stoltz, directeur des affaires économiques et financières à l’ONERA, « une fois achevée, l’instruction est présentée au CGI : le CGI conduit alors des échanges avec l’équipe programme mixte, mais aussi directement avec les industriels ; le CGI peut au passage s’assurer aussi de l’indépendance de l’équipe programme mixte. »
« Une fois la décision prise, la contractualisation est effectuée directement entre les industriels et l’équipe programme mixte. La convention entre l’État et l’opérateur prévoit cependant une information préalable du CGI lorsque la convention dépasse un certain montant. »
Enfin, c’est le CNES lui-même qui a déterminé les projets prioritaires à financer dans le domaine spatial.
A. L’ABSENCE DE RECOURS À LA CHAÎNE DE VALORISATION INSTAURÉE PAR LE PIA
Cette structuration a aussi rendu inutile dans ces filières le besoin de structures de valorisation.
Les démêlés du CEA avec les SATT ont été exposés en troisième partie du présent rapport. Le CEA n’est partenaire que de deux SATT. Les industries spatiale et aéronautique, elles, n’ont presque pas établi de liens avec celles-ci.
« Dans le secteur aéronautique français, a exposé M. Pierre Moschetti, sous-directeur de la construction aéronautique à la direction générale de l’aviation civile, le transfert de la recherche publique vers le privé est aussi ancien que l’aéronautique elle-même. Il existe depuis des décennies des liens très structurants de transfert de technologie entre certaines écoles et les grands groupes. Il en est de même du secteur spatial ou des autres secteurs très technologiques : proposer des orientations à la recherche publique leur permet de diminuer le poids financier et humain de la recherche à conduire en propre. (…) Même des PME réussissent à monter des projets partenariaux de transferts de technologies avec des laboratoires qui gravitent autour d’elles. L’aéronautique n’a donc pas besoin, contrairement à d’autres secteurs, d’une action publique volontariste visant à marier les secteurs public et privé. »
De fait, si le CNES est partie prenante de la société Toulouse Tech Transfer, c’est, selon M. Thierry Duquesne, directeur de la prospective, de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des relations internationales du CNES, parce que cette SATT « est précisément destinée à favoriser le transfert de technologies développées dans le secteur spatial vers d’autres secteurs – des secteurs où le CNES n’est pas présent – », le CNES disposant par ailleurs de sa propre structure de valorisation.
De même, M. Louis Gallois a indiqué que les secteurs spatial et aéronautique n’avaient pas besoin de CVT.
En revanche, ces secteurs s’intéressent à certains IRT, comme celui de Nantes sur les composites. Il existe également un IRT dédié à l’aéronautique et au spatial. « Dans le domaine de l’aéronautique, a exposé M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique au CGI, nous nous sommes, en outre, assurés que (…) les IRT soient en cohérence avec la politique nationale définie par le CORAC. »
I. DES RÉSULTATS DÉJÀ POSITIFS
A. UN EFFET DE LEVIER RECHERCHÉ ET OBTENU
Il n’était pas attendu seulement du versement des crédits du PIA la production de nouveaux résultats de recherche ; Il en était aussi attendu des effets de levier et un retour sur investissement.
Les premiers éléments disponibles indiquent que l’effet de levier attendu est bien là, pour l’ensemble des actions.
Ainsi, expose M. Bernard Bigot, les financements du PIA représentent moins de 50 % des projets ASTRID et RJH ; cependant « ils ont eu un effet de levier très utile pour mobiliser d’autres financements apportés par des partenaires industriels ou internationaux, ainsi que des crédits budgétaires apportés par le CEA lui-même. »
Selon le « jaune » budgétaire pour 2015, au 31 juillet 2014 les cofinancements se montaient déjà à 176 millions d’euros, soit 120 millions d’euros de ressources de l’opérateur (le CEA) et 56 millions d’euros du secteur privé. Lors des réunions des comités de suivi, le CEA rend compte des collaborations industrielles mises en place. Celles-ci font l’objet d’un indicateur : le « taux de participation des partenaires au financement du projet ASTRID ». La valeur cible pour cet indicateur avait été fixée à 30 % à la fin de la première phase de l’avant-projet sommaire (AVP1), avec un minimum de 20 %. Selon M. Bernard Bigot, « Le taux effectivement atteint a été de 28 %, chiffre présenté au comité de suivi de décembre 2013. Le CEA a donc dépassé le minimum requis et s’est approché de l’objectif ambitieux qui lui avait été assigné. »
Les co-financements du réacteur Jules-Horowitz sont plus élevés encore puisque, toujours au 31 juillet 2014, le CEA y investit 282 millions d’euros et des opérateurs privés 315 millions d’euros. Il est vrai que le RJH s’inscrit dans le cadre d’une opération conclue avec des partenaires internationaux. Toujours selon le « jaune », les cofinancements déjà acquis pourront être complétés, pour la production de radionucléides, « par des acteurs privés du domaine médical à l’issue de l’affermissement du modèle économique correspondant. »
L’action « Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs », dont l’opérateur est l’ANDRA, fait également l’objet de cofinancements : un accord prévoit un financement de 43,85 millions d’euros répartis entre l’ANDRA, AREVA – qui contribueront chacune à hauteur de 19,7 millions, soit 45 % du total – et le CEA – qui apportera 4,4 millions, soit 10 % du total.
Enfin, toujours selon M. Bernard Bigot, les conditions du financement par le CGI de l’action « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » (RSNR) du PIA – dotation de 50 millions d’euros au total, assortie d’une exigence de cofinancement de 40 % par projet de la part de leurs bénéficiaires – ont « joué un rôle de levier important pour relancer la R&D sur les problématiques d’accidents graves, qui était en baisse régulière depuis plusieurs années. »
S’agissant de l’espace, selon le « jaune », les ressources internationales publiques représentent 827 millions d’euros de cofinancement, les entreprises privées 74 millions d’euros et le CNES 259 millions d’euros ; soit au 31 juillet 2014 un total de 1,16 milliard d’euros pour un investissement au titre du PIA de 500 millions d’euros.
Enfin, toujours au 31 juillet 2014, alors que 689,6 millions d’euros avaient été décaissés au titre du PIA pour le programme de recherches aéronautiques, l’apport du privé représentait déjà 2,2 milliards d’euros.
On ne peut donc que conclure à la réussite du volet du PIA relatif aux filières industrielles en matière d’effet de levier.
A. DES CONSÉQUENCES POSITIVES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
Le premier objectif du financement de la recherche industrielle par le PIA est le développement, grâce à l’accroissement de leur excellence, des filières ainsi aidées.
En matière spatiale, selon le président du CNES, M. Jean-Yves Le Gall, « les projets financés dans le cadre du programme d’investissement d’avenir ont déjà apporté des résultats positifs substantiels. »
Premièrement, a-t-il poursuivi, « le PIA a permis à la France non seulement de financer les travaux préparatoires autour d’Ariane 6 » mais aussi de « bien positionner son industrie par rapport à la concurrence allemande ou italienne en prévision du lancement de celle-ci ». Or, le 2 décembre 2014, le conseil de l’Agence spatiale européenne, réuni au niveau ministériel à Luxembourg, a donné le coup d’envoi au projet.
Évoquant ensuite le projet de satellite SWOT, élaboré en partenariat avec la NASA, qui « permettra de pérenniser la filière industrielle d’altimétrie (et d’océanographie) française » et « ouvrira de fortes perspectives de développement en région toulousaine à l’ensemble des entreprises de la filière océanographique », M. Jean-Yves Le Gall a estimé que : « Sans les budgets ouverts par le programme d’investissement d’avenir, le projet SWOT n’aurait pas pu exister. La NASA n’aurait pas noué un partenariat avec le CNES pour lancer SWOT. Elle se serait alliée avec des acteurs d’autres pays, ou encore le projet serait resté exclusivement américain. »
Ensuite, « en finançant le projet Myriade Evolution », évolution de la plateforme Myriade, qui, conçue pour de petits satellites, « menaçait d’être surclassée par la concurrence », « le PIA a rendu (à celle-ci) la compétitivité qu’elle était en train de perdre ».
Au-delà des montants fournis par le PIA, M. Jean-Yves Le Gall a insisté sur la rapidité d’action permise par les procédures d’attribution des crédits du PIA. Il a ainsi exposé à propos d’Ariane 6 que : « Ce financement a apporté des crédits supplémentaires, qui ont le double mérite d’être ciblés et rapides à mobiliser. Ainsi, l’année dernière, le recours au PIA a permis de pallier aux difficultés de financement du programme Ariane 6. »
À ce propos, il a également cité le projet « Satellite du futur ». « En ce domaine aussi, la concurrence réagit très vite, notamment aux États-Unis. Des budgets peuvent être mobilisés en quelques semaines, voire en quelques jours. Nous avons connu de fortes alertes (…) : grâce aux financements accordés par la NASA ou par le département américain de la défense, Space Systems/Loral et Boeing taillaient déjà des croupières à des industriels européens tels que Thales Alenia Space ou Airbus Defence and Space, parce qu’ils avaient développé des satellites à propulsion électrique (...)
« Le PIA a permis de mobiliser, en seulement quelques semaines, 50 millions d’euros pour développer, en matière de satellites à propulsion électrique, une offre capable de faire pièce à la concurrence américaine, devenue inopinément très offensive dans ce secteur, et de faire repartir l’activité de nos maîtres d’œuvre de satellites de télécommunication, revenus ainsi au niveau mondial. »
« Dans tous ces cas, a-t-il conclu, le PIA, par sa réactivité et par son fléchage précis, a permis d’obtenir, en seulement deux ou trois ans, des résultats très encourageants. »
Dans le domaine aéronautique, les interlocuteurs de la Mission d’évaluation et de contrôle ont d’abord rappelé le rôle d’entraînement bien connu des avances remboursables : « ce dispositif, qui joue donc un rôle d’amorçage et « s’autorembourse », a permis de financer la recherche et d’aider des industriels à lancer des aéronefs dont la fabrication assure une activité économique considérable et des emplois nombreux » a indiqué M. Patrick Gandil, qui avait préalablement rappelé que l’industrie aéronautique était : « un vecteur de souveraineté et un gisement d’emplois. Cette activité économique génère un chiffre d’affaires annuel de 30 milliards d’euros et apporte une contribution de plus de 20 milliards d’euros par an à la balance commerciale. Elle devrait être durablement favorable à l’industrie nationale puisque les analystes s’accordent sur une prévision de croissance du trafic aérien mondial d’environ 5 % par an sur les vingt prochaines années. »
Mais certains ont aussi insisté sur l’effet structurant du PIA pour l’industrie. Le directeur technique général de l’ONERA M. Thierry Michal, a insisté sur ce point : « À mon sens, le PIA a structuré un premier effort conduit par l’industrie, à travers le CORAC, pour harmoniser les programmes de recherche des industriels et mettre en évidence les thématiques sur lesquels il fallait qu’ils se concentrent. Par exemple, ce qui a été fait au niveau de la plateforme EPICE (Engin Propulsif Intégrant des Composantes Environnementales) sous forme d’une collaboration entre Safran et Airbus, sur des thématiques sur lesquelles ces sociétés n’étaient pas forcément si enclines à collaborer, a créé la base d’une force française relativement efficace dans l’organisation des projets et la définition des feuilles de route. »
« En poussant les industriels à créer des co-projets et en leur donnant la possibilité d’acquérir des habitudes de travail en commun, au lieu de conduire des actions plus limitées, où un industriel allait discuter seul avec la DGAC, le PIA a vraiment créé un effet de masse. »
Enfin, a-t-il conclu « Il y a vraiment, désormais, une véritable action, tout à fait efficace, d’animation de la filière, en particulier pour sa R&T, sous l’égide du CORAC. Par l’importance des moyens qu’il a octroyés d’un seul coup, le PIA a indéniablement créé un effet de levier en ce sens. »
M. Bernard Bigot a lui aussi évoqué les effets d’ores et déjà positifs du PIA, tant en termes de structuration de l’industrie nucléaire et de leadership de la France dans ce domaine, que d’emploi : « Les investissements dans le projet ASTRID ont un impact direct en termes d’emploi : en 2013, près de 500 équivalents temps plein étaient liés à l’ingénierie et à la recherche et développement sur ce projet. »
Quant au RJH : « Le RJH assurera la relève du parc européen de réacteurs de test sous irradiation, actuellement vieillissant. Il deviendra ainsi un pôle d’attraction à l’échelle européenne en matière de soutien aux performances et d’amélioration de la sûreté de l’industrie nucléaire. C’est pourquoi il continue d’attirer de nouveaux partenaires internationaux, avec lesquels le CEA est en négociation. Et ce malgré ses difficultés » ; en effet, en dépit de l’annonce du report de l’entrée en divergence du réacteur de 2014 à l’automne 2019, « les membres du consortium – qui se sont réunis le 8 avril dernier – ont tous accepté de poursuivre leur implication dans le projet dans les mêmes termes. »
A. L’ATTENTE RAISONNABLE DE RETOURS SUR INVESTISSEMENT
Enfin, si l’objectif premier des financements du PIA est le développement des filières industrielles financées à travers l’excellence, certaines réalisations doivent donner lieu de surcroît à retour sur investissement.
Il en est ainsi du réacteur ASTRID. Comme l’expose M. Bernard Bigot : « Le retour pour l’État sur les investissements dans le projet ASTRID ne pourra être apprécié que sur le long terme, en fonction des perspectives de développement du démonstrateur industriel et, in fine, de la filière. » Il reste que : « Au cours de la deuxième phase de l’avant-projet sommaire (AVP2), entre 2013 et 2015, le CEA doit définir un dispositif de rémunération de l’État par les industriels sur l’exploitation future des résultats des études ASTRID. En d’autres termes, les industriels s’engagent à ce qu’il y ait un retour au profit de l’État s’ils déploient ces technologies. »
Les projets de l’action « Aéronefs du futur » ont fait l’objet quant à eux d’un soutien sous forme d’avances remboursables, portant intérêt. Le taux d’intérêt retenu est conforme aux exigences européennes et en ligne avec les taux consentis sur les projets antérieurs négociés.
Si le retour pour l’État dépendra du succès commercial des projets aidés - et ne débutera au mieux qu’à partir de 2017 –, le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil a tenté d’établir pour la Mission d’évaluation et de contrôle un bilan de cette forme de soutien public sur le long terme. : « Toutes les opérations n’ont pas été réussies. À titre d’exemple, l’A340 n’a pas remboursé toutes les avances reçues : dernier quadrimoteur dans sa catégorie, cet appareil fut un échec commercial, sa naissance ayant coïncidé avec l’autorisation de la traversée de l’Atlantique en bimoteur, dont a pleinement profité le Boeing 777, premier bimoteur dans sa catégorie. En revanche, certaines opérations ont été remboursées bien au-delà des avances qui avaient été consenties, en raison des royalties qui s’y attachent – je pense à l’Airbus A320 ou au moteur CFM56. Au total, le bilan financier des avances remboursables est excédentaire. Cet excédent a permis de financer la presque totalité des subventions de recherche aéronautique. »
Enfin, dans le domaine spatial, le projet « satellites du futur », porté par un consortium d’industriels, a donné lieu à la mise en place d’un retour financier vers l’État sous forme de redevances à verser en cas de succès technique et commercial du projet. Les conditions de retour vers l’État ont été définies suite à l’analyse effectuée par le CNES et le comité de suivi et d’évaluation des plans d’affaire présentés par le consortium industriel. Selon le « jaune » budgétaire pour 2015, les premiers retours pourraient intervenir à partir de 2025.
I. LES LIMITES DES CHOIX OPÉRÉS
A. DES FINANCEMENTS TROP CENTRÉS VERS L’AVAL ?
Si le premier bilan qui peut être dressé de l’emploi des financements du PIA relevant de la MIRES dans les filières industrielles est ainsi indiscutablement positif, l’attention de la Mission d’évaluation et de contrôle a cependant été attirée sur le déséquilibre qui avait ainsi été créé au détriment de la recherche la plus en amont, remarque qui vaut surtout pour la filière aéronautique.
« Au 31 mars 2014, sur les 1,5 milliard d’euros de dotation de l’action « Aéronautique », 1,185 milliard avait été contractualisé avec les porteurs de projet. Hors programme A350, qui constitue l’essentiel de ce montant, 121,5 millions d’euros sont alloués à des prestations extérieures, lesquelles sont réalisées à 87 % par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PMI. Par ailleurs, 4,7 % du financement est allé vers des laboratoires de recherche académiques ; cela constitue un faible pourcentage par rapport aux autres actions du PIA. », a indiqué le président-directeur général de l’ONERA, M. Bruno Sainjon.
S’agissant de l’ONERA lui-même, M. Jacques Lafaye, chargé de mission auprès du président-directeur général, a précisé que : « Le montant d’activités de l’ONERA lui-même, non plus comme opérateur mais cette fois comme centre de recherche, prévu au titre de cette partie aéronautique du PIA 1 n’est que de l’ordre de 7 millions d’euros. Compte tenu de notre spécialisation cela peut sembler assez faible, et encore plus quand on sait que la nature de notre recherche est souvent moins académique que celle des laboratoires académiques. »
Et M. Lafaye d’expliquer ensuite que tout cela est assez logique : « Les projets de démonstrateurs du PIA 1 se situent à des niveaux de TRL (5) relativement élevés puisqu’un des souhaits du CGI est que les actions labellisées au titre du PIA se retrouvent clairement à moyen terme dans des produits : ces démonstrateurs ont vocation à programmer de manière très directe des produits qui seront intégrables à de nouveaux avions ou de nouveaux hélicoptères. Dans ces conditions, la part dévolue à la recherche fondamentale académique ne peut qu’être relativement faible. »
Le président du CNES, M. Jean-Yves Le Gall, a du reste en quelque sorte validé cette analyse : « La mise en œuvre des crédits du PIA s’apparente à celle des crédits de politique industrielle autrefois utilisés au ministère de l’industrie, lorsque j’y ai commencé ma carrière. Dès le lancement du projet, des retours étaient attendus, ce qui justifiait par compensation une mobilisation rapide des crédits. »
A. UN RISQUE À LONG TERME POUR L’EXCELLENCE
Le choix de privilégier la partie la plus en aval de la recherche amont n’est cependant pas sans risque pour l’excellence à long terme.
M. Thierry Michal, directeur technique général de l’ONERA, a attiré l’attention de la Mission d’évaluation et de contrôle sur ce point : « L’organisation en termes de grands programmes, de grands démonstrateurs, avec des échéances calendaires qui exigent des responsables des projets qu’ils déterminent très en amont les technologies qu’ils vont retenir dans leur feuille de route, conduit à faire des choix, et éventuellement des impasses, sur des technologies qui mériteraient de continuer à être développées mais pour lesquelles les outils commencent à manquer. » Autrement dit, l’angle de travail adopté, s’il a produit d’excellents résultats, a amené à négliger de financer des recherches plus hasardeuses, mais donc certaines seront peut-être à la source des technologies les plus prometteuses et les plus structurantes de demain.
Le Gifas lui-même, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales s’est inquiété de la situation ainsi créée. M. Thierry Michal a poursuivi : « Un rapport sur les modalités de soutien à la R&T élaboré l’an dernier par le Gifas (…) a conclu que l’organisation en mode démonstrateur, certes efficace et efficiente, conduit de fait, à la fin, à laisser de côté un certain nombre de technologies. Comme elles ne trouvent pas leur aboutissement dans le calendrier de la feuille de route lorsqu’on les y insère, elles ne sont, de ce fait, même pas initiées. En commun accord, toutes les parties prenantes de ce groupe de travail sur la R&T, qui réunissait les industriels du Gifas, ont considéré que, indépendamment des projets, il faudrait essayer de consacrer une part du financement à des sujets à TRL relativement bas, de façon à s’assurer que l’on continue à nourrir le portefeuille de technologies susceptibles d’être in fine intégrés dans des démonstrateurs. »
A. LA NÉCESSITÉ D’UNE MEILLEURE CONCERTATION INTERMINISTÉRIELLE
On se retrouve cependant alors face aux limites des capacités de financement budgétaires.
Le président-directeur général de l’ONERA, M. Bruno Sainjon, a été très clair sur ce point : « Les financements du PIA ont effectivement asséché les activités de la DGAC. L’ONERA n’est aujourd’hui plus financé par la DGAC, mais seulement par une subvention du ministère de la défense. » On retrouve ici le caractère déséquilibrant du PIA, déjà évoqué à propos des équipements relevant du budget de la recherche. « Cette situation, a poursuivi M. Sainjon, rendait très délicat pour nous de cofinancer un démonstrateur relevant d’une activité civile, plutôt en aval de surcroît. Cela a de facto orienté l’activité de l’ONERA vers un double rôle de gestionnaire et de notaire, ainsi que de sous-traitant de l’industrie – pour les 7 millions d’euros évoqués par M. Thierry Michal –, au détriment de sa mission d’irrigation de la recherche plus fondamentale. »
Autrement dit, l’accent mis sur les projets à degré de maturité technologique élevé a asséché les crédits récurrents consacrés à la recherche civile amont. Une fois de plus, on retrouve la nécessité, déjà évoquée dans une précédente partie du présent rapport, de consultations interministérielles, voire d’une concertation interministérielle, plus poussées en amont des choix de financement, de façon à s’assurer que ces choix, quels que soient leurs effets positifs sur les secteurs choisis, n’aboutissent pas à mettre en impasse d’autres secteurs, tout aussi stratégiques, de la recherche. Dans le cas précis de l’aéronautique, peut-être aurait-il fallu tout simplement réserver une part des financements du PIA au profit de la recherche amont.
Dans ces conditions, c’est fort logiquement que le président-directeur général de l’ONERA, M. Bruno Sainjon, a insisté sur la nécessité de corriger cette lacune à l’occasion du PIA 2 : « Nous souhaiterions que le PIA 2 concerne des activités situées plus en amont, de façon à irriguer de la recherche plus fondamentale, à l’instar de ce qui a été décidé dans d’autres domaines. Cela permettrait aussi à l’ONERA de remplir le rôle primordial pour lequel il a été créé en 1946, c’est-à-dire mener des recherches en propre très en amont dans le domaine de l’aviation civile (avions et hélicoptères) et irriguer le monde académique et les laboratoires. »
À l’issue du présent rapport, la Mission d'évaluation et de contrôle formule les observations et recommandations suivantes.
● Sur les modalités de sélection et de suivi des projets
Les rapporteurs ne peuvent que constater l’accord unanime des personnalités qu’ils ont auditionnées sur les modalités de sélection des projets et l’organisation de leur gouvernance.
La sélection des projets par des jurys internationaux – et même les exceptions à cette règle, dans les domaines où il en existe – a fait l’objet d’appréciations systématiquement positives. Aucune proposition de modification n’a été soumise aux rapporteurs.
S’agissant du suivi des projets, le dispositif tel qu’il s’est progressivement structuré – il était visiblement assez confus au départ – fait également l’objet d’un accord général. Rappelons qu’il se compose d’abord d’un suivi régulier de l’évolution du projet par l’opérateur qui en est chargé ; l’opérateur rapporte ensuite au comité de pilotage (COPIL), où il siège avec les administrations compétentes et dont le Commissariat général à l'investissement est systématiquement membre ou observateur. Le Commissariat général à l'investissement fait ensuite rapport au Premier ministre de la décision du COPIL et de son accord – ou, beaucoup plus rarement, de son désaccord. Les décisions les plus importantes – notamment les décisions d’arrêt – sont alors prises par le Premier ministre.
En revanche, les délais de contractualisation ont été jugés particulièrement excessifs. Sont en cause la lourdeur, la complexité et le caractère « tatillon » des demandes faites aux porteurs de projets. Les rapporteurs ne peuvent donc que se féliciter de la simplification en cours : préfinancement systématique des projets, suppression de certains documents et annexes ainsi que de certaines étapes de validation.
Les propositions peuvent donc se résumer ainsi : maintien de la gouvernance actuelle – suivi par l’opérateur, développement des « jalons », dits aussi étapes de « go/no go », prise des décisions stratégiques sur les projets par un comité de pilotage, ou, en cas de désaccord au sein de celui-ci, par le Premier ministre –, allégement des contrôles a priori au profit de procédures a posteriori, dans le cadre d’une plus grande autonomie des acteurs, et meilleur suivi individuel des situations à risque.
● Sur la gouvernance, le nombre et les financements des Idex
Les premiers résultats visibles montrent combien l’actuelle organisation du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur entrave l’expression du potentiel de la recherche française. En resserrant sur chaque site les liens entre universités, grandes écoles et grands organismes de recherche, la politique des Idex, mais aussi celle des Labex, permet une bien meilleure cohérence entre la recherche et l’enseignement supérieur français. La réussite de cette nouvelle organisation passe par l’établissement de gouvernances solides, et ce tout particulièrement pour les Idex.
Dans une perspective de simplification des structures, il peut être envisagé que la gouvernance des nouvelles COMUE assure celle des Idex. Ce choix suppose cependant l’établissement par les COMUE de règles de gouvernance solides et claires, intégrant les établissements des grands organismes de recherche nationaux présents sur le site, et procédant d’une véritable affectio societatis entre leurs composantes.
La première sélection des huit Idex laisse hors du processus de réorganisation une part trop considérable du territoire français. La démarche de création d’Idex doit donc être poursuivie.
La création des I-SITE (regroupements d’excellence que seul leur spectre scientifique moins large que celui des Idex a empêché d’être érigés en Idex) doit être encouragée. Elle offre une réponse à l’insuffisante couverture du territoire par les Idex.
Au-delà, le caractère discriminant, du statut d’Idex par rapport au statut de droit commun, du fait du label d’excellence, de l’organisation de la gouvernance et des financements supplémentaires qui y sont attachés, amène à ne pas fermer ce statut à des regroupements supplémentaires. Cependant, l’octroi du statut d’Idex doit résulter d’efforts réels des sites candidats en vue de l’excellence et d’une gouvernance robuste.
La constitution d’une Idex est une opération complexe ; sans engagement solide – et solidaire – de l’ensemble des membres du projet, les risques d’échec sont élevés, et ce d’autant plus que ce sont bien sûr les projets où l’affectio societatis était la plus forte qui ont été sélectionnés par le PIA 1. Pour les nouvelles vagues d’Idex, les délais nécessaires à l’élaboration, sur la base d’une affectio societatis commune, de projets éligibles sans réserve par le jury doivent être laissés aux porteurs de projets.
Les dotations non consommables attachées au statut d’Idex sont une novation considérable pour le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur français, qui jusqu’ici, sauf exception, ne pouvait compter que sur des dotations budgétaires annuelles. Les conditions d’utilisation de ces dotations, une fois transférées aux Idex, doivent donc être clairement fixées. Elles doivent s’inspirer des clauses d’utilisation qui sont en général attachées aux financements dont bénéficient nombre d’universités étrangères grâce aux fondations.
● Sur les limites des financements apportés par le PIA et les mesures à prendre pour y remédier
Les travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle ont fait apparaître que les conditions de définition et d’attribution des crédits du PIA étaient porteuses de déséquilibres de financement.
Ces déséquilibres tiennent d’une part au caractère partiel des financements de certains projets (Labex) ou équipements (Equipex) de recherche, et de l’autre à la limitation dans le temps de ces financements. Le caractère partiel du financement fait peser une partie des charges des projets sur les crédits récurrents des établissements. La limitation dans le temps pèse sur la viabilité de certains projets, dont la durée de réalisation dépasse l’horizon du PIA 1.
Le remède au caractère partiel du financement est connu. C’est une prise en compte plus réaliste des coûts indirects. À l’instar de ce qui est fait pour les programmes européens, ces coûts devraient être pris en compte à hauteur de 25 % du projet, sauf cas où un effet de levier – c’est le cas lorsque les financements du PIA attirent d’autres financements – peut être raisonnablement attendu ou encore lorsque la nature même de l’équipement ou du projet financé fait apparaître des coûts indirects futurs inférieurs à ce taux.
À terme, ce qui est posé est le financement des projets à coûts complets. Ce mode de financement suppose l’établissement d’une comptabilité analytique précise et fonctionnelle au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La Mission d'évaluation et de contrôle considère que la mise en œuvre d’une telle comptabilité doit être une priorité.
La question de la limitation des financements dans la durée suppose d’effectuer dès à présent la revue des programmes financés. Certains projets ne poseront pas de difficulté, leur durée de réalisation étant cohérente avec la durée de leur financement. Dans d’autres cas, un effet de levier pourra être recherché. Pour d’autres, il faudra trouver des compléments de financements ou réorganiser les projets, dans le cadre de redéploiements de crédits.
● Sur la cohérence du financement de la recherche
Le PIA s’est constitué par la sélection de projets d’avenir dont la rentabilité à terme était considérée comme supérieure au coût des crédits obtenus par emprunts pour les financer, dans des domaines déterminés à l’avance.
Parallèlement, des projets ont été laissés à l’écart du PIA au motif qu’ils pouvaient être financés sur crédits budgétaires. Or, il s’avère que l’état des finances publiques ne permet pas forcément la création, ni non plus la modernisation ou le renouvellement, des équipements scientifiques correspondant à ces projets.
Dès lors, une meilleure mise en cohérence des financements de la recherche qui dépassent les dépenses annuelles courantes s’impose.
La Mission d'évaluation et de contrôle veut être très claire : le caractère stratégique du PIA comme les procédures financières spécifiques qui s’y appliquent non seulement justifient mais imposent que le Commissariat général à l'investissement soit placé auprès du Premier ministre. De même, la sélection par des jurys, composés des meilleurs représentants de la recherche internationale, doit être confortée.
En revanche, l’analyse préalable des projets à financer ne doit pas laisser à l’écart les financeurs habituels de la recherche, autrement dit les ministères de tutelle de la MIRES, au premier rang desquels figure le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci doit pouvoir attirer institutionnellement l’attention du Commissariat général à l'investissement – autrement dit, du Premier ministre – sur l’intérêt stratégique de projets ou d’équipements qu’il porte, et pour lesquels les financements par la voie budgétaire ne sont pas assurés. La rentabilité de certains de ces équipements peut aussi bien, elle aussi, être supérieure au coût d’un éventuel emprunt nécessaire ! Le Commissariat général à l'investissement doit donc développer sa fonction d’instance de coordination interministérielle auprès du Premier ministre pour le financement des investissements d’avenir.
● Sur l’information du Parlement
La participation de deux députés et deux sénateurs au comité de surveillance des investissements d’avenir, la communication à chacune des deux assemblées des conventions, et de leurs avenants chaque fois qu’il en est élaboré un, mais surtout les auditions du commissaire général à l’investissement régulièrement organisées par les commissions parlementaires permettent sans doute une information satisfaisante sur la progression des actions menées dans le cadre du PIA.
En revanche, la Mission d'évaluation et de contrôle ne peut que constater la très faible association du Parlement en amont des choix opérés : les PIA sont instaurés par ouverture de programmes budgétaires, une seule fois, en loi de finances. À cette occasion, l’information qui est donnée au Parlement sur l’objet des crédits ouverts est très générale, peu détaillée ; la procédure d’examen des projets de loi de finances se prête du reste très mal à un examen détaillé de l’objet de ces crédits nouveaux. C’est lorsqu’il est saisi ensuite, pour information, de l’exécution des conventions que le Parlement en découvre le contenu. Ce n’est qu’en entendant les opérateurs que la Mission d'évaluation et de contrôle a pu s’informer de l’objet précis des actions menées.
Ce dispositif doit évoluer. Le Parlement doit se voir présenter les projets de PIA en amont de l’inscription en projet de loi de finances des crédits destinés à les financer. À l’Assemblée nationale, cette présentation pourrait être effectuée sous forme d’audition du commissaire général à l’investissement devant les commissions compétentes, réunies à cet effet, sur la base d’un document élaboré par le CGI en prévision de celle-ci. Les députés pourraient ainsi, notamment, se faire présenter les raisons ayant présidé aux choix des axes d’actions financés et débattre de ceux-ci. L’Assemblée nationale pourrait ensuite exercer un vote beaucoup plus éclairé sur les crédits demandés. Le suivi postérieurement organisé serait celui d’actions déjà identifiées et non la découverte de la conduite d’actions jusqu’ici inconnues ou quasiment inconnues d’elle.
● Sur le dispositif de valorisation de la recherche et le développement de la recherche appliquée
Les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) constituent, par leur objet, un élément essentiel de la chaîne de valorisation de la recherche mise en place par le PIA.
Le modèle régional sur lequel elles se sont développées doit être assoupli pour permettre une collaboration plus harmonieuse avec les grands organismes nationaux de recherche et leurs filiales de valorisation ; ces grands organismes nationaux doivent pouvoir conserver, dans les domaines où ils le souhaitent, la maîtrise du mode de valorisation de leurs découvertes : la commercialisation des brevets n’est ni le seul mode de valorisation de la recherche, ni toujours le plus porteur.
Les critères de réussite appliqués aux SATT doivent faire primer, pour la mesure du succès de celles-ci, les résultats en matière de développement économique sur les objectifs de rentabilité financière.
Une région doit pouvoir, si elle-même et la SATT en sont d’accord, devenir actionnaire d’une SATT opérant sur son territoire, de façon notamment à pouvoir rapprocher la SATT des incubateurs.
Enfin, le rôle de l’État, actionnaire principal de chaque SATT, est essentiel pour la vie du dispositif. Son action de contrôle et d’attribution des fonds doit permettre d’orienter l’action des SATT au bénéfice de l’intérêt général, de vérifier que cette action s’exerce bien dans le cadre des objectifs généraux fixés et d’intervenir au cas où une SATT n’arriverait pas à satisfaire à la feuille de route qui lui a été fixée.
Les consortiums de valorisation thématiques (CVT) sont, du fait de leur structuration, l’instrument des alliances de recherche dans la chaîne de valorisation de la recherche créée par le PIA. Leur adossement aux alliances en fait inévitablement des structures porteuses de valeur ajoutée, d’autant plus précieuses qu’elles ne représentent qu’un faible engagement financier. Il conviendra simplement de s’assurer régulièrement de la qualité de leur engagement dans l’action.
France Brevet exerce un métier rare mais bien connu de ses dirigeants, qui ont pu dans le passé faire la preuve de sa rentabilité. Les rapporteurs considèrent qu’au-delà des 50 millions d’euros prévus par le PIA pour son lancement, le positionnement de cette société est d’être une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Il revient à la Caisse d’effectuer son travail d’actionnaire et de prendre les décisions qui s’imposeront pour l’avenir dans la vie de France Brevets, à qui les rapporteurs souhaitent plein succès.
Les débuts des instituts de recherche technologique, des instituts de transition énergétique et des instituts Carnot semblent plutôt difficiles. La rigidité de leur statut semble concourir à leurs difficultés, en particulier dans leurs relations avec certains grands organismes de recherche.
Une attention toute particulière doit donc être portée à la stabilisation et à la bonne insertion de chacun d’eux dans son univers scientifique et industriel, y compris par un assouplissement de son statut. En cas d’échec persistant ou d’écart trop important d’un institut par rapport au projet retenu, les crédits devront être réorientés.
● Sur l’appui offert à la recherche des filières industrielles relevant de la MIRES
Les projets d’investissements d’avenir dans les trois filières industrielles relevant de la MIRES que sont la filière spatiale, la filière aéronautique et la filière nucléaire ont fait l’objet d’un mode de sélection particulier puisque ce sont les filières elles-mêmes, très bien structurées, qui ont déterminé la nature des projets sur lesquels devraient porter les appels d’offres.
Se situant à la frontière de la recherche et de l’industrialisation, ils ont permis la réalisation de l’effet de levier attendu, des financements privés venant s’ajouter aux financements publics, renforcé les opérateurs et entreprises français par rapport à leurs concurrents, et permettent à l’État d’espérer raisonnablement un retour sur l’investissement consenti par le canal du PIA.
En revanche, la délégation aux filières industrielles elles-mêmes de la détermination des actions à financer a abouti à privilégier des projets à niveau de maturité technologique élevée. L’insuffisance des crédits budgétaires pour financer des recherches civiles amont sur crédits récurrents a amené, comme dans le cas de la recherche académique, à priver de ressources des projets potentiellement porteurs d’innovations de rupture et donc stratégiques pour l’avenir. On retrouve ainsi la nécessité d’une concertation interministérielle plus poussée en amont de la détermination des domaines à financer, de façon à s’assurer que les choix effectués, quels que soient leurs effets positifs sur les secteurs choisis, n’aboutissent pas à mettre en impasse d’autres secteurs, tout aussi stratégiques, de la recherche. Dans le cas précis de l’aéronautique, peut-être aurait-il fallu tout simplement réserver une part des financements du PIA au profit de la recherche amont.
● Gouvernance des programmes d’investissements d’avenir
1. Pour une meilleure cohérence des financements de la recherche, développer la fonction de coordination interministérielle du Commissariat général à l'investissement auprès du Premier ministre lors de l’analyse préalable des projets à financer. Cette procédure doit permettre l’expression des ministères de tutelle de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur, au premier rang desquels le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur leurs priorités.
2. Développer l’information du Parlement en amont de la phase de lancement des PIA, notamment par des auditions du Commissaire général à l'investissement sur la base d’un document élaboré par le CGI en prévision de celles-ci, sur le choix des domaines qu’il est envisagé d’ouvrir à un PIA.
3. En ce qui concerne la phase de sélection, conserver la sélection des projets par des jurys internationaux.
4. Conserver le dispositif institutionnel de suivi des projets : suivi par l’opérateur public, développement des « jalons », dits aussi étapes de « go/no go », prise des décisions stratégiques sur les projets par un comité de pilotage (COPIL), et, en cas de désaccord au sein de celui-ci, par le Premier ministre sur rapport du Commissariat général à l'investissement.
5. Simplifier les procédures de contractualisation et de contrôle des projets, grâce au préfinancement systématique et à la suppression de certains documents et annexes et de certaines étapes de validation.
6. Pour la conduite des projets, privilégier les procédures a posteriori, alléger les contrôles a priori et concentrer le suivi individuel sur les situations à risque.
● Sites d’excellence
7. Veiller à la solidité et à l’efficacité de la gouvernance des Idex.
8. Soumettre le transfert de la gouvernance d’une Idex à une COMUE à l’établissement préalable par celle-ci, pour sa propre gouvernance, de règles solides et claires, associant les établissements des grands organismes de recherche nationaux présents sur le site, et procédant d’une véritable affectio societatis entre ses composantes.
9. Permettre la création de nouvelles Idex, cette création devant continuer à être soumise à de réels efforts des sites candidats en vue de l’excellence et d’une gouvernance robuste.
10. Développer, sous le nom d’I-SITE, les regroupements d’excellence au spectre scientifique plus étroit que celui des Idex.
● Questions financières
11. Fixer des conditions d’utilisation des dotations non consommables, une fois celles-ci transférées aux Idex, en s’inspirant des clauses généralement attachées, à l’étranger, aux financements institués par des fondations.
12. Une prise plus réaliste des coûts indirects, et, à terme, le calcul des financements à coûts complets, doit remédier au financement partiel des projets par le PIA.
13. Eriger en priorité l’établissement d’une comptabilité analytique précise et fonctionnelle au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin d’atteindre l’objectif précédent.
14. Effectuer dès à présent la revue des programmes financés et des conditions de leur réalisation pour anticiper la limitation dans la durée des financements.
● Valorisation de la recherche et recherche appliquée
15. Assouplir le modèle initial des SATT. Tenir compte en particulier des dispositifs de valorisation existant dans les grands organismes nationaux de recherche.
16. Les critères d’évaluation des SATT doivent privilégier les objectifs de développement économique.
17. Veiller à insérer dans leur univers scientifique et industriel les instituts de recherche technologique, les instituts de transition énergétique et les instituts Carnot. Cela peut passer par des assouplissements de statuts. Une évaluation régulière doit être réalisée pour juger de la bonne utilisation des crédits.
● Filières industrielles
18. Dans les filières industrielles qui déterminent elles-mêmes la nature des projets financés sur crédits du PIA, être attentif au maintien de crédits suffisants pour la recherche civile amont.
Au cours de sa séance du mercredi 18 mars 2015 à 9 heures 30, la Commission examine le rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur (MM. Alain Claeys et Patrick Hetzel, rapporteurs.)
M. Dominique Lefebvre, président. Mes chers collègues, nous allons procéder à l’examen du rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle – MEC – sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Je passe la parole aux rapporteurs, nos collègues Alain Claeys et Patrick Hetzel.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le rapport d’information sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir – PIA – relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur est établi selon trois axes principaux. Le premier porte sur la gouvernance, c’est-à-dire la manière dont les dossiers ont été sélectionnés et les investissements d’avenir gérés. Le deuxième porte sur les conséquences des investissements d’avenir sur l’organisation de la recherche. Enfin, le troisième porte sur l’articulation de ces investissements avec les autres formes de financement de la recherche en France.
Le premier programme d’investissements d’avenir est un programme de 35 milliards d’euros visant à rendre le pays plus compétitif et à favoriser une croissance durable. Il a été lancé en décembre 2009, à la suite de propositions faites par la commission dite « Juppé-Rocard ». Les crédits nécessaires, financés pour la plus grande partie par ce qu’on a appelé le « Grand Emprunt » ont été ouverts par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010. Pour en assurer la mise en œuvre, la fonction de commissaire général à l’investissement, placé sous l’autorité directe du Premier ministre, a été créée.
Les deux tiers des crédits du PIA, soit 21,9 milliards d’euros, ont été attribués à la recherche et à l’enseignement supérieur. Sur ce total, 12 milliards d’euros ont été affectés à la recherche fondamentale et à l’enseignement supérieur proprement dits. Il s’agissait de financer pour 8,7 milliards d’euros des initiatives d’excellence, ou Idex – qui sont en fait des sites d’excellence –, ainsi que des laboratoires d’excellence, ou Labex ; s’y ajoutent 2,3 milliards d’euros destinés au site de Saclay et à des sites parisiens ; un milliard d’euros a aussi été attribué à des équipements d’excellence, ou Equipex ; enfin, 163 millions d’euros ont été redéployés en faveur d’une action « Initiatives d’excellence en formations innovantes », ou Idefi. De plus, 2,4 milliards d’euros ont été affectés à la filière santé et biologie, pour la création d’instituts hospitalo-universitaires – qui jouent aujourd’hui un rôle important sur les territoires – et le financement de recherches dans six domaines ciblés.
Le PIA consacre aussi 4,5 milliards d’euros à la valorisation de la recherche et à la recherche appliquée. Sur ce total, un milliard d’euros est consacré à une chaîne de valorisation entièrement nouvelle, destinée à permettre aux résultats de la recherche fondamentale de traverser ce que l’on appelle la « vallée de la mort », qui les sépare de leur exploitation par l’industrie et qui voit parfois le financement public prendre fin alors même qu’aucun financement privé ne vient prendre le relais. D’amont en aval, 50 millions d’euros sont consacrés à six consortiums de valorisation technologique, 900 millions d’euros à quatorze sociétés d’accélération du transfert de technologies – SATT –, pour assurer la maturation industrielle des résultats, et 50 millions d’euros à une société d’exploitation de brevets adossée à la Caisse des dépôts et consignations et dénommée France Brevets. S’y ajoutent 3,5 milliards d’euros pour le développement de trois types d’instituts de recherche appliquée : huit instituts de recherche technologique (IRT), douze instituts de transition énergétique (ITE) et trente-trois instituts Carnot.
Enfin, 3 milliards d’euros ont été réservés à des actions de recherche industrielle conduites dans trois filières, l’espace, l’aéronautique et le nucléaire, dont les opérateurs relèvent budgétairement de la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur.
Les crédits du PIA devaient être attribués sur la base d’appels à projets, examinés par des jurys internationaux sur des critères de qualité ou d’excellence. J’insiste sur le fait que ces critères sont les seuls pris en compte : ceux relatifs à l’aménagement du territoire ne sont en aucun cas pris en considération – il y a cependant eu, à la demande du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, une demande d’évaluation territoriale ayant pour objet de déterminer comment les crédits provenant du PIA avaient été distribués sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, les financements devaient venir en sus des crédits budgétaires, et ne pas s’y substituer. Enfin, les projets devaient faire l’objet d’un suivi précis et d’évaluations régulières, à la suite desquelles les versements, décaissés au fur et à mesure de leur avancement, pouvaient être suspendus ou supprimés.
Les débuts du PIA, et particulièrement le conventionnement des projets après leur sélection par les jurys, ont été marqués par d’importants retards. La première raison a été constituée par les difficultés des porteurs de projets à répondre aux cahiers des charges très précis, voire pointilleux, qu’il leur était demandé de remplir. Les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur sont confrontés à l’obligation de constituer un grand nombre de dossiers, que ce soit pour les investissements d’avenir, pour les demandes adressées directement à l’Agence nationale de la recherche, ou pour les fonds européens destinés à la recherche et à l’enseignement supérieur. La lourdeur des démarches à effectuer a même eu pour conséquence une diminution de la consommation des crédits européens.
Une deuxième raison a pour origine le fait que l’opérateur principal de l’État pour le PIA, l’Agence nationale de la recherche – ANR –, ne disposait ni des instruments financiers ni des moyens humains pour traiter le nombre considérable des projets à conventionner et la masse des 19 milliards d’euros de crédits qu’elle devait attribuer et verser.
L’ANR a été depuis mise à niveau, et cet épisode est derrière elle. Les projets ont été conventionnés, et les crédits sont désormais versés dans les temps. Les non-décaissements sont aujourd’hui le signe non pas d’un engorgement de la machinerie administrative, mais des difficultés du projet financé.
Les projets sont suivis par l’ANR. Des comités de pilotage – COPIL – ont été instaurés. Ils regroupent l’ANR, les administrations compétentes, au premier plan desquelles la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, et le Commissariat général à l’investissement (CGI), qui y siège au moins à titre d’observateur. Ces comités de pilotage constituent une interface stratégique pour la coordination du pilotage des investissements d’avenir entre le niveau interministériel et le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.
À chaque étape, l’ANR fait rapport au COPIL sur le projet concerné, après avoir le cas échéant consulté le jury qui l’avait sélectionné. En fonction de ce rapport, le COPIL décide, par consensus, la poursuite, la réorientation ou – c’est rare, mais c’est arrivé – l’arrêt du projet. Le CGI transmet alors la décision du COPIL au Premier ministre, ou informe celui-ci de son désaccord. La même organisation a été mise en place pour les projets relevant des trois filières spatiale, aéronautique et nucléaire. Cette organisation est désormais jugée pertinente, au même titre que le recours à des jurys internationaux. L’essentiel des propositions de réforme porte sur la simplification des conventionnements et du suivi.
Dans ces conditions, nous proposons de conserver le dispositif institutionnel de suivi des projets : suivi par l’opérateur public, prise des décisions stratégiques sur les projets par un comité de pilotage – COPIL – et, en cas de désaccord au sein de celui-ci, par le Premier ministre sur rapport du CGI. Nous approuvons également l’action conduite pour simplifier les procédures de contractualisation et de contrôle des projets, grâce au préfinancement systématique et à la suppression de certains documents et annexes ainsi que de certaines étapes de validation. Pour la conduite des projets, il faut privilégier les procédures a posteriori, alléger les contrôles a priori et concentrer le suivi individuel sur les situations à risque.
Enfin, nous avons pu constater que le circuit d’attribution des fonds est bien distinct de celui de la répartition des crédits budgétaires. L’usage des fonds est contrôlé avant et après leur attribution. Il est ainsi impossible de rendre les deux types de crédits fongibles. Le seul cas prêtant à confusion, les avances remboursables de l’Airbus A350, est très particulier, et sur ce point nous renvoyons à notre rapport.
Quels sont les premiers résultats des actions menées ? Dans une perspective de développement du potentiel de la recherche française, l’objectif des initiatives d’excellence est de rapprocher universités, écoles et établissements des grands organismes de recherche présents sur un même site. Huit projets ont été sélectionnés par le jury, deux autres recevant des fonds beaucoup plus modestes destinés à les aider à atteindre les critères de sélection.
La création des Idex a abouti à de réels rapprochements : les Idex permettent de remodeler le paysage universitaire et de recherche. À Saclay, où nous nous sommes rendus, une gouvernance commune associant l’ensemble des institutions et organismes d’enseignement supérieur et de recherche présents sur le site a été construite. La totalité des doctorats et des masters y est désormais mutualisée.
L’action Labex produit les mêmes effets. Près de 60 % des Labex sont du reste rattachés à une Idex. À Saclay, les Labex ont un fort effet fédérateur. Le rapprochement des équipes qu’ils provoquent permet de fusionner les laboratoires et d’intégrer les équipes des grandes écoles, en général trop petites pour mener à bien des projets ambitieux. Les effets positifs du rapprochement, dans un même Labex, de spécialistes scientifiques mondiaux en recherche pure et d’équipes habituées à travailler avec l’industrie ont aussi été soulignés.
Ces premiers succès font apparaître de nouveaux défis, que je laisse le soin à Patrick Hetzel de vous exposer.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Même si l’objectif initial des Idex était bien d’accéder au niveau international, huit sites d’excellence ne suffisent pas à constituer une politique de l’excellence sur le territoire. Nous pensons également que la réussite des Idex pourrait aussi, à la longue, affaiblir les autres sites, qui ne disposent pas non plus des mêmes crédits.
Les voies pour remédier à l’insuffisante couverture du territoire par les Idex pourraient être les suivantes. D’abord, développer des regroupements d’excellence au spectre scientifique plus étroit que celui des Idex, mais plus large que celui des Labex. Nous sommes donc favorables à la création des nouvelles I-SITE – initiatives structurantes innovation-territoires-économie – qui correspondent à cette définition.
Ensuite, permettre la création de nouvelles Idex, afin que le système respire : les Allemands, après avoir décidé de lancer des initiatives d’excellence sur leur territoire, ont décidé d’en délabelliser certaines, en même temps qu’ils labellisaient d’autres sites. Une telle démarche n’est pas forcément aisée, mais il faut savoir l’entreprendre en vue de l’excellence et d’une gouvernance robuste. À cette fin, il convient de laisser aux porteurs de projets le temps de constituer l’affectio societatis qui leur permettra de répondre avec succès aux critères des jurys internationaux.
Deux autres risques sont, d’une part, le doublonnage des organes de gouvernance des Idex et de ceux des nouveaux regroupements institués par la loi du 22 juillet 2013, tels que les communautés d’universités et d’établissements – COMUE –, et, de l’autre, la dilution des Idex dans une gouvernance trop confuse de ces nouveaux regroupements.
Pour les éviter, il faut d’abord impérativement veiller à la solidité et à l’efficacité de la gouvernance des Idex. La solution la plus rationnelle sur un site est une gouvernance commune de l’Idex et de la COMUE. Elle doit donc être encouragée, mais à de très strictes conditions. Le transfert de la gouvernance d’une Idex à une COMUE doit être soumis à l’établissement préalable par celle-ci, pour sa propre gouvernance, de règles solides et claires, associant les établissements des grands organismes de recherche nationaux présents sur le site, ainsi que les grandes écoles, et procédant d’une véritable affectio societatis entre ses composantes.
Enfin, 97 % des dotations affectées aux Idex sont dites non consommables : les Idex n’en perçoivent chaque année que les intérêts, actuellement calculés au taux de 3,41 %. Cependant, ces dotations elles-mêmes seront transférées aux Idex dont l’évaluation en 2016 sera positive. Cette disposition prévue dès le départ est essentielle pour la consolidation et la pérennisation des Idex, et la commission des Finances devra veiller à ce qu’elle ne soit pas remise en cause.
Cette chance historique doit être saisie. En revanche, elle ne doit pas être gaspillée. Nous proposons donc que, lors du transfert des dotations non consommables aux Idex, soient fixées des conditions d’utilisation s’inspirant des clauses généralement attachées, à l’étranger – notamment en Allemagne et en Amérique du Nord –, aux financements institués par des fondations.
L’exécution du PIA a aussi fait apparaître, sur le plan financier, des éléments auxquels il faudra remédier. Ainsi, les Equipex ne sont pas toujours financés intégralement. Comme le président de l’université de Strasbourg, M. Alain Beretz, l’a démontré de façon très probante, une partie de leur coût d’exploitation pèse sur les crédits récurrents de l’établissement d’accueil. Les Idex créent une dynamique mais aussi, dans le même temps, des dépenses qui ne sont pas intégralement couvertes par le financement qui leur est dédié. Il en est de même des Labex, qui ne sont pas toujours dotés des crédits nécessaires aux projets qui leur ont valu leur sélection.
L’une des raisons de cette situation est que, alors que les coûts indirects d’un projet sont en moyenne de 25 % de celui-ci, ils ne sont couverts en France qu’à hauteur de 15 % – c’est ce que l’on appelle le préciput, ou overhead en anglais. Au titre du programme des investissements d’avenir, leur taux avait même été fixé à 4 % seulement, avant d’être récemment porté à 8 %, mais pas pour toutes les actions. Une prise en compte plus réaliste des coûts indirects doit remédier au financement partiel des projets par le PIA.
À terme, cependant, le remède est bien le calcul des financements à coûts complets. Pour atteindre cet objectif, il faut ériger en priorité l’établissement d’une comptabilité analytique précise et fonctionnelle au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, auxquels cet outil fait défaut pour le moment.
Le financement seulement partiel de l’équipement ou du projet a pu aussi avoir pour cause l’attente de financements complémentaires, issus d’autres partenaires : or, trop souvent, les crédits qui devaient faire effet de levier ont été les seuls disponibles.
Autre difficulté, le financement du PIA ne couvre pas toujours la durée de vie du projet, ou ne permet pas le renouvellement de l’équipement. Le financement de certaines « cohortes » en matière de santé publique n’est ainsi assuré que pour cinq ans, alors qu’un certain nombre de spécialistes considèrent, à l’instar de l’Inserm, qu’une cohorte nécessite un suivi sur vingt à trente ans pour être efficace. Il faut donc effectuer dès à présent la revue des programmes financés et des conditions de leur réalisation pour anticiper la limitation dans la durée des financements.
Enfin, si les crédits mobilisés par le PIA ont bien financé des projets identifiés comme d’avenir, il s’avère que les crédits récurrents du ministère de la recherche ne sont pas suffisants pour financer d’autres projets. Comme l’a dit Alain Claeys, nous devrons donc revenir sur la question essentielle de l’articulation entre les financements budgétaires, c’est-à-dire récurrents, et les financements extrabudgétaires – en l’occurrence, les investissements d’avenir. Ainsi, les crédits annuels du ministère ne lui permettent de financer ni le renouvellement prochain de notre flotte océanographique, ni la participation de la France à un grand projet européen de production de neutrons. Pour assurer une meilleure cohérence des financements de la recherche, il faut donc développer la fonction de coordination interministérielle du Commissariat général aux investissements auprès du Premier ministre lors de l’analyse préalable des projets à financer. Cette procédure doit permettre l’expression des ministères de tutelle de la mission Recherche et enseignement supérieur, au premier rang desquels le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur leurs priorités.
S’agissant de la chaîne de valorisation de la recherche créée par le PIA, les consortiums de valorisation thématiques offrent aux alliances de recherche, auxquelles ils sont adossés, et qui regroupent par grands secteurs les acteurs de la recherche, un instrument nouveau pour signaler à l’industrie les recherches à valoriser. Par ailleurs, l’activité de France Brevets est désormais bien connue de certaines industries, et son directeur général en est un professionnel reconnu. Que cette activité ne soit profitable que sur le temps long n’est pas considéré comme un obstacle par la Caisse des dépôts et consignations, qui s’y est engagée en toute connaissance de cause.
En revanche, malgré leur rapide développement, les SATT suscitent des controverses : à quelques exceptions près – je pense notamment à la société Conectus Alsace, qui donne toute satisfaction –, il apparaît que leur fonctionnement peut encore être amélioré. Leur fonction de « coopératives de brevets » a rapidement fait entrer certaines d’entre elles en conflit avec les grands organismes nationaux de recherche qui s’étaient dotés de leurs propres filiales de valorisation industrielle, comme le CEA ou l’Inserm.
Quels que soient son dynamisme et son utilité, la chaîne de valorisation du PIA ne doit pas avoir pour conséquence la mise en cause de ce qui a déjà été construit. Dans ces conditions, nous proposons d’assouplir le modèle initial des SATT de façon, en particulier, à tenir compte des dispositifs de valorisation existant dans les grands organismes nationaux de recherche : il serait dommage de ne pas valoriser l’expertise qui a été acquise.
Par ailleurs, il est demandé aux SATT d’assurer leur équilibre économique à dix ans. Si un tel objectif n’est pas toujours insurmontable, il peut amener les SATT à privilégier leur rentabilité interne à court terme grâce à la vente de brevets, ce qui constitue une source de tensions : un certain nombre d’activités de recherche ne doivent pas être traitées uniquement à l’aune du court terme. Nous considérons aussi que les critères d’évaluation des SATT doivent privilégier des objectifs de développement économique : l’articulation entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée – c’est-à-dire l’industrialisation, qui permet la création de richesses pour le pays – ne doit pas être négligée.
Les instituts destinés à mieux associer l’industrie et la recherche, en faisant travailler celle-ci pour celle-là, semblent souvent, même s’il y a des exceptions, connaître des débuts laborieux. L’octroi de la personnalité juridique, des ambitions parfois excessives, ainsi que des conflits entre partenaires, semblent être les causes de ces difficultés. Il faudra donc veiller à insérer dans leur univers scientifique et industriel les instituts de recherche technologique (IRT), les instituts de transition énergétique (ITE) et les instituts Carnot. Cela peut passer par des assouplissements de statuts. Là encore, une évaluation régulière doit être réalisée pour juger de la bonne utilisation des crédits.
La répartition des crédits consacrés aux filières spatiale, aéronautique et nucléaire semble rencontrer un grand succès : l’effet de levier est là, les projets auxquels ces crédits sont affectés renforcent les industriels français face à la concurrence mondiale, des retours sur investissement ont déjà été obtenus et d’autres sont attendus.
Le choix de confier la sélection des projets aux filières elles-mêmes a cependant abouti à privilégier des recherches à maturité technologique élevée aux dépens de recherches plus en amont, porteuses d’innovations de rupture au-delà de l’horizon des projets financés – mais c’est là une difficulté que la France n’est pas la seule à rencontrer.
Dans les filières industrielles qui déterminent elles-mêmes la nature des projets financés sur crédits du PIA, nous devrons être attentifs au maintien de crédits suffisants pour la recherche civile amont, la partie strictement opérationnelle n’étant pas la seule qui importe.
Enfin, si la Mission d’évaluation et de contrôle ne peut que donner acte au CGI de l’abondance de l’information donnée au Parlement sur la progression des actions financées par le PIA, l’information fournie lors des demandes d’ouvertures de crédits en loi de finances est en revanche trop succincte. Il faut donc développer l’information du Parlement, en amont de la phase de lancement des futurs PIA, sur le choix des domaines qu’il est envisagé d’ouvrir à un PIA, notamment par des auditions du commissaire général à l’investissement soit par la Mission d’évaluation et de contrôle, soit par la commission des Finances, sur la base d’un document élaboré par le CGI en prévision de chacune de ces auditions.
M. Dominique Lefebvre, président. Messieurs les rapporteurs, merci pour vos exposés clairs et complets, qui dressent un bilan favorable de la procédure mise en œuvre. Vous semblez dire que les risques de détournement du dispositif en vue de régler des problèmes budgétaires sont maîtrisés. Pour ce qui est des enjeux de gouvernance, pouvez-vous nous indiquer en quoi, selon vous, le dispositif de financement actuel est en train de modifier le mode de fonctionnement des organismes traditionnels de recherche ?
M. Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président, votre question porte en fait sur trois sujets différents.
Premièrement, que la commission des Finances soit informée des orientations du PIA est essentiel : au-delà des quelques données dont nous disposons, un débat doit s’instaurer avec le Parlement sur les grandes orientations et la mise en place des PIA.
Deuxièmement, il ne faut pas que l’attribution des crédits des PIA aboutisse à la coexistence, de fait, de deux ministères chargés du financement de la recherche. La mise en place des investissements d’avenir va forcément conduire à la mobilisation de crédits récurrents, attribués par le ministère de la recherche. À défaut d’une bonne articulation, certains investissements d’avenir risquent de connaître eux-mêmes des problèmes de financement.
Troisièmement, les investissements d’avenir doivent-ils favoriser la mise en place d’une gouvernance plus efficiente, au niveau des universités et des organismes de recherche sur les territoires ? À cette question, nous répondons par l’affirmative. Il faut que la gouvernance des COMUE et des Idex soit commune, et à l’origine d’une plus grande efficience à niveau de financement constant.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. La mise en œuvre des investissements d’avenir a déjà provoqué un travail important pour créer une nouvelle dynamique, et amener les acteurs – notamment les grands organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur – à s’interroger sur leurs stratégies et à modifier leurs structures organisationnelles. Le Parlement a un rôle essentiel à jouer pour maintenir cette dynamique sous tension : l’inertie ne doit pas s’installer.
M. Jean-Louis Gagnaire. Nous devons veiller au respect de certains principes, à commencer par celui selon lequel les PIA n’ont pas vocation à faire de l’aménagement du territoire – même s’ils peuvent incidemment y contribuer. Comme l’a dit le commissaire général à l’investissement, M. Louis Schweitzer, ces financements ne doivent pas être des instruments de péréquation sur les territoires ; leur objectif, c’est l’excellence. Le système doit rester à l’abri de toutes les pressions et obéir à ce seul critère. Dans la région dont je suis l’élu, les projets d’Idex de Grenoble et de Lyon n’ont pas été labellisés. On peut le regretter. Mais cela prouve l’indépendance des jurys face aux pressions qui n’ont pourtant pas manqué de s’exercer. Le principe d’excellence doit rester intangible si nous voulons que notre pays figure parmi les leaders au niveau international. On sait que l’absence de labellisation résulte d’une défaillance des acteurs à s’organiser et à faire émerger un projet en commun.
Par ailleurs, le PIA est un peu trop souvent vu comme une sorte de « couteau suisse » : dès que des besoins de financement se font sentir en matière de recherche ou de développement économique, c’est à ce dispositif que l’on pense en premier, pour ne pas dire en exclusivité – c’est le cas, par exemple, dans le domaine des contrats de plan État-région, où l’État renvoit systématiquement les porteurs de projets aux investissements d’avenir. Si cela ne pose pas vraiment de problème dans les territoires dotés d’une ingénierie suffisante, cela peut se révéler plus gênant dans d’autres ne possédant pas de structuration de la recherche et des entreprises. Il faudrait admettre que, pour un certain nombre de projets, le PIA n’est pas forcément la solution – et, dès lors, réfléchir à la création de dispositifs complémentaires.
Enfin, quelle que soit l’efficacité du PIA, la contrainte budgétaire ne manquera pas de se faire sentir : les crédits du PIA viennent souvent abonder des politiques conduites dans le cadre budgétaire de droit commun, parfois par deux ou plusieurs ministères. Il faudra donc, à un moment où à un autre, réabonder les financements par voie de PIA.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. C’est justement parce que de nombreux projets relèvent de cofinancements par deux ou plusieurs ministères que nous sommes très favorables à ce que le Commissariat général à l’investissement joue davantage son rôle de coordination interministérielle.
Par ailleurs, si nous sommes tout à fait d’accord sur l’importance qui doit être accordée au critère d’excellence, j’insiste à nouveau sur l’intérêt qu’il y aurait à voir émerger des regroupements d’excellence au spectre scientifique plus étroit que celui des Idex, mais plus large que celui des Labex – de ce point de vue, les I-SITE semblent constituer la structure de taille pertinente.
Mme Véronique Louwagie. Notre collègue Alain Claeys a indiqué que certains crédits correspondant à des projets conventionnés n’étaient pas versés, et que cela n’était pas forcément dû à la complexité des formalités à accomplir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point, notamment sur les motifs de non-versement et le pourcentage des crédits concernés ?
Par ailleurs, si chacun s’accorde à reconnaître une importance essentielle au critère d’excellence, le rapport fait aussi état d’avis plus nuancés en la matière. Le Commissariat général à l’investissement lui-même indique qu’à titre expérimental, une enveloppe de crédits de 50 millions d’euros a été créée dans le PIA 2, dont l’attribution sera codécidée par le CGI et les régions, qui l’abonderont de 50 millions d’euros. Par ailleurs, on constate que sur les huit Idex, quatre sont concentrés sur Paris et l’Île de France, ce qui n’en laisse que quatre autres sur les territoires. Cela doit nous inciter à engager une réflexion sur le maillage des territoires, où des réseaux doivent se créer.
M. Éric Alauzet. Au cas où un PIA 3, que M. Louis Schweitzer appelle de ses vœux, serait lancé, je m’interroge sur son éventuelle articulation avec l’action de la Banque publique d’investissement. Si la BPI n’est pas directement positionnée sur les investissements d’avenir, elle détient néanmoins sept à neuf milliards d’euros d’actifs, issus du Fonds stratégique d’investissement, au sein de diverses sociétés sans que cela présente un grand intérêt stratégique : il me semble qu’il serait plus judicieux de diriger ces fonds vers des investissements d’avenir.
Je m’interroge également sur l’articulation du PIA avec le plan Juncker.
Enfin, maîtrisez-vous complètement les inscriptions budgétaires, jusqu’en 2017 voire au-delà ?
M. Christophe Castaner. Ne pensez-vous pas qu’il existe aujourd’hui un effet d’éviction entre les appels à projets annuels organisés par l’Agence nationale de la recherche et ceux financés dans le cadre du PIA, où l’ANR n’est que prestataire de services ? Ces deux types d’appels à projets sont très différents : les premiers sont des soutiens aux opportunités portées par des équipes de recherche, les seconds résultent d’approches plus structurantes. Cependant, quand on examine le budget de l’ANR, on se rend compte que son budget de programmation est passé de 629 millions d’euros en 2010 à 395 millions d’euros en 2014. Dans ces conditions, comment évaluez-vous ce risque d’effet d’éviction entre deux niveaux d’intervention qui, à mon sens, doivent être complémentaires et non exclusifs l’un de l’autre ?
Si chacun s’accorde à reconnaître l’utilité des SATT, il semble que se pose un problème de cohérence entre leur action et celle des régions. Comment préconisez-vous d’y remédier, dans le contexte de la montée en puissance des régions dans les domaines de l’économie et de la recherche ? Par ailleurs, comment assurer la cohérence territoriale de l’action des SATT et des régions dès lors qu’il existe quatorze SATT dans une France qui comptera prochainement treize régions, et que les territoires respectifs de ces entités ne correspondent pas ?
M. Alain Claeys, rapporteur. L’Agence nationale de la recherche a effectivement deux fonctions : d’une part, elle est opérateur des investissements d’avenir – ce pour quoi elle s’est dotée des moyens de gestion nécessaires –, d’autre part, elle lance ses propres appels à projets. L’examen des chiffres fait apparaître que le taux de réussite pour une équipe sollicitant des crédits auprès de l’ANR est de plus en plus bas : il ne faudrait pas que cela ait pour conséquence de voir les équipes porteuses de projets se détourner de l’ANR. En tant que rapporteur des crédits de la recherche pour la commission des Finances, j’estime que, après le redimensionnement effectué ces dernières années, le niveau des crédits d’intervention de l’ANR ne doit plus diminuer.
Les investissements d’avenir et les crédits récurrents doivent être complémentaires, les uns ne vont pas sans les autres. Certains équipements financés par des investissements d’avenir risquent de se trouver bloqués faute de crédits récurrents leur permettant de fonctionner. Un débat sur le pilotage des crédits trouverait, à mon sens, sa place lors du débat budgétaire.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je partage l’avis d’Alain Claeys sur l’historique de l’évolution du financement de la recherche par projets de l’ANR, et j’irai même un peu plus loin en disant qu’il faudrait peut-être augmenter ce financement. Pour ce qui est de l’effet d’éviction, j’estime qu’il est ailleurs : le PIA a contribué à développer un effet d’éviction dans la mesure où un certain nombre d’équipes qui pouvaient y recourir ont, de ce fait, cessé de solliciter systématiquement des financements européens. Nous devons donc veiller à ce que les équipes françaises ne perdent pas l’habitude de capter les ressources disponibles au niveau européen. Sur ce point, nous partageons l’avis du ministère sur le fait qu’il y a là des marges de progression.
M. Alain Claeys, rapporteur. Le PIA n’a effectivement pas pour rôle de financer des actions d’aménagement du territoire. Cela dit, il faut que les appels à projets soient bien diffusés sur le territoire. Lundi dernier, le préfet de ma région a organisé à ma demande une réunion sur les investissements d’avenir avec les opérateurs locaux. J’ai pu constater à cette occasion que la diffusion des appels à projets n’atteignait pas toujours les acteurs du territoire qu’ils pouvaient intéresser. Il y a là un problème d’ingénierie financière auquel il faut rester vigilant. Si les investissements d’avenir n’ont pas pour vocation première l’aménagement du territoire, il est tout de même essentiel que des équipes émergentes puissent être sollicitées à ce sujet.
Des crédits prévus pour un projet pourtant conventionné peuvent ne pas être versés du fait de l’arrêt de ce projet : tel a été le cas pour un projet d’institut de transition énergétique pour lequel des financements d’avenir avait été prévus et qui a été abandonné.
M. Étienne Blanc. Votre proposition n° 5 consiste à simplifier les procédures de contractualisation et de contrôle des projets. Les chercheurs, les chefs d’entreprise et les responsables des structures chargées du financement considèrent effectivement que les contrôles et les formalités sont d’une lourdeur excessive, et plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures visant à simplifier considérablement les choses. Selon vous, comment cette simplification devrait-elle être effectuée ?
M. Patrick Hetzel, rapporteur. En matière d’investissements d’avenir, je pense qu’il faut laisser la main au CGI pour appliquer la feuille de route visant à la simplification des procédures. Comme nous l’avons écrit dans notre rapport, il faut passer d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori, effectué non pas de manière systématique, mais par échantillonnage. Le CGI s’est laissé emporter par une logique un peu trop bureaucratique, peut-être en raison du fait qu’un certain nombre de ses collaborateurs, recrutés au sein des administrations centrales, ont eu tendance à reproduire certains modèles bureaucratiques auxquels la création du CGI visait précisément à échapper. Une première simplification est déjà intervenue mais nous devons aller plus loin dans ce domaine ; je pense que nous y parviendrons, car je sais que M. Louis Schweitzer y est bien décidé.
M. Alain Fauré. Les rapporteurs évoquent, à la page 134 de leur projet de rapport, des financements trop centrés vers l’aval. Ainsi M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales – ONERA –, précise-t-il que seulement 4,7 % du financement va vers des laboratoires de recherche académiques. Pourrions-nous en savoir un peu plus sur ce point ?
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Certaines filières industrielles déterminent elles-mêmes la nature des projets qui seront financés par des crédits provenant des PIA. C’est le cas de la filière aéronautique, qui a eu tendance à privilégier des recherches à maturité technologique élevée, c’est-à-dire se situant plutôt dans la phase de développement, ou de pré-industrialisation, que dans celle de la recherche proprement dite. Ce qu’expose M. Bruno Sainjon, c’est que la quasi-totalité des crédits mobilisés pour cette filière est allé vers la recherche appliquée. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien là aussi de recherche.
M. Dominique Lefebvre, président. Ce qui a été dit précédemment m’amène à m’interroger sur l’articulation entre les investissements d’avenir et d’autres dispositifs de financement de la recherche tels que le crédit d’impôt recherche. Une prochaine mission d’information aura peut-être vocation à s’y intéresser.
En application de l’article 145 du Règlement, la Commission autorise, à l’unanimité, la publication du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur.
*
* *
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition du 19 février 2014
À 10 heures : M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement, accompagné de M. François Rosenfeld, directeur financier du Commissariat général à l’investissement (CGI), M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique, et M. Jean-Régis Catta, chef de cabinet, chargé des relations avec le Parlement. 163
Audition du 8 avril 2014
À 16 heures 30 : Mme Pascale Briand, directrice générale de l’Agence nationale de la recherche (ANR), accompagnée de M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » et de Mme Daniela Floriani, directrice administrative du même département. 182
Auditions du 22 avril 2014
À 15 heures : M. Bernard Bigot, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, accompagné de M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes, et de M. Jean–Pierre Vigouroux, chef du service des affaires publiques. 189
À 16 heures 15 : M. Jean-Charles Hourcade, directeur général de France Brevets, accompagné de M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de cette société. 200
Audition du 13 mai 2014
À 18 heures : M. Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, accompagné de M. Pierre Moschetti, sous-directeur de la construction aéronautique. 210
Auditions du 11 juin 2014
À 16 heures 30 : M. Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d’études spatiales (CNES), accompagné de MM. Thierry Duquesne, directeur de la prospective, de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des relations internationales, Pierre Trefouret, directeur auprès du président et Guillaume de Blanchard, chargé des relations avec les parlements français et européen. 220
À 17 heures 30 : M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, accompagné de M. Thierry Francq, commissaire général adjoint, M. François Rosenfeld, directeur stratégique et financier et M. Claude Girard, directeur de programme valorisation de la recherche au Commissariat général à l’investissement (CGI). 227
Auditions du 25 juin 2014
À 16 heures 15 : M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA, accompagné de MM. Thierry Michal, directeur technique général, Thierry Stoltz, directeur des affaires économiques et financières et Jacques Lafaye, chargé de mission auprès du président. 236
À 17 heures : M. Alain Fuchs, président du CNRS. 245
À 18 heures : MM. Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm et Thierry Damerval, directeur général délégué, accompagnés de M. Arnaud Benedetti, directeur de la communication. 253
Auditions du 16 juillet 2014
À 16 heures 30 : M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 260
À 17 heures 30 : M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT (sociétés d’accélération du transfert de technologies) et président de la SATT Sud-Est, M. Christian Estève, secrétaire de l’association des SATT et président de la SATT Île-de-France Innov, Mme Maylis Chusseau, présidente de la SATT Aquitaine Sciences Transfert, M. Vincent Lamande, président de la SATT Ouest Valorisation et M. Nicolas Carboni, président de la SATT Conectus Alsace. 268
Audition du 24 septembre 2014
À 17 heures 30 : M. Roger Genet, directeur général pour la recherche et l’innovation au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 276
Audition du 17 décembre 2014
À 16 heures 30 : Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche. 286
Audition du 19 février 2014
À 10 heures : M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement, accompagné de M. François Rosenfeld, directeur financier du Commissariat général à l’investissement (CGI), M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique, et M. Jean-Régis Catta, chef de cabinet, chargé des relations avec le Parlement
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Nous ouvrons aujourd’hui les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des finances sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
M. Patrick Hetzel, membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et rapporteur pour avis sur les crédits de recherche, et moi-même, rapporteur des crédits de recherche pour la commission des finances, animerons cette mission. Conformément au mode de fonctionnement de la MEC, fondé sur l’élaboration d’analyses de fond débouchant sur des propositions de consensus, cette mission d’évaluation comporte donc deux rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition.
Nous accueillerons également, tout au long de nos travaux, des magistrats de la Cour des comptes. Il s’agit de Mme Nadia Bouyer et de Mme Laure Fau. Je salue aujourd’hui, la présence de M. Patrick Lefas, président de la troisième chambre, qui a déjà participé à nos travaux lors de nombreuses missions consacrées à la recherche.
Monsieur Louis Gallois, vous êtes, en tant que commissaire général à l’investissement, le chef d’orchestre de la mise en œuvre des investissements d’avenir. Il était donc logique que ce soit par votre institution que la MEC débute son cycle d’auditions, et je vous remercie d’avoir répondu, avec vos collaborateurs, à notre invitation. Nous sommes évidemment désireux de recueillir le fruit de votre expérience, ainsi que vos réflexions. Je rappelle que vous avez déjà eu l’occasion de vous exprimer le 16 juillet 2013 devant la commission des finances.
La gestion des programmes d’investissements d’avenir, enjeu majeur par lui-même, comporte plusieurs sous-enjeux.
Le premier est relatif à la mise en œuvre des investissements d’avenir sur la durée. Comment sont suivis les projets en cours de réalisation ? Comment sont traités les projets prenant trop de retard ? Dans quelles conditions un projet peut-il être arrêté et, dans ce cas, selon quelles procédures les crédits peuvent-ils être redéployés ?
La mission d’évaluation et de contrôle est aussi amenée à s’interroger sur la cohérence des financements de la recherche entre programmes d’investissements d’avenir et crédits budgétaires. Comment avoir une vision d’ensemble des financements, qui permette une allocation des crédits budgétaires tenant compte des dotations versées au titre des investissements d’avenir, notamment des intérêts des dotations non consommables ?
La sortie des investissements d’avenir doit aussi être envisagée dès aujourd’hui. Quel sera le sort des dotations non consommables après la période probatoire imposée à chaque projet ? En particulier, leur attribution définitive sera-t-elle faite sous forme non consommable par le versement d’intérêts annuels, comme c’est le cas aujourd’hui, ou les dotations deviendront-elles consommables ? Cette problématique est particulièrement cruciale pour les initiatives d’excellence (IDEX).
En aval de la recherche, l’influence des investissements d’avenir sur les dispositifs de valorisation de la recherche intéresse aussi notre mission : l’émergence progressive des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) et des consortiums de valorisation thématiques (CVT), ainsi que leur articulation avec les dispositifs déjà créés par les grands organismes de recherche, comme Inserm-Transfert, font partie de ses champs de réflexion.
Enfin, quelles modifications, par rapport à la procédure suivie dans le premier programme d’investissements d’avenir, l’expérience suggère-t-elle pour le deuxième programme ?
En juillet dernier, vous déclariez : « en ce qui concerne nos procédures, j’ai, lors de ma prise de fonctions, donné pour triple mot d’ordre : simplification, accélération et travail en commun ». Quelques mois plus tard, la simplification est-elle au rendez-vous ?
M. Louis Gallois, commissaire général à l’investissement. Je commencerai par présenter la gouvernance du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et sa spécificité. Ce programme est guidé par plusieurs principes.
Le premier est le recours à des appels à projets sélectionnés par des jurys internationaux composés de personnalités ayant une expertise dans les domaines traités – celui des initiatives d’excellence, par exemple, compte vingt membres, dont sept Français, et est présidé par M. Jean-Marc Rapp, professeur à l’université de Lausanne.
Le deuxième est le choix des projets en fonction de critères de qualité ou d’excellence, et non pas, a priori, selon une logique d’aménagement du territoire – ce qui ne signifie pas pour autant que nous nous désintéressons de l’impact territorial.
Troisième principe : les financements accordés sont des financements additionnels aux crédits budgétaires, et non pas substitutifs. Ce principe est le plus difficile à faire respecter : nous subissons une pression très forte pour faire des investissements d’avenir la session de rattrapage des crédits sollicités par les différents ministres auprès du ministre du budget. Notre meilleure défense face à cette pression est de nous appuyer sur le Premier ministre.
Le quatrième principe est la transparence. Nous disposons à cette fin d’un comité de surveillance, au sein duquel l’Assemblée nationale est représentée, et qui est coprésidé par les deux initiateurs des investissements d’avenir, M. Alain Juppé et M. Michel Rocard. Ce comité, qui se réunit régulièrement, nous est très utile. Nous intensifions nos relations avec ce comité, en organisant avec lui, afin qu’il soit très au fait de nos activités, des réunions thématiques sur des sujets tels que la transition énergétique ou la recherche technologique.
Professant la transparence, nous informons régulièrement le Parlement – Assemblée nationale et Sénat – de nos travaux. Nous lui adressons une documentation assez abondante. Je suis auditionné plusieurs fois par an par les différentes commissions des deux assemblées. Le « jaune » relatif aux investissements d’avenir, joint au projet de loi de finances, est un document très complet, auquel nous envisageons d’adjoindre un document d’accès plus aisé.
Les avis des jurys sont transmis chacun à un comité de pilotage – présidé, pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ou par ses représentants. C’est au sein de ces comités que s’organise la coordination entre l’action du ministère et celle au titre des investissements d’avenir. Le CGI, qui n’est pas toujours membre de ces comités, y assiste et transmet leurs décisions au Premier ministre, avec pour seul droit celui d’émettre un avis sur ces décisions.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le CGI ont ainsi le rôle de maîtres d’ouvrage, et l’Agence nationale de la recherche (ANR) celui de maître d’œuvre.
Le dernier principe est celui du suivi et de l’évaluation. Le suivi, qui doit être systématique, porte sur le respect des engagements pris et des procédures. L’évaluation, qui consiste à formuler un jugement plus global sur l’impact des investissements d’avenir et leur capacité à opérer des transformations, est pour nous la tâche la plus difficile.
Après ces quelques rappels sur la gouvernance des investissements d’avenir, j’en viens à la cohérence de notre action avec la politique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les investissements d’avenir donnent des moyens supplémentaires aux équipes et aux organismes qui se situent à un haut niveau de qualité au sein de la compétition internationale, à travers les initiatives d’excellence (IDEX), les laboratoires d’excellence (LABEX) et les équipements d’excellence (EQUIPEX) pour ce qui concerne l’université, ainsi que, pour la recherche technologique, les instituts de recherche technologique (IRT), les instituts pour la transition énergétique (ITE) et les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).
Le deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA2) a ouvert une nouvelle porte en prévoyant, à côté des IDEX, des ensembles au périmètre plus limité, mais du niveau de qualité que nous visons et capables de dialoguer avec l’économie. Ce dispositif, fruit d’un travail collectif, a été défini en totale coopération avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par ailleurs, en créant ainsi des entités dont l’impact et les méthodes sont destinés à se diffuser, nous positionnons des « balises d’excellence ». Ces balises, qui ont vocation à être dupliquées, sont en quelque sorte des instruments de référence, en termes tant de niveau de qualité que de processus, qui permettent d’aider le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à définir sa politique, qui est beaucoup plus globale que la nôtre puisqu’elle s’applique à l’ensemble du dispositif universitaire.
Ainsi, le Commissariat général à l’investissement, s’il est le garant des principes des investissements d’avenir, ne fait pas la politique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : il se contente d’apporter à celui-ci les instruments que je viens d’énumérer. Le CGI soutient la politique du ministère par sa capacité à différencier et à transformer, et par les points d’application que définissent ses équipes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quelle est la procédure des appels à projets ?
M. Louis Gallois. Le CGI signe des conventions avec l’opérateur – l’Agence nationale de la recherche. Ces conventions ont été établies par lui en relation étroite avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les éventuels conflits étant arbitrés au niveau du Premier ministre et la décision alors figée sous forme de « bleu » du Premier ministre – en pratique, pratiquement toutes les conventions sont « bleuies ».
M. François Rosenfeld, directeur financier du Commissariat général à l’investissement. Généralement, nous parvenons à nous mettre d’accord.
M. Louis Gallois. Certes, mais Matignon souhaite pouvoir bleuir les conventions. Le Premier ministre les signe. Le Commissariat général à l’investissement est en effet un outil du Premier ministre et n’a pas d’autonomie vis-à-vis de ce dernier.
Ce sont ces conventions qui fixent les modalités de l’appel à projets.
Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation, le travail préalable mené par l’Agence nationale de la recherche, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et nous-mêmes lors de l’établissement de la convention permet de définir le processus d’évaluation et les documents, les indicateurs et le calendrier du suivi.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quelle est l’articulation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ?
M. Louis Gallois. C’est le maître d’œuvre, l’ANR, qui fait entièrement le travail d’évaluation et de suivi. Pour les universités, nous ne disposons au CGI que de deux personnes et il est donc hors de question que nous le fassions.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Les suivis transversaux que vous avez instaurés et qui se superposent aux suivis par action n’induisent-ils pas un risque de déresponsabilisation des opérateurs ?
M. Jean-Pierre Korolitski, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire au Commissariat général à l’investissement. Outre un suivi par projet et une synthèse par action des suivis par projet, l’opérateur ANR assure en effet, dans une approche transversale, un suivi régional trans-actions.
M. Louis Gallois. Il s’agit là d’une dimension territoriale que j’ai entrepris de renforcer à la demande des régions, qui veulent légitimement connaître l’impact des investissements d’avenir sur leur territoire.
Nous réalisons également une synthèse des remontées des huit IDEX pour voir comment fonctionnent ces initiatives. Il ne s’agit pas d’un suivi transversal, mais d’une synthèse des suivis par projet.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Ainsi donc, les opérateurs, maîtres d’œuvre, remettent au comité de pilotage un rapport de suivi ; par ailleurs, le conseil de surveillance, sous votre responsabilité, établit annuellement un rapport. À ce double mécanisme s’ajoute une dimension territoriale.
M. Louis Gallois. C’est cela. Nous réalisons également, pour notre gouverne et celle du Premier ministre, des analyses par région ou par action. C’est ainsi que nous faisons actuellement le bilan des SATT, afin de savoir lesquelles fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas, et nous en tirons des conclusions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. M. Sarkozy, qui était alors Président de la République, s’était étonné, après avoir fait le point, que des thématiques liées au cancer n’aient pas été retenues. Comment se fait-il que, sur un tel sujet, il n’y ait pas eu d’appel à projets, ou que ces appels aient été infructueux ?
M. Louis Gallois. Il y a beaucoup de trous dans la raquette. L’un, énorme, concerne les industries agroalimentaires, domaine dans lequel nous ne finançons aucun projet. J’ai, du reste, rencontré à ce propos M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de l’agroalimentaire, pour lui demander comment nous pourrions faire émerger des projets dans ce domaine au titre de nos diverses procédures. Pour ce qui est du cancer, la lacune est désormais comblée.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Comment s’expliquait cette absence ? La qualité des projets et des équipes était-elle insuffisante ?
M. Jean-Pierre Korolitski. Trois lacunes ont été repérées : il manquait des programmes consacrés à la formation, à la sûreté nucléaire et au cancer. Cette constatation a donné lieu à des actions rectificatives.
M. Louis Gallois. J’ai sur ce point un avis divergent. Les investissements d’avenir n’ont pas vocation à couvrir la totalité du champ ; c’est à l’État d’indiquer les champs sur lesquels il souhaite que porte l’action. Dans le domaine technologique, par exemple, j’ai proposé trois priorités – les technologies génériques, l’économie du vivant et la transition énergétique ; ces priorités ont été retenues, mais il s’agit d’un choix politique : le CGI ne soutient pas tout… même si les ministres s’en plaignent.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Avec le recul, avez-vous le sentiment que les investissements d’avenir bénéficient plutôt à des équipes installées, au détriment peut-être d’équipes émergentes ?
M. Louis Gallois. Il me semble que nous soutenons plutôt les émergents ; c’est notre responsabilité. Pour ce qui concerne les entreprises, nous soutenons clairement les start-ups.
M. Jean-Pierre Korolitski. En matière de soutien à la recherche universitaire, le potentiel de base a été un facteur très important pour le choix des lauréats, de telle sorte que ce sont les puissances scientifiques qui ont bénéficié des investissements d’avenir. Cependant, il leur fallait remporter des appels à projets compétitifs et, compte tenu de l’émergence de nouveaux thèmes, c’est l’innovation qui a été le facteur de différenciation.
M. Louis Gallois. De fait, l’équipe de chirurgie micro-invasive du Pr Jacques Marescaux, à Strasbourg, n’a pas attendu les investissements d’avenir pour émerger, pas plus que celle du centre de cardiologie de Bordeaux. En revanche, j’ai réuni les instituts hospitalo-universitaires pour leur demander ce que leur avaient apporté les investissements d’avenir en termes d’attractivité, de moyens nouveaux ou de rythme de publication. Mesurer la valeur ajoutée des investissements d’avenir est la partie la plus difficile de notre travail ; il est beaucoup plus facile d’assurer le suivi en fonction du respect ou non-respect des indicateurs. L’évaluation est un art beaucoup plus compliqué et elle est aussi beaucoup plus importante, car ce qu’attend le pays, c’est de savoir à quoi a servi l’argent investi dans différents domaines.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je souscris à l’idée que le rôle du Commissariat général à l’investissement n’est pas de se substituer au ministère.
Comment s’articule la programmation classique de l’ANR – programmation qui s’appuie elle-même sur les alliances – avec son activité d’opérateur pour le compte du CGI ?
M. Jean-Pierre Korolitski. Il faut d’abord rappeler deux données de base. Tout d’abord, un projet normal de l’ANR représente 300 000 euros sur trois ans, tandis qu’un LABEX représente 10 millions d’euros sur dix ans. Ensuite, une fois le PIA2 entré en régime de croisière, en 2014 ou 2015 par exemple, les moyens de l’ANR issus du PIA représenteront probablement plus des deux tiers des moyens répartis par l’ANR une année donnée.
Lors du lancement du PIA1, ceux des grands programmes qui étaient gérés par l’ANR, comme les LABEX et EQUIPEX, s’apparentaient aux programmes blancs de celle-ci. En effet, ils n’étaient pas thématisés. À l’époque, il s’agissait de donner aux meilleures équipes françaises des moyens supplémentaires pour être à armes égales dans la compétition internationale, et donc de faire sortir ces équipes pour toutes les thématiques, sans limitation. C’est aujourd’hui que se posent des problèmes prégnants de programmation thématique.
La deuxième vague des EQUIPEX a accordé un plus grand intérêt à certaines thématiques qui n’avaient pas été assez soutenues durant la première vague. En prévision du nouvel appel à projets pour EQUIPEX qui sera lancé en 2015, la loi de finances prévoit tout au long de l’année 2014 une concertation en amont, notamment avec les alliances, afin de définir les thématiques sur lesquelles il convient désormais de mettre l’accent. Ce travail est d’autant plus important que devraient être publiées en 2014 les priorités de la stratégie nationale de recherche.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. En quoi les nouveaux EQUIPEX, pour lesquels les appels seront lancés sur la base des informations fournies par les alliances, différeront-ils des programmes blancs de l’ANR ?
M. Jean-Pierre Korolitski. Les programmes blancs de l’ANR ne financent pas d’équipements. Alors que nous n’avons pas lancé de nouveaux LABEX dans le cadre du PIA2, nous avons constaté que le besoin en EQUIPEX perdurait. Les équipes ont encore du mal à trouver les financements nécessaires pour les projets de 1 à 20 millions d’euros.
M. Louis Gallois. L’ANR, en sa qualité d’opérateur, n’a pratiquement pas de marge de manœuvre, car c’est le ministère et nous-mêmes qui définissons la politique. Elle n’est qu’un exécutant. Elle a au contraire beaucoup plus de marge de manœuvre sur ses propres actions. C’est au ministère de l’enseignement supérieur, qui pilote l’ANR, d’assurer une cohérence entre l’ensemble des actions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Ce pilotage existe-t-il ? L’ANR est-elle bien le bras séculier du ministère de la recherche ?
M. Louis Gallois. Il me semble. Les relations entre l’ANR et le ministère ne relèvent cependant pas de mes attributions.
Pour chaque projet, l’ANR établit un compte rendu scientifique et un compte rendu financier, après quoi est mesuré l’impact des actions. Le comité de pilotage, quant à lui, est saisi en cas de problème. Il peut alors, par exemple, décider de plans d’action correcteurs ou interrompre des actions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous donner quelques exemples ?
M. Louis Gallois. Pour l’IDEX de Toulouse, par exemple, étant donné que le programme initialement adopté ne faisait plus consensus après les changements de présidence intervenus dans l’université toulousaine, nous avons indiqué qu’il n’y aurait pas d’IDEX tant que ce consensus n’aurait pas été reconstruit sur des bases respectant les principes des investissements d’avenir. Ce processus a pris un an et nous avons dû convaincre Toulouse de mettre en place un comité d’arbitrage totalement indépendant, ce qui n’était pas prévu au départ, et d’adopter une gouvernance stable. Je ne suis pas certain que ce dernier objectif ait été rempli, car le conseil d’administration reste pléthorique, mais au moins ce conseil dispose-t-il d’un bureau à taille humaine, investi de pouvoirs de gestion. L’IDEX de Toulouse doit être suivie avec le plus grand soin, car c’est celle qui nous pose le plus de problèmes pour ce qui est du respect de nos orientations.
Quant à l’IDEX Sorbonne Universités, l’université de Paris II ayant décidé de s’en retirer, nous l’avons informée qu’elle ne pouvait plus avoir accès aux financements de l’IDEX et que nous allions procéder à un audit de Prolex, l’initiative d’excellence en formations innovantes (IDEFI) qu’elle avait constituée, pour savoir si elle méritait d’être soutenue. Nous avons parallèlement fait savoir à Sorbonne Universités que, la consistance de l’IDEX ayant été modifiée par le retrait d’une université très importante dans le domaine juridique, nous réduisions sa dotation de 100 millions d’euros. Cette dotation ne sera cependant pas réutilisée jusqu’au réexamen des IDEX auquel nous procéderons en 2016. Il reviendra alors à Sorbonne Universités de nous indiquer comment sera reconfiguré le périmètre de l’IDEX afin d’assurer sa cohérence et son équilibre. En fonction des éléments qui nous seront fournis, nous déciderons de réaffecter à l’IDEX tout ou partie de l’enveloppe de notre financement, soit de zéro à 100 millions d’euros.
À Toulouse encore, nous avons mis fin au financement de l’IDEFI FORMADIME, consacrée à la formation des maîtres, du fait d’une modification excessive de ses objectifs.
Mon prédécesseur, M. René Ricol, a acquis ses lettres de noblesse le jour où le jury a refusé le projet de Saclay. C’est à partir de ce jour qu’on a commencé à prendre au sérieux les IDEX.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Et vous, les avez-vous acquises ?
M. Louis Gallois. Pour les acquérir, il faudrait que je m’oppose à un projet très emblématique, tant il est vrai qu’une part de notre crédibilité tient à notre capacité à arrêter les opérations. Je viens ainsi, dans un autre domaine, de supprimer l’institut d’excellence des énergies décarbonées (IEED) Géodénergie, ce qui a provoqué de vifs soubresauts – et a du reste suscité chez les partenaires de ce projet des idées nouvelles.
En tout cas, le jury qui, tout en reconnaissant l’excellence de Saclay, a critiqué sa gouvernance, a montré que nous prenions cet aspect au sérieux.
La partie la plus difficile de notre travail est, je l’ai dit, l’évaluation, qui consiste à identifier les effets transformants et la valeur ajoutée des investissements d’avenir. À ce titre, j’ai notamment réuni les IDEX, les instituts hospitalo-universitaires (IHU) et les instituts de recherche technologique (IRT) pour leur demander comment ils imaginaient l’évaluation de cette valeur ajoutée. Pratiquement tous les patrons d’IHU ont répondu que cette dernière se traduisait par une notoriété internationale accrue, par une capacité à attirer des chercheurs de meilleur niveau grâce à des bourses spéciales permettant de les payer et par une accélération de la publication des recherches permettant à des chercheurs français d’accomplir des premières dans un environnement très compétitif. Les IHU ont également pu créer des plates-formes de moyens communs dans des domaines tels que l’informatique, la simulation ou les tests, pour lesquels il était auparavant très difficile de trouver des financements. Nous aurons encore à juger le nombre de brevets et l’importance des travaux interdisciplinaires, dont le développement est l’un des objectifs des IDEX et des IHU, ainsi que, pour les IDEX, l’impact sur le classement de Shanghai.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pour ce qui concerne les IRT, quelles difficultés concrètes rencontrez-vous pour vous doter d’outils d’évaluation ?
M. Claude Girard, chargé du processus de valorisation et de la recherche technologique au Commissariat général à l’investissement. L’évaluation des IRT ne présente pas de difficulté majeure. Elle doit cependant s’inscrire dans une perspective temporelle, car les problèmes considérés évoluent dans la durée. L’ANR assure des remontées annuelles d’information depuis le terrain et nous disposons actuellement d’un bilan pour la première année et demie de réalisations. Une grande batterie d’indicateurs a été contractualisée et les informations qui remontent sont presque trop abondantes, de sorte qu’une simplification de cette batterie d’indicateurs s’imposera afin d’en tirer l’essentiel pour la gestion et l’orientation des IRT. Nous disposons donc des outils, mais pas encore du recul suffisant pour porter un jugement pertinent : l’évaluation s’affinera progressivement.
Au-delà de ce dispositif d’évaluation stricto sensu, nous réalisons des visites sur le terrain : le succès des IRT est très lié au management et à l’affectio societatis. Nous nous rendons sur le terrain pour constater si « la mayonnaise prend » entre les industriels et le monde universitaire.
M. Jean-Pierre Korolitski. Au-delà des mesures internationales de performance que l’on peut appliquer aux IDEX, on verra également l’utilité des IDEX pour la politique visant à organiser des regroupements stables d’établissements. La question se pose tant pour les actuelles IDEX que pour les établissements qui souhaitent le devenir.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il s’agit donc d’un levier. Le ministère partage-t-il cette opinion ?
M. Louis Gallois. Il la partage intellectuellement mais, bien que Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, souhaite des regroupements universitaires, elle doit tenir compte de la réalité et des difficultés du terrain politique. La démocratie universitaire fonctionne de telle sorte que les présidents d’université changent tous les quatre ans, non parce que certaines équipes seraient meilleures que d’autres, mais pour des raisons politiques, au sens noble du terme : tous les quatre ans s’affrontent des visions d’ensemble de ce que doit être l’université. C’est la raison pour laquelle je souhaite que l’IDEX reste en dehors de cela.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Cette question est essentielle, car la contrepartie de l’autonomie des universités est que l’État doit avoir une vision du paysage universitaire : il faut tenir les deux bouts. Or les IDEX peuvent avoir un important effet de levier sur l’organisation du paysage universitaire.
M. Louis Gallois. Les IDEX constituent en effet un levier pour le regroupement, comme le montre bien l’exemple de Saclay, où il est stupéfiant de voir l’École polytechnique travailler avec Paris-Sud. L’effet transformant de l’IDEX est évident et aurait été inimaginable du temps où cohabitaient Paris Tech et les universités. Je suis plus inquiet pour l’IDEX de Toulouse, où je n’ai pas senti de véritable affectio societatis. Il en va de même à Montpellier, où le niveau scientifique est tout à fait adapté, mais où, faute d’entente entre les universités, il sera très difficile de constituer une IDEX. En effet, nous ne pouvons pas accepter une gouvernance insuffisante.
Le fait que les présidents d’université changent tous les quatre ans, et avec eux les orientations fondamentales des universités, peut déstabiliser les communautés universitaires. Je souhaite que les IDEX soient assez solides pour ne pas être trop perturbées par ces événements. Elles ont assez bien tenu jusqu’ici, mais des difficultés sont inévitables.
M. Jean-Pierre Korolitski. Le PIA2 comportera un programme d’initiatives d’excellence plus diversifié et il nous fallait donc savoir comment articuler, ne serait-ce qu’en termes de calendrier, le lancement de ce programme avec la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Il a finalement été décidé que l’année en cours serait consacrée à la mise en application de la loi et que les dossiers de candidature au titre des IDEX seraient constitués ultérieurement, sur la base de ce que les acteurs auraient décidé de faire ensemble. Ce calendrier permet de réguler l’un des problèmes rencontrés dans le cadre du PIA1, où l’IDEX était constituée sur la base d’une « déclaration d’amour » et était immédiatement applicable, ce qui a causé certains décalages. Dans le nouveau calendrier, il faudra donner d’abord une « preuve d’amour », c’est-à-dire définir préalablement quelles compétences les partenaires décident d’exercer en commun et quelle configuration ils adoptent à cette fin.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il faut que cette logique soit suivie.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je voudrais évoquer les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) et leur inscription dans la continuité des investissements d’avenir. Si la France doit rester parmi les leaders mondiaux en matière de recherche, elle ne doit pas oublier pour autant le volet innovation. Mesurer le nombre de brevets déposés est nécessaire, mais insuffisant : il faut aussi savoir ce qu’il adviendra du brevet une fois qu’il aura été déposé et en quoi ce dispositif financé par les deniers publics contribue au fonctionnement de l’économie.
En tant qu’élu du Bas-Rhin, la SATT que je connais le mieux est Conectus.
M. Louis Gallois. C’est celle qui marche le mieux.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je suis heureux de vous l’entendre dire.
Lorsque des brevets partent vers des territoires non européens, on se demande si on a fait le travail jusqu’au bout. C’est un point clé pour les années à venir. Ainsi, je suis toujours gêné de voir que le service du Pr Marescaux fait la promotion de Siemens, voire de General Electric : je préférerais voir sur son matériel des estampilles françaises.
M. Louis Gallois. En matière d’équipements de santé, la situation de la France est en effet dramatique, et il nous faut reconstruire intégralement une industrie dans ce domaine. Comme je l’ai dit chaque fois que j’en ai eu l’occasion, notamment à M. le ministre Arnaud Montebourg, alors que les hôpitaux achètent chaque année pour 18 milliards d’euros d’équipements, nous n’avons aucune politique industrielle ni d’achats dans ce domaine. Les contraintes communautaires ne suffisent pas à justifier que l’on ne fasse rien.
L’une des tâches essentielles des programmes d’investissements d’avenir est d’assurer le flux qui va de la recherche à la mise sur le marché et d’éviter qu’il y ait des « vallées de la mort ». En particulier, ce flux s’arrête s’il n’y a pas de valorisation après la publication.
Les SATT sont précisément destinées à assurer cette valorisation. Certes, elles n’ont pas vocation au monopole : d’autres institutions, comme Inserm Transfert, font bien leur travail. Je souhaite une coordination entre ces institutions et les SATT. Nous avons récemment rencontré M. André Syrota, président-directeur général de l’INSERM, qui nous a confirmé que cette coordination avec les SATT fonctionnait assez bien, sauf dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et avec Innov, une SATT de la région parisienne. Il semble donc bien que nous ayons amorcé un processus de convergence. La vocation essentielle des SATT est de travailler avec les universités, qui ont les plus grands problèmes de valorisation – ce qui n’est évidemment pas le cas du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ni de l’INSERM. Les SATT comblent une lacune béante en matière de valorisation.
Dans le domaine de la recherche technologique, nous avons rencontré de grandes difficultés avec les instituts pour la transition énergétique (ITE), dont j’ignore même s’ils sont désormais tous stabilisés et que nous allons suivre de très près. Bon nombre de ces difficultés tenaient à la complexité des procédures européennes, mais aussi à l’affectio societatis : si beau que soit un projet, si chacun tire la couverture à soi, il ne marchera pas.
Les instituts de recherche technologique (IRT) me semblent mieux partis, et nous avons entrepris d’établir un bilan permettant de savoir lesquels fonctionnent bien ou mal. Ainsi, nous avons invité Bioaster à avancer plus vite et l’avons menacé, dans le cas contraire, de fermer le robinet.
Plus en aval de la maturation assurée par les SATT, on trouve les fonds d’amorçage, puis le capital-risque. Je précise à ce propos que nous finançons la Banque publique d’investissement (BPI) afin qu’elle puisse financer du capital-risque et du capital-développement. Le marché doit ensuite prendre progressivement le relais. À ce propos, la faiblesse du private equity en France depuis la crise est un souci. Le problème n’est pas tant le départ des brevets à l’étranger que le rachat de start-ups par des entreprises étrangères.
Quant aux brevets, j’ai indiqué au patron de France-Brevets que la France ne devrait pas seulement vendre des grappes de brevets à l’étranger, mais aussi en acheter, car ces achats ouvrent, dans certains domaines, un raccourci. Il ne s’agit pas de transformer France-Brevets en un organisme spéculant sur les brevets, comme il en existe aux États-Unis, mais d’assurer une gestion et une valorisation des portefeuilles de brevets. Nous avons absolument besoin de cet outil, qui commence à fonctionner, mais il faut aussi, je le répète, le faire évoluer vers l’acquisition de brevets.
M. François Rosenfeld. Pour ce qui est du risque de voir les fruits du travail des SATT bénéficier à des acteurs extérieurs à nos frontières, je tiens à rappeler que le PIA a permis de mettre en place un continuum d’outils de financement qui va du stade non-économique et très fondamental jusqu’à la mise sur le marché. Or l’analyse révèle parfois que certains projets de recherche ne pourront pas être portés utilement par des entreprises françaises ou européennes. Dans le cas de Conectus, par exemple, il est avantageux pour la SATT de gérer un portefeuille assez large pour, selon les résultats de ce travail d’analyse, se ménager, sur certains projets, par le transfert de brevets ou de licences à des acteurs étrangers, un important retour purement économique lui permettant de financer son activité, et pour d’autres projets, d’accepter un moindre impact économique pour elle-même et de privilégier des effets socio-économiques plus importants en termes d’emploi aux niveaux local et national et de développement de filières. Le système de crible mis en place par Conectus pour gérer son portefeuille et analyser les dossiers selon le triple critère du niveau de risque, de l’engagement financier et des bénéfices socio-économiques est donc particulièrement intéressant.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Cela est d’autant plus vrai que Conectus est appuyé par Alsace Innovation, qui permet des financements. Les investisseurs privés devraient être davantage incités à financer ces projets, mais cela dépasse le cadre de notre mission d’évaluation et de contrôle. Sur ce point, nous devrons nous pencher un jour sur la question de l’assurance vie.
M. Louis Gallois. Nous dotons la BPI de 600 millions d’euros de fonds d’amorçage et finançons divers fonds sectoriels. Nous finançons aussi, à hauteur de 600 millions d’euros également, un fonds multithématique destiné à investir dans des fonds pour exercer un effet de levier sur les investissements privés.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous évoquer les dotations non-consommables et leur devenir ?
M. Louis Gallois. Les dotations non-consommables ont vocation à le demeurer. Cependant, dès lors que sera franchie l’étape de 2016, elles seront acquises définitivement à l’IDEX, qui doit ainsi bénéficier d’une rente à vie.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je souhaiterais revenir sur les alliances. L’une d’entre elles accomplit un travail remarquable sur les sciences du vivant, que vous avez présentées tout à l’heure comme l’une de vos priorités. Quelles sont les coopérations entre cette alliance et le CGI ?
M. Claude Girard. Le métier de cette alliance est de veiller, avec l’ensemble de ses membres, à la cohérence de la programmation de la recherche dans le domaine de la santé. Nous avons couplé à l’alliance un consortium de valorisation thématique (CVT) à compétence nationale, qui veille, lui, à la cohérence des politiques de valorisation des différents membres de l’alliance.
Cette orientation stratégique en matière de valorisation de la recherche dans le domaine de la santé a également des répercussions sur les SATT. Celles-ci, qui sont par définition plurithématiques, peuvent, en matière de santé, inscrire leurs brevets et les fruits de leur valorisation dans un domaine stratégique perçu au niveau national par l’alliance. C’est là une bonne articulation en termes d’orientation de la valorisation dans le domaine de la santé.
M. Louis Gallois. Les CVT m’ont paru manquer un peu de dynamisme ; une réunion a donc été organisée la semaine dernière pour les inciter à aller plus vite et plus fort, sans se limiter à être des clubs sympathiques d’échanges de vues. Dans la mesure où des financements sont engagés, des actions plus dynamiques doivent être menées.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Dans certains secteurs, comme le spatial et l’aéronautique, il n’existe pas de CVT.
M. Louis Gallois. Ils n’en ont pas besoin. Avec un syndicat professionnel, un Conseil pour la recherche aéronautique civile française (CORAC), qui réunit tous les acteurs et qui a l’efficacité d’un véritable bulldozer, et avec l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), l’industrie aéronautique est unie et déterminée. Elle s’est dotée de programmes et sa capacité à déposer des dossiers n’est plus à démontrer. Il me semble donc inutile d’ajouter une structure supplémentaire. L’industrie automobile, qui a d’énormes difficultés pour s’organiser et ne possède aucune tradition en la matière, suscite plus d’inquiétudes.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Y a-t-il encore des « trous dans la raquette » pour ce qui concerne les CVT existants ? Certaines thématiques devraient-elles encore être couvertes ?
M. Claude Girard. La couverture est déjà assez large : un CVT est adossé à chaque alliance thématique de recherche ; de plus, un CVT supplémentaire, très spécifique, a été ajouté pour la valorisation à destination des pays du Sud.
Dans le domaine de l’aéronautique, nous nous sommes, en outre, assurés que les outils que nous avons mis en place pour la valorisation de la recherche, notamment les IRT, soient en cohérence avec la politique nationale définie par le CORAC.
M. Louis Gallois. L’IRT Jules Verne, à Nantes, est dirigé par le patron de l’usine Airbus de Saint-Nazaire, ce qui laisse penser que l’aéronautique y est bien représentée. Quant à l’IRT Saint-Exupéry, à Toulouse, il est intégralement consacré à ce secteur. Le problème, je le répète, c’est l’automobile.
M. François Rosenfeld. En cumulant le PIA1 et le PIA2, 2,9 milliards d’euros ont été spécifiquement fléchés en direction de l’aéronautique, IRT non compris – et hors spatial.
M. Louis Gallois. J’en viens à la simplification. Dans le domaine qui vous intéresse, elle passe par un recours systématique à des conventions de préfinancement pour le PIA2. L’expérience a également montré que l’on pouvait supprimer des documents conventionnels et des annexes n’ayant pas de véritable valeur ajoutée. On a enfin observé que l’on pouvait supprimer certaines étapes intermédiaires de validation des conventions et accélérer le processus de ces conventions pour nos principaux projets, soit quatre ou cinq IDEX supplémentaires et quatre ou cinq initiatives structurantes innovation-territoires-économie (ISITE).
M. François Rosenfeld. Le Gouvernement avait annoncé, lors du lancement du PIA2, une revue transversale des procédures des actions destinées à être amplifiées par ce programme, afin de bénéficier du retour d’expérience.
Nous avons engagé ce travail par le haut, avec un audit du CGI et de la façon dont il fonctionnait avec ses opérateurs, mené par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). Cet audit a été suivi de plusieurs travaux de simplification, par opérateur, dans les domaines où les enveloppes de financement à venir seront importantes.
Dès le mois d’octobre, nous avons saisi l’ANR en tant qu’opérateur du programme, pour lui demander quelles étaient, selon elle, les pistes de simplification. À l’issue d’une première réunion de travail, nous avons pu dégager quelques pistes, que vient d’évoquer le commissaire général. Avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui est également un opérateur très important du deuxième PIA – comme elle l’était du reste déjà pour le premier –, nous avons engagé un travail plus lourd, avec l’appui du SGMAP et de conseils indépendants, visant à décortiquer le processus que suit un projet, de son dépôt au dernier versement, afin de voir si toutes les étapes étaient bien nécessaires à la qualité de la décision finale et si la répartition de la charge de travail était cohérente. Les projets suivis tant par l’ANR que l’ADEME, sont en effet de natures très différentes avec des financements qui peuvent aller de 2 millions d’euros à 20 millions d’euros.
Il s’agit donc, en fonction des enjeux tant financiers que scientifiques ou économiques, d’adapter le processus d’instruction afin de répondre aussi efficacement que possible aux préoccupations des porteurs de projets. En effet, tandis que les dix-huit mois qui s’écoulent entre le dépôt de leur dossier et l’attribution du financement permettent à certains de mûrir leur projet, ce délai est inacceptable pour d’autres, par exemple dans le domaine du numérique, qui progresse très vite et où l’enjeu est d’être le premier sur le marché. Nous sommes donc parvenus à un stade très avancé avec l’ADEME, avec laquelle nous avons mené de nombreux ateliers thématiques, et nous allons déboucher, d’ici à la fin du mois, sur des propositions très concrètes de simplification. Ce travail sera suivi d’un élargissement aux autres opérateurs – ANR, Caisse des dépôts et BPI.
Par ailleurs, pour les projets structurants des pôles de compétitivité (PSPC), le délai d’instruction entre le dépôt du projet et la contractualisation est passé de pratiquement vingt mois pour les premiers projets, très collaboratifs et qui pouvaient réunir jusqu’à une vingtaine de partenaires, à trois mois tout compris aujourd’hui. En contrepartie de cette réduction significative, nous affichons d’emblée des contraintes que les partenaires doivent s’engager à respecter. S’ils veulent renégocier certaines de ces conditions, ils sont prévenus que l’instruction sera plus longue.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Qu’en est-il de la dimension territoriale du processus ?
M. Louis Gallois. Notre charte ne comprend pas d’objectifs relatifs à l’aménagement du territoire, ce qui suscite des débats – j’ai eu, à ce propos, un déjeuner animé avec M. Alain Rousset, président de l’Association des régions de France. Ma mission n’est pas de mener vingt-deux programmes d’investissements d’avenir – elle y perdrait beaucoup de son intérêt. J’ai néanmoins assuré M. Rousset que nous ne nous désintéressons pas de l’impact territorial. Nous effectuons des analyses régulières des volumes financiers affectés et des synergies que les investissements d’avenir ont pu créer, et nous nous assurons que certaines régions ne sont pas passées à côté.
Lorsque nous constatons qu’une région est en retard, nous prenons contact avec les acteurs régionaux et nous voyons avec eux comment ils pourraient être candidats dans de meilleures conditions à nos financements, quels efforts ils doivent faire et quels conseils nous pouvons leur apporter à cette fin. Il ne s’agit pas de remettre en cause nos procédures, mais d’aider les régions à les remplir au mieux. Chaque fois qu’un président de région se plaint de ne pas avoir sa part, nous examinons ensemble les chiffres et, si la région s’estime très décalée par rapport aux autres, nous voyons comment elle peut les rattraper. C’est ce que je m’efforce également de faire avec les secteurs qui n’ont pas bénéficié des investissements d’avenir, comme l’agroalimentaire et même l’automobile, pour laquelle nous devrions pouvoir faire plus, compte tenu des problèmes qu’elle rencontre.
Nous tenons cette étude territoriale à jour avec les préfets de région, qui ont été mobilisés par le nouveau patron de notre pôle territorial, M. Michel Guillot, ancien préfet, et avec lesquels nous travaillons bien. Nous intensifions également nos relations avec les présidents de région, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région (CPER), auxquels nous ne sommes pas partie prenante.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Vous n’affectez pas aux CPER des crédits de substitution ?
M. Louis Gallois. Non, puisque nous n’y sommes pas partie prenante. Néanmoins, le Premier ministre ayant déclaré que les investissements d’avenir ne pouvaient pas s’abstraire de la dimension territoriale, il nous a semblé que la meilleure manière de procéder était d’entretenir un contact plus étroit avec les instances régionales afin de les aider à présenter un plus grand nombre de candidatures dans le cadre de nos procédures. Nous pouvons, en outre, aller un peu plus loin en matière de coordination dans certains domaines, comme la formation professionnelle, qui est désormais une responsabilité des régions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Parmi les nombreux dispositifs de financement existants, investissements d’avenir, ANR ou crédits européens – auxquels nos équipes ont insuffisamment postulé ces dernières années –, que faudrait-il faire bouger, quelle meilleure coordination pourrait-on adopter au profit de la recherche ? De fait, cet empilement de sources de financement se traduit par une certaine complexité. Le manque de lisibilité ne pose-t-il pas un problème de gouvernance préjudiciable à la décision politique ?
M. Louis Gallois. La politique de l’enseignement supérieur et de la recherche a un patron : le ministre. Notre rôle se limite à lui fournir des éléments de référence et à l’aider à promouvoir les centres de recherche qui participent à la compétition mondiale. La coordination, j’y insiste, tout comme la cohérence de la politique de l’enseignement supérieur et de la recherche, relève du ministre, sous l’autorité du Premier ministre. Mes relations avec Mme Fioraso, avec son cabinet, avec M. Jean-Paul de Gaudemar, conseiller du Premier ministre pour l’éducation, et avec M. Vincent Berger, conseiller du Président de la République pour l’enseignement supérieur et la recherche, sont du reste d’excellente qualité. Le dispositif de pilotage de l’enseignement supérieur est clair.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’ANR, qui est votre principal opérateur, n’a-t-elle pas un problème de gouvernance ?
M. Louis Gallois. La difficulté ne tient pas à son rôle d’opérateur de nos programmes, mais à son autonomie vis-à-vis du ministère.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le CGI ne bénéficie-t-il pas lui-même d’une très forte autonomie ?
M. Louis Gallois. J’ai presque plus de contacts avec le ministère que n’en a l’ANR. Le CGI ne mène en aucun cas sa propre politique de recherche. Cette politique relève de la ministre. Le CGI ne décide pas sans elle sur une IDEX, sur un conventionnement. Elle préside le comité de pilotage. Elle a été au jour le jour à la manœuvre pour faire face aux difficultés que nous avons rencontrées à Toulouse.
M. Jean-Pierre Korolitski. Les crédits des investissements d’avenir sont massifs, s’inscrivent dans la durée et ont un très fort effet de labellisation ou de reconnaissance. Autrement dit, ce sont des crédits particulièrement incitatifs.
Pourquoi a-t-on besoin de crédits incitatifs ? La réponse apportée par les pouvoirs publics, avant et après l’alternance, est que le système n’est pas dans l’état où il devrait être et que certains problèmes ne sont pas encore résolus, ce qui suppose de faire bouger certaines lignes. Autrement dit, si nos universités étaient plus stables, à l’instar du modèle international, peut-être n’aurions-nous pas besoin de ce dispositif.
L’un des points sur lesquels les crédits incitatifs peuvent faire bouger les lignes est la fameuse coupure entre universités et grandes écoles, d’une part, et entre enseignement supérieur et organismes de recherche, d’autre part.
Un autre est la diversification du système. Nous n’avons pas d’intérêts propres en la matière, mais on voit très bien qu’il est difficile pour le ministère, qui a la charge de tout l’ensemble, de faire progresser la diversification, par exemple, et que nous pouvons l’aider, de l’extérieur, au moyen de crédits incitatifs.
M. Louis Gallois. C’est là le point essentiel : nous pouvons faire des choses que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, bien qu’elle soit sur la même longueur d’ondes que nous, ne pourrait guère faire seule, comme de dire que certaines universités ou certains laboratoires sont meilleurs que d’autres et que, de ce fait, ils doivent recevoir les moyens de se battre dans la compétition mondiale. C’est un domaine où nous l’aidons vraiment, et elle le reconnaît.
M. Patrick Lefas, président de la troisième chambre de la Cour des comptes. La Cour des comptes est intervenue plus en amont, lors de la mise en œuvre du processus, et le relevé d’observations définitives que nous avons adressé au CGI l’été dernier, s’il soulignait un certain nombre de risques, était moins critique que bon nombre de nos écrits et reflétait une image globalement assez positive de la mise en œuvre du programme. Le président de la commission des finances a demandé au premier président de la Cour des comptes la communication de ce relevé d’observations définitives, qui est, depuis hier, entre les mains des deux commissaires de la mission d’évaluation et de contrôle et dont la publication est désormais à la discrétion de la MEC – nous le mettrons en ligne si elle en décide ainsi. Il me semble, à vous entendre, que vous avez déjà pris en compte les difficultés mises en lumière dans ce document et que certains éléments correcteurs sont déjà à l’œuvre, ce qui est très rassurant, même si beaucoup reste à faire.
Je soulignerai essentiellement trois points. Le premier est qu’il ne faut pas définir d’une manière trop simpliste les rôles respectifs du ministère, du Commissariat général à l’investissement et de l’opérateur chargé de la mise en œuvre des investissements d’avenir. Par comparaison avec d’autres opérateurs, il n’est pas certain que l’ANR soit celui qui ait le moins bien rempli sa fonction. Sa directrice générale a accompli un travail très important, avec des moyens renforcés – nous avions souligné le retard pris par la phase du conventionnement et les équipes ont été étoffées.
L’ANR a cependant une autre mission : les appels à projets. Il ne faut pas trop prêter attention aux affirmations du ministère selon lesquelles il va définir la stratégie, car celle-ci est à l’œuvre dans les alliances et, au niveau des projets, ce n’est plus le ministère qui intervient.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’alliance permet toutefois au ministère une meilleure coordination.
M. Patrick Lefas. Certes. Le plus important reste cependant la définition des enveloppes – vous avez justement évoqué notre retard dans le domaine des sciences du vivant, particulièrement sensible par comparaison avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont fait des efforts considérables dans ce domaine.
Au-delà de la stratégie, dans le détail des procédures qui conduiront aux appels à projets, il faut donner sa chance à l’ANR, qui n’a pas démérité.
En matière de soutien aux filières industrielles, l’ANR intervient essentiellement sur le multithématique, tandis que les autres opérateurs, qu’il s’agisse de l’ONERA, du Centre national d’études spatiales (CNES), du CEA ou de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), sont davantage positionnés sur des thèmes précis.
En deuxième lieu, le rejet de la première proposition pour le plateau de Saclay, sur laquelle nous avions appelé votre attention, a eu un effet considérable et salutaire, et vous avez à juste titre souligné que, lorsqu’un projet ne marche pas, il faut en tirer les conséquences. Néanmoins, les universités qui ont concouru au titre des IDEX étaient confrontées à une opération complexe. C’était notamment la première fois qu’il leur fallait s’exprimer en anglais. Il leur a aussi fallu monter leurs dossiers dans des délais records, en passant par-dessus les structures de gouvernance et de consultation, ce qui n’a pas été sans conséquences : ainsi, le président Louis Vogel, héraut de l’IDEX Sorbonne-Universités, n’a pas été suivi par sa propre université et a même été remplacé par un autre président.
Les délais prescrits étaient très contraints ; sans doute faut-il laisser un peu plus de temps, tout en exerçant un suivi très vigilant. Enfin, le retrait d’un participant, par exemple, appelle évidemment des conséquences financières, mais d’autres mesures de sanction que l’arrêt sont possibles, et il convient de réfléchir à une gradation de ces sanctions.
En troisième lieu, les assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ont largement évoqué, comme l’a mis en évidence le rapport Berger, une structuration institutionnelle qui n’a d’égale que celle du bloc communal. Il convient, dans la structuration que vous avez poussé à mettre en place, d’éviter soigneusement les doublons, qui sont source de dysfonctionnements et alourdissent les charges de fonctionnement. Cette remarque vaut pour la problématique de la valorisation, évoquée à juste titre tout à l’heure. Des frottements demeurent entre Inserm Transfert et la SATT Innov. Le contrôle que nous avons effectué sur le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en est à la phase de la contradiction, de telle sorte que nous ne pouvons pas en tirer les enseignements avant d’avoir reçu les réponses du CNRS et du ministère. Le risque existe d’une mauvaise articulation entre ces structures de valorisation régionale, celles des organismes de recherche et les nouvelles structures créées au niveau national : la multiplication de ces structures est incontestablement un problème.
Le dernier point que j’évoquerai est très positif : la dimension d’évaluation a été prise en compte très tôt, ce qui est d’autant plus essentiel compte tenu de la fonction d’évaluation des politiques publiques qui incombe au Parlement et à laquelle la Constitution prescrit à la Cour des comptes de contribuer. Cependant, on observe très souvent que les objectifs ne sont pas définis et que les structures chargées de cette évaluation ne sont pas mises en place. Les investissements d’avenir ont réglé ces deux problèmes. Il reste à nous donner le temps nécessaire, et le rendez-vous fixé dans quatre ans devrait permettre, à cet égard, d’y voir plus clair.
Chemin faisant, les activités des investissements d’avenir dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche n’en présentent pas moins des risques réels, qui appellent une grande attention dans la procédure de suivi.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourrions-nous avoir copie de l’audit réalisé sur le CGI ?
M. François Rosenfeld. Ce rapport a été transmis aux membres des deux assemblées siégeant au Conseil de surveillance.
M. Louis Gallois. Je précise qu’il s’agit bien d’un audit du CGI, et non pas des procédures que nous mettons en œuvre. Nous avons, en effet, considéré qu’il fallait commencer les audits par nous-mêmes, ce qui nous rendrait plus légitimes pour demander des audits aux autres. J’ai ensuite demandé à l’ADEME un audit des procédures engagées entre elle et nous, car la multitude des projets lancés embouteille l’ADEME et il nous faut améliorer cette situation. Parallèlement à ce processus – qui n’a pas été sans difficulté, car l’ADEME a d’abord pensé que nous avions l’intention de l’auditer, ce qui n’est pas notre rôle –, nous avons engagé la même démarche avec l’ANR. L’exercice est plus difficile avec la Caisse des dépôts, grande maison qui a ses traditions et qui, compte tenu de sa propre envergure, s’interroge sur notre légitimité à lui demander quoi que ce soit – il n’empêche que nous avons tout de même quelques questions à lui poser.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous également nous communiquer vos bilans territoriaux ?
M. Louis Gallois. Nous en avons reçu jusqu’à présent une quinzaine. Il faudra veiller à ce que ces documents ne reviennent pas dans les régions ; ils y susciteraient des débats sans fin avec les régions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Nous partageons pleinement votre opinion. Nous serons très prudents. Nous en prenons l’engagement.
M. Louis Gallois. Pour ce qui concerne l’ANR, je n’ai pas de critiques à formuler, et Mme Pascale Briand fait un excellent travail. La relation avec elle est fluide et agréable, et nous évoquons aisément avec elle la simplification.
Que Saclay ait été un choc, c’est un fait : il faut parfois faire des exemples. Il faut bien sûr établir une hiérarchie des réactions à des manquements ou à des difficultés. Notre mission n’est pas d’arrêter les opérations, mais d’abord de les remettre dans le droit chemin – c’est à cette fin que nous sommes en discussion avec plusieurs institutions, et ce n’est que si nous constatons que ce n’est pas possible qu’il faudra arrêter.
Pour ce qui est de la structuration des blocs universitaires, je m’interroge quant à la possibilité d’avoir à la fois des communautés d’universités et des IDEX. L’IDEX est un périmètre d’excellence qui ne doit pas perdre sa spécificité et qui fait précisément l’objet d’un suivi sur ce point de l’excellence et sur sa gouvernance. Or on observe dans le milieu universitaire une tendance à penser que l’existence des communautés d’universités rendrait caduc le modèle de l’institution IDEX en tant que tel.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. C’est fondamental. L’IDEX peut avoir un caractère incitatif pour la restructuration, mais il ne s’agit pas d’en faire un copier-coller.
M. Louis Gallois. C’est tout à fait notre point de vue.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je souscris pleinement à cette analyse. Lorsque vous avez évoqué la situation de Toulouse, vous avez préconisé le recours à un comité d’arbitrage indépendant. Ce dispositif mis en place en situation de crise pose la question de savoir ce qui relève du périmètre d’excellence. Si ce périmètre est dilué, on tue le principe même des investissements d’avenir.
M. Louis Gallois. Nous résistons à cette tendance. Le comité d’arbitrage a été plus difficile à mettre en place à Toulouse qu’ailleurs, car une université y était très opposée. Il a donc fallu de la persuasion, fondée notamment sur l’argument que, si les choses continuaient ainsi, il n’y aurait pas d’IDEX. Cela signifie en tout cas que cette opération doit être suivie de très près, car nous pourrions revenir en arrière et noyer les spécificités de l’IDEX dans la communauté d’universités, où il n’y aurait plus qu’à procéder à une équirépartition de l’enveloppe entre les différentes universités.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Les bonus qualité recherche (BQR) attribués dans les universités se sont, en effet, achevés par l’équirépartition, au point que les patrons de laboratoires quelque peu dynamiques refusaient de candidater, sachant qu’il n’y avait plus de bonus à attendre au-delà de l’équirépartition.
M. Louis Gallois. Le bonus venant du CGI est attribué en fonction d’une excellence et d’une compétition.
Je reviens aux SATT : s’il faudra progressivement réduire l’effervescence des nombreuses structures existantes dans le domaine de la valorisation, les SATT ne doivent pas pour autant être celles qui feront table rase du passé et élimineront les autres. Très souvent, en effet, la SATT se met dans les pas d’une structure existante. C’est notamment le cas dans la région PACA, où la SATT a suivi la trace du dispositif mutualisé de transfert technologique PACA Innovation, qui lui a donné au départ une impulsion très forte. La nature fera ensuite son œuvre et un certain nombre de structures de valorisation se regrouperont autour de la SATT ou dans celle-ci. Dans certaines régions, l’INSERM a même complètement délégué à la SATT la valorisation de sa recherche.
Je ne souhaite pas me battre avec les autres structures dans l’espoir de dessiner un jardin à la française. Il s’agit seulement de mettre un peu d’ordre dans la petite effervescence que nous observons et de laisser vivre les écosystèmes régionaux.
Par ailleurs, le CGI est en train de mettre en place le « management des risques », qui n’est pas une démarche de suivi, mais une évaluation des risques que certaines opérations pourraient faire courir à nos dotations. L’innovation est un domaine risqué et s’il faut certes accepter une certaine part de risque, il existe des dangers qui tiennent à un défaut de management ou au fait que les acteurs ne s’entendent plus, auxquels il faut pouvoir parer assez tôt. J’ai donc demandé que les opérations qui nous sont présentées par les préfets comme étant en difficulté fassent l’objet d’un suivi individuel afin que nous puissions traiter le problème dès le début du processus. Il n’y a pas de raison pour que le CGI ne puisse pas mettre en œuvre cette démarche, pratiquée par les entreprises.
M. Patrick Lefas. Que prévoyez-vous de faire au vu de l’échec des instituts Carnot ?
Par ailleurs, les EQUIPEX, qui ont comblé un vide entre les très grandes infrastructures scientifiques et les équipements qui peuvent être financés sur le budget normal du laboratoire, ont eu un succès considérable malgré quelques difficultés. La lourdeur de l’investissement nécessaire pour financer les équipements d’une recherche performante suscite cependant des inquiétudes, et il faut donc penser soit à lancer une deuxième vague d’EQUIPEX dans le cadre des arbitrages du PIA2, soit à assurer dans la durée des règles d’amortissement et des conditions garantissant des crédits suffisants aux laboratoires pour assurer ce financement.
M. Louis Gallois. C’est une question centrale.
M. Claude Girard. Nous avions lancé deux appels à projets pour les instituts Carnot : l’un à l’international et l’autre pour favoriser la relation entre les instituts Carnot et les petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI). Un bilan dressé après cinq ans d’existence faisait apparaître une faiblesse des instituts Carnot sur ces deux plans. Peut-être avons-nous été trop ambitieux en lançant l’appel à projet trop tôt, confirmant ainsi la faiblesse des instituts dans leurs relations avec les PME et ETI.
Nous avons cependant reçu des réponses, et trois projets ont été financés, pour lesquels l’articulation avec les PME fonctionne bien. Nous sommes cependant loin d’avoir consommé la totalité de l’enveloppe disponible.
Depuis lors, les instituts ont travaillé sous la direction de l’Association des instituts Carnot et vont se constituer en filières industrielles pour cibler les PME et ETI. Un nouvel appel à projets sera lancé cette année pour permettre aux instituts Carnot, organisés cette fois par filière industrielle, de répondre aux PME et ETI. Nous espérons qu’ils seront désormais mieux organisés et plus à même de reprendre la balle au bond.
M. Louis Gallois. Associer davantage de PME et d’ETI à nos programmes est pour nous un axe de travail.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Messieurs, je vous remercie.
Audition du 8 avril 2014
À 16 heures 30 : Mme Pascale Briand, directrice générale de l’Agence nationale de la recherche (ANR), accompagnée de M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » et de Mme Daniela Floriani, directrice administrative du même département
Présidence de M. Olivier Carré, Président
M. le président Olivier Carré. Nous recevons aujourd’hui Mme Pascale Briand, directrice générale de l’Agence nationale de la recherche (ANR), accompagnée de M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » et de Mme Daniela Floriani, directrice administrative du même département. L’ANR étant l’opérateur principal de la mise en œuvre des investissements d’avenir dans le domaine de la recherche, l’audition de sa directrice générale est essentielle pour éclairer les travaux de la MEC.
Madame la directrice générale, nous souhaitons bien sûr entendre vos réponses aux questions qui vous ont été préalablement communiquées. Nous aimerions aussi avoir votre avis sur la complémentarité entre les investissements d’avenir et les actions financées par le budget de la recherche. Enfin, pouvez-vous citer des cas concrets dans lesquels ces investissements ont permis de donner un coup d’accélérateur aux programmes en cours ?
Mme Pascale Briand, directrice générale de l’Agence nationale de la recherche. En préambule, je souhaite rappeler que si l’ANR a été désignée comme opérateur des programmes d’investissements d’avenir, c’est sans doute parce qu’elle était en mesure de garantir une mise en place compétitive du processus de sélection, eu égard à son expérience depuis 2006. Ce choix est un témoignage de reconnaissance des compétences dont l’Agence a fait preuve dans les actions de sélection, de conventionnement et de suivi en matière de financement sur projet.
L’organisation de la gestion d’une opération de l’importance du programme d’investissements d’avenir a été un enjeu majeur pour l’ANR. Un dispositif dédié à la sélection des projets présentés dans le cadre des quatorze actions définies dans le PIA 1 a été mis en place. Les jurys, internationaux et composés de pairs comme l’exigeait le programme, ont été très rapidement installés, en 2010. Cette installation a été suivie d’une phase de conventionnement au gré de la finalisation des actions.
Parmi les opérateurs en charge des investissements d’avenir, l’ANR est celui dont le champ d’action est le plus large. Son efficacité est également à souligner puisqu’elle accomplit sa mission avec une augmentation très modérée du nombre d’ETP.
Immédiatement après la phase de sélection et de conventionnement, l’ANR a construit le suivi des projets, pour lequel elle a également dû se réorganiser. Ce suivi se distingue de celui qui prévaut pour les projets classiques par sa durée – dix ans – et par l’envergure et la diversité des opérations suivies. La réorganisation a donné lieu à la création d’un département « Investissements d’avenir et compétitivité » auquel est assignée la triple mission de suivi par projet, par action et par territoire. Nous avons, en outre, élaboré des outils d’analyse thématique pour évaluer la contribution des investissements d’avenir à la consolidation du dispositif national de recherche.
La valeur ajoutée des investissements d’avenir par rapport au dispositif national en faveur de la recherche réside dans la particularité des actions mises en œuvre : l’ambition de ces investissements est d’améliorer les chances de réussite de laboratoires ou de sites dont l’excellence est déjà avérée. Il s’agit bien de renforcer leurs atouts.
Pour les Labex, les investissements d’avenir s’adressent aux laboratoires ayant fait leurs preuves ; pour les Idex, aux sites ayant fait leurs preuves et étant en capacité de présenter des projets alliant l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur avec des capacités de valorisation ; pour Equipex, aux équipes qui ont besoin de nouveaux équipements ou d’équipements plus performants ; pour Santé-biotechnologies, ils permettent de doter le secteur d’éléments structurants ou de composantes manquantes – je pense notamment aux cohortes qui n’avaient jamais trouvé les financements adaptés à leurs caractéristiques.
La constitution de sociétés d’accélération du transfert technologique (SATT) apporte la concentration et la mutualisation nécessaires au développement des stratégies de valorisation de la recherche des universités ou des grands établissements de recherche.
La mise en place des instituts de recherche technologique (IRT) et des instituts pour la transition énergétique (ITE) pallie le manque de structures de cette nature. Ces instituts sont plus individualisés que les instituts Carnot par rapport aux organismes de recherche ; la propriété industrielle est partagée et mutualisée, grâce à des dispositifs ad hoc.
Dans l’organisation de la recherche, les investissements d’avenir proposent ainsi des dispositifs innovants permettant aux équipes françaises d’être mieux armées dans la compétition internationale. C’est, en tout cas, ainsi que nous les faisons vivre, notamment à travers une culture de l’évaluation et du suivi.
Lors du conventionnement, nous avons attaché beaucoup d’importance à ce que soient respectés les engagements déclarés dans le projet initial soumis au jury. De même, dans le suivi, nous sommes attentifs au respect des engagements pris lors du conventionnement. Pour ce suivi, qui peut conduire à reformater ou à arrêter certains projets, l’ANR s’appuie sur le jury ayant procédé à la sélection initiale. Ce dernier apprécie le franchissement des étapes et la conformité de celles-ci aux engagements contenus dans le conventionnement. Si des écarts sont constatés, ils doivent être justifiés, au risque, dans le cas contraire, de voir le projet arrêté.
En tant qu’opérateur de l’État, l’ANR met en œuvre les orientations fixées par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Dans ce cadre, des comités de pilotage se réunissent régulièrement. Ces réunions sont importantes pour ajuster le dispositif et répondre aux questions spécifiques. Chaque projet, voire chaque action peut, en effet, nécessiter des adaptations donnant lieu à des avenants.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. L’une de nos interrogations porte sur l’articulation des différents financements. Dès l’origine, la commission Juppé-Rocard recommandait la sanctuarisation des investissements d’avenir. En d’autres termes, il ne devait pas être possible pour un ministère de substituer ces financements à ses crédits budgétaires. René Ricol et Louis Gallois ont tous deux été attentifs à cette question et y ont sensibilisé les Premiers ministres. Or on observe une réduction progressive des budgets de l’ANR, hors investissements d’avenir. La question est délicate à poser à un opérateur de l’État, mais quel serait, selon vous, l’optimum dans ce domaine ? Par ailleurs, avez-vous constaté, de la part des ministères, des velléités de redéployer les crédits dédiés aux investissements d’avenir alors même que l’étanchéité était la règle ?
Mme Pascale Briand. J’ai eu l’occasion de dire devant différentes commissions et devant la Cour des comptes combien l’ANR était préoccupée par la baisse progressive de ses budgets d’intervention, hors investissements d’avenir. Cette inquiétude demeure profonde. La recherche ne peut que pâtir de l’érosion des financements sur projet. Or cette évolution, à rebours de la pratique des autres pays, constitue la réponse du ministère aux souhaits de certains chercheurs et finalement à un vœu exprimé par la communauté scientifique, lors des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’un redéploiement important du financement sur projet vers le financement récurrent. Il s’agit là de pure mécanique budgétaire.
Le choix pour certains projets du recours aux financements émanant des investissements d’avenir ou à ceux issus du financement sur projet peut être entouré d’un certain flou. On peut parfois s’interroger sur la similarité entre des projets pour lesquels l’ANR a été sollicitée, pour les uns, au titre des financements conventionnels et, pour les autres, au titre des investissements d’avenir. On pourrait voir là une tendance à reconstituer une masse financière proche du financement « pseudo-récurrent » que les chercheurs appelaient de leurs voeux. Nous sommes donc extrêmement vigilants sur d’éventuels doublons dans les flux financiers vers la recherche, mais des redondances ne sont pas exclues tant elles sont difficiles à déceler.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’ANR, qui porte une double casquette, rencontre-t-elle des difficultés à assurer une cohérence entre les investissements d’avenir, d’une part, et les crédits budgétaires dont elle assure l’affectation, d’autre part ?
Mme Pascale Briand. Il n’y a pas de difficulté. Au contraire, il est très intéressant qu’un même établissement ait à gérer à la fois les investissements d’avenir et le financement sur projet. Grâce au dispositif d’analyse transversale que nous avons mis en place entre nos différents départements, ceux qui gèrent les investissements d’avenir et ceux qui gèrent les autres financements, ainsi qu’à l’infocentre dont nous nous sommes dotés, nous disposons d’une vision consolidée de l’ensemble des voies de financement. Qu’un site ayant bénéficié des investissements d’avenir rencontre plus de succès lors des appels à projets conventionnels serait un bon signe, car ce serait la preuve de l’effet structurant des investissements d’avenir.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Considérez-vous que les investissements d’avenir favorisent les équipes installées au détriment d’équipes émergentes ?
Mme Pascale Briand. Comme je l’ai déjà dit, les investissements d’avenir sont conçus pour accroître les chances d’équipes déjà reconnues.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. N’est-ce pas un inconvénient ?
Mme Pascale Briand. Je considère que la recherche doit aller vers l’excellence.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Personne ne le conteste, mais cela ne contribue-t-il pas à créer des rentes de situation dans cette recherche d’excellence ?
Mme Pascale Briand. Les investissements d’avenir ont marqué une rupture avec les dispositifs antérieurs qui tendaient à octroyer une rente aux équipes supposées d’excellence, reconnues par les grands établissements et portées par des personnalités scientifiques. Le mode de sélection, qui a parfois choqué – le cas de Saclay est souvent cité comme exemple –, a permis de retenir les projets sur d’autres critères.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Certaines disciplines n’ont jamais été éligibles lors de la première vague, je pense à la recherche sur le cancer.
Mme Pascale Briand. Le projet de pôles de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie (PHUC) a été ajouté après le constat d’une déficience en la matière. La recherche sur le cancer a tout de même bénéficié de trois plans cancer. Depuis le premier plan en 2003, des financements ont été octroyés et un institut dédié, l’Institut national du cancer, a été créé. On ne peut pas nier que, dans ce domaine, la structuration de la recherche était déjà en œuvre.
Il est vrai que les pôles hospitalo-universitaires n’ont pas rencontré le succès dans la première vague de sélection. Mais il en va de même pour Saclay, en dépit de la force mobilisée.
Il me semble plutôt sain que les sites n’ayant pas fait l’effort de s’inscrire dans une logique de projet structurant n’aient pas été sélectionnés, en dépit de leurs qualités indéniables. Cela atteste de la valeur ajoutée des investissements d’avenir. Ils portent sur des projets de plus grande envergure que ceux financés par la voie conventionnelle, et leur sélection est soumise aux mêmes exigences de compétitivité et d’impartialité. Le constat de secteurs non financés ne me choque pas.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Regrettez-vous le choix qui a été fait de privilégier le financement récurrent au détriment du financement sur projet ?
Mme Pascale Briand. En effet, cette décision est contraire à la logique du financement de la recherche. Elle place la France en décalage par rapport à la pratique européenne et internationale.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le financement sur projet ne devrait-il pas porter sur une durée plus longue que trois ans, comme le demandent les chercheurs ? N’y a-t-il pas une voie médiane à trouver entre crédits récurrents et financement sur projet ?
Mme Pascale Briand. Le conventionnement sur trois ans que propose l’ANR fait très souvent l’objet d’avenants portant la durée à quatre ans. Nous en avons tiré les conséquences en proposant d’emblée un financement sur quatre ans. Néanmoins, nous restons attentifs à ce que, sur une telle durée un peu plus longue, de quatre voire cinq ans, la logique de sélection compétitive des projets soit maintenue. Cette voie d’un financement sur projet de plus longue durée est intéressante et certainement préférable à celle du financement récurrent.
M. le président Olivier Carré. Comment s’effectue le contrôle au fil de l’eau par le Commissariat général à l’investissement du suivi des projets ? Celui-ci accepte-t-il de donner du temps au temps lorsque l’évolution du projet le justifie, quitte à reculer les dates butoir initialement fixées ?
Mme Pascale Briand. Nous partageons avec le CGI le souci du respect de la logique de projet, quelle qu’en soit la durée. Il est essentiel, car, au fil du temps, cette logique a tendance à se perdre. Mais il ne faut pas non plus brider la possibilité de développement de la recherche en étant tatillon. C’est dans cet esprit qu’il nous a été demandé de travailler. Nous effectuons donc un suivi rigoureux des engagements, qui se traduit par un point d’étape au bout d’un an, avec un retour d’information sur l’évolution du projet et ses aspects financiers. Toutefois, ce suivi laisse le projet se dérouler, au rythme de ses échéances internes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il n’y a pas de remise en cause du versement des intérêts ?
Mme Pascale Briand. La remise en cause du versement des intérêts est prévue dans certaines actions, si, au bout de quatre ans, le jury qui a sélectionné le projet estime que l’écart constaté par rapport aux engagements initiaux ne peut être imputé à une réorientation logique du programme de recherche. Nous avons ainsi eu un cas de non-conventionnement d’un institut pour la transition énergétique et, dernièrement, l’arrêt d’un projet de nanobiotechnologie.
M. Arnaud Torres, responsable du département « Investissements d’avenir et compétitivité » de l’ANR. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une décision unilatérale de l’ANR ou du CGI, même si nous avons le pouvoir de stopper les projets en cas de faute grave. Nous avons suivi la recommandation des pairs qui, lors de la phase de sélection, avaient inscrit dans les annexes à la convention une procédure de go-no go au bout de deux ans. Nous avons de nouveau contacté les membres du jury, un rapport a été demandé aux bénéficiaires et soumis, il y a huit jours environ, au comité de pilotage impliquant les différents ministères concernés.
Ces jalons, prévus dès l’origine, permettent d’évaluer si le projet conserve son intérêt et sa valeur ajoutée. Ils pourront s’appliquer, au bout de trois ans, aux SATT comme aux IRT pour évaluer s’ils doivent être maintenus ou réorientés, si leurs dotations doivent être diminuées, ou au contraire – sous réserve de crédits disponibles – augmentées dans le cas où l’effet de levier s’avérerait important.
J’insiste sur le fait que si la concertation implique l’ensemble des instances de copilotage, la décision finale revient au Premier ministre, et sur l’idée que l’application d’une procédure de go-no go au bout de trois ans constitue une précaution élémentaire compte tenu de l’ampleur des budgets en jeu et de la durée des projets.
Mme Pascale Briand. Il faut également souligner la valeur d’exemplarité d’une telle procédure. Il n’est pas neutre que nous soyons en mesure d’arrêter des projets.
M. Arnaud Torres. Je tiens d’ailleurs à préciser que le récent comité de pilotage auquel j’ai fait allusion avait à statuer sur deux projets et qu’il a, dans un cas, fait une proposition de go et, dans l’autre, de no go.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Considérez-vous que l’ANR dispose aujourd’hui des outils et des moyens lui permettant d’assurer le suivi des actions menées au titre du PIA ?
Parallèlement au suivi par action, des suivis régionaux transversaux ont été mis en place. Quel est leur intérêt et comment s’articulent-ils avec le suivi par action ?
Mme Pascale Briand. Nous nous sommes progressivement dotés des outils nous permettant d’effectuer un suivi satisfaisant et de produire les synthèses en temps voulu. Nous avons mis au point un cadre pour la remontée systématique des informations et leur traitement annuel. Au sein de ce cadre, nous mettons en œuvre, au cas par cas, une multiplicité d’actions permettant d’affiner ce suivi, notamment grâce à des visites de site. La situation est beaucoup plus tendue, en revanche, sur le plan des moyens humains, et ce d’autant plus que nous sommes à la veille du PIA 2. Quant aux budgets de gestion, nous les estimons suffisants.
Les suivis régionaux nous semblent très importants à divers titres. Si l’ambition des investissements d’avenir est bien de doper l’excellence, cela doit se faire avant tout au profit de notre compétitivité et de nos emplois. Le transfert et la valorisation sont donc essentiels, y compris pour des actions telles que les Labex ou les Idex. À ce titre, les bilans régionaux permettent de mieux évaluer comment les investissements d’avenir s’inscrivent dans l’écosystème de la recherche territoriale, en perspective cohérente avec l’autonomie croissante des pôles universitaires, ainsi que dans l’écosystème des entreprises.
En parallèle des synthèses nationales qui fournissent aux ministères, au CGI et aux organismes de recherche des évaluations par secteur, l’analyse régionale du point de vue de l’enrichissement des écosystèmes nous paraît essentielle.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pour un homme politique, la question est : comment concilier cette nécessité d’excellence et l’harmonisation territoriale ?
Mme Pascale Briand. À l’origine, la logique des investissements d’avenir n’est pas celle de l’équilibre territorial. L’émergence d’équipes ou de sites s’insérant dans un « maillage de l’excellence » doit cependant pouvoir être recherchée, mais par d’autres mécanismes. La question de l’émergence des équipes me semble pouvoir être posée aux organismes de recherche et aux universités, l’émergence de sites pouvant être envisagée à partir de sites d’excellence, capables d’établir des maillages en réseau avec des sites plus isolés.
Nous mettons à disposition des synthèses annuelles apportant le même type d’informations région par région.
M. Arnaud Torres. Le suivi territorial permet également de faire apparaître la synergie entre les projets – les montages associant Equipex et Labex par exemple. À terme, il devrait éclairer, en aval de la chaîne de l’innovation, les projets relevant de la valorisation, comme les IRT voire les SATT. Avoir des interlocuteurs disposant d’une visibilité sur le territoire nous permet de mieux percevoir l’impact du PIA.
Dans les dix ans à venir, même les actions amont, plus académiques et tournées vers la recherche – comme les Idex et les Labex –, seront dans la nécessité absolue de rechercher un retour sur investissement non plus seulement par la création de connaissances mais par la création de valeur. Disposer d’indicateurs d’impact est donc nécessaire.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. En observant Conectus, la SATT installée sur le territoire dont je suis l’élu, je constate que ces sociétés, dont l’un des objectifs est, à terme, de parvenir à équilibrer leurs comptes, peuvent être confrontées au dilemme suivant : privilégier le travail territorial ou valoriser à tout prix les brevets disponibles. Dans ces conditions, la logique des investissements d’avenir peut les conduire à stimuler la compétitivité d’industries, et donc d’économies, étrangères. L’ANR, le CGI et les ministères concernés ont-ils une doctrine en la matière ?
Mme Pascale Briand. Si la France a légèrement rattrapé son retard en matière de prise de brevets, ce n’est pas le cas pour ce qui concerne l’utilisation de ces brevets, les licences d’exploitation ou les achats, donc l’utilisation par des entreprises françaises de brevets nationaux ou étrangers permettant la création de richesses. Les SATT ne résoudront pas le problème à elles seules, mais ce sont des structures intéressantes, qui apportent une réelle valeur ajoutée aux pôles de compétitivité.
M. Arnaud Torres. Conectus est un bon exemple de SATT parfaitement intégrée dans son écosystème, notamment parce qu’elle est parvenue à nouer des partenariats très forts avec les pôles de compétitivité et à fonctionner en harmonie avec l’Unistra, l’Université de Strasbourg.
Cette société peut bien parvenir à l’équilibre financier en 2020, une fois épuisés les financements liés au PIA, et rapporter alors des dividendes à l’État actionnaire ; mais, s’il s’avère que 90 % de ses clients sont implantés hors de France et que notre appareil productif n’a pas bénéficié du transfert de connaissances de la recherche publique, l’opération aura été un échec. D’où l’importance de parvenir à un équilibre entre les indicateurs de production et de performance de la SATT – autrement dit, son chiffre d’affaires et son taux de retour sur investissement – et l’indicateur d’impact fourni par son portefeuille de clients. L’évaluation triennale des SATT, sur laquelle nous travaillons actuellement avec le CGI, le ministère de la recherche et la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), tiendra ainsi compte de l’impact de leur action sur les PME et les ETI de l’écosystème. Pour ce qui est de Conectus, j’ai bon espoir.
L’idée de l’État n’est pas de faire des SATT des machines à cash. Reste que, si certains brevets ne peuvent trouver à être exploités dans son écosystème, une SATT doit conserver la possibilité de les valoriser sur des marchés extérieurs.
Mme Laure Fau, rapporteure à la Cour des comptes. À quelle logique va obéir la deuxième génération d’Idex ? Va-t-elle servir de rattrapage pour des projets comme les PRES Lyon et HESAM qui n’avaient pas obtenu de financement sur dix ans ou vise-t-elle le financement d’un autre type de sites ?
Mme Pascale Briand. Selon les dernières orientations fournies par le CGI et le MESR, le second appel à candidatures pour les Idex comportera les mêmes exigences d’excellence que celles formulées pour les Idex de première génération.
M. Arnaud Torres. Le texte d’orientation publié conjointement par la ministre de l’enseignement et de la recherche et le commissaire général à l’investissement, M. Louis Gallois, le 28 mars dernier est parfaitement clair sur ce point : les projets Programme d’avenir Lyon Saint-Étienne (PALSE) et Hautes Etudes-Sorbonne-Arts et Métiers (HESAM) devront faire acte de candidature. Ils devront fournir, en 2015, une pré-proposition – dont tiendra lieu leur dossier de fin de période d’évaluation – puis une proposition en 2016.
Quant aux Idex retenus dans le cadre du PIA 1, ils pourront, à l’issue de la sélection, soit se voir attribuer définitivement leur dotation, soit voir celle-ci réduite, sachant que, dans un souci de cohérence et de visibilité, c’est le même jury qui statuera sur les Idex de première génération en fin de période probatoire et sur les projets d’Idex liés au PIA 2.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Alors que les procédures d’évaluation du PIA 1 sont en place, quelles premières leçons pouvez-vous tirer, qui pourraient vous conduire à modifier certains dispositifs ?
Mme Pascale Briand. À la demande du CGI, nous avons analysé la mise en place du PIA 1 pour faire plusieurs propositions.
Il nous a semblé que le dispositif d’appel à projets confiant la sélection à des jurys internationaux et le suivi à des comités de pilotage devait être maintenu, car il avait donné satisfaction.
Nous estimons qu’il serait intéressant de recourir plus systématiquement à des conventions de préfinancement permettant d’accélérer le démarrage des projets.
Il faut simplifier le contenu des conventions et de leurs annexes, et supprimer certaines étapes de validation des documents.
Il importe également d’étendre à toutes les actions le recours aux jalons permettant de rediriger ou d’arrêter certains projets.
Enfin, nous militons pour une conception simplifiée du suivi, reposant sur la responsabilisation des acteurs, dont nous souhaitons qu’ils soient eux-mêmes porteurs des alertes, afin de diminuer les contrôles a priori au profit d’un contrôle a posteriori. Cette position vaut aussi pour les appels à projets gérés par l’ANR sur crédits budgétaires.
M. le président Olivier Carré. Nous vous remercions pour ces informations et ces analyses.
Audition du 22 avril 2014
À 15 heures : M. Bernard Bigot, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, accompagné de M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes, et de M. Jean–Pierre Vigouroux, chef du service des affaires publiques
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je vous remercie, monsieur l’administrateur général, d’avoir accepté notre invitation. Nous souhaiterions connaître votre point de vue sur la mise en place des programmes d’investissements d’avenir (PIA). Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est notamment l’opérateur de deux actions engagées dans le cadre du programme « Nucléaire de demain » : le réacteur de quatrième génération ASTRID – Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration – et le réacteur Jules Horowitz (RJH).
M. Bernard Bigot, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Le CEA est concerné par les PIA à plusieurs titres : il est opérateur des deux actions que vous avez mentionnées ; aux côtés du monde universitaire et de la recherche, il s’implique dans plusieurs projets collectifs : initiatives d’excellence (IDEX), laboratoires d’excellence (LABEX) et équipements d’excellence (EQUIPEX) notamment ; il participe à des instituts de recherche technologique (IRT), à des instituts pour la transition énergétique (ITE) et à des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), qui visent à soutenir l’innovation.
De notre point de vue d’opérateur, la mise en œuvre des PIA a été très satisfaisante en ce qui concerne les projets ASTRID et RJH, en dépit des difficultés rencontrées sur ces deux projets. De même, malgré une certaine complexité, les IDEX, les LABEX et les EQUIPEX s’avèrent bénéfiques, car ils permettent de travailler en commun. En revanche, le CEA est très critique sur les IRT, les ITE et les SATT, qui l’exposent à des risques importants.
Les projets ASTRID et RJH se sont vu initialement affecter 900 millions d’euros – respectivement 651,6 et 248,4 millions. Les crédits alloués au démonstrateur ASTRID ont ensuite été ramenés à 626,5 millions par un avenant à la convention correspondante, signé entre l’État, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le CEA. Cet avenant a permis de redéployer 50 millions d’euros au profit de l’ANR – 25 millions à partir de l’action « Réacteur de quatrième génération ASTRID » confiée au CEA et 25 millions à partir de l’action « Recherches en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » confiée à l’ANDRA, respectivement actions 1 et 3 du programme « Nucléaire de demain » – afin de financer le programme de renforcement de la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection lancé à la suite de l’accident de Fukushima.
Les projets ASTRID et RJH sont suivis, chacun, par un comité présidé par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et comprenant des représentants de la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), de la direction du budget (DB), de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), du contrôle général économique et financier (CGEFI) et du directeur de programme « Énergie, économie circulaire » du Commissariat général à l’investissement (CGI). Lors des réunions des comités de suivi, qui se tiennent au moins deux fois par an et font l’objet d’un compte rendu validé par toutes les parties, le CEA présente l’état d’avancement technique et financier du projet considéré, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la tenue du calendrier d’exécution.
Les fonds affectés aux projets ASTRID et RJH ont été versés sur un compte spécifique ouvert au nom du CEA. Leur déblocage est autorisé ou non par le comité de suivi en fonction de l’avancement des projets et sur la base d’un état des dépenses engagées. Cette procédure spécifique permet de s’assurer que les crédits sont utilisés de manière strictement conforme à leur destination initiale et qu’ils ne constituent en aucun cas une ressource complémentaire permettant au CEA de financer d’autres charges.
Si ces moyens issus du PIA n’avaient pas été attribués au CEA, les projets ASTRID et RJH n’auraient tout simplement pas pu être mis en œuvre. Certes, ils représentent moins de 50 % des ressources totales des deux projets ; cependant, ils ont eu un effet de levier très utile pour mobiliser d’autres financements apportés par des partenaires industriels ou internationaux, ainsi que des crédits budgétaires apportés par le CEA lui-même.
Les crédits accordés au titre du PIA ont parfois été consommés de manière anticipée par rapport aux crédits budgétaires que le CEA s’était engagé à affecter. Ils ont ainsi permis une gestion plus souple de la trésorerie. En revanche, en aucun cas ils n’ont été substitués aux crédits budgétaires initialement prévus, ni n’ont été attribués à d’autres projets.
M. Charles de Courson. Les intérêts sont-ils capitalisés ?
M. Bernard Bigot. Non.
M. Charles de Courson. Ces sommes ne sont-elles pas placées ?
M. Bernard Bigot. Si elles le sont, le bénéfice en revient non pas au CEA, mais au Trésor. Comme cela a été convenu, les crédits sont déposés sur un compte du CEA ouvert dans les écritures du receveur général des finances de Paris.
M. Charles de Courson. Confirmez-vous que ce compte ne porte pas intérêt ?
M. Bernard Bigot. Oui. Dès l’origine, il a été décidé que les crédits affectés seraient en euros non pas constants, mais courants. De ce fait, la décision du Gouvernement d’allonger la durée de réalisation du programme ASTRID de deux ans supplémentaires nous pénalise, les coûts étant renchéris par le simple jeu de l’inflation.
Je reviens aux procédures garantissant que les crédits alloués aux projets ASTRID et RJH au titre du PIA sont utilisés conformément à leur objectif initial. Deux conventions ont été signées entre l’État – par le Premier ministre et les ministres concernés – et le CEA – par votre serviteur – pour définir l’usage précis de ces crédits, ainsi que le dispositif de suivi associé. Comme je l’ai indiqué, les fonds attribués ont été déposés sur un compte spécifique ouvert au nom du CEA dans les écritures du receveur général des finances de Paris. Leur déblocage est opéré après accord préalable du CGI, sur la base d’un rapport intermédiaire synthétique que lui envoie le CEA chaque trimestre pour chacun des deux programmes. Ce rapport, également remis au comité de suivi, comporte les informations suivantes : l’état d’avancement du programme concerné ; le calendrier actualisé de décaissement des fonds ; le bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés ; la valeur des indicateurs de résultat intermédiaire et d’avancement du projet tels qu’ils figurent dans les conventions. Le CEA assure donc un suivi budgétaire précis de l’utilisation de ces fonds.
De plus, les comités de suivi veillent à ce que la gestion et l’utilisation des crédits versés au titre des conventions soient conformes à la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, qui définit précisément le PIA. Comme je l’ai rappelé, ils se réunissent au moins deux fois par an, notamment avant l’examen par le conseil d’administration du CEA du projet d’établissement des comptes et du projet de budget. Ces procédures ont fait l’objet d’une analyse par la Cour des comptes dans le cadre de son examen de la situation du CEA civil pour les années 2007 à 2012. La Cour n’a émis aucune remarque particulière à ce sujet, ni dans son pré-rapport ni lors de la réunion de restitution.
S’agissant de l’effet de levier des financements accordés au titre du PIA, le retour pour l’État sur les investissements dans le projet ASTRID ne pourra être apprécié que sur le long terme, en fonction des perspectives de développement du démonstrateur industriel et, in fine, de la filière. Deux demandes de l’État concernant la sécurisation des options industrielles à venir ont été inscrites dans la convention sur le projet ASTRID. Premièrement, au cours de la deuxième phase de l’avant-projet sommaire (AVP2), entre 2013 et 2015, le CEA doit définir un dispositif de rémunération de l’État par les industriels sur l’exploitation future des résultats des études ASTRID. En d’autres termes, les industriels s’engagent à ce qu’il y ait un retour au profit de l’État s’ils déploient ces technologies. Deuxièmement, avant la fin de la phase d’élaboration de l’avant-projet détaillé (APD), entre 2016 et 2019, le CEA devra proposer des partenariats structurés ainsi qu’un plan de financement pour la réalisation d’ASTRID. Les indicateurs correspondant à ces demandes seront précisés en temps utile par le comité de suivi.
En outre, lors des réunions des comités de suivi, le CEA rend compte des collaborations industrielles mises en place. Celles-ci font l’objet d’un indicateur : le « taux de participation des partenaires au financement du projet ASTRID ». La valeur cible pour cet indicateur avait été fixée à 30 % à la fin de la première phase de l’avant-projet sommaire (AVP1), avec un minimum de 20 %. Le taux effectivement atteint a été de 28 %, chiffre présenté au comité de suivi de décembre 2013. Le CEA a donc dépassé le minimum requis et s’est approché de l’objectif ambitieux qui lui avait été assigné.
Enfin, les investissements dans le projet ASTRID ont un impact direct en termes d’emploi : en 2013, près de 500 équivalents temps plein étaient liés à l’ingénierie et à la recherche et développement sur ce projet.
Le projet RJH, quant à lui, répond à deux objectifs majeurs : disposer d’un outil pour le développement et le soutien des différentes filières de réacteurs nucléaires – deuxième et troisième générations ou systèmes du futur – dans un cadre international, et produire les radionucléides nécessaires au secteur médical – notamment les éléments de diagnostic au technétium 99m – dans le cadre de la politique de santé publique. Les crédits accordés au titre du PIA ont représenté un apport majeur, complétant le socle de financement initial constitué par les contributions du CEA et de ses partenaires du consortium RJH. À la suite de la concrétisation du partenariat avec les Britanniques en 2013, la contribution totale des partenaires atteint aujourd’hui 250 millions d’euros valeur 2005.
Le RJH assurera la relève du parc européen de réacteurs de test sous irradiation, actuellement vieillissant. Il deviendra ainsi un pôle d’attraction à l’échelle européenne en matière de soutien aux performances et d’amélioration de la sûreté de l’industrie nucléaire. C’est pourquoi il continue d’attirer de nouveaux partenaires internationaux, avec lesquels le CEA est en négociation. Et ce malgré ses difficultés : alors que le réacteur devait initialement entrer en divergence en 2014, la date qui ressort des négociations difficiles que nous avons menées avec le maître d’œuvre est l’automne 2019, après un premier report à 2016. En dépit de cette annonce, les membres du consortium – qui se sont réunis le 8 avril dernier – ont tous accepté de poursuivre leur implication dans le projet dans les mêmes termes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Cela ne pose pas de problème non plus aux partenaires financiers ?
M. Bernard Bigot. Pour le moment, non. Mais 2019 est une date limite. Le RJH correspond à un véritable besoin des différents partenaires, industriels ou agences d’État. Nous ne pouvons pas surseoir davantage. D’autant qu’il existe un risque non négligeable que le réacteur OSIRIS soit arrêté à la fin de l’année 2015.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment les activités de recherche pourront-elles être poursuivies si le réacteur OSIRIS est arrêté ?
M. Bernard Bigot. Elles seront suspendues.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Entre 2015 et 2019 ?
M. Bernard Bigot. Sans doute même jusqu’en 2020, car il faut compter au minimum un an entre le chargement du combustible et le début des premières expériences dans un réacteur au fonctionnement stabilisé.
Le retard pris sur le projet RJH et la fermeture envisagée d’OSIRIS ne sont pas sans conséquences : EDF et AREVA, qui sont nos principaux partenaires, ont décidé de reporter certaines de leurs expériences ou d’en effectuer à l’étranger. En outre, GDF Suez a besoin des services d’un réacteur de recherche de manière urgente : des inclusions ont été découvertes dans les cuves des réacteurs belges exploités par l’entreprise. On peut penser qu’elles étaient présentes dès l’origine, mais cela doit être confirmé ou infirmé par des expérimentations.
M. Charles de Courson. Quelles sont les raisons de ce décalage de cinq ans par rapport aux prévisions initiales ?
M. Bernard Bigot. Cela tient à des difficultés de maîtrise d’œuvre et de gestion industrielle. La maîtrise d’œuvre est assurée par AREVA TA. Le CEA, maître d’ouvrage, n’a jamais réussi à obtenir de planning engageant de sa part. Il y a un environ deux ans, AREVA TA nous a fait part de certaines difficultés et nous a annoncé que l’échéance de 2014 ne pourrait être tenue, ce que nous pressentions nous-mêmes. Nous avons alors créé une plate-forme réunissant AREVA TA, les équipes du CEA et les principaux fournisseurs. Ces négociations ont abouti, en 2011, à la signature d’une convention, qui reportait la divergence du RJH de la fin de l’année 2014 au début de 2016 et prévoyait que les éventuels surcoûts seraient supportés par AREVA TA si ce délai n’était pas tenu.
Or, à l’automne 2012, AREVA TA, qui est non seulement maître d’œuvre mais aussi fournisseur du bloc-pile – cœur du réacteur, en acier, qui supporte le combustible et permet son refroidissement –, nous a informés que son sous-fournisseur, la société CNIM, avait décidé de dénoncer le contrat, parce qu’elle estimait qu’AREVA TA ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires à la réalisation de l’opération. À ma connaissance, CNIM, pourtant une entreprise de taille intermédiaire, a accepté de payer 7 millions d’euros de dédit. C’est dire combien elle estimait supérieur à cette somme le risque qu’elle courait. Je précise qu’on m’avait demandé, en 2011, de faire une avance de trésorerie pour acquérir la matière nécessaire à la réalisation du bloc-pile.
À la fin de l’année 2012, lors d’une réunion au plus haut niveau – entre la direction générale d’AREVA, celle d’AREVA TA et moi-même, assisté de mes équipes –, on nous a annoncé que ces difficultés induiraient un délai supplémentaire de six mois au maximum. Les équipes du CEA estimant de leur côté ce délai à vingt-quatre mois, j’ai demandé que le planning soit consolidé. Un délai a été accordé jusqu’au mois de juillet 2013, afin de trancher entre ces deux scénarios, sur la base d’un véritable projet industriel permettant de remédier aux difficultés. Au mois de juillet 2013, on nous a informés que l’achèvement du projet devait être reporté non plus à 2016, mais à 2018, puis, sans justification supplémentaire, à 2020. En outre, AREVA TA a demandé au CEA de prendre en charge l’intégralité des surcoûts induits par la prolongation du contrat. Or le travail de 100 ingénieurs pendant un an supplémentaire coûte environ 10 millions d’euros. Compte tenu du nombre d’ingénieurs impliqués dans le projet ASTRID – plusieurs centaines –, les surcoûts risquaient d’être très élevés. Le CEA a donc refusé de prendre cet engagement, qui serait revenu à renoncer à la convention de 2011, qui le protégeait. La crise a atteint son paroxysme à la fin de l’année 2013, au moment où AREVA TA a dû établir ses comptes et décider d’y inscrire ou non certaines provisions au titre du projet ASTRID. Finalement, les comptes d’AREVA TA ont été rejetés tant par les commissaires aux comptes que par le CEA.
Nous avons alors mis en place un comité des sages réunissant quatre experts d’AREVA et quatre du CEA, qui se reconnaissaient mutuellement pour leur haute qualité professionnelle, et se sont engagés à chercher les meilleures solutions techniques et organisationnelles. Ils ont travaillé d’arrache-pied et ont remis leur rapport définitif le 21 janvier 2014. Celui-ci a été validé de manière consensuelle par la direction générale d’AREVA et par moi-même. Les experts ont conclu que, contrairement à ce qu’avait affirmé AREVA TA, il était possible de réaliser techniquement et industriellement le bloc-pile. Ils ont estimé que le réacteur pourrait être achevé, au plus tôt, en octobre 2019, mais que cette échéance demandait à être confirmée, le maître d’œuvre devant établir, à cette fin, un planning robuste, ce à quoi il s’emploie aujourd’hui. Enfin, ils ont jugé que l’année 2014 serait critique pour la réussite du projet, et qu’il convenait de séparer la négociation sur les aspects techniques et organisationnels des questions financières et contractuelles, ce qui a été fait.
En complément a donc été créé un groupe de travail financier comprenant deux représentants d’AREVA et deux du CEA non impliqués dans les discussions contractuelles. Il a travaillé lui aussi de manière consensuelle et a rendu son rapport le 11 avril dernier. Il a réalisé, comme cela lui avait été demandé, une estimation du coût global à terminaison, au-delà des coûts déjà provisionnés par le CEA, en distinguant les coûts avérés des coûts pour aléas. Nous sommes désormais engagés dans une négociation sur le partage de ces coûts. Parallèlement, M. Bernard Duprat, délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ancien directeur de l’exploitation et de l’ingénierie chez EDF, a été mandaté par le Premier ministre Jean Marc Ayrault, pour conduire une revue de projet. Celle-ci a vocation à consolider les différents éléments issus des travaux d’AREVA et du CEA que je viens de citer.
M. Charles de Courson. Quel est l’ordre de grandeur des surcoûts ? Comment seront-ils partagés, au vu des négociations actuelles ?
M. Bernard Bigot. Ces chiffres n’ont pas vocation aujourd’hui à être rendus publics. Je pourrai vous les communiquer après l’audition.
M. Charles de Courson. Les éléments que vous nous avez communiqués mettent gravement en doute la compétence d’AREVA TA. Vous avez notamment indiqué que le CEA n’avait jamais obtenu de planning engageant de sa part. Comment cela se fait-il ?
M. Bernard Bigot. Un grand projet est toujours soumis à des aléas. Il n’est jamais complètement planifié à l’avance, surtout lorsqu’il s’agit d’une réalisation à l’unité. Nous avons passé un contrat de gré à gré avec AREVA TA, parce qu’elle était la seule société en Europe à détenir la compétence permettant de mener à bien le projet RJH. Par ailleurs, le CEA a noué des relations avec AREVA TA sur d’autres sujets. L’entreprise a ainsi été choisie pour réaliser les chaudières des bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale, et nous sommes satisfaits de son action dans ce domaine. Il m’est donc difficile de répondre à votre question. Peut-être le projet RJH n’a-t-il pas reçu toute l’attention qu’il méritait. Il s’agit d’un projet ancien, remontant au début des années 2000, conçu dès l’origine par AREVA. Il a été engagé sur la base d’éléments chiffrés en euros de 2005 – d’où la conversion en euros 2005 du montant des contributions que j’ai évoqué précédemment – fournis par les différents acteurs.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Pouvez-vous faire la liste de conséquences induites par le report du projet RJH ?
M. Bernard Bigot. Premièrement, comme je l’ai indiqué, certaines études qui sont réalisées de manière classique dans le cadre du processus continu d’amélioration des technologies nucléaires – et qui portent par exemple sur l’optimisation des combustibles, sur l’amélioration de la sécurité des réacteurs de deuxième et de troisième générations ou sur le vieillissement des réacteurs de notre parc – ont été reportées. Cette suspension mérite notre attention, mais ne devrait pas avoir de conséquences dramatiques si nous parvenons à tenir le délai de 2019.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Cela met-il en péril la souveraineté de notre industrie nucléaire civile ?
M. Bernard Bigot. Certaines des études que j’ai mentionnées concernent le nucléaire militaire. Leur programmation a été elle aussi modifiée en conséquence. Mais les différents acteurs s’accordent sur le fait que le report du projet RJH à 2019 n’aura d’impact significatif ni sur le nucléaire civil ni sur le nucléaire militaire, même si l’exploitation du réacteur OSIRIS n’était pas prolongée jusqu’en 2018 comme le demande le CEA – mais pour un autre motif : la nécessité de produire des radionucléides à finalité médicale. En revanche, les conséquences d’un report du projet RJH au-delà de 2019 n’ont pas encore été évaluées. La date de 2019 n’est connue de manière claire et précise – je le rappelle – que depuis la remise du rapport du comité des sages le 21 janvier 2014.
En revanche, le report du projet RJH aura un impact sur la production de radionucléides à finalité médicale. Par irradiation de l’uranium, on produit du molybdène 99, qui se désactive en donnant naissance au technétium 99m, produit à très courte durée de vie utilisé pour le diagnostic de plusieurs cancers et maladies cardiovasculaires ; il existe huit maladies en France pour lesquelles cette technologie et ces éléments ne peuvent être remplacés par d’autres.
Or, au cours de la période de 2016 à 2018, le réacteur canadien NRU – qui fournit actuellement plus de 35 % des radionucléides à finalité médicale à l’échelle mondiale – et le réacteur belge BR2 – qui en fournit une quantité non négligeable – devront subir des travaux d’entretien. De plus, le réacteur de Petten aux Pays-Bas, qui a été arrêté pendant plusieurs années, n’est pas en mesure de reprendre sa production de manière immédiate. À l’inverse, le réacteur OSIRIS, qui a été régulièrement entretenu, reste en bon état de fonctionnement ; si nous l’arrêtons en 2015 comme cela est prévu, nous le ferons sur une base purement volontaire. Le CEA a donc proposé au Gouvernement d’autoriser l’exploitation d’OSIRIS pendant trois années supplémentaires, de façon à permettre à l’ensemble des acteurs concernés de se réorganiser pour répondre aux besoins de la médecine. En revanche, il ne serait guère opportun de prolonger la durée de vie d’OSIRIS au-delà de 2018. En effet, à partir de cette date, en vertu d’un engagement international, les radionucléides à finalité médicale devront être produits exclusivement à partir d’uranium faiblement enrichi – à moins de 20 % – afin de limiter les risques de prolifération. Or le réacteur OSIRIS ne peut fonctionner qu’avec de l’uranium enrichi à plus de 20 %.
J’en viens à l’action « Recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » (RSNR) du PIA, qui a été lancée par le Gouvernement à la suite de l’accident de Fukushima. Le financement accordé par le CGI – dotation de 50 millions d’euros au total, assortie d’une exigence de cofinancement de 40 % par projet de la part de leur bénéficiaire – a joué un rôle de levier important pour relancer la R&D sur les problématiques d’accidents graves, qui était en baisse régulière depuis plusieurs années. De nouvelles pistes sont ainsi explorées afin de garantir l’absence de radioactivité à l’extérieur des sites nucléaires en toutes circonstances. Des recherches sont notamment effectuées sur la mitigation des effets de la fusion du cœur et sur les diagnostics utiles à la gestion de crise.
Les résultats de ces études, menées en grande partie dans le cadre de partenariats industriels, notamment avec EDF et AREVA, sont indispensables pour répondre aux enjeux de sûreté liés à l’exploitation des réacteurs dans la durée. Ils permettront notamment de rapprocher le référentiel des réacteurs de deuxième génération de celui des réacteurs de troisième génération en ce qui concerne la prise en compte des accidents graves. Ils seront également utiles au développement de nouveaux modèles de réacteurs.
Je terminerai en évoquant l’action « Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs », dont l’opérateur est l’ANDRA. Celle-ci a mis en place une collaboration pour le développement d’un procédé d’incinération-vitrification (PIVIC) des déchets contaminés en émetteurs alpha, qui implique AREVA et le CEA. Ce projet a fait l’objet d’un accord en novembre 2013, soit plus de deux ans après la signature de la convention entre l’État et l’ANDRA au titre de l’action précitée. L’accord porte sur une période allant jusqu’à la fin de l’année 2018 et prévoit un financement de 43,85 millions d’euros répartis entre l’ANDRA, AREVA – qui contribueront chacune à hauteur de 19,7 millions, soit 45 % du total – et le CEA – qui apportera 4,4 millions, soit 10 % du total. L’attribution de crédits dans le cadre du PIA a permis de diviser par deux l’apport du CEA, le projet devant initialement être financé à 80 % par AREVA et à 20 % par le CEA.
En outre, un nouvel appel à projets au titre de l’action « Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » devrait être lancé au cours du deuxième trimestre de cette année. Le CEA y répondra sans doute, avec ses partenaires.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je propose que nous abordions maintenant les questions relatives à la valorisation de la recherche.
M. Bernard Bigot. La valorisation de la recherche se fait notamment au travers des IRT, des ITE et des SATT. Le CEA est responsable de certains IRT et ITE, notamment de l’IRT « Nanoélectronique ». Ces instruments ont posé d’emblée des difficultés au CEA, les engagements demandés par le CGI n’étant guère compatibles avec son mode de fonctionnement. Ainsi, le CEA devait transmettre à l’IRT « Nanoélectronique » des droits de propriété intellectuelle et même des équipements, en particulier des grandes salles blanches fonctionnant en continu. Or nous étions déjà engagés avec des partenaires tiers sur l’utilisation de ces salles. Nous avons donc dû obtenir une dérogation pour l’IRT.
D’une manière générale, la mise en place et la gestion des IRT se sont révélées très complexes. Le CEA a proposé des solutions, mais elles n’ont pas été adoptées d’emblée. Le CGI et le Gouvernement ont alors confié une mission à l’Inspection générale des finances, laquelle a fini par convenir, au bout d’un an environ, que ces solutions étaient les bonnes. Nous avons dû, à chaque fois, jongler avec les règles ou retarder les processus. L’IRT « Jules Verne », dans lequel nous sommes partenaire associé, semble avoir trouvé son point d’équilibre ; il est sans doute celui qui fonctionne le mieux. Les autres – IRT où nous sommes impliqués – « SystemX », « Bioaster » – nous ont posé de réelles difficultés. D’ailleurs, il n’est pas certain que les industriels soient satisfaits du résultat : plusieurs d’entre eux ont souhaité se désengager compte tenu de la complexité des procédures ; il a fallu les mobiliser à nouveau.
M. Charles de Courson. En quoi les procédures sont-elles complexes ?
M. Bernard Bigot. Le CEA est contraint de prendre certains engagements. Par exemple, il était prévu que le personnel mis à disposition des IRT par les organismes de recherche soit placé sous l’autorité des premiers et complètement détaché des seconds. À terme, il devait même être intégré dans le personnel des IRT. Dans le cas du CNRS, compte tenu des fortes réticences exprimées par les agents concernés, certaines souplesses ont été accordées. Le personnel du CEA relève, quant à lui, du droit privé. Lorsque le CEA met un de ses agents à disposition d’un industriel, il lui demande de financer au minimum 80 % du coût complet correspondant ; en effet la direction de la recherche technologique du CEA n’est financée aujourd’hui qu’à hauteur de 20 % maximum par la subvention de l’État. Dans le cas des IRT au cotnraire, il est demandé au CEA de continuer à financer l’intégralité du salaire des agents qu’il met à disposition.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Cela remettait donc en cause votre propre système de valorisation de la recherche.
M. Bernard Bigot. Tout à fait. Lorsque les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), par exemple le CNRS ou l’INSERM, mettent leurs agents à disposition des IRT, ceux-ci leur remboursent 70 % de la masse salariale, alors même que la rémunération de ces agents est intégralement couverte par la subvention publique. Les industriels ont donc tout intérêt à faire appel au personnel du CNRS plutôt qu’à celui du CEA. Ce mécanisme discriminatoire est injustifiable et incompréhensible.
M. Charles de Courson. Comment vous en êtes-vous sortis ?
M. Bernard Bigot. Par des procédures dérogatoires.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourquoi ce système n’a-t-il pas été remis à plat ?
M. Bernard Bigot. En dépit de toutes nos explications et de toute notre bonne volonté, les responsables du CGI s’y sont opposés. Nous nous sommes heurtés à un mur.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Ont-ils avancé des arguments précis ?
M. Bernard Bigot. Il ne m’appartient pas de rapporter leur propos. Je vous suggère de les interroger. J’ai mobilisé des dizaines de personnes sur ces questions, pour des négociations qui ont duré plusieurs mois.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Et personne n’a bougé ?
M. Bernard Bigot. Non, en dépit du soutien que nous ont apporté tant le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche que celui du redressement productif.
Mme Laure Fau, rapporteure à la troisième chambre de la Cour des comptes. Tous les IRT devaient être des structures autonomes et être dotés, à cette fin, de la personnalité morale. Le CGI était très ferme sur ce point. La dérogation consentie pour l’IRT « Nanoélectronique » tient au fait qu’il est hébergé par le CEA.
M. Bernard Bigot. Nous avons créé pour cet IRT un compte bancaire spécial, parfaitement cloisonné, comme nous l’avons fait pour l’agence ITER France.
Pour ce qui est des SATT, elles fonctionnent selon une logique similaire : les organismes partenaires d’une SATT doivent lui transférer la totalité de leur propriété intellectuelle. Ce système nous pose plusieurs problèmes sérieux. D’abord, les SATT sont régionales ou locales, alors que le CEA est un organisme national. Ce n’est pas une seule entité locale ou une équipe donnée qui est porteuse du brevet. D’autant que plusieurs d’entre elles peuvent être impliquées. Ainsi, la direction de l’énergie nucléaire du CEA dispose de différentes équipes, localisées à Marcoule, à Cadarache ou à Saclay.
Ensuite, l’obligation de transférer la propriété intellectuelle aux SATT casse le modèle du CEA en la matière. En effet, le CEA mutualise lui-même la propriété intellectuelle des inventions dont il est l’auteur ou le coauteur. Lorsqu’un partenaire industriel contribue à la mise au point d’une invention avec le CEA, il lui en laisse la propriété intellectuelle. En retour, le CEA lui délivre une licence exclusive pour exploiter l’invention dans son cœur de métier. Mais l’industriel accepte que cette propriété industrielle puisse être déclinée au profit d’autres, ceux-ci devant alors payer des droits pour bénéficier de la licence. Symétriquement, les partenaires industriels du CEA bénéficient d’un droit particulier lorsqu’ils souhaitent exploiter un des 5 200 brevets ou familles de brevets dont le CEA est détenteur.
Si le CEA venait à éclater son capital de propriété intellectuelle, son modèle serait détruit. D’autant que, dans le domaine de la recherche technologique, le CEA doit faire appel pour 80 % à des ressources externes, qui proviennent de fonds européens, d’agences de financement nationales ou de partenaires industriels. Nous avons sollicité et obtenu des aménagements, qui nous permettront d’être partenaires des SATT « Paris-Saclay » et « Grenoble Alpes Innovation Fast Track ». Nous ne participons à aucune autre SATT.
Enfin, lorsqu’un établissement partenaire du CEA – qu’il s’agisse du CNRS ou d’une université – est membre d’une SATT, il doit lui transférer la totalité de sa propriété intellectuelle, tant le background – propriété intellectuelle en amont d’une découverte – que le foreground – droits sur ce qui sera découvert ultérieurement. Dans ce cas, le CEA ne peut plus exploiter les droits de propriété intellectuelle qu’il détient en commun avec cet établissement sans impliquer la SATT, ce qui est source de complexité. Auparavant, lorsqu’une personne souhaitait obtenir une licence pour exploiter une invention dont le CEA et un ou plusieurs autres établissements étaient copropriétaires, il était généralement admis que le CEA joue le rôle de négociateur pour compte de tiers. Désormais, cela ne fonctionne plus.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Le CEA ne peut plus être le négociateur unique ?
M. Bernard Bigot. Il peut toujours l’être, mais la SATT le refuse le plus souvent.
M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du CEA. La SATT « Toulouse Tech Transfer », avec laquelle nous sommes en discussion, pourrait l’accepter. Mais tel n’est pas le cas général : les SATT cherchent à se positionner en tant que mandataire et négociateur unique. Les difficultés s’accumulent dans les cas où le CEA est détenteur de droits de propriété intellectuelle en commun avec d’autres organismes dans le cadre d’unités mixtes de recherche (UMR), la plupart du temps sur le background, mais parfois aussi sur le foreground. De plus, l’introduction d’un nouvel acteur en France – la SATT – a considérablement compliqué le travail au niveau européen. Au sein des consortiums européens, le nombre de partenaires par pays peut être un facteur discriminant. Enfin, les SATT « emportent » la propriété intellectuelle avec elles.
M. Bernard Bigot. La SATT est une structure unique en Europe !
M. le président Alain Claeys, rapporteur. En voulant protéger certains, on remet en cause votre modèle.
M. Jean-Philippe Bourgoin. Les acteurs académiques peuvent eux aussi se trouver pénalisés lorsqu’ils interviennent dans un cadre européen. À titre d’exemple, le fait d’avoir cédé ses droits de propriété intellectuelle à une SATT empêche l’université d’Aix-Marseille de travailler dans le cadre de la communauté de la connaissance et de l’innovation (KIC – Knowledge and Innovation Community) « InnoEnergy », car l’accord de consortium général qui fonde cette KIC ne permet pas d’accueillir un tiers intervenant telle que la SATT.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous être plus précis ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. L’université d’Aix-Marseille a signé un contrat avec plusieurs partenaires européens avant la création de la SATT. Une fois celle-ci mise en place, elle a dû lui transférer ses droits de propriété intellectuelle.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. La création de la SATT ne remet pas en cause le contrat conclu antérieurement.
M. Bernard Bigot. Mais il faudrait que la SATT entre dans la KIC.
M. Jean-Philippe Bourgoin. Et qu’elle soit acceptée par l’ensemble des autres acteurs.
M. Charles de Courson. Est-ce un problème ?
M. Jean-Philippe Bourgoin. Oui. À ce stade, ces difficultés ne sont pas réglées.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. La France avait du retard en matière de transfert de technologies, sauf dans quelques secteurs. C’est pourquoi l’idée des SATT a été développée au moment où les investissements d’avenir ont été décidés. Or le CEA fait partie des organismes qui, depuis longtemps, travaillent avec les industriels et font du transfert de technologies, très efficacement d’ailleurs. Le retour en arrière que vous décrivez n’est pas acceptable. Il nous faut voir comment amender les dispositifs. Nous sommes preneurs de vos éventuelles propositions en ce sens.
M. Bernard Bigot. Nous pouvons en effet vous faire quelques propositions. Le principe des SATT n’est pas mauvais en soi.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il répond en tout cas à un besoin.
M. Bernard Bigot. Le CEA a déposé 756 brevets en 2013 et 654 en 2012. Il y a dix ou quinze ans, il en déposait déjà environ 200. Dans certaines régions, nous travaillons avec des acteurs qui en déposent entre un et dix par an. Je ne peux donc que souscrire à l’idée de mutualiser et d’amplifier cette ressource, mais les règles doivent être plus flexibles. Le transfert de la totalité de la propriété intellectuelle – sans lequel on ne peut pas être partenaire d’une SATT – constitue une exigence trop rigide. Le modèle du CEA, je le rappelle, est complètement différent et organisé à l’échelle nationale. Dans certains cas, il lui serait possible de transférer la propriété intellectuelle, par exemple dans le domaine de la chimie, lorsqu’un laboratoire bien précis crée une molécule qui a des applications médicales. Dans d’autres domaines, c’est quasi impossible : en matière de microélectronique, les inventions sont mises au point par des partenaires multiples et donnent lieu au dépôt non pas de brevets distincts, mais de portefeuilles de plusieurs centaines de brevets.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’INSERM risque-t-il d’être confronté aux mêmes problèmes que le CEA ?
M. Bernard Bigot. Oui, et le CNRS aussi. Dès l’origine, nous avons demandé que les dérogations soient autorisées, lorsqu’elles sont justifiées. Si la convention-cadre n’était pas aussi rigide, la SATT « Paris-Saclay » aurait pu démarrer il y a deux ans comme toutes les autres. Nous sommes en train d’imaginer une convention spécifique, qui permettra au CEA d’accompagner son développement sans en être membre fondateur.
M. Charles de Courson. Existe-t-il toujours, dans les statuts du CEA, une disposition qui interdit à vos chercheurs de détenir une part de la propriété intellectuelle ?
M. Bernard Bigot. Oui. La propriété intellectuelle revient au CEA.
M. Charles de Courson. Intégralement ?
M. Bernard Bigot. Oui.
M. Charles de Courson. Par contraste, certaines entreprises accordent une part de la propriété – 5 % par exemple – aux ingénieurs qui ont mis au point une invention.
M. Bernard Bigot. Pour sa part, le CEA accorde des primes. Notre modèle est différent de celui du CNRS. À titre d’exemple, lorsque Pierre Potier a découvert le Taxotere, molécule aux propriétés remarquables, il a bénéficié d’une partie des retombées commerciales grâce à son statut de chercheur au CNRS.
M. Charles de Courson. La disposition que j’ai mentionnée n’est-elle pas un frein à la créativité et au transfert de technologies, notamment lorsque le CEA travaille avec des entreprises ou des universités qui associent leurs chercheurs aux résultats non pas au moyen de primes, mais d’une part de la propriété sur les inventions ? Pourquoi ne laisse-t-on pas le CEA décider de l’intéressement de ses chercheurs en fonction des découvertes, afin qu’ils aient un juste retour de leurs efforts ?
M. Bernard Bigot. Lorsqu’une entreprise souhaite avoir accès à un droit de propriété intellectuelle, elle préfère avoir affaire non pas à des acteurs multiples, mais à un interlocuteur unique qui puisse prendre un engagement précis pour une durée déterminée. Les difficultés augmentent avec le nombre de copropriétaires : chacun d’entre eux est en droit de demander à modifier tel ou tel aspect du contrat.
M. Charles de Courson. Cependant, le CEA pourrait garder la propriété totale sur les inventions tout en instaurant un mécanisme d’intéressement des chercheurs en fonction des résultats. Le système de primes n’a guère évolué depuis vingt-cinq ans !
M. Bernard Bigot. Si. Les règles ont été précisées et complétées.
M. Charles de Courson. L’existence de différents mécanismes d’intéressement n’est-elle pas une source de problèmes lorsque plusieurs organismes de recherche travaillent ensemble ? Il n’est pas très sain que, à l’intérieur d’une même équipe, certains chercheurs puissent bénéficier d’une part de la propriété et d’autres, seulement d’une prime.
M. Bernard Bigot. En effet. Mais les règles sont propres à chaque employeur, et chacun les accepte. D’autre part, très peu d’entreprises rémunèrent leurs chercheurs sur la base d’un pourcentage.
M. Charles de Courson. Il existe différents systèmes : l’entreprise peut accorder au chercheur la propriété d’une part de l’invention, exprimée en pourcentage, ou bien le faire bénéficier d’un mécanisme d’intéressement, tout en gardant la propriété pour elle-même.
M. Bernard Bigot. Pour conclure, et sans rien modifier de mes propos liminaires, je dirais que l’idée des PIA est excellente : ils permettent d’orienter des moyens vers l’investissement dans le secteur de la recherche et développement.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Nous vous remercions, monsieur l’administrateur général.
Audition du 22 avril 2014
À 16 heures 15 : M. Jean-Charles Hourcade, directeur général de France Brevets, accompagné de M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de cette société
Présidence de M. Alain Claeys, Président, puis de M. Patrick Hetzel, rapporteur
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Nous recevons aujourd’hui M. Jean-Charles Hourcade, directeur général de France Brevets et M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de cette société.
Nous souhaitons connaître les enjeux de la mission qui vous a été confiée et les modalités concrètes de votre action.
M. Jean-Charles Hourcade, directeur général de France Brevets. Si le brevet est une notion datant de la révolution industrielle, l’importance stratégique s’en est sensiblement accrue du fait, d’une part, de la mondialisation, qui permet une circulation presque sans limites des biens sur l’ensemble de la planète et, d’autre part, de l’irruption des technologies numériques, qui ont uniformisé de vastes classes de produits.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Ne faut-il pas aussi tenir compte du développement des sciences du vivant ?
M. Jean-Charles Hourcade. La brevetabilité du vivant est en effet un enjeu. Cependant, l’activité de France Brevets est essentiellement tournée vers le monde des sciences dites dures – l’électronique, la physique, la mécanique, la chimie… – et s’arrête à la lisière du monde du vivant.
Aux États-Unis, environ 10 milliards de dollars ont été investis dans la défense de droits de propriété intellectuelle sous des formes diverses et variées. Il s’agit par là d’obtenir des retours sur investissements dans les nouvelles formes de l’économie des brevets.
Des centaines de milliers de brevets sont déposées chaque année. Dans le classement des déposants, on note la montée de la Chine, désormais au troisième rang mondial. La place de la France – en sixième position – reste honorable. On constate enfin le dynamisme de l’industrie de la Corée du Sud, qui traduit la focalisation de ce pays sur les enjeux liés aux brevets.
Si France Brevets est une première en Europe, il s’agit du quatrième fonds d’intervention sur les brevets à capitaux publics dans le monde après le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, trois pays où la notion de politique industrielle est une réalité forte et où, sous des formes variables, l’intervention de l’État est une composante du dispositif. C’est particulièrement vrai en Corée du Sud où le fonds brevets, Intellectual Discovery, est doté de 400 millions de dollars, financés par le gouvernement, et associe les grands noms de l’industrie coréenne à travers des conseils stratégiques. La mission de ce fonds est de défendre l’écosystème national d’innovation, à savoir le tissu des PME et des centres de recherche publique. Quand on interroge des responsables coréens sur le fait de savoir contre qui est dirigée cette défense, ils répondent : d’une part contre la Chine, perçue comme le concurrent industriel le plus important, et, d’autre part, contre l’appétit jugé souvent excessif de leurs propres chaebol.
France Brevets a été créé en mars 2011 sur l’initiative conjointe de l’État, dans le cadre du programme des investissements d’avenir (PIA), et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), laquelle souhaitait développer des opportunités d’investissements sur un temps long. Or la propriété intellectuelle relève de la catégorie d’actifs à cycle long : la durée de vie d’un brevet est de vingt ans. Il est indispensable, afin d’optimiser une intervention sur les brevets, de raisonner sur des plans à dix ans. De moins en moins d’acteurs se plient à cette discipline de planification. La CDC, quant à elle, a jugé qu’il pouvait y avoir là une opportunité intéressante pour un investisseur, comme elle, patient, d’intérêt général, et de temps long. L’État visait à assurer la cohérence du PIA et en particulier du Fonds national de valorisation de la recherche, lequel articule trois composantes : les sociétés d’accélération du transfert de technologies – SATT –, les consortiums de valorisation thématique – CVT – et France Brevets – censée garantir, tel un filet de sécurité, un retour sur l’investissement en matière de recherche et corriger la situation actuelle où la valorisation des brevets issus de la recherche publique reste en deçà de ce qui serait possible.
La création de France Brevets a répondu par ailleurs à une absence : il n’existait pas, en France, de structure d’intervention dédiée aux spécificités du marché international du brevet, à savoir une structure connaissant parfaitement les règles du jeu, capable d’interventions, dotée des moyens nécessaires, et réunissant l’expérience – qui ne s’acquiert qu’au niveau international – de la négociation sur les grandes affaires de brevet.
Notre rôle consiste à déployer toute une série de moyens et à les apporter aux détenteurs de brevets, qu’il s’agisse d’entreprises ou de laboratoires de recherche. Notre intervention se distingue de celle d’acteurs parfois qualifiés de patent trolls – chasseurs de brevets – mus par la recherche de gains importants à très court terme. Les deux premiers marqueurs de notre intervention sont la stratégie à long terme et l’organisation des retours d’investissement et de cash vers la recherche, qu’elle soit publique ou privée : il nous importe que la part la plus importante possible des montants collectés revienne bien à la recherche, compte tenu bien sûr du respect de l’équilibre économique de l’opération, ce qui n’est pas du tout le cas dans l’approche américaine de type patent troll où les acteurs organisent une coupure définitive entre le business sur brevet et le monde de la recherche, en achetant des brevets à des universités pour en tirer le maximum de profits dont aucun, in fine, n’iront à la recherche au-delà de ce qui aura été négocié au départ.
Le troisième et dernier marqueur de notre rôle est le respect de critères déontologiques exigeants : nous ne nous intéresserons qu’à des brevets dont nous sommes convaincus de la valeur, de la pertinence, de la solidité. Nous menons les négociations avec les licenciés potentiels dans une approche amicale afin de trouver un juste équilibre entre les besoins de financement de la recherche et les contraintes économiques. Toute l’équipe de France Brevets vient de l’industrie et connaît bien le sujet. Reste que si l’approche est amicale, elle est également déterminée : au-delà d’un certain seuil, si un industriel refuse de négocier et se met en situation de contrefaçon de droits de brevets dont nous avons la gestion, nous assignons.
Parmi nos modalités d’intervention, le patent factory, qui se situe le plus en amont de la génération d’un brevet, est celle par le biais de laquelle nous allons accompagner des détenteurs de brevets – en général des structures de recherche publique – afin d’enrichir leur portefeuille de brevets. Cette stratégie s’inscrit typiquement sur une durée de l’ordre de huit à dix ans. Sont en effet nécessaires trois années de procédures pour faire déposer un brevet, puis au moins trois à cinq années de maturation et d’efforts « d’évangélisation » pour que les technologies brevetées finissent, si tout se passe bien, par s’imposer, et enfin plusieurs années pour le développement du marché. Il faut donc compter une dizaine d’années avant la génération de revenus.
Pour autant, il faut pouvoir apporter des financements à nos partenaires à plus court terme. À cette fin, nous développons des stratégies d’alliance en propriété intellectuelle – IP Alliance – qui visent des technologies relativement matures dont certaines peuvent d’ores et déjà connaître un début d’adoption sur le marché. Nous allons regrouper des portefeuilles pour constituer des portefeuilles de brevets puissants qui vont faciliter la négociation et la prise de licence.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
M. Jean-Charles Hourcade. Une alliance de ce type concernant les technologies de communication sans contact, ou near field communication – NFC –, est en cours. Cette technologie en est au début de la phase massive d’adoption. De fait, environ 50 % des smartphones de la dernière génération l’incorporent. Nous avons réuni les portefeuilles de deux sociétés françaises, une PME, Inside Secure, basée à Aix-en-Provence, qui a fait partie des inventeurs de la NFC, et Orange. Nous avons également réuni par acquisition des brevets provenant d’une troisième source, un industriel étranger dans le secteur des semi-conducteurs, avec lequel les accords sont confidentiels et dont par conséquent je tairai le nom.
M. Charles de Courson. Avez-vous acheté 100 % de la propriété de ces brevets ?
M. Jean-Charles Hourcade. C’est le cas mais avec un mode de règlement qui inclura un petit pourcentage sur les redevances futures.
Voilà donc un cas d’agrégation typique de trois sources. Mais nous travaillons également sur des cas d’agrégation bien plus ambitieux, comme dans le domaine des smart grid, la distribution intelligente de l’énergie électrique où nous négocions avec de grands opérateurs comme EDF, de grands industriels comme Alstom, Schneider, Elster, Siemens…
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Où en est l’opération ?
M. Jean-Charles Hourcade. Je peux vous dire qu’elle continue à se construire.
Ces alliances concernent toujours un secteur donné voire un segment relativement fin.
Enfin, nous intervenons pour permettre le financement à partir de brevets : l’utilisation, par exemple, du portefeuille de brevets d’une PME ou d’une belle entreprise de taille intermédiaire – ETI – comme élément collatéral de sécurisation de financements à taux préférentiel, en arguant de ce que ces portefeuilles de brevets vont réduire le risque de l’investisseur ou du prêteur.
M. Charles de Courson. Vous devenez banquiers !
M. Jean-Charles Hourcade. Non, nous ne jouons pas le rôle d’une banque. En revanche, nous pouvons tout à fait jouer le rôle d’intermédiaire dans l’accord de financement que la société trouverait avec une institution financière.
M. Charles de Courson. En apportant une garantie ?
M. Jean-Charles Hourcade. Non, nous ne garantissons pas l’accord : c’est à l’investisseur qu’il reviendra de se faire sa religion sur la qualité de la garantie qu’il prend auprès de la société. Nous apportons seulement, pour notre part, une opinion sur la qualité du portefeuille.
M. Charles de Courson. Vous êtes donc conseil.
M. Jean-Charles Hourcade. Nous sommes conseil et nous pouvons également prendre un engagement de commercialisateur de licences sur les brevets pris en garantie, ce qui est très différent : dans un cas, vous avez une garantie sur un portefeuille de brevets sans que vous sachiez le moins du monde ce que vous allez en faire, alors que dans l’autre cas vous avez la même garantie sur le même portefeuille mais avec, de notre part, un engagement non pas de résultats mais de moyens. Nous disons : nous savons ce qu’il est possible de faire de ces brevets et voilà ce que nous pensons qu’on peut en tirer.
M. Charles de Courson. Et là, vous ne vous engagez pas…
M. Jean-Charles Hourcade. Il s’agit d’un engagement de moyens, pas de résultats.
M. Charles de Courson. Vous n’avez pas donné d’exemple sur le patent factory.
M. Jean-Charles Hourcade. J’y viens.
Le cycle de vie de l’innovation est à la base de l’organisation de notre action. Il va de la recherche publique jusqu’à l’adoption massive par le marché, en passant par des phases de recherche industrielle privée, de développement, puis d’introduction sur le marché par des pionniers industriels, en général des PME innovantes.
Nous allons principalement nous positionner sur les phases aval du cycle, les deux dernières citées. Notre expérience montre cependant que notre travail sera d’autant plus complet et profitable que nous aurons su accompagner les phases de recherche et de développement. Nous avons à cet effet signé toute une série d’accords avec les SATT ainsi qu’avec des structures comme certains pôles de compétitivité et certaines filiales de valorisation des grands organismes de recherche – France innovation scientifique transfert (FIST SA) pour le CNRS ou encore INRA-Tranfert.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment faites-vous pour ne pas doublonner avec les SATT, dont la création visait à faire traiter l’ensemble des éléments relatifs au transfert technologique au sein d’un même organisme chargé de la négociation ? Vous êtes-vous préoccupé de la question de l’articulation entre l’action des SATT et la vôtre ?
M. Jean-Charles Hourcade. Oui. Lors du dernier congrès du réseau C.U.R.I.E., nous avons même animé, avec nos collègues de la SATT Ouest, un atelier sur la question. Il s’agissait d’expliquer aux autres SATT et entités de valorisation de la recherche publique comment et pourquoi il fallait mettre en place cette articulation dans le temps.
M. Pascal Asselot, directeur du licensing et du développement de France Brevets. Prenons l’exemple du projet en cours avec l’Université européenne de Bretagne – UEB – et la SATT Ouest. Le métier de cette dernière consiste à transférer la technologie issue de l’UEB vers le premier adoptant ; France Brevets intervient bien plus tard dans le cycle pour valoriser et défendre les droits une fois que la technologie a été massivement adoptée. Un travail de fond sur la constitution du portefeuille est bien sûr nécessaire et c’est ce à quoi nous nous employons de conserve avec la SATT Ouest et l’UEB, autour d’une équipe de recherche de renommée internationale. Il s’agit en l’occurrence des codes correcteurs qui permettent une bonne réception du réseau sur les téléphones portables, et qui relèvent d’une technologie de rupture.
Le portefeuille de brevets d’une équipe de recherche française n’est pas toujours en rapport avec son expertise. Aux États-Unis, quand un chercheur a un soupçon d’idée, il dépose dix brevets alors qu’en France il faut que dix chercheurs aient une petite idée pour voir déposer un brevet. C’est donc sur la constitution de ce portefeuille de brevets que nous allons travailler dans la durée avec l’UEB, afin que, une fois fournis les efforts de développement et achevé le transfert de technologie par la SATT, nous puissions défendre les droits dans une démarche de licensing.
L’articulation est par conséquent très naturelle entre la SATT et France Brevets.
L’Institut Mines-télécom – IMT – travaille pour sa part dans le secteur des antennes. Nous accompagnerons le travail de transfert technologique, opéré par l’une de ses équipes, en constituant un portefeuille de brevets potentiellement incontournable dans les nouvelles technologies de communication de façon à pouvoir, in fine, faire un travail de licensing. Le processus sera le même avec l’Institut national de recherche en informatique et en automatique – INRIA – qui travaille dans le secteur du codage vidéo.
Le cas d’AlphaMOS est quelque peu différent. Cette PME toulousaine dispose d’un laboratoire de co-développement avec le CNRS, laboratoire qui travaille sur les technologies de capteurs, notamment d’odeurs pour l’industrie agroalimentaire. Nous faisons le pari avec elle que ces capteurs vont se retrouver à grande échelle dans les réfrigérateurs, les téléphones portables, les radiateurs... AlphaMOS ne pourra pas servir l’intégralité du marché mais sa technologie sera une technologie de base, de rupture et sera adoptée massivement. Là encore, nous tâchons de construire un portefeuille à travers un noyau commun entre le CNRS et AlphaMOS.
Intuilab, toute petite PME, dispose quant à elle d’un très beau brevet dans le secteur des interfaces sur les tablettes. Or son portefeuille de brevets est contrefait par Apple sur les I-Pad et Intuilab est absolument incapable de faire valoir ses droits. Nous travaillons donc avec elle pour enrichir son portefeuille afin, ensuite, de faire valoir ses droits vis-à-vis d’Apple.
Mobilead, plus encore qu’Intuilab, travaille sur des technologies mûres. Mobilead, c’est l’internet des objets. Sa technologie permettra une communication assez simple entre les objets manufacturés. L’horizon est assez lointain mais là encore nous allons travailler avec elle à la constitution d’un portefeuille afin de valoriser ses brevets.
Avec le projet Galileo, le CNES dispose d’un magnifique portefeuille en matière de technologies de géolocalisation. Nous avons conclu un accord de licence avec lui pour qu’il nous confie le portefeuille Galileo afin de valoriser les efforts de recherche réalisés.
Le dernier exemple concerne la NFC, déjà évoquée. Je souhaite mettre en lumière notre contribution à Inside Secure. L’adoption massive par le marché de la technologie développée par cette PME conduira à la réduction de ses parts de marché à rien : sa capacité de production ne pourra pas suivre ! Il lui faut donc choisir de valoriser sa recherche par le licensing, par le biais de France Brevets. Nous nous sommes lancés de façon intensive dans la constitution d’un portefeuille de brevets autour de la NFC afin de le valoriser auprès des grands utilisateurs de cette technologie. Les dialogues sont musclés avec des sociétés comme Samsung, Apple, LG, HTC, Huawei, Sony…
Vous avez sans doute le sentiment que notre activité est très marquée par les technologies de l’information et de la communication – TIC ; cela s’explique par la maturité de ce marché dans le domaine du brevet. On observe néanmoins que cette maturité déborde sur d’autres marchés comme l’énergie, les composants, la chimie. Notre portefeuille de programmes et d’interventions va donc accompagner cette extension du domaine. Ainsi travaillons-nous, il y a été fait allusion, dans les domaines des smart grid, des plateformes bio-sourcées ou encore de l’équipement médical. Nous restons en revanche très prudents quant à notre valeur ajoutée dans le domaine pharmaceutique : ce segment s’étant structuré autour du licensing exclusif, une intervention de notre part ne se révèle guère nécessaire.
Présidence de M. Patrick Hetzel, rapporteur
M. Jean-Charles Hourcade. Nous appréhendons en effet la biotechnologie essentiellement sous l’angle des technologies dites vertes – qui visent à l’amélioration des variétés végétales – et blanches – à savoir la production industrielle. En revanche, en ce qui concerne toutes les technologies dites « rouges » – santé humaine, thérapeutique et médicaments –, nous n’interviendrons pas du tout du fait du type des relations entre universités, start-up biotech et grande industrie, fondées sur des modèles de préfinancement et d’exclusivité – domaines où, en effet, nous n’apporterons pas de valeur ajoutée particulière.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. France Brevets participe à la dynamique des investissements d’avenir. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
M. Jean-Charles Hourcade. France Brevets a été créée lors de la première vague d’investissements d’avenir à l’occasion de laquelle près d’un milliard d’euros a été mobilisé pour le Fonds national de valorisation, dont 900 millions environ pour le financement des SATT, sur une base pluriannuelle, 50 millions d’euros pour France Brevets et 50 millions pour les CVT.
Nous nous sommes dans un premier temps employés à mailler le dispositif, ainsi qu’il était prévu, avec les conventions de coopération entre France Brevets et les SATT qui se traduisent par des actions très intenses, notamment, avec la SATT Ouest, ce qui est logique eu égard à la spécificité historique de la région Bretagne en matière de technologie de l’image et de réseaux. Nous entretenons également des relations de coopération fournies avec la SATT Conectus en Alsace, en lien avec les activités de valorisation du secteur chimique menées par l’université de Strasbourg, mais aussi avec la SATT Midi-Pyrénées à Toulouse. Nous travaillons, de même, avec la SATT PACA-Corse – avec les universités d’Aix-en-Provence et de Sophia Antipolis – dans le domaine des TIC.
En ce qui concerne les CVT, nous menons une action commune avec le CVT CVSTENE, qui travaille dans le domaine du cluster des technologies de l’information et des technologies électroniques qui associe, sous le leadership de l’Institut Mines-télécoms et de l’INRIA, le CEA et les laboratoires spécialisés du CNRS.
La deuxième vague du PIA est en discussion. Nous avons été partie prenante, à la fin 2013, de discussions exploratoires avec les services de l’État concernés, visant à définir les contours de ce que pourrait être un deuxième fonds d’intervention brevets qui pourrait être davantage dédié à l’acquisition de brevets dans des secteurs stratégiques.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. La commission Juppé-Rocard, à l’origine du PIA, se préoccupait du développement économique de la France. Pouvez-vous quantifier ou, du moins, formaliser la contribution de France Brevets au processus de réindustrialisation de la France ?
M. Jean-Charles Hourcade. Notre levier d’action en la matière est le renforcement du financement des activités de recherche et développement. Nous travaillons sur la base de cycles relativement longs : de cinq à dix ans. Une fois ces cycles définis, nous visons la mise en place de cercles vertueux où le processus de recherche et développement va pouvoir être partiellement – voire, à terme, totalement – autofinancé par les retours de dividendes sur brevets ; mais, j’y insiste, il faut dix ans pour amorcer le cycle.
L’industrie connaît cette logique. J’ai eu l’honneur de diriger cette activité au sein du groupe Thomson. Grâce à plusieurs décennies de travail et d’investissements patients, il a été possible de générer quelque 400 millions d’euros de redevances par an en moyenne, à partir d’un portefeuille d’environ 7 000 familles de brevets. Philips a la même expérience. Le groupe Ericsson génère pour sa part 1 milliard de dollars par an qui viennent en contribution directe de son budget de recherche et développement. Ce sont là les modèles qui permettent de pérenniser des activités de recherche et développement intenses dans la longue durée.
En ce qui concerne l’emploi industriel, son accroissement sera le résultat naturel de l’impact de l’activité de recherche et développement. Nous pouvons changer la donne en musclant et pérennisant le socle d’activités de recherche et développement.
M. Charles de Courson. Pourquoi a-t-il fallu une structure publique pour développer cela ? Comment expliquer l’absence d’initiatives privées, notamment en matière de patent factory, d’IP alliance voire d’IP finance ?
M. Jean-Charles Hourcade. J’ai dirigé cette activité chez Thomson pendant presque dix ans. Quand la Caisse des dépôts et consignations m’a proposé de créer France Brevets, j’ai répondu par l’affirmative ; si la proposition avait émané d’une banque privée je l’aurai refusée car je n’aurais pas cru à son engagement sur la durée.
M. Charles de Courson. Pensez-vous donc que la finance est court-termiste ?
M. Jean-Charles Hourcade. Absolument.
M. Charles de Courson. Toujours ?
M. Jean-Charles Hourcade. Sur le marché parisien, j’en suis convaincu, même si je peux me tromper ; en tout cas, j’aurais dit non à une banque privée.
M. Pascal Asselot. On retrouve cette caractéristique sur le plan international. Ceux qui seraient plus ou moins nos homologues aux États-Unis sont financés par des capitaux privés et recherchent des retours sur investissement excessivement courts-termistes sur les brevets, ce qui les conduit à avoir une activité très contentieuse et complètement coupée de la recherche. Ils achètent des brevets et les revendent juste après. C’est, j’y insiste, le résultat du court-termisme de leurs investisseurs.
M. Jean-Charles Hourcade. La finance aujourd’hui est en effet extraordinairement court-termiste ; c’est, je le répète, ma conviction absolue, fruit de mes vingt-cinq années d’expérience dans l’industrie.
M. Charles de Courson. Du point de vue du marché, pensez-vous avoir un rôle à jouer plutôt pour les PME ? Et, a contrario, avez-vous un vrai rôle vis-à-vis des grandes entreprises ? Ont-elles besoin de France Brevets ?
M. Jean-Charles Hourcade. Théoriquement, un grand groupe dispose des moyens financiers pour mener cette activité à bien, il peut recruter les personnels au niveau requis et il dispose du temps long. La réalité montre cependant que seule une minorité de grands groupes se sont réellement approprié cette logique, avec la constance dans le temps qu’elle exige. En France, je citerai Thomson, France Télécom-Orange, le CEA, L’Oréal, Alcatel – avec des hauts et des bas –… et c’est tout.
M. Charles de Courson. Et dans l’aéronautique, aucun ?
M. Jean-Charles Hourcade. Non : nous sommes en discussion au plus haut niveau avec Airbus qui considère que nous pouvons leur apporter non des moyens mais, d’une part, la connaissance du marché – pour cela, il leur suffirait d’embaucher le personnel adéquat qui pour l’heure leur fait défaut – et, d’autre part – et cela peut leur être vraiment précieux parce qu’irremplaçable – un positionnement commercial différent. Dans ces métiers, il est en effet parfois nécessaire d’exercer un rapport de force dur, de montrer les dents face à la contrefaçon. Or, un grand groupe peut hésiter à entrer dans ce genre de négociations à cause des risques encourus. Tel groupe renoncera par exemple à aller dans un grand pays émergent défendre ses droits de brevet dans un de ses domaines d’expertise de peur qu’en représailles ne soit pas signé un contrat industriel important dans un autre de ces domaines.
Aussi, nombre de grands groupes peuvent trouver avantage à confier à des tiers compétents la représentation de leurs intérêts dans le domaine des brevets dans certains secteurs industriels.
M. Charles de Courson. Ce rôle d’enforcement – défense des droits de brevets devant les juridictions compétentes vous amène à vous transformer en avocats spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle. A-t-on besoin d’une structure publique pour cela alors qu’il existe d’excellents avocats spécialisés ?
M. Jean-Charles Hourcade. Nous ne sommes pas avocats. Nous allons sous-traiter la partie purement juridique à des avocats. Ce qu’aucun cabinet d’avocats ne fera, en revanche, et que nous faisons, c’est un travail de co-élaboration de la stratégie, ce qui n’est pas si facile.
Prenons l’exemple des technologies NFC : pour parvenir à construire des accords intelligents, il faut piloter les négociations de manière que l’ensemble des acteurs dans la chaîne de valeur finissent par y trouver leur avantage et des raisons de signer. Pour cela, il est indispensable de comprendre comment ces différents acteurs se positionnent dans la chaîne de valeur. Ceux dont nous allons représenter les intérêts font partie de cet écosystème. Dans l’électronique, Samsung, Apple, vont utiliser des technologies brevetées Inside Secure ; or ce n’est pas avec Inside Secure que ces groupes vont avoir un rapport ; en effet son invention a forcément été incorporée dans un circuit intégré. Une troisième catégorie d’acteurs s’est par conséquent incorporée dans le jeu. Le fait de se saisir d’une innovation, de la coder dans une puce silicium, par exemple, et de la revendre à un équipementier, a des incidences juridiques et financières très importantes. Des garanties ont été données et reçues. Il faut comprendre l’ensemble du jeu contractuel qui ne relève pas que du droit mais également des domaines économique, industriel et parfois même commercial.
M. Charles de Courson. Vous faites-vous rémunérer pour ces conseils ?
M. Jean-Charles Hourcade. Nous ne facturons jamais aux entreprises ou aux laboratoires de recherche pour qui nous travaillons. Nous convenons en revanche de la part qui nous reviendra sur les revenus futurs. Nous ne sommes donc rémunérés qu’en cas de succès. Nous cherchons une rémunération à même de garantir l’équilibre économique de France Brevets sur l’ensemble de ses opérations : celles couronnées de succès doivent financer celles qui n’ont pas abouti.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Quels sont vos moyens humains ? comment avez-vous constitué votre équipe et quelle a été la méthode de recrutement de vos experts ?
M. Jean-Charles Hourcade. Notre équipe est composée d’une petite quinzaine de personnes qu’on peut répartir en trois catégories.
La première est celle des stratèges. Ils forment une équipe d’une demi-douzaine de négociateurs seniors dirigés par Pascal Asselot, ici présent, et possèdent une double culture, technologique et juridique, à l’instar de la nature du brevet, d’essence hybride, mi-technique, mi-juridique.
La deuxième est celle des économistes. Ceux-ci vont s’attacher à répondre à la question très difficile de savoir combien vaut un brevet. D’un point de vue financier, la valeur d’un brevet correspond à la valeur actuelle nette du flux de redevances futures. Il s’agit ensuite d’appliquer cette définition en établissant des projections du développement du segment de l’industrie concerné dans le futur. Nous allons compiler des données de marché pour les organiser en fonction de différents scénarios et les probabiliser.
La troisième traite de la compréhension de l’objet brevet lui-même qui a ses spécificités en tant qu’actif.
Un travail correct dépend donc de la réunion de ces différentes compétences – technologie, droit des brevets, procédures et économie.
Nos collaborateurs ont tous été recrutés dans l’industrie – les compétences requises se sont en effet forgées dans le quotidien des activités industrielles –, pour certains par des chasseurs de têtes et, pour la majorité, grâce à la mobilisation des réseaux qui irriguent une communauté qui n’est pas si vaste : en Europe, les experts pointus dans les domaines qui nous intéressent se comptent sur les doigts de quelques mains.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Le business plan que vous nous avez apporté montre que le résultat net escompté devrait devenir positif à partir de 2016 avec des revenus qui augmentent progressivement. Quelle méthode avez-vus utilisé pour établir cette montée en puissance ?
M. Pascal Asselot. L’objet principal de France Brevets est le programme de licensing consistant à agréger un portefeuille de brevets, le constituer soit par acquisition, soit par licence puis aller le défendre par des négociations ou l’enforcement.
Il existe trois types de programmes de licensing.
Le « très gros et très mûr », comme NFC : le programme, les brevets et le marché sont là. Ce type de programme nécessite de très gros investissements et génère d’assez importants revenus.
Nous avons ensuite les petits programmes : un ou deux brevets sont contrefaits ou potentiellement contrefaits par un segment de marché. Nous sommes ici dans une logique de défense des droits mais aussi dans un domaine où les montants engagés et le retour seront beaucoup plus faibles.
Enfin, le troisième type de programme est la continuation du patent factory. La constitution d’un portefeuille de brevets sur cinq ans nécessitera une importante dépense d’énergie et d’argent.
C’est en constituant notre action dans ces trois familles de programmes, et en probabilisant le développement de chacun d’eux, que nous avons construit notre business plan.
M. Jean-Charles Hourcade. Dès lors qu’un grand programme comme NFC est lancé, c’est-à-dire dès lors que nous avons réuni la masse critique de brevets nécessaire et que le début d’adoption par le marché a eu lieu, il n’y a plus vraiment d’incertitude sur les montants de revenus qui seront générés. En revanche, une incertitude demeure sur le moment auquel ces revenus vont apparaître, moment qui dépend essentiellement du rythme des négociations. Une négociation portant sur des montants significatifs, à savoir plusieurs dizaines de millions d’euros, prendra au moins deux ans et pourra être bouclée en moins de trois ans sur une base amiable. Mais si s’intercale dans le processus des phases de procédure contentieuse soit sur le fond soit sur des éléments de forme ou d’environnement, ce qui est très fréquent, la négociation peut prendre trois, quatre voire plus de cinq ans. Ainsi, le profil d’évolution des revenus est un peu heurté, il n’est pas linéaire. Et l’on peut se tromper facilement d’un ou deux ans – éventualité que nous avons intégrée.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2013 consacré au lancement du PIA, et plus particulièrement au volet recherche et enseignement supérieur, écrit : « L’investissement devra pouvoir être arrêté si les premiers programmes de licensing ne procurent pas les revenus attendus. » Quelle est votre réponse ?
M. Jean-Charles Hourcade. On ne peut guère contester ce principe de bonne gestion selon lequel on ne saurait persévérer à l’infini dans l’erreur. Reste que je conseillerais la prudence avant d’arrêter l’investissement : il faut garder à l’esprit que, dans notre activité, le temps est probablement la matière première la plus importante. À partir du moment où certains programmes ont passé les seuils de constitution de portefeuille de brevets et où les inventions brevetées ont passé les seuils de l’adoption par les marchés, nous sommes, si je puis dire, dans le domaine de la balistique : si l’on ignore le moment où des revenus seront produits, en revanche, on connaît leur montant. Je me fais fort de communiquer cette conviction aux magistrats de la Cour des comptes…
Prenons le programme NFC : début janvier 2014, le gouvernement chinois a publié les normes nationales qui vont régir les paiements par téléphone mobile. Compte tenu de l’infrastructure fixe de l’internet en Chine, on prévoit que le paiement par téléphone portable y deviendra le mode dominant. Au cours des deux ou trois dernières années, il y a eu une floraison de tests régionaux de différentes techniques associant les réseaux télécom, les réseaux bancaires, différentes technologies de communication… Bref, les Chinois ont tout essayé et les autorités ont conclu, fin 2013, que la technologie NFC serait obligatoire à compter du 1er mai 2014. Il serait par conséquent imprudent d’arrêter ce programme dans la mesure où nous disposons des brevets fondamentaux sur cette technologie. Je ne sais pas encore quand ni comment nous parviendrons à un accord intelligent avec l’industrie chinoise pour le marché domestique chinois – sachant que certains de ces brevets sont enregistrés en Chine – mais je suis certain que nous y arriverons.
Mme Laure Fau, rapporteure de la Cour des comptes. Où en êtes-vous de l’augmentation de capital ?
M. Jean-Charles Hourcade. Cinquante millions d’euros ont été libérés sur les 100 initialement prévus. À moins que nous n’enregistrions des signatures pour au moins une dizaine de millions d’euros avant fin septembre, il est très probable que nous serons amenés à solliciter la libération d’une tranche supplémentaire avant la fin 2014. La discussion n’a toutefois pas encore été lancée sur le sujet.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Monsieur le directeur général, nous vous remercions.
Audition du 13 mai 2014
À 18 heures : M. Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, accompagné de M. Pierre Moschetti, sous-directeur de la construction aéronautique
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur, la mission d’évaluation et de contrôle reçoit aujourd’hui M. Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
La filière aéronautique est un acteur important des programmes d’investissement d’avenir (PIA) : 1,5 milliard d’euros lui a été attribué au titre du premier programme, et 1,22 milliard d’euros au titre du second.
Spécificité de cette filière, l’opérateur des programmes est l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) tandis que le pilotage est assuré par la Direction générale de l’aviation civile. En outre, les programmes ont été mis en place, non pas par des jurys internationaux mais dans le cadre de procédures de gré à gré. Enfin, ils ont donné lieu à la conclusion de conventions entre l’ONERA et les industriels.
La mission d’évaluation et de contrôle est donc particulièrement intéressée par la gestion des investissements d’avenir par la filière et notamment par la gouvernance qu’elle a mise en place et qui pourrait être exportée dans d’autres domaines.
Nous nous intéressons aussi aux relations des acteurs de la filière avec les diverses instances créées par les PIA en matière de recherche fondamentale. Quelles relations ont-ils noué avec les IDEX ou les LABEX ? Ont-ils, le cas échéant, contribué au financement des EQUIPEX ?
Enfin, Monsieur le directeur général, la mission souhaite vous entendre sur les relations de la filière avec les organismes institués par le PIA en matière de valorisation de la recherche. Plusieurs instituts de recherche technologique (IRT) les concernent en effet directement ; je pense notamment à l’IRT Jules Verne à Nantes et à l’IRT Saint-Exupéry à Toulouse. Des dérogations aux règles établies par le Commissariat général à l’investissement (CGI) ont-elles été mises en place pour assurer des rapports harmonieux entre ces IRT et la filière ? Quel regard la filière porte-t-elle sur les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) et quelles sont ses relations avec ces dernières ?
M. Patrick Gandil, directeur général de l’aviation civile au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. La construction aéronautique est un secteur stratégique pour notre pays. Elle est un vecteur de souveraineté et un gisement d’emplois. Cette activité économique génère un chiffre d’affaires annuel de 30 milliards d’euros et apporte une contribution de plus de 20 milliards d’euros par an à la balance commerciale. Elle devrait être durablement favorable à l’industrie nationale puisque les analystes s’accordent sur une prévision de croissance du trafic aérien mondial d’environ 5 % par an sur les vingt prochaines années. La production des avionneurs est déjà vendue pour plusieurs années. La trésorerie de ces entreprises est souvent florissante grâce aux avances versées par les acquéreurs.
La France est l’un des deux seuls pays au monde, avec les États-Unis, à disposer sur son territoire d’une filière aéronautique complète, capable de fabriquer un avion entièrement français. Aucun autre pays européen ne jouit d’une telle maîtrise du marché. La filière rassemble, dans un fonctionnement harmonieux, les leaders que sont les constructeurs finaux comme Airbus ou Dassault Aviation, un très grand motoriste, Safran, des équipementiers de premier plan comme Zodiac ou Thales mais aussi un tissu d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de PME. Les grands groupes se préoccupent du devenir des PME qui sont leurs sous-traitants : celles-ci sont en effet détentrices d’un savoir-faire qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Ce tissu d’ETI et de PME représente à lui seul la moitié du chiffre d’affaires et des effectifs de l’industrie nationale. Si les grands groupes tirent l’industrie aéronautique, ils s’inscrivent dans ce qu’on appelle un écosystème de l’aéronautique.
L’industrie aéronautique consent un effort permanent de recherche et développement (R&D) ; elle y consacre 15 % de son chiffre d’affaires, ce qui est considérable.
Outre une féroce concurrence entre Airbus et Boeing, l’industrie aéronautique est soumise à des pressions sociétales fortes qui l’ont contrainte à réaliser des progrès remarquables en une cinquantaine d’années. Le bruit à la source a été réduit de 20 décibels depuis les premiers avions à réaction des années cinquante. Les émissions de C02 ont diminué de près de 80 %. Par chance, les préoccupations environnementales et les impératifs d’efficacité économique se rejoignent : depuis les frères Wright, les recherches s’intéressent à la réduction de la consommation de kérosène car plus sa consommation est faible, plus l’avion va loin et transporte plus.
Dans le domaine de la sécurité, les progrès sont spectaculaires. Nous sommes aujourd’hui passés sous la barre des 300 victimes par an à l’échelle mondiale pour les avions de plus de 19 places. Aucun autre mode de transport ne présente un niveau de sécurité comparable ; il est acquis au prix d’efforts importants et très coûteux.
La décennie en cours doit voir le renouvellement de grands produits. Ainsi, si l’A320 n’est pas encore renouvelé, puisque l’A320 NEO a été lancé avec des résultats tout à fait satisfaisants, l’A330 est en passe d’être remplacé par l’A350 ; l’hélicoptère Dauphin cédera la place au X4 et le Super Puma au X6 ; de nouveaux avions Dassault apparaissent ; le LEAP-X est en train de succéder au CFM-56, qui demeure un moteur de référence – il équipe les trois quarts des avions moyen-courriers – ; enfin, Safran développe l’Open Rotor.
Dans cette période stratégique, l’erreur n’est pas permise car, contrairement à l’industrie automobile, la gamme de produits dans l’industrie aéronautique est très limitée. Un grand avionneur comme Airbus présente trois principaux modèles : A320, A330 – prochainement A350 – et A380. Les autres avionneurs, plus petits, essaient, sans succès pour l’instant, de pénétrer le marché des gros avions, qui reste l’apanage d’Airbus et de Boeing. Chaque produit joue dans le modèle économique de ces deux grandes entreprises un rôle essentiel, qui laisse peu de place à l’erreur. Quant aux autres avionneurs, les investissements sont si lourds qu’ils jouent leur vie chaque fois qu’ils lancent un produit.
La concurrence entre Boeing et Airbus est dure et se renforce. Airbus doit affronter un concurrent qui est massivement soutenu, au travers d’aides directes et grâce à la dualité civile et militaire de la filière. L’octroi récent à Boeing par l’État de Washington de la plus large exemption fiscale de l’histoire des États-Unis – 8,7 milliards de dollars – est le dernier exemple de ce soutien. La Chine, la Russie, et à un moindre degré le Canada et le Brésil, qui cherchent à se positionner sur le marché des avions de plus de cent places, subventionnent également leur industrie de façon massive.
Au niveau européen, l’Allemagne déploie d’importants efforts en vue de bâtir une industrie aéronautique plus performante. De même, la Grande-Bretagne relance son soutien public à cette industrie.
Ce secteur, qui stimule les technologies et offre un marché porteur, aiguise donc les appétits des grands pays industrialisés. Il faut prendre garde à ne pas décrocher du peloton. Or l’industrie française n’est pas aidée dans les mêmes proportions.
Que peut-on faire face à cette concurrence ?
L’État recourt aux avances remboursables, pour le lancement des produits, et aux subventions, pour la recherche intermédiaire – la recherche en amont ne relève pas du champ de compétence direct de la DGAC.
Nous avons tenté d’évaluer ce soutien public sur le long terme. Toutes les opérations n’ont pas été réussies. À titre d’exemple, l’A340 n’a pas remboursé toutes les avances reçues : dernier quadrimoteur dans sa catégorie, cet appareil fut un échec commercial, sa naissance ayant coïncidé avec l’autorisation de la traversée de l’Atlantique en bimoteur, dont a pleinement profité le Boeing 777, premier bimoteur dans sa catégorie. En revanche, certaines opérations ont été remboursées bien au-delà des avances qui avaient été consenties, en raison des royalties qui s’y attachent – je pense à l’Airbus A320 ou au moteur CFM56. Au total, le bilan financier des avances remboursables est excédentaire. Cet excédent a permis de financer la presque totalité des subventions de recherche aéronautique.
Le dispositif, qui joue donc un rôle d’amorçage et « s’autorembourse », a permis de financer la recherche et d’aider des industriels à lancer des aéronefs dont la fabrication assure une activité économique considérable et des emplois nombreux.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Le calcul dont vous faites état pour les avances remboursables tient-il compte du loyer de l’argent ?
M. Patrick Gandil. Ce calcul prend uniquement en compte les flux de trésorerie. Il n’en reste pas moins significatif.
Sans les avances remboursables, certains aéronefs n’existeraient pas, privant ainsi notre pays d’une source majeure d’activité et d’emplois. C’est le cas de l’hélicoptère X4 qui va remplacer l’hélicoptère Dauphin en fin de vie : il a bénéficié de ces avances, ainsi que du soutien aux recherches sur l’hélicoptère du futur.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pouvez-vous nous apporter des éléments sur la gouvernance mise en place pour gérer les PIA et nous indiquer ce que ces programmes ont apporté à la filière ?
M. Patrick Gandil. Nous avons mis en place par une convention un comité de pilotage, que je préside, et qui réunit le CGI, la DGAC, la Direction générale de l’armement (DGA), la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) et l’ONERA. Il assure le suivi régulier des projets et des contrats qui en résultent.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quel est le rôle de ce comité par rapport au CGI dans l’évaluation des projets ?
M. Patrick Gandil. Le comité de pilotage assure l’essentiel du suivi et de l’évaluation. Il s’appuie sur le bras armé que représente la DGA et sa capacité d’ingénierie : c’est elle qui instruit les projets et suit les opérations.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Certaines opérations ont-elles été remises en cause ?
M. Patrick Gandil. Une seule opération a été remise en cause. Il s’agissait d’un projet de moteur de l’entreprise Turbomeca pour l’hélicoptère X4 dont le financement a été rejeté par la Commission européenne dans le cadre du contrôle des aides d’État. Par ailleurs, le comité de pilotage a examiné les possibilités de réaffectation d’une somme de 10 millions d’euros, correspondant à des travaux sur les moteurs jugés non nécessaires, à d’autres projets éligibles aux programmes d’investissements d’avenir. Il a choisi de la consacrer à des travaux complémentaires sur l’Open Rotor.
Les décisions de ce comité de pilotage, qui s’est réuni à dix reprises, sont collégiales et consensuelles. Je n’ai pas le souvenir d’une quelconque tension nécessitant un arbitrage du Premier ministre car les membres partagent tous l’objectif de la réussite industrielle.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourtant le choix des projets ne relève pas de jurys internationaux.
M. Patrick Gandil. En effet, la filière aéronautique se distingue par son mode de sélection des projets qui ne fait pas appel à des jurys internationaux.
Cette particularité s’explique par le très petit nombre de produits et l’organisation descendante des projets. L’idée géniale d’un inventeur n’a presque aucune chance d’aboutir car il faut trouver l’avion qui la portera. Compte tenu du nombre limité de produits, ce sont plutôt les grands projets qui structurent le travail de la filière. Une attention toute particulière est apportée à la place des PME. Cette organisation s’appuie sur un syndicat professionnel très actif, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Il faut également souligner le rôle d’une structure consultative mise sur pied avant les PIA, le Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC), qui associe services de l’État (DGAC, DGA, DGCIS), grands industriels, transporteurs aériens, contrôle aérien – la DGAC – et aéroports.
Cette structure avait identifié le besoin de produits destinés à éviter les risques considérables que génère la construction sans étapes intermédiaires d’aéronefs très innovants. Les démonstrateurs technologiques – puisque tel est le nom de ces produits – ont émaillé toute l’histoire de l’aviation. Or, aucun financement n’était prévu à cette fin. L’arrivée des PIA a résolu ce problème.
Le PIA2 permet actuellement de financer un démonstrateur sur les architectures d’avion. Tous les avions depuis le Boeing 707 se ressemblent mais rien ne dit que cette architecture perdurera. Si, demain, l’Open Rotor devait voir le jour, il nécessiterait une modification de l’emplacement des moteurs, qui ne pourront plus être installés sous les ailes. On sait également que Boeing travaille sur un projet d’avion de très grande capacité avec des ailes repliables, comme les avions de porte-avions, afin de respecter les dimensions des aéroports. L’idée de construire de nouveau des sortes de biplans pour améliorer les surfaces portantes est également évoquée.
Deux autres démonstrateurs, « usine aéronautique du futur » et « systèmes embarqués et fonctionnalités avancés » sont soutenus par les PIA. Le premier s’intéresse à tous les matériaux très difficiles à préparer et à usiner qui composent les produits ; la technologie de l’imprimante 3D laisse aussi entrevoir une grande liberté formelle pour concevoir ces produits. Le second porte sur l’avionique, composante majeure pour l’industrie aéronautique, qui doit de surcroît intégrer les exigences de sécurité du système. Les systèmes électroniques actuels sont fermés : leur permettre de recevoir les messages transmis par Galileo oblige à les revoir entièrement et constitue une entreprise extrêmement difficile et coûteuse. Comment créer des systèmes ouverts ?
En résumé, le CORAC identifie le besoin en démonstrateurs, le programme d’investissement d’avenir prend en charge leur financement et le comité de pilotage suit le développement de leurs programmes.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Monsieur le directeur général, vous avez évoqué l’opportunité qu’a constituée l’arrivée du PIA pour financer les démonstrateurs. Avez-vous constaté des phénomènes de substitution entre des crédits alloués au titre du PIA et d’autres financements des programmes ? C’était un des points de focalisation de la commission Juppé-Rocard.
M. Patrick Gandil. Il y a un cas de la substitution : le financement de l’A350. Le projet aurait été pris en charge par un PIA s’il avait été décidé un ou deux ans plus tard : sa nature est en effet analogue à celle de l’hélicoptère X4 ou X6. Tous les acteurs, notamment le Gouvernement qui avait pris la décision de financer le projet, ont considéré comme une nécessité de lancer l’A350. Heureusement, du reste ! Sinon Airbus n’aurait eu aucun avion à proposer dans une des parties les plus actives de la gamme face au nouveau Boeing, sinon un A330 vieillissant, ce qui aurait été calamiteux. Dans ce type de projet, la part industrielle de chaque pays dépend de la contribution financière qu’il apporte. Des autorisations d'engagement ont permis de lancer le projet et 30 millions de crédits de paiement budgétaires ont été trouvés la première année. Mais il fallait atteindre la somme de 1,4 milliard : j’ai donc été soulagé par l’arrivée du PIA ! S’agit-il d’une substitution ou d’une débudgétisation ? Dans ce dernier cas, c’est une débudgétisation d’un argent dont nous ne nous disposions pas, à un moment crucial de la vie de l’industrie aéronautique.
M. Alain Claeys, président et rapporteur. Dans l’industrie aéronautique, quelle est la situation de la valorisation de la recherche ?
M. Patrick Gandil. La recherche aéronautique est liée soit à des produits directs, des aéronefs précis – j’en ai évoqué plusieurs – soit à des produits d’avenir. Ainsi, l’hélicoptère du futur et les démonstrateurs technologiques ne sont pas directement liés à un aéronef précis mais préparent la génération suivante.
Nous aurons probablement encore besoin d’instruments de ce type pour la nouvelle génération d’A320. En effet, si le NEO, grâce aux progrès réalisés dans les moteurs, a été remotorisé sans qu’ait été refaite la cellule – Boeing a procédé de même avec le 737 MAX –, il conviendra à terme de concevoir un aéronef plus moderne. Comme l’A320 représente pour Airbus l’essentiel de son chiffre d’affaires – il en est de même du 737 pour Boeing –, nous devons au moins conserver la part de marché qu’il représente. Les démonstrateurs technologiques – usines du futur, nouvelles architectures, avionique du futur constituent l’étape la plus en amont : ils ne sont liés à aucun aéronef précis. La deuxième étape est celle de la spécification de l’aéronef final. La troisième est celle des avances remboursables.
Un autre produit est sur les rails : un moteur de dernière génération, à très haut taux de dilution : plus la masse qui crée la poussée est composée d’air frais, moins la consommation de kérosène est importante, ce qui permet de diminuer le coût du vol – l’air frais est gratuit. Les moteurs actuels ont un rapport air frais/kérosène de dix : l’objectif est d’atteindre un rapport de vingt, ce qui diminuerait de moitié la consommation de kérosène.
La valorisation est donc en partie directe, pour les produits les plus proches des aéronefs qui seront construits et vendus dans l’immédiat avenir, et en partie indirecte, sans être pour autant très lointaine, pour les démonstrateurs technologiques, situés plus en amont de l’élaboration d’un aéronef.
En revanche, dans la mesure où les produits sont destinés à un seul avionneur, l’industrie aéronautique ne se préoccupe pas d’élaborer des brevets pour les vendre. L’élaboration de brevets n’est importante que dans un but défensif et non pas commercial.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. La valorisation peut être importante pour les PME.
M. Patrick Gandil. C’est la raison pour laquelle il convient de conserver des aides indépendantes du PIA, lequel est plus adapté à la réalisation des produits phares qu’au soutien d’une PME qui travaille non pas directement sur un produit mais sur une méthode de production. Outre que nous pouvons aider certaines PME-PMI dans le cadre de notre enveloppe budgétaire, les plus petites peuvent bénéficier de l’action de la BPI, que nous dotons à cette fin. Cet argent est du reste régulièrement consommé.
Il y a ensuite des cas très particuliers. Je pense à l’E-Fan, un avion à propulsion électrique, conçu par une petite entreprise, qui est un vrai bijou : nous avons directement aidé le projet à hauteur de 250 000 euros. Mais lorsqu’on en sera au financement d’un avion régional électrique, par exemple par Airbus, l’opération sera plus importante et les procédures d’appui différentes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quel volume du crédit d’impôt recherche (CIR) est consacré au secteur aéronautique ? Avez-vous connaissance d’effets d’aubaine ?
M. Pierre Moschetti, sous-directeur de la construction aéronautique. Les grands groupes aéronautiques atteignent très vite le plafond.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Et leurs filiales ?
M. Pierre Moschetti. Il en est de même des filiales.
Le CIR est surtout important pour les PME du secteur aéronautique : toutes n’ayant pas la possibilité de monter des dossiers d’aides, le CIR devient leur principale source d’aides publiques. Si l’effet fiscal du CIR est loin d’être négligeable pour les plus grands groupes, le CIR est essentiel pour les PME.
M. Patrick Gandil. Il est d’autant plus essentiel que l’aide à l’industrie aéronautique est plus faible en Europe qu’aux États-Unis.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Dans quelle proportion ?
M. Pierre Moschetti. Nous vous transmettrons une fiche sur le sujet.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Dans un secteur – l’industrie aéronautique – où l’innovation à long terme joue un rôle déterminant, la question de l’aide est d’autant plus importante qu’elle fait débat avec la Commission européenne.
M. Patrick Gandil. Les données ont été expertisées et contre-expertisées dans le cadre du contentieux opposant Airbus à Boeing auprès de l’OMC.
Il ne faut pas non plus oublier qu’il est arrivé que les États-Unis élaborent des aéronefs tests militaires… qui n’ont été ensuite produits que dans leur version civile : le Boeing 747 – et il n’est pas le seul – est un exemple très réussi d’une telle pratique.
M. Pierre Moschetti. Alors que les aides européennes reposent sur quelques subventions et des avances remboursables – et remboursées en grande partie – le système américain d’aide repose sur un financement du civil par le militaire – le Department of Defence – et la NASA. Ce financement étant indirect, il est difficile de le quantifier. Un autre avantage, qui concerne la localisation des usines, repose sur la concurrence fiscale interne entre les États fédérés ; ce système ne saurait être transposé dans l’Union européenne – la Commission s’y opposerait. Le système d’aide américain, qui est ancien, est très difficile à démanteler.
Il ne faut pas non plus oublier les facteurs exogènes, comme l’effet dollar souvent évoqué par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) : l’intégralité du marché est en dollars alors que l’Europe fabrique en euros.
Il conviendrait enfin de procéder à une comparaison très fine des différents systèmes fiscaux.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. La question des aides au secteur aéronautique est-elle abordée dans les négociations sur le traité transatlantique ?
M. Pierre Moschetti. Pas spécifiquement, du fait que le contentieux Airbus-Boeing n’est pas clos.
La localisation d’une usine ou d’un bureau d’études dans tel ou tel pays européen, notamment la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, est fonction de différents facteurs, tels que la fiscalité, le coût du travail ou les subventions. Grâce au PIA, la France dispose d’un système de subventionnement à peu près équivalent à celui des autres grands pays européens, alors que les crédits budgétaires français sont très inférieurs aux efforts consentis par les Allemands ou les Britanniques.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Pourriez-vous nous donner des précisions ?
M. Patrick Gandil. Nous vous ferons parvenir une fiche qui distinguera les chiffres garantis par l’OMC des autres informations. S’agissant du CIR, bien que nous n’ayons pas les moyens de Bercy, nous essaierons de vous fournir les renseignements que vous nous demandez.
Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Le grand secteur d’activité constitué par la construction navale et aéronautique ne représentait que 5,1 % du total des dépenses déclarées au CIR – je vous renvoie au rapport de septembre 2013 de la Cour des comptes sur L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche. C’est l’industrie électrique qui arrive en tête – certes une grande partie de cette industrie travaille pour la filière aéronautique –, devant l’industrie pharmaceutique.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Nous nous interrogeons sur l’efficacité de France Brevets : comment percevez-vous la contribution de cet organisme au secteur aéronautique ?
M. Patrick Gandil. L’industrie aéronautique dépose des brevets non pas pour les rentabiliser mais pour protéger ses innovations contre le pillage technologique. Pour exploiter sa propre innovation, l’inventeur n’a pas besoin d’un brevet.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Le secteur aéronautique ne fonctionne donc pas en recourant à des technologies disponibles sur étagère.
M. Patrick Gandil. Dans le secteur aéronautique, aucune technologie importante n’est sur étagère. En matière de brevets, la logique du secteur est plutôt une logique défensive de protection.
La technologie aéronautique doit en effet répondre à des règles de certification très strictes, en partie internationales dans le cadre de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les avionneurs doivent également faire face à des contraintes très importantes en matière de poids ou d’efficacité thermique ou énergétique. Il faut savoir que la chaleur d’un moteur d’avion dépasse largement le point de fusion du titane. Le rendement d’un moteur étant meilleur si le moteur est très chaud, il est nécessaire de réaliser des prouesses technologiques, notamment en métallurgie ou en céramique, pour rendre le moteur le plus chaud possible. Il convient aussi, pour une question de poids, de déterminer avec exactitude la quantité de matière du plus simple boulon, tout en garantissant des tolérances, qui sont éprouvées dans le cadre de cycles de tortures très poussés. Chaque produit est donc spécifique et ne convient qu’à un aéronef déterminé, ce qui n’est pas le cas, par exemple dans l’univers du transport terrestre, où la question du poids ne se pose pas de manière aussi impérative.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Quelle est l’utilité pour le secteur aéronautique des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) ?
M. Pierre Moschetti. La logique sectorielle des SATT les éloigne de l’industrie aéronautique.
De plus, dans le secteur aéronautique français, le transfert de la recherche publique vers le privé est aussi ancien que l’aéronautique elle-même. Il existe depuis des décennies des liens très structurants de transfert de technologie entre certaines écoles et les grands groupes. Il en est de même du secteur spatial ou des autres secteurs très technologiques : proposer des orientations à la recherche publique leur permet de diminuer le poids financier et humain de la recherche à conduire en propre. L’Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) est un établissement public de référence dans les domaines aéronautique et spatial qui a permis d’établir, depuis sa création en 1946, des passerelles entre recherche publique et recherche privée. Grands et petits industriels du secteur conduisent la même politique : même des PME réussissent à monter des projets partenariaux de transferts de technologies avec des laboratoires qui gravitent autour d’elles. L’aéronautique n’a donc pas besoin, contrairement à d’autres secteurs, d’une action publique volontariste visant à marier les secteurs public et privé : ce mariage est réalisé depuis déjà des décennies. Cela dit, il est toujours possible de progresser : ainsi, l’Institut de recherche technologique (IRT) aéronautique est également dédié au spatial et aux transports terrestres : c’est vrai aussi de l’IRT de Nantes sur les composites. Il était important pour le secteur aéronautique de ne pas rester dans son microcosme. Ces structures apportent un appoint intéressant à l’innovation aéronautique sans en constituer la source principale.
M. Patrick Gandil. Les structures destinées à valoriser la recherche universitaire ne correspondent pas forcément à nos besoins dans la mesure où les universités qui travaillent dans ces domaines sont déjà bien connues des grands acteurs de l’aéronautique, qui ont parfois créé leurs propres laboratoires de recherche – je pense à Thales ou à Safran ; SUPAERO est installée à Toulouse ; il en est de même de l’École nationale de l’aviation civile (ENAC). Cela dit, les IRT permettent d’allier les différents acteurs de manière féconde. Il en est de même des pôles de compétitivité – je pense à Aerospace Valley ou à Pégase – en plus grand et sur des thématiques choisies.
Mme Nadia Bouyer. Je tiens à rappeler que la Cour des comptes s’était étonnée du montage financier de l’A350 : le protocole d’accord entre l’État et la société Airbus relatif à ce programme ayant été signé six mois avant l’adoption de la loi instaurant les PIA, le soutien à l’A350 était alors uniquement du ressort du programme 190 en titre 7. Le recours aux investissements d’avenir, qui devait être initialement partiel et temporaire, est devenu permanent : les investissements d’avenir couvrent désormais la totalité du programme de l’A350 par la voie d’un fonds de concours au programme 190. Si la prise en charge totale par les PIA assure la soutenabilité sur la durée contractuelle du financement de l’A350, elle officialise et pérennise l’effet de substitution des investissements d’avenir et la débudgétisation du financement de l’A350 à hauteur du 1,4 milliard d’euros nécessaire au projet.
On nous a aussi informés d’un redéploiement interne du PIA 1 vers l’aéronautique à hauteur de 250 millions d’euros à partir de deux PIA gérés par l’Ademe – 150 millions sur des démonstrateurs « énergie renouvelable et chimie verte » et 35 millions sur le programme « réseaux électriques intelligents » –, ainsi que de 65 millions en provenance de l’ONERA - qui n’étaient peut-être pas engagés.
Cette spécificité a ses avantages et ses inconvénients – l’avantage principal étant que le projet est désormais intégralement financé.
M. Patrick Gandil. Compte tenu du calendrier, l’A350 ne pouvait pas être financé à l’origine par le PIA. En revanche, la nature du projet entrait dans le cadre de ceux qui sont financés par le PIA. De plus, aucune autre source de financement n’était disponible.
Si le dispositif du fonds de concours a été maintenu, c’est dans le dessein de ne pas avoir à réviser entièrement le dispositif contractuel : c’était la solution la plus simple. Si la procédure est discutable, en tout état de cause, les conditions de financement du projet ont toujours été transparentes, ont été avalisées par le comité du PIA et présentées au Parlement.
Je tiens, pour conclure, à revenir sur les particularités de la filière aéronautique : peu de produits, une excellente relation verticale entre les différents acteurs de la filière, des plus grands aux plus petits, un travail organisé dans le cadre du GIFAS, un partenariat très approfondi avec l’administration dans ses différentes composantes et avec les acteurs aval de la filière – les aéroports et les compagnies aériennes – dans le cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC).
Les relations de la filière aéronautique française avec l’administration sont critiquées par de bons esprits qui détruiraient bien volontiers cette organisation, unique en Europe mais proche de l’organisation américaine ou chinoise. Il faut savoir que l’administration dispose à la fois d’une compétence technique et d’une compétence réglementaire. La DGAC participe aux différentes instances chargées d’établir la réglementation technique – l’OACI ou l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) – tout en n’hésitant pas à défendre nos industriels lorsqu’ils sont injustement attaqués. Personne, dans le secteur, ne prenant le moindre risque en matière de sécurité, défendre un industriel ne signifie pas lui faire avoir des facilités. En revanche, elle peut viser à compliquer la vie de son concurrent – je vous renvoie à l’affaire du bruit du Concorde. L’administration doit avoir la compétence technique nécessaire pour refuser des mesures jugées inacceptables ou en imposer d’autres.
L’organisation française est issue de la création, avant la deuxième guerre mondiale, du ministère de l’air. Lorsque celui a été partagé entre secteurs civil et militaire, fort heureusement, toutes les structures n’ont pas été scindées en deux. Le génie civil et les bases aériennes ont été confiés à l’aviation civile et aux transports tandis que le savoir-faire technique et industriel a été confié au militaire. La direction générale de l’armement (DGA) est une administration très compétente – je me contenterai de citer son centre d’essais en vol ou ses centres d’essai des propulseurs. La DGAC n’est pas un doublon de la DGA : elle sert d’agence d’objectifs et d’interface en matière de recherche. Si elle veille à la séparation des domaines militaires et civil – eu égard notamment au nécessaire respect du droit des aides d’État – elle ne se prive pas pour autant, sous l’égide de Pierre Moschetti, de recourir à l’expertise de la DGA, qu’il s’agisse des avions ou des hélicoptères. Le double champ de compétences de la DGAC, dans le domaine des avions grâce à la DGA, et en matière de pilotage, de sécurité ou de réglementation générale, en font un acteur très précieux. D’ailleurs, Airbus ne se tourne que vers la France lorsque le groupe rencontre des difficultés, ni l’Allemagne ni le Royaume-Uni ni l’Espagne ne bénéficiant de la même organisation.
Cette organisation demeure fondamentale pour notre industrie parce que l’aviation est – la sécurité est à ce prix – un domaine très réglementé.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je vous remercie, messieurs.
Audition du 11 juin 2014
À 16 heures 30 : M. Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d’études spatiales (CNES), accompagné de MM. Thierry Duquesne, directeur de la prospective, de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des relations internationales, Pierre Trefouret, directeur auprès du président et Guillaume de Blanchard, chargé des relations avec les parlements français et européen
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d'investissement d'avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur », la mission d'évaluation et de contrôle reçoit aujourd'hui M. Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales (CNES). Comme à l’accoutumée, la Cour des comptes nous accompagne dans cette série d’auditions.
Trois filières industrielles font l'objet de financements au titre des investissements d'avenir : la filière nucléaire, la filière aéronautique et la filière spatiale. La filière spatiale a bénéficié de 500 millions d'euros, notamment pour le financement du lanceur Ariane 6, de la mission franco-américaine SWOT pour l'étude des surfaces d'eau océaniques et continentales, du satellite du futur et du programme de plates-formes spatiales Myriade Evolution.
La mission est donc particulièrement intéressée par la façon dont, compte tenu de son organisation, la filière gère les investissements d'avenir, et notamment par les éléments de gouvernance qu'elle a mis en place.
Nous nous intéressons aussi aux relations des acteurs de la filière avec les divers structures créées par le programme d’investissement d’avenir en matière de recherche fondamentale. Quelles relations ont-ils mis en place avec les IDEX ou les LABEX ? Ont-ils, le cas échéant, contribué au financement des EQUIPEX ?
Enfin, la mission souhaite vous entendre sur les relations de la filière avec les organismes institués par le programme d’investissement d’avenir (PIA) en matière de valorisation.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Je serais heureux que vous puissiez plus particulièrement nous présenter les actions que vous avez conduites et qui n’auraient pas été réalisées sans le financement du programme d’investissement d’avenir. En quoi le PIA vous a-t-il aidé ? Quels sont, au contraire, les points de ce dispositif qui pourraient être améliorés ?
M. Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d’études spatiales (CNES). Depuis 2010, le Gouvernement a alloué au domaine spatial 500 millions d’euros à travers le programme d’investissement d’avenir. La convention signée entre l'État et le CNES a permis de financer quatre projets : la préparation du lanceur européen de nouvelles générations Ariane 6 ; la mission franco-américaine SWOT pour l'océanographie opérationnelle et l'hydrologie continentale ; le développement d'une plateforme compétitive de microsatellites, Myriade Evolution, notamment pour le marché à l’export des satellites d'observation de la terre à haute résolution ; et un projet de Satellite du futur préparant une nouvelle génération de plateformes compétitives, destinées en particulier aux satellites géostationnaires de télécommunication.
La convention est en train d’être amendée pour intégrer le projet de satellite à propulsion électrique – les plateformes actuelles doivent en effet être adaptées à la propulsion tout électrique – et l'augmentation du volume sous coiffe d'Ariane 5. Cinquante millions d’euros supplémentaires sont prévus pour ce qui constitue l'un des trente-quatre projets de la Nouvelle France industrielle.
En parallèle, le projet Très haut débit par Satellite, dit « THD Sat » a fait l’objet d’un contrat entre le CNES et la Caisse des dépôts et consignations, opératrice de l'action pour le développement de l'économie numérique. Une convention entre les deux organismes a été signée en 2011, débloquant une subvention de 40 millions d’euros. La convention a été amendée le 6 février 2014 par un avenant prévoyant une subvention complémentaire de 30 millions d’euros.
Enfin, le programme d’investissement d’avenir finance aussi, à hauteur de 172 millions d’euros en 2014, les activités que mène le CNES pour le compte du ministère de la défense. Nous travaillons en effet sur la composante spatiale optique de la prochaine génération de satellites d'observation militaire Musis.
Ces quatre programmes forment ainsi un ensemble cohérent qui couvre tous les secteurs de l’activité spatiale et les soutient de manière efficace dans un contexte de compétition internationale accrue.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le financement issu du programme d’investissement d’avenir s’est-il substitué aux financements budgétaires ou l’a-t-il au contraire complété ?
M. Jean-Yves Le Gall. Ce financement a apporté des crédits supplémentaires, qui ont le double mérite d’être ciblés et rapides à mobiliser. Ainsi, l’année dernière, le recours au PIA a permis de pallier aux difficultés de financement du programme Ariane 6. Le PIA a permis également de mobiliser, en seulement quelques semaines, 50 millions d’euros pour développer, en matière de satellites à propulsion électrique, une offre capable de faire pièce à la concurrence américaine, devenue inopinément très offensive dans ce secteur, et de faire repartir l’activité de nos maîtres d’œuvre de satellites de télécommunication, revenus ainsi au niveau mondial.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’Europe est-elle aussi réactive sur Ariane 6 ? C’était l’un de nos sujets de préoccupation lors de l’examen des crédits de la recherche dans le projet de loi de finances pour 2014.
M. Jean-Yves Le Gall. Je dirais que l’Europe a su se montrer réactive, mais à l’initiative de la France, qui a elle-même pu agir rapidement grâce au PIA. Celui-ci offre en effet une capacité de mobilisation infiniment plus rapide que le financement communautaire. Au niveau européen, un tel outil n’existe pas.
D’une manière générale, les projets financés dans le cadre du programme d’investissement d’avenir ont déjà apporté des résultats positifs substantiels.
Premièrement, le PIA a permis à la France non seulement de financer les travaux préparatoires autour d'Ariane 6, mais aussi de bien positionner son industrie par rapport à la concurrence allemande ou italienne en prévision du lancement de celle-ci : le 2 décembre 2014, le conseil de l’Agence spatiale européenne, réuni au niveau ministériel à Luxembourg, devrait donner le coup d’envoi au projet.
Deuxièmement, le projet SWOT permettra de pérenniser la filière industrielle d'altimétrie française. Rappelons que ses premiers pas remontent à 1992, lorsque le CNES s’était fortement engagé en faveur du lancement par Ariane d’un satellite de la NASA. Le satellite retenu fut le satellite d’altimétrie et d’océanographie Topex/Poséidon, développé conjointement par le CNES et la NASA. Il fut remplacé ultérieurement par Jason I, puis Jason II et Jason III, avant de l’être bientôt par Jason CS. Le projet SWOT s’inscrit dans cette lignée. Élaboré en partenariat avec la NASA, il ouvrira de fortes perspectives de développement en région toulousaine à l’ensemble des entreprises de la filière océanographique. Sans les budgets ouverts par le programme d’investissement d’avenir, ce projet essentiel n’aurait pas pu exister.
Le troisième projet, Myriade Evolution, est une évolution de la plateforme Myriade. Conçue pour de petits satellites, celle-ci menaçait d’être surclassée par la concurrence. En finançant ce projet, le PIA lui a rendu la compétitivité qu’elle était en train de perdre.
Quatrièmement, le projet Satellite du futur relève de la même logique. En ce domaine aussi, la concurrence réagit très vite, notamment aux États-Unis. Des budgets peuvent être mobilisés en quelques semaines, voire en quelques jours. Nous avons connus de fortes alertes lors de la conférence de Washington, qui réunit chaque année au mois de mars tous les acteurs de ce secteur d’activité : grâce aux financements accordés par la NASA ou par le département américain de la défense, Space Systems/Loral et Boeing taillaient déjà des croupières à des industriels européens tels que Thales Alenia Space ou Airbus Defence and Space, parce qu’ils avaient développé des satellites à propulsion électrique. Cela m’avait conduit à attirer l’attention, devant les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur la nécessité de sources de financement rapidement mobilisables, en faveur d’un « Ariane 6 des satellites ». Le programme d’investissement d’avenir a finalement fourni 50 millions d’euros à ce projet qui constitue, comme je l’ai dit, l'un des trente-quatre projets de la Nouvelle France industrielle.
Enfin, le projet de satellite à très haut débit dit « THD Sat » comble les lacunes du satellite KA-SAT. En effet, ce dernier ne couvre pas tout le territoire national et laisse beaucoup de zones blanches, la fibre optique n’étant pas déployée partout. THS Sat assurera aux habitants de ces zones, malgré l’absence de fibre optique, l’accès à une connexion de très haut débit, et ce alors qu’il n’était pas prévu de crédits budgétaires pour ce projet – la technologie évolue extrêmement vite en ce domaine.
Dans tous ces cas, le PIA, par sa réactivité et par son fléchage précis, a permis d’obtenir, en seulement deux ou trois ans, des résultats très encourageants.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment auriez-vous procédé si le PIA n’avait pas existé ? Sur quels leviers auriez-vous pu agir ?
M. Jean-Yves Le Gall. Nous n’aurions pas trouvé de financements équivalents. En passant par des crédits budgétaires classiques, un financement spécifique aurait au mieux connu une lente montée en puissance sur plusieurs années. Les 500 millions du programme d’investissement d’avenir représentent une masse de manœuvre sans égale dans le domaine spatial.
Pour reprendre l’exemple des satellites à propulsion électrique, les premières réflexions des mois d’avril et mai ont pu déboucher sur un financement dès le mois de juillet. Les résultats sont déjà tangibles : depuis le début de l’année, les entreprises françaises reviennent sur ce marché. Dans le domaine de l’océanographie, sans le financement du programme d’investissement d’avenir, la NASA n’aurait pas noué un partenariat avec le CNES pour lancer SWOT. Elle se serait alliée avec des acteurs d’autres pays, ou encore le projet serait resté exclusivement américain.
De même, pour d’Ariane 6, c’est le programme d’investissement d’avenir qui a permis aux autorités françaises d’agir vite, dans le sillage du rapport remis en 2009 au Premier ministre par mon prédécesseur, l’administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), et le délégué général pour l’armement, où ceux-ci préconisaient la mise en œuvre d'un projet de lanceur européen capable de succéder à la fusée Ariane 5.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Que pensez-vous de la gouvernance du programme ? Comment appréciez-vous l’instruction de vos dossiers ?
M. Jean-Yves Le Gall. Nous entretenons une relation exemplaire avec le commissariat général à l’investissement (CGI). Nous lui soumettons des demandes d’admission de projets au PIA. Celles-ci font l’objet d’une instruction détaillée. Le CGI ne semble pas moins bien armé que le conseil d’administration du CNES pour apprécier ce qui lui semble le plus pertinent de financer. Il assure par la suite le suivi des crédits engagés et exécutés. Il faut souligner qu’il contrôle non de manière tatillonne, mais constructive, et engage avec le CNES un dialogue permettant d’enrichir le contenu des programmes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Comment conduisez-vous vos propres évaluations des projets ? Ne font-elles pas double emploi avec celles du programme d’investissement d’avenir ?
M. Jean-Yves Le Gall. Nos instances de contrôle interne conduisent en effet leurs propres évaluations. Par ailleurs, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a remplacé l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, doit évaluer tous les quatre ans l’ensemble des programmes conduits par le CNES au titre du PIA. Il s’engagera dans cette démarche dans quelques mois. Mais ces évaluations ne sont pas redondantes. Le HCERES conduit une évaluation globale, notre propre conseil d’administration évalue les projets financés par nos crédits et le CGI les projets financés par le PIA.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment vous assurez-vous qu’un financement au titre du PIA ne se substitue pas à un financement existant ? Existe-t-il dans vos comptes un mécanisme garantissant une forme d’étanchéité financière entre les lignes existantes et les crédits issus du PIA ?
M. Jean-Yves Le Gall. Le financement du PIA est toujours ciblé sur des projets novateurs. Par définition, il ne peut servir à couvrir des dépenses récurrentes. Quant à ces projets eux-mêmes, loin d’induire des dépenses récurrentes, ce sont tout au contraire des revenus récurrents qu’ils sont destinés à faire naître. De la filière d’océanographie, d’altimétrie et de la gestion de l’hydrologie peut émerger une industrie pérenne à Toulouse. De même, Ariane 6 a vocation à remplacer Ariane 5 et Myriade Evolution à proposer des produits à l’exportation.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Comment garantissez-vous la bonne valorisation des investissements ?
M. Jean-Yves Le Gall. Le CNES dispose de sa propre structure de valorisation. Cependant il n’y a pas de structure spécifique pour la valorisation des projets financés par les investissements d’avenir ; celle-ci s’effectue au cas par cas. Ainsi, Ariane 6 sera exploitée par Arianespace. La mise en œuvre des crédits du PIA s’apparente à celle des crédits de politique industrielle autrefois utilisés au ministère de l’industrie, lorsque j’y ai commencé ma carrière. Dès le lancement du projet, des retours étaient attendus, ce qui justifiait par compensation une mobilisation rapide des crédits.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Est-il trop tôt pour présenter des exemples de bonne valorisation de la recherche ? Par ailleurs, le CNES fait-il appel aux sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) créées par le PIA ?
M. Jean-Yves Le Gall. La perspective d’une valorisation est prise en considération dès que s’engage le dialogue avec le CGI. Elle est inhérente à la décision sur le projet.
M. Thierry Duquesne, directeur de la prospective, de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des relations internationales du CNES. Dans la région toulousaine, la société Toulouse Tech Transfer constitue une SATT où le CNES est partie prenante. Elle est précisément destinée à favoriser le transfert de technologies développées dans le secteur spatial vers d’autres secteurs.
Mme Laure Fau, rapporteure à la Cour des comptes. Avez-vous des liens particuliers avec France Brevets ?
M. Jean-Yves Le Gall. Oui, mas pas pour des projets directement liés au programme d'investissement d'avenir. C’est le cas pour la valorisation des brevets liés au programme Galileo, certains d’entre eux s’appuyant sur des technologies développées par le CNES. Nous avons signé en 2012 un accord avec France Brevets en ce sens.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Concernant les investissements d’avenir, on est passé d’une gouvernance interministérielle à une gouvernance sous la tutelle du ministère de l’économie et, pour les crédits relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES), sous celle du ministère chargé de l’éducation nationale et de la recherche. Cela change-t-il quelque chose pour vous ? Quel jugement portez-vous sur cette évolution ?
M. Jean-Yves Le Gall. Nous n’avons pas encore été confrontés à cette évolution. Pour l’essentiel, les différentes décisions que nous avons obtenues pour les projets dont je vous ai parlé ont demandé de convaincre le CGI, puis de manière classique, la réalisation d’un travail interministériel, après quoi la décision a été prise par le Premier ministre.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. L’organisation de la filière spatiale en matière de recherche et développement vous paraît-elle satisfaisante ? Peut-on y apporter des améliorations ?
M. Jean-Yves Le Gall. Par rapport à ce qui se fait à l’étranger, notamment aux États-Unis, nous pourrions être plus réactifs, même si la France est probablement en Europe le pays qui l’est le plus. Les Américains ont une capacité extraordinaire à se mobiliser rapidement. En outre, le Royaume-Uni a décidé de revenir dans le secteur spatial : son budget spatial a augmenté de 30 % l’an dernier, avec des actions ciblées sur des start-up, des incubateurs d’entreprise ou les télécommunications.
Si on prend l’exemple d’Ariane 6, on considère que ce qui fera la différence avec Ariane 5 repose sur trois aspects : le fait que le lanceur ait un dessin plus simple ; que les États prennent certains engagements ; et que l’industrie spatiale se restructure. Le CNES a été l’aiguillon dans cette restructuration, mais cela fait des années que nous en parlons et, du côté des industriels, c’est toujours un peu difficile. Si je pense qu’ils iront dans le bon sens – on n’a pas le choix –, on aurait pu aller plus vite.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. D’où vient le blocage ?
M. Jean-Yves Le Gall. Il est essentiellement culturel. Aux États-Unis, la société Orbital avait par exemple décidé, sur contrat de la NASA, de développer un nouveau lanceur, dont le premier étage utilisait des moteurs russes. Avec la crise ukrainienne, en l’espace d’un mois, Orbital a fusionné avec la société ATK, qui produit des boosters à poudre, pour que le premier étage de ce lanceur utilise cette technologie et ne dépende plus de la Russie. Si nous avions été confrontés à la même situation en France, je ne suis pas certain que nous aurions réagi aussi vite. Il existe aux États-Unis une capacité à mobiliser des fonds, ainsi que des agences s’apparentant de près ou de loin au CGI. L’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) est ainsi une sorte de super CGI avec des budgets beaucoup plus importants et une capacité d’intervention considérable, sa rapidité d’action étant par ailleurs couplée avec un mécanisme de contrôle rigoureux.
C’est grâce à de telles méthodes que ce pays arrive à développer des start-up qui deviennent ensuite de grandes entreprises. À cet égard, ce qui a été fait dans le cadre du PIA me paraît aller tout à fait dans le bon sens.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Que faudrait-il faire d’autre pour être plus réactif ?
Le secteur spatial a globalement conduit un lobbying assez important pour assurer ses financements, ce qui est bien. Mais les Américains ont de manière générale, au-delà de ce secteur, une capacité de réduire de moitié des budgets dans des délais très courts. La question pour nous est de savoir comment procéder à une autorégulation du système de sorte que les investissements aillent bien aux bons endroits. Si cela n’est pas facile dans le domaine de la recherche et développement, où les résultats sont incertains, ce serait pourtant opportun dans un contexte de raréfaction des finances publiques, d’autant que nous n’avons pas la taille critique des États-Unis en la matière.
M. Jean-Yves Le Gall. C’est en effet la clé de leur succès. S’ils peuvent mobiliser rapidement des budgets très conséquents sur un secteur prioritaire déterminé, c’est parce qu’ils sont capables parallèlement d’en réduire d’autres.
L’exemple d’Ariane 6, où la France et le CNES ont entraîné leurs partenaires européens, est intéressant. Ce projet a été lancé car, si Ariane 5 est en termes de fiabilité le meilleur lanceur du monde – 59 succès d’affilée depuis dix ans –, ce lanceur, pour diverses raisons – définition technique, organisation industrielle, inadéquation au lancement de satellites gouvernementaux –, nous fait perdre de l’argent. La méthode classique, il y a dix ou quinze ans, aurait consisté à mettre en place une subvention pour continuer à le faire fonctionner – les lancements d’Ariane 5 sont d’ailleurs aujourd’hui subventionnés. On a décidé au contraire de prendre le problème à la source et de dire qu’il faut cesser de subventionner Ariane 5, et développer un nouveau lanceur dont la feuille de route sera de vivre sans subvention, ce qui est totalement novateur.
Quand on parle d’un arrêt programmé d’Ariane 5, pour beaucoup de gens – aussi bien chez les industriels qui produisent ce lanceur, les ingénieurs qui l’ont conçu ou les clients –, c’est un crève-cœur ; tout le monde y trouve son compte, à l’exception de l’État, qui le subventionne !
Mme Laure Fau. Les nouveaux projets du CNES sont-ils bien inscrits dans le plan à moyen terme (PMT) ?
M. Jean-Yves Le Gall. Oui.
Mme Laure Fau. Quelle est la part du PIA par rapport au reste du PMT chaque année ?
M. Jean-Yves Le Gall. Le CNES a un budget global de l’ordre de 2,1 milliards d’euros, composé de 500 millions de ressources propres et d’1,6 milliard de subventions publiques, dont une moitié va à l’Agence spatiale européenne et l’autre moitié au programme multilatéral, pour des projets menés avec des partenaires européens ou autres, notamment les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine ou l’Inde. Les 500 millions d'euros du PIA étant répartis sur trois ou quatre ans, ils représentent un financement annuel de moins de 150 millions d'euros. Le PIA ne permet donc d’abonder le budget du CNES que de moins de 10 % par an. En revanche, pour les projets ciblés éligibles au PIA, cet abondement est crucial car nous n’avons pas dans notre budget les lignes correspondantes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je vous remercie.
Audition du 11 juin 2014
À 17 heures 30 : M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, accompagné de M. Thierry Francq, commissaire général adjoint, M. François Rosenfeld, directeur stratégique et financier et M. Claude Girard, directeur de programme valorisation de la recherche au Commissariat général à l’investissement (CGI).
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le commissaire général, nous vous remercions d’avoir répondu à notre demande d’audition aussi rapidement, puisque vous avez pris vos fonctions le 23 avril.
Nous avions procédé, le 19 février dernier, à l’audition de votre prédécesseur, M. Louis Gallois, qui avait fait le point sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir.
Les conditions dans lesquelles le Commissariat général à l’investissement (CGI) exerce son action ont toutefois évolué à la suite de la publication du décret du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique : d’une gestion interministérielle sous la responsabilité du Premier ministre, on est passé à une tutelle de ce ministère, exercée conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les programmes relevant de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Il s’agit pour nous d’un changement majeur, d’autant que M. Gallois avait insisté sur l’importance de la tutelle du Premier ministre dans l’action quotidienne du CGI.
Nous souhaiterions, dans un premier temps, connaître votre appréciation sur ce changement de tutelle, puis que vous nous indiquiez les principales orientations que vous entendez donner à votre action.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Nous avons, en effet, été intrigués – le mot est faible ! – par cette modification, d’autant plus qu’elle a été suivie par la démission de MM. Michel Rocard et Alain Juppé de la présidence du comité de surveillance des investissements d’avenir, sur lequel les deux anciens premiers ministres exerçaient depuis l’origine une autorité morale. Ils ont justifié leur décision par la crainte qu’à la suite de cette évolution institutionnelle la tentation ne soit forte d’utiliser les programmes d’investissements d’avenir pour procéder à des financements récurrents et à des opérations d’aménagement du territoire – ce qui n’était pas leur objectif initial.
M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement. Ma nomination étant intervenue après le changement de tutelle du Commissariat général à l’investissement, je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur les motivations de celui-ci. En revanche, je pense que les conséquences de cette décision sont plus limitées qu’on ne pourrait le penser – et qu’Alain Juppé et Michel Rocard ne le craignaient.
Le Commissariat est une petite structure d’une trentaine de personnes, dont la mission est définie par une loi de finances et un décret d’application. Ces textes attribuent tous les pouvoirs de décision au Premier ministre, ce dernier ayant la possibilité de les déléguer, via une délégation de signature, au commissaire général. Les actes les plus importants, comme la signature des conventions avec les opérateurs, relèvent ainsi du seul Premier ministre. De même, les décisions d’attribution des aides d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, pour les fonds consommables, et à 20 millions d’euros, pour les fonds non consommables, sont prises par le Premier ministre ; l’attribution des aides d’un montant inférieur peut, en revanche, être déléguée au commissaire général ou au commissaire général adjoint. Le fait que le Commissariat général ait été placé sous l’autorité d’un et, pour une partie de son activité, de deux ministres ne change en rien cette structure de compétences juridiques. Toutes les décisions qui relèvent du programme des investissements d’avenir, qu’il s’agisse des conventions, des avenants aux conventions ou des décisions d’attribution d’aide, relèvent toujours soit du Premier ministre lui-même, soit, par délégation, du commissaire général.
En outre, le CGI conserve son siège au 32, rue de Babylone, dans un hôtel qui dépend du Premier ministre, et ses crédits continuent d’être gérés par les services de ce dernier, même s’ils seront à l’avenir inscrits au budget du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique.
À la gestion des programmes d’investissements d’avenir sont associées des procédures interministérielles, les comités de pilotage (COPIL), auxquels participent, outre le Commissariat général, des représentants de plusieurs ministères. Lorsque nous sommes en désaccord avec un ministre, nous en informons le Premier ministre, à qui il revient de trancher. De même, pour la sélection des projets, nous lançons des appels à manifestations d’intérêt ou à projets, et nous réunissons des jurys d’experts, parfois internationaux. Toutes ces procédures restent inchangées. Par exemple, pour le PIA2, le deuxième programme d’investissements d’avenir, qui prévoit, comme le premier, d’allouer des crédits à des institutions universitaires et de recherche, le jury qui sera mis en place sera exactement le même que celui qui avait été retenu pour le PIA1.
On considère traditionnellement que lorsque l’autorité sur un service passe à un nouveau ministre, c’est à ce dernier qu’il revient d’exercer l’ensemble des attributions qui relèvent de ce service. Mais le CGI est un objet particulier, qui gère une procédure relevant d’un cadre législatif précis. Or cette procédure n’est pas remise en cause. La seule nouveauté, c’est que lorsque nous transmettons un projet de décision au Premier ministre, c’est par l’intermédiaire de M. Montebourg et, le cas échéant, de M. Hamon. En revanche, la décision finale est, comme autrefois, préparée par des réunions interministérielles à Matignon.
Le processus décisionnel n’a pas changé ; il continue à reposer sur des exigences d’excellence, d’objectivité et de différenciation. Cela m’a été confirmé lors d’une réunion présidée par le Président de la République, à laquelle assistaient le Premier ministre et plusieurs ministres. Il n’y a aucune équivoque.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. M. Marcel Pochard, président de la Cité internationale universitaire de Paris, laquelle bénéficie d’un financement au titre du PIA, m’a récemment confié qu’il n’avait plus eu d’interlocuteur durant quelques mois : manifestement, il y a eu du flottement dans les prises de décision. Que s’est-il passé ? S’agit-il d’un phénomène ponctuel ?
M. Louis Schweitzer. Je crois avoir signé, il y a quelques jours, une décision concernant la Cité universitaire de Paris. Peut-être y a-t-il eu un moment de flottement, dans la mesure où le décret de délégation n’a été signé que le 23 mai, alors que ma nomination date de la fin avril. Il faut reconnaître que la dissociation entre la procédure juridique et l’autorité sur le service n’était pas évidente au premier regard ; depuis, la situation a été clarifiée.
La base juridique n’a donc pas été changée, non plus que les principes généraux de sélection : l’exigence d’excellence subsiste. En revanche, des progrès pourraient être accomplis sur deux points – Louis Gallois avait d’ailleurs engagé des actions en ce sens.
D’abord, il convient de raccourcir les délais d’instruction, qui pouvaient aisément atteindre dix-huit mois, même pour des dossiers ne présentant aucune difficulté. Un travail a été engagé avec nos deux principaux opérateurs hors du champ de la recherche, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Banque publique d’investissement, Bpifrance, pour ramener ces délais à une durée de trois à six mois. Dans un certain nombre de cas, on pourrait également simplifier les démarches, sans pour autant abaisser le niveau d’exigence.
D’aucuns ont suggéré, pour réduire les délais, de déléguer la décision elle-même à nos opérateurs, comme l’ADEME, Bpifrance ou l’Agence nationale de la recherche (ANR). Je n’y suis pas favorable ; je pense qu’il est important que le CGI, qui est responsable du bon emploi des crédits du PIA, prenne la décision finale ou, si cela dépasse ses attributions, transmette le dossier au Premier ministre. Je me suis engagé, en revanche, sur deux points : premièrement, lancer les éventuelles contre-expertises suivant une procédure parallèle, et non séquentielle ; deuxièmement, faire en sorte que le CGI rende ses décisions rapidement, dans les cinq jours suivant l’avis positif du comité de pilotage interministériel (COPIL).
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Si l’on prend l’exemple de l’ANR, à quel stade les retards commencent-ils ? Les expertises se chevauchent-elles ?
M. Louis Schweitzer. Une succession étant en cours, il se trouve que l’ANR est, parmi nos opérateurs, le seul dont je n’ai pas encore pu rencontrer le responsable. Je laisserai, par conséquent, Thierry Francq répondre sur ce point.
M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement. Pour l’ANR, le principal enjeu en matière de délais porte, non pas sur les grandes décisions d’engagement, mais sur les relations courantes avec les organismes bénéficiaires. Le dispositif actuel est extrêmement complexe. Un travail est en cours.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourriez-vous être plus précis ?
M. Thierry Francq. Par exemple, comme il s’agit d’argent public, nos règlements financiers sont parfois trop tatillons, ce qui ralentit la procédure. Aujourd’hui, on sait mieux ce qui compte. On pourrait concentrer les demandes sur l’essentiel et raccourcir les délais de paiement.
En revanche, le calendrier de labellisation des nouvelles IDEX est défini par convention – il devrait être adopté prochainement. Si les délais convenus doivent être respectés, nous ne souhaitons pas accélérer la procédure : il importe de laisser du temps aux structures candidates pour préparer un dossier susceptible d’être présenté devant un jury international.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le commissaire général, quelle est la spécificité des programmes d’investissements d’avenir au sein du financement de la recherche ?
À l’origine, un mot caractérisait les exigences en matière d’investissements d’avenir : l’excellence. Entre-temps a été introduit, à la demande du précédent gouvernement, un critère relatif à l’aménagement du territoire. Ces deux objectifs sont-ils conciliables ?
M. Louis Schweitzer. Avant de répondre à ces deux questions, je voudrais revenir, monsieur le président, sur notre capacité à « résister à la tentation ».
Pour ce qui est du risque de financement d’opérations qui ne répondraient pas aux critères des PIA, je vous ai indiqué que les procédures restaient inchangées. Pour le reste, c’est une affaire de personnes ; en ce qui me concerne, mon intention est bien de « résister à la tentation ».
Quant au risque de débudgétisation, il n’est pas nouveau. Je ne vous cacherai pas qu’il y a eu quelques cas où la frontière entre ce qui relevait d’un financement budgétaire et ce qui pouvait être pris en charge par le PIA était poreuse ; par exemple, les avances accordées à Airbus ont été financées dans la période récente par le PIA, alors qu’elles l’étaient antérieurement par le budget de l’État. C’est une vraie question, mais qui n’est pas liée au changement de tutelle.
En matière de recherche, les programmes d’investissements d’avenir ont une double spécificité. D’abord, leur objectif premier est la recherche de l’excellence sur des critères non seulement nationaux mais aussi internationaux, avec une volonté de favoriser les transferts de la recherche vers l’industrie. À cela s’est ajoutée une seconde spécificité, qui est de placer l’exigence non seulement sur le projet, mais aussi sur les structures qui le présentent. Nous avons ainsi utilisé le PIA comme un levier pour inciter les établissements universitaires et de recherche à ne pas travailler à l’excellence chacun de son côté, mais à créer pour cela des structures communes. Cet effort a, je le crois, été globalement suivi d’effet.
En résulte-t-il des structures toujours parfaitement lisibles et efficaces ? C’est ce que nous devrons évaluer en 2016, à l’occasion du réexamen après quatre ans de l’affectation des dotations non consumptibles, qui sont notre principal mode d’intervention en direction des établissements d’enseignement et de recherche. Dans un esprit d’indépendance et sous l’autorité du jury, nous vérifierons alors que les rapprochements structurels et les réorganisations annoncés n’ont pas été de pure forme.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Est-ce à cette aune que vous évaluerez les communautés d’universités et d’établissements ?
M. Louis Schweitzer. Absolument.
Il se trouve qu’avant d’être nommé commissaire général à l’investissement, je siégeais aux conseils d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et de l’Université de la Sorbonne nouvelle, deux institutions rassemblées, d’abord dans un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), puis dans une communauté d’universités et d’établissements. J’ai donc été de l’autre côté de la barrière. Si les réorganisations suscitent quelques protestations – c’est une litote ! –, c’est qu’elles changent réellement les choses, notamment pour les formations doctorales. Nous évaluerons les résultats du processus en même temps que les programmes des universités.
Cette double exigence d’excellence et de réforme structurelle est spécifique au secteur universitaire. A contrario, par exemple, la réalisation d’un éco-quartier « zéro carbone » dans une grande ville française nécessitera seulement un investissement innovant. On voit bien que, dans ce cas, la différence entre l’investissement d’avenir et le crédit consenti dans le cadre budgétaire habituel est ténue : il ne s’agirait pas de croire qu’en temps normal, l’État ne finance que des investissements banals !
Quant aux deux critères que sont l’excellence et l’aménagement du territoire, je ne pense pas que le second dispense du premier. Nous devons distinguer les champions, et non pas le régional de l’étape. Il se peut que ce dernier soit un champion, mais en aucun cas le critère d’excellence ne doit être atténué par un souci d’aménagement du territoire.
Dans le premier appel d’offres concernant les regroupements universitaires et les initiatives structurantes innovation-territoires-économie (ISITE), le jury international avait jugé excellents au moins deux projets qu’il n’avait toutefois pas pu retenir, car les organismes concernés ne présentaient pas le degré de polyvalence exigé par le cahier des charges. Nous avons décidé qu’à l’avenir des projets qui seraient excellents, comporteraient la dimension structurelle que nous demandons, mais ne seraient pas totalement pluridisciplinaires, pourraient être retenus.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Le PIA2 prévoit de nouveaux financements d’IDEX. Dans le PIA1, le critère qui avait prévalu était l’excellence et un cahier des charges avait été transmis en ce sens aux établissements et aux jurys. Ce cahier des charges sera-t-il reconduit pour la sélection des IDEX au titre du PIA2 ?
M. Louis Schweitzer. Du fait de la transition en cours à l’ANR, et parce que l’urgence est moindre – la première vague de programmation est achevée et la deuxième n’est pas prévue avant 2015 – , il m’est difficile de répondre à cette question ; je laisserai Thierry Francq le faire.
Je préciserai simplement que, quelques jours avant son départ, Louis Gallois avait signé avec Mme Fioraso une lettre définissant la philosophie des PIA dans le secteur de l’université et de la recherche. Le projet de convention que nous venons de transmettre au Premier ministre pour la mise en œuvre du PIA2 est dans la ligne de ce texte.
Le seul changement que nous opérerons par rapport à l’ancien cahier des charges répond à la préoccupation que je viens d’évoquer : nous laisserons aux jurys une certaine souplesse d’appréciation afin qu’ils puissent retenir comme initiatives d’excellence des dossiers dont la pluridisciplinarité serait moins nette.
M. Thierry Francq. À titre indicatif, sur une enveloppe globale de 3,1 milliards d’euros pour le PIA2, 2 milliards devraient être consacrés à des IDEX, avec un cahier des charges sinon identique, du moins répondant à la même logique que celui du PIA1. Nous tenons à votre disposition le projet de convention, qui est assez prolixe sur le sujet.
Les ISITE sont des initiatives d’excellence dont le spectre scientifique est moins large ; elles permettront à des pôles d’excellence implantés dans des territoires qui ne disposent pas d’une offre scientifique complète de faire acte de candidature. Une certaine souplesse est introduite dans le cahier des charges à cette fin ; en revanche, l’exigence d’excellence reste la même.
Si modification il y a, elle consistera, y compris pour les IDEX, à renforcer les liens avec le territoire, notamment avec le monde économique.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment les ISITE se positionneront-elles par rapport aux IDEX, aux LABEX et aux IRT, mis en place par le PIA1 ?
M. Thierry Francq. À la différence des LABEX et des IRT, qui se consacrent exclusivement à la recherche – ou à l’ingénierie de formation –, l’enjeu des ISITE est, comme pour les IDEX, le regroupement d’organismes à la fois d’enseignement et de recherche, à des fins, par exemple, de concentration ou de rationalisation des masters.
M. Louis Schweizter. En résumé, rien ne changera pour les LABEX et les IRT. En revanche, les ISITE viennent « compléter » les IDEX, qui ne permettaient pas à certaines universités et établissements à spectre moins large de se regrouper – ce qu’avait déploré le jury international. Désormais, elles en auront la possibilité.
Mme Laure Fau, rapporteure à la Cour des comptes. Les projets Programme d’avenir Lyon Saint-Étienne (PALSE) et Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers (HESAM) pourraient donc être candidats au titre du premier volet des IDEX ?
M. Thierry Francq. Ces deux projets sont des cas spécifiques déjà « repêchés » lors du PIA1. Ils doivent encore faire leurs preuves pour devenir des IDEX de plein exercice. Dans le cadre du PIA2, leurs candidatures seront donc soumises au jury dans les mêmes conditions que les autres, aucun droit d’accès particulier au statut d’IDEX ne leur a été accordé.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Existe-t-il un débat avec les ministres à ce sujet ?
M. Patrick Hetzel, rapporteur. La décision finale reviendrait-elle au Premier ministre si les points de vue de M. Benoît Hamon et de M. Arnaud Montebourg ne convergeaient pas ?
M. Louis Schweizter. La loi a donné au Premier ministre un pouvoir qu’il a délégué dans certaines matières au commissaire général à l’investissement. Les décisions relèvent donc soit du Premier ministre en personne, soit du commissaire général. Si celui-ci est en désaccord avec l’un des deux ministres qui se partagent l’autorité sur son service, il fait part de son opinion au Premier ministre. Paradoxalement, celui-ci peut me déléguer des pouvoirs qu’il ne peut déléguer aux deux ministres concernés.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Qui présidera le comité de surveillance du CGI ?
M. Louis Schweizter. Je rêverais qu’Alain Juppé et Michel Rocard acceptent de le présider à nouveau. Je souhaite, en tout cas, que le principe d’une coprésidence soit maintenu, et que les personnalités retenues appartiennent l’une à la majorité, l’autre à l’opposition. Je sais que c’est également le vœu du Gouvernement et du Président de la République.
Les nouveaux coprésidents devront avoir une légitimité comparable à celle de leurs prédécesseurs, qu’ils tireront non plus de leur qualité de fondateurs, mais de leurs compétences économiques et de leur dimension d’hommes d’État. Un tel choix confirmerait utilement la continuité du Commissariat général à l’investissement, face à ceux, trop nombreux, qui pensent que la spécificité du programme des investissements d’avenir a disparu. Je n’ai pourtant pas été nommé dans cet esprit.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Gardez-vous l’espoir d’un retour des anciens premiers ministres ? Leur démission constitue malgré tout une rupture symbolique qui ne manque pas de nous chagriner. Vos deux prédécesseurs, René Ricol et Louis Gallois, pouvaient avantageusement adosser leur action au comité de surveillance, dans la mesure où ses présidents incarnaient, en quelque sorte, le rapport Juppé-Rocard de 2009, à l’origine même de la création du CGI et du positionnement de son action dans le cadre d’une vision stratégique pour la France à moyen et long terme, affranchie des alternances politiques et de leur calendrier.
M. Louis Schweizter. Ces démissions me chagrinent également, d’autant plus qu’elles sont intervenues avant qu’Alain Juppé et Michel Rocard aient pu analyser complètement les limites de la réforme opérée. Si j’avais pu leur expliquer les choses, leur décision aurait sans doute été différente. Je crains cependant qu’il soit difficile pour un responsable politique de revenir sur une position publique.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Au mois de février dernier, votre prédécesseur, Louis Gallois, nous indiquait qu’un bilan du fonctionnement des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) était en cours. Quand pourrons-nous en disposer, sachant que nous allons bientôt commencer à travailler sur le projet de loi de finances pour 2015 ?
M. Louis Schweizter. Je n’ai moi-même pas encore reçu ce bilan. D’ores et déjà, il est clair que les SATT couvrent quasiment tout le territoire national, celles de Saclay et de Grenoble étant en voie de finalisation – sachant que la Normandie n’en a pas. La difficulté des SATT, c’est qu’elles constituent des sortes de coopératives de brevets. Or, ce mode d’organisation n’est pas forcément très pertinent pour réunir des fournisseurs de tailles très inégales. L’intérêt d’une participation à une coopérative n’est pas évident pour un très gros fournisseur. J’attends, moi aussi, ce bilan avec intérêt, car si je ne doute pas de l’efficacité des SATT pour les producteurs moyens, comme les universités, nous devons savoir si elles n’ont pas un peu compliqué la vie d’organismes qui déposent un très grand nombre de brevets, comme le CEA. Si tel était le cas, nous n’hésiterions pas à procéder aux aménagements nécessaires. Nous ne pourrions pas nous considérer comme un organisme d’innovation si nous refusions de tester l’efficacité de structures que nous mettons en place, et si nous n’en tirions pas les conséquences pour l’améliorer.
Mme Laure Fau, rapporteure à la Cour des comptes. Ce bilan correspond-il à l’évaluation qu’il était prévu de mener trois ans après la création des SATT ?
M. Claude Girard, directeur de programme valorisation de la recherche au Commissariat général à l’investissement. Tout à fait. Dans le cadre du contrat entre les SATT et l’ANR, cette évaluation devait servir de base à la fixation du montant de la deuxième tranche de financement de ces sociétés.
Un comité national de gestion des SATT est chargé de définir les modalités de ce bilan, qui s’appuiera sur l’ANR pour ce qui relève de l’analyse scientifique et technologique, sur la Caisse des dépôts – qui porte l’actionnariat de l’État dans les SATT – en matière financière et comptable, et sur un organisme tiers, désigné par appel à projets, qui sera chargé d’auditer la gouvernance, la gestion des ressources humaines et l’organisation de ces sociétés. Ce bilan devrait offrir une bonne vision des cinq premières SATT à avoir été créées.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Nous nous interrogeons sur la nécessité d’introduire une certaine souplesse pour les SATT dont le fonctionnement obéit à un cahier des charges rigide. En Alsace, par exemple, Conectus fonctionne bien dans ce cadre, mais ce n’est pas le cas de toutes les SATT sur le territoire.
M. Louis Schweizter. Dès lors qu’un organisme nouveau est créé, distinguer, parmi les critiques qui le visent, celles qui sont fondées sur des imperfections réelles de celles qui traduisent une résistance au changement n’est pas un exercice facile, surtout dans les milieux de l’université et de la recherche. Pourtant, alors que les premières doivent inciter à remédier aux difficultés signalées, les secondes constituent plutôt la preuve qu’il faut poursuivre dans la même voie.
M. Thierry Francq. Le caractère monolithique des SATT a déjà été écorné puisque celles de Grenoble et Saclay, où le CEA joue un rôle très important, ont un statut dérogatoire, avec assouplissement des règles en matière de propriété intellectuelle.
M. Claude Girard. La dimension monolithique originelle est liée à la notion d’exigence et d’excellence de la valorisation de la recherche. Au moment du lancement de l’appel à projets, il était question de créer six à dix SATT. Le dispositif a ensuite évolué pour tenter de couvrir la totalité du territoire, dont certaines parties se prêtent peut-être moins bien au système d’excellence. Il faut sans doute aujourd’hui adapter les exigences. En tout état de cause, les SATT du premier lot, dont est issue Conectus, fonctionnent très bien aujourd’hui. Pour les SATT dérogatoires, comme Saclay et Grenoble, le dispositif a été fortement adapté à des spécificités locales. Certains projets retenus après ceux du premier lot ne l’auraient peut-être pas été si les recommandations du jury d’origine avaient été suivies.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le commissaire général, le débat entre financement de la recherche sur projet et financement récurrent a-t-il encore un sens aujourd’hui dans notre pays ?
M. Louis Schweizter. Je ne puis que vous donner une opinion personnelle qui n’est pas celle d’un expert et n’engage en rien le Commissariat général. J’ai le sentiment que le choix entre ces deux options suit un mouvement de balancier : on en expérimente une, on en constate les défauts, puis on l’abandonne pour aller vers l’autre, dont on constatera les défauts, et ainsi de suite.
Pour ma part, je considère que tout système de recherche doit comporter des parties libres et des parties sur projet. Il serait, à mon sens, déraisonnable de faire prédominer les unes sur les autres. Aujourd’hui, – je mets à part la recherche appliquée, où, bien sûr, le projet prime forcément –, il me semble que le financement sur projet est privilégié peut-être un peu à l’excès. Il est vrai que lorsque les financements privés sont sollicités, il est plus facile de mettre en avant un projet qu’une participation à des dépenses générales ; un financeur préférera associer son nom et son argent à un projet précis et identifiable plutôt que de se dire contributeur au travail général de tel ou tel organisme. Il serait sans doute préférable – mais c’est difficile – de maintenir un équilibre entre les deux types de financement. Cela dit, il s’agit là d’une opinion personnelle que je n’ai jamais exprimée au sein du Commissariat général.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Si la mission d’évaluation et de contrôle s’interroge sur l’équilibre du financement de la recherche depuis la mise en place de l’ANR, puis du PIA, c’est que, en tant que législateurs, ses membres sont saisis du volet récurrent de ce financement par le biais du budget.
Quelle est l’importance pour le CGI de la dimension internationale ? J’ai été frappé de constater que l’enseignement supérieur a connu une très forte croissance dans le monde au cours de la dernière décennie. Alors que le nombre total d’étudiants français est estimé à 2,4 millions, la population mondiale post-bac explose, s’accroissant de 2,7 millions de personnes chaque année. En matière de recherche également, l’intensité et le degré de l’investissement consenti, notamment par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, ont une incidence considérable. Considérant que des effets de taille critique peuvent jouer, il serait sans doute souhaitable que notre pays étudie les possibilités de convergences européennes pour renforcer l’efficacité du financement public de la recherche.
M. Louis Schweizter. Nous prenons la dimension internationale en compte dans nos évaluations ; les projets d’IDEX notamment sont sélectionnés par un jury international. Même si notre approche privilégie le territoire français, nous ne mesurons pas l’excellence au niveau national. Nous constatons cependant que, dans le cadre du concours mondial d’innovation, qui n’est pas réservé à des équipes nationales, l’immense majorité des lauréats sont français.
À part de très grands projets comme le CERN, il me semble que les systèmes européens fonctionnent mieux sur la base d’échanges et d’irrigations croisées qu’à partir de plateformes institutionnellement européennes ou internationales. Outre qu’elles sont lourdes à créer, ces dernières acquièrent une dimension politique qui leur confère une force d’inertie telle qu’elles ne peuvent que très difficilement être remises en cause. Le programme européen de Lisbonne privilégie d’ailleurs la recherche de l’excellence au niveau européen à travers des actions nationales.
J’ajoute que, même si certains le déplorent, la pratique d’une langue commune, qui n’est pas le français, facilite l’échange entre les chercheurs de tous les pays, et qu’il s’agit d’un très puissant facteur d’internationalisation des équipes et des projets.
M. Thierry Francq. Les outils créés par le PIA, comme les SATT ou les IRT, se sont progressivement construit une image internationale. Alors que le poids des organismes de recherche constituait une spécificité française, ces outils trouvent souvent leur équivalent dans les pays européens, ce qui facilite les partenariats. L’IRT Jules Vernes de Nantes a ainsi pu signer, en mars dernier, un accord de collaboration internationale avec une Fraunhofer Gesellschaft allemande. Les SATT peuvent aussi dialoguer avec les offices de transfert de technologie anglais : la SATT idfinnov de Paris a signé le mois dernier un accord de partenariat stratégique avec Isis Innovation, l’office de transfert de technologie de l’Université d’Oxford. Les outils créés par les PIA sont donc aussi des vecteurs de collaboration avec les pays européens.
La visibilité internationale constitue pour les IDEX un enjeu qui doit permettre de produire des partenariats.
M. Louis Schweizter. Dans un système d’échanges internationaux en développement, notre position sera d’autant plus forte que nos structures nationales seront puissantes et attractives. Finalement, la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, qui créait les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, et la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui les transformait en communautés d’universités et établissements poursuivaient toutes deux ce même objectif.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Messieurs, nous vous remercions.
Audition du 25 juin 2014
À 16 heures 15 : M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA, accompagné de MM. Thierry Michal, directeur technique général, Thierry Stoltz, directeur des affaires économiques et financières et Jacques Lafaye, chargé de mission auprès du président
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Nous recevons aujourd’hui le président-directeur général de l’ONERA, l’Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Monsieur le président-directeur général, bienvenue. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur », la mission d’évaluation et de contrôle a souhaité recevoir les principaux acteurs de la filière aéronautique. En effet, celle-ci est l’une des trois filières – avec la filière spatiale et la filière nucléaire – à avoir été spécifiquement bénéficiaire des financements au titre des programmes d’investissement d’avenir : 1,5 milliard d’euros au titre du PIA1, et 1,22 milliard d’euros au titre du PIA2.
Nous avons récemment reçu le directeur général de l’aviation civile, M. Patrick Gandil. Aujourd’hui, nos questions porteront sur le rôle de l’ONERA, notamment par rapport au CORAC, le Conseil pour la recherche aéronautique civile, dans le choix des actions à lancer, le suivi de leur conduite et même l’organisation de ce suivi, puisque, ce qui est tout à fait notable, ces actions sont conduites par des industriels privés, sur la base de conventions conclues avec l’ONERA.
Nous nous intéressons aussi aux relations nouées par l’ONERA en matière de recherche fondamentale avec les structures créées par le PIA. Quelles relations l’ONERA entretient-il avec les IDEX ? Est-il partie prenante dans certains LABEX ? A-t-il contribué au financement de certains EQUIPEX ?
Enfin, l’ONERA entretient-il des relations avec les organismes créés par le PIA pour la valorisation de la recherche ?
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Monsieur le président-directeur général, nous sommes aussi particulièrement intéressés par l’identification des actions qui, dans le secteur aéronautique, n’auraient pu être conduites si le PIA n’avait pas existé, ou qui auraient dues être menées différemment.
M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, merci de cette invitation.
Comme vous l’avez rappelé, Monsieur le président, le PIA aéronautique, en tout cas dans son volet numéro 1, c’est une enveloppe de 1,5 milliard d’euros.
Le volet aéronautique du PIA comporte deux modalités d’intervention. La première est un soutien sous forme d’avances remboursables aux programmes d’avions et d’hélicoptères de nouvelle génération (l’Airbus A350 XWB et l’hélicoptère X4) ainsi qu’au nouveau cœur de turbine aéronautique TPH (Turbo-Propulseur Hybride). Si le PIA n’avait pas été mis en place, le projet d’Airbus A350 aurait fait l’objet de conventions d’avances remboursables telles qu’elles existent classiquement, passées directement entre la direction générale de l’aviation civile (DGAC), la délégation générale de l’armement (DGA) et les industriels.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le PIA a-t-il pu accélérer le programme ?
M. Bruno Sainjon. Je ne crois pas. Pour autant que j’en sache, le choix entre une convention d’avances remboursables et une inscription au titre du PIA relève d’une question de calendrier.
La deuxième modalité d’intervention est une participation à des démonstrateurs techniques sous forme de subvention ; six projets de démonstrateurs ont été sélectionnés.
L’action « Aéronautique » fonctionne donc selon des modalités particulières par rapport à d’autres actions du PIA. La façon dont notre industrie aéronautique est structurée et organisée lui a en effet permis de proposer rapidement des projets en phase avec les préoccupations des autorités publiques et des utilisateurs. C’est aussi une structure industrielle fédérée autour d’un organisme, le Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), qui a par ailleurs été très présent dans les débats menés lors du « Grenelle de l’Environnement » – de façon générale, notre industrie a veillé à prendre en compte très tôt les effets environnementaux. Enfin, dès 2008, en vertu d’engagements pris en 2007, un Conseil pour la recherche aéronautique civile (le CORAC) a été mis en place pour regrouper l’ensemble des acteurs pertinents : avionneurs, chercheurs, compagnies aériennes, gestionnaires d’infrastructures… Une des missions du CORAC a été d’élaborer et de promouvoir une feuille de route technologique pour la recherche aéronautique civile française qui permette à notre industrie de conserver un rang de dimension mondiale. Notre secteur est en effet l’un des rares secteurs industriels où la France est un leader mondial, avec ce que cela peut représenter comme enjeux industriels, technologiques, économiques, et comme emplois.
Chacun des programmes de R&D doit contribuer de manière quantifiable à l’accroissement de la maîtrise de l’empreinte environnementale du transport aérien du futur. Chaque projet comporte une liste d’indicateurs permettant d’évaluer son bénéfice environnemental et son impact économique.
Pour cette action, l’opérateur qui a été retenu par l’État est l’ONERA : il a été jugé que son statut d’EPIC (établissement public industriel et commercial) lui conférait la réactivité souhaitée par le Commissariat général à l’investissement (CGI) pour la contractualisation des activités liées à ces projets. Comme l’a exposé M. Patrick Gandil lors de son audition, cette action associe dans le cadre d’une convention trois acteurs : l’ONERA, la DGA et la DGAC, réunis dans ce qu’il a décrit comme une « équipe programme mixte ». Par ailleurs un Comité de pilotage (COPIL) a été mis en place : il réunit en plus de ces trois acteurs le CGI et la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Ce COPIL est assisté par des experts en tant que de besoin.
Le parcours type qu’effectue un projet se décompose en trois phases.
Dans une première phase, l’industriel porteur soumet pour évaluation initiale un dossier complet de son projet à l’équipe de programme mixte, qui rédige un rapport.
S’ensuit une phase d’instruction au cours de laquelle ce rapport est soumis à l’avis du COPIL. Le COPIL transmet ensuite son analyse au CGI, qui a la responsabilité de proposer au Premier ministre la décision d’autoriser le financement.
Dans le cas d’une réponse positive arrive ensuite la phase de contractualisation. Elle est menée par l’équipe de programme mixte. Celle-ci intègre la demande de soutien à l’industrie, rédige la convention soumise au COPIL et donne finalement l’autorisation de signer à l’ONERA.
Parallèlement, l’équipe de programme mixte constitue également pour chaque projet un dossier de demande d’autorisation à la Commission européenne.
Contrairement à ce qu’on a pu parfois entendre, c’est bien l’industriel porteur qui soumet son projet et non le CORAC. Par ailleurs, bien que les projets ne fassent pas l’objet d’un appel d’offres formel – contrairement à la plupart des autres actions du CGI – il existe bien, en interne à chaque projet, un appel d’offres pour sélectionner les meilleurs contributeurs.
En résumé, le rôle de l’ONERA en tant qu’opérateur de l’État, c’est d’être le « chef de file » – selon le terme consacré – de la gestion administrative et financière des contrats ainsi que de l’évaluation ex post des programmes de l’action aéronautique ; c’est aussi un contributeur de la définition de la structure du dossier et des critères, ainsi que du suivi des projets.
Au 31 mars 2014, sur les 1,5 milliard d’euros de dotation de l’action « Aéronautique », 1,185 milliard avait été contractualisé avec les porteurs de projet. Hors programme A350, qui constitue l’essentiel de ce montant, 121,5 millions d’euros sont alloués à des prestations extérieures, lesquelles sont réalisées à 87 % par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PMI. Par ailleurs, 4,7 % du financement est allé vers des laboratoires de recherche académiques ; cela constitue un faible pourcentage par rapport aux autres actions du PIA.
L’ONERA est autorisé, en tant qu’opérateur, à prélever des frais de gestion. Je voudrais souligner son caractère très économique : sur 2012-2013, les frais de gestion facturés ont été de 306 986 euros ; le prévisionnel 2014 est inférieur à 150 000 euros. Pour mémoire, alors que le pourcentage plafond des frais de gestion prévue par la convention est de 0,2 %, la réalité est plutôt de l’ordre de 0,2 ‰. On peut donc dire que le coût d’intervention de l’ONERA est particulièrement faible.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pour le suivi des financements, quels sont votre rôle, celui du COPIL et celui du CGI ?
M. Thierry Stoltz, directeur des affaires économiques et financières de l’ONERA. Le COPIL se réunit tous les 6 mois environ. Une première phase a été consacrée à l’étude des dossiers, pour permettre au Premier ministre de décider des différents choix ; aujourd’hui le COPIL est en phase de suivi de ces projets.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Vous nous assurez que la décision est toujours du ressort du Premier ministre ?
M. Thierry Stoltz. Jusqu’à maintenant, la phase de décision s’est déroulée effectivement sous l’autorité du CGI, qui rapportait au Premier ministre. L’ONERA est en relation directe avec le CGI, qui convoque le COPIL – en liaison avec la DGAC puisque c’est le directeur général de l’aviation civile qui pilote ce COPIL.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Lors de son audition, le Commissaire général à l’investissement a démontré que, quelles que soit les compétences attribuées à tel ou tel ministre, l’interministériel demeurait.
M. Bruno Sainjon. La capacité de vision de l’ONERA s’arrête au CGI et au DGAC.
M. Thierry Stoltz. Nous sommes donc maintenant dans une phase de suivi d’exécution de la contractualisation, y compris pour la partie technique. Une description de l’avancement des projets est faite lors de chaque COPIL. Deux formats de COPIL alternent : un format de COPIL « étatique » – où sont présents DGA, DGAC, ONERA et DGCIS – et un format élargi, où les pilotes industriels des plateformes viennent détailler l’avancement des projets. Dans ce deuxième format, le CGI peut interroger les industriels pour s’assurer que les projets sont conformes au dossier que l’équipe programme mixte a pu présenter à l’origine au COPIL. Le suivi est donc à la fois financier et technique.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Qui intervient sur les projets pour lesquels vous avez eu recours au PIA ? Comment s’organise la chaîne décisionnelle ?
M. Thierry Stoltz. Cette chaîne vient d’être décrite par notre président-directeur général, M. Bruno Sainjon. Tout commence par un projet soumis à l’équipe programme mixte par des industriels associés. L’intérêt du PIA a été d’amener des industriels – les grands industriels du secteur aéronautique : Airbus, Safran, Thalès, Dassault – à s’associer entre eux, même s’ils n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Il leur a été demandé de passer des accords de coopération pour que les projets soient conjoints. Une fois le projet déposé par les industriels, il est instruit par l’équipe programme mixte – au départ essentiellement la DGAC, pour l’analyse de l’incitativité du soutien, et la DGA, pour l’analyse de la partie plus technique et la vérification de l’historique de certains projets, afin d’éviter qu’ils soient redondants avec d’autres et de s’assurer qu’ils ne bénéficient pas d’autres financements par ailleurs. Une fois achevée, l’instruction est présentée au CGI : le CGI conduit alors des échanges avec l’équipe programme mixte, mais aussi directement avec les industriels ; le CGI peut au passage s’assurer aussi de l’indépendance de l’équipe programme mixte.
Une fois la décision prise, la contractualisation est effectuée directement entre les industriels et l’équipe programme mixte. La convention entre l’État et l’opérateur prévoit cependant une information préalable du CGI lorsque la convention dépasse un certain montant.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Après cela, c’est l’opérateur qui est maître du jeu ?
M. Thierry Stoltz. Oui, pour ce qui concerne la contractualisation.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment l’équipe programme mixte est-elle constituée ?
M. Thierry Stoltz. Cette équipe programme mixte regroupe la DGAC, la DGA et l’ONERA. La DGAC y est représentée par le directeur des constructions aéronautique, la DGA, par deux unités de management (UM) de la Direction des opérations, chargée l’une de l’aéronautique civile et l’autre des hélicoptères, et enfin l’ONERA par son président-directeur général, M. Bruno Sainjon, qui me délègue la gestion contractuelle, financière et administrative.
M. Bruno Sainjon. Il faut souligner un élément souvent méconnu : le travail de négociation, de discussion technique et administrative des conventions passées avec les industriels mais aussi avec d’autres organismes, dont l’ONERA, en vue du montage des avances remboursables « classiques », est effectué, non pas par la DGAC mais, pour le compte de celle-ci, par la DGA, plus précisément par les deux unités de management dont vient de parler M. Thierry Stoltz. C’est la DGA qui contractualise avec les industriels ou les opérateurs. Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), il n’était pas possible de recourir à cette organisation habituelle : en effet la DGA n’est pas un opérateur. C’est ainsi que l’ONERA est entré dans la boucle. L’ONERA est donc, en quelque sorte, une « pièce rapportée » par rapport au montage habituel. De ce fait l’ONERA est plutôt cantonné dans un rôle de gestionnaire, même si il peut apporter son expertise technique et son savoir-faire. L’ONERA souhaiterait cependant être plus impliqué dans la définition des thématiques.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. De quelle façon souhaitez-vous être plus impliqués ?
M. Bruno Sainjon. D’abord, au titre du PIA 1, il est prévu une évaluation des projets ex post. Plus précisément, les conventions prévoient un rôle pour l’opérateur dans cette activité. Or, l’ONERA dispose de compétences et de capacités très fortes, pour ne pas dire uniques, pour tenir ce rôle. Nous espérons donc bien participer à ce travail, qui n’a pas encore eu lieu mais qui est prévu.
Par ailleurs, sur ce volet particulier du PIA, et contrairement à ce qui a été décidé pour d’autres volets, on a opté pour des démonstrateurs, autrement dit des actions à Technology readiness level (TRL) – ou Niveau de maturité technologique – relativement élevé. Nous souhaiterions que le PIA 2 concerne des activités situées plus en amont, de façon à irriguer de la recherche plus fondamentale, à l’instar de ce qui a été décidé dans d’autres domaines. Cela permettrait aussi à l’ONERA de remplir le rôle primordial pour lequel il a été créé en 1946, c'est-à-dire mener des recherches en propre très en amont dans le domaine de l’aviation civile (avions et hélicoptères) et irriguer le monde académique et les laboratoires.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Dans votre présentation, vous nous indiquez que 4,7 % du financement est allé vers des laboratoires de recherche académiques. Si on compare ce taux à celui d’autres projets, s’agit-il d’un taux plutôt supérieur ou éventuellement en deçà, et quelle conclusion êtes-vous susceptible d’en tirer ?
M. Jacques Lafaye, chargé de mission auprès du président-directeur général de l’ONERA. La valeur de 4,7 %, peut effectivement paraître faible. Les montants concernés ne concernent de plus que la partie qui a été en quelque sorte sous-traitée pour prestations extérieures. Mais cela illustre les propos de notre président-directeur général : les projets de démonstrateurs du PIA 1 se situent à des niveaux de TRL relativement élevés puisqu’un des souhaits du CGI est que les actions labellisées au titre du PIA se retrouvent clairement à moyen terme dans des produits : ces démonstrateurs ont vocation à programmer de manière très directe des produits qui seront intégrables à de nouveaux avions ou de nouveaux hélicoptères. Dans ces conditions, la part dévolue à la recherche fondamentale académique ne peut qu’être relativement faible. Le montant d’activités de l’ONERA lui-même, non plus comme opérateur mais cette fois comme centre de recherche, prévu au titre de cette partie aéronautique du PIA 1 n’est que de l’ordre de 7 millions d’euros. Compte tenu de notre spécialisation cela peut sembler assez faible, et encore plus quand on sait que la nature de notre recherche est souvent moins académique que celle des laboratoires académiques.
M. Thierry Michal, directeur technique général de l’ONERA. Au-delà du chiffre brut des 4,7 %, il faut rappeler que ces actions sont la conséquence d’une contractualisation par l’industriel, qui en cofinance une partie : cette contractualisation avec les laboratoires est donc orientée vers des technologies qui sont plutôt dans la fin de cycle du programme de développement d’une « technologie amont ». De même, les actions contractualisées avec l’ONERA vont majoritairement soit vers les grands moyens techniques que sont nos souffleries, qui constituent des moyens de soutien en début du développement, autrement dit à la limite de la R&D – recherche et développement – et de la R&T – recherche et technologie –, soit vers des départements qui se situent le plus en aval, comme par exemple le département d’aérodynamique appliquée, qui est le plus en relation directe avec l’industrie. Les départements de l’ONERA qui préparent davantage l’avenir ne sont donc pas directement mis à contribution.
Ce point a du reste été souligné par un rapport sur les modalités de soutien à la R&T élaboré l’an dernier par le Gifas. Celui-ci a conclu que l’organisation en mode démonstrateur, certes efficace et efficiente, conduit de fait, à la fin, à laisser de côté un certain nombre de technologies. Comme elles ne trouvent pas leur aboutissement dans le calendrier de la feuille de route lorsqu’on les y insère, elles ne sont, de ce fait, même pas initiées. En commun accord, toutes les parties prenantes de ce groupe de travail sur la R&T, qui réunissait les industriels du Gifas, ont considéré que, indépendamment des projets, il faudrait essayer de consacrer une part du financement à des sujets à TRL relativement bas, de façon à s’assurer que l’on continue à nourrir le portefeuille de technologies susceptibles d’être in fine intégrés dans des démonstrateurs.
M. Bruno Sainjon. Un rapport récent du sénateur Courteau, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, soulève également la question du financement de la science en amont pour préparer l’action aéronautique des années 2030-2040. Celle-ci se prépare aujourd’hui : si la France est encore un acteur majeur mondial dans les différents domaines aéronautiques et spatiaux, c’est bien grâce au travail conduit en amont depuis nombre d’années. Il évoque aussi le financement de l’ONERA. L’ONERA est détenteur d’un capital assez unique, un parc de souffleries très performant dont chacun nous dit qu’il est indispensable à l’Europe. Or, nous avons beaucoup de mal à obtenir des aides pour son entretien.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pensez-vous que cette recherche fondamentale est un peu sacrifiée aujourd’hui ?
M. Thierry Michal. Je ne pense pas. Il y a chez les acteurs de la R&T au sein des groupes industriels une vraie conscience de la nécessité de faire perdurer cette recherche fondamentale. Simplement, l’organisation en termes de grands programmes, de grands démonstrateurs, avec des échéances calendaires qui exigent des responsables des projets qu’ils déterminent très en amont les technologies qu’ils vont retenir dans leur feuille de route, conduit à faire des choix, et éventuellement des impasses, sur des technologies qui mériteraient de continuer à être développées mais pour lesquelles les outils commencent à manquer.
Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Il nous semblait que l’objectif du PIA était justement d’aller vers des TRL plus avancés, et que le PIA a comblé le financement qui manquait pour des démonstrateurs.
Je comprends à votre réponse à la question de M. Patrick Hetzel que l’A350 aurait été financé de toute façon, PIA ou pas. Il y avait un engagement de l’État. La première convention date de juin 2009 et l’avenant avec l’ONERA pour le montage du fond de concours de 2011. Mon analyse consiste plutôt à dire que le PIA sécurise le financement du programme. La question porte donc plutôt sur les démonstrateurs : auriez-vous engagé leur construction en l’absence du PIA ? Autre question, avoir financé le PIA a-t-il conduit à moins financer, par voies classiques, la recherche fondamentale ?
M. Bruno Sainjon. En l’absence de PIA l’hélicoptère X4 aurait lui aussi été financé sur la base de conventions d’avances remboursables classiques. En revanche, les financements du PIA ont effectivement asséché les activités de la DGAC. L’ONERA n’est aujourd’hui plus financé par la DGAC, mais seulement par une subvention du ministère de la défense. Cette situation rendait très délicat pour nous de cofinancer un démonstrateur relevant d’une activité civile, plutôt en aval de surcroît. Cela a de facto orienté l’activité de l’ONERA vers un double rôle de gestionnaire et de notaire, ainsi que de sous-traitant de l’industrie – pour les 7 millions d’euros évoqués par M. Thierry Michal –, au détriment de sa mission d’irrigation de la recherche plus fondamentale.
M. Thierry Michal. À mon sens, le PIA a structuré un premier effort conduit par l’industrie, à travers le CORAC, pour harmoniser les programmes de recherche des industriels et mettre en évidence les thématiques sur lesquels il fallait qu’ils se concentrent. Par exemple, ce qui a été fait au niveau de la plateforme EPICE (Engin Propulsif Intégrant des Composantes Environnementales) sous forme d’une collaboration entre Safran et Airbus, sur des thématiques sur lesquelles ces sociétés n’étaient pas forcément si enclines à collaborer, a créé la base d’une force française relativement efficace dans l’organisation des projets et la définition des feuilles de route. A mon sens, l’ONERA a toute sa place dans le CORAC ; il y participe de plus en plus, notamment pour intégrer au sein des feuilles de route la partie la plus amont. La mise en commun des réflexions et l’habitude d’un travail commun plutôt en confiance a été ressenti de façon très positive par les acteurs de la filière aéronautique. La mise en place du CORAC, antérieure à l’arrivée du PIA, a permis que les projets proposés dans le cadre du PIA soient déjà des projets mûris, réfléchis, résultats de compromis entre les industriels et procédant d’analyses de ce qu’il était nécessaire de faire – la seule réserve de l’ONERA étant que les industriels les ont construits sous forme de plateformes à vocation plutôt technologique ? avec un horizon plus court-termiste que ce que l’ONERA aurait fait en tant qu’établissement de recherche.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Vous avez décrit le processus de façon séquentielle. Mais si, dans le prolongement du rapport Juppé-Rocard, l’objectif poursuivi par le PIA était de fournir une impulsion d’un Etat stratège, il était aussi de veiller à ce que la France, aujourd’hui, en 5e ou 6e position mondiale sur ce secteur, selon les cas de figure, ne décroche pas en termes d’agilité, d’innovation, de recherche et de compétitivité par rapport à de nouveaux arrivants de plus en plus présents. Par conséquent comment percevez-vous les choses en termes de temps ? Y a-t-il eu un effet de ralentissement, d’accélération ou bien encore l’effet du PIA a t-il été neutre dans ce domaine ?
M. Thierry Michal. Mon expérience de terrain m’amène à considérer que des projets de l’ampleur d’EPICE ou de l’avion composite n’auraient pas pu être menés dans un délai aussi resserré en s’appuyant sur les seuls financements, récurrents et annuels, dévolus à la DGAC – et ce même dans ses années les plus fastes. En poussant les industriels à créer des co-projets et en leur donnant la possibilité d’acquérir des habitudes de travail en commun, au lieu de conduire des actions plus limitées, où un industriel allait discuter seul avec la DGAC, le PIA a vraiment créé un effet de masse. Ces nouvelles habitudes de travail ont permis le développement d’analyses plus collégiales pour la mise en évidence des priorités, et donc la définition, au niveau du CORAC, du besoin d’utilisation des financements issus de la DGAC, même si ensuite, bien entendu, chacun fait ses propres propositions à la DGAC.
Il y a vraiment, désormais, une véritable action, tout à fait efficace, d’animation de la filière, en particulier pour sa R&T, sous l’égide du CORAC. Par l’importance des moyens qu’il a octroyés d’un seul coup, le PIA a indéniablement créé un effet de levier en ce sens.
M. Bruno Sainjon. Je voudrais maintenant aborder le volet de la valorisation.
Lors de son audition, M. Patrick Gandil n’a quasiment cité l’ONERA à propos de la mise en œuvre des projets du PIA 1 que lorsqu’il a évoqué l’équipe de programme mixte. En revanche, lorsqu’il a abordé la valorisation, il a indiqué que l’aéronautique présentait, dans ce domaine un paysage très fédéré, qu’il fallait préserver, avec un acteur central, l’ONERA.
Non seulement l’ONERA est labellisé Carnot – il n’est pas le seul à l’être dans le secteur aéronautique – , mais, dans le cadre de l’action initiée en 2012 sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mieux fédérer le réseau Carnot, il a l’intention de se positionner comme leader et chef de file de la partie aéronautique de ce réseau.
Sur les SATT, je crois que la bonne approche consiste à être pragmatique, en fonction de la dynamique que l’intervention d’une SATT peut apporter à la maturation d’un projet. Le conseil d’administration de l’ONERA a ainsi récemment autorisé une concession de licence en s’appuyant sur la SATT de Toulouse, en considérant que celle-ci était sûrement l’outil le plus actif dans la région toulousaine pour porter le projet qui lui était présenté.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. La mise en œuvre des projets du PIA dans le secteur aéronautique a-t-elle eu une influence sur la recherche duale ?
M. Bruno Sainjon. En aéronautique, la recherche est essentiellement duale ! Cela dit, la présence de la DGA dans la boucle de la sélection et de la conduite des projets du PIA est sûrement la meilleure garantie pour la Défense que ses préoccupations, d’ordre aussi bien technique qu’industriel, sont bien prises en compte. Ainsi, des discussions sont actuellement en cours sur le X4 entre l’industrie et l’équipe mixte, et notamment la DGA, pour des raisons d’ordre industriel, relatives plus précisément à la place à donner au sein du projet à des industriels non français par rapport à Thales et à Sagem.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Souhaitez-vous aborder plus en détails les programmes ?
M. Bruno Sainjon. Nous avons déjà évoqué l’A350 et le X4. Il ne reste dès lors que le TPH de Turbomeca. Le document que nous vous avons remis le décrit. Ce projet est actuellement soumis à la Commission européenne.
M. Thierry Michal. Notre fonction d’opérateur inclut une activité finançable au même titre que les frais de gestion, qui est une activité technique d’évaluation, en particulier des bénéfices environnementaux. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure les éléments développés dans le cadre des plateformes financées par le PIA apportent un bénéfice environnemental. L’évaluation n’est pas facile : il faut en effet faire la part des choses entre ce qui aurait existé sans le PIA et ce qui existe grâce au PIA. L’ONERA a déjà mené une évaluation de ce type : nous avons en effet été responsables du projet d’évaluation technologique Technology Evaluator au sein du programme européen Clean Sky qui vise à développer des technologies permettant de réduire l’impact du transport aérien sur l’environnement. Nous avons donc développé dans les années 2005-2009 une plateforme d’évaluation, et nous comptons bien outiller l’évaluation que nous effectuerons dans le cadre du PIA sur la base de cette plateforme. Cette évaluation présente aussi une difficulté liée à la garantie de la confidentialité des résultats et des avancées industrielles, que chaque industriel veille à ne pas voir mis sur place publique. L’ONERA, notamment de par son habitude de traiter des problématiques de défense, a la capacité à gérer cette confidentialité et cette sécurité des informations. Nous souhaitons donc être chargés de cette évaluation ; nous l’avons de nouveau indiqué lors du dernier comité de pilotage. Maintenant que de premiers résultats ont été obtenus, il est temps de la lancer.
M. Bruno Sainjon. Monsieur le président Monsieur le rapporteur, l’ONERA vous accueillera avec plaisirs dans ses locaux si vous souhaitez constater de visu la richesse de ses savoir-faire, de ses outils et, surtout, de ses personnels.
Audition du 25 juin 2014
À 17 heures : M. Alain FUCHS, président du CNRS
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Bienvenue, monsieur le président du CNRS.
Monsieur le président, dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur, la mission d’évaluation et de contrôle a souhaité recueillir le point de vue du CNRS, connaître son implication en matière d’IDEX, de LABEX et d’EQUIPEX, et enfin aborder avec lui la question de la valorisation de la recherche.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Monsieur le président, nous sommes aussi particulièrement intéressés par le point de vue du CNRS sur l’articulation entre ce qu’on pourrait appeler le canal historique des financements par projets, celui de l’ANR, et le nouveau canal qui est celui du PIA, et la façon dont le CNRS organise pour lui-même cette articulation.
M. Alain Fuchs, président du CNRS. La création du PIA a été concomitante à la réorganisation du CNRS, en 2010, et à ma prise de fonctions.
L’orientation de politique scientifique que je voulais donner, et que j’avais présentée à la ministre de l’époque, était celle d’un rapprochement stratégique avec les universités, avec lesquelles les relations du CNRS étaient globalement difficiles alors même que les laboratoires soutenus par le CNRS, les Unités mixtes de recherche (UMR), étaient pour l’essentiel hébergées par les universités et les écoles.
Ces difficultés relationnelles, a priori paradoxales, ont en réalité pour origine la double distinction qui marque l’enseignement supérieur et la recherche français : celle entre universités et grandes écoles, d’une part, et celle entre université et grandes confondues et recherche, de l’autre. Il faut y ajouter la très grande dispersion des structures d’enseignement supérieur, voire de recherche, y compris au sein de ce que nous avons très vite appelé des sites, un site étant, pour parler vite, un grand ensemble métropolitain académique, au sein duquel établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche sont présents.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Les relations entre université et le CNRS se sont améliorées ?
M. Alain Fuchs. De façon considérable.
La raison essentielle de ces difficultés relationnelles est la regrettable habitude qui a été prise en France, depuis très longtemps, de considérer séparément enseignement supérieur et recherche, y compris dans les structures administratives (il existe une direction générale de la recherche et de l’innovation et une direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle) et les stratégies nationales, avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de la recherche.
Or, aujourd’hui, la mission de recherche des universités est très importante. Dans les dernières décennies du XXè siècle, il a été recruté dix fois plus de maîtres de conférences ayant aussi une fonction de chercheur que de chercheurs proprement dits. Eu égard à la puissance de recherche désormais présente au sein des universités, il n’y a plus lieu de maintenir cette forte distinction.
Dans le cadre de cette stratégie de politique scientifique, j’ai exposé à la Conférence des présidents d’universités que le partenariat entre les universités et le CNRS allait se concrétiser désormais par un dialogue sur des projets communs, une conception des UMR comme des unités réellement copilotées par le CNRS et les universités, et une transformation des conventions de partenariat passées entre le CNRS et les universités en véritables documents de réflexion stratégique et de projets communs pour l’avenir.
Le CNRS couvrant presque toutes les disciplines, il est lié par des conventions avec pratiquement tous les établissements de chaque site. J’ai donc proposé l’établissement de conventions de sites, liant plusieurs établissements d’un site et le CNRS, pour réfléchir à des projets partagés, interdisciplinaires et comportant des aspects de mutualisation.
Cette proposition a reçu un très bon accueil. Le CNRS a changé les modalités pratiques de ses relations avec les universités – son président allant sur place signer les conventions de sites au lieu que les présidents des universités partenaires soient convoqués à son siège, par exemple….
Aujourd’hui, le CNRS a établi de nombreuses conventions de site, avec les établissements de Bordeaux-Aquitaine, d’abord, mais aussi avec ceux de Toulouse, voire avec des sites où il n’a pas été constitué d’IDEX. Nous continuons à mailler le territoire de conventions de sites partout où le CNRS est présent. L’objectif est de faire en sorte que, sur un site, les établissements très morcelés ou divisés puissent se réunir autour de projets communs, pour créer de nouveaux établissements susceptibles de disposer de tous les attributs d’universités ou d’établissements de recherche tels qu’on les connaît à l’étranger, la multidisciplinarité notamment.
Le programme d’investissements d’avenir a été une aubaine pour le CNRS ; en effet, ce qu’on pouvait considérer comme son objectif de territorialisation de la recherche et de l’enseignement supérieur – à travers les structures qu’il mettait en place – allait dans le même sens que l’action conduite par le CNRS.
Nous avons donc très vite pris contact avec les sites qui constituaient des projets d’IDEX, et accompagné ces projets. Si certains de ces sites n’ont pas été retenus comme IDEX, nous constatons a posteriori que le simple fait d’avoir présenté un projet a permis par lui-même une meilleure structuration du site ou des réflexions sur la façon dont il pourrait être construit – je pense notamment à Bourgogne-Franche Comté. Aujourd’hui, certains sites qui n’avaient pas jugé leurs chances assez fortes pour construire un projet regrettent souvent de ne pas l’avoir fait, du fait de l’effet de structuration qu’ont créé le montage d’un projet et les échanges avec un jury international.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Vous avez agi selon une logique de territoire.
M. Alain Fuchs. Plutôt de territorialisation. Nous avons voulu identifier la géographie de la recherche. Elle ne coïncide pas toujours avec celle des régions : en science la logique territoriale est celle de l’excellence.
Le CNRS a donc été très présent dans le montage des IDEX – y compris lorsque des réorientations se sont avérées nécessaires pour répondre aux demande du jury international, comme à Paris-Saclay. Aujourd’hui, il participe à la gouvernance de sept des huit projets qui ont été couronnés, son absence de celle de Sorbonne Paris Cité ne tenant qu’à des raisons conjoncturelles – le CNRS est aujourd’hui membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Sorbonne Paris Cité.
Le concours des IDEX a donc permis au CNRS de développer une véritable politique de sites et des partenariats étroits avec ses partenaires universitaires. Il est aujourd’hui d’ores et déjà sollicité par des sites candidats aux nouvelles IDEX et aux ISITE (initiatives science-innovation-territoires-économie) du PIA 2.
De même, les LABEX et EQUIPEX ont également été très bénéfiques pour le CNRS. Bien au-delà des montants qui ont transité par le CNRS en tant que coordonnateur ou porteur de l’un des projets – je vous en ferai parvenir le bilan –, les chiffres les plus importants me semblent être ceux de la participation des équipes du CNRS et des UMR. Les équipes labellisées CNRS participent à 164 LABEX sur 171, soit à 96 % d’entre eux, et à 97 % des EQUIPEX. Autrement dit, quel que soit le canal par lequel les fonds ont transité, le CNRS participe, à travers ses structures propres ou à travers des structures auquel il est associé, à la quasi-totalité des projets, même lorsque ceux-ci sont dirigés par un enseignant chercheur.
Notre souci n’était pas de diriger le plus de projets. Il était de favoriser l’émergence du plus grand nombre de projets de qualité possible. Lorsque des projets dépassaient le périmètre et le territoire d’une fondation de coopération scientifique, c’est assez logiquement que le CNRS s’en est retrouvé le porteur, à la demande des partenaires, et sans contestation ni opposition spécifique. Dans d’autres cas, le CNRS a favorisé la meilleure configuration possible, où il pouvait n’être que partenaire. Au bout du compte, nos structures et celle que nous soutenons ont été fortement bénéficiaires des LABEX et des EQUIPEX.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Y a-t-il eu des effets de substitution entre projets relevant du financement par l’ANR et projets financés par le PIA ?
M. Alain Fuchs, président du CNRS. Non. À ma connaissance, il n’y a eu aucun effet de substitution. Qu’il s’agisse du CNRS ou de nos partenaires, notamment des universités, les structures qui pilotent les programmes ont mis en place les processus comptables et financiers qui permettent de suivre les fonds relevant du PIA séparément des autres financements. Budgétairement et comptablement, il n’est pas possible que les financements relevant du PIA soient utilisés pour financer d’autres projets : les crédits ne sont pas fongibles, l’utilisation des fonds fait l’objet de reportings détaillés transmis par les porteurs à l’ANR.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Ma question se situe plus en amont du processus. Un porteur de projet dispose devant lui d’une palette de systèmes de financement : l’ANR, le PIA, ou encore les financements européens. Au moment où croissaient les appels à projet de l’ANR, on a vu en parallèle diminuer le recours des chercheurs français aux financements européens. Ce type de substitution s’est-il aussi manifesté entre financements par l’ANR et financements par le PIA ?
M. Alain Fuchs. L’envergure des projets de LABEX finançables au titre du PIA est, pour l’essentiel, sans comparaison avec celle des projets financés par l’ANR. Les projets LABEX font coopérer non pas deux ou trois équipes, comme c’est le cas pour des projets ANR, en biologie par exemple, mais cinq, voire dix équipes, relevant de plusieurs UMR, avec un fonctionnement en mode projet. Beaucoup de LABEX deviennent eux-mêmes des systèmes de recrutement de chercheurs post-doctorat, notamment par des appels d’offres internes. Beaucoup d’entre eux fonctionnent comme les anciens réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA). À mon sens nos collègues ne se sont pas présentés de la même façon pour bénéficier des crédits de l’ANR ou pour obtenir une labellisation en tant que LABEX. On a vu des chercheurs seniors, bien installés dans le monde de la recherche, porter des projets de LABEX assez importants, tandis que, dans les laboratoires de ces chercheurs, des chefs d’équipe continuaient à aller présenter des projets à l’ANR. De ce que j’ai pu voir, la création des financements du PIA pour la création de LABEX n’a pas du tout eu pour conséquence une diminution des projets standards soumis à l’ANR.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. On pourrait donc parler d’une complémentarité des deux types de financement ?
M. Alain Fuchs. Oui tout à fait, d’une très grande complémentarité.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Pourtant, les demandes de financements européens ont considérablement baissé.
M. Alain Fuchs. Je ne suis pas complètement sûr de cet effet de vases communicants. D’autres éléments peuvent expliquer cette diminution. Le premier est que l’Europe s’est élargie, et avec elle le nombre de porteurs de projets éligibles aux financements européens. Par ailleurs, nous avons toujours eu des difficultés à motiver des chercheurs pour être coordinateurs de projets européens. Enfin, au CNRS, nous avons dû faire face à un incident assez lourd à gérer et qui a laissé des traces, l’audit du sixième PCRD (programme cadre de recherche et développement). Les auditeurs de la Commission européenne n’ont pas été très loin de penser que le CNRS fraudait la Commission. L’Olaf, l’Office européen de lutte antifraude, a été mis sur l’affaire. Cela a valu à des ingénieurs de recherche du CNRS d’être retenus pendant des après-midi entières par la police judiciaire pour s’entendre demander s’il n’y avait pas eu de fraude organisée au plus haut niveau au CNRS pendant la durée du programme. Le caractère insupportable de la bureaucratie bruxelloise – même si celle-ci s’est légèrement détendue, mais insuffisamment, ces derniers temps – peut aussi être un facteur d’explication de la moindre appétence des équipes françaises pour les financements européens.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Si des modifications devaient être effectuées en matière de gouvernance des investissements d’avenir, quels seraient les points à privilégier ?
M. Alain Fuchs. Le triangle constitué par l’ANR, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Commissariat général à l’investissement nous a souvent laissé un peu perplexes. On ne peut pas dire que c’est la simplicité qui a été recherchée. Il reste qu’aujourd’hui, les structures sont en place et le système tourne. Il n’est pas nécessaire de refaire l’histoire.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. La gestion quotidienne des investissements d’avenir reste-t-elle compliquée ?
M. Alain Fuchs. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui. La mesure des demandes a été prise. Les lourdeurs les plus considérables venaient surtout de l’ANR ; lors de la passation des conventions avec l’ANR, il nous a été demandé de remplir des demandes de renseignements tellement vastes que nous n’en comprenions ni les tenants ni les aboutissants. L’administration du CNRS s’est mobilisée pour aider les porteurs à faire face à la multiplicité, à la précision et la complexité des demandes. Il était par exemple demandé aux porteurs de projets de LABEX d’indiquer le nombre de chercheurs qu’ils prévoyaient d’employer sur une durée de 10 ans. La situation s’est bien améliorée aujourd’hui. Globalement, les équipes de chercheurs relevant du CNRS n’ont pas à se plaindre de l’ANR.
Le sujet, ce n’est pas la gouvernance. C’est la paperasserie extrêmement complexe qui a été mise en place en vue de la signature des conventions.
Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Pendant deux ans, l’ANR s’est trouvé submergée par les dossiers. Pour pallier à l’engorgement des procédures normales, des systèmes d’avance de fonds ont dû être mis en place en vue de la création de certains LABEX. Par ailleurs, si c’est à l’ANR que les porteurs de projet avaient affaire, il faudrait analyser l’ensemble du système pour savoir si la complexité des demandes émanait vraiment de l’ANR elle-même : sa convention avec l’État la contraint elle aussi à un reporting extrêmement précis.
Si la complexité des procédures a retardé les projets d’un an, les leçons de l’expérience ont bien été tirées, puisque les dossiers à fournir pour les LABEX et les EQUIPEX du PIA 2 ont été considérablement simplifiés. D’autres améliorations, comme l’infocentre que doit constituer l’ANR, devraient venir s’ajouter à ces évolutions.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Un autre élément régulièrement abordé, en particulier par les présidents d’université, est que le financement nécessaire pour faire tourner un LABEX ou un EQUIPEX est en réalité toujours supérieur au financement qui peut être obtenu à la suite de la présentation et de la validation du dossier. Dans ces conditions, un projet lauréat du programme d’investissements d’avenir génère des coûts de structure pour l’établissement au sein duquel il est inséré. C’est notamment l’analyse du président de l’université de Strasbourg, Monsieur Alain Beretz.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Autrement dit, les financements sur projets induiraient des coûts indirects. Ces coûts sont-ils financés ? Leur existence peut-elle être un frein à la présentation de projets dans le cadre des investissements d’avenir ?
M. Alain Fuchs. Les présidents d’IDEX ont très vite abordé cette question. Le président Beretz a du reste beaucoup construit sa réflexion en s’inspirant de chiffres recueillis et traités par le CNRS. Nous parlons en réalité là de ce qu’on appelle dans tous les pays overheads – frais généraux – et qu’on a traduit en France par préciput, ce terme ayant vocation à désigner en quelque sorte des overheads à la française, c’est-à-dire des overheads de bien moindre montant qu’à l’étranger.
La question des overheads est une vraie question qui n’a pas été complètement traitée. Le CNRS lui aussi l’a soulevée. Elle déborde largement le cadre des investissements d’avenir, puisqu’elle touche tous les financements sur projets de l’ANR, et ce depuis le début. Hors investissements d’avenir, le coût indirect pour le CNRS des quelques centaines de millions d’euros qui tombent chaque année dans l’escarcelle de ses équipes au titre des financements sur projets de l’ANR est de l’ordre de 20 millions d’euros.
À un moment où il était possible de l’aborder, la question du montant des préciputs a été soulevée. L’ANR ne l’a pas esquivée. Les discussions ont été entamées avec la gouvernance de l’ANR. La réduction des crédits de l’ANR pour les financements sur projets entraînée par l’alternance, et plus globalement la situation des finances publiques, ont cependant rendu de plus en plus difficile d’aborder le dossier.
Certaines universités privées américaines pratiquent des taux d’overheads allant jusqu’à 50 %. Dans ces conditions, même sans se fonder sur des taux aussi élevés, on voit bien que le taux de préciput instauré par l’ANR n’était pas suffisant. C’est que, lors de la création de l’ANR, l’idée était que les financements consentis pour les projets permettraient le financement de l’intégralité de chaque projet.
L’insuffisance du taux de préciput a obligé le CNRS à modifier son organisation. Ainsi, lorsqu’un porteur de projet embauche un post-doc, nous devons vérifier auprès de l’organisme financeur – ANR mais aussi Union européenne, avec qui nous avons eu parfois des discussions un peu tendues – si, par exemple, les dépenses d’assurance-chômage sont ou non éligibles au titre du projet. Si elles ne le sont pas sur le projet même, elles le deviennent sur la subvention d’État au titre de la masse salariale...
Il est dommage que la situation soit bloquée. Malgré l’évolution défavorable des crédits de l’ANR, et même si la situation idéale à la fois pour le calcul du coût du projet et pour des raisons de comptabilité pratique serait évidemment de travailler à coûts complets, la question du préciput devrait être reconsidérée aujourd’hui.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. L’insuffisance du préciput pour les projets lauréats du PIA est-elle amplifiée par rapport à celle qui touche les projets financés par l’ANR, où est-elle de même nature ?
M. Alain Fuchs. La question est difficile. Selon le CGI, le raisonnement ne peut être identique pour tous les outils. La notion de préciput ne peut se calculer de manière identique pour un EQUIPEX, un équipement lourd qui sera acheté par une structure, et un LABEX, au sein duquel seront embauchés des doctorants ou des post-doc, dont la présence va entraîner la consommation de fluides – eau, électricité – ou encore de consommables. C’est plutôt dans ce cas que la notion de préciput a un sens. Cette différenciation a été l’un des éléments sur lesquels le CGI s’est appuyé pour refuser la mise en place de préciputs, les calculs étant, selon lui, trop compliqués. La question du préciput au sein du PIA se pose, mais elle doit être traitée outil par outil, voire au cas par cas.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Passer en comptabilité à coûts complets serait sans doute en effet la meilleure solution. Ce mode de comptabilité est du reste souvent exigé dans les financements européens. Quels sont les éléments qui font achopper sa mise en œuvre ?
M. Alain Fuchs. Mes fonctions ne font sans doute pas de moi la personnalité la mieux placée pour répondre. Je ne crois pas qu’il y ait des réticences, voire des résistances pour aller dans ce sens. Je crois plutôt que la difficulté est que l’effort à produire est extrêmement important, en énergie comme en moyens financiers.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Quel regard porte aujourd’hui le président du CNRS sur la mise en place des sociétés d’accélération du transfert technologique (SATT) ?
M. Alain Fuchs. Le choix – car c’est un choix – du CNRS a été d’être actionnaire de toutes les SATT. Il sera actionnaire des SATT de Grenoble et de Paris-Saclay.
J’avais en effet la conviction que, dès lors que le CNRS considérait que les SATT apporteraient une plus-value d’une part dans la rapidité du transfert et de la valorisation, du fait de leur proximité avec les vecteurs, et de l’autre dans la maturation, domaine qui ne constituait pas vraiment l’un des points forts du CNRS, il fallait qu’il soit présent dans l’ensemble des SATT, et non pas dans certaines d’entre elles seulement – dont on peut se demander sur quels critères nous les aurions choisies.
La structure de valorisation du CNRS, qui est une structure nationale, a ses forces et ses faiblesses. Parmi ses forces figurent sa visibilité nationale, notamment pour les réseaux de recherche. Ceux-ci peuvent constitués d’équipes présentes dans plusieurs régions. Pour de tels réseaux, confier au CNRS la valorisation de leurs innovations, la construction puis la gestion de la propriété intellectuelle qui y sera attachée, a du sens. On n’imagine pas aujourd’hui que des grappes de brevets constituées de façon multi-territoriale et souvent aussi multidisciplinaire se retrouvent dispersées dans différentes SATT. Il y a des sujets qui ne se déclinent pas en logiques territoriales. Il y a un véritable intérêt à avoir sur certains axes stratégiques, que nous appelons des axes stratégiques d’innovation, et que nous définissons, une vision et une capacité de gestion de la propriété intellectuelle nationales.
Ce qui constitue tout l’intérêt des SATT, c’est le contact sur place. Nous savons qu’aujourd’hui, pour valoriser une innovation, il ne faut pas tarder. La rapidité du temps de passage au marché peut être discriminante. Ce temps doit être le plus court possible.
Or, le type d’innovation avec lequel le CNRS est le plus familier, c’est l’invention majeure et structurante, comme en pharmacie le blockbuster, que le CNRS a bien connu avec le Taxotère. Dans ce type de cas, l’invention est telle qu’elle demande encore un travail considérable en aval avant de pouvoir être mise en œuvre par le marché. Ce travail de valorisation sera fait en commun avec un grand groupe – pharmaceutique par exemple – qui pourra y mettre le prix. La rapidité de l’arrivée sur le marché n’est alors pas le plus déterminant.
En revanche, nous nous sommes très vite rendus compte qu’une gestion nationale de la propriété intellectuelle de l’ensemble des brevets – plusieurs centaines chaque année – issus des laboratoires du CNRS ou des unités mixtes de recherche n’était ni le mode de gestion le plus souple ni le plus rapide.
En France, le monde de la valorisation est traversé par des conflits quasi idéologiques entre valorisation nationale ou locale. À mon sens, il faut être pragmatique. Leur implantation régionale permettra aux SATT de trouver sur place les éléments permettant la valorisation et la maturation d’une découverte dans de bonnes conditions de rapidité. Le CNRS accompagne donc sans aucune arrière-pensée la création et le développement des SATT.
Certes, pour le CNRS, il est trop tôt pour dire que le dispositif des SATT est un succès. Nous constatons que certaines d’entre elles, parce qu’elles ont trouvé le bon mode opératoire au sein de leur environnement, fonctionnent mieux que d’autres – je pense notamment, bien sûr, à Conectus. Nous ne savons pas non plus si toutes les SATT réussiront. Il reste qu’il ne faut pas commencer à faire le procès des SATT sans leur avoir laissé le temps de faire leurs preuves. Les SATT ont été créées dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, qui est une grande opération nationale ; pour le CNRS, il faut tout faire, et sans arrière-pensée, pour qu’elles réussissent. Le CNRS joue le jeu des SATT.
Nous devons trouver la bonne articulation entre les SATT sur le territoire, les services de partenariat et de valorisation de nos délégations régionales, qui existent et n’ont pas démérité, notamment en ce qui concerne les start-up, et la gestion nationale. Il ne faut pas que tous les dossiers des SATT que le CNRS souhaite examiner remontent à l’échelon national. Des décisions doivent pouvoir être prises sur place. Il y a, pour y arriver, un important travail à conduire ; l’installation des SATT dans le paysage de la valorisation de la recherche prendra du temps.
On peut aussi se demander s’il est bien raisonnable de demander aux SATT de disposer de comptes équilibrés, voire d’être rentables, à un horizon de 10 ans. Certaines s’interrogent sur ce point. À mon sens, c’est une erreur de penser que la maturation de projets risqués va permettre systématiquement d’équilibrer les comptes des SATT à 10 ans. Si, à l’approche d’un horizon de 10 ans, on constate que de très beaux projets ont été maturés, qu’ils ont réussi à passer la « vallée de la mort » avec des entreprises qui y ont cru, on pourra déjà considérer qu’un résultat est là. Contrairement à une opinion trop répandue, on sait créer des start-up en France. Ce qu’on ne sait pas faire, c’est les faire croître. Les start-up que le CNRS a pu créer depuis l’an 2000 sont souvent vivantes – elles ont parfois été rachetées –, mais, en règle générale, elles ne comportent pas plus de 10 ou 15 salariés ; SuperSonic Imagine, superbe succès de 120 salariés qui vient d’entrer en Bourse, est l’arbre qui cache la forêt.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quel regard le CNRS porte-t-il sur France Brevets ?
M. Alain Fuchs. Le CNRS travaille avec la société France Brevets sans souci particulier. Nous avons signé une convention avec elle. Nous avons passé un contrat de licence sur une technologie particulière. Des relations se mettent en place graduellement. Il y a, je pense, complémentarité.
La question est plutôt celle de la stratégie qui sera celle de France Brevets dans l’avenir. La politique du CNRS est de contribuer à l’application des résultats de la recherche. Il n’est pas dans une logique d’achat et de revente de licences, de pattern troll. Mais il ne semble pas non plus que France Brevets s’engage dans cette direction.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition du 25 juin 2014
À 18 heures : MM. Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm et Thierry Damerval, directeur général délégué, accompagnés de M. Arnaud Benedetti, directeur de la communication
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Monsieur le président-directeur général de l’Inserm, Monsieur le directeur général délégué, bienvenue.
Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur », la mission d’évaluation et de contrôle a souhaité recevoir l’Inserm pour le rôle essentiel qu’il joue au sein de ces programmes.
Nous souhaitons aborder avec vous l’ensemble des questions relevant du PIA – gouvernance, contenu des programmes, valorisation – sous tous leurs aspects, les plus satisfaisants comme les plus délicats.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Monsieur le président-directeur général, un élément nous intéresse particulièrement. Si deux actions du PIA concernent la santé, elles ne relèvent pas du même programme : la première, « Instituts hospitalo-universitaires » relève du programme « Pôles d’excellence » tandis que la deuxième, « Santé biotechnologies » relève du programme « Projets thématiques d’excellence ». Selon l’Inserm, y a-t-il des éléments de synergie entre ces deux actions ou relèvent-elles d’orientations sans relations entre elles ?
M. Yves Lévy, président-directeur général de l’Inserm. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, merci beaucoup de votre invitation. En effet, l’implication de l’Inserm dans les programmes d’investissement d’avenir est extrêmement forte. Je vous propose de la décrire brièvement, en signalant au passage ce qui constitue pour l’Inserm des points d’alerte ou de vigilance : la complexité institutionnelle, d’une part, et la pérennité du financement des structures et de la rémunération des personnels impliqués, de l’autre. J’aborderai aussi la question de la cohérence des structures de valorisation créées par le PIA.
L’Inserm est impliqué selon plusieurs modalités dans les projets du PIA. Il assure la coordination et la gestion d’infrastructures et d’équipements, ainsi que celle des cohortes. Il est partenaire et participe aux instances de décision des huit IDEX et des six instituts hospitalo-universitaires (IHU) ainsi que de l’institut de recherche technologique (IRT) Bioaster et d’un démonstrateur. Enfin, l’Inserm ou certaines de ses équipes sont impliqués dans des projets – pour l’essentiel, des LABEX – dont le portage et la gestion sont assurés par d’autres. Il avait en effet été décidé dès le départ que la gestion des LABEX serait locale. Cependant, du fait du travail de coordination effectué par l’alliance de recherche Aviesan, l’Inserm conserve une certaine implication dans la gestion et le suivi des LABEX de ses domaines de compétences, même lorsqu’il n’en est pas directement responsable – certains LABEX ont même confié leur gestion à l’Inserm.
Au total, les laboratoires de l’Inserm participent à 52 LABEX, 19 EQUIPEX, 16 infrastructures, 10 cohortes, les 6 IHU, les 6 IHU classés « prometteurs » (dits aussi « chaires d’excellence »), les 2 PHUC (projets hospitalo-universitaires en cancérologie), 2 IRT, 3 démonstrateurs ainsi qu’aux 8 IDEX et aux 2 IDEX « en devenir ». L’Inserm participe également à d’autres projets, projets de nano-biotechnologies et de bio-informatique. Le spectre des participations de l’Inserm est donc très large.
Quel est l’apport à la recherche des structures créées par le PIA ? Dans le domaine de la santé, les infrastructures nationales et les financements qui y sont attachés ont été essentiels. Ils ont permis d’accroître le niveau technologique d’un certain nombre d’équipes, la structuration de la recherche à un niveau beaucoup plus large que celle du simple laboratoire – notamment en matière de recherche biomédicale – et enfin la participation de la France à certains projets européens ou, pour certains projets européens, la constitution du nœud français. L’Inserm est impliqué dans plusieurs structures européennes et assure la coordination de deux d’entre elles. Il est aussi partenaire d’autres structures internationales, dont il représente ou gère directement le nœud au niveau français.
Il faut cependant noter que si les financements du PIA ont permis la contribution française aux structures européennes, ils ne couvrent qu’une période de 3 ans. Se pose donc dès maintenant la question de ces financements après 2015.
Les cohortes constituent l’autre exemple emblématique d’implication de l’Inserm. Ces cohortes – une dizaine –, qui ont pu être mises en place grâce au financement du PIA, permettent de générer des données à très grande échelle, soit de personnes en bonne santé, soit de pathologies particulières. Porteuses d’un fort potentiel d’innovation, elles présentent une forte attractivité industrielle : les industriels sont intéressés par les données générées. Cet outil, où la France tenait déjà une place très importante, et qui représente une valeur supplémentaire par rapport aux essais cliniques, ne disposait pas de financements structurés avant l’intervention du PIA.
Là aussi, la question de la pérennité des financements des cohortes va se poser, de même que celle des financements des bio-banques associées à ces cohortes. L’Inserm a donc dès le début réfléchi au modèle économique qui permettrait de pérenniser ces cohortes. Des manifestations, notamment celle de mars 2014, qu’on a appelé « Cohortes innovation Day », ont été organisées pour essayer de mettre en place un modèle permettant l’implication de l’industrie dans le financement des cohortes. Une dizaine de laboratoires d’industries pharmaceutiques ont participé à cette journée, en interaction avec les porteurs de projets des cohortes. Les cohortes sont extrêmement visibles et suivies de manière attentive par l’industrie.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Ces manifestations ont-elles permis la mise en place d’un modèle économique satisfaisant ?
M. Yves Lévy. Non. Le modèle n’est pas réglé sur le long terme. Cette première initiative a été un succès du fait de l’implication de l’industrie et de l’intérêt qu’elle y a porté. Il faudra sûrement la renouveler. L’industrie va maintenant sélectionner les données et les cohortes qui peuvent l’intéresser. Une cohorte comme HEPATHER – qui est plutôt un EQUIPEX – est essentielle aujourd’hui pour la lutte contre le virus C de l’hépatite, dans la mesure où elle fournit des données à large échelle, « dans la vraie vie », sur l’utilisation des drogues chez les patients présentant une atteinte hépatique.
Troisième élément, les équipements d’excellence (EQUIPEX) ont représenté un apport fondamental pour la biologie-santé. Ils permettent des avancées technologiques des laboratoires et des plateformes ; ce sont de très lourds investissements en matériel, que ce soit dans l’imagerie, dans la génomique ou dans des modèles animaux, qui sont ainsi financés. Cependant tous les 3 à 5 ans, de tels matériels demandent un renouvellement ou une jouvence. La question du financement du renouvellement de ces EQUIPEX, et donc de la pérennité de ces équipements, va donc se poser. Si le problème a été identifié, il n’est pas réglé aujourd’hui.
L’Inserm est totalement impliqué au sein des IHU. Leur gouvernance est un peu particulière puisque les 6 IHU sont tous des fondations de coopération scientifique (FCS) – à l’exception de celui de Bordeaux, qui est sur le point de le devenir. Les IHU, qui représentent une masse critique importante, sont le lieu du continuum soins-recherche-innovation.
Les IHU posent trois problèmes. D’abord, leur gouvernance est complexe, puisque certains IHU associent une fondation de coopération scientifique, une fondation reconnue d’utilité publique, d’autres fondations et des centres de recherche. Ensuite, leur mécanisme de valorisation sort de la chaîne de valorisation créée par le PIA et que l’on essaie d’harmoniser. Enfin se pose la question de leur modèle économique, puisque ces IHU vont devoir être autonomes en termes de financement de leurs recherches et de la clinique qui y est conduite ; se pose donc spécifiquement, pour les IHU, un problème de retour sur financement de leur recherche clinique : la répartition des financements qui doivent revenir aux IHU à partir de leurs innovations et de leur recherche clinique est donc posée.
L’Inserm est associé à l’ensemble des IDEX et tout particulièrement à celles qui comportent un volet biologie-santé. L’Inserm a dû s’adapter au modèle particulier de gouvernance des IDEX ou trouver un modèle adapté avec les acteurs locaux, en fonction des thématiques. Il y a deux modes de gouvernance. Lorsque sur le site il y a eu une fusion des universités – comme par exemple à Aix-Marseille, Bordeaux ou Strasbourg –, un comité de pilotage associant l’université, le ou les organismes de recherche auxquels participe l’Inserm et les écoles membres de ces IDEX a été mis en place. Lorsque le portage de l’Inserm passait par un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et que ce PRES, du fait de la loi du 22 juillet 2013, a évolué vers une communauté d’universités et d’établissements (COMUE), l’Inserm est membre de la COMUE et est donc associé à la gouvernance de l’IDEX ; c’est le modèle des IDEX parisiennes, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université et Sorbonne Paris Cité notamment.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Vus de l’Inserm, ces modèles de gouvernances sont-ils satisfaisants ou non ?
M. Yves Lévy. Ces modèles de gouvernance sont satisfaisants. Même lorsque l’Inserm n’était pas, au départ, associé en tant que membre de l’IDEX, pour chacune des IDEX comportant une importante composante biologie-santé, l’Institut s’est très fortement impliqué dans le projet scientifique, notamment en participant aux auditions des jurys de sélection. L’Inserm a su s’adapter à l’évolution des sites. Nous avons trouvé le modèle pour être impliqués aussi bien dans le comité de pilotage des universités fusionnées que dans celui des COMUE. L’Inserm va aussi analyser, site par site, sur la base du projet scientifique, le type de partenariat qui pourrait être le sien dans les nouvelles structures, IDEX ou ISITE, qui vont être créées par le PIA2.
Je voudrais maintenant aborder les questions de financement. La projection du financement sur dix ans par l’ANR au titre du PIA des huit IDEX où l’Inserm est impliqué est de 2,4 milliards d’euros. Sur la même durée, l’apport de l’Inserm en crédits de fonctionnement ou de masse salariale dans ces mêmes IDEX – elles comportent toutes des centres de recherche ou des équipes Inserm – est de 1,74 milliard d’euros. S’agissant des six IHU, le total des dotations fournies sur dix ans par l’ANR est d’environ 350 millions d’euros, contre 381 millions d’euros financés par l’Inserm. Dans les deux cas, on voit l’importance de la part de l’Inserm, importance d’autant plus grande que, bien évidemment, ses financements sont entièrement consacrés à des recherches dans les domaines de la santé et de la biologie-santé. Ces chiffres montrent aussi à quel point, eu égard à l’implication de l’Inserm dans le financement de ces structures et de leurs programmes de recherche, leur gouvernance est pour l’Institut un point essentiel.
Je voudrais maintenant évoquer, même si les données sont parcellaires – il est très difficile de les faire remonter eu égard au nombre de structures impliquées – le taux de réalisation du PIA exécuté aujourd’hui qui revient à l’Inserm. À la fin 2013, ce taux d’exécution depuis 2011 était environ de 20 %. À la fin 2014, ce taux devrait être d’environ 39 %, ce qui correspond à 44 millions d’euros. C’est l’apport tangible, tel qu’on peut le projeter, qui va revenir aux équipes. Fin 2019, la projection serait de 65 millions d’euros. On voit que si les équipes de l’Inserm bénéficient du financement des PIA, il faut mettre ce financement en relation avec la participation de l’Inserm au sein des IDEX et des IHU.
Les financements qui reviennent aux équipes Inserm sont fléchés par le projet ANR et gérés directement par l’organisme gestionnaire et le porteur de projet. Mais leur versement est encadré, avec un contrôle a posteriori par les services financiers de l’Inserm. Le rapport financier est associé à un rapport opérationnel et à un rapport scientifique. Enfin, il n’y a pas de substitution entre les crédits du PIA et le budget récurrent de l’Inserm. L’Inserm n’a absolument pas modifié ses règles de financement des budgets récurrents des équipes. Aucune règle n’a changé. Les financements du PIA répondent à la vitalité et à l’excellence des équipes. Par ailleurs, que les frais de gestion de l’ANR soient passés de 4 à 8 %, pour les structures incluant les LABEX montre bien l’implication que les établissements ont dû avoir pour la gestion de ces structures.
Enfin, un point de vigilance concerne le personnel contractuel recruté pour la réalisation de projets financés par le PIA. En 2013, les contrats à durée déterminée liés aux projets du PIA et gérés directement par l’Inserm représentaient 113 personnes, soit 5 % des 2 113 personnes en CDD à l’Inserm. Cependant, ce chiffre est sûrement sous-estimé : il ne concerne en effet que les postes gérés directement par l’Inserm alors que, pour un même projet, d’autres personnels contractuels peuvent être employés par d’autres gestionnaires – universités ou autres organismes de recherche.
La question du devenir de ces postes se pose dans la mesure où les financements ne sont accordés que pour une durée de 10 ans. Le renouvellement des personnels est limité par le droit du travail pour les fondations de coopération scientifique et par la loi dite Sauvadet pour le secteur public. Pourtant, ces personnels sont des personnels-clés pour les projets auxquels ils participent, du fait de l’expertise scientifique acquise. Souvent, ils ont été indispensables pour le démarrage et la conduite des projets, dans la réalisation desquels ils sont donc complètement impliqués.
Le message que je veux passer aujourd’hui – et que j’ai passé en interne en tant que président-directeur général – est qu’une réflexion doit avoir lieu à l’Inserm sur la vague d’emplois contractuels liée au PIA. Cette réflexion doit s’inscrire dans un cadre beaucoup plus large, légal et réglementaire, et impliquer les autres partenaires – le Commissariat général à l’investissement et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Cette difficulté se pose aussi pour le CNRS.
M. Yves Lévy. Elle se pose partout.
Mme Nadia Bouyer, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Si je comprends bien votre interrogation, ces personnels devront, du fait de la loi Sauvadet, partir au bout de quatre ou six ans puisque vous n’aurez pas nécessairement les moyens de les conserver, et cela pose un problème de continuité dans le suivi des projets qui, eux, s’étalent sur dix ans. Votre réflexion porte-t-elle sur le cadre d’emploi à trouver pour les grands projets compte tenu des contraintes fixées par la temporalité des investissements d’avenir ?
M. Yves Lévy. Il y a deux aspects. Le premier, dont vous avez parlé, concerne les préoccupations des porteurs de projet. Ces derniers ont une inquiétude légitime sur la mise en danger de leurs projets qui pourrait être causée par la perte d’expérience et d’expertise consécutive au départ des personnels qui les ont accompagnés. Mais un second aspect, qui est pour moi aussi voire plus important dans une politique globale, concerne le devenir et la situation de contractuels, les personnels associés au PIA, rémunérés sur la base d’un financement sur dix ans.
Enfin, je voudrais évoquer le rôle des alliances de recherche. Elles facilitent la gouvernance. Le dialogue entre les organismes de recherche fonctionne bien. Je sors d’un conseil d’administration d’Aviesan dans lequel les dossiers ont réellement été discutés ensemble.
Les deux organismes de référence en matière de recherche bio-médicale, le CNRS et l’Inserm, font ensemble des visites de site, et discutent ensemble des politiques de site avec les acteurs de ceux-ci. Il est habituel que ces déplacements soient dénommés « Aviesan ».
Concernant la gestion et la visibilité des LABEX, il a été mis en place au niveau d’Aviesan un comité de coordination qui s’implique complètement, y compris dans les structures qui ne sont pas gérées directement par un organisme désigné tel que l’Inserm ou le CNRS.
M. Thierry Damerval. L’appel à projet spécifique « infrastructures nationales en biologie santé » était absolument essentiel pour que la France soit présente dans la structuration européenne dans le domaine biologie-santé. L’existence d’Aviesan a été primordiale pour la coordination et le positionnement français à partir des infrastructures nationales dans ce même domaine. Elle a permis à l’Inserm de coordonner le projet ECRIN relatif à l’organisation de la recherche clinique au niveau européen – avec en France, le projet FCRIN –, ainsi que celui relatif aux biobanques. Dans les autres domaines, le coordonnateur peut être, par exemple, le CNRS sur la bio-informatique, ou le CEA sur l’imagerie. Mais l’existence d’Aviesan a été absolument déterminante pour notre positionnement et notre organisation en matière d’infrastructures nationales en biologie-santé.
M. Yves Lévy. En matière de valorisation, la question de la cohérence des structures – CVT, SATT, France Brevets, Fonds national d’amorçage – et des politiques est posée.
Les consortiums de valorisation thématique (CVT) et les SATT ont dû trouver leur place face à des structures de valorisation des instituts thématiques déjà créées, notamment Inserm Transfert pour l’Inserm.
Les discussions ont été difficiles avec les SATT – c’est le moins que l’on puisse dire. La place de chacun dans le paysage de la valorisation a été extrêmement complexe à déterminer. Cependant, la discussion d’Inserm Transfert avec les SATT est désormais beaucoup plus apaisée et trouve son équilibre.
La philosophie d’Inserm Transfert – à qui l’Inserm a délégué sa valorisation –, que beaucoup ont acceptée, est que l’objectif doit être d’augmenter l’efficience et la complémentarité, et porter sur l’accroissement du volume de l’activité et l’efficacité plutôt que sur la renégociation de la répartition de l’existant. Dans ces conditions, chacune de ces structures doit trouver son objectif. Ceux d’Inserm Transfert sont clairs. Il s’agit d’être dans une attitude de sourcing, c’est-à-dire de faire monter les brevets à partir des chercheurs, de protéger cette propriété intellectuelle, d’aider aux accords de consortium, à la visibilité, à la valorisation, et au-delà au montage de projets européens.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Lors de son audition, nous avons interrogé le commissaire général à l’investissement sur les SATT. Le débat se situe entre les tenants du maintien de l’existant et les tenants de l’évolution par un maillage à travers les SATT. L’une des difficultés rencontrées au cours de ces dernières années est l’émiettement du dispositif global de l’accélération du transfert technologique – même si Inserm Transfert tranchait par sa situation vertueuse. Puisque la discussion est plus apaisée, quelle organisation à terme vous semble souhaitable ? Jusqu’à présent l’organisation générale des SATT était la même pour toutes. Des différenciations et des adaptations vous paraîtraient-elles justifiées ?
M. Yves Lévy. La situation telle que je l’ai trouvée en arrivant à l’Inserm le 12 juin est la suivante. Il existe actuellement 14 SATT. L’Inserm a réglé les problèmes de convention et de lettre d’intention avec sept d’entre elles ; il en est désormais actionnaire, avec un niveau de partenariat qui varie de 1 % à 13 %. Le chiffre de 13 % est le plus élevé et concerne la SATT Île-de-France INNOV (Idfinnov) pour laquelle la discussion a présenté quelques complexités à cause du périmètre et du type de portefeuille de cette SATT par rapport au terrain d’Inserm Transfert, qui est celui de la biologie santé.
Inserm Transfert est impliqué dans d’autres SATT, notamment celles en cours de création à Saclay et Grenoble. L’objectif de l’Inserm est d’être partenaire de l’ensemble des SATT à travers Inserm Transfert. Il y aura ainsi un accord, une lettre d’intention et une discussion avec chaque SATT en vue d’en être partenaire et/ou actionnaire. Pour chacune des SATT, la discussion porte ou a porté sur la répartition des tâches, des activités et éventuellement des retombées entre Inserm Transfert et ses partenaires.
Plusieurs modèles sont possibles. Un premier modèle consiste à garder les missions de chacune des structures. Les SATT doivent alors jouer le rôle pour lequel elles ont été créées, c’est-à-dire celui de la maturation des projets. Il y a alors une complémentarité évidente entre les SATT et une structure comme Inserm Transfert qui a une expérience, depuis sa création en 2002, de proximité avec les chercheurs pour faire remonter les brevets, défendre les accords de consortium et travailler à la valorisation de ces brevets.
De plus, une troisième composante, Inserm Transfert Initiative (ITI) est liée au PIA, et a bénéficié de financements du fonds national d’amorçage.
Un processus vertueux peut donc se mettre en place : la répartition du portfolio de la propriété intellectuelle et académique avec Inserm Transfert, l’intervention du fonds d’amorçage, et enfin celle de fonds de maturation, avec la SATT, lorsqu’il existe des accords à cette fin.
Inserm Transfert a décidé d’être partenaire de l’ensemble des SATT, sur la base de modèles discutés localement. Avec l’ensemble des SATT, les lettres d’intention sont en cours de signature ou ont déjà été signées. Cela montre que le dialogue est apaisé.
M. Thierry Damerval. Nous n’avons jamais été partisans du maintien de l’existant ; depuis l’origine, nous sommes partisans d’accompagner les SATT. Cependant les différentes SATT ne se sont pas forcément mises en place sur les mêmes bases ni selon les mêmes modèles et les mêmes rythmes, ni encore avec les mêmes objectifs. Dans le même temps, elles avaient besoin de s’installer rapidement pour démontrer la viabilité de leur modèle économique. Les discussions étaient donc compliquées.
Nous arrivons dans une phase où les bases sont clarifiées. Elles seront certes différentes selon les SATT mais comporteront une réelle répartition du travail et seront porteuses d’une réelle plus-value, au lieu de constituer un simple transfert d’activité ou de complexifier la situation des laboratoires. Désormais, il faut montrer aux laboratoires la plus-value apportée par chacun des différents partenaires.
M. Yves Lévy. Pour montrer l’intérêt porté par l’alliance Aviesan à la valorisation, j’ajoute qu’il existait une structure qui mettait en interaction l’ensemble des structures de valorisation des partenaires de l’alliance et qui s’appelait Covalliance. Cette structure a été la base du CVT Aviesan, financé par le PIA à hauteur de 9,3 millions, lors de la création de celui-ci. Ce CVT est un élément de valorisation important du fait de son rôle de fédérateur. Il vient en complément du travail de coordination et de mise en cohérence des programmes scientifiques. Enfin, il donne un bon reflet de la propriété intellectuelle académique puisqu’il concerne l’ensemble des acteurs académiques de l’alliance. Il mobilise aujourd’hui près de 140 personnes ; 16 industries reconnaissent le CVT Aviesan et en sont partenaires.
Le CVT Aviesan fonctionne sur des domaines de valorisation scientifique spécifiques sur lesquels l’ensemble des partenaires mettent leurs compétences et leurs brevets afin d’en assurer la lisibilité au niveau industriel. Cinq domaines de valorisation ont été définis, dont trois sont gérés par Inserm Transfert – vaccinologie, cancer et biomarqueurs. Il existe ainsi une réelle production du CVT Aviesan, production qui a été formalisée grâce au financement du PIA.
M. Thierry Damerval. J’ajoute que ce n’est évidemment pas de manière théorique que l’on peut mettre en évidence la complémentarité entre les SATT, Inserm Transfert et le CVT. Nous arrivons dans une phase où l’on pourra démontrer cette complémentarité grâce à des exemples très précis.
M. Yves Lévy. En conclusion, je rappelle les points de vigilance que j’ai soulignés dans mon propos introductif : pérennité des structures et des projets, devenir des personnels, simplification des modes de gouvernance, notamment dans certaines des nouvelles structures créées par le PIA.
Du fait de la multiplicité des structures, l’état des lieux que nous vous avons présenté est forcément parcellaire. Le PIA a eu indéniablement, en matière de biologie-santé, un effet structurant. Les financements au titre du PIA d’EQUIPEX, de cohortes ou de structures à grande échelle ont comblé des trous technologiques. Après cette phase de démarrage très enthousiasmante, nous avons trois ans pour conduire une réflexion sur l’avenir des structures ainsi créées.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Messieurs, je vous remercie.
Audition du 16 juillet 2014
À 16 heures 30 : M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Présidence de M. Patrick Hetzel, rapporteur
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur », la mission d’évaluation et de contrôle reçoit aujourd’hui M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Monsieur le directeur général, la filière nucléaire est l’une des trois filières – avec la filière spatiale et la filière aéronautique – à avoir été spécifiquement bénéficiaire des financements au titre des programmes d’investissement d’avenir : un milliard d'euros y a en effet été consacré.
Si l’opérateur de ces deux actions est le CEA, dont nous avons reçu l’administrateur général, M. Bernard Bigot, la direction générale de l’énergie et du climat en préside les comités de suivi.
Nos questions porteront donc sur le rôle de ces comités de suivi, et la place qu’y tient la DGEC.
Nous vous demanderons aussi le sentiment de la DGEC sur la mise en place du volet « valorisation » du PIA, et l’intérêt que ce volet peut présenter.
Nous nous interrogeons également sur l’après-PIA.
Je me dois enfin d’excuser l’absence du président Alain Claeys, retenu par la discussion du projet de réforme territoriale.
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, les deux premières actions financées du programme « Nucléaire de demain » ont été le réacteur Jules Horowitz et le projet ASTRID. Le CEA, pour le premier, s’est vu allouer 250 millions d’euros et, pour le second, 675 millions d’euros qui sont devenus 650 millions, une partie de cette somme ayant été affectée, après la catastrophe de Fukushima, à un nouvel axe de recherche : la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Ces deux subventions accordées au CEA visent à couvrir, pour le RJH, une partie des coûts de construction du réacteur, ainsi que des investissements complémentaires pour la production de radionucléides à usage médical et, pour le projet ASTRID, les investissements lourds pour mener les études de conception d’un prototype de réacteur à neutrons rapides, de quatrième génération, utilisant la technologie du sodium, jusqu’à l’avant-projet détaillé. En revanche, cette dotation ne couvre pas les coûts de personnel.
Un comité de suivi a été mis en place pour les deux conventions. Présidé par la direction générale de l’énergie et du climat, il compte des représentants du CEA, du CGI, du contrôle d’État et des administrations concernées, la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) pour le ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique, la direction du budget. Ces comités suivent la conformité de la réalisation des programmes par rapport à leur objet et contrôlent l’utilisation concomitante des crédits. Ils émettent des avis et recommandations, notamment concernant les validations de versements, préparatoires à la décision des services du Premier ministre, en l’occurrence le CGI.
Nous avons émis un certain nombre d’alertes concernant les retards d’exécution pris par le projet de RJH et les surcoûts consécutifs. Au-delà des ajustements normaux des options de sûreté, ce projet innovant a dû être précisé au fur et à mesure de son avancement. À la suite d’une de nos propositions, une décision interministérielle a prévu d’instaurer une revue de projet associant AREVA – maître d’œuvre –, et le CEA pour analyser les causes du retard et surtout les actions à engager pour le bon achèvement du projet. M. Bernard Dupraz – par ailleurs délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense –, à qui a été confiée la revue de projet, et qui s’est entouré d’experts d’AREVA et du CEA, vient de nous envoyer une étude très détaillée sur le projet, ses retards et ses surcoûts.
La situation du projet ASTRID – plus récent et situé plus en amont puisqu’il s’agit de concevoir un prototype – a fait l’objet en décembre 2012 d’une décision d’allongement de son calendrier, consistant en un lissage de deux ans des études d’avant-projet. Cette prorogation n’obéit pas à des considérations techniques de réalisation mais à une difficulté d’ordre budgétaire : malgré la subvention prévue par le PIA, nous ne parvenions pas à suivre en termes de ressources humaines – en effet les investissements d’avenir ne prennent pas les salaires en charge.
Ces projets sont suivis de près, même si c’est le CEA, qui en est le responsable et qui doit les conduire à terme, à charge pour le comité de suivi d’en valider le bon avancement et d’autoriser les versements de crédits.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Comment les décisions sont-elles prises au sein du comité de suivi ? Quel y est le rôle de votre direction générale, étant entendu qu’y siègent également des représentants du CGI ainsi que du CEA ?
M. Laurent Michel. Je préside pour ma part le comité de pilotage traitant des investissements d’avenir relatifs à la transition énergétique. Pour le reste, ce sont mes services qui président. Nous exerçons la présidence en même temps que nous apportons, comme les autres ministères, notre connaissance du domaine, sachant que les éléments techniques et d’avancement du projet nous sont fournis par le CEA. Il revient par conséquent aux administrations d’interroger le CEA soit sur un plan strictement financier soit sur le déroulement des projets. Ainsi, à force de constater les retards et les difficultés entre AREVA, le maître d’ouvrage et d’autres importants fournisseurs, l’administration a mis en place une revue de projet et un cahier des charges, élaborés avec la DGRI, la tutelle la plus présente avec nous sur le plan technique – la direction du budget s’occupe davantage, pour sa part, de l’aspect financier.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Pouvez-vous revenir sur la manière de fonctionner du comité de suivi, par exemple quand l’opérateur vous signale une difficulté ou des retards ? Ces questions sont-elles prises en compte par le comité ?
M. Laurent Michel. En ce qui concerne le projet ASTRID, nous ne notons pas de retard technique. Nous discutons de la faisabilité budgétaire ; même si celle-ci n’est pas un problème majeur, nous éprouvons en effet quelque difficulté à suivre le programme en matière de ressources mobilisables au stade des études de conception.
C’est plutôt pour le RJH que nous avons constaté des retards, des difficultés de compréhension et des surcoûts – on pointe un écart de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport aux estimations de 2005. Il est notamment apparu au comité qu’il fallait faire un point, d’une part, pour recaler les relations entre AREVA et le CEA pour finir le projet – un comité des sages a été institué à cet effet entre AREVA et le CEA – et, d’autre part, pour éclairer les administrations. C’est à cette fin qu’à l’issue de réunions interministérielles, il a été décidé, en janvier 2014, de créer une revue de projet afin d’évaluer la pertinence des actions proposées par le CEA et AREVA pour aboutir et d’établir les surcoûts à terminaison. Si le CEA et AREVA parviennent à un accord qui nous semble équitable sur la répartition du surcoût, l’affaire est tranchée. Sinon, l’État devra jouer un rôle médiateur ou bien y mettre de l’ordre. Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir de quelle manière répartir ces surcoûts, sachant que les investissements d’avenir ont une autre destination.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Estimez-vous que ces comités de suivi fonctionnent bien ou des éléments vous paraissent-ils perfectibles ?
M. Laurent Michel. Concernant les investissements d’avenir, ce n’est pas forcément sur le programme relatif au « Nucléaire de demain » que nous rencontrons le plus de difficultés en termes de fonctionnement ; nous en éprouvons davantage – car les concepts sont plus complexes – dans d’autres domaines, comme le soutien à l’innovation.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Dans le cadre du PIA, votre direction générale participe à d’autres comités de suivi. Pouvez-vous nous préciser lesquels et quel rôle elle y joue plus spécifiquement ?
M. Laurent Michel. Deux programmes s’ajoutent au « Nucléaire de demain », l’un sur les déchets, avec l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), l’autre – j’y ai fait allusion – créé au lendemain de la catastrophe de Fukushima, sur la recherche en sûreté nucléaire et radioprotection. Ce dernier est doté de 50 millions d’euros par redéploiement du programme ASTRID et du programme « Déchets ». Son comité de pilotage est présidé par la DGRI et par la direction générale de la prévention des risques au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – par ailleurs chargée de la sûreté nucléaire. La DGEC, qui n’est pas ici concernée au premier chef, n’est qu’un simple membre du comité de suivi. Un appel à projets a été lancé en 2012, vingt et un projets ont été sélectionnés, qui sont aujourd’hui en phase de contractualisation. Nous en assurerons le suivi.
Le programme concernant les déchets radioactifs était lui doté, initialement, de 100 millions d’euros. Après redéploiement, il l’est de 75 millions. La DGEC est ici présidente du comité de suivi dans lequel on retrouve le CGI, la direction du budget, la direction générale de la prévention des risques, la DGCIS et l’ANDRA. Nous avons procédé en plusieurs étapes. Un premier programme a été lancé pour une vingtaine de millions d’euros ; un appel à projets de R&D va être lancé à la fin de l’année, l’Agence nationale de la recherche (ANR) assurant la gestion des conventions. Ces programmes sont à la fois ciblés et assez modestes.
Pour ce qui est du programme de sûreté nucléaire et de radioprotection, nous abordons la phase de fin de contractualisation et de suivi. Je n’ai pas d’écho en la matière depuis ma participation au fonctionnement, compliqué, du comité de suivi. L’un des objectifs était d’élargir le programme de sûreté nucléaire au-delà des établissements de référence comme le CEA, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’ANDRA, etc…, d’où l’idée de lancer un appel à projets.
Par ailleurs, le PIA comporte un volet relatif à la transition énergétique, composé lui-même de programmes chapeautés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et par l’ANR. La DGEC est particulièrement impliquée dans deux programmes : celui, d’une part, où sont regroupés tous les appels à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ADEME sur les démonstrateurs industriels en termes d’énergie, d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de stockage et de réseaux intelligents ; et, d’autre part, le programme intitulé Instituts d’excellence en énergie décarbonnée, rebaptisés Instituts de la transition énergétique (ITE), équivalents dans le secteur énergétique des Instituts de recherche technologique. Nous sommes actifs au sein des deux comités de pilotage. Mes équipes sont en particulier mobilisées pour l’instruction des dossiers. Je préside le comité de pilotage des ITE qui se réunit deux ou trois fois par an, sans compter, bien sûr, les réunions préparatoires et le travail à distance par courriels – l’ANR organise des comités électroniques –, qui concernent surtout la validation des conventions ou l’examen du franchissement de certaines clauses contractuelles. Ces comités sont plutôt centrés sur l’aval. Pour ce qui est de l’amont, il y a eu une phase de sélection des ITE par un jury international. Et la contractualisation qui a suivi, en 2013-2014, a été marquée par plusieurs étapes : celle de la structuration de consortiums innovants, puisqu’il ne s’agit pas de projets ponctuels devant être réalisés par un maître d’ouvrage important, celle ensuite du montage du financement et de sa validation européenne, puisque l’État apporte son aide. Cela représente beaucoup de travail de rédaction et de notification pour les secrétariats de l’ANR et du CGI et nos services.
Les difficultés que nous avons rencontrées ne touchaient pas au fonctionnement. Pour les ITE, la nouveauté des actions s’est accompagnée d’un niveau d’exigence qui, s’il s’est révélé positif en matière de structuration, d’ambition économique, a pris un caractère un peu contradictoire, avec une demande de projets innovants mais dont on voulait être sûr qu’ils permettraient un bon retour sur investissement. Et si certains projets se sont caractérisés par la part de risque financier prise par des initiateurs bien préparés, d’autres projets ont souffert d’un sous-investissement industriel. La création de deux instituts a dû être abandonnée faute de combattants, ou d’une définition pertinente du projet. Le CGI a ainsi proposé l’abandon d’un institut, tout en réservant la possibilité que d’éventuels projets dans le domaine des sciences du sous-sol pour l’énergie puissent être réexaminés, et – sans qu’aucune garantie soit donnée – financés par d’éventuels redéploiement d’enveloppes.
Les appels à manifestation d’intérêt de l’ADEME, quant à eux, étaient plus classiques puisqu’il s’agissait de projets de démonstrateurs. Cependant, la répartition en dotation en capital, en avances remboursables, en subventions était parfois un peu trop décalée par rapport aux prises de participation. De plus, dans certains secteurs, les projets souhaités étaient tellement innovants qu’il n’a pas été possible d’en sélectionner, alors qu’on aurait pu se contenter d’innovations incrémentales. Les appels à manifestation d’intérêt, notamment pour les démonstrateurs industriels, ont cependant vraiment permis le lancement de projets innovants, en matière d’énergies thermiques des mers, de fermes pilotes hydroliennes, d’éolien, de stockage d’énergie, mais aussi de véhicules du futur.
Nous allons continuer sur cette voie puisque l’an dernier, le Parlement a voté un PIA 2 qui sera opérationnel en 2015 et prévoit à nouveau une ligne d’AMI pour la transition énergétique qui sera gérée par l’ADEME. À l’inverse, la ligne concernant les ITE n’a pas été reconduite, considérant que nous disposions désormais d’acteurs à même de constituer d’importants consortiums de recherche. Les comités de pilotage ont donc été un foyer de réflexion pour l’élaboration du PIA 2 – dont nous allons bientôt préparer les appels d’offres.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Pourquoi l’action « Recherches en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » a-t-elle été confiée à l’ANDRA et non au CEA ?
M. Laurent Michel. L’ANDRA a pour mission de gérer les déchets radioactifs, y compris ceux ne provenant pas d’installations nucléaires – on pense aux hôpitaux – et d’organiser les circuits de collecte. Elle dispose des installations de stockage nécessaires. Certes le CEA, établissement de recherche technologique et appliquée de haut niveau dans le domaine nucléaire, est susceptible, en tant que producteur et détenteur de déchets, de proposer des solutions. Mais c’est aussi le cas de groupes industriels comme AREVA. Il apparaît donc normal que l’ANDRA soit dépositaire de l’organisation de l’appel d’offres, auquel le CEA peut répondre. Nous nous sommes réunis avec M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, et Mme Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l’ANDRA, pour ajuster les actions des uns et des autres. Des laboratoires mixtes ANDRA-CEA tendent désormais à ne plus dépendre que de l’ANDRA.
Au total, l’attribution de l’action « Recherches en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs » à l’ANDRA me paraît assez logique. Elle n’a pas suscité de controverse particulière.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Parmi les outils développés dans le cadre du PIA, on relève les Initiatives d’excellence (IDEX), les Laboratoires d’excellence (LABEX) ou encore les Équipements d’excellence (EQUIPEX). Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été très impliqué en la matière par le biais de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et de la direction générale de la recherche et de l’innovation. La DGEC s’est-elle intéressée de la même manière à ces projets ?
M. Laurent Michel. Elle s’y est intéressée, mais réellement dans une moindre mesure. Au moment de la constitution des investissements d’avenir, vers 2009-2010, l’énergie a été concernée par le programme Instituts d’excellence en énergie décarbonnée et celui consacré aux démonstrateurs industriels. Les autres programmes ne l’ont pas touchée. Nous savons que certains établissements publics dont nous avons la tutelle ont pu participer à quelques LABEX ou EQUIPEX, mais nous n’avons pas été fortement impliqués dans leur suivi.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Je vous propose d’en venir à la valorisation de la recherche et à l’innovation. Quelle appréciation portez-vous sur les consortiums de valorisation thématiques (CVT) ?
M. Laurent Michel. Le CVT que nous connaissons le mieux est le CVT ANCRE (Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie). Plusieurs établissements publics dont il relève sont sous notre tutelle. Nous avons jugé intéressant de renforcer les échanges et la coordination sur la recherche. Depuis le mois de février, l’Alliance nous invite à son comité de coordination, auquel nous participons. Nous avons ainsi pu prendre connaissance des actions du CVT, et notamment d’un certain nombre d’études qu’il a réalisées. Le CVT ANCRE tâche de mener une réflexion stratégique d’intelligence scientifique, technique et économique mutualisée. Identifier les grands déterminants technologiques et économiques de tel ou tel sujet, en termes d’analyse stratégique, apparaît intéressant pour des établissements comme l’Institut français du pétrole-énergies nouvelles (IFP-EN), le CEA, le CNRS, qui font déjà beaucoup de valorisation. Nous avons fait savoir que nous étions très preneurs d’une poursuite des discussions sur les études en cours, pour en connaître les résultats, et sur les futurs programmes d’études, pour lesquels nous envisageons aussi de faire des propositions.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Considérez-vous que, dans votre domaine, les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) jouent bien leur rôle ? Sinon quelles orientations suggérez-vous ?
M. Laurent Michel. La DGEC connaît surtout l’activité de valorisation des établissements avec lesquels elle travaille plus étroitement, l’action des ITE ou les plateformes régionales de transfert de technologies du CEA. Je ne saurai donc vous faire part d’un jugement pertinent sur les SATT.
L’articulation de ces structures régionales avec les structures de transfert mises en place par d’autres, dont les grands établissements, implique qu’au niveau local un grand établissement parvienne à faire dialoguer sa propre structure et la SATT. Il s’agit de tout un art d’exécution.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Quel regard portez-vous sur les IRT, les ITE et les Instituts Carnot ?
M. Laurent Michel. En ce qui concerne les ITE, nous nous tenons à l’objectif que nous avons affiché depuis plusieurs années : rapprocher de manière pérenne – sans toutefois créer des dinosaures administratifs – des consortiums industriels et le secteur public. L’ambition était grande et tous les ITE n’étaient pas prêts. Au bout d’un an de contractualisation, les premiers comités de suivi commencent à se tenir. L’essai reste donc à transformer et nous y veillons de près.
Les IRT, pour leur part, ne relèvent guère de notre domaine de compétences, à l’exception peut-être d’un ou deux comme l’IRT Jules-Verne où nous avons examiné la possibilité d’un lien avec les énergies marines.
Quant aux Instituts Carnot, ils sont le fruit d’une politique plus ancienne et différente visant à récompenser et soutenir les universités ou autres établissements publics qui réalisent de la recherche appliquée, en leur attribuant ce qu’on appelle des subventions de ressourcement. Au sein des écoles des mines, que je connais bien, le système des Instituts Carnot commence à se mettre en place. Il est apprécié et donne certains résultats. Il s’agit de bien montrer l’importance de la valorisation par rapport à d’autres critères d’évaluation des établissements de recherche comme les publications.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Pour vous, quels sont les points sur lesquels il convient de rester le plus attentif pour le lancement du PIA 2 ? En quoi le PIA 2 peut-il prolonger le PIA 1 et l’améliorer ? Comment optimiser les procédures et la gestion du temps ?
M. Laurent Michel. Dans la réalisation du PIA 1, on a pu déplorer une certaine lourdeur et une certaine lenteur des instructions – même pour dire « non ». Il y a deux mois, nous nous sommes réunis avec CGI et l’ADEME sur les AMI afin de simplifier le processus d’instruction sans pour autant diminuer le niveau d’exigence. Certaines questions peuvent ne pas être traitées en comité de pilotage mais par voie électronique, d’autres déléguées à l’ADEME.
Les actions à financer par le PIA 2 ont été définies lors de l’élaboration du projet de loi de finances. L’enveloppe de 2,3 milliards d’euros consacrée à la transition énergétique est divisée en plusieurs programmes, qui en recouvrent tous les thèmes : rénovation urbaine, véhicules du futur, économie circulaire, santé et environnement, eau et biodiversité… Il va désormais falloir procéder à un calage financier au sein des différents programmes existants, et déterminer ceux qui doivent être arrêtés, ou encore identifier des programmes très innovants, éventuellement apparus depuis le lancement du PIA 1, qui valent qu’on lance un AMI, comme ce sera éventuellement le cas pour des fermes pilotes « éolien flottant ». Un comité de pilotage a commencé, en fonction de propositions de l’ADEME, à réfléchir aux priorités à soumettre aux ministres de l’écologie, de l’économie… et, in fine, au Premier ministre. Ainsi, dès cet automne, pourrons-nous enchaîner sur la préparation des nouveaux AMI.
Nous devons en outre examiner s’il n’est pas nécessaire d’assouplir quelque peu la distinction entre prise de participation, avance remboursable et subvention, notamment en cas d’intervention au profit de PME.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Au moment où le rapport Juppé-Rocard proposait de mettre en place le PIA, l’idée était qu’il devait rester ponctuel, destiné à créer en France un élan autour de grands projets en matière de recherche et d’innovation. Qu’en pensez-vous ? Considérez-vous qu’il s’agit bien d’un programme exceptionnel même si le PIA 1 a vocation à être suivi d’un PIA 2 ? Ou bien percevez-vous la nécessité d’une forme d’institutionnalisation de ce mode d’intervention ?
M. Laurent Michel. Votre question est multidimensionnelle : les PIA 1 et 2 couvrent de nombreux secteurs.
En matière de transition énergétique, le PIA a été l’occasion d’une formalisation et d’une accélération des ambitions en ne passant pas uniquement par les dotations budgétaires classiques des grands établissements spécialisés – le CEA, l’IFP-EN… – qui conservent évidemment toute leur importance. Le PIA a permis d’impulser des dynamiques, de rapprocher le public et le privé et de stimuler l’innovation industrielle à un moment où l’on sait le paysage très mouvant – tout ce qu’on entreprend ne fonctionnera pas même s’il reste des enjeux industriels et économiques en lesquels nous pouvons croire : nous ne sommes pas dénués d’atouts, notamment en matière d’énergies marines, qu’il s’agisse de l’énergie thermique des mers ou de l’énergie mécanique comme les hydroliennes. En outre, les marchés concernés sont mondiaux ; si nous développons les éoliennes flottantes, c’est aussi pour les vendre au Japon.
Le PIA a permis à la DGEC de tracer des feuilles de route sectorielles allant de l’innovation jusqu’au déploiement. Il est important que soit défini un second PIA visant, pour les trois ans à venir, à continuer de soutenir l’innovation.
Ensuite, il est vrai que, après qu’il ait été affirmé que le PIA ne se substituait pas au budget général, on peut constater que certains domaines, sans le PIA, se trouveraient dans une impasse. S’il n’a pas « arrosé » de façon uniforme tous les domaines de recherche, le PIA a pris une importance volumique qui n’était pas prévue. L’état d’esprit d’un programme exceptionnel n’en a pas été perdu pour autant, entre ciblages, accélérations, réorientations… Ainsi, quand on s’est rendu compte qu’il fallait « doper » les installations de banques de recherche pour les véhicules électriques, le PIA a lancé un AMI à cette fin. Le PIA n’a certes pas la même vocation que le plan de relance de 2009 ; il en a néanmoins, de facto, dans certains secteurs, quelques traits en matière de soutien de l’activité de recherche et d’innovation.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Je vous remercie pour votre franchise et pour la précision de vos réponses. Nous nous étions bien rendu compte de la tentation de substitution, ça et là, à laquelle vous venez de faire allusion. Ainsi, même un ministère comme celui de la défense lorgne du côté du PIA, pensant peut-être y trouver une partie du financement de sa recherche.
Audition du 16 juillet 2014
À 17 heures 30 : M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT (sociétés d’accélération du transfert de technologies) et président de la SATT Sud-Est, M. Christian Estève, secrétaire de l’association des SATT et président de la SATT Île-de-France Innov, Mme Maylis Chusseau, présidente de la SATT Aquitaine Sciences Transfert, M. Vincent Lamande, président de la SATT Ouest Valorisation et M. Nicolas Carboni, président de la SATT Conectus Alsace.
Présidence de M. Patrick Hetzel, rapporteur
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d'investissement d'avenir relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur », la mission d'évaluation et de contrôle reçoit aujourd'hui l’association des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).
Les sociétés d’accélération du transfert de technologies constituent un élément nouveau dans le paysage de la valorisation française. Non moins de 900 millions d’euros leur sont alloués dans le programme d’investissements d’avenir. La mission d’évaluation et de contrôle s’intéresse en particulier à leur champ d’activité géographique, à l’articulation de leur action avec celles des grands organismes de recherche tels que le CEA, l’Inserm ou le CNRS et à l’objectif de rentabilité qui leur a été fixé.
Je dois excuser le président Alain Claeys, retenu par le débat sur la réforme territoriale. Comme à l’accoutumée, la Cour des comptes nous accompagne. Elle a élaboré des analyses et formulé des préconisations sur les investissements d’avenir.
M. Olivier Fréneaux, président de l’association des SATT et président de la SATT Sud-Est. La présente délégation est représentative des douze premières SATT, créées depuis deux ans et demi. Les treizième et quatorzième SATT ont été créées ces jours-ci – la quatorzième vient de tenir son assemblée générale constitutive cet après-midi.
La création des SATT répond à un triple besoin. D’abord, la mutualisation de différents opérateurs de valorisation devait simplifier un paysage du transfert de technologie trop émietté. En effet, en France, les structures de valorisation, adossées à une multitude d’universités et d’organismes de recherche, étaient plus petites que la moyenne européenne. La création de sociétés professionnelles dotées de compétences multiples sur un territoire permet de dépasser ce problème de taille sous-critique.
Ensuite, le transfert de technologie doit s’accélérer. La création de structures professionnelles de droit privé, contrôlées par l’État – représenté par la Caisse des dépôts et consignations – et par les grands organismes universitaires et de recherche permet la réactivité nécessaire à cette accélération.
Se pose enfin le problème récurrent, et non spécifiquement français, de la « vallée de la mort », c’est-à-dire du comblement de l’écart entre le résultat de la recherche juste issu du laboratoire et le produit qu’attend l’entreprise pour investir. La maturation juridique, commerciale, économique et technologique d’une découverte prend du temps et elle n’atteint pas toujours le niveau suffisant pour permettre à une entreprise de prendre le relais.
Le programme d’investissements d’avenir a alloué des moyens importants aux SATT, puisqu’il leur consacre neuf cents millions d’euros. C’est une somme sans équivalent dans le monde pour un dispositif de maturation. Aujourd’hui, les tech transfer offices étrangers nous envient les sociétés d’accélération du transfert de technologies.
Les SATT ont pour finalité de transformer les résultats de recherches en laboratoire en innovations dans les entreprises. Leur objectif est ainsi de développer la compétitivité des entreprises française et la création d’emplois – objectif qu’elles partagent notamment avec les pôles de compétitivité. Grâce à la mutualisation des moyens, mais aussi à la mise en place d’interlocuteurs uniques, les SATT ont simplifié le paysage de la valorisation : cent cinquante établissements de recherche, dont la très grande majorité des universités, ont confié l’exclusivité de leur transfert de technologie aux douze sociétés d’accélération du transfert de technologies.
Le dispositif est encore jeune. Les SATT les plus anciennes, comme Conectus Alsace, n’ont que deux ans et demi d’existence ; deux d’entre elles n’ont que quelques mois et les deux dernières se créent cette semaine. Par le biais de l’association des sociétés d’accélération du transfert de technologies, récemment fondée, nous nous entraidons, nous nous coordonnons et nous partageons les bonnes pratiques.
En deux ans et demi, grâce à une proximité forte avec les chercheurs, plus de 2 500 projets ont été détectés en laboratoire. Après cette détection, plus de 400 brevets – qui appartiennent aux établissements actionnaires – ont été déposés. Plus d’une centaine de licences d’exploitation de logiciel, de savoir-faire ou de brevet ont été signées.
Aujourd’hui, les douze SATT – et non seulement quelques-unes – se sont bien intégrées dans leur écosystème économique. Les relations sont étroites avec les régions, qui disposent d’un poste d’observateur dans leur conseil d’administration. À Conectus, un siège d’administrateur de plein exercice est même réservé à la Région. Une coopération s’est engagée avec les équipements d’excellence (Equipex), les laboratoires d’excellence (Labex), les instituts hospitalo-universitaires (IHU), les consortiums de valorisation thématiques (CVT), les instituts de recherche technologique... Chacun de ces partenaires a sa propre mission, son propre positionnement. Dans ce paysage, les SATT s’affirment comme les outils de valorisation de ces structures.
Quant à nos liens avec les organismes publics de recherche, le CNRS est actionnaire de toutes les SATT et leur a confié l’exclusivité de la valorisation de ses découvertes. Les relations avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) se normalisent. Sa filiale Inserm Transfert existait déjà. Il fallait donc que les SATT s’articulent avec elle sur les territoires où sont installées des unités de recherche de l’Inserm. De ce fait, selon les cas, l’Inserm est parfois actionnaire, parfois partenaire des SATT. La dynamique avec l’Inserm est positive.
En revanche, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), mais aussi d’autres organismes thématiques, comme l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou l’Institut national de recherche en informatique en automatique (INRIA), se sont tenus à l’écart des SATT. Aujourd’hui, nous entamons des discussions avec ces organismes pour accompagner au cas par cas la maturation de projets qu’ils voudraient nous confier.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Qu’ont apporté de nouveau les SATT ? Comment accélèrent-elles le transfert technologique ? À l’heure où une course contre la montre du développement technologique est engagée au niveau mondial, il est vital que notre recherche publique, de très grande qualité, irrigue le secteur industriel et participe à la création de richesses.
Mme Maylis Chusseau, présidente de la SATT Aquitaine Sciences Transfert. Les sociétés d’accélération du transfert de technologies ont trouvé naturellement leur place dans la chaîne de valorisation, en s’articulant avec les autres acteurs qui se structurent et s’installent.
Les consortiums de valorisation thématique (CVT) ne sont pas des structures de valorisation. En complémentarité avec les SATT, ils constituent cependant un outil précieux d’intelligence économique à l’échelle nationale. Ainsi, le CVT Aviesan a pu lancer avec les SATT un appel à manifestation d’intérêt national en épigénétique et cancer, après avoir défini ce domaine comme stratégique au niveau national.
France Brevets, qui créé de la valeur par agrégation de portefeuilles, constitue un autre outil de valorisation complémentaire aux SATT. En 2013, toutes les SATT ont signé une convention avec France Brevets, afin de pouvoir être apporteurs d’affaires pour des opérations d’agrégation de brevets. La société Ouest Valorisation a ainsi coopéré avec France Brevets pour le transfert d’un titre.
En amont de la recherche, les sociétés d’accélération du transfert de technologies sont la structure de valorisation des laboratoires d’excellence (Labex) et des équipements d’excellence (Equipex) et s’articulent avec les Idex, qui font partie de leurs actionnaires. Grâce aux collaborations et aux partenariats avec ces acteurs dans leur territoire, les SATT protègent le patrimoine intellectuel issu du programme d’investissements d’avenir.
Les relations avec les instituts hospitalo-universitaires (IHU), et, en aval des laboratoires de recherche, avec les instituts de recherche technologique (IRT) et les instituts de transition énergétiques (ITE) sont de quatre types.
D’abord, une société d’accélération du transfert de technologies peut être prestataire de service d’un institut de recherche technologique, comme à Toulouse où la SATT a apporté son expertise juridique à Toulouse Tech Transfert. Ensuite, les SATT peuvent être clientes d’un institut de recherche technologique, quand elles en utilisent les moyens techniques pour affiner une découverte et la rapprocher du marché. Un investissement en commun est également possible. Enfin, comme à Bordeaux, une société d’accélération du transfert de technologies peut assurer l’ensemble de la valorisation pour le compte d’un institut hospitalo-universitaire.
Des liens existent aussi avec les instituts Carnot. Les instituts Carnot, dont la mission est de développer la recherche en partenariat, ne sont pas des structures de valorisation. Selon les cas, les partenaires avec qui ils développent leurs recherches ne sont pas liés aux actionnaires des SATT ou sont, au contraire, situés dans le périmètre d’action de ceux-ci. Dans ce cas, la société d’accélération du transfert de technologies est naturellement la structure de valorisation de l’institut Carnot.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Quels sont les effectifs employés dans les SATT ?
M. Olivier Fréneaux. Les SATT emploient des salariés permanents et des salariés non permanents. Les salariés permanents sont des professionnels du transfert. Ils disposent de compétences juridiques – en propriété intellectuelle notamment –, en gestion de projets, mais aussi en commercialisation et en marketing. Les salariés non permanents sont recrutés pour réaliser un projet donné. Les SATT emploient quelques dizaines de salariés permanents ; celle que je préside en compte quarante et un. Au total, ce sont 350 personnes qui sont employées à titre permanent dans les SATT.
Mme Laure Fau, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Les salariés non permanents sont-ils employés à des projets de maturation particuliers ?
M. Olivier Fréneaux. Oui, ils sont recrutés sur contrats à durée déterminée, comme le permet la forme privée des SATT.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Parlons maintenant de vos actionnaires et de votre structure capitalistique.
M. Christian Estève, secrétaire de l’association des SATT et président de la SATT Île-de-France Innov. Les SATT sont construites sur le même modèle. Chaque SATT est dotée au départ d’un capital de un million d’euros, dont l’État apporte un tiers par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, le reste étant réparti entre les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) – aujourd’hui, de plus en plus, les communautés d’universités et d’établissements (COMUE) – et les grands organismes de recherche. Le CNRS est présent dans la quasi-totalité des SATT et l’Inserm dans la moitié environ, son affectio societatis dépendant de la présence ou non de laboratoires de recherche de l’Inserm en sciences de la vie sur le territoire de la SATT concernée.
Le conseil d’administration reflète le plus fidèlement possible l’actionnariat de la SATT. L’État jouit d’un droit de veto sur les décisions.
Il faut distinguer la dotation en capital de départ des dotations ultérieures en compte courant. Le montant de celles-ci est calculé en fonction du potentiel de recherche du territoire sur lequel la SATT est implantée – mesuré en dépense intérieure de recherche et développement des administrations (DIRDA) ou de dépense intérieure en recherche et développement des entreprises (DIRDE) –, mais aussi en fonction du succès des brevets déposés sur ce territoire.
Les dotations en compte courant varient de trente à soixante-dix millions d’euros sur dix ans. Tous les trois ans, une nouvelle tranche est versée, à l’issue d’une révision fondée sur la satisfaction de critères de poursuite de l’activité (go-no go). Les cinq premières sociétés créées seront ainsi évaluées en fin d’année sur ces critères, avant le passage à la deuxième étape.
Mme Laure Fau, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Puisque ce passage de jalon est proche, quelles sont vos perspectives ? Les paiements se situent-ils dans l’épure initialement prévue ?
M. Christian Estève. Oui, la situation se présente bien et nous remplissons globalement les objectifs de la première tranche, qu’il s’agisse des déclarations d’inventions de brevet ou des licences concédées.
M. Olivier Fréneaux. La première tranche de versements avait pour objectif la mise en place et le démarrage du partenariat entre, d’une part, les structures privées que sont les SATT, et, d’autre part, le monde de l’université et de la recherche, avec les organismes de recherche et les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Si la confiance a mis du temps à s’instaurer, pour les cinq premières sociétés créées – et bientôt pour les douze premières – toutes les conventions entre les actionnaires et les sociétés sont désormais signées, les procédures établies et les comités d’investissement, comités indépendants qui rendent un avis consultatif sur l’ensemble des projets financés, constitués. Le lancement est donc terminé.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Quels sont les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre des SATT et, a contrario, ceux qui ont pu être des freins ? Quelles leçons tirer de ces mises en place ?
M. Nicolas Carboni, président de la SATT Conectus Alsace. Le premier facteur de facilitation est la confiance générée par l’ancienneté des relations entre les acteurs de recherche publique sur un territoire donné ; depuis 2006, ces relations pouvaient s’inscrire dans le cadre d’un dispositif mutualisé de transfert de technologies, un DMTT : les SATT qui ont pu s’appuyer sur les équipes ainsi mises en place sont parties avec une longueur d’avance. L’interaction des partenaires du DMTT avec les autres acteurs de l’écosystème, tels que les incubateurs, les pôles de compétitivité ou les agences de développement, a pu jouer un rôle similaire : dans ce cas aussi, la SATT a relayé, sous une forme plus élaborée, une dynamique préexistantes.
Les écosystèmes sont par ailleurs d’une complexité variable. Sur un territoire de dimension modeste, comme l’Alsace, la convergence est facilitée par le nombre relativement restreint d’acteurs ; il en va bien entendu tout autrement dans des zones comme Saclay.
La création d’une SATT ex nihilo, sans dynamique préexistante, suppose aussi plus de temps car il faut installer la confiance entre les acteurs et constituer des équipes nouvelles.
Le choix de certains périmètres géographiques a également eu un impact. L’association de la Bretagne, où beaucoup de projets avaient vu le jour, avec les Pays de la Loire, où la dynamique était moindre, a logiquement demandé un peu de temps.
Enfin, si les principes qui ont présidé à la création des SATT ont été acceptés au départ – à la faveur des crédits mis sur la table, il faut bien le dire –, des difficultés ont pu émerger lors de la négociation des accords-cadres, lorsque l’historique n’était pas suffisant ou la confiance pas encore établie : cela a pu avoir un effet retardateur ici ou là.
Cela dit, ces difficultés sont aujourd’hui, sinon surmontée, du moins en passe de l’être.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Le climat de confiance paraît en effet essentiel ; beaucoup d’acteurs nous l’ont dit. Avez-vous identifié des moyens de le créer ?
M. Vincent Lamande, président de la SATT Ouest Valorisation. Le premier levier est de convaincre les établissements de recherche, car nous travaillons d’abord pour eux. La démonstration qui leur a été faite qu’une mutualisation des compétences était possible a accéléré la mise en place de la SATT que je préside.
De même, il nous a fallu montrer que notre champ de compétence se limitait à la valorisation de la recherche et au transfert des technologies, et nous imposait donc de nous insérer dans un écosystème : le conventionnement, dont on a beaucoup parlé, a montré la capacité des SATT à le faire. Il va de soi, en effet, que le transfert de technologies, qui débouche sur la création d’entreprises, n’est possible qu’en partenariat avec les technopoles, les incubateurs et les investisseurs en capital-risque – la SATT Ouest Valorisation a ainsi signé une convention avec le fonds Grand Ouest Capital Amorçage. L’insertion se traduit aussi dans l’organisation concrète : les structures de l’écosystème siègent dans les SATT, notamment au sein des comités d’investissement où elles accompagnent nos laboratoires partenaires dans la conduite de projets de transferts de technologies ou de création d’entreprises. Nous avons passé des conventions avec des centres techniques ou des centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT). Ces derniers constituent des relais importants, dans les régions, pour les entreprises sous-dotées en capital immatériel, que les SATT ont précisément vocation à générer via la propriété industrielle. Le défi est de hisser le niveau technologique des inventions afin de développer la compétitivité des entreprises dans les territoires, au bénéfice de l’emploi.
Lors de l’élaboration des avant-projets sommaires des SATT, auxquels certains d’entre nous ont participé, on ne s’était sans doute pas suffisamment interrogé sur la manière d’associer les régions et les métropoles ; nos démarches en ce sens ont permis, là aussi, d’installer un climat de confiance. Nos objectifs ne se limitent pas à soutenir des projets rentables à dix ans : ils sont aussi de développer la compétitivité dans les régions, selon des feuilles de route qu’elles définissent elles-mêmes dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente dites « S3 » – smart specialisation strategy – ou des priorités définies par les métropoles.
M. Olivier Fréneaux. Le climat de confiance se crée d’abord avec les chercheurs ; ils sont présents sur toute la chaîne du transfert. La proximité géographique facilite les choses sur ce plan.
M. Christian Estève. Je vois deux raisons au succès de la SATT Île-de-France Innov, qui va d’ailleurs croissant. D’abord, cette SATT – communément appelée SATT de la ligne A du RER car elle couvre un territoire qui s’étend de Cergy-Pontoise à Marne-la-Vallée – a constitué le premier instrument fédérateur des COMUE. La première demande de la COMUE récemment créée à Cergy-Pontoise a d’ailleurs été d’être actionnaire de la SATT.
Ensuite, les difficultés que notre SATT avait rencontrées, au départ, avec Inserm Transfert tenaient à un sentiment de concurrence frontale, car nous avions à travailler sur les mêmes sujets. Or, même un an et demi après, nous ne couvrons réellement que la moitié de notre territoire : le potentiel est donc considérable. Par ailleurs, nous intervenons très en amont, dès la maturation des projets, contrairement à l’Inserm. Enfin, on s’est aperçu que la dispersion des efforts faisait perdre du temps ; or la vitesse d’exécution est essentielle aux projets. Au-delà de nos objectifs respectifs, il fallait trouver de nouvelles formules pour réaliser notre l’objectif global : la multiplication des brevets, des maturations et des projets, et ce dans les temps les plus courts possibles. Tels sont les éléments qui ont permis de corriger le tir et de créer une véritable affectio societatis.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Vos SATT auraient-elles pu voir le jour sans le PIA ?
M. Christian Estève. Trois fois non. Nous évoluons dans un secteur caractérisé par le risque économique ; or il n’existe pas d’outil, en France, pour assurer le financement des projets depuis la sortie du laboratoire jusqu’aux entreprises : nombre de ces projets se perdent, et lorsqu’ils ne se perdent pas, ils s’exilent. Dans le monde anglo-saxon au contraire, des structures, comme les family offices, assument de tels risques. Sans le financement qui leur a été affecté au titre du PIA, les SATT n’auraient jamais pu être constituées.
Si elle est considérable, l’enveloppe dédiée du PIA, 900 millions d’euros, est correctement dimensionnée au vu du potentiel de projets – à charge pour nous de trouver les bons.
M. Nicolas Carboni. L’enveloppe allouée sur dix ans à chacune des SATT représente 1 % de la dépense intérieure de recherche et développement des administrations (DIRDA) sur le territoire considéré. D’autre part, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement ont clairement identifié la maturation comme un enjeu stratégique : en ce domaine, elles élaborent actuellement des programmes, dotés de financements considérables. Elles ont aussi reconnus l’originalité et l’intérêt de la politique française.
M. Olivier Fréneaux. Les SATT valorisent les projets de deux façons : soit par le transfert vers une entreprise existante, soit à travers la création d’une jeune entreprise innovante, création qui nécessite des investissements. Ceux-ci peuvent provenir de fonds privés ou semi-publics ; le PIA comporte à cet égard un outil, le Fonds national d’amorçage, doté de 600 millions d’euros. Mais les SATT prennent plus de risques encore car elles investissent avant même la création de l’entreprise : aucun investisseur privé n’est positionné aussi en amont dans la chaîne de transfert.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Quel regard portez-vous sur l’objectif, assigné aux SATT dans le cadre du PIA, d’assurer leur rentabilité à un horizon de dix ans ?
M. Vincent Lamande. Cet objectif nous semble essentiel, même s’il n’est pas le seul : la raison d’être des SATT, au fond, est de contribuer à la compétitivité des entreprises. Pour concilier ces deux objectifs, nous devons trouver un équilibre dans notre portefeuille de projets. Certains d’entre eux auront une faible rentabilité mais un impact économique sensible sur le territoire ; pour les financer, et afin de partager les risques, les SATT feront appel aux collectivités ou à des investisseurs privés. D’autres projets, à rentabilité plus élevée, permettront quant à eux un retour sur investissement accru.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Le développement des transferts technologiques a vocation à créer des emplois. De ce point de vue, peut-on évaluer les SATT selon d’autres critères que celui de la rentabilité financière ? Le rapport Juppé-Rocard, ne l’oublions pas, avait également en vue la compétitivité de la France et sa réindustrialisation.
M. Vincent Lamande. Je réponds résolument par l’affirmative à votre question. Nos plans d’affaires sont validés par le comité de gestion des SATT : ils tracent donc notre feuille de route. Toutefois, la finalité des SATT n’étant pas de réaliser des profits, d’autres indicateurs sont à prendre en compte, comme le pourcentage de transfert de technologies en région ou, comme vous venez de le suggérer, la création d’emplois directs ou indirects, via le transfert de technologies vers des PME existantes ou des start-up naissantes. De tels indicateurs ne sont pas constitutifs de notre feuille de route aujourd’hui, mais pourront l’être dans le cadre de nos discussions avec de nouveaux actionnaires, au premier rang desquels les collectivités.
M. Christian Estève. Bien sûr, nous devons respecter l’objectif de rentabilité voué à garantir notre autofinancement à dix ans. Cependant nos responsabilités en matière de création d’emplois et de développement économique et industriel sont à placer au même niveau. Pour ce qui nous concerne, nous ne hiérarchisons pas ces deux objectifs.
M. Olivier Fréneaux. N’oublions pas que les SATT sont jeunes : il est beaucoup trop tôt pour évaluer nos portefeuilles en fonction du critère de la rentabilité à dix ans ; comme l’a rappelé M. Lamande, à ce stade, nous suivons notre feuille de route.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. J’entends cette invitation à une évaluation ex post plutôt qu’ex ante…
Mme Laure Fau. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) ont une organisation nationale, avec des unités mixtes de recherche (UMR) localisées partout sur le territoire. Comment les SATT peuvent-elles prendre en compte cette dimension nationale ? Dans certains domaines stratégiques, il peut être nécessaire de s’appuyer sur les inventions de différentes UMR.
M. Nicolas Carboni. Cette question a été soulevée lors de la création des SATT, notamment dans le cadre des discussions avec le CNRS et l’Inserm. Non seulement l’articulation a été définie dans les accords-cadres, mais elle prend désormais vie au quotidien : au sein de chaque SATT a été mis en place un comité qui examine toutes les déclarations d’invention et les brevets, en associant, dans la SATT concernée, le CNRS et l’Inserm. C’est la première fois que l’ensemble des acteurs de la recherche publique, sur un territoire donné, voient passer tout le flux de brevets.
À l’issue de cet examen, les SATT identifient les opérateurs susceptibles, au vu de leur capacité d’expertise, de prendre un mandat de valorisation. En Alsace comme ailleurs, la SATT investit dans des programmes de maturation dont la gestion du titre et la valorisation sera assurée par tel ou tel de ces opérateurs – le CNRS ou l’Inserm, par exemple – en fonction de son expertise ou d’une grappe de brevets qu’il détient déjà. Bref, cette articulation entre un acteur de terrain, en contact quotidien avec les équipes de recherche, et une logique stratégique de priorités définie par un opérateur national est aujourd’hui effective.
M. Olivier Fréneaux. Si nous nous sommes réunis en association, c’est aussi pour regrouper des technologies issues de différentes régions et proposer des offres communes aux entreprises. Dans plusieurs régions, des PME ou des ETI souhaitent que la SATT régionale assure le relais avec les autres SATT : si elles sont heureuses d’avoir un interlocuteur qui représente tous les laboratoires de recherche de la région, elles appellent de leurs vœux un interlocuteur national. Au sein de notre association, nous développerons cette dernière dimension dans les prochains mois, notamment à travers la création d’un portail d’offres de technologies. Un forum des SATT, auquel vous serez bien entendu invités, devrait être organisé courant novembre en région parisienne ; nous y présenterons nos réalisations concrètes.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes animés par une réelle motivation ; notre plus grande satisfaction est d’entendre, très régulièrement, les entreprises se féliciter de notre existence et de notre action.
M. Patrick Hetzel, rapporteur, président. Merci pour cet échange riche et dense, et bon vent aux SATT ainsi qu’à leur association, qui peut en effet les constituer en réseau et, ce faisant, contribuer à l’émergence d’une vision nationale.
Audition du 24 septembre 2014
À 17 heures 30 : Audition de M. Roger Genet, directeur général pour la recherche et l’innovation au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, accompagné de M. Pierre Valla, adjoint au directeur général.
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Dans le cadre de ses travaux sur la gestion des programmes d’investissement d’avenir relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur, la mission d’information et de contrôle de la commission des finances reçoit M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation (DGRI) au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Monsieur le directeur général, merci d’avoir répondu à notre invitation. Le rôle du ministère chargé de la recherche est en effet essentiel dans la gestion des programmes d’investissement d’avenir (PIA) puisque c’est lui qui préside les comités de pilotage de chaque action conduite au titre des PIA. Nous sommes donc très désireux de recueillir le fruit de votre expérience et vos réflexions sur la conduite de ces actions.
Au-delà de la gestion des PIA dans la durée, la MEC s’intéresse aussi à la cohérence des financements de la recherche entre programmes d’investissements d’avenir et crédits budgétaires, à l’influence des PIA sur les dispositifs de valorisation de la recherche et aux éventuelles modifications, par rapport à la procédure suivie pour les PIA1, que l’expérience pourrait suggérer pour les PIA2.
Elle s’intéresse aussi aux conditions dans lesquelles les dotations non consommables pourront être versées aux initiatives d’excellence (Idex) après la fin du PIA. En particulier, le ministère a-t-il réfléchi à des conditions spécifiques qui pourraient encadrer la dépense de ces dotations ?
M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le PIA apporte des moyens extrabudgétaires très importants à la recherche dans une période critique, où nous avons besoin de faire évoluer notre système.
Ces investissements sont caractérisés par une multiplicité de dispositifs, destinés à favoriser le regroupement des opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, le développement de la valorisation, la promotion d’une recherche d’excellence, et à doter les investissements de taille intermédiaire pour lesquels les financements de base ne sont pas toujours suffisants. Ils représentent 11 milliards d’euros sur une dizaine d’années pour le périmètre enseignement supérieur et recherche, dont 4 milliards en intérêts de dotations non consommables et 7 milliards en « cash », soit 1 milliard d’euros par an en moyenne d’argent frais.
Cette dotation de 1 milliard d’euros représente plus de 5 % de la dépense de recherche annuelle des administrations (DIRDA), estimées à 16 milliards d’euros en 2011, c’est-à-dire plus que l’effort supplémentaire consenti par l’Allemagne entre 2006 et 2010 par rapport à son budget consolidé. Il faut que les acteurs de la recherche en soient bien conscients.
Les effets de ces investissements sont contrastés. Certains renforcent la structuration des dispositifs ; je pense aux Initiatives d’excellence (Idex), qui permettent de faire émerger des initiatives au meilleur niveau international, d’aider aux regroupements au niveau d’un territoire et de renforcer la structuration des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ou aux laboratoires d’excellence (Labex), qui ont donné beaucoup de flexibilité aux équipes pour lancer des appels à projet et attirer des chercheurs réputés.
Il en va différemment pour d’autres outils comme les équipements d’excellence (Equipex), où les fonds apportés ne couvrent pas l’intégralité des besoins, laissant à la charge des budgets de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) et des opérateurs une dépense de fonctionnement importante. Si les programmes sélectionnés sont d’un très bon niveau et suivent les recommandations du rapport Juppé-Rocard, notre ministère appelle, afin d’assurer leur pérennité, à une meilleure définition des axes stratégiques, permettant de les réorienter de manière à ce qu’ils soient mieux réappropriés par les acteurs de la recherche, qui devront les financer sur le moyen et le long terme et les intégrer dans leurs politiques et leurs contrats d’objectifs et de performance (COP).
Les financements apportés par le PIA ne couvrent pas non plus toujours la durée de vie du projet financé. Ainsi, le PIA n’a apporté de financement que sur 5 ans à certaines cohortes qui supposent un suivi longitudinal sur 30 ans. De même, les projets de recherche en biologie-santé ont permis de faire émerger des infrastructures de haut niveau et utiles, dans le domaine du séquençage par exemple, mais avec un financement qui n’est assuré que pour une durée limitée. Or il sera difficile, dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, de dégager sur les budgets de base de la MIRES les moyens de garantir la pérennité de ces infrastructures.
Il faut donc une meilleure complémentarité entre la politique à long terme menée au travers du financement de la MIRES et les incitations portées par le PIA. Les financements supplémentaires ne doivent pas être un facteur de déstructuration.
Il faut tenir compte de ce retour d’expérience que nous avons du PIA1 pour que le PIA2 soit vraiment un outil de renforcement de la structuration, notamment, de ce qui a déjà été financé dans le cadre du PIA 1.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Lorsque les investissements d’avenir ont été mis en place, il y avait une volonté interministérielle de faire « bouger les lignes ». Il aurait peut-être été plus difficile d’arriver à ce résultat avec des financements budgétaires. Avez-vous commencé à organiser une concertation pour permettre la meilleure complémentarité que vous appelez de vos vœux entre financements du PIA et financements budgétaires ?
M. Roger Genet. La politique des Idex, qui consistait à faire émerger des pôles d’enseignement supérieur et de recherche au meilleur niveau international, trouve tout à fait son prolongement dans la loi du 22 juillet 2013 avec la mise en place des politiques et des contrats de sites. Les politiques de sites, celles des Idex, des ISITE et des Labex, favorisent un dialogue entre tous les acteurs de l’écosystème enseignement supérieur–formation–recherche–innovation (écoles, universités, organismes nationaux, sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT), instituts de recherche technologique (IRT), pôles de compétitivité, collectivités locales et État) sur un territoire et donnent des moyens pour créer une politique scientifique territoriale cohérente, à partir d’une mise en commun des diagnostics des forces et des faiblesses. La politique de sites a prolongé l’initiative prise par le ministère dans les années 2007-2008 pour établir un diagnostic et une stratégie territoriaux, qui soient un outil de dialogue entre la région et l’État et de mise en œuvre entre les acteurs.
En revanche, nous avons à progresser sur le financement des priorités en matière de recherche – et nous le faisons. S’appuyer en 2009 sur les travaux de la commission Juppé-Rocard pour essayer d’établir des priorités dans les axes de développement scientifique devant être financés par le PIA a été utile. Cependant, cela ne s’est pas fait en concertation avec les différents ministères qui touchent à la recherche, qu’il s’agisse de ceux de la recherche, de l’industrie ou de l’agriculture, de la défense ou de la santé. Il est essentiel que ce soit le cas.
La loi du 22 juillet 2013 a institué une stratégie nationale de recherche, avec un conseil stratégique de la recherche conseillant le Gouvernement, en s’appuyant sur le ministère de la recherche, au travers de la DGRI qui est chargée de coordonner son élaboration. Nous avons à cette fin mis en place depuis décembre dernier un comité opérationnel, qui réunit, d’un côté, les directeurs d’administration centrale des huit ministères porteurs de politiques de recherche – avec notamment ceux de la défense, de la santé, de l’agriculture, de l’écologie ou de la culture –, le commissariat général à l’investissement (CGI), le commissariat général à la stratégie et à la prospective, la délégation à l’intelligence économique, et, de l’autre, les présidents d’alliances, le président de la Conférence des présidents d’université, celui de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, le CNRS, le CEA, l’ANR, le CNES, deux représentants des pôles de compétitivité et deux représentants des industriels. Nous avons ainsi créé un outil de dialogue entre les attentes en matière de politique de recherche et les opérateurs de recherche qui permette au ministère chargé de la recherche non pas d’imposer sa vision, mais de coordonner l’action des acteurs de la recherche de façon à ce que la France ait non pas plusieurs mais une politique de recherche, qui réponde aux attentes de l’ensemble des acteurs publics.
Nous avons bâti sur cette base les travaux préparatoires à la stratégie nationale de recherche, dont l’objectif est de proposer au Gouvernement quelques priorités. Il n’y a pas de raison que ce dispositif, dont des équivalents ont été mis en place en Allemagne ou au Japon, ne fonctionne pas. Il permet de réfléchir aux priorités offrant un levier fort au développement économique ou social du pays. On peut espérer que la partie d’investissements exceptionnels alimentant la politique de recherche en vue d’un tel développement s’appuie à l’avenir sur cette concertation interministérielle dans la durée, et non, seulement, sur un groupe d’experts réunis à un moment donné – ce qui peut entraîner, dans certains cas, la déresponsabilisation des services de l’État.
Par exemple, la France est dotée d’un outil, étroitement lié à notre industrie – et très utilisé par nos industriels –, dont peu de pays européens disposent : notre flotte océanographique, qui a été un des fleurons de notre recherche. Cet outil nécessite un budget de 600 millions d’euros, amortissable sur 30 ans. Cela signifie que, pour pérenniser cette flotte, il nous faudrait être en mesure de provisionner 20 millions d’euros par an pour assurer le renouvellement et la jouvence de ses bâtiments. Le financement de la flotte s’est toujours effectué par abondement exceptionnel des crédits de la MIRES. Aujourd’hui, ces financements exceptionnels passent entièrement dans le PIA, et pas par les programmes budgétaires. Il sera donc très difficile de financer le maintien de la flotte océanographique si le PIA se limite à sélectionner des appels à projet lancés selon la méthode « bottom-up » à partir des propositions des laboratoires. Il faut qu’il y ait une cohérence entre nos politiques scientifiques, ce que l’on inscrit dans les contrats d’objectifs de nos opérateurs et les financements, qui ne peuvent se limiter à être incitatifs.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. La mobilisation du PIA2 pour des actions de ce type signifierait-elle que le PIA se substitue à des budgets récurrents ?
M. Roger Genet. Cela peut être parfois la position du CGI. Cela dit le ministère n’a pas profité d’opérations du PIA pour effectuer des débudgétisations ou des transferts de financement. En revanche, le financement récurrent de la MIRES permet d’assurer le fonctionnement, mais non les investissements des grandes infrastructures de recherche. Quand on a choisi de faire le synchrotron SOLEIL au début des années 2000, les moyens financiers nécessaires étaient tels qu’ils ne pouvaient être financé par celui de la MIRES.
De même, nous avons un accord avec une nouvelle organisation internationale en Suède destiné à gérer le programme ESS – European Spallation Source – dont le budget global d’investissement est d’1,843 milliard d’euros. La part de la France, qui représente 8 % du budget de construction, ne peut être couverte par la subvention : celle-ci permet seulement aujourd’hui d’assurer la phase d’exploitation qui sera financée par nos opérateurs. Il serait probablement de bonne gestion d’introduire dans le budget de la MIRES une enveloppe correspondant à des investissements à moyen et long terme ; mais ce n’est pas ainsi que sont construits nos budgets : ils permettent seulement d’assurer le fonctionnement des opérateurs, pas de financer des investissements à quinze ou vingt ans.
Autrement dit, soit nos crédits budgétaires nous permettent, grâce à l’introduction dans notre budget de provisions – comme dans le cas du parc nucléaire –, d’assurer le maintien en activité des infrastructures existantes et de contribuer à des opérations exceptionnelles permettant de préparer la science pour les quinze ou vingt années à venir, soit les financements correspondants sont pris en charge autrement. Si le PIA, en privilégiant uniquement des programmes nouveaux issus d’une sélection de projets, ne prend pas en compte la nécessité de financer une vision à moyen et long terme, nous passerons à côté de tout un pan de financement indispensable pour notre recherche.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Est-ce un constat partagé ?
M. Roger Genet. Pas entièrement. Au CGI, certains considèrent que les moyens budgétaires pour ce type de financement doivent relever des crédits du ministère.
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de discussions d’ensemble sur les priorités stratégiques en matière de recherche. Cela peut donner l’impression que les financements du PIA ne concernaient que des opérations choisies et n’avaient pas à se substituer à ce qui était considéré comme relevant de la politique des ministères. Cependant, on perdait de vue que la politique des ministères avait des contraintes ou était financée de telle façon qu’elle ne pouvait prendre en compte les opérations de financement à moyen et long terme. Il nous faut avoir des discussions interministérielles étroites pour éviter des politiques séparées. Le comité opérationnel sur la recherche, dont le CGI est désormais membre, y tend. Je rappelle que le CSTP japonais réunit tous les mois autour du Premier ministre les ministres en charge de l’industrie, de l’éducation et de la recherche, ce qui permet une véritable approche interministérielle, absolument nécessaire, du financement de la recherche.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Les responsables de nos grands organismes de recherche et les présidents d’université que nous avons auditionnés nous ont dit que si les investissements d’avenir constituaient une dynamique formidable, les financements consentis par le PIA ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts des projets qu’ils soutiennent. Partagez-vous ce point de vue et que préconisez-vous ?
M. Roger Genet. Nous sommes tout à fait d’accord avec ce point de vue. L’idée initiale du PIA était bien d’orienter les budgets de base grâce à l’effet de levier généré. Mais la question est de savoir si nos établissements, eu égard à leurs budgets, sont capables de suivre : ils doivent tenir compte de leurs contraintes de gestion ! Certains considèrent que le ministère serait dans l’immobilisme ; la ministre veut au contraire faire évoluer le système. On ne peut le faire en ignorant les contraintes qui s’imposent à lui, et en tout premier lieu les contraintes financières.
Je rappelle que la France est en retard en matière de coûts complets. Nous devons avoir une vision d’ensemble de ceux-ci pour toutes nos opérations, et ce même si les financements ne couvrent pas la totalité de leurs coûts. Nous demandons depuis longtemps à nos opérateurs d’être capables d’établir leurs coûts complets.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Comment expliquez-vous ce retard ?
M. Roger Genet. Cela tient à nos outils de gestion. Certes les systèmes de gestion des universités, qui étaient en retard, progressent. Mais, pour autant, aujourd’hui, les grands établissements de recherche ne disposent pas tous d’une comptabilité analytique. Il faudrait arriver à ce que ce soit le cas. Cette « vérité des prix » permettrait un meilleur équilibre de nos financements.
En outre, le ministère s’est efforcé d’obtenir une simplification de la comptabilité et des financements au niveau européen pour une meilleure prise en compte des coûts indirects, et ce de façon forfaitaire. Désormais, pour un laboratoire public, l’Europe paie 100 % des coûts directs et 25 % en plus forfaitairement au titre des coûts indirects (overheads). Cette amélioration de la prise en compte des coûts indirects est salutaire et il n’y a pas de raison qu’ayant défendu cette position au niveau européen, la France ne fasse pas de même au niveau national.
Je rappelle que les coûts indirects sont estimés en moyenne à un montant compris entre 25 % et 35 % des coûts directs. Il faudrait donc que l’on puisse couvrir au moins l’équivalent de 25 % des coûts directs. Le rééquilibrage nécessaire opéré en 2013 entre les financements sur projets de l’ANR et ceux des laboratoires a conduit à diminuer les premiers. Or même s’il est difficile en même temps de réduire les budgets de l’ANR et d’augmenter le préciput, la ministre y réfléchit. Nous sommes en train de travailler pour aménager le système de préciput et mieux prendre en compte les coûts indirects. Pour le financement des projets ANR, on verse 11 % de préciput à l’hébergeur – sachant que cette notion n’est pas toujours très claire – et 4 % pour les coûts de gestion. Il faudrait accroitre les montants destinés à couvrir les coûts indirects, mais aussi que les unités aient bien conscience qu’on leur verse de l’argent pour cela, et qu’elles soient responsabilisées.
Les projets financés dans le cadre du PIA prévoyaient 4 % de frais de gestion. La ministre a souhaité qu’ils soient portés à 8 %. Le CGI a accepté, mais cela ne concerne que les Idex et les Labex : pour les Equipex, l’investissement étant directement gagé sur des infrastructures, on ne pouvait augmenter les coûts de gestion.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Ce que vous décrivez pour le PIA sera-t-il transposé sur la partie des financements sur projets de l’ANR ?
M. Roger Genet. Oui. La ministre a demandé que nous réfléchissions sans attendre à une évolution du système de couverture des coûts indirects de l’ANR, de façon à créer un meilleur équilibre. Les équipes demandent plus de flexibilité dans l’utilisation des fonds et que soient rendues éligibles à l’ANR les dépenses de fonctionnement liées à des coûts indirects : par exemple, l’augmentation du nombre de contrats à durée déterminée (CDD) provoquée par le succès à des appels à projet conduit les établissements à régler des frais proportionnels au nombre de contractuels pour couvrir l’assurance chômage, ce qui constitue des charges supplémentaires non couvertes. Nous devons aussi donner aux équipes la liberté d’apprécier la réalité des coûts indirects qu’elles ont à couvrir. Nous souhaitons enfin aussi simplifier le système : il ne faut pas accroître les justificatifs à fournir. Dans le système national, où toute dépense est justifiée à l’euro près, ce n’est pas facile. Il faut veiller à ce que l’évolution de la réglementation ne fasse pas perdre du temps inutilement aux équipes.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Les outils qui ont été mis en place à travers les investissements d’avenir pour la valorisation de la recherche, sont-ils compatibles avec les dispositifs existants ? Je sens parfois des incompréhensions à cet égard.
M. Roger Genet. Quand on fait évoluer un système, il faut une phase d’explication et d’accompagnement du changement. Le ministère sait qu’il lui faut prendre en mains le changement et accompagner les opérateurs dans le processus. Il est normal, quand on modifie la programmation de l’ANR ou le nombre et la nature des acteurs de la valorisation, qu’il y ait des interrogations et que des adaptations soient nécessaires.
En revanche, les évolutions introduites sont indispensables. Car si le rapport de 2006 sur la valorisation rappelait que nous avions quelques champions – le CEA et l’institut Pasteur –, il constatait surtout une carence flagrante de notre système, notamment à l’université, que ce soit en termes d’outils, de structures, de compétences – sur la gestion de la propriété intellectuelle ou le transfert – et même de culture, et ce alors même que la loi Allègre du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche avait intégré la valorisation parmi les missions des chercheurs, démarche renforcée par la loi de programme pour la recherche du 28 avril 2006.
Au travers du PIA, le Gouvernement a institué plusieurs outils qui répondent chacun à des besoins particuliers. Des financements très élevés ont été trouvés. Peut-être n’a-t-on pas pris le temps d’expérimenter suffisamment ces outils : nous avons en effet dû opérer une mise en œuvre rapide. Il faudra donc évaluer le système, sans attendre dix ans, pour vérifier qu’il est opérationnel.
La mise en place des SATT, qui ont l’avantage d’être régionales, a permis de réaliser un maillage du territoire. Les SATT ne sont pas parties de rien. Elles se sont inspirées notamment de Bretagne Valorisation, située dans une région ne bénéficiant pas des grands acteurs que j’ai mentionnés, et qui s’est prise en mains pour réfléchir à la meilleure façon de structurer sa valorisation, en partant de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et en fédérant les organismes nationaux implantés sur le territoire. La différence entre les SATT et Bretagne Valorisation, c’est qu’au-delà de la compétence de gestion de la propriété intellectuelle, on les a dotées d’un milliard d’euros de fonds d’émergence pour financer notamment la création de start-up.
Cela dit, cette politique, très utile, doit aussi bénéficier aux acteurs nationaux disposant de compétences en matière de valorisation : les expériences du CEA à Grenoble montrent qu’il faut adapter le système. Mais celui-ci va se réguler.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le fonctionnement des SATT semble un peu inégal.
M. Roger Genet. En effet, et la compétence également, car le vivier de recrutement était lui aussi inégal. En outre, le poids et la situation des acteurs étaient différents d’un territoire à l’autre. En particulier, les grands acteurs nationaux ayant mis en place un politique de valorisation – comme l’Inserm avec Inserm Transfert – n’étaient pas présents sur tous les territoires. Ce n’est pas un hasard si les deux régions ayant la dépense de recherche la plus forte, à savoir Rhône-Alpes et l’Île-de-France, avec Paris-Saclay, sont celles qui ont mis le plus de temps à trouver un modèle économique pour leurs SATT, alors que dans les autres régions, il a été plus facile de se structurer.
Sur les 13 SATT créées, deux ont un modèle particulier : Grenoble avec GIFT, qui a néanmoins réussi à regrouper tous les acteurs, et Saclay. S’il y a eu des discussions un peu âpres, tenant aussi aux personnes, entre les structures préexistantes et les SATT, comme ce fut le cas en Île-de-France avec Inserm Transfert, cela est en train de se régulariser.
On a sans doute eu tort de vouloir au départ imposer un modèle unique. On voit bien que des adaptations sont nécessaires aujourd’hui. Les SATT vont travailler soit en recevant une délégation de gestion de la propriété intellectuelle, soit dans un cadre de mutualisation des moyens pour prospecter dans les laboratoires en cohérence avec les organismes de valorisation des grands organismes nationaux ; la subsidiarité est en train de mettre en place. Bien sûr, les universités sont totalement impliquées.
La SATT a en outre un rôle d’acculturation des acteurs à la gestion de la propriété intellectuelle. Il est donc essentiel que, dans chaque regroupement au sein d’un territoire, dans chaque site, il y ait une compétence de valorisation.
Nous avons aussi lancé cette année une étude dans trois régions pilotes - Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Île-de-France – pour voir comment mieux articuler les incubateurs et les SATT. Cette articulation dépendra des particularités de chaque territoire. Si, en Aquitaine et dans le Languedoc-Roussillon, notre travail montre que les acteurs souhaitent un fort rapprochement de l’incubateur avec la SATT, en Île-de-France, c’est plus compliqué car la politique de site est plus complexe. Mais je pense qu’à Saclay, on pourra opérer ce rapprochement.
En moins de deux ans, le modèle économique des SATT est en train de se formaliser. La dynamique a donc été très forte.
M. Patrick Hetzel. Le calendrier a-t-il été respecté ?
M. Roger Genet. Oui, sur les premières phases des SATT. Même si la contractualisation – comme celle des autres outils du PIA –, a été compliquée, on est dans les temps. Il y a eu du retard dans les régions que j’ai mentionnées, car les acteurs y sont forts et pluriels, ce qui supposait qu’ils se mettent d’accord sur un modèle économique. Mais avoir pris six mois ou un an de plus n’a pas beaucoup d’importance au regard de l’ensemble du processus.
Les SATT sont des instruments viables et utiles. Elles auront une mission élargie par rapport au dogme initial – la ministre l’a d’ailleurs toujours souhaité – de même qu’une plus grande souplesse dans leur mise en œuvre. Il est d’autant plus légitime que les collectivités locales, notamment les régions, soient représentées au sein des SATT qu’elles contribuent largement au financement des incubateurs. Si elles peuvent déjà être observatrices dans les conseils d’administration des SATT, il faudrait qu’elles y prennent un rôle plus large.
La question se pose en revanche de savoir si les SATT seront autofinancées d’ici dix ans. L’innovation le permettra-t-elle ? Certaines SATT trouveront sans doute assez rapidement cet équilibre. Inserm Transfert, qui a été créée en 2005-2006, a été équilibrée financièrement pour la première fois en 2012. Pour d’autres, ce sera sans doute plus long.
L’appropriation par les acteurs est une clé. Si l’État a aujourd’hui une minorité de blocage de 30 %, il ne faut pas que sa présence empêche cette appropriation. Les SATT vivront si ces sociétés anonymes sont considérées comme des filiales communes des membres fondateurs et si ceux-ci les reprennent à leur compte et équilibrent leur budget. L’État n’est là que pour accompagner le développement et vérifier la bonne utilisation des fonds.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Comment l’État peut-il s’assurer d’une cohérence nationale des transferts de technologie ? Qu’avez-vous mis en place pour permettre un pilotage national en la matière ?
M. Roger Genet. Cela aurait été un comble de mettre en place une SATT nationale avec des implantations régionales à l’heure de l’autonomie des universités, des politiques de sites et de la décentralisation.
Par ailleurs, la dynamique des territoires varie selon, notamment, la nature des pôles de compétitivité, des écoles, des universités ou des organismes. Cette diversité ne serait pas compatible avec une SATT unique.
Il n’empêche que toutes les missions prévues doivent être remplies, et l’État doit y veiller. Je rappelle que le ministère détient, avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque publique d’investissement (BPI), 30 % des droits de vote des SATT. L’État est représenté au conseil d’administration de chaque SATT par un représentant de la DGRI et un représentant de l’administration en région. La cohérence est assurée au niveau national dans le cadre de la relation que la DGRI entretient avec les présidents de SATT, qui sont en train de se structurer en association. Elle l’est également, au niveau territorial, par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie, qui sont nos relais en région et qui portent la voix de l’État dans les conseils d’administration. La cohérence résulte donc simplement de l’exercice de la tutelle, avec des acteurs qui sont des sociétés anonymes.
Le CEA a déclaré qu’il fallait que le dispositif soit souple et adaptable. C’est tout à fait notre point de vue. Il faut en effet que la SATT soit la filiale de valorisation commune des acteurs et que ceux-ci, en fonction de leur diversité, lui demandent de mettre en œuvre leur politique.
Parmi les difficultés mentionnées par le CEA figurent celle des grappes de brevets et le fait d’avoir sur différents sites des brevets corrélés qui ne font sens que s’ils sont valorisés ensemble. On peut progresser grâce aux filiales de valorisation des organismes nationaux, en les utilisant comme relais pour la valorisation des grappes de brevets. Des discussions sont en cours avec France Brevets, à la suite d’une convention que cet organisme a signée avec les SATT en juillet 2012, dans laquelle il s’engage à reprendre la propriété intellectuelle portée par plusieurs SATT pour une action de valorisation dédiée.
Par ailleurs, les consortiums de valorisation thématiques (CVT) des alliances sont très utiles car ils permettent aux opérateurs de recherche regroupés par grandes alliances thématiques d’avoir une action de type cartographique sur les marchés et les compétences, au service des SATT. Nul n’est mieux placé que les acteurs de la recherche pour voir ce qui peut être le mieux valorisé.
Les CVT fonctionnent de façon différente en fonction des besoins. L’alliance Allistène, dans le domaine du numérique, a surtout des actions en matière de formation des chercheurs à la valorisation, notamment sur le droit d’auteur, alors que les CVT d’Aviesan ou d’AllEnvi sont plutôt tournés vers des cartographies des domaines de valorisation stratégique, un peu à l’image du bureau marketing du CEA. Le financement des CVT, qui est restreint, est très utile. Jusqu’ici, aucun organisme autre que le CEA n’avait la capacité de faire ce type d’études.
Sur les SATT, nous avons lancé cette année la première phase d’évaluation à trois ans, avec l’obligation de remplir certains indicateurs, insérés dans leur contrat d’origine, sur la base desquels sera décidée la deuxième tranche de financement. Cinq SATT créées en décembre 2012 ont été retenues en premier : Conectus, Sud-est, Île-de-France, Lutech et Toulouse. Le résultat de leur évaluation sera disponible en décembre 2014.
S’agissant des CVT, ils font l’objet d’une « revue » régulière de la direction générale de la recherche et l’innovation. Le financement n’a en effet été attribué que pour deux ans.
Quant au rôle du comité de pilotage, et à celui de chacun de ses participants, il s’est beaucoup clarifié. Sur les actions relatives aux IRT et aux SATT, il est présidé par moi-même, il réunit la BPI, la CDC, la direction générale des entreprises (DGE) ainsi que le CGI, et propose de grandes orientations au Premier ministre, sachant que nous essayons toujours d’aboutir à un consensus ; quand un sujet n’est pas assez mûr, on le réexamine jusqu’à ce qu’on y parvienne. Dans 95 % des cas, le CGI a relayé auprès du Premier ministre une position conforme à ce que le comité de pilotage avait proposé par consensus.
Nous avons aussi mis en place un comité de suivi. Je rappelle que l’ANR est l’opérateur du programme.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Qu’en est-il des instituts de transition énergétique (ITE), ex-IEED ?
M. Roger Genet. Le rôle de pilote a été donné en la matière à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), qui a joué le même rôle que nous, même s’il a fallu un peu plus de temps pour instruire les projets. Il est vrai que le CGI n’avait pas la même vision de la structure juridique de ces organismes – on peut d’ailleurs en discuter, les IRT et les ITE étant très comparables – ce qui a créé une certaine lourdeur des phases d’instruction.
Contrairement au souhait de notre ministère, et alors que tout le monde convenait qu’on avait trop de structures et que le système était complexe et illisible, il a finalement été décidé de conférer la personnalité morale aux IRT et aux ITE. Cela a beaucoup compliqué les choses, notamment en termes d’aides d’État : il a fallu réaliser des expertises approfondies au regard de la réglementation européenne et de la propriété intellectuelle.
Le retour d’expérience du PIA1 nous montre encore une fois qu’une caporalisation du système n’est pas souhaitable et qu’il faut laisser de la souplesse aux opérateurs dans la mise en œuvre, même si nous devons avoir un regard acéré sur leurs propositions.
Le second enseignement est qu’il faut un pilotage clair de l’instruction, depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’au suivi de sa mise en œuvre. Il convient d’éviter les instructions parallèles, qui sont parfois sources de divergences.
Il faut cependant concéder que, pour répondre à la demande politique, le cahier des charges de ces objets nouveaux a été rédigé dans un temps très court ; il a fallu préciser l’analyse juridique en même temps.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. C’était pourtant le rôle du comité de pilotage de s’assurer de cette cohérence.
M. Roger Genet. Même s’il y a bien eu concertation entre les départements ministériels concernés au moment de l’élaboration du cahier des charges des appels d’offres de chacun de ces outils, des avis pas toujours convergents ont pu être donnés aux porteurs de projets – qui les ont sollicités – pendant la phase de montage des projets.
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Qu’en est-il du traitement des dotations non consommables ?
M. Pierre Valla, adjoint au directeur général de la recherche et de l’innovation. Il est variable suivant les actions. Pour certaines, notamment les Idex, il est prévu qu’en cas de passage réussi des différentes évaluations, ces dotations seront allouées de façon définitive aux porteurs du projet.
S’agissant d’un éventuel encadrement à terme de l’usage de ces dotations, faut-il faire confiance aux acteurs ou introduire une réglementation encore plus tatillonne que l’actuelle ?
M. Patrick Hetzel, rapporteur. Vous plaidez donc en faveur de la simplification administrative !
M. Roger Genet. Et de la responsabilisation des acteurs… On est dans un système où on ne fait pas suffisamment confiance aux acteurs, même quand ce sont des opérateurs publics et que leurs dirigeants ont été nommés pour mettre en œuvre les missions qui leur sont confiées par l’État.
M. Pierre Valla. Le modèle retenu en la matière est le financement dont bénéficient les universités américaines grâce aux fondations. Si les donateurs peuvent en l’espèce livrer des indications sur les modalités d’emploi, ils n’exercent pas de contrôle au cas par cas des décisions d’achat ou de lancement de missions.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Je vous remercie.
Audition du 17 décembre 2014
À 16 heures 30 : Audition de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Présidence de M. Alain Claeys, Président
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, au cours des auditions de la mission, nous avons pu prendre la mesure de la diversité des actions menées en faveur de la recherche et de sa valorisation grâce aux financements du PIA, de l'ampleur et de l'intérêt de ces financements, de l'avancement des projets, ainsi que des procédures mises en place pour en assurer une gestion conforme aux décisions prises par les jurys.
Cependant, il nous est apparu aussi une problématique nouvelle, spécifique aux programmes d'investissement d'avenir et à leur articulation avec le financement de la recherche opéré par votre ministère et la stratégie qu'il conduit. C'est de cette problématique dont nous voudrions nous entretenir avec vous aujourd'hui.
Nous nous intéressons en particulier à la réussite des initiatives d’excellence (IDEX) et à leur articulation future avec les communautés d'universités et établissements (COMUE) qui se mettent en place à la suite de la loi du 22 juillet 2013.
Nous nous interrogeons aussi sur la poursuite des actions menées et la pérennité des structures créées par le PIA après la fin de celui-ci. Comment seront-elles financées ?
En outre, il semble que les équipements d'excellence (EQUIPEX), créés par le PIA, ne soient pas financés en totalité par celui-ci. Comment votre ministère organise-t-il la gestion de cette situation ?
De plus, les financements du PIA n'ont-ils pas déséquilibré l'expression de la stratégie de la recherche ? Si oui, comment est-il envisagé d'y remédier pour l'avenir ?
Enfin, madame la ministre, je vous prie d’excuser l’absence du deuxième rapporteur, notre collègue Patrick Hetzel, retenu en séance publique par l’examen du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche. Peut-être est-il utile d’abord de situer le PIA par rapport aux budgets récurrents de la recherche. Le PIA représente un financement d’un milliard d’euros par an pour la recherche – en incluant les IDEX – alors que les budgets de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) s’élèvent respectivement à 23 milliards d’euros et 26 milliards d’euros, salaires compris.
La présentation du PIA vous a probablement déjà été faite par nombre des personnes que vous avez auditionnées, notamment par le directeur général pour la recherche et de l'innovation. Pour ma part, je vais plutôt m’intéresser à la valeur ajoutée apportée par le PIA, qui a été confortée par le rapport de Louis Gallois sur la compétitivité française. Nous constatons en effet que la compétitivité dépend des coûts de production mais plus encore de la diffusion de l’innovation issue de la recherche et de l’élévation du niveau de qualification des salariés. Pour y parvenir, nous devions disposer d’un outil réactif qui puisse établir des priorités, qui soit donc à la main du Premier ministre sans avoir la lourdeur des dispositifs interministériels. Le PIA peut être cet outil de relance car il présente ces qualités : il repose sur un esprit de projet et sur la capacité à utiliser les opérateurs en place, que ce soit l'Agence nationale de la recherche (ANR), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou d’autres opérateurs, le travail de fond étant assuré par les ministères.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Comment est assurée la cohérence entre les choix stratégiques du commissaire général à l’investissement et les vôtres ?
Mme la secrétaire d’État. Il faudrait avoir une vision totalement datée pour imaginer un système figé où le lancement de projets serait séparé des recherches fondamentales récurrentes sans lesquelles il ne peut y avoir de renouvellement de la recherche technologique. En réalité, les recherches fondamentale et technologique se nourrissent l’une de l’autre. La première doit être ouverte aux besoins socio-économiques et aux enjeux sociétaux car on ignore les applications concrètes qui pourront naîtront de ses découvertes. Ces applications peuvent être totalement inattendues et très utiles à l’économie, à la santé, à l’environnement, à la lutte contre le changement climatique, etc. Une vision dogmatique serait pénalisante pour les deux types de recherche : le Commissariat général à l’investissement (CGI) ne ferait que répondre aux opportunités en risquant d’être déconnecté de la recherche et de la vie des laboratoires alors que les services des différents ministères concernés – en particulier celui de l’enseignement supérieur de la recherche – et les laboratoires se trouveraient dans une sorte de continuum qui ne serait pas remis en cause.
Lors de mon arrivée, en 2012, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas suffisamment d’interactions entre le CGI et les services des ministères. Cette situation pouvait même susciter des difficultés entre les services des différents ministères, les acteurs de l’enseignement supérieur de la recherche et le CGI. Une fois admis qu’un outil comme le CGI était très utile pour la relance par l’innovation et l’élévation des qualifications, en particulier celle des jeunes, il convenait de l’intégrer dans la stratégie nationale de la recherche, dans celle de l’enseignement supérieur et dans la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il y a donc une cohérence entre les choix stratégiques du commissaire général à l’investissement et les vôtres.
Mme la secrétaire d’État. On trouvera sûrement des failles à cette cohérence et il existe des marges de progression, notamment sur des points techniques comme le préciput qui est versé par l’ANR aux établissements hébergeant les équipes portant les projets. Cependant, le PIA et l’enseignement supérieur et la recherche doivent s’inscrire dans une même stratégie. C’est nécessaire pour que les actions du PIA soient efficaces et qu’elles servent à faire évoluer le système de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est nécessaire pour que ce dernier soit stimulé, qu’il apporte toute sa compétence et qu’il renouvelle l’innovation. Par exemple, sans financement par les crédits récurrents, il n’y aura pas de renouvellement de la recherche technologique, clinique ou translationnelle dans le domaine de la santé.
Depuis deux ans, nous avons tout fait pour parvenir à un fonctionnement intégré au lieu de fonctionnements parallèles. Ce n’est pas un chemin semé de roses, mais rien n’est facile dans le contexte de compétition internationale que nous connaissons. Nous devions répondre très vite à un besoin de cohérence mais aussi de simplification. Ainsi, il fallait notamment remédier au problème de la multiplication des contrôles. Un même laboratoire peut fait l’objet de cinq contrôles différents dans l’année : par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui a pris le relais de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), par le CGI, par la Cour des comptes, etc. Nous devons faire un effort dans ce domaine pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir une recherche qui fonctionne mieux et qui contribue davantage à la création d’emplois.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Qu’adviendra-t-il des structures créées grâce au PIA, une fois que ce financement aura cessé ? Comment le ministère prendra-t-il le relais ? C’est une source de questions sinon d’inquiétudes pour nombre de chercheurs.
Mme la secrétaire d’État. Pour en terminer sur le sujet de cette fausse opposition entre appels à projet et crédits récurrents, j’aimerais donner un chiffre : les appels à projet représentent 10 % des crédits totaux. Dans notre pays, la part des crédits récurrents reste très importante et c’est peut-être ce qui nous a permis de recevoir entre autres récompenses des prix Nobel ou des médailles Fields depuis deux ans et demi. Nous n’avons pas basculé dans un système où il n’y aurait plus que des appels à projet.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il y a eu un rééquilibrage.
Mme la secrétaire d’État. Exactement, et nous avons calibré le budget de l’ANR en fonction de ce qu’elle était en mesure de réaliser. À notre arrivée, beaucoup de projets étaient bloqués. Nous avons rétabli des crédits récurrents, nous avons « nettoyé » le budget de l’ANR et nous l’avons mis en cohérence avec ce qu’elle pouvait réaliser.
Le deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA2) nous permet d’améliorer la cohérence : les Initiatives science, innovation, territoires, économie (I-SITE) vont faire contrepoids aux IDEX qui ont fait émerger huit sites d’excellence parfois en compétition les uns avec les autres. Or la véritable compétition est internationale, elle oppose nos laboratoires à ceux de Séoul, de Shanghai ou de Bangalore, et non pas l’université de Grenoble à celle de Bordeaux, ou Paris VIII à Paris X – ces deux dernières faisant du reste partie de la même COMUE. Nos équipes doivent donc à la fois gagner en excellence et coopérer au maximum et.
Nous avons demandé au CGI de s’adjoindre les compétences d'un président d’université pour décider sur les IDEX et les I-SITE. Nous en sommes à un stade de négociations avancées et cette audition va peut-être permettre de concrétiser cette demande.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quelle est l’articulation entre les IDEX et les futures COMUE ?
Mme la secrétaire d’État. L’ajout des I-SITE aux IDEX représente un progrès : au lieu d’avoir huit champions en compétition, nous aurons des écosystèmes pluralistes et différents. Si l’émulation n’est pas absente, ces écosystèmes doivent surtout coopérer au service des intérêts généraux du pays : création d’emplois qualifiés, amélioration de la compétitivité par la qualité, réalisation de progrès dans le domaine de la santé, de l’environnement, etc.
Quelle doit être articulation entre les IDEX et les COMUE ? Il s’agit de trouver un équilibre entre les préconisations du ministère, établies en concertation avec le CGI, et les initiatives venues des territoires. Dans tous les pays où il existe une vraie dynamique en matière d’enseignement supérieur et de recherche, il y a aussi des initiatives venant du terrain, sur la base d’une approche ascendante dite bottom-up.
Nous avons voulu que les contours et les territoires des COMUE soient définis de façon beaucoup plus libre que ceux des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) imaginés par la précédente majorité. Ces derniers ont été supprimés, ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), et nous les avons remplacés par des regroupements qui ne sont pas forcément tous des COMUE. Il peut s’agir aussi d’associations, de partenariats ou de fusions, selon le niveau d’intégration. Nous avons même autorisé la combinaison des modes de regroupement. Les territoires ont proposé eux-mêmes une définition des regroupements – qu’ils ont librement choisis – et des territoires de ceux-ci, qui ne recoupent pas forcément ceux des régions : Bretagne-Pays de la Loire est une COMUE.
Nous n’imposerons pas de regroupements ni de fusions : les expériences menées sous le précédent quinquennat ont montré que cela ne fonctionne pas. Les universités et les organismes de recherche doivent avoir un degré d’autonomie et d’initiative, sans quoi ces écosystèmes sont voués à l’échec. Néanmoins, pour simplifier le paysage, nous parions sur le fait que les IDEX s’intégreront aux COMUE.
La loi a prévu une trentaine de regroupements ; vingt-cinq ont été créés sur la base d’initiatives de terrain, avec un degré d’adhésion croissant lors des votes en conseil d’administration et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). L’acculturation se fait petit à petit. Dans vingt COMUE, il peut y avoir des fusions et des associations. Dans cinq associations, il y a trois fusions existantes et deux COMUE en préfiguration. Le système a bien profité de la liberté retrouvée. Je fais le pari que les IDEX seront naturellement absorbées dans les COMUE et serviront à accroître le niveau de qualification global : comme c’est déjà le cas à Toulouse, elles seront des locomotives et non pas des poches d’excellence isolée.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Ce sentiment est-il partagé par l’ensemble des acteurs territoriaux et par le responsable du PIA ?
Mme la secrétaire d’État. Ce sentiment est effectivement partagé par les acteurs territoriaux. Je pense que le fait d’avoir un représentant des universités et des COMUE au CGI aidera à accentuer cette acculturation.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Revenons sur le PIA et la manière de pérenniser les actions menées et les structures créées. Quel rôle le ministère jouera-t-il ? C’est un sujet de préoccupation pour les acteurs concernés et pour les législateurs que nous sommes.
Mme la secrétaire d’État. J’ai exprimé cette préoccupation au commissaire général à l’investissement que je rencontre régulièrement et avec lequel j’ai des échanges directs et constructifs.
Notre pays compte plus de chercheurs que ses grands voisins : 8,8 chercheurs pour 1 000 actifs en France contre 8,3‰ au Royaume-Uni et 7,9‰ pour l’Allemagne. La réponse ne sera pas dans la création de postes de chercheurs, même si nous en avions les moyens. Certes, il faut favoriser l’insertion professionnelle des doctorants à une période où il y a moins de départs en retraite ; il faut faire en sorte que le secteur privé en embauche davantage : cinq ans après leur doctorat, 50 % d’entre eux sont dans la recherche publique et seulement 25 % dans la recherche privée.
Je ne le dis pas pour faire plaisir aux représentants de la Cour des comptes ici présents mais il ne faut pas compter sur une augmentation du nombre de postes dans la recherche publique. Nous essayons de remédier à la dualité de notre système – due à l’existence des grandes écoles – pour faire en sorte que l’université soit le standard comme c’est le cas au niveau international. Nous nous soucions de l’avenir des laboratoires d'excellence (LABEX) et des EQUIPEX.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Cette question de la pérennité des actions et des structures aurait dû être posée lors de la création des investissements d’avenir. À présent, c’est à vous de trouver la solution.
Mme la secrétaire d’État. Nous pouvons regretter d’avoir été placés devant le fait accompli. Quoi qu’il en soit, nous n’allons pas augmenter le nombre de chercheurs et d’équipes ; nous sommes parvenus à une stabilisation du budget, ce qui est assez formidable en cette période de réduction des dépenses publiques. Il va donc falloir apprendre à établir des priorités. Si le LABEX obtenu par un écosystème donné est considéré comme une priorité, peut-on continuer pour autant à garder toutes les recherches conduites auparavant ? Ce LABEX vient-il seulement s’ajouter à l’existant ou donne-t-il l’occasion de faire évoluer l’ensemble ?
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le LABEX peut-il être un élément structurant de la recherche ?
Mme la secrétaire d’État. Nous ne pouvons pas continuer à superposer des strates. Si un projet est structurant et prioritaire, l’organisme de recherche doit en tirer les conséquences dans sa stratégie : il faut responsabiliser les acteurs des écosystèmes et des regroupements pour qu’ils intègrent ces projets structurants dans leur stratégie de recherche et d’enseignement supérieur. C’est facile à dire, plus difficile à mettre en œuvre sur le terrain. Comment les IDEX, LABEX et EQUIPEX vont-ils permettre de créer des stratégies de recherche, pour éviter un empilement de strates inefficace ? Il faut faire le pari de la réflexion et de l’intelligence collective sur les territoires.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Les organismes de recherche partagent-ils cette vision des choses ?
Mme la secrétaire d’État. C’est le cas du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui a signé une convention avec une douzaine de sites : les huit IDEX et d’autres sites qui vont probablement obtenir le label IDEX dans le cadre du PIA2. C’est un moyen pour lui de se doter d’une stratégie structurante dans les écosystèmes sur le territoire. Avec 35 000 salariés dont 25 000 fonctionnaires, le CNRS est le plus gros organisme de recherche en France. En six ans, le nombre de fonctionnaire dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) a baissé de 0,94 % – on peut dire que l’effectif est constant – et le nombre de contractuels a augmenté.
M. Michel Clément, conseiller maître à la Cour des comptes. Pour notre part, nous considérons à la Cour qu’il y a une baisse du nombre de recrutements de chercheurs.
Mme la secrétaire d’État. Certes, puisque le nombre des départs en retraite a diminué de moitié : c’est une problématique de flux. Il reste que le nombre de fonctionnaires dans les EPST est stable, avec une baisse de seulement 0,94 % en six ans. Pour établir ces données, nous sommes retournés à la source, dans les directions des ressources humaines des organismes, après avoir constaté que nos indicateurs issus de déclarations n’étaient pas bons.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Peut-on dire que les actions et structures découlant des PIA ne seront pas remises en cause, mais qu’il faudra procéder à une restructuration autour de l’existant ?
Mme la secrétaire d’État. Il doit y avoir une réflexion globale sur les priorités car le nombre de chercheurs ne peut pas éternellement augmenter. Or, j’y insiste parce que nous avons passé huit mois à vérifier in situ les données des services de ressources humaines de tous les organismes, le nombre de chercheurs dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les EPST a globalement augmenté.
En résumé, nous devons avoir une stratégie nationale de la recherche, partagée dans les écosystèmes. Nous avons créé les I-SITE parce que nous pensons qu’il existe des niches d’excellence dans des universités sur des domaines spécifiques. Dans une académie, un regroupement peut permettre l’émergence d’un laboratoire leader dans le domaine des matériaux, par exemple. D’ailleurs, l’Europe encourage le développement de sites spécialisés. Nous parviendrons à ce schéma idéal – harmonisation au niveau national des stratégies définies dans les écosystèmes – par le dialogue et la concertation. Dès à présent, nous devons anticiper la fin des financements – ce qui n’a pas été fait auparavant – et développer le recours à des fonds privés via des fondations.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Vos propos tendent à indiquer que, depuis deux ans et demi, l’action du ministère a permis de mieux coordonner et renforcer la recherche. Vous estimez aussi qu’un débat sur l’impact territorial et l’excellence doit être mené avec le CGI. À ce propos, disposez-vous d’une étude d’impact territoriale ?
Mme la secrétaire d’État. L’ANR en a établi une. Nous vous la communiquerons.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Considérez-vous que la structuration du paysage de la recherche se fait par le PIA et que l’on doit en tirer des enseignements ?
Mme la secrétaire d’État. Pas exactement. Le PIA n’a pas vocation à restructurer le paysage de la recherche : il accompagne, dans ses domaines d’intervention, des politiques publiques nationales et territoriales.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Il faut néanmoins tirer les enseignements d’actions et de structures issues du PIA, afin de voir, comme vous l’avez suggéré vous-même, comment le paysage peut évoluer.
Mme la secrétaire d’État. Le PIA est un outil intéressant qui, comme les autres ayant un terme, doit être intégré.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quels sont, selon vous, les outils du PIA qui présentent le moins d’intérêt ou génèrent le plus de complexité ?
Mme la secrétaire d’État. Les IDEX, qui bénéficient de crédits pérennes, seront des éléments structurants ; mais les LABEX et les EQUIPEX, qui sont des initiatives ponctuelles, doivent impérativement être pris en compte dans les stratégies locales et nationales. Mais, je le répète, le PIA n’est qu’un levier : il n’est en aucun cas le cœur de la politique publique de recherche.
Il serait hasardeux de classer les outils selon leur intérêt. Les discussions que nous avons eues avec les deux commissaires successifs ont porté sur la nécessaire flexibilité des dispositifs, compte tenu du caractère pluraliste des écosystèmes de recherche : j’avais défendu cette idée lors du quinquennat précédent ; il n’y a aucune raison pour que je change d’avis dans les fonctions que j’occupe aujourd’hui.
Les sociétés d’accélération du transfert de technologies, les SATT, sont plus difficiles à mettre en place dans les territoires déjà pourvus en dispositifs de valorisation et de transfert que dans les autres : l’adaptation du système d’appel d’offre du CGI, assez rigide, ne se fait pas toujours sans mal. Or en ce domaine plus encore qu’en tout autre, les dynamiques doivent émaner des territoires. Les échanges sont parfois musclés, comme avec l’IDEX de Toulouse, mais, jusqu’à présent, ils ont toujours abouti à un accord.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Lors des précédentes auditions, on a souvent évoqué le caractère incomplet du financement des PIA : nous aimerions vous entendre sur ce point.
Mme la secrétaire d’État. Le financement des projets de recherche inclut le coût des équipements et des personnels, mais il faut aussi tenir compte de ce qu’on appelle les coûts indirects, liés à leur environnement : le taux de couverture de ces frais a été fixé à 25 % au niveau européen, ce qui satisfait globalement les porteurs de projet. Nous allons porter ce taux, pour les projets sélectionnés par l’ANR, de 15 %, à 19 %. D’après les chercheurs et la DGRI, les coûts indirects se montent à environ 28 % du coût des projets. Le taux des projets gérés par le Commissariat général à l'investissement n’était que de 4 % ; il a été porté à 8 % après d’âpres discussions, et nous nous efforcerons de le rapprocher du taux de l’ANR. Le CGI veut se concentrer sur l’investissement direct, à l’exclusion des coûts de fonctionnement ; mais l’investissement lui-même suppose des crédits récurrents.
Il faut aussi nous pencher sur la simplification : la multiplication des contrôles, par exemple, tâche qui n’est pas le cœur de métier des chercheurs, leur prend beaucoup de temps et d’énergie.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quand la décision de porter le taux à 19 % pour l’ANR sera-t-elle prise ?
Mme la secrétaire d’État. Elle sera évoquée demain en conseil d’administration de l’ANR ; il faut qu’il l’avalise rapidement, ce que je l’invite à faire. Le nouveau directeur de l’ANR y est d’ailleurs favorable.
La simplification, disais-je, est nécessaire. Les quelques tentatives menées en ce sens auprès de l’ANR ont été plus ou moins bien comprises ; il faut reconnaître que nous avançons plutôt en marchant. Nous pensions qu’en étant présentés sous forme d’enjeux sociétaux, les appels à projet seraient plus visibles pour la société, plus valorisants pour les chercheurs et mieux adaptés aux programmes-cadres européens, notamment « Horizon 2020 », qui inclut des enjeux tels que la dérégulation climatique, la lutte contre les pandémies, la cybersécurité ou la protection des données. Cependant, cette présentation a été perçue comme une dérive utilitariste par un certain nombre de chercheurs, qui craignaient de voir l’ANR se désengager de la recherche purement disciplinaire ou sans application prédictible. Cette crainte était infondée : les éléments déclaratifs des porteurs de projet eux-mêmes font apparaître qu’en 2014, 78 % des financements sont allés vers la recherche de base ou fondamentale – ce qui est d’ailleurs trop : l’équilibre imposerait une répartition paritaire. Pour 2015, nous réfléchissons à une présentation comprise et acceptable par tous.
À des fins de simplification, nous nous efforçons d’harmoniser les procédures. Nous l’avons déjà fait pour les appels à projet européens. Le taux de succès de la France, avec plus de 25 %, y est le meilleur ; en revanche, nous ne déposons pas suffisamment de projets, et notre pays obtient moins de financements que sa contribution.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Améliorons-nous notre volume de financement ?
Mme la secrétaire d’État. Pour l’instant non, mais nous le souhaitons. La France a perdu, dans le septième programme commun de recherche (PCR) d’été, plus de 400 millions d’euros par an, ce qui représenterait une différence de 700 millions dans le cadre du programme « Horizon 2020 » si l’on compare notre contribution à ce que nous obtenons au titre des projets.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. L’apport en financement des investissements d’avenir représente 1 milliard d’euros par an…
Mme la secrétaire d’État. Oui, et le budget de l’ANR est de 580 millions par an.
Alors que des pays comme la Suisse et le Royaume-Uni obtiennent bien plus que leur contribution, la France, deuxième contributeur du programme-cadre de recherche et développement technologique européen avec plus de 16 % des financements, ne se voit attribuer que moins de 12 % des budgets.
Notre pays est en revanche bien placé dans le programme European research council (ERC), autrement dit dans la recherche fondamentale. C’est aussi pourquoi, d’ailleurs, nous veillons à ce que le financement du plan Juncker n’empiète pas sur le budget de l’ERC : pour le dire vite, on ne saurait utiliser des crédits dédiés à la recherche fondamentale pour financer des routes… Mes homologues de l’Union et moi préparons un courrier commun pour faire passer ce message.
La France a progressé au sein de l’ERC non parce que celui-ci est présidé par un Français, mais plutôt grâce à la campagne d’information que nous avons menée à son sujet. Hier, nous avons organisé une manifestation avec remise de récompense aux meilleurs projets, afin d’inciter nos laboratoires à se tourner vers les programmes européens. Comme je l’ai dit, nous essayons d’harmoniser les procédures de l’ANR avec les procédures européennes, de façon que nos chercheurs n’aient pas à refaire des dossiers sous des configurations différentes. Nous incitons aussi les laboratoires à embaucher des personnels issus de « Sciences po » ou du Collège d’Europe, notamment au sein des COMUE où sera mutualisée l’ingénierie des dossiers, car cette ingénierie n’est pas le cœur de métier d’un chercheur. Les universités et les laboratoires qui l’ont déjà fait sont très bien classés dans les programmes européens.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quid du traitement des dotations non consommables ?
Quelle appréciation portez-vous sur les outils de valorisation de la recherche, tels que les SATT ? Des évolutions sont-elles envisageables ?
Mme la secrétaire d’État. Le travail engagé avec le CGI et la DGRI sur les dotations non consomptibles n’a pas encore abouti ; nous sommes en train de réfléchir aux critères et aux indicateurs.
M. David Philipona, directeur de cabinet adjoint. Cette question renvoie au débat sur l’avenir des LABEX et surtout des EQUIPEX, dont une partie des dotations ne sont pas consomptibles. Une réflexion sera nécessaire sur les stratégies de site s’agissant des IDEX et des EQUIPEX. Les dotations non consomptibles des IDEX leur seront acquises à l’issue des évaluations de 2016 ; rien n’est prévu à ce stade pour les EQUIPEX, mais la réflexion stratégique avec le CGI nous permettra de nous pencher sur le sujet à partir de cas concrets.
Mme la secrétaire d’État. Il faut aussi se demander qui définit la stratégie et quels sont les enjeux prioritaires, même si une partie de la recherche sera toujours libre, bien entendu. La COP21 peut être une occasion de s’interroger sur la façon d’inscrire les enjeux climatiques dans notre stratégie de recherche. Le PIA est un levier, mais la vraie structuration passe par les alliances thématiques.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Le PIA, si je vous entends bien, doit tenir compte des alliances et regroupements au niveau territorial.
Mme la secrétaire d’État. Oui. Si les COMUE s’approprient l’outil dans leur gouvernance, cela s’imposera de soi-même. J’ai donc confiance dans les instruments que nous avons créés et dans les structurations de la recherche.
Pour répondre à votre question sur la valorisation, les SATT sont des sociétés par actions simplifiées (SAS), ce qui n’était pas dans la culture française ; de plus, ces sociétés ont des objectifs d’équilibre économique à dix ans qui ne sont pas faciles à atteindre – des exemples aux États-Unis ou ailleurs le montrent. Ces structures se sont avérées très utiles dans les territoires qui étaient dépourvus de dispositifs de valorisation ; dans les autres, où se trouvaient déjà des incubateurs ou des organismes tels que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ou l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) – lesquels disposaient déjà d’outils de valorisation –, l’évolution a été plus difficile. Ce n’est pas un hasard, dans ces conditions, que les SATT de Saclay et de Grenoble aient été les deux dernières à voir le jour.
La pression sur la rentabilité peut être positive si elle pousse les SATT à tenir compte du marché afin de faciliter les ventes – j’avais assisté à une présentation au cours de laquelle les mots « usage » ou « marché » n’apparaissaient jamais, par exemple. Mais il ne faudrait pas que cette pression conduise simplement à accumuler des brevets non exploités : ce qui compte, c’est par exemple le nombre de start-ups créées grâce aux brevets. La loi du 22 juillet 2013 contient des mesures, notamment sur le mandataire unique, destinées à fluidifier le transfert ; le Conseil d’État ayant enfin rendu son avis, le décret sera publié, après un an et demi, jeudi.
L’innovation de rupture génère six à sept fois plus d’investissements que l’innovation incrémentale. Celle-ci, à laquelle sont dévolus des instituts tels que la Fraunhofer en Allemagne ou le CEA Tech en France, n’a pas besoin de structures comme les SATT, contrairement à l’innovation de rupture, qui implique des risques financiers : on le voit avec les structures du Technion ou de la Silicon Valley. Or je crains que la pression sur la rentabilité ne décourage les SATT de prendre des risques, alors même que c’est l’innovation de rupture qui donne de la valeur ajoutée à un produit ou à un service et que c’est ainsi que l’on créera les futurs grands groupes. Toutes les entreprises françaises présentes au sein du CAC40 y sont, à l’exception de Gemalto, depuis quinze ans ou plus : c’est une différence notable avec les sociétés américaines. Bref, le renouvellement et le dynamisme passent par la prise de risques. Aussi devons-nous nous montrer, pour les investissements d’avenir comme pour les procédures ministérielles, moins « tatillons » sur les évaluations, mais très rigoureux sur les bilans après deux ou trois ans de fonctionnement : jouons la confiance et l’initiative. Il est significatif que le « capital-risque », en français, s’appelle « venture capital » ailleurs. Si l’on veut gagner, il faut miser.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Quels enseignements tirez-vous du PIA 1, notamment pour la gestion ou la sélection des projets du PIA 2 ?
Mme la secrétaire d’État. Le dialogue entre le CGI et les ministères, et d’abord le secrétariat d’État que je dirige, s’est nettement amélioré. Lors de la mise en œuvre des investissements d’avenir, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche aurait aimé avoir la main, mais l’on a considéré qu’il s’agissait d’un outil interministériel qui, en tant que tel, devait être placé sous l’autorité du Premier ministre ; si bien que le CGI et le secrétariat d’État à la recherche ne communiquaient guère. La coopération n’est pas encore optimale, mais elle s’est sensiblement améliorée.
La mise en place des I-SITE découle de certains enseignements : on a du mal à expliquer l’absence d’IDEX sur des territoires entiers ; cela ne tient pas, que je sache, à l’absence de talents.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Y a-t-il eu une prime aux équipes reconnues ?
Mme la secrétaire d’État. N’ayant pas pris part à ces décisions, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il y avait en tout cas une marche forcée vers les procédures uniques, et un monolithisme intellectuel incompatible avec la dynamique plurielle des écosystèmes. Le cahier des charges du PIA 2 a donc été conçu différemment ; le secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche a été davantage associé à sa rédaction, et la mise en œuvre des I-SITE permet une meilleure irrigation territoriale – il ne s’agit pas, au demeurant, de faire du saupoudrage.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Si je comprends bien, vous demandez au CGI non pas de mener des politiques d’aménagement du territoire, mais de tenir compte des stratégies de regroupement conduites dans le paysage de la recherche.
Mme la secrétaire d’État. De fait, on ne peut nier l’existence de nos pôles d’excellence, surtout lorsqu’ils sont issus d’une association volontaire entre des entités qui se faisaient pour ainsi dire concurrence. Nous dialoguons avec le CGI et allons rencontrer le jury, par ailleurs souverain, pour expliquer l’état d’esprit dans lequel nous voulons travailler.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Vous aurez donc un échange préalable avec le jury…
Mme la secrétaire d’État. Oui : pas sur les projets pris individuellement, mais sur l’état d’esprit qui doit selon nous prévaloir – je ne me permettrais évidemment pas de donner des instructions au jury. La synergie va donc croissant.
Il y a, partout sur le territoire, des niches d’excellence ayant un spectre moins large que certains grands pôles de recherche, mais que l’on peut encourager. Il y va de la reconnaissance des territoires et des efforts qu’ils ont consentis pour mutualiser leurs pôles de recherche, dans des stratégies d’excellence. Les I-SITE concerneront d’abord la recherche thématique et les IDEX l’excellence, pour peu que celle-ci n’implique pas une compétition entre les sites qui n’aurait aucun sens : la compétition se joue bien au-delà des frontières françaises et même européennes, de l’autre côté de l’Atlantique ou en Asie.
M. le président Alain Claeys, rapporteur. Merci, madame la ministre, pour la clarté de vos propos.
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LES RAPPORTEURS LE MARDI 1ER JUILLET 2014 À LA FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE CAMPUS PARIS SACLAY
– M. Dominique Vernay, président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay ;
– M. Claude Chappert, directeur général de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay, chargé de l’Idex Paris Saclay ;
– M. Philippe Corréa, directeur administratif et financier de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay ;
– M. Patrick Leboeuf, directeur délégué à la recherche de l’Idex Paris Saclay ;
– Mme Christine Paulin-Mohring, professeure à l'Université Paris-Sud, coordinatrice du Labex DigiCosme de l’Idex Paris Saclay ;
– M. Loic Lepiniec, directeur de recherches à l’Inra, coordinateur du Labex SPS – Sciences des Plantes – de l’Idex Paris Saclay.
ANNEXE 2 :
ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DU SITE
DE PARIS SACLAY
GOUVERNANCE DE LA FCS ET DE L’IDEX PARIS SACLAY
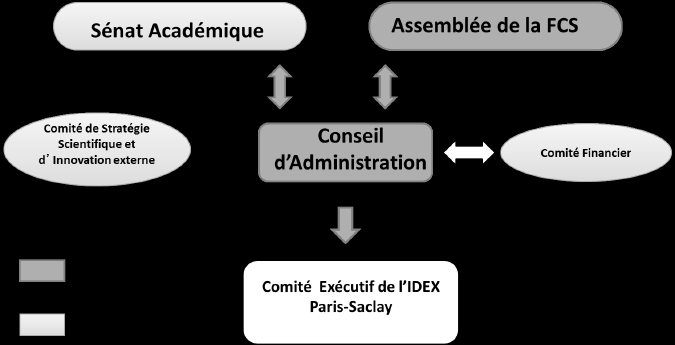
Source : FCS Campus Paris Saclay
GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ PARIS SACLAY
(COMMUNAUTÉ D’UNIVERSITÉS ET D’ÉTABLISSEMENTS – COMUE)
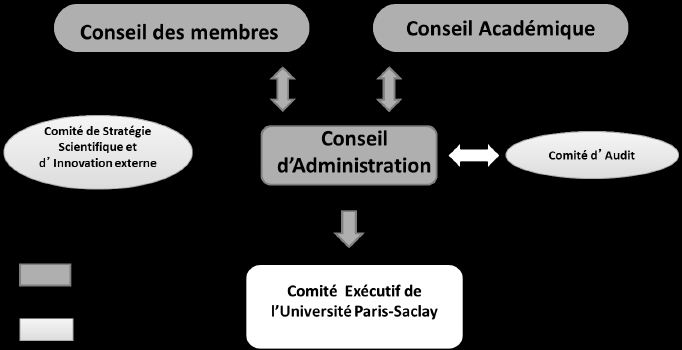
Source : FCS Campus Paris Saclay
FCS ET UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY:
INSTANCES DE GOUVERNANCE COMPARÉES
|
FCS Actuelle |
COMUE | ||||
|
Assemblée |
CA |
Sénat |
Assemblée des membres |
CA |
Conseil Académique |
1- Organismes +établissements ESR |
19 |
8 |
19 |
10 |
40 | |
– Organismes |
6 |
4 |
7 |
4 |
20 | |
– Établissements ESR. |
13 |
4 |
12 |
6 |
20 | |
2- Personnalités ou institut. externes |
4 |
4 |
6 |
24 | ||
– Monde Socio- économique |
2 |
2 |
2 |
|||
– Collectivités territoriales |
|
0 |
2 |
|||
– Pers. qualifiée (dont EPPS) |
2 |
2 |
2 |
|||
– Partenaires ou Associés |
- |
- |
7(*) |
- |
- | |
3- Personnels et Étudiants Élus |
8 |
2 |
150 |
10 |
156 | |
– Chercheurs et Enseignants |
6 |
2 |
150 |
5 |
94 | |
– Autres personnels |
0 |
0 |
0 |
3 |
32 | |
– Étudiants |
0 |
0 |
0 |
2 |
30 | |
TOTAUX |
31 |
14 |
150 |
19+7(*) |
26 |
220 |
(*) Sans voix délibérative
Source : FCS Campus Paris Saclay
ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
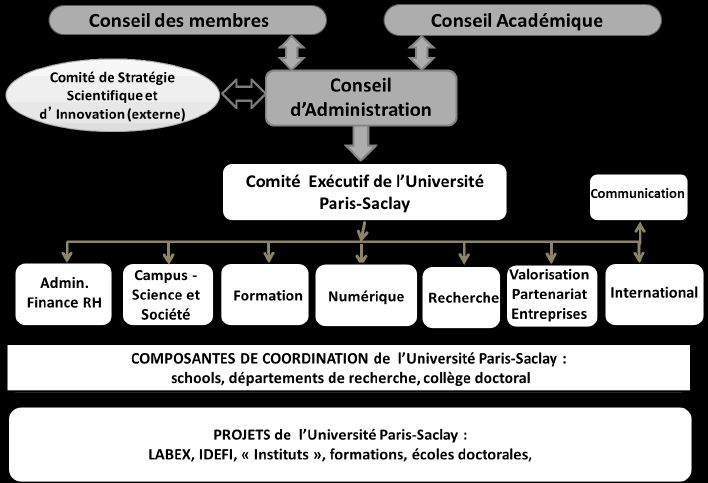
Intitulé |
Date de la décision du Premier ministre |
Projet documentaire d’intérêt national | |
ISTEX |
14/12/11 |
Idex | |
IDEX - PSL* |
01/02/12 |
IDEX - UNISTRA |
01/02/12 |
IDEX - Bordeaux |
01/02/12 |
IDEX - A*MIDEX |
28/03/12 |
IDEX - IPS |
28/03/12 |
IDEX - SUPER |
28/03/12 |
IDEX - Sorbonne Paris Cité USPC |
28/03/12 |
IDEX – UNITI (Toulouse) |
17/06/13 |
Autres projets sélectionnés | |
Lyon-St. Etienne |
29/03/12 |
Paris Nouveaux Mondes HESAM |
29/03/12 |
Total |
11 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
Intitulé du Labex |
Date de la décision du Premier ministre |
LABEX VAGUE 1 | |
Hepsys |
08/06/11 |
MEC |
08/06/11 |
IEC |
08/06/11 |
CAP |
08/06/11 |
BCDiv |
08/06/11 |
RESMED |
08/06/11 |
BRAIN |
08/06/11 |
NetRNA |
08/06/11 |
ILP |
08/06/11 |
INFLAMED |
08/06/11 |
HASTEC |
08/06/11 |
ESEP |
08/06/11 |
MATISSE |
08/06/11 |
AMADEus |
08/06/11 |
DEVWECAN |
08/06/11 |
LaSIPS |
08/06/11 |
SPS |
08/06/11 |
IAST |
08/06/11 |
MiChem |
08/06/11 |
ReFi |
08/06/11 |
LIO |
08/06/11 |
LaScArBx |
08/06/11 |
CeLyA |
08/06/11 |
COTE |
08/06/11 |
GREAM |
08/06/11 |
UnivEarthS |
08/06/11 |
Imust |
08/06/11 |
INRT |
08/06/11 |
Nano-Saclay |
08/06/11 |
TULIP |
08/06/11 |
IMU |
08/06/11 |
SISE-MANUTECH |
08/06/11 |
ASLAN |
08/06/11 |
CORAIL |
08/06/11 |
LIFESENSES |
08/06/11 |
ENS-ICFP |
08/06/11 |
EFL |
08/06/11 |
LIEPP |
08/06/11 |
PALM |
08/06/11 |
AMSE |
08/06/11 |
LABEXMED |
08/06/11 |
SEAM |
08/06/11 |
NEXT |
08/06/11 |
CSC |
08/06/11 |
MemoLife |
08/06/11 |
P2IO |
08/06/11 |
MS2T |
08/06/11 |
TransferS |
08/06/11 |
ImmunoOnco |
08/06/11 |
iPOPs |
08/06/11 |
LERMIT |
08/06/11 |
Medalis |
08/06/11 |
ICCA |
08/06/11 |
IPGG Labex |
08/06/11 |
WIFI |
08/06/11 |
TRAIL |
08/06/11 |
MILYON |
08/06/11 |
LABEX VAGUE 2 | |
DynamiTe |
04/04/12 |
TOUCAN |
04/04/12 |
INFORM |
04/04/12 |
BLRI |
04/04/12 |
OCEVU |
04/04/12 |
BASC |
04/04/12 |
DigiCosme (Ex Digiwolrd) |
04/04/12 |
COMOD |
04/04/12 |
OBVIL |
04/04/12 |
TEPSIS |
04/04/12 |
CIMI |
04/04/12 |
CALSIMLAB |
04/04/12 |
WHO AM I |
04/04/12 |
MitoCross |
04/04/12 |
SMS-SSW |
04/04/12 |
ECOFECT |
04/04/12 |
BIOPSY |
04/04/12 |
ICOME2 |
04/04/12 |
CelTisPhyBio |
04/04/12 |
SMART |
04/04/12 |
IAM-TSE |
04/04/12 |
CHARMMMAT |
04/04/12 |
CORTEX |
04/04/12 |
PRIMES |
04/04/12 |
ECODEC |
04/04/12 |
G-EAU-TERMIE PROFONDE |
04/04/12 |
EHNE |
04/04/12 |
NIE |
04/04/12 |
PLAS@PAR |
04/04/12 |
TRANSPLANTEX |
04/04/12 |
IRMIA |
04/04/12 |
GR-Ex |
04/04/12 |
SERENADE |
04/04/12 |
DEEP |
04/04/12 |
TRANSIMMUNOM |
04/04/12 |
LabEx Mathématique Hadamard |
04/04/12 |
OTMed |
04/04/12 |
DCBIOL |
04/04/12 |
ARCHIMEDE (mathématiques) |
04/04/12 |
Total |
96 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
Intitulé du Labex |
Date de la décision du Premier ministre |
LABEX VAGUE 1 | |
AMIES |
08/06/11 |
MILIEU_INTÉRIEUR |
08/06/11 |
SITES |
08/06/11 |
CeMEB |
08/06/11 |
RESSOURCES21 |
08/06/11 |
VRI |
08/06/11 |
L-IPSL |
08/06/11 |
IBEID |
08/06/11 |
FIRST-TF |
08/06/11 |
CEMAM |
08/06/11 |
IDGM+ |
08/06/11 |
NUMEV |
08/06/11 |
OSUG@2020 |
08/06/11 |
COMIN Labs |
08/06/11 |
VOLTAIRE |
08/06/11 |
EMC3 |
08/06/11 |
Sigma-LIM |
08/06/11 |
EpiGenMed |
08/06/11 |
OSE |
08/06/11 |
CheMISyst |
08/06/11 |
LANEF |
08/06/11 |
Entreprendre |
08/06/11 |
AGRO |
08/06/11 |
STORE-EX |
08/06/11 |
ITEM |
08/06/11 |
GRAL |
08/06/11 |
CEBA |
08/06/11 |
REVIVE |
08/06/11 |
CLERVOLC |
08/06/11 |
MAbImprove |
08/06/11 |
AE&CC |
08/06/11 |
FUTURBAINS |
08/06/11 |
ARTS-H2H |
08/06/11 |
EGID |
08/06/11 |
SOLSTICE |
08/06/11 |
MER |
08/06/11 |
IMoBS3 |
08/06/11 |
CARMIN |
08/06/11 |
MINOS |
08/06/11 |
PATRIMA |
08/06/11 |
Bézout |
08/06/11 |
GENMED |
08/06/11 |
SMP |
08/06/11 |
LABEX VAGUE 2 | |
TEC XXI |
04/04/12 |
LEBESGUE |
04/04/12 |
CEMPI |
04/04/12 |
DAMAS |
04/04/12 |
ARCHIMEDE (archéologie) |
04/04/12 |
MME-DII |
04/04/12 |
ARCANE |
04/04/12 |
ParaFrap |
04/04/12 |
CAMI |
04/04/12 |
INTERACTIFS |
04/04/12 |
MMCD |
04/04/12 |
ARBRE |
04/04/12 |
SIGNALIFE |
04/04/12 |
UCN@SOPHIA |
04/04/12 |
LipSTIC |
04/04/12 |
RFIEA+ |
04/04/12 |
SYNORG |
04/04/12 |
PERSYVAL-lab |
04/04/12 |
ICST |
04/04/12 |
DRIIHM - IRDHEI |
04/04/12 |
GANEX |
04/04/12 |
IRON |
04/04/12 |
DISTALZ |
04/04/12 |
FOCUS |
04/04/12 |
PP |
04/04/12 |
CAPRYSSES |
04/04/12 |
ACTION |
04/04/12 |
IGO |
04/04/12 |
ENIGMASS |
04/04/12 |
CaPPA |
04/04/12 |
DYNAMO |
04/04/12 |
LABEX FCD |
04/04/12 |
Total LABEX |
75 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
Intitulé de l’Idefi |
Date de la décision du Premier ministre |
UM3D |
16/04/12 |
ECOTROPHELIA |
16/04/12 |
PARE |
16/04/12 |
ENEPS |
16/04/12 |
PYREN |
16/04/12 |
Créa-TIC |
16/04/12 |
2PLG |
16/04/12 |
TalentCampus |
16/04/12 |
IIFR |
16/04/12 |
VPE |
16/04/12 |
DSCHOOL |
16/04/12 |
FINMINA |
16/04/12 |
FORMADIME |
16/04/12 |
IDEA |
16/04/12 |
PLACIS |
16/04/12 |
AMACO |
16/04/12 |
Gen.I.D.E.A. |
16/04/12 |
AVOSTTI |
16/04/12 |
CPA-SimUSanté© |
16/04/12 |
FORCCAST |
16/04/12 |
NovaTris |
16/04/12 |
PROLEX |
16/04/12 |
IVICA |
16/04/12 |
PROMISING |
16/04/12 |
TIL |
16/04/12 |
CMI-FIGURE |
16/04/12 |
REMIS |
16/04/12 |
MIRO.EU-PM |
16/04/12 |
DEFI DIVERSITES |
16/04/12 |
INNOVENT-E |
16/04/12 |
INNOVA-Langues |
16/04/12 |
ADICODE |
16/04/12 |
UTOP |
16/04/12 |
M-AN-IMAL |
16/04/12 |
FREDD |
16/04/12 |
SAMSEI |
16/04/12 |
EDIFICE |
16/04/12 |
Total |
37* |
*Dont 8 intégrées à des Idex et 29 hors Idex.
Source : Commissariat général à l'investissement.
.
Intitulé de l’Equipex |
Date de la décision du Premier ministre |
EQUIPEX VAGUE 1 | |
EcoX |
21/02/11 |
Paris-en-Resonance |
21/02/11 |
ImaginEx BioMed |
21/02/11 |
S3 |
21/02/11 |
IPGG Equipex |
21/02/11 |
MATRICE |
21/02/11 |
FIT |
21/02/11 |
PHARE |
21/02/11 |
ROCK |
21/02/11 |
D-FIH |
21/02/11 |
MATMECA |
21/02/11 |
ULTRABRAIN |
21/02/11 |
PLANAQUA |
21/02/11 |
LaSUP |
21/02/11 |
NAOS |
21/02/11 |
ROBOTEX |
21/02/11 |
PETAL + |
21/02/11 |
EQUIP@MESO |
21/02/11 |
FIGURES |
21/02/11 |
CILEX |
21/02/11 |
IVTV |
21/02/11 |
NanoID |
21/02/11 |
IAOOS |
21/02/11 |
Andromede Equipex |
21/02/11 |
PERINAT collection |
21/02/11 |
Sense-city |
21/02/11 |
MANUTECH-USD |
21/02/11 |
ASTER-CEREGE |
21/02/11 |
ELORPrintec |
21/02/11 |
NOEMA |
21/02/11 |
SENS |
21/02/11 |
LIGAN |
21/02/11 |
FDSOI11 |
21/02/11 |
ICGex |
21/02/11 |
ThomX |
21/02/11 |
IMPACT |
21/02/11 |
PHENOVIRT |
21/02/11 |
C.A.S.D. |
21/02/11 |
REC-HADRON |
21/02/11 |
TEMPOS |
21/02/11 |
OptoPath |
21/02/11 |
PHENOMIX |
21/02/11 |
GEOSUD |
21/02/11 |
DIME-SHS |
21/02/11 |
SOCRATE |
21/02/11 |
FlowCyTech |
21/02/11 |
MIMETIS |
21/02/11 |
NewAglae |
21/02/11 |
IMAPPI |
21/02/11 |
Xyloforest |
21/02/11 |
DIGISCOPE |
21/02/11 |
UNION |
21/02/11 |
EQUIPEX VAGUE 2 | |
ExCELSiOR |
16/03/12 |
GENESIS |
16/03/12 |
7T AMI |
16/03/12 |
CRGF |
16/03/12 |
PLANEX |
16/03/12 |
HEPATHER |
16/03/12 |
LEAF |
16/03/12 |
DURASOL |
16/03/12 |
KINOVIS |
16/03/12 |
RESIF-CORE |
16/03/12 |
GENEPI |
16/03/12 |
MIGA |
16/03/12 |
NANOIMAGESX |
16/03/12 |
MARSS |
16/03/12 |
ANINFIMIP |
16/03/12 |
DESIR |
16/03/12 |
GAP |
16/03/12 |
ATTOLAB |
16/03/12 |
CACSICE |
16/03/12 |
LILI |
16/03/12 |
OSC IMP |
16/03/12 |
I2MC |
16/03/12 |
ORTOLANG |
16/03/12 |
REFIMEVE+ |
16/03/12 |
BIBLISSIMA |
16/03/12 |
PATRIMEX |
16/03/12 |
MUSIC |
16/03/12 |
IrDive |
16/03/12 |
FLUX |
16/03/12 |
REALCAT |
16/03/12 |
DILOH |
16/03/12 |
ARRONAXPLUS |
16/03/12 |
RE-CO-NAI |
16/03/12 |
UTEM |
16/03/12 |
EXTRA |
16/03/12 |
AmiQual4HOME |
16/03/12 |
Morphoscope2 |
16/03/12 |
BEDOFIH |
16/03/12 |
PhenoCan |
16/03/12 |
CRITEX |
16/03/12 |
CLIMCOR |
31/03/14 |
Total |
93 |
Source : Commissariat général à l'investissement.
Intitulé |
Date de la décision du Premier ministre |
Instituts hospitalo-universitaires | |
IHU Méditerranée Infection (ex POLMIT) |
17/06/12 |
IHU MIX-Surg |
17/06/12 |
IHU LIRYC |
17/06/12 |
IHU Imagine |
17/06/12 |
IHU ICAN |
17/06/12 |
IHU A-ICM |
17/06/12 |
Chaires d’excellence | |
MMO ex IHU-CANCER |
17/06/11 |
CESTI (ex TSI-IHU) |
17/06/12 |
CESAME |
17/06/12 |
OPeRa |
17/06/12 |
SLI |
17/06/12 |
HandiMedEx |
17/06/12 |
Projets hospitalo-universitaires en cancérologie (PHUC) | |
PHUC - PACRI |
20/03/12 |
PHUC - CAPTOR |
20/03/12 |
Total |
14 |
Source : Commissariat général à l'investissement.
SOCIÉTÉS D’ACCÉLERATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
Intitulé de la SATT |
Date de la décision du Premier ministre |
SATT GRAND EST |
15/12/10 |
SATT Midi Pyrénées |
15/09/11 |
SATT LUTECH |
15/09/11 |
SATT IdF Innov |
15/09/11 |
SATT PACA CORSE |
15/09/11 |
SATT Conectus Alsace |
15/09/11 |
SATT Nord de France Valo |
19/01/12 |
SATT Languedoc Roussillon |
19/01/12 |
SATT Ouest Valorisation |
19/01/12 |
SATT Aquitaine |
19/01/12 |
SATT GRAND CENTRE |
31/08/12 |
SATT Lyon St Etienne |
13/05/13 |
SATT PARIS SACLAY |
18/10/13 |
SATT GIFT (Grenoble) |
18/10/13 |
Total |
14 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
CONSORTIUMS DE VALORISATION THÉMATIQUE
Intitulé du CVT |
Date de la décision du Premier ministre |
CVT SHS |
09/05/12 |
CVT Aviesan |
09/05/12 |
CVT ALLENVI |
09/05/12 |
CVSTENE |
09/05/12 |
CVT ANCRE |
09/05/12 |
Valorisation Sud |
09/05/12 |
Total |
6 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
Intitulé de l’IRT |
Date de la décision du Premier ministre |
IRT Railenium |
24/01/12 |
IRT NanoElec |
24/01/12 |
IRT Materiaux M2P |
24/01/12 |
IRT Jules Verne |
24/01/12 |
IRT BIOASTER ex LYONBIOTECH |
24/01/12 |
IRT Saint-Exupéry ex AESE |
24/01/12 |
IRT B COM |
10/04/12 |
IRT SYSTEMX |
10/04/12 |
Total |
8 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
INSTITUTS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(ex-instituts d’excellence sur les énergies décarbonées)
Intitulé de l’ITE |
Date de la décision du Premier ministre |
IEED PIVERT |
27/12/11 |
IEED VEDECOM |
04/05/12 |
IEED Supergrid |
04/05/12 |
IEED IPVF- Inst Photovoltaique IDF |
04/05/12 |
IEED IFMAS |
04/05/12 |
IEED IDEEL |
04/05/12 |
IEED GEODENERGIES |
04/05/12 |
IEED FRANCE ENERGIES MARINES |
04/05/12 |
INEF4 |
18/10/13 |
PSEE |
18/10/13 |
EFFICACITY |
18/10/13 |
INES 2 |
16/12/13 |
Total |
12 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
INSTITUTS CARNOT
Intitulé de l’institut |
Date de la décision du Premier ministre |
XLIM |
06/12/10 |
LAAS |
06/12/10 |
Energies du Futur |
06/12/10 |
CIRIMAT |
06/12/10 |
IFP Moteurs |
06/12/10 |
LIST (CEA) |
06/12/10 |
ESP |
06/12/10 |
IOGS |
06/12/10 |
IEMN |
06/12/10 |
LISA |
06/12/10 |
CEMAGREF (IRSTEA) |
06/12/10 |
Voir & Entendre |
06/12/10 |
MIB-Bordeaux |
06/12/10 |
FEMTO - ST |
06/12/10 |
VITRES-IFSTTAR |
06/12/10 |
C3S |
06/12/10 |
UT ex TIE |
06/12/10 |
CED2 |
06/12/10 |
INRETS-IFSTTAR |
06/12/10 |
STAR |
06/12/10 |
CETIM |
06/12/10 |
ICEEL |
06/12/10 |
CSTB |
06/12/10 |
M.I.N.E.S |
06/12/10 |
ARTS |
06/12/10 |
BRGM |
06/12/10 |
TELECOM ET SOCIETE NUMERIQUE |
06/12/10 |
LETI (CEA) |
06/12/10 |
PASTEUR-MI |
06/12/10 |
ONERA-ISA |
06/12/10 |
LSI |
06/12/10 |
IFREMER-EDROME |
06/12/10 |
Ingénierie @lyon |
06/12/10 |
Total |
33 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
ESPACE
(Opérateur : CNES)
Intitulé du projet |
Date de la décision du Premier ministre |
Arianespace |
06/12/10 |
SWOT |
28/03/11 |
Satellites du Futur PFgeoNG-NEOSAT |
17/06/11 |
Myriade |
28/03/13 |
Ariane 6 |
08/03/11 |
Ariane 5 ME adapté et Ariane 6 |
27/09/13 |
Ariane 5 ECA |
05/11/14 |
Satellite du futur |
05/11/14 |
Total |
8 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
RECHERCHE DANS LE DOMAINE AÉRONAUTIQUE
(Opérateur : ONERA)
Intitulé du projet |
Date de la décision du Premier ministre |
Aéronef du futur | |
Hélicoptère X4 |
17/06/11 |
Airbus A350 |
17/06/11 |
Démonstrateurs technologiques aéronautiques | |
Hélicoptère du Futur |
17/06/11 |
GEstioN OptiMisée de l’Energie (GENOME) |
12/03/12 |
EPICE |
17/06/11 |
Avion du Futur Composite |
17/06/11 |
Avionique modulaire étendue (AME) |
03/01/12 |
Moteur TS3000 |
23/04/12 |
Total |
8 |
Source : Commission des finances, sur la base de données communiquées par le Commissariat général à l'investissement.
(en millions d’euros)
Actions |
Opérateur |
Décaissements |
Initiatives d'excellence |
ANR |
859,50 |
Laboratoires d'excellence |
ANR |
256,83 |
Équipements d'excellence |
ANR |
407,79 |
Opération Campus |
ANR |
84,20 |
Saclay |
ANR |
97,68 |
Instituts hospitalo-universitaires (IHU) |
ANR |
234,80 |
Santé et biotechnologies |
ANR |
367,69 |
Fonds national de valorisation |
ANR |
299,78 |
France Brevets |
CDC |
25,08 |
Instituts de recherche technologique (IRT) |
ANR |
199,19 |
Instituts Carnot |
ANR |
23,81 |
Instituts pour la transition énergétique |
ANR |
62,15 |
Espace |
CNES |
226,54 |
Recherche dans le domaine aéronautique |
ONERA |
1014,82 |
Réacteur de 4ème génération ASTRID |
CEA |
259,86 |
Réacteur Jules Horowitz |
CEA |
137,16 |
Traitement et stockage des déchets |
ANDRA |
7,99 |
Sûreté nucléaire |
ANR |
4,90 |
Total |
4569,76 | |
Source : Commissariat général à l’investissement.
1 () Lorsque, dans le courant du présent rapport, il sera mentionné un « rapport de la Cour des comptes » sans autre précision, c’est à ce rapport qu’il sera fait référence.
2 () Les chiffres actualisés au 31 juillet 2014, publiés au sein du rapport annuel relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir (« jaune » budgétaire) annexé au projet de loi de finances pour 2015 sont présentés de façon détaillée dans les parties suivantes du présent rapport.
.
3 () Les chiffres actualisés au 31 juillet 2014, publiés au sein du rapport annuel relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir (« jaune » budgétaire) annexé au projet de loi de finances pour 2015 sont présentés de façon détaillée dans les parties suivantes du présent rapport.
4 () Les chiffres actualisés au 31 juillet 2014, publiés au sein du « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2015 sont présentés de façon détaillée dans les parties suivantes du présent rapport.
5 () Technological Readiness Level (degré de maturité technologique).
© Assemblée nationale
