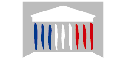
N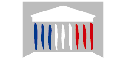
° 2777
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 14 novembre 2012,
sur « engagement et diplomatie : quelle doctrine pour nos interventions militaires ?»
et présenté par
M. Guy-michel CHAUVEAU et M. HervÉ GAYMARD
Députés
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE : RETOUR SUR CINQUANTE ANS D’ENGAGEMENTS MILITAIRES EXTÉRIEURS 9
I. L’OPÉRATION EXTÉRIEURE : UN CONCEPT UNIQUE POUR DES RÉALITÉS DIVERSES ET HÉTÉROGÈNES 9
A. QU’EST-CE QU’UNE « OPÉRATION EXTÉRIEURE » ? 9
1. Origines du terme 9
2. L’OPEX : une notion administrative 10
3. Proposition de définition 11
B. UN CONCEPT APPLICABLE À DES ENGAGEMENTS DIVERS 11
1. Diversité des types d’engagements 11
2. Diversité des volumes d’engagement 11
3. Diversité des cadres d’engagement 12
4. Diversité des durées d’engagement 13
C. LE CAS DE LA MARINE : DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES OU À L’EXTÉRIEUR ? 13
1. La marine par nature déployée hors des frontières nationales 13
2. Engagements extérieurs et à l’extérieur : une frontière floue 14
3. La dimension maritime des OPEX 14
4. Vers des théâtres d’opérations spécifiquement maritimes ? 15
II. CINQUANTE ANS D’ENGAGEMENTS MILITAIRES EXTÉRIEURS 17
A. LES GRANDES « PÉRIODES » DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES FRANÇAISES 17
1. Des opérations circonscrites pendant la guerre froide 17
2. Des engagements militaires tous azimuts à la chute des blocs 19
3. Tendances récentes : vers plus de concentration et de modularité dans les engagements 22
B. QUELS ENSEIGNEMENTS RETIRER D’UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ? 24
1. La France a-t-elle eu une doctrine ou des principes d’intervention ? 24
2. Peut-on établir un bilan global des opérations extérieures françaises ? 27
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL INTERNE DES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 33
I. LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE EFFICACITÉ ÉPROUVÉE 33
A. UNE BOUCLE DÉCISIONNELLE COURTE ET DÉCLOISONNÉE 33
1. La prééminence incontestée du chef de l’État 33
2. Un processus décisionnel efficace 34
B. UN CONTRÔLE EFFECTIF DU PARLEMENT 35
1. Un rôle traditionnellement très effacé 35
2. Des améliorations substantielles à partir de 2008 36
3. Faut-il aller plus loin ? 37
C. POINT DE COMPARAISON CHEZ NOS PARTENAIRES 37
1. États-Unis : du pouvoir de déclarer la guerre au pouvoir d’y mettre fin ? 37
2. Royaume-Uni : le vote des Communes sur la Syrie, un précédent ? 39
3. Allemagne : l’« armée parlementaire » 39
4. Espagne 40
5. Italie 41
II. LE CADRE CONCEPTUEL : LES LIVRES BLANCS DE 2008 ET 2013 41
A. LES « PRINCIPES DIRECTEURS » DES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 41
B. LE CADRE DE L’INTERVENTION POSÉ PAR LE LIVRE BLANC DE 2013 42
III. QUEL CADRE DOCTRINAL CHEZ NOS PARTENAIRES ? 45
A. LES ÉTATS-UNIS 45
1. De la doctrine Bush à la doctrine Obama 45
2. Les nouvelles données de l’engagement américain 45
3. Quel impact pour notre pays ? 47
B. LE ROYAUME-UNI 47
1. Les données historiques de l’engagement britannique 47
2. L’impact du « choc » des engagements en Irak et en Afghanistan 48
3. Un affaiblissement à tempérer 49
C. L’ALLEMAGNE 50
1. Une tradition de « retenue militaire » 50
2. Vers un investissement plus actif 51
3. Les limites de cette évolution 52
D. L’AUSTRALIE 53
1. Une ambition militaire régionale 53
2. Le cadre des opérations extérieures australiennes 53
3. Un partenariat à développer 53
TROISIÈME PARTIE : POUR UN ENCADREMENT RENFORCÉ DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT DE LA FRANCE 55
I. CINQ CRITÈRES CUMULATIFS POUR DÉCIDER D’INTERVENIR 55
A. L’INTERVENTION A UN « SENS STRATÉGIQUE » 55
1. Les intérêts supérieurs de la France sont en jeu. 56
2. L’intervention française doit véritablement servir ces intérêts. 56
B. L’INTERVENTION BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN LARGE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 57
1. La légitimité de l’intervention doit être consacrée par l’ONU. 58
2. Chercher à associer les Européens avec pragmatisme 60
3. Exploiter pleinement la coopération avec les partenaires locaux 64
4. Le soutien de l’opinion publique, plutôt un objectif qu’un critère 64
C. L’INTERVENTION A DES OBJECTIFS CLAIRS ET RÉALISTES 65
1. Les objectifs stratégiques et politiques sont clairement définis. 65
2. Ces objectifs sont proportionnés à nos moyens. 66
D. L’INTERVENTION EST ASSORTIE D’UNE STRATÉGIE DE SORTIE PÉRENNE 67
1. L’intervention est adossée à une solution politique crédible. 67
2. Nous avons une stratégie cohérente et globale pour la reconstruction du pays. 68
E. L’INTERVENTION AURA UN RÉEL EFFET POSITIF POUR LES POPULATIONS CIVILES 72
1. Les limites de l’intervention d’humanité 72
2. L’effet réel de l’intervention militaire pour les populations civiles 73
II. UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE COHÉRENCE BUDGÉTAIRE 75
A. LA FRANCE DOIT ENTRETENIR UN OUTIL MILITAIRE COHÉRENT AVEC SON NIVEAU D’AMBITION 75
1. La France doit entretenir une capacité expéditionnaire solide. 75
2. Cette exigence a des implications budgétaires fortes. 77
B. CE PRINCIPE DE COHÉRENCE BUDGÉTAIRE EST FRAGILISÉ 80
1. De multiples engagements militaires 80
2. Une forte tension sur les hommes 81
3. Une forte tension sur les équipements 82
4. Des incertitudes partiellement levées sur les ressources 83
C. DES CHOIX DIFFICILES EN PERSPECTIVE 85
1. Réinvestir, une nécessité vitale à brève échéance 85
2. Le débat sur l’avenir de la dissuasion nucléaire est-il clos ? 87
3. Opération Sentinelle et cohérence globale de l’outil militaire 88
CONCLUSION 89
EXAMEN EN COMMISSION 91
ANNEXES 111
ANNEXE N° 1 : LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES FRANÇAISES DEPUIS LA GUERRE D’ALGÉRIE 113
ANNEXE N° 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET DES VISITES EFFECTUÉES PAR LES RAPPORTEURS 155
La France est une grande Nation militaire. Son armée s’est remarquablement adaptée aux bouleversements du contexte international et aux mutations technologiques. Alors que notre pays est en paix et ne connaît pas de menace militaire directe contre son territoire, l’action extérieure et la projection de forces en dehors du territoire national donne à l’outil militaire d’être pleinement employé. Celui-ci s’est ainsi forgé une expérience de combat sur des théâtres très divers qui fait aujourd’hui l’admiration de tous nos partenaires.
Déployées à plusieurs milliers de kilomètres du territoire national, prérogative exclusive du pouvoir exécutif, les opérations extérieures ont longtemps figuré en marge du champ de contrôle des parlementaires. Depuis 2008, cette situation a évolué. Les parlementaires ont à présent des outils qui leur permettent de suivre de près la politique d’engagement armé de la France. Ils se doivent de le faire. Par-delà leur appellation sibylline, les opérations extérieures sont des actes éminemment politiques, qui engagent profondément notre pays. Ces opérations mettent en jeu des vies humaines : depuis la guerre d’Algérie. Elles mobilisent lourdement et souvent durablement les finances publiques, 632 militaires français y ont laissé leur vie. Enfin, ces engagements produisent des effets à long terme dans les pays où ils sont menés, des effets parfois bien éloignés des objectifs politiques initiaux et souvent mal anticipés.
Pour toutes ces raisons, il est utile et légitime de s’interroger sur la politique d’engagement armé de notre pays. Dans la lignée d’un précédent rapport d’information parlementaire (1), les rapporteurs avaient initialement pour horizon l’énoncé d’une « doctrine d’intervention militaire ». Cependant, ils ont rapidement été conduits à mettre de côté cet objectif, jugé inadapté à plusieurs égards. L’environnement stratégique largement imprévisible auquel nous sommes confrontés impose de préserver la liberté d’appréciation du chef de l’État. L’énoncé d’une doctrine d’intervention intangible est contradictoire avec cette exigence de souplesse. En outre, une doctrine d’intervention publiquement énoncée aurait pour effet d’amoindrir l’effet dissuasif de notre outil militaire : mieux vaut que de potentiels agresseurs aient toujours un doute sur l’éventualité d’une réponse militaire française.
Les rapporteurs estiment que le chef de l’État doit pouvoir décider d’intervenir souverainement, en fonction des circonstances de l’espèce. Cela ne signifie nullement que ces engagements doivent être affranchis de tout cadre. De nombreux paramètres sont susceptibles d’interférer dans le processus de décision d’intervention : émotion suscitée par la médiatisation des conflits, état de l’opinion publique, échéances politiques diverses… Il convient d’éviter que ces données, par nature volatiles, ne prennent une part trop grande dans la décision politique. Pour cela, les rapporteurs proposent des critères et principes précis, fondés sur l’expérience de cinquante années d’engagements militaires à l’extérieur, destinés à fournir un guide aux décideurs politiques.
PREMIÈRE PARTIE : RETOUR SUR CINQUANTE ANS D’ENGAGEMENTS MILITAIRES EXTÉRIEURS
Les interventions militaires de la France hors de ses frontières se sont multipliées à partir des années 1990, dans le contexte particulier né de la fin de la guerre froide. Cependant, la tradition expéditionnaire de l’armée française remonte aux années 1960 : la fin des conflits coloniaux a aussi marqué le début des « opérations extérieures ». Pour mieux éclairer l’avenir, vos rapporteurs jugent utile de prendre du recul sur ces cinquante années d’«interventionnisme ». Leurs propos s’appuieront sur un travail de recensement des opérations extérieures françaises depuis la fin de la guerre d’Algérie, fourni en annexe au présent rapport.
I. L’OPÉRATION EXTÉRIEURE : UN CONCEPT UNIQUE POUR DES RÉALITÉS DIVERSES ET HÉTÉROGÈNES
L’opération extérieure ou « OPEX » est en réalité un concept fourre-tout servant à désigner des engagements avant tout caractérisés par leur diversité.
A. QU’EST-CE QU’UNE « OPÉRATION EXTÉRIEURE » ?
L’origine de l’expression « opération extérieure » serait probablement liée à la Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieurs (2), une décoration créée en 1921 pour récompenser les civils et militaires ayant obtenu une citation individuelle pour fait de guerre au cours d’opérations exécutées sur des théâtres d’opérations extérieurs. Il s’agissait initialement des zones situées hors de la métropole où les combats se sont poursuivis après l’armistice du 11 novembre 1918 : Levant, Maroc, Afrique occidentale française (AOF) et Afrique équatoriale française (AEF). Cette décoration a ensuite été attribuée dans le cadre de conflits coloniaux et de guerres de décolonisation, au Maroc et en Indochine en particulier, ainsi que pour certains autres engagements (3), avant sa suppression, dans les années 1990.
La fin des conflits armés de type colonial a marqué le passage des « théâtres d’opérations extérieurs » aux « OPEX » que nous connaissons aujourd’hui. La Constitution de 1958 prévoit que le Parlement autorise la déclaration de guerre (4). De la sorte, elle définit un temps de paix et un temps de guerre. Or, au cours des années 1960, les armées et la gendarmerie commencent à participer à des conflits armés qui ne s’apparentent ni à l’un, ni à l’autre de ces temps : ce sont les opérations extérieures.
Ainsi, l’opération extérieure n’est pas la guerre. Il est intéressant de noter que c’est d’abord pour souligner cette distinction que le vocable a été utilisé. Pour le chercheur Jean-Vincent Holeindre (5), c’est typique du « déni de la guerre » propre aux démocraties occidentales. À cet égard, le terme d’« intervention militaire », fréquemment retenu, est encore plus symptomatique. Cette notion issue du vocabulaire médical suggère que l’usage de la force a pour objet de soigner un territoire que l’on considère malade, et non de confronter des volontés politiques.
2. L’OPEX : une notion administrative
Les interventions extérieures de la France sont aujourd’hui volontiers désignées par l’abréviation « OPEX ». Le ministère de la défense définit largement les OPEX comme « les interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national ». Pendant longtemps, l’OPEX était en fait une appellation non contrôlée ; c’est seulement depuis une quinzaine d’année que l’usage en a été réglementé.
À l’heure actuelle, la qualification d’OPEX est attachée à l’ouverture d’un théâtre d’opération extérieur par voie réglementaire. Il s’agit d’un arrêté ministériel qui précise la zone géographique couverte par le théâtre et la période concernée. De cette qualification administrative dépend la prise en charge des surcoûts occasionnés par l’opération sur la dotation OPEX du programme 178 (6).
La décision réglementaire d’ouverture d’un théâtre n’est pas systématique lors du déploiement de forces militaires hors du territoire national. Par exemple, il est fréquent que les opérations menées par les forces prépositionnées sur le territoire où elles sont déployées ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un théâtre. Il en fut ainsi en 2008, lorsque les forces françaises stationnées au Gabon procédèrent à l’évacuation des ressortissants français au Tchad. Nombre d’opérations menées par les militaires des forces spéciales ou des services de renseignement ne reçoivent pas davantage la qualification d’OPEX, en raison de leur caractère confidentiel. Enfin, il arrive souvent que les opérations ponctuelles menées par les bâtiments de la marine nationale au cours d’un déploiement n’apparaissent pas sur le radar des OPEX. Par exemple, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2014, deux frégates françaises ont été envoyées au large de la Libye pour assurer l’évacuation de ressortissants français et britanniques. Il s’agissait d’un cas typique d’engagement des forces armées hors du territoire national ; il n’a pas été comptabilisé comme une OPEX.
Il est nécessaire de donner une définition des opérations extérieures entrant dans le champ du présent rapport. Le critère de la qualification d’OPEX est utile mais trop « administratif » et limitatif pour être seul retenu.
Nous nous appuierons sur les travaux effectués dans le cadre du rapport du Général Bernard Thorette (7), en 2011. Le rapport délimite le champ des opérations extérieures dans le but de recenser les soldats morts au cours de ces engagements. Il en donne la définition suivante :
« Est qualifié d’opération extérieure tout emploi des forces armées hors du territoire national (qu’elles soient déployées sur le théâtre ou opèrent à partir du sol français), dans un contexte caractérisé par l’existence de menaces ou de risques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des militaires. Elle résulte d’une décision politique du pouvoir exécutif, déclinée au niveau militaire par un ordre du chef d’état-major des armées ou, le cas échéant, du directeur général de la gendarmerie nationale, dans un cadre national, multinational ou sous mandat international. »
B. UN CONCEPT APPLICABLE À DES ENGAGEMENTS DIVERS
1. Diversité des types d’engagements
L’outil militaire a été utilisé pour une palette d’engagements variant, sur l’échelle du degré de coercition, de l’acheminement d’aide humanitaire (Orcaella, Birmanie, 2008) à la guerre conventionnelle (guerre du Golfe), en passant par des missions d’observation (MONUIK, Koweït, 1991), de formation (Épidote, Afghanistan, 2002), d’interposition (Épaulard, Liban, 1982), de protection des ressortissants (Totem, Éthiopie, 1991)… En réalité, beaucoup d’opérations ont constitué un mélange de ces différentes formes d’engagements, menées à bien cumulativement ou successivement. Les engagements de la France en Afrique ont souvent comporté des volets coercition, protection des ressortissants, formation et conseil aux forces armées locales... L’archétype de ces engagements « multiformes » a sans doute été l’opération Épervier, conduite au Tchad entre 1986 et 2014.
2. Diversité des volumes d’engagement
Ces volumes varient de quelques militaires à plusieurs milliers. Les années 1990 ont été marquées par les plus gros volumes d’engagement. Le pic a été atteint lors de la Guerre du Golfe, où le corps expéditionnaire français a compris jusqu’à 17 000 hommes. Jusqu’à 7500 militaires français ont été déployés pour les opérations au Kosovo.
La réduction du format des armées au fil des lois de programmation militaire tend désormais à restreindre le volume d’hommes projetables. Depuis le début des années 2000, les plus gros théâtres d’engagement ont mobilisé de 4000 à 5000 hommes au plus fort des opérations (Licorne, Pamir, Harmattan, Serval). Si les volumes d’engagement au sein des opérations de maintien de la paix de l’ONU ont pu être substantiels dans les années 1990, il est à présent habituel que la participation française se limite à quelques observateurs militaires ou quelques officiers insérés dans les états-majors, sauf au sein de la Force des Nations Unies au Liban (FINUL), qui compte près de 900 Français.
3. Diversité des cadres d’engagement
Certains engagements militaires français ont été menés dans un cadre strictement national, surtout au cours des premières décennies. La plupart du temps, ces interventions avaient pour objet de répondre à une demande de pays africains – souvent des anciennes colonies françaises – dans le cadre des accords de défense ou d’assistance signés avec la France. Ces opérations strictement nationales avaient aussi pour objet de protéger les ressortissants et les intérêts français dans ces pays.
En réalité, la plupart des engagements militaires français ont fait l’objet d’un degré plus ou moins poussé et institutionnalisé de coopération internationale. Là encore, la diversité prévaut. Certaines opérations ont été conduites sous commandement ONU (Daman au Liban, FORPRONU en ex-Yougoslavie, APRONUC au Cambodge, Santal au Timor…).
D’autres l’ont été avec un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre de coalitions ad hoc (opérations de la Guerre du Golfe, Oryx en Somalie, début de l’engagement en Afghanistan dans le cadre d’Enduring freedom), de l’OTAN (Pamir en Afghanistan, Harmattan en Libye…), de l’Union européenne (EUFOR Tchad, Atalante…) ou encore de l’Union de l’Europe occidentale (Artimon dans le Golfe arabo-persique…) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). D’autres opérations encore ont été menées en coopération en l’absence de mandat explicite du Conseil de sécurité de l’ONU (Phase aérienne de l’opération Trident, Kosovo, 1999 ; Chammal en Irak, 2014-2015).
Enfin, plus récemment, les opérations menées par la France sont souvent des opérations à dominante nationale mâtinée de multinational (Serval et Barkhane dans le Sahel). Ces opérations sont menées sous commandement national mais les organisations internationales sont présentes sur le terrain et certains partenaires peuvent apporter à la France des appuis ponctuels.
4. Diversité des durées d’engagement
Certaines opérations ont duré quelques jours, voire quelques semaines (Verveine et Bonite au Zaïre, Nouadibou au Sénégal, Requin au Gabon, Godoria à Djibouti…). D’autres se sont prolongées sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. C’est le cas d’opérations dont l’objet est de geler une situation de conflit non résolue, singulièrement au Proche-Orient : Daman au Liban, FMO en Égypte. Dans d’autres situations, l’opération extérieure s’est transformée au fil du temps en prépositionnement de fait, utile pour mener des actions de coopération et des opérations sur court préavis dans la région (Épervier au Tchad, Licorne en Côte d’Ivoire). Dans ces situations, la logique de l’engagement n’est plus vraiment celle de l’opération extérieure telle que définie précédemment. Le caractère permanent de la présence a pu finalement être acté (transformation de Licorne en base opérationnelle avancée en janvier 2015).
Globalement, on peut noter que les engagements militaires « coup de poing », fréquents en Afrique au cours des années 1960 à 1980, ne sont plus d’actualité, exception faite des opérations lancées pour venir en aide aux pays touchés par des catastrophes naturelles ou pour évacuer des ressortissants. Dorénavant, tout engagement militaire semble appelé à durer au moins plusieurs mois, bien souvent plusieurs années.
C. LE CAS DE LA MARINE : DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES OU À L’EXTÉRIEUR ?
Le contour des opérations extérieures est particulièrement difficile à définir s’agissant de la marine. C’est la raison d’être de cette armée que de se trouver déployée en dehors des frontières nationales. En réalité, l’« OPEX » est une catégorie dans laquelle la marine se retrouve bien peu, même si elle y apporte des contributions régulières et indispensables.
1. La marine par nature déployée hors des frontières nationales
Dans la marine nationale, un bâtiment est considéré comme engagé à l’extérieur des frontières nationales dès lors qu’il s’en éloigne de plus de 300 milles nautiques, pour plus de sept jours. Au cours d’une année, les déploiements de ce type sont nombreux et divers, correspondant aux trois grandes missions de la marine. Outre les opérations extérieures stricto sensu, ces missions sont les suivantes :
• Les opérations permanentes
Parmi elles, la dissuasion nucléaire est assurée par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et le porte-avions, soutenus par des frégates et leurs hélicoptères, des chasseurs de mines, des avions de patrouille maritime ou encore des fusiliers marins. Des déploiements permanents sont en outre assurés par des moyens hauturiers au plus près des zones d’intérêts de la France, en Méditerranée orientale, dans le Golfe de Guinée, dans l’Océan Indien ou dans le Golfe arabo-persique. Des missions de prévention peuvent s’y ajouter, en fonction des nécessités du moment.
• L’action de l’État en mer
Il s’agit de missions de sauvetage, d’assistance, de secours aux migrants, de déminage, de lutte contre la pollution, la pêche illicite ou le trafic de drogue menées par les bâtiments de la marine nationale.
2. Engagements extérieurs et à l’extérieur : une frontière floue
En réalité, il existe une grande porosité entre ces différentes missions. Les bâtiments de la marine sont fréquemment appelés à passer de l’une à l’autre au cours d’un même déploiement. Un bâtiment pourra ainsi, au cours d’un déploiement permanent, se voir confier une mission de lutte contre le trafic de drogue ou se voir engagé dans une opération dite « extérieure » si une crise se déclenche ou s’aggrave dans la zone où il se trouve déployé. C’est le cas du porte-avion Charles-de-Gaulle actuellement déployé dans le Golfe arabo-persique, amené, en fonction des besoins, à contribuer à l’opération Chammal en Irak.
Au total, il est très fréquent que les opérations ponctuelles menées par la marine nationale au cours d’un déploiement – quand bien même il s’agit de véritables opérations militaires menées dans un contexte de crise – ne soient pas considérées comme des OPEX stricto sensu. Cela tient au fait que les opérations extérieures ont, depuis leur conception, essentiellement été rattachées à un théâtre d’opérations terrestre sur lequel sur déroulait l’essentiel de l’action, l’espace maritime n’étant conçu que comme un moyen de transit ou de projection pour ces opérations. Ainsi, l’opération Corymbe dans le Golfe de Guinée n’a initialement été considérée comme une OPEX qu’en raison de son rattachement au théâtre de l’opération Licorne, en Côte d’Ivoire.
3. La dimension maritime des OPEX
À travers le prisme de l’OPEX terrestre, la marine, même si elle semble rarement au cœur de l’action, a un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer. En réalité, le milieu maritime devient un espace de plus en plus stratégique pour les opérations extérieures, de plusieurs manières.
Dans le cadre d’une projection de puissance, comme en Afghanistan au début des années 2000 (Héraclès) ou en Libye en 2011 (Harmattan), le milieu maritime offre la possibilité de baser les moyens de projection au plus près de la zone d’opérations, tout en restant hors de portée des armées adverses. Les avions du porte-avion et les hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) projetés à partir d’un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ont ainsi joué un rôle clé, tandis que des frégates ont participé à ces opérations en effectuant des tirs d’artillerie à partir de la mer.
Dans le cadre d’une projection de force, la marine peut utiliser ses bâtiments amphibies pour projeter des forces à terre ou leur servir de support logistique, comme en Côte d’Ivoire en 2011 (Licorne). Elle peut aussi déployer à terre ses commandos marine ou ses avions de patrouille maritime (Sangaris, Barkhane). Enfin, dans le cadre d’une évacuation de ressortissants, la marine permet d’intervenir à partir de la mer, comme au Liban en 2006 (Baliste), en Libye en juillet 2014 et au Yémen en avril 2015.
4. Vers des théâtres d’opérations spécifiquement maritimes ?
Jusqu’alors, les opérations extérieures étaient généralement rattachées à des théâtres de crise terrestres. Mais la maritimisation croissante des enjeux stratégiques (8) pourrait bien changer la donne en faisant de la mer un théâtre d’opérations en soi. Cette tendance se dessine d’ores et déjà avec la montée en puissance de la piraterie maritime, qui a donné lieu à une première OPEX spécifiquement maritime, l’opération Atalante, lancée par l’Union européenne en 2008. Si cette opération a permis de contenir le phénomène au large de la Corne de l’Afrique, la piraterie se développe dangereusement dans le Golfe de Guinée et dans le détroit de Malacca, en Asie du Sud-Est.
Plus généralement, la croissance ininterrompue et spectaculaire des flux maritimes – les volumes transportés ont été multipliés par deux en vingt ans, de 4,5 à 9 milliards de tonnes par an – en rend la sécurisation de plus en plus stratégique. En parallèle, on observe une tendance à la « territorialisation des océans » liée à la recherche de nouvelles sources de matières premières, d’énergie et de ressources alimentaires. Ce phénomène, déjà visible dans le Canal du Mozambique, au large de la Guyane ou en mer de Chine, pourrait devenir demain la source de conflits. Ces différents facteurs pourraient ainsi, à terme, déplacer le centre de gravité des théâtres d’opération extérieurs du milieu terrestre vers le milieu marin.
*
En conclusion, il n’existe pas de définition précise et incontestable de l’opération extérieure. Les modalités de l’engagement des forces armées en dehors des frontières nationales sont en réalité très diverses, et la notion d’OPEX n’en recouvre qu’une partie. Dès lors, toute volonté de recenser les opérations extérieures françaises se heurte à la nécessité d’en donner une définition qui comporte inévitablement une part d’arbitraire.
Conscients de ces limites, les rapporteurs tiennent cependant à souligner deux caractéristiques des opérations extérieures essentielles pour la suite de leur analyse :
– Ces engagements résultent à chaque fois d’une décision politique du pouvoir exécutif, dans une situation où l’intégrité du territoire national n’est pas directement menacée. L’opération extérieure résulte ainsi d’un choix politique.
– Ce choix conduit à désigner l’outil militaire comme un instrument approprié pour résoudre une situation de crise, en l’absence d’autre solution.
II. CINQUANTE ANS D’ENGAGEMENTS MILITAIRES EXTÉRIEURS
Au cours des années 1960, la France a commencé à utiliser son outil militaire pour conduire des opérations extérieures, principalement, dans un premier temps, sur le continent africain. S’ouvrait ainsi une période caractérisée par un certain « interventionnisme » dans les conflits externes, qui était appelé à s’accentuer avec la fin de la guerre froide.
Cette période n’est pas sans précédent dans l’histoire de notre pays. La France du Second Empire (1852-1870) avait eu une politique extérieure marquée par le lancement d’expéditions militaires tous azimuts : Mexique, Crimée, Chine, Liban, mer Baltique, Algérie… À l’exception notable de l’expédition au Mexique, qui avait tourné à la déroute, le bilan de ces opérations extérieures avait pu sembler plutôt positif sur le moment : elles favorisaient le rayonnement de la France, stimulaient l’innovation technologique, encourageaient le développement d’une armée professionnelle. Quelques années plus tard intervenait pourtant la défaite de Sedan (1870). Le bilan des opérations extérieures doit être analysé dans la durée.
Ainsi, sans pousser plus loin le rapprochement avec la France du Second Empire, les rapporteurs jugent utile de faire un bref retour sur les engagements militaires extérieurs de notre pays au cours des dernières décennies.
A. LES GRANDES « PÉRIODES » DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES FRANÇAISES
1. Des opérations circonscrites pendant la guerre froide
La signature des accords d’Évian, le 18 mars 1962, mit fin à la guerre d’Algérie. La France se trouvait alors en paix. Le 18 février 1964, l’armée française intervenait au Gabon, sur l’ordre du Général de Gaulle, pour rétablir le Président Léon Mba qui venait d’être destitué lors d’un coup d’État. Ainsi s’ouvrait un longue période d’opérations extérieures.
Selon l’historien Maurice Vaïsse (9), au cours des années 1960 et 1970, les opérations extérieures de la France ont revêtu un caractère spécifique et limité en raison de deux facteurs : le contexte de guerre froide et la vision stratégique héritée du général de Gaulle.
En premier lieu, l’affrontement des blocs conduisait à geler la situation internationale. Peu de conflits échappaient à cette logique d’affrontement, direct ou indirect, des deux super-puissances. L’ONU se trouvait ainsi complètement paralysée, et donc marginalisée : toute résolution du Conseil de sécurité qui aurait autorisé l’emploi de la force (chapitre VII de la Charte des Nations Unies) se serait immanquablement vu opposer un veto par l’un des deux grands. Seule l’intervention en Corée (1950-1953) avait pu être autorisée par l’ONU de manière tout à fait circonstancielle, parce que l’Union soviétique avait décidé de ne plus siéger au Conseil de sécurité pour protester contre la non-adhésion de la Chine populaire.
Dans ce contexte, l’utilisation de l’outil militaire français répondait aux priorités fixées par le général de Gaulle, pour qui la défense avait pour objet « d’assurer en tout temps la défense du territoire ». S’y adjoignait, dans cette période encore fortement marquée par l’héritage colonial, la défense du traditionnel pré-carré de la France : les anciennes colonies d’Afrique, avec lesquelles elle se trouvait liée par des accords de défense ou d’assistance. Dans la conception du général de Gaulle, il fallait être très prudent en matière d’interventions extérieures.
Aussi le déploiement des forces armées françaises s’effectuait-il dans des limites bien précises. Il s’agissait la plupart du temps d’opérations nationales menées dans le cadre des accords de coopération ou d’assistance signés avec des pays africains. Ces opérations avaient souvent pour objet d’appuyer le pouvoir en place confronté à des mouvements de rébellion : opérations Limousin (1969-1972), Tacaud (1978-1980), Manta (1983-1984) et Épervier (1986) au Tchad ; opération Lamantin (1977-1980) en Mauritanie. Il s’agissait aussi de protéger les intérêts français et les communautés françaises ou européennes présentes dans ces pays : opération aéroportée Bonite à Kolwezi, au Zaïre (1978), opération Barracuda en Centrafrique (1979-1981), opérations Murène (1980-1981) et Requin (1990) au Gabon, opération Oside aux Comores (1989).
La France a commencé à s’affranchir de ce cadre limitatif sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, dans les années 1970. Appuyé par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le lancement, en 1978, de la force d’interposition des Nations Unies au Liban (FINUL, opération Daman) a constitué une première. Ce déploiement fut décidé après que les forces israéliennes eurent envahi le sud Liban en réponse à une attaque meurtrière revendiquée par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et menée depuis ses bases du Sud-Liban. Le mandat de la FINUL, toujours en place, a été modifié à plusieurs reprises. Lors de pics de violences, elle a été ponctuellement renforcée par des opérations multinationales (Épaulard, 1982 ; Diodon, 1982-1984) ou nationales (Chevesne, 1984).
Mais ce dernier type d’interventions restait rare dans le contexte de la guerre froide. Il va connaître un véritable « essor » au cours des années 1990.
2. Des engagements militaires tous azimuts à la chute des blocs
Les interventions extérieures françaises se sont multipliées et considérablement diversifiées à partir des années 1990, avec la fin de la guerre froide.
• Les facteurs
La fin du système des blocs, amorcée avec la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 et parachevée avec l’implosion de l’URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie en 1991, a eu pour effet de « dégeler » la situation internationale, et de libérer, au sein des États, des forces centrifuges qui en contestaient l’autorité. On a ainsi assisté à une multiplication de crises souvent intra-étatiques plus ou moins graves. Dans ce contexte, le recours à l’outil militaire paraissait nécessaire pour prévenir l’extension de ces conflits, voire leur transformation en guerre.
En outre, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la France se considère comme une puissance à vocation mondiale. Elle estime qu’il est dans sons son rôle de contribuer à la paix dans le monde, en s’engageant militairement s’il le faut.
Enfin, au cours des années 1990 a émergé la conviction que, pour des raisons humanitaires, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays devait céder le pas à des considérations plus hautes. Désormais, ce principe fondamental du droit international devait être mis en balance avec un « devoir d’ingérence humanitaire ». Selon Bernard Kouchner (10), qui en a été un théoricien et militant actif, ce principe emporte l’obligation, pour les États qui le peuvent, d’intervenir pour des raisons humanitaires dans tout État où les populations subissent des souffrances inacceptables au regard des droits les plus élémentaires de l’homme et où les principes fondamentaux du droit humanitaire sont violés. Dans la continuité de ce concept, l’Assemblée générale des Nations Unies a endossé en 2005 le principe de « responsabilité de protéger » (R2P) en vertu duquel la communauté internationale doit mener une action résolue pour protéger les populations et prévenir les crimes les plus atroces lorsque les États concernés ne s’acquittent pas de leur responsabilité première en la matière.
Paragraphes relatifs à la responsabilité de protéger dans le document final du Sommet mondial de l’ONU de 2005 (60/1)
138. C’est à chaque État qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l’acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s’acquitter de cette responsabilité et aider l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d’alerte rapide.
139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Nous soulignons que l’Assemblée générale doit poursuivre l’examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et des conséquences qu’elle emporte, en ayant à l’esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu’il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu’une crise ou qu’un conflit n’éclate.
• Diversification et multiplication des engagements militaires extérieurs
À partir de la guerre du Golfe, les déploiements extérieurs des forces françaises se multiplient. Ce premier conflit (1990-1991) revêt un caractère particulier en raison de l’ampleur de la coalition mise sur pied derrière les États-Unis (700 000 hommes issus de 17 pays) et de sa nature interétatique. Le déploiement des forces françaises à cette occasion (17 000 hommes au plus fort du conflit, engagés dans les opérations Artimon, Busiris, Daguet et Méteil) est resté sans égal dans l’histoire récente des opérations extérieures françaises.
À partir des années 1990, l’immense majorité des conflits est de nature intra-étatique. Dans ce contexte, on note une extension et une diversification des actions extérieures françaises.
Les engagements militaires français sont désormais menés en tous points du globe. La guerre du Golfe mise à part, les plus gros contingents français sont déployés dans les Balkans à partir de 1992, d’abord en Croatie puis en Bosnie (FORPRONU, opérations Crécerelle, Hermine et Salamandre) et au Kosovo à partir de décembre 1998 (opération Trident). Cependant, l’armée française ne limite plus ses activités à l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Elle se déploie en dehors de sa zone traditionnelle, par exemple en Asie (APRONUC au Cambodge, 1991-1993 ; Santal au Timor, 1999-2001 ; Héraclès, Pamir et Épidote en Afghanistan, 2001-2014) et en Amérique latine (ONUSAL au Salvador, 1991-1995 ; MINUHA en Haïti ; MONUA en Angola, 1995-1999…). Les années 1990 et le début des années 2000 se caractérisent ainsi par une grande dispersion géographique.
Cette dispersion s’accompagne d’une diversification des cadres d’emploi de la force armée. Les engagements nationaux dans le cadre d’accords de défense ou d’assistance se font plus rares en proportion (Godoria, Iskoutir, Ardoukoba et Khor Angar à Djibouti, 1991-2001 ; Balata et Aramis au Cameroun, 1994-1998 et 1998-2008 ; Azalée au Comores, 1995 ; Licorne en Côte d’Ivoire, 2002-2003). De plus en plus souvent, les opérations extérieures sont placées sous une bannière multinationale. Au début des années 1990, la France s’investit fortement dans des opérations sous commandement ONU (MINURSO, MIPRENUC, APRONUC, FORPRONU, ONUSOM, MONUG, MONUA, MINUHA…). La prise de conscience des limites inhérentes aux opérations sous casque bleu – lourdeur des déploiements, règles d’engagement particulièrement restrictives et mandats insuffisants pour imposer la paix, singulièrement en ex-Yougoslavie – conduit ensuite la France à privilégier des opérations multilatérales sous commandement OTAN (Salamandre en Bosnie, Trident au Kosovo, Pamir en Afghanistan, Harmattan en Libye). Les forces françaises sont aussi engagées dans des opérations européennes, d’abord dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO : Danube en Hongrie, 1992-1997 ; Sharp vigilance et Sharp fence en mer Adriatique, 1992) puis dans le cadre de l’Union européenne, avec l’amorce d’une politique européenne de sécurité et de défense (PESD), puis d’une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) : Althaïr en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 2003 ; EUFOR Tchad, 2007-2009 ; Atalante à partir de 2008…
L’appui des Nations Unies est désormais recherché, après le précédent de la résolution 678 adoptée par le Conseil de sécurité le 29 novembre 1990, qui a fondé l’intervention de la coalition internationale dans la guerre du Golfe.
• Conversion doctrinale et transformation de l’outil militaire
Selon l’historien Maurice Vaïsse (11), l’évolution de la relation de la France à son outil militaire au cours des années 1990 a représenté un véritable « choc doctrinal », consacré par le Livre Blanc sur la défense de 1994 (12). Le précédent Livre Blanc, élaboré en 1972, était totalement imprégné de la vision du Général de Gaulle : la mission des armées était la défense du territoire national, servie par l’arme nucléaire. Dans le Livre Blanc de 1994, l’accent est mis sur la projection et l’action extérieure ; un nouvel équilibre entre dissuasion et action est esquissé, l’arme nucléaire se trouve désacralisée. Une mission de protection extérieure est affirmée : la défense du territoire et de l’intérêt national ne constitue plus le mobile principal d’action.
Cette conversion doctrinale a eu pour conséquence concrète le choix du passage d’une armée mixte à une armée de métier, amorcé en 1996. La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a suspendu la conscription. La loi de programmation militaire 1997-2003 a ainsi prévu la suppression de 200 000 emplois d’appelés et le recrutement de 60 000 professionnels. Cette professionnalisation marquait le choix en faveur des capacités de projection extérieure, la conscription étant davantage orientée vers la défense du territoire national en complément de la dissuasion nucléaire. Il n’était pas envisageable d’envoyer des appelés risquer leur vie sur des théâtres extérieurs. Pour mener des actions en dehors du territoire national, la France avait besoin d’un ensemble de forces homogènes, disponible sans délai et apte aux actions offensives.
3. Tendances récentes : vers plus de concentration et de modularité dans les engagements
Les opérations récentes font apparaître une double tendance dans l’évolution du recours à l’outil militaire français en réponse aux crises extérieures.
• Des engagements militaires plus sélectifs et concentrés
En premier lieu, sous les effets conjugués de la contrainte budgétaire et d’une certaine lassitude de l’opinion publique à l’égard d’interventions extérieures dont l’efficacité est contestée, les engagements militaires français tendent à être plus sélectifs et concentrés. Il s’agit d’un objectif explicitement affiché par le Livre Blanc sur la sécurité et la défense nationale de 2008 (13) :
« Les moyens militaires de la France doivent éviter la dispersion, pour pouvoir agir de façon ramassée et concentrée sur les lieux où nos intérêts peuvent être mis en cause. Nos capacités d’intervention doivent donc entrer dans une logique de concentration sur des axes géographiques prioritaires, couvrant de manière réaliste les hypothèses de déploiement ou d’emploi des forces. Ce principe de concentration constitue une orientation fondamentale du volet militaire de la stratégie de sécurité nationale. »
Le Livre Blanc définit l’axe stratégique prioritaire de déploiement des capacités d’intervention françaises comme épousant « les contours des risques les plus lourds, de l’Atlantique jusqu’à la mer d’Oman et à l’océan Indien, à partir duquel des extensions de présence vers l’Asie sont possibles ».
Au cours des années 2000, on observe dans les faits un resserrement géographique des engagements militaires français, parachevé avec le désengagement français d’Afghanistan en décembre 2014, et la décision de la France de ne pas participer à la mission Resolute support que l’OTAN maintient dans le pays. Durant les années 2000, la France n’entreprend quasiment plus d’opérations sur des théâtres éloignés de la métropole, à l’exception de l’expédition afghane, par laquelle la France marquait sa solidarité avec l’allié américain, agressé sur son propre sol le 11 septembre 2001. Pour le reste, les engagements militaires lointains correspondent essentiellement à des opérations ponctuelles, souvent dans un but humanitaire après une catastrophe naturelle (Béryx, Indonésie, 2005 ; Bahral, Pakistan, 2005-2006 ; Orcaella, Birmanie, 2008).
Au total, les capacités d’intervention françaises ont été concentrées sur une zone allant de la moitié nord de l’Afrique (Licorne en Côte d’Ivoire, Harmattan en Libye, Serval puis Barkhane dans le Sahel, Sangaris en Centrafrique) au Proche-Orient (Daman au Liban, Chammal en Irak) en passant par la Méditerranée et le Golfe arabo-persique. À l’heure actuelle, 80 % des effectifs militaires français engagés en opération extérieure sont concentrés sur quatre théâtres : le Sahel, la Centrafrique, Le Liban et le Levant.
• Des formules d’engagement en marge des cadres traditionnels d’alliance militaire
Au cours des années 1990, la France a privilégié l’engagement de ses forces armées dans des cadres multinationaux institutionnels. L’engagement dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU a progressivement cédé la place aux coalitions militaires au sein de l’OTAN, ce dernier cadre paraissant plus propice à la conduite d’opérations dans une perspective d’imposition de la paix, dès lors que les États-Unis sont partie prenante. Néanmoins, au terme d’une décennie d’engagement de l’OTAN en Afghanistan, et après l’opération Harmattan en Libye, il semble peu probable que l’OTAN soit à nouveau sollicitée à moyen terme pour des opérations hors zone de grande ampleur. Quant aux opérations sous commandement ONU, les contributions françaises se limitent désormais le plus souvent à quelques officiers insérés au sein des états-majors (MINUL, ONUCI, MINUEE…), exception faite de la FINUL, au Liban.
De fait, la France privilégie de en plus, pour ses engagements militaires, de formules de coopération à géométrie variable, en marge des cadres traditionnels d’alliance militaire, en fonction des circonstances de l’espèce et des capacités que chacun peut apporter. Dans cette perspective, les différentes organisations internationales sont considérées, plutôt que comme des cadres d’action, comme des boîtes à outil susceptibles d’apporter de l’interopérabilité (OTAN) ou des appuis au dispositif principal (missions et opérations de l’Union européenne), ou d’en assurer la continuité et la pérennité (opérations de l’Union africaine et de l’ONU). Ces formules de coopération ont l’avantage d’être souples et d’éviter les lourdeurs propres à la mobilisation des structures de commandement internationales. Les opérations Serval, Sangaris et Barkhane en sont des exemples typiques.
B. QUELS ENSEIGNEMENTS RETIRER D’UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ?
1. La France a-t-elle eu une doctrine ou des principes d’intervention ?
Pour l’ensemble des interlocuteurs rencontrés par la mission d’information, la France n’a jamais vraiment eu, au cours de ces cinquante années d’engagements militaires extérieurs, une doctrine d’intervention. Les opérations extérieures françaises ont été décidées au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce. Cela ne signifie pas qu’elles l’ont été en dehors de tout cadre conceptuel. Au contraire, au-delà de la diversité des périodes d’engagements militaires décrites ci-dessus, vos rapporteurs ont été marqués par la permanence de trois grandes tendances qui ont, de longue date, imprégné les décisions françaises d’intervention.
• Une conception large de nos intérêts et responsabilités
Cette conception large découle de l’histoire et de la géographie de notre pays. Le territoire national est ouvert sur trois continents, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Par ses territoires d’outre-mer, la France est présente sur quatre des cinq continents. Elle conserve des liens particuliers avec ses anciennes colonies. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. En raison de tous ces facteurs, la France n’a jamais limité son action extérieure aux abords immédiats de son territoire. Au fil du temps, notre pays a conservé, avec des degrés divers, une conception mondiale nourrie par la philosophie universaliste propre aux valeurs de la République.
• Une disponibilité pour mobiliser l’outil militaire au service de cette conception
En France, la conception large des intérêts et responsabilités nationales se conjugue avec la volonté d’utiliser, si nécessaire, l’outil militaire pour les défendre, et la capacité pratique de le faire, l’outil militaire étant doté des savoir-faire et capacités requis. Ce triptyque est une marque de fabrique de notre pays. On le retrouve seulement, à des degrés divers, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
C’est ainsi que la France a été l’un des contributeurs majeurs de tous les grands rendez-vous militaires des dernières décennies : guerre du Golfe, guerres des Balkans, Afghanistan, bande sahélo-saharienne et à présent Irak. La seule exception a été l’intervention américaine en Irak en 2003, à laquelle la France ne s’est pas associée précisément parce qu’elle l’estimait contraire à ses intérêts et à ses responsabilités de puissance.
En dehors de ces opérations majeures, la France est intervenue à de nombreuses reprises en vertu d’une certaine conception de ses responsabilités envers ses anciennes colonies d’Afrique, y compris quand elle ne semblait y avoir aucun intérêt particulier.
• Un souci marqué de la légalité et de la légitimité internationales
La France a, plus que la plupart des puissances militaires dans le monde, le souci de fonder la légalité et la légitimité de ses engagements militaires extérieurs. Cette tendance n’est pas nouvelle. Depuis que l’ONU a été réactivée, à la fin de la guerre froide, la France a constamment cherché à obtenir l’autorisation du Conseil de sécurité pour intervenir. Ce souci tient évidemment au statut de membre permanent de notre pays : la France a tout intérêt à maintenir la centralité de l’Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Toutes les interventions à dominante française depuis la fin de la guerre froide ont été autorisées par une résolution du Conseil de sécurité prise sous chapitre VII, exception faite des interventions découlant strictement de la mise en œuvre d’accords de défense. L’opération Turquoise au Rwanda, en dépit de toutes les controverses qu’elle a suscitées, avait été autorisée par la résolution 929 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux exactions et préparer le terrain pour une opération de l’ONU. De manière croissante, la France cherche à fonder la légalité de ses engagements militaires en Afrique sur une résolution de l’ONU plutôt que sur la légitime défense collective invoquée dans le cadre de ses accords de défense. L’opération Licorne a été lancée en septembre 2002 en vertu de l’accord de défense qui liait la France à la Côte d’Ivoire, mais sa prolongation à compter de février 2003 s’est effectuée dans le cadre de résolutions du Conseil de sécurité adoptées sous chapitre VII (résolution 1464 et suivantes). Plus récemment, les opérations Serval et Sangaris ont été préalablement autorisées par les résolutions 2085 et 2127, adoptées sous chapitre VII.
S’agissant des interventions au sein de coalitions internationales, seule la campagne aérienne de l’OTAN au Kosovo (mars-juin 1999) a été effectuée en dehors d’un mandat explicite du Conseil de sécurité. Si sa légalité est contestable, la légitimité de cette intervention est néanmoins étayée par le fait que le Conseil de sécurité avait préalablement adopté plusieurs résolutions sous chapitre VII (14), même s’il n’avait pas explicitement autorisé l’emploi de la force. En Libye en 2011, l’opération Harmattan avait été autorisée par la résolution 1973 afin d’assurer la protection de la population civile. Les enchaînements qui ont conduit au renversement et à la mort du colonel Kadhafi ont néanmoins quelque peu débordé le cadre de la résolution. Il faut cependant avoir à l’esprit que les enchaînements mis en branle avec l’intervention étaient en réalité difficilement maîtrisables.
Légalité du recours à la force en droit international
L’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies pose le principe de l’interdiction du recours à la force : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. » Ce principe connaît plusieurs tempéraments, souvent sujets à des interprétations variables, dans une optique plus instrumentale que légaliste du droit international.
La légitime défense. L’article 51 de la Charte des Nations Unies affirme le droit des États à la légitime défense en cas d’agression armée : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». La légitime défense peut aussi être collective : elle autorise donc un État à venir en aide à un autre État auquel il est lié par un accord de défense mutuel ou par la garantie collective prévue à l’article 5 de la Charte de l’Alliance Atlantique.
L’autorisation du Conseil de sécurité. Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies prévoit que, lorsque le Conseil de sécurité constate « l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression », il peut adopter diverses mesures, et notamment « entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ».
L’intervention sollicitée. Elle est effectuée par le Gouvernement légitime, établi conformément aux prescriptions du droit constitutionnel interne de l’État considéré. Dans la mesure où la demande d’intervention résulte de l’exercice par le gouvernement considéré d’une prérogative souveraine, on peut inférer que l’intervention ne porte pas atteinte au principe de non-ingérence. Si la légalité d’une telle intervention ne fait pas de doute en situation de légitime défense (si l’État considéré fait face à une agression externe), elle est cependant plus difficile à apprécier lorsque le Gouvernement fait face à un conflit armé interne, en l’absence de résolution du Conseil de sécurité.
Les interventions à but humanitaire. La question de la légalité des interventions qui ont pour but d’éviter des pertes considérables en vies humaines se pose en particulier lorsque ces interventions ne peuvent s’appuyer sur une autorisation du Conseil de sécurité, celui-ci se trouvant paralysé par le veto imposé par l’un de ses membres permanents. Afin de surmonter cette difficulté, la France milite auprès de ses partenaires à l’ONU pour que soit instaurée une suspension du droit de veto en cas de crime de masse (cf. p.59).
2. Peut-on établir un bilan global des opérations extérieures françaises ?
• Un bilan plutôt positif sur le plan militaire
La grande capacité à se réformer dont a fait preuve l’armée française au cours des dernières décennies a favorisé sa transformation en une force expéditionnaire de grande qualité.
En réalité, l’armée française a été la première armée européenne à développer une telle capacité expéditionnaire. Dès les années 1980, l’armée de terre avait adapté ses structures opérationnelles en spécialisant certaines de ses capacités au sein d’une Force d’action rapide (FAR) qui inspira les Britanniques pour la conception de l’ARRC (Allied rapid reaction force), élément majeur des capacités d’intervention terrestre de l’OTAN dans la gestion des crises sur la période 1990-2005. Cette transformation s’est poursuivie avec la décision prise en 1996 de professionnaliser les armées, qui actait la priorité donnée aux capacités d’action et de projection extérieures.
Depuis, l’armée française n’a cessé de conforter son expérience et son savoir-faire dans ce domaine où elle excelle. À l’épreuve des engagements extérieurs, l’outil militaire français a montré une remarquable aptitude à s’adapter aux tendances de fond du contexte international : raccourcissement des préavis dans le déclenchement des crises, action sur des théâtres lointains et étendus, d’une diversité croissante, montée en puissance des menaces asymétriques… Selon le général Paloméros, commandant suprême allié pour la transformation de l’OTAN (15), la France se distingue, parmi les Nations alliées, par la faculté de son armée à acquérir et murir de nouvelles compétences et à préparer l’avenir.
Cette transformation de l’armée a été rendue possible par le professionnalisme constamment accru du personnel militaire et son aguerrissement aux engagements extérieurs. Au total, les armées ont mis sur pied « une force particulièrement agile, polyvalente, capable d’intervenir dans les contextes les plus divers et de basculer sans délai des situations de basse intensité à des affrontements de haute intensité, avec un savoir-faire et un savoir-être qu’envient nos alliés » (16).
En outre, les opérations extérieures ont été un facteur de légitimité pour les forces armées, qui bénéficient d’une appréciation positive croissante dans l’opinion publique. Au bout du compte, le bilan militaire de cinquante ans d’engagements extérieurs apparaît ainsi incontestablement positif.
• Un bilan politique plus mitigé
Le bilan politique des opérations extérieures s’apprécie à un double niveau, celui de leur efficacité sur le terrain par rapport aux objectifs politiques qui avaient présidé à leur déclenchement ; et celui du bénéfice que la France en a tiré en termes d’image et d’influence diplomatique. À l’aune de ces deux critères, force est de constater que le bilan des opérations extérieures menées par la France est nettement plus mitigé. Vos rapporteurs n’ont pas ici l’ambition de rentrer dans le détail de l’analyse des retombées de chaque engagement militaire français. Ils se borneront à quelques grandes remarques.
– L’efficacité à long terme des opérations extérieures
Sur le long terme, nous ne pouvons que constater les limites de l’efficacité des opérations extérieures pour stabiliser les pays dans lesquelles elles sont conduites.
Depuis les années 1960, la France est intervenue à de nombreuses reprises dans plusieurs pays africains qui ne sont pas pour autant stabilisés à l’heure actuelle. L’exemple de la République centrafricaine est emblématique, 45 ans après la première intervention française, qui a été suivie de nombreuses autres (opération Barracuda, puis éléments français d’assistance opérationnelle – EFAO, opérations Almandin 1,2 et 3, Boali, Sangaris et EUFOR RCA…). À l’heure où la mission des Nations Unies (MINUSCA) doit prendre le relai de la force française Sangaris, la relative stabilisation de la situation sécuritaire paraît bien fragile en l’absence d’avancée substantielle du processus politique.
Les opérations menées dans des cadres multinationaux connaissent les mêmes limites. Le Kosovo fait encore face à des défis nombreux, malgré un investissement important de la communauté internationale pendant plus de quinze ans : la KFOR a compté jusqu’à 50 000 hommes, en sus du personnel de la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et de la mission européenne EULEX Kosovo. Le constat est préoccupant aussi en Afghanistan : treize ans après l’arrivée de l’OTAN dans le pays, et malgré un investissement financier et humain considérable (la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan – FIAS – a compté jusqu’à 130 000 hommes), la situation sécuritaire demeure extrêmement précaire. La culture de l’opium demeure, de loin, la première activité économique d’un pays encore sous perfusion de l’aide internationale, et les forces armées afghanes peinent à faire face à la résurgence de l’insurrection talibane.
Évidemment, les maux de ces pays ne peuvent pas tous être imputés aux échecs des interventions militaires extérieures. Ces interventions ont parfois eu de vrais résultats qu’on ne peut pas non plus ignorer. La présence française – discontinue puis continue – au Tchad depuis quarante-cinq ans (opérations Limousin, Tacaud, Manta, Épervier, EUFOR Tchad, Barkhane) a réellement favorisé la construction d’un État et de forces armées parmi les plus solides dans la région. L’opération Serval au Mali a été unanimement considérée comme une prouesse sur le plan militaire, et elle a permis d’éviter que le Mali ne devienne un nouveau sanctuaire terroriste. D’après Hubert Védrine (17), les nombreuses interventions françaises en Afrique ont permis de stopper dans l’œuf beaucoup de massacres et de guerres civiles dans les anciennes colonies françaises. Il note d’ailleurs que la plupart des drames humanitaires africains dans la période qui a suivi les indépendances se sont déroulés en dehors de la zone d’influence française : Angola, Mozambique, Ouganda, Sierra Leone, Nigéria… Comme le relève le think tank britannique RUSI au sujet des interventions militaires du Royaume-Uni (18), il est plus facile d’évaluer le coût des interventions que celui des « non-interventions ». Cette donnée doit pourtant être prise en compte.
Néanmoins, le recul historique sur les suites des opérations extérieures incite à penser que ces dernières doivent avoir une ambition bien circonscrite et forcément modeste : gagner la guerre n’est pas gagner la paix. L’atteinte des objectifs stratégiques n’est nullement un gage de succès sur le plan politique. La situation actuelle du Mali le montre bien. Personne ne conteste les fondements et les modalités de mise en œuvre de l’opération Serval, et pourtant il est évident qu’elle n’a rien résolu à elle-seule. La résurgence des attaques terroristes dans le nord du pays avec la régionalisation du dispositif français (opération Barkhane) le montre bien. L’esquisse d’un accord de paix à Alger le 1er mars laisse espérer un règlement plus pérenne du conflit, mais rien n’est acquis à ce stade.
Les interventions militaires, même bien menées, ne se transforment pas toujours en succès politiques. À l’inverse, leurs effets potentiellement déstructurants doivent être mieux pris en compte. Cet aspect a indéniablement été sous-estimé lors de l’intervention en Libye en 2011. Du point de vue des militaires français, l’opération Harmattan a été un succès. Et pourtant, le vide politique et sécuritaire né de la chute de Kadhafi est extrêmement nuisible pour la stabilité de la région et pour les intérêts de sécurité européens. Bien que la France ne se soit pas associée à cette opération, le même constat vaut évidemment pour l’opération menée par les Américains en Irak en 2003, dont les dommages ne sont aujourd’hui que trop visibles.
– Le bénéfice politique des opérations extérieures pour la France
Quel bénéfice la France a-t-elle tiré de ces interventions sur le plan politique et diplomatique ? Là encore, le bilan est en demi-teinte.
Les nombreux allers-retours de la France dans ses anciennes colonies africaines ont pu lui donner une image de gendarme de l’Afrique. Ils ont été très critiqués sur le plan des motivations. Certes, ces engagements militaires ont contribué à maintenir des « liens privilégiés » entre la France et certains de ces pays. Ils ont permis d’entretenir et de renouveler la « culture africaine » de l’armée française. Ces effets positifs doivent être mis en balance avec la situation du Royaume-Uni, qui n’a conservé que peu d’expertise et peu de liens avec ses anciennes colonies d’Afrique. Cet investissement militaire en Afrique n’est sans doute pas étranger au fait que les États-Unis considèrent ce continent comme une zone d’influence majoritairement française. Mais au total, il semble que le crédit politique que la France a pu tirer de ses engagements militaires africains demeure miné par la contestation récurrente de la légitimité de ces interventions, sur la scène internationale et dans ses relations avec les pays africains.
Par ailleurs, les déboires de certaines interventions ont eu un retentissement extrêmement négatif en termes politiques. On peut notamment citer les trois premières années de l’intervention de l’ONU dans les Balkans, où la FORPRONU, déployée dans une optique stricte de maintien de la paix, s’est trouvée dans l’incapacité de prévenir les massacres, en l’absence de paix à maintenir. L’opération Turquoise au Rwanda a eu un retentissement très nuisible pour l’image de la France et continue de faire l’objet de controverses, alors même qu’il s’agissait d’un conflit purement interne et que la France n’avait pas d’intérêts particuliers en jeu. Les déboires de l’intervention internationale en Somalie entre 1992 et 1994 ont fortement nui à la réputation de l’ONU et des puissances qui s’y étaient impliquées, en premier lieu les États-Unis mais aussi la France. Le chaos politique et sécuritaire qui a suivi l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011 affaiblit considérablement le crédit politique de la France et du Royaume-Uni qui en ont assuré le leadership, en particulier auprès des voisins de ce pays – Tunisie, Algérie, Égypte, Niger, Tchad – dont certains réclament que la communauté internationale « finisse le travail ». L’affaire libyenne pourrait affaiblir la capacité de notre pays à entraîner des partenaires dans des opérations militaires à l’avenir.
Enfin, s’agissant d’engagements militaires au sein de coalitions dont la France n’a pas le leadership, il est légitime de se demander si le bénéfice politique que notre pays a tiré de ces engagements est à la hauteur de leur coût humain et financier. Le bilan des treize années de présence militaire française en Afghanistan est-il positif ? 70 000 soldats français y ont été envoyés en tout, plus de 700 ont été blessés et 89 y ont laissé leur vie. Pour le Général Vincent Desportes, la réponse ne fait aucun doute : en Afghanistan, la France « a subi sans rien maîtriser, sans en retirer aucun bénéfice » (19). Appréciation en partie partagée par le Général Didier Castres, sous-chef d’état-major Opérations à l’état-major des armées, pour qui « en Afghanistan, le volume de notre contribution ne nous a jamais permis de peser stratégiquement » (20). Cependant, cet engagement dans une opération menée par les États-Unis – tout comme l’engagement actuel de l’armée de Irak – a permis d’afficher la solidarité de notre pays avec son allié américain, lequel avait subi sur son sol une agression d’une violence extrême le 11 septembre 2001.
Là encore, lorsqu’on évalue le bénéfice politique des opérations extérieures, il convient de dresser un tableau nuancé. L’opération Serval et le dispositif français dans la bande sahélo-saharienne sont jugés très favorablement sur la scène internationale. On peut estimer que notre pays tire de ces opérations un bénéfice politique substantiel auprès de nos partenaires, en particulier américains, et même au-delà. L’ambassadeur d’Australie (21), rencontré par vos rapporteurs, a ainsi pu exprimer la grande admiration de la classe politique et des militaires australiens pour l’action de la France au Mali et dans la bande sahélo-saharienne.
*
En somme, un retour en arrière sur les opérations extérieures menées par la France depuis cinquante ans fait apparaître un bilan mitigé. Il est très positif sur le plan militaire : par les opérations extérieures, qui ont incité la France à maintenir un effort continu en faveur de son outil militaire, notre pays dispose à présent de l’une des meilleures armées au monde. Toutefois, l’outil militaire n’est pas une fin en soi : il n’est qu’un outil au service d’une politique.
Or, le bilan politique des opérations extérieures françaises est nettement plus nuancé. Les lendemains compliqués des opérations lancées tous azimuts au cours des années 1990 et 2000 ont fait naître un doute sur l’efficacité de l’utilisation de l’outil militaire en réponse aux crises extérieures. Ce doute qui s’est installé dans les opinions fragilise la légitimité des engagements extérieurs et le bénéfice politique de notre pays peut espérer en retirer.
Pourtant, le contexte international redonne toute sa centralité à l’engagement militaire. Les menaces à la sécurité internationale se multiplient et il devient de plus en plus difficile de tracer une frontière entre les menaces externes et les menaces internes à notre territoire national. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, intervenir à l’extérieur de nos frontières devient impératif pour des raisons de sécurité nationale. La réflexion sur les principes devant guider les engagements militaires de la France est ainsi plus que jamais d’actualité.
DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL INTERNE DES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
L’engagement d’opérations extérieures procède d’une décision des pouvoirs publics qui obéit à des règles fixées par la Constitution (I). Au-delà de ce dispositif juridique, les livres blancs successifs se sont efforcés de délimiter le cadre conceptuel présidant aux engagements militaires français (II), à partir d’une analyse du contexte international et d’une vision de la place de la France dans le monde. Cette analyse mérite d’être complétée par une présentation des principes auxquels nos partenaires extérieurs font appel pour justifier leurs engagements extérieurs, afin d’en tirer les enseignements opportuns (III).
I. LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE EFFICACITÉ ÉPROUVÉE
A. UNE BOUCLE DÉCISIONNELLE COURTE ET DÉCLOISONNÉE
1. La prééminence incontestée du chef de l’État
L’article 15 de la Constitution de 1958 dispose que « le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale ». Cependant, le Gouvernement se voit aussi reconnaître des compétences constitutionnelles en la matière. Ainsi, l’article 20 prévoit qu’il « dispose de l’administration et de la force armée » et l’article 21 qu’il « est responsable de la défense nationale ». En réalité, la pratique institutionnelle a fait de l’engagement des forces armées une prérogative exclusive du chef de l’État, y compris en période de cohabitation. Ce domaine réservé du Président de la République a été conforté par les décrets du 15 mai 2002 et du 24 décembre 2009 qui lui ont accordé la présidence du Conseil de défense et de sécurité nationale.
Le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN)
Le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) a été créé par un décret du 24 décembre 2009, conformément aux orientations du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 et de la loi de programmation militaire pour 2014-2019. Il se substitue au Conseil supérieur de défense, au Comité de défense, au Comité de défense restreint ainsi qu’au Conseil de sécurité intérieure. Politique de défense et politique de sécurité sont désormais associées en vue d’un renouvellement de la nouvelle stratégie de sécurité nationale.
Le CDSN est compétent en matière de programmation militaire, de dissuasion nucléaire, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il rassemble, outre le Président de la République et le Premier ministre, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l’économie et le ministre du budget et s’il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
Le CDSN peut se réunir en formations plénière, restreinte – sa composition dépend alors de l’ordre du jour – et spécialisées – Conseil national du renseignement et Conseil des armements nucléaires.
Alors que les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique sont abordées par le CSDN dans sa formation plénière, le code de la défense précise que les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil restreint. Ainsi, la formation restreinte est opérationnelle en cas de crise, notamment pour les déploiements militaires extérieurs, et en lien direct avec l’actualité internationale.
Depuis sa création, le CDSN restreint s’est réuni à plusieurs reprises notamment en septembre 2010 lors de l’enlèvement de cinq Français au Niger et en août 2012 sur la Syrie. De même, en janvier 2013, le conseil de défense restreint s’est fréquemment réuni lors du déclenchement de l’opération Serval. Plus récemment, plusieurs conseils de défense restreint ont été consacrés à la lutte contre Daech.
2. Un processus décisionnel efficace
Tous les interlocuteurs rencontrés par la mission d’information ont souligné la pertinence et l’efficacité du processus institutionnel encadrant les décisions d’intervention françaises. Celui-ci se caractérise par une chaîne décisionnelle courte verticalement et un fort décloisonnement horizontal. En situation de crise extérieure, une « cellule de crise » est activée au Quai d’Orsay, sous l’autorité du ministre ou de son directeur de cabinet. Le ministère de la défense y participe. Son rôle est de proposer plusieurs hypothèses d’action au chef de l’État qui fixera les orientations stratégiques après avoir réuni un « Conseil restreint ». Ces orientations seront ensuite déclinées sur le terrain par les militaires et les diplomates. En période de cohabitation, le Premier ministre intervient pour valider les options stratégiques qui doivent être soumises au Président de la République lors du Conseil restreint. Toutes ces étapes sont raccourcies en situation d’urgence.
Ce processus décisionnel est bien rodé. Il assure à la France réactivité face aux urgences extérieures et efficacité dans la mise en œuvre des décisions prises au plus haut niveau. Cette efficacité tient notamment aux contacts constants entretenus entre les circuits militaires et civils, notamment diplomatiques. Selon M. Philippe Errera (22), directeur général des relations internationales et de la stratégie au ministère de la défense, notre pays parvient souvent à emporter des négociations au sein de l’OTAN parce que les autorités civiles, au sein du Conseil, et militaires, au sein du Comité militaire, travaillent main dans la main, ce qui fait la différence avec nos alliés, notamment américain.
B. UN CONTRÔLE EFFECTIF DU PARLEMENT
L’efficacité du processus décisionnel français en matière d’engagements armés tient notamment au fait qu’il s’agit d’une prérogative de l’exécutif. Cependant, il est impératif que les engagements militaires n’échappent pas à tout contrôle démocratique. Que penser du rôle actuel du Parlement dans les décisions d’engagements extérieurs ?
1. Un rôle traditionnellement très effacé
Telle que rédigée en 1958, la Constitution française associait le Parlement à l’engagement des forces armées par le biais de la déclaration de guerre, qui devait être autorisée par les assemblées en vertu de l’article 35 de la Constitution. Cependant, cette disposition n’a pas trouvé à s’appliquer dans le cadre des engagements extérieurs, qui n’ont jamais donné lieu à une déclaration de guerre.
Traditionnellement, le Parlement avait ainsi un droit de regard extrêmement modeste sur les opérations extérieures. Il lui était parfois donné de s’exprimer lors de débats sans vote sur certaines décisions, par exemple pour l’envoi de renforts en Afghanistan en 2008. Avant 2009, les parlementaires n’avaient eu qu’une seule fois l’occasion de se prononcer par un vote sur une décision d’engagement militaire. En 1991, le Premier ministre, M. Michel Rocard, avait, à la demande du Président de la République François Mitterrand, présenté une déclaration de politique générale en application du premier alinéa de l’article 49 de la Constitution sur l’engagement de la France dans la Guerre du Golfe. Il avait obtenu l’accord des deux assemblées.
En dehors de ce cas unique, le Parlement n’a, jusqu’à une période récente, que très peu été associé aux opérations extérieures. Il n’a longtemps pas eu connaissance des accords de défense et de coopération militaire susceptibles d’entraîner un déploiement des troupes françaises – ceux-ci n’entrant pas dans le champ de l’article 53 de la Constitution, leur approbation ne nécessitait pas d’autorisation parlementaire. Par ailleurs, en l’absence de budget dédié, la nomenclature budgétaire ne permettait pas non plus au Parlement de connaître précisément les sommes affectées aux opérations extérieures.
2. Des améliorations substantielles à partir de 2008
La nécessité de renforcer le rôle du Parlement en matière d’opérations extérieures a été mise en lumière par de nombreux rapports, en particulier celui du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République – dit comité « Balladur » – qui avait souligné en 2007 que le Parlement français ne disposait pas « d’attributions équivalentes à celles des assemblées des grandes démocraties occidentales » (23). Force est de constater que les principales lacunes soulignées ont été comblées.
Tout d’abord, la liste des accords de défense en vigueur au 1er janvier 2008 a été publiée dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. En outre, la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 dispose que « le Parlement sera désormais informé de la conclusion et des orientations » des accords de défense. Au titre de la révision de ces derniers, en 2012 et 2013, le Parlement a ainsi été amené à approuver ou ratifier cinq accords ou traités en matière de défense, avec l’Algérie, la Serbie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et Djibouti.
Par ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré le rôle du Parlement en matière d’opérations extérieures (24). L’article 35 de la Constitution a été modifié de façon à prévoir l’information systématique du Parlement lors du déclenchement d’une opération extérieure et l’autorisation de sa prolongation au-delà de quatre mois :
« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »
Enfin, une ligne spécifique pour les opérations extérieures a été créée dans la nomenclature budgétaire du programme 178 – Préparation et emploi des forces de la mission « Défense » (25), afin de retracer précisément les dépenses liées à ces engagements. Sur la période de la loi de programmation 2014-2019, ce « BOP OPEX » est provisionné en loi de finances initiale à hauteur de 450 millions d’euros. Le montant effectif des dépenses liées aux opérations extérieures est régularisé en fin de gestion par l’ouverture des crédits correspondants sur ce « BOP OPEX ».
Au total, le Parlement dispose à présent de moyens de contrôle effectifs sur les opérations extérieures de la France. Dans la pratique, le ministère de la défense se montre coopératif et disponible pour répondre aux demandes d’information des parlementaires. Des informations confidentielles peuvent être transmises aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes. Lors du lancement de l’opération Serval au Mali, le ministre de la Défense a fait chaque semaine un point sur les opérations devant la commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale.
Le Parlement a-t-il vocation à jouer un rôle de codécision avec l’exécutif pour l’engagement des forces armées à l’extérieur du territoire ? Vos rapporteurs pensent qu’une telle évolution n’est pas souhaitable. L’équilibre institutionnel trouvé avec la réforme de 2008 permet de valoriser au mieux l’apport du Parlement tout en laissant chacun dans son rôle : à l’exécutif, l’initiative de l’engagement de la force armée ; au Parlement, l’information et le contrôle de ses modalités. Aux yeux de vos rapporteurs, l’analyse des pratiques institutionnelles étrangères conforte ce positionnement (cf. infra).
Cela ne signifie pas que l’on ne puisse pas songer à des aménagements qui, sans remettre en cause cet équilibre, auraient pour objet d’améliorer l’information parlementaire. Les rapporteurs jugeraient utiles que le Parlement soit mieux informé lors des quatre mois qui précèdent le vote sur l’autorisation de prolongation de l’engagement armé. Cela améliorerait la portée de l’autorisation votée, en nourrissant davantage le débat. Pour cela, il pourrait être envisagé de mettre en place des sortes de comités qui permettraient à certains parlementaires habilités voire aux responsables des groupes politiques d’entendre le Gouvernement sur les différents aspects des engagements extérieurs avant les quatre mois réglementaires.
C. POINT DE COMPARAISON CHEZ NOS PARTENAIRES
1. États-Unis : du pouvoir de déclarer la guerre au pouvoir d’y mettre fin (26) ?
Aux États-Unis, la répartition des pouvoirs entre le Président et le Congrès pour le déploiement des forces armées à l’extérieur est source de débats intenses.
D’un point de vue strictement juridique, la situation semble proche de celle de la France. D’après la Constitution américaine, le Président est le chef des armées, et le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Mais, comme en France, les présidents américains sont intervenus militairement à l’étranger tout au long de la seconde moitié du XXème siècle sans déclaration de guerre.
Après le traumatisme de la guerre du Vietnam, le Congrès a voté en 1973 une joint resolution, le War Powers Act, qui vise à limiter la prééminence de l’exécutif dans ce domaine. Le texte prévoit que le président doit désormais notifier dans les 48 heures au Congrès tout déploiement de troupes à l’étranger. Cette notification doit être étayée par un rapport informant les parlementaires des circonstances précises nécessitant l’engagement, ainsi que des conditions, objectifs, et durée de la mission. En outre, en cas d’intervention militaire qui aurait lieu sans déclaration de guerre préalable, le Président doit ensuite dans les 60 jours – durée pouvant exceptionnellement être prolongée de 30 jours – obtenir du Congrès une autorisation d’usage de la force, faute de quoi les soldats doivent être rapatriés. L’esprit de ces dispositions est très proche de celui de la réforme introduite en France en 2008.
Cependant, tous les Présidents américains ont affirmé la non-conformité de cette loi à la Constitution, en invoquant leur pouvoir constitutionnel de commandant en chef des armées. Dans la pratique, ils ont tous cherché à contourner le problème, en s’y pliant à moitié, informant et consultant le Congrès conformément à l’esprit de la loi, mais non à sa lettre. Ils ont toujours évité d’invoquer la section 4 de la loi, qui déclenche le compte à rebours des 60 jours. Quant au Congrès, il ne s’est pas toujours battu pour assumer cette responsabilité, d’autant moins lorsque la menace était perçue comme forte. Au total, seules quatre autorisations de recours à la force militaire ont été votées par le Congrès : en 1991 pour la guerre du Golfe, en 2001 pour l’Afghanistan, en 2002 pour l’Irak et en 2015 pour les opérations contre les terroristes en Irak et en Syrie. En 2013, le Président Obama avait pris la décision de demander une autorisation du Congrès pour procéder à des frappes aériennes en Syrie, contre le régime de Bachar al-Assad, accusé d’utiliser des armes chimiques contre sa population. Dans un contexte où l’opération ne pouvait être autorisée par une résolution du Conseil de sécurité, bloqué par le veto russe, le Président souhaitait s’assurer a minima de l’appui du Congrès. La proposition russe de placer les armes chimiques sous contrôle international avait cependant éloigné la perspective d’une intervention militaire et supprimé la nécessité d’un vote.
Au total, le choix de recourir à l’autorisation parlementaire résulte avant tout d’un calcul d’opportunité de la part du Président. Barack Obama semble vouloir y recourir davantage que son prédécesseur, mais cette évolution n’est en rien gravée dans le marbre. Le Congrès dispose cependant d’autres leviers pour peser sur la politique d’engagement armé du pays. Par son rôle budgétaire primordial, il peut exercer une pression très forte sur l’exécutif, en particulier lorsque l’opération qui a été lancée ne recueille plus le soutien de l’opinion publique. Lorsque l’opération Restore hope en Somalie a mal tourné, en 1993, le Congrès a sommé l’exécutif de rapatrier les militaires américains, interdisant le financement de l’opération au-delà de six mois. Cependant, de telles décisions demeurent exceptionnelles car elles sont difficiles à assumer politiquement : elles conduisent en effet à refuser de soutenir des soldats américains d’ores et déjà déployés sur un théâtre d’opérations.
Au total, le Congrès a un droit de regard important sur les opérations extérieures américaines, mais la pratique institutionnelle l’a conduit à laisser le pouvoir d’initiative – et les responsabilités associées – au Président.
2. Royaume-Uni : le vote des Communes sur la Syrie, un précédent ?
Au Royaume-Uni, pays de droit coutumier dépourvu de constitution écrite, le pouvoir d’engager les forces armées est traditionnellement une prérogative royale déléguée au Premier ministre. Le Parlement n’a en principe aucune prérogative pour autoriser ou empêcher ces déploiements (27). L'usage s'est cependant instauré d'une information officielle de la Chambre des Communes par le biais d'une déclaration du Gouvernement présentant les objectifs et les modalités de l'intervention extérieure. Cette déclaration peut éventuellement donner lieu à un vote. C’est ainsi que la décision du Premier ministre britannique Tony Blair d’intervenir militairement en Irak aux côtés des États-Unis a fait l’objet d’un vote du Parlement en mars 2003.
Pour la première fois, en août 2013, la Chambre des communes s’est opposée à une intervention militaire en Syrie. L’impact de ce vote, encore difficile à évaluer, pourrait créer un précédent et faire évoluer la pratique institutionnelle britannique, essentielle en l’absence de constitution écrite. Le contrôle du Parlement britannique sur les opérations militaires extérieures pourrait se trouver renforcé dans la mesure où il sera difficile, au moins politiquement, de ne pas consulter la Chambre des communes dans le cas de futures opérations extérieures. Confirmant cette évolution, le déploiement des forces armées britanniques dans le cadre de l’opération internationale contre Daech en Irak a été préalablement autorisé par la Chambre des Communes en septembre 2014.
3. Allemagne : l’« armée parlementaire »
Pour des raisons historiques, en Allemagne, le contrôle du Parlement sur les interventions extérieures est très important et l’armée allemande, la Bundeswehr, est qualifiée d’ « armée parlementaire ». L’article 87a § 1 de la Loi fondamentale allemande, conforté par l’arrêt du 12 juillet 1994 de la Cour constitutionnelle, dispose que le Bundestag définit les directives de la politique de sécurité et de défense allemande. Mandataire principal de l’armée, son accord est indispensable pour toute mission extérieure des forces armées. La Constitution prévoit une exception en cas de déploiement de faible intensité mais cette mesure n’a jamais été utilisée. Les parlementaires ne peuvent cependant pas proposer une intervention, cette compétence étant réservée au ministre de la Défense. Le Bundestag dispose d’un « relai » au sein de l’armée, le Commissaire parlementaire aux forces armées, élu tous les cinq ans. Ce n’est pas un membre du Bundestag ; d’après les termes de la Loi fondamentale, il est désigné « en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag pour l'exercice du contrôle parlementaire ». Il bénéficie d’un droit d’information et est régulièrement entendu par les parlementaires sur les opérations en cours.
Cependant, le fort contrôle du Bundestag s’accompagne de débats parlementaires particulièrement longs qui rendent le pays peu réactif en situation de crise – et en font un partenaire d’autant moins fiable. Les débats qui ont entouré le refus allemand de s’engager en Libye ont bien illustré cette difficulté. Après s’être abstenue sur le vote de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU (28), l’Allemagne, qui ne souhaitait pas s’associer à l’intervention militaire de l’OTAN en Libye, a décidé de retirer ses militaires AWACS stationnés en Méditerranée dans le cadre de l’opération Active endeavour, ses quatre bâtiments engagés dans le cadre de cette opération ainsi que 70 personnels responsables de la flotte aérienne de l’AWACS, dont elle était le principal contributeur (29). À partir du moment où le Gouvernement ne voulait pas demander d’autorisation au Bundestag pour intervenir en Libye, l’idée était que l’Allemagne ne pouvait pas risquer de voir des bâtiments et militaires allemands automatiquement engagés dans cette opération par le canal des structures intégrées de l’OTAN. Cependant, ces décisions ont placé les alliés de l’Allemagne dans une situation difficile, car ils ont conduit à affaiblir les moyens de l’OTAN justement au moment où ceux-ci étaient nécessaires.
Des débats sont en cours au Bundestag pour assouplir l’autorisation parlementaire. Il s’agit précisément de faciliter l’engagement des militaires allemands au sein des structures intégrées de l’OTAN (30) où la participation de l’Allemagne est perçue par ses partenaires comme une conséquence logique de son appartenance à l’Alliance. Si elle était menée à bien, cette réforme n’aurait nullement pour effet d’enlever au Bundestag son rôle central en la matière.
En Espagne, depuis la loi organique de la défense nationale (article 4.2) du 17 novembre 2005, le gouvernement doit demander l’approbation du Congrès espagnol avant tout déploiement des forces armées espagnoles. Le Gouvernement doit informer les députés du développement des opérations périodiquement, dans un délai qui ne peut excéder un an. Lorsque, pour des raisons d'urgence, il n'est pas possible d'effectuer la consultation préalable, le Gouvernement doit faire ratifier sa décision par le Congrès des députés dans les plus brefs délais.
Le gouvernement italien peut engager des troupes sans autorisation préalable du Parlement, sa seule obligation étant de l’informer. En pratique, l'accord du Parlement est toujours sollicité lors d'opérations extérieures. De plus, le financement de ces opérations est assuré par un décret-loi qui doit impérativement être transformé en loi par le Parlement dans un délai de soixante jours, ce qui conduit le Parlement à se prononcer systématiquement dans un délai de deux mois. Le financement des opérations doit, en outre, être régulièrement renouvelé par le vote d'une nouvelle loi.
II. LE CADRE CONCEPTUEL : LES LIVRES BLANCS DE 2008 ET 2013
A. LES « PRINCIPES DIRECTEURS » DES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a tenté de clarifier le champ des opérations extérieures en posant sept principes pour lesquels il paraît opportun d’intervenir :
– Caractère grave et sérieux de la menace contre la sécurité nationale ou la paix et la sécurité internationale.
– Examen, préalable à l'usage de la force armée, des autres mesures possibles, sans préjudice de l'urgence tenant à la légitime défense ou à la responsabilité de protéger.
– Respect de la légalité internationale.
– Appréciation souveraine de l'autorité politique française, liberté d'action, et capacité d'évaluer la situation en permanence.
– Légitimité démocratique, impliquant la transparence des objectifs poursuivis et le soutien de la collectivité nationale, exprimé notamment par ses représentants au Parlement.
– Capacité d'engagement français d'un niveau suffisant, maîtrise nationale de l'emploi de nos forces et stratégie politique visant le règlement durable de la crise.
– Définition de l'engagement dans l'espace et dans le temps, avec une évaluation précise du coût.
Ce dernier principe manque singulièrement d’unité et de réalisme. Il agrège des paramètres divers et s’avère en pratique inapplicable. En effet, comme le souligne le Général Vincent Desportes, « ce critère est en opposition profonde avec la nature même de la guerre », qui exclut que l’on puisse prédire exactement, avant de la mener, sa durée et son coût.
À cette réserve près, vos rapporteurs pensent que ces grands principes constituent un cadre général toujours valable pour les opérations extérieures de notre pays. Mais, à l’usage, il s’avère à la fois trop large et trop imprécis pour guider concrètement les décisions d’engagement des forces armées à l’extérieur.
B. LE CADRE DE L’INTERVENTION POSÉ PAR LE LIVRE BLANC DE 2013
Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2013 ne reprend pas explicitement les principes directeurs énoncés en 2008, mais ceux-ci demeurent en filigrane du cadre conceptuel établi pour les interventions militaires. Le Livre Blanc énonce en outre les objectifs et les zones prioritaires des engagements militaires français.
• Les objectifs des interventions extérieures
Le Livre Blanc de 2013 en recense trois :
– Protéger les ressortissants français
Cet objectif ne pose pas de difficulté particulière. Il s’agit là d’un seuil d’engagement incompressible pour notre pays. La défense du territoire national et de sa population est la raison d’être traditionnelle et fondamentale de l’armée ; cet objectif en est l’application directe.
– Défendre nos intérêts stratégiques et ceux de nos partenaires et alliés
Cet objectif doit évidemment être précisé. Quels sont les intérêts stratégiques de la France ? Le Livre Blanc définit des « priorités stratégiques » par ordre décroissant d’intensité des engagements : protéger le territoire et les ressortissants nationaux ; assurer la sécurité de l’Europe et de l’Alliance Atlantique ; garantir la stabilité du voisinage de l’Europe ; et contribuer à la paix dans le monde. Cette échelle n’est pas contestable mais elle ne représente pas véritablement une définition des intérêts stratégiques de la France dont la mise en cause justifierait le déploiement des forces armées à l’étranger. Le Livre Blanc précise qu’il s’agit aussi des intérêts stratégiques « de nos partenaires et alliés », soulignant ainsi la nécessité de mutualiser les efforts pour défendre nos intérêts de sécurité partagés.
– Exercer nos responsabilités internationales
Cet objectif recoupe, pour partie, celui qui porte sur la défense de nos intérêts stratégiques. Compte-tenu de notre implication à l’ONU en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, de son inscription dans divers cercles d’alliances (OTAN, UE notamment), et du fait des accords de défense qu’elle a passés avec un certain nombre de pays, la France peut être amenée à intervenir au nom de ces engagements internationaux et des responsabilités internationales qui en découlent pour elle dans un conflit où ses intérêts ne sont pas directement menacés. Il en résulte que le champ potentiel de nos interventions est potentiellement très extensif. Aussi, dans la mesure où nos intérêts vitaux ne sont pas menacés, il paraît souhaitable que l’exercice de nos responsabilités internationales ne soit un motif pour engager une nouvelle intervention que dans la mesure où plusieurs autres critères seront remplis.
• Les zones prioritaires pour l’engagement des forces armées
Le Livre Blanc définit des zones prioritaires pour la défense et la sécurité de la France : la périphérie européenne, le bassin méditerranéen, une partie de l’Afrique – du Sahel à l’Afrique équatoriale –, le Golfe arabo-persique et l’Océan indien. Cette délimitation géographique ne peut pas être un paramètre déterminant dans la mesure où la France n’a pas forcément intérêt à intervenir dans toute crise à l’intérieur de ce périmètre ; elle n’en aurait à l’évidence pas les moyens. La situation internationale actuelle en fait d’ailleurs la région du monde où les défis sécuritaires sont les plus nombreux : terrorisme en Afrique du Nord, au Sahel et dans la région du lac Tchad, fragilité de nombreux États africains, vides sécuritaires en Libye et au Yémen, conflit israélo-palestinien, crise syro-irakienne…
III. QUEL CADRE DOCTRINAL CHEZ NOS PARTENAIRES ?
1. De la doctrine Bush à la doctrine Obama
La présidence de Barack Obama a constitué un tournant dans la doctrine d’usage de la force des États-Unis, fortement marqués par les vicissitudes de leurs engagements en Afghanistan et en Irak. En 2002, le Président George W. Bush avait décliné sa stratégie d’« action préventive » (preemtive warfare) : la force militaire devait permettre de réduire en amont les différentes menaces auxquelles le pays se trouvait exposé : réseaux terroristes transnationaux, régimes de l’« axe du mal », États faillis ou encore prolifération d’armes non conventionnelles. L’intervention américaine en Irak, en 2003, avait été l’application la plus aboutie de cette stratégie. La force militaire était de surcroît perçue comme un outil pertinent pour promouvoir la démocratie et l’économie de marché au sein d’un « grand Moyen-Orient » (Greater Middle-East) allant de l’Afrique du Nord au Pakistan.
Avec la présidence de Barack Obama, les États-Unis sont entrés dans une phase de réticence à l’engagement militaire. Le Président Obama a théorisé cette évolution – déjà observée dans les faits – lors de son discours devant les cadets de l’académie militaire de West Point, le 29 mai 2014. Si les États-Unis « sont et restent la Nation indispensable », et les forces militaires « la colonne vertébrale du leadership américain », en aucun cas l’action militaire n’est « le seul et premier composant de ce leadership ». Dès lors, les États-Unis utiliseront la force armée, de manière unilatérale si nécessaire, lorsque les intérêts vitaux de l’Amérique seront menacés (menaces à la population, au mode de vie américain et à la sécurité des alliés). En revanche, lorsque les situations extérieures ne représentent pas une menace directe pour les États-Unis, le seuil justifiant une action militaire sera plus élevé. L’action des États-Unis sera alors conduite dans un cadre collectif, et s’appuiera sur tous les outils disponibles : diplomatie, aide au développement, sanctions, stratégie d’isolement, appel aux instruments du droit international et action militaire multilatérale.
2. Les nouvelles données de l’engagement américain
Ce nouveau positionnement américain a été concomitant d’une baisse substantielle du budget de la défense. Cependant, celle-ci ne remet pas en question le leadership militaire des États-Unis, dont les capacités d’intervention restent exceptionnelles et loin d’être égalées. Le Président Obama a désengagé les troupes américaines d’Irak (2009) et conduit une stratégie de sortie en Afghanistan. Il s’est montré très prudent face à l’hypothèse d’une intervention en Syrie en 2013, prenant à la dernière minute le parti de demander une autorisation d’utilisation de la force au Congrès, et se ralliant finalement à la proposition russe de placer les armes chimiques syriennes sous contrôle international, qui permettait d’éviter l’option militaire. Ce moindre interventionnisme a eu pour corollaire un recours accru aux forces spéciales et aux frappes de drones, le Président Obama faisant par ailleurs de la lutte contre le terrorisme une priorité forte de l’action des États-Unis. Ce positionnement traduit bien l’exigence du « no boots on the ground » qui s’est imposée dans le débat public américain à la suite des engagements en Irak et en Afghanistan, et fait l’objet d’un relatif consensus entre les deux principaux partis.
Cependant, cette réticence à l’engagement extérieur n’est pas synonyme d’isolationnisme ; les évènements récents le montrent bien. Lorsque la situation l’exige, les États-Unis continuent d’intervenir militairement. Face à l’expansion fulgurante de Daech, ils ont pris la tête d’une coalition internationale (opération Inherent resolve) dont le but est d’appuyer les forces locales – irakiennes et kurdes, rebelles syriens modérés – dans leur lutte contre l’organisation terroriste. Face à la résurgence de l’insurrection talibane en Afghanistan et aux difficultés rencontrées par les forces armées afghanes pour y faire face, le Président Obama a autorisé le maintien de 1000 soldats supplémentaires, en sus des 10 000 déjà annoncés. Il a en outre autorisé les forces américaines à mener ponctuellement des actions anti-terroristes, au-delà de leur mandat initial de conseil et de formation aux forces armées afghanes. Ces engagements sont cependant ciblés et sélectifs, réduits au strict minimum, consentis en dernière extrémité.
Par ailleurs, les opérations en Irak et en Syrie ont montré que les États-Unis avaient à présent à cœur d’inscrire leur action dans un cadre multilatéral. En contraste évident avec l’intervention militaire en Irak de 2003, ils ont rallié autour d’eux une coalition d’une soixantaine de pays contre Daech en Irak et en Syrie. Ce multilatéralisme résulte d’une volonté politique forte, alors que les Américains assument en réalité la grande majorité des frappes aériennes contre les terroristes, en Irak et plus encore en Syrie. Ainsi, à la mi-février 2015, les États-Unis avaient mené 946 frappes en Syrie contre 79 pour l’ensemble des États arabes engagés dans la campagne aérienne (31).
En outre, les États-Unis ne prennent plus systématiquement l’initiative ni la direction des opérations. C’est le sens de l’expression « leading from behind » évoquée par l’administration Obama lors de la campagne aérienne de l’OTAN en Libye. Si les États-Unis ont été un élément important de cette opération par l’apport – essentiel – de ravitailleurs en vol et celui – plus modeste – de drones armés, ils en ont laissé la direction à la France et au Royaume-Uni. Le cadre est complètement différent mais la logique est la même s’agissant de l’opération Barkhane. Cette opération n’est pas la leur, la France est en première ligne, mais les États-Unis lui apportent une aide indispensable, bien que ponctuelle et mesurée, en particulier en matière de renseignement.
3. Quel impact pour notre pays ?
Pour la France, ce nouveau positionnement des États-Unis est une opportunité. Par leur ouverture nouvelle au multilatéralisme, les Américains se trouvent plus en phase avec les principes d’engagement militaire français. Ils considèrent en outre que la France est crédible sur le plan militaire, et des relations de confiance se sont tissées entre les armées des deux pays. Les États-Unis ont une appréciation très positive de l’action militaire de la France dans le Sahel et la soutiennent. Ces évolutions font que les États-Unis sont aujourd’hui le partenaire majeur de la France pour ses engagements militaires. Réciproquement, la France est pour les États-Unis un partenaire de premier plan dans le domaine militaire : l’importance relative du dispositif français déployé dans le cadre de l’opération Chammal, avec en particulier l’implication du groupe aéronaval, en est une manifestation.
1. Les données historiques de l’engagement britannique
• Une culture expéditionnaire solidement ancrée
L’armée britannique a une tradition expéditionnaire profondément ancrée. Elle remonte à l’époque de l’Empire colonial, où l’armée se trouvait déployée outre-mer de manière habituelle. Le pays n’entretenait en réalité que très peu de forces terrestres sur son territoire, dont la défense était assurée en priorité par la marine, la Royal Navy. Cette tradition a perduré jusqu’à aujourd’hui.
• Les grandes phases des interventions britanniques
Une nouvelle période de l’« interventionnisme » britannique a débuté dans les années 1990, avec la fin de la Guerre froide. Le think tank londonien Royal United Services Institute (RUSI) (32) recense trois principales phases dans ces interventions extérieures. D’abord, le Royaume-Uni est intervenu comme « force for order », essentiellement en vue de rétablir l’ordre, avec un objectif stratégique circonscrit (Guerre du Golfe). À partir des années 1997-1998, a émergé l’idée que le Royaume-Uni pouvait intervenir en tant que « force for good », dans un but humanitaire. L’intervention au Kosovo en 1999 et celle au Sierra Leone en 2000 seraient des illustrations de cette inflexion qui a été théorisée par le Premier ministre Tony Blair lors de son « discours de Chicago », en avril 1999 (33). D’après l’analyse faite par le think tank, après ces opérations considérées comme des succès stratégiques, le Royaume-Uni aurait été gagné par une sorte d’« ubris » qui l’aurait conduit à intervenir en tant que « force for change », pour répandre la démocratie. L’intervention en Irak en 2003, l’expansion de l’intervention britannique dans le sud afghan en 2008 et l’opération en Libye en 2011 découleraient directement de cette conception.
• Des constantes ?
Une donnée fondamentale des engagements militaires britanniques tient à la « relation spéciale » (special relationship) du pays avec les États-Unis. Les Britanniques interviennent généralement aux côtés des Américains. Ce paramètre est devenu structurant dans les années 2000. Après l’intervention au Sierra Leone (34), en 2000, les Britanniques ne sont plus intervenus militairement que dans le cadre de coalitions menées par les États-Unis, à l’exception de la Libye en 2011, qui était une initiative franco-britannique. Les engagements militaires du Royaume-Uni sont aussi façonnés par la priorité absolue accordée à l’OTAN, vecteur essentiel de la puissance militaire britannique. Cette priorité s’accompagne d’une forte réticence à tout développement d’une Europe de la défense.
2. L’impact du « choc » des engagements en Irak et en Afghanistan
• Un choc psychologique et moral
Les difficultés des opérations en Irak et en Afghanistan, où le Royaume-Uni s’est investi jusqu’à l’usure, et dont les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, ont suscité un fort traumatisme dans l’opinion publique et au sein de la classe politique britannique. Les Britanniques demeurent très attachés à leur armée mais tendent désormais à « victimiser » les militaires, que les politiques sont accusés d’employer à mauvais escient. Les gigantesques mises en scène orchestrées lors du rapatriement des corps des soldats morts en Afghanistan – 453 au total – en ont été une illustration saisissante. Cette victimisation se double d’une judiciarisation du champ militaire : de plus en plus de procès sont intentés aux autorités britanniques par les militaires ou leurs familles.
Ainsi, le Royaume-Uni semble désormais entré dans un cycle de scepticisme – sinon d’aversion – à l’égard des opérations extérieures. Le rejet de l’engagement militaire en Syrie par la Chambre des Communes en août 2013 tend à montrer que le Royaume-Uni ne sera sans doute plus prêt à s’engager dans une opération militaire d’envergure si la sécurité nationale n’est pas clairement en jeu.
Cependant, les interlocuteurs rencontrés par la mission d’information ont récusé l’idée d’un nouvel isolationnisme britannique (35). Selon eux, le rejet de l’engagement militaire en Syrie résulte avant tout d’une manœuvre politique mal négociée par le Premier ministre britannique, David Cameron. Le Royaume-Uni devrait continuer à intervenir lorsque les conditions sont réunies : légitimité, définition claire des buts de guerre, réflexion sur les attentes du post-conflit… L’engagement britannique au sein la coalition internationale contre Daech en Irak tend à confirmer cette approche. Cet engagement a été mûri et approuvé par le Parlement, il est d’une ampleur limitée et n’implique que peu de troupes au sol, au sein d’une coalition menée par les États-Unis, dans un contexte où les intérêts de sécurité britanniques sont touchés et où les exactions fortement médiatisées de Daech appelaient une réaction.
• La capacité de projection britannique atteinte ?
Au cours de la première décennie du 21ème siècle, l’armée britannique s’est trouvée dans une situation de « sur-engagement » extérieur qui l’a fortement affaiblie sur le plan des capacités humaines et matérielles. Ces difficultés ont été exacerbées par la cure d’austérité budgétaire qui lui a été imposée à partir du début de la crise financière. Le Livre blanc de 2010 a entériné une baissé de 8 % du budget de la défense entre 2010 et 2014 ; ces coupes ont encore été revues à la hausse en 2012 et 2013 en raison du contexte économique. Le Royaume-Uni a dû se résoudre à abandonner certaines capacités, comme les avions de patrouille maritime, et à accepter une vacance capacitaire de dix ans dans le domaine aéronaval, entre le retrait de l’Ark Royal et l’entrée en service de nouveaux porte-avions, le Queen Elizabeth et le Prince of Wales. Il s’agissait de renoncements considérables pour une grande nation maritime. Dans ce contexte, l’armée éprouve des difficultés à recruter, en dépit de coupes franches effectuées dans les effectifs, avec la suppression, à terme, de 50 000 postes.
Au total, ces affaiblissements ont pu faire naître des doutes sur la capacité du Royaume-Uni à opérer sur l’ensemble du spectre aux côtés des États-Unis. Le pays a rencontré certaines difficultés opérationnelles lors de la campagne aérienne en Libye, en 2011. Et les Britanniques se sont montrés particulièrement admiratifs des savoir-faire militaires français lors de l’opération Serval au Mali, en 2013. Ils avaient conscience de ne plus être capables de mener par eux-mêmes ce type d’opérations, n’étant plus intervenus seuls depuis la Sierra Leone, en 2000.
3. Un affaiblissement à tempérer
Ces difficultés sont réelles mais elles ne doivent pas être surestimées. Sur le plan politique, le Royaume-Uni conserve des ambitions mondiales. Le processus d’élaboration d’un nouveau Livre Blanc, le Strategic defense and security review, devrait aboutir d’ici la fin de l’année. Il précisera les orientations du nouveau Gouvernement Cameron en la matière. Les Britanniques demeurent extrêmement attachés à leur armée. Sur le plan des capacités, le Royaume-Uni est certes affaibli mais il pourra profiter de la baisse de son niveau d’engagement extérieur pour réinvestir, de façon à permettre la remontée en puissance du son outil militaire. Par ailleurs, les renoncements capacitaires ont créé des lacunes sur lesquelles il sera difficile de revenir, mais ils ont aussi permis de préserver les autres équipements, qui s’avèrent « d’une sophistication technologique extrême et en excellent état » (36), bien qu’onéreux à entretenir et à utiliser. Au total, il est probable que le Royaume-Uni est entré dans une phase de moindre investissement militaire dans les crises extérieures, mais cette évolution conjoncturelle ne permet pas de préjuger de l’avenir.
1. Une tradition de « retenue militaire »
Après la chute du IIIe Reich, les alliés autorisèrent, dans les années 1950, un réarmement allemand, tout l’encadrant strictement afin de prévenir tout résurgence de militarisme. La Bundeswehr était alors totalement intégrée dans l’OTAN. C’est une armée de citoyens en uniforme placée sous le contrôle des élus de la nation (cf. supra). Pendant la guerre froide, elle était chargée de la défense avancée en cas de déferlement des chars soviétiques dans les plaines d’Europe centrale. Avec la chute de l’Union soviétique, la mission de défense du territoire devenait moins centrale, et la pertinence d’un modèle d’armée reposant sur la conscription moins évidente, dans un contexte où les menaces provenaient davantage de la multiplication des conflits à la périphérie de l’Europe. L’Allemagne a alors opéré une lente reconversion.
Lors de la Guerre du Golfe, l’Allemagne se refusa à intervenir militairement mais appuya l’action internationale par une contribution financière substantielle. Les dirigeants de l’époque invoquaient, à l’appui de cette décision, la Loi fondamentale allemande qui, selon eux, interdisait toute utilisation de la Bundeswehr en dehors du cadre strict de la défense nationale (37). Le débat qui eut lieu à l’époque contribua à préciser le positionnement de l’Allemagne : le pays devait, en raison de son histoire particulière, d’une part, faire preuve de retenue dans l’usage de la force militaire à l’extérieur de ses frontières, et d’autre part, toujours veiller à insérer son action dans une trame multinationale.
Plusieurs décisions du tribunal constitutionnel du Karlsruhe permirent de donner à la Loi fondamentale une interprétation favorable aux opérations extérieures. En particulier, le 12 juillet 1994, la Cour détermina que la participation de l’Allemagne à des missions hors des frontières de l’Alliance atlantique était légale pourvue qu’elle soit conduite dans le cadre d’un système de sécurité collective. L’armée allemande entama une lente mutation vers une armée professionnelle. La classe politique et l’opinion publique allemande conservaient cependant une certaine réticence à l’engagement militaire extérieur. Le tournant eut lieu avec l’engagement allemand au Kosovo, sous l’impulsion du ministre des affaires étrangères Joschka Fisher. À l’époque, l’argument du passé de l’Allemagne fut retourné pour suggérer que l’Allemagne avait au contraire la responsabilité d’intervenir pour prévenir les violations massives des droits de l’homme, au moins en Europe.
Depuis lors, l’Allemagne a pris une part discrète mais réelle au sein des engagements militaires multinationaux, notamment en Afghanistan, où son contingent a compté jusqu’à 5300 soldats. En 2014, le pays avait près de 5000 soldats déployés en opération extérieure à travers le monde, dont plus de 3000 en Afghanistan. Cependant, les limites à l’engagement allemand demeurent patentes. La nécessité d’obtenir une autorisation du Bundestag pour tout engagement allemand, fût-ce au sein des structures intégrées de l’OTAN (cf. supra sur l’engagement en Libye), fût-ce pour accroître cet engagement de quelques dizaines d’unités, limite fortement la réactivité et la disponibilité de l’armée allemande. Cette contrainte a longtemps été renforcée par la forte réticence de l’opinion publique et des dirigeants politiques allemands à tout engagement militaire direct. Cette réticence est une constante pour la chancelière allemande Angela Merkel, qui cherche à limiter la participation de l’Allemagne à des livraisons d’armes au profit de partenaires sur le terrain – elles aussi strictement encadrées – tout en évitant un engagement militaire direct. L’Allemagne s’est ainsi jointe à la coalition internationale contre Daech en procédant à des livraisons d’armes létales aux Kurdes d’Irak, sans pour autant participer à la campagne de bombardements aériens.
2. Vers un investissement plus actif
À partir du début de l’année 2014, plusieurs voix se sont élevées en Allemagne pour suggérer que le pays devait prendre une part plus active dans la résolution des conflits mondiaux, y compris sur le plan militaire, lorsque cette option s’avérait nécessaire. Cette évolution était liée à l’arrivée au Gouvernement en décembre 2013 de la ministre de la défense Ursula Von der Leyen et du ministre des affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, dont les positions sur le sujet tranchaient nettement avec celles de leurs prédécesseurs.
Interrogée sur le rôle de l’Allemagne dans les conflits en Afrique (Mali, Centrafrique), Ursula Von der Leyen affirmait que le pays « ne pouvait regarder ailleurs », et devait s’engager davantage et prendre plus de responsabilités, en particulier au sein de l’Union européenne, afin que les responsabilités et les risques soient « répartis équitablement » entre les pays membres. Elle plaidait pour faire progresser l’Europe de la défense, arguant que l’« Europe ne pourrait pas gagner en influence dans le jeu global tant qu’un de ses membres resterait coquettement à l’écart de toute intervention militaire tandis qu’un autre s’y précipiterait sans consulter ses partenaires » (38). Cette position est aussi celle du ministre des affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, pour qui les Allemands ne peuvent se contenter de « commenter » et doivent être prêts à intervenir « plus vite et de façon plus substantielle ». Elle a enfin été exprimée par le Président de la République Joachim Gauck lors de la conférence de Munich sur la sécurité, en février 2014. Il a invité ses compatriotes à rompre avec l’inaction des dernières années, arguant du fait que les risques de ne rien faire étaient plus graves que les conséquences de l’action.
Ces évolutions dans le discours sont le signe d’une inflexion progressive du positionnement stratégique de l’Allemagne. Elle devrait trouver une traduction dans le prochain Livre Blanc sur la défense, dont l’élaboration a été lancée et février dernier et doit s’achever en 2016.
3. Les limites de cette évolution
Pour l’heure, ces prises de position n’ont donné lieu qu’à un accroissement modeste de l’engagement allemand en Afrique, en particulier au sein de la mission européenne EUTM Mali, dont l’Allemagne fournit actuellement le deuxième contingent derrière l’Espagne. L’Allemagne doit en assurer le commandement à partir d’août 2015. En outre, l’on évoque le déploiement de la brigade franco-allemande au Mali à partir de décembre 2015.
En tout état de cause, ces évolutions devraient rester limitées. En premier lieu, il n’est pas question de remettre en cause le rôle fondamental du Bundestag pour l’engagement des militaires allemands à l’étranger, qui demeure un facteur très limitatif (cf. supra). En outre, l’opinion publique allemande demeure massivement défavorable à un rôle militaire accru de leur pays dans les conflits mondiaux. L’engagement allemand en Afghanistan, dont les résultats sont perçus comme décevants alors que 57 soldats y ont laissé leur vie, entretient cette réticence. Ainsi, pour le chef d’état-major des armées, le diagnostic est clair : « nous pouvons faire beaucoup avec les Allemands, mais le pilier franco-allemand n’est pas un pilier opérationnel ». Cette ouverture nouvelle d’une partie de la classe politique allemande fait néanmoins de l’Allemagne un partenaire privilégié pour pousser l’utilisation des mécanismes de l’Europe de la défense, dont nos deux pays se sont faits les avocats dans une lettre conjointe du groupe Weimar (39) adressée à la Haute représentante de l’Union européenne le 3 avril dernier, en vue de préparer le Conseil européen du mois de juin.
1. Une ambition militaire régionale
Puissance occidentale entre l’Asie et le Pacifique, l’Australie revendique un rôle de « leader » au sein de sa zone. Par le passé, cette conception l’a conduite à mener deux opérations militaires pour rétablir la paix au Timor oriental (2000) et dans les Îles Salomon (2003). L’Australie compte ainsi parmi les Nations occidentales qui manifestent la volonté d’entretenir une capacité de projection pour pouvoir intervenir militairement dans les crises extérieures. Actuellement, l’Australie consacre 1,6 % de son PIB à la défense, mais le Gouvernement de Tony Abbott, qui a fait des questions de sécurité une priorité, a annoncé son intention d’accroître ce budget dans les années à venir pour atteindre 2 % du PIB en 2023-2024.
2. Le cadre des opérations extérieures australiennes
Les interventions militaires australiennes relèvent de deux logiques différentes. La première, celle des intérêts nationaux directs de l’Australie, conduit le pays à jouer un rôle de meneur pour des opérations au sein de la zone qu’il considère comme son « pré carré », celle des îles du Pacifique Sud. Cette région se caractérise par une forte instabilité liée à un ensemble de facteurs : pauvreté, instabilité politique, problèmes environnementaux, catastrophes naturelles. L’interconnexion des îles accentue les risques de contagion et rend la zone très vulnérable. Il s’agit de la préoccupation sécuritaire majeure de l’Australie. Au-delà, les forces armées australiennes peuvent être conduites à intervenir en Asie pour porter secours aux pays frappés par des catastrophes naturelles.
La deuxième logique guidant les interventions militaires australiennes est celle du soutien de son alliance avec les États-Unis, alliance fondamentale pour la protection des intérêts australiens. Cette logique a conduit l’Australie à s’associer à toutes les grandes opérations militaires américaines : Vietnam, Afghanistan, Irak en 2003 et à nouveau aujourd’hui, entre autres. À l’heure actuelle, l’Australie apporte une contribution substantielle à la lutte contre Daech en Irak (opération Okra). D’après son chef d’état-major, l’armée australienne avait contribué à approximativement 13 % des frappes aériennes en Irak à la mi-janvier au moyen de six avions de chasse, et déployait environ 200 militaires des forces spéciales sur le terrain. Cette opération répond aussi aux intérêts de sécurité propres du pays, qui doit faire face à d’importants départs de « combattants étrangers » en direction du théâtre syro-irakien.
3. Un partenariat à développer
Pour la France, l’Australie est un partenaire dans les grandes opérations militaires multinationales auxquelles les deux pays contribuent avec la même optique : aider et influencer la conduite de la mission. Mais c’est aussi et surtout un partenaire dans la zone du Pacifique sud, où la France est présente par ses territoires d’outre-mer : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Si cette présence n’a pas toujours été bien perçue par les Australiens, en raison notamment du contentieux lié aux essais nucléaires en Polynésie française, ce temps est désormais révolu. La présence française est à présent perçue comme un facteur de stabilité et plébiscitée par les Australiens. Ceux-ci estiment par ailleurs que la France compte parmi les rares pays à partager leur volonté de prendre à bras le corps les enjeux de sécurité et ils voient très favorablement l’action militaire de la France en Afrique.
TROISIÈME PARTIE : POUR UN ENCADREMENT RENFORCÉ DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT DE LA FRANCE
Au fil de leurs investigations, les rapporteurs ont acquis la conviction que l’énoncé d’une « doctrine d’intervention » n’était pas un bon objectif. Le bien-fondé de l’engagement militaire doit pouvoir être apprécié souverainement, en fonction des circonstances de l’espèce. Pourtant, de nombreux paramètres sont susceptibles d’interférer dans le processus de décision d’intervention : émotion suscitée par la médiatisation des conflits, état de l’opinion publique, échéances politiques diverses…Pour éviter que ces données ne prennent une part trop grande dans les décisions d’intervention, il faut avoir un cadre, des principes qui guident l’action. Les rapporteurs ont jugé nécessaire de préciser le cadre fourni par le Livre Blanc de 2013. Leurs travaux les ont conduits à déterminer que la France ne doit s’engager militairement que si et seulement si cinq critères sont remplis (I), et que sa politique d’engagement armé respecte un principe fondamental de cohérence budgétaire (II).
I. CINQ CRITÈRES CUMULATIFS POUR DÉCIDER D’INTERVENIR
« Le premier acte de jugement, le plus important, le plus décisif, que l’homme d’État ou le général exécute, consiste à discerner exactement (…) le genre de guerre qu’il entreprend : ne pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas, ou ne pas vouloir en faire ce qu’elle ne peut pas être en raison de la nature de la situation. »
Ce point de vue exprimé par Clausewitz (40) reste valable aujourd’hui : toute intervention armée doit être précédée d’une indispensable réflexion stratégique. Les rapporteurs estiment que cette réflexion peut être guidée par cinq principes essentiels.
A. L’INTERVENTION A UN « SENS STRATÉGIQUE »
Les dirigeants politiques sont responsables des vies humaines qu’ils exposent au combat et comptables de l’argent public qu’ils engagent. En conséquence, les opérations militaires doivent être justifiées par des impératifs qui leur confèrent un « sens stratégique » (41), autrement dit être réellement motivées par les intérêts supérieurs de la France.
1. Les intérêts supérieurs de la France sont en jeu.
Dans quelle mesure la situation à laquelle nous sommes confrontés met-elle en jeu des intérêts supérieurs de la France ? Il convient, pour y répondre, de définir les intérêts de notre pays dont la mise en cause pourrait justifier une intervention armée.
Le Livre Blanc de 2013 distingue trois catégories d’intérêts : nos intérêts vitaux, nos intérêts stratégiques et nos responsabilités internationales.
Les intérêts vitaux de la France sont la défense du territoire national et des ressortissants français, auxquels on peut adjoindre la défense du territoire des États européens et de l’Alliance atlantique auxquels la France est liée par une clause de défense collective (42). La défense des intérêts vitaux de la France correspond à un seuil d’engagement militaire automatique et incompressible pour notre pays.
Les intérêts stratégiques de la France se situent en dessous des intérêts vitaux. Il peut s’agir d’intérêts de sécurité, d’intérêts économiques, d’intérêts en termes de sécurité d’approvisionnement et de liberté de circulation… Il revient au pouvoir politique d’apprécier si des intérêts stratégiques de la France sont mis en cause par une situation de conflit, et dans quelle mesure la priorité accordée à ces intérêts stratégiques peut justifier une intervention armée.
Les responsabilités internationales de la France sont engagées en cas d’atteinte majeure aux principes et valeurs défendus par notre pays, en cas de rupture à la légalité internationale et d’atteinte à la paix et la sécurité internationales que notre pays se doit de défendre en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. La question de l’engagement militaire français se pose alors dans des conditions très différentes par rapport à une situation où les intérêts de la France sont directement menacés, dans la mesure où les situations en cause ne concernent pas que la France, mais la communauté internationale à travers l’ONU et à tout le moins les membres permanents du Conseil de sécurité.
2. L’intervention française doit véritablement servir ces intérêts.
• Le contre-exemple libyen
Une fois les intérêts français en jeu bien identifiés, il est important de s’assurer que l’intervention militaire est un outil approprié pour servir ces intérêts. L’histoire montre que certains engagements militaires français ont pu avoir un effet contraire.
Pour le grand reporter Renaud Girard (43), l’intervention en Libye en est un exemple flagrant. Elle a conduit à la chute du régime du colonel Kadhafi, qui « rendait deux services » aux Européens. Premièrement, il combattait l’islamisme radical : si l’alcool était interdit sous le règne de Kadhafi, les minorités des autres religions pouvaient pratiquer leur culte librement. Deuxièmement, le régime de Kadhafi empêchait le trafic des êtres humains entre l’Afrique subsaharienne et la Méditerranée. M. Girard en conclut que cette intervention a, de tous points de vue, desservi les intérêts français : elle a créé un vide sécuritaire propice à l’installation et à la régénération de mouvances terroristes que la France combat par ailleurs dans la bande sahélo-saharienne ; et elle a fait de la Libye le point de départ de plus de la moitié des trafics d’êtres humains à destination de l’Europe. Cette position doit toutefois être nuancée, dans la mesure où l’on peut penser que, plus que l’intervention militaire en elle-même, c’est l’absence de planification des suites de l’intervention militaire, notamment du fait des objections de la partie libyenne, qui est à l’origine de l’effondrement sécuritaire qui a suivi, avec les conséquences néfastes qui en résultent pour la sécurité de la région et de l’Europe.
• Quelle mesure des intérêts français au sein d’une coalition ?
Lorsqu’un conflit extérieur met en jeu des intérêts français et que l’engagement militaire français s’effectue au sein d’une coalition, il est important de proportionner l’engagement français à l’influence stratégique que notre pays est susceptible d’exercer sur la conduite des opérations. Les rapporteurs ont déjà cité le contre-exemple de l’engagement français en Afghanistan. Les forces de la France étant comptées, il convient de les concentrer sur les théâtres où elles auront l’effet stratégique le plus fort. Au sein de coalitions où la France n’est pas « leader », elle doit maintenir sa contribution à un niveau juste suffisant pour afficher son engagement politique et accéder à l’information. C’est la perspective actuelle de l’engagement français en Irak avec l’opération Chammal. Les rapporteurs estiment qu’elle est pertinente et qu’elle devra être maintenue dans la durée, alors que notre pays ne manquera pas d’être appelé à s’investir toujours davantage.
B. L’INTERVENTION BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN LARGE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Ce soutien large est essentiel, d’une part parce qu’il détermine la légitimité internationale d’une intervention militaire extérieure, et d’autre part, parce qu’il conditionne le soutien concret dont un engagement pourra bénéficier dans la durée. La France n’a pas les moyens politiques, militaires et financiers d’intervenir militairement absolument seule : son action ne pourra être pérenne que si elle est appuyée et relayée par d’autres acteurs.
1. La légitimité de l’intervention doit être consacrée par l’ONU.
• Préserver la centralité du Conseil de sécurité de l’ONU, formidable multiplicateur de puissance pour la France
L’ONU n’est pas une institution parfaite, et son aptitude à maintenir la paix et la sécurité internationales est à l’évidence limitée. Les réguliers blocages et contournements du Conseil de sécurité l’illustrent bien. Cependant, vos rapporteurs partagent pleinement l’appréciation du journaliste Renaud Girard, pour qui « l’humanité a eu beaucoup de peine à bâtir l’ONU, bafouer son autorité constitue un terrible retour en arrière ». En dépit de tous ses défauts, l’ONU reste une institution unique dans l’histoire, où les dirigeants des régimes du monde entier se parlent, à défaut de pouvoir toujours s’accorder entre eux.
Il importe donc de replacer en permanence le Conseil de sécurité de l’ONU au cœur des problématiques de paix et de sécurité internationales. C’est en enjeu pour le monde entier, mais sans doute plus encore pour la France, pour qui l’ONU représente un formidable « multiplicateur de puissance », selon l’expression du représentant permanent de la France à l’ONU, M. François Delattre. Ce levier tient à son siège de membre permanent du Conseil de sécurité mais aussi à son statut de « puissance trait d’union » entre les puissances occidentales et les autres « pôles » de l’ONU. La France joue ainsi un rôle essentiel pour rallier des consensus sur nombre de sujets tels que la lutte contre le terrorisme.
• Obtenir une résolution, un impératif
Pour ces raisons, il est dans l’intérêt de la France de systématiquement chercher à obtenir l’appui du Conseil de sécurité avant de s’engager militairement, même si cela lui coûte beaucoup de temps et d’énergie. Le Livre Blanc de 2013 est très clair et catégorique sur ce point : « le respect de la légalité internationale est un préalable intangible à tout recours à la force par la France, qu’elle agisse à titre strictement national ou dans le cadre de ses alliances et de ses accords de défense » (44). Et en effet, la France est, de tous les pays de l’ONU, de ceux qui sont les plus attachés à la légalité internationale de leurs engagements militaires. Les rapporteurs estiment que ce positionnement traditionnel de la France reste valable et doit être maintenu avec volontarisme.
La France ne doit pas se contenter de promouvoir les résolutions du Conseil de sécurité, elle doit aussi contribuer à affermir la légitimité et la crédibilité de cette institution. Pour cela, notre pays se montre ouvert et proactif sur la question de sa réforme, s’agissant notamment des appels à un élargissement de la composition du Conseil de sécurité. Par ailleurs, la France porte auprès de ses partenaires une initiative visant à limiter le recours au veto en cas d’« atrocités de masse ». Le texte de cette initiative n’est pas figé et fait l’objet de discussions entre la France et ses partenaires, sous l’impulsion de l’ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Cet encadrement pourrait reposer sur un engagement politique des membres permanents qui accepteraient de s’auto-discipliner dans leur recours au droit de veto dans une situation où des « atrocités de masse » auraient été portées à la connaissance du Conseil. Une telle mesure aurait pu permettre d’obtenir une résolution appuyant une intervention militaire au Kosovo en 1999 ou en Syrie en 2013. Dans les faits, cette initiative a peu de chances d’être adoptée dans la mesure où les Russes et les Chinois y sont opposés. Elle a néanmoins le mérite de souligner l’implication de notre pays sur cette question et d’élever le coût politique d’un veto en plaçant ce débat sur le devant de la scène.
• Une seule exception : la légitime défense collective
La Charte de l’ONU prévoit une exception au principe d’interdiction d’emploi de la force posé à l’article 2 de la Charte : le droit de légitime défense individuelle ou collective (article 51). Il peut être exercé dans le cas d’une agression armée contre un membre de l’organisation. Ce principe peut conduire notre pays à intervenir en l’absence de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, pour aider un pays qui en fait la demande et se trouve lui-même en situation de légitime défense. C’est ainsi que les bombardements aériens effectués en ce moment par la coalition internationale en Irak s’appuient sur une demande expresse du Gouvernement irakien. Certains traités internationaux et accords de défense bilatéraux ont pour effet de rendre automatique un engagement fondé sur la légitime défense collective avec un État auquel la France se trouve liée.
La légitime défense collective dans les traités internationaux
L’article 51 de la Charte de l’ONU consacre ce principe :
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
Certaines clauses des accords de défense et certains traités sont susceptibles d’entraîner un engagement militaire automatique de notre pays en vertu de ce principe de légitime défense collectif.
Il en va ainsi de l’article 5 de la Charte de l’Alliance atlantique :
« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. (…) »
Ce principe est aussi repris par la clause de défense mutuelle prévue par l’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne, complétée par la clause de solidarité posée à l’article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
Article 42§7 TUE : « Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. »
Article 222§2 TFUE : « Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. (…) »
2. Chercher à associer les Européens avec pragmatisme
Au-delà de l’autorisation du Conseil de sécurité, la légitimité des engagements militaires dépend aussi du soutien concret dont ils bénéficient, en France, au sein de la communauté internationale et localement, sur les théâtres d’opérations. Depuis plusieurs années, la France cherche à accroître le caractère multinational de ses opérations, avec un succès modeste à l’échelle européenne. C’est pourtant un enjeu essentiel. En intervenant seule, la France prend le risque de s’isoler. Les rapporteurs estiment que, si nous ne parvenons pas à rallier le soutien de nos partenaires, nous devons nous poser la question de la légitimité et de l’opportunité de l’action envisagée.
• Un double impératif
En Afrique, la France a tout intérêt à associer ses partenaires européens de manière volontariste, au-delà des déclarations de bonnes intentions. Cet impératif est évidemment financier : les besoins en sécurité du continent sont immenses, et les opérations militaires coûtent cher. Mais c’est aussi un impératif de légitimité. Passé un certain temps, la présence militaire française en Afrique finit toujours par être dénoncée comme une nouvelle forme de colonialisme. La présence des Européens pourrait réellement consolider la légitimité des engagements militaires de la France tout en permettant de mutualiser des coûts et des capacités, notamment celles pour lesquelles nous sommes insuffisamment pourvus (transport stratégique en particulier). Cette présence serait d’autant plus naturelle que les intérêts de sécurité européens sont, pour la plupart, des intérêts partagés.
• Déterminer le cadre de coopération avec pragmatisme
Comment associer les Européens ? Lorsque c’est possible, cette association peut prendre la forme d’une mission de politique européenne et de sécurité commune (PSDC), à l’image d’EUTM Mali ou d’EUFOR RCA. Cette formule permet de véritablement asseoir la légitimité d’une intervention en la plaçant sous la bannière de l’Union européenne, et de mutualiser une partie – faible, au demeurant – des coûts engagés (dispositif Athéna).
Toutefois, les rapporteurs pensent que la France ne doit pas chercher à toute force à placer une opération sous la bannière européenne en l’absence de volonté commune. En effet, le cadre de la PSDC présente des rigidités certaines qui ont été exposées à plusieurs reprises aux rapporteurs. La chaîne de commandement, les procédures et le processus décisionnel de l’Union européenne sont mal adaptés aux exigences spécifiques des engagements militaires. En outre, l’Union européenne ne dispose pas d’un état-major de conduite permanent qui lui permettrait de planifier des options militaires en amont des décisions d’intervention. Enfin, il est difficile d’obtenir au sein de l’Union européenne un véritable investissement institutionnel pour les missions de PSDC qui pâtissent en outre de multiples interférences des États membres, de sorte que le soutien politique réel de ces opérations peut laisser à désirer. Nombre de chefs de mission se sentent abandonnés une fois la mission déployée sur le terrain.
En fonction des circonstances, il pourra donc être préférable que la France rallie le soutien de ses partenaires européens en dehors du cadre de la PSDC. La coopération engagée au sein de l’European air transport command (EATC) (45), qui permet de mutualiser le transport stratégique, est une bonne illustration de ce qu’il est possible d’accomplir de manière pragmatique entre Européens. S’agissant de l’investissement des pays européens dans les opérations militaires, ce pragmatisme doit être érigé en norme d’action : la France doit profiter de tout ce qu’elle peut obtenir en appui de ses propres objectifs, indépendamment du cadre d’action.
• Associer nos partenaires en amont des opérations
Encore faut-il que la France soit prête à associer ses partenaires européens à la réflexion en amont des engagements militaires. Plusieurs interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs ont souligné que notre pays avait des progrès à accomplir dans ce domaine. Pour Pierre Vimont, ancien Secrétaire général du Service européen d’action extérieure de l’Union européenne (SEAE) (46), le vrai multilatéralisme implique de procéder plutôt comme nous l’avions fait pour l’opération Artémis que pour EUFOR RCA. L’opération Artémis a été déployée par l’Union européenne en République démocratique du Congo en juin 2003 pour prêter main forte à la mission des Nations Unies (MONUC), dans le contexte des conflits qui avaient éclaté dans le district d’Ituri. D’après M. Vimont, le Secrétaire général de l’ONU avait alors demandé une assistance à la France qui avait, d’entrée de jeu, songé à en faire une opération européenne et mené la réflexion en commun avec ses partenaires. La démarche aurait été exactement inverse pour le Mali et la RCA. Pour M. Vimont, « la France a pris seule l’initiative et est venue voir les Européens ensuite pour se plaindre d’être seule et demander de l’aide, sur le terrain et financière ».
Les rapporteurs estiment qu’il est indispensable que la France obtienne un investissement militaire supérieur des pays européens en Afrique, et ce, quel que soit le cadre d’action. Pour cela, notre pays doit jouer pleinement le jeu du multilatéralisme, qui commence dès le stade de la planification des opérations, et non au moment où les opérations sont déjà engagées et que nous cherchons à en mutualiser la charge.
• Marquer notre solidarité avec nos partenaires baltes et orientaux
Évidemment, ce multilatéralisme franc n’est pas une garantie de succès. Dans le double contexte des restrictions budgétaires et de la crise russo-ukrainienne, la France peine à intéresser ses partenaires européens aux problématiques de sécurité en Afrique, bien que l’Europe soit directement exposée. La France devra veiller à maintenir un certain investissement militaire sur le flanc est de l’Europe, afin de marquer sa solidarité avec ses partenaires orientaux et baltes. Plusieurs d’entre eux – Pologne, Suède, Norvège, Danemark entre autres – peuvent apporter des contributions militaires intéressantes aux engagements français en Afrique, mais uniquement dans une optique de donnant-donnant. De l’avis de plusieurs militaires rencontrés par les rapporteurs, les Suèdes et les Danois sont des partenaires auxquels on ne pense pas forcément, mais qui, lorsqu’ils s’engagent, s’avèrent fiables et de bon niveau. De son côté, la France a donné un signal positif avec sa participation à l’exercice Steadfast jazz en Pologne en 2013, sa contribution à la police de l’air des États baltes, ou encore l’envoi de blindés en Pologne depuis le 20 avril dernier, pour une durée de sept semaines. Il faudra veiller à maintenir cet effort dans le temps.
• Poursuivre nos efforts pour rendre la PSDC plus opérationnelle
Les États de l’Union européenne ont développé une palette d’outils extrêmement complète et variée pour intervenir en situation de crise. Cependant, faute de volonté politique suffisante, et en raison de certains dysfonctionnements sur lesquels les rapporteurs auront l’occasion de revenir, ces outils ne sont que peu voire pas utilisés. Le cas des groupements tactiques de l’Union européenne (GTUE) est emblématique. Créés en 2004, ces groupements sont censés donner à l’Union une capacité de réaction rapide face à une crise urgente. Chaque semestre, un pays membre maintient, sur la base du volontariat, environ 2000 soldats en alerte, susceptibles d’être projetés en quinze jours sur un théâtre de crise. Ces groupements, qui pourraient s’avérer très utiles sur des théâtres de crise africains, n’ont jamais été utilisés. Il importe que la France poursuive ses efforts pour lever les obstacles à leur déploiement. L’une des difficultés tient à l’absence de financement commun pérenne des coûts de déploiement de ces GTUE par le mécanisme Athéna. Cela s’avère fortement dissuasif pour les pays qui envisageraient d’y recourir. Les militaires français rencontrés par les rapporteurs l’ont bien exprimé : dans cette situation, le recours aux GTUE par un État membre entraîne une « double peine ». D’une part, le pays doit accepter les lourdeurs de la chaîne de commandement de l’Union européenne. D’autre part, il doit continuer à assumer tous les coûts de l’opération, comme s’il intervenait seul.
La France doit donc poursuivre ses efforts pour rendre la PSDC plus opérationnelle, elle a tout à y gagner. Signe encourageant, nous avons pour cela le soutien de certains partenaires clé en la matière, en particulier l’Allemagne et la Pologne. Le 30 mars dernier, nos trois pays ont adressé une lettre conjointe à la Haute Représentante de l’Union européenne pour exprimer leurs attentes à l’égard du Conseil européen sur la défense qui se tiendra les 25 et 26 juin prochains. Nos pays ont marqué leur volonté que les GTUE soient envisagés systématiquement comme option privilégiée d’entrée en premier dans les situations de crise requérant une action rapide. Pour cela, il convient de pérenniser l’éligibilité au financement commun du déploiement des GTUE vers le théâtre d’opérations, au travers du mécanisme Athéna.
À un niveau plus fondamental, rendre la PSDC plus opérationnelle suppose de rapprocher les conceptions des Etats membres, s’agissant des menaces et intérêts de sécurité communs aux pays de l’Union européenne. L’élaboration d’une nouvelle stratégie de sécurité sous l’impulsion de la Haute représentante, qui pourrait déboucher d’ici la fin de l’année, fournit une occasion d’œuvrer à ce rapprochement, en élaborant une véritable stratégie européenne commune adossée à des moyens et outils adéquats.
3. Exploiter pleinement la coopération avec les partenaires locaux
La clé du succès à long terme des opérations extérieures est dans l’appropriation de leurs acquis par les pays concernés. L’action militaire ne sera pérenne que si elle trouve un relai efficace auprès des forces armées et de sécurité locales. C’est aussi un impératif de légitimité : la présence étrangère sera d’autant moins perçue comme une « force d’occupation » qu’elle se présentera comme une coopération avec les forces locales et régionales, les pays voisins des pays en crise étant souvent concernés au premier chef.
Cette exigence doit être confrontée à la réalité de l’état des armées locales dans les pays dans lesquels la France intervient. La coopération se heurte souvent à l’important différentiel de niveau entre les armées. Dans le Sahel, la France intervient avec des moyens de pointe qui sont bien loin d’être à la portée des armées locales. En fait de coopération, il s’agit alors de formation et d’accompagnement de ces armées dans la durée. C’est là l’esprit du dispositif Barkhane. Mises à part les opérations ponctuelles de contre-terrorisme menées par les forces spéciales, les opérations ont vocation à être menées conjointement avec les forces armées maliennes, nigériennes, burkinabés, mauritaniennes et tchadiennes, principalement dans les zones frontalières. Il s’agit aussi de favoriser la coopération des forces armées régionales entre elles. Ce mode de coopération produit des résultats : en attestent la robustesse des forces armées tchadiennes que la France a longuement accompagnées (opération Épervier), mais aussi le succès de plusieurs opérations conjointes menées dans le cadre de l’opération Barkhane.
Cependant, ce mode de coopération ne peut porter ses fruits que sur le temps long : il implique que l’on soit prêt à s’investir durablement. La formation des forces armées locales est une œuvre de longue haleine qui risque de voir ses résultats anéantis si ces armées sont trop tôt livrées à elles-mêmes, face à des menaces sécuritaires qu’elles ne peuvent pas gérer. De ce point de vue, le succès de l’opération alliée Resolute support d’appui à l’armée afghane est en enjeu essentiel.
1. Le soutien de l’opinion publique, plutôt un objectif qu’un critère
L’opinion publique est une donnée importante de la politique, ce paramètre ne peut donc être ignoré dans le cadre des engagements militaires de la France. Pourtant, le soutien de l’opinion publique ne pourra jamais être un critère déterminant pour les engagements extérieurs français. Ce soutien est en effet extrêmement volatil, soumis à des interférences nombreuses, et souvent déterminé par l’« engouement médiatique » – par nature éphémère – suscité par un conflit. Le succès des interventions militaires repose souvent sur la constance et la pérennité de l’effort entrepris : paramètre difficilement compatible avec un soutien continu de l’opinion publique, qui souvent se lasse vite.
Si les rapporteurs mettent en avant le critère du soutien de l’opinion publique, ce n’est pas pour suggérer qu’il faut intervenir quand ce soutien existe, et ne pas intervenir quand il n’existe pas. En réalité, la démarche est plutôt inverse. Lorsque le chef de l’État décide d’engager militairement la France, il doit rallier le soutien de l’opinion publique en faisant preuve de pédagogie. Les rapporteurs pensent qu’il ne faut pas chercher à justifier les opérations extérieures uniquement sur le terrain de la morale et des valeurs. S’il n’est fondé que sur des grandes émotions, le soutien rallié risque d’être éphémère, à la mesure de la ferveur médiatique. En outre, se pose alors inévitablement la question de pourquoi intervenir dans tel conflit et non tel autre, où tout autant d’atrocités sont commises. Ainsi, il convient de mieux expliquer aux Français en quoi les intérêts – sécuritaires ou économiques – de la France sont en jeu.
C. L’INTERVENTION A DES OBJECTIFS CLAIRS ET RÉALISTES
1. Les objectifs stratégiques et politiques sont clairement définis.
Quels sont les buts de guerre ? Ou, pour utiliser le vocabulaire des stratèges militaires, quel est l’« effet final recherché » (EFR) ? Préalablement à tout engagement militaire, il importe de répondre précisément à cette question en énonçant clairement le ou les objectifs. Il doit s’agir d’objectifs stratégiques, mais aussi d’objectifs politiques à plus long terme. Ils détermineront la conduite des opérations, constitueront un « fil rouge » auquel les militaires pourront rattacher leur action. En son absence, les militaires naviguent à vue dans un contexte d’indécision souvent très mal vécu par eux.
Ce paramètre va de soi, et pourtant, le défaut de « commande politique » est une difficulté récurrente à laquelle les militaires doivent faire face sur le terrain. C’est particulièrement prégnant lors d’opérations menées en coalition : il est alors plus difficile encore de se mettre d’accord sur des objectifs clairement définis. L’absence de buts de guerre clairs et partagés entre alliés a été une caractéristique permanente de l’engagement militaire dans les Balkans ; elle a beaucoup nui à l’efficacité de l’action militaire sur le terrain. Lors de la campagne aérienne en Libye en 2011, les divergences sur les objectifs de l’opération étaient palpables d’entrée de jeu. Pour certains, il s’agissait simplement d’obtenir un cessez-le-feu pour encourager les parties à discuter ; pour d’autres, il fallait renverser Kadhafi.
Pour fixer des objectifs stratégiques et politiques clairs, il faut avoir une bonne compréhension de la situation sur le terrain. Or, les situations de conflit sont souvent extrêmement complexes. Sommes-nous en mesure d’y faire face ? Selon le journaliste Renaud Girard, les puissances occidentales n’ont jamais réussi à gérer la complexité de la situation ethnique du Kosovo. Elles avaient tendance à faire une lecture identique des cas kosovars et bosniens alors qu’il s’agissait de deux situations très différentes. D’après le journaliste, cela les a conduites à ne pas empêcher l’épuration ethnique du Kosovo, avec l’idée – erronée – qu’un territoire « homogène » serait plus facile à administrer. Les rapporteurs partagent l’avis qu’il convient d’appréhender d’entrée de jeu la situation locale dans toute sa complexité. Si cette complexité paraît telle qu’il n’est pas possible d’énoncer clairement les objectifs stratégiques et politiques de l’intervention militaire, vos rapporteurs estiment que la France ne doit pas s’engager.
2. Ces objectifs sont proportionnés à nos moyens.
Une fois les objectifs stratégiques et politiques fixés, il convient de s’assurer qu’ils sont réalistes, c’est-à-dire atteignables avec les moyens que nous prêts à engager.
Cela exclut d’entrée de jeu les objectifs démesurément ambitieux du type « nation building ». Les déconvenues des interventions en Irak et en Afghanistan au cours des années 2000 ont bien illustré que c’était une chimère que de vouloir installer par la force des régimes démocratiques à partir de rien, fût-ce à renfort de milliards de dollars et de centaines de milliers d’hommes. C’est une des conclusions faites par le think tank britannique RUSI dans son étude sur les interventions extérieures britanniques (47). Lorsque le Royaume-Uni est intervenu comme « force for change », pour mettre en place des régimes démocratiques, il s’est heurté à des échecs stratégiques sans appel. Pour obtenir un succès stratégique, il faut avoir une ambition limitée.
Même avec une ambition limitée, la question des moyens que nous sommes prêts à consacrer doit être posée. Pour avoir un effet stratégique réel et obtenir un résultat politique, toute opération militaire doit avoir une empreinte au sol forte et durable. Les puissances occidentales en ont fait l’expérience en Libye, en 2011. Pour reprendre les termes du Général Desportes, la projection de puissance sans projection de forces ne fonctionne pas à long terme, car elle crée le chaos. Pour obtenir un résultat politique, il faut contrôler l’espace et s’engager franchement dans la reconstruction des armées locales, « seul ticket stratégique de sortie des théâtres d’opération ».
Sommes-nous prêts à mettre autant de moyens qu’il le faudra pour parvenir au résultat politique escompté ? Évidemment, le coût d’une opération est impossible à anticiper précisément. Il faut pourtant, en amont de tout engagement, mener une appréciation aussi poussée que possible du type d’opération dans laquelle la France s’engage. Cela suppose de réfléchir aux implications de l’après-conflit.
D. L’INTERVENTION EST ASSORTIE D’UNE STRATÉGIE DE SORTIE PÉRENNE
La plupart des interlocuteurs de la mission d’information l’ont reconnu, la planification de l’« après-crise » est un point faible des interventions extérieures françaises. Pourtant, comme le formule le Général Desportes en se référant à Clausewitz, il ne faut « jamais faire le premier pas sans envisager le dernier ». Autrement dit : il faut avoir une stratégie de sortie.
C’est là une exigence absolue si l’on veut pouvoir prolonger une victoire militaire en réussite politique. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus de gagner la guerre mais de gagner la paix. Pour le Général Desportes, nous sommes passés du « paradigme napoléonien », où le but était de détruire l’adversaire, de remporter une victoire militaire intégrale, au « paradigme de la paix ». L’horizon de la bataille, c’est la paix qui doit suivre. Il ne s’agit plus tant de détruire l’adversaire que de le contenir pour pouvoir ensuite l’intégrer, de créer des conditions nouvelles d’où émergera le succès stratégique. Une stratégie de sortie de crise efficace repose sur une solution politique crédible à laquelle la France pourra adosser son action militaire, et sur la mise en œuvre effective d’une stratégie globale pour la reconstruction du pays.
1. L’intervention est adossée à une solution politique crédible.
La France ne doit intervenir militairement dans un pays que s’il existe, au sein de la classe politique, des acteurs crédibles sur lesquels elle pourra appuyer son action. Par crédibles, il faut entendre suffisamment puissants et représentatifs pour rallier l’ensemble des composantes de la population, et animés de la volonté de le faire.
Si l’intervention militaire risque d’entraîner un changement des dirigeants politiques, voire un changement de régime, il est impératif de s’interroger sérieusement sur les solutions politiques de remplacement. Comme le formule le journaliste Renaud Girard (48), « pire que la dictature, il y a l’anarchie, pire que l’anarchie, il y a la guerre civile ». Nous devons avoir en tête la « descente aux enfers » des interventions en Irak et en Libye. En Irak, les États-Unis ont installé au pouvoir le dirigeant chiite Nouri al-Maliki qui a mené une politique sectaire excluant systématiquement les Sunnites (majoritaires à 80 % !) de l’armée et des institutions. Cette solution politique n’en était pas une : elle a poussé les tribus sunnites dans les bras de Daech, favorisant sa formidable montée en puissance et la nouvelle guerre dans laquelle nous sommes engagés. En Libye, les puissances occidentales n’ont pas cherché à imposer une solution politique. Elles se sont retirées au terme de la phase militaire de l’engagement, ce qui correspondait à la volonté des nouvelles autorités libyennes. Le processus politique n’a pas pu s’enclencher durablement en l’absence de structures institutionnelles sur lesquelles s’appuyer, Kadhafi s’étant appliqué à réduire l’État à sa propre personne. La Libye a ainsi de nouveau sombré dans la guerre civile. Ces deux théâtres d’interventions militaires occidentales – l’Irak et la Libye – sont aujourd’hui devenus deux foyers majeurs du terrorisme international.
Pour ces raisons, les rapporteurs estiment que la France doit impérativement s’abstenir d’intervenir militairement si aucune solution politique crédible ne se dégage avec force. Ce critère est absolument central, même dans une situation présentant un fort risque humanitaire (cf. critère n°5). Les rapporteurs sont conscients du fait qu’il n’est pas toujours aisé d’évaluer la pertinence des solutions politiques dans une situation d’urgence humanitaire. Il convient pourtant de s’y appliquer dans la mesure du possible, en gardant à l’esprit qu’une solution politique ne peut tenir par le seul volontarisme de la France et de ses partenaires : elle doit bénéficier d’un véritable ancrage local.
2. Nous avons une stratégie cohérente et globale pour la reconstruction du pays.
• Le concept d’« approche globale » : implications et limites
La mise en avant d’une « approche globale » pour la reconstruction des pays en crise est à présent bien ancrée dans la théorie. Elle repose sur le triptyque sécurité – gouvernance – développement. Pour « gagner la paix », il faut mener une action coordonnée sur ces trois fronts. Cette nécessité est explicitement mentionnée dans le Livre blanc de 2013 :
« La résolution des crises obéit de plus en plus à une approche intégrée, dans laquelle les volets civil et militaire sont étroitement imbriqués, ceci jusqu’aux échelons les plus proches du terrain. À mesure que la résolution de la crise progresse, l’opération militaire devra être complémentaire des opérations à dominante civile de reconstruction, de rétablissement du fonctionnement des institutions publiques et de restauration des capacités économiques de base ».
À l’épreuve des faits, cette stratégie indispensable pour obtenir des résultats politiques durables s’avère difficile à mettre en œuvre. Quelles en sont les causes ? Premièrement, le déploiement effectif d’une stratégie globale requiert un fort investissement au niveau politique et une constance dans l’effort, paramètres parfois difficiles à concilier avec les contraintes budgétaires et les échéances de politique intérieure. En outre, la mise en œuvre de l’approche globale relève d’une multitude d’acteurs et suppose un haut niveau de coordination et de coopération entre institutions internationales, États, et en leur sein, entre départements ministériels, qui s’avère compliqué à obtenir.
• Améliorer nos outils de gestion civile des crises
En France, le souci d’une approche globale s’est matérialisé par l’intégration, au sein du Centre de crise du ministère des Affaires étrangères, d’une « Mission pour la stabilisation ». D’après le Ministre, il s’agit « d'intégrer l'ensemble des missions liées aux phases initiales de la stabilisation et de la reconstruction afin de disposer d'une compétence sur la continuité de la gestion de crise. Cette cellule est composée d'agents venant de différents ministères (défense, intérieur, finances, affaires étrangères). Elle a pour missions le recensement et l'analyse des moyens financiers et humains mobilisés sur les pays en phase de stabilisation, la mobilisation de l'expertise française et l'aide à la constitution de plates-formes d'entreprises pour être au plus près des marchés dits de reconstruction ».
En dépit de cet effort de coordination interministérielle, la mise en œuvre de stratégies globales en France butte sur le manque de moyens et d’outils dédiés. C’est l’analyse faite par Étienne de Durand (49), directeur du Centre des Études de sécurité à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Pour le chercheur, les moyens de l’Agence France développement (AFD) sont trop limités, et l’agence n’est en outre pas autorisée à intervenir en zone de guerre. Enfin, nous disposons de trop peu de civils déployables, juges ou policiers. Notre seul avantage comparatif est la gendarmerie mobile, particulièrement adaptée aux missions civiles de post-conflit, mais dont les effectifs restent limités.
M. de Durand suggère que nous devrions mettre en place une petite réserve de civils pouvant opérer sur des théâtres extérieurs pendant au moins un an, sous statut protégé. Le Député européen Arnaud Danjean estime que la France aurait intérêt à mobiliser davantage sa jeunesse pour ce type de missions. C’est un vivier que notre pays exploite peu, à la différence du Royaume-Uni, par exemple. Une fois formés, au terme de leurs études, des jeunes Français pourraient bénéficier d’une expérience d’un an ou deux à l’étranger, sur le terrain, avant de rentrer dans un circuit professionnel. Vos rapporteurs estiment que cette idée est intéressante et mérite d’être approfondie.
En effet, la France ne pourra jamais se reposer entièrement sur d’autres – partenaires ou institutions internationales – pour assurer la gestion post-crise. Cette idée – aussi tentante soit-elle – n’est pas réaliste. Cela nous ramène au débat sur le paradigme du « hit and transfer » évoqué par l’ancien chef d’état-major des armées, l’Amiral Guillaud. Pour Étienne de Durand, « dire à nos alliés qu’on fait la guerre et que c’est à eux de faire le ménage est voué à l’échec ». La France doit s’investir pour la reconstruction des États, d’autant plus que des enjeux économiques sont à la clé.
• Mieux exploiter le potentiel de l’Union européenne
Cela ne signifie pas que la France ne peut pas s’appuyer sur l’action des organisations internationales. Les rapporteurs ont choisi de centrer leur analyse sur l’action de l’Union européenne en post-conflit, parce qu’ils pensent qu’il y a là un potentiel prometteur, bien qu’encore largement inexploité.
– Les avantages comparatifs de l’Union européenne
L’Union européenne est une institution potentiellement très bien calibrée pour intervenir avec une stratégie globale dans les crises. Cela tient à l’étendue de son domaine de compétences et à la diversité des instruments à sa disposition : opérations et missions de politique de sécurité et de défense commune (PSDC), actions structurelles de la Commission européenne, crédits du développement. En outre, si l’Europe ne se conçoit pas du tout comme une puissance militaire susceptible d’intervenir « dans le haut du spectre », son rôle en phase de stabilisation fait davantage consensus parmi ses membres.
Au total, l’Union a ainsi un réel avantage comparatif par rapport aux autres organisations internationales pour la gestion du post-conflit. Le rôle de l’ONU est essentiel pour assurer la mise en œuvre des accords politiques une fois la situation sécuritaire stabilisée, par le déploiement d’une opération de maintien de la paix. Elle a aussi un rôle non négligeable dans la reconstruction des pays, par le biais de ses fonds et programmes. Cependant, sa palette d’instrument est plus limitée que celle de l’Union européenne, et ses missions militaires ne sont pas taillées pour la formation et le conseil aux forces armées, pour lesquels l’Union a une vraie plus-value.
Quant à l’OTAN, les rapporteurs partagent l’avis du Gouvernement pour qui cette organisation n’a pas vocation à mettre en œuvre une stratégie globale. En effet, l’OTAN reste avant tout une organisation militaire, qui a pour cœur de métier les opérations de haute intensité. Elle ne dispose ni des ressources ni des outils nécessaires pour intervenir sur les trois piliers d’une stratégie globale. Vos rapporteurs pensent que l’OTAN et l’Union européenne sont vraiment deux organisations complémentaires : à l’OTAN, l’action militaire de haute intensité, à l’Union européenne, les missions de basse intensité, civiles et militaires. Ce partage pragmatique correspond aux aspirations des Européens.
– Un potentiel largement inexploité
L’Union européenne est bien loin de jouer le rôle qui pourrait être le sien dans la reconstruction des pays en crise. Premièrement, les missions et opérations de PSDC pâtissent de nombreux dysfonctionnements institutionnels : ordres de mission déconnectés de la réalité du terrain, chaînes de commandement déficientes, procédures inadaptées à la gestion de crise dans l’urgence (génération de forces, acquisitions)… En outre, en raison de ce qu’un interlocuteur de la mission a qualifié d’« idéologie bienfaitrice de l’action civile », l’Union européenne tend à concentrer son action sur les missions civiles. Le député européen Arnaud Danjean, qui les appelle des « missions alibi », les juge « souvent catastrophiques », alors que les missions de nature militaire donnent de meilleurs résultats.
Enfin, les missions de PSDC de l’Union européenne sont menées de manière très cloisonnées par rapport aux autres actions européennes conduites par la Commission. L’Amiral Launay (50), qui a dirigé pendant un an la mission civile EUCAP Nestor, en a témoigné devant vos rapporteurs. Cette mission avait pour but de renforcer les capacités maritimes des États de la Corne de l’Afrique. Dans cette région, la Commission européenne menait par ailleurs plusieurs actions à vocation extérieure, dont deux programmes de développement portant sur des aspects sécuritaires. Les périmètres de ces différentes actions étaient variables, et elles ne faisaient l’objet d’aucune coordination en amont entre la Commission et le Conseil. Ce problème a aussi été souligné par M. Pierre Vimont (2), ancien secrétaire général du Service européen d’action extérieure (SEAE). Les crédits du développement relevant de la Commission font l’objet d’une programmation pluriannuelle de six ans relativement rigide, alors qu’il faudrait pouvoir redéployer ces crédits en fonction de l’évolution de la situation, et les orienter en partie sur le secteur de la sécurité. Cela aboutit à des situations particulièrement inefficientes, où l’Union européenne assure la formation des forces armées locales mais n’est pas en mesure de les équiper pour qu’elles puissent mener à bien leur mission.
La conclusion de l’Amiral Launay est sans appel et rejoint l’avis exprimé par plusieurs interlocuteurs de la mission : « À ce stade, l’approche globale de l’Union européenne reste ainsi largement un slogan, en raison des cloisonnements et des rigidités administratives ».
– Perspectives
Pour autant, des progrès sont possibles, et des réussites doivent être soulignées. D’après l’Amiral de Coriolis (51), représentant militaire permanent de la France à l’Union européenne, la mission de formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) a permis de développer un « label de qualité » de l’Union européenne en la matière. Preuve que cela fonctionne, les Européens se sont investis : vingt-trois États ont contribué à la formation de six bataillons. L’Union européenne peut donc avoir une réelle plus-value dans la reconstruction des pays en crise. D’ores et déjà – mais à une échelle bien trop modeste – la France peut s’appuyer sur des actions ponctuelles de l’Union européenne pour ses engagements militaires (EUTM Mali, EUFOR RCA). Avec pragmatisme, elle doit porter auprès de ses partenaires des propositions concrètes d’amélioration qui sont à la portée de ce que les Européens peuvent et veulent faire.
E. L’INTERVENTION AURA UN RÉEL EFFET POSITIF POUR LES POPULATIONS CIVILES
La question de l’effet réel qu’aura l’intervention militaire pour les populations civiles doit être posée plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un engagement décrit comme étant « à but humanitaire », souvent décidé sous le coup de l’émotion.
1. Les limites de l’intervention d’humanité
La notion même d’interventions « à but humanitaire » fait l’objet de controverses passionnées, dont rend compte la Théorie de l’intervention du juriste Antoine Rougier (52). Cet ouvrage, publié en 1910, conserve une certaine actualité :
« La conclusion qui se dégage de cette étude, c'est qu'il est pratiquement impossible de séparer les mobiles humains d'intervention des mobiles politiques et d'assurer le désintéressement absolu des États intervenants. Nous ne dirons pas, comme Phillimore (53), que le respect du droit humain ne sera jamais qu'un motif accessoire d'intervention ; l'histoire a démontré pour l'honneur de l'humanité qu'il pouvait être un motif principal, comme il le fut lors de l'intervention française en Syrie (54). Mais ce ne sera jamais un motif unique. Dès l'instant que les puissances intervenantes sont juges de l'opportunité de leur action, elles estimeront cette opportunité au point de vue subjectif de leurs intérêts du moment. Entre plusieurs actes inhumains dont elles se trouvent spectatrices, elles réprimeront de préférence celui qui par quelque endroit leur est préjudiciable. Si l'Europe a mis la Turquie en tutelle, c'est moins dans l'intérêt des sujets ottomans que pour parer aux conflits d'intérêts de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France et de la Russie autour de la mer Noire, La France n'a éprouvé le besoin de faire respecter l'humanité par les Sultans marocains à l'endroit de leurs sujets que du jour où elle eut dans ce pays un intérêt politique et économique. Les États-Unis ont protesté contre la situation des Israélites roumains non seulement au nom de l'humanité mais à raison du préjudice causé par cette situation à leur pays. Il se commet tous les jours dans quelque coin du monde mille barbaries qu'aucun État ne songe à faire cesser parce qu'aucun État n'a intérêt à les faire cesser. »
Pour le juriste, les interventions à but humanitaire épurées de tout autre motif n’existent pas ; l’intervention militaire est toujours un moyen pour un État de faire valoir ses intérêts, quels qu’ils soient. Les rapporteurs ne contestent pas cette approche réaliste, sans pour autant exclure qu’un engagement militaire puisse être motivé par un réel souci humanitaire. Au-delà de toutes les controverses, la dimension humanitaire des interventions de la France au Rwanda, dans les Balkans ou plus récemment en République centrafricaine n’est pas contestable. Cependant, encore faut-il que ces interventions aient un réel effet positif pour les populations civiles, ce qui n’est pas toujours acquis.
2. L’effet réel de l’intervention militaire pour les populations civiles
L’engagement militaire envisagé – a fortiori lorsqu’on lui assigne un objectif humanitaire explicite – pourra-t-il vraiment améliorer le quotidien des populations civiles ?
Ce questionnement nous ramène à l’exigence d’une solution politique crédible au conflit, sur laquelle pourra s’appuyer l’engagement militaire. Cette solution politique est la seule garante de la stabilité du pays à moyen terme. Si le processus politique ne parvient pas à s’enclencher, le pays risque alors de sombrer dans la guerre civile.
Renaud Girard, grand reporter au Figaro, est revenu devant les rapporteurs sur le cas libyen, typique pour lui d’une intervention à but humanitaire qui a conduit à moyen terme à dégrader la vie quotidienne de la population. La campagne aérienne en Libye avait pour objectif explicite d’empêcher le dictateur Kadhafi de massacrer la population de Benghazi. À court terme, elle a incontestablement sauvé de nombreuses vies. Cependant, pour le journaliste, il ne fait pas de doute que les populations de Benghazi et de Tripoli vivaient mieux du temps de Kadhafi qu’à l’heure actuelle. Les Libyens étaient plutôt favorisés, ils bénéficiaient d’une éducation supérieure gratuite, et il y avait une forme de répartition des produits du pétrole, même si le dictateur et sa famille en retenaient une bonne partie. D’après lui, la vie des Libyens est aujourd’hui devenue « insupportable ». Aussi qualifie-t-il l’intervention militaire de 2011 de « plus grave erreur stratégique de la politique extérieure de la cinquième République ». L’appréciation de Mme Bénédicte de Montlaur, sous-directrice Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères, est plus nuancée. Pour elle, les Libyens vivent aujourd’hui quasi-normalement, les milices s’occupant de la gestion quotidienne et des services publics. Ils n’ont cependant aucune garantie de sécurité ni d’État de droit (55). Pour M. Girard, l’intervention américaine de 2003 a eu un effet délétère sur les conditions de vie des Irakiens. L’État irakien fonctionnait correctement du temps de Saddam Hussein, et l’on pouvait bien vivre pourvu que l’on ne fît pas de politique. Aujourd’hui, les Irakiens doivent faire face au fléau de Daech.
En réalité, la force militaire est, de manière générale, un outil très ambivalent pour assurer la protection des populations civiles. Bien souvent, celles-ci sont les premières victimes de l’instabilité politique suscitée par une intervention militaire ayant conduit à un changement de régime : les exemples libyens et irakiens le montrent bien. Ce constat d’efficacité mitigée est aussi valable pour des opérations extérieures avec un mandat plus modeste. La FORPRONU déployée dans les Balkans au début des années 1990 devait s’interposer entre les belligérants sans prendre parti afin de mettre un terme aux violences. Elle a finalement assisté impuissante à la poursuite des exactions.
Au total, il s’avère particulièrement difficile d’anticiper les conséquences humanitaires d’une intervention militaire. Pour cette raison, les rapporteurs estiment que, lorsqu’il est envisagé d’engager militairement la France avec un objectif humanitaire explicite, il faut a fortiori veiller à ce que les autres critères mis en avant dans ce rapport soient remplis : un soutien large, des objectifs clairement définis et proportionnés aux moyens engagés, une stratégie de sortie reposant sur une solution politique crédible et la mise en œuvre d’une approche globale. C’est lorsque l’ensemble des critères précédents sont remplis que l’intervention armée a le plus de chances de s’avérer bénéfique pour les populations civiles.
II. UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE COHÉRENCE BUDGÉTAIRE
Les rapporteurs estiment que la question de l’engagement militaire français ne peut raisonnablement être posée en faisant abstraction de la contrainte budgétaire, qui est le critère implicite de toute opération extérieure. Le principe de cohérence budgétaire sur le long terme apparaît indissociable des critères précédemment énoncés par les rapporteurs. Lorsque le chef de l’État engage militairement la France, il est nécessaire de s’assurer que les objectifs assignés à l’opération sont compatibles avec les moyens que nous pouvons et voulons y mettre. Mais ce principe suppose aussi que la France se donne, sur le long terme, les moyens d’un niveau d’engagement conforme à ses intérêts et à ses ambitions.
A. LA FRANCE DOIT ENTRETENIR UN OUTIL MILITAIRE COHÉRENT AVEC SON NIVEAU D’AMBITION
1. La France doit entretenir une capacité expéditionnaire solide.
• Un impératif de sécurité
À la fin de la guerre froide, les démocraties occidentales pensaient voir advenir la « fin de l’histoire ». Elles ont eu tôt fait de vouloir profiter des « dividendes de la paix » : les budgets de défense de la France et du Royaume-Uni se sont ainsi contractés de 14 % entre 1993 et 1998 (56). Pourtant, il est bientôt apparu qu’« au cauchemar de l’apocalypse nucléaire et au rêve d’un monde pacifié » s’était substituée « une instabilité généralisée ». Si « la France n’est plus confrontée aujourd’hui à une menace militaire conventionnelle directe et explicite contre son territoire » (57), des crises majeures se multiplient dans une périphérie proche de l’Europe : Sahel, Libye, Levant, Ukraine. En outre, avec la mondialisation, la proximité au territoire national n’est plus nécessairement une bonne mesure de l’imminence de la menace. Cyberattaques, attaques terroristes, piraterie maritime et atteintes à la liberté de circulation sont autant de menaces susceptibles d’avoir des impacts directs et graves sur les intérêts français.
Dans ce contexte, la France ne peut essentiellement compter que sur elle-même pour défendre ses intérêts de sécurité. Ceux-ci sont pourtant communs, pour la plupart, avec ses voisins européens. Mais les budgets de défense européens sont historiquement bas. En 2014, les alliés européens de l’OTAN ont dépensé environ 250 milliards de dollars au total pour leur défense, soit 7 milliards de moins que l’année précédente, et 64 milliards de moins en termes réels qu’en 1990, alors même que l’Alliance compte aujourd’hui douze membres européens supplémentaires. Ces fortes restrictions budgétaires s’avèrent incompatibles avec la mise en œuvre d’un meilleur partage du fardeau des interventions militaires à l’échelle européenne. Cette idée paraît d’autant plus lointaine qu’il existe en réalité de fortes divergences dans l’appréciation des menaces jugées prioritaires par les États européens. Les pays de la « nouvelle Europe » sont focalisés sur la menace russe. De manière générale, la France peine à mobiliser ses partenaires européens sur les questions de sécurité en Afrique, tandis que ses partenaires traditionnels d’Europe du sud – Espagne et Italie – ont été parmi les plus touchés par les restrictions budgétaires.
La France doit donc se donner les moyens de défendre de manière autonome ses intérêts de sécurité. D’ores et déjà, notre pays ne peut plus entreprendre d’opération militaire d’envergure absolument seul. L’opération Serval au Mali l’a bien illustré : l’appui d’alliés européens et américain s’est avéré indispensable pour le transport stratégique, le ravitaillement en vol et le renseignement. Et ces appuis sont en pratique ponctuels et limités, dispensés au compte-goutte. Il ne faut pas exclure que ce soit le niveau maximum de coopération sur lequel notre pays pourra compter, même s’agissant d’une grande nation militaire comme les États-Unis. Au total, alors que nous « financions une politique militaire visant à être le meilleur allié, nous devons à présent assumer le fait que nous serons en première ligne et seuls sur beaucoup de théâtres » (58).
• Un impératif de puissance
La France est aujourd’hui une puissance militaire reconnue sur la scène internationale. L’outil militaire est un indiscutable avantage comparatif de notre pays. Les États-Unis considèrent actuellement la France comme leur premier partenaire politico-militaire, avant l’Allemagne, cantonnée au domaine économique, et le Royaume-Uni, affaibli par sa décennie d’engagement au Moyen-Orient. Cependant, cet avantage comparatif français n’est pas définitivement acquis. Il pourrait s’éroder rapidement si la France usait son capital en opérations sans lui permettre de se régénérer en procédant aux investissements nécessaires.
Le statut de puissance militaire reconnu à la France est intrinsèquement lié à sa capacité de projection. La volonté de notre pays de s’engager militairement si nécessaire et sa capacité à le faire de façon autonome crédibilisent l’outil militaire français. En particulier, la capacité de la France à agir comme « nation cadre » au sein d’une coalition et à entrer en premier sur un théâtre sont essentielles. La valeur opérationnelle des troupes françaises est appréciée à l’épreuve des engagements, qui mettent en valeur cet « art français de la guerre » qui a fait l’admiration de nos partenaires lors de l’opération Serval. Les engagements permettent aussi de valoriser les équipements français, améliorant les chances de l’industrie d’armement français et européenne à l’exportation.
Si la capacité de projection de la France devait se trouver dégradée faute d’investissements suffisants, les conséquences s’en feraient immédiatement sentir. En premier lieu, notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pourrait se trouver menacé, dans un contexte où la France doit d’ores et déjà faire preuve d’un activisme particulier pour le justifier. En outre, notre coopération opérationnelle avec les États-Unis s’en ressentirait immédiatement. Cette coopération a atteint un niveau inégalé par le passé parce que la France est jugée crédible sur le plan militaire. La moindre entorse à cette crédibilité nous ferait perdre ce statut de partenaire privilégié.
2. Cette exigence a des implications budgétaires fortes.
Les rapporteurs pensent que la capacité expéditionnaire de la France doit a minima être maintenue. Ce maintien est en soi un défi. Dans le contexte d’évolutions géostratégiques et technologiques permanentes, il suppose d’investir de manière volontariste dans l’outil militaire, de lui accorder une réelle priorité budgétaire. Car, pour défendre ses intérêts de sécurité et de puissance, la France doit pouvoir s’engager militairement dans de bonnes conditions, c’est-à-dire en préservant son autonomie stratégique et la vie de ses soldats, et avec des moyens lui permettant d’obtenir un effet stratégique réel sur le terrain.
• Assurer l’autonomie stratégique de la France
– Autonomie dans l’appréciation des situations
L’autonomie stratégique de la France a des implications fortes dans le domaine du renseignement. Pour décider de s’engager militairement, la France doit avoir les moyens d’apprécier de manière autonome la situation sur le terrain. En outre, elle doit affirmer sa crédibilité en la matière afin d’avoir accès à un niveau d’échange de renseignements supérieur, en particulier dans le cadre d’opérations menées en coalition. En effet, les échanges de renseignement se font pour l’essentiel sur un mode bilatéral, y compris au sein d’une coalition, dans une logique de donnant-donnant : il faut avoir quelque chose à donner pour recevoir. Cela justifie la priorité accordée au renseignement par la loi de programmation 2014-2019 et renforcée en 2015. Elle permet à la France d’être « dans le coup » sur les grands programmes techniques, cybersécurité et cryptologie en particulier.
– Autonomie dans la conduite des opérations
Le souci de l’autonomie stratégique de la France impose de maintenir un modèle d’armée complet, c’est-à-dire lui permettant d’intervenir sur l’ensemble du spectre. Cet objectif est très onéreux car il implique de maintenir l’intégralité des compétences et des capacités nécessaires dans un contexte où les budgets se contractent et où le coût des équipements militaires tend à s’accroître mécaniquement du fait des évolutions technologiques. L’ambition d’un modèle d’armée complet risque ainsi de conduire à développer certaines capacités et compétences de manière « échantillonnaire », accroissant d’autant leur coût unitaire.
Autre corollaire de l’autonomie stratégique de la France, sa capacité à conduire des engagements militaires en national, indépendamment des cadres multinationaux, a des conséquences financières lourdes. En dehors de sa participation historique à la FINUL, au Liban, la France a pris le parti de ne plus engager ses troupes sous un commandement ONU. Cela tient aux sérieuses difficultés opérationnelles rencontrées lors d’opérations sous commandement ONU, singulièrement au sein de la FORPRONU, en Bosnie-Herzégovine. Mais cela tient aussi au fait que la France souhaite préserver sa liberté d’action pour adapter son dispositif et ses modes d’action, soumis au seul commandement national.
Le Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies (59), suggère pourtant qu’un réinvestissement des opérations de l’ONU par la France n’aurait rien d’absurde. Les opérations onusiennes sont situées à 80 % sur le territoire africain et manquent cruellement de capacités de commandement, de renseignement de forces spéciales que la France pourrait leur apporter. En outre, « le port du casque bleu ôterait à la présence française, dans les pays ayant relevé dans le passé de la souveraineté française, de la tutelle ou d’un mandat français la coloration néocoloniale qui ne manque pas d’être fréquemment reprochée à notre pays ». Et il aurait le mérite de souligner l’investissement de la France au sein de l’ONU. Certes, cette modalité d’engagement restreindrait considérablement la liberté d’action de notre pays. Mais il est indéniable que la volonté de mener des opérations en national conduit la France à devoir en assumer l’intégralité des coûts, en sus de sa participation financière aux opérations multinationales. Ainsi, en République centrafricaine et dans le Sahel, la France finance non seulement l’intégralité des opérations Sangaris et Barkhane, mais aussi, avec une surcote de 7,5 % par rapport à son poids en termes de PIB, la participation des contingents sous casque bleu au sein de la MINUSMA et de la MINUSCA. Il faut ajouter à cela les opérations européennes (opération achevée EUFOR RCA et mission EUTM Mali), dont le financement commun résiduel (mécanisme Athéna) laisse le gros de la charge aux pays contributeurs de troupes, au premier rang desquels se trouve la France.
• Assurer un niveau de protection suffisant aux militaires
Les militaires risquent leur vie en opération. Il faut trouver un juste équilibre entre le souci de protection visant à limiter au maximum leur exposition et l’acceptation d’une certaine dose de risque, inhérente à l’action militaire. La pression des opinions publiques tend à rendre de plus en plus prégnante la problématique de la protection du combattant. Les pertes humaines en opération extérieure sont de plus en plus mal vécues et accroissent la versatilité de l’opinion publique quant à l’opportunité des engagements. D’un autre côté, la France continue de se distinguer par rapport à ses partenaires, notamment américain, par l’acceptation d’une prise de risque importante en opération. L’admiration suscitée par l’opération Serval tenait en partie au fait que nos partenaires ne se seraient jamais risqués à une pareille opération avec les moyens qui étaient ceux de l’armée française.
La prise de risque a donc certaines vertus, mais elle doit être minutieusement calculée : les dirigeants politiques portent la responsabilité des vies qu’ils engagent. La France doit donc limiter l’exposition de ses militaires sur le terrain. Cela entraîne une série de conséquences du point de vue budgétaire. Premièrement, notre pays doit développer des capacités de protection individuelle (blindage, gilets pare-balles) et de sécurisation de l’action militaire (drones, surveillance des zones…). Deuxièmement, il nous faut engager, au regard de l’objectif militaire assigné, des moyens suffisants en hommes et en équipements pour obtenir un effet stratégique substantiel et rapide sur le terrain, afin de ne pas exposer excessivement les militaires.
• Se donner les moyens d’obtenir un effet stratégique réel
Pour avoir un effet stratégique fort, l’engagement militaire doit reposer sur des moyens suffisants en hommes et en équipements garantissant de créer un rapport de forces favorable et de le maintenir dans la durée. Il faut donc des équipements adaptés au théâtre et en nombre suffisant, des effectifs suffisants, et la capacité de maintenir ces équipements et ces effectifs sur le théâtre durant toute la durée des opérations.
Si notre pays parvient en général à déployer des forces importantes et bien équipées à relativement brève échéance, grâce notamment au concours de ses forces prépositionnées, le critère de durée est singulièrement difficile à mettre en œuvre. Sur le temps long, les équipements s’usent et doivent faire l’objet de régénérations. De même, il faut assurer la relève des militaires déployés tous les quatre mois, donner du repos et remettre en condition ceux qui rentrent, en préparer autant à partir… Au total, la réduction du format des armées rend aujourd’hui particulièrement délicat le maintien un dispositif important sur le long terme. Et pourtant, l’une des caractéristiques des engagements actuels est leur durée : ils comprennent souvent, après une phase d’intervention, une phase de stabilisation qui peut se prolonger pendant plusieurs années. Si les effectifs décroissent trop rapidement, les bénéfices tirés de l’intervention risquent de ne pas pouvoir être maintenus dans la durée. Au Mali, les activités terroristes ont repris dans le nord du pays sitôt les effectifs de Serval redéployés sur l’ensemble de la bande sahélo-saharienne. Tous les engagements récents – Afghanistan, Libye, Sahel, Irak – montrent qu’il faut une empreinte au sol solide pour parvenir à stabiliser une situation dans la durée. La France doit donc avoir la capacité de durer sur un théâtre jusqu’à ce qu’elle y trouve un relai efficace – force internationale, armées locales.
B. CE PRINCIPE DE COHÉRENCE BUDGÉTAIRE EST FRAGILISÉ
Le niveau d’engagement actuel des armées expose fortement l’outil militaire français, dans la mesure où il ne permet pas, dans le cadre du budget actuel, une régénération suffisante des ressources en hommes et en équipements.
1. De multiples engagements militaires
Au début du mois de février 2015, la France avait environ 10 200 militaires engagés en opérations extérieures, sur quatre principaux théâtres : la bande sahélo-saharienne (opération Barkhane), la République centrafricaine (opération Sangaris), l’Irak (opération Chammal) et le Liban (FINUL). Ces 10 200 hommes viennent s’ajouter aux 10 000 militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de l’opération intérieure Sentinelle. À noter qu’un déploiement d’environ 20 000 militaires engagés en opérations intérieure ou extérieures en mobilise environ trois fois plus : outre ceux qui sont déployés, ceux qui sont en récupération et ceux qui se préparent à y aller.
Pour ce qui relève des opérations extérieures, le niveau d’engagement actuel entre a priori dans l’enveloppe du contrat opérationnel fixé par le Livre Blanc de 2013. Celui-ci prévoit que la France doit pouvoir projeter 15 000 militaires pour une opération de coercition majeure plus 8000 militaires pour des opérations moins intenses pour une durée de six mois. Elle doit pouvoir le faire en réduisant ses effectifs militaires de 24 000 postes sur la période 2014-2019, qui viennent s’ajouter aux 45 000 postes supprimés entre 2009 et 2014.
Cependant, deux remarques peuvent être faites. Premièrement, les engagements actuels des armées ont pour caractéristique commune de s’ancrer dans le temps long : plusieurs années au minimum. En outre, d’après le Général de Villiers, chef d’état-major des armées, la cible que définit le contrat opérationnel ne pourra probablement pas être atteinte avant 2025 en raison de « trous capacitaires » auxquels les programmes d’équipement prévus par la loi de programmation militaire doivent venir progressivement remédier.
S’agissant de l’opération intérieure, la loi de programmation militaire ne finance pour l’heure le déploiement de 10 000 militaires sur le territoire national que pour une durée d’un mois. L’opération Sentinelle, qui dure déjà depuis quatre mois, excède ainsi le contrat opérationnel. Cela a immanquablement des conséquences sur les ressources disponibles pour les opérations extérieures, puisque les mêmes hommes sont susceptibles d’être tour à tour déployés à l’extérieur et à l’intérieur du territoire national. L’actualisation en cours de la loi de programmation militaire devrait y apporter une réponse en diminuant les cibles de déflations d’effectifs prévues sur la période de programmation, de façon à permettre le déploiement durable de 7000 militaires sur le territoire national.
2. Une forte tension sur les hommes
• Des engagements opérationnels valorisants
Les engagements extérieurs permettent aux hommes et aux femmes qui ont choisi le métier des armes de l’exercer véritablement. Outre leur caractère motivant, ils donnent aux militaires des trois armées d’acquérir une réelle expérience du combat et contribuent puissamment à entretenir leur haut niveau de professionnalisme. Pour ces raisons, le Général de Villiers, chef d’état-major des armées, juge indispensable que les armées aient un seuil d’engagement minimal qu’il estime à environ 8000 militaires déployés en opérations extérieures.
• Un rythme parfois difficile à tenir
Au-delà d’un certain niveau d’engagement, la tension suscitée sur les hommes peut avoir des conséquences négatives. Le rythme opérationnel peut s’avérer difficile à tenir pour certaines unités particulièrement sollicitées. D’après les chiffres de l’état-major de l’armée de l’air, 5,5 % des aviateurs ont passé plus de cinq mois hors de leurs bases en 2014. Les équipages de drones sont les plus sollicités, avec en moyenne neuf mois sur douze en « découché ». Les forces spéciales air (CPA 10 et escadron Poitou) sont également concernées. De manière générale, les forces spéciales des trois armées ont un rythme opérationnel très soutenu, difficilement compatible avec une vie de famille, pour des hommes qui en ont pourtant l’âge (en moyenne trente ans).
• Un effet d’éviction sur l’instruction et l’entraînement
Pour l’ensemble des forces conventionnelles, le niveau d’engagement à l’extérieur retentit défavorablement sur les conditions de travail sur le territoire national. Les ressources consacrées à l’instruction et à l’entraînement générique sont réduites au profit de la préparation spécifique, en amont des déploiements en OPEX. Les militaires n’ont plus toujours la possibilité de s’entraîner autant qu’il le faudrait sur les compétences qui représentent leur cœur de métier et qui ne sont pas forcément sollicitées en OPEX. D’après le chef d’état-major de l’armée de terre, « c’est le capital d’expérience constitué en opération qui permet de compenser, pour le moment, des insuffisances de ressources destinées à l’instruction et à l’entraînement ». Mais à terme, le niveau général risque de baisser, et certaines compétences de se perdre.
Pour l’heure, dans les trois armées, les niveaux d’entraînement sont en moyenne inférieurs de 15 % aux normes préconisées par l’OTAN. Par exemple, les troupes aéroportées ne sont plus en mesure d’effectuer leurs six sauts annuels. Quant aux pilotes de l’aviation légère de l’armée de terre, ils ont été divisés en trois catégories, dont seule la première (60 % des équipages) a les moyens de s’entraîner suffisamment pour être immédiatement opérationnelle. Ces niveaux d’entraînement insuffisants se doublent de difficultés tenant à la faible disponibilité des matériels, fortement sollicités en opération (cf supra).
La situation créée par le niveau d’engagement extérieur élevé emporte donc un double effet d’éviction. D’une part, son impact sur l’entraînement et l’entretien des compétences génériques des militaires fait peser un risque sur la qualité globale de l’outil militaire et la protection des soldats déployés en opérations. D’autre part, il induit une baisse du moral des militaires demeurés en France, dans la mesure où ceux-ci manquent des ressources nécessaires pour exercer leur métier dans de bonnes conditions.
3. Une forte tension sur les équipements
• Les équipements font leurs preuves en opération
Les opérations extérieures mobilisent fortement les équipements militaires. Comme pour les hommes, cette mobilisation a des aspects positifs. L’engagement extérieur éprouve les équipements, valide ou infirme le choix de tel matériel par rapport à tel autre, révèle des besoins nouveaux, suggère des améliorations et donne des orientations pour les programmes d’armement futurs. Il assure la promotion des équipements de l’industrie de défense française et européenne aux yeux de nos partenaires, à l’image des Rafale, dont les récents succès commerciaux ne sont pas étrangers aux performances des aviateurs français en Libye en 2011 et actuellement en Irak.
• La faible disponibilité des équipements en France
Au-delà d’un certain seuil, cette mobilisation des équipements par les OPEX devient problématique. Dans la mesure où elle implique de concentrer prioritairement l’activité d’entretien et de maintenance sur ceux qui sont engagés sur ces opérations, elle retentit sur les conditions d’exercice dans les garnisons, la faible disponibilité des équipements demeurés en métropole contraignant fortement le contenu des entraînements. La situation des régiments de cavalerie dénués de chars légers et contraints à s’entraîner sur des camions en est une illustration typique.
• La forte attrition des équipements en opération
En outre, les engagements extérieurs produisent un vieillissement accéléré des équipements, dont la régénération ne peut plus être assurée dans les temps. C’est particulièrement vrai dans la bande sahélo-saharienne, où les conditions d’emploi des équipements sont extrêmes : très fortes chaleurs, tempêtes de sable. L’attrition des matériels atteint des niveaux préoccupants s’agissant en particulier des véhicules de l’avant-blindé (VAB), très sollicités sur les différents théâtres. Au total, d’après le chef d’état-major de l’armée de terre, environ 1500 véhicules attendent encore d’être remis en état de retour d’Afghanistan ou du Liban, auxquels se sont ajoutés 500 véhicules en provenance du Mali. Le rythme d’usure des équipements dépasse largement les capacités de régénération de l’industriel. La situation est aussi préoccupante pour les hélicoptères. En moyenne, les moteurs des hélicoptères de manœuvre Caracal s’usent dix fois plus vite dans le Sahel qu’en France. De manière générale, leurs performances en aéromobilité sont très réduites dans cette zone.
Cette attrition des équipements aggrave les lacunes capacitaires auxquelles la loi de programmation militaire 2014-2019 s’efforçait de remédier en composant avec un budget d’équipement contraint, à 5,8 milliards d’euros. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation, tous les grands programmes avaient déjà fait l’objet de renégociations avec les industriels pour en diminuer les cibles ou en étaler les livraisons. Les capacités nouvelles arrivent ainsi très progressivement, obligeant à maintenir en fonction des matériels déjà hors d’âge et dont le coût d’entretien s’avère de plus en plus élevé. À titre d’exemple, dans le programme Scorpion qui doit renouveler les matériels de l’armée de terre, moins de 10 % des véhicules blindés multirôles appelés à remplacer les VAB devraient être livrés d’ici à 2019, alors que ces derniers sont déjà dans un état d’usure avancé.
4. Des incertitudes partiellement levées sur les ressources
Prenant acte du contexte géostratégique préoccupant, la loi de programmation budgétaire 2014-2019 a posé le principe d’une « sanctuarisation » du budget de la défense à 31,4 milliards d’euros annuels sur la période 2014-2016. Il s’agit d’une stabilisation en volume et non en valeur : l’inflation n’est pas prise en compte. Ce montant doit être juste suffisant pour permettre aux armées d’assurer la mise en œuvre du contrat opérationnel fixé par le Livre Blanc. En réalité, ces ressources comportent une part trop grande d’incertitude, rendant imparfaite l’application du principe de cohérence budgétaire mis en avant par les rapporteurs.
• Le problème récurrent du financement des OPEX
Les surcoûts liés aux opérations extérieures sont en partie financés par une provision votée en loi de finances initiale. Cependant, cette provision n’est pas réévaluée chaque année, en fonction de l’évolution prévisible des engagements de la France, de façon à coller au plus près aux surcoûts réellement engagés. Son montant a été fixé à 450 millions d’euros annuels dans la loi de programmation budgétaire 2014-2019, en fonction d’une évaluation des engagements militaires de la France en amont du déclenchement de l’opération Serval au Mali, quand bien même cette opération se déroulait déjà depuis plusieurs mois lorsque la loi de programmation a été votée. Dans les faits, les surcoûts liés aux opérations extérieures ont été presque trois fois supérieurs à la provision en 2014 : 1,2 milliards d’euros au total. La tendance est la même pour 2015, le niveau global d’engagement de la France n’ayant pas décru. S’y ajouteront même les surcoûts liés à l’opération intérieure Sentinelle, estimés par le ministre de la Défense à environ 1 million d’euros par jour, pour une provision initiale de seulement 11 millions d’euros. Étant donné le caractère durable des engagements militaires actuel de la France, il est probable que ce niveau de surcoûts se maintiendra au cours des prochaines années.
Au total, plusieurs centaines de millions d’euros de dépenses liées aux opérations se trouvent non financées à la fin de l’année. S’agissant des opérations extérieures, il est acquis qu’elles sont financées par le mécanisme de solidarité interministérielle : chaque ministère y contribue à raison de son poids dans le budget de l’Etat, soit 20 % du total pour la défense. Cela a conduit à annuler 570 millions d’euros sur le budget de la défense en 2014, en prenant en compte l’ensemble des dépenses des ministres éligibles à ce financement interministériel.
Au total, ce mode de financement des opérations est contestable du point de vue du principe de cohérence budgétaire, dans la mesure où il conduit à ne pas assumer complètement le coût induit par le haut niveau d’engagement opérationnel de la France. Les crédits annulés en fin de gestion pour faire face aux surcoûts des opérations extérieures entre autres le sont essentiellement sur le budget des équipements militaires. Les armées se trouvent ainsi dans la situation paradoxale où elles doivent maintenir voire accroître leur engagement opérationnel avec moins de moyens, notamment en équipements.
Les rapporteurs sont conscients des contraintes budgétaires fortes auxquelles notre pays doit faire face. Ils estiment pourtant que la France ne peut pas maintenir un niveau d’engagement inchangé si les ressources ne sont pas au rendez-vous : cette situation expose trop fortement l’outil militaire et en compromet l’avenir. Les ressources nécessaires aux engagements extérieurs devraient faire l’objet d’une prévision aussi fidèle que possible au moment du vote de la loi de finances annuelle, et le budget de la défense être abondé d’autant. S’il était estimé que les ressources nécessaires n’étaient pas disponibles, la France devrait revoir à la baisse son niveau d’engagement.
• Le problème des recettes exceptionnelles en passe d’être réglé ?
Le principe de cohérence budgétaire suppose que le financement des engagements extérieurs de la France soit prévu et assumé. Il implique aussi que ce financement repose sur des ressources effectivement disponibles et sûres. Affecter une proportion toujours plus importante de recettes exceptionnelles, par définition aléatoires, au financement du budget de la défense revient en réalité à ne pas assumer parfaitement le coût de notre outil de défense et le niveau de notre engagement opérationnel.
La loi de programmation militaire votée fin 2013 prévoyait qu’un montant total de 6,1 milliards d’euros de recettes exceptionnelles devait venir abonder le budget de la défense entre 2014 et 2019. Ce montant a encore été accru par le budget triennal 2015-2017, voté en juillet 2014, lequel retranche 500 millions d’euros au budget annuel prévu pour la défense au cours des trois prochains exercices, en prévoyant que ces 1,5 milliards d’euros seront réintroduits dans le budget de la défense sous forme de recettes exceptionnelles.
Au total, rien que pour l’année 2015, le budget de la défense devait percevoir 2,4 milliards d’euros de recettes exceptionnelles, qui devaient provenir pour 200 millions d’euros de recettes immobilières et pour 2,2 milliards d’euros du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences dite des « 700 Mhz », ainsi que des redevances versées par les opérateurs au titre de cessions de fréquences déjà réalisées. Il est désormais acquis que ces recettes ne seront pas disponibles en 2015. Le Président de la République s’est finalement engagé, à l’issue du Conseil de défense du 29 avril dernier, à compenser ces recettes manquantes par des crédits budgétaires. D’après les informations transmises aux rapporteurs, cette solution devrait aussi s’imposer pour les exercices budgétaires prochains : le projet de loi d’actualisation de loi de programmation militaire prévoirait la substitution de crédits budgétaires aux recettes exceptionnelles autres que celles provenant de ventes immobilières et de cessions de matériels militaires. Les rapporteurs saluent cette décision, jugeant que le choix d’un outil de défense de haut niveau et fortement engagé sur des théâtres d’opération extérieurs doit se traduire par l’affectation de ressources budgétaires du niveau correspondant.
C. DES CHOIX DIFFICILES EN PERSPECTIVE
1. Réinvestir, une nécessité vitale à brève échéance
• Un modèle d’armée « en apnée »
Les bonnes performances des militaires français et le prestige dont jouit notre armée sur le plan international ne doivent pas cacher l’état de vulnérabilité actuel de l’outil militaire. Conséquence des « dividendes de la paix » consécutifs à l’effondrement du bloc soviétique, le budget de la défense a, de manière récurrente, servi de variable d’ajustement budgétaire au cours des dernières décennies. Cela s’est traduit par « une lente érosion des capacités opérationnelles et une réduction du spectre couvert » (60). La loi de programmation 2009-2014 a tenté de remédier au sous-investissement en équipements modernes au prix d’une sévère déflation d’effectifs, mais s’est heurtée à la crise économique. Il a ainsi manqué 5,5 milliards d’euros au budget des équipements sur la période 2009-2012. La loi de programmation 2014-2019 s’est efforcée de préserver le modèle d’armée sans abandon capacitaire majeur ; il a fallu pour cela consentir à de nouvelles déflations d’effectifs et à de nouveaux étalements de programmes et réductions de cibles. Au total, « la cohérence du modèle d’armée est tout juste préservée ».
Mais ce modèle est en apnée. S’agissant des équipements, la réduction des cibles a entraîné un renchérissement considérable du coût unitaire des matériels, aggravé par la forte inflation des prix des équipements militaires, tendanciellement nettement plus élevée que la moyenne. Au total, cette hausse du coût de possession « mène le système au bord de l’épuisement, puisqu’il ne peut plus se financer que par une réduction drastique du format ». Les interventions militaires récurrentes et prolongées aggravent cette situation de fragilité en sur-employant les équipements disponibles et en provoquant leur vieillissement prématuré. Concernant le capital humain, le système « vit sur ses réserves » en dépensant le capital accumulé au cours de décennies de formation de qualité et grâce à l’acquis de l’expérience opérationnelle cumulée. Ce capital de compétences est lui aussi en apnée : « il doit nécessairement bénéficier à court terme d’une dynamique de redressement du niveau d’activité, sinon la plus-value opérationnelle dont ont bénéficié les armées se paupérisera rapidement ». À défaut, le risque est fort d’aboutir à « une armée certes aguerrie et rustique mais paupérisée, faisant bonne figure contre des adversaires non robustes, et un système conjuguant quelques belles niches capacitaires avec de nombreuses carences nuisant à la cohérence d’ensemble ».
Ces difficultés risquent d’être aggravées par les évolutions du contexte stratégique, qui conduisent la France à réévaluer à la hausse le niveau de menaces auquel elle se trouve confrontée. Le terrorisme djihadiste touche de manière croissante le territoire national à travers l’action des combattants étrangers et autres individus radicalisés. Cela conduit notre pays à renforcer la défense du territoire national sans pour autant réduire son engagement sur les fronts extérieurs. Mais l’outil militaire d’ores et déjà fragilisé n’a les moyens de faire face au maintien – voire à l’accroissement – de son engagement que si une remontée en puissance budgétaire est assurée à relativement brève échéance.
• Un réinvestissement minimal indispensable
Ce réinvestissement était prévu a minima dans le cadre de la loi de programmation budgétaire 2014-2019 : c’est une donnée essentielle de la cohérence du modèle qu’elle sous-tend. Le budget de la défense, stabilisé à 31,4 milliards d’euros en valeur entre 2014 et 2016, devait recommencer à croître au rythme de l’inflation en 2017 et 2018, et augmenter de 1 % en volume à compter de 2019.
Le 29 avril dernier, le Président de la République a en outre annoncé l’affectation de 3,8 milliards d’euros supplémentaires au budget de la défense d’ici 2019. Les rapporteurs saluent cette décision prise dans un contexte budgétaire difficile. Cependant, ils notent qu’une partie importante de ces 3,8 milliards d’euros sera absorbée par la hausse du contrat opérationnel décidée par le Président de la République, pour permettre le déploiement durable de 7000 militaires sur le territoire national. Or, il importera de trouver, à niveau d’engagement constant, des marges de manœuvre supplémentaires.
Ce réinvestissement doit notamment permettre de redresser le niveau d’activité des militaires. Les trois chefs d’état-major d’armée évoquent tous la période 2016-2017 comme celle où ce niveau d’activité devra impérativement remonter pour préserver le capital de compétences de leurs hommes. Il s’agit là d’un enjeu particulièrement fort, dans la mesure où ces compétences résultent d’un investissement séculaire et qu’il très difficile de les réacquérir si elles devaient se perdre. En outre, cet investissement est particulièrement précieux dans un contexte de carences budgétaires : il permet d’entretenir le moral de l’armée et d’améliorer son aptitude à intégrer des nouveaux savoir-faire sans avoir nécessairement tous les équipements afférents.
Il sera donc indispensable que la loi de programmation militaire 2014-2019 soit mise en œuvre jusqu’au bout, contrairement aux précédentes. Le modèle d’armée qu’elle sous-tend a été rationalisé à l’extrême et ne serait plus soutenable si les ressources dédiées à la défense n’étaient pas accrues à brève échéance. Ce choix sera particulièrement difficile à mettre en œuvre dans un contexte où la simple « sanctuarisation » des 31,4 milliards d’euros annuels s’avère déjà périlleuse. Cette sanctuarisation n’est pourtant qu’une solution d’attente : son acceptabilité est attachée à la perspective d’une remontée en puissance à un horizon proche, la cohérence de l’outil militaire en dépend.
2. Le débat sur l’avenir de la dissuasion nucléaire est-il clos ?
Au-delà de la période de programmation actuelle, la cohérence d’ensemble de l’outil militaire au regard de la politique d’engagement de la France doit être pensée à plus long terme, dans la mesure où les décisions prises dans le présent, en particulier en matière d’équipements, engagent les finances de l’État pour de longues années.
La période de programmation 2014-2019 a pérennisé les moyens de la dissuasion renouvelés par l’entrée en service relativement récente de nouveaux équipements : sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de deuxième génération, Rafale, missile M 51 pour la composante océanique et ASMP/A pour la composante aéroportée. Cependant, Les armes nucléaires ont une durée de vie limitée à une vingtaine d’années en raison de la péremption de certains matériaux et composants. Ainsi, la construction du SNLE de troisième génération appelé à remplacer le SNLE « Le triomphant » devra débuter dès 2020, pour une mise en service actif vers 2030. De même, au début des années 2020, il faudra procéder aux rénovations à mi-vie des missiles M 51 et ASMP/A, et lancer les travaux pour un renouvellement à l’horizon 2030. Au total, les besoins de la dissuasion nucléaire seront croissants dans les années à venir.
Dans ce contexte, les rapporteurs pensent qu’un débat en profondeur sur la politique de dissuasion nucléaire de la France sera incontournable. Ils ne préjugent aucunement de l’issue de cette réflexion. Mais ils estiment que la tenue de ce débat conditionnera l’acceptabilité sociale à moyen terme du coût de la dissuasion nucléaire. Pour reprendre les termes du chercheur Bruno Tertrais (61), « s’il y a un consensus français, il doit être nourri par le débat, par le questionnement permanent. Il ne peut être tenu pour acquis si la dépense nucléaire augmente significativement dans les années à venir ».
3. Opération Sentinelle et cohérence globale de l’outil militaire
À l’heure où les rapporteurs concluent cette étude, la décision du Président de la République de déployer de manière pérenne 7000 hommes sur le territoire national introduit dans le débat une nouvelle donnée dont les conséquences sont aujourd’hui encore difficiles à mesurer.
De l’aveu même du ministre de la Défense, la pérennisation de l’opération Sentinelle constitue un « changement de doctrine ». Le Livre Blanc de 1994 avait consacré la prééminence donnée à l’action extérieure dans les missions des forces armées. Cette évolution des missions s’était traduite par une véritable transformation de l’outil militaire : recrutement, formation, choix capacitaires avaient été organisés en fonction de cette centralité donnée à l’action extérieure. La nature permanente de l’opération Sentinelle change la donne. Elle implique le déploiement de 7000 hommes sur le territoire national en sus des engagements extérieurs des armées. Ce nombre est pratiquement équivalent au total des militaires actuellement déployés en opération extérieure. En raison de son ampleur et de son caractère durable, cette nouvelle mission ne peut être neutre sur le système de forces de notre pays, jusqu’à présent tourné vers l’action extérieure.
L’actualisation en cours de la loi de programmation militaire mobilise des ressources supplémentaires pour recruter les effectifs nécessaires à cette nouvelle mission, à hauteur de 2,4 millions d’euros, ainsi que pour les coûts de fonctionnement afférents à ces emplois (400 millions d’euros). Cependant, la mission Sentinelle diffère tellement de missions habituelles des militaires sur les théâtres extérieurs que son effet ira nécessairement au-delà des coûts directement liés aux effectifs mobilisés à cette fin. Le ministre de la Défense a d’ores et déjà exclu la possibilité d’une armée « à deux vitesses », dont une partie des militaires seraient spécialisés pour l’action de haute intensité sur des théâtres extérieurs, tandis que les autres auraient vocation à remplir des missions relevant davantage du maintien de l’ordre sur le territoire national. Dès lors, comment donner aux militaires une formation qui soit à la fois compatible avec des engagements extérieurs dans des environnements parfois très hostiles et un engagement intérieur où ils devront faire preuve de la plus grande retenue ? On le voit, la formation des militaires serait à repenser.
Pour ces raisons, les rapporteurs estiment que la transformation de Sentinelle en « opération permanente » ne devrait pas être définitivement actée sans que soit menée, en amont, une réflexion approfondie sur les implications de cette nouvelle mission sur la politique de défense de la France et sur la cohérence globale de son outil militaire.
Au terme de cinq décennies d’engagements militaires hors des frontières de la France, on observe un scepticisme grandissant quant à l’efficacité de ces « opérations extérieures » pour résoudre une situation de crise. La vague d’optimisme née dans les années 1990, qui avaient vu le lancement d’expéditions militaires tous azimuts, semble définitivement retombée. Désormais, une prise de conscience s’est imposée : les interventions militaires ne peuvent avoir qu’une ambition limitée et sont un outil à manier avec beaucoup de précautions, tant leurs effets sont parfois éloignés des objectifs qui leur avaient été assignés.
Pour autant, les rapporteurs ne pensent pas que le désengagement extérieur soit une option. Ils en ont la conviction, la France continuera à devoir s’engager hors de ses frontières dans les années qui viennent. Pour cela, elle doit impérativement préserver l’excellence de son outil militaire. Ce formidable atout capitalisé au fil des années est aujourd’hui fragilisé. Il faudra résolument l’entretenir. Cela ne sera pas un choix facile, dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Mais les récentes décisions prises par le Président de la République constituent un signal plutôt encourageant.
Nos engagements passés l’ont bien montré, un outil militaire performant est un prérequis, ce n’est nullement un gage de succès sur le plan politique. Or, les conditions politiques des engagements extérieurs se sont aujourd’hui considérablement complexifiées. Pour cette raison, il est indispensable que la politique d’engagement armé de la France soit débattue et mûrie. Les rapporteurs ont souhaité contribuer à cette réflexion en proposant des critères pour guider la décision politique. Ils ont conscience que leur travail n’est pas définitif, et souhaitent que le débat puisse être poursuivi et élargi, en France et avec nos partenaires, en particulier européens.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 20 mai 2015.
Mme Odile Saugues, vice-présidente. Notre ordre du jour appelle l’examen du rapport de la mission d’information de MM. Guy-Michel Chauveau et Hervé Gaymard, sur la politique d’interventions militaires de la France.
M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur. Hervé Gaymard et moi avons conduit une mission d’information au long cours sur la politique d’engagement armé de la France. Elle dure à présent depuis un an et demi, et l’intitulé en avait été arrêté en décembre 2012, il y a deux ans et demi.
À l’époque, la France se trouvait dans une période d’accalmie du point de vue des engagements extérieurs : l’armée française avait quitté la Libye un an plus tôt et venait d’achever sa mission de combat en Afghanistan. Depuis, les militaires français ont été engagés successivement au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, en Centrafrique et en Irak, entre autres. A l’heure actuelle, 10 000 militaires français sont déployés en opération extérieure. Autant dire que le sujet de notre mission est resté d’actualité !
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, l’information et le pouvoir de contrôle du Parlement sur les opérations extérieures de la France ont été renforcés. Nous le savons tous, l’initiative de l’engagement de la force armée revient, de manière ultime, au Président de la République. Cela ne doit néanmoins pas nous interdire d’émettre des recommandations à ce sujet.
Il nous semble utile et légitime que notre commission ait un débat de fond sur la politique d’engagement armé de la France. Par-delà leur appellation sibylline, les opérations extérieures engagent profondément notre pays : elles mettent en jeu des vies humaines, mobilisent souvent durablement les finances publiques et produisent des effets à long terme qui sont parfois bien éloignés des objectifs politiques initiaux. Les opérations extérieures font débat dans la classe politique, chez les citoyens et chez les experts. C’est légitime, étant donné que c’est la vie de nos soldats que nous engageons.
Il faut donc s’efforcer de donner un cadre rationnel aux interventions militaires de la France. Il s’agit d’éviter que des paramètres conjoncturels ne prennent une part trop grande dans les décisions d’intervention, qu’il s’agisse de l’émotion suscitée par la médiatisation des conflits, de l’état de l’opinion publique voire d’échéances politiques diverses.
Ce cadre, le Livre Blanc de 2013 l’a esquissé. Nous avons jugé utile de le préciser, en nous appuyant sur l’expérience des engagements extérieurs passés de la France. À cette fin, nous avons procédé à un recensement des opérations extérieures françaises depuis la guerre d’Algérie. Vous le trouverez en annexe du rapport. Ce n’est pas un travail scientifique, mais il donne une idée de la diversité et de la multiplicité de ces engagements, ainsi que des évolutions de leurs modalités sur cinq décennies.
Pourquoi remonter à la fin de la guerre d’Algérie ? Après tout, la tradition d’engagement extérieur de l’armée française est bien plus ancienne. Sous le Second Empire, la France avait multiplié les expéditions lointaines, au Mexique, en Crimée, au Liban, en Chine ou en Algérie. Mais la fin de la guerre d’Algérie a marqué le début des opérations extérieures telles que nous les connaissons aujourd’hui. Notre pays se trouvait alors en paix, et la défense du territoire national était assurée notamment grâce à la dissuasion nucléaire.
Des années 1960 à la fin de la guerre froide, la projection de forces sur des théâtres extérieurs est devenue le cadre d’action principal de nos armées. C’est sur ces théâtres qu’elles ont acquis une réelle compétence en termes de capacité d’intervention, quelles que soient les réserves que l’on peut émettre par ailleurs sur l’opportunité de telle ou telle intervention. L’effondrement de l’URSS a accéléré cette évolution. Elle a fait disparaître toute menace directe contre le territoire français, mais s’est traduite, dans les années 1990, par le déclenchement de conflits dans les Balkans. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué le début de la lutte contre le terrorisme, avec l’intervention en Afghanistan. Depuis, les engagements extérieurs n’ont pas cessé. Limiter cette instabilité généralisée, telle est devenue la vocation principale de l’outil militaire français.
Y-a-t-il eu des constantes dans les engagements extérieurs de la France depuis cinquante ans ? Nous avons été marqués par la permanence d’une certaine conception des responsabilités internationales de la France. Cette conception tient tout à la fois à notre géographie, à notre histoire, notamment coloniale, et à notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est un fait, depuis cinquante ans, la France n’a jamais limité le champ de ses engagements extérieurs à la défense de ses intérêts immédiats, en raison d’une conception large de ses responsabilités et de son rôle dans le maintien de la stabilité internationale qui est une singularité de notre pays.
Au-delà de toutes les controverses qu’ont pu susciter ces engagements, c’est aussi cette conception de nos responsabilités internationales qui a poussé la France à intervenir en Afrique quand ses intérêts n’étaient pas directement en jeu, en vertu d’accords de défense qui ont depuis été renégociés. Et il nous faut reconnaître que ces opérations ont permis d’éviter de grands drames tels que ceux qui se sont produits hors de la zone d’influence traditionnelle de la France : Angola, Mozambique, Sierra Leone, pour n’en citer que quelques-uns.
Autre ligne de force des engagements extérieurs de la France, notre pays a toujours eu le souci marqué de recueillir l’approbation de la communauté internationale pour bien asseoir la légitimité de son action. Ceux qui ont lu le rapport rédigé sur le même sujet en 1995 par notre collègue Jean-Bernard Raymond auront constaté que c’était au cœur de ses préoccupations.
Pouvons-nous tirer des enseignements de ces cinquante années d’interventions militaires ? Nous n’avons évidemment pas cherché à établir le bilan de chaque engagement pris individuellement : ce travail aurait été hors de notre portée et tel n’était pas notre sujet. Mais il nous a semblé que nous pouvions dégager un bilan global de ces décennies d’engagement au niveau politique et au niveau militaire.
Sur le plan militaire, nous avons trouvé que le bilan était globalement positif. Au cours de cette période, l’armée française s’est forgé une expérience de combat sur des théâtres très divers. D’une armée de conscrits dédiée à la défense du territoire national, elle s’est transformée en armée professionnelle, polyvalente, agile, capable d’intervenir sur des théâtres très divers. Elle s’est remarquablement adaptée aux évolutions du contexte international et aux mutations technologiques. Nous pouvons dire sans nous tromper que l’armée française est aujourd’hui au meilleur niveau mondial. C’est un acquis extrêmement précieux, qui nous vaut la reconnaissance et l’admiration de tous nos partenaires, y compris des Américains, notamment après l’opération Serval au Mali.
Le bilan militaire est donc positif, mais nous savons bien que l’outil militaire n’est pas une fin en soi. Comme son nom l’indique, il n’est qu’un « outil » au service d’une politique. Que penser du bilan politique des engagements extérieurs français ?
Ont-ils permis d’atteindre les objectifs qui leur avaient été assignés ? Si l’on évalue le succès de la politique d’engagement armé de la France à l’aune de la stabilisation des États où ces engagements ont été conduits, le constat est très mitigé. Pour ne prendre que quelques exemples, la France est intervenue à de nombreuses reprises en République centrafricaine depuis les années 1960 ; elle a dû à nouveau s’y engager fin 2013, et la situation paraît encore bien fragile à l’heure actuelle. Au Kosovo, on ne peut considérer la situation comme complètement stabilisée malgré la présence continue de la communauté internationale depuis 1999. Et l’on peut s’interroger sur l’efficacité des treize années d’opérations en Afghanistan, même si la légitimité de cette intervention n’était pas contestable. Enfin, nous ne pouvons que constater les limites de notre engagement militaire en Libye en 2011, au regard de la situation actuelle.
Malgré tout, nous ne devons pas sombrer dans le dénigrement systématique des engagements extérieurs. Certaines opérations ont eu un réel effet stabilisateur : il en va ainsi de la présence française au Tchad depuis les années 1980, avec l’opération Épervier. Par ailleurs, il est toujours plus facile de souligner les lacunes des interventions que d’évaluer les conséquences des « non-interventions » : que se serait-il passé si l’OTAN n’était pas intervenue en Libye en 2011 ? Aurions-nous été prêts à assumer les conséquences de cette abstention ? Par ailleurs, tous les maux de ces pays ne sont pas imputables aux interventions militaires, c’est évident mais il faut le rappeler.
Quel bénéfice la France a-t-elle tiré de son investissement extérieur en termes d’image et d’influence diplomatique ? Là encore, le bilan est en demi-teinte. D’un côté, les multiples engagements de la France en Afrique jusqu’à la fin des années 1990 ont pu lui donner une image de « gendarme » de ce continent, et ont souvent été critiqués sur le plan des motivations. Cependant, ces engagements nous ont permis de garder des liens privilégiés avec nos anciennes colonies et d’entretenir notre connaissance de cette région, dont nos partenaires européens et américains sont très demandeurs. Si le crédit politique que la France tire de ces engagements a longtemps pu être miné par le fait que nous étions soupçonnés d’intervenir dans notre pré-carré, nous avons essayé de donner une autre image de ces engagements en y associant nos partenaires européens. D’ailleurs, la plupart des opérations européennes lancées depuis 2003 ont eu l’Afrique pour théâtre.
Par ailleurs, certaines opérations n’ont pas eu le résultat escompté, ce qui a eu un retentissement négatif en termes politiques. L’opération Turquoise a été critiquée, même si elle avait pour objet de stopper un génocide, car elle intervenait après plusieurs années de soutien au pouvoir en place qui en était l’auteur. Les opérations de l’ONU dans les Balkans et la Somalie ont été un échec. Si l’intervention en Libye a permis, dans un premier temps, de protéger les populations civiles, elle a involontairement fait naître de nouvelles menaces. Cela pourrait entamer notre crédit politique, car nous avons été leader dans cette opération.
A l’inverse, on peut estimer que la France tire un bénéfice politique substantiel de son engagement dans la bande sahélo-saharienne, notamment auprès des Américains, mais même au-delà. Nous avons reçu l’ambassadeur d’Australie qui nous a exprimé toute l’admiration de la classe politique et des militaires australiens à ce sujet.
Enfin, on peut se demander si la France a tiré de ses engagements au sein de coalitions internationales un crédit politique à la hauteur de leur coût humain et financier. 89 soldats français ont laissé leur vie en Afghanistan, mais le volume de la contribution française – au demeurant loin d’être négligeable – ne nous a jamais permis de peser stratégiquement. Cependant, il était impossible à la France de ne pas afficher sa solidarité avec les Américains au lendemain des attentats du 11 septembre.
Que conclure de cette mise en perspective historique ? Le bilan politique de cinquante années d’opérations extérieures françaises nous semble globalement mitigé. Il a fait naître un doute sur l’efficacité de la réponse militaire en situation de crise. Ce doute s’est installé dans les opinions publiques, en France et chez nos partenaires, et fragilise la légitimité des engagements extérieurs.
Doit-on pour autant en conclure à la nécessité d’un désengagement extérieur ? Le contexte international tend au contraire à nous rappeler l’importance de l’engagement armé. Avec le terrorisme et l’essor des nouvelles technologies, sécurité internationale et défense du territoire national se confondent de plus en plus. La France est amenée à intervenir hors de ses frontières pour des raisons de sécurité nationale. Dans ce contexte où les opérations extérieures sont à la fois nécessaires et fragiles sur le plan de la légitimité, il est d’autant plus important de réfléchir aux principes devant guider la politique d’engagement de la France.
M. Hervé Gaymard, rapporteur. Je voudrais faire deux remarques préalables. D’abord, Guy-Michel Chauveau et moi pensons que le mot de doctrine est inadapté à la conception que nous devons avoir des interventions militaires extérieures, parce qu’il ne faut pas se lier les mains à l’avance. Cependant, cela n’interdit pas de réfléchir à un certain nombre de principes d’action. Deuxième point, l’intervention extérieure fait partie de la dissuasion. Nous avons tendance à imaginer que la dissuasion n’est que nucléaire, mais en réalité la dissuasion doit être une posture globale, avec toute une palette d’actions possibles. De ce point de vue, la capacité d’intervention extérieure participe à la signature globale de notre pays et à son autonomie de décision.
Il nous a semblé que les engagements extérieurs de notre pays devaient respecter cinq principes essentiels cumulatifs : avoir un intérêt stratégique, un soutien large de la communauté internationale, des objectifs clairs et réalistes, une stratégie de sortie pérenne élaborée en amont et enfin, bien évidemment, des effets positifs sur les populations civiles des pays concernés.
• Premièrement, l’intervention doit avoir un « sens stratégique », c’est-à-dire être réellement compatible avec les intérêts supérieurs de la France.
Quels sont ces intérêts ? Le Livre Blanc de 2013 en distingue trois catégories. Les intérêts vitaux : défense du territoire métropolitain et ultramarin ainsi que de nos zones maritimes ; protection des ressortissants français, auxquels on peut adjoindre la défense du territoire des États européens et de l’Alliance atlantique auxquels nous sommes liés par une clause de défense collective. Il s’agit aussi de nos intérêts stratégiques. Ceux-ci sont nombreux et divers ; il convient de déterminer au cas par cas dans quelle mesure leur mise en cause justifie un engagement armé. Il s’agit enfin de nos responsabilités internationales, cercle plus dilué mais très important. Il est dans l’intérêt de la France de les honorer, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. En effet, ce statut n’est pas seulement un legs historique. Dans le monde actuel qui n’est plus celui de 1945, la France doit chaque jour prouver qu’elle en est digne.
Avant toute décision d’intervention, il faut mûrement peser si l’engagement envisagé est compatible avec les intérêts de la France largement appréciés. Au sein d’une coalition internationale dont elle n’est pas leader, nous pensons que la France doit proportionner son engagement à l’influence qu’elle est susceptible d’exercer, afin de pouvoir concentrer ses moyens sur les théâtres où ils auront l’effet stratégique le plus fort.
• Deuxième critère, tout engagement extérieur français doit bénéficier d’un soutien large de la communauté internationale.
Sa légalité et sa légitimité doivent être consacrées par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, cela va de soi. Nous pensons que c’est un impératif. En dépit de tous ses défauts, l’ONU reste une institution unique dans l’histoire. En tant que membre permanent, nous avons tout intérêt à préserver la centralité du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous devons donc nous efforcer d’obtenir systématiquement une résolution autorisant l’usage de la force préalablement à tout engagement extérieur, même si cela nous coûte beaucoup de temps et d’énergie. Le Libre blanc est d’ailleurs très clair sur ce point. Cette exigence ne connaît qu’une seule exception, prévue par la Charte des Nations Unies : la légitime défense collective, qui nous permet d’intervenir à la demande d’un État qui se trouve lui-même en situation de légitime défense, ce que nous faisons actuellement en Irak.
Deuxième élément de ce soutien de la communauté internationale, l’éternelle question européenne. Le soutien des Européens est à la fois indispensable et complexe à obtenir. Il est indispensable sur le plan financier et sur le plan de la légitimité. Sur le plan financier, car les besoins en sécurité du continent africain sont tels qu’ils dépassent largement nos moyens. Et sur le plan de la légitimité, car la dimension européenne d’une opération lui ôte l’éventuelle teinte néocoloniale qui pourrait lui être reprochée. Cependant, ce soutien est compliqué à obtenir, parce que les États européens n’ont pas tous la même histoire et la même implication dans toutes les parties du globe, et c’est notamment le cas en Afrique. En outre, les outils développés au sein de la politique de sécurité et de défense commune ne sont pas faciles à mettre en œuvre. La chaîne de commandement, les procédures et le processus décisionnel de l’Union européenne sont mal adaptés aux exigences spécifiques de l’action militaire. Cela fonctionne actuellement au Mali et en République centrafricaine, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous pouvons donc être tentés de nous affranchir de cette procédure européenne.
Nous pensons qu’il ne faut pas hésiter à le faire lorsque les options de PSDC ne paraissent pas adaptées ou pâtissent d’un manque d’élan politique qui en compliquerait la mise en œuvre. Par exemple, la coopération engagée de manière pragmatique au sein de l’European air transport command (EATC) pour mutualiser le transport stratégique fonctionne bien et pourrait être élargie au ravitaillement en vol. Nous pensons que ce type d’approche pragmatique doit être érigé en norme d’action dans notre coopération avec les États européens.
Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à pousser l’Europe de la défense pour la rendre plus opérationnelle. Il est possible de lever certains obstacles au déploiement des groupements tactiques de l’Union européenne (GTUE), qui n’ont jamais été utilisés à ce jour. Ces forces en alerte, bien entraînées et susceptibles de se déployer en quinze jours, pourraient être particulièrement utiles pour intervenir dans une situation d’urgence. Il faudrait parvenir à faire financer leur déploiement sur fonds communs ; nous plaidons en ce sens, appuyés par nos partenaires allemands et polonais. Pour le moment, il faut reconnaître que c’est un peu la double peine : toute la charge pèse sur le pays qui envoie ses militaires, lequel doit en outre accepter les rigidités de la chaîne de commandement européenne.
Enfin, si nous souhaitons associer les Européens, nous devons jouer pleinement le jeu du multilatéralisme, c’est-à-dire accepter de partager avec eux le renseignement et la réflexion en amont des opérations militaires. Nous ne pouvons pas raisonnablement décider d’intervenir de manière unilatérale et attendre ensuite des Européens qu’ils partagent l’effort. Le multilatéralisme doit commencer dès le stade de la planification des opérations. Nous étions à Berlin en janvier 2013 lorsque l’opération Serval a été lancée. Il était frappant de constater que la plupart de nos collègues allemands ne savaient pas où se situait le Mali et ne comprenaient pas que nous y intervenions. Nous avons donc un effort d’acculturation collective à faire. Cela vaut aussi pour nous, s’agissant des préoccupations sécuritaires de nos partenaires baltes et orientaux, au sujet desquelles nous ne nous sentons pas toujours très concernés.
Troisième élément du soutien de la communauté internationale, il faut, autant que possible, coopérer avec les partenaires locaux. La France sera d’autant moins perçue comme une force d’occupation que son action se présentera comme une coopération avec les forces locales et régionales. L’efficacité à moyen terme de l’intervention militaire dépendra de leur aptitude à assurer notre relai. C’est toute la logique du dispositif Barkhane dans le Sahel. Les opérations des forces françaises sont conduites conjointement avec les armées du G5 Sahel. Nous pensons que c’est un dispositif intelligent mais qui suppose un investissement sur le long terme, en raison du différentiel de niveau entre l’armée française et les armées locales.
• Troisième critère, l’engagement extérieur doit avoir des objectifs clairs et réalistes.
Les objectifs stratégiques et politiques doivent être clairement définis en amont de tout engagement. Souvent, les engagements extérieurs pâtissent d’un défaut de commande politique. Nous pensons que la France doit s’abstenir de s’engager s’il n’est pas possible d’énoncer des objectifs suffisamment clairs.
Ces objectifs doivent aussi être réalistes, c’est-à-dire atteignables avec les moyens que nous sommes prêts à investir dans l’opération. Cela exclut d’entrée en de jeu des objectifs démesurément ambitieux, de type « nation building » dont nous avons constaté la folle présomption. Nous ne devons pas envisager ce que nous ne pourrons jamais arriver à faire, compte-tenu de situations politiques, ethniques et militaires inextricables.
Même avec une ambition limitée, nous devons nous poser la question des moyens que nous sommes prêts à consacrer sur le temps long. Le critère de durée conditionne souvent l’efficacité d’une opération, car il faut s’engager pour reconstruire les forces armées et de sécurité locales. Avons-nous la capacité à durer et sommes-nous prêts à nous investir durablement ? Nous pensons qu’il est essentiel de répondre à cette question avant de s’engager.
• Quatrième critère, l’intervention militaire doit être assortie d’une stratégie de sortie pérenne.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées l’ont souligné, la planification de l’après-crise est le point faible des opérations extérieures françaises. C’est pourtant un enjeu essentiel aujourd’hui, où la difficulté n’est pas tant de gagner la guerre que de gagner la paix.
Pour cela, il nous faut nous assurer, en amont de tout engagement, qu’il existe une solution politique crédible au conflit pour assurer le relai de notre action militaire et permettre la mise en œuvre d’un processus politique bénéficiant d’un ancrage local suffisant.
Par ailleurs, on ne cesse de le dire, il nous faut mettre en œuvre une approche globale des crises. Il est évident qu’au-delà de l’action militaire, nous devons prendre en compte les populations civiles, les nécessités de la reconstruction de l’État, et les aspects économiques. À l’évidence, nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. La France a déjà fait des efforts pour coordonner ses moyens d’action au niveau interministériel, mais la mise en œuvre d’une véritable stratégie globale butte sur le manque de moyens et d’outils dédiés. L’Agence française de développement (AFD) n’a pas le droit d’intervenir pour la reconstruction des pays en guerre. Nous devions utiliser tous les leviers disponibles. Nous pensons que l’OTAN, spécialisée dans les opérations de haute intensité, n’est pas la bonne réponse. En revanche, l’Union européenne a un potentiel intéressant en raison de la diversité de ses instruments et de l’étendue de son champ de compétence. Pour l’exploiter pleinement, il faut qu’elle réforme ses structures et supprime ses cloisonnements. Nous avons auditionné plusieurs praticiens des missions de l’Union européenne, qui sont extrêmement critiques sur la manière dont cela fonctionne – ou plutôt ne fonctionne pas. Il est tout à fait possible de réformer ces dispositifs pour les rendre plus efficaces.
• Dernier critère, qui n’est pas le moindre : nous devons nous assurer que l’engagement militaire aura un réel effet positif pour les populations concernées. Il faut que la dimension de l’aide humanitaire d’urgence soit prise en compte en amont, de même que celle de la protection des populations civiles par rapport aux effets de l’intervention militaire. Cela n’a pas toujours été le cas.
Voilà les quelques lignes de force que nous avons dégagées. A l’évidence, tout ce dont nous avons parlé n’est possible que si nous maintenons, sur le long terme, une cohérence budgétaire dans notre politique de défense et une cohérence dans l’architecture de nos forces. S’agissant de la cohérence budgétaire, nous pouvons en avoir des appréciations diverses après les décisions prises en Conseil de défense le 29 avril dernier. Je ne souhaite pas me lancer dans ce débat maintenant. La question de la cohérence de l’architecture de nos forces est capitale. Comment équilibrer les différentes missions des armées entre dissuasion nucléaire d’un côté et engagement extérieur de l’autre ? Il faudra apporter une réponse claire à ce débat au début du prochain quinquennat. Les décisions prises naguère sur la modernisation des composantes valent jusqu’en 2025-2030 ; les décisions pour l’après 2030 seront complexes dans un contexte géopolitique et dans une situation budgétaire mouvants.
A ce débat s’est adjoint, plus récemment, celui de l’équilibre entre protection du territoire national et engagement extérieur, avec la décision du Président de la République de redéployer une partie de l’armée de terre sur le territoire dans le cadre de l’opération Sentinelle. Cette décision a été prise sans grand débat. Il mérite pourtant d’être posé, et raisonne avec nos questionnements sur les engagements extérieurs. Les militaires déployés en France pour surveiller les lieux sensibles ont-ils besoin de la même formation que ceux que nous envoyons au Mali ? Les réponses que nous apporterons ne seront pas neutres sur le format de nos armées et la panoplie des outils dont nous devons disposer pour garder notre crédibilité militaire – et donc politique – globale.
Voilà les quelques réflexions que nous voulions vous livrer. Vous pourrez constater qu’en annexe du rapport, nous nous sommes livrés à un recensement aussi exhaustif que possible des interventions militaires depuis la guerre d’Algérie. Je pense qu’une telle compilation n’avait jamais été réalisée sous cette forme et j’espère que ce rapport aura fait œuvre utile de ce point de vue-là aussi.
Mme Odile Saugues. Merci pour ce rapport qui a le mérite de faire une présentation synthétique d’un sujet qui pouvait se prêter à de très longues digressions.
Votre rapport contient de très intéressants développements sur l’expérience des dernières années et sur la politique d’intervention de nos principaux alliés.
Il contient surtout des éléments de réflexion sur la politique d’engagement de la France qui sont une excellente base pour un débat au sein de notre commission.
Comme vous l’avez expliqué, il ne saurait être question de présenter une doctrine détaillée pour les interventions militaires de la France. Les situations de crise sont beaucoup trop diverses ; par ailleurs, établir une doctrine risquerait de limiter les prérogatives du Président de la République. Je partage votre opinion qu’il convient de préserver la prééminence du chef de l’Etat dans ce domaine, ce qui n’interdit nullement au Parlement d’exercer un contrôle effectif sur les opérations extérieures.
En revanche, il est utile de réfléchir aux lignes directrices qui peuvent encadrer nos engagements.
Vous soulignez très justement que la décision d’engager nos forces doit être guidée par les intérêts de la France, c’est-à-dire par ses intérêts vitaux et par ses intérêts stratégiques, mais aussi par ses responsabilités internationales.
Ce sont évidemment ces dernières qui sont les plus problématiques car les principes et les valeurs auxquels notre pays est attaché, tout comme nos responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité, pourraient nous conduire à intervenir un peu partout dans le monde.
Il est donc important que ces responsabilités soient encadrées par des garde-fous afin que nous ne soyons pas entraînés dans des aventures militaires interminables et contre productives.
Le premier de ces garde-fous c’est évidemment le Conseil de Sécurité. Vous avez raison d’insister sur le fait que l’obtention d’une résolution du Conseil de sécurité est indispensable en dehors des cas d’application de la légitime défense définie par la Charte des Nations Unies. Naturellement, c’est une condition qui peut s’avérer très contraignante dans les situations où l’un des membres use de son droit de veto pour empêcher l’adoption d’une résolution. Vous rappelez dans votre rapport que la France a lancé une initiative visant à limiter le droit de veto en cas d’atrocités de masse. C’est une initiative que notre commission devra suivre attentivement car elle répond à une préoccupation légitime. Nous pourrions à l’occasion entendre Hubert Védrine sur ce sujet puisque c’est lui qui est en charge de cette mission diplomatique.
Vous évoquez aussi la nécessité de ne pas relâcher nos efforts pour tenter de convaincre nos partenaires européens de s’associer à nous. Nul ne sous-estime la difficulté de la tâche. Ces partenaires n’ont pas la même vision de leurs intérêts stratégiques et surtout pas les mêmes moyens ni la même culture militaire. Pourtant, je pense comme vous que nous devons les associer davantage à la décision en amont des opérations et que nous les sensibiliserons d’autant mieux aux questions africaines que nous nous intéresserons au flanc est de l’Europe. Je partage également votre idée que nous devons poursuivre nos efforts pour rendre la PSDC plus opérationnelle.
Et puis bien entendu, vous avez raison d’insister sur la nécessité de préserver les moyens de notre appareil de défense. La France dispose d’une capacité de projection exceptionnelle mais les moyens budgétaires consacrés à la défense sont sans cesse remis en cause. Je me félicite de la décision du chef de l’État d’affecter 3,8 milliards d’euros supplémentaires au budget de la défense d’ici 2019. Nous aurons l’occasion d’en discuter la semaine prochaine à l’occasion de l’audition de Jean-Yves Le Drian qui précédera l’examen pour avis de l’actualisation de la loi de programmation militaire.
M. Jean Glavany. Je voudrais d’abord féliciter nos collègues pour la qualité de ce rapport et de leurs interventions. Je pense qu’ils touchent juste. C’est un enjeu majeur pour une démocratie parlementaire de s’interroger sur l’emploi de notre force militaire à l’étranger et de tirer les leçons de l’expérience. Je voudrais insister sur le quatrième critère mentionné qui est la stratégie de sortie pérenne. Il ne s’agit pas seulement de définir une stratégie de sortie pérenne mais aussi d’assurer un suivi politique constant car, vous l’avez dit, seule une solution politique peut régler le problème. L’OPEX ne peut être que le préalable d’une solution politique ; croire autre chose serait une erreur majeure, l’histoire nous le montre. Je me souviens de l’intervention française en Afghanistan qui avait été unanimement soutenue par le Parlement après les attentats du 11 septembre ; on avait fixé des objectifs extrêmement précis, qui ont été atteints en quelques mois. Mais au bout de quelques années, nous nous sommes rendu compte que l’opération n’était plus du tout en mesure de répondre à ces objectifs. On s’est donc posé trop tard la question de la pertinence de la durée de cette intervention. Après leur intervention en Irak, les Américains ont mis en place un gouvernement qui s’est avéré sectaire et n’ont pas assuré le suivi politique qui s’imposait. Nous payons aujourd’hui le prix du désordre qui en résulte. Au Mali, nous savons que c’est par un règlement politique sur la question du nord du pays, ô combien difficile à mettre en place, que la sortie de crise sera possible. C’est la même chose en Centrafrique. D’une manière générale, nous devons avoir en tête que les forces militaires souvent accueillies dans l’enthousiasme et comme « libératrices » au début viennent rapidement à être considérées comme des forces d’occupation. Nous avons presque tous appuyé l’intervention en Libye, mais aucun suivi politique n’a été assuré, et nous portons aujourd’hui une responsabilité majeure dans l’effondrement du pays. Notre expérience – et celle de nos partenaires – nous enseigne que les OPEX ne peuvent avoir de résultat positif que si nous en assurons un suivi permanent, acharné, quotidien, auquel le parlement doit être associé. Nous devons nous y tenir.
M. Thierry Mariani. Merci aux rapporteurs pour cette étude intéressante. Je voudrais faire deux remarques. Monsieur Gaymard a dit que, dans le cadre d’une intervention de la France au sein d’une coalition, notre engagement devrait être proportionnel à l’impact que nous pourrions avoir sur la conduite des opérations. J’aimerais savoir quelle est votre appréciation du bilan de notre intervention en Afghanistan, à l’aune de ce critère ? Quand on envoie 4000 hommes en comparaison avec un pays qui en envoie vingt fois plus, quel est notre impact ? Pouvons-nous espérer peser lorsque nous sommes aussi minoritaires dans une intervention lourde ? Je voudrais rappeler que 89 soldats français sont morts en Afghanistan. Ma deuxième remarque concerne l’intervention en Libye. Le paradoxe c’est qu’elle a été décidée quasiment à l’unanimité et qu’aujourd’hui elle est critiquée à l’unanimité, à gauche comme à droite. En vérité, nous nous sommes retrouvés pris dans un enchaînement médiatique et philosophique où il n’y a pas eu d’autre solution pour la classe politique française que d’intervenir dans la précipitation. Il est clair que, pour nos concitoyens, nos interventions ne doivent pas entraîner une déstabilisation qui aurait un impact sur notre pays et sur l’Europe. Pour cette raison, je pense que l’intervention en Libye marquera un tournant dans nos engagements extérieurs. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Enfin, je trouve que nous pourrions ajouter un sixième critère qui serait d’assurer le soutien à nos engagements extérieurs par une communication adaptée aux citoyens français.
M. Jean-Paul Bacquet. Je voudrais bien sûr m’associer aux félicitations qui ont été faites. Vous avez fait un rapport extrêmement didactique. C’est un problème complexe, car nous n’avons pas de solutions toutes faites. Quand vous définissez un programme en cinq points, je trouve que c’est un exploit. Je pense que le problème majeur est de savoir comment l’on se sort de ces engagements extérieurs. Je ne crois pas que les pouvoirs politiques et militaires soient inconscients ; ils ont tous conscience qu’à partir d’un moment, les troupes françaises deviennent des troupes d’occupation. Mais les conditions ne sont jamais réunies pour nous permettre de sortir, il y a toujours de bonnes raisons pour rester. C’est le cas en Centrafrique, où nous sommes potentiellement pour dix ans, alors que le ressentiment à l’égard de nos troupes pourrait conduire une rupture à tout moment. Par ailleurs, je suis moins optimiste que vous sur le Mali ; je vois un engagement français, mais je ne vois aucun engagement européen, si ce n’est que pour récupérer les marchés qui s’ouvrent avec la reconstruction du pays. S’agissant de l’opération Sentinelle, vous avez raison, il s’agit d’une mobilisation massive de soldats français dont ce n’est peut-être pas le rôle et qui n’ont peut-être pas la formation adaptée. Et il me semble que nos antécédents d’utilisation de l’armée comme force de police n’ont pas été très concluants. Enfin, je regrette toujours qu’il n’y ait pas de véritable débat parlementaire lorsque nous lançons des interventions extérieures. Au bout de quatre mois, le Parlement est réuni, les présidents de groupe et le Ministre interviennent, mais ce n’est pas un vrai débat ! Je propose qu’une fiche soit remise à chaque député synthétisant vos cinq critères afin que nous puissions débattre sur cette base chaque fois qu’une opération est décidée. La présidente de la commission devrait faire une proposition en ce sens au président de l’Assemblée. Si le Parlement s’engageait ou refusait de s’engager sur ces cinq points, les choses seraient plus faciles à assumer ensuite. Il me semble que si nous avions fait cela pour la Libye, nous nous serions rendu compte que cette opération ne répondait absolument pas aux cinq critères.
M. Jacques Myard. Je vous remercie de nous avoir rappelé que l’histoire est sans fin et que Fukuyama et quelques Américains avaient vendu des billevesées. Les soldats et la politique marchent ensemble. Il faut être prêt, mais effectivement on ne peut pas avoir de véritable doctrine. Sauf qu’aujourd’hui la France est engagée dans de multiples alliances et que par certains côtés elle en est prisonnière. En Afghanistan, nous avons attaqué un État alors que les États-Unis étaient attaqués par un groupe et le recours à l’article 5 était contesté, de nombreux spécialistes et non des moindres ont considéré que c’était limite. On y est allés pour des raisons politiques et on y est resté à la demande des États-Unis alors qu’on aurait dû partir tout de suite.
Il faut garder l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui pose le droit à la légitime défense individuelle ou collective. C’est la base de l’intervention en Irak et au Mali. L’opération à Kolwezi visait à exfiltrer des otages puis à se retirer. Elle a été montée dans des conditions difficiles car il n’y avait pas les moyens d’aujourd’hui mais elle illustre le principe d’exfiltration.
La politique européenne, c’est « En attendant Godot ». Il n’est pas sérieux de penser qu’on peut intervenir à 28. Le danger est qu’avant d’opérer de frappes militaires, on prend des sanctions. C’est redoutable car la décision doit être prise à 28 et il faut ensuite l’accord des 28 pour les lever. On est prisonnier de nos alliances multiples alors qu’on devrait avoir les mains libres.
Je suis d’accord sur l’importance du scénario de sortie, qui l’aspect le plus difficile à mettre en œuvre. Quand nous étions en Libye avec Jean Glavany, nous avons compris ce qu’était ce pays. Kadhafi s’en servait comme d’une ferme et lorsqu’il est parti, tout s’est effondré. Il n’y a pas de solution sans une assistance à la reconstruction d’un État.
L’ordre, ce n’est pas le rôle de l’armée. On n’échappera pas à la reconstitution d’une garde nationale, avec les communes et les territoires, ce qui permettra aussi de redonner un sens civique. L’armée n’est pas faite pour ça.
Tout cela me rappelle la formule d’Alan Greenspan, au sortir d’un exposé : « Si vous avez compris, c’est que je me suis mal exprimé ». Vous identifiez cinq critères, mais il y a toujours des situations nouvelles qui peuvent en ajouter.
M. François Loncle. Je m’associe aux félicitations pour ce travail pertinent et précieux pour l’avenir, qui est clair et pédagogique. Je partage le scepticisme de mes collègues quant à la possibilité de rassembler les Européens sur les opérations extérieures. C’est possible pour des actions spécifiques, par exemple pour la formation des armées au Mali, mais pas pour l’intervention. A défaut d’intervenir, les Européens pourraient contribuer à payer pour ce qui garantit la sécurité du Continent.
Si l’on regarde les cinq critères, vous avez dû voir que l’intervention récente qui les respecte le plus est celle au Mali, y compris s’agissant de la recherche d’une solution politique avec les efforts entrepris par notre pays pour obtenir un accord de paix, ou encore la transformation de l’opération Serval en Barkhane. Celle qui s’en éloigne le plus est l’opération en Libye. Il n’y a pas eu un vote unanime. Et à l’inverse ils sont au moins deux aujourd’hui à ne pas condamner l’intervention : un ancien Président de la République et un philosophe d’opérette.
M. Jean-Claude Guibal. Je m’associe à tous les éloges qui ont été faits sur ce rapport synthétique et éclairant. L’important c’est l’après-guerre, la sortie de l’intervention, la pérennisation de la solution. Au cœur du sujet figure ce qui fait le titre de la mission : engagement et diplomatie. Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. Dans la période actuelle, on a l’impression que les objectifs militaires des interventions sont atteints, mais qu’aussi bien avant l’intervention et après l’intervention, ce qui relève de la diplomatie plus traditionnelle est plus défaillant. Souvent les interventions ont lieu dans des pays où l’on n’a pas identifié des évolutions pourtant prévisibles et où ensuite la diplomatie ne relaie pas l’intervention, au point que les forces présentes sont perçues comme des forces d’occupation.
Vos cinq principes d’intervention sont clairs et il serait intéressant de débattre sur chacun de ces aspects lorsqu’un engagement est envisagé. Cependant, je me demande si le nombre de facteurs susceptibles de jouer n’est pas trop important pour qu’on puisse prévoir les conditions de la crise et les solutions de sortie.
M. Jean-Marc Germain. Je ferai deux remarques. Il serait utile de compléter la réflexion sur la place du militaire dans l’échelle des sanctions. Ensuite, aucune des interventions envisagées ne serait décidée si on appliquait les cinq critères cumulativement. Cependant, il faut que cela serve de guide, de préparation pour des interventions réussies. Il ne fait jamais que la solution pérenne de sortie politique de la crise ne soit négligée. Les deux aspects – intervention et sortie de crise – doivent être pensés en parallèle. L’Irak l’a montré.
S’agissant des interventions humanitaires, comment procède-t-on lorsqu’on n’a pas de vision sur la sortie, que les moyens militaires ne sont pas adaptés et que l’on est face au risque d’un génocide ? Cela a été le cas en Libye où l’on avait des craintes pour la population de Benghazi et ce qui a alors motivé la France, ce n’était pas ses intérêts stratégiques. Il est souhaitable que la France n’intervienne pas seulement sur des aspects stratégiques mais aussi pour les Droits de l'Homme, le soutien aux populations, même quand ses intérêts ne sont pas en jeu. Cela distingue notre pays, qui a une fonction à assurer avec des responsabilités géographiques particulières. Tout cela est à débattre et à décider. Comme le disait Jean-Paul Bacquet, il faut structurer les débats, mais aussi les élargir au rôle fondamental historique de la France.
M. Guy Tessier. Ce rapport est très pertinent et montre toute la difficulté d’une doctrine. L’opération sur Kolwezi était une opération d’exfiltration de ressortissants dans un contexte extrêmement complexe avec des moyens limités. En Afghanistan, nous sommes intervenus en réaction au 11 septembre. L’action de nos troupes a été remarquable. Fallait-il laisser le territoire aux talibans ? Nous avons fait ce que nous devions faire et nous l’avons bien fait, sur le plan strictement militaire ou plus largement. Si la paix est encore fragile, je constate malgré tout que l’Afghanistan a eu des élections présidentielles et législatives, mais il manque encore un développement économique et social, des investissements, malgré un sous-sol riche, gage de prospérité. Je peux donc comprendre les doutes exprimés au sujet de cet engagement.
En Libye, nous sommes intervenus pour contrer une menace à caractère humanitaire. On avait décidé que cela se ferait par une voie aérienne mais on sait que sans forces terrestres, on court à l’échec. L’infanterie reste la reine des batailles et il fallait stabiliser la situation pour éviter les tueries entre factions. On aurait pu réussir avec un gouvernement en place, nous étions tous d’accord. Nous le restons aujourd'hui.
Quant à l’avenir de la défense, il n’est jamais bon que les troupes soient dans la rue. La décision de lancer l’opération Sentinelle était compréhensible après les attentats contre Charlie Hebdo et le magasin casher. Mais on ne peut pas pérenniser cette mission qui n’est pas celle de nos soldats. Je sais bien qu’il est plus commode de se servir de militaires qui ne se plaignent pas, contrairement aux CRS qui se font porter malades, mais ce n’est pas leur cœur de métier. Au demeurant, ce temps de garde puise sur les forces vives.
Enfin, concernant la question du Conseil de sécurité dont nous sommes membre permanent, nous avons des droits et des obligations. Cela nous impose de pérenniser notre force stratégique. Mais nous pouvons nous permettre de faire une pause dans la modernisation des composantes, car avec le dispositif actuel, nous pouvons frapper en tout point du globe. Le débat sur le maintien des deux composantes aérienne et sous-marine devra être posé. Je rappelle que notre force stratégique représente 18 à 20 % de notre budget de défense. Il faut pérenniser cet effort, mais aussi le réajuster.
M. Noël Mamère. Je voudrais féliciter nos collègues pour la qualité de leur rapport.
Les écologistes réclament depuis longtemps que l’on consulte le Parlement lorsque l’on projette des forces militaires sur un théâtre extérieur, comme c’est le cas dans d’autres démocraties européennes. Il est accablant que nous ne soyons consultés que quatre mois plus tard et que nous soyons conduits, d’une certaine manière, à cautionner des opérations dont on sait toujours comment elles commencent, mais jamais comment elles finissent.
Je rejoins aussi Jean Glavany sur l’idée qu’il s’agit avant tout d’une question politique. Les interventions militaires découlent de la politique extérieure menée par notre pays, en particulier en matière de développement et de soutien à un certain nombre de régimes. Faut-il rappeler que notre intervention au Mali a fait de nous les obligés de régimes ne brillant pas par leurs vertus démocratiques ? Je pense en particulier à ceux des généraux algériens et de M. Idriss Deby, lui-même aidé par le gouvernement de M. Fillon, alors qu’il ne s’agit pas d’un grand démocrate et que ses troupes sont connues pour leur brutalité et leur sauvagerie difficilement égalables en Afrique. La France s’est livrée à d’autres interventions dont nous aurions peut-être pu nous passer si nous n’avions pas laissé pourrir un certain nombre de situations, comme au Mali.
Dans ce pays, où nous sommes désormais présents, où en est-on ? Le Nord est-il intégré à l’État malien ? La question de l’irrédentisme touareg a-t-elle été résolue ? La réponse est non. Même avec le nouveau président, la situation n’est pas des meilleures. En Afghanistan, il n’y aura pas de solution tant qu’on ne réunira pas tous les pays concernés autour de la table, en particulier l’Inde et le Pakistan, dans le cadre d’une conférence régionale. La question du Cachemire est essentielle, et l’Afghanistan sert une base arrière pour les belligérants.
À propos des forces stratégiques, évoquées par notre collègue Teissier, la position des écologistes est constante depuis des décennies. Nous ne sommes pas contre le principe d’une armée ou contre des interventions à l’étranger lorsqu’elles sont nécessaires, mais il faut qu’elles soient intégrées dans un cadre européen. Je m’étonne de n’avoir guère entendu parler de la possibilité d’une armée européenne, à terme, depuis le début de cette réunion. Nous défendons pour notre part l’idée d’une Europe fédérale qui serait capable de se doter d’une politique étrangère et de défense commune. Dois-je rappeler qu’il a fallu faire appel à des troupes de l’OTAN et à un commandement américain lors des crises en ex-Yougoslavie, en particulier au Kosovo ? Ce n’est pas l’Europe qui est intervenue !
Notre pays, malgré ses nombreuses qualités, n’est qu’une puissance moyenne. La France est l’un des seuls pays d’Europe à pouvoir intervenir militairement à l’étranger, du fait des équipements dont elle dispose, et elle se trouve dans une position assez solitaire dans un certain nombre de pays d’Afrique.
Comme François Loncle l’a rappelé, nous n’avons pas tous approuvé l’intervention en Libye. Qu’avons-nous fait au plan politique après cette intervention franco-britannique ? La réponse tient en un mot : rien. Ce pays est devenu un « open-bar » où les terroristes peuvent se servir en toute tranquillité. Le matériel militaire libyen est à la disposition de tous ceux qui veulent bien en acheter. Avons-nous contribué à trouver des solutions pour que les tribus puissent s’entendre ce pays, qui n’en est pas un en réalité, puisqu’il a été créé par le colon, ou bien avons-nous laissé ces tribus s’entretuer ? Nous avons choisi la deuxième solution et il en résulte des métastases, si j’ose dire, dans l’ensemble de l’Afrique.
Le rapport présenté par nos collègues est tout à fait intéressant, mais il ne remet pas en cause un principe que ma famille politique rejette. Tant qu’il n’y aura pas de contrôle du Parlement sur la politique étrangère de la France et qu’elle restera le domaine réservé de l’exécutif, tout cela ne pourra pas fonctionner.
M. Lionnel Luca. Je tiens à remercier nos collègues pour la qualité de ce rapport qui a le mérite de fournir une analyse complète et circonstanciée des engagements militaires extérieurs de la France. Je citerai ici les mots de Clémenceau, qui, en 1918, saluait « la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. » Notre pays n’est toujours pas sorti aujourd’hui de ce rôle de héros de la démocratie qu’il s’est lui-même attribué, n’hésitant pas à intervenir en réponse à la barbarie et aux crises de civilisation. Mais pouvons-nous êtres si sûrs de nous-mêmes, si arrogants ? C’est une prétention dont nous n’avons plus les moyens.
L’histoire de l’Irak nous le montre, nous sommes encore pris dans un héritage colonial qui remonte à la volonté de la gauche radicale, au XIXème siècle, de porter hors de nos frontières la civilisation. Cette même gauche chausse aujourd’hui les mêmes bottes.
Or, sommes-nous acclamés pour notre action ? Non, nous sommes perçus comme des armées d’occupation, la regrettable bavure récente devrait de plus nous accabler moralement. Pourquoi la France seule devrait-elle être le gendarme de démocraties épuisées ? Pourquoi la Grande-Bretagne, elle aussi puissance coloniale, n’intervient-elle pas comme la France en Afrique ? Notre pays y perd sa force morale. J’estime par conséquent qu’il nous faut procéder à un aggiornamento de notre politique. La barbarie n’est qu’un faux prétexte à l’intervention militaire, qui devrait être assumée par des organismes internationaux dont c’est la véritable fonction, comme les Nations unies ou l’Union des Etats africains.
M. Philippe Baumel. Les cinq critères que vous proposez pour examiner la pertinence d’une intervention extérieure constituent une grille d’analyse utile, permettant d’en juger avec davantage de distance. Cependant je doute qu’aucune des interventions ne parvienne à les remplir tous. Pour ma part, votre rapport m’inspire deux réflexions : la première porte sur les modalités de prise de décision – on ne peut se satisfaire en effet que le Président de la République soit seul décisionnaire, nous serions bien avisés de prendre exemple sur d’autres pays qui associent plus étroitement leur Parlement, quitte à aménager des dispositions particulières en cas de nécessité d’une réponse rapide. Ma deuxième interrogation porte sur le post-conflit : comment faire en sorte que nous ne soyons pas perçus comme une armée d’occupation ? Ne faudrait-il pas mettre en place des mandats internationaux adaptés à chaque situation pour gérer la sortie de crise, en nous appuyant des organisations internationales et sur les pays concernés ? Cette réflexion me paraît clé, si nous ne voulons pas que notre influence diplomatique soit usée en vain.
M. François Loncle. Je ne peux pas laisser dire que notre intervention au Mali relevait d’une forme d’arrogance française. L’élection présidentielle qui a suivi nous a montré qu’il ne s’agissait pas de maintenir le pouvoir en place mais de sauver ce pays de la menace djihadiste. S’agissant de la Libye, le péché originel a été la transgression de la résolution 1973, qui avait d’ailleurs suscité une vive réaction de la Chine et de la Russie.
M. Hervé Gaymard, rapporteur. Merci pour vos commentaires et contributions sur un rapport qui n’est qu’une étape et qui ne prétend pas avoir la vérité révélée. Il est clair que la dimension politique est absolument centrale dans la résolution des crises. Cela nous ramène au discours prononcé en 1967 par le Général de Gaulle à Phnom Penh, où il dit que le conflit n’aura pas de solution militaire. Un conflit n’a jamais de solution strictement militaire, l’action militaire doit être subordonnée à la politique décidée par le pouvoir civil.
Nous sommes allés voir les Britanniques, nous nous sommes penchés sur le cas allemand, nous nous rendons compte que les mécanismes institutionnels régissant l’engagement des forces armées à l’étranger sont très variés en Europe. En Allemagne et en Espagne, le Gouvernement a les mains complètement liées par le Parlement. D’ailleurs, tous les militaires français qui se sont battus en Afghanistan nous racontent que les militaires allemands ne pouvaient strictement rien faire, invoquant en permanence le caveat. C’est la position maximaliste. En France, avant la révision constitutionnelle de 2008, nous étions dans un flou artistique. Depuis, il nous semble que nous sommes parvenus à un bon point d’équilibre. La décision d’engager les armées revient au Président de la République, en sa qualité de chef des armées. Quand nous sommes intervenus au Mali en janvier 2013, il fallait réagir vite. Il n’était pas concevable de prendre le temps de mener des consultations – y compris avec les éminents parlementaires que nous sommes – alors que les colonnes de djihadistes déboulaient vers Bamako. Le cas britannique est très intéressant. Comme vous le savez, le Royaume-Uni n’a pas de Constitution écrite. Tous nos interlocuteurs n’ont ont expliqué que, dans ce contexte, la « frappe préemptive » de la Chambre des communes pour refuser ab initio toute intervention en Syrie équivalait à une révision constitutionnelle de fait. Désormais, il ne serait plus possible au Gouvernement britannique de décider d’une intervention extérieure sans l’accord préalable de la majorité du Parlement.
Nous manquons de recul historique, mais il y a lieu de penser que les engagements en Afghanistan et en Libye ont été un tournant dans beaucoup de démocraties sur la question des opérations extérieures. Les Britanniques ont perdu plus de 500 hommes en Afghanistan ; ce n’est pas très loin de ce que la France a perdu en cinquante ans d’opérations extérieures. Cela a provoqué un fort traumatisme en Grande-Bretagne, illustré par les grandes cérémonies organisées au retour des cercueils des soldats morts en Afghanistan. Je pense que ce serait une bonne chose que le Parlement soit davantage consulté avant les quatre mois réglementaires. On pourrait imaginer remettre en place un système de comités secrets, comme lors de la Première Guerre mondiale – pour un conflit d’une toute autre ampleur – qui permettrait à certains parlementaires d’entendre le Gouvernement sur les différents aspects des opérations extérieures que nous avons évoqués. Nous pourrions utilement construire ce modus vivendi.
Les sanctions sont la marche qui précède l’intervention militaire, cela n’entrait pas vraiment dans le cadre de notre étude, mais c’est en effet un sujet important. Elles suscitent généralement un très grand scepticisme. En réalité, il faut être nuancé, car l’histoire nous a montré que les sanctions adoptées contre l’Afrique du Sud et la Rhodésie, devenue ensuite Zimbabwe, ont été efficaces. Et les sanctions économiques et financières contre la Russie porteraient plus qu’on ne le dit, même si c’est un sujet controversé. Cette question pourrait faire l’objet d’une étude à part, c’est un sujet à creuser.
Je partage le scepticisme de beaucoup de nos collègues s’agissant de l’Europe, et je ne partage donc pas l’irénisme de Noël Mamère au sujet d’une défense européenne intégrée. Mars est d’abord de la responsabilité d’un pouvoir politique légitime, basé sur l’indépendance nationale. Si l’Union européenne ne peut pas être utilisée en tant que telle dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, nous pouvons faire de bonnes choses avec certaines nations européennes, en raison de leurs appétences et des compétences qui sont les leurs. Beaucoup de nos interlocuteurs militaires nous disent que certains pays auxquels on ne pense pas remplissent très bien les contrats lorsqu’ils s’engagent, à l’image du Danemark et de la Suède. Pour ces deux pays, il ne faut surtout pas parler de politique européenne. Il faut mener en amont en travail de coopération entre les états-majors, ainsi qu’un travail politique visant à faire partager nos préoccupations et nos analyses des situations. Si nous acceptons de nous départir des grands principes et d’« avancer en crabe », nous pouvons faire un certain nombre de choses avec les Européens.
M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur. La question de l’approche globale des crises nous préoccupe. Nous devons tirer tout le potentiel de l’Union européenne dans ce domaine. Les battle group pourraient nous être très utiles, en particulier dans un contexte civilo-militaire. Nous devons travailler sur l’amont des crises, ce qui permettra de faciliter les sorties de crise, en jouant sur tous les outils : diplomatie, connaissance des situations, économie, etc. Ce travail est en préparation à l’échelle européenne. C’est ce que nous essayons de faire avec la politique de voisinage de l’Union européenne, que nous nous efforçons de transformer en véritable politique extérieure européenne, mais il y a encore du chemin à parcourir. À cette fin, les forums de discussion se sont multipliés : Barcelone pour le flanc sud, Riga pour le flanc est, dialogue sur la Méditerranée 5+5+5 – pour aller vers les voisins de nos voisins, les pays du Sahel – Union pour la Méditerranée (UpM) à laquelle l’Algérie a participé pour la première fois récemment, Initiative de coopération d’Istanbul (ICI)… Par ailleurs, la révision de la Stratégie européenne de sécurité, élaborée en 2003, est en cours et pourrait aboutir à la fin de l’année. C’est très important, car cela donne aux pays de l’Union européenne l’occasion d’échanger sur leurs perceptions des menaces sans en privilégier l’une plutôt que l’autre.
S’agissant du rôle du Parlement en matière d’engagements militaires, nous pouvons continuer à y réfléchir, mais, comme Hervé Gaymard, je ne vois pas comment nous aurions pu réunir les parlementaires alors que les terroristes descendaient sur Mopti, en janvier 2013.
Si nous voulons que l’Europe soit utile, il faut améliorer la relation entre l’Union européenne et l’OTAN. Je vois d’un œil très favorable l’interaction nouvelle entre la Haute Représentante et le Secrétaire général de l’OTAN, qui se consultent à présent tous les mois.
Pour ce qui est de l’approche globale en France, je pense que nous avons fait un grand progrès avec la création du Centre de crises au sein du ministère des Affaires étrangères. Il intègre toutes les composantes de tous les ministères susceptibles d’avoir un avis compétent lors d’une crise.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES FRANÇAISES DEPUIS LA GUERRE D’ALGÉRIE
Cette annexe se fonde sur les sources suivantes :
– Le rapport du groupe de travail « Monument aux morts en opérations extérieures » sous la présidence du Général d’armée (2S) Bernard Thorette, daté de septembre 2011 ;
– Le Répertoire typologique des opérations, tomes 1 et 2, CDEF/DREX, Armée de Terre ;
– Une liste détaillée des contributions de l’armée de l’air aux opérations extérieures depuis 2004 fournie par l’état-major de l’armée de l’air ;
– Diverses listes, dont celle des opérations extérieures de la Marine du SHD/DREE ;
– Des compléments apportés à notre demande par le Service historique de la Défense.
C’est un travail empirique et surement pas exhaustif, qui ne peut être considéré comme une ressource définitive sur les opérations extérieures des armées françaises, notamment faute de définition précise et définitive des « OPEX ».
PREMIERE PARTIE : AFRIQUE
• Gabon (février 1964)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Intervention au Gabon afin de rétablir dans ses fonctions le président Léon M'BA, arrêté puis destitué hier à la suite d'un coup d'Etat perpétré à Libreville par des officiers de l'armée gabonaise.
• Opération Limousin – Tchad (14 avril 1969 – 27 octobre 1972)
Cadre : Accord de défense
Contexte : A la demande de l’Etat tchadien, appui aux forces armées tchadiennes confrontées à la montée en puissance des rebelles du Frolinat soutenus depuis l’étranger et dont les forces se structurent.
Importance du dispositif : Pic à 2.500 hommes
Suites : L’armée française réussit à éloigner les insurgés qui se regroupent aux frontières, notamment de la Libye. Difficultés persistantes de l’administration et de l’armée tchadienne à reprendre le dessus.
• Opération Saphir 2 – Djibouti (mai-juin 1977)
Cadre : national
Contexte : Après un référendum le 8 mai 1977, le Djibouti accède à l'indépendance le 27 juin 1977 et le président Hassan Gouled Aptidon prend le pouvoir mais doit faire face aux meances qui pèsent sur le nouvel État : tensions entre ethnies Afar et Issa et irrédentisme éthiopien ou somalien. L'opération Saphir 2, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence maritime française dans l'océan Indien, à pour double objectif d’assurer la sécurité de Djibouti durant cette phase de transition tout en étant en mesure de procéder à une évacuation de ressortissants en cas de troubles lors de l'indépendance.
Importance du dispositif : un groupe aéronaval (1 porte-avions, relevé sur place, 1 frégate, 1 escorteur d'escadre, 1 pétroliers)
Suites : Le référendum du 8 mai 1977 et les fêtes qui font suite à la proclamation de l’indépendance, le 27 juin, se sont en effet déroulés sans incidents. La situation navale dans le golfe d’Aden est également restée calme, compte tenu du fort accroissement du potentiel français. Les forces somaliennes et éthiopiennes n’ont effectué aucun mouvement, le rapport des forces étant nettement en leur défaveur.
• Opération Lamantin – Mauritanie (25 octobre 1977 – 27 mai 1980)
Cadre : opération nationale
Contexte : Le Front Polisario a été écarté des accords de Madrid qui ont fixé en novembre 1975 le partage du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie. Il déclenche des troubles contre les forces marocaines et mauritaniennes. Quoiqu’elle ne soit plus liée à la Mauritanie par un accord de défense dénoncé en 1972, la France répond favorablement à l’appel du Gouvernement mauritanien, face au risque d’instabilité et de menaces contre ses ressortissants.
Importance du dispositif : 8 avions de chasse Jaguar, des ravitailleurs C.135, des avions de transport C.160
Suites : Les forces mauritaniennes demeurent trop faibles pour endiguer la rébellion. La Mauritanie se retire du Sahara occidental en 1979, et reconnaît en 1984 la République démocratique arabe sahraouie.
• Opération Verveine – Zaïre (7-18 avril 1977)
Cadre : opération multilatérale
Contexte : Le 8 mars 1977, à l'occasion d'une nouvelle poussée de la rébellion communiste au Katangua, renommé Shaba, le Maroc apporte son soutien militaire au Zaïre pour faire face à ces troubles menés avec le soutien de l'Angola dans le sud du pays. Ne pouvant projeter ses forces terrestres, le Maroc sollicite la France pour assurer la mise en place de son contingent. Il est à noter que cette aide marocaine trouve sa contrepartie avec le soutien militaire et diplomatique de la France dans le conflit contre le Polisario.
Importance du dispositif : 13 avions de transport C 160
Suites : Le 23 mai 1977, la dernière ville est reprise des mains des rebelles par les troupes marocaines, au terme d’une guerre de 80 jours.
• Opération Tacaud – Tchad (18 février 1978 – mai 1980)
Cadre : accord d’assistance
Contexte : Face à la progression des groupes rebelles du Frolinat appuyés par la Libye, en provenance du nord du pays, la France renforce l’armée tchadienne par des missions de conseil et de formation. La mission est ensuite élargie à la défense de N’Djamena et du Tchad « utile », à l’est et au sud du lac Tchad, effectuée par une vigoureuse offensive aéroterrestre.
Importance du dispositif : Pic à 2.200 hommes, 10 avions de chasse Jaguar, 2 ravitailleurs C.135, 4 avions de transport C.160
Suites : Les rebelles sont refoulés vers le nord du pays et les civils européens évacués. Des négociations sont ouvertes avec les tendances rebelles. L’opération Anabase est conduite du 27avril au 17 mai 1980 pour évacuer les forces françaises et les ressortissants.
• Opération Bonite – Zaïre (18 mai – 15 juin 1978)
Cadre : accord de défense
Contexte : Depuis 1975, l'URSS profite de la décolonisation portugaise pour renforcer ses positions en Afrique. Le Katanga ou Shaba, qui a essayé de faire sécession en 1964, constitue un point de vulnérabilité qu'elle tente d'exploiter. Ainsi, depuis la Zambie voisine, des troupes katangaises s'emparent le 13 mai 1978 de la ville minière de Kolwezi et menacent plus de 2.300 Européens (1 360 Belges et 400 Français). Face à la tuerie de plusieurs milliers de personnes, dont 130 occidentaux, la France intervient à la demande du Gouvernement zaïrois par une vaste opération aéroportée.
Importance du dispositif : 710 soldats de l’armée de terre et 3 avions de transport C.160
Suites : Les Katangais abandonnent le terrain avec des pertes significatives ; plusieurs centaines d’Européens sont libérés et évacués.
• Opération Barracuda – Centrafrique (septembre 1979 – septembre 1981)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Dans un contexte de dégradation de la situation économique, sociale et sécuritaire dans le pays, cette opération vise à faire tomber l’empereur Bokassa, protéger les ressortissants français et stopper une éventuelle arrivée des Libyens en Centrafrique.
Importance du dispositif : 560 hommes en moyenne
Suites : Dacko est installé au pouvoir sans effusion de sang, et les troupes françaises fournissent une aide à la reconstruction et à la formation de l’armée centrafricaine. Cette opération se transforme en présence permanente (EFAO : éléments français d’assistance opérationnelle).
• Opération Murène – Gabon (11 novembre 1980 – juillet 1981)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Cette opération est destinée à conforter les pays africains après le retrait de Tacaud et à démontrer la capacité de la France à mener des interventions à longue distance depuis la métropole.
• Opération Manta – Tchad (9 août 1983 – novembre 1984)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Après le retrait des forces françaises, l'opposition entre les chefs du nord tchadien entretient les conflits dans le pays. En 1982, le rejet par le Président Hissène Habré de tout droit libyen sur la bande d'Aouzou provoque un retournement d'alliance. Sous l'instigation et avec le soutien de la Libye, Goukouni Oueddei, chef de l'armée de libération nationale (ALN) et du gouvernement d'unité nationale (GUNT, implanté dans le nord du Tchad) lance le 24 juin 1983 une attaque contre Faya Largeau. Le gouvernement tchadien d'Hissène Habré contre-attaque et reprend Faya le 31 juillet 1983. La Libye intervenant par des attaques aériennes, le Tchad demande l'aide de la France, qui intervient pour évacuer les ressortissants français, apporter une assistance technique à l’armée tchadienne, et, dans un deuxième temps, stopper les forces rebelles de Goukouni.
Importance du dispositif : Pic à 3.500 hommes
Suites : Les coalisés n’entreprennent plus d’opérations d’envergure au-delà du 16ème parallèle. En septembre 1984, accord franco-libyen prévoit une évacuation simultanée des troupes françaises et libyennes du Tchad.(Opération Silure 1er oct-1er décembre 1984 qui assure le retrait des forces françaises). Il sera violé par la Libye.
• Opération Epervier – Tchad (13 février 1986 – juillet 2014)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Nouvelles offensives des troupes libyennes et des rebelles coalisés au sud du 16ème parallèle. La France intervient pour fournir aux forces armées nationales tchadiennes (FANT) le soutien et les appuis nécessaires pour s’opposer aux agressions au sud du 16ème parallèle. Il s’agit initialement d’une opération aérienne ; les forces terrestres sont présentes pour assurer la protection des sites et participer à la défense aérienne.
Importance du dispositif : 1.500 hommes en 1987 ; 950 hommes en 2014. Le dispositif a évolué au fil du temps selon la menace et les sollicitations pour d’autres opérations dans la zone.
Suites : Cette opération se transforme en présence permanente (éléments français au Tchad, EFT) destinée à protéger les intérêts français (ressortissants), et apporter un soutien logistique aux forces armées et de sécurité tchadiennes. Les EFT permettent aussi de renforcer ponctuellement des contingents tchadiens ou internationaux et servent de réservoir pour les projections de forces en OPEX dans la région.
• Opération Nouadibou – Sénégal (29 avril – 16 mai 1989)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Des tensions interethniques croissantes entre Maures blancs, Négro-africains mauritaniens et Sénégalais dégénèrent en véritables pogroms en Mauritanie et au Sénégal. Mise en place d’un pont aérien par l’Algérie, la France, l’Espagne et le Maroc pour évacuer des minorités ethniques menacées.
• Opération Oside – Comores (7-16 décembre 1989)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Assassinat du Président des Comores. Bob Denard et ses mercenaires, accusés d’en être l’auteur, contrôlent la garde présidentielle. Cela représente une menace à la sécurité de l’archipel et des 1.200 Français qui y résident. Les autorités comoriennes demandent l’aide de la France, qui intervient pour prendre le contrôle de la garde présidentielle et assurer la sécurité des Français, et, dans un deuxième temps, fournir une assistance militaire technique aux forces armées comoriennes.
Importance du dispositif : près de 1.400 hommes
Suites : Bob Denard et ses mercenaires abandonnent la partie sans combattre lorsque les militaires français passent à l’exécution.
• Opération Corymbe – Golfe de Guinée (1990) : en cours
Cadre : national
Contexte : L’opération Corymbe consiste à maintenir des moyens navals dans le Golfe de Guinée comme forces capables de réagir rapidement à crise face à un littoral où les intérêts français sont nombreux. Maintenue sans interruptions depuis 1990, le dispositif Corymbe a participé à plusieurs évacuations de ressortissants et participe couramment à des actions coopération avec les quatre pays limitrophes avec lesquels la France est liée par un accord de Défense (Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Togo).
Importance du dispositif : un bâtiment amphibie ou un aviso/une frégate
• Opération Requin – Gabon (23 mai – 2 juin 1990)
Cadre : accords de défense ou d’assistance
Contexte : Troubles dans le pays générés par des problèmes de politique intérieure, exacerbés par l’assassinat d’un leader de l’opposition. Le Consul de France à Port-Gentil est séquestré, la communauté française menacée. La France intervient pour stabiliser la situation et assurer la sécurité et l’évacuation des ressortissants français.
Importance du dispositif : près de 1.330 hommes
Suites : Environ 2.000 ressortissants sont mis en sécurité ou évacués sans effusion de sang et dans des délais rapides.
• Opération Noroît – Rwanda (4 octobre 1990 – décembre 1993)
Cadre : opération effectuée dans le cadre d’un accord d’assistance militaire technique signé en 1975, en coopération avec les forces armées belges.
Contexte : Troubles intérieurs d’origine ethnique, attisés par une intervention, le 1er octobre 1990, des rebelles du Front patriotique rwandais (FPR), soutenus par l’Ouganda. Initialement pensée comme une opération ponctuelle destinée à protéger, voire évacuer les expatriés français et étrangers, cette opération se transforme en mission de présence en appui aux forces armées rwandaises.
Importance du dispositif : pic à 350 hommes
Suites : Evacuation de plusieurs centaines de ressortissants au mois d’octobre 1990, puis protection des installations et des personnels diplomatiques dans la durée à Kigali. Le FPR s’abstient d’actions de force dans et à proximité de Kigali. Fin 1993, la signature des accords d’Arusha entre le Gouvernement rwandais et le FPR et le déploiement prévu d’une force des Nations Unies (MINUAR) conduisent la France à mettre fin à l’opération.
• Opération Verdier – Bénin (1991-1992)
Cadre : accord de défense
Contexte : Dans le contexte d’une tentative de putsch contre le premier ministre togolais de transition Joseph Kokou Koffigoh, la France envoie des soldats pour protéger l’aéroport de Cotonou.
Importance du dispositif : 450 militaires
• Opération Totem – Ethiopie (24 mai – 5 juin 1991)
Cadre : opération nationale
Contexte : Après l’effondrement du régime de Mengistu, l’armée éthiopienne cède le pas face aux mouvements de rébellion érythréenne et tigréenne qui menacent la capitale. Un pont aérien destiné à évacuer les ressortissants français et européens d'Addis Abeba et de Dire Dawa est mis en place.
• Opération Godoria – Djibouti (28 mai – 12 juin 1991)
Cadre : accord de défense
Contexte : La guerre civile qui fait rage depuis 25 ans en Ethiopie redouble de violence après le départ du Président Mengitsu, les principaux mouvements de libération menaçant la capitale tenue par les forces loyalistes. Près de 30.000 réfugiés, dont de nombreuses bandes armées, affluent aux frontières de Djibouti, menaçant la sécurité du pays. La violation de la frontière de Djibouti par une armée étrangère entraîne l’activation de l’accord de défense conclu avec la France. Les Forces françaises de Djibouti (FFDJ) déclenchent l’opération Godoria qui vise à stopper l’avance de l’armée éthiopienne sur le territoire djiboutien, désarmer les éléments armés dans l’attente de leur retour en Ethiopie organisé par les forces armées djiboutiennes, et procurer une aide humanitaire.
Importance du dispositif : 2.200 militaires en renfort des éléments prépositionnés
• MINURSO – Mauritanie (octobre 1991) : en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : À la suite d'un accord conclu en 1991 entre le Gouvernement du Maroc et le Front Polisario, la MINURSO a été déployée afin de surveiller le cessez-le-feu et d'organiser un référendum qui permettrait aux habitants du Sahara occidental habilités à voter de décider du statut futur du territoire.
Importance du dispositif : contribution française de 13 personnels non militaires au 9 février 2015, pour un effectif total de 231 personnes.
• Opérations Iskoutir et Ardoukoba – Djibouti (15 février 1992 – 18 février 2001)
Cadre : accords de défense
Contexte : Fin 1991, le Front pour la restauration de l’unité et la démocratie (FRUD), ayant récupéré des armes des militaires éthiopiens en déroute, lance une vaste offensive contre le Gouvernement djiboutien, conquérant de vastes pans du territoire. La France conduit une médiation et installe une force d’interposition entre les parties à compter de février 1992 (opération Iskoutir). Une partie du FRUD signe un accord avec le Gouvernement en 1994 et devient un parti politique autorisé. Mais une autre branche, le FRUD armé, continue à mener des actions de résistance armée qui entretiennent un climat d’insécurité dans le pays. En juin 1999, l’opération Iskoutir et relayée par l’opération Ardoukoba, mission d’observation du cessez-le-feu et d’assistance aux populations civiles. Un accord de paix est finalement signé entre le Gouvernement et le FRUD armé le 12 avril 2001.
• Opération Oryx – Somalie (15 novembre 1992 – 15 mars 1994)
Cadre : opération multinationale sous mandat ONU puis commandement ONU
Contexte : Détérioration de la situation humanitaire en Somalie dans le contexte d’une guerre de clans pour occuper le pouvoir à la mort de Siyad Barré, qui s’accompagne du pillage de l’aide humanitaire. La médiatisation outrée de ce conflit suscite une implication active de la communauté internationale. L’opération Oryx est la contribution française à l’opération multinationale sous commandement américain UNITAF, autorisée par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 3 décembre 1992. Il s’agit d’une opération de police internationale à but humanitaire, qui a pour mandat de garder des dépôts de vivres, d’en assurer la distribution, de chercher et détruire les dépôts d’armes et de munitions, de déminer, d’obtenir du renseignement sur les bandes de pillards et d’apporter une aide à l’administration somalienne. Après une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, l’opération Oryx passe sous commandement ONU (ONUSOM II) à partir d’avril 1993.
Importance du dispositif : 2.400 hommes pendant la première phase (bénéficiant de l’appui naval et aérien des forces maritimes de l’Océan Indien et des forces stationnées à Djibouti), puis 1.100 hommes sous commandement ONU, incluant 400 militaires des Forces françaises de Djibouti et 700 hommes de la Force d’action rapide (FAR), sur un total de 29.500 casques bleus.
Suites : L’ONU rencontre des difficultés pour faire respecter le cessez-le-feu et l’hostilité des clans provoque des affrontements armés, conduisant à l’assassinat de 23 casques bleus pakistanais et de 18 soldats américains. En octobre 1993, les Etats-Unis décident de se retirer. Le contingent français est relevé par une brigade indienne à compter du mois de décembre. A partir de novembre 1993, un détachement français (DAMI) de 100 militaires contribue à l’ONUSOM 100, chargée de fournir une assistance militaire technique permettant le transfert des responsabilités à la police nationale somalienne.
• Opération Bajoyer – Zaïre (1993-1994)
Cadre : opération nationale
Contexte : Le Zaïre s'installe dans un climat d'insécurité grandissante avec une renaissance de violences ethniques au Shaba et au nord du Kivu, qui sera à l’origine du déclenchement des hostilités au Rwanda en 1994. A la suite d'incidents qui coutèrent la vie à l'ambassadeur de France au Zaire, la France lance en janvier 1993 l'opération Bajoyer pour évacuer ses ressortissants.
• Opération Balata – Cameroun (février 1994 - 1998)
Cadre : accords de défense
Contexte : Assistance opérationnelle au Cameroun pour dissuader les prétentions du Nigéria sur les gisements pétroliers de la presqu’île de Bakassi, à la frontière des deux pays.
• Opération Turquoise – Rwanda (20 juin – 22 août 1994)
Cadre : opération multinationale sous mandat ONU
Contexte : En 1990 se créée le Front patriotique rwandais (Tutsi) qui lance une vaste offensive depuis l’Ouganda voisin. Si le front est rapidement stabilisé, les tensions entre Hutus et Tutsis s’intensifient. Lorsque l’avion du Président (Hutu) est abattu en avril 1994, les massacres contre les Tutsis et les Hutus modérés débutent et un exode massif se met en place. La France ferme son ambassade et évacue ses ressortissants (opération Amaryllis). La résolution 929 du Conseil de sécurité de l’ONU autorise la France à mener une action temporaire « à caractère strictement humanitaire », au besoin par la force, pour mettre fin aux exactions et préparer le terrain pour une opération de l’ONU. Les forces françaises sont ainsi déployées avec une consigne de stricte neutralité. Leur action se concentre sur la création d’une zone humanitaire sûre pour permettre l’action humanitaire.
Importance du dispositif : environ 3.000 hommes
Suites : L’opération Turquoise a, sur le moment et par la suite, fait l’objet de controverses nombreuses, certains critiquant les mobiles de l’intervention, d’autres dénonçant la passivité de l’armée française face aux massacres. L’opération a néanmoins eu un incontestable bilan humanitaire en faveur des réfugiés et déplacés, et a permis de faire prendre conscience au monde de l’ampleur de la catastrophe humanitaire en cours.
• Opérations Croix du sud 1 et 2 – Niger (1994)
Cadre : accord de défense
Contexte : Depuis son indépendance du 3 août 1960, le Niger doit faire face à la rebellion de sa population touareg , mal intégré et en proie à des difficultés économiques aggravéee par la sécheresse sahelienne. En février 1993 se déroulent les premières élections démocratiques qui portent au pouvoir Mahamane Ousmane. Des accords de paix sont signés en octobre 1994 puis à nouveau en avril 1995. Avec l'opération Croix du sud 1, la France participe à la cellule de liaison du comité de suivi des accords de paix. Puis, avec l'opération Croix du sud 2, la France participe à l'observation des élections.
Importance du dispositif : 34 puis 30 personnels
• Opération Azalée – Comores (30 septembre – 8 octobre 1995)
Cadre : accord de défense
Contexte : Le Gouvernement élu mais contesté de la République des Comores fait face à un coup d’Etat opéré par des mercenaires. Le Premier ministre comorien se réfugie à l’ambassade de France et demande l’intervention de la France. L’opération vise à réduire les poches de rébellion en assurant la sécurité des ressortissants français.
Importance du dispositif : environ 1.200 personnels
Suites : les rebelles sont neutralisés et les mercenaires capturés.
• Opération Aramis – Cameroun (1996 - 2008)
Cadre : accord de défense
Contexte : Au début de l’année 1996, les troupes nigérianes occupent les deux tiers de la presqu’île de Bakassi, camerounaise en vertu des limitations de frontières déterminées en 1913. Dans le cadre de l’accord de défense liant la France au Cameroun, la France a déclenché en février 1996 l’opération Aramis qui s’est essentiellement traduite par un appui en termes de renseignement et de conseil. Cette opération a permis de geler le conflit, la diplomatie prenant progressivement le pas sur les armes.
Importance du dispositif :
Suites : La presqu’île a été restituée au Cameroun par le Nigeria le 14 août 2008, à la suite d’un arbitrage international, validé par les accords de Greentree du 12 juin 2006. L’opération a pris fin le 31 mai 2008, deux mois avant la restitution de la presqu’île.
• Opérations Almandin 1, 2 et 3 – République centrafricaine (18 avril 1996 – février 1999)
Cadre : accord de défense – protection des intérêts nationaux
Contexte : Au cours des années 1996 à 1998, des crises se développent en Centrafrique, initiées par des mutineries d’une partie des forces armées centrafricaines (FACA), parfois accompagnées de mouvements insurrectionnels à Bangui. Entre ces périodes de crise, des détachements Almandin ont été maintenus dans le pays ; ils ont pu être distincts ou inclure les éléments français d’assistance opérationnelle (EFAO), présence permanente de la France dans le pays. Dans ces situations, la France intervient à la marge de son accord de défense qui ne lui donne compétence que pour réagir à une agression extérieure du pays, et nullement pour participer à des opérations de rétablissement de l’ordre. Ces interventions visent à éviter que la crise ne dégénère et à protéger les ressortissants français. Initialement, cette posture exclut la participation personnelle des militaires aux activités opérationnelles de l’armée centrafricaine (Almandin 1). A partir de la fin 1996 et du début 1997, l’emploi de la force est cependant autorisé pour reprendre le contrôle des quartiers aux mains des mutins ou des insurgés (Almandin 2). A compter de juin 1997, l’opération vise à défendre des intérêts nationaux menacés (mission diplomatique, installations des EFAO) et à appuyer la Mission interafricaine de suivi des accords de Bangui (MISAB), qui ont été signés en janvier 1997 (Almandin 3).
Importance du dispositif : Almandin 1 : environ 1.200 hommes ; Almandin 2 : pic à 2.300 hommes ; Almandin 3 : près de 2.000 hommes.
Suites : En juillet 1997, le Président de la République prend la décision de retirer définitivement les EFAO de Centrafrique. Le désengagement final d’Almandin s’effectue ainsi dans le cadre du retrait des EFAO, effectif en avril 1998 (Opération Cigogne 15 décembre 1998- 28 février 1999). La France maintient toutefois environ 200 hommes jusqu’en février 1999 pour assurer le soutien logistique de la mission des Nations Unies en RCA (MINURCA), déployée dans le pays à partir du mois d’avril 1998. En février 2000, la MINURCA est remplacée par le Bureau des Nations Unies en Centrafrique (BONUCA) qui a pour objet d’appuyer les efforts de réconciliation et d’assurer un suivi de la situation.
• Opération Condor – Erythrée (juin 1996 – mars 2001)
Cadre : Opération nationale sous mandat ONU
Contexte : l'opération Condor, confiée à la France par l’ONU, visait à superviser des opérations de médiation et de surveillance d'un cessez-le-feu entre le Yémen et l'Érythrée dans le conflit qui les oppose à propos des îles Hanish situées en Mer rouge.
• Opération Pélican – Congo-Brazzaville (17 mars – 1er août 1997)
Cadre : Opération multilatérale
Contexte : Au Zaïre voisin, l'avance des rebelles de Laurent Désiré Kabila et les risques de soulèvement dans la capitale zaïroise suscitent des craintes parmi la communauté européenne de Kinshasa. Dès le 17 mars 1997, l’opération Pélican 1 est lancée : des militaires sont projetés à Brazzaville pour préparer l'évacuation des ressortissants menacés de l'autre côté du fleuve qui marque la frontière entre les deux pays. Les deux mois suivants voient le dispositif se renforcer à partir des unités prépositionnées dans la région. Mais au fur et à mesure que la situation s'apaise à Kinshasa, c'est à Brazzaville qu'elle se détériore. La rivalité entre les camps de Lissouba et Sassou N’Guesso, dans le contexte de l’élection présidentielle prévue en juillet, tourne à l’affrontement, au point que l'évacuation des ressortissants français et étrangers commence le 8 juin (Pélican 2). Elle dure sept jours.
Importance du dispositif : de 650 à 1.300 hommes au mois de juin 1997. Présence des troupes américaines, belges, britanniques et portugaises.
Suites : 5.666 ressortissants étrangers, dont 1.524 Français, sont évacués de Brazzaville vers Libreville (Gabon) et Pointe Noire (Congo).
• Opération Iroko – Guinée Bissau (juin 1998-juin 1999)
Cadre : Opération nationale
Contexte : En juin 1998, le limogeage par le général Vieira du chef d’état-major Ansumane Mané, soupçonné de trafic d’armes vers la Casamance, provoque le le soulèvement d'une partie de l'armée. La paix est d’abord rétablie par les accords d'Abudja, le 31 octobre 1998, mais la communication du résultat de l'enquête sur les ventes d'armes provoque un coup d’état du général Ansumane Mané qui renverse le général Vieira le 7 mai 1999. L'opération Iroko est alors montée pour assurer l'évacuation de nos ressortissants, du 5 au 15 juin, puis pour assurer la protection de la représentation diplomatique.
Importance du dispositif : 74 personnels, 1 bâtiment amphibie, 1 aviso, 1 avion de transport et 1 hélicoptère
• MONUSIL/ MINUSIL – Sierra Leone (31 juillet 1998 – 1er septembre 2003)
Cadre : commandement ONU
Contexte : La Mission d’observation des Nations en Sierra Leone (MONUSIL) a été initialement mise en place en juillet 1998 pour surveiller la situation militaire, la sécurité et le respect du droit international humanitaire en Sierra Leone, dans un contexte où le Gouvernement civil faisait face, depuis plusieurs années, aux coups de force répétés d’une junte militaire. Les affrontements se sont poursuivis pendant son mandat. En juillet 1999, les parties au conflit ont signé l’accord de paix de Lomé qui prévoyait la formation d’un Gouvernement d’union nationale. En octobre 1999, la MINUSIL a laissé la place à la MINUSIL, une opération de maintien de la paix nettement plus importante, chargée de coopérer à la mise en œuvre de l’accord de paix avec les parties. Son mandat a été élargi et ses effectifs renforcés au fil du temps.
Importance du dispositif : La France a contribué à l’envoi d’observateurs militaires au sein de la MONUSIL, qui en a compté près de 200 à son pic.
Suites : Cette opération s’est achevée en décembre 2005, mais la France a cessé d’y contribuer à partir du mois de septembre 2003.
• Opération Khor Angar – Djibouti (24 janvier 1999 – juillet 2000)
Cadre : accord de défense
Contexte : Cette mission a pour but de protéger Djibouti d'éventuels débordements de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Elle repose sur la mise en place d'une défense aérienne et maritime renforcée du port et de l'aéroport.
Importance du dispositif : 560 militaires en renfort des Forces françaises de Djibouti (FFDJ), correspondant principalement à l'équipage d'une frégate anti-aérienne et aux personnels de la défense sol-air de l'armée de l'Air.
Suites : En juillet 2000, un cessez le feu est signé entre l'Éthiopie et l'Érythrée, prélude au désengagement de l’opération.
• Opération Khaya – Côte d’Ivoire (décembre 1999)
Cadre : opération nationale
Contexte : Le 24 décembre 1999, suite à une mutinerie qui se transforme en coup d'Etat, le Président Henri Konan Bédié est renversé par l'armée. Du 25 au 31 décembre 1999, la France évacue par voie aérienne des personnalités locales menacées.
• MONUC-MONUSCO – Zaïre/ République démocratique du Congo (30 novembre 1999) : en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : En 1998, un soulèvement contre le gouvernement Kabila a éclaté dans les deux provinces du Kivu où se sont réfugiés près d’1,2 millions de Hutus rwandais lors du génocide de 1994. Quelques semaines plus tard, les rebelles occupent une importante partie du pays. L’Angola, la Namibie, le Tchad et le Zimbabwe proposent un soutien militaire au Président Kabila, mais les rebelles conservent leur emprise sur les provinces orientales. La France évacue ses ressortissants avec l’opération Malachite. Le Rwanda et l’Ouganda soutiennent le mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). En juillet 1999, l’accord de cessez-le-feu de Lusaka est signé entre la République démocratique du Congo (RDC) et cinq États de la région (Angola, Namibie, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe). Par une résolution du 30 novembre 1999, le Conseil de sécurité crée la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), qui devait à l’origine élaborer des plans en vue de l’observation du cessez-le-feu et du désengagement des forces, et maintenir la liaison avec toutes les parties à l´accord de cessez-le-feu. Par une série de résolutions ultérieures, le Conseil a étendu le mandat de la MONUC au contrôle de l’application de l’accord de cessez-le-feu et lui a attribué plusieurs autres tâches connexes.
Importance du dispositif : La mission compte environ 25.000 personnels dont 12 Français au 9 février 2015.
Suites : Cette mission est rebaptisée Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) en juillet 2010, afin de tenir compte de l’entrée du pays dans une nouvelle phase.
• RECAMP Bissau – Guinée Bissau (28 janvier – 17 juin 1999)
Cadre : programme national RECAMP visant à renforcer les capacités militaires africaines pour leur permettre de mener des opérations sur le continent.
Contexte : Mise sur pied et soutien logistique d’un bataillon multinational de la CEDEAO, la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Gambie, Niger et Togo) en Guinée Bissau, afin de maintenir la paix dans les termes des accords de novembre 1998 qui visaient à mettre un terme à la guerre civile qui déchirait le pays.
• MINUEE – Ethiopie (décembre 2000 – juillet 2008)
Cadre : commandement ONU
Contexte : En juin 2000, après deux ans de combats motivés par un différend frontalier, l´Éthiopie et l´Érythrée ont signé l´accord de cessation des hostilités au terme de pourparlers organisés sous les auspices de l´Algérie et de l´Organisation de l´unité africaine. En juillet, le Conseil de sécurité a créé la MINUEE dans le but de maintenir une liaison avec les parties et de surveiller la cessation des hostilités.
Importance du dispositif : Le détachement français assurait la sécurité et le bon fonctionnement de l’état-major (transmissions et moyens de transport). Il a compté jusqu’à 200 militaires en septembre 2001.
Suites : Le Conseil de sécurité a mis fin au mandat de la MINUEE à compter du 31 juillet 2008. Cette décision est due aux restrictions que l’Érythrée a imposées à la mission mais aussi au refus de l’Éthiopie de mettre en œuvre l’avis de la Commission du tracé de la frontière, du 27 novembre 2007.
• Opération Licorne – Côte d’Ivoire (22 septembre 2002 – 2014)
Cadre : accord de défense puis opération nationale sous mandat ONU
Contexte : En septembre 2002, dans un contexte politique tendu, une rébellion partie du nord du pays tente de renverser Laurent Gbagbo, alors président de la République ivoirienne, élu deux ans plus tôt. L’opération Licorne est lancée pour protéger les ressortissants français installés dans le pays. Par la suite, en vertu des résolutions 1464 et suivantes du Conseil de sécurité de l’ONU, la Force Licorne a pour missions de faire respecter le cessez-le-feu entre les deux parties, de soutenir le déploiement d’une mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), puis de celui d’une mission des Nations unies, la MINUCI, remplacée en 2004 par l’ONUCI (participation française = opération Calao). En dépit des accords signés à Marcoussis en janvier 2003, les tensions politiques dans le pays demeurent. En novembre 2004 les forces loyalistes ivoiriennes bombardent des positions rebelles ainsi qu’un camp de la Force Licorne installé à Bouaké, tuant 9 militaires français et en blessant 31 autres. Les effectifs de Licorne sont alors renforcés et conduisent l’évacuation de 6.000 ressortissants français. En 2005, le processus de règlement de la crise se poursuit avec la signature des accords de Pretoria. L’opération amorce son désengagement mais, dans le même temps, les capacités de réaction rapide sont renforcées. Lors de l’élection présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo, battu dans les urnes, refuse de céder le pouvoir à Alassane Ouattara. Une nouvelle crise éclate et les effectifs de la Force Licorne sont à nouveau renforcés. Début avril, suite à des violations répétées du cessez-le-feu par les forces de Laurent Gbagbo, les militaires français prennent le contrôle de l’aéroport d’Abidjan et mènent des frappes en soutien à l’ONUCI. Finalement, l’ancien président ivoirien est arrêté par Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), fidèles à Alassane Ouattara. La situation étant par la suite stabilisée, la Force Licorne s’est concentrée sur l’accompagnement de la réforme et de la montée en puissance de l’armée ivoirienne ainsi que sur des missions civilo-militaires.
Importance du dispositif : de 5.000 militaires en 2004 à 900 militaires à l’été 2009
Suites : En janvier 2015, la stabilisation de la situation sécuritaire permet la transformation de l’opération Licorne en base opérationnelle avancée, prépositionnement destiné à soutenir les opérations menées dans la bande sahélo-saharienne, grâce notamment à l’atout que représente la qualité des infrastructures portuaires et aéroportuaires ivoiriennes, en particulier le port en eaux profondes d’Abidjan. Ses effectifs doivent être stabilisés autour de 900 militaires.
• Opération Boali – RCA (octobre 2002 – décembre 2013)
Cadre : Opération nationale – programme RECAMP
Contexte : Dans le cadre du programme français de coopération RECAMP, qui vise à aider les armées africaines à assurer elles-mêmes la sécurité du continent africain, Boali a assuré principalement le soutien, sur le plan logistique, administratif, technique et si besoin opérationnel, de la force de stabilisation africaine en Centrafrique, la FOMUC, déployée à partir de décembre 2002, puis de la MICOPAX, qui la remplace en 2008. L’opération Boali a également assuré l'instruction opérationnelle des unités des FACA, les forces armées centrafricaines, dans le cadre de la coopération bilatérale de défense entre la France et la République Centrafricaine. Après la prise de pouvoir par la Séléka fin mars 2013, un renforcement du détachement Boali à Bangui a été décidé afin de consolider le dispositif permettant de protéger les ressortissants français en Centrafrique, les points d’intérêts stratégiques français ainsi que de sécuriser l’aéroport de M’Poko.
Importance du dispositif : de 200 à plus de 500 militaires
Suites : L’opération Boali a été absorbée par l’opération Sangaris à compter de décembre 2013.
• Opération Resolute behaviour – Corne de l’Afrique (janvier 2003 – 8 décembre 2004)
Cadre : opération multilatérale sous mandat ONU
Contexte : Déploiement dans l’océan Indien d’une task force de l’EUROMARFOR, qui rassemble les marines italienne, espagnole, portugaise et française, en soutien de l’opération de lutte contre le terrorisme Enduring freedom.
• Opération Mamba – République démocratique du Congo (juin-septembre 2003)
Cadre : Union européenne – opération sous mandat ONU
Contexte : L'opération Artémis, dénommée Mamba pour la partie française, est décidée début juin 2003 pour rétablir la sécurité dans la région de l'Ituri et permettre un redéploiement des effectifs de la MONUC à la frontière. Son déploiement est assuré dans le cadre de l'Union européenne avec la France comme nation cadre. Elle est autorisée par la résolution 1484 du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit la mise en place d'une force intérimaire d'urgence à Bunia avec un mandat de quatre mois pour contribuer à la stabilisation des conditions de sécurité et améliorer la situation humanitaire en coordination avec la MONUC. Sa mission remplie, la région étant stabilisée, la force se retire au profit des forces de la MONUC.
Importance du dispositif : environ 1 000 personnels français sur un total de 1760.
• MINUL – Libéria (1er octobre 2003) : en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), déployée à partir de 2003, vise à mettre fin à l’instabilité chronique au Libéria suite à deux guerres civiles (1989-1996 et 1999-2003). Elle fait suite au déploiement de la force de la CEDEAO, l’ECOMIL, et à la signature de l’accord de paix global d’Accra entre les mouvements rebelles et le Gouvernement, en août 2013. Le mandat de la MINUL consiste principalement à surveiller l’accord de cessez-le-feu, à préparer un programme de désarmement et de démobilisation, à fournir une assistance à l’aide humanitaire et à la réforme du secteur de la sécurité. Elle absorbe l’ECOMIL. Les premières élections ont lieu en octobre 2005 et voient arriver au pouvoir Ellen Johnson Sirleaf. La MINUL a alors pour mission d’assister le nouveau gouvernement dans ses efforts de transition, afin que celui-ci s’approprie la gestion du pays et la sécurité nationale.
Importance du dispositif : jusqu’à 15.000 militaires au cours des premières années. Le 9 février 2015, la France était représentée à l’état-major de la MINUL.
Suites : Si la situation sécuritaire qui prévalait au Libéria à la fin de l’année 2013 conduisait à envisager la fermeture prochaine de cette opération, l’épidémie d’Ebola a profondément déstructuré l’Etat libérien. La prolongation en a été décidée jusqu’en décembre 2015.
• ONUCI – Côte d’Ivoire (4 avril 2004) – en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : cf. opération Licorne
Importance du dispositif : initialement, 173 personnels ont participé à l’opération Calao visant à fournir une force de réaction rapide à l’ONUCI. Au 9 février 2015, une dizaine de militaires étaient insérés à l’état-major de l’opération.
• EUSEC – République démocratique du Congo (8 juin 2005) – en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : mission civile de l’Union européenne visant à apporter un soutien à l’Etat congolais pour la réforme du secteur de la sécurité dans sa composante militaire.
Importance du dispositif : Une trentaine de militaires et de civils au total. Au 9 février 2015, aucun Français n’y participait.
• MINUAD – Soudan (31 juillet 2007) : en cours
Cadre : opération hybride ONU/UA
Contexte : Une guerre civile a éclaté au Darfour en 2003 entre le Gouvernement du Soudan, ses milices Janjaweed alliées et d’autres groupes rebelles armés, faisant des centaines de milliers de victimes. Sous l’égide de l’Union africaine (UA) et avec l’appui de l’ONU et d’autres partenaires, l’Accord de paix pour le Darfour a été signé le 5 mai 2006. En 2006, l'Union africaine a déployé une mission de maintien de la paix au Soudan qui a été remplacée en 2008 par une opération de maintien de la paix hybride Union africaine/Nations Unies (MINUAD). Cette mission est l'opération de maintien de la paix la plus large de toutes celles conduites actuellement dans le monde. Le mandat de la MINUAD a été élargi à plusieurs reprises. Sa tâche principale est d’assurer la protection des populations civiles. Elle doit également contribuer à la sécurité pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, surveiller et vérifier la mise en œuvre des accords de paix, appuyer un processus politique inclusif, contribuer à la promotion des droits de l’homme et de l’état de droit, et suivre la situation le long de la frontière avec le Tchad et la République centrafricaine et de faire rapport à ce sujet.
Importance du dispositif : L’opération compte actuellement près de 16.000 policiers et militaires. Au 9 février 2015, aucun Français n’y participait.
• MINURCAT – Tchad/ RCA (25 septembre 2007 – 31 décembre 2010)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Depuis 2003, plus de 240.000 réfugiés soudanais ont fui le conflit du Darfour vers le sud du Tchad. Ils y ont été rejoints par environ 45.000 réfugiés venant de la République centrafricaine (RCA). La présence d'environ 180.000 tchadiens déplacés par la guerre civile qui ravage l'est du pays a généré des tensions croissantes parmi les communautés de la région. Pour répondre à cette situation et face aux activités des groupes armés basés dans le sud du Tchad et au Darfour, et notamment aux attaques transfrontalières, le Conseil de sécurité a adopté, le 25 septembre 2007, la résolution 1.778, en vue d'autoriser le déploiement d'une opération civile et policière de l'ONU, la Mission hybride des Nations Unies pour la République centrafricaine et le Tchad (MINURCAT), et d'une force militaire de l'Union européenne, l'EUFOR. Le mandat essentiel de cette mission est d’assurer la protection des civils, à l’exclusion de tout mandat politique. Le Conseil de sécurité a ensuite autorisé le déploiement d'une composante militaire de la MINURCAT au Tchad et en République centrafricaine pour maintenir la sécurité à la fin du mandat de l'EUFOR, en mars 2009.
Importance du dispositif : L’opération a compté jusqu’à 3.800 soldats et policiers. La France a contribué aux effectifs militaires et de police.
Suites : Le 15 janvier 2010, le gouvernement tchadien a informé le Secrétaire général de son souhait que la MINURCAT se retire du Tchad. Ce retrait a été effectif à la fin de l’année 2010.
• EUFOR Tchad (15 octobre 2007 – 15 mai 2009)
Cadre : Union européenne – mandat ONU
Contexte : Dans le contexte mentionné pour le déploiement de la MINURCAT, le déploiement d’EUFOR Tchad/RCA représente le volet militaire de la mise en œuvre de la résolution 1.778 de l’ONU. L'objectif principal de cette force est la sécurisation des camps de réfugiés dans les deux pays (estimés à 723 000 dont 241 000 Soudanais réfugiés au Tchad, 3 000 Soudanais réfugiés en RCA, 179 000 réfugiés tchadiens internes et 300 000 réfugiés centrafricains internes - seuls 20 000 de ces derniers, situés au Nord-Est du pays, seront sous protection de l'Eufor) et de la frontière entre la province soudanaise du Darfour et le Tchad et la RCA. L'Eufor doit par ailleurs assurer la protection du personnel et de l'infrastructure de l'ONU et des ONG opérant dans les camps de réfugiés et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans les deux pays et à destination du Darfour. Son déploiement a été finalisé en juin 2008.
Importance du dispositif : 3.700 militaires en provenance de 23 Etats membres, principalement la France (1.700 hommes), l’Irlande (450), la Pologne (400), la Suède (200) et l’Autriche (170), ainsi que de quelques Etats non membres
Suites : La mission de l’EUFOR s’est achevée en mai 2009, après passage de relai à la composante militaire de la MINURCAT.
• Opération Alcyon – Somalie (16 novembre 2007 – 2 février 2008)
Cadre : opération multilatérale
Contexte : missions d’accompagnement des navires affrétés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) entre le Kenya (Mombasa) et la Somalie (Merka), pour lutter contre la piraterie. Ces missions sont ensuite absorbées dans le dispositif Atalante mis en œuvre par l’Union européenne.
• Opération Atalante – Océan Indien (8 décembre 2008) : en cours
Cadre : Union européenne – opération sous mandat ONU
Contexte : Une recrudescence de la piraterie dans le Golfe d’Aden depuis 2008 touche les approvisionnements vitaux transitant par la zone. L’Union européenne lance une opération militaire pour contribuer à la dissuasion, la prévention et la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. Cette opération s’appuie sur les résolutions 1814, 1816, 1838 et 1846 du conseil de sécurité de l’ONU, qui donnent un mandat robuste à la lutte contre la piraterie. Atalante mobilise en moyenne 1.200 personnes et six navires soutenus par 4 à 5 avions de patrouille maritime, indispensables pour surveiller une zone de plusieurs millions de kilomètres carrés. Le commandement des opérations est assuré depuis un état-major européen qui réunit 17 nationalités différentes à Northwood, près de Londres.
Importance du dispositif : La France a initialement compté, avec l’Allemagne et l’Espagne, parmi les pays les plus investis dans cette opération, fournissant en permanence un ou plusieurs bâtiments ainsi que l’essentiel des aéronefs. Elle n’a actuellement plus de bâtiment engagé dans cette opération.
Suites : La force navale de l’UE a contribué de façon significative à la réduction de la piraterie : en 2011, 174 navires marchands ont été attaqués et 25 d’entre eux piratés conduisant à la prise en otage de 736 marins. Au cours de l’année 2013, 7 bateaux ont été attaques sans qu’aucun ne soit pirate. Au mois de novembre 2014, seules deux attaques avaient été enregistrées.
• EUTM Somalie (25 janvier 2010) : en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : Le 10 avril 2010, l'Union européenne a lancé une mission de formation militaire en Somalie en vue de contribuer au renforcement du gouvernement fédéral de transition (GFT) et des institutions de ce pays. Elle a donné la priorité à la formation des sous-officiers, des officiers subalternes, des spécialistes et des formateurs. En raison de la situation politique et sécuritaire de la Somalie, la formation était, dans un premier temps, organisée en Ouganda. Le troisième mandat de la mission, débuté en janvier 2013, a été marqué par l’élargissement de ses missions au conseil et à l’encadrement stratégiques et par le regroupement de la mission à Modagiscio, en Somalie.
Importance du dispositif : 140 formateurs européens dont 26 Français en janvier 2011. En octobre 2014, la mission ne comprenait plus de formateurs français.
• Opération Sabre – Sahel (22 juillet 2010 – 31 juillet 2014)
Cadre : opération nationale
Contexte : Déploiement des forces spéciales dans les pays du Sahel, organisé autour de Ouagadougou, au Burkina Faso.
Suites : Cette opération a été absorbée par l’opération Barkhane à compter du 31 juillet 2014.
• Opération Harmattan – Libye (19 mars – 31 octobre 2011)
Cadre : Commandement OTAN – opération sous mandat ONU
Contexte : En février 2011, dans le contexte des « printemps arabes », de très fortes protestations secouent le régime du Colonel Kadhafi et sont violemment réprimées à Benghazi et Al-Baïda. Le 17 mars, le conseil de sécurité de l’ONU adopte la résolution 1.973, qui ouvre la voie à l’engagement de moyens militaires pour protéger la population civile et faire respecter une zone d’exclusion aérienne. Samedi 19 mars 2011, la France lance l’opération Harmattan, nom de la participation française à l’engagement militaire international conduit par la France et le Royaume-Uni. L’OTAN prend les commandes de l’intervention militaire internationale le 31 mars 2011, dans le cadre de l’opération Unified Protector. Les forces armées françaises engagées dans la coalition fournissent des capacités qui lui permettent de conduire des missions de surveillance maritime de détection, de contrôle aérien, de reconnaissance, de frappes aériennes et de ravitaillement. Progressivement, l’opération dépasse le cadre du mandat fixé par l’ONU et axé sur la protection des populations pour conduire à la chute du régime de Kadhafi. La situation sur le terrain connaît des évolutions contrastées, jusqu’au mois d’août où une offensive décisive permet aux rebelles de prendre Tripoli, entraînant la fuite de Kadhafi. Le 20 octobre 2011, Syrte, le dernier bastion du régime, tombe aux mains des forces du Conseil national de transition (CNT) et Mouammar Kadhafi est tué.
Importance du dispositif : Au maximum des opérations, environ 4 200 militaires français ont été engagés pour mettre en œuvre plus de 40 avions, une vingtaine d’hélicoptères, une dizaine de bâtiments de combat et de soutien dont le porte-avions Charles-de-Gaulle et un bâtiment de projection et de commandement.
Suites : La communauté internationale se retire complètement de Libye à la fin du mois d’octobre 2011, le CNT s’étant montré peu enclin au maintien d’une présence internationale sur le sol libyen, à l’exception de la petite mission civile européenne EUBAM. Cependant, à partir de 2014, la situation sécuritaire se dégrade à nouveau fortement.
• Opération Serval – Mali (11 janvier 2013 – 31 juillet 2014)
Cadre : accord de défense – opération nationale sous mandat ONU
Contexte : En 2012, des groupes armés terroristes ont pris le contrôle de l'Azawad, la partie nord du Mali, exploitant les dissensions entre la capitale et les mouvements séparatistes touareg du nord du pays, en particulier le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). En décembre 2012, le Conseil de sécurité a ouvert la voie à une intervention militaire par sa résolution 2.085, prise sous chapitre VII, dans laquelle il prévoit notamment le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali (MISMA) sous conduite africaine. En janvier 2013, les groupes armés terroristes amorcent une descente en direction de Bamako, la capitale. A la demande du Gouvernement malien, la France lance l’opération Serval, qui a pour objectif de stopper leur avancée, de préserver l’existence de l’Etat malien et de l’aider à recouvrer son intégrité territoriale et de préparer le déploiement de la MISMA et de la mission de formation de l’Union européenne EUTM Mali.
Importance du dispositif : A son pic, l’opération Serval a mobilisé 4.500 militaires français.
Suites : Avec la création et la montée en puissance de la MINUSMA, la mission des Nations Unies qui prend le relai de la MISMA à partir d’avril 2013, les effectifs de Serval décroissent puis sont régionalisés dans le cadre de l’opération Barkhane qui couvre l’ensemble des pays du G5 Sahel. Environ un millier de militaires français sont maintenus au Mali. Ils constituent une force de réaction rapide en appui à la MINUSMA, pour éviter que les groupes terroristes ne se reconstituent dans le nord du pays.
• EUTM Mali (18 février 2013) : en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : A la demande des autorités maliennes, et conformément à la résolution 2.085 du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union européenne a lancé le 18 février 2013 la mission de formation des forces armées maliennes EUTM Mali. Cette mission assure la formation des unités combattantes maliennes, ainsi que des fonctions de conseil et d’expertise, notamment dans les domaines du commandement opérationnel et organique, du soutien logistique, des ressources humaines, de la préparation opérationnelle et du renseignement.
Importance du dispositif : Au total, la mission compte environ 580 militaires, dont 200 formateurs, 150 soldats chargés de la protection du personnel et 150 militaires assumant des fonctions de commandement, de logistique et de soutien médical. Initialement, la France était le premier contributeur de cette mission dont elle a assumé le commandement jusqu’en avril 2014. Au 9 février 2015, la France contribue à hauteur de 70 militaires.
Suites : Le mandat de la mission a été prolongé jusqu’au mois de mai 2016.
• EUBAM Libye (22 mai 2013) : en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : La mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libye) a été déployée en mai 2013 afin d'aider les autorités libyennes à améliorer et à renforcer la sécurité des frontières du pays. Les experts d’EUBAM ont pour tâche de conseiller, de former et d'encadrer leurs homologues libyens en vue de renforcer les services frontaliers ainsi que de les conseiller dans la définition d'une stratégie nationale libyenne de gestion intégrée des frontières.
Importance du dispositif : 45 experts.
Suites : Du fait de la situation politique et sécuritaire en Libye, EUBAM mène ses activités à partir de la Tunisie depuis août 2014. Étant donné que les possibilités de conseiller, d'encadrer et de former les homologues libyens de la mission sont limitées, l'effectif d'EUBAM Libye a été ramené à 17 membres internationaux le 14 octobre. Compte tenu de cette capacité limitée, la mission a continué à soutenir les douanes et les gardes-côtes libyens lors d'ateliers et de séminaires organisés en dehors de la Libye.
• MINUSMA – Mali (1er juillet 2013) : en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : Créée par la résolution 2.100 du Conseil de sécurité de l’ONU du 25 avril 2013, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a pris le relai de la force de l’Union africaine, la MISMA, dont elle a intégré l’essentiel des éléments, pour appuyer le processus politique, assurer la sécurité dans ses zones de déploiement et protéger les civils. Pour ce faire, la MINUSMA est régie par des règles d’engagement robustes, qui lui permettent d’employer tous les moyens nécessaires pour faire face aux menaces à l’exécution de son mandat, lequel consiste entre autres à protéger les civils immédiatement menacés de violences physiques et à préserver le personnel des Nations Unies de menaces résiduelles, dans la limite de ses moyens et dans ses zones de déploiement. À ce titre, la MINUSMA peut réaliser des opérations isolément ou en coopération avec les forces de défense et de sécurité maliennes. Le Conseil de sécurité a également autorisé les forces françaises déployées au Mali (Serval puis Barkhane) à intervenir pour appuyer la MINUSMA, à la demande du Secrétaire général, en cas de menace grave et imminente.
Importance du dispositif : A la fin octobre 2014, environ 10.000 personnels étaient déployés dans le pays, dont 8.300 militaires et 1.000 policiers. Au 9 février 2015, 15 militaires français étaient insérés dans l’état-major de la MINUSMA.
Suites : Depuis le départ des troupes de Serval, la MINUSMA fait face à de fréquentes attaques des groupes armés terroristes qui cherchent à se réimplanter dans le nord du pays.
• Opération Sangaris – République centrafricaine (5 décembre 2013) : en cours
Cadre : opération nationale sous mandat ONU
Contexte : En mars 2013, la rébellion Séléka à majorité musulmane renverse le Président Chrétien François Bozizé. Michel Djotodja devient ainsi le premier président musulman du pays. Les soldats de la Séléka importent avec eux l’islam du nord dans un sud majoritairement catholique. Les combats entre des milices d'autodéfense chrétiennes appelées anti-balakas et les ex-Séléka se multiplient à partir d'octobre 2013 et l’État n'est plus capable de faire régner l'ordre. L’engrenage des cycles de violences et de représailles fait peser le risque d’un véritable désastre humanitaire. Le 5 décembre 2013, par la résolution 2127, le conseil de sécurité des Nations unies autorise le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit et les tensions interconfessionnelles ». La MISCA est appuyée par des forces françaises autorisées à prendre « toutes les mesures nécessaires ». L’opération Sangaris est ainsi lancée le 5 décembre. Dans les semaines précédentes, le dispositif de l’opération Boali, sur place depuis 2002, avait été progressivement renforcé. L’opération Sangaris doit permettre de désarmer les milices et de rétablir un niveau minimum de sécurité dans le pays, de façon à permettre l’installation de la MISCA, puis de la Mission des Nations Unies, la MINUSCA, qui prend son relai à partir de septembre 2014.
Importance du dispositif : Pic à plus de 2.000 militaires
Suites : A partir de la fin de l’année 2014, la baisse des effectifs de Sangaris est amorcée, avec le passage de relai à la MINUSCA de la sécurité de l’ouest de la Centrafrique.
• EUFOR RCA – République centrafricaine (1er avril 2014 – 31 mars 2015)
Cadre : Union européenne – opération sous mandat ONU
Contexte : Le lancement d’EUFOR RCA a été décidé en février 2014. Cette opération a pour but de fournir un appui temporaire à la création d'un environnement sûr et sécurisé dans la zone de Bangui, l'objectif étant de passer le relai aux partenaires africains. Elle assure la protection de l’aéroport et de certains quartiers de Bangui. Elle est opérationnelle depuis juin 2014.
Importance du dispositif : 700 militaires au total, dont environ 260 Français
Suites : A partir de mars 2015, EUFOR RCA est relayée par EUMAM RCA, une mission militaire de conseil destinée à assurer la transition avec d’éventuelles futures actions de formation, une fois la transition politique achevée.
• Opération Barkhane – Sahel (1er août 2014) : en cours
Cadre : opération multinationale à dominante française
Contexte : L’opération Barkhane a absorbé à compter d’août 2014 les opérations Serval, Sabre et Epervier dans le cadre d’un dispositif régional destiné à appuyer les pays partenaires de la bande sahélo-saharienne – Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad – dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Il s’agit aussi de les aider à mieux se coordonner entre eux, notamment par le biais d’actions communes sur les frontières. L’opération Barkhane repose sur plusieurs points d’appui : la base de N’Djamena, au Tchad, qui abrite l’état-major et les forces aériennes ; Niamey, au Niger, où sont basés les moyens de renseignement ; Ouagadougou au Burkina Faso pour les forces spéciales ; Gao, au Mali, où se trouve un groupement tactique interarmes d’environ 1.000 soldats. Des bases opérationnelles avancées ont été installées à Tessalit (Mali), à Madama (Niger) et à Faya Largeau (Tchad). Par ailleurs, un détachement d’instruction opérationnelle (DIO) d’une cinquantaine de militaires est présent en Mauritanie.
Importance du dispositif : Plus de 3.000 militaires
• MINUSCA – République centrafricaine
Importance du dispositif : 10 militaires
DEUXIEME PARTIE : PROCHE ET MOYEN-ORIENT
• Opérations Decan 1, 2 et 3 – Egypte (1974-1975)
Cadre : bilatéral
Contexte : En partie obstrué par les combats de l’affaire de Suez, en 1956, le canal de Suez est fermé en 1967 après la guerre des Six jours. Á l'issue de la guerre du Kippour de 1973, les accords de cessez-le-feu du 18 janvier 1974 rendent possible sa réouverture. La France répond à la demande d’asssitance de l’Égypte en envoyant à trois reprises des bâtiments spécialisés dans la guerre des mines participer au déminage du canal.
Importance du dispositif : jusqu’à huit navires (chasseurs de mines et bâtiments de soutien) et deux groupes de plongeurs-démineurs.
Suites : Muge (1984), Phèdre (1991)
• Opération Daman – Liban (23 mars 1978) : en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : En réponse à une attaque très meurtrière revendiquée par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), les forces israéliennes envahissent le sud du Liban où sont positionnés des éléments armés palestiniens. Le conseil de sécurité de l’ONU décide le déploiement de la FINUL pour contrôler le retrait israélien, rétablir la paix et appuyer la montée en puissance de l’armée libanaise. Le mandat évoluera ensuite en fonction de la situation sur le terrain.
Importance du dispositif : près 900 soldats actuellement, qui arment la force de réserve de la FINUL dotée de capacités renforcées.
Suites : Sous des apparences de stabilité, la zone de déploiement de la FINUL, au sud Liban, reste dans une situation sécuritaire fragile, illustrée par des regains de violence sporadiques. Les risques de déstabilisation sont accrus par les crises qui sévissent aux frontières du pays, avec, au sud, le conflit israélo-palestinien qui demeure non résolu, et au nord et à l’est, la crise syro-irakienne.
• Force multinationale d’observateurs – Egypte (21 mars 1982) : en cours
Cadre : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Contexte : Déploiement d’une force multinationale d’observateurs pour veiller au respect des limitations en personnels et équipements militaires prévues par le traité de paix israélo-égyptien de 1979 dans le Sinaï. En l’absence d’accord aux Nations Unies, cette force est déployée hors du cadre onusien.
Importance du dispositif : Environ 1.600 militaires en janvier 2013. Le 9 février 2015, la France est représentée au sein de l’état-major de la force.
Suites : Dans un contexte d’instabilité croissante de cette région, avec la montée en puissance des groupes terroristes dans le Sinaï, les limites de cette force qui n’est configurée comme une force d’intervention sont évidentes.
• Opération Epaulard – Liban (18 août – 13 septembre 1982)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : En juin 1982, l'armée israélienne déclenche l'opération Paix en Galilée pour neutraliser la résistance des forces palestiniennes au Liban. Devant la difficulté de prendre la ville de Beyrouth, un cessez-le-feu est conclu le 12 août 1982. A la demande du gouvernement libanais et sous l'égide de l'ONU, une force multinationale d'interposition (FMI) est déployée pour évacuer les Palestiniens et éviter un massacre des populations civiles. La France y participe avec l'opération Epaulard.
Importance du dispositif : 865 militaires de l’armée de terre, appuyés par la mission navale Oliphant et 10 C.160 pour le transport
Suites : L’opération permet d’évacuer 14.000 combattants palestiniens, y compris Yasser Arafat, et d’apporter une aide à l’armée libanaise pour reprendre le contrôle de Beyrouth-ouest et déminer. Les violences reprennent dès le retrait de la force d’interposition.
• Opération Diodon – Liban (24 septembre 1982 – 31 mars 1984)
Cadre : opération multilatérale
Contexte : Déploiement d’une force multinationale de sécurité à Beyrouth (FMSB) après l’assassinat du Président libanais Béchir Gamayel, qui a entraîné un nouveau cycle de violences. Elle doit s’interposer en toute neutralité, apporter un soutien au Gouvernement libanais et à son armée pour restaurer sa souveraineté et assurer la sécurité des personnes.
Importance du dispositif : De 1.100 à 2.000 personnels, dont une compagnie de la FINUL redéployée sous commandement français
Suites : Intensification des bombardements et attentats terroristes. A compter de l’automne 1983, la force doit se recentrer sur sa propre sécurité.
• Opération Chevesne – Liban (janvier 1984)
Cadre : opération nationale
Contexte : Confrontée à une situation très difficile au Liban (attentat du Drakkar contre les contingents français et américains le 23 octobre 1983), la France déclenche Chevesne afin de maintenir une protection aérienne compte tenu du départ du porte-avions et de démontrer la capacité de la France à mener des interventions à longue distance depuis la métropole au-dessus du Liban.
Importance du dispositif : 4 avions de chasse Jaguar, 1 ravitailleur C.135
• Opérations Grondin et Muge – mer Rouge (septembre 1984)
Cadre : opérations nationales
Contexte : opérations de guerre des mines dans le canal de Suez.
• Opération Prométhée – Golfe Persique (juillet 1987- septembre 1988)
Cadre : national
Contexte : Durant la guerre Iran-Irak (1980-1988), la France soutient le régime irakien par la fourniture d'armes. D’autre part, son grave contentieux diplomatique avec l’Iran (affaire EURODIFF) menace de dégénérer en crise ouverte : otages au Liban, attentats à Paris, attaques sur des bâtiments français dans le golfe Persique. L'opération Prométhée vise à prévenir ces attaques sur le trafic maritime et adopter une posture plus coercitive vis-à-vis de l’Iran. L'opération dure quatorze mois et constitue le plus long déploiement d’affilé d’un groupe aéronaval français. Elle est appuyée par le déploiement d’un bâtiment de guerre des mines (opération Néréides).
Importance du dispositif : déploiement du groupe aéronaval et d’importants moyens de surface.
• Opération Salamandre – mer Rouge (10 août – 30 septembre 1990)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : Début de l’engagement aéroterrestre de la France suite à l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein, le 2 août 1990. Renforcement du dispositif aérien stationné à Djibouti et acheminement de moyens en Arabie Saoudite par porte-avion.
• Opération Artimon – Golfe Arabo-persique (13 août 1990 – 10 mai 1994)
Cadre : Union de l’Europe occidentale (UEO) – mandat ONU
Contexte : Contribution de la marine nationale au contrôle de l’embargo sur les armes imposé à l’Irak en vertu de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.
• Opération Busiris – Emirats arabes unis (24 août 1990 – avril 1991)
Cadre : accords de défense – mandat ONU
Contexte : Après l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, la sécurité des pays du Golfe paraît menacée. Cette opération vise à renforcer le dispositif militaire émirati. Les forces françaises apportent entraînement et assistance technique, principalement pour la défense aérienne. Elles peuvent mener des actions opérationnelles ponctuelles de nature défensive.
Importance du dispositif : pic à 350 hommes
• Opération Daguet – Arabie saoudite/ Koweït/ Emirats arabes unis/ Irak (août 1990 – avril 1991)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : Saddam Hussein n’ayant pas respecté l’ultimatum du 15 janvier fixé par une résolution de l’ONU pour évacuer le Koweït, une large coalition internationale emmenée par les Etats-Unis se met en place : 700.000 hommes issus de 17 pays, dans le cadre de l’intervention Desert storm puis Desert shield. L’opération Daguet est la contribution de la France à cette offensive.
Importance du dispositif : 14.300 hommes
Suites : Succès et brièveté de la phase offensive, du 21 au 28 février 1991. Phase aéroterrestre de 100 heures, marquée par une faible résistance de l’armée irakienne : les objectifs assignés sont atteints en moins de 48 heures. De nombreux matériels militaires irakiens détruits et récupérés, 3.000 soldats faits prisonniers.
• Opération Méteil – Qatar (17 octobre 1990 – 1er mai 1991)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : complément au dispositif de l’armée de l’air de l’opération Daguet destiné à participer aux opérations aériennes en Irak et au Koweït depuis le Qatar.
• Opérations Libage – Irak et Turquie (avril – juillet 1991)
Cadre : opération multinationale sous mandat ONU.
Contexte : Après la Guerre du Golfe, les populations kurdes du nord de l’Irak se soulèvent contre le régime de Saddam Hussein qui réprime violemment le mouvement. La France se joint à la coalition (Provide comfort) qui décide de venir en aide aux Kurdes en les protégeant contre les forces armées irakiennes, en acheminant l’aide humanitaire et en facilitant le retour des Kurdes depuis la Turquie.
Importance du dispositif : 2.100 hommes
• MONUIK – Koweït (9 avril 1991 – 17 mars 2003)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Mission d’observation non armée destinée à surveiller la zone démilitarisée le long de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, prévenir les violations de la frontière, et observer tout acte hostile commis à partir du territoire d'un État à l'encontre de l'autre. En février 1993, à la suite d'une série d'incidents constatés sur la nouvelle ligne de démarcation entre l'Iraq et le Koweït, le Conseil de sécurité renforce son mandat.
Importance du dispositif : pic à 1.187 hommes, dont ? Français.
• Opération Ramure – Iran (18 avril – 31 mai 1991)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : participation depuis le territoire iranien à l’opération Provide comfort destinée à venir en aide aux populations kurdes d’Irak.
• Opération Aconit – Irak et Turquie (juillet 1991 – 1996)
Cadre : Opération multilatérale sous mandat ONU
Contexte : En parallèle de l’opération Libage, la France participe à la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne dans le Nord de l’Irak (opération Northern Watch) afin de protéger la population kurde de l’aviation irakienne.
Importance du dispositif : 8 avions de chasse, 1 ravitailleur
• Opération Alysse – Irak (septembre 1992 – mai 2003)
Cadre : Opération multinationale sous mandat ONU
Contexte : Contribution française à l’opération internationale Southern Watch, dont l’objet est de faire respecter la zone d’exclusion aérienne décrétée au sud de l’Irak, jusqu’au 32ème parallèle, dans le contexte des massacres perpétrés par Saddam Hussein contre les populations chiites.
Importance du dispositif : dispositif de l’armée de l’air basé en Arabie saoudite, et composé de 180 personnels, cinq Mirage 2000 (chasse), trois Mirage F1CR (reconnaissance) et un ravitailleur C135 au moment de la fermeture de l’opération.
Suites : En septembre 1996, la France se trouve en désaccord avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui décident d’étendre la zone d’exclusion aérienne jusqu’au 33ème parallèle. La France choisit donc de ne plus faire voler ses avions au-dessus de l’Irak. Le dispositif français en Arabie saoudite est cependant maintenu jusqu’en mai 2003 ; il permet à la France de disposer d’un pied à terre dans la région et à l’armée de l’air de participer à des entraînements avec les avions de la coalition.
• Opération Aladin – Arabie saoudite (juin 1998 – janvier 1999)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Cette opération consiste en des missions de reconnaissance au-dessus de l’Irak au profit de l’ONU.
Importance du dispositif : 2 Mirage 2000 basés en Arabie Saoudite.
• Opération Pécari – Liban (décembre 1998-février 1999)
Cadre : opération nationale
Contexte : Après quinze années de guerre civile au Liban, de 1975 à 1990, entre 9 000 et 35 000 mines réparties dans 180 principaux champs de mines sont à retirer. La France apporte sa contribution en prenant à sa charge le déminage des abords de l'ambassade à Beyrouth avec l'opération Pécari.
Importance du dispositif : 39 personnels
• Opération Héraclès – Afghanistan (10 octobre 2001 - ??)
Cadre : Opération multilatérale sous commandement américain et sous mandat ONU
Contexte : L’opération « Héraclès » désigne le dispositif aéronaval français déployé en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux Etats-Unis par le réseau Al-Qaïda, dans le cadre de l’opération Enduring freedom déployée sous commandement américain. Le dispositif comprend deux volets : d’une part une mission de contrôle de l’espace aéro-maritime et d’autre part, des missions aériennes de reconnaissance au-dessus de l’Afghanistan et d’appui des forces terrestres de la coalition.
Importance du dispositif : Pic à 2.900 militaires avec le déploiement du groupe aéronaval autour du porte-avion Charles-de-Gaulle
• Opération Epidote – Afghanistan (2002- janvier 2014)
Cadre : Opération nationale sous mandat ONU
Contexte : L’opération Épidote est le nom donné à la formation des militaires de l'armée nationale afghane (ANA) par des militaires français, en Afghanistan. Cette formation concerne à la foi λα formation initiale des officiers, la formation des officiers d’état-major au sein du Command and staff college (CvSC) et la formation spécialisée, sous forme de détachements d’instruction opérationnelle (DIO), dans les domaines du renseignement et de l’administration.
Importance du dispositif : détachement d’une soixantaine de militaires français
Suites : L’opération Epidote s’est achevée en janvier 2014. Toutefois, une vingtaine des 60 militaires français du détachement a continué à assister les instructeurs afghans et les cadres dans les domaines du commandement, de la tactique et du tir jusqu'au retrait des troupes françaises, à la fin 2014.
• Opération Pamir – Afghanistan (2 janvier 2002 – 31 décembre 2014)
Cadre : commandement OTAN – opération sous mandat ONU
Contexte : Participation français à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) déployée en Afghanistan à compter de 2002, sous commandement OTAN à partir d’août 2003. Créée en vertu d'un mandat de l'ONU, la FIAS avait pour objectif premier d'aider le gouvernement afghan à assurer efficacement la sécurité dans tout le pays et à mettre en place de nouvelles forces de sécurité pour faire en sorte que l’Afghanistan ne redevienne plus jamais un sanctuaire pour les terroristes. Déployée à l'origine pour assurer la sécurité dans la capitale, Kaboul, et aux environs, la FIAS a progressivement élargi son champ d'action jusqu’à couvrir la totalité du pays au second semestre de 2006. D’abord situé à Kaboul, le centre de gravité des forces françaises s’est ainsi déplacé, à compter de 2006, vers l’est de l’Afghanistan, plus précisément dans le district de Surobi et la province stratégique de Kapisa. Avec l’extension de la FIAS, les troupes engagées ont dû livrer des combats de plus en plus intenses face à une insurrection grandissante, en 2007 et 2008 (embuscade d’Uzbin en août 2008). A partir de 2011, le but principal de la FIAS est devenu le renforcement des capacités et compétences des forces armées afghanes. La responsabilité de la sécurité du pays a été progressivement transférée aux Afghans et la mission de la FIAS a évolué d’un rôle de combat vers un rôle de formation, de conseil et d’assistance.
Importance du dispositif : L’opération a compté jusqu’à 4.000 hommes.
Suites : A partir de 2012, la mission de combat des forces françaises s’est achevée. Elles ont cependant continué à être présentes en Afghanistan en assurant notamment le commandement de l’hôpital médico-chirurgical et de l’aéroport international de Kaboul ainsi que celui du laboratoire contre-IED européen, jusqu’au mois de décembre 2014.
• Opération Coherent behaviour – Méditerranée (1er octobre – 30 novembre 2002)
Cadre : opération multilatérale sous mandat ONU
Contexte : Déploiement en Méditerranée orientale d’une task force de l’EUROMARFOR, qui rassemble les marines italienne, espagnole, portugaise et française, en soutien de l’opération de lutte contre le terrorisme Enduring freedom.
• Opération Resolute behaviour – Corne de l’Afrique (janvier 2003 – 8 décembre 2004)
Cadre : opération multilatérale sous mandat ONU
Contexte : Déploiement dans l’océan Indien d’une task force de l’EUROMARFOR, qui rassemble les marines italienne, espagnole, portugaise et française, en soutien de l’opération de lutte contre le terrorisme Enduring freedom.
• Opération Tarpan – Irak (21 février 2003 – 9 avril 2003)
Cadre : mandat de l’ONU
Contexte : Dans le cadre de la Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n° 1441 du 8 novembre 2002 sur le désarmement de l'Irak, et pour soutenir l’action de la CCVINU (Commission de Contrôle, de Vérification et d’Inspection des Nations Unies), la France effectue des missions aériennes de reconnaissance sur des objectifs définis par cette Commission de contrôle.
Importance du dispositif : 2 Mirage IV et 2 avions ravitailleurs C135 FR basés aux Émirats arabes unis, 70 personnels.
• EUBAM Rafah – Israël (24 novembre 2005) : suspendu
Cadre : Union européenne
Contexte : Après le désengagement unilatéral de la bande de Gaza par Israël durant l'été 2005, l'accord sur l'accès et le mouvement a été signé par les autorités palestiniennes. Celui-ci contient également une série de principes convenus pour le franchissement du point de passage de Rafah (Gaza). Conformément à cet accord, le point de passage devait être sous le contrôle conjoint d'Israël, de l'Autorité palestinienne et d'une tierce partie. Ce rôle a été assumé par l'Union européenne à partir de novembre 2005. À la suite de la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, EUBAM Rafah a suspendu ses opérations au point de passage de Rafah le 13 juin 2007. La mission s'est cependant tenue prête depuis lors pour un redéploiement rapide, qui n’a, pour l’heure, été demandé par aucune des parties. Le 3 juillet 2014, le Conseil a prolongé le mandat de la mission jusqu'au 30 juin 2015.
• Opération Baliste – Liban (juillet2006-février 2008)
Cadre : opération nationale
Contexte : l’opération Baliste est déclenchée en juillet 2006 pour évacuer les ressortissants français au Liban lors de la reprise du conflit israélo-libanais. Plus de 14 000 personnes, dont 10 000 Français sont évacués par l’Armée de l’Air (à Chypre) et la Marine nationale.
Importance du dispositif : sept bâtiments de la Marine nationale (1 000 marins)
• Opération Tamour – Jordanie (août 2012 – 27 novembre 2013)
Cadre : Opération nationale
Contexte : En août 2012, le président Hollande décide l’envoi de moyens médicaux français en Jordanie afin d’apporter une aide d’urgence aux populations ayant fui la guerre civile en Syrie. Un groupe médico-chirurgical est déployé au camp de Za’atari, qui compte 120.000 réfugiés.
Importance du dispositif : Un groupement médico-chirurgical (GMC), soit 80 militaires issus du service de santé des armées (SSA) et des trois armées.
Suites : L’évolution de la situation générale et la mobilisation internationale sur ce camp ont rendue marginale l’activité du détachement français, d’où la fermeture de l’antenne chirurgicale en mars 2013, et de l’opération en novembre 2013.
• Opération Chammal – Irak (19 septembre 2014) : en cours
Cadre : opération multinationale sous commandement américain
Contexte : Au cours de l’année 2014, le groupe terroriste Daech conduit une fulgurante offensive territoriale en Irak, qui se traduit par la chute de Mossoul au mois de juin. Ses conquêtes s’accompagnent de massacres et d’exactions à grande échelle. L’opération Chammal est la contribution française à l’opération internationale menée par les Etats-Unis, dans le cadre d’une vaste coalition rassemblant des pays occidentaux et arabes. Cette opération répond à une demande du Gouvernement irakien. Elle vise à apporter un soutien aérien aux forces armées irakiennes et aux peshmergas kurdes, afin de leur permettre de reprendre l’initiative sur le terrain. Les frappes aériennes françaises et européennes sont strictement circonscrites à l’Irak, contrairement aux Etats-Unis et à certains partenaires arabes qui conduisent aussi des frappes en Syrie.
Importance du dispositif : environ 800 militaires autour d’une composante aérienne (9 Rafale, 6 Mirage 2000D, un avion ravitailleur C.135, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un avion de guerre électronique C.160), d’une composante forces spéciales, d’une composante terrestre axée sur le conseil au commandement des forces de sécurité irakiennes, et d’une composante liaison sous forme d’officiers français insérés dans les principaux organes de commandement de la coalition. Ce dispositif peut être renforcé par le groupe aéronaval déployé dans l’Océan Indien au cours du premier semestre 2015, qui mobilise 2600 militaires.
TROISIEME PARTIE : EUROPE
• Mission des observateurs de l’Union européenne (ECMM) en Bosnie Herzégovine/ EUMM (7 juillet 1991) – en cours
Cadre : CEE puis UE
Contexte : mission d’observation de la situation politique, militaire et humanitaire en ex-Yougoslavie
Suites : En décembre 2000, ECMM a été renommée EUMM.
• FORPRONU – ex-Yougoslavie (12 mars 1992 – décembre 1996)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Convulsions ethniques au sein de la Fédération yougoslave après la chute du communisme. La Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance en 1991. En Croatie, la minorité serbe forme une République sécessionniste (RSK) qui demande son rattachement à la Serbie de Milosevic ; l’armée fédérale yougoslave la soutient et ravage la Croatie, menant une épuration ethnique sur le territoire de RSK. En janvier 1992, l’ONU obtient un cessez-le-feu et fait adopter un plan qui doit être mis en œuvre par la FORPRONU, dont le mandat est initialement limité au contrôle de zones de sécurité, dans une optique de maintien de la paix et de stricte neutralité. Cependant la situation se dégrade en Bosnie, partagée entre Bosniaques musulmans, Bosno-croates et Bosno-Serbes, et qui s’est proclamée autonome en octobre 1991. Les Serbes proclament une république autonome et s’entendent avec les Croates sur un partage ethnique du pays. Sarajevo est revendiquée comme capitale par toutes les parties, et soumise au blocus et aux bombardements de l’armée serbe. Le mandat de la FORPRONU est étendu et durci au fil des résolutions : extension à la Bosnie, avec la protection de l’aéroport de Sarajevo et la création de zones de sécurité ; renforcement des effectifs et des armements lourds.
Importance du dispositif : Initialement 2.200 Français sur 10.000 personnels en avril 1992
Suites : Impossibilité de remplir la mission initiale de maintien de la paix, en l’absence de consentement des belligérants. La force n’était pas calibrée pour l’imposition de la paix, par ses règles d’engagement et ses moyens limités. La légitimité de la force a été écornée, en l’absence de résultats décisifs, bien qu’elle ait permis d’atténuer les souffrances des populations. Par la résolution 911 du 31 mars 1995, le Conseil de Sécurité restructure la FORPRONU en 3 opérations de maintien de la paix : la FPNU pour la Bosnie, l’OnuRC pour la Croatie et la FORDEPRENU pour l’Ancienne République macédonienne de Yougoslavie (ARYM).
• Opération Danube – Hongrie (1er juin 1992 – 1997)
Cadre : Union de l’Europe occidentale (UEO) – mandat ONU
Contexte : opération de police et de douane visant à aider la Hongrie à mettre en œuvre l’embargo décidé par l’ONU sur le Danube
• Opérations Sharp vigilance/ Sharp fence/ Sharp guard – mer Adriatique (11 juillet 1992 – 17 juin 1996)
Cadre : UEO puis UEO et OTAN – opérations sous mandat ONU
Contexte : Surveillance de l’embargo décrété par l’ONU sur l’ex-Yougoslavie en mer Adriatique. D’abord entreprise dans le cadre de l’UEO (Sharp vigilance et Sharp fence), cette opération est assurée sous commandement conjoint UEO/OTAN à partir du juin 1993.
• Opération Courlis – ex-Yougoslavie (27 mars 1993- 20 décembre 1995)
Cadre : Commandement OTAN – opérations sous mandat ONU
Contexte : L’opération Courlis est la participation française à l’opération de l’OTAN Provide promise, qui vise à ravitailler par voie aérienne les populations civiles dans les zones de combat intenses liés aux contentieux de découpage de frontières entre belligérants bosniaques, musulmans et serbes.
Importance du dispositif : deux avions de transport
• Opération Crécerelle – ex-Yougoslavie (6 avril 1993 – 20 décembre 1995)
Cadre : Commandement OTAN – opération sous mandat ONU
Contexte : Les missions aériennes au-dessus de la Yougoslavie sont prises en charge par l’OTAN dans le cadre de l’opération Deny Flight, dont l’opération Crécerelle est la contribution française. L’opération vise initialement à assurer une zone de surveillance aérienne. Son format évolue par la suite pour devenir de plus en plus coercitif : zone d’exclusion aérienne, puis recours aux frappes aériennes (en 1994) jusqu’à l’opération Deliberate Force (suite au massacre de Srebrenica), qui se traduit par des campagnes de bombardement et d’appui aérien contre les forces serbes en Croatie et en Bosnie. Cette dernière permet d’aboutir aux accords de Dayton en décembre 1995.
Importance du dispositif : dispositif de l’armée de l’air basé en Italie : une trentaine d’avions de chasse.
• Opération Hermine – ex-Yougoslavie (juin – décembre 1995)
Cadre : opération sous mandat ONU
Contexte : Devant les limites de la FORPRONU, qui n’a pas permis de mettre un terme au conflit en ex-Yougoslavie après trois ans de présence, une Brigade multinationale est créée – hors commandement ONU – pour servir de force de réaction rapide à la FORPRONU. L’opération Hermine est la contribution française à cette brigade. Cette opération marque le passage d’une optique de maintien de la paix à une optique d’imposition de la paix, d’une position de neutralité à une position d’affrontement avec l’armée serbe.
Importance du dispositif : 7.100 Français sur 45.000 hommes de juillet à septembre 1995.
Suites : L’action de la Brigade multinationale – couplée à la campagne aérienne de l’OTAN dans le cadre de l’opération Crécerelle – a finalement permis de parvenir au cessez-le-feu définitif scellé par les accords de Dayton, en novembre 1995, après près de quatre années de présence.
• Opération Salamandre – Bosnie (décembre 1995 – décembre 1996)
Cadre : commandement OTAN – opération sous mandat ONU
Contexte : La Résolution 1031 du Conseil de Sécurité de l’ONU appuie l’Accord de paix de Dayton du 21 novembre 1995 et approuve notamment la création d’une force internationale de mise en œuvre de la paix (Implementation Force = IFOR), sous commandement OTAN (opération firm endeavour) pour appliquer le volet militaire de l’Accord de paix. L’opération Salamandre est la contribution française à l’IFOR ; elle est constituée à partir d’un redéploiement partiel des éléments de la FORPRONU.
Importance du dispositif : Pic à 7.500 Français, sur un total allant jusqu’à 60.000 hommes.
Suites : L’IFOR a permis l’application des aspects militaires des accords de Dayton et l’organisation d’élections dans de bonnes conditions, qui ont entériné la partition de la Bosnie en trois entités ethniques.
• Opération MINUBH-GIP - Bosnie-Herzégovine (21 décembre 1995-30 décembre 2002)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Le 21 décembre 1995, le Conseil de sécurité a autorisé la création, par sa résolution 1035, du Groupe international de police des Nations Unies (GIP) et du bureau civil des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, conformément aux stipulations des accords de paix. Les tâches principales de cette mission étaient de contrôler les activités des services de maintien de l'ordre, donner des avis au personnel et aux forces de maintien de l'ordre, former le personnel de maintien de l'ordre, évaluer les menaces à l'ordre public, fournir une aide en accompagnant le personnel de maintien de l'ordre des parties dans l'exercice de ses fonctions.
Importance du dispositif : Pic à environ 115 gendarmes français sur un total de 1 800
• Opération Alba – Albanie (7 avril – août 1997)
Cadre : opération multilatérale sous mandat ONU
Contexte : En janvier 1997, la faillite frauduleuse de sociétés d’épargne pyramidales cause la ruine de nombreux Albanais, provoquant des émeutes dans tout le pays. Un climat de guerre civile s’installe, dans un contexte où l’armée albanaise est en totale décomposition. La France évacue ses ressortissants avec l’opération Harmonium. Les autorités albanaises font appel aux organismes internationaux. Par solidarité européenne et avec l’Italie, qui est la nation cadre, la France s’associe à cette force multinationale de protection, issue de 10 pays, dont le déploiement est autorisé par mandat de l’ONU. Elle a pour mandat de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et de créer un climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales, notamment de l’OSCE qui doit superviser le processus électoral.
Importance du dispositif : 940 personnels sur un total de 7.230
Suites : L’opération Alba se termine en août 1997. Une opération de l’UEO (EMCP) pour aider à la reconstruction des forces de police albanaise prend le relai. Elle sera ensuite convertie en opération de l’Union européenne. La France y participe à hauteur d’environ 25 personnels.
• Opération Trident – Kosovo (4 décembre 1998) – en cours
Cadre : commandement OTAN – mandat ONU dans un deuxième temps
Contexte : L’opération Trident est la participation de la France aux opérations militaires au Kosovo menées dans le cadre de l’OTAN. La question de cette province serbe peuplée à 90 % d’Albanais a été laissée de côté par les accords de Dayton de 1995. L’échec de la politique pacifique de la Ligue démocratique du Kosovo conduit à l’émergence d’une milice indépendantiste, l’UCK, qui attaque à plusieurs reprises les forces serbes présentes au Kosovo pour assurer la sécurité, entrainant une violente répression de la part de l'armée fédérale et de la police serbe. Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte des résolutions de plus en plus dures à l’égard de la partie serbe, sommée d’offrir à la partie kosovare un véritable processus politique. En octobre 1998, une résolution prévoit la mise en place d’une surveillance aérienne de l’OTAN, qui somme la Serbie de diminuer ses effectifs sur le territoire kosovar, sous peine de frappes aériennes. Mais la situation se dégrade encore début 1999. L’échec de la Conférence de Rambouillet en février et mars, les Serbes refusant de signer l’accord et déployant massivement leurs troupes au Kosovo, conduit l’OTAN à débuter ses frappes aériennes dans la nuit du 24 au 25 mars 1999, en l’absence d’autorisation explicite de l’ONU. La campagne aérienne (opération Allied forces) dure 78 jours et semble dans un premier temps mener à une impasse, suscitant des centaines de milliers de déplacés et accentuant la répression serbe. Un accord est finalement conclu le 3 juin 1999, complété par un accord signé entre la République fédérale de Yougoslavie et l’OTAN le 9 juin qui prévoit le retrait des forces armées serbes du Kosovo ainsi que le déploiement d’« une présence internationale civile et de sécurité » avec une participation « substantielle » de l’OTAN, à partir des éléments de l’organisation prépositionnés en Macédoine. Cette participation se fera par le biais de la KFOR, dont le Conseil de sécurité avalise le déploiement dans une résolution du 10 juin, qui prévoit aussi celui de la mission civile d’administration (la MINUK). La KFOR a pour mandat de participer au maintien d’un environnement sûr et sécurisé au profit de l’ensemble de la population du Kosovo, de soutenir l’action des organisations internationales au Kosovo (EULEX, MINUK) ainsi que la montée en puissance de la force de sécurité du Kosovo (KSF). Son dispositif évoluera au gré de la situation sécuritaire dans le pays.
Importance du dispositif : Jusqu’à 6.000 militaires français ont été engagés au sein de l’opération Trident au plus fort des opérations.
Suites : Le 6 février 2014, les troupes françaises cessent de participer aux missions opérationnelles au sein de la KFOR. Le désengagement français est achevé à l’automne 2014. Le 9 février 2015, seuls une dizaine d’officiers français sont maintenus au sein de l’état-major de la KFOR.
• MINUK – Kosovo (8 septembre 1999) – en cours
Cadre : commandement ONU
Contexte : Après la campagne aérienne de l’OTAN et la conclusion des accords de paix, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé les États Membres à déployer une force de sécurité dans le but de décourager toute reprise des hostilités, de démilitariser l'ALK et de faciliter le retour des réfugiés : c’est la KFOR, sans commandement OTAN (Opération Trident). Il demandait également au Secrétaire général d'établir une présence internationale civile au Kosovo, la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), afin d'assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourrait jouir d'une autonomie et d'une auto-administration substantielles. La complexité et la portée du mandat de la MINUK étaient sans précédent. Le Conseil a investi la MINUK de l'autorité sur le territoire et la population du Kosovo, y compris tous les pouvoirs législatifs et exécutifs, de même que l'administration du pouvoir judiciaire.
Importance du dispositif : pic à 83 gendarmes français
Suites : Au lendemain de la déclaration de l'indépendance par les autorités kosovares et de l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution le 15 juin 2008, le mandat de la Mission a été considérablement modifié de façon à ce qu'il soit principalement axé sur la promotion de la sécurité, de la stabilité et du respect des droits de l'homme au Kosovo. La mission civile européenne EULEX Kosovo a pris le relai de la MINUK pour les questions relatives à la police, la justice et les douanes.
• Opération Mamet – Turquie (août-septembre 1999)
Cadre : opération nationale
Contexte : opération d’aide humanitaire près le tremblement de terre du 16 août 1999 dans les villes de Golcuk et d'Ismit, en Turquie, qui a fait 12 100 morts et 33 400 blessés
Importance du dispositif : 43 personnels
• Opérations Cérès, Minerve, Althaïr et Proxima – ARYM (20 août 2001 – 2005)
Cadre : commandement OTAN puis UE
Contexte : Début 2001, par contagion avec les évènements survenus au Kosovo et en Albanie, la forte minorité albanophone des provinces nord et nord-ouest de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, qui a obtenu son indépendance en 1992, se révolte contre le pouvoir central, à dominante slave. L’Union européenne et l’OTAN mènent des initiatives pour ramener la paix, permettant la conclusion d’un accord cadre à Skopje en août 2001. Cet accord doit permettre un désengagement de l’armée macédonienne en contrepartie d’un désarmement partiel volontaire des groupes armés albanophones. D’août à octobre 2001, la France contribue d’abord à une opération de l’OTAN visant à superviser le désarmement passif des groupes armés dans le cadre de l’opération Cérès. D’octobre 2001 à mars 2003, la France contribue, dans le cadre de l’opération Minerve, à deux opérations de l’OTAN visant à assurer l’information de la communauté internationale et la sécurité, puis, à compter de décembre 2002, à soutenir les observateurs de l’UE et contrôleurs de l’OSCE chargés de veiller à l’application des accords. De mars à décembre 2003, l’UE prend le relai de l’OTAN pour assurer le maintien de la paix dans le pays ; la France y contribue avec l’opération Althaïr. A compter de décembre 2003, la France contribue à une force de police européenne chargée de conseiller et d’entraîner ma police macédonienne dans le cadre de l’opération Proxima.
Importance du dispositif : 545 militaires français engagés dans Cérès, 220 dans Minerve, 175 dans Althaïr et 40 policiers et gendarmes engagés dans Proxima
Suites : Althaïr a été la première opération militaire conduite par l’Union européenne, en relai de l’OTAN, engagé en Irak. Cette opération avait une dimension essentiellement symbolique ; elle était menée dans un contexte de relatif calme dans le pays.
• MPUE – Bosnie- Herzégovine (1er janvier 2003) – en cours
Cadre : Opération de l’Union européenne sous mandat ONU
Contexte : La Mission de Police de l’Union européenne (MPUE) est la première mission entreprise dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense. Elle assure la relève du Groupe international de police (GIP) de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) mise en place par les accords de Dayton, en 1995. Les objectifs spécifiques de la mission concernent notamment le maintien des niveaux de compétence de la police aux plans institutionnel et personnel, l’amélioration des capacités de gestion et d'action de la police, le renforcement du professionnalisme au niveau supérieur dans les ministères, ainsi qu'au niveau des policiers de haut rang, l’appui à un contrôle politique approprié sur la police.
Importance du dispositif : 75 personnels français sur un total de 500
• MCOPEST – Estonie (1er au 30 aout 2004)
Cadre : opération multilatérale
Contexte : Opération de déminage près des côtes littorales estoniennes.
Importance du dispositif : navires venant de onze pays différents.
• Mission EUFOR Althéa – Bosnie (2 décembre 2004) – en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : Le but principal de cette opération est de fournir aux forces armées de Bosnie-Herzégovine un appui au renforcement des capacités et à la formation tout en soutenant les efforts déployés par la Bosnie-Herzégovine pour maintenir le climat de sécurité. L'opération Althéa est également la seule opération militaire européenne en partenariat avec l'OTAN, sur la base des Accords de Berlin Plus.
• Opérations Air Baltic – Pays Baltes (2007, 2010, 2011 et 2014)
Cadre : OTAN
Contexte : Protection de l’espace aérien et police du ciel des Etats baltes, membres de l’OTAN depuis 2004 qui ne disposent pas de moyens propres de défense aérienne.
• EULEX Kosovo (16 février 2008) : en cours
Cadre : Union européenne
Contexte : Le 4 février 2008, le Conseil de l’Union européenne crée la mission « État de droit » au Kosovo, nommée EULEX Kosovo, pour renforcer l’État de droit dans cette ex-province serbe, particulièrement dans ses aspects policiers, judiciaires et douaniers. Appelée à remplacer la MINUK, elle est lancée le 16 février 2008 et atteint sa pleine capacité opérationnelle le 4 avril 2009. La mission assure des actions de suivi, d'encadrement et de conseil des autorités locales, tout en assumant certaines responsabilités exécutives dans des domaines de compétence spécifiques, notamment les crimes de guerre, la criminalité organisée et la corruption à haut niveau, ainsi que les dossiers liés à la propriété et aux privatisations.
Importance du dispositif : 710 membres dont 18 Français en octobre 2014, principalement des juges, des procureurs, des policiers et des agents des douanes
• Opération Air Islande 08 (5 mai – 27 juin 2008)
Cadre : OTAN
Contexte : assistance et police du ciel de l’Islande, membre de l’OTAN qui ne dispose pas d’armée. Sa défense est assurée par les membres de l’OTAN à tour de rôle depuis 2005.
Importance du dispositif : 110 militaires autour de 4 Mirage 2000
QUATRIEME PARTIE : ASIE – PACIFIQUE
• MIPRENUC/ APRONUC – Cambodge (12 novembre 1991 – décembre 1993)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Dans un premier temps, déploiement de la MIPRENUC pour aider les quatre parties cambodgiennes à maintenir leur cessez-le-feu pendant la période précédant l'établissement et le déploiement de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) et mettre en place des activités de formation de la population civile dans le cadre du programme d'alerte au danger des mines. L'APRONUC l’a absorbée en juillet 1992 ; elle avait pour mandat de garantir l'application de l'accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signé à Paris le 23 octobre 1991. Elle devait se substituer à l’Etat cambodgien pour organiser des élections dans le pays.
Importance du dispositif : La France participe à la MIPRENUC (200 militaires sur 1.000) dont elle assure en outre le commandement militaire. Ces éléments sont ensuite intégrés à l’APRONUC, et renforcés en cohérence avec les missions de cette force. A son pic, l’APRONUC a compté 1.500 militaires français sur un total de 16.000 militaires.
Suites : L’APRONUC n’est pas parvenue à mener à bien l’ensemble de ses missions militaires : désarmement des factions, déminage très partiel seulement. La composante militaire a cependant joué un rôle essentiel de soutien de la composante civile électorale, qui a été un succès. Le mandat de l'APRONUC a pris fin avec la promulgation de la constitution du Royaume du Cambodge et la formation d'un nouveau gouvernement.
• MONUG – Géorgie (août 1993 – juin 2009)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Après l'indépendance de la Géorgie en avril 1991, des séparatistes réclament à leur tour un statut équivalent pour la région de l'Abkhazie. Cette situation mène à une guerre. L'ONU établit alors la MONUG pour vérifier l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement géorgien et les autorités abkhazes de Géorgie.
Importance du dispositif : effectif maximum déployé total de 459 personnels en uniforme, dont ? militaires français.
Suites : Le mandat de la MONUG prend fin le 15 juin 2009 à minuit, celui-ci n’ayant pas été renouvelé en raison d’un véto russe au Conseil de sécurité de l’ONU.
• Opération Santal – Timor (16 septembre 1999 – 15 janvier 2001)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Longue guerre civile à partir de 1982 au Timor entre les partisans de l’indépendance, reconnue en 1975, et ceux qui souhaitent un rattachement à l’Indonésie, qui a envahi et annexé l’île. A la mort de Suharto, le nouveau pouvoir indonésien accepte la tenue en août 1999 d’un référendum réclamé et supervisé par l’ONU, qui se traduit par un vote massif pour l’indépendance. Les violences reprennent du fait de milices officieusement soutenues par l’armée indonésienne, poussant l’ONU à envoyer une force d’intervention sous commandement australien (INTERFET), avec une double mission sécuritaire et humanitaire. La France y participe dans le cadre de l’opération Santal, aux côtés d’une dizaine de pays.
Importance du dispositif : Pic à 640 militaires français engagés
Suites : Par la suite, la France maintien trois officiers au sein de ATNUTO qui succède en janvier 2000 à l’INTERFET, avec pour mission d’assurer la sécurité et la reconstruction du Timor oriental.
• Opération Béryx – Indonésie (4 janvier – 5 mars 2005)
Cadre : opération multilatérale
Contexte : Assistance médicale et humanitaire après un violent tremblement de terre suivi d’un tsunami qui a fait près de 300.000 victimes.
• Opération Bahral – Pakistan (8 octobre 2005 – 31 mars 2006)
Cadre : commandement OTAN
Contexte : Le 11 octobre, répondant à une demande du Pakistan, l’OTAN a lancé une opération aérienne de grande ampleur pour aider le pays qui venait d’être ébranlé par un tremblement de terre. L'OTAN a acheminé par voie aérienne le matériel fourni par ses pays membres, les pays partenaires et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en mettant en place deux ponts aériens (l’un au départ de l'Allemagne, l’autre au départ de la Turquie). En outre, l'organisation a déployé du personnel du génie et des unités médicales issus de la Force de réaction de l'OTAN pour appuyer les opérations d'aide.
• Opération Orcaella – Birmanie (7 – 29 mai 2008)
Cadre : opération nationale
Contexte : Après avoir embarqué de l'aide humanitaire à la Birmanie, touchée par le cyclone Nargis, le Mistral appareille le 15 mai et se trouve sur zone le 18 mai. Il attend de la part des autorités birmanes l’autorisation de débarquer, mais elle lui est refusée le 21 mai. Il est alors décidé de décharger le Mistral à Phuket (Thaïlande), afin que le Programme alimentaire mondiale prenne réception de l’aide humanitaire et se charge de l'acheminer en Birmanie dans les zones sinistrées, pour qu’elle soit distribuée par les agences des Nations unies et les ONG.
Importance du dispositif : déroutage d’un BPC Mistral
CINQUIEME PARTIE : AMERIQUE
• ONUSAL – Salvador (16 août 1991 – 30 avril 1995)
Cadre : commandement ONU
Contexte : Opération mise en place pour vérifier l'application de tous les accords négociés par le gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en vue de mettre un terme à 10 ans de guerre civile.
Importance du dispositif : Environ un millier de personnels en armes, dont ? Français.
• MINUHA/ MANUH/ MIPONUH/ MICAH – Haïti (23 septembre 1993 – février 2001)
Cadre : commandement ONU
Contexte : La MINUHA a été créée à l'origine pour aider à appliquer certaines dispositions de l'Accord de Governors Island signé par les parties haïtiennes le 3 juillet 1993. Toutefois, en raison du refus de coopérer des autorités militaires haïtiennes, la MINUHA n'a pas pu être complètement déployée à l'époque. Après le rétablissement, en octobre 1994, du Gouvernement constitutionnel d'Haïti grâce à l'intervention d'une force multinationale dirigée par les États-Unis et autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU, son mandat a été révisé de façon à inclure : le maintien de conditions stables et sûres pour le déploiement de l’opération multinationale, la professionnalisation des forces armées, la création d’une police et l’organisation d’élections. Des élections législatives se sont tenues pendant l'été 1995 et des présidentielles en décembre 1995 et le transfert des pouvoirs au nouveau président a eu lieu le 7 février 1996.
Importance du dispositif : 90 militaires français participent à l’embargo sur les armes et le pétrole décidé dans la foulée des accords de Governors Island. Lors de l’intervention de la force multinationale menée par les Etats-Unis à partir de septembre 1994, la France prépositionne des commandos marine.
Suites : En juillet 1996, la Mission d’appui des Nations Unies en Haïti (MANUH) prend le relai de la MINUHA. Elle a pour but d’aider le Gouvernement haïtien à améliorer les compétences professionnelles de la police et à maintenir des conditions de sécurité et de stabilité propices à sa montée en puissance. La France déploie 30 gendarmes sur un total de 1 500 environ. A partir de décembre 1997, la Mission de Police civile des Nations Unies en Haïti (MIPONUH) succède à la MANUH, puis la Mission civile internationale d’appui en Haïti (MICAH) le 16 mars 2000, au sein de laquelle la France contribue à hauteur de 2 personnels sur un total de 100.
• UNAVEM III et MONUA– Angola (mars 1995 - 1999)
Cadre : commandement ONU
Contexte : A partir de 1992, l’ONU est déployée en Angola pour contribuer à la mise en œuvre des accords de paix entre le Gouvernement et le mouvement UNITA. Le processus politique peine cependant à s’enclencher et les combats reprennent. Un protocole est finalement signé entre le Gouvernement et l’UNITA en novembre 1994. En février 1995, l’UNAVEM III est créée pour contrôler et vérifier l’application de ce protocole.
Importance du dispositif :
Suites : L’UNAVEM III ne parvient pas assurer la mise en œuvre de l’accord de paix, faute de volonté des parties, en particulier de l’UNITA. La mission se retire en 1997, laissant la place à une mission d’observation, la MONUA, au sein de laquelle la France maintient 13 personnels. Les hostilités se prolongent jusqu’à la mort du leader de l’UNITA, Jonas Savimbi, en 2002.
• Opération Carib venture – mer des Caraïbes (31 août – 23 septembre 1998)
Cadre : opération multilatérale sous commandement hollandais
Contexte : opération ponctuelle de lutte contre les trafics de drogue à destination de l’Europe dans les Antilles néerlandaises qui jouxtent le hub vénézuélien de la cocaïne.
• Opération Cormoran – Amérique centrale (novembre 1998)
Cadre : Opération nationale
Contexte : Avec l'opération Cormoran, la France apporte une aide aux populations sinistrées par le cyclone Mitch qui a touché le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras et le Salvador causant près de 11 500 morts, de 13 000 disparus et de 2,8 millions de sinistrés.
Importance du dispositif : 4 avions de transport, 1 porte-hélicoptères
• Opération Carib Royale – mer des Caraïbes (25-29 octobre 2002)
Cadre : opération multilatérale sous commandement français
Contexte : opération multilatérale sous commandement français destinée à lutter contre le trafic de drogue sur la façade est des Caraïbes.
• Opérations Carbet et MINUSTAH – Haïti (28 février 2004) – en cours
Cadre : national puis multilatéral sous mandat ONU
Contexte : Les affrontements entre les partisans du Président Jean-Bertrand Aristide et les opposants au régime dégénèrent. Sous la pression de la communauté internationale, Aristide finit par partir, mais la situation reste très instable. Le Conseil de sécurité de l’ONU autorise le déploiement d’une force multinationale dans l’attente du déploiement de casques bleus dans le pays. La France intervient dans un premier temps pour protéger ses ressortissants, puis pour participer à la sécurisation du pays en facilitant les missions de la police haïtienne, préalablement à la mise en place de la force de l’ONU.
Importance du dispositif : environ 350 hommes. Au 9 février 2015, la France ne comptait plus aucun personnel au sein de la MINUSTAH.
Suites : A partir de juin 2004, la France participe à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH).
• Opération Carib Shield – mer des Caraïbes (20-21 octobre 2004)
Cadre : opération multilatérale sous commandement américain
Contexte : opération de lutte contre le trafic de drogue dans l’ouest et le centre de la mer des Caraïbes.
• Opération Séisme Haïti (13 janvier – 30 septembre 2010)
Cadre : Opération nationale – Mandat ONU
Contexte : La France lance une opération militaire pour venir au secours d’Haïti, frappé par un séisme le 12 janvier 2010. Dans un premier temps, lors de la phase d’urgence, l’opération consiste à acheminer des moyens de secours pour rechercher les personnes portées disparues, de l’aide médicale, à sécuriser les secours, à rapatrier les ressortissants français et à préparer l’organisation de l’aide humanitaire. A partir du mois de mars, la France s’engage dans la phase de reconstruction, répondant à une demande de l’ONU, avec l’arrivée de moyens militaires du génie, engagé jusqu’au mois de juin. Un détachement militaire de 55 hommes a été maintenu dans le pays jusqu’au mois de septembre.
Importance du dispositif : moyens aériens et maritimes pour l’acheminement de l’aide et les évacuations ; personnels du service de santé des armées (SSA), plus de 200 militaires engagés dans la phase de reconstruction.
ANNEXE N° 2 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET DES VISITES EFFECTUÉES PAR LES RAPPORTEURS
1) A Paris
– Général Vincent Desportes, Professeur Associé à Sciences Po Paris (Mardi 17 décembre 2013) :
– M. Etienne de Durand, directeur du Centre des Etudes de sécurité à l’Ifri (Mardi 14 janvier 2014) ;
– M. Emmanuel Beth, ESL France (Mercredi 15 janvier 2014) ;
– M. Maurice Vaïsse, professeur d’histoire des relations internationales à Sciences Po Paris, ancien directeur du Centre d’études d’histoire de la Défense. (Mardi 21 janvier 2014) ;
– M. Camille Grand, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (Mardi 11 février 2014) ;
– M. Bruno Tertrais - Fondation pour la recherche stratégique (Mardi 18 février 2014) ;
– Général Olivier Tramond, contrôleur général en mission extraordinaire, ancien directeur Centre de doctrine d’emploi des forces, ancien Commandant supérieur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Mardi 15 avril 2014) ;
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères (Mardi 29 avril 2014) ;
– M. Jean-Vincent Holeindre, maitre de conférence à l’université de Paris II (Mardi 6 mai 2014) :
– M. Didier Le Bret, directeur du centre de crise au ministère des Affaires étrangères (Mardi 20 mai 2014) ;
– Général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (Mardi 17 juin 2014) ;
– M. Philippe Errera, directeur des affaires stratégiques (ministère de la défense) et ancien ambassadeur à l’OTAN (Mardi 1er juillet 2014) ;
– M. Jean-Dominique Merchet, auteur du blog « Secret Défense » sur les questions militaires (L’opinion.fr) (Mardi 8 juillet 2014) ;
– Amiral Rogel, chef d’état-major de la marine (Mardi 22 juillet 2014) ;
– S.E.M. Ric Wells, ambassadeur d’Australie en France (Mardi 22 juillet 2014)
– M. Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix (Mercredi 17 septembre 2014) ;
– M. Renaud Girard, chroniqueur international du Figaro (Mardi 30 septembre 2014) ;
– Amiral Jacques Launay, ancien chef de la mission civile de l’Union européenne EUCAP Nestor (Mardi 18 novembre 2014) ;
– Général Jean-Paul Paloméros, commandant suprême allié pour la transformation de l’OTAN (ACT) (Mercredi 19 novembre 2014) ;
– Général Xavier Bout de Marnhac, ancien chef de la mission civile de l’Union européenne EULEX Kosovo (Mardi 2 décembre 2014) ;
– S.E.M. François Delattre, représentant permanent de la France à l’ONU, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis (Mercredi 21 janvier 2015).
2) A l’occasion du déplacement à Londres (9 et 10 septembre 2014)
– A l’ambassade de France :
S.E. Mme Sylvie-Agnès Bermann, ambassadeur ; Contre-Amiral Henri Schricke, attaché de Défense ; M. Emmanuel Loriot, conseiller politique ; M. Cyril Blondel, conseiller presse.
– Au think tank Royal United Services Institute (RUSI):
Dr Jonathan Eyal, directeur des études de sécurité internationale.
– Au Department of Defence (DOD):
M. Julian Brazier TD MP, Parliamentary under Secretary of State for Defence and Minister for Reserve ; Rear Admiral Simon Ancona, ACDS Military Strategy; Mr Paul Wyatt, Hd of Defence Strategy and Priorities.
– Au Select Defence Committee de la Chambre des Communes:
Mr. Rory Stewart, Président (Tory); Mr. Day Havard (Labour).
3) A l’occasion du déplacement à Bruxelles (20 janvier 2015)
– A la représentation permanente de la France à l’Union européenne :
Vice-amiral d’escadre Charles-Edouard de CORIOLIS, Représentant militaire permanent de la France auprès de l’UE et de l’OTAN.
– A la représentation permanente de la France auprès du Comité politique et de sécurité (COPS) de l’UE :
M. Philippe SETTON, Représentant permanent de la France auprès du COPS ; M. Arnaud DANJEAN, député européen, membre de la sous-commission SEDE ; M. Jay Dharmadhikari, conseiller politico-militaire.
– Au siège de l’OTAN :
M. Patrick AUROY, secrétaire général adjoint de l’OTAN en charge des investissements de défense ; M. Jean-Baptiste MATTEI, Représentant permanent de la France auprès de l’OTAN.
– Au Service européen d’action extérieure (SEAE) :
M. Oliver RENTSCHLER, directeur de cabinet adjoint de la Haute Représentante pour la PESC ; M. Pierre VIMONT, Secrétaire général du SEAE.
1 () Rapport d’information n°1950 sur la politique d’intervention dans les conflits présenté par M. Jean-Bernard Raymond, 1995.
2 () Rapport du groupe de travail « monument aux morts en opérations extérieures » sous la présidence du Général d’armée (2S) Bernard Thorette – septembre 2011
3 () Guerre du Rif (1921-1926), Indochine (1918-1922 ; 1945-1954), missions militaires dans les pays baltes, Madagascar (1947), Corée (1950-1953), Égypte (1956), Guerre du Golfe (1991), Kosovo (1999).
4 () Article 35 de la Constitution de 1958 : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ».
5 () M. Jean-Vincent Holeindre a été auditionné par la mission d’information le 6 mai 2014.
6 () Programme 178 – Préparation et emploi des forces, au sein de la mission Défense du budget de l’État.
7 () Rapport du groupe de travail « monument aux morts en opérations extérieures » sous la présidence du Général d’armée (2S) Bernard Thorette – septembre 2011
8 () Voir le rapport d’information de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat : « Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans », Jeanny Lorgeoux, André Trillard, juillet 2012.
9 () M. Maurice Vaïsse a été auditionné par la mission d’information mardi 21 janvier 2014. Il est professeur d’histoire des relations internationales à Sciences Po Paris et ancien directeur du Centre d’études d’histoire de la Défense. Il est aujourd’hui membre de l’Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et a co-écrit, en 1992, un ouvrage intitulé « Diplomatie et outil militaire 1871-1991 », publié par les Éditions du Seuil.
10 () « Le Devoir d’ingérence : peut-on les laisser mourir ? », Mario Bettati et Bernard Kouchner, 26 août 1987.
11 () cf ibid., p. 17.
12 () Livre Blanc sur la Défense, La documentation française, 1994.
13 () Défense et sécurité nationale, le Livre Blanc, La Documentation française, 2008.
14 () Résolutions 1160 du 31 mars 1998, 1199 du 23 septembre 1998 et 1203 du 24 octobre 1998.
15 () Le Général Paloméros a été auditionné par la mission d’information mercredi 19 novembre 2014.
16 () Cercle de réflexion G2S, « Défense et opérations extérieures », août 2014.
17 () Auditionné par la mission d’information le 29 avril 2014.
18 () « Wars in peace – British military operations since 1991 », Royal United services institute, 2014.
19 () Le Général Vincent Desportes a été auditionné par la mission d’information le 17 décembre 2013.
20 () Audition du Général Didier Castres par la commission des affaires étrangères et de défense du Sénat, 17 décembre 2014.
21 () S.E M. Ric Wells, alors ambassadeur d’Australie en France, a été auditionné par la mission d’information le 22 juillet 2014.
22 () M. Philippe Errera a été auditionné par la mission d’information le 1er juillet 2014.
23 () Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, « Une Vème République plus démocratique, 2007.
24 () Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
25 () Budget opérationnel de programme (BOP) « OPEX », correspondant à l’action n°6 « Surcoûts liés aux opérations extérieures » du programme 178 – Préparation et emploi de forces.
26 () Cette évolution est décrite par une étude des cahiers de l’INSERM : « Le Congrès, acteur essentiel de la politique étrangère et de défense des États-Unis », Maya Kandel, 2012.
27 () « Évolution du contrôle parlementaire des forces armées en Europe », B. Irondelle et al., études de l’IRSEM, 2012 – n°22
28 () La résolution 1973, adoptée le 17 mars 2011, prévoit un zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye et ouvre la possibilité de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger les populations et la zones civiles menacées d’attaque par le régime de Kadhafi.
29 () L'OTAN exploite une flotte de Boeing E-3A Sentry dotés d’un système aéroporté de détection et de contrôle (AWACS) qui apporte à l'Alliance une capacité aéroportée immédiatement disponible de commandement et de contrôle (C2), de surveillance aérienne et maritime, et de gestion de l'espace de bataille. La base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen (Allemagne) abrite 17 avions AWACS. Il s’agit d'un des rares moyens militaires appartenant effectivement à l'OTAN et exploités par elle. Cette flotte exécute un large éventail de missions, qu'il s'agisse de police du ciel, de soutien aux activités de lutte contre le terrorisme, d'opérations d'évacuation, d'embargo, d'entrée en premier et de réponse aux crises.
30 () « When Germany sends troops abroad : the case for a limited reform of the parlimentary participation act », Ekkehard Brose, Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, septembre 2013.
31 () « Coalition contre l’EI, qui participe et comment », Le Monde, 19 février 2015.
32 () M. Jonathan Eyal, directeur des études de sécurité internationale au RUSI, a été rencontré par la mission d’information lors de son déplacement à Londres, le 9 septembre 2014.
33 () « Doctrine de la communauté internationale », discours prononcé par le Premier ministre Tony Blair le 22 avril 1999 à Chicago, qui met en avant le recours à la force armée en réponse à des considérations d'ordre humanitaire, telle la prévention d'un génocide ou d’un « nettoyage ethnique ».
34 () En mai 2000, dans le contexte de la guerre civile sierra léonaise et de l’entrée du « revolutionary united front » (RUF) dans la capitale Freetown, le Royaume-Uni débute une intervention militaire destinée à évacuer les ressortissants britanniques. Le mandat de l’opération est par la suite élargi au renforcement de l’opération des Nations Unies déployée sur le terrain. Elle évolue ensuite en mission de formation et d’accompagnement de l’armée sierra léonaise.
35 () C’est ce qu’il ressort des entretiens effectués par la mission d’information lors de son déplacement à Londres les 9 et 10 septembre 2014.
36 () “La défense britannique : d’où viennent les fragilités? », Grands dossiers de diplomatie n°25, IRIS, 31 mars 2015.
37 () “German policy towards intervention in Libya”, Sarah Brockmeier, Université de Cambridge.
38 () « We can’t look away », Der Spiegel, 28 janvier 2014.
39 () Le groupe Weimar rassemble l’Allemagne, la France et la Pologne.
40 () De la Guerre, Carl von Clausewitz, Livre 1, chapitre 1 : « Qu’est-ce que la guerre ? »
41 () L’expression est empruntée au Général Vincent Desportes, auditionné par la mission d’information le 17 décembre 2013.
42 () Article 5 de la Charte de l’Alliance Atlantique : « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. (…)»
43 () M. Renaud Girard a été auditionné par la mission d’information le 30 septembre 2014.
44 () Livre Blanc sur la sécurité et la défense nationale de 2013, p. 24.
45 () L’EATC est un commandement militaire intégré opérationnel depuis 2010, qui rassemble six pays (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne et bientôt Italie). Il vise à optimiser l’utilisation des flottes de transport stratégique et de ravitaillement en vol.
46 () La mission d’information a rencontré M. Pierre Vimont lors de son déplacement à Bruxelles, le 20 janvier 2015.
47 () « Wars in peace: British military interventions since 1991 », RUSI, 2014.
48 () « Il faut un cadre à nos interventions extérieures », Renaud Girard, Le Figaro, 14 octobre 2014.
49 () M. Étienne de Durand, directeur du Centre des études de sécurité à l’Institut français des relations internationales (IFRI) a été auditionné par la mission d’information le 14 janvier 2014.
50 () L’Amiral Launay a été auditionné par la mission d’information le 18 novembre 2014.
51 () M. Pierre Vimont et l’Amiral de Coriolis ont été rencontrés par la mission d’information dans le cadre d’un déplacement à Bruxelles le 20 janvier 2015.
52 () La Théorie de l’intervention d’humanité, Antoine Rougier, Revue générale du droit international public, 1910.
53 () Commentaries upon international law, Sir Robert Phillimore, 1854.
54 () À la suite des massacres de chrétiens perpétrés par les Druzes dans le Mont-Liban (mars à juillet 1860) et à Damas par des sunnites (9 au 18 juillet), la France, sous la pression des milieux conservateurs, reprend son rôle ancien de protecteur des Chrétiens et intervient, officiellement en appui aux troupes de l’Empire Ottoman pour maintenir l’ordre, en réalité dans un but principalement humanitaire.
55 () Ce point de vue a été exprimé par Mme de Montlaur lors d’un petit-déjeuner organisé par la commission des Affaires étrangères, mercredi 4 février 2015.
56 () « Diplomatie et outil militaire, l’aggiornamento 1992-2015 », Maurice Vaïsse, Revue défense nationale, février 2015.
57 () Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, p.13, 2013.
58 () M. Étienne de Durand, directeur du Centre des études de sécurité à l’IFRI, auditionné par la mission d’information le 14 janvier 2014.
59 () « Les opérations extérieures de la France et l’ONU », Général Dominique Trinquant, cercle de réflexion G2S, août 2014.
60 () G. Garnier, « Les chausse-trapes de la remontée en puissance. Défis et écueils du redressement militaire », IFRI, Focus stratégique n°52, mai 2014.
61 () « 50 ans de dissuasion nucléaire : exigences et pertinence au XXIème siècle », Les cahiers de la Revue Défense nationale, 2015, p.57.
© Assemblée nationale