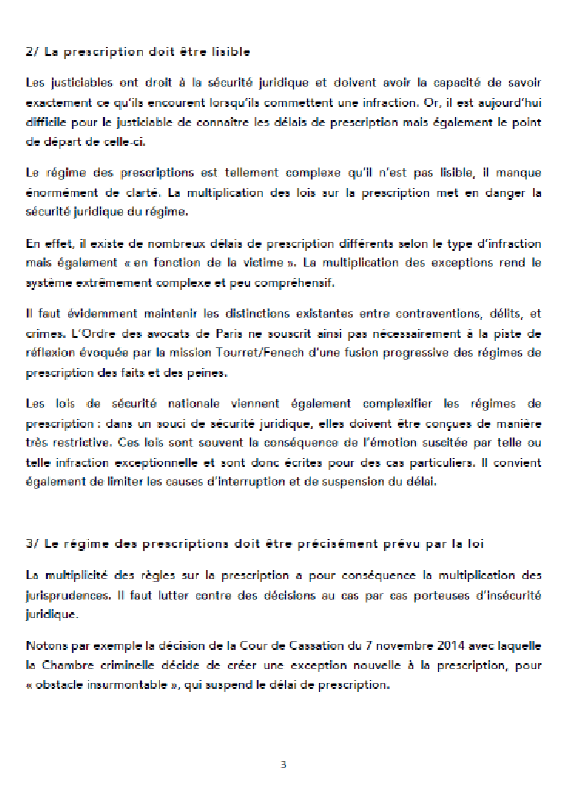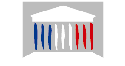
N° 2778
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
en conclusion des travaux d’une mission d’information (1)
sur la prescription en matière pénale
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Alain TOURRET et Georges FENECH
Députés
——
La mission d’information sur la prescription en matière pénale est composée de :
MM. Alain Tourret et Georges Fenech, rapporteurs.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. PILIER DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE, LA PRESCRIPTION EST AUJOURD’HUI RÉGIE PAR DES RÈGLES CONFUSES ET INCOHÉRENTES 11
A. DES FONDEMENTS FRAGILISÉS MAIS BIEN RÉELS 11
1. Des fondements traditionnels de moins en moins admis 11
a. Un « pardon légal » de moins en moins accepté 12
b. Un dépérissement des preuves moins avéré 14
2. La prescription au service de l’effectivité de la réponse pénale 16
a. La prescription ou la sanction de « l’exercice tardif du droit de punir » 16
b. La prescription comme rempart contre les témoignages humains anciens et fragiles 18
c. La prescription comme régulateur de l’action de la justice pénale 20
B. DES RÈGLES DEVENUES DE PLUS EN PLUS COMPLEXES 22
1. La multiplication des délais de prescription dérogatoires au droit commun 22
a. Les infractions imprescriptibles 23
b. Les infractions soumises à des délais de prescription de l’action publique et des peines allongés 27
c. Les infractions soumises à des délais de prescription de l’action publique abrégés 40
2. La diversification des règles de computation du délai de prescription 46
a. La diversité des règles relatives à la fixation du point de départ du délai de prescription 46
b. L’acception jurisprudentielle extensive des motifs d’interruption et de suspension de la prescription 64
II. LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION OU LA RECHERCHE D’UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE RÉPRESSION DES INFRACTIONS ET SÉCURITÉ JURIDIQUE 73
A. UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE 73
1. Des projets de réforme inaboutis 73
a. Des tentatives de réforme de portée générale 73
b. Des tentatives de réforme partielle 76
2. Le choix d’une réforme équilibrée 79
a. La préservation des « régimes spéciaux » applicables à certaines infractions 80
b. Les scénarios écartés par vos rapporteurs 83
B. UN DROIT DE LA PRESCRIPTION PLUS PROTECTEUR DES INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ 89
1. Rationaliser l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription 90
2. Faire des crimes de guerre des infractions imprescriptibles 91
3. Allonger et unifier les délais de prescription de droit commun 96
a. Le doublement du délai de prescription de l’action publique des infractions criminelles 96
b. Le doublement du délai de prescription de l’action publique des infractions délictuelles 101
c. Le doublement du délai de prescription de l’action publique des infractions contraventionnelles 105
4. Adapter les règles de computation des délais de prescription aux exigences de la répression des infractions 107
a. Réaffirmer que le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour de la commission de l’infraction 107
b. Supprimer la règle du report du point de départ de la prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre une personne vulnérable au jour de la révélation des faits 109
c. Maintenir le report du point de départ de la prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre un mineur à la majorité de ce dernier 110
d. Consacrer la jurisprudence relative au report du point de départ de la prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées 111
e. Prévoir dans la loi que la prescription de l’action publique peut être suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites 112
f. Préciser et clarifier les motifs d’interruption de la prescription 113
5. Prévoir de nouvelles modalités d’extinction de l’action publique en cas d’inaction prolongée de l’autorité judiciaire 116
6. Garantir une interprétation stricte des dispositions relatives à la prescription 118
EXAMEN EN COMMISSION 119
LISTE DES PROPOSITIONS 139
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 141
ANNEXE N° 1 : LA PRESCRIPTION EN DROIT COMPARÉ 145
ANNEXE N° 2 : CONTRIBUTIONS ÉCRITES 157
Deux formes de prescription affectent, en droit pénal, l’action de la justice. La première, la prescription de l’action publique, « mode général d’extinction de l’action publique par l’effet de l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction » (2), intervient avant la condamnation définitive. Elle se distingue des autres causes d’extinction de l’action publique mentionnées à l’article 6 du code de procédure pénale – la mort du prévenu, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée – fondées soit sur la disparition de l’auteur présumé de l’infraction, soit sur l’intervention du législateur, soit sur l’action du juge. La seconde, la prescription de la peine, met en échec le droit, pour la puissance publique, d’exécuter à l’expiration d’un certain délai les sanctions définitives prononcées par le juge.
Institution séculaire, ainsi que l’a rappelé le professeur Bernard Bouloc, la prescription est héritée du droit romain et serait apparue pour la première fois sous le règne d’Auguste avec la loi Julia, de adulteriis (18 ou 17 avant Jésus-Christ), qui instaura une prescription de cinq ans pour les delicta carnalia (adultère, déshonneur, inceste, proxénétisme, etc.). Par la suite, les codes romains fixèrent à vingt ou trente ans le délai de prescription de l’action publique et rendirent imprescriptibles les infractions les plus graves, l’hérésie, le parricide ou la substitution d’enfant.
Plus tard, au Moyen Âge, Saint Louis installa la prescription dans notre droit par l’octroi de la Charte d’Aigues-Mortes de 1246. Fait notable, celle-ci posait déjà le principe d’une classification tripartite des délais de prescription selon les distinctions suivantes : « [o]n ne pourra pas enquêter après une période de dix ans au sujet d’un crime (…) contre celui qui aura été présent pendant ces dix ans ou la plus grande partie de ces dix ans ; (…) ni au sujet d’un vol après une période de deux ans ; ni au sujet d’une amende non réglée après une période d’un mois » (3).
La période révolutionnaire vit l’apparition de règles nouvelles édictées par le code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, qui introduisit la notion de prescription des peines – déjà présente, en pratique, dans l’ancien droit – et abaissa sensiblement les délais de prescription de l’action publique, puis du code du 3 Brumaire an IV et, enfin, du code d’instruction criminelle de 1808. Celui-ci fixait, en ses articles 635 à 642, les délais de prescription de l’action publique des crimes, des délits et des contraventions à dix ans, trois ans et un an et les délais de prescription des peines criminelles, délictuelles et contraventionnelles à vingt, cinq et deux ans. Ces dispositions sont toujours en vigueur, sous réserve du délai de prescription des peines applicable aux contraventions désormais fixé à trois ans, et figurent, pour l’action publique, aux articles 7 à 9 du code de procédure pénale (4) et, pour les peines, aux articles 133-2 à 133-4 du code pénal (5).
Les règles de computation des délais sont elles aussi le produit d’une histoire ancienne. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique, établi par le code pénal de 1791 au jour de l’apparition de l’infraction, fut fixé, à compter du code d’instruction criminelle de 1808, au jour de la commission des faits, disposition reprise à l’article 7 du code de procédure pénale. Dès le début du XXe siècle, le juge admit par ailleurs l’interruption du cours de la prescription, principe par la suite inscrit dans la loi.
Simple à l’origine, le droit de la prescription a progressivement perdu de sa clarté en raison du foisonnement des dispositions dérogatoires au droit commun et de l’instabilité du cadre juridique applicable à la détermination du point de départ du délai. C’est ainsi que les exceptions aux règles encadrant la durée des délais – « 1-3-10 » pour l’action publique et « 3-5-20 » pour les peines – et la fixation de leur point de départ se sont multipliées.
Ces évolutions sont le fruit de l’intervention quelque peu erratique du législateur et de l’interprétation prétorienne extensive de textes parfois imprécis et devenus progressivement inadaptés à la répression de certaines infractions. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs tentatives de réforme d’ampleur variable aient vu le jour depuis une vingtaine d’années. Jamais toutefois une réforme globale du droit de la prescription n’est parvenue à apporter des réponses satisfaisantes à ces préoccupations.
C’est dans ce contexte, et alors même que les fondements traditionnels de la prescription sont de moins en moins admis par la société, que notre Commission a créé, lors de sa réunion du 10 décembre 2014, une mission d’information chargée de réfléchir à la question de la prescription pénale et de formuler des propositions destinées à aménager le cadre juridique en vigueur. Cette initiative est apparue d’autant plus justifiée qu’au même moment, la matière était bouleversée par un arrêt de principe relatif à la prescription d’une série d’infanticides (le meurtre de huit nouveau-nés), rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 novembre 2014 (6).
Sur proposition de son président, la Commission a décidé de confier cette mission à vos rapporteurs, appartenant pour l’un à la majorité, pour l’autre à l’opposition, qui avaient précédemment conduit les travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales (7) dont les conclusions avaient largement inspiré la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.
Grâce au temps dont ils ont disposé, vos rapporteurs ont procédé à une quarantaine d’auditions regroupant plus de soixante-dix personnes d’horizons variés : des universitaires, des magistrats à la Cour de cassation, des représentants des conférences et associations des magistrats du siège et du parquet, des représentants de l’Ordre des avocats, des associations d’aide aux victimes, des professionnels du secteur de la presse ainsi qu’un certain nombre de personnalités qualifiées. Vos rapporteurs tiennent à souligner la qualité des échanges qu’ils ont eus avec l’ensemble des personnes entendues, qu’ils remercient vivement pour leurs observations et propositions. Ils ont d’ailleurs souhaité annexer au présent rapport leurs contributions écrites dont ils saluent la richesse et le caractère très constructif (8).
Au terme de plusieurs mois de réflexion, vos rapporteurs sont plus que jamais convaincus de la nécessité de procéder à une réforme globale du droit de la prescription. Mais ils sont bien conscients que cette réforme devra tenir pleinement compte de la grande complexité de la matière. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas hésité à écarter certaines pistes, en apparence séduisantes mais sans doute peu réalistes, et ont privilégié des solutions plus pragmatiques.
Après avoir dressé le bilan du droit existant (I), ils formulent ainsi quatorze propositions destinées à redonner à ce pan de notre droit la lisibilité et la cohérence qui lui font aujourd’hui défaut et à assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique (II).
I. PILIER DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE, LA PRESCRIPTION EST AUJOURD’HUI RÉGIE PAR DES RÈGLES CONFUSES ET INCOHÉRENTES
La prescription constitue, depuis plusieurs siècles, l’une des clés de voûte de notre système judiciaire. Si elle demeure acceptée dans son principe, certains de ses fondements traditionnels apparaissent aujourd’hui en partie remis en question (A). Mais, au-delà des débats sur le principe même de la prescription, l’essentiel des interrogations porte sur la pertinence du cadre juridique actuel, caractérisé par des règles nombreuses, confuses et complexes (B).
A. DES FONDEMENTS FRAGILISÉS MAIS BIEN RÉELS
Interrogée dans ses fondements historiques (1), la prescription n’en conserve pas moins de solides justifications : elle sert l’effectivité de la réponse pénale et permet, in fine, la conciliation de plusieurs exigences fondamentales de notre système judiciaire (2).
1. Des fondements traditionnels de moins en moins admis
Il a été historiquement défendu que la prescription de l’action publique et des peines reposait sur l’œuvre du temps, qui réduirait l’intensité du dommage causé à l’ordre social par le coupable et, partant, la nécessité de le sanctionner. Selon cette théorie, la société aurait intérêt à oublier l’infraction passé un certain délai, plutôt que d’en attiser le souvenir en la réprimant tardivement. Le juriste et philosophe des Lumières, Cesare Beccaria, pourtant fermement opposé à l’idée de prescription pour les crimes les plus graves, considérait lui-même que, pour les « délits ignorés et peu considérables (…) il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments » car « l’obscurité qui a enveloppé longtemps le délit diminue de beaucoup la nécessité de l’exemple, et permet de rendre au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir meilleur » (9).
Aujourd’hui, les fondements traditionnels de la prescription tels qu’ils ont été développés par la doctrine pénaliste à partir du XVIIIe siècle autour de la théorie du « pardon légal » (a) et du dépérissement des preuves (b) sont devenus partiellement obsolètes et méritent donc d’être relativisés.
a. Un « pardon légal » de moins en moins accepté
Premier fondement traditionnel de la prescription, la « grande loi de l’oubli » commanderait à la société d’oublier les infractions commises dans le passé afin de préserver la paix et la tranquillité sociales car le trouble causé par celles-ci s’apaiserait progressivement avec le temps. D’après M. Alexis Mihman, auteur d’une thèse consacrée à l’étude du temps dans la procédure pénale (10), il s’agit du principal fondement retenu au moment de l’élaboration, en 1808, du code d’instruction criminelle, repris par le code de procédure pénale de 1958 (11). Cette présomption d’oubli, qui s’applique aussi bien à l’action publique qu’aux peines, commanderait de renoncer à mettre à exécution une décision pénale trop ancienne, l’efficacité de la justice procédant en grande partie de la célérité avec laquelle elle fait exécuter ses décisions.
Le deuxième fondement traditionnel de la prescription, étroitement lié au premier, repose sur l’idée que le temps qui passe aurait profondément modifié la personnalité et le comportement du coupable présumé (12), en lui permettant de se repentir d’avoir mal agi et de s’amender. Le temps qui passe le soumettrait également à d’incessants remords et d’interminables angoisses liées à la peur d’être condamné. La souffrance du coupable constituerait en quelque sorte un succédané de la peine qu’il aurait dû purger s’il s’était livré à la justice. Ce fondement traditionnel, qui vaut pour l’exercice des poursuites, justifie également la prescription des peines puisque le condamné qui échappe à sa peine aurait intérêt à ne plus faire parler de lui.
Cette forme de « pardon légal » est aujourd’hui discutée et parfois critiquée par la doctrine. À titre d’exemple, M. Jean-François Renucci, professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, s’interroge en ces termes : « comment admettre l’oubli dès lors que la victime réclame réparation, même si cette demande est tardive ? Les remords sont-ils vraiment une réalité, en particulier pour les délinquants qui sont enracinés dans la marginalité ? D’autre part, on peut se demander si la prescription ne risque pas d’être ressentie comme un encouragement à la récidive. (...) Le danger peut être toujours présent, de sorte que du point de vue de l’utilité sociale et de la défense de la société, la prescription de l’action publique n’est pas à l’abri de la critique » (13).
La plupart des personnes entendues par vos rapporteurs ont également constaté le déclin de ces deux fondements ; sans remettre en cause le principe même de la prescription, elles se sont interrogées sur la pertinence de ses délais. Pour l’Union syndicale des magistrats, « le dogme fondateur de la prescription, selon lequel la tranquillité publique serait troublée par des poursuites tardives, est largement remis en question, voire inversé, le bénéfice de ce droit à l’oubli [n’étant] plus admis, le temps n’atténuant pas le danger que les délinquants représentent pour la société » ; au contraire, « l’impunité peut renforcer la détermination criminelle de certains auteurs » (14). MM. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, et Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes et maître de conférences à l’Université de Nantes, ont estimé que la « grande loi de l’oubli », « loi sociale ou sociologique un peu vague », n’apparaissait plus « dans notre société, tout à la fois société médiatique et de mémoire, comme une loi sociale si évidente qu’elle puisse fonder la prescription de l’action publique » (15).
Vos rapporteurs considèrent eux aussi que les justifications traditionnellement apportées au bien-fondé la prescription méritent d’être relativisées et discutées. À leurs yeux, la prescription ne saurait faire échapper les délinquants ou les criminels à la justice et encore moins les faire bénéficier d’une quelconque impunité. Au contraire, vos rapporteurs souhaitent que ses fondements tiennent compte de l’évolution qu’a subie depuis plusieurs décennies la conception de l’ordre public sous l’effet de trois phénomènes mis en lumière par M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, dans sa contribution écrite :
–– en premier lieu, alors que jusqu’au milieu du XXe siècle, la faiblesse des appareils policier et judiciaire conduisait à rechercher davantage l’exemplarité immédiate, on requiert aujourd’hui de la justice « la systématisation de la réponse pénale » ;
–– en deuxième lieu, « la sensibilité de la société à certains crimes et délits n’a plus rien à voir avec ce que l’on connaissait auparavant compte tenu (…) de la primauté donnée à l’individu et à la protection de son intégrité » et des effets de la médiatisation et de l’internet sur le sentiment de proximité et la réactivité de l’État et des juges en matière de répression ;
–– en dernier lieu, « la mise à l’écart de la victime, sauf à des fins indemnitaires, a laissé la place à une victime sujette de droits qui, au plan individuel ou par le biais associatif, met en cause le monopole de fait reconnu au ministère public, y compris quant à l’engagement des poursuites ». Ce dernier phénomène a conduit certains observateurs de l’institution judiciaire à considérer qu’« au nom d’un devoir de mémoire envers les victimes, une " volonté de punir " envahit les sociétés démocratiques » (16).
b. Un dépérissement des preuves moins avéré
Cela est d’autant plus nécessaire que le troisième fondement traditionnellement donné à la prescription de l’action publique, le dépérissement des preuves, est lui aussi devenu moins pertinent en raison de l’essor des preuves scientifiques. S’il est indiscutable qu’avec le temps, les éléments susceptibles de prouver la culpabilité ou l’innocence d’une personne s’estompent, les progrès scientifiques et le développement de nouvelles techniques d’investigation permettent désormais de faire progresser les enquêtes pénales parfois plusieurs années après la commission des faits.
Vos rapporteurs ont procédé à l’audition de plusieurs représentants des services de police technique et scientifique qui, sans remettre en cause le principe même du dépérissement des preuves, en ont fortement relativisé la portée. Pour le colonel François Daoust, directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), « les progrès technico-scientifiques permettent de constater que dans de nombreux domaines, la recherche d’un résultat scientifique robuste et déterminant est possible au-delà des délais de prescription de l’action publique en matière de crime », ce qui montre « que le dépérissement des preuves ne peut plus être considéré comme un des fondements participant à la justification du délai de prescription de l’action publique » (17).
La professionnalisation du personnel qui intervient sur les scènes de crime, l’utilisation de kits spéciaux pour le prélèvement de traces biologiques et le perfectionnement de l’exploitation des éléments prélevés permettent de disposer de moyens de preuve fiables sur une plus longue durée. Comme l’a indiqué à vos rapporteurs M. Frédéric Dupuch, directeur de l’Institut national de police scientifique (INPS), les empreintes digitales et le profil génétique d’un individu ne changent pas avec le temps, les techniques utilisées pour recueillir et exploiter les traces papillaires et l’ADN ont considérablement évolué, permettant « d’exploiter non seulement des traces " riches " (sang, sperme, salive), mais aussi des traces faibles, pauvres en ADN, et de l’ADN dégradé (…) notamment des " traces de contact " issues de seuls frottements ou touchers ». Qui plus est, « des progrès encore plus considérables sont attendus à un horizon assez proche » (18).
Ces dernières années ont également été marquées par une relative amélioration des conditions de conservation des scellés criminels. Rappelons que la destruction des scellés intervient en principe « six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence » (19). Ce délai est porté à cinq ans pour les enregistrements des auditions de mineurs (20) et des personnes placées en garde à vue pour des faits criminels (21) ou – disposition introduite à l’initiative de vos rapporteurs – lorsque la personne définitivement condamnée par une cour d’assises s’est opposée à leur destruction (22), et à vingt-cinq ou quarante ans pour les prélèvements biologiques (23). Le 16 mars 2011, une dépêche du ministère de la justice relative aux délais de conservation des scellés invitait les parquets à conserver les scellés des affaires les plus sensibles ; en outre, une circulaire du 13 décembre 2011rappelait aux juridictions que, « compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués, à l’issue d’un délai de six mois, peut être de nature à faire obstacle à la réouverture et la résolution d’affaires qui n’ont pu être élucidées » (24) et les encourageait à rationaliser leur gestion par l’aménagement de locaux sécurisés et adaptés à leur conservation. La plupart d’entre eux sont conservés soit au sein des greffes des tribunaux, soit dans des établissements adaptés à leur nature, leur dangerosité ou leur volume (25).
Dans plusieurs affaires, les progrès réalisés dans le recueil, l’exploitation et la conservation des preuves digitales et génétiques mais aussi de nature olfactive et acoustique ont permis l’identification tardive de suspects. Ainsi, dans l’« affaire Roussel », à la demande de la famille de Delphine Roussel, disparue à l’âge de dix-neuf ans le 17 mai 1994 et découverte étranglée six jours plus tard, une empreinte génétique a été pour la première fois relevée sur les sous-vêtements de la victime en 2009, permettant l’établissement d’un profil génétique rapproché par le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en 2010 de celui d’Éric G., condamné quelques années plus tard à la réclusion criminelle à perpétuité (26).
Ces évolutions, conjuguées à l’allongement de l’espérance de vie et à la modification des valeurs protégées socialement, expliquent que la société, le juge et le législateur « admet[tent] moins qu’auparavant l’oubli des infractions passées » (27), en tout cas un oubli trop rapide, en particulier pour les infractions les plus graves. Sans être totalement condamnée, la prescription semble de plus en plus perçue « comme un abandon par la justice de ses devoirs, un signe d’indifférence, le déni d’une reconnaissance des victimes, un manquement à un devoir de mémoire » (28).
Pour la Conférence nationale des procureurs généraux, « [l]a force des fondements historiques, moraliste et social, du principe de prescription s’est sans doute atténuée » (29), générant, d’après le premier président de la Cour de cassation, M. Bertrand Louvel, « le sentiment d’un divorce entre cette institution permettant au délinquant d’échapper à une poursuite ou à sa peine, et l’honnête homme chez qui la prescription paraît heurter le sens inné d’une justice voulant que le coupable réponde de ses actes » (30).
2. La prescription au service de l’effectivité de la réponse pénale
S’il est vrai que certains fondements de la prescription sont aujourd’hui fragilisés et semblent avoir perdu de leur force symbolique, d’autres conservent leur validité. Ainsi la prescription continue-t-elle de reposer sur de solides fondements – anciens pour certains – et demeure-t-elle, à ce titre, un pilier de notre système judiciaire.
a. La prescription ou la sanction de « l’exercice tardif du droit de punir »
Tout d’abord et conformément à une idée déjà ancienne, la prescription serait la sanction de l’inaction de l’autorité judiciaire ou, pour reprendre les mots du procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Claude Marin, « la sanction naturelle de l’inertie voire de la carence des personnes et autorités en charge de la poursuite, de la recherche de la vérité ou de l’exécution de la peine » (31). C’est aussi l’idée que Mme Dominique Noëlle Commaret, ancienne avocate générale à la Cour de cassation, développait dans un article paru en 2004 : « parce que tout temps mort excessif laisse présumer le désintérêt de la victime ou du ministère public et leur renoncement, dans un système marqué par le principe d’opportunité des poursuites, la prescription apparaît nettement comme la réponse procédurale apportée à l’inaction ou l’oubli, volontaire ou involontaire. Elle sanctionne le désintérêt lorsqu’il devient manifeste et en signifie l’irréversibilité » (32).
Cette conception mérite cependant d’être nuancée. Ainsi, vos rapporteurs estiment, à l’instar de M. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes et maître de conférences à l’Université de Nantes, que la prescription de l’action publique ne saurait être raisonnablement considérée comme la sanction de l’inaction de l’autorité judiciaire ou des victimes qu’à la condition que ces dernières aient été en mesure d’agir parce qu’elles avaient connaissance de l’infraction. Elle serait donc la « sanction d’un exercice tardif du droit de punir » (33), une fois les poursuites déclenchées, plutôt que la sanction aveugle de la négligence des personnes susceptibles d’engager, directement ou indirectement, des poursuites. La prescription trouverait ici une justification plus contemporaine mais non moins solide : elle serait la traduction du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi que l’ont souligné nombre de personnes entendues par vos rapporteurs.
Ce droit, prévu à l’article 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies, garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ou encore par le deuxième alinéa de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir l’encadré ci-après), figure également dans notre corpus juridique interne. En effet, le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale impose qu’il soit « définitivement statué sur l’accusation dont [une] personne fait l’objet dans un délai raisonnable » tandis que l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « [l]es décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable ».
Le droit à être jugé dans un délai raisonnable : un principe
largement reconnu par le droit international
Article 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies
« Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. »
Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
Le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui impose à l’autorité judiciaire de faire preuve de célérité dès lors qu’une personne a été appréhendée, ne justifie cependant pas, en lui-même, l’établissement de dispositions écrites consacrées à la prescription. Soutenir le contraire reviendrait d’ailleurs à considérer que ce droit ne serait pas garanti dans les pays ne disposant pas de règles écrites en la matière, ce qui, à l’évidence, constituerait un raccourci erroné.
En définitive, si, pour vos rapporteurs, il est parfaitement justifié que la prescription sanctionne, au-delà d’un certain délai, l’inaction de l’autorité judiciaire, qu’elle ait délibérément refusé d’agir ou que la victime ait fait le choix de ne pas la saisir, il semble plus difficile d’admettre que tel puisse être le cas si l’infraction est demeurée dissimulée. Il n’est donc guère surprenant que le juge se soit efforcé de dégager des solutions de nature à éviter que le temps ne bénéficie à celui qui aurait délibérément et habilement caché son forfait. Vos rapporteurs reviendront plus loin sur ce point (34).
L’inaction de l’autorité publique justifie également la prescription de la peine. En effet, il faut admettre que l’absence de mise à exécution d’une sanction pénale prononcée définitivement par une juridiction puisse conduire, dès lors qu’un délai déterminé s’est écoulé, à l’impossibilité pure et simple de la mettre à exécution. Naturellement, vos rapporteurs souhaitent que tous les moyens disponibles soient mobilisés en faveur de la mise à exécution rapide des peines, en particulier des peines de prison. Mais ils reconnaissent que la mise à exécution tardive, voire très tardive, des sanctions de nature carcérale n’est guère satisfaisante. Aussi la prescription est-elle ici justifiée par la nécessité de prévenir l’exécution d’une peine dénuée de sens, tant pour la personne condamnée que pour la société tout entière.
b. La prescription comme rempart contre les témoignages humains anciens et fragiles
S’il ne fait guère de doute, comme vos rapporteurs l’ont précédemment indiqué, que les progrès de la police technique et scientifique battent en brèche l’idée selon laquelle la prescription de l’action publique serait justifiée par le dépérissement progressif des preuves, il n’en demeure pas moins que les témoignages humains demeurent, eux, fragiles et périssables. Ainsi, le procureur général près la Cour de cassation expliquait, dans sa contribution écrite, que le « dépérissement des preuves et le risque d’erreur judiciaire qui y serait attaché sont (…) souvent présentés aujourd’hui comme une des justifications les plus solides de la prescription ». Les représentants de la Conférence nationale des procureurs généraux soulignaient de leur côté que, « si les évolutions de la preuve scientifique ont bien évidemment renouvelé les possibilités de voir élucidés des faits anciens, la pratique montre que, dans bien des domaines, le temps qui passe génère un dépérissement réel des preuves, une perte des témoignages, qui conduit ainsi le ministère public à constater le caractère non caractérisé de l’infraction dénoncée » (35). Enfin, M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale (CPI), a expliqué qu’il avait pu mesurer, grâce à cette dernière fonction notamment, la fragilité des témoignages qui, au fur et à mesure que le temps passe, « s’appauvrissent souvent et deviennent très approximatifs mais (…) s’enrichissent aussi et se nourrissent des récits qui circulent et des conversations échangées » (36).
Aussi la prescription permettrait-elle de prévenir le caractère inéquitable du procès qui se tiendrait trop longtemps après la commission des faits. Nombre de personnes entendues par vos rapporteurs ont insisté sur ce point. D’après les représentants du Conseil national des barreaux (CNB), le temps qui s’écoule jouerait en défaveur de la personne mise en cause, en raison de la disparition progressive des témoignages à décharge. À cet égard, il est intéressant de noter que, dans un arrêt du 22 octobre 1996, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelait que les « délais [de prescription] ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé » (37).
Si la prévention de l’iniquité du procès semble jouer davantage en faveur du coupable présumé que de la victime, il serait sans doute erroné de considérer que cette dernière aurait nécessairement intérêt à ce que le procès ait lieu, même fort longtemps après la commission des faits. Des plaintes déposées tardivement comportent en effet le risque de ne pas aboutir, soit que le ministère public décide de ne pas déclencher de poursuites, soit que la personne mise en cause bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement. La déception de la victime peut alors être grande et le ressentiment à l’égard de l’autorité judiciaire réel. C’est d’ailleurs ce que soulignait avec force le Syndicat de la magistrature dans un document remis à vos rapporteurs : « [l]’argument fort des partisans de l’allongement, voire de la suppression de la prescription est celui qui repose sur la prise en compte des victimes. Ils insistent sur la dimension thérapeutique du procès, qui permettrait seul à la victime de faire son deuil du traumatisme causé par l’infraction.
« C’est oublier, d’abord, que le procès qui se termine par un acquittement ou une relaxe ʺ au bénéfice du doute ʺ en raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves est d’une très grande violence pour la victime. Elle vit ces décisions comme une négation de sa parole et ce, alors qu’elle a supporté la réactivation de son traumatisme et, parfois, le mépris renouvelé de la personne mise en cause tout au long de l’enquête et du procès.
« Même en cas de déclaration de culpabilité, le procès qui intervient trop longtemps après les faits ne peut se terminer que par une ʺ peine symbolique ʺ. Il ne pourra donc apaiser les souffrances de la victime, car si la société démocratique admet et réclame l’individualisation des peines, la victime ne peut la supporter » (38).
Par conséquent, la prescription serait aussi, d’une certaine manière, un moyen de prévenir la souffrance des victimes, ainsi que l’ont notamment reconnu Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, et M. Alain Boulay, président de l’association Aide aux parents d’enfants victimes (APEV), même si cette position n’a pas fait l’unanimité parmi les associations d’aide aux victimes entendues par vos rapporteurs.
c. La prescription comme régulateur de l’action de la justice pénale
La prescription participerait enfin de la régulation de l’action de la justice pénale. Peut-on en effet imaginer que des poursuites puissent être engagées, à tout moment, dans le but de réprimer l’ensemble des infractions, indépendamment de leur degré de gravité ? Notre système judiciaire dispose-t-il seulement de la capacité de poursuivre indéfiniment l’ensemble des affaires portées à sa connaissance ? À l’évidence et à la lumière des remarques formulées notamment par les représentants de la Conférence des premiers présidents de cour d’appel, répondre par l’affirmative à ces deux questions serait faire preuve de naïveté.
Notre justice souffre en effet d’une insuffisance structurelle de moyens humains et matériels. À cet égard, le rapport sur la refondation du ministère public de la commission de modernisation de l’action publique, présidée par M. Jean-Louis Nadal, rappelait que « la Commission européenne pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ) [plaçait] la France, avec un budget annuel hors aide juridictionnelle consacré à la justice de 0,18 % du PIB, au 40ème rang sur 47 pays expertisés, la moyenne européenne étant de 0,32 % » (39). D’après le « rapport Nadal », notre pays comptait, en 2010, trois procureurs pour 100 000 habitants alors que dans l’ensemble des pays étudiés par la CEPEJ, il y en avait onze pour 100 000 habitants en moyenne (40). De même, les magistrats du siège sont proportionnellement moins nombreux en France que dans les autres États européens.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que le nombre des affaires traitées par notre système judiciaire ne puisse pas croître démesurément. Certes, le ministère public dispose de la faculté d’apprécier la suite à donner à chacune des plaintes et des dénonciations qui lui parviennent, en application du premier alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, pour vos rapporteurs, la prescription doit jouer, elle aussi, comme un mécanisme de régulation du stock des affaires pénales.
Cette position se justifie, d’une part, par la situation de nos finances publiques. En effet, en dépit de l’augmentation, au cours des dernières années, du nombre de policiers, de gendarmes et de magistrats, la contrainte budgétaire actuelle empêche toute perspective de recrutements massifs dans les services de police et de gendarmerie ainsi qu’au sein des juridictions. Dans ce contexte, renoncer à la prescription serait irréaliste. Pire, cela risquerait de placer la justice dans l’impossibilité de satisfaire les attentes de nos concitoyens et d’écorner davantage encore la crédibilité de notre système judiciaire.
Elle se justifie, d’autre part et peut-être plus encore, par des considérations de bonne gestion de politique pénale. Ainsi, s’il ne fait pas de doute, comme vos rapporteurs l’ont déjà souligné, que notre société est de plus en plus hermétique à l’idée qu’il existerait une quelconque « loi de l’oubli », il n’en reste pas moins vrai que le trouble à l’ordre public causé par une infraction diminue au fur et à mesure que le temps passe et disparaît même parfois entièrement. Il est donc légitime que l’action de l’autorité judiciaire soit guidée par la nécessité de répondre en priorité aux troubles les plus récents et les plus graves à l’ordre public. C’est ce que M. Jean Danet expliquait en ces termes dans sa contribution écrite : « une bonne administration de la preuve nécessite (…) de facto une sélection des dossiers sur lesquels la police et la justice travaillent. Que cette sélection passe par le critère du temps qui s’est écoulé depuis la commission ou la découverte de l’infraction n’est pas choquant bien au contraire. Ce critère a l’avantage d’être général à gravité équivalente d’infraction. Il renvoie à la présomption, relative certes, mais bel et bien réelle de ce que le trouble à l’ordre public est plus vif sitôt les faits que longtemps après » (41).
Même dans les pays de common law, où les règles de prescription sont généralement moins développées que dans les pays de droit romano-germanique, le juge peut renoncer à poursuivre une infraction trop ancienne. C’est bien la preuve que l’imprescriptibilité généralisée est un leurre. D’ailleurs, quand bien même aurions-nous les moyens de poursuivre sans limitation dans le temps l’ensemble des infractions portées à la connaissance de la justice qu’il serait sans doute nécessaire de s’interroger sur la pertinence d’un tel système. La prescription a donc cette vertu qu’elle sanctionne, au plan juridique, le renoncement à l’exercice des poursuites lorsque la « vengeance sociale et l’expiation apparaissent inutiles » (42).
En définitive, même si certains de ses fondements apparaissent fragilisés, la prescription permet aujourd’hui avant tout de concilier plusieurs exigences :
–– le droit, pour la société tout entière, à la sécurité et l’obligation, pour les systèmes policier et judiciaire, de consacrer leurs moyens, en priorité, à la poursuite des infractions troublant gravement et durablement l’ordre public ;
–– le droit, pour la victime, d’obtenir réparation et celui, pour la personne mise en cause, à être jugée de façon équitable, dans un délai raisonnable ;
–– la nécessité, à travers la mise à exécution des sanctions pénales, de punir le coupable et de protéger le corps social et celle de promouvoir la réinsertion des personnes condamnées, par le renoncement aux peines trop anciennes, dépourvues de caractère éducatif et de véritable sens.
B. DES RÈGLES DEVENUES DE PLUS EN PLUS COMPLEXES
Si les dispositions encadrant la prescription de l’action publique apparaissent, à la seule lecture des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, claires et non équivoques, la multiplication des délais dérogatoires au droit commun (1) et l’hétérogénéité des règles relatives à la détermination du point de départ du délai (2) ont progressivement fait d’une matière relativement simple une matière complexe et confuse, à tel point que le procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Claude Marin, a pu parler de « chaos » pour décrire la situation. Aussi est-il apparu nécessaire de revenir, sans prétendre à l’exhaustivité, sur les différentes manifestations de cet incontestable « désordre », pour reprendre le mot de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice (43).
1. La multiplication des délais de prescription dérogatoires au droit commun
Le temps où le régime de la prescription obéissait à des dispositions claires est désormais révolu. En effet, comment ne pas reconnaître, à l’instar de M. Jean Danet, que « la belle ordonnance des délais de prescription de l’action publique posée en 1808, adossée sur la classification tripartite des infractions subit une remise en cause de plus en plus nette » (44) ? C’est aussi le constat qu’ont dressé l’ensemble des personnes entendues par vos rapporteurs, lesquelles ont très largement insisté sur l’illisibilité et la complexité de ce pan de notre droit.
Assurément, le législateur détient une part de responsabilité dans la segmentation progressive des règles de prescription de l’action publique et des peines. À plusieurs reprises, il a fait le choix d’appliquer à certaines infractions un délai de prescription allongé, marquant ainsi sa réprobation pour des faits qu’il considérait comme d’une particulière gravité tout en offrant aux victimes la possibilité « d’obtenir justice sans se faire opposer un délai de prescription trop court » (45). Mais il a aussi, à l’inverse, prévu des délais de prescription abrégés dans certains cas. C’est donc à raison que M. Jean Danet pouvait constater, dans un article paru en 2006, la dissolution de « la règle du 1-3-10 » (46).
Après avoir fait état du cas exceptionnel des infractions imprescriptibles (a), vos rapporteurs présenteront successivement les infractions soumises à des délais de prescription allongés (b) ou abrégés (c).
a. Les infractions imprescriptibles
La première des exceptions aux règles de droit commun de la prescription et, davantage encore, au principe même de la prescription, réside dans la reconnaissance de crimes imprescriptibles.
C’est la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité qui, la première, introduisit ce principe dans notre corpus législatif. Son article unique disposait ainsi que « [l]es crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 (47), sont imprescriptibles par leur nature ». Rappelons que d’après la Cour de cassation, « la loi du 26 décembre 1964, en " constatant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ", s’est bornée à confirmer qu’était déjà acquise en droit interne, par l’effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l’intégration " à la fois de l’incrimination (…) et de l’imprescriptibilité de ces faits " » (48).
Désormais, le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale précise que la règle selon laquelle l’action publique des crimes se prescrit par dix années révolues s’applique sous réserve de l’article 213-5 du code pénal, aux termes duquel l’action publique comme les peines des crimes contre l’humanité, réprimés par le sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, sont imprescriptibles. De manière notable et comme le faisaient remarquer fort justement les rapporteurs de la mission d’information sénatoriale sur le régime des prescriptions civiles et pénales, l’article 213-5 ne renvoie pas, à l’inverse de la loi du 26 décembre 1964, « à la définition retenue dans la charte du tribunal international du 8 août 1945 afin de marquer sans ambiguïté que le ʺ droit de Nüremberg ʺ est ʺ un droit du passé comme un droit de l’avenir, c’est un droit naturel qui possède la dimension spatio-temporelle d’un droit international universellement reconnu, à la mesure des crimes dont il assure la protection ʺ » (49).
En l’état actuel du droit, sont des crimes contre l’humanité :
–– le génocide (50), que l’article 211-1 du code pénal définit comme « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
« – atteinte volontaire à la vie ;
« – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
« – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
« – mesures visant à entraver les naissances ;
« – transfert forcé d’enfants. » ;
–– la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, prévue à l’article 211-2, lorsqu’elle a été suivie d’effet (51) ;
–– les actes mentionnés à l’article 212-1 commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique (52), à savoir :
« 1° L’atteinte volontaire à la vie ;
« 2° L’extermination ;
« 3° La réduction en esclavage ;
« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
« 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
« 6° La torture ;
« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
« 9° La disparition forcée ;
« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. » ;
–– les actes visés à l’article 212-1 « [l]orsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité », en application de l’article 212-2 (53) ;
–– la participation « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 », en application de l’article 212-3 (54).
Les crimes contre l’humanité sont aujourd’hui les seules infractions imprescriptibles même si tel n’a pas toujours été le cas. En effet, le second alinéa de l’article 94 de l’ancien code de justice militaire prévoyait que l’action publique ne se prescrivait pas dans les cas visés aux articles 408 (désertion à bande armée), 409 (désertion à l’ennemi de tout militaire ou de tout individu non militaire faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire ou d’un navire de commerce convoyé) et 410 (désertion en présence de l’ennemi). De même, l’imprescriptibilité de l’action publique était la règle « lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’[était] réfugié ou [était] resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires ».
Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire ; à présent, les règles de prescription de droit commun s’appliquent aux infractions militaires (voir l’encadré ci-après).
Extraits du code de justice militaire (nouveau)
Dispositions relatives à la prescription de l’action publique applicables
en temps de paix et hors du territoire de la République
Article L. 211-12
« Les modes d’extinction de l’action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l’article L. 211-13. »
Article L. 211-13
« La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur a atteint l’âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire. »
Dispositions relatives à la prescription de l’action publique
applicables en temps de guerre
Article L. 212-37
« En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
« S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
« Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de sa majorité. »
Article L. 212-38
« En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article L. 212-37. »
Article L. 212-39
« En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article L. 212-37. »
Article L. 212-40
« Les dispositions de l’article L. 211-13 relatives à la prescription de l’action publique de l’insoumission et de la désertion sont applicables. »
Dispositions relatives à la prescription des peines
Article L. 267-1
« Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal sous réserve des dispositions de l’article L. 267-2. »
Article L. 267-2
« La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur a atteint l’âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire. »
Toutes les personnes entendues par vos rapporteurs ont fait part de leur attachement au caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité, lesquels portent atteinte à l’espèce humaine tout entière et ne sauraient donc être oubliés. Comment, en effet, imaginer que les responsables des faits les plus atroces, les auteurs des grands crimes du XXe siècle, « qui ont laissé leur empreinte traumatique dans les cœurs et sur les corps » (55), puissent se soustraire à la justice et ne pas répondre de leurs actes ?
Certaines voix s’élèvent cependant pour réclamer l’extension du régime de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines à d’autres crimes particulièrement graves. Vos rapporteurs reviendront plus loin sur la solution qu’ils entendent réserver à ces propositions (56).
b. Les infractions soumises à des délais de prescription de l’action publique et des peines allongés
À côté des crimes contre l’humanité, qui ne sont régis par aucun délai de prescription, d’autres infractions, de plus en plus nombreuses, sont soumises à des délais de prescription de l’action publique et des peines allongés. C’est le cas de certaines infractions commises sur les mineurs (i), des actes de terrorisme (ii), des infractions à la législation sur les stupéfiants (iii) et de plusieurs autres infractions considérées comme d’une particulière gravité (iv).
i. Les infractions commises sur les mineurs
Les évolutions successives des dispositions relatives à la prescription de l’action publique de certaines infractions commises sur les mineurs constituent peut-être l’illustration la plus probante de l’instabilité du droit de la prescription. Pas moins de sept lois ont en effet modifié, depuis 1989, le régime de la prescription de ces infractions, ainsi que l’a rappelé, lors de son audition, Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice. Vos rapporteurs aborderont plus loin la question de la détermination du point de départ du délai de prescription (57) et s’en tiendront, à ce stade, aux évolutions portant sur les seuls délais.
Tout d’abord, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a porté de trois à dix ans le délai de prescription des délits d’agressions sexuelles aggravées autres que le viol commises sur un mineur de quinze ans (par exemple, avec usage ou menace d’une arme) et d’atteintes sexuelles aggravées sur un mineur de quinze ans (notamment, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime).
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu l’application du délai de prescription de dix ans au délit de traite des êtres humains commis à l’encontre d’un mineur.
Puis, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a en partie réécrit les articles 7 et 8 du code de procédure pénale afin de prévoir que :
–– serait porté à dix ans le délai de prescription des seuls délits mentionnés alors à l’article 706-47 du code de procédure pénale : agressions et atteintes sexuelles commises sur un mineur, recours à la prostitution d’un mineur ou encore corruption d’un mineur (58) ;
–– serait porté à vingt ans le délai de prescription des délits d’agressions sexuelles aggravées autres que le viol commises sur un mineur de quinze ans et d’atteintes sexuelles aggravées sur un mineur de quinze ans, auparavant fixé à dix ans ;
–– serait fixé à vingt ans le délai de prescription des crimes également mentionnés à l’article 706-47 et commis sur un mineur : viol, meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie.
À l’occasion des débats à l’Assemblée nationale, en première lecture, le député Gérard Léonard, à l’origine de l’amendement prévoyant l’allongement de ces délais (59), justifiait sa position en ces termes : « [c]haque année, des centaines d’enfants sont victimes de crimes sexuels. La peur, la culpabilité de n’avoir pas su résister à leurs agresseurs ou encore l’affection qu’ils portent parfois aux auteurs de ces abus les empêchent de dénoncer les violences dont ils ont été victimes dans les délais de prescription actuels, fixés à dix ans à compter de leur majorité. Or, c’est souvent quelques années après l’expiration de cette prescription, lorsque l’enfant devenu adulte cherche à construire une vie affective, que la dénonciation des faits devient vitale. L’ensemble des psychologues s’accordent pour reconnaître que l’arrivée du premier enfant, qui survient aujourd’hui en moyenne aux alentours de trente ans pour les femmes, est un moment charnière qui contribue à faire émerger des événements de l’enfance que l’on a souhaité enfouir. La reconnaissance publique des souffrances endurées, qui passe par la condamnation pénale de l’auteur des faits, est un élément essentiel de la reconstruction de ces adultes dont on a volé l’enfance » (60).
Par la suite, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a ajouté à la liste des délits se prescrivant par vingt ans les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur un mineur de quinze ans. Elle a également soumis au délai dérogatoire de vingt ans, en matière criminelle cette fois-ci, la prescription de l’action publique des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises, là encore, sur un mineur de quinze ans. Enfin, elle a ajouté à la liste des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, auquel renvoient les articles 7 et 8 du même code, le délit de proxénétisme à l’égard d’un mineur et le crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans, soumettant par là même ces infractions à des délais de prescription dérogatoires au droit commun – dix ans pour le premier, vingt ans pour le second.
Plus récemment, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a complété la liste des infractions énumérées à l’article 706-47 précité en y ajoutant les délits de traite des êtres humains et de traite des êtres humains aggravée – lorsque l’infraction est commise dans des circonstances qui exposent directement la victime à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes –, ainsi que les crimes de traite des êtres humains commise en bande organisée ou en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie. Aussi l’action publique de ces infractions se prescrit-elle désormais par dix années révolues (pour les deux premières) et par vingt années révolues (pour les deux dernières) lorsqu’elles sont commises à l’encontre de mineurs.
Enfin, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a soumis au délai dérogatoire de vingt ans prévu par le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale la prescription de l’action publique du délit d’agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans alors que l’action publique n’était auparavant régie par ce délai que lorsque l’infraction était accompagnée d’une circonstance aggravante.
Le tableau ci-après dresse un état des lieux des dispositions actuelles relatives aux délais de prescription dérogatoires applicables à certaines infractions criminelles et délictuelles commises à l’encontre de mineurs.
Article du code pénal |
Infraction |
Quantum de la peine de réclusion criminelle / d’emprisonnement encourue |
Délai de prescription de l’action publique |
Crimes |
En application de l’article 7 CPP | ||
222-23 |
Viol sur un mineur de quinze ans ou plus |
15 ans |
20 ans |
222-24 (2°) |
Viol sur un mineur de moins de quinze ans |
20 ans |
20 ans |
222-24 (1° et 3° à 12°) |
Viol sur un mineur de quinze ans ou plus commis avec une circonstance aggravante |
20 ans |
20 ans |
222-25 |
Viol ayant entraîné la mort de la victime |
30 ans |
20 ans |
222-26 |
Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie |
Réclusion criminelle à perpétuité |
20 ans |
225-4-2 (II) |
Traite des êtres humains à l’égard d’un mineur commise avec une circonstance aggravante |
15 ans |
20 ans |
225-4-3 |
Traite des êtres humains commise en bande organisée |
20 ans |
20 ans |
225-4-4 |
Traite des êtres humains en recourant à des tortures |
Réclusion criminelle à perpétuité |
20 ans |
225-7-1 |
Proxénétisme à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans |
15 ans |
20 ans |
222-10 |
Violences ayant entraîné une mutilation – sur un mineur de moins de quinze ans (1°) – sur un mineur de quinze ans ou plus avec une |
15 ans |
20 ans |
222-10 (avant-dernier alinéa) |
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur |
20 ans |
20 ans |
Délits |
En application de l’article 8 CPP | ||
222-12 |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises : – sur un mineur de moins de quinze ans (1°) – sur un mineur de quinze ans ou plus avec une circonstance aggravante (2° à 15°) |
5 ans |
20 ans |
222-12 (avant-dernier alinéa) |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité |
10 ans |
20 ans |
222-29-1 |
Agression sexuelle autre que le viol imposée à un mineur de moins de quinze ans |
10 ans |
20 ans |
227-26 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans, commise avec une circonstance aggravante |
10 ans |
20 ans |
222-27 |
Agression sexuelle autre que le viol sur un mineur de quinze ans ou plus |
5 ans |
10 ans |
222-28 |
Agression sexuelle autre que le viol sur un mineur de quinze ans ou plus commise avec une circonstance aggravante |
7 ans |
10 ans |
222-29 |
Agression sexuelle autre que le viol sur un mineur de quinze ans ou plus en situation de particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur des faits |
7 ans |
10 ans |
222-30 |
Agression sexuelle autre que le viol sur un mineur de quinze ans ou plus en situation de particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur des faits, commise avec une autre circonstance aggravante |
10 ans |
10 ans |
225-4-1 (II) |
Traite des êtres humains à l’égard d’un mineur |
10 ans |
10 ans |
225-7 (1°) |
Proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans ou plus |
10 ans |
10 ans |
225-12-1 |
Recours à la prostitution de mineurs |
3 ans |
10 ans |
225-12-2 |
Recours à la prostitution de mineurs commis avec une circonstance aggravante |
5 ans |
10 ans |
225-12-2 |
Recours à la prostitution de mineurs de moins de quinze ans commis avec une circonstance aggravante |
7 ans |
10 ans |
227-22 (alinéa 1) |
Fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur de quinze ans ou plus |
5 ans |
10 ans |
227-22 (alinéa 1) |
Fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur de quinze ans ou plus lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux |
7 ans |
10 ans |
227-22 (alinéa 2) |
Fait, pour un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions |
5 ans |
10 ans |
227-22 (alinéa 3) |
Fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption : – d’un mineur de quinze ans ou plus, lorsque les faits sont commis en bande organisée – d’un mineur de moins de quinze ans |
10 ans |
10 ans |
227-22-1 (alinéa 1) |
Fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique |
2 ans |
10 ans |
227-22-1 (alinéa 2) |
Fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre |
5 ans |
10 ans |
227-23 (alinéas 1 et 2) |
– Fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre une image ou une représentation pornographique d’un mineur – Fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter |
5 ans |
10 ans |
227-23 (alinéa 3) |
Fait de commettre les infractions prévues aux deux premiers alinéas lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur, un réseau de communications électroniques |
7 ans |
10 ans |
227-23 (alinéa 4) |
Fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit |
2 ans |
10 ans |
227-23 (alinéa 5) |
Fait de commettre les infractions prévues à l’article 227-23 en bande organisée |
10 ans |
10 ans |
227-24 |
Fabrication ou diffusion de messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, lorsque ces messages sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur |
3 ans |
10 ans |
227-24-1 |
– Fait de provoquer un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, lorsque la mutilation n’a pas été réalisée – Fait d’inciter directement autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée |
5 ans |
10 ans |
227-25 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans |
5 ans |
10 ans |
227-27 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou plus, commise par un ascendant ou une personne ayant autorité |
3 ans |
10 ans |
Source : direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
Si l’allongement du délai de prescription de l’action publique de ces infractions se justifie par le fait que les mineurs, « en raison de leur jeune âge, peuvent éprouver des difficultés accrues lorsque les auteurs sont des proches ou des personnes ayant autorité sur eux, à dénoncer des agissements dont ils sont victimes » (61), les modifications successives des règles en la matière ainsi que le choix de rendre applicable à ces infractions un délai fixé tantôt à dix ans, tantôt à vingt ans, se sont faits au détriment de la lisibilité et de la cohérence d’ensemble des règles de prescription, ainsi que l’ont souligné bon nombre de personnes entendues par vos rapporteurs. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse s’est par exemple interrogée sur la pertinence de l’application du délai de prescription de vingt ans au délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur un mineur de quinze ans, passible, en application de l’article 222-12 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette interrogation semble d’autant plus fondée que la même infraction, commise sur un mineur de quinze ans ou plus, se prescrit, quant à elle, selon les règles de droit commun. Qui plus est, certaines infractions criminelles sont passibles de peines nettement plus lourdes mais obéissent à des règles de prescription moins « sévères » : il en est ainsi du meurtre commis sur un mineur de quinze ans, puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 221-4 du code pénal), et des tortures ou actes de barbarie également commis sur un mineur de quinze ans, passibles de vingt ans de réclusion criminelle (article 222-3 du même code), infractions pour lesquelles l’action publique se prescrit par dix années révolues.
Non seulement la fixation à vingt ans du délai de prescription de l’action publique de certains délits soulève des interrogations quant à la pertinence du choix des infractions concernées, mais elle a aussi pour conséquence de soumettre des infractions délictuelles à un délai de prescription de l’action publique applicable à des crimes, au demeurant dérogatoire au droit commun.
En définitive et comme le faisait remarquer Mme Catherine Sultan, « l’empilement des réformes est venu rendre illisibles les règles de prescription et confus les critères d’allongement du délai de prescription » ; de plus « [l]es mouvements contradictoires d’allongement/réduction des délais concernés, [l]es critères peu clairs tantôt fondés sur la gravité de l’infraction, tantôt sur la nature de l’infraction » ont eu pour effet de remettre progressivement en question « la classification entre crimes et délits » (62). De la même manière, Mme Danielle Drouy-Ayral, présidente de la Conférence nationale des procureurs de la République et procureure de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Draguignan, a fait observer, lors de son audition, que le degré de complexité du droit était tel que l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » semblait dénué de toute portée en la matière.
Pour remédier, en partie, à ce désordre normatif, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a proposé de fixer à dix ans le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 8 du code de procédure pénale commis sur des mineurs aujourd’hui soumis au délai de vingt ans. De cette manière, l’ensemble des délits commis sur des mineurs qui obéissent à un délai dérogatoire se prescriraient par dix ans tandis que les crimes se prescriraient, eux, par vingt ans. Vos rapporteurs reviendront plus loin sur le sort qu’ils entendent réserver aux régimes de prescription dérogatoires (63).
ii. Les actes de nature terroriste
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et afin de « limiter les possibilités pour les auteurs de crimes particulièrement odieux d’échapper à toute répression » (64), les actes de terrorisme obéissent à un régime de prescription dérogatoire au droit commun (voir l’encadré ci-après). Ainsi, en application des deux premiers alinéas de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale (65), l’action publique et les peines des crimes constituant des actes de terrorisme se prescrivent par trente ans tandis que l’action publique et les peines des délits de même nature se prescrivent par vingt ans.
Les actes de terrorisme obéissant à un régime de prescription dérogatoire
au droit commun (principales dispositions du code pénal)
Article 421-1
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
« 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
« 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
« 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
« 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État, du code de la sécurité intérieure ;
« 5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
Article 421-2
« Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. »
Article 421-2-1
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »
Article 421-2-2
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte. »
Article 421-2-3
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Article 421-2-4
« Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Article 421-2-6
« I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l’un des autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
« II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. »
iii. Les infractions à la législation sur les stupéfiants
L’allongement des délais de prescription de l’action publique et des peines applicables aux infractions de trafic de stupéfiants est un processus ancien. Déjà l’article 706-31 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (66), prévoyait-il que l’action publique des délits les plus graves en la matière – l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants – se prescrirait par dix ans. Par dérogation à la règle de droit commun, ce même article ajoutait que la peine prononcée serait prescrite, quant à elle, par vingt ans. Ces délits étaient ainsi soumis à des délais de prescription en principe réservés aux crimes.
Par la suite, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée a apporté une double modification au droit alors en vigueur :
–– elle a, d’une part, porté à vingt ans le délai de prescription de l’action publique des délits causant un trouble particulièrement grave à l’ordre public visés à l’article 706-26 du code de procédure pénale (et a ajouté à cette liste le délit de participation à une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de l’une des infractions en question), alignant de ce fait les délais de prescription de l’action publique et des peines ;
–– elle a, d’autre part, fixé à trente ans le délai de prescription de l’action publique et des peines des crimes commis en matière de trafic de stupéfiants
– ainsi de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants commises ou non en bande organisée.
Enfin, le législateur a ajouté à la liste des infractions pour lesquelles l’action publique et la peine se prescrivent en application de ces délais dérogatoires, mentionnées à l’article 706-26 précité, la tentative des délits de trafic de stupéfiants (67). En conséquence, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, tous les crimes et les délits réprimés par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, relative au trafic de stupéfiants, se prescrivent selon les règles dérogatoires prévues aux deux premiers alinéas de l’article 706-31 du code de procédure pénale, soit trente ans pour les crimes et vingt ans pour les délits.
iv. Les autres infractions soumises à des délais de prescription prolongés
D’autres infractions, figurant tantôt dans le code pénal et le code de procédure pénale, tantôt dans d’autres codes, sont soumises à des délais de prescription de l’action publique et des peines allongés. Toutefois, en raison de la multiplicité et de la « dispersion » des dispositions en question, il n’est guère aisé de disposer d’une vision globale en la matière. Vos rapporteurs se sont toutefois efforcés de mentionner ici les principales dispositions concernées, présentées suivant la date de leur intégration dans notre droit.
La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a soumis l’action publique et les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, réprimés par le sous-titre II du titre Ier du livre II du code pénal, à un délai de prescription de trente ans (article 215-4 du même code). La création de ce régime dérogatoire, issue d’un amendement du Gouvernement déposé en première lecture au Sénat, répondait à la nécessité de tenir compte, là encore, « de la gravité exceptionnelle de ces crimes et du caractère occulte et dissimulé de ces infractions » (68).
La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale a, quant à elle, inséré dans le code pénal un article 462-10 aux termes duquel l’action publique des crimes et des délits de guerre ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente et vingt ans. L’article 461-1 du même code, lui aussi créé par la loi du 9 août 2010, définit les crimes et les délits de guerre visés aux articles 461-2 à 461-31 comme des « infractions (…) commises, lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l’encontre des personnes ou des biens ».
Pour justifier cette évolution, l’exposé des motifs du projet de loi indiquait qu’il avait fallu « trouver un compromis entre la nécessité de ne pas ʺ banaliser ʺ en droit français la règle de l’imprescriptibilité de l’action publique à des infractions autres que les crimes contre l’humanité et l’intérêt de limiter au maximum les cas où la Cour pénale internationale pourrait se trouver saisie du seul fait de l’application des règles internes en matière de prescription » (69).
En outre, M. Patrice Gélard, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, faisait remarquer que, si « [l]e projet de loi s’écart[ait] (…) de la convention de Rome qui, dans son article 29, pose le principe de l’imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour » (70), l’allongement significatif des délais de prescription prévu par ledit projet n’en traduisait pas moins « un rapprochement avec les principes retenus par la Cour pénale internationale » (71). Pour vos rapporteurs, cette évolution a constitué un progrès réel mais néanmoins insuffisant. C’est pourquoi ils reviendront plus loin sur la modification qu’ils entendent apporter aux dispositions encadrant la prescription des crimes de guerre (72).
La loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs a, elle aussi, porté à vingt et trente ans les délais de prescription de l’action publique et des peines des délitset des crimes appartenant à la catégorie des infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (73) mentionnées à l’article 706-167 du code de procédure pénale.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement, soucieux de renforcer la répression de la prolifération de ce type d’armes, soulignait que l’allongement substantiel des délais de prescription se justifiait « non seulement par l’extrême gravité des faits mais aussi parce que les conséquences des infractions ʺ proliférantes ʺ peuvent n’apparaître que plusieurs années après avoir été commises » (74).
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France et afin de satisfaire à l’article 4 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, la disparition forcée est réprimée en tant que telle par notre droit pénal – et non plus simplement en tant que crime contre l’humanité.
Caractérisée, aux termes de l’article 221-12 du code pénal, par « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve », la disparition forcée obéit, elle aussi, à un régime de prescription dérogatoire au droit commun, l’article 221-18 du même code disposant en effet que l’action publique et les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
Dans son rapport, Mme Marietta Karamanli, rapporteure au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, soulignait que « ce délai de trente ans, sensiblement plus long que le délai de droit commun et le délai prolongé pour les crimes sexuels ou violents commis contre les mineurs, répond[ait] à l’exigence de longue durée et de proportionnalité à la gravité de l’infraction prévue à l’article 8 de la convention [du 20 décembre 2006] » (75).
Enfin, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a modifié le délai de prescription de l’action publique de l’infraction de fraude fiscale prévue aux articles 1741 et 1743 du livre des procédures fiscales.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le premier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales prévoyait que les plaintes de l’administration fiscale tendant à mettre en mouvement l’action publique en matière de fraude fiscale pouvaient être déposées « jusqu’à la fin de la troisième année qui [suivait] celle au cours de laquelle l’infraction [avait] été commise ». Une règle analogue était prévue pour la poursuite du délit de « fausse affirmation de sincérité » réprimé par l’article 1837 du code général des impôts.
Sur l’initiative de notre collègue Éric Alauzet, l’article L. 230 a été modifié afin de prévoir que les plaintes de l’administration fiscale puissent être déposées « jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise ».
Introduite par l’Assemblée nationale en première lecture mais supprimée deux fois par le Sénat en première comme en nouvelle lecture, cette disposition fut finalement adoptée par notre assemblée en lecture définitive. Lors des débats, M. Alauzet, insistant sur le caractère dissuasif de la nouvelle règle, expliquait que « le fait de savoir qu’il peut être rattrapé par la patrouille peut dissuader le contribuable de s’aventurer dans l’évasion fiscale » et que « [p]lus le temps de reprise est long, plus la menace est forte et plus la dissuasion fonctionne, sauf évidemment à ce que [ce] délai soit ingérable ou disproportionné [par rapport] à l’objet » (76).
À l’occasion de leur audition, MM. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, et Gradzig El Karoui, chef du bureau des affaires fiscales et pénales au sein du service du contrôle fiscal, se sont félicités de cette évolution, estimant que l’allongement du délai laissé à l’administration fiscale pour déposer plainte serait de nature à faciliter la répression des infractions les plus complexes à poursuivre en raison de la sophistication des fraudes.
On notera que la disposition prévue au dernier alinéa de l’article L. 230 précité, selon laquelle « [l]a prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis », n’a pas été modifiée par la loi du 6 décembre 2013.
En définitive, même si la gravité de toutes ces infractions ne fait guère de doute et quand bien même leur répression doit-elle être facilitée, la multiplication des délais de prescription dérogatoires n’en a pas moins rendu de moins en moins lisible le droit de la prescription. Vos rapporteurs, comme les auteurs du rapport d’information sénatorial sur le régime des prescriptions civiles et pénales avant eux, sont d’ailleurs opposés à la création de nouveaux régimes dérogatoires afin de ne pas rendre plus complexe encore une matière déjà très dense et parfois peu cohérente.
c. Les infractions soumises à des délais de prescription de l’action publique abrégés
Outre les cas dans lesquels le législateur a fixé des délais de prescription allongés, il en existe dans lesquels il a prévu des délais de prescription de l’action publique – mais pas des peines – abrégés. Sans doute les infractions de presse en sont-elles l’exemple le plus symbolique (i) même si elles n’en constituent pas l’exemple unique (ii).
Depuis près de deux siècles, les infractions de presse se prescrivent selon des règles fortement dérogatoires au droit commun. Des délais de prescription de l’action publique de six mois et d’un an ont ainsi été institués dès le début du XIXe siècle par la loi du 26 mai 1819, dont l’exposé des motifs soulignait déjà qu’il « est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux agents », avant d’ajouter qu’« [e]lle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dès l’origine » (77).
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixa par la suite le délai de prescription de l’action publique des infractions de presse à trois mois, disposition toujours en vigueur en application de son article 65, dont le premier alinéa dispose que « [l]’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Entre 1881 et 2004, le délai de prescription de trois mois demeura applicable à l’ensemble des infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881. Puis, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté le délai de prescription de l’action publique à un an – disposition introduite à l’article 65-3 de la loi de 1881 – en cas :
–– de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (78)) ;
–– de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité (article 24 bis) ;
–– de diffamation commise à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (deuxième alinéa de l’article 32) ;
–– d’injure commise à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (troisième alinéa de l’article 33).
M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, justifiait la modification par la nécessité de « réprimer plus efficacement des infractions extrêmement graves en matière de racisme et de xénophobie (et d’ailleurs punies de peines d’emprisonnement, à la différence de la quasi-totalité des autres infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881) ». Cette évolution du cadre juridique lui apparaissait d’ailleurs indispensable « du fait de l’évolution technologique et du développement d’Internet, qui entraîne une augmentation exponentielle des informations diffusées » (79).
Par la suite, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a ajouté à la liste des infractions mentionnées à l’article 65-3 précité, pour lesquelles l’action publique se prescrit par un an, les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme alors visés au sixième alinéa de l’article 24 de la loi de 1881.
Après avoir constaté que « la brièveté du délai de prescription [alors en vigueur] ne permet[ait] d’appréhender qu’une courte durée de l’activité d’un site Internet », Mme Marie-Françoise Bechtel, rapporteure au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, expliquait que « [l]’allongement du délai de prescription à un an donnera[it] aux enquêteurs et aux magistrats la possibilité de surveiller un site pendant une plus longue période, ce qui permettra[it] (…) de constituer des dossiers plus solides » (80).
Cette évolution fut rapidement suivie par une nouvelle modification du droit. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme transféra en effet l’incrimination des délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme dans le code pénal, afin d’en faire des « délits terroristes ». D’après le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, M. Sébastien Pietrasanta, malgré l’allongement du délai de prescription de l’action publique de ces infractions, consécutif à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2012 précitée, « – qui pouvait difficilement être plus important dès lors que ces délits demeuraient punis par la loi du 29 juillet 1881, sous peine de dénaturer trop fortement les spécificités du droit de la presse –, cette durée de prescription rest[ait] trop brève pour permettre une surveillance dans la durée des sites dangereux et une répression efficace » (81).
Désormais, ces délits sont prévus à l’article 421-2-5 du code pénal et sont régis par les délais de prescription de droit commun. En effet, le dernier alinéa de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale prend soin de préciser que le délai de prescription de l’action publique et des peines applicable aux délits de nature terroriste – fixé à vingt ans (82) – ne leur est pas applicable. Le législateur a considéré, à raison, que le Conseil constitutionnel aurait probablement vu dans l’application de ces délais à des délits dont l’élément matériel est constitué par une expression « une rigueur non nécessaire à [leur] répression » (83).
Quelques mois avant l’adoption de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap avait soumis au délai de prescription de l’action publique d’un an :
–– la provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ou du handicap (84) ;
–– la diffamation commise à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ou du handicap (troisième alinéa de l’article 32 de la loi de 1881) ;
–– l’injure commise à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ou du handicap (quatrième alinéa de l’article 33).
Le droit de la presse n’a donc pas échappé au processus consistant à allonger le délai de prescription de l’action publique des infractions considérées comme les plus graves et pour lesquelles il est apparu nécessaire de renforcer la répression. Ce mouvement n’est d’ailleurs sans doute pas achevé, notamment en raison de la difficulté à combattre efficacement les infractions de presse commises par l’intermédiaire de la presse en ligne. Dans son rapport sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, Mme Marie-Françoise Bechtel jugeait nécessaire que « la réflexion [se poursuive] sur les limites de la loi de 1881 au regard des nouveaux défis qui résultent des possibilités offertes par Internet » et ajoutait que « [l]e temps viendra où il faudra reconstruire une législation spécifiquement destinée à répondre à ces nouveaux défis » (85). M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, s’est également interrogé, lors de son audition, sur l’adaptation de la loi du 29 juillet 1881 à la répression des infractions de presse à caractère raciste ou antisémite commises sur internet et sur l’opportunité de traiter séparément la question de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion de celle des injures et des diffamations commises pour les mêmes raisons.
Toutefois, interrogés par vos rapporteurs sur le bien-fondé du maintien en l’état du régime dérogatoire applicable aux infractions de presse, les représentants des organisations syndicales du secteur ont fait valoir que la brièveté de ce délai de prescription se justifiait par l’indispensable protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (86).
Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que les règles de prescription des infractions de presse sont, elles aussi, marquées par une instabilité et une illisibilité croissantes. En effet, la rupture avec la règle du délai de trois mois, l’application jurisprudentielle de ce délai à des infractions contraventionnelles prévues par le code pénal qui devraient, en application de l’article 9 du code de procédure pénale, se prescrire par un an (87), le transfert de certaines infractions de presse dans le code pénal et les conséquences procédurales qui en sont résultées
– possibilité de placer les personnes mises en cause en garde à vue et de recourir à la procédure de comparution immédiate par exemple – se sont indiscutablement faits au détriment de la cohérence d’ensemble du droit de la presse.
D’autres infractions que les infractions de presse se prescrivent également dans des délais abrégés.
Il en est ainsi du délit, réprimé par le premier alinéa de l’article 434-25 du code pénal, consistant à « chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance », pour lequel l’action publique se prescrit par trois mois révolus (dernier alinéa de l’article 434-25). On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons qui ont conduit le législateur à faire figurer cette infraction de presse dans le code pénal et non pas dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
On peut aussi s’interroger, à l’instar de M. Emmanuel Derieux, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II Panthéon-Assas, sur les raisons qui ont conduit le législateur à soumettre au délai de trois mois la prescription de l’action publique de cette infraction et au délai de droit commun – trois ans – la prescription de l’infraction prévue à l’article 434-16 du même code, qui réprime la publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, « de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d’instruction ou de jugement ».
Par ailleurs, certaines infractions prévues par le code électoral sont également soumises à un délai de prescription abrégé. Ainsi, aux termes de l’article L. 114, l’action publique des infractions mentionnées aux articles L. 61, L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 se prescrit par six mois (voir l’encadré ci-après).
La brièveté du délai de prescription de l’action publique de ces infractions, pourtant passibles de peines d’emprisonnement d’une durée pouvant atteindre vingt ans (88), s’explique par la nécessité d’éviter la remise en cause trop tardive d’une élection et, partant, de la composition d’un organe élu, ainsi que l’a fait remarquer le directeur des affaires criminelles et des grâces lors de son audition. Aucune des personnes entendues par vos rapporteurs n’a d’ailleurs appelé à une modification de ce régime particulier.
Quelques infractions prévues par le code électoral soumises au délai
de prescription de l’action publique de six mois
Article L. 86
« Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »
Article L. 91
« Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 euros. »
Article L. 94
« Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros. »
Article L. 103
« L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de 22 500 euros.
« Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d’emprisonnement. »
Article L. 104
« La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d’emprisonnement. »
2. La diversification des règles de computation du délai de prescription
Outre la multiplication des délais dérogatoires au droit commun, le droit de la prescription connaît deux autres évolutions notables depuis de nombreuses années : la diversification des règles relatives à la fixation du point de départ du délai (a) et l’élargissement des motifs d’interruption et de suspension de son cours (b).
a. La diversité des règles relatives à la fixation du point de départ du délai de prescription
Si, par principe, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la commission des faits (i), son point de départ est parfois reporté par la jurisprudence (ii) ou par la loi (iii).
i. En principe, le point de départ de la prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission des faits
Évacuons d’emblée la question du délai de prescription des peines, qui commencent à courir « à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive », en application des articles 133-2 à 133-4 du code pénal. La date retenue est le moment où le jugement ou l’arrêt est irrévocable et passé en force de chose jugée.
Les personnes entendues par la mission d’information n’ayant pas fait état de difficultés dans la détermination du point de départ de ce délai (89), vos rapporteurs se concentreront principalement sur l’état du droit de la prescription de l’action publique.
• Le droit commun : le jour où l’infraction a été commise
Pour l’action publique, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour de la commission de l’infraction, ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ».
La même règle s’applique aux délais de prescription des délits et des contraventions.
Précisions relatives à la détermination du point de départ
du délai de prescription de l’action publique
En pratique, la jurisprudence a décidé que le jour précis où l’infraction était commise ne devait pas être pris en compte dans le calcul du délai (dies a quo), celui-ci ne commençant à courir que le lendemain à zéro heure (1). Le dernier jour du terme (dies ad quem) est en revanche pris en compte : le délai expire donc le dernier jour à minuit. Le calcul se fait de quantième à quantième par mois ou années et non par jours : peu importe donc le nombre de jours que comporte chaque mois.
En matière contraventionnelle, lorsque le montant de l’amende est forfaitisé, le jour de commission de l’infraction est le jour du constat de la contravention en cas de non-paiement de l’amende ou en l’absence de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours après remise de l’avis d’amende (2).
(1) Cass. crim., 8 septembre 1998, n° 98-80.742 et 28 juin 2000, n° 99-85.381.
(2) Cass. crim., 18 octobre 2006, n° 06-83.085.
Cette règle est d’application aisée lorsque le mode d’exécution de l’infraction ne soulève pas de difficulté quant à la détermination du jour de la commission de l’infraction, c’est-à-dire en présence d’une infraction instantanée, constituée d’un seul élément matériel et qui se réalise en un trait de temps (90).
C’est également le cas lorsqu’il s’agit d’une infraction instantanée dite permanente qui, bien que constituée d’un seul élément matériel, voit ses effets se prolonger dans le temps sans intervention de son auteur (91).
Des incertitudes ont pu naître sur la nature des infractions de presse commises sur internet (voir l’encadré ci-après) mais, depuis 2004, elles sont considérées comme des infractions instantanées pour lesquelles le point de départ du délai de prescription de l’action publique court à partir du jour où le contenu litigieux est mis en ligne.
Point de départ du délai de prescription de l’action publique
des infractions de presse commises sur internet
Pour les infractions de presse, la prescription de l’action publique court à compter du jour où elles ont été commises, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Historiquement analysées comme des infractions instantanées dont le délai de prescription commence à courir à partir du jour de la publication (où l’écrit a été mis à disposition du public), elles ont été considérées, un temps, comme des infractions continues lorsqu’elles étaient commises sur internet, sur lequel la publication consiste non seulement à placer le message mais aussi à l’y maintenir jusqu’à ce qu’il en soit retiré. Cela justifiait, pour la cour d’appel de Paris (1), de faire partir le délai à compter de la suppression du contenu litigieux en ligne. La Cour de cassation a cependant rappelé que le point de départ, même sur internet, était la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau » (2).
En 2004, dans le projet de loi pour la confiance dans l’économique numérique, le législateur, qui souhaitait tenir compte de la spécificité des infractions de presse commises par internet, avait prévu que, dans le cas d’un contenu publié exclusivement sur support informatique, le point de départ du délai de prescription courrait « à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message » (3).
Mais cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel au motif que, « par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique » (4).
En 2009, la Cour de cassation a précisé que l’ajout d’un lien hypertexte pour accéder au site existant ne constituait pas un nouvel acte de publication (5) et était donc sans effet sur le cours de la prescription de l’action publique.
(1) CA Paris, 15 décembre 1999.
(2) Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-83.004 et 16 octobre 2001, n° 00-85.728.
(3) V de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
(4) Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, considérant 14.
(5) Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 05-83.491.
Le jour où l’infraction a été commise s’entend du jour où tous les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis : la règle de fixation du point de départ de la prescription mérite donc d’être précisée selon la nature (infractions complexes, d’habitude et de résultat) ou la durée (infractions continuées et continues) de l’élément matériel constitutif de l’infraction.
• La prise en compte de la nature de l’élément matériel (infractions complexes, d’habitude et de résultat)
En premier lieu, la prescription de l’action publique des infractions complexes, constituées d’actes matériels multiples de nature différente, court à compter du dernier de ces actes. Ainsi en est-il notamment du délit d’escroquerie, constitué par une sollicitation de l’escroc et la remise d’un bien par la victime, et dont la consommation est fixée à la remise de la chose frauduleusement obtenue, hors les cas dans lesquels les manœuvres frauduleuses constituent des escroqueries distinctes (92) ou une opération délictueuse unique (93).
En deuxième lieu, le point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions d’habitude, constituées d’au moins deux actes matériels identiques qui, pris isolément, ne sont pas répréhensibles, est également fixé au jour où est réalisé le dernier acte caractérisant l’infraction. Sont par exemple concernés les délits d’exercice illégal de la médecine ou de harcèlement sexuel.
En dernier lieu, la jurisprudence a pris en compte les hypothèses dans lesquelles la consommation de l’infraction est retardée. Tel est le cas des infractions de résultat, pour lesquelles le dommage constitutif n’apparaît que plusieurs mois ou années après l’acte qui l’a généré et dont le délai de prescription de l’action publique commence à courir du jour où ce résultat se produit. Sont plus particulièrement concernés les délits d’homicide involontaire, dont la prescription court à compter du décès de la victime (94), d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, dont la prescription court « du moment où existe l’incapacité, élément constitutif de l’infraction » (95), et d’escroquerie au jugement, dont la prescription court à partir du jour où la décision frauduleusement obtenue est devenue exécutoire (96).
• La prise en compte de la durée de l’élément matériel (infractions continuées et continues)
La durée de l’élément matériel constitutif de l’infraction a également un effet sur le point de départ du délai de prescription de l’action publique. L’infraction instantanée doit en effet être distinguée de l’infraction continuée, consistant en une opération délictueuse unique mise en œuvre sous la forme de plusieurs infractions instantanées à exécution successive, et de l’infraction continue, dont l’acte matériel se prolonge dans le temps en raison de la volonté réitérée de son auteur. La jurisprudence a considéré, pour ces deux dernières catégories, que le jour de la commission de l’infraction correspondait au jour où l’activité reprochée prenait fin.
Tout d’abord, cette solution est retenue pour les infractions continuées, c’est-à-dire les infractions qui, instantanées en apparence, s’accomplissent sous la forme d’une série de faits distincts constitutifs d’une seule et même infraction et révélant une même intention criminelle.
Pour ces infractions, la Cour de cassation a décidé que chaque acte d’exécution renouvelait l’infraction et faisait courir un nouveau délai de prescription, notamment pour :
–– le délit d’escroquerie, pour lequel le point de départ du délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise (97) « lorsque les manœuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique » (98), y compris lorsque les « manœuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période » (99) ; la même solution a été appliquée à une infraction voisine de l’escroquerie, la fraude aux prestations sociales, pour laquelle le délai de prescription « ne commence à courir qu’à compter de la perception de la dernière prestation indûment obtenue » (100) ;
–– le délit de corruption, pour lequel le point de départ de la prescription est retardé au jour du dernier versement ou du dernier acte d’exécution du pacte de corruption car, « si le délit de corruption est une infraction instantanée, consommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d’exécution dudit pacte » (101) ;
–– le délit de concussion, pour lequel le délai « ne commence à courir qu’à compter de la dernière des perceptions de sommes indues lorsque ces perceptions résultent d’opérations indivisibles » (102) ;
–– le délit de prise illégale d’intérêts, en principe instantané, mais pour lequel la prescription court, lorsqu’il se renouvelle dans le temps, « à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance » (103) à condition que les faits incriminés n’aient pas constitué des opérations successives indépendantes les unes des autres (104) et qu’ils ne présentent pas un caractère continu (105) ;
–– le délit d’abus de faiblesse, pour lequel le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où ont pris fin les prélèvements bancaires constitutifs de l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime dès lors qu’ils procèdent d’un mode opératoire unique (106) ;
–– ou le délit de trafic d’influence, « qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux » (107).
Par ailleurs, une solution comparable est appliquée à l’infraction continue, qui se réalise par une action ou une omission se prolongeant dans le temps par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur. Pour ce type d’infractions, la Cour de cassation a décidé que le délai de prescription court à compter du jour où la situation illicite prend fin. Sont par exemple concernés :
–– le recel de choses, pour lequel le délai de prescription part du jour où la détention frauduleuse de l’objet a cessé (108) ;
–– le délit de proxénétisme, « infraction continue qui ne commence à se prescrire qu’à l’instant où prend fin la cohabitation avec la personne » (109) ;
–– le délit de participation à une association de malfaiteurs, pour lequel le délai de prescription ne court « qu’à partir de l’instant où le prévenu cesse d’en faire partie, soit en la quittant, soit parce qu’elle a cessé d’exister » (110) ;
–– la conservation d’un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou de données informatisées à caractère personnel, « délits continus à l’égard desquels la prescription de l’action publique ne commence à courir que lorsqu’ils ont cessé » (111) ;
–– le délit de propagande ou de publicité en faveur du tabac qui, « quel qu’en soit le support (…) se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public », même lorsqu’il est commis sur internet (112) ;
–– ou le délit de blessures involontaires, qui « présente un caractère continu » justifiant que la prescription coure à compter de la « date à laquelle le plaignant a eu connaissance du caractère dangereux de l’usage prolongé des produits auxquels il avait été exposé » et qui est à l’origine de sa maladie (113).
De manière plus significative encore, le juge et le législateur ont multiplié les cas de report du point de départ du délai de prescription au-delà du jour de la commission des faits ou de celui de la consommation de l’infraction. Ces reports visent principalement à tenir compte de la gravité des faits poursuivis et de la nécessité d’améliorer l’efficacité de leur répression, en raison notamment de la clandestinité des faits, de la situation particulière de la victime ou de la spécificité de l’infraction.
ii. Le report jurisprudentiel du point de départ du délai de prescription de l’action publique
C’est en dehors de tout fondement légal que le juge a reporté le point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions clandestines ou occultes par nature et des infractions dissimulées par les manœuvres de leurs auteurs. Dans ces circonstances, il a considéré que la prescription ne pouvait pas courir du jour de la commission des faits, ignorés des parties poursuivantes, mais seulement du jour où ils apparaissaient et pouvaient être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette formule vise le moment auquel le ministère public et les parties civiles, seules personnes habilitées à mettre ou à faire mettre en mouvement l’action publique, ont pu connaître les faits et valablement agir.
En pratique, cette jurisprudence a été principalement appliquée aux infractions à caractère économique et financier, ainsi qu’en témoignent les exemples qui suivent.
Les juges du fond apprécient souverainement la date à laquelle les faits réprimés constitutifs de l’infraction sont apparus et ont pu être constatés. La Cour de cassation contrôle toutefois, d’une part, que les motifs retenus par les juges du fond sont suffisants et cohérents (114), et, d’autre part, que la date de la révélation n’est pas simplement hypothétique (115), celle-ci pouvant par exemple être directement liée à la réception par le procureur de la République d’une lettre de dénonciation (116).
• Pour certaines infractions occultes ou clandestines par nature
La Cour de cassation a progressivement décidé du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes et clandestines par nature, c’est-à-dire lorsque « la clandestinité [est] un élément constitutif essentiel » de l’infraction ou « inhérente » à celle-ci.
Cette jurisprudence, inaugurée en 1935, s’est développée au cas par cas sans jamais définir précisément la notion d’infraction clandestine ou occulte par nature et donnant parfois l’impression de tâtonner. Symptomatique est, de ce point de vue, le cas de l’abus de confiance, auquel cette jurisprudence a été appliquée pour la première fois. Après avoir, dans un premier temps, décidé du report du point de départ de la prescription lorsque l’auteur dissimulait ses détournements (117), la Cour de cassation a, dans un second temps, élargi la solution à tous les abus de confiance, avec ou sans dissimulation (118).
Tout aussi caractéristique est l’infraction d’abus de bien social initialement considérée, dès 1967, comme clandestine par nature. La chambre criminelle a décidé, dans un premier temps, que le point de départ de la prescription serait reporté « au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté » (119) ou, plus précisément, « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (120). Puis, elle a, en 1997, modifié sa jurisprudence : tout en maintenant à cette infraction sa nature occulte, elle a décidé que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux [courrait], sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société » (121).
En conséquence, le délit d’abus de bien social est désormais considéré comme une infraction occulte par nature pour laquelle le point de départ du délai de prescription est reporté à la publication des comptes annuels, date qui, sauf dissimulation, présume sa révélation (122).
D’autres infractions ont été par la suite reconnues par la Cour de cassation comme occultes ou clandestines par nature, justifiant un report du point de départ de leur délai de prescription :
–– les délits d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui et de mise en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, de données nominatives, qui ne peuvent être prescrits « avant (…) que soit révélée, aux victimes, l’atteinte qui a pu être portée à leurs droits » (123) ;
–– le délit de publicité trompeuse, pour lequel la prescription ne court qu’à partir du moment où « le caractère trompeur de la publicité (…) est apparu dans des conditions de nature à permettre l’exercice de l’action publique » (124) ;
–– les délits de simulation et de dissimulation d’enfant (125) ;
–– le délit de malversation (126) ;
–– la tromperie, « délit clandestin par nature, en ce qu’il a pour but de laisser le contractant dans l’ignorance des caractéristiques réelles d’un produit » (127).
La chambre criminelle a en revanche refusé de reconnaître à certaines infractions un caractère occulte, en particulier aux délits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics (128), de faux (129) ou de violation du secret professionnel et de recel de violation de ce secret (130). Enfin, elle a refusé de conférer le caractère d’infraction occulte à un crime d’homicide volontaire pour une affaire dans laquelle avaient été découverts les ossements d’une personne signalée disparue onze ans plus tôt (131).
Le mouvement de report du point de départ du délai de prescription s’est encore amplifié avec la jurisprudence relative à la prescription de certains recels. Par dérogation à la règle qu’elle a établie selon laquelle, en matière de recel, délit continu, la prescription est indépendante de celle applicable à l’infraction d’origine et court du jour où le receleur se libère de l’objet volé (132), « alors même qu’à cette date l’infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite » (133), la Cour de cassation a décidé que l’action publique du chef de recel du produit d’un abus de confiance (134) et d’un abus de biens sociaux (135) ne peut commencer à se prescrire avant que l’infraction dont procède le recel soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, même si la détention du produit de l’abus a cessé avant.
• Pour certaines infractions dissimulées
La Cour de cassation retarde également le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour les infractions dont la nature même n’est pas occulte ou clandestine mais qui font l’objet de manœuvres de dissimulation par leurs auteurs ou de l’accomplissement clandestin d’actes irréguliers. Tel est notamment le cas de certaines infractions appartenant au champ économique et financier :
–– du délit d’abus de biens sociaux pour lequel, au terme de l’évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle opérée à partir de 1997 (136), la présomption de révélation du délit, par nature occulte, au moment de l’inscription dans les comptes sociaux des dépenses litigieuses est levée lorsque cette inscription n’est pas explicite et le point de départ du délai de prescription court alors à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (137) ;
–– du délit de trafic d’influence, « infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux » mais dont « le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu’à partir du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites » (138) ;
–– du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, dont la prescription « ne commence à courir, lorsque les actes ont été dissimulés, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites » (139) ;
–– du délit de fraude fiscale : s’il s’agit d’une fraude par omission volontaire de déclarations, le point de départ du délai de prescription est fixé au 1er janvier suivant l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée ou, lorsqu’elle a été déposée, a été minorée (140) ; en matière de droits d’enregistrement, lorsque la vente dissimule en réalité une donation, le délai court à compter de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement et non à la date d’établissement de l’acte authentique (141) ;
–– du délit de participation frauduleuse à une entente prohibée en présence de « dissimulations de nature à retarder le point de départ du délai de prescription » (142) ;
–– ou, très récemment, du délit de prise illégale d’intérêts qui « se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin » mais pour lequel « le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites » (143).
La dissimulation implique un acte intentionnel d’occultation de l’auteur de l’infraction. Elle ne peut donc se fonder sur le seul état d’ignorance de la victime, qui découvrirait par exemple tardivement l’existence d’un faux (144) ou d’un abus de biens sociaux (145). En matière d’abus de biens sociaux, la notion de dissimulation peut recouvrir diverses réalités, comme l’omission ou la présentation sous une fausse imputation d’une dépense litigieuse (146) ou l’établissement de « conventions fictives accompagnées de factures dont la fausseté ne pouvait être mise en évidence à l’occasion des vérifications habituelles, notamment de la part des commissaires aux comptes » (147).
• Une jurisprudence contra legem, source d’insécurité juridique
Vos rapporteurs ont été interpellés par l’ampleur de cette jurisprudence et se sont interrogés sur sa conformité aux exigences de sécurité juridique, d’accessibilité du droit et de confiance légitime, qui impliquent notamment que le cadre juridique dans lequel les individus et les acteurs économiques évoluent soit suffisamment stable et permette de connaître à l’avance la nature et l’étendue des obligations légales.
Ces exigences sont d’ailleurs protégées aux niveaux conventionnel, communautaire et constitutionnel (voir l’encadré ci-après).
Le principe de sécurité juridique
Pour la CEDH, « le principe de sécurité juridique [est] nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire » (1) et « constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit » (2).
La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, a fait du principe général de sécurité juridique une règle de droit à respecter dans l’application du traité (3), puis une « exigence fondamentale » (4) et enfin un principe « inhérent à l’ordre juridique communautaire » (5).
Le Conseil constitutionnel a consacré l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (6) et considère que la sécurité juridique fait partie de la garantie des droits proclamée par l’article XVI de la Déclaration de 1789 (7).
(1) CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n° 6833/74.
(2) CEDH, 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03.
(3) CJCE, 6 avril 1962, Bosch, n° 13-61.
(4) CJCE, 14 juillet 1972, ICI c. Commission, n° 48-69 et 22 octobre 1987, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, n° 314/85.
(5) CJCE, 27 mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato c. Denkavit italiana Srl, n° 61/79.
(6) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes, considérant 13.
(7) Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, considérant 77.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la jurisprudence de la chambre criminelle relative aux infractions occultes et dissimulées. Plus particulièrement saisie du régime de la prescription de l’abus de biens sociaux, elle a considéré qu’il ne soulevait pas de difficultés juridiques particulières. D’une part, elle a relevé que la prescription de l’action publique n’a pas valeur constitutionnelle : « la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ». D’autre part, elle a estimé « que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs » (148).
Toutefois, pour vos rapporteurs comme pour une large partie de la doctrine et de nombreuses personnes entendues, la jurisprudence sur les infractions occultes et dissimulées est contraire au principe de légalité et manque de fondement normatif au regard de l’article 7 du code de procédure pénale, qui dispose sans ambiguïté que l’action publique se prescrit « à compter du jour où le crime a été commis ». Cette jurisprudence, en perpétuelle évolution, génère par ailleurs une forte imprévisibilité qui porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Ainsi, pour M. Jean-Claude Marin, « la Cour de cassation a retenu une conception large des infractions clandestines » et les conditions dans lesquelles elle a décidé du report du point de départ du délai de prescription sont « très fluctuantes, comme en atteste le cas de l’abus de biens sociaux » pour lequel « [d]eux mécanismes conjugués rendent en effet très difficile la prescription de cette infraction » (149). Infraction clandestine par nature mais qui peut être dissimulée, l’abus de biens sociaux peut aussi prendre la forme d’une succession de plusieurs actes. Dans cette hypothèse, le délai de prescription de l’abus de biens sociaux résultant par exemple du versement de salaires rémunérant un emploi fictif commence à courir, comme pour toute infraction instantanée, lors de chaque paiement indu du salaire et non au jour de la conclusion initiale du contrat de travail illicite (150). S’il n’est pas certain que cette solution s’applique à tous les abus de biens sociaux commis par l’intermédiaire de contrats à exécutions successives, la chambre criminelle n’ayant pas clairement tranché ce point (151), la jurisprudence de la Cour de cassation conduirait selon lui « à faire de l’abus de biens sociaux un délit quasi-imprescriptible » et aurait « pour effet, en pratique, d’introduire une grande insécurité juridique dans la vie des sociétés » (152).
D’autres infractions sont concernées par plusieurs motifs de report du point de départ du délai de prescription, à l’instar des atteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui résultant de l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou de la mise en mémoire informatisée des données informatiques à caractère personnel sans le consentement de la personne, infractions qui peuvent être continues et clandestines par nature, ou de la prise illégale d’intérêts, infraction qui peut être à la fois dissimulée et continuée en cas d’opérations successives dépendantes les unes des autres.
Pour M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour de cassation, l’extension par la jurisprudence des cas dans lesquels la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où les faits ont pu être découverts dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique pose un problème de cohérence dans la détermination de la liste des infractions concernées – « [e]n réalité, toute infraction est clandestine, rares sont les malfaiteurs qui agissent au grand jour » – et un problème d’équité, en risquant de « laisser à la victime le choix du moment où elle va dire qu’elle a découvert les faits dont elle décide de se plaindre » (153).
M. Jean Maïa, directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, considère également que le régime de la prescription des infractions à caractère économique et financier génère un « manque de prévisibilité de la matière » et un « manque de sécurité juridique » (154). Pour M. Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’état du droit en matière de report du point de départ du délai de prescription est « le siège d’une casuistique dont le sens est difficile à appréhender » et « aboutit dans un certain nombre d’hypothèses à une véritable imprescriptibilité », « à des dérèglements » et à des « revirements » (155).
Cette situation est d’autant plus préoccupante que le législateur a lui-même encouragé ce mouvement en reportant, pour d’autres motifs, le point de départ du délai de prescription de l’action publique.
iii. Les régimes légaux de report du point de départ du délai de prescription de l’action publique
Le législateur a décidé du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique principalement afin de prendre en compte la situation particulière de la victime – son âge ou sa vulnérabilité – et la spécificité de l’infraction.
• Le report à raison de l’âge ou de la situation de la victime au moment des faits
Deux situations spécifiques ont conduit le législateur à décider du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique : la situation de minorité de la victime et son état de vulnérabilité.
Le législateur a d’abord reporté le point de départ du délai de prescription au jour de la majorité de la victime pour certaines infractions commises à l’encontre des mineurs, afin de tenir compte des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer pour dénoncer les infractions dont ils sont victimes et qui sont souvent commises par leurs proches.
Le législateur a progressivement circonscrit ce report, au départ appliqué à toute infraction commise à l’encontre des mineurs, aux crimes et délits de nature sexuelle commis à leur encontre, même si certaines infractions qui ne sont pas sexuelles ont été conservées dans ce dispositif (voir l’encadré ci-après).
L’évolution du champ des infractions commises sur les mineurs concernées
par le reportdu point de départ du délai de prescription de l’action publique
à la majorité de la victime
Initialement, la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance avait cantonné le report aux crimes commis sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur eux (1). La loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social a étendu ce report aux délits commis sur les mineurs par les mêmes auteurs, afin de tenir compte, en matière d’infractions sexuelles, des difficultés d’établir après de longues années la contrainte, la violence ou la menace exigée en matière de crime sexuel.
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a par la suite sensiblement modifié les conditions de report à la majorité de la victime du point de départ de la prescription de l’action publique pour les crimes et délits commis contre des mineurs :
–– d’une part, elle a prévu que ce report interviendrait à l’égard de toute personne poursuivie, quelle que soit la qualité de l’auteur de l’infraction commise contre le mineur, supprimant la restriction liée à la qualité d’ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou à l’autorité que la personne a sur lui ;
–– d’autre part, elle a limité la liste des délits concernés (voir supra, le b du 1 du présent B).
Le législateur a ensuite modifié la liste des infractions soumises à la règle dérogatoire du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique ainsi qu’à des délais allongés (voir supra, le même b).
(1) L’article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, ne prévoyait pas en tant que tel un report du point de départ mais une réouverture du délai ou l’ouverture d’un nouveau délai en disposant que « lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ».
Au terme de ces évolutions, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est désormais reporté pour l’ensemble des infractions commises à l’encontre des mineurs qui sont soumises à un délai de prescription allongé (156).
Au titre du report du point de départ de la prescription à la majorité de la victime doit également être mentionnée la disposition introduite au second alinéa de l’article 215-4 du code pénal par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, qui a institué une nouvelle incrimination de crime contre l’espèce humaine et reporté le point de départ du délai de prescription de l’action publique du crime de clonage ayant conduit à la naissance d’un enfant à « la majorité de cet enfant ». D’après les travaux préparatoires, cette règle se justifie, en matière de clonage reproductif, par « le fait que l’enfant né de cette technique peut fort bien être tenu dans l’ignorance de ses origines durant de nombreuses années » et la nécessité « de préserver ses droits à agir jusqu’à ce qu’il ait sa pleine capacité de discernement » (157). Combiné au délai de prescription allongé (158), le délai de prescription de l’action publique du crime de clonage reproductif est donc de quarante-huit ans.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour certains délits commis sur une personne vulnérable « du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse » est reporté, en application du dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, au jour où l’infraction est révélée, plus précisément au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
Sont visées par cet article, de manière limitative, plusieurs infractions réprimées par le code pénal : l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (article 223-15-2), le vol et certains vols aggravés (articles 311-3 et 311-4), l’escroquerie et toute forme d’escroquerie aggravée (articles 313-1 et 313-2), l’abus de confiance et toute forme d’abus de confiance aggravé (articles 314-1 à 314-3), la destruction ou le détournement d’objet saisi (article 314-6) et le recel (article 321-1).
Introduite par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (159), cette disposition visait à tenir compte, dans le calcul du délai triennal de prescription de l’action publique applicable aux délits, des « personnes qui, en raison de leur particulière vulnérabilité, n’ont pas conscience immédiatement de l’infraction dont elles sont victimes et la découvrent avec un retard tel qu’il n’est plus possible d’engager des poursuites » (160) en inscrivant dans la loi, pour certaines infractions, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions occultes et dissimulées (161). Les travaux préparatoires précisaient que cette règle ne devait pas avoir pour effet de remettre en cause, par une interprétation a contrario, la jurisprudence plus générale de la Cour de cassation sur les délits occultes ou dissimulés (162) qui n’étaient pas mentionnés dans le dispositif.
Les associations d’aide aux victimes ont défendu cette disposition, protectrice de l’intérêt des personnes vulnérables pour l’Association nationale pour la reconnaissance des victimes (ANPRV). Les associations Stop aux violences sexuelles (SVS) et Mémoire traumatique et victimologie ont même proposé de l’étendre aux infractions sexuelles.
À l’inverse, de nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs ont vivement regretté l’imprécision de sa rédaction, son champ d’application à géométrie variable et, plus globalement, l’insécurité juridique qu’elle génère. Tout en reconnaissant la nécessité d’adapter la prescription de l’action publique à la vulnérabilité de certaines victimes, M. Philippe-Jean Parquet, psychiatre spécialiste de l’emprise mentale et professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’Université Lille II, a constaté, lors de son audition, que la vulnérabilité était par définition multiforme dans la mesure où elle correspond à toute « incapacité partielle ou totale, acquise ou congénitale, à pouvoir faire face à des propositions et à la réalité de ce qu’exige la vie quotidienne ». Il a contesté que l’état de grossesse puisse être considéré comme une source de vulnérabilité. En outre, l’imprécision de la rédaction du dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale rend selon lui inopérant le report du point de départ, face à « [l]a difficulté à définir le moment de la récupération par le sujet de ses pleines compétences » et parce que « la définition claire et consensuelle des critères de cette récupération pose des problèmes difficilement surmontables » (163).
Pour la Conférence nationale des procureurs généraux, « [l]a mise en place d’un report du point de départ de la prescription à l’initiative de la victime appelle de très sérieuses réserves, même si elle a pu être consacrée par la loi du 14 mars 2011 » (164). M. Jacques Dallest, procureur général près la cour d’appel de Chambéry, a estimé devant vos rapporteurs que le dernier alinéa de l’article 8 précité constituait « un précédent fâcheux » qui méconnaissait la nécessité de fonder la notion de vulnérabilité sur des éléments objectifs et précis et rendait, sinon impossible à l’usage, du moins juridiquement hasardeuse, la condamnation d’un prévenu sur les simples réminiscences d’une victime. Même s’il lui paraît inopportun de le remettre en cause pour des raisons de cohérence avec la matière civile dans laquelle l’article 2235 du code civil pose le principe que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle », M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, a considéré, au cours de son audition, que ce régime conduisait à ce que le point de départ soit reporté « à une date indéterminée »et rendait l’action publique « en quelque sorte prisonnière du comportement ou de la stratégie de la victime ».
Pour Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, pareille disposition soulève deux difficultés. D’une part, elle « n’est aucunement justifiée lorsque la victime est majeure » : un tel point de départ est « très insécurisant juridiquement car trop subjectif quel que soit l’âge de la victime ; en effet le champ des poursuites dépendrait alors de l’évolution du psychisme de la victime ». D’autre part, « l’état de vulnérabilité n’est pas défini ni ses déclinaisons », en particulier la vulnérabilité liée à l’âge, notion trop floue, et à l’état de grossesse, discutable. En outre, « les personnes vulnérables ne sont pas toujours isolées et peuvent être entourées de membres de leur famille en capacité de les protéger ou encore bénéficier d’une mesure de protection (tutelle, curatelle,…) » (165).
En définitive, la fixation du point de départ est incertaine et les infractions concernées par ce régime sont susceptibles d’être de facto imprescriptibles. Comme l’a relevé le Syndicat national des magistrats-FO, « la loi a mis la victime au cœur du dispositif d’octroi de l’oubli », conduisant à ce que « le temps de la prescription [soit] suspendu tant que la victime individuelle ne peut exercer tous ses droits » (166).
• Le report à raison de la spécificité de l’infraction
D’autres motifs, plus ponctuels, ont conduit le législateur à décider du report du point de départ du délai de prescription de l’action publique pour certaines infractions spécifiques. Sans être exhaustif, les autres cas légaux de report concernent :
–– le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, pour lequel « la prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire » ou « à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation » (dernier alinéa de l’article 314-8 du code pénal) ;
–– le délit d’usure, pour lequel la prescription de l’action publique « court à compter du jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital » (dernier alinéa de l’article 313-5 du code de la consommation) ;
–– le délit de banqueroute et ses infractions assimilées, pour lesquels « la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date » (article L. 654-16 du code de commerce) ;
–– les infractions liées au non-paiement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur ou le travailleur indépendant, pour lesquelles « les délais de prescription de l’action publique commencent à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suit, selon le cas, soit l’avertissement [de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois dans le cas où la poursuite a lieu à la requête du ministère public], soit la mise en demeure [adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public] » (article L. 244-7 du code de la sécurité sociale) ;
–– certains crimes et délits électoraux, pour lesquels la prescription de l’action publique court « à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection » (article L. 114 du code électoral) ;
–– les crimes et délits d’insoumission ou de désertion, pour lesquels la prescription de l’action publique « ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur a atteint l’âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire », fixé à cinquante ans (167) (article L. 211-13 du code de justice militaire). Il en est d’ailleurs de même pour la prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion (article L. 267-2 du même code) ;
–– ou tout crime ou délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire qui impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, auquel cas le délai court à compter du moment où est intervenue une décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion (article 6-1 du code de procédure pénale).
b. L’acception jurisprudentielle extensive des motifs d’interruption et de suspension de la prescription
La multiplication des motifs d’interruption (i) et de suspension (ii) du délai de prescription de l’action publique contribue également à en proroger le cours. Comme pour le report du point de départ, vos rapporteurs se sont concentrés sur l’état de la jurisprudence relative aux motifs d’interruption et de suspension de la prescription de l’action publique, la prescription des peines suscitant moins d’observations (voir l’encadré ci-après).
L’interruption et la suspension de la prescription des peines
Depuis l’intervention du législateur dans ce domaine en 2012 (1), l’article 707-1 du code de procédure pénale dispose que la prescription des peines « est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution ».
Elle est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exécution de la peine : remise conditionnelle d’une peine (Cass. crim., 30 mars 1957), exécution d’une autre peine à l’étranger (Cass. crim., 2 juin 1964, n° 64-90.046), octroi d’un sursis, etc.
(1) Article 18 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
i. L’extension progressive de la notion d’acte interruptif
Les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale prévoient que le cours de la prescription de l’action publique peut être interrompu par un « acte d’instruction ou de poursuite ». A contrario, ne sont pas interruptives de prescription les simples mesures d’administration judiciaire ou d’ordre intérieur (168). Pour être interruptif, l’acte doit être régulier (169). Vos rapporteurs ont pu constater que l’interruption de la prescription présentait un caractère particulièrement vaste, tant au regard de ses effets que de la nature même des actes qui peuvent la causer.
Quant à ses effets, l’acte interruptif efface le délai de prescription déjà écoulé en faisant commencer un nouveau délai de prescription d’une durée équivalente au délai d’origine (170). Aucune limite n’est posée au nombre d’actes susceptibles d’interrompre la prescription. Bien que cantonnée aux seuls faits poursuivis, l’interruption développe ses effets à l’égard de toutes les personnes pouvant être concernées par les faits, celles effectivement impliquées et celles qui pourraient potentiellement l’être, auteures ou complices, connues ou inconnues (171), poursuivies ou non, nommément désignées ou personnellement impliquées par l’acte interruptif ou non (172).
Ces effets sont amplifiés par le jeu de la connexité puisque l’interruption s’applique à toutes les infractions connexes à celle pour laquelle l’acte interruptif a été pris ou qui sont indivisibles de celle-ci, dès lors que la prescription n’était pas encore acquise, même si les poursuites ont été exercées séparément ou par réquisitoire supplétif (173) et même si les infractions n’ont pas le même auteur (174). De surcroît, ainsi que l’a indiqué à vos rapporteurs M. Jean Maïa, directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, outre les cas prévus par l’article 203 du code de procédure pénale (175), la jurisprudence a élargi les cas de connexité lorsqu’il « existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » (176), pour les infractions procédant « d’une conception unique » (177) et pour les faits procédant d’une identité d’objet et d’une communauté de résultat (178).
De rares textes prévoient expressément des motifs d’interruption du cours de la prescription, comme les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale (179) et de la transaction sur certaines contraventions constatées par la police municipale (180), ou l’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour le règlement transactionnel des contraventions aux codes de commerce et de la consommation (181).
Mais, dans les autres cas, c’est la jurisprudence qui a dû interpréter la notion d’acte d’instruction et de poursuite. Elle en a développé une conception extensive tenant moins compte de l’organe qui en est à l’origine que de son objet.
• Des actes de poursuite entendus comme les actes tendant à la mise en œuvre de l’action publique
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les actes de poursuite correspondaient aux actes pris pour mettre en œuvre l’action publique, y compris ceux qui tendent à la constatation d’une infraction, qu’ils émanent du ministère public ou de la partie civile, ainsi que les arrêts et jugements.
Au rang des actes émanant du ministère public sont notamment interruptifs de prescription : l’information ouverte par le réquisitoire aux fins d’informer, quelle que soit la qualification pénale des faits qui sera finalement retenue (182) ; la citation directe du prévenu à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel (183) ; la convocation par le procureur de la République d’une personne en vue de l’entendre sur une plainte dont elle est l’objet (184) ; les instructions et mandements délivrés par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire (185) ; toute réquisition du ministère public, notamment les réquisitions aux fins de mandement de citation (186) à condition que le mandement ait été transmis à l’huissier en vue de sa délivrance avant le terme de l’année de la prescription de la contravention (187).
Preuve du caractère extensif de l’interprétation jurisprudentielle, la chambre criminelle a inclus dans cette catégorie la simple demande d’un procureur de la République adressée à une administration en jugeant, dans l’affaire des « disparues de l’Yonne », que constituait un acte interruptif tendant à rechercher des infractions et à en découvrir les auteurs le soit-transmis du parquet adressé à la direction de l’aide sociale à l’enfance, à la suite d’un entretien avec la partie civile au cours duquel avait été dénoncée la disparition de plusieurs jeunes filles qui avait donné lieu à une enquête de gendarmerie dans le passé (188). Depuis 2005, elle considère toutefois que, pour être interruptif, le soit-transmis doit révéler « au regard des circonstances dans lesquelles cet acte a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l’action publique » (189).
En définitive, ainsi que l’a souligné M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour de cassation, « [l]a notion d’acte interruptif a été étendue à des actes administratifs » (190), comme l’illustrent l’affaire des « disparues de l’Yonne » ou le cas du mandement de citation, considéré, avant 1988, comme un acte administratif non interruptif.
Les actes de la partie civile tendant à la mise en œuvre de l’action publique sont également interruptifs de prescription : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie d’intervention (191) ; citation directe en cas de contravention ou de délit ; demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles, etc. La chambre criminelle a subordonné le caractère interruptif de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction au versement de la consignation prévue par l’article 88 du code de procédure pénale dans le délai fixé par le juge (192) ou au bénéfice de l’aide juridictionnelle dispensant le plaignant de consigner (193).
Enfin, la Cour de cassation assimile aux actes de poursuite tous les jugements et arrêts définitifs ou avant-dire droit (194), la remise de cause si elle est ordonnée contradictoirement et transcrite sur les notes d’audience du greffier signées par le président (195), la décision rendue par défaut à condition d’avoir été signifiée à la personne (196), l’appel (197), l’opposition (198) ou le pourvoi en cassation (199).
En revanche, la jurisprudence a refusé de reconnaître un caractère interruptif à la simple plainte de la victime sans constitution de partie civile, qui n’a pas pour effet de déclencher l’action publique (200), même lorsqu’elle est un préalable nécessaire aux poursuites comme en matière de fraude fiscale (201) ou, en matière contraventionnelle, à une requête en exonération d’une amende forfaitaire (202).
• La double acception, formelle et matérielle, de l’acte d’instruction
S’inspirant de la rédaction du premier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale, qui dispose que « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité », la Cour de cassation a considéré que relevaient de la catégorie des actes d’instruction les actes qui ont pour but la recherche et la réunion des preuves d’une infraction réalisés au cours de l’instruction préparatoire. Sa chambre criminelle y a inclus à la fois :
–– les actes établis par le juge d’instruction : la mise en examen (203), la commission rogatoire (204), l’avis à une partie civile lui notifiant son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation (205), l’ordonnance de soit-communiqué saisissant le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l’action publique (206) et, plus généralement, « toute ordonnance rendue par le juge d’instruction » (207) ;
–– et les actes qui ont pour objet l’administration de la preuve pris par les policiers, gendarmes et agents chargés de fonctions de police judiciaire : les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire tendant à la recherche et à la constatation d’une infraction (208), comme le recueil de la plainte de la victime d’une infraction (209), l’interrogation d’un fichier (210) ou la réquisition par un officier de police judiciaire tendant à l’inscription au FNAEG d’un profil ADN (211).
ii. La suspension du délai de prescription de l’action publique lorsque l’exercice des poursuites est valablement empêché
Lorsque la partie poursuivante est placée dans l’impossibilité d’agir, le cours de la prescription peut être suspendu. Le délai qui s’est écoulé avant cette suspension n’est toutefois pas anéanti, à la différence de ce qui se produit en matière d’interruption.
Certains motifs de suspension ont été expressément prévus par la loi ou en ont été logiquement déduits, notamment :
–– lorsqu’un obstacle statutaire empêche provisoirement la poursuite de la personne : mise en cause du Président de la République (212), inviolabilité parlementaire (213), etc. ;
–– pour tenir compte de certains évènements de procédure : plainte avec constitution de partie civile (214), alternative à la poursuite (215), exception préjudicielle (216), etc. ;
–– lorsque la mise en œuvre de l’action publique suppose préalablement le recueil d’un avis : infractions militaires (217) ou fiscales (218) ;
–– en cas de consultation d’une autorité administrative : consultation de l’Autorité de la concurrence par une juridiction pénale sur des pratiques anticoncurrentielles (219), consultation pour avis de la commission de conciliation et d’expertise douanière (220) ;
–– ou en raison de la spécificité de certaines infractions : jugement ou arrêt ayant déclaré l’action publique éteinte obtenu grâce à de faux documents (221), diffamation en cas d’imputation d’un fait susceptible de revêtir une qualification pénale (222), dénonciation calomnieuse lorsque le fait dénoncé est l’objet de poursuites pénales (223), etc.
Mais c’est une nouvelle fois en dehors de tout fondement légal que la Cour de cassation a élargi les motifs de suspension de la prescription à d’autres circonstances, en tenant compte de l’existence d’un obstacle de droit ou de fait rendant impossible l’exercice de l’action publique.
Selon les personnes entendues par vos rapporteurs, la Cour de cassation « retient d’une façon générale une conception étroite de la notion d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice des poursuites » (224). Il est vrai que, quelle que soit la nature de l’obstacle, elle exige que les faits invoqués soient constitutifs de force majeure ou d’une circonstance insurmontable rendant impossibles les poursuites et que le ministère public ou la partie civile n’aient pas, par leur comportement, créé cet obstacle (225) ou conduit à la paralysie de la procédure (226).
Dans ces conditions, elle a jugé qu’étaient notamment suspensifs de prescription, outre les cas de catastrophe naturelle ou l’invasion du territoire par l’ennemi (227), la perte de tout ou partie des pièces d’une procédure (228) ou l’examen du pourvoi en cassation (229).
La chambre criminelle a en revanche refusé de reconnaître un caractère suspensif à l’exécution d’une expertise ordonnée par le juge (230) ou à l’amnésie post-traumatique de la victime (231).
Néanmoins, vos rapporteurs observent que la Cour de cassation a, ces dernières années, étendu le champ d’application de la suspension de la prescription en appliquant à la matière pénale la maxime civiliste contra non valentem agere non currit praescriptio, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir. C’est cette maxime que le législateur a choisi de consacrer pour la matière civile, en l’inscrivant en 2008 à l’article 2234 du code civil (232), mais il ne l’a pas fait en matière pénale.
Pourtant, en 2011, la chambre criminelle a considéré, pour la première fois, que « seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique » (233), sans toutefois faire application de cette décision au cas d’espèce.
Le 7 novembre 2014, l’assemblée plénière a dégagé un nouveau motif de suspension du délai de prescription en matière criminelle dès lors qu’un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles (234).
L’assemblée plénière devait se prononcer sur la prescription de sept infanticides sur les huit commis au total par une mère plus de dix ans avant le premier acte interruptif. Elle était saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi (235) qui avait résisté à l’arrêt de la chambre criminelle ayant constaté la prescription des faits (236).
À rebours de cette dernière, l’assemblée plénière a reconnu un principe de suspension de la prescription en matière criminelle « en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». En l’espèce, l’obstacle insurmontable était caractérisé par les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les grossesses (« masquées par [l’]obésité » de la mère), les accouchements (« sans témoin »), les naissances (qui « n’ont pas été déclarées à l’état civil ») et l’enfouissement des cadavres, « nul [n’ayant] été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice n’avait révélé l’existence » (237).
La solution retenue dans cette affaire diffère juridiquement de celle consistant à reporter le point de départ du délai de prescription en raison de la dissimulation de l’infraction. Les crimes, et singulièrement le meurtre, demeurent en conséquence hors du champ de la jurisprudence relative aux infractions occultes et dissimulées stricto sensu, fondée sur la nature de ces infractions et les manœuvres de dissimulation utilisées pour les commettre.
En pratique toutefois, l’effet des deux mécanismes est comparable, l’hypothèse de la suspension se confondant souvent avec celle du report du point de départ. Dans les deux cas, le cours de la prescription se trouve prorogé par la neutralisation du temps durant lequel les poursuites n’ont pas pu être exercées, soit ab initio en raison de la clandestinité de l’infraction (point de départ reporté), soit après que le délai a commencé à courir, en raison d’un obstacle insurmontable à leur exercice (écoulement contrarié).
II. LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION OU LA RECHERCHE D’UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE RÉPRESSION DES INFRACTIONS
ET SÉCURITÉ JURIDIQUE
La confusion et la complexité qui caractérisent le droit de la prescription appellent une indispensable remise en ordre des règles qui le régissent.
Comment, toutefois, réformer la prescription ? La réflexion est ancienne et les pistes d’évolution ne manquent pas. Il n’est donc plus possible de remettre à plus tard l’intervention du législateur (A). À cet égard, les solutions avancées par vos rapporteurs constituent, à leurs yeux, les composantes d’une réforme équilibrée, destinée à redonner au droit de la prescription sa lisibilité et sa cohérence et à garantir un meilleur équilibre entre l’impératif de répression des infractions et le respect du principe de sécurité juridique (B).
A. UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE
Si les auditions conduites par vos rapporteurs leur ont permis de constater que la recherche d’un parfait consensus autour de la réforme du droit de la prescription était vaine, elles leur ont aussi fait prendre conscience de la nécessité et de l’urgence d’une intervention du législateur. Certes, celui-ci est intervenu ponctuellement pour modifier les délais de prescription applicables à plusieurs infractions et reporter le point de départ du délai dans certains cas. En revanche, force est de reconnaître qu’il a jusqu’à présent échoué, peut-être en raison d’une certaine « frilosité politique » (238), à mener à bien une réforme globale des règles de prescription (1). Avant d’en venir à leurs propositions, vos rapporteurs ont souhaité expliquer les raisons pour lesquelles ils ont choisi d’écarter certaines pistes de réforme (2).
1. Des projets de réforme inaboutis
Tout au long des travaux de la mission, nombre de praticiens du droit ont insisté sur la nécessité de procéder à une réforme globale du droit de la prescription. Cette ambition n’est pas nouvelle, comme en témoignent les projets de réforme, de portée générale (a) ou d’ampleur plus limitée (b), restés lettres mortes.
a. Des tentatives de réforme de portée générale
La réflexion sur la réforme du droit de la prescription n’en est pas à ses débuts. Plusieurs rapports se sont en effet intéressés à la question et ont formulé des propositions destinées à clarifier et à simplifier les règles en la matière. Ces différents travaux conclurent à la nécessité d’allonger les délais de prescription de l’action publique mais firent des recommandations distinctes s’agissant de la détermination du point de départ du délai.
Tout d’abord, le rapport d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung fait au nom de la commission des Lois du Sénat, publié en juin 2007, a formulé sept recommandations guidées par le souci de redonner de la cohérence au droit de la prescription (239), parmi lesquelles :
–– préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription de l’action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires (recommandation n° 3) ;
–– allonger les délais de prescription de l’action publique des délits et des crimes, en les fixant respectivement à cinq et quinze ans (recommandation n° 4) ;
–– consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est révélée, et étendre cette solution à d’autres infractions occultes ou dissimulées dans d’autres domaines du droit pénal et, en particulier, à la matière criminelle (recommandation n° 5) ;
–– établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l’infraction, un « délai butoir » de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle soumis aux mêmes conditions d’interruption et de suspension que les délais de prescription (recommandation n° 6).
Ces recommandations ne furent pas reprises dans un texte de loi alors même que les propositions destinées à « réduire les délais et simplifier le régime de la prescription en matière civile », issues du même rapport, trouvèrent une traduction concrète dans l’adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Quelques mois plus tard, le rapport du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, faisait, lui aussi, plusieurs propositions destinées à parvenir à la « sécurisation des règles de la prescription » (240) :
–– fixer de manière intangible le point de départ du délai de prescription au jour de la commission des faits, de façon à rompre avec la jurisprudence de la Cour de cassation, source d’insécurité juridique ;
–– allonger le délai de prescription de l’action publique, en le portant à quinze ans en matière criminelle, sept ans pour les infractions délictuelles passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans et cinq ans pour les infractions délictuelles passibles d’une peine de prison d’une durée inférieure à trois ans ;
–– maintenir en vigueur les règles de suspension et d’interruption du délai de prescription.
Ces propositions ne trouvèrent pas non plus d’écho au plan législatif.
Enfin, l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale soumis à concertation, en mars 2010, par Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, procédait à la réécriture quasi-intégrale des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, qui devaient figurer aux articles 121-6 à 121-19 de ce code (241).
En premier lieu, les délais de prescription de l’action publique applicables aux contraventions, aux délits et aux crimes étaient respectivement fixés à un an, six ans ou trois ans selon que le délit était puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou inférieure à trois ans, et quinze ans.
En deuxième lieu, la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription devait courir à compter du jour de la commission des faits indépendamment de la date à laquelle l’infraction avait été constatée était réaffirmée. Une exception était toutefois prévue : les crimes d’atteinte volontaire à la vie commis de façon occulte ou dissimulée ne devaient se prescrire qu’à compter de la date à laquelle les faits auraient pu être portés à la connaissance de l’autorité judiciaire.
En troisième lieu, deux catégories d’actes susceptibles d’interrompre la prescription étaient définies : les actes ou décisions « émanant de la police judiciaire ou des autorités judiciaires tendant à la recherche et à la poursuite des infractions et à la condamnation de leurs auteurs » et les actes « mettant en mouvement l’action pénale, y compris s’il[s] émane[nt] de la personne exerçant l’action civile ».
En quatrième lieu, un principe général de suspension du délai de prescription « en présence soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait absolu ou insurmontable, rendant impossible l’exercice de l’action pénale », était consacré.
En cinquième et dernier lieu, l’ensemble des dispositions relatives aux délais dérogatoires de prescription de l’action publique applicables aux crimes contre l’humanité, aux crimes et délits de guerre, aux crimes et délits de terrorisme, aux crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, aux crimes et délits de trafic de stupéfiants, aux crimes et délits commis sur des mineurs (242), aux infractions en matière électorale et aux délits et contraventions de presse étaient regroupées au sein d’une même sous-section du code de procédure pénale.
Ces propositions ne virent pas le jour, pas plus que l’avant-projet dans son ensemble. Néanmoins, elles traduisent, comme celles des autres rapports sur le sujet, la richesse de la réflexion, déjà ancienne, sur la réforme attendue du droit de la prescription.
b. Des tentatives de réforme partielle
Outre ces propositions de réforme globale, de nombreuses initiatives parlementaires ont tenté de modifier ponctuellement certains pans du droit de la prescription, sans toutefois y parvenir. Les exemples sont trop nombreux pour pouvoir être tous évoqués ici. Aussi vos rapporteurs n’en citeront que quelques-uns. S’ils ne partagent bien entendu pas toujours l’intention de leurs auteurs, ils n’en demeurent pas moins convaincus que ces tentatives de réforme constituent autant de traductions de l’inadaptation des règles de la prescription.
En premier lieu, certaines initiatives ont visé à supprimer purement et simplement tout délai de prescription pour les infractions considérées comme les plus graves. Ce fut le cas, sous la XIIe législature, de la proposition de loi de M. Pierre Lellouche tendant à rendre imprescriptibles l’action publique des infractions sexuelles commises contre les mineurs ainsi que les peines prononcées (243), de la proposition de loi de M. Léonce Deprez destinée à rendre imprescriptible l’action publique des crimes commis contre un mineur ou une personne vulnérable (244), de la proposition de loi de M. Franck Gilard et plusieurs de ses collègues visant à rendre imprescriptibles l’action publique et les peines s’agissant des infractions sexuelles commises contre les mineurs (245), et de la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues tendant à rendre imprescriptible l’action publique des crimes de pédophilie (246). Ce fut aussi le cas, sous la XIIIe législature, de la proposition de loi de M. Jean-Philippe Maurer et plusieurs de ses collègues visant à supprimer tout délai prescription de l’action publique en matière criminelle (247). Aucune de ces propositions de loi ne fut toutefois inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée.
En deuxième lieu, d’autres initiatives ont été mues par le souhait d’allonger les délais de prescription applicables à certains crimes et délits. Ainsi de la proposition de loi de M. Philippe Feneuil et plusieurs de ses collègues, déposée sous la XIIe législature, dont l’article unique portait le délai de prescription de l’action publique des crimes à trente ans (248) ; de la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues, déposée sous la XIIIe législature, qui avait pour objet de faire passer ce délai à vingt ans (249) ; de la proposition de loi de M. Noël Mamère et plusieurs de ses collègues, déposée sous la même législature, qui visait à porter de trois mois à un an le délai de prescription de l’action publique des propos injurieux ou diffamatoires à caractère homophobe (250) ; et de la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet, également déposée sous la XIIIe législature, qui faisait passer le délai de prescription de l’action publique des délits d’agressions sexuelles commis contre les personnes majeures à dix ans (251). Ces textes ne furent pas davantage discutés par notre assemblée.
En dernier lieu, des initiatives infructueuses plus ou moins anciennes ont eu pour but de clarifier la règle relative à la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action publique, dans des directions cependant distinctes.
Une proposition de loi relative à la prescription du délit d’abus de biens sociaux fut ainsi déposée par M. Pierre Mazeaud au cours de la Xe législature – en novembre 1995 – afin de prévoir que la prescription de l’action publique de ce délit courrait à compter de sa découverte mais que les poursuites ne pourraient plus être engagées dès lors qu’un délai de six ans, à partir de la commission de l’infraction, se serait écoulé. La proposition de loi fut toutefois retirée par son auteur avant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, M. Michel Charasse déposa, dans le cadre de l’examen, en première lecture au Sénat, du projet de loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (252), un amendement aux termes duquel les faits constitutifs d’abus de bien sociaux – alors réprimés par l’article 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales – devaient se prescrire « par trois années révolues à compter du jour où ils [seraient] constatés dans des circonstances permettant l’exercice de l’action publique » (253). Cette disposition fut cependant supprimée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
Plus récemment, le rapporteur désigné par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (254) déposa un amendement tendant à donner un fondement légal à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ du délai de prescription des infractions dissimulées. Dans son rapport, notre collègue Yann Galut affirmait qu’une telle modification « consolidera[it] cette règle, fragile car uniquement jurisprudentielle, mais sans laquelle il serait en pratique quasiment impossible de poursuivre et juger les auteurs d’infractions économiques et financières » (255). La disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, fut supprimée par la commission des Lois du Sénat à la suite d’un amendement déposé par le Gouvernement, soucieux « d’engager une réflexion plus approfondie en vue de donner au droit de la prescription une assise législative et constitutionnelle pérenne » (256).
Enfin, une proposition de loi déposée le 13 février 2014 par les sénatrices Muguette Dini et Chantal Jouanno visait à modifier en profondeur les règles relatives à la détermination du point de départ du délai de prescription des infractions de nature sexuelle. Un nouvel article – l’article 8-1 – était inséré dans le code de procédure pénale afin de prévoir que le délai de prescription de l’action publique des crimes et des délits de cette nature commis tant sur les mineurs que sur les majeurs ne commencerait « à courir qu’à partir du jour où l’infraction [serait] apparue à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique » (257). La proposition de loi fut toutefois significativement modifiée en séance publique, la commission des Lois du Sénat
– qui n’avait pas adopté de texte – ayant présenté des amendements transformant intégralement le dispositif initial. Ainsi, la disposition portant sur le report du point de départ fut supprimée tandis que les articles 1er et 2 de la proposition de loi furent totalement réécrits afin de prévoir que :
–– le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale et à l’article 222-10 du code pénal commis contre des mineurs (258) serait porté de vingt à trente ans ;
–– le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis contre des mineurs, fixé à ce jour à dix ans, serait porté à vingt ans ;
–– le délai de prescription de l’action publique des délits prévus aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, aujourd’hui fixé à vingt ans, serait porté à trente ans.
L’examen de cette proposition de loi, adoptée sans modification par notre Commission mais rejetée par l’Assemblée nationale, fut l’occasion pour le président Jean-Jacques Urvoas d’appeler de ses vœux la création d’une mission d’information sur la prescription en matière pénale, afin d’éclairer la représentation nationale dans la perspective d’une « révision d’ensemble » (259) de ce pan de notre procédure pénale, de même qu’il permit à notre collègue Colette Capdevielle de faire remarquer, à juste titre, qu’« il n’[était] plus possible (…) d’aborder la question des prescriptions infraction par infraction » et qu’« une réforme d’ensemble [était] devenue indispensable » (260).
Vos rapporteurs partagent ce sentiment. Même s’ils sont conscients que les tentatives de réforme globale n’ont jamais abouti par le passé, ils demeurent convaincus que, face à l’illisibilité des règles en vigueur et eu égard à la nécessaire recherche d’une plus grande sécurité juridique au bénéfice de tous les justiciables, il importe de renoncer à toute modification partielle qui n’aurait pour conséquence que d’abimer davantage encore la cohérence d’un système désormais à bout de souffle.
2. Le choix d’une réforme équilibrée
Au terme de leurs travaux, vos rapporteurs ont examiné avec attention les perspectives de réforme du droit de la prescription qui leur ont été proposées. Ils ont veillé à respecter plusieurs exigences contradictoires, rassemblées par M. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes et maître de conférences à l’Université de Nantes, sous la forme d’« un quadruple équilibre » :
–– équilibre entre le droit à la sécurité et celui au procès équitable ;
–– équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable ;
–– équilibre entre la mise en œuvre des moyens techniques d’élucidation des infractions et la nécessité de délimiter le champ du travail de la police, de fixer des priorités pour éviter la paralysie, la dispersion des moyens et l’arbitraire de choix laissés aux forces de police ;
–– enfin, équilibre entre les différents foyers de sens de la peine, entre le rappel de la loi et la défense de la société, d’une part, qui n’impliquent pas la prescription, et, d’autre part, le sens éducatif, le principe de proportionnalité, la nécessité et l’utilité de la peine qui, eux, la justifient (261).
Au-delà, vos rapporteurs ont pris soin de tenir compte de l’évolution des attentes de la société à l’égard de la prescription, qui ne doit pas favoriser l’impunité de certains délinquants, et de la nécessité de restaurer la sécurité juridique, en préservant le « régime spécial » applicable à certaines infractions (a) et en écartant les scénarios mettant en péril l’équilibre général de la réforme (b).
a. La préservation des « régimes spéciaux » applicables à certaines infractions
La réforme proposée par vos rapporteurs ne remet pas en cause l’existence des « régimes spéciaux » qui sont réservés à certaines infractions, conduisant à l’application d’un délai de prescription de l’action publique allongé ou abrégé, selon la nature de l’infraction considérée.
Tout d’abord, le régime spécial applicable à la prescription de l’infraction de fraude fiscale mérite d’être maintenu. Vos rapporteurs ont en effet été convaincus que le délai de prescription de l’action publique d’une durée de six ans, qui commence à courir le 1er janvier suivant l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée ou a été minorée et qui est suspendu durant six mois pour permettre à la commission des infractions fiscales d’émettre un avis (262), était parfaitement adapté à la spécificité de la matière fiscale.
M. Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, en a souligné la pertinence au regard du rôle décisionnaire de l’administration fiscale dans l’exercice des poursuites, de la nécessité de mener une réflexion précise et une analyse fine de l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale – travail qui recoupe largement celui qu’effectue l’administration lorsqu’elle détermine les sanctions administratives – et de l’articulation avec les délais de prescription fiscale régissant l’établissement de l’impôt et son recouvrement (263). MM. Bastien Llorca, sous-directeur du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, et Gradzig El Karoui, chef du bureau des affaires fiscales et pénales au sein du service du contrôle fiscal, ont également estimé que le délai actuel était équilibré et cohérent, permettant à l’administration de poursuivre dans des conditions satisfaisantes ce délit invisible.
De même, dans le domaine forestier, il n’apparaît pas utile de revenir sur le délai de prescription de l’action publique de six ans du délit de défrichement irrégulier mentionné à l’article L. 341-3 du code forestier car, ainsi que l’ont indiqué à vos rapporteurs plusieurs magistrats instructeurs, ce délai permet d’examiner s’il s’agit d’une véritable entreprise de déforestation ou si un reboisement ou une réimplantation d’arbres doivent intervenir (264).
Un constat similaire s’impose pour les infractions qui obéissent à des délais de prescription abrégés. Il s’agit notamment de certaines infractions au code électoral, pour lesquelles le délai de prescription de six mois, courant à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection (265), s’explique par « la nécessité de purger rapidement le contentieux de l’élection et [de] stabiliser la représentation démocratique » (266).
C’est aussi le cas du délai abrégé à trois mois ou un an applicable aux infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (267), en raison de la protection particulière qu’il convient d’apporter à la liberté d’expression. Comme plusieurs représentants de syndicats de presse l’ont souligné, « une personne visée dans un article dont elle considère les termes injurieux ou diffamatoires n’attend pas pour agir » (268). En outre, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, ce délai abrégé « ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi » (269). De surcroît, comme l’a justement indiqué M. Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, ce délai « a toujours été justifié par l’objectif de rapprocher au maximum la date du jugement de la date de la publication, non seulement dans l’intérêt des victimes qui veulent laver leur honneur rapidement, mais également dans celui de la presse qui doit conserver ses preuves et peut être amenée à s’autocensurer en raison d’une procédure en cours, alors qu’elle obtiendra gain de cause au final, ce qui nuit à l’information du citoyen » (270).
Bien que conscients des propos inacceptables qui sont parfois tenus sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, vos rapporteurs considèrent qu’un alignement du délai de prescription des infractions de presse sur le délai de droit commun serait inopportun et inutile.
Mme Fabienne Siredey-Garnier, présidente de la 17e chambre du TGI de Paris, a très justement indiqué à vos rapporteurs qu’« il peut paraître paradoxal d’arguer de la difficulté d’être tenu informé de propos attentatoires à telle ou telle valeur sociale ou individuelle alors même que les moteurs de recherche (…) ou les techniques informatiques permettent précisément une veille d’un niveau jamais atteint » et que « le problème des informations diffusées sur les réseaux sociaux (…) n’est pas tant celui de la prescription que les techniques employées par les auteurs des infractions pour dissimuler leur identité, héberger leurs données à l’étranger et se soustraire ainsi aux poursuites » (271).
La prescription de ces affaires ne semble d’ailleurs pas soulever de difficultés pratiques. En effet, d’après une étude statistique consacrée aux moyens de procédure opposés à la poursuite devant la 17e chambre du TGI de Paris au cours de l’année 2010 (272), seuls huit moyens de prescription auraient été soulevés
– dont trois accueillis et ayant mis partiellement ou totalement fin à la poursuite – sur 237 décisions rendues (273).
Une autre solution aurait pu consister à établir une distinction entre les propos tenus par des « journalistes professionnels », pour les soumettre à une prescription abrégée, et les autres citoyens, dont les propos constitutifs d’infractions auraient été, quant à eux, soumis au délai de droit commun. Mais comme l’a indiqué M. Christophe Bigot, « il est tout à fait impossible de faire de la prescription trimestrielle le marqueur d’un droit strictement professionnel » puisque « les journalistes ne sont pas les seuls à contribuer à l’information du public » et que « de nombreuses personnes qui ne sont pas détentrices de cartes de presse y contribuent : les auteurs de livres, des personnalités de tous bords, les blogueurs, les hommes politiques, les syndicalistes, ou les simples citoyens, pour ne citer que quelques exemples » (274).
Proposition n° 1 Maintenir en l’état les règles de prescription applicables aux « régimes spéciaux » (infractions de presse, infractions fiscales, infractions au code électoral…). |
b. Les scénarios écartés par vos rapporteurs
Parmi les nombreuses propositions formulées devant la mission d’information, vos rapporteurs ont également écarté toutes celles qui auraient remis en cause l’équilibre général de la réforme attendue par tous, qu’il s’agisse de l’extension du périmètre de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes de guerre (i), de la fixation invariable du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la commission des faits (ii) ou de l’instauration d’un délai de prescription processuelle ou « délai butoir » (iii).
i. Étendre l’imprescriptibilité à certains crimes commis contre les personnes
Si la quasi-unanimité des personnes entendues ont souhaité le maintien du champ actuel de l’imprescriptibilité, des associations d’aide aux victimes ont proposé d’en étendre le champ à l’ensemble des infractions sexuelles (275)ou des crimes (276). L’Institut pour la justice a également proposé de rendre imprescriptibles d’autres peines que celles appliquées au crime de génocide et aux autres crimes contre l’humanité, comme les condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité, les condamnations criminelles pour terrorisme et les condamnations criminelles prononcées en récidive (277). Pour Mme Christine Courtin, maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis, « le principe de l’effectivité de la justice pourrait justifier une imprescriptibilité de la peine » (278).
Tout en maintenant un régime général de prescription, plusieurs pays ont rendu imprescriptibles certaines infractions et certaines peines, en dehors du crime de génocide, des autres crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (279) :
–– en Allemagne, les meurtres commis avec circonstances aggravantes prévues par l’article 211 du code pénal à raison d’un mobile spécifique (envie de tuer, rapacité, satisfaction de l’instinct sexuel) ou d’un modus operandi particulier (cruauté ou perfidie) ainsi que les peines de prison à perpétuité ;
–– en Autriche et en Italie, les infractions punies d’un emprisonnement à vie ; en Autriche, les peines de prison à vie, les peines de prison d’une durée supérieure à dix ans et le régime de détention dans un établissement spécialisé pour anomalies mentales ;
–– au Brésil, les infractions à caractère raciste et celles liées à la constitution de groupes armés civils ou militaires agissant contre l’ordre constitutionnel et l’État démocratique ;
–– en Espagne, les délits contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé (sauf ceux punis par l’article 614 du code pénal) ainsi que les délits de terrorisme ayant causé la mort d’une personne ;
–– aux Pays-Bas, les crimes et délits réprimés d’une peine de prison d’une durée de douze ans ou plus et les crimes et délits de violences ou de nature sexuelle commis à l’encontre d’un mineur ;
–– en Russie, les infractions de terrorisme et les peines qui leur sont applicables ;
–– en Suisse (280), « les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes », ce qui vise indirectement le terrorisme, et les crimes sexuels à l’encontre d’enfants âgés de moins de douze ans (281), ainsi que les peines qui leur sont applicables.
Vos rapporteurs, conscients du grave trouble que ces infractions causent à l’ordre public, sont naturellement attachés à leur juste et efficace répression. S’agissant des infractions à caractère sexuel commises contre les mineurs, le législateur a déjà adapté les règles de la prescription afin de tenir compte de leur état de vulnérabilité, en allongeant à dix ou vingt ans le délai de prescription de l’action publique auquel elles sont soumises et en reportant le point de départ à la majorité de la victime. Dans ces conditions, si, comme l’ont indiqué à vos rapporteurs les docteures Violaine Guérin, présidente de l’association Stop aux violences sexuelles (SVS), et Muriel Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie, la majorité des agressions sexuelles sont perpétrées sur les enfants, qui développent un mécanisme de protection psychique les empêchant de conscientiser les faits et de les révéler à la justice immédiatement, les règles actuelles permettent déjà de tenir compte de cette amnésie post-traumatique et de révéler des faits tardivement. Le régime actuel de prescription de ces infractions n’est donc pas de nature à assurer une quelconque impunité à leurs auteurs et permet aux victimes de faire valoir leurs droits en justice.
L’extension de l’imprescriptibilité à la poursuite des infractions sexuelles et à l’exécution de certaines condamnations criminelles ne paraît donc ni souhaitable, ni opportune en France. Pareille disposition soulève des problèmes de principe, en procédant d’un déséquilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable et équitablement. En effet, comment apporter la preuve de faits trop anciens plusieurs dizaines d’années après leur commission ? Ne serait-ce pas, plus généralement, exposer la société et la justice à des risques d’instrumentalisation des poursuites ? Enfin, l’autorité judiciaire ne serait-elle pas dissuadée de mettre rapidement à exécution ses jugements si les peines étaient rendues imprescriptibles ?
Dès lors, pour vos rapporteurs, l’imprescriptibilité doit demeurer réservée aux crimes les plus graves, ceux qui causent un trouble à l’humanité tout entière par la négation de l’homme ou parce qu’ils touchent à la personne humaine. Comme le rappelait M. Robert Badinter en 1996, au moment où certains parlementaires souhaitaient rendre imprescriptibles les actes de terrorisme, « [l]’imprescriptibilité est née du refus de nos consciences d’accepter que demeurent impunis, après des décennies, les auteurs des crimes qui nient l’humanité » et « ne saurait être étendue, (…) dans une sorte de mouvement émotionnel, » à d’autres crimes (282).
Vos rapporteurs souscrivent totalement à cette recommandation et souhaitent que l’imprescriptibilité soit réservée aux crimes contre l’humanité et, ainsi qu’ils vous le proposeront ultérieurement, aux crimes de guerre, qui leur sont souvent étroitement liés (283).
ii. Fixer invariablement le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la commission des faits
Vos rapporteurs se sont également interrogés sur la manière dont le législateur devait tenir compte de la spécificité des éléments constitutifs de certaines infractions ou de leurs conditions de commission, s’agissant en particulier des infractions occultes par nature ou dissimulées.
Dans un premier temps, ils ont envisagé de préconiser un allongement significatif des délais de prescription de l’action publique de droit commun en contrepartie de la fixation du point de départ du délai au jour de la commission des faits, quelle que soit la clandestinité de l’infraction, conformément à la lettre de l’article 7 du code de procédure pénale.
Certaines personnes entendues par la mission d’information ont d’ailleurs plaidé en faveur d’un tel système, à l’instar de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation ou du professeur Jean Pradel. Le rapport du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, avait également formulé, en 2008, une proposition similaire.
Mais, pour vos rapporteurs, cette solution, destinée en principe à englober les situations d’occultation ou de dissimulation, aurait en pratique constitué une forme de prime à la dissimulation et un encouragement à la délinquance astucieuse, en favorisant l’impunité des auteurs des infractions clandestines et dissimulées. C’est ce qu’ont notamment souligné les représentants d’associations de lutte contre la corruption, MM. Éric Alt, vice-président d’Anticor, et William Bourdon, président de Sherpa.
D’une part, elle aurait conduit à rallonger à l’excès les délais de prescription de l’ensemble des infractions de droit commun, pour le seul besoin de la répression des infractions clandestines. Or, comme l’a souligné M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, il « paraît peu opportun (…) d’allonger indistinctement les délais en question pour la masse des infractions qui ne sont en rien occultes ou dissimulées » (284).
D’autre part, elle n’aurait pas ménagé un juste équilibre entre l’impératif de sécurité juridique, qui commande en l’occurrence la fixation invariable du point de départ au jour de la commission des faits, et l’efficacité de la répression des infractions concernées, qui impose de tenir compte des éléments constitutifs de l’infraction ou de leurs conditions de réalisation. Comme le rappelait M. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes et maître de conférences à l’Université de Nantes, « quel que soit le délai de prescription que l’on retienne, il y a toujours le risque en certains cas que la prescription ait couru contre celui qui était empêché d’agir, victime ou ministère public et qu’à un mois ou deux mois près elle soit acquise à l’engagement des poursuites » (285). Ce constat a été corroboré par les propos de M. Renaud Van Ruymbeke, premier vice-président du TGI de Paris, chargé des fonctions de juge d’instruction au pôle économique et financier, qui a estimé qu’une telle solution, inadaptée à l’ingéniosité des techniques aujourd’hui utilisées pour organiser la fraude et la dissimuler, créerait l’impunité pour la grande délinquance offshore et opaque.
Enfin, elle aurait mis à néant plusieurs décennies de construction jurisprudentielle, certes élaborée en dehors de toute prescription légale mais inspirée de l’expérience de la poursuite d’infractions astucieuses, sorte de « patrimoine judiciaire auquel il faut toucher avec beaucoup de précaution », selon la préconisation de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation. C’est pourquoi vos rapporteurs ont écarté cette solution et recherché d’autres propositions ne conduisant pas à rendre aisément prescriptibles les infractions pour lesquelles la partie poursuivante a été mise dans l’impossibilité d’agir.
iii. Instaurer un « délai butoir » au terme duquel l’action publique serait, en toute hypothèse, éteinte
Vos rapporteurs ont enfin examiné la proposition consistant à instaurer un « délai butoir », courant à compter de la commission des faits ou de la mise en cause du prévenu, au terme duquel l’action publique s’éteindrait, quels que soient les motifs d’interruption et de suspension susceptibles d’être soulevés.
S’inspirant d’un mécanisme de l’ancien droit tombé dans l’oubli (286), M. Bertrand Louvel a ainsi proposé d’introduire un mécanisme de prescription processuelle afin de renforcer l’application effective du droit à être jugé dans un délai raisonnable : « [i]l ne faut pas (…) que l’action publique se trouve paralysée par une prescription trop courte ou une application trop mécanique qui interdirait toutes recherches sur des faits particulièrement graves.
« Mais cette préoccupation légitime ne peut non plus, une fois les investigations lancées, se satisfaire au nom de l’efficacité, ou au prétexte malheureusement bien réel de l’insuffisance des moyens de l’autorité judiciaire, de poursuites interminables.
« Or, il existe un risque de voir la durée des procédures s’accroître dès lors que la combinaison des différentes techniques de rallongement des délais de prescription, notamment celle des interruptions successives, permet que l’action engagée devienne, dans les faits, quasiment imprescriptible.
« D’où la nécessité d’un garde-fou qui pourrait consister à prévoir une seconde prescription, de type processuel, venant limiter le temps de la procédure pénale elle-même.
« Conçu comme un délai préfix courant à compter de la mise en cause de la personne, par exemple à l’occasion d’une garde à vue, un tel mécanisme garantirait à ceux sur lesquels pèsent officiellement des charges, et qui se trouvent ainsi placés en situation de précarité judiciaire, un dénouement à bref délai de la poursuite conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
« Ce mécanisme, combiné à la suspension de la prescription en cas d’impossibilité d’agir, aurait au surplus le mérite de la simplicité et de la lisibilité en mettant fin à un dispositif d’actes interruptifs qui est à la source lui aussi de discussions et d’incompréhension » (287).
M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur de Tracfin, a également évoqué cette possibilité devant vos rapporteurs. Tout en reconnaissant son caractère hétérodoxe et la nécessité de l’articuler avec une profonde réorganisation judiciaire, une telle proposition serait, selon lui, d’une part, susceptible d’écarter les risques d’imprescriptibilité de fait générés par le jeu des interruptions et suspensions de prescription, et, d’autre part, de restaurer la crédibilité du système judiciaire français par rapport à d’autres systèmes internationaux qui sont en mesure de juger les affaires, notamment économiques et financières, plus rapidement.
Un tel mécanisme est à distinguer du « délai butoir » pour la prescription des infractions occultes ou dissimulées proposé, en 2007, par MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, lequel aurait eu vocation à être interrompu au premier acte de poursuite ou d’instruction et suspendu dans les conditions de droit commun (288).
Vos rapporteurs sont attentifs à ce que les procédures judiciaires respectent une durée globale acceptable, conforme aux exigences posées par la CEDH en matière de droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ils considèrent toutefois qu’une telle solution supposerait, au préalable, une réorganisation profonde du système judiciaire et le renforcement significatif des moyens mis à sa disposition. De plus, comme l’ont souligné les représentants de l’Union syndicale des magistrats au cours de leur audition, l’institution d’un délai global des poursuites au terme duquel les faits poursuivis seraient automatiquement prescrits pourrait dissuader la réalisation d’expertises complexes, pourtant nécessaires à la recherche de la vérité, et compromettre plus globalement l’exercice des droits de la défense. Il n’est pas non plus à exclure, comme l’a envisagé M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, qu’un tel délai encouragerait les prévenus à multiplier les recours dilatoires afin d’obtenir la prescription processuelle de l’affaire.
En définitive, ainsi que le résumait parfaitement le rapport précité du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, le « délai butoir » « peut être contourné par des disjonctions, il présente des risques du fait de la lourdeur de la coopération judiciaire internationale et, plus généralement, l’institution judiciaire ne maîtrise pas la durée de la procédure (avec notamment le risque de demandes dilatoires). L’exemple de l’Italie, où nombre de procédures atteignent la prescription du fait de ces pratiques dilatoires et de la multiplicité des recours, est à cet égard instructif » (289).
Vos rapporteurs n’ont donc pas retenu cette proposition. Ils estiment que le contrôle exercé par la CEDH sur le respect de l’exigence de délai raisonnable posée par l’article 6.1 de la CESDH répond déjà en partie à la problématique des délais des poursuites. Ils formuleront néanmoins ultérieurement une proposition tendant à prévenir l’imprescriptibilité de fait qui résulterait de l’éventuelle inaction prolongée de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre des poursuites (290).
B. UN DROIT DE LA PRESCRIPTION PLUS PROTECTEUR DES INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ
De prime abord, vos rapporteurs souhaitent réaffirmer leur profond attachement au principe même de la prescription. Force est pourtant de constater que cet attachement n’est pas universellement partagé. Outre les pays dans lesquels l’imprescriptibilité est appliquée à certaines infractions limitativement énumérées (291), les pays de common law, comme l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, n’ont pas érigé la prescription en principe mais en exception en n’édictant pas de règles générales en la matière (statutory time-limit).
Mais vos rapporteurs observent que, même dans ces pays, l’imprescriptibilité n’est pas toujours la règle. Au Royaume-Uni, la répression des infractions les moins graves (summary offences) et de certaines infractions graves (indictable offences) est soumise à un délai de prescription. Aux États-Unis, où le régime de prescription des infractions fédérales est régi par le United States Code, seules sont imprescriptibles les infractions punies de la peine de mort alors que les autres infractions sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. Pour le reste, chaque État fédéré décide de ses règles de prescription : les crimes les plus graves sont en principe imprescriptibles mais la durée moyenne du délai de prescription varie d’un an à trois ans pour les infractions les moins graves (misdemeanors) et de trois à six ans pour les infractions plus graves (felonies). L’imprescriptibilité des peines est également atténuée par l’interprétation que font les juridictions fédérales de la Due Process Clause du XIVe amendement de la Constitution, aux termes duquel aucun État « ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, sans procédure légale régulière ». En Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, la théorie jurisprudentielle de l’abuse of process permet à un tribunal de faire cesser les poursuites contre un prévenu lorsqu’il estime qu’elles sont abusives, c’est-à-dire lorsque la tenue d’un procès équitable ne peut pas être garantie ou lorsque l’accusation a fait un mauvais usage d’une procédure de nature à priver le défendeur de certaines garanties (292).
En tout état de cause, pour vos rapporteurs, la prescription repose en France sur des fondements encore solides tenant à la fois à la nécessité de sanctionner l’exercice tardif du droit de punir, de garantir un jugement dans un délai raisonnable ou de prévenir la tenue d’un procès inéquitable en raison de la dégradation des preuves, notamment humaines, et au besoin de réguler le stock des affaires pénales sur la base d’un critère objectif (293). La prescription est d’ailleurs moins contestée dans son principe même qu’au regard de ses modalités d’application qui doivent s’adapter aux attentes sociales et aux besoins des autorités de poursuite.
Dans ces conditions, vos rapporteurs souhaitent conserver, tout en le modernisant, un système de prescription. Avant toute chose, ils recommandent de mettre de l’ordre dans les dispositions des codes pénal et de procédure pénale qui régissent la prescription (1). Ils suggèrent de réserver l’imprescriptibilité aux crimes les plus graves et de l’appliquer ainsi, en cohérence avec le droit international, aux crimes de guerre (2). Ils proposent de conserver le principe de la prescription pour les autres infractions mais d’en réformer le régime juridique, en allongeant les délais de droit commun (3), en adaptant les règles de computation des délais aux exigences de la répression des infractions et à l’impératif de sécurité juridique (4), et en imaginant de nouvelles modalités d’extinction de l’action publique en cas d’inaction prolongée de l’autorité judiciaire (5). En outre, ils souhaitent que l’ensemble de ces règles fassent l’objet d’une interprétation stricte (6).
1. Rationaliser l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription
Initialement, l’ensemble des dispositions relatives à la prescription de l’action publique et des peines figuraient dans le code de procédure pénale (articles 7 à 10 pour l’action publique et 763 à 767 pour les peines), mais l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, n’a laissé au premier que ce qui a trait à la prescription de l’action publique.
Toutefois, comme vos rapporteurs l’ont brièvement évoqué précédemment et comme Mme Raphaële Parizot, professeure à l’Université de Poitiers, l’a fort justement relevé, l’ordonnancement de ces dispositions n’obéit aujourd’hui à aucune véritable logique. D’une part, les règles encadrant chacune des deux prescriptions figurent à la fois dans le code de procédure pénale et dans le code pénal et, d’autre part, elles sont, au sein de ces codes, réparties de façon peu lisible dans plusieurs titres ou livres.
Ainsi, les articles 7 et 8 du code de procédure pénale prévoient les délais de prescription de l’action publique de droit commun des crimes et des délits mais ne mentionnent que certains délais dérogatoires. En effet, seuls les délais allongés applicables à certaines infractions commises contre les mineurs y sont visés, alors que les délais applicables aux infractions de nature terroriste et à la législation sur les stupéfiants sont, quant à eux, mentionnés aux articles 706-25-1 et 706-31 de ce code. Qui plus est, d’autres délais dérogatoires sont prévus par le code pénal, à l’instar de ceux applicables aux crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (article 215-4), au délit de discrédit jeté sur une décision de justice (article 434-25) ou encore aux délits et crimes de guerre (article 462-10) (294).
De la même manière, si les règles de droit commun relatives à la prescription de la peine sont fixées par les articles 133-2 à 133-4 du code pénal, d’autres articles de ce code prévoient des délais différents, comme pour le crime de disparition forcée (article 221-18). Par ailleurs, le code de procédure pénale comporte également des dispositions relatives à la prescription des peines, notamment en matière d’infractions de nature terroriste ou à la législation sur les stupéfiants (articles 706-25-1 et 706-31 précités) ou encore pour les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs (article 706-175).
Aussi vos rapporteurs estiment-ils nécessaire, à titre préalable, de rationaliser l’ordonnancement de ces dispositions et de regrouper au sein des articles 7 à 9 du code de procédure pénale les règles relatives à la prescription de l’action publique et, symétriquement, au sein des articles 133-2 à 133-4 du code pénal, celles relatives à la prescription des peines.
Cette proposition devrait être de nature à accroître la lisibilité et l’accessibilité des dispositions en question au bénéfice tant des praticiens du droit que des justiciables.
Proposition n° 2 Rationaliser l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription en regroupant au sein des articles 7 à 9 du code de procédure pénale les règles relatives à la prescription de l’action publique et au sein des articles 133-2 à 133-4 du code pénal celles relatives à la prescription des peines. |
2. Faire des crimes de guerre des infractions imprescriptibles
Si la prescription doit être maintenue, c’est aussi parce que, à l’inverse, certains crimes, heurtant particulièrement la conscience humaine, ont été rendus imprescriptibles en raison de leur exceptionnelle gravité, notamment par le droit international.
La Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 prévoit ainsi que sont imprescriptibles les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, « l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid » ainsi que le crime de génocide (295).
En France, en application de l’article 213-5 du code pénal, seuls sont imprescriptibles le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité (296). À la suite de la ratification par la France de la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale et dans le souci de se mettre en conformité avec ses obligations internationales, le législateur a décidé d’incriminer spécifiquement les crimes et délits de guerre dans le droit pénal français. Cependant, il a choisi de les soumettre, ainsi que les peines qui leur sont applicables, à une prescription allongée respectivement à trente et vingt ans (297), alors que l’article 29 de la Convention précitée disposait que « les crimes relevant de la compétence de la Cour [le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression (298)]ne se prescrivent pas ».
Ce choix était motivé par le constat que ces infractions, certes graves, n’atteignaient pas le caractère de gravité intrinsèque du crime contre l’humanité. L’application à ces infractions de délais allongés permettait toutefois « d’en marquer le caractère incommensurable avec toute autre infraction », « [l]’allongement des délais de prescription proposé (…) [traduisant] cependant un rapprochement avec les principes retenus par la cour pénale internationale » (299).
Des voix s’étaient néanmoins élevées afin de rendre les crimes de guerre imprescriptibles et de préserver ainsi l’unité du régime applicable à l’ensemble des crimes relevant de la compétence du Statut de Rome, en soumettant les crimes de guerre, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité au même régime de prescription. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait notamment considéré que l’exclusion du champ de l’imprescriptibilité des crimes de guerre « affaibli[ssait] (…) la répression des crimes et délits de guerre, menaçant l’harmonisation de la répression de ces crimes au niveau international » (300). Plusieurs parlementaires avaient également défendu cette idée au cours des débats (301), arguant notamment de la primauté qu’il convenait d’accorder aux conventions internationales sur le droit interne et de la nécessité de transposer fidèlement les dispositions prévues par le Statut de Rome (voir l’encadré ci-après).
Le débat juridique sur les conclusions à tirer, en droit interne,
des dispositions du Statut de Rome sur la CPI
Pour le Gouvernement, en tant qu’acte constitutif d’une organisation internationale, la Convention de Rome « fait obligation à tous les États parties d’adapter leur législation interne afin de " coopérer pleinement " avec la Cour » (articles 86 à 102) mais « ne fixe aucune autre obligation notamment de transposition des infractions de la compétence de la CPI » (1) et, a fortiori, de leur régime de prescription.
De surcroît, en vertu du principe de complémentarité de juridiction prévu par le Statut de Rome, « au-delà du délai de trente ans, les juridictions françaises [perdent] la faculté de juger les criminels de guerre présents sur [le] territoire ainsi que [l]es ressortissants [du pays] au bénéfice de la compétence de la cour pénale internationale » (2). Il n’y a donc pas de déni de justice.
Mais lors des débats parlementaires sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, M. Jean-Jacques Urvoas s’était interrogé sur les conséquences qu’aurait l’absence de transposition en droit interne du principe international d’imprescriptibilité des crimes de guerre, en estimant que « rien n’empêche[rait] un juge français, au nom de la hiérarchie des normes, de s’affranchir de la loi pour appliquer le traité ». En application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Dès lors, selon ce raisonnement, en vertu de la primauté du droit international sur le droit interne, un juge ordinaire, compétent pour statuer sur la compatibilité d’une disposition législative avec une convention internationale (3), pourrait écarter l’application de l’article 462-10 du code pénal et décider de poursuivre un crime de guerre normalement prescrit en droit français, eu égard à l’imprescriptibilité reconnue à cette infraction au niveau international, notamment par la Convention de Rome.
(1) Réponse du ministre des affaires étrangères et européennes, publiée au Journal officiel de la République française le 17 février 2009, à la question écrite n° 39197 de Mme Danielle Bousquet, publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2008 (XIIIe législature).
(2) Rapport (n° 326, session ordinaire de 2007-2008) précité, pp. 47-48.
(3) Pour l’ordre judiciaire, depuis l’arrêt de la Cour de cassation dit Société des Cafés Jacques Vabre (Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556), pris après que le Conseil constitutionnel eut refusé d’exercer lui-même ce contrôle (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, considérants 1 à 7).
M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, et Mme Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège de France, souhaitent que la France se mette en conformité avec le Statut de Rome en déclarant les crimes de guerre imprescriptibles. M. Bruno Cotte, fort de son expérience au sein de la CPI, a indiqué, à l’appui de sa proposition, « que nombre de faits sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (une dualité de prescription est dès lors surprenante) et que, dans l’échelle de l’horreur, (…) les crimes de guerre peuvent malheureusement atteindre des sommets » (302). La Cour de cassation a elle-même reconnu à l’occasion de l’affaire Klaus Barbie en 1985 que des mêmes faits pouvaient recevoir la double qualification, en jugeant que « constituent des crimes imprescriptibles contre l’humanité, au sens de l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 – alors même qu’ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l’article 6 (b) de ce texte – les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition » (303).
Sur le fond, vos rapporteurs estiment eux-aussi nécessaire de tenir compte de la conception unitaire des crimes internationaux développée par le droit international, qui soumet à un même régime juridique le crime de génocide, les autres crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ils observent du reste que d’autres pays ont fait ce choix, à l’image de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Russie ou de la Suisse (304). Par ailleurs, ce ne serait que reconnaître la nature particulière des crimes de guerre qui peuvent certes concerner des actes individuels isolés mais s’inscrivent généralement dans le cadre d’un plan, d’une politique ou d’une série de crimes commis à grande échelle et dans un contexte particulier. Cette préoccupation rejoindrait la « conviction éthique et politique » de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, pour laquelle « il n’est pas choquant d’envisager l’imprescriptibilité des crimes de guerre » (305).
Enfin, sur le plan juridique, aucune règle constitutionnelle ne paraît s’opposer à l’imprescriptibilité des crimes de guerre. Saisi du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel avait certes estimé que la différence de traitement au regard de la prescription entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre était conforme à la Constitution, au motif que ces deux crimes « sont de nature différente » et que « le principe d’égalité devant la loi pénale, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente » (306). Mais pour le même Conseil constitutionnel, appelé dix ans plus tôt à se prononcer sur la nécessité d’une révision de la Constitution préalablement à la ratification de la Convention de Rome précitée, « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (307).
Il faut d’ailleurs noter que, jusqu’à l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire, l’imprescriptibilité s’appliquait à certains crimes de désertion (308).
En conséquence, vos rapporteurs recommandent d’aligner le régime de prescription des crimes de guerre sur celui du crime de génocide et des autres crimes contre l’humanité. Seraient ainsi rendus imprescriptibles les crimes mentionnés par le chapitre premier du livre quatrième bis du code pénal :
–– les crimes de guerre commis dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux : les atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes (309) (mutilations et expériences scientifiques ou médicales ; violences sexuelles ; traitements humiliants et dégradants), certaines atteintes à la liberté individuelle de personnes protégées par le droit international des conflits armés (310), les atteintes aux droits des mineurs (311), le recours à des moyens et méthodes de combat prohibés (312) et certaines atteintes aux biens (313) ;
–– les crimes de guerre propres aux conflits armés internationaux : les atteintes à la liberté et aux droits des personnes (314) (utilisation d’une personne protégée par le droit international comme un bouclier humain, jugement irrégulier et partial de cette personne, etc.) et le recours à des moyens et méthodes de combat prohibés (315) (utilisation de poisons, gaz, armes ou matériels prohibés ; attaques ou bombardements de villes non défendues ; privation de nourriture aux dépens des personnes civiles ; transfert de populations civiles ; lancement d’une attaque délibérée dont on sait qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des dommages ; utilisation indue du pavillon parlementaire) ;
–– et les crimes de guerre propres aux conflits armés non internationaux : le déplacement des personnes (316) et les condamnations ou exécutions de peines arbitraires (317).
Proposition n° 3 Rendre imprescriptibles, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité, les crimes de guerre visés aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal afin de mettre le droit français en conformité avec l’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. |
3. Allonger et unifier les délais de prescription de droit commun
La question du bien-fondé d’une éventuelle modification des délais de prescription de l’action publique et des peines a occupé une place centrale dans les travaux de la mission. Cette question est cependant déjà ancienne. En effet, les rapporteurs de la mission d’information de la commission des Lois du Sénat de 2007 sur le régime des prescriptions civiles et pénales dressaient le constat suivant : « [l]es délais de prescription de l’action publique apparaissent aujourd’hui excessivement courts. L’allongement des délais de prescription décidé par le législateur pour certaines catégories d’infraction, les initiatives jurisprudentielles tendant à reporter le point de départ du délai de prescription dans certains cas comme la multiplication des motifs d’interruption [et] de suspension de la prescription sont autant de témoignages de l’inadaptation des délais actuels de prescription aux attentes de la société. Ces délais apparaissent, dans l’ensemble, nettement plus courts que ceux retenus par nos voisins au sein de l’Union européenne » (318).
Ce constat demeure d’actualité. En effet, si certains interlocuteurs de la mission, à commencer par les représentants de l’Ordre des avocats, se sont dit favorables au maintien en l’état des délais de prescription des contraventions, des délits et des crimes, la majorité des personnes entendues a appelé à un allongement plus ou moins significatif de ces délais.
Vos rapporteurs traiteront d’abord de la question du délai de prescription des crimes (a) puis feront état de leurs propositions portant sur les délais applicables aux délits (b) et aux contraventions (c).
a. Le doublement du délai de prescription de l’action publique
des infractions criminelles
Pointant du doigt l’excessive brièveté du délai de prescription décennale, certaines personnes se sont prononcées en faveur d’un allongement à trente ans du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle, qui conduirait à aligner le délai de droit commun sur le délai le plus long actuellement en vigueur (319) : ainsi du procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Claude Marin (320), des professeurs Jean Pradel et Philippe-Jean Parquet, ou encore de MM. Alain Boulay, président de l’association Aide aux parents d’enfants victimes (APEV), et Jean-Pierre Escarfail, président de l’Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels (APACS).
D’autres, plus nombreuses, ont expliqué qu’un doublement du délai
– qui passerait donc de dix à vingt ans – serait tout à fait suffisant pour améliorer la répression des infractions criminelles. D’après M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, l’allongement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique pour l’ensemble des crimes se justifierait pour deux raisons : d’une part, il s’agirait du délai maximal au-delà duquel la qualité des éléments de preuve ne serait plus préservée ; d’autre part et vos rapporteurs y reviendront plus loin, cela permettrait d’harmoniser les délais de prescription de l’action publique et des peines. Cette solution fut préconisée par d’autres magistrats, comme M. Jacques Dallest, procureur général près la cour d’appel de Chambéry, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, M. Dominique Foussard (321) et Mme Claire Waquet, des universitaires – Mme Christine Courtin, maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis – ainsi que par le directeur des affaires criminelles et des grâces, M. Robert Gelli.
Certaines personnes ont par ailleurs suggéré de moduler le délai de prescription de l’action publique en fonction du quantum de la peine de prison encourue. Pour M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour de cassation, le délai pourrait ainsi être porté à vingt ou trente ans selon la durée de la peine de réclusion criminelle (322). De même, le professeur Jean Pradel a proposé que le délai de prescription de l’action publique des crimes particulièrement graves – les crimes de nature sexuelle commis sur des mineurs par exemple – soit fixé à trente ans tandis que les autres crimes se prescriraient par vingt ans. De son côté, M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, s’est dit favorable à l’idée de porter à vingt ans le délai de prescription des seuls crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
On notera que la modulation du délai de prescription de l’action publique en fonction de la sévérité de la peine de prison encourue est une solution retenue dans de nombreux États. À titre d’exemples (323) :
–– en Allemagne, le délai est fixé à trente ans si les faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et à vingt ans si la peine de prison est d’une durée supérieure à dix ans ;
–– en Espagne, ce délai est de vingt ans si la peine d’emprisonnement est d’une durée égale ou supérieure à quinze ans et de quinze ans si la durée de la peine d’emprisonnement est comprise entre dix et quinze ans ;
–– en Italie, le délai de prescription est égal à la durée maximale de la peine de prison encourue sans pouvoir être inférieur à six ans pour les infractions les plus graves et à quatre ans pour les contraventions (324).
Soumettre les infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité à un délai
de prescription allongé : une solution envisagée puis écartée
Vos rapporteurs se sont interrogés sur l’opportunité de mettre en place un système dans lequel l’action publique, en matière de crimes, se prescrirait :
–– par trente années révolues pour les crimes punis d’une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ;
–– par vingt années révolues pour les autres crimes.
Cette solution, qui aurait certes eu le mérite de mieux adapter les règles de prescription à la gravité des infractions, a rapidement été écartée. En effet, certaines infractions criminelles, qui se prescrivent, en l’état actuel du droit, par trente ans (en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants notamment), ne sont pas punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dès lors, prévoir une prescription de trente années pour les seules infractions passibles de la réclusion criminelle à perpétuité aurait impliqué de ramener de trente à vingt ans le délai de prescription de l’action publique applicable aux crimes punis d’une peine autre que la réclusion criminelle à perpétuité : ainsi, par exemple, de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants, y compris lorsque les faits sont commis en bande organisée (article 222-35 du code pénal), de l’importation ou de l’exportation illicites de stupéfiants commises en bande organisée (article 222-36 du même code), et de nombreuses infractions commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective à caractère terroriste (voir les articles 421-1 et suivants du même code).
Face à la portée symbolique d’une telle modification du droit, vos rapporteurs ont été contraints de renoncer et de réfléchir à une solution alternative.
La solution consistant à instaurer plusieurs délais de prescription de l’action publique en fonction du quantum de la peine de prison encourue, certes séduisante, impliquerait la réécriture à tout le moins partielle, au préalable, du droit des peines, afin d’en renforcer la cohérence. Aussi vos rapporteurs ont-ils fait le choix d’écarter cette piste et lui ont préféré la solution, équilibrée à leurs yeux, consistant à fixer à vingt ans le délai de prescription de l’action publique des infractions criminelles, qui présenterait deux principaux avantages :
–– faciliter la répression des infractions, dans la mesure où des poursuites pourraient être engagées, à l’initiative de l’autorité judiciaire elle-même ou des parties civiles, dans un délai deux fois plus long qu’aujourd’hui. Sans doute peut-on espérer que cette évolution ait, pour ces mêmes raisons, un effet dissuasif ;
–– unifier les délais de prescription de l’action publique et des peines, dans la perspective d’une simplification et d’une plus grande lisibilité des règles en la matière.
Vos rapporteurs considèrent à cet égard que la distinction actuelle entre les deux délais n’est pas réellement pertinente. La dualité des règles en vigueur s’expliquerait, selon certains, par le fait que la prescription de l’action publique, nécessairement acquise alors que la personne est présumée innocente, devrait être régie par un délai plus bref que la prescription de la peine, dont le délai ne court qu’à compter du prononcé d’une condamnation définitive. Cet argument, parfaitement recevable d’un point de vue juridique, présente cependant une limite. Il revient à admettre que l’État puisse disposer de plus de temps pour mettre à exécution une sanction prononcée par l’autorité judiciaire que pour rechercher l’auteur d’une infraction, pourtant susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. Pour vos rapporteurs, cette justification apparaît quelque peu fragile.
Quoi qu’il en soit, si certains interlocuteurs de la mission se sont opposés à l’idée d’un alignement des deux délais de prescription, plusieurs d’entre eux s’y sont montrés favorables, tandis que le directeur des affaires criminelles et des grâces a indiqué, lors de son audition, qu’il n’y était pas opposé dès lors qu’il était admis qu’une telle évolution ne conduirait pas à une réduction des délais de prescription des peines.
Par ailleurs, l’allongement du délai de prescription de l’action publique des crimes tient compte d’une évolution profonde et majeure de notre société, étonnamment peu évoquée lors des travaux de la mission : l’augmentation de l’espérance de vie. En effet, si la prescription décennale pouvait apparaître adaptée lorsque le code d’instruction criminelle fut rédigé, à une époque où l’on vivait en moyenne quarante ans, tel n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, alors que l’espérance de vie moyenne des femmes s’élève à près de quatre-vingt-cinq ans et celle des hommes à plus de soixante-dix-huit ans (325).
Enfin, plusieurs personnes ont appelé de leurs vœux la suppression des délais de prescription dérogatoires applicables à certains crimes (326). D’aucuns ont par exemple insisté sur la déconnexion entre, d’une part, la longueur des délais de vingt et trente ans auxquels est soumise la prescription de l’action publique des délits et des crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants et, d’autre part, les nécessités concrètes des enquêtes en la matière.
Parmi eux, M. Jean Danet s’est par exemple interrogé en ces termes : « [p]eut-on nous citer un acte de terrorisme qui a dû faire l’objet d’un engagement de poursuites plus de dix ans après sa commission ? Sachant qu’une fois les poursuites engagées, la prescription peut être interrompue autant de fois que l’on veut, et que les juges d’instruction sont saisis in rem, ce délai d’exception n’a aucune utilité pratique. N’est-il pas d’ailleurs contradictoire avec la notion même de terrorisme qui suppose la volonté délibérée de semer la terreur et donc une recherche, hélas atroce, de publicité ? À quoi sert de laisser penser qu’on pourrait aujourd’hui découvrir un acte de terrorisme commis il y a vingt ans ? » (327) Pour M. Bruno Cotte, ramener le délai de prescription des crimes de trente à vingt ans ne « désarmerait pas l’État » dans sa lutte contre le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.
En outre, même s’il est sans doute exact que la recherche d’une meilleure lisibilité et d’une plus grande cohérence dans les dispositions applicables à la prescription des crimes supposerait de supprimer la plupart des régimes dérogatoires, vos rapporteurs n’en estiment pas moins qu’il serait inopportun de revenir sur ces délais de prescription allongés, qui se justifient par la nature particulière du trouble causé à l’ordre public. C’est en effet à raison que Mme la garde des Sceaux a pu rappeler, lors de son audition, que la gravité de ces infractions commandait l’établissement de délais dérogatoires. Qui plus est, il n’est guère envisageable, aux yeux de vos rapporteurs, que leurs propositions de réforme laissent accroire à une diminution de la répression dans ces domaines. La mission d’information sénatoriale précédemment évoquée avait d’ailleurs, elle aussi, suggéré de maintenir en l’état ces exceptions (328).
Bien entendu, il n’est pas non plus question de modifier le délai de prescription de l’action publique applicable à certaines infractions criminelles commises à l’encontre de mineurs, fixé à vingt ans en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale (329), qui se justifie par l’extrême gravité de ces infractions et par la nécessité de faciliter autant que possible la répression de ces faits odieux.
Proposition n° 4 Porter à vingt ans le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle. Maintenir en l’état les délais de prescription de l’action publique et des peines dérogatoires au droit commun applicables à certains crimes. |
b. Le doublement du délai de prescription de l’action publique
des infractions délictuelles
L’allongement du délai de prescription de l’action publique applicable aux infractions délictuelles est l’un des points qui a suscité le plus de débats tout au long des travaux de la mission. Sans doute est-ce d’ailleurs l’une des questions les plus délicates à résoudre, ainsi qu’ont pu le constater vos rapporteurs au fur et à mesure que leur réflexion progressait sur le sujet.
Rappelons tout d’abord que peu de personnes, si ce n’est les représentants du Syndicat de la magistrature, du Syndicat national des magistrats-FO et de l’Ordre des avocats, ont appelé de leurs vœux le maintien en l’état du délai de trois ans.
À l’inverse, plusieurs des interlocuteurs de vos rapporteurs, à l’instar du procureur général près la Cour de cassation, de M. Dominique Foussard ou encore du professeur Michel Véron, ont suggéré de porter ce délai à six, sept ou huit ans. Favorable à cette solution, Mme Claire Waquet l’a justifiée en expliquant qu’à la lumière d’une analyse de la jurisprudence, il apparaissait que, dans les cas où le juge avait admis que le point de départ de la prescription de l’action publique devait être repoussé, le « délai brut » entre la date des faits et l’engagement de l’action publique était d’environ sept ans, ce qui la poussait à conclure qu’en vertu d’une forme « d’inconscient judiciaire », le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle était, en pratique, de sept années (330).
D’autres personnes ont, comme en matière criminelle, préconisé d’instaurer plusieurs délais de prescription afin de tenir compte de la grande diversité des infractions délictuelles, à l’image de ce qu’avait proposé le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires présidé par M. Jean-Marie Coulon et de ce que prévoyait l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale soumis à concertation en mars 2010, resté toutefois lettre morte.
Il est exact que la catégorie des délits rassemble des infractions de gravité très variable. Parmi elles, certaines ne sont passibles, à titre principal, que de peines d’amende : ainsi des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature non rendus publics ou de l’envoi d’objets quelconques
– communément dénommés « outrages » – adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, punis, aux termes du premier alinéa de l’article 433-5 du code pénal, de 7 500 euros d’amende, mais aussi du refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, puni de 3 750 euros d’amende en application de l’article 434-15-1 du même code.
Certains délits sont également punis, à titre principal, de peines dites alternatives à l’incarcération : les personnes reconnues coupables d’avoir tagué, sans autorisation préalable, façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain encourent par exemple, aux termes du second alinéa de l’article 322-1 du même code, une amende de 3 750 euros et une peine de travail d’intérêt général « lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
D’autres infractions délictuelles sont passibles, à titre principal, de peines d’emprisonnement (complétées par des peines d’amende) dont la durée
– comprise entre deux mois au plus et dix ans au plus – varie considérablement. À titre d’illustration, la provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, prévue à l’article 433-10 du même code, est passible de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende alors que le proxénétisme aggravé – commis à l’égard d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur – est, quant à lui, puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende, en application de l’article 225-7 du code pénal. Entre ces deux extrêmes, il existe de très nombreuses infractions délictuelles punies, aux termes de l’article 131-4 de ce code, d’un emprisonnement de six mois au plus, d’un an au plus, de deux ans au plus, de trois ans au plus, de cinq ans au plus ou de sept ans au plus.
Ajoutons, enfin, que le quantum de la peine délictuelle encourue est doublé en cas de condamnation en récidive légale, dans les conditions prévues à l’article 132-10 du même code.
En conséquence, pour de nombreux interlocuteurs de la mission, la différenciation des délais de prescription de l’action publique en fonction du quantum de la peine de prison encourue constitue-t-elle la réponse idoine à la variété des infractions délictuelles. À cet égard, plusieurs propositions ont été soumises à l’appréciation de vos rapporteurs : M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour de cassation, a par exemple préconisé de maintenir le délai de trois ans pour les délits les moins graves et de porter le délai à dix ans pour les délits les plus graves commis contre les personnes. De son côté, M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, s’est montré favorable à l’idée de porter à six ans le délai de prescription des délits les plus sévèrement réprimés par notre législation pénale. Le président de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), M. Jean-Luc Bongrand, a, quant à lui, suggéré d’instaurer un premier délai pour les infractions punies d’une peine de prison d’une durée inférieure à cinq ans, un deuxième délai pour les infractions punies d’une peine de prison d’une durée supérieure à cinq ans, et un troisième délai pour les infractions non punies d’une peine de prison (331).
De manière évidente, la solution consistant à moduler le délai de prescription selon le quantum de la peine de prison encourue présenterait l’avantage de mieux ajuster les règles en la matière au regard de la gravité des infractions et d’éviter, in fine, que des actes délictueux de faible gravité puissent être poursuivis trop longtemps après les faits ou, à l’inverse, que des infractions particulièrement graves se prescrivent trop rapidement. Or l’établissement d’un délai unique fait encourir ces risques. On comprend d’ailleurs aisément qu’il n’est pas forcément justifié qu’un même délai de prescription soit applicable aux infractions d’usage de stupéfiants – puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (332) – et d’importation ou d’exportation illicites de stupéfiants – punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (333). De même, l’écart entre les peines prévues pour sanctionner un vol simple – trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende – et un vol aggravé
– dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis dans trois des circonstances mentionnées à l’article 311-4 du code pénal – est tel qu’il ne semblerait pas impertinent de définir plusieurs délais de prescription.
C’est d’ailleurs le cas dans plusieurs États européens (334) :
–– en Allemagne, le délai de prescription de l’action publique des délits est de dix ans si la durée de la peine d’emprisonnement est comprise entre cinq et dix ans ; de cinq ans si la durée de la peine d’emprisonnement est comprise entre un an et cinq ans ; de trois ans dans les autres cas ;
–– en Autriche, ce délai est de dix ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et dix ans ; de cinq ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et cinq ans ; de trois ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et un an ; d’un an si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ;
–– aux Pays-Bas, il est de six ans si le délit est puni d’une amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure à trois ans ; de douze ans si le crime ou le délit est passible d’une peine de prison d’une durée supérieure à trois ans ; de vingt ans si le crime ou le délit est sanctionné par une peine de prison d’une durée égale ou supérieure à huit ans ;
–– au Portugal, le délai est fixé à dix ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre cinq et dix ans ; à cinq ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un an et cinq ans ; à deux ans dans les autres cas.
Soucieux d’apporter au régime de la prescription la clarté et la lisibilité qui lui font aujourd’hui défaut, vos rapporteurs ont préféré écarter cette piste, dont la mise en œuvre risquerait fort de se heurter aux incohérences de l’échelle des sanctions pénales, que M. Bruno Cotte, chargé par Mme la garde des Sceaux de présider la commission de refonte du droit des peines, n’a pas manqué de souligner lors de son audition (335). Comme le président d’honneur de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), M. Michel Tubiana, ils ont bien conscience qu’il serait préférable de revoir la nature et le quantum des peines afin de les adapter au mieux à la gravité des infractions avant de fixer les délais de prescription de l’action publique et des peines. Toutefois, le réalisme oblige à reconnaître que la réécriture du code pénal n’interviendra certainement pas à brève échéance. Aussi la réforme du droit de la prescription ne saurait-elle être subordonnée à l’hypothétique redéfinition du droit des peines.
En définitive, vos rapporteurs sont favorables au maintien d’un seul délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle, qu’ils proposent de porter à six ans. Cette évolution, qui tire les conséquences de la brièveté du délai de trois ans, notamment à la lumière des comparaisons internationales, devrait permettre, ici encore, de faciliter la répression des délits les plus graves et les plus complexes à poursuivre, notamment en matière économique et financière. Plus généralement, on peut espérer qu’elle jouerait, comme en matière criminelle, un rôle positif en termes de dissuasion. Elle aurait enfin l’avantage de supprimer la distinction entre le délai de droit commun et le délai applicable au délit de fraude fiscale, porté à six ans par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 précitée (336), ce qui devrait aller dans le sens d’une meilleure appréhension des affaires complexes mêlant fraude fiscale et autres infractions astucieuses d’ordre économique et financier (l’escroquerie, le blanchiment…).
Naturellement, vos rapporteurs n’ignorent pas que l’allongement de ce délai se traduira sans doute par l’augmentation du nombre des plaintes ou des dénonciations tardives, y compris pour des faits de faible gravité. Toutefois, ils ne doutent pas que les magistrats du parquet useront de leur faculté d’engager ou non les poursuites avec discernement.
Parallèlement et dans un souci de simplification du droit, vos rapporteurs appellent de leurs vœux, pour les raisons qu’ils ont précédemment exposées, l’unification des délais de prescription de l’action publique et des peines. Dans cette perspective, ils souhaitent que le délai de prescription des peines délictuelles, aujourd’hui fixé à cinq ans en application de l’article 133-3 du code pénal, soit porté à six ans. Cette évolution irait dans le sens de la préconisation de M. Bruno Cotte qui, lors de son audition, a fait valoir que l’allongement des délais de prescription de l’action publique pourrait utilement être accompagné de l’unification des deux types de délais.
Enfin, comme en matière criminelle, vos rapporteurs ne souhaitent pas revenir sur les régimes dérogatoires actuellement en vigueur, en application desquels l’action publique se prescrit, pour certains délits, par dix ou par vingt années révolues et les peines par vingt années révolues (337). Là encore, la réduction de ces délais risquerait d’être interprétée par l’opinion publique comme une forme de laxisme, ce qui n’est clairement pas l’objectif de la réforme proposée par vos rapporteurs. Cette remarque vaut tout particulièrement pour le régime dérogatoire applicable à certaines infractions commises à l’encontre des mineurs, mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale. Vos rapporteurs considèrent en effet que les délais de prescription de l’action publique allongés sont justifiés, quand bien même les règles manqueraient de lisibilité, en raison de l’extrême gravité des infractions en question.
Proposition n° 5 Porter à six ans le délai de prescription de l’action publique et de la peine en matière délictuelle. Maintenir en l’état les délais de prescription de l’action publique et des peines dérogatoires au droit commun applicables à certaines infractions délictuelles. |
c. Le doublement du délai de prescription de l’action publique
des infractions contraventionnelles
Vos rapporteurs se sont interrogés sur la nécessité d’apporter des modifications au régime de la prescription des infractions contraventionnelles. À l’évidence, cette question ne soulève pas autant de difficultés que les deux précédentes. Toutefois, ainsi qu’ils l’ont rappelé à plusieurs reprises, ils sont soucieux d’apporter au droit de la prescription le plus de clarté et de cohérence possible. C’est pourquoi ils sont favorables, là aussi, à l’alignement des délais de prescription de l’action publique et de la peine applicables aux contraventions.
Se pose néanmoins la question de la définition du délai idoine. À cet égard, il leur semble, d’une part, qu’une harmonisation de ce délai à un an
– alignement du délai de prescription de la peine sur celui de l’action publique – comporterait le risque d’entraver le recouvrement des amendes pénales de nature contraventionnelle. Ils estiment, d’autre part, que la fixation à trois ans de ce délai unique – alignement du délai de prescription de l’action publique sur celui de la peine – présenterait l’inconvénient de permettre le déclenchement des poursuites, notamment sur la base de plaintes ou de dénonciations, trop longtemps après la commission de faits d’une gravité toute relative.
Pour vos rapporteurs, la solution la plus équilibrée consisterait à fixer à deux ans le nouveau délai unique. Ils se sont toutefois interrogés sur l’opportunité d’exclure de ce dispositif les contraventions sanctionnées par une amende dont le montant est forfaitisé. C’est peu ou prou ce que proposait, dans sa contribution écrite, M. le procureur général Jacques Dallest, lequel suggérait de porter à deux ans le délai de prescription de l’action publique des contraventions tout en maintenant le délai de prescription actuel pour les infractions au code de la route. Soucieux de poser les jalons d’une réforme aussi claire et lisible que possible, vos rapporteurs ont préféré écarter cette piste et ont souhaité conserver son unicité au régime applicable aux contraventions.
Proposition n° 6 Fixer à deux ans le délai de prescription de l’action publique et de la peine en matière contraventionnelle. |
Vos rapporteurs se sont par ailleurs interrogés sur l’opportunité d’inclure dans leur projet de réforme les cas dans lesquels certaines infractions, prévues par d’autres codes que le code pénal (338), se prescrivent en application des règles de droit commun. Deux situations doivent être distinguées.
Dans certaines hypothèses, le droit commun s’applique « automatiquement ». C’est le cas, notamment, en matière d’infractions douanières, l’article 351 du code des douanes disposant que « [l]’action de l’administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ». Plus généralement, de très nombreux codes comportent des dispositions de nature pénale réprimant certaines infractions qui se prescrivent conformément aux règles prévues par le code pénal et le code de procédure pénale, sans d’ailleurs que des dispositions particulières ne le prévoient expressément. La question se pose donc d’inclure ou non ces dispositions dans le champ de la réforme proposée. À cet égard, vos rapporteurs estiment qu’il ne serait pas logique de ne pas appliquer les nouvelles règles de droit commun aux infractions qui, à ce jour, obéissent d’ores et déjà au droit commun. Ils sont donc favorables à ce que ces infractions continuent d’être régies par les dispositions de droit commun.
Dans d’autres cas de figure, des infractions sont soumises au droit commun de la prescription en application de dispositions expresses faisant mention des délais : les articles L. 212-37, L. 212-38 et L. 212-39 du code de justice militaire énoncent par exemple qu’en matière de crimes, de délits et de contraventions de nature militaire, l’action publique se prescrit respectivement par dix ans, trois ans et un an. Pour vos rapporteurs, il ne serait pas ici non plus justifié de soumettre les infractions concernées à un régime de prescription dérogatoire au droit commun puisque tel n’est pas le cas aujourd’hui. Aussi appartiendra-t-il au législateur, au moment de l’examen du texte que vos rapporteurs souhaitent voir adopter à brève échéance, de recenser et de modifier les dispositions en question.
4. Adapter les règles de computation des délais de prescription
aux exigences de la répression des infractions
Vos rapporteurs souhaitent qu’un nouvel équilibre soit trouvé dans les règles de computation des délais de prescription, afin de mieux concilier, d’une part, la sécurité juridique et les besoins de la répression des infractions, et, d’autre part, les droits des victimes à obtenir réparation et le droit des prévenus à un jugement dans un délai raisonnable ainsi qu’à un procès équitable.
C’est pourquoi vos rapporteurs proposent de réaffirmer le principe selon lequel le délai de prescription de l’action publique court au jour de la commission de l’infraction, quelle que soit la date de sa constatation (a), y compris lorsque la victime est une personne vulnérable (b) autre qu’un mineur, cas dans lequel le report du point de départ de la prescription est justifié (c). Par ailleurs, ils suggèrent de consacrer dans la loi la jurisprudence relative au report du point de départ de la prescription des infractions occultes et dissimulées afin de tenir compte des spécificités de la délinquance astucieuse (d). Ils souhaitent également que le principe de la suspension de la prescription en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites soit inscrit dans la loi (e). Enfin, ils recommandent de déterminer avec plus de précisions les motifs d’interruption de la prescription (f).
a. Réaffirmer que le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour de la commission de l’infraction
Pour vos rapporteurs, le délai de prescription de l’action publique doit commencer à courir au jour de la commission des faits poursuivis, ainsi qu’en dispose déjà l’article 7 du code de procédure pénale. Toutefois, cette règle mérite d’être réaffirmée et de figurer plus expressément dans le code de procédure pénale afin qu’il y soit précisé que la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée.
Cette règle générale est la seule qui garantisse la sécurité juridique, en permettant à tout justiciable de connaître à l’avance et de manière certaine les modalités de calcul du délai de prescription de l’action publique.
Deux précisions doivent cependant être apportées :
–– cette règle continuerait d’être adaptée à la nature et à la durée de l’élément matériel constitutif de l’infraction : jour du dernier des actes matériels constitutifs de l’infraction complexe ou d’habitude, jour où le dommage constitutif de l’infraction de résultat apparaît, jour où la situation illicite prend fin pour les infractions continuées et continues (339) ;
–– cette règle devrait être appliquée sans préjudice des cas dans lesquels la loi reporte elle-même le point de départ du délai, à raison de la spécificité de l’infraction concernée (infractions militaires (340), fiscales et électorales (341)) ou pour certaines infractions plus « techniques », comme le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité (342), le délit d’usure (343), les infractions de non-paiement des cotisations de sécurité sociale par l’employeur ou le travailleur indépendant (344), le délit de banqueroute et les infractions commises dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation (345) ou le délit d’atteinte à la présomption d’innocence (346).
Proposition n° 7 Réaffirmer la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction. |
Par cohérence avec ce principe général, vos rapporteurs suggèrent de n’admettre le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique que dans les situations où il est possible de déterminer avec précision et objectivité le jour auquel l’infraction aurait pu être effectivement poursuivie.
b. Supprimer la règle du report du point de départ de la prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre une personne vulnérable au jour de la révélation des faits
Vos rapporteurs préconisent d’abroger la disposition prévue par le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale qui reporte le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre une personne vulnérable au jour de la révélation des faits, c’est-à-dire à un moment par nature indéterminé et incertain. Cet alinéa dispose que le délai de prescription de l’action publique de certains délits « commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
Or l’état de vulnérabilité de la victime ne peut pas justifier, en dehors de la situation très particulière des mineurs (347), le report du point de départ du délai de prescription au jour où celle-ci serait en mesure de prendre conscience de l’infraction qu’elle a subie et de la faire poursuivre. Car s’il est aisé, pour une victime mineure, de déterminer le moment objectif à partir duquel elle peut raisonnablement agir, tel n’est pas le cas pour les autres victimes vulnérables pour lesquelles ce moment dépend de leur évolution psychique.
Vos rapporteurs souscrivent aux nombreuses critiques formulées à l’égard de ce dispositif par les personnes qu’ils ont entendues : manque de précision et d’objectivité dans la définition des motifs de vulnérabilité, insécurité juridique générée par l’indétermination du jour auquel le point de départ du délai de prescription est reporté, incohérence de la liste des infractions soumises au régime dérogatoire, méconnaissance des mesures de protection juridique et humaine dont peuvent bénéficier certaines personnes vulnérables (348). Comme l’a résumé M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, « [l]e point de départ différé pour les personnes vulnérables (…) n’a pas de sens et pourrait être supprimé » (349).
Proposition n° 8 Supprimer le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale relatif au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse. |
c. Maintenir le report du point de départ de la prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre un mineur à la majorité de ce dernier
En revanche, vos rapporteurs souhaitent maintenir le report à sa majorité du point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions, principalement sexuelles, commises contre un mineur, conformément au dernier alinéa de l’article 7 et au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale. Est également concerné le report à sa majorité du délai de prescription de l’action publique du crime de clonage reproductif s’il en est résulté la naissance d’un enfant, en application du second alinéa de l’article 215-4 du code pénal.
Ces dispositions sont essentielles pour la protection des mineurs victimes et constituent un acquis ancien et constamment réaffirmé depuis leur instauration par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance. Toutes les personnes entendues par vos rapporteurs ont d’ailleurs plaidé pour leur maintien. Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, a souhaité « un statu quo sur le principe du report du point de départ à la majorité » afin de reconnaître la « spécificité pour les victimes mineures des infractions sexuelles au regard de leur très grande fragilité », car « le choc émotionnel subi surtout quand les faits ont été commis sur la durée par un parent ou une personne ayant autorité est de nature à provoquer un traumatisme profond » (350).
Le maintien de ces dispositions est d’ailleurs conforme aux tendances observées dans d’autres pays européens, qui ont choisi de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique en cas d’infractions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur au jour de sa majorité (Autriche, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal) ou à ses vingt-et-un ans (Allemagne) (351). En outre, comme l’a indiqué à vos rapporteurs M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles, « il s’agit d’une évolution internationale, préconisée notamment par la Recommandation 2002-5 du Conseil de l’Europe » (352).
Proposition n° 9 Conserver le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre les mineurs est reporté au jour de leur majorité. |
d. Consacrer la jurisprudence relative au report du point de départ de la prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées
La fixation du point de départ de la prescription de l’action publique au jour de la commission des faits poursuivis est inadaptée à la répression des infractions astucieuses. Ainsi que vos rapporteurs l’ont expliqué dans les développements qui précèdent, cette règle intangible conduirait à encourager la délinquance la plus opaque et habile (353).
C’est pourquoi il est proposé de consacrer la jurisprudence développée depuis 1935 par la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes par nature et dissimulées au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
La consécration dans la loi de cette jurisprudence permettrait de satisfaire doublement à l’impératif de sécurité juridique, et notamment aux exigences de prévisibilité et d’accessibilité du droit qui en sont des composantes :
–– inscrit dans le code de procédure pénale, le principe même du report ne pourrait plus être ignoré des justiciables qui seraient tentés de se soustraire à la justice grâce à des manœuvres de dissimulation ;
–– la définition précise par la loi des notions de clandestinité et de dissimulation délimiterait plus nettement que ne le fait aujourd’hui la jurisprudence le champ des infractions concernées par le report.
Il appartiendrait aux juges du fond de s’assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que les conditions de clandestinité et de dissimulation sont satisfaites dans chaque cas d’espèce et que la date à laquelle les faits poursuivis ont pu être portés à la connaissance de la justice n’est pas simplement hypothétique.
Proposition n° 10 Donner un fondement législatif à la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. |
e. Prévoir dans la loi que la prescription de l’action publique peut être suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites
Au-delà des cas dans lesquels le point de départ du délai de prescription de l’action publique doit être reporté en raison du caractère occulte de l’infraction ou des manœuvres utilisées pour la dissimuler aux autorités de poursuite ou à la victime, principalement en matière de délinquance économique et financière, d’autres motifs, plus larges et plus divers, ne reposant pas sur la clandestinité ou la dissimulation de l’infraction, peuvent mettre la victime ou le ministère public dans l’ignorance de faits répréhensibles et dans l’impossibilité d’agir.
Or la loi ne prévoit aujourd’hui la suspension du délai de prescription de l’action publique que pour des motifs ponctuels et limitativement énumérés, tenant par exemple à l’existence d’un obstacle statutaire à la poursuite d’une personne ou au recueil préalable de l’avis d’une autorité administrative (354). La jurisprudence a donc été contrainte d’intervenir en dehors de toute prescription légale pour autoriser la suspension de la prescription lorsque la partie poursuivante s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, en raison d’un obstacle de droit ou de fait insurmontable. Cette situation n’est pas acceptable, car elle laisse au juge le soin, en dehors de tout contrôle du législateur, de déterminer les conditions dans lesquelles la prescription peut être suspendue (nature de l’obstacle, force dirimante, etc.).
Pour combler ce vide juridique, vos rapporteurs recommandent d’inscrire dans la loi que la prescription de l’action publique est suspendue en cas d’obstacle à l’exercice des poursuites, qu’il s’agisse d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable. La référence à un obstacle de droit ou à un obstacle de fait insurmontable permet de définir avec précision la nature et la portée de l’obstacle suspensif qui ne saurait être caractérisé, aux yeux de vos rapporteurs, par de simples éléments rendant plus difficiles les poursuites mais par des difficultés irrésistibles à leur mise en œuvre, assimilables, lorsqu’il s’agit d’un obstacle de fait insurmontable, à un cas de force majeure.
Cette proposition vise à donner un fondement légal à la règle dégagée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2014 et, ainsi, à renforcer la sécurité juridique des dispositions relatives à la suspension de la prescription. Elle fait aussi écho à la solution adoptée dans le cadre de la réforme de la prescription récemment intervenue en matière civile, avec la consécration par la loi de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, désormais inscrit à l’article 2234 du code civil qui vise toute « impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Proposition n° 11 Inscrire dans la loi le principe selon lequel la prescription de l’action publique est suspendue en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites. |
f. Préciser et clarifier les motifs d’interruption de la prescription
Est aujourd’hui interruptif de prescription, au sens du code de procédure pénale, tout « acte d’instruction ou de poursuite » (355). Dans le silence et l’imprécision de la loi et afin d’adapter cette formulation aux réalités de l’instruction et des poursuites, la Cour de cassation a interprété de façon extensive la notion d’acte d’instruction, en y intégrant non seulement les actes établis par le juge d’instruction mais aussi ceux qui ont pour objet l’administration de la preuve, réalisés par les policiers, les gendarmes et les agents chargés de fonctions de police judiciaire. Elle a fait de même pour la notion d’acte de poursuite afin d’y inclure les actes émanant du ministère public et de la partie civile tendant à la mise en œuvre des poursuites. Elle a également ajouté à cette liste les actes tendant au jugement de l’auteur d’une infraction.
Les auditions menées par vos rapporteurs ont fait apparaître la nécessité d’une clarification de la notion d’acte interruptif :
–– MM. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes et maître de conférences à l’Université de Nantes, et Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont appelé à préciser davantage cette notion, sous l’angle de l’intention exprimée par la partie poursuivante et de la manifestation d’une volonté de poursuivre ou d’instruire ;
–– M. Bernard Bouloc, professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, a relevé que les actes d’enquête, préalables à la poursuite, n’étaient étrangement pas visés par la rédaction retenue par le code de procédure pénale alors qu’ils constituent l’immense majorité des actes interruptifs : aussi a-t-il suggéré, au cours de son audition, de préciser que la prescription est interrompue par tout « acte d’instruction, de poursuite ou de recherche tendant à l’établissement des infractions ou à l’identification de leurs auteurs » ;
–– M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien président de chambre de jugement à la CPI, a proposé de clarifier et de préciser ainsi la rédaction du premier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale : « en matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. Ce délai est interrompu si, dans l’intervalle, intervient un acte ou une décision d’enquête, de poursuite ou d’instruction traduisant explicitement l’intention d’exercer ou de continuer à exercer de manière effective l’action publique » ;
–– M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, a également considéré que le législateur pourrait fixer avec plus de précisions les motifs d’interruption en s’inspirant du dispositif proposé par l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale de 2010 (356) qui prévoyait que la prescription serait interrompue « par tout acte ou décision émanant des autorités publiques tendant à la recherche et à la poursuite des infractions et à la condamnation de leurs auteurs, par tout acte mettant en mouvement l’action pénale, y compris s’il émane de la personne exerçant l’action civile et par la demande d’octroi de la qualité de partie civile formée par la victime » (357).
Vos rapporteurs considèrent eux aussi que le législateur devrait se montrer plus précis dans la définition des actes qui ont pour effet d’interrompre la prescription, ce qui permettrait de limiter les tentations d’extension jurisprudentielle. Ainsi que le leur ont indiqué nombre de personnes entendues, il ne doit toutefois pas s’engager dans une entreprise, « illusoire, voire dangereuse » (358), d’énumération, sauf à prendre le risque de ne pas être exhaustif et de figer à l’excès la matière (359).
Vos rapporteurs proposent donc de préciser la notion d’actes interruptifs mentionnée par l’article 7 précité :
–– en ajoutant aux actes de poursuite et d’instruction les actes d’enquête qui participent, au même titre que les deux premiers, à la recherche des auteurs d’infractions et à leur condamnation ;
–– en prévoyant que, pour être interruptifs, ces actes doivent avoir pour finalités la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs d’infractions : ces précisions permettraient d’exclure de la liste des actes interruptifs ceux qui revêtent simplement un caractère administratif ou de mesure interne et de conférer expressément un effet interruptif aux actes de jugement ;
–– en ajoutant que ces mêmes actes sont interruptifs même s’ils émanent de la personne exerçant l’action civile : si la plupart des actes interruptifs émanant de la partie civile tendent à la mise en œuvre des poursuites ab initio (360) (plainte avec constitution de partie civile, citation directe), certains d’entre eux interviennent au cours de l’instruction ou de l’enquête (appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (361), demande de report de l’ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles dans le cadre de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (362)).
À cet égard, vos rapporteurs proposent que soit ajoutée aux actes tendant à la mise en œuvre des poursuites qui émanent de la victime la simple plainte adressée au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police judiciaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui (363). En effet, la Cour de cassation ne reconnaît un caractère interruptif qu’au dépôt de plainte avec constitution de partie civile opéré à condition que la victime ait procédé au versement, dans le délai imparti, du montant de la consignation prévu par l’article 88 du code de procédure pénale ou qu’elle ait obtenu l’aide juridictionnelle la dispensant de consigner. Sont pourtant considérés comme des actes interruptifs les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire dans le cadre de l’article 14 du même code, contenant une dénonciation d’infraction pénale par une personne entendue pour des faits distincts (364). En conséquence, il apparaît judicieux de considérer que la simple plainte adressée par une victime potentielle au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police ou de gendarmerie soit également interruptive de prescription, dès lors qu’elle ne présente pas un caractère abusif.
Proposition n° 12 Clarifier et préciser la notion d’acte interruptif mentionnée par l’article 7 du code de procédure pénale en conférant un caractère interruptif à tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions, même s’ils émanent de la personne exerçant l’action civile, y compris s’il s’agit d’une simple plainte adressée par la victime au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police judiciaire. |
5. Prévoir de nouvelles modalités d’extinction de l’action publique en cas d’inaction prolongée de l’autorité judiciaire
Vos rapporteurs ont précédemment expliqué qu’ils n’étaient pas favorables à l’instauration d’un « délai butoir » au-delà duquel toute procédure judiciaire serait caduque (365). Néanmoins, ils ont pleinement conscience que le doublement des délais de prescription de l’action publique et la consécration dans la loi de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription iraient dans le sens d’une plus grande sévérité dans la répression.
S’ils sont convaincus du bien-fondé de ces propositions, ils ne souhaitent toutefois pas que l’instauration de ces règles nouvelles conduise à l’avènement d’une forme d’imprescriptibilité de fait. Il paraît en effet difficile d’imaginer que, par le jeu des actes interruptifs, qui effacent rétroactivement le délai déjà écoulé, le délai de prescription de l’action publique recommence à courir pour une durée équivalente à celle des délais que vos rapporteurs ont proposé d’instituer, à savoir six ans en matière délictuelle et vingt ans en matière criminelle (366).
Aussi ont-ils réfléchi à l’opportunité d’instituer de nouvelles règles qui obligeraient la justice, une fois saisie d’une affaire, à faire preuve de toute la célérité possible. Il n’est en effet pas tolérable, comme le faisait remarquer fort justement M. le procureur général près la Cour de cassation, « qu’aucun acte d’investigation ne soit accompli durant 3 ans à partir de la mise en mouvement de l’action publique », de même qu’il est « anormal de laisser prescrire un crime ou un délit alors que des poursuites ont été engagées » (367). Qui plus est, « la dissociation du délai de prescription, à l’intérieur duquel l’acte interruptif doit intervenir, et du délai dans lequel, la prescription ayant été interrompue, l’autorité judiciaire doit poursuivre ses diligences, s’impose avec d’autant plus de force que la durée de la prescription est accrue » (368), ainsi que l’indiquait, à juste titre, M. Dominique Foussard, avocat aux conseils.
Vos rapporteurs ont donc tiré toutes les conséquences de ces remarques et ont conclu à la nécessité de modifier la portée des actes interruptifs de prescription (369) dès lors que les poursuites ont été engagées, en rompant avec la règle selon laquelle chaque acte en question fait courir un délai identique au délai initial. De cette manière, l’action publique serait éteinte à l’issue d’un délai abrégé. À l’instar de M. Jean-Claude Marin, ils estiment que ce délai pourrait être fixé à trois ans, et non pas à un an ou deux ans, ainsi que l’ont proposé M. Dominique Foussard et Mme Claire Waquet. En effet, ces deux derniers délais, vraisemblablement trop brefs, risqueraient de faire peser sur l’autorité judiciaire une contrainte difficilement supportable au regard de ses moyens.
Ce nouveau dispositif ne s’appliquerait que lorsque les poursuites seraient engagées à l’encontre d’une ou plusieurs personnes nommément désignées et pas dans les cas où l’enquête ou l’instruction serait diligentée contre X.
Concrètement, en matière criminelle comme délictuelle (370), l’autorité judiciaire ou les éventuelles parties civiles disposeraient, à compter du premier acte interruptif de prescription ou du dernier lorsqu’il en est réalisé plusieurs
– qu’il émane d’un magistrat, d’un officier de police judiciaire ou de la partie civile – d’un délai de trois ans pour accomplir un nouvel acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ou, s’agissant de la partie civile, un acte considéré comme interruptif de prescription par la jurisprudence.
Chaque acte aurait donc pour effet de faire recourir le délai de prescription pour une durée de trois ans.
Vos rapporteurs n’ignorent pas que cette proposition suscite des réserves au sein du monde judiciaire. Toutefois, ils voient dans cette modification un moyen d’accroître la célérité de l’appareil judiciaire, qui fait parfois cruellement défaut, et de garantir le droit de chacun à être jugé dans un délai raisonnable.
En définitive, l’acquisition de la prescription sanctionnerait la négligence de l’autorité judiciaire ou des parties civiles à faire preuve de vigilance et de diligence une fois l’action publique engagée. N’est-ce pas, comme vos rapporteurs l’ont indiqué au début du présent rapport, l’un des fondements, ancien comme contemporain, de la prescription ?
Proposition n° 13 En matière criminelle et délictuelle, lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées, prévoir l’extinction de l’action publique en cas d’inaction de l’autorité judiciaire en fixant à trois ans le délai de prescription rouvert par chaque acte interruptif. |
6. Garantir une interprétation stricte des dispositions relatives
à la prescription
Une analyse de la jurisprudence montre, ainsi que vos rapporteurs l’ont évoqué précédemment, que le juge s’est affranchi de la lettre de certaines dispositions législatives relatives à la prescription ou en a fait une interprétation extensive. Ainsi, il a pu décider, en dehors de tout fondement légal, que le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions occultes et dissimulées serait reporté à une date autre que celle de la commission de l’infraction (371). Par ailleurs, il n’a pas hésité à conférer un caractère interruptif à des actes dépourvus de nature judiciaire (372).
C’est pourquoi vos rapporteurs estiment judicieux qu’à l’avenir, les dispositions encadrant la prescription fassent l’objet d’une interprétation stricte, ce qui ferait écho au principe posé par l’article 111-4 du code pénal, qui dispose que « [l]a loi pénale est d’interprétation stricte ». Comme le relevait M. Dominique Foussard, avocat aux conseils, si « en droit pénal, les règles sont d’interprétation stricte », en vertu du principe de légalité, « en procédure pénale, les choses sont moins nettes ». Certes, on « évoque bien le principe de légalité procédurale » mais il « n’a pas la force qu’on lui reconnaît lorsqu’on est en présence des règles de fond » (373). Il conviendrait d’y remédier afin de s’assurer que la jurisprudence ne puisse de nouveau s’affranchir des règles édictées par la loi.
Vos rapporteurs ont envisagé de ne consacrer ce principe qu’à l’égard des règles relatives à la prescription. Toutefois, afin d’éviter tout risque d’interprétation a contrario, qui aurait conduit à écarter l’application de ce principe pour les autres dispositions de procédure, ils préconisent de l’inscrire à l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Proposition n° 14 Inscrire à l’article préliminaire du code de procédure pénale le principe de l’interprétation stricte de ses dispositions. |
*
Les propositions formulées par vos rapporteurs sont le fruit d’une réflexion entamée il y a plusieurs mois et constituent à leurs yeux les composantes d’une réforme pragmatique et équilibrée. Ils entendent bien traduire rapidement leurs propositions dans un texte de loi, comme ils l’avaient fait à la suite de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales de décembre 2013, dont les conclusions avaient largement inspiré la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.
Au cours de sa réunion du mercredi 20 mai 2015, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je cède à présent la parole aux deux rapporteurs de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, qui a longuement travaillé et dont les conclusions sont déjà présentées dans un article du Figaro d’aujourd’hui comme « une œuvre d’importance ». L’on avait dit cela de Chateaubriand ; on le dira maintenant de MM. Alain Tourret et Georges Fenech ! (Sourires)
M. Alain Tourret, rapporteur. Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord me féliciter du travail que nous avons réalisé avec Georges Fenech. Nous avons beaucoup travaillé, entendu et écouté de nombreuses personnes ; nous avons ainsi pu nous faire notre propre opinion, rédiger ce rapport et formuler les propositions que nous allons vous présenter, avant de nous atteler à la rédaction d’une proposition de loi. Il s’agit d’une méthode fructueuse qui avait déjà fait ses preuves sur la question de la révision des décisions pénales et permis l’adoption, par notre Assemblée, d’une loi à l’unanimité.
Je souhaite qu’il en soit de même sur la réforme de la prescription pénale mais il faut avouer qu’elle ressemble un peu à la « réforme impossible », tant tous ceux qui s’y sont attelés avant nous ont échoué, à commencer par le président Pierre Mazeaud ou le sénateur Jean-Jacques Hyest qui, après avoir en 2007 formulé des propositions de réforme de la prescription civile et de la prescription pénale, n’a pu faire aboutir que celles relatives à la première. Il y a eu aussi, en 2008, le rapport de M. Jean-Marie Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires, qui est resté lettre morte puis, en 2010, l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale, qui a également échoué. J’espère que cette fois-ci, nous y parviendrons.
Ce que nous proposons n’est pas, comme l’écrivait Le Figaro ce matin, une « petite révolution pénale » mais une révolution pénale douce, qui essaie de trouver des solutions adaptées aux problèmes soulevés.
Deux formes de prescription affectent, en droit pénal, l’action de la justice. La première, la prescription de l’action publique, est un mode général d’extinction de l’action publique par l’effet de l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction ; elle intervient avant la condamnation définitive. Elle se distingue des autres causes d’extinction de l’action publique mentionnées à l’article 6 du code de procédure pénale. La seconde, la prescription de la peine, met en échec le droit, pour la puissance publique, d’exécuter, à l’expiration d’un certain délai les sanctions définitives prononcées par le juge. Ces deux types de prescription se distinguent également par la durée de leurs délais et, au sein de chacune d’elles, par des délais différents en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle : ce sont donc pas moins de six délais de prescription de droit commun qui existent dans notre droit.
La prescription est une institution séculaire et – puisque nous parlons en ce moment beaucoup du latin – elle serait apparue pour la première fois sous le règne d’Auguste, vers 18 ou 17 avant Jésus-Christ, avec la loi Julia, de adulteriis qui instaura une prescription de cinq ans pour les delicta carnalia – chacun aura reconnu ici notamment l’adultère. Par la suite, les codes romains fixèrent à vingt ou trente ans le délai de prescription de l’action publique et rendirent imprescriptibles les infractions les plus graves, comme le parricide : on a déjà là la distinction entre prescription et imprescriptibilité. C’est Saint Louis qui va installer la prescription dans notre droit avec l’octroi de la Charte d’Aigues-Mortes de 1246 qui, fait notable, posait déjà le principe d’une classification tripartite des délais de prescription. Il y est écrit qu’« on ne pourra pas enquêter après une période de dix ans au sujet d’un crime (…) contre celui qui aura été présent pendant ces dix ans ou la plus grande partie de ces dix ans ; (…) ni au sujet d’un vol après une période de deux ans ; ni au sujet d’une amende non réglée après une période d’un mois ». Cette charte, d’une extraordinaire modernité, montre que l’essentiel des principes du code de procédure pénale
– classification par infraction, motif d’interruption – relatifs à la prescription ont été posés dès 1246 !
Les articles 7 et 8 du code de procédure pénale sont simples : ils disposent que la prescription de l’action publique court à partir du moment où le fait est commis. Toutefois, estimant qu’il était insupportable que certaines infractions ne puissent pas être poursuivies, la jurisprudence s’est progressivement écartée de la lettre de ces articles et a multiplié, à partir de 1935, les décisions contra legem en retenant la date de révélation des faits pour point de départ du délai de prescription de l’action publique. Dans le même temps, et cela témoigne de notre totale schizophrénie, nul ne remet véritablement en cause le principe même de la prescription. En effet, à la différence des pays anglo-saxons dans lesquels l’imprescriptibilité est plutôt la règle, la prescription demeure une tradition forte dans notre pays de droit romain, même si un courant de la doctrine défend désormais la généralisation de l’imprescriptibilité en soulignant que ses effets pervers pourraient parfaitement être tempérés ou corrigés par la possibilité laissée au procureur de la République d’entamer ou non les poursuites.
Cette jurisprudence erratique remet en cause la sécurité juridique en faisant courir le délai de prescription de l’action publique de certains délits à partir du moment où ils sont commis – y compris dans la délinquance économique – et d’autres à partir du moment où ils sont révélés. Tous les professionnels du droit ont estimé qu’il n’était plus possible de continuer ainsi et ont reproché au législateur sa frilosité, en l’invitant à se saisir du problème.
Nous-mêmes, législateurs, avons notre part de responsabilité dans le dérèglement du système, car nous avons allongé les délais de prescription de l’action publique et des peines. Nous avons ainsi soumis certains crimes à des délais de prescription de trente années et porté le délai de prescription de l’action publique de certains crimes commis sur mineurs à vingt années. Nous avons également porté à vingt ou dix ans la durée des délais de prescription applicables à certains délits. Peut-on admettre que notre droit soit devenu si peu lisible et insécurisant en raison, d’une part, d’une jurisprudence contra legem en perpétuel renouvellement et, d’autre part, de lois qui modifient incessamment les règles ? Nous ne le pensons pas et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité apporter des réponses à ce double éclatement du droit de la prescription.
Je le disais à l’instant, beaucoup d’autres ont, avant nous, essayé de réfléchir aux modifications nécessaires. Rappelons-nous de la réforme proposée par le président Pierre Mazeaud – chacun se souvient ici de son art du droit et de sa combativité – qui a buté sur la question de la prescription du délit d’abus de biens sociaux, qui, il faut bien le reconnaître, a systématiquement conduit le législateur à renoncer à réformer dans son ensemble le droit de la prescription, souvent sous d’insistantes pressions extérieures. Georges Fenech vous expliquera en quoi la solution que nous avons retenue sur ce sujet nous évitera un tel écueil.
Nous formulons au terme de nos travaux quatorze propositions ayant vocation à être reprises par une proposition de loi qui sera soumise à l’avis du Conseil d’État et, nous l’espérons, rapidement examinée par notre assemblée. Je vais vous en présenter les grandes lignes.
En premier lieu, il nous est apparu que les délais actuels de prescription de l’action publique, respectivement fixés à un an, trois ans et dix ans en matière de contraventions, de délits et de crimes, ne permettaient plus une juste répression des infractions commises. C’est l’avis de toutes les personnes que nous avons entendues et l’enseignement du droit comparé, les délais de prescription instaurés par nos voisins européens étant généralement plus longs que les nôtres. C’est d’ailleurs en raison de la brièveté de nos délais que la Cour de cassation a développé toute sa jurisprudence contra legem.
En conséquence, nous proposons de doubler les délais de prescription de l’action publique et de les porter d’un an à deux ans en matière contraventionnelle, de trois à six ans en matière délictuelle et de dix à vingt ans en matière criminelle. C’est, à notre avis, le seul moyen de ne pas assurer l’impunité des auteurs d’infractions, car, rappelons-le, l’impunité en raison de l’acquisition de la prescription doit demeurer l’exception et chacun doit répondre de ses actes devant les juridictions. Nous suggérons également de procéder à l’unification des délais de prescription de l’action publique et des peines.
Quelles alternatives se présentaient à nous ? D’autres systèmes juridiques sont fondés sur l’imprescriptibilité mais nous n’y sommes pas favorables : l’imprescriptibilité doit être réservée au crime de génocide et aux autres crimes contre l’humanité, sous réserve – j’y reviendrai – d’y ajouter les crimes de guerre. Il nous a également été proposé d’instaurer un délai butoir d’une durée de dix années, courant à compter de la mise en cause de la personne, au terme duquel la procédure judiciaire s’arrêterait définitivement si aucun procès ne s’est tenu. C’est, selon nous, oublier l’intelligence et la malignité juridiques des parties, singulièrement des avocats qui – c’est un avocat qui parle – soulèvent systématiquement de multiples moyens de nullités de procédure, freinant d’autant l’action judiciaire. Je vous laisse imaginer la situation des victimes qui se trouveraient confrontées à une telle situation. Et je rappelle que les affaires dans lesquelles un tel délai serait aujourd’hui dépassé ne manquent pas, à commencer par le procès de l’amiante.
Nos travaux ont été l’occasion de réfléchir aux fondements de la prescription.
La « grande loi de l’oubli », justification traditionnellement avancée à l’existence de la prescription, selon laquelle, au bout d’un certain temps, il ne serait plus normal ni légitime de poursuivre une infraction, a du plomb dans l’aile et n’est plus revendiquée que par de rares personnes.
Mais d’autres fondements conservent leur validité comme la disparition des preuves qui ne sont pas seulement scientifiques mais aussi humaines. Si ce fondement paraît remis en cause par l’irruption des preuves scientifiques, notamment l’ADN, le Syndicat de la magistrature nous a, à juste titre, invités à ne pas en être les esclaves et à tenir compte des conséquences d’un allongement de la durée des délais de prescription de l’action publique sur la fiabilité des témoignages humains. La prescription demeure également la sanction légitime de l’inaction de l’autorité judiciaire tant il paraît inadmissible de laisser la justice n’accomplir aucun acte pendant un certain temps. Comme vous l’expliquera Georges Fenech, nous avons repris l’une des propositions formulées par le procureur général près la Cour de cassation, M. Jean-Claude Marin, sur ce sujet. Nous devons enfin prendre en considération de nouveaux fondements, inspirés des réflexions européennes et anglo-saxonnes autour des notions de droit au procès équitable et de délais raisonnables.
Pour toutes ces raisons, il nous est apparu nécessaire de maintenir un système de prescription, en faisant en sorte qu’elle ne constitue pas un moyen d’impunité mais qu’elle puisse jouer lorsque l’action publique n’a pas été exercée correctement par ceux qui en ont la charge, c’est-à-dire les magistrats et les enquêteurs.
En deuxième lieu, nous nous sommes également intéressés au régime de la prescription des crimes de guerre, actuellement soumis à des délais de prescription de l’action publique et des peines de trente années. Faut-il rendre ces crimes imprescriptibles au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité ?
Notre Commission a déjà débattu de cette question en 2010, lors de la discussion du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, qui a introduit dans notre droit la définition des crimes de guerre et les a soumis à des délais de prescription allongés. J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de la position défendue par le président Jean-Jacques Urvoas, favorable à l’imprescriptibilité des crimes de guerre car il estimait alors qu’un magistrat pourrait poursuivre d’éventuels crimes de guerre prescrits en droit français en invoquant leur imprescriptibilité en application de l’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Cette argumentation nous a convaincus, tout comme celle de M. Bruno Cotte, ancien magistrat à la Cour pénale internationale, qui démontre, dans sa contribution écrite annexée au rapport, que nombre de faits sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, les moyens mis en œuvre pour les commettre étant souvent les mêmes. Dès lors, il ne nous semble plus possible de continuer à ignorer plus longtemps l’exigence d’imprescriptibilité posée par la norme internationale. Nous sommes dans l’obligation de mettre notre droit en conformité avec celle-ci, à défaut de quoi le juge le fera à notre place en développant, une nouvelle fois, une jurisprudence contra legem s’appuyant sur la hiérarchie des normes. Nous avons, enfin, été convaincus par la position de madame la garde des Sceaux sur ce sujet lors de son audition.
Vous l’aurez compris, c’est une modification essentielle et sensible de notre droit que nous proposons, qui nous obligera à réfléchir aux modalités d’application dans le temps de ce nouveau cas d’imprescriptibilité et à décider s’il a vocation à s’appliquer aux faits commis à partir de 2010, date à laquelle les crimes de guerre ont été introduits en droit français.
En troisième et dernier lieu, nous proposons de revenir sur la disposition relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique lorsque la victime est une personne vulnérable. Introduite à l’article 8 du code de procédure pénale en 2011, elle permet de différer le cours de la prescription aussi longtemps que la victime de l’infraction est soumise à un état de vulnérabilité. Peut-on vraiment considérer que l’« état de grossesse » d’une femme enceinte constitue un motif de vulnérabilité ? Aussi stupide que cela puisse paraître, le législateur l’a fait. Est également visée la personne vulnérable « du fait de son âge » : mais comment peut-on se guérir de l’âge alors qu’on vieillit un peu plus tous les jours ? Cela figure pourtant dans notre code ! Le même constat s’impose pour les personnes privées de leur libre arbitre et placées dans l’incapacité de se rendre compte qu’elles ont été victimes d’une infraction : cela reviendrait à confier à la victime le soin de déterminer par elle-même le point de départ du délai de prescription. Cela nous semble intolérable. L’abrogation de cette disposition est, à notre avis, une solution sage, au surplus souhaitée par tous les magistrats entendus qui avaient unanimement manifesté leur incompréhension au moment de son adoption.
En revanche, nous souhaitons que, s’agissant des mineurs, le délai de prescription de l’action publique des infractions commises à leur encontre continue de courir seulement à compter de leur majorité, comme le prévoit déjà notre code de procédure pénale.
Je cède à présent la parole à mon collègue Georges Fenech qui va vous présenter nos autres propositions.
M. Georges Fenech, rapporteur. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous avez confié à Alain Tourret, membre de la majorité, et moi-même, membre de l’opposition, cette mission d’information sur la prescription en matière pénale. Nous ne dirons ni l’un ni l’autre qu’il s’agit d’une œuvre mais d’un défi à relever, qui suppose de parcourir encore un long chemin pour parvenir à un texte équilibré, satisfaisant et protecteur à la fois de la société et du justiciable. Nous avons travaillé comme nous l’avions fait précédemment lors de la mission sur la révision des décisions pénales, dans un esprit qui transcende les clivages politiques. Il ne s’agit d’ailleurs pas, à proprement parler, de politique pénale, sur laquelle nous avons l’occasion de nous confronter, mais de philosophie d’une justice qui se veut admise universellement, de quelque côté que nous nous trouvions.
Notre société moderne, à l’heure de l’internet ou de la mondialisation, fait prévaloir la mémoire sur l’oubli, contrairement à l’époque napoléonienne, quand l’espérance de vie ne dépassait guère les quarante-cinq ans, quand la police scientifique n’existait pas encore, quand enfin la religion du juge ne reposait le plus souvent que sur les témoignages. Les formidables progrès de la preuve, notamment par ADN, ont relégué aux oubliettes l’un des fondements de cette trop courte durée de la prescription, celui du dépérissement des preuves. Le premier président de la Cour de cassation, M. Bertrand Louvel, nous faisait ainsi remarquer que des égyptologues venaient d’identifier, 3000 ans après sa mort, le meurtrier de Ramsès III !
Que valent en conséquence aujourd’hui les fondements liés au dépérissement des preuves et à la faillibilité des témoignages pour justifier une prescription de dix ans en matière criminelle et de trois ans en matière délictuelle ? D’ailleurs, reconnaissons que l’opinion publique n’accepte plus que certains crimes puissent rester impunis. Il suffit de penser à l’affaire des disparues de l’Yonne, en réalité prescrite et dans laquelle il a fallu utiliser un subterfuge juridique pour éviter la prescription et considérer qu’un simple soit-transmis du parquet adressé à la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) l’avait interrompue, et permettre ainsi de poursuivre leur auteur, Émile Louis.
C’est pourquoi les règles édictées par les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale sont devenues obsolètes et infondées. Tant le législateur que le juge se sont efforcés, au fil du temps, d’en limiter la portée, voire de les contourner. À telle enseigne que les systèmes multiples de prescription sont devenus incohérents, illisibles et sources d’une insécurité juridique préjudiciable tant à la société, qu’à l’auteur et à la victime.
Je ne reviendrai pas sur les points qu’à excellemment développés Alain Tourret, notamment en ce qui concerne l’allongement des délais de la prescription de l’action publique et l’imprescriptibilité des crimes de guerre qui nous permettra de nous mettre en conformité avec nos engagements internationaux. Je m’attacherai pour ma part à vous exposer deux autres propositions essentielles, issues de nos quarante auditions de personnalités du monde judiciaire et associatif.
Il s’agit, premièrement, de la consécration législative de la jurisprudence relative aux modalités de computation des délais de prescription de l’action publique des infractions occultes et dissimulées, ou lorsqu’un obstacle rend impossible l’exercice des poursuites en application de la règle romaine contra non valentem agere non currit praescriptio, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir. Cette seconde règle a dernièrement fait l’objet d’une application très commentée à l’occasion d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 novembre 2014 portant sur une affaire d’octuple infanticide, commis par une mère dont l’état d’obésité chronique avait masqué les différentes grossesses et constituait, selon la plus haute juridiction, un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.
Mais vous l’aurez compris, la modification des règles de computation des délais de prescription de l’action publique concerne beaucoup plus fréquemment les délits occultes ou dissimulés, notamment en matière économique et financière, ceux-là mêmes sur lesquels les précédentes tentatives de mise en cohérence du droit de la prescription ont échoué. Sans doute est-ce là l’un des points les plus sensibles, politiquement, de nos propositions et qui est à l’origine des échecs précédents.
Le principe légal est, rappelons-le, que le point de départ de la prescription est celui du moment de la commission des faits. Mais face à la complexité et à la clandestinité de certaines infractions dites astucieuses, tels que l’abus de biens sociaux ou la grande corruption internationale, qui se jouent des frontières, qui sont commises dans la plus grande opacité par de simples jeux d’écritures ou par la fabrication de faux très difficiles à déceler, cette jurisprudence dite de la « révélation » nous apparaît nécessaire et mérite d’être enfin consacrée par le législateur.
Prenons l’hypothèse, telle que nous l’a notamment expliquée le juge émérite du pôle financier, M. Renaud Van Ruymbeke, de malversations à partir de comptes offshore. Bien souvent les faits remontent à plus de trois ans et ne se révèlent que bien plus tard, en raison de législations étrangères très protectrices du secret bancaire. Si effectivement la prescription est interrompue par des actes interruptifs, encore faut-il que l’enquête ait commencé moins de trois ans après la commission des faits, ce qui se révèle pratiquement être une hypothèse d’école dès lors qu’ils se commettent dans les paradis fiscaux.
Il est un fait qu’en vous proposant de consacrer par la loi la jurisprudence sur les faits occultes ou dissimulés, nous nous inscrivons à contre-courant de plusieurs tentatives de réforme précédentes – celle de la commission dite « Coulon » portant sur la dépénalisation de la vie des affaires ou celle de l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale de 2010 – qui suggéraient de retenir toujours la date de commission des faits comme point de départ de la prescription avec, en contrepartie, un allongement du délai de prescription. Nous pensons que de telles dispositions auraient conduit à un affaiblissement de la lutte contre la grande délinquance économique et financière et je suis convaincu que nul ici ne le souhaite. Face à la difficulté de traquer la délinquance qui occasionne un trouble grave et durable à l’ordre public et économique, les juges ont développé, pour l’abus de bien social, la théorie dite de la « dissimulation » à partir d’un arrêt du 7 décembre 1967, afin de retarder le point de départ de la prescription au jour où l’infraction a pu être décelée. De même, dans un arrêt de principe du 10 août 1981, la chambre criminelle a énoncé que le point de départ de la prescription triennale est fixé « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Plus récemment, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 mars 2008, que le délai de prescription en matière de trafic d’influence ne commençait à courir, en cas de dissimulation, qu’à partir du jour ou l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. La même solution a été retenue le 6 mai 2009 dans une affaire de corruption et d’abus de confiance, le 27 juin 2001 dans une affaire de favoritisme et le 18 juin 2002 à l’occasion d’une affaire de détournement de fonds publics.
C’est cette jurisprudence que nous vous proposons de consacrer dans la loi en édictant que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Nous nous inscrivons dans la continuité des propositions qu’avait formulées, le 20 juin 2007, la mission d’information du Sénat conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung. Nous considérons en effet, à la suite de l’avis exprimé le 16 avril 2010 par la Cour de cassation, que revenir sur la jurisprudence de la révélation serait « contraire aux impératifs de lutte contre la grande délinquance ».
Nous pouvons imaginer cependant que quelques esprits chagrins – qui ne sont pas ici bien entendu – puissent objecter la disproportion qu’il y aurait à vouloir rendre quasiment imprescriptibles certains délits occultes ou dissimulés, à l’instar des crimes contre l’humanité, bien plus graves. C’est un point de vue purement caricatural. Ainsi dans les pays de common law qui ne connaissent pas la prescription comme principe général, les poursuites sont de fait abandonnées lorsque le temps écoulé a effacé les preuves ou fait disparaître tout trouble à l’ordre public. Rappelons, dans le même ordre d’idées, que notre système judiciaire repose sur le principe de l’opportunité et non de la légalité des poursuites, ce qui permet de réguler l’action publique en lui conservant tout son sens.
Enfin, avec cette consécration législative, nous renforcerions la sécurité juridique. En effet, d’une part, les justiciables tentés de commettre ces infractions astucieuses seront préalablement avertis des risques encourus et, d’autre part, une définition légale de la notion de dissimulation délimitera plus précisément le champ des infractions concernées par ce report du point de départ de la prescription, qu’il appartiendra bien entendu ensuite à la jurisprudence d’appliquer.
La seconde et dernière proposition que je veux évoquer et que nous soumettons à votre examen, et sur laquelle je voudrais insister, est celle, très novatrice, de la sanction de l’inaction judiciaire. Elle découle en réalité des précédentes propositions sur le report du point de départ de la prescription et l’allongement des délais. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un nouveau cas de prescription mais plutôt d’extinction de l’action publique en raison de l’inaction de l’autorité judiciaire. Nous ne souhaitons pas que, par le jeu cumulé du doublement des délais de prescription de l’action publique, du report du point de départ de la prescription et de l’effacement rétroactif total du temps de prescription déjà écoulé par l’accomplissement d’un acte interruptif, l’on aboutisse à l’avènement d’une forme d’imprescriptibilité de fait. Il n’est en outre pas tolérable, comme nous l’a fait remarquer M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, qu’aucun acte d’investigation ne soit accompli durant trois ans à partir de la mise en mouvement de l’action publique.
Ainsi, dans l’hypothèse de l’ouverture d’une enquête ou d’une instruction judiciaire contre personne dénommée, l’action publique se trouverait éteinte si aucun acte n’intervenait pendant un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il s’agit, vous l’aurez compris, de sanctionner l’inaction judiciaire pendant une durée incompatible avec l’exigence européenne sur le délai raisonnable et d’éviter une forme d’imprescriptibilité de fait. Il appartiendra dès lors aux acteurs du procès pénal de veiller à l’ininterruption du cours de l’enquête et de l’instruction, exigence qu’est en droit d’attendre tout justiciable.
Voilà, mes chers collègues, les points essentiels sur lesquels je souhaitais revenir. Nous vous proposons donc d’approuver ce rapport, prélude à une prochaine réforme d’envergure qui ambitionne de rendre cohérent, harmonieux et moderne notre régime de prescription pénale, tout en améliorant la prévisibilité juridique pour l’ensemble des justiciables. C’est aussi cela la justice du XXIème siècle.
M. Alain Tourret, rapporteur. J’appelle enfin votre attention sur notre proposition n° 14 qui vise à « inscrire à l’article préliminaire du code de procédure pénale le principe de l’interprétation stricte de ses dispositions » car autant nous pouvons admettre un certain nombre d’interprétations par le juge, autant celles-ci doivent demeurer d’ampleur limitée. Cet élément essentiel doit être rappelé par la loi aux magistrats.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. À l’occasion de la création de la mission d’information, nous lui avions assigné l’objectif d’une reconquête de ses prérogatives par le législateur pour sortir de la situation de brouillard que vous avez décrite. Les propositions formulées ont le mérite de la clarté. Nous aurons l’occasion d’approfondir leur présentation en consultant le volumineux rapport qui les accompagne.
M. Philippe Gosselin. Je tiens à saluer le travail de nos collègues : leur exposé très riche témoigne de la bonne entente qui a présidé à leurs travaux. Mais le sujet de la prescription en matière pénale a tout du « serpent de mer » ; il y a de nombreuses années que l’on s’interroge sur le droit à l’oubli. Évoquer cette question nous fait aller d’Auguste à la Révolution française en passant par Saint Louis, comme vous l’avez rappelé. Les règles de prescription sont aujourd’hui peu lisibles et difficiles à appréhender, ce qui est sans doute à mettre au débit du législateur. L’interprétation qu’en font les juridictions et la notion d’ordre public ont également profondément changé.
Nous ne devons pas non plus négliger les évolutions paradoxales de la société : alors qu’internet et les réseaux sociaux voient l’individu revendiquer un droit à l’oubli, la société le récuse collectivement dans la sphère publique. Le phénomène n’est sans doute pas nouveau, mais il connaît une accélération ces dernières années. Sans doute est-ce une conséquence de la considération plus importante dont bénéficient les victimes, ce dont nous devons nous féliciter, mais qui a pour effet d’estomper l’intérêt de la société devant celui de la victime. J’y vois aussi une suite logique de l’idée instillée par certaines séries télévisées américaines, dont il ne faut pas sous-estimer l’impact, qui mettent en scène des enquêtes résolues par la police scientifique laissant penser – dans un droit bien différent du nôtre – que toutes les affaires peuvent être éclaircies, même cinquante ans après les faits.
Malgré ces évolutions, je crois qu’il faut rappeler tout l’intérêt de ce « pardon légal » dont l’abandon serait tout à fait regrettable. Nous ne sommes pas un pays de common law. Pour ma part, je revendique ce droit continental de la prescription, issu de notre histoire et qui façonne en partie notre société. Quelles que soient les accélérations de la vie moderne et la nouvelle place dévolue aux victimes, le trouble suscité par une infraction s’apaise avec le temps. Comme l’ont indiqué nos rapporteurs, le progrès technique n’efface pas complètement la question de la détérioration des preuves et de l’altération des témoignages par l’âge ou par la maladie.
Vos propositions sont, à cette aune, réellement intéressantes. Vous recommandez de conserver le principe d’une prescription, ce que je soutiens, tout en aménageant les durées et le dies a quo. Cette évolution attendue pourrait peut-être éviter, à l’instance, quelques arguties et autres recherches d’éléments en nullité parfois peu convaincantes, même si le succès légal est parfois au rendez-vous. Cette orientation nécessitera une transcription législative que vous saurez, j’en suis sûr, mener à bien.
Je m’interroge sur votre suggestion relative aux crimes de guerre, qui sont par définition insoutenables. Le droit actuel les distingue, en prévoyant leur prescription, des crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles. Aussi le rapprochement des deux régimes me laisse-t-il perplexe : ne risque-t-on pas de banaliser, de donner à penser que tout se vaut et qu’il n’y a pas de gradation entre crimes de guerre et crimes contre l’humanité – ce qui est peut-être, d’ailleurs, une position intellectuellement soutenable ? Une modification de la définition des crimes de guerre n’en résulterait-elle pas nécessairement ? Ce sont des interrogations dont j’ignore les réponses.
En revanche, je m’inscris en faux contre la recommandation d’une modification rétroactive du régime de la prescription. La loi pénale plus rigoureuse ne dispose que pour l’avenir ; c’est un principe intangible. Envisager une application de nouveaux délais à partir de 2010 me semble délicat et même franchement inconstitutionnel. Nous pouvons discuter de l’application future, mais ne touchons pas au passé !
Je veux conclure en rappelant la très grande qualité de ces travaux qui, sans doute, pourront recueillir un très large soutien dans notre Assemblée et dans notre Commission. Plus qu’une base, c’est une première pierre sur laquelle nous pourrons construire efficacement.
M. Philippe Houillon. Je voudrais rebondir avant toute chose sur le propos du rapporteur Alain Tourret, qui a mentionné l’importance de Saint Louis dans l’histoire de la prescription en France. Ce Roi avait sa résidence habituelle à Pontoise et je m’en félicite. (Sourires)
À titre liminaire, je tiens à rappeler que s’il y a des exceptions de nullité qu’invoquent des avocats, c’est parce que le législateur a estimé que le respect de certaines règles était fondamental pour garantir les libertés publiques et les droits de la défense. Ce ne sont donc pas des arguties. D’ailleurs, pour ces mêmes raisons et cette fois comme Philippe Gosselin, j’imagine mal qu’une loi pénale moins favorable puisse être rétroactive : chacun sait que ce n’est pas possible.
Le travail qui nous est présenté ce matin est d’excellente qualité. Je suis plutôt favorable à la consécration législative de la jurisprudence classique sur la prescription des infractions occultes, à savoir retenir le jour de leur découverte comme point de départ du délai de prescription. Je note d’ailleurs, ce qui n’est sans doute qu’une imperfection rédactionnelle, que cette suggestion entre en contradiction avec votre recommandation générale selon laquelle le dies a quo devrait toujours être le jour de l’infraction.
Je ne suis pas défavorable à un allongement du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle. C’est le point qui me semble le plus réclamé pour la société, encore que votre rapport d’information soit précisément présenté au moment où, à Rennes, se déroule un procès d’Outreau dix années après l’acquittement, alors même que le Président de la République et le garde des Sceaux ont présenté leurs excuses et que l’État a versé une indemnisation à la personne qui comparaît maintenant devant la cour d’assises des mineurs. Or ce procès se tient à la limite de la prescription, qui devait intervenir en fin d’année… Rien n’est simple sur des sujets compliqués ; c’est sans doute la raison pour laquelle il est si délicat de les réformer.
Vous avez semblé opposer le droit à la mémoire et le droit à l’oubli. Chacune des deux thèses pourrait être soutenue par de très bons arguments. Mais je crois que nous devons nous intéresser à ce qui constituerait une justice moderne. Est-ce une justice qui intervient vingt ans après les faits ? J’en doute. Je pense qu’il n’est pas utile de doubler le délai de prescription des contraventions, fussent-elles de cinquième classe, alors même que l’institution peine à traiter l’ensemble des dossiers qui lui sont confiés. Ce doublement est-il pertinent en matière délictuelle ? Je n’en suis pas convaincu non plus. Juger vingt ans après des dossiers délictuels n’a pas grand sens. Certes, certaines affaires sont plus lourdes que d’autres, mais la science tend à mettre à la disposition des magistrats des preuves solides plus rapidement que par le passé… D’ailleurs, je signale que l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale se trouve aussi à Pontoise. (Sourires)
Enfin, les rapporteurs proposent une prescription automatique en cas d’inaction de l’autorité judiciaire dans une affaire ouverte depuis plus de trois ans. C’est un premier pas pour lutter contre les procédures qui s’éternisent, même si un même délai ne devrait pas s’appliquer à tous les dossiers, certains demandant plus de temps que d’autres. Néanmoins, dans la mesure où n’importe quel acte interruptif fait repartir pour trois ans le délai de prescription, je crains que l’évolution ne soit vaine, surtout quand vous indiquez dans votre rapport que ces actes interruptifs seront plus nombreux. Il est donc probable que cette bonne réponse ne suffira pas concrètement à résoudre le problème identifié.
J’en termine en insistant sur le fait que les victimes doivent recevoir toute la considération qui leur est due, mais qu’elles disposent toujours de l’action civile pour l’indemnisation d’un préjudice causé par une faute pénale pour laquelle la prescription pénale serait acquise.
M. Dominique Raimbourg. Je félicite tout d’abord les rapporteurs pour le travail fourni et la méthode employée. On en voit les résultats par le consensus qu’ils suscitent, mais aussi par le compromis auquel ils permettent de parvenir entre les nécessités de la répression et le droit à l’oubli. Ce rapport est une base prometteuse.
De plus, les propositions des rapporteurs sont nécessaires. La jurisprudence essaie aujourd’hui d’allonger des prescriptions trop courtes et l’opinion publique est sensible à la possibilité de poursuivre les infractions découvertes tardivement. Il faut un cadre législatif pour améliorer la sécurité juridique. Cependant, c’est plus la question du fonctionnement et de la lenteur de la justice que celle de l’allongement de la prescription qui est posée par ce rapport. L’allongement de la prescription permet des poursuites à retardement, mais il ne faut pas admettre qu’elles puissent être trop tardives.
J’ai été convaincu par l’argumentation de Georges Fenech sur l’inaction judiciaire. Dans un premier temps, j’ai cru que cette proposition était contradictoire avec l’ensemble des autres recommandations. Mais j’ai compris par la suite que la sanction de l’inaction judiciaire au bout de trois ans ne s’appliquerait que lors de poursuites contre une personne dénommée. Par conséquent, il s’agirait de sanctionner l’absence absolue d’actes de procédure pendant trois ans, ce qui paraît être un délai tout à fait raisonnable.
Enfin, je suis, moi aussi, perplexe quant à l’application de la loi dans le temps : je ne crois pas qu’elle puisse être rétroactive. Il m’a semblé que les rapporteurs évoquaient une application à compter de 2010 et je souhaite des éclaircissements sur ce point.
M. Gilbert Collard. Je voudrais commencer par une observation de géographie historique : il ne faudrait pas ne parler que de Pontoise, c’est à Aigues-Mortes que la prescription est née, ville dont j’ai l’honneur d’être le député. (Sourires) Sur le fond, je trouve le travail remarquable et nécessaire : il ouvre le champ à une critique très constructive.
Toutefois, il y a un fondement de la prescription étrangement absent de l’argumentaire des rapporteurs. On croit être moderne, et on en revient finalement à Beccaria qui, dans son Traité, a rappelé que la prescription existait non pas en raison de l’oubli mais parce que le temps qui passe pouvait transformer l’homme. Le criminel poursuivi quinze années après les faits peut ne plus être l’homme du crime. Cicéron l’a également relevé dans nombre de ses plaidoyers. Il faut donc garder à l’esprit que le temps qui s’écoule peut, si la prescription ne l’interrompt pas, nous amener à juger un homme qui n’est plus le même.
Je considère que l’ensemble des propositions des rapporteurs est recevable sur le plan criminel. Sur le plan délictuel, il y a des éléments à discuter. Sur le plan contraventionnel, en revanche, je pense qu’il faut cesser de persécuter les petites gens pour de petites infractions.
Plus généralement, je crains qu’il y ait un danger à l’allongement de la prescription : l’allongement des lenteurs de la justice. Quand on sait la durée des affaires et le poids des procédures judiciaires sur un homme victime ou poursuivi, on peut redouter de donner aux juges une sécurité absolue et la garantie de pouvoir tranquillement s’endormir sur les dossiers. Le sujet, qui ne souffre pas la polémique, mérite d’être débattu.
Par ailleurs, je voudrais savoir si, dans les crimes de guerre que vous rendez imprescriptibles, vous incluez le terrorisme. Le terrorisme doit être imprescriptible, car on sait que, par l’effet des évasions transfrontalières, des terroristes sont parfois retrouvés dix ou quinze ans après les faits. Il faut affirmer que le terrorisme, c’est la guerre, et le faire entrer dans la notion de crime de guerre.
Je suis surpris de la solution que vous préconisez pour les infractions commises à l’encontre de personnes qui n’ont plus leur libre arbitre. Sans libre arbitre, l’individu est un fantôme dans un procès, un fantôme dans son drame. Il est un peu comme le personnage de Goya : il crie mais on ne l’entend pas. J’ai connu personnellement des personnes qui se trouvaient dans cette situation. Il n’est pas possible de les priver, quand elles retrouvent leurs facultés, du droit d’ester en justice. Il faut donc prévoir la possibilité de ne prescrire les infractions commises à leur encontre qu’à partir du moment où elles ont recouvré leur libre arbitre. Je vous demande d’y réfléchir.
Quant à la théorie, presque ecclésiale, de la révélation – il est vrai que notre rapporteur est un spécialiste du droit canonique –, je considère que c’est une jurisprudence pour les maîtres-chanteurs. Elle a son utilité mais peut être très dangereuse. Dans une vie sociale, elle constitue un élément de chantage et de vengeance, souvent utilisé dans les divorces : faire partir la prescription pénale de la révélation des faits me paraît un risque trop grand.
Enfin, j’estime que vous ne prenez pas suffisamment en compte l’honneur et la considération. Pourquoi ne pas rallonger la prescription en matière de diffamation ? Un individu diffamé ne peut agir en trois mois ! Il faut tout de même savoir que, même si la procédure dure pendant un an, l’avocat doit conclure tous les trois mois pour éviter la prescription de l’affaire. Il faut avoir le courage de dire que la presse n’a pas tous les pouvoirs, ni les diffamateurs tous les droits. Lorsqu’un individu se prend une bordée de diffamations et d’injures, il n’a pas le temps de réagir dans un délai si bref. Victime de diffamation, il faut d’abord se remettre avant de pouvoir agir, trouver un avocat et faire l’assignation en justice : or, en trois mois, c’est impossible. L’honneur et la considération méritent donc aussi un rallongement des délais de prescription.
Je suis également contre la rétroactivité de la loi, quelle qu’elle soit. Aucune loi ne devrait rétroagir, mis à part le cas de la rétroactivité in mitius. Car la rétroactivité, c’est l’insécurité totale et le manque de publication, qui ne peuvent être acceptées dans un État de droit humaniste.
M. Patrick Devedjian. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je voudrais à mon tour féliciter les rapporteurs pour leur excellent travail et pour l’analyse saisissante du sujet. J’adhère à la prudence exprimée par Alain Tourret qui nous a rappelé que toutes les tentatives de réforme précédentes avaient échoué, ce qui montre la complexité du sujet. Pourtant, la remise en ordre est indispensable et elle est inséparable de la durée des procédures, notamment en matière financière dans laquelle la question de la prescription est particulièrement aiguë. Il y a des procédures pénales qui durent vingt ans. J’ai connaissance d’une procédure dans les Hauts-de-Seine pour laquelle l’instruction a duré quinze ans et qui vient seulement d’être présentée aux juges, ce qui n’a plus beaucoup de sens. Or l’allongement de la prescription risque inévitablement de conduire à l’allongement des procédures, en encombrant encore davantage les cabinets des juges d’instruction – à Paris, certains cabinets traitent 200 à 300 dossiers.
Par ailleurs, je ne suis pas convaincu par la proposition n° 13 relative à la « prescription-sanction » lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées, car j’ai peur que vous ne généralisiez ainsi l’ouverture de procédures contre X plutôt que contre des personnes nommément désignées.
En revanche, je suis tout à fait d’accord avec l’imprescriptibilité des crimes de guerre : les crimes contre l’humanité se commettent généralement pendant les guerres et les crimes de guerre sont connexes aux premiers et doivent être rendus eux aussi imprescriptibles. Néanmoins, j’estime que l’on ne peut pas prévoir dans la même réforme l’imprescriptibilité des crimes de guerre et le doublement du délai de prescription de l’action publique des contraventions car les deux propositions ne se situent vraiment pas sur le même plan.
De plus, n’y a-t-il pas une contradiction entre la proposition n° 7, qui réaffirme la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction, « quel que soit celui de sa constatation », et la proposition n° 10, qui vise à donner un fondement législatif à la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées ?
M. Alain Tourret, rapporteur. Il s’agit d’un principe et de l’exception mais je vous l’accorde, il conviendra d’améliorer la rédaction de la proposition n° 7.
M. Patrick Devedjian. Probablement. En outre, je ne crois pas à la proposition n° 14 qui vise à inscrire à l’article préliminaire du code de procédure pénale le principe de l’interprétation stricte de ses dispositions. C’est un vœu pieux : cela n’est jamais arrivé et n’arrivera jamais.
Je partage les propos de mes collègues sur la rétroactivité des nouvelles dispositions mais je suis convaincu que nous nous sommes mal compris.
Je pense également, comme d’autres ici, que la prescription de trois mois en cas de diffamation par voie de presse ou, pire encore, par l’intermédiaire d’internet pose un problème majeur car le citoyen est tout à fait démuni s’il fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur un site sans le savoir et qu’il s’en rend compte au-delà du délai de trois mois. Or, je le sais, certains services secrets étrangers participent à la déstabilisation de personnes par ce moyen-là. Ne pas légiférer sur cette question est donc, selon moi, extrêmement dangereux.
Enfin, il me semble important de souligner que la jurisprudence relative au délit d’abus de bien social, créée à l’origine pour répondre à l’affaire Stavisky, a rendu cette infraction, de fait, imprescriptible, au même titre que le crime contre l’humanité. Elle est désormais utilisée par les actionnaires d’une société comme moyen de pression sur des rivaux pour prendre le contrôle de l’entreprise. Or il me semble que le législateur ne devrait pas graver dans le marbre cette forme d’imprescriptibilité.
Pour conclure, je m’inquiète de l’ampleur du projet de réforme que vous proposez compte tenu de la complexité de chacune des questions posées, même si je salue votre initiative. Personnellement, je pense qu’il vaudrait mieux procéder par étapes.
M. François Vannson. Je veux saluer l’excellent travail de nos rapporteurs et les en remercier. Je partage les inquiétudes de mes collègues Gilbert Collard et Patrick Devedjian s’agissant de la prescription de trois mois en cas de diffamation, compte tenu de tous les nouveaux outils technologiques mis à la disposition des auteurs de tels actes. Ce délai de prescription est beaucoup trop court pour permettre aux personnes attaquées de se défendre, et ce d’autant plus qu’il faut parfois solliciter des opérateurs de télécommunications à l’étranger, et que ces derniers ne donnent généralement pas suite aux sollicitations de la justice. Je souhaiterais enfin savoir dans quel délai vos propositions pourront trouver une traduction législative ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Au nom de la Commission, je souhaite remercier les rapporteurs. L’œuvre était délicate. Vous vous êtes lancés dans un défi dans lequel il n’était pas certain de trouver une heureuse issue. Ce me semble être le cas, car la prescription est à l’image du travail que vous avez fait. C’est une recherche de l’équilibre entre l’effectivité de la peine et le souhait qu’a la société d’être certaine d’être défendue, entre la proportionnalité et le sens éducatif de la peine et la prévention de la récidive. Vous savez ce que disait Cicéron sur les affaires délicates : en substance, « les dossiers sensibles se traitent par l’autorité, l’accumulation de bons avis et la prudence ». Je constate que vous avez réuni ces trois qualités, si j’en juge notamment par la qualité des contributions écrites annexées à votre rapport.
La question qui se pose désormais est celle de savoir si l’autorité judiciaire saura répondre efficacement à une telle réforme. S’il n’y a pas les moyens, s’il n’y a pas de questionnement sur les critères de l’engagement des poursuites ou non, s’il n’y a pas de temps, il sera très difficile pour elle d’y parvenir.
En tous cas, si vous élaborez une proposition de loi, la Commission demandera au Président de l’Assemblée nationale, pour la première fois depuis le début de la législature, de saisir le Conseil d’État pour obtenir un avis éclairé sur ces questions sensibles et complexes.
M. Alain Tourret, rapporteur. Nous allons rédiger dans les semaines qui viennent une proposition de loi. Nous aurons des échanges avec la Chancellerie ainsi qu’avec le parquet général et la première présidence de la Cour de cassation – cela me semble très important. Nous souhaitons aller vite. Notre président saisira ensuite le Président de l’Assemblée nationale afin que le Conseil d’État examine la proposition de loi, tant la matière est importante. Cela nous aidera. Vous nous avez couverts de fleurs mais ce sont les enterrements où l’on est couvert de fleurs. (Sourires) Je me méfie beaucoup d’une telle « floraison ».
Je voudrais répondre à plusieurs observations.
S’agissant d’abord des crimes de guerre, on voit bien que c’est une question très importante. J’ai fait référence à l’année 2010 car c’est à compter de l’adoption de la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale que la notion de crime de guerre a été introduite dans notre droit. Sur l’application de la loi dans le temps, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je n’ai jamais dit que la disposition serait d’application immédiate car je suis en faveur de la solution inverse. Il faut simplement bien vérifier quel est l’état de la jurisprudence en droit international et quelles sont les obligations internationales de la France en la matière.
Je voudrais dire un mot des nullités en droit pénal. Pourquoi certaines affaires sont-elles si longues à juger ? C’est à cause des nullités. Lorsqu’une instruction paraît être terminée, le juge d’instruction propose aux avocats, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, de faire leurs observations dans le délai d’un mois avant que le procureur de la République ne prenne ses réquisitions. Or, que se passe-t-il ? Une dizaine de moyens de nullité est toujours soulevée au dernier moment, souvent le dernier jour. Les avocats spécialisés ne le sont pas pour rien. Il ne faut pas tout rejeter sur la justice. Admettons que certains avocats spécialisés font tout ce qu’ils peuvent pour que la procédure soit prolongée. Lorsqu’un moyen de nullité est soulevé, il faut que le juge puisse y répondre ; ensuite, il peut y avoir appel, ce qui oblige la chambre de l’instruction à se prononcer, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation à faire de même. Si celle-ci casse, elle peut le faire sans renvoi mais, généralement, elle saisit une nouvelle cour et l’affaire est ensuite portée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
MM. Bertrand Louvel et Renaud Van Ruymbeke souhaitent qu’une réflexion soit engagée sur les nullités en droit pénal. Il faut avoir le courage de se poser certaines questions. Les nullités ne devraient interrompre la procédure qu’à la condition qu’elles portent véritablement préjudice – un préjudice démontré. Il faut aussi s’interroger sur la possibilité de confier à la chambre criminelle un pouvoir d’évocation et de l’autoriser à casser sans renvoi ; une autre solution consisterait à confier à la juridiction de jugement le soin de se prononcer sur tous les moyens de nullité soulevés devant le juge d’instruction. Autrement, les procédures sont allongées de trois ou quatre ans. Regardez l’affaire de l’amiante : elle a commencé en 1996, j’en sais quelque chose, j’ai déposé la première plainte. En 2015, le tribunal n’est toujours pas saisi, notamment en raison du nombre de nullités soulevées tout au long de la procédure. Ne fallait-il pas, à un moment donné, tout renvoyer devant le tribunal, qui aurait statué ?
Je sais bien que l’on va me répondre que les moyens de nullité sont des moyens de liberté. On ne transige pas avec la liberté, mais on enterre les affaires. Il faut savoir ce que l’on veut ! En tout cas, ce n’est pas parce que l’on allongera les délais de prescription que l’on allongera la durée des procédures. C’est lorsque l’on aura résolu le problème des nullités que l’on résoudra le problème de la lenteur des affaires les plus complexes.
Je remercie notre collègue Dominique Raimbourg pour ses propos. Consensus et compromis caractérisent en effet notre travail. Je laisserai Georges Fenech répondre sur la question de la sanction de l’inaction de l’autorité judiciaire. C’est essentiel. Pourquoi ? Parce que nous proposons de porter le délai de prescription délictuelle de trois à six ans. Si nous ne prévoyons pas de sanctionner l’éventuelle inaction de la justice, le cours de la prescription risque d’être prolongé de manière excessive. Rappelez-vous qu’en matière criminelle, nous portons le délai à vingt ans. Il est donc indispensable qu’il y ait un délai préfix qui oblige la justice à accomplir des actes. Je ne pense pas que les magistrats interrompront le cours de la prescription de manière artificielle. Quand un dossier est enterré, il est enterré. Les procureurs généraux nous ont demandé de soutenir cette proposition. Les procureurs de la République sont beaucoup plus circonspects car ils s’interrogent sur l’adaptation de leurs moyens à une telle modification. C’est à nous de faire en sorte que le budget permette de répondre aux obligations du droit.
S’agissant de notre proposition de porter le délai de prescription de l’action publique des contraventions à deux ans, nous l’avons faite dans un souci de lisibilité du droit : il s’agissait de doubler les délais de prescription de l’action publique. Nous avons aussi proposé de ramener le délai de prescription de la peine de trois à deux ans, mais nous savons que cela risque de ne pas plaire à Bercy.
En ce qui concerne le terrorisme, le délai de prescription est de trente ans. Tous les spécialistes que nous avons rencontrés nous ont dit que cela ne correspondait à rien car le terrorisme ne se traduit pas par des infractions occultes mais par des infractions commises en plein jour, dont la publicité est immédiate. En revanche, je comprends parfaitement que l’on puisse dire que puisque le terrorisme est un acte de guerre, il doit être traité comme tel. Nous allons y réfléchir.
En ce qui concerne les modifications à apporter à la loi sur la presse, je vous invite à la prudence. La loi de 1881 est avant tout une loi sur la liberté de la presse. Si vous soumettez à une pression très forte l’ensemble de ce secteur, je pense que vous aurez attaqué la notion de même de liberté de la presse. Le délai de prescription de droit commun est de trois mois en la matière. Certaines infractions se prescrivent par un an. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, certaines infractions sont soumises à une prescription de trois ans. Introduire des infractions de presse dans le code pénal aurait pour conséquence de les soumettre à une prescription de six ans, le délai que nous proposons en matière délictuelle. Cela n’est pas envisageable. Il est préférable de ne pas modifier les régimes spéciaux de prescription. Il faudrait, sinon, les examiner un à un. Nous en oublierions forcément certains.
M. François Vannson. Je voudrais ajouter quelque chose sur la question de la prescription des infractions de presse. Il faudrait faire un distinguo entre deux situations. Pour les diffamations commises par la voie de la presse écrite, l’on peut s’accommoder du délai de trois mois. En revanche, sur internet et les réseaux sociaux, n’importe qui peut utiliser un pseudo et commettre des infractions. Or les opérateurs étrangers ne donnent pas suite aux demandes de la justice. Peut-être que pour la diffamation commise sur internet, l’on pourrait avoir des règles spécifiques.
M. Georges Fenech, rapporteur. Afin d’éviter toute confusion, je voudrais apporter une explication au sujet de l’application de la loi dans le temps. Il ne faut pas confondre les lois pénales de fond et les lois de procédure. Les premières s’appliquent pour l’avenir sauf lorsqu’elles sont plus douces – c’est la rétroactivité in mitius. Les lois de procédure sont en revanche d’application immédiate : c’est ce qu’énonce l’article 112-2 du code pénal selon lequel sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. Avant 2004, cette règle s’appliquait sauf lorsque les lois avaient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé mais cette précision a été supprimée. Autrement dit, les lois de procédure sont d’application immédiate. Quel serait l’intérêt de faire une réforme qui s’appliquerait dans cinquante ans ? Sur ce sujet, la seule discussion qui aura sans doute lieu portera sur les crimes de guerre. Il nous faudra nous rapprocher de la Chancellerie pour travailler ce point.
Je voudrais revenir sur ce qu’a dit Philippe Gosselin, qui voit un paradoxe entre les notions de droit à l’oubli, que l’on revendique aujourd’hui, et de devoir de mémoire. Je ne vois pas de paradoxe. Le droit à l’oubli s’applique lorsque le coupable a été identifié : une fois qu’il a payé sa dette, il peut bénéficier de l’oubli. Dans l’hypothèse où l’individu n’est pas identifié, la société et la victime se souviennent du crime. Il n’y a donc pas de paradoxe.
M. Philippe Houillon a évoqué l’affaire d’Outreau – il avait été rapporteur de la commission d’enquête, vous vous en souvenez – qui a été l’objet d’une erreur judiciaire. La question de la prescription ne se pose pas en la matière.
M. Houillon a surtout insisté sur la notion de justice moderne et s’est demandé s’il était normal que l’on puisse juger vingt-cinq ans après les faits. Cela pose en effet la question de la lenteur de la procédure judiciaire et des nullités. Le problème a été soulevé par le premier président de la Cour de cassation et par M. Van Ruymbeke. Il y a des réflexions à la Cour de cassation et au tribunal de grande instance de Paris sur le sujet. Nous leur avons d’ailleurs appris qu’ils menaient des réflexions parallèles. Aujourd’hui, il faut réfléchir aux moyens de lutter contre l’usage abusif des moyens de nullité. Lorsque le juge clôture son instruction, il fait face à une avalanche de moyens de nullité formés par des avocats spécialisés. Ce sont des moyens dilatoires et la procédure est prolongée de dix-huit mois, deux ans, trois ans… J’en profite pour dire au président de la commission des Lois que nous serons amenés, avec Alain Tourret, à le solliciter de nouveau pour travailler sur ce sujet.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vois bien que vous préparez une saison trois ! (Sourires)
M. Georges Fenech, rapporteur. Notre volonté est d’aller dans le sens d’une amélioration de la procédure pénale. Je remercie tous ceux qui sont intervenus ; cela montre l’intérêt pour nos travaux.
Je pense que nous avons répondu aux questions de M. Dominique Raimbourg, notamment celle sur l’application de la loi dans le temps.
En ce qui concerne la presse, MM. François Vannson, Gilbert Collard et d’autres ici nous ont interrogés sur les délais de prescription applicables. On ne peut pas y toucher. Nous avons entendu ce que nous ont dit les représentants de ce secteur. La loi de 1881 est un monument ; il n’aurait pas été opportun d’y apporter des modifications dans le cadre de nos travaux. Il ne faut pas rompre l’équilibre de cette loi.
Par ailleurs, nous l’avons dit, le terrorisme n’est pas, aujourd’hui, un crime de guerre. Il ne nous appartient pas, dans le cadre de cette mission, de redéfinir les crimes de guerre.
Enfin, je pense que nous avons répondu aux interrogations de notre collègue Patrick Devedjian. Je m’inscris en faux lorsqu’il dit qu’il y a deux infractions imprescriptibles en droit français : les crimes contre l’humanité et l’abus de biens sociaux. Cela n’est pas vrai. Le point de départ du délai de prescription, pour cette seconde infraction, correspond généralement au moment où les comptes de l’entreprise sont rendus publics, sauf lorsqu’ils ont été falsifiés ou occultés. Il ne faut pas tomber dans la caricature.
Encore une fois, je vous remercie, M. le président, de nous avoir confié cette mission et d’avoir proposé de saisir le Conseil d’État. Cela nous semble très important.
La Commission autorise, à l’unanimité, le dépôt du rapport de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, en vue de sa publication.
Proposition n° 1
Maintenir en l’état les règles de prescription applicables aux « régimes spéciaux » (infractions de presse, infractions fiscales, infractions au code électoral…).
Proposition n° 2
Rationaliser l’ordonnancement des dispositions encadrant la prescription en regroupant au sein des articles 7 à 9 du code de procédure pénale les règles relatives à la prescription de l’action publique et au sein des articles 133-2 à 133-4 du code pénal celles relatives à la prescription des peines.
Proposition n° 3
Rendre imprescriptibles, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité, les crimes de guerre visés aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal afin de mettre le droit français en conformité avec l’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Proposition n° 4
Porter à vingt ans le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle.
Maintenir en l’état les délais de prescription de l’action publique et des peines dérogatoires au droit commun applicables à certains crimes.
Proposition n° 5
Porter à six ans le délai de prescription de l’action publique et de la peine en matière délictuelle.
Maintenir en l’état les délais de prescription de l’action publique et des peines dérogatoires au droit commun applicables à certaines infractions délictuelles.
Proposition n° 6
Fixer à deux ans le délai de prescription de l’action publique et de la peine en matière contraventionnelle.
Proposition n° 7
Réaffirmer la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction.
Proposition n° 8
Supprimer le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale relatif au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse.
Proposition n° 9
Conserver le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre les mineurs est reporté au jour de leur majorité.
Proposition n° 10
Donner un fondement législatif à la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Proposition n° 11
Inscrire dans la loi le principe selon lequel la prescription de l’action publique est suspendue en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites.
Proposition n° 12
Clarifier et préciser la notion d’acte interruptif mentionnée par l’article 7 du code de procédure pénale en conférant un caractère interruptif à tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions, même s’ils émanent de la personne exerçant l’action civile, y compris s’il s’agit d’une simple plainte adressée par la victime au procureur de la République ou déposée auprès d’un service de police judiciaire.
Proposition n° 13
En matière criminelle et délictuelle, lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées, prévoir l’extinction de l’action publique en cas d’inaction de l’autorité judiciaire en fixant à trois ans le délai de prescription rouvert par chaque acte interruptif.
Proposition n° 14
Inscrire à l’article préliminaire du code de procédure pénale le principe de l’interprétation stricte de ses dispositions.
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS (374)
Jeudi 8 janvier 2015
— M. Bernard Bouloc, professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
–– Table ronde réunissant des universitaires
– Mme Christine Courtin, maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis
– M. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes, maître de conférences à l’Université de Nantes
– Mme Raphaële Parizot, professeure à l’Université de Poitiers
Vendredi 23 janvier 2015
— M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation
–– Table ronde consacrée à la prescription en droit pénal des affaires
– Mme Agathe Lepage, professeure à l’Université Paris II Panthéon-Assas
– M. Michel Véron, professeur émérite à l’Université Paris XIII, doyen honoraire de la faculté de droit
— M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
— M. Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice
Jeudi 29 janvier 2015
— M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour de cassation
–– Syndicat national des magistrats-FO : Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale, et M. Jean de Maillard, délégué
–– Conférence nationale des procureurs généraux : Mme Catherine Pignon, présidente, procureure générale près la cour d’appel d’Angers, MM. Jacques Dallest, procureur général près la cour d’appel de Chambéry, et Jean-François Thony, procureur général près la cour d’appel de Colmar
–– MM. Jean-Luc Bongrand, président de l’Association française des magistrats instructeurs, et Denis Guignard, président de chambre de l’instruction à la cour d’appel de Paris
Jeudi 5 février 2015
–– M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur de Tracfin
–– M. Daniel Picotin, avocat au barreau de Bordeaux
–– Union syndicale des magistrats : Mme Céline Parisot, secrétaire générale, et M. Olivier Janson, secrétaire national
–– Syndicat de la magistrature : M. Patrick Henriot, secrétaire national, et Mme Mathilde Zylberberg, secrétaire nationale trésorière
Vendredi 6 février 2015
–– Table ronde consacrée à la prescription des infractions de presse
– Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (375) : M. Maurice Botbol, président
– Syndicat de la presse quotidienne régionale et Union de la presse en région : M. Jean Viansson Ponté, président, et Mme Haude d’Harcourt, conseillère chargée des relations avec le Parlement
– Syndicat de la presse quotidienne nationale : Mme Bénédicte Wautelet
–– M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale
–– Mme Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège de France, membre de l’Institut
–– M. Renaud Van Ruymbeke, premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris, chargé des fonctions de juge d’instruction
Mardi 24 février 2015
–– Direction des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et du ministère des finances et des comptes publics : MM. Jean Maïa, directeur, Jean-Paul Besson, sous-directeur du droit privé et du droit pénal, et Michel Lafay, adjoint au chef du bureau du droit pénal
–– Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen : M. Michel Tubiana, président d’honneur
–– M. Dominique Foussard et Mme Claire Waquet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
–– M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation
–– Institut pour la justice : MM. Alexandre Giuglaris, délégué général, et Jean Pradel, ancien juge d’instruction, professeur émérite à l’Université de Poitiers, expert auprès de l’Institut
Mercredi 25 février 2015
–– Conférence des premiers présidents de cour d’appel : M. Henry Robert, président, premier président de la cour d’appel de Dijon, et Mme Dominique Lottin, première présidente de la cour d’appel de Versailles
–– Table ronde consacrée à la prescription des infractions de presse
– Syndicat national des journalistes : Mme Dominique Pradalié, secrétaire générale, et M. Olivier Da Lage, membre du bureau national
– M. Ivan Levaï, président de l’association Presse-Liberté
–– Conférence nationale des procureurs de la République : Mmes Danielle Drouy-Ayral, présidente, procureure de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, Brigitte Lamy, procureure de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, et M. Thomas Pison, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy
–– Table ronde consacrée à la prescription des infractions de presse
– M. Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris
– M. Emmanuel Derieux, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II Panthéon-Assas
– Mme Fabienne Siredey-Garnier, présidente de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris
–– Direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics : MM. Bastien Llorca, sous-directeur du service du contrôle fiscal, et Gradzig El Karoui, chef du bureau des affaires fiscales et pénales
–– Table ronde réunissant des représentants de l’Ordre des avocats
– Conseil national des barreaux (376) : Mme Françoise Mathe, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme, et M. Florent Loyseau de Grandmaison, membre de la commission
– Conférence des bâtonniers : M. Marc Absire, vice-président, ancien bâtonnier de Rouen
– Ordre des avocats du barreau de Paris (1) : MM. Denis Chemla, membre du Conseil de l’Ordre, et Étienne Lesage, membre du Conseil de l’Ordre chargé du bureau pénal et de la défense d’urgence
Jeudi 26 février 2015
–– Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice
–– Table ronde consacrée à la police technique et scientifique
– M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur
– M. le colonel François Daoust, directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
– M. Frédéric Dupuch, directeur de l’Institut national de police scientifique
–– Table ronde consacrée à l’aide aux victimes
– Association Aide aux parents d’enfants victimes : M. Alain Boulay, président
– Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels : M. Jean-Pierre Escarfail, président
– Association nationale pour la reconnaissance des victimes : Mme Marie-Ange Le Boulaire Verrecchia, présidente
– Association Stop aux violences sexuelles : Mme Violaine Guérin, présidente
–– Table ronde réunissant des psychiatres
– M. Philippe-Jean Parquet, psychiatre, professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’Université Lille II
– Mme Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie
Mardi 3 mars 2015
–– Association Anticor : M. Éric Alt, vice-président
–– M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel de Versailles
–– M. Jacques Buisson, président de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, professeur associé à l’Université Lyon III
Jeudi 5 mars 2015
–– Association Sherpa : M. William Bourdon, président fondateur
–– M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice
Mercredi 18 mars 2015
–– Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice
ANNEXE N° 1 :
LA PRESCRIPTION EN DROIT COMPARÉ
Étude réalisée en janvier 2015 par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni).
I – Présentation générale
1- Fondements de la prescription
Dans les différents systèmes juridiques étudiés, la raison d’être de la prescription – des poursuites ou de la peine – est le plus souvent la même : il s’agit de préserver la tranquillité sociale. Plusieurs autres arguments sont fréquemment invoqués à l’appui de la prescription : la nécessité d’oublier, l’inutilité des poursuites au bout d’un certain temps, la nécessité de sanctionner la carence des autorités publiques qui se sont abstenues d’appliquer une condamnation, ou encore le désir d’éviter une erreur judiciaire. L’Allemagne dépasse la notion de droit à l’oubli pour consacrer plutôt le droit au respect de la dignité humaine, droit fondamental constitutionnel et pilier du système constitutionnel allemand.
2- Délais
Dans l’ensemble des systèmes, la durée de la prescription varie en fonction de la gravité de l’infraction, laquelle peut être établie le plus souvent en fonction de la durée de la peine d’emprisonnement fixée par le législateur ou de la procédure (Canada).
Il peut exister aussi, dans certains pays (Autriche, Belgique, Brésil, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), des délais de prescription spécifiques à certains types de délinquance, dans les domaines de la criminalité économique ou du droit du travail notamment.
Dans plusieurs pays, certaines infractions particulièrement graves sont imprescriptibles. Les dispositions sur l’imprescriptibilité peuvent être ponctuelles, limitées à certaines infractions graves (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie) ou généralisées à des groupes d’infractions graves (Canada, Pays-Bas, Royaume-Uni). Le Royaume-Uni ne prévoit pas de délais de prescription s’agissant de l’ensemble des infractions qui ne peuvent être caractérisées de « mineures ». Le Canada et les Pays-Bas ne prévoient pas de prescription pour les infractions graves.
3- Sources
Les bases textuelles de la prescription sont le plus souvent contenues dans des lois ou principes fondamentaux ayant valeur constitutionnelle.
En Allemagne, la prescription relève de la compétence concurrente de la Fédération et des Länder. En Italie, elle fait partie des principes constitutionnels. Au Portugal, la prescription est un principe fondamental du droit. En Suisse, la prescription est considérée comme une institution générale du droit. Aux États-Unis, la prescription de l’action publique n’est pas uniforme entre l’État fédéral et les États fédérés. Les délais de prescription de l’action publique sont créés par Actes législatifs.
4- Tendances
On peut noter deux tendances.
– De façon générale, la liste des crimes imprescriptibles s’est allongée, suite à l’introduction du droit pénal international dans les différents ordres juridiques internes. La liste des crimes imprescriptibles tend à s’allonger dans la majeure partie des cas (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité…). C’est le cas par exemple en Espagne, où l’article 131-4 du Code pénal prévoit que les « délits de lèse-humanité et de génocide et les délits contre les personnes et biens protégés en cas de conflit armé ne se prescriront en aucun cas ». De même le Code pénal italien dispose en son article 575 que les « crimes les plus graves » sont imprescriptibles. Au Portugal, les crimes de guerre prévus dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans le Code de justice militaire sont imprescriptibles. En Roumanie, l’article 138 du Code pénal exclut les infractions contre l’humanité du champ d’application de la prescription. En Allemagne, les crimes visés à l’article 211 du Code pénal (circonstances aggravantes d’un meurtre telles que le plaisir, la satisfaction sexuelle) ne se prescrivent pas. Aux Pays-Bas, une loi du 15 novembre 2012 a modifié la prescription de l’action publique et rendu imprescriptibles les délits punissables de 12 ans ou plus d’emprisonnement. Jusqu’à cette loi, il n’y avait imprescriptibilité que pour les crimes punissables d’une réclusion à perpétuité.
– Certains États étendent la durée de la prescription des crimes considérés comme les plus graves. En Espagne, la loi organique du 25 novembre 2003 ayant réformé le Code pénal a établi que les peines supérieures à 20 ans d’emprisonnement ne se prescrivaient qu’après 30 ans – auparavant toutes les peines supérieures à 15 ans étaient prescrites au-delà de 25 ans. En Pologne, la nouvelle législation pénale de 1997 a allongé les délais de prescription. Il en est de même en Suisse, qui prévoit un allongement du délai de prescription de l’action pénale pour mieux protéger les enfants.
Il n’existe pas, selon nos recherches, de débats actuels au niveau européen sur la question de la prescription.
5- Point de départ, suspension et interruption du délai de prescription
S’agissant du point de départ des délais de prescription, dans un grand nombre d’États, on peut constater des règles identiques, ou assez proches.
– Le plus souvent le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l’infraction a été consommée, et s’il s’agit d’une infraction continue, du jour à partir duquel l’infraction a cessé. Aux Pays-Bas, le délai de prescription commence à courir du jour suivant celui au cours duquel le délit a été commis – cependant, il existe de nombreuses exceptions.
– Le délai de prescription peut dans certains cas courir à compter de la date de constatation de l’infraction. C’est le cas par exemple en Italie, où, pour certaines infractions économiques, le délai de prescription court à compter de la date de constatation des faits sur PV, ou au Brésil, s’agissant des infractions de corruption. Des règles similaires existent encore au Royaume-Uni.
– Dans plusieurs pays (Autriche, Belgique, Brésil, Espagne, Pays-Bas, Portugal), en matière d’infractions graves commises sur mineurs, le délai de prescription court le plus souvent à compter de la majorité de la victime.
– Certains pays ont introduit des dispositions spécifiques aux fins d’éviter que la prescription ne joue dans le cadre de procès susceptibles de durer. C’est le cas notamment en Allemagne, où le délai de prescription peut dans certains cas être suspendu à compter de l’ouverture de la phase de jugement devant le tribunal – pour une durée maximale de 5 ans.
6- Prescription de la peine
La législation sur le droit de la prescription comporte, dans de nombreux pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal), des dispositions sur la prescription de l’exécution de la peine. Cette prescription varie le plus souvent selon la gravité de l’infraction au sujet de laquelle le délinquant a été condamné.
Il existe plusieurs modèles : imprescriptibilité, absence de réglementation, durée de la prescription variable. On donnera un exemple de chacun des modèles :
– en Allemagne, l’exécution d’une condamnation à une peine de prison à perpétuité est imprescriptible ;
– au Canada, il n’existe aucune disposition en matière de prescription de la peine ;
– aux Pays-Bas existe une règle applicable pour toutes les infractions : le droit d’exécuter la peine s’éteint par la prescription et le délai de cette prescription est supérieur d’un tiers au délai de prescription de l’action publique.
II – Analyse des différents systèmes
Allemagne
Le régime de droit commun de la prescription pénale est inscrit au chapitre 5 du Code pénal (Strafgesetzbuch) (§ 78-79 b).
Les délais de prescription de l’action publique dépendent de la gravité des infractions et de la durée de la peine d’emprisonnement :
– 30 ans si les faits sont punis de la peine d’emprisonnement à perpétuité ;
– 20 ans si la peine d’emprisonnement est supérieure à 10 ans ;
– 10 ans si la peine d’emprisonnement est comprise entre 5 et 10 ans ;
– 5 ans si la peine d’emprisonnement est comprise entre 1 et 5 ans ;
– 3 ans dans les autres cas.
S’agissant des infractions d’affaires, le législateur a consacré trois délais spécifiques :
– 10 ans pour les peines comprises entre 5 et 10 ans ;
– 5 ans pour les peines comprises entre 1 et 5 ans ;
– 3 ans dans les autres cas.
Les meurtres commis avec les circonstances aggravantes prévues à l’article 211 du Code pénal ne se prescrivent pas (infractions commises avec un certain mobile : envie de tuer, rapacité, satisfaction de l’instinct sexuel, et sous un certain modus operandi : de manière perfide ou cruelle).
Le délai de prescription court à partir du moment où la commission de l’infraction est accomplie (§ 78 a). Si le succès de l’accomplissement lié à l’infraction se manifeste à un moment ultérieur, la prescription ne prend effet qu’à partir de ce moment.
Lorsque les poursuites concernent un membre du Bundestag ou un parlementaire régional, la prescription est suspendue (« die Verjährung ruht ») à compter du jour où le ministère public a pris connaissance de l’acte ou de son auteur supposé, ou bien à compter du jour où une plainte a été déposée contre cette personne.
Certaines infractions commises à l’encontre de mineurs ne se prescrivent qu’à compter de l’âge de 21 ans (§ 78 b) (crimes d’abus sexuel, de mutilations sexuelles notamment).
Dans l’hypothèse où l’auteur du crime, ayant commis l’infraction sur le territoire allemand, se trouve à l’étranger, la prescription est suspendue à compter du moment où l’autorité judiciaire compétente a soumis une demande d’extradition auprès des autorités de l’État où l’auteur du crime se trouve.
Le délai de prescription de l’exécution de la peine varie selon sa gravité (§ 79) :
– 25 ans pour une peine d’emprisonnement de plus de 10 ans ;
– 20 ans pour une peine d’emprisonnement entre 5 et 10 ans ;
– 10 ans pour une peine d’emprisonnement entre 1 et 5 ans ;
– 5 ans pour les peines de prison inférieures à 1 an ou les amendes supérieures à 30 « jours-amende » (Tagessätzen) ;
– 3 ans pour les amendes inférieures à 30 « jours-amende ».
Les peines de prison à perpétuité ne se prescrivent pas (§ 79 (2)).
Autriche
La matière de la prescription de l’action publique est traitée à l’article 57 du Code pénal autrichien.
Les infractions punies d’un emprisonnement à vie sont imprescriptibles.
S’agissant des autres infractions, les délais de prescription sont les suivants :
– 20 ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à 10 ans ;
– 10 ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 5 et 10 ans ;
– 5 ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 1 et 5 ans ;
– 3 ans si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 6 mois et 1 an ;
– 1 an si l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 6 mois ou d’une amende.
Il existe des dispositions spécifiques à certaines catégories d’infractions (infractions commises sur les mineurs ; infractions économiques).
En règle générale, le délai de prescription court à partir du moment où l’infraction a été accomplie.
S’agissant des infractions fiscales, la durée de prescription est en principe de 5 ans.
Le délai de prescription de l’exécution de la peine varie selon sa gravité et commence à partir du moment où le jugement est exécutoire (§ 59) :
– 15 ans pour une peine d’emprisonnement entre 1 et 10 ans ;
– 10 ans pour une peine d’emprisonnement entre 3 mois et 1 an (ou pour une amende substituée par une peine d’emprisonnement de plus de 3 mois (Ersatzfreiheitsstrafe) ;
– 5 ans pour tous les autres cas.
L’exécution de la peine ne se prescrit pas dans l’hypothèse où l’auteur du crime est soumis à une peine d’emprisonnement à vie, une peine d’emprisonnement de plus de 10 ans, à un régime de détention dans un établissement spécialisé pour anomalies mentales. Des règles spécifiques concernent aussi les personnes présentant un fort risque de récidive.
Belgique
Les règles de prescription sont contenues aux articles 21 et 21 bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale belge.
L’action publique se prescrit selon les délais suivants :
– 10 ans pour les crimes ;
– 5 ans pour les délits ;
– 6 mois pour les contraventions.
Cependant, certains crimes sont imprescriptibles (crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité).
Il existe aussi des délais de prescription spécifiques à certaines catégories d’infractions :
– 15 ans pour les crimes qui ne peuvent être correctionnalisés par admission de circonstances atténuantes ;
– 15 ans pour les crimes d’abus sexuels, de mutilations sexuelles ou de traite à des fins d’exploitation sexuelle s’ils sont commis sur des mineurs ;
– 15 ans pour les crimes d’abus sexuels, de mutilations sexuelles ou de traite à des fins d’exploitation sexuelle qui sont correctionnalisés ;
– 10 ans pour les crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction d’instruction ou par le ministère public ;
– 5 ans pour les crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés ;
– 1 an pour les délits contraventionnalisés.
La prescription commence à courir dès que l’infraction est consommée, lorsque tous ses éléments constitutifs sont réunis. Lorsque l’infraction est continue, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’état délictueux prend fin. Le point de départ du délai de prescription peut être retardé à la majorité de la victime en matière d’abus sexuel, de mutilations sexuelles et de traite à des fins d’exploitations sexuelles.
Plusieurs infractions relevant du domaine économique et financier sont inscrites dans le Code pénal belge (infractions liées à l’état de faillite, escroquerie, tromperie, fraude informatique, recel, blanchiment, etc.). De manière générale, les lois particulières relevant du domaine économique et financier comportant des dispositions pénales ne prévoient pas de délai de prescription de l’action publique spécifique. C’est par exemple le cas de la prescription de l’action publique des infractions en matière fiscale. Aucune disposition particulière n’est prévue. Les infractions sont donc soumises aux dispositions générales relatives au droit de la prescription.
La loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social a effectué un travail d’harmonisation des délais de prescription de l’action publique en matière sociale. La plupart des lois sociales prévoyaient des délais de prescription de 3 ans ou 5 ans pour les infractions aux dispositions sociales. La loi du 6 juin 2010 a supprimé toutes ces dispositions particulières. Le droit commun s’applique désormais aux infractions de droit pénal social.
Selon les articles 91 à 94 du Code pénal, les peines se prescrivent selon les délais suivants :
– 20 ans pour les crimes à compter de la date des arrêts ou jugements rendus (sauf crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité) ;
– 5 ans pour les délits, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu, délai porté à 10 ans si la peine prononcée est supérieure à 3 ans ;
– 1 an pour les contraventions.
Brésil
S’agissant de la prescription de l’action publique les délais dépendent du quantum de la peine encourue. Ils sont les suivants :
– 20 ans pour les peines encourues supérieures à 12 ans ;
– 16 ans pour les peines encourues comprises entre plus de 8 ans et 12 ans ;
– 12 ans pour les peines encourues comprises entre 4 ans et 8 ans ;
– 8 ans pour les peines encourues comprises entre 2 ans et moins de 4 ans ;
– 4 ans pour les peines encourues comprises entre 1 an et moins de 2 ans ;
– 3 ans si la peine est inférieure à 1 an.
Si seule une peine d’amende est encourue, le délai de la prescription sera de deux ans (ex. détention de drogue pour consommation personnelle).
Le délai de la prescription est réduit de moitié si au moment de l’infraction la personne qui l’a commise avait moins de 21 ans ou plus de 70 ans. En matière de faits de corruption, la prescription est de 5 ans.
Il existe des infractions imprescriptibles : il s’agit des infractions d’actes à caractère raciste et de constitution de groupes armés civils ou militaires agissant contre l’ordre constitutionnel et l’État démocratique.
Le point de départ du délai de prescription est celui de la date du jour de la consommation de l’infraction. Pour les infractions à caractère sexuel commises à l’encontre de mineurs, le point de départ de la prescription est fixé à la date de majorité de la victime (18 ans). En matière d’infractions continues, la prescription commence à courir à compter du jour de la cessation des faits. S’agissant des infractions de corruption, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour de la connaissance de l’infraction. Il en est de même s’agissant d’autres infractions telles que la bigamie ou la falsification de registres de l’état civil.
Le délai de prescription est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique.
S’agissant de la prescription de la peine, elle suit les mêmes règles en termes de délais que celle de l’action publique, mais est fixée en fonction de la peine finalement prononcée.
Canada
En principe, les actes criminels sont imprescriptibles.
Les infractions moins graves – punissables par voie de déclaration sommaire – sont prescrites au bout de 6 mois, à compter de la date de commission de l’infraction, sauf si le poursuivant et le défendeur se sont entendus pour écarter l’application de la prescription (art. 786 du Code criminel). Il importe donc que le poursuivant engage immédiatement des poursuites car il ne pourrait tirer prétexte par exemple d’un verdict de non-culpabilité sur un acte criminel pour engager ensuite des poursuites sur une infraction sommaire associée.
La computation des délais s’effectue en excluant le dies a quo et en incluant le dies ad quem (art. 28 de la loi d’interprétation). Le dépôt de la dénonciation interrompt en soi la prescription (art. 788 du Code criminel), sans qu’il soit nécessaire que le juge de paix ait émis une sommation ou un mandat.
Il n’existe pas de texte sur la prescription en matière d’exécution des peines.
Espagne
Les règles relatives aux délais de prescription sont fixées aux articles 131 et suivants du Code pénal.
Les délais de prescription (article 131 du Code pénal) varient pour les délits (qui sont les seules infractions graves) en fonction de la durée de la peine :
– 20 ans si la peine d’emprisonnement est de 15 ans ou plus ;
– 15 ans si la peine d’emprisonnement est comprise entre 10 et 15 ans ;
– 10 ans si la peine d’emprisonnement est comprise entre 5 et 10 ans ;
– 5 ans pour les autres délits. Dans le projet de réforme en cours, il sera possible de poursuivre des délits « légers » pendant 3 ans, si la peine d’emprisonnement est inférieure à 3 ans.
Pour les infractions mineures (faltas), la poursuite est impossible au bout de 6 mois.
Les crimes contre l’humanité et de génocide et les délits contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé, sauf ceux punis par l’article 614, ne se prescrivent jamais. Les délits de terrorisme ne se prescrivent pas non plus, s’ils ont causé la mort d’une personne.
En matière de délits fiscaux, le délai de prescription pour exiger le paiement de la dette fiscale est fixé à 4 ans. Pourtant, par application des dispositions du Code pénal, le délai de prescription pénale du délit fiscal est de 5 ans.
L’article 132 du Code pénal énumère les critères qui doivent être pris en compte pour fixer le jour où le délai de prescription commence à courir. Les délais prévus sont calculés à compter du jour où l’infraction punissable a été commise. Dans le cas d’un délit continu, les termes sont calculés à compter du jour où la dernière infraction a été réalisée.
Le dépôt de plainte auprès d’un organe judiciaire interrompt la prescription pour un délai maximum de 6 mois dans le cas d’un délit et de 2 mois dans le cas d’une contravention.
Aux termes de l’article 133 du Code pénal, la prescription de la peine est graduée en fonction de sa durée, de 1 an pour les peines mineures jusqu’à 30 ans pour les peines de prison supérieures à 20 ans.
États-Unis
S’agissant des règles de prescription de l’action publique, il convient de distinguer le droit fédéral des législations étatiques.
Droit fédéral :
Le délai de prescription de droit commun pour les crimes fédéraux est de 5 ans. Cependant, des régimes spécifiques sont prévus pour certains types d’infractions : c’est le cas par exemple pour le vol d’œuvres d’art (20 ans) ou les crimes fiscaux (8 ans). Le droit fédéral prévoit en outre un certain nombre d’infractions imprescriptibles. On y retrouve notamment les crimes capitaux, mais aussi les actes terroristes causant ou créant un risque prévisible de mort ou de blessures graves, ainsi que certains actes à caractère sexuel sur mineurs.
Le point de départ du délai de prescription se situe par défaut lorsque le dernier élément constitutif du crime est réalisé. Certaines exceptions existent, notamment en matière d’association de malfaiteurs.
Le délai de prescription n’est généralement interrompu que par un acte formel d’accusation, donc in personam, et non un acte d’enquête in rem, comme en droit français. Cependant des interruptions et extensions sont notamment prévues entre autres pour certaines situations (abus sur mineurs ; cas impliquant des preuves provenant de l’étranger ; fugitifs ; cas impliquant des preuves ADN).
États fédérés :
Le délai moyen de prescription pour les felonies (crimes et délits punis d’une peine supérieure à 1 an d’emprisonnement), ne prenant pas en compte les États dans lesquels celui-ci est imprescriptible, est d’environ 6 ans. Pour ce qui est des imprescriptibilités et des délais particuliers, on remarquera que ces derniers sont souvent appliqués aux crimes capitaux (dont font partie les meurtres), homicides, crimes à caractère sexuel, de même qu’aux enlèvements.
S’il n’existe pas de délai de prescription de la peine dans la législation fédérale ou étatique, la Due Process Clause du 14ème Amendement de la Constitution prévoit néanmoins qu’aucun État « ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, sans procédure légale régulière ». C’est par le biais de l’interprétation de cet Amendement que les juridictions fédérales ont créé un équivalent du délai de prescription de la peine afin de garantir un seuil minimal de protection pour les personnes qui, ayant été condamnées à des peines de prison ferme, n’ont cependant pas été incarcérées pendant une certaine période de temps. Les juridictions américaines n’ont cependant donné aucune définition précise du délai au-delà duquel la prescription de la peine serait acquise. Une violation du 14ème Amendement pour délai excessif dans l’application de la peine de prison ou pour un comportement de l’autorité manifestement négligent a été reconnue dans deux affaires : l’une rendue en 1978 par la Cour d’appel du 8ème Circuit (délai de 7 ans entre le jugement et son exécution) ; l’autre rendue en 1967 par la Cour d’appel du 5ème Circuit (délai de 28 ans entre le jugement et son exécution).
L’application du 14ème Amendement permet davantage de sanctionner une négligence des autorités judiciaires que de réaliser une véritable prescription de la peine.
Italie
La question du droit de la prescription de l’action publique est traitée à l’article 157 du Code pénal.
Le délai de prescription est égal à la durée maximale de la peine encourue, sans pouvoir être inférieur aux seuils minimaux suivants :
– 6 ans pour les infractions les plus graves (delitti), qui sont des délits, car il n’existe pas de crimes en droit pénal italien ;
– 4 ans pour les contraventions (contravvenzioni).
Les infractions punies de l’emprisonnement à vie sont imprescriptibles.
Le délai de prescription court à compter de la date de commission de l’infraction, ou en présence d’infraction continue, à compter du jour au cours duquel a cessé la commission du délit. Pour certains délits nécessitant une autorisation aux fins d’être poursuivis, le point de départ du délai de prescription correspond à la date d’autorisation des poursuites mais dans le cas où il est nécessaire de prendre en compte le consentement de la victime, le point de départ du délai est celui de la date de commission de l’infraction.
Certains délais de prescription spécifiques sont prévus en matière économique par le décret-loi du 10 mars 2000, n° 74. Il s’agit de délais de prescription allongés (le plus souvent d’un tiers) et le point de départ du délai de prescription correspond à la date d’établissement des faits sur procès-verbal.
S’agissant de la prescription de la peine, l’article 172 du Code pénal fixe les règles suivantes :
La prescription de la peine est réalisée lorsqu’une période égale au double de la durée de la peine d’emprisonnement s’est écoulée depuis le jugement de condamnation devenu irrévocable, période qui ne peut toutefois être inférieure à 10 ans.
Lituanie
S’agissant de la prescription de l’action publique, les infractions sont prescrites en fonction de leur gravité, selon des délais qui s’étalent entre 3 ans pour les infractions mineures, jusqu’à 20 ou 30 ans pour les actes les plus graves (article 95 du Code pénal).
Le délai de prescription est calculé à compter de la date de commission de l’acte. Certaines infractions commises à l’encontre de mineurs ne se prescrivent qu’à compter de l’âge de 25 ans. Il existe des infractions qui sont imprescriptibles (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre…).
L’article 96 du Code pénal fixe les délais de prescription de la peine, dont la durée dépend de la gravité de la peine : de 2 ans pour une infraction mineure jusqu’à 15 ans pour une peine supérieure à 10 ans ou une peine de prison à vie.
Malte
S’agissant de la prescription de l’action publique, les infractions sont prescrites en fonction de leur gravité, selon des délais qui s’étalent entre 3 mois pour les infractions mineures, jusqu’à 20 ans pour les actes les plus graves.
Le délai de prescription court à compter de la date de commission de l’infraction, ou, en présence d’infractions continues, à compter du jour au cours duquel a cessé la commission du délit. Pour certains délits nécessitant une autorisation aux fins d’être poursuivis, le point de départ du délai de prescription correspond à la date d’autorisation des poursuites.
Certaines infractions commises à l’encontre de mineurs ne se prescrivent qu’à compter de l’âge de 25 ans.
Pays-Bas
Aux termes de l’article 70 du code pénal néerlandais l’action publique est prescrite :
– au terme de trois ans pour toutes les contraventions ;
– au terme de six ans pour les délits réprimés par une amende ou une peine de détention, d’emprisonnement de moins de trois ans ;
– au terme de douze ans pour les crimes ou les délits réprimés par une peine de détention, d’emprisonnement déterminé de plus de trois ans ;
– au terme de vingt ans pour les crimes et délits réprimés par une peine d’emprisonnement de huit ans ou plus.
Il n’y a pas de prescription de l’action publique :
– pour les crimes et délits réprimés par un emprisonnement de 12 ans ou plus ;
– pour les crimes et délits visés aux articles 240 b 2ème alinéa, 243, 245 et 246 (délits sexuels et de violences), pour autant que le fait a été commis à l’encontre d’une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans.
Le délai de prescription commence à courir du jour suivant celui où le délit a été commis, à l’exception des cas suivants :
– dans le cas des délits prévus aux articles 172 (1), 173 (1) 173 a et 173 b (délits d’atteintes aux personnes), où le délai court à compter du jour suivant celui où le délit parvient à la connaissance d’un officier de police judiciaire ;
– dans le cas de contrefaçon, où le délai court à compter du jour suivant celui où l’objet contrefait a été utilisé ;
– dans le cas des crimes prévus aux articles 240 b, 242 à 250 inclus et 273 f ou 300 à 303 inclus, dans la mesure où le délit constitue la mutilation génitale d’une personne du sexe féminin et où il a été commis contre une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, où le délai court à compter du jour suivant celui où cette personne a atteint l’âge de 18 ans ;
– dans le cas des crimes prévus aux articles 278, 279, 282 et 282 a, où le délai court à compter du jour suivant celui de la libération ou sauvetage ou mort de la personne contre qui le crime a été directement commis.
Tout acte de poursuite interrompt le délai de prescription, y compris à l’encontre des co-auteurs ou complices.
Aux termes de l’article 76 du code pénal néerlandais, le droit d’exécuter la peine s’éteint par la prescription et le délai de cette prescription est supérieur d’un tiers au délai de prescription de l’action publique. Le délai de prescription commence le lendemain du jour où la décision judiciaire peut être exécutée.
En cas d’absence non autorisée d’un condamné exécutant sa peine dans un établissement, un nouveau délai de prescription commence le lendemain du début de l’absence non autorisée. En cas de révocation d’une mise en liberté conditionnelle, un nouveau délai de prescription commence le lendemain de la date de révocation.
Portugal
S’agissant de l’action publique, l’article 118 (1) du Code pénal dispose que les infractions sont prescrites, lorsque les délais suivants se sont écoulés :
– 15 ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à 10 ans ;
– 10 ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement comprise entre 5 et 10 ans ;
– 5 ans lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement entre 1 et 5 ans ;
– 2 ans dans les autres cas.
Certaines infractions particulières sont prescrites au bout d’un délai de 15 ans. Il s’agit notamment d’infractions économiques (fraudes, prises d’intérêts illégales) ou commises par des fonctionnaires.
Les délais de prescription sont calculés à compter de la date de commission de l’infraction. Le point de départ peut être différent pour certains types d’infraction, comme les infractions continues ou habituelles (le délai court alors à compter du jour de commission du dernier acte).
Pour certaines infractions commises à l’encontre de mineurs, le délai de prescription s’écoule à compter de l’âge de 23 ans.
Suivant l’article 122 du Code pénal, l’exécution des peines prononcées se prescrit par :
– 20 ans pour les peines d’emprisonnement supérieures à 10 ans ;
– 15 ans pour les peines d’emprisonnement de 5 ans minimum ;
– 10 ans pour les peines d’emprisonnement supérieures à 2 ans ;
– 4 ans dans les autres cas.
Royaume-Uni
Les infractions peu graves (summary offenses) – pour lesquelles la durée maximale d’emprisonnement est de 6 mois – sont prescrites au bout de 6 mois à compter de la date de commission de l’infraction.
L’exclusion de la prescription est la règle générale pour les infractions qui ne sont pas mineures (celles qui sont suffisamment graves pour relever de la compétence de la Crown Court), le poursuivant conservant le droit de poursuivre le délinquant jusqu’à sa mort.
Exceptionnellement cependant, des textes particuliers ont prévu des délais chiffrés. En vertu de l’article 146 A du Customs and Excise management Act 1979, les infractions douanières se prescrivent au bout de 20 ans.
La jurisprudence a développé la théorie d’abuse of process, afin de suspendre une poursuite qui serait manifestement tardive. Cette théorie est notamment utilisée afin de protéger un accusé qui ne pourrait plus se défendre efficacement parce que les preuves à décharge auraient disparu.
ANNEXE N° 2 :
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ces contributions ont été annexées au présent rapport avec l’autorisation de leurs auteurs. Aucune modification n’y a été apportée.
SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS
Les contributions sont présentées suivant l’ordre chronologique
de l’audition de leurs auteurs.
Pages
Contribution de Mme Christine Courtin, maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis 159
Contribution de M. Jean Danet, avocat honoraire au barreau de Nantes,
maître de conférences à l’Université de Nantes 167
Contribution de M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour
de cassation 191
Contribution de M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation 212
Contribution de M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général à la Cour
de cassation 217
Contribution du Syndicat national des magistrats-FO 224
Contribution de la Conférence nationale des procureurs généraux 230
Contribution de l’Association française des magistrats instructeurs 237
Contribution de l’Union syndicale des magistrats 239
Contribution du Syndicat de la magistrature 249
Contribution du Syndicat de la presse quotidienne régionale / Union de la presse en région 257
Contribution du Syndicat de la presse quotidienne nationale 261
Contribution de M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale 263
Contribution de M. Jean Maïa, directeur des affaires juridiques
à l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie
et du numérique et du ministère des finances et des comptes publics 273
Contribution de M. Dominique Foussard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 284
Contribution de Mme Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour
de cassation 295
Contribution de M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation 301
Contribution de M. Jean Pradel, ancien juge d’instruction, professeur émérite
à l’Université de Poitiers, expert auprès de l’Institut pour la justice 321
Contribution du Syndicat national des journalistes 327
Contribution de la Conférence nationale des procureurs de la République 332
Contribution de M. Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris 335
Contribution de M. Emmanuel Derieux, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II Panthéon-Assas 339
Contribution de Mme Fabienne Siredey-Garnier, présidente de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris 352
Contribution du Conseil national des barreaux 362
Contribution du Barreau de Paris 369
Contribution de Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse au ministère de la justice 371
Contribution de M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique
et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire du ministère
de l’intérieur 381
Contribution de M. le colonel François Daoust, directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale 387
Contribution de M. Frédéric Dupuch, directeur de l’Institut national
de police scientifique 445
Contribution de l’association Aide aux parents d’enfants victimes 448
Contribution de l’Association pour la protection contre les agressions
et les crimes sexuels 451
Contribution de l’Association nationale pour la reconnaissance des victimes 452
Contribution de l’association Stop aux violences sexuelles 457
Contribution de M. Philippe-Jean Parquet, psychiatre, professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’Université Lille II 461
Contribution de M. Daniel Zagury, psychiatre, expert près la cour d’appel
de Paris 465
Contribution de l’association Anticor 469
Contribution de M. Marc Robert, procureur général près la cour d’appel
de Versailles 474
Contribution de M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice 483
Contribution de Mme Christine Courtin,
maître de conférences à l’Université Nice Sophia Antipolis
La prescription est au cœur du fonctionnement de la justice pénale, de l’action publique jusqu’à l’exécution de la peine. En droit répressif, toute prescription est extinctive ou bien libératoire. Les droits que la prescription pénale a pour objet ou pour effet d’éteindre, sont, ou bien les droits d’action qui prennent naissance dans l’infraction, ou bien les droits d’exécution qui prennent naissance dans la condamnation, c’est-à-dire les manifestations juridiques du droit de punir. Par suite, la prescription constitue un mode d’extinction commun au droit de poursuite des infractions et au droit d’exécution des condamnations pénales.
C’est la prescription de l’action publique qui fait l’objet des plus vives critiques en doctrine et c’est à son égard que la jurisprudence manifeste une réelle hostilité. La confusion régnant à l’heure actuelle en la matière rend nécessaire une réforme d’ensemble. Mon propos concernera donc principalement la prescription de l’action publique.
Je voudrais d’abord dresser un bref panorama de la situation actuelle résultant des évolutions de la matière qui viennent toutes du fait que notre société n’accepte plus qu’une infraction, à l’exception des infractions mineures, ne reçoive pas de réponse judiciaire, dans un contexte d’exacerbation des droits des victimes.
Je m’interrogerai ensuite sur l’articulation et la cohérence du dispositif en proposant quelques pistes possibles pour une réforme d’ensemble du système.
I. La prescription de l’action publique : un manque de lisibilité nuisant au principe de sécurité juridique
La complexité des règles relatives à la prescription de l’action publique provient de l’instauration d’exceptions toujours de plus en plus nombreuses non seulement à la règle générale relative aux délais de prescription mais surtout aux règles générales relatives à la fixation du point de départ du délai de prescription.
L’introduction de ces diverses exceptions témoigne de l’hostilité manifestée à l’encontre de l’institution elle-même par le législateur mais surtout par la jurisprudence.
De fait, on peut déplorer d’une part une intervention désordonnée du législateur qui entame l’unité nécessaire à la crédibilité de l’institution et d’autre part un arbitraire prétorien dans la fixation du point de départ du délai de prescription qui nuit au principe de sécurité juridique.
A) Une intervention désordonnée du législateur
Il est admis classiquement que le délai de prescription de l’action publique varie suivant la qualification légale de l’infraction. C’est ainsi qu’il est de dix ans pour les crimes (art. 7 CPP), de trois ans pour les délits (art. 8 CPP) et d’un an pour les contraventions (art. 9 CPP). Or, la multiplication des exceptions législatives à la règle générale des délais de prescription inscrite aux articles 7 à 9 du CPP entame l’unité de l’institution qui reposait logiquement sur la classification tripartite des infractions.
Certaines infractions ont été considérées comme imprescriptibles telles que les crimes contre l’humanité (art. 213-5 CP) ainsi que certaines infractions militaires comme la désertion à l’ennemi ou l’insoumission à l’étranger en temps de guerre (art. 94 al. 2 CJM).
Le législateur a encore instauré des délais spéciaux, plus brefs ou plus longs.
Le délai de prescription est par exemple abrégé à trois mois pour les infractions en matière de presse (art. 65 loi du 29 juillet 1881). En la matière, la publicité de l’infraction justifie la brièveté du délai de poursuite et la liberté d’expression ne pourrait se satisfaire d’une durée plus longue. Cependant, la loi Perben II du 9 mars 2004 est venue ajouter un nouvel article 65-3 à la loi du 29 juillet 1881 aux termes duquel, le délai de prescription est désormais d’une année pour les délits de diffamation ou d’injure à caractère racial, ethnique et religieux, de provocation à des discriminations à caractère racial, ethnique et religieux, ou de contestation de crimes contre l’humanité. Par ailleurs, en matière électorale, le délai de prescription est de 6 mois à compter du jour de la proclamation des résultats. La courte prescription serait ici imposée par une considération d’ordre public, celle de rendre incontestables les résultats d’une élection.
Le délai de prescription est en revanche allongé dans de nombreuses hypothèses. L’allongement de la prescription se justifie tout d’abord par le fait que certains comportements, outre leur gravité ou leur monstruosité, sont indicibles. Les victimes peinent à mettre des mots sur les actes qu’elles ont subis. Elles ont besoin de temps pour comprendre et pour formuler leur détresse. Ainsi, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité se justifie par la spécificité et l’horreur de tels crimes ainsi que par l’incompréhension qu’ils provoquent. Cette dérogation aux règles générales de la prescription est une réponse du droit au devoir de mémoire. L’imprescriptibilité, en tant qu’obstacle à l’impunité, doit également dissuader de la commission de tels crimes.
L’allongement de la prescription pour les infractions commises contre les mineurs se justifie par le fait que ces derniers, en raison de leur jeune âge, peuvent éprouver des difficultés accrues lorsque les auteurs sont des proches ou des personnes ayant autorité sur eux, à dénoncer des agissements dont ils sont victimes. C’est pourquoi, le législateur a décidé de reporter le point de départ du délai de prescription de certaines infractions commises contre des mineurs au jour de leur majorité et a augmenté la durée du délai de prescription de certaines infractions commises contre ces derniers. En effet, suite à la loi du 9 mars 2004, le délai de prescription de l’action publique des crimes visés à l’article 706-47 CPP et commis contre des mineurs est désormais de vingt ans. Cela concerne le meurtre ou l’assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que le viol simple ou aggravé incriminé aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal (art. 7 al. 3 CPP). En outre, la prescription des délits mentionnés à l’article 706-47 CPP et commis contre des mineurs est de dix ans. Il s’agit des délits d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur incriminés aux articles 222-27 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, sauf les délits des articles 222-30 et 227-26 pour lesquels la prescription passe à vingt ans. Le régime dérogatoire de la prescription de l’action publique en matière d’infractions contre les mineurs résulte de lois successives venues remanier au coup par coup le domaine des infractions visées et les délais de prescription. Les auteurs sont nombreux aujourd’hui à dénoncer la démesure temporelle et les incohérences prescriptives d’un régime qu’ils qualifient d’hyperdérogatoire. De plus, la législation distingue selon l’âge du mineur victime. Si le mineur de 15 ans bénéficie de la prescription dérogatoire, il n’en va pas de même pour le mineur entre 15 et 18 ans qui reste soumis au délai de droit commun sauf à caractériser une circonstance aggravante.
L’allongement du délai de prescription se justifie ensuite par la volonté du législateur de dissuader particulièrement certains criminels. Le délai est par exemple allongé pour les actes de terrorisme et pour les infractions de trafic de stupéfiants : l’action publique se prescrit par trente ans en cas de crime et par vingt ans en cas de délit (art. 706-25-1 et 706-31 CPP). Cependant, en la matière, l’absence de tout débat préalable laisse perplexe quant au choix des infractions retenues.
En principe, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise, la détermination de cette date dépendant de la nature de l’infraction (instantanée, continue, de résultat ou d’habitude). Mais dans un certain nombre d’hypothèses, en vue d’une meilleure efficacité de la répression, le législateur retarde expressément le point de départ du délai de prescription. Par exemple, en matière électorale, la prescription ne court qu’à compter du jour de la proclamation des résultats de l’élection (art. L. 114 code électoral) ; en matière d’usure, du jour de la dernière perception d’intérêt ou de capital (art. L. 313-5 code de la consommation). Mais surtout, pour les crimes et les délits visés à l’article 706-47 CPP et commis contre des mineurs, la prescription ne court qu’à partir de la majorité de ces derniers (art. 7 et 8 CPP modifiés par la loi du 9 mars 2004).
B) Un arbitraire prétorien dans la fixation du point de départ du délai de prescription
Dans des hypothèses de plus en plus nombreuses, la jurisprudence n’hésite pas à retarder le point de départ du délai de prescription. Cette hostilité à l’égard de la prescription de l’action publique se manifeste principalement de deux manières : d’une part, par la transformation d’une infraction instantanée en infraction continue ; d’autre part, par la prise en compte de la clandestinité de l’acte délictueux.
Le fait de savoir si, dans une affaire donnée, la prescription de l’action publique et ou non acquise, suppose que soit résolue, au préalable, la question du point de départ du délai de ladite prescription. Or, pour déterminer cette date, tout dépendra de la nature de l’infraction. Par principe, le point de départ de la prescription se situe, pour les infractions instantanées, au jour de la commission de l’infraction et pour les infractions continues, au jour de la fin de l’activité délictueuse. Or, il est évident que la jurisprudence de la Cour de cassation n’apparaît pas toujours orthodoxe s’agissant de la structure des infractions pénales. Et elle n’hésite pas à qualifier de « continues » des infractions qui, pourtant dans leur principe, sont « instantanées ».
Deux exemples permettront d’illustrer cette politique prétorienne arbitraire.
Le premier exemple concerne l’infraction d’escroquerie. Traditionnellement, il est admis que l’escroquerie est une infraction instantanée dont le délai de prescription commence à courir le jour de la remise. Or, la jurisprudence décide que, en matière d’escroquerie aboutissant à des remises successives, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise de fonds, que l’on se trouve dans le cas où les manœuvres constituent une opération délictueuse unique ou dans le cas où des manœuvres se sont répétées sur une longue période et forment entre elles un tout indivisible.
Le deuxième exemple peut être tiré d’un arrêt de la chambre criminelle du 17 janvier 2006. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme clairement que le délit de publicité en faveur du tabac réalisé sur internet constitue une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public. Or, cette infraction est instantanée, le résultat étant obtenu dès que la publicité illégale est réalisée c’est-à-dire dès que la réglementation est transgressée. Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de la jurisprudence visant à retarder le point de départ du délai de prescription au jour où le résultat illicite aura pris fin et qui se justifie par la volonté de sanctionner des infractions instantanées lorsque ces dernières laissent subsister, après leur consommation, des effets inadmissibles socialement.
C’est surtout à propos des infractions clandestines que la jurisprudence a rendu des solutions contra legem en retardant le point de départ du délai au jour où ces infractions auront pu être constatées « dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Cette jurisprudence trouve à s’appliquer s’agissant d’infractions clandestines par nature ou s’agissant d’infractions dissimulées grâce à des manœuvres de leur auteur, comme pour l’abus de confiance ou pour l’abus de biens sociaux avant que cette règle d’exception ne prolifère à de nombreux délits. Récemment, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’application des règles de la prescription s’agissant d’infanticides dissimulés dans un arrêt du 7 novembre 2014. Cette décision a autant été saluée que critiquée par la doctrine. Dans cet arrêt, l’assemblée plénière, faisant référence à la notion de suspension de la prescription, a considéré que, « si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». Or, en l’espèce, il s’agissait de savoir si, en cas d’homicides volontaires dissimulés sur des nouveau-nés, le point de départ du délai de prescription pouvait être reporté au jour de la découverte du crime. En effet, la suspension ne concerne nullement le point de départ du délai mais traduit un empêchement pour la prescription de suivre normalement son cours. Elle trouve son fondement dans l’adage civiliste contra non valentem agere non currit praescriptio (qui, littéralement, signifie que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice). Finalement, en invoquant la suspension de la prescription en l’espèce, la cour de cassation est parvenue à opérer un report de son point de départ.
II) Perspectives de réforme des règles de la prescription pénale
L’état des lieux en matière de prescription fait apparaître un manque criant de lisibilité. Seule l’instauration de règles claires et précises est de nature à restaurer en la matière une certaine sécurité juridique. Cela nécessite au préalable de repenser les fonctions qui sont aujourd’hui celles que doit remplir la prescription.
A) Repenser les fonctions de la prescription
Une réforme d’ensemble des règles de la prescription en matière pénale nécessite que l’on s’interroge au préalable sur les fondements contemporains de cette institution. Pour justifier la prescription, il y a des arguments qui ont toujours été avancés mais qui aujourd’hui apparaissent dépassés.
La prescription repose traditionnellement sur l’idée qu’au bout d’un certain délai, dans un intérêt de paix et de tranquillité sociales, mieux vaut oublier l’infraction qu’en raviver le souvenir. Mais la prescription de l’action publique, présentée comme l’expression procédurale du droit à l’oubli, soulève aujourd’hui de nombreuses contestations à la fois d’ordre social et moral. Elle nuit à la protection de la société tout en profitant aux délinquants. Surtout, en matière de crimes, cette justification ne tient plus dans une société marquée par l’équité et soumise à la presse d’informations.
La prescription viserait, en outre, à sanctionner la négligence des autorités : la société perdrait son droit de punir parce qu’elle ne l’aurait pas exercé en temps voulu. Cet argument cède aujourd’hui devant les nouvelles formes de criminalité qui laissent apparaître des mécanismes de perversion et parfois d’organisation autrefois inconnus.
On a encore pu justifier la prescription pénale par des considérations liées à la psychologie du délinquant. En effet, le coupable, en cherchant à échapper aux poursuites ou à la sanction a dû vivre dans la crainte et le remords. Dès lors, la peine aurait perdu tout caractère rétributif, en même temps que le danger social se serait estompé. En outre, la prescription constituerait un bon moyen de politique criminelle puisque le coupable aurait intérêt à ne pas s’exposer une nouvelle fois en commettant une infraction. Or, une telle vision angélique du délinquant apparaît inadaptée dans notre société.
La prescription de l’action publique a encore pu être justifiée par la volonté de lutter contre les risques d’erreurs judiciaires découlant avec le temps du dépérissement des preuves. Mais cette raison factuelle ne tient plus non plus aujourd’hui au regard de l’évolution des nouvelles technologies, ni du développement de la lutte scientifique contre le crime.
Finalement, il apparaît aujourd’hui que la prescription de l’action publique est davantage pensée au travers des fonctions qu’elle peut remplir dans une politique criminelle qu’au travers de ce qui peut la fonder. Mais quelles peuvent être ces fonctions ?
Tout d’abord, les interventions législatives successives ayant pour objet l’allongement des délais de prescription font apparaître que la prescription devient une échelle de gravité des infractions, concurrente à celle des peines. En effet, l’instauration d’exceptions aux règles générales de prescription constitue pour le législateur contemporain le moyen de témoigner l’importance qu’il attache à la poursuite et à la sanction de certains faits en même temps qu’elle traduit une prise en considération des intérêts des victimes. Ensuite, la prescription constitue une limite posée par le législateur à la tentation d’une expansion sans fin de la réponse pénale.
La réforme d’ensemble du dispositif conduit à se poser une première question, celle du maintien ou non de cette cause d’extinction de l’action publique. Il me semble que l’on ne peut envisager de renoncer à la prescription et ce pour trois raisons au moins. En premier lieu, la prescription est une institution profondément enracinée dans notre tradition juridique. En second lieu, renoncer à la prescription entraînerait par voie de conséquence la perte de spécificité des crimes contre l’humanité, seules infractions ou presque imprescriptibles. Enfin, la nécessité de préserver la prescription apparaît au regard du respect du principe conventionnel du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Mais s’il apparaît difficile de renoncer à la prescription, force est de constater que les lois de circonstance ou la jurisprudence ont considérablement entamé le principe même de l’institution. Une réforme est nécessaire et cette réforme doit impérativement passer par la réaffirmation de principes qui ont été progressivement occultés. Si tout principe doit avoir des exceptions, trop d’exceptions nuisent à l’existence même du principe.
Une réforme de la prescription se doit d’assurer un certain équilibre entre les différents intérêts en présence : intérêts de la société tout d’abord qui a droit à la sécurité et qui dispose aujourd’hui de moyens renforcés d’élucidation des infractions ; intérêts des parties ensuite (droit à un procès équitable et à être jugé dans un délai raisonnable pour l’auteur de l’infraction), (droits des victimes d’être reconnues comme telles et d’obtenir réparation).
L’État, au terme de son pouvoir régalien, doit rendre la justice à celui qui la réclame. Mais il convient également de noter l’interférence du délai raisonnable tant en ce qui concerne l’auteur que la victime, qui peuvent en matière de prescription avoir une vision opposée du temps d’où la nécessité d’une réponse pénale adaptée dans un délai raisonnable.
B) Plusieurs pistes envisageables
Sur la forme, les règles relatives à la prescription de l’action publique sont inscrites soit dans le code pénal (par exemple pour les crimes contre l’humanité ou les crimes contre l’espèce humaine) soit dans le code de procédure pénale (art. 7 à 9 (règles générales) ; art. 706-47 pour les infractions commises contre les mineurs ; art. 706-25-1 et 706-31 pour les infractions de terrorisme et de trafic de stupéfiants).
Ce faisant, l’absence d’une règle unique, c’est-à-dire l’inscription des règles de prescription dérogatoires dans le code pénal pour chaque infraction concernée ou le report de toutes ces règles dans le code de procédure pénale peut être regrettée en ce qu’elle ne favorise pas la lisibilité des règles pénales.
Sur le fond, une réforme des règles relatives à la durée du délai de prescription, de celles relatives à son point de départ ainsi qu’une réforme des règles relatives à l’interruption de la prescription sont nécessaires.
Ce sont tout d’abord des principes clairs au travers des délais de prescription qui doivent être réaffirmés. En effet, la restauration de la sécurité juridique suppose en la matière que l’on revienne sur l’anarchie gouvernant l’édiction de délais spéciaux dérogatoires. Pour ce faire, plusieurs voies de réforme sont envisageables.
• Réviser les délais de prescription de droit commun dans le sens d’un allongement
La fixation de trois durées distinctes selon la nature de l’infraction (crime, délit ou contravention) doit être maintenue car elle permet de prendre en compte la gravité des infractions et assure une réelle lisibilité du droit. Mais, la nécessaire prise en compte des droits des victimes ainsi que l’évolution des techniques d’investigation pourraient permettre un allongement raisonnable des délais de prescription. Il est vrai que les délais actuels de prescription de l’action publique peuvent apparaître injustifiés au regard de l’évolution des techniques d’enquête qui recourent largement aux nouvelles techniques scientifiques. Le recours aux preuves génétiques ouvre dorénavant de plus larges possibilités aux services enquêteurs. De fait, les justiciables ne comprennent pas qu’un crime odieux puisse rester impuni du fait d’une disposition procédurale.
Ces délais rénovés pourraient être trois ans pour les contraventions, cinq ans pour les délits et vingt ans pour les crimes. Il y aurait ainsi une parfaite homogénéité entre les délais de prescription de l’action publique et ceux de la prescription des peines.
On peut également concevoir qu’en raison de la faible gravité des contraventions, le délai d’un an paraît satisfaisant. En revanche, les délais en matière criminelle et délictuelle qui n’apparaissent plus satisfaisants pourraient être portés respectivement à 15 ans et 5 ans comme d’ailleurs l’avait préconisé la commission des lois du Sénat en 2007.
• Continuer à prévoir comme aujourd’hui des délais spéciaux pour les comportements qui nécessitent une répression particulière en raison de la valeur de l’intérêt protégé
La réforme n’empêcherait pas de conserver quelques délais dérogatoires mais parfaitement délimités eu égard à la nature intrinsèque de l’infraction et du trouble spécifique occasionné à l’ordre public (trafic de stupéfiants ou actes de terrorisme) ou à la primauté de libertés fondamentales comme en matière de presse.
Pour les infractions de nature sexuelle, le droit positif prévoit déjà des délais dérogatoires en faveur des mineurs (20 ans pour les crimes et 10 ou 20 ans pour les délits). L’allongement du délai de prescription ne doit pourtant pas être limité aux seules infractions commises contre les mineurs car une victime majeure peut avoir les mêmes difficultés à se confier et à se reconnaître victime. Il pourrait être prévu une prescription de 20 ans pour tous les crimes sexuels et de 10 ans pour tous les délits sexuels. Par ailleurs, il pourrait être sauvegardé pour les mineurs le report du point de départ du délai de prescription au jour de leur majorité.
Autre piste de réflexion : En se calquant sur le dispositif ayant été instauré dans le code pénal et consistant à aggraver la sanction en raison d’une qualité de la victime, une règle identique pourrait être inscrite dans le CPP. C’est ainsi qu’une prescription plus longue (10 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes) pourrait être instaurée lorsque des crimes ou des délits ont été commis à l’encontre de personnes présentant un état de particulière vulnérabilité due à leur âge (ce qui permettrait d’inclure le régime dérogatoire des infractions commises contre les mineurs), à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique (l’affaire Émile Louis est particulièrement édifiante sur ce point).
Pour les infractions de criminalité organisée, il pourrait tout d’abord être envisagé d’étendre les délais de prescription prévus en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants à tous les trafics en réseau. Comment expliquer par exemple que l’infraction de traite des êtres humains destinée à sanctionner des atteintes à la dignité humaine ne bénéficie pas d’un allongement du délai de prescription ?
Ne faudrait-il pas prévoir par exemple que les infractions de délinquance et de criminalité organisée fassent l’objet d’un traitement identique au regard de la prescription de l’action publique dans la mesure où la loi Perben II du 9 mars 2004 est venue instituer en ce qui les concerne un régime procédural dérogatoire du droit commun notamment en ce qui concerne la recherche des preuves (garde à vue, écoutes téléphoniques, sonorisations et fixations d’images).
Il faut ensuite revenir sur l’insécurité juridique découlant de l’indétermination de la liste des infractions dont le point de départ du délai de prescription est reporté. Cette situation se conciliant d’ailleurs très mal avec le caractère d’ordre public de la prescription qui n’a jamais été contesté.
Puisque le point de départ du délai de prescription fixé par la loi « le jour où l’infraction a été commise » n’apparaît plus satisfaisant aujourd’hui au regard du caractère clandestin de certaines infractions, du souci de rendre justice aux victimes, on peut envisager la généralisation d’un report de ce point de départ en légalisant la formule jurisprudentielle c’est-à-dire en fixant ce point de départ au jour où l’infraction « est apparue et a pu être constatée ». Il s’agirait ainsi de fixer le point de départ de la prescription au jour de la découverte de l’infraction.
Il convient enfin de procéder à un encadrement légal de la notion d’interruption de la prescription. Prévoir une liste exhaustive des actes interruptifs de la prescription n’apparaît pas envisageable. En revanche, il est possible de préciser la notion d’actes d’instruction ou de poursuite qui sont interruptifs.
Un article du code de procédure pénale pourrait prévoir le critère finaliste des actes interruptifs : sont des actes interruptifs les actes d’instruction ou de poursuite c’est-à-dire les actes réalisés en vue d’établir la preuve d’une infraction et de confondre le cas échéant ses auteurs. Il conviendrait également d’intégrer parmi les actes interruptifs, les simples plaintes des victimes adressées au parquet. En effet, aujourd’hui, de telles plaintes ne sont pas interruptives de prescription car en vertu du principe de l’opportunité des poursuites du parquet, elles n’ont pas vocation à provoquer la mise en œuvre des poursuites le parquet étant libre de décider des suites à donner à la procédure. Aujourd’hui, dans cette hypothèse, pour engager des poursuites, la victime doit se constituer partie civile auprès d’un juge d’instruction. Cependant, une simple plainte est dans l’esprit des justiciables le moyen de saisir la justice. En déposant plainte, le justiciable a bien la volonté de provoquer des poursuites. De plus, cela coïnciderait avec la jurisprudence selon laquelle le procès-verbal de police recueillant la plainte de la victime d’une infraction est interruptif du délai de prescription.
Pour conclure, quelques mots sur la prescription de la peine. Le régime de la prescription relative aux peines prononcées diffère de celui relatif à l’action publique. Il est de vingt années pour les crimes, cinq années pour les délits et deux années pour les contraventions, à compter du moment où les condamnations sont devenues définitives. Or, aucune justification pertinente n’a jamais été donnée sur ces durées. En la matière, une décision de justice est venue prononcer une condamnation pénale. Or, le principe de l’effectivité de la justice pourrait justifier une imprescriptibilité de la peine. D’une manière générale, la matière ne peut se contenter comme aujourd’hui de la juxtaposition de modifications législatives et du développement d’une jurisprudence contraire à la lettre de la loi. La réforme envisagée devra éviter à l’avenir une remise en cause des grands principes du droit pénal et permettre de restaurer la sécurité juridique.
Contribution de M. Jean Danet, avocat honoraire
au barreau de Nantes, maître de conférences
à l’Université de Nantes
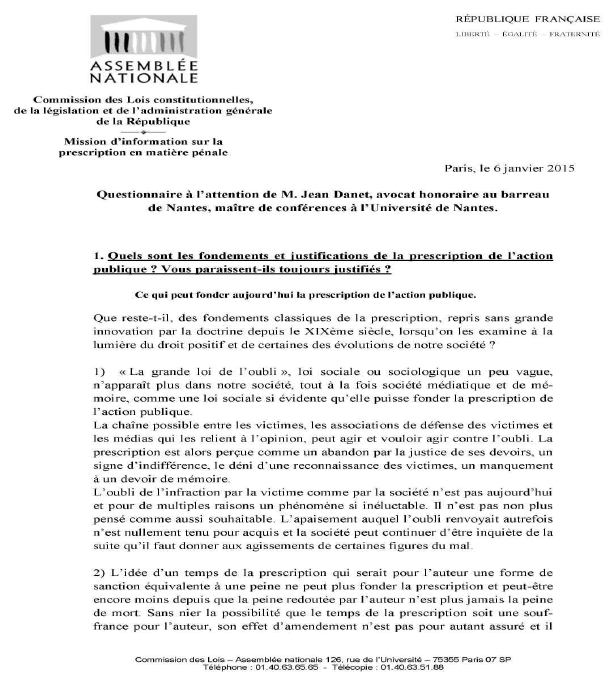
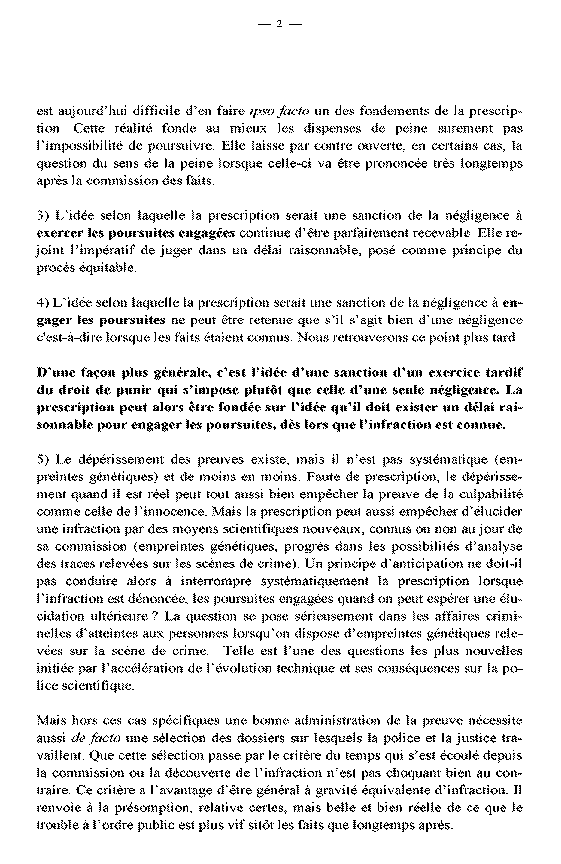
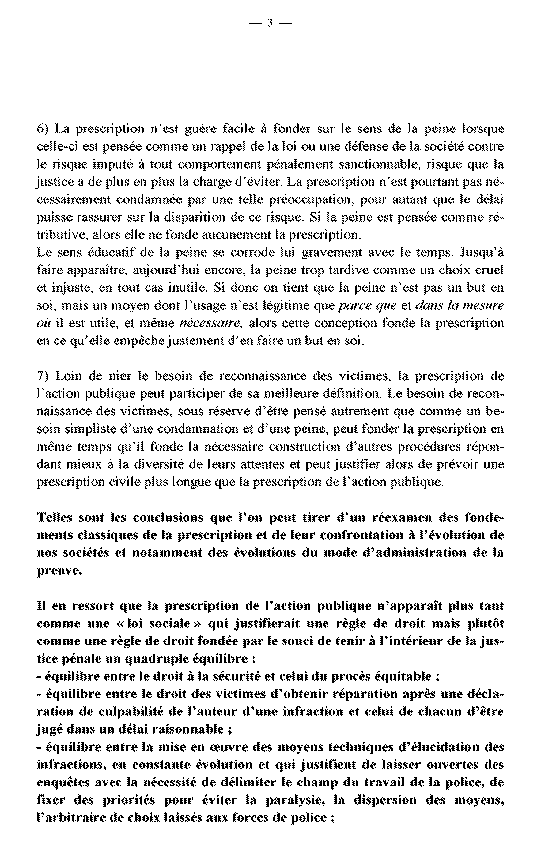
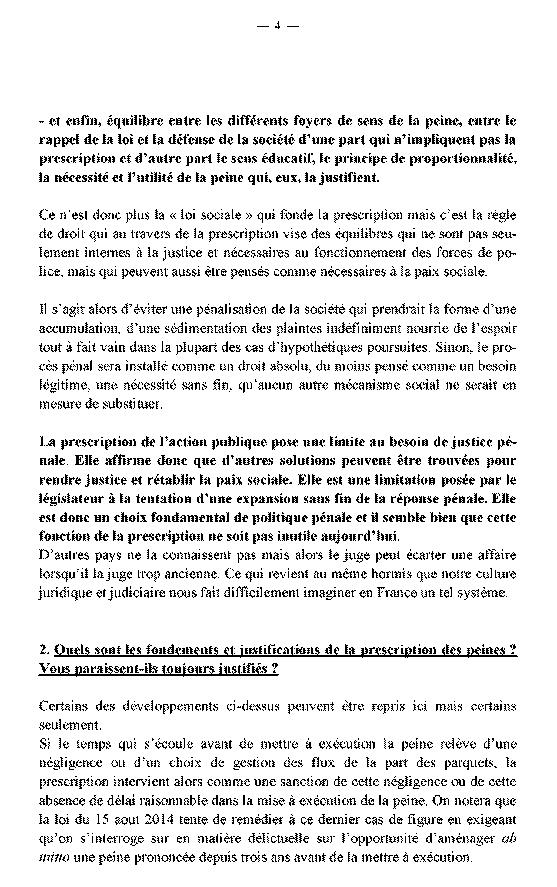
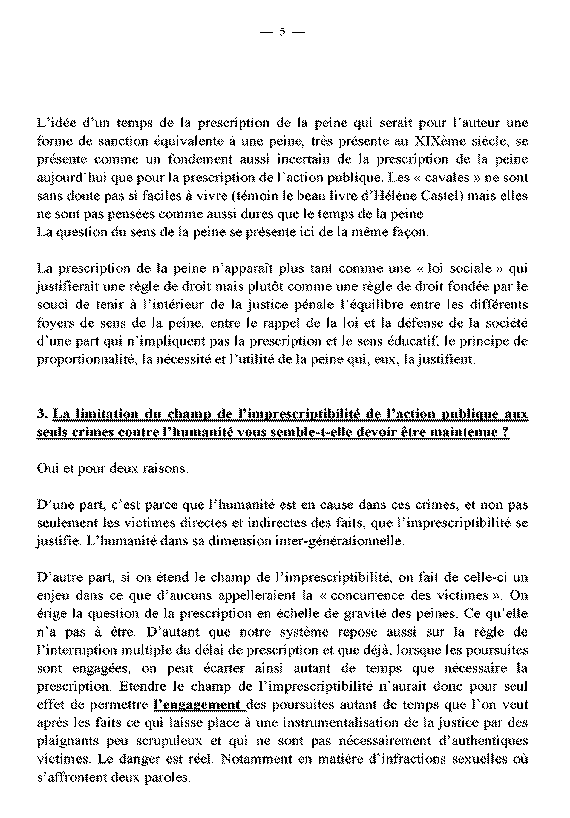
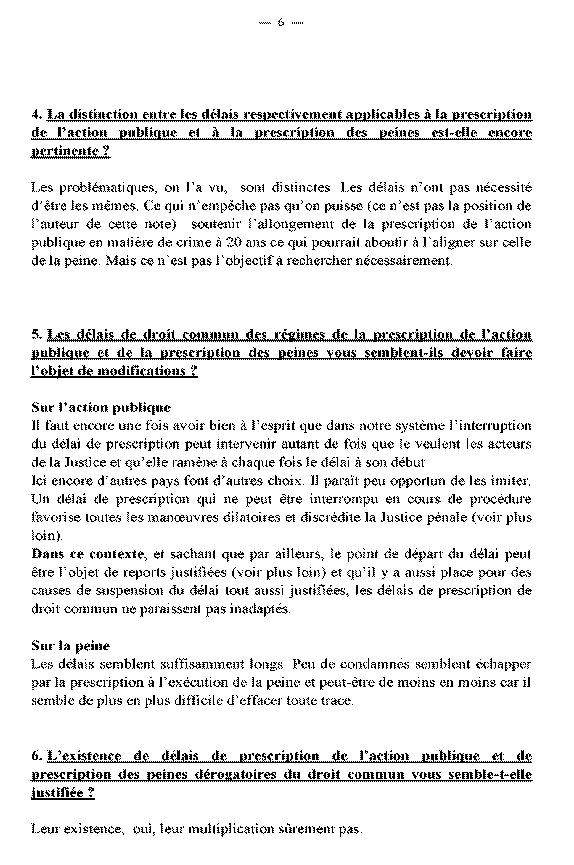
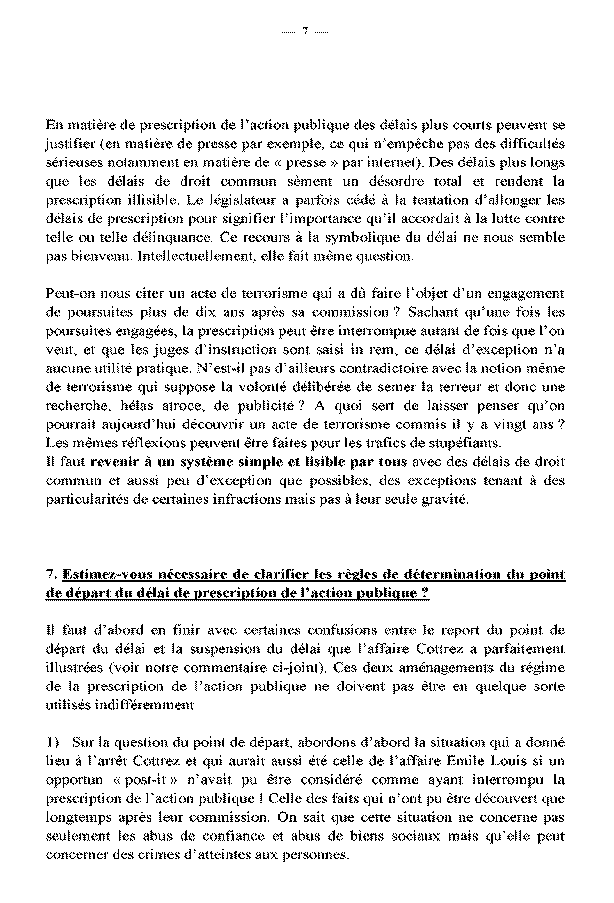
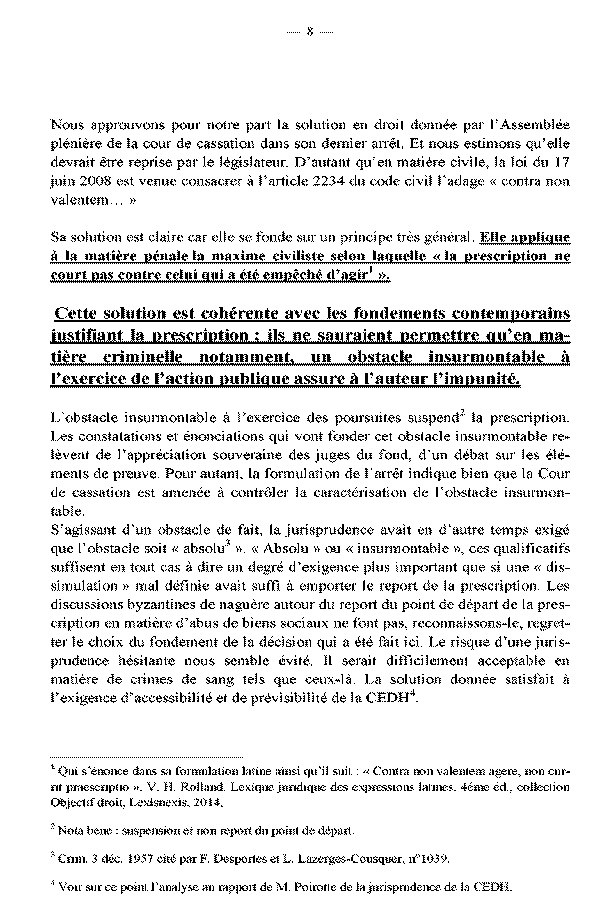
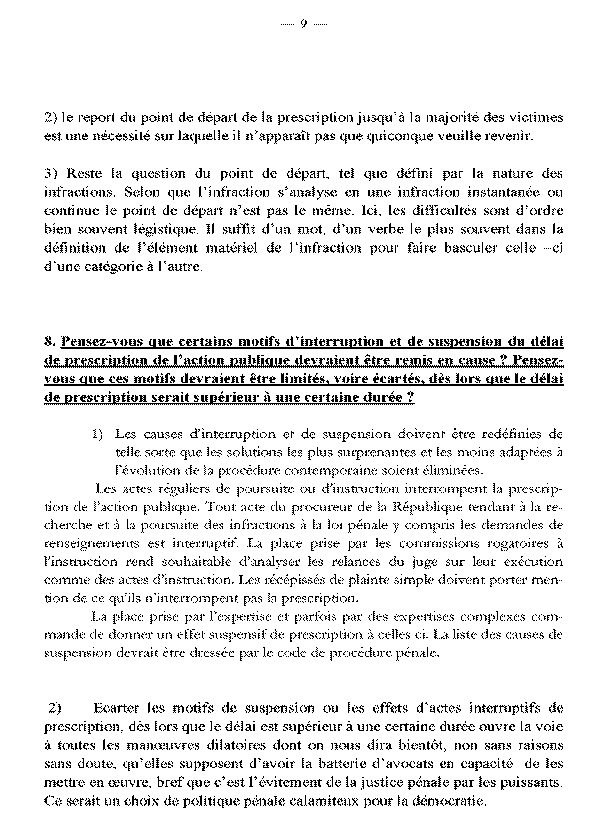
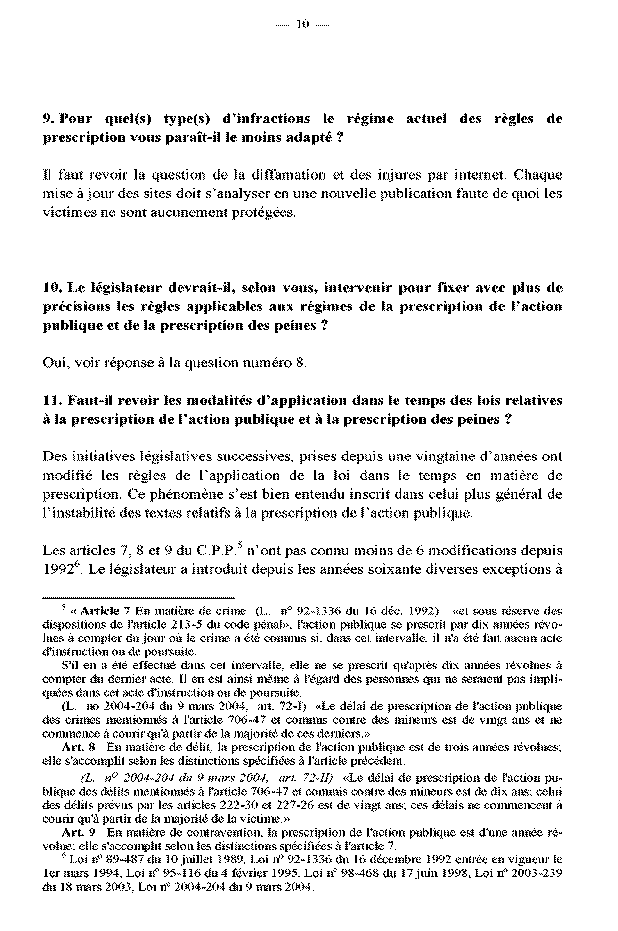
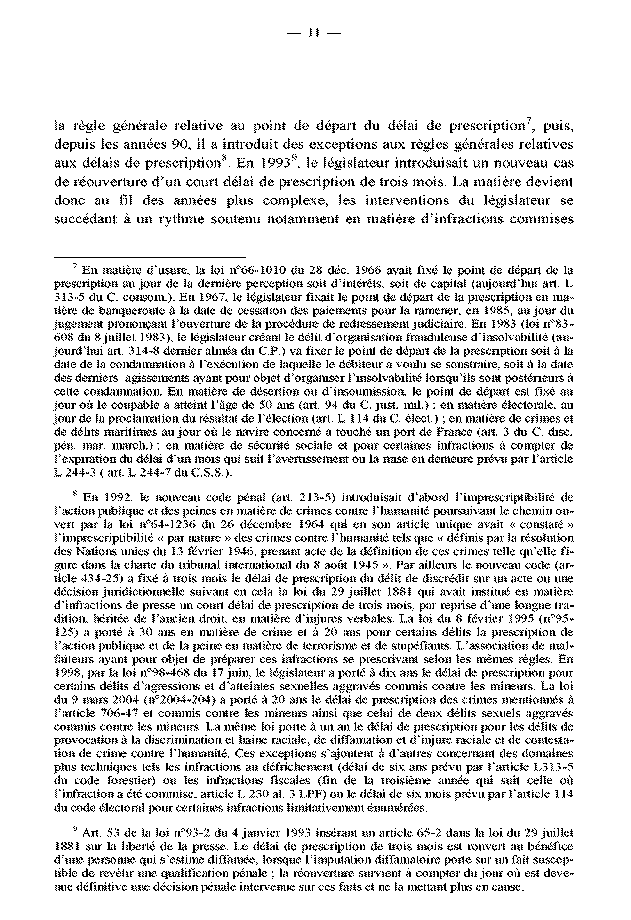
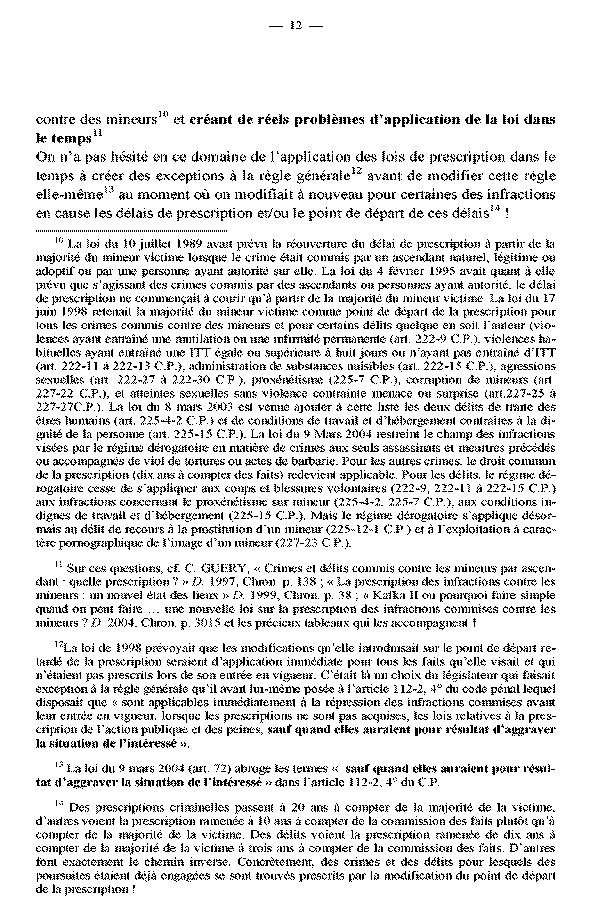
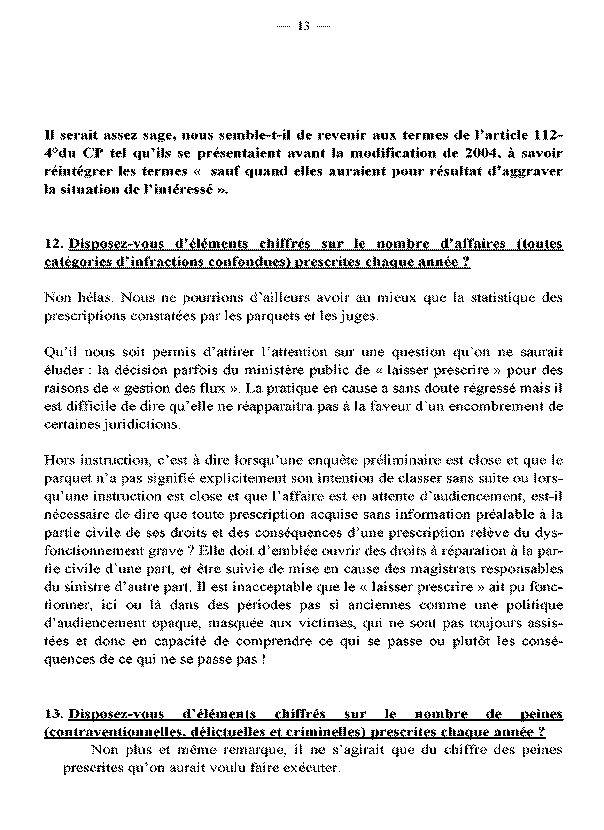
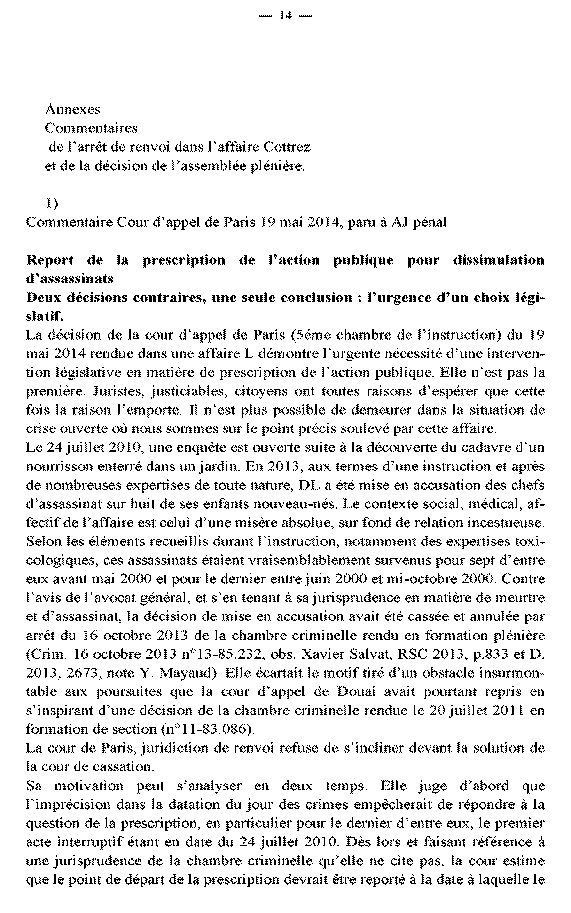
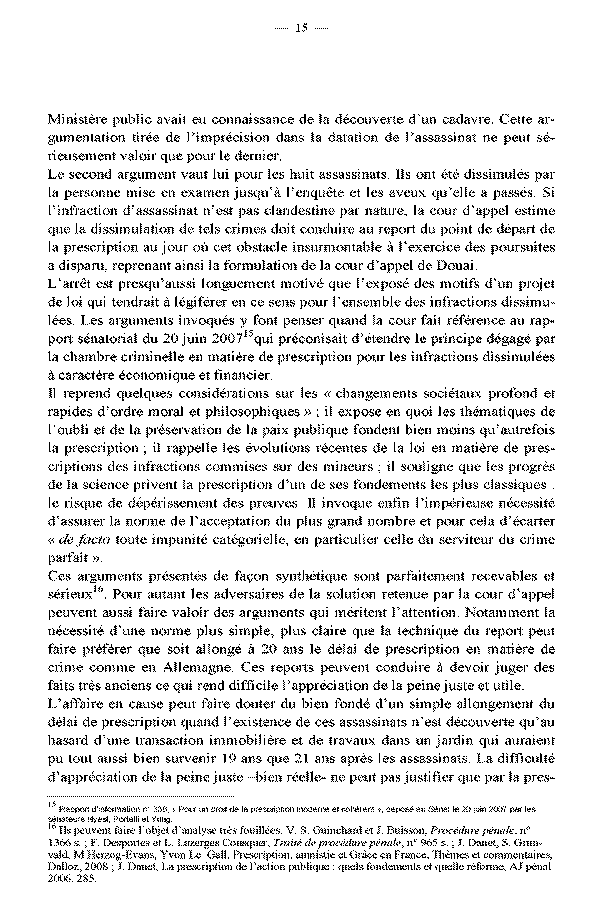
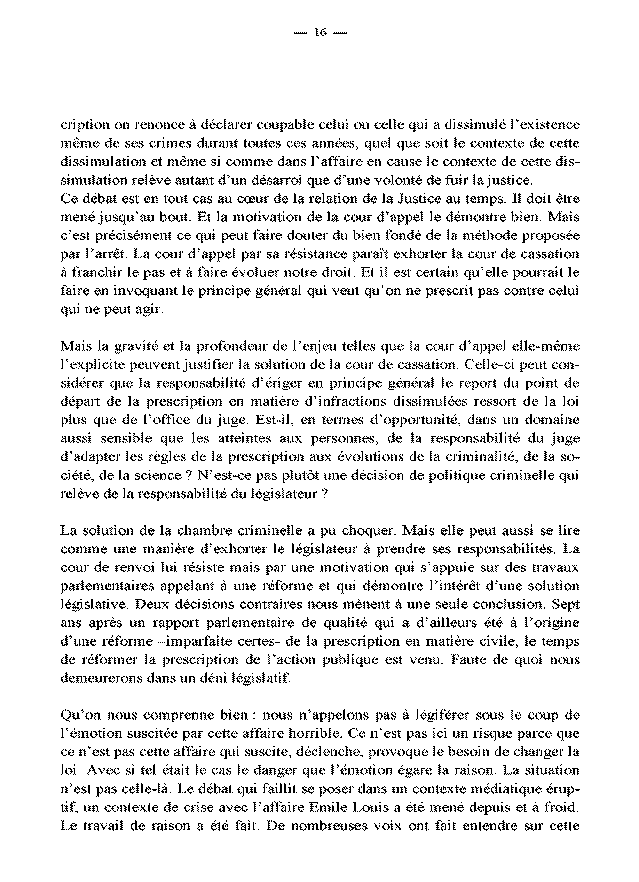
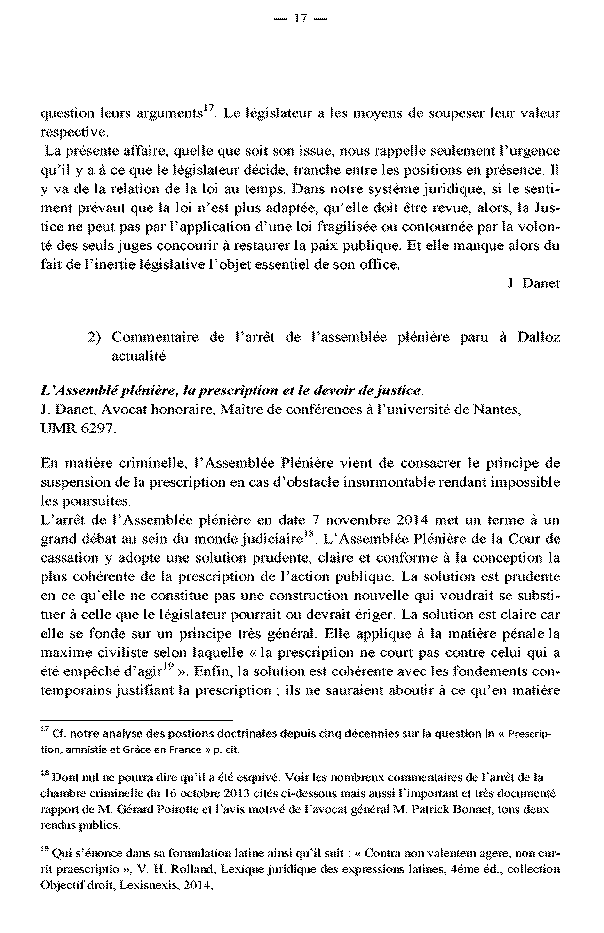
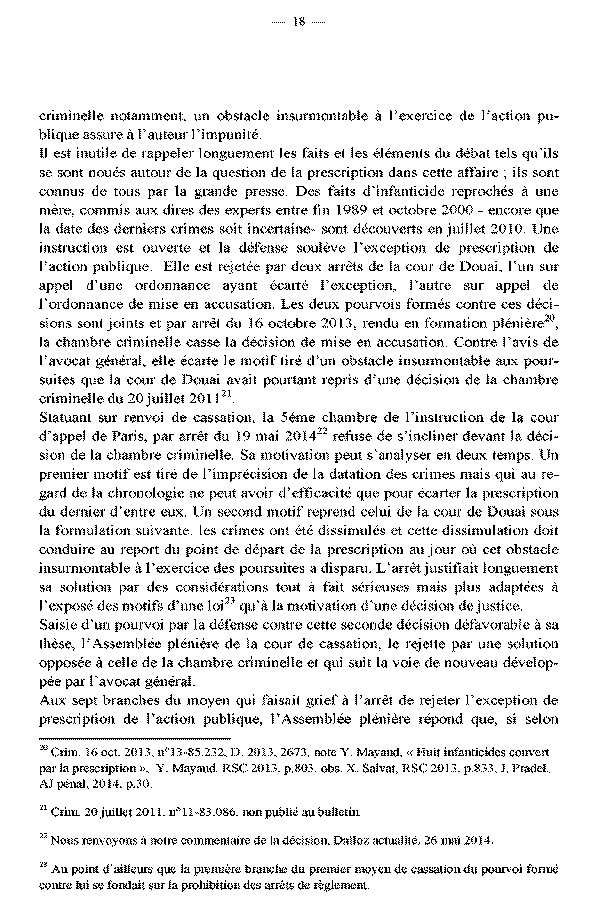
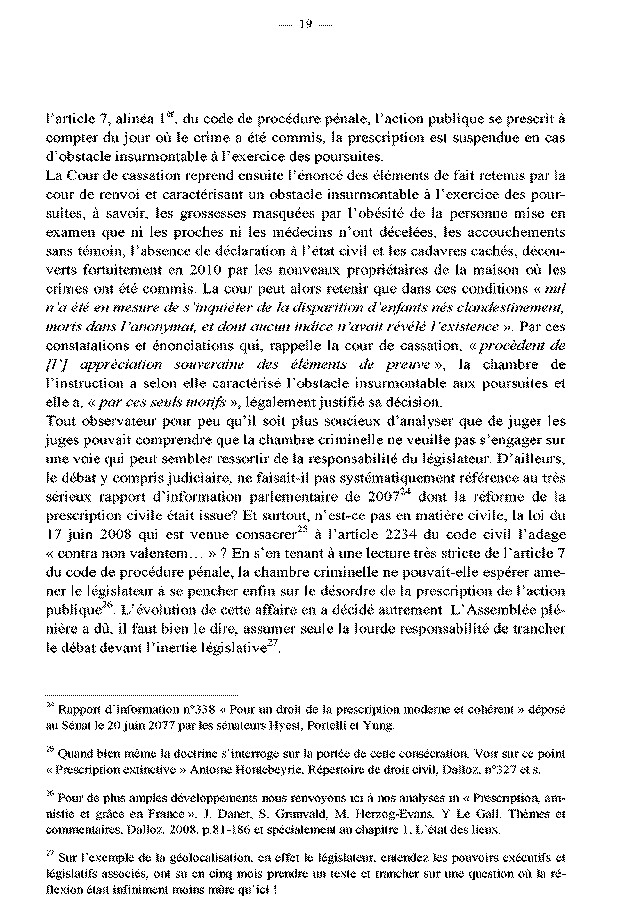
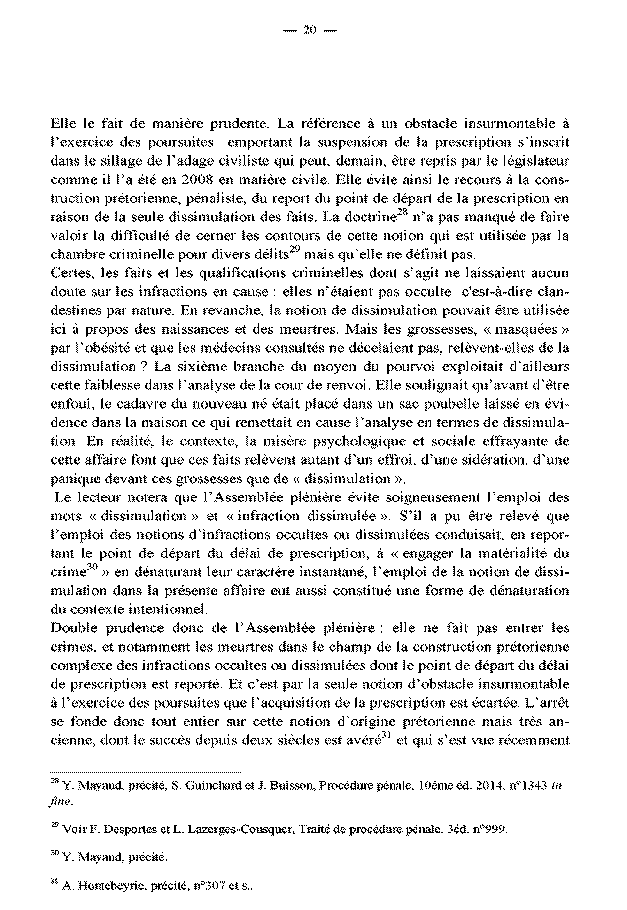
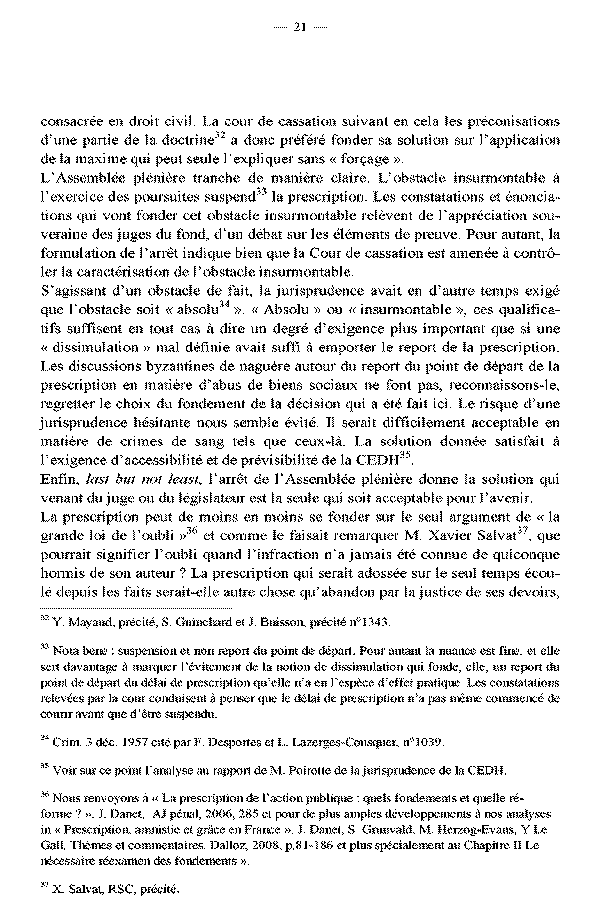
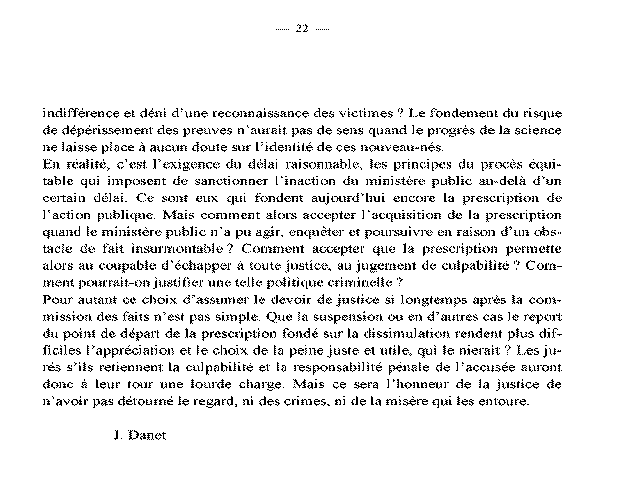
*
* *
Contribution complémentaire de M. Jean Danet
Messieurs les députés,
Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu porter à nos propos, ceux de mes collègues et les miens lors de cette audition sur cet important problème de la prescription en matière pénale.
Comme vous nous y avez invités, je me permets donc de réagir et d’ajouter quelques points à mon précédent écrit.
1) sur l’impératif de lisibilité. Il est central mais il ne peut se réduire à celui de la simplicité. Sur un point en tout cas.
En matière de délit et de crimes, les citoyens ne pourraient comprendre que celui ou celle dont l’infraction n’a pu être poursuivie juste après la commission, parce que l’existence de l’infraction n’était pas connue, du fait d’ailleurs parfois de la dissimulation par l’auteur ou du hasard377, bénéficie de ce hasard ou de son habileté à masquer son forfait.
À partir de là, quel que soit le délai de prescription que l’on retienne, il y a toujours le risque en certains cas que la prescription ait couru contre celui qui était empêché d’agir, victime ou ministère public et qu’à un mois ou deux mois près elle soit acquise à l’engagement des poursuites. La morale commune exige ici du droit qu’il réserve ce cas et que la prescription soit suspendue durant toute la durée de cet empêchement. La règle « contra non valentem… » mérite donc d’être inscrite dans notre code. En sachant qu’elle exige comme la décision récente de l’Assemblée plénière l’a dit que cette impossibilité soit insurmontable.
La règle et l’exception sont alors parfaitement lisibles et d’autant plus qu’elles seraient communes à la prescription civile et pénale.
2) Il me semble que les cas de reports du point de départ du délai peuvent alors être limités à la minorité.
3) Sur les infractions de presse, il me semble qu’on devrait peut-être distinguer entre les infractions véritablement commises par voie de presse (quel que soit le type de presse papier, radio ou autre, mais ne tout cas une entreprise de presse) pour lesquelles la liberté d’expression démocratique peut justifier un délai de prescription court d’avec les délits de diffamation et d’injure publics commis par des particuliers à l’aide des moyens tels qu’internet qui eux ne méritent pas la même précaution mais peuvent être très graves de conséquences.
Et toute mise à jour du support (blog, tweet, sites etc. ) sur lequel le délit est commis doit s’analyser en une nouvelle publication, donc la commission d’un nouveau délit déclenchant un nouveau délai de prescription faute de quoi demain les citoyens ne seront pas effectivement protégés contre ces délits quand lors de leur première commission ils n’auront pas été découverts à temps378.
4) Sur les infractions instantanées et continues. La règle du point de départ de la prescription à la date de la commission de l’infraction subit forcément ici une inflexion dans sa mise en œuvre. On ne voit pas trop comment supprimer celle-ci. Tout au plus doit-on au plan légistique, lorsqu’une infraction nouvelle est créée, prendre soin lors des travaux parlementaires d’éviter les difficultés d’interprétation et dire clairement si l’intention du législateur est de créer une infraction continue ou une infraction de résultat. Il s’en faut généralement d’un mot, un verbe très souvent, pour que l’ambiguïté s’installe entre infraction instantanée et continue de résultat. Quand à l’infraction de résultat, on ne voit pas bien, sauf à provoquer une sévère et légitime colère des victimes, comment on peut éviter de prendre en compte par exemple la mort survenue cinq ans après un accident sanitaire ou de travail, du fait même de celui-ci, en la réduisant à son résultat temporaire sitôt le fait commis, une incapacité permanente ! En revanche, l’exception prétorienne des infractions instantanées qui se renouvellent ou infractions continuées devrait être proscrite et pourrait l’être du fait de l’allongement que vous envisagez des délais de droit commun.
En conclusion,
-des délais de droit commun en matière de prescription d’action publique allongés pour les crimes (20 ans ?) et peut-être pour les délits (5 ans ?) et donc de facto alignés pour les crimes et délits sur ceux de la peine,
-le minimum d’exceptions (avec de tels délais allongés, y en a-t-il d’autres qui se justifient que les délais raccourcis en matière de presse et en matière électorale ?),
- la suspension par application de « contra non valentem » et bien sûr pour mise en œuvre de procédures alternatives aux poursuites,
-le report pour cause de minorité,
-des actes interruptifs largement définis,
-et des conséquences alourdies en termes de responsabilité de l’Etat (voire ma contribution précédente) au cas où l’institution judiciaire à « laissé prescrire » au détriment des intérêts de victimes un dossier dans lequel des poursuites ont été engagées et sans prendre leur accord379, tel est à mon sens le socle autour duquel on peut construire un régime simple et clair de la prescription.
Telles sont les observations complémentaires que je pouvais vous présenter suite à notre échange.
Je reste à votre disposition et vous prie de croire Messieurs les députés en l’assurance de ma considération très respectueuse.
Contribution de M. Jean-Claude Marin,
procureur général près la Cour de cassation
Messieurs les rapporteurs Alain Tourret et Georges Fenech,
Je tiens tout d’abord à vous remercier vivement de m’avoir invité à participer à la réflexion menée par cette mission d’information sur la prescription en matière pénale.
« Lorsqu’il s’agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s’ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s’est soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n’en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables : il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments ». C’est ainsi que s’exprimait Beccaria à propos de la prescription dans son Traité des délits et des peines en 1764.
En matière pénale, il convient d’abord de distinguer la prescription de l’action publique qui fait obstacle à l’exercice des poursuites au terme d’un certain délai, de la prescription de la peine destinée à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l’effet de l’écoulement du temps depuis la décision de condamnation.
Héritier du droit romain, le droit pénal français a toujours admis le principe de la prescription.
Les délais actuels de prescription et leur classement triparti selon la gravité de l’infraction (crimes, délits, contraventions) ont été fixés par le code d’instruction criminelle de 1808.
Les difficultés de mise en œuvre de la prescription de l’action publique sont indiscutables. La question est devenue étonnamment délicate et complexe alors que l’énoncé même de la règle procédurale posée aux articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, constamment confirmée par la jurisprudence comme étant d’ordre public, est d’une réelle simplicité. Règle procédurale utile, justifiée par l’écoulement du temps, la prescription ne saurait par conséquent traduire une échelle de gravité des infractions concurrente de celle des peines. Dans le même sens, la prescription ne saurait constituer un droit au bénéfice de celui qui commet l’infraction ou de celui de la victime. La prescription est un droit, mais également un devoir. Elle s’inscrit dans le sens d’une sécurité juridique accrue.
Néanmoins, depuis une vingtaine d’années, la stabilité de ces règles édictée par le code de procédure pénale est remise en cause par la multiplication des régimes dérogatoires à l’initiative du législateur et du juge qui pour l’ensemble concourent à l’allongement des délais de prescription.
Ces remises en cause du régime de la prescription semblent traduire une hostilité croissante au principe même de la prescription voire la marque d’une société soucieuse de faire prévaloir la mémoire sur l’oubli. La situation actuelle est source de confusion et d’insécurité juridique. Allongement de la durée des délais de prescription, report quasi-systématique du point de départ du délai de prescription au point de lui en faire perdre sa qualité cardinale de sécurité, sont autant de facteurs contribuant à la perte de lisibilité des règles de prescription de l’action publique.
La prescription pénale de l’action publique est en crise. Elle se présente en effet, en droit français, comme une question complexe, mouvante, dépourvue d’unité et discutée, autrement dit comme une notion à géométrie variable selon le type d’infraction poursuivie, créant un sentiment d’insécurité juridique croissant.
Ces évolutions législatives et jurisprudentielles tendant à un allongement des délais de prescription peuvent s’expliquer par la perte de sens des fondements traditionnels de la prescription.
En effet, les raisons de principe justifiant la prescription de l’action publique et des peines ont perdu de leur force. Certains fondements plus pragmatiques sont privilégiés. Pour autant, ces derniers connaissent également des limites. Il convient ici de préciser que les fondements de la prescription de l’action publique et de la prescription de la peine sont en partie communs.
En premier lieu, la prescription de l’action publique repose pour certains sur l’idée qu’après un certain temps, dans un intérêt de paix et de tranquillité sociale, mieux vaut oublier l’infraction qu’en raviver le souvenir.
Plus classiquement, on a fait valoir que la répression perdait sa raison d’être avec le temps en raison de l’apaisement progressif du trouble causé par l’infraction peu à peu oubliée.
Avicenne écrivait « le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise les colères et étouffe la haine ; alors le passé est comme s’il n’eût jamais existé ».
« La grande loi de l’oubli », loi sociale un peu vague, n’apparaît plus dans notre société, tout à la fois société médiatique et de mémoire, comme une loi sociale si évidente qu’elle puisse fonder la prescription de l’action publique. Les victimes, les associations de défense des victimes et les médias, reliés à l’opinion publique veulent agir contre l’oubli.
La prescription est alors perçue comme un abandon par la justice de ses devoirs, un signe d’indifférence, ou comme un déni d’une reconnaissance des victimes. Ainsi, l’oubli d’affaires pénales risque davantage aujourd’hui de heurter l’opinion publique que de conduire à l’apaisement. L’apaisement auquel l’oubli renvoyait autrefois n’est donc nullement tenu pour acquis aujourd’hui et ce d’autant plus qu’il est souvent fait état des vertus thérapeutiques du rappel de faits traumatiques, sous la forme d’un procès et d’une condamnation, qui permettent aux victimes de « faire leur deuil ».
La prescription trouve un autre fondement dans la contrepartie de l’inquiétude dans laquelle vit l’auteur des faits aussi longtemps qu’il échappe à la poursuite et à la punition. En empêchant les poursuites à l’expiration d’un certain laps de temps, il s’agirait de ne pas infliger comme une seconde peine à une personne qui aurait suffisamment souffert après avoir vécu durant des années dans le remords et parfois la clandestinité. «L’insomnie de vingt ans » du délinquant était ainsi évoquée pour justifier la prescription.
En tout état de cause, aussi pénible soit-elle, l’insomnie ne figure pas dans l’échelle des peines criminelles et n’apparaît pas comme l’exact équivalent d’une condamnation pénale. L’idée d’un temps de la prescription qui serait pour l’auteur une forme de sanction équivalente à une peine ne peut plus fonder la prescription et peut-être encore moins depuis que la peine redoutée par l’auteur n’est plus jamais la peine de mort. En revanche se pose la question du sens de la peine lorsqu’elle intervient longtemps après la commission des faits.
Au regard de l’évolution des textes et de la jurisprudence, deux justifications paraissent plus adéquates.
Tout d’abord, la prescription, qui ne peut être acquise que si la victime et les autorités judiciaires et policières sont demeurées totalement inactives pendant le délai légal, peut être présentée comme la sanction naturelle de l’inertie voire de la carence des personnes et autorités en charge de la poursuite, de la recherche de la vérité ou de l’exécution de la peine.
Comme le soulignait Mme Dominique-Noëlle Commaret, avocat général à la Cour de cassation, « parce que tout temps mort excessif laisse présumer le désintérêt de la victime ou du ministère public et leur renoncement, dans un système marqué par le principe d’opportunité des poursuites, la prescription apparaît nettement comme la réponse procédurale apportée à l’inaction ou l’oubli, volontaire ou involontaire »380.
Cependant, cette justification peut s’apprécier différemment selon que la négligence est antérieure ou postérieure à l’engagement des poursuites. En effet, selon M. Jean Danet381, le principe selon lequel la prescription est une sanction de la négligence à exercer les poursuites engagées est parfaitement fondé et rejoint l’impératif de juger dans un délai raisonnable. En revanche, la perte du droit de punir apparaît plus contestable lorsque les poursuites n’ont pas été engagées. Le contentieux des infractions sexuelles ou des violences conjugales témoigne d’ailleurs des difficultés des victimes à dénoncer les faits dans le temps de la prescription : selon lui, « La sanction de la négligence de la victime ne peut être aujourd’hui acceptée comme fondement général de la prescription ».
D’une façon plus générale, c’est peut-être l’idée d’une sanction d’un exercice délibérément tardif du droit de punir qui s’impose plutôt que celle d’une négligence. La prescription peut alors être fondée sur l’idée qu’il doit exister un délai raisonnable pour engager les poursuites, dès lors que l’infraction est connue.
Le dépérissement des preuves et le risque d’erreur judiciaire qui y serait attaché sont, enfin, souvent présentés aujourd’hui comme une des justifications les plus solides de la prescription. Cette justification ne vaut cependant que pour l’action publique et non pour la prescription des peines. Plusieurs années après les faits, les traces ou les indices disparaissent et les témoignages deviennent plus fragiles. Le risque de l’erreur judiciaire conduit logiquement à renoncer à exercer l’action publique.
Une limite doit cependant être apportée à ce fondement de la prescription. En effet, la découverte de nouveaux moyens scientifiques de preuve, comme l’analyse de traces ADN, permettent de relancer des investigations des années après la commission d’une infraction et permettent de rendre justice de plus en plus tard. Les progrès de la technique rendent ce fondement de moins en moins pertinent.
Les différents fondements de la prescription apparaissent ébranlés dans une société réticente à l’oubli. Les fondements de la prescription ne sont plus admis aujourd’hui car la prescription est vue comme un échec des institutions, un manquement de la justice à son devoir de poursuivre les criminels, un manquement des autorités d’investigation à leur devoir de poursuite et de déferrement des criminels à la justice.
Malgré la diversité de ces justifications, la plupart des auteurs s’accordent à considérer que la prescription de l’action publique et de la peine traduit le pardon qu’accorde une société à ses délinquants. Elle est ainsi présente dans la plupart des grands régimes démocratiques.
La prescription, tant de l’action publique que de la peine permet de respecter différents équilibres selon Jean Danet382 :
- équilibre entre sécurité juridique et efficacité du système judiciaire
- équilibre entre le droit à la sécurité et celui du procès équitable ;
- équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation après une déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable ;
- équilibre entre répression des infractions et capacité de la justice d’absorber les affaires anciennes
- équilibre entre la mise en œuvre des moyens techniques d’élucidation des infractions, en constante évolution et la nécessité de délimiter le champ du travail de la police, de fixer des priorités pour éviter la paralysie, la dispersion des moyens, l’arbitraire de choix laissés aux forces de police ;
- et enfin, équilibre entre les différents foyers de sens de la peine, entre le rappel de la loi et la défense de la société d’une part qui n’impliquent pas la prescription et le sens éducatif, le principe de proportionnalité, la nécessité et l’utilité de la peine qui, eux, la justifient.
La prescription de l’action publique pose une limite au besoin de justice pénale. Elle affirme que d’autres solutions peuvent être trouvées pour rendre justice et rétablir la paix sociale. Elle est une limitation posée par le législateur à la tentation d’une expansion sans fin de la réponse pénale. Et ce d’autant plus qu’une suppression totale du système de prescription pose la question de la capacité de l’institution judiciaire à absorber le contentieux. Le risque est fort de voir s’accentuer le sentiment d’impuissance de la justice face à la délinquance. La prescription en matière pénale relève directement d’un choix fondamental de politique pénale.
L’idée que l’écoulement du temps puisse garantir l’immunité à des délinquants – souvent les plus habiles- a toujours été contestée. Ainsi, Beccaria et Bentham383 étaient partisans de cantonner la prescription aux infractions les moins graves. Mais l’hostilité va grandissante et n’est plus seulement doctrinale. Elle se manifeste tant dans l’évolution de la législation que dans celle de la jurisprudence. Plusieurs lois ont en effet, allongé le délai de prescription de l’action publique du chef de certaines infractions ou reporté son point de départ. De même, la jurisprudence ne cesse d’alimenter la catégorie des infractions dites par la doctrine « clandestines » ou « occultes », pour lesquelles, selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription doit être fixé non au jour de la commission de l’infraction mais au jour où les faits délictueux sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. De plus, notre droit de la prescription peut être un handicap en termes de coopération internationale.
Considérant ces évolutions, de nombreux juristes déplorent les incertitudes juridiques entourant les solutions jurisprudentielles et la complexité d’une législation multipliant les régimes spéciaux.
Paradoxalement, si la lecture du Code de procédure pénale semble accréditer l’idée d’une admission large de l’extinction de l’action publique par la prescription, ces dernières années ont laissé apparaître un net recul du pardon de la société avec une complexification des règles de prescription, tant du point de vue de l’allongement des délais de prescription de l’action publique, devenu un facteur d’imprescriptibilité de l’action publique (I), mais également du point de vue de la multiplication des causes d’interruption et très récemment des causes de suspension du délai de prescription de l’action publique (II). Aussi, convient-il de dresser des pistes de réforme (III).
I- L’allongement des délais de prescription de l’action publique, facteur d’imprescriptibilité de l’action publique
Tant l’allongement de la durée du délai de prescription de l’action publique (A) que le report quasi-systématique du point de départ du délai de prescription (B) confinent à l’imprescriptibilité de l’action publique.
A- La durée du délai de prescription allongée par le législateur
Préliminairement, il est important de noter que la prescription de l’action publique (comme celle de la peine) est d’ordre public. Elle doit être relevée d’office par le juge. Le délinquant ou le condamné ne saurait y renoncer.
Les délais de prescription de droit commun de l’action publique sont de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale). Ces délais connaissent néanmoins plusieurs exceptions qui, au fil des réformes législatives, se sont faites de plus en plus nombreuses.
Traditionnellement, notre droit admet des délais plus courts de prescription de l’action publique en matière de presse. La loi du 29 juillet 1881 a ramené ces délais à trois mois.
Au cours de la période récente, le législateur a souhaité allonger les délais de prescription de certaines infractions, diversifiant ainsi le régime hérité du code Napoléon.
Les types d’infractions qui ont paru justifier un allongement des délais pour le législateur se résument à six groupes : les crimes contre l’humanité, le terrorisme et les stupéfiants, plus récemment les infractions de sang les plus graves commises contre les mineurs ainsi que les infractions sexuelles, les diffamations et injures à caractère racial, les provocations à la haine raciale et les contestations de crimes contre l’humanité, et enfin le délit de fraude fiscale.
Un tel allongement de la prescription par le législateur a-t-il pour corollaire l’affirmation d’une plus grande gravité de ces infractions? Si l’on devait répondre par la positive à cette question, la prescription deviendrait alors une échelle de gravité des infractions, concurrente de celles des peines. Un allongement de la durée des délais de prescription semble être le moyen d’obtenir du législateur une marque de reconnaissance de la gravité de telle ou telle atteinte aux personnes.
Attachons-nous à détailler les exceptions aux durées légales de prescription ci-dessus énoncées.
Les crimes contre l’humanité sont depuis la loi du 26 décembre 1964 imprescriptibles. En 1992, le nouveau code pénal (article 213-5) consacrait l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines en cette matière. Il s’agit de la seule catégorie d’infractions imprescriptibles.
À l’instar de la France, dans les systèmes juridiques des Etats de l’Europe continentale, le champ de l’imprescriptibilité est généralement cantonné, aux crimes contre l’humanité, en application des conventions internationales.
Néanmoins, en Allemagne, les homicides aggravés visés par l’article 211 du code pénal sont également imprescriptibles. Les autres faits passibles de l’emprisonnement à vie se prescrivent par trente ans.
Aux Pays-Bas, les infractions réprimées par la réclusion à perpétuité sont imprescriptibles, et l’article 575 du code pénal italien prévoit également que les crimes les plus graves contre la personne, comme le meurtre, ne se prescrivent pas.
En matière de trafic de stupéfiants, de terrorisme, et d’association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer l’une de ces infractions, la loi du 8 février 1995 a porté à trente ans pour les crimes et vingt ans pour les délits la prescription de l’action publique et de la peine (articles 706-25-1 et 706-31 du code procédure pénale).
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux conditions de la criminalité a allongé à un an le délai de prescription en matière de presse concernant les délits de provocation à la discrimination et à la haine raciale, de diffamation et d’injure raciale et de contestation de crime contre l’humanité. Jusqu’à la loi du 27 janvier 2014, il résultait de cette évolution une inégalité de traitement entre les différentes intolérances drainées par notre société. C’est pourquoi la loi du 27 janvier 2014 a entendu procéder à une harmonisation. Elle étend ainsi le délai de prescription annuel aux hypothèses dans lesquelles ces mêmes infractions auraient été commises à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle ou du handicap.
En matière d’infractions sexuelles commises contre les mineurs, le délai de prescription de l’action publique a été porté par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à vingt ans pour les crimes ainsi que certains délits d’agression ou d’atteinte sexuelle aggravée et à dix ans pour les autres délits visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Autre exemple est celui de la loi du 4 avril 2006 qui porte la durée du délai de la prescription de l’action publique des violences commises sur une victime mineure, ayant entrainé, soit une mutilation ou une infirmité permanente, soit une ITT de plus de 8 jours à vingt ans.
Enfin, très récemment, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière instaure un délai de prescription de l’action publique d’une durée de 6 années pour le délit de fraude fiscale.
Il convient de noter que ce phénomène d’allongement de la durée des délais de prescription, sans cohérence ni harmonisation aucunes, survient après que la peine de mort ait été abolie et qu’à l’opposé, l’imprescriptibilité a fait son entrée dans le code pénal pour les crimes contre l’humanité.
Il est également intéressant de relever que le mouvement amorcé en matière de délai de prescription accompagne un mouvement d’aggravation des peines encourues.
La prescription est-elle en train d’être pensée désormais davantage au travers des fonctions qu’elle peut remplir dans une politique criminelle (marquer fortement l’importance que le législateur attache à la poursuite et à la sanction de certains faits) qu’au travers de ce qui la fonde ?
L’échelle des délais de prescription constitue un indicateur de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal. Or, cette échelle ne correspond pas toujours aux autres indicateurs de la gravité des infractions. En effet, pour les délits à caractère sexuel commis contre les mineurs, l’action publique se prescrit par dix ou vingt ans alors que la peine se prescrit par cinq ans.
Ainsi, dans le rapport d’information n°338 de MM. Hyest, Portelli et Yung sénateurs, déposé le 20 juin 2007, intitulé “Pour un droit de la prescription moderne et cohérent”, une des recommandations était de préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription de l’action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires.
« Le législateur devrait à l’avenir éviter de créer de nouveaux régimes dérogatoires qui tendent précisément à susciter des dysharmonies entre l’échelle des sanctions et celle de la durée de prescription de l’action publique. »
On peut cependant retrouver un mouvement connexe d’allongement des délais de prescription de l’action publique dans un grand nombre de pays étrangers. Ainsi, en Espagne, le nouveau code pénal de 1995 a porté le délai de prescription pour les infractions passibles de quinze ans d’emprisonnement de quinze à vingt ans. En 2003, une nouvelle réforme a prolongé cette évolution en faisant passer le délai de prescription de 5 à 10 ans pour les délits punissables d’une peine de prison comprise entre 5 et 10 ans, et de 25 à 30 ans les infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à 20 ans. De même, aux Pays-Bas, le délai de prescription de l’action publique pour les infractions passibles d’une peine de prison de plus de dix ans est passé de 15 à 20 ans en 2006.
Il convient en outre de souligner que depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les lois relatives à la prescription sont d’application immédiate même si elles ont pour effet d’aggraver le sort de l’intéressé.
Jusqu’à cette loi, l’article 112-2-4° du Code pénal disposait que « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur […] lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique […], sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation des intéressés».
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 112-2-4° du code pénal, le dispositif adopté par la loi du 9 mars 2004 maintient l’unité des règles relatives à l’application dans le temps des lois relatives aux prescriptions, qu’il s’agisse de la prescription de l’action publique ou de la peine, mais selon une orientation inverse de celle retenue dans le code pénal en 1992 puisque, désormais, même les lois plus sévères, c’est-à-dire celles qui prévoient une prescription plus longue, s’appliquent immédiatement. En revanche si la prescription est acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci ne produira aucun effet.
En tout état de cause, la loi nouvelle, en vertu de l’article 112-2, 4° n’a pas d’effet sur les prescriptions déjà acquises.
Au-delà de l’allongement de la durée du délai de prescription de l’action publique, le report quasi-systématique du point de départ de la prescription contrevient au fondement de la prescription.
B- Le point de départ du délai de prescription reporté par l’œuvre commune du législateur et de la jurisprudence
1- Le principe
Le code pénal de 1791 prévoyait que les délais de prescription ne commençaient à courir que le jour où l’existence du crime a été connue ou légalement constatée. Le code d’instruction criminelle a remis en cause cette règle et fixé le point de départ au jour de la commission de l’infraction, principe maintenu jusqu’à aujourd’hui (articles 7, 8 et 9 CPP). Ce principe se décline toutefois de différentes manières suivant la nature de l’infraction commise.
S’agissant des infractions instantanées, cette règle s’applique aisément d’une manière générale. Ces infractions instantanées se caractérisent, selon la Cour de cassation, par l’« instantanéité de l’action ou de l’omission qui la réalise, et l’épuisement en un instant de la volonté délictueuse de l’auteur ».
Tel est par exemple le cas du faux et de l’usage de faux, dont la prescription commence à courir du jour de l’établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux et non de la découverte de l’existence de l’écrit argué de faux (Crim 27 mai 1991).
Deux difficultés toutefois sont susceptibles de surgir.
Certaines infractions instantanées peuvent se traduire par l’accomplissement de plusieurs actes qui se succèdent dans le temps. La Cour de cassation décide alors que chaque acte d’exécution renouvelle l’infraction et marque ainsi le point de départ d’un nouveau délai de prescription (Crim 6 sept 1995 pour l’escroquerie ; Crim 8 oct 2003 pour la corruption ; Crim 27 mai 2004 pour l’abus de faiblesse ; Crim 19 mars 2008 pour le trafic d’influence).
Ensuite, la prescription des infractions de résultat ne commence à courir qu’à compter de l’apparition du résultat (ex : blessures et homicides involontaires dont le résultat n’apparaitrait que tardivement).
S’agissant des infractions continues, la prescription de ces dernières ne court qu’à compter du jour où l’état délictueux a pris fin dans tous ses éléments c’est-à-dire «dans ses actes constitutifs et dans ses effets». Ces infractions se réalisent « par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps » et se caractérisent « par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur ».
C’est notamment le cas de l’infraction de recel. Il s’agit d’une infraction relativement récente dans notre corpus juridique puisqu’elle date d’une loi de 1915. Cette loi va prévoir en répression, des peines qui vont s’avérer plus fortes que le délit ayant généré le produit recelé.
La jurisprudence va appliquer à cette infraction une règle simple et légitime : la prescription ne commence à courir qu’au jour où l’infraction a cessé.
L’application de cette règle de la prescription concernant les infractions continues a posé problème s’agissant des infractions commises par la voie de l’internet. En effet, dans sa rédaction initiale, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoyait que les infractions de presse commises sur internet se prescrivent à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition au public du message litigieux. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition dans sa décision du 10 juin 2004, considérant qu’elle rompait l’égalité entre les différents médias, et imposant ainsi que la prescription de ces infractions commence à courir à compter de la publication du message litigieux.
Toutefois dans un arrêt du 17 janvier 2006, la chambre criminelle a décidé tout au contraire qu’une publicité interdite diffusée par internet en faveur du tabac est un délit continu qui ne commence à se prescrire que lorsqu’il est retiré du site émetteur. Doit-on pour autant considérer que la Cour de cassation est allée à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel ? Il semble que cela ne soit pas le cas car l’infraction de publicité interdite en faveur du tabac n’est pas une infraction de presse mais une infraction au code de la santé publique. Elle n’était par conséquent pas visée par la décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, la prescription des infractions d’habitude ne court qu’à compter du dernier acte constitutif de l’habitude.
2- les exceptions
Il est des hypothèses dans lesquelles le point de départ sera reporté à une date postérieure à la commission de l’infraction.
- Exceptions légales
Le législateur a prévu que, dans le cas des mineurs victimes de crimes ou de délits consistant dans des sévices à enfants ou agressions sexuelles (art 706-47 CPP), la prescription ne court qu’à compter de la majorité de la victime.
Par ailleurs, la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a donné naissance à une nouvelle hypothèse de report du point de départ de la prescription de l’action publique. En effet, l’article 8 CPP prévoit désormais que la prescription des infractions d’abus de faiblesse d’une part, et, d’autre part, des infractions de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance ou de recel commises à l’encontre d’une victime d’une particulière vulnérabilité, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
De nombreux pays prévoient, depuis les années 1990, le report du point de départ du délai de prescription en cas d’infractions sexuelles commises à l’encontre d’une victime mineure. Ainsi, en Allemagne, le délai de prescription de l’action publique des infractions relevant de l’article 176 du code pénal (infractions sexuelles sur enfants de moins de 14 ans) ne commence à courir qu’au jour de son dix-huitième anniversaire. Il en est de même en Belgique et aux Pays-Bas. En revanche, le Danemark, l’Espagne, l’Autriche, l’Italie et la Pologne appliquent la même règle que pour les faits commis à l’encontre des majeurs, de sorte que le délai de prescription commence lorsque cesse l’infraction.
En Italie, l’article 158 du code pénal italien fixe le point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions de droit commun au jour de leur commission, mais prévoit que la prescription des infractions continues court à compter du moment où elles cessent, et que la prescription des infractions dont les poursuites sont soumises à une condition ne court qu’à compter de la réalisation de celle-ci.
En France, certaines causes de report du point de départ du délai de prescription sont aussi d’origine jurisprudentielle. Il en est ainsi, notamment, de la clandestinité ou du caractère occulte de l’infraction.
- Exceptions jurisprudentielles
La chambre criminelle a posé la règle suivant laquelle la prescription des infractions clandestines ne court qu’à compter de leur découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. En la matière, l’adage selon lequel « la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir » est appliqué. À cet égard, la Cour de cassation a retenu une conception large des infractions clandestines, par exemple, s’agissant de l’abus de confiance, de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, de la simulation et dissimulation d’enfant.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation a débuté dans les années 30 avec l’infraction d’abus de confiance. La jurisprudence a considéré, s’agissant de cette infraction, que la confiance étant trahie, la victime n’avait pu agir. Ainsi le délai de prescription était reporté au jour l’autorité publique avait pu constater l’existence d’une infraction.
Cette dérogation jurisprudentielle aux règles de prescription est née dans des affaires de notaires. On considérait à l’époque qu’il y avait une différence de culture entre les victimes et les auteurs d’abus de confiance.
Puis en 1967, l’infraction dissimulée est apparue dans la jurisprudence avec un décalé de prescription en droit stricto sensu des affaires. L’abus de biens sociaux va suivre la même règle que l’abus de confiance.
Puis la jurisprudence a appliqué ce report du délai de prescription à une série d’infraction au gré des recours portés devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire.
Ainsi, une série de décisions vont admettre le décalé de prescription pour les infractions de favoritisme, de corruption, de trafic d’influence mais pas pour l’infraction de prise illégale d’intérêt parce qu’aucun pourvoi ne lui a soumis la question du caractère dissimulé de cette infraction. La jurisprudence agissant au coup par coup crée une insécurité juridique certaine.
Elle a récemment étendu cette notion au trafic d’influence (Crim 19 mars 2008) et de manière plus surprenante à l’infraction de blessures involontaires (Crim 3 juin 2008). Dans cette dernière affaire, un ancien salarié n’avait découvert que tardivement le lien entre sa maladie et son exposition à des produits toxiques à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
L’Assemblée plénière a réaffirmé son attachement à cette jurisprudence au travers de quatre arrêts, précités, rendus sur QPC le 20 mai 2011, en matière d’abus de biens sociaux, en énonçant que “les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique (...) sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs”.
La dissimulation implique un acte intentionnel d’occultation de la part de son auteur. Il appartient d’ailleurs à la partie poursuivante de démontrer que son ignorance du délit ou du crime, comme celle de la victime, résultent des manœuvres de dissimulation de la part de l’auteur.
Ce n’est donc pas la nature même du crime ou du délit qui justifie le report du point de départ de la prescription, mais ce sont les circonstances dans lesquelles les actes constitutifs de l’infraction ont été accomplis de façon occulte. Le caractère de clandestinité, ainsi compris, concerne l’acte incriminé et non l’auteur de l’infraction.
Les conditions dans lesquelles la jurisprudence décide de reporter le point de départ du délai de prescription apparaissent néanmoins très fluctuantes, comme en atteste le cas de l’abus de biens sociaux.
• Cas particulier de l’abus de biens sociaux
Il s’agit d’une infraction instantanée qui obéit à un régime particulier s’agissant de sa prescription.
Deux mécanismes conjugués rendent en effet très difficile la prescription de cette infraction.
Il s’agit tout d’abord d’une infraction clandestine. La règle est que la prescription de l’action publique compte à court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société. Il est fait exception à cette règle en cas de « dissimulation ». Dans cette dernière hypothèse, la prescription de l’action publique est repoussée au jour où l’infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 7 mai 2002).
Toutefois, l’inscription dans les comptes sociaux des dépenses constitutives d’abus de biens sociaux ne fait pas courir la prescription de ce délit si elle ne permet pas aux actionnaires de déceler les irrégularités. Ainsi, lorsque les dépenses litigieuses sont inscrites dans les comptes sociaux, mais que cette inscription n’est pas explicite (par exemple, inscription sous le nom d’un client imaginaire), il y a dissimulation et le point de départ de la prescription est retardé au jour où « l’infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (Crim. 28 janvier 2004 et Crim 25 février 2004).
Ensuite, l’abus de biens sociaux se traduit par la succession de plusieurs actes. Dans un arrêt du 28 mai 2003, la Cour de cassation a décidé que l’abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu. L’infraction se consomme lors de la convention illicite (conclusion du contrat de travail) et se renouvelle entièrement lors de chacune de ses exécutions successives. Il faut donc se reporter à l’inscription dans les comptes de chaque exécution de la convention initiale pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Dans un arrêt du 8 octobre 2003, la question s’est posée de savoir si la solution du 28 mai 2003 est applicable à tous les abus de biens sociaux commis par l’intermédiaire de contrats à exécutions successives ou ne doit concerner que les abus de biens sociaux portant sur un emploi fictif.
L’opération litigieuse en l’espèce consistait en un contrat de prestation de services à exécutions successives rémunérées, chaque année, par un pourcentage du chiffre d’affaires de la société victime.
L’arrêt du 8 octobre 2003 ne donne pas de solution unique. Il constate simplement qu’en l’espèce, chaque nouveau paiement constitue le délit parce qu’il résulte d’une renégociation du traité initial.
A contrario, on peut penser que si l’abus de biens sociaux résultait d’une convention liant définitivement la société, sans possibilité de renégociation ou de révision, en l’obligeant à un paiement fixe ou indexé sur une grandeur échappant à la volonté des parties, le délit se consommerait au jour de sa conclusion et non de ses exécutions successives. Il faudrait donc dans ce cas en revenir aux règles de prescription de l’abus de biens sociaux en tant qu’infraction clandestine.
Cette jurisprudence conduit à faire de l’abus de biens sociaux un délit quasi-imprescriptible au même titre que des infractions d’une impardonnable gravité tels que les crimes contre l’humanité.
Une partie de la doctrine estime que cette jurisprudence est contraire au principe même de légalité en ce qu’elle fait fi de la règle générale selon laquelle la prescription d’une infraction instantanée commence à courir le jour où l’infraction est consommée et que la dissimulation de cette infraction ne prolonge aucunement l’activité délictueuse.
Enfin, elle a pour effet, en pratique, d’introduire une grande insécurité juridique dans la vie des sociétés.
La clarification du régime de la prescription du délit d’abus de biens sociaux fait de manière récurrente l’objet d’un débat tant dans la sphère juridique que politique.
En 1995, Mme Marie-Laure Rassat, professeur de droit, dans un rapport sur l’évolution souhaitable du code de procédure pénale, abordait la question générale de la prescription de l’action publique en préconisant notamment de « casser la jurisprudence sur le retard du point de départ du délai de prescription, pour les infractions que la jurisprudence déclare occultes (essentiellement l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux) ».
Cette position était justifiée par deux considérations :
- d’une part, retarder le point de départ d’une infraction ne peut résulter que « d’une solution légale précise » et ne peut être une œuvre prétorienne ;
- d’autre part, le retard du départ de la prescription, s’il était consacré pour les infractions « occultes », induirait « un risque d’erreur judiciaire dû à la difficulté et à l’altération de la preuve dans le temps ».
Le rapport préconisait donc, à titre général, que « le point de départ, pour une infraction instantanée ou complexe se situe le jour où tous les éléments constitutifs peuvent être réputés avoir été accomplis ; pour une infraction d’habitude au jour de la commission du second fait ; pour une infraction continue au jour où l’infraction supposée a cessé. » En tant que délit instantané, l’abus de biens sociaux n’aurait donc pu donner lieu à poursuite que dans un délai de trois ans à compter du jour où tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction ont été effectivement accomplis.
Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 6 novembre 1995 par M. Pierre Mazeaud, « relative à la prescription du délit d’abus de biens sociaux » tendait à maintenir la jurisprudence actuelle en prévoyant que la prescription de l’abus de biens sociaux courrait à compter de la découverte du délit, mais prévoyait un délai butoir de six ans à compter de la commission de l’infraction. Cette proposition fut néanmoins retirée par son auteur avant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Dans le rapport d’information sénatorial précédemment cité, il est également proposé en 5ème recommandation la fixation d’un délai butoir en matière d’infractions occultes ou dissimulées à compter de la commission des faits afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions. La durée de ce délai serait égale au double de celle de la prescription à compter de la commission des faits.
À son tour, la Commission « Coulon », chargée par le garde des Sceaux de mener « une réflexion d’ensemble des sanctions pénales qui s’appliquent aux entreprises en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit de la consommation » a proposé, le 20 février 2008, parmi trente propositions, une réforme de la prescription de l’action publique, consistant à fixer le point de départ de la prescription de façon intangible à la date des faits tout en allongeant corrélativement le délai de prescription.
Toutes ces tentatives de réformes n’ont pas abouti dans un environnement où les responsables politiques ont craint qu’elles soient lues comme un avantage donné à une délinquance d’affaire contre laquelle il fallait absolument lutter.
Une autre possibilité de réforme législative, puisque les exceptions au point de départ de la prescription de l’action publique se sont multipliées, serait de généraliser le report du point de départ, pour l’ensemble des délits, au jour où l’infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
La Cour de cassation ne se prononce, par hypothèse, que dans la limite des pourvois qui lui sont soumis. Aussi la liste des infractions pour lesquelles la jurisprudence accepte de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique n’est-elle pas limitative.
• La dissimulation de cadavres
Très récemment s’est posée la question de savoir si en matière d’infanticide, l’infraction d’homicide volontaire peut lorsque les corps ont fait l’objet d’une dissimulation, être traitée comme une infraction clandestine.
Dans un premier arrêt rendu le 16 octobre 2013, la Cour de cassation avait répondu à cette interrogation par la négative. La chambre criminelle avait en effet exclu la possibilité de traiter comme une infraction clandestine l’homicide volontaire et s’était par voie de conséquence opposée au report du point de départ du délai de prescription au jour de la découverte fortuite des premiers corps d’enfants. En l’espèce, 8 cadavres de nouveaux nés avaient été découverts sans que les expertises ne permettent de déterminer précisément la date de commission des homicides.
Cette décision a conduit la doctrine à désapprouver fortement la cassation pour violation de la loi prononcée.
M. Le professeur Yves Mayaud s’est ainsi interrogé : « Comment justifier une telle distance de l’abus de biens sociaux à l’homicide aggravé, du délit au crime? La prescription deviendrait-elle une technique de requalification des infractions sur le critère d’une gravité judiciaire? A quand des solutions rationnelles et rassurantes sur le terrain si sensible qu’elle occupe? »
L’affaire a ensuite été renvoyée devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui dans un arrêt du 19 mai 2014 a choisi de résister à la Cour de cassation. S’appuyant sur le fait que les investigations mises en œuvre n’ont pas permis de dater la commission des infractions, elle juge que le point de départ du délai de prescription imposé par la chambre criminelle ne peut être fixé. Par ailleurs, la Cour relève que dans la mesure où seule la découverte des restes des nouveau-nés ayant établi la réalité de leur existence jusqu’alors insoupçonnée et ayant permis l’exercice de l’action publique, l’autorité de poursuite s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
La Cour d’appel en conclut qu’il y a lieu de retenir la date de découverte des cadavres comme point de départ du délai décennal de prescription de l’action publique.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 7 novembre 2014, a rejeté le pourvoi porté contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi en considérant que « si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». Dès lors, « la chambre de l’instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
Le principe évoqué plus haut, concernant les délits dissimulés, selon lequel « la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir » peut être invoqué ici afin de comprendre l’arrêt.
Selon M. Boccon-Gibod, premier Avocat général à chambre criminelle, qui commente cet arrêt, « si l’on se réfère à cette conception à tout le moins extensive ainsi adoptée par la Chambre criminelle en matière d’atteinte aux biens, il paraît surprenant de ne pas trouver la même ouverture pour des infractions infiniment plus graves contre les personnes ». C’est ainsi que la décision de l’assemblée plénière pourrait être justifiée.
Cependant, le propre de tout crime est d’être dissimulé, au sens premier du terme. Généraliser le fait que la dissimulation est une cause de report de la prescription risque de supprimer toute idée de prescription (un deuxième bouleversement opéré par cet arrêt sera évoqué plus tard, lors de l’étude de l’extension des causes de suspension de la prescription).
Au vu de ce contentieux jurisprudentiel foisonnant, une rigueur dans les règles édictant la prescription semble indispensable. Un effort de réflexion a été fait en ce sens dans un rapport d’information déposé au Sénat le 20 juin 2007 précédemment cité.
La recommandation n° 5 de ce rapport préconise, au nom du principe «Contra non valentem agere non currit praescriptio », que les solutions dégagées pour les infractions à caractère économique ou financier soient étendues à d’autres domaines du droit pénal, « et en particulier aux crimes dissimulés par leur auteur (en déguisant par exemple un meurtre en une mort naturelle ou en dissimulant le corps) ».
Les sénateurs précisent dans leur rapport que leur proposition rejoint tant les observations formulées par le Directeur des affaires criminelles et des grâces au Ministère de la Justice que celles faites par plusieurs des universitaires entendus par la mission. Ils citent notamment M. Michel Véron, professeur émérite de l’université Paris 13, qui a suggéré qu’en cas de dissimulation avérée, l’infraction se prescrive à compter du jour où apparaissent les éléments constitutifs de l’infraction.
En faveur de cette thèse, un avant-projet de réforme du code de procédure pénale du 3 mars 2010 prévoyait un allongement des délais de prescription, portés à 15 ans pour les crimes, à 6 ans pour les délits punis d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement et à 3 ans pour les autres délits. Le point de départ de ce délai était fixé au jour de commission de l’infraction, quelle que soit la date de sa constatation, sauf pour les crimes d’atteinte à la vie commis de façon occulte ou dissimulée. Dans ce cas, la prescription ne courait qu’à compter du jour où les faits avaient pu être portés à la connaissance de l’autorité judiciaire.
Egalement, lors de l’examen de la loi du 9 mars 2004, M. Pierre Fauchon, sénateur, a déposé devant la commission des lois un amendement visant à la modification des articles 7 et 8 du code de procédure pénale. Il proposait tout d’abord un allongement des délais de prescription de l’action publique passant à 20 ans en matière criminelle et à 10 ou 5 ans en matière délictuelle selon que le délit est puni soit d’une peine égale ou supérieure à 5 ans soit inférieure à cette durée. L’amendement proposait parallèlement une unification du point de départ de ces prescriptions fixé de manière intangible à la commission des faits à l’exception notable des crimes et délits commis à l’encontre des mineurs.
À l’occasion de cet amendement, l’effet des modifications engendrées par ces propositions sur les procédures en cours avait été examiné. Il en était ressorti que la situation des procédures en cours, délits comme crimes, n’étaient pas affectées par ces nouvelles règles de prescription, les actes d’investigation ayant eu un effet interruptif de la prescription.
Il convient enfin de signaler, qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2013 refusant de reporter le point de départ de la prescription pour la victime de viols invoquant une amnésie lacunaire, des sénateurs ont déposé, le 13 février 2014, une proposition de loi modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles et tendant à reporter, notamment pour le viol, le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique. L’action publique reposerait sur une condition potestative. Fort heureusement, la commission des lois a décidé de ne pas retenir cette proposition.
Conjointement à l’allongement des délais de prescription de l’action publique, les causes d’interruption et très récemment de suspension du délai de l’action publique se sont multipliées par l’effet de la jurisprudence.
II- La multiplication des causes d’interruption et de suspension du délai de prescription de l’action publique
Si les causes d’interruption du délai de prescription de l’action publique ont vu leur champ d’application s’élargir ces quinze dernières années (A), les causes de suspension jusqu’à très récemment semblaient encadrées (B).
A- Une appréciation extensive des causes d’interruption par la jurisprudence
Les causes d’interruption sont multiples (1) de même que leurs effets (2).
1- Extension jurisprudentielle des causes d’interruption de la prescription
D’après les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, les « actes de poursuite ou d’instruction » interrompent le cours de la prescription.
La notion d’acte de poursuite regroupe les actes de mise en mouvement de l’action publique (citation directe, plainte avec constitution de partie civile…), les jugements et arrêts, ainsi que tous les actes réguliers de constatation d’une infraction (actes de l’enquête de flagrance).
La notion d’acte d’instruction vise quant à elle les différents actes qui ont pour but la recherche et réunion des preuves de l’infraction accomplis dans le cadre de l’instruction préparatoire (ex : interrogatoire par un juge d’instruction).
La question s’est posée en jurisprudence de savoir si la notion « d’acte d’instruction » pouvait être étendue aux actes de l’enquête préliminaire. La chambre criminelle a répondu par l’affirmative, que l’enquête préliminaire ait été effectuée d’office ou sur réquisition du parquet.
Ces dernières années, la chambre criminelle n’a cessé de faire apparaître de nouvelles causes d’interruption de la prescription.
D’abord dans un arrêt du 20 février 2002 (affaire des disparues d’Auxerre), elle a décidé qu’une demande de renseignements adressée par le Procureur de la République à une autorité administrative (soit-transmis) constitue un acte de poursuite interruptif de prescription, dès lors que son contexte démontre que l’intention du procureur de la République était de poursuivre l’infraction ou d’en rechercher les auteurs.
Selon l’argument développé devant la chambre criminelle, cette demande de renseignements, si elle avait été transmise par la voie de la gendarmerie au service concerné, aurait fait l’objet d’un procès-verbal qui, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, interrompt la prescription.
Il aurait en effet été incohérent de conférer un effet moindre à une initiative prise directement par le mandant qu’à celle reconnue au mandataire, en l’espèce, les gendarmes.
La notion d’acte interruptif s’est encore élargie avec un arrêt rendu le 1er décembre 2004. Jusqu’à lors seuls étaient des actes de poursuite, au sens de l’article 7 CPP, les procès-verbaux présentant une valeur probatoire (procès-verbaux tendant à la recherche et à la constatation des infractions). Dans l’arrêt du 1er décembre 2004, la chambre criminelle considère qu’un procès-verbal sans valeur probatoire (procès-verbal ayant pour objet de renseigner une autorité administrative) constitue un acte de poursuite interruptif de prescription.
C’est ensuite la loi du 9 mars 2004 qui a donné naissance à une nouvelle cause d’interruption de la prescription en posant la règle suivant laquelle les actes relatifs à la mise en œuvre d’une procédure de composition pénale sont interruptifs de prescription.
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2006, la chambre criminelle s’est une nouvelle fois prononcée dans un sens extensif de l’interruption de la prescription en donnant naissance à un nouveau type d’acte interruptif : la diffusion de fiches de recherche d’une personne susceptible d’avoir été victime d’un crime ou d’un délit.
Poursuivant dans cette lignée, par un arrêt rendu le 12 décembre 2012, la chambre criminelle a encore étendu la notion d’acte interruptif de prescription en jugeant que la réquisition émanant
d’un officier de police judiciaire aux fins d’inscription au fichier national des empreintes génétiques du profil ADN établi par l’analyse d’une trace prélevée sur le vêtement de la victime constitue un acte d’instruction, interruptif de prescription au sens de l’article 7 CPP.
En revanche, dans un arrêt du 11 juillet 2012, la chambre criminelle a jugé au visa des articles 6 et 8 CPP qu’ « une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique ». Une telle position s’explique par le fait que, à la différence d’une plainte avec constitution de partie civile, une plainte simple n’a pas pour effet de déclencher l’action publique.
Il convient de préciser ici que les actes de poursuite ou d’instruction ne sont interruptifs de prescription que dans la mesure où ils sont réguliers : un acte nul ne peut avoir aucun effet interruptif.
2- Extension jurisprudentielle des effets interruptifs de la prescription
L’interruption efface le temps écoulé avant sa survenance. Un nouveau délai identique au premier commence donc à courir à compter du lendemain du jour de l’acte interruptif.
La prescription est interrompue à l’égard de tous les auteurs, coauteurs, complices de l’infraction, connus ou inconnus, même si les poursuites n’ont été engagées que contre un seul d’entre eux ou contre X. En revanche, l’effet interruptif est en principe limité aux faits délictueux concrets et précis qui sont visés par les actes interruptifs.
Toutefois la jurisprudence étend l’effet interruptif aux faits connexes au fait délictueux qui a fait l’objet de l’acte de poursuite ou instruction (l’article 203 du CPP énumère 4 cas de connexité : unité de temps et de lieu, unité de concert, unité causale et recel). Or, la jurisprudence a toujours retenu une conception extensive de la connexité. La chambre criminelle juge en effet de manière constante que les dispositions de l’article 203 CPP définissant la connexité ne sont pas limitatives, et « s’étendent aux cas dans lesquels il existe, entre les faits, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ».
Dans cette perspective, un arrêt de la chambre criminelle du 18 janvier 2006 a encore élargi la notion de connexité en y incluant l’ensemble des crimes dont se rendent coupables les différents criminels en série.
Les crimes en série présentent toujours une identité d’auteur, une identité de mode opératoire, et les criminels en série recherchent, d’un crime à l’autre, les mêmes buts. Cela suffit selon la Haute Cour à établir une relation de connexité entre ces différents crimes, bien qu’ils soient commis en des temps et en des lieux éloignés les uns des autres. Ainsi, désormais, les actes interruptifs de prescription effectués à l’occasion d’un crime dont on découvrira ultérieurement qu’il a été commis par un criminel en série, seront interruptifs de prescription à l’égard de tous ses autres crimes.
Beaucoup de systèmes juridiques étrangers prévoient, à l’instar de la France, des causes d’interruption de la prescription de l’action publique, résidant notamment dans les actes de poursuite ou d’investigation.
Par exemple, le nouvel article 160 du code pénal italien prévoit que le délai de prescription est prorogé du fait des diverses interruptions de nature procédurale. Selon le deuxième paragraphe de l’article 161, exception faite de certains délits, lesdites interruptions ne peuvent pas entraîner une augmentation du délai de plus d’un quart et, dans certains cas de figure, de plus de la moitié (dans certains cas de récidive), de plus de deux tiers (dans le cas de récidive réitérée) ou de plus du double (si l’auteur de l’infraction est un délinquant habituel).
A l’inverse des causes d’interruption, les causes de suspension de prescription de l’action publique connaissaient un encadrement assez strict jusqu’à l’arrêt d’assemblée plénière du 7 novembre 2014.
B- Une appréciation encadrée des causes de suspension
En l’absence de texte général, la jurisprudence décide que la prescription de l’action publique est momentanément suspendue en présence d’un obstacle de droit ou de fait (guerre ou cataclysme) à l’exercice des poursuites. Pour avoir un effet suspensif de prescription, l’obstacle mentionné doit être insurmontable (ex : attente d’une autorisation préalable pour déclencher l’action publique).
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, à cet égard, jugé que l’immunité politique dont bénéficie le Président de la République pendant son mandat doit être considérée comme une cause de suspension de la prescription de l’action publique.
Depuis la loi constitutionnelle du 23 février 2007, cette solution a valeur constitutionnelle : l’article 67 alinéa 3 de la Constitution énonce désormais que « les instances et procédures auxquelles l’immunité du président de la République fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ».
Il convient toutefois de souligner que la Cour de cassation retient d’une façon générale une conception étroite de la notion d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice des poursuites.
C’est notamment ce qu’illustre un arrêt rendu le 18 décembre 2013 dans lequel la chambre criminelle décide que l’amnésie post-traumatique de la victime de l’infraction ne constitue pas une cause de suspension de la prescription de l’action publique. Dans les hypothèses où la suspension serait reconnue, dès que la cause de suspension cesse, la prescription reprend son cours. Le délai qui avait été suspendu est repris là où on l’avait laissé.
Cependant un arrêt très récent rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 novembre 2014 s’agissant de l’octuple infanticide semble démontrer l’inverse.
Un deuxième bouleversement consécutif à cet arrêt non évoqué précédemment est relatif au régime de la prescription de l’action publique : alors même que la dissimulation de l’infraction justifie traditionnellement un report de son point de départ, elle constitue, dans le présent arrêt, une cause générale de suspension neutralisant l’exercice de l’action d’après les termes utilisés dans l’attendu de principe de la Cour. En somme, pour l’assemblée plénière, la prescription a bien commencé à courir avec la commission des crimes mais elle s’est trouvée suspendue par un obstacle insurmontable dû à la dissimulation opérée par la mère. Laurent Saenko, Maître de conférences à l’Université Paris-Sud estime que cette position ne peut évidemment qu’étonner car « le droit de la procédure pénale ne connaît pas de principe général de suspension de la prescription de l’action publique, mais uniquement des causes interruptives : chaque acte de poursuite ou d’instruction interrompt le délai parti avec la commission de l’infraction. » Il s’interroge ensuite en ces termes : « le secret qui entoure, par principe, la commission d’une infraction ne va-t-il pas suffire à qualifier de facto l’obstacle insurmontable à l’exercice de l’action ? Si oui, la matière criminelle sera-t-elle la seule concernée ? Quant au ministère public, n’est-il pas désormais incité à adopter une attitude passive, reléguant la recherche de la vérité au second plan pour mieux bénéficier du confort d’un temps suspendu par l’action d’un autre que lui ? ».
Si le ministère public peut ainsi repousser les frontières du temps, c’est à la seule condition de réaliser des actes de procédure utiles à la manifestation de la vérité. Sans eux, son droit de poursuite meurt.
Le juge semble appréhender dans cet arrêt, par la suspension de la prescription, les obstacles de droit ou de fait susceptibles de gêner l’exercice des poursuites.
En matière d’homicides dissimulés, le pas avait - presque - été franchi récemment par un arrêt de la chambre criminelle du 20 juillet 2011, non publié, qui avait affirmé que « seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique » (Crim. 20 juill. 2011, n° 11-83.086). C’est désormais chose faite avec l’arrêt d’assemblée plénière. Un principe si général mériterait certainement d’être énoncé par le législateur.
Si dans l’arrêt d’assemblée plénière, la Cour reprend très précisément les motifs par lesquels la juridiction du fond a souverainement apprécié qu’il existait un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique posant ainsi des conditions strictes à sa mise en œuvre, il n’en reste pas moins que la Cour énonce bien un nouveau principe, celui de la suspension de la prescription en matière criminelle en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.
Aussi, convient-il d’envisager des pistes de réforme de la prescription de l’action publique afin de remédier à ces règles chaotiques et imprévisibles et afin de garantir une sécurité juridique au justiciable.
III- Les réformes législatives envisageables
1- S’agissant des délits
Le législateur pourrait prévoir un allongement de la durée de prescription de l’action publique s’appliquant à l’ensemble des délits.
Certes, une différence entre la délinquance de droit des affaires et la délinquance de droit commun existe et cette dernière influe d’ailleurs sur les décisions prises par la Cour de cassation.
En effet, dans la délinquance de droit commun, le chiffre noir correspond à la différence entre les infractions constatées et les infractions pour lesquelles l’auteur a été identifié et poursuivi. Alors qu’en ce qui concerne la délinquance en droit des affaires, le chiffre noir correspond à la différence entre les infractions connues et l’évaluation macroéconomique de ce que vraisemblablement un certain nombre d’infractions ont été commises.
Cependant, si l’on veut simplifier la législation, il semble opportun de ne pas distinguer entre les infractions touchant au droit des affaires et celles touchant au droit hors des affaires.
Un délai allongé, qui serait commun à l’ensemble des délits pourrait être prévu, il s’agirait du délai utile pour poursuivre de 6, 8 ans voire 10 ans selon la peine encourue.
S’agissant des infractions dites « dissimulées », un maintien de cette jurisprudence avec un décalé de prescription semble inopportun dans la mesure où la durée de prescription de l’action publique est allongée.
En allongeant la durée du délai de prescription de l’action publique pour l’ensemble des infractions délictuelles, le législateur prend en compte la spécificité de ces infractions dissimulées, commises par des auteurs d’une particulière culture, parfaitement au fait des rouages économiques et ayant une capacité supérieure à dissimuler leur forfait.
A l’inverse, si le législateur distinguait les infractions en droit des affaires et les infractions hors le droit des affaires, on aboutirait à un système de prescription où les atteintes aux biens connaitraient paradoxalement une prescription plus longue que les atteintes aux personnes.
De plus, si la catégorie des infractions dissimulées devait être maintenue, cela nécessiterait de la part du législateur une définition. Or, les parlementaires lors de la loi du 6 décembre 2013 s’y sont essayés mais le texte a disparu au cours des discussions.
Par essence, toute infraction est dissimulée, l’auteur ne revendiquant pas la paternité d’une infraction.
2- S’agissant des crimes
De même en matière de crime, un alignement de la prescription de l’action publique sur les délais les plus longs prévus par la loi pourrait être prévu.
En dehors des cas d’imprescriptibilité déjà prévus par la loi (génocide et crimes contre l’humanité) sur lesquels le législateur ne peut revenir dans la mesure où ils font partie des monuments de la démocratie, la prescription de l’action publique pourrait être portée à 30 ans en matière criminelle. Ainsi, le délai de prescription serait aligné sur le délai le plus long prévu par la loi pour l’infraction jugée la plus grave ( en l’occurrence, 30 ans en matière de terrorisme).
3- La création d’un 2ème délai de prescription dans le cours des investigations
Un nouveau délai de prescription de 3 ans pourrait être introduit par le législateur à partir du moment où une enquête préliminaire a été ouverte ou lorsqu’un juge d’instruction a été saisi.
Il s’agirait de distinguer entre une première prescription de l’action publique entre la commission des faits et la saisine de la justice (6 ou 8 ans en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle) et une seconde prescription à partir de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou de la saisine d’un juge d’instruction dont le délai serait de 3 ans afin de respecter le délai raisonnable. Il ne semble pas tolérable qu’aucun acte d’investigation ne soit accompli durant 3 ans à partir de la mise en mouvement de l’action publique.
Si prescription il y a, dans un délai de 3 ans, cela traduit une incapacité de la justice à instruire une affaire dans un tempo raisonnable. Il semble anormal de laisser prescrire un crime ou un délit alors que des poursuites ont été engagées.
Aujourd’hui c’est le même délai qui s’applique entre la prescription de l’action publique (c’est-à-dire entre la commission des faits et la capacité de la justice à poursuivre) et une fois la justice saisie. Le même délai recommence à courir après chaque acte interruptif de prescription.
Or, dès lors que l’on allonge le délai de prescription de l’action publique, il semble difficile de faire bénéficier le train de la justice de cet allongement.
Les actes d’investigation resteraient interruptifs de prescription.
4- S’agissant des actes interruptifs de prescription
Si un délai préfix était mis en place, ce dernier ne recevant aucune interruption de prescription en dehors du cas de l’immunité présidentielle, la justice serait mise en difficulté à raison de la complexité de certaines investigations.
Cependant, le législateur pourrait se montrer plus précis dans son appréhension des actes interruptifs de prescription. Dès lors que le délai de prescription de l’action publique est allongé, le législateur pourrait établir des restrictions et n’admettre comme actes interruptifs de prescriptions que les actes effectifs d’investigation. A titre d’exemple, un rappel à l’expert ordonné par le juge d’instruction pourrait être un acte interruptif de prescription.
Ainsi, il serait mis fin clairement à une jurisprudence abondante qui a peu à peu admis comme interruptifs des actes n’ayant aucune valeur d’investigation ou aucun impact sur l’action publique.
5- S’agissant de la prescription de la peine
Les fondements de la prescription de l’action publique et de la prescription de la peine sont différents. Au stade de la prescription de l’action publique, la personne est présumée innocente alors qu’au stade de la prescription de la peine, la personne est déclarée coupable. Aussi, une unification des deux régimes ne parait pas opportune.
La prescription de la peine est à la fois un instrument utile et à la fois une prime donnée à celui qui sait se soustraire à la justice.
Il s’agit d’un instrument utile dans le sens où le système de jugement par défaut en France a une vertu cardinale : à partir du moment où la personne poursuivie ne peut pas être retrouvée mais qu’il existe des indices graves et concordants que cette personne a pu commettre les faits, le tribunal peut être saisi et peut prononcer une peine par défaut. Ainsi, le prononcé de cette peine fait basculer la prescription de l’action publique dans la prescription de la peine, ce qui allonge le temps au cours duquel l’intéressé devra répondre de ses actes.
La prescription de la peine est une difficulté majeure mais en même temps, entre la commission des faits et le jugement, l’individu auteur a souvent beaucoup changé. Et entre le jugement et la fin de la prescription de la peine, il a encore plus changé.
Aussi, la prescription de la peine révèle la prise en compte du fait que l’individu qui a commis l’infraction n’est plus le même au bout d’un certain temps et que l’exécution de la peine n’a plus le sens que lui donnaient les juges qui ont prononcé la condamnation.
Cependant, une amodiation convient d’être apportée. Le législateur a développé à plusieurs reprises dans les années récentes les capacités d’adaptation de la peine par le juge de l’application des peines. Aujourd’hui, la peine prononcée n’est pas la peine qui sera exécutée puisqu’elle peut être aménagée, morcelée ou suspendue en fonction de l’évolution de la situation du condamné.
Il n’en reste pas moins qu’une imprescriptibilité de la peine ne semble pas envisageable.
Conclusion :
Les enjeux touchant à la prescription sont importants. Une fois acquise, la prescription aura pour effet d’atteindre l’action publique : le délinquant ne pourra plus être poursuivi, et l’infraction dont il s’est rendu coupable restera impunie.
Les évolutions législatives concernant le droit de la prescription soulèvent deux séries de difficultés.
Tout d’abord, les modifications répétées et dispersées des règles applicables en cette matière ont affecté la cohérence du droit pénal et ont complexifié les règles de la prescription.
Ensuite, les délais de prescription de l’action publique apparaissent aujourd’hui excessivement courts au regard des modifications législatives et aménagements jurisprudentiels. L’allongement des délais de prescription par le législateur pour certaines catégories d’infraction, les initiatives jurisprudentielles tendant à reporter de manière presque systématique le point de départ du délai de prescription comme la multiplication des causes d’interruption et de suspension du délai de prescription démontrent l’inadaptation des délais initiaux, prévus dans le code de procédure pénale aux articles 7 à 9, aux attentes de la société. Et ce d’autant plus que ces délais apparaissent, dans l’ensemble, plus courts que ceux retenus par nos voisins au sein de l’Union européenne.
Il pourrait être procédé, à l’initiative du législateur, à un allongement global du délai de prescription. Le délai de prescription de l’action publique pourrait être porté de trois à cinq ans en matière délictuelle et de dix à vingt ans en matière criminelle afin d’harmoniser les différentes règles. Le délai d’un an actuellement en vigueur pour les contraventions pourrait être maintenu, ce dernier ne faisant pas l’objet de difficultés.
Je voudrais enfin terminer mon propos par une remarque sur le lien entre la prescription pénale et la prescription civile, issue de la récente réforme de 2008.
La loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile a bouleversé les solutions existantes en procédant à une réécriture de l’article 10 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit désormais que « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ». Avant cette réforme, l’article 10 du code de procédure pénale prévoyait que l’action civile exercée devant le juge répressif se prescrivait suivant les règles du code civil pour sa durée.
Cette nouvelle prévision de la loi du 17 juin 2008 signe un retour partiel à la solidarité des prescriptions civile et pénale. Elle était motivée par le souci de préserver les intérêts des victimes d’infractions pénales. Cependant, il semble que le législateur ait manqué son but dans la mesure où l’effet premier de cette disposition est de léser ces mêmes victimes en matière correctionnelle, le délai de prescription de l’action civile étant ramené à 3 ans au lieu de 5 ans et en matière contraventionnelle (le délai de prescription de l’action civile étant ramené à un an au lieu de 5 ans).
Il me semble donc opportun qu’une réforme législative cohérente et harmonisatrice des différentes règles s’agissant de la prescription de l’action publique soit mise en œuvre afin de lui redonner un sens et d’améliorer la prévisibilité juridique pour l’ensemble des justiciables.
Je vous remercie.
Contribution de M. Didier Guérin,
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
La prescription a des justifications classiques : la paix et la tranquillité publiques; la sanction de l’inertie de la société dans l’exercice de l’action publique; le dépérissement des preuves.
Ce dernier élément est particulièrement pris en compte par la jurisprudence européenne selon laquelle “l’une des finalités des délais de prescription est d’empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écroulé “- CEDH - 22 oct. 1996 Stubbings contre Royaume Uni-.
Je n’aborderai pas ici le cas particulier dans lequel la courte prescription applicable aux délits prévus par la loi du 29 juillet1881 s’impose traditionnellement comme une protection de la liberté d’expression.
On rappellera que la réflexion sur la prescription s’inscrit dans l’idée qu’il n’est pas inéluctable que le législateur prévoie des règles de prescription de l’action publique. En effet, ainsi que l’a jugé l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 mai 2011 (Bul.crim. N° 7),” la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle”
On doit par ailleurs constater une tendance contemporaine de la loi, à renforcer la protection des victimes en repoussant le point de départ de la prescription de l’action publique.
Cette tendance est illustrée notamment par les évolutions en matière de prescription des infractions sexuelles subies par des mineurs, la dernière loi en date étant celle du 9 mars 2004 qui , après plusieurs lois fixant des modalités de report du point de départ de la prescription de certaines infractions subies par des mineurs à partir de la majorité, a prévu que le délai de prescription de l’action publique courant à partir de la majorité des victimes mineures à la date des faits était porté à vingt ans pour les crimes et les délits de violences ,d’agressions sexuelles aggravées, d’atteintes sexuelles aggravées de quinze ans et à dix ans pour des délits énumérés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (article 7, alinéa 3 et 8, alinéa 2). Dans ces différents cas, l’action publique peut donc être engagée alors que la victime a subi les actes plusieurs dizaines d’années auparavant, ce qui, il ne fait pas le cacher, peut poser en pratique des problèmes de dépérissement des preuves.
Cette orientation a encore inspiré le législateur lorsqu’il a introduit, par la loi du 14 mars 2011, un nouvel alinéa à l’article 8 du code de procédure pénale qui prévoit que pour certains délits subis par des personnes vulnérables en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou de son état de grossesse, la prescription court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Sont visés les délits d’abus frauduleux de l’état de faiblesse, de vol, d’escroquerie et d’abus de confiance.
Cette tendance législative converge avec des évolutions jurisprudentielles contemporaines, intervenant sur le fondement de critères précis et objectifs.
C’est ainsi que la chambre criminelle juge, pour des infractions occultes par nature ou dissimulées, que la prescription court à compter du moment où la victime a pu engager l’action publique.
Tel est le cas en matière d’abus de confiance, délit qui se prescrit à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (cf; en dernier lieu, crim. 7 mai 2002, Bul.crim n° 107). Une formule d’une inspiration identique a été retenue depuis 1981 pour l’abus de biens sociaux, selon laquelle la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société (crim. 5 mai 1997, bul n° 159).
L’orientation jurisprudentielle est la même pour d’autres infractions occultes par nature (par exemple, la publicité trompeuse - crim 20 février 1986 - Bul.crim n° 70-, les atteintes à l’intimité de la vie privée et la mise en mémoire informatisée de données nominatives - (crim 4 mars 1997, Bul.crim n° 83 - la tromperie - crim. 7 juillet 2005, Bul.crim n° 206).
On sait que la jurisprudence a aussi retenu la dissimulation comme cause de report du point de départ de la prescription pour des infractions dissimulées, tels que le trafic d’influence (crim 19 mars 2008, bul. n° 71), la corruption (crim.6 mai 2009, n° 08-84.107) et le détournement de fonds public (crim. 2 décembre 2009, bul. n° 204).
Un point commun existe entre toutes ces infractions: elles peuvent être qualifiées d’astucieuses et supposent donc une démarche intellectuelle élaborée qui est le fait de personnes averties sachant que les actes malhonnêtes qu’ils commettent pourront, du fait de ces règles de prescription, leur faire encourir un risque durable de répression pénale.
Au fond, la Cour de cassation, d’une certaine manière, fait application, sans l’exprimer, de l’adage “contra non valentem non currit praescriptio”. La victime et la société qui lui doit protection voient leurs droits sauvegardés et le délinquant potentiel le risque pénal accru en cas de passage à l’acte.
Une évolution importante traduisant cette préoccupation vient de se produire avec l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2014 (n° 1483739) qui a retenu, ainsi que résumé dans le sommaire, que” si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites et que justifiait sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique présentée par une personne poursuivie pour homicides volontaires aggravés commis sur ses enfants à leur naissance, retient que nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence, caractérisant ainsi un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres.”
Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation n’avait pas fait application de cette règle du report du point de départ de la prescription en matière de crimes. (cf à cet égard crim. 16 octobre 2006, Bul.crim. n° 226), sous une réserve cependant. En effet, par un arrêt du 20 juillet 2011 (11-83.086) la chambre criminelle avait, à l’instar de l’assemblée plénière par son arrêt précité, retenu qu’en matière criminelle également, un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique pouvait suspendre la prescription.
Ainsi, que ce soit par le biais notion de dissimulation ou par celui de la suspension du point de départ de l’action publique en raison d’un obstacle insurmontable, il existe une tendance forte de la jurisprudence à retarder le point de départ de la prescription de l’action publique à un moment où celle-ci peut être effectivement exercée.
Il appartient désormais au législateur de se saisir, s’il l’estime utile, pour tirer les conclusions de ces diverses évolutions.
Faut-il ériger en règle générale une dérogation à la règle selon laquelle la prescription de l’action publique court à compter du jour de l’infraction en prévoyant que la prescription ne court que du jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ? Ce serait là une assurance, face à la tendance naturelle du criminel et du délinquant à dissimuler son infraction, que la loi pénale pourra recevoir application.
On voit aussi qu’une telle règle pourrait dispenser d’allonger les délais de prescription. Cette option ne pourrait toutefois garder son intérêt que si n’est pas créé par ailleurs un délai-couperet de prescription courant systématiquement à compter de la date de commission effective de l’infraction, ce délai ne pouvant qu’encourager les personnes mises en cause à multiplier les manœuvres dilatoires pour retarder leur jugement, à l’instar du code pénal italien, qui prévoit que l’infraction pénale est prescrite après l’écoulement d’un laps de temps équivalent à la peine maximale prévu par la loi.
Il ne faut cependant pas se cacher qu’une telle orientation ne réglerait pas tout problème d’interprétation à l’avenir puisque le point de départ de la prescription dépendrait largement d’appréciation de faits issus des éléments de la procédure.
Plus simple serait certainement un rallongement important des délais de prescription de l’action publique ainsi que le législateur l’a déjà fait en certaines matières particulières, la prescription courant alors de manière générale à compter de la commission de l’infraction, mais demeurant évidemment interrompue par tout acte de poursuite et d’instruction. La fixation de ces délais exigerait cependant qu’ils ne permettent pas aux auteurs d’infractions ayant porté une atteinte aux valeurs essentielles protégées par la loi pénale, qu’elles soient sociales ou économiques, d’échapper aux poursuites dans des domaines où la loi actuelle telle qu’interprétée par la jurisprudence évite une telle impunité.
Contribution complémentaire de M. Didier Guérin (384)
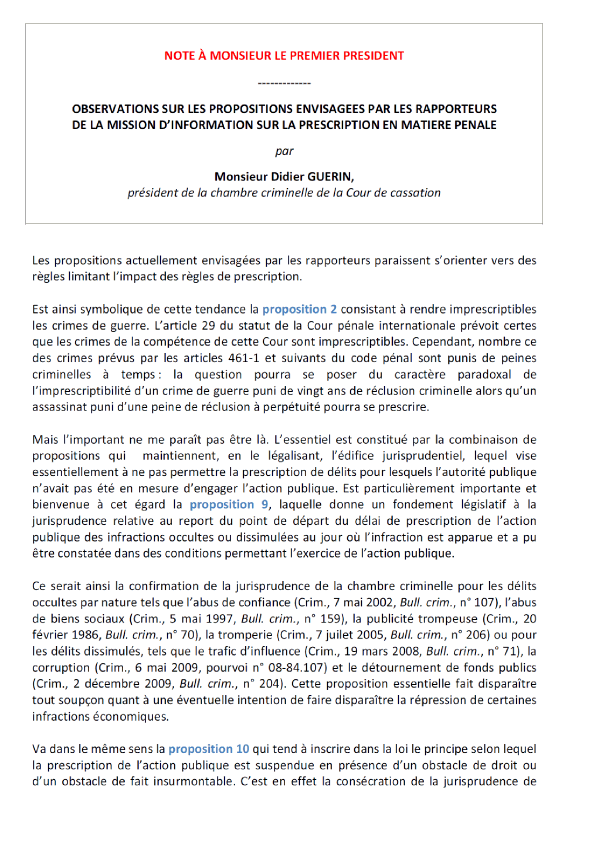
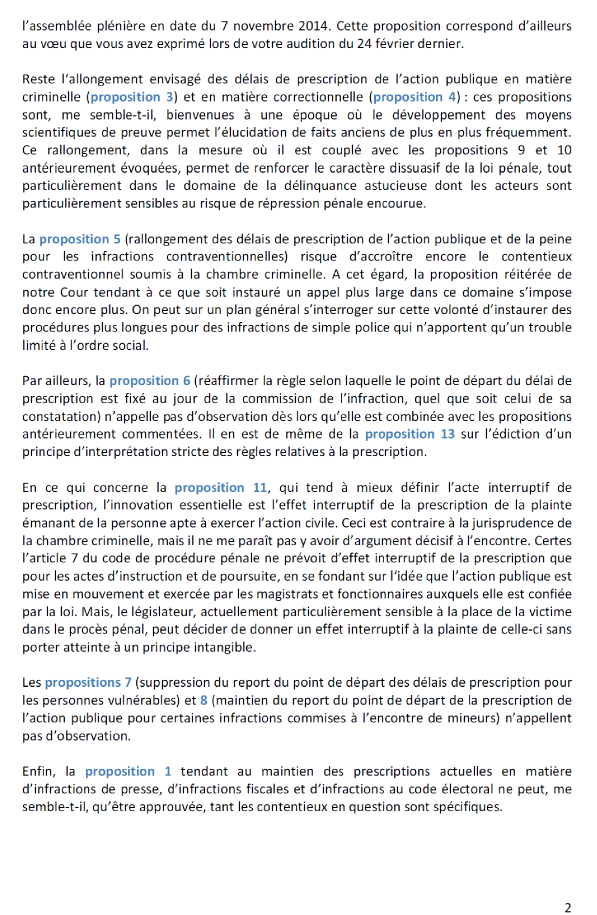
Contribution de M. Didier Boccon-Gibod,
premier avocat général à la Cour de cassation
Messieurs les députés,
Vous avez bien voulu m’inviter à vous entretenir de la prescription en matière pénale. Vous m’en voyez très honoré et je vous remercie pour la confiance que vous voulez bien me témoignez.
Je propose de présenter un bref constat avant de me risquer à l’évocation de quelques évolutions possibles.
Je consacrerai l’essentiel de mon propos à la prescription de l’action publique. La prescription de la peine me paraît en effet poser moins de difficultés, d’autant que les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale, introduites par la loi du 27 mars 2012, permettent de repousser l’échéance de la prescription de toute peine par la voie d’actes interruptifs.
Sur la prescription de l’action publique je me garderai de vous faire l’offense de croire que vous ignorez tout du sujet. C’est donc uniquement pour ordonner mon propos que je vais partir du plus simple, pour aller vers le plus compliqué.
* *
*
Au début de mon activité professionnelle, en 1978, les règles de la prescription étaient des plus simples : Si l’on met à part l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et la courte prescription des délits de presse, les délais étaient ceux que vous connaissez, 1 an, 3 ans 10 ans, contraventions, délits, crimes.
La prescription pouvait être interrompue par des actes d’instruction et de poursuite, selon la formule toujours actuelle de l’article 7 du code de procédure pénale. Les actes interruptifs devaient être véritablement judiciaires : par exemple, l’ordre donné par le procureur de la République à un huissier de citer une personne devant le tribunal était regardé comme un courrier administratif et n’était donc pas interruptif, seule la citation délivrée par l’huissier l’était.
Enfin, si la jurisprudence selon laquelle le délit d’abus de confiance, infraction occulte par excellence, ne se prescrit qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté, était déjà ancienne et bien établie (Crim. Janvier 1935, GP 1935 I 353), la solution était plus récente pour l’abus de biens sociaux (Crim. 7 mars 1967, Bull. n° 321 et 10 août 1981, Bull. n° 244), j’y reviendrai.
Progressivement, le paysage s’est compliqué à tous les niveaux.
La notion d’acte interruptif a été étendue à des actes administratifs. Le mandement de citation encore non interruptif en1978, (Crim 20 juin 1978, Bull n° 204) l’est devenu en 1984 (Crim 28 janvier 1988, Bull n° 44 ; 13 février 1990, Bull n° 74). À l’occasion de l’affaire des Disparues de l’Yonne, un arrêt de la chambre criminelle du 20 février 2002 (Bull n° 42) a qualifié d’interruptif un simple courrier par lequel le procureur de la République s’informait auprès des services sociaux du département du sort de jeunes filles dont la disparition était l’objet d’une enquête judiciaire.
Mais ce n’était qu’un début.
* *
*
La complexité s’est ensuite introduite de deux manières.
- D’une part la jurisprudence a considérablement accru les cas dans lesquels la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où les faits ont pu être découverts dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
J’ai cité tout à l’heure l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance, infractions occultes par nature.
Mais la jurisprudence a ajouté d’autres cas :
- en 1999, le favoritisme (Crim. 19 mars 2008, Bull. n° 71)
- en 2005, la tromperie, dont la Cour de cassation admet qu’elle est occulte par nature, faute de quoi la victime ne serait pas trompée (Crim. 7 juillet 2005, Bull. n° 206).
- en 2008, le trafic d’influence (Crim. 19 mars 2008, bull, n° 238).
- en 2009, la corruption (Crim. 6 mai 2009, n0 08-84.107)
- en 2009 toujours, le détournement de fonds publics (Crim. 2 décembre 2009, Bull. n° 233).
Cette énumération est loin d’être exhaustive.
Il se pose alors un problème de cohérence : pourquoi ces infractions et pas d’autres ?
En quoi par exemple le délit de prise illégale d’intérêt pourrait être moins dissimulé que le favoritisme ? (Crim. 27 octobre 1999, Bull. n° 238, 239).
En réalité, toute infraction est clandestine, rares sont les malfaiteurs qui agissent au grand jour.
On peut donc trouver discutable de ne pas réserver cette jurisprudence libérale aux seules infractions véritablement occultes, comme l’abus de confiance, l’abus de bien sociaux ou la tromperie.
Il se pose aussi un problème d’équité : qui peut dire que cette jurisprudence ne revient pas, en définitive, à laisser à la victime le choix du moment où elle va dire qu’elle a découvert les faits dont elle décide de se plaindre ?
* *
*
En réalité, cette jurisprudence révèle le paradoxe qui domine tout le dispositif de la prescription :
- d’une part, contrairement à d’autres pays, notre système judiciaire connaît la prescription ;
- d’autre part, nous ne manquons jamais une occasion de faire ce qu’il faut pour ne pas l’appliquer.
* *
*
Nous retrouvons cette tendance à la complexité et à la mise hors-jeu de la prescription dans diverses évolutions législatives.
Petit à petit, le régime de la prescription est sorti de la traditionnelle division tripartite.
La loi du 8 février 1995 a porté à 30 ans la prescription du crime de trafic de stupéfiants et du crime de terrorisme, et à 20 ans celle du délit de trafic de stupéfiants
La loi du 17 juin 1998 a porté à dix ans à compter de la majorité la prescription du crime de viol commis sur un mineur.
La loi du 9 mars 2004 a porté ce délai à 20 ans, à compter de la majorité, de même que pour les délits d’agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable avec une autre circonstance aggravante, telles que la qualité d’ascendant ou l’usage d’une arme.
Elle fait de même pour la prescription des crimes les plus graves commis contre des mineurs : meurtre ou assassinat précédé ou accompagné de viol, torture ou actes de barbarie, et pour les délits d’agressions sexuelles
La loi du 6 août 2004 a créé le crime d’eugénisme et de clonage reproductif se prescrivant par 30 ans.
La loi du 4 avril 2006 porte à 20 ans à compter de la majorité le crime de violences sur la personne d’un mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
N’oublions pas, enfin la récente loi du 6 décembre 2013 qui porte de 3 à 6 ans le délai dans lequel l’administration peut porter plainte en matière de fraude fiscale.
L’image du code de procédure pénale, pour ce qui concerne la prescription, est maintenant celle d’un patchwork.
* *
*
Ces prescriptions différenciées obligent à s’interroger sur ce qui fonde la prescription. Ce sera la dernière partie de mon intervention sous l’angle du constat.
On sait que la prescription se voit reconnaître traditionnellement quatre sortes de justification.
J’écarte tout de suite celle de la souffrance du criminel, à raison du remords causé par son acte, et qui serait ravivée par des poursuites tardives.
Plus convaincant est l’argument selon lequel le temps écoulé ne permet pas à la justice d’être rendue dans de bonnes conditions : les preuves ont dépéri, les souvenirs des témoins non décédés se sont estompés. L’observation reste valable même si la technique a permis des progrès majeurs en ce domaine.
Il faut de même regarder comme fondé l’argument selon lequel, passé un certain temps, remettre en marche l’appareil judiciaire cause un plus grand trouble à l’ordre public que l’inaction, surtout si l’infraction n’est pas très élevée dans l’échelle de gravité.
De même, l’idée que la prescription est une sanction de l’inertie de l’autorité publique a un sens pour les infractions de faible gravité/
Mais aucune de ces justifications ne peut maintenant être totalement satisfaisante en raison, à mon sens de deux tendances.
La première est l’amélioration des techniques, on pense en particulier à l’ADN : la question du dépérissement des preuves ne se pose plus de la même manière. Mais l’ADN ne résout pas tout : si les témoins ont disparu ou perdu la mémoire, si d’autres éléments matériels ne viennent pas corroborer ceux tirés de l’expertise génétique, des erreurs tragiques peuvent être commises.
Si l’on regarde ensuite l’ordre public, il faut parler de la révolution que constitue l’accès à l’information immédiate, généralisée, en continu, de sorte que le trouble causé à l’ordre public est bien plus grand quand il est annoncé par tous les journaux écrits et télévisés que tel crime ne sera pas poursuivi en raison de la prescription plutôt que lorsque sont reprises des investigations tardives.
La seconde tendance est la place que prend maintenant la victime dans le procès pénal. L’idée s’est fortement développée selon laquelle la justice pénale n’a pas pour seul objet de juger un criminel mais aussi de rendre justice à une victime. Or, admettre la prescription, c’est précisément empêcher que justice soit rendue à la victime, et c’est ce qui explique l’allongement de la prescription pour certaines infractions en raison de la qualité de la victime.
Je crois donc pouvoir observer que nous sommes dans un mouvement par lequel le législateur a voulu non seulement permettre aux victimes des faits les plus graves d’obtenir justice sans se faire opposer un délai de prescription trop court (viols et actes de barbarie sur mineurs), mais encore, proclamer la gravité de certaines infractions en leur affectant un délai de prescription plus long (terrorisme, eugénisme, trafic de stupéfiants).
* *
*
Le résultat est bien cette perte de cohérence dont une affaire récente bien connue est une malheureuse illustration. Il s’agit de cette femme qui, en l’espace de 18 ans a tué 8 bébés dont elle venait d’accoucher, cela dans l’ignorance de tous pour diverses raisons. Ces crimes étaient donc restés inconnus jusqu’à leur découverte fortuite. Le problème est que le dernier meurtre remontait à plus de dix ans, de sorte que la prescription criminelle était en principe acquise. Vous savez que la cour de cassation, en assemblée plénière a jugé, contre la Chambre criminelle par arrêt du 7 novembre 2014 (n° 14-83-739) que la prescription est suspendue au cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.
À mes yeux, cette affaire a mis en évidence une contradiction dont la Cour de cassation a voulu en quelque sorte sortir par le haut : il était pour le moins paradoxal de voir appliquer un régime de suspension de la prescription pour des atteintes aux biens occultes ou clandestines et d’en refuser l’application à des infractions infiniment plus graves pour lesquelles le problème de la clandestinité se posait dans les mêmes termes.
Il reste que l’on voudrait que cette affaire soit le dernier révélateur de ce type d’incohérence.
Je crois pour autant, puisque la question est posée, que ce serait une erreur de supprimer purement et simplement la prescription. Il faut protéger les victimes et l’ordre public, mais il faut aussi, en quelque sorte, protéger la justice de plaintes visant à l’instrumentaliser mais ne pouvant déboucher sur aucun résultat compte tenu du temps écoulé.
Si l’on supprime ce garde-fou, le risque me paraît grand de voir se perpétuer, dans une société de plus en plus judiciarisée, des règlements de comptes familiaux, des conflits d’affaires, qui jamais ne prendront fin sur fond de plaintes constamment relancées, alors que le temps écoulé ne laisse aucune chance à la vérité d’éclater. Il n’est pas sain de transformer le droit de porter plainte en droit de nuire. Il est sain de dire qu’il y a un moment où il faut que ça s’arrête.
* *
*
Je vais donc conclure en esquissant deux pistes de solutions.
- La première piste consiste :
*/ soit à intégrer dans la loi la formule qui a fait ses preuves, selon laquelle « la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » ;
*/ soit à généraliser la formule, également jurisprudentielle, que la loi a reprise à l’article 7 du code de procédure pénale pour les personnes vulnérables, selon laquelle la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle l’infraction apparaît dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ;
- La deuxième piste consiste à unifier les délais de prescription en se gardant d’entrer dans la casuistique progressivement élaborée. Il me semble que l’on pourrait alors :
- Ne pas toucher aux contraventions : un an ne pose pas de difficulté particulière
Pour les crimes et les délits, il me semble envisageable de prévoir, pour chacune de ces deux catégories, deux délais de prescription selon la peine encourue.
- Maintenir la prescription de trois ans pour les délits « ordinaires » , cela avec le complément que j’ai suggéré, concernant le point de départ du délai.
Ce serait à la Cour de cassation de contrôler les motifs qui justifient le report de la prescription.
Je n’ignore pas qu’en matière fiscale le délai dans lequel l’administration peut agir est maintenant de six ans au lieu de trois, mais il s’agit d’un délai proprement fiscal et je ne suis pas certain qu’il se justifie de porter à six ans le délai de prescription de droit commun.
Il serait plus efficient, à mon sens, afin de ne pas régresser par rapport à la situation actuelle, de prévoir que les délits les plus graves contre les personnes seront soumis à une prescription de 10 ans.
Pour les délits commis sur la personne de mineurs, la règle pourrait être maintenue de reporter le point de départ de la prescription à la majorité.
Pour les crimes, il faudrait tenir compte à la fois des progrès de la technique et de la volonté d’affirmer la gravité de certaines infractions en prévoyant deux délais de prescription selon la peine encourue : 20 ans ou 30 ans.
Il resterait à apprécier s’il faut faire courir ces longs délais à compter de la majorité pour certaines infractions commises contre des mineurs.
* *
*
La question est également posée de savoir s’il faut allonger la liste des crimes imprescriptibles.
Ce serait sans doute une manière d’affirmer la gravité de certains crimes, mais je crains en retour une forme de banalisation du crime contre l’humanité que je vois, en quelque sorte, au-dessus de tous les autres.
Il me semble donc que l’allongement éventuel jusque 30 ans et la prise en compte des facteurs de report du point de départ de la prescription pourraient constituer des mesures conciliant les nécessités de la répression et le maintien d’une gradation dans le regard que nous portons sur la gravité des infractions.
* *
*
Je voudrais terminer par l’évocation de deux difficultés.
- La première concerne les pièces à conviction : il n’est pas utile de maintenir des délais de prescription très longs si l’on n’est pas capable, dans le même temps, de conserver les pièces à conviction.
Or, je me garderai d’assurer que nous sommes capables de conserver des pièces à conviction pendant 20 ou 30 ans.
La seconde observation concerne un cas très particulier qui a donné lieu à des commentaires :
il s’agit de la plainte d’une femme frappée d’amnésie traumatique et qui s’est « souvenue » après l’expiration du délai de 10 ans qu’elle avait été victime d’un viol, faits que son psychisme avait jusqu’alors occultés.
Je ne mets évidemment pas en doute les déclarations de cette victime.
Mais je crois qu’une décision judiciaire ne peut pas être valablement rendue dans un contexte médical aussi lourd et je pense qu’il ne serait pas conforme à la justice de faire de l’absence de souvenir une cause de suspension de la prescription.
Je le dis d’autant plus sérieusement que je n’ignore pas qu’une proposition de loi faisant de l’amnésie traumatique une cause de suspension a donné lieu à un commencement d’examen par le Sénat.
J’ai noté les réticences que ce texte a suscitées, je les partage.
Je crois donc raisonnable l’arrêt du 18 décembre 2013 (n° 13-81.129) par lequel la Chambre criminelle a refusé de faire de l’amnésie traumatique une cause de suspension de la prescription.
La solution se trouve ici dans l’allongement du délai de prescription, mais dans un ensemble cohérent.
Je vous remercie pour votre attention.
Contribution du Syndicat national des magistrats-FO
PRECONISATIONS
Le Syndicat national des magistrats-FO préconise l’adoption d’un dispositif reposant sur :
- le maintien d’une prescription fixe pour tous les délits et les crimes. II n’apparaît pas utile de modifier la durée ni le régime de prescription des contraventions et les durées actuelles de droit commun (3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes) n’auraient pas besoin d’être allongées, en tout cas de manière conséquente ;
- l’introduction d’une dérogation applicable cependant à toutes les prescriptions, dans des termes qui pourraient reprendre ceux de l’article 8 du CPP :
« Le délai de prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où :
1°) l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, soit du fait de sa dissimulation, soit en raison d’un obstacle insurmontable à l’engagement de poursuites contre son auteur ;
2°) tous les éléments constitutifs de l’infraction ont cessé » ;
ce second paragraphe, créant une condition cumulative avec la précédente pour recouvrir les infractions continues et complexes, ainsi que les actes collectifs, notamment dans le cadre de la criminalité organisée, économique et financière ;
- pour tenir compte des situations dans lesquelles la réalisation du dommage ou de l’action prohibée susceptibles de constituer l’infraction intervient à retardement, les dispositions précédentes devraient être complétées par l’alinéa suivant :
« Outre les dispositions de l’alinéa précédent, le délai de prescription ne peut commencer à courir que lorsque les effets dommageables ou prohibés sont apparus dans des conditions permettant de caractériser l’infraction, quelle que soit la date à laquelle ont été accomplis les actes qui les ont provoqués ».
- quelques régimes dérogatoires tendant à différer explicitement et automatiquement le point de départ, comme l’âge de la majorité pour les enfants victimes d’abus sexuels, comme c’est actuellement le cas dans l’article 8 du CPP, ou la spécificité du droit de la presse.
ANALYSES
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a créé une Mission d’information en vue de préparer une réforme de la prescription pénale, dont le régime est devenu, au fil du temps, fort complexe et, il est vrai, de moins en moins lisible.
Le Syndicat national des magistrats-FO estime qu’une refonte du régime de la prescription, dont les conséquences sur la politique pénale sont déterminantes, requiert une réflexion de fond. Non seulement celle-ci doit prendre en considération les aspects techniques liés à la procédure pénale, mais elle doit aborder avant toute autre chose les fondements mêmes de la prescription pénale. On ne peut en effet légiférer sur une question de cette importance – puisque la prescription éteint l’action publique ou met fin à la possibilité de ramener les peines à exécution – que si l’on a justement mesuré les raisons pour lesquelles on en fait un droit pour les personnes susceptibles d’être poursuivies.
Une refonte rendue nécessaire par les évolutions du monde contemporain
Il serait tout à fait illusoire de croire que la complexité du monde moderne pourrait être réduite artificiellement puisqu’elle consiste en réalité à concilier en permanence les contraires. Si l’on veut, comme le souhaite le Syndicat national des magistrats-FO, parvenir néanmoins à un système simple et gérable en accord avec la finalité de la règle, il faut fixer d’une part des objectifs clairs, mais laisser d’autre part à la pratique judiciaire le soin d’en définir ensuite concrètement les contours et les modalités d’application. C’est d’ailleurs ainsi que les rédacteurs du code civil en avaient eux-mêmes conçu la rédaction, dans un contexte pourtant bien différent du nôtre.
Historiquement la prescription peut s’analyser comme un corollaire du droit de grâce, qui est l’apanage du souverain. Depuis le XIXe siècle, des influences contradictoires se sont manifestées. Assurer la paix sociale d’abord, en organisant une certaine forme d’oubli, mais aussi protéger les intérêts des victimes en limitant les effets d’une prescription-couperet.
Aujourd’hui, dans une large mesure, la personne est créatrice de droits qu’elle ne tient plus de son état de citoyen, mais d’elle-même. Le statut de victime, désormais pleinement reconnu, a eu pour effet de concurrencer et parfois même d’estomper le privilège de la société dans le droit de punir et son corrolaire, le droit d’oubli. Sur le droit de déclencher l’action pénale, traditionnel dans notre système juridique, s’en sont greffés d’autres qui font de la victime une partie qui dispose de (presque) tous les droits des autres parties dans le déroulement du procès pénal, du moins en ce qui concerne sa propre défense. A cela s’ajoute que le législateur comme le juge ont intégré, précisément dans le droit de la prescription, des modalités propres à préserver le sort de la victime afin qu’elle puisse, le plus longtemps possible, avoir un « droit au procès ».
Un droit centré désormais sur la victime
La première évolution de taille a concerné bien évidemment les crimes contre l’humanité, elle a consacré l’idée que certains crimes, parce qu’ils touchaient à la personne humaine dans ce qu’elle a de plus essentiel, ne pouvaient jamais rencontrer l’oubli. À un moindre degré, le législateur lui-même a introduit ensuite des dispositifs différenciés de prescription envers les plus vulnérables – enfants, personnes vulnérables – (article 8 du CPP).
Ces derniers méritent qu’on s’attarde pour en comprendre non pas tant la raison d’être, qui ressort clairement de leur énoncé, que la manière dont la loi les a aménagés car on y trouve mieux encore la signification de l’objectif visé. En retardant en effet le point de départ de la prescription à la date à laquelle la victime peut concrètement agir, soit de façon fixe (date de la majorité pour les mineurs) soit en fonction du recouvrement de ses propres capacités (personnes vulnérables), la loi a mis la victime au cœur du dispositif d’octroi de l’oubli. En d’autres termes, elle a transmis une partie de ce privilège de l’Etat vers la victime.
Elle n’a certes pas accordé à cette dernière le droit de déterminer entièrement le droit à l’oubli, mais elle a retardé le point de départ de celui-ci au moment où la victime cesse, en quelque sorte de l’être, ou du moins à compter duquel elle retrouve toutes ses capacités pour cesser de l’être en saisissant la justice. Ainsi, le temps de la prescription est suspendu tant que la victime individuelle ne peut exercer tous ses droits.
La démarche prétorienne adoptée par la jurisprudence a été de même nature. Elle a fait sien le principe que la prescription n’est un droit pour la personne poursuivie que si la victime a pu exercer son droit de poursuite sans entrave dans le délai légal. Elle a même consacré, dans une certaine mesure, l’idée que les infractions sans victimes directes ou clairement identifiées (infractions économiques et financières), mettaient l’Etat lui-même et la société tout entière en position de victimes collectives, ce qui justifiait le report du point de départ à la date à laquelle l’infraction a cessé. Puis elle l’a étendue aux crimes dont la découverte n’avait pas été possible dans le délai de prescription.
La prescription ne peut être une prime à la dissimulation
Toutes ces évolutions convergentes montrent l’ampleur du retournement en la matière, qui entérine le fait que c’est par rapport à la notion de victime – individuelle ou collective, abstraite ou concrète – que s’apprécie aujourd’hui le droit de punir et, partant, l’octroi (ou non) de l’oubli de l’infraction.
Elles traduisent par conséquent un profond mouvement de fond, que le législateur prendrait le plus grand risque à vouloir ignorer.
Soit en effet, il enfermerait le juge dans une formulation qui ne lui laisserait aucune marge d’appréciation en fixant un point de départ uniforme et incontournable à la prescription de tous les délits et les crimes : la rigidité d’un tel régime aurait à coup sûr des effets ravageurs sur l’opinion publique en général et sur les justiciables en particulier.
Soit, ce qui est nettement plus probable, il ne pourrait que laisser au juge – dont l’imagination ne manque guère, comme il l’a montré notamment à ce propos –, volontairement ou non, une marge d’appréciation dans laquelle celui-ci s’engouffrerait aussitôt. Non seulement la réforme aurait manqué son effet, mais elle risquerait fort de créer une nouvelle insécurité juridique jusqu’à ce que la jurisprudence soit parvenue, si elle y parvient, à reconstituer un droit cohérent de la prescription qui serait de toute façon très éloigné alors de ce qu’aurait voulu le législateur.
S’il apparaît de la sorte évident que la refonte du droit de la prescription ne doit pas s’opérer à rebours de l’évolution de toute la société, il reste néanmoins à trouver comment définir et arrêter le critère qui prendra le mieux en compte l’intérêt général.
La construction prétorienne s’est faite à partir de cas concrets et, comme toute casuistique, elle est dépendante des circonstances dans lesquelles elle s’est élaborée. Tandis que des notions comme celle de délit continu ne visaient qu’à parfaire le dispositif législatif initial du code de procédure pénal tout en restant dans les limites qu’il s’était fixées, la jurisprudence sur les infractions dissimulées a eu clairement pour objet de les dépasser pour prendre en compte des infractions et des contextes qui n’existaient pas lors de la création du code d’instruction criminelle, voire même du code de procédure pénale.
Comme on le sait, cette construction jurisprudentielle a essentiellement porté sur les infractions économiques et financières, pour la bonne raison que leurs auteurs disposent de moyens importants pour les dissimuler et qu’il convient de ne pas leur donner une prime supplémentaire à raison de cette capacité de se soustraire à la loi pénale.
La prescription doit tenir compte des évolutions qui retardent la connaissance des faits ou permettent de les poursuivre plus longtemps.
Mais d’autres évolutions et d’autres besoins se sont déjà manifestés, mettant en question de façon plus générale le moment qu’il faut choisir comme point de départ de la prescription. On retiendra bien entendu la décision de la cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2014, à propos de meurtres d’enfants cachés par leur mère.
On peut en évoquer d’autres comme les grandes catastrophes sanitaires – par exemple l’amiante ou le sang contaminé –, qui se déclarent après des années, voire des décennies, de latence ou d’« incubation ». La pollution d’un site industriel causant des ravages dans l’environnement et provoquant, parfois à des années de distance, une multitude de fléaux (malformations de nouveaux nés, maladies et décès, improductivité des sols ou de l’atmosphère, etc.) pose même le problème, au-delà de la dissimulation des causes qui souvent l’accompagne, du point de départ de la prescription.
Faudra-t-il également, si un maire accorde des autorisations de construire dans une zone inondable, que la mort de dizaines de personnes ne puisse plus être poursuivie au motif que la prescription courait à partir de la signature de l’arrêté municipal ? L’opinion publique comprendrait-elle qu’on ne puisse, après une avancée scientifique déterminante comme le séquençage de l’ADN, reprendre des poursuites contre l’auteur d’un crime qui n’aurait pu être précédemment identifié ? Et que dire du cas, récemment révélé aux Etats-Unis, d’une personne décédée cinquante ans après avoir été blessée par arme à feu, décès que les progrès de la médecine ont permis d’imputer à cette blessure ?
Quand, de surcroît, des infractions sont commises collectivement dans le cadre d’une soigneuse division du travail, comme c’est le cas au sein de groupes ou de réseaux criminels, selon quel critère décrètera-t-on si un acte est prescrit ? Faudrait-il considérer le cas de chaque membre de l’association criminelle en particulier pour fixer, contre lui, le point de départ de la prescription, ou continuer de considérer les actes commis en groupe comme un ensemble opposable à chacun d’entre eux ?
Sans doute, de tels cas posent-ils d’autres problèmes en termes de poursuites, mais l’allongement de la durée de vie et des moyens de reconstituer des événements passés grâce aux progrès scientifiques et techniques, tout autant que les nouvelles formes de criminalité, obligent à considérer en tout cas qu’ils ne peuvent être réglés simplement en tirant sur eux trop vite, ou par des procédés trop grossiers, le voile de l’oubli, puisque d’oubli, précisément, il n’y a plus.
Il apparaît ainsi que la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, non seulement doit être entièrement approuvée, d’autant qu’elle s’inspire des mêmes considérations que celles qui ont motivé le législateur au cours des dernières années, mais qu’elle doit être étendue et systématisée. Elle ne saurait en particulier être limitée aux seules infractions économiques et financières : elle doit devenir un principe subsidiaire mais universel en matière de prescription.
Conserver les règles établies et validées par le temps ou justifiées par leur nature ou la bonne administration de la justice
Bien entendu, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et de génocide ne peut, ne serait-ce que pour des raisons symboliques, être remise en cause. En revanche, la prescription du droit de la presse, qui répond à des motifs spécifiques, devrait continuer d’être considérée séparément des infractions de droit commun.
Il paraît peu réaliste par ailleurs, de chercher à modifier la jurisprudence sur les infractions continues, et très inopportun de modifier la règle applicable à la prescription des infractions connexes. Une bonne justice impose en effet que, dans le cas où plusieurs incriminations peuvent être retenues pour sanctionner un ensemble de faits qui sont liés entre eux, le juge ait la possibilité d’examiner tous les actes qui ont concouru à un comportement prohibé à des titres divers, même si le délai de prescription de certains d’entre eux, pris séparément, est achevé.
Par ailleurs, s’agissant de la prescription des peines, la question est plus simple et il pourrait y être apporté une réponse par un allongement raisonnable des durées actuelles de prescription.
Enfin, est posée la question également d’un délai tendant à instaurer une prescription « processuelle », c’est-à-dire un délai préfix de durée de la procédure comme il en existe, par exemple, dans le droit italien. Une telle solution, qui incite à exercer tous les recours, même abusifs et purement dilatoires, ne saurait être considérée comme favorisant une bonne administration de la justice. La jurisprudence de la CEDH sur la durée raisonnable des procédures apparaît un critère largement suffisant pour protéger les droits de la défense en la matière et il convient de laisser à la jurisprudence la souplesse nécessaire pour apprécier, dans chaque circonstance, si les délais de procédure ont été raisonnables et sanctionner les procédures dont la durée a été excessive.
Par conséquent, il suffirait de maintenir une durée de prescription de droit commun qui ne soit pas exagérément allongée et de maintenir les règles actuelles sur les causes d’interruption de la prescription. Si les délais de prescription étaient néanmoins rendus plus longs, il pourrait alors être prévu une prescription processuelle, différente de la prescription de l’action publique, relativement courte (par exemple 3 ans), mais qui ne serait pas un délai préfix et serait donc interrompue par tout acte de poursuite.
Résumé des propositions du Syndicat national des magistrats-FO pour la refonte du droit de la prescription pénale • Conserver la même durée de prescription fixe pour tous les délits et les crimes : 3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes. • Introduire les dispositions suivantes, applicables à toutes les prescriptions : « Le délai de prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où : 1°) l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, soit du fait de sa dissimulation, soit en raison d’un obstacle insurmontable à l’engagement de poursuites contre son auteur ; 2°) tous les éléments constitutifs de l’infraction ont cessé. Outre les dispositions de l’alinéa précédent, le délai de prescription ne peut commencer à courir que lorsque les effets dommageables ou prohibés sont apparus dans des conditions permettant de caractériser l’infraction, quelle que soit la date à laquelle ont été accomplis les actes qui les ont provoqués ». • Conserver quelques régimes dérogatoires tendant à différer explicitement et automatiquement le point de départ, comme l’âge de la majorité pour les enfants victimes d’abus sexuels, comme c’est actuellement le cas dans l’article 8 du CPP. • Conserver les régimes dérogatoires d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et de génocide ainsi que la prescription courte en matière de délits de presse. • Conserver la jurisprudence sur les délits continus et les règles relatives aux infractions connexes. • Prévoir un allongement raisonnable de la prescription des peines. • Ne pas instaurer de délai de prescription processuelle. Uniquement en cas d’allongement de la durée de prescription de droit commun, prévoir une prescription processuelle de trois ans qui serait interrompue par tout acte de poursuites. |
Contribution de la Conférence nationale des procureurs généraux
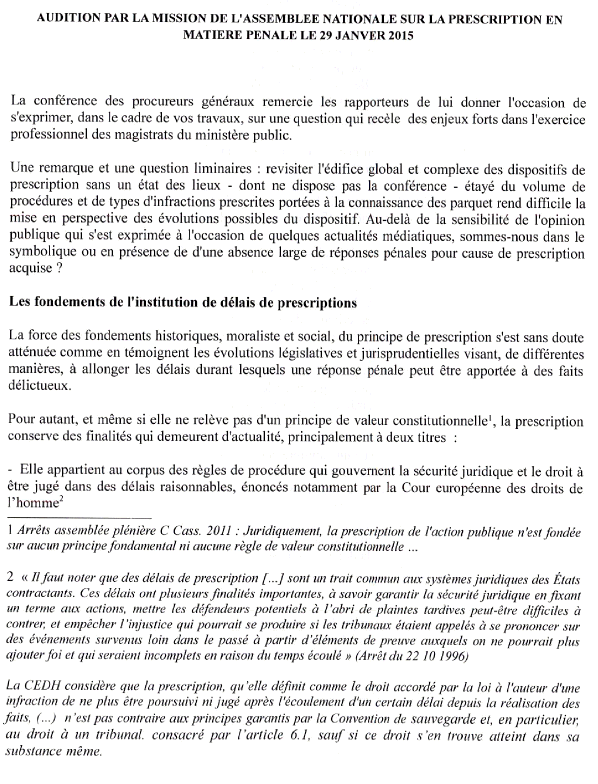
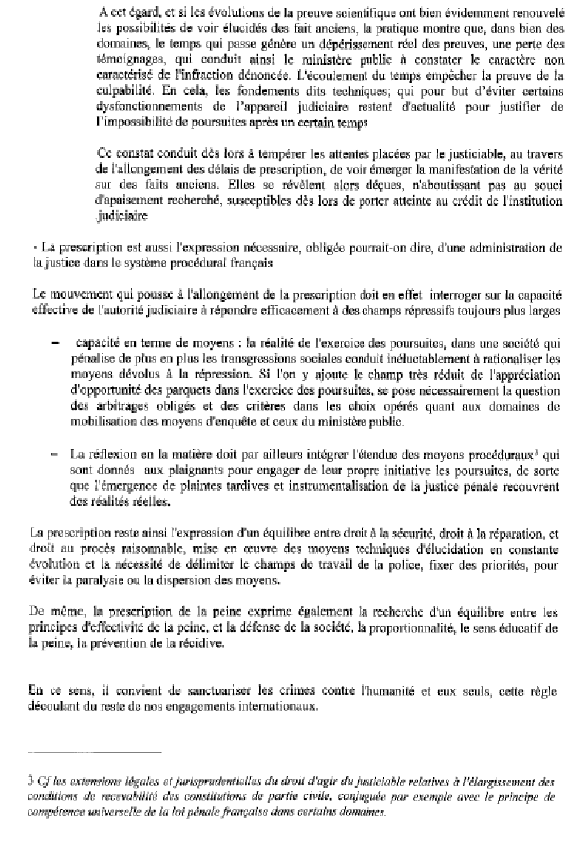
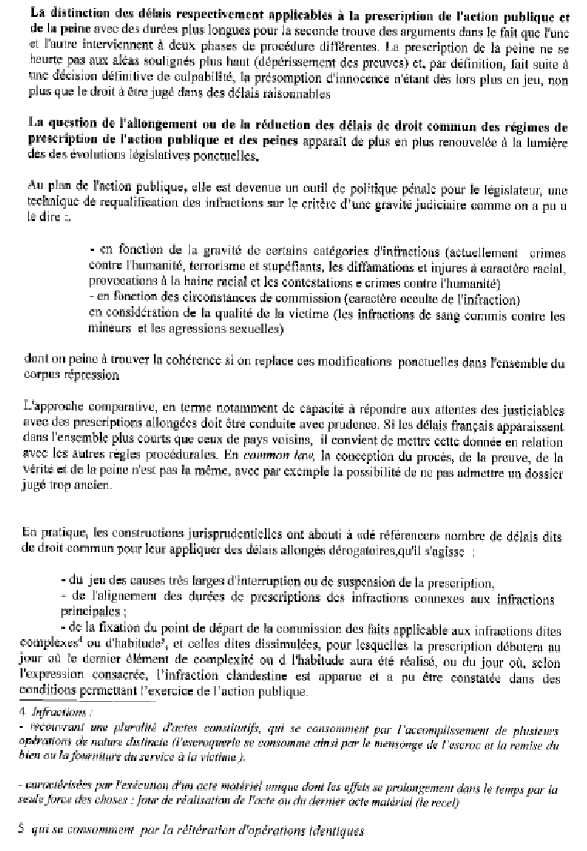
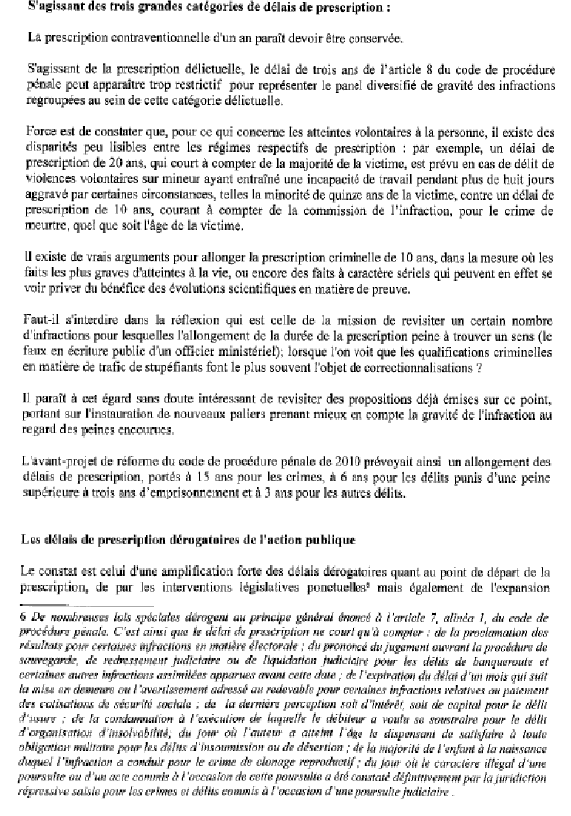
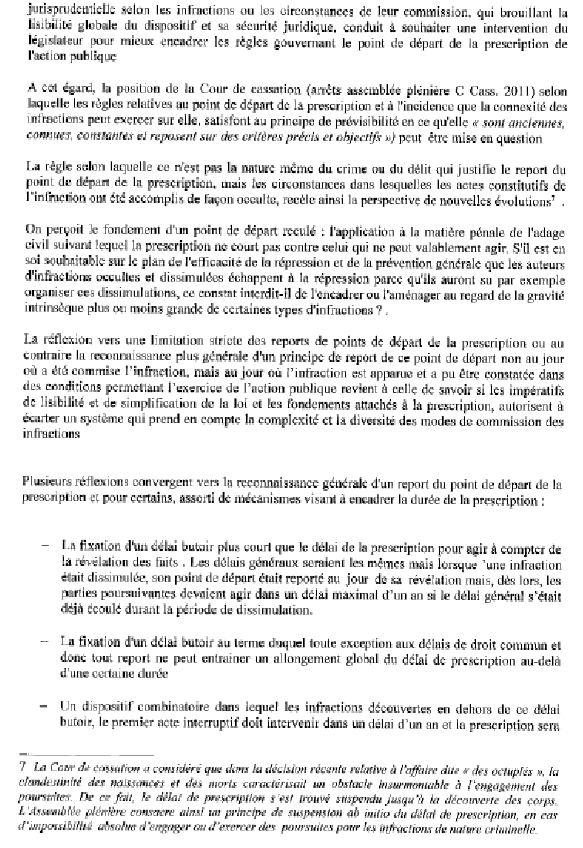
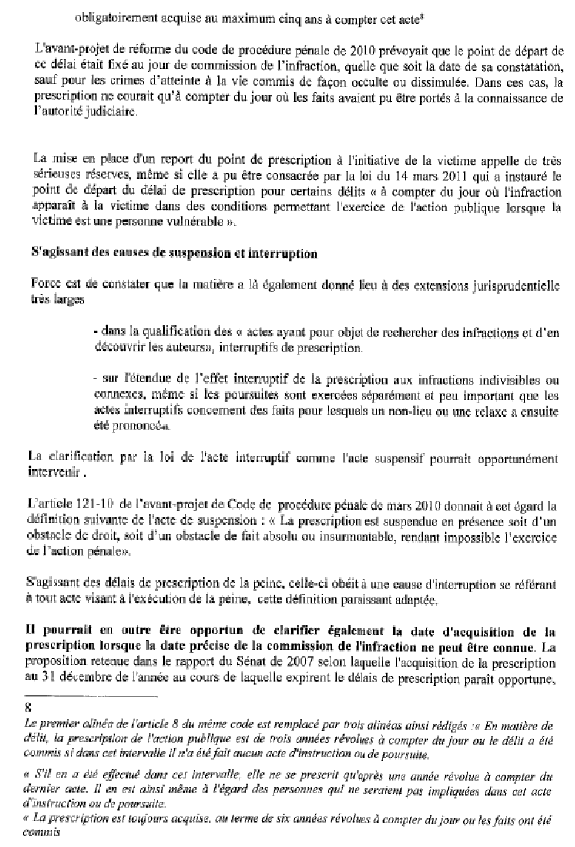
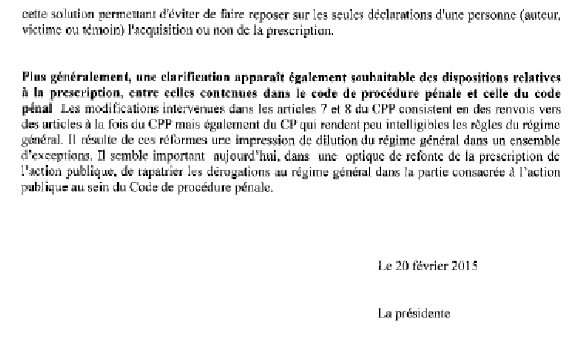
Contribution de l’Association française des magistrats instructeurs
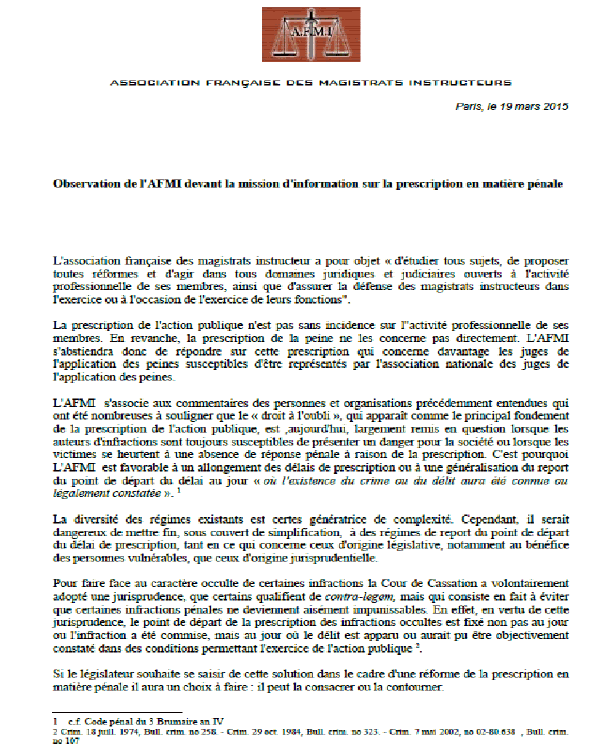
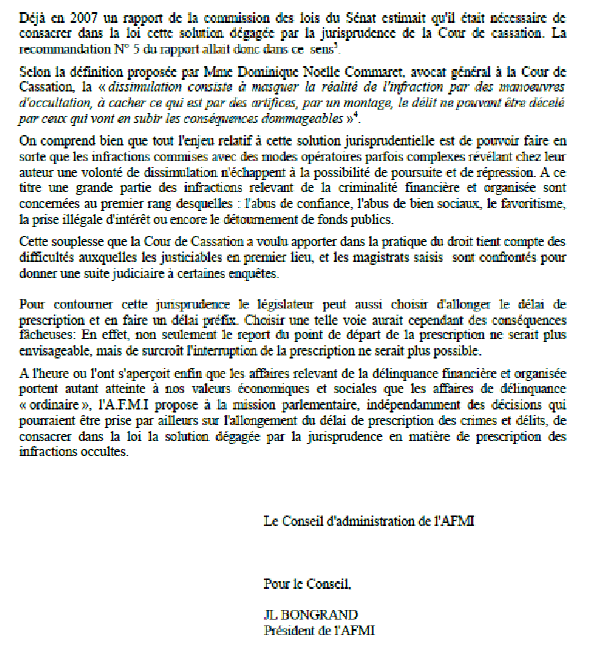
Contribution de l’Union syndicale des magistrats
Paris, le 24 février 2015
L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (72,5% des voix aux élections au Conseil supérieur de la magistrature en 2014).
Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.
"Au fil des années, les règles régissant ces différentes formes de prescription, qu’il s’agisse de leur durée, de leur point de départ, de leurs causes d’interruption ou de suspension, se sont diversifiées et complexifiées à un point tel que leur caractère foisonnant et leur manque de cohérence donnent un sentiment d’imprévisibilité et parfois d’arbitraire." (Pour un droit de la prescription moderne et cohérent. Rapport d’information fait au nom de la commission des lois du Sénat - 20 juin 2007)
De fait, cette complexité, qui porte principalement sur le régime de la prescription de l’action publique et, dans une moindre mesure sur celui de la prescription des peines, s’est encore accrue depuis la rédaction de ce rapport. On notera ainsi l’adoption par le législateur d’un nouveau régime dérogatoire en 2011 concernant les personnes vulnérables et, s’agissant de la jurisprudence, de l’application au droit criminel du principe de report du point de départ de la prescription pour des crimes dont l’existence même était dissimulée (7 novembre 2014, Assemblée plénière de la cour de cassation).
Dans ce contexte, il pourrait être tentant de défendre une réforme de « simplification », visant à rendre ces règles « prévisibles », « lisibles ». Si cet objectif est en apparence louable, encore faut-il éviter que, sous prétexte de simplification, il soit mis fin à un régime qui, actuellement, assure pour l’essentiel un relatif équilibre entre les différents buts de la prescription.
Cette réflexion n’est pas facilitée par l’absence d’élément statistique fiable en la matière. Ainsi, le nombre de procédures classées au motif de leur prescription n’est pas connu. En effet, le motif de classement sans suite est générique ("extinction de l’action publique") et recouvre nombre d’autres réalités (décès...). De plus, il ne peut concerner que les procédures classées après leur transmission au parquet. La prescription des peines ne fait pas non plus l’objet de statistiques précises, à notre connaissance.
La présente note rappelle les fondements et l’évolution du régime de prescription de l’action publique (A), avant de répondre aux questionnements de la mission sur certaines réformes qui pourraient être envisagées (B).
A – Fondements et évolution de la prescription de l’action publique
1 - Fondements des règles de prescription de l’action publique
Le droit pénal français, héritier du droit romain, a toujours admis le principe de la prescription, contrairement au droit anglo-saxon.
Classiquement, la prescription se fonde sur l’idée que le trouble à l’ordre social s’est estompé et qu’il serait plus préjudiciable de raviver le souvenir d’infractions anciennes par des poursuites tardives plutôt que de renoncer à les réprimer.
Le temps écoulé, porteur d’inquiétudes et de remords, serait par ailleurs, en lui-même, une sanction suffisante justifiant la renonciation à toute poursuite, passé un certain délai.
De plus, l’intérêt de l’auteur d’infraction serait de ne pas s’exposer en commettant une nouvelle infraction pendant le délai de prescription.
Enfin, la prescription repose sur l’idée que le temps passant entraîne le dépérissement des preuves et rend les poursuites incertaines, augmentant le risque d’erreur judiciaire.
Ces considérations anciennes, qui ont assuré au régime de la prescription pénale une stabilité pendant près de deux siècles, sont néanmoins remises en cause par les évolutions sociales et scientifiques récentes.
Tout d’abord, le dogme fondateur de la prescription, selon lequel la tranquillité publique serait troublée par des poursuites tardives, est largement remis en question, voire inversé, le bénéfice de ce droit à l’oubli n’est plus admis, le temps n’atténuant pas le danger que les délinquants représentent pour la société (cf. affaire des disparues de l’Yonne).
Ensuite, l’impunité peut renforcer la détermination criminelle de certains auteurs, surtout s’ils ont une personnalité perverse, au sens psychiatrique du terme.
Enfin, les progrès de la science appliquée aux investigations réduisent la portée de l’argument fondé sur le risque de dépérissement des preuves, en mettant au contraire à disposition des enquêteurs des modes de recherche à la fiabilité inégalée par le passé.
Depuis plusieurs années, ces raisons ont conduit le législateur, et dans une certaine mesure la jurisprudence, à allonger les délais de prescription ou à prévoir des exceptions au régime des prescriptions, concernant leur point de départ et leurs causes d’interruption ou de suspension.
Cet allongement des délais de prescription s’inscrit dans une tendance similaire partagée par divers pays européens qui ont procédé à des réformes en ce sens.
Le régime des prescriptions vise à atteindre un équilibre entre divers impératifs :
l’efficacité (qu’il s’agisse des enquêtes ou de la réponse judiciaire),
la sécurité juridique (tant pour les mis en cause que pour les victimes),
le respect d’un délai raisonnable au sens de la CEDH (qui dépasse la simple notion de sécurité juridique).
2 - Délais de droit commun
C’est la recherche de cet équilibre qui a conduit le législateur de 1808 à définir dans le Code d’instruction criminelle les délais actuels de prescription et leur déclinaison tripartite à raison de la catégorie d’infraction.
La durée de principe de la prescription de l’action publique est donc fixée, à compter du jour de la commission de l’infraction, à :
- 10 ans pour les crimes,
- 3 ans pour les délits,
- 1 an pour les contraventions.
Ces durées ont donc été fixées à une époque où les textes ne prévoyaient que très peu d’infractions de nature pénale (le code ne connaissait ainsi pas l’abus de confiance, qui n’a été créé qu’en 1915, ni la plupart des infractions techniques ou économiques et financières...).
Elles s’inscrivent aussi dans un contexte historique où le rapport au temps était différent (durée de vie plus courte , moyens de communications, etc.
C’est donc logiquement que les auteurs du rapport de 2007 (précité) avaient souligné que "le droit français se caractérise par la brièveté des délais de prescription de l’action publique au regard de ceux retenus par les systèmes juridiques voisins, souvent fixés en fonction de la durée de la peine applicable". Ils préconisaient leur allongement à 20 ans pour les crimes et à 5 ans les délits (préconisation n°4).
3 - … qui connaissent de multiples exceptions (tant sur la durée que sur le point de départ)
Le législateur a introduit un certain nombre d’exceptions liées à la gravité des faits ou à la personne de la victime. La jurisprudence y a ajouté des règles spécifiques pour les infractions dissimulées ou occultes.
Ces nombreuses exceptions s’appuient sur diverses justifications :
- la difficulté de poursuivre des crimes et délits causant un trouble important et durable commis par des groupes structurés (prescription allongée pour les faits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants – respectivement de 30 ans et 20 ans pour les crimes et les délits). Cette justification paraît souvent théorique. Le législateur cède en fait à la tentation de faire de l’allongement de la prescription le marqueur de sa réprobation face à tel ou tel type d’acte, alors même qu’un tel allongement des délais n’est pas réellement utile dans les matières concernées, ni durant la phase d’enquête, ni durant celle de la poursuite (combien de trafics de stupéfiants de nature criminelle démantelés du fait d’une prescription dérogatoire de 30 ans?).
- la nécessité de ne pas entraver la liberté d’expression et, singulièrement, la liberté de la presse (prescription raccourcie à 3 mois pour les délits prévus par la loi de 1881 sauf : provocation à la haine raciale ou à la discrimination, diffamation ou injure raciale et contestation de crime contre l’humanité : prescription annuelle)
- l’impossibilité de connaître en temps réel l’existence de l’infraction (report du point de départ du délai de prescription pour les délits dissimulés). Parmi les fondements théoriques du régime de la prescription, c’est bien évidemment la volonté d’efficacité qui justifie ce report.
- la difficulté pour la victime de révéler l’infraction qu’elle a subie (prescription allongée pour les mineurs en matière d’infractions sexuelles ainsi que, s’agissant de certaines infractions, pour les personnes vulnérables).
3.1 - Exceptions légales
• imprescriptibilité
Il existe très peu d’exceptions légales au principe même de la prescription.
Le régime très spécifique d’imprescriptibilité de tous les crimes contre l’humanité tient largement à la nature particulière de ces infractions causant un trouble majeur et « historique » à l’ordre public, qui doit précisément perdurer dans les mémoires collectives pour en prévenir la réitération.
L’imprescriptibilité doit demeurer une exception, justifiée par le fait que le préjudice est d’une telle ampleur que la notion d’oubli ne doit jamais intervenir. Cette opinion était partagée par les auteurs du rapport parlementaire de 2007 (précité. 1ère préconisation).
• Report du point de départ du délai de prescription pour certains crimes et délits commis contre les mineurs
C’est en matière d’infractions sexuelles que les modifications les plus nombreuses du régime de droit commun sont intervenues, les trois arguments tendant à remettre en cause la prescription étant alors exacerbés (trouble à l’ordre public causé par les infractions sexuelles, absence de remords de l’auteur et amélioration des modes de preuves scientifiques).
Les exceptions au régime de droit commun concernent tant le point de départ du délai de prescription (report à la majorité de la victime pour les crimes et délits en matière sexuelle) que la durée du délai lui-même (20 ans pour les crimes visés à l’article 706-47 du CPP, délits d’agressions sexuelles aggravées sur mineurs, délit de l’article 222-10 CP : violences entraînant une mutilation sur mineur de 15 ans, 10 ans les délits visés à l’article 706-47 du CPP et commis contre les mineurs).
Les multiples remaniements des textes relatifs à la prescription des crimes et délits commis contre les mineurs rendent très délicate la détermination des règles applicables (Cf. Ch. Guéry, Kafka II ou pourquoi faire simple quand on peut faire ... une nouvelle loi sur la prescription des infractions commises contre les mineurs, D. 2004, p. 3015).
La justification principale du principe de prescription tient au dépérissement des preuves et au risque d’erreur judiciaire qui en résulte.
Dans un domaine où les éléments "physiques" (blessures, traces biologiques, etc) s’altèrent rapidement, il est souvent particulièrement difficile de rapporter la preuve de l’infraction au moyen des techniques modernes de police scientifique (comparaison ADN, relevé de traces par rayonnement lumineux, révélation de taches de sang, etc...) plusieurs années après la commission des faits, si des relevés d’indices n’ont pu être effectués immédiatement.
Face aux dénégations courantes des personnes suspectées, la grande majorité des enquêtes repose donc sur l’évaluation de la crédibilité des dires de la victime par recoupement avec des constatations matérielles, des témoignages ou des éléments indirects. Or, ceux-ci dépérissent ou deviennent très imprécis avec le temps et la difficulté est proportionnelle au temps écoulé depuis l’infraction. On a pu ainsi constater une réelle incompréhension, voire insatisfaction, de la part de personnes se considérant victimes, qui n’ont pu être reconnues comme telles, alors que la durée allongée de la prescription leur laissait penser qu’une condamnation était envisageable....
• Autres cas légaux de report du point de départ du délai de prescription
- Banqueroute et infractions assimilées (articles L654-1 et suivants du code de commerce) : la prescription ne court que du jour du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
- Désertion et insoumission (L211-13 du code de justice militaire) : la prescription part du jour où le coupable a atteint l’âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.
- Infractions en matière électorale (L114 du code électoral) : six mois à compter de la proclamation des résultats
- Organisation frauduleuse d’insolvabilité (314-8 al. 3 du code pénal) : la prescription ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire, ou à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsqu’il est postérieur à cette condamnation
- Non-paiement des cotisations de sécurité sociale (L244-7 du code de la sécurité sociale) : la prescription commence à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suit, selon le cas, soit l’avertissement, soit la mise en demeure prévus par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale
- usure (L313-5 du code de la consommation) : la prescription a pour point de départ le jour de la dernière perception, soit d’intérêt, soit de capital.
Cette énumération, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, montre que les exceptions légales sont nombreuses et diverses, ce qui ne contribue pas à la lisibilité de l’ensemble.
De plus, ces modifications sont généralement intervenues pour régler des problématiques spécifiques, sans structure d’ensemble.
Il en résulte un manque de cohérence et de lisibilité.
Bien évidemment, la loi n’est pas figée. Mais, s’agissant d’un des principes fondateurs de notre architecture pénale, toute modification doit être mûrement réfléchie. Il est impératif de veiller à la cohérence du droit de la prescription, et de préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée de la prescription de l’action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le droit pénal.
Telles étaient les préconisations n°2 et 3 du rapport précité :
- 2 - Veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles
- 3 - Préserver le lien entre la gravité de l’infraction et la durée du délai de la prescription de l’action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires
Ce rappel peut paraître évident.... mais 4 ans après ce rapport, le législateur prévoyait un nouveau régime dérogatoire, au bénéfice des personnes vulnérables, modifiant à cette fin l’article 8 du code de procédure pénale :
- personnes vulnérables : le délai de prescription de l’action publique des délits d’abus de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance et recel commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse ne court qu’à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
3.2 - les exceptions jurisprudentielles
C’est dans ce contexte de multiples dérogations légales au principe général qu’il faut analyser la jurisprudence, souvent présentée très abusivement comme étant la source de la complexité de cette matière...
Cette dernière, qui diffère le point de départ de la prescription pour certaines infractions, pourrait en première analyse être considérée comme contra legem. Mais, force est de constater qu’elle répond au même principe que les lois particulières : faire respecter l’un des fondements de la prescription, le principe d’efficacité (au profit de la société et des victimes)... au risque d’une relative complexité, voire d’une certaine insécurité juridique (au seul détriment des mis en cause ou des auteurs).
C’est le cas en matière économique et financière lorsque l’infraction, bien qu’instantanée, soit s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, soit lorsqu’elle peut être considérée comme occulte ou clandestine par nature, soit enfin lorsqu’elle s’accompagne de manœuvres de dissimulation qui la rendent difficile à découvrir. Il est alors fait application de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir.
Lorsqu’une infraction comporte des remises successives de fonds ou des actes réitérés, la Cour de cassation fixe le point de départ de la prescription à la dernière remise ou aux derniers actes : escroquerie (chaque remise de fonds réitère l’infraction), corruption et trafic d’influence (l’infraction se renouvelle à chaque acte d’exécution du pacte entre le corrupteur et le corrompu), prise illégale d’intérêts (chaque exécution d’un contrat constitutif de prise illégale d’intérêts caractérise le délit), usage de faux, abus de faiblesse, abus de position dominante.
Concernant les infractions occultes par nature, le point de départ de la prescription doit être fixé, selon la Cour de cassation, non pas au jour de leur commission, mais "au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique". Cette jurisprudence reçoit notamment application pour l’abus de confiance et son recel, le détournement de fonds publics, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, les malversations, les tromperies.
Pour les infractions dissimulées, la cour de cassation repousse le point de départ du délai à compter de la date à laquelle l’infraction pouvait être découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique : atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats aux marchés publics, favoritisme, fraude en matière de divorce ou de séparation de corps. Pour l’abus de biens sociaux, la prescription de l’action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, l’information donnée dans les comptes permettant d’alerter les associés (Cass Crim 27 juin 2001). La règle est la même pour le recel d’abus de biens sociaux.
La jurisprudence adopte ici une position équilibrée entre le « droit à l’oubli » et la nécessaire sanction de comportements portant gravement préjudice à l’ordre public économique, qui sont par nature occultes.
Il faut avoir conscience que, dans ce domaine particulier, des difficultés spécifiques se posent aux parquetiers et juges d’instruction : complexité des faits et des responsabilités à établir (notamment quand diverses personnes morales sont impliquées dans un montage). De plus, il est très difficile de mener des investigations dans un délai raisonnable en raison du faible nombre d’enquêteurs spécialisés et de la sophistication des dispositifs de fraude, qui impliquent parfois des investigations en coopération avec d’autres Etats, investigations dont la durée ne peut être maîtrisée.
Dans une tout autre matière, par un arrêt du 7 novembre 2014, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a fait application de l’adage précité pour un crime d’infanticide et a admis la suspension de la prescription "en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites".
Cet arrêt est d’autant plus remarquable que, dans le cas d’espèce, tous les faits d’infanticide reprochés à l’intéressée n’auraient pas été prescrits si l’on avait appliqué les règles de droit commun. Il s’agit donc bien d’un arrêt de principe, rendu par la formation la plus solennelle de la cour de cassation et rédigé dans des termes généraux ayant vocation à s’appliquer à toutes les infractions de nature pénale.
Il convient de rappeler à cet égard que les auteurs du rapport parlementaire de 2007 préconisaient « de consacrer dans la loi la jurisprudence de la cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est révélée, et étendre cette solution à d’autres infractions occultes ou dissimulées dans d’autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle ».
Faute pour le législateur d’avoir statué en la matière, la jurisprudence a poursuivi son évolution, logique et prévisible.
Il convient par ailleurs de rappeler que par un arrêt du 20 mai 2011, rendue à la suite d’une QPC (jugement de l’ancien président Chirac), l’assemblée plénière de la cour de cassation avait confirmé sa jurisprudence en matière de report du point de départ de la prescription, pour les délits d’abus de biens sociaux (la cour avait rappelé que le régime de prescription ne relève pas « des principes fondamentaux des lois de la République » et pouvait donc donner lieu à une interprétation jurisprudentielle et que, en l’espèce, la jurisprudence ne portait pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines).
Le régime de prescription de l’action publique est donc le suivant :
- prévoyant des délais plus courts que la moyenne selon le droit comparé,
- comprenant de multiples exceptions légales, affinant le système mais nuisant à sa lisibilité,
- marqué par une jurisprudence en expansion en matière d’infractions potentiellement dissimulées.
B – Quelle évolution pour l’avenir ?
La mission d’information s’interroge sur les points suivants :
1- Vers un allongement de la durée de la prescription ?
L’USM n’est pas défavorable à un allongement de la durée des prescriptions en matière criminelle et délictuelle.
La multiplicité des régimes dérogatoires allongeant les délais de prescription démontre en elle-même que le régime général présente un caractère désormais trop restrictif. La brièveté des délais dans la législation française, en comparaison des législations de nos voisins européens, ne se justifie plus.
Il convient en outre de tenir compte de la demande sociale, très hostile à ce que des criminels bénéficient de l’application de ces dispositions. À cet égard, les décisions prises dans le cadre de l’affaire des disparus de l’Yonne ont été présentées comme des artifices conjoncturels destinés à éviter l’application de la prescription.
Il appartient donc au législateur d’assumer cette évolution, pour que l’institution judiciaire n’ait pas à assumer la responsabilité de devoir, le cas échéant, constater l’application de lois de prescription qui ne recueillent plus l’assentiment de la société.
Cet éventuel allongement des délais de prescription doit toutefois demeurer raisonnable.
Une durée excessive implique un risque de dépérissement des preuves, notamment en matière de fiabilité des témoignages, les progrès scientifiques ne permettant pas, à eux seuls, de régler tous les problèmes de preuve. Elle génère ainsi potentiellement de faux espoirs pour les victimes en laissant s’effectuer ou poursuivre des enquêtes dans des conditions ne permettant pas au final de réunir des preuves suffisantes contre un éventuel suspect. C’est au final l’institution judiciaire qui, comme souvent, serait mise en cause à l’issue de ces procédures injustement perçues comme des échecs.
Enfin, il convient de rappeler qu’un allongement des délais de prescriptions implique mécaniquement des enquêtes et poursuites en nombre plus important, alors même que l’institution judiciaire est exsangue, en difficulté majeure pour traiter avec diligence les procédures qui lui sont aujourd’hui soumises. Là encore, il est important de ne pas susciter des espoirs qui ne pourraient être suivis d’effets.
2- Le report du point de départ de la prescription pour certaines infractions : pour son maintien
Certains partisans de l’allongement des délais de prescription présentent comme corollaire à celui-ci la fin du régime de report du point de départ de la prescription pour certaines infractions.
L’USM est fortement opposée à cette proposition. Ainsi que cela a été rappelé, le report du point de départ de la prescription a été prévu par la loi pour certaines infractions, en raison de leur nature occulte, dissimulée, ou continue et pour certaines victimes, mineures, vulnérables...
La justification de ces régimes dérogatoires (pour l’essentiel d’origine législative) repose sur des fondements qui n’ont qu’un lien indirect avec la durée de la prescription. L’incapacité à agir du mineur (d’une durée potentielle de 18 ans), l’incapacité du majeur vulnérable (qui peut être très brève ou définitive), le caractère dissimulé de l’infraction (d’une durée également très variable) sont des données qui varient d’un cas à l’autre. Faut-il par volonté de « simplifier » prendre le risque que certaines infractions ne puissent être jamais poursuivies parce que commises sur des mineurs extrêmement jeunes ou à l’encontre d’adultes durablement vulnérables etc ?...
Le régime dérogatoire relatif aux mineurs doit être maintenu : indépendamment de la durée de prescription des infractions commises à leur encontre, ils ne sont pleinement en capacité d’agir et de dénoncer ces faits qu’à compter de leur majorité. Cette dérogation doit donc être maintenue. Il convient même de s’interroger sur une extension de cette dérogation à d’autres infractions que celles retenues par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, et notamment à certaines infractions d’atteintes aux biens, qui ne sont qu’imparfaitement couvertes par le 3ème alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale.
Le régime relatif aux personnes vulnérables doit être également préservé. C’est très logiquement que le législateur a créé cette dérogation en 2011. Les victimes se trouvent dans une situation ne leur permettant pas d’agir et l’autorité judiciaire peut dès lors ne pas être avisée de faits graves. Faire courir un délai de prescription, même long, serait en contradiction avec les fondements théoriques de la prescription (il n’y aurait en l’espèce ni désintérêt de la victime, ni carence de l’autorité judiciaire). Cela reviendrait à favoriser l’éventuelle impunité de l’auteur.
L’argument selon lequel il y aurait une « insécurité juridique », du fait du caractère incertain du point de départ, est relativement spécieux : en l’occurrence cette insécurité ne concerne que l’auteur des faits et n’est liée qu’à la conséquence de son choix de s’attaquer à une personne vulnérable...
Le régime (jurisprudentiel) relatif aux infractions dissimulées et continues doit également être préservé. Comme les auteurs du rapport sénatorial de 2007, l’USM estime que la seule évolution envisageable en la matière serait son inscription dans la loi.
S’agissant des infractions dissimulées, le régime dérogatoire se justifie par un raisonnement analogue à celui relatif aux personnes vulnérables : il n’y a pas de désintérêt de la victime à sanctionner puisque celle-ci est artificiellement tenue dans l’ignorance de l’infraction jusqu’à ce que les circonstances lui permettent de découvrir qu’elle a été trompée (abus de confiance, abus de biens sociaux...). Il n’y a pas davantage de carence de l’autorité judiciaire, qui n’est pas mise en mesure d’engager une enquête ou des poursuites à l’encontre d’un acte qui est caché...
S’agissant des infractions continues, elles sont parfois présentées comme imprescriptibles de fait, ce qui est inexact. Elles ne se prolongent que du fait d’une décision de l’auteur qui, s’agissant du recel d’un bien par exemple, pourrait parfaitement, en s’en dessaisissant, faire courir la prescription.
L’USM est donc très défavorable à une modification qui, sous couvert de volonté de simplification, de sécurité juridique, serait de nature à ne profiter au final qu’aux auteurs de ces infractions.
Le fait que certaines de ces infractions soient de nature économique et financière pourrait prêter à interrogation sur les motivations principales d’une réforme en la matière.
3- Définition et effets des actes interruptifs de prescription :
Faut-il que le législateur définisse les actes interruptifs de prescription ? L’USM estime que cela serait illusoire, voire dangereux.
En l’état, la prescription est interrompue par tout "acte d’instruction ou de poursuite". Le législateur n’a pas déterminé la liste de ces actes et la jurisprudence a donc dû préciser ces notions. Elle en a également fixé les limites (refusant par exemple cette qualification à des actes de pure administration interne comme des cédules de citation...). Elle a précisé que ces actes n’interrompaient la prescription que s’ils avaient été réalisés par d’un officier public compétent et étaient réguliers en la forme.
La complexité de la matière apparaît pleinement. Les actes recouvrent une plénitude de situations telle que la loi ne peut pas prétendre à l’exhaustivité. Une énumération limitative des actes susceptibles d’interrompre ou suspendre la prescription risquerait de nuire à l’efficacité des enquêtes et d’empêcher certaines poursuites.
En effet, si l’on fait le parallèle avec l’article 707-1 du code de procédure pénale, relatif aux actes interruptifs de la prescription de la peine, force est de constater que le législateur a dû le rédiger dans des termes très généraux, faute de pouvoir embrasser l’ensemble des actes possibles.
Une modification des articles 7, 8 et 9 pour y apporter une définition des « actes d’instruction et de poursuites », en termes généraux, n’est pas pour autant opportune.
Cela ne reviendrait, de fait, qu’à renvoyer pour l’application concrète de ce texte à l’état de la jurisprudence actuelle...
4- Pour un alignement des délais de prescription de l’action publique et de la peine :
Les fondements de la prescription des peines sont globalement les mêmes que ceux de la prescription de l’action publique : droit à l’oubli, intérêt du condamné à ne pas commettre de nouvelle infraction, perte du caractère rétributif de la peine avec le temps.
Cette prescription est cependant à manier avec précaution car elle remet en cause l’autorité de la chose jugée et donne une image d’impunité du condamné, profitant en priorité à ceux qui sauront déjouer les recherches dont ils feront l’objet. Comme en matière d’action publique, le droit à l’oubli n’est plus socialement accepté en matière de prescription de la peine.
En l’état, le délai de prescription de la peine dépend en principe de la nature de l’infraction sanctionnée :
- 20 ans pour les crimes
- 5 ans pour les délits
- 3 ans pour les contraventions.
Le délai court à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
S’il peut être envisagé l’allongement de la prescription de certaines peines, il faut garder en mémoire que l’existence d’une peine à exécuter peut faire obstacle à la réinsertion du condamné qui n’a pas cherché à échapper à l’exécution de la peine mais pour lequel cette mise à exécution tarde.
Par ailleurs, il n’est pas forcément logique que la prescription des peines prononcées pour des contraventions ou des délits en droit de la presse soit de trois ans ou cinq ans alors que l’action publique se prescrit beaucoup plus rapidement, en trois mois ou un an.
Enfin, comme pour l’action publique, la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir (contra non valentem agere non currit praescriptio). Ainsi, l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution d’une peine alors que le condamné purge, dans le pays de condamnation, une peine prononcée à l’étranger, suspend le délai de prescription de la peine prononcée en France.
Ces éléments étant rappelés, l’USM estime que, dans l’hypothèse d’un allongement des délais de prescription de l’action publique, telle que suggéré par la mission d’information, il pourrait être envisagé un alignement des délais de deux types de prescription.
Le bureau de l’USM
Contribution du Syndicat de la magistrature
Héritée du droit romain, la prescription en matière pénale a toujours existé dans le corpus juridique français. Les règles en ont été fixées, dans notre droit positif, par la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant le code de procédure pénale. Pendant longtemps, elles n’ont connu que peu de modifications. Mais depuis la fin des années quatre-vingt, les lois se sont succédées pour modifier, de manière parcellaire, les dispositions relatives à la prescription de l’action publique, introduisant des exceptions, toujours dans le sens d’un allongement des délais de prescription.
Cette succession de lois a bouleversé la logique du régime de la prescription pénale en tirant toujours plus vers l’imprescriptibilité, tout en lui faisant perdre toute cohérence. Ainsi des délits se voient appliquer un délai de prescription plus long que des crimes et la durée de la prescription n’est plus proportionnelle à l’échelle des peines. À titre d’illustration, le délai de prescription des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises sur un mineur de 15 ans (qui constituent un délit) est de 20 ans, alors que le délai de prescription du meurtre d’un mineur de 15 ans, non accompagné de viol ou de torture ou d’acte de barbarie (qui est un crime) est de 10 ans.
La réflexion sur la prescription et ses modifications est devenue une constante du débat politique sur la répression des faits criminels, sous le seul axe de l’étirement contenu de la prescription dans le domaine des infractions à caractère sexuel. Ce débat a ressurgi en 2014 avec la discussion d’un projet de loi modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, auquel le Syndicat de la magistrature s’est déclaré hostile.
Curieusement une tendance inverse se manifeste pourtant en matière économique et financière, la sécurité juridique des entreprises venant opportunément au secours d’une conception restrictive des délais de prescription. On observera d’ailleurs que la tendance du législateur est encore inverse en matière civile. Ainsi, la grande loi réformant la prescription civile du 17 juin 2008 a considérablement raccourci le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, en faisant passer ce délai de 30 ans à 5 ans. Or, qu’est-ce que le procès civil, si ce n’est le procès de la réparation du préjudice personnel de la victime et comment comprendre que la focalisation sur la défense de ses intérêts soit réservée au procès pénal ? Cette inclination du législateur civil s’est poursuivie, puisque plus proche de nous, la loi ALLUR du 24 mars 2014, a introduit dans la loi du 6 juillet 1989 un abaissement du délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail de cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. De même, la loi dite « de sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013 a ramené à deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, le délai dans lequel se prescrit toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Le syndicat de la magistrature n’entend pas répondre aujourd’hui à l’ensemble des questions de la mission d’information dont certaines, particulièrement techniques, mériteraient un travail approfondi que les délais impartis ne lui ont pas permis de réaliser. Mais il souhaite rappeler certains fondamentaux, battre en brèche les nouveaux poncifs sur la question et en appeler à la responsabilité du législateur. Son propos portera essentiellement sur la prescription de l’action publique, la question de la prescription des peines, quoique très technique, n’appelant qu’un bref développement.
I - Un allongement de la prescription inutile ou l’illusion de la poursuite éternelle.
I. 1. Des fondements traditionnels loin d’être obsolètes.
Les fondements de la prescription sont aujourd’hui contestés par des juristes et des parlementaires, relayant les demandes de victimes et d’associations bercées par l’illusion de la « sécurité » que procurerait une répression étendue dans le temps, notamment par le recours à des modes de preuves qualifiés de « scientifiques ». Ce mouvement participe clairement de la diffusion de doctrines déséquilibrées, où la nécessité de réprimer fait loi.
Le Syndicat de la magistrature estime au contraire indispensable de rappeler combien la prescription de l’action publique est un socle fondamental du droit pénal et du droit constitutionnel à la sûreté, lequel protège le citoyen contre l’arbitraire étatique.
- La prescription, instrument d’apaisement social.
L’idée fondatrice est que le temps faisant son œuvre, l’atteinte à l’ordre public causée par l’infraction disparaît peu à peu et qu’il convient de ne pas réactiver inutilement ce trouble en poursuivant tardivement l’infraction. La prescription « est fondée sur l’utilité sociale et non instituée en faveur de l’accusé. » (cf F. Hélie : Traité de l’instruction criminelle, 2ème édition, Tome II, Paris, Henri Plon, 1866, n° 1051, cité par Gérard Poirotte dans son rapport préalable à l’arrêt de l’assemblée plénière du 24 octobre 2014). C’est l’intérêt de la société qui est pris en compte.
Le droit pénal est en fait une branche du droit public. Il est le droit de «l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre ». (Jean Pradel in Droit pénal général ed. CUJAS, 19ème édition). C’est là toute l’ambiguïté de la place prise par la victime dans le procès pénal, certes légitime à mettre en œuvre l’action publique et à demander réparation, mais qui ne saurait devenir le personnage central d’une procédure asservie à ses seuls intérêts.
Le procès pénal est avant tout la réponse de la société à un acte qui a atteint sa cohésion. Il s’adresse d’abord à son auteur, qu’il entend punir mais aussi, en lui permettant de s’amender, réintégrer, dans le corps social.
- Le droit à l’oubli.
La prescription est également justifiée par l’existence d’un droit à l’oubli. Ce fondement, souvent confondu avec celui de la nécessité de la paix sociale, repose sur l’idée qu’avec le temps l’auteur de l’infraction, qui n’a plus troublé l’ordre public depuis lors et a nécessairement connu une évolution individuelle – autrement dit, qui n’est plus celui qui a commis l’infraction - a droit à ce que la société oublie qu’il a transgressé ses lois.
Le nouveau postulat contraire serait que l’oubli de l’infraction, tant par la victime que par la collectivité, ne serait plus « un phénomène inéluctable » (Jean Danet, La prescription de l’action publique : quels fondements et quelle réforme in AJ Pénal 2006, p. 285).
Ceux qui refusent ce droit à l’oubli affirment que, dans la société contemporaine, l’oubli est devenu impossible et insupportable, car nous sommes dans « la société des médias », ces derniers réactivent sans cesse, dans l’opinion publique, la mémoire des faits divers. Mais, outre qu’il est du devoir du législateur responsable de ne pas succomber à ce qui est communément appelé la « dictature de l’opinion », il apparaît surtout que, dans cette fameuse « société des médias », « une information chasse l’autre » et que l’accumulation d’informations entraîne, au contraire, la banalisation et l’oubli plus rapide des faits criminels.
Ceux qui réfutent ce droit à l’oubli invoquent d’autre part « le devoir de mémoire ». Mais ils se trompent alors de champ conceptuel. Le devoir de mémoire est le devoir moral de l’Etat d’entretenir la mémoire des souffrances endurées par les victimes de crimes collectifs incontestables. Le droit n’est pas la morale. Le droit à l’oubli est la reconnaissance, par la société qui a failli en ne poursuivant pas l’auteur d’un délit (ou - rarement – d’un crime), que cet homme a le droit - au bout de plusieurs années et souvent parce qu’il a changé - de poursuivre son existence sans être suspendu à des poursuites ou à une condamnation intervenant alors même que le temps a fait son œuvre.
- Le dépérissement des preuves.
Avec les années, les traces ou les indices disparaissent et les témoignages deviennent plus fragiles, si bien que les risques d’erreurs judiciaires augmentent. Le Syndicat de la magistrature a toujours mis en garde contre les discours visant à affirmer que les preuves scientifiques, comme la recherche d’ADN ou d’autres techniques de preuve, même non encore connues, permettraient de surmonter le dépérissement des preuves. Il estime aujourd’hui fondamental de rappeler que la preuve scientifique n’est pas la reine des preuves, qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments et que son utilisation aveugle, trop longtemps après les faits, porte une atteinte aux droits de la défense dont les conséquences peuvent s’avérer catastrophiques.
La preuve scientifique ne met pas à l’abri d’une erreur judiciaire. À titre de démonstration, en voici une illustration concrète, tirée de la réalité. Lors d’un vol à main armée, les policiers retrouvent sur les lieux des faits une cagoule artisanale (bonnet avec des trous aux ciseaux pour la bouche et les yeux). Cette cagoule présente une trace ADN exploitable qui permet d’arriver, plusieurs mois après, à un individu « connu des services de police ». Les enquêteurs placent l’individu en garde à vue. Interrogé sur la présence de son ADN dans le bonnet, celui-ci répond qu’il est possible que le bonnet lui ait appartenu, qu’en tout cas il a été en possession d’un bonnet similaire, mais nie toute participation aux faits. Il suppose alors qu’il a perdu ce bonnet, lequel a été trouvé par les véritables auteurs des faits. Lorsque la date des faits lui est précisée, il fournit un alibi, dont il peut se souvenir puisque l’enquête se déroule à une date proche de celle des faits. Vérification faite, l’alibi est confirmé par des témoins. Que se serait-il passé si l’individu dont l’ADN était dans la cagoule n’avait pas été capable de se souvenir de son alibi, non plus que les personnes susceptibles de le confirmer ?
Il faut également garder à l’esprit que la preuve scientifique est une preuve manipulable. Elle peut toujours, notamment, être apportée sur les lieux des faits de manière artificielle. Ainsi, un détenu en détention provisoire, là encore pour vol à main armé, confondu parce qu’un mégot porteur de son ADN avait été retrouvé sur les lieux, a-t-il envisagé de demander à un de ses visiteurs, en prison, de déposer un mégot portant son ADN sur les lieux d’un nouveau vol à main armé et ce, afin de ruiner la portée de la preuve apportée par le premier mégot.
Il faut rappeler par ailleurs qu’en matière de crime ou de délit commis sur les mineurs ou sur les personnes dans une situation de vulnérabilité ou de faiblesse, il n’est que très rarement conservé de « traces », de preuves « scientifiques » des faits. Les victimes qui viennent porter plainte des années après les faits n’ont pas conservé de preuves matérielles : elles ne viennent qu’avec leurs souvenirs. Les enquêtes portant sur des viols ou des agressions sexuelles commis sur un mineur ou sur une personne vulnérable se résument le plus souvent à l’opposition de « la parole de l’un contre la parole de l’autre ». Les enquêteurs essaient alors de rassembler des preuves indirectes, notamment d’un changement de comportement de la victime. Il n’est pas rare, par exemple, que l’instituteur de l’enfant soit entendu. Comment demander trente ans après les faits à un instituteur s’il n’a pas remarqué un changement de comportement chez l’enfant à la date supposée des faits ?
Comme l’écrit Xavier LAMEYRE (La prescription de l’action publique en matière d’infractions contre les mineurs, ou les dysharmonies d’un régime pénale d’exception, AJ Pénal 2006 p. 289) « même si la réalité des faits peut être particulièrement vivace chez la victime, ce serait attribuer à la justice pénale une puissance magique ou oraculaire que de l’imaginer capable de gommer les distances temporelles qui érodent inexorablement les preuves »
Cette croyance quasi religieuse en la preuve scientifique révèle qu’une réflexion doit absolument être engagée sur les techniques d’enquête et le recours à de tels instruments.
- La prescription, sanction de la négligence à exercer les poursuites.
Ce fondement rejoint l’impératif de juger dans un délai raisonnable. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable rappelé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est un fondement de notre société démocratique. Si le sentiment d’incompréhension que peut susciter cette affirmation pour certaines victimes peut être entendu, il ne saurait justifier à lui seul la consécration d’un déséquilibre entre le nécessaire respect des principes du procès équitable et le souci des victimes.
C’est que la pénalisation n’épuise pas - bien au contraire - les réponses que peut donner la société aux souffrances réelles exprimées.
I. 2. Le renoncement à la prescription : un leurre et une source de souffrances supplémentaires pour la victime.
L’argument fort des partisans de l’allongement, voire de la suppression de la prescription est celui qui repose sur la prise en compte des victimes. Ils insistent sur la dimension thérapeutique du procès, qui permettrait seul à la victime de faire son deuil du traumatisme causé par l’infraction.
C’est oublier, d’abord, que le procès qui se termine par un acquittement ou une relaxe « au bénéfice du doute » en raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves est d’une très grande violence pour la victime. Elle vit ces décisions comme une négation de sa parole et ce, alors qu’elle a supporté la réactivation de son traumatisme et, parfois, le mépris renouvelé de la personne mise en cause tout au long de l’enquête et du procès.
Même en cas de déclaration de culpabilité, le procès qui intervient trop longtemps après les faits ne peut se terminer que par une « peine symbolique ». Il ne pourra donc apaiser les souffrances de la victime, car si la société démocratique admet et réclame l’individualisation des peines, la victime ne peut la supporter.
En réalité, la compassion étant érigée en vertu cardinale contemporaine, l’attente sociale d’une poursuite et d’une répression imprescriptibles de certaines infractions alimente la hantise des hommes et femmes publiques de se voir reprocher une absence de sensibilité au sort des victimes. Pourtant, comme le souligne Myrian Revault d’Allonnes (in L’homme compassionnel ed du Seuil 2008) « la mise à distance des affects » est nécessaire « pour que s’opère le travail du rationnel ».
Par ailleurs, la prise en compte de la dimension thérapeutique du procès pénal n’est pas univoque. Ainsi Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière peuvent-ils écrire dans « Le temps des victimes » (Albin Michel 2007) : « Le traitement judiciaire suspend abusivement le travail de deuil. C’est bien ce que disent les victimes elles-mêmes lorsqu’elles expliquent qu’elles ne le commencent qu’à l’issue du procès ».
Il est crucial que la société vise à une meilleure prise en considération et dénonciation sociale des violences sexuelles ainsi qu’à la définition de solutions thérapeutiques de reconstruction personnelle et offre aux victimes une reconnaissance. Mais il est dangereux et illusoire de prétendre que le procès pénal - étiré à l’infini pour ne laisser personne sur le bord de la route - constituerait une réponse à ce besoin de se voir « reconnu dans un statut de victime » par l’affliction imposée à celui qui est désigné comme le responsable. La société tromperait les victimes en leur présentant le procès pénal comme la réponse à leurs attentes.
II – L’encadrement nécessaire de la prescription : une durée unifiée et des conditions restrictives de report, de suspension et d’interruption
II. 1. L’admission légale du report du point de départ de la prescription
En matière pénale, la prescription a connu un double mouvement d’allongement de sa durée et de report de son point de départ dans le domaine des infractions à caractère sexuel et notamment celles commises sur des victimes mineures.
Le report du point de départ de la prescription à l’âge de 18 ans pour les faits commis pendant la minorité est conforme à la nécessité de protection de l’enfance comme à la réalité des obstacles qui heurtent la capacité de l’enfant à initier une procédure pénale. Le Syndicat de la magistrature n’en conteste pas le bien fondé.
Mais c’est bien l’effet conjugué de ce report et de l’allongement continu (d’ailleurs extrêmement complexe) de la durée de la prescription qui dévoie l’équilibre de la procédure pénale.
En effet, la volonté de rompre avec la sous-dénonciation des délits et crimes à caractère sexuel, majoritairement commis dans un milieu familial ou de proximité, ne saurait justifier de telles brèches dans le système de la prescription. C’est au contraire par une attention renouvelée à ces faits et par une meilleure connaissance des déterminants de ces actes comme de leurs conséquences sur les victimes et des symptômes qu’elles présentent que la prévention pourra se développer et cette sous-dénonciation reculer. Le Syndicat de la magistrature revendique donc le retour, pour l’ensemble des infractions, au délai classique de prescription de l’action publique de 10 années, qui ménage tout à la fois le temps parfois nécessaire à la dénonciation des faits et l’assurance d’une procédure équitable pour les parties au procès.
Ce refus de délais de prescription rallongés n’est pas incompatible avec la conviction de la nécessité, en certaines matières d’infractions « clandestines », de reporter le point de départ de la prescription. Il s’agit d’infractions occultes commises en matière économique et financière dont la spécificité tient dans un double obstacle : les faits commis l’ont été à l’abri des regards (obstacle classique en matière pénale) et les victimes des faits tardent à découvrir qu’elles sont victimes de faits délictueux. C’est bien cette dernière spécificité qui justifie le report du point de départ de la prescription en matières d’atteintes économiques et financières occultes, faute de quoi on renoncerait à la pénalisation d’actes de délinquance hautement préjudiciables à la société.
Dans ses observations sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, le Syndicat de la magistrature avait déjà demandé, le 28 mai 2013 qu’il soit « inscrit dans la loi que le délai de prescription de l’action publique commence à courir, en cas de dissimulation de l’infraction, au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ». Il rappelait alors qu’il s’agissait de consolider la jurisprudence de la cour de cassation et ce, afin de se conformer aux engagements pris par la France en signant la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Celle-ci dispose, dans son article 29 : « chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice ».
Il apparaît en outre nécessaire que le législateur intervienne pour définir ce qu’est une infraction occulte justifiant le report du point de départ de la prescription et ce, afin de satisfaire les impératifs de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale. Aujourd’hui, c’est à la Cour de cassation, que revient la tâche de dire quelle infraction est occulte - et justifie en conséquence un report du point de départ de la prescription - et laquelle ne l’est pas. Elle le fait au cas pas cas, selon les infractions qui lui sont soumises. Ainsi juge-t-elle que l’infraction de malversations est une infraction dissimulée tandis qu’elle refuse le même qualificatif à l’infraction de prise illégale d’intérêt.
Ce report de la prescription doit rester strictement attaché à l’ignorance dans laquelle sont maintenues les victimes des faits qui leur sont préjudiciables. Il ne saurait être question en ce domaine - celui du droit pénal et de son interprétation stricte - d’envisager une définition trop subjective et imprévisible de ce caractère occulte ou de l’ignorance des victimes. Ainsi, il serait extrêmement dangereux d’envisager en matière de délinquance sexuelle, sur des bases scientifiques peu fiables et contestées, un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle la victime se remémorerait les faits après une période de « refoulement », interrompue par exemple par une pratique de la thérapie. La fragilité psychologique des plaignants ne peut servir à légitimer un tel report de la prescription, qui rend encore plus complexe le rôle d’établissement de la vérité judiciaire dans un procès où viendraient se confronter, potentiellement plusieurs décennies après les faits, une parole incertaine faite de « souvenirs » enfouis - au risque d’avoir été reconstruits, altérés - à une parole incapable de se défendre autrement que par la dénégation non « étayable ».
Ainsi, le Syndicat de la magistrature rejette toute réforme qui impliquerait un report sur des critères « subjectifs » du point de départ de la prescription lorsque la victime subit physiquement et directement les faits, quelle qu’en soit la gravité.
II. 2. La détermination légale du point de départ de la prescription en cas de report.
S’il est admis que le point de départ de la prescription puisse être reporté pour les infractions « clandestines » ou « occultes », encore faudrait-il que le justiciable puisse connaître quel sera ce point de départ. Aujourd’hui c’est à la jurisprudence, dans ce domaine encore, qu’est laissé le soin de définir ce point de départ, avec le risque des revirements ou évolutions impromptues, comme cela a été le cas en matière d’abus de bien sociaux. En effet, la cour de cassation a d’abord jugé, par un arrêt du 7 décembre 1967, « qu’en matière d’abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté ». Par un arrêt du 10 août 1981, elle a ajouté que, pour faire courir le délai de prescription, l’infraction devait être apparue et avoir été constatée « dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique». Enfin, par un arrêt du 5 mai 1997, elle a décidé qu’il « se déduit des articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 que la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ».
La reconnaissance par la jurisprudence du caractère occulte du dommage causé à la société et de la nécessité d’un report du point de départ de la prescription a permis d’assurer que ces atteintes ne restent pas impunies.
Le Syndicat de la magistrature estime crucial de consacrer cette jurisprudence en l’inscrivant dans les textes par une définition, dans la mesure du possible, de l’événement constituant le point de départ des infractions occultes. Une réflexion pourrait être engagée pour évaluer la pertinence d’une définition propre à chaque infraction.
II. 3. La définition des actes ou événements suspendant la prescription des infractions
Un récent arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation peut être interprété comme un appel à l’intervention du législateur en la matière pour garantir la sécurité juridique. Elle a en effet jugé le 7 novembre 2014 (n°14-83.739), à propos d’une infraction d’infanticide, que la « clandestinité des naissances et des morts caractérisait un obstacle insurmontable à l’engagement des poursuites » et que « de ce fait, le délai de prescription s’est trouvé suspendu jusqu’à la découverte des corps ». Dans son communiqué de presse, la Cour a souligné qu’elle avait « consacré ainsi un principe de suspension du délai de prescription, en cas d’impossibilité absolue d’engager ou d’exercer des poursuites pour les infractions de nature criminelle ». Quoique la Cour de cassation ne juge qu’en droit, cette décision est, sans aucun doute, liée à la nature des faits qui lui étaient soumis, une mère ayant par huit fois tué son enfant à la naissance.
Cette jurisprudence est tout à la fois très circonstancielle et préoccupante quant à l’évolution de la notion d’infraction « clandestine ». En effet, ce n’est pas tant le meurtre qui était occulte que la naissance des enfants (la décision relevant que l’entourage proche de l’accusée ne pouvait avoir conscience de ses grossesses successives).
Le Syndicat de la magistrature rappelle que la notion « d’impossibilité absolue d’engager ou d’exercer des poursuites » doit demeurer d’interprétation stricte afin d’éviter des dérives. Si banal soit ce constat, il faut rappeler que c’est le propre du criminel que de tenter de dissimuler son acte : une conception extensive de l’impossibilité d’engager des poursuites conduirait à la négation même de la logique de la prescription.
III - Sur la prescription des peines.
L’obsession pour le nécessaire allongement des délais de prescription n’épargne pas le domaine de la prescription des peines. C’est alors le discours catastrophiste sur l’état d’inexécution des peines en France qui est invoqué pour allonger les délais de prescription (fixés à 5 années pour les délits et 20 ans pour les crimes).
Le Syndicat de la magistrature affirme sa forte opposition à toute réforme visant à l’allongement de délais de prescription déjà particulièrement longs. Il conteste la vision simpliste ainsi portée sur la question de l’inexécution des peines puisque sont mêlées dans les chiffres évoqués publiquement (entre 100 000 et 80 000 peines) les peines non encore signifiées à la personne (et donc non encore définitives quoi qu’exécutoires pour les peines d’emprisonnement ferme), les peines en attente d’aménagement par le juge de l’application des peines et les peines en attente d’exécution dans les commissariats.
Si les peines ne sont pas exécutées, c’est rarement parce que le condamné s’y soustrait, mais plus généralement parce que l’État ne les met pas à exécution. Aussi, pour éviter la prescription des peines, ce n’est pas l’allongement des délais de prescription qu’il faut instaurer, mais l’allocation de davantage de moyens à l’exécution des peines, aux alternatives à l’incarcération (des places de semi-liberté ou de placement extérieures aux structures publiques ou privées permettant la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général), accompagnée d’une réflexion sur le sens de la peine et de la pénalisation de certains actes.
Il importe également de rappeler que ces peines inexécutées concernent des peines délictuelles, inférieures à deux ans (sauf rares exceptions), et même de très courtes peines. L’allongement du délai de prescription des peines conduirait indubitablement à des mises à exécution dépourvues de sens lorsque l’incarcération intervient plusieurs années après la condamnation et encore plus après la commission des faits, sans égard pour le passage du temps comme l’évolution de la personne.
Il est d’ailleurs important de rappeler que l’article 707-1 alinéa 5 prévoit déjà des causes d’interruption ou de suspension de la prescription : « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution ». Ce dispositif est contestable dans la mesure où elle définit de manière extrêmement large les faits interruptifs de la prescription. Ainsi, en application de ce texte, la saisine du juge de l’application des peines aux fins d’aménagement intervenant quelques jours ou mois avant la fin du délai de 5 années aurait pour effet d’empêcher la prescription de la peine, alors que l’incurie est imputable à l’Etat.
Le Syndicat de la magistrature rappelle l’absolue nécessité d’une définition restrictive de la prescription des peines comme de ses causes d’interruption.
Contribution du Syndicat de la presse quotidienne régionale / Union de la presse en région
La Presse Quotidienne Régionale et Départementale diffuse chaque jour 430 éditions de 63 titres auprès de 4,8 millions d’acheteurs – soit une audience imprimée de 18,5 millions de lecteurs quotidiens.
Sur les sites de ces journaux, l’audience numérique est de 16,5 millions de V.U. (530 millions de pages vues).
5000 journalistes et 20 000 correspondants contribuent dans ce cadre au développement du premier vecteur d’information et du premier lien social en France.
La déontologie est une préoccupation constante des éditeurs et des équipes. C’est pourquoi nous attachons une très grande importance au cadre d’exercice stable, éprouvé et efficace qu’a donné la loi de 1881 (ce qui n’empêche pas la presse en région d’adopter des « Règles et Usages » qui illustrent concrètement les bonnes pratiques que nous comptons respecter).
*************
Cette mission de réflexion autour de la durée de prescription en matière de droit de la presse est préoccupante dans un contexte de fragilisation de la loi de 1881 :
- Ces dernières années, de nouvelles infractions de presse ont été introduites, tantôt dans la loi de 1881 tantôt dans le Code pénal (interdiction de publier des photos de personnes menottées / loi Guigou ; introduction des délits motivés par l’homophobie, le sexisme, l’handiphobie, nouvelle infraction d’apologie du terrorisme, …) ;
- La prescription trimestrielle, objet de ce questionnaire, a fait l’objet d’attaques successives. La liste des exceptions introduites par la loi Perben II faisant passer en 2004 ce délai de 3 mois à un an pour les infractions dites les plus graves s’en est récemment vue ajouter de nouvelles par une loi du 13 novembre 2014 malgré les nombreuses décisions de la Cour de cassation qui rappellent le caractère d’ordre public de ces courtes prescriptions.
Ces réformes ont été prises en réaction à des évènements qui ont marqué l’opinion publique et au développement des nouvelles technologies sources d’inquiétudes mal définies. Pour autant, prises dans leur ensemble, elles bouleversent la cohérence générale de la loi de 1881 et contribuent à l’affaiblir considérablement.
Il est impératif de rappeler que cette loi n’est pas pour autant l’instrument d’une impunité supposée des médias. Figure emblématique en droit français de la liberté d’expression, elle l’encadre strictement.
La question de la place qu’il convient de laisser à la liberté d’expression et à la liberté de la presse dans une société démocratique doit être posée clairement et dans son ensemble.
1. Quels sont les fondements et justifications du délai de prescription abrégé de trois mois applicable à certaines infractions de presse (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) ? Ces fondements et justifications vous paraissent-ils toujours justifiés ?
Réponse :
La question serait plutôt de savoir sur quels fondements les délais de prescription ont été allongés de 9 mois dans certains cas.
Le législateur a intitulé la loi du 29 juillet 1881, « loi sur la liberté de la presse ». La courte prescription en constitue une mesure phare à trois égards au moins.
1/ Une actualité chasse l’autre, et la presse doit au regard de ce principe être protégée d’un contexte législatif trop insécurisant.
C’est sur ce constat que le législateur a introduit dans la loi de 1881 la courte prescription de 3 mois comme principe fondateur de la liberté d’expression.
Elle était justifiée par le rapporteur de cette loi en ces termes :
« Elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire à l’origine ; lorsque enfin le long silence de l’autorité élève une présomption si forte contre la criminalité d’une publication. Il a donc paru convenable d’abréger beaucoup le temps de prescription de l’action publique. »
Notons qu’un principe de courte prescription de l’action publique avait pré existé puisqu’une loi du 26 mai 1819 prévoyait une prescription de l’action publique de 6 mois (une prescription de l’action civile de 3 ans).
Un décret du 17 février 1852 avait ensuite posé le principe d’une prescription à 3 ans de l’action publique et de l’action civile.
C’est à ce dernier que la loi de 1881 est venue mettre fin, sans débat ni contradiction dans l’hémicycle.
2/ Une personne visée dans un article dont elle considère les termes injurieux ou diffamatoires n’attend pas pour agir.
3/ Les éléments de l’enquête du journaliste ne peuvent être conservés sur une durée longue.
Ces constats n’ont pas changé avec le temps et l’heure d’Internet ne les modifie en rien.
La Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel ont à plusieurs reprises réaffirmé le caractère d’ordre public de cette courte prescription, applicable tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales385.
En quoi les propos diffusés sur Internet seraient moins accessibles qu’au 19è siècle ?
Au contraire, les moteurs de recherche, les mots-clés, les politiques de référencement permettent de repérer plus vite ce qui est diffusé.
C’est la loi Perben II en 2004 qui a constitué la première brèche en intégrant une exception à la prescription de 3 mois, la faisant ainsi passer à un an, pour certains des délits considérés comme les plus graves (provocation à la discrimination et à la haine raciale, diffamation et injure raciale à caractère raciste). Cette loi a été suivie en 2014 d’une nouvelle loi ajoutant à la liste des exceptions deux autres délits de presse (provocation à la discrimination et à la haine, diffamation et injure, à raison de l’orientation sexuelle du sexe ou du handicap) ;
La gravité de ces délits n’est pas contestable, et les sanctions dont ils sont assortis le caractérisent. Pour autant, ils ne doivent pas justifier une atteinte au principe de la liberté d’expression fondateur de la loi de 1881 et inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme.
De 1881 à 2004, la prescription de 3 mois a été la règle et a permis un exercice de la liberté de l’information compatible avec le droit du citoyen.
2. Vous apparaît-il pertinent de faire bénéficier du délai de prescription abrégé de trois mois l’ensemble des personnes susceptibles de s’exprimer sur Internet ?
Réponse :
Nous parlons ici ès qualité au nom des publications et des sites d’information.
Mais la loi de 1881 concerne non seulement la Presse, mais au-delà le cadre de la liberté d’expression inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et dans la CEDH.
Dans ce cadre, il nous semble qu’il serait logique que le curseur soit le même pour tous.
3. Pensez-vous que la fixation à un an du délai de prescription pour certaines infractions commises par voie de presse (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, contestation des crimes contre l’humanité) permette d’en assurer une meilleure répression ?
Réponse :
La question devrait plutôt être posée aux associations ou aux personnes qui poursuivent en justice.
Pour autant nous ne le pensons pas, car cette question ne peut être posée dans l’absolu mais dans le cadre légal dans lequel elle se place.
La courte prescription de 3 mois, protectrice des intérêts de la presse, a pour contrepartie la liste des délits de presse inscrits dans la loi et fondés sur une présomption de mauvaise foi (la charge de la preuve repose sur le journaliste).
En conclusion, il nous apparaît surtout que l’allongement des délais de prescription fragilise l’exercice de la profession en créant une insécurité – le contexte pouvant modifier l’appréciation du fait générateur d’une action.
4. Serait-il pertinent de porter à un an le délai de prescription de l’ensemble des infractions de presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ?
Réponse :
Non, au contraire. Nous demandons précisément une cohérence avec un délai à 3 mois, quelles que soient les incriminations, pour les raisons par ailleurs développées.
5. Estimeriez-vous judicieux de transférer dans le code pénal certaines infractions aujourd’hui réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur le modèle de la solution retenue pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes (infractions désormais prévues à l’article 421-2-5 du code pénal) ?
Réponse :
Là encore, nous estimons qu’il serait plus cohérent d’inscrire dans la loi de 1881 l’ensemble des limites permettant son juste exercice. Aujourd’hui ces infractions échappent à la courte prescription alors même qu’elles engagent la responsabilité du directeur de la publication sur le fondement de la loi de 1881.
6. La fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la première mise en ligne du contenu litigieux vous semble-t-elle adaptée au mode de diffusion des informations sur Internet ? Le régime de prescription applicable constitue-t-il un obstacle à la répression des infractions de presse commises sur Internet ?
Réponse :
L’infraction de presse est un délit instantané, c’est-à-dire qu’il est consommé à sa publication. Le point de départ du délai de prescription est corrélativement celui qui correspond au jour de publication ou de mise en ligne. La Cour de cassation l’a d’ailleurs énoncé très clairement en Assemblée Plénière. À défaut, les délits de presse deviendraient des infractions continues faisant perdre tout sens au principe de courte prescription.
Le régime de prescription applicable ne nous semble pas un obstacle à la répression des infractions. Les moteurs de recherche existants et la vigilance des acteurs concernés rendent le dispositif opérant.
7. La France devrait-elle s’inspirer de certains modèles étrangers pour apporter d’éventuelles modifications aux régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines en matière de presse ?
Réponse :
Après la chute du mur de Berlin, plusieurs pays se sont inspirés du cadre français pour établir de nouvelles règles permettant la liberté d’expression. La loi de 1881 est efficace, éprouvée et équilibrée. Elle cible les responsabilités et fixe les contours permettant la liberté d’informer dans le respect des personnes et du droit des citoyens. A priori, pourquoi introduire des critères exogènes dès lors qu’un système fonctionne ?
06 février 2015
Contribution du Syndicat de la presse quotidienne nationale
1. Quels sont les fondements et justifications du délai de prescription abrégé de trois mois applicable à certaines infractions de presse (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) ? Ces fondements et justifications vous paraissent-ils toujours justifiés ?
Ce fondement consiste à permettre à l’organe de presse de ne pas vivre indéfiniment avec l’épée de Damoclès d’un procès pour un article publié. Le but est de rapprocher le plus possible le moment du débat judiciaire de celui de la publication, dans l’intérêt de tous. Cela permet aussi à l’organe de presse de savoir le plus tôt possible que des informations sont contestées et d’en tenir compte, en ce sens c’est également dans l’intérêt des personnes mises en cause.
Cet objectif est parfaitement d’actualité, nous ne voyons aucune raison de le remettre en cause. Bien plus, à l’heure où les contenus se multiplient par la multiplication des supports, il y a d’autant plus de raison de maintenir ce garde-fou.
2. Vous apparaît-il pertinent de faire bénéficier du délai de prescription abrégé de trois mois l’ensemble des personnes susceptibles de s’exprimer sur Internet ?
À notre sens, la même règle doit s’appliquer à tous les supports sous peine de créer une liberté d’expression à deux vitesses. Il serait paradoxal que le progrès de l’information induise un recul de la liberté fondamentale qui s’y attache. Le seul problème spécifique à l’internet est celui de l’expression sous le bénéfice de l’anonymat. C’est un problème qui ne concerne pas les organes de presse et ne doit pas se régler en nivelant par le bas et pour tout le monde une liberté fondamentale. Il doit se traiter avec des instruments spécifiques pour traiter la question de la responsabilité de ceux qui abusent de cet anonymat.
3. Pensez-vous que la fixation à un an du délai de prescription pour certaines infractions commises par voie de presse (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, contestation des crimes contre l’humanité) permette d’en assurer une meilleure répression ?
C’est encore une fois poser le problème de manière biaisée. Le fait est que les discours de haine sont souvent le fait d’internautes anonymes et que la répression est surement plus compliquée. Les organes de presse classiques ne sont pas confrontés à ce type de contentieux, nous ne sommes pas en mesure d’avoir un avis sur ce point.
4. Serait-il pertinent de porter à un an le délai de prescription de l’ensemble des infractions de presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ?
Certainement pas, ce serait remettre en cause tout l’équilibre de la loi sur la presse et faire vivre les organes de presse sous la menace de contentieux pendant de longs mois et sans qu’ils soient informés que leurs informations sont contestées. La prescription trimestrielle est une garantie fondamentale et n’oublions jamais qu’elle est contrebalancée par des dispositifs favorables aux victimes dans la loi sur la presse, tels que la présomption de mauvaise foi, ou l’obligation de faire valoir ses preuves dans un délai très court de 10 jours. Ce serait une déstabilisation complète du contentieux qui touche nos titres.
Le délai d’un an n’est pertinent que pour des infractions spécifiques qui mettent en jeu l’ordre public : lutte contre les propos racistes et xénophobes, notamment. Mais pas pour le quotidien des affaires de presse concernant les journaux qui sont des affaires entre parties. D’ailleurs, le délai de 3 mois permet souvent de trouver un terrain d’entente rapidement sur ce genre d’affaires aboutissant généralement à un droit de réponse négocié et publié dans des délais brefs, évitant ainsi un contentieux.
5. Estimeriez-vous judicieux de transférer dans le code pénal certaines infractions aujourd’hui réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur le modèle de la solution retenue pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes (infractions désormais prévues à l’article 421-2-5 du code pénal) ?
C’est le modèle à ne pas suivre, car il gomme totalement un aspect essentiel des procès mettant en cause un organe de presse : celui-ci agit dans le cadre d’une liberté fondamentale qui nécessite de peser les équilibres de manière différente. Nous sommes profondément attachés à un droit spécial qui est indispensable à la mise en place de justes équilibres. Ce serait un retour en arrière dramatique, un signe que la liberté de l’information n’est plus une liberté démocratique qu’on entend traiter de manière spécifique. Ce serait un signal profondément régressif : le journaliste traité comme le voleur à la tire ou le terroriste !
6. La fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la première mise en ligne du contenu litigieux vous semble-t-elle adaptée au mode de diffusion des informations sur Internet ? Le régime de prescription applicable constitue-t-il un obstacle à la répression des infractions de presse commises sur Internet ?
C’est tout aussi adapté pour l’internet que pour le support papier. La situation des journaux serait ingérable s’ils avaient à faire face à une double prescription différente selon le support. Il est fondamental pour nous qu’il y ait un régime unique de prescription, sous peine d’instaurer une liberté d’information à deux vitesses.
Et il ne faut pas se cacher que si un délai spécifique est instauré pour l’internet, là ou sont tous nos contenus, le maintien du point de départ de la prescription pour le papier est un marché de dupes, puisque vous annulez tout l’intérêt de la courte prescription dès lors que notre support internet peut continuer à être poursuivi.
Sur la deuxième question, il faut rappeler qu’il est plus facile d’avoir connaissance d’un contenu sur internet que sur un support papier. Les outils existant permettent en trois clics de mettre en place une alerte sur Google, par exemple, chaque fois que son nom est cité dans un contenu référencé. Ces outils d’alerte sont parfaitement opérationnels. Je rappelle qu’à l’inverse les librairies sont remplies de livres diffamatoires que des personnes mises en cause n’avaient pas les moyens de connaître faute de mécanismes d’alerte opérationnels. C’est donc un faux problème.
7. La France devrait-elle s’inspirer de certains modèles étrangers pour apporter d’éventuelles modifications aux régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines en matière de presse ?
Cela revient à me demander s’il faut s’aligner sur le moins disant en matière de liberté d’expression. En d’autres termes il faudrait niveler par le bas. Bien au contraire le modèle français doit être protégé précisément pour rester un modèle, il est depuis 1881 un signal fort que la liberté d’expression est en France une liberté pour laquelle on a des égards particuliers. Effectivement si vous voulez supprimer ce marqueur fort, alors traitons les journalistes comme des délinquants de droit commun. L’enjeu est là, c’est un enjeu de société.
Contribution de M. Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de chambre
de jugement à la Cour pénale internationale
Je suis sensible au fait que vous m’ayez convié à participer à votre réflexion : j’ai en effet quitté la présidence de la chambre criminelle il y a plus de six ans et je suis à présent, depuis peu, éloigné de la vie professionnelle « officielle ».
Votre invitation m’a donc conduit à revenir, avec du recul cette fois, sur les problèmes que soulèvent la prescription de l’action publique et celle de la peine et à les approfondir.
Je vous propose de dresser un constat – qui rejoint en réalité le vôtre- et je serai donc bref, puis de rechercher les causes de la situation actuelle, enfin de passer en revue un certain nombre de solutions susceptibles d’y remédier en sachant –il faut en avoir conscience – qu’aucune ne s’impose comme étant la seule, la vraie, la meilleure réponse.
I – Le Constat
Le droit de la prescription de la peine et la manière dont il est mis en œuvre ne soulèvent pas, a priori, de difficultés particulières. Tout au plus peut-on se demander s’il ne conviendrait pas d’aligner les durées, actuellement différentes, de ces deux prescriptions. Nous en reparlerons à la fin de cette intervention.
Le régime de prescription de l’action publique soulève en revanche de nombreuses difficultés.
Alors que le droit à appliquer, la « règle du jeu », devrait être claire, accessible et prévisible nous constatons qu’elle est confuse : pour le justiciable, qui est le premier concerné, mais aussi pour les juges et pour les professionnels du droit.
Ce triste diagnostic ne concerne d’ailleurs pas que le doit de la prescription : il est valable pour des pans entiers du code de procédure pénale devenu, au fil des innombrables réformes dont il fait constamment l’objet et des décisions de jurisprudence qui en résultent, une sorte de mille-feuille terriblement complexe !
L’absence de règle claire suscite des réactions souvent très vives, notamment doctrinales mais aussi dans le monde politique ou celui des affaires : il faut les prendre en considération tout en se disant que les critiques formulées seraient peut-être plus nuancées si ceux qui sont précisément les plus critiques participaient aux délibérés de la chambre criminelle et pouvaient ainsi prendre la mesure des difficultés qu’elle rencontre.
Cette confusion favorise en effet d’inutiles procès d’intention à l’encontre de juges qui n’oublient pas qu’ils doivent être légalistes mais qui éprouvent parfois le sentiment que la loi est insuffisante.
Plus grave, ce droit désordonné ne peut qu’être source d’insécurité juridique ce qui n’est pas admissible.
Votre mission, venant après d’autres, en particulier celle qu’a conduite le Sénat en 2006-2007, est donc la bienvenue ; c’est même un peu celle de la dernière chance et elle doit impérativement permettre d’améliorer la situation.
Mais, en préalable, il nous faut rechercher, le plus objectivement possible, comment l’on en est arrivé là et pourquoi un droit qui, jusqu’ici était demeuré assez stable, est depuis 25 ou 30 ans, devenu aussi touffu et donc incertain. Cela revient à examiner le rôle du législateur puis celui des juges et, plus particulièrement, celui de la Cour de cassation et de sa chambre criminelle.
Cet effort d’analyse et de compréhension des causes – qui implique une profonde prise de conscience - me semble indispensable. S’en abstenir ne pourra que conduire à une réforme incomplète et imparfaite qui nous fera retomber très vite dans les mêmes travers. Or c’est précisément »nt ce que vous souhaitez éviter.
II – Les Causes
A – le rôle des autorités publiques et du législateur :
Soit à la demande du Gouvernement soit d’initiative, depuis ces dernières années, le législateur, avec tout le respect que je lui dois et que je lui porte, donne le sentiment d’être à la fois hyperactif, indécis et parfois même contradictoire.
1 – hyperactif voire indiscipliné:
Je ne pense pas qu’il soit besoin que j’énumère tous les textes qui, depuis 1989, sont venus soit allonger la durée de la prescription soit reporter son point de départ soit bouleverser l’équilibre auquel on était parvenu entre les infractions de droit commun d’un côté et les infractions de presse relevant de la loi de 1881 d’autre part :
- crimes contre les mineurs (délai de prescription commençant à courir à compter de la majorité : lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995, 17 juin 1998),
- infractions de nature sexuelle, (délai de prescription porté à 20 ans : lois du 9 mars 2004 et du 4 avril 2006),
- trafic de stupéfiants (loi du 8 février 1995 : allongement du délai : crimes 30 ans et délits 20 ans),
- terrorisme (allongement du délai : crimes 30 ans et délits 20 ans),
- certaines infractions commises à l’encontre de personnes vulnérables (la vulnérabilité étant très largement entendue) telles que l’abus d’ignorance ou de faiblesse, vols, escroqueries, abus de confiance…. loi du 14 mars 2011,
- l’allongement à un an du délai de prescription, jusqu’ici de 3 mois, des délits de provocation à la discrimination et à la haine raciale, de diffamation et d’injure raciale, de contestation de crime contre l’humanité (loi du 9 mars 2004),
- l’article 5 de la loi du 14 novembre 2014 relatif à la provocation directe à des actes de terrorisme ou au fait d’en faire publiquement l’apologie qui transfère cette infraction de la loi sur la presse au code pénal et qui prévoit un délai de prescription de 3 ans… alors que le délit d’apologie de crimes contre l’humanité demeure quant à lui dans la loi sur la presse.
- Notons enfin qu’il s’avère difficile de trouver les textes sur la prescription dès lors qu’ils sont le plus souvent dans le CPP mais aussi dans le code pénal (crimes contre l’humanité) et que, lorsqu’ils sont dans le CPP, ils se trouvent tantôt dans les articles 7, 8 et 9 tantôt dans des textes spéciaux (terrorisme, trafic de stupéfiants) ou encore, bien sûr, dans la loi sur la presse. Il n’y pas sur ce point de rigueur législative.
2 – indécis :
Le législateur, et les gouvernements qui se sont succédés depuis trente ans, ont souvent critiqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ de la prescription court « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
Il faut savoir que la Cour ne souhaitait pourtant qu’une chose : que le législateur intervienne et qu’il clarifie sur ce point la situation ! Il ne l’a pas fait.
Les Rapports ont pourtant été nombreux (citons celui qu’avait demandé M Toubon alors Garde des Sceaux, le Rapport du Sénat de 2006-2007, le rapport Coulon) mais ils sont restés sans suite et les propositions de loi ou les amendements déposées, notamment entre 1995 et 2000, par MM Taittinger, Mazeaud, Charasse soit n’ont pas été discutés, soit ont été rejetés soit ont été retirés.
Sans doute les affaires politico-financières en cours d’instruction ou de jugement à l’époque ont-elles eu un effet inhibant et ont-elles contribué à limiter les initiatives car le monde politique redoutait d’apparaître comme étant le fossoyeur d’affaires délicates. Mais, à la réflexion, ce comportement et ces reculs étaient-ils bien courageux ?
L’initiative prise aujourd’hui par la commission de lois de l’Assemblée nationale n’en est donc que plus méritoire.
3 – contradictoire :
Le rapport précité du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », appelait avec force l’attention sur une indispensable remise en ordre ce qui n’a pas empêché l’adoption de la loi du 14 novembre 2014 qui, en matière de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme, rompt totalement avec la cohérence.
On constate que subsiste dans le code pénal des infractions relevant de la loi sur la presse avec les règles de prescription qui en découlent : tel est le cas du délit de diffusion de message à caractère pornographique susceptible d’être perçu par un mineur de l’article 227-24 du code pénal.
Le législateur déclare imprescriptibles les crimes contre l’humanité et eux seuls, en raison de leur spécificité et de leur incontestable gravité mais la gravité des crimes de guerre ne saurait être sous-estimée. Pour autant le projet de loi portant adaptation de notre droit pénal au Statut de la Cour pénale internationale s’est mis en en contradiction avec l’article 29 du Statut de la CPI qui prévoit l’imprescriptibilité pour ces deux catégories de crimes. Mais il a tenu à les affecter d’une prescription dérogatoire, une de plus, en portant la durée des prescriptions à 30 ans pour les crimes de guerre et 20 ans pour les délits de guerre.
Comme cela vient d’être rappelé, le délai de prescription du délit d’apologie de crimes de terrorisme est plus long que celui d’apologie de crimes contre l’humanité….
La formulation selon laquelle la prescription court « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » a fait l’objet de vives critiques lorsqu’elle était appliquée à l’abus de biens sociaux mais c’est pourtant, à quelques nuances près, celle qui a été retenue dans la loi du 14 mars 2011 concernant les personnes vulnérables. Au surplus, depuis le 4 mars 1935 la jurisprudence analogue dégagée pour l’abus de confiance semblait parfaitement admise.
Enfin rappelons que si la jurisprudence fixant le point de départ de la prescription de l’escroquerie au jour de la dernière remise a été très critiquée, il ne faut pas oublier que c’est le législateur qui en 1966, pour l’usure, a décidé que le point de départ de la prescription serait la dernière perception d’un intérêt usuraire !
B – le rôle de la Cour de cassation.
Il ne s’agit pas à cet instant de faire état de ce qui pouvait se dire au cours des délibérés auxquels j’ai assisté comme avocat général entre 1995 et 2000 (l’avocat général y assistait alors sans y participer) puis que j’ai animés et dirigés en qualité de président entre 2000 et 2008.
Il s’agit seulement de tenter de comprendre ce qu’a pu être la démarche de la chambre criminelle lorsqu’elle a estimé qu’il convenait de retenir un autre point de départ de la prescription que le jour de la commission de l’infraction ou lorsqu’elle a décidé que tel ou tel acte constituait un « acte de poursuite ou d’instruction » interruptif de prescription ou encore lorsqu’il lui est apparu qu’il y avait lieu de suspendre la prescription.
Le libellé de l’article 7 du code de procédure pénale est, en apparence, très clair mais les juges, au cours de ces vingt ou trente dernières années :
- 1 - se sont trouvés confrontés à une forte évolution des mentalités : il est de moins en moins admis qu’un acte susceptible de recevoir une qualification pénale puisse ne pas recevoir de réponse. Et, cette exigence est encore plus grande lorsqu’il s’agit d’actes de nature criminelle largement relayés par les medias et, ce qui est légitime, fortement dénoncés par des associations de victimes : la barrière de la prescription est alors d’autant plus mal comprise que, dans le même temps, le législateur procède, de manière sélective et pas toujours comprise par le plus grand nombre, à l’allongement de certains délais de prescription pour les porter de 10 à 20 ans voire à 30 ans ;
Ce constat, cet état de fait, ont certainement joué dans la manière dont la chambre criminelle a, du moins à une époque, élargi le champ des actes interruptifs de prescription.
- 2 - Les juges se sont, peut-être à tort, crus tenus de prendre en, compte l’évolution des techniques de police scientifique : à cet égard, l’arrêt rendu le 7 novembre 2014 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est très éclairant : la prescription devait-elle être retenue pour ces huit infanticides alors que les examens biologiques avaient permis de déterminer qui était la mère de ces enfants en très bas âge découverts enterrés dans un jardin et nés, pour la plupart d’entre eux bien au-delà du délai de prescription («la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites » a jugé l’assemblée plénière).
- 3 - Les juges ont eu à se prononcer sur l’application des règles de la prescription à des infractions :
o quantitativement beaucoup moins poursuivies jusque-là : une politique de poursuites beaucoup plus déterminée en matière de délinquance économique et financière, les poursuites engagées à la fin des années 1980 et dans le courant des années 1990 à l’occasion d’affaires dites « politico-financières » ont donné un coup de projecteur sur le délit d’abus de biens social, sur la dissimulation dont il faisait l’objet, sur une jurisprudence datant de 1967 et qui n’avait pas jusqu’ici été particulièrement critiquée dès lors qu’elle ne concernait le plus souvent que des responsables de sociétés parfaitement inconnus….
Tuer ces affaires dans l’œuf alors qu’il existait depuis plusieurs années une jurisprudence somme toute logique sur cette question n’aurait d’évidence pas été compris et aurait renforcé le sentiment assez dévastateur selon lequel toutes les formes de délinquance ne sont pas traitées de la même manière.
o ou à des infractions jusqu’alors très rarement poursuivies telles que la prise illégale d’intérêt ou le favoritisme). Les observations qui viennent d’être formulées sont ici aussi valables.
o ou encore à des infractions récemment créées qui, si l’on avait appliqué strictement la règle du point de départ de la prescription « au jour de la commission de l’infraction » n’auraient le plus souvent pas pu être poursuivies : l’abus de faiblesse en est l’exemple le plus topique puisqu’en 2011 le législateur a lui-même décidé de recourir à la formule si critiquée « à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
À cette occasion, le Parlement a démontré qu’il était aussi mal à l’aise que le juge à l’idée que pourraient ne pas être poursuivies des infractions que leurs auteurs ont su habilement dissimuler durant un temps supérieur à celui que couvre le délai de prescription.
Alors, pour reprendre la formulation du mémoire produit en demande dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 novembre 2014, les juges ont-ils trop pris en compte « l’évolution des idées, les changements sociétaux, les progrès de la science, une idée de « la bonne justice »…. ?
Peut-être….sans doute ont-ils été trop influencés par le « factuel », voire par « l’émotionnel » et ont-ils trop privilégié l’impact qu’était susceptible d’avoir une décision constatant la prescription sur la stricte application de la loi.
Ont-ils trop voulu pallier des insuffisances de la loi ?
Peut-être aussi mais ils ont, souvent et depuis longtemps, été laissés seuls, sans encadrement législatif clair et suffisant et ils se doivent pourtant de donner un sens à la loi…
Et cela d’autant plus que la prescription est une question d’ordre public, pouvant être soulevée à toute étape de la procédure et que le juge se doit de relever éventuellement d’office. Il s’agit donc là de questions qu’ils ne pouvaient éluder et sur lesquelles ils étaient donc tenus de se prononcer.
Votre initiative, une nouvelle fois, n’en a donc que plus de prix.
III – Les possibles solutions
En préalable : il s’impose de conserver le principe même d’une prescription de l’action publique à l’exception des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité.
Tout en comprenant que ces deux crimes doivent se voir réserver un traitement « à part », je pense, je le répète, qu’il serait souhaitable de se mettre en conformité avec le Statut de la cour pénale internationale – que la France a signé et ratifié - et de déclarer les crimes de guerre eux aussi imprescriptibles.
Il ne faut pas oublier que nombre de faits sont susceptibles de recevoir la double qualification de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (une dualité de prescription est dès lors surprenante) et que dans l’échelle de l’horreur, j’ai scrupule à utiliser de tels termes car je ne veux surtout pas banaliser les comportements atroces que nous avons tous en mémoire, les crimes de guerre peuvent malheureusement atteindre des sommets.
A - Maintien du principe même de la prescription :
Il s’impose de conserver la prescription : pourquoi ?
- parce que vient un temps où il est de l’intérêt de tous de mettre un terme à des recherches, à une activité judiciaire souvent plus théorique qu’effective et qui est susceptible de faire naître et surtout d’entretenir chez les victimes de faux espoirs ;
- parce qu’il serait illusoire de penser que les services de police seraient en mesure de continuer à travailler sur des stocks de procédure venant s’accumuler d’années en années ; comment feraient-ils d’ailleurs pour déterminer des priorités entre ce qui leur arrive en continu et ce qui demeurerait en stock ?
- parce que toute personne a droit d’être jugée dans un délai raisonnable et surtout équitablement.
À cet égard, si l’évolution des méthodes de police technique et scientifique ouvre incontestablement des horizons et permet de réduire, dans une large mesure, le risque de dépérissement des preuves, il n’en va absolument pas de même pour nombre de pièces à conviction qui peuvent disparaitre et pour les témoignages qui, faute de prélèvements ADN, peuvent dans certaines affaires continuer à être déterminants. Or, plus on s’éloigne de la date des faits plus les témoignages se transforment.
J’en ai plus que jamais pris conscience à la Cour pénale internationale durant plus de deux années de présidence d’audience. Le déroulement des débats est en effet fortement imprégné de common law, le procureur et les équipes de défense citent chacun leurs témoins qui sont interrogés et contre interrogés. Les preuves écrites sont quasi absentes ce qui donne aux témoignages un poids prépondérant dans l’administration de la preuve. J’ai pu mesurer leur fragilité lorsqu’ils interviennent près de 10 ans après les faits : ils s’appauvrissent souvent et deviennent très approximatifs mais ils s’enrichissent aussi parfois et se nourrissent des récits qui circulent et des conversations échangées. C’est l’une des difficultés auxquelles se heurtent aussi en France les juges et les jurés avec le rallongement des délais de prescription en matière de crimes sexuels.
- Enfin, qu’on le veuille ou non, le risque de prescription constitue un stimulant pour les services d’enquêtes et les organes de poursuites et d’instruction… à la condition, s’agissant de l’engagement des poursuites, que le parquet ait été en mesure de les mettre en mouvement
À défaut de supprimer la prescription, il paraît s’imposer d’allonger les délais mais de façon cohérente, en rompant avec les législations d’exception car l’expérience montre que toute dérogation à un texte en appelle inéluctablement d’autres. Cet allongement devra donc tendre à l’instauration d’un régime unique au sein de chacune des trois grandes catégories d’infractions, crimes, délits et contraventions, propres au droit pénal français.
B – L’allongement des délais de prescription ?
Deux préalables :
- Le droit comparé est riche d’enseignements à cet égard et nos délais de prescription, exception faite des crimes contre l’humanité et sous réserve des infractions dissimulées, apparaît globalement plus court que celui de nos voisins européens.
- Il faut avoir conscience que, si l’on veut réellement simplifier et retrouver de la cohérence, il faudra allonger, et de manière uniforme, tous les délais de prescription, quel que soit le crime ou le délit. Ce qui conduira à s’engager dans une démarche à tonalité très répressive. Se posera alors également à nouveau la question de savoir si l’on maintient le régime procédural de l’application immédiate de la loi plus sévère instaurant une prescription plus longue qu’a introduite la loi du 9 mars 2004.
1 - en ce qui concerne les crimes
À l’exception des crimes contre l’humanité et, il faut y revenir, des crimes de guerre, un allongement de la prescription à 20 ans par exemple, pour toutes les infractions qualifiées « crimes » pourrait se concevoir à condition toutefois que, dans la pratique judiciaire, les faits, lorsque c’est possible, ne soient pas « criminalisés » à seule fin de contourner un délai de prescription délictuel acquis !
Retenir un délai de 20 ans impliquerait par ailleurs que l’on redescende pour les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants de 30 à 20 ans et que, pour les crimes de guerre, on passe de 30 ans à l’imprescriptibilité.
Pourquoi 20 ans plutôt que 30 ans ?
Parce que :
- doubler le délai de prescription actuelle constitue déjà un geste très fort,
- un délai de 20 ans est un délai à ne pas dépasser en termes de préservation de la qualité des preuves et des témoignages,
- un délai de 20 ans, même en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, ne désarme pas l’État ; en ce domaine, les informations judiciaires sont ouvertes très vite et les juges sont d’une extrême vigilance pour éviter l’acquisition de la prescription,
- parce que 20 ans correspond au délai de prescription de la peine ce qui permettrait d’unifier les deux délais.
2 - le domaine délictuel soulève plus de difficultés
Si l’on veut véritablement simplifier, l’allongement du délai devra s’appliquer à tous les délits, Mais est-il raisonnable d’allonger à 10 ans par exemple la prescription, par exemple, de délits tels que l’abandon de famille ou de non représentation d’enfants pour lesquels il s’impose de ne pas laisser se pérenniser les possibilités d’engagement de poursuites et d’éviter tout ce qui peut favoriser la reprise tardive de conflits familiaux par un biais judiciaire ? Et il en va de même pour toute une série de délits qui peuvent être de très faible gravité qu’il s’agisse de vols ou même de violences ?
Faudrait-il dès lors opérer des distinctions au sein des infractions délictuelles : les unes voyant le délai de prescription porté à 10 ans et d’autres conservant un délai de 3 ou de 5 ans ?
Mais sur quelle base procédera-t-on à une telle répartition ? N’y aura-il pas inévitablement des oublis car nous savons que nous sommes dans l’incapacité de recenser l’ensemble des dispositions répressives figurant dans le code pénal, les différents autres codes et les lois spéciales.
Faudrait-il alors se référer à la longueur de la peine encourue ? Ce qui permettrait de mieux tenir compte des prescriptions allongées créées en matière de terrorisme, d’infractions sexuelles commises contre des mineurs et de trafic de stupéfiants ?
Mais alors se posent plusieurs autres questions :
- il faut avoir conscience qu’en matière de quantum de peines prévues, le droit pénal est, là encore, quelque peu anarchique en particulier s’agissant des pénalités qui assortissent nombre d’interdictions figurant dans des textes émanant de ministères techniques : ceux-ci sont en effet toujours soucieux de faire sanctionner de manière élevée les manquements entrant dans leurs champs de compétence ; il faudrait donc « toiletter » tous ces textes pour revenir à plus de cohérence ;
- mais parviendra-t-on à recenser toutes les infractions dont les pénalités devraient être réduites et quel critère retiendrait-on ?
- en sens inverse, il faut aussi avoir conscience qu’un délit tel que l’abus de confiance, qui peut être d’une incontestable gravité, n’est puni que de trois ans d’emprisonnement, que l’abus de bien social n’est puni que de cinq ans d’emprisonnement ?
- pour autant, il paraît, là encore, exclu de procéder au recensement des infractions dont les pénalités devraient, dans cette perspective, être cette fois augmentées.
- sans doute pourrait-t-on, pour les infractions dissimulées ou occultes, pallier le faible quantum de la peine encourue en continuant à prendre pour point de départ du délai de prescription le jour où le délit est apparu et a pu être constaté. Mais il est des délits instantanés qui sont eux aussi faiblement réprimés et qui ne pourront pas bénéficier d’un tel report d’où une perte de cohérence !
- enfin, si l’on se réfère à la peine encourue, comment fera-t-on en cas de récidive, car cela entraîne un allongement des peines encourues ?
3 - En réalité, en matière délictuelle, le choix ne paraît exister qu’entre deux solutions qui ne sont ni l’une ni l’autre pleinement satisfaisantes :
- la première consiste à appliquer la règle « contra non valentem » (pas de prescription contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir) : c’est tentant car cela permet de prendre en considération les infractions savamment dissimulées ;
- la seconde consiste à allonger à 10 ans la prescription de tous les délits ce qui permettrait de «mordre » largement sur le domaine des infractions dissimulées.
Mais il faudra alors que, dans le cadre de la politique pénale définie par le ministre de la justice, des recommandations soient faites aux parquets : lorsque, pour un délit de faible gravité, un dépôt de plainte interviendra longtemps après les faits ou presqu’au terme d’un délai de prescription ainsi prolongé, il conviendra que les parquets privilégient dans la mesure du possible les modes de règlements alternatifs : recherche de conciliation, médiation etc…
Il s’imposera donc d’éviter l’engagement de poursuites tardives difficiles à exercer ne serait-ce que parce que les preuves se sont estompées.
Sans doute la voie de la constitution de partie civile restera-t-elle ouverte mais il faudra aussi savoir appliquer l’article 91 du code de procédure pénale relatif aux constitutions de partie civile abusives. Enfin, il faudra, là encore, être attentif et ne pas immédiatement déroger à nouveau en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou pour tout autre délit….
C - Les causes d’interruption de la prescription :
En préalable, il s’impose de bien distinguer le point de départ de la prescription au stade de l’engagement initial des poursuites et l’interruption de la prescription dans le cours de poursuites déjà valablement engagées.
L’allongement du délai de prescription devrait déjà, dans le premier cas, apporter une réponse.
Dans la seconde hypothèse, deux questions se posent :
- faut-il réécrire le membre de phrase « … si, dans l’intervalle, il n’a été fait aucun acte de poursuite et d’instruction » ?
- ou faut-il que le législateur explicite ce que l’on doit entendre par « actes de poursuites et d’instruction » en en donnant une liste précise ?
Si on opte pour une réécriture du texte, on pourrait couper la phrase figurant au premier alinéa de l’article 7 après les mots « le jour où le crime a été commis » et écrire « Ce délai est interrompu si, dans l’intervalle, intervient un acte ou une décision d’enquête, de poursuites ou d’instruction traduisant explicitement l’intention d’exercer ou de continuer à exercer (de manière effective) l’action publique ».
Une éventuelle énumération serait à mon sens risquée car :
- parviendra-t-on à formuler une liste exhaustive des cas d’interruption ?
- toute liste à valeur législative est aussitôt figée, on ne revient pas facilement devant le Parlement et on ne peut exclure qu’au fil d’autres réformes à venir du code de procédure pénale apparaisse un acte susceptible de revêtir cette qualification et que l’on oubliera d’ajouter à cette liste.
Aussi me semble-t-il préférable de conserver une certaine souplesse et de laisser à la jurisprudence le soin de suivre les évolutions mais en appliquant un texte réécrit et plus explicite ?
D - Les causes de suspension de la prescription : faut-il, là encore, que le législateur intervienne en dressant une liste de ce qui est de nature à suspendre la prescription ?
Ce serait peut-être plus facilement envisageable car la plupart de ces causes de suspension sont connues, qu’elles soient légales ou jurisprudentielles, elles paraissent plus stables, les créations jurisprudentielles n’ont pas suscité de critiques notables. Mais ce serait malgré tout risqué.
Aussi pourrait-on envisager que, comme l’a fait le Sénat dans son rapport de 2006-2007, votre rapport donne une liste aussi exhaustive que possible des cas de suspensions légales et jurisprudentielles actuellement recensés. Sa valeur indicative serait forte.
Enfin, l’allongement des délais de prescription devrait permettre – il faut le souhaiter - de ne pas avoir à recourir à la règle « contra non valentem ».
E - La prescription en matière de presse.
Il convient enfin de redonner de la cohérence aux infractions relevant de la transmission des idées et des propos et de conserver dans toute la mesure du possible la courte prescription de trois mois.
Cette loi, initialement conçue pour les écrits (journaux, livres) et pour les propos tenus publiquement ou non a su s’adapter avec l’apparition de la radio et de la télévision.
Il faudrait qu’elle s’adapte mieux à présent à ce qu’Internet a de spécifique en particulier en termes de stockages d’informations. Mais qui dit s’adapter dit presque inéluctablement « dérogation » et il faut en avoir conscience.
Or, il s’impose de conserver une courte prescription car, en matière de liberté d’expression, il faut, judiciairement, réagir vite et faire valoir ses droits sans délai. La sérénité du climat social et politique en dépend. Et à quoi rime l’exercice de poursuites pour des propos tenus publiquement deux ans ou trois ans plus tôt ? À cet égard, l’intention dont il est actuellement fait état d’insérer dans le code pénal tous les délits de presse à connotation raciale ou apologétique avec, vraisemblablement, les délais de prescriptions propres au code pénal, laisse sceptique.
Si le délai de trois mois semble vraiment trop court, il faut avoir le courage de l’allonger à 4 ou 6 mois (comme en matière électorale). Mais il faut veiller, dans le souci de simplification et de cohérence que recherche votre Mission, à ce qu’un même délai s’applique à toutes les infractions relevant de la liberté d’expression.
F – Prescription de la peine et fusion des prescriptions :
La prescription de la peine est de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions.
Il est ici question d’une personne qui a été condamnée et il s’agit d’éviter qu’elle puisse se soustraire trop vite à l’exécution d’une peine à laquelle elle a été définitivement condamnée :
- soit parce qu’elle a pu se soustraire à la mise à exécution en prenant la fuite,
- soit parce que l’autorité de mise à exécution s’est révélée défaillante et a omis de le faire… ce qui n’est tout de même pas la règle.
Il ne semble pas que cette prescription soulève des difficultés particulières
La seule question qui se pose est celle de savoir si ses délais doivent être alignés sur ceux de la prescription de l’action publique.
Si l’on parvient à allonger les délais de prescription de l’action publique, il pourra être raisonnablement envisagé de procéder à un tel alignement. En effet :
- si la prescription de l’action publique en matière de crimes est portée à 20 ans : l’alignement se fera automatiquement ;
- si la prescription délictuelle est portée à 10 ans, il faudra augmenter la durée de prescription de la peine délictuelle : ce qui ne me choque pas s’agissant de quelqu’un qui se soustrait à l’exécution de sa peine. En revanche, ce délai est long pour l’autorité de mise à exécution qui doit agir vite. Mais, une nouvelle fois, elle agit le plus souvent avec célérité ;
- en revanche, il faudra la réduire en matière contraventionnelle et passer de 3 ans à un an ce qui ne paraît pas soulever de difficultés particulières.
Contribution de M. Jean Maïa, directeur des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie
et du numérique et du ministère des finances et des comptes publics
Les observations suivantes sont soumises à l’appréciation de la mission d’information de l’Assemblée nationale sous le double prisme, d’une part, de l’activité de conseil juridique incombant à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers dans le champ d’activité de ces ministères et, d’autre part, de la fonction d’agent judiciaire de l’État exercé par le directeur des affaires juridiques – en annexe de la présente contribution, est présenté à titre illustratif, selon la demande formulée par les présidents de la mission en conclusion de l’audition du directeur, un échantillon de dossiers pour lesquels l’agent judiciaire de l’État a eu ou à prendre en compte les règles de prescription en matière pénale au titre de sa mission légale de défense des intérêts financiers de l’État (article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955).
1. Peut-on dire que le régime de la prescription de l’action publique soulève des difficultés quant à la poursuite de certaines infractions à caractère économique et financier ?
Au premier rang des spécificités que la question de la prescription pénale peut présenter pour la poursuite des délits économiques et financiers paraît à souligner la question de la difficulté de leur détection.
Ces infractions s’inscrivent dans des modes opératoires souvent complexes et ont, par nature, un caractère occulte. Le préjudice qu’elles causent est souvent difficilement perceptible par les personnes physiques et/ou morales qui en sont victimes.
À ce jour, le régime de la prescription de l’action publique ne semble cependant pas, du point de vue de cette direction, soulever de difficultés quant à la possibilité de poursuivre ces infractions dans la mesure où les magistrats judiciaires qui traitent de la matière disposent de différents outils permettant de prévenir le risque d’une acquisition trop rapide de la prescription à raison de cette difficulté de détection de ces infractions :
- la prescription de l’action publique peut être interrompue en raison des circonstances de commission dans le temps de l’infraction ;
- la prescription peut être « rattrapée » par le jeu de la connexité ;
- le juge a développé une théorie jurisprudentielle de la dissimulation permettant le report du point de départ de la prescription pour certaines de ces infractions.
La connexité :
En droit pénal, la connexité concerne la situation dans laquelle deux infractions sont liées entre elles par des rapports étroits, qui font que l’on ne peut considérer, ni juger, chacune d’entre elles, prises isolément.
L’article 203 du code procédure pénale énumère les cas de connexité légale entre les infractions :
- lorsque les infractions ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
- lorsque les infractions ont été commises par différentes personnes, même en temps différents et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
- lorsque les auteurs ont commis les unes, pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité ;
- lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Outre les cas prévus par l’article 203 du code de procédure pénale, la jurisprudence a élargi les cas de connexité, ce qui permet de « corriger » les règles de prescription de l’action publique. Ainsi, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu plusieurs cas de connexité entre infractions :
- lorsqu’il existe, entre les faits, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus386 ;
- pour les infractions procédant d’une conception unique387 ;
- pour les faits procédant d’une identité d’objet et d’une communauté de résultat388 ;
L’existence d’un lien de connexité entre des infractions a des conséquences en matière de prescription de l’action publique puisqu’un acte interruptif de prescription concernant une infraction a nécessairement le même effet, à l’égard de l’infraction qui lui est connexe389.
L’interruption de la prescription par le recours à la notion de connexité a en outre vocation à s’appliquer aux délits d’atteinte à la probité qui peuvent être liés, à d’autres infractions économiques et financières dont ils sont la cause ou la conséquence.
Tout au plus, sans que l’agent judiciaire de l’État puisse véritablement les faire siennes au regard de sa propre pratique, peut-on relever quelques critiques dont le régime de la prescription des infractions à caractère économique et financier a pu faire l’objet en doctrine :
- un certain manque de prévisibilité de la matière : la jurisprudence relative à la dissimulation ne s’applique pas à toutes les infractions économiques et financières, mais seulement à certaines d’entre elles, relevant des atteintes à la probité : abus de confiance, abus de biens sociaux, favoritisme, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts. Lorsque le juge pénal est saisi d’un dossier économique et financier, il doit donc systématiquement s’interroger sur l’application de la théorie de la dissimulation aux infractions dont il est saisi.
- manque de sécurité juridique : l’une des critiques les plus fréquemment formulées au sujet des conditions de répression des infractions économiques et financières tient aux règles jurisprudentielles en matière de prescription s’agissant des délits qualifiés d’occultes, qui ont amené certains à qualifier l’abus de biens sociaux d’infraction virtuellement imprescriptible.
Du point de vue de l’agent judiciaire de l’État, dont le mandat légal est de défendre les intérêts financiers de l’État, les règles issues de la loi et de la jurisprudence n’en ont pas moins l’avantage pratique d’aboutir à ce que la prescription ne joue en pratique guère à son encontre à ce jour (voir annexe).
2. Les délais de prescription de l’action publique et de prescription des peines applicables aux infractions à caractère économique et financier vous semblent-ils devoir être allongés ou réduits ?
En matière pénale, il convient de distinguer la prescription de l’action publique, qui fait obstacle à l’exercice des poursuites au terme d’un certain délai, de la prescription de la peine destinée à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l’effet de l’écoulement du temps depuis la décision de condamnation.
2.1. La prescription de la peine est le principe selon lequel l’écoulement d’un certain délai depuis le jour où la condamnation est devenue définitive empêche l’exécution de cette peine.
Le code pénal prévoit que les peines prononcées par les juridictions se prescrivent au terme d’un délai de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions (articles 133-2 à 133-4 du code pénal). Il semble que les délais de prescription des peines applicables aux infractions à caractère économique et financier n’ont pas à être modifiés. Les règles en matière de prescription des peines n’ont en effet aucune incidence quant à l’efficacité de la répression de ces infractions. Il s’agit en tout cas d’une question relevant de l’effectivité des peines.
2.2. La prescription de l’action publique est le principe selon lequel l’action publique s’éteint si elle n’est pas intentée pendant un certain délai.
L’auteur d’une infraction ne peut plus être poursuivi quand l’action publique s’éteint, et de ce fait, l’infraction dont il s’est rendu coupable reste impunie. Le code pénal prévoit que l’action publique se prescrit au terme d’un délai de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (articles 7, 8 et 9 du code pénal).
Ainsi qu’il a été dit, la matière peut parfois paraître manquer d’une certaine prévisibilité, voire de visibilité par exemple s’agissant d’infractions commises à l’encontre des mineurs, domaine dans lequel la vérification de l’acquisition, ou non, de la prescription, est devenue complexe et nécessite une analyse factuelle, fine, au cas par cas. Encore l’état du droit n’est-il pas sans avantage pour les victimes, au nombre desquelles peut se trouver l’État. Une modification du régime en vigueur semblerait appeler des précautions sous cet angle, au regard de l’enjeu que présente pour la société la défense de l’argent des contribuables.
1. L’allongement du délai de prescription des infractions à caractère économique et financier et la fixation du point de départ de ce délai au jour de la commission des faits (quelle que soit la qualification de l’infraction) risqueraient-ils de porter atteinte à l’efficacité de leur répression ?
L’allongement du délai de prescription des infractions à caractère économique et financier en tant que tel ne porterait pas atteinte à l’efficacité de leur répression. En revanche, s’il était associé à la fixation du point de départ de la prescription au jour de la commission des faits, l’allongement de ce délai (en particulier si ce délai d’allongement n’est pas suffisant) serait susceptible d’y porter atteinte dans la mesure où la particularité d’un certain nombre de délits économiques et financiers est leur caractère complexe et souvent occulte ou délibérément dissimulé.
Les auteurs de délits économiques et financiers mettent souvent en place des systèmes frauduleux astucieux avec la volonté de dissimuler leurs actes. C’est ainsi que dans le domaine du droit des sociétés, des manœuvres comptables peuvent permettre au dirigeant d’une société commerciale de dissimuler qu’il a utilisé, en connaissance de cause, les biens de la société à des fins personnelles. Cette dissimulation peut durer longtemps si les manœuvres comptables sont subtiles. C’est d’ailleurs avec le souci d’appréhender les faits délictueux qui n’avaient pu être constatés dans le délai de 3 ans du fait de la dissimulation des éléments matériels constitutifs de l’infraction que la jurisprudence a développé la théorie jurisprudentielle de la dissimulation en 1945 pour l’abus de confiance et en 1967 pour l’abus de biens sociaux en admettant que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Certains systèmes frauduleux complexes associent un grand nombre d’auteurs ou de complices, et peuvent avoir une implantation internationale. Ce sont autant d’éléments de complexité objective qui rendent difficile la connaissance de l’infraction et la poursuite des faits délictueux.
Il semble en outre permis de se demander si une telle modification du régime en vigueur ne pourrait aller à l’encontre des mesures récentes adoptées par le Parlement pour lutter contre ce phénomène. Dans la continuité d’une politique publique globale traduisant la résolution du Gouvernement à lutter de manière déterminée contre toutes les formes de fraudes et d’atteintes à la probité portant atteinte tant à la solidarité nationale, qu’à l’exemplarité des responsables publics, l’institution judiciaire a ainsi été dotée d’instruments nouveaux permettant de faciliter la détection des infractions, de renforcer l’efficacité des poursuites et d’accroître le recouvrement des avoirs criminels qui en sont le produit. Les lois relatives à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 et la création de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) constituent les deux premiers volets de ce dispositif. C’est dans leur prolongement qu’est venue s’inscrire l’instauration du procureur national financier issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière et de la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013.
Par ailleurs, l’attention semble devoir être appelée sur l’importance pratique qui s’attacherait à ce que l’éventuelle fixation de la date des faits comme point de départ intangible de la prescription de l’action publique ne s’accompagne pas d’une remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions continues ou à exécution successive390.
2. Peut-on dire que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux règles de prescription applicables à l’infraction d’abus de biens sociaux (dissimulée ou non) permet de concilier l’efficacité de la répression et la sécurité juridique ? Cette jurisprudence devrait-elle être inscrite dans la loi ?
2.1. Les règles de prescription applicables à l’abus de biens sociaux en l’absence de dissimulation
Par arrêt du 5 mai 1997, la Cour de cassation a énoncé, pour la première fois, que le délai de prescription de l’action publique de l’abus de biens sociaux ne commence à courir, sauf dissimulation, qu’à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. Ce dernier membre de phrase ne figure pas dans l’arrêt mais dans le sommaire rédigé par le conseiller rapporteur.
Désormais, le délit est présumé révélé à la date de la présentation des comptes annuels et le point de départ du délai de prescription peut être reporté au-delà de cette date, en cas de dissimulation.
Il s’agit d’une présomption, dans la mesure où l’on ne saurait faire courir automatiquement la prescription de l’action publique de ce délit, à compter de la présentation des comptes annuels, dans l’hypothèse par exemple d’une information suffisamment claire et précise, donnée aux associés ou actionnaires avant cet événement, de nature à déterminer le point de départ de la prescription.
2.2. Les règles jurisprudentielles de prescription applicables à l’abus de biens sociaux en cas de dissimulation
La dissimulation consiste à masquer l’existence de l’infraction par des manœuvres d’occultation, à cacher par des artifices, par un montage, le délit ne pouvant être décelé par ceux qui vont en subir les conséquences dommageables. Ce n’est donc pas la nature même du délit qui justifie le report du point de départ de la prescription, mais les circonstances dans lesquelles il a été commis.
Par arrêt du 7 décembre 1967, la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où le délit d’abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté.
En l’espèce, des prélèvements abusifs, effectués par le président d’une société, avaient été enregistrés en comptabilité sous un compte d’ordre qui dissimulait leur cause réelle et ne faisait pas apparaître qu’ils avaient été réalisés pour le compte et dans le seul intérêt du dirigeant. Seule une expertise comptable avait pu révéler ces prélèvements. C’est à la date de cette expertise qu’avait, en conséquence été fixé le point de départ de la prescription.
Par arrêt du 10 août 1981, la chambre criminelle a décidé dans un attendu de principe, que le point de départ de la prescription triennale est fixé « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique », c’est-à-dire par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public.
En l’espèce le délit, antérieurement aux investigations de la police judiciaire, n’était connu que des seuls, commissaire aux comptes et expert-comptable de la société, tous deux co-prévenus du dirigeant, qui n’avaient donc, aucun intérêt, à mettre en mouvement l’action publique. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite.
2.3. Il est à relever que cette jurisprudence sur la dissimulation a fait l’objet de plusieurs tentatives d’inscription dans la loi.
Le rapport d’information de 2007 du Sénat sur la prescription proposait, dans sa recommandation n° 5, de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’étendre à d’autres infractions occultes ou dissimulées, dans d’autres domaines du droit pénal et, en particulier, à la matière criminelle.
Lors de l’examen en commission des lois en 1ère lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière, a été introduit un amendement complétant l’article 8 du code pénal en ces termes : « En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ». Le Sénat a finalement supprimé cette disposition, dont la suppression conforme a été votée le 17 septembre 2013 par l’Assemblée nationale en 2ème lecture.
Pour l’avenir, il appartient au Parlement d’apprécier si et dans quelle mesure il serait utile que la loi reprenne la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est simplement permis, d’un point de vue technique, de se demander si et dans quelle mesure des dispositions législatives nouvelles pourraient la consolider inchangée ou pourraient la modifier, avec les implications que cela pourrait avoir dans le traitement de dossiers complexes. Pour complexe et sophistiqué qu’il soit, l’état du droit qui résulte de la combinaison des normes législatives et des développements jurisprudentiels, présente des avantages dont il est permis de se demander si, en la matière, il ne peut être regardé comme un point d’équilibre.
1. Quelles sont les justifications de l’allongement du délai de prescription applicable au délit de fraude fiscale prévu par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (article L. 230 du livre des procédures fiscales) ?
Il s’agit d’une question ressortissant à la compétence exclusive de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
2. Le délai de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis, durant lequel le cours de la prescription est suspendu, est-il suffisant (dernier alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales) ?
Il s’agit là aussi d’une question ressortissant à la compétence de la DGFiP.
3. Le législateur devrait-il fixer avec plus de précisions les règles relatives à la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action publique et à la fixation des motifs d’interruption et de suspension de ce délai ? Si le délai de prescription de l’action publique était allongé, les motifs d’interruption et de suspension devraient-ils être limités ?
7.1 Conséquences de l’interruption ou de la suspension du délai de prescription de l’action publique
En raison de certains actes accomplis, le cours de la prescription de l’action publique peut être interrompu ou suspendu.
L’interruption a pour conséquence l’effacement du délai déjà écoulé et le commencement d’un nouveau délai de prescription. Conformément aux articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, tout acte d’instruction ou de poursuite est interruptif de prescription. Selon la Cour de cassation, sont interruptifs « les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs ». Définir un cas d’interruption de la prescription, consiste donc à reporter le point de départ du délai de prescription.
La suspension a pour conséquence d’arrêter le cours de la prescription, sans effacer le temps écoulé. Il existe des causes légales de suspension prévues par le code de procédure pénale, mais également des causes jurisprudentielles. Ex : exception préjudicielle, mise en œuvre d’une mesure alternative aux poursuites (cf. art 41-1 du code de procédure pénale avant dernier alinéa).
7.2 Situation actuelle
La direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers n’identifie pas de difficulté grave qui serait de nature à justifier une modification des règles générales relatives à la suspension et à l’interruption de la prescription.
Tout au plus peut-on relever qu’à la suite de décisions récentes, un écart a pu apparaître entre la jurisprudence de l’assemblée plénière et celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il résulte en effet de l’arrêt de l’assemblée plénière du 7 novembre 2014 qui a consacré un principe de suspension du délai de prescription, en cas d’impossibilité absolue liée à un obstacle insurmontable, d’engager ou d’exercer des poursuites pour les (seules) infractions de nature criminelle, une différence de traitement entre la matière délictuelle et criminelle.
La chambre criminelle ne semble pas appliquer la jurisprudence de l’assemblée plénière, dans la mesure où elle continue à utiliser la notion de dissimulation, plutôt que celle d’obstacle insurmontable laquelle constitue non pas une cause de suspension, mais une cause de report du point de départ de la prescription, c’est-à-dire d’interruption. À titre d’illustration, c’est ce que vient de faire la chambre criminelle, s’agissant du délit de prise illégale d’intérêt, auquel cette dernière a pour la première fois me semble-t-il appliqué sa jurisprudence sur la dissimulation pour retarder le point de départ de la prescription, dans un arrêt du 16 décembre 2014, postérieur à celui de l’assemblée plénière391.
7.3 En cas d’infractions « complexes », la jurisprudence reporte également le point de départ de la prescription de l’action publique à la date de commission du dernier fait délictueux
Lorsque les faits délictueux sont multiples et forment une « opération indivisible » les infractions sont dites complexes. Dans ces cas, la Cour de cassation repousse le point de départ du délai de la prescription à compter de la date de commission du dernier fait délictueux. La liste de ces infractions n’est pas fermée, en présence d’une répétition d’actes, la jurisprudence examine au cas par cas, si l’existence de tels faits multiples forme une opération indivisible, justifiant le report du délai de prescription.
Les exemples jurisprudentiels d’infractions complexes les plus significatifs sont les suivants :
- en matière d’escroquerie (313-1 du code pénal) : infraction complexe, puisque plusieurs actes sont nécessaires pour réaliser le délit, le point de départ du délai de prescription court à compter de la dernière remise. C’est le cas lorsque la tromperie initiale a déterminé des remises successives, formant, avec les manœuvres frauduleuses, un « tout indivisible ».
- en matière de concussion (432-10 du code pénal), la prescription ne commence à courir qu’à compter de la dernière des perceptions de sommes indues, ou de la dernière exonération accordée indûment quand elles résultent d’opérations indivisibles.
- en matière de prise illégale d’intérêts (432-12 du code pénal), infraction instantanée, la jurisprudence considère que le délit se prescrit « à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance ». Tel est le cas en présence du dernier versement d’honoraires effectué par un maire au nom de la commune, au profit de son beau-frère, architecte, attributaire d’un marché.
- en matière de trafic d’influence (433-2 du code pénal), la prescription suit les mêmes règles qu’en matière de corruption passive notamment en cas de remises successives, elle part de la dernière de ces remises.
- l’infraction prévue au 2° de l’article L. 245-11 du code de commerce qui réprime pour les présidents, directeurs généraux et administrateurs et les obligataires des sociétés par actions, « le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers », dont les éléments constitutifs sont proches de ceux de la corruption, peut être considérée comme une infraction complexe.
L’état du droit tel qu’il résulte de la combinaison des normes législatives et de ces développements jurisprudentiels, présente des avantages incontestables de souplesse et d’efficacité dans l’appréhension des actes délictueux, notamment pour la défense des intérêts de l’État qu’assure l’Agent judiciaire de l’État, dans le cadre de son mandat légal de représentation de ce dernier devant les juridictions répressives.
4. Faut-il revoir les modalités d’application dans le temps des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ?
Le régime général de l’application de la loi pénale dans le temps est défini à l’article 112- 2 du code pénal, qui prévoit notamment à l’alinéa 4, l’application immédiate lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines392.
Il en résulte que les lois relatives à la prescription de l’action publique sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. Il convient de noter que la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a supprimé la mention, sauf quand elles auraient pour effet d’aggraver le sort de l’intéressé qui complétait auparavant cet alinéa.
La prescription des peines doit quant à elle se régler d’après la loi qui, dans le concours de deux dispositions différentes, peut la faire réputer acquise au profit de l’accusé393.
Pour déterminer la loi applicable à la prescription de la peine, il convient de se placer au jour où ladite peine est devenue définitive et non pas à la date des faits, laquelle n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’action publique.394
Au regard des enjeux de sécurité juridique déjà évoqués, il n’apparaît pas de motif de nature à justifier une révision des modalités d’application dans le temps ainsi définies des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.
Exemple de dossiers à caractère pénal suivis par l’Agent judiciaire de l’État
Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers est également Agent judiciaire de l’État. Il dispose d’un monopole de représentation de l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire, conformément à l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955395.
Le bureau du droit pénal et de la protection juridique de la direction des affaires juridiques instruit, en matière pénale, les dossiers des procédures engagées devant les juridictions répressives, aux fins d’obtenir, à titre principal, la réparation des dommages matériels résultant d’une infraction commise au préjudice de l’État (vols, escroqueries, détournements de fonds, concussion, abus de confiance, fraudes diverses, dégradations, destructions de biens et autres actions préjudiciables).
À cet égard, l’Agent judiciaire de l’État a eu à connaître d’infractions dissimulées commises au préjudice de l’État pour lesquelles il s’est constitué partie civile devant les juridictions d’instruction et de jugement.
La mission d’information de l’Assemblée nationale pourra trouver, ci-après, des exemples de dossiers dans lesquels les poursuites engagées et les condamnations prononcées en faveur de l’État concernent plus particulièrement des affaires de détournements de fonds publics et d’escroquerie.
1. Au préjudice des ministères économiques et financiers.
• Monsieur F. (dossier n° 2012/05299) : détournement de fonds publics commis par un agent des finances publiques.
L’Agent judiciaire de l’État a obtenu devant les juridictions répressives l’intégralité de son préjudice matériel estimé à la somme de 217.890 €.
• Monsieur S. (dossier n° 2008/10981) : détournement de fonds publics commis par un agent administratif du Centre des impôts d’une ville de province.
L’Agent judiciaire de l’État a obtenu l’intégralité de son préjudice matériel, soit la somme de 401.668 €.
• Madame M. (dossier n° 2008/03023) : détournement de fonds publics commis par un agent d’administration de la Direction générale des finances publiques.
Le préjudice matériel de l’État estimé à 43.094,73 € a été entièrement obtenu.
• Madame D.(dossier n° 2008/06459) : détournement de fonds publics commis par un contrôleur des finances publiques.
L’AJE a obtenu la somme de 124.077,30 € au titre du préjudice matériel de l’État ce qui correspond à l’intégralité de ses demandes.
• Monsieur S. (dossier n° 2007/04704) : détournement de fonds publics commis par un agent administratif du Service Impôts Entreprises.
L’agent a été condamné à payer à l’AJE la somme de 3.171.085,46 € au titre du préjudice matériel de l’État. L’intégralité du préjudice matériel a été obtenue.
• Monsieur D. (dossier n° 2015/00607) : détournement de fonds publics commis par inspecteur des finances publiques, en ses qualités de régisseur de la régie d’avances, dont l’objet est le remboursement d’avances de frais de déplacements des agents, et d’agent comptable.
Sur intérêts civils, l’agent a été condamné à verser à l’AJE l’intégralité des sommes réclamées, soit la somme de 156.468,87 € au titre de son préjudice matériel (109 868,87 € pour la DRFIP et 46 600 € pour le Centre régional de la propriété forestière.
2. Au préjudice des autres ministères.
• G. et autres (dossier n° 2007/03447) : Ministère de la défense
Condamnation pour recel d’abus de biens sociaux et d’escroquerie au préjudice de l’État.
Sur l’action civile, le prévenu a été condamné à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 447.538 € correspondant aux sommes issues de l’escroquerie.
Appel en cours.
• Madame DE C. (dossier n° 2014/05673 : Ministère de la justice
Détournement de fonds publics pour un montant de 636.465 € de la régisseuse d’avances et de recettes d’une juridiction ayant pour mission le paiement des frais de justice et la consignation de certaines sommes. En attente de la date d’audience devant le tribunal correctionnel.
• Monsieur LE D. et Madame D. (dossier n° 2009/12625) : Ministère de l’éducation nationale
Agent comptable d’un Lycée ayant réalisé des détournements de fonds publics à hauteur de la somme totale de 618.139,30 €.
Adjointe administrative dans le même Lycée. Les détournements commis s’élèvent à la somme globale de 51.220,46 €.
La date d’audience de cette affaire devant le tribunal correctionnel n’est pas encore fixée.
• Monsieur M. (dossier n° 2011/03520) : Ministère de la défense.
L’Agent judiciaire de l’État a obtenu la somme de 114.276,38 € en réparation du dommage causé par les détournements de fonds dont il a été victime pour un préjudice initial estimé à 315 000 €.
• Monsieur H. (n°2009/12128) : Ministère de l’intérieur.
Sous-brigadier de police condamné pour détournement de fonds publics à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 58.059 € au titre du préjudice matériel de l’État.
• Monsieur et Madame D. (dossier n° 2009/11632) : Ministère de l’éducation nationale
Monsieur et Madame, dirigeants d’un lycée sous contrat d’association avec le Ministère de l’Éducation nationale, ont été condamnés pour escroquerie. Ils avaient créé un système organisant la présence fictive d’élèves qui leur a permis d’obtenir de la part de l’État un financement supérieur à celui auquel ils auraient pu normalement prétendre. Le préjudice matériel de l’État était estimé à la somme de 232.400 €. L’agent judiciaire de l’État a obtenu la somme de 72.224 € au titre de ce poste de préjudice.
Contribution de M. Dominique Foussard,
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
I –
REMARQUES D’ORDRE GENERAL
1) Rôle respectif des sources
Depuis deux siècles, et s’agissant de la prescription pénale, le législateur a laissé le champ libre au juge. Les idées ont évolué, la criminalité aussi. Au long du temps et au fil des espèces, le juge a estimé devoir réaménager certaines règles. L’exercice s’est toutefois heurté à certains obstacles. D’un côté, le juge ne peut modifier un délai. D’un autre côté, il lui est difficile d’élaborer de nouvelles catégories, de toutes pièces, sans les enraciner dans ce qui existe. Réécrivant tel ou tel pan du droit de la prescription, la jurisprudence a peiné à édicter des règles claires, précises, exemptes d’arbitraire. Face à ce constat, elle a frappé à la porte du législateur, mais sans trouver beaucoup d’écho. C’est la source du désordre – certains disent du chaos – qui afflige le droit positif.
Il faut dire que la matière est complexe. Au-delà des questions techniques qu’elle peut susciter, la prescription a pour fonction de régler l’action d’un corps (l’autorité judiciaire), d’assurer l’efficacité de l’action publique, et in fine, d’éliminer l’action publique si elle n’a plus de sens. Eu égard à la liberté qui est la sienne, et aux moyens dont il dispose, c’est au législateur, plus qu’au juge, de fixer les règles en considération de ce type des finalités. Enfin, on ne peut pas ne pas tenir compte de l’opinion publique, dans la mesure où l’action publique est le substitut du droit de se faire justice à soi-même. C’est là encore au législateur plus qu’au juge de prendre en considération cette donnée et de déterminer en quoi elle peut infléchir les règles de la prescription.
Deux enseignements découlent de ce qui précède : il est tout d’abord nécessaire que le législateur, en l’état, reprenne la main et réexamine le droit positif comme il est nécessaire qu’il s’attache, pour l’avenir, à la conserver en édictant des règles appropriées.
2) Les fondements
De ce point de vue également, un retour sur le passé est utile. Le législateur de 1808 a très largement repris les idées qu’avançait la doctrine dans la seconde moitié du 18ème siècle, et a conservé les pratiques qu’avaient consacrées les parlements, sur la base de ces idées, à la même époque. L’état des lieux est le suivant. Si certains fondements continuent d’être évoqués, ils sont incontestablement frappés de désuétude. L’évocation de ces fondements alourdit inutilement le débat. Il serait sans doute judicieux de les éliminer396.
D’autres fondements mis en avant sont le siège d’équivoques. Prenons l’exemple de l’idée d’oubli. Dans certains cas, l’oubli est conçu comme un droit. Dans d’autres cas, l’oubli procède d’un simple constat. Au surplus, l’oubli n’a pas toujours le même objet. Tantôt il a pour objet les faits eux-mêmes : ils s’estompent dans la mémoire collective. Tantôt l’oubli porte, non pas tant sur les faits, que sur le trouble ressenti par la collectivité. Tantôt l’oubli vise, non pas les faits ou le trouble, mais l’auteur lui-même : il est admis que la société puisse s’interdire, l’auteur des faits s’étant réinséré, d’évoquer les faits qui lui sont imputables. Au surplus, l’oubli, dans le public, suscite des attitudes contrastées. D’un côté notre société ne s’attarde pas au passé. Souvent, elle souhaite même qu’on le fasse disparaître assez vite. Ce constat explique, à titre d’exemple, l’orientation du droit de la prescription civile, tel qu’issu de la réforme de 2008. Mais, parallèlement, nos contemporains ont les moyens de remonter dans le temps et ils en usent aisément sans hésiter à ouvrir des débats sur des faits anciens. Là encore, l’idée demeure pertinente. Mais son impact doit faire l’objet d’une appréciation nuancée397.
Enfin, certaines idées mériteraient d’être mieux mises en valeur. Ainsi, il appartient à l’autorité judiciaire, qui est en charge de l’action publique, de prendre les initiatives qui lui paraissent opportunes à l’effet de poursuivre la répression. Mais les moyens donnés à l’autorité judiciaire ne sont pas sans limites. Des choix sont à faire entre les faits anciens et les faits plus récents. Au fil du temps, la nécessité de la répression s’estompe inexorablement. Il est légitime que le législateur intervienne pour mettre un terme à l’exercice de l’action publique, fût-ce à l’effet d’assurer l’égalité de traitement. Parallèlement, on occulte souvent le fait que l’objectif de l’action publique n’est pas toujours le même. Dans certaines hypothèses, l’essentiel est la déclaration de culpabilité. La notion de réprobation prédomine. Dans d’autres hypothèses, l’objectif recherché réside, moins dans la déclaration de culpabilité, que dans le prononcé d’une peine. Et il est alors nécessaire d’établir en rapprochement entre la prescription et les peines susceptibles d’être prononcées.
D’où un travail – indispensable – d’inventaire, d’élimination, de réévaluation, peut-être même de hiérarchisation. Le tout assorti d’un souhait, à savoir que le résultat de cette réflexion sera transcrit dans un préambule pour servir de guide à ceux qui, en pratique, invoquent la prescription ou la mettent en œuvre, et pour établir un lien entre le droit législatif et le droit prétorien nécessairement appelés à le compléter et à l’adapter398.
3) La nécessité d’un périmètre
Au regard des objectifs de clarté et de prévisibilité, l’idéal serait qu’une réforme puisse embrasser toutes les prescriptions ayant cours en matière pénale. Il est permis de se demander si un tel projet n’est pas irréaliste. Déjà, les prescriptions instituées par le législateur sont innombrables, qu’elles figurent dans des codes ou dans des lois non codifiées. Au surplus, s’il est probable qu’un certain nombre de ces prescriptions sont assujetties à des règles spéciales, sans qu’aucune raison sérieuse ne le justifie, on peut penser que tel n’est pas toujours le cas. L’opération de recensement devrait être doublée d’une seconde opération pour vérifier la justification des règles ainsi édictées. Par ailleurs, dans une matière telle que celle-là, le débat risque d’être altéré, pollué, submergé par des considérations venues de disciplines adjacentes, et étrangères à ce qui constitue le cœur de la matière.
Une réforme, permettant d’atteindre les objectifs recherchés, sera d’autant plus aisée à réaliser qu’elle est élaborée à partir d’un ensemble de règles homogènes. Le code de procédure pénale paraît de ce point de vue un cadre approprié. Ainsi, la réforme pourrait permettre l’élaboration d’un droit commun et les partis adoptés dans le cadre de ce droit commun pourraient servir d’étalon, dans un second temps, pour une réévaluation des règles spéciales, qu’elles figurent dans les codes ou dans des lois non codifiées. À titre incident, c’est le parti, remarquons-le, qui a été adopté par le législateur en 2008 pour la prescription civile399.
C’est à la lumière de ces trois remarques préalables que seront examinés les points qui de prime abord, pourraient donner lieu à remaniement.
II –
LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION
1) L’état du droit positif
L’état du droit positif est connu. Il comporte un principe : le point de départ est fixé au jour de la commission des faits ; et une exception : le point de départ est différé jusqu’au jour où les faits peuvent être découverts. Schématiquement, l’exception intervient dans trois cas de figure. Elle concerne tout d’abord le cas où la dissimulation correspond à l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Elle est également retenue dans le cas où l’infraction est commise dans un milieu difficile à pénétrer tel que le milieu des affaires. Enfin, l’exception joue, sans qu’il soit possible d’identifier ce qui meut la jurisprudence, dans les hypothèses où le juge considère qu’il faut faciliter la répression.
L’état du droit positif est à l’origine de multiples inconvénients. Déjà, depuis toujours, la jurisprudence peine à conférer un fondement solide aux solutions qu’elle arrête. Ensuite, elle est dans l’impossibilité de définir les catégories d’infractions entrant dans le champ de l’exception, et les limites de l’exception sont indécises. Ainsi, la matière est le siège d’une casuistique dont le sens est difficile à appréhender et au bout du compte, on aboutit dans un certain nombre d’hypothèses à une véritable imprescriptibilité. Cette situation conduit d’ailleurs à des dérèglements. Pour pallier les difficultés rencontrées, la Chambre criminelle a pris le parti, assez souvent, de laisser les juges du fond libres de leurs décisions, mais c’est la voie ouverte à l’arbitraire et à des ruptures d’égalité. Et quand elle s’empare de la question, on observe que la matière est le siège de revirements. C’est ainsi qu’on a vu l’Assemblée plénière de la Cour de cassation désavouer la chambre criminelle quand il appartient normalement à cette dernière d’assurer la cohérence du droit et l’unité de son application par les juridictions du fond400.
Il importe donc que le législateur se réapproprie la question.
2) Le sens d’une réforme
♦ Dans la mesure où le législateur, à la différence du juge, appréhende globalement la matière, il peut être envisagé – c’est une première réponse – de partir des solutions jurisprudentielles en les encadrant au moyen de définitions ou de catégories.
À la réflexion, l’exercice paraît tout de même délicat. Il est à redouter que le législateur, si même il est mieux armé, ne soit dans l’incapacité de définir des catégories ou de poser des critères fiables, autrement dit, opératoires et aisés à mettre en œuvre.
Dans la même ligne, le législateur pourrait identifier infraction par infraction les cas où le point de départ de la prescription doit être différé. À la réflexion, l’entreprise risque également d’être hasardeuse. Il est à craindre qu’un tel dispositif ne soit à son tour le siège d’arbitraires.
♦ À l’occasion de la réforme de 2008, concernant la prescription civile, le législateur a retenu, dans certaines hypothèses, le double délai : un délai de principe partant du jour de la découverte des faits permettant l’exercice de l’action et un délai butoir, courant du jour de la survenance des faits, dans lequel est enfermé en toute hypothèse l’exercice de l’action401.
La procédure pénale – c’est une deuxième réponse – pourrait s’en inspirer.
Un tel dispositif répond incontestablement à l’objection d’une absence de prescription. Mais il laisse subsister des difficultés : la nécessité de définir des catégories d’infractions ou de fixer des critères et les hésitations liées à l’identification du jour de la découverte des faits demeurent. Et il compromet inévitablement l’objectif de clarté que devrait pourtant poursuivre une réforme.
♦ En définitive, la réponse la plus adéquate – c’est la troisième solution – consisterait à revenir au principe – un point de départ fixé au jour de la commission des faits pour toutes les infractions, avec une exception concernant les infractions où le point de départ peut être différé sur la base d’un évènement clairement identifié tel que l’accession à la majorité du mineur.
III –
L’INTERRUPTION DU DÉLAI
Le délai applicable, une fois l’action engagée.
En l’état actuel, dès lors que le délai pour agir est interrompu, un nouveau délai s’ouvre de même durée. Il serait opportun de rompre avec cette solution car elle n’est pas justifiée. Plusieurs raisons sont à la base de ce point de vue. D’une part, un certain nombre d’idées, mis en avant pour justifier la prescription de l’action et le délai dans lequel elle doit être déclenchée sont sans pertinence aucune dès lors que l’action est engagée. En revanche, la seule question pertinente est la suivante: sur quel rythme l’autorité judiciaire doit agir. Le délai est alors intimement lié à la notion de droit au procès équitable envisagé sous l’angle du délai raisonnable et ce tant au regard de la CEDH qu’au regard du droit interne. C’est en contemplation de considérations propres à l’action de l’autorité judiciaire, par conséquent, et les diligences qu’on est en droit d’attendre d’elle que les délais, permettant de juger de son action, sont fixés. Enfin, la dissociation du délai de prescription, à l’intérieur duquel l’acte interruptif doit intervenir, et du délai dans lequel, la prescription ayant été interrompue, l’autorité judiciaire doit poursuivre ses diligences, s’impose avec d’autant plus de force que la durée de la prescription est accrue.
À cet égard, il serait utile de mettre sur pied une terminologie plus rigoureuse. On sait d’ailleurs que les désordres du droit, à tout le moins ses hésitations, sont souvent le fait d’une terminologie mal maîtrisée. Ainsi, il faudrait réserver la notion de prescription à l’exercice d’action publique, bref au délai dans lequel les actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite doivent être accomplis. Corrélativement, s’il est nécessaire de sanctionner l’inaction de l’autorité judiciaire, une fois le délai de l’action publique interrompu, il serait souhaitable de désigner cette sanction d’un autre terme, tel que péremption, caducité, déchéance etc.
La définition de l’acte interruptif
Soucieuse d’efficacité et attentive à lever tous les obstacles à la répression, la jurisprudence a pris le parti d’étendre, autant que faire se peut, le champ des actes produisant un effet interruptif. On pourrait imaginer d’encadrer le régime de l’acte interruptif. Les questions suivantes se posent : de qui peut émaner l’acte interruptif ? Auprès de qui doit-il être accompli ? Quelle est la nature de l’acte susceptible d’être interruptif (administratif ou judiciaire) ? Quel degré de précisions doit revêtir l’acte quant aux faits que son auteur entend viser
En pratique, une difficulté surgit. L’acte invoqué comme interruptif est parfois libellé de façon si imprécise que, en cas de contestation, l’appréciation portée par le juge sur l’existence ou l’absence d’une interruption s’avère en définitive difficilement prévisible et partant laisse place à l’arbitraire. Sans s’écarter de la définition de l’acte interruptif telle qu’elle est actuellement consacrée, il serait souhaitable de préciser les exigences formelles requises de l’acte interruptif.
L’incidence de la connexité
Le doit positif relatif à la connexité appelle deux observations. D’un côté, la connexité est définie de façon aussi large que possible et en ce domaine, il est admis qu’on puisse raisonner par analogie. D’un autre côté, la Chambre criminelle laisse une très grande liberté aux juges du fond. Pas de contrôle, hormis l’absence totale de motifs, lorsque la connexité est écartée. Et un contrôle très léger lorsque la connexité est retenue du moment que les juges du fond ont pris la précaution de motiver un tant soit peu leur appréciation.
En édictant l’article 203 du code de procédure pénale402, le législateur avait fait l’effort d’identifier, en adoptant une conception large de la connexité, les situations pouvant être regardées comme connexes. Ne convient-il pas, pour éviter en pratique une imprescriptibilité, d’en revenir au parti qu’a adopté le législateur en contraignant la jurisprudence à s’en tenir à ce que décide le texte législatif ? Ce qui paraitrait d’autant plus raisonnable que les délais seraient parallèlement allongés.
IV –
LA SUSPENSION DU DELAI
Deux brèves remarques à propos de la suspension. La première concerne la femme enceinte. En opportunité, il est contestable de l’assimiler à une personne incapable d’agir. Il serait heureux que la disposition propre à la femme enceinte disparaisse. La deuxième observation a trait aux personnes vulnérables. En pratique, le droit positif présente deux inconvénients. Il suscite des débats délicats quant à la date à compter de laquelle la suspension peut se produire. Au surplus, il faut bien mesurer que la règle actuellement retenue – il est d’ailleurs curieux qu’elle ne soit pas retenue, s’agissant des crimes – aboutit pratiquement à une imprescriptibilité.
V –
LES DELAIS SUSCEPTIBLES D’ETRE RETENUS
La fixation des délais de la prescription relève, c’est l’évidence, de considérations relevant largement de l’opportunité. En dehors du délai de prescription relatif aux contraventions qui ne paraît pas en cause, on pourrait prendre le parti de doubler les délais pour le porter à six ans, s’agissant des délits et à vingt ans, s’agissant des crimes, et ce dans un souci de clarté et d’intelligibilité. En tout cas, si le délai de dix ans, en matière délictuelle, paraît trop long, on peut hésiter entre cinq, six, sept et huit ans. Encore qu’un délai poussé vers le maximum peut paraître à son tour d’une longueur excessive, s’agissant de certains délits, tel que le vol qui peut concerner des faits d’importance mineure. En matière criminelle, un délai de vingt ans paraîtrait raisonnable, notamment au regard des finalités de la peine. En toute hypothèse, a-t-on véritablement besoin d’un délai de trente ans ?
VI –
MATIÈRES PARTICULIÈRES
Il a été précédemment souligné qu’a priori la réforme devait être envisagée dans un cadre précisément circonscrit. Le code de procédure pénale pourrait constituer ce cadre. En toute hypothèse, deux matières au moins devraient être soustraites au droit commun de la prescription pénale que viserait à fixer la réforme.
1) Le droit de la presse
Le droit de la presse doit incontestablement faire l’objet d’un traitement à part. D’une part, il met en cause la liberté d’expression. C’est une liberté à juste titre très protégée. S’agissant de l’action publique, cette donnée est assurément fondamentale. Quand l’action publique vise d’ordinaire à déterminer si les faits sont établis et s’ils répondent à une qualification pénale, dès que la liberté d’expression est en cause, l’action publique est soumise à une contrainte, la nécessité de faire le partage entre ce qui relève de la liberté d’expression et ce qui doit en être détaché comme révélateur d’un usage abusif de cette liberté. D’autre part, la marge de manœuvre du législateur est étroite. C’est qu’il doit agir sous l’œil de la CEDH. Or, chacun sait que la CEDH exerce en ce domaine un contrôle très rigoureux. Ainsi pour se prononcer sur l’atteinte à la liberté d’expression, elle peut faire état, par exemple, de la modicité de l’amende. On peut très bien concevoir qu’un jour, dans cette matière, elle se préoccupe de la durée de la prescription ou encore de son régime. À maints égards, le droit de la presse apparaît incohérent. Mais il doit faire l’objet d’un traitement à part. Et l’observation vaut notamment, s’agissant des règles de la prescription.
2) La fraude fiscale
♦ Le droit positif
Les poursuites du chef de fraudes fiscales obéissent à des règles particulières. Elles résultent du Livre des procédures fiscales. L’action publique est engagée sur plainte de l’administration. Celle-ci suppose au préalable un avis favorable de la Commission des infractions fiscales. C’est au Ministère public qu’il incombe de mettre en mouvement l’action publique. À raison du principe de l’opportunité des poursuites, qui reste applicable dans cette hypothèse, il est libre de ne pas poursuivre. En toute hypothèse, il lui incombe, sur la base des faits que dénonce la plainte, d’identifier les personnes donnant lieu à poursuites. En marge de ce qui précède, l’action publique du chef de fraudes fiscales obéit à des règles particulières du point de vue de la prescription. Trois d’entre elles doivent être relevées. Un point de départ fixe : le premier janvier qui suit l’exercice au cours duquel la déclaration n’a pas été déposée, s’il y a omission de déclaration, ou au cours duquel, la déclaration minorée a été déposée, si une déclaration a été régularisée. Une cause de suspension propre à la matière : une suspension de six mois a été instituée pour permettre la saisine de la Commission des infractions fiscales et l’émission d’un avis par cette instance. Un délai excédant aujourd’hui le délai du droit commun : depuis la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013, le délai de prescription est de six ans.
♦ La spécificité de la matière
Si l’exercice de l’action publique, dans le domaine de la fraude fiscale, a toujours été régi par des règles propres, c’est que des raisons puissantes le justifient. Un : quelle que soit la manière dont l’action publique est exercée, le rôle de l’administration fiscale est nécessairement décisif. C’est elle qui collecte, à l’occasion des procédures qui lui sont propres les éléments de nature à mettre en évidence un comportement délictueux. Il est inconcevable que l’autorité judiciaire puisse exercer des poursuites sans le concours de l’administration. Deux : il ne faut pas perdre de vue que la définition du délit, telle qu’elle résulte du texte, a été conçue de façon extrêmement large : toute inexactitude, affectant une déclaration, peut constituer le délit de fraude fiscale. Dans ce contexte, une réflexion doit nécessairement être menée, dossier par dossier, sur les circonstances de nature à caractériser l’élément intentionnel : ampleur de l’inexactitude, répétition des inexactitudes, recours à des procédés destinés à masquer les inexactitudes, distorsions entre les comptes, qui peuvent être tenus correctement, et les déclarations, affectées d’inexactitudes etc. Dans cette même ligne, il ne faut pas perdre de vue que l’identification de l’élément intentionnel postule la prise en compte de la complexité plus au moins grande des règles fiscales applicables. Ce qui suppose parfois une analyse fine, et en tout cas assez poussée des dossiers. Et l’on imagine mal que ces investigations et vérifications ne soient pas confiées à l’administration. Trois : en tout état, ce travail recoupe largement celui qu’effectue nécessairement l’administration lorsqu’elle est appelée à déterminer les sanctions administratives applicables au contribuable. Quatre : il ne faut pas davantage oublier que dans la mesure où l’administration dispose du droit d’infliger des sanctions administratives, l’action publique, du chef de fraude fiscale est là pour épauler et renforcer l’action répressive que l’administration exerce au travers des sanctions administratives, et par suite, on ne conçoit pas que la politique mise en œuvre, s’agissant de la répression pénale de la fraude fiscale, soit dissociée de la politique que met l’administration en œuvre au travers des sanctions administratives dont elle dispose.
Revenons maintenant à la prescription. D’une part, elle est d’une manière générale indissociable du dispositif qui vient d’être évoqué. À ce titre, on peut difficilement l’en détacher pour la soumettre au droit commun de la procédure pénale. D’autre part, on ne peut pas imaginer que la prescription de l’action publique, du chef de fraude fiscale, ne soit pas articulée sur les délais de prescription gouvernant l’établissement de l’impôt et le recouvrement. Enfin, comme il a été relevé précédemment, le droit positif de la prescription en matière de fraude fiscale répond aux objectifs recherchés dans le cadre d’une éventuelle réforme puisque le déclenchement de la prescription est articulé sur un point fixe et que le délai a été tout récemment porté à six ans.
VII –
L’INCIDENCE D’UNE RÉFORME SUR LES PROCÉDURES
EN COURS
Avant de procéder à une réforme, il est légitime que le législateur mesure les effets des règles nouvelles à l’égard des procédures en cours et s’interroge par conséquent sur l’application dans le temps des règles nouvelles gouvernant la prescription. Ce qui suscite trois questions. La première concerne la liberté dont jouit le législateur. La deuxième a trait à l’état du droit positif. La troisième est relative à la nécessité d’édicter des règles de droit transitoire.
1) La liberté du législateur
♦ Au regard du droit constitutionnel, le législateur est en principe libre d’édicter comme il l’entend les règles de la procédure pénale. Entre autres, les contraintes afférentes aux règles de fond (absence de rétroactivité, rétroactivité in mitius etc) n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure403.
Pour autant le législateur n’est pas totalement libre : le contrôle qu’exerce le Conseil Constitutionnel, à propos des règles de prescription proprement dites, pourrait être étendu à la manière dont est conçu le droit transitoire. Déjà, lorsque la loi se réfère à des catégories d’infractions, il faut qu’elles soient définies de façon suffisamment précise. En outre, et au-delà de la rédaction, le Conseil Constitutionnel se réserve un double contrôle. Un, au regard du principe d’égalité : si deux situations similaires sont traitées de façon différente, la différence de traitement ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Deux, au regard du droit au procès équitable : la solution posée ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense404.
♦ S’agissant du droit conventionnel, une observation du même ordre s’impose. A priori, le législateur fixe comme il l’entend les règles de la prescription405. Toutefois, à l’avenir, on ne peut pas exclure que la CEDH puisse s’interroger sur la prescription, au regard du droit au procès équitable.
Dans cette même ligne, il faut faire mention de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 21 décembre 2006406. Il a écarté une règle nouvelle, relative à l’interruption de la prescription, sur le fondement du droit au procès équitable. Il est vrai que l’arrêt a trait au droit de la presse. Surtout, il a été rendu, non pas à propos de l’introduction de l’action publique, mais à propos des diligences qui doivent être accomplies en cours d’instance, et une fois la procédure engagée. Malgré tout, on voit bien que le droit au procès équitable peut le cas échéant perturber le fonctionnement des règles de la prescription.
2) L’état actuel du droit positif
Le droit positif est fixé par les articles 112-2, 112-3 et 112-4 du code pénal. Ces textes sont récents. La rédaction actuelle de l’article 112-2 dernier alinéa, résulte de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. L’idée de base est la suivante : la prescription constitue, non pas une règle de fond, mais une règle de procédure, faisant l’objet d’une application immédiate407.
Déjà, on peut se demander si ces dispositions, en tant qu’elles concernent la procédure, et notamment la prescription, considérées comme relevant de la procédure, ne devraient pas trouver place dans le code de procédure pénale.
Concrètement, des distinctions s’imposent.
Pas de difficulté, s’agissant de la légalité des actes : ils sont soumis à la loi en vigueur au moment où ils interviennent.
Quid, des situations en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle ?
Deux hypothèses. Lorsque la loi nouvelle abrège le délai (ce qui peut résulter d’une modification du point de départ), on applique le nouveau délai, décompté du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Une limite toutefois : le délai ne peut excéder la durée découlant du texte ancien. Lorsqu’au contraire la loi nouvelle allonge le délai, on applique le nouveau délai, lui aussi décompté du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois, dans le calcul du délai, on prend compte le temps écoulé sous l’empire de la loi ancienne.
D’une manière générale, ce dispositif ne suscite pas de critiques. Il est satisfaisant tant du point de vue de la simplicité que du point de vue de la stabilité des solutions. Il faut bien mesurer toutefois que les textes ne tranchent pas tout et laissent place à l’intervention du droit prétorien. Ainsi, les solutions retenues, à propos des situations en cours, résultent de la jurisprudence408. D’où la question : faut-il prévoir des dispositions relatives à l’application dans le temps des règles nouvelles ?
3) L’édiction de règles transitoires
Deux considérations militent en faveur de l’édiction de telles règles transitoires. Tout d’abord, les textes figurant aujourd’hui dans le code pénal, ainsi qu’on vient de le voir, ne règlent pas tout. Il est certes possible de se référer à la jurisprudence. Mais il est plus commode, pour les usagers, de disposer de textes donnant immédiatement la réponse aux questions posées. Par ailleurs, des règles de droit transitoire ont été édictées, en 2008, lors de la réforme de la prescription civile et les raisons qui ont prévalu alors demeurent pertinentes a priori, s’agissant d’une réforme portant sur la prescription pénale409. Certes, la loi ne peut pas apporter réponse à tout. Mais elle peut au moins prendre parti sur des questions d’ores et déjà identifiées et susceptibles, inévitablement, de se poser en pratique.
À titre incident, il est toutefois nécessaire de prendre parti sur le point suivant. Faut-il édicter des règles transitoires, pour les seuls besoins de la réforme à venir, auquel cas les règles de droit transitoire devraient prendre place dans la loi édictant les règles nouvelles ? Ou faut-il au contraire édicter des règles de droit transitoire, ayant vocation à s’appliquer à toute réforme de la prescription, auquel cas les règles en cause devraient normalement figurer dans le code de procédure pénale ?
Dans le cas où le choix serait fait d’édicter des règles générales concernant le droit transitoire et de les insérer dans le code de procédure pénale, elles pourraient être libellées de la manière suivante410 :
En tant que lois de procédure, les règles nouvelles relatives à la prescription sont d’application immédiate.
Les actes accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régis par la loi ancienne. Les actes accomplis postérieurement à son entrée en vigueur relèvent de la loi nouvelle.
La loi nouvelle s’applique dès le jour de son entrée en vigueur aux situations en cours. Lorsque par l’effet de la loi nouvelle le délai est allongé, il est tenu compte du délai écoulé sous l’empire de la loi ancienne. Lorsque par l’effet de la loi nouvelle le délai est abrégé, la prescription est acquise du jour de l’expiration du plus court des deux délais.
Pour déterminer si le délai est allongé ou abrégé, il y a lieu de prendre en compte les modifications affectant la durée du délai et le point de départ du délai.
VIII –
L’ADOPTION D’UN PRINCIPE D’INTERPRETATION STRICTE
En droit pénal, les règles sont d’interprétation stricte. C’est la conséquence inévitable du principe de légalité. En procédure pénale, les choses sont moins nettes. On évoque bien le principe de légalité procédurale. Mais le principe, en matière de procédure, n’a pas la force qu’on lui reconnaît lorsqu’on est en présence des règles de fond. L’expérience montre que la jurisprudence s’est reconnue une très grande liberté pour fixer les solutions. On peut se demander dès lors si le législateur ne doit pas édicter un principe d’interprétation stricte, s’agissant des règles régissant la prescription. Figurant dans le code de procédure pénale, le texte pourrait s’inspirer de l’article 111-4 du code pénal. Mais il devrait être évidemment cantonné au domaine de la prescription.
Contribution de Mme Claire Waquet, avocate au Conseil d’État
et à la Cour de cassation
La prescription est actuellement pour l’opinion publique ce que la retraite était pour le Chancelier Bismarck. L’anecdote raconte que lorsque Bismarck a décidé de mettre en œuvre une retraite pour les vieux travailleurs, il a posé la question de savoir à quel âge – en moyenne – lesdits travailleurs mourraient ; on lui a répondu 65 ans, et il a décidé que la retraite serait due à partir de 65 ans.
L’opinion est assez répandue selon laquelle il faut un délai de prescription, mais il ne faut pas que ce délai permette aux éventuels coupables d’échapper à la répression… D’où le caractère paradoxal de la réflexion menée sur ce terrain.
Quel peut être d’abord le fondement de la prescription ?
Un vieil article de Maurice Garçon, paru dans Le Monde du 3 février 1960, faisait ces réflexions :
« Il existe une notion universellement admise dont le fondement est assez mal défini et que nous appelons, en langage de droit, la prescription. La prescription est au civil une manière d’acquérir une propriété à la faveur du temps, au criminel le privilège pour le coupable de n’être plus poursuivi ou pour un condamné de ne pas subir sa peine lorsqu’une certaine durée s’est écoulée. Si cette idée que le temps modifie le droit s’impose assez impérieusement à l’esprit, pour être universellement acceptée, il n’en reste pas moins que la prescription est toujours une violation d’un droit. Au civil, la prescription acquisitive du droit de propriété est la violation du droit du propriétaire antérieur, au criminel c’est une atteinte au droit de punir ou à la valeur de la chose jugée ».
Il est un fait que les fondements que l’on attribuait traditionnellement, notamment au XIXe siècle, à la prescription sont aujourd’hui complètement dépassés.
Il est assez singulier de relever que le fondement actuel qu’on lui donne, c’est-à-dire le délai raisonnable, consiste à faire du neuf avec du vieux, puisque cette notion de délai raisonnable résulte essentiellement de l’introduction dans notre droit de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne, et que c’est cette notion qu’on utilise pour maintenir et justifier une notion de prescription beaucoup plus ancienne.
Je voudrais néanmoins faire cette observation qu’effectivement, et comme le relève Maurice Garçon, la prescription est assez universellement admise. Traditionnellement on considère que les systèmes anglo-saxons ne connaissent pas la prescription, mais la réflexion qu’a faite devant la Commission Mme le professeur Delmas-Marty est assez éclairante. Elle a relevé que s’il n’existait pas de règle analogue à celles qui existent dans certains droits continentaux, en revanche, le juge anglo-saxon apprécie, de façon pragmatique, le moment où il devient impossible de poursuivre. Pour reprendre une expression canadienne, il vient un moment où agir revient à « abuser le système » et où l’action est véritablement considérée comme tardive.
Singulièrement, ce qu’a fait la jurisprudence française avec la prescription relève d’une démarche tout aussi pragmatique et analogue à celle que semble avoir fait le juge de la Common Law sans règle de prescription expresse.
On comprend néanmoins que le sentiment d’insécurité juridique résultant actuellement d’un maquis de règles légales et jurisprudentielles justifie que notre propre système soit révisé. La confrontation d’une règle rigide avec une incontestable prise de pouvoir judiciaire sur une des règles les moins respectées par un juge, qui se veut néanmoins le serviteur de la loi, laisse un peu perplexe.
Donner à la prescription le fondement du délai raisonnable, c’est en revenir me semble-t-il à ce qui, en réalité, constitue le fondement même de la prescription, c’est-à-dire l’écoulement du temps. La prescription est fondamentalement liée au temps qui passe. Le droit n’est pas une discipline hors sol, c’est une discipline concrète qui s’applique aux hommes et aux facteurs humains, et le temps est un facteur humain fondamental, sans doute l’un des plus fondamentaux, qui fait que les situations juridiques évoluent. Ainsi, tôt ou tard, et même si c’est à des âges différents et selon des systèmes différents, un enfant mineur devient majeur tout simplement parce qu’il a grandi. Ainsi, lorsqu’une propriété immobilière a été possédée de façon paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans, le possesseur devient propriétaire.
C’est le mot « paisible » qui me paraît important dans ces critères de la prescription acquisitive, même si notre sujet est différent. Car l’infraction est tout sauf paisible ; elle est par définition un trouble à l’ordre public. Mais le procès est aussi loin d’être paisible. Même mené en temps utile, il est sans doute curateur, réparateur (quoique pas toujours), il n’en reste pas moins un véritable traumatisme. Or, le temps guérit, le temps efface, le temps remplace, et le temps fait qu’au bout d’un certain délai, si une infraction n’a pas été poursuivie, qu’elle a été en quelque sorte digérée par le corps social nonobstant le trouble qu’elle a produit, le traumatisme qui pourrait être créé par sa poursuite tardive et la remise en cause d’un certain apaisement ne sont plus nécessaires dans le corps social. Poursuivre trop tard, dépasser le temps judiciaire, c’est provoquer des recherches un peu désespérées et des preuves de plus en plus difficiles à trouver, créer de faux espoirs chez les victimes, et prendre le risque d’erreurs de parallaxe à raison d’éventuels changements de mentalité. Tout cela sera en définitive moins bénéfique que le maintien d’une situation, certes, à l’origine violente, mais que le corps social a fini par accepter d’une certaine façon.
À cet égard, je crois qu’il ne faut pas dire que la prescription correspond à l’oubli, et je pense qu’il n’y a rien de commun entre prescription et oubli. Simplement, à partir d’un certain temps, il se produit – parce que le temps s’est écoulé – un basculement qui fait qu’à un moment donné, le bénéfice social de l’action publique devient moindre que celui de l’apaisement.
Ce basculement existe en droit positif. Dans le droit de la diffamation publique, lorsque le diffamé est mort, la diffamation ne peut plus aboutir, sauf dans certains cas extrêmement particuliers, propres à la diffamation de la mémoire des morts. Ainsi, la loi accepte de considérer qu’un évènement fait basculer la diffamation du temps judiciaire au temps de l’histoire ; la parole se libère et on peut parler plus librement de ceux qui sont morts que de ceux qui sont vivants. Ainsi, le temps modifie les situations, le sens des choses, la vision que l’on peut en avoir ; même pour les victimes, cela n’a plus beaucoup de sens de juger éventuellement un vieillard qui ne se rappelle rien ou qui ne veut rien se rappeler. Encore une fois, il ne s’agit pas d’oublier, mais de considérer que le temps de la parole n’est plus le temps de la parole judiciaire, mais un autre temps que je qualifierais de temps plus historique.
*
Le maintien du caractère imprescriptible de certains crimes atroces, comme les crimes contre l’humanité ou les génocides, paraît tout à fait justifié. Le délai de la prescription est fonction de la condamnation morale de l’infraction et de sa gravité. Si l’on veut éviter de banaliser certains crimes particulièrement atroces, la négation même de l’homme ou de certaines catégories d’hommes, il est bon sur le plan symbolique de limiter à ces crimes la règle de l’imprescriptibilité. Pour répondre néanmoins à une préoccupation qui a été émise par M. le Président Cotte, j’observe que sa revendication selon laquelle les crimes de guerre pourraient relever de cette imprescriptibilité trouve un fondement historique.
Lorsque le Tribunal de Nuremberg a été établi par l’accord de Londres, les auteurs avaient prévu trois types de crimes relevant de ce Tribunal spécifique : les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes contre la paix. Il paraît à peu près certain que dans l’esprit des auteurs du statut, chacun de ces trois types de crimes devait être soumis à un régime de prescription identique. La question ne s’est pas posée puisqu’on jugeait les criminels nazis à la fin de la guerre, mais elle s’est posée en France à propos de l’affaire Barbie puisque certains combattants résistants ont voulu faire juger que celui-ci avait commis non seulement des crimes contre l’humanité, mais des crimes de guerre.
Dans un arrêt du 20 décembre 1985, la chambre criminelle leur a opposé que les crimes de guerre étaient prescrits. C’est donc sur ce droit positif que nous vivons depuis quelque temps, mais ce droit positif repose sur une décision probablement plus politique que juridique : à l’époque, il existait une inquiétude sur le point de savoir si une imprescriptibilité des crimes de guerre ne permettrait pas l’ouverture de certains débats sur la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie. Mais encore une fois, le Traité de Nuremberg – très probablement – avait pour intention de soumettre les trois crimes qu’il définissait à un régime juridique et procédural identique.
*
Quid d’un éventuel allongement du délai de prescription de droit commun ?
Il est incontestable que la jurisprudence a fait tout ce qu’elle a pu pour allonger des délais qui lui paraissaient trop courts, et il est tout aussi clair que si le souhait du législateur est de simplifier le système, il faut sans doute allonger les délais ou du moins certains d’entre eux.
À vrai dire, le délai de l’action publique en matière de contravention ne paraît pas poser de problème, et son maintien à un an paraît suffisant. Aucune opinion sérieuse ne milite pour son allongement, et le caractère souvent non intentionnel de ce type d’infraction entraînant une faible réprobation publique, le maintien du délai d’un an paraît envisageable.
Le vrai problème est posé certainement – beaucoup plus à vrai dire que par le délai applicable en matière criminelle – par le délai applicable en matière correctionnelle. Incontestablement, le délai actuel de 3 ans est absolument battu en brèche par toutes sortes de mécanismes jurisprudentiels et même par le législateur. Sur ce délai, dont l’allongement est envisagé, avec des propositions de l’ordre de 7-8 ans par exemple, je ferai trois observations.
• Lorsque la jurisprudence a commencé à s’interroger sur l’abus de biens sociaux et a connu les hésitations que l’on sait, j’ai fait une petite recherche extrêmement factuelle pour rechercher en pratique de combien le délai était allongé à la faveur des divers mécanismes jurisprudentiels utilisés notamment par la Cour de cassation. Mon propos a été de prendre, notamment dans les arrêts publiés au Bulletin, chacun des arrêts dans lesquels le délai avait été manifestement rallongé, de ne jamais m’attarder au mécanisme juridique utilisé pour l’allonger, et de m’interroger uniquement sur le délai brut qui s’était écoulé entre la date des faits et l’ouverture de l’action publique. J’ai constaté que ce délai était de 7 ans. Au-delà, bizarrement, les recettes jurisprudentielles sont mises en œuvre avec beaucoup plus de parcimonie et ne jouent pas nécessairement. D’une certaine façon, il m’a semblé qu’un inconscient judiciaire faisait que le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle était en pratique de 7 ans.
• Je vois également dans ce délai une certaine justification politique. Sans parler de façon polémique de dossiers dans lesquels des instructions personnelles auraient été données de retarder une affaire, on peut considérer que l’action publique, d’une manière générale, a été exercée d’une certaine façon pendant une mandature, et qu’une opposition politique considère qu’il faut l’exercer d’une autre façon, soit en faisant preuve de plus de mansuétude à l’égard d’un certain type d’infraction, soit au contraire en faisant preuve d’une plus grande sévérité et d’une politique de répression plus importante. Il faut rappeler que l’action publique est soumise à un principe d’opportunité et qu’il n’est pas obligé, notamment en matière délictuelle, de poursuivre. On peut donc concevoir que la façon dont l’exercice de l’action publique a été mené par un gouvernement donné fasse l’objet d’un véritable débat politique, éventuellement l’enjeu d’une proposition de changement, et que par conséquent, l’opposition arrivant au pouvoir après une mandature puisse encore avoir la possibilité de poursuivre ce qu’elle considère devoir poursuivre, contrairement à la mandature précédente. À l’heure actuelle, cette réflexion est simplifiée par la concordance des mandats présidentiels et parlementaires, et il paraît donc légitime que si pendant 5 ans l’action publique a été considérée comme négligée sur tel ou tel secteur, éventuellement l’opposition arrivée au pouvoir puisse annoncer qu’entre autres choses, elle exercera l’action publique dans ce secteur qu’elle considère comme délaissé, et il lui restera encore 2 ans pour le faire. Il s’agit là également d’une certaine justification de l’allongement du délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle.
• Je voudrais néanmoins faire part à cet égard d’un certain scepticisme sur le point de savoir si des textes très fermes permettront de supprimer toutes les « recettes jurisprudentielles » qui ont été utilisées pour reporter le point de départ du délai. Je crois qu’à cet égard, il faut faire la part entre deux grosses catégories d’infractions, et donc deux types de « recettes ». Il y a les procédés qui tiennent d’une manière générale à une question de dissimulation, et il y a d’autre part les procédés qui tiennent d’une manière générale à la nature de l’infraction et à sa prolongation dans le temps. Sur la dissimulation, le point de départ du délai de prescription, clairement fixé à la date des faits et allongé à 7 ans, devrait supprimer ce genre d’exception jurisprudentielle. Je suis moins sûre que la jurisprudence renoncerait à la qualification de certaines infractions qui lui permettent de placer le point de départ non pas au début des faits, mais à leur fin : je pense à cet égard aux infractions continues, aux infractions répétitives et à la technique faisant courir par exemple le délai de prescription à compter de la dernière remise lorsque l’infraction suppose des actes répétés. Par exemple, en matière d’infraction au Code de l’urbanisme et de construction sans permis, la jurisprudence considère que c’est bien une infraction instantanée mais qui se termine lorsque les travaux sont terminés. Et elle considère que si l’auteur de l’infraction refait des travaux sur sa maison irrégulière, cela signifie alors que sa maison n’était pas terminée et que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir… Je ne suis pas sûre que ce type de procédé jurisprudentiel disparaisse complètement, même avec un point de départ fixé par le législateur très clairement à la date des faits. Disons qu’en revanche, la solution mettrait sans doute fin à la combinaison des deux types de « méthode jurisprudentielle », c’est-à-dire une infraction assez continuée dans le temps, susceptible de surcroît d’être une infraction dissimulée, ce qui est à l’heure actuelle le cas pour l’abus de biens sociaux.
*
Pour les crimes, il existe à l’heure actuelle des disparités créées par la loi qui, notamment, a créé des délais de 20 ans ou de 30 ans ; l’instauration d’un délai de 30 ans paraît objectivement inutile. Si la prescription criminelle passe de 10 à 20 ans, je ne vois pas d’exemples dans lesquels le fait que la prescription criminelle aurait été de 20 ans ait posé une véritable question411.
*
Enfin, sur cette question d’allongement des délais, je comprends le souci de simplification du législateur, mais je me suis néanmoins interrogée sur le point de savoir si une échelle 1 an / 7 ans / 20 ans ne comportait pas des sauts trop importants. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le délai de prescription est incontestablement lié à la gravité de l’infraction. Or, tous les délits ne sont pas très graves, et il y a des degrés de gravité dans les crimes. Un vol à l’étalage doit-il être puni dans un délai de 7 ans ? Un faux en écriture publique dans un acte authentique doit-il être puni dans un délai de 20 ans ? Pour ma part – et j’exprime là une opinion extrêmement personnelle – il ne me paraîtrait pas complètement impossible de scinder chacun de ces délais de l’action publique en deux, selon la gravité des infractions concernées et donc selon la peine prévue par la loi. Une prescription de 3 ou 4 ans pour les « petits délits » et de 7 ns pour les « gros délits » ; une prescription de 10 ou 15 ans pour les crimes les moins graves, et de 20 ans pour les crimes les plus graves. Il s’agit là évidemment d’une suggestion.
*
En revanche, et surtout si l’échelle est simplifiée mais avec des sauts importants, il est absolument indispensable de déconnecter la notion de l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire de l’ouverture de l’action, du temps judiciaire une fois que l’action publique est engagée. Autrement dit, il est nécessaire qu’une fois l’action publique engagée, elle ne soit plus soumise à ces délais de prescription allongés. Il serait en effet inadmissible que l’autorité publique, l’autorité judiciaire, joue sur des délais allongés et se contente par exemple en matière criminelle d’un acte interruptif de prescription tous les 19 ans pour maintenir une action en œuvre très longtemps.
Dans ce temps judiciaire qui s’ouvre après l’introduction de l’action publique, la notion de délai raisonnable doit trouver son plein exercice. Il est donc très important que l’action publique, une fois engagée, ne soit plus soumise à un délai de prescription proprement dite, mais que l’on considère qu’en quelque sorte la notion de délai raisonnable constitue un mode autonome d’extinction de l’action publique une fois celle-ci ouverte. Faut-il parler de caducité ou de tout autre terme qui remplacerait la notion de prescription qui serait attachée au délai s’écoulant avant l’ouverture de l’action ? C’est sans doute une réflexion à faire, mais il est impératif d’imposer à un juge une fois saisi de juger le plus rapidement possible, en lui imposant de faire des actes dans un délai rapproché : 6 mois, 1 an… – un délai de 3 ans a été évoqué, qui paraît bien long, et la justice doit être diligente une fois qu’elle est saisie – ou alors d’enfermer la totalité du temps judiciaire dans une limite définie. Sans doute serait-il préférable de changer le terme qui s’applique une fois l’action publique engagée, pour qu’il n’y ait pas de confusion entre la prescription concernant l’ouverture de l’action elle-même et la diligence avec laquelle cette action doit être menée.
Contribution de M. Bertrand Louvel,
premier président de la Cour de cassation
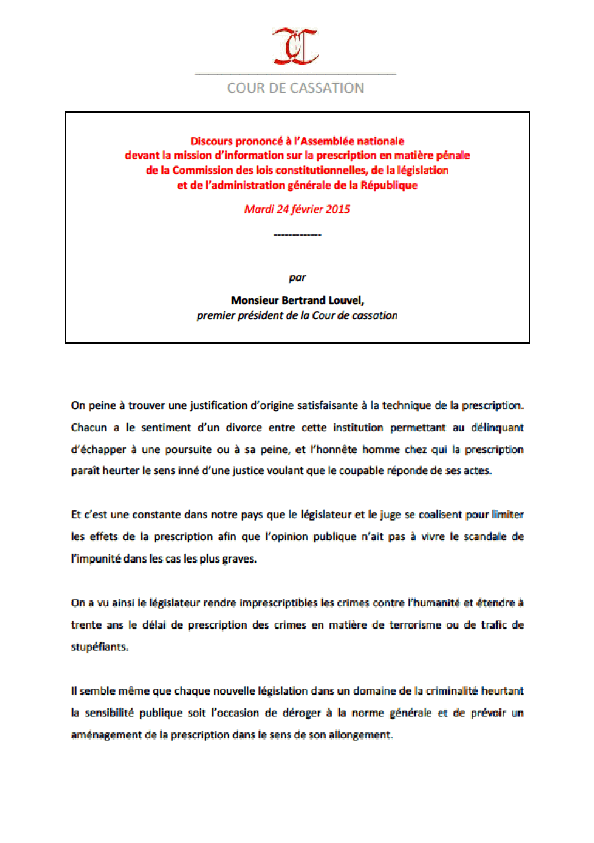
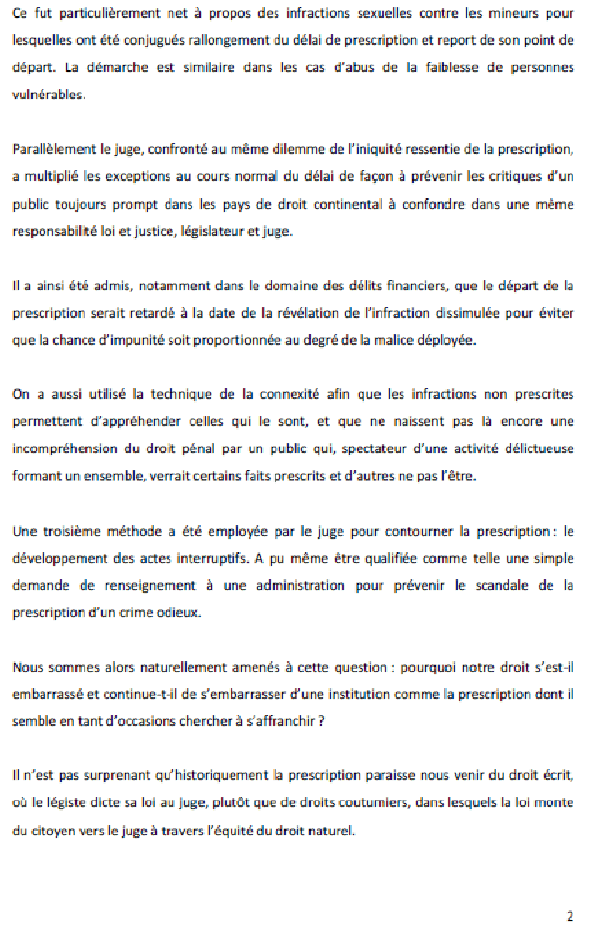
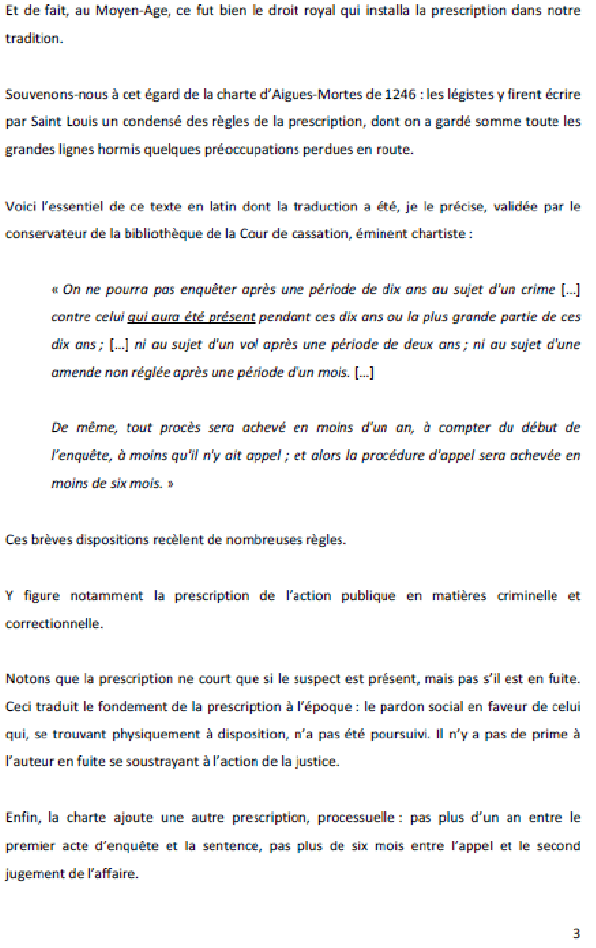
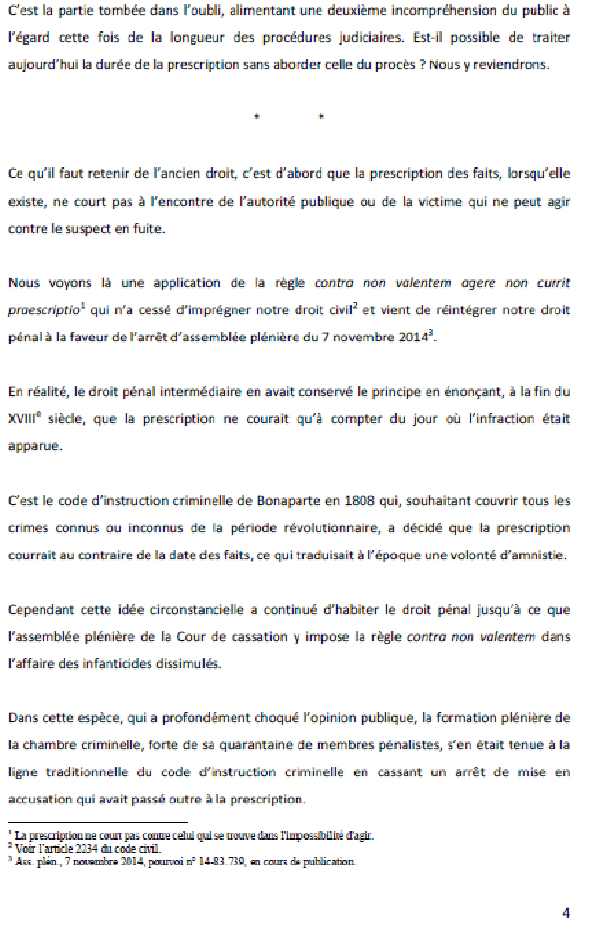
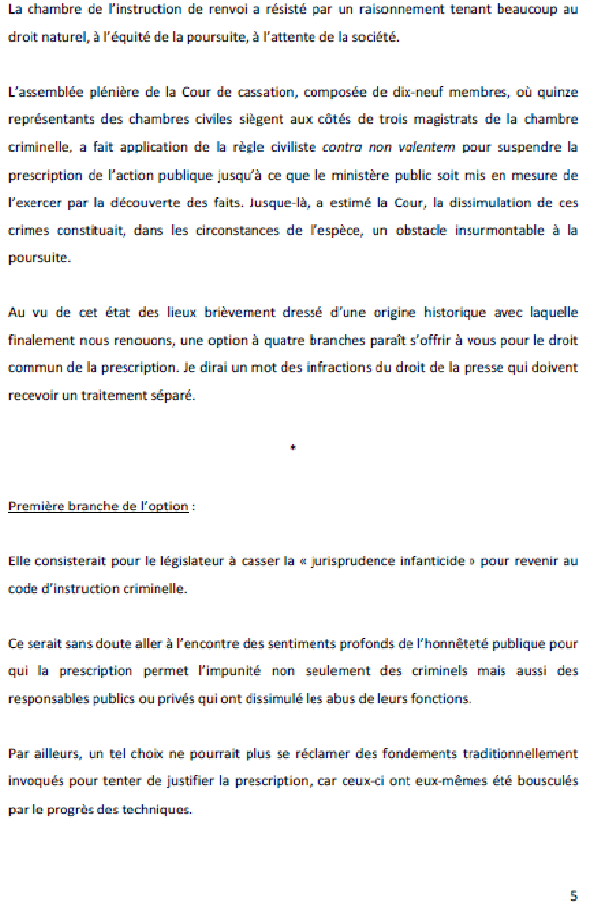
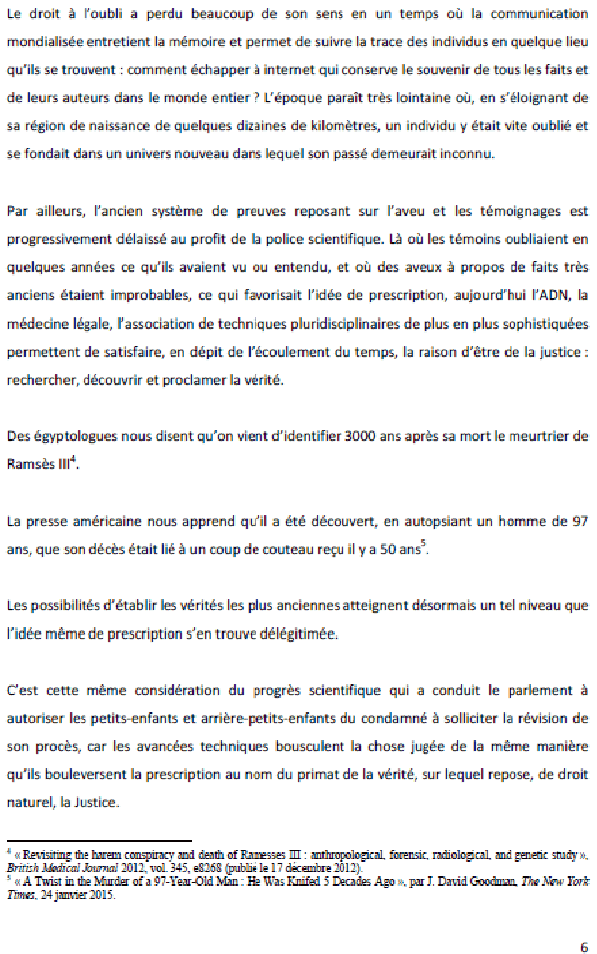
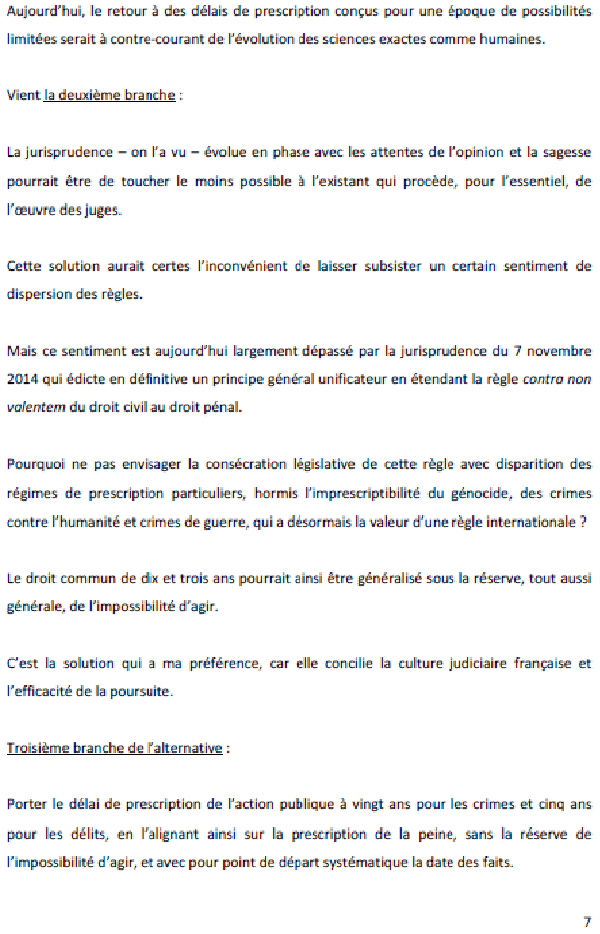
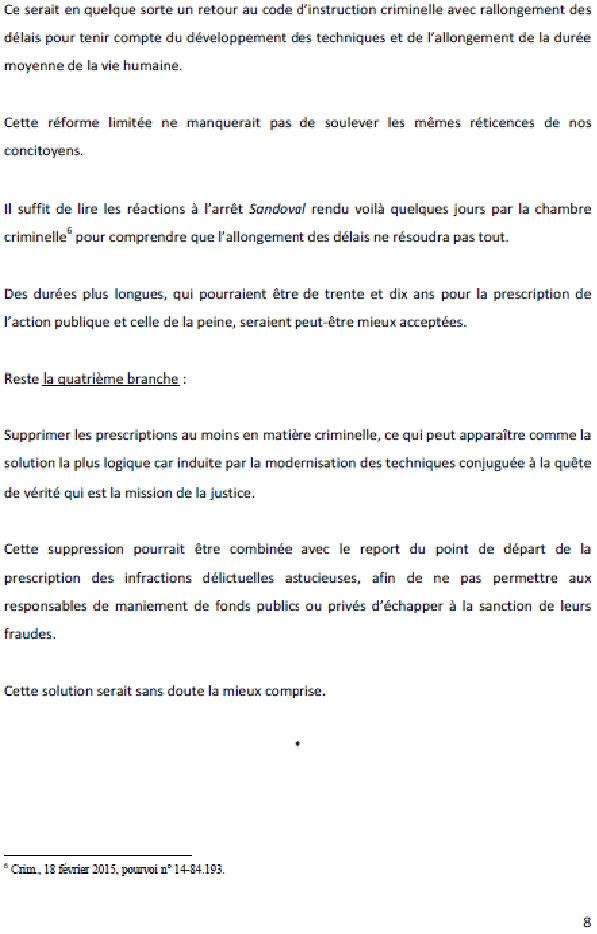
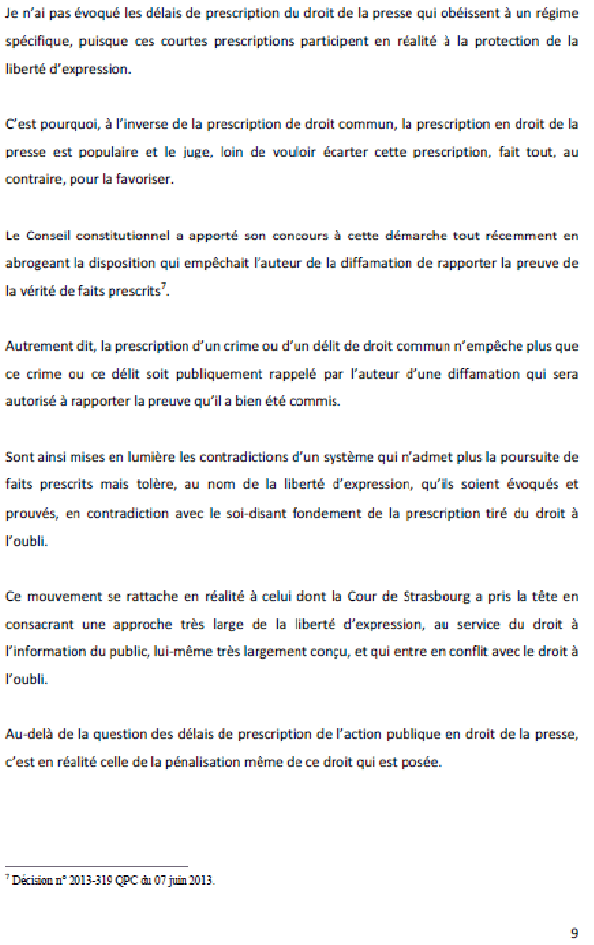
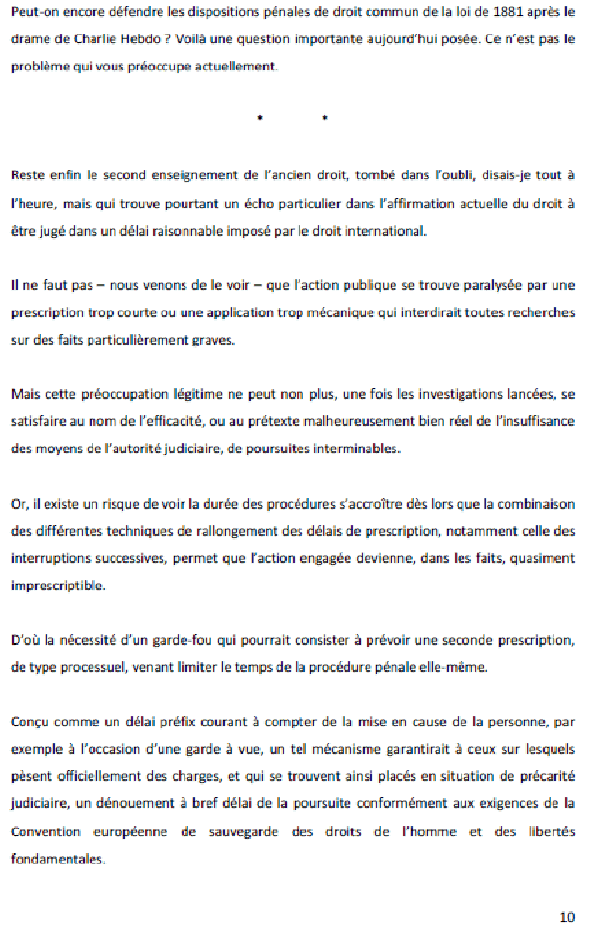
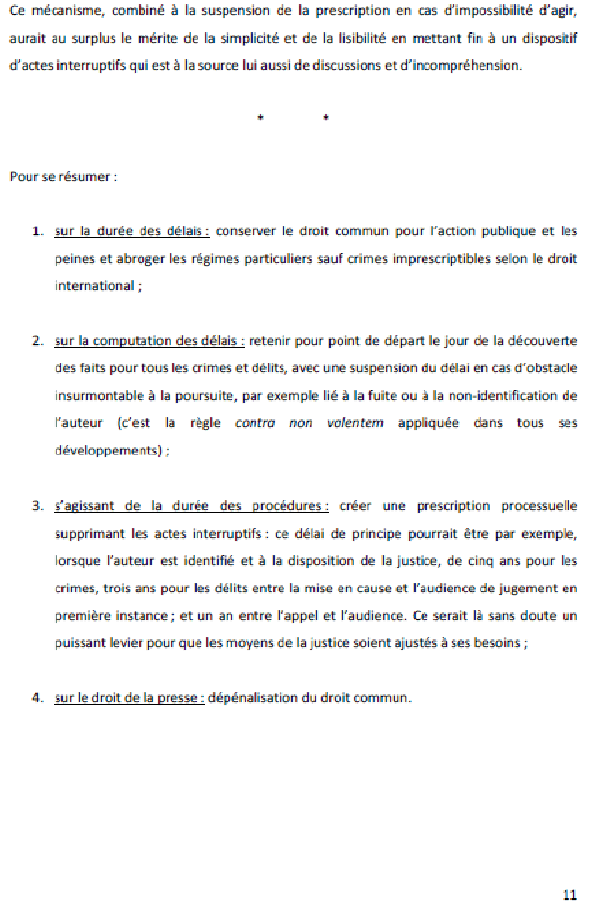
Contribution complémentaire de M. Bertrand Louvel (412)
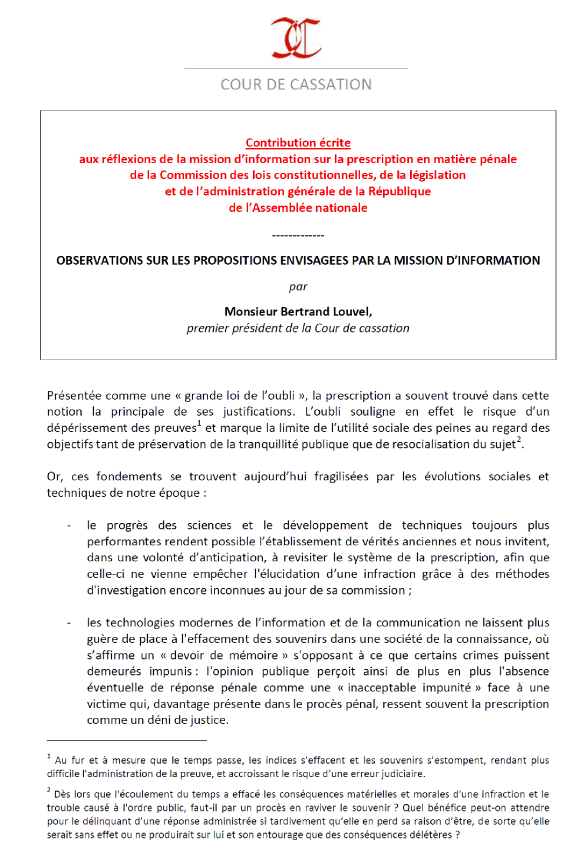
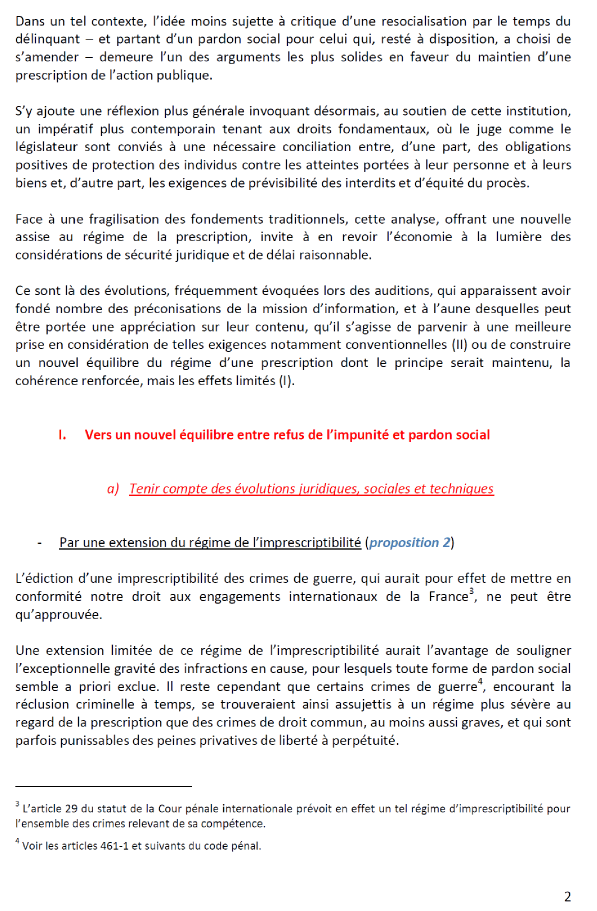
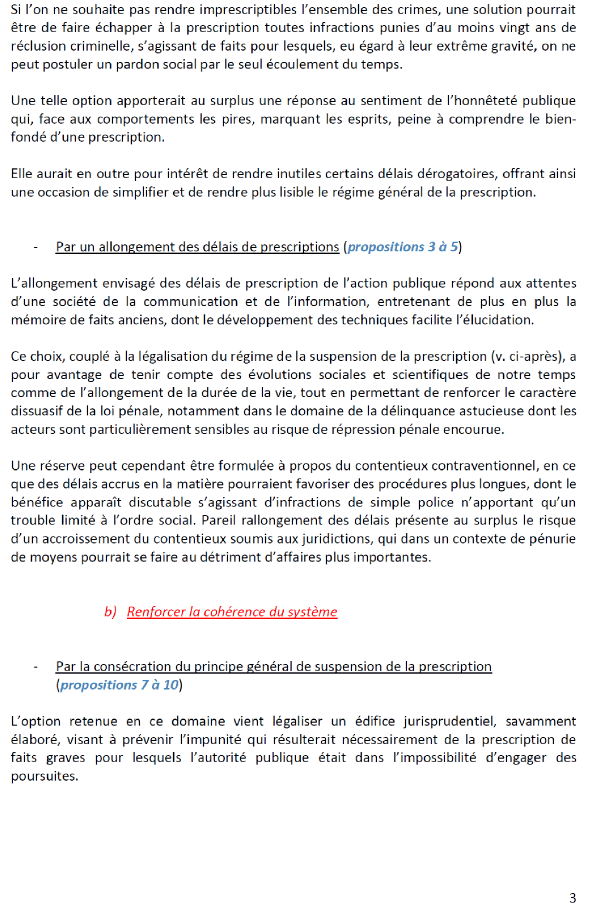

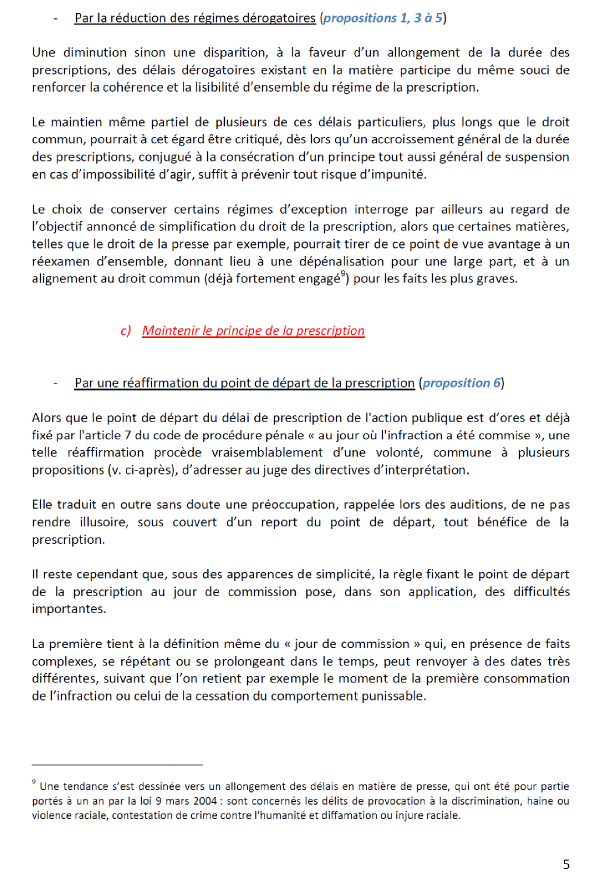
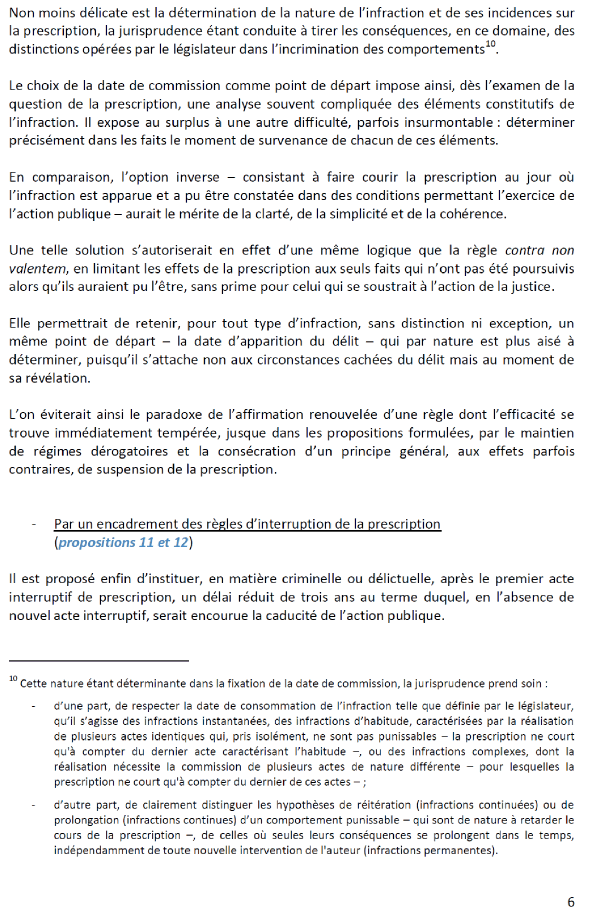
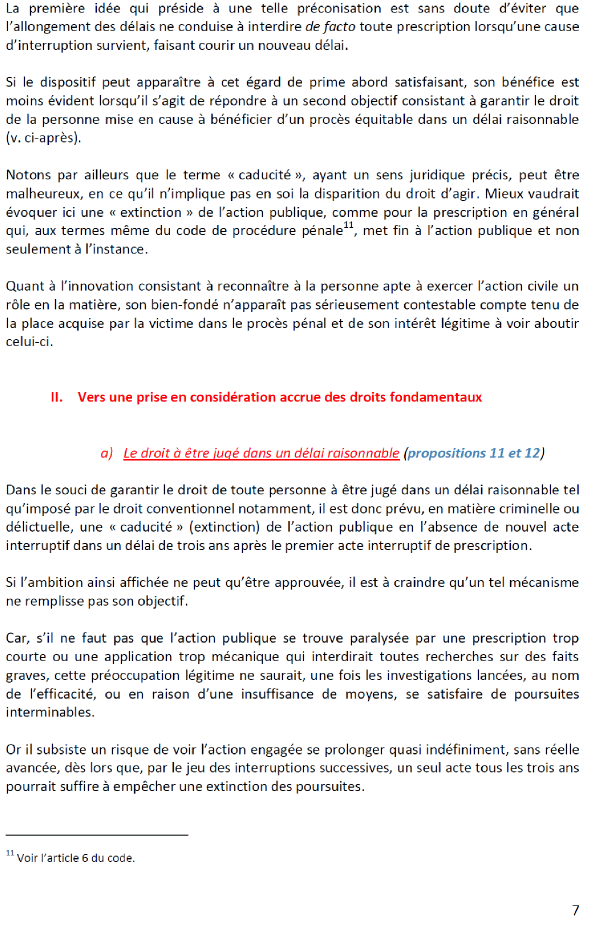
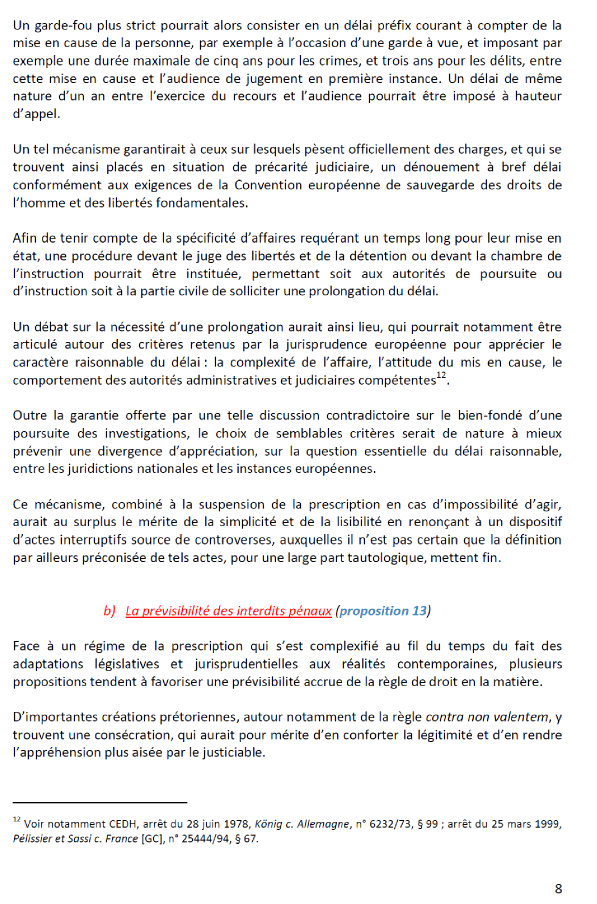
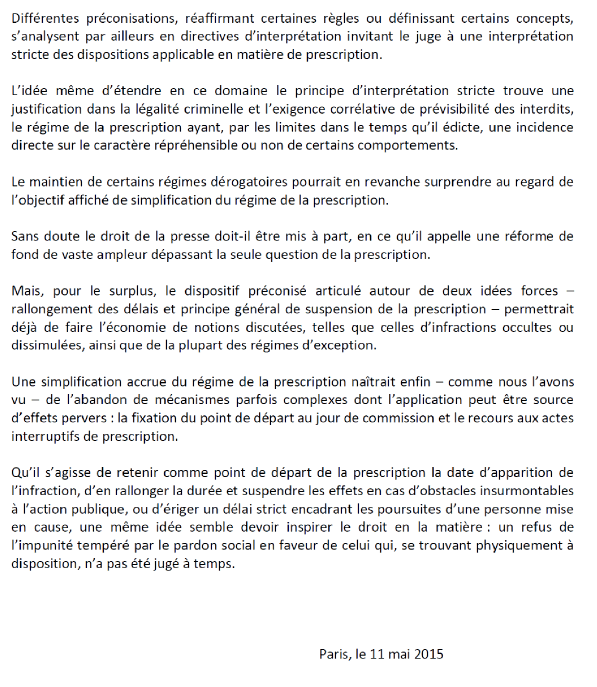
Contribution de M. Jean Pradel, ancien juge d’instruction, professeur émérite à l’Université de Poitiers, expert auprès de l’Institut pour la justice
Il convient de distinguer entre les deux types de prescription pénale, celle sur l’action publique et celle sur la peine. En effet les problèmes posés ne sont pas toujours les mêmes.
I – Sur la prescription de l’action publique
Cette question très actuelle a déjà fait l’objet d’un rapport sénatorial d’information en date du 20 juin 2007413 et de diverses réflexions plus récentes414. Elle fait de ma part l’objet des neuf remarques suivantes.
1. On discute parfois de la nécessité de supprimer la prescription de l’action publique au nom de la justice et de la complexité technique de cette institution. Et l’on vante le système de common law qui ignore, sauf pour les contraventions, la prescription.
C’est oublier l’ancienneté de la prescription qui remonte au droit romain et ses bienfaits : le temps efface (plus ou moins) le souvenir d’un forfait et les preuves permettant de le démasquer s’effritent peu à peu. On ajoutera que la prescription est la sanction de la négligence des agents de l’autorité publique415. Il faut rappeler enfin que la CEDH consacre la prescription qui « dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne a plusieurs fonctions importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, peut-être difficile à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé »416, l’idée de base étant pour les juges de Strasbourg que l’accès à un tribunal n’est pas absolu, appelant des restrictions comme la prescription. On considérera enfin que malgré la prescription et l’existence d’un jugement dans un délai raisonnable, les droits de la victime sont sauvegardés, du moins à une double condition : 1° Que la victime ait le droit d’être partie à la procédure ; 2° Que le délai de la prescription soit suffisamment long ; ces deux conditions sont semble-t-il remplies, surtout si l’on allonge les délais comme il sera proposé plus bas.
On conviendra donc – sans aucune originalité – qu’il faut conserver la prescription. D’ailleurs, en common law, les juges multiplient les moyens pour rendre un fait impoursuivable, contrairement au principe de l’imprescriptibilité même s’il s’agit d’un arrêt de la poursuite non fondé sur le temps : ainsi quand le poursuivant commet un abuse of process (par ex. en attendant la mort d’un témoin important à décharge), les juges rejettent la poursuite417.
2. Cependant à l’heure actuelle, les fondements traditionnels de la prescription sont ébranlés notamment compte tenu de la plus grande fiabilité des preuves et de l’oubli qui perd de sa force sociologiquement. De plus, en droit français, règne un grand désordre inspiré par une idée très nette, celle d’une hostilité croissante au principe de la prescription, comme si la mémoire neutralisait l’oubli. À la simplicité traditionnelle (1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes, le point de départ étant celui du jour des faits, art. 7 à 9 C.P.P.), il est en effet porté deux séries d’atteintes consacrées depuis un petit nombre de décennies418 :
a) C’est d’abord l’allongement du délai. Par exemple, le délai passe à trente ans pour le crime de terrorisme (art. 706-25-1 C.P.P.) et pour celui de trafic de drogue (art. 706-31 C.P.P.). Leurs auteurs sont les bêtes noires de la justice pénale.
b) C’est ensuite le recul du point de départ qui est prévu parfois par la loi (par ex. en matière électorale, l’article L. 114, C. électoral faisant partir la prescription du jour de la proclamation des résultats de l’élection) ou plus souvent par la jurisprudence et à cet égard une triple distinction est opérée par elle :
- infractions à mode opératoire unique, mais supposant des remises de fond successives, comme l’escroquerie à la sécurité sociale, le point de départ repartant à zéro à chaque remise ;
- infractions clandestines par nature (ou occultes) comme le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ou celui de dissimulation d’enfant, la clandestinité étant un élément de l’infraction ; alors la poursuite n’est possible que lorsque les faits sont connus du poursuivant ;
- infractions dissimulées comme l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux, ou encore la présentation de faux bilan, le favoritisme … En une formule ayant plusieurs fois varié au gré des formations de la chambre criminelle, celle-ci décide en général que « le point de départ doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». Et même en matière d’homicide volontaire le délai est suspendu jusqu’à la découverte des cadavres419. Et pourtant la jurisprudence n’inclut pas dans la catégorie des infractions dissimulées le faux qui est pourtant un délit dissimulé, ce qui n’est pas logique420.
3. Or cet éclatement de la matière est source d’insécurité juridique, cette insécurité que l’on a coutume d’imputer au juge alors qu’elle est également le fait du législateur. Comme l’insécurité est ce qui est le plus contraire au droit qui est par principe accessibilité, prévisibilité et clarté421, il importe de réformer la prescription dans le sens d’une certaine unification.
Cette unification peut être faite par la loi puisque la prescription n’est pas un concept à valeur constitutionnelle422 et ne peut être faite que par elle, s’agissant d’une question se rattachant à la procédure pénale, laquelle est du domaine législatif (art. 34 de la Constitution). Mais alors que proposer, que retenir ?
A - Point de départ du délai de prescription
4. Au système actuel, anarchique et complexe, il faudrait substituer le principe selon lequel le délai partirait systématiquement du jour des faits (ou plus exactement du lendemain à zéro heure). Ne plus tenir compte du jour de la découverte constituerait une simplification et aussi une plus grande égalité entre les justiciables. Admettre cette réforme serait d’ailleurs revenir à la lettre des articles 7 et s. C.P.P. : l’article 7 relatif aux crimes parle d’une prescription « à compter du jour où le crime a été commis ». De plus, le recul du point de départ au jour de la découverte des faits conduit à transformer des délits instantanés en délits continus : pourtant l’infraction ne change pas de nature parce que ses conséquences se prolongent dans le temps (escroquerie par exemple) ou parce que la preuve n’est faite que tardivement (abus de confiance par exemple).
Il est cependant des cas où le point de départ sera inévitablement reculé compte tenu de la nature des choses, ce que consacre d’ailleurs l’état actuel du droit : ainsi en cas de délit continu ou d’homicide involontaire quand la mort survient cinq ans après la faute initiale ; de même pour les délits d’habitude, qui résultent de la commission de deux actes au moins, le délai ne peut courir qu’à partir du deuxième acte. Il faudrait également conserver la règle légale selon laquelle pour certains crimes et délits contre les mineurs, le délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité, ce qui est d’ailleurs le cas dans plusieurs droits étrangers (Autriche, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal).
La portée de la réforme serait malgré tout importante. Toute la jurisprudence sur l’abus de biens sociaux et sur l’homicide volontaire tomberait. De même disparaitraient les textes selon lesquels le point de départ est reculé pour certains délits patrimoniaux (vol, escroquerie, etc…) commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité.. , et ne court qu’à compter du jour où l’infraction apparait dans des conditions où elle est punissable (art. 8 al. 3 C.P.P., loi du 14 mars 2011).
Cependant, cette faveur au délinquant quant au point de départ de la prescription doit être compensée par un allongement du délai.
B– Durée du délai de prescription
5. Pour les contraventions, il n’y a pas lieu d’allonger le délai, actuellement fixé à un an. Un allongement (à deux, trois… ans) provoquerait des difficultés hors de proportion avec l’importance mineure des contraventions.
6. En revanche, pour les délits, on pourrait faire passer le délai de trois à huit ou dix ans par exemple423. En proposant huit ans on pense spécialement aux délits d’affaires comme l’abus de biens sociaux. En ce cas les faits sont en pratique, découverts à l’occasion d’un changement des dirigeants sociaux (par voie de cession, absorption) ou de disparition de la société. Or très souvent, ces mutations surviennent dans les cinq à huit ans. Dès lors les faits pourraient être poursuivis sans qu’il soit nécessaire de recourir au subterfuge du recul du point de départ au jour de la découverte.
Dans des cas exceptionnels, la brève prescription pourrait être conservée, par exemple en matière de délits de presse (trois mois en principe) pour maintenir le principe de la liberté d’expression. De même le délai de six mois en matière électorale (art. L. 114 du Code électoral) doit être maintenu pour réduire le temps pendant lequel une élection pourrait être remise en cause. De même encore pourrait être conservée le délai de vingt ans pour les délits de terrorisme (art. 706-25 al. 2 C.P.P.) et de trafic de drogue (art. 706-31 al. 2 C.P.P.), compte tenu de leur gravité.
7. Pour les crimes enfin, l’actuel délai de dix ans est à la fois trop bref et insuffisamment différencié. Trois catégories de crimes pourraient être prévues :
- Le crime contre l’humanité doit rester imprescriptible. C’est même actuellement le seul crime qui soit soumis à ce statut (art. 213-5 C.P.). Or cette règle devrait être étendue aux crimes de terrorisme, au moins en cas de mort de victimes (le délai est actuellement de trente ans, art. 706-25-1 C.P.P.).
- Pour une liste de crimes très graves, on pourrait prévoir le délai de trente ans. C’est déjà le cas pour le crime de guerre (art. 462-10 al. 1 C.P.) et pour le trafic de drogue (art. 706-31 al. 1 C.P.P.). On pourrait y adjoindre les crimes de nature sexuelle contre les mineurs visés à l’article 706-47 C.P.P. (plus précisément meurtre ou assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d’un viol ou de tortures ou actes de barbarie, art. 222-23 à 222-31 C.P.), alors qu’actuellement la prescription est de vingt ans seulement (art. 7 al. 3 C.P.P.)424.
- Pour tous les autres crimes, on pourrait envisager un délai de vingt ans, ce qui constituerait un doublement du délai actuel.
Cet allongement général se fonde sur l’amélioration des moyens de preuve (A.D.N. notamment), sur le sentiment public que l’oubli est moins fort aujourd’hui que naguère et enfin sur le fait que la vie humaine s’allonge : on est passé de 40 ans en 1810 à 80 ans aujourd’hui.
8. Reste la question des causes d’interruption et de suspension de l’action publique. Il n’y a pas de raison de changer les choses425. On devrait notamment conserver la jurisprudence sur la connexité, selon laquelle l’acte interruptif de prescription concernant une infraction A s’étend à une infraction B qui lui est connexe, la connexité prévue par l’article 203 C.P.P. étant d’ailleurs entendue largement. Ce maintien du droit actuel s’impose au regard de l’opinion : il ne faut pas qu’elle celle-ci s’imagine que les délits d’affaires (souvent connexes) soient facilement prescrits. Evidement si au moment où est réalisé l’acte interruptif le délit B est déjà prescrit, il le restera et ne pourra plus donner lieu à poursuite.
9. Faut-il modifier les règles sur l’application dans le temps des lois de prescription ? Ce sont des lois de forme, et donc d’application immédiate (voir en ce sens l’article 112-2, 4ème C.P. : « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique » sont d’application immédiate). Il ne faut donc rien changer.
II – Sur la prescription de la peine
Avant tout une remarque sémantique : on devrait parler de prescription de l’exécution de la peine et non de prescription de la peine426. Cela dit cinq remarques peuvent être faites.
1. Sur le principe, cette prescription se fonde sur le même motif que celle de l’action publique : l’exécution devient inutile puisque le souvenir du fait est censé être effacé. Il faut donc conserver la prescription de l’exécution comme il faut conserver celle de la poursuite.
2. Toutefois, le souvenir d’une condamnation s’efface moins vite que celui du fait de sorte qu’il convient de prévoir des délais plus longs. La doctrine note d’ailleurs que la prescription de l’exécution profite surtout aux individus les moins intéressants et parfois les plus dangereux qui souvent mettent en échec les recherches policières les mieux organisées427. D’ailleurs à l’étranger les délais de prescription de l’exécution sont presque toujours supérieurs à ceux de la prescription de l’action publique, et par exemple, aux Pays-Bas, la prescription de l’exécution est supérieure d’un tiers au délai de prescription de l’action publique (art. 76 C.P.). Mieux même, pour les condamnations portant sur des faits très graves il n’y a pas de prescription de l’exécution : on peut citer le § 79 C.P. allemand pour les peines à perpétuité tout comme le § 57 autrichien qui dit la même chose ; en Espagne, l’article 131 al. 4 C.P. dispose que « les délits de lèse-humanité, de génocide, les délits contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé ne se prescrivent pas et il en est de même des délits de terrorisme s’ils ont causé la mort d’une personne ». L’article 172 C.P. italien exclut la prescription de l’exécution pour certaines infractions commises en récidive, ainsi que pour les délinquants par tendance ou professionnels. On citera encore le droit des USA (fédéral et étatique) : il n’y a pas de prescription de l’exécution, et c’est tout juste et très exceptionnellement si par le biais du 14ème Amendement (due process clause) les juges protègent les condamnés à l’emprisonnement ferme qui n’ont pas été mis en prison pendant une longue durée, au-delà de laquelle l’incarcération serait inéquitable ; la jurisprudence est rare428 et imprécise, évitant de donner un chiffre au-delà duquel l’exécution serait contraire au droit. Enfin en Russie, pour les infractions passibles d’un emprisonnement à perpétuité ou de mort, le tribunal apprécie si la peine est prescrite, et cela en fonction des données de l’espèce.
Bref la prescription de l’exécution a encore moins bonne réputation que celle de l’action publique.
3. En droit français actuel, la prescription est de 20, 5, 3 ans selon qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention (art. 133-2 et s. C.P.), sauf à noter l’imprescriptibilité pour les crimes contre l’humanité (art. 213-5 C.P.) et une prescription de 30 ans pour les crimes contre l’espèce humaine (art. 215-4 C.P.).
4. Une double réforme me parait s’imposer en ce qui concerne les délais.
a) D’abord il conviendrait de multiplier les exécutions imprescriptibles : au crime contre l’humanité on pourrait ajouter – à la lumière du droit comparé ci-dessus évoqué – toutes les condamnations prononcées à perpétuité, les condamnations criminelles pour terrorisme (la peine prononcée n’étant pas forcément perpétuelle), et même les condamnations criminelles prononcées en récidive, perpétuelles ou pas.
b) Ensuite, on devrait relever les plafonds actuels, à défaut de quoi on arriverait à une prescription de l’exécution parfois inférieure à celle de l’action publique alors que celle-ci doit être plus brève que celle-là. On pourrait retenir les plafonds de 50 ans en matière criminelle et de 20 ans en matière correctionnelle. On pourrait ne rien changer en matière contraventionnelle.
5. Actuellement les lois sur la prescription de la peine sont considérées comme des lois de forme (art. 112-2, 4ème C.P.), tout comme les lois sur la prescription de l’action publique. Elles sont donc d’application immédiate. On peut cependant douter du bien fondé de cette assimilation : les lois sur la prescription de l’exécution de la peine ne sont pas vraiment des lois de forme car une peine prescrite est assimilée à une peine exécutée. Bref les lois sur la prescription de l’exécution, sont à mon avis, des lois de fond. C’est d’ailleurs ce que décidait la jurisprudence sous l’empire du Code pénal de 1810429. Il faudrait donc décider que les lois nouvelles sur la prescription de la peine ne s’appliquent immédiatement que si elles sont plus douces. Plus précisément, on pourrait à l’article 112-2, 4ème C.P. ôter les mots « et à la prescription des peines », et ajouter après « peines », « ; il en est de même des lois relatives à la prescription des peines si ces lois sont plus douces ».
Contribution du Syndicat national des journalistes
Texte lu par le SNJ le 25 février 2015 à l’Assemblée Nationale lors de son audition par les deux rapporteurs de « La mission d’information sur la prescription en matière pénale », Alain Tourret et Georges Fenech.
Intervention de Dominique Pradalié :
Cette audition se tient dans un contexte particulier où des citoyens, très nombreux, se sont levés pour proclamer leur attachement à la liberté d’expression et à la liberté d’information alors qu’étrangement, de plusieurs côtés, les restrictions à ces libertés se multiplient.
Veut-on vider de toute substance la loi de 1881 sur la liberté de la presse ? Ce sont les fondements de cette loi qui sont attaqués dans leurs principes mêmes, ceux qui établissent la liberté d’expression et d’opinion.
1 La loi de novembre 2014 permettant de poursuivre l’apologie du terrorisme est utilisée actuellement pour punir des délits d’opinion.
Ce qui devrait ressortir de l’application de la loi de 1881, est poursuivi par des procédures de droit commun.
Dans la France de ce Vingt et unième siècle, on emprisonne pour des délits d’opinion.
Des individus sont condamnés à des peines de prison pour des motifs d’abus de la liberté d’expression, qui sont autant d’atteintes aux libertés fondamentales. Dans d’autres pays démocratiques qui nous entourent, les mêmes propos, condamnés dans notre pays, sont parfaitement licites.
Des individus, dont le raisonnement au moment des faits jugés délictueux, est bien souvent altéré, ivrognes et/ou malades mentaux, se voient infliger de lourdes condamnations.
Des enfants sont entendus dans des commissariats pour avoir refusé de respecter la minute de silence ou avoir témoigné de leur soutien aux terroristes.
Des humoristes doivent plier devant le politiquement correct. Fini les jeux de mots déplacés, les grosses blagues sulfureuses.
La pensée unique et la bien pensance-bobo menacent de nous submerger. Ces lois et décisions veulent réinstituer un contrôle a priori, ce qui est tout à fait contraire aux principes républicains.
Veut-on criminaliser les délits d’opinion ?
2 Aujourd’hui, il se dit de plus en plus souvent que le fameux amendement sur le « secret des affaires », retiré in extremis de la loi Macron devant le scandale qu’il a suscité, serait réintroduit dans la loi sur la protection du secret des sources des journalistes.
Cette loi, enterrée brusquement par le gouvernement PS il y a un an, alors que les députés s’apprêtaient à en discuter, ressortirait opportunément mais… dans quel état ?
Quant à l’amendement sur le « secret des affaires », il est dénoncé, à juste titre, comme liberticide et de plus, absurde, dans un contexte où l’espionnage au niveau mondial par la NSA américaine et d’autres officines de plusieurs pays dits démocratiques, n’est un secret pour personne. Les dernières révélations de vol des données des cartes SIM en sont un exemple cuisant.
Enfin, le nombre grandissant des cyberattaques et autres entreprises massives de pillages des données, démontre, jour après jour, que d’autres systèmes de protection doivent être pensés et mis en place.
L’amendement ne viserait ainsi que les journalistes et les lanceurs d’alerte.
3 Dans le cadre du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo et des événements qui ont suivi, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel vient de prendre une série de décisions/sanctions qui voient se lever contre elles un front uni d’employeurs, de syndicats de journalistes et d’instances indépendantes, tellement elles sont attentatoires à la liberté de l’Information et risquent de laisser la place à l’obscurantisme, au négationnisme et au complotisme sur tous les réseaux sociaux, en France comme à l’étranger.
Le SNJ va se pourvoir contre ces décisions devant le Conseil d’État.
Pour nous, il y a abus caractérisé car ce conseil est une instance administrative dont les membres sont nommés par le pouvoir politique. Elle n’est pas du tout qualifiée pour traiter de la déontologie des journalistes.
Veut-on peser lourdement sur la libre possibilité pour les journalistes d’exercer leur profession au service des citoyens ?
- Pourtant l’Article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les principes de la Constitution française fondent la liberté d’expression et d’information.
- Pourtant, la Cour européenne des Droits de l’Homme construit, depuis plusieurs dizaines d’années, une jurisprudence consacrant concrètement les libertés d’expression et d’information ainsi que le droit pour les citoyens de recevoir une information honnête, complète et pluraliste.
Par exemple, la CEDH a condamné très récemment la Turquie pour avoir mis en garde à vue un kurde qui distribuait un journal. La cour a jugé que cette mesure était « de nature à dissuader le journaliste de faire usage de sa liberté d’expression ».
- Pourtant plusieurs millions de personnes ont manifesté il y a un mois, dans les rues, dans les entreprises et sur tous les réseaux leur attachement à ces libertés fondamentales sans lesquelles il n’y a pas de démocratie digne de ce nom.
Intervention d’Olivier Da Lage, en réponse au questionnaire qui avait été adressé au SNJ :
1. Quels sont les fondements et justifications du délai de prescription abrégé de trois mois applicable à certaines infractions de presse (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) ? Ces fondements et justifications vous paraissent-ils toujours justifiés ?
Les dispositions sur la diffamation (et autres délits de presse) avaient vocation à remplacer les duels d’honneur. L’honneur bafoué doit en effet être réparé rapidement. Il n’y a rien à gagner, ni pour les parties, ni pour la société, à se réveiller un an, trois ans ou 10 ans après. En fait, l’ordre public et l’honneur des intéressés auraient davantage à souffrir de délais allongés. Pour cette raison, la prescription de trois mois reste tout à fait justifiée aujourd’hui.
2. Vous apparaît-il pertinent de faire bénéficier du délai de prescription abrégé de trois mois les personnes (non-journalistes) susceptibles de s’exprimer sur Internet ?
Oui, pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, d’autant que l’internet permet davantage que l’imprimé à la partie lésée d’être informée rapidement des propos diffamatoires ou injurieux tenus sur elle.
3. Pensez-vous que la fixation à un an du délai de prescription pour certaines infractions commises par voie de presse (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, contestation des crimes contre l’humanité) permette d’en assurer une meilleure répression ? Estimez-vous que cette modification porte atteinte à la liberté d’expression ?
Mêmes observations que ci-dessus.
4. Serait-il pertinent de porter à un an le délai de prescription de l’ensemble des infractions de presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ?
En aucun cas. Cela serait à la fois attentatoire aux libertés et porteur de troubles pour la société. Cela permettrait par exemple un chantage implicite de la partie lésée sur le média, faisant dépendre son dépôt de plainte (ou son absence) du comportement du média en cause durant une période de longue durée.
5. Estimeriez-vous judicieux de transférer dans le code pénal certaines infractions aujourd’hui réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur le modèle de la solution retenue pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes (infractions désormais prévues à l’article 421-2-5 du code pénal) ?
Non, certainement pas. Le bilan, même provisoire, de l’application des dispositions réprimant l’apologie d’actes terroristes ne nous paraît pas, bien au contraire, de nature à nous convaincre que c’est un modèle à suivre et à étendre à d’autres champs.
6. La fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la première mise en ligne du contenu litigieux vous semble-t-elle adaptée au mode de diffusion des informations sur Internet ? Le régime de prescription constitue--t-il un obstacle à la répression des infractions de presse commises sur Internet ?
Il ne saurait être question d’un délit continu qui ferait du délit de presse sur internet un délit imprescriptible au même titre que les crimes contre l’humanité. Cette solution, initialement retenue par certaines juridictions, ne l’a pas été au final par la Cour de cassation, qui à juste raison fait partir de la première publication le délai de prescription.
En effet, davantage que pour les imprimés, les propos tenus sur internet peuvent être rapidement connus de la personne éventuellement lésée. Il n’est pas imaginable, compte tenu de la généralisation de l’Internet, qu’elle n’en soit pas informée dans le délai de trois mois, comme cela pouvait éventuellement être le cas lorsque les propos diffamatoires ou injurieux n’existaient que sous formes d’imprimés.
7. Le régime de la prescription des infractions commises sur les réseaux sociaux soulève-t-il des interrogations ou des difficultés particulières ? Il en a manifestement posé au début, mais la situation a été stabilisée par la jurisprudence et une adaptation du comportement des responsables de ces réseaux sociaux. Si la situation est encore loin d’être satisfaisante, rien ne suggère que c’est par un allongement des délais de prescription spécifique aux réseaux sociaux qu’une amélioration pourrait être trouvée.
8. La France devrait-elle s’inspirer de certains modèles étrangers pour apporter d’éventuelles modifications aux régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines en matière de presse ?
Nous ne voyons pas lesquelles. Le modèle français, pour imparfait qu’il soit, n’a pas à rougir des comparaisons internationales. Certes, le juge Jean-Paul Costa, ancien président de la CEDH, avait fait remarquer dans un entretien au Monde que la France n’était pas la « patrie des Droits de l’Homme », comme elle se plaît à le dire, mais celle de la Déclaration des Droits de l’Homme. Modifier le régime de la prescription des infractions de presse ne pourrait que lui donner davantage raison. Nous souhaiterions au contraire lui donner tort en préservant l’équilibre délicat trouvé par la loi de 1881.
Quelques remarques, en réponse à certains des propos d’Yvan Levaï et ceux des deux rapporteurs :
Non, le CSA n’a pas, dans ses responsabilités la « maîtrise de l’information » qu’il s’efforcerait de faire appliquer. Il peut prendre des décisions plus que contestables. Le SNJ peut fournir des exemples.
Non, le droit de la presse « n’oublie pas les autres droits ». Les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Ils en répondent volontiers devant les instances judiciaires quand il le faut. Simplement, les journalistes bénéficient d’un droit dérogatoire du droit commun pour avoir des garanties pour exercer leurs missions au service des citoyens. Ils entendent bien le conserver.
Actuellement huit journalistes sont menacés de mort en France par différents lobbies mafieux et/ou politiques.
Non le SNJ ne soutient pas tous les journalistes sans distinction. Il est solidaire de toutes celles et ceux injustement mis en cause dans l’exercice de leur profession. Il est le premier à dénoncer les dérapages et dysfonctionnements.
Enfin, le SNJ appelle de ses vœux, depuis plusieurs années, la création d’une Instance Nationale de Déontologie qui, paritairement (journalistes et employeurs) et membres de la société civile, aurait à se saisir de dysfonctionnements et autres erreurs et fautes, avérées ou non. Cette instance pourrait être saisie par des simples citoyens. Elle enquêterait et rendrait un avis qui serait publié dans le média concerné.
Une telle instance, indépendante, existe déjà dans plusieurs pays, parmi lesquels nos plus proches voisins.
Contribution de la Conférence nationale des procureurs de la République
1. Quels sont les fondements et justifications de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines ? Vous paraissent-ils toujours justifiés ?
Justifications de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines
- droit à l’oubli
- le trouble causé par l’infraction s’estompe
- dépérissement des preuves
Ces fondements sont-ils toujours justifiés ?
La jurisprudence cherche de plus en plus à éviter la prescription. Le droit à l’oubli a été mis à mal avec la décision de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 7 novembre 2014
Peut-on dire que le préjudice causé à la victime s’estompe vraiment ? Certaines victimes voient au contraire leurs troubles s’aggraver avec le temps.
Les moyens de preuve ont évolué (preuves scientifiques). De ce fait l’argument concernant l’inefficacité des enquêtes passé un certain temps (voire le risque d’erreur judiciaire) perd de sa pertinence
Certains délinquants restent dangereux et peuvent à nouveau commettre des faits graves plusieurs années après leur crime ou leur délit resté non élucidé.
Concernant la prescription de la peine, c’est une atteinte à l’autorité de la chose jugée et elle profite à ceux qui ont su échapper aux recherches (notamment ceux qui ont en les moyens ou qui bénéficient d’un réseau) Ce sont en général les délinquants les plus chevronnés et encore actifs qui arrivent à échapper à la mise en œuvre de la sanction
2. La limitation du champ de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines aux seuls crimes contre l’humanité vous semble-t-elle devoir être maintenue ?
OUI ce sont les seules infractions pour lesquelles on ne pourra jamais évoquer le droit à l’oubli
3. la distinction entre les délais applicables à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines est-elle encore pertinente ?
Les fondements de la prescription qui sont le droit à l’oubli et la disparition progressive du trouble causé par l’infraction sont communs aux deux régimes de prescription.
Seul le risque de dépérissement des preuves ne concerne que la prescription de l’action publique. Or les techniques de preuve ont évolué.
Ceci militerait pour l’instauration d’un régime unique.
Les délais de prescription de l’action publique sont trop cours et la jurisprudence tente souvent de les contourner. Ne faudrait-il pas allonger les délais de prescription de l’action publique à 20, 5 et 3 ans?
4. Les délais de droit commun des régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines vous semblent-ils devoir être allongés ou réduits ?
Voir réponse précédente.
5. L’existence de délais de prescription de l’action publique et de prescription des peines dérogatoires du droit commun vous semble-t-elle justifiée ?
Oui lorsque des impératifs de sécurité nationale et de sécurité publique importants sont en jeu
6. Peut-on dire que le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique applicable à certaines infractions conduit à l’instauration d’un régime d’imprescriptibilité de fait ?
OUI. C’est particulièrement vrai pour les infractions sexuelles commises sur des victimes mineures (pour certains délais de prescription de 20 ans qui commence à courir à la majorité de la victime même si l’infraction a été commise dans sa petite enfance)
7. L’allongement du délai de prescription des infractions à caractère économique et financier et la fixation du point de départ de ce délai au jour de la commission des faits (quelle que soit la qualification de l’infraction) risqueraient-ils de porter atteinte à l’efficacité de leur répression ?
OUI complètement. La plupart de ces infractions sont occultes. Si elles étaient commises au grand jour, elles n’atteindraient pas leur but. Les auteurs de ce type d’infractions n’attendent que cette réforme. C’est le meilleur moyen pour eux d’espérer l’impunité…
8. Si les délais de prescription de l’action publique applicables aux crimes et délits étaient allongés, serait-il pertinent d’instaurer, dès lors que les poursuites auraient été engagées, un délai de prescription plus court sanctionnant l’éventuelle inaction de la justice, qui commencerait à courir au jour de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire (ce délai recommencerait à courir, pour la même durée, après chaque acte interruptif) ?
Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ????
Cette proposition me semble inapplicable (délais de prescription différents, succession de réouvertures de délais de prescription).
Il semble difficile de cerner la notion d’inaction de la justice. Les moyens à disposition des parquets ne permettent pas de suivre efficacement la durée des enquêtes. Les dossiers en attente dans les services de police et gendarmerie peuvent se trouver prescrits du fait de la charge ou de l’inaction des services.
9. Le législateur devrait-il fixer avec plus de précisions les règles relatives à la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action publique et à la fixation des motifs d’interruption et de suspension de ce délai ? Si le délai de prescription de l’action publique était allongé, les motifs d’interruption et de suspension devraient-ils être limités ?
La sécurité juridique y gagnerait.
Il faudrait réfléchir à la situation particulière des majeurs protégés qui, comme les mineurs, ne sont pas en capacité de réagir et de déposer plainte (notamment lorsque les auteurs des infractions sont les tuteurs).
10. Faut-il revoir les modalités d’application dans le temps des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ?
La règle actuelle (art 112-2 du CP) est claire : application immédiate des nouvelles lois en matière de prescription sauf si la prescription est déjà acquise est claire.
Observation
La loi du 27 mars 2012 a modifié l’art 707-1 du CPP « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décision du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du trésor ou de l’AGRASC, qui tendent à son exécution ».
Alors que précédemment la prescription de la peine n’était interrompue que par un acte d’exécution, ce texte confère le même effet aux actes tendant à l’exécution sans donner de ces actes une définition précise. Ces actes peuvent être nombreux. On peut arriver à une imprescriptibilité de certaines peines.
Contribution de M. Christophe Bigot,
avocat au barreau de Paris
1. Quels sont les fondements et justifications du délai de prescription abrégé de trois mois applicable à certaines infractions de presse (article 65 de la loi du 29 juillet 1881) ? Ces fondements et justifications vous paraissent-ils toujours justifiés ?
Réponse :
Ce délai a toujours été justifié par l’objectif de rapprocher au maximum la date du jugement de la date de la publication, non seulement dans l’intérêt des victimes qui veulent laver leur honneur rapidement, mais également dans celui de la presse qui doit conserver ses preuves et peut être amenée à s’autocensurer en raison d’une procédure en cours, alors qu’elle obtiendra gain de cause au final, ce qui nuit à l’information du citoyen. Cet objectif est d’autant plus d’actualité que les contenus se multiplient et que l’information s’accélère.
Précisons à cet égard que dans sa décision de principe du 5 avril 2012 ( Cass. Civ. 1, 5 avril 2012, n°11-25290) refusant de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur ce délai de prescription, la Cour de cassation a considéré que cette justification était toujours d’actualité et a estimé que :
« le délai de prescription institué par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi »
Plutôt que de remettre en cause cet objectif, il faudrait au contraire renforcer les moyens de la justice dite « de presse » pour qu’elle puisse réellement juger dans un délai court. C’est là une question de moyens alloués aux juridictions qui ont ces affaires en charge.
2. Vous apparaît-il pertinent de faire bénéficier du délai de prescription abrégé de trois mois les personnes (non journalistes) susceptibles de s’exprimer sur Internet ?
Réponse :
S’engager dans une protection discriminatoire de la liberté d’expression me semble être une très mauvaise voie. Il est tout à fait impossible de faire de la prescription trimestrielle le marqueur d’un droit strictement professionnel. Les journalistes ne sont pas les seuls à contribuer à l’information du public. De nombreuses personnes qui ne sont pas détentrices de cartes de presse y contribuent : les auteurs de livres, des personnalités de tous bords, les blogeurs, les hommes politiques, les syndicalistes, ou les simples citoyens, pour ne citer que quelques exemples. Et cette expression passe de plus en plus par l’internet.
Il faut par ailleurs ajouter que cette limitation serait contraire aux principes constitutionnels puisque l’article 11 de la DDHC de 1789, intégrée dans le bloc de constitutionnalité, accorde la liberté d’expression à « tout citoyen », ce qui invite à exclure les distinctions catégorielles ou arbitraires.
3. Pensez-vous que la fixation à un an du délai de prescription pour certaines infractions commises par voie de presse (provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, contestation des crimes contre l’humanité) permette d’en assurer une meilleure répression ? Estimez-vous que cette modification porte atteinte à la liberté d’expression ?
Réponse :
Je n’ai jamais été favorable par principe à cette extension du délai de prescription qui me semble être une simple disposition de confort procédural pour les parties poursuivantes. Et j’ajoute que cette disposition n’a à mon sens jamais fait ses preuves. De manière générale, c’est l’anonymat qui fait obstacle à la répression, et le fait d’allonger le délai pour agir ne règle pas le problème de l’anonymat.
Par ailleurs je pense que même pour les discours dits de haine, la justification d’un délai de prescription court demeure, il faut éviter que du fait d’une action tardive, le jugement soit très éloigné de la publication. La prescription trimestrielle a à cet égard des vertus, elle oblige à agir vite, et à enclencher rapidement le processus judiciaire, et cela me paraît être un objectif de politique pénale à prendre en considération. Pour autant, et j’y reviendrai, il ne faut pas se méprendre sur la portée de ce propos, je ne suis en aucune manière favorable à l’utilisation des procédures de comparution immédiate dans le domaine de la liberté d’expression.
4. Serait-il pertinent de porter à un an le délai de prescription de l’ensemble des infractions de presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ?
Réponse :
Aucunement selon moi.
Ce serait tout d’abord la destruction du principal « marqueur » du caractère fondamental accordé à cette liberté publique. À un moment ou la communauté nationale tout entière a défilé pour rappeler l’attachement à cette liberté, ce serait un pied de nez à l’histoire.
Ensuite, cela remettrait en cause tout l’équilibre du droit de la presse, car la loi du 29 juillet 1881 a sa logique propre et celle-ci est fragile. Les organes de presse attaqués sont soumis à une présomption de mauvaise foi et doivent se défendre au fond dans un délai très court de 10 jours. Chaque partie est donc soumise à des règles contraignantes. Supprimer les contraintes du seul côté des parties poursuivantes, c’est remettre en cause toute l’économie du procès.
Enfin, un tel allongement général serait probablement inconstitutionnel. Rappelons à ce sujet que si cet allongement a été validé sur QPC par le Conseil constitutionnel ( 2013-302 QPC du 12 avril 2013), c’est parce que son objet est de faciliter la poursuite et la condamnation de certaines infractions strictement définies, et à raison de la nature de celles-ci (considérant 6). En outre, on ne doit pas oublier que dans sa décision portant sur la loi LCEN du 21 juin 2004, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui visaient à contourner la prescription trimestrielle en retardant son point de départ sur internet (2004-496 DC du 10 juin 2004).
Il convient donc à mon sens de cantonner strictement l’allongement de la prescription aux seuls cas de contenus qui heurtent frontalement l’ordre public, c’est-à-dire aux discours de haine.
5. Estimeriez-vous judicieux de transférer dans le code pénal certaines infractions aujourd’hui réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur le modèle de la solution retenue pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes (infractions désormais prévues à l’article 421-2-5 du code pénal) ?
Réponse :
Non, au contraire, ce n’est pas un modèle à suivre car le traitement des infractions dans le domaine de la liberté d’expression doit obéir à un régime particulier, et ne pas être noyé dans le droit commun. Il est donc à mon sens impératif de garder la loi du 29 juillet 1881 comme matrice des incriminations en ce domaine. Les garanties des droits de la défense doivent pleinement s’appliquer quand les infractions constitutives de restrictions à la liberté d’expression sont sévèrement condamnées. Plus la sanction peut être grave, et plus il est légitime que les garanties s’appliquent.
À mon sens, plutôt que de sortir au compte-gouttes des infractions de la loi du 29 juillet 1881 pour les loger dans le Code pénal, en fonction de la sensibilité de l’opinion publique du moment, il faudrait au contraire regrouper l’ensemble des incriminations qui relèvent du domaine de la liberté d’expression en un Code de la communication, car l’éparpillement des infractions nuit à la cohérence et à la lisibilité du droit de la presse. C’est un facteur évident d’insécurité juridique. D’ailleurs, l’architecture de ce code a déjà été préparée par le Conseil d’Etat, et il est resté dans les cartons.
J’ajoute que les infractions en matière de racisme et d’antisémitisme contiennent des qualifications telles que la diffamation et l’injure raciales, qu’il est radicalement impossible de déconnecter de la loi sur la presse qui fixe quant à elle les éléments constitutifs de ces infractions. On s’acheminera inévitablement vers un monstre juridique, hybride, pour lequel on va mettre des années à fixer le régime précis.
En outre, le passage vers le droit commun, qui a conduit récemment le parquet à user largement de la voie de la comparution immédiate en matière d’apologie de terrorisme, ne permet pas de discuter sereinement des éléments de ces infractions complexes, et pour lesquelles il faut parfois décrypter des discours d’une très grande perversité. Le tribunal doit être autant que possible habitué à ces décryptages, qui ne sont pas le quotidien des formations de comparution immédiate.
Je suis au contraire partisan d’une restriction du nombre de tribunaux qui peuvent connaître de ces affaires, à l’image de ce qui a été fait en matière de propriété intellectuelle par exemple. En effet, à mon sens, l’appréciation des limites de la liberté d’expression est un exercice qui diffère fondamentalement de l’office habituel du juge pénal, car le prévenu est par définition dans l’exercice d’une liberté publique, protégée constitutionnellement et internationalement.
6. La fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la première mise en ligne du contenu litigieux vous semble-t-elle adaptée au mode de diffusion des informations sur Internet ? Le régime de prescription constitue-t-il un obstacle à la répression des infractions de presse commises sur Internet ?
Réponse :
Oui ce point de départ est logique car il s’agit d’une infraction dite instantanée. La cour de cassation a tranché ce point à de nombreuses reprises. Au surplus les outils de veille développés tels que « Google alert » permettent de connaître les contenus publiés sur le net très rapidement, alors que ces outils n’existent pas pour les publications papier ou audiovisuelles.
Par ailleurs cela n’aurait aucun sens qu’un même article de presse publié sur papier et sur le net puisse être indéfiniment poursuivi sur un seul des deux supports. Cela revient à anéantir l’effet de la prescription trimestrielle.
Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496 DC du 10 juin 2004 déjà citée tranche ce sujet. Le Conseil n’a pas admis que le point de départ de la prescription soit retardé au jour où cesse la diffusion. D’ailleurs, comme tout reste en archives, cela reviendrait à rendre les infractions de presse imprescriptibles, ce qui serait un comble dans un domaine où on estime nécessaire de prévoir une prescription abrégée !
7. Le régime de la prescription des infractions commises sur les réseaux sociaux soulève-t-il des interrogations ou des difficultés particulières ?
Réponse :
Oui, la difficulté particulière tient à l’anonymat, mais à mon sens traiter cette difficulté en modifiant le délai de prescription est une impasse. Ce n’est pas parce qu’on permettra à la victime d’agir 12 mois après la mise en ligne que les services d’enquête seront mieux armés pour rechercher l’identité d’un responsable qui aura créé un profil sous pseudonyme, ou mis en ligne un contenu en utilisant un procédé de masquage de son adresse IP. Le résultat sera le même.
8. La France devrait-elle s’inspirer de certains modèles étrangers pour apporter d’éventuelles modifications aux régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines en matière de presse ?
Réponse :
Bien évidemment non. Elle doit garder son modèle qui a fait ses preuves et continue à constituer à mon sens un juste équilibre. Il est fondamental de conserver le principe d’une loi spéciale bâtie sur la règle d’une prescription abrégée. La difficulté à réprimer certains excès, notamment sur le Net, n’est pas la conséquence d’une prescription trop courte mais de l’existence d’un média mondialisé et qui s’est développé en tolérant l’anonymat. C’est à cette tolérance qu’il faut s’atteler, dans un cadre international. L’allongement national du délai de prescription n’aura pas d’effet substantiel et serait un signal politique d’une profonde régression de la liberté d’expression.
Contribution de M. Emmanuel Derieux, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris II Panthéon-Assas
Parmi d’autres particularités de procédure, les délais de prescription spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 constituent, du fait de leur durée réduite et de la détermination incertaine de leur point de départ ou des causes de leur réouverture, un obstacle à la juste et nécessaire sanction judiciaire des abus de la liberté d’expression pourtant définis et voulus comme tels par le législateur.
Selon les dispositions applicables, les délais de prescription de l’action judiciaire susceptible d’être engagée du fait d’abus allégués de la liberté d’expression sont variables. Parfois réduits, notamment lorsqu’ils sont déterminés par la loi du 29 juillet 1881, ces délais se distinguent alors des règles de droit commun et font ainsi obstacle à la poursuite et à l’éventuelle répression et/ou réparation judiciaire des violations supposées. Ils sont sources d’incertitudes et de difficultés. Ils ne contribuent pas à la lisibilité de la règle de droit et ne garantissent pas un égal accès à la justice et la sanction de ce qui, au nom de l’ordre public et du respect des droits des personnes, a pourtant été défini et voulu, par le législateur, comme constitutif d’abus.
Parmi bien d’autres particularités de procédure430 de la loi du 29 juillet 1881, ces délais de prescription réduits peuvent être perçus comme des privilèges accordés aux médias, à leurs acteurs et à ceux –professionnels ou non- qui s’expriment à travers eux et qui se trouvent ainsi mis à l’abri de poursuites et de sanctions. Peut-être historiquement fondées pour, à l’époque, conforter et enraciner la liberté d’expression431, ces spécificités procédurales ont-elles, dans le contexte d’aujourd’hui, les mêmes raisons ou justifications et doivent-elles être maintenues ? Pour quelques abus légalement définis, n’accorde-t-on pas alors une forme d’impunité ou d’immunité à ceux qui ne participent ainsi en rien au débat public et à l’expression de la diversité des opinions et des points de vue, nécessaires à la démocratie, mais sont causes d’un désordre et/ou d’un dommage subi par les personnes et les groupes injustement atteints ou qui, à tout le moins, le ressentent comme tel ?
Pour comprendre tout cela, à l’égard de la sanction judiciaire des abus de la liberté d’expression qui s’en trouve ainsi gênée, jusqu’à en être rendue impossible, ne convient-il pas : de faire état de la diversité des délais de prescription (I) ; d’en considérer les conséquences (II) ; et, pour y remédier, dans le respect du nécessaire équilibre des droits, d’envisager d’y apporter des corrections (III) ?
I.- État de la diversité des délais de prescription
La diversité des délais de prescription de l’action judiciaire à l’égard des abus de la liberté d’expression tient, selon les textes applicables, à leur durée variable (A). Elle est attachée aussi à la détermination du point de départ (B) de ce délai, même si, en raison de cette particularité, mais risquant de l’aggraver encore davantage, des suggestions ou tentatives de retarder celui-ci n’ont, pour le moment, pas toutes été retenues.
A.- Durée variable du délai
Les délais de prescription sont différents selon qu’il s’agit d’abus de la liberté d’expression définis par la loi du 29 juillet 1881 ou par d’autres textes, mais aussi désormais au sein même de ladite loi de 1881.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pose que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi » (provocations à certains crimes et délits ; diffamations ; injures ; fausse nouvelle ; diffusion de l’image d’une personne « mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale (…) faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire » ; diffusion « de la reproduction des circonstances d’un crime ou délit » ; publication d’« actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique » ; emploi, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions (…) de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image » ; comptes rendus de certains procès ; diffusion d’informations concernant des mineurs ou les victimes de certaines infractions ; diffusion de l’« identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires (…) d’agents des douanes »…) « se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Par l’article 65-3 de la dite loi de 1881, ce délai est cependant maintenant « porté à un an » pour : les infractions de provocation à la discrimination ou à la haine raciale, sexiste ou à raison du handicap ; les écrits et propos négationnistes ou révisionnistes (s’agissant exclusivement de l’« holocauste » ou de l’extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale) ; les diffamations et injures raciales, sexistes ou du fait du handicap.
Diverses infractions pénales (d’atteintes à l’intimité de la vie privée ; d’atteintes à l’indépendance de la justice ; et de provocation ou d’apologie de terrorisme, depuis la réforme législative du 13 novembre 2014 qui a transféré cette infraction de la loi de 1881 au Code pénal432…) commises par les mêmes moyens de communication ou découlant d’abus de la liberté d’expression qui ne sont pas définis dans la loi du 29 juillet 1881 se voient normalement appliquer les délais de prescription de droit commun d’un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes.
Si elle est admise, l’action civile en réparation (d’une atteinte à la vie privée, sur le fondement de l’article 9 du Code civil ; d’une atteinte à la présomption d’innocence, sur le fondement de l’article 9-1 du même Code ; ou, de façon bien injustement trop rarement acceptée, sur le fondement de l’article 1382 dudit Code433) d’un abus de la liberté d’expression non constitutif d’infraction pénale au sens de la loi du 29 juillet 1881 ou de quelque autre texte se prescrit généralement par cinq ans. Le délai de prescription d’un abus de la liberté d’expression perçu comme moins grave, que la loi ne définit pas comme constitutif d’une infraction pénale, est paradoxalement plus long que pour ce qui est pourtant considéré comme la cause d’un désordre social…
Alors qu’aucun délai particulier de prescription n’est prévu, par l’article 434-16 du Code pénal, pour les infractions d’atteinte à l’indépendance de la justice, l’article 434-25 du même Code pose, pour l’infraction pourtant voisine d’atteinte à l’autorité de la justice, que « l’action se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction (…) a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite », comme pour celles des infractions définies par la loi de 1881.
En dehors de l’action judiciaire, mais parfois pour des faits assez proches sinon semblables à ceux qui pourraient donner lieu à une telle action, l’exercice du pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en lui-même assez contestable au regard des exigences de séparation des pouvoirs et des garanties de la liberté d’expression, se trouve encadré, dans le temps, par la disposition de l’article 42-5 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel il « ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
Aux différents délais de prescription, s’ajoutent, de manière bien plus complexe encore, les difficultés relatives à la détermination, elle aussi variable, du point de départ dudit délai.
B.- Point de départ du délai
Comme précédemment indiqué, l’article 65 de la loi de juillet 1881 fait, en principe, partir le délai de prescription des abus de la liberté d’expression « à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Compte tenu du caractère bien réduit de ce délai, cela oblige, pour entretenir l’action et échapper à la prescription, à intervenir, par des actes de procédure, tous les trois mois.
Par le même article 65, il est posé que, « avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription ». Encore faut-il, pour cela, que celles-ci satisfassent à d’autres exigences des particularités de procédure de ladite loi. Ce même article précise en effet que « ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ». À la lettre, cette énumération ne paraît pourtant pas envisager l’ensemble des infractions définies par la même loi.
C’est, dans les mêmes conditions, ce même jour « où l’infraction (…) a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite » qui interrompt la prescription et fait démarrer un nouveau délai de trois mois, qui, aux termes de l’article 434-25 du Code pénal, constitue le point de départ du délai de prescription de l’infraction d’atteinte à l’autorité de la justice.
S’agissant des atteintes publiques à la présomption d’innocence, l’article 65-1 de la loi de 1881 pose qu’elles « se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ». C’est la seule référence davantage précise ou explicite, dans ladite loi, au premier jour de la publication. Cela pourrait dès lors conduire à penser qu’il pourrait en être autrement pour les autres abus de la liberté d’expression qu’elle définit. Par l’article suivant il est cependant posé que, « en cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale » (on ne voit pas comment il pourrait y avoir autrement atteinte à la présomption d’innocence si une infraction pénale n’est pas visée dans la mise en cause !), « le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ».
De la même manière, l’exercice du pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ne peut concerner des « faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » interrompant la prescription.
Le texte voté de ce qui est devenu la loi du 21 juin 2004 dite « pour la confiance dans l’économie numérique » (« LCEN ») avait envisagé deux points de départ différents du délai de prescription des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 et commises par un moyen de communication au public en ligne. Il y avait été posé que la « prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d’une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier » et que, « dans le cas contraire », en cas de publication en ligne ou « sans papier » seulement, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l’article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions ». Dans le premier cas, d’une double publication, sur support papier et en ligne, il était prévu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date de la mise en ligne du contenu contesté (considéré, comme il est d’usage en la matière, comme un « délit instantané »), bien qu’il puisse cependant ne pas être identique à celle de l’édition papier ; dans le second cas, d’une publication exclusive en ligne, aurait été retenue la date de la suppression du message (considéré alors comme constitutif d’un « délit continu »). Saisi par les requérants qui estimaient que « ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi en prévoyant que (…) le délai de prescription (court) à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public pour les messages exclusivement communiqués en ligne, alors que, pour les autres messages », ce délai court « à compter du premier acte de publication », le Conseil constitutionnel a posé que, « par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ; que, toutefois, la différence de régime instaurée, en matière (…) de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». En conséquence, la disposition en cause a été déclarée contraire à la Constitution (Conseil constitutionnel, 10 juin 2004, décision n° 2004-496 DC).
À la diversité de la durée des délais de prescription et de la détermination de leur point de départ s’attachent un certain nombre de conséquences bien regrettables et injustifiées.
II.- Conséquences de la diversité des délais de prescription
Cause de bien inutiles complications pour ceux qui pourraient prendre l’initiative d’une action en justice pour abus de la liberté d’expression, la diversité des délais de prescription et de la détermination de leurs points de départ ne contribue pas à la simplification de la règle de droit, à sa lisibilité, à l’accès et à l’égalité de tous devant la justice. Elle paraît ainsi ne pas satisfaire certaines exigences constitutionnelles et conventionnelles (au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’interprétation qu’en fait la Cour européenne des droits de l’homme) notamment de prévisibilité du droit (A) et d’accès à la justice (B).
A.- Prévisibilité du droit
Outre les difficultés liées à la détermination du délai de prescription applicable, en fonction de la nature de l’abus supposé et du texte qui le définit, s’ajoutent des incertitudes relatives à la fixation de son point de départ.
Doivent, à cet égard, être considérés les actes interruptifs de la prescription, liés notamment, s’agissant d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, à une exacte qualification des faits lors de l’engagement de l’action. L’article 50 de ladite loi dispose que « si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures » (qui ne sont pourtant pas les seules infractions définies par cette loi et auxquelles s’applique le délai de prescription très particulier qui y est fixé) « à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite ». Quant à l’article 53 de la même loi, il pose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite » et que « toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ». Une erreur de qualification de l’infraction et de mention de l’article qui la définit n’interrompt pas la prescription. Un délai de trois mois à compter de la date des faits reprochés étant écoulé lorsqu’une telle erreur est dénoncée et constatée, l’infraction est alors prescrite et plus aucune action en justice, ni pénale ni civile, ne peut plus être engagée.
Le point de départ du délai de prescription fixé au jour de la publication est parfois difficile à déterminer, s’agissant d’affichage, des messages diffusés à la radio ou à la télévision que la personne mise en cause peut ne pas avoir écoutés personnellement, en direct, et particulièrement, aujourd’hui, à travers les services de communication au public en ligne et de toutes formes de reprises ou mises à jour d’une édition initiale.
Y compris s’agissant de publications portant une date (hebdomadaires, mensuels… livres), ce n’est pas nécessairement celle-ci qui doit être retenue comme point de départ de la prescription. Plus ce délai est court, plus les risques sont grands pour ceux qui sont à l’initiative de l’engagement de l’action et au seul avantage des personnes susceptibles d’être poursuivies du fait des abus qui leur sont reprochés. Cela peut se jouer à quelques jours sinon à quelques heures près.
Une réimpression ou une réédition d’un ouvrage doivent-elles être considérées comme constitutives d’une nouvelle publication faisant partir un nouveau délai de prescription, particulièrement si ledit ouvrage a, un temps, été épuisé et que la première publication a donc, dans le temps, été interrompue ?
Les informations mises en ligne ne sont pas toujours datées, du moins de façon lisible ou visible pour les utilisateurs et notamment pour les personnes qui s’estimeraient ainsi abusivement ou inexactement mises en cause et qui, en conséquence, envisageraient d’engager une action en justice.
La mise à jour d’un site internet, au moins si sont, à cette occasion, insérés les éléments inédits considérés comme constitutifs d’abus de la liberté d’expression, ne devrait-elle pas être considérée comme constitutive d’une nouvelle publication faisant courir, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription ?
Différentes illustrations jurisprudentielles peuvent être données des hésitations et contradictions des décisions de justice quant à l’application du délai de prescription, et en particulier la détermination de son point de départ, s’agissant d’infractions, à la loi du 29 juillet 1881, commises par la voie de l’internet. Du moins en était-il ainsi dans les premières années d’utilisation de ce moyen de communication. La solution, qui semble aujourd’hui être davantage stabilisée et qui paraît s’imposer, n’en est cependant pas pour autant satisfaisante.
Dans un arrêt du 15 décembre 1999, la Cour d’appel de Paris, évoquant le « délai de trois mois, délai dérogatoire au droit pénal commun », considérait que, « pour appliquer l’article 65, il est nécessaire de déterminer la date de la première mise à disposition du public ». S’agissant de la mise en ligne d’un message, elle estimait alors que « la publication résulte de la volonté renouvelée de l’émetteur qui place le message sur un site, choisit de l’y maintenir ou de l’en retirer quand bon lui semble ». Elle en concluait que « l’acte de publication devient ainsi continu » et que, « en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates où il a été constaté que ceux-ci y figuraient », l’auteur « a procédé à une nouvelle publication ce jour-là et s’est exposé à ce que le délai de prescription de trois mois coure à nouveau à compter de cette date ». De plus, il était alors considéré que, « contrairement à l’appréciation des premiers juges, c’est à une nouvelle mise à disposition du public que s’est livré le prévenu en modifiant l’adresse de son site » (Paris, 11e ch., sect. A, 15 décembre 1999, Licra et autres c. J.-L. Costes)434. Cet arrêt a cependant été cassé par décision du 27 novembre 2001 (Cass. crim., 27 novembre 2001, J.-L. Costes, n° 01-80.134).
Dans un arrêt du 23 juin 2000, la Cour d’appel de Paris a posé, à propos de la diffusion d’un message considéré comme diffamatoire sur l’internet, que « la prescription de l’action en diffamation, fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 », a « pour point de départ non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier acte de publication » (Paris, ch. acc., sect. 2, 23 juin 2000, Min. Public c. G. Bardin)435.
Saisi de la mise en ligne, sur un site internet, d’un message d’abord diffusé sur un support papier, le Tribunal a commencé par rappeler que, « en matière de presse écrite, tout délit résultant d’une publication est réputé commis le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public » et qu’il « importe peu que cette infraction, instantanée, produise des effets délictueux qui se prolongent dans le temps par la force des choses (l’offre d’un livre en librairie, le maintien d’un hebdomadaire ou d’un mensuel en kiosque) dès lors que cette situation ne résulte pas d’une manifestation renouvelée de la volonté de l’auteur ». Mais il a poursuivi que, « au contraire, les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau internet transforment l’acte de publication en une action inscrite dans la durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l’émetteur de placer un message sur un site, de l’y maintenir, de le modifier ou de l’en retirer » et, en conséquence, que « le délit que cette publication ininterrompue est susceptible de constituer revêt le caractère d’une infraction successive » assimilée à « l’infraction continue », dans des conditions telles que « le point de départ de la prescription se situe au jour où l’activité délictueuse a cessé ». Le jugement pose encore que « le fait que l’insertion, sur un site internet, d’un message ayant fait l’objet, sur un autre support, d’une mise à disposition du public constitue (…) une édition nouvelle (…) qui fait courir un nouveau délai de prescription » (TGI Paris, 17e ch., 6 décembre 2000, C. Lang c. T. et R. Meyssan)436.
Par un jugement du 16 janvier 2001, il a été posé que « la diffusion d’un texte sur le réseau internet constitue un acte de publication continu » et que « l’infraction qu’il est susceptible de comporter revêt le caractère d’un délit successif, la prescription ne commençant à courir qu’à compter du jour de la cessation de l’activité litigieuse » (TGI Paris, 17e ch., 16 janvier 2001, R. Pinel c. F. Bonnet, n° 0020704947).
Dans un arrêt du 30 janvier 2001, la Cour de cassation a considéré que, en prononçant « par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n’établissent pas que l’article incriminé ait été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet à une date antérieure » à celle « avancée par la partie civile et, en tout cas, plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En conséquence, l’arrêt contesté a été cassé (Cass. crim., 30 janvier 2001, A. Wilbert)437. Evoquant cet arrêt, le Professeur Didier Rebut écrivait : « s’il est important que la détermination de la prescription applicable aux délits de presse commis sur l’internet fasse l’objet d’une solution sûre qui lui donne sa prévisibilité indispensable, il convient cependant qu’elle soit justifiée. Or, l’application du régime de la prescription abrégée aux délits de presse commis sur l’internet souffre d’être générale. Elle les soumet à une prescription uniforme qui ne rend pas compte de leur différence éventuelle de consommation, dont leur prescription doit pourtant découler. Il en résulte l’inadaptation partielle de la solution choisie par la chambre criminelle ». Le commentateur mentionnait encore, à propos du « mode de calcul du délai de prescription », qu’il « n’a pas été prévu par la loi de 1881. C’est le juge pénal qui l’a déterminé en décidant de fixer le point de départ de la prescription au jour du premier acte de publication (…) Cette solution a impliqué une consommation instantanée de la diffamation qui la rend indifférente au prolongement ou au renouvellement de la publication »438.
Dans un jugement du 3 juillet 2001, le Tribunal pose, de manière bien contestable, que, « en matière d’écrit périodique, et spécialement mensuel (…) le premier jour de publication –fixant le point de départ du délai de prescription- est réputé être celui du premier jour du mois en cause, sauf pour le défendeur, qui prétend la prescription acquise, à démontrer que la publication effective est intervenue à une date antérieure » (TGI Paris, 17e ch., 3 juillet 2001, F. Maignien c. J.-J. Magnies, n° 01/00066). L’on pourrait ajouter aussi et en sens contraire : sauf à celui qui est à l’initiative de l’action à apporter la preuve d’une publication à une date ultérieure.
Par un arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel d’avoir énoncé que « le délai de prescription a pour point de départ le jour du premier acte de publication » (Cass. crim., 16 octobre 2001, G. Tranchant)439.
Par arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation pose que, « lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi » du 29 juillet 1881 « sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date de premier acte de publication » et que « cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs » (Cass. crim., 27 novembre 2001, J.-L. Costes, n° 01-80.134). En conséquence, est cassé l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 1999 (Paris, 11e ch., sect. A, 15 décembre 1999, Licra et autres c. J.-L. Costes).
En matière d’affichage, la question de la détermination du point de départ du délai de prescription a été récemment illustrée par l’affaire dite du « Mur des cons ». Pour le parquet, prenant en considération la date de la première installation et utilisation supposée du panneau d’affichage, les faits reprochés seraient prescrits. Par contre, pour le magistrat instructeur, c’est « le fait de rendre public un panneau en permettant son accès à un journaliste (…) qui a constitué la publicité » et c’est la date de cet événement qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription. Selon l’ordonnance de renvoi, « il importe donc peu de savoir à quelle date les photos incriminées ont été épinglées »440.
Dans de telles conditions, tant relatives à leur formulation qu’aux difficultés de leur interprétation et application, les dispositions concernant le délai de prescription et la détermination de son point de départ semblent loin de satisfaire « les exigences résultant de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » maintes fois rappelées, en d’autres matières, par le Conseil constitutionnel (17 janvier 2008, Décision n° 2007-561 DC ; 21 février 2008, Décision n° 2008-563 DC).
Cette même exigence de prévisibilité ou lisibilité de la loi est également retenue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Celle-ci pose que « les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots ‘prévues par loi’. Il faut d’abord que la ‘loi’ soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants (…) sur les normes juridiques applicables (…) En second lieu, on ne peut considérer comme ‘loi’ qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable (…) les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé » (CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume Uni ; CEDH, 18 mai 2004, Sté Plon c. France ; CEDH, 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens c. France ; CEDH, 14 février 2008, July et Libération c. France ; CEDH, 18 septembre 2008, Chalabi c. France…).
Les incertitudes liées à la détermination du délai de prescription et de son point de départ et un délai de prescription particulièrement court constituent un obstacle évident à l’accès à la justice et, par elle, de la juste et nécessaire sanction des abus allégués de la liberté d’expression tels que définis par la loi.
B.- Accès à la justice
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), à laquelle est reconnue valeur constitutionnelle, énonce, en son article 1er, que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». En son article 6, elle dispose que « la loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Consacrant, en son article 11, le principe de « libre communication des pensées et des opinions », elle précise cependant que, au nom de l’équilibre des droits et de l’égalité des personnes, il convient de « répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». C’est normalement devant le juge que cela peut et doit être fait. L’article 1er de la Constitution mentionne que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens ». Du fait des obstacles mis, parmi d’autres particularités de procédure de la loi de 1881, par des délais de prescription spécifiques, est-ce ce qui peut être constaté en pratique ?
Alors que la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme (ConvEDH) consacre, au paragraphe 1er de son article 10, le « droit à la liberté d’expression », elle détermine, en son paragraphe 2, les diverses limites qui peuvent ou doivent y être apportées par la loi et dont les juges doivent assurer la sanction. Son article 6 précise notamment que « toute personne a droit à un procès équitable ». Cela doit valoir tant pour ceux qui sont en demande ou à l’initiative de l’action, parce que se considérant comme injustement mis en cause, que pour ceux qui sont en défense ou poursuivis pour des abus allégués de la liberté d’expression.
Selon que l’infraction découlant d’un abus de la liberté d’expression est définie par la loi du 29 juillet 1881 ou par un autre texte, le délai de prescription et donc, pour ce qui est, parmi d’autres éléments, du temps de l’action, les conditions d’accès à la justice diffèrent. Même si quelques corrections ont pu y être apportées, contrairement à ce qui pourrait paraître nécessaire, cela n’est pas toujours en relation avec la nature et la gravité de l’infraction supposée. Paradoxalement, le délai de prescription de ce qui a été défini et voulu, par le législateur, comme constitutif d’une infraction pénale, parce que constituant un élément de désordre public, est plus court que celui de la faute, susceptible de donner lieu à une action civile en réparation, ne présentant pas la même nature et gravité.
Un délai de prescription trop court et des incertitudes sur le délai qui doit être respecté dans une situation donnée font obstacle à la possibilité, pour les personnes qui s’estiment injustement atteintes dans leurs droits du fait d’abus de la liberté d’expression, de saisir la justice. Cela n’assure pas l’égalité de tous devant la loi.
D’une manière qui peut ne pas emporter la conviction, par un arrêt du 23 juin 2011, la Cour de cassation a estimé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur instaure des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, dès lors que ces règles ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que sont assurées aux justiciables des garanties égales ; qu’en outre, la prescription trimestrielle de l’action en réparation de l’atteinte à la présomption d’innocence, prévue par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 » (pour un abus de la liberté d’expression dont tous les éléments ne sont pas tous définis dans cette loi mais principalement par l’article 9-1 du Code civil !), « ne prive pas la victime du droit d’accès au juge ; que, dès lors, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle » (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, n° 11-40.023).
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») concernant le délai de prescription de trois mois, de la loi de 1881, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2012, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, au motif notamment, selon elle, que la question « ne peut être regardée comme sérieuse dès lors (…) que le délai de prescription institué par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi » (Cass. civ., 1ère, 5 avril 2012, n° 11-25.290). Etait-ce à elle d’en juger ? Est-ce bien certain ?
Pourtant, saisie de la question de savoir si « les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (…) qui dérogent à la règle d’ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d’égalité devant la justice, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789 », la Chambre criminelle a estimé que « la question présente un caractère sérieux, dès lors que la différence de régime instaurée, en matière de prescription, par les dispositions critiquées est susceptible de dépasser ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la nature particulière des délits ci-dessus visés au regard des autres infractions de presse, et de porter atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice ». Elle en conclut qu’« il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel » d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 22 janvier 2013, Laurent A. et autres, n° 12-90064).
Ainsi saisi, le Conseil constitutionnel a considéré que, « en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu’il désigne, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d’écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité ; que le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles » et que « ces dispositions qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ». En conséquence, il a conclu que « l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité, est conforme à la Constitution » (Décision du 12 avril 2013, n° 2013-302 QPC)441.
Tous ces éléments relatifs aux délais de prescription des abus de la liberté d’expression, définis par la loi du 29 juillet 1881 ou par d’autres textes, causes d’incertitudes et de désordre juridique, appellent assurément des corrections.
III.- Corrections de la diversité des délais de prescription
Les délais de prescription raccourcis de la loi du 29 juillet 1881 constituent, parmi d’autres, une des particularités de procédure de ladite loi. La solution la plus radicale serait d’abroger cette loi442 en cela très spéciale et, à défaut de Code de la communication ou des médias443, d’insérer, dans le Code pénal, comme cela a déjà été fait pour certains abus de la liberté d’expression constitutifs d’infractions, les dispositions qui mériteraient d’être conservées et d’y appliquer alors les règles de procédure de droit commun, notamment en ce qui concerne le délai de prescription et sa durée.
La suggestion faite de « dépénalisation » de la diffamation444 aurait eu pour effet de faire sortir cet abus de la liberté d’expression du texte de la loi de 1881 et de faire échapper l’action civile (probablement suffisante), susceptible d’être engagée à son encontre, à l’application du délai de prescription de l’article 65 de cette loi très spéciale. Mais, tant il est difficile de faire passer quelques réformes que ce soit et de remettre en cause certains « avantages » ou « privilèges », cette proposition a été diversement appréciée445 et surtout contestée par les représentants des intérêts des médias, bénéficiant probablement de davantage de possibilités de faire entendre leur point de vue. Elle n’a donc pas abouti.
La solution minimale serait d’harmoniser les délais de prescription en tenant compte, conformément aux règles du droit commun, de la nature et de la gravité des infractions.
Le Professeur Didier Rebut estime qu’« il est impératif que la jurisprudence adapte le régime de la prescription de trois mois à l’internet. Sa brièveté ne ménage pas un délai suffisant pour que les victimes prennent connaissance de l’existence et du contenu d’un site qui les diffame »446. Cela pourrait très sûrement être étendu, et peut-être de manière plus justifiée encore, à l’ensemble des moyens de publication qui, à la différence des contenus mis en ligne, n’offrent pas les mêmes systèmes d’alerte automatique ou qui ne permettent pas le recours à des moteurs de recherche.
Compte tenu du fait que certaines publications (périodiques et livres notamment), du fait de la durée de leur commercialisation et de leur conservation, dans les bibliothèques et au titre du dépôt légal, sont susceptibles d’être longtemps sinon toujours ou indéfiniment accessibles, il n’y a sans doute pas d’autre solution que de retenir, comme point de départ du délai de prescription, la date de la première mise à disposition du public. Pour remédier aux incertitudes relevées et aux conséquences qui en découlent, il conviendrait cependant d’allonger et de normaliser le délai de prescription des actions en justice susceptibles d’être engagées à raison des abus de la liberté d’expression ainsi commis.
Comme cela a pu être suggéré, conviendrait-il, en application de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », de considérer que la prescription ne serait pas opposable à celui qui n’aurait pas eu connaissance du fait entraînant son action en justice ? Trop spécifique, une telle solution ne satisferait pas les exigences de prévisibilité des règles et d’égalité devant la justice.
À défaut d’intervention du législateur pour remédier à certaines des particularités relevées et aux conséquences qui en découlent quant à la lisibilité ou à la prévisibilité des textes et à la garantie de l’égalité des droits et du droit d’accès à la justice, le Conseil constitutionnel s’étant, parmi d’autres décisions447 relatives à la loi du 29 juillet 1881, déjà prononcé, par la Décision du 12 avril 2013, n° 2013-302 QPC448, sur la conformité à la Constitution de certains au moins des délais particuliers de prescription, resterait encore, à l’occasion d’un litige, les voies de recours interne étant épuisées, la possibilité d’une saisine, sur ce point, de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)… même si celle-ci à une forte tendance à faire prévaloir la liberté d’expression et à s’opposer aux sanctions des abus de la liberté d’expression, telles que définies par les législations nationales et appliquées par les juridictions internes.
**
Du fait notamment de la brièveté des délais de prescription déterminés par la loi du 29 juillet 1881, qui ne sont qu’une des particularités de procédure de ladite loi, et de l’incertitude relative au point de départ de ces délais, les personnes qui se considèrent victimes d’abus de la liberté d’expression se heurtent à des dispositions qui, à l’évidence, ne satisfont pas les exigences constitutionnelles et conventionnelles de lisibilité ou de prévisibilité de la loi. Elles voient ainsi restreindre leur droit d’accès à la justice et se trouvent privées de la possibilité d’obtenir le respect de leurs droits et la réparation des préjudices subis. Dans un souci de respect du principe d’égalité des droits, cela devrait être considéré comme tout aussi essentiel que la liberté d’expression. L’ordre public et l’intérêt collectif s’en trouvent également atteints. C’est là une situation à laquelle il conviendrait assurément de remédier par une clarification et normalisation des règles en vigueur. Sauf à tromper ainsi le public et à ménager et satisfaire le monde des médias, il ne sert à rien au législateur de définir des abus de la liberté d’expression si, du fait d’obstacles de procédure, il n’est pas possible d’en obtenir, en justice, la sanction et si, par ces particularités, leurs auteurs échappent à la mise en jeu de leur responsabilité. Se trouve ainsi violé le principe, pourtant posé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et auquel chacun se réfère, de « libre communication (…) sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Références bibliographiques : Blanchetier, Ph., « Point de départ du délai de prescription des délits de presse sur internet : vers une solution libertaire et contraire au bon sens », Dalloz, 2001, chron., pp. 2056-2058 ; Derieux, E., « Délais de prescription des infractions de la loi du 29 juillet 1881. Conformité à la Constitution » (à propos de la Décision du 12 avril 2013, n° 2013-302 QPC), RLDI/94, juin 2013, n° 3134, pp. 78-81 ; Dreyer, E., « L’allongement du délai de prescription pour la répression des propos racistes ou xénophobes. Commentaire de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 », Legicom, n° 35, 2006/1, pp. 107-116 ; Mallet-Poujol, N., « La notion de publication sur l’internet et son incidence sur la prescription des délits en ligne », Legicom, n° 35, 2006/1, pp. 53-69 ; Raguin, X. et Bigot, Ch., « De l’opportunité d’unifier les prescriptions en matière de presse », Legipresse, avril 1999, n° 160.II.41-45 ; Rebut, D., « Prescription des délits de presse sur l’internet. Le régime de la loi de 1881 », Legipresse, juin 2001, n° 182.II.63-67.
Contribution de Mme Fabienne Siredey-Garnier,
présidente de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris
En droit pénal de la presse où règne encore, malgré l’allongement du délai pour certaines infractions, voire son alignement sur les délais de droit commun pour d’autres (apologie du terrorisme..) le principe d’un délai de prescription extrêmement bref, posé à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la question de la prescription a été, est et demeure centrale. Pour preuve notamment les qualificatifs employés encore récemment, au sein de la doctrine :
-par les tenants farouches du statu quo, ceux qui, en paraphrasant Portalis (in Ecrits et discours juridiques et politiques) pourraient être définis comme « ( ayant...) plus en vue l’intérêt de celui qui peut s’aider de la prescription que l’intérêt de la personne à laquelle cette prescription peut être opposée », ceux qui s’appuient sur la formule quasi-sacramentelle d’Hercule de Serre, ministre de la justice sous Louis XVIII, à l’origine des lois du 17 et 28 mai 1819 ancêtres de la loi du 29 juillet 1881 (qui prévoyaient une prescription pénale de six mois et civile de trois ans et que les journalistes seraient jugés par une assemblée de jurés et non par des magistrats professionnels), « (la courte prescription) est dans la nature même des crimes et délits commis avec publicité et qui n’existent que par cette publicité » et sur la formule rituelle de la Cour de cassation « la courte prescription, édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d’expression » voient en toute modification ou toute velléité de porter atteinte au délai de trois mois la porte ouverte à la violation de la liberté d’expression, s’opposant ainsi à ceux qu’ils appellent « les apologistes de la sanction...plaçant le dommage au cœur du raisonnement » 449.
-par ceux qui, soucieux d’adapter le droit d’une part aux évolutions technologiques, au premier rang desquelles internet, d’autre part à la tolérance manifestement de moins en moins grande des populations au principe même de la prescription, enfin de poursuivre et réprimer plus efficacement certains abus de la liberté d’expression – préoccupation particulièrement vivace à l’heure où nous parlons- insistent sur le caractère obsolète des règles posées par la loi du 29 juillet 1881 et la nécessité absolue de revenir sur la prescription abrégée, ce délai « brévissime...achevé à peine commencé », ce « privilège de la sphère médiatique » dont ils affirment que ni la Cour européenne des droits de l’homme, ni le Conseil constitutionnel n’ont souhaité l’ériger en corollaire indispensable de la liberté d’expression, contrairement à ceux qu’ils présentent comme « conservateurs », « pitoyables », affectés du bien connu « culte des momies » qui a longtemps été reproché aux civilistes français vis-à-vis du code civil 450 et faisant courir le risque, de par cette « coagulation du droit autour de certains principes (que) les faits s’accumulent comme derrière une digue qu’ils finiront par briser » 451.
Derrière ces expressions enflammées, se trouve toute la difficulté de la mission qui vous incombe, et qui a d’ailleurs déjà retenu, pour des motifs divers, mais au moins pour remédier au « vaste désordre » 452 qu’est sans conteste devenue la prescription en matière pénale, un certain nombre de parlementaires (rapport Hyest du 20 juin 2007, rapport de Mme des Esgaulx en 2008), de magistrats ou de professeurs de droit (M. Coulon (2008), Mme Rassat), de gardes des sceaux (cf avant-projet de réforme du code de procédure pénale rendu public le 3 mars 2010, prévoyant allongement des délais de prescription, un point de départ uniforme du délai à la commission des faits sauf en cas d’atteintes à la vie occultes ou dissimulées, voire à la découverte des faits etc...) dans les dernières années sans que pour autant ces réflexions débouchent sur une clarification et une harmonisation des principes régissant la prescription.
Le droit pénal de la presse, que l’on considère la loi du 29 juillet 1881 comme un « monument législatif », en raison de l’équilibre qu’il instaure entre la liberté d’expression et la protection des individus ou au contraire comme le symbole même de la « médiocrité légistique », eu égard à ses strates successives, ses fameuses « chausse-trappes » procédurales, son identification mensongère à « la presse », alors que son champ d’application est de fait beaucoup plus large, et son caractère largement dépassé par les innovations technologiques et l’aspiration à davantage d’encadrement des paroles et discours jugés dangereux pour l’équilibre social n’échappe pas au questionnement général, d’autant moins que son système de prescription repose précisément sur des dérogations et des contraintes qu’il peut parfois, au moins de prime abord, paraître difficile à la fois de mettre en œuvre et de justifier. (I)
Faut-il pour autant considérer que ces difficultés, indéniables, justifient une remise en cause partielle ou globale du système en vigueur? Telle sera l’interrogation à laquelle je m’efforcerai de répondre dans une seconde partie (II).
I « Les lois ne doivent pas être subtiles : elles sont faites pour des gens de médiocre entendement » (Montesquieu)
Le principe de lisibilité de la loi, évoqué par Montesquieu et consacré par le Conseil constitutionnel, n’est bien souvent qu’un vœu pieux, et le droit de la prescription pénale en matière de presse n’échappe pas à ce constat.
Les apparences sont pourtant simples si l’on se fie au seul premier alinéa de l’ article 65 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. ».
Toutefois, tant l’introduction au fil du temps de délais spécifiques que l’inclusion ou au contraire l’exclusion de certaines infractions du champ d’application de la loi sur la presse ont complexifié le régime de la prescription.
Par ailleurs, comme le soulignait déjà le professeur Lepage lors des travaux parlementaires de la mission Hyest, ce n’est pas tant cette multiplicité de sources et de solutions possibles qui pose problème, encore qu’elle soit de nature à augmenter encore davantage le risque d’erreurs que la question, incontestablement plus complexe, du point de départ et des causes d’interruption ou de suspension de la prescription.
A. La dilution du délai de prescription
1) un foisonnement de textes...
Les facteurs potentiels de complexité peuvent s’articuler autour du triptyque suivant :
-toutes les infractions définies dans la loi du 29 juillet 1881 n’obéissent pas aux mêmes règles de prescription.
Jusqu’à la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004, la règle de la prescription trimestrielle s’appliquait à toutes les infractions de presse, y compris celles introduites par la loi du 11 juillet 1972 (incrimination des discours de haine), quelle que soit leur nature (criminelle, délictuelle, contraventionnelle).
Depuis cette loi, le législateur a, par étapes, estimé utile de porter à un an le délai pour certaines infractions de presse. Tel est le cas, aux termes du nouvel article 65-3, des provocations à la discrimination et à la haine raciale de l’article 24 alinéa 8, les infractions de négationnisme de l’article 24 bis, et des diffamations et injures raciales des articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa, et ce quel que soit leur support, y compris donc en cas d’infractions commises sur internet.
La loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 a également porté à un an le délai de prescription en matière d’apologie du terrorisme.
Enfin, la prescription spéciale d’un an a été étendue par la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 à toutes les infractions prévues par la loi sur la presse commises en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap (articles 24 alinéa 8, 32 alinéa 3 et 33 alinéa 4).
Mais, selon la chambre criminelle, le délai de prescription demeure de trois mois pour ces infractions quand elles sont non publiques ...
-le délai abrégé de prescription de la loi du 29 juillet 1881 s’applique à certaines infractions figurant dans le code pénal ou d’autres textes
Il en est ainsi, notamment :
*des contraventions d’injure et diffamation, y compris à caractère racial, et des incitations à la haine raciale non publiques, (articles R 621-1, R 621-2, R 624-3 à R 624-6, R 625-7 du code pénal)
*du délit de discrédit public sur décision de justice (article 434-25 du code pénal)
-certaines infractions pouvant être considérées comme des infractions de presse figurent pourtant dans le code pénal et se voient appliquer les règles générales de prescription
L’exemple le plus courant est le délit d’outrages. Peuvent être également cités le délit de publicité en faveur du tabac sur internet, le chantage, la diffusion de messages pédopornographiques à destination des mineurs etc... Surtout, depuis la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le délit de provocation directe et d’apologie publique du terrorisme a été intégré dans le code pénal (article 421-2-5) et soumis au régime de prescription de droit commun.
De ces quelques constatations il est déjà possible de conclure, sans pour autant dramatiser – d’autres régimes de prescription sont à tout le moins aussi complexes, voire davantage ( agressions sexuelles...)- que le monolithisme de la prescription des infractions de presse et, partant, la spécificité même du droit de la presse, après avoir tenu pendant plus de 120 ans, a connu depuis dix ans de sérieuses atteintes.
2) ...sans logique évidente
Comme le soulignait Olivier Mouysset dans une chronique récente453, la logique de ces différents délais de prescription n’est pas toujours aussi évidente qu’elle en a l’air.
Il paraît de bon sens, en analysant les infractions concernées ces dernières années par l’allongement des délais de prescription, d’estimer que celui-ci est dicté par la valeur sociale de l’intérêt protégé. Mais quid, dans ce cas, du maintien du délai de trois mois pour les crimes de presse (article 23 de la loi, provocation au crime) ? Pour le délit de provocation d’atteintes volontaires à la vie, pourtant plus sévèrement puni que la provocation à la discrimination raciale (5 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende dans un cas, 1 an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende dans l’autre?
Là encore, ce manque de logique n’est pas propre au droit de la presse, mais dans une matière complexe par nature il ne peut qu’augmenter la perplexité.
B. Le casse-tête de la computation des délais
La pratique révèle qu’une fois assimilées les modifications précédemment évoquées, le plus dur est loin d’être fait – et je n’évoque ici que les questions relatives à la prescription- pour les personnes souhaitant engager et mener à bien des poursuites en raison d’infractions de presse, qu’il s’agisse des particuliers ou du ministère public et pour les professionnels du droit, avocats ou magistrats, intervenant en l’espèce.
De fait, reste à déterminer d’une part le point de départ de la prescription applicable, d’autre part si et comment celle-ci est susceptible d’être interrompue ou suspendue.
1) le point de départ
La question du point de départ de la prescription est cruciale car elle conditionne le caractère effectif ou non de la brièveté du délai imparti pour agir, qu’il soit de trois mois ou d’un an.
Comme pour les autres infractions, plusieurs hypothèses sont, de fait, envisageables, par-delà l’apparente simplicité de la formule retenue par l’article 65. Car une fois qu’est posé le principe de retenir la date de commission des faits, reste à définir celle-ci.
La question était déjà quelque peu malaisée quand les publications n’avaient lieu que sur forme papier – il suffit, parmi les nombreuses hésitations jurisprudentielles, de rappeler les interrogations sur la prise en compte ou non d’évènements tels que les faits d’impression, de dépôt légal, de commande ou de livraison454 , de la date des éditions locales en cas de publication pour partie nationale pour partie locale455, de celle des publications trimestrielles456 , la question des rééditions...457 ou celle du point de départ de l’infraction de complicité d’une infraction de presse, fixé non à la date où les faits de complicité ont été réalisés ( interview, reportage, rédaction de l’article, du livre etc...) mais à celle de la publication du document support de l’infraction etc...
Elle a éclaté au grand jour avec l’apparition d’internet et ce que la note sous l’avis de la Cour de cassation du 26 mai 2014 sur la question des liens hypertexte qualifie de « tentation » de certains juges du fond, soucieux de tenir compte de la supposée spécificité de ce nouveau mode de communication en faisant basculer les infractions de presse dans la catégorie des infractions continues, permettant ainsi de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de la cessation de la mise en ligne de la publication contestée.
Tentation, nous le savons, à la fois contrée par la Cour de cassation, qui, dès un arrêt du 30 janvier 2001, a affirmé que le point de départ de la prescription devait être fixé à celui de la première mise en ligne, et par le Conseil constitutionnel, qui, saisi du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique qui prévoyait de repousser le point de départ de la prescription des publications uniquement diffusées sur internet ou d’abord diffusées sur internet à la cessation de cette diffusion a censuré cette disposition, au motif qu’elle équivalait à prévoir un délai quasi-illimité de prescription458.
Tentation qui a pu trouver une autre illustration dans la volonté de certaines juridictions, toujours inspirées par la volonté de mieux appréhender le « phénomène » internet, d’appliquer aux infractions commises sur internet la jurisprudence traditionnelle en matière de réédition, notamment en considérant que chaque mise à jour du site459 ou l’adjonction d’une nouvelle adresse devait être considérée comme une nouvelle publication qui faisait courir à nouveau le délai de prescription mais qui a également été battue en brèche par la Cour de cassation, qui refuse de prendre ces éléments en considération460.
En revanche, le fait de publier le même contenu mais sur deux sites différents est considéré par la Cour de cassation comme deux publications distinctes faisant courir chacune une prescription spécifique...461
Devant ces subtilités et cette casuistique, la formule du professeur Dreyer « Aide-toi le juge t’aidera » prend tout son sens et est encore plus pertinente quand on examine les règles afférentes à l’interruption ou à la suspension de la prescription.
2) l’interruption et la suspension de la prescription
La question de savoir si tel ou tel acte est susceptible d’interrompre la prescription n’est pas propre au droit processuel de la presse mais elle y revêt naturellement une importance d’autant plus grande que les délais sont brefs et que les conditions posées par la jurisprudence pour qu’un acte puisse interrompre la prescription sont drastiques.
Pas question, en effet, qu’en ce domaine un simple post-it, même signé par le procureur, puisse être considéré comme interruptif de prescription dès lors que même des actes soumis en procédure pénale « classique » à des contraintes somme toute légères, tels un réquisitoire introductif ou des réquisitions aux fins d’enquête, ne peuvent interrompre la prescription que s’ils répondent aux conditions de forme extrêmement exigeantes des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ( précision de la date et lieu des faits, éléments d’identification du support incriminé, retranscription des propos litigieux, qualification des faits, visa des textes répressifs etc...).
L’engagement comme le suivi d’une procédure requièrent donc une vigilance de tous les instants des parties poursuivantes, qu’il s’agisse du ministère public ou d’une partie civile et il n’est pas rare, en pratique, dès lors que ces procédures sont suivies par des particuliers, des avocats ou des parquetiers non spécialisés que même engagées en temps utile des poursuites deviennent caduques faute de diligences accomplies dans les délais...
Pour conclure sur ce point, il pourrait être avancé, sous forme de boutade, qu’en droit de la presse arriver à juger le fond du dossier relève de l’exploit et parvenir à une condamnation du miracle... Cela n’est pas conforme à la réalité judiciaire, même si le taux d’annulation des poursuites et de constatation de l’acquisition de la prescription est nécessairement, même si je ne dispose pas de statistiques précises (à titre d’exemple pour le mois de janvier 2015 , sur 23 jugements rendus en matière pénale, 10, toutes infractions confondues, ont vu les poursuites annulées et 2 ont constaté l’extinction de l’action publique) plus élevé que dans d’autres domaines du droit pénal.
Devant ce constat, qui ne peut que réjouir les partisans d’une liberté d’expression la plus large possible mais parallèlement renforcer les interrogations de ceux qui estiment injustifiée la quasi-impunité de fait dont leur paraissent jouir certains propos, est-il possible techniquement et surtout est-il pertinent de revoir le système actuel de prescription et si oui, dans quel sens ?
II « il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante » (Montesquieu)
Au vu de l’actualité récente, il apparaît à l’évidence qu’ un fort courant paraît se dessiner en faveur d’une remise en cause de l’édifice de la loi du 29 juillet 1881, au moins pour toutes les infractions à caractère discriminatoire dont il vient d’être annoncé par le Président de la République qu’elles pourraient être intégrées, selon des modalités qui restent à définir, dans le code pénal et donc, logiquement, être soumises aux règles de poursuite et de prescription de droit commun, à l’instar de ce qui vient d’être fait en matière de terrorisme, le symbole judiciaire de cette modification étant l’attribution au sein du TGI de Paris de ces infractions à la chambre correctionnelle compétente en matière d’infractions à caractère terroriste et non à la chambre spécialisée en droit de la presse.
À ces préoccupations qui ne sont d’ailleurs pas que le reflet exclusif d’une actualité contemporaine- ainsi dès février 2000 l’Assemblée nationale avait repoussé un amendement de M. Charasse proposant de porter le délai de prescription des infractions de presse à trois ans462 - s’ajoute le leitmotiv de l’explosion d’internet et de « l’obsolétisation » consécutive de la loi sur la presse, internet se caractérisant à la fois par la rapidité de la circulation des informations et la possibilité pour chacun de s’y exprimer, sans être soumis aux obligations déontologiques des journalistes.
A. Une évolution techniquement possible
En droit de la presse comme en d’autres branches du droit pénal, toute réforme ne peut s’accomplir qu’à condition de passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme.
1) la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Les limites de l’intervention du législateur en matière de prescription des infractions de presse ont été au moins pour parties définies dans les deux décisions du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 et du 12 avril 2013.
La décision du 10 juin 2004 valide la possibilité de prendre en compte dans la fixation du délai de prescription la différence dans les conditions d’accessibilité d’un message, selon que celui-ci est publié sur un support papier ou disponible sur un support informatique, à condition toutefois que la différence de régime entre ces deux types de support ne soit pas disproportionnée.
La décision du 12 avril 2013 valide l’allongement du délai de prescription pour certaines infractions de presse, à condition que celles-ci soient précisément définies et que cet allongement soit justifié au regard de l’objectif poursuivi.
Il résulte clairement de ces deux décisions, la seconde étant rendue au double visa de l’article 6 (égalité devant la loi) et de l’article 11( liberté d’expression) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que le bref délai instauré en matière de presse n’est, pas davantage d’ailleurs que le principe même de la prescription, une règle à valeur constitutionnelle et peut donc souffrir des exceptions, même si le Conseil constitutionnel, parallèlement, en se plaçant en 2013 sur le terrain des garanties et non seulement des règles de procédure, affirme également que le délai de prescription dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881 doit être considéré non comme une simple règle de procédure (passible d’un seul contrôle restreint sur le terrain de l’atteinte au principe d’égalité) mais comme une garantie procédurale de la liberté non seulement de la presse mais de la liberté d’expression (cf visa de l’article 11) et entend ainsi tout aussi clairement exercer un contrôle approfondi des atteintes possibles à la liberté d’expression.
2) La position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
La CEDH relève, en matière de prescription, que celle-ci est commune aux Etats membres et répond à plusieurs « finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut être difficiles à contrer et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé »463, tout en soulignant dans une autre affaire que « le fait d’opposer la prescription à un stade si avance de la procédure -que les requérants avaient poursuivie de bonne foi et à un rythme suffisamment soutenu- les priva définitivement de toute possibilité de faire valoir leur droit à une indemnité »464.
Une réforme de la prescription pénale en matière de droit de la presse n’est donc techniquement pas impossible. Est-elle toutefois souhaitable, quelles pourraient en être les modalités et, surtout, est-elle de nature à répondre aux préoccupations exprimées ?
B. Une réforme, pourquoi, comment ?
Sous peine d’être taxé d’immobilisme ou de corporatisme, il serait loisible de balayer le problème en soulignant que la plupart des praticiens confrontés à des affaires relatives à des faits extrêmement anciens, que ce soit notamment en matière d’agressions sexuelles ou d’infractions économiques et financières ont tous, à un moment ou un autre, ressenti un certain sentiment d’impuissance, voire de désarroi, devant la difficulté à juger résultant de l’écoulement même du temps : disparition des preuves, fragilité des témoignages, évolution de la personnalité des prévenus etc...
Le problème se pose de manière sans doute moins aigüe en matière de presse , compte-tenu à la fois de la brièveté des délais initiaux et de la nature des infractions, mais l’expérience montre que là aussi, l’écoulement du temps peut jouer, non seulement dans le sens de l’atténuation de la sensibilité de tel ou tel propos mais y compris dans le domaine de la preuve de la vérité ou de la bonne foi pour les infractions de diffamation, s’agissant notamment des témoignages, et ce d’autant plus qu’eu égard aux difficultés d’audiencement des chambres correctionnelles, y compris de la 17 ème chambre du TGI de Paris, qui siège pourtant en matière pénale trois ou quatre fois par semaine, il n’est pas rare de juger ces affaires deux ou trois ans après les faits.
Pour simplifier et tenter de cantonner mes observations, je ferai simplement les quelques remarques suivantes, axées autour des questions figurant dans le document de travail de votre mission :
-oui, l’allongement du délai de prescription favorise à l’évidence la répression des infractions concernées et restreint parallèlement le champ de la liberté d’expression. Il n’est pas sûr, ainsi, que son extension à toutes les infractions de presse puisse passer l’examen de constitutionnalité tel que défini ci-avant. Par ailleurs, il ne résout pas tous les problèmes, notamment dans le champ des infractions que je qualifierai hélas de « quotidiennes », telles les injures à caractère discriminatoire ( sale, au choix « juif, pédé, arabe, nègre etc... »), affaires pour lesquelles les tribunaux sont trop souvent confrontés à de misérables débats autour du thème « je ne l’ai jamais dit » ou « c’est lui qui a commencé », débats qui paradoxalement affaiblissent la portée des poursuites.
-il est compréhensible, devant le flot de propos parfois insoutenables qui déferlent sur internet, de vouloir y mettre un terme : pour autant, le levier du délai de prescription, que ce soit par la modification de sa durée et/ou de la fixation de son point de départ, par la fixation d’un régime particulier pour les non-journalistes est-il le plus adapté ?
Au plan théorique, Yves Charpenel, avocat général à la Cour de cassation, soulignait déjà, lors de l’examen d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 novembre 2005 ayant retenu une autre date que la première mise en ligne du texte litigieux sur le site, qu’il serait « paradoxal que la diffusion planétaire en cours du mode d’information le plus libre et le plus souple qui ait jamais été mis en œuvre soit l’occasion d’un « verrouillage » de la procédure pénale qui rendrait imprescriptible toute infraction commise sur le net alors que le droit à l’oubli et à l’apaisement resterait réservé aux formes les plus anciennes de la diffusion des opinions et des pensées ».
En pratique, sans méconnaître la difficulté de l’obligation mise à la charge des victimes potentielles, plusieurs remarques de nature à relativiser à la fois l’impunité des auteurs des propos et la portée d’une réforme de la prescription me semblent devoir être formulées.
En premier lieu, il peut paraître paradoxal d’arguer de la difficulté d’être tenu informé de propos attentatoires à telle ou telle valeur sociale ou individuelle alors même que les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo! Ou Bing ou les techniques informatiques permettent précisément une veille d’un niveau jamais atteint. Il résulte d’ailleurs d’une recherche faite par un des magistrats siégeant à la 17 ème chambre qu’au début du XX ème siècle la presse française comptait plus de six cents quotidiens, dont presqu’une centaine à Paris, quatre ayant un tirage de plus d’un million d’exemplaires... La portée des propos était-elle si limitée, mutatis mutandis, et la personne diffamée ou injuriée était-elle vraiment mieux à même de les déceler à temps ?
En deuxième lieu et l’expérience le démontre, le problème des informations diffusées sur les réseaux sociaux – cette notion recouvrant par ailleurs des réalités extrêmement diverses, les deux principaux, Facebook et Twitter ne pouvant notamment être comparés, le premier visant à communiquer avec des « amis » et aucun moteur de recherche interne ne permettant de les trouver, le second ayant en revanche vocation à communiquer une information mondiale et son moteur de recherche permettant de rechercher n’importe quel terme parmi les messages publiés par tous les autres utilisateurs, l’inscription préalable n’étant même pas requise...-n’est pas tant celui de la prescription que les techniques employées par les auteurs des infractions pour dissimuler leur identité, héberger leurs données à l’étranger et se soustraire ainsi aux poursuites...
Je pense ainsi à une affaire récemment examinée par la 17 ème chambre où une jeune femme était littéralement harcelée en ligne par un individu ayant créé un site injurieux à son encontre et n’ayant pu être identifié par le juge d’instruction, l’individu recourant à des hébergeurs indiens ou américains refusant de donner accès à leurs données et créant un nouveau site à chaque fois qu’il était déréférencé par les fournisseurs d’accès.
Quant à la distinction entre journalistes et particuliers, outre qu’elle crée une difficulté supplémentaire dans une matière qui n’en manque pas, elle paraît en outre peu lisible : n’ya -t-il pas quelque paradoxe à faire bénéficier les journalistes, au prétexte qu’ils seraient, ce qui reste à démontrer, plus identifiables que les particuliers d’un délai abrégé alors même qu’ils sont des professionnels et sont, de ce fait, soumis à des exigences accrues en matière de bonne foi, faudrait-il distinguer selon qu’ils agissent ou non dans l’exercice de leurs fonctions etc...Toute sophistication de cette nature paraît devoir être exclue à la fois en principe et en raison des multiples difficultés d’interprétation qu’elle engendrerait.
En troisième lieu, ne vaudrait-il pas mieux concentrer la réflexion en droit de la presse non sur la prescription, mais sur les moteurs de recherche, qui ne sont, je le rappelle, ni des éditeurs, ni des hébergeurs au sens de la LCEN et ne sont donc pas soumis aux obligations qui en résultent mais qui permettent, en pratique, l’accessibilité à chacun des informations diffusées sur internet? À cet égard, la Cour de justice de l’Union Européenne, dans son arrêt Google Spain ( C 131/12), en soumettant la société américaine Google Inc. à la législation espagnole de protection des données à caractère personnel, a permis aux ressortissants de l’UE de formuler des demandes de désindexation de contenus jugés illégitimes , les litiges pouvant être portés devant le juge et Google s’en remettant en justice quant à la décision finale465.
-s’agissant de l’inclusion dans le code pénal, si tant est que la question se pose encore pour certaines infractions compte tenu des déclarations récentes du Président de la République, il est difficile de paraître vouloir s’y opposer sans être soupçonné de défendre les intérêts catégoriels des chambres spécialisées en droit de la presse...
Pour autant, les infractions concernées sont-elles toutes suffisamment graves et homogènes pour justifier le retour dans le giron du droit commun et permettre, ainsi, de recourir à la garde à vue, ou aux procédures de traitement rapide ? Quel point commun entre une injure stupide proférée lors d’une querelle de voisinage ou d’un contrôle par un agent de la RATP, la provocation gratuite et immature d’un lycéen refusant « d’être Charlie » et un appel froid et raisonné à la haine raciale ou au terrorisme ? À étendre indéfiniment la banalisation des infractions de presse et la restriction de la liberté d’expression, ne risque-t-on pas d’amplifier l’importance de certains propos et de susciter ou d’encourager le sentiment déjà bien répandu que l’on ne peut plus rien dire ?
Au demeurant, on oublie trop souvent qu’il existe déjà dans la loi du 29 juillet 1881 des modulations autres que la prescription en matière de discriminations, tout aussi, voire davantage efficaces que l’inclusion dans le code pénal ou l’allongement des délais de prescription : ces infractions sont passibles d’emprisonnement, le ministère public peut les poursuivre d’office, la constitution de partie civile de certaines associations est admise, y compris sur le mode de l’intervention...Autant de dispositifs qui sont d’ores et déjà appliqués et qui permettent de penser qu’une inclusion dans le code pénal n’aurait sans doute, à quelques exceptions près, qu’une valeur d’affichage et accentuerait les craintes que tout un chacun peut formuler au regard de ce détricotage au gré des circonstances de la loi du 29 juillet 1881.
Pour conclure, je citerai un très rapide échange, toujours lors du débat sur la loi sur la présomption d’innocence en février 2000, qui me paraît, plus que de longs discours, résumer les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés en abordant cette question:
-Patrick Devedjian « Je suis tout à fait d’accord pour supprimer la disposition portant à trois ans le délai de prescription en matière de presse, qui est folle. Ce sont cent ans de culture qui disparaissent d’un coup. Cela me paraît évident. C’est ne pas comprendre que les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite (Sourires)...
-Frédérique Bredin « Ce n’est pas si sûr, M.Devedjian »
* *
*
Contribution du Conseil national des barreaux
Le 10 décembre 2014, la commission des Lois de l’Assemblée Nationale a décidé de créer une mission d’information sur la prescription en matière pénale. Celle-ci est composée de deux membres, Messieurs Georges Fenech, député du Rhône et Alain Tourret, député du Calvados, tous deux rapporteurs.
Le 25 février 2015, les représentants de la profession d’avocat ont été auditionnés. Etaient présents :
• Françoise Mathe, Présidente de la Commission Libertés et Droits de l’Homme du Conseil national des barreaux
• Florent Loyseau de Grandmaison, membre de la Commission Libertés et Droits de l’Homme du Conseil national des barreaux
• Marc Absire, vice-président de la Conférence des Bâtonniers, ancien bâtonnier de Rouen
• Etienne Lesage, en charge du bureau pénal et de la défense d’urgence du Barreau de Paris
Ce document reprend la position développée par le Conseil national des barreaux, et le travail effectué par la Commission Libertés et Droits de l’Homme.
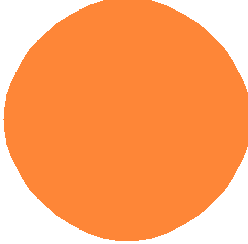
RÉFLEXIONS SUR LA « PRESCRIPTION »
La prescription est l’institution juridique qui consiste à conférer un sens juridique à l’écoulement du temps.
La prescription de l’action publique vise à éteindre la possibilité de poursuivre consécutive à une infraction devant les juridictions répressives (CPP, Art. 7 et suivants) et à permettre que l’action civile puisse encore s’exercer devant les juridictions civiles (CPP, Art. 10). La prescription de la peine vise à éteindre la possibilité pour l’Etat de mettre en œuvre une décision de justice (CPP, Art. 133-2 et suivants).
En matière pénale, la prescription peut apparaître pour certains comme la confirmation d’un statut d’impunité. Il s’agit pourtant d’éviter à la société de vivre à travers le passé. La prescription joue ainsi un rôle d’apaisement social. Il s’agit aussi d’assurer la nécessaire protection des libertés individuelles qui exige le respect d’un délai raisonnable.
Aujourd’hui, le régime de la prescription en droit pénal est devenu illisible, incohérent et imprévisible, ce que l’on ne saurait admettre dans une société démocratique. Les cas de suspension de la prescription se développent de manière anarchique. Les cas d’interruption sont à la seule discrétion du parquet qui a fait de la prescription un outil de régulation des flux.
Pour mettre fin à ce désordre et répondre aux exigences démocratiques, il paraît aujourd’hui essentiel d’homogénéiser les régimes de prescriptions, tant en ce qui concerne le point de départ de la prescription que sa durée.
QUESTION PRÉALABLE : LA PRESCRIPTION, LOI DE PROCÉDURE OU LOI DE FOND ?
Il est traditionnellement enseigné que le droit pénal relève des règles de fond et que les lois de procédure pénale sont des lois de forme.
Les lois qui définissent les incriminations, les lois qui fixent les règles d’imputation et les lois qui déterminent les sanctions sont rangées parmi les lois de fonds, auxquelles sont traditionnellement jointes les lois relatives à l’exercice des actions en justice et les lois concernant le régime de la preuve. Ces lois obéissent au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et au principe d’interprétation stricte du droit pénal.
A contrario, les « lois de forme » regroupent les lois qui ne sont pas des lois de fond. Cette catégorie revêt de ce fait un caractère hétérogène. Une loi de forme est ordinairement d’application immédiate.
En matière pénale, la durée de la prescription de l’action publique - exercée par le ministère public contre l’auteur d’un acte punissable - se déduit en principe de la nature de l’infraction en référence à la gravité de l’infraction commise.
Si les lois relatives à la prescription règlent un point de procédure, en statuant sur une des conditions de la poursuite d’une infraction ou de l’exécution d’une condamnation, il parait difficile de les considérer comme des lois de pure forme dans la mesure où elles déterminent l’une des conditions essentielles de l’utilité et, par conséquent, de la légitimité de la répression.
C’est d’ailleurs ce qu’avait pu juger la 1er Chambre civile de la Cour d’Appel de Versailles en 1989 : « Une loi qui établit un délai de prescription ou un délai de forclusion constitue une loi de fond, et non pas une loi de procédure, et ne peut dès lors, en principe, avoir d’effet rétroactif et s’appliquer aux instances déjà engagées au jour de sa publication », (Versailles, 1er décembre 1989, Gaz.Pal. 1990 II somm. 443).
Les lois sur la prescription appartiennent aux lois de fond et doivent dès lors se voir appliquer les principes d’interprétation stricte et de non rétroactivité, qui permet de les appliquer, dès leur promulgation, aux infractions non jugées et aux condamnations non exécutées dès lors qu’elles seraient plus favorables.
En tout état de cause et au fil des années, les règles régissant la prescription, qu’il s’agisse de leur durée, de leur point de départ, de leurs causes d’interruption ou de suspension, se sont multipliées et complexifiées à un point tel que leur caractère foisonnant et leur manque de cohérence laissent place à une grande imprévisibilité, voire à l’arbitraire, qui s’accommode difficilement avec le principe de légalité et de prévisibilité de la loi pénale.
Parce que « la prescription est une institution indispensable à l’ordre social »466, il nous parait nécessaire d’harmoniser, voire d’unifier, les régimes de prescriptions de l’action publique.
Cette nécessaire unification impose de traiter la question tant en ce qui concerne le point de départ du délai (I), que les causes de suspensions ou d’interruptions (II) et enfin la durée de la prescription (III).
I – UNIFIER LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI
Comme le souligne Julie Klein, Professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Rouen, dans sa thèse sur « Le point de départ de la prescription », le droit positif se caractérise par une extraordinaire diversité des points de départ de la prescription. Mal maîtrisé par le législateur, le point de départ de la prescription n’est pas davantage dominé par les juges, qui n’ont jamais su poser de directives claires susceptibles de guider sa détermination. Mais la détermination du point de départ de la prescription n’est pas seulement plurielle, elle est aussi incohérente. Aucun lien logique ne peut, en effet, unir entre elles les différentes solutions rencontrées. Derrière la diversité, émerge alors non seulement la disparité des solutions observées, mais également la disparité des critères mis en œuvre et celle des finalités poursuivies. L’ampleur du désordre rend nécessaire une mise en ordre.
A- « Le constat du désordre » - la multiplication des dérogations au point de départ du délai de prescription de l’action publique
Le législateur et la jurisprudence déploient un raisonnement spécifique à chaque situation examinée.
Les infractions instantanées comme le vol et le meurtre sont celles qui se commettent en une seule fois. Le délai de prescription court du jour de la commission de l’infraction.
Pour les infractions continues, qui sont répétitives et se poursuivent dans la durée, le délai de prescription commence à courir du jour du dernier acte délictueux. Par exemple en matière de recel, le délai court au jour où le prévenu a vendu les objets recélés. La chambre Criminelle de la Cour de Cassation l’a confirmé le 7 mai 2002.
En matière d’abus de confiance, la prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, comme a pu le préciser la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 11 décembre 2013.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription peut être reporté.
Tel est le cas en matière de crime contre les personnes. La Cour de Cassation a récemment considéré que l’obstacle insurmontable interrompt le délai de prescription (Cour de cassation - 7 novembre 2014, Affaire des « bébés congelés »). Elle fonde sa décision sur la maxime civiliste selon laquelle « la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir ». Ainsi, le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de commission de l’acte et mais à celui de la découverte fortuite des corps au motif que les naissances étaient ignorées, les meurtres ne pouvaient être révélés.
La jurisprudence considère ainsi que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date permettant à l’action publique de s’exercer. S’agit-il ainsi de répondre à l’émotion publique qui s’oppose à toute impunité, sentiment d’autant plus fort qu’il est relayé à grand renfort par les médias ?
De la même manière, concernant les infractions à caractères économiques et financières, occultes ou dissimulées donc difficile à déceler, la jurisprudence considère que le délai de prescription triennal du délit d’abus de biens sociaux ne court pas si le dirigeant a volontairement dissimulé ces abus. Tel est le cas lorsque les comptes annuels ne permettent pas de révéler l’existence du délit (Cass. Crim. 30 janvier 2013 n°12-80107). Il court à compter du jour où l’abus est apparu, ce qui rend ce délit quasi-imprescriptible. Or les ABS ne sauraient être traités de la même manière que les crimes contre l’humanité.
En 2010, un avant-projet de loi portant réforme de la procédure pénale avait tenté de modifier le régime de prescription de l’abus de bien social en proposant de modifier l’article 121-7 du CPP de la manière suivante : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée. » Cette proposition n’a malheureusement pas prospéré.
Pourtant, outre l’instabilité juridique liée au caractère imprévisible de la loi pénale en matière de prescription, l’écoulement du temps lié au report du point de départ à une date lointaine engendre un dépérissement de la preuve qui s’oppose à une bonne administration de la justice.
Unifier le régime du point de départ du délai de prescription de l’action publique est le seul moyen d’éviter l’incohérence, l’illisibilité et l’imprévisibilité du droit pénal. La loi doit être générale, abstraite et impersonnelle, elle a vocation à s’appliquer au plus grand nombre et ne doit pas être le fruit de l’amoncellement de décisions qui répondent à une diversité toujours plus grande de situation.
B- Repenser le régime de droit commun du point de départ du délai de prescription
Mettre fin au désordre impose de définir, pour tout type d’infraction, un point de départ du délai homogène. Ce point de départ devra être fixé à la date de commission des faits et, pour les infractions continues, à la date des derniers éléments constitutifs de l’infraction, y compris en matière financière.
Toute considération psychologique liée à l’état de vulnérabilité ou de résurgence tardive de la mémoire suite au choc psycho traumatique doit être inopérante (sauf dans les cas exceptionnels où la loi en dispose autrement concernant les atteintes aux mineurs – voir développements infra). Il ne peut être admis que, comme dans l’affaire des bébés congelés, l’état de vulnérabilité lié à la grossesse de l’auteur des faits puisse avoir pour conséquence de reporter le délai au moment où l’action publique a pu s’exercer.
En considérant la date de commission des actes prohibés comme point de départ du délai de prescription, la durée du délai de prescription sera plus précisément déterminée et l’exigence de stabilité juridique et de bonne administration de la preuve mieux respectée.
C- Le caractère exceptionnel du report du point de départ du délai : les infractions sur mineurs
L’exception tenant au report du point de départ du délai de prescription posée pour les crimes et délits commis à l’encontre des mineurs doit pouvoir être maintenue, au regard de la gravité de l’infraction et la particulière vulnérabilité des personnes concernées.
La matière criminelle concerne le meurtre ou l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie et de viol et de violences sur mineurs ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente qui se prescrivent par vingt ans à partir de la majorité de la victime (art. 7, al. 3 et 706-47 CPP). La matière délictuelle est relative aux agressions sexuelles sur mineurs et aux atteintes sexuelles sans violence sur mineurs qui se prescrivent (prescription de dix ans : art. 8, al. 2 et 706-47 CPP) à partir de la majorité de la victime (article 8, al. 2 du CPP).
Pour de tels crimes et délits, le point de départ du délai de prescription doit demeurer fixé à la majorité de la victime et non à la date de commission des faits.
II – LIMITER LES CAUSES DE SUSPENSION ET D’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
Les actes d’instruction comme les actes de police judiciaire (ex. : interrogatoires ; auditions, perquisitions, etc.) et les actes du juge d’instruction interrompent le cours de la prescription de l’action publique. Dans l’hypothèse d’interruption par tout acte d’instruction ou de poursuite régulier (article 7 du CPP), cet acte interruptif fera courir un nouveau délai de prescription.
Les actes interruptifs de prescription sont les actes destinés à la mise en mouvement de l’action publique (ex. : citation directe ; plainte avec constitution de partie civile). Or la jurisprudence étend de plus en plus le domaine de ces actes : un soit-transmis, par lequel le parquet communique une plainte à la police judiciaire aux fins d’enquête, est désormais qualifié d’acte de poursuite. « Interrompt le cours de la prescription de l’action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » indique la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 20 février 2002 (il s’agissait en l’espèce d’un soit-transmis du Procureur à une autorité administrative).
Ces exemples illustrent le fait que le parquet, qui a l’opportunité des poursuites, a fait de la prescription un outil de gestion des flux, loin des considérations d’ordre public ou d’intérêt public qui doivent présider.
Est-il raisonnable de considérer que, par tout acte interruptif d’instance, le parquet puisse indéfiniment reporter les délais de prescription ? Le principe d’égalité des armes s’en trouve largement remis en cause. Le parquet ne peut pas à la fois disposer de l’opportunité des poursuites et de toute latitude concernant l’allongement des délais et la gestion du temps de la procédure.
Le désordre constaté nous conduit d’ailleurs à distinguer deux délais :
- Le délai permettant d’engager l’action publique (le droit à la poursuite),
- Le délai de poursuite, une fois l’action publique engagée.
Introduire un délai encadrant la procédure préliminaire (délai d’enquête ou d’instruction) permettrait de garantir les droits du justiciable à bénéficier d’un procès équitable et de répondre à l’exigence européenne de « délai raisonnable ».
Tout acte, à n’importe quel stade de la procédure, ne doit pouvoir faire courir un nouveau délai. À défaut, la prescription serait privée de sens.
Afin de garantir au mieux le droit pour le justiciable à l’examen de son affaire dans un délai raisonnable, il pourrait également être envisagé de formaliser le principe de loyauté des poursuites.
Une autre piste de réflexion pourrait être envisagée en confrontant la notion de forclusion avec le délai de prescription. Le délai de prescription court si l’action en justice est possible. Si l’action en justice est impossible, le délai ne court pas, il est forclos. Le critère de forclusion est un élément de stabilité juridique en ce qu’il est précis et prévisible. La forclusion est une déchéance, une perte du droit d’exercer une action en justice. Or, la prescription peut être interrompue alors que la forclusion ne peut pas l’être. Pour assurer le respect du principe de loyauté des poursuites et du délai raisonnable, le formalisme exigé en matière de forclusion pourrait être exigé en matière de prescription. L’inaction du parquet devrait être justifiée, sauf à s’exposer à une forclusion.
III – UNE NECESSAIRE UNIFICATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
A. UNIFIER LES DELAIS DE PRESCRIPTION
Si le caractère hétérogène du point de départ du délai comme la multiplication des causes de suspension ou d’interruption de la prescription sont sources de désordre, la question de la durée de la prescription amène aussi des réponses trop éparses.
En matière criminelle, le délai de prescription de droit commun est de 10 ans. En matière délictuelle, il est de 3 ans. En matière contraventionnelle, il est d’un an.
Par dérogation au droit commun, il existe des durées de prescriptions courtes. Tel est le cas de la prescription en matière d’infraction au droit de la presse, qui est de 3 mois, ou encore de la prescription de l’action publique relative au délit de discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, de 3 mois également.
Il existe aussi des durées plus longues. Tel est le cas en matière d’infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, au proxénétisme ou à la criminalité organisée, pour lesquelles le délai de prescription est porté à 30 ans.
Pour remédier à ce désordre, il est proposé de fixer des délais de prescriptions unifiés pour les crimes, les délits et les contraventions, auxquels le législateur ne devrait pouvoir déroger.
À cet égard, il pourrait être envisagé que ces délais soient allongés, dès lors qu’ils sont unifiés, que le point de départ est homogénéisé et les conditions de suspension et d’interruption de la prescription soient drastiquement réduites. De cette manière, le droit d’agir en justice serait préservé tandis que les impératifs de prévisibilité et de stabilité juridique seraient respectés.
B. LES EXCEPTIONS A MAINTENIR
La première exception qu’il convient de conserver est celle concernant crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles et qui doivent le demeurer, dans le respect des engagements internationaux de la France (art. 213-5 CP).
La deuxième exception qu’il convient de maintenir est celle concernant les crimes et délits sexuels à l’encontre des mineurs, pour lesquels le délai de prescription est porté à 20 ans. Néanmoins, le Conseil national des barreaux n’est pas favorable à l’allongement de ce délai, comme cela a pu être envisagé par le passé. Dans un souci de cohérence juridique et de protection des intérêts des victimes et des auteurs, le droit ne peut pas se saisir de la problématique de la résurgence de la mémoire à une date trop lointaine de celle de la commission des faits. De plus, dans de telles situations, l’administration de la preuve devient extrêmement difficile, voire impossible.
Enfin, le délai de prescription en matière de droit de la presse n’a pas vocation à être modifié dans la mesure où il assure le respect des intérêts en présence et permet de protéger la liberté d’expression. Il n’en demeure pas moins qu’une problématique posée par l’évolution des nouvelles technologies mériterait d’être réglée. Pour les articles publiés sur internet, le point de départ de ce délai de 3 mois est fixé au jour de la première mise en ligne. Pourtant, tant que l’article litigieux est maintenu en ligne, l’infraction doit être considérée comme continue.
Contribution du Barreau de Paris
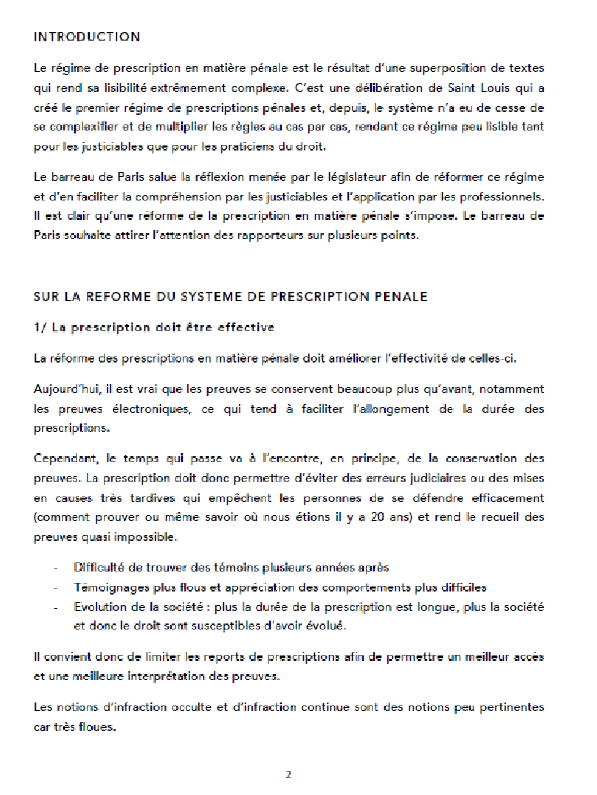
Contribution de Mme Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice
I. ELEMENTS DE REFLEXION GENERALE
Depuis une quinzaine d’années le législateur a adopté une démarche positive de protection des victimes les plus vulnérables en édictant pour les mineurs victimes des règles dérogatoires de prescription prenant en compte les obstacles à la libération de la parole et au dépôt de plainte que sont : l’emprise exercée par l’auteur des faits, l’éventuelle complicité de l’entourage, les pressions subies par l’enfant, le conflit de loyauté dans lequel il se trouve, le syndrome post traumatique…etc.
La question de la prescription est au cœur d’une recherche d’équilibre entre les intérêts de la victime, de l’auteur et de la société.
La justice n’est pas absolue et est enserrée dans des limites temporelles. La prescription consacre l’extinction du droit de poursuivre du ministère public et du droit d’agir de la victime et nous tenons à ce principe au nom de la paix sociale et du droit à l’oubli judiciaire.
De plus, pour des faits poursuivis très longtemps après leur date de commission, la vérité judiciaire atteint ses limites du fait de la déperdition des preuves, d’une extraction du contexte de l’époque des faits, au risque de confronter la victime à une procédure difficile et décevante.
Nous constatons par ailleurs que l’empilement des réformes est venu rendre illisibles les règles de prescription et confus les critères d’allongement du délai de prescription.
Nous pouvons relever des mouvements contradictoires d’allongement/réduction des délais concernés, des critères peu clairs tantôt fondés sur la gravité de l’infraction, tantôt sur la nature de l’infraction et revenant progressivement sur la classification entre crimes et délits. Le choix des infractions aussi peut interroger.
De manière générale s’agissant des mineurs victimes, notre position est un statu quo sur le principe du report du point de départ à la majorité qui est un acquis de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, qui consacre la spécificité de la situation des mineurs victimes et adapte notre droit dans un sens plus protecteur à ce public particulièrement fragile. De même nous sommes favorables au maintien des délais de prescription de 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes avec un toilettage s’agissant des délits dans la mesure où quatre d’entre eux sont concernés par une prescription criminelle de 20 ans :
Texte |
Infraction |
Peine encourue |
Délai de prescription de l’action publique |
222-12 |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises : - sur un mineur de moins de quinze ans (1°) ; - sur un mineur de quinze ans ou plus avec une circonstance aggravante (2° à 15°) |
5 ans |
20 ans |
222-12 (avant-dernier alinéa) |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité |
10 ans | |
222-29-1 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de moins de quinze ans |
10 ans | |
227-26 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans, commise avec une circonstance aggravante |
10 ans |
À notre sens et conformément à l’objectif de simplification de la mission parlementaire, il conviendrait de maintenir une distinction stricte délits (10 ans)/crimes (20 ans).
Pour mémoire, depuis 1989, sept lois sont venues réformer les règles de prescription relatives à certaines infractions pour lesquelles un mineur est victime. La loi du 10 juillet 1989 introduit comme point de départ la majorité de la victime et non plus la date de commission des faits, cela concerne certaines infractions commises par ascendant ou personne ayant autorité, puis la loi du 4 février 1995 a étendu le report du point de départ à la majorité aux délits. La loi du 17 juin 1998 a établi une liste de délits pour lesquels le point de départ est reporté à la majorité et pour certains la durée de la prescription passe de 3 ans à 10 ans, tandis que tous les crimes contre les mineurs ont ce même point de départ. La loi du 18 mars 2003 est venue ajouter des infractions à la liste des délits soumis au délai de 10 ans, tandis que la loi du 9 mars 2004 a réduit la liste des crimes à ceux de l’article 706-47 et la liste des délits à ceux des articles 706-47, 222-30 et 227-26 ; les délais de prescription sont modifiés : 20 ans pour certains crimes, mais aussi pour une catégorie de délits et maintien de 10 ans pour d’autres délits. Enfin, la loi du 4 avril 2006 étend la liste des crimes et des délits. Et ce sans compter les lois qui ont élargi le champ des infractions visées par l’article 706-47 du code de procédure pénale, comme celle du 5 août 2013.
En synthèse voici des tableaux récapitulatifs :
CRIMES COMMIS CONTRE DES MINEURS POUR LESQUELS LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE EST ALLONGÉ ET LE POINT DE DÉPART DE CE DÉLAI REPORTÉ À LA MAJORITÉ DE LA VICTIME (ARTICLE 7 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, ALINÉA 3)
Article du code pénal |
Intitulé de l’infraction |
Peine de réclusion criminelle encourue |
222-23 |
Viol sur mineur de quinze ans ou plus |
15 ans |
222-24 (2°) |
Viol sur mineur de moins de quinze ans |
20 ans |
222-24 (1° et 3° à 12°) |
Viol sur mineur de quinze ans ou plus commis avec une circonstance aggravante |
20 ans |
222-25 |
Viol ayant entraîné la mort de la victime |
30 ans |
222-26 |
Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie |
Perpétuité |
225-4-2 (II) |
Traite des êtres humains à l’égard d’un mineur commise avec une circonstance aggravante |
15 ans |
225-4-3 |
Traite des êtres humains commise en bande organisée |
20 ans |
225-4-4 |
Traite des êtres humains en recourant à des tortures |
Perpétuité |
225-7-1 |
Proxénétisme à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans |
15 ans |
222-10 |
Violences ayant entraîné une mutilation - sur un mineur de moins de quinze ans (1°) ; - sur un mineur de quinze ans ou plus avec une |
15 ans |
DÉLITS COMMIS CONTRE DES MINEURS POUR LESQUELS LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE EST ALLONGÉ ET LE POINT DE DÉPART DE CE DÉLAI REPORTÉ À LA MAJORITÉ DE LA VICTIME (ARTICLE 8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, ALINÉA 2)
Article du code pénal |
Intitulé de l’infraction |
Peine d’emprisonnement encourue |
Délai de prescription de l’action publique |
222-27 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de quinze ans ou plus |
5 ans |
10 ans |
222-28 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de quinze ans ou plus commise avec une circonstance aggravante |
7 ans | |
222-29 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de quinze ans ou plus en situation de particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur des faits |
7 ans | |
222-30 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de quinze ans ou plus en situation de particulière vulnérabilité apparente ou connue de l’auteur des faits, commise avec une autre circonstance aggravante |
10 ans | |
225-4-1 (II) |
Traite des êtres humains à l’égard d’un mineur |
10 ans | |
225-7 (1°) |
Proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans ou plus |
10 ans | |
225-12-1 |
Recours à la prostitution de mineurs |
3 ans | |
225-12-2 |
Recours à la prostitution de mineurs commis avec une circonstance aggravante |
5 ans | |
227-22 (alinéa 1) |
Fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur de quinze ans ou plus |
5 ans | |
227-22 (alinéa 3) |
Fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption : - d’un mineur de quinze ans ou plus, lorsque les faits sont commis en bande organisée ; - d’un mineur de moins de quinze ans. |
10 ans | |
227-22-1 |
Fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique |
2 ans | |
227-23 |
Fait d’enregistrer des images pornographiques de mineurs |
5 ans | |
227-24 |
Fabrication ou diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, lorsque ces messages sont susceptibles d’être vus par des mineurs |
3 ans | |
227-24-1 |
Provocation de mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, lorsque la mutilation n’a pas été réalisée |
5 ans | |
227-25 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans |
5 ans | |
227-27 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou plus, commise par un ascendant ou une personne ayant autorité |
3 ans | |
222-12 |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises : - sur un mineur de moins de quinze ans (1°) ; - sur un mineur de quinze ans ou plus avec une circonstance aggravante (2° à 15°) |
5 ans |
20 ans |
222-12 (avant-dernier alinéa) |
Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité |
10 ans | |
222-29-1 |
Agression sexuelle autre que le viol sur mineur de moins de quinze ans |
10 ans | |
227-26 |
Atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de moins de quinze ans, commise avec une circonstance aggravante |
10 ans |
II. ELEMENTS DE REPONSES AU QUESTIONNAIRE
Questionnaire
1. Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale dispose que « [l]e délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et le crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ». La liste des crimes mentionnés ci-dessus devrait-elle être modifiée ?
2. Le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale prévoit que « [l]e délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime ». La liste des délits mentionnés ci-dessus devrait-elle être modifiée ?
Position DPJJ : Il ne convient pas d’allonger la liste des infractions crimes ou délits, en revanche nous nous interrogeons sur les critères de choix des infractions en lien avec la question suivante :
Sur quel(s) fondement(s) repose la distinction entre les infractions qui se prescrivent par dix ans et celles qui se prescrivent par vingt ans ?
Position DPJJ : Il s’agit alors de sonder l’esprit du législateur. En tout état de cause on ne peut que constater que l’empilement des réformes est venu brouiller la démarche. En effet, on pouvait estimer que la différence entre 10 ans et 20 ans se faisait en fonction de la nature de l’infraction comme les infractions de nature sexuelle commises sur un mineur pour prendre en compte les difficultés dans la révélation des faits ce en lien avec un syndrome post-traumatique ou encore en lien avec le contexte de commission des faits (ex/ intra familial) ; cependant on constate que certaines infractions prévues ne relèvent pas d’une catégorie pour laquelle il y aurait des difficultés de ce type.
En effet, nous relevons des incohérences sur les infractions suivantes qui ne nécessitent pas un délai de prescription de 20 ans et qui pourraient être retirées de la liste :
-222-10 : les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (sur mineur de 15 ans)
- le délit de 222-12 : violences ITT plus de 8 jours pour lequel le délai de prescription de 20 ans ne se justifie pas.
Plus généralement l’application à des délits de la durée de prescription de l’action publique appliquée à des faits de nature criminelle vient rendre la classification des infractions confuse.
Par exemple est prévu un report du point de départ du délai qui plus est de 20 ans en cas de violences avec ITT supérieur à 8 jours ce qui interroge ce d’autant plus que la caractérisation de l’infraction sera compliquée sauf pour la victime de s’être préalablement prémunie de preuves matérielles (certificat médical…).
Le système mélange donc trois critères pour justifier non seulement le report du point de départ mais encore la durée exceptionnelle de la prescription à 20 ans :
-la gravité de l’infraction au sein même d’une même classification (au sein des crimes et au sein des délits),
-la nature des faits,
-la classification crimes/délits.
Sous réserve de votre appréciation sur le retrait des infractions précitées, notre position est de ne pas modifier les délais déjà prévus pour les mineurs victimes (10/20 ans) avec un report du point de départ à la majorité.
La loi du 9 mars 2004 est parvenue à un certain équilibre, de ce fait nous sommes favorables à la conservation pour les mineurs victimes du point de départ du délai de prescription de l’action publique à la majorité en raison de la spécificité de la situation dans laquelle se trouvent ces victimes, cependant nous pensons qu’il ne faut pas allonger encore la durée du délai (porter plainte jusqu’à 38 ans paraît suffisant).
Nous attirons l’attention sur le point suivant : si le système retenu est un point de départ au jour de la commission des faits avec par exemple un allongement de la durée du délai de prescription à 30 ans le sort de certaines victimes sera moins favorable.
Exemple : prenons un mineur victime de faits criminels de viol alors qu’il était l’âgé de 5 ans, il peut aujourd’hui porter plainte jusqu’à ses 38 ans (18 ans+20), il ne pourra porter plainte que jusqu’à 35 ans (5 ans + 30).
Inversement, conserver un point de départ à la majorité tout en allongeant la durée du délai de prescription à 30 ans (soit lui permettre de porter plainte jusqu’à 48 ans) reviendrait à une quasi-imprescriptibilité qui pourrait se retourner contre la victime qui ne verrait pas aboutir sa démarche en raison de la déperdition des preuves. Cela pose la question de ce que l’on attend de la justice, du sens de la procédure judiciaire.
Nous sommes soucieux de ne pas revenir sur l’acquis pour les victimes mineures qui bénéficient déjà d’un doublement du délai (pour les crimes de 10 à 20 ans et pour certains délits de 3 ans à 10 ans) et donc nous proposons à la marge un toilettage des infractions pour assurer une certaine cohérence ce pour conserver un système prenant en compte à titre principal la situation de la victime et les obstacles au dépôt de plainte pendant le temps de sa minorité.
L’existence de délais très dérogatoires au droit commun s’agissant des viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs marque suffisamment la sévérité particulière du législateur à l’égard de ce type d’agissements.
Au surplus, à l’exception d’une part de l’Angleterre et du Pays de Galles, où en vertu de la common law toutes les infractions graves sont imprescriptibles sauf si un texte en décide autrement et d’autre part de la Suisse, l’ensemble des pays européens connaissent un régime de prescription des infractions sexuelles en général moins favorable pour les victimes que le régime français s’agissant des infractions sexuelles commises contre les mineurs.
Par ailleurs un allongement trop important des délais de prescription de l’action publique n’aurait pas de sens lorsque l’auteur est mineur. En effet, quel est le sens de la justice de juger un auteur de faits 30 ans après lorsqu’il les a commis à 13 ans par exemple ?
Se pose la question de la compatibilité de délais trop longs avec les notions de procès équitable et de délai raisonnable.
3. Faut-il revoir les modalités d’application dans le temps des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ?
Position DPJJ : Les modifications législatives successives relatives à la prescription des infractions commises contre les mineurs nécessitent une vigilance toute particulière concernant l’examen de loi pénale applicable à chaque infraction exposée.
Il s’agira pour chaque fait dénoncé de l’analyser dans chacune de ses circonstances (âge donc date de naissance de la victime, nature de l’infraction, circonstances aggravantes différentes en fonction du lien victime-mis en cause) au moment de sa commission (détermination nécessaire de la date des faits) afin de déterminer quelle loi de prescription lui est applicable puis d’effectuer le calcul du délai d’acquisition de la prescription et, à ce stade, de vérifier l’absence de nouvelle loi applicable.
La problématique en résultant est liée à l’application dans le temps des lois relatives à la prescription. Toutes ces lois nouvelles et successives sont à la fois dérogatoires au droit commun et plus sévères puisqu’elles permettent de poursuivre pendant de très longues périodes les auteurs des infractions.
Nous prenons acte qu’actuellement la plus grande sévérité d’une loi de prescription nouvelle n’empêche pas son application immédiate et que la loi nouvelle ne s’applique qu’aux faits qui ne sont pas prescrits lors de son entrée en vigueur. Nous n’avons pas de commentaire particulier à faire sauf à revenir à la règle de la non-application de la loi plus sévère mais ce retour en arrière créerait encore plus de confusion.
4. Le point de départ du délai de prescription des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs et des majeurs devrait-il être reporté au moment de la révélation des faits, c’est-à-dire au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique » (solution retenue par la proposition de loi n° 368 modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles dans sa rédaction initiale) ? Le cas échéant, est-il possible de déterminer ce jour avec précision ?
Position DPJJ : Si nous convenons que lorsque la victime est mineure, le choc émotionnel subi surtout quand les faits ont été commis sur la durée par un parent ou une personne ayant autorité est de nature à provoquer un traumatisme profond, nous estimons que la proposition d’un point de départ « au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique » n’est aucunement justifiée lorsque la victime est majeure et qu’un tel point de départ serait très insécurisant juridiquement car trop subjectif quel que soit l’âge de la victime ; en effet le champ des poursuites dépendrait alors de l’évolution du psychisme de la victime, il y aurait donc une incertitude sur le point de départ.
Ce mécanisme aurait pour conséquence une imprescriptibilité de fait, or l’imprescriptibilité n’existe en droit français que pour les crimes contre l’humanité et le génocide.
De même cette question renvoie au dépérissement des preuves et au sens de la plainte et de ses suites qui pourrait aboutir à un sentiment de déni de justice pour la victime. La justice a-t-elle réponse à tout et peut-elle apaiser toutes les souffrances? Nous pensons que si la prescription est acquise la réparation de la victime peut passer par d’autres voies que la voie judiciaire.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la méthode qui devra être objective, qui serait utilisée pour évaluer le jour à partir duquel le délai de prescription pourrait courir. Nous pouvons craindre des abus de personnes mal intentionnées si les méthodes d’évaluation ne sont pas sécurisées et solides.
Enfin, cette proposition tendrait à assimiler les infractions de nature sexuelle à des infractions occultes ou dissimulées. Or, la chambre criminelle de la Cour de Cassation n’a recours à cette notion que dans des affaires où l’auteur a dissimulé les faits pour en assurer la clandestinité.
Nous attirons l’attention sur le risque d’inconstitutionnalité principalement sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines, et du principe d’égalité des justiciables devant la loi et celui de nécessité et de proportionnalité des peines. Nous renvoyons ici également notre réflexion sur les auteurs mineurs.
Questions :
La fixation de ce délai à vingt ans par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a-t-elle permis de poursuivre plus efficacement les auteurs des infractions en question ? Pensez-vous qu’il serait judicieux de porter ce délai à trente ans ?
La fixation d’un délai allongé (à dix ou vingt ans) a-t-elle permis de poursuivre plus efficacement les auteurs des infractions en question ?
La fixation des délais à 10 ou 20 ans à compter de la majorité de la victime a nécessairement permis de poursuivre des faits qui auraient, sans ces dérogations aux délais de prescription, été prescrits.
Néanmoins, très régulièrement, ces délais longs ne permettent pas d’apporter la preuve des faits dénoncés lorsqu’ils sont niés, ce qui a pour conséquence un classement/non-lieu/relaxe ou acquittement de la procédure. Les victimes peuvent alors mal vivre cette situation, estimant que la justice ne reconnait pas leur situation de victime et ayant le sentiment de ne pas être crues.
Il convient de préciser que le problème de la preuve des faits de nature sexuelle est particulièrement difficile à rapporter s’agissant, en raison notamment de leur caractère non public et de l’absence, par voie de conséquence, de témoins.
L’allongement du délai n’apporterait pas de difficulté supplémentaire, les difficultés de preuve étant les mêmes après 20 ou 30 ans.
Sur l’article 8 et la question de la vulnérabilité
Article 8 (Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 52 )
En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.
Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
La loi du 2 mars 2011 dite LOPSI a modifié de l’article 8 alinéa 3 CPP en ce sens que pour un certain nombre de délits (abus de faiblesse, recel, escroquerie, vol…) commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, le point de départ court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Sur le point de départ nous renvoyons à nos observations relatives à la question 4.
Par ailleurs, nous relevons que l’état de vulnérabilité n’est pas défini ni ses déclinaisons. Que recouvre l’âge par exemple et quels fondements ont amené à inclure l’état de grossesse ? De plus, les personnes vulnérables ne sont pas toujours isolées et peuvent être entourées de membres de leur famille en capacité de les protéger ou encore bénéficier d’une mesure de protection (tutelle, curatelle…). Une imprescriptibilité de fait est inscrite à l’article 8 ce qui pose difficulté.
III. ELEMENTS DE CONCLUSION
La lutte contre les violences sexuelles doit être accompagnée en premier lieu d’une politique publique tendant à renforcer les mécanismes de détection des signes de maltraitance par une formation des personnels de santé, des acteurs du monde judiciaire, de tous les professionnels en contact avec les victimes et avec les enfants.
La notion d’équité doit être prégnante dans l’élaboration d’une réforme de la prescription pénale.
En effet la difficulté principale est la distorsion entre le nombre de plaintes et de condamnations pour des agressions sexuelles et le nombre d’agressions déclarées dans les enquêtes de victimation. Nous pensons que cette situation s’explique davantage par une insuffisance dans la prévention et dans la formation des acteurs malgré les efforts réalisés ces dernières années notamment dans le cadre de campagnes destinées à un large public.
La prévention devrait s’atteler encore davantage aux agressions intra-familiales. En effet, selon l’enquête réalisée conjointement par l’INSEE et l’ONDPR « Cadre de vie et sécurité 2012», pour les femmes au total près d’une agression sexuelle sur deux est le fait d’un proche (conjoint ou membre de la famille) ce qui explique l’hésitation au dépôt de plainte au risque de faire éclater la cellule familiale.
Cette mission est heureuse dans la mesure où au-delà d’une réforme elle peut être le point de départ d’une prise de conscience encore plus accrue des difficultés que rencontrent les victimes de certaines infractions à porter plainte et l’occasion d’une réflexion sur un renforcement de l’accompagnement des victimes et une reconnaissance de leur statut qui viendrait pallier l’absence de reconnaissance judiciaire qui a ses limites.
Nous tenons à une spécificité pour les victimes mineures des infractions sexuelles au regard de leur très grande fragilité.
Contribution de M. Éric Arella, sous-directeur de la police technique
et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire
du ministère de l’intérieur
1. Parmi les fondements traditionnels de la prescription de l’action publique figure notamment le dépérissement des preuves. Dans quelle mesure ce fondement reste-t-il pertinent ?
Longtemps le dépérissement des preuves a été une des justifications de la prescription. Aujourd’hui, les progrès scientifiques ont permis une amélioration constante des moyens techniques et scientifiques d’investigation à même de permettre d’identifier l’auteur des faits de plus en plus longtemps après leur déroulé.
Ces capacités nouvelles ont mis en exergue la nécessité de conserver les scellés issus des opérations de PTS. En effet, il est possible aujourd’hui de ré-exploiter d’anciens scellés et de réussir à en extraire notamment des profils génétiques exploitables. Le dépérissement des preuves ne peut donc plus être considéré comme un fondement pertinent de la prescription de l’action publique.
Compte tenu de ces avancées, le sous-directeur de la police technique et scientifique souhaite que la prescription pénale en matière criminelle soit étendue. Un délai porté à 20 ans pour ces infractions particulièrement graves paraîtrait pertinent.
Partant, cela nécessite d’apporter un soin particulier à la conservation des scellés dans la mesure où le scellé doit rester disponible et intègre pour une éventuelle ré-exploitation.
En ce qui concerne les scellés biologiques, c’est le SCPPB (service central de préservation des prélèvements biologiques à Rosny-sous-Bois) qui est chargé de la conservation des scellés de façon à permettre leurs réutilisations (circulaire du 13/12/2011).
La démarche qualité qui est en cours, vise à normaliser les conditions optimales de gestion des scellés pour permettre leur ré-exploitation (notamment pour un "cold-case"), avec, en filigrane, la question des moyens matériels et financiers limités et pourtant nécessaires à une conservation optimale des scellés.
Enfin, le groupe de normalisation criminalistique travaille, au niveau européen, à l’établissement d’une norme commune de gestion des scellés, en s’inspirant de normes étrangères existantes.
2. Quelles ont été, au cours des vingt dernières années, les principales évolutions des techniques d’investigation en matière de police technique et scientifique (recueil, exploitation, conservation des preuves) ? Notamment, quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation de preuves de nature olfactive ou acoustique ?
Concernant les progrès en matière d’acoustique
L’élément notable de ces vingt dernières années est l’arrivée des technologies numériques qui ont permis :
- de développer des filtres de dé-bruitage très nombreux et de très bonne qualité permettant d’améliorer très sensiblement les techniques de dé-bruitage et de transcription
- de changer les méthodes et techniques utilisées pour la comparaison de voix, celles-ci mettant désormais en œuvre une analyse statistique et la fourniture d’outils de mesure aux phonéticiens au lieu des protocoles controversés utilisés dans les années 70, reposant essentiellement sur des comparaisons rudimentaires de spectrogrammes.
En permettant d’objectiver un résultat par une échelle qualitative au lieu de la seule opinion de l’expert, ces progrès ont fait de la comparaison de voix un élément de preuve désormais reconnu devant les tribunaux.
Concernant les progrès accomplis dans l’exploitation de preuves de nature olfactive
Depuis plus de dix ans, la SDPTS met en œuvre avec grand succès une technique criminalistique importée de l’Europe de l’Est : l’odorologie.
L’odorologie a été développée en Hongrie dans le courant des années 1970 par un colonel vétérinaire de la police hongroise.
Cette technique de criminalistique permet l’identification d’odeurs humaines par comparaison entre des traces odorantes prélevées sur des scènes d’infraction et des odeurs corporelles prélevées sur des mis en cause ou des victimes.
En France, l’odorologie a été mise en place au sein du service central d’identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique en septembre 2000. Discipline de criminalistique opérationnelle depuis juin 2003, elle repose sur un protocole très strict élaboré au sein d’Interpol par un groupe d’experts.
Le groupe odorologie du SCIJ est la seule unité de ce type en France, tous services de police et de gendarmerie confondus.
La comparaison d’odeurs est réalisée exclusivement à Ecully par des maîtres-chiens et chiens spécialement formés à cette technique. Au sein des services territoriaux d’identité judiciaire, des préleveurs en odorologie spécifiquement habilités procèdent aux prélèvements de traces odorantes et d’odeurs corporelles, conformément au protocole en vigueur.
Au cours des dix dernières années, quelques progrès et avancées ont pu être accomplis pour cette technique de criminalistique
- le prélèvement des traces odorantes sur la scène de crime : les localisations de prélèvements sont mieux ciblées, leur pertinence ayant été étudiée, notamment pour limiter au maximum les éventuelles contaminations. La formation des préleveurs s’en est trouvée améliorée.
- la conservation des tissus : ceux-ci sont conservés dans des conditions hygrométriques et thermométriques optimales permettant leur exploitation jusqu’à la prescription criminelle (et même au-delà).
- la reconnaissance de cette technique par les enquêteurs et les juridictions : ce mode de preuve est de plus en plus reconnu et admis, l’accroissement des saisines en est la démonstration.
- l’assise scientifique de la méthode de l’odorologie : de nombreux travaux de recherche et des publications scientifiques attestent sans conteste de l’unicité de l’odeur humaine et de la pertinence de l’odorologie.
3. Quelle place l’exploitation des empreintes digitales et génétiques a-t-elle prise dans les investigations au cours des vingt dernières années ? Quel degré de fiabilité peut-on attacher à l’exploitation de ces empreintes ?
À travers les éléments chiffrés provenant des bases d’identification FAED et FNAEG et faisant état du nombre de rapprochements et d’identifications effectués, on peut voir l’ampleur de l’implication de la PTS dans la conduite des enquêtes judiciaires. Seul le FNAEG permet aujourd’hui d’opérer un distinguo parmi les infractions concernées (tableau infra), la production des résultats chiffrés se faisant par l’alimentation manuelle d’une application dédiée.
Il importe de souligner que ces données ne permettent pas de conclure que l’identification réalisée a permis l’élucidation de l’affaire pour laquelle elle a été sollicitée, ni même qu’elle a été utile à cette enquête (les identifications réalisées ne concernant pas obligatoirement les mis en cause).
ANNEE 2014 | |||
FNAEG (PN/GN) |
Nombre global de rapprochements |
Vols aggravés (dont cambriolages) |
VMA |
26 013 |
14 815 |
1305 | |
Terrorisme et autres atteintes aux intérêts de la nation |
Trafic de stupéfiants |
Vol | |
251 |
1071 |
2119 | |
Dégradations |
Autres atteintes aux biens |
Homicides | |
703 |
1939 |
1153 | |
Atteintes aux personnes |
I.L.A |
Infractions de nature sexuelle | |
1281 |
82 |
1222 | |
FAED (PN/GN) |
Traces identifiées |
Individus concernés |
Affaires concernées |
33 054 |
16 302 |
14 698 | |
La sous-direction de la police technique et scientifique ne dispose pas de retour statistique des services d’enquêtes concernant l’apport de la PTS dans la résolution des affaires (apport qui ne se limite pas au travail criminalistique, mais intègre également l’exploitation des traces technologiques).
Toutefois, l’efficacité de la PTS ne peut pas se mesurer qu’à travers son impact dans l’élucidation des affaires, dans la mesure où, aujourd’hui, elle est un outil d’aide à l’enquête indispensable dans la conduite des investigations et exigé par l’autorité judiciaire.
4. Quel est le cycle d’évolution d’une empreinte digitale ou génétique ?
Au quatrième mois de la vie intra-utérine apparaissent, au niveau de la face interne des mains et sur la face inférieure des pieds (dites « plante des pieds »), des dessins dits « papillaires » résultat de l’arrangement (par glissements et recouvrements) des couches de la peau recouvrant ces extrémités.
Constitués d’une alternance de reliefs (crêtes papillaires) et de creux (ou « sillons »), ces dessins sont pérennes dans le temps et sont régénérés à l’identique tout au long de la vie, sauf si le derme (couche profonde) est soumis à une atteinte (coupure profonde, brûlure), auquel cas les effets de rupture demeureront permanents.
L’empreinte génétique, elle, dépend de l’héritage génétique de la personne et est immuable tout au long de sa vie dès les premières cellules.
Les dépôts laissés par un individu – les traces papillaires ou génétiques – ont une durée de vie totalement dépendante du milieu dans lequel elles se trouvent : ainsi une empreinte papillaire dans la cire pourrait perdurer des centaines d’années si rien ne vient l’abîmer… Un dépôt papillaire classique quant à lui pourra disparaître au bout d’un certain temps, parfois plusieurs semaines voire beaucoup plus, impossible à définir de prime abord dans la mesure où il dépend de circonstances extérieures (sécheresse de l’air supprimant le dépôt sudacé, exposition aux UV...) , de la nature du support (poreux -permettant aux acides aminés, aux chlorures de pénétrer dans le support ou non poreux).
Pour les traces génétiques, à partir du moment où le support a été congelé correctement, sans rompre la chaîne du froid, voire séché correctement (sang) le matériel génétique peut se conserver des années. À l’air libre, là encore, cela dépend des conditions environnantes (UV, pluie qui délave, …).
L’ADN se dégrade rapidement dans une atmosphère chaude et humide et est sensible aux ultra-violets. Il faut impérativement que les traces soient conservées sèches, dans une atmosphère fraîche et protégée des rayonnements solaires. La méthode de conservation varie selon que les traces prélevées sont « humides » ou « sèches ».
Les traces biologiques « sèches » sont conservées à température ambiante (pas au réfrigérateur en raison du risque de condensation) dans un emballage permettant à l’air de circuler comme un sac en papier ou une boîte en carton. Il faut éviter le plus possible l’usage d’emballage en plastique, car les traces risquent à terme de suinter provoquant la formation de moisissures.
Les pièces à conviction humides, comme les vêtements trempés ou les traces « humides » prélevées par exemple au moyen d’écouvillon humidifié seront d’abord séchées dans un environnement adéquat et ensuite stockées comme les traces biologiques sèches.
Les échantillons liquides (échantillon sanguin, rinçage vaginal, prélèvement lors de l’autopsie...) sont congelés.
Avec l’introduction de la PCR (polymérase chain réaction), les analyses ADN ont évolué de façon considérable. Avant les analyses ADN s’effectuaient au niveau même de l’ADN présent dans l’échantillon alors qu’actuellement l’ADN est d’abord soumis à une étape d’amplification (consiste à produire autant de copie que l’on souhaite d’une molécule d’ADN). Théoriquement, il suffit qu’un délinquant laisse une seule de ses cellules pour que l’on puisse identifier sa trace. Les techniques actuelles reposent sur l’amplification simultanée de plusieurs fragments d’ADN (jusqu’à 21 actuellement) ceci garantit l’analyse d’un nombre suffisant de marqueurs génétiques pour des traces minuscules permettant l’obtention d’un profil génétique exploitable pour l’identification génétique. Ainsi, il est possible de déduire un profil génétique même si la trace est altérée grâce à cette méthode.
Quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation d’empreintes partielles ou altérées ?
Pour le papillaire : depuis sa mise en œuvre au début de l’année 2010, la version actuelle du logiciel de traitement des empreintes et des traces (dite « Métamorpho 4.0 »), outre des matcheurs (outils de rapprochement) plus performants et plus pertinents, met à la disposition des spécialistes du traitement des traces papillaires sur le système automatisé FAED les fonctionnalités suivantes :
- reconstitution du tracé initial des crêtes et « nettoyage » des sillons obstrués (outil « Connector »),
- estompage des perturbations (bruit de fond, guillochage, …) générées par les couleurs ou motifs du support de relevé,
- correction de la distorsion induite par le caractère curve d’un support de relevé (cylindre, douille de munition d’arme à feu, …),
- panel élargi des formats et définitions de captation d’images,
- affinage des seuils de contraste et de luminosité.
En outre, ces traces sont désormais comparées avec un échantillon élargi d’empreintes digitales (déroulées et apposées), mais également d’empreintes palmaires, de référence.
Dans ces comparaisons, à l’initiative du spécialiste, le logiciel peut prendre en compte, par la fonctionnalité « Juvénile », la modification spatiale de la configuration de minuties induite par la croissance physiologique de la personne entre le stade de l’adolescence et l’âge adulte.
Ces fonctionnalités permettent d’optimiser les niveaux d’incrimination de ces traces, notamment pour celles d’aspect « partiel » ou « altéré ».
D’un point de vue génétique, l’établissement d’un profil génétique peut dorénavant être fait à partir d’une quantité de matière très réduite (on est passé de 500 nanogrammes à 5 nanogrammes puis dorénavant dans certains cas 0,5 nanogramme). Les traces partielles peuvent être traitées grâce à des outils de recherche plus performants (CODIS).
5. L’exploitation d’une empreinte digitale ou génétique ou, plus généralement, de tout élément de preuve (à l’exception des témoignages humains) est-elle impossible au-delà d’un certain délai ? Le cas échéant, ce délai est-il le même pour l’ensemble des preuves ?
Sur un site en lien avec la commission d’une infraction de nature criminelle ou délictuelle, les indices de nature papillaire, apparaissant pour la grande majorité sous la forme de dépôts sudoraux, sont sensibles, en ce qui concerne leur préservation, à de multiples manipulations susceptibles de générer altération ou effacement et aux aléas environnementaux telles les variations de température ou d’hygrométrie. En amont de la prise en compte de la scène d’infraction et de la mise en place de mesures de préservation des traces et indices, ces agressions extérieures échappent à tout contrôle humain.
Considérant les raisons ci-dessus évoquées, ainsi que la spécificité inhérente à chaque dossier, il apparaît très difficile, voire impossible - du moins en l’état des connaissances actuelles -, de déterminer un délai maximal au-delà duquel tout travail d’exploitation s’avérerait inefficient.
En ce qui concerne la conservation des indices recueillis, les techniques mises en œuvre aux fins de relever / révéler des traces papillaires sur les supports appropriés impliquent une fixation photographique qui permet d’attester dans le temps à la fois la matérialité de cette preuve dactyloscopique et d’en certifier la localisation de son dépôt initial.
La recherche de ces éléments laissés sur une scène d’infraction pourra être réalisée tant qu’une affaire n’est pas prescrite. Certains éléments – comme les traces de sang par exemple – pourront être matérialisés des années plus tard au moyen de luminol ou autre produit de type buestar réagissant avec les particules ferreuses du sang et provoquant une chimiluminescence.
Le délai au-delà duquel aucune trace ne sera retrouvée ne peut être défini de façon générale : il dépend de facteurs environnementaux. Tant que la prescription ne sera pas acquise, il sera utile de rechercher des traces et indices grâce aux moyens de détection de la PTS, qui sont en perpétuelle évolution (moyens optiques, filtres lumineux à longueur d’onde variable, .... ).
Par-delà, les molécules d’ADN ont une très bonne stabilité : si ces conditions sont garanties, les anthropologues et les paléontologues ont déjà réussi à retrouver des restes utilisables de molécules d’ADN dans des échantillons vieux de milliers d’années.
Contribution de M. le colonel François Daoust, directeur de l’Institut
de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
1. Parmi les fondements traditionnels de la prescription de l’action publique figure notamment le dépérissement des preuves. Dans quelle mesure ce fondement reste-t-il pertinent ?
La prescription dans la théorie du droit se base sur les fondements touchant à la paix et la tranquillité publique (commandant d’oublier l’infraction et non d’en raviver le souvenir), ainsi que l’inquiétude (dans laquelle vit l’auteur des faits aussi longtemps qu’il échappe à la poursuite et à la punition), comme la sanction de la négligence de la société à exercer l’action publique ou à exécuter la peine, et enfin le dépérissement des preuves.
L’histoire du droit montre que pour les trois classes d’infraction, les délais actuels n’ont pas fondamentalement changé depuis le code d’instruction criminelle (Consulat et Empire)467 (exceptions faites des nouveaux textes créant de fait de nouvelles infractions ; et sur la définition de certaines, se pose la question du point de départ de la prescription). Ils sont encore le reflet d’un héritage historique notamment dans les délais paraissant d’importance à une époque où l’espérance de vie était bien moindre qu’aujourd’hui. Actuellement, en sus des débats propres à la philosophie et au droit de la prescription, un axe complémentaire de lecture peut venir enrichir le débat dans le domaine du dépérissement des preuves. En effet, si selon ce fondement, il convient que le délai de prescription ne soit pas trop important, au regard de l’usure du temps effaçant les preuves et rendant inutile la pertinence ou la possibilité d’analyser les éléments matériels qui pourraient encore exister après plusieurs années voire décennies, les progrès technico-scientifiques permettent de constater que dans de nombreux domaines, la recherche d’un résultat scientifique robuste et déterminant est possible au-delà des délais de prescription de l’action publique en matière de crime (pour ne prendre que la plus longue). D’ailleurs, dans un certain nombre d’affaires criminelles le délai de prescription de l’action publique n’est jamais atteint par le jeu subtil d’un acte d’instruction ou de poursuite réalisé peu de temps avant la date butoir, repoussant d’autant le délai468 et renvoyant le principe des fondements aux débats philosophique des auteurs du droit.
C’est ainsi que dans plusieurs cas, les analyses ont été refaites de nombreuses années plus tard, avec de nouvelles techniques et ont apporté des résultats probants qui ont permis de résoudre l’affaire là où les premiers examens scientifiques et autres expertises s’étaient soldés par un échec. De même, pour un certain nombre d’infractions la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de l’accession à la majorité de la victime, mineure au moment des faits469, repoussant d’autant la recherche des preuves, dont le dépérissement est alors considéré comme relatif.
Enfin dans de nombreuses affaires, sont découverts des corps putréfiés pour lesquels les autopsies, les expertises en anthropologie, les analyses ADN et les expertises de traces observées sur la peau (quand elle existe) et sur les os (armes à feu, armes blanches, scie, etc.) restent toujours possibles et interviennent bien après les délais théoriques de prescription de l’action publique.
Sans détailler tous les cas légaux et artifices procéduraux possibles, le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle est en pratique beaucoup plus long que ne le laisse supposer le code de procédure pénale et déjà dans l’exercice quotidien de la criminalistique, basé le délai de prescription sur le seul dépérissement des preuves n’est plus fondé comme cela l’avait été au XIXème siècle.
À titre d’illustration voici quelques exemples allant dans le sens d’une révision des délais de prescription au regard des capacités scientifiques :
→ Le 17 mai 1994, la famille Roussel signale la disparition de sa fille, Delphine, âgée de 19 ans et résidant à Soisy-sous-Montmorency (95). Son corps dénudé et partiellement décomposé est découvert le 23 mai 1994 dans un sous-bois de Groslay (95). La victime a été étranglée avec un lacet de chaussure, ses vêtements ont été dispersés. L’enquête est confiée au SRPJ de Versailles (78) et les premières analyses génétiques effectuées par le LPS Paris (75) ne donnent aucun résultat probant. L’enquête stagne et s’endort.
En 1998, le magistrat mandant dessaisit le SRPJ au profit de la SR Versailles (78). qui confie alors l’analyse des scellés à l’IGNA470. Compte tenu des limites de la technique de l’époque, un profil génétique masculin partiel est déterminé à partir des sous-vêtements de la victime, mais ne permet pas une quelconque identification.
En 2008, un an avant la prescription du meurtre et sur conseil des enquêteurs, la famille de la victime relance la justice sur l’opportunité de nouvelles analyses afin de bénéficier des progrès de la criminalistique. En 2009, le magistrat instructeur commet alors un expert de l’IRCGN aux fins d’un nouvel examen génétique des scellés. L’expert, fort des derniers progrès, met alors en évidence la présence de sperme sur les sous-vêtements de la victime et réussit à établir une empreinte génétique.
Ce profil génétique est rapproché par le FNAEG en 2010 avec celui d’Eric G., dont le profil génétique avait été enregistré au FNAEG pour violences intra-familiales471.
Confondu par son ADN, Éric G. est jugé en janvier 2013 devant la cour d’assises du Val-d’Oise. Diminué et arguant ne pas se souvenir des faits à cause d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2005, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Analyse au regard de l’étude sur l’évaluation du délai de prescription de l’action publique et des propositions d’aménagement :
- Entre 1994 et 1998, il serait intéressant de voir avec le juge d’instruction les raisons de ce dessaisissement du SRPJ de la DCPJ (PN) au profit de la SR de Versailles (GN). Si après les premières investigations sur les premiers mois, les enquêteurs n’ayant pas de renseignement n’ont plus agi, le magistrat a toujours le choix de relancer le dossier en changeant d’unité. Dès lors, créer un délai de « carence » de 3 ans par exemple, qui entraînerait une prescription automatique par défaut d’actes d’enquête priverait le magistrat instructeur de saisir un autre service qui se serait plus impliqué ou aurait une autre approche.
- Entre 1998 et 2008, la SR de Versailles a procédé à de nombreux actes les premières années puis face à la fermeture de toutes les pistes a mis en place une cellule de veille chargée de recueillir tout nouveau témoignage qui se ferait de manière incidente (il arrive régulièrement qu’à l’occasion d’une autre enquête, sans lien avec la première, une personne interrogée apporte de nouveaux éléments). Mais en l’espèce aucun élément complémentaire n’est venu relancer les recherches. C’est ainsi qu’à nouveau si un délai de carence existait, il aurait de fait conduit à la prescription de l’action publique par défaut d’acte d’enquête.
- Dans les deux périodes, l’existence d’un délai de carence aurait interdit toute possibilité de relancer une demande d’expertise au regard des dernières techniques et aurait comme conséquence de clore l’affaire sans en avoir le résultat qui a été in fine obtenu. Maintenir un délai de prescription est à la fois culturel et sociétal, mais introduire un délai de carence, revient à réduire le délai de prescription à sa plus courte expression privant la victime et sa famille de toute chance de réparation et offrir au coupable une quasi-impunité car il suffit alors d’une absence d’éléments pendant un moment impliquant une absence d’actes pour un temps voire de quelques priorités pour que le délai de carence soit rapidement atteint, interdisant toute reprise du dossier par d’autres unités ou si de nouveaux éléments apparaissent, et privant le juge de toutes nouvelles analyses scientifiques.
→ Dans le cas particulier des crimes avec enfouissement des victimes, l’IRCGN s’est doté de moyens performants de détection de corps enfouis au moyen de radars géophysiques terrestres. Au sein d’un plateau pluridisciplinaire qui comprend également des experts en anthropologie médico-légale, en odontologie, capables de réaliser des investigations de type archéo-forensique sur le terrain.
Toutes ces techniques associées aux capacités d’expertise génétiques novatrices pour extraire rapidement l’ADN de restes humains472, forment un ensemble complet, cohérent et performant pour le traitement de scènes dont l’ancienneté, par le jeu du report de la prescription, dépasse largement la décennie.
C’est ainsi qu’a été réalisé un dossier fin 2014 suite à la découverte d’un corps, plus de 15 ans après sa disparition. D’abord localisé par le radar géophysique terrestre, puis daté avec une grande précision par les anthropologues473, et enfin identifié formellement par filiation au moyen de l’extraction de l’ADN, l’auteur des faits devrait être jugé prochainement en cour d’assise sur les fondements de l’arrêt du 7 novembre 2014. En l’espèce les derniers éléments d’enquête recueillis ont conduit le juge d’instruction et les enquêteurs à fermer les dernières hypothèses émises en engageant un maximum de moyen sur le positionnement possible du corps.
→ Parmi ces affaires toujours emblématiques figure l’identification de Myrtho Fowel une dizaine d’années après sa disparition, à partir de son squelette retrouvé par les plongeurs de la gendarmerie au fond du Sinnamary en Guyane474.
→ L’IRCGN a également permis l’identification de restes humains de plus de 20 ans d’ancienneté, suite de la disparition d’une personne datant de 1993 et dont les restes ont été retrouvés au fond de la Somme475.
→ Plus récemment, dans le cadre d’une affaire de double homicide datant de 2001 (Mère + enfant), l’IRCGN a été sollicité début 2015 pour effectuer de nouvelles analyses ADN sur les restes congelés des cadavres. En effet, les restes humains analysés à l’époque par un laboratoire privé n’avaient pas donné de résultat.
Après avoir réceptionné les scellés congelés, qui étaient conservés par le laboratoire privé ayant procédé aux premières analyses, l’IRCGN est parvenu en deux jours à obtenir les profils génétiques complets de l’adulte et de l’enfant et à déduire un profil génétique partiel du géniteur présumé de l’enfant.
Les profils détenus par le FNAEG permettent alors de proposer des rapprochements avec des individus susceptibles d’être en relation avec le cercle familial restreint du géniteur. L’enquête qui a été ainsi relancée devrait avec ses nouveaux résultats arriver à son terme et cela grâce à des analyses scientifiques sur des éléments matériels qui au regard des premiers examens pouvaient être considérés comme un dépérissement de preuves.
Analyse de ces cas au regard de l’étude sur l’évaluation du délai de prescription de l’action publique
La disparition de personne après les premiers mois de recherches il arrive régulièrement que le tarissement des pistes et hypothèses et à défaut d’éléments matériels, conduise à une suspension des actes d’enquêtes même si les enquêteurs gardent un lien avec la famille. Si un délai de carence est instauré, l’action publique aurait été prescrite. Sauf à considérer que la découverte du corps devienne le point de départ d’un nouveau délai de prescription.
Si besoin était, les quelques exemples présentés supra montrent que le dépérissement des preuves ne peut plus être considéré comme un des fondements participant à la justification du délai de prescription de l’action publique. Sans remettre en cause ce principe car les autres fondements y concourant restent d’actualité, l’adaptation ou la révision du délai pourrait parfaitement allier les progrès scientifiques avec les attentes de plus en plus prégnantes des familles de victimes pour lesquelles la prescription reste un échec de la justice.
2. Quelles ont été, au cours des vingt dernières années, les principales évolutions des techniques d’investigation en matière de police technique et scientifique (recueil, exploitation, conservation des preuves) ? Notamment, quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation de preuves de nature olfactive ou acoustique ?
2.1 Les principales évolutions techniques
2.1.1 Le recueil, l’exploitation et la conservation des preuves476
Même si le domaine est encore grandement perfectible, le premier des progrès est une professionnalisation progressive du personnel qui intervient sur les scènes de crime.
En gendarmerie les TIC477 (technicien en identification criminelle) reçoivent 9 semaines de formation spécialisée en criminalistique au CNFPJ (centre national de formation à la police judiciaire) dont 4 semaines au sein de l’IRCGN (institut de recherche criminelle de la gendarmerie) pour la mise en pratique des techniques de révélations chimiques des empreintes digitales et la mise en œuvre de l’assurance qualité notamment.
L’appréhension de la scène d’infraction se fait selon 3 grands principes scientifiques qui leur sont enseignés :
1) Le principe de l’échange dit également principe de Locard, du nom de son concepteur a été énoncé comme suit : « La vérité est que nul ne peut agir avec l’intensité que suppose l’action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage. (…) Les indices dont je veux montrer ici l’emploi sont de deux ordres : Tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les marques de son passage, tantôt, par une action inverse, il a emporté sur son corps ou sur ses vêtements les indices de son séjour ou de son geste »478. Ce principe constitue le socle de la criminalistique à partir duquel : les recherches de traces sur la scène de crime vont avoir lieu, les prélèvements qui en découlent effectués et, leurs analyses réalisées pour permettre avec l’interprétation des résultats obtenus, de proposer des scénarii et des éléments corroboratifs participant à l’élaboration de la preuve.
2) Le principe de Kirk est basé sur le caractère unique de tout objet dans l’univers et qui a un impact prégnant en criminalistique, celui du renforcement de la valeur de toute identification. « Une chose ne peut être identique seulement avec elle-même, jamais avec un autre objet, puisque tous les objets dans l’univers sont uniques. Si cela n’était pas vrai, il ne pourrait y avoir d’identification au sens employé par le criminaliste »479. D’abord, il faut comprendre qu’identification n’est pas identité. Ensuite, il convient de comprendre également que l’identité et/ou l’unicité n’est pas la similarité.
3) Le principe d’Inman et Rudin s’appuie sur les deux principes précédents, le transfert et l’unicité de l’objet, ils démontrent que tout objet bien qu’unique peut se briser dès lors qu’il est soumis à une force suffisamment importante (sous-entendu, ce qui peut être la conséquence d’une action criminelle). Ainsi dans un lieu nous pourrons avoir plusieurs fragments chacun ayant leur propre spécificité du fait de la division, mais portant encore des caractères communs de leur origine. « La matière se divise en composants plus petits lorsqu’une force suffisante est appliquée. Les morceaux acquièrent des caractéristiques créées par le processus de division lui-même et retiennent des propriétés physico-chimiques de la plus grande pièce (l’assemblage initial) »480. L’exemple le plus connu est celui du verre. Les morceaux du verre brisé (vitre, vaisselle, etc.) sont uniques par essence, mais les lignes de brisures (les lignes conchoïdales) montrent des traces uniques qui permettent de reconstruire l’objet initial par comparaison et assemblage.
Connaître et maitriser ces principes donnent aux TIC qui interviennent sur une scène de crime un savoir indispensable pour comprendre la scène et les traces qui sont susceptibles de s’y trouver au regard de l’action criminelle. Et par traces nous désignons un panel qui va bien au-delà des seules traces papillaires et biologiques telles que souvent le droit et l’exploitation des fichiers nationaux (FAED et FNAEG) le laissent accroire. La connaissance de la typologie des traces est indispensable pour ne rien oublier sur la scène, d’autant plus que souvent nous n’avons ni ADN, ni empreinte digitale.
2.1.2 S’agissant de l’exploitation des éléments prélevés, il y a beaucoup à dire, le pire côtoie le meilleur. Il s’agit d’une appréciation délicate qui tient compte de la formation réelle des personnels mais également d’un problème juridique.
Le problème juridique tient au moment juridique de la procédure. C’est-à-dire que si les examens dits scientifiques sont faits dans le cadre de l’article D7 du CPP, ils sont considérés par la cour de cassation comme des constatations car réalisés dans le temps des constatations481. Et le personnel qui officie est à ce stade celui qui prélève. La réalisation d’examens scientifiques et l’exploitation qui en est faite dans ce cadre nécessitant une interprétation sont alors sujettes à débat scientifique car le niveau de recrutement et la formation de l’agent préleveur ne sont pas toujours en adéquation avec l’examen réalisé482.
Lorsque le moment judiciaire est différent, nous sommes alors dans le temps des réquisitions à personne qualifiée483 ou des commissions d’expertise484 et le personnel requis ou nommé expert a des formations de plus haut niveau et les contraintes juridiques les obligent à démontrer leur résultat par une interprétation qui se veut être détaillée dans leur rapport, ce qui offre alors une exploitation généralement de bien meilleure qualité.
2.1.3. S’agissant enfin de la conservation des preuves, nous avons plusieurs remarques en ce domaine.
D’abord nous avons avant envoi au laboratoire, la conservation des éléments directement prélevés sur la scène ou à partir des objets saisis sur la scène. Ils seront alors échantillonnés sur un plateau technique485 et, selon leur nature, feront l’objet d’un conditionnement adapté. C’est ainsi que les prélèvements de nature biologique sont prélevés avec des kits spéciaux (que ce soit pour la signalisation des gardés à vue486 ou des traces prélevées sur la scène487) permettant à la fois une collecte efficiente en cas de présence d’ADN, mais également la conservation de son intégrité (présence de dessicant, etc.) jusqu’à son exploitation par le laboratoire. Il en est de même pour les autres traces et éléments prélevés sur la scène (traces de semelles, traces papillaires, armes, traces organiques ou chimiques, etc.) chacune bénéficiant d’un conditionnement adapté assurant la conservation mais également la traçabilité technique (code-barres par exemple) et juridique (la mise sous scellé).
Ensuite après l’exploitation, nous avons la conservation des scellés soit par les greffes des tribunaux dans la grande majorité des cas488, soit par le SCPPB pour les prélèvements biologiques. À ce stade, il convient de faire un focus sur la conservation des scellés et plus particulièrement sur le SCPPB. En effet, si les techniques évoluent et permettent de réaliser même très tardivement dans le temps de nouveaux examens scientifiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ne pourront être effectués qu’à la condition que les greffes les aient gardés dans des conditions de conservation n’entraînant pas une contamination par contact et transfert, ou toute autre dégradation possible.
Le SCPPB, un greffe par défaut.
Créé dans le cadre du décret relatif à la mise en œuvre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)489, le Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) est rattaché à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et implanté depuis le 1er mars 2006 à Cergy-Pontoise (95).
Placé sous l’autorité du haut magistrat nommé par le Garde des Sceaux, assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions (article R. 53-16 du CPP), pour assurer le contrôle du FNAEG, le SCPPB a pour mission de conserver, à la seule demande des autorités judiciaires, les traces et échantillons de matériels biologiques placés sous scellés au cours des procédures, à partir desquelles ont été déterminés les profils génétiques qui sont enregistrés dans la base de données du FNAEG (article R. 53-20 alinéa 1 du CPP).
« L’institution d’un tel organisme n’avait pas été prévue par le législateur car elle ne relève pas du domaine de la loi. Comme le souligne la circulaire, elle représente cependant une fonctionnalité directement liée à la gestion du fichier. C’est pourquoi le décret a intégré ces dispositions dans la même division du Code de procédure pénale et prévoit que l’autorité judiciaire exerce sur ce service un contrôle de même nature que celui existant sur le fichier des empreintes génétiques »490.
À ce titre, le magistrat du Parquet effectue les mêmes visites sur site. Il se fait communiquer les fichiers d’accompagnement des scellés et, plus généralement, tout document justifiant la conservation d’échantillons. Il reçoit les réclamations des particuliers et procède à toutes vérifications utiles. Le Directeur de l’I.R.C.G.N. doit lui adresser chaque année un rapport complet d’activité.
De plus, les prélèvements ainsi centralisés obéissent au régime des scellés judiciaires qui prévoit notamment à l’article 19 du CPP, lors de la clôture des opérations qu’un OPJ doit faire parvenir directement l’original et une copie des procès-verbaux, et doit mettre à disposition tous les actes et documents ainsi que les objets saisis. Les scellés sont donc théoriquement déposés au greffe du TGI destinataire de la procédure. La responsabilité de leur mise en dépôt incombe au magistrat qui dirige l’enquête. À ce titre, il peut leur donner expressément la destination qu’il juge la plus opportune pour leur conservation. Ainsi pour les scellés biologiques, ils ne peuvent, à ce titre, être conservés au SCPPB qu’à la suite d’une décision expresse de la juridiction, qui peut, à tout moment, en demander la restitution au service central. « Ce service est donc ainsi conçu comme un simple dépositaire, qui n’est pas habilité à effectuer sur les objets placés en dépôt des opérations autres que celles nécessaires au stockage »491. Mais de fait tous les scellés biologiques ne font donc pas systématiquement l’objet d’un envoi au SCPPB. Outre l’abandon en 2004 de l’envoi des scellés des individus et des condamnés, le choix d’envoyer ou non au SCPPB des autres types de scellés biologiques appartient à l’autorité judiciaire.
En observant le fonctionnement de ce service, nous pouvons tirer comme conclusion évidente qu’il correspond à un véritable greffe judiciaire, prenant en compte la gestion de scellés judiciaires. La gendarmerie s’est substituée, pour la grande majorité des scellés biologiques, aux missions dévolues à la justice en matière de conservation de scellés. À l’heure actuelle où se pose clairement la question de la gestion des scellés par les greffes des tribunaux montrant de réelles difficultés tant dans leur suivi que dans le maintien de leur intégrité492, l’expérience du SCPPB est intéressante car elle montre un modèle d’organisation, de suivi des scellés, et de conservation qui est parfaitement transposable à la justice. La seule difficulté actuelle, et qui n’est pas la moindre, reste le coût de telles installations, tant en création qu’en maintenance.
Les scellés ainsi conditionnés ne peuvent faire l’objet d’une exploitation, sous quelque forme que ce soit, sans une décision préalable du magistrat en charge du scellé. Le décret a prévu que les scellés doivent faire l’objet d’un conditionnement normalisé « et être conservés jusqu’à l’expiration du délai de quarante ans applicable aux empreintes génétiques inscrites dans le FNAEG ». Toutefois, n’ayant aucune notion du type de normalisation qui convient à la conservation de tels scellés, la justice a laissé les scientifiques de la gendarmerie proposer des solutions de conservation pouvant résister au temps493.
L’identification par empreintes génétiques repose sur l’étude de l’ADN (Acide DésoxyriboNucléique), qui est une molécule résistante (des molécules vieilles de 130 millions d’années ont été découvertes) mais aussi être très fragile quand elle se trouve exposée à certains facteurs tels que l’humidité, les bactéries, la lumière. Ces éléments ont conduit le SCPPB à choisir des techniques de stockage très rigoureuses et confirmées par les études scientifiques les plus récentes. Si la conservation par congélation (à des températures de l’ordre de -80°C) reste inévitable pour certains types d’échantillons, elle présente de sérieux inconvénients (coûts de fonctionnement, difficultés de transport, maintien en stockage provisoire dans des congélateurs standards avant la mise en œuvre des techniques de conditionnement nécessaires à la cryoconservation). Le stockage à température ambiante est donc privilégié, d’autant qu’il favorise la stabilité de l’ADN dans la durée, sous réserve que les conditions de luminosité, de température et d’hygrométrie des locaux soient rigoureusement contrôlées. C’est pourquoi les scellés adressés au SCPPB doivent également répondre à des exigences de normalisation, avec un format maximal fixé pour les scellés ambiants au volume A3 et pour les scellés congelés au tube de 50 ml. Pour certains scellés hors normes un traitement particulier reste envisageable en relation directe avec le service et en fonction de la sensibilité de l’affaire.
La préservation des scellés biologiques sur une longue durée, a soulevé le problème délicat du mode de conservation. En effet, conserver pendant aussi longtemps un échantillon biologique, fragile par nature, ne correspond pas au mode de fonctionnement usuel de stockage élémentaire tel que cela se pratique dans les greffes. Dans cette perspective, deux exigences s’imposaient : optimiser les conditions de conservation des prélèvements, mais aussi et surtout les techniques de recueil de l’ADN. Car le mode de prélèvement en amont conditionne immédiatement la capacité de conservation. C’est en ce sens que le SCPPB a ainsi participé à la création du kit de prélèvement buccal (FTA®) et à la mise en œuvre de la mallette « traces biologiques » dédiée aux unités de terrain pour leur permettre de réaliser des prélèvements de traces biologiques simples et viables en vue de l’alimentation du fichier des empreintes génétiques. Cette activité de recherche et de développement, participe à l’optimisation de la préservation de l’indice biologique, depuis son prélèvement jusqu’à son stockage final.
Afin d’assurer un suivi et une traçabilité efficace, le FNAEG et le SCPPB ont pour chaque scellé un numéro commun qui permet de rechercher l’échantillon biologique correspondant à une fiche sélectionnée par le FNAEG comme étant identique à une autre trace ou empreinte de comparaison, en vue d’une expertise plus complète d’identification. Ce rapprochement ne peut être effectué qu’à la seule demande du magistrat chargé de l’enquête ou de l’information judiciaire au cours de laquelle le fichier a été interrogé. Comme le précise le rapport du député C. CABAL : « En tout état de cause, le fichier du SCPPB ne peut évidemment pas contenir des résultats d’analyses d’identification par empreintes génétiques »494. Cette conclusion montre sans doute aucun que le SCPPB n’est qu’un greffe par défaut, la Justice n’ayant pas encore les moyens de gérer des scellés d’une telle sensibilité.
La seule difficulté qui apparait est justement l’application d’un délai de conservation qui va bien au-delà de ceux existant en matière de prescription de l’action publique, d’autant plus que cette conservation est exigée par les textes même si l’affaire est délictuelle495. Il y a dès lors un risque réel de saturation par un stockage de scellés d’affaires délictuelles en très grand nombre et pour lesquelles est maintenue une conservation qui va bien au-delà de la prescription de l’action publique mais également au-delà de la prescription de la peine. Autant les modes de conservation réellement sophistiqués et scientifiquement efficaces se comprennent aisément pour les affaires criminelles montrant toute la réalité du non dépérissement des preuves, autant ce maintien n’est pas en adéquation avec le régime des infractions délictuelles.
En matière de médecine légale, la conservation des prélèvements organiques, en vue des analyses toxicologiques, est encore par trop oubliée en termes de traçabilité et de conservation. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de « simplification et d’amélioration de la qualité du droit » a donné un encadrement clair à l’autopsie judiciaire496, c’est ainsi que l’article 230-28 du CPP offre à l’autopsie un double régime juridique pour les mêmes actes, à savoir celui lié aux examens scientifiques dans le cadre d’une enquête judiciaire et celui lié aux expertises dans le cadre d’une information. Mais la présence d’un OPJ n’étant pas toujours réalisable, les prélèvements ne font pas toujours l’objet d’un scellé assurant sa traçabilité juridique497. Quant à leur garde, il n’est pas rare qu’ils finissent dans un greffe non équipé pour la conservation de tels scellés, et dès lors interdisant toute analyse ultérieure de substances particulières avec de nouvelles méthodes.
Enfin, le problème de la conservation des preuves touche également le domaine de l’informatique et de l’électronique. Si apparemment le support informatique498 (au sens large, tel que disque dur499, smartphone, etc500.) fait l’objet immédiat d’une copie pour exploitation qui est elle-même placée sous scellé (article R. 15-33-74 du CPP). Mais, si les technologies numériques, avec les nouveaux protocoles d’identification, d’authentification et de protection, permettent de garantir physiquement l’intégralité des données requises ainsi que leur traçabilité, le législateur n’a cependant pas été jusqu’au bout de sa logique novatrice en matière de conservation des données en créant des « scellés numériques » qui pourraient parfaitement être conservés sur un serveur du ministère de la Justice dédier à ce nouveau type de scellés501. Ensuite, en préférant revenir, une fois les informations collectées, au principe du scellé physique, le législateur est resté enfermé dans une procédure connue, rassurante à plus d’un titre et conforme aux modalités générales de traitement des « objets » saisis et placés sous main de justice, mais qui présente un inconvénient majeur, celui de ne pouvoir faire face à l’évolution par trop rapide des matériels informatiques. En effet, cela génère très souvent une impossibilité de lecture des scellés quelques années après, donc une impossibilité de revenir travailler sur des fichiers cachés ou cryptés avec un nouveau logiciel de décryptage ou de détection, alors que le stockage numérique sur un serveur dédié et secouru permettrait à la preuve numérique de ne pas dépérir du fait de l’obsolescence de son support.
La notion de scellé apparaît donc bien à la fois particulièrement sensible dans la recherche de la vérité et leur gestion pose actuellement de véritables problèmes à la fois dans les frais que cela génère mais également concernant le temps et les modes de conservations502. Cette montée en puissance de l’intérêt pour une gestion plus fine, traçable et aussi durable est prégnante car la science est actuellement en capacité de permettre de travailler à nouveau sur de très nombreux scellés.
2.2 Quelques domaines ayant vu des progrès accomplis
Le travail sur l’évaluation du dépérissement des preuves doit pouvoir être apprécié d’une manière suffisamment large et ne pas se limiter à quelques matières503. Le champ de la criminalistique504 recouvre de nombreux domaines scientifiques505, c’est pourquoi nous aborderons des matières exploitées par certains laboratoires de criminalistique (dont l’IRCGN) et pour lesquelles des progrès significatifs ont été réalisés permettant notamment de travailler dans le temps.
2.2.1 La reconstruction 3D des scènes d’infraction est un progrès significatif qui n’est pas toujours employé, ni bien perçu par les acteurs au procès pénal comme un domaine essentiel au moins pour les grandes affaires. En effet, ce système de laser 3D permet d’enregistrer, entre quelques minutes et plusieurs heures (selon le dimensionnement de la scène tel un crash d’avion, un carambolage routier, etc.), une scène de grande ampleur et tous les éléments matériels qui sont présents. À la différence du simple enregistrement qui pourrait être fait par tout appareil photographique à 360°, le laser scanner 3D réalise une modélisation de la scène permettant (grâce aux millions de points marqués par le laser) de toujours être en capacité de prendre des mesures au millimètre près dans la scène sous quelque angle que ce soit (positionnement libre du fait de la modélisation, qui est une reproduction en trois dimensions de la scène) sans aberrations chromatiques, de mesures ou de distances. Mis en œuvre par des ingénieurs du laboratoire, ce système permet de fixer définitivement la scène, d’y revenir sur et à l’intérieur (avec le programme informatique de la modélisation) en tant que de besoin. Ainsi le progrès réalisé dans ce domaine donne aux enquêteurs comme aux magistrats la possibilité de travailler sur la « scène » même si cette dernière n’existe plus depuis de nombreuses années. Dans le cadre du dépérissement des preuves cette évolution favorise la poursuite d’actes d’instruction et la confrontation de témoignages tardifs, avec la réalité de la scène comme l’observation de tous les éléments permettant de nouvelles hypothèses plusieurs années après506.
2.2.2 Un autre domaine fait lui aussi l’objet de progrès déterminants, il s’agit de l’hémato-morphologie ou morpho-analyse des traces de sang507. Cette discipline basée sur la mécanique des fluides et la trajectographie balistique des projections sanguines508 permet d’établir le lien critique entre les opérations de police technique et scientifique (qui visent à identifier l’auteur d’une infraction) et le scénario des faits, par la mise en évidence du déroulement des événements sanglants.
Au cours de son histoire, la morpho-analyse a fait l’objet de nombreuses avancées en ce qui concerne la précision dans l’identification et l’interprétation des traces retrouvées sur les scènes d’infraction509. Ces évolutions lui ont permis d’avoir pleinement sa place au sein du plateau technique pluridisciplinaire que propose l’I.R.C.G.N et permet aujourd’hui, par l’intégration des résultats de disciplines criminalistiques connexes (balistique / médecine légale / génétique / empreintes digitales / etc.), de proposer une synthèse des éléments objectifs recueillis sur une scène d’infraction, et d’établir le ou les scenarii les plus probables de déroulement des faits violents qui s’y sont passés510. Cette discipline est d’autant plus intéressante qu’elle travaille également sur la précision de la datation511 des traces de sang et l’établissement d’une échelle de leur vieillissement à la fois visuellement et par analyse. Ce projet bien avancé, est réalisé dans le cadre d’un projet ANR sous subvention européenne entre l’IRCGN et plusieurs partenaires512. Cette étude vient en support de la volonté de mettre en évidence des preuves qui au regard du temps passé entre la découverte des traces et l’action (parfois plusieurs années avant) n’étaient pas retenues jusqu’à présent faute d’études et d’analyses scientifiques montrant toute leur pertinence et l’absence de dépérissement.
Il convient de souligner que parmi les avancées significatives de ces dernières années, les études menées sur les traces de sang sur vêtements, sur les capacités des produits de détection de traces de sang latentes, ainsi que l’arrivée de l’outil informatique, puis de la modélisation 3D par laser-scanner ont permis de franchir une étape supplémentaire dans l’exploitation de scènes d’infraction anciennes voire effacées, et/ou objets liés :
1) Les vêtements. L’interprétation des traces de sang sur la scène d’infraction est aujourd’hui de plus en plus souvent complétée par une analyse des traces présentes sur les éléments rattachés à celle-ci513. Cela permet d’identifier les mécanismes à l’origine des traces de sang observées, mais également d’attribuer certains événements sanglants violents au porteur du/des vêtements analysés afin, parfois, de préciser son degré d’implication (auteur/témoin, etc.) dans les faits visés514. Ces scellés, souvent conservés durant plusieurs décennies dans les greffes des TGI, peuvent aujourd’hui faire l’objet de ce type d’examen alors qu’au moment des faits ils n’avaient fait l’objet d’aucune morpho-analyse.
2) Les produits de détection515. Les dernières études menées sur les différents produits de détection de traces de sang latentes (basés sur le luminol) ont permis de démontrer leur capacité de détection dans le temps516. En effet, un projet de recherche mené entre 2006 et 2014 a permis de mettre en évidence des traces de sang, déposé en milieu ouvert et donc soumis aux intempéries durant 8 années, à l’aide de ces produits de détection517. Associés à une analyse génétique, ces procédés de détection peuvent donc permettre, même plusieurs années après les faits, de matérialiser la présence d’un auteur et d’une victime blessée et saignante à l’endroit supposé d’une infraction, ou de retrouver des traces de sang altérées sur des vêtements et des objets prélevés sur scènes d’infraction anciennes. Le dépérissement des preuves par ces progrès est encore repoussé d’autant.
3) Techniques de trajectographie / Modélisation 3D. Depuis 2007, l’IRCGN met en œuvre, au sein de l’Unité d’Expertise « Mesure-Modélisation », un laser-scanner 3D. L’expérience accumulée au cours des nombreuses utilisations de cet appareil a montré l’étendue de ses possibilités dans de multiples domaines d’expertise, notamment la morpho-analyse des traces de sang518. Le résultat est également exploitable par les enquêteurs, les magistrats et permet également la création d’animations 3D afin d’illustrer les conclusions d’expertises lors des procès d’Assises519.
Une autre plus-value apportée par le laser-scanner peut être illustrée par un cas réel récent (2009). Il concerne une scène d’infraction sanglante entièrement altérée avant l’intervention des techniciens en identification criminelle. Seules quelques photographies des lieux (réalisées sans protocole particulier) sont disponibles. Le laser-scanner va alors être utilisé afin de reconstruire cette scène « effacée » pour laquelle le dépérissement des preuves apparaissait évident à tous les enquêteurs et magistrats. Cette reconstitution a permis en vue d’une morpho-analyse des traces de sang et à une expertise balistique. En permettant aux experts : de se déplacer « virtuellement » sur la scène d’infraction ; d’observer les traces dans leur environnement de découverte, malgré leur altération/disparition ; et de réaliser des études techniques (prises de mesures, études de convergences et de trajectoires).
À ce jour, la modélisation 3D est la seule technique criminalistique à :
- Offrir la possibilité à tout expert, de refaire et confronter les analyses ayant abouti aux résultats énoncés.
- Permettre, lors d’opérations de reconstitution ou de jugement, de présenter visuellement la scène d’infraction telle qu’elle était au moment de sa numérisation, nonobstant le délai parfois important du déroulement du procès pénal qui peut parfois engendrer une altération telle des traces et indices, que ces derniers peuvent ne plus présenter un réel intérêt criminalistique.
- Offrir la possibilité de présenter et discuter les hypothèses et conclusions au travers du modèle 3D qui est une copie conforme de la scène sanglante depuis longtemps disparue. Et qui peut être enrichie, au fur et à mesure, des résultats d’expertises futures compatibles avec la modélisation 3D520.
2.2.3 L’IRCGN a développé deux spécialités dont les progrès offrent des possibilités d’analyses résistantes au temps et au dépérissement des preuves, il s’agit de la palynologie légale et de l’identification moléculaires des espèces animales521.
Un lieu, un viol, un suspect, des déclarations confuses, un massif de fleurs, et des analyses ADN négatives... Pourtant bien que trop souvent négligé522, un élément existe : le pollen. Cet indice, de quelques micromètres est redoutable et largement utilisé par les laboratoires de police scientifique des pays anglo-saxons de l’hémisphère sud (Australie, nouvelle Zélande), Japon, Grande-Bretagne523 et Etat Unis524 (FBI en matière d’antiterrorisme afin de déterminer l’origine géographique d’objets explosifs). Il permet en effet d’établir un lien entre un objet ou une personne, et un milieu floristique525. Depuis 2004, le département Faune et Flore Forensique de l’IRCGN, travaille sur tous les indices d’origine naturelle, et apporte aux enquêteurs et aux magistrats son expertise en matière d’étude des pollens.
Le principe de base de la palynologie légale est simple : à chaque espèce végétale correspond un grain de pollen ou une spore (par convention, le terme de pollen regroupe aussi les spores) qui lui est propre. Ces gamétophytes mâles se caractérisent par plusieurs éléments morphologiques (la taille des grains, la forme, le type de sculpture de l’exine, la disposition et le type d’apertures, etc.) dont la combinaison permet d’identifier un type pollinique.
L’association de plusieurs types polliniques (c’est-à-dire de plusieurs pollens différents) constitue une empreinte pollinique caractéristique d’une formation végétale.
Une particularité des pollens qui à son importance en criminalistique, est leur extrême résistance aux agressions chimiques qui leur permettent de perdurer dans le temps (les pollens étant utilisés en paléo palynologie qui est l’étude rétrospective des pollens et spores en tant qu’indices permettant de reconstituer les âges relatifs, les paléo environnements, paléoclimats d’un passé plus ou moins récent à très anciens). Cette caractéristique est essentiellement due à la composition de sa surface extérieure, l’exine, qui contient de la sporopollénine. Cette dernière est l’un des matériaux les plus résistants du monde organique limitant toute attaque enzymatique et chimique.
À l’heure actuelle, la méthode privilégiée réside dans la comparaison des différents grains de pollen extraits d’un échantillon de question (vêtements, objets non lisses...) et de comparaison (fleur ou fragments de plantes...). Dans cette analyse quantitative et qualitative, les types polliniques différents apportent toute la pertinence à la réponse fournie526.
Il est également possible d’effectuer une recherche ciblée de pollens, à l’instar du Cannabis sp. sur différents supports. Ainsi il est possible de527 :
- lier une personne à de la manipulation de plants de Cannabis sp.
- déterminer si la culture de plant de cannabis a été réalisée dans un milieu confiné (cave, garage,…) ou en extérieur ,
- évaluer l’appartenance de plusieurs échantillons de résine ou de pains d’herbe de cannabis à un même lot.
Les grains de pollen, marqueurs de milieu, extrêmement résistants dans le temps, constituent un allié de choix pour les enquêteurs, notamment lorsqu’il s’agit de réduire une liste de suspects ou de réfuter un alibi528. La palynologie légale est une nouvelle illustration du principe d’échange de Locard où tout objet ou personne est susceptible d’apporter ou d’emporter des éléments du milieu qu’il fréquente529. Leur extrême résistance au temps permet des analyses de nombreuses années plus tard sans qu’il y ait eu un dépérissement des éléments de preuve.
Les grains de pollen sont à considérer en criminalistique comme tout autre indice matériel.
S’agissant des progrès dans l’identification moléculaire des espèces animales, au même titre que les pollens, l’analyse d’ADN d’un animal ou de tout autre élément organique provenant d’une espèce animale530 est particulièrement intéressante pour le criminaliste et l’enquêteur. Comme une affaire en cours a pu le montrer, seul l’ADN du compagnon canin de l’agresseur a été retrouvé sur la scène de crime et le rapprochement génétique qui en a été fait parmi les animaux de compagnie des suspects a permis de confondre l’auteur.
Cette méthode consiste à déterminer le nom d’une espèce animale à partir de l’ADN contenu dans des traces de sang, du tissu mou ou des phanères (poils, plumes). Elle est similaire à l’analyse biologique de traces d’origine humaine sur le plan du prélèvement et des étapes techniques. Cependant, l’analyse porte sur l’ADN mitochondrial et non pas nucléaire531. Celui-ci résiste mieux à l’usure du temps et aux dégradations, apportant là encore des arguments en matière de non dépérissement des preuves.
Ainsi, cette discipline contribue à la bonne compréhension de la scène d’infraction. En effet, l’identification moléculaire des espèces animales apporte très souvent une nouvelle orientation à l’enquête532. Grâce à des traces d’origines animales tels que les phanères (poils, plumes), le sang, les tissus mous (peau, muscles, organes), il est possible de déterminer l’espèce d’origine, voire selon les cas, l’individualisation d’un individu en particulier. Les travaux en cours à l’IRCGN permettront d’obtenir l’identification d’un animal quelle que soit son espèce d’appartenance au plus tard dans les 2 à 3 ans.
Le champ des possibilités est alors très varié, et cette discipline s’inscrit dans un contexte d’enquête très vaste tel que la découverte de cadavre mais aussi le trafic d’espèces protégées par la convention de Washington533, les accidents, les fraudes, le vol, les sévices, etc. Dans les cas les plus complexes, elle permet d’établir un lien534 entre différents lieux et/ou différentes personnes par l’intermédiaire d’un animal.
Exemples de cas :
- détermination de l’origine de la trace organique (sang, excrément) sur une scène de crime
- détermination de l’origine animale d’un élément de corps retrouvé
- détermination de l’espèce à partir d’ivoire
- identification de poils d’animaux découverts sur un corps et chez un suspect
Quant à la recherche d’ADN humain dans les larves535, des publications existent mais sont encore très rares (moins de 10 depuis 2001). Il est possible à l’heure actuelle de retrouver de l’ADN humain (à partir de l’ADN mitochondrial et STR) dans le jabot des larves mais il reste difficile de réaliser une individualisation. Un seul cas est rapporté à ce jour. Cette présence d’ADN humain semble être fortement dépendante du stade immature de l’insecte et des conditions environnementales. Mais les recherches se poursuivent en incluant la possibilité d’analyser le sang prélevé par un moustique (un cas d’identification par cette méthode). Par contre s’agissant de ces techniques et possibilités innovantes, elles sont encore l’illustration parfaite du dépérissement des preuves qui dans ces cas extrêmes sont très rapides car liés à la durée d’une digestion animale…
2.2.4 Pour en venir sur les points cités dans la question concernant les progrès en matière olfactive, il convient de présenter l’existant et les projets en cours.
Partant de l’observation empirique que chaque personne a une odeur corporelle qui lui est propre et que parallèlement des chiens entraînés sont en capacité de marquer des pistes lors de recherches diverses (chien d’avalanche, chien de cadavre, chien de drogue, chien d’explosif,…), deux approches en vue de l’identification des hommes par leur odeur ont été réalisées. Une prônant l’utilisation de chiens spécifiquement entraînés et l’autre basée sur l’étude scientifique de l’odeur, de ses composants et des moyens analytiques nécessaires pour en extraire un spectrogramme complet des molécules la constituant. Le but étant que l’analyse permette l’individualisation des odeurs laissées sur une scène de crime en vue de l’identification de l’auteur536.
En France, nous trouvons également les deux courants. C’est ainsi que la SDPTS537 a une unité canine d’odorologie, tandis que l’IRCGN est engagé dans un développement analytique.
De quelle odeur parle-t-on ? L’odeur humaine538 regroupe une multitude de composés. Chaque personne aurait donc son empreinte odorante portant toutes les caractéristiques d’une individualisation539. Mais cette individualisation repose sur le profil entier de l’odeur et non sur quelques-uns de ces composants (qui eux peuvent être communs à plusieurs personnes voire avec des animaux)540. Sans rentrer dans le détail de tous les composants, en citer quelques-uns donne une mesure de la complexité de ce support particulièrement volatile. C’est ainsi que nous trouvons des acides, des alcools, des aldéhydes, des esters, des hydrocarbones, des cétones, des composés hétérocycliques et même des sulfures541. Ce à quoi s’ajoutent des composants liés au métabolisme de chacun, à son héritage génétique, à son alimentation comme à son environnement, aux conditions de santé, aux phéromones et autres cycles hormonaux, aux états émotionnels (au moment de l’émission de l’odeur, car des mécanismes hormonaux supplémentaires entrent alors en jeu tel que l’apport d’adrénaline par exemple), les conditions climatiques, toutes les colonies bactériennes endogènes présentes sur le corps et enfin, tous les composés exogènes portés par transfert de matières ou d’autres odeurs542. L’odeur étant in fine un composé complexe dû à plusieurs mécanismes biochimiques générant les sécrétions par les glandes apocrines, écrines et sébacées543 auxquels s’ajoute également le complément odorant provenant de l’activité bactérienne544. Ainsi chaque personne serait caractérisée par une odeur qui peut être divisée en trois sous-classes : l’odeur primaire constituée d’éléments stables dans le temps, l’odeur secondaire comprenant les constituants endogènes mais dépendants d’un régime alimentaire et des facteurs environnementaux, et l’odeur tertiaire provenant de sources exogènes telles que savons, parfums, lotions, transfert d’odeurs, etc545.
L’ensemble de ces éléments, même si certains ne sont pas toujours stables dans le temps, permet de considérer que l’identification par l’odeur est possible et dès lors que le prélèvement par contact d’un objet manipulé ou d’une trace volatile peut apporter des réponses aux enquêteurs.
Une fois présentée brièvement la complexité de l’odeur, les deux approches actuelles méritent d’être elles aussi rapidement développer afin de mieux comprendre l’état du domaine et les capacités réelles d’expertises scientifiques.
L’unité d’odorologie de la SDPTS a choisi la voie canine pour établir l’identification des personnes à partir de leurs odeurs. C’est-à-dire, l’entrainement de chiens à reconnaitre des odeurs prélevées sur des scènes de crime et à les confronter à des odeurs de suspects mais également des odeurs leurres, selon un protocole qui se veut être formel. Toutefois, ce protocole dont la procédure technique, l’absence de biais (dont celui des rapports maître/chien ou encore le nombre d’échantillons présenté au chien tant en comparaison qu’en références, est-il représentatif ou par trop limité ?) la validité, et la répétabilité n’ont pas encore été démontrés scientifiquement et font l’objet d’un rejet des instances scientifiques internationales. Il convient en effet de différencier la recherche de drogue ou le marquage d’une piste, de l’identification d’un individu dans une population. Je citerai ici les auteurs J. Vuille, A. Biedermann et F. Taroni546 : « Désigner un individu au sein d’une population de sources potentielles comme étant à l’origine d’une trace représente une tâche bien différente. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas de détecter l’odeur d’un être humain, mais de désigner catégoriquement cet être humain précis comme étant la source de l’odeur indiciaire, et sans qu’aucune méthode indépendante ne puisse ensuite venir confirmer l’indication donnée par le chien.
Que sait-on, dès lors, des performances des chiens appelés à « identifier » des suspects à partir d’odeurs prélevées sur une scène de crime ? Actuellement, seul un nombre limité de publications scientifiques abordent le sujet, et elles rapportent des résultats très variables. Premièrement, il semble que la façon de mener la procédure affecte les résultats, certains protocoles produisant plus d’erreurs que d’autres547. Les performances paraissent également varier considérablement d’un chien à l’autre et, pour le même chien, d’un jour à l’autre548. Une étude suggère que les performances d’un certain chien sont difficiles à prédire sur la base de ses performances passées549. Le fait que le chien ait eu des contacts préalables avec l’un des suspects qui lui sont présentés influence également sa réaction550. La façon dont les chiens sont formés et utilisés est également très importante : SCHOON & DE BRUIN expliquent les mauvais résultats des chiens américains comparativement aux canidés néerlandais par le fait que les premiers ne sont pas spécifiquement attribués à des tâches d’identification de suspects, et par le fait qu’ils sont uniquement formés à reconnaître l’odeur des mains (et non d’autres parties du corps)551. Une étude au moins suggère que les chiens ont de la peine à associer correctement des objets ayant été en contact avec des parties corporelles différentes de la même personne552. Ensuite, il semblerait que certaines personnes aient une odeur corporelle qui plaise particulièrement à certains chiens, ce qui provoquerait des fausses alertes. Le problème est qu’on ne sait pas actuellement, comment identifier ces personnes, et les mêmes personnes ne plaisent pas aux mêmes chiens, ce qui complique encore la chose553. L’impact des cosmétiques, du tabac ou de l’alcool sur l’odeur corporelle humaine et sur les performances du chien n’ont été que peu (ou pas) investiguées554. Le temps passé depuis la collecte de l’odeur sur la scène de crime influence également les performances des chiens555. Enfin, SETTLE et al. 556 ont noté que les performances des chiens se détériorent lorsque le maître-chien devient émotionnellement impliqué dans la procédure ».
À ces éléments doit être également rapporter le taux de faux résultats positifs (le fait qu’un chien désigne un suspect, alors même que celui-ci n’est pas à l’origine de l’odeur collectée sur la scène de crime) ce qu’au regard de l’état de la recherche, BRISBIN et al.557 résument en disant que « les chiens se trompent dans 10 à 20 % des cas ». Ce constat n’a depuis apparemment pas fait l’objet de publication scientifique démontrant le contraire. C’est pourquoi les chercheurs en ont déduit que « la capacité des chiens à associer correctement une odeur indiciaire à un suspect n’est, pour l’heure, pas établie ».
Apprécié d’un point de vue juridique, considérer cela comme une preuve matérielle fiable de nature à pouvoir faire condamner une personne mise en cause est dangereux pour une bonne administration de la justice. Il est encore impossible d’établir quelle est l’odeur exacte retenue par le chien, le complexe total ou un élément partiel ? Quelle odeur a été prélevée sur la scène ? S’agit-il d’un mélange ou d’un transfert ? Sommes-nous en présence d’une odeur primaire, secondaire ou tertiaire ? Etc. Autant de question auxquelles il n’est pas possible de répondre et c’est à bon droit qu’en 2013 la cour d’assises spéciale de Paris a refusé de se baser sur la seule analyse odorologique pour apporter la preuve de la présence d’un des mis en cause sur les lieux au moment des faits. Et les erreurs judiciaires outre-Atlantique en ce domaine ont conduit un spécialiste de la matière à écrire que « Personne ne devrait être condamné seulement sur la base du frétillement de la queue d’un chien »558.
S’agissant de l’autre approche, plus longue mais plus académique, elle se base sur la réalisation d’une large cartographie des composés organiques analysés par les techniques de chimie analytique performantes présentes au laboratoire et une approche statistique fine mettant en œuvre des outils d’analyse multi variés. Le but est de pouvoir ainsi définir les spectrogrammes de la signature corporelle humaine avec ses variations et ses constantes telles qu’elles ont été présentées supra.
Le défi est de réussir à créer un référentiel de données fiables et stables dans la durée, à partir de prélèvements d’odeurs qui évoluent naturellement comme évolue celle de l’individu lui-même dans le temps.
Actuellement, l’état de la science ne permet pas d’envisager l’odeur corporelle comme une empreinte, et on ne peut donc pas encore envisager la création de banques de données comme pour les empreintes digitales ou l’ADN.
Pour mener à bien son projet de recherche sur la signature chimique corporelle, l’IRCGN travaille avec le réseau de laboratoires franciliens « DIM Analytics »559, financé par la région Ile de France. Parallèlement, une étude de la composition des cosmétiques et parfums est réalisée par l’Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire (ISIPCA) dont l’expérience en matière d’analyses d’éléments odorants et volatils est particulièrement forte. De même, la notion de prélèvement560 fait l’objet d’une étude complète de façon à pouvoir standardiser la collecte des traces volatiles561 (encore en suspension dans une pièce par exemple) comme celle des traces déposées562. De ces modes de prélèvements dépend la pertinence de la batterie d’analyses chimiques563 afin d’établir le spectre le plus exhaustif possible de l’odeur.
Enfin, comme il a été abordé, devant la variation dans le temps de certains composés de l’odeur, actuellement son utilité dans un délai de plus de 10 ans n’est absolument pas pertinente, le fondement du délai de prescription de l’action publique sur le dépérissement de la preuve est encore une réalité pour les traces odorantes.
2.2.5 Les progrès en matière acoustique se sont développés notamment avec l’arrivée d’outil informatique électronique. Pour être plus précis, en criminalistique, il s’agit de l’exploitation des traces acoustiques564.
L’exploitation des enregistrements sonores à des fins judiciaires est en augmentation depuis de nombreuses années. Cet intérêt croissant trouve son origine dans l’apparition de technologies nouvelles comme la comparaison de voix automatique et l’usage facilité de nombreuses technologies de communication. Qu’il s’agisse d’enregistrements issus des réseaux sociaux, d’interceptions téléphoniques, de l’activité de services spécialisés, ou encore d’enregistreurs spéciaux comme les « boîtes noires », le son est souvent le vecteur d’informations cruciales pour la manifestation de la vérité. Les enregistrements sonores constituent une trace criminalistique d’un genre nouveau aux côtés des traditionnelles traces de contact ou de transfert. Support d’informations multiples, notamment en présence de parole, les enregistrements sonores sont des vestiges du passé qui permettent souvent de caractériser des sources, voire de les identifier, et de contribuer à l’établissement de l’élément matériel et de l’élément moral d’une infraction. Du point de vue biométrique, la voix ne dispose pas à ce jour du pouvoir discriminant de l’empreinte génétique ou digitale. Comparée à ces deux modalités, elle présente néanmoins l’immense avantage d’appartenir quasiment systématiquement à un auteur.
Différents traitements et méthodes constituent l’arsenal des laboratoires de criminalistique. Ils sont mis en œuvre en fonction de la nature de la question posée et des spécificités de chaque cas d’espèce. Nous décrirons ces grands domaines de façon claire et intelligible, en nous appuyant sur les références techniques qui sous-tendent l’activité quotidienne du laboratoire.
Si des progrès technologiques ont été réalisés ces vingt dernières années, il est important de garder à l’esprit que le principe de réalité finit toujours par s’imposer. Les conditions techniques des enregistrements étant la plupart du temps non contrôlées, certains obstacles continuent de s’imposer avec force. Certaines technologies sont en revanche inscrites dans une dynamique extrêmement positive, les rendant susceptibles d’apporter leur concours à la justice dans des affaires relativement anciennes. Afin de consolider cette tendance, une coopération plus étroite avec les académiques, les industriels, le ministère de la justice et la CNIL est nécessaire. Nous évoquerons aussi en filigrane les raisons pour lesquelles le « tout technologique » ne peut à lui seul maximiser le retour sur investissement et la réussite de certaines expertises car dans les faits, la captation du signal sonore par les dispositifs de télé-protection est bien souvent réalisée au travers d’équipements qui ne sont, la plupart du temps, pas déployés en fonction d’une réelle stratégie de sécurité. Ce maillon faible constitue parfois un obstacle dont aucune technologie ne parviendra pas à venir à bout à elle seule. La situation est comparable avec celle que connaissait notre pays en matière de vidéo-protection avant la rédaction d’un arrêté technique en 2007 qui visait à rapprocher les spécifications des installations avec les besoins réels des forces de sécurité intérieure. Ces recommandations sont globalement accueillies avec bienveillance par l’ensemble des acteurs, et sont à ce jour en cours de rafraîchissement.
1) Le rehaussement et la transcription des enregistrements sonores
Il est fréquent que des enregistrements sonores soient partiellement ou complètement inintelligibles pour les personnes en charge de leur exploitation. Outre l’emploi d’une langue étrangère par les locuteurs, un nombre important de causes techniques, situationnelles, ou environnementales aboutit à cette situation. Le plus souvent, c’est une combinaison de ces causes qui nuit à l’intelligibilité des propos enregistrés.
Le rehaussement d’un enregistrement sonore consiste à mettre en œuvre des techniques issues du traitement du signal et ayant pour objectif de faire ressortir davantage le signal utile. Ce domaine d’activité débouche assez souvent sur une transcription au niveau mot. Abusivement appelée « débruitage », cette activité ne peut dans les faits se limiter à l’atténuation complète des bruits, distorsions, ou signaux parasites présents. Une telle stratégie aboutit en général à une amélioration de la qualité de l’enregistrement (confort d’écoute) tout en dégradant paradoxalement l’intelligibilité par manque de sélectivité. Il s’agit tout d’abord d’établir un inventaire des phénomènes physiques qui expliquent les dégradations tout en appliquant le niveau de rehaussement tout juste nécessaire. Certains enregistrements moins qualitatifs sont parfois plus intelligibles.
Parmi les principales technologies qui ont connu des développements ces vingt dernières années, on peut citer par exemple le filtrage adaptatif565, le traitement multi-canal566, et la séparation de sources567. Si ces techniques sont encore loin d’êtres applicables à tous les cas de figure, elles donnent d’excellents résultats dans des conditions proches des conditions « de laboratoire ». Certains enregistrements en provenance des unités de terrain réunissent ces conditions mais dans de faibles proportions. Les trois méthodes évoquées permettent de séparer des voix superposées et appartenant à des locuteurs différents, ou encore de cibler spécifiquement des signaux parasites dont les caractéristiques évoluent dans le temps en vue de les isoler. Le traitement multi-canal suppose la présence de plusieurs micros. La plupart du temps, seules quelques sonorisations issues de l’activité de services dédiés sont concernées. L’exploitation conjointe des différents enregistrements simultanés donne en général d’excellents résultats. Malheureusement, ce type de configuration est très rare.
Qu’il s’agisse du rehaussement à proprement parler ou de la transcription, il n’existe à ce jour aucune méthode entièrement automatique qui permette à des non spécialistes d’obtenir des résultats satisfaisants en cliquant sur un simple bouton. Quelques applications dédiées à la criminalistique sont apparues sur le marché mais elles nécessitent un certain niveau de formation pour être utilisées.
2) La comparaison de voix
La comparaison de voix est une discipline qui vise à confronter la voix d’un locuteur dont l’identité est inconnue (trace) à celle d’un locuteur dont l’identité est connue (échantillon de référence ou de comparaison) en vue d’établir ou non un rapprochement. La question sous-jacente est donc clairement celle de l’inférence de l’identité568 et son corolaire d’un traitement automatisé permettant l’identification dans une base de comparaison et de référence569. Malgré un pouvoir discriminant moindre, la voix est une modalité biométrique dont la présence aux côtés de l’ADN et de l’empreinte digitale est indéniable au sein de l’arsenal criminalistique.
Le recours croissant à cette discipline s’explique par le développement incessant des applications/équipements/infrastructures facilitant la transmission du signal de parole au travers de supports et d’usages toujours plus variés et fréquents. Dans le même temps, et plus particulièrement en ce qui concerne les interceptions téléphoniques, il n’est plus possible d’associer aveuglément un individu à un numéro de téléphone. En effet, le changement fréquent de carte SIM par les délinquants est aujourd’hui devenu un acte réflexe.
La multiplication des supports de transmission de la voix implique un revers : celui d’une variabilité accrue venant dégrader les performances des systèmes automatiques. La voix comporte par ailleurs une variabilité intrinsèque lui conférant le caractère de modalité biométrique non seulement physiologique mais aussi comportementale570. Ces éléments contribuent à rendre plus complexe l’interprétation des résultats obtenus. Pour simplifier, on peut ordonner cette variabilité selon deux facteurs :
6. facteurs endogènes : en tant que « matière vivante », la voix possède son propre cycle de vie et évolue donc au cours du temps ; ses caractéristiques varient en outre selon le contexte d’énonciation.
7. facteurs exogènes : la diversité des supports de captation et de transmission qui constituent son « support » de prélèvement a pour conséquence de produire des manifestations variables d’une même voix.
Afin de prendre en compte l’ensemble des contraintes précédentes, il est obligatoire de recourir à des modèles statistiques. Les approches classiques de comparaison de voix abordent l’analyse sous l’angle de la phonétique qui vise à décrire et mesurer, à partir de la réalisation des sons, des indices acoustiques parmi les plus discriminants571. Travaillant au plus près de la matière vocale, ces approches souffrent fréquemment d’un déficit de données de référence et sont chronophages. Elles présentent l’avantage d’une plus grande exhaustivité dans l’approche.
Depuis une vingtaine d’années, l’approche dite automatique a connu des développements très importants572. Le vocable automatique renvoie aux tâches d’extraction des descripteurs d’un locuteur, fondés sur les caractéristiques physiques de son conduit vocal, et de sa modélisation statistique. En marge du développement de ces outils automatiques, un formalisme propre à l’évaluation de la force probante des éléments issus d’une telle comparaison, a été promu et adopté assez largement par la communauté573.
Les performances des systèmes automatiques progressent, en particulier depuis 2008, au rythme des campagnes d’évaluation internationales et de la quantité de données, toujours plus importante, utilisée pour l’apprentissage statistique qui sous-tend ces technologies. Ces évolutions ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité de disposer de systèmes calibrés au regard de la diversité des canaux de transmissions (téléphonie cellulaire et fixe, voix sur IP, Skype, compression vidéo) susceptibles d’être empruntés par les voix qui sont soumises pour analyse574. La connaissance de la fiabilité d’un système, mesurée au travers de la qualité de sa calibration, est un préalable nécessaire à toute interprétation des résultats575.
Dans la pratique, une analyse exhaustive nécessite pour un laboratoire d’être en capacité :
- de disposer de données annotées et représentatives du cas d’espèce ;
- de disposer de systèmes automatiques développés sur la base des algorithmes issus de l’état de l’art576, voire d’adapter un système ad hoc en fonction des caractéristiques techniques du cas d’espèce.
- de manière plus générale, d’appliquer les prescriptions de l’ENFSI577 relatives à l’exploitation d’échantillons de voix en vue d’une comparaison.
3) L’authentification
L’authentification consiste à rechercher sur un enregistrement audio des indices tendant à établir la présence de manipulations éventuelles578. Il s’agit typiquement d’une problématique asymétrique pour laquelle l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence.
Différentes méthodes ont été développées par la communauté scientifique. L’avènement du numérique a orienté un certain nombre d’entre elles vers des approches spécifiques à certains formats de fichier579 comme pour détecter les montages580. Considérant la délinquance courante, le ratio de l’effort à consentir en matière de recherche et de développement sur le nombre de sollicitations se révèle assez défavorable. Le besoin d’authentification semble plus prononcé en matière de contentieux civil. En matière de justice pénale, il n’en demeure pas moins que les besoins exprimés ont quasiment toujours un lien avec des affaires sensibles, et que la menace terroriste devrait nourrir un intérêt croissant pour cette discipline.
Récemment, une approche ciblant la datation d’un enregistrement audio a vu le jour581. Fondées sur l’extraction de signaux en rapport avec les variations du réseau électrique à proximité de l’enregistreur, la datation et la détection de ruptures sont rendues possibles582. Pour appliquer cette méthode, un laboratoire doit :
• procéder à l’enregistrement permanent des variations de la fréquence électrique afin de constituer une base de référence ;
• disposer d’une méthode robuste d’extraction de la composante recherchée583.
Malheureusement, il convient de préciser que tous les enregistrements ne comportent pas nécessairement un vestige de perturbations en rapport avec le réseau électrique au moment de l’enregistrement. Les conditions de "contamination" sont spécifiques à certaines circonstances de l’enregistrement (raccordement au secteur des équipements notamment).
4) Conclusion et perspectives : un état des besoins
Dans le contexte actuel, la délinquance « traditionnelle » et la menace terroriste divisent l’action judiciaire en deux échelles de temps très distinctes. L’exploitation des traces « technologiques », selon le cas, doit aboutir in fine à la caractérisation des faits et des auteurs, ou à l’élaboration très rapide d’un renseignement permettant d’interrompre des actes préparatoires ou des commencements d’exécution. En ce qui concerne les enregistrements sonores, la technologie a fait un certain nombre de progrès extrêmement significatifs sans pour autant garantir à elle seule la production de sécurité attendue.
La reconnaissance du locuteur automatique est sans aucun doute le domaine qui a été le plus dynamique ces vingt dernières années. Cette technologie est aujourd’hui suffisamment mature pour permettre la constitution de fichiers dont l’emploi serait conforme au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ou au Fichier National des Empreintes Génétiques (FNAEG). La force discriminante de la voix étant néanmoins très inférieure à celle de l’ADN ou des crêtes papillaires, un tel fichier ne peut être considéré que comme un outil de renseignement technique destiné à orienter une enquête.
Les enregistrements injectés au sein d’un tel système peuvent être considérés comme des enregistrements de référence (identité du locuteur connue) ou comme des requêtes (identité du locuteur inconnue). La constitution de traces non résolues (le locuteur est considéré comme un auteur mais son identité est inconnue) permettant d’effectuer des recoupements est envisageable. Les sources d’enregistrement peuvent être multiples (interceptions, vidéos postées sur internet,…). La principale limite relève de la qualité des enregistrements mais aussi du « vieillissement » de la voix. Actuellement l’état de l’art conduit à écarter du système des échantillons dont l’ancienneté est supérieure à dix ans (dispositifs d’enregistrements différents donc écrêtant les signaux rendant impossible toute comparaison avec les nouveaux appareils).
Les services d’enquête sont aussi confrontés à la problématique de la transcription des enregistrements sonores. Il est clair qu’un système de transcription automatique robuste, éventuellement capable de produire des traductions, permettrait à l’ensemble des acteurs de gagner en efficacité. Le passage du signal de parole au texte est par ailleurs un préalable nécessaire à l’exploitation « intelligente » des enregistrements sonores : analyse sémantique, établissement de schémas relationnels, résumés, détection de mots-clés… Des technologies performantes sont disponibles au sein de la communauté académique mais elles ne sont pas immédiatement transposables au contexte de l’enquête judiciaire. Étant basés sur des principes de reconnaissance de forme et d’apprentissage automatique, ces outils ont besoin de données représentatives pour atteindre un niveau de performance acceptable (moins d’erreur pour moins d’intervention humaine). L’extrême variabilité dans la qualité des enregistrements et le style de paroles sont autant d’obstacles qui justifient une coopération plus étroite entre les développeurs de ces systèmes et les détenteurs des données nécessaires à l’élaboration des modèles mathématiques sous-jacents. La Plateforme Nationale d’Interception Judiciaire (PNIJ) devrait disposer à terme des données nécessaires à l’élaboration des modèles de langage représentatifs du « cas judiciaire ». Cette plateforme du ministère de la justice bénéficierait par ailleurs de données permettant au système de reconnaissance automatique du locuteur de progresser de façon extrêmement significative.
À côté des progrès technologiques, nous avons démontré l’importance d’une plus grande coopération interministérielle et d’une collaboration encadrée avec les académiques et les industriels. Certaines propositions nécessitent par ailleurs une mise à jour du cadre juridique. Des technologies efficaces sont disponibles et rendent aujourd’hui de nombreux services. Certaines d’entre elles continueront de souffrir d’un manque de robustesse si une stratégie cohérente et respectueuse d’un droit « réformé » n’est pas mise en place pour l’échange de données pouvant être anonymisées entre les différents acteurs.
Enfin, l’harmonisation des modes d’enregistrements comme de stockage sans déformation du signal permettra alors de pouvoir consulter et comparer dans le temps les voix ainsi collationnées à l’occasion d’affaires judiciaires voire si l’évolution du droit le permet par prélèvement biométrique des personnes mises en causes à l’instar du FNAEG et du FAED. Si de telles conditions étaient réunies, le dépérissement de la preuve acoustique ne tiendrait plus à l’obsolescence du matériel et pourrait ainsi perdurer au même titre que d’autres traces.
3. Quelle place l’exploitation des empreintes digitales et génétiques a-t-elle prise dans les investigations au cours des vingt dernières années ? Quel degré de fiabilité peut-on attacher à l’exploitation de ces empreintes ?
Alors que dans la majorité des pays, la criminalistique est appréciée pour l’ensemble de ses domaines scientifiques, la France a vu se développer dans l’inconscient collectif et administratif une prépotence des empreintes papillaires et des empreintes génétiques. Fortement liés aux grands fichiers nationaux que sont le FAED et le FNAEG, ces deux domaines ont écrasé la vision globale des traces sur une scène d’infraction pour n’en retenir que celles susceptibles d’identifier les individus et cela même si la pertinence des résultats n’est pas toujours au rendez-vous.
A.3 Les empreintes digitales
3.1 Les progrès en la matière
Au cours de ces vingt dernières années, des évolutions majeures ont eu lieu en matière de traces digitales. Des techniques performantes de révélation de traces ont permis de révéler un nombre toujours plus grand de traces là où il était difficilement concevable de pouvoir obtenir un résultat.
3.1.1 La composition d’une trace papillaire
Les traces papillaires laissées sur un support après contact sont composées d’un mélange de différentes sécrétions émises par les glandes de la peau réparties sur différentes zones du corps humain (glandes écrines, apocrines et sébacées)584. Les traces papillaires sont ainsi constituées de plus de 300 composés chimiques parmi lesquels l’eau (provenant de la sueur), les sels inorganiques, les acides aminés ou les acides gras. L’eau, qui demeure l’élément prépondérant des traces papillaires, est un élément éphémère (soumis à l’évaporation) et non spécifique aux traces papillaires585. La composition des traces va donc varier d’un donneur à l’autre (intervariabilité), mais également pour un même donneur (intravariabilité), en fonction des différents paramètres référencés dans la littérature comme l’âge du donneur, l’alimentation, l’hygiène, la présence de contaminants, l’activité physique, l’état de santé ou encore la durée d’apposition des traces586.
Cette parfaite connaissance de la composition des traces a permis de mettre au point des méthodes de révélation plus sensibles et plus spécifiques, notamment en ciblant les acides aminés ou les composés gras des traces papillaires. Par exemple, lorsqu’un support poreux a été mouillé, les acides aminés sont "lavés". Il est toutefois encore possible de révéler des traces en ciblant les acides gras587.
3.1.2 Les progrès dans la révélation des empreintes digitales
La luminescence
Un point essentiel dans la révélation des traces papillaires est l’obtention d’un bon contraste entre la trace et son support. La luminescence des traces est donc particulièrement recherchée.
Ainsi, la ninhydrine* qui cible les acides aminés s’est déclinée en un grand nombre de dérivés. Le DFO588 était jusqu’à la fin des années 2000 un des dérivés les plus utilisés. Il est maintenant largement remplacé par l’1,2-Indanedione/ZnCl2589. Grâce à un système de filtre lumineux, cette technique permet d’obtenir une éclatante trace jaune/orange sur fond noir.
À la fin des années 2000, de nombreux colorants du sang ont également été optimisés. Un colorant luminescent comme l’AY7* reformulé au sein de l’IRCGN590 est maintenant disponible pour rehausser les traces ensanglantées sans préjudice d’une analyse ADN ultérieure.
Avec l’arrivée du Lumicyano591, il est possible d’obtenir directement une trace jaune luminescente sur certains supports particuliers. Ce cyanoacrylate* incorpore un composé luminescent qui permet de détecter les traces même sur fond blanc, tout en évitant une 2ème étape de coloration risquant d’effacer la trace.
L’arrivée de lampe laser (532 et 577 nm) et plus généralement de moyens optiques performants a permis de mettre en évidence des traces papillaires avant traitement. À l’issue de leur exploitation, ces traces peuvent sans dommage être prélevées en vue d’une analyse ADN.
Nanoparticules :
Commercialisées sous forme de poudres utilisées sur scène de crime, elles offrent des perspectives de révélation intéressante. Mises en suspension, elles permettent de traiter des supports ayant été mouillés ou d’améliorer un traitement (SMD II*)592.
Les dernières recherches portent sur l’utilisation d’anticorps spécifiques à certaines protéines contenues dans les traces. Il s’agit de nanoparticules d’argent auxquelles sont ajoutés différents types d’anticorps. Ces nanoparticules sont fonctionnalisées pour permettre la détection de drogues ou d’explosifs dans les traces ou simplement pour permettre leur révélation.
Imagerie chimique :
Des protocoles utilisant les instruments d’analyse chimique usuels sont testés afin d’explorer la possibilité de détecter les traces grâce à des contaminations accidentelles particulières (drogues)593 ou volontaires (poudres spécialement conçues, Analytical chemistry] ; après fumigation de cyanoacrylate*594.
Scène de crime :
Développement de système de fumigation* de cyanoacrylate portatif. Ces systèmes toujours plus compact et performant permettent de déplacer le laboratoire sur la scène de crime595. Cette technique a montré également son efficacité par rapport à l’utilisation des poudres596.
Prélèvement des traces :
De plus en plus d’unités utilisent des feuilles de gélatine au lieu de ruban adhésif pour prélever les traces révélées à la poudre sur scène de crime597. Cette innovation technique a permis au sein de la gendarmerie d’augmenter la qualité des traces transmises pour exploitation.
Photographie et traitements numériques
L’utilisation des appareils photographiques numériques permet de ne plus systématiquement prélever les traces papillaires. L’augmentation de la résolution des appareils, l’utilisation de matériel informatique performant et de haute définition ainsi que le choix de logiciels adaptés (CSIpix, PiAnoS...) permettent à l’expert de travailler avec une haute qualité de trace. Il peut ainsi observer l’infiniment petit et donc se servir de la forme des bords de crêtes (crêtoscopie) et des pores (poroscopie) pour soutenir une identification598.
3.1.3 Exploitation des résultats
Méthodologie :
ACE-V*, cette méthodologie a pour but de poser les étapes primordiales de l’exploitation d’une trace ou empreinte papillaire.
Un groupe de réflexion (SWGFAST, Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology) particulièrement actif propose des normes à respecter pour arriver à une exploitation plus transparente et rigoureuse des traces599. L’ensemble des démarches vont vers l’explicitation du processus de décision des experts, la standardisation des pratiques et la minimisation du risque d’erreur.
Systèmes automatisés :
Les progrès en matière d’exploitation automatisée des traces papillaires concernent aussi bien la procédure d’alimentation de la base de données que le système d’exploitation. Ainsi, l’insertion des relevés palmaires depuis 2010 a permis une augmentation significative des identifications. Les efforts faits par les unités de terrain concernant la qualité des encrages, la systématisation des signalements pour tout auteur de délit et la remontée numérique des données via des bornes décentralisées (bornes T4 par exemple) ont fait progresser la qualité, le nombre de fiches enregistrées dans la base FAED et donc le nombre d’identifications. Les unités de terrain, notamment les CIC, sont désormais dotées d’appareils photographiques leur permettant d’effectuer des photographies de traces de qualité, ce qui a considérablement augmenté le nombre de traces transmises au FAED (environ 25000 traces transmises en 2014).
Des entreprises développent également des appareils, de type tablettes, permettant de prélever les traces sur une scène de crime et de la comparer directement avec les empreintes des familiers qui auront préalablement été enregistrées avec le même système.
3.2 La fiabilité des empreintes digitales.600
Pour résumer le problème, la fiabilité des empreintes papillaires ne tient pas à leur révélation, mais à leur interprétation.
Pourtant, l’histoire de la criminalistique montre tout le potentiel qu’elles portent en elles-mêmes : identifiantes, identificatrices et individualisantes y compris entre jumeaux univitellins601. Et si dans un premier temps leur attrait permit de se concentrer sur l’identification des récidivistes d’une manière plus aisée que le bertillonnage (ou anthropologie judiciaire), le développement très rapide des moyens de les révéler sur différents supports602 en a fait une trace à la valeur indiciaire forte. Ainsi sur la scène de crime, les ASPTS de la PN et les TICP et les TIC de la GN recherchent ce genre de traces papillaires. Selon le niveau de qualification de ces techniciens (niveau de qualification acquis en interne), ils peuvent utiliser différents procédés de révélations et de prélèvements603 sur la scène proprement dite, et en cas de possible présence d’empreintes sur des supports particuliers, les objets sont prélevés et traités dans un deuxième temps sur le plateau technique local pour les révéler. Les traitements alors mis en œuvre sont (selon les moyens techniques du plateau et le niveau de l’agent ou du technicien) beaucoup plus complexes et nécessitent pour certains l’application de véritables procédures scientifiques de véritables traitements physicochimiques.
À la lecture de certaines annexes de procès-verbaux, il reste un peu étonnant de ne pas voir détaillé, de discussion (ou développement) permettant d’apprécier la démonstration scientifique qui devrait être faite à la fois pour expliquer pourquoi la trace ainsi révélée est considérée comme exploitable (c’est-à-dire que sa qualité doit permettre de la comparer avec d’autres traces et aux empreintes digitales détenues au sein du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales). Déjà à ce stade, malgré la croyance populaire de la simplicité de comparaison, qui ne serait liée qu’à une observation, la qualité de la trace digitale peut parfaitement faire l’objet d’un débat scientifique sur ce qui est bien l’apposition non déformée du relief digital et qui peut servir utilement à toute comparaison de ce qui sont peut-être des entrelacs dus à une superposition d’empreintes, ou des déformations résultant d’un glissement du doigt ou de la paume créant ainsi des artefacts et des dessins digitaux non pertinents604. À cette seule remarque, les premières questions de bon sens devraient venir alors naturellement aux acteurs du procès pénal : qu’est-ce qui permet à cet agent de retenir comme valable, déterminant et appartenant bien à la source (doigt ou paume ayant laissée l’empreinte) un point, une ligne ou toute autre caractéristique des dessins digitaux ou minuties605, et d’ignorer tout autre point, ligne ou dessin en le considérant comme un accident ou une déformation lors du dépôt ? Quelle est sa démarche scientifique qui l’autorise à ne pas les retenir car ils ne correspondent pas aux détails qu’il a trouvés dans une empreinte ou une autre trace de comparaison ? Son interprétation est pourtant déterminante car elle va conduire soit à une identification soit à une exclusion d’une personne mise en cause.
- Exemple de résultat d’identification mis en annexe de procès-verbal de constatation
(à gauche nous avons l’empreinte issue du relevé décadactylaire de la personne signalisée, à droite nous avons la trace papillaire de bonne qualité révélée sur la scène d’infraction). Seul le nombre de concordances et l’absence de discordance inexplicables accompagnent en légende ce résultat qui est l’interprétation du personnel ayant réalisé l’examen technique dans le cadre des constatations sans autre explication détaillée. Ce qui est dommage car même si la trace est considérée comme exploitable et de bonne qualité par lesdits spécialistes, il semblerait pertinent que pour apprécier à sa juste valeur cette trace déterminante dans la construction de la preuve, ce rapprochement mérite une démonstration a minima plus élaborée que ces seuls repères sur les photographies.
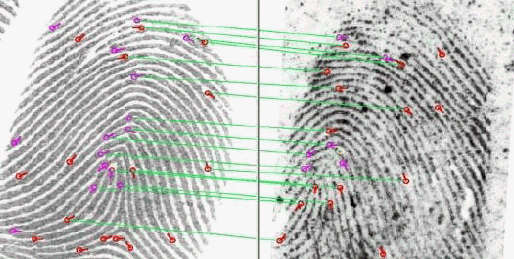
Il est particulièrement étonnant, voire dommageable pour le débat juridique, dont le contradictoire est un principe essentiel, qu’à ce stade de la procédure le seul résultat exposé et joint à la procédure (sans la rédaction d’un rapport complet) par un agent ou un technicien (dont la formation, les connaissances scientifiques, les capacités d’interprétation, la méthodologie, la démonstration, etc., sont totalement inconnues et ignorées des acteurs du procès pénal), soit déjà considéré comme une preuve matérielle à forte valeur probante. La réponse fournie généralement pour étayer ce résultat est que la trace montre au moins 12 points de concordance et que les dissemblances sont dues à la déformation du doigt sur le support ou que l’empreinte est glissée. Là encore c’est méconnaitre la morphogénèse des dessins digitaux606, et confondre éléments historiques avec la réalité scientifique.
Depuis les travaux de Locard607 sur le sujet après la publication de Balthazard608 sur son appréciation probabiliste du nombre de points commun nécessaires pour l’identification et de l’individualisation et la démonstration de Bertillon qui estimait 12 points possibles mais leur préférait a minima 16 points609 (suite à son article montrant des ressemblances artificielles obtenues par découpages), un nombre de douze points ou minuties fut généralement retenu. Dès lors dans de nombreux services, la « règle » empirique des 12 points s’imposa, seul le service de l’identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, fidèle à son fondateur, appliqua jusqu’à la fin du XXème siècle la règle des 16/17 points de Bertillon.
Mais là encore la difficulté réside dans le type de point caractéristique retenu et de l’absence certaine de dissemblances. En effet, selon la partie du doigt considérée tous les points caractéristiques n’ont pas la même valeur probante en termes de rareté. De même, comme l’a montré Locard610 et de nombreux auteurs à sa suite, certaines caractéristiques comme les pores (qui bien que fortement distinctives et mesurables ne sont pas considérées comme des minuties, de fait ne comptent pas dans le calcul empirique des 12 points caractéristiques) ou le nombre de crêtes leur écart et leur mesure, ou encore d’autres formes rares, et en l’absence de dissemblances inexplicables611, permettent d’identifier une empreinte même partielle et dégradée, et ce en retenant un nombre de caractéristiques bien inférieur à 12 dès lors que leur rareté est remarquable.
Malgré cela certains services dits spécialisés désignés dans le cadre de l’article D7 du code de procédure pénale, refusent de prononcer une identification sur moins de 12 minuties concordantes et ce même s’il n’y a pas de discordance, considérant la trace papillaire sans aucune valeur, et ce par ignorance de la force probante que peut apporter la rareté de certains points qui dans une démonstration de probabilité simple peut démontrer que 8 minuties rares et combinées ont plus de force probante pour l’identification qu’une vingtaine de minuties communes sans rareté ni combinaison particulière. Les dits spécialistes restreignent leurs résultats à un univers déterministe réduit à un nombre « d’or » de 12 points minimum permettant de retenir l’identification ou l’exclusion.612
La thèse de C. Champod613 détaille tout le poids (ou force probante) que peuvent avoir certaines minuties ou caractéristiques selon leur rareté.
Dans ses démonstrations, il expose et affine les nombreuses recherches qui ont été faites sur le sujet montrant les différents poids probabilistes qui ont été relevés pour différents types de minuties :
Auteurs Base des calculs de probabilités de fréquence des minuties |
Gupta614 Réf : 1000 ulnaires |
Osterburg & al.615 Réf : 39 ED – 8591 cellules de 1mm² |
Lin & al.616 Réf : 76 ED 14280 minuties | |
Type de Minuties |
Fréquence des minuties par rapport au nombre total d’observations (présentes et absentes) | |||
Arrêt |
|
0.075 |
0.0832 |
0.096 |
Bifurcation |
|
0.080 |
0.0382 |
0.026 |
Crochet |
|
0.020 |
0.0075 |
0.0048 |
Déviation |
|
0.009 |
Non pris en considération |
Non pris en considération |
Pont |
|
0.008 |
0.0122 |
Non pris en considération |
Lac |
|
0.025 |
0.0064 |
0.0017 |
Point |
|
0.035 |
0.0151 |
0.0052 |
Croisement |
|
0.005 |
Non pris en considération |
Non pris en considération |
Transversal |
|
0.005 |
Non pris en considération |
Non pris en considération |
Retour |
|
0.008 |
Non pris en considération |
Non pris en considération |
Double bifurcation |
|
Non pris en considération |
0.0014 |
0.0027 |
Trifurcation |
|
Non pris en considération |
0.0009 |
Non pris en considération |
Ligne angulaire |
|
Non pris en considération |
Non pris en considération |
0.0027 |
Delta |
|
Non pris en considération |
0.0020 |
Non pris en considération |
Occurrence multiple |
|
Non pris en considération |
0.0355 |
Non pris en considération |
Absence de minutie |
|
Non pris en considération |
0.7660 |
0.839 |
Depuis ces travaux, de nombreuses autres études sont encore venues confirmer en étudiant à partir de milliers d’empreintes, la rareté de certaines minuties et la possibilité d’identification formelle par certaines combinaisons de quelques points dont la probabilité de fréquence est extrêmement faible617.
Ainsi l’identification d’une empreinte ne se limite pas à une simple comptabilité des points concordants618, une véritable démonstration est attendue pour expliquer les observations, les choix de points caractéristiques retenus de ceux qui sont écartés, etc. Se baser sur un standard numérique qui n’existe que dans un usage coutumier et empirique de certains services spécialisés est un non-sens scientifique. C’est pourquoi, les scientifiques nord-américains sous l’impulsion de l’I.A.I. (International Association for Identification) ont exclu en 1973 toute norme numérique minimale619. Le congrès international de dactyloscopie de 1995 réunissant 11 nations (dont la France, représentée par l’IRCGN) ont repris les conclusions de l’IAI et les ont précisés pour retenir le principe « aucune base scientifique n’existe pour exiger qu’un nombre prédéterminé de particularités de crête papillaire minimum soit présent dans deux empreintes pour établir une identification positive »620.
La nature réelle de l’interprétation d’une trace papillaire en vue de l’identification est probabiliste et non pas déterministe comme l’usage empirique existant encore en France le laisserait supposer. Les travaux probabilistes que C. Champod a réalisés pour sa thèse621 montrent que pour une configuration de six minuties, une valeur de probabilité supérieure à un sur un milliard est très vite atteinte selon la rareté et les combinaisons rencontrées ainsi que la prise en compte de détails comme les pores par exemple. L’avancée des recherches et des connaissances en matière d’empreintes digitales est telle que les positions des organismes internationaux considèrent aujourd’hui que l’identification par ce procédé ne peut être basée que sur un modèle statistique622,623 tel que celui qui est accepté et utilisé pour l’identification à partir des profils génétiques.
Mais dès lors que l’on rentre dans ce champ où la démonstration scientifique est indubitablement nécessaire, le simple technicien est totalement déstabilisé car non formé à ce niveau de compétence, alors que l’application aveugle d’un nombre « d’or » de 12 points lui évite toute justification devant les enquêteurs, les juges ou au prétoire. Et au-delà, le traitement et cette façon par trop empirique et simpliste de procéder à l’identification de l’empreinte digitale dans le cadre des opérations dites de constatations, offre un confort d’irresponsabilité juridique pour bon nombre de magistrats qui ainsi n’ont pas à se poser des questions sur la valeur réelle de la trace papillaire qui lui est servie ainsi parée de l’image d’infaillibilité.
À cela s’ajoute également la méconnaissance du mécanisme624 qui après avoir intégré la trace révélée dans le FAED et au regard d’un certain nombre de propositions faites par le système Morpho (système informatique qui gère le FAED) permet à ce même technicien de retenir celle qu’il estime avoir la même source (identifiant la personne qui est à l’origine du dépôt du dessin digital) ou au contraire lorsqu’un certain nombre de suspects (non encore inscrits au FAED) font l’objet d’une comparaison directe par le technicien avec la trace digitale relevée, le dessin digital de l’auteur du dépôt n’est pas rapproché de la trace. C’est ce que la littérature scientifique en matière d’empreintes digitales considère comme des faux positifs (incrimination erronée d’une personne sur une trace mal interprétée) ou des faux négatifs (exclusion erronée d’une personne auteur du dépôt mais dont les empreintes n’ont pas été rapprochées de la trace)625.
Dès lors il y a lieu de s’interroger sur l’existence ou non des moyens de contrôle, permettant de limiter le nombre de distorsions des relevés d’empreintes risquant de générer des erreurs, sur ce qui est apprécié généralement par tous les acteurs comme une preuve incontestable et fiable.
De nombreux biais viennent perturber le technicien : celui d’ignorer la déformation initiale de l’empreinte de référence introduite dans le système626, mais aussi celui des propositions données par le système informatique627. Pour beaucoup dès lors que le système propose un certain nombre de candidats possibles628, de fait, l’agent a une tendance naturelle à considérer a priori que l’auteur de la trace fait partie de ces propositions et son interprétation de la trace va alors dans le sens de ne retenir que les caractéristiques convergentes en écartant les divergentes, au motif de la dynamique de l’action du dépôt, les considérant comme une partie glissée, ou pour une empreinte partielle ne faisant pas cas du peu d’éléments de comparaison ou négligeant les superpositions, etc. A cette interprétation peut s’ajouter ce qui est appelé dans la littérature scientifique, le biais de confirmation629 par lequel un premier technicien fait contrôler son travail par un autre mais ce dernier ayant eu connaissance du résultat, il aura alors tendance à confirmer l’interprétation du premier. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans l’affaire Brandon Mayfield :
« Après les attaques terroristes de mars 2004 commises dans des trains à Madrid (193 morts plus de 1800 blessés), les relevés de deux traces d’empreintes digitales partielles, relevées sur des sacs plastiques qui contenaient les détonateurs, furent soumis par les autorités espagnoles au FBI pour analyses. Les images numériques de ces relevés furent intégrées au système automatisé du FBI630 , et elles sont ainsi comparées aux millions d’empreintes enregistrées (suspects, condamnés mais également toute personne voyageant qui sort et rentre aux USA). Le résultat de la recherche fournit une courte liste de candidats potentiels. Un spécialiste qualifié en empreinte digitale prend la liste et les traces partielles afin de déterminer si la qualité des traces peut faire l’objet d’une comparaison valable avec les empreintes potentielles fournies par le système automatisé. En utilisant et suivant scrupuleusement les protocoles standardisés et les méthodologies scientifiques arrêtées en la matière, il détermine que la trace digitale latente était de qualité et de valeur suffisantes pour faire l’objet d’une comparaison et permettre une identification. Et elle fut liée à Brandon Mayfield631. Ce rapprochement fut analysé indépendamment du premier spécialiste par un expert renommé en empreintes digitales et à sa suite deux autres qui confirmèrent. Peu après ce rapprochement, les autorités espagnoles émirent des doutes sur ce résultat. Le FBI envoya deux experts à Madrid pour comparer directement la trace partielle relevée (et non l’image enregistrée) avec les empreintes de Brandon Mayfield, confirmant leurs travaux précédents, montrant chaque fois plus de 15 points caractéristiques correspondants et expliquant les discordances par la nature dégradée de la trace. In fine les Espagnols déterminèrent que les traces digitales avaient été laissées par un nommé Ouhane Daoud. Et Brandon Mayfield qui avait été incarcéré fut remis en liberté. Cette affaire révéla plusieurs biais et erreurs dans le protocole de comparaison et d’identification, d’abord, bénéficier d’un format d’image de la trace de haute définition permettant de voir tous les détails (ce qui n’était pas le cas) ensuite ne pas croire que les propositions d’un système automatique préparent l’identification (en l’espèce l’algorithme avait positionné 20 points caractéristiques possibles), après prendre du recul pour échapper au biais de confirmation qui agit à deux niveaux, en premier lieu par les experts en empreintes digitales qui connaissant la position de leur prédécesseur qui avait retenu 15 points firent de même (à noter que ce ne fut pas les mêmes points 15 que les experts retinrent), et en second lieu par les enquêteurs du FBI qui ne cherchèrent pas les preuves qui allaient contre leur théorie et ne pas les utiliser pour étudier une théorie alternative quand ils en trouvaient »632.
Cette affaire entraina une inspection générale des services633 et méthodes de prélèvements et d’identification des empreintes digitales aux USA qui a eu comme conséquences une réévaluation des procédures scientifiques dans le domaine qui généra de nombreux travaux634 pour le remettre à niveau ainsi que les spécialistes635 qui y officient.
Les travaux de Dror et Charlton ont également montré que selon les circonstances de l’examen d’identification, un même expert n’est pas toujours d’accord avec ses propres conclusions quand l’analyse est présentée dans un contexte différent quelque temps plus tard636. Il est dommageable que ces travaux ne soient pas développés plus avant par les centres de formation à l’identification des empreintes digitales637. Mais surtout, il est encore plus étonnant qu’ils soient complètement ignorés des acteurs au procès pénal pour apprécier la pertinence des résultats selon la qualité de la trace digitale ayant fait l’objet d’une analyse et d’une identification.
Enfin, il est toujours surprenant que ne soit jamais abordé le taux d’erreur en la matière638, et en France dans la droite ligne de Bertillon, la majorité des services spécialisés, magistrats, enquêteurs, considèrent, sans la moindre réflexion scientifique, que les empreintes digitales offrent une identification simple claire, fiable et imparable puisque la croyance voudrait qu’il ne saurait y avoir d’erreur en la matière. À l’heure actuelle, il semblerait que seuls les experts de l’IRCGN, dont beaucoup sont formés dans les universités à l’étranger, abordent dans leurs rapports d’expertise la nécessaire introduction des probabilités ainsi que le problème des erreurs possibles dans le domaine scientifique. Pourtant comme l’illustre l’exemple de l’affaire Mayfield, le taux d’erreur639 dans l’identification des empreintes digitales existe bien, il suffit pourtant de lire la littérature scientifique640 à ce sujet pour en apprécier toute l’importance641 alors que les agents qui officient, n’abordent jamais le sujet, si t’en est qu’ils le connaissent.
Le développement sur les empreintes digitales, avec sa complexité largement ignorée des acteurs du procès pénal, est l’illustration de la méconnaissance de nombreux facteurs rentrant dans la construction de la preuve pénale tant par les magistrats que certains des techniciens participant à l’interprétation des empreintes digitales. La méconnaissance de la dimension scientifique, qui si elle peut être compréhensible de la part des professionnels du droit reste dérangeante de la part desdits techniciens. Il ne s’agit pas ici de renier les empreintes digitales et de les retirer de l’arsenal criminalistique, mais simplement de reconnaître que comme tout domaine scientifique, la fiabilité absolue et l’absence d’erreur n’existent pas. Croire le contraire engendre naturellement des certitudes favorisant les biais et les résultats erronés. Alors que les connaître oblige tout spécialiste à un contrôle drastique pour en limiter les effets.
3.B Les empreintes génétiques642
Les empreintes génétiques ont tout d’abord été exploitées pour identifier les auteurs de crimes et de délit à caractère sexuel. Le CPP a progressivement étendu le champ d’application des empreintes génétiques à un grand nombre de délits simples ( Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (dite « loi Sarkozy »), dans son article 29 : elle élargit le fichier à de simples délits (vol, tag, arrachage d’OGM, etc.) et permet aussi d’inclure de simples suspects, Loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales, Loi sur les violences conjugales du 4 avril 2006 dans son article 17, Loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007).
La baisse des prix des réactifs pour réaliser des empreintes génétiques ainsi que la robotisation ont permis ainsi d’utiliser les empreintes génétiques pour la petite et moyenne délinquance (vol, cambriolage, dégradation...).
Les empreintes génétiques reposent sur l’étude de marqueurs présentant chacun une fréquence propre dans une population de référence. Les résultats obtenus peuvent ainsi s’exprimer en probabilité de coïncidence fortuite c’est-à-dire la probabilité que deux personnes présentent le même profil génétique dans une population de référence. Ainsi pour 10 marqueurs obtenus à partir d’un individu, il est communément admis que la probabilité de coïncidence fortuite est supérieure à 1 sur 1 milliard autrement dit il est 1 milliard de fois plus probable que ce profil génétique corresponde à l’individu identifié qu’à un autre individu (sans lien de parenté) pris au hasard dans la population.
Les empreintes génétiques sont devenues un domaine incontournable dans l’enquête judiciaire au cours de ces vingt dernières années en raison de leurs succès retentissants mais aussi de la fascination qu’elles suscitent auprès des médias. Si leur accessibilité est sans aucun doute un bénéfice pour la communauté judiciaire, force est de constater leur mauvaise assimilation par les acteurs de l’enquête.
Présentée à tort comme la « reine des preuves », l’empreinte génétique ne demeure qu’un indicateur au même titre que le traitement des autres traces exploitées en criminalistique.
Si une trace permet d’identifier une personne par son ADN, il convient de remettre la trace de question dans son contexte pour déterminer les circonstances et les raisons pour lesquelles la personne a laissé cette trace de son patrimoine génétique sur la scène d’infraction.
Elle ne saurait se substituer au travail de réflexion de l’enquêteur qui se doit de remettre en perspective un profil génétique par rapport aux éléments de son dossier. Également, il est devenu trop commun pour les enquêteurs et les magistrats de demander des analyses génétiques non pas pour la plus-value qu’elles pourraient amener à une affaire mais par phénomène de « mode judiciaire » ou d’ignorance des autres domaines qui peuvent souvent s’avérer plus pertinents selon le cas. Par manque de réflexion préalable, les profils génétiques déterminés dans certains dossiers rendent au final une situation encore plus confuse au lieu de l’éclaircir, à l’inverse de l’effet recherché.
La place croissante occupée par la génétique dans les procédures judiciaires s’accompagne souvent de difficultés inhérentes à cette discipline, où le haut degré de discrimination a aussi comme corollaire des problématiques d’interprétation des résultats analytiques, peu accessibles aux acteurs du procès pénal.
3.1 Comprendre le domaine des empreintes génétiques
3.1.1. Le principe d’analyse d’un prélèvement ADN
L’analyse d’un prélèvement ADN débute par une étape d’extraction et de purification, qui va “décrocher” la molécule d’ADN de son support en la mettant dans un milieu aqueux. Pouvant interférer avec le processus d’analyse, les substances autres que l’ADN seront éliminées.
L’étape suivante sera la PCR (Polymerase Chain Reaction), technique d’amplification qui « photocopie » l’ADN afin d’obtenir une quantité suffisante pour l’analyse. Des parties de la molécule ADN sont sélectionnées par ce qu’on nomme des amorces, définissant la zone à copier.
Sous l’action de l’enzyme nommée ADN polymérase, des brins vont se séparer avant de se recombiner. Les nucléotides G – C et T – A étant complémentaires ( Guanine – Cytosine, Thymine - Adénine), la chaîne se reforme à l’identique. La technique de la PCR s’effectue en trois grandes étapes :
• La dénaturation : les deux brins sont dissociés par un chauffage à 95°C ;
• L’hybridation : (température 50 à 60°C) les amorces viennent se fixer aux parties d’ADN à copier ;
• La polymérisation ou élongation : l’ADN polymérase effectue un assemblage de nucléotides sur la chaîne en construction.
Chaque cycle de copie permet de doubler la quantité d’ADN et de rapidement obtenir des milliards de copies de la zone sélectionnée. Les analyses ADN finissent par l’électrophorèse, technique permettant de séparer des molécules en fonction de leur taille en leur appliquant un champ électrique.
3.1.2 Les progrès des empreintes génétiques
Au cours des vingt dernières années, les empreintes génétiques se sont démocratisées : nécessitant à leurs débuts des moyens conséquents réservés à des affaires d’ampleur, elles se sont ouvertes à l’ensemble des infractions et se sont adaptées à ce nouveau contexte. La PTS française en matière d’ADN est ainsi passée d’un stade que l’on pourrait qualifier d’artisanal à industriel impactant les agents préleveurs ainsi que le travail des experts en empreintes génétiques.
En biologie moléculaire, les techniques mises en œuvre n’ont de cesse d’évoluer très rapidement.
En matière de recueil de trace ADN, la standardisation des moyens de prélèvement permet de traiter en routine un important volume de prélèvements : mise en place des kits FTA pour prélever des individus (victimes, suspects, condamnés...) et la mise en place de kits de prélèvements standardisés (Ecouvillons Chemunex) pour prélever des traces sur les scènes d’infractions en facilitant le travail des enquêteurs et en assurant une meilleure traçabilité.)
Associés à une nécessaire gestion de la pertinence des prélèvements, les laboratoires de génétique moderne sont en capacité de traiter de manière semi-automatisée des flux de masse, notamment dans le domaine de la délinquance de masse.
Dans un souci d’harmonisation des données génétiques soumises à expertise, uniformisation des réactifs employés pour répondre tant à la contrainte législative (arrêté A.38 définissant le nombre de marqueurs génétiques sur lesquels portent les analyses françaises) que d’échange des informations entre laboratoires français et européens réalisant des empreintes génétiques.
Le développement de nouveaux kits d’analyses et de nouveaux séquenceurs ont permis d’augmenter le nombre de marqueurs étudiés (permettant une meilleure discrimination entre les profils génétiques) en diminuant les temps d’analyses. La robotisation progressive de la préparation des différentes étapes permettant l’obtention d’un profil génétique a permis d’augmenter le nombre de profils génétiques produits et enregistrables au FNAEG. Actuellement, l’IRCGN est en capacité d’analyser plus de 10.000 prélèvements chaque mois.
Parallèlement aux profils génétiques obtenus à partir de l’analyse de séquences STR des chromosomes autosomaux643, des analyses du génome mitochondrial644 ou des STR du chromosome Y (STR Y)645 ont été développés permettant une identification par la lignée maternelle (génome mitochondrial) ou par la lignée paternelle (STR Y). Ces techniques ont cependant un pouvoir discriminant très faible, mais sont un recours technique dès lors qu’il n’est plus possible de procéder aux analyses basées sur les STR des chromosomes autosomaux.
Émergence de nouvelles formes d’exploitation criminalistique de l’information contenue dans l’ADN :
La recherche en parentèle est une technique d’investigation fruit d’une expérimentation menée en 2011 dans le cadre de l’affaire Elodie Kulik par le Chef d’escadron Pham-Hoai, officier de gendarmerie biologiste.
Couronnée de succès, elle est une première dans l’histoire judiciaire française et a ouvert la voie à la possibilité de déterminer indirectement l’identité d’un individu non enregistré au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ;
[Le monde, 21 février 2012] : « Elodie Kulik, 24 ans est retrouvée le 12 janvier 2002 sur un terrain militaire désaffecté de la petite commune de Tertry (Somme). Une décennie d’enquête inlassable durant laquelle les efforts des gendarmes n’ont abouti qu’à des impasses ou à des fausses pistes. La scène de crime avait pourtant offert de précieux indices. Un ADN nucléaire, c’est-à-dire complet, extrait du sperme retrouvé dans un préservatif, quatre ADN incomplets et une empreinte digitale. Autant de signatures que les assassins n’avaient pu effacer en brûlant le corps de leur victime, surnommée localement "la banquière de Péronne" parce qu’elle dirigeait une agence bancaire de cette ville de la Somme .
Ratissée dans les grandes largeurs par les gendarmes, la Picardie est restée muette. Au moins 10 000 personnes entendues, 14 000 factures téléphoniques passées au crible et près de 600 hypothèses suivies. Sans succès. L’ADN, nouvelle "reine des preuves", n’a pas parlé. L’empreinte génétique retrouvée sur place ne correspondait à aucun profil référencé au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), qui recense les personnes condamnées ou mises en cause au cours d’une enquête. Pas plus qu’aux milliers de prélèvements effectués sur des hommes pendant les recherches.
Une approche inédite
Jusqu’à ce qu’en janvier 2011, un capitaine de la section de recherche d’Amiens, biologiste de formation précédemment en poste à l’Institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale (IRCGN), ait l’idée d’interroger à nouveau le Fnaeg avec une approche inédite. Celle-ci repose sur une composante "familiale" de l’identité génétique : chaque enfant possède un allèle (c’est-à-dire une version d’un gène héréditaire) du père et un allèle de la mère. En se fondant sur ce point commun, les enquêteurs pouvaient espérer identifier non plus le meurtrier, mais un membre de sa famille.
Cette recherche est une première dans l’histoire judiciaire française. Elle repose sur un pari : l’hypothèse qu’un parent du meurtrier aurait déjà eu affaire à la justice, sans quoi il ne figurerait pas au Fnaeg. Les gendarmes se lancent sur cette piste à l’automne 2011. Et il faut une semaine pour que le Fnaeg révèle l’existence d’une personne qui possède un point génétique commun avec le meurtrier. Et qui, de surcroît, est localisé dans la région où a eu lieu le meurtre. Cet homme est en prison, depuis 2001, pour agressions sexuelles. "L’ADN de départ a ensuite été comparé à celui de la conjointe de ce détenu, explique une source proche du dossier. Cette analyse a confirmé que l’empreinte génétique retrouvée sur place appartenait bien à l’un des enfants de ces deux personnes". Ceux-ci ont donné naissance à une fratrie de six frères et sûrs, parmi lesquels les enquêteurs isolent l’un des fils. Il s’agit de Grégory Wiart, un plombier-chauffagiste de Montescourt-Lizerolles (Aisne), commune située à 27 km de Tertry. Il est mort en 2003 dans un accident de la route. Le juge d’instruction Jordan Duquenne ordonne alors l’exhumation du corps de ce suspect pour que la comparaison avec l’ADN retrouvé sur place ôte tout doute sur la validité des recherches de parentèles effectuées sur le Fnaeg. Cette mesure a confirmé la concordance des profils génétiques, comme l’a annoncé le 26 janvier le procureur d’Amiens. Le jeune homme est bien l’un des meurtriers d’Elodie Kulik. Est ainsi démontrée la validité d’une nouvelle technique de recoupement par l’ADN familial qui ouvre des perspectives pour d’autres affaires criminelles ».
À ce jour, plus d’une vingtaine de dossiers d’affaires criminelles font l’objet d’une recherche en parentalité.
Nous trouvons également de nouvelles méthodes matérialisant un domaine dont les progrès et les changements sont en constante évolution.
La microdissection laser est une technique qui se révèle particulièrement adaptée pour les affaires de viol. Elle permet de séparer différents types cellulaires en procédant dans un premier temps à leur identification (microscope) puis à leur découpe (laser) ;
L’ADN rapide, qui permet de déplacer un laboratoire d’analyses génétiques transportable au plus près de la scène de crime646
Le séquençage nouvelle génération (Next generation sequencing – NGS - ) qui permettra dans un avenir proche d’avoir accès à des marqueurs supplémentaires (single nucleotide polymorphism - SNP- )647 voire d’effectuer le séquençage complet d’un génome648 ;
L’affinement du modèle statistique employé pour déterminer la probabilité de coïncidence fortuite entre deux profils génétiques non apparentés, recours aux probabilités bayésiennes649.
Focus sur le portrait-robot génétique
L’arrêt du 25 juin 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ouvre désormais la possibilité pour les laboratoires de criminalistique de déterminer des caractéristiques physiques à partir d’un profil génétique dans le cadre d’une enquête.
Cette approche, qualifiée communément de "portrait-robot ADN", fait déjà l’objet d’études dans le monde scientifique (I) qui est actuellement transposé au sein de l’IRCGN. Au-delà de son aspect technique, se pose la problématique de l’appréciation de cette méthode dans l’enquête (II).
Le "portrait-robot ADN" qui vient en supplément des profils génétiques actuels et permet de déterminer certaines caractéristiques morphologiques d’un individu non identifié650
I. Généralités
Le portrait-robot ADN se base sur le recours aux « single nucleotide polymorphism » (SNP). Deux tests ont été mis en place par M. Manfred Kayser, autorité scientifique en la matière :
- le premier, IrisPlex, s’intéresse à la couleur des yeux et prédit avec un degré acceptable la couleur bleue, marron ou intermédiaire (94 % de réussite sur un échantillon de 3800 individus). Plusieurs laboratoires nord-américains et européens ont été engagés dans un test en aveugle concluant651 ;
- le second, HIrisPlex, est de manufacture récente et combine prédiction de la couleur des yeux et des cheveux652.
Les résultats concernant la couleur des cheveux sont cependant à prendre avec réserve : le test ne tient pas compte des modifications de la couleur des cheveux d’un individu au cours du temps (influence de l’environnement). Ainsi, l’analyse génétique peut donner comme résultat une couleur châtain que l’individu ciblé n’a porté qu’étant enfant.
Sur le court terme, les résultats obtenus ne pourraient être délivrés que sous une forme "en tant que tels".
Sur le long terme, la solution d’interprétation la plus aboutie scientifiquement passerait par le recours aux réseaux bayésiens et l’utilisation de paramètres supplémentaires affinant la réponse comme la couleur de la peau, la taille, la calvitie, la morphologie du cheveu, etc.
II Appréciation
Réalisable dès à présent sur deux paramètres phénotypiques (couleur des yeux et des cheveux), le portrait-robot ADN ouvre de nouvelles perspectives pour la communauté judiciaire. La technique nécessite néanmoins de plus amples indicateurs afin de se révéler pleinement pertinente en termes de plus-value informative.
Cependant, demeure le problème de l’appropriation d’un résultat scientifique par le non-scientifique, en quête d’une solution "miracle" lui livrant un coupable « désigné » par la science.
3.2 La fiabilité653
La place croissante occupée par la génétique dans les procédures judiciaires s’accompagne souvent de difficultés inhérentes à cette discipline, où le haut degré de discrimination a aussi comme corollaire des problématiques d’interprétation des résultats analytiques, peu accessibles aux acteurs du procès pénal.
Celles-ci sont récurrentes dans les cas de mélanges, sur le nombre et la qualité des contributeurs. De même, elles apparaissent lorsque l’individu source de la trace biologique est connu, mais qu’il nie le processus de transfert réputé avoir conduit au dépôt de matière recueillie.
En amont des problématiques de mélanges et de transfert, les questions de fiabilité des résultats méritent un important développement. En effet, les résultats d’analyses génétiques jouissent, plus que tout autre en criminalistique, d’un a priori favorable. La qualité de la chaine analytique, toujours plus sanctuarisée, n’épargne toutefois pas les agents de redoutables, mais très discrets, biais de logique et de curiosités statistiques.
Aborder le procédé de révélation scientifique de l’ADN permet de mieux comprendre qu’à la différence des empreintes papillaires, la robustesse de la fiabilité ne dépend pas uniquement de l’interprétation mais également de toutes les étapes du processus.
La molécule ADN étant chargé négativement, les morceaux d’ADN migrent sous l’action d’un champ électrique. La migration est d’autant plus rapide que le fragment d’ADN utilisé est court.
En électrophorèse capillaire, la migration se fait dans un tube de la taille d’un cheveu. Des tensions élevées permettent une séparation rapide des molécules. Un détecteur placé à la sortie du tube enregistre le passage des morceaux d’ADN en fonction du temps. Les résultats sont donc présentés différemment sous forme de graphique avec en abscisse le temps et en ordonnée la quantité d’ADN détecté.
Les techniques d’analyse d’ADN utilisées aujourd’hui permettent d’analyser plusieurs STR en même temps : on parle d’analyse en multiplex. Jusqu’à environ 15 fragments sont amplifiés simultanément par une analyse en mode “multiplex”. Les fragments amplifiés sont des STR qui ont été choisis en fonction de leurs polymorphismes et de leur taille
3.2.1 La fiabilité des analyses
3.2.1.1 L’éventualité d’une erreur dans le profil
Le risque encouru ici est une erreur d’attribution d’un (ou plusieurs) allèle(s) à un profil. Un allèle peut être mal attribué pour des motifs tenant au processus d’analyse, à l’environnement de travail ou à l’agent humain.
Ø les erreurs inhérentes au processus d’analyse
* Les stutters
L’amplification par PCR peut produire des éléments parasites lors de la phase de copie des zones sélectionnées par les amorces. En effet, la copie étant faite par une réaction enzymatique, elle peut se dérouler dans des conditions défavorables, qui la perturbent ; comme si le copiage omettait un élément répétitif, générant alors un produit raccourci.
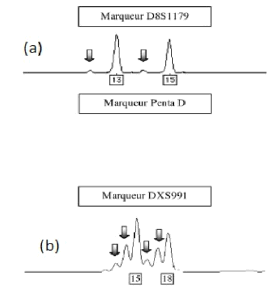
Sur le graphe de l’électrophorèse ou électrophorégramme, cela se traduira par l’apparition d’un petit pic précédent un pic présent plus important. Le problème de cet artéfact est d’autant plus prononcé pour interpréter le résultat que l’élément répétitif est court, ou que l’hypothèse d’un mélange peut être avancée.
Sur la figure ci-dessus, sur la ligne (a), comment affirmer si sur le STR
D8S1179 est un mélange de deux sources dont l’une est 13/15 pour le majoritaire et 12/14 pour le minoritaire, ou si 12/14 ne sont que des stutters ? Cette difficulté est encore accrue pour la ligne (b), sur laquelle on voit qu’un stutter peut avoir son propre stutter.
* Le drop-out
La PCR a ouvert la voie à l’analyse de très petits échantillons contenant quelques cellules. Cependant la littérature scientifique considère que pour obtenir sans difficulté un profil de qualité, il est nécessaire d’analyser une centaine de cellules, une quantité d’ADN proche d’un milliardième de gramme (1ng). En dessous de cette quantité, des résultats peuvent être faussés par la dégradation du prélèvement ou par des contaminations.
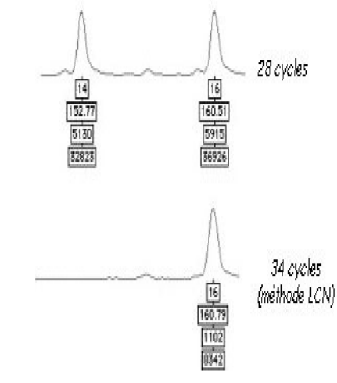
En ce qui concerne les dégradations, lorsque l’analyse porte sur deux à trois molécules d’ADN, la moindre dégradation de l’une d’elles peut conduire à une absence de pic après électrophorèse et donc à un profil incomplet, voir erroné.
Prenons l’exemple d’un prélèvement composé de deux cellules d’un individu possédant les allèles 14 et 16 pour le marqueur D5S818 (confer figure au-dessus). Si un dommage (mutation) survient sur deux molécules possédant l’allèle 14, on constatera la disparition du pic correspondant. L’analyste pourra alors croire que l’individu est homozygote et possède uniquement l’allèle 16.
Ø Les erreurs dues à l’environnement de travail
*La contamination du prélèvement avant son introduction : le bruit de fond de la trace
Bien que toutes les précautions soient prises pour éviter des pollutions environnantes (opérateur, matériel et environnement de travail, atmosphère), il est difficile d’obtenir un environnement avec une absence totale d’ADN.
Lorsque la PCR est poussée à l’extrême, les contaminations même infimes sont détectées, y compris dans les cas où des techniques dites de quantification conduisent à considérer a priori une quantité nulle à analyser. Malgré ces difficultés, certains laboratoires réalisent des analyses de spécimen ne contenant que quelques cellules, qui doivent être alors lues avec davantage de précautions.
En effet, le risque est alors de considérer ces quelques cellules comme a priori pertinentes. Cependant, la pertinence recouvre une notion précise en criminalistique : une trace sera dite pertinente si elle est un vestige de l’auteur des faits, contemporain de leur commission. Or, une trace dépend seulement de l’action qui la génère, et celle-ci peut n’avoir pour origine ni les faits visés, ni l’auteur de l’infraction : l’ADN sera alors dit présent à titre de bruit de fond.
Le haut degré de divisibilité de la trace ADN doit ainsi inviter les acteurs du procès pénal à une lecture attentive des résultats produits sur les petites quantités de matière biologiques.
Dans un premier temps, il peut être légitimement retenu que des identifications de profils génétiques demeurent techniquement réalisables. Toutefois, l’interprétation de ces résultats ne doit pas s’arrêter à l’établissement du seul profil génétique, mais bien se poursuivre en appréciant les incertitudes qui l’entourent, et en remettant le support de la trace dans la perspective globale et dynamique de la scène d’infraction.
En effet, le stade actuel de la connaissance scientifique sur les phénomènes de transfert et de persistance reste un frein pour inférer avec précision de la trace biologique vers l’action à son origine.
* La contamination des prélèvements dans la chaîne analytique
Bien plus rares que les traces d’ADN présentes à titre de bruit de fond, les contaminations intervenant au cours du circuit analytique sont aussi plus dommageables. En effet, un a priori en faveur du laboratoire d’analyse rend cette hypothèse difficilement envisageable, tant les mesures prises pour éviter ce type de problème sont drastiques.
Leur caractère, bien qu’exceptionnel, ne les rend toutefois pas impossible. C’est ainsi qu’une décontamination incomplète d’une partie du circuit (tapis de bouchons de type septa) fut ainsi supposée à l’origine de l’émergence artificielle d’un profil sur un prélèvement issu d’une scène de crime en 2003654. La conséquence fut qu’un suspect fut ainsi faussement désigné. Dans ce cas précis, seule la véracité de l’alibi du mis en cause a permis de rendre plausible l’hypothèse de l’erreur de laboratoire. Ce type d’erreurs ne peut être que très difficilement recensées, au sens où rares sont les cas dans lesquels le laboratoire se trouve mis en défaut sur la base des éléments d’enquête.
* Les personnels intervenant dans le processus analytique
En amont, il est de plus en plus assuré une discrimination du (des) profil(s) éventuellement révélé(s) avec les profils des individus acteurs du procès pénal, potentiellement présents dans l’environnement de la trace, sur la scène d’infraction ou dans la chaîne analytique. Deux cas de figure doivent ici distingués :
X Les personnels de laboratoire : intervenant sur leur chaîne analytique et dans le cas de l’IRCGN sur des scènes d’infraction, ils sont préalablement enregistrés et systématiquement discriminés, à travers un processus préventif mis en place par le décret n° 2013-406 du 16 mai 2013, relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés « outils de recherche de contamination ADN » (ORCA).
X Les autres personnels intervenant au cours de la prise en compte ou du traitement d’une scène d’infraction : leurs identités sont répertoriées en une liste mise à disposition du magistrat. Celui-ci peut alors, lorsqu’il l’estime opportun, demander à procéder à leur génotypage, à des fins de discrimination avec les profils des traces recueillies sur la scène d’infraction.
* La contamination du matériel dit de prélèvement
Les kits de prélèvement sont supposés non contaminés. Cependant, ils sont fabriqués eux aussi dans une chaîne de fabrication, sujette à diverses sources de contamination. Ils ne peuvent donc avancer qu’un taux de fiabilité de la stérilité des équipements fournis.
Sur ce point, il était traditionnellement admis de la part des fabricants qu’ils livrent un matériel garanti fiable à 95 % ; ce chiffre provient de la procédure d’échantillonnage que le fabricant applique pour contrôler sa propre marchandise. Cela signifie alors qu’au vu du nombre de kits testés, au moins 95 % du total des kits est stérile. Mais dans l’appréciation inverse, 5 % du total des kits peuvent ne pas être stériles et donc être porteur d’ADN. C’est pourquoi l’IRCGN a pour sa part élaboré une procédure d’échantillonnage plus exigeante, et a demandé aux potentiels fournisseurs qui permet d’avancer un taux de fiabilité à 99 %, en appliquant des méthodes statistiques bayésiennes655. L’élaboration du cahier des clauses techniques préparé par l’IRCGN pour le marché public a permis d’obtenir ses exigences en matière de fiabilité de stérilité des matériels.
L’affaire dite du Fantôme de Heilbronn illustre le besoin d’une fiabilité extrême dans le matériel employé à des fins de prélèvements et d’analyses de traces biologiques. Une série de crimes et délits se trouvaient liés entre eux par des analyses ADN, suggérant à chaque fois l’implication de la même femme. Ces faits se sont déroulés principalement en Allemagne et en Autriche principalement, le premier meurtre connu datait de 1993 et les derniers de 2008.
En mars 2009, l’attribution de ces meurtres en une seule et même personne se révèlera finalement être une erreur due à une contamination du matériel de prélèvement. En effet, le journal allemand Bild révèle que l’ADN prélevé sur les scènes de crime et supposé être celui d’une tueuse en série était en réalité celui d’une employée de l’entreprise qui fabriquait les cotons tiges servant à prélever les échantillons d’ADN. L’information, reprise par les médias allemands, sera confirmée par le parquet d’Heilbronn, qui expliqua que le lot contaminé d’écouvillons fut vendu dans tous les pays européens, ces derniers, par souci d’économie, ayant utilisé ce lot périmé. De plus, l’institut de médecine légale de Hombourg (Sarre) réalisa des tests démontrant que des bâtonnets non encore utilisés par les services de police portaient le même ADN. L’enquête mobilisa plus de 100 policiers en Allemagne et en Autriche avec plus de 1 400 pistes différentes suivies et plus de 2 400 vérifications d’ADN pratiquées. Elle sera qualifiée par les médias (avant les révélations de mars 2009 du journal Bild) de « plus grande énigme criminelle de l’Histoire ».
Ø L’erreur due à l’agent humain : assignation d’un allèle à un marqueur
Le facteur humain est lui bien plus difficile à soumettre à un contrôle intégral, peut ainsi, au moment d’interpréter les électrophorégrammes, davantage entacher une analyse d’une erreur, sans que la compétence puisse pour autant être remise en question. La phase au cours de laquelle les résultats des analyses par électrophorèse sont interprétés pour assigner un profil, peut en effet s’avérer rapidement très délicate, et donner lieu à des interprétations différentes les unes des autres. La difficulté consiste dans le fait suivant : l’argumentation de chaque interprétation demeure raisonnable par ailleurs, argumentée en cohérence avec les principes en vigueur enseignés aux généticiens. De manière intrinsèque à une analyse, il est donc périlleux d’affirmer ce que serait censé être la bonne interprétation, et par là si le profil attribué est le bon profil.
Certains ouvrages établissent les principes prévalant à cette assignation de profil, y compris destinés à l’usage des enquêteurs et magistrats656, comme l’équilibre allélique pour les marqueurs hétérozygotes, ou le ratio des stutters. Afin de se prémunir des effets de stutter et de drop-out, les garde-fous suivants sont employés :
> Pour considérer le caractère homozygote (en se prémunissant des drop-out, et une fois le problème des stutters éliminé) il faut alors observer sur le seul allèle apparent une quantité nettement supérieure à celle relevée sur les allèles des marqueurs hétérozygotes (pour 100 RFU sur un hétérozygote, il ne faudra pas moins de 400 RFU pour assigner le caractère homozygote à un marqueur).
> Pour les stutters, la particularité reste que le défaut de copie génère un élément raccourci et que sur des allèles 13/15, le stutter sera ainsi 12/14 (et non 11/18 par exemple). La répétition de ces artéfacts de type « petit pic avant grand pic » sur l’ensemble des STR contribue à supposer un phénomène de stutter.
Certains fournisseurs comme SGMPlus avancent aussi un stutter ratio de 0,15 (15 %) ; ainsi, pour être considéré comme stutter, l’artefact doit faire moins de 15 % du pic qu’il précède.
Cet ensemble de principes (équilibre, stutters, drop-out, seuils ...) rend difficile une lecture unique d’un résultat d’analyse. Une seconde analyse, lorsqu’elle est opérée, prend alors sens non comme confirmation de la première, mais comme confrontation à celle-ci. Les différences observées ne seront en effet pas seulement écartées du profil éventuellement rendu au FNAEG : elles peuvent jeter le discrédit sur la qualité de la trace tout entière.
Pour apprécier les variations observées entre deux analyses d’un même spécimen, une étude comparative fut réalisée à l’IRCGN sur 1130 traces (provenant du flux entrant réel), traitées en double analyse. Sur ce millier de paires d’analyses, certains types de paires de résultats furent observés. Moins de 20 % du flux entrant de traces est constitué de profils de qualité, dits riches, la grande proportion des traces générant des profils nuls ou de trop faible quantité. Certains résultats montrent l’existence de profils dits incertains, voire conflictuels dans des proportions faibles (respectivement 2 % et 1 %), mais suffisantes pour argumenter qu’une simple analyse systématique des profils est susceptible de provoquer des erreurs dans l’association ultérieure d’une trace à un individu.
* Les profils incertains
Le cadre d’emploi actuel prévoit qu’un enregistrement dans la base traces du FNAEG nécessite que la trace en question ait été analysée sur des marqueurs prédéfinis (article A38 du CPP), et ait généré un profil avec au minimum 5 de ces marqueurs renseignés (plus le sexe).
Toutefois, lorsque la trace est de faible qualité, il arrive que peu de marqueurs dépassent le seuil minimum retenu par les généticiens pour considérer que le pic présent sur l’électrophorégramme est réellement présent (et non pas un artéfact). Selon que ces marqueurs soient alors au nombre d’au moins 5 (ou au contraire au plus 4), le profil est susceptible d’être enregistrable (ou au contraire non enregistrable). Prenons un seuil posé à 75 RFU par exemple (pour l’hétérozygotie) et le cas suivant :
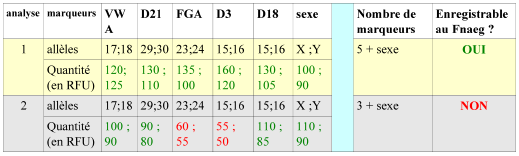
Lorsqu’on fait face à un tel cas, la seconde analyse ne permet pas de conforter le profil issu de la première analyse, et une troisième analyse est réalisée à titre d’arbitrage.
Il est important de noter qu’une alternative se présente alors : soit la troisième analyse conforte le profil issu de la première, soit elle vient conforter l’idée que les critères de qualité ne sont pas assez remplis pour qu’il puisse être légitimement retenu un profil génétique de cette trace.
Lorsque les traces ne sont analysées qu’une seule fois, le risque est donc d’intégrer des profils issus de traces dont la seconde analyse, voire la troisième, conduit à penser que les pics puissent être des artéfacts, ou concernés par des drop-out, sur lesquels pèsent donc des incertitudes.
Dans les 1130 double analyses effectuées, environ 2 % des traces étaient ainsi susceptibles de générer des profils ainsi nommés incertains, qui, statistiquement, entreraient pour moitié en enregistrement en base si une seule analyse est réalisée dessus.
* Les profils conflictuels
D’autres cas, plus troublants encore, se produisent lorsque les deux analyses ne produisent pas des profils compatibles entre eux, et pourtant tous deux susceptibles de permettre un enregistrement de la trace au FNAEG.
L’exemple ci-dessous est une des paires de résultats analytiques dont les interprétations sont contradictoires l’une avec l’autre, bien chacune d’entre elle, prise isolément, soit cohérente avec les principes généraux en vigueur en matière d’attribution d’un profil génétique à un électrophorégramme.
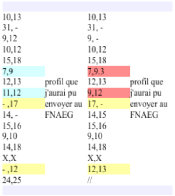
En simple analyse, chacun aurait pu ainsi être enregistré au FNAEG, avec au moins l’un d’entre eux de faux, puisqu’un seul d’entre eux peut être le vrai. Ces cas représentaient 1 % des 1130 traces étudiées. Cela implique qu’en fonctionnement systématique en simple analyse, le taux le plus probable d’enregistrement de profils comportant une erreur d’assignation est de 0,5 %.
Ces observations illustrent la difficulté d’interpréter des résultats analytiques pour attribuer un profil génétique, et par là l’importance d’une double analyse. Celle-ci contribue de manière centrale à la maîtrise des demandes d’enregistrements envoyés au FNAEG.
Les profils « aisés » à interpréter (riches, complets, équilibrés) ne couvrent pas plus de 20 % du flux de traces entrant. Les traces sont généralement incomplètes, voire faibles, et une basse qualité du profil augmente les risques d’interprétation comme les cas présentés l’illustrent.
Les traces incomplètes recouvrent donc un nombre d’analyses considérablement bien plus important que les analyses sujettes à erreur du processus machine décrits supra (inversion de puits, ...). Pourtant, l’effort de rigueur se porte de façon essentielle sur la fiabilité de la chaîne analytique et bien moins sur l’interprétation des électrophorégrammes par les experts pour y assigner des profils génétiques. Il s’agit pourtant d’un rouage essentiel de toute analyse génétique, car cette étape cruciale d’interprétation des électrophorégrammes ne peut s’automatiser entièrement, sans faire encourir des risques d’erreur encore plus importants que ceux liés aux variations d’interprétations possibles entre experts.
3.2.1.2. La probabilité que deux personnes aient le même profil génétique
Il faut distinguer ici trois situations recouvertes par la mention « probabilité que deux personnes aient le même profil » :
Ø La situation a), le hit fortuit de deux profils individus complets :
Les situations de procédures pénales sont plutôt concernées par des hits entre traces et individus, ou entre traces. Le cas a) ne sera donc pas développé.
Toutefois, par rigueur, il convient de souligner que si « être jumeaux » implique « avoir le même profil génétique sur un kit d’analyse », la réciproque est fausse ; des individus peuvent différer sur des marqueurs existants, mais non couverts par le kit.
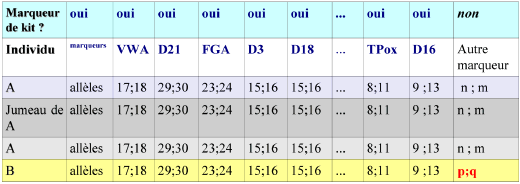
- b) le hit fortuit d’un individu suspect en procédure avec une trace en base,
- c) le hit fortuit d’un individu en base avec une trace prélevée sur une scène d’infraction.
Les profils issus des traces sont moins complets en termes de marqueurs que les profils « individus ».Ainsi, la probabilité de coïncidence fortuite est bien plus faible entre deux individus qu’entre deux traces.
Dans le cas b), l’enregistrement en base présuppose 5 marqueurs renseignés plus l’amélogénine (marqueur du sexe ), hors certains cas motivés tels que l’article A38 peut le prévoir.
Or, dans le cas c), il peut y avoir une trace avec trop peu de marqueurs renseignés pour une inscription en base, toutefois sa comparaison avec le profil génétique d’un individu peut se révéler possible techniquement, et d’intérêt pour l’enquête.
Type de trace |
Nombre de marqueurs renseignés |
Individu |
>15 marqueurs + amélogénine |
Trace en base |
>5 marqueurs + amélogénine |
Trace prélevée sur une scène d’infraction |
≥ 1 marqueur |
Ø la situation b)
Soit un individu donné, on souhaite interroger la base des traces afin de savoir sur quelles scènes d’infractions un profil compatible avec le sien a été révélé. Ici, on va alors chercher des traces (> 5 marqueurs + amélogénine ) avec des marqueurs identiques au sien.
Il ne suffit pas seulement que 5 marqueurs plus l’amélogénine correspondent, il est également nécessaire que les autres marqueurs révélés sur la trace ne portent pas un marqueur distinct de celui de l’individu (cette différence aurait alors valeur discriminante).
Les profils traces portent un nombre variable de marqueurs renseignés, selon la qualité de la trace (20 % de profils complets et 80 de profils plus faiblement renseignés).
La probabilité de coïncidence fortuite d’un individu avec une trace en base (fortuite au sens de l’hypothèse : « l’individu n’est pas la source de la trace ») tient alors à la probabilité que les n marqueurs renseignés sur la trace correspondent.
Il est important de noter qu’au niveau élémentaire, le niveau du marqueur, les allèles possibles ont une probabilité de coïncidence qui varie également : certains allèles sont courants, d’autres rares.
Par exemple, sur le marqueur VWA seul, la probabilité de coïncidence fortuite d’observer une trace portant l’allèle 17 sera de 27 %, alors qu’elle sera de seulement 10 % pour l’allèle 14, et de 0,45 % pour l’allèle 13.
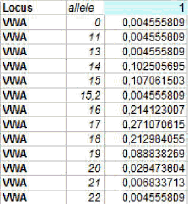
En fonction du nombre de marqueurs renseignés, et des allèles possédés par l’individu, la probabilité d’observer fortuitement des traces lui correspondant couvre un intervalle large :
* Sur une trace A , renseignée sur 8 marqueurs par des allèles aussi peu courants que l’allèle 13 sur le marqueur VWA, la probabilité de coincidence fortuite peut ressembler à celle de la probabilité du marqueur VWA renseigné par l’allèle 13, portée à la puissance 8 ; cette probabilité est d’environ 4.5 sur 1000, mis à la puissance 8 ; soit 0,00458 ; ce chiffre vaut 1,6815.10-19.
* Sur une trace B, portant 6 marqueurs aussi courants que l’allèle 17 sur le marqueur VWA, la probabilité de coïncidence fortuite ne sera alors « que » de 0,271-6 ; ce chiffre vaut 0,00038742, soit environ 4 pour 10.000.
Le quotient de ces deux chiffres vaut 2,3.1015 ; en termes clairs, il est incommensurablement plus probable d’observer un autre individu compatible avec une trace de type B, qu’avec une trace de type A.
Ø la situation c)
Elle est une extension de la situation b) au sens où moins de marqueurs que ne nécessite l’enregistrement au FNAEG peuvent être soumis à la comparaison ; si elle porte sur deux marqueurs avec des allèles aussi courants que l’allèle 17 sur le marqueur VWA, alors la conclusion peut porter la mention « l’ADN du suspect est compatible avec la trace de la scène d’infraction » alors que la probabilité de coïncidence fortuite n’est que de (0,27*0,27) = 7,3 % .
Pour conclure, le nombre de marqueurs portés par la trace et la rareté des allèles en commun jouent un rôle absolument prédominant dans l’interprétation d’un hit entre un individu et une trace.
Remarque sur l’effet de la taille de la base de données et les profils difficiles à interpréter
Les profils traces susceptibles de conduire un enregistrement portant une erreur (évoqués supra) sont des profils dits faibles, avec peu de marqueurs. Leur probabilité de coïncidence fortuite moyenne est d’environ 2,3.10-6.
Il est actuellement difficile de comprendre les biais d’interprétation auxquels peuvent conduire les profils génétiques sans quelques notions de statistiques. Une notion est ici particulièrement cruciale, il s’agit de l’effet de la taille de la base de données sur la probabilité d’un hit fortuit. La base des individus sera considérée ici dans son ordre de grandeur global soit un million, noté 10-6.
Dans une petite classe d’école, la probabilité d’observer un autre individu possédant la même date d’anniversaire est faible. Il suffit d’augmenter d’une certaine portion la taille de classe pour la probabilité augmente ; cette portion est liée à la probabilité de l’évènement.
Ainsi, la probabilité de l’évènement « au moins un individu correspond au profil trace » vaut 1 – probabilité (« aucun individu ne correspond au profil trace »), et c’est bien cet événement « aucun individu ne correspond au profil trace » qui devient de moins en moins probable, au fur et à mesure que grandit la taille de la base de données.
Au final657, il y a une probabilité de 63 % d’observer dans la base individus FNAEG au moins un profil correspondant fortuitement avec une trace de profil avec une coïncidence fortuite 2,3.10-6.
Pour illustrer par une analogie, les sociétés de jeux connaissent bien ce mécanisme et modulent la probabilité de gain sur le nombre de joueurs ; chaque joueur a ainsi une faible chance de gagner ; mais la probabilité qu’il y ait un moins un gagnant est forte ; car un jeu où personne ne gagne n’incite que peu à y participer.
3.2.2 Les mélanges et les risques d’erreurs d’interprétation
3.2.2.1 Les éléments permettant à l’expert de conclure à l’existence d’un mélange
Lorsqu’au moins deux marqueurs sont porteurs d’au moins trois allèles, il sera alors inféré l’existence d’un mélange d’au moins deux contributeurs. Par analogie, pour inférer sur un mélange d’au moins trois contributeurs, il faudra au moins deux marqueurs portant au moins cinq allèles.
Le phénomène de stutter décrit précédemment doit alors être étudié et il est examiné si l’un des allèles n’est pas juste précédent le pic suivant (allèle 14 avant allèle 15 par exemple) et également artéfactuel.
La faiblesse relative de pics peut être attribuable à un mélange lorsque les pics les plus faibles respectent entre eux l’équilibre allélique au sein d’un même marqueur pour les hétérozygotes, et entre eux de manière générale sur l’ensemble des marqueurs.
Lorsque les allèles artéfactuels portent sur un allèle autre que celui juste précédent le plus haut pic, ils seront d’autant plus attribuables à un mélange qu’à un stutter. Par exemple, un allèle 13 de quantité 150 RFU précédent un allèle 17 de quantité 2000 RFU sera attribuable à un mélange et non un stutter.
3.2.2.2 Les moyens de comparer une trace mélange à un profil individu
Au sein d’un mélange, le critère permettant d’isoler au moins un profil individu, en distinguant un profil majoritaire et un profil minoritaire est un rapport de proportionnalité d’au moins trois.
Le profil sera alors rendu en tant que tel au FNAEG « au sein d’un mélange », car les probabilités de coïncidence fortuite vont varier selon que le nombre de contributeurs supposé sera de un, deux ou plus dans la trace.
Le profil majoritaire, mais aussi le profil minoritaire, pourra alors ensuite être comparé à un profil individu en tenant simplement compte du nombre de contributeurs.
À titre d’illustration, dans un dossier récent, un profil minoritaire soumis à comparaison au profil d’un individu avait pour probabilité de coïncidence fortuite 1/83.000.000 dans un mélange à deux contributeurs ; cette probabilité devient 1/2140 dans un mélange à trois contributeurs.
En effet, l’augmentation du nombre de contributeurs exerce un effet de couverture probabiliste des éléments observés.
Des modèles mathématiques de plus en plus construits permettent d’aborder la question des mélanges. Les hauteurs de pics alléliques sont modélisables à travers des fonctions particulières (distributions Gamma) et les divers scenarios peuvent être tressés à travers des graphes appelés réseaux bayésiens658. Ci-dessous, un réseau bayésien de mélange victime+suspect.
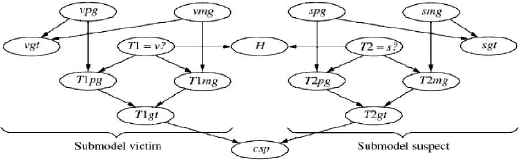
Pour sophistiqués qu’ils puissent paraitre, les travaux de Lauritzen, Moreira et Cowell d’une part, ainsi que Taroni, Aitken, Bidermann ou Gittleson en réseaux bayésiens appliqués aux mélanges en ADN permettent de considérablement rationnaliser l’approche des mélanges, et leur logique est assez intuitive pour permettre qu’ils soient utilement vulgarisés.
3.2.3. Les transferts
La question du transfert en ADN la maintient encore à ce jour comme un indice qui renseigne au niveau de la source de la trace et non de son activité d’origine. Le haut degré de divisibilité de l’ADN montre qu’inférer sur son mode de transfert, sa persistance et son bruit de fond sur différents supports sont des points discutables, complexes et encore peu référencés.
Georgina Meakin et Allan Jamieson ont réalisé, dans un article publié dans FSI Genetics659, une revue des travaux effectués en la matière.
À titre expérimental, récupérer de l’ADN sans contact, d’une personne ayant parlé, a été révélé possible dans un environnement de 50 cm et dans un laps de temps immédiat (2 à 30 secondes) lors d’une expérience en 2005660, mais sans que les quantités des profils relevés soient fournies, ni mis en place un protocole plus proche des délais d’intervention sur scène d’infraction.
Ils résument ensuite en deux tables, les résultats obtenus en contact direct et indirect.
De plus, différents facteurs apparaissent pour favoriser ou non le dépôt d’ADN sur un support :
- le shedding ou capacité d’un individu à produire un ADN susceptible de transfert ;
-les qualités dermatologiques des donneurs (ainsi les personnes ayant du psoriasis déposent un ADN de plus grande qualité et en plus grande quantité que des donneurs autres)661
- activités préalables au contact et temps de délai entre activités et contact ; le lavage de mains réduit d’autant plus la quantité déposée que le délai est court entre le lavage et le contact ; l’effet d’essuyage est également valable pour des contacts répétés avec des surfaces plastiques ;
- le type de surface de dépôt : plus la surface est rugueuse, plus elle est susceptible de collecter de l’ADN ;
- la nature et la durée du contact (pression, frottement, ...)
Différents facteurs apparaissent pour favoriser la persistance d’ADN sur un support :
- délai entre dépôt et recueil ;
- type de surface de dépôt : la porosité de la matière support joue un rôle : sur du coton, la quantité décroit de 50 % en 24h, tandis que des surfaces lisses plastiques avaient les mêmes quantités entre 1 minute et 24 h ;
- facteurs environnants : humidité, lumière et haute température sont nocives pour l’ADN ;
De façon connexe, des facteurs peuvent affecter la qualité du recueil de l’ADN sur son support (les surfaces dures et non poreuses seront écouvillonnées) et la quantité récupérée. Outre cette phase de recueil de matière biologique sur la scène d’infraction, des facteurs peuvent influencer l’extraction de la molécule depuis la trace, et la méthodologie employée doit ainsi tenir compte que la matrice ne doit pas interférer avec le processus (cf documents en papiers).
Cas particulier du transfert peau à peau en strangulation
Dans des simulations de strangulation, sur 29 tests, dans 7 tests l’ADN de l’agresseur était recueilli dans un délai allant jusqu’à 6 heures. Dans 12 tests, seul l’ADN de la victime était recueilli, et dans les 10 cas restant, aucun profil n’était même révélé662.
Cas particulier du bruit de fond sous les ongles
Cent volontaires d’âges et d’activités courantes ainsi que variées donnèrent 200 ongles à écouvillonner, un par main663 et révélèrent une proportion d’ADN étrangers à hauteur de 15 %. Sur ces 15 %, seul un tiers, soit 5 % du total, furent des profils exploitables en dossier judiciaire, et tous les profils étrangers aux titulaires de l’ongle étaient profil minoritaire dans la trace mélange. Cette expérience appuie le fait qu’un mélange riche sous les ongles soutient l’hypothèse d’un contact intime intense entre les deux sources.
Cette expérience fut corroborée par une autre portant sur 12 couples fournissant 144 écouvillons664; la proportion de mélanges était alors de 37 % (53/144). Sur les 53 mélanges, 24 étaient exploitables (soit 45 %) et sur ces 24 exploitables, 20 étaient un mélange donneur-conjoint, 3 étaient un mélange donneur-conjoint-personne inconnue, et 1 était un mélange donneur-personne inconnue.
Ces deux expériences au prisme l’une de l’autre corroborent l’idée que la proximité favorise un transfert fortuit sous les ongles.
Cette présentation des risques d’erreurs accompagnant les empreintes génétiques de la scène de crime (sans être totalement exhaustive elle se veut embrasser au plus large le sujet) montre toute la difficulté d’user d’une science dont la puissance et les résultats apportent beaucoup mais dont le revers est la faillibilité à ses différentes étapes.
En conclusion de cette question et comme il a été précisé pour les empreintes digitales et ce qui est également valable pour tous les domaines de la criminalistique, toute science n’est pas sûre et fiable en totalité. Chaque matière a un taux d’erreur plus ou moins important et des biais plus ou moins variable. Ce n’est pas pour autant qu’il faut s’en priver bien au contraire. Il est important de les connaître pour s’en prémunir au maximum et poursuivre dans les programmes d’assurance qualité, qui s’ils sont appliqués strictement dans le cadre de l’accréditation ISO 17025665 (normes de laboratoire) limitent grandement un certain nombre de risques.
De même dans cette application normative, les contrôles internes mais également les tests de compétence externes (par des sociétés indépendantes de la structure) sont également des moyens permettant de suivre et vérifier les procédures internes comme les capacités d’interprétation des experts.
4. Quel est le cycle d’évolution d’une empreinte digitale ou génétique ? Quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation d’empreintes partielles ou altérées ?
4.1 Les empreintes digitales
Concernant l’évolution d’une empreinte digitale, s’agissant de son cycle naturel de « vie », confère la question 5 sur la persistance.
Concernant les progrès accomplis dans l’exploitation d’empreintes partielles ou altérées, il s’agit de distinguer la révélation de l’interprétation. La révélation est la même que pour une empreinte complète. Concernant l’interprétation, il convient de garder à l’esprit que la majorité des traces papillaires révélées sur une scène de crime sont partielles et/ou altérées. Il n’y a pas de changement particulier en ce domaine, l’interprétation restant liée à la compétence de l’expert (confer le § 3.2 sur la fiabilité des empreintes digitales).
Les seules recherches qui existent actuellement, sont sur l’utilisation spécifique de filtres optiques associés avec des programmes informatiques (en cours de développement) pour essayer de séparer des empreintes superposées.
4.2 Les empreintes génétiques
Concernant le cycle d’évolution d’une empreinte génétique, confer la question 5 sur la persistance et dans la section sur sa fiabilité.
5. L’exploitation d’une empreinte digitale ou génétique ou, plus généralement, de tout élément de preuve (à l’exception des témoignages humains) est-elle impossible au-delà d’un certain délai ? Le cas échéant, ce délai est-il le même pour l’ensemble des preuves ?
La notion de temps dans l’exploitation (prélèvement, révélation ou analyse et interprétation des résultats) est bien évidemment déterminante dans l’enquête judiciaire. Comme les exemples cités dans la réponse à la première question, les évolutions de la criminalistique viennent apporter un autre regard sur le dépérissement des preuves par les possibilités d’exploitation même de nombreuses années voire décennies après les faits. Toutefois, les progrès restent dépendants du vieillissement de l’élément matériel qui lui-même va demeurer ou au contraire disparaître selon son environnement immédiat sans qu’une règle constante et unique soit applicable à tous.
5.1 La persistance des empreintes digitales
La première difficulté est la protection des traces papillaire. En effet, leur fragilité initiale sur une scène de crime et des objets quels qu’ils soient tient à leur nature même. Il s’agit d’un infime dépôt de matières organiques reproduisant les dessins digitaux de la peau. Ainsi, le moindre frottement entraine la destruction irréversible des traces digitales Ils doivent donc être manipulés avec précaution. La seule avancée dans ce domaine est dans la formation des personnels.
Au-delà de la protection immédiate des empreintes papillaires, Une fois apposée, une trace est soumise à de nombreux paramètres environnementaux qui peuvent la dégrader ou l’altérer. Les principaux facteurs reconnus sont :
• le temps : la composition chimique d’une trace va s’altérer plus ou moins rapidement avec le temps ;
• les conditions environnementales : les traces sont sensibles à la chaleur, à l’humidité et aux rayons UV. Ces éléments peuvent altérer directement la trace ou accélérer une éventuelle activité bactérienne qui va dégrader les composés chimiques ;
• les frottements mécaniques : en fonction du support sur laquelle la trace a été apposée, cette dernière va être plus ou moins sensible aux frottements.
Les traces vont donc progressivement se dégrader jusqu’à devenir complètement inexploitables. La persistance d’une trace va dépendre de l’interaction de plusieurs facteurs (composition chimique initiale, quantité de sécrétions déposées, conditions de stockage, support d’apposition....) dont le résultat est impossible à prédire à l’avance. En tout état de cause, une trace conservée dans des conditions idoines (température et humidité contrôlées, à l’abri de la lumière et des frictions) pourrait être conservée plusieurs années666. Il a ainsi été possible de révéler des traces sur un support poreux près de 50 ans après son apposition667. A contrario, une trace apposée en milieu extérieur sous la pluie ne perdurera que quelques heures, voire quelques minutes.
Toutefois, dès lors que la trace a été révélée et prise en photographie au moyen d’appareil photographique haute définition, celle-ci peut être conservée indéfiniment en format numérique. Comme les traitements effectués sont pour la plupart irréversibles et non réalisables une 2ème fois, il n’est alors plus nécessaire de garder le support (ou le scellé).
Enfin, il est constaté que les dessins papillaires d’un même individu restent comparables (sauf accidents, maladie ou blessure profonde) tout au long d’une vie (et même un certain temps après la mort). Ses empreintes peuvent ainsi être comparées à une trace numérisée de nombreuses années après les faits668.
Ainsi la persistance d’une trace papillaire dans son environnement ou sous scellé est une donnée variable et non maîtrisée. Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise en évidence et prise en photographie, son exploitation à des fins de comparaisons, n’est plus limitée que par le délai légal de prescription de l’affaire.
En effet, les dessins papillaires présents sur les zones palmaires, digitales et plantaires sont permanents et le dessin papillaire se renouvelle ainsi de façon identique au cours de la vie d’un individu. De sa naissance jusqu’à sa mort, un individu conservera donc le même dessin papillaire. Seuls les évènements comme des coupures ou des brûlures impactant la couche profonde de la peau (le derme) peuvent entraîner une modification durable du dessin papillaire.
Il est alors possible d’exploiter une trace papillaire et de la comparer avec les encrages d’une personne effectués plusieurs années après. C’est ainsi que fonctionne la base automatisée du FAED. Une trace non identifiée est enregistrée, si elle dispose des caractéristiques requises, dans la base des traces dites non résolues. Elle est ensuite comparée régulièrement aux différents encrages en base et aux encrages de chaque nouvelle fiche insérée (une fiche est insérée pour une durée de 25 ans). Elle peut donc être identifiée jusqu’au délai légal de prescription de l’affaire entraînant l’effacement de cette trace de la base. Délai qui pourrait être allongé sans craindre un dépérissement de l’enregistrement de la trace.
5.2. Les empreintes génétiques
Il est difficile de donner une durée au-delà de laquelle une empreinte génétique ne peut plus être obtenue à partir d’un prélèvement biologique puisqu’elle dépend des conditions dans lesquelles celui-ci a été conservé. Des squelettes de plusieurs siècles permettent encore d’extraire utilement de l’ADN. De même des objets ayant eu un dépôt d’ADN peuvent dans les mêmes durées donner un résultat si les conditions de conservation ne l’ont pas dégradé (voir l’exemple de la médiatisation faite autour de l’ADN extrait d’un dépôt sur le foulard d’une des victimes de Jack l’éventreur en 2014).
Actuellement, l’évolution des techniques repousse chaque jour un peu plus les limites dans l’exploitation des empreintes génétiques.
Scientifiquement, si les conditions de conservation sont réunies, seule la prescription légale semble aujourd’hui constituer l’obstacle à l’exploitation d’une empreinte génétique.
5.3. Les autres éléments matériels
Abordés directement ou indirectement dans la question 2 en traitant de différents domaines, la conservation d’autres éléments matériels pouvant constituer des preuves peut parfaitement perdurer des décennies (documents, squelettes, données numériques sur serveurs, pollens, algues, etc.). La condition essentielle est de bénéficier d’un environnement permettant une telle conservation. À défaut, la dégradation est tellement rapide qu’ils n’arriveront pas à être conservés dans le temps de l’action publique et ce quel que soit le type d’infraction.
***
Contribution de M. Frédéric Dupuch,
directeur de l’Institut national de police scientifique
1. Parmi les fondements traditionnels de la prescription de l’action publique figure notamment le dépérissement des preuves. Dans quelle mesure ce fondement reste-t-il pertinent ?
Les éléments de preuves ne sont pas que scientifiques ; le témoignage humain, notamment, perd en fiabilité avec le temps et l’effacement de la mémoire, justifiant le principe évoqué.
En revanche, au plan scientifique, la question de dépérissement n’a jamais eu véritablement de sens dans bien des domaines comme la balistique ou les traces d’outils (couteau ébréché / éclat retrouvé dans le corps d’une victime), les documents et écritures manuscrites. Même en toxicologie, abstraction faite des métabolisations post mortem et de l’influence des substances contenues dans l’environnement immédiat des pièces analysées, des résultats fins sont obtenus sur des supports de plusieurs siècles.
Il en est de même dans les disciplines dites identifiantes, traces papillaires et ADN, selon les modalités de conservation et l’existence d’éléments de comparaison. Si une photographie de trace papillaire résiste à l’épreuve du temps, l’être humain correspondant est plus éphémère. L’ADN présente sur ce plan une supériorité extraordinaire, car non seulement il peut résister aux siècles (archéologie génétique, découverte de Oetzi dans les Alpes), mais de surcroît sa transmission familiale permet d’élucider des affaires alors même que les mis en cause sont décédés, via la parentèle. C’est le cas par des recherches en parentalité, comme dans l’affaire Elodie KULIK, mais aussi pour des rapprochements plus ciblés avec des descendants (affaire GORDON, un soldat américain mort en Normandie en août 44 et inhumé sous « X allemand », identifié en 2014 par l’ADN de ses ossements comparé à celui des enfants de sa sœur ; en 2015, suspicion d’un « bébé du franquisme » décédé en 1967 et inhumé à Tarbes ; dans les deux cas, analyses du laboratoire de Marseille).
2. Quelles ont été, au cours des vingt dernières années, les principales évolutions des techniques d’investigation en matière de police technique et scientifique (recueil, exploitation, conservation des preuves) ? Notamment, quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation de preuves de nature olfactive ou acoustique ?
Sous l’angle laboratoire, le progrès majeur est la création du service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB), qui recueille et stocke dans des conditions optimisées, pendant 40 ans, tous les scellés à partir desquels un profil génétique a pu être établi.
Par rapport aux scènes de crimes, du point de vue des laboratoires, les modalités d’intervention sur le terrain, par des spécialistes formés et munis de tenue prévenant les contaminations, fiabilisent considérablement les résultats analytiques postérieurs. Il en est de même pour les kits de prélèvements.
L’existence des fichiers nationaux d’identification (FAED pour les empreintes digitales, FNAEG pour les empreintes génétiques) et des fichiers techniques tels CIBLE en balistique, contribue également considérablement à l’efficacité de la police technique et scientifique.
Concernant les odeurs (stupéfiants, explosifs, humains), plusieurs programmes de recherche, souvent dans un cadre européen (DOGGIES et EMPHASIS), ont été lancés, afin de parvenir à les caractériser et les identifier chimiquement. L’objectif est d’éviter les aléas judiciaires des interventions canines. Si les composantes de l’odeur humaine ont pu être déterminées, leur profil invariant n’est toujours pas maîtrisé. Les travaux se poursuivent.
3. Quelle place l’exploitation des empreintes digitales et génétiques a-t-elle prise dans les investigations au cours des vingt dernières années ? Quel degré de fiabilité peut-on attacher à l’exploitation de ces empreintes ?
Plus que centenaires, les empreintes digitales et palmaires occupent toujours une place très importante : 320 000 traces relevées en 2014, amenant 127 000 envois au fichier spécialisé (FAED).
Pour autant, l’ADN, par son efficacité et sa facilité de recueil, devient progressivement l’attente dominante des enquêteurs et magistrats. Dans les laboratoires de l’INPS, qui couvrent tout le champ de la criminalistique, ce domaine correspond aux trois quarts de l’activité, avec, en 2014, 70 000 des 93 000 dossiers traités. Au plan général, l’ADN, en 2014, ce sont 305 000 prélèvements sur les scènes d’infraction, et 48 000 profils génétiques envoyés au fichier spécialisé (FNAEG).
La fiabilité des analyses, au sens du pouvoir discriminant, est garantie par les travaux scientifiques sur lesquelles elles s’appuient, et par des processus qu’entérinent des accréditations. Tous les laboratoires de police scientifique (les 5 de l’INPS et l’IRCGN) sont en effet accrédités en génétique et en traces papillaires, selon la norme ISO 17025.
Pour autant, les conclusions fournies ne sont que scientifiques. Exemple classique : un ADN découvert dans une cagoule de voleur à main armée ne dit pas qui portait la cagoule lors de l’infraction, mais simplement que la cagoule a été mise en contact avec l’ADN de cette personne. Et des transferts d’ADN sont également envisageables, au moins pour des traces « riches » comme le sperme. La police scientifique ne se substitue pas à l’investigation traditionnelle.
4. Quel est le cycle d’évolution d’une empreinte digitale ou génétique ? Quels ont été les progrès accomplis dans l’exploitation d’empreintes partielles ou altérées ?
Les empreintes digitales et le profil génétique d’un individu ne changent pas avec le temps.
En traces papillaires, les techniques ont évolué avec des révélateurs toujours plus efficaces (Lumyciano) et des pratiques nouvelles pour des supports poreux comme les lettres de menace (indanedione chlorure de zinc) ou encore sur les étuis de munitions (révélations par haut voltage).
Mais c’est surtout l’ADN qui a connu une véritable révolution, avec la possibilité d’exploiter non seulement des traces « riches » (sang, sperme, salive), mais aussi des traces faibles, pauvres en ADN, et de l’ADN dégradé. Il s’agit notamment des « traces de contact », issues de seuls frottements ou touchers. De façon caricaturale, là où il fallait 500 picogrammes pour obtenir un profil génétique, 50 suffisent désormais (1pg = 10-12g). Ce qui rend de simples traces de contact efficaces.
Des progrès encore plus considérables sont attendus à un horizon assez proche. Les techniques liées au SNP (single nucleotide polymorphism) conjuguées avec le séquençage à haut débit (next generation sequencing) vont permettre de traiter en quelques heures des quantités phénoménales de minuscules fragments. Des ADN fortement dégradés, des vrais jumeaux, des mélanges relativement complexes, pourront ainsi recevoir des réponses.
Enfin, des recherches sont en cours sur la datation des traces papillaires et biologiques par des analyses chimiques. Si des résultats encourageants ont été obtenus en conditions de laboratoire contrôlées, beaucoup reste à faire pour en tirer des conclusions en conditions réelles.
5. L’exploitation d’une empreinte digitale ou génétique ou, plus généralement, de tout élément de preuve (à l’exception des témoignages humains) est-elle impossible au-delà d’un certain délai ? Le cas échéant, ce délai est-il le même pour l’ensemble des preuves ?
Cf. question 1, dans bien des domaines techniques, le temps a peu d’impact.
L’archéologie génétique témoigne des possibilités inouïes, par l’ADN nucléaire ou mitochondrial.
Pour les éléments issus de scènes d’infraction, tout est question de condition de conservation, l’humidité étant l’ennemi majeur pour l’ADN. Les cold case (environ 70 à l’INPS depuis 2007 pour des faits remontant jusqu’aux années 80) concernent essentiellement des viols, avec des prélèvements de traces riches gardés, secs, dans des enveloppes de type kraft.
La prolongation de la prescription, pourquoi pas jusqu’à 30 ans en matière criminelle, ne serait pas choquante au plan du potentiel scientifique. Mais une telle décision devrait impérativement s’accompagner d’une réflexion sur les conditions de conservation des pièces à conviction.
Tout autant que ces conditions de conservation, la manipulation est à prendre en compte pour les traces de contact, faibles en ADN et donc susceptibles d’être contaminées, avec au résultat des mélanges inexploitables. D’où l’importance de la gestion des scènes de crimes. D’où également les difficultés à obtenir des éléments décisifs à partir de scellés antérieurs à l’ADN en criminalistique, et donc antérieurs aux précautions désormais en vigueur. Prolonger la prescription ne signifiera pas pour autant être en mesure d’apporter des réponses scientifiques dans des dossiers passés et anciens.
Contribution de l’association Aide aux parents d’enfants victimes
Jeudi 26 février 2015
L’APEV (Aide aux Parents d’Enfants Victimes) est une association nationale de victimes et d’aide aux victimes qui regroupe des parents d’enfants assassinés ou dont un enfant a disparu (depuis sa création en 1991 nous regroupons plus de 250 familles).
Nos actions sont orientées en tout premier lieu vers le soutien et l’accompagnement des familles : accompagnement personnel, individuel ou en groupe et accompagnement judiciaire.
Je suis membre du Conseil National de l’Aide aux Victimes à la Chancellerie et de la CPMS (Comité Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté) de Paris.
Je pense que tout le monde est d’accord sur un point : Le crime ne doit pas rester impuni,
Pourtant, il existe plusieurs cas où l’auteur des faits connu ne peut pas être jugé :
- mort du prévenu
- irresponsabilité pénale
- amnistie
- prescription
La prescription : c’est la décision de ne pas poursuivre et juger l’auteur d’un crime identifié après un certain délai.
Bien sûr, en tant que représentant de victimes, je vous dirais que ce principe est intolérable, et qu’aucune victime ne peut l’accepter.
Qu’est ce qui justifie qu’une société aurait le droit d’« oublier » un crime ? Qu’une société se refuse à juger l’auteur d’un crime, comme si ce crime n’avait jamais existé ? Au mépris des victimes.
Dans ce cas, pourquoi ne pas abolir purement et simplement la prescription des crimes ?
On pourra évoquer l’augmentation de la durée de vie, ou le développement de techniques nouvelles d’investigation de la police scientifique et plus particulièrement la recherche ADN permettant de résoudre une affaire de nombreuses années après les faits (d’où la nécessité de bien conserver les scellés).
Un autre danger, la prescription fait courir le risque d’une justice personnelle pour suppléer la justice défaillante.
Quelles sont donc les raisons qui ont justifié l’introduction de la prescription en droit français ?
Un peu d’histoire. Ce principe a été introduit dans les codes napoléoniens dans les années 1810. Il n’existait pas sous l’ancien régime.
Le Code Pénal, et le Code d’Instruction Criminelle qui a été remplacé par le Code de Procédure Pénale en 1960, énoncent le principe de la prescription criminelle fixée à 10 ans, ce délai n’a pas changé depuis 200 ans.
Pourquoi avoir introduit cette notion de prescription ? Le législateur de l’époque, les jurisconsultes, voulaient "restaurer la paix sociale" après la révolution, en introduisant un délai de prescription pour réconcilier la société nouvelle avec la société de l’Ancien régime qui avait été victime d’exactions criminelles de la part des révolutionnaires (les exécutions de masse d’innocents à Lyon et dans l’Ouest de la France, la période de la Terreur avec les lois d’exception, le tribunal révolutionnaire,…).
Ce qui était une démarche politique à l’époque, permet aujourd’hui à des criminels de droit commun d’échapper à la justice.
« La paix sociale » n’est-t-elle pas aujourd’hui, au contraire, remise en cause par la prescription de moins en moins admise par nos concitoyens.
Ce principe est maintenant inscrit dans la culture française, comme un principe de base, immuable. Le remettre en cause semble inimaginable.
Pourtant la prescription n’est pas un principe universel, il est inconnu du droit anglo-saxon. Il n’y a pas, par exemple, de prescription aux Etats-Unis. Ce n’est dons pas un critère d’un Etat démocratique.
Revenons en 1815, après la chute de l’Empire, au retour des émigrés, l’application de la prescription rendant impossible la poursuite des crimes de la révolution, a favorisé la vengeance personnelle qu’on a appelé la "Terreur Blanche".
La prescription a exacerbé le désir de vengeance de la part de victimes ne pouvant obtenir justice par la voix légale.
De plus, ce principe est très ambigu. C’est ainsi que les enlèvements sans découverte du corps de la victime n’ont pas de délai de prescription, car celle-ci n’a pas de point de départ, l’infraction se poursuivant toujours dans le temps. C’est à partir de la découverte du corps qu’on estime scientifiquement le moment de la fin de l’infraction d’enlèvement, remplacée par un meurtre. C’est de ce moment que part fictivement le délai de prescription.
C’est très compliqué et totalement incompréhensible pour les victimes.
Ex : Emile Louis et les disparus de l’Yonne,
Tant que l’on ne retrouvait pas le corps des victimes, c’était une disparition donc non prescrit, si on le retrouvait, ce que bien sûr souhaitaient les victimes, cela devenait un meurtre, donc était prescrit.
Il y a eu dans ce cas précis, une grande hypocrisie, les magistrats ont contourné le principe de la prescription, pour satisfaire le public qui n’aurait pas compris qu’un tel criminel ne soit pas jugé.
Les conditions d’application du principe de prescription devraient être plus logiques, devraient être clarifiées.
Pour les affaires les plus graves, il pourrait même être abandonné, mais malgré tout, je n’irais pas jusque-là, car il faut un jour pouvoir mettre fin à une enquête.
Je pense que l’imprescriptibilité doit être réservée aux seuls crimes contre l’humanité.
Cette notion de génocide est assez récente, elle a été énoncée au procès de Nuremberg en 1945 pour pouvoir juger les criminels nazis. C’est un message universel fort qu’il est important de conserver.
Retenons pourtant ce principe, aucun criminel ne devrait pouvoir échapper à la justice :
ü Nous demandons la modification de la durée de prescription pour les crimes de sang.
La meilleure solution serait d’uniformiser la durée de prescription à 30 ans, en l’alignant sur celle des actes de terrorisme et le trafic de stupéfiants. Le point de départ restant le dernier acte de procédures comme actuellement, ou de la découverte du corps de la victime.
On pourra nous opposer, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ?
Il serait paradoxal qu’un criminel accuse la société de ne pas l’avoir identifié plus tôt.
ü Plusieurs affaires criminelles anciennes réouvertes à l’initiative des victimes et de l’APEV, ont été résolues par l’application de techniques scientifiques nouvelles sur des éléments matériels recueillis lors des enquêtes initiales.
Par exemple, grâce à l’analyse ADN de microtrace sur des vêtements, plusieurs assassins d’enfants ont pu être arrêtés et jugés pour des crimes vieux de plus de 20 ans.
C’est pour cela que nous proposons qu’on impose systématiquement, avant classement du dossier, une reprise de l’enquête, une dernière fois, afin d’appliquer les dernières techniques scientifiques connues pour donner une dernière chance de retrouver l’auteur des faits.
ü Concernant le signalement des agressions sexuelles commises sur des mineurs. Le régime de prescription de 20 ans après la majorité nous paraît satisfaisant.
Paradoxalement, le délai est plus long pour un viol que pour un meurtre.
Mais je pense surtout qu’il faut mettre un point final aux hésitations de la victime, car plus le temps passe, plus il est difficile de porter plainte pour la victime, plus il est difficile de connaître la vérité pour la justice. Comment juger ? Les victimes ne peuvent être que déçues du résultat de leur démarche.
Deux points sans rapport avec la prescription, nous tiennent à cœur :
ü Les « erreurs de procédure » toujours favorable au criminel, au mépris de la vérité et de la protection de la société.
Oubli d’une signature, dépassement d’un délai, manque d’encre dans un fax… Comment, pour des raisons techniques ou administratives, peut-on admettre de laisser libres des criminels ?
Une solution : la mise en place d’une procédure de rattrapage confiée à un comité de magistrats, qui déterminera si ce « vice de forme » masque ou déforme la vérité et décidera si la demande est recevable ou non.
ü La remise en cause de la chose jugée. Un individu acquitté à tort est aussi une erreur judiciaire. Il faudrait avoir la possibilité de rejuger un individu acquitté à tort, lorsque des « éléments nouveaux » prouvent sa culpabilité, même de nombreuses années après le jugement :
Nous proposons d’étendre la procédure de « révision du procès » prévue actuellement uniquement pour les personnes condamnées à tort, aux personnes acquittées à tort.
Contribution de l’Association pour la protection
contre les agressions et les crimes sexuels
Recommandation de l’APACS en matière de prescription :
Instituer une durée de prescription unique de 30 ans pour les délits et les crimes sexuels :
• Simplifie un système trop compliqué avec de nombreuses exceptions
• Tient compte des avancées scientifiques, notamment des empreintes génétiques
• Evite un vrai déni de justice : la différenciation des viols et agressions sexuelles en matière de prescription. En effet les deux tiers des viols sont « correctionnalisés », c’est-à-dire jugés comme agression (délit) pour éviter l’encombrement des cours d’assises.
Contribution de l’Association nationale pour la reconnaissance des victimes
La prescription pénale est un sujet primordial pour les victimes. L’ANPRV a pour but de favoriser la reconnaissance du statut des victimes et de veiller au respect des lois relatives aux droits des victimes, de fédérer les associations de victimes et d’aide aux victimes ayant les mêmes valeurs d’intérêt public que l’ANPRV et d’organiser des actions et manifestations pour faire reconnaître le statut des victimes.
Sa présidente, Marie-Ange LE BOULAIRE VERRECCHIA est réalisatrice de nombreux documentaires (Envoyé Spécial) et auteure du livre autobiographique Le Viol (Flammarion / J’ai Lu). Victime en 1994 du violeur en série Patrick Trémeau, elle se bat depuis pour l’amélioration de l’aide aux victimes et la prévention. Formatrice auprès de la Police Judiciaire et de la Gendarmerie Nationale et des magistrats, en 2005 elle demande au Procureur de Paris de metre en place le premier bureau d’aide aux victimes au sein d’un TGI afin que les victimes puissent être informées (par exemple pour qu’elles puissent être présentes et se porter partie civile lors des comparutions immédiates). Membre du groupe de travail du Ministère Droits des Femmes pour l’amélioration de l’accueil des victimes de viols, membre de la Commission départementale contre les violences faites aux femmes de Paris, membre le Commission pluridisciplinaire des Mesures de Suretés, elle organise depuis 2010 la journée “Tous ensemble pour les Victimes”, première manifestation d’information et de prévention ouverte au public, place Louis Lépine en face du Palais de Justice de Paris. Le village regroupe une trentaine de fédérations et associations nationales d’aide aux victimes et de lutte contre la délinquance représentant plus de 450 associations locales, en partenariat entre autres avec plusieurs ministères, la ville de Paris et l’ordre des avocats.
La Fondation Marie Ange Le Boulaire Verrecchia « Tous Ensemble pour les Victimes » est en cours de création. Son but est de lever des fonds privés pour les redistribuer aux associations d’aide aux victimes et de créer un centre de soins spécialisé dans le stress post-traumatique.
Audition au sein de l’Assemblée Nationale
lors de la Mission d’Information sur la Prescription en matière pénale
En tant que présidente de l’Association Nationale pour la Reconnaissance des Victimes, j’ai axé mon audition du point de vue de la victime afin de vous faire part du ressenti de celle-ci qui reflète aussi le point de vue de l’opinion publique.
Pour les victimes, ce qu’elles ont subi est injuste et la prescription est vécue comme une injustice supplémentaire qu’elles vivent souvent avec encore plus de difficultés.
La prescription est source de revictimisation, la victime se sent à nouveau victime de la société qui n’a pas réussi à la protéger aux moments des faits et qui ne lui permet pas aujourd’hui de déposer plainte pour la prescription de l’action civile ou qui ne permet pas l’application de la condamnation pour la prescription des peines.
La prescription pénale couvre un champ très large de la contravention au crime, ce qui complique souvent le travail du législateur et la compréhension du justiciable.
Même si au sein de mon association, je travaille sur l’ensemble des victimes de délits et de crimes, j’ai envie aujourd’hui de vous apporter mon avis sur la prescription en matière de viols et d’agressions sexuelles. En effet, de par mon passé et le travail que j’effectue depuis plus de 15 ans sur le sujet, j’ai une connaissance approfondie de ces délits et crimes.
Les viols sont les crimes les plus couramment jugés en Cours d’assises. En effet, près de la moitié des procès en Assises concernent des faits de viols, d’où l’importance de bien réfléchir sur les délais de prescription concernant ce crime.
Il est très difficile de connaître les chiffres exacts des personnes victimes. Toutefois, selon des estimations reconnues, au moins 84 000 femmes adultes et 150 000 enfants sont violés tous les ans en France.
Seulement 10% des victimes déposent plainte. Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d’abord le sentiment de honte, de culpabilité, la peur, les menaces, l’état psychologique sans oublier l’amnésie due à la dissociation et à l’effet de sidération vécue pendant le viol.
Et également bien sûr le délai de prescription qui rend impossible toute action judiciaire au-delà de 10 ans pour les victimes adultes et après l’âge de 38 ans pour les victimes mineures au moment des faits.
Pourtant, porter plainte est la façon la plus évidente pour être reconnue en tant que victime et pouvoir ainsi cheminer vers une réinsertion et recommencer à vivre.
Évidemment, nous savons que de nombreuses plaintes sont classées sans suite et que le nombre des condamnations est faible. Les chiffres sont éloquents : 10% des victimes portent plainte, 2% des viols aboutissent à des condamnations (selon OND 2008 Office National de la délinquance).
On pourrait donc se poser la question de l’utilité de déposer plainte.
Lorsque j’ai réalisé ma série documentaire sur les victimes de viols pour Envoyé Spécial, j’ai filmé pendant 8 mois au sein du 2nd district de police judiciaire à Paris. J’ai donc rencontré de très nombreuses victimes de viols. Il y avait parmi elles celles que l’on nomme « les plaintes tardives », c’est-à-dire des plaintes qui sont déposés des mois voir des années après les faits.
C’est après avoir souffert durant des années (sans parfois savoir pourquoi ou se rappeler des faits), qu’elles ont enfin la force ou la possibilité de déposer plainte. Les victimes n’attendent pas forcément que la plainte aboutisse à la condamnation de leur agresseur. Elles ont besoin d’être reconnues en tant que victime par la société et le fait de déposer plainte, même si cela n’aboutit pas à un procès ou une condamnation, leur permet d’avoir cette reconnaissance.
C’est la raison pour laquelle, lorsque je forme les policiers et les gendarmes, j’insiste auprès d’eux que lorsqu’une personne arrive des années après les faits, qu’ils prennent le temps de l’écouter, de ne pas mettre en doute sa parole et de bien expliquer les suites possibles à cette plainte.
Il parait évident que le délai de prescription était un véritable frein à la considération des préjudices subis par la victime.
Afin de vous illustrer mes propos, j’ai demandé au Collectif Féministe Contre le Viol, association avec laquelle je travaille régulièrement de me donner quelques exemples. Je précise que le collectif a mis en place à sa création il y a 29 ans une ligne téléphonique spécialement pour les victimes de viols. Ils ont récolté plus de 47 000 témoignages.
En voici trois.
1
Une femme nous appelle, bouleversée.
Sa grand-mère étant décédée, la famille a décidé de vendre la maison. Mais auparavant il faut vider la maison. Elle est chargée de trier et nettoyer ce qui se trouve au grenier.
En le faisant elle découvre dans une sacoche son « ours en peluche des vacances ». Alors qu’elle était enfant et passait ses vacances chez la grand-mère elle avait une fois oublié son ours. Sa grand-mère l’avait alors dotée d’un « ours de vacances » qui restait là-bas et qu’elle retrouvait chaque année.
Elle prend l’ours et le caresse et comme lorsqu’elle était petite elle passe la main sous son collier de cou. Il y retrouve le trou dans lequel elle passait son doigt et elle refait ce geste.
Là dans cette petite caverne elle touche un papier roulotté. C’est un papier qu’elle a autrefois rédigé. Elle avait complètement oublié l’avoir fait.
Elle espère qu’avec ce document d’époque, elle va pouvoir porter plainte et faire établir la réalité des viols que son grand-oncle lui a fait subir… Sa plainte est refusée : prescription.
2
Il y a environ un an Jean a été appelé par la gendarmerie lui demandant s’il connaissait Mr X car une enquête est en cours pour viols sur mineurs.
Au premier abord Jean ne se souvenait de rien. Il se rend à l’audition à la gendarmerie et c’est à ce moment que ses souvenirs lui reviennent par flashs. C’est entre ses 11 et 13 ans quand « ça s’est passé ». C’était lors de « camp » où les enfants dormaient tous ensemble. Il se souvient que l’agresseur lui prenait sa main pour qu’il le masturbe. L’agresseur le touchait également. Il y a une scène où il est avec un autre garçon qui lui est violé par l’agresseur. Il n’a pas de souvenir de viol sur lui pourtant il a le goût du sperme dans la bouche.
Il doit témoigner devant la Cour. Une trentaine de victimes ont été retrouvées dans la procédure.
Jean a voulu se constituer partie civile à l’audience mais les faits d’agression sexuelle sont prescrits et la présidente de la Cour d’assises a refusé sa constitution.
16 victimes ont porté plainte, et parmi elles : 10 sont prescrites.
3
En 2013, une femme de 31 ans appelle. Elle a été agressée sexuellement et violée par son beau-frère. Elle était hébergée en France par sa sœur et ce beau-frère. Les viols se sont produits lorsqu’elle avait 20 et 21 ans. Elle ne pouvait pas en parler à sa sœur, car l’agresseur battait sa femme. L’appelante a fait un déni de grossesse jusqu’à l’accouchement d’un enfant né des viols. Elle en a parlé à sa sœur dix ans plus tard. Elle ne pouvait pas en parler auparavant, car l’agresseur la culpabilisait beaucoup et la menaçait. Elle avait très peur de lui et craignait pour sa sœur. Lorsque les deux sœurs décident de porter plainte elles consultent un avocat qui leur apprend que les faits sont prescrits.
………………………
Alors que la prescription est le droit à l’oubli, je propose qu’aujourd’hui on fasse enfin prévaloir la mémoire sur l’oubli, la mémoire des victimes retrouvée des années plus tard, la mémoire des viols et des agressions qui resteront malgré tout dans la vie de toutes les victimes et avec laquelle elles devront vivre le mieux possible.
Voilà donc mes propositions en matière de prescription :
Concernant le début du délai. Il a été évoqué la possibilité dans une proposition de loi de reporter le délai de prescription des infractions sexuelles au moment de la révélation des faits. Qu’entend-t-on par la révélation des faits ? Le moment où la victime se souviendra des faits, le moment où elle aura la force de porter plainte ?
Dans le premier cas, c’est l’introduction d’une inégalité de droits entre les victimes des mêmes faits. Celle qui n’a pas « bénéficié » d’une amnésie traumatique durable serait pénalisée comme si on lui disait « Puisque vous aviez la « chance » de ne pas avoir « oublié » vous auriez dû faire valoir vos droits plus vite ! » En bref : ce sera une nouvelle fois « de sa faute ».
Dans le second cas, cette possibilité répond à la problématique des victimes qui ne peuvent pas déposer pas plainte immédiatement et dont les faits pourraient être prescrits. Toutefois cela me paraît compliqué à mettre en œuvre.
En effet, comment déterminer ce jour ? Je vois très bien la défense s’engouffrer dans cette brèche en démontrant que la victime aurait pu dénoncer les faits avant, qu’elle a parlé à une amie ou à ses parents, qu’elle se souvenait mais n’a pas été déposer plainte. On risque donc dans ce cas de revenir sur la notion absolument inaudible de la négligence de la victime, ce qui renvoie donc la culpabilité sur elle et non plus sur l’agresseur.
Je pense donc que le point de départ doit rester la commission des faits à l’exception des personnes vulnérables, dont le délai commencerait au moment de la capacité à témoigner.
Concernant les infractions sexuelles, les allongements que je propose conservent la distinction existante entre les victimes mineures et majeures.
Je propose également de faire une distinction entre les agressions sexuelles et les autres délits. En fait, les conséquences des agressions sexuelles sont parfois très proches de celle du viol et il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de viols sont correctionnalisés et requalifiés en agressions sexuelles.
Délais Prescription action publique
Contravention 1 an
Délits
Pour les majeurs
10 ans en général sauf :
- Agressions sexuelles, trafic de stupéfiants et terrorisme : 20 ans
- Abus de confiance et Bien sociaux : 3 ans à partir de la découverte des faits ou 10 ans à partir des faits.
Pour les mineurs
- délits violence : 10 ans à partir de la majorité
- Agressions sexuelles : 20 ans à partir de la majorité
Crime : Pas de prescription
En effet, au vu des raisons pour lesquelles les victimes de viols ne déposent pas plainte (amnésie, peur, honte, culpabilité…), il me semble inégal de spécifier un nombre d’année pour la prescription car cela reviendrait à donner des droits différents aux victimes de mêmes faits.
Délai Prescription des peines
Elle se calcule toujours à partir jugement définitif et tout acte magistrat interrompt le calcul du délai.
Je propose en vue de simplification nécessaire à la lisibilité de la loi de garder les délais identiques à l’action publique
Contravention 1 an ou passer l’action publique à 3 ans
Délits 10 ans
Crimes Pas de prescription
Aujourd’hui, l’imprescriptibilité ne s’applique qu’aux crimes contre l’humanité. Je précise que mon propos n’a pas pour but de mettre d’échelle de valeur sur les gravités des crimes ou de déconsidérer les génocides.
Toutefois, il me semble important de mettre en avant les effets dévastateurs des crimes et agressions sexuelles sur les victimes, sur la société et donc sur l’humanité.
Pourquoi vouloir mettre une échelle de valeur et opposer les crimes contre l’humanité aux autres crimes ? Les génocides restent un crime contre l’humanité et le viol est un crime contre l’humain, qui touche 225 000 personnes majeures et mineures par an. Sur une génération (20 ans) ce sont plus de deux millions de personnes, femmes et enfants qui sont touchées.
Nos enfants ne sont-ils pas l’humanité de demain ?
Un second point est qu’il ne faut pas oublier qu’une grande majorité de criminels sexuels ont subi des violences sexuelles dans leur enfance.
L’imprescriptibilité des crimes dont les viols, permettrait aussi de responsabiliser les criminels face à leur acte et ainsi éviter qu’ils fassent d’autres victimes qui pourraient elles aussi devenir des criminels. Le viol est pourvoyeur d’une spirale infernale que la législation peut aider, reconnaître et interrompre.
L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité a été mise en place pour que l’on n’oublie jamais ces horreurs et pour que le devoir de mémoire permette que cela ne se reproduise plus.
L’imprescriptibilité des viols donnerait aussi le droit à la mémoire pour toutes les victimes et ainsi diminuer le nombre de viols et d’agressions sexuelles en évitant la récidive et le cercle infernal de l’agresseur ayant été lui-même victime et ainsi diminuer le nombre des victimes tout en leur laissant le droit de déposer plainte lorsqu’elles en auront la capacité.
Contribution de l’association Stop aux violences sexuelles
À titre liminaire, l’association SVS défend l’imprescriptibilité des infractions sexuelles, et nos réponses s’attacheront à éclairer le rationnel et l’importance de cette position.
De nombreuses contradictions autour des règles de prescription actuelles militent en faveur de cette imprescriptibilité et méritent d’être ici soulignées :
- en raison des règles actuelles de prescription, certaines victimes d’un même agresseur peuvent porter plainte alors que d’autres non : il existe alors de fait une inégalité de traitement des victimes, une inégalité d’accès au service public de la Justice et même un risque d’incohérence dans le traitement de l’affaire puisque certaines victimes pour qui les infractions ne sont pas prescrites pourront porter plainte, se constituer partie civile devant un juge d’instruction et lors du procès pénal, demander réparation, et disposer pendant toute la procédure d’un accès au dossier, tandis que d’autres victimes d’un même auteur, pour qui les crimes ou délits sont prescrits, pourront uniquement être entendues comme témoin et ne seront jamais reconnues officiellement par la justice comme victimes. Ces inégalités entre les victimes d’un même auteur en raison des règles de prescription, outre leur incohérence, ne nous semblent pas acceptables ;
- les violences sexuelles subies dans l’enfance peuvent se retrouver anesthésiées par la mémoire mais peuvent « resurgir » de la mémoire d’une victime plusieurs années après les faits, à la faveur d’un événement déclencheur quel qu’il soit. Ce phénomène de « résurgence » est fréquent, on parle de « conscientisation des faits » qui prend très souvent corps au-delà des délais de prescription légale. L’existence même de ces délais rend impossible, ici encore, le recours à la justice pour un certain nombre de victimes ;
- le problème de la preuve de la matérialité des faits, la difficulté à réunir des preuves très longtemps après la commission des faits, est un argument souvent opposé par ceux qui ne souhaitent pas modifier des règles de prescription actuelle. Pourtant, ce problème resterait in fine le même que l’enquête débute aux 38 ans de la victime (18 ans + 20 ans pour les faits les plus graves), c’est-à-dire dans les délais de prescription, ou à ses 40 ans (hors délai de prescription aujourd’hui). Les difficultés de preuve de la matérialité des faits seraient identiques à la limite de la prescription comme au-delà. Pourquoi accepterait-on d’examiner une plainte d’une victime de 38 ans et pas celle d’une victime de 39 ? L’argument des difficultés de preuves n’apparaît donc pas pertinent. Qui plus est, la preuve de la matérialité des faits, reposant sur des faisceaux d’arguments incluant des données cliniques, quand examinée par des professionnels formés et hautement qualifiés en matière de violences sexuelles est rarement discutable ;
- les délais actuels de prescription sont favorables aux agresseurs, ils peuvent engendrer chez eux un sentiment d’impunité et encourager la perpétration de nouvelles violences sexuelles envers d’autres victimes. Le risque de récidive en l’absence de prise en charge et de sanction par la justice est réel, et surtout, en l’absence de procès pénal, ces auteurs sont privés d’une obligation de soins.
De plus, l’association tient à souligner que toutes les natures d’infractions sexuelles sont concernées, crimes comme délits et souligne l’intérêt qu’il pourrait y avoir à réviser les définitions inscrites dans le code pénal : en effet, il n’y a pas aujourd’hui dans le code pénal de définition générale de ce qu’est une violence sexuelle, de sorte qu’une telle définition introduite dans le chapitre du code consacré à ce type de violences serait opportune.
De même, les définitions actuelles distinguent le viol des agressions sexuelles, et définissent même les agressions sexuelles comme des atteintes sexuelles. Ce n’est pas assez précis et le code introduit une différence légale entre le viol et les agressions sexuelles qui ne semble pas fondée au regard du préjudice subi par la victime, et alors même que le viol reste une forme d’agression sexuelle ; la frontière entre ces deux types de violences sexuelles est floue et cette imprécision dans les définitions légales est de nature à rendre complexe l’appréhension des dossiers de violences sexuelles.
La France pourrait s’appuyer sur l’exemple canadien qui semble beaucoup plus lisible : une seule définition de la violence sexuelle avec des circonstances aggravantes.
1. Considérez-vous que le régime de la prescription de l’action publique parvient à concilier les droits reconnus aux victimes et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ?
La majorité des agressions sexuelles sont perpétrées chez les enfants qui développent un mécanisme de protection psychique, l’amnésie post-traumatique, qui les empêche souvent pendant de longues années de conscientiser les faits et d’être donc en mesure de les révéler à la Justice. Ce n’est souvent que bien plus tard, à l’âge adulte, lorsqu’ils se trouvent confrontés à des situations émotionnelles particulièrement fortes, que les souvenirs des agressions vécues dans l’enfance resurgissent.
Pour comprendre l’amnésie post-traumatique (présentation du Pr Louis JEHEL, chef de service de psychiatrie, CHU Fort-de-France - 2èmes Assises Nationales sur les violences sexuelles - 12 et 13 janvier 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=mPvG6TphN7U).
Diapositives en PJ
Pour autant à cette étape de « conscientisation », la plupart des victimes ne sont pas en état de porter plainte. Ce n’est souvent qu’après un travail thérapeutique qu’elles seront en mesure de le faire. Or, les délais pour entreprendre une démarche judiciaire sont trop souvent prescrits.
Par ailleurs, de plus en plus de communications scientifiques attirent l’attention sur les liens entre certaines pathologies somatiques développées par les victimes d’agressions sexuelles et les agressions sexuelles subies dans l’enfance. Ce champ de la médecine démontre que les corps s’expriment au travers de ces pathologies dès lors que les victimes n’ont pu exprimer leurs traumatismes et suivre un parcours de soin.
Etude SVS14-01- enquête épidémiologique sur la somatisation médicale chronique des violences sexuelles (présentation du Dr Jean-Louis THOMAS, endocrinologue - 2èmes Assises Nationales sur les violences sexuelles - 12 et 13 janvier 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=zwv-fYbS8Kk).
Diapositives en PJ
Revue de la littérature sur la somatisation médicale chronique des violences sexuelles (présentation du Dr Jean-Louis THOMAS, endocrinologue - 1ères Assises Nationales sur les violences sexuelles - 13 janvier 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=ypJ2XqqhgYo)
Diapositives en PJ
Il est important de souligner que ces pathologies se révèlent généralement au-delà des délais de prescription.
Somatisation médicale chronique dans une consultation d’endocrinologie et de gynécologie médicale in Comment guérir après des violences sexuelles ? Dr Violaine GUERIN, Editions Tanemirt, Paris, 2014- p43-62.
Extrait en PJ
Ainsi, le régime actuel de la prescription de l’action publique en matière d’infractions sexuelles est en ce sens inadapté car il prive un grand nombre de victimes de la possibilité de porter plainte et d’accéder à la Justice.
Concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, si cette question renvoie à la préoccupation d’avoir à juger un auteur dans un temps très éloigné de la commission des faits, il est important de souligner qu’en matière d’infractions sexuelles, deux aspects sont fondamentaux :
- un auteur est exceptionnellement auteur d’une infraction unique et isolée, mais est au contraire, souvent auteur de multiples agressions sur plusieurs victimes. Il est donc primordial de l’empêcher de continuer à nuire. Un acte judiciaire reste un moyen efficace de pouvoir interrompre ce cycle d’agressions ;
- un auteur doit être soigné de façon pertinente et adaptée, quel que soit le moment où il est jugé. C’est dans son intérêt, celui des victimes et de la société. La violence étant la racine de la violence, imposer une obligation de soin dans un cadre judiciaire reste le seul moyen de l’éradiquer et d’assainir la société.
2. La limitation du champ de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines aux seuls crimes contre l’humanité vous semble-t-elle devoir être maintenue ?
Cette limitation ne doit pas être maintenue et doit pouvoir s’étendre aux violences sexuelles : en effet, l’ampleur des dégâts quantitatifs et qualitatifs engendrés par ces violences entraîne de telles répercussions dans la société tout entière qu’elles s’apparentent à un crime contre l’humanité.
3. Les délais de droit commun des régimes de la prescription de l’action publique et de la prescription des peines vous semblent-ils devoir être allongés ou réduits ?
Ces délais doivent être allongés pour permettre aux victimes de violences sexuelles d’exercer une action en justice à un moment où elles sont en capacité de le faire. La position de l’association reste néanmoins l’imprescriptibilité de ces infractions.
4. L’existence de délais de prescription de l’action publique et de prescription des peines dérogatoires du droit commun vous semble-t-elle justifiée ?
En matière d’infractions sexuelles ce régime dérogatoire est totalement justifié mais il est nécessaire aujourd’hui d’aller encore plus loin pour les raisons exposées à la question 1.
5. Le régime de prescription prévu par le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale relatif aux personnes vulnérables vous semble-t-il devoir être supprimé ou, à l’inverse, appliqué à d’autres catégories de personnes ? Devrait-il être rendu applicable à certaines atteintes aux personnes ?
Ce régime de prescription devrait être appliqué en matière d’infractions de nature sexuelles.
6. Le régime de prescription de l’action publique applicable à la poursuite des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs vous paraît-il satisfaisant ?
Il est insatisfaisant : d’une part les délais sont majoritairement trop courts pour les personnes victimes dans leur enfance, d’autre part ces délais insuffisants privent l’auteur des soins ordonnés dans le cadre d’une obligation prononcée par la Justice. En outre, un procès permet une indemnisation du préjudice de la victime. Cette indemnisation financière donne notamment accès à la victime au financement de son parcours de soin. Et ce point est fondamental, car il faut réaliser qu’un certain nombre de victimes peuvent devenir des auteurs à leur tour et que la meilleure prévention reste un accès aux soins. Il est important de noter que ce parcours qui inclut les thérapies, n’est quasiment pas remboursé aujourd’hui.
7. Le régime de prescription de l’action publique applicable à la poursuite des infractions sexuelles commises à l’encontre des majeurs vous paraît-il satisfaisant ?
Il est insatisfaisant pour les mêmes raisons que celles développées pour les victimes mineures.
Il est également nécessaire de comprendre que la majorité des victimes majeures ont été victimes en tant que mineures ; en effet, ces agressions vécues lors de la minorité émergent la plupart du temps lors du travail thérapeutique.
8. Le point de départ du délai de prescription des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs et des majeurs devrait-il être reporté au moment de la révélation des faits, c’est-à-dire au « jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique » (solution retenue par la proposition de loi n° 368 modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles dans sa rédaction initiale) ? Le cas échéant, est-il possible de déterminer ce jour avec précision ?
L’association SVS soutient l’imprescriptibilité des infractions sexuelles, mais reconnaît néanmoins à cette proposition, portée au travers du groupe de travail des législateurs de l’association, une avancée significative.
Des experts formés au sujet des violences sexuelles sont dans la capacité de déterminer ce jour avec précision. Il est indéniable cependant que trop peu de professionnels disposent de cette expertise aujourd’hui. Des formations des professionnels concernés, au premier rang desquels les magistrats et les médecins, sont indispensables.
9. Faut-il revoir les modalités d’application dans le temps des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ?
Simplifier le régime de prescription de l’action publique et des peines permettrait davantage de lisibilité. Ce régime peut en effet apparaître complexe et engendrer des difficultés d’application.
Contribution de M. Philippe-Jean Parquet, psychiatre,
professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l’Université Lille II
Mes domaines de compétences sont la psychiatrie infanto juvénile, l’addictologie et l’emprise mentale tant en matière de dérives sectaires que lorsqu’elle est mise en place dans l’entreprise. Je n’interviendrai que dans ces domaines.
Par ailleurs, je ne parlerai que de la prescription de l’action publique.
J’évoquerai plus particulièrement l’ensemble des violences faites à l’encontre des mineurs et singulièrement les violences sexuelles, et d’autre part les délits commis à l’encontre des personnes vulnérables et singulièrement les personnes placées sous emprise mentale.
Les délais de prescriptions sont calés sur la nature des crimes et délits commis pour une grande part, il conviendrait d’ajouter deux autres critères : la nature de ou des victimes d’une part et d’autre part, l’altération ou non des compétences de la personne à évoquer le crime ou le délit et à introduire une action en justice.
Il convient d’affirmer d’emblée que le concept de prescription m’apparaît comme légitime, utile et opératoire sauf dans certains cas comme le crime contre l’humanité qui lui doit demeurer imprescriptible.
Notons que pour le citoyen, la grande diversité des délais de prescription apparaît comme complexe, confus, il n’en perçoit pas la cohérence. La jurisprudence dans ce domaine doit être mieux explicitée au citoyen.
D’autant plus que pour le « citoyen victime », il n’y a jamais de prescription concevable, le crime et le délit doivent être évoqués et punis, car ils ont existé et ont produit des dommages immédiats et à distance. Même si la réparation apportée par la justice et la reconnaissance du statut de victime sont utiles et bienfaisantes, la réparation à partir de l’action judiciaire n’est jamais totale.
La prescription est articulée autour des crimes et délits dans leur diversité. Construite par tâtonnements successifs au cours du temps ; elle repose sur l’analyse de la nature des crimes et délits et de leur gravité appréciée avec des critères multiples. L’organisation de la prescription repose aussi sur le souci du bon fonctionnement de l’activité judiciaire. Cela est légitime. Mais la prescription doit aussi reposer sur la nature des victimes : adultes, enfants, personnes vulnérables…
Pour ces personnes, la date du délai de prescription devant être retenue est-elle celle du début de l’action criminelle ou le moment ou la victime est capable d’évoquer celui-ci ?Le dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale dispose que « le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-331-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou e son état de grossesse, court à compter du jour ou l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »
Mais faut-il aller plus loin, ces personnes sont à un moment donné capables d’évoquer le crime ou le délit, mais n’ont que plus tardivement la capacité retrouvée de mener une action en justice.
Nous nous permettons de souligner ici qu’il convient de s’interroger sur l’inclusion de l’état de grossesse dans cette liste.
Il faut donc démontrer l’incapacité de ces personnes à exercer leurs droits et d’énoncer les critères utilisables pour affirmer et dater le moment ou les compétences psychologiques perdues ou altérées sont de nouveau disponibles et utilisables ?
Il convient par ailleurs de faire la preuve de l’incapacité des personnes à évoquer le crime ou le délit pendant une période longue.
ABUS SEXUELS et autres VIOLENCES faites aux MINEURS.
S’il est vrai qu’actuellement les crimes de cette nature sont souvent révélés pendant la minorité des enfants soit de leur fait, soit par des acteurs divers, ce qui représente un acquis remarquable, il n’en demeure pas moins que beaucoup demeurent cachés.
Les conséquences et les dommages induits sont scellés par l’enfant et l’adolescent. Un enkystement psychologique défensif se met en place empêchant l’évocation, et de plus, conduit à une amnésie pouvant être durable. C’est sur cette constatation clinique que certaines personnes construisent les « faux souvenirs induits ». L’interdit de divulgation par le ou la criminelle, la proximité affective et sociale, le chantage affectif, la culpabilité induite, l’exigence de loyauté quant au partage du secret avec le criminel, celui-ci a noué une relation forte de dépendance avec la victime conduisent à l’impossibilité d’évoquer et de divulguer le crime. Cela empêche de demander de l’aide et même à l’envisager.
C’est souvent après une longue période que ces crimes peuvent être évoqués et qu’une demande de réparation peut être introduite, souvent sur la provocation d’un tiers. Mon expérience clinique de psychiatre en fait foi. Les données de la clinique et les études épidémiologiques permettent d’affirmer l’importance et la gravité des dommages à distance de ces crimes perpétrés pendant l’enfance et l’adolescence, et que ceux-ci sont durables.
Un délai long de prescription est donc légitime pour tenir compte de cet état psychologique. En toute logique, il devrait prendre date au moment où la capacité d’évocation est devenue possible. Cependant la datation précise de ce changement est délicate. En pratique, il serait plus opératoire, mais IMPARFAIT, de fixer un délai long. Mes compétences en psychiatrie ne m’autorisent pas à en fixer le chiffre exact mais 20 ans pourraient couvrir la plupart de ces cas.
PRESCRIPTION en ce qui concerne les PERSONNES VULNERABLES.
La vulnérabilité peut être appréhendée de plusieurs manières. La vulnérabilité est caractérisée par l’absence ou le blocage des compétences physiologiques et psychologiques du sujet à promouvoir des conduites adaptées face aux événements, aux situations, aux relations …auquel il est confronté, et de trouver des réponses adaptées pour les comprendre, se protéger et faire des choix de vie qui correspondent à ses besoins, à ses désirs dans le cadre de son milieu et de la société à laquelle il appartient.
Cette vulnérabilité peut affecter la totalité de la vie du citoyen ou le fragiliser face à telles ou telles circonstances de la vie, elle est dite partielle ou sectorielle. Elle peut être constitutionnelle, acquise, transitoire ou fixée, elle peut aussi être induite. La vulnérabilité peut être considérée d’un point de vue psychologique et physiologique comme une altération des compétences du sujet.
Pour certaines personnes, comme celles qui présentent une déficience intellectuelle grave congénitale ou induite par à une pathologie démentielle par exemple, elles n’ont pas ou plus la capacité à induire une action judiciaire.
En ce qui concerne les personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement, il s’agit d’une vulnérabilité induite. On a induit chez elles un état psychologique spécifique appelé emprise mentale.
J’ai donné une définition de l’emprise mentale dont les caractéristiques permettent de comprendre que l’altération de leurs compétences ne leur permet plus de recourir à une action judiciaire.
CRITERES DE L’EMPRISE MENTALE
L’emprise mentale est habituellement caractérisée par 10 critères dont 5 doivent être retrouvés pour porter le diagnostic d’emprise mentale.
Les critères de l’emprise mentale sont :
1 Rupture imposée avec les modalités antérieures des comportements des conduites, des jugements, des valeurs, des sociabilités individuelles, familiales et collectives
2 Occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure
3 acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposés par un tiers ou une institution : ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé
4 Adhésion et allégeance inconditionnelle, affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une personne ou à un groupe ou à une institution : ceci conduisant à
- une loyauté exigeante et complète
- une obéissance absolue
- une crainte et une acceptation des sanctions
- une impossibilité de croire possible, de revenir à un mode de vie antérieur, ou de choisir d’autres alternatives étant donné la certitude imposée que le nouveau mode de vie est le seul légitime
5 une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution.
6 Une sensibilité accrue dans le temps, aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres à un « corpus doctrinal » avec éventuellement mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte
7 Dépossession des compétences d’une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des repères, des valeurs et du sens critique
8 Altération de la liberté de choix
9 Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l’environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement.
10 Induction et réalisation d’actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas partie de la vie du sujet. Ces actes ne sont plus perçus comme dommageables ou contraires aux valeurs et aux modes de vie habituellement admis dans notre société.
Les critères énoncés ci-dessus montrent l’incapacité des personnes sous emprise à apprécier les situations comme elles auraient pu le faire auparavant, elles ne peuvent imaginer avoir une attitude différente de celle qui a été induite. On retrouve chez elles une loyauté exigeante et complète à la personne ou à l’institution qui a induit cet état, une dépossession des compétences, une altération du jugement. Ceci explique leur incapacité à faire valoir leurs droits, d’autant plus qu’elles ne sont plus accessibles aux avis, attitudes et valeurs de leur environnement. Cela leur apparaît même comme une faute. Ce nouvel état psychologique est évolutif et extensif, pouvant durer plusieurs années. Il ne s’éteint pas brusquement, mais progressivement laissant des séquelles souvent invalidantes.
Dans ces conditions, il parait légitime que le délai de prescription puisse débuter au moment où la victime a récupéré la plénitude de ces compétences. Un tiers peut révéler les crimes et délits sur une personne en état d’emprise mentale, mais cela relève de la citoyenneté de le faire soi-même.
Encore, faudrait-il ajouter une difficulté de taille, beaucoup de personnes ayant été sous emprise, même si elles sont capables de révéler les faits ne sont pas encore capables d’initier une action en justice.
CONCLUSION
On conçoit aisément que cette argumentation légitime et fondée puisse perturber les bases de la construction du délai de prescription, non pas dans ses fondements, mais dans la construction du délai et de sa datation. La difficulté à définir le moment de la récupération par le sujet de ses pleines compétences, la définition claire et consensuelle des critères de cette récupération posent des problèmes difficilement surmontables. C’est pourquoi ce qui apparaît évident pour les victimes et ceux qui les aident est repoussé car non maîtrisable dans la vie judiciaire institutionnelle.
S’il en était ainsi, il conviendrait de fixer un délai de prescription suffisamment long pour apporter une potentialité forte à couvrir la plupart des « cas cliniques »rencontrés ; l’utilisation de ce vocable montre que l’expert n’a pas la légitimité à fixer la durée du délai de prescription à partir de son expérience professionnelle, mais qu’il a comme mission d’éclairer sur la nature de la problématique. La littérature internationale n’apporte pas d’arguments convaincants sur une durée recommandable. Un délai de 20 ans est avancé le plus souvent dans la littérature sans bases solides. L’approche réaliste et opératoire semble prévaloir.
La fixation de la durée de prescription est la plupart du temps influencée par d’autres déterminants gravité des faits, capacité à garder des preuves, gestion de la preuve, capacité à gérer des dossiers très anciens, fonctionnement de la procédure et capacité à gérer l’abondance de dossiers par l’appareil judiciaire.
MARS 2015
Contribution de M. Daniel Zagury, psychiatre,
expert près la cour d’appel de Paris
N’ayant pu participer à l’audition du jeudi 26 février 2015, pour des raisons de force majeure, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint quelques commentaires en réponses à votre questionnaire.
• Abordée frontalement, la question de savoir si les délais de droit commun des régimes de la prescription de l’action publique doivent être allongés ou réduits, ne concerne pas directement l’expert. Je pense notamment aux questions d’harmonisation européenne, qui ne relèvent pas du psychiatre. La position de l’expert, c’est d’éclairer le Juge sur les enjeux techniques, non de décider. Cela implique :
- Qu’il y ait de bons experts (Je vous ai adressé un appel au secours rédigé avec le Professeur Senon, pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation catastrophique de l’expertise psychiatrique).
- Que l’expert ne soit pas en position de décider de facto de l’existence ou non d’une infraction. C’est le point de vue que j’avais développé au sein de la commission Viout, consistant à « déplier » la question de la crédibilité. C’est le même principe qu’il me semble devoir être respecté dans le cas d’abus de faiblesse dans le cadre de l’emprise sectaire. Dans l’article que j’avais rédigé pour la MIVILUDES, j’avais proposé des questions permettant au Juge de décider ou non si l’infraction est constituée, en s’éclairant des avis d’expert, sans que celui-ci ne soit jamais en position de le déterminer de façon binaire (oui ou non)et sans que la question lui soit directement posée.
• Le délit d’abus de faiblesse soulève des difficultés du point de vue de la prescription dans les cas d’amnésie lacunaire concernant des enfants victimes présumés devenus adultes, déposant plainte après la levée d’amnésie. Cette levée d’amnésie se fait souvent vers la quarantaine, longtemps après l’âge de vingt-huit ans.
Il se trouve que j’ai été amené, à la demande de Maître Portejoie, à examiner des plaignantes dans ce cas de figure.
Voici la discussion médico-légale rendue anonyme de l’une d’entre elle :
« L’examen psychiatrique de mademoiselle X permet d’éliminer une psychose évolutive ou constituée. Il n’y a aucun argument dans ce registre, aussi bien à l’anamnèse systématique qu’à l’examen lui-même.
Il n’y a guère plus de raison de retenir une tendance à la mythomanie ou à l’affabulation. Que les faits soient avérés ou non, elle en a la conviction sincère et cela ne relève ni d’une construction délirante ni d’une fabulation destinée à combler une problématique narcissique.
Mademoiselle X était donc très motivée pour rendre compte de l’ensemble de sa trajectoire. Elle m’a rapporté l’existence d’une amnésie complète pendant environ trois décennies (de 1977 à 2009). La levée de l’amnésie serait contemporaine d’une séance d’hypnose en janvier 2009. Elle s’était résolue à consulter un thérapeute à la suite d’un événement particulier en 2008 : la rencontre avec sa nouvelle supérieure hiérarchique avait déclenché le surgissement de toute une série d’images filmiques relatives à son séjour à l’étranger
Mademoiselle X rapporte comment sa première réaction a été de chercher à oublier et « de mettre ça sous le tapis ». Mais elle relate qu’au cours d’un stage de développement personnel, une levée de refoulement d’images sexuelles très violentes de la scène présumée l’a amenée à engager une démarche auprès de celui qui avait été son abuseur, selon elle. Son exigence d’explications n’ayant pas abouti à une réponse, elle déposait plainte.
Mademoiselle X rapportait parallèlement toute une série de vécus corporels douloureux, de fantasmes mortifères, d’angoisses intenses. Son récit est livré avec une grande actualité émotionnelle. Les événements semblent constamment vécus en direct, avec une narration fourmillant de détails.
Mademoiselle X décrit une relation très perturbée à son père, ce qu’elle interprète dans l’après-coup comme un déplacement de sa rage contre son abuseur présumé.
Le présent examen approfondi n’a pas pour objectif de dire si la conviction de mademoiselle X correspond bien aux événements allégués. Au demeurant, l’expérience de la psychiatrie légale appelle à la plus grande prudence pour établir la vérité des faits à partir de la vérité psychologique.
À l’inverse, il est exclu de prétendre que de solides arguments cliniques ne se sont pas accumulés pour éclairer l’évolution à l’âge adulte des sujets ayant subi des abus sexuels dans leur enfance.
Dans ce registre, plusieurs caractéristiques du parcours de mademoiselle X sont très fréquemment repérées :
- Amnésie de l’événement traumatique.
- Dans l’après-coup de l’adolescence, apparition de troubles des conduites alimentaires.
- Perturbation de la relation au père.
- Troubles de l’orientation sexuelle : mademoiselle X a longtemps cru qu’elle avait une orientation homosexuelle exclusive ; puis elle fait état d’une attirance hétérosexuelle altérée par la peur des hommes et le dégoût de certaines pratiques ; actuellement, elle a le sentiment d’avoir une orientation sexuelle très incertaine.
- Évitements en rapport avec la scène traumatique alléguée (terreur des hommes, dégoût de la fellation….)
- Tentatives de suicide.
- Cortège symptomatique post-traumatique au moment de la levée du refoulement (cauchemars ; terreurs diurnes et nocturnes ; sentiment de « devenir folle » ; polarisation idéique ; actualité émotionnelle d’un récit vécu avec une grande intensité).
- Sensations corporelles très douloureuses…
Plusieurs études ont montré de façon convaincante qu’une proportion importante de femmes victimes d’abus dans leur enfance présentait une amnésie (38% de femmes amnésiques dix-sept ans après l’événement traumatique, selon l’étude de Daniel SCHACTER en 1996 par exemple).
En conclusion : l’amnésie alléguée par mademoiselle X, son contexte, sa durée, et sa mise en perspective évolutive (événement traumatique présumé– amnésie – troubles des conduites à l’adolescence – levé du refoulement à l’âge adulte – symptomatologie envahissante), est tout à fait compatible avec les connaissances actuelles de l’évolution à l’âge adulte des abus sexuels subis dans l’enfance ».
• Il y a donc un vrai problème. Mais l’allongement de la durée de prescription est-il la solution ? On peut craindre :
- La multiplication des recours, compte tenu de la difficulté majeure à établir des critères objectifs.
- L’impossibilité, aussi longtemps après, d’établir la moindre vérité des faits.
- Le foisonnement de théories péremptoires, comme ce fut le cas aux États-Unis autour des souvenirs induits et des faux souvenirs, avec des écoles qui ont successivement cherché à s’imposer.
- Le risque de provoquer des procédures interminables, sans issue judiciaire satisfaisante pour le plaignant qui interpelle la justice à un endroit où elle ne peut plus lui répondre. Au demeurant, ce que veulent souvent les plaignantes, ce n’est pas tant que leur abuseur devenu très âgé aille en prison, mais que leur souffrance soit apaisée par la reconnaissance des faits. Peut-être certaines d’entre elles se contenteraient-elles de l’aveu et de l’excuse, comme cela semble être le cas pour l’exemple précédent.
Mais on ne peut esquiver qu’il s’agisse d’un vrai problème, le sujet n’ayant pu en délibérer du fait de l’amnésie, sa démarche pouvant participer d’un processus visant à tourner la page de la période traumatique et de ses conséquences ultérieures. Le débat me paraît donc ouvert et la démarche légitime dans un petit nombre de cas.
• Le délit d’abus de faiblesse me semble soulever des difficultés du point de vue de la prescription dans les cas de l’emprise sectaire. Les victimes ne sont pas toujours des personnes vulnérables, mais rendues vulnérables, vulnérabilisées par une relation de sujétion particulièrement intense, au point de lui faire perdre son autonomie de pensée. Je vous ai adressé la conférence que j’avais faite lors du colloque de la MIVILUDES. Dans le cas de l’affaire des reclus de Monflanquin, il ne me semble pas que les victimes étaient particulièrement vulnérables. C’est le cas par exemple d’un homme, gynécologue accoucheur, inscrit sur la liste d’Alain Juppé pour les élections municipales. Il me paraît difficile de dire qu’il s’agissait au départ d’une personne particulièrement vulnérable. Mais il me semble impossible de nier qu’elle ait été vulnérabilisée par la relation d’emprise exercée par le gourou-escroc qui a ruiné sa famille.
Cette vulnérabilisation pourrait être ainsi caractérisée « lorsque les infractions sont commises par une personne ayant autorité ou exerçant une fonction professionnelle dévoyée à des fins de profit purement personnel, de pouvoir, d’argent, ou de soumission sexuelle ».
Dans les cas de tels abus de transfert, de sujétion, le point de départ de la période de prescription pourrait être celui des manifestations de la crise du sujet précédant la levée d’emprise. Autrement dit, il s’agirait de repérer le moment où le sujet autonome commence à échapper à l’emprise. S’il semble difficile de prétendre dater avec exactitude le jour et l’heure d’un tel début d’autonomisation, il est par contre possible de le circonscrire, un peu comme l’on fixe une date de consolidation en expertise de dommage corporel.
• Ainsi, pour ce qui me concerne, le régime de prescription de l’action publique applicable à la poursuite des infractions sexuelles commises à l’encontre des majeurs me semble satisfaisant. Par contre, pour ce qui concerne les abus subis par des mineurs, devenus majeurs et déposant plainte après la levée de l’amnésie, il me semble que le débat est ouvert.
En vous remerciant de m’avoir sollicité pour donner mon avis, je vous prie d’agréer, Messieurs les Députés, l’assurance de ma considération la plus respectueuse.
Contribution de l’association Anticor
La prescription de l’action publique est "une règle de droit visant un quadruple équilibre :
• un équilibre entre le droit à la sécurité et celui du procès équitable,
• un équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation et celui de chacun d’être jugé dans un délai raisonnable,
• un équilibre entre la mise en œuvre des moyens techniques d’élucidation des infractions, et la nécessité de délimiter le champ du travail de la police, de lui fixer des priorités pour éviter la paralysie, la dispersion des moyens, l’arbitraire de choix laissés aux forces de police
• enfin un équilibre entre les différents foyers de sens de la peine, entre le rappel de la loi et la défense de la société, d’une part, qui n’impliquent pas la prescription, et le sens éducatif, le principe de proportionnalité, la nécessité et l’utilité de la peine, qui eux la justifient " 669.
Ce n’est pas un principe constitutionnel, la Cour de cassation a constaté:
• que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
• que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
• que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration670.
Les quatre arrêts rendus le 20 mai 2011 concernent pour trois d’entre eux, des prévenus dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris, et pour l’un d’entre eux, l’accusé Fourniret.
La note est centrée sur la prescription des infractions à la probité, objet statutaire d’Anticor.
1. La prescription différée des infractions dissimulées : une construction jurisprudentielle aboutie.
Les infractions continues se prescrivent à partir du jour où l’activité a pris fin. Les infractions à exécution successive se prescrivent à compter du jour où l’activité délictueuse a pris fin. La prescription peut être interrompue par le jeu de la connexité : l’interruption de la prescription a le même effet à l’égard de l’infraction qui lui est connexe.
Par ailleurs, pour un ensemble important d’infractions, le point de départ court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique en cas d’infraction dissimulée.
C’est ce dernier point qui est le plus souvent contesté.
Cette construction n’est pas exclusive au droit pénal. La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui ne peut poursuivre a une portée générale671.
C’est une construction ancienne, dont l’origine remonte au début du siècle. Dans un arrêt du 10 décembre 1925, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir, pour rejeter l’exception de prescription, décidé que "c’est seulement lors de l’enquête officieuse qui avait immédiatement précédé la citation directe devant le tribunal correctionnel, que la violation du mandat était apparue et avait pu être constatée".
Dans un arrêt du 4 janvier 1935, elle a admis, de manière explicite, que la dissimulation de l’infraction par son auteur pouvait retarder le point de départ du délai de prescription.
Cette construction s’est poursuivie en matière d’abus de biens sociaux :
- par un arrêt du 7 décembre 1967 qui fixe le point de départ de la prescription triennale de l’abus de biens sociaux au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté (Crim, bull. n° 321) ;
- par un arrêt du 10 août 1981 qui précise que le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public (Crim. Bull. n° 244) ;
- par un arrêt du 5 mai 1997 qui énonce que le délai de prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux ne commençait à courir, sauf dissimulation, qu’à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. (Crim, Bull. n° 159)
Elle s’est également étendue :
• Le délai de prescription de l’action publique en matière de trafic d’influence ne commence à courir, en cas de dissimulation, qu’à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. (Crim. 19 mars 2008, Bull. n° 71) ;
• De même, dans l’affaire du marché des lycées d’Ile de France, il a été jugé que le délai de prescription du délit de participation frauduleuse à une entente prohibée, infraction instantanée, part du jour où cette infraction a été constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 20 février 2008, Bull. n° 44) ;
• Le point de départ du délai de prescription des faits de corruption et d’abus de confiance qui ont été dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être constatés dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 6 mai 2009 ; n° 08-84 107).
La jurisprudence concerne également le favoritisme, (Crim. 27 juin 2001, n° 98-85 214) et le détournement de fonds publics (18 juin 2002 n° 00-86.272).
L’intérêt de cette jurisprudence est évident dans les affaires importantes, par exemple lorsque le juge d’instruction travaille sur des comptes off-shore. Il s’agit souvent d’enquêter sur des faits qui remontent à plus de trois ans, car il faut tracer des mouvements de comptes complexes dans des pays dont les législations sont protectrices du secret bancaire. Si la prescription est interrompue à partir du début de l’enquête, encore faut-il qu’elle ne soit pas acquise auparavant.
Le nombre d’infractions à probité sanctionné est faible, au regard de l’ensemble des peines prononcées. Le nombre total d’infractions à la probité (concussion, corruption, favoritisme, prise illégal d’intérêts, recel de ces infractions, trafic d’influence) a été de 206 en 2010, 274 en 2011 et 247 en 2012 (672).
Par ailleurs, dans une seule affaire criminelle, la Cour de cassation a approuvé une chambre d’instruction qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu (Assemblée plénière, 7 novembre 2014, Bull. n° 613).
2. Une règle à confirmer dans une réforme d’ensemble.
3.1. La suppression de la prescription différée : une réduction significative de l’efficacité des enquêtes sur des faits complexes.
Ainsi, la commission "Coulon" sur la dépénalisation du droit des affaires avait proposé le 20 février 2008, parmi trente propositions, une réforme de la prescription de l’action publique, consistant à fixer le point de départ de la prescription de façon intangible à la date des faits tout en allongeant corrélativement le délai de prescription.
Cette proposition a été reprise dans l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale de 2010 : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée". En contrepartie l’avant-projet prévoyait d’allonger en matière délictuelle, de trois à six ans, le délai de prescription d’un délit puni d’une peine supérieure à trois années d’emprisonnement.
Cette proposition a été rejetée, notamment par la Cour de cassation, réunie en assemblée générale le 16 avril 2010. L’avis soulignait que les nouvelles modalités de la prescription seraient "contraires aux impératifs de lutte contre la grande délinquance".
Les observateurs notaient que si la règle proposée avait été en vigueur, il aurait été impossible de poursuivre l’affaire des ventes d’armes à l’Angola, survenue en 1993 et dénoncée en 2000, et nombre d’autres affaires de corruption, comme celle des emplois fictifs de la ville de Paris.
Ils rappelaient que la jurisprudence actuelle s’explique par le fait que les délits financiers sont des délits cachés et ne sont découverts le plus souvent que des années après les faits, par exemple à l’occasion d’un changement de majorité dans une municipalité, ou un audit de comptes publics ou privés.
Par ailleurs, le législateur a modifié la prescription fiscale dans la loi du 6 décembre 2013 (673).
3.2. Les dates butoir : Une solution séduisante, mais dont l’impact doit être mesuré.
Le rapport sénatorial de 2008 (674) proposait d’allonger les délais de prescription et d’établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l’infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d’interruption et de suspension que les délais de prescription.
Une telle solution mériterait d’être accompagnée par des mesures destinées à surmonter l’obstacle de la dissimulation en particulier en renforçant le statut des lanceurs d’alerte.
En ce domaine, une législation reste à construire, qui pourrait s’inspirer d’exemples étrangers, comme le Royaume-Uni ou le Canada. D’abord, en clarifiant les dispositifs pour protéger de manière générale ceux qui signalent des infractions ou des risques en matière économique ainsi qu’en matière de santé ou d’environnement. Ensuite, en permettant aux lanceurs d’alerte de s’adresser à un interlocuteur sûr, permettant la confidentialité du signalement. Dans les cas les plus graves, ils pourraient bénéficier d’une protection active. Enfin, en prévoyant la sanction des auteurs d’éventuelles mesures de rétorsion.
Par ailleurs, si cette solution peut être satisfaisante en matière d’infractions à la probité, il n’est pas évident qu’elle soit appropriée aux délits en matière de santé ou d’environnement.
3.3. La consécration de la jurisprudence actuelle dans la loi.
Cette option que nous soutenons, vise à inscrire dans la loi la jurisprudence actuelle qui serait ainsi sécurisée. Cette proposition figurait déjà dans notre plaidoyer concernant la loi sur la grande délinquance financière.
Cette jurisprudence pourrait être généralisée pour une disposition prévoyant que "Le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites."
Lors de l’examen en commission des lois en 1ère lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière, un amendement avait été adopté en ce sens, mais il avait été supprimé par le Sénat.
Ce choix confirmerait une construction équilibrée au regard des exemples étrangers et de nos engagements internationaux.
Ainsi, certains pays comme l’Irlande et le Royaume-Uni ou Chypre dans la tradition de common law, ne connaissent pas de période de prescription. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’empêcher des poursuites du fait du temps écoulé. Cependant, une longue période de temps qui se serait écoulée depuis la commission de l’infraction pénale peut avoir un impact sur la probité et le poids des preuves disponibles et pourrait constituer un obstacle pour la possibilité matérielle de tenir un procès équitable. Dans le cas les poursuites sont abandonnées, car elles s’apparenteraient à un abus de procédure.
Dans les pays qui connaissent la prescription, beaucoup définissent la prescription en fonction de la sanction encourue. En Allemagne et en Espagne la prescription ainsi calculée : 3 ans pour les peines inférieures à 1 an, 5 ans pour des peines comprises entre 3 et 5 ans ; 10 ans quand les peines encourues vont de 5 à 10 ans.
L’Italie connaît sans doute le système le plus sophistiqué en ce domaine. Mais, compte tenu de la difficulté d’interrompre des délais, il conduit à ce qu’un nombre important de dossiers n’aboutisse pas.
Par ailleurs, la Convention des Nations unies contre la corruption (Convention de Mérida) prévoit en son article 29 : "chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice".
Elle correspond aussi aux engagements pris en signant la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers qui stipule en son article 6 :" Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction."
Cependant, lors de l’évaluation de la France (rapport de phase 3, publié en octobre 2012), les examinateurs ont notamment considéré que " la prescription triennale ne garantit pas un délai suffisant pour les enquêtes et les poursuites compte tenu notamment des difficultés particulières en matière de preuve et de détection de ce délit. Tout en prenant note de projets législatifs passés visant soit un allongement du délai de prescription, soit la consécration de la jurisprudence, les examinateurs relèvent l’absence d’avancée concrète en la matière".
Contribution de M. Marc Robert, procureur général
près la cour d’appel de Versailles
Messieurs les députés,
Permettez-moi, en premier lieu, de vous remercier de me faire l’honneur de m’entendre sur cette question juridique complexe.
Je bornerai mes propos à la prescription de l’action publique, celle qui focalise toutes les attentions et la seule qui me paraît faire véritablement débat.
Il est aujourd’hui commun de constater que, tant au plan normatif qu’au niveau de la jurisprudence, le bel édifice que nous connaissions encore il y a une trentaine d’années, à l’époque où nous travaillions à la réforme du code pénal Napoléonien, s’est fissuré.
Et même si, curieusement, la Chambre criminelle, voire la Cour de cassation dans son ensemble, énonce des principes qui se voudraient généraux autour de la notion d’infraction dissimulée, alors que la Représentation nationale vise précisément certains pans du droit pénal spécial, l’une et l’autre sont guidées par un seul et même objectif : cantonner les effets de la prescription et renforcer d’autant l’effectivité de l’action pénale.
Dans la mesure où elle fait suite à 180 années de stabilité juridique, une telle évolution conduit nécessairement à s’interroger sur ses raisons d’être qui sont difficiles à saisir si l’on se contente d’agir sur la prescription de manière parcellaire, sans réflexion d’ensemble.
C’est à cette réflexion d’ensemble que vous invitez chaque personne auditionnée à procéder en lui demandant de s’interroger, d’abord, sur les fondements et justifications de la prescription. C’est à cette réflexion que je vais donc me livrer avant de vous faire part de mon sentiment sur des pistes de réforme possible, et en faisant l’économie de détailler une évolution juridique qui l’a déjà été par les personnes que vous avez auditionnées ces deux derniers mois.
*****
S’agissant de ce qui justifie la prescription de l’action publique, je dirai d’abord que la relativité paraît de mise puisque la prescription ne constitue ni un principe conventionnel, ni un grand principe constitutionnel français, la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel se bornant à vérifier que les dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité et ne vident pas de toute substance le droit d’accès à un tribunal garanti par l’art.6 de la Convention (cf. CEDH Grégoire HENRY c. FRANCE, 3.11.2009 ; CE n° 2004-491 du 10.06.2004 ; CRIM 4.12.2012).
C’est dire que le législateur français dispose d’une grande marge de manœuvre en ce domaine.
Cette marge de manœuvre est d’autant plus grande que, d’évidence, certains des fondements traditionnellement avancés pour motiver la prescription ne méritent pas que l’on s’y arrête ; telle l’affirmation selon laquelle l’auteur des faits aurait gagné le droit à l’oubli au terme d’un certain délai acquis après leur commission, lointain héritage de nos racines judéo-chrétiennes du pardon ; ou encore la tentation d’expliquer la prescription par l’inaction volontaire de l’autorité poursuivante ou de la victime, qui, si elle existe, ne joue qu’un rôle marginal et pour les infractions les moins importantes.
Historiquement, le droit à ne pas répondre de ses actes après un certain délai me paraît plutôt consubstantiel avec la notion même d’infraction, définie, dès le début du XIX°s., comme constitutive d’une atteinte à l’ordre public, raison pour laquelle l’action publique était dans le même temps confiée à des magistrats spécialisés afin d’échapper aux aléas de l’action des victimes. Or, passé un certain nombre d’années en fonction de la gravité de l’atteinte, la défense de l’ordre public n’exige plus l’action pénale, le trouble causé s’effaçant avec le temps.
Ce fondement me semble toujours justifié.
Toutefois, c’est la nature même de la conception de l’ordre public qui me paraît avoir évolué, compte tenu de trois phénomènes :
- En premier lieu, jusqu’au milieu du XXe s., du fait de la faiblesse des appareils policier et judiciaire, c’était davantage l’exemplarité immédiate qui était recherchée, et non, comme aujourd’hui, la systématisation de la réponse pénale par rapport à des formes de délinquance d’ailleurs en expansion.
- En second lieu, la sensibilité de la société à certains crimes et délits n’a plus rien à voir avec celle que l’on connaissait auparavant compte tenu, d’une part, de la primauté donnée à l’individu et à la protection de son intégrité et, d’autre part, du sentiment de proximité né des effets de la médiatisation et encore davantage depuis Internet : la réactivité à certaines actualités en est l’illustration, l’État - c’est-à-dire le législateur comme le juge - se sentant comme sommé d’y répondre.
- Enfin, la mise à l’écart de la victime, sauf à des fins indemnitaires, a laissé la place à une victime sujette de droits qui, au plan individuel ou par le biais associatif, met en cause le monopole de fait reconnu au ministère public, y compris quant à l’engagement des poursuites, avec des conséquences sur les délais spécifiques qui peuvent lui être reconnus à cet égard. Elle occupe désormais une place de plus en plus centrale dans la procédure pénale, en lien d’ailleurs avec le phénomène précédent de proximité médiatique.
Cette triple évolution du concept de l’ordre public plaide en faveur d’une refonte des règles de la prescription, même si elle peine à être théorisée.
Il convient néanmoins de ne pas procéder à des généralisations abusives.
Ainsi l’attention du public se porte principalement, et même quasi exclusivement, sur les atteintes à l’intégrité ou à la vie humaine. Cela pourrait servir de support à une réforme si le spectre des jurisprudences et législations dérogatoires n’était pas beaucoup plus vaste.
Encore faut-il relativiser les effets du processus de médiatisation, dans la mesure où il fait aussi en sorte qu’un événement a du mal à s’inscrire dans la durée et qu’une priorité médiatique chasse l’autre.
En outre, une focalisation excessive sur la seule victime individuelle ne serait pas sans conséquence sur les nombreuses atteintes à l’ordre public sans victimes directes, qui lèsent l’État, une collectivité ou une personne morale. Au surplus, et l’histoire des plaintes avec constitution de partie civile l’a bien montré, la Justice n’est pas à l’abri de tentatives d’instrumentalisation, soit pour tenter de porter l’opprobre sur telle ou telle personne, soit pour entraver des procédures civiles, commerciales ou prud’homales.
Au-delà, force est de constater que d’autres évolutions plaident plutôt en faveur d’une conception restrictive de la prescription.
Il en est ainsi du renforcement des droits de la défense et à la nécessaire effectivité de tels droits qui pourrait être mise à mal si les délais de prescription étaient par trop rallongés.
Plus encore, l’allongement des délais de prescription fait courir le risque du dépérissement des éléments de preuve : à quoi sert d’accroître ce délai si, compte tenu du temps écoulé, le recueil de la preuve est rendu impossible ?
L’on parle beaucoup du contre-exemple de la preuve par l’A.D.N. - qui, pour l’essentiel, ne concerne que les crimes de sang et les crimes sexuels et à la condition que les prélèvements utiles aient été réalisés dès la constatation de l’infraction ; mais les praticiens, même s’ils se réjouissent de cet apport scientifique, savent bien qu’un résultat génétique est fragile si aucun élément matériel ne vient le corroborer, compte tenu du risque de pollution, volontaire ou involontaire, des scènes de crime.
L’on évoque beaucoup moins toutes ces affaires dans lesquelles la plainte tardive se heurte à l’impossibilité de recueillir des éléments et indices matériels, mettant la Justice à la merci de tel ou tel témoignage, voire de la parole de celui qui se dit victime contre celle du mis en cause. C’est loin d’être un cas d’école, notamment lorsqu’un jeune majeur porte plainte pour des faits d’agressions sexuelles commis, dix ou vingt ans auparavant, pendant sa minorité.
J’ai donc tendance à considérer que l’allongement des délais de prescription peut aussi accroître le risque d’erreurs judiciaires, lorsqu’il ne porte pas en germe une nouvelle désillusion pour celui ou celle qui se dit victime en cas de classement sans suite, de non-lieu ou d’acquittement. De grâce, ne donnons pas à la Justice des mandats impossibles à exécuter.
Toujours au titre de ce que l’on pourrait qualifier de faisabilité, l’allongement des délais de prescription nécessiterait un effort considérable pour préserver les pièces à conviction et les scellés judiciaires durant de nombreuses d’années en l’attente d’hypothétiques plaintes. Et les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de la récente loi sur la révision des condamnations pénales, qui nous oblige à conserver l’ensemble des scellés lorsque la procédure criminelle s’est soldée par une condamnation, en témoignent.
Enfin, la surcharge actuelle des appareils policier et judiciaire laisse peu de place à l’instruction de plaintes des années après la commission d’un fait, sauf s’il s’avère d’une gravité toute particulière.
Tels sont, en résumé, les fondements modernes de la prescription, qui valent d’ailleurs bien au-delà des frontières de la France, puisqu’on les trouve énoncés dans plusieurs arrêts de la C.E.D.H. (STUBBINGS et autres c R-U du 22.11.1996 675 ; STAGNO c. BELGIQUE 7.07.2009 ; SOMMER c. ITALIE 23.3.2010 ; GMHB c. ALLEMAGNE 17.06.2014).
L’on comprend, dès lors, pourquoi les exhortations d’origine universitaire en faveur d’une réforme simplificatrice, pour en terminer avec ce qui est dénoncé comme une source supplémentaire d’insécurité juridique, peinent tant à recevoir réponse.
L’on aurait tort cependant de considérer que la question de la prescription est unique en son genre ; trente ans après l’adoption du nouveau code pénal, la trilogie crime-délit-contravention comme l’échelle des peines qui fondent notre droit répressif cartésien ont volé en éclats sous le coup de nombreuses dispositions de droit pénal ou de procédure pénale dérogatoires au droit commun relatives, par exemple, au terrorisme ou à la criminalité organisée, dispositions dérogatoires motivées par l’importance particulière que revêtent ces formes de délinquance et dont la prescription ne représente qu’un des aspects.
Il faut aujourd’hui donner une nouvelle intelligence à toute cette construction juridique, en recréant une cohérence entre le droit pénal de fond et la procédure pénale.
*****
Quels pourraient en être les critères s’agissant de la prescription ?
1.- Tout d’abord, et contrairement peut-être à une opinion dominante, je ne suis pas assuré que l’allongement des délais de prescription de l’action publique ait une véritable incidence sur l’effectivité de la répression, sauf à la marge.
Même si aucune étude d’impact sérieuse n’a été réalisée s’agissant des réformes entreprises depuis 20 ans 676, j’estime qu’à quelques exceptions près - crimes contre l’humanité, certaines infractions de presse, apologie et provocation au terrorisme, et, vraisemblablement, fraude fiscale -, que les allongements de délai réalisés ne semblent pas avoir permis la poursuite d’un nombre significatif d’affaires qui, sans cela, auraient échappé à la répression.
À titre d’exemple, la grande majorité des praticiens estime que l’allongement à 20 ou 30 ans des délais s’agissant des trafics de stupéfiants n’a pas eu d’impact.
Certes, à la marge, certaines améliorations seraient souhaitables, ne serait-ce que pour tirer les conséquences du déport, dans le code pénal, par la loi du 13 novembre dernier, des délits de provocation et d’apologie du terrorisme, s’agissant des infractions de presse à connotation raciste, antisémite et xénophobe subsistant dans la loi de 1881 afin de les faire bénéficier aussi de la prescription de droit commun.
Pour le reste, les allongements opérés m’apparaissent davantage traduire la réprobation du corps social s’agissant d’infractions jugées particulièrement graves qu’avoir un effet direct sur les poursuites.
La prescription est aujourd’hui devenue un marqueur de gravité, qui concurrence de plus en plus la seule échelle de gravité légitime, celle qui procède du code pénal, avec la classification des infractions entre crimes-délits et contraventions, et à l’intérieur de cette classification, l’échelle des peines maximales à laquelle chacune de ces infractions appartient.
Telle est sans doute la raison pour laquelle le droit de la prescription est devenu aussi instable, avec les effets que l’on imagine pour les praticiens.
Toutefois, si l’allongement de certains délais de prescription était le prix à payer pour donner une nouvelle intelligence au droit répressif, en recréant une cohérence entre le droit pénal de fond - essentiellement la trilogie crimes-délits et contraventions et les peines maximales encourues - et la procédure pénale, et en revisitant les lois spéciales votées ces dernières années, j’y souscrirai volontiers.
Le principe de réalité me laisse à penser, en effet, que nous n’avons des chances de sortir des incohérences actuelles qu’en alignant vers le haut certains délais, comme le recommandait déjà le rapport d’information du Sénat de juin 2007.
Encore faut-il en préciser les contours.
Laissons de côté les contraventions, où l’ordre public comme l’intérêt privé sont peu en cause et qui relèvent majoritairement de procédures semi-automatisées.
S’agissant des délits, la masse des infractions n’appelle pas, à mon sens, un allongement des délais de prescription de l’action publique car leur nature ne le justifie pas et qu’il risquerait d’éparpiller encore davantage les moyens restreints de l’appareil répressif au détriment des affaires les plus graves, qui méritent toutes les attentions.
Je suis donc fermement hostile à une aggravation généralisée et indistincte de la prescription correctionnelle.
En revanche, pour les délits jugés les plus attentatoires à l’ordre public, le délai de prescription pourrait être doublé en créant, au sein même de la catégorie correctionnelle, un nouvel échelon de délits qui, tout à la fois, se verraient relever des maxima de peines les plus importants, pourraient justifier de dispositions procédurales dérogatoires et ne seraient prescrits qu’au terme de 6 années.
Quant aux crimes, le délai de 10 ans me paraît suffisant, sauf à porter à 20 ans la prescription des crimes punis de réclusion criminelle à perpétuité selon des modalités similaires à celles envisagées en matière correctionnelle.
En réponse à l’une de vos interrogations, j’estime, en revanche, inopportun d’étendre l’imprescriptibilité à d’autres infractions que les crimes contre l’humanité.
Nonobstant les termes du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale et dans la droite ligne de la loi d’adaptation de 2010, il ne me paraît pas souhaitable de déclarer les crimes de guerre imprescriptibles ; j’observe que la décision du Conseil constitutionnel du 5.08.2010 a justifié le sort particulier réservé aux crimes contre l’humanité.
J’ajouterai que j’ai eu le redoutable privilège d’être l’un des rares magistrats à devoir requérir dans une affaire de crime contre l’humanité et que j’en ai retiré une conviction : aucun crime ne saurait être mis au même plan que le crime contre l’humanité, au plan idéologique comme au regard de ses effets. Ce serait, en quelque sorte, le banaliser.
2.- La deuxième question consiste à savoir s’il est opportun de fixer un autre objectif à l’éventuel allongement des délais de prescription, consistant à remettre en cause les législations et jurisprudences différant, d’une façon ou d’une autre, le point de départ du délai de prescription au-delà de la date de commission des faits.
De manière générale, retarder, suspendre ou interrompre le point de départ du délai de prescription me paraît être assuré d’une beaucoup plus grande efficacité répressive que l’allongement des délais de prescription.
Sur ce point, il importe d’abord important de maintenir les dispositions existantes relatives aux mineurs. Je note d’ailleurs que, les concernant, il s’agit d’une évolution internationale, préconisée notamment par la Recommandation 2002-5 du Conseil de l’Europe.
L’on pourrait s’interroger sur l’opportunité de maintenir ou non les dispositions similaires concernant les personnes vulnérables, dans la mesure où, si ces dernières se trouvent bien souvent dans la même incapacité d’agir que les mineurs, le point de départ étant reporté à une date indéterminée.
Toutefois, par souci de cohérence avec la matière civile - l’article 2235 du code civil posant le principe que la prescription “ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle” -, il paraît inopportun de remettre en cause les dispositions dérogatoires existantes.
En ce qui concerne les actes interruptifs du délai de prescription, l’état du droit positif permet, certes, de reculer, de manière parfois très significative, le délai légal et donc de poursuivre, voire de juger bien des années après les faits.
Toutefois, remettre en cause sur ce point l’article 7 du C.P.P. - dont l’origine remonte au code d’instruction criminelle - ainsi que la jurisprudence associée, au bénéfice d’un allongement général des délais de prescription, obligerait à procéder de manière globale pour résoudre des questions n’intéressant qu’une minorité des affaires dont nous avons à connaître.
Une telle réforme conduirait ainsi à étendre les délais pour la grande majorité des affaires simples qui ne requièrent pas de longues investigations.
Pour les autres, l’allongement des délais ne pourra jamais être suffisamment important pour certaines affaires emblématiques, particulièrement complexes et tardivement dénoncées, qui sont parfois jugées plusieurs dizaines d’années après la commission des faits : qui pourrait prendre une telle responsabilité devant l’opinion publique dans l’affaire du sang contaminé, dans celle des incidences sanitaires de l’amiante...? En réalité, une telle solution reviendrait à enfermer les enquêtes comme les instructions dans des délais pré-fixés, avec les conséquences que l’on connaît dans certains autres systèmes juridiques, notamment en Italie : faute de moyens suffisants en police judiciaire et en magistrats, nombre d’affaires - et parmi elles, les plus complexes et les plus importantes - doivent être déclarées prescrites.
Compte tenu du combat procédural incessant que mènent, souvent, les avocats spécialisés, dans le domaine financier comme en matière de trafic de stupéfiants, une telle remise en cause serait nécessairement nocive. L’information judiciaire est déjà, si vous me permettez cette formule, “un véritable parcours du combattant”. N’en rajoutons pas et laissons, sur ce point, la jurisprudence sur le délai raisonnable jouer son rôle.
Enfin, je ne pense pas qu’il y ait des excès, le recours aux actes interruptifs intervenant dans des affaires complexes ou revêtant un volet international qui, sans cela, ne pourraient jamais être jugées dans les délais de 3 ans.
Certes, en matière criminelle, cette faculté est parfois utilisée dans quelques affaires particulièrement sensibles, essentiellement des disparitions d’enfants, afin de retarder sciemment le délai de prescription dans l’espoir qu’un fait nouveau permettrait de les solutionner (cf. Bruay en Artois 1972, Grégory VILLEMAIN 1984...), mais qui le reprocherait ?
J’observe d’ailleurs qu’il serait quelque peu paradoxal de revenir sur l’article 7 relatif aux effets interruptifs de la prescription de l’action publique, deux ans après que le législateur ait à nouveau consacré, dans l’art. 707-1 du C.P.P. créé par la loi du 27 mars 2012, la notion d’actes interruptifs définis de manière particulièrement large, s’agissant de la prescription de la peine 677. Au surplus, beaucoup de systèmes juridiques étrangers prévoient des dispositions comparables.
Tout au plus pourrait-on quelque peu préciser la nature des actes interruptifs, afin que seuls soient considérés comme interruptifs les actes et décisions du ministère public, du juge d’instruction et des juridictions de jugement - compris les décisions juridictionnelles non définitives et l’exercice des voies de recours - tendant à la manifestation de la vérité.
La dernière interrogation a trait à la jurisprudence sur les affaires occultes et dissimulées, qui concerne les atteintes à la vie privée, certaines infractions économiques et financières et, depuis la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7.11.2014, même si son fondement est légèrement différent, les crimes les plus graves contre la vie humaine.
Cette jurisprudence a fait l’objet d’une triple critique : son manque de fondement normatif; son caractère évolutif puisque le champ des infractions concernées s’est accru avec le temps ; l’imprévisibilité qui en résulte s’agissant du délai de prescription.
Pour autant, sans cette jurisprudence, il est certain qu’une partie des abus de confiance et du pillage des biens sociaux serait restée sans guère de réponse répressive.
Depuis 80 ans qu’est apparue cette jurisprudence, de nombreux projets et propositions de loi destinés à la cantonner ou à l’encadrer se sont succédés sans pouvoir aller à leur terme, faute de consensus.
Il est vrai que la majorité d’entre eux préconisaient de substituer à cette jurisprudence un allongement général des délais de prescription. Outre qu’il me paraît peu opportun, je l’ai déjà dit, d’allonger indistinctement les délais en question pour la masse des infractions qui ne sont en rien occultes ou dissimulées, la problématique me paraît mal posée : en 1811 comme en 1958, le législateur était fondé à considérer que, pour l’essentiel, la prise de connaissance de l’infraction était concomitante, à quelques délais près, à sa commission : prendre alors le jour de commission comme point de départ de l’action publique était sans conséquence.
Il n’en est plus de même aujourd’hui, compte tenu de l’évolution du droit économique et financier.
Il me paraît, en conséquence, nécessaire d’inscrire dans la loi ce principe jurisprudentiel.
La loi du 14 mars 2011 a déjà fait un pas en ce sens en complétant le dernier alinéa de l’art.8 s’agissant des personnes vulnérables, en ne faisant courir, pour certains délits, le délai de prescription qu’ “à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique”, et cela même si cette formulation peut paraître sujette à caution puisqu’elle semble conditionner l’exercice de l’action publique à la réactivité de la victime.
La difficulté est de savoir jusqu’où aller.
Légiférer me paraît nécessaire pour les infractions occultes par nature, car elle permettrait de restaurer une égalité devant la répression actuellement plus théorique que réelle.
Je suis plus dubitatif s’agissant des infractions dites dissimulées, puisque la dissimulation tient à la nature du modus operandi ou à l’habileté de leurs auteurs, et que légiférer aurait une portée considérable, compte tenu du nombre des affaires effectivement dissimulées aux yeux des victimes ou du ministère public et de l’impossibilité de limiter le futur principe normatif à partie de ces infractions.
Toutefois, s’il n’apparaissait pas techniquement possible de procéder à pareille distinction, je serai d’avis de s’inspirer, une nouvelle fois, de la loi du 17 juin 2008 qui, reprenant un vieil adage civiliste selon lequel la prescription ne court que contre celui qui peut véritablement agir, a prévu, respectivement dans les articles 2224 et 2234 du code civil, que, d’une part, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”, et, que , d’autre part, “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure”
De manière générale, sans doute faudrait-il aussi préciser exactement ce que l’on entend par report du point de départ, suspension ou interruption de délai, ainsi que le champ d’application précis de ces différents dispositifs, comme cela a été fait en matière civile.
Et si l’on craint le risque d’une imprescriptibilité de facto, faisons, là encore, comme en matière civile et fixons un délai butoir ainsi que l’article 2232 du code civil le prévoit, qui dispose que “le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance de ce droit”.
3.- Quant à l’application dans le temps des lois sur la prescription, il me paraît sage, de ne pas remettre en cause la loi du 9.03.2004 qui a posé le principe de l’application immédiate de ces lois, renouant ainsi avec une longue tradition qui avait été interrompue par la loi de 1992 relative au nouveau code pénal.
Contribution de M. Robert Gelli, directeur des affaires criminelles
et des grâces au ministère de la justice
1. La limitation du champ de l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines aux seuls crimes contre l’humanité vous semble-t-elle devoir être maintenue ?
Oui. La nature spécifique de ces crimes, et de ces seuls crimes, justifie leur imprescriptibilité. L’extension de celle-ci à d’autres crimes reviendrait, d’un point de vue symbolique, à banaliser les crimes contre l’humanité.
2. La distinction entre les délais respectivement applicables à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines est-elle encore pertinente ?
Une prescription plus longue dans le second cas se justifie traditionnellement par l’existence d’une condamnation définitive, alors que dans le 1er la présomption d’innocence impose une réaction plus rapide de l’autorité publique. Mais la distinction n’existe pas dans tous les États, et une unification est envisageable, dès lors qu’elle ne conduirait pas à réduire les délais de prescription de la peine, mais impliquerait une augmentation des délais de prescription de l’action publique.
3. Pensez-vous qu’il serait judicieux de fixer le délai de prescription de l’action publique et des peines en matière délictuelle à 6 ans, 8 ans ou 10 ans ? Seriez-vous opposé à l’idée de ramener de 20 ans à 6 ans, 8 ans ou 10 ans le délai de prescription des peines applicables à certaines infractions ?
Pas d’opposition à l’augmentation de la prescription de l’action publique.
Diminuer la prescription des peines en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiant ou de délit de guerre ne paraît pas opportun.
4. Pensez-vous qu’il serait judicieux d’allonger le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle à 20 ans ou 30 ans ? Serait-il pertinent de porter le délai de prescription des peines criminelles à 30 ans ?
Pas d’opposition pour fixer à 20 ans les prescriptions criminelles (action publique et peine).
5. Dans l’hypothèse d’un allongement des délais de prescription de l’action publique et des peines en matière délictuelle et criminelle, l’existence de délais spécifiques à certaines infractions devrait-elle être maintenue ?
Oui. 3 mois pour les délits de presse, 6 mois pour les délits électoraux, délais justifiés par la liberté d’expression, et par la nécessité de purger rapidement le contentieux de l’élection et stabiliser la représentation démocratique.
Pour les régimes de prescriptions aggravées, ils pourraient être maintenus mais unifiés, en ne prévoyant plus qu’une seule exception pour les délits, et une seule pour les crimes.
- Délit terrorisme, de trafic de stupéfiants, de guerre et sur mineur victime : 20 ans
- Crime terrorisme, de trafic de stupéfiants, de guerre, d’eugénisme et sur mineur victime : 30 ans
Pour les mineurs victimes, il est toutefois également envisageable de considérer, dès lors que le point de départ est la majorité, que le délai de prescription doit être celui, allongé, de droit commun : il resterait donc de 20 ans pour les crimes, mais diminuerait pour les délits, pour lesquels la prescription est actuellement de 20 ou de 10 ans, sauf à conserver pour les délits les durées actuelles.
Les autres régimes pourraient sans doute être supprimés, leur justification n’apparaissant pas clairement (par exemple le délai d’un an pour les délits de rémunération insuffisante en matière de transport routier (article L.3242-3 du code des transports), ou le délai de 6 ans pour les délits de défrichement irrégulier du code forestier.)
6. Pensez-vous que le point de départ du délai de prescription de l’action publique devrait être fixé, dans tous les cas, au jour de la commission des faits, y compris lorsqu’ils sont commis sur des personnes vulnérables (seuls seraient exclus du dispositif les mineurs ainsi que le prévoit aujourd’hui le code de procédure pénale) ?
Le point de départ différé pour les personnes vulnérables prévu par le dernier alinéa de l’article 8 du CPP n’a pas de sens et pourrait être supprimé.
Mais la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées pourrait être reconnue, consacrée, précisée et généralisée à tous les crimes et délits par la loi.
7. L’allongement du délai de prescription des infractions à caractère économique et financier et la fixation du point de départ de ce délai au jour de la commission des faits (quelle que soit la qualification de l’infraction) risqueraient-ils de porter atteinte à l’efficacité de leur répression ?
Par définition oui, puisque des faits occultes ou dissimulés mais découverts après le délai de prescription, même augmenté, ne pourraient plus être poursuivis.
Il y aurait donc une prime à la dissimulation, qui garantirait l’impunité à l’issue d’un certain délai.
8. Le législateur devrait-il intervenir pour fixer avec plus de précisions les motifs d’interruption et de suspension du délai de prescription de l’action publique ?
Oui. Des dispositions plus précises pourraient s’inspirer des articles qui figuraient dans l’avant-projet de nouveau code de procédure pénale de 2010.
Dans leurs dernières versions, ces dispositions prévoyaient notamment que la prescription était interrompue par tout acte ou décision émanant des autorités publiques tendant à la recherche et à la poursuite des infractions et à la condamnation de leurs auteurs, par tout acte mettant en mouvement l’action publique, y compris s’il émane de la personne exerçant l’action civile et par la demande d’octroi de la qualité de partie civile formée par la victime.
9. Si les délais de prescription de l’action publique applicables aux crimes et délits étaient allongés, serait-il pertinent d’instaurer, dès lors que les poursuites auraient été engagées, un délai de prescription plus court sanctionnant l’éventuelle inaction de la justice, qui commencerait à courir au jour de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire (ce délai recommencerait à courir, pour la même durée, après chaque acte interruptif) ?
Il s’agirait là d’une complication très importante par rapport au droit actuel, puisque la durée de la prescription varierait au cours de la procédure, alors que l’objectif de la réforme est de simplifier un droit déjà jugé trop complexe.
Par ailleurs en pratique, une telle prescription abrégée en cours de procédure ne semble répondre à aucune nécessité.
Certes, il convient, lorsqu’une personne est « accusée » (au sens large de la CEDH), de respecter l’exigence de délai raisonnable posée par l’article 6 de la CEDH.
Mais cette exigence est déjà contrôlée, de manière générale, par la Cour de Strasbourg. Si des condamnations délictuelles sont prononcées alors que cette exigence n’a pas été respectée en raison notamment de l’existence d’une ou plusieurs périodes d’inaction prolongée au cours de la procédure, la France sera condamnée – et ce même si ces inactions ont duré moins de 3 ans, durée actuelle de la prescription délictuelle.
En matière criminelle, des inactions de dix ans semblent par ailleurs peu vraisemblables.
Ce qui arrive en revanche parfois, c’est qu’à la suite d’une instruction criminelle qui n’a pas permis de découvrir l’auteur du crime un non-lieu soit rendu, et que, presque dix ans plus tard, de nouvelles pistes ou de nouvelles preuves sont découvertes, permettant la réouverture d’une information qui permettra de confondre l’auteur du crime. S’il était institué une prescription abrégée de 3 ans dans un tel cas, cela assurait l’impunité à l’auteur des faits.
Enfin, il existe déjà de nombreuses règles dans le code de procédure pénale destinées à éviter qu’un juge d’instruction reste inactif ou prenne trop de temps pour clôturer son dossier. On peut ainsi citer :
- Le calendrier prévisionnel de l’instruction (1 an ou moins pour les délits, 18 mois ou moins pour les crimes) qui permet au partie, à l’issue de ce délai, de demander la clôture de l’instruction et à défaut de réponse positive du juge de saisir la chambre de l’instruction (art. 175-1 CPP)
- Le contrôle semestriel par le président de la chambre de l’instruction du fonctionnement de l’ensemble des cabinets d’instruction, le président recevant à cette fin un état de toutes les affaires en cours, ce qui lui permet de vérifier que des actes ont été récemment accomplis dans chacune d’entre elles (art. 221 CPP).
- La possibilité pour le mis en examen détenu de saisir la chambre de l’instruction si elle n’a pas été entendue depuis 4 mois (art. 148-1).
- La possibilité pour une partie de saisir la chambre de l’instruction si aucun acte n’a été accompli depuis 4 mois, délai ramené à 2 mois en cas de détention (art. 221-2 CPP)
- La possibilité pour le président de la chambre de l’instruction de saisir la chambre aux fins d’évocation si aucun acte n’a été fait depuis plus de 4 mois (art. 221-1), ou si une détention dure depuis plus de 3 mois (art. 221-3).
Au cours de l’enquête, l’article 77-2 qui permet au suspect gardé à vue d’interroger le procureur sur les suites apportées à l’enquête six mois après sa garde à vue. S’il s’agit d’une enquête portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée, l’article 706-105 oblige le procureur qui veut poursuivre l’enquête à communiquer le dossier à l’avocat du suspect.
Ces différentes garanties paraissent suffisantes.
La solution d’une prescription abrégée de 3 ans pourrait en définitive soit être sans portée, soit soulever des difficultés importantes, spécialement en matière criminelle en raison de son effet couperet.
Elle pourrait en effet conduire :
- soit à des pratiques purement hypocrites consistant à réaliser tous les 3 ans un acte formel uniquement pour éviter la prescription (ce qui ne poserait en pratique pas de problème, dès lors que les applications informatiques rappelleraient automatiquement aux magistrats de le faire)
- soit, si aucun acte n’a été commis en raison de circonstances exceptionnelles
– remplacement du juge d’instruction et erreur dans le suivi du dossier – à permettre une impunité de l’auteur de l’infraction, qui serait très choquante en matière criminelle.
10. Certains régimes dérogatoires du droit commun (durée, point de départ, motifs d’interruption et de suspension du délai) devraient-ils être maintenus en l’état ?
Oui, comme indiqué en réponse aux questions précédentes.
11. Vous apparaît-il pertinent de ramener de 3 ans à 1 an le délai de prescription des peines contraventionnelles de façon à l’aligner sur le délai de prescription de l’action publique ?
Non, il serait plutôt proposé la solution inverse. Une solution intermédiaire consisterait à fixer les deux prescriptions à deux ans.
12. L’application immédiate de dispositions nouvelles modifiant les délais de prescription, dès lors que les prescriptions ne sont pas acquises, vous semble-t-elle envisageable d’un point de vue juridique et pratique ? Peut-on, à l’inverse, envisager l’application de ces dispositions aux seuls faits commis après leur entrée en vigueur ?
La cohérence exige qu’une loi prévoyant une prescription plus longue s’applique aux faits non encore prescrits, comme l’indique le 4° de l’article 112-2 du code pénal depuis la loi du 9 mars 2004. Il n’existe en effet pas, pour l’auteur d’une infraction, de droit acquis à la prescription, comme l’observe le Doyen Vitu.
Si la loi prévoit une prescription plus courte, il peut sembler difficile, pour des raisons constitutionnelles, de ne l’appliquer qu’à des faits commis après son entrée en vigueur (règle qui serait inverse de celle prévue par le 4° de l’article 112-2). Si le législateur estime en effet qu’il n’est plus nécessaire de réprimer une infraction à l’issue d’un certain délai, on ne voit pas pourquoi cela resterait nécessaire pour des faits commis avant la réforme. Seules des dispositions transitoires prévoyant un régime intermédiaire, pour éviter que du jour au lendemain des faits deviennent prescrits, semblent alors envisageables.
13. Disposez-vous d’éléments chiffrés sur le nombre d’affaires (toutes catégories d’infractions confondues) prescrites chaque année ?
Le ministère de la justice ne dispose pas de données statistiques spécifiques sur le nombre d’affaires prescrites.
Ces affaires relèvent, dans les outils statistiques du ministère concernant le nombre de classement sans suite, de la catégorie « autres cas d’extinction de l’action publique » qui recouvre les cas de décès, d’abrogation de la loi pénale, chose jugée et prescription. Cet item concernait 39 099 affaires en 2013 (40 331 en 2012 et 32 307 en 2011), soit 0,8% des affaires traitées en France cette année-là, sans que l’on puisse, parmi elles, discriminer celles concernant des cas de prescription de l’action publique.
Parmi ces affaires, il n’est pas possible de distinguer lesquelles étaient des contraventions, des délits ou des crimes.
14. Disposez-vous d’éléments chiffrés sur le nombre de peines (contraventionnelles, délictuelles et criminelles) prescrites chaque année ?
Le ministère de la justice ne dispose pas d’éléments chiffrés sur ce point.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Bernard Challe, « Prescription de l’action publique (articles 7 à 9, § 1) », Jurisclasseur code de procédure pénale, avril 2011.
3 () Contribution écrite de M. Bertrand Louvel.
4 () Ces articles disposent respectivement qu’« [e]n matière de crime (…), l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite », qu’« [e]n matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues » et qu’« [e]n matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ».
5 () Ces articles disposent respectivement que « les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive », que « [l]es peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive » et que « [l]es peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ».
6 () Cass. ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739.
7 () Rapport d’information (n° 1598, XIVe législature) de MM. Alain Tourret et Georges Fenech au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la révision des condamnations pénales, décembre 2013.
8 () Voir infra, l’annexe n° 2.
9 () Cesare Beccaria, Des délits et des peines, éditions du Boucher, 2002, pp. 44-45.
10 () Alexis Mihman, Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale : pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale, thèse sous la direction de M. Jacques Francillon, professeur à la faculté Jean Monnet, présentée et soutenue publiquement le 2 avril 2007.
11 () Alexis Mihman, « Comment réformer la prescription de l’action publique ? », Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 3, juillet / septembre 2007, pp. 517-563.
12 () Gabriel Tarde fait reposer la prescription sur l’identité personnelle du coupable qui se modifierait avec le temps : « la loi pourrait au moins, ce semble, édicter deux délais de prescription pour les poursuites des crimes : l’un, beaucoup plus court, en ce qui concerne les mineurs et les impubères, l’autre, en ce qui concerne les majeurs ou les adultes, beaucoup plus long » (Gabriel Tarde, La philosophie pénale, 1890).
13 () Jean-François Renucci, « Infractions d’affaires et prescription de l’action publique », Recueil Dalloz 1997, p. 23.
14 () Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats.
15 () Contributions écrites de MM. Jean-Claude Marin et Jean Danet.
16 () Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette Littératures, 2005, p. 12.
17 () Contribution écrite du colonel François Daoust.
18 () Contribution écrite de M. Frédéric Dupuch.
19 () Article 41-4 du code de procédure pénale.
20 () Article 706-52 du code de procédure pénale.
21 () Article 64-1 du code de procédure pénale.
22 () Article 41-6 du code de procédure pénale. Cet article a été introduit par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, issue des travaux de la mission d’information conduite par vos rapporteurs sur la révision des condamnations pénales.
23 () Articles R. 53-10 et R. 53-14 du code de procédure pénale.
24 () Circulaire conjointe (NOR : JUSB1134112C) du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés.
25 () Par exemple, le Service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) est chargé de conserver, dans des conditions optimales, les traces et échantillons de matériels biologiques placés sous scellés (article R. 53-20 du code de procédure pénale).
26 () Contribution écrite du colonel François Daoust.
27 () Rapport (n° 148, session ordinaire de 2003-2004) de M. François Zocchetto au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, janvier 2004, pp. 179-180.
28 () Jean Danet, Sylvie Grunvald, Martine Herzog-Evans, Yvon Le Gall, Prescription, amnistie et grâce en France, GIP « Mission Recherche droit et justice », mars 2006, p. 139.
29 () Contribution écrite de la Conférence nationale des procureurs généraux.
30 () Contribution écrite de M. Bertrand Louvel.
31 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin.
32 () Dominique Noëlle Commaret, « Point de départ du délai de prescription de l’action publique : des palliatifs jurisprudentiels, faute de réforme législative d’ensemble », Revue de science criminelle, 2004, p. 897.
33 () Contribution écrite de M. Jean Danet.
34 () Voir infra, les a et b du 2 du B du présent I.
35 () Contribution écrite de la Conférence nationale des procureurs généraux.
36 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte.
37 () CEDH, 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, nos 22083/93, 22095/93.
38 () Contribution écrite du Syndicat de la magistrature.
39 () Commission de modernisation de l’action publique, sous la présidence de M. Jean-Louis Nadal, Refonder le ministère public, rapport à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice, novembre 2013, p. 22.
40 () Ibid., p. 23.
41 () Contribution écrite de M. Jean Danet.
42 () Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, Éditions Cujas, 5e édition, 2001, p. 66.
43 () Cette expression a été employée par Mme la garde des Sceaux à l’occasion de son audition, le 18 mars 2015.
44 () Jean Danet, « La prescription de l’action publique, un enjeu de politique criminelle », Archives de politique criminelle, 2006/1 – n° 28, p. 81.
45 () Contribution écrite de M. Didier Boccon-Gibod.
46 () Jean Danet, op. cit., p. 81.
47 () Aux termes de l’article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international du 8 août 1945, les crimes contre l’humanité sont définis comme « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ». Le Statut du Tribunal militaire international ne prévoyait pas l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ; ce sera chose faite avec la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968. Par la suite, la disposition sera reprise par la Convention européenne du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
48 () Cass. crim., 26 janvier 1984, n° 83-94.425.
49 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d’information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, juin 2007, p. 14.
50 () Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
51 () Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
52 () Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
53 () Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
54 () Cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
55 () Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Le Seuil, 2000, p. 648.
56 () Voir infra, le b du 2 du A du II.
57 () Voir infra, le a du 2 du présent B.
58 () Ce faisant, elle a ôté de cette liste le délit de traite des êtres humains commis à l’encontre d’un mineur que la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure avait soumis à un régime de prescription dérogatoire au droit commun.
59 () L’amendement déposé initialement par M. Gérard Léonard proposait de fixer respectivement à trente et vingt ans les délais de prescription de l’action publique des crimes et des délits de nature sexuelle. En outre, ces délais dérogatoires concernaient aussi bien les infractions commises sur les mineurs que celles commises à l’encontre des majeurs. Finalement, la disposition, adoptée à l’unanimité à deux reprises par l’Assemblée nationale et supprimée, en première comme en deuxième lecture, par le Sénat, fut adoptée, moyennant quelques aménagements, par la commission mixte paritaire.
60 () Compte rendu intégral de la 3e séance du jeudi 22 mai 2003, publié au Journal officiel de la République française du vendredi 23 mai 2003.
61 () Contribution écrite de Mme Christine Courtin.
62 () Contribution écrite de Mme Catherine Sultan.
63 () Voir infra, les a et b du 3 du B du II.
64 () Rapport (n° 116, première session ordinaire de 1994-1995) de M. Pierre Fauchon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, le projet de loi de programme, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la justice, et le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, décembre 1994, p. 24.
65 () Cet article renvoie à l’article 706-16 du code de procédure pénale, qui fait lui-même référence aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
66 () Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
67 () Cette infraction est prévue à l’article 222-40 du code pénal.
68 () Amendement n° 127 déposé par le Gouvernement sur le projet de loi (n° 3166) relatif à la bioéthique et adopté par le Sénat en première lecture.
69 () Exposé des motifs du projet de loi (n° 308) portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale présenté par M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2007.
70 () Rapport (n° 326, session ordinaire de 2007-2008) de M. Patrice Gélard au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, mai 2008, p. 47.
71 () Ibid., p. 48.
72 () Voir infra, le 2 du B du II.
73 () La disposition figure à l’article 706-175 du code de procédure pénale. Le délai dérogatoire de prescription de l’action publique et des peines des délits en question n’est applicable qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, en application du second alinéa de l’article 706-175.
74 () Exposé des motifs du projet de loi (n° 1652) relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs présenté par M. Hervé Morin, ministre de la défense, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2009.
75 () Rapport (n° 840, XIVe législature) de Mme Marietta Karamanli au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 736 rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, mars 2013, p. 133.
76 () Compte rendu intégral de la 2e séance du mardi 17 septembre 2013, publié au Journal officiel de la République française du mercredi 18 septembre 2013.
77 () Rapport (n° 60, session ordinaire de 2008-2009) de Mme Marie-Hélène des Esgaulx au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, présentée par M. Marcel-Pierre Cléach et plusieurs de ses collègues, tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet, octobre 2008, p. 8.
78 () Cette infraction figure désormais au septième alinéa de l’article 24.
79 () Rapport (n° 441, session extraordinaire de 2002-2003) de M. François Zocchetto au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, septembre 2003, p. 266.
80 () Rapport (n° 409, XIVe législature) de Mme Marie-Françoise Bechtel au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 297), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, novembre 2012, p. 55.
81 () Rapport (n° 2173, XIVe législature) de M. Sébastien Pietrasanta au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2110) renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, juillet 2014, p. 88.
82 () Voir supra, le b du présent 1.
83 () Rapport (n° 2173, XIVe législature) précité, p. 113.
84 () Cette disposition, qui figurait au neuvième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014, est désormais prévue à son huitième alinéa.
85 () Rapport (n° 409, XIVe législature) précité, p. 54.
86 () « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
87 () Il s’agit des diffamations et des injures non publiques réprimées par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal, comme l’a souligné Mme Agathe Lepage, professeure à l’Université Paris II Panthéon-Assas, lors de son audition du 23 janvier 2015.
88 () L’article L. 101 du code électoral punit de vingt ans de réclusion criminelle toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
89 () Pour plus de précisions, voir Laurent Griffon-Yarza, « Prescription de la peine », Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, février 2014 : en particulier, les précisions relatives au caractère définitif des décisions (décisions contradictoires, contradictoires à signifier, décisions rendues par défaut ou par itératif défaut, etc.).
90 () Par exemple, le faux et l’usage de faux, dont le délai court « à compter de la date de l’établissement de l’écrit argué de faux et non de la découverte de son existence » (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329), ou, en cas d’usage de faux, à compter du jour de son dernier usage délictueux (Cass. crim., 8 juillet 1971, n° 70-92.683 ou 3 mai 1993, n° 92-81.728) ; le faux témoignage, dont le délai « commence à courir du jour où la déposition a été faite » (Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-81.424) ; ou la dénonciation calomnieuse, dont le délai commence « au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente » (Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 02-84.485).
91 () Par exemple, le délit de bigamie, dont le délai court « dès la célébration du second mariage » (Cass. crim., 12 avril 1983, n° 82-91.088).
92 () Cass. crim., 26 avril 1994, n° 93-84.880.
93 () Voir les développements qui suivent.
94 () Cass. crim., 4 novembre 1985, n° 84-90.634 ou 4 novembre 1999, n° 99-81.279.
95 () Cass. crim., 22 octobre 1979, n° 77-93.117 ou 4 décembre 1990, n° 90-81.772.
96 () Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.019.
97 () Cass. crim., 3 décembre 1963, n° 62-93.686.
98 () Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 94-84.008.
99 () Cass. crim., 22 juillet 1971, n° 70-90.318.
100 () Cass. crim., 23 février 1994, n° 93-81.171.
101 () Cass. crim., 6 février 1969, n° 67-93.492, 27 octobre 1997, n° 96-83.698 ou 8 octobre 2003, n° 03-82.589.
102 () Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 05-87.096.
103 () Cass. crim., 4 octobre 2000, n° 99-85.404.
104 () Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-82.534.
105 () Lorsque l’auteur a conservé un intérêt après avoir acquis une qualité incompatible avec l’opération concernée, le délit de prise illégale d’intérêts devient un délit continu qui se prescrit à compter du jour où prend fin cette situation (Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-82.880).
106 () Cass. crim., 27 mai 2004, n° 03-82.738.
107 () Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124.
108 () Cass. crim., 16 juillet 1964, n° 63-91.919 ou 28 mars 1996, n° 95-80.395.
109 () Cass. crim., 29 juin 1983, n° 83-90.987.
110 () Cass. crim., 16 octobre 1979, n° 79-90.762.
111 () Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773.
112 () Cass. crim., 17 janvier 2006, n° 05-86.451.
113 () Cass. crim., 3 juin 2008, nos 07-80.240 et 07-80.241.
114 () Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-80.796.
115 () Cass. crim., 13 janvier 1970, n° 68-92.118 ou 8 février 2006, n° 05-80.301.
116 () Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217.
117 () Cass. crim., 4 janvier 1935, Gaz. Pal., 1935, 1, Jur, p. 353.
118 () Cass. crim., 11 février 1981, n° 80-92.059 ou 8 février 2006, n° 05-80.301.
119 () Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 66-91.972.
120 () Cass. crim., 10 août 1981, n° 80-93.092.
121 () Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.482, 27 juin 2001, n° 00-87.414 ou 28 mai 2003, n° 02-83.544.
122 () Dans d’autres hypothèses, le point de départ du délai peut être reporté à une autre date :
– « le délit d’abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu » (Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.544) ;
– de même, en cas d’usages successifs résultant d’une convention, c’est-à-dire lorsque « l’usage contraire à l’intérêt social, constitutif d’abus de biens sociaux, [résulte] non des conventions litigieuses mais de leurs modalités d’exécution », « celles-ci [doivent] faire l’objet, à la fin de chaque exercice, d’un rapport spécial des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées générales [constitue] le point de départ du délai de prescription en cas de conventions de versements d’honoraires à un tiers, en rémunération de prestations pour partie fictives » (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-81.471).
123 () Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773.
124 () Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-85.763.
125 () Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371.
126 () Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-85.508.
127 () Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-81.119.
128 () Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85.214.
129 () Voir supra : Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329.
130 () Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-80.370.
131 () Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 06-83.963.
132 () Cass. crim., 17 mai 1983, n° 83-90.110.
133 () Cass. crim., 16 juillet 1964, n° 63-91.919.
134 () Cass. crim., 7 mai 2002, n° 02-80.797.
135 () Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-80.615 ou 7 juillet 2005, n° 05-81.119.
136 () Voir les développements qui précèdent.
137 () Cass. crim., 25 février 2004, n° 03-81.673.
138 () Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124.
139 () Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.319.
140 () Cass. crim., 13 décembre 1982, n° 80-95.151 et 20 février 1989, n° 87-90.806.
141 () Cass. crim., 19 mars 1979, n° 78-92.575.
142 () Cass. crim., 20 février 2008, nos 02-82.676 et 07-82.110.
143 () Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939.
144 () Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329.
145 () Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 12-80.107.
146 () Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414.
147 () Cass. crim., 16 novembre 2005, n° 05-81.185.
148 () Cass. ass. plén., 20 mai 2011, nos 11-90.025, 11-90.032 et 11-90.033.
149 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin.
150 () Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.544.
151 () Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-81.471.
152 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin.
153 () Contribution écrite de M. Didier Boccon-Gibod.
154 () Contribution écrite de M. Jean Maïa.
155 () Contribution écrite de M. Dominique Foussard.
156 () Voir supra, le b du 1 du présent B.
157 () Avis (n° 709, XIIe législature) de Mme Valérie Pecresse au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 593), relatif à la bioéthique, mars 2003.
158 () Voir supra, le b du 1 du présent B.
159 () Cette disposition est issue d’un amendement de M. Christian Demuynck adopté au Sénat en première lecture avec avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement (voir le compte rendu intégral de la séance du vendredi 10 septembre 2010 publié au Journal officiel de la République française du samedi 11 septembre 2010).
160 () Exposé sommaire de l’amendement n° 62 rect. ter de M. Christian Demuynck.
161 () Voir les développements qui précèdent.
162 () Rapport (n° 2827, XIIIe législature) de M. Éric Ciotti au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2780), modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, septembre 2010, pp. 116-117.
163 () Contribution écrite de M. Philippe-Jean Parquet.
164 () Contribution écrite de la Conférence nationale des procureurs généraux.
165 () Contribution écrite de Mme Catherine Sultan.
166 () Contribution écrite du Syndicat national des magistrats-FO.
167 () Article L. 3 du code du service national.
168 () Comme les ordonnances de désignation du juge d’instruction (Cass. crim., 11 avril 1959), la réquisition faite à la gendarmerie d’extraire un détenu pour l’amener à l’audience (Cass. crim., 28 août 1913) ou le rappel adressé par le juge d’instruction à un service d’enquête (Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 01-80.726).
169 () Ne sont donc pas interruptifs les citations irrégulières (Cass. crim., 24 avril 1979, n° 78-92.033), le rapport de police assorti d’aucun procès-verbal établi dans les formes légales (Cass. crim., 6 janvier 1965, n° 64-91.568) ou les actes d’instruction ou de poursuite accomplis par un organe incompétent matériellement ou territorialement (Cass. crim., 16 mars 1988, n° 87-82.240), sauf si l’incompétence a été révélée plus tard.
170 () Sauf en matière électorale, dans laquelle le juge a décidé que l’acte interruptif de la prescription dérogatoire de six mois fait courir non pas une nouvelle prescription abrégée mais la prescription de droit commun (Cass. crim., 3 juin 1986, n° 86-91.301).
171 () Cass. crim., 5 juillet 1993, n° 92-82.799.
172 () Cass. crim., 11 juillet 1972, n° 72-90.719.
173 () Cass. crim., 15 janvier 1990, n° 86-96.469.
174 () Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-85.919.
175 () « Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées. »
176 () Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-83.536.
177 () Cass. crim., 30 novembre 1987, n° 87-80.737.
178 () Cass. crim., 18 février 1991, n° 90-80.025.
179 () Vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale.
180 () Troisième alinéa de l’article 44-1 du code de procédure pénale.
181 () Avant-dernier alinéa des articles L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation.
182 () Cass. crim., 25 novembre 1969, n° 68-92.669.
183 () Cass. crim., 20 novembre 1968, n° 68-90.799.
184 () Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-81.415.
185 () Cass. crim., 16 mai 1973, n° 71-92.496.
186 () Cass. crim., 28 janvier 1988, n° 86-92.565.
187 () Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-81.660.
188 () Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-85.042.
189 () Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.307.
190 () Contribution écrite de M. Didier Boccon-Gibod.
191 () Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-83.582.
192 () Cass. crim., 9 décembre 1980, n° 80-91.546.
193 () Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 94-83.837.
194 () Cass. crim., 1er février 1912.
195 () Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 05-85.085.
196 () Cass. crim., 21 février 2012, n° 11-87.163.
197 () Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-83.136.
198 () Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-85.403.
199 () Cass. crim., 20 juin 1951.
200 () Cass. crim., 25 juin 1970, n° 69-93.357.
201 () Cass. crim., 7 avril 1992, n° 91-82.842 ou 19 mai 2005, n° 04-85.076.
202 () Cass. crim., 15 septembre 2010, n° 10-80.273.
203 () Cass. crim., 16 octobre 2002, n° 01-88.381.
204 () Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 08-80.381.
205 () Cass. crim., 9 juin 1998, n° 96-84.894.
206 () Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.995.
207 () Cass. crim., 10 février 2004, n° 03-87.283.
208 () Cass. crim., 15 mai 1973, n° 71-93.648.
209 () Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.995.
210 () Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88.684.
211 () Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-85.274.
212 () Suspension jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions (dernier alinéa de l’article 67 de la Constitution).
213 () Suspension pendant la durée de la session lorsque l’assemblée à laquelle le parlementaire appartient requiert la suspension des poursuites ou jusqu’à la levée de l’inviolabilité en cas d’arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté en matière criminelle ou correctionnelle à condition qu’ait été formulée une demande de mainlevée (deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 26 de la Constitution).
214 () Suspension entre le dépôt de plainte et la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois (deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale).
215 () Suspension pendant le temps nécessaire à sa mise en œuvre (avant-dernier alinéa de l’article 41-1 du code de procédure pénale).
216 () Suspension pendant le délai que le juge fixe pour statuer dessus (article 386 du code de procédure pénale).
217 () Suspension jusqu’à la production de l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire en cas d’infractions militaires non dénoncées par cette dernière et à condition qu’elles ne soient pas flagrantes (article 698-1 du code de procédure pénale).
218 () Suspension pendant six mois maximum à partir de la date de sa saisine lorsque la poursuite exige l’avis conforme de la commission des infractions fiscales (articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales).
219 () Suspension pendant la consultation de l’Autorité (avant-dernier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce).
220 () Suspension pendant la consultation de la commission ou le délai de douze mois durant lequel elle doit rendre son avis (c du 1 de l’article 450 du code des douanes).
221 () Suspension depuis le jour où la décision est devenue définitive jusqu’à celui de la condamnation du coupable lorsqu’une personne a obtenu ledit jugement ou arrêt (deuxième alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale).
222 () Suspension jusqu’à ce qu’intervienne la décision mettant hors de cause la personne soumise à diffamation (article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
223 () Suspension jusqu’à la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé (article 226-11 du code pénal).
224 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin.
225 () Par exemple, le ministère public ne peut pas invoquer les déclarations mensongères des personnes mises en cause pour demander la suspension de la prescription, car il aurait dû mener des investigations complémentaires au moment de l’enquête pour les confirmer ou les infirmer (Cass. crim., 8 août 1994, n° 93-84.847).
226 () Cass. crim., 30 mai 1995, n° 94-80.087.
227 () Cass. crim., 1er août 1919.
228 () Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 99-86.348.
229 () Suspension jusqu’à la notification de l’arrêt rendu sur le pourvoi (Cass. crim., 5 mars 1979, n° 78-92.809).
230 () Cass. crim., 3 octobre 2000, n° 00-81.257.
231 () Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-81.129.
232 () « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
233 () Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.086.
234 () Cass. ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739.
235 () CA Paris, 19 mai 2014, n° 2013/08837.
236 () Cass. crim., 16 octobre 2013, nos 11-89.002 et 13-85.232.
237 () D’après la Cour de cassation, « les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, (…) les accouchements ont eu lieu sans témoin, (…) les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, (…) les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et (…), dans ces conditions, nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ».
238 () Dominique Noëlle Commaret, op. cit.
239 () La liste de ces propositions figure à la page 9 du rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité.
240 () La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, du groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, janvier 2008, p. 101.
241 () Voir l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale.
242 () Comme en l’état actuel du droit, il ne s’agissait que de certains crimes et délits.
243 () Voir la proposition de loi n° 171.
244 () Voir la proposition de loi n° 355.
245 () Voir la proposition de loi n° 2536.
246 () Voir la proposition de loi n° 2582.
247 () Voir la proposition de loi n° 1341.
248 () Voir la proposition de loi n° 1909.
249 () Voir la proposition de loi n° 2251.
250 () Voir la proposition de loi n° 3231.
251 () Voir la proposition de loi n° 3899.
252 () Devenu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
253 () Voir l’article 21 bis A du projet de loi (TA n° 163), modifié en première lecture par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, 25 juin 1999.
254 () Devenu la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
255 () Rapport (nos 1130 et 1131) de M. Yann Galut au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, après engagement de la procédure accélérée, sur le projet de loi (nos 1011 et 1021) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique (n° 1019) relatif au procureur de la République financier, juin 2013, p. 93.
256 () Amendement n° 690 déposé par le Gouvernement sur le projet de loi (n° 1011) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et adopté par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat en première lecture.
257 () Voir l’article 3 de la proposition de loi (n° 368) de Mmes Muguette Dini et Chantal Jouanno et plusieurs de leurs collègues modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, enregistrée à la Présidence du Sénat le 13 février 2014.
258 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
259 () Rapport (n° 2352, XIVe législature) de Mme Sonia Lagarde au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 1986), modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles, novembre 2014, p. 18.
260 () Compte rendu intégral de la 1ère séance du jeudi 27 novembre 2014, publié au Journal officiel de la République française du vendredi 28 novembre 2014.
261 () Contribution écrite de M. Jean Danet.
262 () Voir supra, le b du 1 du B du I et les a et b du 2 du même B.
263 () Contribution écrite de M. Dominique Foussard.
264 () Cette explication a été avancée lors de l’audition des magistrats instructeurs du 29 janvier 2015.
265 () Voir supra, le c du 1 du B du I et le a du 2 du même B.
266 () Contribution écrite de M. Robert Gelli.
267 () Voir supra, le c du 1 du B du I.
268 () Contribution écrite de M. Jean Viansson Ponté.
269 () Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-25.290.
270 () Contribution écrite de M. Christophe Bigot.
271 () Contribution écrite de Mme Fabienne Siredey-Garnier.
272 () Sous réserve des affaires par définition ignorées d’elle parce que, ayant été prescrites, elles n’ont jamais été portées devant la juridiction.
273 () Nicolas Bonnal, « Les " chausse-trappes " procédurales de la loi de 1881 : mythe ou réalité ? Essai d’étude statistique », Légipresse n° 289, décembre 2011, pp. 665-675.
274 () Contribution écrite de M. Christophe Bigot.
275 () Contribution écrite de Mme Violaine Guérin.
276 () Contribution écrite de Mme Marie-Ange Le Boulaire Verrecchia.
277 () Contribution écrite de M. Jean Pradel.
278 () Contribution écrite de Mme Christine Courtin.
279 () Les informations qui suivent sont issues d’une étude transmise à vos rapporteurs par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (voir infra, l’annexe n° 1).
280 () Article 101 du code pénal suisse.
281 () À la suite de la votation populaire du 30 novembre 2008, l’article 123b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse prévoit désormais que « l’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles » et le e de l’article 101 du code pénal dispose en conséquence que « sont imprescriptibles (…) les actes d’ordre sexuel avec des enfants (…), la contrainte sexuelle (…), le viol (…), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (…), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (…) et l’abus de la détresse (…), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans ».
282 () Compte rendu de la séance du Sénat du jeudi 1er février 1996, publié au Journal officiel de la République française du vendredi 2 février 1996, consacrée à la discussion du projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
283 () Voir infra, le 2 du B du présent II.
284 () Contribution écrite de M. Marc Robert.
285 () Contribution écrite de M. Jean Danet.
286 () La Charte d’Aigues-Mortes de 1246 avait déjà instauré une forme de prescription processuelle puisqu’elle prévoyait que « tout procès sera[it] achevé en moins d’un an, à compter du début de l’enquête, à moins qu’il n’y ait appel ; et alors la procédure d’appel sera[it] achevée en moins de six mois ».
287 () Contribution écrite de M. Bertrand Louvel.
288 () Voir supra, le a du 1 du présent A.
289 () Rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, du groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, op. cit., p. 102.
290 () Voir infra, le 5 du B du présent II.
291 () Voir supra, le b du 2 du A du présent II.
292 () Alexis Mihman, « Comment réformer la prescription de l’action publique ? », op. cit.
293 () Voir supra, le c du 2 du A du I.
294 () Voir supra, les b et c du 1 du B du I.
295 () La France n’a cependant pas ratifié la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968.
296 () Voir supra, le a du 1 du B du I.
297 () Voir supra, le b du même 1.
298 () La CPI n’exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression que lorsqu’il aura été défini.
299 () Rapport (n° 326, session ordinaire de 2007-2008) précité, pp. 47-48.
300 () Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, adopté par l’Assemblée plénière du 6 novembre 2008, p. 2.
301 () Notamment à l’Assemblée nationale, en commission des Lois (amendements CL 26 de M. Noël Mamère, CL 45 de M. François Vannson et CL 88 de M. Jean-Jacques Urvoas) et en séance publique (amendements n° 17 de M. Noël Mamère, n° 50 de M. Jean-Jacques Urvoas, n° 60 de Mme Françoise Hostalier et n° 65 de M. Jean-Pierre Grand).
302 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte.
303 () Cass. crim., 20 décembre 1985, n° 85-95.166.
304 () Elisabeth Lambert Abdelgawad et Kathia Martin-Chenut, « La prescription en droit international : vers une imprescriptibilité de certains crimes ? » in Hélène Ruiz Fabri, Gabriele Della Morte, Elisabeth Lambert Abdelgawad, Kathia Martin-Chenut (dir.), La Clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce en droit international et comparé, UMR de droit comparé de Paris, vol. 14, 2007, pp. 121-128.
305 () Audition de Mme Christiane Taubira du 18 mars 2015.
306 () Décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, Loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, considérants 2 à 8.
307 () Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, considérant 20.
308 () Voir supra, le a du 1 du B du I.
309 () Articles 461-2 à 461-5 du code pénal.
310 () Article 461-6 du code pénal.
311 () Article 461-7 du code pénal.
312 () Articles 461-8 à 461-14 du code pénal.
313 () Articles 461-15 à 461-17 du code pénal.
314 () Articles 461-19 à 461-22 du code pénal.
315 () Articles 461-23 à 461-29 du code pénal.
316 () Article 461-30 du code pénal.
317 () Article 461-31 du code pénal.
318 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 40.
319 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
320 () M. Jean-Claude Marin a toutefois proposé, parallèlement, que le point de départ du délai de prescription de l’action publique soit invariablement fixé au jour de la commission de l’infraction et ne puisse donc faire l’objet d’aucun report (sauf en cas d’infraction commise sur un mineur, comme c’est le cas aujourd’hui).
321 () M. Dominique Foussard a également proposé que le point de départ du délai de prescription de l’action publique soit invariablement fixé au jour de la commission de l’infraction (sauf en cas d’infraction commise sur un mineur, comme c’est le cas aujourd’hui).
322 () M. Didier Boccon-Gibod a toutefois précisé que l’allongement des délais de prescription de l’action publique et la consécration dans la loi de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ du délai constituaient, à ses yeux, deux pistes alternatives et non pas cumulatives.
323 () Ces informations sont issues de l’étude transmise à vos rapporteurs par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (voir infra, l’annexe n° 1). Vos rapporteurs ont assimilé les peines de prison d’une durée supérieure à dix ans – quel que soit le pays considéré – aux peines criminelles prévues en droit pénal français. Ils n’ont donc pas tenu compte de la qualification des infractions dans les pays en question. De même, ils ont retenu l’expression « peine d’emprisonnement » (figurant dans le document transmis par le service des affaires européennes et internationales), y compris pour des peines de prison d’une durée supérieure à dix ans.
324 () Les infractions punies de l’emprisonnement à vie sont imprescriptibles.
325 () Ces données sont disponibles sur le site de l’INSEE.
326 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
327 () Contribution écrite de M. Jean Danet.
328 () Rapport d’information (n° 338, session ordinaire de 2006-2007) précité, p. 41.
329 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
330 () Contribution écrite de Mme Claire Waquet.
331 () M. Jean-Luc Bongrand a précisé que l’allongement des délais de prescription de l’action publique et la consécration dans la loi de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ du délai constituaient des pistes alternatives.
332 () Premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
333 () Premier alinéa de l’article 222-36 du code pénal.
334 () Ces informations sont, là encore, issues de l’étude réalisée par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (voir infra, l’annexe n° 1). Vos rapporteurs ont considéré que les peines de prison d’une durée maximale de dix ans s’analysaient, dans le cadre de la présente réflexion, comme des peines délictuelles au sens du droit pénal français.
335 () Les conclusions de la commission devraient être remises à Mme la garde des Sceaux à la fin de l’année 2015.
336 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
337 () Voir supra, le b du 1 du B du I.
338 () Il n’est pas question ici des « régimes spéciaux » de prescription qui sont applicables à certaines catégories d’infractions pour lesquelles la répression obéit à une logique particulière (infractions de presse, infractions fiscales, etc.). Vos rapporteurs ont précédemment indiqué leur position sur la modification des règles de prescription applicables à ces infractions (voir supra, le a du 2 du A du présent II).
339 () Voir supra, le a du 2 du B du I.
340 () Article L. 211-13 du code de justice militaire.
341 () Article L. 114 du code électoral.
342 () Article 314-8 du code pénal.
343 () Article L. 313-5 du code de la consommation.
344 () Article L. 244-7 du code de la sécurité sociale.
345 () Article L. 654-16 du code de commerce.
346 () Article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
347 () Voir supra, le a du 2 du B du I.
348 () Voir supra, le même a.
349 () Contribution écrite de M. Robert Gelli.
350 () Contribution écrite de Mme Catherine Sultan.
351 () Ces informations sont issues de l’étude réalisée par le bureau du droit comparé du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice (voir infra, l’annexe n° 1).
352 () En application du point 48 de l’annexe à la Recommandation Rec (2002) 5 adoptée par le Comité des ministres le 30 avril 2002, les États membres devraient « prévoir, pour les crimes et délits de nature sexuelle, que tout délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de la majorité civile ».
353 () Voir supra, le b du 2 du A du présent II.
354 () Voir supra, le b du 2 du B du I.
355 () Voir supra, le b du 2 du B du I.
356 () Voir l’article 121-8 de l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale soumis à concertation en mars 2010.
357 () Contribution écrite de M. Robert Gelli.
358 () Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats.
359 () Contribution écrite de M. Bruno Cotte.
360 () Les demandes d’actes nécessaires à la manifestation de la vérité (article 81-2 du code de procédure pénale) ou d’expertise (article 156 du même code) que peut formuler la partie civile sont examinées par le juge d’instruction qui, s’il n’y fait pas droit, doit rendre une ordonnance motivée.
361 () Cass. crim., 25 janvier 1993, n° 92-83.136.
362 () Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-65.032.
363 () Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-83.582.
364 () Cass. crim., 7 juin 2001, n° 00-85.973.
365 () Voir supra, le b du 2 du A du présent II.
366 () Voir supra, les a et b du 3 du présent B.
367 () Contribution écrite de M. Jean-Claude Marin.
368 () Contribution écrite de M. Dominique Foussard.
369 () Pour une définition de ces actes, voir supra, le b du 2 du B du I.
370 () La matière contraventionnelle ne serait pas concernée par ce nouveau dispositif.
371 () Voir supra, le a du 2 du B du I.
372 () Voir supra, le b du même 2.
373 () Contribution écrite de M. Dominique Foussard.
374 () Les fonctions mentionnées ci-dessous sont celles qu’occupaient les personnes entendues au jour de leur audition. Ces auditions ont été publiques et ouvertes à la presse à l’exception de celle de M. Jacques Buisson.
375 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
376 () Cet organisme a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
377 ex. le cadavre n’a été découvert que très longtemps après, personne ne s’étant soucié de la disparition de la victime, comme ce fut le cas très récemment dans le cas d’une mort naturelle, et comme malheureusement cela peut arriver dans une société où les individus peuvent être tout à fait isolés.
378 Lorsque comme je vous l’ai dit du fait d’une homonymie un citoyen est dans l’incapacité du fait des très nombreuses occurrences sur son nom, présentes sur internet, de savoir qu’il est victime d’une diffamation, faute de pouvoir passer le temps nécessaire à le vérifier.
379 Ce point, pardon d’y insister est important quand dans nombre de dossier, du fait d’empreintes génétiques relevées sur une scène de crime, une procédure va être ouverte dans laquelle on peut espérer élucider le crime des décennies plus tard, en tout cas, plus de vingt ans plus tard. Dans notre système actuel, le juge d’instruction en charge du dossier devrait avoir l’obligation de provoquer un débat en temps utile c’est-à-dire avant toute prescription aux fins de savoir si la victime ou ses ayants droits souhaite que la procédure demeure en cours. On rappellera ici que de telles instructions au long cours sont nées avant même les progrès de la police scientifique, témoin l’instruction sur l’assassinat de Medhi ben Barka.
380 Mme Dominique-Noëlle Commaret, Point de départ du délai de prescription de l’action publique : des palliatifs jurisprudentiels faute de réforme législative d’ensemble, Revue de science criminelle, 2004.
381 M. Jean Danet, Prescription, amnistie et grâce en France, Université de Nantes (recherche subventionnée par le GIP « Mission Recherche Droit et Justice »), mars 2006, p. 125.
382 Jean Danet : La prescription de l’action publique : quels fondements et quelle réforme ? AJ Pénal, 17 juillet 2006 n°285.
383 Beccaria, Traité des délits et des peines, chapitre XIII ; Bentham, Traité de législation, t. II.
384 () Cette contribution a été envoyée à vos rapporteurs à la suite des consultations qu’ils ont conduites avant l’achèvement des travaux de la mission d’information.
385 C.Cass.Civ 2 14.12.02 : « la courte prescription, …, a pour objet de garantir la liberté d’expression » / C.Cass Ch Cri 02.10.01 sur conformité à l’art 6 de la CEDH/C.Cass 05.04.12 : refus de renvoyer une QPC : « le délai de prescription (…) procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au Juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi »/ CConst. 10.06.04 décision n°2004-496DC/ CConst 120413 n°2013-302 QPC réaffirme la valeur constitutionnelle de la courte prescription.
386 Crim. 19 septembre 2006 n°05-83.536.
387 Crim. 30 novembre 1987 n°87-80.737.
388 Crim. 18 février 1991 n°90-80.025.
389 Cass. Crim. 17 Sept. 1997.
390 Les infractions instantanées, dont l’acte matériel s’accomplit en un trait de temps, ou permanentes, dont l’acte matériel s’exécute en un trait de temps, mais dont les effets se prolongent dans le temps, sans aucune intervention de l’auteur des faits initiaux, se prescrivent à compter du jour de la commission de l’infraction (de l’acte délictueux), même si ces effets se prolongent après cette date (Exemples : construction d’un immeuble sans permis de construire, en matière d’atteinte à la probité : la prise illégale d’intérêts.).
Les infractions continues, qui sont constituées d’un élément matériel qui, en raison de la définition même de l’incrimination, se prolonge pendant une certaine durée, du fait de la volonté réitérée du délinquant (ex : recel, séquestration), ne se prescrivent qu’à partir du jour où l’activité délictueuse a pris fin (Exemple : En matière de recel, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où le receleur se dépossède des objets volés.).
Les infractions à exécution successive constituées chaque fois qu’une opération délictueuse unique entraîne une répétition d’actes d’exécution, ne se prescrivent qu’à partir du jour où l’activité délictueuse a pris fin. Ainsi, chaque renouvellement de l’acte délictueux est interruptif de prescription. La chambre criminelle a considéré ainsi, que les délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, sont des infractions uniques, résultant de la conclusion d’un contrat de travail fictif, instantanément commises lors de chaque versement indu, effectué en vertu de ce contrat. De même, elle juge que « le délit de trafic d’influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux ».
391 Crim. 16 déc. 2014, FS-P+B, n° 14-82.939
392 Article 112-2 du code pénal :
« Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ;2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ».
393 Crim.25 nov.1830.
394 Crim.11 mai 1995, Bull.crim.n°174.
395 Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État ».
396 Ainsi en va-t-il, nous semble-t-il, de la présomption de repentance, liée à l’écoulement du temps ou de l’argument tiré de la double peine, l’une étant constituée par l’angoisse éprouvée par l’auteur des faits tout au long du temps écoulé, ou encore de l’idée que l’institution vise à masquer l’impuissance de l’autorité publique et le discrédit qui en découle.
397 Une observation du même ordre peut être faite à propos du délai raisonnable. Cette notion est projetée sur le temps qui s’écoule avant que l’action ne soit exercée. Mais à d’autres moments, elle concerne l’action d’autorité judiciaire, une fois l’action engagée.
398 L’exposé des motifs est obligatoire pour les projets de lois (article 7 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009). En droit communautaire, les règlements et les directives sont systématiquement précédés d’un exposé des motifs. Si libre soit-elle dans ses interprétations, la jurisprudence s’y réfère de façon quasi-systématique.
399 v. not. art. 2220 et 2223 du c. civ.
400 Cass. Ass. Plén. 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83739.
401 Art. 2232 c. Civ, alinéa 1er : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. ».
402 Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la connexité est à finalités multiples : elle concerne tout à la fois l’interruption de la prescription, mais également, la compétence du juge ou la condamnation solidaire des personnes poursuivies à la réparation.
403 Cass. Crim. 4 décembre 2012, pourvoi n° 86-347.
404 Cons. Const., 12 avril 2013, n° 2013-302 QPC.
405 CEDH, 22 juin 2000, aff. Coëme et a. c. Belgique ; CEDH, 11 juin 2014, aff. Howald Moor et a. c. Suisse.
406 Cass. Ass. Plén. 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20493, Bull. n° 15.
407 Il est à noter que la jurisprudence traditionnelle du Conseil Constitutionnel est perçue comme rattachant la prescription plutôt au fond qu’à la procédure.
408 Cass. crim. 29 avril 1997, Bull. n° 155. V. pour la même solution en matière de prescription civile, art. 2222 c. civ.
409 V. art. 26 de la loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008 et art. 2222 c. civ.
410 Pour la rédaction de ces dispositions, deux modèles existent : les articles 112-2, 112-3 et 112-4 c. pén., d’une part, l’article 2222 c. civ, d’autre part.
411 Il est à noter que l’affaire de « l’octuple infanticide » jugée le 7 novembre 2014 par l’Assemblée Plénière ne posait pas une question de délai, puisque le délai de 20 ans eût couvert les faits. Il est à craindre que la décision prise contre la loi et la jurisprudence n’ait eu pour réel fondement qu’un certain ordre moral que l’arrêt conforte de surcroît par des considérations physiques déplacées.
412 () Cette contribution a été envoyée à vos rapporteurs à la suite des consultations qu’ils ont conduites avant l’achèvement des travaux de la mission d’information.
413 Rapport n° 338, sur le régime des prescriptions civile et pénale par MM Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG.
414 V. not. L. Sanko, La prescription de l’action publique est-elle morte ? D. 2014, 2469.
415 En ce sens, articles 9 et 10 du Code de Brumaire an IV qui fixait le point de départ de la prescription non au jour de la commission des faits, mais au jour où le parquet en a eu connaissance et a pu agir.
416 CEDH, 11 mars 2014, Howald Moor c./ Suisse, § 71-72.
417 J. Pradel, Droit pénal comparé, 3ème éd., 2008, Dalloz, p. 398.
418 Pour les mineurs victimes, on ne compte pas moins de sept lois en vingt ans : 10 juillet 1989, 4 février 1995, 17 juin 1998, 9 mars 2004, 12 décembre 2005, 4 avril 2006, 14 mars 2011 !
419 Cour de cassation, ass. plén., 7 novembre 2014, D., 2014, 2498, note. R. Parizot.
420 En jurisprudence belge, le délai en matière de faux débute « quand l’effet utile de la pièce incriminée cesse de produite ses effets, RDPC, Bruxelles, décembre 2014, 1085.
421 Jurisprudence considérable, v. par ex., C.E.D.H., 28 octobre 1990, Brumarescu c./ Roumanie, n° 28342/95, JCP 2000, I, 203, n) 10, obs. Sudre.
422 Cass. ass. plén., 20 mai 2011, QPC, D. 2011, 1346, obs. Lienhard.
423 Le rapport Hyest, Portelli et Yunk proposait cinq ans, recommandation n° 4, p. 9.
424 Le délai ne démarrant qu’à la majorité de la victime.
425 On pourrait tout de même modifier la formule « aucun acte d’instruction ou de poursuite » (art. 7 C.P.P.) par celle plus juste « d’aucun acte d’enquête, de poursuite ou d’instruction ».
426 R. Garraud, Traité de droit pénal français, Tome 2, p. 600, Sirey, 1914.
427 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 7ème éd., n° 886, Cujas, 1997.
428 Arrêt de 1967 de la cour d’appel du 5ème circuit, délai de 28 ans entre le jugement et l’exécution.
429 Crim., 26 décembre 1956, D. 1957, 126.
430 Bigot, Ch., « Les règles de poursuite relatives aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 », Pratique du droit de la presse, Victoires Editions, 2013, pp. 211-293 ; Bonnal, N., « Les ‘chausse-trappes’ procédurales de la loi de 1881 : mythe ou réalité ? Essai d’étude statistique », Legipresse, décembre 2011, n° 289, pp. 665-675 ; Derieux, E., « La responsabilité des médias. Responsables, coupables, condamnables, punissables ? », JCP 1999.I.153 ; « Règles de procédure applicables à la poursuite des abus de la liberté d’expression. Garantie de la liberté d’expression ou privilège des médias ? », RLDI/89, janvier 2013, n° 2983, pp. 60-77 ; « Défense des médias : loi du 29 juillet 1881. Application à l’action civile des particularités de procédure pénale de la loi du 29 juillet 1881 », RLDI/91, mars 2013, n° 3048, pp. 88-95 ; Derieux, E. et Granchet, A., « Régime général de responsabilité », Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextensoéditions-LGDJ, 6e éd., 2010, pp. 455-489 ; Dreyer E., « Engagement des poursuites », Responsabilités civile et pénale des médias, LexisNexis, 3e éd., 2012, pp. 361-493 ; Tavieaux-Moro N « L’engagement des poursuites », in Beignier, B., de Lamy B et Dreyer E., dir., Traité de droit de la presse et des médias, LexisNexis, 2009, pp. 583-636 ; Véron, M., « Le parcours procédural en matière d’injures et de diffamations envers les particuliers », in Ass. fr. dr. pénal, Liberté de la presse et droit pénal, PUAM, 1994, pp. 67-86.
431 C’est du moins l’explication ou justification qui en est parfois donnée aujourd’hui : « la courte prescription, édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, a pour objet de garantir la liberté d’expression » (Cass. civ. 2e, 14 décembre 2000, n° 98-22427).
432 Derieux, E., « Lutte contre le terrorisme et droit de la communication. Eléments du droit de la communication introduits par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme », Legipresse, décembre 2014, n° 322, pp. 686-691.
433 En raison du principe contestable, parce que sans aucun fondement légal, dégagé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 12 juillet 2000, et fréquemment repris depuis (ce qui ne suffit cependant pas à emporter la conviction, tout au contraire même) : « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ». Bigot, Ch., Crédeville, A.-E. et Lepage, A., « Vers une remise en cause de l’unicité du procès de presse ? », Legicom, n° 46, 2011/1, pp. 5-37 ; Derieux, E., « Responsabilité civile des médias. Exclusion de l’application de l’article 1382 du Code civil aux faits constitutifs d’infraction à la loi du 29 juillet 1881 », Comm. Comm. électr., février 2006, pp. 14-20 ; « Une exclusion non légalement justifiée. Très favorable aux médias et préjudiciable aux victimes d’abus de la liberté d’expression », Legicom, n° 52, 2014/2, pp. 15-22 ; Dreyer, E., « Qu’est devenue la responsabilité civile en matière de presse ? », note sous Cass. civ. 2e, 9 octobre 2003, Dalloz 2004.J.590-594 ; « Disparition de la responsabilité civile en matière de presse », Dalloz 2006.chron.1337 ; Lamy, B. de, « Les tribulations de l’article 1382 du Code civil au pays de la liberté d’expression », Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Dalloz, 2008, pp. 275-296 ; Mallet-Poujol, N., « Abus de droit et liberté de la presse. Entre droit spécifique et droit commun, l’autonomie brouillée de la loi de 1881... », Legipresse, juillet 1997, n° 143.II.81-88 ; « De la ‘cohabitation’ entre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 1382 du Code civil », Legipresse, septembre 2006, n° 234.II.93-100 ; Martin-Valente, S., « La place de l’article 1382 du Code civil en matière de presse depuis les arrêts de l’Assemblée plénière du 12 juillet 2000. Approche critique », Legipresse, juin 2003, n° 202.II.71-77 et juillet 2003, n° 203.II.89-94 ; Viney, G., « Le particularisme des relations entre le civil et le pénal en cas d’abus de la liberté d’expression », Les droits et le droit, Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2006, pp. 1165 s.
434 Legipresse, mars 2000, n° 169.III.38-39, note B.A. ; JCP G 2000.II.10281, note Ph.-A. Schmidt et V. Facchina.
435 Legipresse, novembre 2000, n° 176.III.182-184, note C. Rojinsky.
436 Legipresse, janvier 2001, n° 178.III.10-14, note E. Derieux ; JCP G 2001.II.10515, note A. Lepage.
437 Legipresse, avril 2001, n° 180.III.58-60, note B. Ader.
438 Rebut, D., « Prescription des délits de presse sur l’internet. Le régime de la loi de 1881 », Legipresse, juin 2001, n° 182.II.63-67.
439 Legipresse, décembre 2001, n° 187.III.205-212, note E. Dreyer ; JCP G 2002.II.10028, note Ph. Blanchetier.
440 Béguin, F., « Imbroglio autour du ‘Mur des cons’ », Le Monde, 22 février 2015.
441 Derieux, E., « Délais de prescription des infractions de la loi du 29 juillet 1881. Conformité à la Constitution », RLDI/94, juin 2013, n° 3134, pp. 78-81.
442 Derieux, E., « Faut-il abroger la loi de 1881 ? », Legipresse, septembre 1998, n° 154.II.93-100.
443 Albertini, J.-P., « Vers un Code de la communication », Legipresse, juin 1993, n° 102.II.45-56 ; Conseil d’Etat, Inventaire méthodique et codification du droit de la communication, La documentation française, 2006, 240 p. ; Derieux, E., « Le projet de loi portant Code de la communication et du cinéma », JCP 1997.I.4007 ; « Le Code de la communication et du cinéma », Legipresse, janvier 1997, n° 138.II.15-16 ; « Diversité des sources et codification du droit de la communication », Forum Legipresse, Le droit de la presse de l’an 2000, Victoires Editions, 2000, pp. 85-90 ; « Perspectives d’une codification du droit de la communication », RLDI/15, avril 2006, n° 457, pp. 67-75.
444 Guinchard, S., L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceaux, juin 2008, pp. 290-293.
445 Ader, B., Bonnal, N., Chaillou, Cl., Filippetti, A., Olivennes, D., Val, Ph., « Il ne faut pas dépénaliser la diffamation », Le Monde, 26 janvier 2009 ; Derieux, E., « Dépénalisation de la diffamation. Une proposition de la Commission Guinchard », Petites affiches, 8 août 2008, pp. 4-7 ; « Dépénalisation de la diffamation. Contribution à la réflexion », in Mbongo, P., dir., Philosophie juridique du journalisme, Mare & Martin, 2011, pp. 73-90 ; de Lamy, B., « Vers une dépénalisation de la diffamation et de l’injure », JCP G 2008.I.209 ; Malaurie, Ph., « Ne dépénalisons pas la diffamation et l’injure », JCP G. 2008.Actualités.566 ; Ternisien, X., « Dépénaliser la diffamation, une fausse bonne idée », Le Monde, 13 janvier 2009.
446 Rebut, D., « Prescription des délits de presse sur l’internet. Le régime de la loi de 1881 », Legipresse, juin 2001, n° 182.II.63-67.
447 Derieux E., « Question prioritaire de constitutionnalité. Contestations de la constitutionnalité de dispositions de la loi du 29 juillet 1881 », RLDI/65, novembre 2010 ; n° 2138, pp. 34-49 ; « Contrôle de constitutionnalité du droit des médias », RLDI/73, juillet 2011, n° 2421, pp. 38-52 ; « Conformité à la Constitution de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 » (à propos de la décision QPC n° 2013-311 du 17 mai 2013), RLDI 2013/94, juin 2013, n° 3135, pp. 82-83 ; « Preuve de la vérité du fait diffamatoire. Non-conformité à la Constitution du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 » (à propos de la décision QPC n° 2013-319 du 7 juin 2013), RLDI 2013/95, n° 3151, pp. 10-13 ; « Initiative de l’action en justice en cas de diffamation alléguée envers une collectivité territoriale. Assouplissement du régime par une décision QPC du Conseil constitutionnel. Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 », RLDI/99, décembre 2013, n° 3284, pp. 28-30 ; Mbongo, P., « Droit des médias et question prioritaire de constitutionnalité », Legipresse, mai 2011, n° 283, pp. 281-286 ; de Montalivet, P., Bigot, Ch., Boyer, J., Guérin, D., « Question prioritaire de constitutionnalité et droit des médias », Legicom, n° 48, 2012/1, pp. 3-36.
448 Derieux, E., « Délais de prescription des infractions de la loi du 29 juillet 1881. Conformité à la Constitution », RLDI/94, juin 2013, n° 3134, pp. 78-81.
449 Christophe Bigot.
450 R.Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, cité dans l’article d’E.Dreyer mentionné en note 2 infra
451 Emmanuel Dreyer, L’illusoire constitutionnalité de la prescription en matière de presse, in Gazette du Palais 5 au 9 août 2012, pages 10 ss.
452 Expression employée par Louis Di Guardia, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de son audition par la mission Hyest ; cf titre du mémoire de Master II Droit Pénal et Sciences Pénales 2010-2011 de Valérian Fourmy, sous la direction de Mme Lepage « le désordre de la prescription de l’action publique ».
453 In revue de droit pénal n° 6, juin 2013, Un an de droit pénal de la presse (avril 2012-avril 2013).
454 Solution négative cf TGI Paris 12 avril 1995 Front Patriotique Rwandais c/Société Dictionnaire Robert.
455 Est retenue la date effective de publication de l’édition locale cf CA Paris 7 septembre 1995 Ferrer C/Ligue Française des Droits de l’Homme.
456 L’infraction est réputée commise, sauf preuve contraire qu’il appartient à la partie civile d’apporter, le premier jour du premier mois de la période ( Cass crim 19 mai 1998).
457 Considérées comme de nouveaux actes de publication qui font repartir la prescription.
458 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 considérants n° 13, 14 et 16.
459 Cf TGI Paris 17 ème chambre 26 février 2002, qui avait considéré que chaque nouvelle vente d’insignes nazies sur le site de Yahoo constituait une mise à jour et donc une nouvelle infraction.
460 Cass crim 19 septembre 2006, n° 05-87-230 ; Cass crim 6 janvier 2009.
461 Cass crim 11 juin 2013 n° 12-84.573.
462 Cf JOAN débats 10 février 2ème séance page 1019.
463 CEDH, 22 octobre 1996, Stubbings et a.c/Royaume-Uni.
464 CEDH, 6 décembre 2001, Yagtzilar c.Grèce.
465 TGI Paris, réf, 24 novembre 2014, Marie-France M.c Google.
466 « Le point de départ de la prescription par Julie Klein, Economica, sept. 2013.
467 Danet J., « La prescription de l’action publique, un enjeu de politique criminelle », Archives de politique criminelle, Editions A. Pédone, n°28, 2006/1, pp. 73-93, p. 78.
468 Article 7 alinéa 1 du CPP.
469 Article 7 alinéa 2 du CPP.
470 IGNA, l’Institut Génétique Nantes Atlantique est un laboratoire privé de génétique.
471 http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/perpetuite-pour-le-meurtrier-d-une-etudiante-juge-19-ans-apres-les-faits_1213717.html
472 l’IRCGN a développé une technique rapide (moins de 24h) et peu couteuse d’extraction de l’ADN sur des corps dégradés et anciens et l’a mis en routine depuis l’été 2013.
473 Le travail des anthropologues dans une première approche sert à vérifier s’il s’agit du corps d’un contemporain et non remontant à plus d’un siècle et si les restes sont en quantité suffisante, déterminer le sexe et l’âge de la victime.
474 http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/disparu-en-2004-le-suspect-etait-au-fond-du-fleuve-23-12-2013-3433227.php
475 http://www.courrier-picard.fr/region/le-corps-du-disparu-retrouve-21-ans-apres-au-fond-de-la-somme-ia0b0n437026
476 Ce paragraphe regroupe des extraits des travaux de Daoust, F., sur « La criminalistique et le procès pénal », Paris, 2014.
477 À noter que les TIC sont tous OPJ (officier de police judiciaire) ce qui leur permet de constater, de prélever et de mettre sous scellés les éléments recueillis sans mettre en péril la procédure judiciaire.
478 E. Locard, « L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques », Flammarion, Paris, 1920.
- E. Locard explique dans son ouvrage « Policiers de roman et policiers de laboratoire » (Payot, Paris, pp 96-97, 1924), que c’est en lisant « une étude en rouge » de Sir Conan Doyle qu’il lui a emprunté cette vision.
479 P. Kirk, « The Ontology of Criminalistics », Journal of Criminal Law, Criminology and Science - Vol.54, pp 235-238, 1963 : “A thing can be identical only with itself, never with any other objects in the universe are unique. If this were not true, there could be no identification in the sense used by the criminalistics”.
480 K. Inma & N. Rudin, “Principles and Practice of Criminalistics – The Profession of Forensic Science”, CRC Press, Boca Raton – London – New York – Washington, D.C., p. 87, 2001 : “Matter divides into smaller component parts when sufficient force is applied. The component parts will acquire characteristics created by the process of division itself and retain physic-chemical properties of the larger piece”.
481 Crim. 29 sept. 1992, n° 89-84.237, publié au Bulletin criminel 1992 N° 289 p. 787.
482 À titre d’exemple, les ASPTS (agents spécialisés de police technique et scientifique) employé dans les SLPT (service local de police technique) sont recrutés selon l’arrêté du 20 juillet 2013 au niveau de la 3ème élémentaire (brevet élémentaire) et reçoivent une formation de 1 semaine sur les traces et de 2 semaines sur les empreintes digitales à la SDPTS à Ecully.
483 Articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale.
484 Articles 156 et suivant du code de procédure pénale.
485 Nous trouvons des plateaux techniques en police nationale selon les directions de sécurité publique ou police judiciaire ou de la préfecture de police de Paris (SLPT, BT, GC, IJ, etc.) et en gendarmerie les CIC (cellule d’investigation criminelle), 1 par département.
486 FTA® est un acronyme pour Fast Technology for Analysis of nucleic acids. Il a été originellement développé par Burgoyne and Fowler à l’université de Flinders en Australie en 1980 afin de protéger les échantillons d’acide nucléique de la dégradation par le phénomène de nucléase et d’autres réactions. Un échantillon contenant l’ADN peut ainsi être appliqué sur ce papier traité pour être préservé et stocké sur un long terme. La société Whatman® commercialise sous licence la technologie FTA® de l’université de Flinders.
487 Il s’agit de Kit de prélèvement ADN se la société CHEMUNEX.
488 Circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés – NOR : JUSB1134112C – Bulletin Officiel du Ministère de la Justice et des Libertés du 30 mars 2012.
489 Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000.
490 C. CABAL, « Rapport sur la valeur scientifique de l’utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire », office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, N° 3121 Assemblée Nationale, 7 juin 2001.
491 C. CABAL, op. cit., § 2.3.3.
492 Cass. Crim., 20 nov. 2002, Omar X., JCP, G, 2002, act. n° 49. Dans cette affaire célèbre, une demande de révision avait été introduite car différents profils ADN avaient été retrouvés sur la porte objet du scellé. Mais la cour de cassation a rejeté la demande sur des motifs tenant essentiellement au mode de conservation de ce scellé au greffe du TGI, ne garantissant aucunement l’absence de contamination ou de pollution. Le libellé du motif est certes conforme à une étude criminalistique, mais le fondement provient bien des modes de stockage habituels : « il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées ; attendu que de nombreuses personnes ont pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci ; dès lors, serait privée de pertinence toute recherche complémentaires sur les empreintes génétiques découvertes, comme sur celles qui pourraient l’être par de nouvelles investigations ; d’où il suit que la demande en révision ne peut être admise ».
493 Alors que bon nombre d’auteurs s’interrogent sur la durée de cette conservation la considérant comme excessive au regard des délais de prescription, les possibilités technicoscientifiques s’améliorant de nouvelles expertises apparaissent dans le temps comme réalisables et plusieurs exemples ont montré que des résultats devenaient possibles de nombreuses années après. Partant de ce constat, les travaux parlementaires tels que l’avis présenté par Mme C. Tasca, « Justice et accès au droit », Tome XIII, sur le projet de loi de finances pour 2014, du 21 novembre 2013, comme une dépêche de la DACG, relative à la conservation des scellés, du 16 mars 2011, préconisent la conservation de certains scellés au-delà des délais prévus par l’article 41-4 du CPP et de maintenir la longue durée pour les scellés biologiques.
494 C. CABAL, op. cit., § 2.3.3.
495 R. 53-20 du CPP (décret n° 2044-470 du 25 mai 2004, art. 11).
496 L’article 147 de la loi du 17 mai 2011 a introduit un nouveau chapitre IV au code de procédure pénale intitulé « Des autopsies judiciaires » comportant les nouveaux articles 230-28 à 230-31. Toutefois, pour apprécier les modalités et les détails d’application de ces articles, un décret d’application des dispositions de ce chapitre doit être précisé par décret en Conseil d’Etat. A noter qu’à ce jour le décret n’a toujours pas été rédigé.
497 Inspections générales des services judiciaires, des finances, des affaires sociales, de l’administration, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, « Rapport sur l’évaluation du schéma d’organisation de la médecine légale », décembre 2013.
498 Support : désigne toute technologie destinée à enregistrer des données. Dictionnaire informatique internet consultable sur le site : http://dictionnaire.phpmyvisites.net
499 RAM pour Random Access Memory ; SDD pour Solid State Drive disque de stockage à mémoire flash sans pièce mobile ; HDD pour Hard Disk Drive, terme anglais pour disque dur, c’est un support magnétique, avec tête de lecture et pièces mobiles, intégré dans un ordinateur ou équivalent, permettant le stockage de plusieurs giga-octets de données.
500 Les enregistreurs de salon (HDD), les consoles de jeux (type X-box, Sony, Nintendo), les boitiers de connexion et de télévision par internet, etc. ont tous des mémoires de plusieurs types permettant le stockage de données numériques y compris des photos, des dossiers, etc., et dans quelques affaires les preuves numériques de l’infraction y étaient enregistrées. À noter que ces appareils ont également des accès internet qui permettent de multiplier les déports de données sans qu’il soit toujours possible de remonter au lieu exact de stockage. La notion de « cloud » qui constitue un espace de stockage à la disposition de l’usager en fait également partie.
501 Cette conception nouvelle de la forme d’un scellé est parfaitement compatible avec les évolutions législatives et matérielles existantes actuellement et conduisant officiellement à la dématérialisation des procédures, à la transmission de données informatiques. De plus, cela viendrait alléger et faciliter de gestion des scellés au sein des greffes des tribunaux qui rencontrent en la matière de grandes difficultés. Confer à cet effet l’Avis n° 162 du sénat du 21 novembre 2013 sur le projet de loi de finance pour 2014 Tome XII « Justice judiciaire et accès au droit » présenté par Mme Catherine TASCA, p. 31-36.
502 Lire à ce propos sur la place des scellés, la perception de la justice comme des élus quant à leur gestion, leur contrôle et leur maintien sous main de justice les textes suivant montrant la richesse des débats et la place centrale de la question du scellé dans le procès pénal : la circulaire conjointe du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés – NOR : JUSB1134112C – Bulletin Officiel du Ministère de la Justice et des Libertés du 30 mars 2012, mais également, le rapport n°1807 d’ A TOURRET, « Rapport sur la proposition de loi (n°1700) relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive » du 19 février 2014, Le rapport de la Cour des comptes sur « Les frais de justice » de septembre 2012, la séance du 22 novembre 2013 sur le sujet « gestion et conservation des scellés judiciaires », http://www.senat.fr/seances/s201311/s20131122/s20131122001.html .
503 P. Margot « La place des sciences forensiques dans la lutte contre la criminalité », Verlag Stämpfli + Cie AG Bern, 1992.
504 O. Ribaux & P. Margot « Science Forensique » in http://www.criminologie.com/article/science-forensique Dictionnaire de criminologie en ligne.
505 P. Boel, G. De Boeck, V. De Cloet, J. De Kinder & M. Mons Delle Roche, « L’enquête forensique », éditions Politeia, Bruxelle, 2011.
506 Ici cela concerne la gendarmerie qui possède un groupe dédié et spécialisé dans la fixation de l’état des lieux au sein de l’IRCGN.
Lire à ce propos : H. Daudigny, C. Lambert, P. Lamusse, G. Galou, J. Sinnaeve et L. Fleury, « Fixation de l’état des lieux par des moyens spéciaux : validation d’un concept et appui opérationnel dans un contexte criminalistique », Topographie, Revue XYZ, n° 138, 1er trimestre 2014, p. 3-9.
Le laser 3D permettant d’enregistrer une scène très rapidement, la précision de lasers donnant une mesure de chaque point de la scène balayé par le faisceau ; de plus ce système donne la possibilité aux enquêteurs et magistrats de visualiser la scène reconstituer et de pouvoir effectuer des déplacements en son sein comme dans un univers 3D, ce qui est essentiel dans les confrontations et vérifications de témoignages. De même l’engagement en complément des tachéomètres à localisation satellitaire permet de répertorier et cartographier l’ensemble des éléments retrouvés sur une scène de catastrophe ou d’accident notamment. Enfin, l’engagement du VAIC (vecteur aérien d’investigation criminalistique) est l’usage d’un drone amélioré par la gendarmerie pour prises de mesure, de photographies, de vidéo dans une visualisation spatiale différente et pour effectuer certains prélèvements.
507 Le Roux, F., Cloux, P., Nicloux C., & al., « L’hémato-morphologie ou morpho-analyse des traces de sang », Documentation IRCGN, février 2015.
508 T. Bevel & R. M. Gardner, « Bloodstain Pattern Analysis », 3rd edition, 2007.
509 Slemko, J. A., “Bloodstains on Fabric : The Effects of Droplet Velocity and Fabric Composition”, International Association of Bloodstain Pattern Analysts News, 19(4), 3–11, 2003.
510 Castro, T. De, Nickson, T., & Carr, D., “Interpreting the formation of bloodstains on selected apparel fabrics”, 251–258. doi :10.1007/s00414-012-0717-3, 2013.
511 Bremmer R.H., de Bruin K.G., van Gemert M.J.C, van Leewen T.G., Aalders M.C.G, “Forensic quest for age determination of bloodstains”, Forensic Science International, In Press, Corrected Proof, Available online August 25th, 2011.
512 Projet ANR “D-Blood” en partenariat avec le CNRS : IUSTI Marseille et le laboratoire de Rhéologie et des Procédés de Grenoble ainsi que l’Ecole Normale Supérieure de Paris.
513 White, B., “Bloodstain Patterns on Fabrics : The Effect of Drop Volume, Dropping Height and Impact Angle”, Journal of the Canadian Society of Forensic Science, 19(1), 3–36, 1986.
514 Daroux, F. Y., Carr, D. J., Kieser, J., Niven, B. E., & Taylor, M. C., “Effect of laundering on blunt force impact damage in fabrics”, Forensic Sci Int, 197(1-3), 21–29. doi :10.1016/j.forsciint.2009.12.016, 2010.
515 Det. Lt. Paonessa, N. A., “Bloodstains of Gettysburg : The Use of Chemiluminescent Blood Reagents to Visualize Bloodstains of Historical Significance”, International Association of Bloodstain Pattern Analysis News, (March), 2008.
516 Bily, C., & Maldonado, H., “The Application of Luminol to Bloodstains Concealed by Multiple Layers of Paint”, Journal of Forensic Identification, 56(6), 896–905, 2006.
517 Adair, T. W., Gabel, R., Shimamoto, S., & Tewes, R., “A Comparison of the Luminol and Blue Star Blood Reagents in Detecting Blood in Soil Nearly Four Years After Deposition”, I.A.B.P.A Newsletter, (December), 2008.
518 Albertini, N., Schmidt, L., Thali, M., Buck, U., Kneubuehl, B., & Na, S, “3D bloodstain pattern analysis : Ballistic reconstruction of the trajectories of blood drops and determination of the centres of origin of the bloodstains”, doi :10.1016/j.forsciint.2010.06.010, 2010.
519 Maloney, K., Carter, A. L., Jory, S., & Yamashita, B., “Three-Dimensional Representation of Bloodstain Pattern Analysis”, Journal of Forensic Identification, 55(6), 2005.
520 Carter, A. L., Illes M., Maloney, K., Yamashita, A. B., Allen, B., Brown, B., Stewart, C., “Further Validation of the BackTrack TM Computer Program for Bloodstain Pattern Analysis - Precision and Accuracy”, International Association of Bloodstain Pattern Analysts News, 21(3), 15–22, 2005.
521 Dourel, L. & al., “Le département faune et flore forensiques de l’IRCGN”, Documentation IRCGN, février 2015.
522 Bock, Norris, 1997, Forensic Botany : An Under-Utilized Ressource, Journal of Forensic Sciences, 42(3), 364-367.
523 Wiltshire, P.E.J., “Consideration of some taphonomic variables of revelance to forensic palynological investigation in the United Kingdom”, Forensic Science International, 163, 173-182, 2006.
524 Bryant V.M.Jr. and Mildenhall D.C., “Forensic Palynology in the the United States”, Palynology, 14 : 193-208, 1990.
525 Graham, A, “Forensic Palynology and the Ruidoso, New Mexico plane crash - The Pollen Evidence II”, Journal of Forensic Sciences, 42(3) : 391 – 393, 1997.
526 Horrocks, M., “Forensic palynology : assessing the value of the evidence”, Review of paleobotany and palynology, 103 : 69-54, 1998.
527 Pate David W., “Chemical ecology of Cannabis”, Journal of the international Hemp Association 2: 29, 32-37, 1994.
528 Montali E., Mercuri A.M., et al., “Towards a "crime pollen calendar" - Pollen analysis on corpes troughtout one year”, Forensic Science International, 163 : 211-223, 2006.
529 Morgan , Davies , Balestri & Bull, “The recovery of pollen evidence from documents and its forensic implications”, Science and Justice, 53 : 375–384, 2013.
530 GUGLICH WILSON WHITE, “Forensic application of repetitive DNA MArkers to the species Identification of Animal Tissues”, Journal of Forensic Sciences, 39 (2) : 353-361, 1994.
531 WILSON DIZINNO POLANSKEY REPLOGLE BUDOWLE, “Validation of mitochondrial DNA sequencing for forensic casework analysis”, International Journal of Legal Medicine, 108 : 68-74, 1995.
532 LINACRE, “The use of DNA from non human sources”, Forensic Science International, Genetics Supplement Series 1 : 605-606, 2008.
533 BALL FINNEGAN NETTE BRODERS WILSON, “Wildlife forensics "supervised" assignment testing can complicate the association of suspect cases to source populations”, Forensic Science International Genetics 5 : 50-56, 2011.
534 HALVERSON BASTEN, “Forensic DNA Identification of Animal derived Trace Evidence Tools for Linking Victims and Suspects”, Croatian Medical Journal, 46(4) : 598-605, 2005.
535 MARCHETTI, ARENA, BOSCHI, VANIN, “Human DNA extraction from empty puparia”, Forensic science International, 229 : 26-29, 2013.
536 Prada, P. A. & Furton, K. G., “Human scent detection : a review of its developments and forensic applications”, Rev. Ciencias Forenses 1, 81–87, 2008.
537 SDPTS, Sous-direction de la police technique et scientifique de la Direction centrale de la police judiciaire.
538 Pandey, S. K. & Kim, K.-H., “Human body-odor components and their determination”, TrAC Trends Anal. Chem. 30, 784–796, 2011.
539 Penn, D. J. et al., “Individual and gender fingerprints in human body odour”. J. R. Soc. Interface 4, 331–40, 2007.
540 DeGreeff, L. E., Curran, A. M. & Furton, K. G., “Evaluation of selected sorbent materials for the collection of volatile organic compounds related to human scent using non-contact sampling mode”, Forensic Sciences International 209, 133–42, 2011.
541 Brown, J. S., Prada, P. a, Curran, A. M. & Furton, K. G., “Applicability of emanating volatile organic compounds from various forensic specimens for individual differentiation”. Forensic Sciences International. 226, 173–82, 2013.
542 Sorokowska, A., “Assessing Personality Using Body Odor : Differences Between Children and Adults”, J. Nonverbal Behav. 37, 153–163, 2013.
543 Wilke, K., Martin, a, Terstegen, L. & Biel, S. S., “A short history of sweat gland biology”. Int. J. Cosmet. Sci. 29, 169–79, 2007.
544 Zeng, X. N. et al., “Analysis of characteristic odors from human male axillae”, J. Chem. Ecol. 17, 1469–92, 1991.
545 Kusano, M., Mendez, E. & Furton, K. G., “Comparison of the volatile organic compounds from different biological specimens for profiling potential”, J. Forensic Sci. 58, 29–39, 2013.
546 Vuille J., Biedermann A. & Taroni F., “Comme une odeur de déjà vu”, Plaidoyer 4/13 du 3 juillet 2013 / aktualisiert am 6 octobre 2013, disponible sur le site : https://www.plaidoyer.ch
547 Schoon, G. A. A., “Scent identification lineups by dogs (Canis familiaris) : experimental design and forensic application”,Applied Animal Behaviour Science, 49(3), pp. 257-267, 1996.
548 Schoon, G. A. A., & De Bruin, J., “The ability of dogs to recognize and cross-match human odours”, Forensic Science International, 69(2), pp. 111-118, 1994.
Settle, R. H., Sommerville, B. A., et al., “Human scent matching using specially trained dogs”. Animal Behaviour, 48(6), pp. 1443-1448, 1994.
549 Jezierski T., Gorecka-Bruzda, A. et al., “Operant conditioning of dogs (Canis familiaris) for identification of humans using scent lineup”, Animal Science Papers and Reports, pp. 28(1), 81-93, 2010.
550 Schoon G.A.A. & De Bruin J., op. cit.
551 Schoon G.A.A. & De Bruin J., op. cit.
552 Brisbin, I. L., & Austad, S. N. (1991). “Testing the individual odour theory of canine olfaction”, Animal Behaviour, 42(1), pp. 63-69, 1991.
553 Jezierski, T., Sobczynska et al., “Do Trained Dogs Discriminate Individual Body Odors of Women Better than Those of Men ?”, Journal of Forensic Sciences, 57(3), pp. 647-653, 2012.
554 Wojcikiewicz, J., “Dog scent lineup as scientific evidence”. Paper presented at the International Academy of Forensic Sciences, Los Angeles, 1999.
555 Schoon, G. A. A., “The effect of the ageing of crime scene objects on the results of scent identification line-ups using trained dogs”, Forensic Science International, 147(1), pp. 43-47, 2005.
556 Settle, R. H., Sommerville, B. A., et al., “Human scent matching using specially trained dogs”. Animal Behaviour, 48(6), pp. 1443-1448, 1994.
557 Brisbin, I. L., Austad, S. et al., “Canine detectives : the nose knows-or does it ?”, Science, 290(5494), 1093b.
558 Wojcikiewicz, J.,, op. cit., “Nobody should be convicted solely on the basis of a dog waggling its tail”.
559 Laboratoire de Sciences Analytiques Bioanalytiques et Miniaturisation, PSL Institute, UMR CBI, l’Equipe de Statistique Appliquée, l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle.
560 Hudson-Holness, D. T. & Furton, K. G., “Comparison between Human Scent Compounds Collected on Cotton and Cotton Blend Materials for SPME-GC/MS Analysis”, J. Forensic Res. 01, 1–6, 2010.
561 DeGreeff, L. E. & Furton, K. G., “Collection and identification of human remains volatiles by non-contact, dynamic airflow sampling and SPME-GC/MS using various sorbent materials”. Anal. Bioanal. Chem. 401, 1295–307, 2011.
562 Prada, P. a, Curran, A. M. & Furton, K. G., “The evaluation of human hand odor volatiles on various textiles : a comparison between contact and noncontact sampling methods”, J. Forensic Sci. 56, 866–81, 2011.
563 À ce titre, voir l’étude réalisée par l’équipe de recherche dont le doctorant du consortium mis en place par « DIM Analystics » (et consultable sur leur site) faisant l’état de la recherche en matière d’analyse d’odeur et leur orientation nécessaire pour aboutir à une méthodologie scientifique répétable et fiable. Cuzuel V., Cognon G., Rivals I.,Huelard F., Thiébaut D. et Vial J., « Human odor, origin, analytical characterisation and potential use as forensic tool », pp.1-19, 2014.
564 Galou, G. & De Miras, M., « Présentation du domaine et de l’état de l’art de l’exploitation des traces acoustiques en criminalistique », Documentation IRCGN, février 2015.
565 J. Prado and E. Moulines, “Frequency-domain adaptive filtering with applications to acoustic echo cancellation,” Annale des télécommunications, vol. 49, no. 7, pp. 414–428, 1994.
M. Wu and D. Wang, “A one-microphone algorithm for reverberant speech enhancement,” Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings.(ICASSP’03). 2003 IEEE International Conference on, vol. 1, 2003.
566 I. McCowan, “Microphone arrays : A tutorial,” Queensland University, 2001.
567 M. Schmidt, “Single-channel speech separation using sparse non-negative matrix factorization,” International Conference on Spoken Language, 2006.
568 C. Champod and D. Meuwly, “The inference of identity in forensic speaker recognition,” Speech Communication, vol. 31, no. 2, pp. 193–203, 2000.
569 A. Alexander, “Forensic automatic speaker recognition using Bayesian interpretation and statistical compensation for mismatched conditions,” Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, 2005.
570 J. Bonastre, F. Bimbot, L. Boë, J. Campbell, D. Reynolds, and I. Magrin-Chagnolleau, “Authentification des personnes par leur voix : un nécessaire devoir de précaution,” 2004.
- J. Bonastre, F. Bimbot, L. Boë, J. Campbell, D. Reynolds, and I. Magrin-Chagnolleau, “Person authentication by voice : A need for caution,” Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003.
571 P. Rose, “Forensic speaker identification”, Ed. Taylor and Francis, 2002.
572 F. Bimbot, J. Bonastre, C. Fredouille, G. Gravier, I. Magrin-Chagnolleau, S. Meignier, T. Merlin, J. Ortega-García, D. Petrovska-Delacrétaz, and D. Reynolds, “A tutorial on text-independent speaker verification,” EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, pp. 430–451, 2004.
J. P. Campbell, W. Shen, W. M. Campbell, R. Schwartz, J.-F. Bonastre, and D. Matrouf, “Forensic speaker recognition,” Signal Processing Magazine, IEEE, vol. 26, no. 2, pp. 95–103, 2009.
573 C. Champod and D. Meuwly, op. cit.
574 N. Brümmer, “Application-independent evaluation of speaker detection,” Computer Speech & Language, 2006.
D. van Leeuwen and N. Brümmer, “An introduction to application-independent evaluation of speaker recognition systems,” Speaker Classification I, pp. 330–353, 2007.
575 J. Gonzalez-Rodriguez, P. Rose, D. Ramos, D. Toledano, and J. Ortega-Garcia, “Emulating DNA : Rigorous quantification of evidential weight in transparent and testable forensic speaker recognition,” Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, vol. 15, no. 7, pp. 2104–2115, 2007.
576 Kenny, G. Boulianne, P. Ouellet, and P. Dumouchel, “Speaker and Session Variability in GMM-Based Speaker Verification,” Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, vol. 15, no. 4, pp. 1448–1460, 2007.
N. Dehak, P. Kenny, R. Dehak, P. Dumouchel, and P. Ouellet, “Front-End Factor Analysis for Speaker Verification,” Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, vol. 19, no. 4, pp. 788–798, 2011.
577 ENFSI (European Network Forensic Science Institutes) c’est le réseau européen des laboratoires de criminalistique. Il est notamment mandaté par le conseil de l’union européenne pour toutes les études de normalisations et de bonnes pratiques dans les différentes matières composant la criminalistique.
578 R. Korycki, “Methods of Time-Frequency Analysis in Authentication of Digital Audio Recordings,” International Journal of Electronics and …, 2010.
D. L. Rappaport, “Establishing a standard for digital audio authenticity : a critical analysis of tools, methodologies, and challenges” University of Colorado, 2012.
579 D. Nicolalde and J. Apolinario, “Evaluating digital audio authenticity with spectral distances and ENF phase change,” Acoustics, Speech and Signal Processing, 2009. ICASSP 2009. IEEE International Conference on, pp. 1417–1420, 2009.
580 R. Yang and Z. Qu, “Detecting digital audio forgeries by checking frame offsets,” Proceedings of the 10th ACM workshop, 2008.
H. Farid, “Detecting Digital Forgeries Using Bispectral Analysis,” Jul. 2001.
581 C. Grigoras, “Applications of ENF criterion in forensic audio, video, computer and telecommunication analysis,” Forensic Science International, vol. 167, no. 2, pp. 136–145, Apr. 2007.
582 E. Brixen, “ENF quantification of the magnetic field,” presented at the AES 33rd International Conference, 2012.
583 A. J. Cooper, “An automated approach to the Electric Network Frequency (ENF) criterion - Theory and practice,” International Journal of Speech Language and the Law, vol. 16, no. 2, Apr. 2010.
584 Champod, C., Lennard, C. J., Margot, P., & Stoilovic, M. “Fingerprints and other ridge skin impressions”. CRC press, 2004.
585 Weyermann, C., Roux, C., & Champod, C. (2011). “Initial results on the composition of fingerprints and its evolution as a function of time by GC/MS analysis”. Journal of forensic sciences, 56(1), 102-108, 2011.
586 Girod, A., Ramotowski, R., & Weyermann, C., “Composition of fingermark residue : A qualitative and quantitative review”. Forensic science international, 223(1), 10-24, 2012.
587 Lee, H., Ramotowski, R., & Gaensslen, R., Eds “Advances in Fingerprint Technology”, 3rd Ed, CRC Press : Boca Raton, FL, 2013.
588 Champod, et al., op. cit., “Fingerprints and other ridge skin impressions”. CRC press, 2004.
589 Lee, H., Ramotowski, R., & Gaensslen, R., Eds (2013) “Advances in Fingerprint Technology”, 3rd Ed, CRC Press : Boca Raton, FL, 2013.
590 Pithon, A., Henrot, D., Thiburce, N., & Jégou, J. (2012). “A New Formulation of Acid Yellow 7 with an Ethanol/Water-Based System”. Canadian Society of Forensic Science Journal, 45(1), 6-13, 2012.
591 Prete, C., Galmiche, L., Quenum-Possy-Berry, F. G., Allain, C., Thiburce, N., & Colard, T., “Lumicyano™: A new fluorescent cyanoacrylate for a one-step luminescent latent fingermark development”. Forensic science international, 233(1), 104-112, 2013.
592 Becue, A., Scoundrianos, A., Champod, C., & Margot, P., “Fingermark detection based on the in situ growth of luminescent nanoparticles—Towards a new generation of multimetal deposition”. Forensic science international, 179(1), 39-43, 2008.
593 Francese, S., Bradshaw, R., Ferguson, L. S., Wolstenholme, R., Clench, M. R., & Bleay, S., “Beyond the ridge pattern : multi-informative analysis of latent fingermarks by MALDI mass spectrometry”. Analyst, 138(15), 4215-4228, 2013.
594 Tahtouh, M., Kalman, J. R., & Reedy, B. J., “Synthesis and characterization of four alkyl 2‐cyanoacrylate monomers and their precursors for use in latent fingerprint detection”. Journal of Polymer Science Part A : Polymer Chemistry, 49(1), 257-277, 2011.
595 Bandey, H., & Kent, T., “Superglue Treatment of Crime Scenes : A Trial of the Effectiveness of the Mason Vactron SUPERfume Process”. Home Office, Police Scientific Development Branch.
596 Fieldhouse, S. J., “An Investigation into the Use of a Portable Cyanoacrylate Fuming System (SUPERfume®) and Aluminum Powder for the Development of Latent Fingermarks*”. Journal of forensic sciences, 56(6), 1514-1520, 2011.
597 Bleay, S. M., Bandey, H. L., Black, M., & Sears, V. G., “The Gelatin Lifting Process : An Evaluation of its Effectiveness in the Recovery of Latent Fingerprints”. Journal of Forensic Identification, 61, 581-606, 2011.
598 Ashbaugh D. (1999). Quantitative-Qualitative friction ridge analysis. CRC Press.
599 Confer le site de ce groupe de travail : www.swgfast.org
600 F. Daoust, « La criminalistique et le procès pénal », travaux de thèse de doctorat, Paris, 2014.
601 C. Champod et P. Margot, « L’identification dactyloscopique », Support de cours, Institut de Police Scientifique et de Criminologie, septembre 1996, p.9.
602 Les méthodes chimiques sont très vite mises en œuvre par les pionniers de la criminalistique comme des scientifiques qui au cours de leurs recherches y compris sur des sujets annexes, découvrent de nouvelles méthodes permettant leur révélation sur différents supports et ce dès la fin du XIX° siècle, confer l’article de M. Coulier, « Les vapeurs d’iode employées comme moyen de reconnaître l’altération des écritures », in L’année scientifique et industrielle, 8e année, 1863, pp. 157-160.
603 Le prélèvement d’une empreinte digitale se fait par transfert sur un « papier » spécial, soit directement si l’empreinte est visible et bien contrastée, soit après traitement physico-chimique pour la mettre en évidence avant qu’elle ne soit collectée. Quand le transfert n’est pas possible, la trace papillaire révélée par un procédé physico-chimique fait alors l’objet d’une photographie légendée. Pour que le contraste de la trace soit suffisant pour faciliter la visibilité et la comparaison, sont alors employés des colorants et/ou des filtres optiques sur lumière monochromatique pour rehausser le signal.
604 Nous n’évoquons ici que les traces digitales complexes qui sont la majorité de celles retrouvées sur les scènes d’infraction. Des traces digitales sans accidents de dépôt, ne présentant aucun défaut sont alors comparables sans risque d’erreurs ou de biais.
605 Selon F. Galton, « Finger Prints », Reprint, William S. Hein & Co., 2003, La minutie est l’arrangement particulier des lignes papillaires formant des points caractéristiques à l’origine de l’individualité des dessins digitaux : arrêts de lignes, bifurcations, lacs, îlots, points, etc., la combinaison des minuties est pratiquement infinie.
606 « Les données de la morphogénèse indiquent clairement que l’individualité papillaire ne se réduit pas à la seule configuration des minuties – à ce seul facteur quantitatif – mais qu’elle s’exprime également au travers de nombreux éléments qualitatifs tels que la spécificité d’une combinaison de minuties, les caractéristiques des pores ou encore des bords de crêtes. », C. Champod et P. Margot, « L’identification dactyloscopique », op. cit., p. 42.
607 E. Locard, « La preuve judiciaire par les empreintes digitales », Revue les Archives d’Anthropologie Criminelle, n°245, 1914, pp. 321-348
608 V. Balthazard, « De l’identification par les empreintes digitales », Académie des sciences, comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences publiés par MM. Les secrétaires perpétuels, séance du 26 juin 1911, pp. 1862-1864.
609 A. Bertillon, « Les empreintes digitales », Revue les Archives d’Anthropologie Criminelle, n°217, 1912, pp. 36-49.
610 E. Locard, « La poroscopie », Revue les Archives d’Anthropologie Criminelle, n°235, 1913, pp. 528-546.
611 Le terme « absence de dissemblances inexplicable » est très intéressant, car lorsque l’agent qui a procédé à la révélation puis à l’identification dans le cadre du D7 remet ses simples conclusions d’identification (qui font l’objet d’une annexe au procès-verbal de constatations), mais il n’apparait jamais les explications montrant en quoi dans l’empreinte relevée les dissemblances existantes sont explicables et ne sont pas représentatives des caractéristiques physiques du reste du doigt ou de la paume à l’origine de la trace.
612 « Il en résulte un standard numérique incontournable – comme la règle des douze points (…) – ne trouve aucune justification dans les fondements de l’individualité papillaire. Cet usage s’est échafaudé d’une part sur un empirisme du début du XX° siècle faisant valoir que deux empreintes digitales différentes présentant plus de douze minuties concordantes n’ont jamais été observées et d’autre part sur des calculs de probabilités dont les prémisses furent rapidement contestées » in C. Champod et P. Margot, « L’identification dactyloscopique », op. cit., p. 43.
613 C. Champod, « Reconnaissance Automatique et Analyse Statistique des Minuties sur les Empreintes Digitales », Thèse de doctorat, Institut de Police Scientifique et de Criminologie, Université de Lausanne, 1996.
614 S. Gupta, « Statistical Survey of Ridge Charactéristics », International Criminal Police Review, n° 218, 1968, pp. 130-134.
615 J. Osterburg, T. Parthasarathy, T. Raghvan, & al., « Development of a mathematical Formula for the Calculation of Fingerprint Probabilities Based on Individual Charactéristics », Journal of American Statistical Association, n° 72, 1977, p. 772.
616 C. Lin, J. Liu, J. Osterburg & al., « Fingerprint Comparison I : Similarity of Fingerprints », Journal of Forensic Science, 27, n°2, 1982, p. 290.
617 E. Gutiérrez-Redomero, C. Alonso-Rodriguez, L. E. Hernandez-Hurtado & J. L. Rodriguez-Villalba, « Distribution of the minutiae in the fingerprints of a sample of the Spanish population », Forensic Science International, Vol. 208, Issues 1-3, pp. 79-90, May 2011,
E. Gutiérrez- Redomero & al., « Are there population differences in minutiae frequencies ? A comparative study of two Argentinian population samples and one Spanish sample » , Forensic Science International, Vol. 222, Issues 1-3, pp. 266-276, 2012.
618 C. Champod et P. Margot, « L’identification dactyloscopique », op. cit., p. 32.
619 Lors du congrès international de dactyloscopie à Ne’urim en Israël en 1995, la résolution de l’IAI a été encore précisée. Confer « Fingerprint Identification Breakout Meeting – Ne’urim Declaration », International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, Summary by Pierre Margot and Ed German, 2ç June 1995.
620 « No scientific basis exists for requiring that a predetermined minimum number of ridge features must be present in two impressions in order to establish a positive identification. » cité in, « L’identification dactyloscopique », op. cit., p. 43.
621 C. Champod, « Reconnaissance Automatique et Analyse Statistique des Minuties sur les Empreintes Digitales »,op. cit.
622 Position of the European Fingerprint Working Group (EFPWG) of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) regarding the NRC report, Journal of Forensic Identification, 61 (6), 2011, pp. 677-679.
623 IAI Resolution 2010-18, International Association For Identfication, www.theiai.org
624 C. Champod & P. Margot, « Evidence evaluation in fingerprint comparison and automated fingerprint identification systems – Modelling within finger variability », Forensic Science International, vol. 167 (2-3), 2007, pp. 189- 195.
625 « Latent Print Examination and Human Factors : Improving the Practice through a Systems Approach », The Report of the Expert Working Group on Human Factors in Latent Print Analysis, US Department of Justice’s National Institute of Justice and in collaboration with the Law Enforcement Standards Office in the U.S. Department of Commerce National Institute of Standards and Technology, 2012, pp. 21 – 38.
626 A. Ross, S. Dass & A. Jain, « A deformable model for fingerprint matching », The Journal of the Pattern Recognition Society, Pattern Recognition, vol. 38, 2005, pp. 95-103.
Lors des signalements, c’est-à-dire lors d’une mesure de contrôle d’identité ou de garde à vue, la personne voit ses empreintes digitales relevées soit directement sur un scanner dédié à cette prise (il s’agit de bornes T1 qui enregistrent directement la prise d’empreinte dans le FAED par apposition des mains de la personne sur la surface vitrée de la borne) soit sur des relevés décadactylaires (papier révélant les empreintes encrées) qui seront enregistrées par des scanners (bornes T4 qui les introduisent dans le FAED) ou envoyés au STRJD/SRCGN (organisme central de la gendarmerie qui collationne entre autre tous les relevés qui ne sont pas passé par les T4 pour les introduire dans le FAED. Mais ces relevés sur les personnes signalés sont de plus ou moins bonne qualité (mouvement de la personne, écrasement des doigts, étalement de leur déroulé, etc.) générant des empreintes dont certaines portent déjà des erreurs.
627 Egli N., « Interpretation of Partial Fingermarks Using an Automated Fingerprint Identification System », Thèse de doctorat, Faculté de droit et des sciences criminelles, Ecole des sciences criminelles, Institut de police scientifique, Université de Lausanne, 2009. Dans ses travaux de recherche, l’auteur montre que le système automatisé donne un taux maximal de rapports de vraisemblance soutenant l’hypothèse que les deux impressions aient été laissées par le même doigt alors qu’en réalité les impressions viennent de doigts différents de 0,8 % à 5,2 % selon le nombre de minuties retenues. Ainsi malgré un taux d’erreur possible non négligeable, ce biais n’apparait nullement discuté, ni pris en compte par l’agent qui travaille sur les propositions données par le système.
628 S. Cole, M. Welling, R. Dioso-Villa & R. Carpenter, « Beyond the individuality of fingerprints : a measure of simulated computer latent print source attribution accuracy », Law, Probability and Risk, pp. 1-25, 2008.
629 I. E. Dror & D. Charlton, « Why experts make errors », Journal of Forensic Identification, 56 (4), 2006, pp. 600-616.
630 Il s’agit du IAFIS, Integrated Automated Fingerprint Identification System.
631 Brandon Mayfield, ancien militaire, est un avocat américain qui s’était converti à l’islam, ce qui en faisait dans ce contexte lors de l’enquête d’environnement un suspect idéal.
632 FBI. May 24, 2004, Press Release : www.fbi.gov/pressrel/pressrel04/mayfield052404.htm.
633 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General, « A Review of the FBI’s Handling of the Brandon Mayfield Case », 2006.
634 R. B. Stacey « Report on the Erroneous Fingerprint Individualization in the Bombing Case », 2005, Disponible sur www.fbi.gov/hq/lab/fsc/current/special_report/2005_special_report.htm.
635 « A Model policy for Friction Ridge Examiner Professional Conduct (Latent/Tenprint) », SWGFAST (Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology) de l’IAI (International Association for Identification, 2012. Consultable sur www.swgfast.org/Documents.html
636 I. E Dror & D. Charlton, op. cit.
637 Ils sont abordés par l’IRCGN lors de la formation des TIC, et à titre d’exercices, ils sont confrontés aux biais ayant été relevés jusqu’à présent dans les travaux scientifiques internationaux. Si cette approche pédagogique permet de limiter les effets de certitude de l’identification et introduit la notion de taux d’erreur, le nombre de semaines de formation apparaît encore trop limité au regard de la complexité réelle des domaines enseignés.
638 L. Haber & R. N. Haber, « Error Rates for Human Fingerprint Examiners », in :, « Automatic Fingerprint Recognition System », N. K. Ratha, & R. Bolle Editors, Springer-Verlag New York, 2004, pp. 339-360.
639 C. Champod, C. Lennard, P. Margot & M. Stoilovic, « Errors », in : « Fingerprints and Other Ridge Skin Impression », Taylor & Francis Ltd, 2004, p. 196-198.
640 « Standard for the Definition and Measurement of Rates of Errors and Inappropriate Decisions in Frictions Ridge Examination (Latent/Tenprint) », SWGFAST (Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology) de l’IAI (International Association for Identification, 2012, pp. 1- 16. Consultable sur www.swgfast.org/Documents.html
641 S. A. Cole, « More than Zero : Accounting for Error in Latent Fingerprint Identification », The Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 95, n°3, 2005, pp. 985-1078. Dans son article, l’auteur répertorie 22 identifications à partir des traces papillaires (aux USA et en GB) qui se sont avérées être des erreurs d’interprétation et dont la majorité des personnes accusées furent condamnées.
642 Coquoz R., Taroni F., « Preuve par l’ADN : la génétique au service de la justice », Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013.
643 Butler JM, “Genetics and Genomics of Core Short Tandem Repeat Loci Used in Human Identity Testing”. J Forensic Sci, March 2006, Vol. 51, No. 2.
- Butler J M., “Forensic DNA testing”, Cold Spring Harb Protoc 2011
644 Walther Parson, Hans-Jurgen Bandelt “Extended guidelines for mtDNA typing of population data in forensic science”. Forensic Science International : Genetics 1 (2007) 13–19.
645 Butler, K. P., Michelle ;Hart, Jessica ;Schanfield, Moses ;Podini, Daniele. "Molecular “eyewitness” : Forensic prediction of phenotype and ancestry." Forensic Science International : Genetics Supplement Series 3(1): e498-e499, 2011.
646 Revue de la gendarmerie nationale N°249, mars 2014.
647 Senge, T., B. Madea, A. Junge, M. A. Rothschild and P. M. Schneider (2011). "STRs, mini STRs and SNPs – A comparative study for typing degraded DNA." Legal Medicine 13(2): 68-74.
648 Wheeler et al. « The complete genome of an individual by massively parallel DNA sequencing ». Nature, Vol 452| 17 April 2008.
649 Butler, J. M. (2014). Advanced Topics in Forensic DNA Typing : Interpretation, Elsevier Science & Technology Books.
650 Walsh, S. W., Andreas ;Liu, Fan ;Chakravarthy, Usha ;Rahu, Mati ;Seland, Johan H. ;Soubrane, Gisele ;Tomazzoli, Laura ;Topouzis, Fotis ;Vingerling, Johannes R. ;Vioque, Jesus ;Fletcher, Astrid E. ;Ballantyne, Kaye N. ;Kayser, Manfred. "DNA-based eye colour prediction across Europe with the IrisPlex system." Forensic Science International : Genetics 6(3): 330-340, 2012.
- Walsh S, Liu F, Wollstein A, Kovatsi L, Ralf A, Kosiniak-Kamysz A, Branicki W, Kayser M., « The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour fromDNA ». Forensic Sci Int Genet. 7(1):98-115, 2013.
651 Collaborative EDNAP exercise on the IrisPlex system for DNA-based prediction of human eye colour ; Forensic Sci Int Genet. 2014 Jul ;11:241-51.
652 The HIrisPlex system for simultaneous prediction of hair and eye colour from DNA.Forensic Sci Int Genet. 2013 Jan ;7(1):98-115
653 C. Sauleau et IRCGN, « Rapport sur les analyses génétiques : Fiabilité, Mélanges et Transferts », travaux d’études réalisés pour la DACG, octobre 2014.
654 Reviron P., « l’ADN : la preuve parfaite ? », AJ Pénal Dalloz p590-591, 2006.
655 Taroni F., Aitken C., « Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists » Editions WILEY, 2004.
656 Puch-Solis - Roberts - Pope - Aitken, « Assessing the probative Value of DNA evidence ».
657 Taroni F., Aitken C., « Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists » Editions WILEY, 2004.
658 Lauritzen , « Bayesian Networks for DNA mixtures analysis » International Meeting of Statisticians, Toulouse, 2009.
- Lauritzen-Moreira-Cowell « Object oriented Bayesian Networks for DNA mixtures analysis » -Taroni « Bayesian Networks and Probabilistic Inference for Forensic Scientists ».
659 G.Meakin – A.Jamieson, « DNA Transfer : Review and implications for casework », Forensic Science International : Genetics, numéro 980, 2013.
660 Port, Bowyer, Graham, Batuwangala, Rutty, « How long does it take a static speaking individual to contaminate the immediate environnment ? » Forensic Science Medecine Path. 2, 2005, 157-164, 2005.
661 Schadendorf, Von Wurmb-Schwark, Bajanowski, Poetsch, Kamphausen, « Good shedder or bad shedder-the influence of skin diseases on forensic DNA analysis, from epithelial abrasions », Int. J.Legal Med. 126(1) (2012)179-183, 2012.
662 « An investigation into the transference and survivability of human DNA following simulated manual strangulation with consideration of the problem of a third party contamination » Int. J. Legal Med. 116 170-173, 2002.
663 Cook, Dixon, « The prevalence of mixed DNA profiles in fingernail samples taken from individuals in the general population », Forensic Science Genetics 1 62-68, 2007.
664 Malsom, Flanagan, McAlister Dixon, « The prevalence of mixed DNA profiles in fingernail samples taken from couples who cohabit using autosomal and Y-STRs », Forensic Science Genetics 1 57-62, 2009.
665 Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil de l’Union Européenne du 30 novembre 2009 relative à l’accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire.
666 Cohen, Y., Rozen, E., Azoury, M., Attias, D., Gavrielli, B., & Elad, M. L., “Survivability of latent fingerprints Part I : adhesion of latent fingerprints to smooth surfaces”. J Forensic Identif, 62(1), 47-53, 2012.
667 Girod, A., Ramotowski, R., & Weyermann, C., “Composition of fingermark residue : A qualitative and quantitative review”. Forensic science international, 223(1), 10-24, 2012.
Girod, A., Roux, C., & Weyermann, C. « La datation des traces digitales (partie II) : proposition d’une approche formelle ». RICPTS, 2014.
668 Holder, E. H., Robinson, L. O., & Laub, J. H., “The fingerprint sourcebook”. US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 2011.
669 Jean Danet, La justice pénale entre rituel et management (Postface A. Garapon), Presses universitaires de Rennes, 2010.
670 Assemblée plénière, 20 mai 2011, n° 11-90032.
671 Contra non valentem agere non currit praescriptio.
672 () Rapport SCPC pour 2013.
673 () Article L.230 du livre des procédures fiscales :
(...)
Lorsque l’infraction a été commise dans les conditions prévues à l’article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse. [les affirmations sont celles prescrites par dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier et les textes pris pour leur exécution].
Seul le délai de plainte, qui doit être dissocié du délai de prescription de l’action publique, a été modifié. Mais si le délai de prescription et le délai de plainte se différencient, il apparaît souhaitable, si l’on veut faciliter ou renforcer la répression fiscale, de les modifier ensemble. Allonger le seul délai de plainte accroît le risque de plaintes tardives. Allonger le seul délai de prescription ne profite qu’à la justice pénale alors que l’action de l’Administration en est le support. En d’autres termes, il faut raisonner à l’égard de ces deux délais.
674 () Rapport n°338 du 22 février 2007 sur le régime des prescriptions civiles et pénales.
675 1 Cet arrêt, repris par la suite, après avoir constaté que les délais de prescription gardent plusieurs finalités importantes, en énonçait trois : “Garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions ; mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer ; et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé”.
676 2 cf. Les lois du 10.07.1989, 16.12.1992, 4.02.1995, 8.02.1995, 17.06.1998, 18.03.2003, 6.08.2004, 4.04.2006, 4.03.2011, 21.12.2012, 5.08.2013, 6.12.2013, 27.01.2014, 4.08.2014, 13.11.2014.
677 3 Art. 707-1 al.5 C.P.P. : La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende et de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor et de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à leur exécution”.
© Assemblée nationale