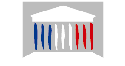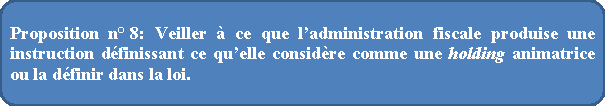______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
en conclusion des travaux d’une mission d’information
sur l’investissement productif de long terme
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Olivier CARRÉ et Christophe CARESCHE
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. CONSOLIDER LE MODÈLE FRANÇAIS DU FINANCEMENT DE L’AMORÇAGE 14
A. LE CONSTAT : DE FORTES SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES À L’ÉPREUVE D’UNE CONJONCTURE DIFFICILE 15
1. Malgré un rebond en 2014, les levées de fonds n’ont toujours pas rattrapé leur niveau d’avant-crise 15
2. Le rôle irremplaçable des love-money et des business angels au stade de l’amorçage de l’entreprise 18
3. Les comparaisons internationales font ressortir certaines faiblesses du modèle français 20
a. De fortes spécificités françaises 20
b. Les business angels au Royaume-Uni 21
c. Les business angels en Allemagne 21
d. Quels dispositifs fiscaux en faveur des business angels ? 22
4. La menace d’une mise en conformité européenne dont l’ampleur est relativement mal appréhendée 24
a. L’ISF-PME et le régime des aides d’État 25
b. Le régime « de minimis » 27
c. Les lignes directrices concernant les investissements en faveur du financement des risques 28
B. QUELLES ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES ET FISCALES ? 29
1. Un recentrage de l’ISF-PME et du Madelin sur l’amorçage et le lancement semble incontournable 29
2. Vers davantage d’harmonisation entre les dispositifs ISF-PME et Madelin 30
3. La nécessaire augmentation corrélative de l’avantage fiscal 31
4. Suivre la montée en puissance du crowdfunding en protégeant les épargnants 32
5. Adapter nos dispositifs de mécénat pour structurer les réseaux de créateurs d’entreprises 34
II. FLUIDIFIER LA TRANSITION FINANCIÈRE VERS LE CAPITAL-RISQUE 36
A. L’ÉQUATION COMPLEXE DU FINANCEMENT DU CAPITAL-RISQUE PAR LES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT 36
1. Un nombre d’opérateurs important malgré la crise 37
2. Le rendement du capital-innovation semble insuffisant pour attirer massivement les grands fonds d’investissement 39
3. L’importance cruciale des fonds réglementés 40
B. QUELLES ADAPTATIONS FISCALES OU RÉGLEMENTAIRES ? 44
1. L’urgence de fluidifier le fonctionnement des fonds réglementés de capital-investissement 44
a. Harmoniser les modalités de calcul de la défiscalisation ISF-PME et Madelin selon le mode de souscription 44
b. Simplifier les règles de fonctionnement des fonds de capital-investissement 46
2. Clarifier le cadre de l’activité des holdings en posant une définition légale de la holding animatrice 48
a. La notion de holding animatrice au cœur d’un feuilleton jurisprudentiel 49
b. L’inaction du législateur régulièrement mise en cause 51
3. Diversifier le profil des investisseurs en développant la « corporate venture » 54
4. Fluidifier la transition entre les investisseurs individuels et les investisseurs plus institutionnels 58
III. LA DIVERSIFICATION DES TYPES DE FINANCEMENT AU STADE DE L’EXPANSION ET DE LA MATURITÉ DE L’ENTREPRISE 61
A. AUGMENTER L’ATTRAIT DES FRANÇAIS POUR L’ÉPARGNE FINANCIÈRE 61
1. Poursuivre les efforts d’orientation du PEA vers les actions des PME et certains produits dérivés d’actions 63
2. Poursuivre la diversification de l’encours de l’assurance vie vers les fonds propres des PME 68
a. Les efforts pour orienter l’assurance vie vers le financement de l’économie et les PME 70
b. Quelles propositions pour l’assurance vie ? 72
3. Mettre fin aux signaux contradictoires de la fiscalité des plus-values mobilières 73
B. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES PESANT SUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 76
1. Les contraintes excessives sur les compagnies d’assurance doivent être desserrées avant la fin de l’année 2015 77
2. L’évaluation délicate des effets de la réglementation sur les capacités de financement bancaire 80
3. La solution passe par une coordination européenne dans le domaine du financement de long terme des entreprises 82
C. LA NÉCESSAIRE AMÉLIORATION QUALITATIVE DU FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS FINANCIERS 86
1. Une structuration de l’offre aux PME et aux ETI 87
2. Le financement des PME et des ETI en titres de dettes 88
IV. DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE ET FISCALITÉ DES DIRIGEANTS 92
A. COMMENT ÉVITER QUE LA DISTINCTION ENTRE OUTIL DE TRAVAIL ET PATRIMOINE NE PÈSE SUR LES CHOIX DU DIRIGEANT ? 92
1. La faiblesse française dans le domaine de la transmission des entreprises familiales 92
2. Les conséquences sur le rachat de certains fleurons nationaux 94
B. PLUSIEURS VOLETS DE NOTRE FISCALITÉ DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS EN CONSÉQUENCE 95
1. Les nécessaires ajustements de la définition de biens professionnels 95
2. Les rigidités liées à la mise en œuvre du pacte Dutreil doivent être levées 97
3. Pour la mise en place d’un nouveau statut d’investisseur de long terme et la structuration de l’entreprenariat familial 100
V. CONCLUSION : ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DES PRÉCONISATIONS DU PRÉSENT RAPPORT 103
1. Évaluation du coût brut des propositions 103
2. Pour une évaluation dynamique des effets de la relance fiscale 104
3. Cette dépense fiscale peut être gagée par une réduction des aides moins efficaces aux entreprises 105
EXAMEN EN COMMISSION 107
LISTE DES PROPOSITIONS 117
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 119
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ».
Jean-Marie-Etienne Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, 1801.
Le bon fonctionnement de ce qu’il est convenu d’appeler la « chaîne de financement » de la croissance des entreprises françaises est un enjeu majeur de politique économique. C’est en effet le passage d’une PME à une entreprise de taille intermédiaire (ETI) qui permet la création d’un maximum d’emplois. Bloquer cette croissance revient à entretenir un chômage de masse.
Or, la composition du tissu économique français, où les PME sont abondantes mais les ETI trop rares, est révélatrice d’obstacles structurels qui empêchent l’émergence d’un capitalisme entrepreneurial efficient. Si la France veut tirer profit des mutations technologiques qui amènent de nombreux nouveaux acteurs économiques à émerger sur notre sol, il faut s’interroger sur la pertinence non seulement des outils publics mis en œuvre mais aussi de l’environnement fiscal et législatif qui entoure les investisseurs.
De ce point de vue, la France se trouve depuis quelques trimestres dans un cycle de sortie de crise qui se traduit par une situation inédite :
– d’une part, les liquidités sont abondantes ; avec des taux d’intérêt historiquement bas, les investisseurs disposent de ressources à un coût modéré. Certains d’entre eux semblent cependant contraints par des facteurs exogènes (contraintes de liquidités pesant sur leur passif, objectifs de rentabilité) lorsqu’il s’agit d’affecter ces ressources à des besoins productifs classiques ;
– d’autre part, les besoins des entreprises pour financer sur le long terme leur développement sont importants. Compte tenu de l’érosion significative de leurs capacités d’autofinancement depuis 2008, ces besoins doivent être comblés soit par l’augmentation de leurs fonds propres, soit par l’endettement. L’arbitrage entre ces deux modes de financement n’est évidemment pas le même suivant la taille de l’entreprise et son stade de développement ;
– la rencontre entre l’abondance de liquidités et le besoin de financement ne se fait pas de manière optimale, les entreprises faisant remonter des difficultés à accéder à des investissements de long terme à plusieurs stades de leur développement. Les pouvoirs publics sont en situation, par une politique d’orientation de l’épargne financière des ménages, de combler cette déficience de marché ; cette politique a toutefois un coût budgétaire conséquent qui suppose, dans un contexte parallèle de rareté des ressources publiques, d’établir des priorités.
La présente mission a pour ambition, en se plaçant du point de vue des entreprises aux différents stades de leur développement (amorçage, développement, croissance, transmission), d’appréhender l’ampleur de ces difficultés et d’évaluer la propension des dispositifs publics, qu’ils soient réglementaires ou fiscaux, nationaux ou européens, à les corriger.
Comme l’a rappelé le Premier ministre dans le cadre de ses annonces en faveur des TPE et des PME le 9 juin 2015, ces entreprises représentent près de 99 % de notre tissu économique et environ 50 % de l’emploi en France.
Toute mesure permettant d’améliorer cette chaîne de financement aura des effets vertueux, en chaîne eux aussi, sur la croissance des entreprises, leur valeur ajoutée et leur capacité à embaucher.
Cet enjeu de politique publique est d’autant plus important que les Français semblent exprimer un attrait renouvelé pour la création d’entreprises ; les élèves et les étudiants eux-mêmes expriment désormais sans fard leur préférence pour cette forme d’activité (1) – et les journaux économiques font une large place à ces courants d’opinion –, alors que le temps n’est pas si loin où leur préférence pour le secteur public faisait les manchettes de ces mêmes journaux (2).
Cet engouement peut paraître paradoxal dans le contexte actuel. L’étude des données statistiques longues de l’INSEE met en évidence le fait que les créations brutes d’entreprises se sont maintenues en dépit de la crise, y compris en distinguant l’effet de la nouvelle législation sur les auto-entrepreneurs.
LA CRÉATION BRUTE D’ENTREPRISES EN FRANCE DEPUIS 2009
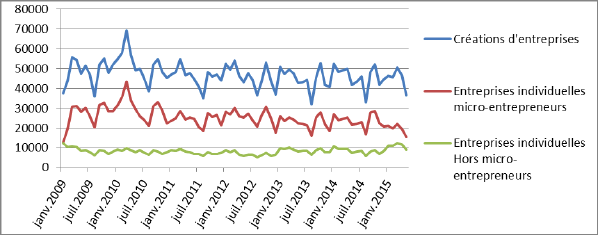
Source : INSEE
Les pouvoirs publics se doivent d’accompagner cette évolution, en ciblant plus particulièrement leurs efforts sur l’évaluation des politiques menées au stade de l’amorçage et du développement des entreprises.
Comparé à notre voisin allemand, le tissu des entreprises françaises se traduit en effet par une « surmortalité » des sociétés créées depuis moins de cinq ans ou par le rachat des entreprises les plus prometteuses par des investisseurs étrangers répondant, souvent, à des impératifs de rentabilité de court terme. Il se caractérise également par un maillage de PME nettement moins dense que le Mittelstand d’outre-Rhin.
Ces différences fondamentales résultent pour partie des problématiques de financement mentionnées précédemment.
Pour appréhender ces questions, la mission a volontairement choisi un intitulé de recherche large qui conduit d’abord à définir ce qu’il faut entendre par « investissement productif de long terme ».
Cette notion peut être définie à partir de données économiques et comptables dont les dirigeants d’entreprises ou les investisseurs conçoivent clairement les contours et la portée opérationnelle :
– l’ « investissement » est l’acte par lequel l’entreprise consacre un certain financement à la concrétisation de gains futurs plus importants. En général, l’investissement se traduit par un accroissement de l’actif stable (immobilisations corporelles et incorporelles, voire immobilisations financières) et son financement par une augmentation des capitaux propres, soit par un accroissement de l’endettement ;
– la notion d’investissement « productif » renvoie aux perspectives de l’investisseur ; celui-ci peut répondre au besoin de financement en entrant au capital de l’entreprise ou en la finançant par la dette ; en fonction du type de financement, l’entreprise pourra affecter ces ressources nouvelles plus ou moins durablement à de nouveaux facteurs de production. C’est bien évidemment l’apport en fonds propres, le « haut de bilan », qui permettra à l’entreprise de mettre en regard des actifs stables qui lui permettront d’accroître ses capacités de production ou d’innovation ;
– enfin, la notion d’investissement productif « de long terme » renvoie de manière plus générale à la durabilité de l’investissement, dont l’ampleur est évidemment très variable en fonction des marchés et de la nature des investisseurs.
La problématique de l’investissement productif de long terme concerne essentiellement les entreprises, qu’il s’agisse de leurs créateurs ou des actionnaires fondateurs ou de tous ceux qui interviennent dans la chaine de financement, aussi bien directement – d’autres actionnaires ou prêteurs – qu’indirectement – financiers, professionnels, qu’ils soient gestionnaires de fonds ou banques. Toutefois, une partie importante de l’immobilier est aussi concernée par ces notions car son usage permet également de créer de la valeur ajoutée.
Le Conseil d’analyse économique rappelle de manière générale que l’horizon des investisseurs s’est fortement raccourci, passant « en trente ans, de 6 ou 7 années à quelques mois aujourd’hui » (3).
Entre ces différentes bornes, plusieurs dispositifs fiscaux destinés à inciter l’investissement de long terme retiennent généralement des durées de détention de six à huit ans :
– l’abattement de droit commun des plus-values mobilières pour durée de détention atteint son taux maximal au bout de huit ans, ce même taux étant atteint au bout de quatre ans pour les créateurs d’entreprises ;
– le taux du prélèvement sur l’assurance vie est le plus avantageux après huit années également, de même que pour le PEA ;
– les dispositifs ISF-PME et Madelin sont assortis d’une condition de détention des titres de cinq ans et d’un non-remboursement des apports de dix ans (4) ;
– le pacte Dutreil, dans son volet relatif aux droits de mutation, est conditionné par une durée de conservation des titres de six ans (deux ans d’engagement collectif et quatre ans d’engagement personnel du redevable).
En réalité, l’analyse de la durée de l’investissement est largement insuffisante pour déterminer ou définir ce que serait un investissement (ou un investisseur) productif de long terme.
Comme le montre le rapport du Conseil d’analyse économique de 2010 consacré à ces problématiques (5), la capacité de l’investisseur à accepter de miser sur des capacités productives, dont les retombées peuvent être longues notamment lorsqu’il s’agit d’investir dans des machines, dans des infrastructures ou dans l’innovation, plutôt que sur objectifs de rentabilité à court terme (amélioration du cours de bourse pour augmenter les dividendes, focalisation sur les ratios comptables, action prioritaire sur la masse salariale) résulte en grande partie de la composition de son passif, qui lui permet de porter son horizon de rentabilité plus ou moins loin.
Cette définition permet d’écarter les critiques trop faciles sur le prétendu « court-termisme » de certains investisseurs : il n’y a pas d’un côté les bons investisseurs qui tablent sur un horizon suffisant pour l’entreprise et d’un autre côté ceux qui ne visent que leur propre rentabilité. Il n’y a que des contraintes économiques variées dont le législateur peut et doit tenir compte.
Qu’est-ce qu’un investisseur de long terme ?
Le rapport du Conseil d’analyse économique précité dresse une typologie des investisseurs de long terme (6) par-delà leur évidente diversité.
Si l’horizon d’investissement est insuffisant pour caractériser de tels investisseurs, le rapport met en évidence le rôle prépondérant de la composition du passif de ces investisseurs qui, soumis à des contraintes de liquidités moins fortes que d’autres intervenants du fait de la nature de leurs ressources, leur permettent d’investir « afin de dégager des revenus à une échéance ou durant une période lointaine ».
Cette contrainte moins forte leur permet d’opérer des arbitrages entre bénéfices à court terme et à long terme, en choisissant, lorsque cela est plus rentable, d’investir dans des projets dont la rentabilité est forte mais à un horizon plus lointain (infrastructures, innovation, etc.).
Au-delà des fonds souverains, les investisseurs de long terme peuvent être des institutions financières auxquelles l’État donne des mandats de gestions, par exemple pour gérer les produits du livret A, les fonds de pension ou les compagnies d’assurances.
Pour agir dans ce domaine, les pouvoirs publics disposent de trois leviers distincts :
– la réglementation, qui contraint les opérateurs privés à se conformer à un cadre normatif national et aussi souvent européen dans ce domaine. Ce domaine d’action appelle rapidement une comparaison avec celui qui existe dans d’autres pays, voire hors de l’Union européenne. Un cadre excessivement restrictif risque en effet de porter préjudice à la compétitivité d’un marché qui est désormais mondialisé ; on peut penser en particulier à certains cadres posés par l’Autorité des marchés financiers destinés à assurer, légitimement, la sécurité de l’épargnant mais qui peuvent à terme dissuader les investisseurs ;
– l’incitation, en particulier l’incitation fiscale, qui doit permettre en premier lieu d’infléchir les choix économiques des opérateurs privés. Ce levier a, dans la majorité des cas, un coût important et difficile à piloter ex ante ; toutefois, la mission insiste sur l’idée que la dépense fiscale doit absolument être mise en regard de la dynamique qu’elle peut créer et des autres rentrées fiscales qu’elle peut générer par ailleurs, lorsqu’on accepte, là aussi, d’adopter un horizon d’analyse politique qui soit de long terme ;
– l’intervention directe, héritière de notre longue tradition colbertiste. Cette intervention directe, qui a dans la majorité des cas un coût plus conséquent que l’incitation et génère en général des coûts de structure, risque de souffrir deux critiques : la première consiste à dire que cette intervention se fait au détriment des opérateurs privés (effet d’éviction), tandis que la seconde met davantage en cause le fait que l’opérateur public se comporte comme un opérateur privé, minant ainsi sa légitimité. Les politiques mises en œuvre récemment dans le domaine du capital-investissement, au travers notamment de la création de BPI France, doivent être évaluées à l’aune de ces deux écueils.
Dans un contexte de rareté des ressources publiques, la mission sera amenée à recommander une réorientation des moyens financiers publics vers les leviers les plus efficients.
*
Compte tenu de l’ambition de la mission, qui consiste à analyser les éléments de grippage dans le fonctionnement de la chaîne de financement de l’entreprise à ses différents stades de croissance, le présent rapport se propose en toute logique de repartir de la fondation de l’entreprise et de présenter, aux différents stades de cette croissance, les enjeux de financement qui se posent et les dispositifs publics qui peuvent déterminer ou corriger ces enjeux.
Il ressort des auditions que ces stades sont généralement décrits de la manière suivante :
Amorçage : Financement destiné à une entreprise avant sa création
Création : L’entreprise peut être en phase de création ou au tout début de son activité. Elle n’a pas commercialisé son produit. Le financement est destiné au développement du produit.
Post-création : L’entreprise a déjà achevé le développement d’un produit et a besoin de capitaux pour en démarrer la fabrication et la commercialisation. Elle ne génère encore aucun profit.
Développement : L’entreprise a atteint son seuil de rentabilité et dégage des profits. Les fonds seront employés pour augmenter ses capacités de production et sa force de vente, développer de nouveaux produits, financer des acquisitions et/ou accroître son fonds de roulement.
Transmission ou succession : Cette catégorie inclut les différents types de buy-outs, (généralement le leveraged buy out) ainsi que les rachats d’entreprises par les salariés. Les capitaux sont destinés à permettre l’acquisition par la direction existante, ou par une nouvelle équipe, et par leurs investisseurs, d’une entreprise déjà établie. Ce peut être également un financement visant à créer une société holding afin d’acquérir une ou plusieurs entreprises existantes, notamment dans le cadre de successions.
Ce stade comprend la problématique du rachat de positions minoritaires (qui désigne le rachat d’actions détenues par des actionnaires familiaux minoritaires ou par d’autres opérateurs en capital investissement.
Retournement et redressement : À ce stade, le problème consiste à financer et à accompagner le redressement d’entreprises en difficulté. Cette problématique, très spécifique comparée aux autres situations car elle ne concerne qu’une partie seulement des entreprises, a été volontairement laissée de côté par la mission.
On peut noter que les directives européennes adoptent un typologique plus simple, dont la mission s’inspire également, distinguant l’amorçage, le démarrage, l’expansion et le désengagement (7).
À ces différentes étapes sont associées des courbes permettant d’illustrer le lien entre le stade de la vie de l’entreprise et son mode de financement.
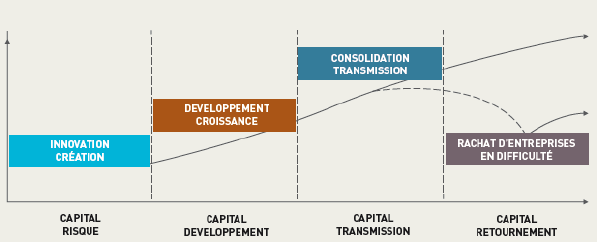
Source : AFIC.
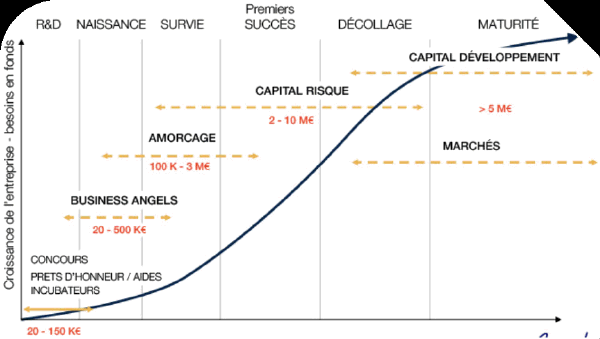
Source : France Angels.
I. CONSOLIDER LE MODÈLE FRANÇAIS DU FINANCEMENT DE L’AMORÇAGE
À l’automne 2012 et durant toute l’année 2013, la fronde dite des « pigeons » contre les effets de la barémisation des plus-values mobilières (dans le cas particulier d’une création d’entreprise) a mis en évidence le rôle très particulier du réseau des business angels, peu nombreux mais très actif, dans le financement de l’amorçage et du décollage des entreprises en France.
La mission a acquis la conviction que ce rôle, qui est probablement en proportion plus crucial en France que chez plusieurs de nos voisins, doit absolument être conforté car il relève d’une mission que le législateur pourrait qualifier « d’intérêt général ».
Rappelons en effet, par comparaison, que la loi créant BPI France (8) reconnaît explicitement à cette structure publique une mission d’intérêt général, rattaché à un périmètre d’intervention défini de la manière suivante : « le soutien à l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ». Cet article précise en outre qu’elle oriente en priorité son action vers les TPE, les PME et les ETI, en adoptant une politique d’investissement de long terme.
Autant de missions qui sont également mises en œuvre par le réseau des investisseurs providentiels et qui justifient probablement encore aujourd’hui l’existence de puissants mécanismes de défiscalisation.
L’amorçage et le financement des entreprises en création ne sont toutefois pas réductible au seul réseau des business angels, ni aux entreprises technologiques sur lesquelles ce réseau polarise souvent ses investissements.
Du côté du financement, l’amorçage peut également être assuré par des fonds d’investissement (qui bénéficient d’ailleurs pour certains des mêmes mécanismes de défiscalisation), voire par le grand public par le biais du dispositif Madelin ou de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le crowdfunding. Il peut également l’être par d’autres entreprises, via par exemple le corporate venture, mais l’incitation publique dans ce domaine est encore balbutiante.
Du côté des entreprises financées, l’enjeu consiste à ne pas focaliser nos politiques publiques sur les entreprises à haute technologie (9) pour prendre en compte également les problématiques de financement d’entreprises plus traditionnelles, industrielles par exemple, qui peuvent être implantées loin des centres de décisions de financement.
A. LE CONSTAT : DE FORTES SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES À L’ÉPREUVE D’UNE CONJONCTURE DIFFICILE
L’ampleur des difficultés rencontrées par les entreprises en création pour accéder au financement ont fait l’objet d’une appréciation contrastée selon les différents réseaux auditionnés par la mission.
Pour certains, il n’y a pas de problème de financement de l’amorçage en France ; pour d’autres, cette appréciation doit être fortement nuancée en fonction des secteurs économiques mais aussi des régions.
Au-delà de ces divergences, la mission se félicite de constater que plusieurs interlocuteurs existent désormais pour faire part de leurs évaluations (10).
1. Malgré un rebond en 2014, les levées de fonds n’ont toujours pas rattrapé leur niveau d’avant-crise
Selon une étude de l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) rendue publique le 24 mars 2015 (11) portant sur l’ensemble du capital-investissement en 2014, les levées de fonds ont enregistré cette année une augmentation de 24 % par rapport à l’année 2013, pour s’établir à 10,1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le montant des investissements est en forte progression de 35 %, à 8,7 milliards d’euros ; le nombre d’entreprises soutenues (1 648 entreprises) est désormais au-dessus de sa moyenne de long terme (en effet, 1 560 entreprises ont été aidées chaque année entre 2006 et 2013). Les montants investis ont en outre enregistré une hausse de 43 % après deux années de repli.
On peut toutefois noter que, malgré cette embellie de l’année 2014, le capital-investissement dans son ensemble n’a pas rattrapé son niveau d’avant-crise.
ÉVOLUTION DES LEVÉES DE FONDS ET DES INVESTISSEMENTS DEPUIS 2005
(en milliards d’euros)
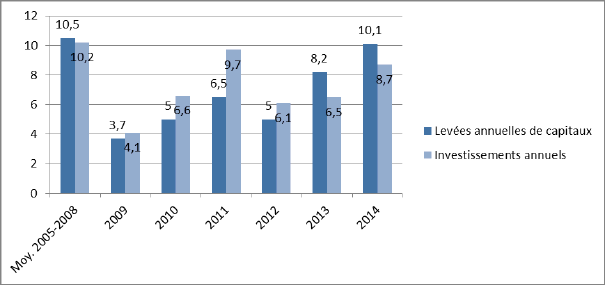
Source : Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), étude du 24 mars 2015.
Certains éléments de cette étude permettent toutefois de mettre en évidence le fait que cette embellie globale sur le marché du capital-investissement ne concerne pas l’ensemble de ses segments, en particulier celui du capital-amorçage.
En premier lieu, la part des levées de fonds très importantes (supérieures à 1 milliard d’euros) dans l’ensemble est historiquement élevée en 2013 comme en 2014, représentant au cours de ces deux années près du tiers du montant total des levées de fonds (3 milliards d’euros sur 10,1 milliards d’euros en 2014).
Les « petites » levées de fonds restent encore en marge de la reprise. Selon cette étude, 78 % des capitaux levés ont été concentrés sur les véhicules de plus de 100 millions d’euros en 2014. L’embellie est en grande partie concentrée sur les levées opérées par les fonds de fonds, les investisseurs français représentant par ailleurs la majorité de la hausse des levées en 2014.
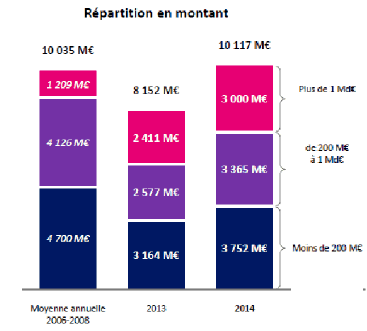
Source : Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), étude du 24 mars 2015.
Enfin, l’étude met en évidence le fait que la hausse des levées de fonds profite essentiellement au capital-développement et au capital-transmission tandis que le capital-innovation continue de décroître en 2013 et 2014. Une telle évolution est également confirmée par les montants effectivement investis (626 millions d’euros en 2014 contre 642 millions d’euros en 2013) et en nombre d’entreprises soutenues (438 entreprises soutenues en 2014 contre 469 en 2013).
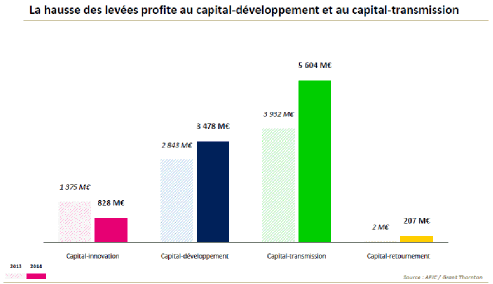
Source : Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), étude du 24 mars 2015.
Dans le dernier décile (en montant) des investissements en capital-innovation, l’étude fait ressortir une baisse assez conséquente des montants inférieurs à 5 millions d’euros (363 millions d’euros en 2014 contre 408 en 2013) mais aussi pour les segments 5 à 15 millions d’euros et 15 à 30 millions d’euros. Ce n’est qu’à partir de 30 millions d’euros que la tendance semble s’inverser.
Cette étude fait enfin ressortir une très grande inégalité des montants investis suivant les régions, qui sont en l’occurrence celles de l’ancienne carte administrative, avec une très forte prépondérance de la région Île-de-France et l’ancienne région Rhône-Alpes ; les investissements étant régionalisés en fonction du siège social de l’entreprise, l’étude introduit toutefois un biais en faveur de ces deux régions qui ne reflète qu’imparfaitement la réalité.
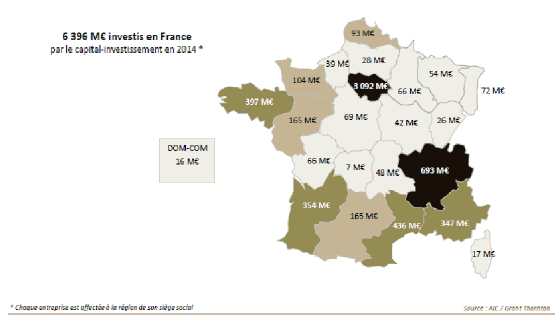
Source : Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), étude du 24 mars 2015.
Notons que ces éléments portent sur l’année 2014 ; pour le premier semestre de l’année 2015, les chiffres disponibles font état d’une nette amélioration des levées de fonds dans le secteur du capital-risque (12) . Cette tendance est tirée par des levées importantes et bénéficie pour l’essentiel aux entreprises à forte perspective de croissance des secteurs technologiques ou de l’Internet.
2. Le rôle irremplaçable des love-money et des business angels au stade de l’amorçage de l’entreprise
Alors que l’année 2014 est, dans un contexte de sortie de crise, une année en demi-teinte si l’on prend en considération l’ensemble du capital-investissement, tel n’est pas le cas lorsqu’on se consacre sur le capital-amorçage et le rôle plus particulier des love-money et des business angels.
Les études concernant ce secteur assez ciblé ne sont pas extrêmement nombreuses ; l’un des outils d’analyse est le French internet business angel money yardstick (Fibamy), un indicateur mis en place par le fonds d’investissement ISAI, dont l’un des dirigeants est l’entrepreneur Jean-David Chamboredon.
Selon le Fibamy, les investissements des business angels se sont essoufflés en France, avec un recul de 13 % des montants investis (13) en 2014. L’indicateur s’est même dégradé au second semestre, enregistrant une chute de leurs investissements de près de 24 % par comparaison avec le second semestre 2013. Le Fibamy met donc en évidence un retour aux niveaux d’investissement de 2011-2012, après une embellie en 2013, ce qui tranche avec les analyses de sortie de crise que l’on peut lire par ailleurs.
Selon M. Jean-David Chamboredon, « la communauté des business angels ne grossit pas, elle a tendance à se concentrer sur quelques entrepreneurs qui ont réussi et qui réinvestissent, alors que les autres investisseurs individuels ont peut-être eu tendance à se redéployer vers les secteurs traditionnels, les sociétés Internet ayant connu des fortunes diverses entre 2010 et 2012 ».
Cette analyse du fonds ISAI est corroborée par les données de France Angels, qui publie chaque année des données relatives aux investissements réalisés par les réseaux qui leur sont affiliés.
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Nombre de business angels |
4 000 |
4 124 |
4 292 |
4 442 |
Nombre de réseaux de BA |
82 |
82 |
82 |
75 |
Nombre d'entreprises financées |
327 |
352 |
370 |
305 |
Montant total investi par les BA |
44,5 |
40 |
41 |
36,5 |
Effet de levier pour les 1ers tours |
x 2,5 |
x 2,5 |
x 3 |
x 3,4 |
Emplois créés ou maintenus |
2 400 |
2 600 |
3 000 |
3 000 |
Investissement moyen par entreprise (en milliers d'euros) |
136 |
114 |
132 |
120 |
Source : France angels.
Selon ces données, si le chiffre global des investisseurs providentiels semble augmenter de manière tendancielle depuis plusieurs années, le nombre d’entreprises financées et l’investissement moyen par entreprise semblent avoir enregistré un coup d’arrêt entre 2013 et 2014.
Ces chiffres concernant les business angels sont particulièrement préoccupants pour le financement du capital-risque, dans la mesure où ceux-ci occupent un terrain laissé vide par les investisseurs plus institutionnels. Plusieurs études de la direction générale du Trésor montrent que ce prisme résulte en grande partie de nos dispositifs fiscaux et du fait que le capital-risque français offre des perspectives de rentabilité qui sont probablement insuffisantes pour ces investisseurs institutionnels.
3. Les comparaisons internationales font ressortir certaines faiblesses du modèle français
Globalement, le montant des investissements par les business angels a enregistré une embellie au niveau européen, si l’on en croit les statistiques de l’European business angels network (EBAN) relatives à l’année 2014 (14). Le montant total de leurs investissements a augmenté de 5,5 milliards d’euros (+ 8,7 %) par rapport à 2013.
a. De fortes spécificités françaises
Sans surprise, l’EBAN confirme que le Royaume-Uni constitue le pays où les business angels sont les plus importants (84,4 millions d’euros investis dans 535 entreprises). Beaucoup plus curieusement, le second pays est l’Espagne (57,6 millions d’euros investis) puis la Russie (41,8 millions d’euros investis). La France n’arrive qu’en quatrième position.
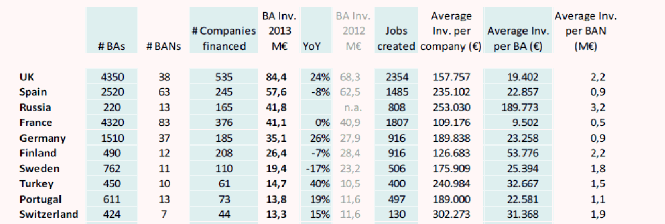
Les chiffres fournis par l’EBAN montrent par ailleurs que la France présente certaines spécificités par rapport, notamment, aux trois premiers pays et à l’Allemagne : le montant moyen investi par business angel y est relativement limité, tandis que le nombre des entreprises financées y est plutôt important (près de deux fois plus important qu’en Allemagne). Leur nombre total est comparable à celui du Royaume-Uni et nettement supérieur à ceux de l’Espagne, de la Russie ou de l’Allemagne.
On notera que ce type de chiffres doivent être pris avec une certaine prudence dans la mesure où ils peuvent varier d’une étude à l’autre ; les tendances restent cependant les mêmes suivant les études (15).
b. Les business angels au Royaume-Uni
Les informations généralement reprises par les études publiques proviennent des travaux réalisés par le Professeur Colin Mason de l’Université de Glasgow.
D’après les auteurs de ces travaux, le marché des business angels est en train de connaître une évolution de fond qui n’est pas forcément totalement appréhendée par les pouvoirs publics : « Alors que les business angels menaient auparavant une activité plutôt invisible mise en œuvre par des individus de leur propre chef ou avec de petits groupes d’associés, ils ont tendance maintenant à constituer de véritables groupements d’investisseurs (parfois appelés à tort des syndicats) ». Cette évolution répond à l’objectif de drainer plus de fonds tout en confiant la levée à un responsable, ce qui permet à l’investisseur de réduire son investissement en temps.
Cette évolution aurait permis d’attirer de nouveaux investisseurs providentiels, renforçant ainsi leur rôle dans le financement du capital-risque ; par ailleurs, elle implique que la décision d’investir soit de moins en moins individuelle mais plus collective. Le rôle du manager du groupe d’investisseur devient alors primordial.
c. Les business angels en Allemagne
Selon une étude d’un centre de recherche spécialisé en économie (16), publiée sur le site des business angels allemands (17), entre 2 et 7 % des entreprises créées ont bénéficié de versements d’investisseurs providentiels ; les chiffres sont plus importants dans les secteurs technologiques et numériques.
L’étude allemande tente de dresser une typologie des business angels suivant qu’ils ne sont qu’investisseurs passifs dans l’entreprise ou qu’ils vont y participer activement par la fourniture de contacts, de conseils personnels, voire la prise en charge d’une partie de la direction de l’entreprise.
Il apparaît qu’entre 2002 et 2012, la part des investisseurs « actifs » a augmenté, en particulier dans les secteurs à haute technologie. Cette implication de l’investisseur providentiel est plus limitée dans les autres secteurs d’activité. Cette participation active recoupe également des investissements qui sont majoritairement réalisés dans les sociétés de capitaux ; toutefois, dans les sociétés technologiques, les investissements sous forme de sociétés de personnes sont également très importants.
Il existe 7 500 business angels en Allemagne ; toutefois, seuls 1 500 d’entre eux appartiennent à un réseau actif ; les investissements réalisés par les 7 500 personnes avoisinent les 650 millions d’euros par an.
d. Quels dispositifs fiscaux en faveur des business angels ?
L’étude comparative la plus concluante a été réalisée en 2014 par l’EBAN ; les principaux éléments en sont retracés dans le tableau ci-dessous.
LES INCITATIONS FISCALES EN FAVEUR DES BUSINESS ANGELS
DANS PLUSIEURS PAYS DÉVELOPPÉS
France (18) |
Réduction d’IR de 18 % dans la limite de 50 000 euros (100 000 euros pour un couple) ; la réduction est limitée aux PME et l’investissement doit être conservé cinq ans. Les personnes passibles de l’impôt sur le patrimoine peuvent imputer 50 % de leurs investissements dans la limite de 45 000 euros. |
Italie |
Les gains en capital indépendants de l’activité professionnelle du BA sont exonérés à hauteur de 50,28 % de leur montant ; le reste est soumis au barème de l’IR. Une possibilité de compensation avec les pertes enregistrées dans la même catégorie de revenus est prévue. Lorsque l’investissement n’est pas éligible à ce régime, le taux de 26 % est applicable. Selon une étude du ministère de l’Économie du 26 mai 2015, l’Italie a en outre profondément revu divers pans de son droit dans ce domaine au travers d’un « Startup act » voté en 2012 ; cette loi prévoit une adaptabilité des normes, notamment celles du droit du travail, pour les jeunes entreprises innovantes. En outre, un éventuel résultat annuel négatif peut n’être répercuté sur les titres de capital de l’entreprise qu’avec une année de décalage par rapport aux entreprises normales. |
Royaume-Uni |
Le Royaume-Uni a trois dispositifs distincts : – L’Entrepreurs’relief permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le capital (au travers d’un taux préférentiel de 10 % au lieu de 28 %) sur une tranche de 10 millions de £ (soit environ 14 millions d’euros au cours actuel) valable en une ou plusieurs fois tout au long de la vie ; – L’Enterprise investment scheme (EIS) permet de bénéficier d’une réduction d’IR de 30 % de la souscription à une PME (de moins de 15 millions de £ et 250 salariés) à condition qu’elle ne soit pas cotée en bourse. Ce taux était de 20 % avant le 6 avril 2011. L’investisseur ne doit pas détenir plus de 30 % de l’entreprise ; la souscription maximale est de 1 million de £ par an, et la réduction d’impôt maximale est quant à elle de 300 000 £. Les investissements éligibles à l’EIS sont par ailleurs exonérés de taxation sur le capital après trois ans de détention et de droits de mutation après deux ans ; – le 6 avril 2012, le Seed enterprise investment scheme a été mis en place afin d’attirer les investisseurs vers les startups ; d’après le site officiel, le SEIS a été créé « en miroir avec celui de l’EIS, afin de créer une continuité entre les deux dispositifs ». Ce nouveau dispositif permet d’obtenir une réduction d’IR de 50 % de montant investi dans la limite d’un investissement annuel de 100 000 £. Les gains en capital provenant de telles actions sont totalement exonérés de la taxe sur les gains en capitaux après trois années. Avant ce délai, l’exonération n’est acquise qu’en cas de réinvestissement dans une entreprise éligible au dispositif. L’entreprise ne peut pas lever plus que 150 000 £ par le biais du SEIS ; elle ne doit pas avoir plus de 25 employés et avoir plus de 200 000 £ de capitaux avant l’émission des nouveaux titres. En outre, l’entreprise doit avoir moins de deux ans. |
Allemagne |
Ce n’est qu’en 2013 que l’Allemagne a mis en place un dispositif de subvention original, dont le montant total a été fixé à 150 000 euros par an pendant quatre années. La subvention correspond à 20 % d’un investissement entre 10 000 et 250 000 euros, dans la limite de 50 000 euros par an et par investisseur. L’investissement doit ensuite être bloqué pendant trois ans. L’entreprise ne doit pas avoir plus de dix ans, être une PME au sens européen, ne pas être cotée en bourse, avoir son siège en Europe et au minimum un établissement en Allemagne. L’entreprise doit être spécialisée dans l’innovation. Les conditions relatives à l’investisseur sont assez strictes : dans le cas où l’investissement est réalisé par une société de capitaux, elle ne doit pas avoir plus de quatre associés, l’investissement ne peut se faire sous forme de prêt et l’investisseur ne peut être connecté avec l’entreprise. Par ailleurs, un dispositif fiscal de portée plus générale permet d’exonérer les plus-values mobilières provenant de certaines cessions : si l’investisseur possède, par le biais d’un fonds, moins de 10 % d’une entreprise, les gains provenant de cette cession sont exonérés. D’après le réseau allemand, contacté par la mission, cette disposition est très utilisée par les BA d’outre-Rhin mais des discussions politiques ont lieu afin d’évaluer si une remise en question de ce régime ne serait pas opportune. |
États-Unis |
Au niveau fédéral, les États-Unis n’ont pas de dispositif permettant de soutenir fiscalement les BA ; certaines aides existent au niveau des États. De manière générale, les BA bénéficient des dispositions applicables aux « S-corporations » (19) ; pour en bénéficier, la S-corporation ne doit pas avoir plus de 75 actionnaires. Les dividendes versés par les S-corporations ne sont pas passibles de l’IR ; en outre, la détention de long terme de titre de S-corporations ouvre le droit à une exonération de la taxe sur les gains en capital. |
Source : rapport EBAN, contacts directs avec les réseaux.
Comme on peut le constater, la comparaison avec les dispositifs étrangers démontre certaines spécificités françaises qui tiennent principalement à l’existence en France d’une imposition sur le patrimoine ; elles conduisent à ce que le dispositif français d’incitation à l’investissement dans les entreprises en amorçage soit essentiellement assis sur l’ISF.
Les exemples étrangers démontrent en outre avec force que l’incitation à l’investissement dans les entreprises en amorçage est intégrée, de manière identique et cohérente, dans les différents compartiments fiscaux : l’investissement dans les entreprises éligibles entraîne une réduction d’imposition sur le revenu. Après une certaine durée, cette réduction se décline en réduction ou exonération d’imposition sur les gains en capital, lorsque les titres ouvrant droit à la réduction d’IR sont cédés. Enfin, ces mêmes titres ouvrent des avantages en termes de droits de succession.
A contrario, le système français ne semble pas offrir ce même chaînage fiscal vertueux : les titres éligibles au dispositif Madelin ne sont pas exactement les mêmes que ceux éligibles à l’ISF-PME, qui ne sont pas les mêmes que ceux éligibles à l’abattement pour durée de détention renforcé. Ces périmètres sont également différents des réductions de droits de succession ou de donations prévus par le droit français.
4. La menace d’une mise en conformité européenne dont l’ampleur est relativement mal appréhendée
Cette forte spécificité française du dispositif Madelin et de l’ISF-PME fait peser sur la pérennité du dispositif une menace qui nous vient de Bruxelles.
Sa stabilité a fait l’objet d’un engagement du président de la République dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 à Château-Renault : « Le troisième impôt qui ne changera pas, ce sont tous les dispositifs en faveur de l’investissement dans les PME, aussi bien pour l’impôt sur la fortune que pour l’impôt sur le revenu, le régime des pactes d’actionnaires favorisant la détention et la transmission, ce que l’on appelle la Loi Dutreil (…) ».
Toutefois, cet engagement pourrait être remis en cause sous la pression de la Commission européenne, dans une mesure qui est mal connue des parlementaires et sur laquelle l’administration fiscale communique peu.
En attendant le dénouement des négociations entre les services fiscaux et ceux de la Commission, les initiatives parlementaires – notamment de nombreux amendements présentés dans le cadre des lois de finances ou de la loi pour la croissance et l’activité – sont écartées au motif qu’ils pourraient influencer négativement ces négociations.
De ce fait, ce qu’il est convenu d’appeler « la remise à plat » du dispositif ISF-PME et du Madelin est probable dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances.
Actuellement, les dispositifs ISF-PME et Madelin font l’objet, du point de vue européen, d’un cadre qui a enregistré, ces dernières années, voire ces derniers mois, des évolutions considérables :
– il est en premier lieu soumis au régime européen des aides d’État, qui interdit en principe aux États membres d’établir des dispositifs d’aide aux entreprises, que ce soit par le biais de subventions ou de régimes fiscaux avantageux, qui puisse avoir un effet sur les échanges entre États membres ;
– en outre, le régime d’exemption par catégorie permet de faire « sortir » du régime des aides d’État certains types d’aides, notamment celles en faveur du capital-risque ou de l’investissement dans les PME ;
– il est également encadré par le volet dit « de minimis » dont est assorti le régime européen des aides d’État, qui définit un seuil au-delà duquel l’entreprise bénéficiaire doit notifier l’aide reçue.
Dans le cadre général d’un renforcement du contrôle opéré par la Commission européenne dans ce domaine, les trois volets de ce régime ont été renforcés au cours de la période récente ce qui devrait avoir un effet, dans un avenir proche, sur nos dispositifs nationaux.
a. L’ISF-PME et le régime des aides d’État
Si le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe par principe les aides accordées par les États membres, sous quelque forme que ce soit, à certaines entreprises dès lors que ces aides risqueraient de fausser les échanges ou la concurrence intra-communautaire, celui-ci prévoit, par dérogation, que la Commission peut autoriser la mise en œuvre de régimes particuliers.
Sur ce fondement, le régime ISF-PME a été notifié à la Commission qui l’a autorisé dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d’État n° 596/A/2007).
Par conséquent, les sociétés bénéficiaires des versements doivent satisfaire aux conditions suivantes :
– être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME ;
– ne pas être qualifiables d’entreprises en difficulté ;
– par ailleurs, le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond fixé à 2,5 millions d’euros par période de douze mois. Ce plafond, initialement de 1,5 million d’euros, a été relevé en 2009 à la demande du Gouvernement français.
Ce régime devrait être impacté par l’entrée en vigueur du nouveau règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le règlement du 17 juin distingue en effet deux régimes différents :
– les aides à l’investissement en faveur des PME, prévu par l’article 17 du règlement ;
– les aides au financement des risques (régi par son article 21) avec un régime particulier en faveur des « jeunes pousses ».
S’agissant de l’aide à l’investissement en faveur des PME, l’article 17 du règlement prévoit un premier régime d’exemption de l’obligation de notification exclusivement centré sur les investissements dans les actifs corporels et incorporels ainsi que certains coûts salariaux.
L’essentiel du dispositif consiste à expliciter ce qu’il faut entendre par actif corporel ou incorporel ; s’agissant de cette seconde catégorie, ils doivent en particulier être exploités dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, être considérés comme des éléments d’actif et être acquis aux conditions du marché.
Selon ce nouveau régime, l’intensité de l’aide ne doit pas excéder 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises et 10 % de l’aide pour les moyennes entreprises.
Le montant total de l’aide ne doit pas dépasser 7,5 millions d’euros : au-delà de ce seuil, l’aide est à nouveau susceptible d’être soumise à obligation de notification.
L’article 21 du règlement prévoit par ailleurs un régime spécifique pour les « aides au financement des risques en faveur des PME ». Les entreprises admissibles à ces aides doivent être non cotées au moment de l’investissement initial et soit n’exercer leurs activités sur aucun marché, soit l’exercer depuis moins de sept ans, soit avoir besoin d’un investissement initial qui, sur la base du plan d’entreprise en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
Cet article prévoit en outre, en ce qui concerne les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans ces entreprises, que « la mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles ».
En outre, il prévoit un plafond global par entreprise bénéficiaire fixé à 15 millions d’euros, quelle que soit la mesure de financement des risques.
Il impose en outre un cofinancement privé (indépendant des intermédiaires financiers) qui doit atteindre 10 % pour les entreprises en pré-amorçage, 40 % pour les entreprises de moins de sept ans et 60 % pour les entreprises dont le plan d’entreprise montre que l’investissement initial en faveur du financement des risques est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années.
L’article 22 du règlement prévoit enfin un régime spécifique en faveur des « jeunes pousses » ; les entreprises admissibles sont des petites entreprises non cotées, enregistrées depuis moins de cinq ans, qui n’ont pas encore distribué de bénéfices et qui ne sont pas issues d’une concentration.
Pour ces « jeunes pousses », les aides autorisées sont encadrées de manière différente. Il s’agit :
– des prêts à taux d’intérêt bonifiés d’une durée de dix ans, dont le montant n’excède pas 1 million d’euros (pour des durées inférieures à dix ans, le montant maximal autorisé est calculé à partir d’une règle de trois) ;
– des garanties d’une durée de dix ans et d’un montant maximal de 1,5 million d’euros ;
– les subventions, notamment en fonds propres, dont le montant n’excède pas 400 000 euros.
Ces montants peuvent être doublés pour les entreprises qualifiées d’innovantes au regard de la réglementation européenne.
Dans l’hypothèse où l’entreprise bénéficiant de l’investissement n’est pas éligible à l’exemption par catégorie définie ci-dessus, le bénéfice des aides reçues à raison de ces investissements est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides « de minimis ».
Conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, sont considérées comme des aides « de minimis », les aides dont le montant n’excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.
Le plafond de 200 000 euros s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc.).
Une mesure fiscale de capital-investissement est qualifiée d’aide « de minimis » si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
– le montant total des aides octroyées par chaque État dans une entreprise est limité à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux (toutefois, ce montant ne s’applique pas aux véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement) ;
– le montant de l’aide indirecte accordée à chaque entreprise doit respecter le plafond global d’aides « de minimis » fixé pour chaque entreprise à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.
L’article 14 de la loi de finances pour 2009 a en outre procédé à un relèvement temporaire du plafond du montant brut total des aides accordées aux entreprises soumises à la réglementation relative aux aides de minimis. Pour les aides fiscales accordées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, un seuil unique de 500 000 euros se substitue aux seuils normalement en vigueur.
Le plafond de 200 000 euros n’a pas été modifié par le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.
c. Les lignes directrices concernant les investissements en faveur du financement des risques
Le 22 janvier 2014, la Commission européenne a rendu publiques de nouvelles orientations concernant l’application du droit européen dans le domaine du financement des risques.
Ainsi qu’elle le note dans le point 15 de ces lignes directrices, ce document trouve à s’appliquer pour les aides qui ne sont pas exemptées de notification, soit au titre de l’exemption par catégorie, soit au titre du règlement « de minimis ».
Ce document pose certaines bornes qui conduiront la Commission européenne à écarter certains dispositifs nationaux :
– en premier lieu, il rappelle que la défaillance de marché dans le domaine du financement ne concerne que les PME, parfois certaines entreprises de moyenne capitalisation. En tout état de cause, la Commission ne saurait recevoir des dispositifs visant des entreprises cotées ;
– l’approche de la Commission est très centrée sur le fait que les dispositifs d’aide doivent être axés sur la prise de risque par l’investisseur et non sur la durée de détention. Le point 4 indique que « les mesures d’aide au financement des risques pour lesquelles les investisseurs privés ne supportent pas de risques sensibles ou pour lesquelles les bénéfices sont entièrement réservés aux investisseurs privés ne seront pas déclarées compatibles avec le marché intérieur. Le partage des risques et de la rémunération est une condition nécessaire pour limiter l’exposition financière de l’État et lui garantir un rendement équitable » ;
– l’État membre se doit d’intervenir comme un opérateur en économie de marché, dont l’investissement répond au critère « pari pasu » c’est-à-dire lorsqu’il est réalisé aux mêmes conditions par des investisseurs publics et des investisseurs privés, lorsque les deux catégories d’opérateurs interviennent simultanément et lorsque l’intervention de l’investisseur privé revêt une importance économique réelle ;
– concernant les investissements en fonds propres, le document formule certaines préférences qui devraient guider la Commission dans son appréciation des dispositifs nationaux.
En particulier, la Commission recommande l’usage des instruments à rendement plafonné (si le rendement prédéfini est dépassé, tous les profits excédentaires sont distribués aux investisseurs privés), avec option d’achat (les investisseurs privés ont alors une option pour racheter la part publique) ou une répartition asymétrique des revenus sous forme de liquidité (les investisseurs privés reçoivent une part des produits distribués plus importante que celle correspondant strictement à leur investissement initial) ;
– dans le domaine des prêts, le point 112 du document indique que la Commission jugera positivement les mesures qui prévoient un plafond explicite pour les premières pertes supportées par l’investisseur public, notamment lorsque ce plafond n’excède pas 35 %. En outre, le principe d’un co-investissement avec des partenaires privés est préférable, de l’ordre de 30 % en règle générale.
B. QUELLES ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES ET FISCALES ?
1. Un recentrage de l’ISF-PME et du Madelin sur l’amorçage et le lancement semble incontournable
Compte tenu des évolutions du cadre européen et des comparaisons avec les dispositifs existants dans les autres pays, un recentrage des dispositifs Madelin et ISF-PME sur les entreprises en phase d’amorçage et de lancement semble inévitable.
Cette mise en conformité aura d’ailleurs des effets différents sur des deux dispositifs :
– s’agissant du dispositif Madelin, l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, par un renvoi à l’article 239 bis AB du même code, limite son bénéfice aux sociétés de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan est inférieur à 10 millions d’euros. En outre, l’entreprise bénéficiaire doit être créée depuis moins de 5 ans. Compte tenu des règles posées dans le nouveau règlement européen d’exemption par catégorie, il est envisageable, sans que les conséquences pour les finances publiques ne soient insoutenables, de porter à sept ans l’âge de l’entreprise bénéficiaire ;
– à l’inverse, il semble inévitable que le dispositif ISF-PME, qui ne prévoit aucune limitation quant à l’âge de l’entreprise bénéficiaire, soit également adapté afin d’être centré sur les entreprises de moins de sept ans.
Budgétairement, les deux adaptations devraient s’équilibrer et conduiront à une meilleure harmonisation entre les deux dispositifs.
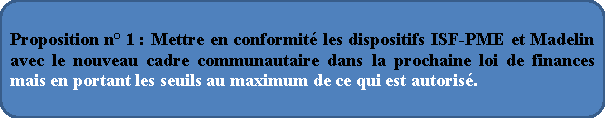
2. Vers davantage d’harmonisation entre les dispositifs ISF-PME et Madelin
Cette harmonisation entre les deux dispositifs devra par ailleurs être déclinée dans plusieurs autres directions.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a déjà procédé à une harmonisation des conditions dans lesquelles l’investisseur peut se défaire des titres acquis tout en conservant à l’avantage fiscal :
– en l’état actuel du droit, l’avantage Madelin est conservé en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du contribuable ou de son conjoint, ou en cas de donation si le donataire reprend l’obligation de conservation ;
– concernant l’ISF-PME, l’avantage est conservé en cas de fusion ou de scission de l’entreprise si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; il en est de même en cas de cession obligatoire si les fonds correspondants sont réinvestis dans un délai de douze mois dans une entreprise éligible, ou d’offre publique d’échange si les titres reçus sont éligibles au dispositif.
Conformément à cette loi, les conditions de conservation de l’avantage fiscal prévues pour l’ISF-PME seront également valables pour le Madelin ; toutefois, les conditions de conservation applicables au Madelin ne sont pas valables pour l’ISF-PME, ce qui n’est pas forcément logique.
De manière plus générale, il serait opportun de créer un corpus législatif commun aux deux dispositifs, qui permettrait une harmonisation totale de la définition des entreprises bénéficiaires. Plusieurs professionnels ont en effet mis en lumière d’infimes différences qui rendent la mise en œuvre des deux dispositifs trop complexe. À titre d’exemple, le dispositif ISF-PME est ouvert aux souscriptions en numéraires ou en nature, alors que les seules souscriptions en numéraire sont éligibles au Madelin.
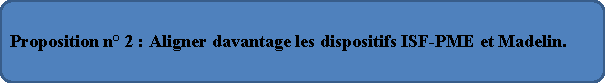
3. La nécessaire augmentation corrélative de l’avantage fiscal
Parallèlement à la mise en conformité européenne des dispositifs ISF-PME et Madelin, ce qui conduira à revoir les deux dispositifs dans un sens restrictif, il semble nécessaire, pour accompagner la conjoncture actuelle de redémarrage de l’activité, de renforcer la portée de ces deux avantages fiscaux.
S’agissant de l’ISF-PME, rappelons qu’il a été créé dans la loi TEPA sous la forme d’une réduction d’ISF de 75 % des montants investis, dans la limite d’une réduction d’impôt de 50 000 euros. Au total, l’investisseur pouvait donc réaliser un investissement de 200 000 euros. Le montant de cet avantage a été ramené à 50 % dans la limite de 45 000 euros.
S’agissant de l’avantage Madelin, le taux de la réduction d’IR a été fixé de manière très stable à 25 % depuis sa création en 1994 jusqu’en 2011, date à laquelle l’avantage a été ramené à 22 % avant de descendre à 18 % en 2012.
En outre, l’avantage Madelin a été intégré dans un plafonnement global des niches fiscales qui a lui-même évolué de manière de plus en plus restrictive. Alors que ce plafonnement était, lors de sa création en 2008, fixé à 25 000 euros et à 10 % du revenu imposable, il a été fixé à 10 000 euros par la loi de finances pour 2013, alors même que d’autres crédits d’impôts (Malraux, Outre-Mer, SOFICA) bénéficient d’un traitement fiscal plus avantageux puisqu’ils sont placés sous un second plafonnement à 18 000 euros, voire hors de tout plafond.
Pour un ménage donné, l’investissement dans une PME est donc désormais mis en balance avec certaines contraintes, notamment lorsqu’il s’agit de bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’emploi à domicile ou la garde d’enfant.
Dans le cadre d’une refonte du dispositif Madelin, la mission considère qu’il serait particulièrement opportun que le plafonnement global soit réorienté en faveur de l’emploi et de l’investissement plutôt qu’en faveur de dépenses dont les effets sur la croissance et l’activité sont beaucoup plus indirects.
Dans le cadre d’une réflexion plus globale, il sera bon de s’interroger sur l’opportunité d’inciter le plus grand nombre à investir dans les PME des sommes relativement faibles en moyenne, alors que dans les autres pays, les investisseurs sont sensiblement moins nombreux mais les montants unitaires beaucoup plus élevés. Cela conduit à réserver un cadre fiscal approprié à des investisseurs avisés plutôt que de considérer cet investissement comme une niche fiscale comme les autres. Cette réorientation peut, a minima, passer par une réforme des dépenses fiscales placées sous le plafonnement à 10 000 euros et celles qui sont sous le plafonnement à 18 000 euros.
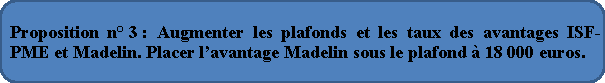
4. Suivre la montée en puissance du crowdfunding en protégeant les épargnants
De nombreux intervenants auditionnés par la mission voient encore le développement du crowdfunding comme un phénomène nouveau, qui ne viendra corriger que de manière marginale les difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder au financement au stade du pré-amorçage et de l’amorçage.
Crowdfunding et crowdlending
Littéralement, le terme de crowdfunding renvoie à une notion de « financement par la foule », mais il désigne également une nouvelle modalité de collecte de ce financement par un biais dématerialisé.
Désormais, dans le domaine spécifique du financement des entreprises, le crowdfunding désigne spécifiquement la prise de participation au capital d’une entreprise (ou le crowdequity) tandis que le crowdlending consiste en un prêt rémunéré.
Le cadre juridique applicable à ces deux modes de financement est différent.
Le crowdfunding s’apparente désormais à un nouveau mode d’appel public à l’épargne. Il doit donc bénéficier du même encadrement protecteur à la fois de l’investisseur et du bénéficiaire des fonds souscrits.
Compte tenu de la vitesse des évolutions enregistrées dans le secteur du numérique, la mission a la conviction que ce mode de collecte va rapidement prendre une importance non négligeable, ne serait-ce que parce que certaines plates-formes créées récemment se situent à mi-chemin entre le crowdfunding et le private equity. Le rôle de l’intermédiaire financier n’est pas totalement effacé ; en revanche, juridiquement, son rôle de conseiller, ses responsabilités, le devoir de mise en garde de l’épargnant semblent amoindris par l’interface numérique.
Il semble fondamental que la puissance publique et le régulateur ne laissent pas se développer un canal de financement, qui sera probablement de plus en plus important, en marge des canaux existants pour lesquels la régulation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est très précise. Le cadre juridique applicable au crowdfunding a d’ailleurs été considérablement renforcé dans le courant de l’année 2014.
Un renforcement considérable du cadre juridique applicable au crowdfunding
L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a posé un cadre permettant la régulation du crowdfunding. Cette ordonnance a ensuite été déclinée par le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, l’arrêté du 30 septembre 2014 et plusieurs modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
L’ordonnance prévoit un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs (CIP), dont l’activité doit être liée à une offre de titres de capital ou de titres de créance, uniquement au moyen d’un site internet. Les CIP doivent être établis en France, présenter des garanties de compétence et adhérer à un réseau de CIP. L’ordonnance prévoit qu’ils doivent se comporter avec loyauté et exercer leur activité avec prudence.
À côté du statut de CIP, l’ordonnance prévoit également un nouveau statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP), qui consiste à mettre en relation par internet les porteurs d’un projet et les personnes qui veulent le financer. Les IFP doivent également présenter des garanties de compétence et d’honorabilité (immatriculation obligatoire auprès de l’ORIAS, assurance de responsabilité civile professionnelle, code de bonne conduite).
La régulation des CIP est confiée à l’AMF tandis que celle des IFP revient à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
En outre, pour l’exercice de leur activité, les plateformes de dons ou de prêts sont susceptibles de collecter des fonds pour le compte de leurs clients ; il est donc créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement conformément aux possibilités offertes par la directive relative aux services de paiement.
L’AMF a en outre précisé dans son instruction 2014-12 les informations que la plate-forme de financement participatif doit transmettre à l’investisseur. Il s’agit d’informations relatives au porteur de projet, émetteur de l’offre de titres (son activité, son projet, les caractéristiques des titres existants et des titres à émettre, les conditions de sortie) et à la plate-forme elle-même (frais facturés à l’investisseur, faculté de recevoir le détail des prestations fournies au porteur de projet et les frais s’y rapportant).
La vitesse avec laquelle un cadre juridique adapté a été mis en place mérite d’être saluée. Il reste que, selon les sites, il n’est pas évident de prime abord de faire la distinction entre les sites à caractère plutôt philanthropiques et ceux qui sont vraiment dédiés au financement des entreprises. Dans cette dernière catégorie, les financements par le biais de prêts ne se distinguent pas non plus clairement des prises de participations au capital de l’entreprise ainsi financée.
De manière générale, les risques encourus par l’investisseur pourraient être indiqués plus clairement, sans que les pouvoirs publics ne soient accusés de s’immiscer dans le nouvel espace de liberté ouvert par ces sites, dont la mission se félicite par ailleurs. En particulier, certains sites spécialisés dans le domaine des prêts mettent l’accent sur les taux d’intérêt servis aux investisseurs, laissant entendre que le retour est garanti. Or, il est bien évident qu’une PME qui dépose le bilan ne pourra pas rembourser la plupart de ses créanciers, notamment les petits prêteurs.
La mission recommande donc au Gouvernement et au régulateur d’ajuster ce cadre juridique afin que l’investisseur potentiel soit davantage mis en garde contre les risques encourus.
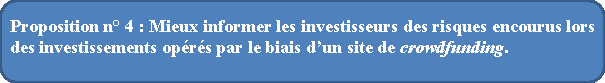
5. Adapter nos dispositifs de mécénat pour structurer les réseaux de créateurs d’entreprises
Comme l’a démontré la comparaison internationale exposée précédemment, les réseaux des business angels français sont relativement nombreux et il est donc fondamental que les pouvoirs publics continuent à apporter leur appui à la structuration de ces réseaux.
En termes de création d’entreprise, les plus belles réussites de ces derniers mois semblent se produire dans des secteurs à très forte spécialisation technologique ; dans le domaine de la santé, il pourra s’agir d’électronique ou d’imagerie médicale. Dans le domaine des greentechs, la création de l’entreprise passe souvent par la mise au point d’un nouveau matériau de construction ou de filtration.
En bref, ces nouvelles « pépites » semblent faire le lien entre la création d’entreprise et nos centres de recherche très en pointe, que ce soit dans les écoles d’ingénieurs ou les pôles publics de recherche. Au sein de ces pôles, le lien entre recherche et création d’emploi mérite d’être renforcé ; à cet effet, un assouplissement des règles fiscales est probablement nécessaire afin, notamment, que les entreprises puissent se positionner en financeur des réseaux de création d’entreprise.
En l’état actuel de la rédaction de l’article 238 bis du code général des impôts, tel qu’interprété par l’administration fiscale, la réduction d’IS dont peuvent bénéficier les entreprises dans le cadre de leur politique de mécénat (dans la limite de 60 % du don et 5 pour mille du chiffre d’affaires) ne s’applique pas aux dons réalisés à un cercle restreint de bénéficiaires (comme les réseaux d’anciens élèves d’une école d’ingénieur).
Si la prudence de l’administration fiscale se comprend, il semble important d’assouplir les règles posées par instruction fiscale afin que les réseaux de création d’entreprise rattachés à ces écoles ou pôles de recherche puissent bénéficier de tels dons.
Cette évolution du dispositif du mécénat rejoindrait une évolution timide du régime de l’ISF-dons (qui permet de bénéficier d’une réduction de 75 % des dons effectués, dans la limite de 50 000 euros annuels, à certaines œuvres de bienfaisance). L'article 40 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a en effet procédé à l’extension du champ d'application de cette réduction d’ISF aux dons effectués au profit d'associations de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises reconnues d’utilité publique.
La modification législative a renvoyé à un décret le soin d’établir la liste des associations de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises, éligibles à ce dispositif. À cet effet, le décret n° 2011-380 du 7 avril 2011 modifié par le décret n° 2013-173 du 26 février 2013 mentionne seulement les trois associations reconnues d'utilité publique suivantes :
– l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) ;
– le Réseau Entreprendre ;
– la Fédération des plates-formes France Initiative, dite "France Initiative" (à compter du 1er mars 2013).
Cette évolution législative va dans le bon sens mais la mission recommande d’élargir le nombre des associations éligibles aux dispositifs afin de cibler également les réseaux de création ou d’incubateurs d’entreprises de nos grands centres de recherche ou des écoles d’ingénieur ou de commerce.
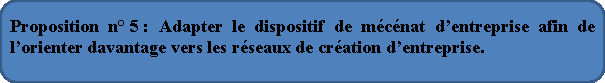
II. FLUIDIFIER LA TRANSITION FINANCIÈRE VERS LE CAPITAL-RISQUE
Après quelques mois, parfois quelques années de vie, l’entreprise est appelée à basculer vers des financements qui vont l’éloigner d’interlocuteurs particuliers (proches ou amis) ou d’investisseurs physiques (business angels ou investisseurs au titre du Madelin) pour la rapprocher d’investisseurs plus institutionnels.
Si l’entreprise en arrive à ce stade de son développement, c’est en général qu’elle a quitté la zone rouge où son activité n’est pas encore rentable, où elle enregistre parfois des pertes et où les difficultés de trésorerie peuvent constituer le quotidien particulièrement difficile des fondateurs. La confiance des investisseurs initiaux est alors fondamentale.
Selon les témoignages concordant des personnes auditionnées par la mission, cette nécessaire transition financière vers des investisseurs plus structurés résulte de l’impossibilité pour une personne seule, voire un petit groupe de personnes, d’assurer des seconds ou troisièmes tours de table dont les montants peuvent dépasser plusieurs millions d’euros. L’entrepreneur se tourne alors davantage vers les fonds d’investissement, des gestionnaires de private equity ou des holdings financiers qui constituent l’une des autres grandes particularités du système français.
Il va de soi que les fonds d’investissement peuvent, dans de nombreux cas, intervenir dès l’amorçage de l’entreprise. Pour la clarté de la présente analyse, il a semblé préférable de les situer en aval des investisseurs providentiels, ce qui ne se vérifie pas forcément dans la pratique.
Cette nécessaire évolution vers des fonds d’investissement peut poser à l’entreprise des problèmes très importants de fluidité entre les investisseurs historiques et les nouveaux investisseurs dont la surface financière est plus importante. Pour les fondateurs, cette substitution d’interlocuteurs correspond également au moment où l’investissement est nettement moins intuitif mais répond davantage à une logique d’analyse financière et de rendement.
A. L’ÉQUATION COMPLEXE DU FINANCEMENT DU CAPITAL-RISQUE PAR LES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
La présente étude n’a pas pour objet de présenter dans le détail la galaxie fort complexe et très diversifiée des différentes formes de fonds d’investissement, des évolutions récentes de la réglementation européenne et de leurs pratiques d’investissement.
La mission a toutefois pris pour parti, dans ce domaine, de rappeler quelques grandes tendances généralement tenues pour acquises par les professionnels du secteur ; elles serviront de base à la mise en lumière des principaux problèmes et à l’évaluation de nos politiques publiques.
1. Un nombre d’opérateurs important malgré la crise
Selon les données concordantes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Association française de la gestion financière (AFG), le nombre total des sociétés de gestion financières n’a cessé de croître en France, malgré l’importance de la crise financière des années 2008 et suivantes.
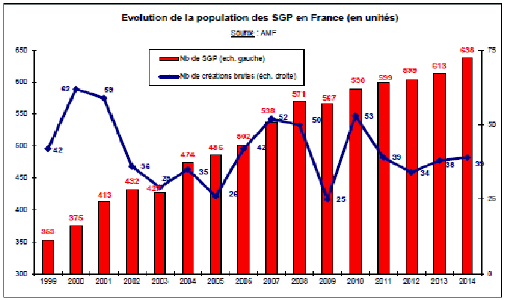
Cette crise a eu, certaines années, un impact sur le nombre de sociétés créées (flux annuels) mais le stock annuel n’a cessé d’augmenter à l’exception notable de l’année 2009.
Corrélativement à l’augmentation du nombre d’acteurs, le montant total des actifs gérés par ces sociétés est également plutôt en augmentation, même si la crise a produit ses effets, dans ce domaine, à deux reprises en 2008 et en 2011.
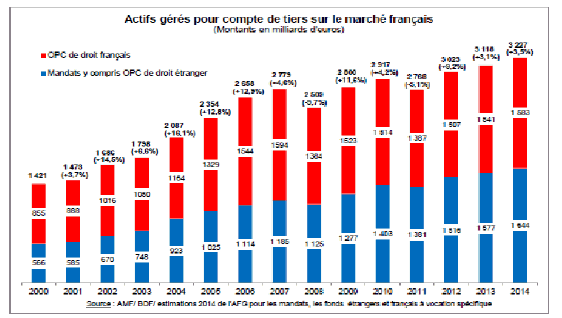
Si cette augmentation générale du nombre d’opérateurs est une bonne nouvelle en soi, elle implique nécessairement une grande concurrence entre eux et la mise en place de pratiques contestables sur lesquelles la mission reviendra.
Au sein de cette activité globale du marché français, celui du capital investissement en général a également témoigné d’un grand dynamisme malgré la crise.
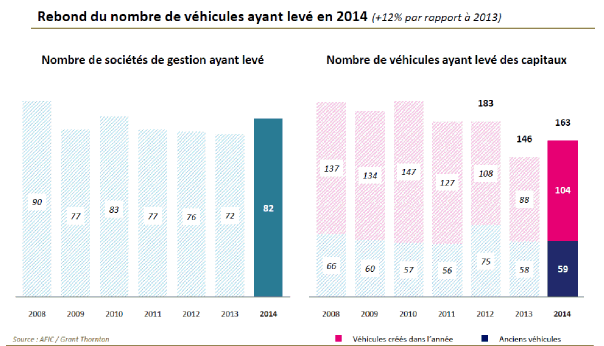
Il n’est pas non plus inutile de rappeler que ce secteur est, compte tenu du nombre d’acteurs, extrêmement concurrentiel ; les fonds les plus performants font l’objet des classements annuels qui permettent d’attirer les investisseurs ou qui ont, au contraire, pour effet de les pousser à changer d’interlocuteur.
De ce point de vue, certains éléments de notre fiscalité ne sont pas neutres. En particulier, la différence de défiscalisation entre l’investissement direct et l’investissement intermédié conduit, d’une certaine manière, à accroître cette concurrence.
Tant à l’ISF-PME qu’au Madelin, l’investisseur peut, en effet, prendre en compte l’intégralité de son investissement lorsqu’il investit en direct. En revanche, lorsqu’il investit via un fonds, le montant de son investissement est pris en compte au prorata des investissements réalisés par le fonds dans des entreprises éligibles soit à l’ISF-PME soit au Madelin (voir supra).
2. Le rendement du capital-innovation semble insuffisant pour attirer massivement les grands fonds d’investissement
Malgré ce dynamisme général des sociétés de gestion et du capital investissement, il apparaît toutefois que la présence des fonds d’investissement sur le segment plus particulier du capital-risque ou du capital-innovation est plus modeste.
Cet état de fait provient essentiellement de la moindre rentabilité de ces segments par rapport à d’autres possibilités d’investissement. Les études de l’AFIC mettent en effet en évidence une différence considérable entre le capital-innovation et les autres segments du capital investissement.
Selon une étude publiée le 20 juin 2014, après enquête auprès de 752 fonds et 110 sociétés de gestion représentant environ 50 milliards d’euros d’actifs dans le capital-investissement, il apparaît globalement que le capital-investissement offre des perspectives de rendement supérieures aux indices boursier sur une période d’analyse de dix ans (comparaison effectuée à partir du taux de rendement interne à dix ans). Il en est de même par rapport aux autres grandes catégories d’investissement.
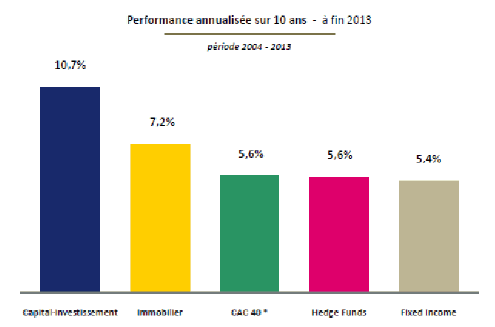
Source : AFIC
Toutefois, cette hiérarchie des rentabilités n’est valable que sur longue période. Elle a pour contrepartie une volatilité plus forte sur les investissements de type capital-risque que les revenus fixes, par exemple. Cela étant, l’histoire économique nous montre que cela est toujours vrai, quelle que soit la période à laquelle on démarre son investissement.
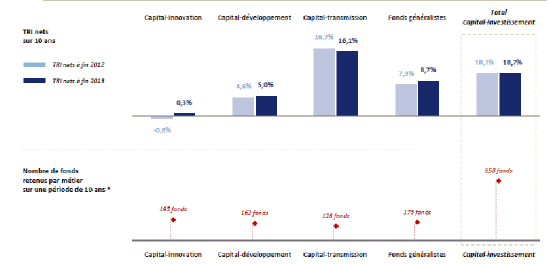
L’étude met également en évidence le fait que le TRI net à l’horizon d’un an s’établit, à la fin de l’année 2013, à 5,6 % pour le capital-innovation (contre 0,7 % en 2012).
Malgré ces résultats, qui valent pour toutes les économies développées, les Français restent très peu enclins à accepter le risque d’une forte volatilité, même si l’espérance de gain est plus forte que sur des véhicules plus stables. Ainsi, il est souvent nécessaire de les inciter à investir en actions par l’artifice d’un avantage fiscal.
3. L’importance cruciale des fonds réglementés
Le législateur a encadré depuis un certain nombre d’années les fonds plus particulièrement axés sur l’amorçage et l’innovation, dans le but de leur associer certains avantages fiscaux permettant de drainer l’épargne financière des ménages français.
Le tableau ci-dessous rappelle succinctement les principales caractéristiques de ces fonds.
Les principaux types de fonds de capital investissement
Fonds communs de placement à risque |
Composition de l’actif : – au moins 50 % en titres de capital de société non cotées (obligatoire) ; – au plus 15 % d’avances en compte courant (faculté) ; ils sont alors pris en compte dans le quota de 50 % ; – placements dans une entité qui investit dans des sociétés non cotées (faculté) ; le quota de 50 % est rempli en proportion de l’actif de l’entité investi en sociétés non cotées – au plus 20 % en titres de sociétés cotées de petite capitalisation (faculté) ; ils sont alors pris en compte dans le quota de 50 %. |
Condition ISF-PME/Madelin : Le régime des FCPR n’est pas mentionné dans le dispositif ISF-PME. | |
Exonération de l’assiette de l’ISF : L’exonération d’ISF sur les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME (art. 885 I ter du CGI) s’applique aux parts de FCPR dont l’actif est composé à 40 % au moins de titres de sociétés de moins de cinq ans. | |
Fonds communs de placement dans l’innovation |
Composition de l’actif : Les FCPI sont des FCPR dont l’actif est constitué à 70 % de titres ou d’avances en compte courant de sociétés non cotées de moins de 2 000 salariés Ces sociétés doivent avoir 15 % de dépenses de recherche (10 % pour les entreprises industrielles). L’actif peut être composé de titres cotés d’entreprises de moins de 2 000 salariés à hauteur de 20 % L’actif est composé à 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial de ces sociétés L’actif peut être composé, sous certaines conditions, à 20 % au plus de titre d’entité investissant dans les sociétés visées par le FCPI. |
Condition ISF-PME/Madelin : Le redevable doit conserver les titres cinq ans suivant la souscription. Le redevable et son conjoint ne doivent pas détenir plus de 10 % des parts du fonds et 25 % des droits de vote. Outre le respect du quota de 70 %, le fonds doit atteindre, au plus tard trente mois après la fin de la période de souscription, un objectif complémentaire de 50 % de titres de « jeunes entreprises innovantes » | |
Exonération de l’assiette de l’ISF : L’exonération d’ISF sur les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME (art. 885 I ter du CGI) s’applique aux parts de FCPI dont l’actif est composé à 40 % au moins de titres de sociétés de moins de cinq ans. | |
Fonds d’investissement de proximité |
Composition de l’actif : Les FIP sont des FCPR dont l’actif est constitué à 70 % au moins d’actifs éligibles au FCPR. 20 % de l’actif doit en outre provenir de société de moins de huit ans Les sociétés doivent être implantées dans la zone géographique du fonds et avoir une activité limitée à quatre régions limitrophes. Elles doivent être des PME au sens européen, ne pas être des holdings, ne pas avoir pour actif principal des objets d’art, et ne doivent accorder aucune garantie en capital. Elles doivent être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens européen. Elles ne doivent pas être une entreprise en difficulté et ne pas dépasser les plafonds européens applicables au capital-investissement L’entreprise doit compter au moins deux salariés. Sont éligibles au quota de 70 %, dans la limite de 20 %, les titres de sociétés de petite capitalisation boursière. L’actif est constitué au moins à 40 % de souscriptions au capital initial des sociétés visées par les FIP. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres de sociétés établies dans une seule région. Les parts de FIP ne peuvent être détenues à plus de 20 % par un même investisseur. |
Condition ISF-PME/Madelin : Le redevable et son conjoint ne doivent pas détenir plus de 10 % des parts du fonds et 25 % des droits de vote. Outre le respect du quota de 70 %, le fonds doit atteindre, au plus tard trente mois après la fin de la période de souscription, un objectif complémentaire de 50 % de titres de « jeunes entreprises innovantes » | |
Exonération de l’assiette de l’ISF : L’exonération d’ISF sur les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME (art. 885 I ter du CGI) s’applique aux parts de FIP dont l’actif est composé à 20 % au moins de titres de sociétés de moins de cinq ans. | |
Fonds professionnels de capital investissement |
Composition de l’actif : Comme le nom l’indique, les FPCI ne sont ouverts qu’aux professionnels. Ils doivent avoir 50 % de leur actif en titre des sociétés non cotées. Ils sont constitués sous la forme d’un fonds commun de placement (FCP) ou d’une SICAV Le FPCI peut détenir des créances dans la limite de 10 % de son actif. Il peut détenir des avances en compte courant dans la limite de 15 % |
Condition ISF-PME/Madelin : pas de mention. | |
Exonération de l’assiette de l’ISF : L’exonération d’ISF sur les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME (art. 885 I ter du CGI) s’applique aux parts de FPCI dont l’actif est composé à 40 % au moins de titres de sociétés de moins de cinq ans. |
Source : Code général des impôts, code monétaire et financier.
Le rôle de ces fonds de capital-investissement encadrés par le législateur, auxquels sont reliés des avantages fiscaux, est fondamental pour drainer vers le capital-investissement des montants importants.
Selon une étude de l’AFG du 4 mars 2015, les fonds ouverts aux publics (FIP et FCPI) ont permis de lever 763 millions d’euros en 2014. Au cours de cette même année, 68 fonds nouveaux ont été créés, 36 sous forme de FIP et 32 sous forme de FCPI. Sur l’ensemble des fonds ouverts, 22 sont reliés au dispositif Madelin, 8 à l’ISF-PME et 38 combinent les mécanismes IR et ISF.
En tendance annuelle, le niveau des levées enregistre une remontée depuis 2012, mais le niveau de l’année 2008 est encore loin d’être atteint. La reprise est pour l’essentiel portée par les collectes au titre de l’ISF.
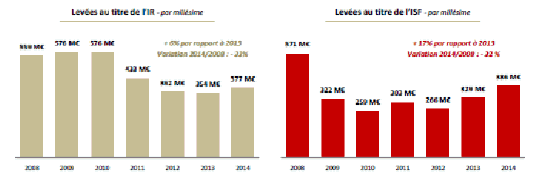
Source : AFIC
En outre, cette reprise est portée par la remontée des collectes des FIP plutôt que des FCPI.
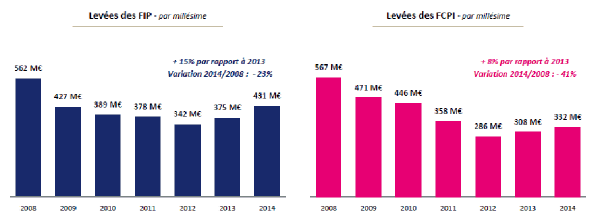
Source : AFIC
B. QUELLES ADAPTATIONS FISCALES OU RÉGLEMENTAIRES ?
1. L’urgence de fluidifier le fonctionnement des fonds réglementés de capital-investissement
Ainsi que l’ont souligné les gestionnaires de fonds auditionnés par la mission, le dispositif actuel est d’une grande complexité. Il nécessite d’opérer en temps réel un pilotage de chaque fonds avec une dizaine, parfois une quinzaine de ratios à respecter.
La finesse de ce pilotage est d’autant plus importante qu’une erreur de gestion du fonds peut, d’une part, se répercuter sur l’éligibilité du fonds aux qualifications mentionnées précédemment mais surtout, d’autre part, entraîner, pour la personne qui investit dans ces fonds, la perte de l’avantage fiscal. D’une certaine manière, il existe une certaine asymétrie entre celui qui prend la décision et celui qui bénéficie de l’avantage fiscal.
Devant ces impératifs, les gestionnaires de fonds formulent des propositions dont certaines méritent d’être retenues.
a. Harmoniser les modalités de calcul de la défiscalisation ISF-PME et Madelin selon le mode de souscription
Actuellement, la méthode de calcul de la réduction d’impôt est différente en fonction de l’impôt (ISF ou IR) et du mode de souscription au capital de la PME (souscription directe ou souscription intermédiée).
Les différents modes de calcul des réductions d’impôt ISF-PME et Madelin
ISF-PME |
Madelin | |
Souscription directe : |
– 50 % des versements en numéraire ou en nature dans la limite de 45 000 euros |
– 18 % des versements (en numéraire uniquement) dans la limite de 50 000 euros et du plafonnement global des niches fiscales |
Souscription via des holdings (dite « directe intermédiée ») : |
– Les plafonds sont les mêmes que pour la souscription directe ; – La réduction d’impôt est proportionnelle aux souscriptions de la holding au capital d’une société éligible. |
– Les plafonds sont les mêmes que pour la souscription directe ; – La réduction d’impôt est proportionnelle aux souscriptions de la holding au capital d’une société éligible. |
Souscription via des FIP ou FCPI (dite « indirecte) |
– 50 % des versements à proportion du quota d’investissement dans les sociétés éligibles, dans la limite d’une réduction d’impôt de 18 000 euros (et 45 000 euros en cumulant avec la souscription directe ou via une holding). |
– 18 % du montant des versements, dans la limite annuelle de 12 000 euros ; – la réduction d’impôt est calculée à partir de son montant brut, sans prise en compte du quota d’investissement du FIP ou du FCIP |
En termes simples, le dispositif actuel peut conduire à appliquer 6 taux effectifs de défiscalisation suivant le choix opéré par l’investisseur.
Cette hétérogénéité pose un premier problème de gestion pour la mise en place des FIP et des FCPI ; compte tenu du fait que la défiscalisation sera différente suivant que l’investisseur recherche une défiscalisation d’ISF ou d’IR (prorata pour l’ISF et montant brut pour l’IR), les gestionnaires de fonds sont en général amenés à créer deux fonds différents, ce qui n’est économiquement pas rationnel. En outre, selon l’AFG, cette distinction conduit mécaniquement à augmenter les frais de gestion à percevoir pour couvrir les frais inhérents à la création d’un fonds.
La mission propose par conséquent d’harmoniser les modalités de calcul dans les deux cas, afin de permettre de créer des fonds uniques éligibles à la fois à l’ISF et l’IR ; les professionnels recommandent évidemment que le montant brut du versement soit retenu pour le calcul de la réduction ISF-PME. Compte tenu du coût probable pour les finances publiques, la mission recommande qu’une évolution de la législation dans ce sens puisse être précisément chiffrée.
En l’état actuel du droit de l’ISF-PME, le calcul du montant de la défiscalisation à partir du quota d’investissement conduit les gestionnaires de fonds, dans le cadre ultra-concurrentiel décrit précédemment, à maximiser leurs investissements dans des sociétés éligibles, à 95 % voire parfois 100 %. En conséquence, il peut arriver que le fonds n’ait plus les moyens de réinvestir dans l’une des PME déjà financée dans son portefeuille et qui aurait besoin d’un complément de financement pour mener son projet à terme.
L’autre effet négatif de cette concurrence réside parfois dans le fait que les fonds ne perçoivent plus les frais sur leur propre actif (ce qui conduirait à dégrader leur quota d’investissement) mais les répercutent sur les PME financées, ce qui n’est évidemment pas dans l’esprit du dispositif fiscal.
Ce problème a d’ailleurs fait l’objet d’un article, inséré au Sénat, dans le projet de loi « Macron ». Cet amendement prévoyait l’interdiction d’imputer les frais de gestion ou autres commissions sur l’entreprise financée.
Cet article a été supprimé à l’Assemblée nationale, au motif que la solution proposée serait probablement insuffisante ou inefficace. Une simple interdiction, même assortie de pénalités par ailleurs prévues par le dispositif voté au Sénat, risquerait de ne pas dissuader des professionnels aguerris de continuer à mettre en œuvre de telles pratiques ; par ailleurs, on voit mal une entreprise en recherche de fonds entrer dans une logique de dénonciation auprès du régulateur.
Une nouvelle solution doit être étudiée par l’administration fiscale pour être proposée au Parlement dans le cadre de la prochaine loi de finances.
La mission considère que la solution globale à ce problème passe par un rapprochement du calcul de la défiscalisation non seulement entre ISF-PME et Madelin mais aussi en fonction du mode de souscription (directe, via une holding ou un fonds de capital-investissement).
Quel que soit le mode de souscription ou d’impôt, l’assiette de la réduction d’impôt doit être le montant brut du versement opéré par le redevable. Pour les investissements réalisés par le biais d’une holding ou d’un fonds, la prise en compte de ce montant brut doit être assortie d’un quota d’investissement en entreprises éligibles (dont le montant doit être déterminé par l’administration, probablement autour de 80 %). En outre, le montant maximal de la défiscalisation doit être harmonisé entre souscription directe et intermédiée (45 000 euros pour l’ISF-PME et 50 000 euros pour le Madelin).
Cette harmonisation permettrait en outre d’apporter une solution au problème, lui aussi soulevé au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la croissance et l’activité, consistant à organiser la souscription directe par le biais d’un mandat de gestion. Afin de maximiser la réduction d’impôt, la société de gestion ou un gestionnaire seul organise la souscription dans une PME sous la formule juridique d’un mandat, ouvrant ainsi la voie à la défiscalisation prévue pour les souscriptions directes alors que, de toute évidence, on se rapproche davantage d’une souscription intermédiée.
La mission considère qu’il existe un risque assez important que le contournement du régime applicable à la souscription intermédiée ne soit de plus en plus général, appelant nécessairement un rapprochement des deux dispositifs.
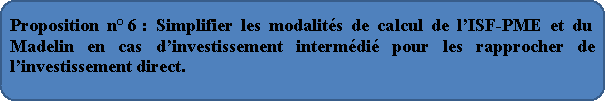
b. Simplifier les règles de fonctionnement des fonds de capital-investissement
La multiplication des ratios décrits précédemment a rendu trop complexe la gestion de ces fonds ; il en résulte, pour les gestionnaires, des prises de décisions guidées par le respect de ces contraintes réglementaires et fiscales plutôt que par un choix économique rationnel ou les besoins de la PME à financer.
Ces ratios méritent d’être réduits en nombre, harmonisés entre le code monétaire et financier et le code général des impôts. S’agissant de la durée de détention et du type d’entreprises financées, la logique déjà retenue par le règlement d’exemption par catégorie doit être déclinée dans notre dispositif des FIP et des FCPI.
Ces ratios méritent bien évidemment d’être harmonisés entre l’ISF-PME (qui permet une réduction d’ISF au moment de la souscription) et le régime d’exonération de l’assiette de l’ISF dont bénéficient ensuite ces mêmes titres (article 885 I ter). Actuellement, l’exonération s’applique uniquement aux parts de fonds dont l’actif est constitué à hauteur de 20 % de sociétés de moins de cinq ans (FIP) ou à hauteur de 40 % pour les FCPI.
Cette exigence n’étant pas reprise dans le dispositif ISF-PME, il est donc envisageable que l’acquisition de parts de certains fonds de capital-investissement puisse ouvrir le droit au bénéfice de l’ISF-PME mais pas de l’exonération par la suite.
Enfin, plusieurs différences techniques de gestion entre les FIP et les FCPI semblent injustifiées :
– l’article L. 214-30 du code monétaire et financier interdit aux FCPI d’investir dans une filiale du groupe détenue majoritairement, tandis que cette réserve n’existe pas dans le régime des FIP ;
– s’agissant de la possibilité d’investir dans des sociétés de petite capitalisation à hauteur de 20 % de l’actif du fonds, une différence de rédaction entre les deux régimes conduit à comptabiliser, dans ce ratio de 20 %, uniquement les titres cotés pour les seuls FIP.
En outre, la durée de vie des fonds de capital-investissement conditionne leur exigence de maturité d’un dossier d’investissement. Si elle est trop courte, cela oblige le gestionnaire des fonds à n’investir que dans des dossiers dont il pourra sortir « rapidement » ce qui n’est pas compatible avec les dossiers les plus jeunes et les moins matures. Donner une durée de vie longue, comme pour les autres OPCVM, permettrait une moindre sélectivité des dossiers et donc une plus grande souplesse dans les investissements.
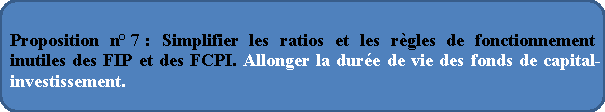
2. Clarifier le cadre de l’activité des holdings en posant une définition légale de la holding animatrice
Outre l’investissement par le biais des fonds de capital-investissement, l’amorçage des entreprises et le segment plus particulier du capital-risque est souvent assuré par d’autres investisseurs structurés que sont les holdings (20).
Il existe bien sûr une différence de nature entre les fonds de capital-investissement et les holdings ; cette différence est particulièrement bien mise en évidence sur le site de l’AMF.
LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
ET HOLDINGS
Caractéristiques |
Fonds de capital investissement |
Holdings |
Caractéristiques juridiques |
– Ces fonds sont des FCPR, FCPI ou FIP soumis à l’agrément de l’AMF. – Ils sont gérés par des sociétés de gestion de portefeuille agréées par l’AMF. |
– Les holdings peuvent prendre toute forme juridique de société commerciale (société anonyme, société en commandite par actions, etc.). – Lorsqu’elles font une « offre au public », les holdings entrent dans le champ de compétences de l’AMF qui vise le prospectus de l’opération. – Les holdings peuvent aussi vendre leurs actions par le biais d’un « placement privé ». Dans ce cas, il n’y a pas de prospectus et toute publicité ou tout démarchage sont interdits. On ne peut pas vous solliciter pour vous proposer cet investissement. |
Règles d’investissement |
– Ces fonds doivent investir à hauteur de 50 % minimum dans des PME non cotées. – Ils peuvent également investir la partie de leur actif qui n’est pas placée dans des PME non cotées dans d’autres types d’investissement (actions, obligations, etc.) afin de diversifier leur portefeuille. – Ils respectent également des règles de dispersion des risques. Ils ne peuvent notamment pas investir plus de 10 % du portefeuille dans une même société. |
– La holding investit son portefeuille en titres de PME non cotées, sachant qu’elle peut investir la totalité de celui-ci dans le capital d’une seule société. – Aucune règle de dispersion des risques n’est imposée. |
Information des souscripteurs |
– Le souscripteur reçoit préalablement à sa souscription la notice d’information du fonds. – La société de gestion de portefeuille doit publier la valeur liquidative du fonds selon la périodicité prédéfinie dans le prospectus (au moins une fois par semestre), ce qui permet au souscripteur de suivre l’évolution du produit. |
– En cas d’offre au public, le prospectus doit être remis obligatoirement aux investisseurs avant la souscription. – En cas de placement privé, aucun prospectus n’est visé par l’AMF. |
Risques du placement |
– Risque de perte de tout ou partie de l’investissement réalisé. – Risque d’illiquidité de tout ou partie du portefeuille. – Risque de requalification fiscale. |
– Risque de perte de tout ou partie de l’investissement réalisé. – Risque d’illiquidité sur la totalité du portefeuille jusqu’à une éventuelle liquidation de la holding. – Risque de requalification fiscale. – Risque de difficulté à estimer la totalité des frais sur la durée du produit, frais qui peuvent entamer significativement sa rentabilité. – Risque de conflits d’intérêts potentiels entre les fonctions du gestionnaire de la holding et les autres fonctions qu’il exerce, en l’absence de règles destinées à encadrer et résoudre la gestion de ces conflits. |
Durée de blocage du placement |
– Il est en pratique impossible d’obtenir le rachat de ses parts pendant la durée de vie du fonds (qui peut aller jusqu’à dix ans, voire plus) même au-delà du délai fiscal de cinq ans. |
– Dans la plupart des cas, obligation de conserver les actions tout au long de la durée de vie de la société, même au-delà du délai fiscal de détention de cinq ans. |
Source : AMF.
Malgré le rôle capital des holdings dans ce secteur de financement, il existe très peu d’études sur leur importance numérique, leur capitalisation totale ou la répartition sectorielle de leurs actifs. Cette absence d’études peut résulter des difficultés à cerner le sujet : si de nombreuses holdings sont des véhicules d’investissement, d’autres permettent plus simplement de loger certains actifs, parfois uniquement des actifs immobiliers.
Une étude de la Banque de France de 2012 indique toutefois que, dans la catégorie des PME au sens européen, la proportion des sociétés détenues par l’intermédiaire d’une holding est de 33 % ; dans le segment haut de ces PME (entre 100 et 250 salariés), la proportion passe à 62 %.
En termes économiques, les holdings peuvent balayer une large palette d’activités qui vont de l’acquisition de titres de capital ou de dette jusqu’à la simple détention de parts de SCI ; en termes fiscaux, elles sont à mi-chemin entre la fiscalité du capital et la fiscalité du patrimoine.
Cette ambivalence s’articule très mal avec l’économie générale de notre fiscalité sur le patrimoine ; cette dernière suppose de faire la différence, au sein de l’actif de ces sociétés, entre ce qui relève du pur patrimoine du ou des fondateurs et ce qui relève davantage du capital qu’ils utilisent à des fins économiques.
De toute évidence, la réalité est plus complexe ; pour certains contribuables, la différence entre patrimoine et capital existe peu. Opérer la distinction entre les deux contraint l’administration fiscale à des subtilités juridiques incomprises des personnes auxquelles elles s’appliquent tandis que, du strict point de vue économique ou du financement des entreprises en création, elle peut être totalement contre-productive.
a. La notion de holding animatrice au cœur d’un feuilleton jurisprudentiel
C’est bien évidemment la notion de holding animatrice qui s’est rapidement trouvée au cœur des travaux de la mission. Cette notion traverse notre fiscalité du patrimoine comme une faille autour de laquelle les contentieux ne cessent de se multiplier.
LA NOTION DE HOLDING ANIMATRICE EN DROIT FISCAL
TYPE D’IMPÔT |
DISPOSITIF CONCERNÉ |
Impôt sur le revenu |
– Dispositif Madelin (article 199 terdecies-0 A du CGI) ; – Réduction d’impôt de 25 % pour les intérêts d’emprunt contractés jusqu’au 31 décembre 2011 pour le rachat d’une PME (article 199 terdecies-0 B du CGI) ; – Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS cédés par des dirigeants partant en retraite (article 150-0 D ter du CGI) ; |
Droits de mutation à titre onéreux |
– Abattement de 300 000 euros sur les droits de mutation dus sur les cessions d’entreprises aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (article 732 ter du CGI). |
Droits de mutation à titre gratuit |
– Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (article 787 B du CGI) ; – Paiement différé et fractionné sur quinze ans des droits de donation ou successions sur les entreprises (annexe III du CGI, article 397 A et 404 GA à GD). |
ISF |
– Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (article 885 0 bis du CGI) ; – Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (article 885 I bis du CGI) – Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (article 885 I quater du CGI ; – Réduction de 50 % de l’ISF pour les investissements au capital de certaines PME (ISF-PME). |
Source : Code général des impôts
La notion de holding animatrice donne lieu à un contentieux très abondant depuis plusieurs années centré autour de deux problèmes :
– le premier concerne la notion de groupe : une holding qui ne fait partie d’aucun groupe ne peut être qualifiée d’animatrice, tandis qu’une holding ayant une seule filiale peut l’être. En outre, plusieurs arrêts de la Cour de cassation portent sur le taux de détention de la filiale permettant de rattacher une entreprise à sa holding. Si le taux de 1,3 % n’a pas été jugé suffisant par le juge, il n’existe aucun taux légal ;
– le second volet concerne la notion d’animation de groupe, qui permet de qualifier la holding animatrice. Une condition de contrôle et de gestion de la société mère a été posée par la jurisprudence ; pour le bénéfice de la qualification de bien professionnel, elle a par ailleurs indiqué que la seule participation au capital ou l’exercice de mandats sociaux par le redevable n’était pas suffisante. La seule prise en compte des moyens matériels et humains de la holding est également insuffisante.
Récemment, une difficulté nouvelle est apparue s’agissant de l’animation de l’intégralité des participations ; l’administration fiscale aurait, à plusieurs reprises, pris position pour affirmer que le défaut d’animation de l’une des filiales emporte disqualification de la notion de holding animatrice.
Cette interprétation semble avoir été écartée par un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014, reconnaissant explicitement qu’une société holding qui anime effectivement les filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire dans une société non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice.
Parmi les arrêts les plus récents, on peut mentionner celui de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mai 2014, indiquant que la seule aide financière d’une holding à sa filiale est insuffisante pour la qualifier d’animatrice.
La même chambre avait déjà rendu un arrêt en date du 10 décembre 2013 refusant le caractère de société animatrice dès lors que les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société holding ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales.
Au total, le présent rapport ne suffirait pas à établir la liste des arrêts qui permettent, à la manière d’une œuvre pointilliste issue du courant impressionniste, de découvrir « l’idéal-type » de la holding animatrice dessiné par la Cour de cassation (21). Ce sujet pourrait se limiter à l’expertise des fiscalistes et des chercheurs si, par ailleurs, certaines sociétés ne se retrouvaient pas dans des situations inextricables du fait de cette insécurité juridique.
La mission a, en particulier, auditionné les dirigeants de l’entreprise Finaréa, présentée dans la presse comme « le plus gros redressement de l’histoire de l’ISF » (22). L’incertitude sur la notion de holding animatrice a en effet entraîné le redressement de plus de 1 400 souscripteurs à ce fonds, entraînant en même temps les difficultés que l’on peut imaginer pour le fonds lui-même mais également pour les entreprises financées par ce biais. La presse évoque en effet une dizaine d’entreprises ayant survécu à cette affaire sur 52 financées par Finaréa soit 42 entreprises qui ont dû détruire les emplois qu’elles avaient créés.
b. L’inaction du législateur régulièrement mise en cause
Le législateur est régulièrement accusé de « douce insouciance » (23) en ne posant pas de définition légale suffisamment claire de la notion de holding animatrice.
En premier lieu, il faut rappeler que la notion est désormais définie, certes en termes généraux, au sein du dispositif ISF-PME : « Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Cette définition résulte de l’article 38 de la loi de finances pour 2011, inséré à l’initiative de la commission des Finances avec un avis favorable du Gouvernement ; cette définition a été posée en lien avec une disposition prévoyant que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal « ISF-PME direct » seulement lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.
Selon les professionnels, cette définition mériterait d’être précisée. Toutefois, la nécessité de figer dans la loi les critères de définition de la holding animatrice, en substitution du faisceau d’indices sculptés peu à peu par le juge, est en soi une question qui mérite d’être pesée avec beaucoup d’attention :
– elle risque précisément de figer la notion, dans un domaine où les pratiques sont extrêmement évolutives ;
– elle n’empêchera pas, par elle-même, la multiplication des contentieux et donc, d’une certaine manière, l’insécurité juridique, sauf à élaborer un dispositif fort long et extrêmement précis.
Pour une fois, le législateur mériterait par conséquent de ne pas être accusé d’inaction lorsqu’il évalue avec le plus de précaution possible l’opportunité d’exercer son pouvoir avec retenue, c’est-à-dire en décidant de ne pas légiférer.
L’administration fiscale s’est, en revanche, engagée dans un travail de définition de la notion par instruction fiscale, ce qui est probablement la bonne méthode ; cet outil juridique est suffisamment adaptable pour suivre les évolutions des pratiques financières et fiscales. Nous ne pouvons que l’encourager à reprendre ce travail au plus vite alors qu’il semble avoir été abandonné.
La mission recommande par conséquent la poursuite des travaux sur l’instruction fiscale, afin que sa publication intervienne incessamment. À défaut, un amendement détaillé peut être déposé dans le prochain projet de loi de finances.
À cet effet, la rédaction élaborée par la Fédération nationale du droit du patrimoine peut constituer une base de travail. Sans se prononcer dans le détail sur cette proposition, la mission considère que deux pistes de rédaction sont particulièrement importantes :
– fixer quelques critères clairs permettant de définir une présomption d’application du régime de la holding animatrice, en inversant ainsi vers l’administration la charge de la preuve ;
– créer une forme spécifique de rescrit permettant au redevable de connaître par avance la position de l’administration, laquelle serait ensuite opposable.
Proposition de définition de la holding animatrice par la fédération nationale du droit du patrimoine
I.– Est animatrice de son groupe, toute société holding qui participe à la conduite et au contrôle de l’application d’une politique de groupe par tout ou partie des sociétés dont elle détient une fraction du capital social. L’animation peut aussi être établie par les services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou de tout autre nature que la holding rend auxdites sociétés. Une holding ne cesse pas d’être animatrice du seul fait qu’elle rend aussi des services à des tiers. Une société, française ou étrangère, peut être holding animatrice quels que soient sa forme juridique, et son régime fiscal. Elle peut être animatrice du groupe, soit seule, soit conjointement avec d’autres associés des sociétés filiales.
II.– Est réputée holding animatrice toute société holding se trouvant dans l’une des trois situations suivantes :
– la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle y exerce un mandat prévu à l’article 885 O bis du CGI ;
– la holding contrôle une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et elle leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de tout autre nature ;
La holding a conclu avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient une fraction du capital, une convention prévoyant que la holding participe à la conduite d’une politique de groupe et que la ou les autres sociétés signataires s’engagent à l’appliquer.
III.– Les sociétés holding animatrices utilisent leurs participations dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale au sens du présent code. En conséquence, les parts ou actions composant leur capital sont donc éligibles de plein droit à tous régimes applicables aux titres des sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale, et selon les conditions et modalités propres à chacun d’entre eux.
IV.– Tout contribuable peut interroger préalablement l’administration pour se voir confirmer la qualification de holding animatrice de toute société dont il est associé. À cet effet il dépose un dossier comportant les renseignements nécessaires à l’analyse et les pièces justificatives. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour rendre un avis motivé. En cas de confirmation expresse de cette qualification ou à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la holding est réputée animatrice de son groupe pour les deux années qui suivent, et les opérations et déclarations fiscales effectuées par le contribuable sur la base de cette qualification dans ce délai ne pourront plus être remises en cause de ce chef.
V.– Lorsqu’une société holding ne remplit pas les conditions pour être qualifiée d’animatrice de son groupe, elle n’est éligible aux régimes visés au 3° ci-dessus, que si, outre la détention de participations, elle exerce elle-même une activité propre de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou financière. »
3. Diversifier le profil des investisseurs en développant la « corporate venture »
Le corporate venture, pratique qui vient pour l’essentiel des États-Unis, désigne en règle générale la prise de participation d’une entreprise, de grande taille ou de taille intermédiaire, dans une entreprise en création par le biais d’un fonds d’investissement généralement mis en place dans l’entreprise qui prend les participations.
Dans certaines analyses, le corporate venture désigne, de manière plus générale, les prises de participations entre deux entreprises, tandis que le corporate venture capital désigne plus spécifiquement la prise de participation dans une entreprise en démarrage. C’est bien de cette seconde thématique qu’il est question dans le présent paragraphe.
Du point de vue économique, ces participations présentent un intérêt très particulier : la PME trouve en effet ainsi une source de financement stable et peut bénéficier de l’expertise de l’entreprise mère, voire de la participation directe de certains de leurs salariés.
Une étude universitaire (24) synthétise les avantages du corporate venture par rapport au capital-risque de la manière suivante :
– il existe en premier lieu une différence de temporalité ; les fonds de capital-risque sont créés pour une durée limitée généralement fixée entre sept et dix ans. Selon l’étude, « c’est donc en moins de six ans que les fonds doivent créer de la valeur pour les investisseurs », avant de souligner que les grandes entreprises ne sont pas soumises à de telles contraintes ; elles n’ont pas les mêmes contraintes de liquidité ;
– cette prise de participation permet de créer des effets d’échelle ; les montants finalement investis sont plus importants que par les autres biais ;
– selon l’étude, ce type d’investissements obtient des meilleurs résultats que le capital-investissement lorsqu’il existe une connexité entre l’entreprise mère et la PME financée ;
– enfin, la prise de participation par une grande entreprise peut offrir des garanties en termes d’emploi, dans le cas où que la PME financée soit contrainte au dépôt de bilan.
Conscient de ces atouts, le Gouvernement a lancé en 2013, conformément aux engagements du président de la République aux Assises de l’entreprenariat (25), un plan destiné à favoriser le corporate venture.
D’après le document mis en ligne à cette occasion, son objectif était le financement en fonds propres des PME et des ETI, qui souffriraient d’une asymétrie d’information entre les investisseurs et les entrepreneurs notamment dans le domaine du lancement de l’entreprise.
Le coût du dispositif proposé a été évalué à 200 millions d’euros par an pour un montant d’investissement de 600 millions d’euros. Il était par ailleurs précisé que « le coût de la mesure sera compensé par une recette fiscale en cas de cession des participations (voire plus que compensée en cas de cession des participations à un prix supérieur au prix initial) ».
En application de ce plan, un article a été inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013, permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans des PME innovantes d’amortir sur cinq ans le montant de leurs participations.
Sont éligibles à cet amortissement les souscriptions directes au capital de PME innovantes, mais également les souscriptions de parts ou actions dans certains véhicules de capital-investissement (fonds communs de placements à risques, fonds professionnels de capital-investissement, sociétés de capital-risque).
Lorsque l’investissement est réalisé de manière intermédiée, l’amortissement est conditionné au fait que 60 % de l’actif du véhicule soit constitué de titres de PME innovantes, et que 40 % du même actif corresponde à des souscriptions directes au capital desdites PME.
Les PME innovantes sont les PME au sens du droit de l’Union européenne, établies en Europe et satisfaisant l’une des deux conditions que doivent remplir les entreprises dont les titres sont détenus par des fonds communs de placement dans l’innovation (26).
Les entreprises réalisant l’investissement ne doivent pas détenir plus de 20 % de la PME innovante (en cas d’investissement direct) ou du véhicule de capital-investissement (en cas d’investissement intermédié), cette condition étant le cas échéant appréciée au niveau des entreprises liées.
La valeur des participations pouvant faire l’objet de l’amortissement est plafonnée à 1 % du total de l’actif de l’entreprise souscriptrice.
En cas de non-respect des conditions ouvrant droit à l’amortissement, ou de cession des participations dans un délai de moins de deux ans, l’amortissement déduit du résultat imposable est réintégré à l’assiette taxable au titre de l’exercice.
Afin d’éviter le cumul d’un avantage à l’entrée – via l’amortissement – et d’un avantage à la sortie – du fait de l’exonération des plus-values de cession à long terme de titres de participation (27) –, il est prévu d’imposer au taux normal de l’IS la fraction de plus-value réalisée après au moins deux ans de détention, à hauteur de l’amortissement déduit. Une disposition symétrique est prévue pour les répartitions de l’actif des fonds, qui sont fiscalement traitées comme des plus-values à long terme.
En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté deux modifications plus substantielles au dispositif.
À l’initiative de M. Dominique Lefebvre, complétée par un sous-amendement du Gouvernement, il a été décidé de permettre à une entreprise de détenir plus de 20 % d’un véhicule de capital-investissement, sous réserve de ne pas détenir ainsi, indirectement, plus de 20 % de la PME innovante.
L’Assemblée a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement destiné à rendre effectif le dispositif tendant à éviter le cumul des avantages à l’entrée et à la sortie, et à l’élargir aux distributions opérées à leurs actionnaires par les sociétés de capital-risque.
Le dispositif voté par l’Assemblée nationale prévoyait que la date d’entrée en vigueur de ses dispositions sera fixée par décret, dans les six mois suivant l’accord de la Commission européenne, à qui le dispositif devait être notifié au titre du régime des aides d’État.
Conformément aux recommandations que la Commission européenne a formulées, celui-ci a été ajusté par l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2014, article qui résulte de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement.
Les adaptations apportées au dispositif de corporate venture en loi de finances rectificative pour 2014
Un élargissement du dispositif aux souscriptions de parts ou actions dans des véhicules de capital-risque européens
L’article procède à cet élargissement, au profit de fonds situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, sous réserve qu’ils remplissent les conditions exigées des fonds établis en France. Ces fonds ne doivent pas nécessairement détenir des parts de PME françaises.
Des modifications dans la définition des PME innovantes
Sont exclues du champ :
– les PME cotées sur un marché réglementé. L’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement indiquait que sont maintenues « dans le champ d’application du régime celles cotées sur des plateformes de négociation alternatives comme Alternext » ;
– les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices européennes, « ces dernières bénéficiant d’un encadrement spécifique en matière d’aides d’État ».
Les critères permettant de qualifier une PME d’innovante sont simplifiés, puisqu’il suffit d’avoir réalisé au cours d’un des trois exercices précédant la souscription des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche représentant au moins 10 % des charges d’exploitation. Pour les entreprises n’ayant jamais clôturé d’exercice, une évaluation ex ante par un professionnel du chiffre est admise.
Un plafonnement du montant des souscriptions
Leur montant ne peut excéder 15 millions d’euros par PME bénéficiaire sur l’ensemble de la période d’amortissement.
Un possible effet d’aubaine supprimé
L’amortissement n’est plus permis pour les sociétés détenant déjà des titres de la PME et pour lesquels l’amortissement n’a pas été pratiqué. Cette condition s’apprécie à la date de la souscription. En pratique, la première vague de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement sera donc le fait d’entreprises qui ne sont pas déjà actionnaires de PME innovantes.
Le Sénat a restreint la portée de cette mesure, en ouvrant le bénéfice de l’amortissement « dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur et qui investit pour la première fois dans les PME innovantes en question ».
Une limitation du dispositif dans le temps
Le régime sera applicable pendant seulement dix ans.
À ce jour, le dispositif voté par le Parlement n’est pas opérationnel, ce qui n’est pas acceptable compte tenu de l’enjeu. La mission appelle donc le Gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine.

4. Fluidifier la transition entre les investisseurs individuels et les investisseurs plus institutionnels
Selon les analyses convergentes de plusieurs réseaux auditionnés par la mission, la transition entre une phase de pré-amorçage soutenue essentiellement par les individus ou des petits groupes vers une phase d’amorçage financée davantage par des fonds de capital-investissement ou des holdings bloque actuellement sur certaines particularités du dispositif ISF-PME.
Cette évolution suppose en effet que les investisseurs initiaux, parfois aussi dits « historiques », puissent, si la croissance et le besoin de financement de l’entreprise l’exigent, sortir de manière fluide du capital de l’entreprise pour laisser la place à des investisseurs dont la surface financière est plus importante.
Selon plusieurs personnes auditionnées par la mission, pour des PME dont la réussite est relativement rapide, cette exigence peut devenir une réalité au bout de deux à quatre années.
Or, en l’état actuel de la rédaction du dispositif ISF-PME et du dispositif Madelin, les titres acquis en bénéficiant de ces deux régimes dérogatoires sont assortis de deux conditions de détention :
– une condition de non-remboursement des apports aux souscripteurs pendant une durée de dix ans suivant la souscription. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu de ramener ce délai à sept ans ;
– en outre, les titres acquis par le redevable doivent être détenus pendant cinq années.
Selon les analyses de France Angels, cette condition de détention peut conduire l’investisseur à faire primer sa situation fiscale sur l’intérêt de l’entreprise. En effet, le code général des impôts prévoit explicitement que l’avantage fait l’objet d’une reprise a posteriori si la condition de détention n’est pas retenue.
Les différents cas analysés par France Angels
Cas n° 1 (le plus courant) : la société est en péril, un nouvel investisseur est prêt à intervenir
Lorsqu’une société ne remplit pas ses objectifs commerciaux, il est souvent possible qu’un nouvel élan soit nécessaire par l’injection de nouveaux capitaux. Dans ce cas, les actionnaires individuels peuvent ne plus suffire, un investisseur en capital-risque étant prêt à reprendre le flambeau pour un euro symbolique ; les actionnaires historiques peuvent refuser cette solution car, en plus de leurs pertes, ils devront, si la cession a lieu avant cinq ans, restituer l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié à l’entrée. Selon France Angels, « ils auront intérêt à acculer l’entreprise au dépôt de bilan pour préserver l’avantage fiscal initial ».
Cas n° 2 (assez fréquent) : la société est en péril, un industriel est prêt à intervenir en souhaitant conserver les fondateurs
Dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus, le rachat est envisagé par un grand groupe qui souhaite conserver les créateurs dans le capital. L’opération ne pourra se faire car il ne s’agit pas d’une sortie conjointe, ni d’une sortie complète.
Cas n° 3 : la société décide de délocaliser son siège à l’étranger
Soit le cas d’une société active dans le domaine de l’hôtellerie de luxe ; après deux ans d’exploitation, les fondateurs décident de transférer le siège à Luxembourg en faisant entrer des investisseurs étrangers. Les business angels qui ont financé l’entreprise à ses débuts sont mis devant le choix soit de continuer l’aventure au Luxembourg, soit de céder leurs parts. Dans le second cas, l’avantage fiscal doit être restitué, les investisseurs initiaux n’ayant d’autre choix que de s’expatrier.
Les dispositifs ISF-PME et Madelin prévoient certains cas dans lesquels l’avantage fiscal pourra être conservé en dépit du non-respect de la condition de détention.
Pour l’ISF-PME, l’avantage fiscal sera conservé sous certaines conditions :
– en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, l’avantage n’est pas perdu si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; en cas d’annulation des titres, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause ;
– en cas de cession des titres rendue obligatoire par un pacte d’associé, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause si le montant correspondant est réinvesti dans un délai de douze mois dans une entreprise elle-même éligible à l’ISF-PME ;
– en cas d’offre publique d’échange, l’avantage n’est pas non plus perdu si les titres reçus sont ceux d’une entreprise qui répond aux critères de l’ISF-PME et si l’éventuelle soulte d’échange est intégralement réinvestie, pour son montant net, dans l’acquisition de titres éligibles au dispositif.
Pour le Madelin, très curieusement, les conditions dans lesquelles l’avantage fiscal est conservé sont pour l’instant totalement différentes : ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de décès, de licenciement ou d’invalidité. En cas de donation, le donataire s’engage à conserver les titres. La loi « Macron » a apporté, dans ce domaine, des ajustements opportuns.
Plusieurs propositions examinées dans le cadre des dernières lois de finances ou du projet de loi en faveur de la croissance, de l’activité et de l’égalité des chances économiques visent par ailleurs à assouplir les conditions de réinvestissement.
L’une des propositions, adoptée à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de ce dernier texte, prévoit en particulier que l’avantage fiscal pourra être conservé quelle que soit la cause de la sortie du capital de l’entreprise, à condition que le montant correspondant soit lui-même réinvesti dans une entreprise éligible, selon le cas, à l’ISF-PME ou au Madelin.
À notre grand regret, cette proposition a été écartée au motif que, en permettant aux investisseurs initiaux de sortir avant cinq ans tout en conservant l’avantage fiscal, le législateur risquerait de permettre également que ces investisseurs de se désengager rapidement à la première difficulté de l’entreprise (tension sur la trésorerie, délai de paiement en augmentation). Il reste toutefois que, pour pouvoir se désengager d’une entreprise qui commence à connaître certaines difficultés, l’investisseur initial doit trouver un investisseur prêt à reprendre ses titres.
Le législateur doit donc adapter le dispositif en tenant compte de deux situations distinctes :
– lorsque l’entreprise est en croissance, l’investisseur initial doit pouvoir se défaire de ses titres lorsqu’un investisseur plus important veut permettre à l’entreprise d’adopter un rythme de croissance plus important ;
– lorsque l’entreprise est plutôt en phase de difficulté, il semble au contraire inopportun d’inciter fiscalement à la sortie du capital.
Du point de vue juridique, il semble toutefois fort complexe de distinguer les deux situations.
La mission propose donc d’assouplir la condition de détention en s’inspirant de la logique du pacte Dutreil :
– pendant une première période de deux ans, l’avantage serait conservé aux conditions actuelles limitativement prévues dans le code des impôts ;
– pendant une période de trois années, l’avantage serait conservé quelle que soit la raison de la sortie du capital, sous condition de réinvestissement dans un délai de douze mois.
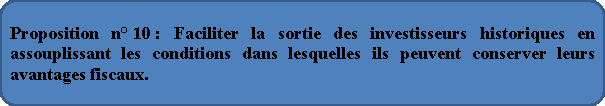
III. LA DIVERSIFICATION DES TYPES DE FINANCEMENT AU STADE DE L’EXPANSION ET DE LA MATURITÉ DE L’ENTREPRISE
Selon la typologie arrêtée au début du rapport, le stade de l’expansion et de la maturité de l’entreprise désigne généralement celui où l’entreprise a atteint une taille significative.
De nouvelles sources de financement seront sollicitées pour augmenter les capacités de production et la force de vente, développer de nouveaux produits, ou financer des acquisitions.
D’un point de vue plus structurel, ce financement se diversifie :
– il peut être réalisé soit par une augmentation des fonds propres, par le biais du capital-développement. Il devient également possible pour l’entreprise de recourir plus largement à l’endettement ou à des titres mixtes entre capital et endettement ;
– cette politique de financement peut être assurée en continuant l’échange avec des investisseurs identifiés (banques ou fonds de capital-investissement) ou s’orienter vers un financement de marché.
Pour le législateur, cette phase de la vie de l’entreprise semble offrir moins de prise à l’action publique. L’entreprise est en effet complètement autonome pour aller chercher les financements sur un marché qui ne présente pas, a priori, de défaillance significative.
Au niveau macroéconomique, elle met toutefois en évidence un faible appétit des Français pour une épargne financière placée en titre de capital.
A. AUGMENTER L’ATTRAIT DES FRANÇAIS POUR L’ÉPARGNE FINANCIÈRE
À la une de son édition du 17 avril 2015, Les Échos titraient : « Pourquoi les Français redécouvrent la Bourse ». Le quotidien souligne qu’avec la remontée des taux et un fort rebond du CAC 40, les Français « retrouvent doucement le marché de la Bourse ».
Si on ne peut que se féliciter de cette évolution, il reste que, sur longue période, l’épargne des ménages français reste modérée comparée à d’autres pays de l’OCDE, notamment leur épargne financière.
TAUX D’ÉPARGNE FINANCIÈRE DES MÉNAGES FRANÇAIS
(en pourcentage)
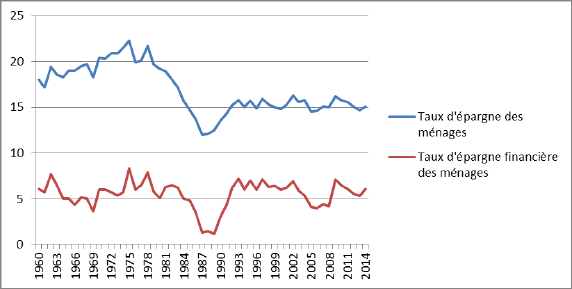
Source : INSEE.
Les dernières études de l’INSEE concernant le patrimoine financier des ménages mettent en évidence le fait que la France ne fait pas partie des États membres de l’Union européenne dont le taux d’épargne financière est important. L’absence de mécanisme de retraite par capitalisation n’explique pas tout.
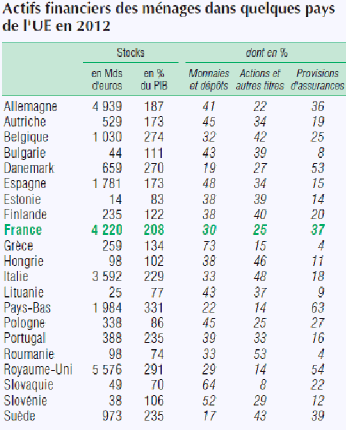
Source : INSEE.
La partie détenue en valeurs mobilières est, en particulier, assez réduite. Dans son étude sur le patrimoine des ménages en 2010, l’INSEE note en effet que « un cinquième des ménages détiennent des valeurs mobilières en 2010, contre un quart en 2004. Ce repli concerne à la fois le compte-titres ordinaire et le plan d’épargne en actions (PEA). Pour la première fois depuis sa création en 1992, ce dernier recule. La crise financière et la forte chute des indices boursiers qui s’en est suivie peuvent avoir incité des ménages à se retirer de ces produits risqués et à se replier sur des produits potentiellement moins rentables mais plus sûrs ».
TAUX DE DÉTENTION D’ACTIFS PATRIMONIAUX DANS LA POPULATION TOTALE
(en pourcentage)
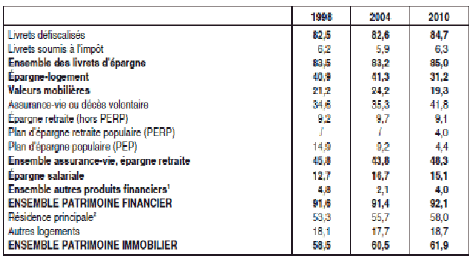
Source : INSEE, « Le patrimoine des ménages en 2010 ».
Compte tenu de ces données macro-économiques, il semble opportun, encore aujourd’hui, de mettre en œuvre tous les leviers publics ou fiscaux existants pour orienter ne serait-ce qu’une partie de l’épargne des Français vers la détention d’actions d’entreprises ayant une vraie activité commerciale ou industrielle.
1. Poursuivre les efforts d’orientation du PEA vers les actions des PME et certains produits dérivés d’actions
La mise en place d’un nouveau volet du PEA a fait l’objet de très nombreuses recommandations dans le courant de l’année 2012, puis d’annonces dans le courant de l’année 2013, pour un lancement effectif au début 2014. Le décret d’application permettant sa mise en place a été pris le 5 mars 2014.
Annoncé dès le 20 septembre 2012 par le Président de la République, et repris dans les recommandations du rapport de M. Louis Gallois sur la compétitivité de l’industrie française et du rapport de Mme Karine Berger et de M. Dominique Lefebvre sur l’épargne financière, cette réforme visait à rendre le plan d’épargne en action (PEA) plus attractif grâce au relèvement du plafond des versements ouvrant droit au régime fiscal dérogatoire et à la création d’un PEA-PME, réservé au financement en fonds propres de petites et moyennes entreprises (PME) ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), bénéficiant de ce même régime fiscal.
Lors de son discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat, le 29 avril 2013, le Président de la République a reformulé ce même engagement en y ajoutant la perspective d’une réforme de l’abattement pour durée de détention des titres financiers.
Près d’une année et demie après ce lancement, il apparaît, de l’avis notamment de plusieurs personnes auditionnées par la mission, que les résultats sont décevants.
Selon les chiffres publiés par le réseau PME Finance, largement à l’origine du dispositif, le PEA-PME enregistre une augmentation de son encours au cours des derniers mois.
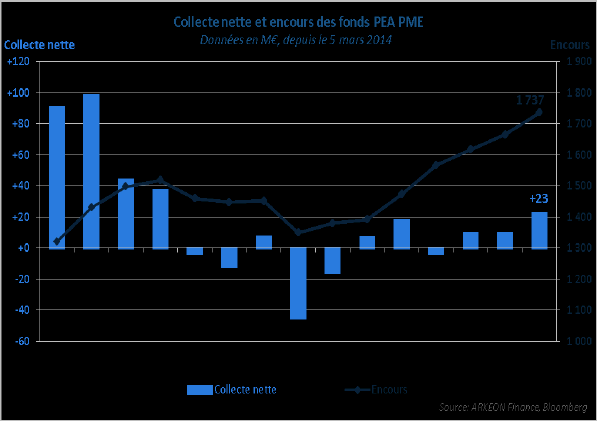
Au mois de mai 2015, les 64 fonds éligibles au PEA-PME ont collecté 23 millions d’euros (collecte nette, ajustée de l’effet marché). À cette même date, les encours de ces fonds ont atteint 1 737 millions d’euros, grâce à une collecte nette positive et à un marché favorable aux PME-ETI.
La collecte nette des fonds éligibles au PEA PME s’élève ainsi à 264 millions d’euros depuis le lancement du dispositif le 5 mars 2014.
Selon les chiffres avancés par le sénateur Philippe Adnot, le PEA-PME connaîtrait un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts ; leur encours moyen s’établit donc à environ 3 500 euros par plan, ce qui est peu.
Alors que plusieurs observateurs semblaient déjà évoquer un échec du PEA-PME dans les derniers mois de l’année 2014, il semble bien que le début de l’année 2015 enregistre une inversion de tendance certainement liée à la conjoncture.
Le Gouvernement lui-même, au travers des annonces du Premier ministre le 8 avril 2015, s’est engagé à stimuler le déploiement du PEA-PME, sans que la nature exacte des mesures ne soit, pour l’instant, dévoilé.
Pour expliquer le faible attrait du PEA-PME durant ses premiers mois, plusieurs interlocuteurs ont mis en avant le faible effort du réseau bancaire pour commercialiser un produit perçu comme insuffisamment protecteur de l’épargnant.
La mission considère que le réseau bancaire doit poursuivre ses efforts dans ce sens, même si les évolutions des derniers mois semblent montrer que l’amélioration de la conjoncture est principalement le levier par lequel ce produit trouvera naturellement ses clients.
De ce fait, plusieurs amendements ont été présentés à l’automne 2014 et au printemps 2015 pour tenter de donner un nouveau coup de pouce au PEA-PME :
– dans le cadre de l’examen du projet de loi « Macron », le Sénat a inséré un article qui prévoit un abattement renforcé, allant jusqu’à l’exonération totale au-delà de huit années, sur les plus-values mobilières liées à la cession de titres financiers, à condition que le produit correspondant à ces cessions soit versé sur un PEA-PME et investit en titres éligibles dans un délai de douze mois. L’Assemblée nationale a considéré qu’une telle mesure conduirait à empiler les avantages fiscaux alors même que l’abattement pour durée de détention de droit commun, tel que voté en 2013, est déjà relativement avantageux dès lors que les titres sont conservés un certain nombre d’années ;
– le sénateur Philippe Adnot a proposé un dispositif permettant de transférer les liquidités en attente sur un PEA classique, par exemple sous forme de SICAV monétaire, vers un PEA-PME en franchise d’impôt sur les plus-values mobilières. La logique est donc plus ciblée que le dispositif voté au Sénat qui vise toutes les sortes de plus-values mobilières. Le dispositif proposé par M. Philippe Adnot était, tout comme celui voté au Sénat, limité dans le temps (pour l’essentiel à une année suivant le vote de la loi).
La mission considère que les finances publiques de la France ne permettent plus vraiment d’envisager un nouveau coup de pouce significatif qui, compte tenu des dispositifs proposés, aura nécessairement un coût important.
En revanche, plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l’état actuel du dispositif voté, l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ne rend éligibles au PEA-PME que les actions, à l’exclusion des actions dite « de préférence »,les certificats d’investissement ou les certificats coopératifs d’investissement.
Une première proposition consiste à rendre éligible au PEA-PME les obligations convertibles en action : la mission est extrêmement réservée concernant cette proposition, qui consiste in fine à pousser les PME vers l’endettement plutôt qu’à solidifier leur bilan par l’acquisition d’un actif seul à même de permettre la croissance de long terme de l’entreprise.
Une seconde proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les bons de souscription d’actions (ou « stock-options ») ; en l’état actuel du droit fiscal, la différence entre le prix de l’action au moment de sa souscription et celui au moment de la levée de l’option est taxable dans la catégorie des salaires (donc sans l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières). En logeant ces BSA dans un PEA, le résultat serait d’amoindrir les rigueurs du barème de l’IR par le biais de la prise en compte de la durée de détention. La mission considère que la solution la plus simple aurait consisté, dans le cadre du projet de loi précité, à faire basculer le gain de levée d’option de la catégorie des salaires vers celle des plus-values mobilières, comme cela a été le cas pour les attributions d’actions gratuites. Le Gouvernement ayant décidé de laisser cette option de côté, celle consistant à pouvoir loger les BSA dans un PEA peut permettre à son détenteur de conserver ces titres plus longtemps, ce qui est favorable à la détention longue des actions sous-jacentes à ces titres.
Dans le même ordre d’idée, la mission d’information propose de rendre éligible au PEA-PME les droits préférentiels de souscription (DPS) aux augmentations de capital qui, aux termes de l’article L. 225-132 du code de commerce, sont négociables indépendamment de l’action pendant la période de souscription. Selon plusieurs professionnels auditionnés par la mission, l’administration fiscale aurait en effet pris position afin d’interdire de loger les DPS dans un PEA classique (sauf lorsqu’ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital, sont liés à des titres de sociétés figurant déjà dans le PEA et sont négociables sur un marché réglementé) ; il semble favorable à la fluidité du financement des PME que de tels titres financiers puissent être logés dans un PEA-PME y compris lorsqu’il s’agit de sociétés non cotées dans des conditions plus souples que le PEA classique.
Une troisième proposition consiste à assouplir l’éligibilité des fonds au PEA-PME : en l’état actuel de la rédaction de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent être employées en vue de la souscription :
– d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises éligibles au PEA-PME et pour les deux-tiers d’actions de ces mêmes sociétés ;
– de parts de fonds communs de placement dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises éligibles au PEA-PME, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions de ces mêmes sociétés ;
– de parts de fonds commun de placement à risques (FCPR).
Par cohérence avec ses propositions concernant le régime de droit commun des FCPR, visant notamment à assouplir la gestion des multiples ratios, la mission recommande d’alléger ceux qui pèsent actuellement sur les fonds éligibles au PEA-PME.
En concentrant le dispositif sur la détention de titre de capital, celui-ci deviendrait plus favorable à la capitalisation des PME. La mission recommande donc que le ratio de 75 % soit abandonné.
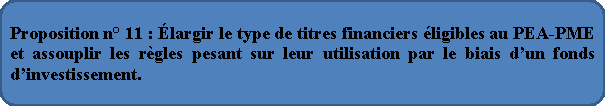
Enfin, il existe un certain nombre d’OPCVM dormants, dont le montant des plus-values latentes dissuade tout détenteur de les liquider. Il est proposé de les exonérer de l’impôt sur les plus-values si elles sont réinvesties dans un PEA-PME, dont nous rappelons qu’il est lui-même plafonné à 75 000 euros.
Cet avantage serait consenti pour une période courte – six mois – afin d’obtenir un flux de liquidités qui aiderait au décollage de ce dispositif, pour un coût fiscal faible.
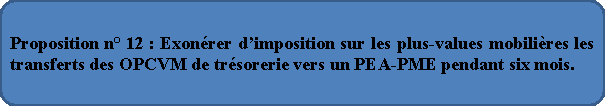
2. Poursuivre la diversification de l’encours de l’assurance vie vers les fonds propres des PME
Avec un encours de plus de 1 500 milliards d’euros, l’assurance vie reste le placement préféré des Français, une forme de fonds de pension à la française et un moyen de financement à la fois de notre dette obligataire (et de celle de certains États étrangers) et de nos entreprises.
Selon les dernières statistiques disponibles de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances en cumul depuis le début de l’année est de 46,8 milliards d'euros (contre 44,5 milliards d'euros sur même période en 2014). Les versements sur les supports unités de compte représentent 9,9 milliards d’euros depuis le début de l’année (+ 46 % par rapport à la même période en 2014), soit 21 % des cotisations en 2015.
Les prestations versées par les sociétés d'assurances sur la même période s'élèvent à 38 milliards d'euros (contre 36,8 milliards d'euros sur les quatre premiers mois de 2014). La collecte nette s'établit donc à 8,8 milliards d'euros depuis le début de l'année.
L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 559 milliards d’euros à fin avril 2015.
Face à cet encours considérable, le constat reste invariablement le même depuis de nombreuses années : la contribution de l’assurance vie au financement des entreprises, par le biais de l’acquisition de titres de capital, reste limité, notamment lorsque l’analyse porte plus particulièrement sur les PME.
Les chiffres publiés régulièrement par la Banque de France concernant les placements financiers des sociétés d’assurance en matière d’assurance vie, d’assurance non vie et de contrats mixtes démontrent également que les encours en actions sont très limités dans le total. Le tableau ci-après, publié le 20 avril 2015, détaille ces grandes masses financières pour le dernier trimestre 2014.
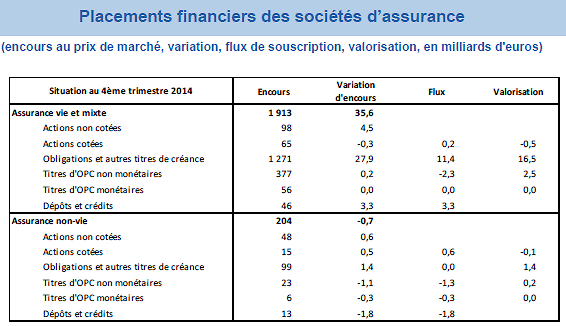
Cette même étude pour le dernier trimestre 2014 met également en évidence le fait que les obligations sont émises, pour une part importante, par des émetteurs non-résidents (34 % de l’encours total). Le placement en obligations d’administrations atteint 28 % de cet encours total, soit 20 % pour des administrations nationales et 8 % pour des administrations publiques d’autres États membres de la zone euro.
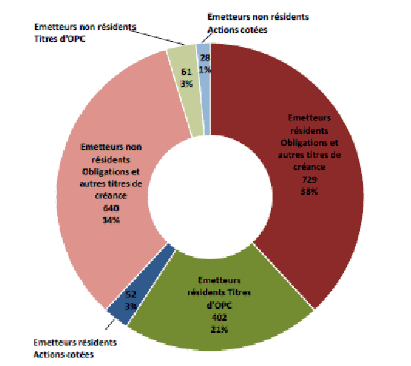
L’exploitation des séries longues disponibles sur le site de la Banque de France permet en outre de mettre évidence que l’encours en actions de l’ensemble des produits d’assurance vie et non vie évolue à la baisse alors même que l’encours total augmente.
ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE L’ASSURANCE VIE ET NON VIE
(en milliards d’euros)
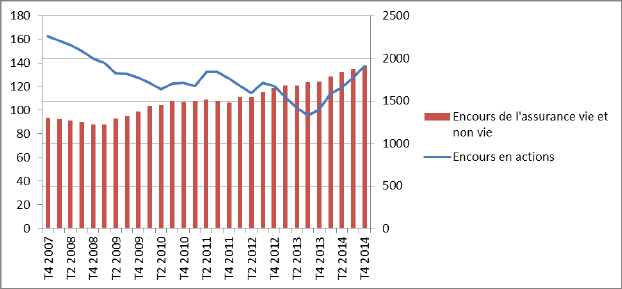
Source : données Banque de France.
a. Les efforts pour orienter l’assurance vie vers le financement de l’économie et les PME
Les efforts réalisés depuis plusieurs décennies pour orienter davantage l’assurance vie des français vers les titres de capital, voire vers les actions de PME non cotées, ont eu des effets limités.
Dans son rapport de janvier 2012 (28), la Cour des comptes évoque un échec des politiques publiques dans ce domaine, analysant notamment la mise en place des contrats en unité de compte dits « DSK » et « NSK ».
La Cour des comptes avance plusieurs explications sur cette efficacité relative d’une politique publique, pourtant associée à une dépense fiscale considérable (29) :
– une part importante de l’assurance vie appartient à des patrimoines très importants, qui utilisent l’assurance vie essentiellement pour les avantages qu’elle présente pour la transmission de ce patrimoine. Dans une logique de diversification des placements, l’assurance vie n’est donc pas le support recherché pour les placements plus risqués mais au contraire pour ceux qui présenteront la plus grande sécurité ;
– compte tenu de ce constat général, il s’ensuit que les placements opérés sur des contrats d’assurance vie le sont généralement pour de très longues périodes, jusqu’à la retraite voire le décès de l’assuré. Comme il a été indiqué au début du rapport, la durée moyenne du contrat d’assurance vie est de plus de dix ans. De ce fait, la fiscalité de l’assurance vie, dont l’horizon temporel est fixé à huit ans, est également inadaptée pour inciter l’épargnant à allonger son horizon de placement.
De manière plus globale, la Cour des comptes estime que la politique de l’assurance vie ne saurait durablement poursuivre plusieurs objectifs différents, tels que l’incitation aux placements longs ou l’incitation aux placements plus risqués.
La mission estime au contraire que, compte tenu de l’importance des sommes en jeu, il n’est pas impossible de segmenter les objectifs de cette politique en créant un cadre plus particulier pour certains contrats destinés à financer plus spécifiquement les fonds propres de PME.
Cette politique a d’ailleurs été remise en avant depuis 2012 avec la création des deux nouveaux contrats dits « vie génération » et « euro-croissance ».
Les contrats euro-croissance et vie-génération
Prévus dans le cadre de l’article 9 de la dernière loi de finances rectificative pour 2013, ces deux contrats ont pour objectif, conformément aux recommandations faites dans le rapport Berger-Lefebvre, de dynamiser la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie. Le décret d’application de ces mesures a été publié le 6 septembre 2014.
Les contrats « euro-croissance » ont en principe trois avantages :
– ils permettent d’affecter une partie de l’épargne sur des placements plus risqués et plus utiles à l’économie ;
– ils sont plus rémunérateurs pour les épargnants et constituent un produit intéressant pour les assureurs contraints de respecter certaines règles prudentielles ;
– ils garantiront le capital investi à une échéance fixée par le contrat.
La comparaison avec les contrats d’assurance-vie en euros ou en unités de compte permet d’apprécier ces avantages. Dans le cas de contrats en euros, le mécanisme de provisionnement mis en place par l’assureur consiste à inscrire au passif sous la forme d’une provision mathématique le montant que l’assureur s’est engagé à garantir.
Dans le cas d’un contrat en unités de compte, le capital versé n’est pas garanti. La valeur des actifs détenus sur le contrat dépend donc de l’évolution de leur rentabilité. Les épargnants sont donc exposés au risque de réaliser une moins-value.
Dans le cas de contrats « euro-croissance », les primes versées sur des fonds diversifiés sont affectées pour partie à la provision mathématique et pour le reste à la provision technique de diversification dont l’objet est de lisser les fluctuations des actifs du contrat.
Le capital investi n’est garanti en euros qu’à l’échéance de la période de détention fixée par le contrat. Les conditions de gestion de l’actif détenu sur le contrat sont donc moins contraignantes que dans le cadre d’un contrat en euros et l’assureur peut donc orienter une partie de cet actif sur des placements plus risqués et assurer ainsi un meilleur rendement au contrat
Le contrat « vie-génération » présente la particularité d’allier un régime fiscal favorable (abattement de 20 % en cas de succession) à une prise de risque plus élevée. Les primes versées ou réaffectées sur ces contrats doivent être représentées dans une ou plusieurs unités de compte constituées :
– de parts ou d’actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
– de placements collectifs ou d'organismes de même nature établis au sein de l’Union européenne ;
– de parts ou d’actions de sociétés civiles soumises à l’impôt sur le revenu et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits se rapportant à ces biens (SCI), de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Par ailleurs, au moins 33 % des actifs détenus par le biais de ces placements en unités de compte doivent être investis dans :
– des titres et droits de SCI, d’OPCI et de SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;
– des titres d’organismes de placement collectifs dont l’actif est lui-même constitué par des parts de FCPR, de FPCI, de FCPI ou de FIP, de titres de PME ou d’ETI au sens européen ou d’actifs relevant de l’économie sociale et solidaire.
b. Quelles propositions pour l’assurance vie ?
Compte tenu des efforts, relativement récents, pour relancer l’orientation l’assurance vie vers les PME, la mission juge qu’il serait prématuré de vouloir faire de nouvelles propositions ambitieuses dans ce domaine.
Plusieurs propositions formulées par la Cour des comptes en 2012 restent toutefois d’actualité, visant non pas à améliorer la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie mais à permettre que le cadre fiscal qui lui est applicable incite davantage à la détention longue.
La Cour des comptes met notamment très justement en évidence le fait que le dispositif actuel pénalise la sortie de l’assurance vie en rente viagère. Or, le dénouement du contrat sous forme de rente offre à l’assureur des perspectives d’immobilisation plus longues ainsi qu’une grande maîtrise du rythme des retraits.
Actuellement, les rentes ainsi constituées sont intégrées au revenu imposable dans une proportion variable en fonction de l’âge de l’assuré (de 70 % s’il a moins de 50 ans à 30 % s’il a plus de 69 ans), ce barème n’ayant pas été revu depuis 1963.
D’après la Cour des comptes, ce dispositif pose deux problèmes :
– d’une part, le code général des impôts exonère explicitement les produits acquis pendant la phase de constitution de l’épargne. Or l’obsolescence du barème des rentes a pour effet que tout ou partie de ces produits acquis, voire une fraction des primes versées, est comprise dans l’assiette de taxation au barème de l’impôt sur le revenu ;
– d’autre part, le fait de taxer la rente au barème de l’impôt sur le revenu ne donne pas l’avantage du prélèvement forfaitaire libératoire au crédirentier.
La mission recommande donc, comme le fait la Cour, que le régime des rentes viagère soit modernisé afin d’éviter que notre dispositif fiscal leur soit défavorable. Cette modernisation permettrait en outre d’alléger les contraintes en fonds propres pesant sur les entreprises d’assurance, les contrats en rente viagère faisant l’objet d’un traitement plus avantageux dans le cadre de la directive Solvabilité II. Les assureurs pourraient alors allouer une beaucoup plus grande part de leurs actifs en actions et donc soutenir l’investissement de long terme dans les entreprises.

3. Mettre fin aux signaux contradictoires de la fiscalité des plus-values mobilières
Depuis la barémisation des plus-values mobilières (PVM), destinée à mettre en œuvre l’engagement présidentiel visant à taxer les revenus du capital comme ceux du travail, le législateur a prévu un abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 A du code général des impôts.
Cet abattement a été ajusté à de trop nombreuses reprises en 2012 et en 2013 ; il s’ensuit globalement une perte de lisibilité de l’action publique dans ce domaine et une érosion de la confiance que les redevables peuvent encore avoir dans la stabilité des dispositifs fiscaux. À l’arrivée, c’est la stabilité de leurs investissements en valeurs mobilières qui risque d’être affectée.
Le projet de loi initial de finances pour 2013 prévoyait un abattement avec de nombreuses tranches, limitant les effets de seuil mais difficilement lisible par le contribuable. La loi définitivement votée a finalement retenu un nombre moins important de tranches mais aboutissant au même niveau d’abattement maximal après une durée de détention deux fois moins longue.
Projet de loi initial de finances pour 2013 |
Loi de finances pour 2013 | ||
Durée de détention |
Abattement |
Durée de détention |
Abattement |
2 à moins de 4 ans |
5 % |
2 à moins de 4 ans |
20 % |
4 à moins de 7 ans |
10 % |
4 à moins de 6 ans |
30 % |
7 à moins de 8 ans |
15 % |
Plus de 6 ans |
40 % |
8 à moins de 9 ans |
20 % |
||
9 à moins de 10 ans |
25 % |
||
10 à moins de 11 ans |
30 % |
||
11 à moins de 12 ans |
35 % |
||
Plus de 12 ans |
40 % |
||
Suite aux assises de l’entreprenariat et à la fronde dite des « pigeons », le cadencement de l’abattement a été renforcé mais rallongé dans le temps, tandis qu’un abattement renforcé était créé pour les créateurs d’entreprises.
Loi de finances pour 2014 : cas général |
Loi de finances pour 2014 : création d’entreprises | ||
Durée de détention |
Abattement |
Durée de détention |
Abattement |
2 à moins de 8 ans |
50 % |
1 à moins de 4 ans |
50 % |
Plus de 8 ans |
65 % |
4 à moins de 8 ans |
65 % |
Plus de 8 ans |
85 % | ||
Outre cette instabilité des règles fiscales, la mission regrette que l’administration fiscale ait assorti le principe, tout à fait justifié en soi, de l’abattement pour durée de détention d’une interprétation économique contre-productive.
La mise en œuvre de l’abattement pour durée de détention et de la possibilité de report et de contraction des plus-values et des moins-values a mis l’administration fiscale en situation de décider que l’abattement pour durée de détention aurait à s’appliquer aux moins-values ainsi reportées.
Dans ses notices de déclaration des plus et moins-values réalisées en 2013 puis lors de la refonte de la section du BOFIP du 14 octobre 2014, elle a précisé que l’abattement pour durée de détention s’appliquerait aux moins-values de cession d’actions et de parts sociales réalisées depuis 2013, dans les mêmes conditions que pour les plus-values.
Il faut en effet rappeler que l’abattement pour durée de détention s’applique en combinaison avec la possibilité de contracter les plus-values et moins-values mobilières de même nature pendant une durée de dix ans. Conformément au 11 de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, « les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ».
Comme l’ont relevé de nombreux professionnels entendus par la mission, cette interprétation pose de nombreux problèmes :
– un problème juridique en premier lieu, dans la mesure où cette décision, du domaine de la loi puisqu’il s’agit d’une modalité de perception de l’impôt, n’a fait l’objet d’aucune prise de position du législateur.
En votant le principe d’une application de l’abattement pour durée de détention aux « gains nets » résultant de la cession de valeurs mobilières, il y a tout lieu de penser que le législateur a entendu réserver cet abattement aux seules plus-values.
Il n’est donc pas à exclure que cette interprétation fasse l’objet de contentieux dont l’issue, à ce stade, n’est pas certaine ;
– économiquement et du point de vue de la stabilité du financement des entreprises, la prise de position de l’administration fiscale risque d’entraîner des comportements davantage guidés par l’optimisation du régime d’abattement que par une décision rationnelle. Le redevable peut en effet décider d’imputer ses moins-values au plus tôt afin d’éviter que le montant à prendre en compte ne se réduise avec le temps. Un tel arbitrage peut en particulier être opéré lorsque d’un gain important a été enregistré pendant une année donnée. Mais à l’inverse, ce même redevable peut décider de liquider une position afin d’enregistrer une plus-value uniquement pour pouvoir la contracter avec une moins-value avant que celle-ci ne subisse un abattement.
En tout état de cause, la mission considère que cette interprétation est orthogonale avec le principe même de l’abattement pour durée de détention, qui vise à inciter le redevable à la détention longue de titres financiers. En l’appliquant aux moins-values, ce redevable est amené à opérer des arbitrages fiscaux de court terme, l’éloignant ainsi de l’intérêt de l’entreprise qu’il finance.
La mission recommande donc que cette prise de position soit purement rapportée.
Exemple :
1. Un contribuable a cédé le 20 janvier de l’année N des actions d'une société acquises le 5 septembre de l’année N-10 et a réalisé à cette occasion une plus-value de 20 000 euros.
2. Il a cédé le 29 novembre de l’année N des actions d'une société acquises le 15 mars N-10 et a constaté à cette occasion une moins-value de 10 000 euros.
3. La durée de détention de ces actions est donc de plus huit ans. L’abattement applicable est de 65 %.
4. Le montant de la plus-value, après prise en compte de cet abattement, est donc de : 7 000 euros. Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 euros.
5. L’imposition porte donc sur une plus-value de 3 500 €.
Conclusion : la mission recommande à titre principal que la moins-value soit prise en compte pour son montant brut de 10 000 euros ; compte tenu de la plus-value de 7 000 euros enregistrée la même année, il n’y aurait donc plus de plus-value taxable.
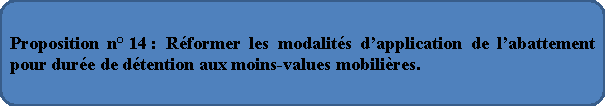
B. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES PESANT SUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
MIF II, Bâle III, Solvency II, révision de la directive Prospectus, tels sont aujourd’hui les cadres réglementaires en cours d’élaboration ou de mise en œuvre qui inquiètent à la fois les professionnels de la finance et les entreprises.
Prises en réaction à certaines faiblesses systémiques ayant entrainé ou propagé la crise financière de 2008, certaines de ces réglementations, dont l’élaboration a été nécessairement longue, risquent d’entrer en vigueur à contretemps et de brider le redémarrage de l’économie européenne. À propos de MIF II, l’Association française des marchés financiers (AMAFI) dénonce ainsi les longueurs du processus législatif européen se traduisant par le fait que la réglementation effective a, au moment de sa mise en œuvre, « un état d’esprit vieux de cinq ou six ans ».
Sans nier qu’une meilleure régulation financière soit totalement nécessaire, au niveau européen mais aussi international, la mission ne peut que se faire l’écho de la crainte d’un empilement de réglementations mal coordonnées entre elles qui pourraient avoir des effets macroéconomiques mal évalués, notamment dans le domaine du financement des investissements productifs de long terme des entreprises.
La mission passera volontairement plus rapidement sur leur impact sur le rôle général des banques, des compagnies d’assurances et des marchés financiers dans le financement des PME et des ETI. Le sujet est pourtant capital et mérite certainement des analyses économiques et financières approfondies. Toutefois, dans ce domaine largement européen voire international, les préconisations qui se limiteraient à la France auraient nécessairement une portée trop limitée.
La mission rappelle en outre que le Premier ministre a confié à M. François Villeroy de Galhau, le 21 avril 2015, une mission portant sur le financement de l’investissement et tout particulièrement sur ces aspects macroéconomiques de régulation du secteur bancaire, des compagnies d’assurances et des marchés financiers. Les propositions de cette mission, qui seront remises avant la fin de l’année 2015, devraient rejoindre des préoccupations qui se posent à un niveau européen et certaines négociations internationales en cours.
Le présent rapport se limitera donc, sur ce sujet, à faire état des échanges que la mission a pu avoir avec les professionnels ou le régulateur et des solutions qui sont envisagées.
1. Les contraintes excessives sur les compagnies d’assurance doivent être desserrées avant la fin de l’année 2015
La perspective de l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II (plus souvent désignée en anglais Solvency II) au 1er janvier 2016, à laquelle les compagnies d’assurances françaises sont déjà dans l’obligation de se préparer sous la supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), laisse les assureurs français perplexes.
Selon eux, cette préparation entraîne d’ores et déjà une réévaluation de leurs risques et l’abandon de certaines de leurs positions en titres cotés et non côtés de PME.
Comme la mission l’a déjà mis en évidence, le rôle de l’assurance vie dans le financement en fonds propre des PME et des ETI est déjà limité ; on peut donc légitimement craindre que l’entrée en vigueur de nouvelles contraintes de solvabilité n’accentue cette tendance
Rappel succinct des préconisations de la directive « Solvabilité II »
La directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, dont la mise en œuvre a été repoussée du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016 par la directive 2013/58/EU du 11 décembre 2013, prévoit trois piliers, le premier étant consacré aux exigences financières.
Le premier pilier prévoit en effet des exigences quantitatives, c'est-à-dire les règles de valorisation des actifs et des passifs, ainsi que les exigences de capital et leur mode de calcul. Les exigences de capital peuvent être calculées au moyen d’un modèle interne complet ou partiel. Les organismes peuvent demander différentes autorisations touchant aux exigences quantitatives.
Solvabilité II prévoit deux exigences de capital :
– le minimum de capital requis (Minimum Capital Requirement – MCR en anglais) ;
– le capital de solvabilité requis (Solvency Capital Requirement – SCR en anglais).
Le SCR peut être calculé au moyen d’une formule standard ou d’un modèle interne partiel (certains risques étant couverts par la formule standard) ou complet. Par ailleurs, des paramètres propres à l’organisme (Undertaking Specific Parameters – USP en anglais) ou au groupe (Group Specific Parameters – GSP) peuvent remplacer certains paramètres de la formule standard.
Les exigences quantitatives comprennent des dispositions de niveau 1 (directive Solvabilité II modifiée), de niveau 2 (règlement délégué de la Commission européenne et normes techniques réglementaires) et de niveau 3 (normes techniques d’exécution et orientations de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).
La directive Omnibus II, adoptée par le Parlement européen le 11 mars 2014, a modifié la directive Solvabilité II, notamment certaines règles du pilier 1.
De manière relativement originale sur le plan juridique, l’ACPR est chargée de suivre la préparation des compagnies d’assurances à l’échéance du 1er janvier 2016, date à laquelle la directive entre en vigueur.
À cette fin des exercices sont prévus par cette autorité chaque année depuis l’année 2013. Les exercices de l’année 2015 se sont déroulés entre le 3 juin et le 15 juillet 2015, date à laquelle les compagnies devront remettre une série d’états financiers permettant d’évaluer leur préparation, un rapport du contrôleur du groupe et plusieurs annexes techniques.
Selon les informations disponibles à cette heure, l'exercice de préparation du début du mois de juin 2015 montre que 97 % des assureurs déclarent ainsi être prêts à plus de 75 % sur les aspects quantitatifs (pilier 1). Ils étaient 89 % dans ce cas en 2014. Pour les aspects ayant trait à la gouvernance et à la gestion des risques (pilier 2), la part des organismes ayant avancé leurs travaux à plus de 75 % est passée de 38 % à 60 % d'une année sur l'autre.
Ils sont en revanche toujours très loin d'être préparés sur le pilier 3 portant sur les exigences en matière d'informations vis-à-vis de l'ACPR et du public. Seuls 42 % (contre 16 % en 2014) se disent prêts à plus de 75 %.
Les certains effets négatifs de la mise en œuvre de Solvency II sont toutefois de plus en plus mis en avant.
Ainsi, le rapport de Fabrice Demarigny du 18 mai 2015 (30), réalisé à la demande du ministre des Finances pour préparer, dans le cadre du Comité de Place de Paris 2020, la mise en place de l’union des marchés de capitaux est très sévère sur les effets de la mise en œuvre de Solvency II.
L’auteur du rapport indique : « Un grand nombre d’entreprises d’assurances a anticipé l’entrée en vigueur de Solvabilité II et a déjà procédé à des réallocations d’actifs au sein de ses portefeuilles d’investissement. On observe ainsi que la perspective de Solvabilité II bloque la diversification des portefeuilles et ce au détriment de classes d’actifs telles que les investissements en infrastructure (en dette ou en fonds propres), les actions cotées ou non cotées de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), les placements privés ou les véhicules de titrisation. La principale raison tient au surdimensionnement des nouvelles exigences en capital introduites par Solvabilité II pour chacune des classes d’actifs. Au vrai, le cadre prudentiel de Solvabilité II créé des incitations négatives à l’investissement de long terme et à la prise de risque, qui ne sont pas justifiées en termes de stabilité financière ».
Compte tenu de ce constat, l’auteur du rapport propose de revoir les ratios de solvabilité ainsi prévus, notamment dans le domaine du financement des PME.
Il indique ainsi : « sous certaines conditions, Solvabilité II permet aux assureurs d’appliquer le régime des “investissements stratégiques” aux actions qu’ils détiennent à long terme. Ce régime ouvre droit à des exigences en capital plus favorables reflétant l’horizon de long terme de ces placements (une forme d’exemption du risque lié à la marge – spread risk). Cependant, il est difficile en pratique de respecter les critères d’éligibilité à ce régime pour les actions non cotées, alors que cela serait économiquement justifié dans la mesure où ces placements ne sont pas exposés à un risque de volatilité. Une extension de la définition des « investissements stratégiques », fixée par le règlement délégué de la Commission n°(UE) 2015/35 pour mieux couvrir les actions non cotées serait une réelle amélioration ».
La presse s’est déjà fait l’écho de la volonté du Gouvernement français de proposer au niveau européen certains ajustements au dispositif Solvency II avant la date d’entrée en vigueur (31).
La mission appuie cette démarche dans la mesure où la renégociation permettra la mise au point d’un dispositif plus favorable aux investissements productifs de long terme, notamment dans les PME non cotées.
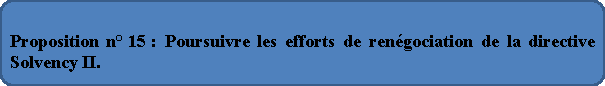
2. L’évaluation délicate des effets de la réglementation sur les capacités de financement bancaire
Les effets décrits sur les entreprises d’assurances par la réglementation européenne le sont également par certains, pour le secteur bancaire, sous l’effet de la réglementation mise en place par le comité de Bâle au travers de ce qu’il est convenu d’appeler « l’accord Bâle III ».
Le durcissement des contraintes de liquidités entre Bâle II et Bâle III
En premier lieu, du fait des règles de Bâle 2,5, la pondération des risques de marché et des risques associés à la titrisation a été renforcée. En d’autres termes, ces actifs doivent être couverts par un montant plus important de fonds propres. Une telle évolution réduit mécaniquement la rentabilité du capital ainsi investi et l’incitation économique à mener de telles activités.
En deuxième lieu, les règles de Bâle III ont eu pour objet de renforcer les exigences de fonds propres demandées aux banques. Le montant de fonds propres rapporté aux actifs pondérés par les risques est ainsi plus important, comme l’illustre le graphique ci-dessous. Par ailleurs, la « qualité » des fonds propres est également renforcée avec l’instauration du nouveau ratio relatif aux fonds propres « durs », principalement les actions, de l’établissement.
LES RATIOS DE FONDS PROPRES : DE BÂLE II À BÂLE III
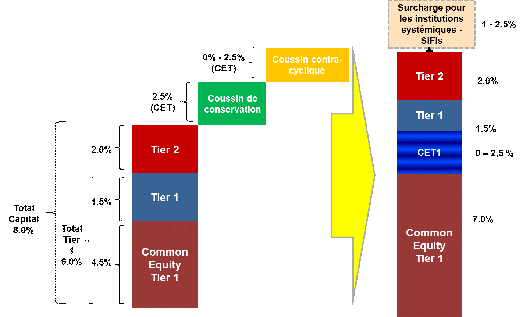
Une telle évolution tend à accroître la solvabilité des banques en renforçant leur capacité à absorber des pertes et à réduire le risque de faillite bancaire. Elle a également pour conséquence mécanique de réduire la rentabilité du capital investi dans les banques, un même bénéfice devant être réparti, toutes choses égales par ailleurs, sur un capital plus important.
Enfin, tirant les conséquences des crises de liquidité constatées au moment de la crise financière, les règles de Bâle III prévoient également des ratios de liquidité destinés à renforcer la capacité des banques à faire face à leurs engagements de court terme en cas de restriction du financement externe :
– le liquidity coverage ratio (LCR) est un ratio à un mois, dont l’objectif est de garantir que la banque détient suffisamment d’actifs liquides pour faire face à ses besoins de liquidité en cas de crise pendant un mois ;
– le net stable funding ratio (NSFR) doit permettre de s’assurer que les actifs à plus d’un an sont couverts par des ressources à plus d’un an.
Ces deux règles prudentielles ont été fortement critiquées, notamment par les banques françaises dont le financement externe occupe une place proportionnellement plus importante en raison des spécificités de l’épargne française.
Il importe néanmoins de noter que la principale difficulté posée par le LCR semble avoir été résolue par l’élargissement des types d’actifs entrant dans le champ du ratio.
Les avis recueillis par la mission s’agissant des effets de cette réglementation sur la capacité des banques à investir, dans le long terme, dans des titres de PME et d’ETI en développement, sont relativement divergents.
De nombreux intervenants ont souligné une frilosité grandissante dans ce domaine ; si beaucoup de réseaux sont décrits comme refusant de financer des difficultés de trésorerie, il semble arriver que des prêts à l’investissement, pourtant bien étayés, soient également refusés.
Pour d’autres, il n’existe pas vraiment de « credit crunch » pour les entreprises en croissance ; celles dont les fondamentaux sont solides peuvent toujours trouver un financement, que ce soit par le biais du réseau bancaire ou par d’autres réseaux.
Pour d’autres enfin, cette frilosité pourrait relever du ressenti de la part des entreprises qui sont dans une situation d’asymétrie d’information.
L’impact macroéconomique des ratios de Bâle III fait également l’objet d’appréciation divergente dans la littérature financière : les organes du comité lui-même (le Macroeconomic assessment group) mettent en évidence un effet relativement modeste (– 0,22 % sur le PIB des États concernés entre 2011 et 2020) tandis que l’International institue of finance (IIF) évoque un effet très négatif (- 2,4 % du PIB entre ces deux dates) sachant que l’étude de l’IIF porte sur un champ plus large que les seuls ratios de Bâle.
Le rapport de Paris Europlace(32) consacré au financement des PME et des ETI évoque pour sa part un renchérissement du coût du crédit bancaire de 100 à 200 points de base étalé sur plusieurs années.
3. La solution passe par une coordination européenne dans le domaine du financement de long terme des entreprises
La mission considère que la régulation des risques systémiques des banques et compagnies d’assurance, qui échappe largement au législateur national, doit être globalement développée.
Ses effets collatéraux sur le financement de long terme des entreprises, notamment des PME en croissance, doivent cependant être corrigés par la mise en place, au niveau européen, d’une politique volontariste dans ce domaine.
Le plan Juncker, dont les annonces ont été faites en novembre 2014, se traduit par un volet spécifiquement destiné au financement des PME. Ce plan vise principalement à supprimer les obstacles aux investissements, à accroître la visibilité des projets d’investissement, et à leur fournir une assistance technique, ainsi qu'à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes.
Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit trois volets :
– mobiliser des investissements à hauteur d’au moins 315 milliards d’euros sur trois ans ;
– soutenir les investissements dans l’économie réelle ;
– créer un environnement propice aux investissements.
Dans le domaine des investissements, le plan Juncker se traduit par la mise en place d’un fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui vise à « combler l’actuel déficit d’investissement dans l’Union européenne en mobilisant des financements privés pour les investissements stratégiques que le marché ne peut pas financer seul. Il soutiendra les investissements stratégiques dans les infrastructures, ainsi que le financement des risques pour les petites entreprises ».
Du point de vue financier, la Commission européenne prévoit que le plan d'investissement, doté en propre de 63 milliards d’euros, permettra de mobiliser au moins 315 milliards d'euros d'investissements supplémentaires en Europe au cours des trois prochaines années. Sur les 315 milliards d’euros, la commission prévoit que 240 iront au financement des projets d’infrastructures et 75 au financement de l’innovation dans les PME.
L'UE fournira un financement initial de 21 milliards d'euros : une garantie de 16 milliards d'euros, qui devra être approuvée par un règlement de l’UE (33) et 5 milliards d'euros provenant des ressources propres de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le fonds sera créé au sein du groupe BEI, afin de pouvoir démarrer rapidement et de bénéficier de l’expérience de la BEI.
Selon les informations disponibles sur le site de la Commission, l’adoption du règlement par le Conseil et le Parlement européen devrait permettre au FEIS « d’être opérationnel en septembre comme prévu ». Concernant spécifiquement des aides aux PME, les demandes devront être introduites directement auprès de la structure ad hoc du FEIS.
Pour la mise en œuvre de ce plan, la Commission s’est largement appuyée sur les compétences existant dans les États membres dans la mesure où chaque pays a été sollicité fin 2014 et début 2015 pour présenter une liste de projets potentiels.
Pour la France, le Commissariat général à l’investissement a présenté une liste de 32 projets représentant potentiellement 48 milliards d’euros d’investissement. Selon les informations de BPI France, 40 % de ce montant est constitué par des projets dans le domaine de l’innovation des PME.
La mise en place du plan Juncker se fait par ailleurs en synergie avec les actions mises en place par BPI France en faveur du capital-investissement : cette structure annonce en effet avoir mis en place deux types de prêts aux PME, le « prêt innovation » (avec une enveloppe totale de 320 millions d’euros) et le « prêt amorçage investissement » (pour une enveloppe de 100 millions d’euros).
En parallèle avec ces plans de financement, la mission souhaite faire état de l’accueil très favorable réservé par les professionnels concernés au projet européen de création d’un nouveau véhicule d’investissement de long terme souvent désigné en anglais par les termes « European long term investment fund » (ELTIF).
La création de ce nouveau véhicule, qui a fait l’objet de concertations dès la fin de l’année 2013, a été actée par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015. Dans sa version soumise à concertation, préalable à l’adoption par le Parlement européen le 17 avril 2014, le projet comportait certaines rigidités faisant craindre aux gestionnaires de fonds une certaine inadéquation aux besoins. L’immense intérêt de ce nouveau véhicule normalisé au niveau européen est d’offrir un passeport pour l’ensemble des États membres. Les ELTIF sont en effet destinés à constituer une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif (OPC) réservée aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) agréés conformément à la directive FIA.
Les ELTIF sont toutefois soumis à des règles supplémentaires, prévoyant notamment qu’ils doivent investir une certaine proportion de leur capital en catégories d’actifs décrits ci-dessous.
Les actifs éligibles aux fonds ELTIF
Un ELTIF peut en premier lieu investir dans des « actifs éligibles à l’investissement » définis de la manière suivante :
a) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont :
i) émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;
ii) émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi- capitaux propres auparavant acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;
iii) émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF conformément au point i) ou ii) auprès de l'entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;
b) instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible ;
c) prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF ;
d) parts ou actions d'un ou plusieurs autres ELTIF qui n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF ;
e) actifs physiques particuliers (notamment immobilier ou infrastructures) détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10 millions d’euros, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.
Au sens de ce règlement, une entreprise de portefeuille se définit comme une entreprise non financière, soit non cotée soit cotée et de petite capitalisation boursière (inférieure à 500 millions d’euros).
Un fonds ELTIF peut en outre investir dans certains actifs définis à l’article 50 de la directive OPCVM du 13 juillet 2009, c’est-à-dire à titre principal des valeurs et titres du marché monétaire cotés ou nouvellement émis, des parts d’OPCVM, certains instruments financiers dérivés cotés (dont le sous-jacent est nécessairement un produit de taux).
Conformément à l’article 13 de ce règlement, un ELTIF doit répondre aux règles d’investissement suivantes :
– 70% du capital doit être investi en « actifs éligibles à l’investissement » tels que définis ci-dessus ;
– un ELTIF ne peut pas investir plus de 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise, dans un seul et même actif physique ou en parts ou actions d'un autre ELTIF ;
– il ne peut investir plus de 20 % de son actif dans un autre ELTIF.
Ces règles sont en outre assorties de sous-ratios de répartition des risques par pays émetteur (10 % au plus pour les quotas de 70 % et de 20 %).
Selon plusieurs professionnels entendus par la mission, le projet initial devait être assoupli ; l'AFG a notamment recommandé que ce produit à durée déterminée (dix ans au plus) soit transformé en produit de plus long terme. Cette limitation a finalement été retirée du règlement dans sa version finale. Le point 3 de l’article 18 du règlement indique en effet désormais que « la durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF ».
La mission regrette qu’une durée minimale n’ait pas été retenue dans le règlement.
L’article 38 du règlement prévoit que son entrée en vigueur est fixée au 9 décembre 2015 ; avant cette date, une transposition en droit national est nécessaire.
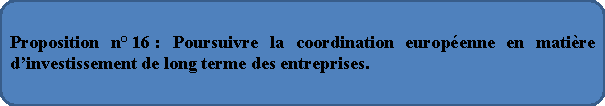
C. LA NÉCESSAIRE AMÉLIORATION QUALITATIVE DU FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS FINANCIERS
Aversion au risque, court-termisme des placements, pression des actionnaires pour une rentabilité rapide, contraintes de transparence : pour de nombreuses personnes auditionnées par la mission, le financement d’une entreprise par le marché semble être porteuse de risques. Dans le même temps, les analyses plus macroéconomiques mettent en évidence le fait que le financement des entreprises, notamment des PME et des ETI, par les marchés est plus réduite en France et en Europe qu’aux États-Unis.
S’agissant de la France, le rapport de Paris-Europlace sur le financement de l’économie (34) indique très clairement que « le financement par le crédit bancaire domine en France, comme dans le reste de la zone euro (…). La France apparaît au même niveau que l’ensemble de la zone euro, légèrement supérieur à 80 % et très nettement supérieur au niveau observé aux États-Unis, proche de 30 % »
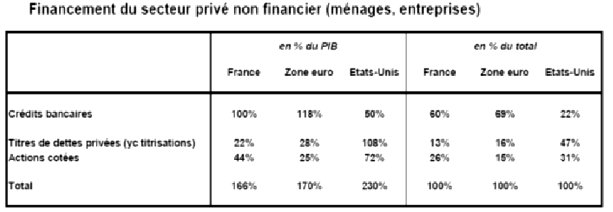
Source : Rapport Paris Europlace 2013.
Partant de ce constat, la mission ne peut que rappeler les efforts réalisés pour améliorer le financement des entreprises par les marchés financiers.
1. Une structuration de l’offre aux PME et aux ETI
Au cours de ses auditions, la mission a pu constater qu’un effort particulièrement poussé était réalisé par la place de Paris pour structurer son offre aux entreprises, notamment aux PME et aux ETI.
On peut rappeler pour mémoire que la plate-forme Alternext a été organisée à compter de 2005 par Euronext Paris afin d’améliorer le financement de marché de ces entreprises.
Alternext n'est pas un marché réglementé au sens de la directive européenne sur les services en investissement et au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier. Il s'agit d'un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) au sens de l'article L. 424-1 du code monétaire et financier et de l'article 524-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L’objectif de cette plate-forme est d’offrir une alternative de cotation aux petites et moyennes entreprises souhaitant lever des capitaux dans la zone euro à l'heure où il devient de plus en plus difficile et coûteux pour les entreprises d'accéder aux marchés réglementés. Un autre objectif affiché par Euronext pour la création de cette plate-forme est de proposer un trait d’union entre le marché réglementé et le capital-investissement.
Deux segments ont été créés sur Alternext (offre publique et placement privé) pour mieux distinguer en théorie les sociétés introduites sur ce marché par offre au public, d’une part, et par placement privé, d’autre part, offrant ainsi aux investisseurs une meilleure lisibilité.
Plus récemment, la plate-forme EnterNext, filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses marchés boursiers propres aux PME‐ETI, a été lancée en mai 2013.
Ouverte simultanément dans les pays d’Euronext, EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros et couvre les sociétés cotées sur les compartiments B (de 150 millions à 1 milliard d’euros) et C (moins de 150 millions d’euros) de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext.
Selon les chiffres transmis par les représentants d’Enternext, la mise en place de cette plate-forme aurait permis de lever 9 milliards d’euros en 2014 pour les seules PME-ETI des marchés d’Euronext.
Leur action a permis la cotation de 31 nouvelles PME ou ETI en 2014 (contre 26 en 2013), ce qui a permis de leur ramener un financement de 740 millions d’euros, soit en moyenne 24 millions d’euros environ. Chaque introduction en bourse a rencontré un fort intérêt des investisseurs puisque les introductions ont été en moyenne souscrites 2,6 fois.
À côté des introductions en bourse, l’action d’Enternext passe également par des émissions secondaires d’actions (de 2,7 milliards d’euros en 2013 à 5,4 milliards d’euros en 2014) mais également des émissions sur le marché obligataire (2,7 milliards d’euros en 2014).
Au total, ce sont plus de 700 PME-ETI dont la croissance a pu être financée par cette nouvelle plate-forme. En outre, 52 % des nouvelles cotations réalisées en France concernent des sociétés régionales, avec un effort particulier de la plate-forme pour ouvrir et entretenir des bureaux régionaux.
Il ressort des auditions que le réseau d’Enternext réalise un travail approfondi avec les chefs d’entreprises (avec plus de 1 200 d’entre eux rencontrés en 2014) afin d’étudier avec eux la faisabilité d’un recours au financement de marché. Ce travail les amène souvent, lorsqu’il s’agit d’entreprises familiales, à devoir vaincre certaines appréhensions du recours au marché (obligation de transparence, sentiment de devoir livrer des informations sensibles potentiellement utilisées par les concurrents, obligation de composer avec de nouveaux actionnaires, appréhension de la lourdeur de la procédure de l’introduction en bourse).
La dimension régionale de leur action est également un levier important pour attirer les investisseurs qui peuvent ainsi s’inscrire dans une relation de proximité avec l’entreprise financée.
Dans ce domaine particulier, la mission se fait l’écho de craintes qu’à certaines réglementations européennes en cours de réforme, notamment la directive « Prospectus », ne viennent se superposer des réglementations nationales qui, sous couvert de la protection de l’épargnant, risquent d’affaiblir l’attractivité de cette nouvelle plate-forme.
2. Le financement des PME et des ETI en titres de dettes
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, le financement des marchés en direction des PME et des ETI peut reposer sur l’offre au public de titre de capital, mais aussi bien souvent de titres de dettes sous forme d’obligations.
Du point de vue de l’analyse retenue par la mission, le financement de ces entreprises par l’endettement constitue un optimum économique et financier que l’on pourrait qualifier « de second rang ». Dans la présentation bilancielle, ce type de financement n’offre pas la même perspective temporelle ; il ne permet donc pas le même type d’investissements.
Il va toutefois de soi que ce canal de financement reste d’une grande importance et qu’il doit être promu par les pouvoirs publics.
Les pistes qui peuvent être suivies sont indiquées par le rapport précité de Paris Europlace sur le financement des PME et des ETI par des titres de dette.
Selon ce rapport, « la nouvelle cartographie des sources de financement des entreprises en Europe établi par l’Association for financial markets in Europe (AFME) montre très clairement que les PME/ETI se financent de plus en plus par de nouveaux modes alternatifs : financement structuré, placement privé, produits de titrisation, etc. Ce processus est soutenu par les acteurs bancaires, dont le rôle a évolué vers des partenaires opérationnels des entreprises pour la structuration, l’accompagnement sur les marchés, des entreprises à la recherche d’une diversification de leurs financements, mais aussi des créanciers investisseurs ».
Le marché obligataire français à destination des PME et des ETI constitue déjà l’un des plus importants d’Europe. Il représente en effet 35 % des émissions internationales en euro et plus de 40 % des encours. Selon le rapport de Paris Europlace, la majeure partie de cet encours provient toutefois par les entreprises qui, au sein de cette catégorie, ont la plus grande taille.
Une cartographie des solutions de financement pour ces entreprises peut être élaborée de la manière suivante :
– pour les très grandes ETI dont le besoin de financement est supérieur à 250 millions d’euros, un très large accès aux solutions de placement privé ainsi qu’aux financements obligataires est possible ;
– pour les grandes ETI dont le besoin de financement se situe entre 100 et 250 millions d’euros, un large accès aux solutions de placement privé est possible (avec une base obligataire et une base sous forme de prêt). Un financement obligataire public est plus complexe, pour des raisons de taille minimum d’émission ;
– pour les ETI et les grandes PME dont le besoin de financement se situe entre 20 et 100 millions d’euros, un accès aux émissions obligataires publiques et aux solutions de placement privé est possible ;
– pour les PME dont le besoin de financement se situe entre 3 et 20 millions d’euros, un accès aux solutions de financement obligataires public et aux financements mutualisés est également possible ;
– en dessous de 3 millions d’euros, le rapport indique que l’accès aux sources de financements en dette est beaucoup plus limité. Toutefois, de nouvelles solutions se développent comme le prêt participatif.
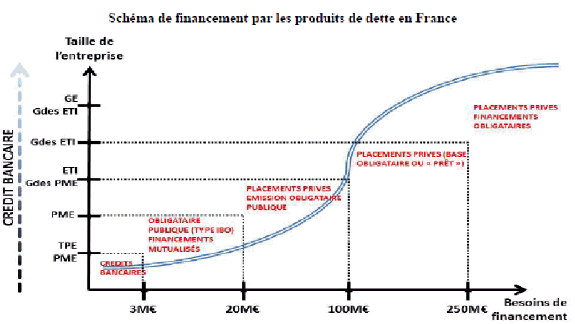
Source : Rapport Paris Europlace, « Financement en dette des PME/ETI », mars 2014.
Sur le modèle américain (35) mais aussi allemand (36), les marchés européen et national tendent à donner une place de plus en plus importante au placement privé, qui est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise, cotée ou non, et un nombre limité d’investisseurs. Il s’agit d’un financement direct entre un investisseur et une entreprise avec l’aide des experts financiers pour sa mise en place.
Afin d’organiser ce type de financement, une plate-forme Euro PP a été mise en place à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. L’enjeu est de faire émerger des bonnes pratiques sur un marché encore naissant.
Les travaux préalables à sa mise en place, qui ont débuté en 2012, ont impliqué de nombreux professionnels avec l’appui de la direction du Trésor, de la Banque de France et de Paris Europlace ; ils ont permis la finalisation d’une charte en décembre 2013 définissant des standards de marché, qui a été endossée par les associations professionnelles représentatives des entreprises, des investisseurs et du monde financier de la place de Paris.
Depuis, des groupes de travail se sont constitués afin de favoriser le développement de nouvelles sources de financement au travers de l’émergence d’un marché des placements privés plus efficient et mieux intégré. Ces groupes de travail, composés de plus de 60 participants représentant l’ensemble des acteurs concernés, traitent des sujets prudentiels et comptables, d’éligibilité des actifs.
S’agissant de la France, les chiffres les plus récents dont dispose la mission datent de 2012 : cette année-là les entreprises françaises avaient émis 3,4 milliards d’euros de placement privé sous forme d’USPP (1,9 milliard d’euros) ou de Schuldstein (1,5 milliard d’euros).
Dans le même temps, l’Euro-PP avait enregistré 3,1 milliards d’euros d’émissions en 2012. Ce montant correspond aux levées effectuées par 28 entreprises. Une douzaine d’autres entreprises ont levé 1,2 milliard d’euros au cours du 1er semestre 2013.
Aujourd’hui, le marché de l’Euro-PP est encore très peu structuré et organisé. La mission recommande de poursuivre les efforts dans la structuration des placements privés.
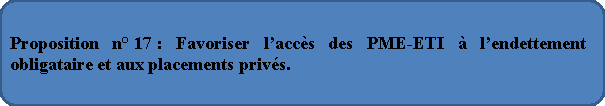
IV. DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE ET FISCALITÉ DES DIRIGEANTS
La transmission de l’entreprise est souvent le moment où plusieurs des problématiques relatives à la situation personnelle du ou des dirigeants, parfois de plusieurs membres de leur famille, peuvent se dénouer.
Dans de nombreux cas, ce dénouement se joue au prix d’arbitrages fiscaux où l’intérêt de l’entreprise et ses modalités de financement sont mis en balance avec la situation personnelle de ces dirigeants.
A. COMMENT ÉVITER QUE LA DISTINCTION ENTRE OUTIL DE TRAVAIL ET PATRIMOINE NE PÈSE SUR LES CHOIX DU DIRIGEANT ?
En règle générale, les problématiques fiscales sont peu appréhendées par les fondateurs d’une entreprise, d’une part en raison de leur complexité mais également parce que le projet de création de l’entreprise prime logiquement dans sa phase de lancement
Toutefois, à mesure que l’entreprise croit, ce sujet s’impose de plus en plus au chef d’entreprise, au risque de déformer sa vision financière de l’entreprise pour l’analyser au prisme de sa situation patrimoniale personnelle.
La fiscalité du patrimoine du dirigeant d’une entreprise française est une des différences importantes avec l’état du droit dans les autres pays de l’Union européenne, notamment avec l’Allemagne qui se présente comme une championne des ETI.
1. La faiblesse française dans le domaine de la transmission des entreprises familiales
La littérature économique et les rapports publics sur la vente de certains joyaux français, souvent familiaux, à des fonds d’investissements étrangers, sont légions. Tous rappellent invariablement que les entreprises familiales représentent une part importante de notre tissu de PME-ETI, notamment de celles qui sont encore actives dans le domaine industriel. Selon une étude de 2012 du cabinet PricewaterhouseCoopers, dont les chiffres sont repris par le réseau ASMEP-ETI (37), ces entreprises représentent 70 % des sociétés en Europe et 83 % en France. Elles représentent entre 65 % et 90 % des entreprises dans le mode.
Certains soulignent le désamour de la France pour les entreprises familiales, résultant probablement de notre histoire : « Longtemps, la France aura boudé ses entreprises familiales. Le mythe des « 200 familles » et l’image laissée par les Maitres des Forges y ont été pour beaucoup. Pourtant, depuis une quinzaine d’années, et plus encore depuis 2008 alors qu’une crise inédite secoue l’ensemble de nos pays, les économistes mais aussi les responsables politiques redécouvrent les vertus de ce modèle qui défie le temps » (38).
La présente mission ne peut que s’inscrire dans le prolongement des analyses déjà réalisées, et qui n’ont pas été corrigées par les dispositifs Madelin ou, plus récemment, l’ISF-PME.
Le rapport réalisé en octobre 2009 par M. Olivier Mellerio au secrétaire d’État chargé du commerce (39), met des mots clairs sur une réalité préoccupante :
– d’après ce rapport, la transmission des entreprises familiales en France se passe généralement mal : « D’après une étude KPMG commanditée par le ministère en 2007, moins de 10 % des entreprises de plus de 10 salariés sont transmises dans le cadre d’une continuité familiale. Ce chiffre est particulièrement alarmant lorsqu’il est comparé à d’autres pays d’Europe : Italie 72 %, Allemagne 55 %, Pays Bas 58 % ou d’autres territoires industrialisés : Québec : 50 % » ;
– cet état de fait est d’autant plus préoccupant que les entreprises familiales possèdent de très nombreux atouts, notamment en termes de stabilité de l’actionnariat et de politique d’investissement durable, qui rejoignent plusieurs des préoccupations de la mission : « De nombreuses études récentes menées en France comme à l’étranger, en particulier dans le cadre du Family Business Network, démontrent que les entreprises familiales sont, en général mieux gérées que les autres, qu’elles obtiennent des performances meilleures. »
M. Luc Darbonne, président du Family Business Network en France précisait dans une interwiew : « La première spécificité des entreprises familiales réside dans leur rapport au temps. À la différence des autres entreprises qui sont avant tout guidées par des préoccupations financières, les entreprises dont le capital est contrôlé par des familles cherchent avant tout à durer. Pour elles, s’inscrire dans le long terme est à la fois un objectif et une valeur. La raison en est simple : par définition, toute entreprise familiale a une vocation transgénérationnelle. Si un entrepreneur de la première, de la deuxième ou de la cinquième génération fait des bêtises, ce sont ses enfants qui les paieront… et il en a conscience ».
Cette spécificité a par ailleurs fait l’objet de nombreuses recherches économiques :
– une étude américaine de 1999 présente les avantages concurrentiels dont peuvent bénéficier les entreprises familiales aux États-Unis (40) ; ces avantages tiennent à une grande prudence patrimoniale et une vision de long terme dans le domaine de l’innovation ; une stabilité des collaborateurs est également un facteur d’efficience, qui pousse ces entreprises à investir davantage dans leur formation ;
– une étude française met par ailleurs en évidence la meilleure résilience de ces entreprises familiales, notamment en termes d’emploi, à la crise économique connue depuis 2008 (41) ;
– enfin une étude de PricewaterhouseCoopers de 2012 met en évidence le fait que les entreprises familiales ont un chiffre d’affaires supérieur à la moyenne nationale ; pour 60 % d’entre elles, la croissance du chiffre d’affaires est supérieure de 5 % à la moyenne et pour 33 % d’entre elles, la croissance est supérieure à 10 %.
Cette spécificité a été peu prise en compte par les pouvoirs publics jusqu’à une période récente. Comme le souligne le rapport de M. Olivier Mellerio, « jusqu’à l’époque la plus récente, l’État s’était plutôt désintéressé du sort des entreprises familiales. Il avait surtout cherché à constituer des groupes nationaux mis au service des objectifs stratégiques (défense, puissance, sécurité, indépendance) dans les domaines de l’énergie, des matières premières, des infrastructures, de la finance… Il s’agissait concrètement d’un capitalisme d’État, centralisé, renforcé en son temps par les nationalisations. »
2. Les conséquences sur le rachat de certains fleurons nationaux
De ce fait, le taux de transmission des entreprises françaises est inférieur à celui de nos principaux partenaires européens. Selon le rapport précité de l’ASMEP-ETI (devenu entre-temps le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire – METI), « le taux de transmission des entreprises patrimoniales s’établissait à 7 % en France contre 51 % en Allemagne et 70 % en Italie. Plus récemment, une étude menée par l’observatoire BPCE indiquait un taux de transmission des entreprises patrimoniales de 14 %, une fois encore loin des standards européens ».
Au sein de ces transmissions, il convient en outre de distinguer les cessions-transmissions, permettant à l’actif de l’entreprise de rester au sein de la même famille, d’une transmission classique à un acquéreur extérieur.
La France se singularise par le taux important de rachat des entreprises familiales par des acteurs institutionnels, comme le note le rapport précité de 2009 : « Le développement récent du marché des fusions acquisitions pour les entreprises non cotées et la montée en puissance des nouveaux acteurs financiers : sociétés de capital développement et sociétés de LBO, au service de la rémunération des grands fonds d’épargne institutionnels et internationaux a contribué à accélérer l’attrition et l’affaiblissement des entreprises familiales en France ».
B. PLUSIEURS VOLETS DE NOTRE FISCALITÉ DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS EN CONSÉQUENCE
Au cours de ses auditions, la mission a pu recueillir une liste des dispositions dont l’objet est, en principe, d’établir une distinction entre outil de travail et patrimoine.
Lorsqu’ils sont mis en œuvre, ces principes se heurtent pourtant à une réalité simple : la distinction entre outil de travail et patrimoine est largement conceptuelle. Dans les faits, il est quasiment impossible, dans de nombreux cas, de distinguer ces deux catégories qui vont toutefois déterminer l’application de régimes fiscaux très différents.
L’élaboration progressive de ces régimes différents pèse de plus en plus sur les choix du dirigeant, le forçant à prendre des décisions stratégiques qui peuvent être contraires à l’intérêt à long terme de l’entreprise.
1. Les nécessaires ajustements de la définition de biens professionnels
Pour la mise en œuvre de l’ISF, la notion de bien professionnel vise à exonérer les biens ou les titres nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Comme le précise l’article 885 N du code général des impôts, cette notion s’étend au conjoint du propriétaire.
Si le principe ne peut que paraître justifié, il apparaît toutefois dans le détail que certains critères permettant la qualification de bien professionnel viennent interagir avec les modalités de fonctionnement ou de financement de l’entreprise :
– en premier lieu, en cas de disparition du dirigeant, les biens anciennement professionnels sont transmis à son conjoint mais ne bénéficient plus de l’exonération. De nombreux cas ont donc été rapportés à la mission où le conjoint voit peser sur les parts transmises un ISF qui peut être extrêmement important ;
– conformément à l’article 885 O ter du code général des impôts, « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l’activité » de l’entreprise est considérée comme un bien professionnel. Pour mettre en œuvre cette disposition, l’administration fiscale considère notamment qu’une trésorerie anormalement élevée n’est pas éligible à l’exonération. La mission rappelle que, comptablement, l’importance de la trésorerie est la résultante mécanique de la différence entre le fonds de roulement (FDR) et le besoin de fonds de roulement (BFR). Certaines entreprises ont un BFR particulièrement faible du fait de leur modèle économique, notamment lorsque les délais de paiement des fournisseurs sont réduits. Mais l’inverse est également vrai.
La mission considère que la fiscalité ne doit pas s’appuyer sur la notion économique de trésorerie ni s’immiscer dans le fonctionnement de l’entreprise pour évaluer ce qui, économiquement, est susceptible de constituer une trésorerie excédentaire ;
– l’article 885 O bis du code général des impôts indique que les parts de sociétés soumises à l’IS sont également exonérées d’ISF lorsque plusieurs conditions sont réunies. Le redevable doit en premier lieu assurer une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, PDG, DG, membre du directoire d’une société par action).
L’article précise que ces fonctions « doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale ». Selon les professionnels entendus par la mission, cette notion de rémunération normale donne lieu à des grilles indicatives de la part de l’administration ; cette obligation de verser une rémunération normale ne permet pas au dirigeant de décider, si l’entreprise traverse une situation délicate, de ne plus se verser de salaire pendant quelque temps afin de reconstituer les marges financières de l’entreprise ou sa trésorerie.
En outre, l’article 885 O bis prévoit que le dirigeant doit posséder « 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société » afin de pouvoir bénéficier du régime des biens professionnels. Ce seuil est abaissé à 12,5 % lorsqu’une augmentation de capital a entraîné la dilution de la part détenue par le dirigeant ou sa famille. Il reste toutefois de nombreux cas où ce seuil peut suffire à faire obstacle à l’application de l’exonération dont bénéficie le dirigeant ;
– de manière plus générale, de nombreux avocats fiscalistes entendus par la mission ont avancé l’idée que la condition tenant au poste de direction pouvait conduire le dirigeant à continuer à occuper de tels postes à un âge auquel il pourrait en principe aspirer à passer la main, uniquement afin de continuer à bénéficier de l’exonération.
Si l’exonération des biens professionnels de l’assiette de l’ISF est reconnue par les différentes majorités qui se sont succédé, celle-ci est aujourd’hui soumise à un carcan juridique qui est de plus en plus source de contentieux.
Cela décourage la détention des entreprises par les personnes physiques résidentes et les amène trop souvent à délocaliser l’entreprise ou à s’en séparer prématurément.
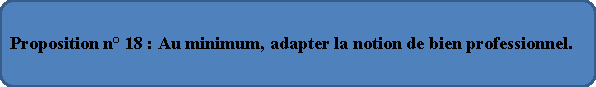
2. Les rigidités liées à la mise en œuvre du pacte Dutreil doivent être levées
L’existence du pacte Dutreil a été unanimement saluée par les personnes auditionnées par la mission, qui ont également mis en avant la nécessaire stabilité d’un dispositif désormais bien connu des personnes pour lesquelles il a été conçu.
Cette nécessaire stabilité a d’ailleurs été rappelée par le président de la République lui-même dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 à Château-Renault.
Toutefois, cette nécessaire stabilité, à laquelle la mission tient également, ne doit pas faire obstacle à une analyse de certains effets indésirables liés à la mise en œuvre du dispositif et à son vieillissement.
Il apparaît en particulier que le pacte Dutreil peut, dans certains cas, conduire à figer les participations dans les entreprises soumises à ce pacte, empêchant les évolutions capitalistiques pourtant nécessaires.
Ces problèmes ont fait l’objet d’amendements, adoptés à l’initiative du Sénat, dans le cadre du projet de loi « Macron ». Lors de l’examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a préféré supprimer ces dispositions dans l’attente de la remise du rapport confié à Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, sur les problèmes de transmission des entreprises.
• La disposition figeant les participations en cas de sociétés interposées devrait être supprimée
Actuellement, le bénéfice du pacte Dutreil, dans son volet applicable à la transmission, est entouré de nombreuses conditions destinées à assurer la sécurité juridique du dispositif :
– l’engagement doit porter sur 20 % des droits financiers et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;
– ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l’engagement, les associés pouvant effectuer entre eux des cessions ou admettre un nouvel associé à condition que l’engagement soit reconduit pour deux ans au minimum ;
– l’engagement collectif doit être enregistré devant notaire pour être opposable à l’administration.
Un dispositif particulier est prévu dans l’hypothèse où la société dont les titres font l’objet d’une transmission possède des participations dans une autre entreprise ou lorsque son capital est lui-même détenu par une autre société :
– dans le cas où le capital de la société à transmettre est détenu par une autre société holding, les titres correspondant entrent dans le calcul des ratios mentionnés précédemment si la société est elle-même partie à l’engagement collectif de conservation ;
– dans ce cas, la valeur des titres transmis fait l’objet d’une exonération à hauteur de la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;
– l’exonération s’applique également lorsque la société détenue par le redevable possède des participations dans une société qui détient elle-même les titres de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. L’exonération est alors applicable à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet de l’engagement.
Le dernier alinéa du b de l’article 787 B prévoit enfin que le bénéfice de ces dispositions n’est applicable qu’à condition que les participations soient inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, sauf dans le cas où la participation dans la société soumise à engagement collectif augmenterait.
Cette dernière précision conduit à l’évidence à figer la fluidité des participations et devrait donc être supprimée.
• Vers un allègement des formalités déclaratives permettant
l’application du pacte Dutreil
Actuellement, le e de l’article 787 B du code général des impôts prévoit deux obligations déclaratives pour le bénéfice du pacte Dutreil (dans son volet relatif aux droits de transmission) :
– en premier lieu, l’acte de succession ou de donation doivent être appuyé par une attestation de la société que les conditions relatives au pacte Dutreil sont vérifiées ;
– en second lieu, depuis la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la société faisant l’objet de l’engagement doit adresser avant le 31 mars de chaque année une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du pacte Dutreil sont remplies au 31 décembre de chaque année.
La liste précise des documents à fournir est détaillée par l’article 294 bis de l’annexe 2 du code général des impôts. L’article 294 quater du même code précise quels sont les actes à fournir par les personnes bénéficiaires du pacte pendant les quatre années du pacte, avant le 31 décembre de chaque année.
Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il ressort des auditions que l’administration fiscale a fait preuve d’une certaine intransigeance ; le manque ou l’oubli d’un document pendant l’ensemble des six années entraine l’impossibilité de bénéficier du régime dérogatoire du pacte Dutreil.
Cette position étant difficilement acceptable, un amendement a été adopté dans le projet de loi précité afin de distinguer :
– le délai de deux ans pendant lequel l’engagement collectif est applicable ; dans cet intervalle, la société aurait été tenue d’adresser une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du régime du pacte Dutreil uniquement sur demande de l’administration ;
– pendant les quatre années suivantes, pendant lesquelles l’engagement de conservation des titres pèse sur les héritiers ou donataires, il était prévu que ces personnes doivent également produire une telle attestation sur demande de l’administration.
Ce dispositif, qui a ensuite été supprimé à l’Assemblée nationale, reprend l’une des propositions du rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises, dit « rapport Mandon » remis au Gouvernement le 2 juillet 2013.
La mission considère que cette proposition doit être reprise au plus vite.
• Assouplir les conditions d’applicabilité du pacte Dutreil en cas d’apport de titres
Actuellement le f de l’article 787 B du code prévoit que le régime du pacte Dutreil reste applicable dans deux cas alors que la condition relative à la durée de détention n’a pas été respectée :
– quand les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ;
– quand les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans des sociétés du même groupe que la société dont les parts ont été transférées et ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.
En termes plus simples, ces dispositions maintiennent le dispositif du pacte Dutreil lorsque l’héritier ou le donataire décide de transmettre ses titres à une holding.
Dans ces deux cas, l’exonération reste applicable si :
– la société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes bénéficiant de l’exonération ;
– la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres jusqu’à la fin du délai de quatre ans ;
– les héritiers ou donataires doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au même terme.
Dans le dispositif actuellement en application, ces dispositions ne sont applicables que dans le délai de quatre ans qui suit celui de deux ans durant lequel l’engagement collectif est applicable.
La mission recommande de rendre applicables ces dispositions dès la signature de l’engagement collectif, c’est-à-dire y compris durant les deux premières années.
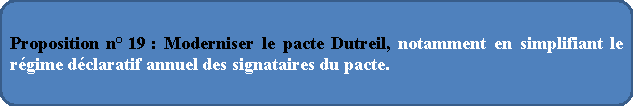
3. Pour la mise en place d’un nouveau statut d’investisseur de long terme et la structuration de l’entreprenariat familial
Le plus simple serait de considérer que les actions détenues en direct soient sorties de l’assiette de l’ISF à l’instar d’un certain nombre d’autres actifs et que la transmission de ces actifs soit forfaitisée. Il semble toutefois que cette proposition, bien qu’économiquement efficace, ne soit pas consensuelle et semble trop « généreuse » au regard du contexte des finances publiques que nous connaissons.
Une autre piste mérite d’être explorée. L’ASMEP-ETI (devenu depuis le mois de mai 2015 le METI) a proposé que soit créé un régime de défiscalisation plus avantageux en lien avec une condition de détention plus longue, fixée à dix années.
Ce nouveau statut d’investisseur de long terme aurait une double traduction fiscale :
– il serait en premier lieu assorti d’un pacte Dutreil renforcé permettant d’exonérer totalement la transmission des entreprises réalisées dans un cadre familial ;
– il serait en outre accompagné d’un assouplissement du régime de l’ISF applicable aux membres de la famille qui, désireux de rester dans le capital de l’entreprise familiale, ne sont pas en mesure toutefois d’assurer les fonctions de direction qui leur permettent de bénéficier de l’exonération d’ISF.
Ce statut permettrait de rapprocher la fiscalité applicable aux transmissions d’entreprises en France du régime extrêmement avantageux en vigueur en Allemagne.
La transmission d’entreprise en Allemagne
Depuis 2008, la transmission d’une entreprise est exonérée à hauteur de 85 % lorsque l’héritier ou le donataire maintient l’activité et l’emploi pendant cinq ans. Cette exonération est portée à 100 % au bout de sept ans ou si l’entreprise transmise compte moins de vingt salariés.
Toutefois, une décision du 17 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle allemande a jugé que ce dispositif était trop avantageux.
Les juges constitutionnels ont reconnu la nécessité de protéger les PME lorsqu’elles sont transmises à des descendants, pour ne pas les menacer dans leur existence « par des considérations fiscales », selon les termes du vice-président de la Cour. Les juges ont donc demandé au législateur d’imposer des conditions plus restrictives en termes de garantie d’emploi et de salaires aux entreprises familiales de petite taille – notamment les sociétés de moins de 20 salariés − en échange des allégements fiscaux dont elles bénéficient.
Le 8 juillet 2015, le Gouvernement a donc déposé un projet de loi prévoyant d’alourdir la fiscalité sur les plus grosses transmissions. Ainsi, en dessous de 26 millions d’euros, les règles actuelles continueront à s’appliquer.
Au-delà de 26 millions d’euros de capital, en revanche, les règles se durcissent, conformément à la demande des juges constitutionnels. Pour bénéficier d’une exonération d’impôt, l’héritier devra dorénavant apporter la preuve que la charge fiscale liée à la succession est trop lourde pour lui, c’est-à-dire qu’elle dépasse 50 % de son patrimoine personnel. Une exception est toutefois prévue pour les entreprises familiales. Si elles satisfont à certaines conditions, elles ne seront soumises à ces nouvelles règles que pour un capital de plus de 52 millions d’euros.
Plus largement, la mission recommande de poser un cadre législatif pour l’action des family offices qui sont, en France comme dans de nombreux autres pays développés, chargés d’organiser le développement des activités familiales.
Cette structuration permettra également de clarifier les relations entre l’entreprise familiale et la fondation qui en constitue bien souvent le prolongement.
Selon une étude du cabinet Prohil réalisée en lien avec le cabinet d’avocat Delsol et avec le soutien de Mazars (42), les fondations actionnaires sont de plus en plus utilisées pour loger l’actif de l’entrepreneur ; l’étude cite les cas d’Ikéa, de Bosch ou Bertelsmann en Allemagne, de Rolex ou Sandoz en Suisse. Pour la France, ce modèle est utilisé par les laboratoires Pierre Fabre, le groupe de presse La Montagne ou la fondation Mérieux.
Selon cette étude, la fondation devient actionnaire de la société au terme d’une donation qui « ne va pas de soi » ; en effet, elle « inverse les rôles classiquement admis : ce n’est plus l’entreprise qui alloue une part infime de ses bénéfices à une fondation périphérique, mais la fondation qui détient l’entreprise elle-même, oriente directement ou indirectement sa stratégie et finance, grâce aux dividendes qu’elle perçoit des causes d’intérêt général ».
L’objet d’une telle fondation ne se limite pas à soutenir des projets culturels ou sociaux accessoires mais il est « en priorité de protéger l’entreprise, maintenir le patrimoine industriel sur le territoire national, de développer l’emploi tout en servant le bien commun ».
Il semble toutefois que la législation mérite une clarification dans ce domaine : l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) prévoit que « dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation ».
La condition posée par cette rédaction, eu égard aux enjeux stratégiques de contrôle de l’entreprise explicités précédemment, est restrictive et donne lieu à des contrôles de l’administration et du juge. Il convient donc de l’ajuster afin que le principe de spécialité de la fondation ne soit pas interprété comme un élément limitant.
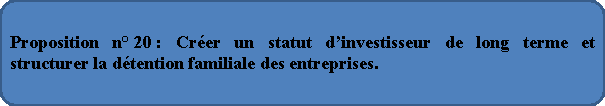
V. CONCLUSION : ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DES PRÉCONISATIONS DU PRÉSENT RAPPORT
Les rédacteurs de ce rapport sont conscients que l’état actuel de nos finances publiques ainsi que l’effort fiscal qui est demandé aux Français rendent difficile le souhait de certains de leurs interlocuteurs d’une baisse massive de l’imposition des revenus du capital, par exemple, ou de la taxation de sa détention.
Les mesures qui sont proposées n’entraineraient pas un coût fiscal majeur mais permettraient de lever un certain nombre d’obstacles pour accélérer la croissance des entreprises françaises, leur passage de PME en ETI et donc d’avoir un véritable effet structurant sur l’emploi marchand.
En règle générale, les propositions d’élargissement ont une portée relativement limitée et le surcoût correspondant devrait être en partie compensé par certaines propositions qui se traduisent, au contraire, par une réduction de la dépense fiscale.
1. Évaluation du coût brut des propositions
Le tableau ci-dessous tente d’établir une étude d’impact budgétaire global des propositions, sachant que l’Assemblée nationale ne dispose pas des bases de données de l’administration fiscale pour pouvoir réaliser des chiffrages précis.
ESSAI DE CHIFFRAGE DU COÛT BRUT DES PROPOSITIONS DU RAPPORT
(en millions d’euros)
PROPOSITIONS |
MÉTHODOLOGIE |
IMPACT BUDGÉTAIRE |
Mise en conformité européenne de l’ISF-PME et du Madelin |
La simple transposition des nouveaux plafonds devrait se traduire par une réduction de la dépense fiscale. |
– 50/– 60 |
Augmentation des plafonds et des taux de l’ISF-PME et du Madelin, placement du Madelin sous le plafond à 18 000 euros |
L’ISF-PME représente en 2015 une dépense fiscale de 468 millions d’euros, le Madelin une dépense de 160 M€ en comprenant la Corse et l’Outre-Mer |
+ 100/+ 110 |
Adaptation du dispositif du mécénat en faveur des réseaux de création d’entreprise |
L’ensemble de la dépense fiscale du mécénat représente 790 M€ en 2015 mais l’élargissement proposé est très limité |
+ 20/+ 30 |
Simplification des modalités de calcul de l’ISF-PME et du Madelin en cas d’investissement intermédié |
+ 20/+ 30 | |
Définition de la notion de holding animatrice |
0 | |
Relancer le dispositif de corporate venture |
Le dispositif a en principe été budgété lors de son vote pour un montant de 10 M€ en 2014 jusqu’à 200 M€ à compter de 2019. |
+ 10/+ 20 |
Assouplir les conditions de sortie des investisseurs historiques tout en conservant leur avantage fiscal |
Le coût est négligeable dans la mesure où ces investisseurs respectent la condition de détention en vigueur pour conserver leur avantage fiscal |
0 |
Élargissement du PEA-PME à certains titres financiers |
Coût très négligeable compte tenu de la spécificité des titres |
+ 5/+ 15 |
Favoriser la sortie de l’assurance vie en rente viagère |
0 | |
Ajuster l’application de l’abattement aux moins-values mobilières |
+ 75/+ 85 | |
Ajustement de la notion de bien professionnel |
L’exonération n’est pas chiffrée dans le fascicule Voies et moyens |
0 |
Assouplissement du pacte Dutreil |
Dans son volet applicable aux transmissions, le pacte Dutreil se traduit par une dépense fiscale de 500 M€. Toutefois, les aménagements proposés sont de portée très limitée |
+ 20/+ 30 |
Création d’un statut d’investisseur de long terme |
+ 150/160 |
Au total, l’ensemble des mesures prévues ci-dessus devrait se traduire par un coût global de l’ordre de 350 à 450 millions d’euros. Compte tenu de l’état des finances publiques, cette fourchette représente un effort important, qui peut toutefois être rapproché de ceux qui ont été consentis récemment dans le cadre de la loi « Macron » (l’allègement de la fiscalité sur les attributions gratuites représente, à titre d’exemple, un coût de 125 millions d’euros en année pleine).
2. Pour une évaluation dynamique des effets de la relance fiscale
Évidemment, le coût des mesures proposées par la mission ne saurait être pris pour son seul montant brut. Il est important de garder à l’esprit que de telles dépenses fiscales ont un effet d’entraînement sur l’investissement et que cet investissement vise à un accroissement du chiffre d’affaires des entreprises qui les réalisent.
À titre d’exemple, le dispositif de corporate venture, tel que chiffré par le Gouvernement, devait avoir un coût fiscal de 200 millions d’euros en année pleine, c’est-à-dire à compter de 2019. Il devait également permettre des investissements dans les PME de 600 millions d’euros.
D’autre part, le dispositif du CICE devrait, selon les prévisions réalisées par le modèle MESANGE de la direction générale du Trésor, se traduire par une augmentation de 0,9 point de PIB à l’horizon 2017 et 1,1 point de PIB à l’horizon 2022 ; autrement dit, la dépense fiscale de 20 milliards d’euros du CICE se traduirait par une croissance de 20 à 25 milliards d’euros.
3. Cette dépense fiscale peut être gagée par une réduction des aides moins efficaces aux entreprises
Les dépenses nouvelles préconisées par le présent rapport méritent également d’être mises en regard d’autres dispositifs à destination des entreprises, dont l’efficacité a parfois été remise en cause par des rapports récents.
Pour mémoire, le rapport réalisé par MM. Jean-Philippe Demaël, Philippe Jurgensen et Jean-Jack Queyranne en juin 2013 (43) proposait des économies sur les aides aux entreprises dont le montant s’élevait à 3 milliards d’euros.
Ce rapport avait pour ambition de passer en revue une masse financière de 46,5 milliards d’euros de dépenses publiques « qui peuvent être considérées, dans un sens très large, comme étant des interventions en faveur des acteurs économiques ».
Si le rapport propose conforter plusieurs instruments notamment en faveur de l’investissement des particuliers (FCPR, PCPI, PEA) et le régime des jeunes entreprises innovantes, il préconise par ailleurs de réaliser des économies substantielles en réformant d’autres dispositifs d’aide aux entreprises.
La mise en œuvre des préconisations du rapport d’évaluation des niches fiscales ou sociales de 2011 permettrait, à lui seul, de générer 400 millions d’euros d’économies. La mission ne peut, entre autres, que renvoyer à certains débats qui ont encore eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi « Macron » portant sur le régime fiscal avantageux dont bénéficie l’épargne logement. Cet avantage est chiffré à 735 millions d’euros en 2015, alors que le rapport d’évaluation des niches fiscales de 2011 a clairement démontré que l’efficacité des dispositifs d’épargne logement était très faible : le nombre de PEL se dénouant par un prêt est seulement de 11 %.
La Commission examine le rapport de la mission d’information sur l’investissement productif de long terme (MM. Christophe Caresche et Olivier Carré, rapporteurs) au cours de sa séance du mercredi 16 septembre 2015.
M. le président Gilles Carrez. MM. Christophe Caresche et Olivier Carré vont nous présenter le rapport de leur mission d’information sur l’investissement productif de long terme, créée par notre commission le 1er décembre 2014. Ce travail, très important, pourra nous servir de support dans la rédaction des amendements au projet de loi de finances (PLF) pour 2016.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Notre étude est vaste, car son sujet touche à beaucoup de domaines : nous avons examiné l’ensemble de la chaîne de financement des entreprises, de l’amorçage à la transmission, en passant par le développement.
L’accès des entreprises au financement s’avère satisfaisant dans notre pays, mais certaines particularités freinent la fluidité du système ; ainsi, les investissements ne soutiennent pas suffisamment l’innovation, et les détenteurs d’épargne privilégient souvent les placements les moins risqués. Nous devons donc œuvrer pour mieux orienter l’épargne vers les entreprises, notamment celles qui viennent de se créer et celles qui sont les plus innovantes.
M. Olivier Carré, rapporteur. Les différentes majorités parlementaires ont tenté de résoudre ces difficultés en mettant en place de nombreux dispositifs et en faisant évoluer la législation financière et fiscale. Cependant, ces réformes n’ont pas toujours porté leurs fruits. Alors que la France consent d’importants efforts financiers dans ce domaine – plus élevés que dans les pays anglo-saxons –, les entreprises croissent plus difficilement dans notre pays qu’ailleurs. Le rapport de nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre sur l’épargne financière avait déjà dressé ce constat, et nous avons prolongé cette observation, y compris en matière de fiscalité applicable au dirigeant. Notre étude, exhaustive, met en lumière de très nombreuses scories, souvent d’origine réglementaire ou jurisprudentielle, qui contrarient la volonté des majorités successives, cette question dépassant souvent les clivages partisans comme la rédaction de cette étude en apporte une nouvelle fois la preuve.
Notre rapport peut paraître technique, car il propose plusieurs mesures ciblées, mais celles-ci sont assises sur une vision d’ensemble commune à celle ayant animé la rédaction de rapports précédents. Ces derniers ont certes conduit à l’adoption de dispositions législatives qui ont permis de mobiliser des masses financières importantes, mais nous devons encore lever les verrous qui existent en plusieurs endroits de cette chaîne de financement.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Nous proposons de renforcer l’attractivité de certains dispositifs fiscaux, mais de manière raisonnable pour prendre en compte la situation des finances publiques. Une partie du rapport vise à « dégripper » ces investissements en se penchant sur les mesures permettant de rendre les outils plus cohérents.
Au stade de l’amorçage, on constate que les levées de fonds n’ont toujours pas retrouvé leur niveau d’avant la crise financière. L’intensité du capital amorçage présente de grandes disparités régionales, les investisseurs, notamment les business angels, se concentrant en Île-de-France et en Rhône-Alpes. En outre, les montants mobilisés restent insuffisants pour assurer la croissance de nombreuses entreprises. Nous suggérons donc de modifier les deux instruments fiscaux attachés à ce type d’investissement que sont le Madelin et l’ISF-PME. Il nous apparaît opportun d’harmoniser ces deux dispositifs afin de réduire les distorsions nées des différences de cibles en termes d’investisseurs et d’entreprises qu’ils visent. Ce mouvement s’avère d’autant plus nécessaire que la Commission européenne a demandé à la France de modifier ces outils qu’elle assimile à des aides d’État. Nous proposons ainsi de concentrer l’ISF-PME sur les entreprises les plus récentes.
M. Olivier Carré, rapporteur. Le droit de l’Union européenne dispose que le soutien fiscal aux entreprises peut être assimilé à des subventions. Cependant, les gouvernements successifs ont instauré ces dispositifs parce qu’ils avaient constaté le manque d’appétence pour les investissements directs ou indirects dans les entreprises dans notre pays ; ces instruments visent donc à inciter l’investisseur – et non l’entreprise – à placer son épargne dans les entreprises et à compenser une partie du risque qu’il prend.
Pour une dépense fiscale équivalente, il est possible d’augmenter les montants unitaires, notamment ceux de l’ISF-PME qui reposent sur un taux de 50 % et un plafond de 90 000 euros, soit une déduction maximale de 45 000 euros. Afin d’accroître les fonds propres des entreprises, il paraît opportun d’en élever le plafond et d’en diminuer le taux. Cette piste est intéressante, car les fonds proviennent de contribuables qui bénéficient du bouclier fiscal de 75 % d’imposition globale. Avec une telle évolution, l’efficacité économique du système serait plus forte sans que la dépense fiscale ne croisse.
Nous proposons également des modifications de forme sur les souscriptions de titres vifs, sous mandat et par organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), que l’on pourra examiner lors de la discussion du PLF pour 2016 et qui sont susceptibles de rapporter des recettes à l’État.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Nous proposons d’augmenter l’avantage fiscal, car le plafonnement actuel de 10 000 euros conduit à une concurrence entre les dépenses et à des arbitrages défavorables aux placements dans les entreprises. Si l’on crée des cibles à l’intérieur de chaque mécanisme éligible à l’avantage fiscal, on ne lève pas les contraintes pesant sur l’investissement dans les entreprises ; on pourrait donc placer ces niches fiscales sous le plafond de 18 000 euros, et nous avons prévu les recettes qui pourraient absorber ce coût supplémentaire.
M. Olivier Carré, rapporteur. Cette augmentation du plafond constitue la mesure la plus coûteuse de notre rapport.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Nous proposons également d’élargir aux réseaux de créateurs d’entreprises l’accès à la réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) liée aux dons de mécénat, aujourd’hui très restreint.
Il convient aussi de mieux encadrer le financement participatif – ou crowdfunding –, ce qui ressort des compétences de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La phase de croissance et de développement s’avère extrêmement sensible pour les entreprises – on la nomme même la « vallée de la mort » ; nombre d’entre elles périssent à cause d’une impossibilité de trouver de nouveaux financements. C’est pourquoi il y a lieu de rationaliser, de simplifier et de rendre plus lisible l’action des fonds d’investissement. Il s’agirait, entre autres, d’harmoniser les ratios utilisés par les fonds et de lever certaines contraintes réglementaires qui ont un impact sur la gestion de ces structures. En effet, le cadre actuel aboutit à privilégier la défiscalisation au bon investissement dans l’entreprise.
M. Olivier Carré, rapporteur. L’Union européenne propose d’instaurer un nouveau véhicule, le Fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF pour European long term investment fund), qui préfigurera la convergence de tous les fonds opérant dans ce domaine. La question du bénéfice fiscal que gagneront les particuliers à souscrire à ces fonds reste ouverte. Plus généralement, ce champ va connaître d’importants changements, si bien que toute instabilité fiscale perturberait les collectes, l’exercice du métier de gérant et l’efficacité du système français. Nous devons être attentifs et surveiller l’action des services du ministère de l’économie et des finances sur ce point.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Une concurrence dissimulée se développe entre les souscriptions directes – via les dispositifs Madelin et ISF-PME – et les souscriptions effectuées auprès des fonds. Lorsqu’un redevable investit directement dans une petite et moyenne entreprise (PME), il peut imputer l’intégralité de la somme versée, ce qui n’est pas le cas s’il investit via un fonds. Il faudrait donc harmoniser le mécanisme entre souscriptions directe et intermédiée.
Nous nous sommes aussi penchés sur la question des holdings animatrices, dont l’action génère un important contentieux. Le législateur n’a que partiellement précisé leur cadre juridique. Nous ne recommandons pas qu’il s’en empare de crainte qu’il n’arrête une définition trop figée. L’administration fiscale devrait, en revanche, élaborer une instruction fiscale précisant ce qu’elle entend par « holding animatrice », afin de sortir de la situation d’insécurité juridique qu’ont dénoncée nombre de nos interlocuteurs. Le passage d’un régime à l’autre emporte, en effet, de lourdes conséquences financières.
M. Olivier Carré, rapporteur. Les professionnels comme les notaires et les gestionnaires de fonds, et les acteurs internes à l’entreprise – dirigeants et syndicat des entreprises intermédiaires (ASMEP-ETI) – nous ont alertés sur l’intégration des questions juridiques par les entreprises dans la formulation de leur stratégie ; que ce soit l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui a structuré une partie du capitalisme français en 1981, le pacte Dutreil en 2003 ou l’exclusion de l’outil de travail de l’assiette de l’ISF. Ainsi, dans le cas d’une requalification juridique pour une holding possédant cinquante-deux participations, quarante-deux entreprises ont disparu et seules dix ont survécu ! Combien d’entreprises n’ont pu se développer et créer de l’emploi à cause de la complexité de la fiscalité française sur le capital ? Le sujet de la fiscalité du patrimoine peut nous séparer sur le principe, mais nous devons avoir à l’esprit des éléments pratiques comme ceux que nous soulevons à chaque examen de l’amendement sur les œuvres d’art et l’ISF. Tant que les entreprises resteront, de près ou de loin, soumises à l’ISF, la fiscalité aura des conséquences économiques sur le tissu industriel.
M. Christophe Caresche, rapporteur. La loi a créé en 2013 et adapté en 2014 le dispositif de corporate venture, qui permet aux grandes entreprises d’investir dans des PME pour favoriser leur développement. Ce mécanisme nous semble très intéressant, et nous souhaitons qu’il soit renforcé.
Lorsque l’entreprise se développe, les investisseurs institutionnels remplacent les investisseurs historiques et individuels, et cette transition ne se déroule pas toujours bien. Les investisseurs historiques tendent à préserver l’avantage fiscal, lié à une durée de détention, plutôt que de s’assurer de la bonne gestion de l’entreprise. Notre collègue Bernadette Laclais avait déposé des amendements dans le cadre de l’examen du dernier PLF, et nous proposons, à notre tour, de faire évoluer le système, mais de manière quelque peu différente : pendant deux ans, la sortie de l’investisseur serait bloquée, et elle ne deviendrait possible les trois années suivantes que sous condition de réinvestissement dans les douze mois.
L’instrument du PEA-PME a du mal à prendre son envol, et le Gouvernement a déjà tenté de le rendre plus attractif. Nous ne proposons pas de modifier l’avantage fiscal, mais nous aimerions que des titres qui ne sont pas actuellement éligibles à ce produit – comme les bons de souscription d’actions et les droits préférentiels de souscription – le deviennent.
M. Olivier Carré, rapporteur. Nous reprenons la proposition qui nous a été présentée d’utiliser les abondantes trésoreries des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) dormantes. Les détenteurs ne les vendent pas à cause de la fiscalité actuelle et attendent une transmission qui ne permettra pas à l’État de récupérer la plus-value sous-jacente de ces fonds. Il s’agirait de permettre la mobilisation de l’épargne très dormante en offrant la possibilité de souscrire un PEA-PME à l’occasion du transfert de ces SICAV. Ces dernières ne seraient pas abritées, car l’objectif est d’inciter à leur liquidation lors de la transmission, celle-ci se faisant de manière exceptionnelle en franchise d’impôt sur les plus-values et de droit. Cela nous semble raisonnable sur le plan fiscal et opportun pour relancer le PEA-PME.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Nous suggérons également de favoriser la sortie de l’assurance vie en rente viagère par rapport à celle en capital.
M. Olivier Carré, rapporteur. En effet, les ratios de détention dans les fonds cantonnés reposent, pour les compagnies d’assurances, sur l’obligation de pouvoir à tout moment assurer la sortie en remboursement en capital. Cela a contraint ces sociétés à présenter un ratio de fonds propres bien supérieur depuis l’entrée en vigueur de Solvency II, du moins si une partie des actifs qu’elles détiennent sont des actions. Dans un mécanisme de sortie en rente viagère, les ratios prudentiels sont plus faibles si le portefeuille est diversifié et incorpore une part significative d’actions. On ne doit plus décourager la sortie en rente viagère par une fiscalité plus lourde que celle frappant le transfert de capital. Si le système était ainsi rééquilibré, nous pensons que les souscripteurs demanderaient beaucoup plus fréquemment des fonds assortis en rente viagère, ce qui permettrait une réallocation des actifs bien plus favorable aux actions du fait d’un moindre besoin en fonds propres. Les enjeux sont importants, car l’assurance vie, premier placement en valeurs mobilières des Français, draine plus de 1 500 milliards d’euros. Les conséquences fiscales de cette évolution sont limitées alors que la masse financière qui pourrait ainsi s’investir en fonds propres dans les entreprises est très importante.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Nous avançons plusieurs propositions de modernisation du pacte Dutreil, à la suite d’amendements déposés à l’occasion de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron. Le sujet des biens professionnels s’avère essentiel aux yeux des entrepreneurs, et le régime fiscal entraîne ainsi de nombreux rachats d’entreprises qui n’ont pas réussi à assurer leur transmission.
M. Olivier Carré, rapporteur. Les pactes Dutreil sont efficaces après le lancement de l’entreprise, mais au fur et à mesure des changements d’actionnaires, le maintien du pacte sclérose les mouvements à l’intérieur de l’entreprise et nourrit l’instabilité juridique. Nos interlocuteurs nous ont affirmé que la principale solution à ce problème était la cession de l’entreprise en bloc. Voilà pourquoi de nombreuses petites entreprises en croissance sont absorbées par des groupes ou délocalisent leur production. Le facteur fiscal est déterminant ; ce n’est pas 1 à 2 % de la valeur de l’entreprise qu’il concerne, mais le tiers voire la moitié. D’où la suggestion d’élaborer un statut de l’investisseur de long terme, qui permettrait de sortir les biens économiques de la fiscalité patrimoniale de celle applicable aux transmissions pour les intégrer au régime de droit commun des autres véhicules d’épargne et des biens immobiliers. Il s’agit d’une question cruciale, car elle structure l’économie française.
M. Christophe Caresche, rapporteur. L’administration fiscale a décidé d’étendre le régime d’abattement sur les plus-values aux moins-values, ce qui pose de nombreux problèmes, dont le rapport fait état. L’interprétation de l’administration s’avère, en tout cas, contraire à l’intention du législateur.
M. Olivier Carré, rapporteur. Je la qualifierais même d’abusive.
M. Dominique Lefebvre, président. Au nom de la commission, je tiens à remercier les rapporteurs pour la qualité de leur exposé et de leur travail. Nous connaissons bien ce sujet important qui n’a pas fini de nous occuper.
Mme Valérie Rabault, rapporteure générale. À chaque projet de loi de finances, nous sommes sollicités par différents acteurs, dont les représentants syndicaux, au sujet des holdings animatrices. Connaissez-vous le nombre d’entreprises concernées ? Je n’ai jamais pu obtenir l’information.
Je vous remercie, messieurs les rapporteurs, d’avoir dressé un état des lieux précis et exhaustif de la question de l’investissement productif de long terme. Je partage votre point de vue sur la décision, quelque peu ahurissante, de l’administration fiscale d’élargir le régime d’abattement sur les plus-values aux moins-values.
M. Alain Fauré. Nous souhaitons que de plus en plus d’entreprises se créent et se développent dans notre pays. Pour ce faire, nous devons envoyer à la population un message d’incitation à entreprendre, en insistant sur le fait qu’il est possible et positif d’entreprendre. Sans cela, tous les clichés erronés véhiculant l’idée qu’il est impossible d’investir en France et d’y créer des entreprises continueront de freiner les vocations. Qui sait que l’on peut toucher quinze mois de salaire, versés par Pôle emploi, pour se lancer sereinement dans une aventure entrepreneuriale ? Personne ! Il conviendrait de faire œuvre de pédagogie.
Au cours du dernier trimestre de 2014, 93 % des entreprises françaises ont trouvé un financement pour leurs investissements. Là aussi, nous vivons avec une fausse idée, propagée dans les selon laquelle il y aurait un problème de financement de l’économie.
On aura beau créer tous les outils fiscaux du monde, le créateur d’entreprise ne se pose pas des questions de rentier lors des quinze premières années d’activité ; il se préoccupe de son développement, de son financement et de la recherche d’un conseil régulier – qu’il leur est difficile d’avoir, d’ailleurs, la plupart des dirigeants des entreprises de moins de cinquante salariés changeant tous les ans d’interlocuteur dans leur banque. Certaines entreprises disparaissent à cause de problèmes de trésorerie ponctuels. Leur survie dépend alors souvent de la connaissance de leur histoire par le conseiller bancaire.
Quand l’entreprise se développe, elle a besoin de conseils. Certaines régions ont créé des postes d’apprentis conseillers, qui n’ont jamais entrepris de leur vie, qui vous noient sous tous les conseils du monde et qui, quoi qu’ils en disent, ne vous accompagnent pas dans le temps car, eux aussi, changent de poste très rapidement. Cette situation se constate partout, indépendamment de l’orientation politique de la région. Les cellules d’accompagnement des chefs d’entreprise devraient être beaucoup plus restreintes pour accompagner ces dirigeants plus efficacement.
Messieurs les rapporteurs, vous n’évoquez pas les plans de sauvegarde, qui font partie de l’accompagnement d’une entreprise. Il faut les pérenniser et en expliquer le fonctionnement au public concerné ; ce système est méconnu, alors qu’il peut permettre à des entreprises de continuer leur activité.
En matière de transmission, il faut en finir avec la niche « Copé ». Celle-ci permet à une grande entreprise de racheter une plus petite structure, souvent riche d’idées et de salariés, et de la revendre en en tirant une plus-value qui n’est pas taxée. Et cela est très rapide : dès après le rachat, les licenciements, nombreux, interviennent, les brevets sont estimés, un audit financier est engagé, et l’entreprise est revendue au bout de deux ou trois ans. Ainsi l’on tue des entreprises, puisque celui qui rachète la société se retrouvera avec un personnel moins qualifié et moins de brevets.
Lorsqu’une personne a dirigé une entreprise pendant vingt ou trente ans et s’apprête à la transmettre, il y a lieu d’agir pour maintenir la continuité de l’activité qui a créé de la richesse dans un territoire.
M. Marc Goua. Messieurs les rapporteurs, je vous remercie de votre travail, ne serait-ce que parce qu’il met en lumière la complexité des systèmes mis en place qui ne facilite pas l’investissement. Nous devons simplifier et améliorer les dispositifs existants sans changer trop fréquemment la règle du jeu.
Les fonds sont très nombreux puisque tous les établissements bancaires et toutes les compagnies d’assurances en possèdent, si bien que les montants de capitaux se révèlent souvent faibles ; cette situation entraîne un morcellement des participations contre lequel il conviendrait de lutter.
Les gens craignent l’interprétation des textes fiscaux effectuée par l’administration, parfois même à l’échelon de ses services régionaux. Cela crée une insécurité juridique qui ne favorise pas la croissance des entreprises.
L’appétit des Français pour la création d’entreprises reste limité et leur activité boursière s’effondre. Le goût du risque n’est pas développé dans notre pays.
M. Jean-Claude Fruteau. J’ai pris un grand intérêt à entendre nos collègues exposer les propositions de leur rapport. Vous suggérez, messieurs les rapporteurs, de « placer l’avantage Madelin sous le plafond à 18 000 euros ». J’émets les plus grandes réserves à l’égard de cette idée, car, comme vous l’indiquez vous-mêmes dans votre rapport, cette piste revient à aligner le régime Madelin sur celui du crédit d’impôt en faveur de l’outre-mer. Cette position, qui pourrait a priori passer pour vertueuse, placerait sur un pied d’égalité le Madelin avec un instrument qui représente l’une des rares sources de financement du logement social en outre-mer où existe encore de l’« habitat indigne ». La mise en œuvre de votre proposition pourrait diminuer l’attractivité de l’investissement outre-mer. Je demande donc que l’on pèse donc toutes les conséquences d’une telle évolution.
M. Razzy Hammadi. Merci, messieurs les rapporteurs, pour ce travail qui nous donne des éléments permettant d’appréhender la complexité de notre système à la veille de l’examen du PLF, qui ressemble de plus en plus à un débat d’initiés.
Si, pour nous, la question de l’investissement productif de long terme relève du domaine de l’entreprise, les fonds d’investissement de long terme sont aussi productifs alors qu’ils soulèvent de nombreuses incompréhensions. Le rapport aurait donc pu évoquer les suites des mesures prises dans la loi de finances de 2013 en matière d’impôt sur les sociétés des fonds d’investissement en infrastructures.
Vous évoquez rapidement la question des mini-bonds en vous appuyant sur le rapport de Paris Europlace de mars 2014, qui se concentre sur le financement des entreprises par dette obligataire. Dans votre rapport, vous insistez sur la facilité d’accès à ce type de financement, alors que son régime s’avère inadapté fiscalement et difficile. Par rapport à l’Italie et à l’Allemagne, le financement par dette obligataire en est à l’âge préhistorique dans notre pays. Les entreprises réalisant plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires arrivent à agir dans ce domaine, mais cela s’avère bien plus délicat pour les sociétés effectuant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires à cause du coût, de la complexité et de la vitesse de réalisation d’une telle opération. Il y a lieu d’élaborer des préconisations dans ce domaine qui se distinguent du rapport que vous citez dans votre étude.
Mme Véronique Louwagie. Merci, chers collègues, des propositions riches et diverses contenues dans votre rapport. Nous devons encourager les entreprises à prendre les décisions d’investir, et, pour ce faire, il convient de renforcer la sécurité juridique. La complexité des mécanismes crée, en effet, des difficultés, et nous devons au moins veiller à la stabilité des dispositifs et évaluer les impacts des modifications législatives et réglementaires sur le cadre dans lequel agissent les dirigeants d’entreprise.
Vos onzième et douzième propositions concernent le PEA-PME, instrument qu’il faut promouvoir. Le dispositif est une réussite partielle, car si 80 000 plans d’épargne en actions (PEA) ont été souscrits, les montants restent faibles puisque l’encours moyen n’excède pas 3 500 euros. Nous devons parvenir à flécher l’épargne des particuliers vers les entreprises, et vos suggestions reprennent les amendements que j’avais déposés à l’occasion de l’examen de la loi Macron. Le ministre de l’Économie, de l’industrie et du numérique n’était pas opposé à leur orientation, mais il souhaitait réfléchir à la question.
J’espère que nous nous saisirons tous des propositions de votre rapport à l’occasion du prochain examen du PLF.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens l’objectif de réorientation de l’épargne vers l’investissement à risque et la création d’entreprise. En revanche, je ne suis pas favorable, par souci de cohérence, au relèvement de 10 000 à 18 000 euros du plafond des niches fiscales, puisque nous avons récemment effectué le mouvement inverse. Nous devrions plutôt nous pencher sur les 6 000 aides économiques, identifiées par le rapport de M. Jean-Jack Queyranne, qui représentent un coût de 3 milliards d’euros et dont certaines mériteraient d’être revues. Nous pourrions également mobiliser d’autres niches fiscales en faveur de l’investissement.
Par ailleurs, il y a lieu de réfléchir à un système incitant les entreprises à développer l’actionnariat salarié.
M. Éric Alauzet. Messieurs les rapporteurs, merci pour ce travail qui ne prévoit pas de « grand soir » de l’investissement productif, mais qui repose sur un examen précis débouchant sur des propositions méritant probablement pour la plupart d’être mises en œuvre.
Nous savons que l’avantage fiscal peut être qualifié de subvention déguisée par l’Union européenne ; par contre, la fiscalité avantageuse de certains pays n’entre pas dans cette catégorie. Il faut s’attaquer à cette différence de traitement.
Malgré la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, il reste de l’argent dormant. Le Sénat n’a malheureusement pas retenu l’un de nos amendements à la loi Macron, qui prévoyait d’aller plus loin pour mobiliser des fonds, dont certains se trouvent à l’étranger et notamment en Suisse. Une fois récupérés, ces fonds pourraient alimenter l’investissement productif.
Afin de mobiliser la colossale épargne des Français, qui s’avère mal orientée, il conviendrait de développer les fonds dédiés, car nos concitoyens souhaitent connaître la destination de leur argent. Ces fonds devraient être transparents, respecter les lignes directrices de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et générer des rendements connus à l’avance et sécurisés pour vingt ans. Les infrastructures énergétiques et des projets d’énergie renouvelable sont souvent financés par des fonds de pension étrangers, ce qui donne des arguments aux associations de riverains qui refusent ces travaux ; on gagnerait beaucoup à orienter l’épargne des Français vers des projets précis et aux rendements sûrs.
Si l’on augmente le plafond de la défiscalisation à 18 000 euros, on complexifie le système en créant de nouvelles dérogations. Il serait préférable de trouver un autre instrument pour agir.
M. Alain Fauré. Messieurs les rapporteurs, votre vingtième proposition vise à « créer un statut d’investisseur de long terme et structurer la détention familiale des entreprises ». Il est dommage que le rapport ne la développe pas davantage, car c’est l’augmentation de la participation des salariés dans l’actionnariat des entreprises – jusqu’à 50 % aujourd’hui – plus que les réformes lancées par M. Gerhard Schröder qui a permis à l’Allemagne de croître au cours des dernières années. En effet, l’association à long terme des salariés à la vie de l’entreprise s’avère très positive.
M. Dominique Lefebvre, président. MM. les rapporteurs ont inscrit leur travail dans le contexte de la forte contrainte qui pèse sur les finances publiques. Des mesures qualitatives touchant à l’environnement de l’investissement productif de long terme sont nécessaires, comme l’a souligné Alain Fauré, et elles doivent s’accompagner de la réorientation de certains dispositifs, l’action publique devant suivre une démarche globale.
Du point de vue de la commission des finances, les demandes relatives au plafonnement des dépenses fiscales des particuliers se multiplient ; deux dispositifs – les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) et le Malraux – ont échappé au plafonnement, et nous faisons face à de nombreuses revendications d’extension du plafond des dispositions relatives à l’outre-mer. L’accroissement du plafond des mécanismes visant à soutenir l’investissement nous conduirait à le remonter pour l’ensemble des dispositifs, ce qui créerait une grande difficulté pour les finances publiques. Cette proposition ne sera donc sans doute pas reprise, mais votre rapport en énonce bien d’autres qu’il serait opportun de mettre en œuvre.
M. Olivier Carré, rapporteur. Nous ne connaissons pas le nombre de holdings animatrices, et je tiens à souligner que les services de Bercy n’ont d’ailleurs pas répondu à plusieurs de nos demandes.
Les territoires d’outre-mer doivent considérer qu’il existe des intérêts qui les concernent spécifiquement, mais qui importent aussi pour l’ensemble de notre pays.
Nous avons été sensibles au contexte budgétaire et nous avons écarté de nombreuses suggestions en matière fiscale. Christophe Caresche et moi-même nous nous séparons sur la question de l’ISF, puisque, à la différence de mon collègue, j’en souhaite la suppression. Nous avons étudié un mécanisme touchant à la détention d’actions, mais nous n’avons pas pu évaluer son coût pour les finances publiques, si bien que nous l’avons pas formulé. Nous avons donc cherché des effets de levier en jouant sur les assiettes et les taux sans que le coût pour les finances publiques en soit plus élevé.
Monsieur Fauré, il est possible de créer des entreprises en France, et notre pays figure d’ailleurs parmi ceux qui en créent le plus. L’équation entre la capacité de distribution d’argent des acteurs financiers – qu’ils soient bancaires ou institutionnels – et les besoins des entreprises s’avère effectivement bien meilleure que ce que l’on entend généralement. En revanche, les flux n’irriguent pas suffisamment les acteurs qui en feraient l’usage le plus productif. Ainsi, Bpifrance possède des dispositifs de fonds quasiment gratuits, mais elle ne peut les mobiliser que si certains ratios de fonds propres sont respectés. La banque publique d’investissement intervient ainsi à l’amorçage, mais elle n’aide pas à résoudre les problèmes de trésorerie que l’on constate lors du développement des entreprises – et qui, en langage financier, s’appellent tout simplement le besoin en fonds de roulement. Beaucoup d’entreprises dressent ce constat sur le terrain : les dispositifs fiscaux sont importants à l’amorçage, notamment pour les jeunes entreprises innovantes, mais le dispositif se grippe lors de la croissance de la structure, si bien que nous restons un pays de bonzaïs, où les arbres sont beaux et nombreux mais de petite taille.
Le rapport n’annonce pas le grand soir, il vise à repérer les obstacles à l’investissement productif de long terme afin de les lever. Nous ne manquons pas d’argent, mais nous devons favoriser la fluidité des circuits irriguant les entreprises.
Il faut développer l’intérêt des Français pour les actions, qui a décliné, du fait de l’attrait de l’assurance vie qui a cannibalisé toute l’épargne disponible. Il s’avère difficile de réorienter l’épargne du fait de l’obstacle posé par Solvency II. Il convient de chercher, pour les compagnies d’assurances, une répartition de leurs actifs qui leur permette de respecter les obligations de Solvency II tout en utilisant comme effet de levier les masses financières considérables dont elles disposent. Ce travail nous a conduits à élaborer une proposition favorisant la sortie du contrat d’assurance vie en rente viagère pour laquelle les ratios prudentiels diffèrent de ceux de la sortie en remboursement en capital. Il faut noter que cette divergence est logique. Cela permet de développer une allocation d’actifs adaptée aux distributions de revenus et dans laquelle les actions jouent un rôle plus important, puisque, à long terme, elles rapportent plus que les obligations, la théorie n’ayant jamais été démentie malgré les krachs boursiers.
Les compagnies d’assurances ouvrent l’accès du marché obligataire aux entreprises réalisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires – ce qui leur permet de se présenter comme des soutiens des PME –, mais les banques françaises sont en réalité efficaces pour financer les entreprises de cette taille. Nous nous sommes concentrés sur la croissance des entreprises, qui exige davantage de fonds propres que d’endettement, même si la question du financement par l’endettement mériterait sans doute d’être approfondie.
Nous aurions pu également travailler sur l’investissement long et les infrastructures à cinquante ans, mais nous avons privilégié le thème du financement des entreprises.
Je suis tout à fait favorable au développement de l’actionnariat salarié, mais la fiscalité des personnes touche le dirigeant comme le cadre qui a acquis des actions. La France dispose d’outils très compétitifs en matière d’actionnariat salarié – si l’on met de côté la dimension fiscale –, mais il importe de connaître la répartition du pouvoir de décision au sein du conseil d’administration entre les investisseurs extérieurs et les représentants des collaborateurs de l’entreprise. Ces personnes physiques seront donc confrontées, dans une entreprise qui a de bons résultats, aux problèmes posés par la fiscalité et notamment par l’ISF ; or, ces entreprises s’inscrivent dans une compétition internationale et les cadres se situent également en concurrence avec des étrangers pour investir dans ces structures. La fiscalité sur les personnes ne concerne donc pas que vingt dirigeants du CAC 40, mais de très nombreux cadres.
M. Christophe Caresche, rapporteur. Par facilité, les niches fiscales ont été plafonnées de manière globale ; le législateur n’ayant pas statué, c’est au contribuable qu’il revient de procéder à l’arbitrage entre les différents dispositifs auxquels il est éligible. Le législateur devrait au contraire fixer pour chaque niche un plafond et un taux adaptés ; les orientations arrêtées à cette occasion reposeraient alors sur des choix politiques.
La Commission autorise la publication du rapport d’information de la mission d’information sur l’investissement productif de long terme.
Proposition n° 1 : Mettre en conformité les dispositifs ISF-PME et Madelin avec le nouveau cadre communautaire dans la prochaine loi de finances mais en portant les seuils au maximum de ce qui est autorisé.
Proposition n° 2 : Aligner davantage les dispositifs ISF-PME et Madelin.
Proposition n° 3 : Augmenter les plafonds et les taux des avantages ISF-PME et Madelin. Placer l’avantage Madelin sous le plafond à 18 000 euros.
Proposition n° 4 : Mieux informer les investisseurs des risques encourus lors des investissements opérés par le biais d’un site de crowdfunding.
Proposition n° 5 : Adapter le dispositif de mécénat d’entreprise afin de l’orienter davantage vers les réseaux de création d’entreprise.
Proposition n° 6 : Simplifier les modalités de calcul de l’ISF-PME et du Madelin en cas d’investissement intermédié pour les rapprocher de l’investissement direct.
Proposition n° 7 : Simplifier les ratios et les règles de fonctionnement inutiles des FIP et des FCPI. Allonger la durée de vie des fonds de capital-investissement.
Proposition n° 8 : Veiller à ce que l’administration fiscale produise une instruction définissant ce qu’elle considère comme une holding animatrice.
Proposition n° 9 : Mettre en place une politique volontariste dans le domaine du corporate venture.
Proposition n° 10 : Faciliter la sortie des investisseurs historiques en assouplissant les conditions dans lesquelles ils peuvent conserver leurs avantages fiscaux.
Proposition n° 11 : Élargir le type de titres financiers éligibles au PEA-PME et assouplir les règles pesant sur leur utilisation par le biais d’un fonds d’investissement.
Proposition n° 12 : Exonérer d’imposition sur les plus-values mobilières les transferts des OPCVM de trésorerie vers un PEA-PME pendant six mois.
Proposition n° 13 : Favoriser la sortie de l’assurance vie en rente viagère.
Proposition n° 14 : Réformer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention aux moins-values mobilières.
Proposition n° 15 : Poursuivre les efforts de renégociation de la directive Solvency II.
Proposition n° 16 : Poursuivre la coordination européenne en matière d’investissement de long terme des entreprises.
Proposition n° 17 : Favoriser l’accès des PME-ETI à l’endettement obligataire et aux placements privés.
Proposition n° 18 : Au minimum, adapter la notion de bien professionnel.
Proposition n° 19 : Moderniser le pacte Dutreil, notamment en simplifiant le régime déclaratif annuel des signataires du pacte.
Proposition n° 20 : Créer un statut d’investisseur de long terme et structurer la détention familiale des entreprises.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
A Plus Finance
M. Niels Court-Payen, président
Association française du family office (AFFO)
M. Jean-Marie Paluel-Marmont, président
Me Jérôme Barré, membre de l’AFFO
Association française des investisseurs pour la croissance AFIC
M. Michel Chabanel, président
M. Paul Perpère, délégué général
Mme France Vassaux, Directrice des affaires juridiques et fiscales
Association française de la gestion financière (AFG) *
M. Paul-Henri de La Porte du Theil, président
M. Pierre Bollon, délégué général
Mme Laure Delahousse, directrice développement des acteurs et gestions spécialisées
Association française des marchés financiers (Amafi)
M. Pierre de Lauzun, délégué général
M. Bertrand de Saint Mars, délégué général adjoint
Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM)
M. Patrick de Lataillade, président
ASMEP-ETI
M. Alexis Bouygues, chargé de mission
M. Philippe d’Ornano, co-président d’ASMEP-ETI et président du directoire de Sisley
Mme Elizabeth Ducottet, co-présidente d’ASMEP-ETI et PDG de Thuasne
M. Alexandre Montay, Délégué général d’ASMEP-ETI.
Autorité des marchés financiers (AMF)
M. Benoit de Juvigny, secrétaire général
M. Xavier Parain, secrétaire général adjoint, en charge de la Direction de la gestion d’actifs
Mme Laure Tertrais, conseillère technique, législation et régulation à la Direction des affaires juridiques
Bpifrance *
M. Pascal Lagarde, directeur exécutif en charge de l’international, de la stratégie, des études et du développement de Bpifrance
CMS Bureau Francis Lefebvre
Me Daniel Gutmann, avocat associé responsable du département Doctrine fiscale
Me Florent Ruault, avocat du département Doctrine Fiscale
Croissance Plus
Mme Florence Depret, directrice déléguée
M. Alexandre Crosby, co-président de la commission création et financement
Me Franck Van Hassel, membre de la commission fiscalité
M. Thibault Baranger, chargé de mission
EUROPLACE
M. Arnaud de Bresson, délégué général
Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)
M. Bernard Spitz, président
M. Antoine Lissowski, président de la commission plénière économique et financière de la FFSA
M. Jean Vecchierini de Matra, délégué général des Bancassureurs
Fidal
Me Jean-François Desbuquois, avocat associé, directeur-adjoint du département Droit du patrimoine
Financière de Courcelles
M. Alain Sitbon, directeur
Finaréa
M. Christian Fleuret, président
Fonds d’investissement ISAI
M. Jean-David Chamboredon, gérant
France angels
M. Dominique Favario
M. Philippe Gluntz
M. Alain Bommelaer
M. Guy Roulin
IFRAP
Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur
Institut pour la démographie des entreprises (IRDEME)
M. Jean-François Bauer
M. Gérard Dosogne
M. Hervé Gourio
Mme Nathalie Droal, chargée de mission
Omnes Capital
M. Michel de Lempdes, responsable Capital Risque, directeur associé NTIC
M. Renaud Poulard, directeur associé
PME Finance
M. Jean Rognetta, président
Mme Alexia Pérouse, vice-présidente
M. Éric Pichet, économiste
Maître Arlette Darmon, notaire
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
1 () La Tribune, « L’entreprenariat séduit les plus jeunes ! », 4 février 2015. Le Figaro « Les moins de 20 ans veulent être leur propre patron », 20 janvier 2015.
2 () Le Parisien, « Ils veulent tous être fonctionnaires », 5 avril 2013.
3 () Conseil d’analyse économique, « Investissements et investisseurs de long terme », mai 2010, p. 243.
4 () Ce délai a été ramené à 7 ans par la loi pour la croissance et l’activité..
5 () Conseil d’analyse économique, « Investissement et investisseurs de long terme », mai 2010.
6 () Complément C de ce rapport, « Profil et rôle des investisseurs de long terme », Christian Gollier, Didier Janci, p. 125.
7 () Voir notamment l’article 28 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.
8 () Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement.
9 () Les professionnels du secteur distinguent généralement les Fintech (dans le domaine de la désintermédiation financière), les Biotech (dans le domaine de la santé et des biotechnologies) et les Greentech (dans le domaine du développement durable) et plus globalement les Hitech (qui désignent les entreprises du numérique).
10 () On peut noter en particulier Croissance plus, PME Finance, l’Association française pour la croissance et le développement ou encore France Angels. La fusion de Croissance plus et de PME Finance a été annoncée le 14 septembre 2015.
11 () AFIC, « Activité des acteurs français du capital-investissement en 2014 », 24 mars 2015.
12 () Voir par exemple l’article des Echos du 2 septembre 2015 : « Boom des capitaux investis dans les start-up françaises ».
13 () Les Échos, « Les investissements des « business angels » s’essoufflent en France », 28 janvier 2015, p. 24.
14 () Les éléments de l’EBAN sont détaillés dans le « Statistics compendium 2014 ».
15 () À titre d’exemple, le Centre for strategy and evaluation service, organismes anglais de prospective et d’évaluation des politiques publiques, évalue le nombre de business angels français actifs davantage autour de 8 000 personnes, dont les montants d’investissements peuvent toutefois être, pour certains, peu importants.
16 () Zentrum fûr europäische Wirtschaftforshung, « Finanzierung von jungen Unternehmen in Deustchland durch Privatinvestoren », avril 2014.
17 () http://www.business-angels.de.
18 () La description du dispositif français correspond à celle figurant dans l’étude de l’EBAN.
19 () Lors des débats au Parlement français, il est souvent fait référence au régime des entreprisses « Subchapter S ».
20 () Pour le présent rapport, ce terme sera utilisé au féminin, ce qui a semblé être la pratique la plus répandue.
21 () L’expression est empruntée au Professeur Eric Pichet dans son article « Holdings animatrices de groupe : théorie et pratiques », Revue de droit fiscal n° 13, 27 mars 2014.
22 () Le Monde , « Le plus gros redressement fiscal de l’histoire de l’ISF », 8 mai 2014.
23 () L’expression est empruntée au même auteur.
24 () « Les grands groupes et l’innovation : définitions et enjeux du corporate venture », Finance Contrôle stratégie, volume 8, n°4, décembre 2005, p. 33-61.
25 () Ce dispositif est la traduction législative d’un engagement du Président de la République, formulé dans le discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat, le 29 avril dernier : « J’ai bien conscience que les grandes entreprises, depuis plusieurs années, ont accompagné les PME sans qu’il ait été besoin de les inciter. Mais je souhaite encourager cette pratique toujours en cohérence avec notre politique de filières. Les prises de participation des grands groupes dans les jeunes PME innovantes ouvriront donc droit à un amortissement fiscal sur cinq ans, de façon à ce que le coût, la charge du soutien aux PME, puisse être, en cas d’échec, pris pour partie en charge par l’État. »
26 () Avoir réalisé au cours de l’exercice précédent des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles ou bien justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant, les perspectives de développement et le besoin de financement sont reconnus par BPI France.
27 () Sous déduction d’une quote-part de frais et charges, réintégrée à l’assiette taxable (12 % des plus-values brutes de l’exercice).
28 () Cour des comptes, « La politique en faveur de l’assurance vie », janvier 2012.
29 () Le tome II du fascicule « Voies et moyens » associé au projet de loi de finances pour 2015 avance un coût de 1,865 milliard d’euros.
30 () Fabrice Demarigny, « 25 recommandations pour une Union des marchés de capitaux axée sur l’investissement et le financement », 18 mai 2015.
31 () Voir notamment Les Échos, « Paris va demander à la Commission européenne de revoir les futures règles de capitaux du secteur », 13 avril 2015.
32 () Paris Europlace, « Financement en dette des PME/ETI, nouvelles recommandations », 10 mars 2014.
33 () Ce règlement a été approuvé par les ministres des Finances de l’UE lors du conseil ECOFIN du 19 juin 2015 puis voté en séance plénière du Parlement européen le 24 juin 2015.
34 () Paris Europlace, « Financement des entreprises et de l’économie française : pour un retour vers une croissance durable », 8 février 2013.
35 () L’USPP repose sur une dérogation au Securities Act de 1933 : de tels titres restent soumis à cette législation mais n’ont pas l’obligation d’être enregistrés auprès de la Securities and exchange commission. La maturité moyenne de l’USPP va de 3 à 15 ans pour des montants moyens de 300 millions d’euros. Le marché est très important puisqu’il a enregistré 55 milliards d’euros d’émissions en 2012 pour environ 215 opérations.
36 () En Allemagne, le Schuldscheindarlehen est un prêt bilatéral faisant l’objet d’un placement privé non coté en Bourse et non noté par une agence. Ils sont régis par le code civil allemand. Il s’agit par nature d’un produit hybride entre crédit syndiqué et obligation.
37 () Depuis le mois de mai 2015, le réseau ASMEP-ETI a changé de nom pour devenir le METI (Mouvement des entreprises de taille intermédiaire).
38 () « Vive le long terme ! Les entreprises familiales au service de la croissance et de l’emploi », ASMEP-ETI et Institut Montaigne, septembre 2013.
39 () Olivier Mellerio, « Transmission de l’entreprise familiale », rapport à Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, des services et de la consommation.
40 () Habbershon, Williams, « A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms », Family business review, 1999.
41 () Bloch, Kachaner, Mignon, « La stratégie du propriétaire, enquête sur la résilience des entreprises familiales face à la crise », Pearson education France, 2012.
42 () « Les fondations actionnaires, première étude européenne », Prophil et cabinet Delsol avocats, 2015.
43 () « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité », MM. Jean-Philippe Demaël (directeur général de Somfy activités), Philippe Jurgensen (inspecteur général des finances) et Jean-Jack Queyranne (président de la région Rhône-Alpes), juin 2013.
© Assemblée nationale