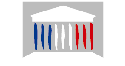
N° 3305
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
sur le passage à un monde décarboné
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Jean-Paul CHANTEGUET,
Président.
——
SOMMAIRE
___
Pages
I. LA COP DE PARIS, 21E ÉPISODE DE LA NÉGOCIATION CLIMATIQUE MONDIALE 7
A. C’EST À LA CONFÉRENCE DE RIO DE 1992, QUE LE RÉGIME CLIMATIQUE S’EST STRUCTURÉ. 7
B. DES COP QUI CONSTITUENT À N’EN PAS DOUTER UNE FABRIQUE DE LA LENTEUR. 8
C. LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA VICTOIRE DES MARCHÉS DE QUOTAS SUR LA TAXE. 10
D. UNE NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DU CLIMAT EST AUJOURD’HUI À L’œUVRE 10
E. LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE EN DIFFICULTÉ 13
II. LE PASSAGE À UN MONDE DÉCARBONÉ N’EST PLUS NÉGOCIABLE 15
A. LA RÉALITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SES CONSÉQUENCES 15
1. Les dérèglements climatiques 15
2. La biodiversité également impactée 18
B. LE CONSTAT D’ÉCHEC OBLIGE À RAISONNER AUTREMENT 19
III. LES CHEMINS DE LA TRANSITION VERS UN MODÈLE PLUS SOUTENABLE À L’AUNE DE LA NÉGOCIATION CLIMATIQUE 23
A. VERS UNE AUTRE GOUVERNANCE 23
B. LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE 24
C. IL FAUT DONNER UN PRIX AU CARBONE 25
1. Les différents types d’instruments 25
a. Le panorama mondial du prix du carbone en 2014 26
b. Quatre expériences de tarification carbone 27
2. Que faire demain pour que le prix du carbone devienne une réalité ? 28
D. LA REMISE EN CAUSE DU SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES 29
E. LES FINANCEMENTS CLIMAT, CLÉ DE VOÛTE D’UN ACCORD AMBITIEUX 31
1. En finir avec la financiarisation de l’économie 31
2. Le financement des 100 milliards 32
3. Réorienter les financements privés, afin de favoriser la transition vers une économie décarbonée. 34
4. Les financements innovants 35
a. La taxe sur les transactions financières (TTF) 35
b. Les transports internationaux 36
c. Les revenus des marchés de carbone 36
F. DES POLITIQUES PLUS DURABLES ET PLUS SOBRES EN CARBONE 36
1. Un urbanisme résilient 37
2. Produire différemment 38
3. Cultiver au lieu d’exploiter 38
G. LA PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DES PUITS DE CARBONE 39
1. Restaurer les terres 39
2. Protéger les océans 41
3. Préserver les forêts 41
H. RETERRITORIALISER LE CLIMAT 42
1. Valoriser les acteurs non étatiques 42
2. Les montagnes, réserves de patrimoine et d’innovation pour le climat 43
3. Les Outre-Mer, espaces prioritaires d’innovation en matière de lutte contre le changement climatique 44
TRAVAUX DE LA COMMISSION 47
I. COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION 47
1. Audition de M. Gilles Bœuf, président du Muséum national d’histoire naturelle (9 octobre 2012) 47
2. Audition de M. Hervé Le Treut, climatologue, directeur de recherche au CNRS, sur le changement climatique et la transition écologique (12 décembre 2012) 59
3. Audition de M. Jean-Marc Jancovici, sur le changement climatique et la transition énergétique (6 février 2013) 76
4. Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, sur les négociations climatiques et les aides au développement (12 mars 2013) 93
5. Audition de M. Jean Jouzel, climatologue, et de Mme Catherine Tissot-Colle, présidente de la Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux, co-rapporteurs d’un avis du Conseil économique, social et environnemental sur la transition énergétique (13 mars 2013) 107
6. Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, sur l’agro-écologie (17 juillet 2013) 125
7. Audition de Mme Laurence Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), sur le débat sur la transition énergétique et écologique (11 septembre 2013) 152
8. Audition de Mme Catherine Chabaud, rapporteure de l’avis du CESE intitulé « Quels thèmes et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? » (8 octobre 2013) 167
9. Table ronde sur le 5e rapport du groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (27 novembre 2013) 184
10. Audition de M. Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement (14 janvier 2014) 208
11. Table ronde sur l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires et les paysages (22 janvier 2014) 226
12. Audition de M. Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) (4 février 2014) 248
13. Table ronde sur l’impact des changements climatiques en France (12 février 2014) 271
14. Table ronde sur les « plans d’adaptation au changement climatique » (16 avril 2014) 299
15. Audition de Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 (5 novembre 2014) 319
16. Audition de Mme Hakima El-Haite, ministre déléguée chargée de l’environnement du Royaume du Maroc, sur la politique marocaine dans le domaine du développement durable, ses priorités pour la conférence Paris climat 2015 (COP 21) et la Présidence marocaine de la Conférence des parties de 2016 (COP 22) (28 janvier 2015) 338
17. Audition de M. Dominique Potier sur son rapport d’évaluation et de révision du plan Écophyto : « Pesticides et agro-écologie : les champs du possible » (10 février 2015) 347
18. Table ronde sur l’élevage et l’environnement (11 février 2015) 366
19. Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur le bilan de la COP 20 à Lima et la préparation de la COP 21 à Paris (3 mars 2015) 399
20. Table ronde sur les conséquences des changements climatiques outremer (25 mars 2015) 420
21. Table ronde sur les objectifs du développement durable (1er avril 2015) 457
22. Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur la préparation de la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21) (6 mai 2015) 478
23. Table ronde sur le financement de la lutte contre le changement climatique (27 mai 2015) 490
24. Audition de M. Bernard Guirkinger et de M. Gaël Virlouvet, rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental (CESE), sur leurs avis « Réussir la conférence climat 2015 » et « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques » (14 octobre 2015) 520
25. Audition de M. Philippe Guettier, directeur général du Partenariat français pour l’eau, et de M. Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail « eau et climat », sur le thème « eau et climat » (17 novembre 2015) 546
II. EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 557
I. LA COP DE PARIS, 21E ÉPISODE DE LA NÉGOCIATION CLIMATIQUE MONDIALE
A. C’EST À LA CONFÉRENCE DE RIO DE 1992, QUE LE RÉGIME CLIMATIQUE S’EST STRUCTURÉ.
En 1988, deux institutions des Nations Unies, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), créent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cet organisme, ouvert aux pays membres de ces deux organisations, doit fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Le GIEC travaille à dégager clairement les éléments qui relèvent d’un consensus de la communauté scientifique et à identifier les limites d’interprétation des résultats. Les rapports ne doivent pas préconiser de choix de nature politique mais envisager des stratégies d’adaptation et d’atténuation.
Dix-huit mois seulement après sa création, le GIEC publie son premier rapport d'évaluation, qui conduit l'Assemblée Générale des Nations Unies à demander à l'INC (Comité de négociations intergouvernementales) de préparer une convention sur le climat (Rio 1992).
Très rapidement, des fractures apparaissent entre les différents États. La première grande division s'opère entre pays développés et pays en développement (PED) réunis dans le cadre onusien, sous la bannière du G77 (77 pays en 1964 et 130 en 2009).
Les PED insistent sur les différentes responsabilités historiques à l’origine de ce problème, accordent une priorité à leur droit au développement, aux questions de transfert de technologies et d'assistance financière pour l'adaptation, alors que les pays développés soulignent l'urgence de la réduction des émissions.
De plus, au sein du G77, plusieurs fossés se creusent rapidement entre les pays pétroliers (qui tentent de bloquer toute action), les pays émergents qui insistent sur leur droit au développement et enfin les pays les plus exposés à des changements climatiques, réunis dans l'alliance des petits états insulaires (AOSIS), qui s'érigent en gardiens d'un accord fixant des réductions ambitieuses de GES.
Le 14 juin 1992, Rio marque la mise en place du régime climatique sous la houlette onusienne.
C'est un énorme succès du multilatéralisme environnemental, avec 172 gouvernements représentés et 2 400 représentants d’ONG.
Les négociations débouchent sur trois traités internationaux, la « convention climat », la « convention sur la diversité biologique » et la « convention sur la désertification » ainsi que sur deux textes programmatiques, la « déclaration de Rio sur l'environnement et le développement » et « l'agenda 21 » appelant à la mise en œuvre du développement durable.
C'est le 21 mars 1994, que la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique entre en vigueur après la signature de 50 pays.
Trois éléments principaux structurent le régime climatique :
– un processus politique et une expertise scientifique séparés mais étroitement liés ;
– une stratégie de partage du fardeau ;
– et une distinction entre pays industrialisés et pays en développement.
La convention climat est, quant à elle, régie par deux principes onusiens :
– l'égalité, qui stipule que chaque pays dispose d’une voix ;
– le principe de « responsabilité commune mais différenciée ».
Depuis 1995, tous les ans, se tient la conférence des parties de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dénommée aussi COP.
La première COP se tient en 1995 à Berlin. Puis la COP 2 en 1996 à Genève, la COP 3 en 1997, qui débouche sur le protocole Kyoto.
Elle est suivie par Buenos Aires, Bonn, La Haye, Bonn, Marrakech, New Delhi, Milan, Buenos Aires, Montréal, Nairobi, Bali, Poznan, Copenhague (2009), Cancun, Durban, Doha, Varsovie, enfin en 2014 celle de Lima et dans quelques semaines la COP 21 à Paris.
B. DES COP QUI CONSTITUENT À N’EN PAS DOUTER UNE FABRIQUE DE LA LENTEUR.
Lors d’une COP, on négocie vraiment sur tout, car le climat a tendu à reconfigurer et à englober tous les problèmes environnementaux ou de développement durable. Si, comme le rappelle Christina Figueras, la secrétaire de la convention depuis 2010, « nous préparons ici le business plan de la planète », en revanche, on discute beaucoup moins sur les niveaux d’ambition, sur les engagements de réduction des émissions à un horizon précis, ou sur le fossé qui sépare depuis des années, d’un côté les émissions effectives et leur évolution prévue, et de l’autre des objectifs affichés, comme par exemple le plafonnement du réchauffement de la température moyenne à 2°C. Souvent on privilégie la forme sur le fond. Néanmoins, les critiques de l’organisation du processus onusien et les aménagements, qui peuvent y être apportés, ont leur limite, puisque sa lenteur tient aussi à la complexité irréductible d’un processus multi niveaux, dans lequel les acteurs contrôlent mal certaines dynamiques. Enfin, la concentration sur les questions juridiques (valeur juridique et caractère contraignant d’un accord) et sur les procédures, plutôt que sur les questions purement politiques, constitue aussi un frein.
Mais une COP ne se réduit pas aux seules négociations. En parallèle se tiennent de nombreux événements, auxquels participent des ONG, des élus, des citoyens, dont les préoccupations et motivations sont infiniment variées : risque climatique certes mais aussi développement des pays pauvres, priorités environnementales, opportunité d’un nouvel ordre mondial, place d’un groupe de pays, rôle d’une agence internationale ou d’une ONG. Pourtant, malgré la diversité des publics et des intérêts, il y a peu de franches oppositions, de débats passionnés ou de déclarations hostiles. D’ailleurs, jamais il n’est question de remettre en cause ouvertement le processus onusien.
C’est lors de la COP 3, le 11 décembre 1997, qu’est adopté le protocole de Kyoto. Celui-ci représente la victoire d’une approche top down et de partage du fardeau (un quota global de réduction des émissions de GES est défini avant d’être partagé entre les pays). Le protocole prévoit des objectifs d’émissions différenciés selon le niveau de développement : - 8 % pour l’Europe, -7 % pour les États Unis, - 6 % pour le Japon, stabilisation pour l’Ukraine et la Russie et augmentation modérée pour l’Australie et l’Islande. Globalement cela représente une baisse de 5,2 % par rapport au niveau de 1990. Ces objectifs doivent être atteints au cours d’une période allant de 2008 à 2012. Il faudra huit ans pour que le protocole entre en vigueur en 2005, après avoir été ratifié par 175 pays (mais pas les États Unis). Enfin, il introduit trois mécanismes de marché ou mécanismes « flexibles » :
– le marché de carbone, qui prévoit l’achat et la vente de quotas d’émissions entre pays visés à l’annexe B (pays développés et pays de l’ancien bloc soviétique),
– le mécanisme de développement propre (MDP), qui permet aux pays industrialisés, qui investissent dans le développement sobre en carbone dans les pays en développement, de bénéficier en échange de crédits carbone,
– la mise en œuvre conjointe des objectifs (MOC), destinée à la coopération entre les pays industrialisés et les économies de transition.
Ces mécanismes de flexibilité créent donc un marché global, mais fragmenté.
À ces 3 unités s’ajoutent les crédits carbone générés par des marchés de carbone régionaux, comme celui de l’Union Européenne (le marché ETS…) ou ceux mis en place dans certains états des États-Unis et provinces canadiennes.
Il est à noter que ces marchés n’ont pas de lien avec le protocole de Kyoto. Ils concernent l’échange de quotas entre entreprises, alors que Kyoto ne prévoit que l’échange de quotas entre pays.
C. LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA VICTOIRE DES MARCHÉS DE QUOTAS SUR LA TAXE.
C’est là une victoire assez surprenante. En effet, avant la première COP en 1995, l’option semblant requérir la plus forte adhésion fut celle d’une taxe énergie carbone. C’est tout d’abord l’Union Européenne qui a lancé l’idée d’une taxe harmonisée au niveau international, pour lutter contre le changement climatique, la Commission Delors proposant une taxe mixte énergie carbone à hauteur de 600 francs/TEP au printemps 1992 (environ 100 euros la tonne). Du côté américain, l’administration Clinton entreprend dès 1993 d’introduire une taxe sur l’énergie. Mais, compte tenu des oppositions féroces de l’industrie européenne (et de certains pays dont la France), la taxe européenne n’aboutira pas.
Au travers des quotas, on régule par les quantités, alors qu’avec les taxes on régule par les prix. Le choix fait dans le protocole de Kyoto de retenir la solution des marchés de quota, procède de l’économisation de l’environnement, un choix qui n’est pas neutre politiquement et que critiquent ceux qui proposent d’inverser les priorités et de rechercher plutôt une écologisation de l’économie. D’ailleurs le marché européen a vu son prix s’effondrer rapidement du fait de la distribution très large de quotas, de la réduction de l’activité du fait de la crise et de la domination du marché à terme de la City de Londres, ouvert à des hedge funds spéculatifs.
D. UNE NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DU CLIMAT EST AUJOURD’HUI À L’œUVRE
Elle se caractérise d’une part par la lente montée en puissance du thème de l’adaptation.
Pour les pays du Sud, l’enjeu principal reste incontestablement le développement. La question climatique (celle de l’émission des GES) leur paraît secondaire dans la hiérarchie des urgences à examiner. Certains pays, comme ceux de la coalition AOSIS, considèrent qu’il est plus urgent de discuter de la question de l’adaptation (construire en dur, se préparer à modifier l’usage des sols, traiter les questions de l’eau potable, résoudre le problème de la distribution de l’électricité…), que de celle du taux de CO2 dans l’atmosphère.
Le mandat de Bali, arrêté en décembre 2007, constitue un agenda autour de quatre sujets, dont tous les pays considèrent qu’ils doivent être discutés désormais ensemble. Ce sont :
– les actions pour réduire les émissions,
– les solutions d’adaptation aux impacts des changements climatiques,
– les transferts de technologie,
– les mécanismes financiers.
D’autre part la question des forêts et le dispositif de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD) sont maintenant au centre des débats.
En effet, selon le GIEC, la déforestation est responsable de 20 % des émissions de GES (elle touche essentiellement les pays en développement). Dans le cadre du protocole de Kyoto, le MDP ne reconnaît dans le secteur des sols que les projets de boisement ou de reboisement forestiers. À Bali, la décision est prise d’inclure dans le texte « successeur » du protocole, un mécanisme financier, destiné à rémunérer les pays qui réduisent les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.
La Chine, quant à elle, devient un pays incontournable dans le régime climatique. Elle est, depuis 2007, le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre par an (mais pas par habitant) et elle bénéficie d’un incontestable leadership au sein des pays en développement. La Chine dépend du charbon pour les 2/3 de ses besoins énergétiques et pour 69 % de sa production d’électricité. La part du pétrole est de 19 %, celle des énergies renouvelables de 8,6 %, celle du gaz naturel de 5 % et celle du nucléaire de 0,8 %.
En 2007, un plan national du climat a été arrêté. Il s’organise autour de l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la politique industrielle. Dans les négociations internationales, la Chine a toujours refusé les engagements de réductions d’émissions exprimés en valeurs absolues, mais se réfère à l’objectif d’intensité énergétique. Pour ce nouveau plan, la loi rend les gouvernements locaux responsables de la mise en œuvre de leur part de réalisation des objectifs nationaux.
Pour ce faire, ils ont recours à différentes politiques :
– une fiscalité plus lourde sur les ressources fossiles,
– une tarification énergétique différenciée, afin de pénaliser les entreprises qui ne font pas d’efforts d’efficacité énergétique,
– voire la fermeture d’aciéries et de cimenteries.
Les politiques d’énergie renouvelable se sont intensifiées ; ainsi la Chine a atteint, en 2007, l’objectif d’éolien fixé pour 2020 de 30GW puis, en 2013, de 91 GW avec une progression prévue à 100 GW en 2015. L’énergie solaire augmente elle aussi, même si elle a démarré d’un point plus bas : 0,32 GW en 2009, 15 GW en 2013 avec un objectif de 35 GW en 2015. L’énergie hydraulique devait passer de 240 GW en 2012 à 260 GW en 2015. Au total, les renouvelables atteindront 15 % du mix énergétique en 2015.
La Chine est aujourd’hui une puissance économique et diplomatique, à laquelle le qualificatif d’émergent sied mal.
Il est un autre pays émergent qui compte, c’est le Brésil. Le Brésil, contrairement à la Chine, mais aussi l’Inde ou l’Afrique du Sud, n’est pas un grand producteur d’émissions générées par les énergies fossiles. Cela est la conséquence d’investissements importants dans l’énergie hydroélectrique et les barrages, puis dans les agro-carburants.
L’exportation de matière première est au cœur de l’économie du Brésil, plus grand producteur mondial de viande de bœuf, de canne à sucre et de café, et deuxième producteur de soja.
Malgré un recours impressionnant aux énergies renouvelables, le Brésil a attiré l’attention du monde et de la gouvernance climatique par un taux énorme de déforestation en Amazonie, qui contribue à élever son niveau d’émissions de GES.
Le Brésil, qui est le 4e plus grand émetteur mondial (du fait de la déforestation), a présenté, fin 2009, un programme ambitieux de diminution de ses émissions, qu’une loi et un décret ont rendu juridiquement contraignant.
L’équité devient aussi un enjeu majeur des négociations.
La façon de concevoir la justice dans le régime climatique est celle du « principe de responsabilités communes mais différenciées ». Il figure dans la Déclaration de Rio mais également spécifiquement dans la convention et dans le protocole. Permettant de rééquilibrer les rapports Nord-Sud dans la balance internationale des droits et devoirs du développement, il continue à jouer un rôle important. C’est en particulier la Chine, qui a réussi à imposer ce principe structurant du multilatéralisme environnemental. Il reflète bien la responsabilité des pays industrialisés dans la dégradation de l’environnement global, tout en reconnaissant que les pays en développement ont d’autres priorités plus urgentes.
Enfin nous devons évoquer le nouvel ordre géopolitique mondial.
L’accord de Copenhague a été principalement rédigé par les États Unis et les pays du groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine). La transition s’est opérée d’un monde dominé jusque dans la décennie précédente par les principaux pays développés (États-Unis, Europe et Japon) vers un monde différent, dont le centre de gravité est en Asie et qui, cette fois, est dominé par le couple États-Unis, Chine. À Copenhague, le bloc des grands émergents est resté très éloigné de tout le discours environnemental porté par les ONG sur la crise écologique planétaire ou sur la synergie des crises : biodiversité, climat, sécurité alimentaire, limitation des ressources. Le problème climatique est apparu pour la première fois, pas tant comme un problème environnemental que comme la question de décarboniser le capitalisme mettant en jeu, dans cette transformation, des intérêts économiques concurrentiels énormes et des enjeux énergétiques vitaux.
E. LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE EN DIFFICULTÉ
Il existe en effet un décalage croissant entre, d’un côté, une réalité du monde, celle de la globalisation des marchés, de l’exploitation effrénée des ressources d’énergies fossiles et des autres ressources naturelles, renouvelables ou non et des États pris dans une concurrence économique féroce et s’accrochant plus que jamais à leur souveraineté nationale et, de l’autre, une sphère des négociations et de la gouvernance, qui véhicule l’imaginaire d’un « grand régulateur central » apte à définir des droits d’émissions, mais de moins en moins en prise avec cette réalité extérieure.
Cette gouvernance onusienne est aujourd’hui marquée :
→ en premier lieu, par une gestion apolitique du problème, c’est-à-dire une gouvernance, qui fait l’impasse sur le volet proprement géopolitique de la question climatique.
N’est-il pas trop naïf de supposer que la communauté internationale aurait un intérêt commun à combattre le changement climatique ?
C’est bien de la prédominance d’une autre lecture plus clivante dont il faut parler, qui est centrée sur la question de l’approvisionnement continu et bon marché en combustibles fossiles.
Cette lecture est d’autant plus importante aujourd’hui que la situation énergétique mondiale est désormais dominée par un « trio fossiliste », ce qui rend très difficile toute solution du problème climatique : la Chine, qui possède les réserves les plus importantes au monde de charbon, la Russie dont l’énergie primaire repose à 50 % sur le gaz et les États-Unis, gendarme mondial du marché du pétrole, dont le recours aux hydrocarbures a encore augmenté avec l’essor des huiles et gaz de schiste.
→ ensuite, par une gestion isolée, alors que le dossier du climat est inséparable des problèmes d’énergie, des modes de développement, de la forme prise par la mondialisation économique et financière.
En effet l’enjeu climatique a principalement été pensé et institutionnalisé comme problème environnemental, l’enclavant sur l’échiquier international, le séparant d’autres régimes internationaux, avec lesquels il interfère, comme ceux de l’énergie, du commerce international et du développement.
→ enfin, par l’illusion de pouvoir mener l’inévitable transformation industrielle et sociale de manière centralisée.
II. LE PASSAGE À UN MONDE DÉCARBONÉ N’EST PLUS NÉGOCIABLE
A. LA RÉALITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SES CONSÉQUENCES
1. Les dérèglements climatiques
L’extraordinaire accélération des émissions de gaz à effet de serre (plus de 70 % entre 1970 et 2004) et leur accumulation dans l’atmosphère provoquent l’augmentation des températures, l’acidification des océans, la fonte des glaciers, la montée des eaux, la multiplication des inondations, sécheresses et incendies, accroissent la désertification et concourent à toutes sortes d’évènements météorologiques extrêmes.
Des migrants climatiques commencent à quitter certaines régions devenues submersibles ou incultivables. Ce nouveau type de migration a concerné plus de 40 millions de personnes dans la zone Asie Pacifique en 2010 / 2011. Par ailleurs, la déstabilisation du Proche Orient et d’une partie de l’Afrique, même si elle revêt une dimension politique évidente, trouve également ses fondements dans les dérèglements climatiques, comme le démontre la superposition des cartes de la désertification, de l’insécurité alimentaire et de la présence de groupes islamistes armés en Afrique sahélienne, mise en exergue par les travaux de la Convention des Nations Unies contre la désertification (CNUCD). Dans cette région entre autres, le changement climatique constitue également un facteur de conflit pour la possession des ressources naturelles, notamment l’eau et l’énergie.
Ailleurs on doit remédier à des dérèglements, qui coûtent déjà des sommes colossales, 80 milliards de dollars pour l’ouragan Sandy sur la côte est et la sécheresse au sud des États-Unis en 2012. Tandis que, selon Swiss Re, deuxième société mondiale de réassurance, les catastrophes naturelles dans le monde ont coûté 45 milliards de dollars aux assurances en 2013 et 35 en 2014. Mais ce n’est rien comparativement à la menace qui se profile. La fonte de l’Arctique coûterait, par exemple, un an de PIB mondial, soit 45 000 milliards d’euros, selon le modèle d’évaluation des coûts du changement climatique, élaboré par Nick Stern en 2006.
Les experts du GIEC le confirment au fil de leurs rapports, seules des mesures à grande échelle, prises d’ici 2030 et prolongées de telle sorte que nous ayons réduit les émissions mondiales de 40 à 70 % d’ici à 2050 par rapport à 2010, pour atteindre zéro en 2100, pourraient contenir le réchauffement aux 2°C, au-delà desquels les êtres humains n’auront plus de prise sur les événements. Mais d’ores et déjà le changement est visible. La dernière décennie est la plus chaude jamais connue et 2014 l’année la plus chaude jamais mesurée. En mars 2015, la concentration mensuelle moyenne de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a dépassé, pour la première fois depuis le début des mesures, le seuil des 400 parties par million, alors que la limite recommandée à ne pas dépasser est de 350 ppm. La course engagée par les pays émergents pour rattraper notre « niveau de vie » nous donne à voir, en accéléré, la façon dont notre développement a changé la planète. Les images des villes chinoises noyées dans la pollution, de l’Australie ravagée par les feux, des grands fonds marins dévastés par le chalutage, des forêts abattues en Amazonie, des îles submergées, des régions désertifiées ou des gigantesques icebergs, qui se séparent des glaciers en Arctique alimentent de façon récurrente nos écrans.
La COP 21, qui réunit à Paris à la fin de l’année les représentants des 195 pays, parties prenantes à la négociation sur le changement climatique, va donc constituer un rendez-vous essentiel pour décider de la survie, non pas de la planète, mais de l’espèce humaine qui la peuple. L’objet même d’un accord international devrait être de servir l’intérêt général, pas les intérêts privés. Il devrait garantir une action climatique cohérente avec le respect des droits humains, les objectifs de développement, la lutte contre la pauvreté et le principe de solidarité internationale. Cependant les décisions qui y seront prises, annoncées par les principaux acteurs, ne suffiront pas à assurer une réduction des émissions de gaz à effet de serre, telle que le réchauffement de l’atmosphère soit limité à 2° d’ici la fin du siècle.
L’augmentation de la température, qui en résultera, débouchera sur une crise majeure pour l’existence des êtres humains. Selon le GIEC, les océans, qui constituent 70 % de l’espace, continueront à s’acidifier en absorbant toujours plus de carbone, ce qui affaiblira les récifs coralliens protecteurs des côtes et bouleversera la biodiversité marine. La fonte des glaciers provoquera l’élévation des niveaux des mers et fera disparaître ou reculer de nombreux territoires. Sur terre, les pénuries d’eau potable se multiplieront, accompagnées de sécheresses sur certains continents, tandis que d’autres seront soumis aux inondations. La baisse des rendements agricoles menacera la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes. La propagation des maladies, l’explosion des exodes de populations et la multiplication des conflits pour la survie déboucheront sur un monde largement marqué par l’instabilité et la violence.
En ouvrant la conférence environnementale pour la transition écologique le 20 septembre 2013, François Hollande s’interrogeait ainsi « Avons-nous bien appréhendé les conséquences sur les flux migratoires de populations, qui viendront là où elles peuvent se nourrir, là où elles peuvent accéder à l’eau ou éviter des catastrophes ? A-t-on bien évalué ce que signifiera le partage des richesses à l’horizon de trois ou quatre décennies ? Est-ce que l’on a bien établi le lien entre ce risque de catastrophes et les conditions mêmes du maintien de la paix ? ».
Les dérèglements climatiques affecteront en premier lieu les régions les plus déshéritées, en faisant subir aux populations les plus pauvres, sans qu’elles en aient touché le moindre bénéfice, les conséquences du développement des populations les plus riches. Au quotidien, le dérèglement climatique affecte plus sévèrement les femmes pauvres que les hommes : la raréfaction des ressources naturelles a un impact sur le maintien des filles à l’école, allonge les trajets – il leur faut aller chercher l’eau et le bois toujours plus loin – de même la réduction de la biodiversité engendre l’augmentation des risques de malnutrition, qui touchent particulièrement les femmes et les enfants. Le dérèglement climatique a une incidence avérée sur la santé des femmes notamment la santé sexuelle et reproductive. Le manque de soin peut entraîner une hausse de taux de mortalité maternelle et infantile. La reconnaissance de l’impact différencié du dérèglement climatique sur les femmes et les hommes dans le cadre de l’Accord de la COP 21 est la première étape de la mise en place de solutions adaptées et efficaces et de politiques de lutte contre le dérèglement climatique de long terme permettant d’augmenter les capacités de résilience des femmes, en soutenant leur autonomisation, leur accès au droit et la remise en cause des inégalités de genre.
Les sénateurs Cédric Perrin, Leila Aïchi et Eliane Giraud ont publié, début octobre, un rapport d’information du groupe de travail sur les conséquences géostratégiques du dérèglement climatique. Ils y soulignent, qu’à défaut d’agir rapidement, il résultera du dépassement du seuil des 2° C une aggravation des fractures entre pays pauvres et riches, entre hémisphère nord et sud, démultipliant des problèmes déjà existants et accroissant les injustices à l’échelle mondiale, puisque les pays qui subiront en première ligne les impacts du dérèglement climatique ne seront pas les principaux émetteurs actuels et historiques des gaz à effet de serre. Ils alertent également sur la modification des équilibres régionaux, sur l’augmentation des tensions concernant les ressources alimentaires, hydriques et énergétiques et sur la forte croissance dès 2020-2030 des déplacements de population internes aux États et internationaux.
Une analyse également partagée par le Parlement européen, qui évoque dans sa résolution « Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris » votée le 14 octobre, « que le changement climatique peut accroître la concurrence pour certaines ressources, telles que la nourriture, l'eau et les pâturages, et pourrait devenir le principal facteur des déplacements de population, tant au sein qu'au-delà des frontières nationales, dans un avenir relativement proche ».
À l’origine de ce désastre annoncé, se situe notre modèle de développement, marqué par un recours massif aux énergies fossiles depuis la révolution industrielle mais surtout depuis le milieu du XXe siècle et particulièrement dans les pays développés, puisque aujourd’hui 80 % de l’énergie sont consommés par 20 % de la population. Aujourd’hui l’énergie utilisée pour l’alimentation, le chauffage, le transport et la production de tous les biens et services est à 78 % d’origine fossile. Pétrole, gaz et charbon sont d’ailleurs responsables de 80 % des émissions mondiales de CO2 et de 67 % des émissions de gaz à effet de serre. Demain il deviendra vital, selon les mots de François Hollande, de « renoncer à utiliser 80 % des ressources d’énergies fossiles facilement accessibles, dont nous disposons encore ». En somme la survie de l’espèce humaine impose de passer à une société bas-carbone.
Cette obligation est d’autant moins contestable que les changements dans la composition chimique de l'atmosphère et l'effet de serre anthropique (dû aux émissions de CO2) sont irréversibles à l’échelle humaine. Cela signifie qu'il n'y a pas une durée de vie donnée du carbone, au-delà de laquelle il disparaîtrait. Même s'il existe une série de « puits de carbone » (principalement les océans, mais aussi les forêts) qui régulent une partie du carbone émis, une très large fraction reste dans l'atmosphère au-delà de 100 000 ans. Chaque année, le changement climatique dû au CO2, laisse des traces irréversibles pendant au moins 1 000 ans sur le niveau des glaces, sur l'acidification des océans : une telle inertie climatique impose de penser le long terme dans la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La hausse du niveau de la mer, bien que décalée et plus lente (menace patente pour les petites îles, et plusieurs deltas...) est également liée de manière irréversible au pic de CO2 qui sera atteint au XXIe siècle.
Enfin, au fil du changement climatique, apparaissent des éléments, que le GIEC n’a pas encore forcément pris en compte, comme la fonte du permafrost. Cette partie du sous-sol, gelé en permanence, commence à fondre dans la région arctique, ce qui réveille les bactéries, qui absorbent à leur tour le carbone, contenu dans les éléments organiques et rejettent ensuite du dioxyde de carbone (CO2), voire, si le milieu est privé d’oxygène, du méthane (CH4), qui sont les deux principaux gaz à effet de serre. La fonte du permafrost pourrait ainsi devenir une cause majeure de réchauffement aux côtés de la combustion des fossiles et de la déforestation, puisque, selon Florent Dominé, responsable du programme « accélération de la fonte du permafrost », il y a deux fois plus de carbone dans le permafrost que dans toute l’atmosphère.
2. La biodiversité également impactée
En parallèle, la biodiversité subit les effets du changement climatique, qui concourt à la disparition d’espèces animales et végétales et à la destruction d’écosystèmes, via les dérèglements, qui atteignent toutes les régions du monde, qu’il s’agisse de réchauffement, de sécheresse, de disparition de zones humides, d’inondations, d’érosion ou de fonte des glaciers.
Les océans stockent le gaz carbonique et absorbent la chaleur au prix du réchauffement de leurs eaux, donc de leur dilatation et de leur montée mais aussi de leur acidification, ce qui appauvrit le stock et la qualité des ressources naturelles. L’acidification, en particulier, entrave le développement des exosquelettes des animaux marins et de certaines micro-algues.
Depuis 1970, les océans ont ainsi perdu 49 % de leurs animaux, mammifères, poissons, reptiles et oiseaux (source WWF et Zoological Society of London). Certaines espèces atteignent un seuil critique, tandis que des habitats, massifs coralliens, mangroves et herbiers marins, disparaissent. Une méta-analyse de 632 études menée par des chercheurs de l’Université australienne d’Adelaïde vient de conclure que la très vaste majorité des espèces marines n’auront tout simplement pas la capacité de s’adapter aux changements très rapides, qui se produisent dans les océans. Le recul marqué de la biodiversité dans les eaux marines se traduira par un effondrement des espèces en cascade dans la chaîne alimentaire. Ces effets seront aggravés dans les régions polaires où les écosystèmes sont déstabilisés par l’apport accru d’eau douce issue de la fonte glaciaire, ce qui entraîne une désalinisation. De plus, les espèces animales y sont confrontées à l’arrivée d’autres espèces en provenance de latitudes plus tempérées, qui leur font concurrence et apportent avec elles des zoonoses et parasitoses, jusqu’ici non endémiques. Enfin ces animaux polaires n’ont aucune possibilité de repli vers des zones plus fraîches et sont donc directement menacés (rapport parlementaire d’Hervé Gaymard et de Noël Mamère).
Cet usage par l’humain de la planète ne se traduit pas seulement par une exploitation excessive responsable de perte de biodiversité et de dérèglement climatique. Il se mesure aussi par la dégradation des biens communs du fait de leur pollution. Soixante-dix années de production intensive ont pollué l’air des villes, l’eau des rivières et des nappes phréatiques, les sols et sous-sols de nos régions, affadi nos aliments et abîmé nos paysages, tandis que nos déchets contribuent à former plusieurs océans de plastique et à pénétrer la chaîne alimentaire via les animaux marins.
Au final, l’empreinte écologique de l’humanité sur la planète croît à une vitesse exponentielle, alors que la population mondiale, de plus de 7 milliards aujourd’hui, devrait atteindre 8,5 milliards en 2030 et 9,6 milliards en 2050, selon les dernières estimations de l’ONU. En 2015, l’Humanité avait, dès le 13 août, consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an. Nous sommes aujourd’hui entrés dans l’ère de l’anthropocène, notion introduite par le Prix Nobel Paul Crutzen pour désigner une nouvelle époque géologique, caractérisée par l’influence prédominante de l’homme sur la planète et par sa capacité à la transformer.
B. LE CONSTAT D’ÉCHEC OBLIGE À RAISONNER AUTREMENT
Dans un exercice d’une habile clairvoyance, le fondateur du forum de Davos, qui rassemble les décideurs politiques, économiques et financiers de la planète, a reconnu, en janvier 2014, à l’occasion de sa 44e édition, l’existence d’une face sombre de la mondialisation. « Si celle-ci a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions d’êtres humains », a-t-il expliqué, « elle s’est accompagnée de l’explosion de nouveaux risques à la fois systémiques et interconnectés ». Si chacun d’entre eux peut provoquer une défaillance mondiale, leur mise en résonance, capable de susciter un effet domino, est encore plus inquiétante. « Les inégalités croissantes, le chômage, les changements climatiques et les crises de l’eau constituent les défis les plus dangereux, que la gouvernance mondiale est incapable de traiter ».
Ce partage du diagnostic de l’état de notre monde par les tenants de la mondialisation et par leurs opposants les plus engagés appelle à changer nos modes de réflexion, à sortir des schémas intellectuels dominants, à nous interroger sur l’extraordinaire bascule, qui a eu lieu à partir de la première révolution industrielle. L’Humanité s’est alors engagée dans un combat idéologique majeur sur la façon de répartir la création de richesses et d’organiser sa production. Après la chute du mur de Berlin, l’échec du communisme a supprimé toutes les limites, qui bridaient encore le capitalisme. Le triomphe de celui-ci, sous sa forme libérale la plus exacerbée, a imposé le dogme de l’ouverture des marchés, présentée comme source d’enrichissement et garantie de la démocratisation. Vingt-cinq ans plus tard, la réalité est toute autre. Dans de nombreux pays développés, les citoyens ont troqué des objets toujours moins chers à acheter contre la délocalisation de leurs usines et la destruction de leurs emplois. Dans de nombreux pays émergents, le libéralisme économique s’est installé, sans entraîner aucun progrès pour les libertés politiques et la démocratie. Et il n’y a aucune raison que cela change, tant que les pays en développement n’auront pas rattrapé le niveau de vie moyen des pays les plus riches. Ce qui se fera au prix d’un effondrement de l’environnement.
Il nous faut donc d’urgence sortir de ce carcan mental, parvenir à nous convaincre que ce mode de développement n’est pas un modèle à suivre mais une parenthèse à refermer dans l’histoire de l’humanité, afin d’ouvrir un nouveau chapitre porteur d’espoir. Il ne s’agit pas d’adapter le modèle mais d’en changer. Ceci dans la droite ligne de l’engagement de François Hollande, qui déclarait, le 14 septembre 2012, à l’occasion de la conférence environnementale « Il s’agit de mettre la France en capacité de porter un nouveau modèle de développement. Car les défis ne se divisent pas ; ils ne se hiérarchisent pas ; ils doivent être affrontés et surmontés ensemble. Les crises ne se séparent pas ; la crise écologique ce n’est pas une crise de plus, elle est dans la crise globale qui se décline sur tous les terrains, dans tous les domaines : économique, social, sanitaire. La transition n’est pas un programme, n’est pas non plus un choix politique partisan, c’est un projet de société, c’est un modèle de développement, c’est une conception du monde ».
Demain il ne suffira donc pas d’inventer de nouvelles régulations, de définir de nouveaux garde-fous ou d’espérer que le progrès technique nous sauve. Même si la tentation est grande d’utiliser les sciences et les techniques, pour repousser les limites du modèle actuel qui reste fondé sur une exploitation aboutissant à l’épuisement des ressources. C’est dans cet état d’esprit que nous tentons encore d’extraire, à des coûts prohibitifs pour l’environnement mais également de plus en plus pour l’économie, des ressources non conventionnelles, qu’il s’agisse de pétrole à 5 000 mètres de fond sous la mer ou de gaz emprisonné dans le schiste à 2 500 mètres dans le sous-sol, sans oublier le rêve de forer sous l’Océan arctique.
C’est dans cette volonté de ne rien changer fondamentalement, que nous continuons d’exploiter les terres agricoles à coups de béquilles chimiques et génétiques, pourtant de moins en moins rentables, qui dégradent les sols au point de les rendre quasi-stériles. Toutes ces pistes ne pourront que hâter les catastrophes, tout en nous privant de découvrir les vraies alternatives, basées sur une réorientation de la recherche, pour adapter l’ensemble de l’existence humaine et trouver au fil de l’expérience d’autres façons de produire, de consommer, de travailler, de financer, d’habiter, de circuler, d’échanger. Il nous faut donc découvrir de vraies alternatives, engager une large transition, partir en reconnaissance de toutes les tentatives réussies de résilience, combattre l’inertie grâce à des minorités agissantes, entrer en résistance contre tous ceux qui s’obstinent à tirer pour eux les derniers profits du système actuel au détriment du plus grand nombre et, au final, inventer de nouvelles façons d’être au monde. Cette transition sera celle des citoyens, des territoires et des entreprises, dont les initiatives les plus robustes et les plus résilientes devront être repérées et diffusées. Mais elles devront être encouragées par une gouvernance internationale, garante de la réorientation des grands flux financiers.
III. LES CHEMINS DE LA TRANSITION VERS UN MODÈLE PLUS SOUTENABLE À L’AUNE DE LA NÉGOCIATION CLIMATIQUE
Le cadrage du régime climatique s’avère de plus en plus inadapté pour penser les enjeux climatiques. Si la gouvernance onusienne a eu des mérites, elle est le seul lieu où les pays pauvres peuvent s’exprimer et elle a offert la possibilité à la société civile et aux ONG de se saisir activement de ce sujet, son fonctionnement a toujours eu tendance à préférer la recherche du consensus sur les questions de forme et de procédure à l’affrontement sur les divergences fondamentales. La gouvernance onusienne, technocratique et trop éloignée du terrain, ne peut rester l’instance unique de traitement du problème climatique et de mise en œuvre d’actions nécessaires pour protéger les êtres humains, les infrastructures et le capital naturel des impacts du changement climatique.
S’il faut repolitiser les enjeux, il faut aussi désenclaver le climat, car la question climatique n’est pas seulement un problème environnemental lié à la pollution des gaz à effet de serre.
En ciblant les émissions de CO2 au lieu de s’attaquer aux modes de consommation et de production actuels découlant du libéralisme, aux règles du commerce international ou au fonctionnement du système énergétique mondial, le régime climatique ne prend pas en compte ces autres régimes internationaux.
Considérant, contrairement à ce que l’on avait pu penser au moment du protocole de Kyoto, que l’essentiel ne réside pas dans des objectifs assignés dans une approche top down, mais dans ce qui se passera dans chaque pays, il convient en effet d’œuvrer pour un développement des savoirs climatiques locaux, afin d’ancrer la nécessaire transformation écologique de nos sociétés dans les réalités sociales, productives et économiques d’aujourd’hui. C’est dans ce sens qu’ont été remises par les États, en amont de la COP 21, leurs INDC - c’est-à-dire leurs contributions nationales à la lutte contre le changement climatique.
Si nous ne devons pas sous-estimer les possibles avancées en termes d’engagements de réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’approche bottom up retenue pour la COP 21 de la part des pays développés, des pays en développement et des grands pays émergents, celles-ci risquent de ne pas être suffisantes, si elles ne sont pas complétées par des actions concrètes. Afin d’atteindre le but fixé par le GIEC de ne pas émettre plus de mille milliards de tonnes d’équivalent CO2 au cours de ce siècle, ce qui correspond, si l’on souhaite répartir équitablement l’effort, à 2 tonnes par habitant et par an, il est nécessaire et urgent de changer de régime et de passer à un système qui procède directement par les moyens : instruments, politiques, acteurs…
B. LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
Pétrole, charbon et gaz naturel produisent, en 2012, 81 % de l’énergie mondiale, les biocarburants et les déchets 10 %, le nucléaire 5,7 % et les énergies renouvelables 3,2 %. Ces pourcentages diffèrent évidemment, lorsque l’on s’intéresse à l’énergie électrique. Les fossiles baissent à 67 %, tandis que le nucléaire augmente à 14 % et les énergies renouvelables à 19 %. C’est cette part de renouvelables, qui est en train de croître très rapidement, puisqu’elle passera selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à 26 % en 2020, notamment dans les pays pauvres et en développement, grâce à la baisse des coûts de production.
Dans un rapport publié le 2 octobre 2015, l’Agence balaye l’argument du caractère variable de la production des renouvelables, en expliquant que les systèmes d’énergie peuvent apprendre à s’adapter au caractère fluctuant des renouvelables, tandis que c’est la volatilité des décisions politiques (réduction des soutiens publics), qui représente le plus gros risque. L’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) révèle de son côté, en avril 2015, que la France pourrait obtenir 100 % de son électricité à partir d’énergies exclusivement renouvelables dès 2050, et que cela ne coûterait pas plus cher que le maintien du nucléaire à 50 % de la production électrique en 2025. En Europe, les 5 pays scandinaves ont déjà atteint la moyenne de 67 % d’électricité renouvelable (géothermie, éolien, hydroélectricité, biomasse) et ambitionnent une sobriété en carbone bien plus élevée que celle de l’Union européenne (en 2030 : diminution de 40 % des émissions de GES, 27 % d’énergies renouvelables comme objectif contraignant au niveau européen et 27 % d’efficacité énergétique comme objectif non contraignant).
En France, les bâtiments et les transports comptabilisent, à eux seuls, plus de 51 % des émissions de gaz à effet de serre. La transition énergétique, mesure d’urgence pour limiter significativement la hausse des températures, devra donc se concentrer sur la rénovation thermique des logements et le développement de transports alternatifs et communs, marqué par la sortie du « tout-automobile » pour entrer dans la multi-modalité économe en énergie et en carbone (tramways, navettes fluviales, téléphériques). Un programme extrêmement mobilisateur, puisqu’il allie la réduction des émissions polluantes, la création d’emplois non délocalisables, la réduction de la facture des ménages et la diminution de notre dépendance aux importations de produits fossiles. Mais il faudra aussi encourager partout l’efficacité et la sobriété énergétique : mutualiser les usages des biens et services, localiser les habitations à proximité des transports en commun, renforcer les services de proximité, réduire les distances quotidiennes parcourues, préférer les circuits courts, notamment alimentaires, utiliser les transports en commun et les modes doux, diminuer le gaspillage alimentaire et les emballages, consommer moins de viande, généraliser, pour tous les produits et services, un affichage carbone et énergie, établir des comparaisons avec les communes et communautés voisines. Comme l’indiquait François Hollande lors de la première conférence environnementale : « les économies d’énergie représentent la moitié au moins du chemin à parcourir vers une société sobre en carbone à l’horizon 2050 ».
La transition ne pourra enfin s’opérer que si elle s’accompagne de la mise en place d’un modèle décentralisé de l’énergie, réclamé par les acteurs locaux, qui raisonnent en termes de mix de toutes les formes d’énergies renouvelables, ce qui devra permettre de diminuer progressivement la part du nucléaire, en prenant en compte son véritable coût, qui relève aujourd’hui partout d’un non-dit peu démocratique (explosion des budgets de construction et de sécurisation des réacteurs, démantèlement des centrales, traitement des déchets), tout en revendiquant le choix d’une plus grande sécurité. Le déploiement des énergies renouvelables, en intégrant une forte dimension territoriale et citoyenne, rapprochera la production d’énergie du consommateur et créera ainsi une appropriation du service et une prise de conscience de sa valeur, qui pousseront à la mise en place des meilleures solutions et à une plus grande sobriété. Les micro-systèmes complèteront le macro-système au sein d’une hybridation nouvelle. Ceci est hautement souhaitable dans les pays du Sud, où les projets à petite échelle sont les mieux à même de répondre aux besoins des femmes en matière d’énergie : solaire, éolien, biogaz, biomasse etc.
C. IL FAUT DONNER UN PRIX AU CARBONE
Faire payer le carbone émis permet d’indiquer à chaque acteur économique et à chaque citoyen le coût des dommages associés à ses émissions de GES, d’inciter par là même les décideurs publics et privés à réaliser la transition énergétique et d’amorcer le changement de modèle productif, tout en aidant au financement des actions nécessaires. En effet, comme le rappelle le 5e rapport du GIEC, vingt ans de négociation n’ont pas réussi à infléchir les émissions mondiales de CO2, dont la progression s’est, au contraire, accélérée au cours de la dernière décennie.
Cette évolution est en réalité inscrite dans le fonctionnement actuel de notre économie. Les prix du charbon, du pétrole et du gaz reflètent les raretés relatives de leurs stocks en terre et les contraintes de leur transport et distribution. La baisse du prix du pétrole, après celle des prix du gaz et du charbon, démontre qu’il y a bien trop d’énergie fossile sous nos pieds par rapport à ce que peut absorber l’atmosphère sans risques pour la stabilité du climat.
Pour sortir de cette impasse, il est urgent d’intégrer une nouvelle valeur dans l’économie ; cette valeur c’est le prix du carbone qui doit s’ajouter aux valeurs s’échangeant sur les marchés, pour faire payer à chaque émetteur de CO2 le coût des préjudices climatiques associés à ses rejets. La difficulté réside dans le fait que son introduction, à l’échelle internationale comme à l’intérieur d’un pays, provoque des effets importants sur la distribution des revenus. De plus, toute la question est de savoir quel instrument choisir pour le mettre en œuvre avec succès.
1. Les différents types d’instruments
Pour faire émerger progressivement un prix du carbone, qui ne peut être identique sur la planète entière, trois grands types d’instruments, permettant une tarification du carbone, ont déjà été expérimentés. Le premier, la taxe carbone, est un prélèvement monétaire ajouté au prix de vente d’un produit ou d’un service, qui repose sur la quantité de carbone émise lors de la production, du transport et de la consommation de ce bien ou de ce service. Le deuxième, la norme d’émission, consiste en un standard de référence, qui détermine la quantité maximum d’émission de gaz à effet de serre à ne pas dépasser lors de la production d’un bien ou d’un service. Enfin le troisième, le système d’échange de quotas au sein d’un marché, est un mécanisme, qui fixe des obligations de réduction d’émission aux participants de ce marché et leur distribue des quotas d’émission correspondant à ce plafond. L’essentiel étant d’arriver, de façon incitative, à limiter la quantité totale de CO2 émis, les participants peuvent acheter des quotas, afin de compenser des émissions excessives ou en vendre, afin de valoriser les efforts supplémentaires de réduction qu’ils auraient pu faire.
À ce jour, selon la « CDC Climat », 17,3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par des mécanismes de tarification du carbone : 8,8 % par les systèmes de quotas, 4,3 % par les taxes carbone et 4,2 % par les normes d’émission. La dernière étude parue le 9 octobre à l’initiative de la « New climate economy » évoque un chiffre moins élevé, à savoir 12 % des émissions couvertes.
a. Le panorama mondial du prix du carbone en 2014
Un système de quotas d’émissions de CO2 existe aujourd’hui dans l’Union européenne, au Québec et en Californie regroupés en un seul marché depuis 2014, en Alberta, en Nouvelle-Zélande, au Kazakhstan, en Corée du Sud, dans 2 régions japonaises et dans 7 provinces et villes de Chine. Celle-ci vient d’ailleurs d’annoncer l’extension de ses projets pilotes à l’ensemble de son territoire en 2017, même si, dans un premier temps, seuls une demi-douzaine de secteurs fortement émetteurs de CO2 seront concernés, parmi lesquels l’acier, l’énergie ou encore la chimie.
La taxe carbone, de son côté, est en application dans de nombreux pays européens : Suède, Norvège, Islande, Finlande, Danemark, Irlande, Royaume Uni, France ainsi qu’en Colombie britannique, au Mexique, au Kazakhstan et au Japon. Le Chili et l’Afrique du Sud l’ont en projet.
Selon un rapport publié par la Banque mondiale en mai 2015, des progrès notables ont été accomplis depuis dix ans, aboutissant à l’existence, à ce jour, de quarante systèmes nationaux et d’une vingtaine régionaux. Un groupe de coordination recense d’ailleurs les bonnes pratiques à l’œuvre au sein des grands pays. Aujourd’hui les marchés de quotas pèsent 34 milliards de dollars, tandis que la taxe carbone rapporte 14 milliards, ce qui fait un total de 48 milliards. Mais au total, les prix du carbone sont encore trop bas, pour influer sur les stratégies d’investissement des pouvoirs publics et des entreprises, de telle sorte que ces agents économiques se détournent des énergies fossiles pour accélérer la transition. La plupart se situent, selon la Banque mondiale, sous les 15 dollars la tonne, notamment au sein du marché européen, où le prix évolue entre 5 et 10 euros, même s’il existe des exceptions comme la Suède où la tonne de carbone atteint 115 euros.
b. Quatre expériences de tarification carbone
À titre d’exemple des expériences en cours, l’on peut citer :
– Le « Clean Power Plan » des États-Unis, présenté par Barack Obama le 3 août dernier, qui vise à réduire de 32 %, d’ici à 2030, les émissions de CO2 liées à la production des centrales électriques par rapport à l’année 2005. Pour atteindre cet objectif, le plan d’action prévoit une réduction de la part de charbon à 27 % de la production à l’horizon 2030, contre 39 % en 2014. Ce « Plan d’Énergie propre » donne une flexibilité aux États pour atteindre l’objectif en matière d’instruments économiques et de calendrier de mise en œuvre ;
– La taxe carbone chilienne, votée en septembre 2014 pour entrer en vigueur le premier janvier 2017, concerne les centrales thermiques de 50 MWth pour l’ensemble des gaz à effet de serre et les particules fines, tandis que les véhicules légers et les vans professionnels ne sont taxés que pour leurs émissions de NOx. Les montants sont encore modestes : 5 dollars par tonne de CO2 et 0,1 dollar par tonne de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et de particules fines ;
– Les systèmes pilotes d’échange de quotas de CO2 chinois sont expérimentés depuis juin 2013 dans deux provinces et cinq villes. Le choix de ces territoires visait à représenter la diversité des modèles économiques, industriels et géographiques. Cette expérience a concerné quelque 1 900 entreprises et les échanges ont atteint au premier décembre 2014 plus de 14 millions de tonnes de CO2. Le texte de loi, qui prévoit la généralisation à l’ensemble du territoire chinois, prévoit que 8 000 entreprises soient concernées en 2017 ;
– Certaines entreprises privées ont commencé à instaurer un prix du carbone interne, afin d’anticiper les réglementations futures, de démarrer leur adaptation au changement climatique ou encore de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Selon le « Carbon Disclosure Project », en 2014, 150 entreprises sont dans ce cas, tandis que 254 ont investi dans des projets de réduction d’émissions à hauteur de 362 millions de tonnes de CO2.
D’autre part la Banque mondiale a lancé en octobre 2014 une coalition « Carbon Pricing Leadership » qui invite présidents, ministres et dirigeants d’entreprise à se mobiliser en faveur de la mise en œuvre d’un prix du carbone. De février à juin 2015, la première partie de l’action a consisté à analyser l’efficacité économique d’un tel prix et jusqu’en octobre de cette même année, la Banque mondiale aura multiplié des actions de sensibilisation et d’assistance à destination des gouvernements et des secteurs privés.
2. Que faire demain pour que le prix du carbone devienne une réalité ?
Pascal Canfin et Alain Grandjean ont listé dans leur « feuille de route pour financer une économie décarbonée » une série de propositions. Fixer un prix au carbone leur paraît incontournable, afin de réorienter de manière rapide et massive les investissements et les consommations vers des modes moins émissifs. En tenant compte des difficultés et des échecs des expériences déjà menées à travers le monde, il semble que l’idée d’un corridor de prix pour le carbone soit la mieux adaptée à la réalité. Il permettrait aux différents pays de se situer entre 15 et 20 dollars la tonne de carbone en 2020, pour passer à un écart de 60 à 80 dollars, 15 à 20 ans plus tard.
Le Parlement français a, de son côté, voté dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, une valeur de 100 euros la tonne en 2030. Thomas Porcher y ajoute l’idée d’une corrélation à l’indice de développement humain (IDH) du pays, ainsi qu’à ses émissions de CO2 par habitant, en tenant compte des biens consommés et non produits. Cette proposition présenterait le double l’avantage d’admettre la nécessité de se développer pour les pays pauvres et de comptabiliser les véritables émissions des pays développés, qui sous-traitent leurs productions industrielles, en les délocalisant en même temps que les émissions de celles-ci, vers les pays émergents. Cependant la mesure de l’IDH pouvant se révéler conflictuelle, la communauté internationale pourrait acter un corridor d’un niveau plus faible pour les pays en développement. Enfin, à l’intérieur de chaque pays, l’impact de la taxe carbone sur les ménages les plus pauvres devrait être compensé via un crédit d’impôt.
Par ailleurs, les marchés de quotas devront poursuivre leur mutation. Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (EU ETS), qui s’applique dans 30 pays européens, dysfonctionne. Il devrait bénéficier d’une gouvernance rénovée, qui permettrait d’afficher un couloir de prix, dont les bornes haute et basse encadreraient la valeur tutélaire arrêtée par le rapport Quinet, à savoir 100 euros la tonne de CO2 en 2030. Cette valeur de référence du carbone fixée en France, afin de pouvoir guider les choix en matière d’investissements publics, se retrouve dans les préconisations de l’AIE et de nombreuses entreprises. Enfin, ce marché européen pourrait être couplé avec le marché réunissant déjà la Californie et le Québec mais aussi, à terme, avec celui qui se développe en Chine. Une telle coordination pourrait permettre d’avancer vers un marché transcontinental du carbone, selon Christian de Perthuis, qui voit à terme se mettre en place ainsi une mutualisation entre la Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe.
En tout état de cause, l’idée de fixer un prix au carbone est dorénavant prônée par les institutions financières les plus conventionnelles. La Banque mondiale estime que le seul risque en la matière est de ne pas aller assez vite et affiche sa nette préférence pour la taxe carbone, peu affectée par les possibilités de fraude, peu chère à lever et efficace, tant pour financer des infrastructures décarbonantes, que pour continuer à éradiquer la pauvreté. La présidente du FMI, Christine Lagarde, affirme, elle aussi, que « c’est simplement le bon moment pour introduire une taxe carbone plus efficace pour diminuer les émissions de CO2 que le système d’échange de quotas d’émissions ».
C’est d’ailleurs dans le cadre du « Carbon Pricing Panel » ou « Comité sur la tarification du carbone », créé par les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI, que François Hollande et Angela Merkel mais aussi les présidents du Chili, du Mexique, des Philippines, le premier ministre éthiopien, le gouverneur de Californie et le maire de Rio de Janeiro ont appelé, le 19 octobre, leurs pairs à une alliance sans précédent de chefs d’État et de collectivités, laquelle exhorte les pays et les entreprises du monde entier à donner un prix au carbone. Initiative soutenue par l’énergéticien français Engie, dont le président-directeur général Gérard Mestrallet appelle également à la mise en place d’un signal prix, « qui ne doit pas être considéré comme un frein pour l’économie mondiale mais comme un accélérateur de croissance, en installant de la confiance, de la visibilité propices à l’investissement et à l’innovation »,
Même les six compagnies pétrolières majeures européennes l’ont réclamé dans une lettre commune adressée le premier juin dernier au président de la COP 21, Laurent Fabius, et à la secrétaire exécutive de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Christiana Figueres.
D. LA REMISE EN CAUSE DU SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
En 2011, le rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement « vers une économie verte » recommande d’investir 2 % du PIB mondial dans la transition énergétique. L’AIE chiffre à 2 000 milliards de dollars la somme nécessaire à la construction des infrastructures d’une économie mondiale faiblement carbonée. Le coût de la transition énergétique peut paraître astronomique, mais le prix de l’inaction serait infiniment plus élevé, 5,5 % du PIB en 2050. Et l’on sous-estime, d’autre part, les effets d’entraînement qu’aurait le passage à un autre modèle. Le prix Nobel d’économie Paul Krugman souligne ainsi que la production énergétique renouvelable est de plus en plus abordable et cite, pour exemple, la division par deux du coût du photovoltaïque depuis 2010 : « Si un jour nous passons outre les intérêts particuliers et l’idéologie, qui ont bloqué l’action nécessaire pour sauver la planète, nous verrons que cela sera plus simple et moins coûteux que personne, ou presque, ne l’avait imaginé ».
Sur ce chemin, la première mesure à prendre est d’arrêter de subventionner les énergies fossiles au détriment des énergies renouvelables. L’OCDE a confirmé à la fin du mois de septembre dernier l’énormité des richesses publiques consacrées à encourager la production et la consommation domestiques des combustibles fossiles : 200 milliards de dollars sont versés chaque année par 40 États, les 34 les plus développés et 6 émergents pour financer, côté producteurs, des terminaux charbonniers ou gaziers, ou encore la recherche et l’exploration et côté consommateurs, toutes sortes de mesures d’encouragement, pas moins de 800, en faveur des agriculteurs, des pêcheurs, des forestiers, des taxis, des compagnies aériennes, des routiers et des automobilistes. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait avancé en 2014 le chiffre de 550 milliards de dollars pour le monde entier en comptabilisant les subventions transnationales, comme les crédits à l’exportation du charbon. En mai 2015, le FMI allait encore plus loin en chiffrant à 5 300 milliards de dollars par an les subventions effectivement versées et camouflées sous forme de non prise en compte des coûts liés à la pollution. L’arrêt de ces subventions devra évidemment se concentrer sur les grosses entreprises et mettre fin aux niches de consommation dans les pays développés mais épargner les pratiques liées à la vie quotidienne des populations de certains pays en développement.
La deuxième piste à suivre est de pousser les acteurs publics et privés à désinvestir dans les énergies fossiles. À la suite d’une campagne de mobilisation citoyenne, menée notamment par le mouvement 350.org présent dans 188 pays, plusieurs actions ont été lancées comme la décision de la fondation Rockefeller de retirer d’ici à 2018 les énergies fossiles de son portefeuille d’actifs à hauteur de 850 millions de dollars ou l’annonce par plusieurs banques françaises, la Société générale, la BNP, le Crédit Agricole de ne plus investir dans les grands projets miniers australiens. De la même façon, le Fonds souverain norvégien, qui contrôle 1,3 % de la capitalisation boursière mondiale, a décidé de se désengager des entreprises minières ou des groupes d'énergie, pour lesquels le charbon représente plus de 30 % de l'activité ou du chiffre d'affaires.
Pour engager une masse critique d’investisseurs institutionnels à décarboner progressivement leurs portefeuilles, le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et son initiative Finance (UNEP FI) ont créé en compagnie du gestionnaire d’actifs Amundi, du fonds de pension suédois AP4 et de l’organisation à but non lucratif CDP (Carbon Disclosure Project) une « coalition pour décarboniser les portefeuilles », qui a pour objectif la réduction de l’empreinte carbone de 100 milliards d’euros d’investissements.
Au total, selon « Divest-Invest », l’ensemble des actifs gérés par des fonds de pension, des compagnies d’assurances et des œuvres philanthropiques, ayant pris l’engagement de ne plus investir dans les énergies fossiles, a atteint, en septembre 2015, quelque 2 600 milliards de dollars. Il témoigne de la prise de conscience de la part des gestionnaires d’actifs financiers de ce qui apparaît dorénavant comme un véritable risque carbone, que les investisseurs sont en droit de voir pris en compte, tout comme ils peuvent exiger que les flux financiers soient dorénavant dirigés vers la nouvelle économie sobre en carbone.
E. LES FINANCEMENTS CLIMAT, CLÉ DE VOÛTE D’UN ACCORD AMBITIEUX
1. En finir avec la financiarisation de l’économie
Ce virage que la communauté internationale va devoir faire prendre à l’économie pour sauver la planète des dérèglements climatiques ne se fera pas sans une remise en cause fondamentale du système financier, tel qu’il s’est développé depuis une trentaine d’années.
En termes de finance, le marché a longtemps fait son office, à savoir assurer la rencontre entre l’épargne des particuliers, qui souhaitent placer leurs économies et les besoins de financement des entreprises et des États, qui manquent de liquidités pour investir, ceci par le biais des banques. De leur côté, les assureurs ont fourni avec succès, aux particuliers comme aux entreprises, des protections contre les risques encourus dans leurs activités respectives. Mais la dérégulation massive du marché de la finance, mise en place dans les années quatre-vingt à la suite de l’abandon en 1971 de la convertibilité or du dollar, a déstabilisé le système, faisant éclater au fil des ans de nombreuses crises, limitées à certains pays (Mexique, Brésil, Argentine, Russie, Turquie), généralisés à un continent (Asie, Europe avec la crise des dettes souveraines) ou étendues au monde entier via l’éclatement de bulles (internet en 2000, subprimes et hedge funds en 2007-2009).
En créant une infinité de produits de couverture sophistiqués, en favorisant la titrisation de produits toxiques et en multipliant, via des modèles mathématiques complexes, certains types de transaction, comme le trading à haute fréquence, non seulement la finance, devenue extrêmement volatile, ne joue plus son rôle, puisqu’elle distribue insuffisamment le crédit à l’économie réelle mais elle se retourne contre celle-ci. La finance toute puissante réduit la sphère de l’État, le niveau des salaires, le nombre de salariés et le périmètre de la protection sociale. Les produits dérivés, échangés en 2012, représentent 700 000 milliards de dollars, tandis que prospèrent les paradis fiscaux.
Les États, qui ont laissé le système se développer sans règles, se retrouvent seuls à la manœuvre, quand la faillite d’un établissement bancaire ou assurantiel menace de se répercuter sur l’ensemble de l’économie. Au sein de la zone euro, les plans de soutien aux pays attaqués entraînent un creusement gigantesque des dettes. Devant le risque de faillite de leurs États respectifs, les gouvernements utilisent l’arme budgétaire, qui plonge les populations dans une situation toujours plus délétère, d’autant que la monnaie européenne a été créée sans harmonisation ni fiscale ni sociale. Ce capitalisme financiarisé fonctionne comme un gigantesque casino, qui n’aurait pas fixé de plafond de jeu, ni interdit de joueur et fait finalement payer à l’ensemble des citoyens le prix d’une flambée sans fin.
Selon ATTAC, la mesure la plus urgente à prendre en termes de finance compatible avec le climat serait d’interdire les produits financiers dérivés et/ou indexés sur les énergies fossiles. La mise en place d’une taxe sur les transactions financières européennes à large assiette assurerait ensuite à la fois la réconciliation entre la finance et l’économie et doterait la lutte contre le changement climatique de financements pérennes. Mais au-delà de ces décisions ponctuelles à prendre rapidement, c’est évidemment l’alignement du système financier sur les objectifs du développement durable qu’il faut obtenir. Le PNUE a publié en ce sens, le 8 octobre, un rapport intitulé « le système financier dont nous avons besoin », qui liste des exemples de bonnes pratiques déjà en cours dans 15 pays et dans les principaux secteurs du système financier et présente un cadre d’actions à mener.
2. Le financement des 100 milliards
En 2009, lors de la conférence climat de Copenhague, les pays développés ont pris l’engagement d’apporter collectivement 100 milliards de dollars par an aux pays en développement, pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et à s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique (adaptation). Cette promesse a conduit la plupart des pays en développement à conditionner leurs engagements les plus ambitieux de réduction de GES (INDC) à l’obtention de ces financements.
Pour la Fondation Nicolas Hulot, il conviendra de veiller très précisément à ce que la part privée de ce financement global n’excède pas 35 milliards, la part publique atteignant au minimum 65 milliards par an à partir de 2020, soit un doublement a minima de ce qui existe en 2012 (entre 14 et 34 milliards selon les sources). En effet, l’engagement des institutions publiques est primordial pour lever les obstacles à ces investissements de long terme et rassurer les acteurs privés par l’effet levier procuré. Le rapport Canfin-Grandjean évoque à ce sujet l’évolution nécessaire du rôle des banques de développement, qui devraient devenir des opérateurs d’investissements bas-carbone, en utilisant leurs outils à fort effet de levier, pour orienter leurs aides vers les projets compatibles avec le maintien des températures sous les 2°.
Les institutions, qui régulent la finance, comme le Comité de Bâle, devraient de leur côté surveiller l’exposition aux risques climat et carbone des différents acteurs, qu’il s’agisse des banques, des fonds de pension ou des assureurs, qui seraient soumis à des « stress tests climat ». À noter que la saisine sur ce sujet par Michel Sapin au printemps 2015 du Conseil de stabilité financière a permis de démarrer le processus. Ensuite les fonds publics devront évidemment mobiliser de nouvelles ressources et ne pas provenir du transfert de budgets déjà existants et consacrés à d’autres enjeux de l’aide au développement, que l’on diminuerait d’autant. Enfin, alors qu’aujourd’hui seuls 10 % environ des financements climat sont consacrés aux dépenses d’adaptation des pays les plus vulnérables via des subventions, c’est-à-dire des dons, cette part devra augmenter dans l’avenir. François Hollande s’y est engagé devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le 28 septembre dernier, en promettant que « l’augmentation de l’aide ne sera pas simplement des prêts, mais aussi des dons, parce que c’est par rapport aux dons- c’est-à-dire ce qui est transféré directement, ce qui n’est pas remboursé- que l’on pourra favoriser puissamment l’adaptation des pays en développement aux effets du dérèglement climatique ».
À la veille de la COP 21, la communauté internationale a cependant encore un long chemin à parcourir. Le rapport de synthèse présenté en octobre par l’OCDE, qui fait état de l’existant, chiffre à moins de 62 milliards le financement climat Nord-Sud en 2014. Il agrège les aides publiques bilatérales (37 %), les interventions des banques multilatérales (33 %), les financements privés (27 %) et les crédits à l’export (3 %), qui permettent principalement aux pays du Nord d’exporter vers leurs clients du Sud des éoliennes (à 72 %) et des centrales photovoltaïques (à 22 %). Ce rapport ne distingue pas les prêts des dons, ce qui représente une véritable faiblesse de l’analyse, notamment pour l’aide attendue par les pays les plus pauvres incapables de contracter des prêts. Enfin, il chiffre à 16 % la part totale consacrée au financement de l’adaptation, ce qui reste insuffisant, en comparaison des 77 % allant à l’atténuation (les 7 % restant sont dévolus à des projets transversaux). Les crédits export s’adressent ainsi à 100 % et l’aide privée à 90 % à l’atténuation, au détriment des investissements d’adaptation, pourtant urgents à mettre en œuvre pour sauver les pays et régions les plus vulnérables.
La création, début octobre à Lima, du V20 composé des ministres des finances des vingt pays les plus vulnérables au changement climatique, qui se sont accordés sur un mécanisme de mutualisation des risques climatiques, illustre ce besoin particulier. Plusieurs banques de développement ont cependant annoncé de nouveaux engagements lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Lima le 12 octobre. La Banque mondiale augmentera ses financements climatiques jusqu’à 29 milliards de dollars par an en 2020. Toujours par an et à partir de 2020, la Banque asiatique de développement doublera ses financements à 6 milliards de dollars, la Banque africaine de développement ira jusqu’à un quasi triplement, à hauteur de 5 milliards de dollars et la Banque interaméricaine de développement doublera son effort. Enfin, la Banque européenne d’investissement fournira plus de 110 milliards de dollars et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 18 milliards d’euros pour des projets climatiques dans les 5 prochaines années. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, souligne le rôle essentiel de ces banques régionales, qui ont permis, en ce qui concerne l’Union européenne, de susciter depuis 2007 à partir d’un investissement initial d’un milliard d’euros plus de 25 milliards d’investissements privés dans les pays en développement.
En termes d’engagement global, la France, hôte de la COP 21, a annoncé par la voix de François Hollande, lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, qu’elle augmenterait son financement de 2 milliards, comme l’Allemagne, le portant de 3 milliards en 2015 à 5 milliards en 2020. Barak Obama s’est engagé à verser 3 milliards de dollars au fonds vert pour le climat, tandis que le président chinois indiquait son engagement à hauteur de 3 milliards de dollars également en faveur de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Côté européen, l’effort à accomplir pour parvenir à cette augmentation pourrait passer par la mise en place de la taxe sur les transactions financières, dont le principe a déjà été adopté par 11 des 28 pays de l’Union européenne sous forme de coopération renforcée et dont la création annoncée pour janvier 2016 risque d’être reportée début 2017, selon les dires de François Hollande, sans que l’on sache encore sur quoi elle porterait (actions, produits dérivés).
La France, qui a déjà mis en place depuis août 2012 une taxe limitée à certains titres, qui exclut notamment les produits dérivés, sur lesquels interviennent ses principales banques, pourrait à la fois élargir le champ de la TTF, en y intégrant les transactions « intra-day » (qui sont dénouées au cours d’une seule journée) et augmenter l’affectation de son produit au fonds de solidarité pour le développement, comme le prônent deux amendements à la loi de finances 2016. Aujourd’hui seuls 17 % du montant de la TTF servent à financer les dépenses de développement à hauteur de 160 millions ; en passant ce plafond à 50 %, la France serait en capacité d’abonder ce poste jusqu’à 466 millions d’euros.
Alors que ces sommes peuvent paraître importantes, il convient de les rapprocher de la mobilisation, effectuée en 2009 sans aucune difficulté, de 1 000 milliards de dollars, pour sauver le système bancaire, alors menacé par la crise financière. Ces 100 milliards de dollars ne représentent par ailleurs que 0,14 % du PIB mondial. D’ailleurs la FNH, qui s’est livrée à une estimation des besoins en termes d’adaptation des pays les moins avancés et des pays en voie de développement, indique qu’en 2020 les 100 milliards couvriront à peine la moitié des investissements nécessaires. L’autre moitié devra venir d’investissements nationaux, d’investissements privés et de financement Sud-Sud. Le PNUE chiffre, lui, les besoins d’adaptation des pays en développement à 150 milliards de dollars par an en 2025-2030 mais à 500 milliards à l’horizon 2050. En tout état de cause, la part publique des 100 milliards devra être réévaluée tous les 5 ans et son financement élargi à de nouveaux contributeurs, comme la Chine, qui aura acquis d’ici là une puissance financière suffisante.
3. Réorienter les financements privés, afin de favoriser la transition vers une économie décarbonée.
Un premier pas important, au niveau international, a été franchi à l’initiative de la France, puisque les ministres du G20 ont mandaté le Conseil de stabilité financière pour analyser comment le secteur financier peut prendre en compte les questions liées au changement climatique. D’ailleurs, la France est le premier pays au monde à s’être doté d’un arsenal législatif obligatoire (loi sur la transition énergétique et la croissance verte) pour les gestionnaires et détenteurs d’actifs, afin de mieux tenir compte du risque climat, de mesurer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles financiers, de rendre publique la part d’investissements réalisés dans la transition vers une économie décarbonée et la façon dont ils rendent leurs stratégies d’investissements cohérentes avec l’objectif internationalement reconnu des 2°C. Certaines de ces mesures sont également en débat en Suède mais aussi en Chine.
De leur côté Pascal Canfin et Alain Grandjean ont, dans leur rapport, mis en évidence une prise de conscience sans précédent dans le monde financier, qui commence à intégrer l’enjeu climatique non plus comme un sujet extra-financier et de responsabilité sociale et environnementale (RSE) mais comme un risque financier potentiel majeur sur les modèles économiques des entreprises et sur la stabilité financière. De même, considérant que les banques de développement constituent un levier essentiel, ils proposent différentes innovations financières, qui permettraient de financer plus de projets bas-carbone et d’augmenter l’effet d’entraînement sur le financement privé de ces projets (développement des garanties, nouveau rôle des banques de développement vis-à-vis des marchés de capitaux, capacité renforcée à l’appui de l’émergence de projets bas-carbone, gestion du risque politique et de convertibilité…).
Allant dans le même sens, Jean-Charles Hourcade et Michel Aglietta proposent de rendre éligible à la politique de rachat d’actifs par la Banque centrale européenne des titres privés, dont l’impact bas-carbone avéré serait garanti par la puissance publique. Il s’agirait de mettre en place un système d’intermédiation financière, gagée sur le carbone, permettant la mise en œuvre d’une politique monétaire non conventionnelle, orientée vers les investissements nécessaires à la transition bas-carbone. Enfin, relevant que la partie essentielle à financer concerne les infrastructures bas-carbone, Pascal Canfin et Alain Grandjean notent que celles-ci peuvent comporter des spécificités qui, dans de nombreux cas, bloquent leur financement. L’identification de ces obstacles et leur levée constituent alors une priorité (absence de recul pour évaluer le cash- flow futur, faible expérience des administrations pour intégrer les spécifications bas-carbone dans la commande publique et les appels d’offres, nouveau modèle économique…).
Le rapport Canfin-Grandjean fait le point sur les financements dits « innovants », qui permettraient de mobiliser davantage de financements notamment publics.
a. La taxe sur les transactions financières (TTF)
Même si, en 2011 à Cannes, sous présidence française, le G20 s’est déclaré en faveur d’une taxe sur les transactions financières, aucune discussion à ce jour n’a réellement eu lieu au plan international (suivant les modalités retenues, une taxe mondiale rapporterait entre 90 et 300 milliards de dollars par an). En 2013, onze pays de l’Union européenne ont décidé de mettre en place une coopération renforcée pour instaurer une TTF. En janvier 2015, le Président de la République française s’est prononcé en faveur d’une taxe reposant sur l’assiette la plus large possible. L’engagement politique est de trouver un accord avant la fin de l’année 2015. La France a, à plusieurs reprises, indiqué son intention d’en affecter une partie très significative au climat. Pascal Canfin et Alain Grandjean parlent d’une recette possible de 10 milliards d’euros en 2020, sur laquelle 2 milliards reviendraient à la France, ce qui lui permettrait de consacrer près de 1,4 milliard d’euros au climat (soit 70 % d’allocation pour le climat). La réussite de cette négociation sur la TTF à Onze est un élément clé pour la mobilisation de financements publics supplémentaires pour le climat.
b. Les transports internationaux
Les transports maritimes et aériens sont des émetteurs importants et croissants de gaz à effet de serre (entre 2 et 3 % des émissions mondiales pour le secteur aérien et 3 % pour le secteur maritime). L’ensemble du secteur de l’aviation a pris en 2010 un engagement cible de croissance neutre en carbone à partir de 2020, dont il doit décider les modalités précises en 2016. En complément des normes d’efficacité énergétique, dont l’application doit être accélérée et généralisée, la mise en œuvre de cet engagement sous la forme d’une compensation carbone dans les pays en développement et notamment les plus vulnérables, permettrait de dégager entre 2 et 6 milliards de dollars de transferts financiers en 2025, qui pourraient permettre de financer la restauration des terres agricoles dégradées.
c. Les revenus des marchés de carbone
À ce jour, les mécanismes de tarification du carbone ne permettent pas d’atteindre les potentiels de revenu estimés au début de la décennie. De plus, l’essentiel des revenus des mises aux enchères des marchés de carbone a été affecté à des fins domestiques, pour financer des politiques de réduction d’émissions mais aussi de réductions de cotisations sociales par exemple. En 2013, dans le schéma européen d’échange de quotas (ETS), sur les 3,8 milliards d’euros de revenus générés par les enchères, seulement 0,5 milliard d’euros ont été orientés vers des flux internationaux de la finance climat.
Avec l’expansion des marchés carbone dans le monde, il est probable que ces dispositifs constituent une source de revenus croissants. Pour l’EU ETS, les estimations de revenus sont de l’ordre de 230 à 320 milliards d’euros entre 2015 et 2030 (compte tenu de l’augmentation de la part de quotas mis aux enchères). En faisant l’hypothèse que les États membres affectent en moyenne 70 % du revenu des enchères au climat et qu’environ un tiers de cette part aille à l’aide internationale, cette dernière représenterait 3,5 à 5 milliards d’euros par an (selon les hypothèses de prix du carbone).
F. DES POLITIQUES PLUS DURABLES ET PLUS SOBRES EN CARBONE
Si l’énergie constitue à la fois le cœur de la crise climatique, le moteur de notre développement et donc la politique à réformer en première urgence, les villes, les usines, les campagnes sont autant d’espaces concrets, où doivent s’inventer de nouvelles manières d’être au monde, dictées par une politique de sobriété en carbone. En reconsidérant ses rapports avec la nature, la ville doit concourir à une meilleure intégration des espaces urbains et ruraux et renouer avec les écosystèmes sous la pression de la pollution, des canicules ou des inondations.
L’appareil productif doit s’adapter à la société bas-carbone. Après la bataille historique entre l’économie capitaliste et l’économie planifiée, au-delà de l’expérience de l’économie sociale de marché adaptée aux Trente glorieuses, par-delà l’économie libérale sans limites, c’est une nouvelle économie multiple, qui doit demain réconcilier l’outil du marché, la prise en compte du social et l’obligation de l’écologie. Économie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie sociale et solidaire, économie positive : toutes ces nouvelles formes d’organisation, déjà mises en œuvre de façon marginale, devront coexister et inspirer l’ensemble de notre transition. Enfin une agriculture résiliente au changement climatique et favorable à la biodiversité doit remplacer le modèle conventionnel, qui se heurte aux limites physiques, environnementales et sanitaires des excès de son productivisme.
Les villes consomment aujourd’hui les deux tiers de l’énergie mondiale et représentent 70 % des émissions de GES liées à cette consommation. Appelées encore à se développer, elles doivent devenir des acteurs du changement. Les pistes sont nombreuses :
– Favoriser la densité des villes, au contraire de l’étalement, afin d’éviter le mitage de l’espace et la dispersion des habitations, éloignées des lieux de travail ;
– Prévoir des ceintures vertes réservées à des usages agricoles ;
– Intégrer des espaces naturels et préserver la biodiversité en ville ;
– Favoriser les jardins urbains ;
– Réserver dans les villes des espaces pour les pratiques collectives et durables, telles que des lieux de co-travail, des ateliers collaboratifs, des pistes cyclables, des places de stationnement pour le co-voiturage et les voitures électriques ;
– Prévoir dans les immeubles collectifs des espaces partagés (laverie, local à vélo, compost, atelier de bricolage) ;
– Développer les systèmes de réseaux de chaleur, qui valorisent les déchets via la cogénération et consomment de la biomasse ou du biogaz ;
– Encourager l’implantation des petites et moyennes surfaces en centre-ville et décourager celle des grandes surfaces en périphérie, afin de densifier la ville et de préserver les terres agricoles ;
– Favoriser la collecte et la livraison mutualisées en ville. Dédier des voies d’autoroutes urbaines et de périphériques aux voitures remplies, aux cars et aux bus.
L’économie circulaire, déjà largement expérimentée dans certains territoires et pays, inscrite dans différentes constitutions comme en Allemagne, permet aux déchets de certaines entreprises de devenir les ressources des autres. À terme, les objets seront conçus pour être réparés puis démontés et leurs différents composants réutilisés ou recyclés. Cela nous amènera à sortir de la logique du traitement des déchets, pour créer une nouvelle valeur à chaque étape sans perte finale.
À Cotonou, grâce à l’accès à des financements externes, les « Gohotos » -les femmes récupératrices- ont mis en place un système de gestion efficace des déchets solides ménagers, devenu pérenne. Elles recyclent les plastiques, bouteilles et objets métalliques, qu’elles revendent au marché. Les déchets organiques sont transformés en engrais et revendus aux jardiniers de la ville pour leurs cultures de légumes Cette économie du flux, qui copie les systèmes vivants, est la seule capable de permettre à la population humaine de se partager une planète finie.
Néanmoins si le recyclage est indispensable, car il retarde l’échéance de la raréfaction puis de l’épuisement des matières premières, il ne peut constituer à lui seul la solution. Le recyclage se révèlera insuffisant à satisfaire les besoins d’une population mondiale toujours plus nombreuse, tout comme l’aspiration des pays émergents à accéder au même niveau de vie que les pays développés, à moins que la consommation mondiale des matières premières n’augmente pas de plus de 1 % par an, étant donné l’aspect exponentiel des courbes de croissance, défini par François Grosse. Ce qui ouvre des perspectives à la recherche, afin de parvenir à réduire très fortement la quantité de matériau nécessaire par unité de produit. La raréfaction puis l’épuisement des matières premières nous obligeront donc à aller au-delà, en réduisant très fortement notre production et en développant l’économie de la fonctionnalité, c’est-à-dire en choisissant de vendre non plus les biens mais leur usage. Par ailleurs, l’économie sociale et solidaire, ancrée dans les territoires, conciliera éthique, valeurs collectives et efficacité économique.
3. Cultiver au lieu d’exploiter
La nécessité de nourrir 9 milliards d’êtres humains d’ici 2050 s’accommodera parfaitement des pratiques agro-écologiques, selon Olivier de Shutter, l’ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation des Nations Unies, qui les créditent à la fois de l’augmentation de la productivité, de la réduction de la pauvreté en milieu rural, de l’amélioration de la nutrition et de l’adaptation au changement climatique.
Déjà, en France, des milliers d’agriculteurs se sont engagés dans toutes sortes de pratiques en rupture avec le modèle conventionnel, qui repose sur l’économie du pétrole à base d’engrais, de pesticides et de carburants. L’agroforesterie, la permaculture, l’agriculture biologique ou biodynamique sont autant de façons naturelles de travailler la terre, qui permettent d’augmenter la production par la régénération de l’écosystème, en se fondant sur l’observation scientifique du vivant et le bio-mimétisme. La révolution agricole de l’après-guerre, menée à raison pour augmenter rapidement la production et répondre aux pénuries alimentaires, touche aujourd’hui à sa fin. Les pratiques agricoles, qui en découlent, sont à la fois émissives et polluantes et posent des problèmes de santé publique.
Ce qui relève encore aujourd’hui de la marginalité devra donc se généraliser. En tirant le meilleur parti de la nature, plutôt qu’en la dopant artificiellement, la nouvelle agriculture évitera les dommages collatéraux sur les sols, les végétaux, les animaux, les paysans, les éleveurs et les consommateurs, tout en augmentant la résilience au changement climatique et en favorisant le développement de multiples races animales et espèces végétales adaptées aux terrains et capables d’une production variée et saine.
Après des décennies d’exode rural, de concentration des exploitations et d’artificialisation des sols, l’agriculture a besoin de renouveler ses générations de paysans et d’éleveurs et de leur permettre un nouvel accès au foncier, tout en protégeant celui-ci du grignotage par la périurbanisation. Une réorientation de nos politiques publiques est définie ainsi par François Hollande en septembre 2014 : « Lutter contre la consommation rapide des terres agricoles, ce n’est pas protéger une profession, c’est protéger le pays. Préserver la biodiversité, c’est limiter l’artificialisation des sols, c’est encourager le développement d’un nouveau modèle agricole, plus respectueux de l’environnement qui réduise l’usage des pesticides, protège les ressources en eau ».
G. LA PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DES PUITS DE CARBONE
La préservation des puits de carbone, qu’il s’agisse des sols, des océans ou des forêts doit constituer un pilier de la lutte contre le réchauffement. Leur utilisation durable doit s’inscrire au cœur de toutes nos politiques publiques.
À l’intersection de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité alimentaire apparaît un élément de notre planète, fondamental mais largement ignoré, voire totalement oublié. Il s’agit du sol que l’on foule quotidiennement et qui enveloppe d’une mince et fragile pellicule la croûte terrestre. Artificialisé dans l’espace urbain, disparu sous les immeubles, avalé par les hangars commerciaux et les parkings, recouvert du bitume des routes et des aéroports, le sol, avant que l’homme n’intervienne, est principalement constitué de terre, si l’on exclut les roches sédimentaires. Au fur et à mesure de l’urbanisation, cette terre a été détournée de ses usages agricole et forestier, sans que les États ne fixent de limites. Il a, par ailleurs, été pollué par différentes activités industrielles, minières et agricoles. Ainsi le recours trop important aux fertilisants chimiques et aux pesticides a entraîné la perte de matières organiques et d’éléments nutritifs, alors que le premier service écosystémique rendu par les terres est de nourrir les populations humaines et animales.
Or la hausse de la population mondiale va nécessiter une augmentation de production agricole, qui pourra d’autant moins résulter de l’amélioration de la productivité, que le réchauffement va entraîner une perte moyenne de 1 % de celle-ci tous les 10 ans (GIEC). L’alternative réside dans la restauration des 2 milliards d’hectares de terres aujourd’hui dégradées et donc abandonnées, à travers le monde. Une opération au coût limité, une centaine de dollars en moyenne l’hectare, et qui par ailleurs comporte un énorme avantage en matière de lutte contre le réchauffement.
Les terres fixent, en effet, le carbone organique et absorbent ainsi le gaz carbonique. L’Université de Yale estime que, si l’on restaurait 500 millions d’hectares de terres, soit le quart de l’existant, cela absorberait 30 % des émissions de CO2. Allant dans ce sens, le ministre français de l’agriculture a lancé en avril dernier un projet de recherche internationale sur la séquestration du carbone dans le sol, qu’il présentera lors de la COP 21, dénommé 4 pour mille. En captant du CO2 dans l’air via la photosynthèse, une plante absorbe du carbone. Si cette plante se décompose dans le sol, elle lui restitue son carbone sous forme de matière organique. Le sol s’enrichit alors et devient plus fertile. Si l’on augmente ainsi la matière organique des sols agricoles chaque année de 4 pour mille (4 grammes stockés dans les sols pour mille grammes de carbone), on serait capable de compenser l’ensemble des émissions annuelles de gaz à effet de serre produits par la planète. En outre, l’augmentation du taux de matière organique dans les sols est bénéfique en termes de biodiversité (développement de réseaux de champignons, de galeries de vers de terre et de milliards de bactéries) et de capacité de rétention d’eau, ce qui est important en période de sécheresse.
Révolutionnaire, ce concept remet en question le modèle agricole dominant et ses pratiques conventionnelles. Dans la continuité du projet agro-écologique, il doit s'accompagner d'un changement de nos modes de production et de notre rapport à la nature, puisque les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), à l’origine de ce projet, préconisent l’amélioration des techniques de fertilisation, la couverture permanente des sols, l’agroforesterie. Le programme international de recherche 4 pour mille associera des chercheurs du monde entier : l’INRA, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD), l’université américaine de Columbia, l'université néerlandaise de Wageningen et d'autres instituts de recherche au Danemark et en Afrique du Sud.
Plus nous protégerons la planète, plus nous apporterons une réponse aux plus vulnérables, à ceux qui aujourd'hui souffrent de famine ou de malnutrition.
La Great Green Wall (Grande muraille verte) lancée en 2008 à l’initiative des pays du Sahara et du Sahel avec le soutien de l’Unité africaine (UA), vise à lutter contre la dégradation des terres et la désertification. Depuis l'idée initiale d'un mur d'arbres traversant le désert africain, pour stopper l'avancée du désert, en restaurant une bande de 7 775 km des côtes sénégalaises jusqu’à Djibouti, la Grande muraille verte s'est peu à peu transformée en de multiples interventions pour le développement rural, la gestion durable des terres, le renforcement de la résilience des populations et des systèmes naturels au changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. L’initiative a déjà porté ses fruits grâce à la plantation de plus de 11 millions d’arbres et à la restauration de 24 600 hectares de terres au Sénégal, qui se sont accompagnées d’un meilleur accès à l’eau pour les populations locales. La Convention des Nations Unies contre la désertification souhaite soutenir cette initiative triplement vertueuse en termes de changement climatique, de sécurité alimentaire et de prévention des conflits et migrations, en recrutant 60 000 personnes au sein des communautés vulnérables, afin de mettre en œuvre le projet sur une plus large échelle. Cette initiative sera lancée officiellement lors de la COP 21 en présence des chefs d’État africains concernés.
En stockant le quart des émissions de gaz carbonique, les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et de la montée des températures. Pourtant, de manière très étonnante et regrettable, les océans, réservoirs de chaleur et pompes à carbone, si essentiels à la lutte contre le réchauffement, ne font l’objet d’aucune prise en compte dans la négociation climatique. Recensés comme thème transversal, les océans, qui couvrent 70 % de la planète et concentrent 60 % de la population mondiale sur une bande littorale d’une largeur de 60 km, seront encore les grands absents de la COP 21, même si une journée leur sera consacrée par le ministère de l’écologie.
Tout se passe comme si la Communauté internationale, prisonnière d’une approche purement juridique, refusait de s’approprier cet espace à 64 % situé hors de toute juridiction nationale ou internationale, mais pourtant à l’abri ni du pillage de ses ressources, ni des pollutions générées par l’activité humaine.
L’absence de gestion durable des océans, la surpêche et la surexploitation des ressources halieutiques font peser une menace évidente sur l’ensemble des ressources alimentaires issues de la mer.
Le recul de la forêt ne cesse de s’amplifier : en 2014, l’équivalent en bois de deux fois la surface du Portugal a été coupé à travers le monde pour satisfaire les productions agricoles (culture de l’hévéa pour la production de caoutchouc, de palmiers pour l’huile de palme et de soja), l’élevage des bovins mais aussi permettre l’extraction de minerais, soit un recul de plus de 18 millions d’hectares du couvert forestier de la planète (source : Université du Maryland et Google). Le patrimoine vert de notre terre est ainsi passé sous la barre des 4 milliards d’hectares, ce qui se traduit par une libération de carbone dans l’atmosphère lorsque les arbres disparaissent.
En septembre 2014, plus de 130 acteurs, des gouvernements de pays développés et en développement, des multinationales dans les secteurs de l’alimentation, du papier ou de la finance et des peuples autochtones se sont engagés, dans la « déclaration de New York sur les forêts », à réduire de moitié la déforestation d’ici à 2020 avant d’y mettre fin en 2030 et à restaurer 350 millions d’hectares de forêts et de terres agricoles, soit une surface plus vaste que le territoire de l’Inde. Combinés, ces trois objectifs permettraient d’éviter l’émission d’une quantité de dioxyde de carbone estimée entre 4,5 et 8,8 milliards de tonnes par an d’ici 2030.
H. RETERRITORIALISER LE CLIMAT
1. Valoriser les acteurs non étatiques
Les villes, où se concentre un peu plus de la moitié de la population mondiale, directement concernée par les effets de la pollution et du réchauffement, disposent de leviers d’action pour s’adapter au changement climatique. La moitié des émissions de GES mondiales dépend, en effet, de décisions prises à leur échelle au travers de la planification de l’occupation des sols, de la construction, des transports ou encore de la gestion des déchets (rapport du Sénat de Michel Delebarre et Ronan Dantec).
Alors que les États peinent à s’engager sur des mesures drastiques permettant de lutter contre le changement climatique, de nombreux territoires commencent à mettre en pratique des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’image de l’accord signé le 16 septembre dernier par les représentants de métropoles et de provinces américaines et chinoises ou de l’engagement, le 22 septembre dernier, du Compact of States and Regions (une vingtaine de régions d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et d’Australie, soit 220 millions de personnes) de réduire les émissions de GES de 7,9 gigatonnes d’ici 2030, autrement dit davantage que les émissions des États-Unis (6,2 Gt en 2012). Mais d’autres initiatives sont déjà plus anciennes comme le pacte des maires signé au sein de l’Union européenne et au niveau mondial, le C40Cities, les Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) ou encore le Conseil international pour les initiatives écologiques (ICLEI).
Les entreprises, elles aussi, s’engagent pour le climat. 36 multinationales sont parties prenantes du programme RE100 mis en place par l’ONG « The Climate Group », afin d’entraîner le monde industriel à utiliser 100 % d’énergie renouvelable et à faire œuvre d’exemplarité. De manière plus contrainte mais significative, Shell a annoncé fin septembre cesser ses activités d’exploration au large de l’Alaska, du fait de résultats décevants mais aussi des coûts élevés du projet et de l’environnement réglementaire fédéral « difficile et imprévisible ».
Enfin de nombreuses initiatives citoyennes, de la plus internationale à la plus locale, voient le jour. Le Pape François, à travers l’encyclique « Laudato Si » publiée en mai dernier, ainsi que les représentants des autres religions ou spiritualités, réunis lors du Sommet des Consciences, ont défini le sujet écologique comme un enjeu majeur pour l’humanité. Trente-six titulaires du prix Nobel ont signé en juillet dernier la déclaration de Mainau, appelant les États à « prendre des mesures décisives limitant les futures émissions, faute de quoi les générations futures seront soumises à un risque inadmissible et inacceptable ». Le débat mondial réunissant 10 000 citoyens, le 6 juin 2015, dans 76 pays, de l’Afghanistan au Zimbabwe en passant par les Seychelles, la Bosnie Herzégovine ou le Canada, a confirmé la mobilisation des populations du monde, en majorité convaincues que la lutte contre le changement climatique constitue une opportunité pour améliorer la qualité de la vie. Plus de 400 000 personnes ont participé à un village des alternatives au changement climatique « Alternatiba » ou à une étape du tour d’Europe organisé cet été à vélo de Bayonne à Paris, pour démontrer que des solutions au dérèglement climatique non seulement existent mais construisent une société plus juste, plus solidaire et plus humaine.
Ces initiatives, individuelles ou collaboratives, entreprises par des acteurs non étatiques avec ou sans les États, sont aujourd’hui compilées et mises en lumière dans le cadre de l’agenda des solutions, l’un des quatre objectifs de l’accord attendu à l’issue de la COP 21.
2. Les montagnes, réserves de patrimoine et d’innovation pour le climat
En métropole comme en outre-mer, le milieu montagnard et ses habitants sont particulièrement concernés par le changement climatique. L’évolution plus ou moins forte de la température aura des conséquences tantôt sur le maintien de l’économie actuelle (par exemple les sports d’hiver), tantôt sur le fonctionnement agricole, tantôt sur l’augmentation des risques naturels. La vulnérabilité des massifs est donc importante, et l’avenir de leurs dix millions d’habitants est en jeu.
Derniers grands espaces sauvages au cœur de l’Europe occidentale et malgré des millénaires de présence humaine, les montagnes sont encore de formidables réserves de patrimoine biologique. De par leur altitude, nos massifs sont autant d’îles septentrionales isolées dans un univers tempéré, ou méditerranéen. Le réchauffement les menace directement, avec le risque d’une forte perte de diversité biologique et de banalisation des espaces montagnards.
Durant ce dernier siècle, les montagnes ont autant, sinon plus qu’ailleurs assuré leur développement sur une consommation d’énergie importante, involontairement à la pointe du progrès renouvelable avec la houille blanche, pleinement dans la consommation d’énergie fossile avec le développement du tourisme, de ses fortes migrations saisonnières et l’adoption quasi généralisée de modes de vie de type citadin.
Le réchauffement climatique menace toute l’économie de la montagne : disparition possible du produit d’appel (la neige), évolution botanique pouvant menacer les produits agricoles AOC, et comme dans toutes les zones rurales, difficultés accrues de transport si les énergies fossiles se renchérissent ou ne sont plus utilisables.
Les enjeux environnementaux et climatiques sont donc plus importants en montagne qu’ailleurs.
Mais les atouts sont à la hauteur des enjeux. Depuis toujours, les montagnards savent s’adapter à des conditions difficiles dans un univers topographiquement hostile. Le réapprentissage d’une certaine sobriété énergétique, joint à la mobilisation des capacités de recherche et d’innovation, peut permettre de recréer une montagne sobre et énergétiquement autonome. L’enjeu de la montagne est encore plus qu’ailleurs de moins consommer d’énergie pour le chauffage, les transports et de s’appuyer sur une production locale (hydro-électricité, solaire, éolien, biomasse…).
Après des décennies d’expansion urbaine à toutes les altitudes, la reconquête des « lits froids », la densification raisonnée, le rapprochement du domicile et du travail sont des moyens de préserver le climat, mais aussi les espaces agricoles et naturels, sans nuire à la qualité de vie des montagnards.
Souvent traversées par de grands itinéraires internationaux, dépendant aussi d’un tourisme induisant de fortes migrations mécanisées, souffrant parfois de pollutions atmosphériques valléennes, les montagnes sont encore plus que d’autres attachées au développement de moyens de transport propres, collectifs et individuels, permettant de garantir autant la qualité du climat que le style de vie montagnard.
3. Les Outre-Mer, espaces prioritaires d’innovation en matière de lutte contre le changement climatique
Les Outre-Mer couvrent 97 % du domaine maritime français, le deuxième au monde avec ses 11 millions de km2. Ils sont présents dans l’ensemble des bassins océaniques et sont les plus immédiatement exposés aux conséquences visibles du changement climatique, via l’amplification des risques de tempêtes et de séismes, étant donné qu’ils sont tous des îles, à l’exception de la Guyane. À la vulnérabilité physique de ces territoires s’ajoute la fragilité économique, puisque ces territoires sont modestes, isolés, extrêmement carbonés et marqués par des monocultures, toutes conditions qui les rendent peu autonomes. Les chocs économiques tout comme les risques épidémiologiques y sont d’autant plus forts.
En même temps, ces Outre-Mer possèdent une grande richesse. À de rares exceptions près, ils se situent dans des climats équatoriaux ou tropicaux, qui leur assurent une biodiversité exceptionnelle, qu’illustre la présence des récifs coralliens et de 13 000 espèces endémiques. La France, à travers ses territoires, est ainsi en mesure de dépasser ses dimensions continentale et européenne pour affirmer un potentiel mondial et maritime, aujourd’hui insuffisamment développé.
Par ailleurs, ces territoires se sont déjà dotés des moyens de pratiquer avec leurs voisins des coopérations efficaces à travers les déclarations régionales signées dans le Pacifique (l’appel de Lifou du 3 avril 2015) et dans la Caraïbe (l’appel de Fort-de-France du 9 mai 2015). Ils sont ainsi à même de prendre la mesure des difficultés vitales liées au changement climatique, de définir des stratégies d’atténuation et d’adaptation propres à en limiter les effets.
*
Lutter contre le dérèglement climatique nécessite l’éveil des consciences et l’émergence d’une nouvelle représentation du monde. Le changement de modèle que cela implique se heurte à de nombreuses résistances, auxquelles il faut opposer des arguments d’autant plus solides que les procès d’intention sont faciles à intenter, tant la gravité de la crise peut générer la démobilisation, l’impuissance, voire la sidération.
Ce changement ne sera pas un retour vers le passé. Le développement des énergies renouvelables, le stockage de l’électricité, le développement de moyens de transport non polluants, la mise au point de bâtiments autonomes, l’invention d’un urbanisme utilisant la technicité de la nature, pour traiter les eaux usées ou refroidir la température, le développement d’une agro-écologie performante, susceptible de nourrir sainement la population, tout en restaurant la fertilité des sols et la pureté des eaux, sont autant de chantiers de très haute technicité.
Ce changement ne sera pas une limite imposée à nos sacro-saintes libertés. Le mener de manière volontaire et contrôlée nous permettra au contraire d’éviter de subir des restrictions imposées de manière autoritaire, lorsque les prix de l’énergie exploseront ou quand les pollutions rendront inaccessibles tel territoire ou telle nourriture.
Ce changement ne sera pas la renonciation, sous le couvert de la peur, aux découvertes. Mais nous devrons choisir en toute transparence celles que nous assumerons. Une robotique ultra sophistiquée sera indispensable pour démanteler les centrales nucléaires mais pas souhaitable pour remplacer le travail pollinisateur des abeilles. Plus l’innovation, par le biais de l’interconnexion croissante entre l'infiniment petit (les nanotechnologies), la fabrication du vivant (les biotechnologies), les machines pensantes (l’intelligence artificielle) et l'étude du cerveau humain (les sciences cognitives), bouleversera les codes, les repères, les valeurs, l’éthique, plus les hommes devront s’interroger sur son bien-fondé. L’homme « augmenté » devra veiller à toujours conserver sa souveraineté.
L’accord de Paris, quel que soit son niveau de réussite, ne sera pas un point d’arrivée mais un point de départ pour la réalisation d’une nouvelle économie bas carbone. Il convient donc que la France, qui présidera, durant une année, la COP après la réunion de Paris, s’engage à porter un nouveau modèle de développement à l’intérieur de ses propres frontières et au-delà, au sein de l’Union européenne bien sûr mais également avec le plus grand nombre de pays, afin de constituer une sorte d’avant-garde sur la voie de la transition.
I. COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION
1. Audition de M. Gilles Bœuf, président du Muséum national d’histoire naturelle (9 octobre 2012)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Soyez le bienvenu, Monsieur le président du Muséum national d’histoire naturelle. Un certain nombre d’entre nous ont participé à la conférence environnementale, notamment à la table ronde n° 2 sur la biodiversité, que vous avez animée. Or, la feuille de route établie lors de cette conférence prévoit le vote d’une loi-cadre sur la biodiversité en 2013, ainsi que la création d’une agence de la biodiversité. En vue d’apporter notre contribution au contenu de ce projet de loi, nous avons prévu d’organiser des rencontres sur la biodiversité, dont la présente constitue la première.
M. Gilles Boeuf évoquera certainement l’état de la biodiversité en France, les causes de son recul, et il ouvrira ainsi des pistes d’action et de réflexion.
Je considère pour ma part que la compétence en matière de protection et de valorisation de la biodiversité doit être transférée aux collectivités territoriales – en particulier aux régions – dans le cadre de l’acte III de la décentralisation. Nos auditions, l’examen prochain de cette loi-cadre et l’acte III de la décentralisation sont donc très étroitement liés.
M. Gilles Boeuf, président du Muséum national d’histoire naturelle. Le thème de la table ronde à laquelle Jean-Paul Chanteguet et moi-même avons participé il y a environ deux semaines m’a surpris, puisqu’il s’agissait de savoir comment « faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité » – la notion de reconquête supposant qu’on l’avait quelque peu perdue auparavant.
Je vous remercie de m’avoir invité car dans ce pays, les relations entre parlementaires et chercheurs ne sont pas assez étroites. Ainsi n’y avait-il que quatre chercheurs – venus un peu par hasard et peut-être pas en qualité de chercheurs – sur les 300 personnes présentes lors de la conférence environnementale. Or, en tant que chercheur scientifique public, j’ai toujours été extrêmement attaché à nos relations avec le monde politique et le monde social. Quelle serait notre perception des enjeux de changement global, de perte de diversité biologique et de changement climatique – qui ont des conséquences sociales – sans les scientifiques ? Si ceux-ci n’ont aucune envie de prendre le pouvoir ni de décider, leur rôle est important dans le débat public : il consiste à apporter des avis éclairant la prise de décision et les méthodes de gestion de notre environnement. Et si je me suis longtemps défendu de tenir un discours politique, je m’aperçois que j’ai fini par en avoir un, non pas certes un discours partisan mais un discours de scientifique engagé. Lorsqu’en février 2007, le Président Chirac réunit une conférence à l’Élysée sur le climat et la biodiversité, les grands experts du climat étaient présents à ses côtés : Jean Jouzel, Édouard Bard, du Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement, et Hervé Le Treut, alors que Michel Loreau, Jacques Blondel, Robert Barbault, Yvan Le Maho et moi-même, en tant qu’écologues de la diversité, étaient dans la salle. Auprès du Président se trouvait également une « strate » intermédiaire constituée de Nicolas Hulot, Jean-Louis Étienne, Nicolas Vanier et Yann Arthus Bertrand. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils besoin d’une telle strate intermédiaire pour dialoguer avec les élus ?
Je préside l’un des trois plus grands musées d’histoire naturelle du monde, avec la Smithsonian de Washington et le National History Museum de Londres. Il ne s’agit pas d’un musée d’art au sens classique du terme puisque les 70 millions d’objets qui y sont conservés sont d’abord des objets d’études, avant d’être des objets muséographiques. Nous avons cinq missions complémentaires : la recherche scientifique – notamment en matière de biodiversité –, l’enseignement, la gestion des collections nationales, l’expertise – avec plus de mille avis rendus par an, essentiellement à destination du ministère de l’écologie et du développement durable – et la dissémination muséographique, tous publics confondus.
La biodiversité, je m’y intéresse depuis longtemps : au cours des quatre dernières années, j’ai écrit sur le sujet une quarantaine d’articles scientifiques ou de chapitres de livres, donné à 250 conférences en France et dans le monde, participé à une cinquantaine d’émissions de télévision et de radio et publié dans des quotidiens tels que Le Parisien, Ouest France ou Le Monde. En outre, le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité du ministère de l’écologie a collectivement écrit et distribué aux élus trois petits ouvrages sur la biodiversité en 2007, 2008 et 2012 : les histoires que l’on y raconte visent à sensibiliser le plus possible le lecteur au thème de la biodiversité et à la rendre aussi compréhensible que possible. Il y est question du secret de la nature et de ses réactions inimaginables aux agressions. Nos expérimentations ont en effet très souvent des résultats contraires à nos intuitions.
L’année 2010 a été « l’année de la biodiversité ». Étant donné les recommandations de Johannesburg en la matière, lors d’une rencontre avec des étudiants de l’École normale supérieure le 23 décembre 2009, je leur annonçai donc qu’une semaine plus tard, nous allions vivre un événement extraordinaire : la fin de l’érosion de la biodiversité. Cependant, les ayant retrouvés le 4 janvier, j’ai dû annoncer un échec : en effet, lors de la conférence de l’Unesco des 25-26 janvier 2010 à Paris, nous avons constaté que les recommandations formulées à Johannesburg, huit ans auparavant, n’avaient pas été tenues. On s’est contenté de reporter l’échéance à 2020. Mais comment réussir d’ici 2020 ce que l’on n’a pas été capable d’accomplir depuis 2002 ? En mai 2010, nous avons tout de même inauguré la conférence environnementale française à Chamonix qu’organisait la ministre de l’écologie de l’époque, Chantal Jouanno.
En tant que président du Muséum, je m’étais fixé trois buts pour cette année 2010 : définir la biodiversité, expliquer pourquoi il faut s’en préoccuper, et surtout, faire en sorte que l’on ne cesse pas de s’y consacrer après le 31 décembre 2010.
La biodiversité ne consiste pas en un catalogue d’espèces : la biodiversité, terme né il y a vingt-sept ans à peine, se définit comme la fraction vivante de la nature. Il ne faut pas confondre biodiversité et nature : comme en témoigne une météorite extraordinaire que possède le muséum et qui est dotée de la signature géochimique de la formation du Soleil. La biodiversité, elle, est apparue il y a environ 3,85 milliards d’années, lorsque la première cellule apparue dans l’océan ancestral s’est scindée en deux cellules clones qui, elles-mêmes, ont commencé à se scinder – soit 700 millions d’années après la mise en place du Soleil et de la Terre, au cours desquelles la nature fut certes présente sur la Terre, mais pas la vie.
Ensuite, la biodiversité est quelque chose dont on ne peut se passer. Ainsi sommes-nous tous dans cette salle de merveilleuses odes à la biodiversité, car nous sommes remplis de bactéries. Celles-ci existent depuis qu’il y a de la vie sur Terre et sont sorties de l’océan ancestral il y a 800 millions d’années, après s’y être divisées. Si nous sommes constitués de cent milliards de cellules fort diverses – neurones du cerveau, globules rouges du sang, cellules musculaires ou de notre cartilage – issues de la cellule initiale qu’est l’ovocyte maternel fécondé par un minuscule spermatozoïde paternel, l’organisme humain contient cependant mille fois plus de bactéries que de cellules, présentes dans nos cheveux, nos oreilles, notre intestin... Nous sommes donc partout entourés de cette diversité biologique indispensable pour nous qui en sommes des fragments : une diversité que nous retrouvons dans tout ce que nous mangeons et avec laquelle nous coopérons. L’exemple des médicaments illustre son intérêt industriel : en effet, les molécules anticancéreuses, anti-champignons, anti-virales, anti-bactérielles et antibiotiques sont issues de morceaux de plantes ou d’animaux marins ou terrestres, à l’instar de l’AZT, première molécule active contre le SIDA, que l’on trouve dans le sperme du hareng. Cette exploitation industrielle pose d’ailleurs un problème de piraterie et de pillage des plantes des populations autochtones en vue d’y trouver certaines molécules.
C’est pourquoi plus l’on abîme la biodiversité, plus l’on touche au capital naturel qui nous entoure et plus l’on crée de désordres. Or, en France, on est bien plus capable de valoriser les aspects culturels que naturels de notre patrimoine, alors même que les deux aspects sont liés, l’humain ayant construit une culture sur la nature. À cet égard, j’ai d’ailleurs beaucoup apprécié les récents discours du Président de la République et du Premier ministre qui, enfin, ont clairement affirmé qu’opposer la question économico-financière, la croissance économique et le plein emploi, considérés comme primordiaux dans la crise actuelle, d’une part, à la prise en compte des questions environnementales, d’autre part, c’est oublier que ces enjeux sont intimement liés, tant il est vrai que la crise actuelle est aussi une crise de raréfaction des ressources – qu’elles soient minérales ou vivantes.
Afin de mettre en évidence l’état actuel de la biodiversité et de proposer de meilleures méthodes de gestion des environnements, il nous faut nouer une relation intime entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Notre éducation demeure en effet trop compartimentée, tant du point de vue des élèves – auxquels il conviendrait d’expliquer l’importance des mathématiques dans la compréhension des phénomènes et de l’anglais pour parler de chimie au niveau international – que des professeurs, eux-mêmes peu habitués à travailler de manière transversale. Or, le Muséum est l’une des institutions qui a le plus réfléchi à ces questions transversales, étudiant les populations autochtones, les océans, les mathématiques pures, la chimie, la biologie, la biologie moléculaire... C’est en effet la mise en relation de toutes ces matières qui permet aux chercheurs de répondre aux questionnements de la société et d’aider les élus, confrontés à de dramatiques problèmes environnementaux dans leur circonscription, à y faire face et à les expliquer. Ainsi, outre-mer, la confrontation aux espèces invasives introduites par l’homme, tels le chien, le chat ou le poulet, qui détruisent la faune locale – ainsi des chats vis-à-vis des oiseaux endémiques en Nouvelle Calédonie. En métropole, c’est la migration de la population vers les côtes qui pose un réel problème.
Mettre fin à l’érosion de la biodiversité constitue un travail de longue haleine. C’est pourquoi les scientifiques requièrent l’aide des politiques. Aujourd’hui, le citoyen dispose d’une meilleure perception du changement climatique que de la biodiversité. A-t-on mal communiqué ou insuffisamment expliqué les choses ? A-t-on abordé la question sous un angle inadapté ? Comment communiquer sur les OGM, les nano-technologies et la biologie de synthèse ? Viscéralement opposé à tous les extrémismes, non pas écolo mais écologue, j’estime qu’il ne s’agit pas de revenir à la bougie mais d’arriver à un système d’harmonie et de partage. Comme l’illustre l’histoire de la vallée de Tautavel, à vingt personnes, les êtres humains peuvent vivre de la chasse et de la cueillette sans détruire leur environnement, mais avec sept milliards d’habitants, l’humanité utilise l’agriculture : c’est donc un autre débat.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous disiez à l’instant qu’à l’inverse de ce qui se passe pour le changement climatique, il n’y a pas assez de prise de conscience pour la biodiversité. Il nous faut donc tous faire preuve de pédagogie. Or, si vous nous indiquiez les causes, cela nous permettrait de comprendre ce que nous ne devrions pas faire.
M. Gilles Boeuf. La perte de biodiversité a quatre causes.
Tout d’abord, le lien entre pollution et destruction, qui explique deux tiers de cette perte : l’homme détruit le vivant, par exemple pour construire des villes ou des ports. L’homme pollue également. Et si le documentaire réalisé sur la décharge gérée par Veolia située à Villeneuve-Loubet illustre bien ce phénomène de pollution, celui-ci, loin de se réduire aux décharges et aux poubelles, existe partout, y compris dans les zones où l’homme est absent, tels que les océans Pacifique et Arctique : l’eau de mer est acide au Vanuatu et la viande des Inuits est contaminée, ce qui entre autres rend l’allaitement maternel dangereux.
La deuxième cause réside dans la surexploitation des stocks, dont les meilleurs exemples sont la forêt tropicale et les pêches maritimes. Or, à la différence du changement climatique, auquel on doit s’adapter avant de pouvoir le freiner, on peut agir contre la surexploitation. L’été dernier, malgré le conflit congolais, je me suis rendu en Ouganda pour y observer les gorilles et les chimpanzés : je me suis rendu compte de l’impact de l’humain sur ces populations animales que nous sommes seuls à pouvoir sauver. Et contrairement à ce que je croyais naïvement, les espèces économiques, telles que le thon rouge, sont menacées et cela n’empêchera pas les gens d’aller pêcher le dernier spécimen vivant, quel qu’en soit le prix – qui atteint des sommets pour le thon rouge.
Les espèces invasives constituent la troisième cause de perte de biodiversité. À la différence des espèces envahissantes, déjà présentes localement et qui se mettent à proliférer en raison d’activités humaines, celles-ci sont exotiques, c’est-à-dire qu’elles viennent d’ailleurs – tel le chat en Nouvelle Calédonie ou le frelon asiatique en France – et sont également beaucoup plus insidieuses. La plupart du temps, cela se passe de façon presque invisible dans un premier temps. Ainsi, à Oman, on voit proliférer depuis trois ans des algues rouges. L’explication : les tankers qui se délestent de leurs ballasts venu de la mer du Nord : douze milliards de tonnes d’eau contenant des bactéries, des virus, des champignons et des phéro-micro-organismes, qui, une fois rejetés à la mer, produisent des phénomènes pathologiques dans l’indifférence générale.
Enfin, la dernière raison en est le changement climatique. Et il faut être de très mauvaise foi pour affirmer que l’homme n’y est pour rien !
M. Jean-Yves Caullet. J’appartiens à une génération, qui, au moment du choix de ses études, se voyait offrir des boulevards en matière de biochimie, tandis que la systématique était considérée comme datant du siècle passé. Assiste-t-on aujourd’hui à un retournement de situation, grâce à notre intérêt pour la biodiversité ? Quels sont les efforts nécessaires pour permettre à un maximum de personnes de l’apprécier ?
Comment mesurer la valeur et l’intensité d’une biodiversité par rapport à une autre, étant donné qu’il est plus aisé de sensibiliser à la disparition d’une espèce visible qu’à celle d’un insecte tel que la mouche – que l’on écrase facilement d’une main alors même qu’elle contient autant d’informations génétiques que nous ?
Si les espèces invasives ne datent pas d’aujourd’hui, le brassage en est néanmoins beaucoup plus important désormais : quelles mesures imaginer pour éviter les accidents ?
Enfin, le stock d’espèces inconnues est extraordinairement important. La France, qui présente la particularité de comprendre des territoires extrêmement variés, notamment ultramarins, est-elle en mesure de relever un tel défi ?
Vous avez rendu un rapport à la précédente ministre de l’écologie, Mme Kosciusko-Morizet, intitulé L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité. Dès lors, pourriez-vous nous proposer une photographie des moyens du Muséum d’histoire naturelle et nous présenter un bilan, ainsi que les perspectives d’avenir des observatoires participatifs Spipoll et Vigie Nature ? Comment vous situez-vous entre la science participative et les lanceurs d’alerte ? Pourriez-vous dresser un bilan de la gestion du problème du frelon asiatique, espèce invasive la plus connue, ainsi que du Plan Abeille et des pollinisateurs sauvages ?
M. Stéphane Demilly. Si chacun connaît les activités destinées au grand public du Muséum, notamment l’emblématique Grande galerie de l’évolution, l’institution est aussi dédiée à la recherche et à l’enseignement. Le changement climatique faisant partie de vos nombreux thèmes de recherche, quelles sont les conclusions de vos travaux sur cet enjeu fondamental pour notre planète, sachant que le bilan du sommet Rio +20 de juin dernier est plus que mitigé, et la priorité accordée à la lutte contre le réchauffement climatique de plus en plus remise en cause ?
Quant aux secrets de la nature, ils sont une grande source d’intérêt pour l’industrie. C’est ainsi que l’industrie textile s’intéresse de plus en plus aux propriétés extraordinaires de la toile d’araignée. Le Muséum a donc probablement conclu des partenariats de recherche avec certaines entreprises sur ce sujet. Sans violer la confidentialité inhérente à ce type de contrats, pourriez-vous nous en fournir quelques exemples ?
Enfin, quels sont les principaux projets actuels de coopération ou d’échanges internationaux du Muséum, notamment dans le domaine de la biodiversité ?
Mme Laurence Abeille. Quels sont les projets ou travaux en cours au Muséum en matière de biodiversité en milieu urbain ?
M. Gilles Boeuf. Je rejoins tout à fait M. Jean-Yves Caullet quant à la systématique : le systématicien est aujourd’hui l’une des espèces les plus menacées de disparition, alors que c’est lui qui est le plus à même de mettre en évidence la biodiversité qui nous entoure. Ne faudrait-il pas, grâce au ministère de l’Écologie, mettre en place un corps d’ingénieurs spécialisés dans la description de la diversité biologique, afin de permettre aux jeunes chercheurs de valoriser leur travail en la matière ? En effet, actuellement, les chercheurs publics français sont appréciés et promus en fonction de leurs publications scientifiques. Or, les éditeurs de revues ne s’intéressent pas du tout à la description d’espèces nouvelles. Dans les musées du monde entier, il existe actuellement deux millions d’espèces déposées – l’homo sapiens inclus –, sur les dix à vingt millions d’espèces marines et continentales vivant sur la planète. Si on prend une douzaine de millions, il reste donc une douzaine de millions d’espèces à cataloguer. Et comme, depuis dix ans, entre seize mille et dix-huit mille espèces sont décrites chaque année – pour moitié par des « amateurs », le Muséum devant ensuite organiser cette connaissance –, il nous faudra entre 500 et 1 000 ans pour constituer un catalogue de ce qui nous entoure, même si, encore une fois, la biodiversité ne se réduit pas un catalogue d’espèces mais relève bien davantage d’interrelations entre les êtres vivants. En outre, la systématique s’est considérablement modernisée puisque désormais, lorsqu’on dépose une espèce nouvelle, on commence par en séquencer vingt gènes pour ensuite créer un code barre permettant de la distinguer beaucoup plus rapidement.
La valeur écologique des différentes espèces ne correspond pas bien sûr à un prix et n’est pas identique pour toutes. Certaines d’entre elles, dites « espèces clefs de voûte », organisent tout un écosystème, ce qui signifie que leur retrait le modifie entièrement – à l’instar de l’étoile de mer sur le littoral américain ou du castor, auquel deux mille espèces sont associées. Ainsi, s’il y a probablement plus d’espèces et de biodiversité en Guyane et dans les autres territoires ultramarins qu’en métropole, cela ne signifie pas que toutes les espèces qui y vivent aient été enregistrées dans les bases de données de notre inventaire national du patrimoine naturel – loin de là – ni que la valeur écologique de la biodiversité française se trouve essentiellement outre-mer. Les organisations non gouvernementales luttent pour défendre des espèces emblématiques telles que le tigre, le chimpanzé, l’ours polaire ou la baleine, et c’est bien normal, cela leur permet de récolter des financements. Au Muséum en revanche, nous luttons pour protéger « le vrac », la limace des Galapagos et le moustique des Bermudes qui, eux aussi, font partie des écosystèmes.
Quant aux espèces invasives, elles sont apparues dès que l’homme a commencé à se déplacer, ce qu’il a toujours fait en compagnie de ses espèces favorites, à commencer par le chien, il y a quinze mille ans, puis la chèvre et le cheval, il y a environ six mille ans, et surtout les rats et les souris. Ce transport d’animaux a créé des chocs dans certaines régions du monde, en particulier dans les îles du Pacifique où souvent, l’homme a épuisé le système pour ensuite repartir. L’exemple de la pêche à la crevette au Liban – où une espèce venue de la mer Rouge en a remplacé une autre native – est également éloquent. Il nous faut donc être très attentifs à la question, et légiférer pour interdire par exemple le rejet, sans traitement et en toute impunité, des eaux de ballast des grands navires qui apportent partout des micro-organismes extrêmement dommageables pour les environnements.
À l’heure actuelle, seules 20 % des espèces continentales et 14 % des espèces marines sont identifiées, d’où la nécessité d’un travail systémique. Mais hâtons-nous car, bien souvent, les espèces ont déjà disparu au moment où elles sont décrites ! S’il faut bien évidemment continuer à faire des descriptions d’espèces, il faut aussi trouver d’autres moyens d’évaluer la biodiversité, en particulier en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles. L’outre-mer français est constitué de territoires, soit très petits et ultra peuplés, soit immenses et non habités. L’établissement de la diversité sur des listes reste très insuffisant : il est nécessaire de trouver des indicateurs, des scénarii d’évolution qui nous permettront de mieux estimer la biodiversité.
Je suis très attaché aux sciences participatives et j’ai un profond respect pour les personnes qui travaillent avec nous. Les programmes s’appuient sur un protocole commun. Je citerai STOC (suivi temporel des oiseaux communs) ; SPIPOLL (suivi photographique des insectes pollinisateurs), qui mobilise 10 000 personnes pour 1,5 million d’heures d’observation et qui a permis de montrer l’évolution des abeilles dans les terres agricoles et dans les terres non agricoles ; VigieNature, dont le but est d’observer les oiseaux communs, les escargots et les papillons de jardin, que nos compatriotes observent très attentivement, etc. Il nous appartient ensuite à nous, scientifiques, de restituer ces données. Le Muséum a un rôle central dans ce domaine, qui intéresse désormais également le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), mais aussi l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) dont le nouveau président souhaiterait mener avec nous deux programmes portant sur l’évolution des milieux, où l’enquêteur de base serait l’agriculteur. Donnez-nous les moyens de mener ces programmes très intéressants, qui présentent un double intérêt : obtenir des données et responsabiliser les observateurs.
Je suis un lanceur d’alerte, tout en me défendant d’être un catastrophiste : je m’emploie non pas à désespérer mes étudiants, mais à leur exposer la réalité. Je combats deux attitudes, encore fréquentes chez les scientifiques comme dans le grand public : le déni et la triche. Comment peut-on accepter d’entendre que « Dieu nous sauvera en 2100 » à propos de l’étude scientifique portant sur la montée des eaux en Caroline du Nord d’ici à la fin du siècle ? Comment accepter la falsification des données ? Travaillons avec des gens sérieux. Vous avez un rôle très important à jouer en la matière.
Le frelon asiatique n’est pas l’envahisseur qui m’inquiète le plus. Les plantes, comme l’ambroisie d’Uruguay, responsable de crises d’asthme chez 20 % des Français, les jussies, présentes dans le Sud de la France, et la jacinthe d’eau me préoccupent davantage. Claire Villemant, grande spécialiste du frelon asiatique, pourrait vous renseigner mieux que moi sur cet insecte.
L’Égypte, le Liban et la Syrie ont perdu 90 % de leurs abeilles. Dans certaines régions de Chine, elles ont même totalement disparu et ce sont les femmes qui doivent effectuer les opérations de pollinisation. Il est impératif de se pencher sur cette question très préoccupante. Les insectes pollinisateurs rendent un service au niveau mondial estimé à 172 milliards d’euros par an !
J’en viens à la situation du Muséum, placé sous la tutelle conjointe du ministère de la recherche, qui assure l’essentiel de notre financement, et du ministère de l’écologie. Je précise que mon mandat prendra fin dans quatre mois et que l’État a décidé de supprimer les fonctions de directeur et de président au profit de celle de président-directeur général.
Aujourd’hui, le Muséum connaît une situation dramatique par manque de moyens. D’abord, je crains qu’il soit incapable de rembourser les traites, très élevées, du projet du zoo de Vincennes réalisé sous forme de partenariat public-privé, dont il aurait dû, à mon avis, se contenter d’être le partenaire intellectuel et scientifique. Ensuite, il lui manque 20 millions d’euros pour achever le Musée de l’Homme, installé palais de Chaillot à Paris, d’autant que la création d’un musée de l’histoire de l’humanité constitue un véritable défi. Aidez-nous, sinon ce projet n’aboutira pas.
J’ajoute que l’implantation sur l’Îlot Poliveau des bâtiments de la faculté de Censier, qui doit être désamiantée, ce que bien entendu je ne conteste pas, se fera malheureusement au détriment des terrains du Muséum.
Enfin, le Muséum manque cruellement de crédits pour la paléontologie, alors qu’il possède les plus belles collections européennes, sinon mondiales, de fossiles vertébrés. Notre galerie va fermer. La situation est tout aussi dramatique pour l’entomologie, alors que nous possédons la plus grande collection d’insectes au monde, avec 41 millions de spécimens.
Je ne dis pas que l’État a oublié le Muséum – qui est traité comme les autres – mais qu’il doit, pour le sauver, imaginer de grands projets, à l’image de la Grande Galerie de l’évolution.
S’agissant du changement climatique, nous regardons comment les informations du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) peuvent nous aider à gérer les scénarii que l’État nous demande. Nos nombreux travaux sur les migrations et les pertes de diversité biologique, menés grâce à l’aide des sciences participatives, ont ainsi démontré que, sur dix-huit ans, nos oiseaux ont migré de 33 kilomètres vers le Nord, et les papillons de 114 kilomètres.
Comme je l’ai écrit sur mon blog du Monde, la biodiversité a été la grande oubliée de la conférence Rio+20. La déclaration finale se contente de multiples formules du genre « Nous réaffirmons », « nous prenons acte », « nous notons ». Quel manque de courage ! Sur cinq décisions qui commencent par « nous décidons », trois ne servent à rien ! (Sourires). La question centrale est de savoir comment passer de connaissances scientifiques à un vrai travail sur le terrain.
Je me suis rendu à la conférence environnementale des Ateliers de la terre, la semaine dernière, à Évian, où deux mondes étaient représentés : les puissants et le peuple. J’y ai vu l’Indien Bunker Roy, fondateur du « collège des pieds nus » qui travaille à la formation de femmes âgées à l’énergie solaire : on a pu ainsi donner accès à cette énergie à 36 000 villages en Inde et en Afrique ! Inspirons-nous de cet exemple magnifique pour agir dès maintenant. Et arrêtons d’opposer la question de l’écologie, du partage et du bien-être, à celle de l’économie et du plein-emploi ; faute de quoi, nous irons droit dans le mur !
Le 10 décembre prochain, j’organiserai, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable, un colloque intitulé « Systèmes bio inspirés : une opportunité pour la transition écologique », qui amènera des industriels, des ingénieurs et des scientifiques à réfléchir aux moyens d’aider les entreprises en s’inspirant de systèmes vivants naturels. Deux exemples. Il y a quelques années, les ingénieurs se sont inspirés de la vitesse de vol des grands rapaces pour donner aux ailes d’avion un profil relevé, ce qui a permis d’économiser 15 % de carburant ! Dans le désert de Libye, vit un petit coléoptère dont la structure des élytres lui permet de capter sa réserve d’eau – une goutte – pour la journée : cette structure a été modélisée pour produire de l’eau dans le désert du Chili ! Faisons preuve d’humilité : inspirons-nous de cette biodiversité, dont nous faisons partie !
En 2006, nous avons mené une importante expédition au Vanuatu. Nous nous sommes également rendus à Madagascar et au Mozambique. Nous sommes actuellement présents à Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et projetons de nous rendre en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. La préservation de notre crédibilité nous impose de rendre la biodiversité que nous avons étudiée aux gens des pays qui nous ont accueillis : j’ai moi-même ramené, en juin 2011, des boîtes de coléoptères et 400 espèces de plantes au premier ministre du Vanuatu.
Enfin, on sait que la population mondiale se concentre désormais dans les villes, tendance qui s’accélèrera au cours des vingt prochaines années. Le Gouvernement a annoncé un objectif de « zéro artificialisation des sols » en 2025. Une vraie écologie urbaine se développe, grâce aux sciences participatives : 10 000 personnes sur Paris et les grandes villes ont répondu à notre programme « Sauvages de ma rue » ! Bref, ramenons la campagne en ville car, pour l’avenir, il nous faudra des villes totalement vertes.
Mme Chantal Berthelot. Déforestation, destruction des habitats, perte de la biodiversité, le mercure n’est pas le seul dommage infligé à l’environnement guyanais par l’orpaillage illégal. Quelles sont les pistes de travail pour reconquérir cette biodiversité ?
M. Jean-Marie Sermier. Depuis 1992, le terme de « biodiversité » est pris en compte au niveau international, notamment par la Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée à Rio. En France, la stratégie nationale pour la biodiversité a été lancée en 2004 sous la présidence de Jacques Chirac, le conseil général de l’environnement et du développement durable a été mis en place en 2011, et la loi Grenelle II a consacré plusieurs avancées, notamment la trame verte et bleue.
Monsieur le directeur, comment situez-vous la politique française sur la biodiversité au regard de celle des autres pays ?
Actuellement, entre 17 000 et 100 000 espèces sont susceptibles de disparaître de notre planète chaque année. Dispose-t-on d’indicateurs scientifiques fiables en la matière ?
Mme Marie-Line Reynaud. Il me semble que les travaux du Muséum mettent davantage l’accent sur le vivant – la faune et la flore –, que sur la géologie. Notre pays comporte pourtant de remarquables sites géologiques et paléontologiques, tel celui d’Angeac-Charente dans ma circonscription sites qu’une des dispositions du Grenelle 2 permet de préserver. Comment les protéger ? Travaillez-vous dans ce domaine ?
M. Édouard Philippe. Maire du Havre, où se trouvent de nombreux bassins, je suis un grand défenseur de la biodiversité en milieu urbain. Comme il existe des espèces clés de voûte, existe-t-il des espaces où le dispositif légal de protection de la biodiversité devrait être renforcé ? Autrement dit, que pensez-vous du caractère systématique de l’application de la loi ?
M. Philippe Plisson. Comment intégrer juridiquement l’outil « aire marine protégée » ? Quel est l’état d’avancement du projet de convention ayant pour objectif la protection des mers et des océans ?
En raison de la pénurie de chercheurs, un certain nombre de travaux restent inachevés, comme l’étude portant sur la famille des lombricidés. Quelle solution voyez-vous à ce problème ?
Mme Geneviève Gaillard. Monsieur le président, vos propos sont passionnants, et nous avons toujours autant de plaisir à vous écouter.
L'adoption d'une loi « biodiversité » dès 2013 et la création d’une agence nationale dédiée ont été confirmées par la feuille de route de la Conférence environnementale. Pensez-vous que cette agence nationale de la biodiversité, calquée sur le modèle de l’ADEME, constituera un bon outil ?
M. Charles-Ange Ginesy. Ces dernières années, les conférences de Copenhague et de Kyoto, tout comme le Grenelle de l’environnement, ont constitué des avancées. Néanmoins, la pression visant à créer des réserves naturelles dans lesquelles l’homme n’aurait plus sa place m’inquiète. L’activité agricole comme celle de nos chasseurs, notamment pour la protection des habitats, présentent en effet un grand intérêt. Faut-il accepter ces réserves totalement naturelles que quelques « ayatollahs » veulent nous imposer ?
M. Jean-Pierre Vigier. En Haute-Loire, où je suis élu, se trouve le site paléontologique de Lavoûte Chilhac, sur lequel ont été découverts dans les années soixante-dix des ossements de mammouths grâce aux recherches menées par Christian Guth et Odile Boeuf. Après seize ans d’interruption, les fouilles viennent de reprendre sur le site. Comment le Muséum pourrait-il nous aider à poursuivre l’activité de ce magnifique site, qui contribue au développement culturel, touristique et économique de notre territoire ?
M. Gilles Boeuf. Si la France veut conserver la Guyane, qui est l’un des plus beaux morceaux de diversité au monde, elle doit être beaucoup plus ferme. Pour ce faire, je pense qu’elle a besoin de l’aide de l’Europe. Des événements inacceptables se sont déroulés dans cette région. On trouve malheureusement au Brésil des sites Internet encourageant les gens à y venir orpailler ! Et il n’y a plus de patrouille dans le parc amazonien de 34 millions d’hectares, et je passe sur les conflits entre la gendarmerie et l’armée.
Le Grenelle de l’environnement a été un grand événement. La ministre m’a promis que les décrets d’application sur la trame verte et bleue seraient pris avant la fin de l’année. Les lois sur la biodiversité et sur la transition écologique devraient être votées en 2013.
Le Muséum travaille ainsi sur le patrimoine inerte, au travers de deux disciplines : la minéralogie dans sa dimension environnementale ; la cosmochimie, quand nous étudions les signatures géochimiques d’objets géologiques. Ce qui m’amène à parler de plus en plus de géodiversité.
Sur les quelque 4 500 espèces minérales déposées dans les musées, 3 000 n’existeraient pas sans les bactéries. La meilleure signature de la Terre, c’est la vie. Les astrophysiciens eux-mêmes ne justifient-ils pas leurs missions dans l’espace par la recherche du vivant ? Et le patrimoine géologique renvoie à la géodiversité.
Paris compte trois collections minéralogiques : celle de Jussieu – université Pierre et Marie Curie –, celle de l’École des Mines et celle du Muséum. Réunissons-les sur un site emblématique pour en faire la plus belle collection minéralogique au monde ! Aidez-nous, car je crains que ce projet ne puisse aboutir pour des raisons financières.
Pour ma part, je n’envisage pas la création d’espaces où l’humain serait exclu. Je ne cherche pas à sauver la planète, comme certains le prétendent, mais à sauver le bien-être de l’humain sur la planète ! Les lois nous ont donné des outils, mais leur application devient problématique car je ne pense pas qu’une espèce de coléoptère, aussi emblématique soit-elle, justifie l’arrêt de chantiers. Ces lois ont été votées en réponse au mépris total dont faisaient preuve certaines castes dans ce pays pour les questions environnementales. Les choses ont évolué : mettons-nous autour d’une table pour revoir ce sujet en évitant les outrances.
J’ai travaillé en Ouganda, où 40 % des chimpanzés sauvages des réserves sont mutilés, après avoir été capturés par des braconniers ! Actuellement, il y a des projets de forages qui sont situés dans des parcs naturels. Vous le voyez : la situation n’est pas la même partout, chaque espèce n’a pas la même valeur dans tous les types d’écosystème.
La conférence environnementale a le mérite d’avoir existé. Elle a été calquée sur la conférence sociale, et les participants y ont réalisé un travail sérieux.
Il est impératif de travailler à des schémas de retour de la diversité en ville. J’y crois : on peut encore faire des choses, mais il faut se hâter.
L’extension au large des aires marines protégées est une nécessité et il faut légiférer en la matière. Il ne s’agit pas de créer des réserves où l’humain n’ira pas : les pêcheurs de Cerbère-Banyuls sont désormais très heureux de pêcher à la périphérie de la réserve, des poissons qui avaient disparu il y a vingt ans !
Le thème de l’océan sera abordé lors de la conférence d’Hyderabad. Il faut cesser de considérer l’océan seul : il y a une continuité entre le milieu continental terrestre et le milieu océanique.
Les parcs naturels régionaux et nationaux, les réserves naturelles, les conservatoires d’espaces naturels, les aires marines protégées, le Conservatoire du littoral, toutes ces structures doivent nous amener à réfléchir ensemble.
Selon nous, il y a une grande différence entre une agence de la nature et une agence de la biodiversité. Si celle-ci doit voir le jour, je préconise de supprimer auparavant toutes sortes de structures qui s’empilent, comme les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), de réfléchir, grâce à un vrai débat public, aux domaines sur lesquels elle portera, et surtout, de lui donner des moyens adéquats.
Enfin, le Muséum possède un réseau de sites nationaux de préhistoire : celui de Lavoûte-Chilhac, la grotte du Lazaret, celle de Tautavel, l’abri Pataud et l’abri du Poisson. Venez nous rendre visite : nous vous aiderons avec plaisir.
M. le président. Merci beaucoup, monsieur le président, pour votre intervention très riche.
2. Audition de M. Hervé Le Treut, climatologue, directeur de recherche au CNRS, sur le changement climatique et la transition écologique (12 décembre 2012)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Hervé Le Treut, que nous sommes heureux d’accueillir ce matin, est directeur de recherches au CNRS et membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Connu pour ses travaux de modélisation numérique du système climatique et de ses perturbations, il a écrit de nombreux ouvrages ; il est notamment coauteur d’un essai paru en 2004, intitulé Climat : chronique d’un bouleversement annoncé. Je le remercie d’avoir accepté notre invitation, quelques jours après la conférence sur le climat qui s’est tenue à Doha, à laquelle ont participé plusieurs députés membres de cette Commission : Denis Baupin, Jean-Yves Caullet, Bertrand Pancher, Arnaud Leroy et Olivier Marleix. Hervé Le Treut nous parlera du rythme du changement climatique et en évoquera les conséquences environnementales.
M. Hervé Le Treut, climatologue, directeur de recherche au CNRS. Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, je suis également membre de l’Académie des sciences et, jusqu’à la fin de l’année, du conseil scientifique du programme mondial de recherches sur le climat. J’essaierai de montrer que la climatologie – mon domaine de compétence – est une science collective.
Parler du diagnostic posé aujourd’hui sur le climat exige de remonter en arrière. L’éventualité d’un changement anthropique du climat est envisagée dès les années soixante-dix, lorsqu’on se rend compte que la concentration du CO2 dans l’atmosphère augmente, les océans et la végétation n’étant pas capables de capter ce gaz au rythme des émissions. On se demande alors dans quelle mesure les gaz à effet de serre représentent un danger, et dès cette époque, on formule des éléments de réponse : le CO2 restant une centaine d’années dans l’atmosphère, le doublement de sa concentration entraînerait un réchauffement de plusieurs degrés. On conçoit déjà une typologie grossière des conséquences régionales de ces changements, notamment un réchauffement particulièrement fort dans les régions polaires et, plus généralement, sur les continents, et une exacerbation des tendances naturelles des précipitations, avec des pluies plus abondantes dans les régions pluvieuses et moins abondantes dans les régions semi-arides. On mesure également la portée du changement, le précédent réchauffement de cette ampleur remontant à la dernière déglaciation. Le premier rapport sur ces problèmes – celui de l’Académie des sciences américaine, en 1979 – contient tous ces éléments.
Dans les dernières décennies, ce que la science avait depuis longtemps prévu a progressivement commencé à se réaliser. La chronologie est ici très importante : l’émission des gaz à effet de serre à travers la combustion du gaz naturel, du charbon et du pétrole a essentiellement commencé après la Deuxième Guerre mondiale ; les premiers effets d’accumulation de ces gaz dans l’atmosphère datent des années soixante-dix ; et c’est à partir des années quatre-vingt-dix – car il faut un certain temps pour que la planète commence à se réchauffer – que l’on a pu observer les premières manifestations des changements climatiques, allant exactement dans le sens de ce qui avait été anticipé. L’important effort de recherche entrepris depuis a conduit – grâce notamment aux rapports réguliers du GIEC, qui en font la synthèse – à une prise de conscience d’autant plus vive que les observations confirmaient les prévisions faites auparavant. Cette science a maintenant trente ans d’âge, et s’il ne peut y avoir de certitudes absolues, ses fondements sont très solides.
La situation est pourtant très préoccupante, malgré les tentatives d’accords internationaux. Dans les années cinquante, les émissions s’élevaient à un ou deux milliards de tonnes de carbone par an ; dans les années soixante-dix, elles ont dépassé le seuil fatidique des trois ou quatre milliards de tonnes, estimé conduire à une déstabilisation du climat ; à la fin du vingtième siècle, elles ont atteint six ou sept milliards, et elles sont maintenant évaluées à plus de neuf milliards par an. Les dix dernières années ont ainsi vu l’augmentation la plus rapide de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les changements annoncés sont donc plus que jamais devant nous, et il faut avoir conscience que les difficultés ne font que commencer, les conséquences du changement climatique devant s’amplifier au fil du XXIe siècle. Par rapport aux différents scenarii envisagés, le rythme actuel des émissions nous place en effet sur la trajectoire la plus pessimiste, voire en dehors des prévisions.
D’une part, face à ce problème, la seule véritable solution consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou à développer des techniques – pour le moment marginales – de stockage du CO2. D’autre part, dans la mesure où le changement climatique est en train de commencer, il nous faut nous adapter à ses manifestations. L’alimentation représente l’un des défis majeurs. Des études du CNRS sur l’Afrique de l’Ouest montrent ainsi que le changement climatique met en péril l’accroissement de la production agricole par habitant, alors qu’aujourd’hui même cette production a tendance à décroître, et que la quantité globale de nourriture devrait être quatre à cinq fois ce qu’elle est actuellement.
L’adaptation doit être pensée à l’échelle locale. Ainsi, en France, certains secteurs – comme l’agriculture, et plus généralement le vivant – et certaines régions – comme les littoraux –, sont particulièrement vulnérables. Le niveau des mers s’élève aujourd’hui de quelque 35 centimètres par siècle, et il est voué à augmenter pour atteindre, à la fin du XXIe siècle, plus de 50 centimètres. Certains espaces sont en outre par nature sensibles aux changements climatiques, notamment la zone montagnarde où l’étagement des systèmes naturels se fait en fonction de la température.
Les régions les plus exposées sont celles de la zone intertropicale – où la perturbation de la saison des pluies peut avoir des conséquences catastrophiques – et les régions littorales, à la fois touchées par la montée du niveau des mers et particulièrement concernées par les événements extrêmes comme les typhons. Autour du bassin méditerranéen, les deltas – dont celui du Nil – sont également extrêmement vulnérables. Mais il faut avoir conscience de la mondialisation des risques : dans un monde globalisé, les changements climatiques n’épargneront personne.
Pourtant, si la science est relativement unanime et claire sur la notion de risque global que le changement climatique fait peser sur l’ensemble de la planète, sa capacité à en appréhender les effets à l’échelle régionale est au contraire très limitée. Les systèmes de moussons dans les tropiques ou le phénomène d’El Niño dans le Pacifique étant fondés sur des interactions partiellement chaotiques, il est difficile de savoir si la mousson indienne, par exemple, augmentera ou se modifiera. Pour certaines régions du monde, plusieurs scenarii sont possibles, et la nature décidera un jour si elles subiront plutôt des sécheresses, des inondations ou une succession des deux. Ces évolutions locales, en particulier dans les zones vulnérables, viendront par surprise, à l’occasion de crises inattendues. La prévision est également délicate en matière d’événements extrêmes, comme les cyclones ou les typhons ; tout au plus peut-on affirmer que certaines régions qui n’y sont pas soumises actuellement le seront dans le futur.
Il convient de bien séparer deux échelles temporelles. La transition qui nous attend nous exposera simultanément à toute une série de risques de nature différente – en matière d’énergie, d’alimentation, de biodiversité ou de ressources en eau – qu’il nous faudra hiérarchiser. Pour appréhender au mieux cette transition, il faut établir un diagnostic pluridisciplinaire, mobilisant des spécialistes du climat, de la biodiversité et de l’hydrologie. L’articulation de tous ces aspects est fondamentale, même si les problèmes d’équité sociale – notamment entre les pays du Nord et du Sud – que soulèvent ces questions excèdent le champ de l’expertise scientifique. Or, actuellement, les experts des différents domaines ont du mal à trouver des lieux où se réunir ; même le GIEC est séparé en trois groupes relativement autonomes et étanches, avec peu de transmission d’expertise d’un domaine à l’autre. Il faut donc ouvrir un espace de réflexion collectif, organisé et structuré, sur ces problèmes.
Au-delà de cette transition critique des prochaines décennies, reste cependant la question plus globale du futur de la planète, et plus précisément de celui de nos descendants. À la fin du XXIe siècle, plusieurs processus seront plus marqués : la fonte des glaciers, les évolutions des courants ou celles de la végétation. Aujourd’hui, beaucoup d’actions – comme la gestion du méthane ou d’autres gaz – ont pour horizon le court terme ; les tentatives de limiter les émissions de CO2 – gaz le plus massivement émis dans l’atmosphère et qui y reste le plus longtemps – constitue au contraire une action forte sur le long terme. Mais en abordant ce futur lointain, l’on ne saurait dissocier l’évolution du climat et celle du vivant.
Pour résumer, le climat représente l’entrée dans tout un écheveau de complexités. Il faudrait classer les difficultés – en isolant, d’une part, la question des quelques prochaines décennies et, d’autre part, celle du futur plus lointain – et établir des lieux de partage de compétences plus organisés qu’actuellement.
M. Jean-Yves Caullet. Au nom du groupe SRC, je remercie M. Le Treut pour cet exposé bref, mais complet.
Les modèles climatiques existants sont-ils capables de rendre compte des évolutions passées de façon satisfaisante ?
D’après votre exposé, l’effet de l’émission des gaz sur le réchauffement planétaire se fait sentir avec un décalage de vingt à trente ans ; est-ce à dire que ce qu’on fait aujourd’hui n’a aucune incidence sur ce qui se passera durant les vingt à trente prochaines années, pour lesquelles tout serait déjà écrit ?
Ayant participé, avec plusieurs collègues, à la délégation qui s’est rendue à Doha, je me suis entendu dire que les modèles climatiques n’étaient plus opérationnels lorsqu’il s’agissait d’envisager des augmentations de température au-delà de 3 ou 4 °C. Est-il vrai que les perspectives aujourd’hui imaginées ne sont peut-être pas modélisables ?
Y a-t-il un risque de dégel des permafrosts et de poursuite de la fonte des glaciers, y compris dans leur partie continentale ? Quelles en seraient les conséquences ?
Vous avez évoqué le cycle de carbone ; quel est votre avis sur le rôle de la forêt ? Sa capacité à capter le CO2 est souvent mise en avant, d’autant qu’en utilisant le bois comme source d’énergie, on ne relâche que le carbone qui avait précédemment été fixé, le stock restant donc invariable ; les litières émettent néanmoins du méthane. Quel est donc, en matière de carbone, le bilan d’une forêt qu’on exploiterait, d’une part, en bois d’œuvre et, d’autre part, en bois énergie ?
Enfin, la forêt est plantée aujourd’hui pour produire dans soixante-dix à quatre-vingts ans. Est-il possible de prévoir et éventuellement de modifier les choix d’essences et les modalités de sylviculture, pour que les récoltes espérées par les forestiers d’aujourd’hui ne soient pas mises en cause par l’évolution climatique à mi-chemin de leur période de production ?
M. Martial Saddier. Je voudrais, au nom de mes collègues du groupe UMP, saluer M. Le Treut et le remercier pour sa présence.
Au niveau mondial, 75 % de la consommation d’énergie proviennent aujourd’hui des énergies fossiles, et quels que soient nos efforts, ce pourcentage ne pourrait être inférieur à 70 % en 2030. Même si tous les pays de l’OCDE parviennent à stabiliser leurs émissions, les pays en voie de développement, qui connaissent une croissance très forte, absorberont en effet la diminution.
On parle désormais d’un réchauffement de 4 °C en 2060 ou en 2100. Quel est, selon vous, le scénario réaliste de changement climatique ?
Cette audition étant suivie sur Internet et couverte par la presse, le large public apprécierait certainement que vous reveniez plus précisément sur les origines de cette évolution du climat, et notamment sur la part de la responsabilité humaine.
N’avez-vous pas le sentiment que la communauté scientifique évolue vers la résignation, considérant qu’il est trop tard pour empêcher le changement climatique, et que par conséquent les efforts sont largement inutiles ?
Y a-t-il, au sein de la communauté scientifique, un consensus sur le lien entre l’évolution du climat et les accidents climatiques, notamment l’accélération et l’intensité des ouragans et des typhons ?
Pourriez-vous être plus précis sur l’incidence du réchauffement climatique sur les rendements agricoles et halieutiques ?
A-t-on commencé à chiffrer le pourcentage ou le nombre d’habitants qui connaîtront une mobilité du fait du réchauffement ?
Le dégel du permafrost et la disparition de la calotte glaciaire suscitent beaucoup de débats ; a-t-on des chiffres relatifs à leurs conséquences potentielles ?
Peut-on avoir un tableau plus précis en matière d’élévation du niveau des mers et des océans sur le territoire français – métropolitain et d’outre-mer ?
Qu’en sera-t-il des températures en ville, et notamment des canicules ?
Le réchauffement est deux fois plus rapide en montagne ; où en est-on dans ces régions ?
M. Jean-Christophe Fromantin. Le groupe UDI se satisfera des réponses aux questions déjà posées.
M. Patrice Carvalho. Le groupe GDR se réjouit de ce débat.
La lutte contre les gaz à effet de serre est d’autant plus difficile que l’on est face à une multitude de petites sources d’émission – notamment les fermes. Comment arriver à capter – et éventuellement à stocker – les gaz qui en proviennent ?
La forêt est présentée comme l’un des moyens forts de lutter contre les émissions de CO2 ; mais est-il exact que certaines plantes – notamment la betterave, pourtant en disparition au profit de la canne à sucre – seraient des capteurs encore plus efficaces ?
Mme Laurence Abeille. Le décalage est énorme entre, d’un côté, la réalité du changement climatique qui s’accélère et, de l’autre, l’inaction politique internationale dont l’issue des négociations de Doha fournit un nouvel exemple ; nous partageons tous une grande inquiétude à ce sujet. Plus personne ne conteste la réalité du changement climatique, mais son impact et ses conséquences sur l’activité humaine, l’agriculture, la biodiversité ou l’alimentation continuent à faire l’objet de dénis. D’aucuns considèrent en effet que cet impact serait maîtrisable, et que le progrès technique et technologique permettrait d’y faire face. Il ne serait dès lors pas nécessaire de changer de modèle de développement : s’adapter aux changements suffirait. S’ils conçoivent que les catastrophes naturelles sont plus intenses, ils estiment qu’il faudrait rendre les constructions humaines plus résistantes. En somme, tout pourrait s’arranger dans le cadre actuel.
Le groupe écologiste considère que ce schéma de pensée doit être fortement combattu ; l’homme ne peut pas sortir indemne de ces bouleversements, et nier les désastres du changement climatique vers lequel nous allons aurait un coût immense.
La séparation des groupes de chercheurs en compartiments étanches que vous avez évoquée est très préoccupante. N’y a-t-il pas là une volonté d’entretenir l’inaction ? À qui cette situation profite-t-elle ?
Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) recommande la prise en compte, dans les modèles climatiques, de la fonte du permafrost qui renferme 1 700 milliards de tonnes de carbone, soit le double du volume déjà présent dans l’atmosphère. Où en est la prise en compte de ce paramètre dans les débats et calculs des scientifiques ?
Les écologistes défendent depuis longtemps la participation des citoyens et des ONG aux processus de négociation et de décision. Pensez-vous qu’une participation effective du public pourrait faire avancer les choses ?
Quelles informations nouvelles peut-on attendre du rapport du GIEC prévu en 2014 ?
Nous examinerons, en janvier, une proposition de loi du Sénat sur l’expertise indépendante en matière de santé et d’environnement et la protection des lanceurs d’alerte. Qu’en pensez-vous ?
Vous avez soulevé la question de l’équité qui constitue, au niveau international, l’un des points essentiels. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment arriver à des politiques qui prennent cette question en compte ?
L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels – gaz et pétrole de schiste – ne pourrait-elle pas anéantir tous les efforts consentis par ailleurs ?
Enfin, que faire pour que l’écologie et la protection du climat ne soient pas considérées comme des ennemis de l’économie ? Peut-on réussir la transition écologique en gardant le même mode de pensée économique productiviste ?
M. Jacques Krabal. Le groupe RRDP aimerait recueillir les impressions des membres de la Commission qui ont assisté à la conférence de Doha. Peut-on dépasser le pessimisme qui transparaît dans tous les discours ?
Monsieur Le Treut, le typhon Bopha a causé plus de 540 morts aux Philippines, et près de 580 personnes sont encore portées disparues ; le dernier ouragan Sandy a causé d’importants dégâts aux États-Unis. Est-ce une fatalité ? Peut-on faire un lien de cause à effet entre le réchauffement climatique et ces accidents ?
Le cloisonnement de la recherche vous préoccupe visiblement ; avez-vous réfléchi aux contours de cet espace de réflexion collectif que vous appelez de vos vœux, au niveau national, européen ou international ? L’ONU constitue-t-elle un cadre pertinent ?
J’ai apprécié de vous entendre dire que le risque était mondial ; comment peut-on le prévenir au niveau régional ? La météorologie a fait de grands progrès ; la prévision des accidents climatiques pourrait-elle également être améliorée ?
Votre discours, empreint de pessimisme, est assez fataliste. Quelles propositions pourraient être mises en œuvre pour éviter la catastrophe ?
M. Philippe Plisson. Voilà plus de vingt ans que le GIEC a été créé, plus de trente ans que la question de l’influence de l’homme sur l’atmosphère a été évoquée. Alors que Doha vient de s’achever sur un énième fiasco, quel est le sentiment de l’ensemble de la communauté scientifique sur la multiplication des échecs pour trouver un accord entre les différentes parties prenantes ?
Quel est votre avis sur la méthodologie et les conclusions des rapports rendus publics en novembre dernier par différentes organisations ? Celui du PNUE sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction d’émissions constate que la concentration des gaz à effet de serre a augmenté de 20 % depuis 2000 et prévoit, si rien n’est entrepris, une hausse des températures de 3 à 5 °C au cours du XXIe siècle. Il contient néanmoins une pointe d’optimisme : l’objectif d’un réchauffement limité à 2 °C resterait toujours réaliste. Le rapport de la Banque mondiale table, pour sa part, sur une hausse de 4 °C. Le dernier rapport du GIEC dressait un tableau sensiblement différent ; le prochain s’orientera-t-il vers des conclusions similaires ? Les prévisions du GIEC prennent-elles en compte les variations naturelles du cycle d’activité solaire ?
En tant que spécialiste des interactions entre l’atmosphère et l’océan, pourriez-vous nous éclairer sur le problème de l’acidification des océans ? Quels organismes en souffrent le plus ? Observe-t-on un déficit en calcification, comme les scientifiques le prévoyaient ? Le blanchiment des coraux observé sur les grandes ceintures coralliennes est-il une conséquence de l’acidification, et leur disparition est-elle inéluctable ?
M. Yves Albarello. Ma question a déjà été posée par Martial Saddier. Je suis, monsieur Le Treut, dans le même état d’esprit que vous. J’observe – non en tant que climatologue, mais en tant que citoyen – un piétinement des conférences internationales, dont le statut quo de Doha est une illustration. On assiste, impuissants, au réchauffement climatique, alors que certains grands pays industrialisés refusent d’entrer dans le cercle vertueux que nous essayons de mettre en place. Que faut-il faire ? Comment voyez-vous notre avenir ?
Mme Geneviève Gaillard. La lutte contre le changement climatique nous concerne tous, pouvoirs publics, citoyens, entreprises. Quel peut être le rôle de la fiscalité environnementale ? Est-elle efficace ou devons-nous aller plus loin, comme le fait aujourd’hui l’Allemagne ?
M. Charles-Ange Ginesy. La France est candidate à l’organisation de la prochaine conférence climatique : pour que celle-ci réussisse, à l’inverse de la conférence de Doha, quelle organisation faudra-t-il adopter ?
Par ailleurs, l’économie de la montagne représente en France beaucoup d’emplois – de 30 000 à 40 000 selon les estimations. D’après le GIEC, le réchauffement est une tendance sur le très long terme : quelles transformations doit-on envisager pour nos stations de sport d’hiver ?
M. Philippe Noguès. L’association Two Degrees Investing, lancée il y a quelques jours et soutenue par le Commissariat général au développement durable et une vingtaine d’acteurs, dont la Caisse des dépôts – gage incontestable de sérieux –, propose des indicateurs permettant de combiner financement à long terme et lutte contre le changement climatique. En effet, d’après cette association, notre modèle financier à court terme ne mesure la performance et les risques que sur les indices boursiers phares. Or ceux-ci comptent 10 % à 15 % d’entreprises qui extraient ou produisent des énergies fossiles.
Les marchés ne se sentent pas menacés par le risque climatique, et ne l’intègrent pas à leur modèle de gestion financière : ils continuent donc, sans remords, à provoquer toujours plus d’émissions de carbone. L’association constate que, pour limiter le réchauffement à deux degrés, nous disposons d’un budget carbone maximum de 450 gigatonnes d’émissions de CO2 d’ici à 2050, alors que nous devrions être à 550 gigatonnes d’ici à 2035, montant auquel il faut ajouter le CO2 produit par les réserves prouvées d’énergie fossile. Nous risquons donc d’atteindre un réchauffement de six degrés en 2050. On mesure dès lors l’ampleur des risques environnementaux, accentués encore par les conséquences financières catastrophiques des désastres climatiques. Or ces dépenses nous empêcheront de financer la transition écologique et de favoriser de nouveaux modèles économiques plus sobres en carbone.
Il existe un rapport étroit entre dégradation climatique et modèle économique : il est par conséquent nécessaire d’intégrer le risque climatique à la mesure de la performance et des risques financiers. Pour cela, nous avons besoin d’une grande transparence. Il faudrait commencer par obliger les investisseurs à déclarer leur degré d’exposition au risque climatique.
M. Guillaume Chevrollier. Le réchauffement climatique est une menace : nous devons préserver notre planète pour les générations futures. Notre pays a fait des efforts, mais ceux-ci doivent être équitablement répartis. L’accord de Doha nous laisse sceptiques : il engage l’Union européenne et une dizaine d’autres pays industrialisés, mais sa portée sera essentiellement symbolique, puisque les signataires ne produisent qu’environ 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment régler ce qui est un problème planétaire, alors que les États-Unis, la Chine, l’Inde, contestent ces accords ?
M. Christian Assaf. Lors des sommets internationaux, les pays en voie de développement et les pays émergents comme la Chine et l’Inde répondent aux pays occidentaux, volontiers donneurs de leçons, que les contraintes qu’on leur imposerait pourraient freiner leur développement. Mais ces pays ne pourraient-ils pas être aussi les premières victimes du changement climatique ?
M. Jean-Marie Sermier. Peut-on mesurer précisément l’importance des différents facteurs du réchauffement climatique ?
En évaluant mal certains risques, les scientifiques n’ont-ils pas une part de responsabilité dans l’absence de décisions ? Autrement dit, qu’est-ce qui vaut mieux pour l’humanité : le risque nucléaire ou le risque du changement climatique ?
M. Arnaud Leroy. Essayons d’être positifs : le captage de gaz à effet de serre pourrait peut-être constituer une vraie solution. Si cela fonctionne, ne faudrait-il pas, dans les prochains textes de loi portant sur l’environnement, prévoir un pourcentage pour la captation ? Cela nous permettrait de faire émerger des filières industrielles, et par là même de rassurer nos concitoyens, qui voient avec crainte, voire avec angoisse, les conséquences que pourraient avoir sur leur emploi et leur vie quotidienne les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique.
M. Laurent Furst. L’ouragan Sandy a eu, selon certains, une influence considérable sur la récente réélection du président des États-Unis. Les commentateurs ont parlé de conséquence du changement climatique, mais tout événement météorologique est-il une conséquence du changement climatique ?
Mme Sophie Errante. Certains grands États boudent les conférences environnementales et refusent de prendre des engagements. Partagez-vous l’analyse selon laquelle ce sont les nouvelles découvertes de réserves d’énergies fossiles, pour les 250 prochaines années peut-être, qui motivent ce désintérêt ?
M. Olivier Marleix. Je veux d’abord rendre hommage aux climatologues, dont le travail est reconnu par tous ceux qui s’intéressent à ce domaine, et qui sont malheureusement parfois confrontés au scepticisme de ceux qui ne s’y intéressent pas. Nous avons besoin de pédagogie : il faut faire comprendre que l’évolution du climat n’est pas linéaire, et que nous allons plutôt vers un dérèglement du climat. Pouvez-vous souligner ce point ?
Par ailleurs, la gestion des crises climatiques sera de plus en plus difficile, les risques de famine et de bouleversements migratoires seront de plus en plus forts. J’ai été surpris que ces aspects soient peu évoqués à Doha : quel serait l’espace de réflexion pertinent pour agir ?
M. Jean-Pierre Vigier. Le Gouvernement souhaite diminuer la production d’électricité d’origine nucléaire au profit des énergies renouvelables. Nous ne savons pas aujourd’hui si celles-ci seront suffisantes ; si elles ne le sont pas, devrons-nous consommer plus de gaz, et donc produire plus de CO2, polluer plus et accélérer encore le changement climatique ?
Que peut-on dire de la pollution engendrée par la production de CO2 des pays émergents ?
Mme Sophie Rohfritsch. Les modèles de calcul des évolutions climatiques prennent-ils en compte le stockage de CO2 dans les roches ? Un laboratoire toulousain a montré que, contrairement à ce que l’on pensait jusqu’à présent, le processus d’altération chimique des continents pourrait avoir des conséquences à l’échelle d’un siècle, c’est-à-dire l’échelle de temps prise en considération par ces modèles.
M. Alain Lebœuf. Pourriez-vous apporter des précisions sur le captage et le stockage du CO2 ? L’évolution de la consommation du CO2 a-t-elle évolué sur notre planète depuis plusieurs décennies ?
M. Jacques Kossowski. La population mondiale est responsable du changement climatique, et elle continuera à augmenter dans les années qui viennent. Comment peut-elle moins polluer ?
Par ailleurs, les bovins émettent du méthane, ce qui n’est pas sans influence : quelle action peut-on envisager dans le domaine agricole ?
M. David Douillet. Comment allons-nous faire pour que tout le monde s’asseye autour de la table, pour provoquer une prise de conscience mondiale de la nécessité de protéger notre planète ? Les États-Unis, le Canada, la Chine… adoptent des visions à court terme, et placent au-dessus de nous une épée de Damoclès.
Pourrait-on essayer de calculer le coût du changement climatique, d’évaluer le prix des désastres qui en résulteront ? Cela nous permettrait peut-être de convaincre ceux qui adoptent une vision purement mercantile de ces problèmes.
M. Hervé Le Treut. La notion de modèle est générique : elle sert à désigner des choses très différentes les unes des autres. Les modèles climatiques visent surtout à prévoir l’évolution du climat sur la base des lois de la physique. Le calage de ces modèles est donc partiel, l’essentiel de l’information venant des lois de la physique. En bonne science, le calage des modèles doit se faire sur des événements passés ; il faut également faire des hypothèses, que l’on vérifie ensuite en testant la capacité du modèle à reproduire une série de processus. Pour être qualifié, un modèle doit donc répondre à un large ensemble de critères.
Une vingtaine de groupes produisent des modèles climatiques : c’est un travail lent et lourd qui mobilise cinquante à cent personnes pendant une dizaine d’années. Le dernier rapport du GIEC a permis de mettre en commun les résultats obtenus par la communauté scientifique internationale, en construisant des bases de données auxquelles peuvent accéder les scientifiques du monde entier quand ils souhaitent analyser les changements climatiques et vérifier la capacité des modèles à reproduire des événements actuels ou passés. Un millier d’études qui utilisent les simulations réalisées par les vingt groupes de modélisation ont été publiées ; nous en attendons beaucoup plus encore pour le prochain rapport du GIEC. Cela souligne l’une des difficultés de ce travail : il n’est pas facile de prendre connaissance d’une telle masse de résultats.
Globalement, la confiance que l’on peut avoir en ces outils a beaucoup augmenté. Ceux-ci ne permettent pas, bien sûr, de faire n’importe quoi : pour construire un modèle, il faut d’abord avoir une bonne connaissance des processus que l’on veut modéliser.
Le permafrost, par exemple, n’est pas connu et étudié depuis très longtemps. Toutes les régions arctiques sont complexes, notamment parce qu’il est difficile de savoir jusqu’où va pénétrer le réchauffement, puisqu’il s’agit de savoir comment va se libérer le méthane emprisonné dans les cristaux de glace. De plus, le sol se reforme, l’activité biologique pouvant être intense en été dans ces régions, avec un restockage du méthane et du CO2. Le bilan global a toutes chances de varier beaucoup selon des facteurs locaux. Enfin, si nos équipes peuvent travailler sans problème au Canada, ce n’est pas toujours le cas en Russie.
L’appréhension de ces problèmes est progressive, et si les scientifiques hésitent encore à mentionner le permafrost, c’est qu’il y a encore bien des choses que nous ne comprenons pas bien : lors du dernier épisode de réchauffement de la planète, il y a 120 000 ans de cela, le méthane n’a pas beaucoup augmenté ; nous ne savons pas l’expliquer.
Il existe donc des risques tout à fait réels, mais que la science ne sait pas encore préciser. Il en va d’ailleurs de même pour le CO2 stocké dans les roches, problème dont je ne suis pas spécialiste.
Si les rapports du GIEC sortent tous les cinq ans, c’est parce que cette périodicité nous permet non seulement d’accumuler des résultats scientifiques nouveaux, mais aussi de prendre le temps de les tester, et donc de nous appuyer sur quelques certitudes. Des publications paraissent tous les jours, mais la communauté scientifique doit les mettre à l’épreuve.
Vous m’interrogez sur le scénario le plus probable. Les rapports précédents du GIEC proposaient plusieurs scenarii possibles si l’on ne prenait aucune mesure politique, avec une fourchette de réchauffement en 2100 qui allait de deux à six degrés : même sans intervention, l’émission de gaz à effet de serre pouvait donc avoir des effets très variables. Malgré une recherche très active dans ces domaines, les modèles scientifiques ont du mal à appréhender tous les facteurs aggravants, par exemple les nuages.
Aujourd’hui, nous suivons plutôt une trajectoire pessimiste ; nous allons vers quatre à cinq degrés de réchauffement. C’est le réchauffement qui correspond à la dernière déglaciation : c’est un phénomène d’une très grande ampleur. Il ne faut donc pas, j’y insiste, juger du changement climatique futur et de ses risques à partir de ce que l’on observe aujourd’hui.
Cela fait une vingtaine d’années que nous constatons un réchauffement de la planète, et que nous voyons des signes nous incitant à penser que ce réchauffement est lié à l’augmentation des gaz à effet de serre – refroidissement, par exemple, de la stratosphère qui accompagne un réchauffement des basses couches de l’atmosphère, ou bien réduction de la surface de la banquise de 30 % à 40 % par rapport à ce qu’elle était il y a une quarantaine d’années.
Mais pour beaucoup d’autres phénomènes, il est extrêmement difficile de faire un diagnostic, ne serait-ce que parce que le temps de recul est trop court. C’est le cas pour les ouragans, les cyclones, les tornades : si le temps de retour d’un événement passe de cent à cinquante ans, comment peut-on faire la part de ce qui est naturel et de ce qui tient aux activités humaines ? Ce n’est pas possible. Pour tous ces événements rares, mais puissants, nous ne pouvons pas encore dire qu’il y a un changement. Nous sommes bien obligés de dire que nous sommes incapables de mesurer un éventuel impact du changement climatique sur l’apparition, par exemple, de Sandy.
Cela ne veut pas dire pour autant, bien au contraire, que nous ne sommes pas inquiets de la multiplication, dans le futur, de ces événements : nous savons que la température des océans est un facteur majeur de déclenchement d’un cyclone.
C’est toute l’ambiguïté de ce débat : il ne faut pas confondre l’absence de preuves qu’un événement donné soit d’origine anthropique avec ce qui peut se produire dans le futur. Dans le passé, nous avons d’abord compris ces problèmes de façon théorique ; nous avons constaté certains phénomènes de façon pratique, ensuite, mais certains autres, plus difficiles à établir, ne pourront être vérifiés que plus tard, par des moyens statistiques.
Cette différence vaut pour le réchauffement lui-même : nous commençons à pouvoir dire qu’il ne peut pas être le résultat de processus naturels ; le dernier rapport du GIEC estimait qu’il y avait 90 % de risques que le réchauffement actuel soit d’origine anthropique.
Plusieurs questions ont porté sur la forêt, domaine dont je ne suis pas spécialiste. La forêt peut constituer une richesse, que certains pays veulent exploiter. Elle joue également un rôle climatique en modifiant le cycle de l’eau. Ainsi, au Brésil, si elle venait à mourir, elle serait, peut-on estimer, remplacée par une savane : la forêt entretient un système de végétation parce qu’elle entretient aussi un certain régime hydrique. Elle peut constituer un stock de carbone, mais je ne crois pas qu’il faille accorder trop d’importance à ce point : toutes les propositions de stockage de carbone dans la forêt ont une limite, puisqu’une fois leur croissance achevée, les végétaux ne stockent plus rien.
La forêt constitue enfin un réservoir pour une partie du patrimoine génétique de la planète, que nous devons préserver. Il y a d’autres choses à préserver que les caractères physiques de notre planète : notre patrimoine est aussi biologique. Une forêt, c’est des arbres, mais c’est aussi tout un écosystème cohérent, des bactéries aux animaux.
Beaucoup de questions portaient sur l’évolution probable du changement climatique. Je l’ai dit, le GIEC prévoyait un réchauffement de deux à six degrés si nous ne faisions rien, et nous sommes plutôt en haut de cette fourchette. Les prochaines décennies sont-elles déjà déterminées par les émissions de gaz à effet de serre passées ? En partie, oui. Les systèmes réagissent plus ou moins vite ; l’histoire future de ceux qui réagissent lentement, comme les océans, est aujourd’hui largement écrite. La hausse du niveau des mers relève par exemple de la très longue durée.
Si nous ne faisons rien, le réchauffement de deux degrés arrivera vers le milieu de ce siècle à peu près. Si nous voulons faire quelque chose, il faut prendre en compte l’inertie des systèmes climatiques. Il faut donc agir très vite et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions considérables.
La communauté scientifique fait-elle preuve de fatalisme ? C’est compliqué. D’abord, les scientifiques analysent, travaillent, et ont donc « le nez dans le guidon », si vous me permettez l’expression. Par ailleurs, le seuil de deux degrés est un choix politique, que je crois judicieux parce qu’il représente un seuil au-delà duquel le climat sera effectivement beaucoup plus difficile à prévoir, mais il n’y a pas en réalité un seuil unique. Le climat dépend de composantes dont les rythmes diffèrent ; l’océan peut réagir, mais nous ne savons pas comment ni à quelle échelle de temps ; les glaciers, la végétation, la forêt peuvent être vulnérables au changement climatique, mais là encore nous ignorons comment. Il y a donc des seuils à un, deux, trois degrés.
Les conséquences de cette complexité sont paradoxales. D’une part, il faut vraiment éviter de franchir ces seuils : la forêt amazonienne pourrait ainsi rencontrer un tipping point, un moment où la disparition de sa niche écologique ne lui permettra plus de survivre, mais nous ne savons pas quand. D’autre part, chaque franchissement de seuil rend les choses plus compliquées, mais il n’y a pas un seuil précis, unique, au-delà duquel tout serait perdu.
La question des ressources agricoles et halieutiques est extrêmement complexe. Il faut d’abord savoir si ces systèmes peuvent retirer du CO2 de l’atmosphère et le stocker. Il est possible que cette capacité ne soit que temporaire, et la communauté scientifique craint même qu’elle ne soit diminuée par le réchauffement : les forêts réagissent mal au réchauffement important, de même que les océans. Ces rétroactions sont mal évaluées aujourd’hui. Nous avons besoin de systèmes de végétation en bon état, c’est certain ; faut-il les utiliser pour stocker du carbone ? C’est une solution sans doute très difficile à mettre en œuvre.
Quant au stockage de CO2 dans les couches géologiques, je n’en suis pas spécialiste, mais je sais que c’est possible. J’ai appartenu au conseil scientifique de Gaz de France et je fais partie du conseil d’administration de l’Institut français du pétrole : les uns et les autres développent des prototypes en ce sens. Cette technique fait partie de celles qui pourraient nous permettre de nous débarrasser du CO2 en excédent. Mais il faudrait être capable de l’imposer. Aujourd’hui, nous sommes extrêmement loin de ce que l’on pourrait faire : c’est un problème de volonté politique, quand des centrales thermiques s’ouvrent régulièrement un peu partout sur la planète.
Plusieurs questions portaient sur les risques en France même. Le retour de phénomènes comme la sécheresse ou la canicule fait évidemment partie des risques bien identifiés du changement climatique : l’essentiel des modèles conduit à penser qu’une canicule comme celle de 2003 pourrait se reproduire toutes les quelques années à partir du milieu du siècle – il est bien sûr difficile d’émettre une prévision précise, mais ce sera certainement plus souvent que tous les dix ans. C’est suffisamment plausible et étayé pour en tirer des conséquences en termes d’urbanisme, par exemple.
Depuis quelques années, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) réalise des études sur le littoral. Je connais quelques exemples en détail, et tous sont différents. J’ai ainsi animé un groupe interdisciplinaire qui a travaillé sur le littoral aquitain : celui-ci a tendance à reculer, mais pas par submersion, plutôt sous l’effet de vagues plus puissantes, donc d’une érosion plus forte. La fragilité du milieu littoral dépend de facteurs locaux qui diffèrent d’une région à l’autre : par exemple, la capacité des fleuves à s’alimenter peut être plus ou moins grande, et peut être modifiée par le changement climatique ; le sol peut être relevé. Le travail sur le littoral est donc d’une grande importance. Le problème se pose de façon plus aiguë encore dans d’autres pays, notamment les Pays-Bas, qui ont déjà dû prendre des décisions.
Le terme d’« étanchéité » des domaines scientifiques est sans doute exagéré ; la communauté scientifique fait preuve d’une forte volonté de faire émerger des projets interdisciplinaires, mais c’est très difficile : ces problèmes sont extrêmement complexes. Le lien entre climat et biodiversité constitue, par exemple, un sujet de recherche très riche, mais que nous ne pourrons aborder que très progressivement. Le contact entre les disciplines ne viendra pas seulement de la recherche ; il viendra aussi de l’enseignement, comme de l’expertise et de son partage. Pour ces questionnements pluridisciplinaires, il faut des lieux, des projets, à l’échelle nationale voire régionale – j’ai cité tout à l’heure l’expérience aquitaine.
Qu’attend-on du prochain rapport du GIEC ? Depuis sa création, nous avons assisté à une confirmation progressive du diagnostic scientifique ; je pense que cela continuera. L’accent doit aujourd’hui être mis fortement sur les questions d’adaptation. Il ne faut pas, comme on l’a parfois fait dans le passé, opposer les politiques qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre à celles qui visent à s’adapter au changement climatique, que l’on condamnait comme des formes de démission. Les solutions peuvent être les mêmes, notamment à l’échelle régionale et locale : c’est une raison supplémentaire pour travailler à ces échelles.
Les fluctuations solaires sont prises en compte ; nous pensons qu’elles jouent un rôle d’un ordre de grandeur faible, en tout cas par rapport à ce que l’on peut craindre pour le futur. Certains scientifiques, qui travaillent sur le cycle climatique naturel, estiment que les effets du rayonnement solaire peuvent être amplifiés par des effets naturels : si c’est vrai, je ne vois pas en quoi ce serait rassurant ! Nous subirons alors la somme des fluctuations climatiques dues aux activités humaines et des fluctuations climatiques naturelles qui seraient plus grandes que prévues.
L’acidification est effectivement considérée par ceux qui l’étudient comme un problème majeur.
Plusieurs questions portaient sur le contexte international et la responsabilité des différents pays.
Comme climatologue, je ne suis pas compétent pour parler de ces pays, que je ne connais que par leurs communautés scientifiques. L’Inde, la Chine, et bien entendu les États-Unis et le Canada disposent de communautés scientifiques très fortes qui connaissent très bien ces enjeux. L’Inde, et surtout la Chine, ont conscience qu’elles sont fortement tributaires du climat : ainsi, l’intensité des moussons chinoises, qui pèsent sur toute l’activité économique, peut varier du simple au double. La Chine est exposée aux typhons, et la désertification y progresse. Ce pays connaît donc les enjeux du changement climatique, mais ne veut pas prendre d’engagements contraignants vis-à-vis des pays occidentaux. Ces considérations ne relèvent plus de la climatologie, mais devront être prises en considération pour la préparation des prochains sommets.
Quant à l’origine du réchauffement, le débat médiatique a beaucoup obscurci la situation. Les médias posent en effet sans cesse la question du réchauffement tel qu’il est aujourd’hui ; or, les origines de ce réchauffement sont à la fois naturelles et anthropiques : séparer les choses, c’est le quotidien des scientifiques, et ce n’est pas toujours facile. Mais cela n’a que peu à voir avec ce qui nous attend dans les décennies qui viennent : le risque de réchauffement lié aux activités humaines est très important.
Encore une fois, la communauté scientifique ne s’appuie pas sur des événements récents pour prévoir des choses ; elle réfléchit aux conséquences, selon les lois de la physique, de l’émission de gaz à effet de serre. Ce travail a dû être bien fait, puisque l’on voit aujourd’hui se réaliser des prévisions faites dès les années 70.
Vous m’interrogez aussi sur la responsabilité des scientifiques. J’ai beaucoup insisté sur la pluridisciplinarité et sur la collégialité : on parle ici de scientifiques dont les compétences sont souvent très différentes les unes des autres. Il est très difficile, voire impossible, pour un seul scientifique de comprendre aussi bien les risques climatiques que ceux liés à certaines filières énergétiques. Cela pose le problème de l’expertise et de son organisation. Il y a des sujets que j’étudie depuis trente ans, sur lesquels je me sens capable de répondre, et d’autres que je connais par la lecture du journal : je ne veux pas mettre sur le même plan les uns et les autres. Tous les scientifiques, je crois, partagent ces scrupules.
Les problèmes de démographie, et d’alimentation bovine, font partie des facteurs importants. La Chine ou l’Inde les mettent souvent en avant, la Chine parce qu’elle a fait des efforts considérables pour réduire sa population, l’Inde parce que son alimentation fait qu’elle émet moins de gaz à effet de serre que les pays occidentaux. Ces pays émettent d’ailleurs moins de gaz à effet de serre par habitant que les pays occidentaux.
L’opposition de l’échelle mondiale et de l’échelle régionale est délicate. Autrefois, nous nous disions que, puisque nous ne savions pas prévoir où les changements se manifesteraient, puisque nous habitions après tout sur la même planète, nous allions prendre des décisions collectives, dans un esprit de solidarité. Aujourd’hui, malheureusement, nous connaissons suffisamment bien ces problèmes pour que certains se disent qu’ils vont profiter du changement climatique, quand d’autres voient bien qu’ils vont en pâtir. Il faut donc articuler diagnostic mondial et diagnostic régional.
Ce diagnostic régional est toutefois, scientifiquement, souvent plus difficile à faire – les systèmes climatiques sont extrêmement complexes. Même à l’échelle de la France, on peut s’attendre à un climat dominant plutôt de sécheresse dans le sud, mais cela n’exclut pas des évolutions différentes, avec des crues intenses par exemple. Peut-on donc choisir les essences d’arbres que l’on plante en prenant en considération le changement climatique ? Je dirais qu’on peut donner des conseils, tout en gardant à l’esprit les incertitudes actuelles. Il faut donc favoriser des solutions de résilience, c’est-à-dire prendre des précautions plus générales du fait de la difficulté à anticiper l’avenir à l’échelle régionale. Il faut, ici, mêler expertise scientifique et planification, à l’échelle par exemple des collectivités locales.
Par ailleurs, une chose est sûre : les efforts nécessaires ne se feront pas de façon spontanée. Il faudra des outils – quotas, fiscalité, marchés, tout cela existe ; aucun ne fonctionnera tout seul et il faudra sans doute les associer. Mais, n’étant pas économiste, je ne peux pas en dire plus.
Une communauté scientifique active travaille sur le chiffrage des dégâts. On estime que cela coûterait moins cher de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de s’adapter tardivement au changement climatique. Je vous renvoie notamment au rapport Stern. Ces estimations seront réactualisées dans le prochain rapport du GIEC.
Quant aux stations de sport d’hiver, il y a un réchauffement global – c’est la plus inéluctable des prévisions que l’on peut faire. Cela ne veut pas forcément dire moins de neige partout, mais probablement l’enneigement deviendra-t-il très irrégulier, avec de mauvaises années plus fréquentes. C’est, je pense, inévitable pour les stations situées à basse altitude : si certains facteurs peuvent varier, voire refluer, la tendance au réchauffement doit être envisagée sur la très longue durée.
3. Audition de M. Jean-Marc Jancovici, sur le changement climatique et la transition énergétique (6 février 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai le plaisir d’accueillir M. Jean-Marc Jancovici pour sa première audition devant la commission du développement durable. Nous le recevons dans le cadre du débat sur la transition énergétique. Professeur à Mines ParisTech, expert reconnu sur les questions climatiques et énergétiques, auteur – et développeur principal – du bilan carbone pour le compte de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), vous avez créé en 2007, avec Alain Grandjean, le cabinet de conseil Carbone 4. Par ailleurs, vous siégez au Conseil économique, social et environnemental (CESE) et au comité de la veille écologique de la Fondation Nicolas-Hulot.
M. Jean-Marc Jancovici. Je vous remercie de prendre le temps de cet échange. Je n’ai certes jamais été auditionné par cette commission, mais j’ai participé à la mission de l’Assemblée nationale sur l’effet de serre que présidait, sous la législature précédente, M. Jean-Yves Le Déaut et dont Mme Nathalie Kosciusko-Morizet était rapporteure.
Sans énergie, le monde moderne n’existerait pas. La hausse du pouvoir d’achat, l’urbanisation, la tertiarisation, la mondialisation, le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures et tous les acquis sociaux ont pu se développer grâce à l’énergie. Or, cette dernière se trouve dorénavant en quantité insuffisante pour que le travailleur français puisse maintenir son niveau de consommation. Que faire pour que cette situation ne dégénère pas en instabilité sociale forte ?
La production mondiale ne dépend que de l’énergie disponible. Toute contrainte sur le volume de l’énergie – et non sur son prix – se répercute sur le PIB. MM. Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont trompés : en annonçant la progression du pouvoir d’achat en 2007 pour le premier, en prédisant la reprise de la croissance en 2012 pour le second, ils pensaient que leur volonté pouvait prévaloir sur la physique. Dorénavant, l’Europe ne connaîtra plus de croissance : son cycle économique est appelé à reposer sur l’alternance d’une année de récession suivie d’un faible rebond. La croissance continue ne reviendra plus, car l’approvisionnement énergétique de l’Europe est déjà restreint : le gaz et le pétrole fournissent les deux tiers de la consommation énergétique européenne. Ainsi, tout plan prévoyant de nouvelles dépenses financées par un surplus de croissance échouera. L’avenir doit être pensé dans un environnement sans croissance.
Dans un tel cadre, il convient de veiller au puissant effet d’éviction des dépenses inutiles : engager des dizaines milliards d’euros pour des panneaux photovoltaïques revient à se priver de financement pour des actions véritablement utiles. Les énergies fossiles sont trop abondantes pour sauver le climat, mais trop rares pour relancer l’économie européenne. Il va être difficile de convaincre les pays détenteurs de charbon de ne pas l’utiliser dans un contexte de stagnation économique. L’Allemagne a emprunté cette voie. La hiérarchie des mérites et des nuisances varie selon la finitude ou l’infinitude de la disponibilité des ressources, puisque le poids des contraintes diffère en fonction de la source d’énergie.
Les modèles macroéconomiques d’aujourd’hui bouclent leurs équations par les prix et reposent sur des élasticités constantes entre prix et volumes. Ils sont devenus inopérants et n’ont pas permis d’anticiper la crise de 2007. Portons notre attention sur les volumes et non sur les prix ! Pour le pétrole, par exemple, l’élasticité entre prix et volume n’existe plus ; il n’est plus possible de déduire la quantité de pétrole produite à partir de son prix. Et c’est bien la quantité qui importe pour l’économie, non le prix.
En revanche, le pétrole nécessaire à la création d’un euro de PIB décroît en volume. De même, la part de l’énergie dans le budget des ménages diminue depuis quarante ans ; elle se situe à un niveau inférieur à celui qu’elle atteignait avant le premier choc pétrolier. De plus en plus de pétrole, de gaz et de charbon sont extractibles. Mais en conclure que le progrès technique et des politiques courageuses permettraient d’atteindre n’importe quel but néglige le principe de réalité. L’énergie correspond à une grandeur physique qui caractérise le changement d’état d’un système. Ce processus obéit à des lois qui ne souffrent aucune exception. Ainsi, quand le monde change, l’énergie intervient. Là où l’économiste mesure la transformation de l’activité par une valeur ajoutée libellée en monnaie, le physicien évalue la quantité de kilowattheure nécessaire à cette mutation. De fait, il ne peut y avoir d’énergie propre, puisque l’énergie exige la transformation, alors que la propreté induit l’immuabilité. Il s’agit d’en user en permettant aux avantages de surpasser les inconvénients.
Une personne bien entraînée, capable de gravir le Mont-Blanc un jour sur deux, produit avec ses muscles environ 100 kilowattheures d’énergie mécanique par an. Si un individu était payé au SMIC pour accomplir cette formation d’énergie, le kilowattheure coûterait entre plusieurs centaines et quelques milliers d’euros. Les énergies fossiles ont permis de réduire ce prix. Un litre d’essence correspond environ à 10 kilowattheures, ce qui permet une énergie mécanique mille à dix mille fois moins chère que le coût du travail en Occident. En 1860, une personne disposait chaque année de 1 500 kilowattheures d’énergie – surtout thermique, charbon et bois – ; elle les utilisait pour le chauffage, la métallurgie, le bateau à vapeur et le train. Cette quantité n’a cessé d’augmenter pour atteindre 20 000 kilowattheures.
Dans cette énergie extraite de l’environnement, le charbon n’a jamais décru et toutes les nouvelles sources d’énergie – pétrole et gaz dans un premier temps – sont venues s’ajouter à l’existant sans le remplacer. Quant à l’éolien, au biogaz, au photovoltaïque et à la géothermie, leur poids est infinitésimal. Ainsi, même une baisse limitée du pétrole, du gaz ou du charbon sera très difficilement compensée par ces énergies nouvelles. Le charbon constitue le premier mode de production de l’électricité et les deux tiers de sa consommation se font en ce sens. Voilà pourquoi cette dernière n’a jamais diminué. Le pétrole, lui, sert avant tout pour les transports.
Pendant plus d’un siècle, la consommation énergétique de chacun a crû de 2,5 % par an afin de réaliser les infrastructures de transport, l’urbanisation, la mutation de l’agriculture, l’essor industriel et les systèmes sociaux. Depuis 1980, cette hausse s’est tarie ; elle ne résulte plus que du charbon et de la Chine. Les chocs pétroliers ont constitué une rupture radicale dans l’approvisionnement énergétique qui a, à son tour, engendré le chômage et l’endettement, problèmes qui n’existaient pas en 1974. Là encore, le problème ne réside pas dans le prix mais dans le volume.
Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, chacun dispose d’une énergie équivalente à celle de 200 esclaves. Sans les énergies fossiles, nous aurions besoin de deux cents planètes sur lesquelles 7 milliards de personnes produiraient de l’énergie pour maintenir notre niveau de vie actuel. Nous pouvons nous consacrer aux affaires publiques uniquement parce que l’énergie a remplacé la force de nos muscles.
Ce progrès s’est accompagné d’une croissance démographique exponentielle. Au moment où l’humanité s’est sédentarisée, la population mondiale ne dépassait pas quelques millions d’habitants ; elle atteignait 500 millions de personnes au début de la révolution industrielle et dépasse maintenant les 7 milliards, progression fabuleuse en seulement huit générations.
La consommation globale d’énergie a explosé : entre 1945 et le premier choc pétrolier, la consommation d’énergie mondiale a crû, en moyenne, de 5 %. Ensuite, elle a décéléré et diminuera bientôt. Elle provient, pour une part s’élevant à 80 %, de combustibles fossiles, restes de vie ancienne – fougères du carbonifère pour le charbon, algues et planctons pour le gaz et le pétrole. Même l’électricité est massivement fossile : la production française actuelle se monte à 550 térawattheures, soit à peine moins que la consommation mondiale en 1945. La généralisation de l’électricité date donc véritablement de la seconde moitié du XXe siècle. En 1973, les combustibles fossiles représentaient les trois quarts de la production électrique ; cette part s’est réduite aux deux tiers en 2007. Au cours de cette période, c’est de très loin le charbon qui a connu la progression la plus soutenue. Actuellement, la Chine installe une centrale à charbon par semaine et des capacités de production de 150 à 200 gigawatts sont en construction – à rapporter avec la capacité totale de la France qui ne dépasse pas 100 gigawatts. Après le charbon, l’énergie ayant connu la plus forte hausse est le gaz. Viennent seulement ensuite l’hydroélectricité et le nucléaire.
Le bois fournit 10 % de l’énergie mondiale. Il n’est, dès à présent, plus totalement renouvelable, puisqu’une partie de cette énergie correspond à de la recherche de bois de feu autour des villes africaines qui engendre de la déforestation. L’hydroélectricité représente l’essentiel des capacités d’énergies renouvelables en construction dans le monde, loin devant l’éolien. Ce dernier, même compté en équivalent primaire, ne produit pas 1 % de l’énergie mondiale. Les agrocarburants ne dépassent pas 0,4 % : quand le monde absorbe 4 milliards de tonnes de pétrole, il ne consomme que 60 millions de tonnes d’agrocarburants. Pour élaborer leurs agrocarburants, les États-Unis utilisent 40 % de leur maïs – soit la même part que celle qu’ils destinent à l’alimentation animale. En Allemagne, certains producteurs insèrent leur maïs directement dans les méthaniseurs pour favoriser la fabrication de biogaz. Enfin, le photovoltaïque contribue pour 0,1 % à la production énergétique mondiale.
Une fois observé ce panorama, je tiens à préciser que le terme de « production » d’énergie est impropre. L’action de l’homme consiste en effet à extraire l’énergie dite primaire de l’environnement, avant de la transformer en énergie finale qu’il pourra consommer.
La France, comme ses voisins, consomme une énergie provenant de combustibles fossiles. Son électricité provient, en très grande partie, du nucléaire. Mais il est faux d’affirmer que toute l’énergie française est nucléaire. Cela ne peut se dire que de l’électricité. L’essentiel de l’usage de l’électricité n’est pas thermique, mais spécifique, à savoir qu’il sert à alimenter des appareils – réfrigérateurs, pompes, lave-linge, lave-vaisselle, ascenseurs – non producteurs de chaleur. Or limiter cette utilisation s’avère plus difficile que de restreindre le besoin de chaleur.
L’emploi d’énergies renouvelables en France répond à la même hiérarchie que celle constatée dans le monde : d’abord le bois, puis l’hydroélectricité, puis l’éolien et, enfin, le photovoltaïque. Ces deux dernières sources d’énergie satisfont respectivement 0,35 % et 0,07 % de la demande d’énergie.
L’énergie a modifié la structure des métiers. Il y a deux siècles, les deux tiers des Français étaient paysans et chacun nourrissait 0,5 personne en plus de lui-même. Avec l’énergie, l’agriculture a pu se mécaniser – un tracteur de 100 chevaux équivaut à environ 1 000 individus – et un agriculteur actuel assure l’alimentation de 50 personnes. Ces dernières ont pu effectuer d’autres tâches grâce à l’énergie, qui permet de transformer de nombreuses ressources présentes dans l’environnement comme des minerais, du bois ou des sols. Ainsi s’est développée l’industrie, activité de transformation des réserves naturelles. Dans tous les pays occidentaux, le choc pétrolier a tari la croissance énergétique globale, qui est devenue inférieure à la productivité du facteur travail, ce qui a entraîné le déclin de l’emploi industriel. La contribution des services à la productivité plus faible a, en revanche, poursuivi son essor. Parallèlement, le chômage s’est massifié. Il y a un siècle, les lois sur le travail avaient pour objet de réduire le travail des femmes et des enfants, comme le temps que devaient y consacrer les hommes. Avant 1974, le facteur limitant l’activité était le travail disponible ; c’est désormais l’énergie. Plus la consommation d’énergie par personne est grande, moins la part de l’emploi dans l’agriculture est élevée. L’énergie abondante a permis l’urbanisation. Que la ville puisse, en accueillant 80 % de la population, organiser un système socio-économique stable dans un environnement énergétique contraint apparaît douteux.
L’opinion courante veut que le développement des services entraîne une dématérialisation, moins consommatrice d’énergie. Or c’est l’inverse : l’augmentation de la part des services dans l’économie n’est possible qu’une fois les fonctions productives remplies par des machines énergivores. Je pressens d’ailleurs que la contrainte énergétique va entraîner une hausse du travail manuel et une baisse des activités de service.
Les échanges plus massifs et mieux organisés ont permis l’étalement de l’habitat. Lorsque les villes ont été construites avant la période de profusion énergétique, les centres sont denses. Mais lorsqu’elles sont récentes, il n’y a pas de centre-ville. Atlanta constitue un bon exemple de cette dernière catégorie.
L’approvisionnement en énergie des pays de l’OCDE a déjà commencé de décroître. À l’inverse, il progresse dans les pays émergents, notamment en Chine. Épisode inédit, le PIB des pays de l’OCDE a également cessé d’augmenter depuis 2007. Cette situation risque de perdurer, car elle découle d’un tarissement énergétique. La France connaît la même situation, alors que l’économie des pays émergents poursuit sa croissance.
À l’école, nous apprenons que le travail et le capital sont les deux facteurs de production. Si cette dernière ne s’avère pas assez élevée pour financer la protection sociale, on diminue le coût du travail et du capital pour les stimuler. Or cette politique ne répond plus : alors que l’Allemagne emprunte à coût négatif et que les chômeurs sont très nombreux, le PIB n’augmente plus. C’est bien la preuve que cette description de l’économie est erronée. En fait, l’économie est une machine à transformer des ressources naturelles gratuites, la formation de capital n’étant qu’une boucle interne au système. Le brevet qu’un industriel dépose aujourd’hui ne résulte que de la transformation – par le travail – de ressources déjà existantes. Le goulet d’étranglement pour l’approvisionnement en ressources énergétiques – quel qu’en soit leur prix – induit mécaniquement un gel de la production. Le prix reste un élément significatif de l’équation économique tant qu’il n’y a pas de problème de quantité. Dans la pêche, le bateau représente le capital, le marin incarne le facteur travail, l’énergie provient du carburant mis dans le bateau et le PIB correspond à la valeur des poissons pêchés : si le diesel ou les ressources halieutiques disparaissent, la pêche et la production deviennent impossibles. Aujourd’hui, le niveau de notre activité économique est significatif du stock de ressources naturelles à transformer : il convient de surveiller attentivement ce dernier.
Depuis 1965, la consommation d’énergie et le PIB varient dans le monde de manière strictement parallèle. « Dis-moi combien d’énergie tu consommes et je te dirai quel est ton PIB » : telle pourrait être, simplement énoncée, la règle qui régit nos économies. En revanche, la variation du prix du baril et le PIB ne connaissent pas la même identité d’évolution. Lorsque le prix du baril augmente, un transfert de rente s’opère et la France s’endette au bénéfice de l’Arabie saoudite, mais rien ne change au niveau global. Vouloir régler le problème énergétique en attendant que les prix croissent fortement, revient à souhaiter une progression des revenus des pays producteurs d’hydrocarbures. Ainsi, la facture pétrolière et gazière de l’Europe a décuplé au cours de la dernière décennie. Cela a engendré un déficit commercial structurel qui s’est traduit par une augmentation de l’endettement. Cette situation se constate aussi bien dans les pays latins que dans les pays nordiques – y compris l’Allemagne. Il ne s’agit pas ici d’une question de couleur politique, mais d’un sujet de physique structurelle qui évolue à l’échelle du demi-siècle.
Le PIB par habitant est strictement égal au produit de l’énergie disponible par habitant et de l’efficacité énergétique, que l’on définit par l’augmentation du PIB induite par la création d’un kilowattheure d’énergie. La croissance du PIB par habitant résulte du produit de la variation de ces deux facteurs. La croissance de l’énergie mondiale s’établissait à 2,5 % par personne et par an avant 1980 et à 0,4 % depuis lors ; l’efficacité énergétique de l’économie a connu une croissance mondiale annuelle moyenne légèrement inférieure à 1 % depuis 1970. Pour que la règle que je viens d’énoncer soit juste, le PIB par habitant aurait dû croître de 3 % avant 1980 et de 1 % maintenant. Les chiffres de la Banque mondiale le confirment. Je suis donc en accord avec M. Vittori, éditorialiste aux Échos, lorsqu’il écrit que les lois de finances doivent dorénavant reposer sur une croissance économique nulle. Ce n’est pas agréable, mais mieux vaut prendre la réalité en compte plutôt que d’élaborer des plans voués à échouer.
Dans la relation étroite entre la production mondiale de pétrole et l’évolution du PIB, c’est la baisse du volume du pétrole qui entraîne celle du PIB et non l’inverse. On ne consomme pas moins de pétrole parce que c’est la crise, mais c’est la crise parce qu’on a moins de pétrole. La production mondiale atteindra son pic dans environ cinq ans. Ensuite, la décélération est inéluctable. Chacun s’interroge pourtant sur le prix du pétrole, alors que la question ne réside pas dans son évolution. La consommation de pétrole par l’Europe s’est réduite de 10 % depuis 2006 – repli amorcé avant le Grenelle de l’environnement – et cette tendance se poursuivra.
S’agissant du gaz, une projection réalisée par Total montre une production mondiale qui plafonne à partir de 2025, nonobstant le développement des gaz non conventionnels dont l’extraction sur le territoire français serait, de toute façon, difficile. L’approvisionnement gazier de l’Europe a cessé de croître lorsque les gisements de la mer du Nord – qui représentent 60 % de la consommation – ont atteint leur pic. Il est douteux que le nucléaire puisse être – même partiellement – remplacé par du gaz dans l’Union européenne.
Si l’on attribue la totalité des émissions de gaz à effet de serre aux citoyens et qu’on les inclut dans la fabrication des produits et services, les Français consomment, en moyenne annuelle, quelques centaines de kilos de CO2 pour la construction de leurs logements, deux tonnes de CO2 pour le chauffage de ces maisons, deux tonnes et demie pour l’alimentation – dont la moitié est due aux viandes et aux laitages –, deux tonnes et demie pour l’achat des biens manufacturés, deux tonnes pour le déplacement de personnes dans leur sphère privée et deux tonnes pour les services publics et privés – l’école, l’hôpital et l’armée d’une part, les banques, les coiffeurs, les opérateurs de téléphonie, entre autres, d’autre part. La fabrication de l’électronique destinée aux particuliers représente un tiers de l’empreinte carbone des achats de produits manufacturés ; deux tiers de la progression de 10 % de cette empreinte constatée entre 1990 et 2010 sont dus à l’électronique grand public : les technologies de l’information n’induisent aucune dématérialisation, ils ont créé des usages sans en supprimer d’autres. Dans les transports, l’avion a connu la plus forte croissance entre 1990 et 2010 ; or son utilisation est concentrée sur les deux premiers déciles de la population : créer un nouvel aéroport revient à construire une infrastructure pour riches.
Les émissions de gaz à effet de serre et l’usage de l’énergie fossile sont présents dans toutes nos activités. Le changement climatique ne peut donc être évité en contraignant une petite fraction de la population pour le bénéfice du plus grand nombre ; il ne peut l’être que par un effort de tous. Afin d’accompagner un tel effort collectif, il convient de développer une vision – un projet « sexy ». Sans vision, c’est le chaos qui règlera la situation. Voilà où vous entrez en scène, mesdames et messieurs les députés, et où je cesse de parler.
M. Arnaud Leroy. Monsieur Jancovici, je dois vous avouer que je comptais consacrer mon intervention au changement climatique, car vous aviez été présenté comme climatologue. Hélas, vous n’en avez pas dit un mot. En outre, comme vous êtes ingénieur, vous devriez nous proposer des solutions que j’ai cherchées en vain dans votre présentation.
Je suis d’accord avec vous pour affirmer la nécessité d’un effort commun. Encore faut-il préciser qu’il ne concerne pas que les Français, mais l’ensemble des habitants de la planète ! Je vous rejoins également sur l’exigence qui s’impose aux responsables politiques de tracer une vision et un plan pédagogique qui soit à son service.
Les précaires énergétiques existent bel et bien ! Après avoir discuté avec bon nombre de députés britanniques, allemands, estoniens et danois, je peux vous assurer que la situation des fuel poors crée un véritable problème social qui se situe, notamment, au cœur de l’actuelle campagne électorale en Allemagne. Le poste de la facture énergétique dans les dépenses n’a peut-être jamais été aussi faible statistiquement, mais les ménages ressentent fort différemment la situation et nier ce sentiment revient à faire peu de cas de la démocratie.
Mme Christiana Figueres, secrétaire générale de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, souhaiterait que les autorités locales et les parlements nationaux s’impliquent davantage dans la mise en place du plan post 2015. La France a fait le choix de se rendre disponible pour accueillir la prochaine conférence des parties – dite COP 21 – en 2015. Cette candidature s’inscrit dans le cadre de la très forte ambition de notre gouvernement en la matière ; ainsi, M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, considère la diplomatie climatique comme un axe prioritaire de notre action extérieure. Comment enrichir et accompagner notre réflexion sur le sujet dans les deux ans qui viennent ? Quelles sont les pistes que vous pourriez proposer pour répondre au défi – que vous avez exposé de manière percutante – de la diminution de la disponibilité de l’énergie ?
Je vous trouve trop critique sur les énergies renouvelables, assez silencieux sur votre rapport au nucléaire et très peu prolixe sur l’efficacité énergétique. Mes collègues du groupe SRC, ravis de vous accueillir, vous interrogeront sûrement là-dessus.
M. Martial Saddier. Vous exposez vos travaux avec brio, et il faut au moins vous reconnaître le mérite de la logique. Les députés UMP sont d’accord avec vous sur l’urgence de l’enjeu pour la société ; le Grenelle 1 et le Grenelle 2, qui permettaient d’associer tout le monde, devaient d’ailleurs servir à établir du consensus, donc à éviter la démagogie et le populisme. Le président Nicolas Sarkozy n’en a pas été remercié, il est vrai, mais vous n’êtes pas plus tendre avec le président François Hollande…
Aux États-Unis, la question énergétique a été débattue durant la récente campagne électorale : comment analysez-vous ce débat ?
Que pensez-vous des potentielles réserves nouvelles d’énergies fossiles ? Que pensez-vous de la décision prise par l’actuel Président de la République de diminuer la part du nucléaire dans notre production énergétique, et de la décision de fermer la centrale de Fessenheim ?
M. Yannick Favennec. Merci pour cette présentation décoiffante. Lors de la conférence de Doha, les grandes puissances ont rivalisé d’inertie. La France, elle, n’a pas à rougir de son bilan en matière de gaz à effet de serre, notamment grâce au Grenelle de l’environnement ; une étude allemande récente nous place parmi les meilleurs élèves de la classe, ce qui doit nous amener à prendre le leadership. Mais où est aujourd’hui le volontarisme français ? La voix de la France semble s’être éteinte, au point que nous avons cédé sur des avancées que nous avions pourtant portées – je pense au fonds vert de la conférence de Copenhague qui devait mobiliser 100 milliards d’euros à l’horizon 2020, aux aides destinées aux pays qui seront les premières victimes du réchauffement climatique, à la taxe carbone aux frontières de l’Europe…
Quel est votre sentiment sur Doha et sur la position française ? Quel peut être le rôle de la France en ce domaine, en Europe comme lors des prochains sommets internationaux ?
Que pensez-vous de la réduction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français ? Les énergies renouvelables permettront-elles de compenser cette baisse ? Cette réduction est-elle compatible avec nos objectifs en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ?
M. Denis Baupin. Merci pour cet exposé provocateur ! Sur l’essentiel, nous sommes d’accord : nous traversons une crise structurelle, et l’énergie est au cœur de cette crise ; il est urgent de donner un prix au carbone, à l’épuisement des ressources pétrolières. Mais nous avons un désaccord majeur sur le nucléaire. Vous n’avez parlé ni de Tchernobyl, ni de Fukushima : si l’on veut prendre en compte le risque d’un accident nucléaire, il faut refaire tous les calculs, et donner aussi un prix au risque d’accident nucléaire.
Il faut donc commencer par réécrire les équations économiques et énergétiques. Mais que faire de ces constats ? Nous ne pouvons pas continuer à consommer de l’énergie comme avant, surtout avec une population croissante ! Pour l’Agence internationale de l’énergie (AIE), fondée à l’OCDE, la priorité doit être aujourd’hui d’aller à 77 % vers une plus grande sobriété et à 19 % vers les énergies renouvelables.
Je note d’ailleurs au passage que les États-Unis ont installé en 2012 plus de puissance éolienne que de puissance en gaz, et qu’il existe 1 662 éoliennes off-shore en Europe, dont aucune en France. Notre retard est donc conséquent.
Il faut aussi, vous avez raison, réfléchir sur notre alimentation, en particulier carnée, sur la mobilité, sur les bâtiments et leur consommation énergétique… Le ménage allemand, qui n’est pas moins doté en appareils électroménagers que le ménage français, consomme 20 % d’électricité spécifique de moins que le ménage français – sans même compter le chauffage électrique. Nous disposons donc de marges de progression très importantes.
Nous devons investir dans les secteurs les plus intensifs en emploi : rénovation thermique des bâtiments, transports collectifs, énergies renouvelables…
Ce débat est particulièrement utile. Nous avons, c’est vrai, besoin d’une vraie vision : le groupe écologiste pense que l’on peut sur ces sujets porter un discours positif sur la transition énergétique comme réponse à la crise.
M. Olivier Falorni. Voilà un exposé qui bouscule les certitudes, ce qui est toujours utile !
J’ai lu dans vos articles que vous privilégiez la « décarbonisation » des bâtiments, puis de l’industrie lourde et enfin des véhicules. Je vous rejoins sur ce point. Mais que devient alors l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique française – cap fixé pour 2025 par la Conférence environnementale ? Comment peut-on promouvoir le véhicule électrique et la pompe à chaleur tout en réduisant la part du nucléaire, sans favoriser l’exploitation de nouveaux gisements de gaz ou la production de biocarburants ?
Pourriez-vous nous éclairer sur la sortie du tout-pétrole ? Dans les grandes villes, le taux de motorisation diminue, mais c’est l’inverse à la campagne comme dans les villes petites ou moyennes, où l’automobile demeure indispensable.
Les biocarburants de troisième génération, produits à partir d’algues microscopiques riches en lipides qui peuvent accumuler entre 60 % et 90 % de leur poids en acides gras, ce qui pourrait laisser espérer une production annuelle d’une trentaine de tonnes d’huile par hectare, peuvent-ils constituer une réponse adaptée ? Le rendement du colza est, à titre de comparaison, trente fois inférieur.
La production de pétrole décroîtra dès 2020, et la production européenne diminue déjà. Le gaz de schiste ne pourrait-il pas diminuer notre dépendance vis-à-vis du pétrole ? Le retour d’expérience américain est, on le sait, mauvais pour l’environnement, mais d’autres formes d’exploitation pourraient remplacer la fracturation hydraulique. Que pensez-vous des recherches menées pour substituer à l’eau du GPL voire du gaz carbonique ? N’existe-t-il pas une exploitation écologique des hydrocarbures ? L’extraction du gaz de houille, contrairement au gaz de schiste, peut s’opérer sans recourir à la fracturation hydraulique.
Enfin, le Centre d’analyse stratégique a rendu en 2012 un rapport intitulé Énergies 2050, qui propose quatre scénarios d’évolution de la politique énergétique française, notamment en ce qui concerne le nucléaire, auquel je crois comprendre que vous êtes attaché. Quelle trajectoire devrions-nous suivre pour répondre aux exigences de la décarbonisation ? Devons-nous prendre en considération le développement des pompes à chaleur et des véhicules électriques, qui impliquent par ailleurs une évolution du réseau de distribution d’électricité intelligent ?
Le Danemark fait figure de bon élève en la matière, avec des objectifs très ambitieux. Est-ce la voie à suivre ?
M. Patrice Carvalho. Eh bien voilà qui décoiffe ! Ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas non plus la langue de bois, donc je le dis : c’était parfois un peu hard ! Je connaissais Marx, et son explication de la société capitaliste qui nous mène à la ruine, maintenant je connais aussi Jancovici (Sourires).
Vous parlez de risques d’explosion sociale, mais aujourd’hui, beaucoup de gens n’arrivent pas à se loger, se chauffer, se soigner… Pour satisfaire ces besoins, nous avons besoin de croissance économique. Sinon, ne risquons-nous pas le retour à la bougie et à l’âge où nos grands-mères faisaient la lessive au lavoir ?
Sur le rôle des médias, je suis entièrement d’accord avec vous : même à LCP, c’est vraiment la pensée unique ! (Sourires)
Vous ne parlez pas de la recherche : nous sommes peut-être à l’âge de pierre en matière d’énergie, ne perdons pas espoir dans le progrès scientifique.
Votre message est fort, mais quelles sont les perspectives d’avenir ? Je vous l’avoue, j’ai craint un moment que vous ne lanciez un appel au suicide collectif !
M. Philippe Plisson. On ne peut que partager votre diagnostic, mais quelles solutions proposez-vous ? Ne devons-nous pas saisir l’opportunité de changer radicalement de modèle de développement, en remettant les énergies renouvelables que vous méprisez au cœur du dispositif ?
Que pensez-vous de l’exploitation des gaz de schiste ? Que pensez-vous des clathrates de méthane : épée de Damoclès climatique ou ressource énergétique potentielle ?
M. Jean-Marie Sermier. Votre constat est partagé par le plus grand nombre. Mais comment pouvons-nous aujourd’hui prendre des mesures à l’échelle nationale quand la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine ? Quelle gouvernance mondiale pourrait permettre des avancées significatives ?
Chacun doit pouvoir se retrouver dans le grand projet d’avenir que vous appelez de vos vœux. Avons-nous le temps d’intéresser la population à cette réflexion ?
L’exploitation de l’hydrogène fatal vous paraît-elle présenter un intérêt ?
Mme Geneviève Gaillard. Je partage les grandes lignes de l’exposé, mais vous ne présentez pas de solutions. L’énergie la plus propre, c’est celle que l’on ne consomme pas : la France est-elle armée pour entrer dans la transition énergétique ? Avez-vous des propositions en matière de fiscalité énergétique, et en matière d’aménagement du territoire ?
M. Édouard Philippe. Merci pour cette présentation perturbatrice mais stimulante.
Il est temps, vous le dites, de prendre en considération des indicateurs de prélèvements sur les stocks : des économistes, des spécialistes de comptabilité nationale, mènent-ils des recherches en ce sens ?
Vous avez peu parlé des conséquences de ce système sur le climat ; vous avez montré une diminution de la ressource énergétique, mais vous n’avez pas évalué l’échelle de temps nécessaire pour mesurer les conséquences pour les émissions de gaz à effet de serre de la diminution de cette ressource énergétique.
Votre message me paraît un message d’espoir pour les politiques que nous sommes : c’est à nous d’inventer des réponses nouvelles à la réalité que vous décrivez. J’entends donc un message de prise de pouvoir des élus, et non de condamnation des élus.
M. Jacques Krabal. Vous semblez opposé aux hydrocarbures non conventionnels et peu confiant dans l’avenir des énergies renouvelables : pourquoi ?
Vous êtes si peu effrayé par le nucléaire que vous prétendez, dans l’un de vos livres, que l’accident de Tchernobyl n’aurait provoqué que quelques dizaines de morts, mais aucun surcroît de mortalité par cancer. Certaines études évaluent pourtant les morts de 5 000 à 80 000. Vos assertions paraissent aujourd’hui choquantes : les maintenez-vous ?
Mme Sylviane Alaux. Vous écrivez que le gaz de schiste est une « fausse bonne idée » : sur quelles études vous fondez-vous ? Certes, la méthode d’extraction aujourd’hui utilisée pose problème, mais ne devrions-nous pas surtout en chercher d’autres – ce que font certains pays ?
M. Jacques Kossowski. Vous êtes, à l’inverse du Gouvernement actuel, un ferme partisan du nucléaire civil. Pouvez-vous expliciter votre position ?
Mme Brigitte Allain. Vous avez souligné l’importance de l’alimentation dans nos émissions de gaz à effet de serre. L’étude prospective Afterres 2050 propose un scénario d’évolution possible : nourrir tous les habitants de notre planète impose des changements profonds, et donc l’adoption, de façon quasi-générale, de nouvelles pratiques agricoles et alimentaires. Qu’en pensez-vous ?
M. Serge Bardy. Quels sont les blocages, notamment institutionnels, qui rendent si difficile la lutte contre le changement climatique à l’échelle du monde ? Vous aviez proposé la nomination dans chaque cabinet de ministère et dans chaque direction générale européenne d’un conseiller technique au développement durable, et même la création d’une Cour du développement durable, qui serait une extension de la Cour des comptes. Pouvez-vous préciser cette proposition ?
Comment, en période de crise, augmenter fortement les tarifs de l’énergie sans diminuer brutalement le niveau de vie des Français, dont une grande partie est d’ores et déjà fragilisée ?
Comment concilier l’engagement n° 41 du Président de la République – baisser la part du nucléaire dans notre production énergétique – avec une diminution de nos émissions de CO2 ?
M. Jean-Pierre Vigier. Voilà un exposé qui décoiffe ! Si nous diminuons notre production d’énergie nucléaire, nous devrons utiliser d’autres moyens de production. Vous l’avez dit, l’éolien et le solaire seront bien loin d’y suffire. Avec le gaz, le charbon et le pétrole, nous dépendrons de l’étranger et nous polluerons beaucoup plus. Que faire alors ?
M. Charles-Ange Ginesy. Vous nous dites qu’il faut diminuer notre consommation d’énergies fossiles, mais que les énergies renouvelables ne représentent à peu près rien : en diminuant notre consommation, pourrons-nous éviter la décroissance ? Vous préconisez le vote d’un budget sans croissance ; mais, d’un point de vue économique, cela empêcherait notre société de rebondir.
Vous semblez enfin compter pour rien le progrès scientifique : je crois, moi, que la recherche représente une nouvelle espérance pour demain.
M. Christophe Priou. Quel avenir pour ce marin-pêcheur breton que vous évoquez ? Ce jeune pêcheur, en particulier, doit se loger, une fois revenu à terre, et souvent la pression démographique sur le littoral oblige à construire sur les terres agricoles… Quel urbanisme peut-on imaginer pour demain ?
M. Jean-Louis Bricout. Vous préconisez un nouvel urbanisme et un nouvel aménagement du territoire. Vous plaidez également pour que les collectivités territoriales s’acquittent d’une taxe carbone. Mais vous n’ignorez pas la situation financière difficile de ces collectivités : comment envisagez-vous la mise en place de cette taxe ? Plus généralement, quel rôle assignez-vous à l’État pour accompagner les collectivités territoriales ?
M. Michel Heinrich. Merci pour cet exposé dont je suis encore abasourdi. L’alternative pour vous, c’est la vision ou le chaos. Pensez-vous que nous aurons cette vision ? La taxe carbone dans un seul pays vous paraît-elle pouvoir constituer un gadget temporairement utile ?
Mme Sophie Rohfritsch. Votre exposé était passionnant : plutôt que de transition énergétique, ne faudrait-il pas parler de transition tout court ? Le coût du capital n’ayant jamais été si bas, ne peut-on d’ailleurs pas voir là l’opportunité d’investir massivement – dans les énergies renouvelables, ou peut-être dans le nucléaire ?
Il paraît impossible d’agir à l’échelle mondiale. Quelle serait alors la bonne échelle de réflexion pour un élu – le petit territoire, la France, l’Europe ?
Vous avez proposé la création d’une mission parlementaire sur les travaux de l’AIE et sur la meilleure façon de prévoir les quantités d’énergie, notamment fossile, dont nous disposerons. Monsieur le président, ne pourrait-on pas envisager la création d’une telle mission ?
M. Yves Albarello. Ma question sera provocatrice : en persistant à vouloir améliorer notre propre bilan carbone, quand la Chine ouvre une centrale à charbon par semaine, ne sommes-nous pas dans l’erreur ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que la Chine est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables.
M. David Douillet. Comment envisagez-vous la transition énergétique globale ? La France est-elle en retard ?
M. Alain Gest. Vous écouter est toujours un vrai bonheur, monsieur Jancovici. Vous estimez qu’il faudrait multiplier par deux, voire par trois, le prix des carburants, et vous vous opposez aux tarifs subventionnés sur le gaz et l’électricité. Quelle est votre position sur la vérité des prix de l’énergie ?
M. Jacques Alain Bénisti. Un séisme de magnitude 8 a frappé ce matin même les îles Fidji. Y a-t-il un lien de cause à effet entre le changement climatique et les mouvements géologiques de plus en plus fréquents que nous constatons ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je ne pourrai bien sûr pas répondre à toutes les questions qui ont été posées ; je vous renvoie à mon site internet. Je prends la précaution de dire ici, comme je le fais souvent, que les malentendus vont se nicher dans ce qui n’a pas été dit : or le temps qui m’est imparti est limité.
Certains d’entre vous ont remarqué qu’il faut parler de transition tout court, d’un projet de société à long terme : il s’agit d’aller conquérir la Lune ! Pour cela, il faudra aller chercher les gens où ils sont : ils ne viendront pas d’eux-mêmes.
Plusieurs questions portaient sur les ressources et le gaz de schiste. Pour vous donner les ordres de grandeur, l’Europe consomme aujourd’hui 500 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont 300 milliards viennent de la mer du Nord. On pourrait obtenir des gaz non conventionnels quelques dizaines de milliards de mètres cubes par an en Europe. La France consomme 50 milliards de mètres cubes par an, dont 30 pour le chauffage et 15 pour l’industrie. Si le seul souci, c’est de satisfaire les demandes des chimistes français, il suffit de conserver une consommation de 15 milliards de mètres cube par an et nous nous en sortirons : il faut seulement supprimer les 30 milliards du chauffage qui coûtent 6 milliards d’euros en importations par an ; cela se fait avec l’isolation et les pompes à chaleur.
Sortir le gaz et le fioul des usages thermiques dans le bâtiment est l’une des toutes premières priorités à fixer pour cette nouvelle conquête de la Lune. Il faudra demander des efforts à tout le monde, et l’effort partagé par tous n’est possible que si l’on propose un projet : dites à un astronaute qu’il va aller sur la Lune, il sera d’accord pour risquer sa vie. Cela, c’est votre rôle. Si vous ne proposez pas une vision exaltante à notre pays, n’essayez pas de demander des efforts : ça ne marchera pas !
Quant à l’argent nécessaire, on peut toujours trouver des « clopinettes pour bricoler », poser des rustines et boucher des trous ; ce n’est pas très exaltant. Mais si l’objectif est de conquérir la Lune, alors l’argent n’est plus le sujet. On le trouvera ! On a bien trouvé mille milliards pour les banques...
Le vrai sujet, c’est l’arbitrage : nous n’aurons pas d’argent pour tout – pour donner un travail à tout le monde, pour donner de l’espoir à tout le monde, et pour donner plus de consommation à tout le monde. Mais préserver la stabilité socio-économique de notre pays avec de l’espoir et un travail pour tous, on peut le faire.
D’autres questions portaient sur les négociations internationales et le rôle de la France. Je l’ai dit, l’énergie fossile, c’est le pouvoir d’achat et le niveau de vie ; dès lors, jamais des hauts fonctionnaires, si méritants soient-ils, ne pourront se réunir et décider ensemble d’un niveau rationnel de consommation des individus sur la planète. Cela ne peut tout simplement pas fonctionner. Ce qui pourrait fonctionner, c’est qu’une région du monde se lance dans ce projet avec résolution, massivement et de façon structurée. Or l’Europe, je vous l’ai montré, est dos au mur : notre choix doit donc être de nous lancer, de façon déterminée, dans la construction d’une économie de moins en moins liée aux combustibles fossiles. Cela sera notre conquête de la Lune, et cela nous occupera quarante ans car il faudra tout refaire : les villes, les réseaux de transport, les paysages agricoles…
Ce n’est pas une transition à 100 milliards d’euros, c’est une transition à 5 000 ou à 10 000 milliards. Et c’est une très bonne nouvelle : cela nous donne une colonne vertébrale, un projet qui exige un très large consensus politique – aussi large que sur la nécessité d’avoir des caisses de retraite. Il faudra que vos divergences s’expriment à la marge – un peu plus de marché ici ou un peu plus d’État là-bas… C’est une union nationale qu’il nous faut.
Beaucoup de questions portaient sur le nucléaire. Pour résumer ma position, je pense que c’est une bien meilleure idée qu’une mauvaise. Le nucléaire crée des inconvénients – je vous l’ai dit, l’énergie propre n’existe pas. Mais il évite globalement plus de problèmes qu’il n’en crée. On trouve aujourd’hui, même chez les Verts, des gens qui, en tête-à-tête, seraient prêts à classer le dossier nucléaire parmi les points de désaccords constatés que l’on peut mettre de côté...
M. Denis Baupin. Il faut les virer ! (Sourires)
M. Jean-Marc Jancovici. …non, il faut les écouter ! Le nucléaire est une question d’arbitrage. Sur la partie technique, sur le nombre de morts provoqués par Tchernobyl, sur les déchets, je vous renvoie à mon site où vous trouverez une avalanche de chiffres, les sources et les méthodes.
La question fondamentale des besoins a été posée. Il y a les faits et leur ressenti. Le second intéresse l’électeur et l’élu, mais le physicien se concentre sur les premiers. Tocqueville l’avait prévu : la démocratie nous rend « rouspéteurs » et perpétuellement insatisfaits. En France, on consomme 60 mégawattheures par personne chaque année, c’est-à-dire l’équivalent du travail de 600 esclaves ! L’espérance de vie a triplé en deux siècles. Alors qui est pauvre ? Votre question est centrale, si l’on s’intéresse au ressenti et à l’équité. Mais en termes de réalité physique, je répète que les citoyens modestes devront prendre leur part de l’effort. La seule façon de les convaincre, c’est de leur donner du boulot, de la fierté et des perspectives.
Sur la taxe carbone, les choses sont simples : elle taxe l’énergie tout en détaxant le travail. Ce n’est pas un impôt punitif, mais un guide. Elle donne de la visibilité.
Mon ambition consiste à soutirer de l’argent à des gens qui ne sont pas a priori volontaires pour réfléchir à leur avenir : les industriels. Que fait un industriel, ou un gestionnaire d’entreprise, quand il réfléchit à l’avenir ? Il cherche les certitudes. S’il n’est pas convaincu que l’énergie coûtera de plus en plus cher, il n’investira pas pour diminuer sa consommation. Or l’énergie fait marcher des systèmes extrêmement rigides : ce problème se résout par l’investissement. L’efficacité énergétique, c’est monstrueusement capitalistique : il faut changer les procédés industriels, les bâtiments, les infrastructures de transports et les bateaux. Pour investir, il faut de la visibilité, donc un prix à l’externalité. Sinon, les industriels resteront assis sur leur chaise.
C’est d’ailleurs la même chose pour les particuliers : regardez combien la différence de prix entre essence et gazole a déformé le parc automobile. Ces signaux jouent un rôle majeur à long terme. Évidemment, c’est la difficulté de votre mandat où vous êtes jugés sur des résultats à court terme, d’où la nécessité d’un consensus. Si l’on veut que la population et les milieux économiques adoptent cette vision à long terme, on doit être cohérent. Il faut hiérarchiser les problèmes. Si l’on considère qu’il faut d’abord se débarrasser des énergies fossiles et lutter contre le changement climatique, alors il faut privilégier tout ce qui agit en ce sens, nucléaire compris. Dire qu’on va diminuer notre production nucléaire de 50 % en 2025 revient à une illusion – ce chiffre est sorti d’ailleurs d’un chapeau, mais cela arrivait aussi avec Nicolas Sarkozy. Si nous décidons vraiment de mettre en place une société qui fonctionne avec beaucoup moins d’énergie fossile, alors le nucléaire devient secondaire. Rappelons que l’acceptation du nucléaire au Royaume-Uni a augmenté après l’accident de Fukushima.
M. Denis Baupin. Et en Iran ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je ne suis vraiment pas partisan du nucléaire en Iran ! (Sourires)
La France a encore du poids en Europe. Si nous parvenons à entraîner le continent dans l’invention d’une économie qui permette de conserver des aspirations sociales et un espoir pour l’avenir avec moins de combustible fossile, alors nous arriverons peut-être à entraîner aussi le reste du monde. Voilà vingt ans que nous nous regardons tous en chiens de faïence parce que personne ne sait comment faire. Mais les premiers qui se lanceront emporteront le morceau ! L’Europe a une excellente raison d’agir, en dehors même du changement climatique : si nous continuons à suivre la ligne de pente, nous subirons, complètement désemparés, l’enchaînement des périodes de récession, et nous irons vers le chaos.
Je ne dis pas cela pour critiquer l’actuel Président de la République : je veux vous montrer les enjeux et les marges de manœuvre. Édouard Philippe l’a dit, cela doit vous stimuler et pas vous abattre. Mais le temps presse : il est urgent de se demander sérieusement comment construire un projet politique dans ce genre d’univers. Je veux bien vous y aider.
J’ai été taquin sur les énergies renouvelables, mais cela correspond aux faits. Si, à la suite du Grenelle de l’environnement, on avait décidé de généraliser les poêles à bois, j’aurais applaudi ; investir en revanche dans le photovoltaïque, c’était de la dernière stupidité. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais je suis contre la gestion d’un sujet sérieux par des méthodes sentimentales.
Prenons l’exemple suédois, pays remarquable en matière d’énergies renouvelables. La Suède jouit d’une réputation parfaitement écologique, alors qu’elle consomme autant d’énergie nucléaire par personne que la France, et deux fois plus d’électricité par personne – moitié hydraulique, moitié nucléaire. L’industrie lourde n’utilise quasiment pas de combustible fossile, essentiellement de l’électricité décarbonée et du bois. La consommation de gaz et de charbon y est quasi-nulle, et la totalité du chauffage est assurée par des réseaux de chaleur au bois. Mais il est vrai que le pays fait 350 000 kilomètres carrés, pour 9 millions d’habitants, et qu’il est couvert à 70 % de forêts.
La clé du succès pour les énergies renouvelables, c’est toujours beaucoup de montagnes ou beaucoup d’espaces arables. Les Européens devraient se pencher sur ce qui se passe dans le désert : beaucoup de soleil et peu de monde. Au lieu de dépenser 100 à 150 milliards d’euros de contribution au service public d’électricité (CSPE) pour déployer du photovoltaïque en France, on aurait bien mieux fait de monter un grand projet avec les Marocains et les Tunisiens – les Algériens, qui ont du gaz, n’auraient sans doute pas été intéressés. On aurait lancé une belle entreprise, et donné du boulot aux ouvriers français pour développer des technologies qui seront peut-être très utiles dans toute la bande tropicale à l’avenir.
Les Espagnols, qui boivent aujourd’hui une potion économique peu sympathique, auraient bien tort de ne pas chercher à exploiter les conditions climatiques de leur pays. Aller faire du solaire à concentration dans le sud de l’Espagne, c’est à mon avis beaucoup plus sérieux que de faire du photovoltaïque en France. Bref, je suis un grand partisan des énergies renouvelables, quand elles sont gérées avec des méthodes sérieuses.
Quant à l’éolien, il n’a pas en France beaucoup d’intérêt : il en a dans les pays qui souhaitent consommer moins de charbon. La diffusion massive de l’éolien impose en effet de disposer de moyens de stockage très important, ce qui porte le coût du mégawattheure entre 200 et 400 euros… Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, d’ailleurs : une hausse du prix de l’énergie, ce n’est pas grave si c’est de la rente redistribuée nationalement.
Enfin, vous verrez sur mon site que, lorsque vous déplacez une énergie produite nationalement – le nucléaire, par exemple – vers une autre énergie produite nationalement – l’éolien, par exemple –, vous ne créez globalement pas d’emploi si vous payez les gens de la même façon. Je sais que c’est perturbant, mais une simple règle de trois permet de le montrer.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci pour ce débat nourri qui sera, je l’espère, fructueux pour nos réflexions.
4. Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, sur les négociations climatiques et les aides au développement (12 mars 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je souhaite la bienvenue à M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, pour une audition sur les négociations climatiques internationales et les aides au développement.
M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement. C’est déjà un symbole que le ministre chargé du développement vienne s’exprimer devant votre commission – on m’a d’ailleurs plusieurs fois attribué dans la presse le titre de ministre du développement durable !
Je voudrais évoquer deux questions principales : la façon dont nous intégrons le développement durable dans la politique de développement et l’action de la diplomatie française pour réussir l’accord sur le climat de Paris 2015, qui est conduite conjointement par les ministères chargés de l’écologie et des affaires étrangères.
Sur le premier sujet, je rappelle qu’existent, d’une part, un agenda du développement et de la solidarité internationale sur l’éducation, la santé ou les infrastructures, et, d’autre part, un agenda du développement durable, du climat, de la biodiversité et de la lutte contre la diversification, et que les deux ne sont pas spontanément convergents. Tel est l’enjeu des grandes négociations qui ont commencé à s’ouvrir dans le cadre de l’ONU sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) – à savoir les huit objectifs de lutte contre la pauvreté – et ceux du développement durable, à la suite du sommet de Rio+20, qui doivent être respectivement renouvelés et définis en 2015.
La position française a été affinée avec la société civile dans le cadre des Assises du développement et de la solidarité internationale, conclues le 1er mars dernier, et les positions européennes sont en train de se stabiliser. Je me rendrai demain à New York pour deux jours de réunions de travail à l’ONU sur la définition des futurs objectifs du développement durable. Nous partageons notre siège avec l’Allemagne – ce qui est une première, dont je me réjouis – et la Suisse sur ce sujet.
La France et l’Europe plaident pour une convergence entre ces deux agendas : il s’agit d’un point majeur des négociations internationales des trois années à venir. Il est inenvisageable de poursuivre une politique de développement n’intégrant pas les questions de soutenabilité. C’est d’ailleurs ce que dit la Banque mondiale dans un récent rapport publié juste avant la conférence de Doha sur le climat, dans lequel elle précise qu’un monde connaissant une température de 4 degrés supplémentaires aurait plus d’enfants mourant avant l’âge de cinq ans à cause de l’insécurité alimentaire et de la sécheresse. Au Sahel, il pleut aujourd’hui en moyenne 30 % de moins qu’il y a dix ans ; au Sénégal, à Saint-Louis, l’érosion côtière commence à grignoter la ville. Les pays les plus pauvres sont les plus touchés et les plus vulnérables. Il est illusoire de penser qu’on puisse continuer à se développer avec 9 milliards d’habitants en 2050 comme on l’a fait jusqu’ici.
J’ai pris plusieurs mesures pour intégrer la soutenabilité environnementale dans les politiques de développement – la soutenabilité sociale l’étant par essence dans celles traitant d’éducation ou de santé.
En matière énergétique, nous avons modifié en octobre dernier la stratégie de l’Agence française de développement (AFD) – qui est notre troisième banque publique après la Caisse des dépôts et la Banque publique d’investissement (BPI) –, de façon à faire des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique les deux priorités de notre intervention. Cet organisme va prêter entre 5 et 6 milliards d’euros dans les trois prochaines années à des pays du Sud, émergents ou en développement, pour favoriser des investissements dans ce secteur. Le Président de la République a annoncé à cet égard, lors de la clôture des Assises du développement et de la solidarité internationale, que nous arrêterons de financer des centrales à charbon sans dispositif de type CCS (capture et stockage de carbone) : nous considérons que soutenir de telles infrastructures est incompatible avec notre agenda de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.
Dans le domaine agricole, nous sommes en train de revoir la doctrine de l’AFD, de manière à donner la priorité, dans nos investissements sous forme de prêts mais aussi de dons, à l’agriculture paysanne, c’est-à-dire à des formes d’agriculture peu intensives en carbone, et à des circuits courts sur des marchés locaux – plutôt qu’à une agriculture d’exportation sur le marché mondial, qui a sa raison d’être mais ne doit pas forcément être financée par des fonds publics. Nous avons achevé la concertation avec une soixantaine d’organisations de la société civile, du Nord comme du Sud, et allons adopter un texte lors du prochain conseil d’administration de l’AFD fin mars.
S’agissant de la biodiversité, la doctrine évoluera au cours du second semestre 2013 en vue de renforcer sa prise en compte dans les projets financés par l’AFD.
En outre, deux éléments transversaux ont été mis en place.
D’abord – cela est à l’œuvre pour la première fois sous une forme pilote ce mois-ci, avant une instauration définitive en octobre pour tous les projets de l’AFD –, chaque projet fera l’objet, au-delà d’un premier avis bancaire et financier, d’un avis « développement durable » – qui intégrera une méthodologie permettant d’évaluer le projet et de le noter –, au vu duquel le conseil d’administration prendra sa décision. Cela donnera un système de références communes à l’ensemble des projets financés par l’agence.
Deuxièmement, la France s’est donnée pour objectif de porter à 50 % les projets financés ayant des « co-bénéfices » climat – nous allons d’ailleurs atteindre un taux de 45 %.
Notre action est aussi conduite au niveau européen. Le dernier budget européen en matière de politique de développement pour les sept prochaines années est de 27 milliards d’euros. Nous souhaitons intégrer dans cette politique l’objectif de 20 % de projets favorables au climat au travers du Fonds européen de développement (FED) – il n’y a pas aujourd’hui d’objectif de soutenabilité en la matière.
Par ailleurs, la France a proposé d’organiser en 2015 la grande conférence sur le climat. Lorsque j’ai annoncé cette nouvelle dans le cadre du forum des économies majeures, le négociateur chinois a déclaré « vous voulez faire Copenhague sur Seine ! », ce qui montre la difficulté de la tâche ! Cela donne à l’ensemble des acteurs politiques français une responsabilité particulière. Je gère ce dossier pour le ministère des affaires étrangères, sous l’autorité de Laurent Fabius.
Nous devons éviter l’erreur du « tout ou rien » de la Conférence de Copenhague, où l’on a voulu obtenir un accord qui allait changer le monde pour finalement aboutir à peu de chose – ce qui a créé une sorte de « climate blues » freinant toutes les mobilisations. Il convient d’être modeste : la logique voudrait qu’il n’y ait pas d’accord, même si nous allons tout faire pour que ce soit le cas.
Nous commençons à travailler sur plusieurs pistes. D’abord, nous essayons de savoir pourquoi les agendas en vigueur échouent. On voit qu’on est dans un imaginaire du « burden sharing » ou partage du fardeau. Or la capacité de l’humanité à se mettre d’accord sur un tel partage de manière coopérative et pacifique sans que rien ne l’impose est aujourd’hui à peu près nulle, même si l’on peut toujours espérer une forme de sursaut à Paris en 2015. Il y a donc lieu de construire autre chose : d’où l’importance de travailler sur un imaginaire positif en termes de technologies ou de financements et des bonus de coopération pour chaque pays. Nous devons trouver des alliés, au Nord comme au Sud, pour prendre des initiatives à cet égard.
Deuxièmement, on peut se demander si les 100 milliards de dollars que les pays riches ont décidé de consacrer aux pays en développement lors de la Conférence de Copenhague sont publics et additionnels aux actions en cours en matière d’aide publique au développement ou intègrent les fonds privés et ce qui est déjà entrepris. Même si l’on se situait dans le premier cas, l’objectif serait très difficile à atteindre dans le contexte budgétaire actuel, et s’il l’était, cela ne changerait pas grand-chose dans la mesure où ce montant constitue une goutte d’eau par rapport à celui consacré à l’ensemble des infrastructures – au mieux 2 à 3 % – et ne permettrait pas de vraiment lutter contre le changement climatique. Il faut essayer de construire un agenda à la fois plus réaliste politiquement et plus ambitieux, ce qui suppose de faire de l’investissement favorable au climat la norme. On pourrait déjà orienter en ce sens les 100 milliards actuels consacrés à l’aide publique au développement sans qu’il en coûte un euro de plus, autrement dit faire en sorte que les fonds finançant des centrales à charbon ou des modèles agricoles ou énergétiques n’intégrant pas la question climatique le fassent.
La France a une responsabilité particulière car elle dispose d’un appareil diplomatique lui permettant d’être présente à peu près partout dans le monde pour faire avancer ce dossier au cours des trois années à venir. Je compte sur vos idées et vos initiatives pour nous y aider et obtenir un succès diplomatique à Paris en 2015.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai lu que dix fois plus de moyens étaient consacrés par l’AFD à lutter contre le réchauffement climatique que contre la perte de biodiversité : est-ce toujours le cas ?
M. Jean-Yves Caullet. Au nom du groupe SRC, je retiens de votre propos, monsieur le ministre, la nécessité d’intégrer la responsabilité environnementale et sociale dans la politique publique de développement. On peut en effet difficilement soutenir une divergence entre les agendas que vous avez évoqués, qui serait un grave échec.
S’agissant des outils à mettre en place, notamment dans le cadre de l’AFD, que pouvons-nous envisager comme saut technologique dans l’énergie comme dans l’agriculture, permettant d’offrir un développement ne passant pas par des consommations énergétiques, des investissements ou des dépendances industrielles mettant à mal les efforts en termes de durabilité ? Quand aurons-nous un pilotage numérique solaire pour les instruments de traction agricole ou des matériaux composites allégés pour améliorer les performances d’un certain nombre de paysans pauvres, plutôt que de voir la traction animale diminuer de moitié ?
De nombreux établissements publics français mènent des politiques de coopération en matière de formation vis-à-vis des pays en développement, mais la coordination de leurs actions n’est pas la règle : comment unir davantage ces efforts ?
Concernant l’avis sur le développement durable que vous souhaitez généraliser, comment s’assurer que l’on disposera des compétences nécessaires à cet effet ?
Enfin, nous avons pensé qu’un travail parlementaire pouvait être nécessaire pour préparer la conférence de Paris de 2015, afin de faire converger les positions : comment pourrions-nous coordonner les actions du Parlement et du Gouvernement dans ce domaine ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. À cet égard, je rappelle que nous avons créé une antenne du forum interparlementaire Globe international – une première rencontre de Globe Europe a eu lieu il y a quelques semaines à Paris – et que nous sommes prêts à prendre dans ce cadre des initiatives en la matière.
M. Bertrand Pancher. L'éradication de la pauvreté et le droit au développement sont les deux messages prioritaires adressés par les pays en développement aux pays riches depuis le Sommet de la Terre de 1972. De plus, la conférence de Rio+20 a démontré que l’on ne pouvait plus aborder les questions environnementales sans parler de développement et de progrès social. Je rappelle que la première réunion du Fonds vert pour le climat de l'ONU s'est déroulée à Genève en août dernier et que ce fonds est hébergé en Corée du Sud. Selon l'accord de Copenhague de 2009, il devait mobiliser 100 milliards d'euros d'ici 2020.
Or ce fond est actuellement vide et les nations sont confrontées à la crise. En outre, le mécanisme technologique et le comité d'adaptation – les deux autres institutions onusiennes d'aide au développement – ne sont pas encore opérationnels. L'urgence est d'abord de donner des signaux politiques sur les financements de ce fonds vert.
La France consacre 0,46 % de son revenu national brut (RNB) à l'aide aux pays pauvres, ce qui a représenté 9,35 milliards d'euros en 2012. Le 1er mars, lors des Assises du développement et de la solidarité internationale, le Président de la République a affirmé que, malgré les difficultés actuelles, nous conserverions une « politique ambitieuse de développement ». Il a également annoncé une loi d'orientation, la création d'un Conseil national du développement et de la solidarité et le doublement de la part de l'aide au développement délivrée par les organisations non gouvernementales (ONG).
Les moyens préconisés sont de trois ordres : une part importante de la taxe sur les transactions financières, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui sera réactualisée, et les moyens supplémentaires qu’auront les collectivités territoriales pour financer leur coopération décentralisée. En outre, la loi Oudin-Santini pourra être appliquée aux déchets – j’avais déposé à cet égard un amendement, qui a été adopté par notre commission mais non repris malheureusement lors du débat budgétaire.
Toutefois, selon les ONG, les enveloppes budgétaires ne correspondent pas aux annonces du Président de la République et la Coordination Sud regrette que la politique de développement n’ait pas intégré la responsabilité sociale et environnementale, qui pourrait être développée au travers de mécanismes nouveaux.
Je souhaite, dans ces conditions, vous poser plusieurs questions au nom du groupe UDI : quelle mobilisation française est exactement prévue ? Comment s'organisera-t-elle ?
Les ONG demandent que la France tende vers l'objectif mondial fixé par l'ONU de consacrer 0,7 % du PIB à l'aide au développement : qu'en sera-t-il ?
Par ailleurs, quel est le calendrier prévu pour permettre aux collectivités territoriales de disposer de moyens supplémentaires pour financer leur coopération décentralisée ? Combien rapportera le mécanisme envisagé, qui ne devrait être qu'incitatif ?
Beaucoup de problèmes et d'interrogations subsistent également sur la gouvernance du Fonds vert : le choix de son directeur, la transparence des réunions du conseil d’administration, le mandat et la sélection des observateurs actifs en son sein. Quelle est la position de la France en la matière ?
Concernant la lutte contre la déforestation, quelles sont vos préconisations ? Je rappelle que les chances de mise en place d'un mécanisme de réduction contre la déforestation, effectif au niveau international, sont malheureusement faibles, le financement de l’initiative REDD étant fortement conditionné à l'élargissement du mécanisme de Kyoto.
Enfin, n'est-il pas temps de réfléchir au conditionnement de certaines de nos réductions d'impôts à des pratiques en faveur d'un développement international partagé – je pense aux actions des fondations d'entreprises et aux placements des produits des assurances-vie en faveur de l'épargne responsable ?
M. Denis Baupin. Les politiques de développement et d’environnement sont en effet extrêmement liées. Tant qu’on ne sera pas capable d’apporter une réponse commune dans ces domaines, on n’aboutira pas.
Le fait que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ait obtenu le Prix Nobel de la paix montre que le dérèglement climatique est bien plus qu’une question environnementale : il soulève celle de savoir si nous serons capables de concevoir l’avenir des 9 milliards d’habitants de la planète en 2050.
2015 sera une année très importante, au cours de laquelle sont prévus à la fois un accord planétaire sur le dérèglement climatique, la réévaluation des objectifs du Millénaire pour le développement et l’élaboration des objectifs de développement durable issus de la conférence de Rio+20. Cette tâche très lourde peut constituer une opportunité de sortir de l’équation complexe à laquelle nous sommes confrontés dans le cadre d’un accord global.
Cela implique que nous modifiions la façon dont nous abordons les choses : il faut en effet apporter un imaginaire positif, qu’il convient d’assortir d’une négociation de droits et de devoirs pour l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des efforts en termes d’émissions de CO2 ou d’aide au développement. Les 100 milliards de dollars évoqués ne représentent qu’un quinzième des dépenses planétaires annuelles d’armement : si l’on regarde les enjeux géopolitiques liés à une mauvaise gestion du dérèglement climatique, il ne serait pas absurde que cette somme serve à prévenir les conflits.
Il faut essayer d’élaborer de nouvelles réponses sur les mesures mises en place au niveau planétaire. On observe à cet égard une évolution positive en matière de développement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des fiscalités de lutte contre le dérèglement climatique ou des marchés du carbone.
Quels sont les alliés privilégiés de la France pour mener les négociations en vue de 2015 ? Quelle posture l’Europe peut-elle prendre en termes de propositions pour aller au-delà de l’objectif des « trois fois vingt » et le porter par exemple à « trois fois quarante-cinq » à l’horizon de 2030 ? Quelle analyse faites-vous de l’évolution des États-Unis avec la nouvelle équipe présidentielle américaine ? Observe-t-on un changement de posture de leur part pouvant permettre de débloquer la situation ?
Je suis également favorable, au nom du groupe écologiste, à associer le plus grand nombre d’acteurs aux niveaux national et international, notamment les parlementaires pour la réussite de la conférence de Paris en 2015.
M. Olivier Falorni. Au nom du groupe RRDP, je suis heureux, monsieur le ministre, de votre présence parmi nous aujourd’hui.
S’agissant de l’aide au développement, j’aborderai l’exemple du Mali. Les forces françaises sont intervenues avec succès afin de mettre un coup d'arrêt au fondamentalisme : nous pouvons saluer leur courage et leur détermination. Mais Tombouctou, Gao et bien d'autres villes et villages sont un champ de ruines : il va falloir reconstruire.
Les collectivités locales sont un relais essentiel pour la dynamisation des rapports économiques bilatéraux. En ce sens, la coopération décentralisée est un levier extraordinaire pour l'essor des contrats passés par les entreprises françaises et l'aide à la pénétration du marché national par les entreprises maliennes. Si les associations sont actives dans ce domaine – particulièrement dans mon département –, elles sont aussi au bord de l'asphyxie : les aides provenant des régions et des collectivités locales sont de moins en moins nombreuses en raison du contexte budgétaire et elles ne peuvent prétendre à une aide de l'État dans le cadre de la coopération décentralisée.
Vous avez repris un certain nombre de mesures du rapport Laignel, notamment la continuité du budget, la tenue chaque année d'une conférence « Diplomatie et Territoires » et la création d'un fonds d'urgence. Dans quelles conditions prendront-elles concrètement forme et selon quel calendrier ?
Le 1er mars, lors de la clôture des Assises du développement et de la solidarité internationale, le Président François Hollande a fixé trois objectifs, dont celui de contribuer à l'essor des pays en développement, en donnant au Mali toutes les conditions nécessaires pour assurer son développement une fois les opérations militaires terminées.
Malgré tout, l'aide française d'aide publique au développement stagne et, en dépit de taux de concentration croissants en faveur de l'Afrique, on ne peut que constater la diminution des moyens en subventions. Nous pouvons cependant saluer l'attribution de l'enveloppe de 150 millions d'euros gelée après le coup d'État de mars 2012, dont la distribution se fera en fonction de la feuille de route qui a été établie : pouvez-vous nous donner des précisions sur ce point ?
La mise en place de la taxe sur les transactions financières, dont 10 % des recettes seront affectés au développement, est une bonne chose. La Commission européenne ainsi que les onze pays engagés dans la voie de la coopération renforcée s'attendent à des recettes de l'ordre de 35 milliards d'euros pour 2014 : qu'en est-il réellement ? Les ONG ont fait part de leur inquiétude sur le manque d'engagement concernant la réalisation des Objectifs du millénaire, et ce malgré la promesse de porter la part de l'aide de la France transitant par les ONG de 1 à 2 %.
En matière climatique, il y a urgence : la Banque mondiale redoute une hausse de la température de la planète de 4 degrés d'ici 2100, voir 2060, si rien n'est engagé d'ici là. Alors que les pays en développement en subiront les plus forts effets, la France ne sera pas en reste : l'effort que doit fournir notre pays pour s'adapter à ces changements est considérable. Les politiques publiques évoluent depuis quelques années et le budget alloué au changement climatique est de plus en plus conséquent, se situant à 33,4 millions d’euros ; cette action, bien que modeste au regard des enjeux, est louable. Or vous êtes un ministre très engagé dans la solidarité climatique et le programme mis en route au Cambodge sur la compensation en CO2, permettant de réduire les dépenses dans les pays du Nord afin d'aider les pays du Sud, est prometteur. Pensez-vous engager d'autres actions de ce type dans différents pays ?
M. Philippe Plisson. Alors que le processus de changement climatique évolue plus rapidement que le plus pessimiste des scénarios du GIEC, il est inquiétant que les plus grandes nations restent dans la logique du « tout pour la croissance » : la dernière conférence des Nations unies sur le changement climatique a été fortement critiquée par les organisations environnementales, qui ont parlé de fiasco absolu. Il aura fallu pas moins de 18 réunions internationales de cette organisation pour se mettre d’accord sur le minimum : une extension de huit années du protocole de Kyoto, qui expirait le 31 décembre 2012. Si les 190 pays participant à la conférence mondiale ont décidé de poursuivre leurs efforts pour trouver une solution en 2015 à la conférence de Paris, vers quel type d’accord nous dirigeons-nous ? Quel est le programme de travail pour y arriver ? Vous semblez afficher une ambition limitée pour éviter d’être déçu : face à l’urgence, ne sommes-nous pas déçus de n’avoir que des ambitions limitées ? (Sourires)
Qu’en est-il des 100 milliards du Fonds vert pour le climat ? Qu’adviendra-t-il de l’article stipulant que ses engagements financiers ne seront honorés que lorsque les circonstances financières des pays le permettront ? Quelles sont les solutions prévues pour les pays insulaires et les perspectives pour la protection de l’environnement et le développement des énergies renouvelables en Afrique ?
M. Guillaume Chevrollier. Je souhaiterais vous alerter sur la question des déchets dans les pays les moins avancés (PMA), notamment en Afrique. Nombre de ces pays récupèrent en effet des pays occidentaux des déchets en leur donnant une deuxième, voire une troisième vie ; comment sont-ils traités quand ils sont transformés, sachant que certains peuvent contenir des produits dangereux ? Quelle est votre position sur ce sujet, qui pourrait constituer un véritable enjeu de coopération entre le Nord et le Sud ?
M. Yann Capet. Je salue la feuille de route du Gouvernement tendant à lier négociations sur le développement durable et aide au développement. On sait que la trilogie lutte contre la pauvreté, développement et développement durable, est une condition du succès. Il est essentiel de consacrer la participation de l’ensemble des acteurs contribuant à celui-ci, qu’il s’agisse des ONG, des parlementaires ou des collectivités territoriales. Ces dernières sont souvent en avance, y compris dans les États les plus climatosceptiques, notamment les États-Unis : leur rôle dans le cadre des coopérations décentralisées et des transferts d’expérience et de technologie – au travers des projets de coopération à l’initiative du ministère des affaires étrangères –, leurs compétences propres – facilitant ce transfert de savoir-faire vers les collectivités étrangères –, et leur échelle – permettant des changements de comportement et une meilleure association des citoyens, y sont pour beaucoup. Elles disposent à cet effet d’outils tels que les conventions de coopération ou la loi Oudin-Santini : comment envisagez-vous de renforcer leur rôle dans le cadre des négociations à venir ?
M. Yannick Favennec. La Conférence de Doha s’est achevée le 8 décembre par un accord a minima, insuffisant mais nécessaire, dans la mesure où il permet de prolonger le protocole de Kyoto jusqu’en 2020 dans les conditions souhaitées par l’Union européenne : renforcer la mobilisation politique vers un accord mondial en 2015 et répondre aux pays en développement en matière de réparation des pertes et dommages dus au changement climatique – sans pour autant céder à leurs demandes de compensation financière. La France a notamment fait valoir la mobilisation de la taxe sur les transactions financières et la poursuite de son soutien aux actions de lutte contre le réchauffement climatique, notamment par le biais de l’AFD, dont la moitié d’entre elles est consacrée à cette fin.
Avez-vous l’intention de mobiliser le Parlement français en vue de la conférence de Paris en 2015 ? Si oui, comment ?
M. Christophe Priou. Lors des Assises du développement et de la solidarité internationale, on a parlé d’une loi d’orientation qui pourrait être débattue au Parlement au début de 2014 : qu’en est-il exactement ?
Un rapport de la Cour des comptes de juin 2012 a souligné trois travers de la politique française d’aide au développement : l’absence de priorités géographiques, l’éparpillement des responsabilités entre ministères et l’usage croissant des prêts – au détriment des dons – certes coûteux budgétairement mais plus adaptés aux capacités des États les plus démunis.
Comment à cet égard mieux coordonner les actions de coopération mises en place par les collectivités territoriales ? Dans ma région, nous avons par exemple un partenariat avec des pays africains à travers des producteurs de sel. Ce partenariat fonctionne bien, sans mobiliser des crédits importants : il faut savoir se nourrir de ce type d’expériences qui ont fait leurs preuves depuis des décennies !
M. Philippe Noguès. Je suis d’accord pour intégrer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans le cadre de la refonte de la politique française d’aide au développement, à condition de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas exclure les PME locales des appels d’offres.
Le conseil d’administration de l’AFD a validé en octobre dernier le principe selon lequel, dorénavant, l’ensemble des appels d’offres comportera des clauses sociales et environnementales. Les opérations financées par Proparco peuvent par ailleurs être soumises à une démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Ces mesures sont-elles concrètement mises en place ? La prise en compte des critères sociaux et environnementaux est-elle aujourd’hui systématique dans les appels d’offres et les décisions de l’AFD ?
Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence environnementale, la création d’une plateforme interministérielle, qui semble tarder à se mettre en place : quand sera-t-elle effective ?
Mme Catherine Quéré. Lorsque les projets soumis à l’AFD répondent à tous les critères requis, les aides sont-elles attribuées quel que soit le pays concerné ?
Mme Brigitte Allain. Concernant la biodiversité, quelles mesures internationales doit-on mettre en place pour lutter contre les effets nocifs de la brevetabilité du vivant – de nombreuses plantes ayant été accaparées dans des pays en voie de développement ?
Par ailleurs, les semenciers réussissent à proposer leurs semences génétiquement modifiées aux pays en développement, en risquant de placer les paysans dans une position de soumission mais aussi de porter gravement atteinte à l’environnement – je pense notamment aux plantes insensibles aux désherbants ou aux OGM insecticides qui risquent de déséquilibrer la biodiversité animale. Par ailleurs, les pays en développement subissent une concurrence déloyale de nos produits industriels. Une réforme de fond de la politique agricole commune n’est-elle pas indispensable pour permettre un réel développement intracontinental ? L’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne doit-elle pas se conformer aux droits de l’homme et au respect de l’environnement ?
M. Christian Assaf. Les modifications environnementales, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou de la raréfaction de certaines ressources, ont des implications importantes sur le développement de certains États. Les pays en développement se trouvent souvent démunis autant face aux crises ponctuelles que vis-à-vis de ces évolutions de long terme – je pense par exemple aux événements climatiques extrêmes à répétition, qui font peser de lourdes menaces sur la sécurité alimentaire de certaines régions du monde, ou à la situation préoccupante de pays insulaires, sans parler de la difficulté croissante à pratiquer certaines activités comme la pêche, en raison de l’épuisement des écosystèmes. Ces phénomènes touchent les populations les plus pauvres, dont l’indigence ne fait qu’aggraver la situation : comment, dans ce contexte, l’aide française au développement accompagne-t-elle ces évolutions ? De quelle façon aidons-nous ces pays à faire face à ces changements ? S’il est important de lutter contre le changement climatique, il est également nécessaire de s’adapter à ses conséquences.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Lors de la conférence d'Hyderabad, des engagements ont été pris de doubler les fonds consacrés à l’aide à la lutte contre la perte de biodiversité à l’horizon de 2015 : comment cet objectif sera-t-il atteint ?
M. le ministre. S’agissant de la responsabilité sociale des entreprises, vous avez raison de dire qu’elle constitue un axe déterminant. C’est la raison pour laquelle nous avons doté l’AFD d’une nouvelle doctrine en octobre dernier pour que tous les appels d’offres comportent des critères sociaux et environnementaux définis et contrôlés ; nous sommes en train de la mettre en place.
La question est de savoir si l’on doit continuer à faire du « moins-disant », en ayant en amont sélectionné les entreprises sur la base du respect de ces critères, ou si l’on passe au « mieux-disant », sachant que l’AFD cofinance la plupart de ses projets, ce qui suppose de faire partager notre point de vue par les autres partenaires. C’est ce que nous sommes en train de faire auprès de l’Union européenne et de la Banque mondiale – dont les règles sont en cours de révision –, mais cela prend du temps. Si les règles de l’AFD seront modifiées au milieu de cette année, elles n’entreront pleinement en vigueur que lorsque nos partenaires auront adopté la même position.
En ce qui concerne le rôle du Parlement, je vous invite à nous faire part de vos propositions – votre commission a un rôle particulier à jouer dans ce domaine – ; nous les prendrons en compte.
À travers le partenariat que constitue Globe international, que j’ai rencontré à Doha, vous pouvez identifier les obstacles au déploiement des énergies renouvelables. Dans les pays du Sud, on butte d’abord dans ce domaine sur des obstacles techniques et réglementaires – le fait par exemple que les sociétés d’électricité ne sont pas en mesure de gérer une source intermittente sur des réseaux extrêmement faibles ou saturés. Les analyser nécessite souvent une volonté politique locale en complément des financements internationaux. Nous avons suivi avec beaucoup d’attention le travail réalisé par la Norvège et le PNUD sur ce sujet : il donnera lieu à un rapport qui sera publié dans quelques semaines. La gouvernance d’une société d’électricité demande la plupart du temps des évolutions managériales, réglementaires ou législatives : les parlementaires des pays concernés ont donc un rôle primordial à jouer en la matière et votre action peut être utile à cet égard. Nous pourrions vous faire parvenir la liste des pays dans lesquels nous travaillons. Nous allons déployer par exemple dix assistants techniques sur une plateforme intitulée « Énergies durables pour tous », qui permettront de lever ces obstacles : nous pourrions indiquer dans leur feuille de route qu’ils auront à travailler avec les parlementaires ; Globe international serait une instance appropriée pour une telle coopération.
Concernant l’innovation, nous pensons que l’aide publique au développement doit s’inscrire dans une logique d’innovation d’ensemble – technologique ou non. Pour les Kenyans, le mobile banking – ou paiement mobile – est ce qui a le plus changé leur vie ces dernières années. De même, la microassurance permet, à côté du microcrédit, d’assurer contre les changements climatiques les petites organisations paysannes ou coopératives qui n’ont pas accès au marché international de l’assurance. C’est la raison pour laquelle j’avais fait de l’innovation l’un des cinq chantiers des Assises du développement et de la solidarité internationale.
Dans l’agenda climatique, nous pourrions gagner à identifier une quinzaine à une trentaine de technologies – ou d’objectifs impliquant des changements technologiques – constituant des passages obligés pour réussir les négociations et piloter ensuite notre aide publique au développement – qui contribue à financer ces technologies – par les résultats. La Fondation Bill & Melinda Gates a par exemple lancé un appel d’offre international auprès de centres de recherche pour trouver les toilettes du futur, conciliant les contraintes financières et écologiques pour les populations qui en manquent : si le prototype n’est pas encore déployable, compte tenu de son coût, de l’ordre de 1200 dollars, une réponse technique a pu être élaborée. Nous pourrions ainsi adopter une gouvernance des projets, non seulement par les moyens, mais aussi par les résultats et les objectifs.
Nous avons aujourd’hui 4 000 chercheurs au sein de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) qui sont mobilisés pour le développement et la recherche au Sud : nous pourrions plus clairement leur indiquer ce qu’on leur demande de trouver – ce que nous avons d’ailleurs commencé à faire.
Quant à la taxe sur les transactions financières, je rappelle que la France a été le premier pays à l’instaurer au plan national et à affecter 10 % de son produit au développement. Cette année, cette part a été consacrée à l’accès à l’eau et à la santé, notamment au Sahel et, l’an prochain, elle le sera pour moitié au Fonds vert – sachant que nous attendions que les règles de celui-ci soient fixées pour le faire, ce qui a permis de peser davantage sur leur définition.
Vous avez un rôle à jouer dans la négociation européenne en la matière. L’étude de la Commission européenne a évalué le montant des recettes à 35 milliards d’euros, ce qui est considérable. Il serait paradoxal, alors que cette taxe a vocation à financer les biens publics mondiaux, dont le développement, la lutte contre le changement climatique, la pauvreté ou le Sida, qu’aucune recette ne soit affectée à ce qui l’a historiquement légitimée. Or certains pays comme l’Espagne, l’Italie ou l’Autriche sont assez réservés, voire hostiles, à ce qu’une partie de cette taxe européenne soit consacrée au développement. Le Président de la République a pourtant redit le 1er mars dernier qu’il souhaitait qu’une part significative de celle-ci le soit. J’ai essayé moi-même de convaincre différents partenaires de l’intérêt de cette mesure. Nous pourrions avoir dans ce domaine une action commune en raison de votre capacité à peser sur les décisions prises par les autres parlements européens. Si la France est pilote sur ce sujet, nous avons besoin d’alliés car nous ne sommes pas majoritaires.
Au sujet du Mali, la stratégie française repose sur trois piliers : le pilier militaire, le pilier politique – faire en sorte qu’il y ait un dialogue politique menant à des élections et à un gouvernement démocratique, ce qui est de la responsabilité des Maliens – et le pilier du développement. Mon objectif est de contribuer à gagner la paix, ce qui veut dire, par exemple, faire en sorte que les élections puissent se tenir, ce qui suppose que les 400 000 réfugiés et déplacés rentrent chez eux et que les conditions matérielles de ce retour soient réunies.
Je me concentre sur ce qui n’est ni l’humanitaire ni le développement stricto sensu, ce que l’on appelle la réhabilitation – que la plupart du temps on rate. En effet, nous savons mener des missions humanitaires – d’ailleurs les ONG nous disent qu’au Mali, la situation humanitaire est à peu près sous contrôle – de même que de grands projets de développement sur deux à trois ans, mais il faut réussir les « six mois » de reconstruction, ce qui veut dire par exemple rétablir l’eau à Tombouctou, l’électricité à Gao ou faire en sorte que le centre de santé de Kidal fonctionne à nouveau. Nous nous sommes mis d’accord sur une liste de priorités avec l’Union européenne et la Banque mondiale, après en avoir discuté avec le gouvernement malien, pour nous répartir le travail. Je rappelle qu’aujourd’hui, à Tombouctou et à Gao, les habitants vont chercher leur eau dans le fleuve Niger, ce qui présente des risques pour la santé. La responsabilité de la France – la mienne en particulier – a été de mettre tous les donateurs autour de la table pour gagner ces « six mois ». Nous organiserons d’ailleurs mi-mai à Bruxelles une grande conférence internationale des donateurs présidée par la France et l’Union européenne, en présence du Président de la République, afin de mobiliser le monde entier.
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer à cet égard. Nous organiserons le 19 mars à Lyon une réunion ayant vocation à mobiliser les 100 collectivités locales ayant un partenariat avec le Mali pour définir le type de coopération que nous voulons, ses priorités et la répartition des rôles. Les élus locaux pourront écouter à cette occasion des représentants de la société civile, de l’État malien et des grandes organisations internationales, afin de mieux comprendre la situation sur place.
Nous souhaitons qu’une partie substantielle de l’aide passe par ces collectivités, dont le rôle est en effet de plus en plus marqué. Cela nous paraît correspondre à une logique de décentralisation, qui constitue une part de la solution politique dans ce pays. De plus, cette approche donne lieu à des circuits financiers plus directs et mieux contrôlés.
Vous avez cité, monsieur Falorni, le rapport Laignel : je rappelle que 5 000 collectivités locales ont des actions de coopération décentralisée. Plusieurs mesures ont été retenues dans ce domaine : la sanctuarisation des crédits budgétaires pour la coopération décentralisée – ce qui n’était pas évident –, la transformation du concept de coopération décentralisée en un dispositif davantage lié à l’action extérieure des collectivités, ainsi que, après une étude d’impact, l’extension de la loi Oudin-Santini à la gestion des déchets.
En ce qui concerne les négociations climatiques, je souhaite vous faire part de premiers éléments – je vous répondrai après mon audition personnellement sur les points que je n’aurais pas eu le temps d’aborder.
Nous souhaitons écrire un nouvel agenda nous permettant de lever les obstacles actuels, de manière à réussir à Paris là où toutes les autres conférences ont échoué auparavant.
On observe un petit changement aux États-Unis : les discussions entre Laurent Fabius et John Kerry le laissent penser. Mais sur la question, par exemple, d’un accord légalement contraignant tel que nous l’entendons en Europe, la position américaine reste inchangée. Ce pays reste attaché à une approche « bottom-up » – reposant sur des engagements nationaux – en invoquant l’absence de majorité politique pour ratifier ce type d’accord. Or cette approche a montré ses limites : elle est très en deçà de ce qu’il faudrait opérer pour limiter une augmentation de la température à deux degrés. Nous devons trouver un compromis entre ces deux conceptions : la pure approche inverse – « top-down » – se heurterait très vite à un refus, non seulement des États-Unis, mais aussi de la Chine ou du Brésil.
À la mi-avril, un forum des économies majeures se tiendra sur ce sujet : il permettra de voir si les États-Unis entrouvrent de nouvelles portes.
Quant à nos alliés, ils sont de trois ordres. En premier lieu, les pays riches, contributeurs financiers, qui auront à prendre des engagements fermes – nous travaillons par exemple avec les Norvégiens sur les questions énergétiques ou avec les Britanniques sur l’agenda du financement et les marchés de carbone. La France est à cet égard passée dans le camp des États européens qui soutiennent des règles plus ambitieuses – par exemple autoriser la Commission européenne à modifier le nombre de quotas en circulation pour augmenter le prix du carbone. Deuxième catégorie d’alliés : les progressistes au sein du G77 et des pays émergents, comme le Mexique, l’Indonésie ou l’Afrique du Sud, avec lesquels nous devons construire des agendas communs – l’agenda technologique ou celui du financement par exemple. Enfin, les pays les plus vulnérables, avec lesquels nous devons également élaborer un agenda commun et à qui nous devons aussi proposer quelque chose d’acceptable, de plus ambitieux que ce qui leur a été proposé à Copenhague, notamment en matière de financement.
Cela implique une diplomatie active de la part de la France. C’est la raison pour laquelle nous avons un nouvel ambassadeur sur le climat, que les services des ministères de l’écologie et des affaires étrangères travaillent ensemble, ou que nous avons envisagé d’organiser une session entière consacrée à la négociation climatique lors de la prochaine journée des ambassadeurs, de façon à ce que ceux-ci soient sensibilisés à cette priorité.
Mais nous avons aussi besoin de vos initiatives ainsi que des collectivités locales. Nous réfléchissons à cet égard à la forme que pourrait prendre l’association de celles-ci à la négociation de 2015 – cela correspond à une grande revendication des réseaux internationaux des collectivités. Vous pourriez également participer à ce travail.
(Applaudissements sur divers bancs)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous remercie pour cet échange fructueux et intéressant.
5. Audition de M. Jean Jouzel, climatologue, et de Mme Catherine Tissot-Colle, présidente de la Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux, co-rapporteurs d’un avis du Conseil économique, social et environnemental sur la transition énergétique (13 mars 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section Environnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE), à Mme Catherine Tissot-Colle, présidente de la Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux (FEDEM), et à M. Jean Jouzel, climatologue, membre du CESE. Je profite de l’occasion pour féliciter ce dernier qui, déjà Prix Nobel de la paix dans le cadre du GIEC en 2007, est, à ce jour, le premier lauréat français du prestigieux prix Vetlesen. Je tiens à lui dire notre fierté. (Applaudissements sur tous les bancs)
Comme j’en avais pris l’engagement auprès du président Delevoye, la Commission du développement durable a décidé, dans le cadre de ses auditions, de recevoir les rapporteurs du CESE conduisant des réflexions liées à des thématiques fortes. C’est ainsi qu’il y a quelques semaines, Mme Anne de Béthencourt et M. Jacky Chorin sont venus nous parler d’efficacité énergétique. Aujourd’hui, avec Mme Tissot-Colle et M. Jouzel, nous aborderons la transition énergétique, sur la base de leur rapport remis le 9 janvier 2013 et intitulé La transition énergétique : 2020-2050, un avenir à bâtir, une voie à tracer.
Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section Environnement du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, messieurs les députés, permettez-moi de vous remercier de votre invitation et d’inaugurer, en quelque sorte, les relations entre votre Commission du développement durable et la section Environnement du CESE. C’est, en effet, la première fois que nous sommes auditionnés ici et j’espère qu’il y aura d’autres occasions. J’en profite pour vous indiquer que la section Environnement, qui incarne une partie de la réforme issue des lois Grenelle de l’environnement par laquelle l’ancien Conseil économique et social est devenu le CESE, a pour mandat de travailler sur les thèmes de la transition énergétique, de la biodiversité, des mers et des océans, des risques environnementaux, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’habitat. Différents travaux sont en cours dans notre institution, d’autres sont à venir qui nous donneront peut-être d’autres occasions de revenir devant vous.
Avant de vous quitter, puisque je préside cette section le mercredi matin, je renouvelle mon invitation pour le 11 avril, date à laquelle le CESE organise une conférence internationale sur la gouvernance de la haute mer. Ce sujet gagne en importance et mérite une très grande attention de la part des parlementaires, en raison des questions de droit qu’il pose notamment. Nous sommes en train d’instruire une saisine sur la gestion durable et la gouvernance des océans, dont les questions de la haute mer font partie.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je ne peux que me féliciter des relations qui sont en train de s’établir entre le Conseil économique, social et environnemental et la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. Merci de votre présence et de tout le travail que vous faites au sein du CESE. Nous y sommes très sensibles.
M. Jean Jouzel, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la transition écologique. Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de cette invitation à présenter notre avis sur la transition énergétique, qui résulte du travail collectif de la section.
Le prix Vetlesen est l’équivalent, pour les disciplines des sciences de la terre, de l’environnement et de l’univers en général, du prix Nobel, plutôt attribué aux grandes disciplines que sont la physique, la chimie, la médecine, l’économie,…– prix que j’ai eu le plaisir de partager avec le GIEC. Ce prix, établi dans les années cinquante, est décerné tous les quatre ans. Je le partage avec Susan Solomon, qui a plus travaillé sur la chimie atmosphérique et son lien avec le climat, et je suis effectivement le premier Français à l’obtenir, ce qui me rend très fier au nom de toute notre communauté scientifique. C’est la reconnaissance d’une très bonne place de la recherche française dans ces domaines sur le plan international. Le prix Crafoord, autre récompense pour nos disciplines, a été établi quant à lui dans les années quatre-vingt et l’un des premiers récipiendaires, et seul Français à ce jour, en a été Claude Allègre.
Mme Catherine Quéré et M. Philippe Plisson. Personne n’est parfait ! (sourires)
M. Jean Jouzel, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la transition écologique. Dans le domaine de la datation de la terre et de l’univers, ses travaux ont tout de même été très significatifs, et il le méritait.
J’ai accepté de m’investir dans ce travail sur la transition énergétique en qualité de climatologue, bien sûr, mais aussi parce que le lien entre l’énergie et le climat m’a toujours intéressé. Je me suis d’ailleurs beaucoup impliqué dans le Grenelle de l’environnement, et je le suis également dans le comité de pilotage du débat national sur la transition écologique. Bien que nous ayons proposé cet avis sur la transition énergétique bien avant la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, il s’inscrit totalement dans la dynamique de la transition écologique. Puisque vous avez auditionné Mme Anne de Béthencourt et M. Jacky Chorin, vous savez que nous avons mené cet avis en parallèle et de façon complémentaire avec le rapport sur l’efficacité énergétique.
En tant que climatologue, je place les aspects environnementaux à un niveau assez élevé dans cette réflexion sur la transition énergétique, mais, en dehors même de ces sujets, beaucoup d’autres aspects de l’énergie devraient nous inciter à y réfléchir, qu’ils soient économiques, géopolitiques ou sociaux, avec les problèmes d’emploi et de précarité énergétique. On ne peut pas nier non plus, dans le contexte spécifique de changement climatique, que se profilent devant nous un réchauffement qui risque d’être important, une augmentation prévisible des prix de l’énergie et une raréfaction des ressources. Même si l’on parle maintenant plutôt de plateau que de pic pour le pétrole ou le gaz, le problème est toujours là dans la mesure où ce sont des quantités finies, en tout cas pour celles qui sont facilement exploitables. Il est important de ne pas limiter le débat au seul problème de l’électricité, qui n’est qu’une part de l’énergie. La transition énergétique concerne aussi la chaleur et la mobilité. L’industrie nucléaire est partie prenante de cette transition pour la partie électricité, et elle est mise en question au regard de sa sûreté, qui doit satisfaire des exigences de plus en plus importantes.
Ce qui peut intéresser un climatologue s’agissant des problèmes énergétiques, c’est le lien fort entre climat et énergie, en particulier les énergies fossiles, puisque les trois quarts de l’augmentation de l’effet de serre dans les années récentes sont liés à notre utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel au niveau international. On peut aussi incriminer le méthane et les autres gaz à effet de serre, mais il faut avoir en tête que cette augmentation est liée pour 80 % au gaz carbonique et pour 10 % à la déforestation. Ce sont les chiffres au niveau international, ils sont un peu différents pour la France. Les rapports récents de la Banque mondiale ou de l’Agence internationale de l’énergie sont encore plus anxiogènes que ce que dit le GIEC : si nous laissons aller les choses comme nous le faisons actuellement, on ne pourra pas empêcher un réchauffement de l’ordre de quatre degrés dans la seconde partie du XXIe siècle, ce qui aura des conséquences très importantes. Aller vers une société sobre en carbone et émettre moins de gaz à effet de serre n’est pas une option mais vraiment un impératif.
Nous avons collectivement adhéré à cet objectif d’un maintien du réchauffement climatique en dessous de deux degrés. Cela exige que les émissions de gaz carbonique commencent à décroître d’ici à 2020 – ce qui est un véritable défi, sachant qu’elles augmentent actuellement à un rythme de 3 % par an –, et qu’elles soient divisées par trois au niveau mondial entre 2020 et 2050. Malheureusement, on sait déjà que l’objectif pour 2020 risque fort de ne pas être atteint, avec un fossé de l’ordre de 15 à 20 %.
Sur le plan national, la France a pris des engagements qui s’inscrivent largement dans un cadre européen et en conformité avec la directive sur l’efficacité énergétique. L’objectif du « facteur 4 », voire 5, de diminution des émissions de gaz à effet de serre est inscrit dans la loi sur l’énergie de 2005, votée pratiquement à l’unanimité. Le Grenelle de l’environnement a permis des avancées, avec beaucoup de réflexions qui n’ont pas toutes abouti mais qui se poursuivent. Enfin, un débat national sur la transition énergétique a été lancé, dont j’espère qu’il va vraiment aider à mûrir une loi qui devrait arriver devant vous à la fin de l’année.
Mme Catherine Tissot-Colle, co-rapporteure de l’avis du CESE sur la transition écologique. En introduction au travail que nous avons fait au sein de la section et qui a été voté par le CESE, nous nous sommes autorisés à rédiger une feuille de route pour le Gouvernement et les parlementaires dans la perspective du débat et des textes législatifs qui suivront. Ce n’est pas un travail d’expertise sur les thèmes que nous avons abordés que nous communiquons, mais plutôt le reflet de ce que les composantes du CESE attendent du monde politique. C’est ainsi qu’il faut interpréter nos recommandations. Dans cette logique et pour la première fois au CESE, nous avons essayé de dater certaines propositions, en fonction de l’urgence des décisions à prendre. Ce sont des orientations destinées à lisser le travail et à donner le temps des évaluations intermédiaires.
Nous avons structuré notre travail autour de quatre axes : la transition énergétique au service de la performance économique et sociale ; l’évolution du mix énergétique ; l’évolution des jeux d’acteurs et les aspects financiers – que nous n’avons fait qu’aborder, puisque la section de l’environnement n’a pas vocation à travailler sur ces sujets extrêmement techniques et sensibles ; la R&D et le lien entre recherche et développement économique.
En qualité de représentante du monde des entreprises au CESE, je suis heureuse de pouvoir vous dire qu’il n’y a pas eu débat quant à la priorité que représente la transition énergétique au service de la performance économique et sociale. Personne n’imagine, surtout dans le contexte actuel, que la transition énergétique ne soit pas positive pour notre économie. C’est un défi, car vouloir une économie décarbonée à la fois compétitive et écologique, c’est vouloir tout. En même temps, le contexte expliqué par Jean Jouzel du changement climatique, de la raréfaction des ressources bon marché et accessibles et de l’augmentation de la population mondiale ne nous laisse pas le choix.
Nous vous recommandons de réfléchir, dès le débat, c’est-à-dire maintenant, à des sujets qui nous paraissent essentiels. En premier lieu, il faudrait retravailler les notions d’efficacité et de sobriété énergétiques, en s’interrogeant sur l’évolution que nous souhaitons imprimer à nos modes de consommation – au besoin en passant par des contraintes. Nous avons pu constater que tout le monde n’a pas la même définition de ces notions. Nous attendons de vous que vous définissiez et précisiez clairement ces deux concepts et leur réalité.
Nous avons rencontré beaucoup d’experts qui nous ont présenté de multiples scénarios d’une grande qualité et d’une grande richesse. Il importe de procéder à des évaluations socio-économiques et environnementales de même niveau pour chaque scénario retenu, afin d’en dégager les implications dans ces domaines. En particulier, nous attirons votre attention sur un volet qui n’a pas été traité dans la plupart des scénarios, qu’ils soient de statu quo ou de rupture : l’emploi. Entre le mythe que le changement d’énergie apportera des tas de choses formidables qui ne sont pas quantifiées et la crainte d’un danger extrême, il y a un énorme travail pour déterminer quels emplois vont disparaître, quels sont ceux qui vont émerger, aussi bien en quantité qu’en qualité. Notre attente à nous, société civile s’exprimant au sein du CESE, c’est qu’on ne dégrade pas, sinon le nombre, du moins la qualité des emplois. Nous voulons une France de haut niveau technologique, pas des emplois de bas niveau.
Dès maintenant, il faut examiner, pour l’horizon 2020, les problèmes de coût et d’accès des acteurs à l’énergie. Nous demandons que l’électricité reste à un coût compétitif et que l’accès à l’énergie pour les ménages précaires ou certaines entreprises, selon les contextes, soit facilité. Pour nous, il s’agit de deux sujets différents qui font l’objet de deux recommandations distinctes. Nous n’avons pas pris une position à l’allemande pour savoir si ce sont les ménages ou les entreprises qui doivent porter les surcoûts attachés à des évolutions du mix énergétique. Nous ne l’avons pas dit de manière claire, mais nous sommes attachés à des coûts de production réduits.
S’agissant des énergies renouvelables, dites ENR, dont nous recommandons le développement, les propositions foisonnent au point parfois d’être brouillonnes. Nous souhaitons que soient privilégiées les énergies à fort potentiel de développement au niveau de la recherche et du savoir-faire technologique, et susceptibles de générer des emplois qualifiés non délocalisables. Cela rejoint complètement la première recommandation : quand on analyse les scénarios et qu’on tend à privilégier une orientation, il faut vraiment regarder dans le détail ce qu’elle va donner et favoriser les ENR qui sont le plus proches de l’autonomie économique. Nous sommes bien conscients qu’il va falloir accompagner une partie de cette transition, mais plus vite les nouvelles formes d’énergie pourront vivre de manière autonome dans un monde économique normal, sans être assistées, mieux cela vaudra.
M. Jean Jouzel, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la transition écologique. De façon schématique, si l’on place les impératifs climatiques à un niveau élevé, la première priorité dans le mix énergétique, c’est clairement une diminution des combustibles fossiles. Or je crains que le secteur n’y soit pas vraiment préparé. Si l’on peut jouer sur le développement, grâce à la recherche, du piégeage et du stockage du gaz carbonique et sur le rééquilibrage interne en faveur du gaz naturel qui est moins émetteur de gaz à effet de serre, globalement, c’est une consommation nettement moindre qui sera déterminante. Un autre équilibrage est possible entre les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, c’est-à-dire le nucléaire et les énergies renouvelables. Pas plus que nous ne pensons utile de se focaliser sur le nucléaire, nous ne souhaitons éviter le débat, lequel doit commencer par un questionnement des besoins. Le mix énergétique doit offrir une bonne adéquation entre les moyens de production et les besoins. En termes d’efficacité énergétique, on sent plus facilement les améliorations dans le secteur du logement que dans celui des transports. C’est là un point sur lequel le débat devrait se focaliser.
Les scénarios énergétiques doivent être évalués d’ici à 2020, mais aussi jusqu’à l’horizon 2050. Les ENR en phase de développement commercial sont citées dans le rapport, à la page 29 – éolien terrestre, solaire photovoltaïque, biomasse, géothermie –, de même que celles qui présentent un réel potentiel de développement – photovoltaïque, éolien offshore, biocarburants avancés, énergies marines. Les réseaux de transport de l’énergie, principalement d’électricité ou de gaz, sont très importants. Dans les transports, il faut réfléchir au développement des moteurs électriques, hybrides, au gaz naturel et aux énergies renouvelables, favoriser de nouvelles mobilités. Derrière tout cela, cependant, il n’y a pas de véritable proposition. Un vrai travail sur le transport s’impose. Nous considérons que la programmation pluriannuelle n’est pas suffisamment forte actuellement. Il faut l’envisager pas seulement sur une mandature, mais sur une dizaine d’années, voire plus. J’espère que la future loi aura cette ambition. Certains de ces aspects devront être mis en place dès le débat national sur la transition énergétique, puis, d’ici à 2030, l’électrification des transports individuels et collectifs devra connaître une accélération et les énergies renouvelables être organisées en filières créatrices d’emplois.
Mme Catherine Tissot-Colle, co-rapporteure de l’avis du CESE sur la transition écologique. Le troisième axe de notre travail concerne la mobilisation des acteurs et des moyens à la hauteur du défi climatique et de la transition énergétique. Cette partie est vraiment l’âme du CESE, puisque nous représentons le monde des acteurs. Nous avons beaucoup discuté et travaillé au sein de la section sur cette question. Reprenant notre logique d’échelle de temps, nous pensons important que, au cours du débat et dans les textes qui en seront issus, une clarification des rôles respectifs des acteurs publics intervienne. Partout sur le territoire, au niveau des communes et des intercommunalités, les initiatives foisonnent et il est important que la production et la distribution d’énergie demain soient mieux implantées dans les territoires. Pour autant, il nous semble aussi que l’optimum global n’est pas forcément la somme des optimums locaux. Il va y avoir des choix à faire, d’où la nécessité de clarifier les rôles. La recommandation votée par le CESE est de privilégier deux niveaux : l’État, qui doit être responsable de la cohérence nationale, qu’il s’agisse des politiques énergie-climat, de la fiscalité et de tous les aspects financiers associés ; la région, qui nous paraît le bon niveau de responsabilité de la cohérence de la transition énergétique sur l’ensemble du territoire. C’est, nous semble-t-il, votre mission que d’y veiller, mais cela n’empêche pas d’autres acteurs de jouer un rôle. Il faut aussi renforcer les programmes opérationnels territoriaux visant la maîtrise de la demande en énergie. C’est là un message très fort qui vous est adressé.
Nous autorisant à penser par-delà l’hexagone, nous avons considéré qu’il faut soutenir plus fortement qu’actuellement l’orientation de la politique étrangère de la France vers un accord international équitable. On connaît les difficultés du sujet, en particulier Jean Jouzel et Anne-Marie Ducroux qui est spécialiste des débats internationaux. Nous pensons aussi qu’il faut développer le niveau européen en matière de politique de l’énergie. S’il y a une politique climatique, il n’y a pas de véritable politique commune de l’énergie ambitieuse et solidaire cohérente avec la politique climatique. C’est aussi une recommandation forte que nous faisons au monde politique.
Nous avons également réfléchi au défi du financement. S’il faut maintenir un système de type « quotas ETS », le marché a montré des faiblesses et des ambiguïtés qui nécessitent de le remettre à plat, d’en tirer un bilan objectif. Il faut aussi le doter de véritables règles du jeu de marché, ce qui signifie une forme de contrôle tout en lui laissant sa nature de marché. Nous souhaitons aussi que les politiques s’emparent de cette question.
Autre recommandation importante, le réexamen absolument nécessaire de l’ensemble des mécanismes fiscaux français attachés à l’énergie, à l’aune à la fois de leur efficacité économique, de la justice sociale et de leur cohérence avec la lutte contre le changement climatique. C’est encore un sujet qui mériterait un travail approfondi, parce qu’il y a énormément de choses à dire.
La transition énergétique est un changement important qui va durer longtemps. Il faudra vraiment y associer l’ensemble des acteurs, notamment les citoyens, à travers la formation et la communication. Nous recommandons de s’appuyer, tout au long de la vie, sur une formation aux questions de transition énergétique, d’efficacité et de sobriété. Ce ne sont pas des sujets simples, mais ils concernent chacun dans sa vie quotidienne et au travail et ils méritent d’être expliqués. Il faut s’appuyer sur des réseaux de formation à l’éducation au développement durable et impliquer très largement les ministères concernés. Il nous semble que le ministère de l’éducation nationale est un peu trop absent de ces débats.
M. Bertrand Pancher. Excellent !
Mme Catherine Tissot-Colle, co-rapporteure de l’avis du CESE sur la transition écologique. Le ministère de l’enseignement supérieur doit également y être associé. Il est important de favoriser une approche interdisciplinaire puisqu’il s’agit de sujets complexes qui impliquent de nombreuses disciplines. Il faut également former les personnels enseignants.
Quand notre pays se sera doté de textes de loi, bien que nous sachions la rareté des deniers publics, nous recommandons des campagnes de communication fortes pour expliquer, irriguer les territoires avec ce qui aura été décidé et le partager avec les citoyens.
M. Jean Jouzel, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la transition écologique. Le dernier axe de notre travail a trait à la recherche et à l’innovation. Dans la mesure où la transition énergétique est inévitable, ceux qui s’y investiront le plus tôt seront gagnants du point de vue économique, à condition de savoir innover dans ces domaines. Un fort potentiel de recherche et d’innovation doit être mis en œuvre si l’on veut faire de la transition énergétique un levier de compétitivité. Ne pas le faire serait courir à l’échec économique. L’Agence internationale de l’énergie rappelle que toute somme non investie d’ici à 2020 dans les technologies nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique devra être multipliée par quatre après 2020 pour obtenir le même résultat. La transition énergétique n’est donc pas qu’un jeu écologique, c’est aussi un jeu économique. Nous en sortirons plus compétitifs, pour peu que nous sachions innover dans ce domaine, en particulier dans les énergies renouvelables qui prendront une place de plus en plus importante au niveau mondial.
Les recommandations de notre rapport sont assez classiques mais néanmoins importantes : associer recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation et développement, autrement dit mobiliser toute la chaîne de valeur dans ces domaines ; favoriser les partenariats pour arriver à de véritables innovations et permettre le passage jusqu’au développement de nouvelles filières. La recherche sur l’énergie, actuellement, n’est pas forcément conforme à cette recommandation. L’ANCRE, l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie, a bien été mise en place, mais elle n’est pas vraiment organisée pour faire face aux défis des dix ou vingt prochaines années. Dans ce domaine de la recherche en énergie, nous préconisons d’effectuer un état des lieux.
Nous insistons – et nous ne sommes pas les seuls – sur l’importance, dans tous ces travaux, des sciences humaines et sociales, pas seulement des sciences de l’ingénieur. La façon dont on saura intégrer les découvertes et les innovations dans le tissu social a son importance. Or ce n’est pas simple. Il faut réfléchir dès maintenant à la façon de développer des réseaux pluridisciplinaires, de même qu’au mode de financement de ces aspects de recherche et d’innovation. À cet égard, nous avons émis quelques recommandations à observer d’ici à 2020 : réalisation d’un état des lieux et affectation des crédits de recherche en fonction des résultats, pas simplement de façon abstraite par rapport à des objectifs. Bien sûr, il faut trouver des sources de financement. Le marché ETS est censé constituer une voie de soutien à la recherche sur l’énergie en général. Je répète que les recherches en sciences humaines doivent être développées et plus encore intégrées. Cette recherche doit être européenne et nous nous devons d’être présents au niveau européen dans ce domaine de la recherche et de l’innovation.
Nous réitérons notre intérêt à continuer d’explorer et de déployer toutes les pistes de valorisation et de transformation du CO2, y compris le captage et le stockage. On ne voit pas bien comment le fossile réussira à diminuer ses émissions d’un facteur quatre si cette technique ne devient pas mature rapidement. C’est vrai au niveau français comme au niveau international.
Mme Catherine Tissot-Colle, co-rapporteure de l’avis du CESE sur la transition écologique. Le CESE a essayé d’avoir une vision assez large et d’identifier les paramètres essentiels d’une transition énergétique réussie. Sortir de la crise systémique actuelle nécessite de repenser les fondamentaux, c’est un point de vue partagé dans notre assemblée. On doit associer volontarisme et progressivité ; donner un prix au carbone ; permettre l’adaptation de tous les acteurs en n’allant pas trop vite et en accompagnant, mesurant et vérifiant ce qui se passe au niveau de tous les acteurs ; améliorer la gouvernance dans le sens des recommandations que nous avons faites ; faire évoluer en profondeur la fiscalité ; bâtir une véritable Europe de l’énergie ; investir dans la R&D ; développer des filières économiques pérennes.
Nous avons confiance, car notre travail a montré que la société est prête à entendre la nécessité de changer. Des gens qui n’étaient pas proches au début sont prêts à travailler ensemble. En s’appuyant sur un large accord politique et une anticipation sociale, nous vous remercions de prendre en compte nos recommandations.
M. Jean-Yves Caullet. Monsieur Jouzel, je garde le souvenir de notre rencontre à Doha, au cours de laquelle vous m’avez aidé à comprendre que la différence entre + 2 degrés et + 4 degrés pour notre planète équivaut à celle d’une casserole d’eau à 98 ou à 100 degrés : à 98 degrés, la surface est tranquille ; à 100 degrés, elle ne l’est pas du tout. Cela m’a conduit à penser que, compte tenu de l’enjeu du climat, désormais, en matière de transition énergétique, la vertu individuelle et collective est un devoir et sûrement pas un moyen de rachat.
En matière de fiscalité, faut-il s’attacher à l’énergie en général ou au carbone en particulier pour privilégier l’aspect transfert de ressources, ou bien à la sobriété d’abord ?
Vous recommandez de préserver, dans le futur service de l’électricité, la compétitivité de certains secteurs. Est-ce à dire que, dans la transition, il faut réserver prioritairement l’énergie nucléaire aux secteurs électrodépendants pour que son bas coût n’incite pas à une consommation immodérée par l’ensemble de l’économie et de la société, mais soit ciblé vers ceux dont la transition est la plus compliquée ? Ce type de « part du feu » vous paraît-il pertinent ?
En matière de transports, le secteur rural est l’otage historique de la voiture individuelle, il s’est même constitué autour de ce modèle dans les cinquante dernières années. Les efforts que vous recommandez en matière de transports ne rendent-ils pas souhaitable de faire obligation aux collectivités locales, au niveau intercommunal, départemental ou régional, d’organiser des transports de substitution aux véhicules individuels pour éviter qu’une partie de notre territoire et de notre population ne soit prise en otage ?
L’articulation entre l’État et la région est évidemment une nécessité, mais je souhaiterais être certain de la capacité régionale à ne pas dupliquer un centralisme national et à faire en sorte que la capitale régionale ne soit pas l’échelon le plus rapproché du peuple que nous puissions concevoir dans la République.
En matière de gouvernance, vous semble-t-il souhaitable d’officialiser la responsabilité sociale et environnementale au niveau des organismes publics, notamment des organismes d’État et des collectivités locales ?
Je souhaite souligner l’importance de votre proposition en matière de formation. Pour ne citer qu’un exemple relevé dans le cadre d’une de mes missions, dans la filière bois comme matériau de substitution en matière de construction, nous n’avons une formation en structures et calcul de structures que très embryonnaire. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Que pensez-vous de la recherche sur l’hydrogène, pas seulement comme combustible mais comme outil de réduction des émissions de gaz carbonique ?
M. Alain Gest. Lors d’une réunion précédente, notre porte-parole habituel, Martial Saddier, a souligné que notre groupe était tout à fait ouvert à ce que les contacts avec le Conseil économique, social et environnemental puissent se développer. Je me réjouis que ce soit le cas aujourd’hui avec vous, monsieur Jouzel. J’entends avec plaisir votre discours, puisque vous concevez la transition énergétique en la mettant au service de la performance économique. À l’UMP, nous sommes persuadés que les efforts à fournir dans la lutte contre le réchauffement climatique doivent se traduire autant que faire se peut par des mesures n’apparaissant pas comme des punitions permanentes pour la population. Qu’ils doivent se faire en conciliation avec le développement économique et social nous convient donc tout à fait. En vous écoutant, nous ne pouvions donc qu’être en accord avec le constat que vous faites et avec vos recommandations. C’est pourquoi je souhaiterais que vous répondiez à mes questions par un avis personnel plutôt que par les positions du CESE.
Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de garder un coût compétitif de l’électricité tout en privilégiant les énergies renouvelables, ce qui aboutirait à une quasi-autonomie économique. Avez-vous déjà retenu des préférences parmi toutes les énergies possibles que vous avez citées ?
Vous envisagez davantage de transparence sur la contribution au service public de l’électricité ainsi que l’élargissement de son assiette. Pour quelles raisons souhaitez-vous cette transparence ? Avez-vous déjà réfléchi à une méthode d’élargissement de l’assiette ?
S’agissant des transports, quel est votre point de vue sur l’évolution du multimodal dans notre pays ? Aujourd’hui, la SNCF éprouve de grandes difficultés à faire fonctionner le fret ferroviaire, même si le président actuel considère qu’il y a quelques améliorations. Par ailleurs, les décisions concernant le fluvial sont bloquées, s’agissant d’un investissement important comme le canal Seine-Nord.
La diminution de l’utilisation des combustibles fossiles suppose-t-elle de prendre des mesures drastiques de réduction ? Si oui, dans quels domaines ? En passant, monsieur Jouzel, quelle est votre position sur les gaz de schiste ?
Selon l’expérience des débats internationaux que vous avez acquise au sein du GIEC, que peut-on faire de plus pour contrer le laisser-faire au niveau international et faire évoluer les positions diverses ? Avez-vous des raisons d’être optimiste sur les chances qu’ont la France et d’autres pays de n’être plus les seuls à faire des efforts ? Je vous remercie d’avoir cité notre loi de 2005 sur l’énergie et les débats du Grenelle.
M. Bertrand Pancher. N’ayons pas peur des mots : un monde s’effondre. Néanmoins, la construction d’un monde nouveau est vraiment à notre portée, en termes de créations massives d’emplois et d’amélioration de la qualité de vie, à condition de communiquer sur les enjeux, comme vous l’avez indiqué. Si nous réussissons à le faire, nous trouverons les moyens d’assurer la transition énergétique dans de bonnes conditions.
Je suis très frappé de constater que ces moyens sont à notre portée. En matière de transports, nous avons besoin d’à-peu-près 3 milliards d’euros par an pour engager les infrastructures de demain. Demander aux trente millions d’automobilistes cent euros en moyenne – trente pour les petites voitures et trois cents pour les 4 x 4 –, c’est à notre portée. Les usagers contribuent à hauteur de 95 milliards d’euros aux services de transport ; c’est 30 % de moins que la moyenne européenne. En l’augmentant un tout petit peu, on aurait les moyens d’engager les grandes infrastructures de demain fortement créatrices d’emplois. Le constat est le même dans le domaine des énergies renouvelables. Nous payons l’électricité la moins chère du monde. Si Mme Tissot-Colle a raison de dire qu’il ne faut pas l’augmenter, avec une légère augmentation des tarifs pour augmenter très fortement les tarifs de rachat, notre pays serait inondé d’énergies renouvelables. Il n’y a pas de problème de financement à cet égard. Même chose dans le secteur du logement : la construction est tombée à 150 000 unités chaque année, alors qu’il en faudrait 500 à 600 000. Avec un effort sur la TVA, notamment dans l’ancien, on y arrivera. La condition à cela, bien évidemment, est de communiquer sur les enjeux.
Partagez-vous ce constat sur la possible mobilisation des moyens ? Si les domaines par lesquels il faudrait commencer sont bien les transports et le logement, ne faudrait-il pas se préoccuper aussi de la politique énergétique ?
La politique européenne nous déçoit fortement. C’est un monde de fous que celui où le carbone ne vaut plus rien, à peine cinq euros la tonne ! C’est d’autant plus surprenant que, partout dans le monde, on s’engage sur ces marchés du carbone. La politique monétaire de l’Europe est une folie. Si on ne la desserre pas, on ne s’en sortira pas. Or c’est la voie qui permettrait de trouver tous les moyens pour un futur New Deal à l’échelle européenne.
Si nous ne disposions que de très peu de moyens, nous aurions intérêt à les consacrer uniquement à la communication et à la politique de formation. Je partage sans réserve vos préconisations en cette dernière matière. On veut faire de nos enfants des robots de connaissance, pour quoi faire ? Le long terme n’est-il pas la perspective de l’éducation nationale ? N’est-il pas urgent d’engager des campagnes de concertation pour déterminer les priorités ? Si les Français partagent les priorités et les enjeux, on trouvera sans problème les moyens pour cette transition dans le monde de demain que nous souhaitons tous.
M. François-Michel Lambert. Le groupe écologiste est très attentif à vos travaux. Pour nous, la crise, que l’on dit tantôt économique tantôt financière, est bien systémique et trouve son origine dans cet enjeu de l’énergie. La vie, c’est l’énergie, et nombre d’obstacles se dressent entre nous et la transition énergétique. C’est ce qui donne son côté enthousiasmant à cette affaire.
Vous avez parlé d’une gouvernance aux deux niveaux de l’État et de la région. Pour notre part, nous sommes très attachés à la territorialisation : à chaque espace son approche particulière. Le nucléaire est l’exacte antithèse de cette notion de territorialisation, puisqu’à peine vingt sites en France couvrent 80 % de la consommation électrique, ce qui est unique au monde et nous place dans une position de fragilité extraordinaire. Comment s’intégrerait la région dans les nouvelles dynamiques de décentralisation en cours ?
Dans le domaine des transports, on ne s’en sortira pas sans une réelle volonté d’aménagement du territoire. Quelle est votre vision en la matière ?
Avec ma collègue Sophie Rohfritsch, je suis co-rapporteur de la mission d’information sur la biomasse créée au sein de cette commission. Vous le savez, la biomasse – biogaz, bois-énergie et un peu de biocarburants – représentera 60 % des énergies renouvelables de l’objectif 2020, soit plus que le photovoltaïque, l’hydraulique et l’éolien cumulés. Pourtant, elle ne fait l’objet d’aucune communication, alors qu’elle est accessible immédiatement dans tous les territoires. Je n’ose pas parler du ratio de communication entre la biomasse et les gaz de schiste : alors que ces derniers représentent la persistance à s’engager dans l’impasse qui conduit droit dans le mur, ils ont droit à une communication intense à tous les niveaux, la biomasse devant se contenter au mieux d’une sous-communication. Pourquoi n’avons-nous pas encore adopté une communication imprimant une dynamique vers les vraies solutions solides et robustes de l’avenir ?
Selon mes informations, le captage de CO2 est dans une impasse et les industriels sont en train de s’en retirer. Le nucléaire n’est-il pas plutôt un frein à la transition énergétique ? À nos yeux, il représente non pas l’énergie made in France mais l’absence de perspective : son très fort pouvoir de captation de ressources financières agit au détriment des énergies renouvelables ou de la sobriété énergétique ; la perspective de vingt à cinquante ans d’énergie qu’il offre contribue au blocage d’autres initiatives et de la création d’emplois.
La transition énergétique ne nécessite-t-elle pas de revoir en profondeur notre mode de développement économique, par exemple en passant de l’économie linéaire à l’économie circulaire, c’est-à-dire à l’écoconception, l’écofonctionnalité dans laquelle les déchets de calorie et frigorie sont des matières secondaires procurant d’énormes gains énergétiques ?
M. Philippe Martin. Monsieur Jouzel, je pense – hélas ! – qu’il vous faudra gagner encore bien des médailles et des trophées avant que les politiques n’entendent le discours que vous tenez depuis des années. Les travaux du GIEC constituent indéniablement un appui précieux à la décision politique. Malheureusement, celle-ci concerne un horizon plus immédiat que la fin du siècle puisqu’elle ne vise, en général, que la fin des mandats. Si les scénarios du GIEC, qui sont établis pour 2100, sont nécessaires pour tracer une évolution statistique, des prévisions à l’échelle régionale pour les décennies à venir seraient sans doute plus parlantes pour les citoyens et plus utiles pour les responsables politiques que nous sommes. Je conduis actuellement, à la demande du Premier ministre, une mission sur la gestion quantitative de l’eau d’irrigation. Au fil des auditions auxquelles je procède, tant avec les organisations agricoles qu’avec des organismes de recherche comme l’INRA ou le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), je constate combien il serait déterminant de pouvoir appréhender la fréquence des précipitations que vont connaître nos arrière-petits-enfants ou quelles sont les plantes que l’on pourra et devra faire pousser dans le Sud-Ouest dans trente, soixante ou quatre-vingt-dix ans. Pensez-vous possible de disposer, à terme, de prévisions à la fois proches et fiables qui permettront de donner un caractère concret à la situation due au réchauffement climatique ?
M. Jacques Kossowski. Pour réussir sa transition énergétique, notre pays se doit de développer des solutions technologiques et organisationnelles nouvelles. Dans votre rapport, vous insistez avec pertinence sur l’importance de la recherche et du développement made in France. Répondant à cet objectif, notre pays a mis en place plusieurs programmes d’investissement d’avenir concernant notamment l’énergie et le climat. Par exemple, ont été financés à hauteur de 1 milliard d’euros neuf instituts d’excellence sur les énergies décarbonées, qui ont été labellisés en 2011 et 2012. Ces instituts ont pour but d’ancrer durablement ces thématiques au cœur de notre compétitivité économique et de donner à la France un savoir-faire de pointe dans la création d’une économie sans carbone. Quel est votre sentiment sur ce programme ? Son état d’avancement est-il satisfaisant ?
M. Yannick Favennec. Quelle sera la place de la filière bois dans la future politique énergétique de notre pays ? Cette filière contribue directement à la lutte contre le réchauffement climatique et ses atouts sont en phase avec les objectifs et les priorités de la France en matière d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique. Aujourd’hui, le bois-énergie domestique permet de répondre à différents enjeux, notamment la réduction d’émission de gaz à effet de serre et la réduction des charges d’énergie qui, bien souvent, représentent une dépense considérable pour les ménages les plus modestes. J’ajoute que cette filière est créatrice d’emplois non délocalisables dans les territoires, près de soixante mille personnes vivant des activités liées à ce secteur. Pourtant, elle ne semble pas suffisamment mobilisée sur ce défi : seuls 40 % de la forêt sont exploités en France, alors que 20 % de plus suffiraient à assurer la matière première nécessaire à la chaleur renouvelable. Quel est l’avis du CESE sur l’avenir de la filière bois en France et sur les mesures qu’il conviendrait de prendre pour mieux la mobiliser ?
M. Philippe Plisson. Votre rapport est très intéressant, riche et exhaustif, mais sans appel quant à la situation et aux perspectives d’avenir. Il évoque logiquement toutes les solutions, par exemple le captage et le stockage du CO2 ou encore le marché du carbone qui procède typiquement de l’adaptation au système productiviste et libéral. Or le marché carbone est un véritable fiasco réglementaire, puisque la Commission européenne se propose de geler 900 millions de tonnes de quotas de CO2, dans l’optique d’une hypothétique relance des prix à la hausse. Cela pose une question fondamentale, que vous ne tranchez pas sur le fond puisque ce n’est pas le but de votre rapport, entre adaptation et évolution. À propos du « monde nouveau » dont parlait notre collègue Bertrand Pancher tout à l’heure, je ne suis pas sûr que nous y mettions le même contenu. Pensez-vous que le nouveau modèle dont vous tracez les contours dans votre rapport soit compatible avec le système libéral qui nous régit ?
M. Charles-Ange Ginesy. Il est indéniable que le réchauffement climatique tend à progresser, puisque les rapports du GIEC prévoient une hausse de quatre degrés en 2050. Croyez-vous véritablement que l’homme, avec sa production et sa consommation énergétiques, est essentiellement responsable de ce réchauffement climatique et de cette tendance ? Sans nier notre part de responsabilité, je ne la pense pas pour autant totale. L’histoire du monde est faite de périodes de réchauffement et de périodes de refroidissement.
Nous avons ici reçu M. Jancovici, selon lequel il n’est point de croissance sans consommation énergétique. Quel est votre avis sur cette théorie dont les conséquences sur la vie de l’homme et la poursuite de son activité sont très importantes ?
M. Jean-Marie Sermier. Monsieur Jouzel, parmi vos nombreuses qualités, celle qui m’étonne le plus est votre sérénité. Vous nous expliquez si tranquillement que notre maison brûle qu’on pourrait en douter. Si une hausse de quatre degrés dans les soixante prochaines années est effectivement un scénario catastrophe pour l’humanité, nous n’avons pas du tout le niveau de réaction adéquat. Au vu de l’état des lieux, que s’est-il passé ces dernières années ? On ne peut pas dire que les énergies renouvelables n’ont pas bénéficié de moyens de recherche aux États-Unis, au Japon ou en France. Il y a des problèmes avec l’éolien, dès qu’il s’agit d’implanter une éolienne ; avec le photovoltaïque, ce sont les métaux lourds ; avec l’hydraulique, c’est la continuité des cours d’eau. Face à ces difficultés, n’y a-t-il pas urgence à travailler sur notre grande compétence qu’est le nucléaire ? Allons-nous nous mettre un boulet aux pieds en refusant de continuer dans cette filière d’excellence, plutôt que de chercher à réduire un par un les risques qui y sont inhérents et à apporter la pierre de la France à l’édifice ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il y a quelque temps, un parlementaire dont je tairais le nom nous indiquait qu’il faudrait très rapidement construire vingt-quatre EPR. S’il y a des candidats dans la salle, je leur donnerai ses coordonnées.
M. Jean-Louis Bricout. Voilà un rapport très intéressant qui nous montre, s’il en était encore besoin, qu’en matière de transition énergétique, demain se prépare dès aujourd’hui. Chacun partage votre analyse selon laquelle les régions correspondent à l’échelon le plus à même de coordonner l’ensemble des efforts. Pourtant, les stratégies doivent se décliner à tous les échelons. Une vision territorialisée me paraît indispensable. Comment imaginer une production au plus près des territoires sans faire intervenir les départements, certainement plus à même de détecter et d’accompagner les publics les plus fragiles ou en situation de précarité énergétique ? Les compétences doivent être redéfinies, vous le dites dans votre rapport, mais pourriez-vous nous détailler la façon dont vous imaginez ce partage des compétences ?
M. Christophe Priou. Notre collègue Philippe Martin s’inquiétait de l’avenir de l’Armagnac dans cent ans : nous serions d’ores et déjà preneurs d’un armagnac de cent ans ! (Sourires). Votre rapport souligne le rôle de l’État en la matière. Je me réjouis de ne pas avoir voté en son temps la fusion GDF-Suez, considérant que l’énergie est une mission régalienne de l’État. On voit même aujourd’hui que c’est un enjeu européen.
Vous choisissez, dans les partenariats avec les collectivités territoriales, la région comme chef de file, mais l’entendez-vous au sens de nos vingt-deux régions administratives ? Souvent, les régions les plus dépendantes en termes d’énergie, par exemple le Grand Ouest qui regroupe au moins la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, sont sans doute celles qui ont d’autres filières à exploiter. En l’espèce, dans le domaine maritime, outre l’éolien en mer, d’autres expériences sont menées, comme la courantologie ou la houlométrie. Comment les mettriez-vous en perspective avec votre rapport très général ? On a toujours du mal à dépasser le constat et les pistes pour aller aux solutions du producteur au consommateur, surtout dans le contexte de millefeuille administratif que constituent l’État, la région, le département, les communes et l’intercommunalité. Il y a souvent des pertes de charge entre les préconisations et les réalisations.
Mme Sophie Rohfritsch. À mon tour, je voudrais saluer les préconisations contenues dans ce rapport et insister aussi sur la région en tant qu’échelon territorial le plus pertinent pour établir un calendrier le plus court possible. Je pense faire plaisir à François-Michel Lambert en indiquant qu’un grand élément national perturbe cette organisation régionale : la Commission de régulation de l’énergie, à travers ses interventions et labellisations d’appels d’offres, stérilise et neutralise certains projets régionaux, alors que, concrètement, CRE 1, CRE 2, CRE 3 ou CRE 4 ne sont pas visibles pour nos concitoyens. Elle empêche notamment certains projets de biomasse de voir le jour quand ils ont une échelle plus réduite. Il faudrait organiser cela aussi, sinon on ne pourra pas faire grand-chose sur les territoires.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Le financement de la transition énergétique s’élèverait à un montant annuel compris entre vingt et quarante milliards d’euros, que l’on pourrait dégager en mettant en place une véritable fiscalité écologique, en donnant un prix au carbone. D’aucuns pensent que la fiscalité du diesel doit rattraper le niveau de celle de l’essence sur plusieurs années. Est-ce aussi votre état d’esprit ?
Mme Catherine Tissot-Colle, co-rapporteure de l’avis du CESE sur la transition écologique. Nous vous remercions de la richesse de vos questions. Malheureusement, pour des raisons de temps autant que de légitimité, nous ne saurions répondre à toutes. Ce sont les limites du travail collectif dont nous sommes ici les représentants ; nous ne sommes pas venus à titre d’experts.
S’agissant de la fiscalité, par exemple, nous ne pouvons aller plus loin que les quelques ébauches dessinées dans le rapport. Un avis est en cours au CESE sur la fiscalité écologique et je ne peux que vous inviter à solliciter les rapporteurs, une fois leur travail terminé. Vous nous avez demandé des réponses personnelles. S’agissant du monde des entreprises, je peux vous indiquer que notre réponse générale sur la fiscalité est que cette dernière doit être au maximum équivalente à ce qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire déjà très élevée. Qu’on opère par transferts, par modification de type de fiscalité, par moindre taxation du travail ou par d’autres modes, nous sommes tout à fait prêts à en discuter. En tout état de cause, il ne peut pas y avoir de supplément.
Beaucoup de questions concernent les aspects territoriaux. Nous avons fait une recommandation sur la région après qu’un débat sur la territorialisation maximale a montré que small is beautiful n’est pas forcément vrai. Il ne s’agit certainement pas de tuer toutes les initiatives qui pourraient être prises en dessous de l’échelon régional. Bien entendu, il y a place pour des ajustements, mais n’ayant pas travaillé dessus, nous ne pouvons rien vous en dire. C’est à la définition de niveaux structurants que nous nous sommes attachés. Recoiffant ma casquette du monde des entreprises, je peux dire que celles-ci attendent d’avoir de la lisibilité au regard des investissements, surtout pour ceux qui ne concerneront pas seulement un petit producteur en rapport direct avec le consommateur dans un rayon de cinq kilomètres. C’est pourquoi il faut absolument définir les bons échelons et ce travail d’approfondissement vous revient à vous, législateurs. Si, sur certains aspects de ce sujet, l’avis du CESE vous intéresse, n’hésitez pas à le saisir.
Que les vingt-deux régions ne ressemblent pas à vingt-deux États, c’est un souci que l’on peut partager. Les présidents des CESER, qui sont des CESE régionaux, devant lesquels nous avons présenté le résultat de nos travaux, ont montré un grand intérêt et un esprit extrêmement pragmatique. L’orientation économique et sociale, notamment, leur a immédiatement parlé.
Officialiser la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les organismes publics ? L’idée est, à mon avis, excellente. Les entreprises le font, il serait normal que les autres acteurs le fassent aussi.
La formation semble vous importer autant qu’à nous. Nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions relatives aux différentes technologies. Nos débats internes au CESE ont montré que certains avaient des idées très arrêtées, tandis que d’autres voulaient protéger l’existant. Plutôt que rédiger un catalogue de recommandations, nous avons préféré préconiser de privilégier les technologies matures – ce qui n’interdit pas la R&D –, afin de réduire au maximum le coût économique de la transition pour les finances publiques et les citoyens. Pour cela, il faut pouvoir créer des entreprises, des entités économiques qui gagnent suffisamment d’argent pour produire sans être dépendantes de l’État ou des collectivités. Quant à savoir si ces entreprises doivent évoluer dans un système libéral ou autre, là n’est pas le débat, même si je pense que ce doit être le cas.
M. Jean Jouzel, co-rapporteur de l’avis du CESE sur la transition écologique. J’ai participé à la commission Rocard et je regrette vraiment que la contribution énergie-climat n’ait pas été réellement actée à l’époque. Nous n’en serions pas là aujourd’hui et j’y suis vraiment attaché. Si on ne donne pas un prix au carbone, le piégeage et le stockage du gaz carbonique ne seront jamais compétitifs, puisqu’ils coûtent de l’argent sans rien rapporter. Ce qui me rend optimiste, c’est le rapport du GIEC qui montre que la transition est techniquement possible, que nous ne sommes pas obligés de rester accrochés aux combustibles fossiles. Techniquement, nous pouvons développer, au plan mondial, une économie sur les renouvelables. Le rapport dit clairement qu’en 2050, 50 % de l’énergie mondiale, électricité et chaleur, pourraient provenir de sources renouvelables. Mon avis personnel est qu’il faut, en plus, aller vers la sobriété et l’efficacité, car si l’on ne couvre pas l’ensemble des champs énergétiques, on n’y arrivera jamais. C’est parce que nous n’avons pas su faire cela que nous avons, en France, des consommations de pointe équivalentes à la consommation de la moitié de l’Europe, ce qui est ahurissant. Ce qui l’est plus encore, c’est que nous sommes en train de construire notre système énergétique sur cette base que nous avons nous-mêmes créée.
La recherche sur l’hydrogène, avec la méthanation, offre beaucoup d’ouvertures. Je suis aussi très sensible à la biomasse, sans doute en raison de mes origines bretonnes, ainsi qu’à toutes les énergies marines. Cela dit, les énergies matures dont nous parlons sont, pour le moment, l’éolien terrestre et le photovoltaïque. L’éolien en mer reste cher, mais on sait qu’on n’atteindra pas nos objectifs d’énergies renouvelables en 2020 sans développer l’éolien, terrestre comme marin.
Nous avons parlé du gaz de schiste plutôt en creux, disant que nous étions favorables à un effort de recherche dans tous les domaines, sans limitation. La discussion sur le sujet a été assez rude, car le gaz de schiste n’est pas un gaz naturel et il pose beaucoup de problèmes environnementaux. Je pense que le débat national actuel en traitera. En tout cas, il faut savoir qu’en cas de fuite, le gain par rapport au gaz naturel, au pétrole et au charbon serait totalement perdu.
Vous voulez connaître ma position personnelle sur le nucléaire. D’abord, travaillant au CEA depuis quarante-cinq ans, je ne suis pas un antinucléaire convaincu. Mais je suis aussi de ceux qui pensent qu’on doit accentuer le développement des énergies renouvelables et ne pas commettre l’erreur de mettre toutes les disponibilités en R&D sur le nucléaire. En 2050, quand 50 % de l’énergie mondiale seront issus de sources renouvelables, le nucléaire n’en représentera que 6 % au maximum. Si nous ne savons pas acquérir, comme est en train de le faire l’Allemagne, des compétences – y compris à l’exportation – dans le domaine des énergies renouvelables, nous aurons encore raté une marche de compétitivité. Il faut donc réserver une part de notre effort de recherche aux hydroliennes, aux énergies marines et autres. Ensuite, toutes les questions que suscite le nucléaire sont légitimes, tant celles touchant au coût que celles liées aux risques. Gardons en tête que, dans les vingt ou trente ans, tout accident nucléaire, par exemple dans une vieille centrale d’un pays de l’Est, signera la fin du nucléaire. C’est pourquoi je suis d’accord avec l’invitation que nous lançons à un débat ouvert et serein sur cette énergie. Si j’ai toute confiance et que la sécurité ne me pose pas de problème, je m’intéresse également de près au développement des énergies renouvelables. Je ne tiens pas à opposer les deux. Il y a beaucoup à faire, par exemple en matière de recherche sur les biocarburants de deuxième génération.
Le GIEC se soucie de la demande des décideurs politiques de projections à échéance relativement brève, de quelques décennies, et très régionalisées. Dans le cinquième rapport du GIEC, qui sortira en septembre, le chapitre « Projections » est scindé en une partie « Projections à court terme », plus régionalisées et avec beaucoup de cartes, et une partie « Projections à long terme », d’ici aux trois prochaines décennies et au-delà. Le groupe II s’est aussi scindé en deux gros ouvrages, dont l’un est réellement consacré aux aspects régionaux des impacts et de l’adaptation. L’inconvénient est que cette réduction d’échelle de temps et d’espace rend les projections scientifiques moins précises. Elle a donc ses limites. Si l’on a besoin de projections pour comprendre à quoi on doit s’adapter, encore faut-il s’y préparer. Je me suis engagé avec Dominique Meyer dans un rapport sur l’adaptation au réchauffement climatique, pas du tout pour remettre en cause le plan national d’adaptation dans lequel je me suis moi-même beaucoup investi, mais plutôt pour voir s’il se met en place correctement. L’adaptation doit être menée de front avec la lutte contre le réchauffement climatique. C’est ainsi que, dans le pourtour méditerranéen, il faudra se préparer non seulement au réchauffement, mais aussi à un problème de ressource en eau. Cela dit, il ne faut pas attendre trop de nous. On arrive à décliner quelques caractéristiques régionales qui rendent les problèmes du sud de la France distincts de ceux du Nord ou des régions montagneuses ou côtières, mais on n’ira jamais au-delà de ce que l’on sait.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il me reste à vous remercier sincèrement et chaleureusement pour la qualité de votre présentation et des échanges auxquels elle a donné lieu. La réunion de ce matin a montré combien méritait d’être tenu et poursuivi l’engagement que j’ai pris de collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. C’est grâce à de tels échanges que notre réflexion progressera et que nous deviendrons, nous, responsables politiques, plus efficaces demain.
6. Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, sur l’agro-écologie (17 juillet 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, je tiens à remercier M. Stéphane Le Foll d’avoir répondu à notre invitation. Votre nombreuse présence témoigne de l’intérêt que vous portez aux questions de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
M. le ministre nous parlera de l’agro-écologie. Je vous rappelle qu’il a confié une mission à Marion Guillou qui a travaillé sur le sujet et a, notamment, abordé la mise en place des groupements d’intérêt économique et écologique.
Vous aurez la possibilité d’interroger le ministre sur le plan national loup, sur le plan « abeilles », sur le programme « ambition bio 2017 », voire sur le nouveau règlement européen du 8 juin 2013 relatif aux OGM.
Mais avant que nous l’entendions, je passe la parole à Mme Catherine Quéré.
Mme Catherine Quéré. Monsieur le ministre, comme vous le savez, une bombe a été déposée à la permanence du Parti socialiste de Carcassonne par des viticulteurs du Comité d’action viticole. En tant que membre du groupe d’études viticoles, je m’interroge. Vous nous avez appuyés dans toutes nos demandes et vous avez pratiquement tout obtenu. Alors, pourquoi une telle action ? Sachez que de notre côté, nous avons rédigé un communiqué pour vous soutenir.
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Aucune demande explicite ne m’a été adressée. Certes, j’ai appris qu’un débat avait eu lieu dans le cadre de la loi de consommation à propos des avances – de 15 % – payées par les négociants aux viticulteurs, que certains voulaient rendre obligatoires. Mais il se trouve que la profession n’en n’a pas accepté le principe – même si des dérogations sont toujours possibles. Quoi qu’il en soit, je trouve inacceptable qu’on ait pu placer une bouteille de gaz devant la fédération du PS et, qui plus est, en face d’une école.
J’admets qu’on puisse ne pas être d’accord. Mais précisément, comme vous l’avez dit, nous avons obtenu gain de cause sur ce qui nous avait été demandé, par exemple sur les droits de plantation ou les avances à l’échelle européenne. Nos relations avec le Comité interprofessionnel de FranceAgrimer sont d’ailleurs excellentes.
J’ai donc été surpris par cette action, que je ne comprends pas et que je condamne. Une enquête est en cours et nous verrons qui en est à l’origine. J’espère que des sanctions seront prises.
Mme Catherine Quéré. Il est exact que nous n’étions pas favorables à la proposition présentée par Marie-Hélène Fabre sur ces fameuses avances de 15 %. Nous craignons en effet, et la profession est d’accord avec nous, que cela ne dissuade certains négociants de signer des contrats.
M. Jean-Marie Sermier. Je ne reviendrai pas sur l’aspect politique de la question mais en tant que viticulteur et membre du groupe UMP, je condamne sans réserve l’action de ces voyous qui desservent la cause agricole en général, et la cause viticole en particulier.
M. le ministre. Notre débat d’aujourd’hui porte sur les liens entre l’agriculture et l’environnement, et sur les enjeux qui en découlent.
Je l’ai dit dès que je suis arrivé aux affaires : il faut abandonner notre propension à opposer performance écologique et performance économique. Une telle attitude a pu avoir des conséquences très négatives en agriculture. C’est ainsi qu’en Bretagne, la production porcine a fini, au bout de trente ans, par rencontrer des difficultés et que des abattoirs vont malheureusement devoir fermer.
Ma stratégie est de combiner cette double performance. Cela dit, je ne peux que prendre en compte l’histoire de l’environnement par rapport à l’agriculture.
Dès 1979, à l’échelle européenne, on a essayé de limiter les externalités négatives liées au modèle existant. On avait en effet choisi de développer la production, afin de rattraper le retard dû à la guerre. Les rendements ont été améliorés, multipliés, voire quintuplés ! Mais il faut bien reconnaître que pendant toute cette phase d’accélération du niveau de la production agricole, la question environnementale n’était pas, loin s’en faut, la priorité. J’en veux pour preuve la façon dont a été mené le remembrement, le volume de produits chimiques utilisés pour accroître la productivité, ou la multiplication des traitements spécifiques. Par exemple, pour éviter que les tiges du blé ne versent sous le poids des grains, on a eu recours aux régulateurs de croissance du type Cycocel pour en réduire la taille…
Ainsi s’est-on contenté pendant vingt ou trente ans de procéder à des corrections et de créer de nouvelles normes. Voilà à quoi s’est résumée la politique de l’environnement ! Si nous voulons réussir cette double performance, nous devons changer d’attitude et réfléchir à de nouveaux modèles de production qui intègrent d’emblée l’objectif économique et l’objectif écologique.
Ce que j’ai appelé l’agro-écologie repose sur l’idée qu’on va conceptualiser, en revenant à des critères d’agronomie et en prenant en compte les mécanismes naturels, la manière d’aborder la production agricole. C’est tout l’enjeu d’aujourd’hui, qui a débouché sur un plan et sur une nouvelle démarche, consistant à repérer les expériences positives conduites par des agriculteurs ou des réseaux d’agriculteurs recherchant la double performance économique et écologique.
Le 18 décembre 2012, nous avons organisé à Paris la Conférence nationale « Agricultures : produisons autrement », au Conseil économique, social et environnemental. Nous avons étudié, sans aucun a priori, toutes les pistes possibles, pour dégager ensuite certains critères. De son côté, Marion Guillou, dans son rapport, a tenté de caractériser ce qui pourrait être, selon les OTEX – orientations technico-économiques des exploitations agricoles –, les critères de l’agro-écologie. Car il nous faut, à terme, concevoir de nouveaux modèles de production.
Les itinéraires techniques que l’on a connus depuis trente ou quarante ans ont eu leur vertu. Ils étaient simples et faciles à diffuser. Mais ils n’étaient pas forcément adaptés aux écosystèmes. Aujourd’hui, nous sommes obligés de réfléchir à la meilleure manière d’utiliser les potentiels que nous offrent les écosystèmes pour maximiser la production économique tout en en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement.
Par exemple, pour les céréaliers, le fait de couvrir les sols de manière continue présente de multiples avantages.
Premièrement, plus les sols sont couverts, moins on les retourne, moins l’eau s’en évapore, et moins on consomme d’énergie pour les retourner. On préserve en outre leur microbiologie. Laissons les lombrics travailler : ils n’ont pas besoin du secours de la chimie, ils travaillent tout le temps – et pas aux 35 heures (Sourires), sans revendications sociales, et vont plus profond que la charrue.
Deuxièmement, cela permet de conserver de la matière organique, laquelle contient du carbone. Or le carbone est un des gaz responsables du réchauffement climatique. Plus il y en a dans les sols, moins il y en a dans l’air. Il y aurait aujourd’hui environ 70 milliards de tonnes de carbone dans les sols, soit l’équivalent de 35 ans du carbone rejeté par l’Europe dans les conditions actuelles. Ce n’est pas rien, et le renforcement de la capacité d’absorption du carbone aura un impact sur le réchauffement climatique. Il en est de même des dioxydes d’azote : moins on travaille le sol, moins on en émet dans l’atmosphère.
Troisièmement, la couverture des sols permet une économie d’énergie fossile : moins on retourne ceux-ci, moins on a recours aux tracteurs et autres engins qui consomment du fuel. Dans les exploitations que je connais, on passerait ainsi de 5 500 heures de tracteur à possiblement 2 000 ou 2 200 heures par an. Et ce serait excellent pour le dos des agriculteurs…
Enfin, la couverture des sols contribue à améliorer nos capacités d’autonomie fourragère en nous permettant d’utiliser plus longtemps l’énergie solaire. Et c’est d’autant plus intéressant que notre pays est dans une zone tempérée, dans un niveau où la durée des saisons favorables à la production agricole est beaucoup plus longue qu’ailleurs. Au Canada ou en Ukraine, il faut attendre que l’hiver se termine pour pouvoir travailler les sols ; il n’y a qu’une récolte – voire une récolte et demie – de possible. Nous avons l’avantage énorme de pouvoir faire beaucoup plus tout en étant sur le plan écologique parfaitement durables. Bien sûr, le processus prendra du temps et il n’aboutira que si nous sommes capables d’y associer les agriculteurs.
Les agriculteurs doivent être les acteurs de cette nouvelle démarche qui consiste à prendre, dans les modèles de production nouveaux, les éléments de l’écologie. Le 18 décembre, quand nous avons repéré l’ensemble des systèmes innovants, nous nous sommes aperçus que ceux-ci étaient performants parce qu’ils avaient été mis au point par des passionnés. Pour mener à bien la révolution que nous souhaitons, il faut diffuser ces systèmes auprès du plus grand nombre.
Cela passera aussi bien par la formation – l’enseignement agricole, sur lequel nous pourrons revenir – que par la création de certaines dynamiques. Je me souviens des « clubs des 100 quintaux » réunissant des agriculteurs qui discutaient sur la façon d’atteindre un rendement de 100 quintaux de blé à l’hectare. Je suis persuadé de l’intérêt de ce genre de mobilisation et je fais confiance aux agriculteurs. Nous avons d’ailleurs proposé, dans le projet de loi d’avenir agricole, de créer des groupements d’intérêt économique et écologique, un peu à l’image des anciens GDA – les groupes de développement agricole – ou des anciens groupements de développement. Ces nouveaux groupements d’intérêt économique et écologiques permettront de diffuser le savoir et, dans ce cadre, les agriculteurs pourront, ensemble, se fixer des objectifs ambitieux. Telle est la dynamique que nous essayons de mettre en œuvre.
Tout cela suppose l’appui de la politique agricole européenne, qui passe, notamment, par le verdissement de la politique agricole et par un certain nombre de mesures agro-environnementales – ou MAE.
Il faut que nous fassions évoluer les MAE vers des MAE systémiques. Au Parlement européen, dès qu’un problème environnemental surgit, on y répond par une directive. À un problème de sols, on répond par une directive sur les sols ; à un problème d’oiseaux, par une directive sur les oiseaux. Et c’est la même chose pour l’eau ou les produits phytosanitaires. Mais pour un agriculteur, tous les paramètres se conjuguent sur son exploitation. Par exemple, le contexte éco-systémique fait qu’il utilise plus ou moins de produits phytosanitaires, voire pas du tout s’il fait de l’agriculture biologique.
L’enjeu est donc de définir ensemble des outils qui permettent d’appréhender tous les écosystèmes. Nous vous proposerons de prendre des MAE systémiques mettant en relation des agriculteurs pour qu’ils créent, dans chacun des écosystèmes qui les concernent, les meilleures conditions possibles, tout en respectant certains objectifs environnementaux et économiques.
Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, nous pourrons revenir sur la PAC, le verdissement ou le premier pilier. Mais je tenais à insister sur la dynamique que je souhaite enclencher avec la loi d’avenir agricole, dont nous allons débattre. L’économie n’est pas incompatible avec l’écologie, et l’écologie peut être au service de l’économie.
Mais revenons sur le cas de la Bretagne, de ses lisiers et de ses algues vertes. Jusqu’à présent, on a mesuré l’excédent structurel de matière organique zone par zone et exploitation par exploitation. On a calculé ce qui était nécessaire pour une exploitation, chacune d’entre elle devant avoir sa zone d’épandage. Mais il arrive qu’un agriculteur ait trop d’azote organique, et qu’un autre qui se trouve à quelques centaines de mètres achète de l’azote minéral. Pourtant, aucun échange n’est possible. Nous allons donc vous proposer, dans la loi, que l’excédent d’azote organique puisse se substituer à l’azote minéral. C’est ce que l’on appelle la logique de l’azote total. C’est aussi un changement complet de logique qui fait qu’on ne raisonnera plus exploitation par exploitation, zone excédentaire par zone excédentaire. De la même façon, s’agissant de la polyculture-élevage, on ne devrait plus raisonner exploitation par exploitation, mais par zones d’échanges. Ainsi, le fumier qui se trouve à un endroit pourrait servir à fumer les terres à un autre endroit.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je passe la parole aux représentants des groupes.
M. Jean-Yves Caullet. Merci, monsieur le ministre, pour votre exposé.
Je voudrais d’abord saluer les négociations sur la PAC qui font que, désormais, nous disposons d’une certaine marge. Malgré un contexte difficile, le Gouvernement a réussi à faire en sorte que les outils de la PAC puissent servir des politiques nouvelles comme celles qui viennent d’être présentées. C’est un excellent résultat.
Je voudrais ensuite saluer cette démarche vers l’agro-écologie. Le choix qui a été fait dans le passé en faveur d’une agriculture productiviste a abouti à laisser de côté l’aspect environnemental, mais aussi l’aspect social de la question. En effet, le bénéfice de ces nouveaux rendements a été pour le moins inéquitablement partagé entre les filières, entre les producteurs de matières premières agricoles et l’ensemble de la distribution.
Comme vous l’avez très bien souligné, cette nouvelle approche n’est pas un retour en arrière. Elle suppose même une technicité systémique, très complexe, qui devrait dépasser l’exploitation. Sans doute les bassins d’exploitation, en réunissant plusieurs professionnels, auraient une taille plus adaptée pour gérer des actions comme celles que vous avez indiquées, notamment sur l’azote.
Par ailleurs, des débats passionnés tournent autour des rejets carbonés et des performances recherchées par l’élevage traditionnel. Ce que vous avez dit à propos des stocks de carbone présents dans les sols est donc particulièrement bienvenu, puisqu’il démontre tout l’intérêt de ne pas retourner les prairies naturelles et d’y faire de l’élevage bovin.
Vous avez souligné l’importance de la connaissance. Mais comment conjuguer ce qui est relève de la recherche et des institutions, avec ce qui relève de l’observation et du retour d’expériences du terrain par les agriculteurs ? En effet, pour faire progresser des systèmes, il faut également se placer au niveau de l’exploitation elle-même.
Comment partager avec la population cette connaissance et ces nouveaux itinéraires techniques, dont l’objectif ne serait pas d’atteindre 100 quintaux de blé à l’hectare mais, par exemple, d’améliorer le revenu des agriculteurs, l’autonomie protéique de nos élevages et de minimiser les intrants d’origine extérieure ? Comment faire en sorte que la population se réconcilie avec son agriculture ? Les agriculteurs ont souvent le sentiment que l’opinion leur est hostile, pour des raisons liées à l’environnement.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez dénoncé l’aspect anachronique des normes qui ont été imposées au fur et à mesure que des problèmes apparaissaient. Mais sera-t-on capable, au niveau européen, d’apprécier la performance systémique ? Il ne s’agit plus de se demander comment faire évoluer les normes, mais de se demander si les objectifs sont bien respectés.
M. Martial Saddier. Merci, monsieur le ministre, pour votre présence et votre intervention.
La première question que je vous poserai, au nom des députés UMP, concerne la loi d’avenir agricole. Êtes-vous en mesure de nous en préciser le calendrier ?
Par ailleurs, bien que nous appartenions à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, nous nous intéressons à la nouvelle PAC. Après l’accord tripartite qui a été passé au niveau européen, pouvez-vous nous faire un point rapide sur la déclinaison française de cette nouvelle PAC ? Où en sont les discussions avec le monde agricole ? Comment le verdissement va-t-il se traduire sur le territoire national ? Pouvez-vous nous parler de la surprime aux cinquante premiers hectares et des zones de handicap ?
Quel est votre point de vue sur les agrocarburants ? Quelles sont les perspectives en ce domaine ?
Nous avions lancé, lors des législatures précédentes, trois grands chantiers, qui se sont traduits par des plans. Le plan Écophyto a eu le mérite d’éliminer un certain nombre de matières actives, mais nous savons que le système est perfectible. Que pouvez-vous nous en dire ? Pouvez-vous également nous parler du plan apicole et du plan sur l’agriculture biologique ?
Ensuite, le président Jean-Paul Chanteguet a missionné deux parlementaires de notre commission pour mener une mission d’information sur l’expérimentation de l’affichage environnemental. Quelle est votre position sur cette expérimentation ?
Je terminerai sur un dernier point qui me tient à cœur en tant que président du Conseil national de l’air – CNA. Bien sûr, je vous rejoins lorsque vous dites qu’il n’est pas question de montrer du doigt les agriculteurs. Mais lorsque nous identifions, dans le cadre du contentieux européen, les différentes sources potentielles de pollution de l’air, nous nous rendons compte qu’il existe des marges de progression dans le monde agricole. Quel est votre point de vue en la matière ? J’imagine que vous êtes sensible à cette question. Vous êtes-vous associé à la démarche interministérielle qui est en cours ?
M. Bertrand Pancher. Monsieur le ministre, je suis issu d’un grand département agricole, la Meuse, où les agriculteurs font, depuis des années, des efforts considérables pour améliorer leurs pratiques. Je me fais leur porte-parole auprès de vous.
Premièrement, il faut mener des contrôles intelligents. Les agriculteurs sont parfois excédés par l’idiotie des systèmes de contrôle actuels, dont il faudrait revoir la temporalité et l’échelle. Pourquoi 20 mg de concentration par litre dans la Meuse et 70 mg en Bretagne ? Pourquoi limiter cette année le retournement du colza à 36 %, dans le cadre des mesures rotationnelles ? Pourquoi, lorsque le printemps est humide, n’est-il pas possible d’utiliser des outils de traitement alternatifs ? Les agriculteurs se mobilisent, notamment à travers le réseau des Défis ruraux. Comment rendre ces contrôles plus adaptés ?
Deuxièmement, nous avons besoin d’un minimum de moyens. Je vous donne un exemple. Pour éviter des traitements phytosanitaires excessifs et mal positionnés, un réseau de stations météorologiques a été créé par le ministère de l’agriculture il y a quelques années. La finalité de ce réseau était, à terme, de modéliser le risque régional vis-à-vis de certains bioagresseurs. Or, en 2013, la Direction générale de l’alimentation qui finance la maintenance de ce réseau et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques – ONEMA – ont décidé d’une baisse de crédits. En conséquence de quoi, de nombreuses stations météorologiques, dont celle de Redon, ne seront plus entretenues. Mon département est touché. Trois stations vont être fermées. Or, dans le cadre du programme Écophyto, ces stations sont incontournables pour mieux adapter les traitements au contexte pédoclimatique. Pourriez-vous évoquer ce sujet ? Nous risquons de décourager les nombreux agriculteurs qui s’étaient engagés. Il nous faut des moyens ciblés.
Troisièmement, nous avons besoin de mesures de bon sens. Comment concilier l’agro-écologie vertueuse et les réalités locales ? S’il apparaît plutôt séduisant sur le papier, le projet agro-écologique pour la France laisse sur le terrain quelques interrogations. Par exemple, il pourrait bien signer l’arrêt définitif du plan de stockage de l’eau. En effet, le ministère de l’agriculture, en se basant sur certaines expériences, proposera peut-être de réduire fortement les quantités d’eau utilisées. Nous ne le contesterons pas. Sauf que cela remettra en cause un certain nombre de pratiques de bon sens.
Enfin, les recherches, notamment celles menées par l’INRA, permettent-elles de dégager des résultats que des agriculteurs pourraient mettre à profit sur le terrain ? Je sais que le sujet n’est pas facile, car cela pose la question de l’acceptabilité des nouveaux types de production et de la part des subventions dédiées à ces recherches dans les prochaines années.
Mme Brigitte Allain. En tant que viticultrice et au nom des écologistes, nous condamnons bien sûr l’action violente qui a été menée cette nuit, a priori par le Comité d’action viticole, et ce quelles que soient d’ailleurs les revendications de ses auteurs.
Je tiens par ailleurs à rappeler que si les agriculteurs sont sensibles à leurs revenus, ils sont capables de s’orienter vers de nouvelles pratiques et de nouvelles filières dès lors qu’ils ont confiance et qu’ils se sentent réellement soutenus et encouragés pour le faire. Ils sont aussi soucieux de préserver leur santé, celle de leur famille et leur environnement. Mais ils ne souhaitent pas être montrés du doigt.
J’axerai maintenant mon propos sur les programmes d’action proposés pour l’agro-écologie.
Concernant le plan « énergie méthanisation autonomie azote » ou plan EMAA, je voudrais vous interroger sur les méthaniseurs. Ne vaudrait-il pas mieux en installer à l’échelle du territoire plutôt qu’à l’échelle de la ferme, pour assurer leur continuité et regrouper les effluents de plusieurs exploitations ? Ne faudrait-il pas légiférer pour interdire l’alimentation de ces méthaniseurs avec des céréales ou autres végétaux destinés à l’alimentation animale. C’est mon avis. Quel est le vôtre ?
Le plan « protéines végétales » est positif pour l’autonomie des fermes et la relocalisation. En effet, aujourd’hui, nous importons 70 % des protéines végétales. Cela étant, nous avons besoin d’outils pour aider à la contractualisation entre producteurs végétaux et producteurs éleveurs. J’espère que la prochaine loi le prévoira.
Le plan « ambition bio 2017 » soutiendra l’agriculture biologique en matière de production agricole. Mais pour qu’il réussisse, il faudrait pouvoir structurer les filières commerciales et coopératives ou collectives.
Le plan de développement durable de l’apiculture a été activé, et il me paraît essentiel que l’apiculture figure dans cette loi d’avenir. Rappelons que sans les abeilles et leur travail de pollinisation, de nombreuses productions oléagineuses ou fruitières ne seraient tout simplement pas possibles.
Concernant le plan Écophyto, les groupements d’intérêt économique et environnemental – GIEE – devraient bénéficier de moyens importants. Mais quelle emprise aurez-vous sur les comités VIVEA, notamment pour orienter les formations et le développement ?
Le fait de séparer la vente du conseil agricole est important, mais je pense qu’il faut aller plus loin, et notamment interdire l’introduction d’antibiotiques dans les aliments du bétail.
Je voudrais avoir également des précisions sur les leviers mis en place, notamment sur la fiscalité écologique, et appeler votre attention sur la nécessité de préserver les terres agricoles, forestières et naturelles. Leur répartition et leur affectation devront prendre en compte un objectif ambitieux pour l’installation. Des schémas régionaux agricoles et alimentaires pourraient y contribuer. L’agriculture biologique devrait elle aussi être encouragée par ce plan.
Enfin, monsieur le ministre, envisagez-vous de prendre des mesures foncières pour favoriser l’agro-écologie ?
M. Jacques Krabal. Monsieur le ministre, merci pour vos propos sur l’agro-écologie. Vous avez tenu un discours novateur et prometteur, à la fois pour l’environnement et pour le développement de notre agriculture.
Vous nous proposez de prendre en compte les problématiques environnementales et de santé alimentaire, tout en préservant – voire en confortant – notre savoir-faire, la rentabilité et la qualité de la production agricole dans l’intérêt économique de la France. Je pense que nous partageons tous cette volonté d’une agriculture durable, visant l’équilibre économique, social et environnemental. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si la définition de l’agro-écologie a été clairement exposée et si elle partagée par la profession. Les agriculteurs ont-ils été associés à sa mise en œuvre ? En seront-ils les acteurs ? Cette agro-écologie coexistera-t-elle avec autres schémas de production agricole, ou s’imposera-t-elle comme seule solution possible. ?
Je voudrais vous interroger sur la révision des zones sensibles destinée à mettre notre pays en conformité avec la directive « nitrates » de la Commission européenne. La décision d’interdire tout apport azoté sur les terrains en pente de plus de 15 % impacterait directement 40 % du vignoble champenois comme d’autres vignobles d’ailleurs. Un projet d’arrêté vient mettre à mal les techniques naturelles mises en place avec succès pour lutter contre l’érosion, comme l’enherbement ou l’apport d’écorces. Et dans l’état actuel du texte, l’épandage du fumier, pratique courante chez les viticulteurs biologiques, serait interdit. Je sais que vous connaissez ce dossier, comme en atteste la lettre que vous m’avez adressée le 4 juillet dernier. Alors que nous parlons d’agro-écologie, n’est-il pas contradictoire de provoquer l’abandon de ces pratiques, qui sont pourtant écoresponsables ? C’est pourquoi il me semble nécessaire de revoir le taux de pente tel qu’il est proposé, afin de préserver ces modes d’exploitation en développement dans le vignoble champenois et ailleurs. Qu’en pensez-vous ?
Concernant la PAC, afin d’éviter de pénaliser l’élevage, vous proposez de primer les cinquante premiers hectares de productions fragiles. Le président de la FNSEA nous a déclaré récemment que le verdissement et la convergence pourraient se traduire par un prélèvement important, auquel s’ajouterait le possible impact de la surprime aux cinquante premiers hectares, et conduire à de nouvelles inégalités. Les agriculteurs que j’ai rencontrés dans le département de l’Aisne ont exprimé les mêmes craintes et leur manque d’enthousiasme. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes ?
Le 29 juin dernier, vous avez déclaré vouloir utiliser les outils mis à votre disposition dans le cadre de la nouvelle PAC pour rééquilibrer la répartition des aides en faveur de l’élevage, sans déséquilibrer d’autres filières. Comment allez-vous faire ?
Nous connaissons par ailleurs la position du Président de la République, du Premier ministre, et d’autres ministres, sur l’extraction des gaz de schiste.
M. Alain Gest. Elle est catastrophique !
M. Jacques Krabal. Quelle est la vôtre ? Nous connaissons en effet les impacts qu’une telle extraction peut avoir sur l’eau, le foncier et sur l’agriculture.
Je terminerai sur les aides allouées aux secteurs agricoles. Je vous ai fait parvenir un courrier concernant la Société des moulins Hoche, à Rozet-Saint-Albin, dans l’Aisne. Cette entreprise a bénéficié d’une aide à la diversification de la production agricole d’un montant de 490 000 euros – sur un investissement total de 2 millions d’euros. Suite à une erreur de comptabilité, cette subvention est aujourd’hui remise en cause par les services de l’État, ce qui menace la pérennité de l’entreprise. Je compte sur vous pour regarder ce dossier… avant de vous inviter à visiter cette entreprise de mon département.
Mme Fanny Dombre Coste. Monsieur le ministre, je ne peux, comme l’ensemble de mes collègues, qu’adhérer à cette vision d’une nouvelle agriculture et d’un nouveau modèle agricole pour notre pays. En effet, la raréfaction des ressources, l’augmentation de la demande alimentaire, l’usage accru de la biomasse à des fins non alimentaires, ainsi que les conflits d’usage du sol rendent ces évolutions nécessaires. Toutefois, si l’agro-écologie n’entraîne pas une baisse de rendement comme le craignent certains agriculteurs, sa mise en place prend indéniablement du temps. Comment accompagner la prise de risque liée à la modification des pratiques et encourager, à l’échelle des territoires, cette nouvelle forme d’agriculture ? Comment construire avec les collectivités territoriales ces changements si ambitieux ? Monsieur le ministre, j’approuve votre méthode, mais j’aimerais savoir à quel rythme, selon vous, se fera cette mutation.
Par ailleurs, notre commission est en train d’examiner le projet de loi sur l’accès au logement et à l’urbanisme rénové – ALUR. Ce matin même, nous avons évoqué la question de la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Certains de nos collègues considèrent que ce projet ne va pas assez loin en ce domaine. Lors de la mise en place de l’Observatoire national de consommation des espaces agricoles, à la présidence duquel vous m’avez fait l’honneur de me nommer, vous aviez manifesté votre volonté de traiter cette question dans la loi d’avenir agricole. Vous aviez également proposé d’élargir les compétences de l’Observatoire aux espaces naturels et forestiers. Qu’en est-il ? Pouvez-vous confirmer votre engagement de lutter contre l’artificialisation des sols ?
M. Alain Gest. Monsieur le ministre, je voudrais connaître votre réaction à l’annonce de la pause du degré d’incorporation des biocarburants dans les carburants à hauteur de 7 %, et à l’annonce, par le groupe Sofiprotéol, de la nécessité de restreindre l’implantation et le développement de ces biocarburants.
Par ailleurs, le découplage des soutiens spécifiques à la filière fécule a des conséquences alarmantes. La baisse de la production européenne est en effet estimée à 400 000 tonnes sur 1 700 000 tonnes – soit environ 25 %. Pourtant, ce secteur a une carte à jouer au niveau mondial, puisque de nouveaux débouchés existent dans le domaine de l’alimentaire, de la cosmétique et de la chimie du végétal. Il reste des recherches à mener. En attendant, le secteur souhaite un soutien couplé transitoire sur la période 2014-2020. Quelle réponse pouvez-vous lui apporter ?
M. Paul Molac. Monsieur le ministre, je vais aller dans votre sens : on peut avoir une production importante tout en limitant au maximum les intrants, voire en n’en utilisant pas. De fait, certains agriculteurs biologiques sont particulièrement performants, avec des niveaux de rendement quasiment identiques à ceux de l’agriculture classique.
Je pense moi aussi que la méthanisation est un des moyens qui nous permettra de sortir de nos ZES – zones en excédent structurel – et des problèmes d’azote que nous rencontrons en Bretagne. Nous devons néanmoins rester vigilants. Cela dit, la profession est consciente du problème.
Je rejoindrai enfin notre collègue Brigitte Allain, qui nous a parlé des méthaniseurs : il vaut mieux en effet qu’ils desservent plusieurs exploitations. Des coopératives se mettent d’ailleurs en place. Le problème est que les projets mettent très longtemps à aboutir – dans ma circonscription, un projet est en cours depuis deux ans. Envisagez-vous de revoir la réglementation pour accélérer le processus ?
M. Jean-Jacques Cottel. Je confirme que tous les agriculteurs essaient d’améliorer leurs pratiques et je salue le travail effectué dans le cadre du projet agro-écologique.
Ma première question concerne le plan « énergie méthanisation autonomie azote ». Comment va-t-il se concrétiser ? Avec quelles aides et selon quels circuits ? À partir d’initiatives individuelles, ou non ?
Je viens d’une région de grande agriculture. Néanmoins, je tiens à insister sur l’importance de l’élevage et sur la nécessité de travailler à sauver l’élevage et la production laitière, quel que soit le territoire où l’on se trouve. L’élevage génère en effet davantage d’emplois que d’autres activités agricoles et permet de maintenir nos paysages, avec des prairies et des bocages.
L’agriculture biologique a commencé à se développer, même dans des secteurs de grande agriculture mais aujourd’hui, elle semble plafonner. Quel est donc votre plan pour la relancer ? Les agriculteurs qui la pratiquent ont souvent besoin de faire de la vente à la ferme. Y a-t-il d’autres moyens de l’encourager ?
M. Jean-Marie Sermier. Monsieur le ministre, j’ai l’impression de ne pas vivre dans le même monde que vous ! Vous parlez de nouveaux modèles, de nouveaux enjeux qui intègrent les objectifs de production et les objectifs écologiques. De mon côté, depuis trente ans, je constate que mes collègues agriculteurs travaillent intelligemment à réduire les produits phytosanitaires tout en faisant en sorte d’améliorer la qualité des plantes et de l’alimentation, et à limiter les pollutions azotées.
Monsieur le ministre, ne tombons pas dans la caricature de l’agriculteur pollueur ! (Exclamations et rires) Ce débat vaut mieux que vos récriminations. Nous devons trouver des solutions pour que l’agriculture, qui remplit une première fonction de production – il lui faudra nourrir les 9 milliards d’habitants de la planète –, soit encore plus respectueuse de l’environnement. Car elle l’est déjà.
Monsieur le ministre, que pensez-vous de la décision de l’INRA d’arrêter les recherches sur les OGM en plein champ ? Le dernier essai ayant pris fin, il n’y en a plus du tout dans notre pays. La filière est aujourd’hui complètement décapitée. Qu’en pensez-vous ?
M. Olivier Falorni. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention. Je tiens d’abord à saluer le travail effectué sous la houlette de Marion Guillou. La méthode me paraît excellente : identifier les bonnes pratiques, les blocages, et trouver des solutions réalistes de compromis pour aller plus loin vers l’agro-écologie.
Mais au-delà de tous les progrès que nous devons encourager, au-delà de toutes les méthodes innovantes que nous soutenons, il reste malheureusement quelques points de conflit entre la logique environnementale et la logique économique. Je pense, par exemple, aux produits phytosanitaires et aux engrais. Ces produits permettent évidemment d’augmenter les rendements, mais ils peuvent être nocifs. Nous devons les contrôler et interdire ceux qui posent des problèmes.
Reste que nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser certains produits, contrairement à leurs concurrents européens, espagnols, allemands ou italiens. Nous devons donc répondre à un problème simple : les interdictions des produits phytosanitaires ou des engrais doivent être décidées au niveau européen. C’est une question de bon sens car, de toutes les façons, les produits italiens, espagnols et allemands se retrouvent dans nos supermarchés, nos marchés et nous finissons par les manger. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes de l’harmonisation européenne sur les produits phytosanitaires ? Pouvez-vous convaincre vos homologues européens ? Et comment ?
Mme Geneviève Gaillard. Merci, monsieur le ministre, pour vos propos qui nous laissent espérer une mutation de l’agriculture dans les années qui viennent car nous l’attendions depuis fort longtemps.
Chacun connaît ici les différences de revenus et de primes existant entre certaines catégories d’agriculteurs. Aujourd’hui, les éleveurs souffrent fortement. J’avais eu l’occasion de vous parler plus particulièrement des éleveurs bovins et caprins : certains d’entre eux mettent la clé sous la porte ; d’autres agriculteurs arrivent alors pour cultiver leurs terres, arrachant des haies et mettant en place des systèmes de production totalement contraires à ce que nous souhaiterions. Je voudrais savoir si, dans le cadre des possibilités ouvertes par la nouvelle PAC, l’agro-écologie va tenir sa place. Dans quels délais pensez-vous que ces pratiques pourront cesser ?
Je souhaiterais vous interroger également sur l’Observatoire agricole de la biodiversité, créé en 2009, afin de combler le manque d’indicateurs de suivi de l’état de la biodiversité en milieu agricole, de créer des données nationales sur cette biodiversité et d’y sensibiliser les agriculteurs. Au bout de quatre ans, je ne sais pas trop quels sont ses résultats. Quel est donc son bilan ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous resterez tous pour écouter les réponses !
M. David Douillet. J’aimerais que M. le ministre nous parle du réseau « Agrifaune », que soixante-dix départements ont rejoint par le biais d’une convention de partenariat. Ce réseau est d’ores et déjà considéré par tous comme étant une vraie réussite. 328 fermes témoins « Agrifaune » permettent de démultiplier les actions sur le terrain. Qu’avez-vous mis ou qu’allez-vous mettre en place ?
Mme Suzanne Tallard. J’ai assisté à la conférence du mois de décembre et j’y ai vu la volonté de réorienter la politique agricole à la fois vers l’efficacité économique et l’écologie. Ce fut une grande satisfaction.
Sur mon territoire, deux questions se posent : l’installation des jeunes agriculteurs et le soutien à l’élevage. Chaque année, dans ma circonscription, plusieurs grandes exploitations agricoles passent de l’élevage à la culture des céréales et des oléagineux – l’inverse ne se produit jamais. (Approbations diverses)
L’accord qui a été obtenu en juin sur la réforme de la PAC doit être l’occasion de rééquilibrer les aides en faveur de l’élevage, que ce soit pour la filière viande ou la filière lait, en faveur de l’emploi et d’une agriculture durable. Pouvez-vous nous éclairer sur les conditions d’une mise en œuvre, plus juste, plus verte et néanmoins ferme, du cadre négocié de la PAC en France ?
M. Guillaume Chevrollier. Monsieur le ministre, l’utilisation des déchets biodégradables sous différentes formes est devenue indispensable pour l’amendement et la fertilisation des cultures. Les raisons en sont nombreuses, comme le fort déficit en matières organiques de notre sol français – 40 % de celui-ci serait déficitaire. Or seulement 20 % de la surface utile française serait fertilisée à l’aide des déchets agricoles, et 5 % par des déchets et produits biodégradables. Quelles évolutions envisagez-vous afin d’améliorer ces taux ?
Par ailleurs, monsieur le ministre, permettez au député mayennais que je suis de vous interpeller sur la situation tendue de mon département : vous savez que les producteurs de lait réclament un meilleur prix. Le week-end dernier, ils ont mené des actions sur le site de Lactalis. Les agriculteurs promettent des actions continues pendant l’été. Leur détermination s’explique par la difficulté de leur situation. Les producteurs de lait ont droit à une rémunération décente. Quelle est donc la position de votre gouvernement ?
Mme Sophie Errante. Monsieur le ministre, l’agro-écologie vise à promouvoir des modes de production plus respectueux de l’environnement, mais aussi de la santé humaine. En effet, ces deux objectifs sont indissociables. L’INSERM a récemment présenté devant l’Assemblée nationale une expertise collective qui dresse un état des lieux de la recherche sur les effets des pesticides sur la santé. Les résultats sont très préoccupants. Cette expertise rappelle les maladies pour lesquelles il existe une forte corrélation avec une exposition aux pesticides. Je pense aux exploitants agricoles, mais aussi à l’ensemble de nos citoyens.
Monsieur le ministre, je connais votre attachement à défendre la réduction de l’utilisation des pesticides. C’est pourquoi je souhaite savoir si vous envisagez de reprendre certaines préconisations de l’INSERM, à savoir : la poursuite des recherches, aussi bien sur les pesticides déjà interdits que ceux en vente ; la mise en place d’un système de recueil des données d’usage des pesticides pour améliorer les connaissances sur les pratiques des agriculteurs ; et la mise à disposition des scientifiques d’une base de données regroupant la composition exacte des produits chimiques mis sur le marché.
M. Jean-Pierre Vigier. Monsieur le ministre, vous avez présenté, en février dernier, une communication relative au projet agro-écologique pour la France. L’objectif est de concilier la performance économique de notre agriculture avec la performance écologique.
Vous souhaitez que la France soit leader en ce domaine. À cet effet, votre ministère prépare plusieurs plans comme, par exemple, le plan « ambition bio 2017 ». Vous envisagez par ailleurs de réactiver les plans Écophyto et Éco antibio. Les agriculteurs seront donc incités à se convertir à de nouvelles pratiques, s’appuyant notamment sur la diversification des cultures. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quelles mesures vous préparez pour encourager les agriculteurs ? Ces dispositions seront-elles du domaine de la formation, à caractère financier ou autres ?
M. Philippe Bies. Monsieur le ministre, le projet de loi ALUR prévoit d’élargir les prérogatives des commissions départementales de consommation des espaces agricoles – CDCEA – en cas d’ouverture à l’urbanisation à tous les espaces agricoles et à tous les espaces naturels. Le projet de loi d’avenir de l’agriculture est lui-même en cours d’élaboration. Est-il donc envisagé de réformer la gouvernance et la composition des CDCEA, voire de les rapprocher ou de les fusionner avec les commissions départementales des sites, lesquelles sont le résultat de la fusion d’un certain nombre de commissions, opérée en 2006 ?
M. Julien Aubert. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur le plan national loup 2013-2017, que vous avez signé avec Mme Delphine Batho, sur deux points principaux : la logique du tir de prélèvement et le recours aux lieutenants de louveterie. D’une part, il est prévu de prélever le carnivore responsable des attaques. Mais comment, très concrètement, faudra-t-il procéder ? Ne risque-t-on pas, en fait, de prélever un loup au hasard ? D’autre part, comment allez-vous vous appuyer sur les lieutenants de louveterie ? Comment faire pour mieux les employer ?
Je remarque par ailleurs qu’à la page 34 de ce nouveau plan loup, il est précisé que le nombre plafond de prélèvements sera calculé de façon que la population continue de croître pendant la durée du plan. Doit-on en conclure qu’il s’agit d’un plan de réintroduction du loup en France ? (Sourires)
Mme Catherine Quéré. Monsieur le ministre, j’aimerais d’abord savoir si la future loi d’avenir de l’agriculture comportera un volet dédié aux SAFER, auxquelles nous sommes très attachés.
M. le ministre. Oui !
Mme Catherine Quéré. Ensuite, vous savez que 30 % du vignoble de France est touché par des maladies : syndrome de l’Esca, Eutypiose, flavescence dorée. Autrefois, on arrivait à pallier ces problèmes avec l’arsenic de soude. Les viticulteurs utilisaient du Pyralion, mais ils n’ont plus le droit de le faire. Dans ces conditions, comment réaliser la double performance économique et écologique ? Nous demandons donc une mission d’information à l’Assemblée sur les maladies du bois. Nous sommes nombreux à la souhaiter. Pouvez-vous nous soutenir ?
Enfin, la loi de finances que nous avons votée au mois de décembre 2012 comprend un volet sur les taxes foncières. Dans les communes à forte pression en matière de logement, les terres agricoles incluses dans un PLU seront taxées à hauteur de 50 000 euros par hectare la première année et à 100 000 euros la deuxième année. Imaginez ce que cela représente pour des maraîchers ou des petits céréaliers ! J’ai alerté M. Bernard Cazeneuve et la commission des finances. Ne pourrait-on pas exonérer les exploitants de ces taxes car il leur est impossible de les payer ?
M. Michel Heinrich. Monsieur le ministre, ma question concerne les exploitations herbagères, qui ont plus de 70 % d’herbe. Les agriculteurs regrettent que les MAE soient uniquement environnementales, et qu’il n’y en ait pas de productives. Une évolution dans ce domaine est-elle envisagée ?
M. Jean-Luc Moudenc. La réforme de la PAC qui a été conclue le mois dernier pour la période 2014-2020 prévoit des mécanismes de soutien, en particulier des soutiens couplés en faveur de plusieurs filières. Or la filière chevaline s’est sentie exclue, pour ne pas dire sacrifiée. La Fédération nationale du cheval s’est exprimée en ce sens. Je voulais donc connaître vos intentions à son égard. N’oublions pas qu’après l’affaire Spanghero, le contexte est dramatique pour cette filière.
M. Philippe Noguès. Monsieur le ministre, malgré vos efforts, une menace plane sur notre modèle agricole. Par un hasard du calendrier, vous nous présentez votre projet agro-écologique moins d’une semaine après le premier cycle de négociations entre les États-Unis et la Commission européenne, qui aboutira vraisemblablement dans les mois à venir à la signature du plus important accord de libre-échange entre les deux espaces économiques et qui touchera, notamment, le domaine de l’agriculture.
Les récentes divergences de vue entre les différents partenaires européens ont mis en lumière les difficultés que nous avons, en Europe, à parler d’une seule voix. Je crains que cela n’ait des conséquences sur notre pouvoir de négociation face à la première puissance économique mondiale. Une négociation implique forcément un compromis, et pour notre modèle, un risque inquiétant de moins disant. En particulier, les États-Unis souhaitent exporter en Europe des produits OGM, de la viande de bœuf nourri aux hormones ou des poulets chlorés. Aussi bien la FNSEA que la Confédération paysanne s’inquiètent de ces nouvelles importations. Cette négociation n’est-elle pas une menace pour notre modèle agricole, voire pour notre société ?
Mme Valérie Lacroute. Monsieur le ministre, avec l’agro-écologie, vous avez engagé un vaste chantier, où la réflexion sur les modes de production du futur tient une place importante. Cependant, des interrogations propres à notre modèle agricole actuel se posent.
J’ai relevé une certaine marginalisation des petites exploitations familiales, qui ne sont pas suffisamment intégrées dans les politiques publiques, alors qu’elles sont bien souvent plus productives que les grandes exploitations de monoculture.
J’ai également noté une certaine insuffisance de la recherche en agro-écologie. Par exemple, l’agro-foresterie n’est étudiée que par une petite équipe à l’INRA, dont un seul chercheur à temps plein. 500 personnes seulement, dont une soixantaine dans ma circonscription de Seine-et-Marne, y travaillent aujourd’hui. N’est-il pas temps de donner des moyens conséquents à cette recherche fondamentale ?
Ne faudrait-il pas également arrêter d’agrandir les fermes, et créer plutôt des connexions entre elles et avec les filières ? Les agriculteurs conventionnels pourraient, dans un premier temps, substituer des intrants et des pratiques par d’autres intrants et d’autres pratiques, plus naturels. Ne pensez-vous pas qu’il faut se donner les moyens d’aménager la transition des agriculteurs conventionnels vers l’agro-écologie en cinq ou six ans, le temps nécessaire pour créer un mécanisme financier de stabilisation des revenus pour tous ceux qui s’engagent dans l’agro-écologie ?
Enfin, la transition agro-écologique ne passe-t-elle pas par de nouvelles pratiques de gouvernance territoriale, qui visent à la construction de lien social ?
M. Philippe Plisson. Le bureau de la Commission européenne a proposé de limiter à 5 % la part de la première génération d’agrocarburants et de supprimer d’ici à 2020 toutes les subventions. Dans le même sens, la Cour des Comptes a pointé le coût de la politique de soutien à ces productions, dont la pertinence est contestable. Le Gouvernement, de son côté, a annoncé, lors de la Conférence environnementale, une baisse progressive de leur taux de défiscalisation. Peut-on en déduire que les agrocarburants n’auront plus leur place dans le nouveau modèle agricole français ?
Ensuite, la loi relative aux certificats d’obtention végétale votée le 8 décembre 2011 interdit aux agriculteurs de se servir des graines issues de leurs propres récoltes. Cette loi, qui va à l’encontre du « produire autrement » que vous préconisez, sera-t-elle abrogée dans le projet de loi que nous aurons à débattre ?
Enfin, j’ai eu l’occasion de vous interroger sur le projet de ne plus confier aux distilleries la récupération des résidus de la vigne qui pourraient alors être épandus dans la nature. Outre le fait que l’État perdrait tout contrôle sur les quantités produites, ne peut-on craindre des atteintes sur l’environnement, par un épandage sauvage systématique ? Où en est ce projet ?
M. le ministre. Je commencerai par les questions des représentants des différents groupes.
M. Jean-Yves Caullet m’a interrogé sur la possibilité de modifier, à l’échelle européenne, les normes telles qu’elles sont actuellement définies. Eh bien, le débat va s’engager. M. Philippe Martin et moi-même rencontrerons le Commissaire européen à l’environnement, pour lui expliquer ce que nous envisageons de faire. En effet, sur les zones vulnérables et l’application de la directive « eau », il y a des divergences de vue entre la Commission et la France. J’essaierai, notamment, de présenter les futurs groupements d’intérêt économique et écologique. Il faut que la Commission puisse intégrer ces nouveaux éléments, comme elle l’a d’ailleurs fait avec les coopératives « nature » qui existent aujourd’hui au Pays-Bas, et qui gèrent directement le deuxième pilier de la PAC. Certes, nous n’en sommes pas là. Mais voilà comment nous allons nous y prendre pour tenter de faire évoluer la situation.
M. Martial Saddier a posé plusieurs questions. La première portait sur le calendrier de la loi d’avenir. Sachez donc qu’il sera présenté en conseil des ministres en octobre-novembre 2013 et qu’on devait en débattre, à l’Assemblée nationale, début janvier 2014. Nous aurons donc l’occasion d’y travailler ensemble.
Il m’a également interrogé sur l’apiculture, le plan Écophyto et l’agriculture biologique, sujets qui sont d’ailleurs revenus à plusieurs reprises.
Pour la première fois, il existe un plan apicole, auquel seront consacrés 40 millions d’euros sur trois ans. Nous avons en effet constaté que la production de miel avait baissé en France – de 25 000 tonnes par an à un peu moins de 20 000 tonnes – alors que sa consommation restait d’à peu près 40 000 tonnes. Aujourd’hui, notre importation nette de miel atteint près de 20 000 tonnes, dont 16 000 tonnes viennent de Chine. Il faut redresser la barre !
La diversité de notre agriculture conduit à une diversité des organisations, une individualisation des choix stratégiques et à la perte totale d’intérêt collectif de filière. Il en est évidemment de même en apiculture. Ce plan vise donc à mieux structurer la filière, à développer et à adapter la production apicole selon les zones, à améliorer la connaissance du consommateur – signes de qualité, origine des miels – et la recherche, à laquelle l’INRA sera associée.
Il faut travailler sur les différentes espèces d’abeilles, et notamment sur leur résistance à un certain nombre de maladies. Je vous signale que j’ai réussi à obtenir de l’Europe un moratoire de deux ans sur l’ensemble de la famille des néonécotynoïdes qui sont considérés par les apiculteurs comme responsables de la mortalité des abeilles. Cela dit, ces produits ne sont sûrement pas les seuls responsables.
Ensuite, nous nous appuyons sur un réseau Certiphyto – que nous avons d’ailleurs utilisé pour l’agro-écologie.
Quant au plan Écophyto, son objectif était d’abaisser de 50 % la consommation de produits phytosanitaires d’ici à 2018. L’atteindra-t-on ? Si oui, tant mieux. Mais en 2012, la consommation de ces produits avait augmenté de 2 % ! Commençons par réduire l’utilisation du recours aux produits phytosanitaires. Car c’est cela le vrai objectif.
Nous devrons bien sûr tenir compte des résultats du travail de l’INSERM, évoqués par l’une d’entre vous. Nous ne devrons pas nous contenter de dire aux agriculteurs de diminuer les doses de phytosanitaires. Si nous ne réfléchissons pas, derrière, sur les raisons qui faisaient qu’on utilisait de telles doses, si nous ne repensons pas le modèle, nous mettrons les agriculteurs en difficulté, et la situation n’évoluera pas. Il nous faut mener une réflexion plus globale et systémique. Par exemple, pour limiter l’usage des phytosanitaires, il est possible de mettre en place des alternances et de procéder à des rotations.
Il faudra enfin poursuivre le travail sur les molécules les plus dangereuses. 85 % d’entre elles, qui étaient cancérogènes ou provoquaient des mutagénèses, ont d’ores et déjà été supprimées dans le cadre de ce plan. Michel Barnier y a d’ailleurs largement participé. Mais nous devons aller encore plus loin.
M. Martial Saddier. Le monde agricole n’est pas le seul concerné.
M. le ministre. En effet.
Ensuite, l’agro-écologie ne consiste pas à dire qu’il ne faut pas utiliser d’eau, mais qu’il faut l’utiliser mieux et moins. Le ministre de l’écologie aura des décisions à prendre à propos du moratoire suspendant le financement de projets de stockage pour l’irrigation. L’objectif n’est pas d’utiliser l’eau pour irriguer le maïs, mais pour éviter que des modèles durables ne disparaissent. Malgré tout, je tiens à faire remarquer que l’herbe a autant besoin d’eau que le maïs. En cas de sécheresse, les zones herbeuses sont les premières touchées. Prétendre que l’herbe n’a pas besoin d’eau est donc ridicule et il faut éviter tout mauvais procès. Nous allons travailler sérieusement sur cette question avec M. Philippe Martin. Le rapport qu’il avait rendu juste avant d’être nommé ministre de l’écologie, et qui avait salué par de nombreux professionnels, servira de ligne directrice.
M. Bertrand Pancher a demandé des contrôles intelligents. On a en effet parfois le sentiment que la multiplication des contrôles perturbe les agriculteurs. Alors qu’ils ont besoin de s’adapter, ils sont systématiquement renvoyés à des objectifs extrêmement précis. Il faudrait que l’on passe d’un système de contrôle des moyens demandés aux agriculteurs, à un contrôle sur les objectifs et les résultats. Ce qui est insupportable ce n’est pas qu’on mesure l’objectif en soi, mais qu’on demande aux intéressés s’ils ont bien respecté ce qu’on leur avait demandé de respecter. Et c’est partout pareil.
Pour lutter contre la pollution, on interdit aux viticulteurs d’utiliser des produits azotés lorsque la pente de leurs parcelles atteint un certain pourcentage, sans leur permettre d’utiliser des techniques comme l’enherbement, qui sont fait leur preuve. Déjà, nous avons pu relever la limite de la pente autorisée de 10 % à 15 % et obtenir des dérogations. Mais ce n’est pas facile parce que l’Europe nous dicte avec précision ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Alors que ce qu’il faut faire, c’est éviter qu’il y ait des polluants dans les rivières. Voilà pourquoi je souhaite que l’on passe d’un contrôle a priori sur les moyens à un contrôle a posteriori sur les résultats. C’est comme cela qu’on y arrivera.
Le débat sur la PAC, évoqué par M. Martial Saddier, sera délicat, car il s’agira de répartir des aides dans un budget qui n’est pas en expansion. Aujourd’hui, les producteurs les plus en difficulté sont les éleveurs – ce qui ne signifie pas que ceux qui sont en bonne santé, à savoir les céréaliers, sont responsables de quoi que ce soit ou doivent être montrés du doigt. Et quand les éleveurs arrêtent, ils cultivent des céréales. Et je peux vous le dire : on ne reviendra pas des céréales vers l’élevage car c’est beaucoup plus compliqué.
M. Alain Gest. Et la filière fécule ?
M. le ministre. Vous m’avez dit que le secteur souhaitait des aides couplées sur la fécule. On n’en aura pas, mais j’ai bien compris votre message.
L’élevage est plus difficile parce que les prix ont été stables et que le coût de production lié à l’alimentation a augmenté. L’achat de fourrages – le blé fourrager en particulier – a absorbé une partie de l’augmentation du prix des céréales produites en France, en Europe ou dans le monde – soja ou autres. La rentabilité du capital investi dans l’élevage est aujourd’hui plus faible que dans les céréales. Il en est de même de la productivité du travail dans l’élevage, tout simplement parce qu’il demande davantage de main d’œuvre.
Dans ces conditions, l’agriculteur qui le peut se lance dans une autre production. Donc, si on ne compense pas en partie par la dépense publique cette faiblesse de la rentabilité du capital et de la productivité du travail, la tendance actuelle se confirmera : on fera de moins en moins d’élevage et de plus en plus de céréales. Or ce n’est pas l’intérêt de la France. Si nous ne transformons pas nos protéines végétales en faisant de la viande, nous y perdons en termes d’emplois et de valeur ajoutée. Nous ne pouvons pas l’accepter.
Il va donc falloir procéder à une répartition. Aujourd’hui, la moyenne des aides de la PAC tourne autour de 268 euros l’hectare. Certaines exploitations sont au-dessus, d’autres sont au-dessous. Cette moyenne passera à 242 ou 243 euros parce que le volume de l’enveloppe du premier pilier va un peu baisser. Comme, en 2003, l’Europe a fait le choix du découplage total et de la convergence des aides, certaines exploitations vont y perdre, et d’autres y gagner.
Ceux qui sont autour de la moyenne – par exemple, les céréaliers qui reçoivent entre 240 et 260 euros par hectare – n’y perdront pas. Mais d’autres y perdront. Je vous suggère de vous référer aux cartes reproduites sur le site du ministère de l’agriculture. Les producteurs des zones intensives, qui ont des droits à paiement unique – DPU – élevés, comme le Grand Ouest, y perdront ; ceux qui sont au sud de la Loire et dans le grand bassin du Massif central, et ceux des zones extensives y gagneront.
Comment faire en sorte que ceux qui y perdent n’y perdent pas trop et éviter que leur viabilité économique ne soit remise en cause ? Je pense plus particulièrement aux éleveurs laitiers, qui sont déjà en difficulté. Et comment faire en sorte que le transfert qui s’opère persiste tout de même ? En effet, l’élevage allaitant, il faut bien le reconnaître, est le secteur où les revenus sont les plus faibles.
J’ai plusieurs leviers à ma disposition.
Le premier est la convergence. Plus je fais converger les aides, plus je baisse celles qui sont au-dessus de la moyenne et je remonte celles qui sont au-dessous. Plus je converge, plus je fais de la redistribution. L’Europe nous laisse entre 60 % et 100 % de convergence. Ceux qui veulent le plus de redistribution doivent aller jusqu’à 100 % de convergence. Mais si je fais cela sans opérer aucune correction, certains élevages et certaines zones y perdront beaucoup.
Voilà pourquoi, pour corriger et soutenir l’emploi dans l’élevage, je remonterai une partie des aides sur les cinquante premiers hectares. C’est mon deuxième levier. Tout le monde en profitera, les céréaliers comme les autres. Mais il s’agit d’abord de limiter les pertes là où il y a le plus d’emplois agricoles.
Le troisième levier est le couplage des aides. Il consiste à amener des aides directement sur des productions spécifiques, en particulier l’élevage : ovin, caprin, bovin. C’est déjà acquis. Dans l’enveloppe que j’ai négociée, le taux de ces aides peut aller jusqu’à 13 %. Aujourd’hui, nous sommes autour de 10,8 % et nous intégrerons une des primes qui existait déjà mais qui était payée sur le budget français, la prime nationale à la vache allaitante. On sera alors autour de 11,8 %. Il nous reste donc à répartir 1,2 %.
Mais passons au deuxième pilier.
D’abord, nous prendrons des MAE. À ce propos, il n’est pas possible d’en changer l’objectif puisqu’elles sont, par définition, de nature agro-environnementale. Elles sont liées à l’amélioration de la production, mais elles doivent également être écologiques. Lorsque j’ai dit que je souhaitais des MAE « système », c’est précisément pour pouvoir favoriser des dynamiques de groupements d’intérêt économique et écologique.
Ensuite, nous avons relevé les plafonds de l’ICHN – indemnité compensatoire des handicaps naturels. Par souci de simplification, nous proposerons de fusionner l’ICHN et la prime à l’herbe.
Voilà comment se présente le débat. Vous vous rendez compte que dès que l’on déplace un curseur, on modifie l’équilibre général. Voilà pourquoi j’ai dit que je voulais rééquilibrer sans déséquilibrer.
Prenez l’Aisne, dont un des députés, monsieur Jacques Krabal, est intervenu tout à l’heure. Une partie de ce département, la Thiérache, fait de l’élevage, alors qu’ailleurs on y fait des céréales. Les céréaliers ont peur qu’on ne leur en prenne trop ; ils sont contre la surprime pour les cinquante premiers hectares et désirent le moins de convergence possible. Mais ceux de la Thiérache ne sont sans doute pas du même avis.
En Alsace, où les exploitations ne dépassent pas, en moyenne 70 ou 72 hectares, la surprime aux cinquante premiers hectares garantira une partie des DPU. Mais elles font par ailleurs beaucoup de maïs irrigué, très haut en DPU. Il est donc probable que globalement, leurs aides baisseront tout de même.
Les situations sont très diverses. Un exemple : dans les Deux-Sèvres (Rires), il y a beaucoup de céréales, mais aussi un certain nombre de productions spécifiques : chèvres, lait, etc., qui font l’objet de plans et sur lesquelles nous allons continuer à travailler.
Les exploitations de montagne peuvent bénéficier de l’ICHN et de l’intégration du pastoralisme, sachant que les droits à paiement de base – DPB – ne seront pas calculés sur l’hectare, parce que cela coûterait trop cher.
Cela m’amène à la formation des louvetiers et au plan national loup, dont l’objectif n’est évidemment pas la réintégration de cet animal (Sourires) – monsieur Aubert, je connais votre ironie – mais son prélèvement ciblé. Aujourd’hui, il faut trois semaines pour tuer un loup, sans même savoir si c’est bien celui-là qui a attaqué. Les lieutenants de louveterie venant d’ailleurs, il faut attendre qu’ils arrivent et qu’ils prennent des repères, ce qui fait perdre du temps. C’est pourquoi nous avons travaillé avec les louvetiers et avec les fédérations de chasse – en particulier avec les associations communales de chasse agréées, les ACCA – pour former des chasseurs locaux, qui connaissent le terrain. Nous serons ainsi plus efficaces.
Mme Brigitte Allain s’est interrogée sur le plan EMAA et les méthaniseurs.
Investir exploitation par exploitation alourdit la responsabilité et les charges de l’exploitant sans résoudre les problèmes économiques et écologiques auxquels on doit faire face. Il faut donc raisonner beaucoup plus collectivement. Pour autant, il faut éviter que les méthaniseurs n’atteignent une taille gigantesque. Tout est une question d’équilibre.
Le plan EMAA aboutira par ailleurs à des changements réglementaires. Nous souhaitons en effet que le digestat – ce qui reste après la méthanisation – soit homologué comme fertilisant, ce qui suppose de renégocier la réglementation. Nous devrions avoir abouti avant la fin de l’année, voire dès le début de l’automne, à l’homologation des digestats.
Cela acquis, on pourra raisonner « azote total » : le digestat, à base d’azote organique, pourra être utilisé comme tout fertilisant et évitera les importations d’azote minéral. Autant utiliser de manière intelligente notre excédent d’azote organique. Cela va changer beaucoup de choses. Ainsi, dans la loi d’avenir agricole, il est prévu que l’on demande des déclarations de vente d’azote minéral. L’objectif est en effet de limiter ce dernier. Mais pour pouvoir le diminuer, il faut qu’on le mesure ; pour pouvoir le mesurer, il faut savoir qui en achète et qui en vend. J’espère que vous me soutiendrez. (Sourires)
Mais je m’aperçois que j’ai oublié de vous indiquer qu’une partie du couplage des aides, soit 2 % de celles-ci, pourra aller vers des productions de protéines végétales. C’est très important. Reste à savoir à qui iront ces aides.
J’en viens rapidement aux agrocarburants, que l’on peut aussi appeler les biocarburants – je n’ai pas de religion en la matière (Sourires). La seule chose dont je sois sûr, c’est que la France a été le premier pays à proposer que l’on fasse une pause en matière d’incorporation des bio ou agrocarburants. Maintenant, l’Europe va plus loin que nous. Nous sommes aujourd’hui autour de 7 %, et l’Europe veut redescendre à 5 %.
Je ne suis pas contre ces bio ou agrocarburants – je vous souhaite d’ailleurs de vous procurer le rapport qui vient de sortir sur le sujet. Mais il n’était pas réaliste d’imaginer qu’ils allaient remplacer le pétrole : nous faisons donc une pause sur l’incorporation. La défiscalisation sur ces bio ou agrocarburants durera encore trois ans. Pour autant je ne veux pas qu’on dise que cette filière serait inutile : elle a été utile, ne serait-ce que pour remplacer une partie de l’énergie fossile et pétrolière.
Nous avons choisi de limiter cette incorporation à 7 % – alors même que certains souhaitaient la porter à 12 ou 15 %. Quand la Commission européenne reviendra avec un projet, on en rediscutera de manière sérieuse. La France, je le rappelle, a été la première à propose une pause. Nous sommes parfaitement cohérents avec nous-mêmes.
Revenons à la méthanisation. L’Allemagne produit du maïs pour faire du méthane. Si nous sommes malins, avec des systèmes et des productions intercalaires, et que nous associons les intercommunalités qui produisent des déchets, nous pourrons mettre en place un système autonome en termes de matières carbonées pour utiliser les digestats. C’est en tout cas l’objectif sur lequel nous sommes en train de travailler.
Le plan sur les antibiotiques doit se poursuivre. Nous souhaitons nous diriger vers un système d’utilisation des antibiotiques spécifiques, avec un objectif de réduction des antibiotiques critiques – qui sont également utilisés par les humains – afin de lutter contre l’antibiorésistance envisagée de manière globale.
Deux rapports sont sortis sur la prescription et la vente de produits antibiotiques par les vétérinaires. Le réseau vétérinaire est essentiel à la protection sanitaire.
Mme Geneviève Gaillard. Il ne faut pas négliger l’action des vétérinaires ! (Sourires)
M. le ministre. En effet ! Des pays ont coupé le lien entre la prescription et la rémunération ; d’autres l’ont gardé. Or certains de ceux qui l’ont gardé ont baissé leur consommation autant, voire plus, que ceux qui ont coupé le lien. Nous ne voulons pas mettre en difficulté le réseau vétérinaire. Nous voulons le conserver, passer des contractualisations très claires sur les objectifs et changer la logique qui était celle que nous connaissions jusqu’à présent, à savoir des antibiotiques de manière préventive, que l’on pouvait consommer dans les aliments. C’est fini : on n’en utilisera qu’en cas de nécessité.
Nous reviendrons sur la loi d’avenir agricole qui, à la suite des accords passés avec Cécile Duflot, traitera de questions liées au foncier – CDCEA, gouvernance, SAFER, objectifs, etc.
Nous avons encore à travailler la question des nitrates, des pentes et des zones vulnérables. Un recours de manquement sur manquement a été engagé par la Commission auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne. La Commission considère en effet que, dans ses plans, la France n’a pas appliqué correctement ce qui lui avait demandé. Nous risquons d’être condamnés financièrement.
Le Gouvernement précédent avait fait des propositions. Nous avons essayé de les améliorer. Mais il faut que nous arrivions à ne pas payer pour les programmes que nous avons mis en place il y a cinq ou six ans. Aujourd’hui, nous en sommes au cinquième programme, à partir duquel nous allons passer à une démarche agro-écologique.
Nous souhaitons préserver ce qui existe aujourd’hui pour éviter d’être sanctionnés, puis négocier avec la Commission sur ce que nous allons faire. Nous voulons être jugés sur les résultats, et pas uniquement sur les moyens. Ce ne sera pas facile techniquement, entre les questions de pente, les autorisations de stockage des fumiers pailleux et celle des fumiers mous (Rires), qui concernent le Grand-Est de la France. Il nous faudra travailler dur.
Par ailleurs, je suis évidemment favorable à la reconnaissance mutuelle des produits phytosanitaires. Mais je tiens à faire remarquer que c’est la France qui, depuis des années, a fait des choix stratégiques plus contraignants que ceux de l’Europe s’agissant de certains produits. D’où le décalage que vous dénoncez. L’Europe fixe une norme minimale. Ensuite, chaque État membre peut aller au-delà. Nous allons donc nous engager ver la reconnaissance mutuelle. Un premier débat a eu lieu sur le sujet, alors que j’étais encore député européen. Le problème est de savoir comment nous allons nous adapter.
Un autre problème est bien plus compliqué à gérer : les grandes entreprises chimiques et phtytosanitaires n’ont pas forcément envie d’investir pour mettre au point des produits destinés à soigner certaines maladies. C’est un vrai problème, dans la mesure où l’on ne dispose pas d’alternatives, sinon globales et très délicates à manier. Les agriculteurs ne peuvent pas les utiliser, et ils protestent. En l’occurrence, madame Catherine Quéré, on ne parle pas de maladies orphelines, mais d’usages mineurs de produits sanitaires. Nous allons essayer de créer un fonds pour ces usages mineurs dans le cadre de la loi d’avenir.
M. David Douillet m’a demandé de parler du réseau Agrifaune. Nous n’en sommes pas directement acteurs, sauf par le biais de l’Office national des forêts. Mais, bien entendu, tout ce qui permet d’intégrer la chasse à la gestion globale de la diversité est digne d’intérêt.
Aujourd’hui, le problème qui se pose est lié aux dégâts du gibier qui font qu’il y a un conflit d’intérêt entre la chasse, les chasseurs et les agriculteurs. (Approbations diverses) La chasse doit évoluer vers une logique de service public plutôt que vers une logique de loisirs. Je prendrai l’exemple de la tuberculose bovine, qui a amené la Grande-Bretagne à procéder à l’éradication des blaireaux.
Plusieurs députés. En ville aussi ? (Rires)
Monsieur le ministre. Nous en connaissons tous, à la campagne comme en ville… (Rires)
Il ne s’agit pas de remettre en cause la chasse, mais de se demander quelle est son utilité dans l’équilibre et la régulation des espèces. Dans certaines régions, la chasse « loisir » prend le pas sur la chasse « équilibre et biodiversité ». C’est le problème que nous aurons à gérer dans les années qui viennent.
M. Guillaume Chevrollier a soulevé les problèmes que rencontrent certains producteurs de lait avec Lactalis. Le Gouvernement avait décidé d’engager une négociation avec un médiateur et de forcer la grande distribution à débloquer 25 euros de plus par millier de litres pour les producteurs. La médiation a été acceptée et l’accord conclu. Or aujourd’hui, ce n’est plus la grande distribution qui pose problème, mais les transformateurs qui ne veulent pas donner ces 25 euros aux producteurs et qui en réservent une partie. C’est le cas de Lactalis et d’autres, qui prétendent que ce sont des avances qui seront remboursables plus tard. Mais ce n’est pas l’esprit de l’accord, sur lequel le ministre s’était engagé.
Nous avons reçu des agriculteurs de Mayenne qui, à juste raison, sont en conflit avec Lactalis qui, en outre, ne respecte pas les contrats passés. Nous devrons discuter ensemble, à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la loi d’avenir, sur d’éventuelles corrections à apporter au mécanisme de contractualisation de la LMA – la loi de modernisation de l’agriculture. En effet, quand les agriculteurs de Mayenne protestent en disant qu’ils n’ont pas obtenu ce qui avait pourtant été négocié, on leur répond qu’on ne ramassera pas leur lait ! Il y a là un vrai souci.
J’ai parfaitement conscience de la situation, monsieur le député. Mais sachez qu’à l’origine, il s’agit un accord sur la revalorisation du prix du lait, qui, dans 80 % des cas, est appliqué de façon satisfaisante. Dans d’autres endroits, son application pose problème. En l’occurrence, Lactalis met en avant les volumes de lait qu’elle achète pour ne pas accepter davantage en termes de prix. Il faut tout de même savoir que Lactalis fait du volume pour exporter de la poudre de lait sur le marché international. Ainsi, l’entreprise se fait de l’argent en exportant, mais ne veut pas en redonner aux agriculteurs. Nous serons donc ensemble pour forcer les industriels et les transformateurs à répercuter cette hausse du prix du lait qui a été acceptée par la grande distribution.
Monsieur Philippe Noguès, les négociations entre l’Europe et les États-Unis sont un sujet majeur. En effet, il n’est pas question de laisser remettre en cause une conception de l’agriculture qui fait que l’on s’appuie sur des normes sanitaires, sociales, de bien-être animal, et surtout sur des normes liées à la définition des origines et de la qualité. Cela dit, aucun accord ne sera pris dans les mois qui viennent. Nous négocions ainsi depuis cinq ans avec le Canada et il n’y a toujours pas d’accord. Avec les États-Unis, les négociations n’aboutiront pas en cinq ou six mois.
Mandat a été donné à la Commission européenne. Ce mandat porte, notamment, sur les indications géographiques protégées – IGP – ainsi que les questions sanitaires et environnementales. Mais je vous rappelle que la Commission sera renouvelée l’année prochaine. Nous avons donc intérêt à être vigilants jusqu’au bout. Je connais la tendance de certains libéraux à considérer qu’une fois que l’on a conclu un grand accord sur l’industrie automobile, les grands services, etc., on peut s’en remettre à plus tard pour l’agriculture.
On ne peut pas demander à nos agriculteurs de faire des efforts et de respecter certaines contraintes, et ouvrir nos marchés à des agriculteurs qui ne les respecteraient pas. On marche parfois sur la tête ! Encore une fois, les libéraux ne sont pas avares de contradictions. Ils sont les premiers à insister sur le bien-être animal, à rajouter des normes… mais les premiers à dire que c’est le commerce qui fait avancer les choses. Il faudra que nous soyons vigilants ensemble.
Mme Valérie Lacroute est intervenue sur l’agro-écologie et l’agro-foresterie. Oui, l’agro-foresterie fait partie de l’agro-écologie. Nous devrons étudier comment l’intégrer. Les systèmes forestiers sont intéressants, puisqu’ils concourent à la biodiversité, favorisent la fixation de l’eau, permettent la production d’énergie, voire de fruits et contribuent à lutter contre certains parasites.
L’INRA tiendra un colloque début octobre, précisément pour mobiliser la recherche française autour de la logique de l’agro-écologie. Nous travaillerons, à partir du rapport de Marion Guillou, pour faire en sorte de générer de la connaissance.
Il faut se rendre compte que notre productivité et notre compétitivité sont liées à notre niveau de connaissance, comme à la maîtrise technique des écosystèmes. C’est en effet ce qui nous permettra d’économiser sur les intrants et donc d’être, en marges brutes et en marges nettes, beaucoup plus performants que d’autres. D’où l’intérêt d’investir dans ce domaine.
M. Bertrand Pancher m’a posé une question sur les stations météos. Je vais regarder ce qu’il en est, car je ne peux pas vous répondre maintenant.
Ensuite, je suis d’accord pour l’Observatoire des maladies du bois…
Mme Geneviève Gaillard. Et l’Observatoire de la biodiversité agricole ?
M. le ministre. J’y suis également favorable… (Sourires)
Sur la question des semences et des certificats d’obtention végétale, j’ai déjà dit plusieurs fois que nous avions fait évoluer les choses. Mais il est clair que l’on a besoin de financer une partie de l’obtention végétale. Le débat est en effet assez simple : il se joue entre le brevetage du vivant et l’obtention végétale. Certains disent qu’il ne faut pas payer pour l’obtention végétale. Mais si on ne finance pas l’obtention végétale, on devra payer pour le brevetage du vivant.
En même temps, nous sommes en train d’élargir l’éventail des semences qui passeront dans le domaine public et qui pourront être multipliées par les agriculteurs sans avoir à rémunérer la recherche. Nous allons par ailleurs améliorer le repérage de l’ensemble des semences, pour valoriser un certain nombre de semences anciennes qui ont de l’intérêt dans l’adaptation aux écosystèmes.
M. Martial Saddier m’a interrogé à propos de l’affichage environnemental. Je pense qu’il est en effet nécessaire de renvoyer au consommateur des éléments d’information sur l’impact environnemental des produits. Malgré tout, si le principe de cet affichage me semble positif, je pense que nous aurions intérêt à cibler l’information délivrée.
Un consommateur s’intéresse d’abord à la quantité du produit et à son prix. Ensuite, il peut regarder s’il contient ou non des OGM, si des produits phytosanitaires ont été utilisés, s’il est ou non biologique et quelle est son origine géographique. Pourquoi pas son taux de carbone ? Reste que si nous voulons être compris, nous devons établir des priorités et nous interroger sur l’information que devra assimiler le consommateur avant de décider ou non d’acheter le produit. Parce qu’à force de multiplier les informations sur les produits, le consommateur risque bien de s’y perdre.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je conseille à Sophie Errante et à Martial Saddier, qui préparent un rapport sur l’affichage environnemental et les résultats de l’expérimentation qui a été menée en la matière, à le remettre très officiellement, quand il sera terminé, au ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation que je remercie en notre nom à tous.
7. Audition de Mme Laurence Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), sur le débat sur la transition énergétique et écologique (11 septembre 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Laurence Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), qui a animé le comité de pilotage du grand débat national sur la transition énergétique et qui remettra prochainement au Gouvernement la synthèse de ce débat, adoptée par le Conseil national du débat, le 18 juillet dernier.
Mme Laurence Tubiana, directrice de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). Je vous remercie de me recevoir au sein de votre Commission. À l’issue du débat national sur la transition énergétique, qui s’est clos le 18 juillet, votre Assemblée examinera un projet de loi dont M. Philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé le dépôt au printemps 2014.
À la différence d’autres débats sur l’énergie, menés généralement par des groupes d’experts et consacrés principalement à la production de l’énergie, celui qui vient d’avoir lieu a eu une ampleur particulière, abordant aussi bien l’avenir probable ou souhaitable de la demande d’énergie que le mix énergétique.
Le débat s’est déroulé à plusieurs niveaux. Au sein du comité de pilotage, j’étais chargée de la facilitation du débat du Conseil national, qui réunissait des collèges hérités du Grenelle de l’environnement et des parlementaires, dont le président Chanteguet et d’autres membres de votre Commission, ainsi que des représentants traditionnels du dialogue social, comme le MEDEF et les syndicats de salariés, des représentants des collectivités locales à différents niveaux et des associations environnementales ou généralistes – comme les associations de défense des consommateurs ou des familles –, des associations de développement et des associations qui travaillent auprès des ménages pauvres. Ce conseil de 612 membres, qui se réunissait chaque mois, était assorti de huit groupes de travail examinant à un rythme assez intense quelques grandes questions.
Le débat était décliné sous plusieurs formes, notamment dans les régions et les territoires, où certains d’entre vous y ont participé. Sans doute l’échange mené à ces niveaux a-t-il été plus dynamique et innovant qu’au niveau national, où il était plus traditionnel.
Il s’est déroulé de novembre à juillet au niveau national et de janvier à la fin juin dans les régions. Au total, plus de 1 000 réunions publiques ont été tenues, auxquelles ont participé près de 200 000 personnes. Un moment fort du débat dans les territoires a été la journée citoyenne du 25 mai, dont la mise en place a été surveillée par l’Office danois des technologies, organisme précédemment lié au Parlement danois et spécialisé dans l’observation des méthodes participatives. Ce débat citoyen réunissait 100 citoyens par région, choisis selon une méthode d’échantillon et sans lien avec le débat principal – ni militants, ni représentants professionnels, par exemple –, qui ont été informés et ont débattu durant une journée sur de grandes questions telles que la demande énergétique, les modes de vie, le mix énergétique ou les énergies renouvelables.
Le débat, présenté par un site Internet remarquable, a été très riche et a donné lieu à de nombreux travaux, dont témoignent des cahiers d’acteurs précis et nourris, et a bénéficié de nombreuses contributions d’experts, qui constituent un matériel très intéressant pour les chercheurs – parmi lesquels je me place. Je suis notamment persuadée que Sciences Po, ma maison-mère, lancera un travail de recherche sur cet extraordinaire matériel.
Parallèlement au débat centralisé qui s’est tenu à Paris et où la direction des grandes entreprises et les représentations traditionnelles du dialogue social ont exposé leurs orientations, celui tenu au niveau local a présenté des déclinaisons différentes et décalées. La réunion, le 8 juillet, de ces deux débats, a mis au jour des perspectives intéressantes quant à la vision de l’avenir, certaines régions présentant une vision plus dynamique et positive de la transition énergétique que celle qui ressortait du débat national, marquée par des craintes pour la croissance économique et l’emploi.
Il s’agit d’une première, car le travail a été mené à différents niveaux et a porté sur l’horizon à long terme de 2050. La feuille de route était celle qu’avait donnée le Président de la République en septembre dernier : respecter les engagements français, internationaux et européens, diversifier le mix énergétique pour réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité, dynamiser les énergies renouvelables et, surtout, reprendre l’énorme effort d’efficacité énergétique qui avait été engagé en France dans les années 1970, entre le premier et le deuxième chocs pétroliers, notamment dans les bâtiments et les véhicules. Il s’agit donc de rallumer cet effort de transformation technologique et de raison dans les comportements, afin de nous libérer d’une facture énergétique toujours plus lourde.
J’en viens aux résultats du débat, et tout d’abord aux points consensuels.
Un consensus s’est dégagé pour respecter les objectifs français pour 2020 et décarboner profondément l’économie française d’ici 2050, notamment en éliminant complètement les produits fossiles – charbon ou pétrole – de la production d’électricité ou en parvenant à capturer et à stocker le carbone, ce qui est du reste une perspective encore lointaine en termes de faisabilité économique et technique.
Un autre consensus s’est exprimé pour faire porter l’effort sur les secteurs du bâtiment et des transports.
Autre point de consensus : bien que l’électricité soit appelée à jouer un rôle croissant dans l’ensemble de l’économie pour permettre un développement plus sobre en carbone, une grande modération s’impose pour parvenir à réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre.
Sur la base de ce constat, le secteur du bâtiment joue le rôle d’un test de vérité. Qu’ils optent pour la sortie du nucléaire ou pour l’augmentation du parc nucléaire, tous les scénarios que nous avons envisagés, produits par des groupes de recherche, des entreprises comme ERDF ou des agences publiques comme l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), partagent la même vision de l’effort à produire, notamment dans les quinze premières années, pour engager cette transition. Cet effort porte essentiellement sur la rénovation thermique des bâtiments. Dans ce domaine, le chiffre de 500 000 logements à rénover par an, bien que difficile à atteindre, est cohérent avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les énergies renouvelables ont donné lieu à un débat plus mûr que voici quelques années : j’étais alors conseillère pour l’environnement de Lionel Jospin et l’on s’opposait alors autour de leur principe même. La discussion, désormais rationnelle, a porté sur le coût supportable de ces énergies, sur la vitesse de leur déploiement et sur le partage entre ce qui relève de l’autoconsommation et des énergies réparties. Ce débat a donc connu une maturation, comme cela a été également le cas pour le débat sur le nucléaire.
Si l’importance de la rénovation thermique fait consensus, il reste néanmoins à décider comment mobiliser à cette fin les différents niveaux de financement et à quels taux les grands travaux d’économie d’énergie à réaliser dans l’habitat tant collectif qu’individuel pourront être rentables. Au-delà de l’accord qui s’est fait jour sur le volume à engager jusqu’à 2050 dans ce domaine, le travail doit donc être achevé pour ce qui concerne les modalités de financement.
S’agissant des transports, des orientations intéressantes ont été évoquées, concernant des usages assez différents de la voiture. Les grands constructeurs automobiles français ont déjà une vision très moderne de l’évolution de leur métier. Le parc de voitures devrait désormais s’adapter aux nouveaux usages et des progrès devraient intervenir en matière de consommation d’essence, sous l’effet notamment de l’émergence du véhicule électrique, du développement de l’autopartage et de l’apparition d’une conception nouvelle du transport collectif.
Quant au mix énergétique et au nucléaire, la diversification répond à un objectif de sûreté dans un contexte de vieillissement du parc des centrales nucléaires. La discussion a donc porté sur la sécurité énergétique, qui suppose à la fois la montée en puissance des énergies renouvelables et la modération de la consommation.
La précarité énergétique a été abordée, d’une manière classique, en termes de prix de l’énergie pour les ménages pauvres, mais il est apparu qu’il s’agissait là d’une course-poursuite sans fin. Les tarifs sociaux jouent certes un rôle, mais ils ne sont pas un outil durable et cette demande doit être traitée d’un point de vue structurel, notamment en donnant la priorité à la rénovation thermique des habitations les moins bien isolées. Il s’agit donc moins d’abaisser le prix de l’énergie pour les ménages pauvres que de rendre ces ménages beaucoup plus indépendants de l’usage de celle-ci, avec des maisons plus efficaces et moins de transports contraints, ou tout au moins des transports plus économes. Les associations qui s’occupent des précaires ont indiqué que la précarité énergétique, souvent conçue comme concernant les ménages les plus pauvres, pouvait désormais toucher des couches moyennes qui s’appauvrissent. La modération de la consommation par l’efficacité doit donc permettre d’assurer un reste-à-vivre aux ménages les plus pauvres comme à ceux qui sont gagnés par la précarité.
Il y a dans la transition énergétique française à la fois une politique nationale à construire, voire à reconstruire, et à développer, une mobilisation des acteurs économiques, qui devraient y voir des opportunités d’investissement et de marché, et une dynamique locale – la gouvernance locale de l’énergie. Malgré la décentralisation de certains éléments, le modèle français est plus centralisé que celui prévalant en Suède, en Allemagne, au Danemark, en Espagne ou au Royaume-Uni. Certaines ressources, par exemple certaines énergies fatales ou l’énergie répartie – comme le gaz produit à partir de déchets ou le biogaz – sont perdues, faute des compétences locales pour les utiliser.
La maîtrise de la consommation est par ailleurs très liée à des facteurs structurels, comme l’urbanisation, l’étendue des territoires et la prise en charge des travaux au niveau local. Tout cela plaide pour une approche localisée de la question de l’énergie, surtout quand on l’aborde du point de vue de la demande. Les collectivités locales, comme les régions Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville de Grenoble ou le Grand Lyon pensent à leurs scénarios pour 2050 et ont engagé des actions souvent assez complètes en termes de prospective et de modes de financement. Une conférence sur le financement de la transition énergétique est ainsi sur le point de se tenir – ou vient de se tenir – en région Pays de la Loire, avec la participation des acteurs financiers. Cette dynamique locale est très nouvelle et répond à une demande des citoyens, comme nous avons pu le constater lors de la journée citoyenne. Le projet de loi devra donc aborder la décentralisation de la gestion de l’énergie.
Les points de conflit sont de deux types. Les premiers sont liés à l’incertitude, car tous les paramètres ne sauraient être maîtrisés, a fortiori à l’horizon 2050. Ainsi, on évaluera différemment la quantité d’énergies fossiles qu’on pourra conserver dans l’économie française selon qu’on sera pessimiste ou optimiste quant aux perspectives de capture ou de stockage du carbone. Dans le premier cas, la solution réside dans la sobriété de la consommation énergétique et dans la part importante des énergies décarbonées – nucléaire, renouvelables ou biogaz. Dans le second, on peut conserver une partie significative d’énergie fossile, car on pourra en faire une utilisation propre. Cette incertitude économique et technologique a introduit un dissensus face au scénario que le Gouvernement devrait adopter pour proposer une vision aux acteurs économiques. Il a ainsi été clairement proposé de faire progresser les mesures qui paraissent indispensables et de réviser le scénario au fur et à mesure que certaines incertitudes seront levées par les évolutions technologiques ou l’absence de solutions.
Certaines positions demeurent par ailleurs inconciliables – les partisans de la sortie du nucléaire, par exemple, ne sont pas disposés aujourd’hui à accepter l’idée que le mix énergétique conserverait 50 % de cette énergie. En outre, le consensus qui s’est formé sur la nécessité de la diversification ne dispense pas le Gouvernement de trancher sur la rapidité de cette dernière. Cela dit, le dissensus est sain et souhaitable dans une démocratie. De fait, le débat a permis de faire apparaître les points constituant une base commune et ceux qui se révèlent contradictoires et irréconciliables.
Le Gouvernement devra également trancher pour enclencher l’indispensable mouvement de rénovation des bâtiments, en définissant ce qui doit relever de la subvention, de crédits adaptés ou de pratiques différentes de la part des banques. L’obligation de travaux n’a pas fait l’objet d’un consensus, car les collectivités locales et certaines associations souhaitaient son instauration, conditionnée par l’existence de financements permettant d’éviter d’en faire supporter la charge aux ménages en étalant la dépense dans le temps, tandis que d’autres acteurs étaient hostiles à cette idée.
Il se pose un problème de cohérence des politiques au niveau national et au niveau local. En effet, les grands déterminants de la consommation et de la production d’énergie sont pour une bonne part structurels – il s’agit notamment des réseaux de distribution d’énergie, des politiques d’urbanisme et des plans de déplacement, qui correspondent à des politiques de très long terme et exigent de la cohérence. De bonnes pistes existent pour atteindre celle-ci sur le fond, non par une redistribution des compétences, mais pas la création d’un cadre de concertation, notamment au moyen des contrats de plan État-région, qui obligent les différents niveaux à adopter une vision structurelle et organisée de l’évolution de la consommation et de la production d’énergie à moyen et à long terme. La rénovation des schémas régionaux sur l’énergie et le climat offre précisément un tel cadre, que tous les acteurs sont prêts à revisiter et à développer.
Le débat, plutôt que de porter sur la nature de l’énergie nécessaire, a mis au jour un point de consensus sur la flexibilité et la capacité à hybrider différents vecteurs – le vecteur gaz et le vecteur électrique, par exemple. L’important est de disposer d’un système énergétique dont les réseaux de production et de distribution permettent le passage d’une énergie à l’autre et des usages différents, comme le stockage de l’électricité via l’eau ou le gaz, ou la combinaison de formes complémentaires telles que la voiture électrique et la production d’électricité domestique. Il convient donc d’adopter une vision beaucoup plus souple, qui permette cette hybridation des différentes énergies. C’est là une direction très intéressante sur les plans économique et technologique, ainsi que pour la déclinaison la plus adaptée possible au territoire de la production et de la distribution d’énergie.
Quant aux « conclusions » du débat – car le MEDEF s’est opposé à l’emploi du terme de « recommandations » –, elles seront remises en plusieurs étapes.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il ressort du débat que, pour atteindre le « facteur 4 », c’est-à-dire la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, la consommation d’énergie finale devrait être divisée par 2 d’ici là. Cette question devra être abordée dans le projet de loi et sera du reste un point fort des orientations que retiendra le Gouvernement.
M. Jean-Yves Caullet. Je vous remercie, madame la directrice, au nom du groupe SRC, pour votre exposé qui montre bien que le débat donc vous venez de nous rendre compte n’est pas un aboutissement, mais qu’il s’inscrit dans une démarche continue qui ne fait que commencer.
Je souligne – permettez-moi ce clin d’œil – que le niveau local n’est pas le niveau régional, même si l’on perçoit moins cet échelon depuis Paris. Le débat régional est d’ailleurs loin de toucher tout le monde, car il existe aussi un centralisme régional, qui n’est pas meilleur que le centralisme national.
A-t-il été envisagé, notamment à propos du nucléaire, de réserver l’énergie issue de certaines sources à des usages particuliers, afin de compenser, dans le cas par exemple des industries électrodépendantes, les inconvénients d’une ressource par son intérêt pour un secteur donné ? Une telle réflexion est-elle engagée à propos du mix énergétique ?
Vous avez indiqué à propos de la précarité énergétique qu’il fallait rendre économes en priorité les modes de vie de nos concitoyens les moins fortunés. Or, pour faire des économies, il faut d’abord pouvoir investir : la loi devrait veiller à remédier à ce problème. Que pensez-vous des normes d’excellence s’appliquant à la consommation énergétique dans les bâtiments et dont le coût peut dissuader certains propriétaires de faire de travaux ?
Au-delà de l’aménagement du territoire, l’aménagement de notre fonctionnement institutionnel pourrait faire baisser considérablement la consommation d’énergie, en particulier grâce aux technologies numériques. Y a-t-il des perspectives d’économies dans ce domaine ?
La mobilisation des compétences locales en fonction des potentiels locaux est très importante et les échelons de décision en matière d’affectation des moyens devraient s’intéresser moins à l’importance démographique des zones où ils agissent qu’à l’efficience de leurs actions et de leurs investissements.
Les questions de logistique doivent être revues : après avoir appris, durant cinquante ans, à diffuser des produits manufacturés dans tous les foyers, nous n’avons pas encore réussi à récupérer symétriquement par le même circuit ce qui peut être valorisé.
En matière de stockage, qu’en est-il de l’hydrogène, qui pourrait permettre de recréer les conditions de la photosynthèse pour ce qui est de la réduction du gaz carbonique et fournir un carburant non producteur de gaz à effet de serre ?
Enfin, vos travaux ont-ils été jusqu’à interroger le modèle de propriété, fondé sur l’usus et l’abusus ? Qu’en est-il de la liberté de choix d’un mode de vie liée à une égalité d’accès à certains biens, dont l’énergie ? Faut-il subordonner la possibilité de s’installer à certains endroits à l’autonomie énergétique ? Comment l’égalité et la liberté s’articulent-elles dans un contexte de rareté ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle qu’un groupe automobile allemand conduit actuellement, avec le soutien de deux groupes français – Schneider et Alsthom – une expérimentation sur l’hydrogène : l’électricité permet de produire de l’hydrogène qui, mélangée au CO2, produit du méthane.
M. Jean-Marie Sermier. On sent que la réflexion n’en est encore qu’à son début et que beaucoup de travail reste à faire sur le texte de loi qui nous sera présenté au début de 2014. Vous avez précisé que certains objectifs faisaient l’objet d’un consensus et que les mentalités avaient changé. Sans doute le Grenelle de l’environnement n’y est-il pas pour rien, au-delà des avancées technologiques évidentes qui ont permis à la part des énergies nouvelles de passer de 6 % à 13 % : chacun comprend désormais que l’environnement et l’énergie sont des éléments essentiels du devenir de notre planète.
Il faut également évoquer les moyens d’atteindre ces objectifs, notamment la fiscalité écologique. Celle-ci ne doit pas être punitive, mais incitative, et la France doit travailler avec les autres pays membres de l’Union européenne pour éviter des distorsions de concurrence et une perte de compétitivité de nos entreprises. Le produit d’une éventuelle fiscalité écologique doit en outre être affecté intégralement à la transition écologique, et non au budget de l’État : l’affectation de ces recettes au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, évoquée par le Président de la République, n’est pas le meilleur signe à donner. Cette fiscalité doit en outre être compensée par une baisse des charges pesant sur le coût du travail, afin de ne pas pénaliser les entreprises, et ne doit pas entraîner de perte de pouvoir d’achat des classes moyennes.
Le groupe UMP est par ailleurs défavorable à l’augmentation du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le diesel, qui a bénéficié d’efforts très importants de la part des constructeurs français, auxquels il ne faut pas accrocher un boulet qui leur serait fatal.
Il convient d’avoir une réflexion plus large sur la contribution climat-énergie, portant notamment sur la taxe carbone. Une approche globale est nécessaire, mais nous redoutons que certains gouvernements ne se contentent d’ajouter une nouvelle taxe sans s’interroger sur les progrès de cette contribution. Le but n’est pas, en effet, de créer des impôts, mais d’amener nos concitoyens à changer leurs mentalités.
Nous souhaitons enfin que la mise en place de la fiscalité sur la biodiversité, qui est une réalité depuis l’application du Grenelle de l’environnement, puisse elle aussi s’articuler en cohérence avec les dispositifs existants en matière de protection, sans préjudice des dispositifs de compensation et d’évaluation déjà en vigueur.
M. Bertrand Pancher. Contrairement à mes craintes, le débat sur la transition énergétique a été de qualité, car les débats territoriaux ont permis de toucher le grand public, qui était le grand absent du Grenelle de l’environnement. Cependant, je rappelle, au nom du groupe UDI, que certaines personnalités qui ont participé à ces travaux déplorent, à l’instar d’un responsable d’organisation environnementale que je recevais hier, qu’« … une montagne ait accouché d’une souris... ». Vos interlocuteurs étaient les mêmes que ceux du Grenelle de l’environnement, qui a donné lieu, au terme de consensus parfois difficiles et de certains dissensus, à des décisions claires. Pourquoi n’êtes-vous pas parvenus à formuler des recommandations précises ? Souvent, en effet, votre débat s’est traduit par des constats de désaccord. Il revient maintenant au Gouvernement d’aller puiser dans ses synthèses pour prendre des décisions.
Le bâtiment, par exemple, était par excellence le domaine où l’on attendait des progrès. Pourquoi aucun accord n’a-t-il été trouvé pour créer, comme partout en Europe, un financement à taux très réduit ? Quelle date butoir allez-vous fixer à l’obligation de rénovation thermique ?
Dans d’autres domaines, un souhait de progresser s’est parfois exprimé mais, souvent la messe était déjà dite, comme dans le domaine du transport, où les arbitrages de l’État ont été rendus au titre du schéma national des infrastructures de transport, lequel aurait pourtant pu faire l’objet d’une discussion dans la perspective de la transition énergétique. Comment la question du transport a-t-elle été raccrochée au débat ? Assistant l’an dernier à la Conférence environnementale, je m’interrogeais déjà sur l’absence de ce secteur, qui est pourtant le deuxième pilier de l’économie verte.
Pour ce qui est enfin des énergies renouvelables et de la baisse de la consommation énergétique, EDF se comporte comme un État dans l’État et tout le monde a intérêt à ce que perdure la consommation d’électricité – EDF, les collectivités et même les syndicats, car le comité d’entreprise d’EDF reçoit 1 % du budget.
M. Gabriel Serville. Au nom du groupe GDR, je compte, madame la directrice, sur la position que vous occupez au sein de certaines organisations internationales telles que l’IDDRI et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) pour soutenir la Guyane, où le débat s’est tenu et d’où les conclusions de celui-ci nous parviendront prochainement.
La forêt amazonienne, qui joue un grand rôle dans la capture et le stockage du gaz carbonique, est menacée par le fléau de la déforestation sauvage pratiquée par les orpailleurs clandestins venus du Brésil et contre lesquels le Gouvernement a engagé l’opération Harpie, menée par la gendarmerie et l’armée pour rétablir l’ordre républicain et faire respecter la souveraineté nationale. Cependant, aussitôt les opérations terminées, les orpailleurs reviennent.
Au Brésil, où je me suis rendu du 13 au 20 juin, j’ai rencontré des parlementaires et des gouverneurs dont certains m’ont assuré qu’ils mettraient tout en œuvre pour remplacer le député chargé d’introduire à la Chambre des députés le texte du traité de coopération de 2008, déjà ratifié par la France et en attente de ratification par le gouvernement brésilien. Avant d’être examiné par les deux chambres du Parlement brésilien, le texte doit être validé par la Commission des affaires extérieures et la Commission d’intégration du bassin amazonien. Si cela a été fait au mois d’août, le texte se heurte à la réticence de certains parlementaires de l’État de l’Amapá, qui retarderont autant qu’ils le pourront cette ratification.
En marge du débat sur la transition énergétique et sachant que tous ces phénomènes sont intimement liés, pourriez-vous peser auprès de la communauté internationale pour faire entendre l’idée qu’il est nécessaire de rétablir l’ordre sur le territoire de la Guyane afin d’épargner la forêt guyanaise ? Ce n’est pas simple, car la diplomatie s’efforce d’avancer avec ses propres armes. Votre concours serait donc un poids supplémentaire permettant de progresser dans le processus mis en place.
M. Jacques Krabal. J’estime, au nom du groupe RRDP, que ce débat sur la transition énergétique a été un premier succès. Il a mobilisé beaucoup de monde dans les régions : plus de 2 000 personnes y ont ainsi participé en Picardie, ce qui est une première sur un tel sujet. D’ailleurs, les organisateurs ont fait part de leur volonté de tout mettre en œuvre pour que les citoyens et tous les acteurs locaux – syndicalistes, chefs d’entreprise, élus – soient associés.
Mais la gestation du processus n’est pas terminée et il faudra attendre la Conférence nationale sur l’environnement, qui aura lieu dans dix jours, et le projet de loi annoncé pour pouvoir juger des résultats.
Cela dit, une idée importante a déjà émergé : la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas, sachant que la fiscalité énergétique ne doit pas être additionnelle.
S’agissant de la réduction de l’effet de serre d’ici 2050, est-il cohérent d’intégrer dans le mix énergétique les gaz et huiles de schiste ?
Enfin, comment conjuguer la transition énergétique au niveau européen ?
M. François-Michel Lambert. La dimension européenne est en effet essentielle.
Je pense, au nom du groupe écologiste, que ce débat a atteint son premier objectif, qui est de démontrer que l’énergie peu chère est une chimère, surtout si elle est d’origine nucléaire. Les Français prennent conscience que l’engagement dans cette transition énergétique est indispensable et l’idée que la France est protégée de l’augmentation de l’énergie grâce au nucléaire n’est plus d’actualité.
Mais cette transition suppose une politique de long terme. Les éléments structurels en sont les infrastructures de transport de l’énergie, notamment du gaz, ainsi que de transport des personnes, qui sont parfois négligées. À cet égard, l’urbanisme français, fait de mitage et de dispersion urbaine, est une contrainte. Comment ces infrastructures ont-elles été précisément prises en compte ?
Par ailleurs, il existe de mauvais choix : les gaz de schiste ou le diesel – qui ne fait que repousser à plus tard la réalité à laquelle nous sommes confrontés en provoquant 15 000 à 30 000 morts par an.
D’autre part, la répartition des flux financiers de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au profit des énergies renouvelables a permis la confiscation de plusieurs millions ou centaines de millions d’euros par quelques-uns sans, finalement, atteindre les objectifs recherchés. Une personne a pu ainsi bénéficier d’un chèque de 500 millions d’euros. M. Jacques Bucki, maire de Lambesc et représentant de l’Association des maires de France (AMF) dans vos débats, a proposé à cet égard un autre modèle avec des boucles redistributives de flux financiers pour améliorer les performances et replacer les collectivités locales et les citoyens au cœur de l’action et de la décision. Comment avez-vous pris en compte cette proposition ?
En outre, il faut sortir du modèle de l’économie linéaire surconsommatrice de matière, mais aussi d’énergie, et entrer dans un nouveau modèle de prospérité, reposant sur une économie circulaire, s’appuyant sur l’écoconception, l’économie de la fonctionnalité – c’est-à-dire fondée sur l’usage plutôt que l’acquisition du bien –, l’écologie industrielle, la réparation, le réemploi et le recyclage, qui sont moins consommateurs d’énergie. Comment avez-vous pris en considération cette approche, qui peut apporter des réponses structurelles, importantes en termes de performance énergétique ?
Malgré ce que peuvent dire les médias, nombre d’entreprises s’engagent déjà dans la transition énergétique. C’est le cas par exemple de GRDF, qui a annoncé qu’en 2050, la totalité du gaz qui circulera dans ses 30 000 kilomètres de tuyaux sera renouvelable ou de synthèse. De même, GDF-Suez s’est engagé pour 2030 à distribuer 30 % de biométhane, au lieu des 20 % prévus par l’État, et EDF Optimale Solutions est également très active.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les entreprises s’engagent et les territoires aussi !
M. Christophe Bouillon. Merci, madame la directrice, pour votre présentation, qui traduit la densité des débats auxquels vous avez participé. Je suis heureux que la question du nucléaire ait été abordée, ce qui n’avait pas été le cas au cours du Grenelle de l’environnement.
La transition énergétique doit relever trois défis : un défi économique, qui est celui de la compétitivité ; un défi social, vis-à-vis de la précarité énergétique ; et un défi écologique, qui est la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Y a-t-il un équilibre entre ceux-ci dans les différents scénarios que vous avez envisagés ?
Par ailleurs, toutes vos recommandations sont-elles de nature normative ? Y a-t-il eu d’autres débats en Europe sur le sujet ? Avez-vous examiné la question des interconnexions ?
Enfin, quelle est la hauteur de la marche entre la transition énergétique et la transition écologique ?
M. Claude de Ganay. Je vous remercie également, madame la directrice, pour la clarté de votre exposé.
Mais j’ai le sentiment que ce débat sur la transition énergétique se solde par un échec, ce que nous ne pouvons que regretter, car ce sujet est déterminant pour notre croissance dans les cinquante prochaines années. Il a été dès le départ sacrifié sur l’autel des promesses électorales, alors qu’il aurait dû reposer sur l’idée qu’aucun pays ne peut connaître de croissance économique sans augmentation de sa consommation énergétique, même si celle-ci doit tendre vers plus de sobriété et faire appel progressivement aux énergies renouvelables.
L’un des éléments essentiels voulus par le Président de la République se résume à la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production énergétique, ce qui engendrera inévitablement une perte de notre compétitivité sur la scène internationale. Le cadre politique préalable aux discussions a conduit plusieurs acteurs à refuser certaines recommandations issues de celles-ci.
Pensez-vous également que ce débat a été abordé de façon biaisée ? Et que la condition nécessaire à l’acceptation d’une véritable transition énergétique ne pouvait passer que par une phase de réflexion approfondie, indépendante et objective sur la place du nucléaire dans notre économie ?
M. Jean-Pierre Vigier. Le rapport de 2012 de votre institut souligne la nécessité d’une réflexion et d’une coopération européennes et internationales pour lutter contre le réchauffement climatique et les pollutions atmosphériques. Si la France avance bien dans ce domaine, les pays émergents, comme la Chine ou l’Inde, qui connaissent un fort développement industriel, remettent en cause les efforts des pays développés. De nombreux experts se réunissent pour élaborer des textes et des normes, mais ceux-ci ne sont pas respectés par ces pays. Quelles mesures suggérez-vous pour concilier à la fois le respect de l’écologie et le développement économique mondial, notamment dans ce type de pays ?
M. Guillaume Chevrollier. La Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre et le leader mondial de la production éolienne et de panneaux solaires – avec des pratiques commerciales contestées. Cette position dominante n’est pas sans soulever des inquiétudes. Pensez-vous que l’on puisse trouver un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux en la matière dans les années à venir ? Ce pays évolue-t-il vers une politique de développement durable ?
S’agissant de la rénovation thermique des bâtiments et de la nécessité de rendre les ménages indépendants par rapport à l’énergie, quelles mesures proposez-vous pour les acteurs du bâtiment ? Y aura-t-il un consensus sur les moyens à mettre en œuvre ?
M. Jean-Luc Moudenc. On ne peut parler de transition énergétique sans aborder le problème de la filière photovoltaïque, qui a connu un retournement de situation très négatif depuis quelques années, que ce soit en France avec les décisions de 2010 sur les tarifs de rachat et leurs conséquences considérables en termes de disparitions d’emplois, mais aussi en Europe, puisque le subventionnement de cette filière par l’Union européenne a été plusieurs fois réduit. D’autant qu’à ces difficultés s’ajoute le dumping pratiqué par la Chine. Si un accord a été conclu par l’Union européenne avec ce pays au mois de juillet dernier, on peut être dubitatif sur les suites concrètes qui y seront données.
Mme Laurence Tubiana. J’ai souhaité, dans ma présentation, vous exposer les grandes lignes du travail issu du débat sur la transition énergétique. 225 mesures précises ont fait l’objet d’un consensus.
Nous avons à l’évidence bénéficié de l’acquis du Grenelle de l’environnement, qu’il convient de saluer : il y a eu l’apprentissage d’une démocratie délibérative, qui reste d’ailleurs encore balbutiante.
Nous avons besoin de cette méthode délibérative, qui permet de clarifier les choix et de faire émerger une vision sociale commune. Les syndicats de salariés et patronaux sont à des degrés différents de maturation sur la transition énergétique, qui est à un moment de basculement. Nous sommes en train de sortir d’une République d’ingénieurs, qui avait conçu le système énergétique français avec beaucoup de talent, pour entrer dans un monde plus compliqué, marqué par une révolution technologique. Celle-ci suscite parfois des peurs, notamment s’agissant de ses conséquences en termes de redistribution ou sur les métiers. Concernant la rénovation thermique, j’ai été étonnée de voir que l’obligation de travaux suscitait un rejet de la part des fédérations d’artisans ou de la Fédération française du bâtiment (FFB). Cela dit, on peut en comprendre les raisons : elles ont été déçues dans le passé, craignent que les nouveaux marchés soient monopolisés par de grands groupes capables de faire des offres intégrées – reléguant les autres au rôle de sous-traitant – et redoutent la concurrence internationale, avec des produits moins chers venant d’ailleurs, ainsi que la redistribution du travail au sein de la profession. La manière dont est constitué le débat délibératif dépend étroitement de la capacité de ces corps constitués à incarner le changement.
Concernant le prix de l’énergie, nous avons évidemment besoin d’avoir une industrie compétitive. À l'égard des concurrents européens, on peut remédier aux écarts existants, notamment au sujet des prix du gaz. Les énergo-intensifs ou électro-intensifs doivent faire l’objet d’un traitement particulier. J’ai vu d’ailleurs des associations écologistes qui étaient d’accord pour dire que l’industrie ne doit pas être pénalisée et doit pouvoir prévoir le prix de l’énergie. Quant à l’écart existant avec les États-Unis, il s’agit d’une autre question.
Le modèle allemand est intéressant, même s’il trouve ses limites : on ne peut établir un équilibre entre industriels, prix de l’énergie relativement bas – des prix très bas étant selon moi illusoires – et ménages pouvant supporter des prix supérieurs que si les ménages sont très économes dans l’usage de l’énergie.
En Californie, le prix du kilowhattheure est le plus élevé des États-Unis mais la facture électrique est la deuxième plus basse du pays, en raison de la grande efficacité énergétique des ménages. On pourrait aussi évoquer le modèle suédois, qui est assez proche.
Nous avons donc un compromis social nouveau à construire. Mais nous avons aussi de grands changements technologiques en perspective, comme la voiture à 2 litres aux cent kilomètres ou le véhicule électrique – dont on sait qu’il sera urbain et probablement partagé dans la plupart des cas. Il est donc normal qu’il y ait encore des incertitudes et, d’ici cinq ou dix ans, beaucoup de questions pourront être éclaircies, notamment s’agissant des transports.
Il est vrai que ce dernier sujet a été abordé avec difficulté : les acteurs du secteur étaient là mais n’ont pu apporter suffisamment de contributions à temps. Quand on a interrogé les constructeurs, on n’était pas informé des innovations de telle ou telle entreprise et ce n’est que grâce au groupe de contact des entreprises qu’on a pu les connaître. Il y a donc un décalage entre le débat tel qu’il est organisé et cette période de révolution technologique mais aussi organisationnelle, grâce aux technologies de l’information.
EDF voit, par exemple, ce que peuvent être les énergies réparties et comment offrir des services énergétiques et se faire rémunérer sur les économies d’énergie, à l’encontre de l’Union française de l’électricité (UFE), qui défend qu’il faut dépenser davantage d’électricité – ce que l’on peut comprendre. Par ailleurs, des entreprises comme Mercedes ou Renault ont une approche très différente de l’usage et de la consommation d’énergie.
Je ne suis pas convaincue que la croissance impose nécessairement un accroissement de la consommation d’énergie. Les exemples de la Californie, de l’Allemagne ou de la Suède le montrent. Il existe en effet un découplage possible entre la croissance et la consommation d’énergie. Notre histoire l’atteste : après le premier choc pétrolier, la France a continué à avoir une croissance économique forte et a enregistré un extraordinaire succès en matière d’économie d’énergie, grâce au progrès technique. D’autant qu’on peut gagner en rationalité en fonction des incitations économiques.
On ne peut avoir des scénarios ambitieux de sobriété énergétique, voire de réduction de 50 % de la consommation, que si l’on pense que ce découplage est possible. Celui-ci est au cœur de la révolution technologique. D’ailleurs, la Chine est obsédée par ce découplage et n’hésite pas parfois à recourir à des mesures brutales, comme fermer des usines en octobre pour tenir les objectifs du plan qu’elle s’est fixé pour l’année.
La planète n’est pas infinie : nous avons des capacités limitées d’absorption des gaz à effet de serre et des ressources halieutiques, minérales et forestières réduites. Mais le progrès technique rend ces limites complexes. D’autant que, selon les données publiées par les Nations Unies cet été, la population mondiale pourrait passer à 11 milliards d’habitants, plutôt que se stabiliser à 9 milliards, à horizon 2050.
Il est donc essentiel de réussir ce découplage, même si l’on peut discuter du rythme et des moyens pour y parvenir, sachant qu’il faut le faire de manière rationnelle et scientifique. Faute de quoi, nous nous lancerions dans une course effrénée dans l’accès au pétrole, au charbon, au gaz ou à l’uranium.
Parmi les mesures précises qui ont fait consensus, je citerais notamment le fait d’arriver à un taux de crédit identique à celui du crédit immobilier pour les travaux, le parcours de rénovation ou le guichet unique. Certaines, d’ailleurs, n’imposent pas de recourir à la loi.
Quant à la fiscalité écologique, elle est très difficile à mettre en place sans réforme fiscale d’ensemble. Tous les pays qui ont réussi à l’instaurer n’ont pu faire l’économie de celle-ci. Cela a été le cas en Suède, où la taxe carbone atteint 112 euros la tonne, sans mettre en cause la compétitivité de l’industrie. Nous devons examiner le système prévalant dans les autres pays européens et construire à cet égard une ligne cohérente.
Ce sera le cas dans le cadre du paquet européen de 2030, sachant que les politiques énergétiques sont différentes d’un pays à l’autre, ainsi que dans celui de la négociation internationale de 2015 en vue d’un grand accord sur le climat.
Quant à la Chine, elle a le même débat que nous sur le fait de savoir si l’on peut aller vers une économie moderne faiblement carbonée. Le gouvernement actuel pense que oui. Il faut construire avec ce pays un rapport à la fois de force et de coopération.
Le photovoltaïque est un véritable échec, car il y a eu une crise des industries de fabrication de panneaux solaires dans ce pays et en Europe, que ce soit en France, en Espagne ou en Allemagne. Mais de cet échec peut naître une coopération.
Sur la question de la contribution carbone, il faut manier la carotte et le bâton. D’une part, la Chine a terriblement peur de mesures de rétorsion commerciale. D’autre part, elle réfléchit aux impacts du changement climatique sur elle et, en tant que premier émetteur de gaz à effet de serre, est motivée pour avancer.
Malheureusement, nous avons agi a posteriori dans l’affaire de la taxe antidumping, pour arriver à une discussion qui pourra finalement être positive. On aurait pu traiter le problème en amont et réfléchir à l’avenir de la filière photovoltaïque de manière à éviter les erreurs du passé. J’en suis d’autant plus consciente que j’ai participé à la préparation des tarifs de rachat de l’électricité solaire, mais à l’époque, le secteur paraissait très petit et on n’a pas élaboré de politique industrielle en même temps que les mesures incitatives – ce qu’on ne peut plus se permettre aujourd’hui.
Si l’on développe les nouvelles phases d’industrie photovoltaïque, notamment des couches minces, il faut donc définir une politique industrielle en maniant, là encore, la carotte et le bâton vis-à-vis des compétiteurs.
J’espère que la presse couvrira nos débats de façon plus positive. Nous avons fait, je le répète, de nombreuses propositions concrètes, dont beaucoup sont d’ordre organisationnel ou tiennent au fait de donner de bonnes instructions à la Caisse des dépôts et consignations et de créer des associations entre petites et grandes entreprises pour que les parcours de rénovation existent. Cela dit, le débat doit encore mûrir et se poursuivre au sein du Parlement. Encore une fois, beaucoup de désaccords tiennent aux incertitudes que j’évoquais : il faut profiter du délai nous séparant de l’examen du projet de loi prévu pour approfondir la réflexion, en faisant venir des experts devant les commissions parlementaires et en commandant des études, notamment sur la question des transports ou du financement.
On sait notamment que l’on doit obtenir des taux de crédit pour les travaux de 2 à 3 % : nous avons plusieurs idées à cette fin, mais il faut aussi favoriser une synergie entre les banques privées, la Caisse des dépôts et la Banque européenne d’investissement (BEI). De même, il conviendra, dans le cadre du projet de loi, de favoriser la décentralisation et faciliter la vie des tiers financeurs – qui relèvent de l’habitude en Californie, plutôt que de l’expérimentation, comme chez nous.
Monsieur Gabriel Serville, je me ferai volontiers votre porte-parole pour protéger l’Amazonie et la forêt guyanaise. La gestion collective du bassin amazonien est une vraie question. Je pense que le gouvernement français peut avancer avec le Brésil dans ce domaine d’ici 2015 : cela ferait mauvais effet qu’on ne noue pas d’accord sur ce point. Je rappelle que la déforestation est à l’origine de 20 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Enfin, certaines institutions françaises peuvent prendre en charge la suite du débat sur la transition énergétique, comme le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). Il faut élaborer un scénario national où les parties prenantes convergent sur la vision à 2050. Il convient à cet égard de trancher certaines questions comme le découplage et faire le lien entre le débat national et le débat parlementaire.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci madame la directrice.
Le débat engagé doit en effet déboucher le plus rapidement possible : derrière le scénario, il y a le projet de loi sur la transition énergétique. Nous avons d’ailleurs, dans le droit fil de votre suggestion, déjà commencé à auditionner de nouveaux experts, à l’occasion des tables rondes que nous avons organisées et qui ont donné lieu à la publication d’un premier rapport d’étape.
8. Audition de Mme Catherine Chabaud, rapporteure de l’avis du CESE intitulé « Quels thèmes et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? » (8 octobre 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, c’est la troisième fois que notre commission auditionne des rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Dans le cadre de nos réflexions sur la préparation du volet énergétique de la transition écologique, Mme Anne de Bethencourt et M. Jacky Chorin sont venus, en février dernier, présenter les conclusions de leur avis sur l’efficacité énergétique. En mars, M. Jean Jouzel et Mme Catherine Tissot-Colle ont évoqué la transition énergétique 2020-2050.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Catherine Chabaud, navigatrice, membre de la section de l’environnement du CESE depuis 2010 en qualité de personnalité qualifiée, et rapporteure en juillet dernier d’un avis intitulé « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? », qu’elle va nous présenter.
En plus de son engagement au sein du CESE, Mme Catherine Chabaud pilote le projet Voilier du futur retenu, dans le cadre des investissements d’avenir et du programme Navire du futur, par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Commissariat général à l’investissement.
Elle est accompagnée de Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section environnement du CESE, de M. Serge Peron, administrateur de cette même section, et de M. Jacques Beall, conseiller au CESE, auteur d’un avis sur la sécurité des plateformes pétrolières en mer.
Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section de l’environnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Nous avons eu le plaisir de vous soumettre un avis sur la transition énergétique. Notre souhait est de pouvoir vous présenter nos travaux chaque fois que cela est possible. Vous avez le rôle de décideur, nous avons celui de conseil ; nos échanges doivent pouvoir nourrir vos réflexions.
Issue de la réforme du CES devenu CESE, la section que je préside est compétente sur plusieurs thèmes : le climat, la biodiversité, les mers et les océans, la transition énergétique, les risques environnementaux, la protection de l’environnement et la qualité de l’habitat. Nous avons à cœur de travailler ces questions environnementales sous l’angle de leurs interactions économiques et sociales.
Dans la perspective du projet de loi sur la biodiversité, nous venons de publier un avis sur ce thème. Nous avons aussi été saisis par le Gouvernement sur la question de l’éducation à l’environnement et au développement durable, qui fut un des thèmes de la Conférence environnementale.
Dans les jours prochains, nous nous attellerons à deux autres thèmes : les inégalités environnementales et sociales ainsi que l’adaptation climatique, sujet sur lequel nous espérons formuler un avis au printemps 2015, au moment de la parution du cinquième rapport des groupes 2 et 3 du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).
En ce qui concerne l’avis sur la gouvernance des océans qui va vous être présenté, il s’agit d’une auto-saisine. Nous avions déjà été amenés à réfléchir à cette question à travers les risques environnementaux des plateformes pétrolières en mer. Nous avons également organisé un colloque international sur la haute mer, qui a débouché sur « l’Appel pour la haute mer ».
A la faveur de la position exprimée lors du sommet de Rio + 20, nous souhaitons mener une réflexion sur l’élaboration d’un instrument international concernant la biodiversité dans les zones situées au-delà des limites des juridictions nationales au sens de la convention sur le droit de la mer. Ce travail, commencé aux Nations unies en septembre 2013, devrait arriver à échéance en septembre 2014. Je précise que le Président de la République a soutenu l’idée de cet instrument.
Enfin, la Conférence environnementale a consacré une table ronde sur la biodiversité marine et, plus largement, sur les enjeux liés aux océans.
Mme Catherine Chabaud, rapporteure de l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) intitulé « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? ». Je me présenterai en quelques mots. Je suis une ancienne navigatrice et une journaliste de formation. Les courses au large que j’ai effectuées pendant quinze ans m’ont donné envie de m’engager car, à chaque traversée de l’Atlantique, j’ai constaté – chaque jour, voire plusieurs fois par jour – la présence de macro-déchets.
Depuis une dizaine d’années, je me mobilise pour la préservation de la mer et du littoral, et plus généralement pour le développement durable. J’ai piloté des missions que m’avait confiées Jean-Louis Borloo sur le thème du nautisme et du développement durable. J’ai présidé le groupe de travail du Grenelle de la mer sur la sensibilisation, l’éducation et la communication. J’ai mené une mission sur le nautisme pour le pôle Mer Bretagne. J’ai été membre du conseil d’administration du Musée national de la marine, de l’Agence des aires marines protégées, de la Fédération française de voile, de la Société nationale de sauvetage en mer. Je fais partie du comité de pilotage du Conseil d’orientation de la recherche et de l’innovation pour la construction et les activités navales (CORICAN). Membre du CESE depuis la nouvelle mandature dans le groupe des personnalités qualifiées, je fais partie de la section environnement. Enfin, je suis pilote du projet Voilier du futur, lauréat des investissements d’avenir.
Notre rapport Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? est l’occasion de fournir une photographie des océans, que malheureusement peu de Français connaissent. Il est le fruit du travail de la section environnement et de l’expertise de nos administrateurs. De l’avis d’un certain nombre de personnes qui l’ont lu, il fera date. Il est divisé en quatre chapitres : « les ressources des océans : un monde peu connu et pourtant si riche » ; « les enjeux des activités humaines en mer » ; « les impacts subis par les océans : des richesses fragilisées » ; « la gouvernance des océans : un cadre complexe, des règles inachevées ».
Les océans recouvrent 71 % de la surface de la terre, mais seuls 5 % ont été explorés de manière systématique. La biodiversité marine représente 90 % de la biomasse de la Terre – le phytoplancton équivaut à lui seul à 50 % de cette biomasse planétaire. Les océans jouent un rôle essentiel dans l’équilibre du climat ; ils recyclent le gaz carbonique de l’atmosphère et produisent plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons. En outre, 98 % des ressources hydriques proviennent des océans. Et plus de 2,6 milliards d’êtres humains dépendent principalement de la mer pour leurs besoins en protéines.
À l’échelon international, les activités maritimes atteignent un chiffre d’affaires de 1 500 milliards d’euros, dont 190 milliards proviennent de secteurs qui n’existaient pas il y a dix ans, ce qui traduit une émergence d’activités – offshore profond, énergies marines, etc. Pour la France, l’économie maritime génère 450 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros.
Le milieu marin subit quatre grandes pressions : la destruction et la pollution des écosystèmes, la surexploitation des ressources, la dissémination des espèces et les impacts du changement climatiques. Environ 41 % des écosystèmes sont fortement menacés. Près de 30 % des stocks de poissons sont surexploités, et 60 % sont exploités au maximum. Enfin, 80 % des macro-déchets sont d’origine terrestre.
La convention de Montego Bay de 1982 a créé la zone économique exclusive (ZEE) qui repousse à 200 milles nautiques la souveraineté des États côtiers. L’espace maritime français est ainsi porté à 11 millions de kilomètres carrés, ce qui donne à notre pays une légitimité sur ces sujets, mais aussi des perspectives économiques. Au-delà de cette ZEE, la haute mer est un espace de liberté ; elle représente les deux tiers des océans. Compte tenu des ressources minérales et biologiques qu’elle recèle, l’enjeu est de savoir si l’on continue librement à l’exploiter ou si l’on essaie de définir un cadre juridique. À cet égard, nous assistons aujourd’hui à l’émergence du concept de patrimoine commun de l’humanité autour de la haute mer.
Les outils de la gouvernance internationale sont la convention de Montego Bay, la convention sur la diversité biologique et des instruments thématiques ou régionaux. L’Europe dispose d’un commissaire compétent pour les affaires maritimes et la pêche. La France hésite depuis toujours entre un ministère, dénommé aujourd’hui « des transports, de la mer et de la pêche » et placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, et un secrétariat général de la mer.
Notre rapport est exhaustif, mais notre avis pointe des sujets prioritaires. Nos préconisations portent sur quatre thèmes : la recherche, la connaissance et la formation ; la gestion durable des activités humaines en mer ; la prévention des dommages environnementaux majeurs ; l’amélioration de la gouvernance.
Sur le premier thème, nous préconisons le maintien des capacités de la flotte océanographique française et une mutualisation des différents supports d’observation à la mer. Nous souhaitons également le maintien des moyens satellitaires. Pour nous, il est urgent de développer la recherche fondamentale sur les écosystèmes des grandes profondeurs ainsi que sur les environnements insulaire et polaire. Nous suggérons le développement de partenariats entre la recherche scientifique et l’industrie ainsi qu’un renforcement des sciences participatives sur ce sujet.
Nous préconisons que la France et l’Europe affichent une stratégie maritime ambitieuse. Le CESE estime prioritaire de finaliser l’évaluation mondiale de l’état du milieu marin. Il demande une articulation entre les travaux du GIEC et de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Une sensibilisation à la mer, de tous les acteurs et pour tous les cursus, nous semble également indispensable.
Sur la gestion durable des activités humaines en mer, nous promouvons une approche écosystémique et concertée du développement. L’enjeu est d’arriver à gérer durablement et collectivement le milieu – pêche, énergies marines, transport maritime, plaisance, etc. Pour ce faire, nous recommandons une écoconception des navires et des infrastructures maritimes, une concertation de tous les acteurs, un développement des énergies marines renouvelables (EMR) avec des objectifs ambitieux au niveau européen, et la création d’une filière nationale et continentale de démantèlement des navires.
Nous préconisons un pacte national pour une pêche et une aquaculture durables, la question de la ressource halieutique engageant l’ensemble des acteurs. Nous recommandons la traçabilité du poisson, une réflexion sur la pêche profonde au sein du Conseil national de la mer et des littoraux, et une réforme du modèle de production de l’aquaculture.
Enfin, il nous paraît essentiel d’évaluer les besoins en nouveaux métiers.
Sur la prévention des dommages environnementaux majeurs, nous avons pointé deux sujets : les conséquences du réchauffement climatique sur les océans et les impacts des macro-déchets. Le CESE demande à la France de promouvoir l’intégration du rôle des océans dans les négociations internationales relatives au climat. Nous avons bon espoir qu’elle le fasse en 2015 dans le cadre de la Conférence des parties, sachant que les océans n’ont jamais été abordés jusqu’à présent dans ces réunions.
Au niveau international, nous souhaitons l’adoption d’une convention-cadre de lutte contre les pollutions marines d’origine tellurique. Nous appelons à un renforcement de la prise en compte du lien terre/mer : un effort doit être entrepris pour équiper notamment les collectivités d’outre-mer de réseaux d’assainissement et de station d’épuration.
Le succès de ces préconisations a un préalable : la définition d’une politique maritime ambitieuse au travers d’une gouvernance claire. Nous soulignons l’importance de la pérennité de l’institution en charge de cette gouvernance, d’une part, et de la dimension politique du rôle confié à son dirigeant, d’autre part. Nous proposons, non pas d’instaurer un grand ministère de la mer, mais de réformer le rôle du secrétariat général de la mer qui serait compétent sur l’ensemble des questions maritimes – biodiversité, action de l’État, activités maritimes, etc. Nous préconisons de confier ce pilotage à un haut-commissaire, avec rang de ministre, sous l’autorité directe du Premier ministre.
Au niveau international, le CESE souhaite que la biodiversité en haute mer bénéficie enfin d’un cadre juridique protecteur et que la place de la société civile dans les instances internationales soit renforcée. La conférence que nous avons organisée sur la gouvernance de la haute de mer au mois d’avril a mobilisé les services de l’État et des démarches sont entreprises. Au niveau européen, nous proposons la création d’un registre d’immatriculation des navires, prenant comme référence le plus exigeant de l’Union.
Nous appelons de nos vœux l’instauration d’un cadre international de gestion durable des ressources de l’Arctique. Il y a urgence car la fonte de la banquise ouvre la voie à l’exploration et à l’exploitation des ressources pétrolières.
Enfin, le CESE souhaite que le préjudice écologique soit intégré dans le droit européen.
Mme Geneviève Gaillard. Votre rapport comporte un certain nombre de propositions que nous pouvons soutenir. Il y a en effet urgence à nous pencher sur des sujets aussi divers que la détérioration des récifs coralliens, la pêche en haute mer, l’émergence de nouvelles activités qui vont peut-être porter atteinte aux océans…
Comment envisagez-vous l’articulation entre votre travail et la future loi relative à la biodiversité, qui comportera un chapitre sur les océans ?
Ne pensez-vous pas indispensable de doter l’assemblée générale des Nations unies d’un mandat clair afin que soient définies les conditions d’accès et de partage des bénéfices de l’exploitation des ressources marines ?
Lors de la conférence d’Hyderabad sur la diversité biologique, peu de représentants du monde marin étaient présents ; les chercheurs qui l’étaient se sont plaints de ne pas être suffisamment reconnus. Comment promouvoir la recherche sur le milieu marin ?
J’ai eu l’occasion de recevoir, dans ma ville de Niort, François Gabart et Bernard Stamm qui ont participé au dernier Vendée Globe – François Gabart l’a même gagné. En les interrogeant, j’ai eu le sentiment que les marins ne semblaient pas avoir conscience de la nécessité de conserver les océans en bon état. Comment mobiliser toutes celles et tous ceux qui utilisent la mer à des fins professionnelles ou de loisir ? Et comment sensibiliser les populations elles-mêmes ?
M. Christophe Priou. Le journal Ouest France écrit ce matin que « la France, avec 11 millions de kilomètres carrés d’océan, joue les gros bras maritimes. Mais c’est de la gonflette. Peu de moyens sont mobilisés pour développer ces zones souvent lointaines de la métropole. » Il ajoute que Gérard Grignon va remettre un rapport sur le sujet.
L’application du Grenelle de la mer pose problème, notamment entre l’État et les collectivités. On peut parler de la gestion intégrée des zones côtières, de la trame bleue, de la préservation du littoral, de la prescription de protections après la tempête Xynthia. Il conviendrait également d’accorder davantage de moyens au Conservatoire du littoral dont le rôle est essentiel dans la préservation des rivages, sachant que 80 % de notre population vivra soit dans les pôles urbains, soit en bord de mer.
Un rapport sénatorial intitulé Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans souligne la nécessité de mieux suivre et mieux évaluer notre politique maritime en regroupant des actions au sein d’une loi de programmation quinquennale. Votre proposition de nommer un haut-commissaire va dans ce sens. On sait à quel point l’éclatement des administrations a été problématique lors naufrages de l’Erika et du Prestige.
Les « navires du futur » s’inscrivent dans une diversification industrielle que nous appelons de nos vœux.
Le volet social de la pêche doit être souligné, car ces métiers attirent peu aujourd’hui.
L’État va mettre en place des parcs éoliens en Manche et dans l’Atlantique. Mais un accent particulier doit être porté sur les micro-algues, sur lesquelles sont mobilisés des pôles à Brest et à Nantes : ce sont de gigantesques ressources en termes alimentaires et pharmaceutiques.
S’agissant de la responsabilité environnementale, nous avons gagné une grande bataille l’année dernière au sujet de l’Erika. Avec Alain Leboeuf, nous avons déposé une proposition de loi visant à inscrire le préjudice écologique dans le droit. Il est vrai que les divers naufrages ont fait évoluer la législation européenne et française.
M. Bertrand Pancher. Je remercie vivement Catherine Chabaud pour la qualité de sa présentation et pour son engagement. Le rapport du GIEC souligne le réchauffement des couches océaniques superficielles et le rôle considérable des océans dans l’atténuation du changement climatique en absorbant 90 % de l’augmentation de la quantité d’énergie. Il indique également que, de 1901 à 2010, le niveau moyen des océans a augmenté de 19 centimètres, que le niveau des mers devrait monter de 17 à 38 centimètres d’ici à 2050, et de 28 centimètres à près de 1 mètre d’ici à 2100. Les parlementaires ultramarins, notamment de la Polynésie, nous font part de leur grande inquiétude à cet égard.
L’océan va continuer à se réchauffer et la chaleur emmagasinée va pénétrer plus profondément encore dans les couches océaniques, ce qui affectera la circulation des eaux. Il y a donc urgence à réduire les émissions de CO2, à lutter contre la surexploitation des mers, la pollution tellurique, la disparition progressive des récifs coralliens.
Votre rapport est passionnant. Vous formulez des préconisations sur la gouvernance, mais ne peut-on aller plus loin, notamment en affichant des objectifs en matière de politique commune sur le plan européen ? Nous n’avons pas, en France, les moyens de nos ambitions, mais nous pouvons les avoir à l’échelon européen grâce à des transferts de compétences. Qu’en pensez-vous ?
Vous préconisez une meilleure articulation des travaux du GIEC et de l’IPBES. Pourriez-vous nous apporter des précisions en la matière ?
Un continent de déchets en plastique pollue l’Atlantique Nord et tue de nombreux animaux. Des travaux sont menés sur ce sujet par le commissaire européen à l’environnement. Comment vous reconnaissez-vous dans sa réflexion ?
Mme Laurence Abeille. Merci pour ce travail passionnant. J’axerai mon propos sur la pêche et la préservation de la biodiversité marine. La plupart des études indiquent un effondrement des ressources halieutiques, notamment la disparition totale des poissons marins d’ici à 2048 si rien n’est entrepris. La surpêche d’une espèce a des conséquences en chaîne, provoquant un bouleversement de l’écosystème marin dont on a du mal à mesurer les conséquences. Par exemple, la baisse drastique du nombre de grands poissons, comme le thon, a favorisé la prolifération des méduses : c’est le cas notamment au Japon qui se retrouve face à un vrai problème écologique – encore un…
Si l’équilibre écologique des océans n’est pas maintenu ou rétabli, il semble illusoire de parler de pêche durable. On sait que la politique des quotas de pêche fonctionne mal et qu’elle a pour conséquence le rejet massif de prises accessoires et accidentelles. Les techniques sont, en effet, assez rudimentaires : c’est comme tuer tous les animaux d’une forêt pour prélever une seule espèce… La pêche en eaux profondes, que vous évoquez dans votre rapport, fait partie de ces pratiques catastrophiques sur le plan écologique. C’est pourquoi elle devrait être interdite, comme le propose la Commission européenne.
La solution pourrait-elle être l’aquaculture ? Cela s’avère très compliqué. Contrairement aux animaux d’élevage qui se nourrissent le plus souvent de végétaux, les poissons consomment principalement des poissons ! Et si pour produire un kilo de poisson d’élevage, il faut en pêcher deux kilos, c’est un non-sens. Les rapports sont même bien souvent pires : il faut de 3 à 4 kilos de poissons pour obtenir 1 kilo de saumon d’élevage, et ce rapport est de 22 pour 1 dans l’élevage du thon. Certes, ce ratio est similaire dans la nature, mais il respecte un cycle systémique qui n’a rien à voir avec le rythme industriel de l’aquaculture. Pour nourrir ces poissons d’élevage, on utilise des poissons sauvages, souvent surexploités, comme la sardine, le merlan, l’anchois. La solution ne peut évidemment pas être d’alimenter les poissons avec de la farine de porc, comme certains le voudraient.
La question du lieu où pratiquer cette aquaculture pose également problème, dès lors que certains facteurs sont pris en compte, comme la concurrence avec les espèces locales et la pollution avec le rejet d’antibiotiques. Une aquaculture non raisonnée, sans équilibre entre productivité et respect de l’environnement, ne règle pas le problème des stocks halieutiques : elle le déplace des poissons carnivores aux autres espèces tout en entraînant une pollution des milieux. Il est nécessaire de s’interroger sur le modèle de production aquacole, et c’est ce que vous préconisez à juste titre dans votre rapport. Mais les solutions semblent, en fait, très peu nombreuses.
Le débat sur la pêche est le même que sur la viande. Nous savons que l’élevage d’animaux terrestres est responsable de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que l’ensemble des transports, et accapare une grande partie des terres arables. Il est impossible de nourrir 9 milliards d’humains avec la même consommation de viande que dans les pays développés. Le problème est donc le même pour le poisson : il est presque impossible de répondre à la hausse de la demande sans aboutir à une catastrophe écologique.
Je note avec satisfaction dans votre avis que vous souhaitez organiser une campagne nationale de sensibilisation destinée à inciter le grand public à une consommation responsable des produits de la mer. Une consommation responsable passe forcément par une baisse globale de la consommation – et donc des prélèvements. C’est, il me semble, la seule solution viable écologiquement. L’idée d’un label européen certifiant des produits issus d’une pêche durable, comme vous le proposez, semble pourtant à double tranchant si l’on a, d’un côté, des poissons labellisés et chers et, de l’autre, des poissons non labellisés issus de la surpêche.
M. Olivier Falorni. Merci pour la qualité de votre présentation. Nous sommes heureux d’accueillir la première femme à avoir terminé un tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escale.
Trente ans après la signature de la convention des Nations unies sur le droit de la mer à Montego Bay – l’accord le plus important de l’histoire concernant la haute mer –, les océans continuent à mobiliser. Le Secrétaire général Ban Ki-moon a lancé le Pacte pour les océans qui vise à renforcer la capacité du système de l’ONU à soutenir les actions des gouvernements ainsi qu’à promouvoir l’engagement des organisations intergouvernementales et des ONG.
Dans ce contexte, le CESE s’est posé la bonne question : comment gérer collectivement et préserver les écosystèmes de cet espace extrêmement précieux pour l’être humain ? Dans cette optique de gouvernance et de gestion durable des océans, vous nous avez fait part aujourd’hui de vos préconisations. La lecture d’un article du Programme international sur l’état des océans, la semaine dernière, montre à quel point il est urgent de considérer vos recommandations. Dans ce texte, on peut lire que l’état de santé des mers décline plus rapidement qu’on le pensait, sous l’effet de trois composantes : le réchauffement, la désoxygénation, et l’acidification. Les chercheurs estiment que ce cocktail néfaste, qui touche à la température, à la chimie, à la stratification des océans et à l’apport en nutriments, compromet gravement la productivité et l’efficacité des océans.
Les résultats de ces études vont au-delà de la conclusion du GIEC selon laquelle l’océan absorbe une grande partie du réchauffement climatique, ainsi que des taux sans précédents de dioxyde de carbone. Les chercheurs redoutent un impact cumulé bien plus grave que les estimations précédentes : la combinaison des différents facteurs a un résultat global supérieur à la simple addition des impacts de chaque facteur.
Les scientifiques du Programme international sur l’état des océans proposent trois solutions : réduire les émissions mondiales de CO2 pour limiter l’augmentation des températures à moins de 2 degrés ; garantir la mise en place d’une gestion basée sur la communauté et les écosystèmes, favorisant les pêcheries de petite échelle ; et construire une infrastructure mondiale pour la gouvernance de la haute mer. Les préconisations de votre rapport font-elles écho à ces trois propositions et, si oui, comment s’articulent-elles ?
Enfin, le CESE demande que la biodiversité marine, composante fondamentale de la diversité biologique, en particulier dans les collectivités ultramarines, soit traitée à la hauteur de son importance dans la loi cadre sur la biodiversité. Selon vous, faut-il réaffirmer la place des aires marines protégées dans le projet de loi ?
Mme Sylviane Alaux. Merci pour la qualité de votre rapport. Les mers, les océans sont notre assurance-vie pour les siècles à venir, pour nos enfants et les générations futures. Il y a urgence à les préserver, avec l’absolue nécessité pour tous les usagers de la mer de cohabiter. Parmi ces usagers, nos pêcheurs sont trop souvent stigmatisés alors qu’ils sont plutôt de bons élèves.
Je voudrais vous interroger sur les grands fonds. Votre rapport s’appuie sur des observations scientifiques. Les professionnels ont-ils été ou sont-ils suffisamment associés à ces études ? Préconisez-vous une interdiction ou un encadrement plus sévère, avec l’impact économique que cela pourrait avoir sur le devenir de certains de nos ports, en un mot d’aller plus loin ?
M. Laurent Furst. La France a un « vaisseau amiral », l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) avec ses bases de recherche. Qu’en pensez-vous ?
Pouvez-vous nous dire un mot sur le « sixième continent », le « continent de plastique » évoluant dans les océans ? Comment lutter contre ce phénomène ?
Quelle est la position de la France sur la problématique des déchets enfouis en mer, notamment des déchets nucléaires ?
M. Yannick Favennec. La France possède le deuxième espace maritime mondial après celui des États-Unis. Nous disposons d’un potentiel unique en termes de richesses, qu’il convient néanmoins de préserver compte tenu de sa fragilité. Je souscris pleinement à l’ambition de ce rapport qui concilie les trois piliers du développement durable – économique, social et environnemental.
La pêche française en eau profonde est dépendante de la politique commune de la pêche, et il faut veiller à ne pas ajouter trop de contraintes à celles qui existent déjà. Nous devons laisser aux professionnels le temps de s’adapter aux nouvelles techniques. Les pêcheurs doivent faire face à une concurrence illicite et dangereuse d’opérateurs sans scrupule ; c’est pourquoi un label européen de qualité certifiant les produits de la pêche durable permettrait de lutter contre la pêche illégale. J’aimerais avoir votre point de vue sur ces deux sujets : l’inflation de contraintes et ce label européen.
M. Jean-Jacques Cottel. Merci pour votre excellent rapport. Lors de la conférence environnementale, vous avez évoqué l’idée d’une filière à responsabilité élargie aux producteurs de bateaux, assortie d’une prime à l’écoconception des navires. Cette piste permettrait de produire moins de déchets et de recycler plus de matériaux. Elle me semble intéressante même si le rapport que j’ai rédigé avec mon collègue Guillaume Chevrollier préconise d’abord la mise en place satisfaisante des filières REP avant d’en créer d’autres.
Existe-t-il une filière de valorisation des matériaux issus des bateaux ? Quels sont les progrès possibles pour concevoir les navires les plus écologiques possibles ? Les utilisateurs sont-ils sensibles à cette problématique ? Que deviennent les vieux bateaux ?
S’agissant des navires de pêche, il me semble nécessaire de se donner plus de temps avant d’envisager de les renouveler, afin de tenir compte des contraintes économiques.
M. Guillaume Chevrollier. L’immensité des océans ne les protège pas des nombreuses menaces : pollution, réchauffement climatique, épuisement des ressources du fait de la surexploitation, disparition d’espèces rares. Notre pays, deuxième puissance maritime mondiale a une responsabilité particulière sur le sujet. Selon votre rapport, la France doit faire pression pour une gestion écoresponsable des océans, ce que nous approuvons.
Vous qui avez tant navigué sur les océans, comment envisagez-vous les projets, prévus le long de nos côtes, de fermes hydroliennes et de parcs d’éoliennes flottantes en mer ? Selon vous, avons-nous le recul suffisant pour mesurer l’impact de ces projets et méritent-ils le label écoresponsable ?
Plusieurs députés. Très bonne question !
Mme Florence Delaunay. Je tiens tout d’abord à exprimer toute mon admiration : Madame Catherine Chabaud a été une navigatrice très courageuse. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont des documents de planification terriens et il est difficile d’y intégrer des volets littoraux. Pourtant, de multiples activités existent : récifs artificiels, hydroliennes, zones de surf et de plongée, parcs naturels marins, etc.
Lors des auditions que vous avez réalisées, une disposition sur le volet littoral dans les SCOT a-t-elle été envisagée, avec comme objectifs de connaître et de coordonner les activités marines, d’éviter les conflits d’usage, de limiter les activités susceptibles de pollution sur les plages et en mer, d’affirmer la mer comme partie prenante du territoire et de l’intégrer réellement dans les politiques d’aménagement ?
M. Jean-Luc Moudenc. Il y a quelques années paraissait un livre signé d’un journaliste scientifique et d’un chercheur, intitulé Une mer sans poissons. Comment évaluez-vous le risque de la surexploitation des océans ? Dans la mesure où les hommes pêchent toujours plus loin et toujours plus profond, comment concilier préservation de l’océan, besoins économiques et pêche durable ?
Mme Laurence Abeille. L’extraction de sable marin utilisé pour la construction pose de nombreux problèmes, notamment dans certaines îles du Pacifique, avec un recul voire une disparition des plages. La méthode d’extraction est particulièrement brutale ; elle détruit les fonds marins côtiers où la biodiversité est souvent la plus riche. Un projet très contesté est en gestation dans la baie de Lannion pour extraire du sable coquillier. Que pensez-vous de l’impact écologique de ce type d’exploitation ?
Des milliers de mètres cubes d’eau radioactive s’échappent de la centrale de Fukushima. Faut-il craindre une pollution massive de tout ou partie de l’océan Pacifique ?
M. Christophe Bouillon. Vous soulignez dans votre rapport les atouts indéniables de la France en termes de ressources minérales sous-marines. Toutefois, ces richesses sont sous-exploitées, voire relativement peu explorées. Des travaux de cartographie ont été conduits à Wallis-et-Futuna. Pourrait-on imaginer une application à grande échelle de cette méthode de travail au sein d’un pôle minier français pour établir une documentation plus précise ?
L’exploitation des ressources minières fait l’objet d’une véritable concurrence internationale, notamment avec la Chine et l’Inde. Comment envisagez-vous le rôle de la France ? Doit-elle, comme l’a proposé le rapport que j’ai rédigé avec Michel Havard sur la gestion durable des matières premières minérales, renforcer sa présence à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), notamment à la commission juridique et technique, pour améliorer la gouvernance internationale et suivre les règles encadrant les permis ?
Enfin, selon votre rapport, le cadre juridique n’est pas encore stabilisé. Quelles pourraient être les modifications à apporter au code minier sur l’exploitation sous-marine ?
M. Jean-Pierre Vigier. Les océans occupent 71 % de la surface terrestre. Avec une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, la France est le deuxième espace maritime mondial et la première intéressée par la gestion de la ressource en eau. Alors que les océans sont un vecteur économique majeur, les pollutions et les changements climatiques agressent cette ressource. Comment concilier sur le long terme la préservation du milieu marin et la valorisation économique des océans ?
M. Philippe Plisson. Les réseaux fluviaux amènent à la mer des pollutions diverses, mais intensives, auxquelles s’ajoute le déversement des eaux usées. Le dixième programme des agences de l’eau 2013-2018 a fait de la lutte contre les pollutions sa priorité. Dans votre rapport, vous appelez à un renforcement de la prise en compte du lien terre/mer par les collectivités territoriales. En effet, la gestion des rivières et de leur bassin versant est souvent laissée à des syndicats sans moyens ni compétences. Quelle solution préconisez-vous ? L’un des principaux enjeux n’est-il pas d’inclure ces syndicats dans des intercommunalités à fiscalité propre ?
Votre rapport mentionne la présence des déchets nucléaires au fond des océans. Quelles sont vos préconisations ?
Les océans sont un vaste réservoir d’énergie renouvelable ; or seuls quelques prototypes sont en service. Les océans représentent certes 70 % de la surface de la terre, mais les sites d’exploitation les plus favorables sont limités. Quelles dispositions prendre pour organiser leur exploitation dans le respect du milieu marin ?
M. Yves Albarello. Votre rapport comporte un grand nombre préconisations, mais le plus difficile est d’apporter des solutions. La fonte de la calotte glacière et la montée des océans sont des sujets majeurs. Au sud du Sénégal, j’observe chaque année une montée des eaux de plusieurs centimètres, avec une destruction de la flore et l’ensablement du fleuve Casamance. En outre, les bateaux usines coréens ont totalement pillé la ressource halieutique des fonds marins de ce pays.
L’éco-participation que vous proposez pour la filière marine suppose une réciprocité, afin d’éviter de se retrouver dans le même cas de figure que la compagnie Air France qui est la seule à s’acquitter d’une taxe sur la solidarité, à hauteur de 70 millions. C’est une bonne idée à condition que tout le monde y souscrive.
M. Jean-Marie Sermier. Je voudrais me faire l’écho des agriculteurs de la mer que sont les pêcheurs. Beaucoup confirment que la stabilisation des captures de poissons sauvages depuis les années 1990 traduit une surpêche dans bien des endroits. Pourtant, à chaque fois que des chiffres sont publiés, un certain nombre de professionnels les contestent. Comment expliquez-vous une telle différence entre les statistiques fournies par les organismes compétents et celles des pêcheurs dont on ne peut contester l’honnêteté intellectuelle ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Est-il possible de faire évoluer la convention de Montego Bay, signée il y a trente ans. Si oui, dans quelle direction ? Une volonté politique s’exprime-t-elle en ce sens ?
Mme Catherine Chabaud. Toutes ces questions sont pertinentes, mais je suis tout sauf une experte de la mer ! Ce rapport est le fruit d’un travail collectif au sein de la section de l’environnement.
Mme Anne-Marie Ducroux. Nous avons publié l’avis sur les océans et l’avis de suite sur la biodiversité avant l’été. L’avant-projet de loi ne nous avait pas encore été présenté – il le sera certainement à l’automne. Néanmoins, nous insistons dans ces deux avis pour que la loi biodiversité inclue tous les milieux, dont le milieu marin.
Nous préconisons également dans ces deux avis que les problématiques des océans soient intégrées dans les travaux du GIEC et de l’IPBES et que ces deux structures, au travers des représentants français, travaillent de façon coordonnée en mutualisant leurs moyens.
En outre, Jean Jouzel présentera un avis sur l’adaptation climatique, qui sera centré sur le vivant – agriculture, biodiversité, santé.
Nous souhaitons une protection de la biodiversité marine et des ressources génétiques. Selon nous, les acquis de la Convention sur la diversité biologique (CDB) – par exemple le protocole relatif à l’accès aux ressources et le partage des avantages (APA) – devraient inspirer les évolutions de la convention de Montego Bay.
Nous espérons que l’Agence de la biodiversité traitera de l’ensemble des milieux, sans mettre le milieu marin à part. De manière générale, l’approche écosystémique et concertée doit être un fil directeur de son action.
Mme Catherine Chabaud. Les acteurs de l’économie maritime sont très inquiets de voir la mer disparaître dans cette grande agence. Une représentation forte de ces derniers au conseil d’administration permettrait de faire comprendre le lien entre la terre et la mer. De plus, les conseils de gestion des aires marines protégées doivent être conservés : ce sont des instances de gouvernance de référence.
J’ai été étonnée de vous entendre dire qu’il n’y avait pas de représentants de la recherche maritime à Hyderabab, car notre pays dispose d’une véritable expertise. Dans la section sur l’éducation à l’environnement, nous recommandons que toutes les formations, y compris celle des ingénieurs, incluent le maritime et le développement durable.
Je peux vous dire que François Gabart et Bernard Stamm sont vraiment conscients des enjeux. Mais il est vrai qu’ils ne vivent pas toujours bien le fait de naviguer sur des bateaux en fibre de carbone. Bernard Stamm a mis son navire à disposition de la science : celui-ci comporte un système d’observation des océans, un capteur océanographique qu’il a mis au point avec l’IFREMER et Océanopolis à Brest. Il reste que les plus mobilisées sur ces sujets sont des navigatrices : Isabelle Autissier est ainsi présidente du WWF-France, et Ellen MacArthur a créé une fondation sur l’économie circulaire.
Le navire du futur est un navire propre, économe, intelligent et sûr. Les travaux portent sur la réduction des émissions de CO2, les énergies, la sécurité embarquée, les matériaux, notamment les biocomposites. Nous préconisons l’écoconception parce que la fin de vie des bateaux constitue un réel problème. Pour la plaisance, une filière de collecte et de déconstruction a démarré sur de petites unités. Mais si une filière devait véritablement se mettre en place, les professionnels préféreraient une démarche à l’échelon européen.
D’ailleurs, un grand nombre de préconisations devraient être portées par la France au niveau européen, que ce soit sur la pêche, le navire du futur, le démantèlement des navires, la recherche, ou la mutualisation des moyens. Étonnement, l’Allemagne, dont les frontières maritimes ne sont pas très importantes, se mobilise beaucoup plus.
Sur les parcs éoliens, je crois au développement des énergies marines et, plus largement, à une approche écosystémique et concertée. Nous avons un avenir économique en mer, mais il faut introduire la concertation et l’écoconception très en amont. Le projet de parc éolien prévu au large de Guérande n’aurait peut-être pas suscité une telle levée de boucliers si un cahier des charges avait prévu la concertation et l’écoconception. Dans ce domaine, il y a vraiment des solutions qui font appel à l’innovation, avec des emplois à la clé. D’ailleurs, les parcs éoliens en mer des Danois et des Anglais sont loin d’être exempts de reproches. Nous pourrions promouvoir une exemplarité française à la faveur des nouveaux appels à projet.
Les énergies marines sont un véritable enjeu pour l’outre-mer. Mais je pense que la France ne l’a pas suffisamment compris.
Mme Annie-Marie Ducroux. Sur le préjudice écologique, nous estimons que la France a un rôle à jouer pour promouvoir ce principe afin qu’il soit intégré dans le droit européen.
Mme Catherine Chabaud. La biomasse des océans subit le réchauffement climatique, les pollutions telluriques, les microparticules de plastique. Par conséquent, la pêche elle-même est impactée. On pointe souvent la pêche profonde, mais la pêche illicite et la pêche de plaisance sont également de vrais sujets. La question doit être traitée de façon globale ; c’est pourquoi notre avis propose un pacte, notamment une traçabilité du poisson. Le label européen me paraît une voie intéressante.
Les chercheurs ne sont pas tous d’accord sur la pêche profonde ; c’est pourquoi j’ai tendance à invoquer le principe de précaution. Personnellement, j’ai fini par être convaincue qu’il fallait mettre un terme aux prélèvements à certaines profondeurs. Néanmoins, il y a plusieurs sortes de pêches profondes, et les pêcheurs font de réels efforts pour aller vers une pratique plus responsable dans une réflexion écosystémique. Notre rapport préconise de développer des recherches sur des engins de pêche plus sélectifs, moins dommageables. Des expériences d’unités d’exploitation et de gestion concertées (UEGC) sont menées avec les pêcheurs. La pêche artisanale, si elle recevait les mêmes subsides que la pêche profonde, pourrait peut-être mieux se développer. Je ne crois pas à la disparition des poissons, je m’inquiète de la prolifération des méduses.
L’aquaculture peut être une bonne solution, à condition qu’elle soit durable et que les poissons mangent autre chose que des farines animales.
Les solutions viendront des éco-innovations qui pourront être développées, mais aussi de notre capacité à gérer collectivement le milieu. Il y a des emplois à la clé et donc des formations à envisager. Ce qui manque actuellement, c’est une vision collective.
Sur les déchets, il n’y a pas un unique « continent de plastique » : il y en a dans tous les vortex océaniques – Pacifique Nord et Sud, Atlantique Nord et Sud, océan Indien Nord et Sud. Lors de la Conférence environnementale, un représentant de fédération de la plasturgie m’a parlé d’un projet visant à ramasser des macro-déchets, ce qui n’est pas réaliste. En revanche, développer des bateaux pour collecter les macro-déchets sur le littoral est envisageable. Mieux encore : il faut agir en amont sur les fleuves, comme nous le préconisons dans notre avis. À ce sujet, un livre passionnant, rédigé par trois spécialistes, va sortir prochainement.
S’agissant des TAAF, nous estimons qu’il faut préserver le Marion Dufresne, navire océanographique qui joue un rôle scientifique et logistique, en particulier dans les mers australes. Nous préconisons de renouveler son contrat d’affrètement.
Nous parlons des déchets nucléaires immergés dans notre rapport, mais sans formuler aucune recommandation.
M. Jacques Beall. Il faut se saisir de ce sujet dans la mesure où des conteneurs immergés dans les années 1980 commencent à donner des signes de faiblesse. Une menace est possible dans certaines régions, notamment dans la fosse des Casquets, d’une profondeur de cent mètres, située en Manche.
Mme Catherine Chabaud. Sur la fin de vie des objets, j’évoque souvent la directive européenne sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) à l’origine de la création d’une filière de collecte et de démantèlement en France. Le problème est que 80 % des bateaux de plaisance sont fabriqués en verre polyester qui ne peut être valorisé actuellement que par incinération. Les solutions ne sont pas sur l’existant, elles sont à l’écoconception. L’acier et l’aluminium sont recyclables à l’infini.
Le Gouvernement vient de lancer un appel à projet sur les fermes d’hydroliennes. J’y suis favorable, mais toujours dans le respect des principes d’anticipation et de concertation. Il convient de sélectionner les lieux d’implantation. Dans le parc naturel marin d’Iroise, une première hydrolienne devrait être immergée, et ce projet a réuni autour de la table l’Agence des aires marines protégées, les énergéticiens et les chercheurs ; l’idée est de placer des capteurs océanographiques sur l’hydrolienne. Je ne suis pas contre le développement, mais il faut – et on peut le faire – trouver des solutions pertinentes.
Mme Anne-Marie Ducroux. Notre avis sur la transition énergétique indique que tout ne pourra pas être financé en même temps et que des choix devront être faits. Nous préconisons de financer en priorité les énergies renouvelables au potentiel commercial important et qui sont déjà dans une phase de maturité.
Mme Catherine Chabaud. Sur les ressources minières, Jacques Beall et moi sortons d’une réunion organisée par le ministère de l’écologie sur une recherche scientifique en cours sur l’impact environnemental de l’exploration et de l’exploitation des minerais profonds. Nous passons au crible toutes les études réalisées sur le sujet pour en tirer des enseignements sur la manière d’explorer et d’exploiter ces ressources. Un colloque se tiendra le 19 juin prochain sur ce sujet, qui concerne les nodules polymétalliques, les encroûtements cobaltifères et les sulfures hydrothermaux. Une campagne d’exploration a été menée à Wallis-et-Futuna en 2010. Notre avis souligne que l’outre-mer pourrait être davantage associée.
M. Jacques Beall. Plusieurs problèmes se posent s’agissant de la modification du code minier. D’abord, ces ressources font l’objet de recherche et d’exploration, mais pas d’exploitation, comme le pétrole. Ensuite, la gestion des risques marins doit être intégrée, ainsi que les moyens de contrôle et la gestion des accidents. Aujourd’hui, les moyens sont relativement faibles – pour les forages en Guyane, par exemple, les moyens de secours en cas d’accident restent mineurs. Enfin, il faut trouver une articulation entre la ZEE, les eaux internationales et les ressources du sous-sol dans le plateau continental étendu, qui seront gérées par la France, et les fonds marins de haute mer sous la juridiction de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM).
Mme Catherine Chabaud. Les granulats marins sont un vrai sujet. Je m’étais opposée à l’extraction des granulats au large de Lorient en raison de la présence d’une zone Natura 2000. Il est aberrant d’avoir besoin de granulats, alors que des opérations de dragage sont menées pour retirer des boues afin de permettre aux bateaux de passer dans les chenaux : je préconise leur valorisation depuis toujours. Des solutions sont possibles ; une expérience pilote a été menée au niveau européen associant les ports du Guilvinec et de Toulon.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les sables coquilliers sont utilisés en agriculture pour les amendements.
Mme Catherine Chabaud. En ce qui concerne Fukushima, je vous renvoie à notre rapport, mais nous ne formulons pas de préconisation.
S’agissant des SCOT, je pense qu’il faut mettre plus de maritime dans tous les textes.
En définitive, je crois possible de concilier économie et préservation à condition d’avoir une politique volontaire. La France doit mettre en place une gouvernance et s’appuyer sur sa légitimité pour porter des sujets au niveau européen. Ainsi, nous trouverons plus facilement des solutions et nous pourrons promouvoir des approches écosystémiques et concertées. C’est ce fil rouge qui résume le mieux notre ambition.
M. Jacques Beall. De l’avis des personnes auditionnées, une approche pragmatique et régionale est préférable à une évolution de la convention de Montego Bay. En revanche, des outils complémentaires sont prévus dans le processus, notamment le nouvel instrument juridique de partage des avantages qui ne concerne que la biodiversité. Les fonds marins relèvent de l’AIFM, à laquelle les futurs exploitants paieront une redevance redistribuée selon des critères qui avantageront les pays en développement. L’ambition initiale a été fortement réduite, notamment par l’intervention des États-Unis, non signataires de la convention.
Au niveau européen, la stratégie pour le milieu marin comporte l’objectif d’un bon état des eaux pour 2020. Néanmoins, les moyens ne semblent pas en adéquation.
S’agissant des énergies marines renouvelables, la directive sur la planification de l’espace maritime devrait permettre de définir les zones et les usages puis, grâce à la concertation, les zones qui seront utilisées et leur affectation. Aujourd’hui, faute de dialogue en amont, des projets rencontrent des difficultés d’acceptabilité.
Mme Catherine Chabaud. En conclusion, si la mer bénéficiait de l’attention portée au milieu terrestre, le CESE consacrerait non pas un, mais dix ou vingt avis à toutes ces questions, et peut-être autant de rapports !
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci beaucoup, mesdames, monsieur, pour cette audition très intéressante.
9. Table ronde sur le 5e rapport du groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (27 novembre 2013)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Le groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a décidé de publier son cinquième rapport en trois volumes. Le premier, consacré aux études scientifiques, a été publié en septembre dernier. Les deux autres volumes, consacrés aux impacts et aux politiques d’atténuation, seront publiés dans les six prochains mois. Le premier volume confirme l’origine anthropique du changement climatique, l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe, l’élévation du niveau des océans et l’accélération de la fonte des glaciers.
Cette table ronde nous permettra de dresser une synthèse des principaux enseignements de ce cinquième rapport, d’identifier ses implications et de préciser les enjeux climatiques auxquels la France métropolitaine et l’ensemble des territoires ultramarins seront exposés au cours des décennies à venir.
Nous accueillons à ce titre :
- M. Jean Jouzel, climatologue, que nous avons déjà auditionné le 13 mars dernier sur la transition énergétique ;
- Mme Valérie Masson-Delmotte, corédactrice du 5e rapport ;
- M. Philippe Dandin, qui a été directeur de la climatologie à Météo-France ;
- M. Alexandre Magnan, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) et coauteur du rapport « Les outre-mer face au défi du changement climatique » réalisé en 2012 pour l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC).
M. Jean Jouzel, climatologue. Il est important que les parlementaires accueillent la communauté scientifique. Nous y sommes très sensibles et vous remercions d’avoir organisé cette table ronde.
Je suis parmi vous au titre de mon implication au sein du groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) dont le président est M. Rajendra Kumar Pachauri et dont je suis membre du bureau : ce dernier est composé de trente personnes, et aucun pays, à l’exception de l’Inde, n’est représenté deux fois. Chacun des trois groupes de travail y est représenté – je suis vice-président du groupe I, consacré aux études scientifiques. La France est également représentée au sein du bureau par Nicolas Bériot, secrétaire général de l’ONERC.
Je voudrais dire quelques mots du processus qui a abouti au rapport du groupe scientifique qui a été adopté à Stockholm il y a plus d’un mois.
Le GIEG est né suite au cri d’alarme qu’ont lancé les scientifiques dans les années 1970-1980 devant la menace du réchauffement climatique. Il a été mis en place sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale et de la branche environnement des Nations Unies en 1988. Notre instance obéit donc aux règles onusiennes.
Le rapport du groupe II, relatif à l’impact, à la vulnérabilité et à l’adaptation aux changements climatiques, sera adopté à Yokohama à la fin du mois de mars, et le rapport du groupe III, sur les moyens d’atténuer le changement climatique, sera adopté en Allemagne début avril. Ces travaux seront complétés par un rapport de synthèse qui sera présenté en octobre prochain à Copenhague.
Les membres du bureau sont généralement élus pour la durée de l’établissement du rapport d’évaluation. Toutes les décisions sont prises par une assemblée plénière où sont représentés tous les pays.
Nous proposons l’organisation du contenu du rapport, et lorsque celle-ci est approuvée, nous sélectionnons les auteurs sur des critères scientifiques, géographiques et de genre. C’est un tel honneur d’être rédacteur d’un rapport du GIEC que nous recevons de nombreuses candidatures. Ainsi, 259 auteurs ont participé à la rédaction de ce 5e rapport, pour laquelle nous avions reçu un millier de candidatures.
Chaque chapitre est rédigé sous l’égide d’une douzaine d’auteurs et de deux coresponsables, auxquels peuvent s’adjoindre des contributeurs.
Nous avons ensuite quatre rendez-vous, tous les six à huit mois, de la première rédaction, dite « draft zéro », aux rédactions suivantes auxquelles sont adjoints des commentaires. Nous avons ainsi recueilli plus de 55 000 commentaires qui seront pris en compte. Il s’agit d’un processus collectif et transparent.
Les coprésidents de notre groupe sont MM. Thomas Stocker (Suisse) et Qin Dahe (Chine). Sous la responsabilité des coachs et d’un sous-groupe de rédacteurs, un résumé technique à l’intention des décideurs est établi – il s’agit de passer d’un millier de pages à cinquante pages – et c’est ce document qui fera l’objet d’un processus d’adoption auquel personnellement je suis très attaché. Certains considèrent qu’il est politique, mais je ne le pense pas. D’ailleurs, ce résumé reste la propriété des scientifiques et les représentants des gouvernements ne peuvent en modifier le contenu.
Je précise que le rôle du GIEC est non pas de faire des recommandations, mais d’établir un diagnostic. En clair, nous nous devons d’être policy-relevant et non policy-prescriptive. En revanche, à l’issue de ce processus, les décideurs sont censés prendre des mesures – j’emploie à dessein le mot « censés » car nous considérons que ces mesures ne sont pas prises assez rapidement.
Le rapport du GIEC doit être le livre de chevet des négociateurs du climat et il semble que l’objectif soit atteint.
Mme Valérie Masson-Delmotte, corédactrice du 5e rapport. J’évoquerai brièvement les principaux éléments du résumé à l’usage des décideurs du 5e rapport du GIEC.
Ce rapport, qui repose sur 9 200 publications scientifiques, est organisé en 14 chapitres auxquels est adjoint un atlas qui donne accès à des cartes présentant les simulations des évolutions futures du climat dans les différentes régions sur une échelle de temps allant de 30 à 100 ans.
Le constat de ce rapport est le suivant : le réchauffement du système climatique est sans équivoque et beaucoup de changements observés depuis les années 50 sont sans précédent sur une échelle de temps remontant à plusieurs milliers d’années.
Nous observons un réchauffement de l’atmosphère et chacune des dernières décennies a été successivement plus chaude que les précédentes. Dans l’hémisphère nord, les derniers 30 ans ont été les plus chauds depuis plus de 1 400 ans.
L’océan s’est réchauffé et contient la plus grande partie de l’énergie emmagasinée dans le système climatique. Sur 100 % d’énergie supplémentaire, 1 % se traduit par le réchauffement de l’atmosphère, plus de 90 % sont stockés dans les océans, 3 % font fondre les glaces et 3 % réchauffent les sols. Le surplus d’énergie est donc en grande partie emmagasiné dans les océans, et cela pour longtemps.
La quantité de neige a diminué dans l’hémisphère nord, en particulier au printemps, et la masse des glaciers et des calottes polaires ne cesse de se réduire. Enfin, on observe un recul très important de la banquise autour de l’Océan Arctique.
Le réchauffement des océans et la fonte des glaciers a entraîné une montée du niveau des mers de 20 cm environ au XXe siècle, ce qui constitue une rupture par rapport au niveau relativement stable observé au cours des deux précédents millénaires.
Les activités humaines, il n’y a plus aucun doute sur ce point, sont responsables de l’augmentation des teneurs en gaz à effets de serre dans l’atmosphère. Les concentrations actuelles en dioxyde de carbone, méthane ou oxyde nitreux sont exceptionnelles par rapport aux résultats des enregistrements effectués par carottes de glace qui permettent de mesurer ces concentrations sur plus de 800 000 ans.
Depuis la fin de la période préindustrielle, en 1750, la concentration en dioxyde de carbone a augmenté de 40 %, en premier lieu du fait de la combustion d’énergies fossiles, et en second lieu du fait des changements d’usage des sols, en particulier la déforestation. L’océan a absorbé environ 30 % de nos émissions de dioxyde de carbone, ce qui a conduit à l’acidification de l’eau.
S’agissant de l’influence des activités humaines sur le climat, nous constatons l’effet réchauffant des gaz à effet de serre et un léger effet refroidissant, plus incertain, lié aux particules de pollution. Pour vous donner un ordre de grandeur, l’effet réchauffant net lié aux activités humaines a été détecté dès 1950. Cet effet a doublé entre 1950 et 1980, pour doubler à nouveau entre 1980 et 2011.
L’influence humaine sur le système climatique est donc clairement établie. L’homme agit sur les échanges d’énergie entre la terre et l’espace. L’impact des activités humaines sur le climat se traduit par le réchauffement observé de l’atmosphère et des océans, l’augmentation de la quantité de vapeur d’eau dans une atmosphère plus chaude, la transformation des glaces, la montée du niveau des mers et la survenue d’événements climatiques extrêmes : vagues de chaleur, fortes précipitations.
Le 5e rapport renforce le constat de l’impact de l’homme sur le climat. Nous en concluons qu’il est extrêmement probable que l’influence humaine ait été la cause principale du réchauffement observé depuis 1950.
J’en viens aux risques futurs. Évaluer les conséquences futures des activités humaines sur le climat nécessite des travaux de modélisation qui sont établis à partir de différents scénarii.
Selon le premier scénario, à savoir la mise en place rapide, dans les vingt prochaines années, d’un contrôle mondial des émissions de gaz à effets de serre, celles-ci disparaîtraient quasiment à l’horizon 2060. Ce scénario, qui repose sur des politiques climatiques, est le plus bas.
Le scénario haut – la poursuite d’une consommation croissante d’énergies fossiles au niveau mondial – aurait pour conséquence de multiplier par quatre l’impact des activités humaines sur les échanges de rayonnement. Je précise que c’est le scénario que nous avons suivi, en termes de consommation d’énergies fossiles, au cours de la dernière décennie.
Dans le scénario le plus bas, nous pourrions, avec un degré de confiance élevé, connaître un réchauffement de l’ordre de 2 degrés, peut-être même inférieur, par rapport au climat de la période préindustrielle, et qui plafonnerait à partir de 2050.
Dans tous les autres scénarios, nous serions confrontés à un réchauffement supérieur à 2 degrés et qui se poursuivrait au-delà de 2100. Dans le scénario le plus haut, nous atteindrions 4 degrés de réchauffement en 2100.
Ce changement est exceptionnel par rapport à l’histoire du climat des derniers millions d’années et il est extrêmement rapide. Pour vous donner un ordre de grandeur, le dernier changement le plus rapide que nous connaissons est une augmentation de 4 degrés entre un climat glaciaire et un climat chaud, mais cette augmentation s’est produite à un rythme de 1,5 degré par période de mille ans.
Ce changement affectera en outre profondément le cycle de l’eau. Il augmentera les contrastes en provoquant des précipitations plus abondantes dans les régions humides et moins abondantes dans les régions sèches, en particulier celles qui bénéficient d’un climat méditerranéen. Nous envisageons également l’aggravation des phénomènes extrêmes – vagues de chaleur, fortes précipitations, tempêtes tropicales.
Ce changement de température se manifestera également au niveau des océans en accélérant la fonte des glaces. Dans le scénario haut, l’Océan Arctique sera libre de glace en été à l’horizon 2050, tandis que, dans le scénario bas, une couverture réduite de glace de mer sera maintenue sur l’Océan Arctique.
Quant au niveau moyen des mers, selon le scénario le plus bas il continuerait à monter, et plus vite qu’au XXe siècle, pour atteindre 40 cm en 2100 selon l’estimation la plus probable. Dans le scénario haut, l’estimation la plus probable situe autour de 75 cm l’augmentation du niveau des mers à l’horizon 2100, et l’on ne peut exclure que celle-ci atteigne un mètre.
Cette montée du niveau des mers, du fait de l’inertie de l’océan et de la réponse dans le long terme des calottes de glace, se poursuivrait, dans le scénario haut, pour se situer entre 1 et 3 mètres à l’horizon 2300.
Plus nous émettrons de dioxyde de carbone, plus nous acidifierons les océans. Dans le scénario le plus bas, le PH de l’eau continuerait à baisser au même rythme qu’actuellement ; dans le scénario le plus haut, nous aurions une perte de PH de 0,3 unité, soit 1 000 fois plus d’ions hydrogènes dans les océans, ce qui aurait des conséquences difficiles à anticiper sur les écosystèmes marins.
L’élément le plus important de ce rapport est qu’il fait apparaître une relation linéaire entre le cumul des émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effets de serre et l’évolution des températures. Cela signifie que le cumul des émissions passées, présentes et futures détermine l’évolution du climat. Nous pouvons donc relier le contrôle des températures au cumul des émissions admissibles. En d’autres termes, si nous voulons limiter le réchauffement à 2 degrés, le cumul d’émissions admissibles doit être de l’ordre de 800 gigatonnes de carbone. Or nous avons déjà émis 515 gigatonnes et le rythme actuel des émissions est de 10 gigatonnes par an. Si nous ne changeons rien, d’ici 20 à 30 ans, nous connaîtrons donc inéluctablement un réchauffement de plus de 2 degrés.
Enfin, et nous n’en avons pas nécessairement conscience, une part du changement climatique est irréversible par rapport à la durée d’une vie humaine. En effet, 20 % des émissions actuelles de dioxyde de carbone continueront à produire un effet sur le climat dans plus de 1 000 ans.
M. Philippe Dandin, anciennement directeur de la climatologie à Météo-France. L’action de Météo-France en matière d’étude du climat est double.
L’établissement public a reçu une mission de mémoire du climat – dire le temps qu’il a fait hier, il y a dix ou cent ans. À ce titre, nous servons différents utilisateurs de l’information météorologique et nous fournissons aux organismes de recherche des éléments de diagnostic recueillis en métropole et outre-mer.
L’autre aspect du travail de Météo-France est lié aux travaux de modélisation et aux recherches sur le climat effectués au Centre national de recherches météorologiques de Toulouse, qui dépend de Météo-France et du CNRS, et au sein duquel nous participons, aux côtés de nos collègues de l’Institut Pierre Simon Laplace, aux travaux que vous ont présentés les intervenants précédents.
Comment se traduiraient, en France, les chiffres présentés dans le rapport du GIEC ? Notre pays suit une trajectoire parfaitement similaire à celle présentée dans le 5e rapport. Nous avons observé au XXe siècle une augmentation de 1 degré sur le territoire métropolitain, qui s’est accélérée de 0,3 à 0,5 degré au cours des trois dernières décennies. Nous avons connu récemment des années record comme l’année 2011, la plus chaude jamais enregistrée en métropole, qui constitue une anomalie par rapport à la normale calculée sur la période 1961-1990.
J’attire votre attention sur ces chiffres. Lorsque l’on considère une moyenne globale de température, une augmentation de quelques degrés peut paraître peu significative, mais plus nous régionalisons le diagnostic et les projections climatiques à l’échelle de notre continent, de notre pays, voire de nos régions, plus les augmentations sont marquées, tout comme les variabilités entre les saisons. Pour vous donner un ordre de grandeur, la canicule de 2003 est une anomalie de 3,1 degrés par rapport aux normales saisonnières.
Il existe naturellement des disparités régionales sur notre territoire, sans même parler de l’outre-mer. Les températures minimales, qui sont un paramètre important pour la santé publique, ont évolué en France, au XXe siècle, de 0,9 degré à 1,5 degré dans les régions du Nord-ouest – Bretagne, Normandie, Nord. Les outre-mer ont connu la même évolution, avec une particularité liée à leur environnement océanique.
Les températures sont l’élément le plus robuste du diagnostic et des projections obtenues par modélisation, mais le diagnostic est beaucoup plus difficile à établir en matière de précipitations et de tempêtes, en dépit de la richesse des informations dont la France dispose dans le domaine météorologique. Ainsi au XXe siècle, la moyenne annuelle des précipitations a augmenté de 10 %, avec des disparités saisonnières marquées par une augmentation en hiver, ce qui prédispose à la survenue d’inondations, et une diminution en été, ce qui prédispose aux sécheresses. Ces phénomènes illustrent l’amplification des extrêmes que l’on commence à bien mesurer et à mieux comprendre.
Il reste des paramètres et des phénomènes pour lesquels, par manque de recul historique, nous n’avons pas la possibilité de détecter un quelconque signal d’évolution. Cela ne veut pas dire qu’il faut cesser d’accumuler des informations. Météo-France s’est ainsi engagé à rechercher une mémoire du climat dans le cadre du Plan national d’adaptation au changement climatique et dans le contrat d’objectifs et de performance qui lie l’établissement à son ministère de tutelle.
S’agissant des projections, nous avons obtenu le même signal, en ce qui concerne la France et les territoires ultramarins, que celui présenté dans le rapport du GIEC, mais avec des variations plus importantes.
M. Alexandre Magnan, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). J’évoquerai la situation des outre-mer avant d’aborder les adaptations au réchauffement climatique.
Les outre-mer français sont caractérisés par des configurations spatiales extrêmement variées qui couvrent un large gradient latitudinal. Cette grande diversité de situations complexifie grandement les travaux de modélisation climatique. La bonne nouvelle, c’est que nous disposons ainsi d’excellents observatoires des changements environnementaux liés au changement climatique.
En 2012, l’ONERC a publié la première synthèse sur les impacts potentiels du changement climatique dans l’ensemble des outre-mer et pour différents secteurs socio-économiques et environnementaux.
Outre-mer, le changement climatique intergit avec d’autres processus climatiques que nous ne maîtrisons pas encore très bien – je pense au phénomène El Nino dans le Pacifique – et amplifie les phénomènes extrêmes.
L’incertitude climatique est normale, mais les scientifiques qui travaillent sur la question des impacts et de la vulnérabilité affirment que le changement climatique exacerbera des problèmes que nous connaissons déjà et qui sont liés à des modes de développement non soutenables.
On peut établir un parallèle entre le processus de changement climatique et le processus d’anthropisation et de développement – densification de l’urbanisation, essentiellement sur le littoral dans les outre-mer, densification de l’occupation des sols occasionnant une dégradation qualitative et quantitative des ressources, et plus généralement une perturbation des activités économiques, notamment l’agriculture, la pêche et le tourisme. Mais des opportunités de développement peuvent aussi émerger. Le changement climatique pose problème à nos sociétés dans la mesure où il obligera fatalement à un redéploiement des activités et des stratégies d’exploitation des ressources, de conservation et de développement.
Dans ce contexte, les incertitudes ne sont pas une barrière infranchissable. Deux grands groupes de solutions existent en matière d’adaptation : celles qui existent et celles qui restent à inventer. Parmi celles-ci, je citerai le développement d’énergies renouvelables qui tiennent compte des évolutions futures de l’environnement, ou, dans le domaine du tourisme, la diversification de l’offre.
Mais de nombreuses solutions existent déjà, et c’est un message qui n’est pas suffisamment diffusé. Il faut d’abord poser un principe de base, « commencer par faire bien ce qu’on fait mal », c’est-à-dire cesser d’aggraver les problèmes qui se poseront dans le futur. Les scientifiques appellent cela « éviter la maladaptation aux changements climatiques ». C’est une première étape fondamentale du processus d’adaptation.
Dans le domaine de l’aménagement du littoral, il est ainsi indispensable de protéger les écosystèmes qui jouent un rôle tampon face à la mer et aux vagues – récifs coralliens, dunes de sable, mangroves – et de mettre fin à l’urbanisation des zones qui présentent un risque de submersion.
Les efforts de modélisation climatique doivent être poursuivis. Mais l’incertitude climatique n’est pas un frein à la prise de décision et à l’action parce que nous avons déjà une expérience, notamment dans le domaine des risques naturels, et c’est une bonne nouvelle.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Quels conseils pourriez-vous donner aux membres de la mission d’information sur les conséquences du réchauffement climatique pour que l’Assemblée nationale aborde dans de bonnes conditions le sommet de 2015 ?
M. Denis Baupin. Je remercie les intervenants de nous avoir rappelé la gravité du constat établi par le 5erapport du GIEC. Les précédents rapports en faisaient déjà état, mais nous n’avons rien fait et la situation s’est aggravée, comme en témoignent les récents événements climatiques. Les pires scénarii sont en train de se réaliser : le climat se dérègle progressivement et cela a des conséquences extrêmement graves pour des pays déjà très fragiles. Mais face à cette situation, nous l’avons constaté à Varsovie, certains États sont incapables de prendre des décisions.
La tenue de conférences successives peut donner le sentiment que rien n’avance, mais certains pays, comme les États-Unis et la Chine, commencent à faire évoluer leur politique en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est positif. En revanche, l’Europe, qui pendant longtemps s’est prétendue à la pointe de la lutte contre le dérèglement climatique, n’est plus exemplaire en la matière. Elle doit le redevenir.
L’engagement que nous avions pris dans le paquet énergie-climat de réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 sera largement atteint, ne serait-ce que parce que nous traversons une crise économique : en 2020, nos émissions devraient ainsi être réduites de 24 %. Si l’Europe veut donner un signal à la communauté internationale, elle doit fixer un objectif plus ambitieux, qui pourrait être une réduction de 30 % des émissions en 2020, comme cela était prévu, et pourquoi pas de 50 % à l’horizon 2030. Ce pourrait être l’objet du sommet européen qui se tiendra en mars prochain sur la politique climatique et énergétique. En tant que parlementaires, nous devons adresser ce signal aux États européens et à notre propre Gouvernement.
M. Philippe Plisson. La COP 19 – Conférence des parties – qui s’est déroulée à Varsovie a été conclue sur un accord caractérisé par un grave manque d’ambition, après le départ fracassant des ONG qui entendaient ainsi manifester leur désapprobation.
Le seuil de basculement irréversible des écosystèmes se rapprochant dangereusement, il devient urgent de se mettre en ordre de marche. Avez-vous la certitude qu’il existe un lien entre les activités humaines et l’accroissement des températures constaté depuis 1950 ?
Pouvez-vous d’ores et déjà statuer sur les conséquences du réchauffement, qui sera probablement compris entre 0,3 et 0,7 degré pour la période 2016-2035, et son coût pour la société, ou faudra-t-il attendre la synthèse des rapports des différents groupes ? Dans ce cas, à quelle date sera publiée cette synthèse ?
Quelles seront les conséquences les plus importantes du réchauffement climatique en France et en Europe au cours de ce siècle ?
Le risque d’emballement du changement climatique lié au relâchement du clathrate de méthane par le permafrost ou le fonds océanique est-il pris en compte dans votre rapport ? Une unité japonaise est en bonne voie pour exploiter des gisements de clathrate de méthane. Quelles conséquences cette exploitation pourrait-elle avoir sur le climat ?
Dans son rapport, le GIEC introduit la notion de géo-ingénierie, ce qui ouvre la voie à des méthodes de lutte contre le réchauffement climatique mais pas à la réduction des émissions. Quelles sont les limites de ces préconisations ?
Plus généralement, au vu des résultats des négociations climatiques, ne faut-il pas définitivement réduire les ambitions affichées et abandonner le scénario RCP 2.6, au profit du scénario RCP 8.5, plus réaliste ?
Enfin, après les échecs des conférences successives, que préconisez-vous, sur le fond et sur la forme, pour que la COP 2015, qui se tiendra à Paris, ne débouche pas sur la catastrophe annoncée ?
M. Martial Saddier. Les députés du groupe UMP vous remercient, madame, messieurs, pour votre présence et la qualité de vos interventions.
Je tiens avant tout à témoigner de l’engagement et de la sensibilité de mes collègues de l’UMP sur ce sujet de l’évolution du climat. En leur nom, je salue la communauté scientifique pour la qualité des documents qu’elle met à la disposition des décideurs, publics et privés.
Nous vous remercions, monsieur le président, pour la mise en place de la mission d’information sur les conséquences des changements climatiques. Nous sommes d’autant plus satisfaits que nous en avions aussi eu l’idée. Vous pouvez compter sur l’engagement des députés UMP. Quant le projet de loi sur la transition énergétique sera-t-il inscrit à l’ordre du jour du Parlement ?
Le constat des scientifiques est sans appel : la montée des températures, le réchauffement et l’acidification des océans, le recul des glaciers, l’élévation du niveau des mers et la multiplication d’événements extrêmes sont une réalité due aux activités humaines. Malheureusement, le Protocole de Kyoto, qui couvrait 33 % des émissions de gaz à effets de serre, n’en couvre plus que 15 %. Quels conseils pouvez-vous donner à la France pour que la Conférence de 2015 débouche sur un engagement ?
En ce qui concerne l’impact des activités humaines, pouvez-vous être plus précis sur le volet énergétique et la production d’électricité, qui est une source d’émissions de gaz à effet de serre ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur la pollution de l’air, qui fait l’objet d’un contentieux européen et représente un vrai défi de santé publique ? Je pense aux particules fines et à l’ozone qui auront des incidences sur l’évolution du climat.
Enfin, pouvez-vous illustrer concrètement ce qui se passera pour les stations de ski, les villes, les campagnes, l’agriculture, les mers et les océans si nous n’arrivons pas à enrayer l’évolution du climat ?
M. Bertrand Pancher. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé cette rencontre, et je remercie les personnalités qui nous font l’amitié de leur présence.
Cette table ronde nous rappelle que si nous ne faisons rien, un drame absolu se produira à très court terme. Les chiffres que vous avez cités, et qui méritent d’être rappelés en permanence, font froid dans le dos. L’augmentation du niveau des océans de près d’un mètre en 2100 serait une catastrophe économique, humaine et environnementale que l’humanité n’a jamais connue.
Pourtant des solutions simples existent. Mais comment ne pas être frappé par l’absence de mobilisation de la communauté internationale ? J’ai assisté à plusieurs conférences internationales : j’en sors de plus en plus pessimiste. Je me demande comment nous ferons de celle de 2015 un succès, ou tout au moins un début de succès.
Si nous ne bougeons pas c’est parce que les grands pays développés, dont la France, sont tétanisés à l’idée de changer leur modèle de développement. Nous sommes tellement arc-boutés sur le développement économique, coûte que coûte et par tous les moyens, que nous en oublions l’essentiel.
Je fais partie de ceux qui pensent que si nous ne réussissons pas à mobiliser l’opinion publique, nous ne ferons rien, ni sur le plan européen ni sur le plan national. Ces dernières années ont démontré que la mobilisation française et européenne pouvait nous engager vers des modèles vertueux. Nous avons ainsi dépassé nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : notre pays et l’Union européenne doivent continuer à s’engager dans ce modèle vertueux et montrer l’exemple en proposant un objectif de réduction de 50 % de l’émission des gaz à effet de serre à l’horizon 2030. En effet, si tel n’est pas le cas, les ONG prétendent que nous n’arriverons pas à une décarbonisation totale en 2050. Pouvez-vous confirmer ces informations ?
Nous devons mettre en place des règles de bonne gouvernance, notamment en instaurant la taxe carbone à l’intérieur des frontières européennes pour inciter les grands pays émergents à faire de même.
Quelles seront les conséquences du changement climatique pour les agriculteurs, le tourisme, les habitants des zones littorales ?
Comment sensibiliser les opinions publiques et l’ensemble des leaders aux conclusions de votre rapport ? Comment pourrions-nous diffuser ces informations sur l’ensemble du territoire ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Notre mission d’information devra contribuer à cette action de sensibilisation. Je rappelle que nous disposons désormais d’un plan d’adaptation au réchauffement climatique. Nous aurons l’occasion ultérieurement de faire le point sur ce dossier.
M. Patrice Carvalho. J’étais parmi les parlementaires ayant accompagné le ministre de l’écologie Philippe Martin au sommet de Varsovie, qui devait préparer celui qui se tiendra à Paris en 2015. La tâche sera rude. Des engagements avaient déjà été pris au cours de sommets précédents, notamment à celui de Copenhague qui avait fixé l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d’ici à la fin du siècle. Or, au rythme actuel d’émissions, nous atteindrons les 4,6 degrés.
Une aide de 100 milliards de dollars avait été promise aux pays du Sud pour leur permettre de réduire leurs émissions de CO2 et s’adapter aux impacts du changement climatique. Il semble qu’ils n’aient encore rien reçu. Qu’en pensez-vous ?
Le rapport du GIEC montre pourtant qu’il y a urgence à agir, et le typhon qui vient de ravager les Philippines est une nouvelle alerte. Les océans se sont élevés de 19 cm entre 1901 et 2010, et cette hausse pourrait atteindre 26 à 98 cm avant 2100. Une grave menace pèse sur les zones côtières les plus peuplées comme New York, Miami ou Bombay. L’augmentation de la température des océans et l’intensité des pluies va multiplier les cyclones. Enfin, les vagues de chaleur ou de froid comme en ont connu l’Europe en 2003 et les États-Unis en 2012 seront de plus en plus fréquentes.
Le 5e rapport du GIEC confirme le diagnostic : les activités humaines ont une responsabilité dans ce changement climatique. Pourtant la dérive se poursuit. Ainsi, la part du charbon dans les émissions de CO2 s’élève à 44 %. Depuis 2000, la production globale de charbon a progressé de 70 % pour atteindre 16,9 milliards de tonnes par an. Le charbon est l’énergie privilégiée non seulement par les pays émergents, mais aussi par les Allemands qui ouvrent des centrales à charbon pour compenser la fermeture de leurs centrales nucléaires. Ce rapport est un cri d’alarme qu’il serait urgent d’entendre avant le sommet de Paris en 2015.
Permettez-moi une question : quels seront les effets de l’augmentation de l’acidité des océans sur la faune et la flore ?
M. Jacques Krabal. Je remercie le président d’avoir prévu cette table ronde quelques jours après notre retour de Varsovie.
Madame, messieurs, je salue le travail formidable que vous avez accompli, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos souhaits. Vous avez rappelé que vous ne faites que formuler un diagnostic, à charge pour d’autres de prendre les décisions qui s’imposent.
Au-delà des résultats obtenus à Varsovie, nous devrions nous inquiéter, nous parlementaires, de voir que les décisions que nous prenons ne s’inscrivent pas toujours dans une démarche de limitation du réchauffement climatique.
Nous devons insister sur la gravité de la situation et dénoncer l’aggravation perpétuelle du phénomène. Comme le soulignait Stéphane Hessel, « Le dérèglement climatique s’aggrave et s’accélère, mettant à mal dès aujourd’hui les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur terre ».
Les rapports de la Banque mondiale publiés le 18 novembre dernier avancent des chiffres alarmants : 2,5 millions de morts en 30 ans à cause du climat, 4 000 milliards de dollars de dommages causés par les événements climatiques extrêmes. Il ne faut pas remettre à plus tard la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Pourtant, force est de constater que nos besoins d’énergies fossiles ne cessent d’augmenter, que nous redémarrons des centrales à charbon, que nous nous lançons dans l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. À ce propos, j’espère que notre ministre de l’écologie ne signera pas les permis de recherche en Seine-et-Marne et dans l’Aisne.
Je crains que la crise économique ne soit un prétexte, ici et ailleurs, pour diminuer l’effort engagé de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ne pas envisager de changer de modèle de développement économique ?
Quel regard portez-vous sur la COP 19 ? Qu’en avez-vous retenu ? Peut-on espérer accroître les financements destinés à la lutte contre le réchauffement climatique dans un contexte économique défavorable ? Comment conjuguer croissance économique et réduction des gaz à effet de serre ? Quelle fiscalité écologique mettre en place ?
Je m’adresse à MM. Dandin et Magnan : si nous ne faisons rien ou pas plus, quelles seront demain les conséquences du réchauffement pour notre planète ? Comment l’étude du climat peut-elle éclairer notre futur ? Quels impacts réels aurait le réchauffement sur la vie ?
Monsieur Magnan, que recouvre le concept de « maladaptation aux changements climatiques » ?
Enfin, madame Masson-Delmotte, quelle pédagogie devons-nous adopter pour que la COP 21 de Paris soit une réussite ?
M. Philippe Noguès. Je remercie à mon tour les intervenants pour leur présence ainsi que pour la pédagogie et l’effort de vulgarisation dont ils font preuve. Le 5e rapport et l’écho qu’il a pu trouver auprès des dirigeants du monde m’inquiètent. Alors même qu’il est confirmé que les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique, nous nous engouffrons dans une crise écologique sans précédent dont personne ne maîtrise avec précision les impacts financiers et humains.
Les conclusions de la COP de Varsovie viennent assombrir le tableau. L’Australie et le Japon ont d’ores et déjà reculé sur les engagements qu’ils avaient pris en 2009, et les États-Unis refusent de parler d’« engagement » de réduction de l’émission de gaz à effets de serre, préférant évoquer une « contribution ». Les négociations portant sur le caractère juridiquement contraignant d’un accord qui s’appliquerait à tous sont au point mort. Et la commissaire européenne à l’action pour le climat nous a souhaité « bon courage » pour l’organisation de la COP 21 à Paris.
En France, le tableau est peut-être un peu moins sombre, mais à quel prix ? Sans m’étendre sur le coût de fonctionnement de notre parc nucléaire, je constate que nous ne sommes pas capables de démanteler une seule centrale en France, et les récents événements de Fukushima nous ont démontré, si cela était nécessaire, notre vulnérabilité face à une technologie à très haut risque.
Que proposerons-nous demain si nous ne prenons pas rapidement conscience de l’urgence de la transition énergétique et de la nécessité de nous doter des moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour développer sans modération les énergies renouvelables qui représentent, je le déplore, une part marginale de notre production énergétique ? Si nous ne le faisons pas, il nous restera peut-être l’autre solution, celle qui consiste à construire des digues, des arches, des bunkers et des abris anti-nucléaires. Auquel cas, il faut faire vite ! Mais je suis peut-être trop pessimiste…
M. Jacques Kossowski. J’ai été surpris par les résultats d’un baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat publié le 2 août dernier par le Commissariat général du développement durable. Selon cette enquête, 35 % de nos compatriotes sont climato-sceptiques et nient les conclusions du GIEC sur le sujet, 22 % considèrent que le changement climatique est une réalité mais qu’il n’est pas prouvé qu’il soit le résultat des activités humaines, 13 % doutent de la réalité du changement climatique et 4 % sont sans opinion. Certes, une majorité de Français – 61 % – est convaincue de la réalité du changement climatique et considère qu’il est dû aux activités humaines.
Un tel niveau de scepticisme ne remet-il pas en cause la communication publique des travaux des scientifiques du GIEC ? Car s’il est essentiel de rédiger un rapport, encore faut-il que ses conclusions soient massivement diffusées au sein de la population. Le Gouvernement a peut-être son rôle à jouer dans cette diffusion. Si nous voulons obtenir le consentement actif de nos compatriotes dans la lutte contre le réchauffement climatique, encore faut-il les convaincre qu’il est urgent de changer leurs habitudes de vie et de consommation.
Mme Sophie Errante. Le rôle de poumon des forêts est essentiel en matière de lutte contre le réchauffement climatique. L’exemple de l’Amazonie, sur le territoire de la Guyane, montre qu’en séquestrant le carbone dans les sols et la biomasse, la forêt participe activement à la lutte contre le changement climatique.
Cette question était au cœur des discussions de la Conférence de Globe International qui s’est tenue la semaine dernière à Varsovie, parallèlement à la COP 19 et à laquelle j’ai eu l’opportunité de participer. À l’issue de cette conférence, de nombreuses questions restent sans réponse, comme celle de la valeur du service rendu par la nature. Comment calculer le prix du service rendu par les forêts qui captent les émissions de gaz à effets de serre ? Qui doit payer, et combien ? Comment calculer l’impact sur la santé et l’économie de l’absence de considération du réchauffement climatique ?
M. Guillaume Chevrollier. Ma question s’adresse à M. Magnan. Les différents scénarii, même les plus favorables, prévoient que le réchauffement climatique va entraîner des perturbations considérables. Vous affirmez que les sociétés développées n’y sont pas nécessairement moins vulnérables que les autres.
On pourrait pourtant croire que les pays riches sont les plus aptes à se protéger des aléas climatiques puisqu’ils sont informés des conséquences et que les risques naturels sont identifiés. Pouvez-vous nous expliquer votre affirmation ?
M. Philippe Bies. Les derniers travaux du GIEC confortent le constat du réchauffement climatique et du rôle des activités humaines dans ce dernier. La réduction durable des émissions de gaz à effet de serre constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics.
Au plan international, la France accueillera en 2015 la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle devra porter haut l’engagement de réduction des émissions et peut-être proposer une nouvelle méthode de travail permettant d’obtenir de meilleurs résultats.
Au plan national, le Gouvernement s’est engagé à déposer une loi-cadre sur la biodiversité ainsi qu’une loi sur la transition énergétique. Cette dernière devrait encourager le développement des énergies renouvelables qui est le corollaire de la diminution de notre dépendance aux énergies nucléaire et fossiles.
Au plan local, les collectivités fédèrent de plus en plus les acteurs privés et publics au travers des plans climat-énergie et des contrats de performance énergétique. Ces instruments sont efficaces mais insuffisants. Nous savons que les financements innovants joueront un rôle moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quelle doit être, selon vous, la stratégie française en la matière, non seulement dans les négociations internationales, mais aussi au niveau local pour mettre à la disposition des collectivités territoriales de nouveaux outils ?
M. Jean-Marie Sermier. Tout d’abord, je souhaiterais faire part de mon étonnement : tous les groupes parlementaires étaient-ils représentés à la conférence de Varsovie comme le voudrait le consensus qui existe sur le sujet ?
Je suis dubitatif : la France serait le seul pays vertueux tandis que les autres pays ne s’intéresseraient pas au problème du changement climatique – le Japon a réduit ses objectifs, les États-Unis sont sceptiques et la Chine est indifférente. Comment expliquez-vous que les gouvernants de ces pays ne soient pas sensibles à vos arguments ? Serait-il possible que certains dirigeants internationaux soient, à l’instar des Français évoqués précédemment, climato-sceptiques ?
On sait que les émissions de CO2 proviennent principalement des énergies fossiles. Quel serait l’impact d’une modification de la capacité de production d’énergie nucléaire sur les changements climatiques ? Avez-vous élaboré un scénario avec le nucléaire et un autre sans le nucléaire ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. M. Bernard Deflesselles était, me semble-t-il, membre de la délégation parlementaire à Varsovie pour le groupe UMP, de même que M. Julien Aubert. Pour la prochaine conférence à Lima, je céderai s’il le faut ma place à un représentant du groupe UMP. (Sourires)
M. Jean-Pierre Vigier. Madame, messieurs, je vous remercie pour vos exposés qui dressent un constat alarmant. La conférence de Varsovie, loin d’être un succès malgré quelques avancées, a abouti à un accord minimal. Plusieurs pays émergents ont fermement refusé d’inscrire dans le document final le terme d’engagement, lui préférant celui plus équivoque de contribution. Pour l’Union européenne en revanche, l’engagement est le seul moyen de progresser dans la lutte contre l’effet de serre.
Comment, dans ces conditions, peut-on espérer un succès de la conférence de 2015 à Paris ? Comment peut-on imposer aux pays émergents des mesures de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre ?
M. François-Michel Lambert. Vous avez mis en évidence le lien entre l’hyperexploitation des ressources et le réchauffement climatique. Le commissaire européen, M. Potočnik, a évoqué l’urgence à passer d’un modèle de gaspillage à un modèle de préservation des ressources. Avez-vous évalué les conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre du gaspillage des matières premières et celles d’un modèle de développement vertueux fondé sur l’économie circulaire ?
Les subventions aux activités polluantes sont estimées à 50 milliards d’euros par an en France et entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars dans le monde. Que vous inspirent ces chiffres ?
Ne croyez-vous pas que nous sommes menacés d’une rupture de notre modèle de société, davantage que d’un glissement progressif ? La démographie, l’élévation du niveau de vie dans le monde, la raréfaction des ressources et l’aggravation des impacts climatiques en sont pour moi autant de signaux convergents.
M. Michel Heinrich. Votre constat est sans appel. Il est d’autant plus angoissant que l’Europe intensifie le recours aux centrales thermiques. J’ai été frappé par les commentaires, après la publication du rapport du GIEC, qui continuent à mettre en doute la corrélation entre réchauffement climatique et émissions de gaz à effet de serre.
M. Laurent Furst. La consommation des trois énergies fossiles – gaz, pétrole et charbon – est, avec le développement de l’agriculture, la principale responsable du changement climatique. Or, le seul élément susceptible de la limiter est le prix. Tant qu’une régulation ne sera pas mise en place, il n’y aura aucune politique mondiale de lutte contre le réchauffement climatique digne de ce nom… Le reste relève de la philosophie.
Comment peut-on mettre en place une régulation de la production et de la consommation de ces énergies ? L’intérêt économique de la France rejoint les exigences de la lutte contre le changement climatique pour imposer des politiques alternatives puisque 70 % de l’énergie sont aujourd’hui importés.
M. Jean Jouzel. Nous ne sommes pas armés pour répondre à toutes vos questions. Vous devriez interroger les spécialistes des impacts et les économistes – je pense à Roger Guesnerie, Jean-Charles Hourcade et Franck Lecocq – qui travaillent avec nous. Eux aussi réfléchissent aux positions que la France pourrait défendre dans les négociations.
Je suis d’abord un chercheur qui travaille à partir de données du passé nous renseignant sur le fonctionnement du système climatique. Mais, outre le rapport du GIEC, j’ai participé au Grenelle de l’environnement comme responsable du thème « énergie et climat » avec Nicholas Stern ainsi qu’au débat sur la transition énergétique au titre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour lequel je prends part à la rédaction d’un avis sur l’adaptation au réchauffement climatique.
Je vais répondre sur quatre points : la conférence de 2015, le rôle des activités humaines dans le changement climatique, les problèmes de communication et le nucléaire.
S’agissant de la conférence de 2015, je rappelle que nous sommes dans la deuxième phase du protocole de Kyoto qui prendra fin en 2020. L’Europe est aujourd’hui presque la seule à appliquer celui-ci puisque le Japon, le Canada et l’Australie ont annoncé à Varsovie qu’ils ne tiendraient pas leurs engagements. Après Bali en 2007, qui fut une date importante, et Copenhague en 2009, qui a substitué à l’objectif qualitatif un objectif quantitatif « tout faire pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés », la conférence de Durban a débouché sur la mise en place d’une plateforme. Les Chinois ont joué un rôle majeur dans le dénouement tardif de cette conférence en acceptant de commencer un cycle de négociations en vue d’un accord pour l’après 2020 qui engage tous les pays, alors que le protocole de Kyoto n’engage que les pays développés.
La conférence de 2015 comporte deux volets : le premier, souvent oublié, consiste à renforcer immédiatement les ambitions de réduction des émissions. Il est en effet avéré que seul un changement de modèle de développement dans la décennie à venir permettra de respecter la trajectoire d’un réchauffement inférieur à deux degrés. Il y a un fossé entre la trajectoire actuelle et celle vers laquelle nous devrions tendre. Nous savons déjà que les émissions sont supérieures de 15 à 20 % à ce qu’elles devraient être pour respecter l’objectif de 2020.
Le second volet porte sur la conclusion d’un accord qui engage tous les pays.
Les parlementaires ont un rôle actif à jouer dans la préparation de la conférence de Paris, pour laquelle Ban Ki-moon a déjà convoqué les chefs d’État en septembre prochain. Avant Paris, d’autres étapes intéressantes sont prévues, dont la conférence de Lima.
Pour préparer la COP 21, un comité se réunit régulièrement sous la présidence de Laurent Fabius. Outre les trois ministres – MM. Laurent Fabius, Pascal Canfin et Philippe Martin – il rassemble M. Pierre-Henri Guignard, qui en est le secrétaire général, M. Jacques Lapouge, ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique, M. Nicolas Hulot, ambassadeur pour la planète, Mme Laurence Tubiana, M. Pierre Radanne, M. Ronan Dantec, M. Hervé Le Treut et moi-même. La prochaine réunion portera sur l’implication de la société civile. L’intervention de trois ministres dans l’organisation de cette conférence risque néanmoins de rendre la tâche difficile.
Je suis personnellement très attaché à l’implication de la communauté scientifique. Nous proposerons l’organisation d’une grande conférence début 2015, comme cela avait été fait à Copenhague. Le CESE devra aussi s’impliquer, de même que les parlementaires. Je vous remercie donc de nous avoir invités à discuter avec vous. On ne réussira pas 2015 si on n’attire pas les chercheurs, les jeunes et la société civile. Il y a beaucoup à faire et nous devons le faire ensemble.
Il faut savoir que la présidence joue un rôle dans les COP, même si la France n’est pas négociatrice puisque ce rôle est dévolu à l’Union européenne, et c’est d’ailleurs une bonne chose.
La conférence de Paris sera la seule réunion internationale importante en France sous la présidence de M. François Hollande. Nous devons tous nous mobiliser. Je suis sûr que les parlementaires pourront apporter beaucoup à cette conférence dans laquelle il est important que la France et l’Europe s’investissent fortement. L’adoption d’une loi ambitieuse sur la transition énergétique, répondant aux quinze enjeux identifiés du débat national, est un passage obligé. Une appréciation positive de cette loi à l’étranger crédibilisera la parole de la France. Il vous appartient donc de faire voter un texte à la hauteur des ambitions affichées. Le débat sur la transition énergétique, très riche, a fait apparaître des désaccords sur le nucléaire et les gaz de schiste.
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 pose que la France soutient l’objectif d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés, qui correspond à la feuille de route de la conférence de Bali. Une division par deux des émissions mondiales à l’horizon 2050, sans nuire au développement, est possible et très souhaitable. Le coût de l’énergie dans nos importations – 70 milliards d’euros pour les combustibles fossiles – doit faire réfléchir.
Quant au rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique, les réponses sont, depuis le premier rapport du GIEC, chaque fois plus précises. Ce rôle a d’abord été qualifié de possible, ensuite de probable, puis de très probable dans le rapport de 2007. Aujourd’hui, le diagnostic est plus clair encore : il y a plus de 95 chances sur 100 pour qu’une part importante du réchauffement des cinquante dernières années soit liée aux activités humaines. Cette affirmation s’appuie sur des chiffres. Le réchauffement planétaire a été de 0,6 à 0,7 degré lors des cinquante dernières années quand il est presque le double en France. Nous faisons la part des causes naturelles – l’activité solaire, la variabilité naturelle, l’activité volcanique – mais elles ne représentent pas plus d’un dixième de degré de réchauffement. Les sept-dixièmes peuvent être expliqués par les activités humaines. En outre, tous les compartiments du système climatique se réchauffent, d’où des conséquences sur l’atmosphère, le niveau de la mer, la fonte des glaces.
Le diagnostic est aujourd’hui bien plus documenté et les arguments des climato-sceptiques sont minces. Personne dans la communauté scientifique ne remet en cause les conclusions du GIEC. La contestation n’a aucun fondement scientifique ; elle repose sur des considérations philosophiques. Malheureusement, ce sont celles-ci qui font que 30 % des Français restent climato-sceptiques. Le discours des sceptiques n’a rien à voir avec la réalité des faits. Dans le cadre du Haut conseil de la science et de la technologie que je préside, nous avons réfléchi à ce problème de perception. Il y a beaucoup à faire en matière de communication pour rétablir la confiance des citoyens dans le monde scientifique.
Enfin, s’agissant du nucléaire, je considère qu’il est normal de s’interroger, mais je ne suis pas antinucléaire. Il faut avoir en tête les chiffres suivants : le nucléaire mondial fournit 2 % de l’énergie finale et, même s’il connaît un développement sans frein, ce chiffre ne dépassera pas 6 %. À l’inverse, à l’horizon 2050, les énergies renouvelables permettraient de subvenir à 50 % des besoins planétaires en énergie finale. Je plaide donc pour que la France investisse massivement dans les énergies renouvelables, car c’est là que les choses vont se passer dans les vingt ou trente prochaines années.
Mme Valérie Masson-Delmotte. Je revendique le scepticisme. Je suis rémunérée par de l’argent public non pas pour défendre une thèse, mais pour remettre en cause constamment l’état des connaissances.
L’action de l’homme sur le climat est l’objet d’un déni dont les causes sont multiples : absence de formation aux sciences du climat, fossé entre la perception quotidienne et le discours sur le climat, peur et impuissance. Ce déni porte parfois sur des faits avérés. C’est le cas pour l’action de l’homme sur la composition atmosphérique et son effet sur le climat, qui correspond à de la physique élémentaire. Or, le déni est alors en décalage complet avec les connaissances scientifiques.
Une présentation caricaturale laisse croire que seul le CO2 a une influence sur le climat, ce dont certains ne manquent pas de tirer argument pour contester les préconisations en matière de lutte contre le réchauffement. Or le système climatique est complexe. Il réagit à des facteurs naturels – soleil et volcans, avec un rôle déterminant pour ces derniers – et subit des fluctuations internes dont une part seulement est prévisible. Là encore, la formation et l’éducation sur le système climatique sont insuffisantes.
Le doute porte aussi sur le bien-fondé de l’urgence à prendre certaines mesures de court terme face aux conséquences d’un climat qui change. Cela demande selon moi d’une véritable réflexion politique.
Il est difficile pour les scientifiques de faire des recommandations à l’intention des politiques. Néanmoins, en tant que parlementaires, vous faites le lien entre le niveau national et le niveau local. Dans le même esprit, il serait utile de faire une synthèse nationale des plans territoriaux énergie-climat. Cette lecture serait intéressante pour les Français car elle permettrait d’identifier les vulnérabilités du territoire et les voies d’action.
La formation des élus est notoirement insuffisante, comme celle des professionnels. Quant à l’école, les enseignements manquent d’un fil conducteur.
Nous avons besoin d’une communication positive qui propose une stratégie en réponse à un constat qui est anxiogène. J’observe également un décalage croissant entre les élus et la jeunesse, faute de sensibilisation aux enjeux de long terme. La question du climat dépasse le temps d’un mandat et d’une vie humaine. Il faut parvenir à associer la jeunesse, à transmettre et à construire un lien entre les générations. Cette mobilisation de la jeunesse est également essentielle pour s’adresser à l’opinion publique.
Enfin, il ne faut pas séparer la question du climat des aspects sociaux et de l’emploi. Il s’agit non pas uniquement de sauver la planète, mais de construire un monde dans lequel on puisse vivre dignement et où le coût de l’action soit justement partagé. Il est évident que l’augmentation du prix de l’énergie est le seul levier efficace pour réduire la consommation. Mais comment faire appel à ce moyen de la manière la plus équitable possible, sans pénaliser ceux qui souffrent le plus aujourd’hui ? L’équité et la justice sociale sont indispensables.
Quant à l’impact de l’homme sur le climat, nous avons besoin de grands instruments d’observation et d’étude pour appréhender un système complexe. Cette science n’est pas disponible dans les pays pauvres. L’Afrique souffre d’un déficit de scientifiques du climat, ce qui pose problème pour réaliser l’adaptation locale. Il faut peut-être s’appuyer sur la francophonie pour transmettre les connaissances scientifiques et construire ensemble des moyens d’action communs pour surmonter les blocages nationaux.
Nous travaillons non pas sur les corrélations – aucun constat n’est fondé sur les corrélations entre gaz à effet de serre et climat –, mais sur la compréhension des processus en appliquant à un système complexe des lois de la physique bien établies.
La qualité de l’air, s’agissant de l’ozone et des particules, dépend des émissions. Dans un climat qui se réchauffe, la concentration d’ozone pourrait diminuer en surface. En revanche, plus les émissions de méthane sont importantes, plus la concentration d’ozone va augmenter. Dans les grandes villes, les pics de chaleur vont certainement augmenter la concentration ponctuelle en ozone et en particules fines, dont les effets importants sur la santé sont connus.
La question du dégel du permafrost, avec le risque de libération de gaz à effet de serre due au réchauffement des zones arctiques, est prise en compte dans le rapport du GIEC à partir de l’état des connaissances, qui demeure partiel. À l’horizon 2100, dans le scénario le plus haut, les rejets de méthane et de dioxyde de carbone pourraient représenter l’équivalent de 10 à 20 % des émissions humaines. Ces rejets de gaz à effet de serre viendront s’ajouter aux rejets actuels et occasionneront un réchauffement plus important. L’exploitation des hydrates de méthane sous-marins a-t-elle un impact ? C’est une source d’énergie fossile qui s’ajoutera aux autres.
M. Philippe Dandin. Je partage entièrement ce que vient de dire Mme Masson-Delmotte. Nous sommes engagés quotidiennement auprès des jeunes et de la société pour essayer de transmettre une part de nos savoirs.
Nous disposons d’éléments solides sur l’évolution des températures. En revanche, des incertitudes demeurent sur les précipitations. Nous alertons néanmoins sur la disponibilité de la ressource en eau du fait de l’évapotranspiration que provoque le réchauffement. Dans nos projections, la quasi-totalité du territoire pourrait, à la fin du XXIe siècle, connaître toute l’année une sécheresse similaire à celle de 1976. Dès la moitié du siècle, des zones importantes pourraient en être victimes. Quand on quitte les chiffres et les rapports pour faire appel à la mémoire – je pense à 1976 ou à l’épisode du printemps 2011 –, on peut éveiller l’attention et mettre en mouvement la société. Nous montrons parfois l’image d’agriculteurs appelant la pluie dans leurs prières devant un calvaire en 1976.
Notre premier travail consiste à parfaire la connaissance scientifique et à améliorer le diagnostic. Il y a dix ans, sur la carte d’évolution des précipitations par département, de nombreux départements n’étaient pas renseignés faute de données suffisamment solides, malgré une riche histoire météorologique. Nous avons entrepris un effort de reconquête qui s’apparente à de la paléoclimatologie dans les archives. Cet effort n’est possible qu’avec le soutien financier du mécénat, en complément du soutien institutionnel, en l’occurrence de la Fondation BNP Paribas.
Nous devons couvrir le territoire pour des raisons non seulement scientifiques, mais aussi politiques car certains élus nient la réalité. Or ces derniers doivent être de puissants relais d’opinion. Le message que nous portons est que notre devoir est de regarder la situation avec lucidité.
Les pays doivent s’adapter parce que le système climatique est en mouvement. L’adaptation consiste en une gestion des risques qui tienne compte d’échéances plus longues et plus complexes. En la matière, nous observons un fourmillement de bonnes volontés et d’actions qui demeurent isolées. Il manque une stratégie et une planification sur le modèle du plan que nous avons connu il y a quelques années.
Nous rencontrons des chargés de mission dans les collectivités territoriales, qui élaborent seuls dans leur coin des plans climat-énergie et nous appellent à la rescousse. Mais les climatologues ou les météorologues ne sont pas aptes à couvrir tous les champs des plans climat-énergie territoriaux. Ces chargés de mission sont parfois une manière de se donner bonne conscience.
Nous ne nous intéressons pas aux industriels et à ce qu’ils font dans ce domaine alors qu’eux ne peuvent pas se permettre de faire l’impasse sur l’analyse de tous les possibles.
Il faut accepter l’idée que l’adaptation a un coût, mais celui de la non adaptation est encore plus élevé. Il faut donc porter un nouveau regard sur nombre de secteurs de notre économie dont les activités ont un impact sur le climat.
Enfin, pour conclure, je veux répéter combien Météo-France est engagé en matière de changement climatique. L’établissement public travaille à cet effet en collaboration avec l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) et le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (CERFACS), ainsi qu’avec toutes les communautés connexes à la météorologie, l’agronomie, l’hydrologie. Nous sommes en effet convaincus de la nécessité de renforcer la cohérence de l’action des organismes publics dans ce domaine. Nous avons ainsi créé une mission, baptisée « mission Jouzel » qui doit fournir une synthèse des scénarii climatiques pour la France métropolitaine et l’outre-mer. Nous souhaitons faire des projections sur l’ensemble du territoire des conclusions du GIEC, qui soient suffisamment unanimes et cohérentes pour être utilisées par tous les acteurs de l’action publique.
Nous ne sommes pas assez nombreux et devons encourager la participation de tiers capables de relayer l’information, d’être à vos côtés et aux côtés des industriels. Je n’ai malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais si j’avais un seul mot à dire, ce serait : « plan ».
M. Alexandre Magnan. J’ai publié un livre dans lequel j’affirme que nous sommes tous vulnérables au changement climatique. La communauté internationale a tendance à penser que seuls les pays pauvres souffrent de vulnérabilité et que les pays développés n’y sont pas exposés. Réduire la vulnérabilité ne serait qu’une question de moyens. Cela est partiellement vrai. L’argent permet en effet de réduire les risques et de mettre en place des plans, mais il n’apporte pas une solution à tous les problèmes. Nos pays ne doivent pas se sentir à l’abri des impacts du changement climatique. Les pays plus pauvres, les atolls ou les territoires aux marges de l’Arctique, sont en première ligne car ils seront les premiers à subir les effets du changement climatique, mais cela ne signifie pas que les pays développés ne sont pas concernés. Nos exposés vous l’ont montré.
La « maladaptation » ne traduit pas une vision négative. Elle signifie que l’adaptation est une entreprise difficile. Au niveau local, les décideurs, qu’ils soient dans les entreprises ou dans les collectivités, sont confrontés à la même question difficile : comment développer une stratégie d’adaptation au changement climatique sans connaître les impacts précis de celui-ci ? Comment se préparer à l’inconnu ? Cette question est légitime et la réponse scientifique n’est pas claire.
Pour les milieux coralliens que je connais bien, nous pouvons expliquer aux décideurs : plus vous rejetez vos eaux usées sur les récifs, plus vous cassez les récifs pour construire des accès, plus vous perturbez la dynamique sédimentaire et plus vous serez confrontés à des problèmes d’érosion, plus vous limiterez la capacité des écosystèmes à répondre naturellement aux problèmes. Nous leur disons aussi : il y a une part d’incertitude, mais l’incertitude fait partie de votre métier. En outre, il y a aussi des certitudes sur la dégradation à l’œuvre du système climatique. L’idée de la « maladaptation » peut se résumer ainsi : il y a des choses à inventer, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on sait comment agir. Il faut donc trouver les moyens de passer des discours à la réalité.
Vous avez demandé des exemples susceptibles de mobiliser l’opinion publique. Un bilan des plans climat-énergie territoriaux offrirait certainement de bons exemples. La tempête Xynthia fournit un autre exemple : elle a fait énormément de dégâts et elle a induit une évolution de la législation sur l’aménagement et la protection du littoral qui a marqué les esprits pour un temps. Je crois à la force de l’exemple, mais cela ne fait pas tout. Tant que les populations ne sont pas directement touchées par des catastrophes naturelles, la prise de conscience reste insuffisante.
S’agissant de la mobilisation de l’opinion publique, le problème vient de ce que le changement climatique est perçu comme un élément très négatif. Le message ne parvient pas à passer auprès de l’opinion publique car celle-ci n’a pas envie de se confronter à la peur. L’urgence et la catastrophe annoncée ne sont pas des messages mobilisateurs et efficaces. Il serait bienvenu d’introduire une vision positive mettant en avant les moyens dont nous disposons déjà pour agir. Les atolls, parce qu’ils sont confrontés aujourd’hui au changement climatique, sont dans l’obligation de trouver des solutions – bonnes ou mauvaises – permettant de répondre aux enjeux économiques et démographiques et de se protéger contre les risques naturels. On pourrait les présenter comme des pionniers de l’adaptation plutôt que comme des victimes du changement climatique. Cette approche positive serait davantage pertinente que la vision négative qui est improductive.
L’adaptation au changement climatique s’inscrit pleinement dans la logique du développement durable. Si le développement durable pose les principes de l’adaptation, le changement climatique impose les échéances. La Commission pourrait insister sur ces échéances car les conditions de l’action – les principes et les moyens – sont réunies.
Mme Valérie Masson-Delmotte. S’agissant de la géo-ingénierie, on nous a demandé s’il serait possible de compenser une partie de l’impact des gaz à effet de serre sur le climat grâce à différentes technologies, matures ou encore embryonnaires. On commence à évaluer les conséquences du déploiement de ces technologies. Dans le cas de l’injection massive de particules d’aérosols pour créer un effet parasol contre le réchauffement induit par les gaz à effet de serre, le rapport du GIEC montre que le recours à cette technique permettrait de compenser une partie du réchauffement de surface au détriment de changements majeurs dans le cycle de l’eau. Mais cette technologie devrait être utilisée indéfiniment car un arrêt de l’injection entraînerait un réchauffement brutal au lieu d’un réchauffement progressif. Cela fait aussi partie du travail du GIEC de fournir des éléments d’aide à la décision sur le déploiement de nouvelles technologies, à partir des méthodes utilisées pour évaluer les risques climatiques.
Le risque pour le niveau des mers de l’instabilité des parties marines de la calotte de l’Antarctique est difficile à quantifier. Dans le rapport, il est fait état d’un risque possible au cours du XXIe siècle d’une montée du niveau des mers de quelques dizaines de centimètres. Mais nous avons une incertitude majeure sur l’anticipation et la modélisation du glissement des parties marines de l’Antarctique.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants d’avoir consacré cette matinée à nous parler d’un sujet qui nous passionne et qui nous place devant nos responsabilités.
La conférence de 2015 sera pour nous tous une opportunité de réfléchir, de proposer et de faire de la pédagogie afin de sensibiliser les citoyens aux risques à venir.
La réponse au changement climatique réside dans la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement. C’est ainsi que nous ferons ressortir les éléments positifs.
Le changement climatique illustre le débat permanent entre l’urgence du court terme et les exigences de long terme. Il est de notre responsabilité de nous battre pour un nouveau modèle de développement afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit d’un vrai et long combat. À cet égard, la mission d’information que nous avons créée en vue de la conférence de 2015 est une bonne initiative.
10. Audition de M. Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement (14 janvier 2014)
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la Commission. La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire souhaite suivre les négociations environnementales internationales car, d’une part, elles concernent nos secteurs de compétence – les affaires maritimes, la biodiversité terrestre et marine, l’accessibilité à l’eau, les questions liées à la désertification et au reboisement – et d’autre part, notre pays y occupe une place essentielle.
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui a eu lieu du 11 au 22 novembre dernier à Varsovie, nous avons auditionné le 30 octobre M. Jacques Lapouge, ambassadeur chargé des négociations internationales sur les changements climatiques.
Nous accueillons aujourd’hui M. Jean-Marc Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement, qui va nous informer sur le déroulement des autres négociations environnementales internationales ainsi que sur les positions défendues par la France et les États les plus impliqués.
Monsieur l’ambassadeur, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Quels sont les enjeux des négociations actuelles et sur quels thèmes portent-elles ?
M. Jean-Marc Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement. Je vous remercie, monsieur le président, et vous adresse, ainsi qu’aux membres de la Commission du développement durable, mes meilleurs vœux durables pour la nouvelle année.
Qu’est-ce qu’un ambassadeur délégué à l’environnement ? Ce poste a été créé par les autorités françaises, en 2000, suite à un rapport qui visait à tirer les conclusions de la nouvelle donne internationale après les négociations du premier Sommet de la terre de Rio et l’adoption d’un certain nombre de grandes conventions internationales. Ces négociations, de par leur multiplicité et la transversalité des sujets abordés – la notion de développement durable nécessite de traiter simultanément des sujets environnementaux, mais également économiques et sociaux – posaient à la France un certain nombre de difficultés. J’ai pris mes fonctions en juin 2010 en tant que cinquième titulaire du poste.
Que recouvre le champ d’action de l’ambassadeur délégué à l’environnement ? Tout ce qui a trait à l’environnement et au développement durable, hors climat, dans le cadre des négociations internationales, même si, au fil du temps, pour des raisons liées à la politique interne ou à la dynamique des négociations, les autorités ont autonomisé certaines négociations.
Ce fut le cas d’abord des négociations liées aux pôles, pour lesquelles un ambassadeur spécifique a été désigné – il s’agit de l’ancien Premier ministre Michel Rocard – puis, en 2007, des négociations climatiques internationales, qui ont été séparées du champ global de l’environnement lors de la création d’un grand ministère de l’environnement, du développement durable, de l’énergie, du logement et de la mer.
Il reste à l’ambassadeur délégué à l’environnement tout ce qui concerne la planète, à l’exception des pôles, donc, et de l’atmosphère. Il participe ainsi aux négociations relatives aux sols – prévention de la désertification et de la dégradation des sols, forêts, biodiversité – aux océans et aux mers, aux produits chimiques. Il suit en outre les instruments financiers internationaux liés à ces sujets, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et les institutions internationales en charge de ces sujets, en particulier le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il s’intéresse à l’ensemble des sujets transversaux relevant du développement durable, tout particulièrement au sein des institutions new-yorkaises comme le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, et enfin il participe aux négociations transversales comme le Sommet de la terre – j’étais le chef de la délégation française lors de la Conférence dite « Rio+20 » qui s’est achevée il y a deux ans.
Maintenant que je vous ai présenté l’essentiel de ma mission, je voudrais insister sur trois points.
Je veux avant tout vous dire que tous ces sujets finiront devant vous, parlementaires, à un moment où à un autre, qu’il s’agisse de traités internationaux devant être ratifiés ou de projets de loi portant mise en œuvre d’engagements internationaux.
Vous aurez à connaître de ces sujets à travers les conséquences de ces textes. Les négociations sur tous ces sujets ayant un aspect transversal – à la fois environnemental, social et économique – elles ont un impact sur les règles internationales dans les domaines des échanges, de la propriété intellectuelle, de l’industrie et du développement économique, social et environnemental.
Ce sont enfin des sujets en forte croissance, dont l’importance, en termes de conséquences et de décisions prises, est de plus en plus grande. Il ne s’agit plus de déclarations de principe, mais de textes susceptibles d’une mise en œuvre concrète. En outre, les enceintes internationales s’emparent de nouveaux sujets qui finissent par s’ancrer – je pense au changement des modes de production et de consommation, qui fait l’objet d’objectifs définis au niveau international pour développer l’économie circulaire, consommer autrement et faire face aux défis de la planète de manière soutenable – pour l’ensemble des pays, des économies et des populations.
Telles sont les raisons pour lesquelles ces sujets sont importants et méritent toute votre attention.
Ces sujets ne sont pas optionnels. Que nous le voulions ou non, ils s’imposent à nous. Car nous partageons une planète unique, et la population est passée de 5 milliards d’individus il y a une trentaine d’années à 7 milliards. La terre comptera 9 milliards d’habitants en 2050 et probablement 11 milliards en 2100. Or notre planète ne dispose pas, en l’état actuel des modes de production et de consommation, des ressources suffisantes pour faire face aux besoins légitimes d’une population sans cesse croissante.
L’enjeu auquel sont confrontés l’ensemble des États, individuellement et collectivement, sachant que les ressources renouvelables sont minoritaires, est de faire face aux besoins de populations comme la nôtre, qui souhaitent vivre mieux, ce qui suppose consommer plus, et de populations qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté ou accèdent à peine au confort et qui souhaitent également consommer plus. C’est un point que nous abordons dans le cadre de nos discussions sur l’économie circulaire.
Les négociations internationales, dont le point de départ semble environnemental, ne se comprennent donc que dans une perspective globale de développement durable et s’appuient sur la prise en compte de l’écosystème planétaire et de sa relation avec les populations. Elles portent essentiellement sur la question environnementale, mais elles ont des impacts sociaux et économiques, et relèvent de la diplomatie car c’est bien des relations entre les pays, les peuples, voire les communautés, que dépendra le règlement pacifique de ces contradictions.
L’exemple du Sahel est la parfaite démonstration de cette continuité. Cette région, qui il y a 30 ans comptait 200 millions d’habitants, en compte aujourd’hui près de 500 , et en comptera bientôt un milliard. Au Sahel, 90 % de la population est rurale et tente de survivre en exploitant de plus en plus intensivement des terres qui, par ailleurs, pour de nombreuses raisons, sont de moins en moins étendues. Pour cette population, la variable d’ajustement est l’émigration, d’abord des campagnes vers les villes, puis des villes vers l’extérieur, ce qui a de lourdes conséquences. Ce peut être aussi la concurrence pour l’usage des sols, qui commence entre les nomades et les agriculteurs, notamment au Soudan et au Mali, et la concurrence entre les peuples, ce qui exacerbe les différences ethniques, religieuses et nationales. Depuis 10 ou 15 ans, la désertification et la dégradation des sols sont devenues des éléments de paix et de sécurité qui relèvent des affaires étrangères.
Si nous observons l’extension des zones arides ou en voie de désertification et les lieux où sont apparus des phénomènes terroristes au cours des 20 dernières années, nous constatons une parfaite adéquation. Nous pourrions presque déterminer où auront lieu les prochains phénomènes de déstabilisation.
J’insiste sur la dégradation des sols car, bien que mal connu, ce problème affecte entre un et deux milliards de personnes dans le monde. La France a beaucoup agi dans ce domaine par le passé et pourrait encore le faire.
La dégradation des sols n’est pas seulement un phénomène rural, elle a des conséquences extrêmement importantes sur le climat. Les scientifiques estiment que les terres dégradées ou désertifiées contribuent à l’effet de serre à un niveau égal à celui de la déforestation, lui-même égal à l’effet produit par les transports routiers. Ce n’est donc pas un sujet mineur, d’autant moins que la dégradation des sols est le domaine dans lequel l’euro investi est le plus rentable puisqu’il permet non seulement de prévenir l’évolution du changement climatique mais aussi de maintenir les surfaces agricoles, ce qui a un impact social, économique et politique dans les régions concernées.
J’en viens au calendrier des manifestations.
Les grandes conventions internationales sont rythmées par des Conférences des parties (COP) annuelles ou biannuelles. L’année 2014 sera marquée par la douzième Conférence des parties (COP 12) de la Convention sur la diversité biologique, et par une Convention sur les produits chimiques dangereux et le traitement des déchets. L’année 2015 sera chargée avec une Conférence sur les changements climatiques (COP 21), la Conférence des parties sur la Convention sur la lutte contre la désertification, et la Conférence internationale sur les forêts au cours de laquelle sera négociée la création d’un instrument spécifique pour les forêts.
Parallèlement, des négociations sur la désertification sont en cours et devraient aboutir en 2014 ou en 2015. Il s’agit tout d’abord, dans le cadre de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), de faire de la zone saharo-sahélienne un exemple de coopération internationale en matière de prévention de la dégradation des sols. La France est très engagée dans ce dispositif intergouvernemental. Par ailleurs, une négociation très importante est en cours aux Nations Unies à propos de la création, très attendue, dans le cadre du traité sur le droit de la mer, d’un statut juridique pour les aires marines protégées en haute mer. Cet enjeu, soutenu par la France, permettrait de revivifier le traité du droit de la mer et de concrétiser la prise en compte des enjeux environnementaux en haute mer.
Les années 2014 et 2015 seront enfin marquées par des négociations sur plusieurs sujets qui ont fait l’objet de conclusions lors de la Conférence de Rio, notamment la définition d’objectifs de développement durable qui devraient compléter les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et faire du développement durable un objectif universel.
Enfin, en juin 2014 se tiendra à Nairobi la première assemblée des Nations Unies pour l’environnement. Le programme des Nations Unies pour l’environnement sera défini également dans le courant de l’année. Ce sera l’occasion pour la France de défendre concrètement la mise en œuvre des engagements pris à Rio, notamment en ce qui concerne le renforcement de la place du développement durable et la participation active de la société civile aux négociations environnementales internationales.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Notre action, à nous parlementaires, pourrait demain s’exercer par le biais du forum interparlementaire d’origine britannique Globe International dont nous avons, il y a près d’un an, créé une antenne en France, avec l’autorisation du président et du bureau de l’Assemblée nationale. Nous essaierons de faire avancer la réflexion au sein de Globe International, qui s’intéresse à la biodiversité, aux océans, au climat, à la déforestation.
Dans quelques semaines, le Gouvernement nous présentera un projet de loi relatif à la biodiversité dont l’un des articles portera sur la ratification du protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages (APA). L’Union européenne devrait ratifier ce protocole. Disposez-vous d’informations sur son rythme de ratification ?
M. Jean-Yves Caullet. Je voudrais, au nom de mes collègues du groupe SRC, vous poser quelques questions susceptibles d’aider les parlementaires à définir leur action.
Vous évoquez le risque de conflits. Il est vrai que, dans l’histoire de l’humanité, les défis ont été plus souvent réglés par un conflit que par un accord. Combien parieriez-vous sur la probabilité que des conflits surviennent face aux défis que vous avez évoqués ?
Vous parlez de sujets qui s’imposent, comme si le contexte international faisait redescendre en pluie fine sur les États des contraintes plus ou moins surprenantes – c’est ainsi que nous les vivons parfois, étant insuffisamment impliqués dans la préparation des négociations. Globe International représente en effet une diplomatie parlementaire qui influe sur les négociations gouvernementales ou internationales, mais comment les parlementaires français peuvent-ils se préparer pour affronter ce contexte ?
Existe-t-il une interaction entre l’action publique et les organisations non gouvernementales ? Les ONG internationales ont des composantes françaises. Comment faire en sorte que les thématiques soutenues par les composantes française et européenne d’une ONG soient reprises par l’ONG au niveau international ? Pouvez-vous agir en ce sens ? Que pouvons-nous faire pour vous aider ?
Parmi les autres thématiques, je voudrais évoquer la forêt, la francophonie et la protection de l’environnement. Je rappelle que dès 1948 a été fondée l’union des pays pour l’environnement, devenue l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Une diplomatie forestière est-elle possible entre les grands pays forestiers que sont le Canada, le Brésil, la France ou la Finlande ? C’est une question à laquelle je suis très attaché. Nous avons intérêt à faire participer des communautés d’intérêts pour obtenir un consensus capable de surmonter la fausse uniformité des objectifs. Car tout le monde est d’accord pour protéger la planète, mais chaque pays a par ailleurs des intérêts particuliers.
La dégradation des sols est aussi une réalité en France, où le cycle de la matière organique n’est plus maîtrisé. Il faut 5 à 10 ans pour détruire un sol, mais il en faut 50 à 80 pour le reconstituer. Quels sont les moyens mis en œuvre au plan international ? Que peut faire l’Europe en la matière ?
Enfin, vous évoquez une conférence internationale sur la forêt. Je ne sais si c’est le bon outil, mais entre la préservation de la forêt primaire, illustrée dans de magnifiques documents cinématographiques, la réalité des enjeux du bois, l’exploitation des grandes forêts arctiques ou subarctiques et ce qui se passe dans nos forêts cultivées, il faut savoir ce dont nous parlons exactement quand nous parlons de forêt, de déforestation, d’exploitation forestière ou de valorisation du bois.
M. Martial Saddier. Mes collègues du groupe UMP et moi-même vous adressons, monsieur l’ambassadeur, nos meilleurs vœux pour l’année 2014. Nous sommes très attachés à tous les enjeux que vous avez évoqués, qu’il s’agisse des pôles, des sols, de la forêt, de la biodiversité, des océans, des mers et de la gestion des produits chimiques. Sur quels sujets la France se situe-t-elle parmi les bons élèves, et sur quels autres sujets est-elle un mauvais élève ?
Même si tous ces sujets sont des priorités, il convient d’établir une hiérarchie en vue de répartir les financements, comme l’illustrent les difficultés des pays du Nord pour s’accorder sur la fameuse compensation annuelle de 100 milliards de dollars versés aux pays du Sud. Pouvez-vous nous dire quelques mots de l’étape de 2015 et de l’objectif de 2020 ?
Nous pouvons nous mettre d’accord sur le bilan et le constat et reconnaître la bonne volonté que manifestent certains pays qui se mettent autour de la table pour inverser la tendance, mais cela ne se fait pas sans mal – l’exemple le plus emblématique est la décision de maintenir le réchauffement climatique à 2 °.
La France, avant de faire partie du monde, se situe dans l’Union européenne. Or notre pays a un certain nombre de contentieux en cours. Comment s’articulent vos travaux dans le cadre des négociations internationales et vos relations avec la Commission et la Cour de Justice européennes ? Quels sont les sujets sur lesquels la France fait l’objet d’un précontentieux ou d’un contentieux – autres que celui portant sur la qualité de l’air ?
Enfin, notre commission a voté à l’unanimité un rapport sur l’affichage environnemental des produits qui préconise dans ses conclusions que la France pèse enfin dans l’expérimentation européenne. Ce point entre-t-il dans le champ de vos compétences ? Avez-vous travaillé sur cette question ? La position française a-t-elle une chance d’être entendue à l’échelle de l’Union européenne ?
M. Yannick Favennec. Au nom du groupe UDI, je vous remercie pour votre exposé, monsieur l’ambassadeur, et vous présente mes meilleurs vœux pour cette année au cours de laquelle vous allez préparer la Conférence Paris Climat 2015, point d’orgue des négociations internationales sur le climat.
En septembre dernier, le Gouvernement annonçait qu’il voulait aboutir à un accord juridiquement contraignant, ambitieux et applicable à tous qui permettrait de respecter la limite de 2 ° de réchauffement climatique. À l’issue de la Conférence de Varsovie, on peut affirmer sans être pessimiste qu’on en est encore très loin. Le nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) préconisait pourtant l’engagement immédiat, sans attendre 2020, de l’ensemble des pays sur des réductions importantes d’émissions de gaz à effets de serre. Mais l’Australie, le Canada et le Japon ont revu leurs objectifs à la baisse pour 2020, tandis que l’Union européenne, elle, se refuse à revoir les siens à la hausse. Or ce sont 8 à 12 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis en trop, chaque année, par rapport à la réduction des émissions qui nous permettrait ne pas dépasser les 2 ° d’augmentation de température d’ici à la fin du siècle, ce qui représente environ 20 fois les émissions de la France.
Les contours d’un accord pour la période post 2020 sont encore très flous et les objectifs de réduction des émissions sont repoussés à plus tard et confiés au libre choix de chacun des pays. En se rapprochant de la position des États-Unis, qui consiste à laisser chaque pays définir lui-même son niveau d’engagement, l’Union européenne perd toute possibilité de leadership.
La Conférence de Paris peut être une immense occasion de redonner un sens politique à ces négociations, mais le choix des alliances du Gouvernement, en France et au sein de l’Union européenne, décidera largement du contenu de l’accord final. Comment le Gouvernement français peut-il agir dans la perspective de la Conférence de 2015, et quels doivent en être, selon vous, les objectifs ?
M. François-Michel Lambert. Je vous souhaite à mon tour, monsieur l’ambassadeur, au nom des députés du groupe Écologiste, une bonne année remplie d’espoir.
Vous avez abordé les enjeux planétaires, le changement climatique, les tensions dues à la raréfaction des ressources, la préservation de la biodiversité. Nous avons besoin d’une vision planétaire de ces sujets, au lieu de la vision franco-française dans laquelle nous sommes installés, pour comprendre comment ces enjeux planétaires sont pris en compte dans chaque territoire, chaque pays, chaque peuple, chaque culture et chaque religion. Pouvez-vous nous y aider ?
Comment s’articule votre mission avec les membres du Gouvernement en vue de la Conférence de 2015 ?
Comment percevez-vous l’action de Pascal Canfin, ministre chargé du développement, qui a reconfiguré l’action de la coopération française et semble lier son ministère aux grands enjeux mondiaux ?
Mme Geneviève Gaillard. Je vous remercie, monsieur l’ambassadeur, pour votre présence parmi nous et vous adresse mes vœux de bonheur et de réussite pour l’année qui commence et les années ultérieures, car les défis sont énormes et votre travail ne doit pas vous laisser beaucoup de repos. (Sourires)
Vous nous confirmez l’importance de l’enjeu démographique par rapport aux ressources naturelles et aux changements qui se produiront au niveau planétaire. Abordez-vous ces sujets dans le cadre des négociations et comment, selon vous, évoluera cette problématique ? Serons-nous capables de relever rapidement ce défi ?
Nous connaissons les intérêts contradictoires de ceux qui consomment les services de la nature. Le regard porté par certains chefs de gouvernement sur la préservation de la nature a-t-il évolué ? Que pensez-vous des actions menées par l’Agence française de développement (AFD) ?
Enfin, j’ai eu l’honneur d’assister aux conférences de Rio, de Nagoya et d’Hyderabad. La biodiversité est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. La préservation de la biodiversité est-elle, selon vous, en bonne voie au plan international ? Sachant qu’un projet de loi qui, je l’espère, portera création de l’Agence française de la biodiversité, nous sera bientôt présenté, la France fait-elle partie des pays exemplaires ?
Enfin, considérez-vous que les financements dont vous disposez sont suffisants ? Comment vous organisez-vous pour mener à bien la mission qui vous a été confiée ?
M. Jean-Pierre Vigier. Monsieur l’ambassadeur, je vous souhaite à mon tour mes meilleurs vœux pour 2014.
Vous avez souligné dans différentes interventions la nécessité de reconnaître le rôle essentiel des investissements à long terme pour favoriser le maintien et l’élargissement du développement durable. C’est une vision intéressante.
Cependant, la crise économique mondiale et le fait que la reprise ne se dessine pas clairement risquent de privilégier les investissements à court terme, moins coûteux.
Vous dites souhaiter que de nouvelles ressources soient mises en place. La taxe sur les transactions financières, impulsée par la France, peine à prendre forme. Mais il y a quelques jours, Paris et Berlin ont décidé de prendre une initiative commune dans ce dossier. La création de cette taxe peut-elle, selon vous, intervenir rapidement ? Avez-vous d’autres propositions innovantes pour assurer le financement du développement durable au niveau mondial ?
Mme Sophie Errante. Je vous souhaite moi aussi une bonne santé et surtout beaucoup de courage…
Concernant REDD+, le programme de coopération de l’ONU sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement, quelles doivent être pour la France les priorités à défendre concernant la forêt amazonienne ? Avez-vous des préconisations pour gérer durablement les forêts majeures qui se trouvent sur notre territoire ?
J’ai récemment assisté à Varsovie à une conférence de Globe International sur la protection du climat. Que proposez-vous pour évaluer financièrement les services rendus par la nature ? Sur ce point, nous sommes plus proches du conflit que de l’accord.
Les pays émetteurs de gaz à effets de serre (GES) doivent participer au financement du fameux Fonds vert pour le climat, mais il est très difficile d’obtenir les crédits prévus. Que préconisez-vous pour atteindre l’objectif fixé ? Comment analysez-vous l’après-Varsovie ?
M. Christophe Priou. Je vous souhaite quant à moi longue vie, monsieur l’ambassadeur… (Rires)
On ne peut considérer notre pays comme le centre du monde, mais la France doit sa présence planétaire aux mers et aux océans. Quel est le rapport de force, au sein des organisations internationales, entre ces deux philosophies : celle des Pays-Bas, qui depuis la catastrophe de 1953 ont réalisé des ouvrages pour se protéger des inondations, ou celle qui consiste à agir sur les causes de l’évolution climatique, qui exige un consensus international ?
Nous, nous avons subi deux marées noires sur le littoral atlantique, mais ces catastrophes étaient d’origine matérielle et humaine, et non naturelle. L’Europe a pris un certain nombre de mesures en matière de sécurité maritime – contrôle des bateaux, formation des personnels – mais lorsqu’elle a souhaité les étendre au niveau international, elle s’est heurtée au blocage d’un certain nombre d’organisations comme l’Organisation maritime internationale (OMI). Quel est actuellement le rapport de force entre les deux tendances ? Laquelle, selon vous, risque de l’emporter face à une menace qui est devenue une certitude ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Pouvez-vous nous dire un mot sur la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer ?
M. Jean-Pierre Thébault. Je vais tenter de répondre à vos questions, mesdames et messieurs les députés, même si chacun des sujets que vous avez abordés mériterait à lui seul un débat de fond.
J’ai oublié de vous indiquer qu’en tant qu’ambassadeur je suis diplomate de carrière et qu’à ce titre j’ai été nommé par le Président de la République, mais mon rôle et ma mission sont définis à l’échelle interministérielle. Je dispose d’une lettre de mission signée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre en charge de l’environnement, de telle façon que les négociations soient bien menées en association avec l’ensemble des administrations compétentes. Je joue un rôle d’animateur d’équipes interministérielles, composées naturellement de représentants des ministères des affaires étrangères et de l’environnement, très souvent accompagnés de représentants des ministères de l’agriculture, des finances et de l’industrie.
Mon rôle est également d’assurer dans la durée la présence de la France au sein des multiples enceintes internationales où je suis le chef de la délégation et représente, en cas d’absence du ministre concerné, la voix politique de la France dans les négociations.
La création du poste d’ambassadeur délégué à l’environnement est un dispositif original. De rares pays l’ont repris, même s’ils sont généralement incapables de le mettre correctement en pratique car la nature de ses fonctions s’oppose à leur organisation sectorielle. De ce point de vue, la France est plutôt exemplaire.
J’en viens aux questions que vous m’avez posées.
Vous allez effectivement être saisis prochainement d’un projet de loi relatif à la biodiversité. Il s’agit d’un texte symbolique qui s’inscrit dans une dynamique que la France a la capacité d’encourager ou de bloquer, ce qui dépendra en partie de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, notamment du titre IV qui traite de la transcription en droit français de l’accord sur le partage des ressources (APA).
Sur les trois grandes conventions de Rio, celles sur la diversité biologique et sur les changements climatiques ont pris leur essor. La négociation de Nagoya a débouché sur un accord important dont le protocole APA est le point central. Ne pas le ratifier dans des délais raisonnables aurait un impact sur la crédibilité de l’Union européenne et le dynamisme des négociations sur la biodiversité.
L’accord sur le partage des ressources issues de la biodiversité doit être ratifié par 50 États pour entrer en vigueur. À ce jour, 28 États l’ont ratifié, dont quelques grands pays émergents. Une deuxième Conférence des parties est prévue en octobre en Corée pour évoquer un certain nombre de questions, en particulier celle du financement de la protection de la biodiversité au niveau international. Cette réunion sera, nous l’espérons, l’occasion de constater l’entrée en vigueur de l’accord APA, à condition que les 28 États membres de l’Union européenne l’aient ratifié, à la fois séparément et collectivement, même si un projet de règlement à effet immédiat règlera une partie des questions au niveau communautaire.
Ces difficultés illustrent le rôle important que jouent les Parlements nationaux quant à la crédibilité des négociations. Mais vous rencontrerez sans doute sur votre chemin des sujets difficiles. Ainsi le protocole APA aura un impact sur la réglementation de la propriété intellectuelle et créera des droits collectifs au profit des communautés indigènes et autochtones, ce que demandent un certain nombre d’États européens, dont la Suède et le Danemark. C’est donc un sujet éminemment sensible que nous devrons veiller à aborder dans les débats franco-français de manière apaisée. Il serait dommage que la France soit l’État qui empêche la ratification de l’accord par l’Union européenne.
La Conférence des parties qui se tiendra en Corée sera l’occasion de mettre en œuvre une stratégie de financement international de la protection de la biodiversité. Sur ce point, la France et les États européens devront prouver le sérieux de leur position car nous avons pris à Hyderabad des engagements sur le doublement des financements dédiés à la protection de la biodiversité et nous avons demandé aux autres États de les prendre également.
Tous ces sujets sont doublement importants, d’une part pour les enjeux qu’ils représentent et parce qu’ils font apparaître la nécessité d’adopter un regard différent sur le développement économique. Ils font également apparaître que nous, Européens, sommes de moins en moins influents au niveau international, non seulement parce que nous sommes moins compétitifs mais également parce qu’un certain nombre de pays se sont aperçus que, contrairement à eux, nous n’avions pas de ressources naturelles. Cette réalité leur donne une nouvelle assurance. Ils considèrent que si nous insistons sur l’économie des ressources, c’est que nous n’en avons pas, et que si nous adoptons de nouveaux concepts comme l’économie verte et le changement des modes de production et de consommation, c’est pour essayer de prendre le contrôle de leurs propres ressources.
S’ils veulent conserver un certain niveau de consommation et trouver les voies d’une nouvelle compétitivité, les pays qui ne disposent pas de ressources naturelles doivent être capables d’inventer de nouveaux modes de production et de consommation crédibles. Si des affrontements surviennent entre les pays émergents, les pays pauvres et les pays anciennement riches sur ces différents sujets, nous savons tous qu’à un moment donné nous serons obligés collectivement d’inventer ces nouveaux modèles.
Les négociations internationales sont également, pour les pays comme le nôtre, l’occasion de comprendre cette nouvelle donne et d’en tirer les conséquences en termes d’éducation, de formation, de recherche et d’innovation opérationnelle.
Quelques pays émergents, comme le Brésil, dont le territoire est assez vaste pour accueillir une population plus importante et qui dispose de ressources sans limites, n’ont aucun intérêt à changer leur modèle de développement. Ils considèrent que si nous les y incitons, c’est pour les empêcher de profiter de notre modèle.
Les négociations mettent en lumière la nécessité pour nous d’inventer de nouveaux modes de production et de consommation et de faire de certaines d’entre eux des opportunités dans les domaines de l’industrie, de la recherche, de l’éducation afin de redevenir des pays compétitifs. Il ne faut pas croire que nos pays ont découvert l’environnement et le développement durable au détriment des autres pays du monde, qui l’ignorent mais pourraient se laisser tenter parce qu’ils sont pauvres ou qu’ils disposent d’importantes ressources. Aujourd’hui, de nombreux pays sont en train d’adopter ce raisonnement. C’est le cas du Brésil, où la chambre de commerce de Sao Paulo est très en pointe sur tous ces sujets : les Brésiliens se rendent compte que les modèles économiques évoluent et ils adoptent de nouvelles valeurs, en particulier la reconnaissance des services rendus par la nature, en vue de ce qui pourrait être la troisième révolution industrielle.
En bref, au-delà de leur intérêt spécifique et sectoriel, chacun de ces sujets nous invite à développer une nouvelle compétitivité et à adopter de nouvelles valeurs.
Monsieur le député, la probabilité de voir apparaître des conflits face à ces nouveaux enjeux est très forte, même en étant très optimiste… Ce qui pourrait provoquer le grand conflit du XXIe siècle, ce sont les OPA internationales qui permettent à des sociétés chinoises d’acheter des sociétés brésiliennes ou des filiales de sociétés canadiennes dans le domaine des ressources. La rareté affectera peut-être tout d’abord l’énergie, mais la liste des ressources minérales rares et non renouvelables s’allonge.
Le conflit est certes possible, mais il est en même temps inconcevable car il se produirait à une telle échelle qu’il ne pourrait conduire qu’à une forme d’annihilation. À cet égard, il est urgent de prévenir un tel risque.
Non, madame Geneviève Gaillard, la croissance démographique, même si son ampleur pourrait déclencher un conflit, n’est pas prise en compte dans les négociations internationales car nous ne pouvons évoquer cette question sans apparaître comme des malthusiens, ce qui a des résonances extrêmement négatives pour un certain nombre de pays. C’est d’ailleurs un sujet sur lequel nous ne sommes pas d’accord au sein même de l’Union européenne.
Toutefois, la croissance démographique se dessine en creux dans les négociations. Le calcul, pour réduire le risque potentiel de conflit, consiste à rechercher les nouveaux modes de production et de consommation qui permettront de produire des quantités extrêmement plus importantes qu’aujourd’hui avec des ressources beaucoup plus rares. Il consiste à permettre à une fraction de plus en plus grande de la population mondiale de sortir de la pauvreté et d’amorcer la transition démographique. Si, dans les 10 à 20 ans qui viennent, ces négociations aboutissent, nous n’éviterons pas les 9 milliards d’habitants prévus en 2050 mais nous éviterons peut-être les 11 milliards en 2100.
Il reste que certaines réalités sont perturbantes. En termes de production agricole, nous avons suffisamment sur la planète de quoi nourrir 11 milliards d’habitants, voire plus. Mais nous ne savons pas mettre fin au fait que 50 % des productions agricoles sont détruites – environ 25 % avant leur mise sur le marché et 25 % après leur mise sur le marché.
Comment agir et avec qui ? Je ne peux que vous encourager, mesdames et messieurs les parlementaires, à utiliser tous les canaux, comme Globe International – que la France, malheureusement, a laissé aux mains des Anglo-saxons, ce qui en fait un outil peu francophone –, mais il en existe d’autres. Globe sera un succès lorsqu’il sera franco-britannique ou anglo-français et qu’il permettra de travailler dans les deux langues car il est regrettable que 50 à 60 pays francophones soient de facto exclus des négociations internationales.
La France souhaite que les négociations ne se limitent pas aux États et que la société civile – parlementaires, ONG, entreprises, collectivités locales, syndicats – y soit associée. Cette proposition provoque les réticences de nombreux pays comme la Chine, la Russie, sans parler de la Syrie ou du Soudan. Cela dit, notre voix est de plus en plus entendue par des populations qui prennent conscience des enjeux de ces négociations.
La situation de la francophonie est un drame permanent. Quels que soient nos efforts pour y remédier, notre langue nous exclut car nous avons, nous Français, des difficultés à parler l’anglais qui est devenue la langue standard des négociations. L’anglais exclut encore plus les pays francophones en voie de développement. Alors que la Namibie joue un rôle de coordonnateur dans les négociations sur la biodiversité du G77, l’ensemble des pays africains francophones en sont totalement exclus. C’est une vraie difficulté que nous ne savons pas traiter.
Vous évoquez les forêts, madame Sophie Errante, sous l’angle de REDD+. C’est dommage, car cet objectif est l’antithèse de ce qui devrait être fait. En effet, les forêts y sont traitées non pas en tant que telles mais sous l’angle des puits de carbone. Lors du Sommet de Rio en 1992, nous étions nombreux à souhaiter une convention sur les forêts, mais un certain nombre de pays, dont le Brésil, s’y sont opposés.
Il existe plusieurs sortes de forêts. La définition de la FAO est un exemple de ce qu’il ne faut pas faire puisqu’elle définit les forêts uniquement sous l’angle de leur densité et de leur hauteur. Or il n’y a aucun point commun entre une forêt primaire et une forêt subarctique, ni entre les forêts du pourtour sahélien et la forêt du Congo.
Comment progresser sur cette question ? Sachant que certains pays s’opposent à la création d’un instrument général pour les forêts, est-il possible de mettre en place des instruments spécifiques ? C’est ce que nous tentons de faire, d’ailleurs en juin une réunion se tiendra en Europe pour évoquer la possibilité d’un premier accord légalement contraignant sur la forêt européenne.
La protection des forêts, pourtant essentielle, est inexistante. Et lorsqu’on demande aux États africains ce qu’ils pensent des grandes négociations internationales, en particulier de la REDD+, ils répondent qu’ils ne sont pas concernés puisqu’ils n’ont jamais reçu le moindre financement… Ils n’ont pas totalement tort. Plus un État déboise et ce faisant attire l’attention de l’opinion internationale, plus il reçoit de financements. La plus grande forêt primaire intacte, qui se trouve sur le bassin du Congo, reçoit beaucoup moins d’aides que d’autres grands bassins, et les ministres de l’environnement de ce pays ont du mal à expliquer à leur chef de Gouvernement que le palmier à huile n’est pas une bonne solution…
Les problèmes liés à la forêt sont multiples et très complexes ; la gestion du foncier génère des réactions contradictoires au sein d’un même gouvernement, sans parler de la politique soutenue par cette célèbre organisation internationale qui commissionne des études sur le potentiel agricole des territoires couverts par les forêts tropicales. Nous ne traitons pas la question des gaspillages des productions agricoles et nous créons de nouvelles terres agricoles, mais nous ne faisons rien pour faire cesser la désertification. Nous savons pourtant que les terres pauvres ont une durée de vie très courte.
J’en viens à l’état des sols, qui est un véritable drame. Entre 1,5 et 2 milliards de personnes dans le monde dépendent directement de sols pauvres qui nourrissaient les populations depuis plusieurs milliers d’années mais ont été surexploités – ce que l’on appelle la pression anthropique. Pourtant amender les sols ne coûte pas cher. Mieux, un sol devenu stérile pendant quelques années conserve la capacité de se régénérer. Il y a des exemples très intéressants, en Afrique notamment, de communautés villageoises, souvent des associations de femmes, qui amendent les sols devenus stériles au profit des agriculteurs qui les exploiteront. Hélas, cette politique ne bénéficie d’aucun financement : c’est une vérité terrible car ces populations, parmi les plus pauvres du globe, devraient bénéficier de la solidarité internationale. La Convention sur la lutte contre la désertification et la prévention de la dégradation des sols, soutenue par la France à Rio en 1992, à la demande des pays africains, a été poursuivie pendant quelques années, mais c’est vraiment la convention des pauvres, créée par les pauvres et pour les pauvres…
L’Observatoire du Sahara et du Sahel, créé par la France, associe l’ensemble des États du pourtour saharien, 25 dont le Kenya, la Somalie, le Burkina Faso, l’Algérie. On peut parler d’une remarquable réussite, mais les moyens de l’Observatoire, déjà faibles, ne cessent de décroître. Il est regrettable que nous nous intéressions peu à cette Convention car elle ne coûte pas cher et pourrait avoir un impact considérable. La France a un atout en la matière : la nouvelle secrétaire exécutive de la Convention est une Française – il s’agit de Monique Barbut, ancienne directrice générale du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Plusieurs d’entre vous m’ont interrogé sur le climat : je ne suis pas compétent en la matière, mais je puis vous dire que nous réussirons les négociations non seulement parce qu’il devient nécessaire de trouver un accord mais aussi parce que notre diplomatie se mobilise pour y parvenir, et je peux porter témoignage de l’engagement de l’État, en particulier du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Mais pour gagner un accord sur le climat, il nous faudra accepter de traiter la question sous tous ses aspects, à savoir les sols, les forêts et les océans, et nous montrer très dynamiques lors des négociations relatives à la biodiversité.
Nous devons être conscients du fait que les financements dont nous parlons aujourd’hui sont essentiellement consacrés à l’évolution climatique, au détriment des autres conventions. La Convention sur la désertification reçoit un budget de 20 millions, le programme des Nations Unies pour l’environnement un budget de 200 millions, tandis que la Convention climat en reçoit cinq fois plus. À cet égard, nous avons peut-être mis tous nos œufs dans le même panier, ce qui est quelque peu antithétique avec les notions de développement durable et d’écosystème.
Quant à la hiérarchie des priorités, elle nous amène à diriger notre effort là où nous pouvons réussir, mais la priorité n’est pas la même pour chaque État. En la matière, la diplomatie nous oblige à adopter une vision transversale et une attitude ambitieuse.
La France est-elle, monsieur Martial Saddier, un bon ou un mauvais élève ? Elle est à la fois l’un et l’autre. Elle n’est pas un mauvais élève par volonté mais plutôt par manque de moyens, parce que les arbitrages n’ont pas été faits ou que les politiques menées ne sont pas dans sa tradition. Nous essayons d’être de bons élèves, mais ce n’est pas aisé. À Nagoya, Chantal Jouanno avait exprimé le souhait que la France augmente significativement les financements au profit de la biodiversité. Elle pensait avoir obtenu les engagements nécessaires mais elle a appris par la suite que ce n’était pas envisageable car la direction du Trésor n’avait pas été consultée. Pendant ce temps-là, l’Allemagne engageait cinq fois plus de moyens en faveur de la biodiversité.
L’articulation avec l’Union européenne, qu’il s’agisse de la Commission ou de la Présidence, est permanente. Mais nous conservons toujours – et c’est mon rôle – une marge de manœuvre nationale, à travers des contacts privilégiés. Nous avons aussi, parfois, une meilleure analyse de certaines situations.
Nous sommes d’autant plus influents que nous sommes exemplaires et que nos parlementaires, nos ONG, nos collectivités locales sont engagés. Même si ces acteurs savent se montrer extrêmement dynamiques, l’influence majoritaire au sein des négociations reste anglo-saxonne. C’est l’un de nos problèmes.
L’affichage environnemental des produits est un outil intéressant en ce qu’il contribue au changement des modes de production et de consommation, qui donnera de la France et de l’Europe une image dynamique. Ce n’est pas une politique facile à défendre, même si un certain nombre de pays non européens nous suivent sur ce point. J’ai moi-même animé à New York un atelier sur ce thème dans le cadre de la Commission du développement durable de l’ONU, en présence d’une entreprise chilienne qui avait accepté de participer à l’expérimentation française.
La vision planétaire que vous appelez de vos vœux, monsieur François-MichelLambert, n’existe pas. C’était tout l’intérêt du Sommet de la terre, dont je regrette beaucoup qu’il n’ait pas suscité une participation plus large, notamment de la part des faiseurs d’opinion que vous êtes. Outre les personnes intéressantes que nous y avons rencontrées, il était fascinant de voir à quel point la vision du monde est très différente selon le pays où l’on vit, que ce soit au Brésil, en Chine ou en Inde, dont les représentants nous ont opposé des arguments qui ne sont pas dénués de bon sens.
Nous avons appris que les messages que nous avions diffusés avaient eu un écho, en particulier l’engagement du Gouvernement français de mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse, le « PNB+ » mais la France semble s’être détournée de cet objectif, ce qui suscite une certaine déception au niveau international. À l’exception du Brésil, l’Amérique Latine s’oppose à nous sur les nouveaux modèles de développement qui prônent le « bien vivre » au détriment du « consommer plus ». Il n’est pas inintéressant de le savoir, car cela peut nous permettre d’expliquer à nos chefs d’entreprise et aux différents relais d’opinion comment conquérir ces marchés.
Ces sujets ne feront pas la différence lors de la COP de 2015, mais ils auront une influence et nous ne devrons pas les délaisser au cours des deux ans qui viennent. Nous parlerons beaucoup de climat et engagerons d’importants moyens, mais le succès peut venir des autres compartiments de la négociation internationale. N’oublions pas la leçon de Durban. Après le Sommet de Copenhague, si les renégociations ont repris, c’est grâce au soutien de l’Afrique et des petits États insulaires qui a permis à l’Union européenne de contraindre les grands États émergents à revenir autour de la table des négociations.
Pour être entendu par les pays d’Afrique, il faut parler des forêts et de la désertification, mais pour être entendu par les petits États insulaires, il faut parler des océans. C’est pourquoi nous devons suivre avec la plus grande attention la négociation du troisième protocole de mise en œuvre de la Convention de Montego Bay sur la protection environnementale en haute mer ainsi que les conventions régionales. Nous disposons d’instruments très intéressants sur les plans politique, économique, social et environnemental en Méditerranée, en Atlantique Nord-Est, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes, et nous sommes très influents, même si ces instruments manquent de visibilité et de moyens au niveau français.
La taxe internationale sur les transactions financières est aujourd’hui la seule source additionnelle de financement que nous ayons pu identifier. Elle sera utile dans le cadre des grandes négociations, nous permettra de travailler ensemble sur les nouveaux modes de production et de consommation et de soutenir l’innovation et l’éducation dans le domaine du développement durable.
Nous avons le sentiment, madame Sophie Errante, que la prise en compte des services rendus par la nature a attiré l’attention d’un certain nombre de pays, mais la crise nous a détournés de cet objectif. C’est dommage car les pays qui y ont cru se retrouvent un peu orphelins… Quoi qu’il en soit, même si certaines idées ne peuvent être incarnées dans l’immédiat, il ne faut pas cesser d’enfoncer le clou.
Enfin, la Convention de Montego Bay est un traité admirable qui avait déjà raison en 1980, mais il est un peu dépassé. Nous y sommes néanmoins toujours attachés, car il a permis de résoudre des contentieux très lourds. Nous ne souhaitons pas le remettre en cause, mais au contraire le fortifier. Encore faut-il prendre en compte les nouvelles problématiques et en particulier celles de la haute mer, qui couvre les deux tiers de la surface de la planète et est devenue pour la diplomatie internationale l’une des nouvelles frontières. Or aujourd’hui, au-delà des zones sous juridiction, ne sont applicables que des réglementations minimales et sectorielles : celle de l’OMI, quelques réglementations sur les déchets. Le principe général qui s’applique est celui de la liberté. Cela pose un problème car la perspective de l’épuisement des ressources remet en question l’exploitation des ressources de la haute mer, et les grandes catastrophes ont montré que ce qui se passe en dehors des zones sous juridiction a des conséquences sur ces dernières. Il nous faut donc trouver un modus vivendi sur la gestion de la haute mer.
Aujourd’hui, nous pouvons simplement espérer la mise en place d’un statut juridique international qui permette de créer des aires marines protégées. Certes, ce statut ne correspondra qu’à une partie infime de la haute mer, mais il démontrera que toutes les institutions concernées peuvent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun.
La France est très en avance sur ce sujet, qu’elle avait défendu à Rio et qu’elle souhaite voir aboutir avant la fin de la prochaine assemblée générale des Nations Unies qui s’achèvera en 2015. Réussirons-nous ? Ce sera difficile, mais nous n’abandonnerons pas. L’Europe a pris une position forte sur ce point, initiée par la France, mais nous faisons face aux fortes réticences de pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, la Russie, ce qui amène d’autres pays comme le Brésil, la Chine ou l’Indonésie à les croire justifiées.
Pour résumer, les pessimistes considèrent que toutes ces négociations sont comme le tonneau des Danaïdes, que l’on remplit avec des crédits et de bonnes intentions, mais qui se vide continuellement. C’est ce qui se passe lorsque l’on n’investit peu. La France, sur ces questions, a une légitimité historique et politique et à plusieurs reprises, quelle que soit la majorité qui se trouvait aux responsabilités, elle a initié des projets qui ont aidé à faire progresser les choses. À l’inverse, notre pays a une faiblesse due à l’insuffisance des moyens qu’il engage dans ces négociations, à l’exception de la négociation climat, et il ne peut se prévaloir d’une continuité dans l’action. On ne peut songer sans regret au fait que des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande ont la réputation d’être des pays en pointe sur ces sujets, alors qu’ils n’oublient jamais leurs intérêts économiques. La France est capable d’innovation et de créativité, mais elle n’a pas cette image qui aiderait nos entreprises à réussir sur le plan international.
En tant que diplomate chargé des négociations environnementales internationales, je n’ai aucun problème à parler d’économie, de compétitivité ou de marché. C’est la règle du jeu. Ces négociations sont une excellente occasion de promouvoir ce que nous savons faire.
Ces défis s’imposent à nous. Ils s’imposeront moins si la Commission du développement durable de l’Assemblée nationale s’empare de ces sujets et élabore une position parlementaire propre à inciter l’État à suivre ces sujets dans la durée et de manière cohérente.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous remercie, monsieur l’ambassadeur, pour la qualité et la tonalité positive de votre intervention. Il est clair que nous avons nous aussi, au sein de l’Assemblée nationale, un travail pédagogique à entreprendre. (Sourires)
Vous avez à plusieurs reprises évoqué le changement des modes de production et de consommation. Nous y sommes particulièrement sensibles et je me réjouis qu’en tant qu’ambassadeur délégué à l’environnement, vous partagiez notre analyse. Je vous en félicite.
11. Table ronde sur l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires et les paysages (22 janvier 2014)
La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a organisé une table ronde sur l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires et les paysages, avec la participation de Mmes Odile Marcel et Mathilde Kempf, et de MM. Christophe Bayle, Sébastien Giorgis, et Baptiste Sanson, co-auteurs de l’ouvrage Paysages de l’après-pétrole.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ma collaboration avec Mme Odile Marcel m’a amené à inviter autour de cette table quelques-uns des coauteurs d’un numéro de la revue Passerelles consacré aux « Paysages de l’après-pétrole » et qui présente, au travers du concept de paysage, une série de contributions démontrant les liens qui existent entre les questions liées à la transition énergétique, l’agriculture et l’aménagement du territoire.
Nous accueillons à ce titre : Mme Odile Marcel, philosophe et écrivain, qui s’exprimera sur le paysage comme moyen d’envisager conjointement les projets d’aménagement et agricoles ; M. Baptiste Sanson, agronome, responsable de l’Écocentre de Villarceaux, qui évoquera les agricultures en transition en se concentrant sur le paysage, fil conducteur pour un aménagement agro-écologique ; M. Sébastien Giorgis, architecte paysagiste, président de l’Association des paysagistes-conseils de l’État, sur le thème « Nouvelles énergies, nouveaux paysages » ; Mme Mathilde Kempf, architecte et urbaniste, qui traitera des paysages pour mettre les actions en cohérence ; et M. Christophe Bayle, urbaniste, chef de projet à la SEMAPA (Société d’études et de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne) et aux Ateliers de Cergy, qui nous parlera des lisières agri-urbaines et de l’aménagement durable des métropoles.
Mme Odile Marcel, philosophe et écrivain. Je vous remercie, monsieur le président, de nous donner l’occasion de nous exprimer devant les parlementaires, car il appartient aux techniciens que nous sommes de les aider à faire avancer la nation.
Nous avons créé ce collectif car nous avons le sentiment que le processus de transition énergétique est beaucoup plus contrôlé que nous ne le pensons. Un certain nombre de compétences sont d’ores et déjà disponibles, et il suffirait d’un peu de courage politique pour que nous nous engagions clairement dans la recherche de cet équilibre souhaitable pour notre économie, notre environnement et notre société.
Nous sommes convaincus que la transition énergétique n’est pas ingérable. Un certain nombre d’expériences concluantes sont menées à bien dans nos territoires, ce qui montre que le développement durable n’est ni une utopie, ni une exigence prophétique impraticable.
Au cours du siècle dernier, l’aménagement du territoire a fait l’objet, en quelques générations, de transformations radicales dues à l’arrivée du pétrole, énergie abondante et peu chère mais dont nous n’avions pas évalué les conséquences.
Prenons l’exemple du périphérique parisien. Sa fonctionnalité est maximale puisqu’il permet aux automobilistes de faire le tour de Paris en un temps très court, mais, contrairement aux aménagements qui avaient été réalisés auparavant, comme les ponts sur la Seine ou le métro aérien, il est dépourvu de qualités spatiales. La fonction a pris le pas sur la forme et la visibilité, ce qui dénote une rupture dans l’art d’aménager puisque traditionnellement, depuis Vitruve, nous cherchions à donner aux infrastructures, au-delà de leur fonction, un visage représentant ce qu’elles apportent à la société.
La brutale modernisation de la Ville de Paris, à l’époque de Georges Pompidou, a ainsi oublié la qualité visuelle des ouvrages.
Ce n’est pas l’esprit du tram, qui ne traduit pas la modernité triomphale et aveugle de ces structures performantes dont nous n’avions pas identifié les dégâts collatéraux – qui, d’après les plus extrémistes, pourraient mettre en péril la biosphère elle-même. Le tram est une structure remarquable en ce qu’il témoigne de la compatibilité de ses différentes fonctions : non seulement il achemine des voyageurs mais il le fait dans le silence, en réalisant des économies d’énergie, et le support engazonné apporte une certaine grâce aux boulevards des Maréchaux.
Cette innovation délivre un double message : un message culturel – il existe des solutions techniques qui correspondent aux attentes de la société – et un message politique – toute implantation technique doit désormais correspondre à un projet de société. Sans un tel message, la confiance disparaît et le pacte social se dissout.
M. Baptiste Sanson, agronome, responsable de l’Écocentre de Villarceaux. Mon métier d’ingénieur agronome m’a conduit à animer la Bergerie de Villarceaux. Ce territoire rural de 650 hectares, propriété de la Fondation pour le progrès de l’homme, qui était à l’origine une grande ferme céréalière conventionnelle, est engagé depuis plus de 20 ans dans la transition agro-écologique.
L’engagement de ce territoire prouve qu’il est possible de passer d’une agriculture très dépendante du pétrole et des produits phytosanitaires à une agriculture autonome, plus économe en ressources non renouvelables, moins productrice de nuisances environnementales et qui offre aux populations un cadre de vie plus harmonieux.
L’histoire de ce territoire peut être reliée aux défis de l’agriculture, dont le cahier des charges, à l’aube du XXIe siècle, s’est extraordinairement complexifié puisqu’on lui demande de produire toujours plus tout en rendant des services environnementaux et en donnant aux habitants les moyens de mieux vivre ensemble.
Certes, pour protéger les espaces, limiter les pollutions, développer la biodiversité et réduire les émissions de gaz à effets de serre, nous disposons d’un certain nombre de lois, mais comment les mettre en cohérence ? En outre, ces lois contiennent peu de dispositions concernant le paysage et l’aménagement des espaces agricoles.
Pourtant, lors du processus de modernisation, dans les années 1960, il existait une vision connexe permettant de lier un projet technique visant à augmenter les rendements et un objectif d’aménagement du territoire, ce qui a permis de développer la mécanisation et d’agrandir les parcelles. Mais il sera très difficile, dans un cadre spatial aménagé pour une agriculture industrielle, reposant sur des apports massifs d’intrants, de mettre en place des pratiques agro-écologiques.
L’approche paysagère repose sur la connaissance fine d’un territoire, de sa géographie, de son histoire, des savoir-faire locaux et de leur inscription dans l’espace. Elle est nécessaire si nous voulons construire des projets qui revalorisent les atouts de chaque territoire, atouts qui, après la Révolution française, ont contribué à construire la France des 500 régions agricoles fondées sur des races, des terroirs et des noms géographiques, dans des paysages reflétant l’harmonie sociale. Ce souci de joindre l’utile à l’agréable a fait de la France un « pays de cocagne ». Comment retrouver cette démarche qui joint utilité technique et harmonie spatiale ?
M. Sébastien Giorgis, architecte paysagiste. Les projets de développement énergétique font très souvent l’objet de contentieux et la plupart de ceux qui sont rejetés le sont pour des questions relevant du paysage. Or la notion d’atteinte au paysage, très subjective, est difficile à appréhender par le juge et tout aussi difficile à anticiper pour l’aménageur ou la collectivité.
Le terme de paysage fait l’objet de nombreuses confusions. Pour certains, il renvoie à la nature, tandis que pour d’autres, il reflète une certaine image du passé. Depuis près de 50 ans, rendus frileux par la façon dont le monde évolue, nous percevons le paysage comme un refuge identitaire. Ainsi, les propriétaires de résidences secondaires, très nombreuses dans notre pays, apprécient les paysages en espérant qu’ils n’évolueront plus, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des populations qui y habitent. J’appelle cela la « lutte des paysages ».
Pour sortir de cette difficulté, la France a ratifié en 2006 la Convention européenne du paysage, qui définit le paysage comme « une partie de territoire telle qu’elle est perçue par les populations sous l’angle de l’aménagement du territoire, de la perception visuelle et de la sensibilité ». Cette convention crée un objectif de qualité paysagère auquel doit répondre désormais tout projet et toute infrastructure.
Plusieurs territoires sont à ce jour membres du réseau des Territoires à énergie positive (TEPOS) et devraient parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2030-2040. C’est le cas notamment de la Communauté de communes du Mené ou de la Biovallée, dans la Drôme.
Les projets de développement énergétique ont plus de chances d’aboutir lorsqu’ils sont le fruit d’un projet politique et que la population y est associée. Auparavant, l’aménageur allait voir le maire s’il voulait implanter un projet, et cela débouchait presque toujours sur un contentieux. Ce n’est plus ainsi que les choses se passent. En tant que membre du conseil scientifique du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), je peux vous dire que les scientifiques ont pris conscience de la valeur culturelle des projets. Il faut mettre au travail les artistes, mais aussi les jeunes étudiants, qui portent un regard plus neuf que leurs aînés sur ces questions.
Mme Mathilde Kempf, architecte et urbaniste. J’évoquerai deux territoires intercommunaux engagés depuis plus de dix ans sur les questions de paysage, d’agriculture, d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’énergie.
D’abord la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, dont l’ensemble du territoire est couvert par trois chartes paysagères et environnementales qui associent les habitants, les professionnels et de nombreux acteurs du territoire, à l’instar de la relance en cours des plans de paysage.
La charte paysagère et environnementale des Costières de Nîmes a été créée à la demande des vignerons confrontés au développement de l’urbanisation. Elle a permis d’engager le dialogue. Cinq ans après sa mise en place, l’économie viticole s’est développée, les produits et les paysages ont gagné en qualité et les débats autour de la gestion du foncier sont plus apaisés. Une autre charte paysagère environnementale permet en outre aux élus de différents territoires d’agir sur le foncier et de s’impliquer de façon concrète dans l’établissement du plan local d’urbanisme (PLU).
Je citerai par ailleurs la communauté de communes du Val d’Ille, située au nord de l’agglomération de Rennes. Celle-ci est née de la volonté des élus de ce territoire très rural de mettre en place un développement durable et une économie sociale et solidaire basés sur les ressources propres du territoire et les circuits courts. Pour mettre fin à l’urbanisation des terres utiles à l’agriculture, l’intercommunalité s’est engagée dans une politique de densification des centres-bourgs en y construisant notamment des logements sociaux écologiques.
La communauté de communes s’est dotée d’une organisation administrative intéressante : elle possède plusieurs chargés de mission, un par thématique, mais tous les dossiers sont examinés par l’ensemble d’entre eux.
Ces deux expériences, qui ne sont naturellement pas les seules, ont en commun de n’avoir pas mis le PLU en avant et d’avoir fait émerger une volonté politique pour choisir l’outil le plus adapté. Elles ont ouvert le débat à de nombreux publics – habitants, professionnels, représentants du monde économique et associatif – et envisagé leurs actions sous un angle global et transversal.
M. Christophe Bayle, urbaniste, chef de projet à la SEMAPA et aux Ateliers de Cergy. Je concentrerai mon propos sur les lisières agri-urbaines. Je me suis intéressé à cette question pour répondre à l’inquiétude du président du conseil général de Seine-et-Marne, Vincent Eblé, vis-à-vis des projets du Grand Paris, en particulier celui des transports dont il craignait que son département soit exclu.
En 2025, le monde comptera 4,6 milliards d’urbains. Le bien-être et la sécurité alimentaire seront essentiels pour les villes voulant conserver leur statut de métropole. L’avenir de toute métropole, particulièrement celle de la région Île-de-France, se joue dans sa périphérie. Or 2 % des fruits et légumes consommés à Paris et sa proche banlieue sont produits en périphérie. À San Francisco, cette part est de 50 %.
La périphérie de la région Île-de-France est confrontée à deux mouvements : l’étalement urbain et l’hégémonie des grandes cultures. Si celles-ci couvrent désormais 80 % de la surface agricole utile de la région, nous assistons a contrario au déclin des cultures spéciales : les légumes frais couvrent 1,5 %, la culture florale 0,1 %, l’horticulture et l’arboriculture 1 % de cette surface. Depuis les années 2000, la région a perdu 940 exploitations agricoles.
Ces deux mouvements ont pour origine le même phénomène, apparu dans les années 1970, à savoir l’étalement urbain – que les urbanistes appellent mitage. Celui-ci n’est pas un signe de développement urbain. Au contraire, il témoigne de l’entrée des économies du monde développé dans le cycle des rendements décroissants. Jusque dans les années 1960, la concentration urbaine allait de pair avec les gains de productivité. Lorsque ceux-ci ont cessé, nous avons assisté à un étalement urbain de faible densité, à une désurbanisation. Parallèlement, la recherche de rendements croissants entraînait la baisse des salaires et le développement du chômage. Les pays occidentaux ne souffrent pas de la mondialisation mais d’une crise de la productivité. Les exploitants agricoles européens obtiennent les meilleurs rendements du monde – jusqu’à 100 quintaux de céréales à l’hectare – mais ils sont en concurrence avec des pays où les surfaces et les salaires sont très différents.
Ces deux mouvements pourraient converger, ce qui inciterait les acteurs à quitter leur position structurellement conflictuelle et mettrait fin à la guerre entre la ville et la campagne.
En bref, l’avenir de nos agglomérations se trouve, plus encore que nous le pensons, entre les mains des agriculteurs.
J’en viens aux lisières. En Île-de-France, la lisière est constituée par une bande de 10 à 20 kilomètres d’épaisseur. Cette bande est parcourue par une ligne invisible, dressée par l’INSEE, reliant les points se trouvant à 200 m de la dernière maison, et sa longueur atteint 13 800 km, dont 8 000 km au contact des espaces agricoles et 5 000 au contact d’espaces boisés. Qui a conscience de la longueur et de la pérennité de cette limite ? Pas grand monde. (Sourires)
La zone interstitielle entre rural et urbain concerne 15 % de la surface de la région Île-de-France, qui est de 1,2 million d’hectares, soit 185 000 hectares. L’avenir de la région dépend de ce qui se passera sur cette zone.
La lisière représente un important potentiel social et politique. Celle de la région Île-de-France accueille une population rejetée à la périphérie par les coûts du logement et de l’énergie, à savoir des jeunes couples et des travailleurs pauvres. Mais elle bénéficie d’une activité agricole, qu’il faut de toute urgence diversifier, en raison de la proximité d’un marché de 11 millions d’habitants.
Les lisières sont en attente d’un projet, comme le fut le centre de Paris au milieu du XIXe siècle, lors de l’émergence de la classe moyenne. La structure spatiale des lisières actuelles n’est pas constituée, comme à l’époque d’Haussmann, de boulevards, de places et d’avenues, mais d’espaces agricoles, d’exploitations, de jardins, de relais de vente de production, d’habitats productifs. Elle attire des personnes dont les modes de vie sont liés à l’économie de transition et des actifs qui ne demandent qu’à s’investir.
Cette émergence sociale a besoin de trouver sa figure, qui ne sera pas issue de l’association de l’ingénieur Alphand avec un paysagiste, mais de celle d’un urbaniste et d’un agronome. Le mariage entre les agronomes et les urbanistes est difficile à envisager puisque les premiers, depuis les années 1970, ne n’intéressent qu’à la production, au détriment de l’espace, et les seconds n’entendent rien à l’agronomie.
Vincent Eblé me confiait récemment que s’il avait souhaité dans un premier temps raccrocher la Seine-et-Marne au projet métropolitain, il s’était ensuite rendu compte que son département avait une carte différente à jouer : il s’agit de ce que j’appelle le collier, qui est fait de pièces de tailles et de fonctions différentes mais sur lesquelles repose l’agglomération. Ce collier doit avoir une existence politique.
M. Philippe Plisson. Je vous remercie, mesdames et messieurs, au nom du groupe SRC, d’avoir accepté de participer à cette table ronde et d’enrichir ainsi notre débat.
Depuis plusieurs années, une série de phénomènes – évolution climatique, raréfaction des sources d’énergie fossile, dégradation des sols, pollutions diverses – ont amené les sociétés industrialisées à engager une réflexion profonde sur leur fonctionnement.
Alors que notre pays s’oriente vers un nouveau modèle agricole et de nouveaux modes de production et de distribution de l’électricité, nous nous interrogeons sur l’impact de ces changements dans nos territoires.
Actuellement, la question du paysage n’intervient dans le débat énergétique que pour s’opposer au développement d’infrastructures nouvelles. La transition énergétique pourrait-elle faire régresser le paysage ? Après les clochers d’église, les châteaux d’eau, les lignes de 300 000 volts et les centrales nucléaires, va-t-on condamner les éoliennes sous prétexte qu’elles perturbent le paysage, comme certaines associations veulent le faire croire ?
Peut-on concevoir autrement le rôle du paysage par rapport à l’enjeu énergétique ? La recherche scientifique peut-elle aider à ce que le paysage soit pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de projets énergétiques innovants ?
Comment ont été gérés, dans le passé, les conflits paysagers liés au développement de l’hydroélectricité ?
Pourquoi ne pas orienter les agriculteurs qui développent des alternatives aux modes de production industriels vers une démarche paysagère basée sur la diversité ? L’agriculture productiviste, en particulier celle du maïs, a modifié considérablement les paysages en supprimant les haies et en comblant les fossés. Faut-il stigmatiser la démarche inverse ?
Vous soulignez l’existence d’un conflit entre agriculteurs et urbanistes au sujet de la préservation des espaces agricoles. C’est en partie inexact car les agriculteurs exercent une forte pression sur les élus pour que leurs terrains soient inclus dans les PLU afin, en cas de vente, d’en augmenter la valeur. Cette situation est très difficile à gérer sur le terrain. L’adoption d’un PLU intercommunal ne serait-elle pas la meilleure solution ?
Enfin, la création de zones – zones de protection des captages d’eau, trames vertes et bleues, zones d’urbanisation, zones de loisirs – est-elle, selon vous, la solution la plus adéquate pour la protection des territoires ? Les zones ne risquent-elles pas de freiner l’intégration de l’ensemble des fonctions d’un territoire ?
M. Jacques Kossowski. Je rappelle, au nom du groupe UMP, qu’en novembre dernier, le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature a publié une étude présentant un état des lieux des énergies renouvelables – solaire, éolienne, hydroélectrique, bioénergique et géothermique –, de leur potentiel et des enjeux qu’elles représentent pour les territoires de montagne.
Ce document met en lumière la nécessité de maîtriser le développement de ces énergies car il pourrait avoir des conséquences négatives sur les milieux naturels fragiles de montagne : déboisement, atteintes provoquées par les installations hydroélectriques sur les écosystèmes et les espèces, impact des éoliennes sur la faune et les paysages, et, de manière plus générale, consommation d’espaces. Que préconisez-vous pour la préservation du paysage montagnard et sa biodiversité dans le cadre de la transition énergétique ?
Enfin, toute transition énergétique a un coût ; or vous n’avez à aucun moment évoqué cette question. Pouvez-vous en dire un mot ?
M. Bertrand Pancher. Au nom du groupe UDI, je vous félicite, mesdames et messieurs, pour la qualité de votre réflexion et je vous remercie de mettre l’accent sur la beauté des paysages et la nécessité de nous mobiliser pour leur préservation.
Le titre de votre ouvrage, « Paysages de l’après-pétrole ? », est de nature à susciter la controverse car nous ne sommes pas encore, hélas, parvenus à ce stade.
Vous nous invitez à engager une nouvelle politique d’aménagement du territoire qui passerait par la mise en cohérence de différentes politiques. À ce titre, je souligne l’intérêt de la planification, en particulier si nous voulons que l’agriculture urbaine occupe demain une place majeure. Pouvez-vous préciser votre position sur ce point ?
S’agissant de la nouvelle gouvernance, vous souhaitez que les habitants choisissent les nouveaux paysages et expriment leurs nouveaux besoins, mais lorsqu’on voit ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, on s’interroge sur l’opportunité d’associer nos concitoyens aux grands projets collectifs.
Par ailleurs, la surconsommation des sols et le développement des transports exigent que nous entrions dans une ère plus économe. Comment voyez-vous la sortie de la surconsommation ?
Quant à la multifonctionnalité, en quoi répondra-t-elle aux exigences de préservation des paysages ?
M. Patrice Carvalho. Lorsqu’on évoque l’impact des transitions écologiques sur les territoires et les paysages, on pense à l’énergie éolienne. La directive européenne de 2009, relative à la promotion de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, composante du paquet climat-énergie, demandait aux 27 États membres de présenter leur plan d’action national en matière d’énergies renouvelables (NREAP). Le cumul de ces plans d’action, soumis à la Commission européenne en janvier 2011, devrait aboutir à ce qu’en 2020 la part de l’éolien représente 14 % de la production totale d’électricité. Un rendement aussi faible mérite-t-il que nous organisions le mitage de notre territoire ?
Le texte issu du Grenelle 2 prévoyait la création de zones de développement de l’éolien terrestre (ZDE) afin d’identifier les espaces favorables et de stopper l’anarchie des projets. Certes, le préfet prenait seul les décisions, mais les élus locaux pouvaient saisir la juridiction administrative et ils ont parfois eu gain de cause. Or la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, adoptée en avril 2013, supprime les ZDE au bénéfice de schémas régionaux éoliens (SRE), qui définissent régionalement les sites d’implantation. À cet ajustement, qui rend caduque la possibilité pour les élus de faire valoir leur avis et tarit à la source les contentieux éventuels, il faut ajouter la remise en cause de la règle des 5 mâts introduite par le Grenelle 2 pour limiter les implantations anarchiques.
Ces mesures prises à la hussarde constituent une atteinte aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités, de participation du public aux décisions les concernant et du droit des personnes à un environnement sain, et ce, pour une production d’énergie aléatoire.
Ma seconde remarque porte sur l’évolution des législations et des réglementations relatives à la transition énergétique, qui alourdissent les coûts et font perdre de l’argent aux collectivités qui engagent des projets impactant le paysage. Il est juste, en matière environnementale, d’offrir des garanties, mais la tendance est à l’évolution des exigences.
Mme Brigitte Allain. Au nom du groupe Écologiste, je vous remercie, monsieur le président, de nous permettre d’aborder ces questions.
Le paysage est un concept éminemment sociétal dont la perception, à l’instar de l’architecture, ne cesse d’évoluer. Au cours des cinquante dernières années, l’extension de l’urbanisme commercial, les infrastructures routières et ferroviaires, toujours plus gourmandes en foncier et qui défigurent les paysages, ont produit de tels excès qu’ils ont amené le législateur à intervenir.
Le modèle agricole productiviste et l’agriculture intensive ont détruit la topographie et les reliefs traditionnels comme le bocage, et une exploitation à perte de vue est moins agréable pour le regard que de petites parcelles agrémentées de haies d’arbustes et d’arbres. Cette évolution du paysage a des impacts environnementaux – érosion accélérée par les vents, ruissellements, pollution des rivières souterraines, impact sur la faune et la flore. Comment le lien entre paysage et mode traditionnel d’agriculture est-il abordé dans votre ouvrage ? La mise en place de contrats alimentaires territoriaux permettra-t-elle d’évoluer ?
L’inévitable raréfaction des ressources énergétiques fossiles aura un impact sur les transports, donc sur l’organisation spatiale. Quels outils faudra-t-il mettre en place pour anticiper ces mutations qui, à terme, rapprocheront les lieux de production, de consommation et de vie ? Quelles seront les étapes intermédiaires et quels pouvoirs publics accompagneront ces transitions ?
Le développement du photovoltaïque est limité par son importante consommation de foncier. Que peuvent provoquer les champs photovoltaïques ? Existe-t-il des solutions techniques pour mieux les insérer sur les bâtiments existants et ainsi ne pas concurrencer le rôle nourricier des terres agricoles ?
Quant aux méthaniseurs, ils ont, comme les bâtiments d’élevage, un fort impact visuel, qui déclenche la controverse chez les néo-ruraux.
Les députés du groupe Écologiste ont introduit dans le projet de loi d’avenir pour l’agriculture la valorisation des services rendus par les écosystèmes. Demain, l’Assemblée nationale examinera notre proposition de loi visant à interdire l’utilisation des pesticides dans les espaces verts publics et, à terme, dans les jardins particuliers, ainsi qu’une proposition de loi visant à prendre en compte de nouveaux indicateurs de richesse, et non seulement le PIB, dans les projets de loi de finances. Que proposez-vous pour évaluer les services rendus par les paysages, désormais perçus comme des biens collectifs ?
M. Jacques Krabal. Le groupe RRDP tient à remercier les intervenants pour leurs exposés passionnants, et le président de notre Commission pour l’occasion qui nous est offerte d’engager une réflexion originale sur les paysages et la ruralité.
En tant qu’élu, je suis confronté aux problèmes particuliers que soulève le développement d’un territoire rural – le pays du Sud de l’Aisne – bordé par deux métropoles, Paris et Reims, dont il subit l’attraction. Votre vision de l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires dits interstitiels m’intéresse d’autant plus qu’elle semble suggérer que, pour une fois, la campagne pourrait être en avance sur la ville. À ce propos, je me félicite du soutien du Gouvernement à la candidature des paysages « Coteaux, maisons et caves de Champagne » à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Leur succès constituerait un signe fort de reconnaissance de la valeur de notre patrimoine rural et de notre savoir-faire agro-viticole.
En effet, comme vous l’écrivez, madame Marcel, nos espaces de vie et nos territoires sont marqués de l’empreinte profonde du travail de façonnement et de configuration des hommes. Tous les temps s’y trouvent imprimés : le passé, à travers nos sites archéologiques et nos monuments – que nous retrouverons dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale –, le présent, par le biais du développement urbain issu des différentes révolutions industrielles, et l’avenir, simple esquisse soumise à l’incertitude.
Il apparaît impératif de repenser le lien entre le fait urbain et le fait rural. Madame Kempf, vous expliquez, avec Mme Lagadec, la dissociation entre les usages et les fonctions des espaces aménagés. Le développement économique de ces dernières années a promu l’habitat individuel, portant la dissonance au cœur de nos territoires ruraux et de nos paysages. Depuis plus de vingt ans, la France perd tous les sept ans l’équivalent d’un département de surface agricole ; pourtant, le débat autour de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a montré qu’il nous manquait toujours un million de logements. Le conflit entre urbanisme et agriculture est donc appelé à s’accentuer encore. Mais les questions relatives à l’écologie et à l’énergie – défis communs aux deux secteurs – devraient favoriser les points de convergence. Quelle serait, selon vous, la bonne méthode pour réussir à concilier ces deux impératifs autour de la transition écologique ?
Madame Marcel, vous écrivez que « l’espace qui a été construit par un groupe lui appartient » et que « les habitants font vivre le pays » ; pourtant, nos concitoyens se sentent de plus en plus dépossédés de ce qu’ils pensaient leur appartenir. Les changements nécessaires que vous appelez de vos vœux paraissent bien loin de leurs préoccupations immédiates. Comment articuler leurs aspirations et l’impératif de changer de modèle de développement ?
Je rejoins M. Giorgis lorsqu’il écrit que « le débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation des paysages qui en accompagneront la mise en œuvre ». J’adhère à l’idée de considérer la diversité des territoires comme induisant une diversité de potentiels, et d’y associer des gisements et des projets de production d’énergies renouvelables spécifiques, afin de relocaliser l’activité en promouvant les circuits courts, l’économie sociale et solidaire, l’échange circulaire.
Je suis également d’accord avec ce que M. Bayle appelle « la ville du contrat socio-agricole » ; celle de Château-Thierry s’emploie à suivre ce modèle. Comment envisagez-vous la mutation d’une agriculture conçue pour répondre à une demande tant nationale qu’internationale en une agriculture recentrée sur les objectifs de développement durable, qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail ? Sachez en tout cas que le Sud de l’Aisne – un territoire de lisière – est prêt à nourrir les Parisiens ! (Sourires)
Mme Geneviève Gaillard. À travers les paysages, c’est le projet économique, social et environnemental de la société qui prend forme. Néanmoins, monsieur Giorgis, vous vous déclarez plutôt satisfait de la définition que l’Union européenne donne au paysage : « une partie de territoire telle que perçue par les populations ». Cette définition faisant l’objet de l’article 6 de la loi sur la biodiversité, nous devrons bientôt nous en saisir ; pourtant, elle renferme un côté subjectif, difficile à appréhender.
Comment concilier le caractère évolutif d’un paysage avec les impératifs de conservation ? Si le paysage est subjectif, comment intégrer dans la définition, à côté de son aspect évolutif, les éléments de notre passé, auquel nos concitoyens restent très attachés ? Comment, au contraire, travailler avec les populations pour leur faire accepter les évolutions sociétales ? Dans une zone telle que le Marais poitevin, on a beaucoup de difficultés à convaincre les habitants que si ce site classé représente bien un espace particulier, il peut également évoluer. Lorsqu’on essaie, dans une commune, de faire valoir les nouveaux modes de production d’électricité comme le photovoltaïque, on se heurte souvent au refus des architectes des bâtiments de France (ABF) d’en installer dans tel ou tel périmètre. Ces questions – qui relèvent d’une démarche philosophique mêlant passé et avenir –, délicates à appréhender, nécessitent sûrement une réglementation et une gouvernance différentes. Qu’en pensez-vous ?
M. Guillaume Chevrollier. Selon vous, les atteintes aux paysages perpétrées au siècle dernier ont des causes et des origines diverses, et ne peuvent pas être uniquement attribuées à l’ère du pétrole. M. Giorgis évoque dans son article la diversité des potentiels de chaque territoire par rapport à la production des énergies renouvelables. Élu d’un département rural où les projets de méthanisation collective sont de plus en plus nombreux, je constate que les nuisances qu’ils induisent – notamment les atteintes au paysage – provoquent parfois des réactions d’opposition. En effet, si tout le monde est favorable aux énergies renouvelables, chacun voudrait qu’elles se développent loin de son domicile, personne n’ayant envie de se voir imposer le spectacle d’une éolienne ou les odeurs d’un méthaniseur, sans compter l’impact sur les prix de l’immobilier qu’entraîne la détérioration du cadre de vie.
La concertation et le dialogue apparaissent donc incontournables : avant d’imposer un projet, il importe de le présenter et de l’expliquer à la population. Tout nouvel élément devant respecter l’environnement, son emplacement doit être soigneusement étudié, d’autant que le scepticisme de nos concitoyens face aux garanties apportées par l’État traduit un niveau inquiétant de défiance. Comment assurer la compatibilité entre la préservation de nos paysages et le développement des énergies renouvelables ? Quels outils publics peut-on mobiliser pour y arriver ?
M. Yannick Favennec. L’impact de la transition écologique sur les paysages constitue à l’évidence un enjeu très important pour les territoires ruraux et leurs habitants. Une des conditions de leur adhésion à l’évolution des paysages semble être le partage de la gouvernance. Mais cette ambition légitime paraît compliquée à mettre en œuvre dans une société où les territoires restent contrôlés par l’élite des élus. Par quel biais, selon vous, les citoyens pourraient-ils se saisir de ce sujet qui concerne leur avenir et celui de leurs enfants, mais dont ils se sentent aujourd’hui dépossédés ?
Mme Catherine Beaubatie. La réforme de la politique agricole commune (PAC) a renforcé le rôle du développement rural et aidé les territoires à conjuguer performance économique et écologie. Ses dispositions peuvent donc constituer un premier point d’appui en cette matière. Mais les mesures du second pilier – concernant l’aménagement des espaces, l’obligation de maintien des haies, les murets ou les zones humides –, telles que renégociées en 2013, seront-elles suffisantes pour maîtriser les impacts de l’agriculture sur les territoires ?
Les espaces semi-naturels – zones enherbées, haies, prairies permanentes – et les infrastructures agroécologiques – murets ou arbres isolés – favorisent la biodiversité et l’état sanitaire général d’un territoire, et possèdent une valeur biologique et économique indéniable. Pour encourager ces dispositions paysagères, il faut avant tout travailler avec les agriculteurs. Certains travaux récents de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur l’adoption de nouvelles pratiques de travail encore plus vertueuses montrent que les politiques publiques d’accompagnement pourraient être plus efficaces si elles encourageaient davantage les actions collectives locales portées par les acteurs des territoires, telles que les circuits alimentaires courts ou l’utilisation du foncier disponible pour l’installation des exploitations biologiques.
Dans le cadre de la transition d’un territoire vers une double performance économique et écologique, comment préserver les ressources cruciales – l’eau, les sols, la biodiversité – et renforcer la régulation des bio-agresseurs et la pollinisation ? Comment gérer l’organisation des activités agricoles à l’échelle locale ? Comment déterminer la part de l’espace à réserver à la couverture des besoins d’épuration des intrants agricoles ou au maintien d’une espèce fragile ? Quels critères faut-il privilégier dans l’évaluation des besoins pour décider le déploiement des aménagements nécessaires ? Quelles mesures politiques efficaces peut-on entreprendre pour faciliter la transition ?
M. Laurent Furst. Alors que la question des paysages concerne à la fois le milieu urbain, périurbain et rural, les interventions m’ont parfois semblé explorer ces logiques séparément. On parle beaucoup en France de la perte d’espaces agricoles, mais on aborde rarement le problème tout aussi important de la qualité paysagère. Les questions varient d’une région à l’autre ; en Alsace, on se demande ainsi comment gérer les sorties d’exploitations agricoles qui fractionnent les paysages ; faut-il situer le développement urbain autour des bourgs-centres ou le long des voiries existantes ? Les élus municipaux, qui gèrent les paysages, manquent parfois de connaissances, de culture et d’information sur le sujet ; comment y remédier ? On manque aussi parfois d’outils car les PLU et les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui ont posé, dans leur élaboration, des séries de contraintes réglementaires – notamment sur la biodiversité – abordent assez peu la question du paysage. Comment regagner de la qualité paysagère au travers d’un dispositif aussi léger ?
Je suis heureux que vous ayez évoqué le progrès technique. En effet, on tend à juger les perspectives en matière de paysage à échéance de dix ou vingt ans à l’aune des systèmes de transport d’aujourd’hui. Or les voitures de demain ne pollueront ni ne consommeront comme celles d’aujourd’hui : les problèmes seront donc différents, tout comme le logiciel de réponse.
N’oublions pas que le rêve français – celui d’une maison individuelle qui consomme énormément d’espace et morcelle les paysages – reste très ancré dans l’esprit de nos concitoyens ; le souhait de s’installer dans une zone périurbaine, loin de son lieu de travail, demeure également très prégnant.
Mme Françoise Dubois. La qualité des réflexions qui nous ont été soumises nous permettra d’étudier les textes législatifs sous un angle différent.
Madame Marcel, vous semblez espérer que la transition énergétique devienne un vecteur pour une transition environnementale, culturelle et sociale, créant ainsi les conditions d’un futur soutenable dans nos territoires. On ne peut que partager votre aspiration à une transition globale, qui pourrait s’inspirer de l’art de faire de nos ancêtres, capables de s’adapter à leur territoire et de le modeler, sans pour autant le dénaturer. L’aménagement du territoire devrait également respecter l’évidence spatiale – aujourd’hui davantage socioéconomique que géographique. Pensez-vous que les centres de gravité de cette dernière soient représentés par les bassins de vie ?
Ma deuxième question s’adresse à tous les intervenants. Depuis quelques années, nous subissons les effets d’une grave crise économique, et nous nous battons collectivement pour la surmonter, mobilisant pour cela des moyens importants ; en même temps, nous essayons, autant que possible, de faciliter la transition énergétique. Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle crise d’ampleur, et l’épuisement des réserves de pétrole lui-même risque d’entraîner beaucoup de difficultés. Ne craignez-vous pas que l’« après-pétrole » intervienne trop tôt, à la fois pour les filières industrielles et pour les collectivités locales françaises, tant la reconstruction du paysage – vaste chantier au cœur de votre réflexion commune – suppose des moyens importants ?
Mme Sophie Rohfritsch. Cette table ronde nous offre un regard d’une grande hauteur de vue, si grande parfois qu’il est difficile d’en saisir les applications concrètes. (Sourires) Peut-on réaliser ce que vous préconisez en restant uniquement sous l’égide de la sphère publique ? Les investissements publics dans les infrastructures étant appelés à se réduire, ne faudrait-il pas réfléchir à l’association du secteur privé à ces initiatives ? Certes, je me réjouis de voir qu’à Nîmes ou ailleurs, le public intervient activement dans les projets ; mais je reste persuadée que ces actions devraient être du ressort du privé.
Les exemples les plus frappants que vous évoquez impliquent de grandes métropoles, donc des collectivités bien outillées pour intégrer le paysage dans leur réflexion. Vous allez jusqu’à dire qu’il faudrait libérer les petits maires de la pression en transférant le pouvoir de décision à l’intercommunalité. Je trouve vos préconisations contradictoires : si l’on pense que tout doit venir du terrain, le citoyen devant s’approprier cette dimension paysagère comme instrument de développement, il faut également admettre que c’est au plus petit échelon de la collectivité que revient le choix final de l’intégrer dans ses outils de planification. Il faudrait donc inverser le raisonnement afin de rester au bas de l’échelle.
M. Florent Boudié. Au regard de la richesse de vos contributions, le titre de votre ouvrage apparaît presque réducteur ! Une analyse – développée à propos de l’Île-de-France, mais pouvant s’appliquer à l’ensemble du territoire – me semble particulièrement essentielle : évoquant la situation de ce que vous appelez les « lisières », vous affirmez la nécessité de mettre fin à l’opposition entre ville et campagne, plaidez pour l’élaboration de projets de villes décentrées et le développement du couplage entre l’urbain et le rural. Nous aussi avons récemment abordé cette question dans le cadre du débat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Avec des collègues tels que Philippe Plisson, nous avons tenté de trouver une articulation entre différents types d’espaces à travers la création des pôles territoriaux d’équilibre, l’un des objectifs de ce dispositif – repris dans le texte final de la loi – étant précisément de jeter des passerelles entre aires urbaines et rurales.
Monsieur Bayle, je souhaiterais vous entendre sur la transformation de la gouvernance des territoires qu’amorce la réflexion sur le rapport entre ville et campagne. Comment voyez-vous la reconnexion institutionnelle entre les enjeux ruraux et ceux des agglomérations ? Comment prendre en compte, dans notre organisation territoriale, ces territoires de lisière ou espaces interstitiels ? Vous citez l’exemple de la montée en puissance des urbains dans les conseils municipaux de nos communes rurales : j’en fais également le constat.
M. Jean-Pierre Vigier. En proposant une approche des paysages surtout visuelle et sensitive, vous développez une vision idyllique et poétique des territoires. Chacun s’accorde à reconnaître la nécessité de conserver aux paysages français à la fois leur diversité et leur beauté. Mais comment concilier au mieux votre vision avec les contingences économiques telles que le développement des énergies diversifiées, les impératifs de la production agricole, l’urbanisation croissante et la multiplication des infrastructures de transport ?
Mme Martine Lignières-Cassou. Vos propos m’ont d’autant plus comblée que je suis maire d’une ville – Pau – qui s’est construite autour d’un paysage – les Pyrénées. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension sensible, donc subjective, du paysage ; en même temps, on tente aujourd’hui de construire une politique publique autour de cet enjeu, combinaison d’une politique agricole, énergétique et urbaine, gérée à travers une gouvernance de plus en plus complexe. Si cette construction apparaît nécessaire, elle suppose de pouvoir évaluer et mesurer l’efficacité du dispositif – procédé désormais incontournable. Or comment penser l’évaluation d’un phénomène en partie sensible, donc subjectif ? Comment envisager la construction d’indicateurs d’efficacité de cette politique publique ?
M. Jean-Luc Moudenc. Dans votre ouvrage, vous parlez du renchérissement des coûts de l’énergie fossile et plaidez logiquement pour la transition énergétique, le changement des habitudes et une consommation différente des énergies. Or certains experts – nous en avons récemment eu la preuve dans les médias – estiment au contraire que le cours du pétrole continuera à baisser, à tel point que certains envisagent qu’en 2017, le prix du baril sera divisé par deux. La prudence est certes de mise ; mais si cette évolution se confirmait, comment verriez-vous l’avenir de la transition énergétique ?
M. Jean-Jacques Cottel. En tant qu’acteur local d’un secteur de grande plaine, je connais d’expérience la tension entre le passé et l’évolution des paysages qui nous est imposée. J’ai vu successivement arriver dans mon territoire d’abord une autoroute, puis une ligne TGV, des lignes à très haute tension, des réseaux de toute sorte. Au fur et à mesure de l’installation de ces infrastructures, on a essayé de réorganiser le paysage à travers les aménagements fonciers qui, il y a vingt ou trente ans, consistaient à supprimer des haies, des arbustes et des chemins. Viennent désormais s’y greffer les éoliennes ; si je suis favorable à cette source d’énergie renouvelable, la concertation a d’abord manqué quant à leur lieu d’implantation. Le schéma régional, assez précis, indique qu’elles doivent se positionner le long d’axes structurants ; mais on peine toujours à articuler l’ensemble de ces transformations, à harmoniser notre vision du paysage et à le faire évoluer en tenant compte des intérêts économiques et agricoles, d’autant que l’ingénierie reste sous-développée en milieu rural. Dans ce domaine, le législatif ne peut pas tout ; et même si l’optimisme est salutaire, il convient de faire preuve de modestie en faisant évoluer les choses par petites touches.
M. Jean-Louis Bricout. Vos interventions nous font rêver ; mais ne pensez-vous pas qu’il est utopique d’espérer fonder la généralisation de vos expériences agroécologiques sur la seule volonté politique, sans y associer des moyens humains et financiers, ainsi que des outils adaptés ?
Votre action passe par une réflexion extrêmement décentralisée ; mais chacun connaît les inégalités criantes entre les territoires en termes de capacités et d’ingénierie. À l’aune d’une nouvelle organisation territoriale et d’une volonté de construire une agriculture douée d’une double performance, auriez-vous des préconisations à nous soumettre dans ces différents domaines, afin de concrétiser des objectifs que nous partageons tous, mais qui restent délicats à atteindre dans certains territoires ?
M. Michel Lesage. Nous vivons dans un monde qui change. Il reste difficile de comprendre les évolutions en cours – l’avènement de l’« après-pétrole », la transition énergétique ou le réchauffement climatique – et de préparer l’avenir en termes d’aménagement du territoire sans prendre en compte plusieurs facteurs fondamentaux : la domination croissante du fait urbain et le décrochage parallèle du modèle de développement rural ; l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; le vieillissement de la population ; la fracture sociale renforcée par l’augmentation du prix de l’énergie ; la crise des finances publiques ; la nouvelle gouvernance qui accompagne la décentralisation ; le désengagement de l’État des politiques publiques ; le rôle de plus en plus prégnant de l’Europe. Comment intégrer et concilier ces différents enjeux dans l’action publique ?
Mme Odile Marcel. Nous sommes très satisfaits de l’attention compétente que vous avez bien voulu manifester à notre travail. Le fait que vos questions couvrent presque tout le champ des interrogations pertinentes montre que vous avez saisi l’enjeu de ce débat : savoir quel avenir on prépare ensemble. L’intérêt de l’unité nationale autour de ces questions relatives au patrimoine et au bien commun est de rendre toute cette effervescence constructive.
L’ingéniosité humaine et la plasticité des réponses sociales aux difficultés sont extraordinaires ; même si un compte à rebours est désormais enclenché, j’espère donc – et j’ai confiance – que nous arriverons à relever ces défis à temps. L’esprit humain recèle des ressources considérables et je reste convaincue, en tant que philosophe, que nous arriverons, par-delà les polémiques, à construire des réponses adaptées.
D’un point de vue plus pragmatique, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) – qui relèvent respectivement du ministère de l’agriculture et du ministère de l’environnement –, intéressés par notre démarche, nous demandent d’organiser un colloque national afin d’éclairer l’ensemble des questions que vous avez énumérées et de déterminer comment l’État peut mettre ce cahier des charges en cohérence. Dans le contexte de la décentralisation et de la complexité des problèmes locaux, il faut tracer une marche à suivre qui nous permette d’aller de l’avant. Ce projet de journée d’étude n’a pas encore trouvé son lieu ; la représentation nationale ne serait-elle pas la matrice toute trouvée pour ce débat – que nous avons d’ores et déjà engagé aujourd’hui ?
M. Baptiste Sanson. Je m’appuierai sur les images pour illustrer un propos qui peut paraître abstrait par l’exemple d’un territoire singulier : la Bergerie de Villarceaux. Il faut, en effet, partir de la diversité des territoires pour proposer non pas des modèles, mais des principes d’action.
Dans les années 1990, cette ferme du Bassin parisien, engagée dans la modernisation, s’était spécialisée dans la céréaliculture, abandonnant l’élevage ovin et les vergers qui participaient jadis d’une diversité agricole. Cette spécialisation s’est appuyée sur le recours aux intrants fossiles et aux produits phytosanitaires.
Pour réduire les intrants au sein de cette ferme, il a fallu, de manière conjuguée, travailler sur le redécoupage des parcelles, le retour de l’élevage, les complémentarités entre polycultures et élevage, et la place de l’arbre. Dans les années 1990, les cultures principales – colza, blé, maïs – occupaient des parcelles faisant jusqu’à 60 hectares d’un seul tenant. Une telle organisation ne peut fonctionner qu’à l’aide de la « béquille chimique » qui permet de maîtriser les maladies ravageuses. Pratiquant une agriculture conventionnelle, la ferme restait alors très dépendante des engrais d’origine minérale. Pour passer à l’agroécologie, il a fallu, en amont des pratiques plus économes, repenser l’organisation même du système – de même que si l’on veut rendre une maison énergétiquement efficace, on commence par penser à son isolation et à son exposition. Le rapport entre structure et fonction est en effet essentiel.
Le nouveau découpage parcellaire – en lanières – tient compte des nécessités d’une agriculture mécanisée, les parcelles faisant quelque 8 hectares en moyenne. L’assolement est diversifié, l’élargissement du nombre des cultures facilitant les débouchés économiques tout en évitant la propagation des maladies d’une parcelle à l’autre. À côté de ces mesures prophylactiques, on travaille également à la place des infrastructures agroécologiques que sont les espaces semi-naturels tels que les haies ou les bandes enherbées. Ces surfaces de compensation écologique – terme utilisé dans la nouvelle PAC – constituent des éléments productifs qui, s’ils sont bien répartis dans l’espace, suivent un maillage et abritent des insectes auxiliaires, permettant ainsi de retrouver un équilibre écologique et de limiter les produits phytosanitaires.
Dans la ferme de Villarceaux, ces transformations ont suivi des principes systématiques. Pour généraliser le modèle, il faudrait certainement l’affiner.
Enfin, à cette réflexion qui vise à mieux produire, on peut en conjuguer une autre, qui cherche à recréer un territoire aux usages partagés. En effet, les nouvelles pratiques modifient le territoire et permettent de retrouver un espace répondant aux attentes de nos concitoyens. Le retour de l’arbre sous forme de haies périphériques et d’alignements au sein des parcelles – l’enjeu de l’agroforesterie – et la mise en place d’un réseau de chemins d’exploitation ouverts à d’autres usages – agrotouristiques ou récréatifs – permettent de créer de l’emploi. Aujourd’hui, au sein de la ferme de Villarceaux, les activités touristiques, la vente directe, le développement de gîtes et l’organisation de séminaires ont permis de générer une quinzaine d’emplois supplémentaires. Il faut donc veiller à bien lier cadre de vie et recherche d’une production plus efficace.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Sur combien d’années cette transformation s’est-elle étalée ?
M. Baptiste Sanson. Les travaux visant à modifier le système de production se sont échelonnés entre 1997 et 2001. On a plusieurs fois mentionné le coût de ces transitions, mais je pense que l’agriculture doit non seulement l’assumer, mais le réclamer. Lorsqu’on coule du béton ou qu’on réalise des travaux de grandes infrastructures, on y voit un investissement, alors que quand on plante un arbre, que l’on fait des travaux de réaménagement parcellaire ou que l’on met des clôtures afin de réintroduire du cheptel bovin, comme ce fut le cas dans cette ferme, on considère qu’il s’agit de dépenses. Il faut, là aussi, voir ces coûts comme des investissements qui permettent à l’agriculture de gagner en autonomie vis-à-vis des facteurs de production non renouvelables. Il est intéressant de chiffrer ce coût – travail actuellement en cours – et de le mettre en perspective d’une performance économique, sans oublier qu’il peut également être justifié par les retombées environnementales positives de ces évolutions.
Mme Odile Marcel. L’ensemble de cette initiative de Villarceaux, comme la publication du volume Paysages de l’après-pétrole ? dans la collection Passerelle ont été financés par la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (FPH), une fondation privée suisse qui anticipe les transitions agroécologique et sociétale, et travaille sur la question Nord-Sud.
Les questions de l’aménagement durable préoccupent beaucoup les sphères compétentes de la décision publique, même si le paysage reste insuffisamment inclus dans le débat, qui reste dominé par les notions de biodiversité et d’environnement. Pourtant, le vécu et le regard humain sur le milieu importent également. De plus, le paysage représente un patrimoine commun, un monde de références culturelles collectives qui constituent un langage partagé que chacun intériorise et s’approprie à sa façon, mais qui permet à une société de se comprendre, de garder sa cohésion et de fonctionner. Cette dimension du paysage reste pour l’heure négligée ; dans le contexte actuel où il nous faut chercher la résilience, il serait opportun qu’elle revienne dans le débat. En effet, ce sont les références culturelles communes qui permettent aux sociétés de dépasser les crises les plus graves.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous propose d’inviter prochainement M. Pierre Calame, président de la FPH, à intervenir devant notre Commission.
M. Sébastien Giorgis. En évoquant le coût de ces nouvelles façons de produire de l’énergie à partir des ressources locales, n’oublions pas que les autres modes de production ne sont pas non plus neutres en termes de paysage et d’environnement, ni gratuits. Le pétrole coûte 50 milliards d’euros par an, soit à peu près le déficit commercial de la France. L’enjeu économique derrière ces débats est donc considérable.
Je suis touché par l’intérêt manifesté à la notion de paysage. En matière de gouvernance, elle représente un instrument merveilleux pour porter les projets de la population sur un territoire. En effet, cette notion – contrairement à celles de SCOT ou de PLU – remporte spontanément notre empathie ; nous sommes tous experts, tous compétents, tous porteurs d’un avis sur notre paysage. Celui-ci constitue donc, avant tout, un bel outil de démocratie locale et de réappropriation des projets d’aménagement.
Le paysage dans lequel nous vivons est toujours contemporain ; aucun morceau du paysage en France n’appartient au XIIIe siècle, quand bien même on y verrait des cathédrales datant de cette époque. On protège les châteaux du XVIe siècle pour qu’ils gardent leurs caractéristiques propres, mais le paysage global date toujours d’aujourd’hui. Cette question pâtit d’une grande confusion puisqu’en 1930, on a calqué les lois de protection des monuments, inventés au début du XXe siècle, pour les appliquer au paysage. Pourtant, alors que les monuments sont datés, le paysage se transforme ; dans son cas, la question ne se pose donc pas en termes de protection, mais de gestion de la qualité et de projet social. Il faut changer de paradigme : si les ABF ont du mal à accepter l’évolution du paysage, c’est qu’ils en restent au schéma monumental daté, alors qu’on a affaire à un concept toujours contemporain, même si un paysage peut être plus ou moins urbanisé, avec ou sans infrastructures, géré sans cohérence – parce que l’économie générale du projet a été négligée – ou affichant des arrangements harmonieux – parce qu’on a pensé à l’avenir, à l’économie du sol et à l’érosion.
La question du patrimoine dans le paysage représente une autre question. Le territoire est saturé de patrimoine : les spécialistes parlent de palimpseste pour signifier qu’on continue à écrire les paysages contemporains sur les traces du passé. Je vous invite à ce titre à lire l’urbaniste italien Alberto Magnaghi qui montre, dans son livre Le Projet local, que tout projet local contemporain s’appuie sur les éléments patrimoniaux du paysage, sans que le paysage en tant que tel ne se confonde avec le patrimoine.
Le concept du paysage renferme une part de subjectivité, mais la définition évoquée permet de limiter cette dernière. En effet, « une partie de territoire » évoque les fossés, les lignes, les dimensions, les passages d’eau ; l’harmonie – la bonne combinaison des différents éléments – est objective, on peut en mesurer la qualité en termes d’efficacité économique, environnementale ou sociale. Le terme « perçue » renvoie au sens de la vue, notion là aussi parfaitement objective : on voit la cathédrale de Chartres ou on ne la voit pas ; on voit l’éolienne à côté du château du XIIe siècle ou non – parce qu’on a décidé de ne pas l’y installer. Le sensible est très objectif. Enfin, « par les populations » permet d’ouvrir un débat où nos propres sensibilités, nos histoires et nos aversions entrent en contact avec celles des autres, où s’expriment les préférences et s’arrêtent les choix. On peut donc objectiver les deux premières parties de la définition ; quant à la dernière, elle relève du débat et de la gouvernance, en somme de la politique.
Ainsi, certains viticulteurs du Languedoc-Roussillon sont favorables aux éoliennes car celles-ci s’intègrent dans leur stratégie d’un vin contemporain. Optant pour des bouteilles aux étiquettes actuelles et aux bouchons en plastique, ils jouent la carte de la modernité, et les éoliennes vont dans leur sens. En revanche, ceux de Saint-Chinian ont fait le choix de vendre un autre type de vin, pourvu d’une autre image, qui s’appuie sur la taille en gobelet et la restauration des murs en pierre sèche ; l’éolienne venant ruiner tout leur travail, ils s’y opposent naturellement. C’est pourquoi il faut rester attentif à la cohérence des choses et ouverts à la diversité – une des valeurs essentielles du paysage. Quel intérêt y aurait-il à voyager à travers le monde, voire la France, si tous les paysages étaient identiques ? C’est ce qui est arrivé à nos entrées de villes, et cette évolution nous a tous heurtés, provoquant même une loi en 1993. L’entrée d’Avignon ne doit pas ressembler à celle de Roubaix, de Dunkerque ou de Draguignan. Chaque territoire a son propre potentiel énergétique, son intensité solaire, ses ressources géothermiques, hydrauliques ou forestières ; il ne faut pas installer des éoliennes partout, mais créer une diversité des productions et donc des paysages.
Enfin, s’agissant de la planification et de la nouvelle gouvernance, le plateau de Saint-Agrève offre un bel exemple de gestion des éoliennes au niveau d’une communauté de communes. Pour éviter de subir la pression des aménageurs, son président a soumis le projet pour 2030 – projet à la fois économique, démographique et de vie – à la population. Le débat a notamment porté sur les formes de production d’énergie. Les communes ont confié aux paysagistes une étude afin de déterminer les endroits qui, sur leur territoire, pourraient accueillir des éoliennes ; sur les douze sites proposés, mis en débat, deux ont finalement été retenus. Sur ces deux sites, la communauté de communes a lancé un appel d’offres, cherchant l’aménageur le mieux offrant en termes économiques, énergétiques et environnementaux pour réaliser le projet de la population et de ses élus. Ainsi, au bout de deux ans, le projet a pris forme. Cet exemple montre qu’introduire cette nouvelle gouvernance permet de choisir le paysage ensemble.
M. Jacques Kossowski, secrétaire de la Commission, remplace le président Jean-Paul Chanteguet à la présidence
Mme Mathilde Kempf. Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) constituent un outil intéressant. Tous les territoires qui se posent ces questions de paysage, d’aménagement du territoire et d’urbanisme sentent qu’ils doivent adopter cette solution, mais sa mise en œuvre reste délicate. Les communes ont peur de se voir déposséder du pouvoir de décision, de se faire imposer des choses par l’échelle supra-communale. L’appropriation des projets est également rendue difficile par le manque de culture partagée. Un PLUI réalisé dans ces conditions est forcément vécu sur un mode défensif et a peu de chances d’aboutir à une vision cohérente d’ensemble ; il se limite alors à une somme de visions communales agrégées au sein d’un seul document. Or l’ambition du PLUI n’est sûrement pas de juxtaposer les petites réflexions locales, mais de proposer un regard global harmonieux. De plus, en période de crise, les petites communes ne disposent pas de services techniques adaptés pour réaliser des projets souvent très complexes ; l’échelle intercommunale permet aussi de bénéficier d’une ingénierie, de compétences et de savoirs pour aller vers des documents plus intéressants. Mais débloquer la situation et comprendre qu’on peut entrer dans la dimension intercommunale sans perdre la finesse de la connaissance locale du territoire ne sont possibles qu’à condition de construire une volonté et une culture communes.
Deux exemples permettent d’illustrer mon propos. Pour réaliser son PLUI, la communauté de communes des Vertes vallées, dans le Pas-de-Calais, a commencé par envisager de petites entités paysagères regroupant les communes par deux ou trois, et par rédiger une charte – outil de concertation et d’échange – permettant de bien connaître les communes voisines. Petit à petit, est arrivée la prise de conscience de la communauté des enjeux, problèmes et intérêts, et donc la volonté de planifier à plusieurs. C’est progressivement qu’on est arrivé finalement à un PLUI. Ce n’est donc pas l’outil qui est arrivé en premier, mais bien une culture partagée. Prendre le temps de la concertation avec les autres publics permet de parvenir à la conclusion de la nécessité de l’outil ; et une fois que la volonté est là, on n’est plus sur la défensive.
Autre exemple : l’Association des maires de la Vaunage, dans le Gard, a réalisé un travail très fin sur le foncier pour déterminer quelles parties pouvaient revenir à l’agriculture et quels étaient les projets des agriculteurs et des autres propriétaires, afin de permettre des échanges de parcelles. Celles-ci retrouvant une fonction et une utilité économique, les agriculteurs – qui peuvent à nouveau vivre de leur profession – n’ont plus forcément besoin de les vendre pour qu’elles soient urbanisées. À l’échelle communale, cela s’est traduit par la création d’une zone d’activité agricole qui permet de regrouper les sorties d’exploitation au lieu de les disséminer dans le paysage. Ainsi, en pérennisant l’outil de travail qu’est le sol et en définissant l’orientation du territoire, le public parvient à encadrer l’action du privé.
Le Val d’Ille, au nord de Rennes, a également mis en place une stratégie d’achat systématique de foncier visant à réinstaller l’agriculteur dans une approche biologique. Mais il ne suffit pas d’installer l’agriculteur, il faut également lui assurer des débouchées économiques. Là aussi, la collectivité assume sa responsabilité en décidant que toutes les cantines publiques s’alimenteront en produits biologiques fournis localement, en circuit court. On a donc organisé des marchés, des points de vente dans toutes les communes, qui garantissent des revenus aux agriculteurs. À nouveau, le foncier agricole est préservé parce qu’il devient utile et rentable.
Plus généralement, le paysage sert souvent de déclencheur à l’action en révélant les dysfonctionnements des politiques de développement, de construction, d’aménagement ou de voirie. En constatant des éléments dérangeants, on est poussé à travailler sur la qualité des paysages. Mais le sujet tend à disparaître dès lors qu’on entre dans le cœur du projet, comme s’il paraissait insuffisamment sérieux parce que trop subjectif, pas assez concret, trop flou ou trop vaste. Une fois le projet mené à bien, le paysage redevient un outil de communication vendeur : on reparle de sa qualité en mettant en avant sa beauté. Il faut donc travailler sur ce maillon faible et utiliser le paysage dans la construction même des projets. L’une des pistes consiste à agir sur la formation des futurs professionnels : pour éviter le cloisonnement par disciplines, il faut multiplier les rencontres afin de construire une culture partagée. Les artistes peuvent également permettre de se poser des questions nouvelles à propos des paysages.
En ce qui concerne les coûts de la transition énergétique, il est difficile de les évaluer car ils ne sont guère isolables. Il faut au contraire envisager les choses de façon transversale. Dans le Val d’Ille par exemple, cette transition passe d’abord par la réduction de la consommation d’énergie à travers les programmes de construction portés par la collectivité – logements sociaux ou bâtiments communautaires écologiques – et par l’utilisation des ressources locales telles que le bois de bocage ou les près de fauche, qui servent de matière première à la méthanisation tout en assurant un complément de revenu aux agriculteurs. Toute une économie s’organise donc autour de cet objectif. Ainsi, appréhender les situations de façon transversale permet d’en mesurer la complexité, mais également la richesse, tout en interdisant d’isoler un élément donné.
M. Christophe Bayle. Parler de gouvernance semble immédiatement fragiliser l’aspect identitaire de la construction communale. Comment changer d’échelle ? Certaines communes ont lancé des études sur l’alimentation de la ville, allant jusqu’à créer des postes d’adjoint à l’alimentation. Légitimement appelés à s’intéresser à toute une aire, ces responsables ne peuvent que dépasser les limites de leur commune, sans que d’autres collectivités y trouvent à redire. Ces initiatives – auxquelles participe le centre d’éco-développement de Villarceaux – constituent ainsi une piste intéressante pour dépasser l’aspect identitaire et la structure communale.
Un autre axe de travail accompagne la prise de conscience du fait que l’étalement urbain constitue un signe de désurbanisation et de faiblesse économique, et non une garantie de développement. Le démontrer permettrait de donner une fierté à l’espace périphérique, longtemps dévalorisé. Il ne s’agit pas de refaire le Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région parisienne (PADOG), mais de permettre à cet espace de lisière de gagner sa vie. Or je sais d’expérience que ce n’est possible que si l’on renverse l’image qu’il a de lui-même. Ainsi, l’espace sur lequel je travaille depuis vingt ans était au départ totalement dysphorique, affichant des valeurs foncières négatives ; ces valeurs sont aujourd’hui les plus fortes de la région parisienne. Cette transformation en espace euphorique passe par toute une série d’éléments, mais reste un objectif réalisable.
Je travaille en binôme avec un ingénieur sur une ligne qui fait 600 mètres de long, s’étirant du pont de Bercy au pont d’Austerlitz ; on devrait soumettre les 13 800 kilomètres de la lisière à l’attention de ce type de binômes formés d’un paysagiste et d’un agronome. La forme de cette collaboration reste à déterminer, mais les responsables politiques devraient d’ores et déjà travailler à la prise de conscience sociale et politique de l’existence de ce territoire, sans forcément commencer par la déstabilisation des identités communales.
M. Jacques Kossowski, secrétaire de la commission. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour la qualité de vos interventions au cours de cette table ronde.
12. Audition de M. Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) (4 février 2014)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, je rappelle que nous avons pris la décision d’auditionner les responsables des grandes organisations environnementales. Après avoir entendu en décembre dernier Bruno Genty, président de France Nature Environnement (FNE), nous accueillons aujourd’hui M. Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme (FNH).
La FNH est une fondation française qui a été créée en décembre 1990 par vous-même, cher Nicolas, sous le nom de Fondation Ushuaïa, de 1990 à janvier 1995, et reconnue d’utilité publique en 1996. Ses actions poursuivent trois objectifs : mobiliser les citoyens et les inciter à agir au quotidien ; sensibiliser les décideurs politiques et économiques – nous nous rappelons tous l’initiative du Pacte écologique lancé en novembre 2006 en vue de l’élection présidentielle de 2007 ; soutenir les projets et structures associatives dédiées au développement durable en France et à l’international.
Monsieur Hulot, nous souhaitons vous entendre sur les missions et les moyens de votre association, mais aussi sur votre think tank, ce laboratoire d’idées innovantes pour la transition écologique, et votre do tank, laboratoire d’initiatives porteuses d’avenir. Cette audition nous permettra également d’aborder des sujets d’actualité : la préparation du sommet sur le réchauffement climatique qui se tiendra au Bourget en décembre 2015, l’élaboration des textes sur la transition énergétique et du texte sur la biodiversité, ou encore la réforme du code minier.
M. Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la nature et l’Homme. Mesdames, messieurs, je vais vous présenter en quelques mots ma fondation, avant de vous faire de part de mes inquiétudes et de mes espoirs au regard des enjeux et des échéances.
Après vingt-cinq ans d’existence, ma fondation, comme la plupart des ONG françaises, est aujourd’hui en très grande difficulté car elle doit faire face à une multiplication des demandes, ce qui l’amène à jouer le rôle de médiateur entre les partenaires privés, sociaux, politiques et économiques, mais aussi à une réduction brutale de ses financements. Pour la première fois de son existence, elle va devoir engager un plan social. À travers l’histoire de ma propre fondation, je me permets donc de vous alerter sur la situation du secteur associatif, en particulier sur la grande vulnérabilité des ONG oeuvrant pour l’écologie.
Quand j’ai créé cette fondation, ma lecture des enjeux était bien plus étroite que celle que j’en ai aujourd’hui. À l’époque, ma préoccupation était plutôt naturaliste et environnementale, avec le souci de m’inscrire dans une dynamique afin que soit pris en compte le respect de la biodiversité et des écosystèmes. Chemin faisant, sous l’éclairage d’un certain nombre de personnes, je me suis retrouvé de plain-pied dans le combat le plus humaniste qui soit, un combat complexe dont les racines se trouvent dans les fondamentaux de notre modèle de développement économique et sociétal – d’où la difficulté à passer à la mise en œuvre des solutions pour faire face aux enjeux.
Au fil du temps, à mesure que la vocation d’origine de la Fondation a évolué, ses modalités d’action se sont transformées.
Sur un sujet considéré comme purement vertical, environnemental, la première des modalités est de passer par l’éducation et la sensibilisation, pour tenter de changer les regards et les comportements. Ensuite, à mesure que l’on découvre la complexité de l’enjeu, s’inscrit une sorte d’obligation de commencer à sensibiliser tous les acteurs de la société : les citoyens, puis les acteurs sociaux, professionnels, économiques, et enfin les acteurs politiques. L’ADN de cette fondation a donc consisté à jeter des passerelles afin de permettre à l’ensemble de ces acteurs de se parler et de prendre en compte les difficultés et les arguments des autres.
Ainsi, dans un premier temps, la Fondation a-t-elle joué un rôle de médiateur pour tenter d’amener la réflexion dans un espace apaisé et documenté. C’est ce que nous avons fait étape après étape. Nous avons mobilisé, d’abord, les jeunes, puis les citoyens en général, ce qui nous a permis de constater une disponibilité de ces derniers à s’engager. Grâce à l’opération « Défi pour la terre », 700 000 à 800 000 personnes ont pris l’engagement de changer leurs comportements. C’est ainsi qu’a été lancé le processus du Pacte écologique : en effet, nous étions désormais en mesure de dire aux hommes et aux femmes politiques que pour aller au-delà, la volonté individuelle devait rencontrer l’organisation collective. Nous nous sommes donc tournés vers les politiques, tous bords confondus, pour leur proposer de prendre des engagements, de principe, mais aussi très concrets : cela a donné lieu au « Pacte écologique ». Cette campagne de mobilisation a contribué à libérer les énergies dans notre pays, à créer une dynamique positive au niveau de l’État, des collectivités locales et des entreprises, et elle a crédibilisé et légitimé tous ceux qui étaient jusqu’alors isolés sur ces sujets jusqu’alors.
Ensuite, la Fondation a participé, avec d’autres ONG, à la dynamique du Grenelle de l’environnement. Chemin faisant, nous avons continué à sensibiliser tous les acteurs et nous nous sommes positionnés en médiateur entre les scientifiques, le grand public et les décideurs pour rendre un certain nombre de sujets compréhensibles.
Tout cela représente un travail de fond difficilement quantifiable. Il n’est pas aisé pour la Fondation de faire le bilan de son utilité sur vingt-cinq ans. À mes yeux, elle a très clairement participé à décloisonner ce sujet, à créer des passerelles de dialogue et de réflexion ; elle a essayé de faire en sorte que le diagnostic soit partagé par le plus grand nombre et que chacun puisse apporter sa part de contribution. Mais dans la mesure où la Fondation n’est pas le seul acteur, il est difficile de quantifier ses succès. Pour faire court, je dirai que nous avons été un des contributeurs à une première phase d’engagements sur les enjeux écologiques.
Deux aspects ont principalement caractérisé l’esprit de la Fondation. D’une part, nous étions ouverts au dialogue. D’autre part, au-delà du constat, nous nous sommes très rapidement efforcés de travailler sur des propositions concrètes en vue de dégager des solutions. Cela a été le cas avec le Pacte écologique, mais aussi avec des propositions que nous avons présentées dans le cadre du Grenelle et des conférences environnementales.
Ce travail de fond est précieux, mais il se fait souvent dans l’ombre. Il s’agit en effet d’une cause plus difficile à expliquer qu’une cause bien identifiée, comme celle défendue par la Ligue de protection des oiseaux, WWF ou encore Greenpeace. Étant dans l’éducation, la mobilisation, la formation, l’information, le dialogue, notre travail est plus discret. Il a néanmoins son utilité : ce n’est pas à vous que je vais apprendre que, parfois, l’ombre peut porter la lumière.
La Fondation fonctionne avec un personnel permanent et un collège de scientifiques et d’experts, entièrement bénévoles, comme son président. Son financement, plus ou moins équilibré, repose sur trois piliers : le mécénat, puisque la Fondation est reconnue d’utilité publique, avec les contraintes économiques et juridiques afférentes à ce statut ; quelques subventions aléatoires ; des dons et des legs, dont elle a bénéficié à mesure que sa notoriété a pris de l’ampleur.
Je voudrais maintenant vous faire part d’un certain nombre de réflexions.
Inscrit, comme d’autres, dans cet engagement depuis un quart de siècle – presque une vie –, je m’étonne de la difficulté à convaincre sur ces sujets. Je m’étonne, chaque matin, d’avoir à répéter en boucle les mêmes arguments, les mêmes mots, et d’être écouté comme une personne venue défendre un intérêt sectoriel ou particulier. Entre moi et mes interlocuteurs, en dépit d’une forme de sincérité partagée avec certains, je constate un immense malentendu : nous entendons les mêmes mots, mais ne les comprenons pas de la même manière. En fait, les mots n’ont pas la même signification selon le degré de connaissance ou d’attention porté à ces sujets. Dit autrement, l’enjeu écologique est un enjeu optionnel pour certains, alors qu’il est un enjeu conditionnel pour d’autres, dont je fais partie. Or si l’on y voit un enjeu optionnel, compte tenu de l’avalanche de difficultés qui s’accumulent sur nos épaules, un argument primera toujours pour ajourner la prise en compte de ces sujets. À l’inverse, si l’on considère que l’enjeu écologique conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés, il doit l’emporter sur tous les autres, comme cela a été reconnu par le Pacte écologique. Cette différence de lecture provoque une forme de fracture ou de quiproquo.
Bien que nous soyons en 2014,et alors qu’une avalanche de rapports présente des données incontestables sur l’état des écosystèmes, de la biodiversité de la planète, de nos ressources, notre lecture sur la réalité du monde reste la même que celle du siècle précédent. Pourtant, en ce XXIé siècle, il nous faut prendre en compte des paramètres qui n’ont absolument rien à voir avec ceux du XXé siècle. Tant que nous n’en serons pas convaincus, il y aura toujours, d’un côté, ceux dont la vision des choses s’inscrit à plus long terme, et, de l’autre, ceux qui ont une vision à plus court terme. Certes, chacun a sa part de vérité, de sincérité, mais cette différence de posture aboutit à une lecture différente des choses. Pour le dire simplement, il est difficile de chausser simultanément deux paires de lunettes : l’une pour voir de près, l’autre pour voir de loin. Cette formule résume toute la difficulté de l’exercice : comment combiner les impératifs du court terme avec les enjeux du long terme ?
En ce début de XXIe siècle, trois paramètres incontournables, qui vont complexifier l’action publique, doivent être pris en compte. Il faut changer notre regard. En effet, si le temps et le progrès ne suffisent plus pour améliorer les choses, si le monde va de crise en crise – que la crise devient donc un état permanent –, c’est parce que les outils d’hier ne conviennent plus et que nous n’avons pas acté ces paramètres.
Le premier paramètre, parfaitement identifié dans leur rapport par les 700 experts du Forum de Davos, est la contrainte des inégalités. Certes, celles-ci ne datent pas du XXIe siècle, mais elles sont aujourd’hui plus accentuées et, surtout, beaucoup plus visibles. En effet, dans notre monde connecté, chacun est en mesure de prendre conscience des différences de traitement, d’où un élément explosif : l’humiliation face à des inégalités criantes.
Ces inégalités sont accentuées par un deuxième paramètre : la vulnérabilité. Au XXIe siècle, nous découvrons la vulnérabilité de nos écosystèmes, avec comme première conséquence la crise climatique. Celle-ci est, pour moi, le facteur aggravant : elle ajoute de l’injustice à l’injustice, de l’inégalité à l’inégalité, de la souffrance à la souffrance. Elle nous oblige donc à nous orienter vers une nouvelle forme de solidarité : la solidarité dans le temps. Selon les choix que nous ferons, soit nous sacrifierons le futur au présent, soit nous assurerons un avenir plus épanouissant à nos enfants. Or lorsqu’on écoute les hommes et les femmes politiques, lorsqu’on lit les journaux, force est de constater que la crise climatique préoccupe moins que la crise économique.
Pourtant, les différentes publications, et notamment le dernier rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirment ce qu’avait annoncé le premier : que la première manifestation des changements climatiques est l’intensification et la multiplication des extrêmes climatiques. Chacun, en allumant son téléviseur, se rend compte que les changements climatiques, y compris sous nos latitudes, nous affectent déjà socialement, humainement et économiquement. Les rapports de la Banque mondiale eux-mêmes indiquent que la hausse des températures, qui pourrait atteindre six degrés en 2060, doit conduire chaque pays à choisir des modèles différents pour une croissance plus écologique. Je ne suis pas climatologue, je m’efforce simplement de vous restituer de la manière la plus compréhensible possible les prévisions de tous ces experts selon lesquels aucun de nos modèles économiques, aucune démocratie ne pourra faire face aux conséquences des emballements climatiques.
Certes, la diplomatie avance à petit pas, mais ce sujet est le seul pour lequel les phénomènes que l’on essaie de combattre n’avancent pas au même rythme que ces efforts. Chaque année que nous perdons, chaque conférence que nous ajournons, rend de plus en plus difficile l’équation. D’ores et déjà, les changements climatiques jettent des millions de personnes sur les routes, font des centaines, voire des milliers de victimes. Le coût des catastrophes naturelles a été multiplié par quatre à l’échelle de la planète en l’espace de vingt ans. Aux États-Unis, il a représenté 3 milliards de dollars en 1980 : en 2012, l’ouragan Sandy a coûté 60 milliards, la sécheresse dans le Midwest 40 milliards de dollars.
Ce facteur de vulnérabilité, qui est un facteur aggravant, n’a pas été suffisamment pris en compte. Nous sommes trop peu nombreux à le porter. On ne peut pas demander en effet aux ONG d’être à la fois dans l’alerte, la sensibilisation, la mobilisation et, avec le peu de moyens dont elles disposent, dans la solution ! Cette solution n’est pas exclusivement politique, technologique ou économique ; elle s’explique aussi par la défaillance culturelle.
Le troisième paramètre, majeur à mes yeux, est lié aux deux précédents : il s’agit de la rareté. Le XXIe siècle nous a fait basculer brutalement de l’illusion de l’abondance, entretenue jusqu’à plus soif, à une réalité prévisible, celle de la rareté des ressources naturelles. Or la rareté se situe entre l’abondance et une autre étape beaucoup plus tragique : la pénurie. Il demeure donc essentiel de ne pas céder à une forme de fatalisme en se précipitant dans la pénurie.
Les conséquences de la pénurie sont déjà une réalité. Au cours des cinquante dernières années, nombre de conflits ont plus ou moins été provoqués par l’accès aux ressources naturelles. Aujourd’hui, chacun comprend que l’épuisement des ressources halieutiques, le manque d’accès à l’eau potable, les compétitions autour des terres arables, des matières premières sur lesquelles notre économie a été bâtie, ou encore des terres rares, – quasi-monopole chinois –, auront des conséquences géopolitiques gigantesques.
Telle est la réalité de notre monde au XXIe siècle : il doit prendre en charge les conséquences du succès indéniable, mais parfois non maîtrisé, des 150 dernières années. Nous avons changé d’échelle, nous sommes entrés dans l’anthropocène, l’ère de l’Humanité ; grâce au charbon et au gaz, nous avons démultiplié nos capacités musculaires et, avec les ordinateurs, nous sommes capables d’externaliser nos cerveaux – mais aussi de démultiplier l’avidité et la cupidité. En définitive, nous ne sommes plus dans une société où l’on consomme, mais dans une société où l’on consume.
Pardon de vous le dire, mais je me sens un peu seul sur ces sujets. Certes, la tâche est complexe car nous devons changer notre modèle économique, nos comportements, et il nous faut coordonner les volontés. Certes, on peut se gausser de l’action des ONG, du combat des écologistes, et dire que ceux-ci sont contre tout et veulent seulement créer de nouvelles taxes. Mais les choses sont tellement plus compliquées ! Dans ce contexte, il me paraît incompréhensible, alors que la contrainte s’avère si forte, que la créativité demeure aussi faible sur ces sujets. Pourtant, la créativité foisonne partout, y compris dans notre pays ! Elle se heurte cependant malheureusement à un mur de conformisme et de scepticisme. À l’heure où je vous parle, il est certainement possible de s’ouvrir à cette créativité en relançant notre économie grâce à la transition écologique et énergétique, mais encore faut-il y croire, encore faut-il croire qu’un autre modèle est possible.
Sans doute les défenseurs de cette cause ont-ils commis une erreur. Nous avons pensé pouvoir mobiliser sur un constat, mais force est de constater que l’on ne mobilise pas sur un constat, on « tétanise ». À nous de montrer qu’il y a un chemin. Nous n’y parviendrons cependant pas en restant sur nos postures conventionnelles. L’enjeu est universel : c’est l’avenir de l’Humanité qui se joue. Or la fenêtre de tir entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pourrons plus faire se réduit de jour en jour. Le moment de trêve n’est-il pas arrivé, au moins pour partager une vision, un horizon ?
En tout cas, si l’on continue en France, en Europe, dans le monde entier, à sous-traiter ces sujets, je crains que nous n’allions de reddition en reddition. (Applaudissements)
M. Jean-Yves Caullet. Monsieur Hulot, certaines personnes pensent que l’Humanité s’est toujours sortie de ses problèmes par le conflit. Comment évaluez-vous le risque cynique ? Une part de la politique du pire n’est-elle pas en train de se construire dans notre monde ?
S’agissant du rôle des ONG, les principes de la Convention d’Aarhus ont été repris dans la Charte de l’environnement. Un débat public a permis d’introduire les orientations forestières dans la future LAF. Cette mise en commun des compétences n’est-elle pas celle que vous aviez imaginée au début pour faire émerger un constat partagé à destination des décideurs ? L’institutionnalisation de ce travail n’est-elle pas une phase normale de la mobilisation des ONG ? Ces dernières ne doivent-elles pas à présent se situer à un autre niveau, celui d’acteur opérationnel des choix politiques au niveau planétaire, et ne plus s’en tenir simplement à un rôle d’alerte et d’éveil des consciences ?
Nous l’avons constaté à Doha, l’action intergouvernementale n’est pas suffisante. Les parlementaires se mobilisent autour d’initiatives diverses, comme Globe international, mais qui restent peu structurées. Les ONG agissent. Comment faire converger les parlements, les secteurs professionnels – comme les forestiers – et les ONG ? Comment organiser la marche vers un succès collectif dans le cadre de la Conférence Paris Climat 2015 ?
Enfin, vous l’avez dit, la créativité est primordiale. Chaque fois que l’on veut bouger, c’est soit l’aventure, soit le retour en arrière. Quant à l’immobilisme, il n’est porteur d’aucune solution d’avenir. Comment l’objectif de sécurité de notre société peut-il être compatible avec la créativité, la mise en mouvement ? De quelle manière votre ONG peut-elle inciter les acteurs publics et politiques à participer à la créativité, et non pas à l’organisation des choses établies ?
M. Bertrand Pancher. Monsieur Nicolas Hulot, je tiens à saluer votre engagement, ainsi que celui de toutes les ONG en France sans lesquelles ce discours serait inaudible.
La loi sur la transition énergétique devait être soumise au Parlement début 2013, mais elle le sera plutôt début 2015. En période de crise, on a le sentiment que les objectifs ambitieux que le pays s’est assigné, en matière de logement, de transport, d’énergie renouvelable, ne sont plus la priorité de personne. D’où le ras-le-bol de toutes les grandes organisations environnementales nationales. Que faut-il faire pour promouvoir une nouvelle stratégie en période de crise ?
En la matière, nous disposons d’outils de deux ordres, la gouvernance et les moyens de régulation. Après l’échec de Copenhague, avez-vous le sentiment que les choses évoluent sur le plan européen en matière de gouvernance ? Les éléments de régulation sont la fiscalité et la valeur que l’on peut donner au climat et à la nature. La valeur du climat est peut-être la plus simple, avec un prix pour les émissions de carbone. Pour le second élément, comment donner une valeur au capital naturel ?
M. Denis Baupin. Merci, cher Nicolas. Le groupe écologiste a bu votre discours « comme du petit lait » et partage entièrement votre constat. Il ne suffira pas d’attendre le retour de la croissance pour sortir de la crise. La crise économique est aussi une crise écologique. La résolution de la première passe par l’écologie. La preuve en est que les conséquences du dérèglement climatique, chiffrées par le rapport Stern de 2006, sont d’ores et déjà visibles et que la raréfaction des ressources et des matières premières a un impact certain sur le coût de l’énergie.
Il ne suffira pas non plus de s’en tenir à ce constat négatif pour s’en sortir. La transition écologique et énergétique, créatrice d’emplois non délocalisables et génératrice de pouvoir d’achat, est une solution pour résoudre la crise économique. Un bâtiment mieux isolé, des transports collectifs et des véhicules sobres permettront de consommer moins d’énergie. Les réponses à la crise sont donc à la fois économiques, écologiques et sociales.
La COP 2015 sera cruciale, elle sera une sorte de deal planétaire visant à répondre à la fois aux enjeux de développement et au défi climatique. Quel est votre sentiment sur la préparation de cette échéance ? Quelle stratégie faut-il adopter pour que cette conférence sur le climat soit une réussite ?
À l’initiative de Delphine Batho, et pour la première fois dans notre pays, un débat national s’est tenu sur la transition énergétique, auquel votre fondation a activement participé. Nous sommes maintenant dans la phase de préparation de la future loi sur cette transition. Mais notre sentiment est celui d’une perte en ligne entre ce débat très riche et cette loi qui vient d’être reportée et sur laquelle travaille une commission spécialisée du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) auquel participe votre association. Selon vous, quelles priorités doivent être inscrites dans ce projet de loi ?
M. Patrice Carvalho. La Commission européenne a rendu publique le 22 janvier dernier sa proposition de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030. En 2009, dans le cadre du paquet « énergie climat », avait été fixé l’objectif d’une réduction de 20 % d’ici à 2020. La bataille s’annonçait rude puisque le commissaire à l’industrie et le commissaire à l’énergie proposaient de limiter l’effort à 35 % pour 2030. Vous défendiez vous-même, monsieur Hulot, l’objectif de 40 %. C’est ce seuil qui a été retenu. Il correspond aux recommandations des scientifiques du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, afin de contenir la hausse moyenne des températures en deçà de 2 degrés au niveau mondial d’ici à la fin du siècle.
Actuellement, il est estimé que l’Union européenne est responsable de 11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Fixer des objectifs à un bon niveau ne suffit pas, il faut maintenant se poser la question des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Au sommet de Varsovie, j’ai constaté que tous les acteurs n’étaient pas sur la même longueur d’ondes, loin s’en faut. Selon un certain nombre de pays émergents en Europe, les efforts qui leur sont demandés en matière de réduction des gaz à effet de serre contrarient leurs perspectives de développement. En définitive, ils reproduisent le même mode de développement des pays riches à l’ère de la révolution industrielle, sur fond de gaspillages énergétiques considérables, sans aucun souci de préservation de la planète.
Le charbon, première énergie du monde, reste l’énergie la plus polluante. Or lorsqu’elle ferme ses centrales nucléaires, l’Allemagne ouvre des centrales à charbon. Bravo pour l’avancée environnementale ! Sur cette question majeure, vous n’avez pas dit un mot, monsieur Hulot.
La Commission européenne peut sanctionner les États qui ne respectent pas les seuils qui leur sont imposés en matière de dettes et de déficit. Les gouvernements doivent même soumettre préalablement à Bruxelles leurs budgets nationaux pour voir s’ils sont conformes aux normes « austéritaires ». Mais lorsqu’il s’agit de réduire les émissions de GES, aucune contrainte réelle n’est envisagée : il n’y a pas lobby pour cela ou, du moins, ils sont bien moins puissants que ceux de la finance et de l’industrie, capables d’imposer l’austérité généralisée.
Personne n’a encore porté l’exigence d’une austérité environnementale. Je crois pourtant que nous n’atteindrons pas les objectifs fixés si nous n’instaurons pas d’incitations fortes pour des productions et un développement propres.
Finalement, monsieur Hulot, il vous a fallu vingt-cinq ans pour aboutir à la même conclusion que Marx, à savoir qu’une série de crises successives débouche sur une crise durable ! (Sourires)
J’aimerais vraiment connaître votre point de vue sur l’Allemagne. Contrairement à ce que pensent certains, je ne suis pas pour le tout nucléaire – cette énergie aura une fin, comme les autres. Cela dit, la superficie de notre territoire ne nous permettra pas d’installer suffisamment d’éoliennes, pour couvrir nos besoins en électricité. Cette énergie est du reste quasiment inexistante aujourd’hui. En outre, la moitié de notre production hydraulique va s’arrêter à cause de la loi sur l’eau ! (Murmures) Comment allons-nous faire ?
Développer l’écologie, c’est très bien, mais encore faut-il produire ! Il faut préserver l’industrie. L’isolation des habitations implique de fabriquer de la laine de verre, du placoplatre, des parpaings ! En trente ans, les efforts du secteur industriel en matière de mise en conformité ont été considérables : il ne faut pas les nier.
M. Jacques Krabal. Monsieur Hulot, j’ai apprécié votre discours sur la nécessité d’une mobilisation beaucoup plus forte pour sauver la planète. Pour autant, votre discours me semble très pessimiste, car vous n’insistez pas suffisamment sur le lien entre écologie et progrès social – pour la santé, le développement durable, la justice sociale. Pour ma part, je considère que l’écologie ne doit pas être impopulaire, qu’elle ne doit pas créer des peurs, comme c’est le cas aujourd’hui. Je m’attendais donc à un discours beaucoup plus offensif.
J’ai lu votre interview dans le journal Le Monde. Oui, vous avez raison : les élus, les États veulent lutter contre le chômage, ce qui est tout à fait légitime, mais si nous poursuivons dans la voie du développement actuel, nous n’atteindrons pas les résultats escomptés en matière de créations d’emplois et nous subirons les catastrophes que vous annoncez. Vous parlez d’un changement de paradigme : j’aurais aimé vous entendre sur la définition d’un modèle, en particulier sur la transition écologique et énergétique qui constitue un des moyens d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
J’aimerais également vous entendre sur la position de la Commission européenne, sur le nucléaire et les gaz de schiste.
Dans le cadre du débat passionnant et complexe entre économistes sur la méthode à adopter pour inciter au développement des énergies propres et limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous tâtonnons entre carotte et bâton. Que pouvez-vous nous dire au sujet des droits à polluer ? Faut-il chercher à améliorer à court terme le marché des droits à polluer, faut-il taxer les émissions, ou encore maintenir un mix énergétique ?
Dans le cadre de votre think tank, vous introduisez la notion de démocratie écologique, en partant du constat que le système actuel est incapable de prendre en charge les enjeux du long terme et qu’une réforme de nos institutions est incontournable. Permettez-moi de vous faire remarquer que le temps démocratique est celui d’un mandat et que nous autres, responsables politiques, élus, posons des actes qui vont bien au-delà. Pouvez-vous développer davantage votre argument dont la logique ne me paraît pas évidente ?
M. Philippe Plisson. Beaucoup de questions que je souhaitais poser l’ont déjà été, et je ne les reprendrai donc pas. Elles concernaient notamment la conférence internationale de Paris en 2015 et tous les espoirs qu’on place en elle.
Êtes-vous favorable, monsieur Hulot, au lancement d’un Green New Deal européen qui serait créateur d’emplois, ainsi qu’à la création d’une Organisation mondiale de l’environnement qui permettrait une gouvernance équitable et démocratique ?
Vous êtes membre du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) et avez pris part au débat national sur la transition énergétique (DNTE). Votre fondation appelle notre pays à s’engager dans cette voie. Quels éléments souhaiteriez-vous absolument voir figurer dans la future loi ?
C’est votre ouvrage pédagogique Le syndrome du Titanic qui m’a fait prendre conscience de la nécessité de s’engager pour la planète. Ayant beaucoup de respect pour vous et soutenant activement votre combat, je partage votre découragement devant l’inaction des États. Et ce n’est pas ce que j’ai entendu à la conférence de Varsovie en décembre dernier qui a pu me réconforter ! La crise nourrit les sentiments les plus bas de l’humanité, notamment l’égoïsme que traduisent le primat donné au court terme et l’attitude consistant à penser « Après moi, le déluge ! ». Comme vous, nous pensons qu’un autre chemin est possible. Mais là où nous divergeons, c’est sur les moyens de la mobilisation. Je ne vous suivrai pas dans votre appel aux autorités religieuses en ultime recours. Après l’appel que vous avez lancé au Saint-Père, ne nous resterait-il plus, à ce point de découragement et de désespoir, qu’à nous tourner vers Dieu et à revenir à l’hostie hebdomadaire, dont j’ai eu l’occasion, dans mes jeunes années, de mesurer l’efficacité toute relative avant de m’en séparer définitivement à l’adolescence – sans l’aide de Closer… ? (Sourires)
M. Guillaume Chevrollier. Je salue, monsieur Hulot, le combat que vous menez depuis des années auprès des divers gouvernements de notre pays pour la défense de la planète. Des succès ont été enregistrés, dont je veux pour preuve la tenue du Grenelle de l’environnement et les lois qui ont suivi. La France fait certes aujourd’hui figure de bon élève, mais on ne peut qu’être déçu de l’attitude d’autres grands pays. Quelle action mène votre fondation à l’international ? Comment sensibiliser les grandes puissances concernées en Europe, en Asie et outre-Atlantique ? Les Jeux olympiques de Sotchi, tenus pour la compétition olympique la plus polluante de l’histoire, ont déjà occasionné des dommages irrémédiables aux écosystèmes. Nous sommes tous, hélas spectateurs impuissants de ce désastre.
Quelle est par ailleurs votre position sur l’exploitation des gaz de schiste ?
Après votre exposé à la tonalité pessimiste, je souhaiterais terminer par une note plus optimiste. Il n’y a pas de fatalité : il est possible de changer de modèle pour accompagner les mutations qui s’imposent dans de multiples domaines, qu’il s’agisse d’environnement ou d’État-providence par exemple. Écoutons Delacroix qui nous disait que « l’adversité rend aux hommes les vertus que la prospérité leur enlève ».
M. Yannick Favennec. Merci, monsieur Hulot, pour votre brillant exposé, en effet teinté de pessimisme.
Au grand dam des associations de défense de l’environnement et à l’encontre du souhait du Parlement européen qui appelait en 2012 à une interdiction totale de la fracturation hydraulique dans certaines zones, le 22 janvier dernier, la Commission européenne adoptait une recommandation qui laisse la voie libre à l’exploitation du gaz de schiste en Europe, à la seule condition de respecter certains principes communs sanitaires et environnementaux. Refusant d’imposer des normes juridiques contraignantes pour l’exploration et l’exploitation de ce gaz, elle a toutefois prévu une évaluation dans les dix-huit mois à compter de la publication du texte au Journal officiel de l’Union européenne, ne s’interdisant pas d’édicter des règles juridiquement contraignantes si les États ne respectaient pas ses recommandations.
Le gaz de schiste reste très controversé en Europe. Certains pays, comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne et la Roumanie, développent des projets d’exploration. La France et la Bulgarie pour leur part, en ont interdit l’exploitation. L’Allemagne a banni la technique de la fracturation hydraulique dans les zones riches en eau de son territoire. Selon la Commission, une révolution du gaz de schiste semblable à celle qui a eu lieu aux États-Unis est hautement improbable en Europe. Mais elle estime aussi qu’il faut développer toute ressource propre de gaz, conventionnel ou non, susceptible de réduire la dépendance énergétique de l’Union. Quel est votre sentiment sur sa décision ?
Mme Laurence Abeille. Dans votre exposé peut-être pessimiste, j’ai surtout entendu, pour ma part, un appel à la créativité. Les écologistes prônent depuis longtemps une telle écologie des solutions. En effet, si on en restait au scénario, hélas crédible, qui se dessine, on se dirigerait tout droit vers la guerre – le mot n’a certes pas été prononcé, on préfère, pour ne pas effrayer, parler seulement de « conflits ». Mais de fait, des guerres ont d’ores et déjà lieu dans certains pays autour des ressources naturelles comme l’eau et d’autres éléments vitaux.
La résistance au changement la plus forte sur le plan international est-elle aujourd’hui de nature politique ou vient-elle des lobbies de l’industrie ou de la finance ?
Mme Françoise Dubois. Pourrait-on avoir des précisions sur la mise en place d’un guichet unique de la rénovation, souhaitée par votre fondation, et qui devrait permettre d’atteindre l’objectif d’un million de logements rénovés ?
Votre fondation a demandé, on le sait, l’annulation d’un permis d’exploitation aurifère en Guyane. Que pensez-vous de la future réforme du code minier qui ferait incomber aux exploitants la gestion des dégâts de l’après-mine et mettrait en place un fonds national de l’après-mine, chargé de pallier leur défaillance éventuelle et d’indemniser les victimes des dommages ?
M. Jean-Pierre Vigier. La Commission européenne vient de proposer aux États membres de réduire de 40 % leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Le commissaire à l’énergie juge, pour sa part, cet objectif irréaliste pour l’économie européenne et fait valoir que les gros efforts consentis par l’Union européenne pour sauver le climat mondial sont contrecarrés par le reste du monde, notamment les pays émergents. Que faire pour que ceux-ci prennent conscience du danger et engagent enfin des actions pour réduire leurs émissions ?
M. Gabriel Serville. Avec ses quelque huit millions d’hectares, soit environ un tiers de la forêt française, la forêt guyanaise regorge, de par sa faune et sa flore, de ressources à la valeur inestimable, notamment de plantes aromatiques, tinctoriales et médicinales. En dépit des mesures prises pour assurer sa protection et sa valorisation, ce patrimoine national reste menacé par les activités liées à l’orpaillage illégal, dont les conséquences sur les milieux naturels et les hommes ne peuvent même être évaluées. Toute une nature se meurt et les jeunes Amérindiens se suicident en silence, malgré les cris de colère poussés par la population, les ONG, les élus, et même un commandant de la gendarmerie dans le département qui a dénoncé l’inefficacité presque totale de l’opération Harpie, censée pourtant éradiquer le fléau de l’orpaillage illégal. Afin de donner un écho national, voire international, à la situation catastrophique que connaît la forêt guyanaise, pourriez-vous envisager un séjour en Guyane à l’occasion de la première édition de la Journée internationale des forêts en France, qui se déroulera du 14 au 21 mars prochain ? D’avance, je vous en remercierais. Nous sommes prêts à lancer une souscription pour que les ONG puissent prendre en charge le prix de vos billets d’avion.
M. François-Michel Lambert. Nous sommes en effet passés d’une ère d’abondance à une ère de rareté, et sommes même peut-être aujourd’hui à l’aube d’une ère de pénurie. Merci donc, monsieur Hulot, d’alerter sur la situation. Vous connaissez le modèle de transition que je défends pour économiser les ressources, avec l’approche de l’économie dite circulaire. Mais là encore, c’est une approche transversale qui fait défaut. Comment rendre notre gouvernance plus transversale afin de dépasser les cadres préétablis et permettre que s’exprime vraiment la créativité ? Il faudrait notamment que l’économie circulaire acquière plus d’importance et de visibilité, à la fois au ministère de l’écologie, au ministère du redressement productif, au ministère de l’économie et au ministère de l’éducation.
M. Alexis Bachelay. En tant qu’élu local chargé dans ma collectivité des questions de développement durable, j’ai constaté que la créativité se situait plus souvent du côté des territoires et de la société civile que du côté de l’État et des structures inter-gouvernementales, qui donnent plutôt un sentiment d’inertie. Dans notre pays très centralisé, la difficulté est encore plus grande. Quelle serait, selon vous, la bonne gouvernance écologique ? La réponse n’est certainement pas indépendante de la réforme territoriale en cours.
Au cours des travaux d’une mission d’information sur la mise en application de la loi sur le Grand Paris, nous avons été amenés à interroger plusieurs entreprises sur le sort qui serait réservé aux 80 millions de tonnes de déblais issus du creusement du futur métro automatique. À notre grande surprise, les acteurs du secteur du recyclage nous ont expliqué que des possibilités de réutilisation existaient, les technologies étant parfaitement maîtrisées, mais que, du fait des cahiers des charges, les principaux donneurs d’ordre – SNCF, RFF et EDF – donnaient la préférence aux matériaux primaires pour réaliser les remblais de voies routières ou ferrées, alors même que les produits recyclés coûtent 30 % de moins pour des caractéristiques équivalentes. Il y a donc loin des bonnes intentions, de l’affichage politique du greenwashing, à la réalité de la commande publique !
Mme Delphine Batho. Je partage vos constats, monsieur Hulot, et j’aimerais que votre interpellation provoque un sursaut des consciences.
Je n’ai pas la même approche que notre collègue Philippe Plisson concernant la mobilisation des autorités morales et religieuses. La question reste : comment mobiliser la société civile internationale, notamment dans la perspective de la conférence de 2015 ?
Les ONG, qui concourent à la définition de l’intérêt général, sont les principaux acteurs de la démocratie environnementale dans notre pays. Même si je sais que les fonds publics ne sont pas seuls en cause, je ne souhaiterais pas que sous cette législature, les ONG environnementales s’affaiblissent. Que pourrions-nous faire, nous parlementaires, pour éviter cet affaiblissement ?
M. Charles Ange Ginésy. Vous dites vous sentir parfois seul, monsieur Hulot. Imaginez alors quelle peut être la solitude du parlementaire de base !
Grâce à la modélisation mathématique, la climatologie progresse beaucoup aujourd’hui, comme l’a fait avant elle la météorologie. Mais quel est le degré de fiabilité des prévisions d’experts comme ceux du GIEC ? Je m’interroge sur la pertinence des projections à cinq, dix ou quinze ans.
Comme vous, je crois à la créativité des individus pour trouver des solutions. Les ordinateurs, avez-vous dit, nous ont permis « d’externaliser nos cerveaux ». La découverte de l’imprimerie a permis de stocker une mémoire considérable dans les dictionnaires et les encyclopédies, ce qui a permis à l’homme d’imaginer de nouvelles solutions. Pensez-vous que la révolution numérique nous permettra d’inventer de nouvelles voies en matière d’écologie ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. À toutes ces questions, je n’en ajouterai que deux. La réussite de la conférence de Paris en 2015 ne passera-t-elle pas par l’institution d’une taxe sur les transactions financières au niveau européen, dont une partie du produit pourrait alimenter le Fonds vert, créé au profit des pays en développement ?
Aujourd’hui strictement diplomatique, la gouvernance des sommets internationaux consacrés au climat ne devrait-elle pas à l’avenir associer des territoires, des agglomérations, voire de grandes entreprises qui se mobilisent dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
M. Nicolas Hulot. Si j’étais vraiment pessimiste, comme plusieurs d’entre vous semblent le penser, je consacrerais moins d’énergie à mon engagement. L’optimisme et le pessimisme sont les deux faces d’une même médaille, qui a nom la capitulation. Que l’on soit optimiste et que l’on pense que tout finira par s’arranger, ou que l’on soit pessimiste et que l’on considère que tout est perdu, dans les deux cas, on s’en remet au destin. Même si chaque jour peut être grande la tentation de se résigner, il faut au contraire se garder de tout fatalisme. Au vu du temps qui a été nécessaire à la prise de conscience, préalable à toute action, et de la vitesse à laquelle on est ensuite passé de l’indifférence à une forme d’impuissance, on peut certes douter du moment où s’engagera vraiment la mutation. Mais d’un pessimisme de la raison, il faut passer à un optimisme de la volonté.
L’enjeu écologique et l’enjeu social sont intimement liés. Partout, les premières victimes de la crise écologique sont les plus démunis, et ces victimes se comptent déjà par centaines de milliers. Dans certains pays du Sud, les souffrances sont déjà quotidiennes. Si nous ne concluons pas aujourd’hui de pacte de responsabilité planétaire, ce sont tous nos enfants qui souffriront demain. Il en va rien moins que de l’avenir de l’humanité. Du temps du commandant Cousteau déjà, on évoquait le sort des générations futures, mais on pouvait croire alors qu’on visait le XXIIe siècle. Or, c’est aujourd’hui, en ce XXIe siècle, que tout va se décider. Il y a de quoi être inquiet car il est extrêmement difficile de tenir compte à la fois du court terme et du long terme. Selon les lunettes que l’on chausse, ce ne sont pas les mêmes décisions qui semblent s’imposer. Si l’on regarde à court terme, on encouragera par exemple sans réserve l’exploitation des gaz de schiste, alors que si on porte le regard plus loin, d’autres arguments prévaudront. C’est la combinaison de ces deux horizons qui rend l’équation du développement durable si difficile à résoudre. Il n’existe pas de solution simple. Il n’y a que des problèmes complexes, appelant des solutions complexes.
À un tel carrefour, on ne pourra s’accommoder plus longtemps des postures et des clivages traditionnels. Rassemblons-nous pour être les plus créatifs possible : il n’y a pas d’alternative. Mais ce n’est pas dans l’épaisseur du trait que pourront s’opérer les changements nécessaires. C’est de cap qu’il faut changer. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous engager à fond dans la transition écologique, porteuse d’ailleurs d’un modèle économique grâce auquel on peut espérer réindustrialiser une partie de la France et de l’Europe. Il n’est pas possible d’attendre et de laisser faire en pensant que notre modèle économique pourrait continuer de prospérer. La Banque mondiale elle-même, que l’on ne peut soupçonner de parti pris – les experts du GIEC sont parfois plus contestés, alors qu’eux non plus n’ont aucun parti pris – explique fort bien que la crise écologique, et tout d’abord la crise climatique, aura un coût économique considérable.
Soyons volontaristes, faisons preuve d’imagination et acceptons de changer de modèle. La phase de transition est difficile car il faut investir, alors même qu’il existe une grande part d’inconnu sur le futur. Mais la seule chose certaine, en revanche, est que, sur la trajectoire actuelle, il ne saurait y avoir de dénouement heureux pour quiconque.
Notre rôle, le mien comme le vôtre, n’est pas facile. Il nous faut à la fois montrer que le chemin actuel mène à une impasse mais aussi, et c’est là qu’il nous faut probablement faire preuve de plus de pédagogie, montrer qu’il en existe un autre, praticable, et même séduisant, et que les enjeux économiques, sociaux et écologiques ne sont pas incompatibles. La préoccupation sociale et la préoccupation écologique sont au contraire intimement liées. Il suffit pour s’en convaincre de songer aux centaines de milliers de foyers confrontés dans notre pays à la précarité énergétique.
Est-ce que j’en appelle à Dieu car seul un miracle pourrait maintenant nous sauver ? Même si la conférence de Copenhague n’a pas été un échec total, force est de constater qu’elle n’a pas permis de placer la communauté internationale sur la trajectoire que recommandent les scientifiques et les experts. En 2015, lors de la conférence de Paris, l’humanité aura donc rendez-vous avec elle-même. On ne peut se permettre un nouvel échec, qui mènerait sur une voie irréversible. Ce rendez-vous est donc crucial. Le rôle de la France, qui ne fait qu’accueillir cette conférence des parties, est limité. Nous pouvons créer un cadre apaisé, et déjà, avec l’Union européenne, nous montrer exemplaires, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Nous pouvons surtout dialoguer et écouter les points de vue de chacun.
Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée par le Président de la République, j’ai rencontré l’an passé de nombreux responsables politiques internationaux. Chaque pays, à sa manière, développe d’excellents arguments pour ne pas agir tout de suite, mais plus tard, se dédouaner de sa responsabilité, ou encore ne vouloir s’engager que lorsque tel autre pays aura fait de même. Sur cette pente, on va vers un blocage des négociations en 2015. Si l’on pense vraiment que l’enjeu est crucial, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir. Quelqu’un s’est étonné l’autre jour auprès de moi que j’aie rencontré le pape pour parler d’environnement, comme si cela était déplacé. Mais est-ce déplacé quand la pollution atmosphérique tue déjà sept millions de personnes par an ?
Parce que nous sommes à un carrefour de civilisation et parce que demeurera toujours la question fondamentale du sens, oui, à côté des réponses politiques, technologiques, économiques qui pourront être apportées, il est bon que les Églises et les intellectuels s’engagent. Vous évoquiez le progrès et la révolution numérique. Nous aurons besoin de tout le génie humain. Mais encore faut-il donner un horizon et dire où faire porter l’effort. On ne peut continuer de se disperser sur tous les fronts. Il faudra, à un moment, fixer les priorités pour orienter l’effort de recherche et les investissements. Pour moi, la priorité absolue doit être accordée à la transition écologique, et tout l’effort porter là-dessus.
Je me suis rendu au Vatican car je pense que les autorités religieuses doivent mettre les responsables politiques devant leurs responsabilités. L’Histoire retiendra celles et ceux qui auront tenté de débloquer le processus pour l’échéance de 2015 et pointera du doigt celles et ceux qui auraient laissé le monde entier basculer dans l’irréversible.
Il faut jouer à la fois sur les deux registres de l’inquiétude et de la créativité.
Les ONG, les hommes et les femmes politiques, qu’ils soient élus sur le plan national ou sur le plan local, où en effet le changement est parfois en marche de manière plus probante, sont-ils capables de se retrouver sur ces sujets-là ? Il peut exister des divergences sur les modalités de la transition énergétique par exemple, mais cela doit-il occulter tous les autres points sur lesquels nous pouvons être d’accord ?
Avant d’en venir aux outils, je voudrais insister sur un préalable, que j’avais déjà évoqué dans Pour un pacte écologique : je ne suis pas certain qu’il existe des solutions de droite ou des solutions de gauche pour répondre à des problèmes comme ceux que nous évoquons ici. Dès lors qu’il s’agit de l’avenir de nos enfants, le préalable me paraît être de dépasser la petite politique politicienne.
Pour le reste, ne me demandez pas de décrire ici une boîte à outils que je ne possède pas. Je n’en ai d’ailleurs pas les compétences. Ma fondation a son propre think tank et travaille sur divers outils, non encore finalisés.
Pour s’engager résolument dans la transition énergétique et écologique, orienter les filières de production, les comportements de consommation, et tout le modèle économique dans le bon sens, plusieurs changements sont nécessaires.
Le premier d’entre eux est ce que j’appellerai le basculement des régulations. Le dénominateur commun de toutes les crises actuelles – crise financière, crise économique, crise écologique, crise du capitalisme, lequel est bien en crise de par ses excès – est notre incapacité à nous fixer des limites. Or, la finitude même de la planète nous impose des limites. Point n’est besoin d’être Prix Nobel pour comprendre qu’une croissance infinie n’est pas possible dans un monde fini. Ne vous méprenez pas, je ne défends pas ici la décroissance. Les écologistes ne sont pas « contre tout ». Ils souhaiteraient même que certaines choses se développent très vite, mais pensent en revanche que d’autres devront être régulées pour des raisons sociales ou écologiques, et qu’il va nous falloir changer certains comportements afin de ne pas subir violemment la pénurie. Hélas, ce sujet central de la régulation n’est pas aujourd’hui abordé de manière cohérente. Ainsi, d’un côté se tiennent des assises de la fiscalité, tandis que de l’autre, travaille un comité pour la fiscalité écologique. Ces deux instances croiseront-elles leurs réflexions ?
Le principe en matière fiscale devrait être de taxer ce qui est négatif et de favoriser ce qui est positif. C’est pourquoi il faudrait réfléchir en un même mouvement sur la fiscalité en général et sur la fiscalité écologique en particulier. Tant que l’on donnera, à tort ou à raison, le sentiment que cette dernière est une fiscalité additionnelle, elle ne pourra qu’être rejetée. Lorsqu’on sera parvenu à faire comprendre que la fiscalité écologique, pour la plupart des acteurs économiques et des particuliers, n’entraînera pas de hausse de la pression fiscale, qu’elle ne vise qu’à inciter à des comportements vertueux afin de limiter la pollution et d’économiser l’énergie, les matières premières et les ressources naturelles, et que tous peuvent en attendre des gains de pouvoir d’achat, on pourra y réfléchir de manière rationnelle. Certains pays scandinaves se sont engagés sur cette voie de la vertu écologique et ont mis en œuvre de profondes réformes fiscales, sans que leur compétitivité économique n’en soit affectée.
Le débat sur la transition énergétique en France a été un très bel exemple de dialogue et de concertation, de processus démocratique associant experts, ONG, scientifiques, collectivités, organisations syndicales… Mais après ce foisonnement, il y a, hélas, eu beaucoup de perte en ligne – c’est notamment vrai de la conférence environnementale. On a pu avoir le sentiment, une fois les débats achevés, que des discussions se poursuivaient dans l’ombre.
La transition énergétique, élément clé pour le futur, doit privilégier deux priorités, sur lesquelles chacun s’accorde mais qui vont se heurter au problème du financement. Quel que soit le modèle énergétique retenu, l’efficacité énergétique est la priorité des priorités. L’énergie est devenue le premier facteur de compétitivité. Aussi toute énergie qu’on pourra ne pas consommer, à service et confort égal, est-elle bienvenue. Nos entreprises savent parfaitement faire en ce domaine, pourvu que les règles soient clairement fixées. Plusieurs d’entre elles, françaises et européennes, ont, il y a peu, interpellé la Commission européenne pour que soient durcies les normes d’écoconception. Elles avaient elles-mêmes calculé que des économies se chiffrant en milliards d’euros pourraient en résulter, à leur profit mais aussi au profit des consommateurs, que cela pourrait permettre de créer un million d’emplois et d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 500 millions de tonnes de gaz à effet de serre. C’est ce cercle vertueux qu’il faut enclencher.
La deuxième priorité est celle des énergies renouvelables. Certains peuvent encore être tentés de les opposer, de manière caricaturale, à l’énergie nucléaire par exemple, en expliquant que ce n’est pas celles-là qui remplaceront celle-ci. Mais elles n’en sont qu’au début de leur développement. La situation sera différente lorsqu’elles feront vraiment partie du bouquet énergétique, d’autant que les évolutions vont être beaucoup plus rapides qu’on ne le pense en matière d’efficacité énergétique. Comme je l’ai constaté à l’occasion de deux voyages récents en Chine et aux États-Unis, ces deux pays ont parfaitement intégré qu’une grande partie de la solution passait par les énergies renouvelables. Parmi ces énergies, il y a bien sûr l’éolien, le solaire, la biomasse, notamment la filière bois sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, la géothermie, mais aussi les énergies marines – il en existe plusieurs sources, qui toutes présentent l’avantage de n’être pas intermittentes. Dans ce domaine, la France possède un énorme potentiel. Mais là encore, du retard a été pris, et du temps va s’écouler entre les expérimentations et le développement des solutions sur le plan industriel. Il faut progresser sur la question du stockage de l’énergie produite de façon intermittente. Certains pays avancent d’ailleurs à grands pas dans ce domaine. Une fois cette difficulté maîtrisée, la vision du potentiel des énergies renouvelables sera toute autre.
La mise en œuvre de ces deux priorités est bien sûr conditionnée par les financements. Je vous invite à prendre connaissance des propositions de notre fondation, qui a travaillé sur les enjeux du financement à long terme. J’espère notamment que la Banque publique d’investissement (Bpi) fléchera en priorité ses crédits vers ces enjeux-là. J’aurais souhaité que, dans le futur pacte de responsabilité, certaines aides soient subordonnées à certains investissements ou orientations, bref que l’on dope l’activité économique en France dans le sens que l’on souhaite.
Un mot sur les gaz de schiste. On essaie de nous culpabiliser en nous expliquant que ce sera de notre faute si notre pays rate le train de l’innovation et s’enfonce dans le déclin économique. Je n’ignore pas qu’en peu de temps, les États-Unis sont parvenus à améliorer le solde de leur balance commerciale grâce aux gaz de schiste. S’il était démontré de manière certaine que l’exploitation de ces gaz n’avait pas d’impact sur l’environnement, ni en surface ni en sous-sol, il ne faudrait pas être dogmatique. Mais outre que cette démonstration n’a pas été apportée pour l’instant, la France ne peut faire abstraction de ses engagements en matière climatique. Il faut savoir aussi qu’avec des techniques plus respectueuses de l’environnement, les coûts ne seraient pas de l’ordre de ceux constatés au Canada ou aux États-Unis. La rentabilité économique de cette exploitation mériterait donc d’être évaluée. Enfin, les sommes qu’on y consacrerait seraient autant d’argent capté au détriment des deux priorités que j’évoquais plus haut.
Quelles que soient nos positions sur le nucléaire, chacun sait que notre pays ne pourra pas en sortir demain et que, même si nous devons réduire notre parc, celui-ci doit nous permettre d’assurer la transition énergétique sans avoir recours aux énergies fossiles non conventionnelles.
Pour ce qui est de l’Allemagne, tous les rapports montrent qu’elle tient encore ses objectifs en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En dépit d’un recours accru aux énergies fossiles, le pays reste sur la trajectoire qu’il s’est fixée.
M. Denis Baupin. On n’utilise pas davantage d’énergies fossiles en Allemagne. Le gaz est seulement remplacé par le charbon.
M. Nicolas Hulot. L’Allemagne a fait le double pari d’aller vers l’autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables et de ne pas accroître ses émissions de gaz à effet de serre. Dans la période de transition, certains choix sont inévitables. Il n’existe pas de solution parfaite. L’Allemagne a choisi celle-là.
Imaginons que l’Union européenne ou la France parviennent à l’indépendance énergétique grâce aux énergies renouvelables, rêve qui n’est d’ailleurs pas inaccessible. Les conséquences en seraient considérables à tous points de vue : notre balance commerciale serait équilibrée, la donne géopolitique serait également profondément modifiée car nous sommes aujourd’hui dépendants, y compris pour le nucléaire, de certaines routes et notre approvisionnement est loin d’être parfaitement sécurisé.
Lorsqu’on saura tirer tout le parti possible des énergies renouvelables et qu’on aura amélioré l’efficacité énergétique, il est même envisageable de retrouver une certaine forme d’abondance énergétique. Il existe dans le secteur du bâtiment des gisements considérables d’économies d’énergie, à service et confort égal. Il faut donc s’engager à fond dans cette voie en fixant un cap et en sachant être pragmatique s’agissant du calendrier et des moyens.
La Commission européenne va proposer au Conseil que l’Union réduise de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. C’était un minimum, nous aurions souhaité davantage. Certains se demandent à quoi cela sert si l’Europe agit seule et estiment que celle-ci, plutôt exemplaire, n’a pas été payée en retour de ses efforts. Je reconnais que lorsque je rentre de Chine ou d’Inde, je suis moi-même plus indulgent à l’égard de l’Union européenne. Mais à attendre que tous se comportent parfaitement, le risque est de ne rien faire ! Sachant que, plus la contrainte sera forte, plus la créativité sera grande, n’avons-nous pas intérêt à laisser ce qui deviendra incontournable susciter une offre, à laquelle nous serons capables de répondre ? Il faut consentir le plus d’efforts possible dans le bâtiment, les transports, l’énergie, l’agriculture – la Cour des comptes a rappelé que l’on ne sollicitait pas assez les secteurs du transport et de l’agriculture pour tenir nos engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. S’il a fallu cesser d’encourager le développement de la filière solaire, c’est que nous étions inondés de panneaux photovoltaïques chinois, mais si cela s’est passé ainsi, c’est aussi que nous n’étions pas prêts.
On constate, hélas, actuellement en Europe un certain relâchement, sous la pression de quelques pays. Les Polonais commencent de déchanter s’agissant du gaz de schiste, s’apercevant que la rentabilité économique n’est pas aussi mirobolante qu’on le leur avait annoncé. Pour moi, le gaz de schiste n’est pas une option en France, et d’ailleurs elle n’est pas, que je sache, envisagée. J’espère que la future loi sur la transition énergétique affichera une ambition, assortie des moyens nécessaires pour l’atteindre.
Tant que quelques-uns – cela vaut à l’échelle mondiale comme à celle de notre pays – continueront d’être considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, tout simplement parce que le constat n’est pas partagé, on restera dans une position stérile de confrontation, laquelle constituera une entrave à la mutation, à ce qu’Edgar Morin appelle « la métamorphose ». Quelle que soit la qualité d’un ministre de l’environnement, quand il est isolé dans son propre gouvernement, sa marge de manœuvre est réduite. Quand l’écologie à l'Assemblée nationale n’est représentée que par un groupe à l’effectif réduit, il est difficile de progresser...
J’en appelle à chacun pour faire preuve d’imagination et surtout ne pas être réticent à juger pertinente une proposition qui l’est, même si elle émane d’un autre camp que du sien. J’enfonce là des portes ouvertes, me direz-vous. Mais je suis si souvent triste devant tant de gâchis d’intelligence à cause de telles postures. Ainsi aux États-Unis, le marqueur politique du parti républicain est de s’opposer à tout engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, alors que lorsqu’on les rencontre en privé, des sénateurs républicains reconnaissent que leur pays se trompe lourdement en ne s’engageant pas davantage. Ils prennent conscience que les événements climatiques extrêmes commencent d’affecter l’économie américaine et qu’un modèle économique nouveau peut se mettre en place, susceptible de « rapporter gros ». Dans le même temps, les militaires démontrent que la menace climatique pèse autant que la menace terroriste sur la sécurité intérieure américaine. Ces marqueurs, qui cristallisent les clivages et empêchent la mutualisation, sont profondément dommageables. On ne réussira pas si chacun reste dans son coin. Les ONG n’ont pas la possibilité de relever tous les défis, elles ont aussi leurs angles morts et, de toute façon, elles n’ont pas toujours les moyens de mener à bien les projets.
Il faudrait multiplier les occasions de dialogue, comme celui que nous avons aujourd’hui, en sachant dépasser les clivages politiques, ce qui n’empêche pas ensuite chacun, le moment venu, d’exprimer ses différences. Voilà vingt-cinq ans que je dialogue avec des hommes et des femmes, de droite et de gauche. En privé, chacun dit partager le combat que je mène. En public, plus grand monde ne l’assume.
M. Philippe Plisson. En public, il ne reste que les hommes de gauche (Rires).
M. Nicolas Hulot. Pourquoi ? Si l’on est convaincu de l’importance des enjeux, peut-être pourrait-on faire l’effort de laisser les armes au vestiaire le temps de la réflexion et des propositions.
S’agissant de gouvernance, notre fondation considère que les instances actuelles sont inadaptées aux enjeux universels du long terme. L’échec récurrent des grandes conférences internationales sur le climat en est la preuve. Les délégations se rendent à ces sommets dans le même état d’esprit que pour des négociations multilatérales traditionnelles, chacune représentant les intérêts de son pays et se dédouanant du maximum de responsabilités en amont et en aval, sans tenir compte du fait que, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous sommes confrontés à des enjeux universels. À l’issue de la conférence de Paris en 2015, ou tout le monde aura gagné ou tout le monde aura perdu. Plutôt que de s’en remettre à de tels sommets pour la coordination et la régulation, il serait bien sûr plus efficace qu’une Organisation mondiale de l’environnement édicte des règles communes. Si le projet a été envisagé à un moment, il ne figurait pas dans les résolutions du sommet Rio+20 et n’est donc plus, hélas, à l’ordre du jour.
J’en reviens à la France. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, il est difficile, notamment pour l’exécutif, de tenir compte à la fois des deux horizons des court et long termes. D’autant que pour les enjeux de court terme, chaque intérêt particulier n’hésite pas à se manifester, parfois de manière vive, grâce à la multitude de canaux d’expression, alors que les enjeux de moyen et long terme exigent au contraire de prendre le temps d’une réflexion apaisée et documentée. Ne faudrait-il pas à un moment scinder les deux degrés de réflexion, pour les recombiner plus tard, de façon que le long terme soit mieux pris en considération ? Dominique Bourg, vice-président de notre fondation, a développé toute une réflexion sur ce sujet.
D’excellents travaux, comme ceux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ou du Conseil économique, social et environnemental, ne sont pas suffisamment mis à profit. Depuis combien de temps traîne dans les tiroirs le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité, qui contient pourtant nombre de propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre immédiatement ?
Quels sont les principaux verrous au changement ? Allons-nous assister en spectateurs, avertis mais impuissants, à la marche vers une catastrophe globale ? Pourquoi a-t-on si peu progressé en vingt-cinq ans ? À cela, je vois une cause culturelle tout d’abord : on a encore tendance à considérer, en France et ailleurs, que le progrès est irréversible, que la crise n’est que passagère et que, le temps étant notre meilleur allié, il suffit de courber l’échine et que la situation va s’arranger. Demeure aussi profondément ancrée une vision scientiste et positiviste, selon laquelle la science aurait réponse à tout : le génie humain pourrait réussir à régler de nouveau la machinerie climatique, à remplacer les écosystèmes détruits, à réparer les dommages causés par la disparition de certaines espèces… et saura, pourquoi pas, utiliser les ressources d’une deuxième planète pour satisfaire toutes nos convoitises. Il existe aussi, certes de manière marginale, un certain scepticisme quant à ces enjeux universels et à la part anthropique des changements climatiques. Mais même l’académie des sciences du Saint-Siège ne met pas en doute la responsabilité de l’homme dans ces changements.
À ces blocages culturels, s’ajoutent des verrous économiques. En effet, la transition écologique exige d’investir : pour la seule transition énergétique, les investissements se chiffrent en France en dizaines de milliards d’euros. Et une transition plus profonde aurait des coûts encore plus élevés. Si on ne réfléchit pas parallèlement sur des financements innovants ou de nouvelles modalités de financement, notamment à l’idée de solliciter un pan entier de l’économie qui aujourd’hui ne participe ni aux investissements ni à la solidarité, si on tergiverse encore pour instituer une taxe sur les transactions financières, pourtant indolore alors qu’elle donnerait de l’air à nos États, on butera toujours sur la question des moyens. C’est pourquoi il faut non seulement être convaincu qu’il s’agit de sujets majeurs mais aussi en avoir une approche holistique. À défaut, s’opposeront toujours d’un côté, un Arnaud Montebourg, défendant sa logique, et d’un autre côté un Philippe Martin ou une Delphine Batho, défendant la leur. Et ce sont de telles postures, tenues coûte que coûte, qui nous mènent de redditions en redditions.
Vous avez évoqué la Guyane et le sort des peuples indigènes. Vous savez que j’ai ardemment plaidé pour que le grand chef indien Raoni soit reçu à l’Élysée, et ce contre l’avis de beaucoup qui craignaient de froisser le Brésil. Je m’intéresse de près à ce qui se passe sur l’ensemble du continent américain, notamment au Pérou ou au Brésil, où de multiples exactions ont encore eu lieu récemment. Ce que l’on fait subir aux Indiens est une infamie : après les avoir tués une première fois lors de ce qui a bien été un génocide, puis une deuxième fois en taisant ce génocide dans l’histoire, on les tue aujourd’hui une troisième fois en niant totalement leurs intérêts. Ce sujet me tient à cœur, mais je dois reconnaître que je me sens un peu seul. J’ai eu beaucoup de mal à faire recevoir le chef Raoni dans certaines enceintes et encore davantage par les médias, que le sort des Indiens d’Amérique n’émeut visiblement pas. Pour ce qui est de votre invitation à me rendre en Guyane, monsieur Gabriel Serville, je vous en remercie mais dois préalablement vérifier certaines dates sur mon agenda.
Un mot de la Chine, où je me suis rendu récemment. Je n’y étais pas retourné depuis vingt-cinq ans et n’ai bien sûr pas retrouvé le même pays. De pays horizontal, la Chine est devenue un pays vertical. J’ai eu l’impression de me retrouver dans une imprimante 3 D géante, où tout serait démultiplié. Ce qui m’a frappé est que la Chine a depuis peu intégré dans son logiciel de développement l’enjeu climatique à cause de la pollution qui sévit dans le pays. Jusqu’à présent, Pékin ne se rendait qu’à reculons, et sous la pression internationale, aux conférences sur le climat. Aujourd’hui, lors de tous les plenums du parti, on entend parler de « civilisation écologique », et ces mots y sont associés à des objectifs et des stratégies, notamment d’économie circulaire. La pollution est devenue un problème intérieur majeur, qui a une incidence économique. Peu de temps avant mon arrivée à Shanghai, les écoles, la circulation automobile et le trafic aérien avaient été fermés durant une semaine tant la visibilité était réduite à cause de la pollution de l’air. Les autorités chinoises redoutent aussi des mouvements de masse importants à cause de ces phénomènes. Les outils qu’elles mettent en place pour lutter contre la pollution sont les mêmes que ceux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On peut donc nourrir un certain optimisme, d’autant que lorsque la Chine s’assigne un objectif, elle sait décliner les moyens nécessaires pour l’atteindre.
En Chine comme aux États-Unis, le contexte a donc changé, laissant espérer que d’ici à 2015, des initiatives seront prises. Les deux pays attendront sans doute la réunion que doit organiser le secrétaire général des Nations unies ou, en tout cas, la conférence de Lima en décembre 2014 pour s’avancer davantage et énoncer des objectifs.
L’objectif de la conférence de Paris en 2015 serait de parvenir à un accord applicable à tous les pays, juridiquement contraignant et assez ambitieux pour permettre de contenir le réchauffement à 2°C. Ce ne sera pas facile. En effet, les États-Unis n’étaient a priori pas prêts à s’engager, au motif que le Congrès ne ratifierait jamais un tel accord, et jusqu’à présent, la Chine considérait qu’elle devait préalablement achever son développement. Et aucun des deux pays n’était de toute façon disposé à agir si l’autre ne faisait pas de même.
Cela étant, je pense que la situation va évoluer. Je ne peux imaginer que l’administration Obama prenne la responsabilité d’un échec à la conférence de Paris. L’Histoire retiendra ce que les États-Unis auront fait ou n’auront pas fait lors de ce rendez-vous. Plusieurs signes montrent que le président Barack Obama pourrait prendre des initiatives ne requérant pas l’aval du Congrès. Il y a eu des précédents avec le Clean Air Act. Je m’en suis entretenu avec Al Gore, lors de notre rencontre. N’oublions pas non plus l’effort du pays en matière d’énergies renouvelables. J’ai visité dans le Colorado la plus grande agence de recherche au monde sur ces énergies, qui accueille quelque quatre mille chercheurs, de toutes nationalités. Ces chercheurs ont une foi absolue dans la capacité des énergies renouvelables à répondre aux besoins énergétiques de la planète. La courbe d’efficacité de ces énergies, c’est-à-dire le ratio énergie captée/énergie restituée, s’améliore très vite, tandis que la courbe de leur coût, elle, diminue tout aussi vite. Les États-Unis ont bien perçu qu’il y avait là une opportunité économique. C’en est fini de la caricature consistant à penser que trois éoliennes pourraient remplacer une centrale nucléaire ! La Chine aussi développe ces énergies à une rapidité incroyable. Elle construit certes aussi des centrales au charbon et des centrales nucléaires, mais elle va beaucoup plus vite dans le domaine des énergies renouvelables que dans celui du nucléaire.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci beaucoup, Nicolas Hulot, d’avoir accepté notre invitation. Notre échange a été particulièrement fructueux.
13. Table ronde sur l’impact des changements climatiques en France (12 février 2014)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de créer une mission d’information sur les conséquences géographiques, économiques et sociales des changements climatiques en France et sur la préparation de la 21e Conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui se tiendra en 2015 au Bourget. Cette mission d’information est présidée par M. Martial Saddier et Mme Sophie Errante en est la rapporteure.
La présente table ronde est la troisième que nous organisons sur ce thème. La première, qui s’est tenue le 27 novembre 2013, a permis d’évoquer le 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La seconde, organisée le 23 janvier dernier, sur l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires et les paysages, a réuni certains des co-auteurs de l’ouvrage Paysages de l’après-pétrole.
Nous souhaitons étudier de manière plus concrète les impacts des changements climatiques sur notre pays et nous accueillons à ce titre :
- M. Jean-Michel Soubeyroux, ingénieur à la direction de la climatologie à Météo-France ;
- M. Guy Landmann, directeur-adjoint du GIP Ecofor ;
- M. Jean-François Soussana, directeur scientifique Environnement à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
- M. Frédéric Berger, responsable de l’équipe « dynamiques et fonction de protection des écosystèmes forestiers de montagnes » à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) ;
- M. Éric Chaumillon, enseignant chercheur à l’Université de La Rochelle, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche « Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs) » CNRS/Université de La Rochelle.
Chacun interviendra sur un thème particulier. Nous nous intéresserons d’abord à l’impact du changement climatique sur les trois ressources cruciales que sont l’eau, la biodiversité et les sols. M. Soubeyroux traitera des ressources en eau des sols, M. Landmann de la biodiversité et de la forêt, et M. Soussana de l’agriculture.
Les deux derniers intervenants, MM. Berger et Chaumillon, consacreront quant à eux leur propos à deux zones de notre territoire particulièrement fragiles : les espaces de montagne pour le premier et les espaces littoraux pour le second.
Je vous indique enfin qu’une table ronde consacrée aux stratégies de lutte et d’adaptation aux différents impacts du changement climatique sera organisée en avril, à la reprise de nos travaux. Je vous rappelle à ce propos que la France dispose d’un plan d’adaptation aux conséquences du réchauffement climatique.
M. Jean-Michel Soubeyroux, ingénieur à la direction de la climatologie à Météo-France. Dans un mois, le GIEC publiera le deuxième volet de son 5e rapport sur les impacts du changement climatique. Il y a fort à parier que la question de l’eau y sera centrale. Il en était d’ailleurs déjà ainsi dans le rapport de 2007 qui prévoyait la hausse probable des risques de crues et de sécheresse en Europe, l’augmentation du pourcentage de populations vivant dans des bassins soumis à un stress hydrique, l’augmentation des inégalités entre les régions pour ce qui est de la ressource en eau, ainsi que des difficultés prévisibles d’adaptation de nombreux écosystèmes et activités.
Depuis 2007, de nombreuses études sur l’impact du changement climatique sur la ressource en eau ont été menées en métropole mais, dans le temps dont je dispose, je me bornerai à faire état des travaux menés à Météo-France, en particulier de ceux relatifs au suivi hydrologique conduits dans le cadre de la commission ad hoc du Comité national de l’eau, ainsi que des études d’impact effectuées en collaboration avec d’autres organismes, comme le projet ClimSec.
Parmi les différents paramètres à considérer, les évolutions des précipitations ne sont pas très significatives en France, même si nous notons une diminution pendant la période estivale. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas essentielles pour la compréhension des évolutions de la ressource en eau.
Concernant les débits des cours d’eau, les tendances sont difficiles à établir du fait des fortes influences anthropiques qu’ils subissent, sous forme de retenues comme de prélèvements. Toutefois, un consensus se fait jour au sein de la communauté scientifique pour reconnaître quelques évolutions comme une légère élévation des étiages hivernaux dans les Alpes, l’avancée du pic de fonte au printemps, l’augmentation des débits estivaux des cours d’eau alimentés par cette même fonte glaciaire, la baisse, en revanche, des débits estivaux dans le sud-ouest du pays, notamment pour les cours d’eau venant des Pyrénées, et peut-être une légère tendance à la hausse des débits de crue dans le nord-est.
Dans le cadre du projet ClimSec, nous nous sommes intéressés à la teneur en eau des sols, qui était jusqu’alors difficilement mesurable. Nous avons pour cela utilisé des modélisations physiques du bilan hydrique et valorisé des travaux de recherche réalisés dans le cadre du suivi hydrologique.
L’histogramme que vous voyez apparaître sur l’écran est un indicateur de la sécheresse des sols, accessible sur le site de l’Observatoire national des effets du réchauffement climatique (ONERC) et qui présente la surface de la France affectée annuellement par la sécheresse sur la période 1959-2012. On y retrouve les grandes années de sécheresse : 1976, 1989, 1990, 2003, 2005 et 2011. Vous pouvez constater la hausse progressive des surfaces touchées par le phénomène, marquée par une hausse de la moyenne glissante, et vous observerez que, sur les dix dernières années, neuf ont enregistré des sécheresses supérieures à la moyenne constatée entre les années 1961 et 1990.
Ce n’est pas l’évolution des précipitations, mais la hausse des températures qui a un effet sur le bilan hydrique, la « demande évaporative » étant satisfaite en fonction de la teneur en eau des sols. L’évaporation réelle augmente principalement au printemps mais, le reste de l’année, les sols tendent à devenir plus secs qu’auparavant.
Qu’indiquent les projections climatiques ? La référence pour ce qui est de l’évolution des débits est le projet Explore 2070, piloté par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et auquel Météo-France a participé ainsi que quelques autres laboratoires – ses résultats sont pris en compte dans le Plan national d’adaptation au changement climatique. Il en ressort que, vers le milieu du XXIe siècle, la ressource en eau en France aura diminué, selon les bassins, de 10 à 40 %, que la plupart des étiages estivaux seront plus sévères qu’aujourd’hui et que quelques bassins, notamment ceux du Sud-Ouest et du district Seine-Normandie, seront particulièrement affectés par la baisse du niveau des nappes phréatiques.
Dans le cadre du projet ClimSec, nous avons étudié l’humidité des sols. Le second tableau qui vous est présenté montre l’évolution de la superficie de la France concernée par des sécheresses par périodes de trente ans. Vous observez que l’augmentation de cette superficie deviendra significative en milieu de siècle et que les sécheresses, aujourd’hui exceptionnelles, deviendront un phénomène ordinaire à partir de 2050, et plus encore à partir de 2080.
En conclusion, j’appelle votre attention sur la nécessité, en matière de changement climatique, de considérer les extrêmes – et pas uniquement les moyennes – et donc de développer des capacités de suivi et d’anticipation de ces extrêmes, spécialement pour ce qui est des sécheresses.
M. Guy Landmann, directeur-adjoint du GIP Ecofor. J’évoquerai brièvement l’impact du changement climatique sur la forêt, sur sa biodiversité, sur son fonctionnement et sur les services qu’elle peut rendre. Pour commencer, je passerai en revue les questions qui se posent à nous.
Le changement climatique affecte-t-il déjà la forêt et sa biodiversité, et éventuellement sa gestion ? De quelle manière et à quel niveau ? Comment ces impacts évolueront-ils en fonction de l’importance du réchauffement climatique ?
Ces impacts peuvent être envisagés à plusieurs niveaux. Du point de vue génétique, tout d’abord : les espèces végétales – les arbres en particulier – vont-elles s’adapter à l’évolution du climat d’ici un siècle ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Du point de vue de la composition des peuplements, ensuite : à cet égard, nous disposons de données plus précises, relatives au fonctionnement hydrique, aux cycles du carbone et des éléments minéraux.
Dans quelles régions les effets du réchauffement climatique se manifesteront-ils le plus ? Dans les plaines ou en montagne ? Il convient de nous intéresser particulièrement à la zone méditerranéenne, car les effets y seront sans doute plus importants que sur le reste du territoire.
Le réchauffement de l’atmosphère produit déjà des effets. En effet, depuis les années 1960, la saison de végétation de nombreux végétaux a augmenté de dix à quinze jours. La flore herbacée se modifie et les arbustes à feuilles persistantes, comme le houx, prospèrent.
À ce jour, la démonstration est moins évidente pour les arbres que pour les organismes de petite taille, qui s’adaptent plus vite, comme une partie des oiseaux, qui progressent vers le nord, moins toutefois que ce que l’on attendait en fonction du réchauffement. Par ailleurs, certains champignons, consommables ou toxiques, apparaissent dans des zones où ils étaient inconnus. Enfin, un certain nombre d’insectes et d’organismes ravageurs ont opéré des déplacements dans l’espace. C’est le cas de la chenille processionnaire du pin, dont l’INRA a reconstitué la migration depuis les années 1960. Cette étude montre que la chenille a progressé de la région d’Orléans jusqu’en région parisienne après avoir parcouru, au cours des vingt dernières années, une distance de l’ordre de six kilomètres par an.
Des changements de fond sont observés en forêt. Ainsi la productivité a été fortement améliorée par rapport aux années 1950, bien que nous ne sachions pas précisément quel rôle a joué le changement climatique dans cette évolution.
Tous ces effets vont certainement s’amplifier, à un degré difficile à quantifier mais certainement très important. Par exemple, la zone de répartition des principales essences sera modifiée de façon sensible, ce qui amène les forestiers, depuis une dizaine d’années, à s’interroger sur les décisions à prendre aujourd’hui pour aider la forêt à affronter ces changements et la rendre plus résiliente face aux situations climatiques extrêmes.
En résumé, les impacts du changement climatique sont nombreux. Je vous invite à consulter un document intitulé « Connaissance des impacts du changement climatique sur la biodiversité en France métropolitaine », publié il y a trois ans pour le compte du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et disponible en ligne. De nombreux impacts sont d’ores et déjà détectables. S’ils sont pour l’instant peu pénalisants pour la gestion des forêts, ils risquent de le devenir demain. Nous sommes donc amenés, j’y insiste, à prendre des décisions dès maintenant, alors même que nous nous trouvons dans l’incertitude, tout en sachant qu’elles engageront l’avenir de la forêt pour de nombreuses années – les arbres que nous plantons aujourd’hui pousseront encore dans les années 2050 et au-delà.
Les effets du changement climatique exigent de notre part un effort soutenu en faveur de la recherche et d’une évaluation fine de ses résultats – ce à quoi contribue le GIEC, à son niveau –, mise en œuvre par Météo-France, l’Institut géographique national (IGN) et un certain nombre d’autres opérateurs, dont des organismes de recherche, mais nécessitent d’améliorer encore l’efficacité des outils de détection et de suivi.
Nous nous sommes engagés au sein d’Ecofor dans un certain nombre de chantiers, dont la constitution, en liaison avec l’ONERC, d’indicateurs du changement climatique, et un autre portant sur les services écosystémiques fournis par les forêts.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Pouvez-vous nous dire un mot sur Ecofor ?
M. Guy Landmann. Ecofor est né il y a vingt ans de la volonté d’un certain nombre d’institutions, aujourd’hui au nombre de douze – les grands organismes de recherche engagés dans l’étude de la forêt, les organisations gestionnaires de la forêt, l’IGN et les deux ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt –, soucieuses de mener des programmes de recherche, des évaluations et des expertises en rapport avec la forêt.
M. Jean-François Soussana, directeur scientifique Environnement à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). La parution, le 30 mars prochain, du rapport du groupe II du GIEC – j’ai contribué au chapitre consacré à l’Europe – permettra de mieux évaluer les impacts possibles du changement climatique sur l’agriculture, en particulier les risques pour la sécurité alimentaire.
Je voudrais tout d’abord insister sur le caractère incrémental du changement climatique : en France, nous connaissons depuis 1900 un réchauffement d’environ 1,5° qui se traduit dans l’agriculture par une avancée des dates de récoltes, de semis et de vendanges ; d’autre part, ce réchauffement s’accompagne d’une importante variabilité du climat, qui a de nombreux impacts sur l’agriculture.
Le continent européen a été confronté à une décennie d’extrêmes climatiques dont, en 2003, la sécheresse et la canicule qui ont frappé la France et les pays voisins jusqu’en Europe centrale, entraînant la perte de 20 à 30 % des récoltes et un déstockage de carbone de l’ordre de 0,5 gigatonne sur les écosystèmes, les forêts et les sols.
Ensuite, l’Europe du Sud a subi d’importantes sécheresses en 2004, 2005 et 2007, et en 2010 une terrible vague de chaleur s’est abattue sur l’ouest de la Russie, causant des dommages considérables à l’agriculture, à la forêt et, du fait de la multiplication de problèmes respiratoires dus aux feux, à la santé.
Dans le même temps, en 2007, l’Angleterre et le Pays de Galles ont été victimes d’inondations qui ont également provoqué des dommages considérables dans les cultures.
Enfin, en 2011, nous avons connu le printemps le plus chaud et le plus sec depuis 1880, avec des dégâts estimés entre 700 et 800 millions d’euros, soit une baisse de 23 % du revenu agricole au cours de la saison. Un tiers seulement des exploitants agricoles étant assurés, cet épisode a entraîné de graves problèmes économiques.
Au niveau mondial, par rapport à la production attendue si le climat n’avait pas changé, nous aurions perdu, de 1980 à 2010, 5,5 % de la production de blé et 3,8 % de la production de maïs. Nous enregistrons donc déjà un effet du changement climatique sur les rendements.
Qu’en est-il en France ? Le progrès génétique du blé se poursuit au même rythme, mais la stagnation de son rendement est attribuée pour partie au changement climatique. Cette part n’est pas connue avec précision, mais on a estimé qu’elle était comprise entre 30 et 70 %.
Dans ce contexte, l’INRA a engagé une série d’actions et de recherches. Nous avons en particulier organisé une veille agro-climatique qui permet de pronostiquer l’impact du climat sur les cultures en cours de saison. Nous avons également, avec le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et Météo-France, mis en place le système ISOP – Information et suivi objectif des prairies – qui nous permet de diagnostiquer les impacts du changement climatique sur les prairies et qui fut particulièrement utile en 2003 et en 2011 ne serait-ce que pour estimer les calamités agricoles.
Nous appuyant sur un ensemble de modèles climatiques régionaux de qualité, nous avons acquis la conviction que, d’ici à la fin du siècle, nous connaîtrons une augmentation de la fréquence et de l’intensité des canicules et des sécheresses, essentiellement en Europe du Sud, ce qui englobe une grande partie de la France.
Quelles en seront les incidences sur les cultures ? Le Centre commun de recherche européen (Joint research centre – JRC) a réalisé des travaux détaillés de modélisation laissant prévoir pour une partie de l’Europe des pertes de production qui, en l’absence d’adaptation, pourraient atteindre 20 %. L’adaptation permettrait sans doute de remonter la pente, voire d’obtenir des augmentations de production, mais il convient d’en souligner les limites, du fait de l’impossibilité de semer en hiver sur des sols trop engorgés, de la faible productivité des variétés résistantes à la sécheresse et de la réduction de la quantité d’eau disponible pour l’irrigation, comme l’a rappelé M. Soubeyroux. Enfin, nous nous attendons à un développement accru des bioagresseurs, en particulier de ceux dont les vecteurs sont des arthropodes, c’est-à-dire les maladies à virus, les phytoplasmes et les infections fongiques hivernales.
Pour ce qui est de la viticulture, l’évolution climatique aura des effets sur la qualité du vin car les baies de raisin contiendront plus de sucre et moins d’acides organiques. En outre, du fait de l’extension du domaine de la vigne, de nouvelles zones viticoles risquent d’entrer en compétition avec nos vignobles. L’adaptation de la vigne requerra de nouvelles pratiques de taille, des recherches en œnologie, le recours à l’irrigation et des changements de cépage – mais l’exploitation de ces deux dernières ressources se heurtera aux dispositions régissant les appellations d’origine contrôlée. L’avenir du pinot noir en Bourgogne nous inquiète particulièrement car c’est un cépage adapté à un climat tempéré qu’il sera sans doute difficile de conserver dans la région.
S’agissant de l’élevage, nous observons que les animaux très productifs sont plus sensibles à la chaleur que les autres. Des mesures réalisées aux Pays-Bas montrent les effets négatifs d’une température supérieure à 18° sur la production laitière et des travaux français font de même pour les porcs à l’engraissement soumis à une température dépassant 21°.
En ce qui concerne les prairies, nous assisterons à une augmentation de la production en hiver et au début du printemps, mais à des risques accrus de pertes en été. Des changements de flore sont vraisemblables. Nous pouvons également craindre l’émergence de maladies comme la fièvre catarrhale ovine, véhiculée par un insecte, le culicoïde, et dont la propagation s’étend en Europe, ainsi que de la maladie de Lyme et des encéphalites véhiculées par les tiques.
La région méditerranéenne sera probablement la plus touchée, du fait de la conjonction de la réduction des ressources en eau, de celle des services rendus par les écosystèmes et, probablement, de celle de la production agricole, et, s’agissant des forêts, de la forte augmentation des risques d’incendie.
L’INRA a engagé sur tous ces sujets des travaux de recherche. Nous avons en particulier lancé un programme prioritaire sur l’adaptation au changement climatique de l’agriculture et de la forêt, portant sur l’ensemble des composantes – cultures, vigne et arbres fruitiers, élevage, forêts et écosystèmes. Nous étudions la résilience à moyen terme et les impacts à long terme et nous recherchons des pistes d’adaptation faisant intervenir à la fois la génétique et des changements de pratiques agricoles. Nous aimerions, en collaboration avec un ensemble d’institutions scientifiques et Météo-France, développer un portail de services sur tous les impacts du changement climatique et sur les adaptations nécessaires.
Enfin, en coordination avec le BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council), l’INRA s’est engagé dans une programmation conjointe de la recherche regroupant 21 pays européens fortement engagés sur ces questions d’agriculture, de changement climatique et de sécurité alimentaire.
M. Frédéric Berger, responsable de l’équipe « dynamiques et fonction de protection des écosystèmes forestiers de montagnes » à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). Le territoire alpin est couvert à 40 % par de la forêt, contre 30 % en moyenne nationale. Une production annuelle de 7,5 millions de m3 y est exploitée, dont 60 % de résineux – l’exploitation annuelle de 1 000 m3 de bois représente quatre emplois dans la filière bois, ce qui fait de la forêt un important pourvoyeur d’emplois.
La forêt rend de nombreux services écosystémiques. En zones de montagne, outre la production de bois, elle joue un rôle important de protection en réduisant les risques liés aux mouvements gravitaires rapides. Elle est également source de biodiversité, mais c’est aussi un espace d’accueil du public et de loisir et les forestiers contribuent à l’entretien des paysages.
Le réchauffement et la survenue de climats plus secs auront des conséquences considérables pour les territoires de montagne – où la température chute de 0,6° par tranche de 100 mètres d’altitude. Une élévation de la température de deux degrés ferait monter de trois cents mètres l’aspect actuel d’une zone de montagne. Or les scénarios les plus probables prévoient une élévation de deux à cinq degrés, de sorte que ce glissement vers le haut pourrait atteindre jusqu’à neuf cents mètres.
La végétation en zone de montagne est répartie en fonction de l’altitude (étagement de la végétation). Au-delà de l’étage subalpin, caractérisé par des forêts de résineux, se trouve une zone limite, dite de combat, à partir de laquelle la végétation forestière ne pousse pas. Une augmentation de 2° fera remonter cette limite de plusieurs centaines de mètres, ce qui aura d’énormes conséquences en matière de gestion des risques naturels. Nous trouverons de la forêt dans des secteurs où il n’y en avait pas jusqu’à présent. En revanche, cette élévation de la présence des arbres aura des conséquences positives en améliorant la stabilité du manteau neigeux et en limitant les départs d’avalanche.
Nous allons assister à une migration des essences, certes limitée par des barrières naturelles dues aux reliefs, par la géomorphologie et par la diversité des sols. Cette migration suivra un mouvement général nord-nord-est et nous trouverons des feuillus à une plus haute altitude, au détriment des résineux. Aujourd’hui, comme je l’ai dit, la production de bois utilise 60 % de résineux, mais le rapport risque de s’inverser, ce qui obligera la filière bois à privilégier l’exploitation du bois-énergie et à modifier ses pratiques pour celle du bois d’œuvre. D’autre part, le relief rendant difficile l’accès à la ressource, elle devra se doter des outils nécessaires pour aller chercher celle-ci de plus en plus haut. En résumé, la profession doit anticiper une adaptation de ses pratiques, et une réflexion sur l’aménagement du territoire devra être menée.
Certes, la forêt poussera mieux, plus haut, et elle sera plus productive, mais elle sera aussi confrontée à l’apparition de toute une série d’éléments indésirables : problèmes phytosanitaires, insectes ravageurs. La processionnaire du pin est désormais présente en altitude et le gui a remonté de deux cents mètres.
Cependant, les zones de montagne ont de larges facultés d’adaptation car le renouvellement des peuplements forestiers se fait essentiellement par régénération naturelle, ce qui permettra au patrimoine génétique de bien s’adapter.
Pour ce qui est des risques naturels, la communauté scientifique dans son ensemble prévoit l’augmentation, à court et moyen termes, des mouvements de terrain superficiels liés aux alternances de périodes de gel et de dégel, qui seront beaucoup plus marquées, et à la survenue, en moyenne tous les dix ans, d’une année catastrophique.
En revanche, mes collègues qui travaillent sur cette question n’ont pas produit de statistiques tendant à démontrer une augmentation ou une diminution des avalanches. Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui quelles seront les conséquences du changement climatique sur ce phénomène.
Quant aux crues torrentielles, nous en enregistrerons davantage en période hivernale, mais elles ne causeront pas plus de dégâts.
Aujourd’hui, 30 % des forêts de montagne jouent un rôle de protection active contre les phénomènes naturels. Mais l’entretien des versants boisés coûte cher. Il ne s’agit plus de gérer un écosystème mais un ouvrage de protection naturelle, ce qui implique de se rendre sur le terrain, d’assurer la régénération des peuplements, de couper des arbres pour éventuellement les laisser sur place. Cette démarche est très efficace contre un certain type de phénomènes rocheux, contre les avalanches et contre les glissements superficiels. Si l’augmentation de la température de 2° se confirme, on estime que la surface des forêts ayant une fonction de protection passera de 30 à 38 %, voire à 40 %. La montée en altitude des feuillus rendra les forêts plus efficaces contre les chutes de pierres et celle des résineux diminuera le risque d’avalanche.
Nous sommes tous impliqués dans des programmes de recherche pour suivre ces évolutions. Nous avons effectivement besoin d’un observatoire. La montagne est un laboratoire à ciel ouvert. Nous disposons dans les Alpes du nord d’une Zone Atelier, que nous gérons avec la communauté scientifique française (CNRS, Universités...) et qui constitue une plateforme d’échanges avec nos collègues européens, et nous participons à différents projets européens, comme NEWFOR (NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization), dans le cadre du programme Espace alpin, ou ARANGE (Advanced multifunctional management of European mountain forests) et BACCARA (Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis) relevant du programme-cadre de recherche et développement (PCRD) et qui traitent spécifiquement de la gestion adaptative et des migrations des espèces forestières en zone de montagne.
M. Éric Chaumillon, enseignant chercheur à l’Université de La Rochelle, directeur adjoint de l’unité mixte de recherche « Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs) » CNRS/Université de La Rochelle. Les littoraux sont des espaces extrêmement complexes en raison de l’interaction qui s’y fait entre hydrosphère, atmosphère, lithosphère et anthroposphère.
Il existe deux types de côtes : les côtes régressives et les côtes transgressives. Les premières gagnent sur les océans tandis que les secondes perdent du terrain. Il se trouve qu’en France, depuis des millénaires, nous avons des côtes essentiellement transgressives. Il est important de le savoir pour faire face à l’élévation prévue du niveau de la mer. Il faudra également prendre en compte le fait que le disponible sédimentaire, c’est-à-dire la quantité de sédiments sur nos côtes, est limité.
La variabilité des côtes en fonction des saisons étant très supérieure à l’érosion globale, il est difficile de faire émerger une tendance.
Selon une synthèse publiée par l’Institut français de l’environnement (IFEN) en 2007, 24 % du littoral métropolitain subit une érosion. Cette proportion est relativement peu importante parce que nous avons un fort pourcentage de côtes rocheuses et un grand nombre de systèmes estuariens ou lagunaires qui sont des lieux d’accumulation sédimentaire et, de ce fait, gagnent sur l’océan. Mais 23 % des terres urbanisées étant situées à moins de 250 mètres des côtes en recul, elles devront faire l’objet d’une attention accrue compte tenu des effets du changement climatique.
Le niveau de la mer s’élève globalement, depuis 6 000 ans, d’un millimètre par an, en France. S’il est peu connu, ce n’est pas un phénomène nouveau. Mais nous enregistrons depuis quelques décennies une accélération de cette élévation puisqu’elle est passée progressivement à 1,5, puis à 2 mm pour atteindre 3 mm par an.
D’autres facteurs agissent sur l’évolution des côtes : les vagues, qui transportent le plus de sédiments vers la côte ; les tempêtes, qui sont les agents morphogènes dominants puisqu’une seule tempête peut bouleverser la côte et provoquer une érosion spectaculaire pouvant aller jusqu’à 30 mètres, et enfin le débit fluviatile et la couverture végétale du bassin versant, qui sont aussi des pourvoyeurs de sédiments.
L’accélération de la hausse du niveau marin global est inquiétante et l’on prévoit pour la fin du siècle une élévation située entre 25 cm et un mètre. Cette élévation aura pour conséquence une transgression généralisée, c’est-à-dire un recul des côtes. Certains secteurs comme les fonds d’estuaire continueront à gagner sur la mer, mais les polders, qui sont coupés des apports sédimentaires par les digues, ne pourront pas s’adapter à l’élévation du niveau de la mer.
Il convient de prendre en compte la forte variabilité des réponses des côtes à ce phénomène, mais il est clair qu’elles vont reculer de plusieurs dizaines de mètres.
Les tempêtes sont assez mal connues parce qu’elles sont rares et que nous ne disposons pas d’instruments adaptés pour les étudier. Nous n’avons pas, en France, la preuve d’une augmentation de leur fréquence au cours des dernières décennies ou des derniers siècles. Nous savons en revanche qu’au petit âge glaciaire et au cours des derniers millénaires, des crises climatiques ont conduit à des érosions et à des transgressions responsables de reculs rapides et durables du littoral.
Le problème majeur que posent les tempêtes est celui de la surcote – il s’agit d’une élévation du plan d’eau non pas astronomique, à savoir liée à la lune et au soleil, mais due à des paramètres de pression, de vagues et de vent. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces élévations quasiment instantanées peuvent atteindre 1,6 mètre, voire 2,4 mètres comme ce fut le cas lors de la tempête Martin, en 1999.
Quant à la conséquence des évolutions des paramètres des vagues sur les côtes, il faut retenir que les vagues sont à la fois capables d’engraisser les littoraux et de les éroder. Tout est affaire de seuil ; or ces seuils sont différents pour chaque côte, et qu'il est très difficile d'obtenir des mesures pendant ces événements Je voudrais insister sur ce phénomène très mal connu qu’est la circulation de retour induite par les vagues, c’est-à-dire sur la capacité qu’ont les fortes vagues de tempête à emporter des sédiments très loin en mer, jusqu’à rendre impossible leur retour à la côte.
L’augmentation de la taille des vagues devrait conduire à une érosion des côtes. Nous avons mis en évidence, comme un certain nombre de nos collègues étrangers, cette augmentation au cours du XXe siècle, mais les modèles de Météo-France et du GIEC ne la prévoient pas en France pour le siècle en cours.
Les stratégies d’adaptation des sociétés face aux changements climatiques sont au nombre de trois : le laisser-faire et le repli – la France possédant 7 000 km de côtes, il sera évidemment impossible de toutes les protéger –, le renforcement et le redimensionnement. Nous sortons d’une longue période au cours de laquelle nous nous sommes montrés conquérants face à la mer, comme en attestent de nombreux exemples de poldérisation. Désormais, il faudra probablement envisager d’abandonner certains territoires, de laisser inonder certaines régions côtières, ce qui empêchera l’eau de monter et d’atteindre des zones plus vulnérables ou qui représentent des enjeux plus importants.
Il existe deux types de défense face à l’érosion des côtes : les défenses dures et les défenses douces. Nous avons tendance à privilégier les premières en construisant des digues ou des épis, mais ces dispositifs font disparaître le sédiment, à savoir la plage, ce qui est un inconvénient majeur dans les zones touristiques. Quant aux défenses douces, c’est-à-dire le rechargement de la plage ou de l’avant-plage, très pratiqué aux Pays-Bas, des études ont montré que leur coût n’était pas forcément plus élevé que celui des défenses dures.
En conclusion, notre degré de connaissance de l’évolution des côtes et notre capacité à prévoir cette évolution sous l’effet du changement climatique sont assez limités. Il faut donc intensifier les recherches et les travaux. Créer un observatoire national des côtes permettrait de comparer les réponses des différentes côtes aux aléas climatiques. Nous avons attendu en France la tempête Xynthia pour établir un relevé précis des côtes grâce à un procédé laser de type LIDAR (Light Detection and Ranging). Alors que nous vivons cet hiver l’épisode le plus houleux des quinze dernières années, il serait intéressant d’enclencher un nouveau suivi du trait de côte pour comprendre ce qui s’est passé.
Mme Sophie Errante. Je vous remercie, messieurs, au nom du groupe SRC, pour tous les éléments, certes toujours plus inquiétants, que vous venez de nous communiquer à propos du réchauffement climatique.
Le 5 février dernier, l’Organisation météorologique mondiale annonçait que l’année 2013 avait été la sixième année la plus chaude depuis 1850, et les treize années qui viennent de s’écouler figurent parmi les plus chaudes jamais observées sur la planète. Le 5e rapport du GIEC sur l’évolution du climat présenté fin 2013 a clairement réaffirmé l’influence humaine sur le changement climatique puisque l’évolution du climat constatée au cours des 150 dernières années ne peut s’expliquer qu’en incluant les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine dans le calcul.
Je salue les déclarations communes de Barack Obama et de François Hollande en vue d’un accord mondial ambitieux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, accord qui devrait se concrétiser lors de la Conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015.
Les députés de la Commission du développement durable se sont mobilisés sur cette question, créant une mission d’information sur les conséquences géographiques, économiques et sociales du changement climatique en France qui, en sus du travail d’analyse qu’elle va mener, contribuera à la préparation de cette Conférence de 2015. Quelles suggestions pourriez-vous faire pour nous aider à mener à bien cette deuxième mission ?
Les citoyens sont de plus en plus sensibles à la question du réchauffement climatique et nombreux sont les consommateurs qui souhaitent avoir des informations sur l’impact des produits qu’ils achètent. Mais cette demande est encore rarement associée à un changement de comportement. Comment mieux associer les citoyens et les consommateurs à la lutte contre le réchauffement climatique ?
Ce réchauffement aura un impact sur les cultures puisqu’il favorisera le développement de nouvelles maladies et l’apparition de nouveaux ravageurs. Comment anticiper cet impact pour prévenir plutôt que d’avoir à guérir, en matière de choix des espèces, des investissements, etc. ?
Puisque vous parlez d’adaptation, quelle chronologie proposez-vous au monde agricole, en particulier aux viticulteurs et aux sylviculteurs qui ne peuvent s’adapter du jour au lendemain ?
M. Martial Saddier. Je salue, messieurs, au nom du groupe UMP, la qualité de vos exposés.
Cette table ronde participe à la prise de conscience de l’enjeu que représente le réchauffement climatique. Je rappelle que Jacques Chirac fut le premier, avec sa formule « La maison brûle et nous regardons ailleurs » à s’engager dans cette voie. Ensuite l’ancienne majorité et Nicolas Sarkozy ont poursuivi son action en organisant le Grenelle de l’environnement. Et, aujourd’hui, nous saluons la candidature de la France, proposée par le Président Hollande, pour accueillir la Conférence sur le climat à Paris, en 2015.
Les députés du groupe UMP continueront d’apporter leur contribution active à cette cause. Nous avons souhaité la création de la mission d’information sur le réchauffement climatique et nous attendons avec impatience le projet de loi sur la transition énergétique en espérant que la surcharge du calendrier parlementaire n’en reculera pas trop l’examen.
Alors que nous traversons un hiver particulièrement éprouvant en raison des intempéries, nous exprimons notre profonde solidarité à l’égard de nos concitoyens touchés par les catastrophes naturelles survenues dans les Pyrénées, dans le sud-est et en Bretagne.
J’en viens à mes questions.
L’hydroélectricité est une énergie par nature propre, disponible de suite et donc précieuse pour les périodes de pointe de consommation. Quel est le lien entre l’évolution de la ressource en eau et celle du potentiel hydroélectrique ?
Pouvez-vous préciser quelles sont les zones où la forêt progresserait et celles où elle régresserait ? Quelles conséquences voyez-vous pour la filière bois-énergie, autre filière propre ?
En ce qui concerne l’agriculture, pouvez-vous nous dire dans quelles régions du monde elle disparaîtrait ? Quid en particulier de l’Afrique ?
Alors que les gouvernements successifs tentent, par voie réglementaire, d’imposer une disposition qui aurait pour conséquence d’augmenter les risques d’avalanche, je note avec satisfaction que vos propos rejoignent la position de l’Association nationale des élus de la montagne.
À propos du littoral, aucun membre de cette Commission ne souhaite abandonner les populations vivant sur le bord de mer, mais pourriez-vous préciser dans quelle proportion celles-ci pourraient être touchées par l’élévation du niveau des eaux ?
J’en terminerai avec la qualité de l’air. L’ozone contribue à la fois à une dégradation de la production végétale et au réchauffement climatique. Or nous voyons apparaître au niveau européen une augmentation de la pollution par l’ozone. Que pouvez-vous en dire ?
M. Bertrand Pancher. Je m’exprimerai au nom du groupe UDI. Face au réchauffement climatique, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Il nous faut aller vite pour adapter notre modèle de production et de consommation au niveau national, européen et international, et mettre en place des systèmes de protection et de prévention. Pour cela, nous avons besoin de perspectives et d’informations et, à ce titre, je vous remercie pour vos exposés et pour la qualité de vos travaux.
Mais il faut aller plus loin et adapter vos réflexions aux niveaux régional et local et pour chaque secteur professionnel. Vos analyses sont intéressantes, il faut maintenant les agréger et les porter à la connaissance de tous les citoyens. Comment y parvenir ? Ce partage peut-il être entrepris par institutions respectives, de manière individuelle, ou relève-t-il davantage de la compétence des collectivités ? Pouvez-vous nous aider à être plus proches de nos concitoyens ?
Il y a deux ans, j’ai invité dans mon département Jean Jouzel à s’exprimer devant un public très large. Tout le monde dans l’assistance pensait savoir ce qu’était le réchauffement climatique mais, lorsqu’il en a présenté en détail les conséquences, les yeux ont commencé à s’ouvrir et chacun avait hâte qu’on agisse enfin !
M. François-Michel Lambert. Je salue tout d’abord, au nom du groupe écologiste, l’extraordinaire travail fourni par vos différents organismes. Vos analyses confirment qu’au-delà du réchauffement de la température, le changement climatique est un immense défi que l’humanité va devoir relever, d’autant qu’il se conjugue avec l’effet de la croissance démographique. Même s’il ne peut quant à lui invoquer l’action d’aucun Président de la République, le groupe écologiste a mis cet impératif au cœur de son projet politique, et cela depuis très longtemps.
À quels exécutifs avez-vous présenté vos connaissances – je pense en particulier aux régions ? Comment percevez-vous la capacité des médias à relayer vos travaux ?
Que pouvez-vous nous dire des enjeux du changement climatique pour les territoires proches du nôtre, Europe et pourtour méditerranéen, et comment notre expertise pourrait-elle les aider ? Comment s’effectue la coopération, et de quelle manière pourrions-nous la renforcer ?
La diversité de notre territoire métropolitain nous amène à privilégier une approche locale – à ce propos, je relève qu’aucun d’entre vous n’a traité de la question telle qu’elle se pose pour nos collectivités d’outre-mer. Comment prendre en compte de façon spécifique les problèmes propres à chaque territoire ?
Monsieur Soussana, pour adapter nos productions au changement climatique, vous préconisez le recours à la génétique. Nous préférons, nous, une autre approche, à savoir l’agro-écologie, adaptée à chaque territoire et à ses spécificités.
La ressource forestière pourrait-elle s’effondrer brusquement, sous l’effet de tempêtes ou de maladies qui s’abattraient sur des forêts entières ? Comment préserver les intérêts à long terme de la sylviculture et de la filière bois-énergie en dépit des mutations qui vont affecter nos forêts ?
Enfin, vous venez de nous démontrer que le soutien à la recherche doit rester une priorité. Quelle mobilisation de fonds publics attendez-vous ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous indique, cher collègue, que nous consacrerons prochainement une table ronde sur les conséquences des changements climatiques outre-mer.
M. Jacques Krabal. Au nom du groupe RRDP, je remercie moi aussi les intervenants pour la qualité de leurs exposés.
La question de l’impact du changement climatique sur notre pays est d’autant plus d’actualité que les médias, depuis plusieurs semaines, relaient des informations préoccupantes sur ce que d’aucuns qualifient de caprices de la nature mais que d’autres, peut-être plus réalistes, qualifient de dérèglement climatique. Ces phénomènes, inhabituels il y a peu, deviennent récurrents.
Monsieur Soubeyroux, vos travaux confirment que les sécheresses seront plus fréquentes et plus intenses au cours des prochaines années, ce qui affectera gravement des domaines d’excellence de l’économie française, comme l’industrie agroalimentaire, et mettra en péril des activités cruciales pour le développement de nos territoires, je pense en particulier au champagne, bien sûr. Dans l’état actuel de vos connaissances et de vos réflexions, pensez-vous qu’il sera plus facile de s’adapter aux changements climatiques que d’intervenir sur leurs causes pour empêcher la survenue des effets que vous prévoyez ?
Monsieur Landmann, le programme « Gestion et impacts du changement climatique » d’Ecofor vise à développer une approche interdisciplinaire. Quel regard vos collègues des sciences humaines et sociales portent-ils sur les propositions tendant à atténuer les effets des changements climatiques ou à s’y adapter ? Quelles protections devons-nous immédiatement mettre en œuvre ?
Monsieur Soussana, vous nous indiquez que là où il pleut beaucoup, il pleuvra encore davantage et que là où il ne pleut pas beaucoup, il pleuvra encore moins. Que proposez-vous aux agriculteurs, aux viticulteurs et aux pisciculteurs qui devront s’adapter à ces évolutions ?
Monsieur Chaumillon, les littoraux sont le lieu de tous les dangers. Cependant, je n’ai pas trouvé dans le document que vous nous avez transmis une carte faisant apparaître le recul des côtes dans les années à venir et les espaces destinés à être sacrifiés. Une telle carte existe-t-elle ?
Enfin, je ne puis que souscrire aux initiatives qui viseraient à vulgariser vos travaux afin de sensibiliser les élus et la population à toutes ces questions.
M. Philippe Plisson. Le changement climatique se heurte encore au scepticisme de nombre de nos concitoyens, qui font valoir qu’alors que le réchauffement devrait se traduire par une aggravation de la sécheresse, il n’a jamais autant plu depuis deux ans au point que les réserves débordent. Comment expliquez-vous cette contradiction ?
L’Aquitaine est l’un des territoires qui souffriront le plus du réchauffement climatique. Quels seront les impacts sur la vigne, qui est fortement dépendante des conditions pédoclimatiques ? Devons-nous envisager des changements de cépages ?
Les tempêtes de plus en plus fréquentes qui touchent nos côtes sont-elles liées au changement climatique ?
L’estuaire de la Gironde pourrait subir une montée des eaux d’un mètre à la fin du siècle. Comment évoluera-t-il si on ajoute à ce phénomène l’engraissement des vases ?
M. Jacques Kossowski. Malgré l’immense travail réalisé par vos laboratoires et par Météo-France, il demeure bien des interrogations sur la façon dont évoluera le climat en France dans les prochaines décennies, et le constat vaut a fortiori pour chacune de nos régions, où ce même exercice prédictif serait pourtant bien utile. Nous sommes par conséquent condamnés, tant en ce qui concerne l’amplitude du réchauffement qu’en ce qui concerne les événements climatiques extrêmes, à nous adapter à une marge d’incertitude, mais sans doute pourrions-nous la réduire grâce aux progrès que nous pourrions faire dans la science du climat, mais aussi dans plusieurs autres sciences comme les sciences de la vie. De ce point de vue, peut-on raisonnablement envisager de nouvelles avancées dans les prochaines années ? Notre pays sera-t-il capable d’affiner prévisions et simulations ? Consacre-t-il suffisamment de moyens budgétaires à ces recherches ?
M. Yannick Favennec. Je vous remercie, messieurs, pour ces présentations passionnantes.
Les dérèglements climatiques entraînent des bouleversements sur l’ensemble de la planète. La France n’y échappe pas, avec des tempêtes à répétition et des températures anormalement élevées pour un mois de janvier. Les graves intempéries qui touchent l’ouest, le sud-ouest et le sud de notre pays sont-elles, selon vous, réellement et uniquement dues au réchauffement ?
Que fait Météo-France pour améliorer les systèmes de surveillance, de prévision et d’alerte ? Comment ceux-ci évolueront-ils dans les dix prochaines années ?
Il paraît indispensable, pour définir et conduire une politique durable et efficace, tant dans le domaine environnemental que dans les domaines économique et social, de s’appuyer sur des analyses scientifiquement et techniquement argumentées. Aussi, que pensez-vous des récentes critiques sur la place insuffisante donnée aux scientifiques dans les débats sur la future politique énergétique ?
M. Olivier Falorni. Après le demi-échec de la Conférence de Varsovie sur le changement climatique, pensez-vous possible de parvenir à un accord destiné à contenir le réchauffement du globe lors de celle de Paris, en 2015 ?
Selon le rapport Global Risks 2014 publié à Davos le 22 janvier dernier, cinq risques environnementaux, en particulier celui d’un réchauffement et celui d’événements météorologiques extrêmes, auraient beaucoup crû depuis 2011. Les quatorze tempêtes successives qu’ont connues nos côtes cette année peuvent-elles être attribuées au réchauffement climatique ?
M. Christophe Priou. Comme plusieurs de mes collègues, je crois qu’il faudra faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens : aujourd’hui, il arrive d’entendre mettre dans le même sac la tempête Xynthia et la catastrophe de l’Erika – les événements météorologiques extrêmes et les catastrophes d’origine humaine.
Il faudra réfléchir aux meilleurs moyens de protéger les personnes et les biens tout au long du littoral français et européen – et le problème est particulièrement aigu dans mon département de la Loire-Atlantique où ce littoral est urbanisé à 85 % et où nous devons à tout prix préserver les marais salants, dont l’intérêt économique est majeur. On cite en exemple les Pays-Bas, qui ont certes réalisé des travaux titanesques en ce sens depuis les catastrophes des années 1950, mais ils n’ont que quelques centaines de kilomètres de côtes : le problème se pose en France à une tout autre échelle !
L’observatoire que vous proposez, monsieur Chaumillon, me paraît une très bonne idée, car il faciliterait sans doute la mise au point de solutions techniques ; mais celles-ci nécessiteraient des décisions politiques, voire une véritable révolution culturelle : en effet, si on vous suit, on passerait, sur le littoral, de « l’aménagement » du territoire au « déménagement » du territoire ! Raison de plus pour travailler à un rapprochement entre scientifiques et décideurs.
Mme Geneviève Gaillard. Les changements climatiques sont une réalité à l’échelle mondiale : prenez-vous en considération ceux qui interviennent dans les autres pays, mais aussi les migrations qui pourraient résulter de ces bouleversements ? Travaillez-vous à la définition de mesures d’adaptation de nos productions animales ou végétales cohérentes avec celles qui sont adoptées ailleurs ?
M. Julien Aubert. Les changements climatiques ne risquent-ils pas de nous poser des problèmes de souveraineté ? En matière énergétique, d’abord : ne vont-ils pas réduire les potentialités de notre territoire ? Faut-il envisager, par exemple, de modifier l’implantation de certaines centrales nucléaires ? En matière agricole ensuite : certaines cultures ne vont-elles pas disparaître purement ? Comment adapter nos productions ?
D’autre part, ne faudra-t-il pas renoncer à certaines importations ou l’offre agricole mondiale restera-t-elle, mutatis mutandis, aussi diversifiée qu’elle l’est aujourd’hui ?
Enfin, notre pays est organisé autour de grandes agglomérations nourries par leur hinterland. Est-ce encore l’avenir ? Ne faut-il pas envisager une modification radicale de nos modes d’urbanisation ?
M. Franck Montaugé. Sur cette question des changements climatiques, les esprits évoluent, mais vos travaux scientifiques, messieurs, alimentent-ils aujourd’hui des travaux macroéconomiques prenant en compte les risques que vous avez décrits pour élaborer de nouveaux modèles ?
M. Guillaume Chevrollier. Le XXIe siècle a déjà enregistré treize des quatorze années les plus chaudes jamais observées, et ce phénomène devrait s’amplifier ; les fortes pluies devraient aussi, selon le GIEC, s’intensifier dans le nord de l’Europe et, de fait, le mois de janvier a connu des précipitations supérieures de 40 % à la normale. Nos concitoyens prennent toutefois conscience de la réalité des changements climatiques, même si la pédagogie demeure nécessaire.
Député de la Mayenne, département à fort potentiel agricole, je m’interroge sur les adaptations qui s’imposent dès maintenant à nos agriculteurs et à nos éleveurs. Quelles sont les innovations nécessaires ?
M. Jean-Louis Bricout. La fréquence accrue des extrêmes climatiques rend plus cruciales encore les prévisions météorologiques. Les intempéries exceptionnelles de ces dernières semaines vous conduisent-elles à revoir vos méthodes de prévision ?
M. Jean-Pierre Vigier. La diversification énergétique, qu’essaient de favoriser tous les gouvernements, est indissociable de la transition écologique. A-t-elle eu selon vous des effets positifs tangibles ?
Comment faire, d’autre part, pour que les efforts français et européens de limitation du réchauffement climatique ne soient pas, comme c’est le cas aujourd’hui, réduits à néant par l’industrialisation des pays émergents ?
M. Alain Leboeuf. Pour la Vendée, département d’élevage comptant 280 km de côtes, il est vital d’identifier les conséquences des changements climatiques : sans doute davantage de précipitations, mais aussi de sécheresses, etc. Certaines espèces animales et végétales ne seront plus adaptées à des températures un peu plus élevées qu’aujourd’hui. Comment faire face à ces évolutions ?
Certaines terres agricoles vendéennes, parmi les plus riches de notre pays, ont été gagnées sur la mer au cours des siècles passés ; elles sont aujourd’hui menacées d’engloutissement. Comment allons-nous choisir les territoires qui seront sacrifiés et ceux qu’il conviendra de préserver à tout prix ?
M. Patrick Vignal. Ma circonscription compte des stations balnéaires importantes, notamment La Grande-Motte. Tous les dix ans, on réensable : cela donne un peu l’impression que l’on arrête la mer avec des pâtés de sable… Est-ce la meilleure solution ?
Mme Catherine Quéré, vice-présidente de la Commission, remplace le Président Jean-Paul Chanteguet à la présidence.
M. Jean-Marie Sermier. Les évolutions climatiques posent, en France, le problème des appellations d’origine contrôlée (AOC), fondées sur le lien établi entre un climat, un sol et un savoir-faire. Or tout cela va s’écrouler, puisque la géographie des productions végétales et animales va changer ! Est-ce que l’INRA réfléchit à de nouveaux systèmes d’AOC ?
M. David Douillet. Dans vos modèles, prenez-vous en considération les effets d’un apport massif d’eau douce, lié à la fonte des pôles, et qui pourrait contribuer à dérouter les courants marins qui nous assurent un climat tempéré ? Bordeaux est après tout à la latitude de Montréal.
Gouverner, c’est anticiper, mais j’ai le sentiment que nous sommes souvent désarmés face à la rapidité et à l’ampleur des changements climatiques.
M. Claude de Ganay. La forêt française contribue beaucoup à atténuer le changement climatique, puisqu’elle capte chaque année de 10 à 15 % des émissions nationales de CO2, principal gaz à effet de serre. À cette fonction naturelle de puits de carbone s’ajoute la fourniture de bois pour la construction et pour la production d’énergie. Quelles sont les politiques à imaginer – ou à soutenir davantage – pour mieux adapter cette forêt aux changements climatiques ?
M. Éric Chaumillon. Faut-il déménager la population côtière ? Loin de moi l’idée d’abandonner des territoires habités, parfois densément, mais 45 % des terres situées à moins de 500 mètres de la côte sont des espaces naturels. Nous disposons donc de marges de manœuvre, et c’est bien sûr à ces espaces que je pensais lorsque j’évoquais la possibilité de laisser inonder certaines terres.
La densité de la population littorale est d’environ 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale et cette tendance à la concentration de l’habitat près de nos côtes ne faiblit pas. Or nous attendons une transgression généralisée, c’est-à-dire un recul des côtes, plus ou moins important. En tant qu’élus, il vous faut donc vous montrer très vigilants dans l’attribution des permis de construire et limiter les constructions trop proches des côtes. Celles-ci sont très mobiles, et édifier aujourd’hui une villa à quelques dizaines de mètres d’une dune ou laisser se développer l’urbanisation en bordure de mer ne peut qu’exposer à des problèmes graves dans quelques années.
Nécessité de la pédagogie ? Enseignant à l’université, j’ai en effet constaté chez mes étudiants une grande méconnaissance du fonctionnement des littoraux. J’ai pour ma part une politique volontariste de communication et je suis toujours disposé à débattre avec les collectivités et avec les médias. La Rochelle est le chef-lieu du seul département côtier de la région Poitou-Charentes, mais je suis convaincu qu’il pourrait être intéressant de faire des conférences à Poitiers, par exemple.
Il n’est pas possible aujourd’hui d’établir une carte du recul prévisionnel des côtes. Il existe certes des programmes de recherche qui tendent, ponctuellement, vers ce but, mais nous ne disposons que de modèles morphodynamiques de faible extension pour appréhender des systèmes très compliqués d’interactions entre vagues, vents, courants et littoraux.
S’agissant de la Gironde, il faut savoir que les estuaires et les lagunes, qui sont des zones à fort taux de sédimentation, arrivent à suivre l’élévation du niveau de la mer si celle-ci n’est pas trop importante – on parle de quelques décimètres pour les prochaines décennies. Mais les polders, parce que protégés par les digues, sont soustraits à l’action de la sédimentation et ils ne peuvent pas s’adapter. De vastes territoires se retrouvent ainsi sous le niveau de la mer.
Je ne m’autoriserai pas à attribuer les tempêtes que nous avons connues cet hiver aux changements climatiques : pour constater une tendance, il faudrait disposer de plusieurs décennies de recul et il me semble de toute façon dangereux de lier un événement ponctuel à une tendance climatique.
La Vendée est effectivement un territoire très vulnérable. Comme en Charente-Maritime, plus de la moitié de la bande côtière de dix kilomètres de large se situe en dessous du niveau des plus hautes mers. Sans les digues, il y aurait une inondation tous les mois… Au cours des quatorze tempêtes qui ont été évoquées, nous avons connu par deux fois des surcotes d’un mètre qui auraient provoquées des inondations importantes, si elles s'étaient produite pendant des marées hautes de vive-eau, comme pendant la tempête Xynthia de 2010. Si ces surcotes étaient intervenues au moment de marées hautes de vive-eau, c’était l’assurance de catastrophes : tous les hivers, la nature joue à la roulette russe !
Comment choisir les zones à abandonner ? Ce sont forcément celles qui sont les plus proches de la mer, car c’est là que se fera la déverse. L’exemple de la Vendée est tout à fait pertinent même si je pensais plutôt aux terres agricoles de part et d’autre des estuaires de la Gironde et de la Charente : en interdisant à tout prix l’inondation de ces territoires, on laisse forcément la mer monter, éventuellement jusqu’à la ville. Il faut se doter d’une stratégie – modéliser, rehausser des digues, choisir les territoires à protéger et ceux qui resteront inondables, etc.
Le rechargement des plages est-il la meilleure solution possible à La Grande-Motte, et ailleurs ? Le choix est entre défense « en dur » – des digues – et défense « douce », c’est-à-dire le rechargement de plage. M. Van Rijn – l’une des sommités de ma discipline – a bien montré que les coûts de l’une et l’autre solution sont comparables. Dans une zone touristique, les défenses en dur appauvriraient les plages ; le rechargement paraît donc la solution la plus pertinente. Certains systèmes en dur comme les épis en T permettent de faire de petites plages « de poche » ; cela a été pratiqué par exemple à Sitges, près de Barcelone, mais l’effet sur le paysage est désastreux.
Les touristes finissent par tuer ce qu’ils viennent chercher : à force de se masser sur les côtes, ils dénaturent les paysages !
Mme Catherine Quéré, vice-présidente. La tempête Xynthia a été un exemple frappant des risques que vous évoquez, comme peuvent le confirmer ceux d’entre nous qui étaient membres de la commission d’enquête.
M. Jean-Michel Soubeyroux. Vous avez soulevé des questions très vastes qui excèdent souvent les compétences d’un scientifique ; je vais néanmoins essayer de les traiter du mieux possible.
Pour sensibiliser les citoyens et les associer à la réflexion en vue d’élaborer des politiques susceptibles de recueillir leur adhésion, il me semble effectivement que les scientifiques ont un rôle à jouer, mais sans doute pas un rôle d’organisateurs. Des observatoires, régionaux ou nationaux, ont été créés : ce sont des outils tout à fait intéressants à cet effet. Il existe ainsi un Observatoire pyrénéen du changement climatique qui couvre les régions espagnoles et françaises : ce caractère transfrontalier est essentiel, car les mêmes problèmes se posent bien sûr sur les deux versants du massif.
Avec une ressource en eau moindre et plus variable selon les saisons, il faut effectivement s’attendre à une réduction de notre potentiel hydroélectrique. Quant au refroidissement de nos centrales nucléaires, c’est bien sûr un sujet de préoccupation majeure. Météo-France contribue à la réflexion dans ces domaines.
Plus généralement, pour ce qui est de la ressource en eau et de l’adaptation nécessaire aux nouvelles conditions climatiques, il me semble qu’il faut réfléchir à l’échelle du bassin, du territoire. Cette ressource a ceci de particulier qu’elle est partagée entre différents usages et il faut donc une réflexion globale : on ne peut pas se contenter de laisser chaque profession chercher et faire prévaloir ses solutions. Tout le monde doit se mettre autour de la table pour gérer la ressource de façon cohérente, et c’est toute la difficulté de l’exercice. Il est d’autre part impossible de traiter des changements climatiques indépendamment des autres changements globaux, comme les évolutions démographiques qui commandent celles de la demande.
Beaucoup de projets, européens notamment, tendent à agréger les expertises de différents pays et à assurer une action cohérente de l’un à l’autre. L’expérience de l’Observatoire pyrénéen du changement climatique pourrait servir d’exemple à cet égard aussi.
J’ai surtout parlé des sols et des cours d’eau, mais les nappes phréatiques sont également affectées par le changement climatique. Plutôt que de sécheresse météorologique, je préfère parler de sécheresse des sols : l’évolution des précipitations n’est pas forcément bien établie, mais, quelles que soient les incertitudes sur le sujet, la sécheresse des sols, dont pâtissent l’agriculture et l’hydrologie, se développeront de toute façon sous l’effet des températures. Je ne voudrais pas que l’incertitude sur les précipitations soit comprise comme une incertitude sur d’autres composantes du cycle de l’eau.
Faut-il opter pour l’adaptation ou pour l’atténuation des impacts ? Il faut, je crois, faire les deux : les derniers modèles du GIEC montrent que même des politiques d’atténuation draconiennes ne sauraient suffire : l’évolution du climat est déjà en cours et nos sociétés seront donc de toute façon confrontées à des changements climatiques.
Sur le rapport entre événements extrêmes et changements climatiques, il faut, comme l’a dit M. Chaumillon, demeurer très prudent : il est difficile de démontrer vraiment l’existence d’un lien. Certains événements extrêmes sont annoncés par les projections climatiques et on peut penser qu’ils interviendront de plus en plus souvent : c’est notamment le cas pour les vagues de chaleur et pour les sécheresses, mais on n’a pas aujourd’hui prouvé qu’il en était de même pour les tempêtes, du moins en métropole. Le lien entre météorologie et climat est complexe. D’autre part, nous avons déjà connu des événements pluvieux intenses sur notre territoire : il faut peut-être aussi développer notre mémoire des événements passés.
L’amélioration des systèmes d’alerte est bien sûr une préoccupation constante de Météo-France et des pouvoirs publics. De grands progrès ont déjà été réalisés ; le système de vigilance prend ainsi en considération les crues, les submersions marines… C’est un travail long, mais nécessaire. Bien sûr, les intempéries que nous connaissons nous permettent d’améliorer nos prévisions et, surtout, nos dispositifs d’alerte.
La prise en considération dans les modèles climatiques de la fonte des glaciers du Groenland et donc de l’apport massif d’eau douce qui pourrait s’ensuivre est une question qui revient systématiquement dans tous les exercices du GIEC. Aujourd’hui, l’affaiblissement éventuel du Gulf Stream n’est pas de nature à remettre en cause les évolutions climatiques attendues : ce courant est lié à la circulation océanique, mais aussi à la dominance des vents d’ouest.
M. Guy Landmann. Nos concitoyens sont sensibles, je crois, à la question des changements climatiques et de leurs conséquences sur la forêt. Mais, vous l’avez constaté, ces conséquences sont très complexes et donc difficiles à traiter : à nous de trouver les moyens de le faire.
La forêt peut-elle disparaître ? Tout dépend de l’élévation de la température ; le scénario le plus probable n’est pas celui d’un effondrement massif de la ressource, mais plutôt d’une accélération des dépérissements qui, au lieu de concerner un à deux millions de mètres cubes, en feraient disparaître dix millions, puis cinquante… Certes, les tempêtes hors normes de 1999 ont mis à terre 170 millions de mètres cubes, mais des pertes de 20 ou 30 millions de mètres cubes qui ne seraient pas liées à des tempêtes n’en seraient pas moins très significatives. Plus qu’à une catastrophe soudaine, il faut donc plutôt s’attendre à une baisse de production d’une partie importante de la forêt française, notamment dans le sud : cela fera moins de bruit, mais n’en sera pas moins sensible. Le prochain rapport de l’ONERC, que vous recevrez bientôt puisqu’il est envoyé au Parlement et au Premier ministre, sera consacré à la forêt, et un chapitre y présentera ce que pourrait devenir la forêt française en 2100.
Quelles politiques forestières faut-il aider, et comment améliorer notre efficacité en matière d’atténuation ? Il a été opportunément rappelé que la forêt captait l’équivalent de 10 à 15 % de nos émissions annuelles de CO2, ce qui est considérable. Il existe aujourd’hui des politiques visant à favoriser la biodiversité, mais aussi la transition écologique, donc entre autres choses l’utilisation accrue de bois pour l’énergie. Une action efficace en faveur de la forêt, c’est aussi, nécessairement, un soutien à la filière et à l’emploi. Tous les plans que nous pouvons élaborer n’ont de chances de succès que s’ils s’appuient sur une politique de développement forestier économiquement et territorialement cohérente. Mais il sera à coup sûr difficile de conserver les performances actuelles de la forêt française dans tous les domaines – énergie, captation de carbone, biodiversité, emploi…
Nous disposons maintenant d’un arsenal de plans régionaux : du point de vue administratif, le travail est fait. En revanche, nous sommes moins bons – moins bons que nos collègues canadiens, par exemple – pour impliquer toutes les parties prenantes : nous tâtonnons. On réalise cependant de plus en plus de prospectives – le ministère de l’agriculture a par exemple publié un rapport sur ce que pourrait devenir la forêt française entre 2050 et 2100 – et ce type d’exercice permet de faire prendre conscience à tous les acteurs des évolutions possibles et, ainsi, de les motiver.
L’outre-mer est effectivement trop souvent oublié ; à Ecofor, nous essayons systématiquement soit de traiter cette question, soit d’expliquer pourquoi nous ne le faisons pas – dans le rapport « Connaissance des impacts du changement climatique dans la France métropolitaine », c’est parce que le marché ne nous avait pas été attribué… Mais nous travaillons aujourd’hui à une synthèse des indicateurs de gestion de la forêt – couvrant donc la question du changement climatique – dans tous les outre-mer – domaine extraordinairement vaste.
Ecofor anime en effet, pour le compte du ministère de l’écologie, le programme « Gestion et impacts du changement climatique » (GICC), dans lequel nous poussons l’interdisciplinarité très loin : les sciences sociales y interviennent au même niveau que les sciences dures, ce qui est assez remarquable.
En matière de recherche et développement comme en matière de traduction concrète des résultats de nos recherches, nous ne sommes pas au bout de nos peines, je le reconnais. Je veux toutefois mentionner le travail du réseau mixte technologique AFORCE, « Adaptation des forêts au changement climatique », qui rassemble forestiers et chercheurs. Il existe en tout cas une volonté forte chez les acteurs du secteur forestier de prendre cette question à bras-le-corps. Mais c’est aussi une affaire de moyens !
M. Jean-François Soussana. La question la plus vaste est sans doute celle de la stratégie à adopter : adaptation ou atténuation ?
L’INRA a conduit une étude sur le potentiel d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture en France – soit, je le rappelle, plus de 20 % des émissions nationales. Par une dizaine de mesures, il serait possible de réduire ces émissions, sans toucher à la production agricole elle-même, dans une proportion difficile à calculer précisément, mais dont on estime qu’elle pourrait être de l’ordre de 20 %.
Il est également important de garder à l’esprit les perspectives temporelles. Jusqu’en 2050, comme l’a rappelé Jean-Michel Soubeyroux, les trajectoires climatiques sont largement fixées, car elles sont fonction d’émissions qui ont déjà eu lieu. Ce n’est donc qu’au-delà qu’il existe encore des incertitudes. Tout dépendra des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, à l’échelle internationale, si le réchauffement atteignait 4 degrés, tout le système alimentaire serait menacé.
Pour la France, il convient donc d’examiner, pour la période qui court jusqu’à 2050, les enjeux de la variabilité climatique et de l’adaptation à cette variabilité. On peut appliquer des mesures locales et régionales en se guidant sur les enseignements de la veille agro-climatique. Les agriculteurs eux-mêmes peuvent, de façon autonome, s’adapter en modifiant les dates de semis ou de récolte – ainsi, en 2011, certaines céréales ont été récoltées en vert, car il était peu probable qu’elles puissent arriver à maturité. On peut aussi s’attacher à diversifier les systèmes agricoles : toute diversification permet de réduire les risques. Enfin, il faut bien sûr, quand cela est nécessaire, changer des variétés. Le rôle de la recherche et développement est d’informer et d’offrir de nouvelles options.
Au-delà de 2050, il faut songer à des adaptations planifiées. Vous avez raison, les dispositions régissant les AOC posent des problèmes particuliers du fait de leur caractère rigide ; il serait donc utile de débattre avec l’ensemble des acteurs concernés des conditions d’une certaine flexibilité, de manière à accompagner les changements plutôt que d’y résister – ce qui, en tout état de cause, ne serait pas possible très longtemps.
Cette réflexion sur des changements profonds, qui demanderont sans doute des infrastructures nouvelles, doit être engagée dès maintenant. Le temps nécessaire pour un cycle de sélection variétale est de dix à quinze ans : il ne nous reste donc que peu de temps pour agir.
Avec un réchauffement de 4 degrés à la fin du siècle, les risques deviendraient systémiques : toutes les interrelations entre l’eau, l’agriculture, la biodiversité, l’énergie… seraient alors à revoir. Nous avons déjà évoqué les relations entre l’eau et l’agriculture ; quant à l’énergie, vous savez que les barrages français sont très majoritairement gérés par EDF, qui a besoin aussi de refroidir ses centrales nucléaires. Mais, lorsqu’on se projette dans l’avenir comme cela a été fait dans l’étude Explore 2070 conduite par le ministère chargé de l’écologie, on constate que le taux de couverture des besoins agricoles va chuter : dans un scénario de réchauffement, les besoins d’irrigation ne seraient plus couverts. Il y a là un problème très sérieux.
On peut bien sûr passer du maïs au sorgho même si cela implique pour les filières de revoir quelque peu leurs technologies. On peut aussi adopter des méthodes avancées d’irrigation, beaucoup plus économes en eau, mais cela nécessite aussi des investissements. D’autre part, il nous faut absolument conserver nos ressources génétiques, car c’est le patrimoine dont nous dépendons pour nous adapter. Si ces ressources de biodiversité devaient elles aussi être menacées, nos marges de manœuvre s’amoindriraient. Il faut enfin diversifier nos systèmes agricoles – c’est, je crois, le sens de la question sur l’agro-écologie. Si nous y parvenons, nous résisterons mieux aux chocs climatiques.
Il faut donc informer, communiquer, mais aussi investir dans la recherche et le développement et développer des stratégies régionales qui impliquent fortement tous les acteurs des filières et des territoires.
Sur les risques particuliers encourus dans chaque région, il est difficile d’être péremptoire car les modèles utilisés peuvent beaucoup varier. Mais il semble que le nord de la France serait plutôt menacé par les inondations, comme l’ouest – Poitou-Charentes et Aquitaine notamment – qui le serait aussi par les sécheresses ; on peut aussi s’attendre à un renforcement de la sécheresse dans le sud de la France – mais peut-être sur tout notre territoire.
L’INRA mène des recherches importantes sur ces sujets ; plusieurs de ses projets en matière de bioressources sont financés par les programmes d’investissements d’avenir : cela nous permet par exemple de conduire les travaux de fond sur l’adaptation des grandes cultures – blé, maïs, tournesol…
L’investissement est moindre dans les filières d’élevage, dont la situation risque pourtant d’être inquiétante. Ces filières traversent déjà une mauvaise passe et le réchauffement, qui fera chuter la production laitière et retardera la croissance des animaux tout en provoquant des dégâts sur les prairies, aura une incidence économique forte. Nous devrions donc investir dans ce secteur, comme, Guy Landmann l’a dit, dans celui de la forêt.
Nous menons des travaux sur l’outre-mer, avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) notamment. Dans ces territoires, le réchauffement se situe d’ores et déjà au-delà de la variabilité climatique habituelle et des adaptations assez profondes devront donc être engagées.
La France devant accueillir la 21e Conférence sur le climat en 2015, nous réfléchissons à l’organisation d’un colloque scientifique international qui aiderait à préparer cet événement. Avec le CIRAD et avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), nous organiserons également à Montpellier, en 2015, un colloque sur les solutions d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. Il existe aussi des programmes internationaux, consacrés par exemple à la télédétection – GEO-GLAM (GEO Global Agricultural Monitoring) – et à la modélisation des impacts du changement climatique – AgMIP (Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project). Enfin, l’INRA a, avec d’autres instituts et plusieurs entreprises, lancé la Wheat Initiative – le blé étant l’une des cultures qui seraient les plus affectées par le changement climatique.
Dans le monde, ceux qui souffriront le plus seront les petits agriculteurs et les éleveurs des zones sèches : leur survie même sera menacée. Avec un niveau élevé de réchauffement, on risque d’enregistrer des impacts importants sur les prix, sur les marchés, et donc une aggravation de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, ainsi qu’un accroissement des migrations…
L’ozone est effectivement un polluant atmosphérique qui touche les cultures, et nous constatons déjà les effets de cette pollution. C’est un problème non négligeable et qui peut avoir une incidence sur la production ; toutefois, les projections sont plus alarmantes pour l’Asie et pour l’Amérique du nord que pour l’Europe. Il est possible que l’augmentation du CO2 atmosphérique permette de réduire quelque peu les effets dus à ce gaz : d’après les estimations dont nous disposons, on resterait plutôt au même niveau de dommages à l’avenir. Mais l’incertitude est très grande : il faut donc y songer lorsqu’on établit des schémas de sélection et d’investissement.
M. Frédéric Berger. S’agissant de l’ozone, je peux ajouter que j’ai participé, avec des collègues italiens, à un programme de recherche qui a analysé, dans le Tyrol italien, la répartition de l’ozone et ses conséquences sur des peuplements forestiers, notamment de mélèzes : la démonstration a été faite qu’il existe un accroissement de mortalité lors de pics de pollution. C’est donc bien une question importante.
Il faut bien insister : il est très difficile d’apprécier les interactions entre les différentes conséquences des changements climatiques. Ainsi l’augmentation des températures en montagne provoque une fonte du permafrost et des glaciers ; il y a donc davantage d’eau, ce qui veut dire plus de ressources pour l’hydroélectricité par exemple, mais aussi une déstabilisation des sols, donc davantage de laves torrentielles et de crues torrentielles, et des sécheresses plus importantes, donc des feux de forêts plus fréquents. Si l’on en arrive à la disparition du couvert forestier, ce sera un véritable scénario catastrophe.
Il existe des tendances démontrées : élévation de 0,8 degré de la température dans les sols de type permafrost, donc fonte de ces sols ; recul des glaciers, que chacun constate malheureusement, comme, par exemple, dans la vallée de Chamonix. Mais nous restons très prudents, car l’étude des synergies est infiniment complexe, en particulier pour ce qui est de la forêt – elle piège du carbone mais, en l’absence de gestion adéquate, ses capacités de stockage risquent de s’épuiser. Il faut donc conserver une gestion forestière dynamique pour que les arbres puissent continuer à stocker du carbone : cela veut dire aller en forêt, couper du bois et, pourquoi pas, l’y laisser. Mais il n’est pas toujours facile d’aller dans les forêts de montagne… On risque donc, si l’on n’y prend pas garde, d’avoir à la fois une surexploitation des zones les plus faciles d’accès et une capitalisation, c’est-à-dire des arbres qu’on laisse grandir, dans les zones plus difficiles d’accès : dans ce cas, les capacités de stockage du carbone seront moindres et les peuplements vieilliront, ce qui veut dire que les arbres seront beaucoup plus sensibles aux tempêtes, aux ravageurs, au vent… On peut alors enregistrer, du jour au lendemain, des disparitions sur de vastes surfaces.
Pour remédier à ces phénomènes, il faut commencer par bien connaître la ressource, c’est-à-dire établir des cartes, identifier les fonctions de chaque zone de la forêt – protection, production… Sur ces fondements, on peut mettre en œuvre une sylviculture raisonnée et respectueuse des services rendus par ces écosystèmes. Il nous faut donc des données sur une très vaste échelle. La télédétection ouvre des perspectives intéressantes. La technologie LIDAR de scannérisation aéroportée, déjà mentionnée par M. Chaumillon, va constituer une véritable révolution : la résolution obtenue est sans commune mesure avec celle que permettaient les procédés utilisés jusqu’ici – de cinq à vingt-cinq points par mètre carré, au lieu d’un point tous les vingt-cinq mètres ! – et elle procure des informations non seulement sur le sol, mais aussi sur les obstacles – dont les arbres font partie. Plusieurs programmes de recherche, notamment le programme NEWFOR, visent à une meilleure connaissance de la ressource forestière grâce à ces nouvelles technologies : nous pouvons maintenant évaluer la ressource avec une précision de l’ordre de 80 %.
Nous avons besoin de représentations mathématiques de très vastes étendues forestières, mais le recours à la technologie LIDAR coûte cher et la France est malheureusement en retard par rapport à ses voisins alpins : la Suisse, l’Autriche, les provinces autonomes italiennes en sont à la deuxième campagne d’acquisition de ce genre de données. En France, la montagne ne couvre que 25 % du territoire et l’acquisition de données n’a pas été considérée comme prioritaire ; c’est pourtant dans les massifs qu’on rencontre des chutes de pierre, des avalanches, la fonte de glaces, des crues torrentielles… Des programmes d’acquisition à vaste échelle sont donc indispensables.
Nous faisons un effort de communication : nous transmettons nos travaux aux services déconcentrés de l’État, en particulier aux directions régionales de l’agriculture et de la forêt, mais aussi à nos collègues de l’Office national des forêts et aux centres régionaux de la propriété forestière. Nous intervenons dans les écoles et les universités comme auprès des conseils généraux et des autres collectivités, notamment auprès des communautés de communes. Beaucoup de ces dernières, surtout en Isère, commencent d’ailleurs à envisager de financer leurs propres acquisitions de données LIDAR et donc leur propre cartographie de la ressource forestière et des fonctions de la forêt.
J’ajoute que, dans le cadre du Plan d’adaptation au changement climatique, le ministère de l’agriculture nous a confié une cartographie des forêts à fonction de protection : nous travaillons aujourd’hui sur un département pilote, l’Isère, ainsi que sur les Pyrénées. Nous avons ainsi pu développer une méthode de cartographie des forêts à fonction de protection contre les avalanches et les chutes de pierre. Il est tout à fait essentiel de continuer ces travaux, qui tiennent à la fois de la recherche et du développement.
Pour apprécier les effets du changement climatique, il est nécessaire d’avoir du recul : le forestier y est habitué mais, pour cela, il a besoin d’observatoires – d’observations, d’observateurs, d’instruments de mesure. La Zone Atelier Alpes est un exemple de ce qu’il faut faire. Malheureusement, s’il est relativement facile de trouver des financements pour créer un observatoire, l’argent manque très souvent pour le faire fonctionner. Si je puis m’autoriser un souhait, ce serait celui-ci : donnez-nous les moyens de maintenir ces instruments de recherche !
Enfin, il faut avoir accès à la ressource : il faut aménager le territoire, planifier… Certains secteurs forestiers sont sous-exploités et la dynamique des peuplements y est catastrophique : il faut donc faire renaître des compétences que nous avons malheureusement perdues. Ainsi l’usage du câble pour l’exploitation de la forêt était une compétence assez forte en France dans l’entre-deux-guerres, mais elle s’est perdue à la fin de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, il n’y a plus sur le territoire alpin que trois câblistes… Il faut aider ces entreprises. Il faut une politique volontaire pour aller chercher la ressource, notamment le bois-énergie.
Mme Catherine Quéré, présidente. Merci, messieurs, pour la qualité et pour la précision de vos interventions. Je vous prie d’excuser le départ de nos collègues, notamment ceux membres de la mission d’information sur l’écotaxe poids-lourds.
14. Table ronde sur les « plans d’adaptation au changement climatique » (16 avril 2014)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé la création d’une mission d’information sur les conséquences géographiques, économiques et sociales des changements climatiques en France, présidée par notre collègue Martial Saddier et dont la rapporteure est Mme Sophie Errante. Dans ce cadre, c’est la 4e table ronde que nous organisons. La première table ronde, le 27 novembre 2013, a permis d’évoquer le 5e rapport du groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). La seconde, le 23 janvier dernier, sur l’impact des transitions écologique et agricole sur les territoires et les paysages, a réuni certains des co-auteurs de l’ouvrage « Paysages de l’après-pétrole ». La troisième table ronde, le 12 février dernier, a analysé de manière plus concrète les impacts des changements climatiques sur l’agriculture, les écosystèmes forestiers, les espaces littoraux et les côtes, les territoires de montagne.
Aujourd’hui, la table ronde est consacrée aux plans d’adaptation aux changements climatiques. Nous accueillons avec plaisir :
- M. Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), qui fera le point sur le premier plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2011-2015 et son évaluation à mi-parcours ;
- M. Michel Pascal, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Nord-Pas-de-Calais, qui illustrera un plan d’adaptation infra-national par l’exemple de la région Nord-Pas-de-Calais, région littorale qui présente des aires urbaines très denses ;
- M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes, qui nous présentera le plan d’adaptation infra-national mis en place dans la région Rhône-Alpes et le bassin Rhône-Méditerranée. Il s’agit d’un territoire à la fois urbanisé, agricole, industriel et touristique dans lequel la gestion de l’eau est essentielle ;
- M. Michel Ray, vice-président délégué d’Advancity, pôle de compétitivité « Ville et Mobilités durables », dont l’objet est de rechercher et de promouvoir des solutions innovantes pour un développement urbain et énergétique durable.
M. Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC). Je remercie votre commission de me permettre de vous parler du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC).
Le développement durable et la transition écologique de la France sont engagés alors que le climat est d’ores et déjà en évolution. Pour y répondre, un plan national d’adaptation au changement climatique couvrant la période 2011-2015 a été publié en juillet 2011. Ce plan décline en mesures opérationnelles les recommandations issues de la large concertation nationale et régionale organisée en 2010.
Le PNACC comporte 84 actions, qui concernent différents ministères et agences publiques, destinées à renforcer la préparation et la résilience de la France face à l’évolution inéluctable du climat. Ces actions sont regroupées en 20 thèmes. Le plan prévoit un bilan à mi-parcours en 2013, bilan que nous avons présenté en janvier 2014 au Conseil national de la transition écologique (CNTE) et qui rend compte de la mise en œuvre de la politique nationale d’adaptation.
Nous constatons à mi-parcours que l’exécution technique des actions enregistre une progression satisfaisante : 92 % des actions ont démarré et 60 % du budget identifié a été engagé, soit un peu plus de 100 millions d’euros. Malgré le contexte budgétaire difficile depuis 2011, le budget actualisé s’élève à 168 millions d’euros – contre 171 millions initialement programmés –, 60 % des actions sont en phase avec les objectifs initiaux, 5 % sont abandonnées ou ajournées, pour des raisons de pertinence ou d’insuffisance de moyens, et 35 % pourraient n’atteindre qu’une partie de leurs objectifs initiaux.
Le cadre fourni par le PNACC contribue par ailleurs à inscrire les actions décidées en 2011 dans la durée et crée des effets leviers propres à mobiliser de nouveaux moyens, en particulier la création de compétences intersectorielles et interministérielles. Les outils du PNACC permettent en outre de mieux planifier l’adaptation au niveau régional et local dans le cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et des plans climat-énergie territoriaux (PCET).
Le PNACC a notamment permis à ce jour d’améliorer la connaissance du changement climatique au niveau national et de donner accès gratuitement aux projections climatiques à haute résolution – avant d’entrer dans la phase de réglementation proprement dite qui, elle, n’interviendra dans les prochaines années –, d’intégrer l’élévation du niveau de la mer dans les zonages de risques littoraux, d’adopter une méthodologie en vue de définir le risque acceptable face aux aléas climatiques, et de revoir les normes des infrastructures de transport.
Le point d’étape sera suivi en 2015 d’une évaluation globale approfondie visant à déterminer les orientations futures de la politique d’adaptation sur des thèmes moins avancés à ce jour tels que la prospective économique, le secteur de la pêche aquaculture et le tourisme.
Le prochain PNACC ne ressemblera donc pas nécessairement au premier, d’autant que l’adaptation est une politique de l’anticipation qui s’inscrit dans une perspective de long terme. Elle constitue pour nous un axe essentiel qui doit être pris en compte comme un paramètre additionnel.
M. Michel Pascal, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Nord-Pas-de-Calais. La politique d’adaptation au changement climatique dans la région Nord-Pas-de-Calais s’est illustrée essentiellement par la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) copiloté par le préfet de région et le président du conseil régional. Grâce à la forte mobilisation des acteurs, nous avons élaboré des orientations précises et leur déclinaison concrète dans l’ensemble des politiques publiques.
Le SRCAE prévoit en premier lieu la réduction des émissions de gaz à effets de serre dans tous les domaines d’activité – industrie, tertiaire, transports – et le développement des énergies renouvelables. Je précise que la part des énergies renouvelables dans la fabrication d’électricité est en moyenne de 11 % en France mais qu’elle se limite dans notre région à 3 % pour la bonne raison que nous n’avons aucun barrage. C’est pourquoi nous avons décidé non pas de doubler notre production, conformément à l’objectif national, ce qui reviendrait à passer de 2 à 6 %, mais de la quadrupler. Cela montre qu’une politique régionale peut aller plus loin que la politique nationale.
Le SRCAE fixe aussi de nouveaux objectifs en matière d’urbanisation. Depuis dix ans, l’artificialisation des territoires a explosé dans la région, passant de 500 à 1 500 hectares par an. Sans aller jusqu’à supprimer l’artificialisation, nous souhaitons revenir à la dynamique qui prévalait de 1990 à 2000, et un des moyens en sera la densification autour des gares. Toutes ces orientations ont fait l’objet de documents d’application actuellement étudiés par le conseil régional.
Notre région est engagée dans une dynamique climat qui associe l’État, le conseil régional, l’ADEME, les deux conseils généraux, et leurs représentants se réunissent tous les deux mois pour faire avancer le SRCAE. Cette dynamique a par exemple suscité la création d’un observatoire régional de l’énergie et du climat qui permet de mesurer l’effet des politiques que nous menons.
Le schéma régional comporte en outre huit orientations liées à l’adaptation des territoires au changement climatique. S’agissant de la gestion de l’eau, nous avons contribué à l’élaboration du nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Notre région, si elle n’a pas de problème quantitatif s’agissant de l’eau, connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.
Le schéma régional propose en outre d’utiliser la nature pour prévenir les îlots de chaleur en ville.
Nous envisageons d’étudier, en collaboration avec l’INRA, l’évolution des pratiques agricoles car dans ce domaine nous devons savoir avec précision vers quoi nous souhaitons aller.
L’action la plus avancée est celle relative aux effets du changement climatique sur le littoral, afin de lutter contre les submersions marines, et grâce aux études menées depuis 2006 nous détenons désormais des mesures prospectives très précises concernant l’élévation du niveau de la mer. Ces études nous ont permis de constater le mauvais état de 90 % des dunes et de 25 % des ouvrages en dur et nous savons désormais que 20 000 personnes vivent, en regard des submersions marines, dans des conditions de précarité identiques à celles des victimes de la tempête Xynthia. Dans le cadre du programme de prévention des risques littoraux, nous avons constitué une cellule technique regroupant le conseil régional et le syndicat mixte de la Côte d’Opale et nous avons élaboré un plan d’action de travaux dont le coût est évalué entre 200 et 300 millions d’euros – c’est peu comparé au milliard d’euros que les Pays-Bas ont décidé d’engager chaque année jusqu’en 2100 dans le plan Delta, avec une gouvernance centrale qui plus est, alors que nous avons, nous, 25 propriétaires d’ouvrages de défense contre la mer. C’est trop, c’est pourquoi nous procédons actuellement à la constitution d’une gouvernance unique.
Nous avons étudié la situation du delta de l’Aa. Ce polder, situé entre Calais et Dunkerque, sur lequel vivent 500 000 personnes, perdure depuis six siècles grâce à un système d’assèchement. Agricole à l’origine, ce territoire s’est progressivement industrialisé, et on y trouve même aujourd’hui une centrale nucléaire, celle de Gravelines. Or à un horizon de dix ans, le système de pompage ne fonctionnera plus. L’institution des wateringues nous a demandé d’étudier un plan de financement et de mettre en place une nouvelle gouvernance pour accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable du territoire.
M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes se caractérise par de forts contrastes : 16 % de la croissance démographique française sur seulement 8 % du territoire, une population concentrée dans les fonds de vallée, deux tiers de communes de montagne ; la région occupe la 6e place des PIB les plus élevés au niveau européen, mais son tissu industriel est très dépendant de la météo ; son économie repose sur des secteurs classiques – agriculture, forêt, tourisme – mais elle est aussi la première région hydroélectrique, du fait de la présence de nombreux barrages, ainsi que la première région nucléaire d’Europe.
La ressource en eau est totalement centrale dans notre région. Bien qu’elle abrite deux fleuves – le Rhône et la Loire – et trois des plus grands lacs de France – le Léman, Le Bourget et Annecy – la moitié du territoire rhônalpin est composé de nappes ou de bassins-versants en situation de déficit ou de tension. Cela nous a amenés à élaborer un plan d’adaptation aux effets du changement climatique dont le but est de gérer la ressource en eau dans le cadre du bassin Rhône-Méditerranée.
Cette initiative, soutenue par l’Agence de l’eau, a bénéficié de la contribution d’un collège d’experts, en particulier Hervé Le Treut, dont le rapport scientifique a permis de dresser des projections et d’analyser la vulnérabilité de différents secteurs du bassin au regard de critères comme la ressource en eau, le bilan hydrique des sols, la biodiversité, l’enneigement. Le plan propose une « boîte à outils » pour les politiques publiques ainsi que des mesures originales et prospectives, notamment pour les secteurs les plus vulnérables.
Le changement climatique s’observe déjà dans la région Rhône-Alpes. L’élévation moyenne du réchauffement de l’atmosphère s’élève à 0,74 ° Celsius sur la planète et à 0,9 ° en France, mais elle atteint 1,5 ° dans les Alpes. Cette différence explique pourquoi la question de l’adaptation était déjà prise en compte il y a cinq ans lors de l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), comme elle explique la présence d’un chapitre transversal dédié à cette question et la création de l’observatoire régional des effets du changement climatique (ORECC) dédié à la diffusion des connaissances dans la région, et l’affluence constatée lors de son installation, en novembre dernier, notamment de la part des collectivités, est un très bon signe.
Au-delà de la consolidation des données, nous avons choisi d’orienter les travaux de l’ORECC vers la production d’indicateurs adaptés à notre territoire et ses usages en insistant sur la participation de tous les acteurs à l’adaptation. Deux groupes de travail ont été mis en place, l’un sur l’agriculture et l’autre sur le tourisme.
Le tourisme est le moteur de l’économie hivernale de notre région qui représente 9 % du nombre de nuitées au niveau national, dont 41 % pendant la saison hivernale. La région Rhône-Alpes est le plus grand domaine skiable du monde – elle a d’ailleurs accueilli trois fois les Jeux Olympiques.
Le groupe tourisme de l’ORECC a établi un diagnostic sur les impacts du changement climatique et analysé le degré de vulnérabilité de chacun des 106 domaines skiables de la région, dont 60 se situent en dessous de 1 500 m et 17 en dessous de 1 200 m. Ces altitudes sont particulièrement critiques puisque 1 200 m est l’altitude minimale qui assure aujourd’hui la viabilité économique d’un domaine, en fonction de la durée d’enneigement, mais avec le réchauffement attendu, la barre critique des 1 500, voire des 1 800 m, sera franchie.
Face à cette réalité, le groupe tourisme a évoqué la possibilité d’utiliser l’enneigement artificiel, technique particulièrement développée dans notre région, mais il s’agit là d’une question très sensible. Il faut avant tout éviter un débat manichéen et définir dans quels cas elle peut être une réponse adaptée.
M. Michel Ray, vice-président délégué d’Advancity, pôle de compétitivité « Ville et Mobilités durables ». Advancity est un pôle de compétitivité dédié à la ville et aux mobilités durables qui travaille depuis 2005 sur les innovations urbaines. C’est donc tout naturellement que nous avons soutenu des projets de recherche et d’innovation liés à l’adaptation au changement climatique.
Advancity regroupe aujourd’hui plus de 240 membres qui forment un véritable écosystème multi-acteurs. Ce sont 160 PME très innovantes, 18 grands groupes leaders mondiaux, plus de 30 établissements d’enseignement et de recherche, dont les grands organismes techniques du ministère de l’écologie, et plus de 30 collectivités territoriales de toutes tailles qui explorent ensemble les champs d’innovation urbaine au sein de quatre comités stratégiques, véritables ateliers d’émergence de projets innovants, de produits et de services dédiés à la ville de demain.
Selon le dernier rapport du GIEC, de nombreux risques liés au changement climatique se concentrent dans les villes.
Le premier de ces risques, ce sont les vagues de chaleur qui, nous en sommes quasiment certains, seront plus intenses, plus longues et environ cinq fois plus fréquentes en 2050. Cette situation est nettement aggravée dans les villes du fait de l’apparition d’îlots de chaleur qui ont des conséquences dramatiques sur les personnes vulnérables – n’oublions pas que la canicule de 2003 a entraîné environ 20 000 morts « supplémentaires ».
L’étude EPICEA – Étude pluridisciplinaire des impacts du changement climatique à l’échelle de l’agglomération parisienne – menée par la Ville de Paris, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Météo France et l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) sur les îlots de chaleur a montré que la différence maximale de température entre le cœur de la ville et la campagne en 2003 a atteint 8 ° Celsius.
L’étude a évalué les impacts de plusieurs actions préventives, en particulier l’évolution de l’albédo – nous savons que la couleur blanche réfléchit plus la lumière – la végétalisation des toits et des façades, l’évaporation produite par l’humidification des rues, mais leur combinaison réduirait les effets des îlots de chaleur de 2 ° Celsius, ce qui est très utile mais insuffisant face à l’ampleur de l’enjeu.
Le projet de recherche VegDUD « Rôle du végétal dans le développement urbain durable », en cours d’achèvement, confirme les bienfaits du végétal, reflète la grande complexité des phénomènes urbains, permet d’améliorer significativement la modélisation et facilite le choix des espèces végétales à utiliser en fonction du lieu et des contraintes hydriques.
Le projet de recherche MUSCADE – Modélisation urbaine et stratégie d’adaptation au changement climatique pour anticiper la demande et la production énergétique – qui s’est achevé fin 2013, modélise le climat du territoire de Paris via des scénarios intégrés et caractérise les vulnérabilités urbaines face au changement climatique. Le projet souligne le risque de généralisation de la climatisation électrique, avec ses conséquences sur les plans énergétique et esthétique, et met en avant le rôle clé du comportement des habitants, notamment pour le confort d’été.
Le deuxième risque majeur pour les villes est la survenue d’inondations exceptionnelles. Celles-ci appartiennent à trois catégories : les inondations à montée plus ou moins lente, qui ont de graves conséquences économiques – du type de la crue de 1910 à Paris ; les inondations subites, liées à des précipitations de plus en plus intenses, qui ont des conséquences humaines et économiques ; les inondations de zones urbanisées côtières liées à la combinaison de plusieurs facteurs – niveau de la mer, dépression, houle.
Afin de développer la résilience urbaine au changement climatique, Advancity a labellisé le projet Resilis, qui a abouti fin 2013. Ce projet vise à développer des solutions innovantes pour l’amélioration de la ville, notamment les villes moyennes, grâce à trois leviers : une amélioration de la gouvernance des systèmes urbains, une gestion optimisée des réseaux techniques structurants, une implication accrue de la population. Il a permis la formalisation d’une démarche intégrée pour les collectivités territoriales et la proposition d’indicateurs de vulnérabilité climatique et des remèdes associés, assorties d’un document de recommandations et d’une série d’outils concrets.
Le troisième risque, ce sont les vents extrêmes, dont la tempête de 1999 fut un exemple dramatique. Leur évolution liée au changement climatique fait l’objet de longues discussions scientifiques, mais c’est maintenant que les maîtres d’ouvrage, notamment dans le cas de construction ou de réhabilitation d’infrastructures, doivent prendre des décisions opérationnelles.
En conclusion, voici quatre réflexions, essentiellement inspirées par les constatations faites sur le terrain par notre écosystème, assorties de pistes d’action.
Si, pendant des millénaires, l’adaptation humaine au climat a été réactive, la vitesse à laquelle se produit le changement climatique actuel, comparée au temps nécessaire pour adapter les villes, exige une adaptation beaucoup plus anticipative. Or nos écosystèmes sont peu habitués à cela. Nous devons donc multiplier et intensifier de véritables incitations pour devenir plus proactifs et amener les acteurs à travailler de façon plus concertée sur un sujet éminemment transversal. Il faut donc accentuer la créativité des offres et pour cela faire en sorte que les cahiers des charges, en amont, fassent mention de l’adaptation au changement climatique. Il faut aussi généraliser, comme le demande le PNACC, l’utilisation des contrats de délégation de service public pour inciter tous les acteurs concernés à se mobiliser.
Par ailleurs, la notion juridique actuelle de « force majeure », associée par exemple à un événement climatique centennal, peut s’avérer inappropriée, d’une part parce que l’emploi du mot « imprévisible » est ambigu, compte tenu de l’état de nos connaissances actuelles, et d’autre part parce qu’elle comporte un risque de déresponsabilisation des acteurs, que le recours à cette notion pourrait dissuader d’entreprendre des démarches préventives.
Deuxième piste de réflexion : les incertitudes qui entourent les événements climatiques exceptionnels seront malheureusement fortes et durables. Or leur évolution est absolument déterminante pour déterminer le dimensionnement des infrastructures. Il faut aider les maîtres d’ouvrage, faute de quoi ils préféreront ne pas agir dès maintenant.
En matière d’adaptation au changement climatique, les approches trop normatives peuvent exiger des travaux de réalisation parfois inutiles et très coûteux. L’approche reposant sur une analyse pluridisciplinaire des risques est plus appropriée et nettement moins coûteuse en travaux. Nous avons fait des recommandations en ce sens aux Directions des routes de plusieurs pays européens et elles semblent avoir été appréciées (projet européen RIMAROCC).
Troisième réflexion : il est essentiel de disposer d’études de qualité sur ces sujets nouveaux et complexes que sont la vulnérabilité et la résilience : trois ans avant Katrina, une étude fédérale américaine avait identifié avec précision les cinq principaux facteurs de risque pour la Nouvelle-Orléans.
Je fais à cet égard trois propositions concrètes : investir dans l’expertise des personnes qui réaliseront les études sur le terrain, affecter des enveloppes suffisantes à la réalisation d’études d’adaptation et de résilience, et valoriser effectivement et rapidement les résultats les plus intéressants de la recherche et de l’innovation.
Ma dernière piste de réflexion est de professionnaliser les capitalisations d’expériences sur les diagnostics sectoriels, ce qui nécessite de créer des réseaux très réactifs et surtout multiacteurs.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous parlons d’adaptation au changement climatique, mais il n’en faut pas pour autant oublier le volet atténuation.
La France s’est dotée en 2011 d’un plan national et les collectivités territoriales ont à leur disposition un certain nombre d’outils – SRCAE, PCET – permettant d’atténuer les effets du réchauffement. J’aimerais pour ma part que le plan national soit débattu au Parlement et fasse l’objet d’un vote avant d’être mis en œuvre par les collectivités territoriales, mais il faudrait pour cela adapter les outils des collectivités. Qu’en pensez-vous ?
Les collectivités territoriales, l’État, les administrations et les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans l’adaptation.
M. Arnaud Leroy. Au nom du groupe SRC, je vous remercie, messieurs, pour la qualité de vos présentations.
Vous soulignez la nécessité d’inscrire votre action à la suite d’un plan national et vous saluez la mise en place des observatoires régionaux. Je pense pour ma part que la région est le bon niveau car elle est à même de prendre en considération la pluralité des paysages, de la faune et de la flore de chaque territoire.
L’adaptation exige-t-elle que nous menions une politique publique nationale du climat ? Aujourd’hui l’adaptation fait l’objet de peu de contraintes. Devons-nous nous satisfaire des plans régionaux ou nous doter de nouveaux instruments législatifs ?
Nous savons que 20 % des crédits européens ont été fléchés vers l’action climatique et qu’une discussion est en cours pour décider de leur affectation. Les observatoires régionaux et l’ONERC sont-ils associés à cette discussion ?
M. Martial Saddier. Les députés du groupe UMP se réjouissent de la prise de conscience collective de l’enjeu que représente le réchauffement climatique. C’est le cas au sein même de l’Assemblée nationale et la Commission du développement durable y est pour beaucoup. Mais pour que nos démarches soient réellement efficaces, cette prise de conscience doit être internationale et nous espérons que la Conférence internationale y parviendra en décembre 2015.
Si nous sommes là aujourd’hui, c’est que la loi Grenelle 1, dans son article 42, a imposé à notre République un plan d’adaptation au réchauffement climatique.
Vous évoquez un budget de 168 millions d’euros : cette somme se rapproche des objectifs initialement fixés et nous en prenons acte, mais quel est, selon vous, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, le budget idéal pour les collectivités territoriales ? Existe-t-il des pistes de ressources nouvelles ou pérennes ?
Quels sont les secteurs qui méritent d’être renforcés ?
La multiplication du nombre des acteurs vous semble-t-elle justifiée alors que se profile la baisse de 20 à 25 % des dotations aux collectivités territoriales ? Il nous faudra bien un jour simplifier l’échelon territorial et lui assurer des ressources pérennes.
Que pensez-vous du « big bang » territorial annoncé par le Premier ministre ? Quel est l’échelon territorial le plus adapté pour le plan d’adaptation au changement climatique ?
Enfin, nous avons connu cet hiver de graves pics de pollution. Le prochain plan d’adaptation au changement climatique devra-t-il tenir compte de la qualité de l’air ?
M. Jean-Paul Chanteguet. Les SRCAE rapprochent les questions du climat et de l’air, et à votre demande, mon cher collègue, la loi sur la transition énergétique abordera le problème de la qualité de l’air.
M. Yannick Favennec. Le groupe UDI considère qu’il est urgent de nous adapter aux conséquences du changement climatique.
Les rapports du GIEC, outre leur intérêt scientifique, jouent un rôle politique majeur dans la perspective de la 21e Conférence des parties à la Convention de l’ONU sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015.
Selon les experts du GIEC, il nous est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 2 ° par rapport à ce qu’il était durant l’ère préindustrielle, mais cela implique d’agir vite afin de réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 à 70 % d’ici à 2050. L’Union européenne a récemment annoncé qu’elle adopterait dans le courant de cette année un programme de réduction des émissions pour 2030, mais tant que les plus grands émetteurs de gaz à effets de serre que sont la Chine et les États-Unis ne prendront pas les mesures qui s’imposent, il sera impossible de limiter la hausse du thermomètre sur la planète. Quel est votre point de vue sur cette question ?
M. Patrice Carvalho. Je m’exprime au nom du groupe GDR. Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), issu de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de l’environnement, définit des mesures concrètes et opérationnelles visant à préparer la France, à partir de 2011 et à échéance de 2015, à faire face aux nouvelles conditions climatiques.
Ces dernières sont identifiées à l’horizon du 21e siècle : hausse des températures, multiplication des périodes de canicule, sécheresses de plus en plus sévères. Ce processus affectera la vie de nos concitoyens et de nombreux secteurs d’activité dont l’agriculture, le tourisme, le BTP, les infrastructures.
Le PNACC accompagne et complète les actions de réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ses intentions sont bonnes et je m’en félicite, mais ce qui intéresse les Français ce sont ses implications pratiques. Je prendrai deux exemples.
Nos grandes agglomérations ont récemment été confrontées à un pic de pollution qui s’est traduit par des mesures de réduction de la vitesse des véhicules puis, en Ile-de-France, par une journée de circulation alternée alors que nous nous trouvions à la fin du pic et que la mesure n’a pas été reconduite le lendemain. Cette disposition relevait plus de l’opération de communication que d’une véritable adaptation à l’une des manifestations du changement climatique. Elle a néanmoins mobilisé quelques milliers de policiers pour verbaliser les automobilistes – qui avaient été prévenus la veille ! – et surpris les mères de famille accompagnant leurs enfants à l’école qui n’ont pas été verbalisées à l’aller car elles entraient de ce fait dans le cadre du covoiturage, mais l’ont été au retour puisque les enfants n’étaient plus dans le véhicule. J’ajoute que la circulation alternée n’est pas une bonne solution car elle peut être contournée par les ménages qui possèdent deux véhicules.
Dans ce cas concret, avons-nous été à la hauteur des enjeux ? Quid du plan national d’adaptation ?
Nos concitoyens sont prêts à observer des règles – fussent-elles contraignantes – mais à condition qu’elles soient clairement définies et expliquées, et non édictées en fonction des circonstances et sans effets concrets.
Je suis naturellement favorable aux énergies alternatives, à condition toutefois qu’elles aient des effets réels sur le changement climatique. Prenons l’exemple de l’éolien : la législation a récemment évolué pour faciliter son déploiement sur tout le territoire. Mais la production d’énergie éolienne étant par nature intermittente, il faudra doubler le kilowatt issu de l’éolien par un kilowatt provenant de centrales thermiques, au gaz et à charbon, qui sont polluantes et émettrices de CO2.
Nous risquons donc de nous retrouver avec, sur notre sol, des milliers d’éoliennes à faible rendement qui nuisent à nos paysages et à la qualité de vie de nos concitoyens, sans compter les millions de m3 de cailloux, de gravats et de ciment enfouis en terre, alors que dans le même temps on refuse l’ouverture de nouvelles gravières ou l’extension de carrières.
Nos voisins allemands remettent en cause le développement de l’éolien et envisagent de cesser les incitations financières accordées à une solution qui surenchérit le prix du kilowattheure et aggrave les émissions de CO2.
Le choix entre différentes énergies est nécessaire si nous voulons que nos plans d’adaptation au changement climatique soient réellement opérationnels, mais je ne suis pas sûr que nous soyons dans cette logique aujourd’hui. D’autres énergies gagneraient à être développées, comme la biomasse, la géothermie.
Mme Laurence Abeille. Le groupe Écologiste considère que la lutte contre l’aggravation du changement climatique est essentielle, même si aborder cette question de façon globale nous éloigne souvent des solutions concrètes. Les solutions se trouvent naturellement dans la remise en cause de nos transports publics, de nos productions d’énergie, de nos modes de construction... Le monde doit se transformer pour cesser de s’autodétruire. Pour autant, le catastrophisme qui entoure cette question est souvent contre-productif.
Cela dit, les nouvelles échéances évoquées par le GIEC concernent notre propre existence, et non plus celle de nos enfants ou de nos petits-enfants, ce qui, je l’espère, convaincra les responsables politiques de la nécessité d’engager l’adaptation.
Nous examinerons dans les prochaines semaines le projet de loi relatif à la biodiversité qui, j’en suis persuadée, sera un levier d’action pertinent pour infléchir le changement climatique.
En ce qui concerne les îlots de chaleur, j’avais proposé dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, devenu la loi ALUR, l’obligation de végétaliser les toitures plates, des centres commerciaux et des bâtiments. Ma proposition a été refusée et l’obligation est devenue une simple option. Cela a pourtant été accepté très facilement ailleurs, dans la ville de Bâle par exemple.
Certes, les toitures végétalisées ne peuvent à elles seules enrayer le changement climatique, mais le cumul d’un certain nombre de mesures du même ordre pourrait réduire les îlots de chaleur, abaisser les températures et améliorer la qualité de l’air en milieu urbain. Quelles solutions concrètes pouvez-vous nous proposer ?
Nous savons qu’une grande partie de la pollution en milieu urbain est due à la circulation automobile. Que faire pour y remédier ?
M. Olivier Falorni. Les députés du groupe RRDP se félicitent de cet échange qui survient au moment où le GIEC publie le dernier tome de son cinquième rapport d’évaluation.
Sous le double effet de la croissance économique et de la démographie, notre rythme de carbonisation s’accélère. Le bilan carbone de ces 40 dernières années est supérieur à celui des 200 premières années de la révolution industrielle et à moins d’un changement radical de cap, l’avenir ne s’annonce pas meilleur.
Or, comme le soulignent les auteurs du rapport, nous disposons des outils et des technologies nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique et stabiliser le réchauffement à 2 °. Nous savons en traiter les causes. Nous avons les moyens de procéder à la décarbonisation de nos organisations et de changer la gouvernance mondiale du climat. Il appartiendra à la Conférence de 2015 de rédiger un accord en ce sens.
Le réchauffement climatique modifie notre environnement. Ainsi, dans ma circonscription, les tempêtes de l’hiver ont fait reculer les cordons dunaires de plusieurs dizaines de mètres. Et l’hypothèse – optimiste – d’une hausse de 40 cm du niveau marin à la fin du siècle entraînera une modification considérable des paysages. Face à cela, quelle stratégie devons-nous adopter ? Devons-nous mettre en place une stratégie de défense – enrochements, digues – sur certains sites et accepter le risque sur d’autres parties du littoral ? Devons-nous envisager un repli stratégique pour les villes situées directement en bord de mer ?
Comment évaluer l’impact de l’augmentation de la température et de la modification du régime des précipitations sur les activités économiques ?
Le Plan national d’adaptation au changement climatique prend en compte la montée du niveau de la mer et l’évolution du trait de côte pour la gestion et l’aménagement des zones littorales. Il s’agit d’intégrer dès à présent leurs conséquences, en termes de risques, dans les plans de prévention des risques littoraux, les fameux PPRL. Dans ma circonscription, en particulier l’île de Ré, les zones à risque ont été évaluées et les services de l’État et des collectivités locales déterminent actuellement la carte des aléas. Dans certaines modélisations, cette carte est nettement surdimensionnée. Ainsi le canton nord de l’île disparaît totalement sous les eaux et, avec lui, toutes les autorisations liées au droit du sol, à savoir les permis de construire et les déclarations de travaux.
Je suis conscient de l’enjeu que constitue l’adaptation au changement climatique, mais veillons à ne pas prendre des mesures excessives qui sont, vis-à-vis de la population, totalement contre-productives.
L’adaptation réglementaire induite par ces cartes obligera les propriétaires à entreprendre des travaux. Il serait peut-être utile que les assurances disposent d’un fonds d’adaptation leur permettant d’aider leurs clients à réaliser les aménagements propres à réduire les risques. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Jacques Cottel. Contrairement à notre collègue Carvalho, j’ai l’impression que le développement de l’éolien fait encore l’objet de certains freins, en particulier dans le sud du département du Pas-de-Calais où, bien qu’aucune contrainte ne s’y oppose, les permis de construire sont refusés suite à l’avis négatif de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages.
La gestion de l’eau est un enjeu majeur qui mérite que nous approfondissions la concertation avec différents acteurs, ce qui n’est pas toujours facile.
Pour ce qui est du meilleur niveau territorial, je me pose moi aussi la question. Un certain nombre de collectivités territoriales, notamment rurales, ont pris des mesures utiles et montré leur solidarité en alimentant en eau potable leurs voisins urbains. Comment prendre en compte leurs efforts ?
M. Jean-Pierre Vigier. Le Plan national d’adaptation au changement climatique présenté en 2011 était censé refléter une vision stratégique et efficace à travers des mesures concrètes permettant à notre pays de tirer parti des changements climatiques.
Or, trois ans après, le GIEC publie un rapport très alarmiste qui souligne en particulier la nette hausse des températures et l’accélération des conséquences néfastes des gaz à effets de serre pour l’homme et l’environnement. Comment articuler les efforts de la France et de l’Europe avec l’industrialisation croissante des pays émergents, notamment de la Chine ?
M. Jean-Louis Bricout. Les prochains programmes d’intervention des agences de l’eau 2013-2018 devraient intégrer les enjeux du changement climatique. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quelle traduction concrète peut-on attendre des agences, en particulier de celle du bassin Artois-Picardie ?
M. Laurent Furst. Parmi les risques que vous avez évoqués, l’aggravation du risque d’inondations, notamment en milieu urbain, me semble particulièrement redoutable. Ce risque doit nous inciter à modifier notre perception du territoire, de la ville, des constructions. Mais nous sommes confrontés à une addition de lois et de réglementations qui, bien que traduisant la bonne volonté de leurs auteurs, tuent l’enthousiasme et freinent l’avenir d’une communauté, voire d’un pays. Le temps est venu de hiérarchiser les contraintes. Qu’en pensez-vous ?
Mme Sophie Rohfritsch. Pourquoi l’identification des secteurs industriels sensibles au changement climatique a-t-elle été reportée ? Que pouvons-nous proposer aux industriels pour les aider à adapter leurs filières ?
Bien que nous ne soyons pas encore dotés des outils technologiques capables de mesurer toutes les particules susceptibles de modifier notre environnement, quelles sont les avancées de la recherche en matière d’analyse et de surveillance aérobiologique ?
Quel est votre sentiment sur le report – je crains pour ma part un abandon… – à 2050 des projets Saône-Moselle et Saône-Rhin ?
Enfin, dans l’optique de la cité durable, est-ce que quelqu’un envisage la réintroduction du cheval cantonnier ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cette proposition m’est particulièrement sympathique, chère collègue… (Sourires)
M. Nicolas Bériot. La situation de la Chine et des États-Unis n’est pas aussi mauvaise que ce que l’on dit parfois. Aux États-Unis, la conjoncture est relativement favorable car le président actuel est plutôt moteur en matière d’évolution climatique et le pays participe activement à la préparation de la Conférence de Paris.
Quant à la Chine, elle investit chaque année 100 milliards de dollars dans des infrastructures liées à l’énergie, mais les Chinois souhaitent que nous les aidions à orienter leurs investissements dans la bonne direction et nous demandent d’accélérer les transferts de technologie. Il leur est difficile de prendre des engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effets de serre car leur trajectoire de développement est encore loin du pic d’émissions, mais ils sont dans des dispositions favorables, en particulier sur le sujet des villes durables.
En outre, les dirigeants chinois subissent une très forte pression interne due à la pollution de l’air, ce qui plaide en faveur d’un changement de politique énergétique. Depuis 2013, les discours évoluent : le président chinois lui-même a évoqué la notion de « civilisation écologique » et la planification place la croissance au second plan derrière le développement harmonieux.
En ce qui concerne notre association aux travaux européens, l’Union européenne a adopté en mars 2013, après plusieurs années de travaux, une stratégie d’adaptation au changement climatique, sans oublier la DG Climat créée en 2010.
L’Europe a défini plusieurs axes de travail.
Le premier est la mise en commun de connaissances via une plateforme d’échanges, le site Climate-ADAPT, auquel nous contribuons. L’adaptation est une discipline très jeune et nous sommes tous des apprentis en la matière. Le plus important est d’échanger de la connaissance.
Le deuxième axe est l’intégration de l’adaptation dans les politiques publiques.
Le troisième consiste à promouvoir le traitement des questions au niveau transfrontalier afin, par exemple, d’amener les pays partageant un bassin fluvial à coordonner leur action.
Le quatrième axe tend à la mise en place d’outils d’incitation.
L’ONERC est associé à cette démarche. La Direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été désignée point focal français en matière d’adaptation.
Faut-il alourdir la réglementation ? Encore une fois, la discipline est très jeune et des transformations profondes nous attendent. Nous en sommes au stade du développement de nos connaissances. Il nous faut élargir notre regard et améliorer notre compréhension des systèmes que nous mettons en œuvre et leur dépendance par rapport à l’environnement, aux extrêmes, leur consommation de ressources naturelles, la variabilité climatique actuelle, la saturation de la ressource et la fragilité dans laquelle nous nous trouvons par rapport à toute évolution du climat.
Le moment d’entrer dans le dur de la réglementation n’est pas arrivé mais nous pouvons commencer à prendre en compte l’adaptation en prenant en compte cette question du changement de climat avant toute décision d’investissement, par exemple en demandant à des scientifiques, avant de procéder à toute nouvelle construction, une étude sur son adaptation au changement climatique.
Hervé Le Treut, directeur d’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace), membre de l’Académie des Sciences et modélisateur du climat, a animé en région Aquitaine un chantier pour lequel il a demandé à plusieurs dizaines de laboratoires de travailler ensemble. Cette expérience a été extrêmement riche.
En matière de réglementation, il convient de ne pas aller trop vite, faute de quoi nous risquons de prendre des dispositions contraires à l’adaptation. Nous devons plutôt nous projeter et envisager différents scénarios.
Réfléchir sur l’adaptation est une formidable porte d’entrée vers le développement durable et la transition écologique. Je dirai que l’on ressort d’un travail sur l’adaptation plus intelligent qu’avant d’y être entré…
Concernant l’industrie, l’adaptation au changement climatique relève d’une échelle de temps supérieure à celle de la planification des investissements et beaucoup d’entreprises travaillent avec une visibilité de quatre ou cinq ans. Ce sont les entreprises des secteurs de l’énergie ou des transports, qui réalisent des investissements plus importants, qui sont les plus investies dans la question de l’adaptation.
Je voudrais pour terminer vous parler de l’association des Entreprises pour l’environnement (EPE). Depuis près de trois ans, nous entretenons une relation de travail avec ce club de grandes entreprises investies dans les questions environnementales et nous venons de publier un guide intitulé « Les entreprises et l’adaptation au changement climatique » qui a rencontré, lors de sa présentation au début de ce mois, un très grand succès.
Présidence de M. Jean-Jacques Cottel
M. Nicolas Bériot. Pour ce qui est du budget, nous disposons aujourd’hui d’un plan national et avons identifié des éléments spécifiques. Il est cependant assez difficile de distinguer ce que l’adaptation ajoute dans un budget, car elle est par nature intégrée dans les politiques publiques. La période actuelle est, historiquement, celle où commence l’adaptation : il faudra donc faire ces bilans et développer cette perspective, mais l’urgence aujourd’hui ne semble pas être de déterminer un budget spécifique.
En matière de planification, l’évaluation qui sera menée en 2015 permettra de définir le mode de travail du prochain Plan national d'adaptation au changement climatique (PNAC), qui pourrait être moins généraliste que le premier et se focaliser par exemple sur certains secteurs ou sur des points durs de réglementation, en consacrant davantage d’études aux coûts.
Enfin, si les atteintes à la biodiversité ne sont pas liées au premier chef au changement climatique, qui n’est qu’un facteur parmi d’autres, tout ce qui maintient en bon état les équilibres écosystémiques et les milieux naturels leur donne plus de chances de traverser la période du changement climatique jusqu’à ce que le climat se stabilise à nouveau.
M. Michel Pascal. Depuis la promulgation de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), le schéma de cohérence territoriale (SCOT) a acquis une nouvelle importance.
En matière de gouvernance, il faut noter que la Direction générale énergie climat est la première à intégrer le climat dans son nom et que la DREAL comporte depuis 2007 un service énergie-climat.
Bien que de nombreux budgets ne portent pas l’étiquette « climat », le plus gros budget dont je dispose est paradoxalement celui qui est consacré au climat. La région Nord-Pas-de-Calais destine en effet 30 millions d’euros à la rénovation thermique des bâtiments, 40 millions d’euros à la construction de tramways et de transports en commun en site propre et une cinquantaine de millions d’euros à la prévention des risques littoraux liés notamment à l’élévation du niveau de la mer. S’il n’y a actuellement pas de plan régional climat (PRC), il serait tout à fait imaginable d’en concevoir un.
Pour ce qui est des normes, on peut faire un parallèle avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), où l’Agence de l’eau permet de disposer à la fois du « bâton », c’est-à-dire de la réglementation, et de la « carotte », c’est-à-dire des crédits. La synergie de ces deux outils a permis à l’Artois-Picardie de voir la qualité de l’eau progresser considérablement par rapport à ce qu’elle était voilà une quarantaine d’années.
À l’échelle européenne, nous sommes associés localement à la définition du nouveau Fonds européen de développement régional (FEDER), dont la gouvernance est désormais placée sous l’autorité des régions. Notre région a presque atteint le chiffre plancher de 20 % – le plafond étant de 35 %. En la matière, il s’agit surtout de donner envie, car on ne saurait par exemple imposer une réduction des émissions de gaz à effet de serre à la Chine ou aux États-Unis. Il peut à cet égard être intéressant de disposer des technologies appropriées et de marier l’économie et l’écologie – c’est précisément ce en quoi consiste, dans la région Nord-Pas-de-Calais, la « troisième révolution industrielle », avec des recherches portant notamment sur le stockage des énergies intermittentes et sur la diffusion des énergies renouvelables.
Les éoliennes ont leurs partisans et leurs adversaires : la réglementation dans ce domaine évolue souvent et le développement de l’éolien se heurte à des freins, par exemple à cause des radars. Des simplifications sont cependant en cours, avec le passage prévu de cinq procédures à une seule, qui fait l’objet d’une expérimentation et prévoit notamment, afin de réduire les délais, la fusion du permis de construire avec l’autorisation pour installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), dans le respect toutefois des paysages – ce qui peut se traduire, comme c’est le cas dans le sud du Pas-de-Calais, par la révocation d’autorisations accordées à des éoliennes à la suite d’une action en justice.
Pour ce qui est des liens entre air et énergie, je rappelle que nous disposons du schéma régional climat air énergie et du plan de protection de l’atmosphère. Dans ce domaine, il y a ce que l’on voit – les alertes intervenues récemment dans toute la France – et ce que l’on ne voit pas : la pollution de fond, qui cause dans notre pays 42 000 morts prématurées et que les politiques publiques visent à réduire. Dans la région Île-de-France, la circulation alternée a été bien appliquée par l’ensemble de la population, même s’il est clair qu’une telle mesure ne règle pas à elle seule tous les problèmes.
Le fait que les crédits alloués par l’Agence de l’eau à l’activité agricole représentent le double des redevances acquittées par la profession agricole témoigne de l’importance accordée à cette activité.
En matière de biodiversité, on observe dans la région Nord-Pas-de-Calais l’apparition de nouvelles espèces végétales et animales, qui migrent rapidement du Sud vers le Nord – comme les rougets, que l’on ne trouvait pas dans le port de Boulogne voilà quinze ans. Telle est bien du reste la logique des schémas régionaux de cohérence écologique.
Quant aux zones à risque évoquées par M. Falorni, il faut rappeler que les mesures prises ont pour objet d’éviter des morts. Ce n’est pas l’État qui crée le risque et la difficulté consiste à appliquer aujourd’hui un règlement visant à prévenir les effets d’un phénomène qui se manifestera dans 80 ans. Là où l’élévation prévue du niveau de l’eau atteint 60 centimètres, les maisons existantes sont conservées – sauf cas d’extrême urgence – et leurs propriétaires sont incités à se préparer, tandis que les nouvelles constructions sont proscrites.
M. Jean-Philippe Deneuvy. M. Pascal a évoqué à juste titre la nécessité de faire bouger les lignes et de réduire la pollution, chronique ou de pointe, liée à la circulation automobile en centre-ville. Il a également eu raison de souligner que, jusqu’à présent, les agences de l’eau répondaient essentiellement à une vision de court terme, avec des cycles de six ans, et que l’aide destinée aux économies d’eau, notamment pour les communes rurales, doivent désormais s’inscrire dans une vision de long terme. Ainsi, le plan d’adaptation au changement climatique de bassin a pour objectif un rendement de 85 % sur les réseaux, chiffre bien supérieur aux objectifs fixés ces dernières années.
Le « mille-feuille » constitué par l’État et les collectivités doit impérativement être réorganisé en vue d’une plus grande efficacité de nos actions grâce à une optimisation de nos moyens. La complexité des procédures ou de l’organisation procède souvent d’une absence de définition précise des responsabilités des différents acteurs et des objectifs poursuivis par les politiques publiques : on invente alors de nombreux outils qui contribuent certes au résultat, mais qui se superposent d’une manière très compliquée. Ces outils dont disposent aujourd’hui les collectivités gagneraient donc à être simplifiés et il conviendrait que la future loi de programmation sur la transition énergétique clarifie les objectifs et les responsabilités de chacun.
Par ailleurs, l’adaptation est encore très peu prise en compte. Ainsi, dans le cadre du plan climat énergie territorial (PCET), sur les 38 « obligés » de la région Rhône-Alpes, un très petit nombre des 33 documents reçus traitent ce sujet de manière approfondie. Dans ce domaine, l’État – notamment par le biais de l’ADEME et de l’Agence de l’eau – et le Conseil régional ont défini conjointement des schémas, comme le schéma régional de cohérence écologique, qui traite notamment de la biodiversité. Des observatoires sont également mis en place, comme l’Observatoire régional des effets du changement climatique ou l’Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre, ainsi que l’association Air Rhône-Alpes, qui mesure la qualité de l’air. Cependant, nombre d’usagers ne sont pas encore aussi moteurs qu’ils pourraient l’être dans ce domaine.
En matière de gouvernance, les fonds européens jouent un rôle majeur pour l’atténuation. En Rhône-Alpes, le fait que les régions deviennent autorité de gestion n’a pas cassé la mécanique de la coopération avec l’État – j’ai moi-même été copilote de la construction du programme consacré à l’adaptation dans le domaine de l’économie décarbonée, quatrième objectif thématique (OT 4) du FEDER. L’atténuation est au centre des financements de la future maquette.
En termes budgétaires, comme l’a observé M. Pascal, les deux poids lourds de nos schémas régionaux climat air énergie sont la réhabilitation thermique des logements et les transports.
En Rhône-Alpes, l’estimation budgétaire correspondant à la réhabilitation thermique à l’horizon 2020 s’élève à 1,5 milliard d’euros – que nous n’avons évidemment pas aujourd’hui. Cet aspect est la clé des objectifs que nous nous sommes fixés.
En matière d’adaptation, la question budgétaire n’est cependant pas la première qui se pose. Tout d’abord, en effet, les actions menées aujourd’hui sont essentiellement expérimentales et nous disposons à cette fin de sources de financement – comme c’est le cas à Lyon pour l’opération Lyon Confluence, à la confluence du Rhône et de la Saône, qui fait l’objet d’une démarche ÉcoCité et bénéficie de financements issus du grand emprunt, permettant ainsi d’éprouver des technologies qui pourront ultérieurement être proposées ailleurs.
Au-delà de l’aspect technique, il nous faut aussi travailler à l’acceptabilité sociale de ces projets. De fait, la construction de retenues destinées à la fabrication de neige artificielle ou à l’agriculture n’est pas un problème financier, mais ces installations supposent, lorsqu’elles se justifient, un travail de pédagogie quant à leur utilité.
M. Michel Ray. Dans le domaine de la végétalisation, notamment des toitures, et pour ce qui concerne plus généralement les îlots de chaleur, le travail réalisé depuis quatre ans a permis de lancer les quatre projets majeurs que j’ai évoqués tout à l’heure, associant collectivités territoriales, entreprises et monde académique. Afin de lever les freins à la mise en œuvre et à la valorisation de ces projets, la diffusion des connaissances est essentielle et pourrait par exemple prendre la forme d’un séminaire réunissant les utilisateurs potentiels et les experts de ces projets. Un tel séminaire permettrait aux collectivités territoriales et aux maîtrises d’ouvrage de se saisir des renseignements accumulés.
En deuxième lieu, Advancity a mis en place un groupe de travail à vocation nationale sur les démonstrateurs urbains, ou laboratoires territoires urbains, afin de faciliter l’expérimentation concrète des innovations en croisant les regards de différents acteurs. Advancity pourrait là aussi, si ces acteurs le souhaitent, intégrer dans ces laboratoires certains des sujets que nous avons évoqués.
En troisième lieu, certaines réponses, bien que très utiles, ne sont pas encore à la hauteur des enjeux – c’est notamment le cas, et de loin, pour ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et les îlots de chaleur. Il faut donc, là encore, mobiliser les acteurs français de haut niveau qui entretiennent des liens à l’échelle européenne et internationale.
Enfin, Advancity est un écosystème très riche, qui réunit notamment 160 PME très innovantes dans le domaine urbain et des collectivités territoriales, ce qui lui permet de bâtir, sur un sujet donné, à partir des besoins identifiés par les acteurs, un consortium pertinent. Pour y travailler depuis neuf ans et en avoir été président, je puis témoigner de la pertinence de cette forme de travail multi-acteurs sur des sujets systémiques tels que l’adaptation au changement climatique, je pense en particulier à l’un des premiers projets pilotes de la Banque mondiale consacrés à l’adaptation au changement climatique, notamment sur les grandes villes des zones côtières nord-africaines, auquel des membres d’Advancity ont contribué.
M. Jean-Jacques Cottel, président. Messieurs, je vous remercie pour la qualité de vos interventions et je vous prie d’excuser le départ de mes collègues qui devaient assister à l’une des dernières réunions de la mission d’information sur l’écotaxe poids lourds.
15. Audition de Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 (5 novembre 2014)
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015. La réunion de trois commissions témoigne de l’importance que nous attachons à ce sujet. Cette première audition sera sans doute suivie d’autres rendez-vous puisque les négociations vont s’échelonner jusqu’à la conférence de Paris.
Dans cette perspective, nous avons créé un groupe de travail commun aux trois commissions. Nous prévoyons également la tenue à l’Assemblée nationale d’une conférence interparlementaire parallèlement à la conférence des Parties.
L’échéance de 2015 est essentielle car elle doit aboutir à la conclusion d’un accord universel permettant de plafonner à deux degrés l’augmentation de la température terrestre par rapport à l’ère pré-industrielle en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Le cinquième rapport du GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme, de façon plus inquiétante encore, confirmant les analyses de Sir Nicholas Stern et du Global carbon project. Il est impératif d’aller au-delà du protocole de Kyoto, prolongé jusqu’en 2020 par l’amendement de Doha, qui ne couvre que 15 % des émissions de gaz à effet de serre –celles de l’Union européenne pour l’essentiel.
Nous avons tous en mémoire l’échec de la conférence de Copenhague en 2009. Cette fois, la préparation semble mieux engagée. Le secrétaire général de l’ONU est très investi : il a réuni à New York le 23 septembre dernier de nombreux chefs d’État et de gouvernement. La prise de conscience au plus haut niveau semble réelle, y compris de la part de pays traditionnellement réservés.
La conférence de 2015 est aussi l’occasion de réunir des représentants de la société civile, des entreprises et des collectivités locales autour de l’agenda positif, aussi appelé « agenda des solutions ». L’Union européenne a su montrer la voie en parvenant à un accord sur un nouveau paquet énergie climat qui fixe à l’horizon 2030 les objectifs d’une baisse de 40 % des émissions, d’une part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique porté à 27 % et de 27 % d’efficacité énergétique.
Il reste 400 jours pour traduire les paroles et les intentions en actes, 400 jours pour sauver la planète. Comme l’a dit le secrétaire général de l’ONU, nous avons l’obligation de réussir : il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B.
Plusieurs questions viennent spontanément à l’esprit : quel contenu et quelle forme peut-on envisager pour un futur accord universel et contraignant ? Que peut-on attendre de la prochaine conférence climat de Lima le mois prochain ? Les premières contributions des pays sont attendues pour le premier trimestre 2015 : que pourrait-on faire si leur ambition est insuffisante ? Par ailleurs, l’un des éléments clés de la réussite du futur accord, l’aide aux pays en voie de développement au travers du Fonds vert pour le climat, « patine ». Seules la France et l’Allemagne ont en l’état annoncé leur contribution. Comment donc créer la dynamique nécessaire afin que l’économie verte ne reste pas l’apanage des seuls pays riches ? Comment éviter à ces derniers d’encourir la critique de la part des pays en développement ; de s’acheter une bonne conscience à moindre coût ?
Mme la présidente Danielle Auroi. Je me félicite que nous soyons tous réunis au chevet de la planète.
Nos sociétés sont-elles capables et désireuses de relever le défi des deux degrés ? Cette résolution peut-elle prendre corps à Lima ?
La conférence de Paris sera décisive mais l’accord qui en résultera sera-t-il juridiquement contraignant ?
L’Union européenne fait figure de bonne élève depuis Kyoto mais ses décisions récentes sont-elles aussi ambitieuses qu’il y paraît puisque certains des objectifs fixés ne sont pas contraignants ? Les signaux adressés sont-ils suffisamment forts pour entraîner la conférence de Paris sur une voie positive ? Quel est le mandat défendu par l’Union européenne à Lima ?
Quel accord peut-on espérer avec les États-Unis – à cet égard, les résultats des élections ne sont pas rassurants –, la Chine, l’Inde ou le Brésil ?
Quels sont les points clés de la négociation ? S’agissant du Fonds vert, les résultats après la réunion de New York sont décevants : le fonds est très faiblement abondé au regard des besoins.
Vous avez compris que le groupe de travail évoqué par Mme Élisabeth Guigou s’est emparé de l’ensemble de ces questions. Quelle place voyez-vous pour la diplomatie parlementaire dont on sait qu’elle peut parfois aider ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Votre audition est incontournable pour les parlementaires des différentes commissions tout comme celles, à venir, de M. Laurent Fabius et de Mme Ségolène Royal.
Le Parlement ne peut pas être absent de la préparation de la conférence. Ce projet est particulièrement enthousiasmant pour nous et pour la France compte tenu des enjeux.
Il n’est pas facile de se positionner dans la diplomatie onusienne. J’espère malgré tout que nous trouverons un espace, nous y travaillerons de toutes nos forces.
Nous misons évidemment sur la diplomatie parlementaire mais nous souhaitons également organiser un débat citoyen planétaire comme il s’en est tenu à Copenhague et à Hyderabad. Je sais pouvoir compter sur le Président de l’Assemblée nationale pour nous apporter son aide. Ce débat doit permettre aux citoyens de délivrer un message unique à l’attention des chefs d’État, des collectivités locales et des entreprises.
Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015. Cette audition intervient à un moment important alors que nous nous apprêtons à honorer la mission qui a été confiée à la France de préparer et présider la conférence des parties en décembre 2015. Le travail parlementaire est essentiel car l’accord que nous allons discuter porte principalement sur les politiques nationales : la vision de l’énergie, sa consommation, sa transformation, la modernisation technologique des économies. Le débat sur le climat est moins international que national. Les parlementaires français ont donc un rôle à y jouer.
Le moment est important car chacun se souvient de Copenhague. L’Union européenne ne peut pas se permettre un échec.
Certaines choses se sont améliorées mais les forces contraires demeurent. J’observe aussi une grande lassitude de cette négociation. Un accord est indispensable pour indiquer aux partenaires économiques la transformation de l’économie qui est recherchée afin qu’ils s’y engagent résolument.
L’accord qui pourrait être annoncé le 12 décembre 2015 sera nécessairement intergouvernemental. Contrairement à Kyoto, la France a pour mandat de négocier un accord universel qui engage toutes les parties et pas seulement les pays développés.
Cet accord doit être crédible. Il ne s’agit pas d’installer un gouvernement mondial ou d’instaurer une police du climat. L’objectif est de faire converger les anticipations de tous les acteurs, en particulier les acteurs économiques, pour démontrer que la transformation économique et écologique est en marche.
L’accord doit également être dynamique. Il n’a pas vocation à régler toutes les questions jusqu’en 2050. Le cinquième rapport du GIEC réaffirme que nous devons au minimum diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre jusqu’en 2050 pour avoir 66 % de chances de rester en dessous d’une hausse des températures de 2 °C. Nous devons à la fois définir un cadre qui va durer trente ans et prévoir des rendez-vous réguliers pour faire le point des transformations, améliorer les propositions des uns et des autres, et examiner le déploiement des technologies en fonction de l’innovation, de la baisse des coûts et de la coopération internationale.
L’accord doit en outre être solidaire. Les pays les plus pauvres sont aussi les plus affectés par le changement climatique. Lors de la réunion du 23 septembre, tous les responsables politiques ont évoqué les impacts du changement climatique qu’ils commencent à observer dans leur pays, pas seulement le Bangladesh, mais aussi l’Éthiopie, le Maroc, les petites îles ou les États-Unis.
L’accord doit « mettre sur les rails » une politique de décarbonation des économies susceptible de limiter – puisqu’il n’est pas possible de les éliminer – les effets du changement climatique.
L’accord intervient entre les États mais – c’est au moins aussi important – les sociétés civiles doivent être convaincues que l’avenir passe par une économie différente.
De nombreux acteurs peuvent s’engager aux côtés des gouvernements pour soutenir cette vision nouvelle parmi lesquels les collectivités locales et les entreprises. Les acteurs non gouvernementaux doivent être mobilisés pour appuyer et mettre en œuvre l’accord. C’est le sens de l’Alliance pour le climat que nous souhaitons promouvoir.
Quelle que soit la forme qu’il prendra, l’accord va définir des règles et fixer des points de rendez-vous pour réévaluer et corriger les trajectoires. Parallèlement, les États vont présenter pour la période qui va débuter – l’Union européenne a proposé 2030 comme horizon – leur contribution nationale. Nous espérons les avoir rassemblées au premier semestre 2015, si possible au premier trimestre.
Le premier signal tient à la conclusion d’un accord. Le deuxième signal réside dans l’engagement des pays à proposer un plan en faveur du climat pour 2025-2030 qui se décline en diverses politiques : la politique climatique mais aussi la fiscalité pour ceux qui vont utiliser des instruments comme la taxe carbone, les marchés carbone, les transports publics ou encore les innovations technologiques. Pour chaque État, il y a d’une part, les engagements pris au regard des pairs de la communauté internationale en matière de réduction des émissions et d’autre part, le corps de politiques déployées. C’est très important pour les acteurs économiques.
Lorsque les pays auront annoncé leurs objectifs en matière d’énergie propre ou d’énergies renouvelables, cela enverra un signal considérable aux marchés. Le pourcentage de véhicules électriques ou propres, l’intensité de l’effort dans les transports publics, la part d’énergies renouvelables, le nombre de bâtiments à énergie positive sont autant d’éléments susceptibles de redessiner les marchés mondiaux, de renseigner les acteurs économiques et de les rassurer.
L’accord doit s’accompagner d’un volet financier. Le Fonds vert a connu, il est vrai, un lent démarrage à New York. Nous attendons des annonces plus positives pour la fin du mois de novembre à Berlin. Réunir 7 milliards de dollars sur les 10 que nous escomptons au total serait un signe positif. Mais nous savons que certains États ne s’acquitteront de leur contribution que début 2015.
Parallèlement, il nous faut adresser des signaux économiques différents aux marchés financiers. En permettant aux marchés de mieux identifier les investissements dans les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique, ou les transports publics, on peut espérer réduire la prime de risque qui pèse sur le coût des emprunts pour les pays désireux de s’engager dans la transition énergétique.
L’effort d’aide publique doit être adossé à une réforme progressive des signaux adressés aux marchés financiers pour que les investissements se reportent sur une économie sobre dès l’année prochaine. La France entend porter cette question au sein du G20 et auprès des banques multilatérales.
Quant à la contribution des acteurs non gouvernementaux, la grande innovation de cette négociation sur le climat réside dans l’idée que ces derniers ont leur mot à dire. Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’espace pour ceux qui sont sur le terrain.
Dès Lima, nous espérons obtenir la création d’une plateforme pour donner, après 2020, une voix au chapitre aux collectivités, aux entreprises innovantes et aux institutions internationales. Cette plateforme leur permettrait de rapporter leurs efforts en faveur de la transition. Elle sera à la fois un lieu de démonstration et d’engagement.
Les gouvernements prendront des engagements et se reverront régulièrement – nous espérons tous les cinq ans – pour faire le point et examiner les solutions afin d’améliorer les propositions de chacun car le chemin à parcourir pour limiter la hausse des températures reste long. Les collectivités et les entreprises feront également tous les cinq ans le bilan de leur action et se projetteront dans l’avenir.
L’accord doit être porteur d’une vision partagée de l’avenir et d’une méthode pour faire converger les anticipations. Il s’apparente à une prophétie auto-réalisatrice.
Quant à l’agenda des solutions, on observe une mobilisation des acteurs économiques sans précédent.
Je souhaite conclure en montrant que nous avons beaucoup plus de chances de réussir qu’à Copenhague, en dépit des risques nombreux.
La plupart des pays sont infiniment mieux préparés qu’en 2009. Je pense en particulier aux pays émergents, notamment la Chine. Il y a un travail parlementaire considérable à faire avec la Chine. 2009 a été un choc, choc politique de la confrontation du vieux monde des pays développés avec les pays émergents, mais aussi choc pour les émergents dont la prise de pouvoir coïncidait avec de nouvelles responsabilités mondiales : la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre ; d’ici à 2030, elle sera probablement le plus grand pays responsable des émissions globales.
Ce choc était dépourvu de solution politique. Mais, depuis 2009, de nombreux pays ont réfléchi à la transformation de leur économie. La préparation est importante dans les pays émergents et un changement est à l’œuvre aux États-Unis.
Même si les élections n’ont pas été favorables à l’administration qui essaie de faire des efforts aujourd’hui, nombre d’États américains ont pris le chemin de la décarbonation de l’économie, pas seulement la Californie : les énergies renouvelables, l’amélioration des réseaux, les réseaux intelligents, les bâtiments à énergie positive se répandent avec un souci croissant de l’impact du changement climatique.
Le degré de préparation est donc sans précédent.
Des pays, qui s’étaient par le passé retrouvés sur une ligne défensive comme l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud commencent à diverger : l’Afrique du Sud et le Brésil penchent pour une bonne solution en 2015, l’Inde s’interroge sur la conduite à tenir et la Chine est décidée à avoir un accord à Paris. Le paysage politique a beaucoup changé ce qui me fait penser que les grands pays souhaitent arriver à un accord en décembre 2015. Tout l’enjeu est de conclure un accord, non pas au rabais, mais qui indique la direction.
On sait que cet accord ne donnera pas la solution pour respecter la limitation de la hausse à deux degrés Celsius en 2015 car les contributions des pays ne seront pas dès à présent à la hauteur de ce qu’il faut faire. Les émissions mondiales devraient déjà avoir commencé à diminuer. En revanche, nous devons nous entendre sur un cadre de discipline pour les pays, des solutions et une feuille de route. Il faut qu’à l’issue de la conférence de Paris, un plan ait été établi pour revenir à deux degrés, un plan partagé par les gouvernements, les collectivités et les entreprises, même si ce plan dessine une trajectoire qui fait l’objet de rendez-vous tous les cinq ans pour s’assurer qu’elle est respectée.
L’annonce européenne, qu’on aurait pu rêver plus ambitieuse, a eu un effet très positif vis-à-vis de nos partenaires. Nous sommes les premiers à afficher un chiffre ambitieux de réduction des émissions. Malgré la récession qui l’affecte, l’Europe affirme sa croyance dans une économie sobre en carbone. Le travail de mise en œuvre de ce paquet européen est très important. On le sait, celle-ci est conditionnée à la conclusion d’un accord international en 2015. Mais c’est très bien ainsi : l’Europe montre qu’elle considère unilatéralement que la transition écologique est bonne pour elle et, en même temps, elle envoie un signal très positif à tous les pays qui doutent encore.
Il faut vaincre deux doutes : le premier, est-ce qu’on peut le faire, est-ce que nos sociétés sont prêtes à le faire ? À cet égard, plus on observe les pays se préparer à le faire, plus le doute se dissipe. Second doute, est-ce que les autres vont le faire ? Ce doute est précisément plus facilement dissipé aujourd’hui car nombreux sont les pays à souhaiter aboutir en décembre face à un risque climatique qui n’a jamais été autant appréhendé, on l’a vu le 23 septembre.
M. Jean-Pierre Dufau. Vous avez rappelé le choc qu’a représenté l’échec de Copenhague pour souligner que le changement du modèle de développement n’est plus une hypothèse mais une nécessité. Vous proposez une évolution dans notre conception du développement qui est presque une révolution.
Nous connaissons les objectifs scientifiquement établis. Vous êtes enthousiaste sur la dynamique, la nouvelle gouvernance et l’agenda de solutions. Vous estimez que l’ensemble des responsables, en insistant sur les acteurs non gouvernementaux, vont tirer dans le même sens pour définir des objectifs et se donner les moyens concrets de les atteindre.
À ce jour, les pays émergents n’ont pas manifesté la prise de conscience que vous escomptez. On peut être dubitatif sur votre optimisme d’autant que pour un certain nombre de pays, le problème climatique s’ajoute à d’autres problèmes à régler comme l’insuffisance alimentaire ou la pauvreté qu’ils n’hésiteront pas à ériger en priorité.
Sur l’agenda des solutions, vous insistez sur la nécessaire mobilisation des acteurs économiques en faveur de la transition énergétique. Pouvez-vous préciser comment vous entendez faire comprendre aux marchés financiers que c’est l’intérêt commun ?
Pour que Paris 2015 soit un succès, vous parlez d’un accord-cadre accompagné de mesures concrètes. Comment sera assuré le suivi de ces mesures ? Peut-on envisager la mise en place de sanctions ?
M. Arnaud Leroy. Je vous remercie pour cette présentation claire et pragmatique. Le pragmatisme est en effet la bonne manière d’aborder les négociations climatiques.
Le prix carbone est une question importante qui nous préoccupe aussi au niveau européen. Si on peut saluer le paquet énergie climat, on peut aussi s’interroger sur le choix qui a été fait de mettre l’accent sur le système de l’échange de quotas avec une certaine faiblesse, à savoir une distribution de quotas trop généreuse. Il nous faut avancer sur cette question. L’agenda des solutions est conditionné à un accord sur un prix carbone raisonnable qui donne de la visibilité aux entreprises et à ceux qui développent des technologies propres. Ces dernières restent plus chères et ne deviendront rentables qu’avec un prix du carbone faisant sens, au-delà des cinq euros d’aujourd’hui.
La question de la gouvernance est décisive. Comment orchestrer le contrôle sur les contributions proposées par les États ? Doit-on convaincre l’Agence de l’énergie d’être le pivot du contrôle – le MRV pour Measurement Reporting and Verification selon la terminologie onusienne – ou créer une nouvelle institution ?
Les pays sont préparés, c’est un fait. Tous les États ont adopté des législations nationales, plus ou moins ambitieuses, sur lesquelles le prochain accord doit impérativement s’appuyer.
Dernier point, sur le plan budgétaire, au-delà du financement du Fonds vert, je m’interroge sur l’opportunité de flécher dans les budgets des États qui le peuvent, notamment européens, une somme conséquente pour les affaires climatiques. Comment discuter de cet aspect à l’échelle européenne, en permettant par exemple de soustraire ces dépenses au cadre maastrichtien ?
M. Bernard Deflesselles. Au lendemain de la publication du cinquième rapport du GIEC, chacun a bien compris les objectifs, vous les avez rappelés : augmentation limitée à deux degrés et diminution de moitié des émissions.
Le rapport rappelle, d’une part, qu’à 95 % nous avons la certitude que l’activité humaine est responsable des désagréments et, d’autre part, que l’augmentation de la température pourrait atteindre 4,5 à 4,8 degrés à la fin du siècle. Il pointe également la montée des océans, les bouleversements touchant à la sécurité alimentaire, santé, les déplacements de population.
Bref, tout est sur la table. Les scientifiques ont fait le job. Il appartient aux politiques et aux États de faire le leur.
Je retiens deux sujets clés. Le premier tient à la nature de l’objet juridique qui sera négocié en 2015 à Paris : sera-t-il contraignant ou pas ?
Avec le recul dont nous disposons, il paraît difficile de reproduire ce qui s’est passé avec le protocole de Kyoto dont la mise en application est intervenue huit ans après la signature en raison des délais de ratification. Le nœud gordien est là : quel objet juridique peut-on mettre sur la table sachant que quelques grands pays comme les États-Unis, l’Inde ou la Chine, ne veulent pas s’embarquer dans une nouvelle aventure ?
En outre, en matière de contrôle – non pas au sens de contrainte mais plutôt du MRV du système onusien –, comment voyez-vous les choses sachant que la Chine et les États-Unis n’ont pas envie qu’on s’ingère dans leur feuille de route ?
En voyageant, on se rend compte que tous les pays préparent une feuille de route car tout le monde a pris conscience du problème. Mais lorsqu’on consolide ces feuilles de route, on est très loin d’une augmentation limitée à deux degrés.
Deuxième sujet clé, l’état des négociations internationales. L’Europe pèse 12 % des émissions. Elle vient de faire un effort extraordinaire avec le nouveau paquet énergie climat.
Dans le même temps, les émissions représentent aux États-Unis, 17 tonnes par habitant et en Chine, 6 tonnes par habitant, soit l’équivalent de la France, mais avec 1,35 milliard d’habitants. Rien ne peut se faire sans eux et ils se tiennent par la barbichette. Pouvez-vous décrypter ce qui peut se passer avec la Chine et les États-Unis ? Les résultats des élections de midterm ne sont pas une bonne nouvelle, le président Obama est pris dans les filets du Congrès. On se rappelle que le président Clinton a été désavoué par le Congrès après avoir signé le protocole de Kyoto. Que peut faire Obama aujourd’hui ? Il essaie de contourner le Congrès en passant par la voie réglementaire mais le dernier mot revient aux États.
Ce sont les deux nœuds gordiens : le caractère contraignant de l’objet juridique et l’état des relations internationales. Outre la Chine et les États-Unis, qui sont les acteurs clés, il ne faut pas oublier l’Inde qui, malgré une évolution, reste réticente à un accord international contraignant, mais aussi le Brésil ou le G77 dont la position est évanescente.
Il ne vous reste plus qu’à négocier, madame l’ambassadrice.
M. Bertrand Pancher. Je dois sans doute manquer d’intelligence (Murmures sur divers bancs) mais, plus je réfléchis et moins je comprends pourquoi, face aux défis qui nous menacent, personne ne songe à remettre en cause notre modèle de développement. Tout se passe comme si au lieu de changer le moteur nous accélérions pour foncer dans un mur. Je ne comprends pas.
D’autant que les défis que nous avons à relever ne suscitent plus de controverse. Le dernier rapport du GIEC indique clairement qu’à ce rythme-là, l’augmentation de la température sera de quatre degrés à la fin du siècle. Les conséquences seront sans aucune mesure avec les drames que nous avons connus dans notre histoire.
Trois questions. Premièrement, au plan national : comment expliquez-vous la phobie environnementale qui nous affecte tous ? Nous sommes capables de grandes et belles déclarations à Paris mais, de retour dans nos territoires, nous nous dérobons à la contrainte, nous devenons les fossoyeurs de la fiscalité environnementale et les défenseurs de la déréglementation.
Deuxièmement, au plan européen, je me félicite des dernières avancées même si les chiffres annoncés ne sont pas à la hauteur des ambitions. Quelle analyse faites-vous du refus de l’Union européenne de se doter de mécanismes de régulation, au premier rang desquels les certificats d’économies d’énergies qui sont pourtant le seul instrument utile ? Au plan extérieur, pourquoi abandonnons-nous l’idée d’une régulation environnementale aux frontières de l’Europe ? Nous sommes encore la première puissance économique mondiale, nous avons la possibilité de réguler l’économie mais nous ne faisons rien : ainsi sommes-nous les premiers responsables du drame qui s’annonce.
Troisièmement, au plan international, comment désamorcer le choc Nord-Sud ? Les pays en voie de développement disent à juste titre : à vous de faire des efforts, vous qui avez pollué. Mais où sont les contreparties, combien de promesses non tenues depuis Copenhague ? Va-t-on enfin aller de la coupe aux lèvres ?
Les pays industrialisés n’auront pas atteint le seuil de réduction de 20 % des émissions en 2020 alors que les experts du GIEC s’accordent désormais sur une fourchette de 25 à 40 % pour atteindre l’objectif.
M. Patrice Carvalho. Nous vous auditionnons un an avant le sommet de Paris alors que le cinquième rapport du GIEC vient d’être publié. Ce rapport comporte des éléments de confirmation et des données nouvelles. La responsabilité des activités humaines dans le réchauffement climatique, de « probable » à « très probable », est passée à « extrêmement probable ». Quatre scénarios sont élaborés ; le plus probable est aussi le plus pessimiste qui table sur une poursuite des émissions actuelles de gaz à effet de serre.
Je relève quelques autres éléments nouveaux : la hausse du niveau des mers pourrait être plus importante que prévue ; des événements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents pourraient intervenir ; depuis 30 ans, chaque décennie a été significativement plus chaude que la précédente.
Bref, seul un scénario de réduction des émissions est en mesure de maintenir la hausse des températures sous le seuil des deux degrés, ce qui implique de réduire nos émissions de 10 % par décennie.
Tel est l’enjeu majeur de la conférence de Paris en 2015. Elle est censée aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays qui entrera en vigueur en 2020. Ces derniers sont au nombre de 195, signataires de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
L’intérêt de lutter contre le réchauffement climatique est commun à tous. Pour autant, les intérêts d’États n’en sont pas moins divergents.
Les pays les plus développés ont apporté leur lot au dérèglement climatique mais une prise de conscience a commencé à s’opérer, avec de grandes inégalités. Les pays émergents, quant à eux, vivent souvent les exigences environnementales comme des contraintes et des freins à leur développement. Leur engagement est donc loin d’être acquis.
Le sommet de Paris est un vrai défi. On assiste à un bras de fer entre les grands émergents – Chine et Inde – l’Union européenne et les États-Unis. J’ai pu le constater lors du sommet de Varsovie auquel je participais en novembre 2013.
Si nous ne voulons pas que les pays émergents déploient, comme nous l’avons fait, un mode de développement productiviste et énergivore, il faut les y aider. C’était l’idée du Fonds vert pour le climat décidé au sommet de Copenhague en 2009 et crée en 2010 par les accords de Cancun. Il s’agit de financer la transition des pays en développement vers un modèle sobre en carbone. Ce fonds devrait mobiliser, à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an. Les chefs d’État et de Gouvernement s’étaient engagés, en 2009, à fournir 30 milliards de dollars. Mais tout cela peine – c’est le moins que l’on puisse dire – à se mettre en place.
Avez-vous des éléments sur la place que prendra cette question décisive au sommet de Paris ?
M. Noël Mamère. Je suis rassuré quand je vous entends, madame Tubiana, mais je le suis beaucoup moins quand je vois la réalité. Car nous ne parviendrons pas à contenir à 2° C le réchauffement climatique si nous ne changeons pas de mode de développement, de mode de vie et de mode de pensée. La question se joue au niveau international, au niveau européen, mais aussi au niveau national. Or, en France, nous restons loin des engagements pris sur les énergies renouvelables à l’horizon 2020.
Deux cultures, deux visions du monde se font face, entre lesquelles une passerelle devra être jetée. D’un côté, le productivisme compte, pour vivre mieux, sur le maintien du statu quo et sur une croissance du type de celle des Trente glorieuses. De l’autre côté, la notion de « bien commun » s’impose de plus en plus, dans une perspective de respect de l’environnement et de la condition humaine.
En Amérique latine, les mouvements de lutte contre l’extractivité visent à protéger les ressources premières de la vie. Le même phénomène s’observe en Afrique. En France, les syndicalistes agricoles eux-mêmes peuvent accaparer les terres et diminuer la souveraineté alimentaire des paysans.
Pour tenir nos engagements, nous devons changer de logiciel, en instituant une fiscalité écologique, fondée sur le principe du pollueur-payeur, que la France continue de refuser. Quant à l’Europe, certes elle a pris des engagements, mais elle ne rejette que 13 % des gaz à effet de serre émis au niveau mondial. Pendant ce temps, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie ont abandonné le protocole de Kyoto.
Hier encore, au Canada, le Président de la République exaltait l’extraction des sables bitumineux. La tendance à favoriser des modes de vie dévastateurs pour la planète ne se dément pas, comme le montre le débat sur les gaz de schiste. Sortir de l’âge carboné est indispensable pour contenir à 2 °C le réchauffement climatique. Ce n’est pas faute de pierre que l’âge de pierre s’est effacé devant l’âge de fer, mais du fait d’une évolution anthropologique.
Mme Geneviève Gaillard. Certes, l’alliance pour le climat regroupe des acteurs non gouvernementaux ; une plateforme de démonstration et d’engagement réunira les collectivités et les entreprises soucieuses d’agir contre le réchauffement ; un agenda positif de solutions sera défini. Mais, à l’heure où prévaut le travail dans l’immédiateté, la mise en œuvre d’un projet de long terme ne passe-t-elle pas par une mobilisation des acteurs territoriaux ? Les documents territoriaux ne devraient-ils pas inclure obligatoirement des objectifs de nature climatique ?
M. Martial Saddier. La France figure plutôt parmi les bons élèves en matière climatique, puisqu’elle a réduit de 6,6 % entre 1990 et 2010 ses émissions de gaz à effet de serre. Elle ne rejette plus aujourd’hui que 1 % des gaz à effet de serre émis au niveau mondial, alors que son économie correspond à 4 % du PIB mondial.
Mais les efforts actuels ne permettent cependant pas d’espérer la baisse de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2010 et 2050 seule à même de contenir à 2° C le réchauffement de la planète. L’accord du Conseil européen ne fixe pas de critères contraignants. Un plan à l’échelle mondiale ne pourra être au mieux établi que l’an prochain. Dans ces circonstances, et vu les conditions économiques actuelles, comment les objectifs climatiques peuvent-ils encore être atteints ?
M. Yannick Favennec. Selon le rapport du GIEC, les températures se seront élevées de 4° C à l’échelle planétaire d’ici à 2100. Par suite, le niveau des mers montera, les rendements agricoles s’affaisseront et l’eau deviendra une ressource plus rare. Comment faire pour changer les mentalités des populations ? Selon un expert de l’IRIS, les chiffres ne parviennent pas par eux-mêmes à frapper l’opinion. Tant que les effets du changement climatique ne seront pas perceptibles, les obstacles à la compréhension ne seront pas totalement levés, car c’est le ressenti qui est primordial. Alors que seuls nos descendants verront éventuellement le profit de l’action climatique, ne faut-il pas diffuser mieux les résultats du GIEC en les reliant à des problématiques de la vie quotidienne – pêche, tourisme, agriculture, santé ?
Mme Cécile Duflot. Il me semble que la mobilisation citoyenne constitue la clef de l’action climatique, au-delà des accords entre États. De nombreux collectifs de jeunes se sont déjà formés. Comment imaginez-vous la mobilisation de la société civile au niveau mondial ? Comment pourra-t-elle fournir un appui en vue de la conclusion d’un accord sur le climat, mais aussi dans la perspective de sa bonne mise en œuvre ?
M. Jean-Yves Caullet. Je voudrais insister sur le secteur particulier de la biomasse. Car toutes les formes de décarbonation ne se valent pas, de même qu’il ne faut pas confondre le carbone de stock et le carbone renouvelable. La forêt se renouvelle et le bois stocke le carbone. Une politique ambitieuse de la biomasse forestière pourrait faire converger États et collectivités vers ce secteur, où des investissements qui seraient de l’ordre de 100 ou 150 millions d’euros en France apparaissent négligeables si on les compare avec les avantages qu’ils pourraient produire, en matière de renouvellement de la forêt, notamment. Quel cadre imaginez-vous pour aller dans ce sens ?
Une diplomatie forestière ne peut-elle voir le jour, qui regroupe les grands et petits États concernés, en vue d’optimiser l’exploitation de cette ressource pour le plus grand bénéfice de l’environnement et de l’économie ?
M. Yves Albarello. L’Europe, bonne élève en matière climatique, traverse cependant une crise. Comment sa politique climatique est-elle susceptible de l’en faire sortir ? Doit-elle emprunter plutôt la voie de la fiscalité ou celle de l’investissement ?
M. François-Michel Lambert. Le danger climatique ne représente qu’un péril parmi tant d’autres, tels que la pénurie alimentaire, la raréfaction des ressources ou encore les choix hasardeux en faveur du nucléaire. Que l’avenir appartienne à une économie différente a été assez dit. Il faut définitivement sortir de l’idée que l’énergie fossile est abondante. Loin des gaspillages, l’humanité urbaine doit s’orienter vers une économie circulaire où la biodiversité est à conquérir et à conserver. Les pistes sont très nombreuses. Mais comment sera-t-il possible de les coordonner ?
Mme Sophie Errante. Au titre de la commission du développement durable, je suis rapporteure d’une mission d’information parlementaire sur les conséquences des changements climatiques en France. Mais nous avons déjà évoqué le rôle des parlementaires. L’article 6 de la convention cadre des Nations unies prévoit la participation de tous à son action, comme l’a évoqué notre collègue Cécile Duflot. Quel regard portez-vous sur l’initiative World Wide Views on Climate and Energy, débat citoyen planétaire qui rassemble 10 000 personnes ? Une consultation sera organisée le 6 juin 2015, au cours de laquelle les participants exprimeront leur avis sur trente questions. D’autres initiatives de ce genre sont-elles à signaler ?
M. Michel Terrot. Le dernier rapport du GIEC fait état de prévisions pessimistes, selon lesquelles les températures augmenteraient de 5° d’ici à 2100, entraînant une augmentation du niveau de la mer d’un mètre. Or, dans la région Nord-Pas-de-Calais, une augmentation de 80 centimètres de ce niveau bouleverserait déjà la vie d’un demi-million d’habitants. Comment faire face aux conséquences de ce phénomène ?
M. Jean-Marc Germain. Madame l’ambassadrice, je vous souhaite le plein succès dans vos fonctions. Vous avez évoqué l’instauration d’une politique de l’environnement, mais où en est l’agence environnementale de niveau mondial proposée par le Président de la République ? À défaut de Conseil de sécurité climatique, peut-être une telle organisation pourrait-elle regrouper au moins les États qui y sont favorables. Alors que la Banque mondiale est chargée de coordonner les efforts des banques régionales de développement, parvient-elle à les orienter dans un sens favorable aux investissements écologiques ? À la conférence de Paris l’an prochain, préférerez-vous un accord a minima à une absence d’accord ?
M. Jean-Marie Sermier. Nous menons aujourd’hui un débat essentiel, à l’heure où la planète commence pour ainsi dire « à prendre feu ». Nous partageons des objectifs communs, mais je n’ai pas bien compris comment nous parviendrons à changer le cours des choses. Dans l’immédiat, ne faudrait-il pas privilégier l’emploi d’énergie décarbonée, tel le nucléaire, en considérant qu’il représente un péril moindre que le péril climatique ?
M. Gérard Sebaoun. Le secteur des transports, notamment le secteur des transports aériens, connaît une forte croissance. Il rejettera 625 millions de tonnes de carbone en 2020, sans doute le double en 2036, et le quadruple ou le sextuple en 2050. Les systèmes d’échanges régionaux de permis d’émission se sont heurtés aux réticences des compagnies non européennes. L’Organisation de l’aviation civile internationale a récemment fait plier l’Union européenne sur un projet de réduction à l’horizon 2020. N’est-ce pas un mauvais signal en amont de la conférence de Paris ?
M. Jacques Kossowski. En Chine, en Europe, aux États-Unis, des marchés du carbone existent, mais ils ne sont pas coordonnés et concernent seulement 7 % des rejets de gaz à effet de serre, même s’ils pourraient bientôt s’étendre au Brésil ou à la Turquie. Il faut éviter de reproduire l’expérience désastreuse qui a suivi la conférence de Kyoto. Peut-on attendre de la conférence de Paris des avancées, en particulier l’émergence d’un marché du carbone à l’échelle mondiale ?
Mme Suzanne Tallard. À 400 jours du début de la conférence, la France a le devoir d’être exemplaire par la mobilisation des acteurs non gouvernementaux. Quelles sont les initiatives déjà prises ou encore à prendre pour impliquer le monde économique, le monde éducatif et les collectivités locales ? Est-ce qu’une taxation ambitieuse des transactions financières est envisagée pour constituer une recette pérenne du Fonds vert pour le climat ?
M. Guillaume Chevrollier. Madame l’ambassadrice, vous avez été nommée représentante spéciale pour la conférence de Paris 2015 par Laurent Fabius, qui vous a chargé, par lettre de mission, de mobiliser tous les acteurs pour porter un agenda positif destiné à montrer que non seulement la lutte contre le dérèglement climatique est indispensable, mais qu’elle peut aussi apporter des bénéfices majeurs en termes de croissance, d’emploi et de qualité de vie. À ce titre, votre rôle est très important, car il est impératif de relier les considérations environnementales aux données économiques. Saurons-nous proposer à nos concitoyens un projet entraînant – et pas seulement contraignant – pour eux, en soulignant les retombées économiques positives de l’action pour le climat ?
M. Jean-Louis Bricout. À l’heure de la crise en Ukraine, l’interconnexion des réseaux européens est un enjeu essentiel pour assurer la sécurité énergétique. Au niveau européen, l’Espagne et le Portugal en ont fait une condition sine qua non de leur engagement en faveur de l’action climatique. Quelle est votre réponse en face de ce contexte politique particulier ? En outre, quels enseignements tirez-vous du projet de loi relatif à la transition énergétique récemment examiné en première lecture par l’Assemblée nationale ? Enfin, comment mobiliser la jeunesse sur les enjeux climatiques, pour qu’elle les fasse aussi partager aux adultes ?
M. Jacques Myard. Si nous sommes d’accord sur l’objectif assigné à la conférence de Paris, je suis étonné de son coût, car la venue de 20 000 experts coûtera 160 millions d’euros. Y recherchera-t-on un accord contraignant ? Cette démarche me paraît vouée à l’échec. À Helsinki, des avancées avaient été réalisées grâce à un engagement politique non contraignant ; la formule ne doit donc pas être écartée a priori. La France adopte une attitude paradoxale en refusant l’énergie nucléaire ou les barrages hydrauliques tout en voulant s’engager dans l’action climatique. Quelle est au fond la position de notre pays ? Enfin, pensez-vous que le Fonds vert pour le climat pourra être alimenté par des droits de tirage spéciaux ?
Mme Sylviane Alaux. Les mots que nous avons entendus tintent positivement à nos oreilles, tout en étant empreints de réalisme. La nécessité de décarboner doit en effet nous pousser à dépasser le cadre strictement national du débat. Mais ces bonnes intentions sont fragiles, si l’on songe à leur possible mise en œuvre dans les pays en voie de développement. Comment ceux-ci pourront-ils fournir les efforts nécessaires alors qu’ils peinent déjà à se bâtir une économie pérenne ? Dans l’agenda des solutions que vous évoquez, un rôle spécial est-il imparti aux pays développés pour qu’ils accompagnent la démarche des pays en voie de développement sur la voie du respect des préconisations de décembre 2015 ?
Mme Sophie Rohfritsch. Nous abordons un sujet en effet essentiel. En attendant un accord entre les gouvernements, prend-on déjà en compte les conséquences du réchauffement sur la production agricole, alors que la FAO prévoit que les besoins alimentaires, pour des raisons démographiques, augmenteront de 60 % d’ici à 2050 ? Le dérèglement climatique affecte déjà l’arboriculture, la céréaliculture et l’élevage, mais provoque aussi une acidification des océans dangereuse pour les poissons. Est-ce pris en compte au niveau européen ?
M. Gilles Savary. Pour changer les comportements, il faut en effet changer de modèle économique. Au cours d’un déplacement récent en Chine, j’ai pu observer comment y émerge un nouveau modèle de mobilité. Puisque l’altruisme n’est pas l’une des premières valeurs anthropologiques, puis-je vous demander si la question démographique est taboue ? La croissance de la population mondiale, qui pourrait atteindre dix à onze milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle, constitue un choc écologique majeur. La population humaine n’est-elle pas devenue une population invasive pour la planète, qui fait obstacle aux efforts déployés contre le réchauffement de la planète ?
M. Michel Heinrich. Mon collègue Jean-Yves Caullet a déjà abordé la question de la biomasse sur laquelle je souhaitais également vous interroger. J’attendrai donc la réponse.
Mme Françoise Dubois. Hier, dans l’hémicycle, j’ai interrogé la ministre de l’écologie sur le rapport de synthèse du GIEC, sur l’organisation de la conférence de Paris et sur les perspectives de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour contenir la montée des températures à seulement 2 °C supplémentaires, il faut espérer, à mon sens, un accord mondial contraignant qui inclue les États les plus pollueurs. D’ici là, comment évoluent les pourparlers en amont de la conférence de Lima qui se tiendra le mois prochain ? Quels résultats sont-ils attendus ?
M. Philippe Plisson. Ayant présidé la commission de préfiguration du Conseil national de la transition énergétique, considérez-vous que le projet de loi sur la transition énergétique, tel qu’il a été adopté, répond à l’enjeu climatique ?
Les réactions les plus contradictoires se sont fait entendre à l’issue du Conseil européen consacré à l’action climatique. Tandis que les gouvernements applaudissaient, les organisations non gouvernementales étaient consternées. En matière de lutte contre le réchauffement, les États adoptent souvent une attitude schizophrène, puisqu’ils mêlent aux vœux en faveur de l’action climatique des incantations en faveur de la croissance. Est-ce hypocrisie, incompétence ou lâcheté face au chantier d’une révolution de notre société qu’une autre orientation induirait ?
M. Yves Nicolin. Madame l’ambassadrice, vous occupez une multitude de fonctions, puisque vous êtes représentante spéciale pour la conférence de Paris 2015, que vous présidez l’Agence française de développement et que vous siégez dans un certain nombre de conseils. À l’heure où un parlementaire ne peut même plus être maire d’une commune de 200 habitants, ce cumul est-il bien raisonnable ? (Murmures sur divers bancs)
Mme Chantal Guittet. L’enjeu principal de la conférence de Paris sera de définir des objectifs communs à tous les pays. Mais quelle sera la nature de ces engagements ? Il conviendra d’en assurer la traçabilité et le suivi grâce à des instruments internationaux. L’énergie faisait partie des grandes absentes au nombre des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), et il faut espérer qu’elle fera partie des objectifs de développement durable (ODD) pour l’après-2015. Loin des recoupements entre agendas qui peuvent nuire à l’efficacité de l’action climatique, n’est-ce pas une approche transversale qu’il faut privilégier ? Que pensez-vous des initiatives récentes en faveur d’une énergie durable pour tous, qui garantisse à chacun une vie digne ?
M. William Dumas. Le gaz de schiste est souvent présenté comme une source d’autonomie énergétique. Mais, dans les Cévennes, où je suis élu, le territoire est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et l’exploitation des gisements serait une catastrophe d’un point de vue touristique. Que pensez-vous de cette perspective ?
Mme Laurence Tubiana. Si j’avais le moindre doute sur le degré d’implication ou le niveau de connaissance des élus en matière de réchauffement climatique, je crois que cette série de questions l’auront définitivement dissipé. Je regrouperai les questions pour y répondre.
Un plan d’action climatique ambitieux peut-il être adopté pour introduire de nouveaux comportements ? Pourquoi ce succès pourrait-il être enregistré maintenant, même si tout le monde s’accorde sur la nécessité de changer ? À l’heure actuelle, des acteurs économiques et politiques conçoivent déjà le changement, dans des régions aux niveaux de développement aussi différents que la Californie, le Kenya ou encore l’Éthiopie, où le Gouvernement s’est récemment engagé à parvenir à la neutralité carbone en 2025.
Un effet de masse apparaît ainsi progressivement. Le récent prix Nobel d’économie Jean Tirole a, comme d’autres, travaillé sur les anticipations des marchés, en montrant que les marchés sont dirigés par une forme de psychologie. Les attentes des acteurs évoluent jusqu’au moment où la minorité cesse d’en être une pour déterminer à son tour l’opinion majoritaire (mainstream). En Chine même, des débats très intenses ont lieu au sein du parti communiste, comme je peux m’en rendre compte lors de mes fréquents déplacements dans ce pays.
Au cours de la semaine des énergies renouvelables organisée à Abu Dhabi, ce ne sont pas des petites et moyennes entreprises, mais de grandes sociétés pétrolières qui présentent leurs projets. Un noyau économique se constitue ainsi depuis dix ans. Le patron de Tesla, Elon Musk, a récemment donné accès à ses brevets gratuitement car il a besoin d’un grand marché des véhicules électriques pour développer son entreprise. De son côté, Michael Bloomberg a également fait paraître un rapport sur le risky business, tandis que le patron d’Unilever se retirait de BusinessEurope au motif que ce groupe est trop frileux quant à sa vision de l’avenir. Ces responsables, dont les anticipations convergent et qui sont animés par la recherche du profit, pensent aux marchés de demain.
Quant aux aspects financiers, il faut agir pour que l’économie décarbonée soit plus avantageuse que les secteurs qui reposent sur les centrales à charbon. Or la perception financière évolue, tant chez les gestionnaires de fonds de pension, chez les assureurs ou dans les banques commerciales telle la Bank of America. Car un risque carbone émerge, qui s’analyse comme une anticipation de standards et de normes nouveaux qui coûteront cher aux secteurs anciens.
L’agence de notation financière Standard&Poor’s vient d’introduire ce risque dans sa grille d’évaluation des portefeuilles. Distinct du risque carbone, le risque climatique prend quant à lui en compte l’évolution du climat et ses conséquences, ainsi que le coût des investissements nécessaires pour y faire face. Il faut miser sur cette évolution. La Banque mondiale et les institutions financières s’emploient ainsi à diminuer le coût des obligations vertes. Car l’accès à un capital bon marché est un enjeu primordial et une évolution en ce domaine peut entraîner des États comme la Pologne à adopter d’autres positions.
La politique commerciale fournit également des leviers d’action. Les autorités chinoises commencent à prendre en compte un prix du carbone implicite dans leurs anticipations. Une taxe carbone pourrait frapper les filières de l’acier, du ciment, du verre ou encore du papier, même si l’Union européenne ne parviendrait pas arrêter une démarche commune sur ce point. La menace d’une taxe aux frontières pour les produits à forte empreinte carbone, telle qu’elle avait été agitée aux États-Unis, pèse néanmoins sur les grands pays exportateurs. Cet outil sera au demeurant fatalement utilisé si trop de divergences se font jour dans les efforts de lutte contre le réchauffement climatique.
Les relations sino-américaines sont centrales à la solution du problème au niveau mondial. La Chine continue de croître de 7 % par an, tandis que 350 millions de ses habitants attendent encore d’entrer dans l’ère de la modernité, ce qui gonflera largement sa consommation. Mais le développement côtier et le risque sanitaire induit par l’usage excessif du charbon et des automobiles font voir au gouvernement chinois le coût environnemental de cette croissance et le poussent à une réorientation. Ainsi, le 23 septembre dernier à New York, le représentant chinois a annoncé pour l’an prochain un engagement de calendrier sur une réduction absolue de la consommation carbone de son pays, alors qu’une telle déclaration aurait été hors de question en 2009.
Il faut que les deux grands émetteurs de gaz à effet de serre parviennent à s’entendre d’ici à l’année prochaine. À cet égard, contrairement aux analyses que j’ai pu avancer il y a quelques années, je pense que c’est possible car la Chine est aujourd’hui décidée à trouver un accord ; elle a besoin des États-Unis et ceux-ci ont besoin d’elle. Car ils ne peuvent, l’un et l’autre, s’engager qu’en vertu d’un parallélisme et d’une comparabilité de leurs efforts. C’est la clé de la conférence de Paris 2015. C’est notre chance de réussir. L’accord trouvé sur cette base pourra trouver de nombreuses formes différentes. Il pourra être contraignant seulement sur le plan procédural, en imposant une obligation de présenter des résultats et de se plier à des mesures de vérification. Il marquerait une première étape vers la définition de nouveaux objectifs à horizon 2050. Car la conférence de 2015 n’apportera pas de solution définitive ; il faut aspirer à ce que les États proposent d’ici à 2020 de nouveaux objectifs à plus long terme. Même si l’Union européenne veut aller plus loin encore, il serait déjà essentiel que les deux grands émetteurs acceptent une discipline minimale, que l’accord impose une méthode de travail et une clause de rendez-vous tous les cinq ans, ce qui ne fait pas encore consensus aujourd’hui.
Où en est l’Europe ? Quelle solution permettrait de sortir de la crise européenne ? Le débat est lancé, notamment parmi mes collègues économistes. Ce qui est sûr, c’est que cette solution passe par un investissement dans une économie sans grand carbone, visant à accroître l’efficacité énergétique, à transformer nos systèmes de transport et à développer les nouvelles technologies. Certes, on pourrait décider d’investir dans une économie intensive en carbone, mais ce serait aberrant, alors même qu’un extraordinaire mouvement d’innovation technologique se fait jour, comme cela ressort du débat qui a eu lieu autour du texte sur la transition énergétique. En effet, le progrès est là, et on ne peut pas concevoir que l’investissement n’aille pas dans le sens du progrès.
Avant de répondre à la question sur le cumul de mes fonctions, je ferai quelques observations sur les grands objectifs du développement durable.
On ne parle plus seulement de climat : on parle aussi de développement, et d’un développement plus sobre en matière d’utilisation des ressources naturelles. On a compris que le changement climatique avait déjà provoqué des dégâts, au point de mettre en péril des besoins fondamentaux, notamment nos besoins en eau, laquelle est indispensable à l’agriculture et à la production d’énergie – centrales nucléaires comme centrales à charbon.
À cet égard, la conférence Paris Climat 2015 constitue une chance fantastique pour nous, alors même qu’une négociation sur le développement durable et sur des objectifs beaucoup plus intégrés entre l’environnement et le développement a été engagée. Le débat Nord-Sud traditionnel est d’ailleurs en train de changer fondamentalement. Les pays les moins avancés, donc les plus pauvres, sont les plus demandeurs d’un accord solide sur le climat : d’une part, ils sont les plus impactés par le changement climatique ; d’autre part, ils considèrent que « le rêve américain, c’est le cauchemar pour le reste du monde » – pour reprendre une formule que je trouve particulièrement heureuse.
Bien sûr, il ne faut pas négliger la société civile. En septembre dernier, la manifestation sur le changement climatique a réuni 400 000 personnes à New York. En 1970, la première célébration du Jour de la terre (Earth Day), avait mobilisé 20 millions de personnes dans la rue ; elle s’était même traduite dans les politiques américaines de l’époque, qui se sont alors révélées extraordinairement avancées en matière de pureté de l’air, de conservation des ressources, de biodiversité, des parcs naturels, etc.
La mobilisation de la société civile aura lieu de toute façon. Il faut donc engager le dialogue. Cela suppose de garder le contact avec les différentes organisations, notamment avec les plus nouvelles, qui mobilisent la société civile à travers les réseaux sociaux. Je pense à la pétition sur le climat que nous avions lancée sur le web avec quelques collègues scientifiques : nous étions péniblement parvenus à 200 000 signatures, lorsque Avaaz s’en est mêlée, nous en étions à 3 millions de personnes trois jours plus tard.
Au Bourget, nous pensons construire un « village » dédié à la société civile, où chacun pourra s’exprimer – les communautés autochtones, les nombreux mouvements, etc. Mme Sophie Errante a parlé de World Wide Views on Climate and Energy, fantastique opération sur laquelle nous nous étions appuyés pour préparer le débat sur la transition énergétique, avec l’Office danois de la technologie. De la même façon, au Bourget, nous souhaitons générer les contributions citoyennes et rapporter au Gouvernement la vision des citoyens.
Le débat français sur la transition énergétique n’a pas toujours été facile, mais les contributions des uns et les autres ont révélé une fantastique vitalité. J’ai par ailleurs remarqué que beaucoup d’acteurs locaux « pensaient le long terme » – pour répondre à l’interrogation de l’un d’entre vous. De nombreux acteurs, dont les jeunes, sont en train de penser le changement.
Cela dit, j’aimerais que nous soyons plus nombreux sur le chantier. En effet, je trouve parfois que je suis trop sollicitée. Mon métier n’est pas d’être diplomate, ni de travailler au sein du Gouvernement : je suis un professeur d’université, un chercheur qui a envie de s’impliquer dans la vie publique.
Penser la transformation du monde, défendre le climat, doit relever non pas seulement des écologistes, mais de la société tout entière. Je me suis battue à Sciences-Po pour que l’on mette en place des masters de formation en développement durable, et je me réjouis d’avoir des étudiants dans plus de cinquante délégations de la négociation « climat ». J’espère toutefois que dans quinze ans, je n’aurais plus à être à la fois « au four et au moulin ».
De ce fait, j’ai été amenée à renoncer à beaucoup de choses – mes conseils dans différentes fondations où j’opère, mes cours à Columbia University, etc. – et je le regrette. Mais en janvier 2016, je « rendrai les clés » au ministère des affaires étrangères pour retrouver mes chers étudiants. Des gens plus jeunes reprendront le flambeau. Ils auront à travailler sur ce que l’on commence à reconnaître comme étant un sujet de politique publique majeure.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci infiniment, Madame, d’avoir mis votre expertise, votre compétence, votre engagement, votre militantisme au service de ce grand enjeu.
16. Audition de Mme Hakima El-Haite, ministre déléguée chargée de l’environnement du Royaume du Maroc, sur la politique marocaine dans le domaine du développement durable, ses priorités pour la conférence Paris climat 2015 (COP 21) et la Présidence marocaine de la Conférence des parties de 2016 (COP 22) (28 janvier 2015)
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Hakima El-Haite, ministre déléguée chargée de l’environnement du Royaume du Maroc, pour une réunion fermée à la presse et commune avec la Commission du développement durable et la Commission des affaires européennes.
Merci, madame la ministre, d’avoir dégagé du temps lors de votre visite à Paris pour vous rendre devant nos Commissions. Nous espérons que cette audition nous permettra de mieux comprendre la façon dont le Maroc appréhende les enjeux de l’environnement et prépare à la fois le rendez-vous de la conférence sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris à la fin de cette année, et celui de 2016 au Maroc, votre pays ayant été désigné pour présider la COP22.
Nos trois Commissions sont très impliquées dans la préparation de ces conférences. Nous avons constitué un groupe de travail réunissant les députés spécialistes de ces sujets, pour faire tout ce qu’il est possible de faire au titre de la diplomatie parlementaire. Notre travail vise, dans un premier temps, à mieux comprendre les positions des pays parties.
Vous êtes vous-même, madame la ministre, une spécialiste de l’environnement, ce qui vous a permis d’exercer des responsabilités dans ce domaine. Vous avez été directrice générale de l’Agence urbaine de Fès, vous avez fondé une entreprise spécialisée dans l’ingénierie de l’environnement, et vous avez également eu des activités associatives.
Votre ministère joue un rôle clé dans la définition de la stratégie de développement durable au Maroc. Le Parlement marocain a adopté une loi-cadre qui doit déboucher sur un plan d’action concernant tous les secteurs de l’économie. Par ailleurs, votre pays a lancé un plan d’investissements verts, décliné en plans sectoriels.
Le Maroc est engagé depuis longtemps dans les négociations sur le climat. Il est signataire de la convention-cadre de 1992, a accueilli la COP7 à Marrakech en 2001, et a ratifié le protocole de Kyoto en 2002. Votre pays est par ailleurs un pont avec l’Afrique subsaharienne : votre influence en Afrique contribuera très certainement à l’élaboration d’un consensus au sein du groupe africain.
Je vous invite à présenter les actions conduites au Maroc dans le domaine du développement durable, vos objectifs, ainsi que votre évaluation des résultats de Lima et ce que vous attendez de la conférence de Paris.
Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir car j’apprécie beaucoup votre action : vous êtes une de ces femmes marocaines qui font honneur à leur pays et aux femmes en général. À un moment où les relations bilatérales entre nos deux pays connaissent quelques difficultés, nous avons tous à cœur de les surmonter le plus rapidement possible.
Mme la présidente Danielle Auroi. Le Maroc est un partenaire majeur de la logique euro-méditerranéenne, si importante pour le dialogue Nord-Sud. Vous nous direz, Madame la ministre, ce que, vu du Maroc, on pense de l’Europe de l’énergie, cette nouvelle politique européenne, soixante ans après l’Europe du charbon et de l’acier, et en particulier de la logique d’interconnexion des réseaux en matière d’énergies renouvelables. Le Maroc est concerné par cette logique, dans la mesure où sa production d’électricité photovoltaïque est importante.
Vous participez activement, dans le cadre de l’Union de la Méditerranée, à la stratégie du développement urbain durable ou encore à la gestion durable de la ressource en eau. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces programmes, s’agissant du Maroc ?
Avec Christophe Bouillon et quelques autres, nous nous sommes rendus à Lima, où nous avons pu cerner la complexité des enjeux. Quelles sont vos priorités dans la lutte contre le changement climatique ? Selon vous, en quoi Paris doit être une étape essentielle pour permettre à la communauté internationale d’être plus solidaire avec les générations futures ? Que pensez, à cet égard, du Fonds vert ? Quelles autres formes d’incitation financière ou d’accès au financement verriez-vous pour les pays du Sud ?
M. Christophe Bouillon, vice-président. Depuis sa création, la Commission du développement durable suit les négociations internationales dans les domaines du climat et de la biodiversité, et nous avons délégué plusieurs de nos membres aux réunions interparlementaires qui se sont tenues dans le cadre de différentes négociations. Nous sommes particulièrement désireux de connaître la politique marocaine dans le domaine du développement durable, ainsi que vos priorités pour la conférence de Paris en décembre 2015, dans la mesure où la conférence des parties de 2016 sera présidée par le royaume du Maroc.
Nous souhaiterions tout particulièrement connaître les thèmes sur lesquels vous entendez mettre l’accent. Est-ce la question de la ressource en eau, celle de la désertification, celle de la gestion des déchets… ? Par ailleurs, quelles sont les conséquences économiques et sociales des changements climatiques au Maroc sur lesquelles vous comptez axer vos politiques d’adaptation et d’atténuation ?
Mme Hakima El-Haite, ministre déléguée chargée de l’environnement du Royaume du Maroc. Les relations entre nos deux pays sont structurelles, historiques, et j’espère que nous dépasserons rapidement les difficultés que vous avez évoquées, madame la présidente Élisabeth Guigou.
Le Maroc a engagé un processus d’adaptation au changement climatique dans les années soixante, alors que l’on ne parlait pas encore de changement climatique. C’est en effet à cette époque que le Maroc, parce qu’il connaissait des périodes de sécheresse récurrentes et qu’il arrivait que nos villes soient privées d’eau potable, a édifié les premiers barrages de la région. Pendant une décennie, notre pays a ainsi conduit une politique en vue de sécuriser son alimentation en eau potable. Nous avons compris par la même occasion que les bassins versants devaient être protégés, et nous sommes ainsi partis dans l’aventure de la reforestation, de la stabilisation des sols, afin de diminuer l’envasement des barrages. La culture du développement durable a tout d’abord existé chez nous en raison de besoins nationaux, pour répondre à des phénomènes naturels propres au Maroc.
Notre pays connaît une distribution irrégulière des précipitations, entre le Nord, où elles sont de 1 800 millimètres cubes par an, et le Sud, où elles sont de moins de soixante millimètres cubes. C’est ainsi que nous en sommes venus à la notion de plan national des ressources en eau. Ce plan s’est sophistiqué d’année en année, et l’alimentation en eau potable a ainsi pu être sécurisée. Alors que dans les années quatre-vingt-dix le taux d’alimentation en eau potable était inférieur à 30 %, il est de 100 % aujourd’hui. Sur cette politique de la ressource en eau, s’est ensuite greffée, pour assurer la sécurité alimentaire, une politique agricole, profitant elle-même des barrages.
Dans les années quatre-vingt-dix, le Maroc a connu une passe très difficile, avec un plan d’ajustement structurel. À partir de 2000, avec l’avènement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous avons engagé une période de stratégies sectorielles. Il s’agit de stratégies ciblées, avec un objectif de rattrapage économique et social, dans un contexte où le potentiel en eau avait diminué, la facture énergétique avait été multipliée par quatre, les prix des denrées, du blé, du sucre, avaient augmenté. Face à la facture énergétique, une caisse de compensation avait été mise en place, mais une telle situation appelait d’autres solutions. À partir de 2003, nous avons donc commencé à cibler les stratégies. C’est ainsi qu’en dix années de règne, nous avons réalisé en termes d’indicateurs économiques et sociaux ce qui n’avait pu l’être en quarante ans : le PIB marocain a été multiplié par trois, le taux d’accès à l’eau potable est passé de 14 à 90 %, le taux d’électrification de 15 à 97,5 %, la pauvreté a diminué de moitié, passant de 17 à 8 %, l’extrême pauvreté a été pratiquement éliminée, le taux de scolarisation a augmenté…
Cette période d’accélération économique et sociale a eu – on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs – un impact important au plan environnemental. L’empreinte écologique a été significative, la biocapacité a diminué – une dégradation représentant un coût monétaire de près de 4 % du PIB. En même temps, la densification de la population, et sa concentration, à hauteur de 60 %, sur le littoral, de même que 90 % de l’industrie et 95 % du tourisme, engendrait d’énormes pressions.
Les lois environnementales ont commencé à voir le jour en 2003 avec la promulgation de la loi sur les études d’impact, qui impose à tous les projets, publics comme privés, une étude certifiant leur soutenabilité environnementale. Puis, le lancement de la charte nationale de l’environnement et du développement durable, en 2008, a donné lieu à l’intégration dans la nouvelle Constitution du Maroc en 2011 du droit à un environnement sain et au développement durable.
Les stratégies sectorielles concernent tout d’abord la politique de l’eau, sachant qu’est anticipé un déficit de 5 milliards de mètres cubes à l’horizon 2020. Il s’agit d’organiser la solidarité des régions et des agences marocaines au plan de la distribution et de la sécurisation de l’eau potable.
Le plan vert, ensuite, plan agricole lié à la politique de l’eau, vise à convertir les systèmes gravitaires d’irrigation en systèmes de goutte-à-goutte permettant d’économiser l’eau et en même temps d’intensifier la production. Ce plan traite également la question des pollutions par pesticides et autres.
La politique énergétique, initiée en 2010, est fondée sur l’objectif de 42 % d’énergies renouvelables – éolien, solaire et hydroélectricité – dans le mix énergétique marocain. Quand nous avons défini cette stratégie, les Marocains pensaient qu’elle était trop ambitieuse, que nous n’aurions pas les moyens d’atteindre cet objectif. Or nous sommes sur la bonne voie. Nous avons déjà réalisé une grande station d’énergie solaire à Ouarzazate, la première au monde, et nous avons lancé les deuxième et troisième étapes. Nous sommes en train de réaliser 500 gigawatts d’énergies renouvelables, et nous escomptons 2 000 gigawatts à l’horizon 2020.
Cette nouvelle tendance de la politique énergétique, entièrement durable, est elle-même une réponse à une problématique nationale, car nous étions dépendants à 97,5 % de l’extérieur pour notre consommation d’énergie. Cette facture pesait très lourd sur le budget de l’État, car celui-ci subventionnait l’énergie extérieure par une caisse de compensation, ce qui profitait aux industriels marocains mais aussi aux étrangers transportant des marchandises dans notre pays. Pendant des années, on se demandait comment mettre fin à ce système et aller vers des prix réels, sans affecter pour autant la couche sociale bénéficiant de la subvention du carburant.
Dans le cadre d’une nouvelle vision déclinée par la Constitution, a été promulguée, début 2014, une loi-cadre sur l’environnement et le développement durable, qui a posé trois principes majeurs : l’intégration de la protection de l’environnement dans toutes les politiques publiques et tous les projets de développement au plan national, l’intégration de la contrainte du changement climatique dans tous les projets, enfin la considération de la croissance verte comme une composante de la dynamique économique et industrielle marocaine. Les départements ministériels ont une année pour se mettre à jour et intégrer les exigences de cette stratégie. Des divisions ou directions ont été créées dans les ministères afin de mettre en œuvre ses recommandations et plans d’action.
Grâce à ce travail, nous avons été le premier pays à préparer un plan d’investissements verts, outil proposé à New York. C’est le « verdoiement » de toutes les politiques sectorielles, avec une convergence : les études ont en effet montré une perte de quatre points de PIB à cause du manque de convergence. Les départements ministériels ont constaté que cette stratégie permettait de réaliser des gains : si elle coûte 2 % à leurs budgets, les gains sont de 8 %. Je vous donne un exemple. Les exploitants agricoles du Maroc 95 % d’entre eux ont sont propriétaires de moins de cinq hectares , qui utilisaient du butane subventionné par l’État, ont été incités par une subvention à passer au pompage solaire. Ce projet a permis de réduire la subvention du butane, qui représentait 12 % des dépenses de la caisse de compensation. Ce sont des économies pour l’État. Il en va de même de la levée de la subvention sur les énergies fossiles : celle-ci avait perdu toute logique dans le contexte d’une stratégie de croissance verte. La question était posée depuis des années ; nous avons eu le courage de prendre la bonne décision.
En 2005 a été lancée l’initiative nationale de développement humain, en vue de réduire les ségrégations sociales et de faire en sorte que le développement économique ait un plus grand impact sur le social, mais elle a longtemps piétiné. Nous sommes aujourd’hui passés aux évaluations des politiques publiques, qui nous permettent de mesurer l’impact de la création de valeur ajoutée sur le social, tout en nous inscrivant dans une philosophie de croissance verte.
De même, si le chantier des déchets a longtemps accusé du retard, on ne parle plus aujourd’hui, au Maroc, de déchets : on parle de ressource. Nous sommes en train de créer des centres de valorisation de matière. Une dizaine de filières industrielles sont en cours de création, pour les déchets dangereux et non dangereux. Cela a permis d’entraîner le secteur privé dans des investissements importants, de créer de l’emploi, et l’État a pu se désengager de chantiers de traitement de déchets dangereux pour lesquels il n’avait pas de compétences.
Notre stratégie de développement durable nous coûtera 2 % du PIB mais elle permet des gains au plan national, ainsi que la création de 250 000 emplois à l’horizon 2020 grâce à l’économie circulaire.
Dans ma déclaration à Lima, j’ai dit que nous étions en train de préparer un accord à Paris. Il faut garder en mémoire que les enjeux des différents groupes de pays parties ne sont pas les mêmes. Au sein même du groupe auquel le Maroc appartient, le Groupe des 77 plus la Chine, les enjeux sont divers. La COP21 devrait être la conférence qui apporte une réponse gagnant-gagnant à toutes les parties prenantes. C’est certes difficile, mais nous avons gagné du terrain à Lima en parvenant à instaurer une répartition de 50 % des fonds pour les mesures d’atténuation et 50 % pour les mesures d’adaptation. Les pays africains, fortement menacés par les changements climatiques, et où se trouvent quarante des cinquante pays les plus pauvres du monde, perdent 8 % de terres chaque année. On ne peut fermer les yeux sur leur situation. Limiter le réchauffement à moins de deux degrés Celsius, c’est l’objectif ultime. Pour l’atteindre, les mesures d’atténuation, je vous l’accorde, sont prioritaires. Nous nous attendons à ce qu’à la conférence Paris les engagements des pays soient clairs et échelonnées dans le temps, ainsi que leurs participations financières, et que les apports au Fonds vert soient clarifiés : il ne s’agit pas de donations mais d’engagements des pays industrialisés.
L’exemple marocain peut montrer aux pays africains qu’il n’y a pas besoin de 100 % d’apport initial pour financer les mesures d’adaptation, qu’une petite participation suffit pour enclencher l’investissement privé. Le Maroc a prouvé que, moyennant un euro de financement, nous pouvons faire appel à cinq euros d’investissement privé. Cette expérience est importante car les pays africains peuvent se projeter dans le Maroc, alors qu’ils ne se projettent pas forcément dans la France ou d’autres pays industrialisés. La COP21 devra également clarifier les besoins. Tels qu’ils ont été estimés, ils démotivent les pays industrialisés, qui se disent en crise. En tout état de cause, il n’y a pas besoin de 100 % de financement, et le plan vert, le plan solaire marocains en sont les meilleurs exemples. Les filières industrielles créées au Maroc grâce à une petite contribution de l’État ont fait gagner de l’argent à celui-ci
De Paris dépendra la COP22 au Maroc. J’espère que les critères d’éligibilité au Fonds vert seront clarifiés. Pour le moment, nous savons qu’il y a quelques 10 milliards de dollars dans le Fonds, mais non comment ils seront répartis. On nous demande des intended nationally determined contributions (INDC) d’ici à mars, alors que les pays africains sont dans l’incapacité d’y pourvoir à cette date ; le Maroc, qui est prêt depuis un an déjà, se mobilise pour les aider.
Je suis confiante quant à la possibilité que les négociations à Paris aboutissent à un accord qui soit opérationnel. Je reste donc sur le plan A, supposant que Paris va réussir. Si ce n’est pas le cas, nous devrons revoir les accords. À Lima, j’ai dit que Varsovie était la COP des concertations, Paris celle des décisions, et que le Maroc serait celle de l’action : j’espère qu’il nous reviendra d’opérationnaliser les accords de Paris.
M. Jean-Pierre Dufau. Vous avez, madame la ministre, montré le pragmatisme avec lequel l’environnement a été pris en considération dans votre pays. Comme M. Jourdain faisait de la prose, vous avez commencé par faire de l’environnement sans le savoir, avant d’en prendre conscience et d’être monté en pointe avec un dispositif particulièrement intéressant, adapté à votre pays mais pouvant faire école. Cette adaptation pragmatique est un élément frappant de votre exposé. Partis du développement, vous avez traité l’ensemble des problèmes liés au développement : il n’y a ainsi pas d’opposition entre le développement et le respect de l’environnement. C’est la même logique, la même dynamique : on ne peut faire l’un sans l’autre.
Si vous allez contribuer largement, et même à titre exemplaire, à la conférence de Paris, vous privilégiez une approche selon des enjeux différenciés. Vous considérez que ce n’est pas la contrainte qui permettra de réussir, mais plutôt une dynamique permettant à chacun de participer, de faire ce qu’il peut comme il peut ; cette addition de bonnes volontés donnera un résultat global. En même temps, nous sommes obligés de nous fixer des objectifs : les scientifiques ont démontré que les deux degrés, par exemple, étaient incontournables. Il risque d’être difficile de concilier votre démarche, dont je partage la philosophie, avec les objectifs à atteindre.
Entendez-vous faire profiter de votre expertise les autres pays du continent africain, pour lesquels le Maroc peut être une tête de pont exemplaire dans ce domaine ?
M. Michel Destot. Le Maroc, comme tous les pays du monde, est touché par l’urbanisation, une urbanisation pas toujours maîtrisée qui est l’un des nœuds du problème du développement. Le plan national marocain prend-il en considération ce problème ? Nous voyons bien, dans certains pays africains, la difficulté de maîtriser le phénomène, de même que les dégâts de l’absence de maîtrise.
La dimension environnementale doit être liée au développement social et économique. Dans les relations entre nos deux pays, l’Agence française de développement (AFD) a souhaité développer cette dimension écologique. Quel bilan faites-vous de cette action ?
Ma dernière question rejoint celle de M. Dufau et concerne votre rôle de leader sur le continent africain. On ne peut imaginer que la COP réussisse si tous les continents ne s’engagent pas. Comment les pays africains vont-ils venir ensemble à Paris en décembre ?
Mme Catherine Quéré. Les citoyens marocains, madame la ministre, se sont-ils accaparés de façon positive la politique environnementale ? Y sont-ils réceptifs ? Par ailleurs, quels sont, en dehors des énergies renouvelables, les systèmes qui produisent de l’électricité au Maroc ? Quel est le pourcentage des énergies renouvelables ? Avez-vous mesuré l’empreinte carbone de votre pays ? Enfin, avez-vous une politique de tri des déchets ?
M. Yannick Favennec. Le changement climatique représente une grande menace pour la croissance et le développement durable en Afrique, continent qui contribue pourtant le moins aux émissions globales de gaz à effet de serre. L’Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment à cause de la dépendance des rendements de l’agriculture à la pluie, de la pauvreté et du manque d’infrastructures. Les effets du changement climatique réduction de la production agricole, détérioration de la sécurité alimentaire, incidence accrue des inondations et des sécheresses, propagation des maladies sont d’ores et déjà évidents. Des mesures urgentes doivent être prises pour réduire les niveaux d’émission et permettre à l’Afrique de s’adapter au changement climatique. Quelles sont, selon vous, les mesures les plus urgentes ?
Mme Hakima El-Haite. Le Maroc a engagé il y a quelques années une politique de coopération Sud-Sud. Notre pays est une porte vers l’Europe et connaît un important phénomène de migration depuis le Sahel. Les flux migratoires au Maroc dépassent les 100 000 personnes. Nous avons régularisé cette année, dans le cadre de nos conventions relatives aux droits humains, la situation de 30 000 migrants, que nous avons intégrés à notre marché du travail. Le changement climatique et la dégradation des terres en Afrique a également un impact sur notre pays. Il était donc nécessaire de réfléchir à une politique migratoire nationale. C’est dans ce cadre que Sa Majesté Mohammed VI a décidé de renforcer la coopération Sud-Sud, en favorisant l’investissement dans les pays africains et en créant des projets de développement en Afrique. Le Maroc, par le biais de nombreuses institutions et entreprises, est aujourd’hui implanté dans beaucoup de pays africains ; c’est le cas, par exemple, de nos institutions financières, telles qu’Attijariwafa Bank, présente dans vingt-quatre pays africains.
Au sein du ministère de l’environnement, nous avons créé un centre de compétence sur les changements climatiques, qui travaille depuis un an avec plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs politiques de gestion des déchets, de traitement des eaux usées, d’économie circulaire… Après Lima, ce centre, grâce au soutien du Fonds vert et du Gouvernement allemand, a étendu ses activités au soutien à la préparation des INDC par les pays africains. Mme Girardin, que j’ai rencontrée ce matin, m’a parlé d’Expertise France, créé il y a deux jours avec le même objectif d’accompagner les pays africains à préparer leurs contributions. Le premier objectif est d’aider ces pays à bénéficier du Fonds vert et à opérationnaliser leurs projets.
Nous avons appris de nos échecs, comme des vôtres, et nous apprenons aussi des succès. Nous avons acquis une expertise, qui permettrait à nos entreprises, soit directement, soit dans le cadre d’une coopération triangulaire, par exemple avec les entreprises françaises présentes sur notre marché national, de se rendre dans les pays africains pour réaliser ces projets.
S’agissant du tri, nous n’avons pas, au Maroc, ni dans les autres pays africains, les moyens de prévoir cinq poubelles. Nous avons développé un modèle de deux poubelles, l’une pour les déchets organiques, l’autre pour les déchets non organiques. À la fin de l’année 2014, j’ai mis en place une écotaxe sur le plastique. Ces recettes sont entrées dans les caisses de l’État et seront redistribuées pour lancer le recyclage en 2015, à partir de Casablanca. Nous ne pratiquons plus la mise en décharge ; nous sommes dans la valorisation, dans toutes ses composantes.
Nous avons créé nos propres modèles. Dans le passé, nous avions tenté de transposer des modèles français, mais cela a été un échec. Je pense par exemple aux stations de compostage implantées au Maroc dans les années soixante, avec des technologies françaises : ces technologies n’étaient pas adaptées aux déchets marocains, en raison d’un taux d’humidité différent, d’un taux de matière organique différent, de l’absence de tri, et nous avons connu des cas de contamination.
Je salue l’AFD, auprès de laquelle j’ai d’ailleurs été consultante sur le projet de dépollution industrielle de la baie d’Agadir. Sa contribution à notre programme d’alimentation en eau potable a été très importante, ainsi que pour le traitement des eaux usées. En revanche, elle est encore très peu présente au ministère de l’environnement, sans doute parce que celui-ci est de création récente ; elle est davantage active auprès de l’office national de l’électricité et de l’eau potable, ainsi que du ministère de l’agriculture.
L’urbanisation est un problème sensible. Avec les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres, la salinisation de l’eau dans plusieurs parties du territoire, la population rurale a commencé à migrer vers les villes. Ces dix dernières années, nous avons lutté contre la ceinture de bidonvilles qui se créait ainsi autour des villes marocaines, et ce avec des projets de ceintures vertes et de développement vertical, en lieu et place du développement horizontal qui a coûté très cher à l’État, pendant longtemps.
J’ai l’habitude de dire que le ministre le moins aimé, dans tous les gouvernements du monde, est le ministre de l’environnement, qui doit toujours évaluer et critiquer ses collègues. On ne peut protéger l’environnement sans impliquer les citoyens. Mon ministère n’ayant pas les moyens de toucher ceux-ci directement, nous passons par les universités, les écoles, les associations, dont j’ai fait des alliés d’excellence. Nous avons créé le forum des associations spécialisées dans l’environnement et nous accordons à ces associations un accès direct sur le site Web du ministère. Nous sommes également en train de conduire un programme d’éducation environnementale en milieu scolaire, et nous recevons les écoles. De même, nous préparons une campagne de communication en direction du grand public concernant le recyclage.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci beaucoup. Vous avez été très éloquente, et je suis certaine que les choses vont bien avancer avec vous.
Mme la présidente Danielle Auroi. Merci. Vous avez été précise et avez su donner de l’espoir à chacun.
17. Audition de M. Dominique Potier sur son rapport d’évaluation et de révision du plan Écophyto : « Pesticides et agro-écologie : les champs du possible » (10 février 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, je tiens à vous faire part du plaisir que j’éprouve à accueillir de nouveau notre collègue Gilbert Sauvan, qui n’a pu participer à nos travaux pendant plusieurs mois.
Nous auditionnons aujourd’hui notre collègue député Dominique Potier, membre de la commission des affaires économiques, qui a rendu au Premier ministre un rapport d’évaluation et de révision du plan Écophyto intitulé « Pesticides et agro-écologie. Le champ des possibles ». Je rappelle que le plan Écophyto, lancé dans le cadre du Grenelle de l’environnement, visait à réduire de moitié la consommation de produits phytosanitaires dans l’agriculture d’ici 2018.
Nous avions auditionné, le 17 juillet 2013, M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, sur l’agro-écologie – et il avait alors évoqué la révision du plan Écophyto. Il a procédé récemment à des annonces reprenant les conclusions de votre rapport et dévoilant ce que l’on pourrait appeler un plan « Écophyto 2 ».
La commission avait entendu M. Serge Bardy lorsqu’il avait rendu son rapport sur la filière papier. Je crois qu’il est important que notre commission auditionne les parlementaires lorsqu’ils rendent des rapports sur des thématiques qui relèvent de ses compétences.
M. Dominique Potier. Si je suis membre de la commission des affaires économiques, c’est pour y défendre mes conceptions sur l’agro-écologie et je suis fier de présenter les conclusions de mon rapport devant la commission du développement durable, dont je suis les travaux et dont je partage l’esprit.
La mission que m’a confiée le Premier ministre se situait à mi-parcours, soit cinq ans, de la mise en œuvre de l’engagement 129 du « Grenelle de l’environnement », et à la croisée de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la maîtrise des pesticides. Celle-ci prévoyait, à échéance de cinq ans, une révision du plan ainsi qu’une évaluation des politiques nationales. Le Gouvernement français a procédé, au sein de ses services, à cette évaluation outil par outil ; il a aussi souhaité confier à un parlementaire une mission qui permettrait de dire des choses que l’administration ne pouvait dire sur elle-même.
La France connaît une période de transition de l’État-providence, de l’appareil productif et de l’écologie ; c’est au point de rencontre de ces deux dernières que se situe l’agro-écologie, promue par Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. « Écophyto » et la gestion des pesticides sont à la pointe de cette démarche, à la fois comme indicateur et comme condition de réussite – car, si ce plan échoue, c’est que l’agro-écologie n’aura été qu’un discours.
Les conclusions ont été présentées il y a deux mois devant le Premier ministre, Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et M. Stéphane Le Foll. Un comité d’orientation stratégique a avalisé la charpente du rapport, et le Gouvernement a fait siennes la plupart de ses propositions. L’année 2015 a été donnée comme date de départ pour l’agro-écologie.
Le rapport prend acte d’un relatif consensus sur ces questions au sein des différentes familles de pensée représentées au Parlement. Des travaux du Sénat ont abouti à des propositions relatives aux phytovictimes, dont certaines ont été reprises dans la loi d’avenir pour l’agriculture – je pense à la phytovigilance. Un certain nombre de nos collègues ont également travaillé sur ces sujets : Bertrand Pancher ; Antoine Herth, qui avait, à la demande de François Fillon, remis un rapport sur les biotechnologies ; Brigitte Allain, qui a conduit avec moi de nombreuses auditions. Sur tous les bancs, je constate un grand pragmatisme et une relative indulgence envers l’échec de la France à tenir les ambitions affichées par le Grenelle. L’objectif, je le rappelle, était de réduire de 50 %, entre 2008 et 2018, l’usage et la consommation de pesticides dans notre pays.
Où en sommes-nous, cinq ans après ? En 2012, un palier a été atteint, puis, en 2013, une reprise de 9 % de la consommation a été observée, ce qui donne, en moyenne annuelle depuis 2008, de 2 à 3 % d’augmentation. Force est donc d’admettre l’échec. Mais chacun, par-delà les clivages politiques, s’accorde sur le fait qu’il faut chercher à comprendre ce qui n’a pas marché, et reconnaît humblement que les transitions exigent du temps et qu’une volonté ferme est nécessaire pour avancer.
Il convient de souligner tout d’abord que les intuitions des acteurs du Grenelle étaient fondées et qu’elles ont été confortées par la suite des événements. Un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a confirmé la corrélation entre l’exposition aux pesticides et le développement de cancers ou de maladies endocriniennes. Cela doit nous conduire à ne pas attendre vingt ans pour protéger toutes les populations exposées à ces produits.
Nous avons ensuite découvert que, si nous nous sommes laissés obséder par les effets des pesticides sur la qualité de l’eau, les études sur l’air sont encore balbutiantes et doivent être approfondies, tandis que la microbiologie des sols demeure largement une terra incognita… (Sourires). Il reste à mettre en évidence comment, à long terme et même à doses d’exposition minimes, les sols sont affectés.
Enfin, l’évolution des marchés européens a montré à quel point ceux-ci sont sensibles à la question des pesticides dans l’alimentation. Coca Cola, par exemple, est plus exigeant dans ses contrats à long terme que les directives européennes elles-mêmes. Cela répond à une demande des consommateurs et nécessite une évolution de nos pratiques de production.
La prise de conscience par les agriculteurs du risque pour eux-mêmes est significative. Ils ont formé, en lien avec l’État, 200 000 personnes à ces questions, dont 95 % d’agriculteurs et 5 % de jardiniers amateurs ou de gestionnaires d’espaces publics. L’ensemble des outils mis en place – bulletin de santé végétal, Certiphyto, fermes Dephy (acronyme de « Démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phytosanitaires »), etc. – ne pouvait cependant donner de résultats rapides.
Par ailleurs, l’évolution des structures de production agricoles, influencée par la politique agricole commune (PAC) dont le virage agro-environnemental ne date que de 2013, a constitué un facteur d’échec. Nous avons connu deux années où les prix des matières végétales étaient très favorables, ce qui a primé sur toute autre considération, tandis que les conditions climatiques, particulièrement mauvaises au printemps 2013, ont motivé un traitement accru aux pesticides.
Il nous faut donc agir en nous fondant sur des principes. Sur la base de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, dite « loi Labbé », et avec l’accord de Mme Ségolène Royal, il convient d’accélérer la mise en œuvre des interdictions d’utilisation des phytosanitaires dans les espaces publics, en établissant un mémento pédagogique et réglementaire à l’intention des intercommunalités. L’interdiction portera aussi sur la vente en libre-service de ces produits aux jardiniers amateurs. Il s’agit là de mesures immédiates propres à sensibiliser aux risques que représentent ces produits et de préparer leur interdiction future.
Cependant, l’essentiel de notre action doit porter sur l’agriculture, et en particulier sur le blé, le colza, la vigne et l’arboriculture, qui représentent 60 % de l’utilisation des pesticides.
Nous préconisons de maintenir le principe d’une réduction de moitié, en procédant en deux étapes.
Pour les cinq premières années, l’objectif est l’amélioration des usages. Cela consiste à réduire le gaspillage, en utilisant mieux les pesticides, au bon moment, à la bonne dose, avec des règles d’application et du matériel différents. Un accord a été passé avec les instituts de recherche des coopératives, Arvalis-Institut du végétal et InVivo AgroSolutions, et nous discutons encore d’ajustements à la marge avec Orama. Cela doit conduire à une réduction de 20 % de l’usage des produits, tout en conservant nos structures de production, et sans perte de parts de marché.
Nous proposons également de mettre en place une surveillance tous azimuts des impacts : cessons d’être obsédés par la seule qualité de l’eau, quand nous savons que celle de l’air et la microbiologie des sols ne sont pas moins importantes ! Quant à l’alimentation, elle doit faire l’objet de nouveaux indicateurs. Bref, il ne saurait y avoir de politique phytosanitaire qui ne s’inscrive dans un plan global d’agro-écologie : on ne peut pas prendre les problèmes isolément.
L’entreprise doit être au cœur de notre action. Le premier plan Écophyto a privilégié les organismes de développement, de recherche et d’infrastructures, mais c’est au niveau des entreprises, des exploitations, des administrations locales ou encore des jardiniers amateurs, que se prennent les décisions. Nous devons mieux accompagner les décideurs, grâce à des aides et des conseils, et proposer aux deux filières les solutions de nature à favoriser la mise en œuvre commune des moyens disponibles au niveau territorial. Par ailleurs, le rapport suggère une fiscalité en légère augmentation, mais dont les recettes soient entièrement recyclées au bénéfice de la transition agroécologique.
Notre action s’exercera nécessairement dans un cadre européen, car nos producteurs se trouvent placés dans une situation insupportable. Certains produits qui pénètrent le marché français sont soumis à des règles sanitaires bien moins contraignantes que les nôtres. C’est le cas, en particulier, des importations en provenance de plusieurs pays de l’Union européenne, mais aussi de pays tiers, la Chine notamment, dont certains se livrent à la fraude fiscale aux redevances sur les produits phytopharmaceutiques et à la contrefaçon de molécules. Il nous faut donc lutter pour l’harmonisation des contraintes, ainsi que pour celle des produits, qui ne sont pas les mêmes, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique. Il y va de notre capacité à concilier transition et maintien de nos chaînes de production.
Pour atteindre la baisse de 20 % ou 25 % qu’il s’agit d’atteindre dans cette première étape, le rapport préconise la mise en œuvre de mesures déjà connues. Les produits de biocontrôle, qui représentent actuellement de 3 à 5 % de la substitution à l’agrochimie, pourraient voir cette part passer à 10 % ou 15 % à un horizon de cinq à dix ans selon les experts. Le plan Écophyto a par ailleurs largement ignoré la question de l’équipement ; or, dans les vignes, l’utilisation de machines adéquates permet de réduire de 40 % la consommation de produits. Des progrès importants restent également à accomplir dans le domaine de la génétique, s’agissant notamment de la résistance aux produits.
Mais la question essentielle demeure à mes yeux celle de l’allongement des rotations de cultures. Une des causes de notre échec est liée à l’un des traits majeurs de l’évolution de la « ferme France » : l’agrandissement des exploitations, qui s’est souvent accompagnée d’une spécialisation nuisible à la biodiversité. La défense de celle-ci, par exemple à travers les plans « protéines végétales » et « Ambition bio », est une réponse à la dépendance aux pesticides et un moyen de réduire structurellement le poids des biodépresseurs.
Dans la perspective d’une réduction de 50 % d’ici 2020, date de la réforme de la PAC, il est souhaitable que la régulation foncière et la politique d’installation contribuent à garantir cette biodiversité économique, importante pour nos paysages comme pour l’environnement. Je propose même que l’allongement des rotations et la diversité des cultures deviennent un élément d’éco-conditionnalité dans la future PAC, ce qui ne manquera toutefois pas de se heurter aux intérêts de certains bassins de production. Je demande également l’harmonisation des normes européennes : en arboriculture et viticulture, les doses d’homologation sont actuellement liées à la surface cadastrale, alors que seule la surface foliaire est pertinente. Un outil informatique d’aide à la décision permettrait de calculer le taux de conversion et de réduire d’autant l’impact sur l’eau et les sols.
Je n’énumérerai pas les 68 préconisations du rapport, et me bornerai à en citer encore deux en guise de conclusion. La première est que soit nommé un délégué interministériel, coordonnant l’action des ministères de l’agriculture et de l’écologie, et ayant autorité sur les programmes afin de mieux utiliser les ressources, très importantes, des agences de l’eau. La seconde est que les nouvelles régions soient l’échelon retenu pour la mise en œuvre de ces mesures, afin que celles-ci s’articulent bien avec les actions relevant des fonds européens.
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Cher collègue, je vous remercie de cette présentation, et vous poserai cette première question : l’échec du plan Écophyto est-il lié, selon vous, à un manque de moyens financiers ? C’est un aspect que vous n’avez guère évoqué, me semble-t-il.
M. Michel Lesage. Les enjeux évoqués par le rapport de notre collègue sont multiples : qualité de l’eau, de l’air, des sols, paysages, biodiversité. Le titre lui-même, « Les champs du possible », reprend celui de l’ouvrage d’un militant paysan breton, André Pochon, qui a beaucoup écrit et montré dans la pratique que l’agroéconomie peut être une réalité.
La compréhension des raisons de l’échec du plan Écophyto conditionne la réussite des nouvelles propositions. Une transition prend toujours beaucoup de temps, les agriculteurs qui s’y sont attelés le savent. La réduction des intrants est indispensable au développement de l’agro-écologie, particulièrement en ce qui concerne les pesticides, les produits phytosanitaires, mais aussi les engrais en général et l’eau elle-même. La diversification des cultures tient une place cruciale, comme André Pochon l’a montré, mais elle rencontre un certain nombre d’obstacles et ses progrès sont très faibles. Ces obstacles sont-ils liés au fonctionnement global de la filière ? Plusieurs études de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) soulignent que le développement de nouvelles pratiques est conditionné par la présence de débouchés commerciaux durables. Cela nécessite la création de filières de production, mais aussi l’implication des consommateurs.
Les directives et règlements européens relèvent d’une logique économique. Or, sans le « verdissement » de la PAC, pour lequel la France milite avec constance, les objectifs visés seront difficiles à atteindre. Par ailleurs, la formation continue et le conseil aux agriculteurs constituent des enjeux importants, mais il ne faut pas oublier la formation initiale et l’accompagnement au quotidien Cela concerne les animateurs territoriaux, les aires d’alimentation des captages, les conseils, les coopératives et le secteur privé. Par ailleurs, le rapport ne semble pas évoquer les diagnostics d’exploitation et de territoire. Y a-t-il des propositions à ce sujet ?
Afin d’encourager les politiques environnementales, les pouvoirs publics cherchent à articuler plusieurs instruments réglementaires avec les aides, les incitations économiques et les taxes ou redevances. Quid de la fiscalité écologique et du rôle du système financier ? Enfin, la démarche contractuelle met les acteurs et les territoires – dont le rôle me semble primordial – au cœur de l’action : comment coordonner tous ces leviers afin de rendre plus efficace un système complexe ?
Mme Valérie Lacroute. Mon groupe n’ayant pas pris position sur le rapport, je m’exprimerai donc en mon nom propre pour faire état d’une expérience réalisée en Seine-et-Marne, département constitué à 60 % de terres agricoles. Vingt-cinq agriculteurs se sont engagés dans le cadre du réseau Dephy afin de mettre en œuvre le plan Écophyto, et le taux d’utilisation des produits phytosanitaires a pu être ainsi réduit de 25 %, parfois de 30 %, mais l’apparition d’adventices a fini par causer des pertes, en termes de quantité comme de qualité.
Dans le cadre du plan départemental de l’eau, certains agriculteurs ont testé des mesures de réduction de moitié des produits phytosanitaires, moyennant compensation des pertes économiques au cours de la phase d’adaptation. À l’usage, les mesures se sont révélées élitistes, et peu d’agriculteurs ont réussi à modifier significativement leur système de culture en cinq ans. Des problèmes se sont posés : pertes économiques, apparition de maladies dangereuses comme l’ergot des céréales, développement de l’ambroisie. Les cultivateurs de Seine-et-Marne sont toujours prêts à expérimenter, mais à condition que cela ne mette en péril ni les exploitations ni les filières. Ils ont donc besoin d’être rassurés sur le plan Écophyto 2 annoncé par le ministre de l’agriculture.
M. Bertrand Pancher. Le rapport dresse un double constat que chacun peut partager : le morcellement des organisations, et l’omertà sur les risques liés aux produits phytosanitaires. Beaucoup d’agriculteurs sont pris de panique devant le changement de modèle auquel ils sont confrontés, tant celui de demain diffère de celui d’aujourd’hui, et légiférer trop vite peut avoir pour effet de pousser certains acteurs de premier plan à se refermer sur eux-mêmes.
L’échec du plan, cependant, est davantage quantitatif que qualitatif. Les volumes globaux n’ont que peu changé, mais l’amélioration est spectaculaire pour les produits les plus dangereux : l’utilisation des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques a diminué de 80 % s’agissant de ceux classés CMR 1 et de 20 % s’agissant de ceux classés CMR 2.
La mise en œuvre du plan Écophyto a donné lieu à débat : fallait-il rendre obligatoires toutes les mesures ? Cela s’est révélé impossible, car l’évolution de la recherche n’a pas été au rendez-vous. Il a donc été convenu qu’il fallait se limiter à faire ce qui était possible. Certains objectifs du nouveau plan laissent perplexes, car l’on passe de l’incitation à l’obligation assortie de sanctions, ce qui tétanise la profession, alors même que le rapport ne fait qu’effleurer les autres pistes envisageables, telles que la contractualisation et la régionalisation – souhaitables, mais sous réserve d’être affinées et pratiquées à l’échelon le plus adéquat. L’assurance est également un mécanisme très important, et certaines incertitudes devraient être levées au sujet du réseau Dephy. La question de la formation et celle de l’information sont, quant à elles, stratégiques. Enfin, dans le domaine de la consommation, le financement des filières courtes et de l’agriculture biologique reste incertain, tandis que les contrôles demeurent insuffisants.
Mme Brigitte Allain. Le rapport ne dit pas assez que les pesticides sont des poisons pour la biodiversité comme pour les humains, à commencer par les utilisateurs eux-mêmes. Notre collègue Dominique Potier évoque les impératifs économiques, mais beaucoup de jeunes agriculteurs s’interrogent aujourd’hui, et s’inquiètent pour leurs enfants. La transition peut être amenée soit par la coercition, soit par la pédagogie et la participation. C’est cette dernière voie que le rapport privilégie, et nous devons insister auprès du Gouvernement, car la démarche préventive est toujours la moins coûteuse, et le plan présenté par le ministre me laisse sur ma faim, à cet égard.
Les régions, responsables de la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, proposent des programmes moins ambitieux que par le passé ; nous devons intervenir pour que ces plans soient revus à la hausse. Les contrats de circuit court, qui permettent d’associer agriculteurs et citoyens, ne sont pas assez mis en valeur dans le rapport. Quant aux outils tels que les groupements d’intérêt économique et environnemental, ils concourent bien à la formation, mais il faut s’appuyer, au-delà, sur les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, pionniers en la matière.
Enfin, il faut, dès à présent, exiger un moratoire européen pour interdire l’usage des néonicotinoïdes, très dangereux pour la santé humaine comme pour la biodiversité et pour les insectes pollinisateurs, garants de la pérennité de la production.
M. Jacques Krabal. Je salue la volonté de consensus qui caractérise ce rapport. Ces sujets doivent être abordés, en effet, non dans la confrontation, mais dans l’écoute. Les problèmes de santé ne sont pas connus des seuls consommateurs : ils le sont aussi des agriculteurs eux-mêmes. Il ne faut pas négliger les efforts et les progrès réalisés depuis de nombreuses années par les artisans de la terre, et que le rapport ne souligne pas assez. On ne peut non plus ignorer la question de la plus-value économique, qui est, elle aussi, signe de santé sociale.
Je constate que les objectifs fixés en matière de produits phytosanitaires sont strictement quantitatifs, alors que leur utilisation est fortement liée aux conditions climatiques ainsi qu’à de nombreux autres paramètres.
La plupart des pays membres de l’Union européenne prônent la réduction de l’impact des produits phytosanitaires, au lieu de se focaliser sur la réduction de leur usage. Pourquoi la France se prive-t-elle de tels objectifs, alors qu’ils sont recommandés par une directive européenne et par le plan Écophyto ? Comment ces indicateurs vont-ils s’intégrer au plan Écophyto 2 ?
Aucun moyen n’est à négliger pour que notre agriculture soit capable d’assurer une production suffisante et d’équilibrer la balance commerciale du pays tout en préservant l’harmonie des territoires. Mais la pression fiscale exercée sur les agriculteurs par de nouvelles taxes ne saurait être l’unique solution : le groupe RRDP préfère une démarche incitative à une écologie punitive.
Il faut valoriser davantage l’agriculture biologique, les circuits courts, les plantations de haies et les systèmes vertueux. L’objectif de l’agriculture de demain devra être l’alimentation durable. Pour cela, il faut faire coexister tous les systèmes agricoles afin qu’ils soient à la fois respectueux de la santé humaine et des ressources naturelles. Ainsi, comment le projet de loi sur la biodiversité et le plan Écophyto 2 s’inscrivent-ils dans cette perspective ? Car, comme l’écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le renard et le bouc : « En toute chose il faut considérer la fin. »
M. Florent Boudié. Élu d’une région viticole prestigieuse, dont je suis fier (rires), j’observe, monsieur le rapporteur, que vous indiquez que les zones arboricoles et viticoles concentrent les plus forts taux d’usage de pesticides. Plusieurs de nos collègues ont souligné que les agriculteurs étaient pris de peur panique devant les risques sanitaires encourus, certes, mais aussi devant les perspectives d’évolution rapide de leur modèle d’exploitation. Comment concilier les enjeux environnementaux avec les intérêts économiques d’une profession qui a déjà consenti beaucoup d’efforts et connaît des difficultés ? Comment accompagner, en d’autres termes, la filière viticole : en passant par les interprofessions, comme le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) ? Ou également par les syndicats viticoles, qui travaillent sur les cahiers des charges et auxquels la question des pesticides pourrait être associée ?
Par ailleurs, les cultivateurs sont désormais confrontés à des problèmes de voisinage et à des conflits d’usage. L’an dernier, une école a été contaminée à Villeneuve, dans les Côtes-de-Bourg, et la question de la protection de lieux accessibles au public a été posée. Enfin, de nouveaux habitants, poussés par la pression foncière, s’installent dans des zones viticoles et réagissent très vivement à l’exposition aux pesticides. La filière viticole ne pourra faire l’économie d’une évolution extrêmement rapide sous la pression des populations.
M. Claude de Ganay. À l’occasion de la présentation du plan Écophyto 2, le ministère de l’agriculture s’est montré très favorable aux recherches interdisciplinaires sur les pesticides. Les agriculteurs sont également demandeurs. Selon plusieurs recherches, effectuées notamment par l’INRA, les pesticides de la famille des néonicotinoïdes sont responsables de la mortalité accrue du cheptel apicole français. Le débat relatif à un moratoire portant sur ces substances revient régulièrement, notamment dans les enceintes parlementaires. La semaine dernière, le Sénat a d’ailleurs rejeté une motion de résolution tendant à proscrire l’usage des néonicotinoïdes en France ainsi que dans l’Union européenne. Ce sujet a-t-il été abordé dans le rapport ? Est-il prévu d’en faire un axe de recherche particulier ?
M. Yannick Favennec. Ne serait-il pas préférable de privilégier la réduction de l’impact des produits phytopharmaceutiques plutôt que de se limiter à la réduction de leur usage ? Au sein de l’Union européenne, seuls le Danemark et la France ont choisi cette seconde voie, et la France ne dispose toujours pas d’objectifs d’impact, alors que ceux-ci sont demandés par une directive européenne et par le plan Écophyto.
La pression fiscale excessive exercée sur les utilisateurs du fait de la hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) et de la création de nouvelles taxes ne résoudra rien et risque, au contraire, de nuire encore plus à la compétitivité de notre agriculture par rapport à nos concurrents européens.
Mme Geneviève Gaillard. Cela fait des années que le débat sur les pesticides est engagé. Il a fallu attendre que le lien entre ces produits et la santé soit établi – et ce, depuis peu, d’ailleurs – pour que les professionnels en prennent conscience. Certains d’entre eux, parmi lesquels les grandes entreprises chimiques, ont refusé pendant des années de changer leurs pratiques. Souvenez-vous des produits organophosphorés et organochlorés, dont certains existent encore ! Certes, des progrès ont probablement été réalisés, mais pas par tous. Il faut pousser les collectivités à atteindre le « zéro phyto ». Quant à la SNCF, elle a mis énormément de temps à renoncer à l’usage de certains produits dangereux.
Dans votre propos, monsieur le rapporteur, vous n’avez mentionné qu’in fine la biodiversité, dont je rappelle qu’elle est l’« assurance-vie » de nos productions agricoles.
Enfin, quel lien faites-vous entre la Charte de l’environnement, qui a constitutionnalisé le principe « pollueur-payeur », et l’augmentation limitée de la fiscalité que vous suggérez ?
M. Julien Aubert. À mes yeux, la question essentielle est celle de l’application des règles phytosanitaires. Dans ma circonscription de Vaucluse, une reconversion en agriculture biologique de vignes mères et de greffons est actuellement conduite. La vigne est attaquée par la flavescence dorée ainsi que par une cicadelle appelée Scaphoideus titanus. Or, il nous est interdit, dans le cadre des traitements obligatoires, d’utiliser des insecticides biologiques. Il y a là un no man’s land juridique, et certaines pépiniéristes me disent que, faute de dérogation, ils seront condamnés à disparaître.
À la faveur de plusieurs hivers doux, la mouche asiatique Drosophila suzukii commet des ravages dans les vergers d’une dizaine de départements. Dans le Vaucluse, la production d’huile d’olive a baissé de 80 % ! En ce qui concerne la cerise, il m’a été indiqué que, faute de pouvoir recourir au diméthoate – produit qui, certes, présente des risques s’il est absorbé en grandes quantités – ce fruit va disparaître. Il faudra alors importer des cerises de Turquie, pays où l’utilisation de ce produit est autorisée.
Nous partageons tous le souci de la biodiversité et d’un environnement sain, mais comment éviter la disparition de certains produits dans le contexte de l’application de normes trop restrictives ?
M. Dominique Potier. Très bonne question !
Mme Françoise Dubois. Quel regard portez-vous sur la perception de la démarche agroécologique par les jeunes agriculteurs qui s’installent ? Il me semble qu’ils ne peuvent la méconnaître, étant donné qu’il s’agit d’un marché en pleine expansion. Et le fait qu’un certain nombre d’agriculteurs soient aussi apiculteurs vous paraît-il susceptible de jouer un rôle positif ?
M. Gérard Menuel. Diminuer de moitié le taux d’utilisation des pesticides est certes un objectif ambitieux, mais je rappelle que la baisse, au cours des dix années précédant le Grenelle de l’environnement, avait déjà atteint 40 %, et que cette baisse a justement été freinée par certaines interdictions. Dans le secteur de la pomme de terre, où dix à douze traitements annuels sont nécessaires contre le mildiou, des expériences ont été conduites, dont il ressort que des capteurs d’air permettent un traitement plus pertinent. Certains pays européens cultivent la variété Fortuna, qui ne nécessite que trois traitements annuels. Cependant, il s’agit d’un produit génétiquement modifié, sujet sensible dans notre pays.
Le rapport ne souligne pas assez l’intérêt du recours à des produits protecteurs des cultures. Si la formation semble satisfaisante « sur le papier », sa mise en œuvre laisse à désirer. Quant aux investissements matériels, ils demeurent trop souvent l’apanage des grandes exploitations. Par ailleurs, il faut accentuer la recherche-développement dans le domaine des biomolécules, où la France a pris du retard.
Je souhaite enfin m’assurer qu’aucune des nouvelles mesures qui seront prises ne viendra complexifier encore le dispositif des certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP).
M. Jean-Louis Bricout. Ce rapport, dont je vous félicite, a le mérite de montrer qu’il peut exister un autre modèle économique viable, reposant sur la limitation du gaspillage par l’amélioration de l’utilisation des produits. Si chacun s’accorde sur les objectifs fixés par le rapport ainsi que sur la nécessité de changer de modèle, l’exercice est économiquement difficile pour les agriculteurs. D’où l’importance de la pédagogie et de la communication, pour lesquelles le système scolaire a un rôle essentiel à jouer, et en particulier les lycées agricoles. Enfin, au regard des enjeux, monsieur le rapporteur, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) vous paraît-elle adaptée ?
M. Michel Heinrich. Depuis des années, l’utilisation des produits phytosanitaires a diminué ; vous considérez, monsieur le rapporteur, qu’une nouvelle baisse de 20 % ne compromettrait pas le niveau de production en volume. Par contre, vous ne vous prononcez pas sur les conséquences d’une réduction de moitié, alors que l’agriculture contribue, je le rappelle, pour plus de 10 milliards d’euros à notre balance commerciale.
Par ailleurs, vous évoquez les volumes mais non les molécules. Or, la toxicité n’est pas seulement affaire de quantité.
Enfin, les détracteurs du rapport redoutent une perte de compétitivité du fait de l’augmentation des taxes. Qu’en pensez-vous ? Vous indiquez que le produit de ces taxes sera consacré à la transition agroécologique des entreprises, mais cela concerne-t-il les fabricants de produits phytopharmaceutiques ?
M. Gilbert Sauvan. Le fait que ce rapport émane d’un agriculteur en renforce la crédibilité. Les collectivités territoriales, qui représentent 5 % des utilisateurs, doivent être exemplaires, et il y a lieu de se montrer exigeant à leur égard. Dans mon département, les services du conseil général, que je préside, ont atteint le « zéro phyto », de même que ceux des trois quarts des communes. Dans toutes ces collectivités, on n’utilise plus de désherbants au bord des routes, dans les cimetières ni dans aucun lieu public.
Pour les agriculteurs, le problème est la garantie d’un rendement suffisant. Allonger la durée de rotation des cultures est souhaitable, mais les surfaces foncières disponibles ne sont pas toujours suffisantes. Je connais un jeune agriculteur qui a innové et développe la culture de lentilles et de pois chiches dans un endroit où la production traditionnelle est plutôt celle de fruits et légumes ; beaucoup souhaiteraient s’engager dans l’écoagriculture, mais le premier obstacle est d’ordre économique. Dans un contexte de compétition européenne et internationale, les entreprises doivent rester viables financièrement.
M. Jean-Pierre Vigier. Le rapport se fixe pour objectif la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en France. Cela vous paraît-il compatible, monsieur le rapporteur, avec la compétitivité de notre agriculture ? Les autres pays à forte production agricole adopteront-ils les mêmes orientations ? Et ce plan n’induit-il pas des charges supplémentaires pour nos agriculteurs, alors que leur revenu a encore baissé ?
M. Jean-Jacques Cottel. Quelles sont les possibilités d’harmonisation de la réglementation entre pays européens ? Vous avez évoqué la proximité de la Belgique, où celle-ci est très différente. Collectivités territoriales comme agriculteurs s’interrogent sur l’adaptabilité du modèle et sur le coût des matériels nécessaires à la transition écoagricole.
M. Guillaume Chevrollier. Il n’y a pas lieu de stigmatiser l’utilisation de produits phytosanitaires en liant systématiquement celle-ci à des problèmes de santé publique. Les agriculteurs reprochent au plan Écophyto 2 son aspect par trop technocratique, attendent de l’administration qu'elle fasse confiance aux chefs d’entreprise qu’ils sont, et réclament de la souplesse dans l’application des normes. Il serait risqué, à cet égard, de se démarquer à l’excès du modèle européen ; or, lorsque celui-ci fixe, par exemple, un taux de 50 %, la France a tendance à faire du zèle et à aller jusqu’à 100 %. Nos agriculteurs sont confrontés à la double exigence de l’économique et de l’environnemental, et il ne faudrait pas que la mise en œuvre du plan Écophyto 2 porte atteinte à la compétitivité des exploitations agricoles.
Mme Sophie Rohfritsch. Il me paraît souhaitable de raisonner en termes de filières, de cultures et de territoires, de façon à bien mesurer les impacts incriminés au lieu de fixer des objectifs purement quantitatifs. Seule une approche globale permettra de déterminer des méthodes compatibles avec la compétitivité de notre agriculture.
M. Christophe Priou. Au sein de cette commission comme ailleurs, nous avons vu sur ce sujet, quels que soient les gouvernements, beaucoup de rapports rester lettre morte. À ce titre, la comparaison entre les espoirs provoqués par le Grenelle de l’environnement et les résultats montre qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. En 2012, le ministre Stéphane Le Foll avait tenté de relancer le plan Écophyto, puis reconnu que les agriculteurs ne s’appropriaient guère les outils proposés. Dans le cadre de l’application du nouveau plan, nous risquons d’être confrontés à un millefeuille composé de six interlocuteurs différents : Europe, État, régions, départements, communautés de communes – à travers les schémas de cohérence territoriale (SCOT) – et communes – qui gardent la compétence en matière de droit des sols. Quelle sera la collectivité de référence ?
M. Laurent Furst. Les agriculteurs se plaignent régulièrement d’être confrontés à trop de paperasse. Ne craignez-vous pas, monsieur le rapporteur, qu’avec la mise en œuvre du plan Écophyto 2 ce ne soit l’overdose ?
L’objectif final est louable et partagé, mais, dans la période transitoire, notre compétitivité ne risque-t-elle pas de souffrir, alors que l’Allemagne nous dépasse déjà pour certaines productions, comme les fraises, les asperges ou la viande porcine ? Sommes-nous bien sûrs que nos concurrents font les mêmes efforts que nous ?
La France ne prend aucune précaution particulière lorsqu’elle importe du miel chinois, alors qu’elle impose à ses apiculteurs des contraintes draconiennes. Ne faudrait-il pas vérifier la composition des produits eux-mêmes, plutôt que des intrants ? Cela garantirait l’équité entre nos produits et les produits importés.
S’il est vrai qu’en France nous mesurons la qualité de l’air et celle de l’eau, nous mesurons mal la santé des sols. Les indicateurs manquent, mais j’en veux pour preuve la disparition massive des lombrics, dont l’utilité n’est plus à démontrer.
Enfin, puisque vous avez voté la réforme des régions, vous devez désormais vous dire « Acalien » – adjectif formé sur « Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine » – et non plus Lorrain car la Lorraine n’existe plus ! (Rires).
M. Dominique Potier. Mais la Lorraine est éternelle… (Sourires.). Vos questions sont précises et appellent des réponses appropriées.
Le président m’a interrogé sur les moyens financiers ; des études des services de l’État prévoyaient la mobilisation de 500 millions d’euros de recettes fiscales. Le montant actuel du produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD), acquittée par les producteurs et refacturée aux utilisateurs, s’élève à 110 millions d’euros, dont 70 millions vont aux agences de l’eau et 40 millions sont gérés par le dispositif Écophyto. Nous avons voté une augmentation de la part de son assiette portant sur les produits CMR2 pour un montant de 30 millions d’euros en 2016, soit 20 % d’augmentation d’une redevance qui pèse en tout et pour tout 0,85 % de la valeur ajoutée des entreprises agricoles.
Le rapport préconise une baisse globale de 10 millions d’euros de toutes les dotations des structures et la réinjection de ces 10 millions dans les entreprises agricoles, selon le même ratio que pour les agences de l’eau : 7 millions d’euros iraient ainsi directement aux entreprises. Ce système est plus proche des cotisations volontaires obligatoires (CVO) que d’une fiscalité punitive. J’avais suggéré de porter la redevance à 1 %, voire à 1,5 %, ce qui aurait rapporté entre 100 et 150 millions d’euros, mais la doxa d’aujourd’hui veut qu’il n’y ait pas de fiscalité supplémentaire.
La mutualisation des moyens doit donc constituer un des principaux leviers d’action. L’argent des agences de l’eau, celui du FEADER et les recettes de la RPD doivent être gérés par les régions, avec quelques mesures nationales claires et des mesures régionales adaptées à l’orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX), au contexte pédoclimatique et aux filières. Ainsi, plutôt que des moyens supplémentaires, je préconise une utilisation des fonds plus propice à la transition agroécologique des entreprises.
Le choix qui a été fait de ne pas séparer le conseil de la vente m’est reproché par de nombreuses associations écologistes. Je mise, pour ma part, sur une responsabilisation de toute la chaîne de distribution telle que définie par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. La séparation du conseil et de la vente et l’interdiction « aveugle » de celle-ci sont deux voies que j’ai écartées, comme incompatibles avec la compétitivité de nos produits. Cela aurait abouti à remplacer une production française certes perfectible, mais souvent plus vertueuse que les produits concurrents. Le ministre le répète à l’envi, l’objectif n’est pas la décroissance de l’agriculture française, mais l’amélioration de ses résultats sur les plans environnemental et économique.
Parmi les freins à la diversification figurent des impasses techniques que la science n’a pas résolues à ce jour, comme, par exemple, la mise au point d’espèces compatibles avec certains types de sols. L’obstacle principal tient au fait que les fruits de la recherche ne trouvent pas de débouchés. Le deuxième pilier, à travers le FEADER, ainsi que les aides directes du plan « protéines végétales », viennent soutenir cette diversification, mais, à l’instar de l’agriculture biologique, les moyens me semblent insuffisants. Notre balance commerciale, soutenue par nos exportations de blé et de produits fins à haute valeur ajoutée, comme les vins ou les fromages, s’améliorerait beaucoup si nous étions autonomes dans le domaine de l’alimentation protéique de nos troupeaux.
Je propose de multiplier par dix la formation et l’accompagnement. Aujourd’hui, nos deux mille fermes Dephy, toutes tailles et tous modes d’exploitation confondus, constituent un laboratoire dans lequel est expérimentée la voie vers le « moins 50 % ». Le taux de baisse constaté, au bout de deux ou trois ans, est de 10 à 12 %, et je ne peux que saluer, comme exceptionnels, les résultats dont fait état Mme Valérie Lacroute en Seine-et-Marne. Les groupes Dephy, pilotés par les coopératives, obtiennent les meilleurs résultats en termes d’environnement, de production et de revenu. L’agriculture de double performance que j’appelle de mes vœux est celle de l’excellence et de la précision. C’est pourquoi je recommande de passer de 2 000 à 3 000 fermes-laboratoires, de façon à multiplier les contextes pédoclimatiques et les filières explorées. À partir de ces 3 000 fermes, nous pourrons former 30 000 agriculteurs, qui démultiplieront cette diffusion du savoir selon un facteur sept, en vue du rendez-vous de 2025.
Conseil, accompagnement, moyens donnés aux chambres d’agriculture, aux coopératives et à tous les distributeurs : il s’agira d’une mobilisation équivalente à celle qui, au lendemain de la guerre, nous a permis de relever le défi de la productivité. À cette fin, nous avons actionné un levier qui fait débat, et que je n’avais pas choisi au départ : les certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP), que les distributeurs de ces produits, qu’ils soient privés ou coopératifs, devront afficher en nombre suffisant pour diminuer de 20 % au terme de cinq années l’impact phytosanitaire sur leur territoire. Lorsque le résultat ne sera pas atteint, l’intéressé sera soumis à une taxation de 11 euros par nombre de doses unité (NODU) – nouvel indicateur qui fait la synthèse entre quantité et toxicité et permet de dépasser le débat entre l’une et l’autre. Vous avez raison, monsieur Heinrich : dans les dernières décennies, nous avons diminué la quantité de 40 %, mais aujourd’hui nous disposons, avec le NODU, d’un indicateur plus fin.
Il existe, sur le marché du biscuit, des coopératives pionnières dont les exigences vont au-delà de la réglementation nationale, et qui voient leurs ventes augmenter. Terrena, par exemple, expérimente des relations avec des producteurs correspondant à des chaînes de production à haute valeur ajoutée. Ceux-là feront sûrement mieux que les 20 % demandés et pourront vendre leurs acquis à des entreprises qui, elles, n’auront pas encore atteint l’objectif. Cette stimulation par le monde de l’entreprise, assortie d’une pénalité relativement faible, est, de la part du ministre, une audace que je salue.
J’ai proposé néanmoins de limiter le marché interentreprises afin d’éviter les effets pervers. Le contexte n’est pas celui des certificats d’économie d’énergie : il existe dans ce secteur une éthique et une culture professionnelles qui rendent inconcevable un « marché du droit à polluer ». Il faut donc des régulations d’une autre nature, et j’espère que le décret sera rédigé dans cet esprit.
À Mme Valérie Lacroute, j’indique que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, sera compétente pour délivrer les autorisations de mise sur le marché. Elle dispose désormais de moyens dans le domaine de la pharmacovigilance, permettant la surveillance des effets épidémiologiques des produits sur la santé et l’environnement après leur mise sur le marché. Lors de la discussion de la loi, nous avions défendu des amendements qui rompaient avec le dogme, hérité de la précédente législature, qui voulait que les agences de l’État ne puissent pas augmenter leur masse salariale. C’était absurde, puisque l’ANSES a des clients européens et répond à des demandes d’expertise rémunérées. Elle pourra désormais recruter les personnels dont elle a besoin et devenir un accélérateur de progrès dans nos territoires.
Mme Brigitte Allain a parlé de poison. J’ai rappelé, dans l’introduction du rapport, l’importance du rapport de l’INSERM. Je rencontre les entreprises, les grands groupes de l’industrie chimique et de l’agroalimentaire, et je leur explique à chacune de nos rencontres que leur compétitivité n’est pas menacée par la première phase du plan Écophyto 2. Quant à la deuxième phase, elle comportera des réformes qui préserveront l’égalité des chances entre les entreprises. Le revenu agricole, en effet, diffère considérablement d’une région à l’autre et d’une production à l’autre. Si nous savons rééquilibrer les aides européennes en faveur de la diversité des agricultures, alors nous renouerons avec la compétitivité pour toutes les formes d’agriculture et pour toutes les entreprises agricoles.
J’ai écrit également, dans le préambule du rapport, qu’il nous faut faire des choix qui dépassent notre seul pays. Comme M. Olivier de Schutter, rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, je crois à un monde futur dans lequel tous les écosystèmes et toutes les agricultures auraient leur place et sauraient nourrir l’humanité, ce qui n’interdira évidemment pas des échanges internationaux fondés sur le modèle du commerce équitable, garant de la juste rémunération des producteurs.
Les plus éminents agronomes m’ont tous dit que la « course aux armements chimiques » constituait une impasse. C’est ce qui a pu être évité à La Réunion qui, par la mise en œuvre de bonnes pratiques, a su gagner des parts de marché d’avenir et constitue aujourd’hui un modèle d’agro-écologie pour la zone de l’océan Indien.
Nos propositions ne sont pas coercitives et n’ont pas pour ambition de révolutionner la réglementation. Il ne s’agit que d’instaurer une pénalité de 11 euros, et certaines inquiétudes exprimées au sujet de la fiscalité relèvent du fantasme, tant la hausse est modérée. Sur le plan réglementaire, il n’y a aucun ajout, et les quelques communiqués que j’ai pu lire lors de la sortie du rapport relevaient plutôt du réflexe de Pavlov ; ils n’ont d’ailleurs pas résisté au dialogue que j’ai pu avoir avec les parties concernées, qui ont convenu que les propositions avancées étaient raisonnables et susceptibles de faire consensus.
J’ai préconisé l’application de la réglementation relative aux néonicotinoïdes. La France a décidé de demander un examen express, à l’échelon européen, des risques de perturbations endocriniennes susceptibles de résulter de l’utilisation de ce produit. Souvenons-nous du cas de l’amiante : il serait grave de dire que les néonicotinoïdes ne posent pas problème. J’invite cependant toutes les parties prenantes au débat à tempérer leurs propos. Il faut accélérer les études scientifiques ad hoc afin que le public soit informé et que les apiculteurs disposent demain des outils dont ils auront besoin. Quelques mois sont nécessaires pour trouver un point d’équilibre. Pour ma part, je n’ai pas signé la résolution anti-néonicotinoïdes : je pense qu’il y aura des restrictions d’usage, dans certaines conditions, pour certains produits, et que, dans d’autres cas, l’usage sera maintenu de façon très réglementée. De fait, certaines solutions de substitution auraient un impact sanitaire deux à trois fois plus négatif.
Je pense répondre ainsi à ce que M. Julien Aubert évoquait au sujet de l’interdiction de certaines molécules ou de leur usage. Il faut être ferme en cas de danger. Lorsqu’une filière est en péril, il faut s’appuyer sur la recherche pour trouver des solutions. Pour cela, nous avons besoin de clusters de recherche ainsi que d’une architecture coopérative européenne de recherche-développement. Les start-up françaises sont très puissantes : elles sont d’ailleurs achetées par des multinationales. N’aurions-nous pas intérêt à préserver la présence de cette précieuse matière intellectuelle sur notre territoire ? Évitons les prises de positions trop hâtives susceptibles de nous faire renoncer à certains produits pour en importer d’autres qui n’offrent aucune garantie sanitaire supplémentaire.
Les impacts des phytosanitaires sont peu connus, car on ne sait pas les mesurer aujourd’hui. La seule attitude raisonnable consiste à diminuer les usages tout en affinant notre connaissance des impacts, sans opposer les premiers aux seconds.
Une des recommandations du rapport incite l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) à introduire des clauses environnementales dans les appellations d’origine contrôlée (AOC) afin de prendre en compte les problèmes posés par le voisinage des exploitations. Aujourd’hui, les considérations environnementales sont absentes des travaux de l’Institut. Ainsi, la tradition est maintenue au détriment de la modernité, alors que des solutions intelligentes pourraient être trouvées.
La question du voisinage n’est pas propre à la Gironde, et la loi d’avenir pour l’agriculture a déterminé les bonnes conduites à tenir à proximité des habitations. Le rapport va plus loin : j’évoque les lisières urbaines, qui doivent être redécouvertes dans les documents d’urbanisme comme zones-tampon afin d’éviter des conflits à l’avenir. Pour l’arboriculture, les panneaux récupérateurs donnent d’excellents résultats. De bonnes pratiques, du matériel adapté et, peut-être, une planification spatiale apporteront des solutions à terme.
À M. Julien Aubert, j’indique que la proposition 68 du rapport porte sur l’homologation des usages orphelins. Il s’agit de productions marginales, de l’ordre de quelques milliers de tonnes, qui ne sont pas homologuées car aucun industriel ne souhaite financer leur mise sur le marché. Le dispositif serait financé syndicalement, par un prélèvement assis sur les cotisations pour l’industrie pharmaceutique.
Je précise à Mme Françoise Dubois que j’ai eu un dialogue précieux avec les Jeunes Agriculteurs. J’ai rencontré leur conseil d’administration et leur vice-présidente chargée de l’environnement, qui m’a assuré que leur génération sera productrice d’aliments, d’environnement et de santé. C’est cette génération qui fera la révolution culturelle de l’agrobiologie. Il faudra cependant penser à pouvoir l’installer par la régulation foncière, d’ailleurs évoquée dans le rapport.
M. Gérard Menuel s’est inquiété d’une éventuelle complexification du dispositif des certificats d’économie de produits phytosanitaires. Même s’il paraît complexe à Coop de France, qui a pourtant participé à sa conception, il est en réalité d’un usage assez pratique, et je suis sûr que Coop de France saura établir et valoriser les fiches actions. Ce groupement conteste, par ailleurs, l’objectif de 20 % en cinq ans et demande qu’il soit ramené à 15 %, mais ce sujet relève du ministère chargé de l’agriculture.
À M. Jean-Louis Bricout, qui a évoqué une pédagogie nécessaire, je réponds qu’une dynamique positive en ce domaine, comme dans celui de la transition énergétique ou du redressement productif, peut rassembler les différentes parties par-delà leurs divergences de vues. C’est un défi français.
Sur les taxes, je ne partage pas l’avis de M. Michel Heinrich. Lorsque le taux est limité à 1 % et que le produit est affecté pour 70 % à des aides au changement de matériel, il s’agit plutôt d’un investissement d’avenir que d’une taxe punitive ou discriminante. En revanche, il est parfaitement vrai que l’harmonisation européenne des produits peut avoir un effet très discriminatoire – particulièrement dans les zones frontalières puisque, à quelques kilomètres de distance, on peut utiliser ou non certains produits, ou des semences génétiquement modifiées. Il faudrait soit interdire partout, soit n’interdire nulle part.
M. Gilbert Sauvan a évoqué les collectivités exemplaires, au premier chef desquelles je citerai les régions Poitou-Charentes et Bretagne. Cette dernière, « tétanisée » par les nitrates, a souhaité être pionnière pour les phytosanitaires, et a montré que c’était possible dans un climat plutôt humide, favorable aux mauvaises herbes. Le rapport à la mémoire des morts conduit à devoir réfléchir davantage à l’interdiction de tout phytosanitaire dans les cimetières, car il y a un aspect culturel à prendre en compte.
Je comprends les inquiétudes de M. Guillaume Chevrollier au sujet des pratiques administratives et des normes. Si je suis partisan de la simplification, je ne le suis pas moins de la régulation. Or j’observe que, derrière certaines demandes de simplification, se cache en réalité une volonté de dérégulation, qui revient à laisser l’avantage aux plus puissants. Il faut savoir faire le départ entre les bonnes et les mauvaises normes, et notre collègue Frédérique Massat est d’ailleurs chargée d’une mission de simplification administrative.
Je suis d’accord avec Mme Sophie Rohfritsch qui a évoqué une approche par filières et par territoires : c’est exactement ce que je préconise, car il n’y a pas de modèle unique.
Je veux bien admettre, avec M. Christophe Priou, que tous les rapports n’ont pas la même utilité, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas suivis… Je veux lui dire que, sur ces sujets extrêmement sensibles, le Gouvernement m’a laissé carte blanche. On critique volontiers le fonctionnement du Parlement sous la Ve République, mais je puis témoigner de la confiance et de la liberté dont j’ai pu jouir pour mes travaux. Il appartient néanmoins au Gouvernement de décider ensuite – et j’observe avec satisfaction qu’il a retenu une majorité de propositions du rapport.
À ceux qui me demandent quels niveaux de collectivités seront responsables, je réponds sans hésiter : les communautés de communes et les régions agrandies.
M. Laurent Furst a dit qu’il faut éviter les mauvaises concurrences et simplifier pour préserver l’équité. Je partage pleinement son avis, par ailleurs, sur l’attention qui doit être portée aux vers de terre… (Sourires.)
Je concède à Mme Brigitte Allain que le rapport n’insiste pas assez sur le thème de l’alimentation comme moteur du changement. À cet égard, je vous renvoie aux propositions 50 et 51, qui visent à organiser un dialogue des filières afin d’éviter que le caprice des consommateurs, encouragé de façon démagogique par certains acteurs de l’agroalimentaire, ne crée des impasses de production. Lorsque, par exemple, un acheteur de pommes allemand propose à un producteur de la vallée de la Drôme de se limiter à deux molécules, il le contraint à traiter massivement ses fruits pour résister aux bioagresseurs. Or, un panel de trois molécules, négocié intelligemment au sein de la filière, aurait permis de diviser les doses par deux. Dans ce dialogue de filière, l’État a à jouer un rôle d’animateur plus que d’arbitre, puisque la liberté du commerce est en jeu.
Je confirme que les modifications des habitudes alimentaires constituent un véritable instrument de changement. J’accueille M. Nicolas Hulot dans ma circonscription après-demain et vais le faire dialoguer avec la chambre d’agriculture, les syndicats de tous horizons, le conseil général et le conseil régional. Nous allons réfléchir avec lui à des solutions qui permettent de valoriser non seulement le bio, lequel ne pourra jamais répondre à l’ensemble de la commande publique, mais aussi des produits dits intégrés de niveau 1 ou 2. La commande publique, les circuits courts, l’éveil des consommateurs sont autant de moteurs puissants.
Je conclurai en faisant le lien avec la mission confiée à M. Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire. Nous avons une démarche écophytosanitaire, agroécologique, qui prône – 20 à – 25 % de pesticides, un ministre qui annonce 50 % de fermes pratiquant l’agro-écologie dans cinq à dix ans, tandis que M. Garot nous rappelle, de son côté, que 20 à 25 % de la nourriture produite est jetée « entre la fourche et la fourchette ». Pour réussir la transition, nous devons agir sur les deux fronts : lutter contre le gaspillage, changer nos pratiques alimentaires, hiérarchiser nos choix de consommateurs, mais aussi créer une alimentation de qualité, environnementale comme gustative, de nature à garantir à notre pays les capacités de production lui permettant de se nourrir lui-même et de tenir sa place dans l’économie-monde.
M. le Président Jean-Paul Chanteguet. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation.
18. Table ronde sur l’élevage et l’environnement (11 février 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mesdames, messieurs les députés, l’idée de la table ronde d’aujourd’hui est issue de la visite du salon international de l’agriculture par une délégation de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire au mois de février 2014. Sur le stand d’Interbev, il nous avait été présenté le groupe de travail « Environnement et territoires » chargé d’évaluer les impacts de l’élevage sur l’environnement, de quantifier les services territoriaux de cette activité et de faire émerger de bonnes pratiques.
Je rappelle que le rapport d’information de nos collègues Sophie Errante et Martial Saddier en novembre 2013 sur l’affichage environnemental avait souligné la difficulté d’évaluer l’impact environnemental de certaines filières, en particulier dans l’agroalimentaire.
L’engagement que j’avais pris alors est tenu puisque nous nous retrouvons pour une table ronde qui réunit les acteurs de la filière et les associations environnementales.
Je suis heureux d’accueillir aujourd’hui M. Dominique Langlois, président d’Interbev, et président de la Fédération nationale des industriels et des commerçants de la viande (FNICGV) ; M. Emmanuel Coste, éleveur ovin, président du comité d’experts « Moutons » de l’Office international de la viande (OIV) et ambassadeur « Climat » à OIV ; M. Dominique Daul, éleveur bovin, responsable des dossiers « Environnement » de l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) ; M. Jean-Baptiste Dollé, chef du service environnement de l’Institut de l’élevage ; M. Arnaud Gauffier, chargé du programme « Agriculture durable » de WWF France ; M. Jean-Claude Bevillard, vice-président de France Nature Environnement (FNE) en charge des questions agricoles.
M. Dominique Langlois, président d’Interbev et président de la Fédération nationale des industriels et des commerçants de la viande. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de nous recevoir.
L’interprofession bétail et viande (Interbev) regroupe l’ensemble des acteurs de la filière bovine, ovine, caprine et équine, de la production à la mise en marché, en passant par les commerçants en bestiaux, le secteur de l’industrie de la viande, les abattoirs, les unités de transformation, la distribution en boucherie traditionnelle et en grande distribution et une partie de la restauration collective.
Le rôle de l’interprofession est de défendre les intérêts des familles professionnelles représentées : vingt depuis le mois de juin contre treize auparavant, puisque nous avons dû adapter nos statuts à l’évolution de la réglementation communautaire et à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Nous devons aussi communiquer sur la viande en général et faire un travail auprès des parlementaires pour suivre les débats qui nous concernent et apporter un éclairage sur notre secteur d’activité.
Le secteur de la viande est important, puisqu’il concerne 59 000 emplois directs, et le secteur de la mise en marché 80 000 emplois, entre les bouchers traditionnels et les professionnels de la viande dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).
Notre secteur est très encadré au plan environnemental, puisque nous sommes soumis à des enquêtes publiques et à des agréments sanitaires. Nous sommes aussi dans un cadre européen très contraint puisque le « paquet hygiène » réglemente très largement notre secteur d’activité.
Trois points sont importants pour nos activités en termes d’environnement : l’eau et son traitement, la production de froid, la valorisation des coproduits.
Nous sommes consommateurs d’eau parce que nous en avons besoin pour assurer à la fois le nettoyage et la désinfection de nos installations. Un travail important a été accompli, puisque nous sommes passés d’une consommation de l’ordre de 5 m3 par tonne en 1995 à 2,2 m3 aujourd’hui. Des améliorations peuvent encore être apportées, mais nous devons assurer la désinfection de nos installations.
Comme nous consommons de l’eau, nous devons la dépolluer : 80 % de cette dépollution est effectuée sur site, les 20 % restants l’étant généralement dans les stations communales pour les abattoirs de plus petite taille. Le traitement des résidus se fait par différentes méthodes telles que l’épandage, le compostage, la méthanisation, voire l’incinération avec valorisation énergétique de la vapeur produite.
S’agissant de la production de froid, nous allons devoir modifier nos installations pour nous mettre en conformité avec l’interdiction d’employer le gaz que nous utilisons actuellement. L’ammoniac semble être a priori le gaz le plus approprié et le moins polluant. Nous recherchons des solutions alternatives qui ne sont pas forcément simples à trouver. Nous faisons également un travail important en matière d’économies d’énergie. Comme nous produisons du froid, nous essayons de nous doter de pompes à chaleur afin de récupérer cette énergie.
Enfin, nous valorisons les coproduits, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas consommé. Je pense aux peaux, que nous salons avant de les vendre à des tanneurs. On peut regretter le faible nombre de tanneries en France, qui nous amène à exporter nos cuirs, principalement en Italie et maintenant en Chine. Il est également possible de traiter et de valoriser les graisses, les gras et les os en dehors des circuits traditionnels comme l’équarrissage, qui laisse peu de marge de manœuvre dans les négociations. Les graisses sont utilisées dans la lipochimie en particulier, et notamment les os de bovins servent à fabriquer de la gélatine, dont l’utilisation se développe en Chine.
Il est possible désormais d’utiliser des graisses dites C1, destinées normalement à la destruction, en particulier les graisses issues des animaux trouvés morts dans les fermes, et de les valoriser sous forme de biocarburants. En plus de mes fonctions, je suis président d’une société qui a créé une unité de transformation de ces graisses pour produire du biocarburant. Nous sommes d’ailleurs très attentifs au projet de loi pour la croissance et l’activité, dont un volet concerne le double comptage accordé aux graisses animales par rapport aux graisses végétales. Il faut savoir que cette question est remise en cause, ce qui modifie l’équilibre économique de ce genre d’installations. C’est donc une question très importante que nous suivons de très près.
D’autres sujets nous préoccupent, comme l’étiquetage environnemental ou les emballages. Comme le nombre de produits élaborés est de plus en plus important sur le marché, nous recherchons des solutions à la fois pour réduire le nombre d’emballages et pour produire des emballages biodégradables.
M. Dominique Daul, éleveur bovin, responsable des dossiers « Environnement » d’Interbev. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir pris l’initiative d’organiser cette table ronde au sein de votre commission. Il est essentiel qu’un débat concret et pragmatique ait lieu entre le monde de l’élevage et l’ensemble des élus de notre pays.
Si notre secteur est souvent pointé du doigt en matière d’environnement, l’éleveur que je suis et la profession que je représente aujourd’hui estiment que les atouts de notre secteur et sa façon d’aborder la question sont en général peu connus. Ainsi, la semaine dernière j’ai eu le plaisir d’aller dans l’Aveyron visiter des élevages. En traversant ce département, je me suis dit que seules l’activité d’élevage et la profession d’éleveur pouvaient valoriser l’ensemble des prairies et les façonner. L’élevage doit faire l’objet d’une réflexion pragmatique. Lorsque l’on aborde les sujets environnementaux, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain.
Quelques chiffres : la France compte 13 millions d’hectares de prairies, ce qui représente plus de 20 % de sa superficie. Seule l’activité bovine, ou celle des ruminants en général, peut valoriser ces surfaces. Forts de ce constat, nous avons voulu être proactifs et avoir un discours beaucoup plus positif sur l’élevage que celui qui a prévalu jusqu’à présent. D’où la création, au sein d’Interbev, du groupe « Environnement et territoires », qui affiche clairement que l’élevage a toute sa place et que les acteurs sont des acteurs de la transition écologique. Nous abordons sans complexe des sujets tels que le climat, l’eau, l’air, la biodiversité, la qualité des sols, etc., non seulement pour expliquer ce que fait l’éleveur au quotidien, mais aussi pour améliorer nos pratiques et nos impacts environnementaux.
Je veux citer quelques exemples concrets de notre travail au quotidien. La ration d’un bovin est constituée à 60 % d’herbe – jusqu’à 80 % pour les races allaitantes – et 90 % de cette alimentation est produite sur les exploitations. Le lien au sol fait partie intégrante de notre modèle de production et de nos élevages. Les déjections issues de nos élevages sont soumises à des normes, et c’est justifié. Elles apportent une vraie valeur ajoutée à nos élevages. Je suis agriculteur à dix kilomètres de Strasbourg – je me permets ici de saluer Mme Rohfritsch – et je peux vous dire que notre matière organique est valorisée sur l’exploitation. Le système de polyculture que je pratique avec mon associé est équilibré entre l’animal et le végétal. Le modèle français qui s’inscrit dans cette démarche est un vrai atout environnemental aujourd’hui. C’est un élément qu’il faut garder à l’esprit avant d’aborder tous les sujets, y compris les impacts négatifs.
Depuis deux ans, nous avons mené une concertation avec cinq ONG – France Nature Environnement, WWF, Fondation Nicolas Hulot, Green Cross et Orée – dont deux sont représentées à cette table ronde. Nous avons fait ensemble le constat que, si l’élevage disparaissait en France, ce serait une catastrophe pour l’environnement, l’économie et la vie sociale de nombreuses régions. Vous avez tous, je crois, des exploitations agricoles et des exploitations d’élevage dans vos circonscriptions : regardez ce qu’il s’y passe, enlevez-les et imaginez le résultat.
Bien sûr, nous avons aussi abordé avec les associations les points de friction. Pour produire un kilo de viande, il faudrait, paraît-il, 15 000 litres d’eau. Il nous semble aberrant de comptabiliser l’ensemble des eaux de pluie qui tombent du ciel, recouvrent les prairies et font pousser l’herbe. S’il n’y a pas de vache dans un pré, l’eau y tombe tout de même. Nous avons demandé à l’Institut de travailler sur le sujet : on atteindrait plutôt 50 litres d’eau pour un kilo de viande produit. Il faut donc aborder ces sujets avec pragmatisme.
On parle beaucoup du bilan carbone de notre production de viande, surtout en cette année où la COP21 se tiendra en France. C’est le cumul de deux choses : le carbone émis par l’acte de production, qui représente 45 % des émissions – c’est tout ce qui est lié à l’énergie, aux épandages d’effluents, etc. –, et le méthane entérique, qui en représente 55 %. Le méthane entérique est un phénomène naturel lié à la rumination de l’herbe, c’est-à-dire, en clair, le rot des vaches. On n’a pas encore trouvé de solution pour le réduire. (Sourires)
Si l’on s’en tient à cette méthode de calcul, eau et bilan carbone, on aboutit à des aberrations puisqu’un feedlot américain, c’est-à-dire le regroupement de 50 000 à 100 000 têtes dans des parcs de contention, nourries avec des céréales, du soja, etc. – en fait, c’est un élevage intensif à outrance – est beaucoup mieux placé que le modèle économique de production français. Ce qui veut dire qu’il vaudrait mieux acheter du bœuf américain. (Murmures)
Vaut-il mieux conserver nos régions françaises avec l’herbe, le territoire, etc., et analyser l’ensemble des critères, ou se fonder uniquement sur le critère du carbone ? Réfléchissez bien, regardez les conséquences que cela pourrait entraîner.
J’ai oublié cet atout phénoménal que sont nos prairies, puisque 75 % des gaz à effet de serre émis sont compensés par le puits de carbone qu’elles représentent. Mais personne n’en parle ; ce n’est pas normal. Il est pourtant essentiel que vous en teniez compte dans vos décisions.
Je le répète, il est indispensable d’avoir une approche globale de l’élevage sur le plan environnemental. Nous avons engagé une démarche de progrès avec le projet Beef carbon d’une durée de six ans qui vise à essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 15 à 20 %. Pour montrer notre engagement, la Confédération nationale de l’élevage organise, le 10 juin prochain, un colloque sur le climat et l’élevage. Nous aurons le plaisir de vous y inviter, ce qui vous permettra de voir les réels engagements de notre profession en englobant toujours l’aspect multicritères sur l’environnement.
M. Emmanuel Coste, éleveur ovin, président du comité d’experts « Moutons » de l’Office international de la viande et ambassadeur « Climat » à l’OIV. Mesdames, messieurs les députés, pour ma part je suis éleveur en Haute-Loire et je travaille avec mon fils. J’ai été président de la section ovine d’Interbev.
L’Office international de la viande regroupe la plupart des interprofessions viande qui existent dans la majorité des pays – États-Unis, Chine, Brésil, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Australie, quelques pays d’Afrique, etc. Il est fortement mobilisé sur les aspects liés au climat du fait de cette année 2015 très particulière, à la fin de laquelle des décisions doivent être prises.
Je ferai quelques constats internationaux, qui donnent une image de ce qu’est l’élevage dans le monde. Il y a un milliard d’éleveurs dans le monde. Certes, ce ne sont pas tous des éleveurs à la française ou à l’américaine, mais ils ont des animaux. Un autre chiffre très significatif change la perception du phénomène : les trois quarts des surfaces agricoles mondiales sont des terres non labourables, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas utilisables directement pour cultiver des céréales. Il faut donc se demander ce que l’on fait de ces terres non labourables.
L’élevage, qu’il s’agisse des petites ou des grandes exploitations, transforme les protéines que l’on trouve, soit par les graminées, soit par les arbres et les arbustes, en protéines de qualité, qu’elles soient de lait ou de viande. Cette biomasse non comestible représente 80 % de l’alimentation des animaux. C’est un chiffre légèrement supérieur au niveau français et c’est normal, puisqu’il existe de nombreuses petites agricultures de par le monde. Cela montre que l’élevage est une réalité naturelle et économique de la planète.
On ne peut pas oublier non plus les services que rend l’élevage, quel que soit son lieu : traction animale – c’est un phénomène qui subsiste, même si, dans notre pays, on ne la voit plus que sous l’angle touristique –, peaux et cuirs, apport d’engrais organique voire de chauffage dans certains cas, entretien d’espaces et de paysages. Quel que soit l’endroit de la planète, l’élevage a formé le paysage et les espaces.
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production de viande devra s’accroître de 70 à 160 % selon les espèces. La quantification de la demande de viande est liée aux phénomènes religieux, importants puisqu’ils déterminent des données différentes selon les pays. La réponse à cette demande croissante qui se manifeste en Chine, en Afrique et partout dans le monde où le niveau de vie augmente, ne doit pas se faire n’importe comment, sans sécurité sanitaire et environnementale. C’est là que le rôle de l’OIV et des associations comme Interbev est important. Il faut une gouvernance internationale, afin d’éviter que l’élevage soit sacrifié ou, au contraire, intensifié dans certains endroits. Cette gouvernance internationale doit tenir compte de l’aspect durable de l’élevage. Pour ce faire, nous développons plusieurs axes de travail avec la FAO. Ces programmes de coopération concernent la diffusion de pratiques concernant le stockage et la valorisation maximale des déjections animales. En effet, plutôt que de les considérer comme des déchets, il faut les composter et voir ce que l’on peut en faire, quelle que soit la partie du monde où l’on se trouve. Il faut aussi améliorer l’alimentation et la santé animale. Dès lors que les animaux sont en bonne santé, le nombre de kilos de viande obtenus à partir d’un animal est plus élevé et on a moins besoin d’une population mère. Il faut donc réfléchir à une alimentation de qualité.
Pour vous montrer que nous travaillons déjà aux côtés de la FAO, je prendrai deux exemples. L’OIV est engagé dans l’Agenda global pour un élevage durable. Ce programme vise à permettre au secteur de l’élevage de contribuer à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté – le revenu est lié à la façon dont les petits éleveurs parviennent à vivre de leur production – et à la protection de la santé publique.
L’OIV est également impliqué dans un partenariat pour l’évaluation environnementale et les performances de l’élevage. Comme vient de le dire Dominique Daul, il est important que l’ensemble de la société – organisations non gouvernementales (ONG), lobbies, etc. – soit d’accord sur des constats clairs et objectifs. L’enjeu est de faire reconnaître nos contributions positives, c’est-à-dire de montrer le rôle que peut jouer l’élevage dans la lutte contre la pauvreté et la création ou l’entretien de la biodiversité. La quantification du stockage du carbone, qui a été appréciée à juste titre par la communauté scientifique, doit être faite correctement pour que l’on sache vraiment comment l’élevage contribue aux efforts demandés en matière climatique.
M. Jean-Baptiste Dollé, chef du service environnement de l’Institut de l’élevage. Mesdames, messieurs les députés, je veux tout d’abord insister sur le fait que la problématique environnementale concernant l’élevage n’est pas récente. Elle est en effet intégrée depuis plus de vingt ans, puisque nous travaillons sur toutes les pratiques qui permettront aux systèmes d’élevage d’émettre moins de nitrates, ce qui se traduit aujourd’hui par une amélioration de la qualité de l’eau au niveau national.
Nous travaillons depuis plusieurs années sur la méthodologie à mettre en œuvre afin d’apprécier le rôle exact de l’activité d’élevage dans les émissions de gaz à effet de serre, sachant que le processus de production du lait et de la viande est plus complexe que le processus industriel. On a l’habitude de compartimenter l’exploitation d’élevage en deux parties – d’une part l’animal, d’autre part le sol –, sachant qu’il y a des interactions permanentes entre les deux par l’affouragement des animaux – 80 à 90 % de l’affouragement est associé au sol de l’exploitation – et la valorisation des déjections sur ces mêmes exploitations. Cet élément très important est lié au cycle naturel du carbone et de l’azote, c’est-à-dire à un ensemble de phénomènes qui existent depuis de nombreuses années et qui sont en équilibre sur nos systèmes de production.
Il existe différents types de méthodologie pour évaluer ces impacts. Le premier se fonde sur les inventaires nationaux, qui permettent de déterminer la contribution d’un secteur aux émissions nationales. Le second se fonde sur l’analyse du cycle de vie, qui consiste à déterminer les impacts environnementaux associés à la production d’un kilo de viande ou de lait.
Ces méthodologies sont discutées à différents niveaux – national, européen, international – dans le cadre de travaux conduits en collaboration avec la FAO, l’objectif étant de partager ces évolutions méthodologiques et d’aboutir à une méthodologie harmonisée dans les différents pays. Ces évolutions méthodologiques ont d’ailleurs permis à la FAO de revoir la contribution de l’élevage à l’émission de gaz à effet de serre puisque, si elle était évaluée en 2006 à 18,6 %, en 2013 elle était de 14,5 % au niveau international. Cela nous permet aussi d’entrer dans les exploitations et de proposer des plans d’action aux éleveurs.
Grâce à cette évolution méthodologique, nous avons pu mettre en évidence les gains réalisés sur les émissions de gaz à effet de serre. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’élevage bovin est de 14 % depuis 1990, la meilleure performance technique des systèmes de production ayant permis d’améliorer la qualité de l’eau.
Jusqu’à présent, la contribution de l’élevage était analysée sous le seul angle des émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d’azote. La prise en compte du stockage de carbone n’était pas effective par manque de références, d’études scientifiques. Aujourd’hui, des éléments nous permettent de dire que nous pouvons intégrer le stockage de carbone. Des études récentes ont en effet été réalisées au niveau européen et international. Il en ressort que les prairies, qui représentent 13,5 millions d’hectares en France et 55 millions d’hectares en Europe, ont un potentiel de stockage deux fois supérieur aux grandes cultures. Cela nous amène à considérer la contribution de l’élevage aux émissions de gaz à effet de serre non pas seulement sous l’angle de l’émission mais aussi sous l’angle du bilan « émission moins stockage », ce qui nous permet de dire que l’élevage contribue à une compensation des émissions à hauteur de 30 % au niveau national.
Tout cela nous permet d’entrer en action, c’est-à-dire d’informer les éleveurs, de former les techniciens et de les sensibiliser à la démarche environnementale et aux problématiques du changement climatique, d’où ces deux programmes lancés à l’initiative des filières : Carbon Dairy pour la filière laitière, Beef Carbon pour la filière viande. Ils ont pour objectif de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à dix ans.
Ces programmes sont d’une assez grande ampleur puisqu’ils associent une centaine d’acteurs au niveau national. D’ailleurs, Beef Carbon s’étend au-delà du territoire national puisqu’il implique l’Irlande, l’Italie et l’Espagne dans un projet concerté pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin. 6 000 éleveurs vont être impliqués dans la démarche, avec une évaluation des impacts environnementaux sur leurs exploitations et la mise en œuvre de plans d’action. L’objectif de ces programmes d’une durée de six ans est de permettre une réduction des émissions de CO2 de 250 000 tonnes pour ces exploitations. Il s’agit vraiment d’avoir une force de démonstration sur le territoire national pour la diffuser ensuite à d’autres interlocuteurs du développement, du conseil, à d’autres régions et d’avoir une dissémination importante.
L’environnement est parfois abordé sous un seul aspect, par exemple la qualité de l’eau ou le changement climatique. Or il est très important d’avoir une approche globale car, en ne considérant qu’un seul impact sur l’environnement, on pourrait être conduit à promouvoir des pratiques ayant un effet bénéfique dans ce domaine mais un effet néfaste sur d’autres points, par exemple sur la préservation de la biodiversité.
Dans la mesure où l’activité de l’élevage bovin est en lien avec le sol et a une influence importante sur le paysage, la biodiversité, la faune et la flore, il est important de pouvoir intégrer cette dimension dans l’évaluation que l’on fait. Cela répond tout à fait à la démarche agroécologique suivie au niveau national.
M. Arnaud Gauffier, chargé du programme « Agriculture durable » de WWF France. Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie d’avoir invité WWF à participer à cette table ronde. Notre organisation ne s’occupe pas uniquement de la protection des pandas, comme le grand public peut le croire. Bien entendu, nous protégeons beaucoup d’espèces emblématiques connues et menacées, mais nous nous intéressons aussi à la protection de l’habitat de ces espèces. C’est ce qui nous a conduits à travailler avec Interbev pour mesurer les impacts environnementaux de l’élevage bovin.
Les ONG considèrent que l’élevage des vaches allaitantes tel qu’il est pratiqué en France a beaucoup d’atouts : il a un très fort lien au sol, et la nourriture est essentiellement basée sur l’herbe. Donner à manger à des vaches, qui sont des ruminants, autre chose que de l’herbe est à la fois un peu dommage et un peu bête, étant donné que ces animaux ont cette particularité assez fantastique de produire de la viande à partir d’une nourriture à base d’herbe. Il n’en est pas de même pour le porc et la volaille.
L’élevage bovin a également des atouts en matière de valorisation des paysages, de maintien des emplois dans les territoires ruraux, de stockage de carbone. Il existe aussi un très fort lien culturel à l’élevage. Les touristes vont davantage visiter le bocage normand que la Beauce. (Sourires)
Depuis tout à l’heure, on parle beaucoup de la vache allaitante. Mais il faut savoir que 50 % environ de la viande de bœuf consommée en France provient d’élevages laitiers, c’est-à-dire de vaches de réforme. Or celles-ci ne sont pas nourries avec 80 % d’herbe, mais plutôt avec 50 % d’herbe. Il s’agit donc d’exploitations plus intensives, où les rations comportent beaucoup plus de céréales, voire du soja. Par exemple, le groupe laitier Bel importe 40 000 tonnes de soja d’Amérique du Sud chaque année, via ses éleveurs, pour produire son fromage, et Danone importe un million de tonnes de soja d’Amérique du Sud ou des États-Unis pour nourrir ses animaux. Évidemment, cette nourriture sert principalement à produire du lait, des yaourts et des produits laitiers, mais toutes ces vaches de réforme se retrouvent en fin de vie sur le marché de la viande. La consommation de viande a donc aussi un impact et un rôle à jouer.
Je ne suis pas sûr que l’élevage de volailles et de porcs, tel qu’il est pratiqué en France et en Europe actuellement, contribue beaucoup au façonnement de nos paysages et au maintien fort du lien au sol des exploitations. Une exploitation porcine a un lien au sol bien moindre qu’une exploitation bovine ; l’élevage porcin est beaucoup plus intensif ; l’alimentation est à base de céréales et la dépendance au soja importé d’Amérique du Sud forte. Le soja est l’une des grandes causes de déforestation dans le monde, et l’huile de palme peut aussi entrer dans l’alimentation des vaches laitières. C’est pourquoi WWF est fortement concerné par les questions d’élevage.
L’une des solutions consiste à diminuer la consommation de viande. Actuellement, on constate une baisse de la consommation de bœuf en France, avec un report sur la consommation de plats préparés et de viandes travaillées qui, d’un point de vue nutritionnel et environnemental, sont pires que de manger un steak. S’il fallait délivrer un message, ce serait qu’il vaut mieux manger du bon bœuf deux à trois fois par semaine et, au total, manger moins de viande. Si l’on maintient le niveau de consommation actuel tout en voulant réduire les impacts environnementaux, il faudra en passer par des feedlots. (Murmures)
Au Brésil, la première cause de déforestation, c’est l’élevage bovin, du fait de méthodes très extensives. Comme l’a dit tout à l’heure M. Daul, il faut avoir recours à une analyse multifactorielle, mais aussi examiner chaque situation puisque celle de la France est forcément différente de celle du Brésil. Une intensification de la production en France n’est pas nécessairement utile s’il y a une baisse de la consommation de viande. En revanche, une intensification de l’élevage au Brésil a du sens si la consommation des Brésiliens et l’exportation du bœuf brésilien se maintiennent au niveau actuel, voire continuent de progresser à cause, pour la seconde, de la demande asiatique, notamment chinoise.
Au niveau mondial, seul un quart des terres est labourable, dont 40 % destinés à la consommation des animaux. Il serait peut-être bon que les cultures dédiées à l’alimentation des animaux soient moins importantes, notamment dans l’intérêt de la sécurité alimentaire à moyen et long termes.
M. Jean-Claude Bevillard, vice-président de France Nature Environnement, en charge des questions agricoles. Mesdames, messieurs les députés, à mon tour je vous remercie pour votre invitation. Nous sommes très attachés au dialogue en matière d’agriculture et en particulier d’élevage puisqu’il s’agit du fondement de notre vie nationale, de notre culture et de notre civilisation.
France Nature Environnement (FNE) regroupe 3 000 associations sur le territoire national. Comme nous sommes généralistes, nous abordons l’ensemble des problématiques environnementales et nous sommes contraints d’être cohérents dans notre plaidoyer, notre argumentation entre nos différents relais, ce qui n’est pas très simple. En matière d’agriculture, nous sommes toujours dans la nécessité d’un compromis entre les enjeux alimentaires, environnementaux et d’aménagement du territoire.
Il est clair que si l’on ne préserve pas le sol, la qualité de l’eau, la biodiversité, bientôt nous ne pourrons plus produire suffisamment. La préservation de l’environnement est intrinsèquement liée à l’avenir de notre alimentation.
Quand on sait que la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d’habitants dans quelques décennies, on ne peut pas envisager de nourrir l’humanité de la même façon qu’aujourd’hui puisque, pour produire une protéine animale, il faut entre dix et quinze protéines végétales, et que nous ne disposons pas de la surface nécessaire. On ne peut donc pas envisager l’avenir de l’humanité sans prendre en compte d’abord l’enjeu alimentaire.
FNE a déjà eu l’occasion de défendre sa vision de l’agriculture lors du Grenelle de l’environnement. L’agriculture doit réduire l’usage des intrants. Les intrants correspondent à tout ce que l’agriculteur achète à l’extérieur. Cela va de l’énergie à l’alimentation des animaux en passant par les engrais ou les produits de traitement. Il ne s’agit pas de les supprimer et d’aller vers une agriculture autarcique, mais de parvenir à une plus grande autonomie, à un système beaucoup plus résilient du point de vue économique. L’impact négatif sur l’environnement est très fortement lié, de façon générale, au volume d’intrants. Pour l’élevage, c’est la même chose.
Nous constatons avec satisfaction que cette vision a été traduite dans la certification environnementale de niveau 3, c’est-à-dire haute valeur environnementale (HVE). Le niveau de certification est basé sur le niveau d’intrants et sur la place laissée à la nature, c’est-à-dire aux infrastructures agro-écologiques. Il est rassurant de voir que, malgré l’alternance, il y a continuité dans l’approche agro-écologique suivie par les ministres de l’agriculture, et nous nous inscrivons parfaitement dans cette continuité. L’élevage doit y trouver sa place.
En fait, il n’existe pas un, mais des élevages : l’élevage en plein air, dont on parle beaucoup ce matin, mais aussi l’élevage en batterie, l’élevage hors sol, l’élevage des ruminants, l’élevage des animaux monogastriques, c’est-à-dire ceux qui ne s’alimentent pas à l’herbe. On ne peut donc pas tenir le même discours pour la vache élevée à l’herbe dans le Massif central ou sur le contrefort des Alpes, et le cochon ou la volaille élevés en batterie.
Il ne faut pas oublier non plus qu’il est nécessaire d’améliorer le respect de l’animal. Je sais que le sujet est sensible, mais il est fondamental. Nous devons avancer sur cette question éthique. Notre civilisation a de l’avenir dans la mesure où l’on prend en compte aussi cet aspect-là.
On peut rapidement dresser une liste des impacts négatifs de l’élevage sur l’environnement. D’abord, l’impact sur l’eau, avec les phénomènes d’eutrophisation. La manifestation la plus aiguë concerne les algues vertes en Bretagne, mais l’eutrophisation des eaux affecte la plupart de nos territoires.
Ensuite, l’impact sur l’air n’a pas beaucoup été pris en compte jusqu’à aujourd’hui, la prévention des impacts sur l’eau n’entraînant pas nécessairement une prévention des impacts sur l’air. Or, si l’azote va dans l’eau, il va aussi dans l’air. Il va donc falloir modifier à la fois les systèmes et les pratiques, sans quoi nous serons confrontés à des problèmes sociétaux.
Quand l’élevage n’est pas lié au sol, il faut prendre en compte les impacts sur l’environnement issus des cultures, notamment celles destinées à l’alimentation du bétail, au plan national et européen, mais aussi sur les autres continents du fait des importations.
Disons-le clairement, il est indispensable de réduire le cheptel, mais pas nécessairement les installations, le nombre d’élevages ni le revenu. Nous considérons que la meilleure régulation, c’est le lien au sol, c’est-à-dire le fait de n’élever que les animaux que l’on est capable de nourrir sur l’exploitation ou sur le territoire sans aller chercher des cultures outre-mer ou dans des régions très éloignées. L’élevage lié au sol entraîne nécessairement une diminution du cheptel et une amélioration de la qualité. Or la qualité, c’est l’avenir de l’élevage. J’habite en Haute-Savoie. Si les agriculteurs ne produisaient pas dans les Alpes du Nord des produits de qualité, il n’y aurait quasiment plus d’agriculture, ou en tout cas très peu. Aujourd’hui, avec le reblochon et le beaufort par exemple, la valeur ajoutée du lait est relativement forte, ce qui permet de maintenir un élevage actif dans une région où les contraintes liées au climat et au relief sont fortes, alors que les problèmes sont plus nombreux dans des régions où ces contraintes apparaissent plus faibles. Il faut donc encourager la qualité et la valorisation des produits.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous n’avez pas mentionné, dans vos différentes interventions, la dimension européenne. Considérez-vous que la nouvelle politique agricole commune (PAC) permettra de trouver un meilleur équilibre entre l’élevage et l’environnement ?
M. Jean-Louis Bricout. Messieurs, je vous remercie pour la qualité de vos interventions.
Concilier l’agriculture et la préservation de l’environnement, c’est possible et même indispensable.
En France, les émissions agricoles de gaz à effet de serre représentent environ 100 millions de tonnes de CO2 par an, soit 20 % des émissions totales du pays. Dans ce contexte, et comme l’a rappelé à plusieurs reprises le ministre de l’agriculture à la suite de l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’enjeu est de considérer le défi écologique et de lutte contre le réchauffement climatique, le défi alimentaire et le défi agricole et forestier comme un ensemble, sans pour autant réduire les productions agricoles.
Le développement et la montée en puissance de ce qu’il convient dès lors d’appeler l’agro-écologie demeure une priorité. Elle a été encore rappelée mercredi dernier par le Premier ministre et la ministre de l’environnement à l’occasion de la présentation de la feuille de route 2015 pour la transition écologique, qui fait suite à la conférence environnementale.
Par ailleurs, le texte insiste sur le nécessaire maintien de la production au nom de la sécurité alimentaire. Ceci sera également défendu par la France dans les négociations climatiques internationales.
Pour résumer les choses simplement, je dirai que la seule question qui vaille est de savoir quel type d’élevage nous souhaitons privilégier.
L’impact de l’élevage sur l’environnement est important et diffus. La production animale a de fortes retombées sur les disponibilités en eau, car elle consomme plus de 8 % des utilisations humaines d’eau à l’échelle mondiale. Elle est essentiellement destinée à l’irrigation des cultures fourragères. Il est aussi attesté que la production animale est la plus grande source sectorielle de polluants de l’eau, notamment à cause des déchets animaux, antibiotiques, des hormones, des produits chimiques des tanneries, des engrais et pesticides utilisés pour les cultures fourragères.
Face à cette menace environnementale, se pose la question d’une meilleure efficacité d’utilisation des ressources qui sera la clé pour diminuer l’ombre portée par l’élevage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’efficacité des nouveaux processus de production ? Quelles solutions apporter pour limiter ces menaces qui pèsent sur la dégradation des terres, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution de l’eau, sur la biodiversité ?
Chacun sait l’incidence que peuvent avoir le coût des intrants, le prix des terres, les comparaisons entre la rentabilité des différentes productions agricoles, les normes, les règlements qui sont imposés et qui font partie des contraintes lourdes à supporter par nos éleveurs. Quelle est l’incidence de ces coûts, de ces niveaux de prix sur les choix, les méthodes d’élevage et l’utilisation des ressources naturelles ? Quelles méthodes employer ? Des méthodes coercitives ? Des compensations sur le principe « pollueur-payeur » ? Quelle stratégie mettre en place pour favoriser les bonnes méthodes environnementales et encourager les possesseurs de bétail qui fournissent aussi des services environnementaux ? On a bien vu que l’approche de l’agriculture devait être globale et qu’il fallait prendre en compte ses effets positifs sur l’économie et le tourisme, sans oublier qu’elle permet le maintien des prairies.
De nombreux arguments avaient été avancés pour justifier l’impossibilité d’avancer en matière environnementale. Mais on se trouve face à une contradiction puisque si l’on pollue moins quand on élève rapidement, la qualité est aussi moindre. Chacun sait en effet qu’il y a une grande différence de qualité entre un poulet de batterie et un poulet élevé en plein air. Il faudra bien déterminer un jour ce que l’on souhaite exactement.
Enfin, le gaspillage alimentaire représente jusqu’à 30 % de la production française. Une proposition de loi a été discutée jeudi dernier et un plan a été présenté par le Gouvernement afin de réduire d’ici à 2050 le gaspillage alimentaire. Pensez-vous pouvoir jouer un rôle auprès des plus jeunes en accentuant le lien entre l’agriculture et la sensibilisation du milieu éducatif, notamment les lycées agricoles ?
Enfin, je souhaite souligner l’engagement des députés du groupe SRC dans l’accompagnement nécessaire de nos agriculteurs pour une agriculture verte et responsable. Il y va de notre capacité à demeurer compétitifs à l’échelle européenne.
M. Jean-Marie Sermier. Je veux remercier les orateurs pour la qualité de leurs propos ainsi que le président de notre commission pour avoir su associer des intervenants qui ne se retrouvent pas naturellement autour d’une même table. (Sourires)
Je tiens à féliciter les éleveurs de France, car l’histoire de l’élevage, c’est tout simplement celle de l’humanité. Depuis que l’homme a essayé d’organiser son développement, il a eu des animaux à ses côtés, que ce soit pour se faire aider d’eux ou pour en tirer un moyen de subsistance.
Les agriculteurs et les éleveurs ont apporté un plus à notre pays. Finalement, il y a longtemps que certains pratiquent l’agro-écologie alors que d’autres la découvrent. Les paysages ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui sans les agriculteurs, et plus particulièrement les éleveurs, qui ont contribué à l’aménagement du territoire et sont présents sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones difficiles comme la montagne.
La biodiversité ne serait pas ce qu’elle est si nous n’avions pas préservé toutes les prairies qui permettent la croissance d’une multitude d’espèces végétales. La biodiversité animale ne serait pas ce qu’elle est si des passionnés n’avaient pas engagé des réflexions, ce qui permet par exemple d’avoir encore aujourd’hui quarante-trois races de chevaux, alors que l’on sait que cet élevage est dû à la passion plus qu’à la raison.
Des avancées très significatives ont eu lieu au cours des dernières décennies en termes d’alimentation. On peut penser que les Français, les Occidentaux en général, consomment trop de viande, mais on constate qu’un certain nombre de pays émergents sont en train de consommer de plus en plus de viande, que la consommation s’accroît au niveau mondial et qu’il faut être en mesure de répondre à la demande.
La qualité de l’alimentation française a été améliorée, comme l’a été la qualité sanitaire et la traçabilité. Aujourd’hui, on ne parle presque plus d’alimentation mais de gastronomie. Il existe de nombreuses appellations d’origine contrôlée (AOC), comme l’AOC « poulet de Bresse », l’AOC « porc noir de Bigorre » ou l’AOC « agneau de pré-salé ». Ces quelques exemples montrent que l’élevage a réussi sa mutation. Toutefois, un certain nombre de questions se posent.
On sait qu’aujourd’hui, en France, un tiers des repas sont pris hors du foyer. Quelle est l’action d’Interbev en direction de toutes ces structures organisatrices de la production des repas, qu’elles soient publiques ou privées ?
On a évoqué les émissions de gaz à effet de serre. A priori, 8 % sont d’origine animale, mais on constate que ces émissions ont été réduites de 10 % en quelques années, notamment par la valorisation des déjections. Où en est-on exactement ? Que pensez-vous de la filière méthanisation qui a bien du mal à se développer en France ? En Allemagne par exemple, la méthanisation se développe bien. Sur quelles mesures pourrait-on prendre exemple pour apporter des réponses à cette filière ?
Le grand public confond souvent sélection génétique et organismes génétiquement modifiés (OGM). Qu’en est-il exactement pour l’élevage ? Celui-ci est-il quelquefois génétiquement modifié, ou est-il simplement issu d’une sélection génétique traditionnelle ? La réponse à cette question doit être claire.
Puisque nous avons la chance d’avoir un éleveur ovin à notre table, je voudrais lui demander ce qu’il pense du loup et des attaques régulières qui font le désespoir d’un certain nombre d’éleveurs.
Comment parvenez-vous à mobiliser encore des jeunes générations ? On sait que la passion de l’élevage, qui n’est malheureusement plus rémunératrice dans un certain nombre de régions, se vit 365 jours par an, que les animaux ont besoin d’être soignés chaque jour. Comment faire pour permettre demain à des jeunes de prendre votre succession et faire en sorte que l’élevage français soit toujours bien vivant ?
À quelques jours de l’ouverture du Salon international de l’agriculture 2015 qui va attirer, à n’en pas douter, plusieurs centaines voire un million de citadins qui découvriront avec intérêt toute la qualité de l’élevage français, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les nouveautés pour l’élevage français en 2015 ?
M. Yannick Favennec. Monsieur le président, je m’exprimerai au nom du groupe UDI et plus particulièrement de notre collègue Stéphane Demilly, qui a dû s’absenter et vous prie de bien vouloir l’excuser.
Stéphane Demilly souhaitait mettre en exergue l’impact de l’élevage sur l’environnement qui est régulièrement pointé du doigt. Il en sait quelque chose puisqu’il est député de la Somme où sévit cette violente polémique autour de la fameuse « ferme des mille vaches ».
Au niveau mondial, les systèmes de production animale sont responsables de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, soit beaucoup plus que les transports. Cependant, je voudrais insister sur la déprise agricole, phénomène particulièrement inquiétant dans notre pays. Le développement à grande échelle de la déprise agricole que connaissent diverses parties du territoire national constitue un événement majeur dans l’histoire écologique de la France, événement dont nos concitoyens n’ont d’ailleurs pas encore vraiment pris la mesure.
Ainsi, l’extension progressive des surfaces qui retournent à la friche puis à la forêt aboutit à une transformation des paysages et des écosystèmes sans équivalent depuis le mouvement de déforestation qu’a connu la France au Moyen Âge. En silence, certaines parties du territoire retrouvent en quelque sorte l’apparence qu’elles avaient avant l’intervention des moines de Cluny. (Sourires) Certains pourraient être tentés de se réjouir de ce qui leur apparaîtrait comme un juste retour à la nature. En réalité il est urgent de souligner les dangers d’un mouvement difficilement réversible et qui constitue un véritable retour en arrière aux conséquences incalculables.
Dans plusieurs départements, les paysages se ferment progressivement du fait de la réduction de la surface agricole utilisée et de l’extension des forêts. Le cas du Jura, où la surface agricole utile (SAU) a très fortement diminué depuis 1970, est emblématique de ce mouvement qui concerne d’autres massifs tels que les Vosges ou le Morvan. Dans ces conditions, l’agriculture revêt des enjeux qui dépassent largement le cadre de l’économie agricole. À ce titre, l’élevage joue un rôle essentiel pour l’équilibre et la préservation du paysage, en entretenant l’espace. Qu’il soit bovin, ovin, caprin ou équin, son rôle est irremplaçable car la tonte de l’herbe par les animaux permet d’enrichir la variété de la flore et favorise, grâce à l’apport de matière azotée, l’apparition d’espèces végétales qui ne croîtraient pas en leur absence. De même, les pâturages, qui constituent 70 % des terres agricoles dans le monde, contribuent à absorber de grandes quantités de CO2.
Cette dimension de l’élevage n’est pas suffisamment rappelée lors des débats sur les relations entre l’élevage et l’environnement. C’est pourquoi j’aimerais connaître votre point de vue sur ce sujet.
Mme Laurence Abeille. Monsieur le président, je tiens à vous féliciter pour avoir organisé une table ronde sur ce thème beaucoup trop rarement évoqué, en particulier à quelques mois de la conférence de Paris. Il est très important d’évoquer le lien entre la production de viande et le réchauffement climatique. (Murmures)
Je rappellerai quelques chiffres qui montrent l’impact énorme de notre alimentation carnée sur le dérèglement climatique. Selon la FAO, l’élevage est responsable de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire davantage que l’ensemble des moyens de transport réunis. D’autres organismes évoquent des chiffres encore plus élevés.
Nous savons que la production d’un kilo de bœuf engendre cinquante à cent fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que la production d’un kilo de blé. L’un des problèmes principaux générés par cette surconsommation de viande est le changement d’affectation des sols. La destruction de la forêt amazonienne dont tout le monde s’émeut est liée en majeure partie à la culture du soja qui est utilisé pour nourrir les cheptels occidentaux, sans compter que cet accaparement des terres pour produire de la nourriture pour le bétail concurrence les cultures vivrières locales. Le WWF Suisse a ainsi calculé que la production d’un kilo de bœuf nourri au fourrage nécessitait 323 mètres carrés, contre 17 mètres carrés pour un kilo de riz et 6 mètres carrés pour un kilo de légumes. Nous savons que cette course au « toujours plus » de viande n’est pas viable écologiquement ; elle est surtout aberrante. Alors que plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim, nous détruisons des calories végétales pour les transformer en calories animales. Il faut en effet sept à dix kilos de végétaux pour faire un kilo de viande de bœuf, quatre à cinq kilos et demi pour un kilo de viande de porc. Or, cette surconsommation de viande est récente. Un Français consomme plus de 1,5 kg de viande par semaine, ce qui est beaucoup trop, et beaucoup plus qu’il y a encore quelques décennies.
Répondre à cette demande toujours croissante ne peut se faire qu’en développant l’élevage intensif, le plus pollueur et le plus dramatique pour la condition animale. Or nous savons que la France ne gagnera pas cette compétition de la quantité et qu’il faut au contraire réorienter notre filière vers l’élevage extensif et de plein air dans les pâturages. Il faut cesser cette course à la quantité et aller vers une consommation moindre mais de qualité.
Je pourrais encore évoquer l’impact de l’élevage sur la dégradation des sols, la pollution des rivières, la pollution de nos côtes avec les algues vertes, etc. Une prise de conscience de l’impact écologique de l’élevage est nécessaire, et les pouvoirs publics devraient promouvoir une baisse de la consommation en réorientant nos filières vers la qualité.
Rappelons également que la consommation excessive de viande est mauvaise pour la santé et que le régime végétarien est bénéfique. (Sourires) Ce que nous mangeons est avant tout culturel.
Face à ce péril écologique qu’est la croissance à venir de la production et de la consommation de viande, il est nécessaire de modifier nos comportements et d’accompagner la mutation des installations agricoles. Quand on voit que le Programme national nutrition santé recommande de consommer entre 80 et 200 grammes de viande par jour, on peut douter de notre capacité à évoluer et affronter ce problème environnemental !
M. Jacques Krabal. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir tenu votre engagement. Lorsque les politiques s’engagent dans cette voie, il faut le faire savoir.
Le plus important, c’est d’avoir réuni autour de cette table une diversité d’intervenants. Cela renforce notre possibilité de réflexion dans un monde où il est difficile de trouver sa propre vérité. Sur ce sujet, je pense que les vérités sont multiples. Il est bon que nous puissions échanger sur des sujets compliqués. On se rend compte qu’il n’est pas facile de s’y retrouver entre l’action locale et la réflexion globale.
Les enjeux sont nombreux dans ce domaine comme dans d’autres, on l’a vu hier s’agissant des produits phytosanitaires. Ils concernent l’alimentation, la santé, l’environnement mais aussi l’économie sur laquelle vous n’avez pas suffisamment insisté. Quand on parle d’élevage, on ne peut pas faire non plus l’impasse sur l’enjeu culturel ou patrimonial. La France est rurale, agricole. Au XXIe siècle, on oublie que « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». (Sourires) Or ce sont des réalités que vous avez rappelées.
Il y a en effet plusieurs élevages et il faut favoriser le lien avec le sol. Vous avez voulu nous démontrer que cette prise de conscience était réelle.
Dans quelles tendances êtes-vous engagés depuis ces vingt dernières années en matière de lutte contre les gaz à effet de serre et de pollution de l’eau et de l’air ?
La commission et le Gouvernement ont souhaité exclure les gaz entériques du champ d’application de la stratégie « bas carbone ». Si tel n’avait pas été le cas, quel aurait été l’impact financier pour les éleveurs ?
J’estime que vous êtes les premiers acteurs de la défense de la biodiversité. Quelle est votre réflexion sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte ? Quelles évolutions mettez-vous en œuvre pour que le respect de la biodiversité soit une réalité de votre action ?
Je voudrais revenir sur l’agriculture intensive. Quelle est votre position sur le traité de libre-échange transatlantique ? Comment peut-on agir pour maintenir une agriculture qui soit en lien avec le sol ?
Vous n’avez pas non plus beaucoup développé la dernière proposition du ministre en matière de circuits courts. Mon territoire est en train de s’engager à fournir 10 000 repas chaque jour à nos écoles. Or la majorité des produits carnés proviennent de l’étranger. Comment agir pour que vos adhérents soient également acteurs, qu’ils nous fassent savoir comment nous pouvons mieux travailler ensemble ? Vous n’avez pas parlé non plus de l’économie circulaire alors qu’elle est mise en avant aujourd’hui.
Quelles sont vos réflexions en ce qui concerne la prochaine loi sur l’étiquetage ?
En conclusion, je vais encore faire sourire mes collègues puisque je citerai Jean de La Fontaine, qui se servait « d’animaux pour instruire les hommes », quand vous nous parlez d’animaux pour mieux nourrir les hommes. J’espère que vous le faites en préservant l’environnement.
Mme Catherine Beaubatie. Les éleveurs ont souvent le sentiment que les mesures environnementales – les trames vertes et bleues, les lois sur l’eau et sur l’urbanisme – sont des contraintes, voire des carcans qui sclérosent l’activité agricole, notamment l’élevage. Certains éleveurs de montagne et de zones défavorisées ont du mal à absorber les coûts supplémentaires et les réglementations. Celles-ci semblent parfois disproportionnées par rapport aux impacts carbone limités de certains types d’exploitation.
Quels mécanismes de régulation peuvent être envisagés afin de prendre en compte la taille et la capacité des exploitations à intégrer les normes environnementales ? La convergence des aides de la nouvelle PAC et le verdissement jouent-ils assez bien ce rôle ? Les évaluations environnementales qui préfigurent les projets de loi et les projets de territoire prennent-elles suffisamment en compte l’impact positif des puits de carbone des pâturages pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’impact négatif du transport lié aux importations de viande étrangère ?
M. Jacques Kossowski. En tant que député du nord des Hauts-de-Seine, l’agriculture est un domaine qui ne me concerne pas beaucoup. (Sourires) Il n’empêche que le sujet m’intéresse.
Après de vifs débats parlementaires le 28 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté définitivement une disposition reconnaissant dans le code civil que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer très prochainement sur cette question. Une telle évolution juridique vise, semble-t-il, à moderniser le code civil en mettant en cohérence les dispositions du code rural et celles du code pénal. Il s’agit aussi de rapprocher le droit français des autres législations européennes.
Notre collègue Marc Le Fur s’est récemment inquiété de ce changement. Pour lui, le problème n’est pas de légiférer sur l’animal, mais de le faire dans le code civil qui est le code régissant la personne, les relations interpersonnelles et le droit de propriété. Comme lui d’ailleurs, je m’interroge sur la possibilité que vont avoir tous les opposants à l’élevage d’engager de multiples contentieux juridiques. Je souhaiterais connaître votre point de vue en la matière.
Vous allez connaître, dans les années qui viennent, une montée de la viande halal. Cela va-t-il vous gêner dans vos abattoirs ? Comment allez-vous faire ?
Enfin, j’aimerais que vous abordiez la question des prix dans les abattoirs.
M. Yannick Favennec. Un sondage qui date du mois de décembre dernier, réalisé à la demande du ministère de l’agriculture, conclut que 93 % des agriculteurs français déclarent s’être engagés dans des démarches agro-écologiques ayant comme priorité la limitation des intrants et l’amélioration de la qualité des sols. Si ce chiffre paraît encourageant, les agriculteurs engagés semblent pourtant peu enclins à poursuivre leur réflexion. En effet, si 33 % sont prêts à aller plus loin, 61 % ne prévoient pas d’en faire davantage car ils estiment que l’investissement financier est trop important, de même que le temps de travail que cela nécessite. Un autre frein est souvent cité, celui des contraintes réglementaires. Qu’en pensez-vous ? Comment parvenir à ce que les éleveurs français qui subissent un déficit de compétitivité sur le plan réglementaire adhèrent majoritairement à la nécessaire transition agro-écologique ?
Mme Brigitte Allain. Messieurs, je vous remercie pour vos interventions.
Ma question concerne la réforme de la PAC et son influence par rapport à l’évolution des élevages. Selon vous, quel type d’élevage risque de prendre le pas ?
Avec la fin des quotas laitiers, il semblerait que l’on évolue plutôt vers un agrandissement des ateliers. Cette évolution vous paraît-elle sérieuse d’un point de vue environnemental, climatique et économique ?
M. Florent Boudié. Cela fait près de dix ans que la FAO a alerté la planète dans son rapport intitulé « L’ombre portée de l’élevage ». Le diagnostic est très préoccupant et va très au-delà des propos qui ont pu être tenus tout à l’heure par les différents intervenants.
On voit bien que de nombreuses mesures ont été prises – sans même parler de la directive « Nitrates » de 1991 – à l’échelle européenne et nationale pour inciter à des modes de production plus neutres pour l’environnement. La filière élevage a pris conscience que la mutation des modes d’exploitation est inéluctable à moyen terme pour les rendre soutenables sur le plan écologique.
Au fond, on a du mal à avoir – et je crois que vos interventions le traduisent bien – une vision d’ensemble des mesures qui sont prises à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne, alors que la réduction de l’impact de l’élevage sur l’environnement est l’une des clés de la protection de la ressource en eau, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, et de la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
Quel est l’agenda de l’Europe sur cette question et celui de la France à la veille de la COP21 ? Comment les interprofessions de l’élevage se mobilisent-elles et se concertent-elles, notamment à l’échelle européenne ? Qui pilote en France l’adaptation des systèmes d’exploitation d’élevage à l’enjeu environnemental ? Cette dernière question rejoint celle du rôle que pourraient jouer les collectivités territoriales.
M. Gérard Menuel. Monsieur le président, je vous remercie pour votre initiative. Je suis heureux de voir que le monde agricole et celui de l’environnement se parlent.
Les producteurs agricoles, les éleveurs en particulier, répondent à un certain nombre de besoins, notamment ceux des consommateurs. L’évolution de la production est due pour partie aux consommateurs. Notre alimentation a deux qualités : elle est sécurisée et souvent labellisée.
S’agissant plus précisément de l’alimentation des animaux, je ne vois pas comment on pourrait produire de la viande uniquement avec de la paille, de l’herbe ou du foin. Or nous sommes fortement dépendants en protéines, d’où l’importation massive de soja.
Des efforts ont été accomplis dans le passé. On a essayé de mettre en place des unités de déshydratation, avec le succès que l’on connaît et l’évolution que l’on constate aujourd’hui. On a cultivé des pois protéagineux. Mais aujourd’hui la production est plutôt à la baisse. Je citerai également les coproduits issus du diester, notamment dans l’est de la France. Selon vous, quelles voies doivent être développées pour que la France soit moins dépendante en matière de protéines ?
En Allemagne, une unité de méthanisation se construit chaque jour, notamment chez les éleveurs. Là-bas, il faut six mois pour monter une unité parce que le parcours administratif est très court. En France, par contre, il faut quatre à cinq ans. Voilà pourquoi on en crée si peu.
M. Philippe Noguès. Ma question porte sur l’autonomie protéique, enjeu à la fois environnemental et économique en raison de la variation des cours mondiaux des protéines et des compléments azotés.
La FAO estime que l’élevage peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 30 % grâce aux technologies existantes et en améliorant les pratiques. Un certain nombre d’éleveurs adoptent des pratiques visant à accroître leur autonomie protéique via l’introduction de cultures moins gourmandes, voire excédentaires en azote, telles que l’herbe, la luzerne, le lupin, ce qui se traduit généralement par de meilleures performances technico-économiques et une moindre dépendance aux variations des cours sur les marchés.
Pourriez-vous nous indiquer la part de l’élevage actuellement engagée dans une démarche de recherche d’autonomie protéique ? Les aides et incitations de la PAC vous semblent-elles suffisantes et adaptées ? Quelles sont les régions de France les plus en avance sur ces questions ?
En tant que président du groupe d’études sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et membre de la plate-forme d’actions globales pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE), je souhaiterais savoir s’il existe des initiatives de RSE au sein de la filière bovine. Dans l’affirmative, quelle forme prennent-elles et sur quel sujet portent-elles exactement ?
M. Guillaume Chevrollier. Il est souvent affirmé que l’élevage est l’une des causes des problèmes d’environnement les plus pressants, à savoir le réchauffement de la planète, la dégradation des terres, la pollution des eaux et la perte de biodiversité. Ce tableau est très éloigné des réalités du terrain, ce qui donne lieu à de nombreuses polémiques. Il est à souligner que la recherche peut contribuer à atténuer ces nuisances.
Surtout, les pratiques de nos agriculteurs se sont considérablement améliorées pour répondre à la double contrainte en matière de performance économique et environnementale à laquelle ils sont soumis. En effet, je considère que l’on parle trop peu des contributions positives de l’élevage. Or celles-ci existent aussi en matière environnementale. Le secteur de l’élevage est socialement et politiquement très important, à la fois dans les pays en voie de développement où il est essentiel, et dans nombre de nos départements français, bien évidemment dans les départements ruraux. Là où il y a de l’élevage, il y a de la vie économique.
Les préoccupations environnementales ont donné lieu à des obligations innombrables pour les éleveurs, que ce soit en termes de contrôles, de déclarations, de paperasserie et donc de coût dont on n’a pas suffisamment parlé ce matin.
Je veux rappeler la situation délicate des éleveurs, notamment bovins, pris en étau entre la chute des prix de la viande bovine et l’augmentation des coûts de production. Je veux me faire l’écho de ce que j’entends dans ma circonscription de Mayenne : assez de contraintes et d’obligations, davantage de prise en compte des difficultés réelles des éleveurs.
Quelle est votre réflexion sur le débat relatif au bien-être animal, avec les risques que cela peut entraîner pour nos éleveurs ?
Enfin, l’étiquetage indiquant l’origine nationale des produits agricoles est-il un moyen efficace pour valoriser la production nationale française ?
Mme Sophie Rohfritsch. Monsieur le président, à mon tour je tiens à vous remercier pour avoir organisé cette table ronde. Je remercie également les intervenants d’avoir exposé avec beaucoup de clarté la situation et planté le décor. On comprend bien que nos destins sont liés et que les éleveurs sont vraiment des acteurs de la protection de l’environnement.
À ceux de mes collègues qui continuent de parler de compromis ou de lutte, je dirai qu’ils devraient cesser d’aborder la question de cette manière. Ils doivent comprendre que nous devons travailler ensemble sur des thématiques destinées au développement de l’élevage. Cela passe d’abord par une bonne qualité de vie des éleveurs et une bonne rémunération de leur activité. On n’a peut-être pas beaucoup insisté sur la façon dont on pourrait parvenir à une meilleure répartition de la valeur ajoutée de la transformation de la viande, donc de la production. En Alsace, un projet porté par une coopérative d’éleveurs alsaciens, Copvial, que Dominique Daul connaît très bien, vient d’aboutir au rachat d’une unité de transformation de la viande. Celle-ci est ensuite vendue sous un label tout à fait identifié par le consommateur alsacien comme un label de qualité. Il faudrait donc faciliter ce type d’acquisition pour que la filière soit présente sur l’ensemble de l’activité, de la production à la transformation.
On pourrait aussi envisager des mesures toutes simples comme le transfert aux collectivités territoriales des personnels en charge d’acheter la viande dans les collèges et lycées. Ils seraient plus sensibles à l’achat de la viande produite localement que des personnels d’État. Il faudrait également encourager la méthanisation. Bref, nous devons nous saisir de beaucoup de sujets, car les éleveurs comme les agriculteurs seront plus sensibles à la protection de l’environnement lorsqu’ils vivront bien de leur activité. Tel est le message qu’il faut délivrer en priorité.
Mme Sylviane Alaux. Ce que j’ai entendu ce matin est très intéressant.
Vous savez qu’un député a toujours tendance à parler en priorité de son territoire. (Sourires) Aussi, je vous ferai part d’initiatives qui ont fleuri dans le pays basque, concernant notamment l’alimentation du bétail. Des recherches ont été menées pour changer l’alimentation mais toujours avec l’objectif de ce que peut produire l’éleveur lui-même.
Vous parliez du revenu de l’éleveur. À cet égard, l’association EHLG, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, a mis en œuvre une véritable politique de revenu du paysan. Elle considère que les agriculteurs ne sont ni des producteurs ni des éleveurs mais des paysans qui ont à cœur de mettre à la disposition du consommateur un produit de qualité tout en leur assurant un revenu qui leur permet de vivre.
Vous évoquez les circuits courts. La région Aquitaine développe de telles filières et, avec l’aide des conseils de développement du pays basque, nous avons mis en place des clusters agroalimentaires qui permettent de développer les circuits courts.
Mon intervention était davantage un témoignage qu’une question pour montrer que des initiatives sont prises dans nos régions de France. Peut-être faudrait-il qu’une concertation soit engagée sur ce point entre tous nos territoires.
M. Jean-Pierre Vigier. Je remercie les différents intervenants pour leur exposé.
Certains orateurs viennent d’affirmer que l’élevage est l’une des principales causes des problèmes environnementaux : réchauffement de la planète, dégradation des terres, pollution de l’atmosphère et des eaux, perte de biodiversité. Je veux bien, mais il ne faut pas généraliser.
Tout d’abord, je voudrais féliciter et remercier nos éleveurs qui nourrissent la planète.
Je ferai trois remarques pour rappeler des choses simples.
Premièrement, pour bien connaître le sujet, je peux affirmer que l’élevage en moyenne montagne concerne de petites exploitations agricoles. Elles ne sont pas intensives et elles respectent l’environnement, notamment par la mise en place de nouvelles pratiques agricoles, ce qui permet d’obtenir des produits de qualité, parfois labellisés AOC ou AOP (appellation d’origine protégée).
Deuxièmement, ces exploitations agricoles représentent 40 % de l’activité économique des territoires ruraux. Elles entretiennent l’espace dans des endroits parfois très difficiles. Je le dis clairement : sans elles, il n’y a plus de vie dans ces territoires ruraux. Nos agriculteurs font de l’aménagement du territoire.
Troisièmement, il ne faut pas oublier que les agriculteurs travaillent durement, dans des conditions difficiles, parfois pour dégager de faibles, voire de très faibles revenus.
Bien sûr, il faut protéger l’environnement, mais il faudra bien penser, un jour, à aider plus fortement et peut-être à protéger nos éleveurs. Qu’en pensez-vous ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Jean-Pierre Vigier, je suis tenté de répondre d’abord moi-même à votre intervention.
L’état d’esprit de cette table ronde doit nous conduire, les uns et les autres, à tenir des propos les plus équilibrés possible parce qu’il y a différents types d’élevage et différents agriculteurs. L’analyse ne peut donc pas être unique et elle est forcément complexe. (Approbations sur divers bancs)
Les interventions des uns et des autres, professionnels comme représentants des ONG ou parlementaires, prouvent que les choses progressent, et c’est tant mieux. Elles avancent au niveau européen, dans les territoires, mais peut-être pas suffisamment en ce qui concerne l’installation des jeunes, sujet qui n’a pas encore été abordé ce matin. Actuellement, on compte une seule installation pour trois départs à la retraite. Que ferons-nous demain dans nos territoires ? Comment mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, la biodiversité, l’aménagement de l’espace, la protection des sols si demain il n’y a plus d’élevages extensifs ? À ce jour, vous le savez, les politiques n’ont pas apporté de réponse. La réduction du nombre d’exploitants agricoles est un fait majeur qui commence à avoir des conséquences sur nos agricultures, et qui en aura aussi demain.
M. Dominique Langlois. L’enjeu économique des filières que nous représentons – filières bovine et ovine principalement – est majeur, puisqu’elles sont en crise. Aujourd’hui, les producteurs bovins ne gagnent pas leur vie, ce qui veut dire que le renouvellement des générations ne peut pas se faire. On ne peut pas attirer grand monde avec une perspective de revenu de 14 000 euros par an. Nous y travaillons avec les organisations syndicales, notamment la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).
L’industrie de transformation de la viande constitue également un enjeu économique majeur puisqu’elle concerne 59 000 emplois. Là aussi, nous sommes confrontés à un problème de renouvellement des générations puisqu’il est difficile d’attirer les jeunes vers les métiers de la viande. Il faut valoriser ces métiers nobles et qui ont un réel savoir-faire. C’est pourquoi nous avons entrepris une campagne importante de communication.
J’ajoute que, s’il n’y a plus de producteurs, il n’y aura plus d’industrie de la viande. La consommation de viande bovine baisse en France, tandis que la consommation d’autres espèces augmente, en particulier en raison du prix.
Depuis trois ans, nous avons la chance de voir l’ouverture des marchés extérieurs qui ne l’étaient plus à cause de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ce problème est maintenant derrière nous et nous espérons être classés, au mois de mai prochain, en « risque négligeable » par la Commission européenne, ce qui permettra que soit levé l’embargo de la Chine et d’autres pays sur les viandes européenne et française.
La question de l’étiquetage est effectivement très importante. Elle sera au cœur de nos préoccupations lors du prochain salon international de l’agriculture. Il y a un an, nous avons vécu la crise du Horsegate. Nous avons créé « Viandes de France » qui regroupe l’ensemble des viandes et pas seulement la viande bovine, et certifie que les animaux sont nés, élevés, abattus et transformés en France. Mais, comme nous considérons que ce logo n’est pas suffisamment utilisé, nous allons intensifier notre action. Disons-le clairement : nous avons rencontré des réticences de la part d’industriels de la transformation. Nous menons également un combat auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. Il y a quinze jours, nous avons réussi à empêcher qu’un amendement soit déposé qui considérait qu’il n’était pas possible de mentionner l’origine de la viande transformée en raison d’un coût élevé. En réalité, cet argument ne tient pas, car la quantité de viande dans un plat à base de viande est très faible, et l’impact sur le prix négligeable.
Ce combat est important parce qu’il permet de répondre à une attente du consommateur, dont le premier critère de choix est l’origine du produit. Il ne s’agit pas d’imposer la viande française partout, mais de permettre au consommateur de connaître l’origine de la viande qu’il consomme.
J’en viens à la restauration collective, qui représente 28 % de la consommation de viande en France. Nous savons qu’une part très faible est réservée à la viande française, ce qui est totalement anormal. Il faut bien distinguer la restauration collective commerciale de la restauration collective scolaire, des administrations, de l’armée, etc. Il est absolument anormal que 80 % de la viande consommée ne soit pas d’origine française. À cela, certains nous répondent que nous ne pourrions pas fournir suffisamment de viande. C’est faux : c’est un problème de gestion, mais nous savons le résoudre. Nos comités régionaux ont un travail important à faire auprès des collectivités pour leur expliquer que nous pouvons fournir de la viande. Nous avons une répartition territoriale des unités de transformation de viande qui permet également de valoriser des démarches régionales.
S’agissant du prix de la viande, une réunion de concertation a lieu aujourd’hui. Même s’il n’est pas rémunérateur pour l’éleveur, le prix est élevé pour le consommateur. Se pose donc la question des marges, que je n’aborderai pas. Nous avons un outil de réflexion qui peut nous permettre d’avancer : la contractualisation. Cela permettrait de mieux valoriser les démarches de qualité. Une caisse de sécurisation serait créée qui permettrait d’abonder le prix lorsqu’il est très bas et de capitaliser lorsqu’il est plus élevé.
Un autre point a été soulevé, celui de la valorisation des coproduits. En la matière, il existe de grandes complexités administratives et fiscales, mais il y a des chances à saisir. La méthanisation est très compliquée pour les industriels de la viande, et l’on se rend compte que le résultat n’est pas à la hauteur des études qui ont été réalisées.
S’agissant du bien-être animal, le code civil a été aligné sur le code rural. Je rappelle que le bien-être animal fait bien partie intégrante des préoccupations des éleveurs mais aussi des industriels de la viande que nous sommes, contrairement à ce que peuvent dire certaines associations dont le discours relève du militantisme. Pour ce qui est du transport des animaux, il est préférable que des animaux qui auront été élevés en France soient abattus en France avant d’être exportés, car le délai de transport est alors beaucoup plus court.
M. Dominique Daul. Il est important de noter que, quel que soit le gouvernement, le budget de la PAC a été maintenu globalement au niveau européen. La France a fait du bon travail. En ce qui concerne l’élevage, le choix a été fait de soutenir et de maintenir une prime couplée à la production de la vache allaitante, ce qui veut dire qu’à une vache correspond une prime. La prime n’est pas liée à l’exploitation, mais bien à un acte de production. C’est un choix fort pour les zones herbagères et l’on ne peut que s’en féliciter.
Je souhaite dire haut et fort qu’il n’est pas acceptable que les éleveurs, qui doivent faire leur « déclaration PAC » au mois de mai prochain, ne connaissent toujours pas le cadre de la nouvelle PAC. Il y a là un dysfonctionnement global des services du ministère de l’agriculture.
Un plan protéines a été avalisé dans le cadre de la nouvelle PAC et un fonds est spécifiquement lié à l’agriculture, notamment aux éleveurs. C’est essentiel pour développer différentes productions. Je pense notamment aux légumineuses, au mélange herbe-légumineuses, ce qui permettra de gagner en autonomie fourragère et d’améliorer notre plan « protéines végétales ». Cela ne veut pas dire pour autant que nous deviendrons indépendants. On estime pouvoir accroître les surfaces d’un million d’hectares, ce qui n’est pas négligeable. Les essais réalisés dans les fermes expérimentales et les différentes mesures déjà prises dans un certain nombre d’élevages montrent que ça marche. Mais ce ne sera pas possible partout. Et la mesure aura un impact agronomique auquel les éleveurs sont sensibles.
Je veux rappeler quelques chiffres. Le revenu moyen d’un éleveur est aujourd’hui de 14 000 euros par an. Quel jeune a envie de s’installer pour gagner une telle somme ? Il faut savoir qu’il est plus facile aujourd’hui de reprendre ou d’agrandir une exploitation céréalière que de reprendre un élevage. C’est souvent un voisin éleveur qui reprend l’élevage. Et si c’est un voisin céréalier qui reprend l’élevage, il vend les animaux et reprend les surfaces. C’est plus intéressant de pratiquer de la sorte en termes de qualité de vie et de vie sociale. Dès lors, que faire ? Ce n’est pas compliqué : il faut permettre à l’éleveur de gagner sa vie, comme l’a dit Mme Sophie Rohfritsch.
Ce n’est pas facile d’élever seul cinquante vaches. Pour ma part, je suis engraisseur, c’est-à-dire que j’achète des broutards issus de zones extensives. Je dis toujours qu’il est plus facile d’en produire 800 à deux que 400 tout seul, (Sourires) en termes de rentabilité, sans oublier le facteur humain. On parle beaucoup de bien-être animal, mais il faut aussi penser au bien-être de l’éleveur et à sa vie sociale. Dans un même village, on autorise aujourd’hui deux producteurs à avoir 400 jeunes bovins sur chaque exploitation. Par contre, on leur impose 20 000 euros d’études, deux ans d’expertises pour associer les deux exploitations. Il faudra donc savoir évoluer tout en maintenant un lien au sol pour éviter le développement des exploitations hors-sol de bovins.
On a beaucoup parlé des zones extensives. Il faut mentionner aussi la complémentarité des zones que nous avons la chance d’avoir en France : il y a des zones totalement herbagères ou à forte potentialité herbagère, et des zones de plaine où sont cultivées les céréales qui permettent de fournir des protéines et donc d’engraisser nos animaux. Si notre pays compte encore autant d’élevages, c’est bien que les différentes zones se complètent et que les systèmes de production sont équilibrés et cohérents. Venez visiter nos fermes : nous n’avons pas peur de montrer ce que nous faisons. Dernièrement, Interbev a organisé les rencontres « Made in viande ». Quand les citadins viennent sur nos exploitations, ils peuvent voir tout ce que nous faisons en matière d’environnement et se rendre compte de ce que cela coûte.
Je citerai encore un chiffre : 50 % des éleveurs ont plus de cinquante ans. Dans ces conditions, comment maintenir le potentiel de production, surtout lorsque l’on sait que le nombre d’exploitants va baisser ? Il y a actuellement 4 millions de vaches allaitantes en France. Sur 2 millions de broutards, jusqu’à présent la moitié partait en Italie. Mais d’ici à dix ans, on estime que seulement 600 000 iront à l’étranger. Dès lors, que faire des animaux restants ? Il y a des réalités économiques qui s’imposent à nous. Je ne dis pas qu’il faut aller vers de grands modèles – je ne parle pas des feedlots – mais si les normes sont respectées et le lien au sol conservé, nous serons capables de faire de belles choses au niveau environnemental, d’améliorer la vie sociale des éleveurs et de garantir la pérennité économique des exploitations. Il est essentiel de repenser fondamentalement la production. C’est ce que pensent l’interprofession et la Fédération nationale bovine (FNB) et c’est ce que les élus devraient penser. Ce sont de vrais enjeux, non seulement pour les éleveurs, mais aussi pour toute la filière en aval : fabricants d’aliments, concessionnaires, abattoirs, transformateurs, etc.
Méfions-nous de ce qui se passe en Allemagne en matière de méthanisation. Certaines exploitations allemandes sont allées jusqu’à arrêter l’élevage et ne cultivent que du maïs ensilage pour faire tourner leur méthaniseur. Ce n’est pas une solution pour nous. Certaines unités de méthanisation peuvent regrouper deux ou trois exploitations de 350 à 500 animaux et être viables. Mais que fait-on avec l’énergie et avec la chaleur ? Ne faudrait-il pas plébisciter les injections directes de gaz ? Actuellement, peu de méthaniseurs se montent en France pour des raisons administratives et financières, les éleveurs n’ayant pas toujours la capacité financière pour s’engager.
M. Emmanuel Coste. Je voudrais répondre à Mme Laurence Abeille. Nous souhaitons que nos discussions avec la FAO soient basées sur une analyse multicritères. Que l’on compare la quantité produite au mètre carré, à l’hectare ou en pourcentage de la planète, on obtiendra toujours des chiffres exacts, mais il faut parvenir à se mettre d’accord sur les évaluations multicritères. Nous sommes souvent attaqués sur le nombre d’animaux ou sur la qualité, mais il ne faut pas oublier qu’ils produisent d’autres choses, comme du lait, du cuir, etc. On parle souvent des impacts négatifs de la production de viande sur l’environnement, alors qu’il existe d’autres productions liées à l’animal.
Le modèle français est très particulier, si on le compare à ce qui se passe sur le reste de la planète, où l’on s’oriente plutôt vers des modèles de type industriel, qui sont les plus dangereux au plan environnemental. La confrontation environnementale nous conduit à orienter l’élevage de telle manière que l’on ne construise pas des usines à viande ou à lait. À cet égard, je voudrais signaler l’initiative qui a été prise au Brésil, où des gens se sont mis autour d’une table avec des ONG, en particulier WWF, pour réfléchir à un « bœuf durable ». Même si de telles initiatives ne sont pas suffisamment développées, elles devraient permettre de discuter d’un autre modèle. Mais le modèle mis en place en Afrique ou en Asie n’est pas du tout basé sur la dépendance au sol, contrairement à ce qui se passe en France et dans la partie orientale de l’Europe.
L’année dernière, lors du congrès mondial de la viande en Chine, le gouvernement chinois a posé la question suivante : déplacer les populations rurales en bordure des villes est peut-être une solution, mais que fait-on des territoires et de l’agriculture qui y reste ? Est-ce du développement industriel, ou un modèle à l’européenne ou à la française ? Ces questions sont au cœur de nos discussions. La réponse de la PAC est intéressante dans la mesure où elle allie le caractère productif et économique d’une exploitation à des qualités environnementales développées par l’agriculture. Je crois que ce modèle peut être intéressant, même s’il est contraignant pour les agriculteurs qui ont encore du mal à accepter d’avoir à remplir chaque jour des papiers. La prime à la vache allaitante ou à la brebis est associée à un caractère économique, c’est-à-dire que, contrairement à ce qui a pu être dit, les agriculteurs qui touchent des primes de Bruxelles s’engagent à produire un minimum de veaux ou d’agneaux, ces primes étant également liées à des critères environnementaux, à des densités, etc.
Vous nous avez demandé quelle sera la nouvelle PAC. On voit bien que la PAC est plutôt un assemblage de différentes positions nationales qu’une véritable politique européenne qui aurait alimenté l’avenir agricole de l’Europe. Ces questions se posent essentiellement au niveau européen mais elles ont un retentissement mondial parce que le problème de l’élevage au niveau mondial n’a rien de semblable avec l’évolution qui existe chez nous. Nous sommes parvenus à de premières réponses parce que les discussions locales avec les ONG ont permis quelques avancées.
M. Dominique Langlois. Je n’ai pas répondu sur les accords de libre-échange. Ce sera le deuxième sujet important du salon international de l’agriculture. Il y a un an, le Président de la République nous avait indiqué qu’il n’était pas question de saborder l’agriculture dans ces accords et que cette question devait être évacuée avant tout autre négociation. Or, aujourd’hui, nous sommes très inquiets en raison des accords qui ont été conclus avec le Canada et des discussions avec les États-Unis. Le risque est majeur puisque 250 000 tonnes seraient importées vers l’Europe – sans entrer dans le détail, il s’agirait de « muscles nobles », c’est-à-dire à valeur forte. Cela induirait une baisse de revenus de 30 à 40 % pour les éleveurs. Je le répète, cette viande importée est élevée dans de grands parcs d’engraissement où les antibiotiques sont utilisés comme activateurs de croissance et où les carcasses sont stérilisées à l’eau de javel. Ce n’est pas du tout le modèle de production européen, sauf à considérer que ce que l’on nous impose, en Europe et en France, ne sert à rien.
M. Jean-Baptiste Dollé. En France, depuis l’entrée en vigueur de la directive « Nitrates », on a constaté une meilleure valorisation des effluents d’élevage. De grands investissements ont été réalisés sur les exploitations pour mieux valoriser ces effluents. Cela s’est traduit par un moindre recours aux engrais de synthèse, donc une moindre dépendance aux engrais minéraux et, de fait, on observe une amélioration de la qualité de l’eau avec des teneurs en nitrates qui baissent dans les eaux superficielles.
S’agissant de la quantité d’eau nécessaire à la production de lait ou de viande, le schéma français n’est pas du tout le même que le schéma israélien, où l’on a recours à l’irrigation pour la production de tous les fourrages. En France, seulement 5 % des surfaces destinées à l’alimentation des animaux sont irriguées. Cela représente une faible part et donc une très faible dépendance à l’irrigation. Néanmoins, des améliorations sont nécessaires pour optimiser la consommation d’eau dans les élevages.
En 2006, la FAO estimait que l’élevage contribuait pour 18 % aux émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Depuis, la FAO a conduit une nouvelle évaluation qui fait état de 14,5 % en 2013. Nous avons constaté que les pratiques mises en œuvre pour réduire la pollution par les nitrates ont un effet positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait qu’entre 1990 et 2010, une réduction de 14 % de ces émissions a été obtenue dans l’élevage bovin. Ce résultat est lié à l’amélioration des pratiques, mais aussi à l’augmentation de la productivité, sachant que la production par vache a augmenté entre 1990 et 2010 du fait de la génétique et d’une meilleure efficience des systèmes de production : nous sommes passés de 5 500 kg de lait par vache à 6 500 à 7 000 kg de lait, ce qui n’a rien à voir avec les 10 000 ou 12 000 kg que l’on peut observer dans certains pays où le lien au sol a été perdu. L’augmentation de la productivité en France nous a permis en effet de conserver malgré tout ce lien au sol. Il y aura de toute façon une augmentation des cheptels dans les exploitations, dès lors que le lien au sol sera conservé par la production de fourrage et la valorisation des déjections. Nous ne prendrons pas de risques environnementaux plus importants.
Vous nous avez demandé si l’on prenait suffisamment en compte le stockage de carbone dans les exploitations. La réponse est non. Même si nous progressons sur l’intégration du stockage de carbone, il nous faut un soutien pour que ce stockage soit reconnu en tant que tel dans les inventaires nationaux, dans les évaluations environnementales. Le risque serait sinon de voir disparaître ce puits de carbone, ce qui se traduirait par un emballement du changement climatique. Un effort important est donc nécessaire pour faire reconnaître cette contribution positive de l’élevage au stockage de carbone.
Il est difficile de dire que l’élevage contribue à une perte de biodiversité lorsque l’on voit, sur une zone de polyculture élevage, à la fois des champs de céréales, de maïs, de colza et des prairies. Cette mosaïque paysagère contribue à la biodiversité floristique et faunistique, c’est-à-dire qu’il y a un transfert d’espèces entre les différentes cultures, ce qui est bien plus favorable à la biodiversité qu’une zone de grandes cultures avec des étendues très importantes de monocultures. Pour l’éleveur, le dispositif est doublement bénéfique car, dès lors qu’il contribuera à une meilleure biodiversité du sol et de tout le paysage qui l’entoure, il aura moins recours aux intrants. L’élevage bovin s’inscrit donc dans la préservation de la biodiversité. Je précise que les produits phytosanitaires sont très peu utilisés en élevage, à la différence des grandes cultures.
Bien sûr, il faut engager d’autres évolutions. La FAO annonce un objectif de 30 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est envisageable à plus ou moins long terme. Sur certaines exploitations, il reste encore des marges de progrès très importantes puisque des exploitations au système de production identique peuvent avoir une efficience technique et des impacts environnementaux différents.
M. Arnaud Gauffier. Aujourd’hui, un éleveur de vaches allaitantes gagne 14 000 euros par an pour 3 200 heures de travail, tandis que le revenu moyen d’un agriculteur qui cultive de la betterave, de la pomme de terre et du blé était de 75 000 euros avant impôts en 2011 pour 900 heures de travail. À cela s’ajoutent les aides de la PAC qui sont de 300 euros par hectare en grandes cultures et de 100 euros pour les prairies. Il y a là un véritable gâchis d’argent public. Comment voulez-vous justifier une telle PAC auprès des éleveurs et surtout des contribuables ?
J’ai trouvé Dominique Daul très accommodant sur la réforme de la PAC. Qui va accepter que l’on verse de l’argent public à des céréaliers qui, pour la plupart, n’en ont pas besoin ? Cette année, les prix des céréales ont chuté, mais, ces deux dernières années, ça a été le « gavage » complet ! Certaines ONG demandent une disparition de la PAC. Cela réglerait peut-être le problème, mais il n’y aurait plus d’éleveurs. Telle n’est pas la position de WWF. Pour notre part, nous demandons une meilleure répartition des aides et une convergence totale en 2020, mais cela nous a été refusé. Nous avions demandé un plafonnement des aides, mais cela nous a été également refusé. Nous avions demandé un paiement pour services écosystémiques, c’est-à-dire à ce que les agriculteurs soient payés pour le service rendu, ce qui leur permettrait de tirer leur épingle du jeu. Un céréalier en Beauce qui épand des pesticides et des engrais minéraux ne rend pas beaucoup de services écosystémiques à la société. Il n’a pas du tout d’infrastructures agro-écologiques, c’est-à-dire de haies, etc. En revanche, un éleveur de vaches allaitantes dans le Limousin, qui entretient un paysage et ses prairies et qui stocke du carbone, rend à la société un service largement supérieur. Aidons nos éleveurs ! Il est important de penser sérieusement à ces pistes pour la future PAC.
Beaucoup d’intervenants se sont félicités que les émissions de gaz à effet de serre aient baissé de 10 % dans l’élevage. Attention à cet argument à double tranchant, car ce résultat est dû à l’intensification de l’élevage. La « ferme des mille vaches » n’aura pas nécessairement un plus mauvais bilan carbone qu’une exploitation de vaches allaitantes nourries à l’herbe dans le Limousin.
On a parlé aussi de déprise agricole. C’est une réalité dans certaines régions, en moyenne montagne notamment parce que nos éleveurs ne sont plus du tout aidés et que personne ne veut s’y installer. Mais c’est aussi une réalité dans les régions de grandes cultures. Les aides PAC sont en quelque sorte des primes à l’agrandissement, puisqu’elles sont liées au nombre d’hectares. Du coup, les exploitations céréalières s’agrandissent tandis que le nombre d’agriculteurs diminue drastiquement. À ma connaissance, la région Champagne-Ardenne est la seule qui reçoit des aides du Fonds européen de développement économique et régional (FEDER) parce qu’elle perd de la population. Dans certains villages, il y avait auparavant quinze agriculteurs, contre un seul maintenant.
Cela doit nous conduire à nous poser la question de l’hyperspécialisation, qui est aussi le résultat des politiques agricoles françaises et européennes. Aujourd’hui, certaines régions sont spécialisées et déconnectées des autres. Dans la Beauce, on produit des céréales, en Bretagne du lait et du porc, en Aquitaine du maïs et du vin. (Murmures sur divers bancs) Reconnectons ces zones, essayons de réinjecter un peu d’élevage dans les zones de grandes cultures afin que des complémentarités vertueuses soient remises en place et que les céréaliers trouvent des débouchés pour les protéagineux qu’ils vont cultiver. Le plan « protéines » permettra d’accroître l’autonomie protéique des élevages, les éleveurs ayant intérêt à cultiver des protéines puisqu’ils toucheront des primes. Par contre, les céréaliers n’ont aucun intérêt à en cultiver car les niveaux de prix sont extrêmement bas, la recherche publique et privée sur les variétés a été arrêtée, d’énormes attaques de ravageurs font baisser les rendements, et les coopératives n’offrent pas de débouchés puisque les régions d’élevage sont éloignées.
La responsabilité sociétale des entreprises est une question importante. Il convient de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne : les éleveurs, l’abattage, l’alimentation animale qui est un secteur clé en ce qui concerne l’autonomie protéique, mais aussi les industriels, la grande distribution et le consommateur. Le WWF travaille beaucoup avec les entreprises de tous les secteurs que je viens de citer – alimentation animale, distribution, transformation – et il distille des messages à destination des consommateurs pour qu’ils partagent la valeur ajoutée et les coûts. L’ONG environnementale que nous sommes souhaite que les coûts ne soient pas supportés uniquement par les éleveurs, mais qu’ils soient partagés tout au long de la chaîne de valeur et que tout le monde essaie de travailler la main dans la main. Vous avez cité l’exemple de la Global roundtable for sustainable beef (GRSB), la table ronde mondiale sur le bœuf durable, qui a été cofondée par le WWF et des industriels de la viande. Certes, cette initiative concerne plutôt la problématique de la déforestation, donc la Colombie, le Brésil, l’Argentine et l’Australie, mais c’est un bon exemple de travail avec le secteur de l’industrie.
M. Jean-Claude Bevillard. Je suis gêné par cette espèce de quiproquo qu’il y a sur le terme d’élevage. Il n’y a rien de commun entre un troupeau de vaches allaitantes dans le Jura ou dans le Limousin, et une usine de 5 000 cochons ou de 10 000 volailles en Bretagne. Les élevages hors-sol industrialisés sont quasiment insoutenables d’un point de vue environnemental. Je tenais à apporter cette précision car on utilise souvent les qualités d’un type d’élevage pour défendre l’autre, ce qui est dangereux.
Le lien au sol sur lequel j’ai insisté tout à l’heure signifie qu’il faut déconcentrer l’élevage et le réimplanter dans toutes les régions. Il y a des excédents d’azote en Bretagne dont on ne sait que faire, et des terrains dans le Bassin parisien qui sont en train de perdre leur humus et donc leurs qualités agronomiques. Il va falloir résoudre ce problème. Il y va de notre responsabilité à l’égard des générations futures. La déspécialisation et la diversification des régions sont importantes.
Arnaud Gauffier a très bien présenté la problématique de la PAC. France Nature Environnement a commencé à travailler sur la nouvelle PAC dès 2007. Nous étions partis du constat qu’en tant que politique publique, la PAC devait financer les prestations d’intérêt général des agriculteurs globalement, c’est-à-dire de ceux qui cultivent et de ceux qui élèvent. Les premières positions du Parlement allaient dans ce sens. Mais au final, la PAC ne ressemble à rien du tout parce que les égoïsmes nationaux se sont manifestés, notamment au Parlement, et l’on a abouti à une juxtaposition de politiques nationales. En matière de diversification, par exemple, on a réussi ce coup de maître d’accepter qu’une exploitation ne puisse avoir que deux cultures sur 95 % de la SAU.
Je suis tout à fait d’accord pour dire que l’élevage lié au sol ne fonctionne pas, que les revenus ne suivent pas, et que l’obsession des jeunes qui s’installent est de basculer de la polyculture élevage vers la culture. On voit bien quelles sont les contraintes d’un élevage lié au sol : il faut être présent chaque jour, gérer un troupeau, etc. Je ne dis pas que la culture soit facile, mais elle laisse davantage de souplesse dans l’emploi du temps et des revenus sans commune mesure.
Soit les politiques publiques visent à maintenir un élevage lié au sol dans toutes les régions et s’en donnent les moyens, soit elles se contentent de ces incantations que nous allons encore entendre pendant le salon de l’agriculture, sans que les décisions suivent. Si, d’un côté, on ne cesse de dire que l’on veut préserver l’élevage tandis que, de l’autre, dans la restauration collective, par exemple, on rechigne à faire le choix d’acheter des produits locaux de qualité, on n’aura rien gagné. Il faut mettre en accord les actes avec les discours. La PAC ne fait rien pour les prairies, elles ne sont pas protégées. Il était prévu de les cartographier, et voici que, finalement, on ne va retenir qu’une partie de celles de Natura 2000, tandis que les autres devront se contenter du fameux ratio régional qui, autant que l’on sache, n’a pas préservé nos prairies jusqu’à présent. Disons les choses clairement : les surfaces de prairies diminuent, ce qui veut dire que le stockage de carbone dans les prairies diminue aussi.
Il y a un consensus national autour de l’agriculture et de l’élevage. Pourtant, les décisions ne suivent pas. Il faut prendre des décisions plutôt que de continuer à constater les dégâts.
S’agissant de la méthanisation, on ne peut pas aller vers le modèle allemand, car il met en place des méthaniseurs alimentés par des cultures dédiées. Ces élevages ont tendance à voir les revenus de la revente du gaz comme un revenu principal, les produits de l’élevage étant des revenus secondaires. Cela ne ressemble pas à notre modèle français d’agriculture. Mais je suis d’accord pour que les méthaniseurs résorbent une partie des excédents d’azote, même si cela ne peut être qu’un moyen très partiel.
En ce qui concerne les échanges, on ne peut pas dire que notre élevage doive répondre à des exigences de qualité et respecter des normes, et importer d’Amérique du Nord de la viande et des cultures pour alimenter nos élevages hors-sol. Il ne s’agit pas de fermer nos frontières, mais de réguler nos échanges en nous fondant sur des critères environnementaux et sociaux, sans quoi ce sera la foire d’empoigne au niveau mondial et, comme toujours, ce sont les plus faibles qui trinqueront. Nous voyons bien aujourd’hui que l’élevage hors-sol subit les conséquences de niveaux de salaires beaucoup plus bas en Europe de l’Est et en Allemagne que dans notre pays. Ce n’est pas normal. On ne peut pas travailler dans ces conditions. C’est la prime au brigand, à l’augmentation des exploitations, à l’industrialisation de l’élevage.
À chaque fois que l’on va vers l’industrialisation de l’élevage, on le fragilise et on rend la défense de l’agriculture beaucoup plus difficile. Il ne faut jamais oublier que l’élevage comme l’agriculture travaillent sur le vivant. Une vache, c’est très différent d’une machine à laver ou d’un fauteuil, ce n’est pas un produit industriel. Notre civilisation est basée aussi et surtout sur l’éthique, et nous devons en tenir compte. Il est dangereux de considérer un animal seulement comme une masse de viande.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a vraiment eu raison d’organiser cette table ronde. Vous êtes tous intervenus avec vos connaissances, votre sensibilité, vos histoires personnelles et vos responsabilités. Je tenais à vous remercier pour ces échanges de qualité.
On a pu avoir quelquefois le sentiment que le sujet essentiel était l’élevage extensif. Mais il n’y a pas que celui-là. Nous sentons bien, à travers vos propos, que la prise en jeu des enjeux environnementaux est aujourd’hui une réalité, même si nous savons qu’il faut aller encore beaucoup plus loin. La PAC conduit à de nombreuses réflexions. Certains d’entre nous auraient souhaité que les choses aillent beaucoup plus loin en matière de rééquilibrage, de prise en compte des différents types d’agriculture. Ce n’est pas complètement le cas. Néanmoins, nous progressons un peu.
Enfin, l’évaluation multicritères me paraît fondamentale. Nous faisons parfois des analyses un peu abruptes, en ne retenant qu’un seul critère.
19. Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur le bilan de la COP 20 à Lima et la préparation de la COP 21 à Paris (3 mars 2015)
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Je vous prie tout d’abord d’excuser mon collègue Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable, qui a prié notre collègue Christophe Bouillon, vice-président de la commission du développement durable, de le suppléer.
Nos trois Commissions sont très impliquées dans la préparation de ces conférences. Nous avons constitué un groupe de travail réunissant les députés spécialistes de ces sujets. Nous vous serons donc très reconnaissants si vous pouvez faire le point sur l’état d’avancement des négociations relatives à la lutte contre le réchauffement climatique, chacun d’entre nous étant conscient de l’urgence de ce problème.
Notre réunion est placée sous le signe d’un double compte à rebours. Le premier, c’est celui des 270 jours qui nous séparent maintenant de la conférence Paris Climat 2015 (COP21). Le second, c’est celui, de plus long terme, qui nous sépare du moment où l’atmosphère aura atteint le seuil de concentration de dioxyde de carbone au-delà duquel nous n’avons aucune certitude de limiter à 2° le réchauffement global.
Plusieurs initiatives ont émergé. La conférence de Paris aura un volet parlementaire les 5 et 6 décembre prochains. Je travaille à une réunion entre les réseaux de la Fondation Anna Lindh et les présidents des parlements de l’Union pour la Méditerranée qui pourrait se tenir en octobre, très en amont de la réunion de Paris. Elle permettrait de resserrer l’objectif sur la dimension méditerranéenne, faisant suite à la réunion qui se tiendra à Marseille au début du mois de juin.
En faisant ce rappel, je tenais à souligner combien nous sommes prêts à jouer sur tous les leviers possibles pour mobiliser les différents acteurs de la société en prévision de cette conférence si importante.
Sur le fond, vous pourriez, monsieur le ministre, faire le point sur la préparation de cette conférence qui doit déboucher sur un accord climatique. Nous avons suivi le déplacement du président de la République aux Philippines la semaine dernière. Vous y étiez également présent. Le président de la République et le président philippin ont rappelé l’objectif d’un accord « négocié et accepté par tous qui tienne compte des différences de situations », et l’impératif de la « solidarité financière et technologique ». Cet appel est hautement symbolique, car lancé du deuxième pays le plus vulnérable au changement climatique.
Le dépôt des premières contributions se précise. La Commission européenne a présenté mercredi dernier son programme de lutte contre le changement climatique après 2020, qui doit servir de mandat de négociation, dès lors qu’il sera avalisé par les États membres dans les jours qui viennent. Les objectifs sont ceux décidés à l’automne dernier pour l’horizon 2030 : une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre ; une hausse à 27 % pour la part des renouvelables dans le bouquet énergétique ; un relèvement à 27 % des gains d’efficacité énergétique.
La réunion de Genève, le mois dernier, a abouti à un premier projet d’accord, qui est la base reconnue de négociation. Ce texte de plus de 80 pages est à la fois trop volumineux et peu cohérent, car il couvre toutes les options possibles. D’ici juin et la réunion de Bonn, il y a un important travail de tri à faire. À partir de ce document, comment voyez-vous les choses évoluer, tant sur le fond que sur la méthode ? Selon quelles modalités l’accord sera-t-il contraignant, notamment pour éviter tout blocage aux États-Unis. Nous savons que le Congrès et le président Obama ne sont pas sur la même longueur d’ondes.
Comment la différenciation, à laquelle tiennent les pays en développement, sera-t-elle prise en compte ? Quelle sera la place exacte des mesures d’adaptation ? Quels seront les financements en faveur des pays du Sud et quelles seront leurs possibilités d’accéder dans les meilleures conditions aux technologies bas-carbone, de manière que le Sud réalise sa triple transition : économique, énergétique et démographique ?
Les grands émergents, notamment l’Afrique du Sud, qui est à la tête du G77, accordent une grande attention à ces questions. L’Inde a évoqué récemment une feuille de route pour passer de l’actuelle capitalisation du Fonds vert à hauteur de 10 milliards de dollars aux 100 milliards de dollars annuels de transferts globaux promis par les pays développés à partir de 2020. À l’ONU, le 23 septembre dernier, la France s’est engagée à verser au Fonds vert un milliard de dollars. Avez-vous le sentiment que les choses avancent dans le bon sens ?
Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire des grandes rencontres à venir, notamment de la conférence des ministres africains de l’environnement, qui a débuté aujourd’hui même au Caire, ou encore de la première session informelle à Lima du 20 au 22 de ce mois, ou enfin de la conférence des villes européennes sur le climat, le 26 mars. Comment les préparons-nous ?
Enfin, nous serions très heureux que vous puissiez nous dire un mot des contributions nationales déjà annoncées dans le cadre de la préparation de la COP21.
Mme la présidente Danielle Auroi. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir accepté le principe d’une audition conjointe sur l’état des préparatifs de la COP21. La présidente Élisabeth Guigou a rappelé la logique de travail commune à nos trois commissions sur ce sujet.
Pleinement conscients des enjeux, nous avons vu votre engagement à Lima, qui montre bien que vous avez pris en main la question fondamentale du climat. Aussi est-ce avec confiance que nous vous questionnons, en espérant que vous pourrez vous faire le relais de certaines de nos interrogations. Le signal de Manille, d’où vous revenez, est important pour la réussite d’une COP21 exigeante.
Quelles sont aujourd’hui les chances qu’un accord mondial soit signé ? Quelle pourrait être sa forme ?
Je me suis récemment rendue à Washington et à New-York avec nos collègues Jérôme Lambert, Bernard Deflesselles et Arnaud Leroy.
À New York, nous avons rencontré l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies. Son pays souhaite beaucoup de flexibilité avant de prendre des engagements en matière climatique. Son discours nous a inquiétés, tout comme une tendance similaire qui paraît se dégager aux États-Unis. Dans le même temps, une autre série de pays veut au contraire des engagements plus précis et plus contraignants. Comment pouvons-nous parvenir à un accord inclusif, capable de concilier ces différents niveaux d’ambition ? À quelles conditions pourrons-nous parler d’un succès à la conférence de décembre ?
Nombre d’interlocuteurs rencontrés étaient optimistes, qu’ils viennent de la Chine, de l’Inde, du Brésil, ou de l’Afrique francophone. Ils se déclaraient prêts à un travail conjoint avec la France. Mais ils ont tous insisté sur la prise en compte adéquate du niveau de développement, condition nécessaire pour emporter leur pleine adhésion. Avec la réunion d’Addis Abeba en juillet sur le financement du développement, le rendez-vous aux Nations unies en septembre, puis la conférence de Paris à la fin de l’année, le calendrier forme à leurs yeux un tout. Nous ne devons manquer aucune de ces étapes.
Venons-en au rôle de l’Union européenne dans ces négociations présentes et à venir. La Commission européenne a très récemment présenté les grandes lignes d’une union de l’énergie qui devra faire une large part au développement des énergies renouvelables et fixer un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990. Parallèlement, elle a publié des propositions relatives à la lutte contre le changement climatique après 2020. L’Union européenne reste ainsi le bon élève du monde en matière climatique. À la manœuvre avec nous, ses objectifs peuvent-ils avoir un effet d’entraînement sur les autres ensembles régionaux ? Les États membres sont-ils suffisamment unis pour que l’Union européenne joue un rôle d’entraînement à la conférence de Paris ? Au niveau national, adopter une loi ambitieuse sur la transition énergétique serait un premier signal fort de la France à l’approche de la COP21.
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international. Je vous remercie de votre invitation, étant à votre disposition pour répondre à vos questions après mes quelques propos liminaires, où je vais essayer de faire le point sur l’état de la négociation.
Le conseil des ministres français m’a officiellement demandé de préparer la COP21 à Paris, conférence que je suis par ailleurs chargé de présider en vertu d’une décision internationale. Il s’agit d’un sujet essentiel pour le monde et important pour la France.
Nous sommes à neuf mois de l’ouverture de la COP21. Les négociations se déroulent dans un climat constructif, mais l’essentiel reste à faire. Qui voit l’ampleur du chemin à parcourir et la gravité de la situation, le fait que les conférences précédentes n’ont pas été un grand succès et la circonstance qu’un accord ne peut être adopté que par consensus entre 196 parties prenantes, soit plus que les États membres des Nations unies –car l’Union européenne en sera une aussi– mesure la difficulté de la tâche. Les points de vue sont différents et il faudra rassembler.
La présidence devra être ambitieuse, mais à aussi à l’écoute, consciente de ce qu’aucun succès n’est possible sans esprit de compromis. Dans le cadre du groupe de travail de la plateforme de Durban pour une action renforcée (Ad hoc working group on the Durban Platform, ADP), une première négociation a eu lieu à Genève, où je me suis rendu. Tous les pays y seront représentés. Deux co-présidents en préparent et en animent les travaux, un Algérien et un Américain. Ils doivent livrer en octobre un texte qui serve de base de travail à la COP21 à partir de la fin novembre.
La première session de négociation a abouti à un résultat contrasté. Un consensus s’est dégagé sur un texte qui, publié plus de six mois avant la COP21, pourra valablement servir de base à un accord à la conférence. Mais, s’il fait l’objet d’un accord général, c’est que, pour paraphraser Corneille, parti de 37 pages, le texte a gonflé jusqu’à en compter désormais 86. Si le compromis est essentiel, six ou sept points d’achoppement demeurent. Plusieurs solutions sont avancées pour les dépasser, généralement au nombre de trois. Mais les questions ne sont pas tranchées. Aussi faut-il tout mettre en œuvre pour que la prochaine session officielle de négociation, en juin, soit un succès.
J’œuvre déjà avec le président de la COP20, mon ami péruvien, pour aplanir les difficultés avant la session de juin, comme nous en sommes convenus tous les deux. En vertu de la convention, la France ne prend en effet la présidence de la conférence qu’à partir du début du mois de décembre. Mais la réalité politique et la réalité juridique ne se recoupent pas totalement. Ainsi, un pays considéré comme un pays du Nord, la France, et un pays du Sud, le Pérou, préparent ensemble la conférence de Paris. Mon collègue péruvien m’accompagnera durant la COP21, de même que j’aurai à prendre en compte la perspective de la COP22, qui se tiendra au Maroc.
D’ici le mois de juin, nous avons prévu, le président péruvien et moi-même, d’organiser, pour obtenir des compromis, plusieurs sessions de consultations informelles avec des groupes représentatifs tels que l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA), le groupe des 77, le groupe LMDC (like-minded developed countries)… Il est important que chacun soit représenté dans ces discussions, sans que le cercle soit cependant trop ouvert.
Un important travail bilatéral reste aussi à faire. Le président de la République s’est ainsi rendu aux Philippines, pays particulièrement touché par le dérèglement climatique, puisqu’il essuie vingt typhons par an. Le plus grave, le typhon Haiyan, a causé en 2013 des milliers de morts. À l’ONU, au mois de septembre, le président philippin n’a au demeurant pas renvoyé dos à dos Sud et Nord, reconnaissant que les Philippines, quoique pays en voie de développement, devaient aussi faire leur part du chemin. Cette reconnaissance est au cœur de la déclaration de Manille.
Au deuxième semestre de cette année viendront les réunions techniques et ministérielles. À partir des mois de juin et juillet, les ministres seront davantage mobilisés. Le cas échéant, les chefs d’État et de gouvernement seront sollicités pour que se dégage, si possible dès octobre, un accord de compromis sur les grandes questions.
Car l’échec de Copenhague est dû au fait que trop de choses ont été laissées à la décision de la conférence. Arrivés à la dernière minute, les chefs d’État et de gouvernement n’ont pu s’entendre sur un accord. Mais, à l’heure actuelle, il y a une volonté politique incontestable pour qu’il y ait un accord à Paris. En vue d’en assurer le succès, nous avons proposé qu’il repose sur quatre piliers, à savoir qu’il soit juridiquement contraignant, universel, différencié et ambitieux. Il doit également viser quatre objectifs, dont la valeur normative varie néanmoins.
En premier lieu, les précédentes conférences ont fixé à la COP21 le mandat d’arriver à un accord juridique contraignant, mais sans qu'il y ait encore de consensus sur la nature juridique exacte, ni sur le champ, de cet éventuel accord. Aux États-Unis, le Sénat et le président ne sont ainsi pas du même avis sur l’opportunité d’adopter un protocole ou un accord d’un autre type. En outre, tout le monde ne s’accorde pas sur la question de savoir si le texte doit prévoir, au-delà des grands objectifs et des engagements procéduraux, également des engagements chiffrés.
En deuxième lieu, l’accord devra avoir une portée universelle. C’est une nouveauté. Même le protocole de Kyoto est mis en application par des pays ne représentant que 15 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour que l’accord soit efficace, tous devront être inclus cette fois, avant tout les principaux émetteurs, y compris les pays émergents quand ils sont de grands émetteurs.
En troisième lieu, l’accord devra être différencié, suivant la formule consacrée qui évoque une responsabilité commune, mais différenciée. Le principe a amené à développer une séparation étanche entre les pays du Nord, répertoriés à l’annexe I, et les autres pays de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette summa divisio permet d’imposer aux uns de prendre des engagements, tandis que les autres se voient seulement reconnaître la faculté d’agir dans le domaine climatique. À Varsovie, en 2013, tous les pays ont cependant voulu livrer une contribution à la lutte contre le changement climatique, en amont de la COP21. Un changement de paradigme serait ainsi en cours, qui conduirait vers une auto-différenciation, telle que l’appellent certains spécialistes.
Cette évolution est toujours en cours, comme l’a prouvé l’accord de novembre entre les États-Unis et la Chine, pays non répertorié à l’annexe I. Cela n’a pas de sens que seuls les pays riches se fixent des objectifs. À Lima, où la conférence s’est prolongée quelque peu pour arriver à dégager un accord, le texte a repris la formule de l’accord sino-américain, aux termes duquel les efforts à fournir seraient également évalués « à la lumière des circonstances nationales ». Ces termes demandent à être précisés sur un plan opérationnel dans les trois domaines où la différenciation peut s’appliquer : les contributions nationales, la soumission à un mécanisme commun de vérification et l’apport financier.
En quatrième lieu, l’accord devra être ambitieux. Soit la conférence permettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2° C, soit elle ne le permettra pas. Tel est le critère à l’aune duquel se mesurera son succès.
L’accord fera fond sur des contributions nationales. D’ici la COP21, chaque pays est invité en effet à soumettre des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre constituant son projet de contribution au niveau national (intended nationally determined contributions –iNDC). Il faut s’attendre à ce que, une fois ces contributions additionnées, la barre des 2° C soit déjà franchie. Cela n’est pourtant pas choquant, car, par ailleurs, l’Agenda des solutions et un mécanisme encore à trouver à Paris devraient cependant permettre de ne pas dépasser ce seuil.
C’est pourquoi certains proposent d’inclure dans l’accord un objectif de long terme qui soit plus opérationnel que l’objectif des 2° C, d’autres souhaitent une clause de révision à la hausse, régulière, des objectifs nationaux. C’est une discussion à mener.
Notre réseau diplomatique a fait le point sur l’état des contributions. La Suisse s’est singularisée positivement en publiant la sienne la première. Une centaine de contributions sont attendues, pas seulement des pays développés ou émergents ; elles devraient couvrir 80 % des émissions. Normalement, tous les États devraient livrer leur contribution avant la COP21 –l’accord de Lima le prévoit expressément–, mais certains se heurtent à des difficultés techniques.
Une trentaine de pays n’ont pas la capacité de le faire rapidement ; ils pourraient demander de l’aide. C’est pourquoi j’ai établi un fonds français financé par l’Agence française de développement (AFD). Il met à la disposition d’Expertise France, regroupant désormais l’expertise des différents ministères, 3,5 millions d’euros pour apporter une assistance technique à au moins quinze pays, notamment subsahariens, dépourvus de moyens ou d’expertise pour livrer une contribution nationale. Les membres de l’Alliance des petits États insulaires (Alliance of Small Island States, AOSIS) peuvent également en bénéficier. L’AFD apporte ainsi un appui financier et Expertise française l’appui technique. La solution proposée est concrète, simple et pratique.
Comme je vous le disais, les contributions attendues entre mars et juillet aboutiront à un résultat dont l’addition peut être insuffisante. Aussi certains plaident-ils pour une clause de révision régulière des objectifs, tandis que certains, parfois les mêmes, parfois d’autres, souhaitent qu’un objectif de long terme complète de manière plus opérationnelle celui des 2° C, par exemple la neutralité carbone à l’horizon à partir de 2050. En tout état de cause, tout ne sera pas résolu à la conférence de Paris, qui constituera aussi bien un point d'aboutissement qu’un point de départ pour un nouveau cycle.
Le volet du financement fait l’objet d’attentes très fortes de la part des pays en développement, comme l’a souligné la présidente Auroi. Soulignant qu’ils sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, ces pays nous demandent comment financer leur action. À Paris, les pays développés devront faire la preuve qu’ils respectent leurs engagements.
À ce sujet, il convient de ne pas confondre le Fonds vert pour le climat, les financements pour le climat et le financement des Objectifs du développement durable (ODD). Le premier sera abondé, entre 2015 et 2018, à hauteur de dix milliards de dollars. Son administration se met en place. Le mécanisme devra financer les projets verts des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine climatique. À partir de 2020, les financements pour le climat dans les pays en développement devraient recueillir 100 milliards de dollars par an. Ce n’est donc pas du tout le même ordre de grandeur que le Fonds vert pour le climat. Les ODD englobent un champ plus large. Ils seront évoqués à la conférence d’Addis Abeba en juillet, puis au sommet de septembre des Nations unies.
Notons que ces sommes ne sont pas exclusives les unes des autres, la sauvegarde du climat faisant partie des objectifs du développement. Mais ces sommes ne sont pas non plus réductibles les unes aux autres. Il faut donc un fléchage, compréhensible par tous, de telle sorte que les États, notamment ceux des pays développés, ne se sentent pas floués. Les dollars des ODD sont à la fois publics et privés ; il ne s’agit donc pas exclusivement d’argent public, encore moins de financement exclusivement budgétaire. Aussi de fortes incertitudes demeurent-elles chez les observateurs et chez les acteurs.
À la fin de ce mois, une réunion, en partie organisée avec l’AFD, aura lieu avec les banques multilatérales pour clarifier la méthodologie. Comme l’a souligné la présidente Auroi, il conviendra d’accorder une attention particulière aux projets d’adaptation qui concernent les pays les plus vulnérables, notamment ceux de l’AOSIS. Ils reconnaissent en effet qu’une action générale vise bien à endiguer le réchauffement planétaire, mais ils mettent en avant que des typhons leur arrivent, tandis que les océans montent dangereusement pour eux. Aussi doivent-ils d’ores et déjà s’adapter.
Ces questions devront être tranchées au cours des prochaines réunions, où il faudra se mettre d’accord sur la comptabilisation des engagements en faveur du climat. Chez certains de nos partenaires, une méfiance se développe vis-à-vis d’une comptabilisation abusive qui tendrait à détourner le financement du développement vers l’action climatique, au détriment de l’éducation ou de la santé.
Il faut pousser les banques multilatérales et les bailleurs à se fixer des objectifs chiffrés pour le climat, comme nous l’avons pour l’AFD. Il faut également convaincre les pays en voie de développement de verdir leurs projets. Nous poursuivons notre plaidoyer en faveur des financements innovants pour le climat. À Lima, où se trouvait la directrice générale du Fonds vert, je l’ai incitée à œuvrer pour que l’offre du Fonds vert se traduise déjà de manière concrète dans le cadre de la COP21.
Comme État assurant la présidence de la COP, la France a pour objectif d’amener les acteurs financiers à réorienter leurs ressources vers des activités sobres en carbone, en prenant en compte la contrainte liée au changement climatique. Je voudrais vous donner trois exemples montrant l’intérêt qu’il y a à verdir ses investissements.
Premièrement, à Lima, des fonds de pays, notamment de l’Europe du Nord, engagés depuis longtemps dans des investissements verts, ont souligné que leur rendement est loin d’être négligeable. Voilà un nouvel état d’esprit à répandre.
Deuxièmement, les gouverneurs de banque centrale et les agences de notation doivent donner des signaux publics de leur prise en compte du risque climatique. Venu du Canada, le gouverneur de la banque d’Angleterre est un défenseur éloquent des financements verts. Il montre que cette orientation est bienvenue y compris du point de vue strictement financier, démonstration d’autant plus convaincante qu’elle émane d’un homme du sérail et non d’une personnalité appartenant au monde politique.
Les agences de notation, qui évaluent des risques, doivent montrer qu’elles prennent également en compte le risque climatique, de même que doivent le faire les compagnies d’assurance et de réassurance. Pour elles, la dimension des catastrophes climatiques est centrale. Elles ont un intérêt direct à agir contre le dérèglement climatique.
Troisièmement etd’une manière générale, il faut pousser enfin à l’émission d’obligations vertes.
Le financement n’est pas un sujet qui entre strictement dans le cadre de la COP21, mais évoquer la question du climat sans apporter de réponse en termes de financement reviendrait à parler en l’air. Plusieurs étapes importantes s’annoncent pour essayer d’engranger progressivement des résultats.
Les assemblées du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale se tiendront en avril puis en octobre. J’ai souhaité qu’au cours de la réunion d’octobre, qui se tiendra à Lima, le volet climatique soit abordé, ce qui constituera une innovation. Au prochain sommet du G7 en Allemagne, en juin, sera présenté un rapport sur le financement de l’action climatique, sujet dont la France et l’Allemagne veulent faire un thème central. Le contenu pourrait en être repris au sommet suivant du G20, organisé en Turquie. À la mi-mai, les acteurs du secteur financier se rencontreront à Paris.
Au-delà des chiffres, ma conviction est que l’issue de la COP21 dépendra en effet de mesures concrètes. La COP21 porte sur l’après-2020, alors que l’opinion publique mondiale a déjà des attentes pour la période 2015-2020. Toute inaction au cours de ces cinq ans rendrait l’obstacle plus difficile encore à franchir par la suite.
Nous devons donc développer un programme particulier pour cette période. Chaque État, y compris chaque État africain ou chaque État insulaire, devra trouver son compte dans l’accord de la COP21. Ainsi, un réseau mondial d’avertissement des catastrophes pourrait être créé. Rien de tel n’existe encore. Aux Philippines, la semaine dernière, j’ai constaté que des dégâts humains et matériels auraient pu être en partie évités si un tel système avait fonctionné, permettant par exemple de prévenir la population par des messages sur des téléphones mobiles. Voilà un apport possible de la COP21, qui devra déboucher sur un texte, mais aussi sur des actions concrètes.
Enfin, un Agenda des solutions est en voie d’élaboration, qui revêt le nom de plan d’action Lima-Paris. Car les gouvernements devront faire leur travail. Mais d’autres acteurs joueront un rôle au moins aussi important : les villes, les régions, les grandes entreprises, les organisations de la société civile… L’accord de Lima contient un court paragraphe prévoyant qu’à Paris, ces solutions soient répertoriées et visibles, pour que les délégués et l’opinion publique prennent conscience de ce qu’il est non seulement nécessaire, mais possible de lutter contre le réchauffement climatique, car des solutions pratiques, techniques, politiques, financières existent. La configuration et le calendrier de la COP21 seront conçus de telle manière que cet agenda soit visible et compréhensible par la population et la société civile.
Ces engagements ont vocation à s’ajouter aux objectifs des États qui auront souscrit à l’objectif des 2° C. La mairesse de Paris, qui va bientôt recevoir ses homologues d’autres capitales, a eu l’excellente idée de leur proposer de réfléchir à un verdissement de leurs marchés publics. Autre exemple, M. Jeff Brown, gouverneur de Californie, a déjà pris, à la suite de M. Arnold Schwarzenegger, des décisions en faveur de la neutralité carbone.
Plusieurs réunions se tiendront sur ce thème : mi-mai à Paris, un dialogue est prévu avec les acteurs privés ; début juillet à Lyon, avec les acteurs territoriaux ; enfin, la réunion déjà évoquée par la présidente Guigou aura lieu à Marseille en juin. Ces rencontres devraient déboucher sur des engagements précis.
Cette approche est plutôt bien accueillie. Quant à la COP21 proprement dite, la présidence ne pourra pas y imposer ses vues, mais devra au contraire être à l’écoute des uns et des autres, dans la perspective de favoriser des compromis.
Les parlementaires ont un rôle important à jouer. Ils peuvent d’abord peser sur la définition des contributions nationales présentées par leur gouvernement. Ils auront ensuite à ratifier ou à autoriser la ratification d’un éventuel accord, ou du moins à ne pas s’y opposer. De nombreuses missions parlementaires sont prévues sur ce thème, qui seront certainement utiles. Mon équipe est à votre disposition pour en favoriser la bonne coordination. En outre, des réunions interministérielles se tiennent régulièrement en amont de la conférence, regroupant les ministres concernés, des scientifiques, les services. Je serais heureux que deux députés puissent participer à ces réunions mensuelles du comité de pilotage (COPIL) interministériel, comme me l’a demandé le président de l’Assemblée nationale. À la COP21, la place réservée aux parlementaires français devrait être au demeurant plutôt large.
Permettez-moi de saluer enfin le précieux appui de l’Assemblée nationale, toutes sensibilités politiques confondues, dans la préparation de cette échéance diplomatique majeure.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cet exposé très exhaustif qui clarifie un sujet touffu et complexe. Vous nous donnez à voir la difficulté des objectifs, mais aussi l’ambition de toutes les parties prenantes.
M. Christophe Bouillon, vice-président. En parlant seulement maintenant, je peux vous interroger directement, monsieur le ministre, sur ce que vous attendez des parlements dans le cadre de la préparation de la COP21. Vous avez rappelé l’ambition de la France, qui vise à faire évoluer la vision du simple « partage de fardeau » des efforts mondiaux vers une approche de partage des solutions, à travers l’Agenda des solutions. Quelles actions les parlements sont-ils susceptibles de mener pour accompagner les efforts de la présidence française afin de construire un accord à Paris en décembre prochain, qui soit conclu par tous, pour tous, durable, dynamique, ambitieux ?
Vous connaissez, monsieur le ministre, mon enthousiasme lorsqu’il s’agit de faire participer les parlementaires français. Comment la diplomatie parlementaire peut-elle jouer un rôle dans le cadre des négociations climatiques ?
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Permettez-moi de prendre un instant pour saluer en notre nom à tous des étudiants de la conférence Olivaint, qui assistent à notre réunion.
M. Arnaud Leroy. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la grande clarté de votre exposé. Vous avez brossé un panorama large de la situation. Le compte à rebours est engagé, puisqu’il est, selon la formule consacrée, minuit moins cinq.
J’ai particulièrement apprécié que vous souligniez que la période 2015-2020, immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord à la COP21, constitue comme une première marche dans la lutte contre le réchauffement climatique. À New York, où nous avons rencontré les ambassadeurs d’Afrique francophone à propos des Objectifs du développement durable, j’ai été frappé par leur volonté d’aboutir sur ce sujet. Dès la conférence de juillet 2015 à Addis Abeba, la France doit trouver les mots pour s’adresser à ses partenaires, qui sont parfois en difficulté.
Instrument crucial, le protocole de Kyoto remonte à 1992 et n’est plus du tout d’actualité. La pensée climatique est née dans les années 1970, avant le développement de la mondialisation actuelle. Or nous sommes en face d’un système figé d’annexes, qui assigne par exemple à l’annexe II la Corée du Sud, alors qu’elle est plus avancée sur le plan économique que certains de nos partenaires d’Europe du Sud, pourtant assignés à l’annexe I. Dans le débat sur la question climatique, les Brésiliens, réputés partenaires difficiles sur les questions climatiques, portent une voix intéressante, même si l’approche qu’ils développent, fondée sur l’idée d’un système concentrique, mérite encore d’être affinée.
Vous connaissez, monsieur le ministre, mon engouement et mon engagement en faveur de la finance verte. Les esprits doivent encore mûrir, dites-vous. Tous groupes politiques confondus, nous avons travaillé à déposer des amendements au projet de loi relatif à la transition énergétique, pour nous apercevoir que certains ministères ne sont pas encore mûrs sur cette question. Avant l’ouverture de la COP21, j’envisage de déposer une proposition de loi sur le sujet.
Par rapport à celle de Copenhague, la conférence présentera la grande nouveauté de faire une place aux entreprises, s’éloignant de la traditionnelle discussion fermée entre diplomates. Jusqu’à présent, la France a su être facilitatrice. Nombreux sont ceux qui sont reconnaissants à la France de s’être attelée à trouver des solutions, chacun saluant le réseau diplomatique français. Car, s’il devait ne pas y avoir d’accord, la négociation climatique entrerait certainement dans une zone de turbulences. Notre pays peut ainsi compter sur beaucoup d’alliés, collectivités, entreprises et parlements.
Pour finir sur une question, monsieur le ministre, quel est votre avis sur la proposition brésilienne ?
M. Bernard Deflesselles. Monsieur le ministre, votre propos était exhaustif. À Lima, un accord a déjà pu être trouvé sur la nécessaire remontée des calendriers. Mais le bilan est assez faible. Paraphrasant un ancien premier ministre, je dirais que, pour la COP21, la route est droite, mais la pente est rude. Il reste en effet à la France beaucoup de points à défricher, car le succès mitigé de Lima s’explique par le fait que les États n’ont pas su débroussailler assez le terrain sous l’égide des Nations unies.
Parmi les points positifs, je voudrais citer l’engagement de l’Union européenne tant sur le « 3 × 20 » d’ici 2020 que sur les objectifs complémentaires « 40/27/27 » d’ici 2030 : 40 % d’émissions en moins, 27 % de gains d’efficacité énergétique, 27 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Avec l’Union européenne, nous sommes vraiment en pointe sur le sujet. Quant à l’accord de novembre dernier entre les États-Unis et la Chine, sans être une révolution, il se révélera utile pour porter de 26 % à 28 % la réduction des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d’ici 2025 par rapport à 2005 ; pour la Chine, elle s’est engagée à ne plus augmenter ses émissions après 2030. Cela signifie cependant que la Chine continuera à augmenter ses émissions jusqu’à cette date. Or elle émet en moyenne sept tonnes d’équivalent carbone par habitant, pour une population de 1,25 milliards d’habitants, contre cinq tonnes et demi par habitant en France. Rappelons qu’à eux deux, ces grands pays représentent entre 42 % et 43 % des émissions totales de gaz à effet de serre, la Chine en rejetant 28 % et les États-Unis environ 15 %.
Dernier point positif, le calendrier paraît désormais robuste, jalonné qu’il est par la conférence de Bonn en juin prochain, puis par les rendez-vous de septembre et d’octobre avant la tenue de la conférence à la fin de l’année. Cela permettra d’accélérer la négociation.
Il faut cependant déplorer que les feuilles de route, dont la remontée au printemps a été décidée à Lima, ne soient établies qu’ « à la lumière des circonstances nationales ». Le risque est grand que l’addition des engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (iNDC) ne permette pas d’atteindre une limitation du réchauffement planétaire en deçà de 2° C d’ici 2100. Or, s’il s’élève à 4,8° C à la fin du siècle, comme l’envisage le groupement d’experts intergouvernementaux sur le climat (GIEC), nous courons à la catastrophe. Le collationnement des feuilles de route nous réserve donc sans doute un printemps difficile.
Le Fonds vert est désormais mis en place, avec une administration implantée en Corée. Les États-Unis l’abondent de trois milliards de dollars, le Japon d’un milliard et demi de dollars, la France à hauteur de presque un milliard. Je me demande comment sera comblé l’écart entre ces dix milliards qui sont alloués au Fonds vert et les cent milliards qu’il est prévu d’allouer au financement du développement après 2020.
Enfin, le transfert de technologies vertes ne fonctionne pas, car les grandes entreprises répugnent à partager leurs brevets. Les Nations unies ont mis en place un groupe de travail sur le sujet. Si les moyens font défaut et que le transfert de technologie n’a pas lieu, comment pouvons-nous aider les pays en voie de développement ? Le fossé entre eux et les pays développés reste toujours prégnant. Car ces derniers n’ont pas tenu leurs promesses, ce qui leur a fait perdre en crédibilité et a fait naître des blocages.
Il me semble essentiel que l’accord obtenu à Paris soit juridiquement contraignant. Mais le protocole de Kyoto de 1997 n’est entré en vigueur qu’en 2005, car chaque pays a dû le ratifier. Le traité international s’avère être un outil compliqué à utiliser. Les parlementaires du Congrès américain que nous avons rencontrés il y a quinze jours sont au demeurant complètement bloqués sur cette question. En invoquant le Clean Air Act de 1963, la présidence américaine pourrait essayer de contourner –même si je répugne à utiliser ce terme– cette opposition, pour adopter une décision de l’administration Obama. Quant à la France, il est temps qu’elle sorte du bois, tant sur la nature juridique de l’accord à obtenir que sur le mécanisme de contrôle et de vérification (monitoring, review, verification, MRV) qu’il doit prévoir, en incluant d’éventuelles sanctions.
M. Jean-Louis Roumegas. Je me concentrerai sur un aspect essentiel et peu évoqué, bien qu’il joue un rôle essentiel dans le réchauffement climatique, à savoir la déforestation. Chaque année, ce sont treize millions d’hectares, soit l’équivalent de quatre fois la superficie de la Belgique, qui sont perdus, en Afrique centrale, en Amazonie et en Asie, notamment aux Philippines. Il s’agit d’un phénomène massif, même si le rythme de la déforestation recule. Depuis 2000, quarante millions d’hectares ont été définitivement perdus.
Les causes sont d’abord d’ordre agricole. Les terres sont défrichées pour permettre la culture de palmiers à huile, car l’industrie agro-alimentaire est friande d’huile de palme, qui se conserve bien, mais dont l’usage est peut-être excessif. En outre, des projets de barrage se développent, notamment en Amazonie, avec l’implication d’entreprises françaises telles qu’EDF, GDF Suez ou Alstom. Ces projets sont souvent marqués par de la corruption, et en tout cas par le viol des droits fondamentaux des populations autochtones en matière d’environnement. Enfin, le commerce illégal de bois incite à la déforestation. La France applique mal l’interdiction prévue par le règlement sur le bois de l’Union européenne de 2013.
Monsieur le ministre, quel type d’engagements relatifs à la déforestation un accord à la COP21 pourra-t-il inclure ? Comme pays d’accueil se devant d’être exemplaire, quels engagements la France envisage-t-elle pour lutter contre la déforestation ?
M. Patrice Carvalho. Nous devons tous avoir en tête le cinquième rapport du GIEC de novembre 2014, qui comporte des éléments de confirmation, mais aussi des données nouvelles. Il place le réchauffement climatique à un niveau de quasi-certitude sur le plan scientifique. Alors que celui-ci était jugé seulement probable il y a quelques années, puis très probable, il est désormais reconnu comme extrêmement probable. Quant à son évolution, le scénario le plus pessimiste, sur les quatre qui sont envisagés, apparaît malheureusement aux yeux du GIEC comme le plus probable. Élément nouveau, la hausse du niveau des océans pourrait être notamment plus importante que prévu, tandis que chaque décennie continuerait d’être plus chaude que la précédente.
Aussi faudra-t-il réduire les gaz à effet de serre de 10 % par décennie pour rester en-deçà de la barre des 2° C. Un accord à la COP21 concernerait l’après-2020. Les pays concernés sont au nombre de 195. Ils partagent tous la volonté de lutter contre le réchauffement climatique, mais défendent des intérêts divergents. Tandis que les pays développés ont apporté leur lot au dérèglement climatique, mais en sont désormais conscients, les pays en voie de développement vivent la lutte contre le réchauffement comme un frein à leur développement économique ; leur engagement est donc loin d’être acquis. Aussi l’organisation de la COP21 constitue-t-elle un vrai défi. Il faut en particulier s’attendre à un bras de fer entre la Chine, l’Inde et les États-Unis. Les tensions dont j’ai été témoin à la conférence de Varsovie en novembre 2013 se sont confirmées au Pérou en novembre dernier.
À la conférence de Lima, Mme Mary Robinson, envoyée spéciale des Nations unies pour les changements climatiques, a déclaré que : « les gouvernements à Lima ont fait le strict minimum pour garder le processus de négociation multilatéral, mais ils n'ont pas fait assez pour convaincre le monde qu’ils sont prêts à un accord équitable et ambitieux sur le climat l’an prochain ».
Le Fonds vert constitue le seul élément positif dans ce contexte. Si nous voulons éviter aux pays en voie de développement un type de développement productiviste et énergivore, il faut les aider à s’orienter vers une économie sobre en carbone et résiliente au réchauffement climatique. Les États-Unis abondent le Fonds vert à hauteur de trois milliards de dollars, le Japon à hauteur de un milliard et demi, la France et l’Allemagne chacune à hauteur de un milliard. Mais le Canada et Australie n’y participent pas. Le Fonds vert constitue un objet de tensions, depuis quatre ans, entre pays industrialisés et pays en voie de développement. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous ainsi son évolution ? Quelles initiatives la France compte-t-elle prendre ?
Par ailleurs, je me rends régulièrement de Compiègne à Paris en voiture. Les abords de la route sont jonchés de détritus, de même que ceux de la route qui mène de Paris à l’aéroport de Charles-de-Gaulle. À la vue de ces talus, il est difficile d’imaginer que l’environnement est une préoccupation dans ce pays. Il ne faudrait pas s’étonner d’entendre nos visiteurs dire que la France s’est africanisée. Il convient de nettoyer l’environnement immédiat du périphérique, non seulement pour la COP21, mais de manière durable, car il est actuellement dans un état lamentable. Qui a d’ailleurs la charge de l’entretien de ces bordures de voirie ?
Mme la présidente Élisabeth Guigou. La députée de Seine-Saint-Denis que je suis s’associe à cette question très concrète.
M. François Rochebloine. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre exposé clair et complet, comme je remercie mes collègues Bernard Deflesselles et Arnaud Leroy de leurs interventions, qui ont apporté des éléments complémentaires. Monsieur le ministre, en vous écoutant sur France Info, j’ai entendu votre volonté de réussir cette COP21. La conférence de Lima n’a dû quant à elle sa réussite, d’ailleurs mitigée, qu’à un accord au dernier moment. Quels sont donc les points durs pour celle-ci ? Quels sont les pays où il y a blocage ? « Le principal reste à faire », dites-vous en effet.
Ce sont non moins de 40 000 personnes qui sont attendues à Paris pour la COP21. Nous n’avons pas le droit d’échouer, car la France est attendue au tournant. À propos des coûts, quelles sont les garanties de financement jusqu’en 2020 des dix milliards de dollars annoncés pour le Fonds vert, et qu’en est-il des cent milliards d’euros annuels qui sont prévus au-delà ? Mon collègue Bernard Deflesselles a beau jeu de dire que cela ne représente qu’1 % du PIB, les montants sont énormes. N’est-ce pas une COP à risque qui s’annonce ? La dégradation de la situation internationale ne lui fait-elle pas courir des risques supplémentaires ?
M. Philippe Plisson. La semaine dernière, la Commission européenne a publié son projet de contribution à la COP21. Il doit être adopté par les États membres d’ici le 20 mars. Une unanimité se dégage-t-elle ? La France est-elle motrice sur ce sujet ? L’Union européenne abordera-t-elle la conférence avec une vision unitaire, offensive et exemplaire ? Quant à son récent projet d’union de l’énergie, privilégiant un renforcement de l’infrastructure gazière, il ne me semble pas aller vers plus de sobriété et d’efficacité énergétique, pourtant seules à même de faire gagner en indépendance énergétique.
M. Yannick Favennec. Si elle est couronnée de succès, ce que nous souhaitons tous, la COP21 constituera une étape décisive dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il semble qu’il y ait une volonté commune d’aboutir. Quelle forme pourrait prendre un mécanisme juridique contraignant ? À défaut, quels seraient les outils à utiliser pour s’assurer que les parties prenantes à l’accord respectent leurs engagements de réduction ?
Mme Chantal Guittet. Monsieur le ministre, que vous inspire le récent rapport d’une agence français qui indique que notre environnement continue de se dégrader, malgré les actions déjà entreprises au niveau européen ? Par ailleurs, que pensez-vous de l’annonce faite par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (groupe des BRICS) qu’ils vont instituer une banque d’investissement qui inclurait un fonds vert dédié ?
M. Thierry Mariani. Comme mon collègue Yannick Favennec, je m’interroge sur la possibilité d’obtenir un accord juridiquement contraignant. À Kyoto, seulement une partie des États avaient signé le protocole. Que fait-on si tous ne s’engagent pas cette fois-ci ? Enfin, je m’interroge sur la différence déjà évoquée entre les dix milliards d’euros rassemblés pour le Fonds vert et les cents milliards à trouver pour le financement du développement après 2020.
Mme Martine Lignières-Cassou. Le président de la République a annoncé en janvier dernier que la contribution française au Fonds vert serait alimentée par le produit de la taxe sur les transactions financières. Les négociations sur la mise en place de la taxe ont-elles des chances d’aboutir avant la fin de l’année ? Pourrait-elle faire partie des mesures concrètes que vous évoquiez tout à l’heure ?
M. Bruno Gollnisch, député européen. Monsieur le ministre, je voudrais insister à mon tour sur cette notion d’accord juridiquement contraignant. Le critère de la ratification parlementaire en France est celui d’un engagement des finances publiques. Soumettrez-vous à l’approbation du parlement l’accord issu de la conférence ? Si les États-Unis ne le font pas et qu’ils ne le ratifient pas, comment pourra-t-il être contraignant pour eux, alors qu’il le sera pour nous ? Enfin, quelles mesures envisageriez-vous de prendre si un certain nombre de pays continuaient d’exploiter leur avantage en matière d’énergies fossiles, ce qui induit des distorsions de concurrence au détriment de notre industrie ?
M. Philippe Noguès. Si nous voulons atteindre nos objectifs en matière climatique, nous devons réduire notre dépendance aux énergies fossiles. À travers ses banques, la France est pourtant le cinquième financeur du charbon dans le monde. Aux assises du développement et de la solidarité internationale, le président de la République s’est engagé à ce que l’AFD cesse de financer les centrales à charbon. Êtes-vous favorable à la fin de tout soutien financier à ce secteur, comme à la publication par les établissements bancaires de leur empreinte carbone ?
M. Philippe Baumel. Pour l’élaboration des contributions nationales, la France s’était engagée à fournir un appui technique, notamment aux États d’Afrique. Quelle forme prend-il ? Quels pays ont-ils déjà formulé ce type de demande ? Compte tenu des enjeux croisés de la politique de développement et de la lutte contre le réchauffement climatique, quel rôle joue l’AFD en ce domaine et comment compte-t-elle réorienter son action après la COP21 ?
M. Guillaume Chevrollier. Dans le cadre de vos travaux préparatoires à la COP21, vous avez évoqué l’importance d’un agenda positif, soulignant que la lutte contre le réchauffement climatique apporte aussi des bénéfices en termes de croissance, d’emploi et de qualité de vie. En étayant par des chiffres sérieux et motivés la démonstration de ces retombées économiques, il convient en effet de mettre en avant le lien, encore trop peu évident, entre l’enjeu climatique et les préoccupations économiques qui sont des sujets majeurs tant au Nord qu’au Sud.
M. Yves Daniel. La France a souhaité inclure les territoires et les élus locaux dans la préparation de la conférence, en confiant aux sénateurs Ronan Dantec et Michel Delebarre un rapport sur le rôle des collectivités territoriales dans les négociations climatiques. Ils l’ont remis en septembre 2013. Comment leurs travaux ont-ils été, ou vont-ils être, pris en compte dans le cadre des discussions ?
Mme Catherine Coutelle. Comme nous vous recevons demain, monsieur le ministre, devant la délégation aux droits des femmes, je ne dirai que deux mots. Les femmes sont actrices du développement et comptent parmi les premières touchées par les conséquences du réchauffement climatique, comme vous l’avez sans doute constaté aux Philippines. Comment cette dimension sera-t-elle prise en compte dans le cadre de la COP21 ? Comment est-il possible de mobiliser en marge de la conférence les organisations non gouvernementales qui défendent les femmes ? Sera-t-il possible d’organiser à l’occasion de la COP21 un événement sur les femmes et le climat ?
M. le ministre. Monsieur Bouillon, la diplomatie parlementaire peut contribuer au succès de la COP21. Sans faire aucune allusion à un événement récent, je dirais qu’elle peut s’épanouir dans le cadre des groupes d’amitié, qui peuvent mettre l’enjeu climatique à l’ordre du jour de leurs rencontres, là où des problèmes particuliers se posent, mais aussi ailleurs. Le Quai d’Orsay est à la disposition de chaque groupe d’amitié pour l’informer de l’état de l’art dans chaque pays, relativement aux négociations climatiques. Il peut également vous indiquer avec quels pays il peut être plus particulièrement utile d’aborder le sujet. Je vous signale que, dans chacun d’entre eux, les ambassadeurs suivent personnellement la préparation de la COP21.
Monsieur Arnaud Leroy, le Brésil se montre en effet toujours plus actif dans les conférences sur le climat, avançant beaucoup d’idées. Il a ainsi récemment articulé une proposition reposant sur le principe de différenciation concentrique. Ouvrant sur une graduation dans le temps entre les actions volontaires et les engagements contraignants, elle pourrait offrir le moyen de surmonter la distinction entre les pays de l’annexe I et les autres, ou du moins de jeter des ponts entre les pays en voie de développement et les pays développés. Alors qu’elle sera prochainement débattue au cours des réunions ADP, il est encore trop tôt pour dire si elle sera retenue dans le texte final.
Monsieur Deflesselles, je salue votre travail sur les questions climatiques. Vous évoquez les difficultés qui nous attendent. Peut-être ne voit-on pas les points positifs quand on a le nez sur l’obstacle, mais trois changements s’observent cependant depuis dix ou quinze ans.
D’abord, le réchauffement climatique ne fait quasiment plus l’objet d’une contestation scientifique, par exemple en France, où le réchauffement était un phénomène reconnu, mais n’était pas mis systématiquement en rapport avec l’activité humaine. Il en va différemment aux États-Unis, mais, dans la majeure partie des pays où je me rends, les États reconnaissent la cause humaine du réchauffement. Il faut rendre hommage sur ce point aux travaux du GIEC.
Ensuite, les entreprises, les collectivités territoriales et la société civile s’intéressent désormais à ces sujets.
Enfin, de grands responsables politiques ont pris des positions positives sur l’enjeu climatique, tel le président Obama. En Chine également, la remontée des problèmes sociaux et politiques liés au réchauffement a changé la donne, amenant de la part des autorités un changement de position qui me semble authentique.
Je ne suis donc ni optimiste, ni pessimiste. « Je le crois, parce que je l’espère », disait Léon Blum. Mais la formule est naturellement fort peu scientifique. Nous ferons naturellement le maximum, sans pouvoir préjuger du succès compte tenu de la difficulté du sujet et de la variété des parties prenantes. À Varsovie, lorsque la France a été désignée pour accueillir cette conférence, beaucoup d’autres délégués m’ont souhaité bonne chance avec ce que j’ai perçu comme une pointe d’ironie dans la voix.
Monsieur Roumegas, vous avez évoqué la déforestation. Ce sujet très important est traité dans l’Agenda des solutions grâce à la reprise d’une initiative contre la déforestation adoptée au sommet sur le climat en septembre à New York, où les entreprises consommatrices d’huile de palme se sont engagées à lutter contre ce fléau. En France, la feuille de route issue de la conférence environnementale prévoit d’orienter la commande publique de telle sorte qu’elle ne concoure pas à la déforestation. Dans le cadre de l’initiative internationale sur la réduction des émissions causées par la déforestation et la dégradation des sols (REDD plus), la France finance également des pays pour qu’ils entretiennent leurs forêts.
Vous soulignez avec raison, monsieur Roumegas, que la déforestation constitue un problème majeur. Je ne crains pas de dire qu’elle est à l’origine de l’expansion du virus Ebola et du virus du Sida. Ces virus existaient en effet depuis longtemps à l’état latent dans ces forêts. Avec la déforestation, les conditions écologiques ont changé, tandis que les populations ont migré. Cela a fait, pour ainsi dire, « exploser » les virus. Il y a donc une dimension épidémiologique à prendre en compte ; elle peut même faire toucher du doigt au grand public les conséquences néfastes du dérèglement climatique, tant sur la santé que sur la sécurité.
Sur ce dernier point, force est de constater qu’il peut être une cause majeure de conflit et de guerre, en induisant une lutte pour le contrôle des ressources en eau, en pétrole, en autonomie énergétique. L’argument de la sécurité peut jouer un rôle important pour convaincre nos compatriotes des méfaits directs du dérèglement climatique.
Monsieur Carvalho, je conviens bien volontiers avec vous que l’organisation de la COP21 constitue un vrai défi. Pour les financements, faisons toutefois attention. Je vous ferai passer une note sur ce sujet complexe. D’un côté, le Fonds vert sera abondé entre 2015 et 2018 à hauteur de dix milliards de dollars en fonds publics. De l’autre, les financements pour le climat devront bénéficier, à compter de 2020, de cent milliards de dollars par an provenant de fonds tant privés que publics. Ce sont deux véhicules de financement différents.
Vous avez également soulevé la question du nettoyage des abords de Paris et, en particulier, des routes qui relient la capitale à ses aéroports. Quand je me rends à l’étranger, ce qui m’arrive naturellement souvent, je constate que la voie entre l’aéroport et la capitale du pays visité est en général très propre. Ce n’est pas le cas chez nous ! Je ne saurais même pas qualifier en langage châtié l’état de ces abords.
Comme vous le savez, j’ai repris le tourisme dans mes attributions ministérielles. L’entretien des abords routiers de Paris relève de la responsabilité de l’État. Même si les finances publiques sont dégradées, il faut qu’il soit conduit efficacement, non seulement dans la perspective de la COP21, mais durablement. J’ai soumis au Premier ministre des propositions en ce sens. Je connais son arbitrage interministériel, qu’il rendra public quand il le souhaitera. En tout état de cause, il faut que ça change.
Monsieur Rochebloine, vous m’avez demandé d’indiquer quels sont les pays réticents à un accord. La question est pertinente, mais je ne saurais naturellement dresser une liste. Objectivement, certains se trouvent dans une situation plus difficile que d’autres. Très peuplés, ils utilisent beaucoup de charbon. Ou bien ils vivent essentiellement sur des énergies fossiles. D’autres encore, notamment les États insulaires, sont d’accord avec la démarche, mais se demandent où trouver les moyens financiers et technologiques. Mon collègue péruvien et moi-même devons donc travailler pour trouver des solutions concrètes à leur proposer.
M. François Rochebloine. Mais ces États sont-ils nombreux ?
M. le ministre. En tout cas, ils sont puissants. En outre, comme président de la COP, je ne saurais imposer une solution. Un accord éventuel ne pourra être issu que d’un travail collectif.
Monsieur Plisson, vous m’avez interrogé sur le rôle de l’Union européenne. Le 25 février, la Commission européenne a adopté un document qui sera discuté le 6 mars par le Conseil « Environnement », sans qu’on puisse dire à ce stade s’il recueillera l’assentiment général. Madame Ségolène Royal y représentera la France, car il est convenu qu’elle défende la position spécifique de notre pays, tandis que j’assume la présidence de la COP21. Outre que le cumul des deux fonctions serait de toute façon délicat, je sortirais sinon de mes attributions ministérielles.
L’Union européenne joue son rôle dans la préparation de la COP21, grâce à l’accord auquel nous sommes parvenus en octobre, qui fixe un niveau d’exigence suffisant. Mais l’expérience de 2009 à Copenhague nous a enseigné qu’il ne suffit pas d’être exemplaire. Encore faut-il que cette exemplarité soit contagieuse. Si l’Union européenne doit être à l’avant-garde, il faut encore éviter que, lorsqu’elle se retourne, elle ne constate qu’elle a perdu ceux doivent l’accompagner. Car une exemplarité unilatérale serait une contradiction dans les termes. Un travail de conviction et d’entraînement reste donc à faire.
Il faut veiller à ce que les décisions politiques d’octobre soient concrètement mises en œuvre dans une législation effective, de même qu’il faut mettre en œuvre les engagements internationaux auxquels nous avons souscrit : l’amendement Doha au protocole de Kyoto doit être ratifié par tous les États membres ; les financements promis en faveur du climat doivent être honorés. L’Union européenne doit également jouer un rôle particulier vis-à-vis des pays en voie de développement et des pays intermédiaires tels que l’Égypte, la Malaisie ou la Colombie, qui craignent d’être les oubliés de la négociation. Nos différents réseaux diplomatiques doivent se coordonner en ce sens, mais j’engage aussi mes collègues, quand ils reçoivent des homologues et les interrogent sur les enjeux climatiques, à articuler clairement ce que souhaite l’Union européenne.
Monsieur Favennec, monsieur Gollnisch, vous m’avez interrogé sur la portée exacte du mécanisme juridique contraignant auquel doit arriver la COP21. Je ne sais vous répondre à ce stade, cette question ne faisant pas l’objet d’une décision unilatérale de ma part. Il s’agit de l’un des aspects les plus complexes de la négociation. La question ne se pose simplement pour les États-Unis. Oui, monsieur Gollnisch, la ratification sera soumise en France à l’autorisation parlementaire.
Je recevais il y a peu M. Tod Stern, négociateur américain, qui me rappelait que la conférence de Durban a prévu trois sortes possibles d’accord, allant du protocole à une « solution concertée ayant une force légale dans le cadre de la convention », en passant par un « autre instrument légal ». Le protocole constitue l’option la plus contraignante. C’est celle qui est défendue par l’Union européenne et par les pays les plus vulnérables, tels ceux de l’AOSIS. Les États-Unis, qui ont une pratique et une législation particulières, sont prêts à adopter un protocole contraignant s’il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre des Nations unies sur le climat ; il échapperait ainsi à l’obligation d’être ratifié.
Cela suppose cependant que l’accord n’inclue pas d’engagement chiffré en termes de réduction des émissions par pays, même s’il pourrait comprendre des éléments contraignants tels qu’un mécanisme de suivi ou l’obligation de présenter des objectifs nationaux. Il faut sortir de cette difficulté pour que tous les pays, grands ou petits, puissent être amenés à s’engager et que leurs engagements soient vérifiés. Car un engagement sans mécanisme de vérification est un engagement qui n’existe pas.
Madame Guittet, vous avez évoqué l’annonce régulièrement faite par le groupe des BRICS qu’ils vont instituer une banque d’investissement qui inclurait un fonds vert dédié. Mais les Chinois veulent quant à eux fonder une banque dédiée au financement des infrastructures. Dans quelle mesure les deux banques pourraient-elles subsister de manière concurrente ? Vantée bien haut il y a quelques années, l’homogénéité du groupe des BRICS semble se défaire.
Madame Lignières-Cassou, votre question sur la taxation des transactions financières n’est guère facile. Partis cinq cents, nous ne sommes plus tout à fait le même nombre à l’approche de l’arrivée, pour paraphraser de nouveau Corneille… Quand l’idée fut évoquée, elle a recueilli l’approbation nécessaire pour que soit lancée une coopération renforcée. L’exercice concret est en cours, mais chacun défend ses intérêts, cherchant à isoler telle ou telle catégorie de véhicule financier pour protéger ses banques. Mon collègue Michel Sapin m’assure cependant que des progrès réguliers ont lieu.
Dans le dernier état des discussions, la taxe serait assise sur une base large, mais fixée à un taux bas. Même sous cette forme, elle suscite cependant des réticences, car certains craignent qu’une fois introduite la taxe, les taux bas ne soient qu’un début, car il serait aisé de les relever.
Monsieur Noguès, le Premier ministre rendra bientôt un arbitrage sur l’arrêt du financement par la COFACE de centrales à charbon. Il s’agit de mettre en œuvre l’engagement pris publiquement par le président de la République au cours d’une réunion à laquelle j’ai assisté. Je suis également favorable à la publication par les établissements bancaires de leur empreinte carbone.
Monsieur Baumel, l’AFD a déjà reçu onze demandes de pays voulant bénéficier de l’appui technique qu’elle propose dans le cadre de la préparation de la COP21, à savoir le Niger, le Burkina, la République centrafricaine, le Gabon, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo, les îles Fidji et Djibouti. Cela prouve l’utilité de ce mécanisme.
Monsieur Chevrollier, les retombées économiques positives de la lutte contre le réchauffement climatique méritent certes d’être soulignées. Il est assurément possible de montrer que la croissance verte constitue l’un des piliers de la croissance de l’avenir et qu’une convergence, non une opposition, existe entre développement et écologie.
Monsieur Daniel, le sénateur Dantec fait déjà partie du COPIL. À la réunion de Lyon, début juin, il aura l’occasion d’inviter les collectivités territoriales du monde entier à suivre la démarche défendue dans le rapport qu’il a remis.
Madame Coutelle, vous soulignez avec raison que les femmes sont à la fois actrices du développement et victimes du dérèglement climatique. Quant au déroulement de la conférence, la présidence n’en décide pas à elle seule, les Nations unies y étant très impliquées. À l’approche du 8 mars, il faudrait cependant prendre une décision. Je partage totalement votre point de vue : une action particulière serait souhaitable.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci beaucoup. Nous apprécions à sa juste valeur le temps que vous nous avez consacré.
Mme la présidente Danielle Auroi. À mon tour de vous remercier. La prochaine présidence luxembourgeoise de l’Union européenne est déjà très mobilisée sur les questions climatiques. Cela ne peut que nous aider à réussir la COP21.
M. le ministre. Je dois voir bientôt mon homologue luxembourgeoise, qui est en effet très mobilisée sur le sujet.
20. Table ronde sur les conséquences des changements climatiques outremer (25 mars 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La Commission du développement durable a décidé, il y a quelques mois, la création d’une mission d’information sur les conséquences géographiques, économiques et sociales des changements climatiques en France. Dans ce cadre, nous avons organisé plusieurs tables rondes : le 27 novembre 2013, sur le cinquième rapport du groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; le 12 février 2014, sur l’impact des changements climatiques en France ; le 16 avril 2014, sur les « plans d’adaptation au changement climatique » ; enfin le 16 juillet 2014, sur le changement climatique, à la suite du rapport du GIEC, en collaboration avec les commissions des affaires étrangères et des affaires européennes.
La table ronde organisée aujourd’hui est davantage centrée sur les outremer.
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Virginie Duvat, chercheuse en géographie des littoraux tropicaux à l’Université de La Rochelle, membre du GIEC, coauteur du rapport de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), intitulé Les outremer face au défi du changement climatique, qui présentera les manifestations du changement climatique dans les outremer, leurs impacts sur les écosystèmes et les secteurs d’activité, ainsi que les voies d’adaptation possibles.
M. Luc Bas, directeur du Bureau européen de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Bruxelles, qui a animé l’atelier « Encourager l’adaptation au changement climatique, accroître la résilience et diminuer la vulnérabilité et les modèles énergétiques » de la Conférence internationale de la Guadeloupe sur la biodiversité et le changement climatique, fera un point sur la prise en compte des problématiques affectant les « petites îles », en insistant plus particulièrement sur les enseignements de cette Conférence internationale, et présentera des projets, soutenus par l’UICN, qui ont une incidence sur ces territoires.
Enfin, M. Alby Schmitt, directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, fera un point sur les forces et les faiblesses des acteurs de certains territoires où l’atténuation du réchauffement climatique rejoint la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau.
Mme Virginie Duvat, chercheuse en géographie des littoraux tropicaux à l’Université de La Rochelle, membre du GIEC. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous remercie de m’avoir invitée pour vous présenter l’état des connaissances scientifiques sur les impacts du changement climatique dans les outremer français et les voies d’adaptation identifiées à ce jour.
Le changement climatique se traduit par des modifications des paramètres climatiques et océaniques qui engendrent des changements environnementaux rapides, durables et irréversibles à l’échelle du siècle prochain, changements qui fondent la double urgence, d’une part, des mesures de mitigation visant à réduire leur ampleur, d’autre part, des politiques d’adaptation consistant à réduire leurs impacts.
Face à ces enjeux, les outremer constituent des territoires spécifiques, au moins pour deux raisons : premièrement, parce que des écosystèmes très sensibles à ces modifications environnementales jouent un rôle déterminant dans leur fonctionnement ; deuxièmement, parce que les pressions anthropiques fortes et en augmentation, qui existent sur ces territoires, en se combinant aux pressions climatiques, ont pour effet de démultiplier leurs impacts. Cela rend d’autant plus cruciale notre capacité à contrôler ces impacts.
Or ces territoires possèdent des possibilités de redéploiement spatiales et économiques limitées, en raison de leur configuration physique. Autant de spécificités qui font des outremer des laboratoires absolument majeurs en France pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation très concrètes, dans l’esprit de l’« agenda positif » voulu par la France dans le cadre de la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21).
Quelles sont les principales manifestations du changement climatique dans les outremer ?
On prévoit une accélération de la hausse des températures atmosphériques, qui devrait s’établir entre + 1 et + 3 °C d’ici à 2100, hausse rapide aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. On prévoit parallèlement une hausse des températures océaniques de surface, plus rapide dans la Caraïbe que dans le Pacifique, et une évolution des précipitations contrastée entre les différents bassins océaniques : les précipitations pourraient en effet baisser dans l’océan Indien et en Nouvelle-Calédonie, mais augmenter dans le Pacifique Sud.
Cette baisse des précipitations aura pour effet d’aggraver la pression qui s’exerce déjà sur les ressources en eau, par exemple à la Réunion, où une baisse des précipitations dans l’Ouest peuplé et dynamique économiquement, couplé à la hausse des températures et de la pression démographique, va aggraver la pression qui s’exerce sur les ressources en eau.
Concernant l’élévation du niveau de la mer, nous allons assister à une poursuite de son accélération, déjà enregistrée depuis le début des années 1990, et arriver à une élévation comprise entre soixante centimètres et un mètre d’ici à 2100. Il est à noter que cette hausse est particulièrement rapide dans certains outremer, comme en Polynésie française qui connaît une vitesse d’élévation près de deux fois plus élevée que dans les territoires de la Caraïbe.
À cela il faut ajouter l’acidification des océans, qui accroît la pression s’exerçant sur les écosystèmes et les ressources halieutiques.
Enfin, en ce qui concerne l’évolution des événements extrêmes, on attend une hausse de la fréquence des sécheresses – ce qui va accroître le risque de feux de forêt à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie – et de l’intensité des cyclones les plus puissants, qui va toucher les territoires les plus affectés par ces phénomènes atmosphériques que sont les Antilles et La Réunion.
Ces modifications du climat et des paramètres océaniques vont accroître des pressions qui s’exercent, premièrement, sur les ressources vitales – eau et sols ; deuxièmement, sur les écosystèmes, ce qui va affecter la biodiversité et les fonctions que remplissent ces écosystèmes ; troisièmement, sur les secteurs d’activité économique qui, outremer, dépendent fortement des conditions environnementales et climatiques, qu’il s’agisse de l’agriculture, de la pêche, du tourisme ou de l’aquaculture.
Je vais examiner les impacts par composante, en commençant par ceux qui concernent les écosystèmes et les services qu’ils rendent.
Les pressions climatiques vont entraîner, sur les îles sur lesquelles les forêts primaires couvrent encore 20 à 40 % du territoire – comme c’est le cas à La Réunion, à la Martinique, en Nouvelle-Calédonie –, la disparition des forêts de basse altitude et une remontée progressive des étages forestiers en altitude, qui se traduira nécessairement par une perte de biodiversité, ce qui donne toute leur pertinence aux politiques de protection déjà mises en place.
Par ailleurs, en Guyane, elles vont engendrer un changement progressif de composition de la forêt, avec le remplacement de certaines espèces d’arbres par de la savane, ce qui va se traduire également par une perte de biodiversité et une augmentation du risque de feux de forêt.
Les mangroves, très développées en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles, vont se contracter, voire disparaître dans les territoires dans lesquels elles ne pourront pas, du fait des pressions anthropiques, migrer vers la côte pour se maintenir, comme on le redoute aux Antilles ou à Mayotte.
Parallèlement, l’accroissement des pressions qui s’exercent sur les récifs coralliens engendrera une dégradation progressive de leur état de santé, qui pourrait mener à leur disparition dans certains archipels à partir de 2050 : on a de fortes inquiétudes au sujet des îles de la Société, en Polynésie française. Cela aurait des répercussions majeures sur l’alimentation des populations dépendantes des ressources récifales et sur les niveaux de risques côtiers, puisque la mort des récifs coralliens renforcerait les impacts dévastateurs des tempêtes intenses.
En ce qui concerne l’agriculture et l’élevage, la hausse des pressions climatiques va affecter la qualité des sols et exercer des pressions accrues sur les principales cultures commerciales : la banane, qui joue un rôle central à la Martinique, la canne à sucre, pour laquelle on attend une chute de productivité marquée, et le maraîchage. L’agriculture de subsistance sera également affectée, en particulier à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, où elle souffrira de la dégradation des sols, de la sécheresse et des feux de brousse.
En ce qui concerne la pêche – et l’aquaculture –, on prévoit une diminution globale des ressources halieutiques, qui sera aggravée par la surexploitation là où la pêche persistera. Elle sera compensée dans les outremer par une hausse fortement probable de certaines populations de thonidés, sous l’effet de leur redistribution en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
On doit s’attendre par ailleurs à une modification qualitative des stocks, qui va exiger une évolution des techniques de pêche ; à une hausse de la variabilité interannuelle des captures, qui va rendre plus aléatoire la production de certaines filières, comme celle de la crevette dans la Caraïbe ; à une baisse des stocks côtiers, qui va toucher les pêches côtières et vivrières de la Caraïbe, de Mayotte dans l’océan Indien, des îles de la Société dans le Pacifique, et aggraver les tensions alimentaires et économiques.
En ce qui concerne le tourisme, bien que de fortes incertitudes demeurent, on retiendra les impacts négatifs de quatre facteurs : la dégradation des écosystèmes, sur lesquels s’appuient certaines formes de tourisme – plongée en Polynésie française, éco-tourisme basé sur la découverte de la mangrove à Mayotte –, l’augmentation des risques sanitaires liés au développement des maladies et épidémies tropicales dû au pullulement des moustiques – c’est l’exemple de la crise du chikungunya à La Réunion en 2005-2006 ; la pression sur les ressources en eau, qui pourrait poser problème assez rapidement aux Antilles et à Mayotte ; enfin, les extrêmes climatiques, qui ont un impact négatif sur la fréquentation touristique de certains territoires, comme les îles de la Caraïbe, dans lesquelles les cyclones de 1995 et 1999 ont fait chuter pendant plusieurs années la fréquentation en provenance des États-Unis, qui constitue une part majeure de la clientèle.
Enfin, de manière plus globale, les aménagements et les systèmes de production côtiers, quels qu’ils soient, vont être beaucoup plus exposés, à l’avenir, aux risques de submersion marine et d’érosion côtière, ce qui signifie que le changement climatique renforce l’impératif de mise en sécurité de l’ensemble des activités humaines exposées.
Face à ces projections, quelles stratégies d’adaptation promouvoir ? Dans quelle mesure peuvent-elles s’appuyer sur des expériences acquises ? Ce qui pose la question de la part de l’innovation et de celle des savoir-faire et des acquis – j’aborderai également la question des solutions par secteurs.
Dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, l’adaptation passera par la mise en œuvre de trois types de mesures.
Le premier visera au maintien des conditions de production, c’est-à-dire la protection des sols et le maintien à un niveau suffisant de la ressource en eau. Pour ce qui est de l’eau, enjeu majeur, je retiens trois points : premièrement, des actions à entreprendre d’urgence dans certains territoires comme la Martinique, où 93 % de la ressource dépendent de captages fortement exposés aux mouvements de terrain ; deuxièmement, l’expérience acquise dans le domaine du transfert de l’eau, par La Réunion ou par la Guadeloupe, devrait aider à gérer l’aggravation des distorsions spatiales entre disponibilité de la ressource et besoins humains. Troisièmement, la maîtrise de l’irrigation, et notamment la lutte contre l’excès d’eau, doit être à l’avenir une priorité, en Guadeloupe par exemple, afin de mieux gérer la ressource et limiter le développement des parasites.
Le deuxième type de mesures concerne l’adaptation du système agronomique à travers la sélection de cultures et d’espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques, la relocalisation en altitude de certaines cultures, comme la banane, le renforcement de la résilience du secteur agricole par l’introduction de plantes de service qui aident à fixer les sols et à limiter la propagation des parasites, la réintroduction de la rotation des cultures et le développement de la pluriactivité, autant de mesures qui permettront tout à la fois d’améliorer la productivité et la biodiversité agricole et de réduire les risques. Pour les mettre en œuvre, nous disposons d’une intéressante expérience antillaise, qui peut être valorisée.
Le troisième type de mesures visera à soutenir et à intégrer l’innovation à travers notamment une gestion plus participative de ce secteur d’activité, et à mettre en œuvre une politique volontariste de transformation en profondeur de ce secteur qui souffre souvent d’archaïsme, d’une faible productivité et d’une faible rentabilité.
En ce qui concerne l’adaptation dans le secteur de la pêche, la politique nationale de protection des ressources halieutiques menée dans les îles subantarctiques et les eaux polynésiennes constitue un atout pour l’exploitation durable des ressources. Ce type de politique est à promouvoir dans le contexte actuel d’augmentation des pressions qui s’exercent sur les ressources halieutiques. Une telle politique peut par ailleurs constituer une véritable force pour la France pour renforcer les politiques régionales d’évaluation et de gestion collaborative des stocks, qui constituent un enjeu majeur à l’échelle des prochaines décennies.
En parallèle, certains principes d’adaptation qui s’appliquent au secteur agricole sont également très porteurs pour le secteur de la pêche. Ils consistent à adapter les techniques de pêche à l’évolution des captures, à soutenir la diversification de la production par des efforts dans le domaine de l’innovation technologique et de la commercialisation, en s’appuyant notamment sur le rôle majeur que peuvent jouer les dispositifs de concentration de poissons (DCP) en appui à la pêche côtière, dans l’océan Indien et dans l’océan Pacifique, tout en encourageant également dans ce secteur la pluriactivité – pêche, agriculture, tourisme. Ces efforts sont d’autant plus stratégiques dans le Pacifique que la variabilité du climat y est forte et engendre une forte variabilité des captures, que la pêche récifale devrait sérieusement reculer et que les ressources halieutiques devraient au moins se maintenir, voire augmenter. En fait, il s’agit tout autant de limiter les risques que de saisir des opportunités.
Enfin, pour réduire les risques côtiers, trois voies d’adaptation majeures se dégagent.
La première consiste à réduire l’exposition des enjeux actuellement menacés en les protégeant mieux ou en les relocalisant suivant les cas et à contrôler les développements futurs afin d’éviter que le nombre des personnes et des biens menacés continue à augmenter, dans un contexte qui est souvent celui d’une forte croissance démographique, favorable à l’augmentation des risques.
À ce titre, les grands projets de développement des infrastructures constituent des leviers intéressants pour soutenir les politiques de rééquilibrage démographique et économique en faveur des mi-pentes – ainsi l’ouverture de la route des Tamarins à La Réunion. Ces enjeux de réduction de l’exposition des biens et de contrôle des développements futurs s’appliquent au secteur touristique, qui va devoir évoluer et valoriser des facteurs d’attractivité plus indépendants du climat.
Enfin, il va falloir mettre en place des politiques d’anticipation des risques, globales et intégrées, c’est-à-dire trans-risques, impliquant des acteurs publics et privés et incluant en particulier une amélioration des dispositifs de prévention – qui peut passer, sur certains territoires, par la construction de refuges anticyclones, par exemple –, et de gestion de crise.
En conclusion, un certain nombre de voies d’adaptation majeures identifiées à ce jour, telles que la protection des écosystèmes, la gestion durable des stocks halieutiques ou encore la mise en œuvre de l’agriculture dite « intelligente » ou durable, constituent des solutions très concrètes relevant des logiques mêmes de l’agenda positif promu par la France dans le cadre de la COP21. Il s’agit à ce jour de valoriser des initiatives existantes au nom des bénéfices multiples qu’elles peuvent produire et de voir, tant en outremer que dans d’autres territoires, le changement climatique comme une véritable opportunité de régler les problèmes environnementaux et socio-économiques existants, en repensant nos modes de développement et d’aménagement du territoire.
M. Luc Bas, directeur du Bureau européen de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Bruxelles. Les outremer sont clairement les premières victimes des changements climatiques, mais ils peuvent aussi être des espaces pilotes d’innovation, d’actions exemplaires et de mobilisation régionale et internationale, car il s’agit d’une problématique, non pas géographique, mais universelle.
L’UICN souligne à cet égard, depuis de nombreuses années, l’importance qui doit être justement apportée aux outremer, au travers de ses travaux, de ses analyses, mais aussi de ses actions de mobilisation, et ce grâce à un programme dédié aux outremer européens.
Très largement insulaires, les outremer, présents dans tous les océans du monde, sont les sentinelles du changement climatique. Ses impacts ne sont pas qu’environnementaux, ils sont aussi humains et économiques. Le rapport rendu l’an dernier à la Commission européenne souligne cette réalité. À titre d’exemple, le rapport indique que, pour les régions ultrapériphériques (RUP), la biodiversité est le système environnemental où la mise en place de mesures d’adaptation est la plus urgente, étant donné qu’elle est à risque et qu’elle a une grande valeur pour ces territoires.
Malheureusement, si la Guadeloupe a accueilli une grande conférence sur la biodiversité et le lien avec le changement climatique, la déclaration adoptée par les RUP sous sa présidence ne fait aucune mention de l’importance de cette biodiversité. Cela plaide pour une nouvelle analyse des projets de territoires, mais aussi et surtout pour des soutiens financiers tant nationaux qu’européens pour appuyer les projets de territoires locaux. Il s’agit bien d’envisager différemment le développement et l’aménagement afin de mieux tirer parti des services écologiques que peuvent pourvoir des écosystèmes en bonne santé. C’est ce que l’UICN appelle les solutions basées sur une nature plus respectée.
Vous m’avez demandé une brève rétrospective des dernières réunions importantes et de vous faire part des attentes de l’UICN pour la COP21.
L’île de La Réunion, qui avait accueilli en 2008, avec l’appui de l’UICN, la première conférence dédiée aux questions de perte de biodiversité et de changement climatique dans les outremer, a accueilli en juin 2014 une conférence internationale sur les îles et le changement climatique. Une déclaration y a été adoptée.
La volonté de La Réunion est que cette déclaration des îles montre les initiatives exemplaires des territoires insulaires et les idées à développer entre les outremer européens et les petits pays insulaires.
La déclaration souligne les enjeux de renforcement des capacités, des partenariats, de la coopération, mais aussi de la solidarité internationale et régionale, afin d’appuyer une économie verte et bleue.
Les outremer européens sont mobilisés sur le sujet et nous nous en félicitons. Pour autant, notre vigilance porte sur une approche plus intégrée. La transition énergétique est très importante. Mais les enjeux de résilience ne peuvent être totalement appréhendés sans une meilleure gestion des écosystèmes, car ce sont leurs services écologiques et leur dynamique qui supportent in fine les capacités de résilience des populations insulaires. Mieux vaut préserver ce qui nous est donné gratuitement que tenter de restaurer très difficilement ce qui est détruit ou très endommagé.
Je rappelle quelques chiffres.
Les récifs coralliens et les mangroves jouent un rôle tout particulier dans le service de protection des côtes et des populations outremer. Les récifs et leurs écosystèmes associés atténuent 70 à 90 % de l’énergie des vagues.
En Nouvelle-Calédonie, ce service d’atténuation de l’ampleur des dégâts causés par les phénomènes naturels permet une économie évaluée entre 115 et 219 millions d’euros chaque année.
Une récente analyse a estimé à près de 250 millions de dollars et à quatre cents ans la durée nécessaire pour restaurer les récifs au sud de la Floride et en région Caraïbe.
À ce titre, le rapport de l’UICN sur l’état des récifs dans la Caraïbe démontre que la résilience peut être favorisée avec une meilleure conception intégrée du développement et de l’aménagement de ces îles.
Au regard des conclusions du GIEC, les choix et la durabilité de certains aménagements dans les outremer est largement à reconsidérer. À ce titre, l’allocution du Président des Kiribati, lors de la troisième conférence sur la réduction des risques, a conclu que la résilience ne pouvait être une question isolée et devait être intégrée lors de la COP21.
Le « Scénario de Samoa » et la cérémonie de clôture de l’année internationale des Petits États insulaires en développement, auquel l’UICN a fortement contribué grâce au partenariat global des îles GLISPA (Global Island Partnership), souligne également le lien intrinsèque entre le changement climatique et le développement. Il s’agit à nouveau d’avoir une approche intégrée et de veiller à ce que le débat sur l’agenda post-2015 intègre les questions de changement climatique et de résilience.
L’UICN travaille tout particulièrement à ce que les nouveaux objectifs de développement abordent la biodiversité comme un pilier fondamental, notamment avec des objectifs tangibles pour les océans, sur lesquels je reviendrai plus loin.
En octobre dernier, la Conférence internationale de la Guadeloupe sur la biodiversité et le changement climatique a de nouveau souligné l’importance des outremer. J’ai eu le plaisir d’animer un des ateliers dédiés à la résilience dans le domaine du changement climatique, mais aussi dans le domaine énergétique, car il est très important pour les îles de parvenir à l’indépendance énergétique – j’ai été étonné en découvrant la part d’énergie fossile encore importée dans ces îles. Des propositions concrètes sont sorties de cette conférence et pourvoient à une feuille de route très utile pour engager des actions concrètes dans les cinq prochaines années.
Pour résumer, deux priorités ont été retenues concernant la transition énergétique. Des mesures « sans regret » ont également été adoptées, visant notamment à améliorer l’efficacité énergétique, à promouvoir les transports publics, à protéger et restaurer les écosystèmes, quelles que soient les incertitudes qui subsistent sur les impacts spécifiques et locaux du changement climatique.
En termes d’actions concrètes, la construction d’un cadre de collaboration permettra à chaque RUP outremer de se fixer des objectifs propres en matière de réduction d’émissions et d’énergies renouvelables, et de définir les voies et moyens de les atteindre, contribuant ainsi à l’objectif européen adopté par le Conseil européen en octobre 2014 : même si l’on peut relativiser le niveau d’ambition, force est de reconnaître qu’en proposant de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre, l’Europe montre le chemin.
S’agissant encore d’actions concrètes, une initiative « îles pour l’adaptation et l’atténuation au changement climatique » comprend des solutions basées sur la nature. Elle capitalise et renforce davantage les initiatives existantes telles que le Pacte des Îles ou BEST (Voluntary scheme for Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas – régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d’outremer européens).
BEST a déjà financé des projets touchant au changement climatique. L’UICN travaille, pour la Commission européenne, à la pérennisation de cette initiative exemplaire pour financer de nouveaux projets de terrain – nous sommes en train de réfléchir à la création d’un outil de financement, sous la forme d’un trust fund. À ce titre, si le Fonds Vert pour le Climat, qui doit être débattu à la COP21, ne financera pas des actions pour les outremer, BEST, qui a fait ses preuves, constitue un mécanisme de financement adapté pour ces territoires. Je pourrais vous donner des précisions sur BEST dans la deuxième partie de cette table ronde, en réponse à vos questions.
L’UICN a notamment publié un rapport important sur le rôle fondamental des océans en matière d’absorption et de stockage de carbone. Vous n’ignorez pas l’importance du domaine marin que représentent les outremer : c’est le premier domaine maritime au monde. La COP21 doit refléter cette importance des océans. L’UICN fait partie d’une plate-forme Océan et Climat et va participer à un événement important le 8 juin prochain à l’Unesco pour souligner cette conviction.
Ironie de l’histoire, me direz-vous, si la Guadeloupe a accueilli en octobre 2014 la Conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique, les débats de la conférence des RUP, qui s’est tenue à peine quelques mois plus tard, sur la même île, ne font pas mention des enjeux liés à la biodiversité, alors qu’ils sont fondamentaux en matière de développement économique. La déclaration de cette conférence des RUP, très centrée sur les questions de chômage, demande néanmoins à la Commission européenne de « développer l’axe horizontal de lutte contre le changement climatique » et d’« envisager la meilleure façon de déployer le financement en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et de mettre en place et de renforcer les politiques publiques permettant une transition écologique et énergétique tenant compte des spécificités des RUP ».
Une fois de plus, il devrait s’agir d’aborder les enjeux de développement de manière plus intégrée. Que seraient les économies locales et l’avenir des populations locales, l’agriculture, la pêche, le secteur touristique, sans les services écologiques gratuits auxquels pourvoient leurs écosystèmes ?
L’UICN avait mené de façon pionnière une analyse des fonds publics alloués aux outremer français. Le constat était sans appel sur la trop faible partie accordée à la biodiversité et sur les effets pervers de certains financements. Quelques années après, le rapport de la cour d’audit européenne a souligné le difficile financement d’actions en faveur de la biodiversité par les fonds structurels.
Les conclusions du 13e Forum des Pays et territoires d’outremer (PTOM) encouragent les outremer à mettre en œuvre les conclusions de la Conférence de la Guadeloupe et rappellent l’importance de l’utilisation durable des ressources naturelles. Référence est faite à la COP21 et à la volonté de contribuer au succès de la Conférence, et la Commission européenne accueille favorablement les propositions des PTOM en matière d’adaptation et de protection de la biodiversité.
À ce titre, l’UICN va travailler à un événement « Outremer et Petits pays insulaires » lors de la COP21 de Paris pour souligner le rôle de ces entités politiques pour le succès de tous.
M. Alby Schmitt, directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Je vous remercie de m’avoir invité à cette réunion pour débattre de ce sujet d’actualité. Ma compétence ne se limite pas aux deux seuls sujets de l’eau et de la biodiversité : elle s’étend aussi au domaine marin. Le changement climatique n’est qu’un des aspects des questions de l’eau, de la biodiversité et du marin.
Mon intervention portera, pour l’essentiel, sur la situation de l’action publique dans les secteurs de l’eau, de la biodiversité et du marin dans les outremer. Je commencerai par l’analyse des forces et des faiblesses des acteurs et des politiques menées, que je mettrai en perspective avec les enjeux du changement climatique.
On parle toujours « des » outremer, car aucun outremer ne ressemble à un autre, que ce soit du point de vue géographique, du point de vue du statut ou du point de vue de la réglementation applicable. Cela vaut aussi pour la biodiversité : il y a plus d’espèces végétales sur un kilomètre carré de forêt en Guyane que dans l’Europe tout entière, tandis que certains outremer souffrent d’une relative pauvreté en matière de biodiversité.
Il en est de même pour les pressions exercées sur l’eau et la biodiversité. Ce ne sont pas les mêmes dans des régions où la démographie explose, comme la Guyane ou Mayotte, dans les régions plutôt stables dans ce domaine, comme les Antilles, ou encore dans des régions à très faible densité : je pense en particulier au Pacifique, au regard de régions comme Mayotte, laquelle atteint facilement 1 000 habitants au kilomètre carré.
S’agissant du statut et du contexte réglementaire, on pourrait faire un cours d’université pour présenter toute la réglementation en matière d’environnement dans les outremer. Globalement, le code de l’environnement s’applique aux départements d’outremer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ailleurs, comme dans les provinces de Nouvelle-Calédonie, chaque collectivité d’outremer définit sa législation en matière d’environnement.
L’Union européenne distingue dans les outremer les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays et territoires d’outremer (PTOM).
Dans les RUP, le droit européen s’applique, moyennant quelques adaptations. Dans les outremer français, les régions ultrapériphériques appliquent, en matière d’environnement, essentiellement les directives traitant de l’eau, mais elles n’ont pas à appliquer à ce jour les directives « nature », comme la directive Oiseaux ou la directive Habitats, plus connues sous le nom de « réseau Natura 2000 ».
Les RUP, soumises au droit européen, bénéficient en contrepartie d’avantages financiers importants. Globalement, entre 2007 et 2013, plus 7 milliards d’euros ont été consacrés aux RUP, au titre des fonds structurels, du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds européen pour la pêche (FEP). Si l’on veut mettre en perspective les fonds affectés à la biodiversité, je ne dispose pas du chiffre exact, mais on peut supprimer trois ou quatre zéros du chiffre indiqué précédemment… En ce qui concerne l’eau en revanche, les montants sont loin d’être négligeables. Pour les années à venir, 30 millions d’euros en provenance du FEDER iront au secteur de l’eau en Guadeloupe. Le secteur de la biodiversité est le parent pauvre pour ce qui est des financements européens, contrairement au secteur de l’eau, qui tire bien son épingle du jeu.
Les PTOM sont tous les outremer qui ne sont pas des RUP. La réglementation est locale et ne relève pas du droit européen. Cela étant, les PTOM bénéficient d’un certain nombre de crédits, comme les crédits BEST, à destination de la biodiversité. Nous avons appris récemment que la Commission européenne ne voulait pas accorder de crédits LIFE, y compris pour des appels d’offres pourtant ouverts à des PTOM. Les TAAF se sont vues ainsi refuser 3,1 millions d’euros alors qu’elles étaient lauréates de l’appel d’offres.
La Commission européenne s’intéresse beaucoup aux outremer français, car la France est le seul pays dont les outremer sont situés sur quatre océans et couvrent à la fois des zones tropicales et des zones subarctiques et antarctiques, ce qui permet d’avoir une vision très générale de la problématique. Qui plus est, c’est le seul État membre qui compte des RUP et des PTOM.
Concernant les structures en place dans les outremer, il n’y a aujourd’hui, nulle part ailleurs, une telle densité d’organismes traitant de la biodiversité. Plus de dix-sept organismes qui interviennent sur la biodiversité dans les DOM, sans compter les universités ! Résultat : de faibles masses critiques, du fait d’équipes réduites et souvent très dispersées, très faibles, des recouvrements de compétences, parfois même des compétitions : on cite souvent le cas des espaces forestiers qui peuvent être couverts à la fois par des parcs nationaux et par l’Office national des forêts (ONF), alors que certains domaines sont encore délaissés. Un effort de rationalisation s’impose.
Nulle part en France il n’y a davantage d’espaces naturels protégés. Pour les parties soumises au code de l’environnement, près de 30 % de la surface des outremer est classée en espace fortement protégé : cœurs de parcs, réserves nationales, réserves biologiques, etc. En métropole, cela représente moins de 2 %, un chiffre qui reste l’objectif à atteindre.
Ce sont des bases sur lesquelles nous pouvons travailler, car les notions de parc ou de réserve ne signifient en rien une simple gestion « sous cloche » : derrière ces parcs, il y a des comités de gestion, des plans de gestion, qui permettent de prendre en compte l’ensemble des pressions qu’il peut y avoir et de trouver les solutions, notamment aux problèmes liés au réchauffement climatique. Ces espaces protégés et ces organismes sont de réels atouts.
La gouvernance en matière d’eau et de biodiversité a été plutôt faible jusqu’à présent. Concernant les financements et les moyens humains, la multitude des organismes ne veut pas dire qu’il y a énormément d’agents. Aujourd’hui, dans l’ensemble des DOM, 1 128 équivalents temps plein (ETP) travaillent dans les dix-sept organismes dont j’ai parlé précédemment. On dit que 80 % des enjeux de biodiversité sont dans les outremer ; je ne suis pas sûr que 80 % des moyens humains et financiers y soient consacrés… Cela étant, des investissements considérables ont été consentis dans les outremer : les montants investis dans le basculement des eaux à La Réunion et en Guadeloupe atteignent des centaines de millions d’euros.
Il y a également des engagements forts de la France vis-à-vis des outremer. Les dernières conférences et tables rondes ont toujours abouti, dans les feuilles de route, à des mesures spécifiques en faveur de de l’eau et de la biodiversité, dans le cadre du changement climatique.
La ministre de l’écologie s’est fortement engagée en octobre dernier, lors de la Conférence internationale de la Guadeloupe portant sur les outremer européens. Le tableau de suivi de ces engagements, régulièrement actualisé, montre l’importance des sujets eau, biodiversité et changement climatique pour le ministère de l’écologie.
Vous avez débattu, la semaine dernière, du projet de loi relatif à la biodiversité. Des engagements en matière de biodiversité outremer ont été introduits dans le texte, avec des impacts possibles en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l’adaptation aux changements climatique, et un programme de protection de 55 000 hectares de mangrove et de 75 % des récifs coralliens.
La première piste à explorer sans attendre consiste en des solutions très simples à mettre en œuvre, que M. Luc Bas a appelées, selon une terminologie européenne, des mesures « sans regret ». Que l’on ait ou non des certitudes sur l’ampleur du réchauffement climatique et de son impact sur l’eau, le problème aujourd’hui, au moins dans les DOM, n’est pas celui de la ressource, mais celui de la gestion et de l’exploitation des réseaux. La Guadeloupe apparaît comme un cas totalement caricatural, puisque plus de 50 %, voire 60 % d’eau, se perdent dans les réseaux. Vous en conviendrez, la meilleure ressource est celle que l’on ne perd pas…
En ce qui concerne l’eau, une première mesure à prendre, la plus simple, consisterait à réduire les fuites et à investir dans l’entretien et le renouvellement du réseau. Ensuite, il vaudrait mieux traiter les eaux usées et les déchets, qui vont dans les lagons, détruisant au passage la biodiversité du littoral. C’est une des principales causes du mauvais état des lagons et des récifs coralliens. Du côté de la gestion des eaux pluviales également, il y aurait certainement des choses à faire.
Autrement dit, des mesures simples, efficaces et valables quelle que soit l’évolution climatique. En outre, le bénéfice est multiple, puisqu’elles se répercutent également dans le domaine de l’hygiène et de l’économie, et il n’y a pas d’économie sans eau potable ni assainissement qui fonctionne bien, sans oublier l’aspect social, car derrière cela, il y a des travaux et des emplois réellement durables.
Deuxième piste : la planification, la stratégie, la gouvernance, qui concernent aussi bien l’eau que la biodiversité, le marin et les risques naturels.
Toute une série de dispositifs de planification sont actuellement mis en avant, et parfaitement applicables dans les outremer, à commencer par les schémas d’aménagement régionaux (SAR). Ils ont l’avantage d’être à la bonne échelle pour les outremer, ils sont inclusifs, c’est-à-dire qu’ils prennent en compte à la fois les sujets d’urbanisation et les problèmes de continuité écologique puisque la trame verte et bleue doit faire l’objet d’un volet dans les SAR ; ils permettent enfin de jouer sur la perspective : quand on travaille sur le changement climatique, il faut avoir une vision des évolutions que l’on envisage sur un territoire. Peut-être faudrait-il même revisiter les SAR pour les rendre encore plus inclusifs : des sujets comme l’assainissement, l’eau potable, qui pourraient tout à fait trouver leur place dans les SAR. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui est un document parallèle, devrait normalement, comme le prévoient les instructions, inclure une vision prospective concernant les évolutions climatiques.
La gouvernance en matière d’eau et de biodiversité a fait l’objet d’un rafraîchissement dans le cadre de la loi sur la biodiversité, en cours d’examen par le Parlement : ce sera une gouvernance adaptée, locale, au niveau régional des territoires outremer.
Troisième piste : les expérimentations et l’innovation administrative.
Premier cas de figure issu de la stratégie nationale de la gestion du trait de côte : il concerne la commune de Petit-Bourg, en Guadeloupe, où des expérimentations, qui ont fait l’objet d’un appel à projets, sont en cours sur la relocalisation des activités et des biens. C’est un cas exceptionnel, qui concentre les problèmes de réchauffement climatique, de remontée des eaux, de submersion marine, de risques volcaniques, sans oublier les risques de tremblement de terre et d’inondation.
Autre excellent exemple, que j’ai pu apprécier en tant que membre de la Commission mixte inondation qui évalue les Programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) : le premier projet émanant des outremer, qui concernent Grande-Terre. La commune des Abymes, pilote en la matière, l’ensemble des communes, l’Office de l’eau et la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ont présenté un projet quasiment expérimental, très inclusif puisqu’il intègre tous les services écosystémiques impliqués dans la prévention des inondations, la rétention des crues et la protection du littoral, puisque c’est là qu’est située la plus grande barrière corallienne des Petites Antilles.
Planification, stratégie, expérimentation me semblent être, dans ces domaines, trois voies de progrès pour les outremer.
M. Jean-Yves Caullet. Je remercie les trois intervenants pour le caractère complet de leurs interventions sur un sujet par nature très divers et très prégnant. Qu’il s’agisse de transition énergétique, de biodiversité, de changement climatique, d’actions à mener ou de conséquences supposées, les outremer français sont aux premières loges. Nous l’avons du reste constaté lors de l’examen du texte relatif à la biodiversité : les élus de ces territoires sont très mobilisés et ils ressentent parfaitement les urgences et les enjeux.
Ma première question portera sur le caractère plus ou moins intégré des acteurs, qu’il s’agisse des acteurs en réparation, en recherche ou en innovation. Dans ces territoires à la fois à très forts enjeux, de petite taille – à l’exception de la Guyane – et extrêmement spécifiques, il me semble que l’intégration des acteurs n’est pas suffisante pour avoir une action coordonnée marquée. L’exemple, qui me va droit au cœur, des parcs et de l’ONF en est une parfaite illustration : à cause d’une organisation pratiquement calquée sur celle de la France métropolitaine, on perd énormément d’énergie au niveau local à coordonner des services qui devraient, à mon avis, être bien plus intégrés. J’aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet.
La deuxième a trait à la coopération régionale. Ces territoires français ne sont pas isolés. Ils sont dans un environnement régional, lui aussi soumis à des enjeux analogues, mais pas toujours identiques – les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Comment faire en sorte que notre pays, par sa présence sur ces territoires et dans ces zones géographiques, soit un acteur important, majeur, reconnu, en termes d’observation, de recherche, d’innovation, d’investissement et de réparation ?
La troisième portera sur les financements, ce qui renvoie à celle de l’organisation et de l’intégration. Dès lors que les collectivités, les organismes publics, les organismes de recherche, les acteurs économiques ne sont pas intégrés, chacun dispose de moyens de financement qui lui sont propres et est confronté à des arbitrages qui lui sont également propres. Tout cela ne garantit pas une optimisation des moyens mis en œuvre.
Je citerai l’exemple de l’ONF, dont la présence outremer est considérée de la même façon qu’en Franche-Comté. Il y a des directions, des missions d’intérêt général (MIG) qui sont financées, un produit bois qu’on est censé vendre, la différence entre les deux faisant apparaître un déficit annuel. Ce modèle, qui peut se comprendre, en termes de péréquation, sur un territoire forestier tempéré et de grandes dimensions, n’a plus aucune signification à l’échelle de La Réunion, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Pourtant, ce sont sous ces auspices que l’on gère les moyens éventuellement disponibles. On pourrait même en conclure qu’il faut réduire ces fameux déficits, et donc supprimer des moyens, alors qu’il faut au contraire intensifier la politique de restauration des terrains en montagne (RTM), la forêt, la biodiversité, le génie écologique ou la protection contre l’érosion. Organisation et financement me semblent liés. Quelles solutions pouvez-vous proposer ?
N’oublions pas enfin la nécessité de ne pas nuire, comme disaient les vieux médecins. Autrement dit, dans toutes les actions entreprises aujourd’hui, il faut garder à l’esprit le souci de ne pas aggraver la situation. Pour ce qui est de l’eau, cela me rappelle un souvenir : j’ai commencé mes études sur la gestion de l’eau à Saint-Louis-Baillif, sur la Côte-sous-le-Vent. Je constate que je n’ai pas réussi puisque la situation en Guadeloupe est toujours aussi difficile… Ne faut-il pas s’interroger sur la pertinence de l’organisation des réseaux d’eau avec des myriades de sociétés distinctes qui gèrent en affermage ou en concession sur un territoire extrêmement restreint ? Ne faudrait-il pas réfléchir à une organisation administrativo-technique plus adaptée et plus efficace ?
M. Martial Saddier. C’est la première fois que notre commission, qui a, entre autres, les transports aériens, dans son domaine de compétence, se réunit depuis le terrible accident d’avion survenu hier dans les Alpes du Sud. Je tenais à exprimer notre compassion à l’endroit des victimes et notre solidarité envers les familles, ainsi que nos remerciements à l’ensemble des services de secours qui, encore en ce moment, travaillent en haute montagne, dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses.
Le parlementaire UMP, au nom desquels j’interviens, souhaitent rappeler que les outremer sont des territoires à part entière de notre République. Comme d’autres territoires où la densité de population est faible, ils sont parfois oubliés ou peuvent en avoir le sentiment. Pourtant, les outremer sont une des grandes richesses de notre nation. Ils représentent, par exemple, 80 % de la biodiversité de notre territoire et c’est une des grandes destinations touristiques au monde, ce qui fait que la France reste, à l’instant où nous parlons, au premier rang dans ce domaine.
La semaine dernière, et notamment dans la nuit de mardi à mercredi, les parlementaires UMP ont mené un combat qu’ils ont gagné, avec les parlementaires ultramarins de toutes sensibilités. Nous avons inversé le cours des choses, en modifiant la composition du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité. (Murmures sur les bancs SRC)
Après plusieurs heures de combat acharné, nous avons obtenu que cinq représentants permanents au conseil d’administration de cette future agence soient issus des territoires ultramarins. Telle n’était pas la proposition initiale du Gouvernement et de la majorité. Grâce au concours unanime des parlementaires UMP et de l’ensemble des députés ultramarins, le texte adopté en première lecture reconnaît, et c’est pour nous un sujet de fierté, la richesse de la biodiversité des territoires ultramarins.
Mme Geneviève Gaillard. À ceci près que groupe UMP n’a pas voté le projet de loi !
M. Martial Saddier. S’agissant de l’élévation de la température, le constat est sans appel : ce sont les territoires qui contribuent le moins à ce phénomène qui demain en subiront le plus les conséquences. Cela vaut pour les territoires d’outremer, mais également pour les zones de montagne ou du continent africain qui contribuent peu à l’élévation de la température, mais qui, demain, seront fortement impactées.
Mes collègues reviendront dans le détail sur des questions plus précises, comme l’élévation du niveau des océans ou la prolifération des algues marines, qui est d’ores et déjà un vrai problème, l’intensité et la fréquence des catastrophes climatiques. Mais d’ores et déjà, au nom de l’ensemble des parlementaires du groupe UMP, je souhaitais exprimer notre reconnaissance et notre fierté de compter dans notre belle République les territoires d’outremer.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Comme d’autres parlementaires, j’étais présent dans l’hémicycle lors de l’examen du texte sur la biodiversité. En ce qui concerne la composition du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, je rappelle la proposition très concrète présentée par notre rapporteure Geneviève Gaillard, qui a permis d’arriver à une meilleure prise en compte des territoires d’outremer au sein du conseil d’administration. Cela étant, la reconnaissance de la dimension outremer dans le projet de loi sur la biodiversité, qui est particulièrement présente, résulte de l’action de notre rapporteure, mais aussi celle de Serge Letchimy et d’autres parlementaires d’outremer et pas uniquement de l’action du groupe UMP. Il est de ma responsabilité de donner de temps en temps des précisions afin que ceux qui n’étaient pas là puissent comprendre de quoi il est question. (Approbation sur de nombreux bancs)
Mme Maina Sage. Je ne reviendrai pas sur l’amendement du groupe UDI, que nous avons adopté à l’unanimité. Ce sujet a su réunir l’ensemble des parlementaires et a fait l’objet d’un travail commun avec la majorité. Je suis ravie que l’UMP, qui est dans l’opposition, se soit jointe à cette proposition que nous avons tous votée.
M. Martial Saddier. L’UDI ne serait-elle pas dans l’opposition ?
Mme Maina Sage. Bien sûr que si. (Sourires)
Les présentations de nos invités nous ont permis d’appréhender plus en détail l’impact du changement climatique pour les outremer. Il n’y a pas qu’un seul modèle, chaque outremer subira des conséquences qui pourront varier d’un territoire à l’autre.
En Polynésie française, il semble important de se préparer au mieux. J’ai pris note des solutions « sans regret ». J’ai aussi entendu parler, et cela m’a un peu choquée, des « opportunités » liées au changement climatique : pour l’outremer, l’impact ne sera pas seulement d’ordre environnemental ou économique, ce sera avant tout un impact sur nos lieux de vie, sur nos habitats. Nous sommes bel et bien menacés sur nos territoires. Nos populations ne savent pas si elles pourront continuer à y vivre.
La Polynésie française est un territoire grand comme l’Europe, avec cinq archipels très différents les uns des autres. Si certains sont constitués d’îles montagneuses, l’archipel des Tuamotu-Gambier a une caractéristique particulière à laquelle j’aimerais vous sensibiliser : il est constitué d’atolls, des îles plates d’à peine deux ou trois mètres de haut et dont les points culminants ne dépassent pas quatre à cinq mètres – autrement dit, moins haut que le plafond de cette salle. Tous ces atolls risquent demain d’être engloutis.
Je voudrais que vous saisissiez la dureté de ce sujet pour nous. Nous vivons d’ores et déjà les effets du réchauffement climatique. Tous les jours, nous sentons des changements sur nos houles cycloniques et sur nos ressources halieutiques. Et ce n’est pas qu’une activité économique : c’est d’abord un moyen de subsistance.
Nous sommes très soucieux de ces changements parce qu’ils nous touchent tous les jours et qu’ils menacent d’abord notre habitat, mais aussi notre biodiversité. Ils vont entraîner des bouleversements dans nos habitudes de vie et dans nos activités économiques. Les solutions que vous proposez sont-elles suffisantes nous y préparer ?
J’ai deux questions à vous poser, dont la première touche à la fiabilité des études. Je vous ai entendue, madame Duvat, parler des perspectives d’élévation du niveau de la mer à soixante centimètres, voire un mètre, d’ici à 2100. Le souci, c’est que nous avons pléthore d’études : celle du CNRS de septembre 2013 sur l’impact de l’élévation de la mer sur les îles françaises dans le monde parlait une hausse de 1 à 3 mètres. Pour un atoll qui ne fait pas plus de deux ou trois mètres de haut, entre soixante centimètres et trois mètres, cela fait une sacrée différence !
Faut-il perdre notre temps à gérer dans ces territoires le renforcement des littoraux, le changement de gestion des eaux, le traitement des déchets, si c’est pour se retrouver sous l’eau dans vingt ans ? Je parle crûment, mais comprenez que ce sont des questions que nous nous posons au quotidien. Nous avons engagé des programmes pour la construction d’abris de survie en cas de cyclone, qui coûtent extrêmement cher : cela nous prendra quasiment un quart de notre contrat de projet sur les cinq prochaines années. Quel intérêt, si nous sommes certains que l’élévation du niveau de la mer dépassera demain deux ou trois mètres ? Si l’on veut mettre à l’abri des populations, encore faut-il qu’elles soient encore sur place. Concrètement, comment pouvons-nous avoir une garantie sur le niveau d’élévation ?
On parle beaucoup des fameux « deux degrés ». Nous sommes dans le contexte de la COP21 et nous attendons demain la conclusion d’un accord historique. Avec le maintien à deux degrés d’élévation de la température, que sera l’impact sur les outremer ? Ce plafond, qui est en cours de négociation, sera-t-il suffisant pour assurer la protection de nos territoires et particulièrement des atolls ?
Ma deuxième question concerne le financement. Vous avez évoqué le programme BEST. Il y a également le programme Initiative des territoires du Pacifique Sud pour la gestion régionale de l’environnement (INTEGRE). La Polynésie travaille activement, en partenariat avec l’État, pour drainer des financements européens, voire internationaux. Malheureusement, alors que des milliards sont inscrits dans les programmes de l’Union européenne, ce qui arrive dans nos territoires auprès des acteurs locaux ne représente même pas 15 à 20 % du montant prévu. Il y a tellement d’intermédiaires entre le point de départ et le point d’arrivée que je m’interroge sur l’efficacité de ces programmes de soutien, notamment européens.
M. François-Michel Lambert. Votre présentation, chère collègue Maina Sage, fait honneur aux représentants de la République que nous sommes, et relève le niveau du débat après la précédente présentation de certains qui se plaisent à laisser croire qu’ils ont fait avancer le débat, mais qui ont surtout voté contre la loi sur la biodiversité ! (Approbations sur les bancs SRC et exclamations sur les bancs UMP)
Mme Geneviève Gaillard. C’est vrai !
M. François-Michel Lambert. Votre intervention me fait penser à la métaphore de l’omelette au lard : si la poule est concernée, le cochon, lui, est impliqué… Nous, députés de l’Hexagone, nous sommes la poule et nous nous contentons de dire que nous sommes concernés tandis que vous, députée d’outremer, venez d’expliquer qu’il s’agit pour vous d’une question vitale.
C’est à nous, députés hexagonaux, d’appréhender la responsabilité que nous avons envers la nation tout entière, outremer compris, voire envers la planète, dans nos choix, notre capacité à dépasser un certain conformisme, à repousser toute frilosité et à aller de l’avant. Mme Virginie Duvat a expliqué que nous devions voir ces enjeux comme une opportunité, mais pour revoir nos politiques d’aménagement du territoire et de développement, et non pour dégager davantage de marges.
Quand vous dites, madame Maina Sage, que les atolls sont moins hauts que la salle où nous nous trouvons, on perçoit immédiatement ce que peut être la conséquence d’une élévation du niveau de la mer de seulement vingt ou trente centimètres. Nous devons aussi avoir en tête que nous sommes les seuls à profiter de nos modèles de développement égoïstes, comme le tout-voiture, le gaspillage de nos ressources, le gaspillage énergétique, etc., alors que c’est vous qui en subissez les conséquences.
Il est temps de passer d’une action défensive à une action offensive en termes de développement. Nous devons valoriser les initiatives existantes. Certes, mais comment passer des paroles aux actes ? Comment parvenir à coordonner toutes les initiatives existantes ? Il en est une qui est mise en avant dans plusieurs régions d’outremer : l’économie circulaire. Les présidents des régions Martinique et Guadeloupe ont décidé d’en faire un élément central de développement de leurs territoires et de privilégier une autre approche : n’oublions pas qu’ils dépendent pour l’essentiel de leurs besoins, du cordon ombilical qui les relie à l’Hexagone. Autrement dit, ils en sont totalement dépendants et en subissent les impacts ! En passant à un modèle d’économie circulaire plus inclusif, il doit être possible de changer les choses.
Que pensez-vous des différents projets pharaoniques en outremer, comme la nouvelle route du littoral à La Réunion ? Il faut, selon moi, arrêter ces projets extrêmement consommateurs de moyens financiers, moyens qui viennent à manquer par ailleurs. Mme Maina Sage a également évoqué ces projets particulièrement coûteux d’abris en cas de cyclone, au détriment de tout ce qui privilégierait la résilience positive et une réappropriation par les citoyens.
Comment mettre en avant la question de ces territoires lors de la COP21 ? Quelle réponse la France doit-elle apporter ? Un rendez-vous est prévu au mois de mai prochain lors du passage du Président de la République aux Antilles. Une politique plus globale, qui ne serait pas centrée sur nos seuls départements, me semblerait judicieuse.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. En général, ce sont les nouveaux venus qui ont un droit de tirage, mon cher collègue… Je vous invite à respecter votre temps de parole, c’est-à-dire une minute et demie maximum. La prochaine fois, je ferai l’inverse : je contraindrai les représentants des groupes à un temps bien inférieur à celui des autres parlementaires. (Rires)
M. Philippe Plisson. L’intitulé de la table ronde ne fait qu’acter notre aveu d’impuissance. Il faut s’adapter à ce que l’on a renoncé à empêcher. Je regrette d’ailleurs les petites manœuvres politiciennes de l’UMP qui, étant le parti du productivisme, n’a pas de leçons à donner. (Exclamations sur les bancs UMP)
Je préfère l’intervention de Mme Maina Sage, membre du groupe UDI : sur un tel sujet, il est nécessaire d’unir nos efforts plutôt que de chercher nos différences.
Le constat des experts est unanime, la situation est grave. Bien sûr, les principaux émetteurs ne sont pas épargnés et les alertes de plus en plus fréquentes à la pollution de l’air, encore avant-hier à Paris, témoignent de cette évidence.
Pour ce qui concerne les outremer, c’est la double peine : ils subissent des aléas décuplés, sans avoir, la plupart du temps, bénéficié des avantages économiques afférents.
Vous nous parlez d’un changement de modèle culturel et économique, mais toujours sur le mode de l’incantation. Est-il encore temps d’inverser le processus ? Peut-on au moins espérer, dans un souci de justice, que des moyens inversement proportionnels soient accordés aux outremer dans cet agenda dit « positif » de la COP21, pour amortir les catastrophes que vous annoncez ?
M. Guillaume Chevrollier. On ne parle pas assez de la richesse de l’outremer en termes de biodiversité ni des menaces que le changement climatique fait peser sur ces régions. Ces menaces sont réelles : accélération des sécheresses et des intempéries destructrices, réchauffement de l’eau et montée du niveau des mers.
Ces régions doivent déjà faire face à des dégâts importants du fait de l’arrivée d’espèces dévastatrices : ainsi l’invasion du poisson-lion, arrivé sur les côtes de Floride à la fin des années quatre-vingt-dix, qui a, depuis, achevé de coloniser toute la Caraïbe. On dénombre jusqu’à 1 000 individus à l’hectare au lieu de cinquante dans l’environnement initial. Il représente un préjudice certain pour quantité d’espèces.
Quel est le lien entre le développement de ces espèces invasives et le changement climatique ?
M. Stéphane Demilly. Les outremer sont particulièrement riches sur le plan de la biodiversité : M. Schmitt a rappelé qu’un kilomètre carré en Guyane était plus riche en biodiversité que toute l’Europe métropolitaine.
Cependant, s’il est particulièrement riche, le patrimoine naturel des outremer est aussi le premier à être frappé par les effets du changement climatique, car le réchauffement de l’eau et de l’atmosphère déstabilise des écosystèmes particulièrement vulnérables.
M. Luc Bas a repris les conclusions de la Conférence internationale qui s’est tenue en Guadeloupe. Les îles sont particulièrement exposées à l’accélération des sécheresses et des intempéries destructrices, comme le cyclone Gonzalo, qui a frappé Saint-Barthélemy à l’automne dernier, ou encore, il y a seulement deux semaines, le cyclone Pam, qui a dévasté l’archipel de Vanuatu en Polynésie, avec des rafales de vent à plus de 320 kilomètres-heure.
Dans ce contexte, les défis sont multiples. C’est à une véritable mutation écologique et énergétique qu’il faut s’atteler. Je voudrais, pour ma part, évoquer rapidement trois enjeux qui me paraissent particulièrement importants.
Le premier, évoqué par Mme Virginie Duvat, est celui de la préservation et de la restauration des mangroves et des forêts tropicales dont le rôle est essentiel pour filtrer et dépolluer, capter le carbone et protéger des tsunamis et de la houle cyclonique.
Le deuxième enjeu est celui de la lutte contre la prolifération des espèces invasives aux effets dévastateurs pour les écosystèmes locaux. Citons le cas du poisson-lion dans les Caraïbes, de la petite fourmi de feu à Tahiti ou encore des algues sargasses en Martinique.
Le troisième enjeu est celui des impacts du changement climatique sur la santé outremer, avec la propagation de maladies comme le chikungunya, la fièvre jaune, la dengue ou encore le virus du Nil occidental.
J’aimerais avoir quelques éléments d’information complémentaires concernant ces trois enjeux.
Mme Brigitte Allain. Madame, messieurs, vous avez beaucoup parlé de résilience. La résilience, pour moi, c’est la capacité de reconstruire en résistant. Le témoignage de Mme Maina Sage nous interpelle sur la responsabilité collective que nous avons à lutter contre le réchauffement climatique et pour un vrai développement écologique, qui doit être la base, le socle de nos politiques économiques et sociales, tous partis confondus.
La résilience sur les territoires d’outremer, ce devrait être dès aujourd’hui l’organisation de stratégies de territoires pour une capacité d’autonomie vitale, en valorisant les richesses naturelles pour encourager à la relocalisation alimentaire et énergétique, ainsi qu’au traitement des déchets.
Quelles actions concrètes sont-elles mises en œuvre pour favoriser cette résilience ?
M. Stéphane Claireaux. Par sa situation géographique, Saint-Pierre-et-Miquelon est très exposé aux risques littoraux en ce qui concerne, notamment, l’érosion et la submersion.
L’archipel est composé de petites îles basses sur l’eau. Le village de Miquelon, par exemple, est installé sur un cordon littoral dont l’altitude maximum est de trois mètres. Les risques liés à la montée des eaux sont donc grands. Ce sujet a d’ailleurs été abordé lors de la visite du Président de la République, en décembre dernier, à Saint-Pierre.
Nous avons déjà noté des phases d’érosion plus actives, un recul généralisé du trait de côte et une fragilisation des cordons littoraux. Nous avons aussi de fortes inquiétudes concernant la biodiversité et les écosystèmes. Nous avons déjà noté des impacts du réchauffement climatique sur notre forêt boréale, unique sur le territoire français, avec l’apparition de parasites. Des parasites sont également apparus sur l’omble de fontaine, du fait du réchauffement des cours d’eau. Nous avons aussi noté un déséquilibre dans le Grand-Barachois, avec une prolifération d’algues inhabituelle. Nous nous inquiétons de l’impact économique du réchauffement climatique sur l’activité d’aquaculture de coquilles à Miquelon ou encore sur les stocks de poisson en Atlantique nord.
Si un travail d’étroite collaboration scientifique s’est engagé avec nos voisins canadiens, il n’en reste pas moins que, localement, nous restons relativement démunis en ressources humaines : nous nous reposons actuellement sur le seul organisme public présent dans l’archipel, l’Institut de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), qui ne compte qu’un seul salarié.
Il serait souhaitable de renforcer localement les acteurs scientifiques en développant, par exemple, des partenariats avec des universités nord-américaines ou métropolitaines. Nous avons réclamé la création d’un délégué régional à la recherche et à la technologie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Malheureusement, cette demande n’a pas eu de suite.
Ainsi que l’a souligné M. Schmitt, les outremer sont pluriels. Vous avez toutes et tous beaucoup parlé des problématiques dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’océan Pacifique. Malheureusement, vous n’avez fait quasiment aucune allusion à l’Atlantique nord. Pourtant, nous sommes aussi, à Saint-Pierre-et-Miquelon, très concernés par les conséquences du réchauffement climatique, qu’elles soient écologiques, environnementales ou économiques.
Je souhaiterais savoir quelles sont, concrètement, les intentions de l’État en matière de lutte contre le réchauffement climatique à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mme Geneviève Gaillard. Je remercie le président Jean-Paul Chanteguet et François-Michel Lambert pour les propos qu’ils ont tenus en réponse à ceux de M. Martial Saddier, qui étaient, de mon point de vue, dérisoires et sans intérêt au regard des enjeux dont nous débattons aujourd’hui.
Mme Maina Sage, quant à elle, a posé de vraies questions, d’une gravité extrême, qui nous mettent face à nos responsabilités concernant un problème dont nous parlons depuis longtemps.
Mme Virginie Duvat a dit, dans sa conclusion, que nous avions peut-être aujourd’hui l’opportunité de régler des problèmes environnementaux et sociaux. Certes, mais j’estime que nous avons perdu beaucoup de temps à tergiverser. Nous aurions pu le faire depuis très longtemps, et c’est précisément parce que nous n’avons pas su régler ces problèmes que les territoires d’outremer sont aujourd’hui dans une situation dramatique.
Je tiens à ce propos à excuser l’absence des députés ultramarins du groupe SRC, dont l’absence pourrait surprendre. Ils ont passé beaucoup de temps à débattre du texte sur la biodiversité et ont dû retourner chez eux.
J’en reviens à la question que je souhaite poser à Mme Virginie Duvat.
Il est très difficile de changer nos habitudes. Les populations commencent-elles, dans les territoires ultramarins, à admettre qu’il va falloir changer certaines de leurs pratiques ? Elles ont besoin de manger, de vivre. Sont-elles aujourd’hui en capacité de changer leurs habitudes ? Si oui, avec quels moyens, quel financement peut-on agir ?
Monsieur Luc Bas, vous avez parlé des effets pervers de certains financements sur la biodiversité. Nous en sommes convaincus. J’aimerais que vous nous indiquiez ceux qui sont véritablement défavorables à la biodiversité, dans un contexte où le changement climatique est important.
M. Alby Schmitt a précisé que 80 % de la biodiversité se trouvait dans les territoires ultramarins, mais que les financements n’étaient pas toujours à la hauteur. Il a souligné les actions menées par le ministère en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. J’aimerais savoir s’il y a des perspectives d’évolution dans le contexte économique et financier que nous connaissons.
M. Christophe Priou. J’hésite à intervenir au nom des forces réactionnaires, qui n’ont pas forcément voté la loi sur la biodiversité… (Murmures divers)
M. Philippe Plisson. C’est un aveu !
M. Christophe Priou. Notre collègue Philippe Plisson lui-même était un peu gêné par certains amendements : sur l’ONF et la chasse notamment, il a parfois une position très radicale-socialiste ! (Sourires)
M. Alby Schmitt a parlé de décisions importantes, comme la protection de 55 000 hectares de mangrove et de 75 % des récifs coralliens. La protection des mangroves relève de la politique du Conservatoire du littoral et celle des récifs coralliens du futur plan d’action quinquennal de l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR). Ces actions vous semblent-elles suffisantes ? Entre action et décision, ne craignez-vous pas des pertes de charge qui semblent fréquentes, au-delà de la collecte d’eau ?
Un rapport sur le climat de la France au XXIe siècle, consacré à l’étude du niveau de la mer, livre des projections climatiques dans les régions d’outremer. Quelles leçons peuvent être tirées de ces données, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’intensité des cyclones tropicaux ?
M. Yannick Favennec. J’ai trois questions à poser aux intervenants, que je remercie pour leurs exposés.
Quelles sont précisément les conséquences du changement climatique sur les populations humaines et sur les économies des départements et territoires d’outremer ?
Comment, selon vous, réduire la vulnérabilité des cultures et des activités humaines ?
Enfin, comment la COP21 pourrait-elle apporter des réponses concrètes concernant ces territoires ?
Mme Sophie Errante. Le climat est, à plus d’un titre, l’un des grands déterminants en outremer. Les outremer sont aussi des laboratoires majeurs de mise en œuvre de solutions d’adaptation, notamment pour la survie de leur population. Pour avoir vécu en Polynésie et dans l’océan Indien, je comprends très bien et je partage l’intervention de Mme Maina Sage.
Quelle place, selon vous, devrait être consacrée aux expérimentations et aux réussites, qui pourraient être valorisées lors de la COP21, afin de les partager avec d’autres territoires, sachant que nous allons accueillir le monde entier ?
Ma seconde question touche à la santé environnementale. Vous avez évoqué les épidémies dues à des espèces invasives et redoutables, telles que le chikungunya, pour l’homme, mais aussi pour l’agriculture, et donc, les productions vivrières. On se sent également perdu devant la multiplicité des actions. Ne devrait-on pas chercher à hiérarchiser les urgences, afin de flécher au mieux les moyens du Fonds vert pour le climat et les autres outils financiers ? Que proposez-vous dans ce sens ?
M. Jean-Pierre Vigier. La lutte contre le changement climatique est aujourd’hui un enjeu majeur. La France se positionne au cœur de cette problématique avec l’organisation de la COP21.
Les territoires d’outremer ont une diversité unique en matière d’espèces et d’écosystèmes et – j’irai encore plus loin – d’une importance cruciale pour la biodiversité mondiale. Or celle-ci est clairement en danger.
Comment voyez-vous l’avenir de la biodiversité dans les territoires ultramarins à court terme ?
Comment voyez-vous, toujours à court terme, l’évolution du changement climatique sur ces zones ?
Avez-vous pu identifier des instruments ou des plans d’action afin de lutter plus efficacement contre les effets du changement climatique outremer ?
M. Jacques Kossowski. L’Union européenne compte neuf RUP, qui font partie intégrante de son territoire, et vingt-cinq territoires d’outremer qui lui sont associés. Les RUP et les PTOM abritent une biodiversité d’une richesse et d’une variété extraordinaires.
L’ensemble de ces zones est particulièrement menacé par le changement climatique. J’aimerais savoir comment les RUP et les PTOM peuvent agir conjointement en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Est-il normal de laisser nos populations dans l’expectative, en leur disant qu’on ignore s’ils seront encore là en 2100 ?
Enfin, qui contrôle les financements, afin d’être sûr qu’ils aillent où il faut ?
M. Jean-Marie Sermier. En tant qu’orateur du groupe UMP sur la loi biodiversité, je me dois de rappeler qu’on ne confond pas une loi sur la préservation de la biodiversité et une loi pour la chasse aux voix, chez les écologistes, pour un scrutin local ! (Exclamations diverses)
Dans les années soixante-dix, un météorologue disait que le simple battement d’aile d’un papillon déclenchait une tornade de l’autre côté du monde. Cette phrase est aujourd’hui devenue une réalité. Le dérèglement climatique est partout, et s’il est très présent dans les îles, c’est qu’il y a eu un accroissement important des émissions de gaz à effet de serre. La capacité maximale sera de 2 900 gigatonnes pour rester en dessous des deux degrés de stockage. Nous en sommes à 2 040 ou 2 100 tonnes. Il nous reste donc peu de temps pour réagir. La non-réaction des pays développés ou des pays en voie de développement engendre des problèmes dans des pays lointains.
Il ne suffit pas de s’inquiéter, il faut aussi réagir. L’une des réactions les plus évidentes et les plus efficaces consiste à éviter de rejeter du CO2 dans l’atmosphère. Pour cela, il convient de trouver des moyens en matière de développement économique et des solutions respectueuses en matière d’environnement. La filière nucléaire française fait partie de ces moyens. Il est important, aujourd’hui, de reprendre les choses en main pour qu’elle devienne leader au niveau mondial.
M. Jacques-Alain Bénisti. Je repense à la catastrophe d’hier. Que ce serait-il passé hier si l’avion s’était crashé sur les zones très urbanisées aux alentours de Paris ?
M. François-Michel Lambert. Sur une centrale nucléaire, par exemple… (Murmures)
M. Jacques-Alain Bénisti. Cette question pourrait faire l’objet d’un débat au sein de notre Commission.
J’en reviens à la Guyane française, et plus globalement à toute la zone amazonienne, en raison de sa situation géographique et de ses spécificités environnementales, économiques et sociales.
Nous savons tous que ce territoire est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Je citerai les ressources, l’eau, l’énergie, les risques naturels, l’érosion, la submersion marine, les inondations, les mouvements de terrain, les cyclones, l’élévation du niveau de la mer, la biodiversité terrestre et marine, avec le blanchiment des coraux, l’émergence d’espèces envahissantes nouvelles et de maladies potentielles, l’agriculture, la pêche, l’urbanisme ou encore la santé.
Il est donc essentiel de connaître les impacts et de les anticiper en planifiant des mesures d’adaptation, afin de réduire la vulnérabilité du territoire et surtout les effets des activités humaines dans une région marquée par une forte croissance démographique.
Fort heureusement, les études sont unanimes sur le diagnostic. Les systèmes naturels seront affectés avec des conséquences plus ou moins marquées pour la gestion et l’aménagement du territoire guyanais. Nous savons tous maintenant que la température moyenne devrait augmenter de deux à six degré d’ici à 2080 en Guyane, avec une intensification des saisons sèches. Conséquence attendue : des arbres qui poussent moins vite et qui meurent en bien plus grand nombre.
De nombreuses réflexions ont été menées depuis deux décennies. Mais force est de constater que les initiatives d’adaptation face aux effets du changement climatique sont extrêmement restreintes. Quelles sont les mesures concrètes envisagées aujourd’hui ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. M. Alby Schmitt a indiqué qu’il y avait dans les outremer dix-sept organismes œuvrant dans le domaine de la biodiversité. Nous avons longuement débattu à propos de la création de l’Agence française pour la biodiversité et des organismes qui devaient intégrer cette agence. Pourquoi les organismes qui œuvrent dans ce domaine dans les outremer ne sont-ils pas intégrés à l’Agence française pour la biodiversité ?
Mme Virginie Duvat. Les outremer présentent une immense diversité et de très fortes spécificités qui les distinguent les uns des autres, que ce soit entre eux, mais aussi à l’échelle d’un seul et même territoire. Répondre à toutes vos attentes dans un temps court est donc difficile. Cela étant, je comprends que cela puisse être frustrant pour vous de ne pas avoir d’indications précises, vous le signaliez, monsieur Claireaux, à propos de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous pouvez avoir des attentes portant sur un territoire en particulier et vous sentir un peu frustré par ce type d’exposé quand on doit aborder, dans un temps contraint, deux thèmes – impacts et mesures d’adaptation – sur un ensemble de territoires.
Ce doit être d’autant plus frustrant qu’on vous dit que l’adaptation doit être mise en œuvre à l’échelle locale, qui est la seule bonne échelle, l’adaptation devant être spécifique à la configuration des territoires, à leurs forces et faiblesses, ainsi qu’aux impacts du changement climatique, eux-mêmes tout à fait spécifiques en termes qualitatifs et quantitatifs. Sachez en tout cas que les éléments d’information disponibles pour chacun des territoires sont contenus dans le rapport au Premier ministre et au Parlement, que j’ai eu la chance de coordonner fin 2012. Je peux vous en faire parvenir des exemplaires en nombre suffisant.
Vous voulez savoir très précisément quels sont les impacts du changement climatique sur ces territoires. Vous voulez connaître les chiffres et les impacts de ce changement sur les populations et sur les secteurs d’activité économique. À tous ceux qui se posent ces questions, je veux répondre ici : il faut accepter qu’il existe encore un certain nombre d’incertitudes scientifiques sur les valeurs relatives à des projections futures. La science est mobilisée : le changement climatique est l’une des questions qui mobilisent le plus les scientifiques, au point de générer des reconversions chez les chercheurs. Mais veuillez, je vous en prie, accepter les incertitudes sur les chiffres. Parce que c’est ainsi. Les scientifiques doivent être honnêtes et faire part de leurs incertitudes. Nous organisons des colloques et des programmes de recherches spécifiquement consacrés à l’incertitude.
Cela étant, nous connaissons les tendances et nous avons aujourd’hui des faits avérés depuis assez longtemps pour savoir exactement dans quel sens doit aller la décision et dans quel sens doit se faire l’action, publique ou privée, qui de toute façon devra être participative et collaborative.
Je le répète, acceptons l’incertitude sur certaines données chiffrées. Ainsi, la valeur d’élévation du niveau de la mer ne doit aucunement paralyser l’action. Vous l’avez tous dit, il est déjà tard pour agir. Nous sommes acculés à mettre en œuvre, aujourd’hui, des politiques lourdes, ambitieuses et intégrées, parce qu’un certain nombre de choses n’ont pas été faites correctement. C’est en ce sens que je vous disais tout à l’heure que le changement climatique devait être vécu comme une opportunité, une opportunité de bien faire ce que l’on a mal fait jusqu’à présent. De toute façon, nous n’avons plus le choix : il faut agir, car nous sommes dans une situation d’urgence.
Cela étant, la connaissance scientifique progresse à un rythme soutenu. J’ai moi-même beaucoup travaillé sur les Tuamotu. Il faut savoir qu’il y a différentes temporalités à envisager : entre la temporalité de la science et la temporalité de l’action, il y a une jonction toujours plus forte à établir. Ce qui est certain, c’est qu’il faut des solutions adaptées localement, qui visent à renforcer la résilience des écosystèmes et des sociétés, pareillement malmenés par la mondialisation dans leurs fondements propres. C’est ce qui crée aujourd’hui des situations difficiles.
J’en viens à la première question sur le caractère plus ou moins intégré des acteurs, des financements, et sur la coopération régionale. Je suis spécialiste des îles tropicales, dans les outremer français, mais aussi dans les Maldives, Kiribati et ailleurs : en matière de recherche, nous souffrons à l’évidence d’un manque d’intégration des initiatives mises en œuvre, d’un manque d’instrumentalisation de ces territoires qui permettrait de mieux connaître, de mieux enregistrer, de manière plus précise, les changements environnementaux qui les concernent. Ce sont des territoires dans lesquels il y a beaucoup de mouvements : des mouvements de populations, des mouvements financiers, des investissements opportunistes. Il y a souvent une très forte discontinuité, dans le temps, des actions menées, et, globalement, un degré de collaboration, de coopération, lui aussi très discontinu et souvent insuffisant, avec des moyens financiers parfois extrêmement aléatoires.
Ajoutons que ces territoires sont parfois pénalisés par les modalités d’attribution des financements. Je me bats en Polynésie, où j’ai un programme de recherche, pour intégrer dans nos équipes françaises des chercheurs australiens, néo-zélandais ou américains, parce que ces gens-là vivent dans le Pacifique. Il s’agit de pays extrêmement puissants, qui déploient des moyens colossaux en termes de recherche. Pourtant, un certain nombre de financements publics français nous interdisent de faire bénéficier de nos financements des chercheurs étrangers, alors que ce serait nécessaire pour qu’une véritable collaboration puisse exister.
Pour ma part, j’échappe à la plupart de ces difficultés. En tant que membre du GIEC, j’ai la chance d’œuvrer dans le cadre d’une énorme tribune internationale qui, sur le plan scientifique, permet de brasser les idées, d’échanger, de construire. Cela étant, vous avez souligné un point important : il y a une discontinuité, un manque de cohérence des actions ; il y a, dans certains territoires, une rotation des personnels en charge des dossiers, qui fait que l’on ne revoit jamais les mêmes personnes, qui savent dès le départ qu’elles ne vont pas rester longtemps, souvent pas plus de deux ans. De notre côté, nous avons des programmes de recherche sur trois ou quatre ans et nous prévoyons de faire des retours vers les acteurs aux différents échelons de la décision publique, et nous nous apercevons qu’ils ont disparu en cours de route… C’est un problème de fond sur lequel il me semble crucial d’avancer même si, actuellement, je ne vois pas comment faire concrètement.
J’en viens à l’intervention, très riche, de Mme Maina Sage. Je suis moi-même particulièrement attentive à la situation des atolls. En termes de résultats quantitatifs des études produites, aujourd’hui, il faut accepter qu’elles ne puissent pas être optimales. C’est déjà magnifique de pouvoir dire qu’entre 1950 et 2009, l’élévation moyenne du niveau de la mer en Polynésie française, à Tahiti, a été de 3 millimètres par an en moyenne, et comprise entre 2,5 et 2,9 millimètres par an dans certains atolls des Tuamotu-Gambier. Il y a quelques années seulement, on ne connaissait pas ces chiffres.
Au demeurant, ces petites îles concentrent tellement l’attention de la communauté scientifique que, quand on me demande des valeurs chiffrées pour les littoraux français, à Marseille ou à La Rochelle, je ne suis pas capable de répondre aussi précisément que pour la Polynésie française. C’est bon signe : cela montre que les équipes spécialistes de ces questions sont aujourd’hui très fortement mobilisées sur les petites îles, parce qu’on sait que, comme l’Arctique et les déserts, elles font partie des territoires en première ligne face aux impacts du changement climatique, et que ces impacts vont frapper très fortement les populations et leur culture. Cela touche à des questions identitaires, à des questions de survie.
Bref, on fait ce qu’on peut, on essaie d’avancer le plus vite possible. Mais soyez rassurée, madame Sage : ces territoires sont de plus en plus au cœur des programmes de recherche, et ces programmes obtiennent des financements.
Vous me demandez si vos atolls seront sous l’eau dans vingt ans. J’ai écrit un ouvrage intitulé Ces îles qui pourraient disparaître et je serai ravie de vous en envoyer un exemplaire. Il faut être très conscient des menaces qui pèsent sur ces territoires, mais en même temps fortement convaincu que le catastrophisme conduit à des erreurs en termes de décisions. Je pense à ce qu’il s’est passé en Papouasie Nouvelle-Guinée où les populations sont venues à la hâte vers Bougainville, suite à des submersions majeures, et sont, parce qu’elles n’avaient plus de terres, tombées dans une misère effroyable. Nous le savons, il ne faut pas agir trop vite. Les îles composant ces atolls ne vont pas disparaître au cours des prochaines années.
Il n’y a pas qu’une seule suite de l’histoire, il y a des trajectoires insulaires extrêmement diversifiées et il y aura un certain nombre d’histoires futures différentes les unes des autres, notamment pour les atolls. Certains de mes collègues étaient sur le terrain, en Polynésie, sur l’atoll de Mataiva, après le passage récent de la dépression tropicale Niko. Même si cette dépression n’était pas très intense, elle a apporté à Mataiva entre 5 et 30 centimètres d’épaisseur de sable et de débris coralliens sur une partie de l’atoll – par chance celle qui est habitée –, exhaussant par là même le niveau des côtes.
L’an dernier, j’étais à La Réunion, immédiatement après le passage du cyclone Bejisa. Ces événements extrêmes, dont l’intensité va augmenter dans le contexte du changement climatique, nous permettent de décrypter les processus, de procéder à des mesures et de voir concrètement ce qui se passe sur le terrain, le terrain de la nature, mais aussi le terrain des hommes. Qu’ai-je constaté à La Réunion ? Que dans certains secteurs, sur les côtes récifales, le cyclone Bejisa était à l’origine de l’accumulation de quatre-vingts centimètres à un mètre de sable et de débris coralliens. Autrement dit, le problème auquel devaient répondre les résidents, ce n’était pas l’attaque des parcelles, la destruction des ouvrages de défense, etc., mais le remplissage des piscines par des quantités phénoménales de sable et de débris coralliens ! Suite à cela, que peut-on dire aux acteurs ? D’engager des actions concrètes de recul stratégique, de relocalisation de ces quartiers urbains qui n’ont rien à faire dans la bande des cent mètres. Il existe des mécanismes de résilience naturels des côtes : les récifs coralliens, on le sait, nourrissent les côtes. Le plus dramatique lorsque ces événements surviennent, c’est que parfois des ouvrages de défense verticaux ont été construits qui empêchent le sable et les débris coralliens de s’accumuler, tant et si bien que les mécanismes naturels d’ajustement vertical des îles ne peuvent plus fonctionner !
Il faut donc avoir une vision des choses extrêmement nuancées et travailler à l’échelle locale, car les impacts sont très différenciés d’un endroit à un autre du littoral. Ce qui est certain, c’est que là où les pressions anthropiques sont faibles et où il existe une zone tampon naturelle permettant au système naturel de respirer, il y a, de fait, des mécanismes naturels de résilience extrêmement favorables aux sociétés humaines.
Aujourd’hui, il est crucial de parvenir très rapidement à réduire tous les impacts anthropiques qui ne font que démultiplier les impacts du changement climatique. Il est urgent et vital de réduire nos impacts directs sur les milieux naturels. Il y a parfois des configurations extrêmement dramatiques : je travaille sur Avatoru, à Rangiroa, qui fait partie des zones critiques, comme Malé, aux Maldives. Dans certaines zones urbaines, la densité peut atteindre un pic de 13 000 habitants par kilomètre carré, sur des îles qui culminent à quatre mètres. Mais pour l’heure, nous n’en sommes pas encore à devoir envisager la disparition de territoires et la migration de populations. Continuons à travailler et sachons que nous avons du temps devant nous – au moins quelques décennies. Bien entendu, il faut agir dès aujourd’hui, mais il faut agir graduellement, prévoir des ajustements. Il ne faut pas s’affoler et dramatiser trop vite : la précipitation dans l’action a des effets contreproductifs.
S’agissant des abris anticycloniques dans les atolls les plus peuplés des Tuamotu, dans lesquels les hauteurs de vagues connues pour les cyclones les plus intenses sont comprises entre douze et quinze mètres, il me semble très dangereux, pour ne pas dire irresponsable, de ne pas envisager, là où on ne pourra pas évacuer la population, la construction d’abris. L’affaire de la route du littoral à La Réunion est d’une tout autre nature.
Pour répondre à la question très précise de Mme Geneviève Gaillard, oui, les populations sont de plus en plus sensibilisées à la nécessité de changer leurs pratiques. J’ai, sur le terrain, des entretiens avec les populations, qui contribuent à produire les connaissances dont nous disposons car elles en détiennent une partie importante. Elles sont sensibilisées, en particulier à travers deux types d’impacts. Dans certaines zones, elles souffrent d’une érosion côtière forte, qui parfois s’accélère. Elles souffrent aussi de submersions marines qui ont des impacts extrêmement forts. Face à une situation dont elles savent de surcroît qu’elle va s’aggraver sous l’effet du changement climatique, elles réclament une intervention rapide, coordonnée, robuste et durable des pouvoirs publics, que ce soit en Polynésie française ou à La Réunion. Après un cyclone, les particuliers ont un peu l’impression qu’on ne s’occupe pas assez d’eux. Ceux qui ont des moyens font intervenir des entreprises pour se doter d’ouvrages de défense massifs ; ceux qui n’en ont pas se demandent ce qu’ils vont pouvoir faire. Il y a une très forte inégalité dans les réponses et du coup, une incohérence dans les actions, ce qui constitue un facteur aggravant : la situation est devenue à ce point complexe dans certains sites que, le jour où l’on voudra agir correctement, il faudra commencer par nettoyer tout ce qui a été fait auparavant.
Sur les questions de santé publique, les populations sont également sensibilisées lorsqu’elles sont touchées, par exemple, par une crise forte de ciguatera, très probablement influencée dans un sens négatif par le changement climatique, ou quand elles ont du mal à trouver des ressources alimentaires à cause de modifications des températures des eaux océaniques et des courants comme El Niño dans le Pacifique. Il y a des moments où il est difficile de pêcher.
Oui, les populations sont déjà affectées. Mais comme nous, les scientifiques, elles sont incapables de mesurer avec précision la part du changement climatique dans les impacts qu’elles subissent, ceux-ci résultant d’une combinaison de processus : activités humaines, variabilité du climat tout à fait naturelle, qui a toujours existé – il y a toujours eu des cyclones et des épisodes El Niño – et qui n’a rien à voir avec le changement climatique.
M. Luc Bas. Je vais essayer de faire preuve de la même éloquence que Mme Virginie Duvat, en français… mais je n’entrerai pas trop dans les détails scientifiques.
Il est évidemment très important, pour une organisation comme la nôtre qui, par nature, travaille sur la base de faits établis, de toujours chercher à savoir mieux et plus. Mais parfois, la vérité commande de dire que l’on ne sait pas exactement ce qui se va se passer. Dans ce cas, que doit-on faire ? Cela m’amène à reprendre, en l’élargissant, la question de Mme Maina Sage.
Il y a des incertitudes, c’est vrai. Mais il y a une certitude : c’est le changement climatique et il aura des conséquences. Il n’y a que dans l’État de Floride, aux États-Unis, où l’on s’obstine à ne pas comprendre et où il est interdit d’utiliser l’expression « changement climatique » ! Une vidéo sur internet montre une discussion assez incroyable entre un sénateur et un fonctionnaire de l’État de Floride, que je vous invite à visionner : c’est tout à la fois très triste et assez comique.
Lorsque rien n’est certain, il est difficile de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde, et je suis assez étonné qu’il n’y ait pas dans la langue française une expression équivalente à no regret measures…
Mme Virginie Duvat. On peut très bien dire « mesures sans regret ».
M. Luc Bas. Très bien. Mais pour qu’une action soit sans regret, encore faut-il être sûr du bénéfice. Or il existe toute une série d’actions qui, même si le réchauffement climatique ne se produisait pas, auraient des effets bénéfiques immenses pour toute la société et les écosystèmes. Mais on ne les prend pas en compte, et c’est bien le cœur du problème. On en reste à des essais, des démarches ponctuelles.
Pour intégrer cette dimension, il faut un leadership. Votre Président a déjà montré qu’il pouvait y prétendre ; il va falloir accélérer un peu le rythme d’ici à la COP21, mais la France a l’opportunité de prendre ce leadership. En effet, à la différence d’autres pays européens comme le Royaume-Uni, l’Espagne ou le Portugal, la France est dans une situation unique en ce qu’elle est présente partout grâce à ses outremer. Du coup, vous avez une responsabilité globale en montrant ce que vous pouvez faire dans vos outremer et diffuser des bonnes pratiques dans les zones alentour.
Malheureusement, certains de vos schémas de développement ne constituent pas à proprement parler des modèles : ainsi, j’ai été surpris en découvrant que la population de La Réunion atteignait presque le million d’habitants, ce qui ne peut que poser de gros problèmes dans une île aussi petite. C’est toute la question de la croissance et de la poursuite de cette croissance.
Pour apprécier les utilisations des écosystèmes, il faut un accounting system, un système comptable qui prenne en compte non seulement les gouvernements, mais également les entreprises : l’UICN travaille actuellement avec le World Business Council for Sustainable Development – Conseil mondial des entreprises pour le développement durable – sur un protocole appelé Natural Capital – « Capital Naturel » – visant à développer une approche intégrée dans la gestion de l’entreprise. Pour l’instant, soyons honnêtes, 99 % des actions relèvent du simple « verdissement » : on fait un petit quelque chose à côté juste pour montrer qu’on est très vert. Mais c’est un essai : nous sommes très contents que le WBCSD soit avec nous et que le message commence à passer.
Autre aspect de l’intégration : quand il est question d’infrastructures « dures », bâtiments, routes, etc., ce n’est jamais vu comme un coût, mais comme un investissement. Mais sitôt qu’il s’agit de mesures en direction de la nature, qu’il faille protéger ou restaurer, c’est toujours considéré comme un coût !
Jean-François Lambert. Tout à fait !
M. Luc Bas. Encore faut-il avoir les bons moyens de mesure pour y voir un investissement, avec les bénéfices qui en découlent, et déterminer ceux qui en profitent.
Autant d’aspects qui sont au cœur de la problématique des outremer, mais également des discussions de la COP21, où nous attendons que les démarches dites nature-based solutions – solutions basées sur la nature – et ecosystem-based adaptations – adaptations basées sur les écosystèmes – soient réellement prises en compte. L’atténuation s’inscrit dans ces démarches. Nous ne prétendons pas que ce soient les seules réponses, mais elles doivent faire partie d’une solution hybride. Nous ne sommes pas des utopistes, mais force est de reconnaître qu’en écartant toutes les solutions « naturelles », ce sont autant d’opportunités que l’on néglige.
Un mot sur les subventions préjudiciables. Tout le monde sait où elles sont : les subventions pour le pétrole, dans l’agriculture… On sait que cela a des effets pervers et que cela nuit au combat contre le changement climatique, mais apparemment, certains acteurs ne l’admettent pas, ils refusent de changer et même de commencer à changer. La politique agricole commune a essayé de faire son « verdissement », avec quelques résultats : c’est une étape, mais on voit beaucoup de contorsions pour ne pas montrer que, certes, c’est vert, mais que, au final, toutes ces mesures ne jouent pas réellement en faveur de la biodiversité.
Il faut effectivement contrôler beaucoup plus le financement. Beaucoup de financements n’arrivent pas là où ils devraient arriver, les autorités locales de vos îles le savent bien. C’est un peu comme pour l’eau : beaucoup d’argent se perd dans le réseau ! (Sourires) Cela étant, il ne faut pas se focaliser exagérément sur cette dimension. En fait, ce n’est jamais une question d’absence de moyens : c’est souvent utilisé comme une excuse au niveau européen.
L’Europe va participer à la COP21 avec la première contribution du monde, puisqu’elle s’engage à réduire de 30 % ses émissions d’ici à 2030. C’est un chiffre élevé, mais qui doit être relativisé. Ainsi, nous avons réduit de 19 % exactement nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 ; on peut en déduire qu’il est possible de préserver la croissance tout en réduisant ses émissions. Mais il faut être honnête : un rapport de l’agence européenne de l’environnement, sorti il y a deux semaines, montre que si l’on prend en compte les émissions de GES liées aux produits que nous consommons, elles ont bel et bien augmenté. Ceux qui pensent qu’il faut changer notre manière de consommer comme les défenseurs des entreprises seront d’accord sur un point : l’industrie s’est délocalisée en Chine et en Inde, et avec elle les emplois et les émissions de carbone. L’argument peut donc être utilisé dans les deux sens… Normalement, qui dit développement dit création d’emplois : or si l’économie en Europe a doublé en volume en vingt ans, les emplois n’ont pas doublé. Cela doit amener à s’interroger sur la nécessité d’une approche intégrée, son financement et la manière de la mener à bien.
Enfin, le leadership doit s’entendre au niveau des collectivités régionales ou autorités infranationales, et non au niveau du ministre de l’environnement ou du Gouvernement national ou fédéral. C’est lorsque l’autorité infranationale est convaincue du bien-fondé de la démarche intégrée que l’on voit apparaître les premiers changements – on l’a vu dans certains pays. Une opportunité, une de plus, à ne pas négliger.
Quoi qu’il en soit, pour les îles, le recours aux solutions naturelles est toujours une bonne chose, que l’élévation du niveau des mers soit de cinq centimètres ou d’un mètre. Les retours sur investissement sont immenses par comparaison avec les coûts, mais on ne mesure pas vraiment les bénéfices que l’on en retire. L’UICN continuera d’agir pour promouvoir l’atténuation et faire la preuve que ces solutions intelligentes ont également un réel intérêt économique.
Un dernier mot à propos d’une grande opportunité – encore une – au niveau européen : des centaines de milliards d’euros seront bientôt mobilisés dans le plan d’investissement du président Juncker, qu’il va falloir utiliser le plus intelligemment possible. Or le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans a, entre autres responsabilités, celle de la coordination au service du développement durable. Nous travaillons à le convaincre de se comporter en visionnaire et à saisir cette opportunité pour ordonner son action politique.
M. Alby Schmitt. Dans la mesure où il y a autant d’outremer que de territoires, il n’y a pas une solution unique, standard, à appliquer en termes tant d’institutions que de projets ou de réalisations. L’expérimentation adaptée aux conditions locales est une idée qui doit prévaloir dans les outremer.
Il ne faut pas oublier que la biodiversité est également une richesse économique. Un seul exemple : aujourd’hui, 60 % des substances médicamenteuses ont pour origine des plantes terrestres. Les molécules actives de ces médicaments sont à 60 % d’origine terrestre. On ne sait ce qu’il en est pour le domaine marin ; mais l’AZT, qui a permis de soulager de nombreux malades du sida, n’aurait jamais vu le jour s’il n’y avait pas eu, pour produire cette molécule, une petite éponge des Caraïbes, malheureusement très menacée.
Toutes les actions menées dans les outremer doivent répondre à une logique gagnant-gagnant, gagnant pour la métropole, gagnant pour les outremer, car nous avons tous intérêt, métropole et outremer, à avancer dans ce domaine. « Gagnant-gagnant », cela signifie que des efforts doivent aussi être faits du côté des outremer. En ce qui concerne l’eau, par exemple, sujet majeur, je suis inquiet lorsque je vois, sur un contrat de plan État-région (CPER), la répartition des financements : 3 millions d’euros pour les collectivités, 30 millions pour l’Union européenne et 13 millions pour l’État français. Il y a à l’évidence un déséquilibre.
Je suis également inquiet lorsque, dans le cadre de la conférence des RUP, la déclaration finale, à aucun moment, ne fait état de la Conférence de la Guadeloupe et de son message. D’autant que c’est dans ce même outremer que se sont tenues les deux conférences, à quelques semaines d’intervalle.
L’Agence française pour la biodiversité a, certes, été votée ici, à l’Assemblée, mais les discussions parlementaires sont loin d’être terminées. Aussi, m’apprêtant à parler de l’AFB, je vous prie de m’excuser d’anticiper sur la décision finale du Parlement.
Pour ma part, je vois clairement l’outremer comme le porte-étendard de la biodiversité française et l’AFB outremer comme le porte-étendard de l’AFB dans son ensemble. Car la biodiversité outremer parle aux citoyens français, elle fournit des exemples. On y voit concrètement ce qui peut être fait et l’AFB peut jouer un rôle majeur dans ce rééquilibrage entre métropole et outremer.
J’en viens à la rationalisation concernant l’ensemble des organismes qui interviennent outremer.
L’AFB peut être vue comme étant, en particulier dans les outremer, la colonne vertébrale de l’action publique dans le domaine de l’eau et de la biodiversité, ce à partir de quoi on va pouvoir construire, la matrice solide à laquelle on pourra se raccrocher. Parallèlement à cela, le projet de loi en cours de discussion prévoit des outils précisément destinés à aider à construire dans les outremer, autour de cette colonne vertébrale, un ensemble qui donnera plus de cohérence à l’action publique, qui simplifiera le paysage de l’action publique.
Enfin, aucune action ne peut se décider de Paris ; elle doit se faire en pleine intégration, en plein partenariat avec les acteurs locaux, que ce soient les collectivités, les établissements, les organismes qui travaillent déjà sur ces sujets.
S’agissant toujours de l’AFB, la possibilité de créer des délégations territoriales dans les outremer a été ouverte, ainsi que la possibilité de passer par des établissements publics de coopération environnementale (EPCE) regroupant dans le cadre d’une même structure, autour d’une même table du conseil d’administration, l’État, les collectivités d’outremer et leurs établissements. Ce sera un outil intéressant pour mutualiser l’action de l’ensemble des intervenants sur l’outremer.
Au sein même de l’AFB, un certain nombre d’organismes vont être mutualisés, en particulier l’Agence des aires marines protégées (AAMP), l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), etc.
La possibilité de rattachement sera un deuxième outil : je pense au rattachement des parcs nationaux à l’AFB, mais ce pourra être le cas d’autres organismes qui existent et coopèrent déjà. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCSF), par exemple, travaille beaucoup avec l’ONEMA et l’AAMP à créer des brigades de police au niveau local. On peut donc imaginer, sur le plan local, des rattachements de ce type. Mais d’autres outils sont prévus pour faire de l’AFB outremer le fédérateur de l’ensemble des actions publiques dans ces territoires.
Pour ce qui est du financement, la mutualisation obtenue au sein de l’AFB doit permettre de mieux répartir, en fonction des besoins, les ressources propres de l’établissement. Aujourd’hui, nous avons des politiques un peu orphelines ou insuffisamment dotées, particulièrement dans le domaine du marin et de la biodiversité outremer – la politique du marin s’appliquant par nature beaucoup outremer. L’une des missions de l’AFB consistera à réorienter, à rendre des arbitrages internes pour que les moyens humains et financiers aillent là où il y a le plus de besoins.
On peut aussi imaginer des économies d’échelle dès lors qu’on aura rationalisé l’ensemble des structures. Sans oublier d’autres dossiers sont en cours, dont ceux concernant le Programme d’investissements d’avenir (PIA) sur la biodiversité et sur l’eau ; le plan Junker, sur lequel des demandes importantes ont été faites, s’agissant notamment de l’eau en outremer, où les besoins se chiffrent en milliards d’euros ; certaines actions enfin pourront se financer grâce à des prêts, en particulier du côté de la Caisse des dépôts et consignations.
Dernier point, les financements européens, dont on espère qu’ils pourront être aussi progressivement orientés vers la biodiversité, comme ils le sont vers l’eau, ce qui n’est pas toujours le cas pour l’instant, dans la mesure où les fonds ont tendance à se concentrer sur les macro-projets.
L’AFB devra professionnaliser tout ce qui touche aux demandes de financements internationaux ou européens. Il faut savoir que les RUP françaises réussissent moins au niveau de l’Europe que les RUP non françaises. Les PTOM, a contrario, fonctionnent plutôt mieux côté français… Il faut vraisemblablement mutualiser ces expériences dans le domaine du portage de projets et des demandes de financements pour qu’au final, nous soyons tous gagnants et que nous améliorions notre taux de succès auprès de Bruxelles…
Une mission interministérielle a lieu en ce moment, en lien avec le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAER), sur tous les sujets concernant l’eau dans les DOM et à Saint-Martin. Cette mission aboutira à la publication d’un rapport au début du mois d’avril. Une réflexion profonde doit être menée sur l’organisation des services de l’eau.
Des chiffres seront sans doute avancés sur les besoins de financement des départements d’outremer, non seulement pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne – c’est là où le bât blesse au niveau national –, mais également pour donner aux outremer un niveau de qualité et de services en matière d’eau et d’assainissement qui corresponde à ce que l’on peut attendre d’un État développé comme la France au XXIe siècle.
Des efforts seront sans doute demandés aux outremer. J’ai vécu un certain temps à La Réunion et j’y ai travaillé sur la question de l’eau. Avec cette mission, je découvre que des équipements sur lesquels on a investi il y a vingt ans, sont aujourd’hui dans un état qui n’est pas celui d’un équipement normalement entretenu. Il y a donc des efforts à faire de chaque côté.
On a également évoqué la réalité des actions. Je vous invite à examiner chaque année, au premier jour de la Conférence environnementale, le compte rendu sur l’état d’avancement des feuilles de route précédentes, qui sont fournies régulièrement au Conseil national de la transition écologique (CNTE), et qui font le point sur les engagements pris. Les engagements de la ministre en Guadeloupe font également l’objet d’un suivi et d’un rapport à l’adresse des parties prenantes.
Pour ce qui est de la biodiversité en outremer, nous sommes loin d’être en retard. Aujourd’hui, 30 % de la surface, au niveau terrestre, est sous protection forte. Au niveau maritime, beaucoup d’actions concrètes sont également menées, dans la Mer de Corail, par exemple, et bientôt aux Marquises. Les choses avancent : si l’objectif de 55 000 hectares de mangrove protégés a été inscrit dans la loi, c’est parce que le précédent – 35 000 hectares – a été largement atteint, et dès 2015.
L’aménagement de la route du littoral est clairement une opération d’intérêt public majeur et un impératif de sécurité. Sept milliards d’euros sont financés par l’Union européenne. La première question, dans le cas d’un important financement européen, consiste à savoir comment on va le dépenser le plus rapidement possible. On identifie alors les deux ou trois projets majeurs sur lesquels on va pouvoir investir. Du coup, on privilégie surtout des opérations lourdes alors qu’il existe des projets d’infrastructures environnementales qui, en termes de retour pour le territoire au niveau de l’emploi et du financement, sont tout aussi intéressants, et plus intéressants encore en termes de retours secondaires. Ainsi, à Mayotte, la mise en conformité de l’assainissement représente 700 millions d’euros : pour une île qui fait quelques centaines de kilomètres carrés et compte 200 000 habitants, c’est un investissement énorme. Imaginons que l’on finance ce projet très rapidement : cela représente un emploi par tranche de 100 000 euros par an. Autrement dit, chaque fois qu’on investit 100 000 euros par an dans l’assainissement, c’est un emploi pour les travaux et 0,1 emploi définitif dans les services. Au-delà, je vous garantis que l’impact sur le lagon de Mayotte, qui est un des plus beaux lagons des outremer français, sera nettement positif, avec des retombées sur le tourisme et sur la qualité de vie autrement plus importantes que pour des infrastructures telles qu’on les conçoit habituellement.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je remercie nos trois invités d’avoir participé à cette passionnante table ronde et aux échanges fructueux que nous avons eus.
21. Table ronde sur les objectifs du développement durable (1er avril 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il y a quelques semaines, nous avons pris la décision d’organiser une table ronde sur les Objectifs du développement durable (ODD) qui prendront le relais, fin 2015, des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ces derniers ont été fixés par la Déclaration du millénaire du 8 septembre 2000 que les membres des Nations unies se sont engagés à réaliser : éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Un processus de consultation est en cours pour définir les ODD. Leur liste définitive sera arrêtée lors du sommet spécial sur le développement durable qui se tiendra à New York en septembre 2015.
La France est engagée au plus haut niveau dans la définition de ces objectifs et de l'agenda de leur mise en œuvre. Par ailleurs, la société civile a pu contribuer à la réflexion sur la définition de la position française à travers les Assises du développement et de la solidarité internationale qui ont eu lieu fin 2012 - début 2013 et qui ont donné lieu à la publication d'un document sur l'agenda post-2015.
La table ronde organisée aujourd'hui est centrée sur les priorités que notre pays entend défendre dans le cadre de la définition des ODD : renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; accès universel à l'eau potable et à l'assainissement ; accès à une éducation de qualité pour tous tout au long de la vie ; promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ; accès de tous à la santé, notamment grâce à une couverture sanitaire universelle ; accès de tous à un travail décent, à une énergie durable, à un cadre de vie décent, et connecté aux services, aux infrastructures et aux biens culturels ; préservation des biens publics mondiaux ; promotion d'une gouvernance démocratique.
En votre nom, j’ai le plaisir d’accueillir M. Serge Michailof, consultant, ancien directeur à la Banque mondiale et à l'Agence française de développement (AFD), M. Pierre Jacquemot, président du Groupe de recherche et d'échanges technologiques (GRET), chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), ancien ambassadeur en République démocratique du Congo (RDC) et au Ghana, M. Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'AFD, et M. Frédéric Bontems, directeur du développement et des biens publics mondiaux à la direction générale de la mondialisation au ministère des affaires étrangères et du développement international.
Je vous propose de commencer notre table ronde en écoutant les intervenants avant de passer aux questions des groupes politiques et des députés.
M. Frédéric Bontems, directeur du développement et des biens publics mondiaux à la direction générale de la mondialisation au ministère des affaires étrangères et du développement international. Au préalable, je précise que mes fonctions au ministère des affaires étrangères et du développement international me conduisent à coordonner l’équipe qui négocie les ODD pour la France.
On nous avait demandé d’intervenir sur les ODD, analysés sous l’angle du développement durable et de l’aménagement du territoire. Dans le temps de quelques minutes qui m’est imparti, je vais essayer de vous livrer les quatre idées qui me semblent les plus importantes.
Cet agenda des ODD qui prendra le relais des OMD en 2015 innove sur trois points : il est universel, transversal et transformatif. Son caractère universel implique que, contrairement aux OMD, il concerne tous les pays du monde : les États-Unis ou la France comme le Bénin ou le Burkina Faso. Son caractère transversal signifie qu’il intègre tant le domaine du développement social et économique que celui de l’environnement et du climat ; il s’inscrit dans la filiation des conférences des Nations unies sur le développement durable, Rio et « Rio + 20 ». Enfin, cet agenda se veut transformatif, c'est-à-dire qu’il ambitionne de changer les modèles économiques des sociétés, en encourageant des modes de production différents.
Cet agenda a une double nature. D’un côté, il s’agit d’une sorte de charte qui exprime une vision partagée de l’avenir collectif que nous voulons dessiner pour tous les pays et il est donc plus déclaratif que normatif. Personne n’imagine que tous les gouvernements du monde, quelle que soit leur orientation politique, auront comme priorité de mettre en œuvre l’ensemble du programme défini par l’agenda post-2015. De l’autre côté, cet agenda définit les objectifs de la communauté internationale du développement, c'est-à-dire de l’ensemble des agences bilatérales, multilatérales, généralistes ou sectorielles qui interviennent en matière de développement. Il a ainsi une dimension plus précise puisqu’il va organiser la politique de solidarité internationale et de développement pour les quinze ans à venir.
Comment la France s’est-elle organisée pour participer aux travaux de cet agenda ? Nous avons travaillé dans le cadre d’un groupe interministériel comprenant le ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) mais aussi le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) qui a joué un rôle extrêmement important, assistant à toutes les sessions de négociations à New York. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le Président, la société civile a été impliquée à travers les Assises du développement et de la solidarité internationale. Tout au long des négociations, nous avons aussi organisé de multiples rencontres et discussions avec les associations et la société civile, afin de faire valoir leurs positions.
Lors de ces négociations, nous avons été animés par un double souci : défendre des objectifs ambitieux et qui soient conformes à nos grandes orientations nationales. Nous voulions intégrer la dimension climatique qui est présente à la fois à travers un objectif dédié et une prise en compte transversale dans tous les objectifs. Nous voulions aussi retenir tous les aspects du développement durable, notamment les modes de consommation et de production durables, la protection des écosystèmes, l’économie circulaire, etc. Cet agenda devait néanmoins rester conforme aux grandes orientations que la France suit pour elle-même : les visées universelles ne doivent pas entrer en contraction avec nos projets nationaux. Il me semble que nous y sommes très largement parvenus.
L’aménagement du territoire n’est pas pris en compte en tant que tel dans l’agenda mais il est plutôt envisagé sous l’angle de l’égalité d’accès aux services publics, particulièrement à l’eau et à l’énergie. On le retrouve également à travers le thème de la préservation des écosystèmes terrestres, notamment dans l’ODD n° 15. À New York, le débat sur le rôle des collectivités et autorités locales a été complexe : d’une part, nous ne voulions pas opposer les villes et les campagnes ; d’autre part, nous étions face à 190 pays dont les organisations territoriales et les structures de pouvoir sont extrêmement variées. Nous sommes parvenus à une rédaction qui n’est pas forcément très heureuse, celle de l’ODD n° 11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et soutenables. » Quant à l’ODD n° 16, il porte sur les aspects de gouvernance, de droits de l’homme, d’État de droit, et l’une de ses cibles énonce la nécessité de « faire en sorte que le processus de prises des décisions soit souple, ouvert à tous, participatif et représentatif à tous les niveaux. » Les collectivités territoriales sont directement concernées.
Où en sommes-nous et quelle est la suite des travaux prévus ? En juillet dernier, dans le cadre du groupe de travail des Nations unies, nous avons adopté une liste de dix-sept objectifs qui sont associés à quelque 170 cibles plus précises. C’est beaucoup. Quand on négocie à 190 pays, il est toujours plus facile d’ajouter que de retrancher. En tant que négociateurs français, nous avons le sentiment que ces objectifs reprennent 90 % ou 95 % de nos souhaits et ne contiennent rien d’insupportable. Nous sommes donc plutôt satisfaits du résultat. Nous sommes actuellement engagés dans un travail sur les indicateurs associés à ces objectifs, qui va se poursuivre jusqu’au début de l’année prochaine dans le cadre d’un groupe de travail des Nations unies auquel la France participe très activement. Il reste quelques débats sur les cibles associées aux indicateurs, mais ils devraient être relativement limités. En septembre prochain, devrait donc être adopté un agenda très proche de sa version provisoire actuelle.
M. Pierre Jacquemot, président du GRET, chercheur associé à l'IRIS. C’est en ma qualité de président du GRET, une organisation non gouvernementale (ONG) française spécialisée dans le développement, que je vais m’exprimer ici. Je vais exposer le point de vue partagé par les organisations françaises émanant de la société civile. Parmi les documents qui vous sont distribués, vous trouverez un texte de Coordination Sud, l’organisation qui « chapeaute » les ONG françaises impliquées dans les questions internationales.
En premier lieu, je voulais indiquer notre appréciation générale du travail effectué sur les ODD. Nous saluons le travail de consultation tout à fait exceptionnel qui a été mené depuis deux ans. Nous saluons aussi le choix de faire des ODD un enjeu universel, sachant que les pays du Nord sont, eux aussi, concernés par les inégalités. Dans les propositions qui sont faites, le secrétaire général des Nations unies insiste sur la dignité. Davantage que la lutte contre la pauvreté qui est la thématique générale, la conquête de dignité nous paraît être un enjeu extrêmement fort.
En ce qui concerne l’ambition transformatrice des ODD, il faut signaler que les travaux effectués n’ont pas vraiment cherché à analyser la raison du creusement des inégalités dans le monde en général et dans chaque pays en particulier. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut s’interroger sur la capacité des seuls ODD à remédier aux inégalités flagrantes qui existent à l’échelle internationale comme à celle qui existe au niveau des pays ou des territoires.
Les ODD sont au nombre de dix-sept. D’aucuns, qui s’expriment notamment dans la presse anglo-saxonne, estiment que c’est beaucoup trop. Pour notre part, nous préconisons de les maintenir tels qu’ils sont. Si nous commençons à détricoter le dispositif, nous risquons de voir les uns ou les autres retirer les problématiques de genre, de climat ou autres, qui ne plaisent pas à tout le monde. Nous plaidons pour le maintien des dix-sept ODD tels qu’ils sont ainsi que des cibles qui leur sont associées.
Entre autres motifs de satisfaction, nous avons celui de retrouver des approches qui sont voisines de celles de la France sur les questions de développement : par le droit, par les socles de protection sociale, et par les territoires. Les droits humains, sociaux et économiques sont très présents dans les ODD, ce qui traduit une évolution qui nous semble tout à fait favorable et qui rejoint le travail qui a été effectué par le Parlement français avec l’adoption, en juillet dernier, de la loi sur le développement et la solidarité. L'approche par les socles de protection sociale, qui nous tient beaucoup à cœur, se retrouve dans plusieurs ODD et repose sur l’idée que, pour accéder aux biens publics, un minimum requis doit être garanti d’une manière ou d’une autre. Quant à l’approche par les territoires, elle laisse penser qu’il n’y a pas de formule universelle : il y a des approches universelles mais les options politiques et pratiques doivent être adaptées aux réalités locales selon le principe de l’appropriation.
S’agissant des thèmes, nous insistons sur ceux qui nous sont particulièrement chers : l’économie paysanne et familiale ; l’accès pour tous à l’éducation, à la santé, à l’eau potable et à l’assainissement ; la lutte contre le dérèglement climatique. L’économie paysanne et familiale, qui a fait l’objet de nombreux travaux l’année dernière, peut permettre la résorption du chômage rural. En outre, l’ensemble de la planète – en particulier les villes –, peut bénéficier de ses activités liées à l’alimentation. Dans les ODD actuels, on retrouve assez bien tous ces thèmes qui nous paraissent devoir être mis en exergue.
À chaque ODD ainsi qu’à leurs cibles sont associés des indicateurs de suivi. Ce travail extrêmement lourd et complexe ne sera pas terminé en septembre 2015 et il se poursuivra en 2016. À l’initiative de la France, des travaux avaient été conduits dans ce domaine, il y a quelques années. On ne peut fixer des objectifs sans prévoir un système qui permette de mesurer les performances des différents pays, au fil du temps.
La cohérence est une autre question clé. On ne peut pas avoir une politique agricole commune (PAC) qui diverge des préconisations que nous formulons à l’échelle internationale ou pour les pays pauvres. Il en va de même en matière de climat ou de commerce.
Venons-en à la question du financement. Pour réaliser les ODD entre 2016 et 2030, les besoins de financement sont absolument considérables : on parle de 2 à 3 trillions de dollars par an pendant quinze ans, sachant que l’aide publique internationale actuelle est de l’ordre de 140 milliards de dollars. L’écart est énorme. Ces estimations hypothétiques montrent qu’il va falloir mobiliser des ressources tout à fait exceptionnelles.
C’est d’abord aux États eux-mêmes, qu’il revient de trouver leurs propres sources de financement des ODD. Nous constatons qu’il existe une fâcheuse tendance à rechercher des ressources au plan international alors que d’énormes gisements pourraient être mobilisés grâce à des évolutions dans le domaine fiscal – moins de droits de porte et plus de droits internes –, à une meilleure utilisation des ressources venant des migrants, à une lutte efficace contre les fuites de capitaux. Selon les dernières statistiques, parues il y a quinze jours, l’Afrique perd 50 milliards de dollars par an du fait de la fuite des capitaux.
Si le développement durable doit d’abord être financé par des ressources domestiques, il est évident que celles-ci ne suffiront pas. Nous collaborons à la réflexion générale sur les mixages qui permettent d’associer diverses ressources – privées, publiques, issues de l’économie sociale et solidaire – afin de construire des modèles de financement adaptés. Les ressources publiques sont de plus en plus faibles, particulièrement en France : l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vient de classer notre pays parmi les mauvais élèves en matière d’aide publique au développement. Ces ressources publiques servent à garantir la prise de risque par des opérateurs privés, ce que l’on appelle l’effet de levier ou catalytique. Les réflexions sur la co-création de projets par le public, le privé et le monde associatif nous paraissent intéressantes.
Chaque année, lors de l’examen du volet relatif à l’aide publique de la loi de finances, vous insistez sur les garanties de redevabilité et de transparence. Comme à vous, ces garanties nous sont chères car nous considérons qu’il faut rendre compte de l’efficacité de ces ressources.
Enfin, il m’appartient de dire que les ONG françaises jouent un rôle majeur à la fois sur le terrain et par le biais de leurs nombreuses innovations. Or, en termes de financements, le sort qui leur est réservé n’est pas à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre.
M. Serge Michailof, consultant, ancien directeur à la Banque mondiale et à l'Agence française de développement. Je vais m’exprimer en tant que consultant individuel, chercheur associé à l’IRIS et enseignant, c'est-à-dire en tant que « parfait irresponsable » : je ne représente aucune institution. Depuis dix ans que j’ai quitté toute fonction officielle, je travaille sur la situation de pays fragiles, dont certains émergent d’un conflit alors que d’autres, comme le Niger dont je suis rentré hier matin, n’en sont toujours pas sortis. Je voudrais me placer dans la perspective des agences de développement qui observent la situation de ces pays qui nous posent de plus en plus de problèmes.
Les OMD de l’an 2000 ont beaucoup de défauts qui ont fait leur succès : définis au cours d’un processus descendant (top-down) et piloté par un comité très restreint de personnes du comité d’aide au développement et par Jeffrey Sachs, ils sont restés très simples et facilement compréhensibles. Ils ont une dimension systématique, c'est-à-dire qu’ils s’appliquent à tous les pays en voie de développement, quel que soit leur niveau effectif de développement.
Leur simplicité a fait leur faiblesse. Leur polarisation sur les seuls aspects sociaux est un produit de l’histoire : il fallait se faire pardonner les dérives de l’aide au développement des années 1980 et 1990, durant lesquelles des politiques d’ajustement structurel ont littéralement mis à bas les secteurs sociaux. Les OMD sont focalisés sur la lutte contre la pauvreté, un objectif très simple. Les principaux responsables sont identifiés, l’aide publique au développement étant un acteur et un responsable fondamental.
Dans ce contexte, les OMD ont été une véritable boussole : ils ont dirigé les flux de l’aide internationale vers certains sujets qui paraissaient majeurs à la collectivité internationale. Réalistes, ils n’ont rien de vœux pieux. En cela même, ils portent une assez lourde responsabilité dans la mesure où ils ont oublié certains éléments essentiels de la lutte contre la pauvreté. Ils ont oublié le rôle de la croissance économique, alors que celle de la Chine a permis à elle seule d’atteindre les objectifs. Ils ont oublié – ce qui est très grave à mon sens – que la lutte contre la pauvreté passe d’abord par le développement de la petite paysannerie, dans les pays les plus pauvres. Cet oubli a renforcé les distorsions en matière d’allocations d’aide publique au développement, au détriment de l’agriculture.
Si la focalisation des ODD sur les secteurs sociaux était louable, elle a créé des habitudes et des dépendances dans des pays qui sont incapables de soutenir l’effort budgétaire correspondant alors que l’aide internationale ne peut s’engager sur le long terme. Les OMD ont aussi écarté le problème des bidonvilles : l’afflux des nouveaux arrivants équivaut au nombre estimé des personnes qui en partent chaque année. Enfin, dans le secteur de la santé, ils ont complètement laissé de côté le problème de la maîtrise de la fécondité. Rappelons qu’au Niger, la population double tous les dix-huit ans.
Venons-en aux ODD. Je crains qu’à vouloir corriger les défauts précités et se fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux, nous n’en arrivions à une situation très problématique.
D’abord, à la place d’un processus descendant très simple et très critiquable, où une bureaucratie définit ex abrupto un nombre limité d’objectifs, nous avons une démarche participative qui, si je m’en réfère à internet, a impliqué un million de personnes, des centaines de groupes et d’institutions. Le mécanisme relève de l’usine à gaz. On voit bien que ce sont les bureaucraties des Nations unies, sous leur pire aspect, qui ont été ici aux manettes.
Ensuite, on a cherché à fusionner les OMD, les ODD issus de la conférence de Rio et d’autres objectifs, tout à fait nobles, qui se rapportent aux droits de l’homme. Résultat : la confusion règne ; des objectifs de nature microéconomique ou se référant aux biens publics mondiaux se mêlent à des vœux pieux et à des déclarations de bonnes intentions. On lutte à la fois contre l’insécurité routière, la pauvreté et le changement climatique.
La méthode choisie a conduit à une prolifération d’objectifs et de cibles – respectivement dix-sept et 169. On perd de vue les réelles priorités, en tout cas celles des pays qui me concernent. Le message, lui, perd de sa clarté : au-delà de cinq objectifs, on ne les a plus en tête, alors quand on en a dix-sept… Le manque de clarté, l’absence de priorités, le mélange d’objectifs de nature différente rendent pratiquement impossible le retour à un recoupement d’objectifs cohérent. Sur internet, j’ai trouvé au moins une dizaine de tentatives de recoupement des objectifs dont aucune n’est vraiment satisfaisante.
La volonté de fixer des objectifs identiques à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement économique, relève de l’utopie. La responsabilité, quant à l’atteinte ou non des objectifs, s’en trouve complètement diluée. Les concepteurs ont dû reconnaître qu’il fallait adapter les objectifs au niveau de développement économique, ce qui veut dire que les pays concernés risquent d’adopter une approche à la carte : ils vont picorer les objectifs qui les intéressent et oublier les autres. Je connais bien la Chine ; j’ai passé dix ans de ma vie aux États-Unis ; je travaille sur le Sahel depuis quarante ans ; je suis allé quinze fois en Afghanistan depuis douze ans. Et je ne vois pas comment on peut fixer des objectifs identiques à tous.
La semaine dernière, par exemple, j’ai participé à des séances de travail avec les responsables du plan de développement nigérien. Ils se demandaient s’ils devaient signaler le fait qu’une centrale à charbon allait être construite au Niger ? Ils se posent une telle question alors que la Chine construit une centrale à charbon par semaine !
Certains ODD ont un côté « vœu pieux » qui frôle le ridicule, alors que les OMD étaient concrets et très ciblés. Pour autant, les omissions graves des OMD n’ont pas toutes été correctement corrigées. Qu’y a-t-il sur un développement agricole accéléré, fondé sur le paysannat, et sur une condamnation sans équivoque des achats ou locations de terres par les pays riches dans les pays pauvres ? Rien de bien convaincant. Le problème des bidonvilles et des quartiers non intégrés est abordé, mais les mesures n’ont pas le caractère contraignant que j’aurais aimé trouver. Y a-t-il des objectifs ambitieux de régulation de la fécondité ? Je n’ai trouvé que des allusions vagues, à droite et à gauche. Qu’en est-il des pays les moins avancés (PMA), de ceux qui sont extrêmement fragiles en raison de conflits récemment terminés ou non encore achevés ? Je n’ai rien trouvé sur la nécessité de renforcer leur secteur régalien ni sur les réformes nécessaires et urgentes dans le domaine de la sécurité.
Pour résumer, je trouve que cette opération est beaucoup trop ambitieuse, et qu’il aurait fallu établir une typologie des pays pour distinguer ceux de l’OCDE, les pays émergents, les pays à revenu intermédiaire, les PMA, et les pays déstabilisés par un conflit récent ou en cours.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne plaidaient pour une reprise des OMD corrigés de leurs erreurs manifestes. Cette approche aurait été d’autant plus réaliste et raisonnable que, selon mon expérience personnelle, c’est le temps et la durée des efforts qui comptent en matière d’aide au développement. Le Niger, par exemple, n’aura atteint aucun des OMD. Il aurait fallu repartir des OMD pour fixer huit à dix objectifs réalistes.
S’agissant de la position française, je la connais par le rapport du ministère des affaires étrangères de 2013. Les priorités qui y sont définies me semblent raisonnables, sous réserve d’un regroupement des pays selon une typologie simple et de la prise en compte des omissions des OMD. J’en déduis que nous avons été prisonniers d’une mécanique qui relève de l'usine à gaz, que nous n’avons pas pu nous en dégager, que nous avons fait pour le mieux. Mais je ne suis pas très satisfait et je ne dois pas être le seul, si j’en juge d’après l’article de The Economist que je viens de découvrir.
M. Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l’Agence française de développement. J’interviens ici à un double titre. J’ai été l’un des membres du panel mis en place par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, afin de préparer les ODD. Présidé par les présidents indonésien et libérien et par le Premier ministre britannique, ce panel rassemblait une quinzaine de personnes. Le processus des ODD a été initié par le rapport rédigé par ce panel, dont on retrouve la quasi-totalité des idées dans le document final, à certains éléments près. En 2011 et 2012, avec l’appui du secrétariat général des Nations unies, nous avions lancé une consultation extraordinairement large sur ces ODD, ce qui me permet de nuancer les propos de Serge Michailof : bien qu’il y ait eu une très grande concertation, notamment avec la société civile, le point de départ du processus était relativement concentré, sans pour autant être non démocratique ou déjà négocié.
La seconde fonction qui explique ma présence ici, c’est celle de président de Convergences, un mouvement qui milite pour les OMD depuis une petite décennie. Les 6, 7 et 8 septembre prochain, Convergences réunira quelque 7 000 personnes pour sa conférence annuelle qui offrira l’occasion d’amorcer le travail d’internalisation des ODD par tous les partenaires de la société civile.
Ce processus des ODD a abouti au concept de la double universalité dont certains points sont très importants pour les gouvernements et les représentations parlementaires.
L’élargissement de l’agenda, abondamment critiqué par Serge Michailof, va permettre d’insister sur l’approche par les droits, une revendication fondamentale de la société civile. Rappelons que les OMD étaient perçus comme des objectifs technocratiques élaborés par les agences de développement, et que leur légitimité était très faible dans la société civile, aussi bien celle des pays du sud que celle des pays industrialisés. Le processus réhabilite le critère de croissance économique et identifie un objectif spécifique lié à la création d’emplois et à l’accès à l’emploi. De ce fait, l’agenda des ODD s’appuie sur les trois piliers du développement durable – l’économie, l’environnement et le social – et il introduit une approche par les droits.
Cet agenda est universel car il s’applique également aux pays de l’OCDE. À partir de 2016, le Gouvernement français et les parlementaires vont être interpellés sur la façon dont ils contribuent à l’atteinte des ODD sur le sol français. « C’est ridicule, comment peut-on avoir les mêmes objectifs que le Burkina Faso ? » m’objecterez-vous. La France n’aura pas les mêmes objectifs que le Burkina Faso, ce serait un non-sens. En revanche, la France va être interpellée sur sa politique de l’emploi – pour citer un sujet qui fait un peu mal – sur l’égalité des sexes, sur l’environnement, sur le changement climatique, sur la biodiversité. Elle sera amenée à formuler des objectifs et des contributions. Sous l’effet de cet agenda global, les ministères français concernés – environnement, transports, affaires sociales – devront répondre sur la manière dont ils s’intègrent dans ce processus onusien.
Pourquoi en est-on arrivé là ? Je peux témoigner, pour avoir vécu le processus ayant conduit à la définition d’objectifs universels, qu’il s’agit d’une revendication fondamentale des pays en développement, notamment africains. Pour les pays pauvres, il est humiliant d’être les seuls auxquels on fixe des objectifs internationaux : ils n’ont cessé de le répéter pendant toute la durée de la concertation car ils y voient une forme de tutelle coloniale inacceptable. Il faut vivre avec cette réalité politique. Il n’aurait pas pu y avoir des OMD 2, parce que les pays en développement auraient refusé des objectifs qui leur auraient été spécifiquement attribués. On peut s’en indigner, dire que c’est confus, mais c’est comme ça. Il ne pouvait être question de redéfinir des OMD plus ou moins bons pour les pays en développement, le choix se situait entre la suppression des OMD ou l’élaboration d’ODD globaux.
Autre aspect que je souhaiterais souligner : il est très difficile de vouloir le beurre, l’argent du beurre, l’estime du crémier et la main de la crémière. À partir du moment où l’on conteste le caractère descendant des OMD, leur faible légitimité politique, leur manque de prise en compte des préoccupations des populations, et que l’on engage une vaste consultation de la société civile, il faut en accepter les conséquences. En sortant d’un système perçu comme autoritaire et néocolonial et en négociant avec 190 États, on obtient un produit qui reflète la diversité et les ambitions de la planète. C’est le fruit d’une négociation où chacun doit tenir compte des objectifs de l’autre. Il va falloir passer sur des défauts qui sont différents de ceux des OMD. Les ODD sont plus modernes et en résonance avec la société mondiale contemporaine que les OMD, mais ils ont d’autres défauts qu’il va falloir gérer.
Outre cette question de la double universalité, qui me semble inévitable, je voudrais évoquer le partenariat global. Enfonçons encore une fois cette porte ouverte : ni l’aide publique au développement, ni les financements publics ne sont à la hauteur du défi des ODD. Je vous propose de vous référer au scénario macroéconomique qui sous-tend les ODD et qui figure dans le rapport du panel de haut niveau. Selon ce scénario, si la planète conserve un rythme de croissance de l’ordre de 4 % par an en moyenne – 6 % dans les pays en développement, 2 % dans les pays de l’OCDE – et si un processus de répartition équitable de cette richesse se met en place, alors on peut éliminer l’extrême pauvreté sur la planète dans les quinze ans.
Les deux conditions vont de pair : sans une croissance moyenne de 4 %, les ODD ne seront pas atteints, ce n’est même pas la peine d’en parler ; sans politiques redistributives fortes, ils ne seront pas atteints non plus. Pour la réalisation de la première condition, les politiques publiques sont très importantes, mais les financements publics sont presque marginaux et le comportement des acteurs privés est absolument essentiel. Dans le partenariat global qui est appelé pour la mise en œuvre de ces ODD, les acteurs privés vont jouer un rôle primordial, alors qu’ils étaient dans une quasi zone d’ombre des OMD.
Qu’attend-on des acteurs privés ? On attend d’abord qu’ils réorientent les flux financiers mondiaux. Ce mouvement est en cours : les investissements privés vers les pays les plus pauvres de la planète – c'est-à-dire des pays comme le Niger ou la RDC – ont quadruplé au cours de la dernière décennie, mais ils sont encore très insuffisants par rapport aux besoins.
On attend ensuite qu’ils contribuent à la mise en place de services aux populations, qui vont permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. C’est tout l’agenda de la « Base de la pyramide » (Bottom of the pyramid – BOP) qui correspond à la fraction la plus vaste mais aussi la plus pauvre de la population mondiale. Il s’agit de la fourniture par des acteurs privés, à but lucratif ou non, des services essentiels : accès à l’énergie, à la santé, à l’éducation... La sphère est très large.
On attend enfin une montée en puissance de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui se rapporte à leurs pratiques : manières d’investir, comportements vis-à-vis de leurs salariés, clients et fournisseurs, attitudes en matière d’environnement, etc. Cette activité demande à la fois une régulation internationale mais aussi une transformation volontaire des pratiques des acteurs car il est impossible de réguler tous les sujets qui entrent dans le champ de la RSE.
Ces ODD nous ouvrent à de nouvelles ambitions, tout en étant porteurs de défaillances. C’est avec tristesse que l’on doit accepter chaque critique formulée par Serge Michailof. Mais une fois ces critiques formulées, que faire ? Il faut saisir les opportunités qui s’offrent : faire émerger certaines préoccupations de politiques publiques dans l’agenda national français, valoriser la contribution de notre pays à l’amélioration du bien-être mondial. Il faut travailler sur la convergence de la politique française avec les politiques internationales. Intéressons-nous aux possibilités offertes par l’approche par les droits, qui est une façon de travailler sur la problématique des régimes autoritaires et des libertés publiques dans les pays en développement, et qui ouvre des perspectives de légitimité qui n’existaient pas autrefois. Il faut travailler sur la croissance économique et son rôle dans le développement, introduire la question du secteur privé et des partenariats multi-acteurs.
Ces idées ne sont pas forcément toutes nouvelles mais elles peuvent faire progresser l’agenda du développement. Certes, nous avons 170 cibles et dix-sept objectifs que personne n’est capable de mémoriser. Est-ce vraiment si important ? Nous avons cette chance extraordinaire d’être mobilisés collectivement autour d’un objectif fantastique : l’élimination de l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération. Si nous avons la chance de vivre cet événement grâce aux ODD, nous n’aurons pas perdu notre temps.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vais maintenant passer la parole aux représentants des groupes, en commençant par Chistophe Bouillon, pour le groupe SRC.
M. Christophe Bouillon. Je voudrais remercier à la fois le président d’avoir organisé cette table ronde et les intervenants d’avoir tenu des propos sans concession qui permettent d’ouvrir largement la discussion.
Se fixer des objectifs c’est bien ; se donner les moyens de les atteindre, c’est mieux. La question du financement des ODD se pose, en effet, quand on voit combien il est difficile d’alimenter le Fonds vert, destiné à aider les pays pauvres à lutter contre le réchauffement climatique. Êtes-vous optimistes sur l’issue de la conférence sur le financement du développement durable qui doit se tenir à Addis-Abeba en juillet 2015 ?
Comment articuler ces objectifs avec la conférence sur le climat, dite COP 21, qui va avoir lieu à Paris, avec le forum mondial de l’eau qui va de dérouler en Corée ou avec l’Exposition universelle qui va se tenir à Milan sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » ? Vous avez évoqué l’idée de lier les ODD à ces rendez-vous cruciaux. Ajoutons que les Nations unies ont choisi de faire de 2015 l’année internationale de l’agriculture, en posant notamment la question du foncier et de l’affectation des sols.
À raison, Serge Michailof a évoqué le bilan des OMD : avant de lancer de nouveaux objectifs, il est utile de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les précédents n’ont pas été atteints. Quels freins et obstacles ont empêché d’atteindre les OMD ? Des progrès n’ont-ils pas néanmoins été constatés, notamment en termes de santé et d’accès à la nourriture ? Quels ont été les progrès mesurables par rapport aux objectifs chiffrés ?
Quelle est votre vision de la précarité énergétique, une notion essentielle qui est liée aux ODD et aux problématiques du changement climatique et des réfugiés climatiques ? Les événements récents montrent que cette question viendra, elle aussi, contrarier les ODD.
M. Laurent Fabius, que nous recevions récemment en audition commune avec la Commission des affaires étrangères et celle des affaires européennes, évoquait le lien qui existerait entre le climat et le SIDA ou d’autres maladies. Qu’en pensez-vous ?
Comment envisagez-vous le rôle des femmes dans le développement, que vous avez évoqué par le biais de l’agriculture familiale ?
Pour permettre le financement des ODD, la planète doit conserver un rythme de croissance de l’ordre de 4 % par an, dites-vous. Qu’entendez-vous par croissance ? Êtes-vous favorable à la croissance verte ? Comment la définissez-vous ? Quelles sont vos réflexions sur le modèle économique et notamment sur la mesure de progrès humain ?
La corruption figure parmi les freins et obstacles à la réalisation des ODD. L’aide, qui existe même si elle n’est pas à la hauteur des enjeux, se perd parfois comme l’eau dans le sable. Vous avez évoqué l’évasion fiscale, mais que pensez-vous de la corruption qui sévit dans certains pays et sur certains continents ?
Enfin, j’aimerais connaître vos avis sur les nouvelles orientations de l'AFD, notamment sur la priorité donnée aux énergies renouvelables et sur la concentration des aides utilisées comme levier pour les ODD.
M. Martial Saddier. Les députés UMP font leurs les 17 objectifs définis en l’an 2000 afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Si ces questions sont urgentes, elles s’inscrivent aussi dans la durée et, pour cette raison, concerneront d’autres majorités. C’est donc avec humilité que nous devons aborder ce défi considérable qu’est la diminution des écarts de pauvreté à l’échelle mondiale.
Nous prônons également une évaluation qui serve de base aux objectifs fixés pour la période 2015-2030. Un arbre cache la forêt, puisque le boom économique de la Chine, lors de la précédente décennie, a largement pesé sur des indicateurs mondiaux qui affichent une réduction de la pauvreté, une baisse des mortalités infantile et maternelle ainsi qu’un recul de la faim et des maladies : en dépit de ces chiffres, les inégalités restent fortes d’un continent à l’autre.
Des élus, au Parlement et dans les territoires, se sont engagés dans ce combat, par exemple – on l’a rappelé – au Niger, où une commune de 50 000 habitants est jumelée avec la mienne. La coopération décentralisée peut-elle, selon vous, jouer un rôle dans la réduction des inégalités ?
Le défi est aussi de trouver des financements et de susciter l’adhésion des populations, à commencer par la nôtre, sans pour autant nous ériger en donneurs de leçons. Comment associer en amont les citoyens, les professionnels et les élus dans cette démarche, afin de trouver des leviers financiers ? Les différentes majorités se sont attelées à cette tâche, comme en témoigne, par exemple, le Grenelle de l’environnement. Sous l’impulsion du Président Chirac, du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et de Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la ville, ce sont près de 12 milliards d’euros qui avaient été mobilisés au titre du plan de rénovation urbaine : c’est là une feuille de route dont notre pays pourrait continuer à s’inspirer, mais qui pourrait servir de modèle dans les continents où les populations souffrent le plus. Quoi qu’il en soit, l’évaluation des objectifs doit être au cœur du bilan de la période 2000-2015, car elle a vocation à crédibiliser les moyens mobilisés pour 2015-2030.
Comment, enfin, ne pas parler des questions de justice et de sécurité ? Pour revenir sur la coopération décentralisée, nous ne pouvons plus nous rendre au Niger, compte tenu des risques. Ces questions feront-elles partie de la feuille de route pour 2015-2030 ?
Enfin, cette dernière associera-t-elle, dans une vision globale, les problèmes de qualité de l’air et l’élévation des températures ?
M. Bertrand Pancher. Je vous remercie, messieurs, pour ces analyses qui apportent un « air de fraîcheur ». Je vous encourage à tenir bon, car les responsables politiques et l’opinion se réveilleront forcément à un moment ou à un autre. Peut-être pourrions-nous envisager des réunions de ce type avec l’ensemble des parlementaires et avec des membres du Gouvernement, afin de définir notre propre Agenda 21. La ville dont je suis maire vient d’ailleurs de lancer le sien, alors que personne n’y croyait au départ ; aujourd’hui, chacun se félicite du partage en réseau des objectifs.
Rien ne se fera sans un déclic au niveau national. Or, depuis plusieurs années, la crise nous assomme, si vous me passez l’expression : nous ne raisonnons plus qu’en termes de pouvoir d’achat et de croissance, en omettant le développement durable. Au train où vont les choses, la prochaine campagne électorale risque fort de virer à un concours d’imbécillités sur les « trois I », l’immigration, l’intégration et les impôts. (Sourires)
Or le développement du futur est d’abord humain, autrement dit à la fois économique, social et environnemental. Avez-vous des idées pour nous aider à réveiller les consciences ? Faudra-t-il empiler, sur le seuil des maisons des responsables politiques, les cercueils des victimes décédées en Méditerranée ? (Murmures sur divers bancs) Convient-il, selon vous, de changer de braquet ?
Quels financements innovants et crédibles préconisez-vous ? La taxation aux frontières peut-elle être une piste ?
En matière de régulation, notamment avec la RSE, la France a un rôle à jouer : elle peut mobiliser l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et influer sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les grands groupes internationaux s’engagent tous dans les processus dont nous parlons, au vu de leur écho dans l’opinion, et des règles se mettent en place auxquelles il faut cependant donner, sous peine d’affaiblir nos entreprises, une vraie dimension internationale, que ce soit à l’échelle de l’Europe ou du monde : quid de l’évolution de la régulation, de ce point de vue ?
Quoi qu’il en soit, je réitère mes remerciements et mes félicitations pour votre engagement.
Mme Geneviève Gaillard. Je m’associe à ces remerciements. Depuis plus d’une dizaine d’années, les inégalités vont croissant et la pauvreté, loin de reculer, atteint désormais des pays développés, dont le nôtre. Les écosystèmes continuent de disparaître en dépit des actions engagées pour les préserver ; la corruption fait toujours des ravages ; la démographie, dans certains pays reste galopante ; enfin, l’aide au développement, par exemple en provenance de l’AFD, ne prend pas toujours en compte les questions de développement durable. Les organisations non gouvernementales, d’ailleurs, sont de plus en plus nombreuses au sein des territoires les plus pauvres, où elles effectuent un travail remarquable.
L’agenda, a suggéré M. Bontems, est transformatif dans la mesure où nous avons à changer nos modes de production et de consommation. Le système d’économie libérale dans lequel nous vivons permettra-t-il de passer à une vitesse supérieure sur ces questions ? Pour ma part je ne suis guère optimiste, même si j’ai envie d’y croire. Quel est votre propre sentiment ? L’agenda dont nous parlons commencera-t-il à porter ses fruits dans les années qui viennent ?
M. Jacques Kossowski. Les pays du bassin méditerranéen, notamment dans sa partie sud, font face à ce qu’il est convenu d’appeler un « stress hydrique » en partie lié au réchauffement climatique : d’ici une trentaine d’années, leurs ressources en eau devraient fortement diminuer. Or les États concernés, notamment au Maghreb, ne semblent pas disposer des moyens publics suffisants pour financer un accès à l’eau et à son assainissement.
Lors de la conférence « Rio + 20 » en 2012, de nouveaux financements sont apparus dans le cadre d’une politique de coopération internationale pour le développement. Quels types de financements innovants peut-on envisager dans le secteur de l’eau ? Des taxes visant certaines activités qui ont profité du développement économique de l’espace méditerranéen vous paraissent-elles envisageables ? On évoque, par exemple, une taxe sur les navigations maritimes, de plaisance et de croisière.
Toutes les réformes seront de toute façon bienvenues si l’on veut éviter, avec l’eau, les guerres que l’on a connues avec le charbon et le pétrole. De fait, la situation peut vite dégénérer si un peuple manque d’eau.
M. Yannick Favennec. Selon The Economist, le travail des différentes commissions chargées d’actualiser les objectifs du Millénaire est si étendu, et parti sur de si mauvaises bases, qu’il risque d’échouer. Si les OMD ont permis des résultats décents qu’il ne faut toutefois pas surestimer – la réduction de moitié de la pauvreté dans le monde étant due avant tout au bond économique de la Chine –, les nouveaux ODD, fixés à l’horizon 2030, paraissent illimités. Les groupes de travail proposent en effet 169 cibles regroupées en 17 objectifs : les pays en développement estiment que les aides au développement seront d’autant plus élevées que les objectifs sont nombreux, ce que The Economist juge irréaliste car les besoins se chiffrent, au bas mot, entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars par an.
En revanche, des programmes de transferts ciblés permettraient sans doute d’éliminer, dans les quinze prochaines années, l’extrême pauvreté, laquelle touche encore un milliard de personnes dont les revenus sont inférieurs à 1,25 dollar par jour. Pour ce faire, un tel objectif ne devrait-il pas constituer une priorité absolue au sein d’une liste simplifiée ?
M. Gilles Savary. Le terrorisme et les déstabilisations politiques constituent une nouvelle donne au sein de pays où subsistent des poches de grande pauvreté. Dans ces conditions, que devient l’aide au développement ? Trouve-t-elle sur place une capacité d’absorption, notamment institutionnelle ? Sur quoi l’appuyer ? Est-on sûr qu’elle n’est pas détournée à d’autres fins, sachant que le financement des armes, lui, ne pose visiblement aucun problème ? On parle beaucoup des objectifs sociaux et environnementaux, mais la paix pourrait être un objectif aussi… (Approbations sur divers bancs)
Dans le cadre de la lutte contre certaines endémies, notre pays a institué une taxe sur le kérosène, dont on se désespère qu’elle reste isolée : un élargissement à d’autres compagnies aériennes est-il envisagé ? Des actions sont-elles menées auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ? Des recommandations ont-elles été faites ? Air France, dont le taux de marge est tombé à environ 1 %, milite, en effet, contre l’application unilatérale de cette taxe, arguant qu’elle crée une distorsion de concurrence.
M. Yves Albarello. Le rapport sur les ODD pour l’Afrique définit un certain nombre de cibles, pour une aide globale de 120 milliards de dollars, soit vingt fois moins que l’enveloppe nécessaire. Dès lors, comment faire mieux avec moins ? Comment les acteurs privés pourraient-ils être associés ? S’ils le sont sous une forme non lucrative, les objectifs seront-ils atteints ? Et s’ils le sont sous une forme lucrative, quid de la sécurité et de la stabilité politique au sein des pays considérés ?
Enfin, quelques cibles précises ne seraient-elles pas préférables à un inventaire à la Prévert ?
M. Jean-Marie Sermier. Depuis des décennies, les aides au développement ne cessent d’augmenter, avec le même constat d’échec. Le temps n’est-il pas venu de changer de paradigme ? Les pays concernés veulent s’en sortir et ils ont des atouts, notamment le climat et les sols. L’agriculture est donc pour eux un secteur essentiel mais, alors même qu’ils sont producteurs, ils ont beaucoup de mal à organiser la transformation et la distribution : ne devrions-nous pas encourager les grands groupes internationaux – parmi lesquels des groupes français de grande qualité – à y investir massivement pour structurer ces circuits ? Des groupes tels que Danone ou Andros seraient à même de le faire, selon une logique gagnant-gagnant.
M. Laurent Furst. Nous partageons tous un certain nombre d’objectifs, en termes de croissance – 4 % à l’échelle mondiale –, de résorption de la pauvreté, de qualité de l’air et de l’eau, d’accès aux soins pour tous et de lutte contre la pollution des mers ; mais j’aimerais que l’on parle, de temps à autre, d’un pays qui va mal et qui s’appelle la France. (Murmures)
Le PIB par habitant, on l’oublie trop souvent, y est en recul, plus de 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, 5 millions de personnes sont privées d’emploi et la dette dépasse les 2 000 milliards d’euros, soit plus de 30 000 euros par Français. Notre pays emprunte cette année plus de 180 milliards d’euros : cela n’est possible qu’en raison du niveau historiquement bas des taux d’intérêt, niveau sans lequel le budget de l’État ne serait plus finançable. Bref, j’aimerais que l’on parle un peu du développement durable en France – en prenant les deux mots de cette expression dans leur pleine acception. Au lieu d’agiter en permanence de belles idées pour la planète, occupons-nous du bien-être de nos concitoyens ; faute de quoi nous aurons des réveils douloureux. (Murmures)
Les hauts fonctionnaires que vous êtes peuvent-ils nous donner les moyens alloués par la France au titre des objectifs de développement durable, y compris au sein de son administration ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les responsables de l’AFD, que nous avons auditionnés, nous ont donné des éléments d’information sur ce dernier point. Votre intervention, monsieur Laurent Furst, me semble s’adresser plutôt aux membres de notre commission qu’à nos invités du jour.
M. Guillaume Chevrollier. Il faudra du temps, vous l’avez dit, pour atteindre les 17 objectifs que vous avez rappelés : de ce point de vue, l’efficacité n’appelle-t-elle pas une réduction du nombre des priorités ? J’en relèverai deux. Selon la Banque mondiale, le nombre de déchets urbains ménagers augmentera, au niveau mondial, de 70 % d’ici à 2025. Une telle progression aurait des répercussions sensibles sur le coût de leur traitement, notamment dans les pays à faibles revenus, où la mise en décharge reste la solution privilégiée, avec les conséquences que l’on sait sur l’environnement.
L’autre priorité est l’investissement dans l’agriculture familiale, en Afrique notamment, où la population rurale croîtra de 300 millions de personnes d’ici à 2030. Cette agriculture est donc au cœur des enjeux de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de préservation et d’aménagement du territoire.
M. Christophe Priou. Les objectifs définis sont-ils amendables ? Il faut insister, non seulement sur les projets eux-mêmes, mais aussi sur ceux qui les portent. Jean-Louis Borloo, qu’évoquait Martial Saddier, avait ainsi mené à bien et le Grenelle de l’environnement et le Grenelle de la mer ; récemment, dans le cadre de ses nouvelles activités, il a créé une fondation pour l’accès à l’eau et le développement de l’électricité en Afrique. Des initiatives de ce genre peuvent-elles s’insérer dans la concrétisation des objectifs de développement durable ? Sont-elles de nature à optimiser les aides ? Les retours d’expérience montrent en effet que l’action des hommes peut s’avérer plus déterminante que les dépenses elles-mêmes. Ma région, par exemple, a conclu un partenariat avec la Guinée en matière de production de sel et de riz : si les moyens sont restés modestes, l’énergie des hommes a porté ses fruits.
M. Michel Heinrich. Les questions que je souhaitais poser ont déjà été formulées. Aussi je ferais seulement une remarque : sur les objectifs, les intentions ne me semblent jamais suivies par des actes, qu’il s’agisse, par exemple, des fonds verts ou des droits des communautés autochtones.
M. Jean-Pierre Vigier. Les objectifs du développement durable seront adoptés cette année à l’ONU ; ayant une vocation universelle, ils doivent être partagés par le Sud et le Nord. Je rappelle certaines des priorités du programme : réaliser le développement et la prospérité ; garantir l’éducation des jeunes et des enfants ; protéger les écosystèmes ; garantir une gestion saine des ressources naturelles. Ma question sera très simple, mais c’est à mon sens la première qui doit être posée : aussi louables et ambitieux soient-ils, les ODD ne sont-ils pas difficiles à atteindre au vu, notamment, du budget qui vous est alloué ?
M. Jacques Alain Bénisti. Je fais miennes certaines des questions qui viennent d’être posées. Sur les 169 cibles, seules 49 ont été jugées « scientifiquement rigoureuses » par certains experts. Quel est votre sentiment sur ces doutes ? Les travaux de l’ONU aboutiront-ils, malgré tout, à la définition d’objectifs concrets, limités quant à leur nombre, ambitieux et lisibles, afin d’être appliqués dans tous les pays, compte tenu de leurs ressources et de leurs niveaux de développement respectifs ?
M. Frédéric Bontems. Merci pour ces questions, qui me paraissent toutes pertinentes et justifiées ; au reste, elles rejoignent celles que nous nous posons tous les jours, et l’on ne peut leur apporter de réponses simples.
Le nombre de cibles est-il raisonnable ? Vous avez vous-mêmes exprimé ce matin, mesdames et messieurs les députés, des préoccupations sur : l’agriculture familiale, la gestion des déchets, la mer, la lutte contre la corruption, le rôle des collectivités locales, la coopération décentralisée, la santé, l’éducation, le climat, l’immigration, l’énergie, l’eau, la responsabilité sociale des entreprises, le développement économique et la gestion des conflits ; cela fait déjà beaucoup. Encore sommes-nous dans une réunion entre acteurs politiques français ayant une vision et des références partagées, et se voyant interpellés, par leurs électeurs, sur des sujets similaires : imaginez la complexité d’une réunion entre 190 pays ayant chacun des référentiels, des acteurs de terrain et des partenaires différents. Cette complexité, Jean-Michel Severino l’a dit, est le prix à payer pour un agenda réellement partagé. Le fait extraordinaire, de ce point de vue, est qu’un consensus ait pu émerger depuis un an et demi, aux Nations Unies, sur cet agenda que les pays membres se sont pleinement approprié. Aussi les pays du G77, au premier rang desquels la Chine, soulignent-ils qu’un équilibre politique a été trouvé, auquel il ne faut pas toucher.
L’intérêt scientifique d’un certain nombre de cibles n’est pas démontrable, c’est vrai ; mais si nous entreprenons de plaider pour la limitation de leur nombre, la première cible qui disparaîtra sera celle qui correspond à l’objectif 16, relatif à la gouvernance, à l’État de droit et à la gestion des conflits. Cela appauvrirait donc l’ensemble de l’approche. Plusieurs groupes des Nations Unies travailleront jusqu’en mars prochain ; la France y joue un rôle très actif, notamment sur la définition d’indicateurs précis et sur l’affinement des cibles.
Sur le bilan des OMD, nous disposons de nombreuses données. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ; reste que des progrès sensibles ont été accomplis. Ils sont liés, bien sûr, à la croissance économique soutenue de certains pays émergents, comme la Chine et l’Inde, mais pas seulement : les progrès en matière d’accès à l’éducation ont été très rapides, par exemple, au Burkina Faso, et l’atteinte des OMD est fort satisfaisante au Rwanda. La limite de cette approche, au demeurant, est qu’elle est plus quantitative que qualitative : cela appelle des ajustements qu’il serait trop long de détailler.
Vous avez été nombreux à nous interroger sur le climat et sur les conflits – et la fragilité des États face à eux. D’après les rapports internationaux – notamment de la Banque mondiale –, ce sont précisément les deux causes susceptibles de faire échouer les OMD et d’annihiler la totalité des progrès réalisés depuis quinze ans – les pays les plus en retard dans la mise en œuvre des OMD étant les pays fragiles qui connaissent un conflit. C’est dire la dimension transversale de l’agenda.
Sur les moyens, l’aide publique au développement n’est qu’une petite partie de la réponse. Une conférence se tiendra à Addis-Abeba, en juillet prochain, sur le financement du développement et de l’agenda post-2015 ; un premier texte sur ses conclusions commence à circuler, qui précise que les ressources domestiques constituent la première source de financement. En ce domaine, la communauté internationale peut agir, à travers la lutte contre la fraude fiscale et pour la transparence, ou contre l’érosion des bases fiscales et le transfert illicite de profits. Le même texte indique que d’autres flux doivent être mobilisés, y compris internationaux, lesquels peuvent être publics mais aussi privés, qu’il s’agisse des investissements directs des entreprises ou des transferts de fonds des travailleurs migrants.
L’aide publique au développement a atteint, l’an dernier, un pic historique – même si c’est moins vrai pour la France. Cependant, son impact reste très variable selon les pays : pour les moins avancés d’entre eux, elle représente 60 % des transferts extérieurs nets et 30 % des dépenses budgétaires ; elle y est donc un apport essentiel, qu’il faut maintenir, dans la mesure où les ressources domestiques et les flux privés resteront faibles, même s’ils peuvent jouer un rôle non négligeable. Pour les pays à revenus intermédiaires, l’APD ne représente que 2 % des transferts extérieurs nets ; elle doit alors, de notre point de vue, agir comme un catalyseur, pour favoriser les apports extérieurs et aider ces pays à évoluer vers un modèle de développement plus durable et plus conforme aux aspirations des populations. Le développement, aujourd’hui, suppose donc une coalition d’acteurs locaux, et des bases institutionnelles solides.
Présidence de Mme Catherine Quéré, vice-présidente
M. Pierre Jacquemot. Le travail sur les ODD a des effets très bénéfiques sur la mobilisation des acteurs. On constate depuis deux ans, aussi bien dans les milieux académiques qu’au sein des collectivités et des ONG, un réel engouement pour ces questions. La prolifération des travaux et la mobilisation soutenue tiennent aussi à un calendrier serré, entre la conférence d’Addis-Abeba en juillet, celle de New-York en septembre et la COP21 à Paris en novembre-décembre.
Nous pouvons d’autre part être fiers d’être français, car nos thèses sont très présentes : j’y reviendrai. Quant aux moyens, on compte moins sur l’aide publique classique – l’objectif d’y consacrer 0,7 % du revenu national brut restant un horizon « mythique » – que sur d’autres ressources. Dans l’un des documents qui vous ont été distribués, un tableau fait la synthèse de tous les financements susceptibles d’être mobilisés dans le cadre des ODD : les financements nationaux peuvent être publics – à travers la fiscalité ou la lutte contre la corruption – ou privés – à travers la bancarisation croissante d’un certain nombre de pays et la lutte contre les fuites de capitaux ; on peut aussi compter sur des financements publics internationaux, qu’il s’agisse de l’aide publique ou de fonds dédiés – et l’on peut sur ce plan nourrir, comme je le suggérais, une certaine fierté d’être français à l’évocation des fonds mondiaux contre le SIDA, la tuberculose ou le paludisme –, comme sur des financements innovants – à l’instar du Fonds vert –, sur des fonds privés internationaux – les transferts de flux des migrants représentant près de 400 milliards de dollars qui peuvent, pour une large part, appuyer des investissements dans les pays d’origine – ou sur des investissements directs étrangers. Enfin, les financements mixtes sont légion ; j’ai dressé une liste non exhaustive de ceux qui relèvent de l’économie sociale et solidaire, des mécanismes de garantie ou des obligations à impact social. Hier, nous avons aussi appris que 50 % des investissements de l’AFD sont climatiquement compatibles, autrement dit qu’ils ont un impact direct sur les objectifs climatiques – étant entendu que les autres 50 % ne sont évidemment pas incompatibles avec eux.
On assiste par ailleurs à une mutation significative du capitalisme privé, en particulier français, dont témoignent par exemple le renforcement des mécanismes de responsabilité sociétale et environnementale, l’adhésion à des certifications, par exemple de l’OCDE ou de l’Organisation internationale du travail (OIT) en matière sociale, ou la reconnaissance des investissements socialement responsables. Les responsables d’agences de développement, réunis hier à Bercy, ont d’ailleurs évoqué l’importance de ce concept dans la définition des mécanismes de garanties financières à l’échelle internationale. Bref, la dynamique engagée nous paraît intéressante, à condition bien entendu que l’État joue son rôle de régulateur et que la vigilance reste de mise.
Je parlais de la fierté d’être français. Le Conseil mondial de l’alimentation, placé auprès de la FAO – l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, a adopté, en octobre dernier, de nouvelles directives relatives à l’investissement agricole responsable afin de lutter contre l’accaparement des terres, phénomène qui, depuis une dizaine d’années, a touché 50 millions d’hectares, soit la taille de notre pays. Si les mises en valeur concernent, selon les estimations, un tiers des concessions, les dégâts et les échecs ont été importants, par exemple avec les agrocarburants. À l’initiative de la France – qui dispose, depuis 1997, d’un comité technique « Foncier et développement » associant administration, chercheurs et autres intervenants –, a été mis en place un mécanisme de plus en plus contraignant pour les investissements étrangers, avec des résultats tangibles dans un certain nombre de pays.
En ce qui concerne la parité entre hommes et femmes, les résultats sont probants, depuis une quinzaine d’années, en matière de scolarité. Soit dit en passant, les parlements qui, dans le monde, accueillent le plus de femmes sont africains ; celles-ci sont même majoritaires au sein du Parlement rwandais. Ces évolutions ont bien entendu été conquises par les femmes elles-mêmes, à travers leurs luttes et les pressions qu’elles ont exercées. Au demeurant, l’indicateur le plus pertinent, pour juger des 17 objectifs, est la place des femmes car cela a un impact immédiat sur la scolarisation, la santé, la microfinance ou la nutrition des enfants. S’il y avait un seul objectif à préserver, je le dis, sans démagogie et avec l’objectivité du professeur, ce serait donc celui-là.
M. Serge Michailof. La notion de « pays en voie de développement » n’a plus de sens : il faut plutôt parler de « pays émergents », lesquels posent à la planète, en matière de développement durable, des problèmes qui pourraient devenir dramatiques. Si la croissance mondiale s’établit à 4 % dans les quinze prochaines années, selon l’objectif retenu, elle sera essentiellement tirée par ces pays, qui par ailleurs font peu d’efforts en matière environnementale, même si les choses commencent à changer en Chine.
L’aide au développement ne relève pas de la charité : l’enjeu n’est pas de faire passer « la Corrèze avant le Zambèze » (Murmures), mais de relever un défi mondial. J’ajoute que certains pays en voie de développement glissent lentement vers la faillite. Les conséquences dramatiques d’un tel processus sont déjà visibles en Afghanistan, mais la situation est très préoccupante aussi en Irak, en Syrie, en Lybie ou au Yémen. Pour les représentants de la communauté internationale, que je viens de rencontrer à Niamey, la question est seulement de savoir si le Niger tiendra le choc pendant trois, cinq ou sept ans... L’implosion peut d’ailleurs se produire très rapidement : on l’a vu au Mali, où nous n’en sommes qu’aux prémices. J’ajoute que ces pays sont au centre d’enjeux géopolitiques : on ne les aide pas par charité, je le répète, mais pour éviter une accélération des migrations incontrôlables, comme celles qui arrivent de Syrie et de Libye. Bref, aider certains pays revient à s’aider soi-même et à prévenir des risques considérables.
De ce point de vue, je reste très déçu par les ODD : les enjeux environnementaux me préoccupent, bien entendu, mais ils ne sont pas du tout centraux dans les pays sahéliens. L’ambassadeur des États-Unis au Niger m’a dit que l’objectif, dans ce pays, était de développer le secteur privé, lequel comprend 4 000 emplois marchands formels, sur un total de 18 millions d’habitants. Le Niger est aujourd’hui classé parmi les derniers pays du monde au regard de l’indice de la Banque mondiale mesurant la facilité de faire des affaires : une progression dans ce classement ou un quadruplement du nombre d’emplois marchands ne changeraient donc strictement rien au problème. Ces pays dépendent entièrement de l’aide internationale, qui finance 80 % des budgets d’investissement et une bonne partie des budgets de fonctionnement.
Quant à l’argument selon lequel la multiplication des objectifs permettrait l’augmentation des moyens, la réalité est autre. Dans le cas du Niger, l’augmentation des aides à l’éducation et à la santé s’est traduite par une réduction drastique des aides au développement agricole. Ont été financés des secteurs sociaux dont la soutenabilité, en l’absence de mécanismes fiscaux susceptibles de garantir des transferts sociaux durables, est illusoire ; si bien que ce pays doit désormais faire face, comme ses voisins, à des charges sociales insoutenables. Compte tenu de la montée des risques sécuritaires, on assiste aussi, depuis trois ans, à un dégonflement des ressources allouées aux secteurs sociaux – santé, éducation et développement agricole – au profit des dépenses de sécurité, qui sont de toute façon incontournables. Ce pays se retrouve donc étranglé financièrement : ou il transfère ses ressources sociales pour les allouer à la sécurité, ou il ne le fait pas, et des groupes tels que Boko Haram le « phagocyteront ». Bref, je ne me retrouve pas dans les ODD tels qu’ils ont été définis au niveau des Nations Unies, avec la novlangue que l’on connaît ; cela dit, puisque nous y sommes engagés, essayons d’en tirer le meilleur parti.
Les enjeux géopolitiques français, en tout état de cause, relèvent d’objectifs climatiques assignés à des pays émergents et à revenus intermédiaires, dont le développement pose déjà des problèmes environnementaux dramatiques ; quant aux pays en voie d’implosion, ils relèvent d’un agenda spécifique, dont les premières étapes doivent être la réforme des secteurs de sécurité, la consolidation du domaine régalien et le développement des secteurs créateurs d’emplois, à commencer par l’agriculture et le développement durable, entendu au sens large ; mais force est de constater que les financements font défaut.
Mme Catherine Quéré, présidente. Messieurs, je vous remercie pour ces éclairantes analyses. Je vous prie d’excuser le départ de certains de nos collègues mais l’imbrication de nos réunions les a conduits à partir avant que vous n’ayez répondu à leurs questions. Mais soyez assurés qu’ils liront vos réponses dans le compte rendu écrit de nos débats.
22. Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur la préparation de la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21) (6 mai 2015)
Mme Élisabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères. Nous avons le plaisir et l’honneur de recevoir Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour une audition, ouverte à la presse, sur la préparation de la Conférence Climat 2015 (COP21).
Madame la ministre, c’est sous votre autorité et celle du ministre des affaires étrangères que travaille l’équipe interministérielle chargée de la négociation et de l’agenda des solutions. Le communiqué du conseil des ministres du 28 janvier précise qu’il vous appartient de définir la contribution de la France à la construction d’une position européenne ambitieuse et d’occuper le siège de la France dans les instances de discussion européennes et onusiennes. Par ailleurs, la mobilisation de la société civile s’appuie sur les initiatives que vous proposez.
La diplomatie parlementaire participe à l’effort de persuasion que la France entreprend pour que cette conférence soit un succès. À l’occasion de chacune de nos réunions avec nos homologues étrangers, nous rappelons combien il est important que nous parvenions à un accord en décembre. Cette conférence aura d’ailleurs un volet parlementaire, puisque des délégations internationales de l’Union interparlementaire (UIP) et de GLOBE International doivent se réunir les 5 et 6 décembre à l’Assemblée nationale et au Sénat. En amont de cette réunion, nous organisons par ailleurs deux événements à l’Assemblée afin de créer une dynamique euro-méditerranéenne dans le domaine du climat : le président Bartolone a accepté que se tiennent simultanément des réunions de travail des présidents de l’assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, représentant quarante-deux pays, et un Forum euro-méditerranéen sur le climat rassemblant les ONG et d’autres représentants de la société civile, forum organisé par la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures, que j’ai l’honneur de présider.
L’année 2015 s’est ouverte sur des records de température. Les pays insulaires du Pacifique subissent déjà la montée des eaux et l’aggravation des ouragans et des cyclones ; ils l’ont rappelé au sommet Oceania 21, à Nouméa, qui s’est achevé vendredi.
Plusieurs éléments mobilisent notre vigilance. Tout d’abord, des retards sont constatés dans le dépôt des contributions nationales. Au début du mois d’avril, à la première date d’échéance, trente-trois pays avaient déposé leurs contributions : la Suisse et l’Union européenne avec ses vingt-huit membres, la Russie, les États-Unis, le Mexique, la Norvège et le Gabon, mais il n’y a dans cette liste aucun pays d’Asie, alors que c’est l’un des continents les plus menacés.
La qualité des contributions et le niveau des engagements sont par ailleurs jugés décevants par les acteurs de la société civile et les experts. Par exemple, l’année de référence choisie par les États-Unis pour la réduction de leurs émissions n’est pas 1990, mais 2005, plus avantageuse pour eux. De même, la Russie met en avant la capacité d’absorption de son immense massif forestier pour éviter d’avoir à changer son modèle énergétique, et la Suisse, qui prévoit une réduction de 50 % de ses émissions, le fait à raison de 20 % au titre des mécanismes de marché, c’est-à-dire des améliorations qu’elle promeut dans les autres pays et non sur son sol.
Dans ce contexte, la contribution européenne, qui reprend le deuxième paquet « Énergie climat » pour 2030, à raison d’une baisse de 40 % des émissions de CO2 par rapport à 1990, d’un rehaussement à 27 % de la part des renouvelables dans le bouquet énergétique et de 27 % de l’efficacité énergétique, avec la perspective d’une économie enfin décarbonée au milieu du siècle, est extrêmement importante, mais aura-t-elle un effet d’entraînement ?
L’adoption de la loi sur la transition énergétique montre que notre pays prend ses responsabilités. Quelle a été sa contribution à la position de l’Union européenne ? Sur quels leviers peut-on espérer agir encore pour rapprocher la position des pays tiers ?
En ce qui concerne le financement, dernier point de vigilance, comment passer des 10 milliards de dollars de capitalisation du Fonds vert à l’enveloppe de 100 milliards par an de fonds publics et privés en faveur des pays en développement, et de quelle manière articuler ces fonds avec l’agenda des solutions de la société civile ?
Mme Danielle Auroi, présidente de la commission des affaires européennes. Avant la COP21 qui se tiendra à Paris, il y aura deux autres rendez-vous qu’il ne faut surtout pas rater : celui d’Addis-Abeba sur le financement du développement – les pays du Sud attendent des réponses sur ce point et sur celui des transferts de technologie – et le rendez-vous de New York. Si ces deux étapes sont des succès, les choses auront été clarifiées pour l’agenda des solutions.
La France s’apprête à recevoir plus de 40 000 participants, mais elle n’a pas attendu l’organisation de cette conférence pour témoigner de son volontarisme. Elle l’a fait notamment par le biais de la loi sur la transition énergétique, sur deux points, en particulier, qui sont à mes yeux des faiblesses au niveau européen.
Le premier concerne l’efficacité énergétique. Même si l’Europe affiche un objectif de 40 % de réduction des émissions, les directives en la matière sont très insuffisantes et n’ont pas été révisées depuis longtemps. Le second point sur lequel nous devrons convaincre nos partenaires porte sur une union de l’énergie au plan européen, une union qui gère les marchés des énergies fossiles – la crise ukrainienne montre à quel point c’est devenu nécessaire – tout en développant les énergies renouvelables. La COP21 est une formidable occasion de montrer que l’Europe peut rester ce qu’elle a toujours été depuis Kyoto, à savoir la bonne élève de la lutte contre le changement climatique.
Pensez-vous, madame la ministre, que les objectifs de la stratégie européenne à l’horizon 2030, qui ont fait l’objet de quelques critiques, seront tenus ? De même, la contribution déposée par l’Union pour la COP21 vous semble-t-elle aller assez loin ? L’Europe et la France sont-elles en mesure d’avoir un effet d’entraînement dans les négociations ?
Les enjeux sont notamment ceux de l’économie décarbonée. On ne parle toujours pas de taxe carbone aux frontières de l’Union européenne, alors que cela aurait du sens. Les questions de financement seront déterminantes. Quel rôle l’Europe et la France peuvent-elles jouer pour débloquer les principaux points d’achoppement, décrits par Élisabeth Guigou ?
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Élisabeth Guigou a évoqué les rencontres parlementaires des 5 et 6 décembre dans le cadre de GLOBE International et de l’UIP, mais nous portons aussi un intérêt particulier au grand débat citoyen planétaire organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) et le Danish Board of Technology, qui est soutenu par les ministères de l’écologie et des affaires étrangères, par la Fondation Nicolas Hulot et par le président de l’Assemblée nationale, et qui verra le jour dans le cadre de la COP21.
Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Le fait que trois de vos commissions se réunissent pour cette audition prouve l’ampleur et la complexité de la tâche que représente la préparation de la Conférence Climat, ainsi que le caractère passionnant de l’action que nous avons à conduire ensemble.
Je me suis rendue ce matin dans un lycée du Bourget, où étaient présents plus d’une centaine de lycéens de différents établissements de la région, avec leurs professeurs. Ces lycéens travaillent depuis la rentrée sur une simulation des négociations sur le climat, chacun représentant un État ou groupe d’États. C’était passionnant. Ces élèves témoignent d’une grande maturité et d’une bonne connaissance des enjeux, tirée des documents officiels, et font preuve d’une grande mobilisation.
Cela me permet d’insister sur le fait que cette conférence concerne absolument tout le monde : tous les pays, mais aussi tous les citoyens, toutes les entreprises, toutes les ONG, toutes les collectivités territoriales, bref l’ensemble de la société civile, ainsi que les parlementaires que vous êtes. Vous avez en effet un rôle majeur à jouer, en tant que représentants de la démocratie. Le combat pour l’environnement est toujours lié à la question démocratique, à la capacité d’associer les citoyens aux décisions qui les concernent. Si les opinions publiques se mobilisent, les pays se mettront en mouvement. Même dans certains pays non démocratiques, les opinions publiques se manifestent, contre la pollution de l’air ou les risques industriels, par exemple, et les dirigeants, sous cette pression, sont obligés de bouger.
La France et l’Europe ont un rôle crucial à jouer. L’Europe a été à la hauteur de sa tâche en figurant parmi les premières parties à la convention-cadre des Nations Unies pour le changement climatique à communiquer son INDC (Intended Nationally Determined Contribution), avec un objectif à l’horizon 2030 de réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, de 27 % de la consommation d’énergie à partir des énergies renouvelables et d’augmentation de l’efficacité énergétique de 27 %. À ce jour, trente-six parties à la convention-cadre, dont les vingt-huit pays de l’Union européenne, qui se sont positionnés en bloc, ont soumis leurs contributions. Ces pays représentent un tiers des émissions mondiales et 80 % des émissions des pays développés.
Je présenterai les objectifs, les outils et les échéances de la conférence.
L’objectif majeur est un changement de civilisation. Un monde est en train de disparaître, celui qui a conçu son développement sur la consommation des énergies fossiles, avec les dégâts que nous connaissons, et un nouveau monde est en train de naître, que nous devons aider à émerger. Pour cela, il faut tout d’abord surmonter quelques doutes. Certains de ces doutes se sont déjà bien estompés : plus personne ne conteste aujourd’hui les effets de la consommation d’énergies fossiles sur le dérèglement climatique et les risques graves que fait courir ce dérèglement. Le contexte est donc favorable pour mettre un terme aux tergiversations des années passées.
Des doutes subsistent sur les motivations des pays les plus riches. L’échec relatif de Lima s’explique par ces doutes des pays les plus pauvres, qui ont subi les modes de développement des pays riches et à qui l’on demande aujourd’hui de faire des choix différents. Nous devons dissiper ces doutes, tout d’abord en étant très clairs sur la question des financements : c’est un préalable au succès du sommet. Il faut espérer que ces financements seront mis en place, non seulement les 10 milliards qui sont déjà sur la table, mais pour lesquels il reste encore à définir les modalités d’engagement, mais aussi les 100 milliards d’ingénierie financière en provenance du secteur financier et des entreprises. Les entreprises et le secteur financier commencent à comprendre que le coût de l’inaction est plus élevé que celui de l’action. S’engager dans la transition énergétique et dans un autre modèle de développement peut permettre de créer des activités et des emplois, et de concevoir une sortie de la pauvreté pour de nombreux pays qui sont aujourd’hui privés d’accès à l’énergie et subissent de surcroît le plus durement, étant sous les latitudes les plus chaudes, le coût du réchauffement climatique, avec des déplacements massifs de populations que l’on appelle désormais des « réfugiés climatiques ».
Nos objectifs ne sont pas seulement arithmétiques ; ce sont des objectifs de valeurs, de survie, d’accès au développement et de sortie de crise pour les pays industrialisés. C’est un défi majeur à relever, mais aussi – c’est le message que veut porter la France – une formidable chance à saisir pour réparer les dégâts du passé et définir les conditions d’un développement durable, grâce à l’imagination, aux progrès de la technologie, à l’investissement dans les filières du futur : l’efficacité énergétique et la lutte contre le gaspillage énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, par laquelle les déchets des uns deviennent la matière première des autres, le secteur de la biodiversité.
Il n’est pas question de séparer la transition énergétique et les actions liées à la biodiversité, à la protection de la nature, des paysages et de l’agriculture. Les actions en faveur de la biodiversité peuvent en effet elles-mêmes apporter des solutions au réchauffement climatique. Par exemple, la forêt des Landes limite l’érosion de la côte aquitaine. En outre-mer, la reconstitution des mangroves, que nous avons inscrite dans la loi de transition énergétique, permet d’amortir la violence des vagues. De même, les toits végétalisés permettent des économies d’énergie.
Si nous réussissons à accélérer la transition écologique et énergétique et à la mettre à la portée de tous par des transferts de technologie vers les pays les plus pauvres, nous aurons les moyens de définir un modèle de développement assis sur des valeurs de civilisation permettant à la planète de nourrir ses habitants, qui seront 10 milliards en 2050. C’est une question de survie.
Vous connaissez les outils pour y parvenir. Laurent Fabius les a énoncés devant vous : il s’agit de l’accord, bien sûr, de l’agenda des solutions, du financement et de la mobilisation de la société civile.
Le sujet de la Conférence Climat est systématiquement inscrit à l’ordre du jour des sommets internationaux. Du 17 au 19 mai prochain aura lieu le dialogue de Petersberg sur la transition énergétique, rassemblant une trentaine de pays sous co-présidence allemande et française. Le couple franco-allemand entend accélérer la préparation de la conférence. Se tiendront ensuite le sommet du G7, en juin, celui du G20, en novembre, le sommet d’Addis-Abeba, qui doit résoudre la question du financement, en juillet, ainsi que le sommet des Nations Unies à New York à la fin du mois de septembre, qui sera un moment clé dans la mesure où la plupart des chefs d’État et de Gouvernement seront présents et que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, est très engagé pour la réussite de la conférence.
Aussi, je suggère que la mobilisation des parlementaires se fasse avant septembre, afin que vous puissiez peser de toutes vos forces. Je me réjouis que le sujet mobilise au-delà des clivages politiques, comme j’ai pu le constater lors des débats sur la loi de transition énergétique et la loi de biodiversité. Ce qui fait la force du message de la France, c’est justement que nos forces politiques sont unies sur cette échéance.
Le succès de la maîtrise du changement climatique sous le seuil de deux degrés dépend bien sûr de l’accord qui sera signé, mais plus encore des solutions opérationnelles locales. C’est le niveau local, et notamment l’engagement des collectivités territoriales et des réseaux d’entreprises, qui déterminera la réalité de la lutte contre le réchauffement climatique. C’est pourquoi j’ai lancé l’appel à projets sur les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). À ma grande satisfaction, nous avons reçu cinq cents réponses, de tous les territoires. L’initiative locale a très souvent été en avance sur les initiatives nationales. Seule une bonne articulation entre une impulsion nationale, des initiatives locales et les enjeux internationaux pourra rendre le mouvement irréversible.
Votre présence est attendue lors de la Business Week, à partir du 20 mai, qui rassemblera à l’UNESCO les grandes entreprises et les grands groupes financiers. Il y aura ensuite, début juillet, un rassemblement mondial de la recherche de haut niveau. La recherche française sur les écosystèmes et dans les sciences du vivant est reconnue mondialement. Ce sommet de la science sera un moment très fort de la préparation de la Conférence Climat ; il rencontre un tel succès que l’espace ne sera pas suffisant à l’UNESCO et que plusieurs organismes scientifiques ont été mobilisés pour accueillir une partie des débats.
Ces échéances s’accompagnent, comme l’a indiqué M. le président Chanteguet, d’un grand débat mondial, que j’ai souhaité lancer avec le concours de la Commission nationale du débat public et qui démarrera début juin. Des formateurs ont été établis dans chacun des grands groupes de pays, pour éviter un trop grand nombre de déplacements et maintenir le bilan carbone à un niveau raisonnable. Nous travaillerons par visioconférence. Les citoyens du monde entier, les élus, les collectivités, les entreprises sont invités à participer à ce débat. Les résultats des grandes décisions qui seront prises dépendent des citoyens : si tout le monde se mobilise, nous pourrons compter sur le caractère opérationnel des décisions.
M. Jean-Yves Caullet. Les « climato-sceptiques » ont perdu leur combat et nous pouvons nous en féliciter. Il nous faut à présent être exemplaires et mobilisateurs. Vous pouvez compter, madame la ministre, sur le groupe SRC et, je crois, sur l’ensemble des parlementaires pour soutenir vos efforts afin que cette conférence internationale soit un succès.
Je ferai quelques suggestions pour que cette mobilisation ait tout le rayonnement nécessaire au-delà des institutions. Le badge que je porte, un smiley sur la planète bleue, a fait beaucoup d’envieux ; c’est un bon signe. (Sourires) J’espère qu’il en sera distribué quelques centaines de milliers d’ici à la conférence et que chacun des porteurs du badge entraînera avec lui au moins un millier d’autres citoyens.
Mobiliser la société civile est très difficile. Je voudrais vous suggérer de faire ce qui a été fait pour la construction de l’Europe, à savoir de vous appuyer sur des jumelages entre collectivités, jumelages qui ont pu, à l’époque, effacer les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ne pourrions-nous partager sur cette base les enjeux du dérèglement climatique, entre les pays du Sud et ceux du Nord, les pays qui ont bénéficié de la gabegie carbonée et ceux qui en subissent les conséquences, afin de dépasser les oppositions et les frilosités ?
La mobilisation des jeunes est également essentielle. Il faut que la jeunesse devienne un prescripteur majeur pour le monde des adultes.
Enfin, je manquerais à tous mes devoirs si je n’évoquais le rôle de la forêt et la nécessité d’engager au plan mondial une véritable diplomatie forestière. La forêt est à la fois un acteur de la lutte contre le changement climatique, un réservoir de biodiversité, et la victime de pratiques qui aggravent les conséquences du dérèglement climatique et que nous dénonçons tous. Nous pouvons là aussi être mobilisateurs, car la gestion forestière est exemplaire dans notre pays, durable, multifonctionnelle, portée par des propriétaires privés comme par des propriétaires publics au premier rang desquels les communes et l’État, par le biais de l’Office national des forêts, dont j’ai l’honneur de présider le conseil d’administration et qui fêtera son cinquantenaire cette année. Je souhaiterais que nous portions le travail de cet office comme un modèle de lutte contre l’érosion du trait de côte ainsi que d’actions pour la biodiversité et une exploitation durable des ressources, et que nous en fassions un argument pour un véritable marché du carbone international en vue de financer la lutte contre le changement climatique.
M. Jean-Marie Sermier. Vous l’avez dit, madame la ministre, tous les parlementaires partagent l’objectif de réussir la COP21 et de contenir le réchauffement climatique sous le seuil des deux degrés. Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a redit combien il était urgent d’agir et d’accroître l’ambition des promesses de réduction des gaz à effet de serre. Il faudrait ainsi réduire ces émissions de 40 à 70 % d’ici à 2050.
Les négociations préalables à la conférence de Paris vont bientôt s’ouvrir, avec trois sessions à Bonn, la première entre le 1er et le 11 juin, la deuxième à la fin du mois d’août et la troisième à la mi-octobre. La synthèse des différents scénarios présentés par les pays sera prête, a priori, pour le 1er novembre. Après la phase de réflexion, il faut à présent viser des éléments opérationnels. Un outil juridiquement contraignant, différencié et universel s’impose. Or il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus, ni sur la nature de cet instrument, protocole ou traité, ni sur les champs d’application de l’accord. Quelle est votre position à ce sujet ?
Chaque pays doit présenter une contribution nationale pour la réalisation de l’objectif qui lui est propre, avec en vue une limitation de l’augmentation des températures à deux degrés. Ces contributions doivent être envoyées avant la fin du mois de juin. Or seuls une centaine de pays pourront envoyer leurs contributions ; trente au moins ne le pourront pas sans une aide particulière. Un fonds géré par l’Agence française de développement (AFD) a été créé pour aider quinze pays d’Afrique à présenter la leur. Pouvez-vous nous confirmer qu’une telle aide sera suffisante pour ces pays ?
Le fossé entre les pays en voie de développement et les pays développés est immense et n’a cessé de se creuser. Alors que les engagements financiers sont prévus à hauteur de 100 milliards, seuls 10 milliards ont été récoltés à ce jour. Comment comptez-vous faire en sorte que chacun respecte ses engagements ?
Enfin, les décisions qui seront prise à Paris ne devant entrer en vigueur qu’après 2020, ferez-vous des propositions relativement à une période intermédiaire ?
On voit bien qu’il y a peu de progrès concrets et que les résultats attendus à la conférence risquent d’être difficiles à obtenir. Au-delà de l’affichage, il faudra se concentrer sur la nature des contraintes de l’accord. Le Gouvernement français devra se positionner clairement sur la question des financements et des contrôles, sinon rien de sérieux ne sortira de cette conférence.
M. Bertrand Pancher. Comment faire en sorte que la conférence de Paris ne se résume pas à une vaste foire au climat ? (Murmures divers) La probabilité pour qu’elle devienne une telle foire est très forte. Un certain nombre d’entre nous participent à toutes les conférences sur le réchauffement climatique et nous voyons bien la tournure que prennent les événements.
Tout d’abord, de mauvais signaux apparaissent eu égard aux engagements des pays. Laurence Tubiana, la négociatrice française, a déclaré il y a quelques semaines que les contributions nationales déposées ne sont pas suffisantes pour maintenir le réchauffement climatique à deux degrés. Si, par bonheur, grâce à un sursaut de la communauté internationale, les contributions déposées permettent de ne pas dépasser ce seuil, dans la mesure où les accords ne sont pas contraignants et qu’il n’existe aucun moyen pour qu’ils le soient, la conférence de Paris ne pourra tout de même régler la question à elle seule.
Les parlementaires attendent donc du Gouvernement qu’il mette tout en œuvre pour aboutir à un accord sur la base des propositions des pays – et nous savons que vous y mettez les moyens –, mais aussi que vous rappeliez avec force que cet accord ne réglera pas à lui seul la question du réchauffement climatique et qu’il faut donc s’engager dans de nombreuses autres directions.
Ces directions sont connues. C’est tout d’abord la régulation de nos échanges au plan mondial et l’évolution de l’Organisation mondiale du commerce de façon à internaliser dans nos échanges les coûts externes, notamment le coût carbone. C’est aussi la nécessité pour les grands espaces économiques tels que l’Union européenne de se doter d’instruments de régulation à la hauteur des enjeux. C’est également la nécessité que les entreprises et les autres acteurs fassent preuve de responsabilité. Quelle est votre appréciation de ces mesures complémentaires ?
M. François-Michel Lambert. La COP21 n’est pas un aboutissement, mais une étape majeure : à son issue, nous devrons « avoir changé de braquet » et réussi la mobilisation planétaire des États et de toutes les composantes de la société civile. Je vous remercie, madame la ministre, de votre vision ainsi que des opportunités qui sont à présent devant nous en matière de transition énergétique et peuvent nous permettre de sortir d’un modèle de gaspillage d’énergie, de gaspillage des ressources, de destruction de nous-mêmes.
Pour saisir ces opportunités et bâtir un nouveau monde, nous devons agir dans plusieurs directions, en créant de la convergence et en avançant ensemble. Un accord ambitieux doit être obtenu : quelle est la stratégie du Gouvernement pour y parvenir ? Au-delà de l’accord, il faut des moyens. Il est prévu de mobiliser 100 milliards de dollars en 2020. Comment pensez-vous tenir une telle ambition ? Disposez-vous d’ores et déjà de certaines assurances ?
Nous sentons que la société civile est prête à mettre en œuvre des solutions, à condition qu’elle perçoive une véritable ambition politique. Comment évaluez-vous cette ambition en France, en Europe et même dans le monde ?
Le climat, c’est notre avenir, c’est-à-dire, avant tout, celui de notre jeunesse. Notre Gouvernement a fait de celle-ci un atout majeur de la politique nationale. Il faut aujourd’hui en faire un atout majeur de la mobilisation mondiale. Comment pensez-vous y parvenir ?
L’étape suivante sera la COP22 au Maroc. Comment la France assurera-t-elle la liaison avec nos amis marocains ? Pouvez-vous par ailleurs préciser l’articulation entre votre ministère et celui des affaires étrangères ?
Les écologistes sont entièrement disponibles pour la réussite de cette conférence.
M. Jérôme Lambert. Depuis sept ans, avec Bernard Deflesselle et, depuis cette année, Arnaud Leroy, je suis le processus des négociations mondiales sous l’égide des Nations Unies avec beaucoup d’intérêt. Ce processus nous conduit cette année à accueillir la COP21, qui porte l’espoir d’un accord global pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le succès de cette conférence ne dépend pas que de l’implication de la France ; c’est une conférence mondiale et tous les pays sont, au même titre que le nôtre, en responsabilité. Cela dit, l’impulsion que donne la France aux discussions est manifeste, et nous vous en remercions, madame la ministre. Les députés sont fiers de l’implication de notre pays. Les enjeux sont primordiaux, et, à défaut d’accord à Paris, nous porterons une lourde responsabilité vis-à-vis des générations futures ; nous ne pouvons nous permettre l’attitude « après nous le déluge ». Nous soutenons donc notre Gouvernement et les Nations Unies afin que la conférence de Paris soit un succès pour l’humanité.
Le point le plus préoccupant est celui du financement en direction des pays en voie de développement. Nous avons du mal à dégager les 100 milliards de dollars promis pour la fin de cette année, et, d’après nos engagements collectifs, nous devrons trouver 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2020. Comment y parviendrons-nous ?
M. Patrice Carvalho. L’objectif, madame la ministre, est loin d’être atteint. Les scénarios climatiques établis par le GIEC indiquent qu’à trajectoires constantes, les températures pourraient croître de cinq degrés. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a organisé la semaine dernière une importante rencontre sur la lutte contre le réchauffement climatique et la préparation de la COP21. Un rapport consacré à cette conférence identifie les obstacles auxquels nous nous heurtons pour avancer. Ce qui freine le processus, c’est le manque de volonté politique. Le rapporteur du CESE relève que ces négociations sont avant tout économiques et géopolitiques, et restent dominées par une vision court-termiste, incompatible avec les enjeux du réchauffement.
Le protocole de Kyoto, signé en 1997, avait fixé des objectifs de réduction chiffrés pour les pays développés. Depuis lors, certains pays qui l’avaient ratifié s’en sont désolidarisés. D’autres l’ont rejoint au cours d’une seconde phase d’engagement, mais ce n’est pas le cas de pays comme la Chine ou l’Inde qui sont de très gros pollueurs. Ces pays considèrent que s’engager nuirait à leur développement. Ils affrètent chaque jour de grands bateaux pour venir chercher le bois de nos forêts et le rapporter chez eux avant de nous le renvoyer en planches ou en parquet. En matière de développement durable, on doit pouvoir faire mieux ! (Sourires)
Nous ne pouvons afficher une volonté de gouverner le climat si nous ne gouvernons pas l’économie. Or nous sommes incapables de prendre des directives ne serait-ce que sur les abeilles ! Le réchauffement climatique est intimement lié à nos modes de production et de consommation. Les émissions sont en grande partie l’effet des traités sur le libre-échange, qui n’ont pas seulement consacré le dumping social, mais aussi le dumping environnemental, dans une course effrénée à la concurrence. Nous sommes dans la même logique aujourd’hui avec les traités transatlantiques et transpacifiques. Tant que nous ne reconsidérerons pas nos modes de développement et de production, que nous ne placerons pas le climat au centre des négociations sur le commerce mondial, nous peinerons à trouver des solutions pérennes. Allez convaincre les Allemands qui développent le charbon à tout va !
C’est pour les mêmes raisons que nous ne parvenons pas à récolter les sommes nécessaires à l’abondement du Fonds vert, créé à Copenhague en 2009 et qui a pour finalité d’aider les pays pauvres subissant les effets du réchauffement climatique. L’objectif est d’atteindre 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020. Nous sommes loin du compte puisque la première capitalisation s’élève à 9,3 milliards de dollars. La France s’est engagée à contribuer à hauteur de 1 milliard de dollars. Pouvez-vous nous préciser comment cette contribution sera financée ?
M. Bertrand Pancher. Très bien !
Mme la ministre. Je souhaite en premier lieu dissiper un malentendu. Il ne s’agit pas d’une conférence organisée par la France, mais d’une conférence des Nations Unies. La France a offert le lieu de réunion ; elle a été la seule candidate, beaucoup de pays ayant été échaudés par les échecs précédents, notamment à Copenhague. Aussi, les questions sur la façon dont la France dégagera 100 milliards ou parviendra à un accord ne se posent pas en ces termes : la France facilite les choses, mais ce sont les Nations Unies qui organisent la conférence.
La question de la forêt, monsieur Jean-Yves Caullet, est en effet cruciale. Le sujet devra constituer une part importante de l’agenda des solutions. La forêt est un des grands enjeux du débat, à côté des océans et des vallées, car la déforestation entraîne des conséquences dramatiques sur la biodiversité et les sols. En replantant des forêts, on fait baisser la chaleur, on crée des puits de carbone et des filtrages naturels, on contribue à la conservation des sols etc.
Monsieur Jean-Marie Sermier, nous aidons vingt-trois pays à rédiger leurs contributions nationales, ce qui leur permettra de soumettre des contributions de qualité avant le 1er octobre. Nous participons également à un forum informel avec les autres États qui aident les pays pauvres à rédiger leurs contributions.
Le Gouvernement français, monsieur Bertrand Pancher, doit en effet tout faire pour faciliter l’accord, et vous avez également raison de souligner que celui-ci ne suffira pas. L’accord se nourrit de l’agenda des solutions et des engagements nationaux ; c’est parce qu’il y aura une dynamique des engagements nationaux que les pays seront amenés à signer cet accord. Si certains pays, encore très éloignés des problématiques de la transition énergétique, s’engagent sur des propositions concrètes pour leurs territoires, ils verront, avec les retombées envisageables, que signer l’accord n’est pas un problème. Il existe une synergie entre l’accord, les engagements nationaux et l’agenda des solutions.
La Conférence Climat, monsieur François-Michel Lambert, est un moment majeur dans l’histoire de la lutte contre le dérèglement climatique, dans une double dynamique. La France doit saisir cette opportunité pour accroître ses exigences écologiques, ce que nous avons fait avec les lois de transition énergétique et de biodiversité, mais cette action doit se prolonger dans les années à venir, car nous travaillons à l’échéance de 2030, et même de 2050.
Je ne souhaite pas, cependant, évoquer la prochaine COP. Certains négociateurs se projettent déjà dans la COP22, ce qui revient à considérer que notre prochain rendez-vous a peu d’importance. Non, la COP de Paris doit vraiment être un moment historique de basculement vers un nouveau modèle de civilisation, un modèle où les pays du monde prennent conscience de leur unité et de leur volonté d’agir, ensemble, mais aussi nationalement et localement, et de rendre des comptes sur leur action.
Nous devons en effet, monsieur Jérôme Lambert, mobiliser 100 milliards. Cela passe à la fois par des financements pour le Fonds vert, mais aussi par l’ingénierie financière et la mobilisation du secteur financier et des entreprises. La Business Week, à la fin du mois de mai, verra apparaître un certain nombre de problématiques, de propositions et d’initiatives. Les entreprises et groupes financiers vont comprendre qu’en finançant la transition énergétique et écologique, ils se financent eux-mêmes. Cela peut encore paraître un idéal : pourquoi la finance internationale aurait-elle intérêt à lutter contre la pauvreté et le fossé entre le Nord et le Sud, alors qu’elle en a profité jusqu’à présent ?
Les groupes d’assurance se rendent déjà bien compte que les dégâts du dérèglement climatique, tsunamis, inondations, effondrement du trait de côte…, ne leur permettent plus de chiffrer les assurances ; pour verser moins d’indemnisations, ils ont intérêt à investir dans l’atténuation du dérèglement climatique. Il appartiendra aux États et aux opinions publiques de contrôler les nouvelles règles du jeu qui, par une répartition différente des richesses et des investissements, consacreront un système plus égalitaire à l’échelle de la planète.
Je partage, monsieur Patrice Carvalho, votre préoccupation pour les abeilles, et nous allons engager un plan national de reconquête des abeilles et des pollinisateurs, durement frappés par les néonicotinoïdes et les pesticides. Nous en avons débattu à l’occasion du texte sur la biodiversité. Vous avez également raison de poser la question du commerce international : elle fait partie des négociations.
M. Jean-Marie Sermier. Nous savons que l’agenda d’un ministre est toujours très chargé, mais le groupe UMP regrette que l’audition de la ministre par trois commissions ne dure qu’une heure, ne permettant pas un réel débat. Nous souhaitons qu’une autre audition soit rapidement inscrite à l’ordre du jour, avec un temps suffisant pour permettre à chaque parlementaire de s’exprimer.
M. Bertrand Pancher. Le groupe UDI formule la même demande.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ce sera le cas, nous y veillerons.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci, madame la ministre. Nous avons pu mesurer la force de votre engagement ainsi que votre volonté que la COP21 soit un moment de basculement – volonté que nous partageons.
23. Table ronde sur le financement de la lutte contre le changement climatique (27 mai 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Au cours des auditions ou des tables rondes que nous avons organisées dans le cadre de la préparation et du suivi des conférences climatiques internationales, la question du financement de la lutte contre le changement climatique a été souvent abordée. De nombreuses interrogations ont été soulevées sur les montants et les mécanismes de financement ainsi que sur les engagements réels des différents protagonistes.
Aujourd’hui, nous accueillons : M. Antoine Michon, sous-directeur du climat et de l’environnement à la direction du développement et des biens publics mondiaux du ministère des affaires étrangères et du développement international, qui fera un panorama des trois processus de négociation qui se déroulent de façon parallèle sur le climat et sur le développement, M. Tancrède Voituriez, directeur de programme Gouvernance à l’IDDRI, qui évoquera les enjeux du financement de la lutte contre le changement climatique et les conséquences spécifiques sur la COP 21 ; M. Benoît Leguet, directeur de la recherche à CDC Climat, qui dressera le panorama des financements climatiques en France et dans le monde ; et, enfin, M. Stanislas Dupré, directeur du think tank 2 °C II. M. Dupré présentera la méthodologie d’évaluation de la performance climatique des actifs d’un portefeuille, et évoquera la portée des dispositions votées dans le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
M. Antoine Michon, sous-directeur du climat et de l’environnement au MEADI. Mesdames et messieurs les députés, je vais vous présenter, dans le court temps qui m’est imparti, un panorama général des trois processus de négociations qui sont en cours cette année et qui touchent aux questions liées au développement et au climat : premièrement, le processus sur le financement du développement, qui se conclura à Addis-Abeba au mois de juillet, et s’inscrit dans la suite des conférences précédentes de Monterrey et de Doha sur le financement du développement ; deuxièmement, le processus post 2015 sur l’agenda du développement, qui vise à établir, en septembre prochain à New York, le nouvel agenda pour le développement pour la période 2015-2030 et prendra la suite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 ; troisièmement, la COP 21 de Paris, en décembre, dont l’objectif sera d’établir un accord universel sur le climat pour la période post 2020.
Ces trois processus, dans laquelle la France est engagée – avec un positionnement différent – sont à la fois séparés et étroitement connectés, notamment à travers la question du financement. À Addis-Abeba, l’objectif sera d’essayer de mettre en évidence les liens étroits existant entre le financement du développement et le financement du climat. À New-York, il s’agira d’intégrer de manière transversale dans cet agenda du développement l’enjeu climatique. Enfin, à Paris, il s’agira de concilier l’objectif du respect de la limite des deux degrés avec le développement économique et social – un des enjeux de la convention Climat.
Aujourd’hui, où en est-on ?
La négociation d’Addis-Abeba a été engagée dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la base d’un texte proposé par deux « cofacilitateurs », norvégien et guyanais. On a retrouvé dans la discussion les clivages assez habituels entre les pays du G 77 et les pays développés, en particulier sur le niveau d’engagement des pays développés sur l’aide publique au développement, ou sur les liens entre climat et développement. Les pays du G 77 demandent que le financement du climat soit additionnel au financement de l’aide au développement.
Dans cette négociation, notre objectif est de bien identifier et d’encourager les synergies qui existent entre les actions de développement et celles qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique, et de bien mettre en évidence que les différents instruments qui concourent au développement économique bénéficient aussi au climat. Mais il faudra aussi rassurer les pays en développement sur notre engagement dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement. Ce processus, qui va se poursuivre au cours de trois prochaines séances de négociation, doit aboutir à la mi-juillet.
À New-York, l’agenda a déjà été largement écrit par un groupe de travail qui a rendu ses travaux l’année dernière. Il a été repris dans un rapport du secrétaire général des Nations Unies. La négociation reprendra, mais il y aura sans doute très peu de changements par rapport au texte qui a été approuvé. Nous disposons donc aujourd’hui d’un cadre, qui sera formellement adopté par les chefs d’État et de gouvernement lors de l’Assemblée générale de septembre, avec dix-sept grands objectifs pour le développement. Six d’entre eux sont proprement environnementaux ; l’un d’entre eux portera sur le climat.
Cet agenda du développement a comme spécificité d’intégrer de manière bien équilibrée les trois dimensions du développement durable, social, économique et environnemental, d’être universel, en permettant de dépasser les clivages Nord-Sud traditionnels, et d’offrir une vision vraiment partagée du développement à l’horizon 2030. Il servira très certainement de cadre aux interventions des bailleurs de fonds. On y retrouve, et c’est un de ses intérêts, au-delà d’un objectif spécifique pour le climat, des cibles « climat » à l’intérieur de plusieurs objectifs, sous la dimension « énergie », la dimension « ville », la dimension « forêt ». Ces cibles témoignent de l’intégration de l’enjeu climatique dans l’ensemble des politiques de développement.
À Paris, la discussion est engagée depuis 2011, et l’on devrait aboutir en décembre prochain à un accord universel sur le climat. La France est dans une position particulière, étant à la fois pays « hôte » et présidente de la Conférence. Nous sommes là pour faciliter les convergences et les consensus, ce qui implique de notre part un travail bilatéral très intense. Vous avez sans doute noté que le Président de la République, plusieurs ministres, dont le ministre des affaires étrangères, ont mis le climat à l’agenda de leurs déplacements à travers le monde et organisé plusieurs rencontres – le Président de la République était tout récemment dans les Caraïbes – spécifiquement dédiées au climat. Mais cela implique aussi de mener un travail dans des enceintes multilatérales, le G 7, le G 20, ou dans des réunions informelles que la France, avec la présidence péruvienne, a commencé à organiser au niveau des négociateurs, et qu’elle organisera très prochainement dès le mois de juillet au niveau des ministres.
En matière de finances, l’enjeu est triple : tout d’abord, crédibiliser les engagements pré 2020, qui ont déjà été pris ; ensuite décider, à Paris, de ces financements pour la période post 2020, avec, sans doute, un horizon de long terme ; enfin, contribuer à réorienter l’ensemble des flux financiers vers l’économie à bas carbone.
Sur le pré 2020, la crédibilisation de l’engagement des 100 milliards par an, il y a deux enjeux.
Le premier est que l’on parvienne à une comptabilisation, sinon négociée, du moins partagée entre bailleurs et récipiendaires ; des travaux sont en cours, afin d’harmoniser les méthodes de comptabilisation. Le deuxième enjeu est de donner aux pays en développement des indications sur notre trajectoire, à partir d’aujourd’hui, 2015, et au moins jusqu’en 2020, pour qu’ils sachent ce qu’ils peuvent attendre en matière de financements, publics et privés, d’ici à 2020.
Sur le post 2020, pour ce qui est en discussion dans le cadre de la négociation de l’accord, il y a au moins quatre enjeux principaux.
Le premier enjeu porte sur le chiffre et le niveau d’engagement. Établira-t-on un chiffre post 2020, similaire à l’engagement des 100 milliards ?
Le deuxième porte sur les cycles, et notamment les cycles d’engagement. Voudra-t-on établir un réengagement régulier des pays donateurs sur des montants financiers ? Et si l’on décidait d’adopter un système de cycles, quelle en serait la fréquence ? Quels en seraient principes ? Quels liens seraient alors établis avec l’adaptation et avec l’atténuation ? Certains pays demandent l’établissement d’un lien direct entre les engagements pris en matière d’adaptation, les engagements pris en matière d’atténuation et, bien entendu, les engagements financiers. Enfin, quelle transparence, quels mécanismes de revue pour ces cycles d’engagements financiers ?
Un troisième enjeu est lié à la question de la différenciation, qui traverse la négociation. D’abord, qui paie ? Les pays développés dits « de l’annexe I » souhaitent que la palette des pays donateurs s’élargisse, notamment aux pays émergents et aux pays en mesure de financer des actions d’atténuation et d’adaptation. Ensuite, qui reçoit ? Établit-on des catégories privilégiées de récipiendaires, par exemple des pays vulnérables, des pays les moins avancés auxquels on allouerait en priorité certaines sommes. Ces questions sont ouvertes et sont en discussion.
Un quatrième enjeu porte sur les institutions. Il existe aujourd’hui plusieurs mécanismes financiers mis en place dans le cadre de la convention, des fonds spécifiques comme le fonds d’adaptation ou le fonds pour les pays les moins avancés (les PMA). Ces fonds sont-ils pérennes ? Seront-ils fondus ou intégrés au sein du Fonds vert qui est établi cette année ? Ces questions sont en discussion et sont ouvertes. Mais les réponses qui seront apportées sur ces différents sujets dépendront en partie des réponses qui seront apportées sur d’autres sujets, notamment les engagements en matière d’atténuation, ou les questions de transparence et de revue.
Les discussions sur la mobilisation des acteurs privés et la réorientation des flux financiers se déroulent très largement en dehors de la négociation, mais elles font partie de l'ensemble des discussions que l’on souhaite voir aboutir à Paris. Pour nous, il y a trois enjeux principaux.
Le premier est d’accroître, de développer les engagements volontaires des « champions » parmi les acteurs privés qui s’étaient manifestés en septembre 2014 au sommet de New-York, et qui sont susceptibles de prendre de nouveaux engagements, plus importants.
Le deuxième est d’intégrer la problématique climat à l’intérieur du système financier, à la fois à travers des acteurs comme les agences de notation, mais aussi à travers des mécanismes pris par les régulateurs.
Le troisième est que les politiques publiques prennent en compte l’enjeu climatique. Cela nous renvoie à toutes les questions de prix du carbone, de subventions aux énergies fossiles, et plus largement aux mécanismes incitatifs à l’investissement vert.
M. Tancrède Voituriez, directeur de programme Gouvernance de l’IDDRI. Mesdames et messieurs les députés, je commencerai par trois généralités concernant les négociations sur le financement du climat.
Premièrement, il existe un certain décalage entre les négociations qui portent sur le financement, et celles qui portent sur les contributions en tant que telles. L’accord de Paris, contrairement à ce qui se passait avant celui de Copenhague, comportera des contributions nationales, établies pour l’instant sans référence ou avec une référence très limitée au principe de responsabilité commune et différenciée. La grande modernité de l’accord de Paris sera sans doute que ce principe se trouvera quelque peu estompé. Tous les pays, de manière bottom-up, participeront au pot commun en annonçant leurs contributions pour l’atténuation ou l’adaptation. Mais ce n’est pas le cas en matière de finance, où la responsabilité commune et différenciée reste très présente.
Deuxièmement, l’attente suscitée par les INDC (Intended Nationally Determined Contributions), ces contributions nationales, a quelque peu éclipsé les discussions sur le financement. Les discussions sur le financement sont moins matures que les discussions sur les contributions.
Troisièmement, la chronologie est particulière. On va commencer la séquence par une négociation sur les financements du développement durable, qui abordera les questions de financement du climat sans que l’on connaisse ni les objectifs du développement durable dont la liste sera finalisée en septembre, ni l’ensemble des contributions nationales.
En matière de financement du climat et de négociation sur le financement du climat, plus particulièrement, je distingue principalement trois grands sujets, qui sont liés entre eux : d’abord, la réorientation et la réallocation des flux financiers, publics et privés – on parle en anglais du shifting trillions ; ensuite, le Fonds vert pour le climat ; enfin, la place du financement dans l’architecture de l’accord de Paris.
Commençons par la mobilisation et la réallocation des flux financiers, qui atteignent en effet des milliers de milliards. Les discussions commencent par l’estimation des besoins. En gros, ne serait-ce que pour financer des infrastructures bas carbone, il nous faudrait 100 000 milliards d’ici 2030, c’est-à-dire sur quinze ans. Le PIB mondial étant de 100 000 milliards par an, 15 % du PIB mondial annuel devraient donc prendre la forme d’investissements dans des activités bas carbone.
Finalement, ce n’est pas beaucoup, dans la mesure où l’investissement dans le PIB mondial est d’un peu plus de 20 %. Donc, contrairement aux idées reçues, il ne faut pas beaucoup plus d’argent, mais il faut qu’une partie des investissements qui s’élèvent à quelque 20 000 milliards par an dans le monde soient réalloués à hauteur des trois quarts vers des activités bas carbone. Et pour que ces investissements soient alloués vers les bons endroits, il faut des cadres juridiques nationaux incitatifs. L’argent n’étant pas très cher en ce moment, il n’est pas difficile de mobiliser des fonds, la question qui se pose est de les orienter vers les bons secteurs.
C’est là que les difficultés surgissent : pour allouer ces investissements dans les bons secteurs, il faut des signaux et des cadres de réglementation et de régulation. Or ceux-ci ne sont pas homogènes à travers le monde. Et on investit toujours beaucoup d’argent dans des activités très intensives en carbone.
La CCNUCC, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique – en anglais l’UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change – ainsi que la Banque mondiale et un think tank qu’on appelle le Climate Policy Initiative (CPI), ont estimé le niveau des investissements climat – ou finance climat. Le problème est que ces estimations sont très disparates. Ainsi, l’UNFCCC annonce jusqu’à 600 milliards par an, mais la CPI et la Banque mondiale en annoncent plutôt la moitié : 300 milliards par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, l’aide publique au développement, 150 milliards, en représente encore la moitié. Le financement climat se situe donc entre 300 et 600 milliards par an. Or, en 2014, selon la Banque mondiale, les investissements dans les énergies fossiles atteignaient encore 1 000 milliards. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’argent à gagner à moindre coût. Ce n’est pas davantage de dettes, c’est simplement de l’argent qui est mieux utilisé.
Le financement climat représente 300 ou 600 milliards selon le périmètre, lequel n’est pas clairement établi. Cela suscite beaucoup de discussions techniques et donc de discussions politiques : que mettre dans le périmètre du financement climat ? Faut-il y mettre les tarifs d’achat d’électricité renouvelable par exemple ? Si oui, à quelle hauteur et avec quelles références de prix ? C’est très compliqué.
Dans ces 300 ou 600 milliards par an, 60 % sont de l’investissement privé, et 40 % de l’investissement public ou des dépenses publiques. Dans ces 40 %, la grande majorité prend la forme de financement concessionnel, c’est-à-dire en dessous du taux d’intérêt du marché – ce peut être au seuil de l’aide publique au développement (APD) ou entre le seuil de l’APD et le taux de marché. L’essentiel du financement climat public international ressemble ainsi à de l’aide publique au développement. Cela pose problème : comment comptabiliser l’APD non climatique et l’APD climatique ? D’où une nouvelle querelle, évidemment très politique, sur la méthode.
Il y a trois manières de faire, qui ne sont pas convergentes :
D’abord, l’approche de l’OCDE et du Comité d’aide pour le développement (CAD), qui a été élaborée à partir des marqueurs de Rio. Ces marqueurs sont très qualitatifs. Imaginons que je travaille à l’AFD (Agence française de développement) et que mon projet ait pour ambition d’atténuer ou de produire des résultats en matière d’adaptation. Je cocherai une case différente selon que je considère que ce projet est significativement ou principalement tourné vers tel ou tel objectif. Évidemment, cela provoque des controverses.
Ensuite, la France, par le biais de l’AFD et du Club International des Finances du développement IDFC (International Development Finance Club), propose une méthodologie alternative, plus objective. Celle-ci ne vise pas à apprécier l’impact climatique d’un projet, mais à montrer, à partir des émissions évitées, l’impact réel de ce projet.
Enfin, une troisième méthode, plus mystérieuse, sur laquelle on fait des études, a été développée par la Banque mondiale. Sur cette base, jusqu’à 80 % des projets de la Banque mondiale sont « amis du climat », alors qu’avec d’autres mesures comme les marqueurs de Rio, le pourcentage tombe à 20 ou 30 %. Cela pose quelque problème.
Toutes ces discussions techniques mettent en évidence qu’il est impossible de dissocier les discussions sur le financement du développement des discussions sur le financement du climat. De nombreux projets de financement de développement ont des effets sur le climat, et beaucoup de projets d’atténuation ont des effets sur le développement. Ainsi, aujourd’hui, l’Agence française de développement, avec sa méthodologie, annonce que 50 % de ses projets sont compatibles avec des objectifs climatiques.
Je tiens à préciser que dans cette masse de 300 ou 600 milliards, l’essentiel, soit 90 %, sont des investissements d’atténuation ; l’adaptation représente moins de 10 %. Or l’adaptation devient un sujet et un motif de revendication croissant de la part des pays en développement. Ceux-ci se doutent qu’on ne va pas atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à deux degrés, que ce réchauffement atteindra plutôt trois ou quatre degrés, et que les impacts de ce réchauffement sur le climat seront très importants. Plutôt que de se focaliser sur la négociation de contributions qui seront sans effet, ils préfèrent négocier tout de suite une masse d’argent dédiée à l’adaptation. Les montants et les estimations des montants dédiés à l’adaptation vont donc aller croissant. Or le point de départ est très bas. Cela risque d’entraîner des difficultés pour les bailleurs internationaux, notamment la France.
J’en viens à mon deuxième grand sujet : le Fonds vert pour le climat, qui est une initiative symbolique et politique.
On ne sait pas à quoi ce fonds va servir. Il n’a pas d’objectifs très spécifiques, hormis l’atténuation et l’adaptation. Le concernant, on a commencé à discuter d’argent, bien davantage que d’objectifs.
Les critères de mobilisation de ce fonds ne sont pas clairs non plus. Y aura-t-il un droit de tirage pour les pays en développement et les banques nationales de développement, sur la base du principe de responsabilité commune et différenciée ? S’agira-t-il d’un fonds du type « fonds pour l’environnement mondial », hébergé par une institution multilatérale ? Les pays en développement n’en veulent pas.
Enfin, on n’arrive pas à mobiliser les fonds privés. Les privés ne veulent pas financer dans le climat à hauteur de ce que l’on attend d’eux. Il ne pourra s’agir que de financements conjoints, ce que l’on appelle de la finance mixte, de la blended finance.
Dernier grand sujet : la place du financement dans l’architecture de l’accord.
Il y a trois pistes ou trois options, qui toutes procèdent de la distinction entre la mobilisation des fonds et la fourniture des fonds. Il pourrait y avoir des objectifs globaux de mobilisation des fonds ; des objectifs de fourniture des fonds établis sur la base du principe de responsabilité commune et différenciée, avec un calendrier et des cycles d’engagement sur cette fourniture de fonds ; enfin, des principes pour guider la mise en œuvre et la dépense du Fonds vert, qui restent encore à établir.
M. Benoît Leguet, directeur de la recherche à CDC Climat. Mesdames et messieurs, je vais continuer à peindre sur la toile qu’ont commencé à brosser M. Michon et M. Voituriez, en vous parlant des flux réels et des besoins de financement – au niveau mondial et en France.
D’où viennent les chiffres cités par M. Voituriez ? Quand on parle de finance climat, on parle d’investissements dans du dur, dans du matériel, dans de l’infrastructure tangible, donc de projets d’investissement. On se consacre essentiellement à l’étude des flux que je qualifierais de « durs » en excluant généralement ceux que je qualifierais de « mous », qui sont liés à la recherche et développement, à la formation, à l’information, à l’éducation, etc. Ce n’est pas que ces derniers aient une importance négligeable dans la lutte contre le changement climatique. Mais on regarde essentiellement là où l’on a des chiffes. Et il se trouve que l’on a plutôt des chiffres sur du dur, sur de l’infrastructure, sur des projets d’investissement.
On regarde surtout les projets qui participent à la lutte contre le changement climatique – atténuation et adaptation. Cela dit, comme l’a rappelé M. Voituriez, la plupart des projets concernent plutôt le secteur de l’atténuation, et donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
On ne traite donc qu’une partie des flux financiers. En général, tout ce qui est mou est oublié. Les projets non capitalistiques ne sont pas non plus pris en compte, ou ils sont peu ou mal traités. Il convient donc de toujours avoir à l’esprit que l’on ne parle que d’une partie de la question, la plus documentée.
Pourquoi les estimations divergent-elles ? Pour un certain nombre de raisons, qui sont essentiellement des problèmes de périmètre. On ne parle pas toujours de la même couverture sectorielle ; on regarde parfois l’énergie, parfois l’ensemble de l’économie, etc. Il est difficile de savoir ce qui relève, ou ne relève pas, du climat. Est-ce qu’une centrale à gaz est un projet climat, ou pas ? On pourrait trouver autant de réponses que de personnes dans la salle. On ne parle pas toujours de la même couverture spatiale, voire du même horizon temporel. Or plus l’horizon temporel s’accroît, plus les besoins augmentent. Cela peut alors accroître l’addition lorsque l’on raisonne en flux annualisés.
Cela dépend également de la part du climat estimée dans un investissement donné. Est-ce que l’on raisonne en marginal ou en absolu ? Par exemple, j’investis aujourd’hui dans l’éolien. C’est un investissement vert. Mais est-ce que je considère mon investissement total comme un investissement climat ? Dois-je prendre seulement en compte le surcoût éventuel entre l’éolien et une solution de référence, par exemple celle qui aurait été adoptée en l’absence de toute incitation ?
Voilà pourquoi nous trouvons autant de divergences dans les chiffres qui nous sont donnés. Néanmoins, des sources existent : le Comité permanent sur les finances de la CCNUCC (en anglais, le Standing Comittee of Finance de l’UNFCCC), a publié en 2014 une étude, qui devrait être renouvelée tous les deux ans, et qui a le mérite de faire consensus ; d’autres organismes publient des chiffres, comme la CPI ou la New Climate Economy, dont a parlé M. Voituriez tout à l’heure.
Dans l’étude de l’UNFCCC, je retiendrai trois chiffres, ou plutôt trois fourchettes. Certes, il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les années qui ont été prises en compte. Pour autant, au début des années 2010, le total de la finance climat au niveau mondial se situait entre 340 et 650 milliards de dollars par an. C’est une fourchette très large – mais vous devez garder en tête les raisons qui font que ces chiffres paraissaient parfois diverger. Le total des financements climat Nord Sud variait entre 40 et 175 milliards de dollars par an, et la part de ceux transitant par des institutions publiques entre 35 et 50 milliards de dollars par an.
Comment relier cela au débat sur la mobilisation de 100 milliards de dollars par an, pour laquelle les attentes, en vue de la Conférence de Paris, des pays du Sud sont très fortes ? Le montant se situe entre les deux derniers montants que j’ai donnés : l’ensemble des financements qui partent du Nord pour aller au Sud, et la part publique de ces financements. Je précise que personne n’imagine aujourd’hui que l’ensemble de ces financements viendra du public ; il y aura donc une part de public et une part de privé. Je précise également que je n’ai pas comptabilisé le Fonds vert. La raison est très simple : d’après les chiffres du Comité permanent sur le financement, le Fonds vert n’est pas encore opérationnel.
Pour gagner du temps, je ne parlerai pas des énergies fossiles ni des subventions aux énergies fossiles. On pourra y revenir au cours de la séance de questions, si vous le souhaitez.
Vous remarquerez que j’ai avant tout parlé des flux réels – et non de flux qui sont des objectifs, du type des 100 milliards de dollars par an. J’en viens maintenant à l’autre côté du problème, à savoir les besoins.
En ce domaine également, les estimations varient beaucoup. Je vous conseille de garder en tête 1 000 milliards de dollars – ou un trillion – par an. C’est un ordre de grandeur assez pratique, même si ce n’est qu’un ordre de grandeur (et que les chiffres peuvent varier de 1 à 9).
Pour être plus précis, un rapport de la New Climate Economy mentionne le chiffre de 90 000 milliards de dollars d’investissements totaux dans le monde d’ici à 2030. Que ces investissements soient verts ou qu’ils ne le soient pas, ces chiffres restent à peu près les mêmes : 89 000 milliards de dollars dans un cas, et 93 000 milliards de dollars dans l’autre. Soit, dans les deux cas, 4 000 milliards de dollars par an, et donc dans l’ordre de grandeur du millier de milliards par an.
Certaines estimations, je vous le signale, prennent en compte les investissements qui devront être faits en tout état de cause dans les énergies fossiles. Quand on fait du vert, on doit toujours avoir une petite partie d’énergies fossiles résiduelle. Même en faisant du renouvelable, on peut désirer avoir du gaz en soutien sur le renouvelable. Cela fait partie de l’équation.
Une grande partie de ces investissements devront être faits quoi qu’il arrive. Faire du bas carbone ou faire du haut en carbone, ce n’est pas si différent que cela en termes de chiffres globaux de financement. On devra de toute façon réinvestir dans des moyens de production énergétique, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de développement, et pour remettre en service des installations qui arriveraient en fin de vie.
Il faut par ailleurs prendre en compte l’existence d’un effet d’éviction. Si on investit dans l’efficacité énergétique, on a moins besoin d’investir dans des moyens de production. C’est peut-être aussi cela qui permettra de réduire la facture.
Quand on entend parler de milliers de milliards de dollars, on se dit que c’est beaucoup d’argent. Mais finalement, au niveau mondial, faire « vert », cela représente moins de 5 % de la formation brute de capital fixe. C’est donc faisable. Et ce qui est vrai au niveau mondial est vrai au niveau français.
Nous avons une étude équivalente au niveau français, à savoir un panorama des financements climatiques sur des données 2011 – les dernières données disponibles. On travaille aujourd’hui à une mise à jour sur les données 2013 et sur les données 2014. Le panorama de la finance climatique en France 2013-2014 devrait répondre à ce qui figure aujourd’hui dans l’article 48 bis du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. C’est en tout cas l’ambition qu’on s’est fixée.
En France, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques qu’au niveau mondial. Les flux financiers actuels représentent à peu près 20 à 25 milliards d’euros par an qui se répartissent ainsi : 40 % sur les énergies renouvelables, 40 % sur l’efficacité énergétique et 20 % sur les transports.
Les besoins, sur lesquels se sont penchés un certain nombre d’organismes comme la Cour des Comptes, ainsi que le débat national sur la transition énergétique, sont estimés entre 40 et 60 milliards d’euros par an. Je précise que les périmètres ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout état de cause, il manque entre 20 et 25 milliards d’euros par an à peu près.
On peut se dire qu’il faudrait doubler notre effort, et que c’est impossible. On peut aussi se dire qu’en France, la formation brute de capital fixe est de 400 milliards d’euros par an et que l’enjeu principal, c’est donc de déplacer 5 % de la formation brute de capital fixe pour y arriver. Mais faire basculer les investissements implique de donner les incitations adéquates.
Notre étude ne dit pas qu’il suffirait de trouver ces 20-25 milliards. Elle ne s’intéresse pas non plus à l’efficacité de l’utilisation de ces fonds. Mais dans tous les cas, ce qu’il faut retenir, c’est que c’est faisable.
En conclusion : gardez en tête les 100 milliards de dollars et les 1 000 milliards de dollars par an. Certes, il reste des progrès considérables à faire sur le suivi des financements climat. Néanmoins, les ordres de grandeur sont déjà là. Tous les chiffres que l’on vous a donnés sont à peu près cohérents, et cela suffit pour travailler.
Enfin, et c’est le troisième message-clé : cette transition est gérable. Il s’agit avant tout de rediriger des flux financiers, et pas tellement de trouver de l’argent supplémentaire. Pour y parvenir, il convient d’envoyer les bons signaux économiques. On pourrait, par exemple, mettre un prix sur le carbone afin de rediriger une partie des investissements du haut carbone vers le bas carbone. Mais si c’est nécessaire, ce n’est certainement pas suffisant.
M. Stanislas Dupré, directeur du think tank 2° C II. Je vais vous parler de la mobilisation et de la réallocation du capital, ainsi que du secteur financier. Celui-ci se trouve en amont de la chaîne. De fait, les investisseurs institutionnels, les banques et leurs régulateurs ont une influence assez importante sur la façon dont les capitaux sont alloués.
Je me focaliserai sur la question du reporting, ou de l’information communiquée par les investisseurs, à la fois aux régulateurs et à leurs clients. Notre mission est de voir comment les objectifs climatiques peuvent être intégrés dans le fonctionnement du secteur financier. Nous avons été créés pour cela.
On appelle cela le « concept d’investissement 2° » - un investissement cohérent avec l’objectif de réduction du réchauffement climatique à 2 degrés. On a un budget carbone disponible sur le siècle au niveau international. Ce budget est traduit en scénarios climatiques impliquant des changements économiques : pour schématiser, plus d’activités vertes et moins d’activités grises. De façon plus technique, des organisations, comme l’Agence internationale de l’énergie, transcrivent ce concept dans des scénarios technologiques conduisant à développer davantage d’énergies renouvelables, la capture du carbone, différentes technologies…
La recherche et développement (R&D) a une place importante dans ces scénarios technologiques, alors qu'elle est assez peu présente dans les chiffres qui sont en général communiqués. On considère globalement que celle-ci ne représente que quelques pour cent des investissements mobilisés. En revanche, le décalage entre ce qu’il faudrait faire et ce qui est fait est beaucoup plus important en matière de R&D qu’en matière d’investissements en infrastructures – l’ordre étant de 1 à 10. Si on regarde les scénarios dans le détail, on s’aperçoit que la majorité des réductions d’émissions qui doivent avoir lieu sur le siècle sont liées à des technologies qui n’existent pas encore, et pour lesquelles il faudrait faire dès maintenant des investissements en R&D. Je vous invite à garder en permanence ces éléments en tête, car aujourd’hui ils sont totalement absents du débat public sur les questions de mobilisation des investissements.
Ces scénarios technologiques sont traduits en besoins d’investissements, par l’Agence internationale de l’énergie, mais aussi en besoin de financements, et là, on dispose de beaucoup moins d’informations. Or la façon dont le secteur financier va investir – en actions, en obligations, en création de crédits – pour financer ces nouveaux investissements se retrouve, en fin de compte, dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels en réallocation de leurs actifs.
Cela va dans deux directions : dans l’une, les objectifs climatiques fixés par les pouvoirs publics ont un impact sur le rendement et les risques des actifs détenus par les investisseurs ; dans l’autre, la façon dont les investisseurs institutionnels allouent leur portefeuille d’actifs a un impact sur la disponibilité et le coût du capital, sur les flux d’investissement et, in fine, sur la réussite des objectifs climatiques. C’est cette dynamique que l’on appelle « l’investissement deux degrés ».
Chez 2° C II, nous avons trois objectifs : essayer de définir des indicateurs pour mesurer comment ce double système fonctionne ; comprendre le fonctionnement des processus d’investissement au sein du secteur financier pour voir comment ceux-ci peuvent intégrer des objectifs climatiques ; enfin, travailler avec le régulateur pour voir comment la réglementation financière peut favoriser cette transition au sein du secteur financier.
Nos membres sont à la fois des pouvoirs publics comme le gouvernement français, des institutions financières, à la fois publiques et privées, des associations environnementales, des universités. Globalement, notre travail consiste à mettre en relation, sur des aspects très techniques, des organisations financières – qui peuvent être des investisseurs, des banques, des agences de notation, par exemple – et des gouvernements, comprendre comment améliorer le système et aller dans le même sens.
Je terminerai sur la question de l’impact climatique des portefeuilles d’investissement. Le projet sur la transition énergétique pour la croissance verte porte, à l’issue de son examen par votre assemblée la semaine dernière, une disposition qui va contraindre les investisseurs à mesurer l’impact de leur investissement sur le climat, à essayer d’influencer l’allocation d’actifs des investisseurs pour avoir un effet sur le coût et la disponibilité du capital, et donc contribuer au financement de la transition énergétique.
Globalement, ce qui a été voté rend obligatoire une pratique qui avait commencé à être mise en place en 2005 de façon pilote, à la fois en Suisse et en Angleterre. Cette pratique consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités indirectement financées par le secteur financier et, in fine, par les épargnants. Les investissements des entreprises, des collectivités locales, voire des particuliers peuvent être concernés.
En 2007, ces expériences pilotes ont été traduites à l’échelle du Groupe Caisse d’Épargne dans un programme qui couvrait tous les produits d’investissements ; une étiquette a été testée pendant un an et diffusée au sein du réseau au consommateur. Cette expérience s’est terminée au moment de la crise financière. À l’époque du Grenelle de l’environnement, il était envisagé de rendre ce type d’étiquette obligatoire. Mais finalement, le projet a été abandonné.
Entre 2007 et il y a à peu près un an et demi, on peut dire qu’il y a eu une sorte de « traversée du désert en matière de pratiques. En revanche, d’assez nombreuses associations environnementales se sont mobilisées pour faire de la pédagogie sur ces questions.
Un reportage, diffusé en prime time sur France 2, a mis l’accent sur le sujet et sur l’impact des banques sur le climat. Cela a mobilisé les leaders d’opinion.
Une autre association, qui est de nos membres, a publié en 2011 un rapport mettant en avant le fait que le contenu en carbone des réserves de pétrole de gaz et de charbon était beaucoup plus important que ce que l’on pouvait rejeter dans l’atmosphère si l’on voulait respecter les objectifs climatiques. L’idée sous-jacente était que, potentiellement, il y avait une sorte de bulle financière liée à l’investissement dans ces actifs, qui éclaterait si les objectifs climatiques étaient mis en place.
Ce rapport a eu un écho certain dans les médias et a contribué, à partir de 2014, à mobiliser les investisseurs sur cette question de l’impact climatique des portefeuilles. De fait, au cours des mois qui viennent de s’écouler, des investisseurs ont annoncé qu’ils allaient « décarboner » leurs portefeuilles à partir des méthodes qui avaient été développées une dizaine d’années plus tôt. Enfin, une loi obligeant les investisseurs français à le faire sur tous leurs portefeuilles a été adoptée.
On en est là aujourd’hui ; quelles sont les prochaines étapes ?
Première étape, le décret d’application, qui doit être publié à la fin de l’année. Les enjeux sont énormes. Le problème est qu’une bonne partie des annonces qui ont été faites reposent sur des méthodes à la fiabilité incertaine : on peut faire des choses qui ont du sens, et d’autres qui n’en n’ont absolument pas. Je vous incite donc à la plus grande vigilance à tous les stades de la rédaction de ce décret d’application.
Deuxième étape, les incitations : une fois que les investisseurs rendront des comptes sur l'impact climatique de leurs portefeuilles, il n’y aura pas de raison spécifique d’améliorer cet impact climatique. Globalement, il est assez peu probable que les épargnants descendent manifester dans la rue en demandant que leur portefeuille soit plus vert. D’où l’importance de la fiscalité.
Nous allons publier le mois prochain, avec France Stratégie, un rapport qui fait le point sur l’efficacité et les objectifs liés à la dépense fiscale sur l’épargne – à peu près 10 milliards d’euros par an. En un mot, est-il techniquement possible de mettre en cohérence les incitations fiscales avec les objectifs climatiques, en s’appuyant notamment sur ces nouvelles obligations d’information ? Je suis à votre disposition pour en discuter après sa parution, si vous le souhaitez.
La troisième étape consiste à mobiliser les partenaires européens. Si les investisseurs réallouent leurs actifs de manière isolée, l’impact sera faible sur les marchés financiers mondiaux. D’assez nombreuses annonces ont été faites lors de la Climate Week de New-York. De nombreuses annonces, très intéressantes et très regardées, ont été faites la semaine dernière à Paris.
Quatrième étape : la tenue du G7 le mois prochain. Nous sommes en train d’y travailler avec le gouvernement allemand. Dans le communiqué final, il sera vraisemblablement fait mention de la question de l’investissement 2° C, et de l’objectif de mobiliser les investisseurs publics sur cette question. Les États-Unis et le Japon n’y sont pas très favorables. Pour l’instant, c’est dans le texte. On verra ce que cela va devenir.
Tout cela nous amène à la COP. Il serait intéressant qu’en parallèle des négociations, les gouvernements fassent des annonces sur cette question de la mobilisation du secteur financier.
Je ferai une dernière remarque de méthodologie. D’une certaine façon, on met la charrue avant les bœufs en imposant des obligations d’information, en incitant certains à s’engager, alors que les méthodes de calcul ne sont pas stabilisées. Nous sommes en train de mener avec la Commission européenne et de nombreux partenaires, venant notamment du secteur financier, un travail visant à définir une méthode scientifique. Il serait également important que, dans les années à venir, les pouvoirs publics se mobilisent pour développer des standards internationaux en la matière, investir dans la recherche, définir les scénarios climatiques et mieux comprendre de quels investissements on a besoin et où. Aujourd’hui, il y a un déficit criant de mobilisation sur ces méthodes et sur la production de données correspondantes.
Enfin, le but – et c’est peut-être le changement qu’apportera cette COP – est de donner au secteur financier un rôle actif dans la mise en œuvre des objectifs climatiques, au même titre que les secteurs industriels.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai vu que dans votre think tank, vous aviez comme partenaire le groupe AXA. Or, la semaine dernière, M. Henri de Castries a annoncé une politique de désinvestissement dans le charbon à hauteur de 500 millions d’euros, et un engagement plus important en matière d’investissements verts à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici 2020. Dois-je y voir l’influence de votre think tank sur le groupe AXA ?
M. Arnaud Leroy. Je pense très sincèrement, monsieur le président, que le travail mené par 2 °C II – que l’on a reçu plusieurs fois à l’Assemblée nationale, notamment au sein du groupe « changement climatique » – a contribué à cette évolution du groupe AXA. Celui-ci s’intéresse à la question climatique sous un aspect assurantiel, et voit dans le changement climatique un risque majeur, à terme, pour son activité.
Je suis ravi que l’on ait cette discussion aujourd’hui. C’est un peu la conclusion de M. Dupré sur la nouveauté du secteur financier, et sur ce que celui-ci peut apporter au débat climatique. En effet, pendant très longtemps, nous nous sommes focalisés sur les fameux 100 milliards du Fonds vert.
Je pense qu’au-delà des investissements en infrastructures énergétiques, il faut que le gouvernement se mette à l’écoute des convergences, et en tout cas des parcours parallèles de développement durable. L’investissement sera de plus en plus lié à l’adaptation au changement climatique : construction d’infrastructures capables de résister à des événements climatiques majeurs ; modification de la politique de l’eau dans les zones où l’on a financé pendant très longtemps la construction de puits, mais qui subissent aujourd’hui des sécheresses conséquentes.
Je n’ai pas de solutions, mais je crois qu’il faut réfléchir. Je rentre de New-York, où nous avons rencontré l’ensemble des ambassadeurs des pays francophones d’Afrique, notamment subsaharienne. La crainte est grande que la réunion d’Addis-Abeba de juillet ne soit un échec. Car un échec à Addis-Abeba menacerait de facto la réussite de la prochaine réunion de Paris. Le ministre, Laurent Fabius, lorsque nous avons discuté avec lui, se souciait de cette réussite et s’inquiétait de l’enchevêtrement des agendas.
Je crois aussi qu’il faut prendre en considération l’évolution des flux financiers. Dans votre présentation, vous n’avez pas abordé la question des flux Sud-Sud, qui concerne notamment la Chine, le Brésil, et la Russie quand elle le peut. La Chine souhaite la création d’une banque internationale qui viendrait concurrencer la Banque mondiale ou d’autres instruments qui luttent contre le changement climatiques. C’est un élément qu’il faudra prendre en considération.
Selon moi, il faudra tenir un discours de vérité sur la question du paiement différencié. Car c’est bien de cela que l’on parle, et l’accord sino-américain sur le climat montre que l’approche de la responsabilité différenciée a évolué. Les Brésiliens eux-mêmes, qui ont été très longtemps à l’origine de blocages, ont fait une proposition. Celle-ci vaut ce qu’elle vaut, mais cela prouve qu’ils ont ouvert la porte à la négociation.
Il y a encore beaucoup de travail, mais je suis optimiste. Je pense que l’on peut aboutir à Paris parce qu’il y a un besoin. De nouveaux alliés – notamment une partie du secteur financier et une partie du secteur industriel – se sont manifestés. Ils veulent que cela avance. Il faut dire – et répéter – que nous jouons notre survie. Il en va de l’avenir de la vie sur terre : les scénarios développés par le GIEC ne relèvent pas de la science-fiction !
En dernier lieu, je remarque que vous avez très peu mentionné le rôle de l’Union européenne dans ces négociations. Pouvez-vous nous en parler ? Par ailleurs, nous savons qu’il y a des problèmes budgétaires au niveau européen. Il fut un temps, on avait fléché 20 % de l’enveloppe 2014-2019 sur les changements climatiques. Pourra-t-on en récupérer une partie pour abonder, notamment, le Fonds vert ?
M. Martial Saddier. Au nom des députés UMP, je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Nous souhaitions rappeler que nous ne sommes pas devant un problème franco-français, mais devant un problème mondial, dans lequel la France a déjà pris sa part. Tout le monde reconnaît le rôle moteur et le rôle d’entraînement joué par notre pays tant au niveau mondial qu’européen.
La France produit 1 % des émissions de gaz à effet de serre, alors qu’elle contribue à peu près à hauteur de 4 % du PIB mondial. Elle fait partie des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre – 14 % en dessous du plafond d’émissions auquel nous nous étions engagés à Kyoto. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à jouer ce rôle moteur, et à poursuivre les efforts accomplis depuis quinze ans sous toutes les majorités et par tous les Présidents de la République, qu’il s’agisse de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy ou du Président François Hollande.
En 2009, les États réunis à Copenhague avaient décidé de créer un Fonds vert pour le climat et de mobiliser à cette fin 100 milliards de dollars par an. Nous en sommes à peu près à 9,3 milliards d’euros. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir, même si personne ne remet en cause l’objectif des deux degrés. Il faut dire que dans un certain nombre de territoires en France, l’élévation de température est proche des deux degrés.
Permettez-moi, pour terminer, de soulever quelques interrogations. Mais je le dis à la majorité actuelle, il n’est pas question de montrer du doigt qui que ce soit. Depuis quinze ans, les mêmes débats ont lieu à l’Assemblée nationale et de par le monde.
Tout d’abord, on observe un décalage entre le moment où nous discutons sur le fond de textes qui vont avoir une influence sur le climat, et leur financement. Par exemple, nous avons discuté d’une loi sur la transition énergétique, mais nous avons renvoyé tout le volet financier au projet de loi de finances. Et vous voyez bien que le ton change, entre le moment où nous discutons avec un ministre de l’environnement et le moment où nous discutons avec Bercy.
De la même façon, au niveau mondial, l’ensemble des analyses et des notations sont basées sur des critères économiques et n’ont qu’une faible connotation environnementale.
Ensuite, le monde et la France sont partagés entre le souci d’afficher l’objectif des deux degrés pour ne pas décourager ceux qui font des efforts, et celui d’envisager ouvertement leur éventuel dépassement et les conséquences qui en découleraient pour favoriser une prise de conscience. Il y a donc un débat entre l’atténuation et l’adaptation. Peut-être que le fait de ne pas trancher est une bonne excuse pour ne rien faire. Cela expliquerait que de grandes nations ne veulent toujours pas s’engager. Mais je le dis au nom des députés UMP, ce n’est pas le cas de la France, qui a prouvé son engagement dans la lutte contre l’évolution du climat, toutes tendances politiques confondues.
Les députés UMP prendront toute leur part dans ce défi pour la France, pour l’Europe et pour le monde.
M. Stéphane Demilly. Messieurs, l’UDI vous remercie également pour vos interventions.
À quelques mois de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique et au lendemain du colloque Business and Climate qui s’est tenu la semaine dernière à l’Unesco à Paris, il était important que notre commission se réunisse pour échanger autour d’un sujet à la fois central et de crispation, à savoir le financement de la lutte contre le changement climatique.
Quand on sait que pour limiter le réchauffement de la planète à deux degrés, il faudrait, selon certains observateurs, investir 700 milliards de dollars de plus chaque année d’ici à 2030, on mesure l’ampleur du challenge.
Avant de venir à cette réunion, nous avons consulté quelque documentation, et aujourd’hui, nous avons entendu beaucoup de chiffres, notamment de la part de M. Voituriez. Mais il y a de quoi y perdre son latin ! Les chiffres sont tous très différents, avec des écarts parfois très impressionnants.
Ces remarques faites, je souhaiterais connaître l’avis de nos invités sur un certain nombre de points.
Premier point : le financement public. Les chiffres actualisés du FMI font état de 5 000 milliards d’euros d’accompagnement financier direct ou indirect aux énergies fossiles – ce que l’on appelle d’ailleurs abusivement des subventions – pour une bagatelle de près de 10 millions d’euros par minute ! Mais si l’ampleur de ces montants est impressionnante, ce n’est pas une découverte.
L’un des sujets importants abordés par la COP 21 sera le basculement des financements vers les énergies renouvelables. À peine une quarantaine de pays sur les 196 parties à la COP 21 ont, pour le moment, rendu publique leur contribution. Je suis conscient de la difficulté de l’exercice, notamment pour M. Antoine Michon, mais je serai très intéressé d’avoir un point d’étape à ce stade de la préparation de la Conférence de Paris.
Deuxième point : l’implication des entreprises et du monde de la finance. Le colloque Business and Climate auquel je faisais allusion a réuni plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises, dont la moitié du CAC 40. Il s’est conclu par un Climate Finance Day, très prometteur pour l’avenir, ces acteurs ayant parfaitement compris que le développement économique était désormais étroitement lié au développement durable. En ces temps de croissance atone, il va de soi que l’innovation, l’investissement dans les énergies renouvelables, en d’autres termes la transformation de notre économie en une économie décarbonée, sont devenus des vecteurs de croissance.
Les énergies vertes représentaient dans le monde 7,7 millions d’emplois en 2014, soit une croissance de 18 % selon le dernier rapport annuel de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA ou International Renewable Energy Agency). Cette agence considère par ailleurs que le doublement du mix énergétique mondial à l’horizon 2030 conduirait à un total de 16 millions d’emplois dans le secteur du renouvelable.
D’un autre côté, l’investissement dans les énergies fossiles est désormais classé comme un facteur de risque financier par les banques et par les assurances. Plusieurs grands groupes se sont ainsi engagés à décarboner leurs activités et à se désinvestir des énergies fossiles pour investir parallèlement dans les énergies vertes. Le directeur général du groupe Caisse des dépôts, un des bras armés financiers de l’État, a déclaré s’engager dans cette voie.
Le rôle de l’État actionnaire est ici clairement en question, en raison notamment du soutien qu’il apporte au charbon, via des entreprises au capital desquelles la France participe. Il serait intéressant que M. Benoît Leguet, directeur de CDC Climat Recherche, puisse détailler pour nous les modalités de l’engagement pris par M. Pierre-René Lemas.
Mme Laurence Abeille. Je pense qu’il était très important de tenir aujourd’hui ce débat, tellement les questions financières sont importantes en matière de lutte contre le changement climatique. Mais vos interventions ont suscité chez moi deux remarques et plusieurs questions.
Première remarque : dans un langage extrêmement compliqué, truffé de termes anglais, vous avez parlé de milliards de milliards de dollars. Des questions extrêmement importantes peuvent ainsi être abordées d’une manière que la plupart de nos concitoyens ne comprennent pas. Cela crée un fossé entre les uns et les autres. Pour moi, c’est un problème politique : de tels débats doivent pouvoir redescendre dans la société.
Deuxième remarque : vous avez fait la distinction entre le financement « dur » et financement « mou » et précisé que la finance climat n’allait pas vers la recherche et développement (R & D). Or, même si cela doit prendre beaucoup de temps et d’argent, il conviendrait de renforcer la R & D pour lutter de façon effective contre le changement climatique. Il ne faut pas se contenter de faire de l’adaptation, il faut être plus ambitieux. Cela nous redonnera peut-être l’espoir de sauver la planète.
J’aimerais donc que vous nous en disiez un peu plus sur le manque de financements en R & D, en insistant peut-être sur ses conséquences. On parle bien des milliards et des milliards de dollars qu’il faut investir. Mais a-t-on mesuré les milliards et les milliards de dollars que pourrait coûter l’inaction dans ce domaine, ou simplement l’adaptation ?
Vous avez déclaré que vous parleriez des énergies fossiles dans la suite du débat. Je pense en effet que nous sommes plusieurs à avoir des questions là-dessus. Évidemment, nous souhaitons faire basculer les financements consacrés aux énergies fossiles vers la transition énergétique. Mais je me méfie beaucoup du terme « décarboné ». Comme vous le savez sans doute, les écologistes préfèrent, de loin, que l’on utilise celui de « décarboné de façon durable ». En effet, on ne souhaite pas que les financements aillent vers l’énergie nucléaire, mais vers les énergies renouvelables et la transition énergétique.
Par ailleurs, je m’inquiète de tout ce que l’on dit à propos du Fonds vert pour le climat. Je souhaiterais que vous nous donniez quelques précisions. Comment faire pour que les sommes annoncées soient bien mises sur la table ? Il doit bien avoir des moyens de contraindre les pays à respecter les engagements qu’ils ont pris, et à alimenter ce fonds. Pourquoi, finalement, est-ce un échec ?
Je souhaiterais maintenant vous parler du plan Juncker et des critères d’écoconditionnalité – que l’on pourrait peut-être appeler critères de « climatoconditionnalité ». En effet, ne pourrait-on pas s’interroger, au-delà de ces critères, sur la pertinence d’une relance de la croissance, sachant que la recherche d’une croissance ininterrompue génère elle-même la dégradation de la planète ? Y avez-vous réfléchi ?
Enfin, j’irai très vite sur les taxes comportementales. Est-ce que la mise en place de telles taxes au niveau mondial ou au sein d’un bloc de pays serait une perspective envisageable à court ou moyen terme ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Un petit clin d’œil par rapport à « décarboner » et « décarboner de façon durable » : nous avons accepté, pas plus tard qu’hier, lors du vote sur la transition énergétique, à la fois la stratégie bas carbone, inscrite dans la loi, et les budgets bas carbone.
M. Patrice Carvalho. Comme notre collègue Leroy l’a fait remarquer, nous parlons aujourd’hui de l’avenir de la vie sur terre. 100 milliards avaient été prévus pour nous aider à agir. Comme on le constate aujourd’hui, on en est très loin ! Et j’ai bien peur que la COP de Paris, tout comme celle de Varsovie ou celle de Lima, ne se réduise à des effets d’annonce et n’ait qu’un intérêt politique pour le Gouvernement, dans un contexte d’élections régionales désastreuses. Tout cela est un peu compliqué, et je ne suis pas persuadé qu’il y ait derrière une vraie volonté de changer la situation et de limiter l’élévation de la température sur la planète.
Le seul moyen d’y parvenir serait de contraindre les pays à agir en ce sens. Inutile d’expliquer aux Chinois qu’il faut à tout prix investir sur l’environnement. D’ailleurs, nos propres industriels quittent la France pour installer leurs usines en Chine, en partie pour ne pas avoir à se mettre aux normes européennes et françaises en matière d’environnement. Il faut dire que dans la grosse industrie, la mise aux normes entraîne des investissements très importants.
Cela me conduit à vous faire cette remarque : il y de grands producteurs de bois en France, et nous savons gérer nos forêts. Or aujourd’hui, notre bois traverse la France et la Belgique pour aller à Anvers, puis en Chine et revenir en France. Quel exemple de développement durable ! Il suffirait de développer localement la filière bois et de vendre notre bois en France ou dans les autres pays d’Europe – qui sont quand même plus près.
Les exemples ne manquent pas : il est difficile de progresser en matière de développement durable. Vous ne convaincrez pas un industriel qu’il va gagner plus d’argent en investissant beaucoup plus pour des résultats obligatoirement plus faibles, même s’il le fait au nom de l’environnement. On voit bien comment se comportent la Chine, les États-Unis, l’Allemagne – que les Verts citaient en exemple – et la Pologne. Pensez au charbon allemand et polonais. En fin de compte, on fait l’inverse de ce qu’il faudrait.
Alors, oui pour le développement durable et pour les énergies renouvelables. Mais encore faut-il y mettre les moyens. On ne le fait pas pour la géothermie, ni pour l’énergie marémotrice, ni pour les éoliennes, etc. Tout cela montre qu’il n’y a pas beaucoup d’évolution dans ce domaine. Encore une fois, il faudrait exercer de fortes contraintes sur les industriels et sur les pays et, par exemple, refuser d’acheter en Chine si on n’a pas la garantie que ce n’est pas produit dans des conditions acceptables pour l’environnement. D’ailleurs, il en est des produits comme des humains : des gens meurent au travail dans des conditions lamentables, dans des pays qui exportent des vêtements de haut de gamme dans notre belle Europe. Il y a de quoi se poser des questions…
M. Jacques Kossowski. Messieurs, d’après ce que j’ai lu, le prix du CO2 sur le marché européen de quotas d’émission est actuellement trop faible pour développer des investissements bas carbone. Aussi, certains économistes préconisent d’orienter vers des projets bas carbone une partie des 1 100 milliards d’actifs que prévoit de racheter la Banque centrale européenne.
L’idée est que les États européens définissent ensemble une valeur sociale du carbone (VSC), donnant un prix suffisamment élevé à la tonne équivalent CO2 évitée dans le cadre de nouveaux investissements. Ainsi, une entreprise souhaitant mener un projet bas carbone se verrait certifier par un organisme indépendant le tonnage de CO2 susceptible d’être évité grâce à ce projet. L’entreprise pourrait alors utiliser ce certificat carbone pour rembourser une partie de ses emprunts auprès du système financier.
La BCE apporterait sa garantie à ce système en s’engageant à racheter ces certificats carbone au prix de la VSC. Comme l’affirme Étienne Espagne, chargé de mission pour France Stratégie, organisme de réflexion rattaché au Premier ministre, la transition énergétique n’attendrait pas, et les nouveaux investissements se feraient en intégrant d’emblée une forte valorisation du carbone. J’aimerais avoir votre point de vue sur ce dispositif. Selon vous, celui-ci a-t-il une chance de voir le jour ?
Mme Catherine Quéré, vice-présidente, remplace M. Jean-Paul Chanteguet à la présidence de la Commission
Mme Martine Lignères-Cassou. J’ai été très intéressée par vos propos, mais je trouve qu’à six mois de la COP 21, le débat sur les financements manque de maturité. Cela m’inquiète. Ensuite, d’après ce que vous nous avez dit, l’essentiel des financements proviendra d’une réallocation des flux financiers existants. Je me demande donc à quoi va servir le Fonds vert au niveau mondial. Enfin, toujours selon vous, le lien sera de plus en plus étroit entre financement, développement et climat. Pourtant, on exclut de la stratégie du développement ce qui est mou, et notamment l’éducation et la santé. Or Esther Duflo, dans ses derniers travaux, défend une approche globale du développement. Je m’interroge donc sur l’efficacité des politiques publiques que l’on va pouvoir mettre en place.
M. Laurent Furst. Vos interventions m’ont inspiré quelques réflexions. D’abord, alors que l’Europe émet environ 9 % des gaz à effet de serre au niveau de la planète, les nouveaux pays en développement en émettent plus de 40 %. Or ces pays n’ont pas les moyens de financer une reconversion, de l’habitat, de l’industrie ou du secteur tertiaire. C’est pourtant là où, dans l’absolu, le rendement de l’argent investi serait le plus important.
Ensuite, je suis heureux que vous ayez abordé la question de la recherche. En effet, j’ai l’impression que nous avons les moyens technologiques de créer de la croissance propre. Selon moi, ce n’est pas la décroissance qui va sauver la planète, mais la croissance propre qui passera par des systèmes peu polluants, garantissant la sécurité sanitaire et assurant un mode de vie collectif agréable et prospère.
Enfin, on découvre actuellement beaucoup de pétrole et de gaz, notamment en Arctique car la fonte des masses glaciaires les rendent accessibles. On peut penser que l’homme consommera jusqu’à la dernière goutte de pétrole ou de gaz, à moins que les technologies n’évoluent et ne rendent le pétrole et le gaz eux-mêmes obsolètes. D’où cette question : la véritable solution n’est-elle pas d’intensifier la recherche et la généralisation de nouvelles technologies ?
M. Jean-Louis Bricout. Un récent rapport publié par les ONG agissant dans le secteur de l’environnement vient nous rappeler que depuis 2005, le système bancaire a financé à hauteur de 373 milliards d’euros l’industrie du charbon ; la part des trois banques françaises, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, est d’ailleurs de 28 milliards. Cela classe la France au quatrième rang des pays financeurs d’une énergie responsable de 44 % des émissions mondiales en CO2.
En revanche, en matière d’investissements propres, les banques sont beaucoup plus frileuses. Ce n’est pas sans poser souci puisque celles-ci ont évidemment un rôle majeur à jouer en ce domaine. Qu’en pensez-vous ? Constatez-vous une évolution dans leur approche de ces thématiques ? Comment pouvons-nous en faire des alliés, dans la perspective du sommet sur le climat qui se tiendra en décembre prochain ?
M. Guillaume Chevrollier. Vous avez fait le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique et l’aide publique au développement. C’est évidemment fondamental, car les deux ont des conséquences en matière de flux migratoires, ainsi que des conséquences économiques et humanitaires parfois dramatiques.
Les deux sont également liées sur le plan du financement. Elles mobilisent beaucoup d’argent public, comme les 100 milliards du Fonds vert pour le climat, qui proviennent des États. On parle d’instituer une taxe internationale sur les transactions financières, mais une telle mesure ne sera pas suffisante. Par ailleurs, cette taxe ne doit pas se substituer aux aides publiques des États. Quoi qu’il en soit, nos concitoyens sont en droit de savoir comment tous ces engagements vont être financés et quelles autres pistes de financement vous proposez – sans menacer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des Français.
M. Yannick Favennec. Messieurs, j’ai trois questions à vous poser. Premièrement, à moins de 200 jours de la grande conférence environnementale des Nations Unies qui aura lieu à Paris en décembre, les entreprises et les milieux économiques vous semblent-ils suffisamment sensibilisés et mobilisés ?
Deuxièmement, les grandes entreprises et les établissements financiers sont-ils prêts à passer à l’action ? Comment s’assurer que les engagements pris seront bien respectés
Troisièmement, comment faire pour orienter la finance mondiale vers la lutte contre le changement climatique ?
M. Jean-Pierre Vigier. Les changements climatiques figurent parmi les principales menaces environnementales, sociales et économiques qui pèsent sur notre planète. Dans les pays en développement, des milliers de personnes pourraient retomber dans la pauvreté sous les effets du changement climatique.
Les pays développés, lors de la Conférence de Copenhague en 2009, se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 afin de financer la lutte contre le changement climatique dans les pays du Sud. Mes collègues en ont parlé, mais je souhaiterais vous poser une question qui est à la base de toute discussion : en 2015 et à la veille de la COP 21, pensez-vous sincèrement que cet objectif pourra être tenu ?
M. Jean-Marie Sermier. Les acteurs économiques acceptent désormais quasiment tous les conclusions du GIEC, et ils sont prêts à financer les investissements et l’innovation économique décarbonée. Cela me semble tout à fait normal : ils imaginent que cette économie leur ouvrira un certain nombre de marchés, et leur assurera une certaine rentabilité financière. Mais in fine, qui va payer ? Ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes, mais leurs clients et donc les citoyens.
Les propositions qui ont été faites le 22 mai dernier, comme l’institution d’une taxe TVA sur les transports aériens ou d’une taxe sur les transactions financières, en sont l’exemple : c’est finalement la société qui va payer. On voit bien qu’il y a un fossé entre vos propos et ceux des participants à ces groupes de travail internationaux, et le grand public. N’est-il pas temps de passer d’un discours très technocratique à un discours plus populaire ?
M. David Douillet. Les chiffres avancés ce matin sont hallucinants ! Pourra-t-on honorer les objectifs fixés, compte tenu de la situation financière des pays et, plus généralement, de l’économie mondiale ? De leur côté, les entreprises privées ne sont pas à l’abri d’une crise financière comme celle de 2008. Bien sûr, il faut se fixer des objectifs et de grands objectifs. Mais ceux-ci me paraissent tellement immenses que j’ai d’énormes craintes.
Comme mes collègues Chevrollier et Furst, j’essaie de trouver des pistes. Ne pourrait-on pas imaginer un nouveau modèle économique mondial auquel participeraient l’ensemble des États, conscients du rôle qu’ils ont à jouer pour sauver la planète ?
M. Jacques Alain Bénisti. Vous nous avez parlé du Climate Finance Day, qui a eu lieu le vendredi 22 mai à Paris. Ce fut l’occasion de faire le point sur les verrous à faire sauter pour que le secteur financier s’engage un peu plus dans la lutte contre le changement climatique. Mais si l’enjeu reste toujours le même, l’ambiance a sensiblement évolué en six ans : tous les acteurs économiques acceptent désormais les conclusions des rapports du GIEC et soutiennent l’objectif un peu plus politique de limiter à deux degrés le réchauffement en cours. Reste que le système bancaire finance l’industrie du charbon – depuis 2005, près de 400 milliards d’euros. La part des trois banques françaises (BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole) avoisine aujourd’hui les 28 milliards d’euros, ce qui place la France au quatrième rang des pays financeurs d’une énergie responsable de 44 % des émissions mondiales de CO2.
Le milieu de la finance commence donc à prendre conscience de son rôle, et surtout à s’engager dans le retrait des projets charbon – enfin ! Mais ces engagements sont-ils concrets, selon vous ? S’agit-il de vœu pieux ?
Par ailleurs, une vingtaine de pays ont converti en contributions leurs promesses de dons au Fonds vert pour le climat. Cela représente 4 milliards de dollars, montant nettement trop faible pour commencer à financer des projets. Comment pensez-vous pouvoir associer davantage les fonds privés ? Pour l’instant, ceux-ci sont quasiment inexistants de ces différents financements.
M. Antoine Michon. J’aborderai deux points sur lesquels plusieurs questions ont été posées.
Premier point : les contributions des États.
À ce stade, quarante pays ont présenté des contributions. Nous espérons que la très grande majorité des pays l’auront fait avant la COP. La France soutient d’ailleurs certains pays en leur apportant une aide d’expertise technique pour qu’ils réalisent ces contributions. Nous pensons qu’entre juin et septembre, nous connaîtrons les contributions des grands pays émergents et de beaucoup de pays en développement d’Afrique et d’Amérique latine.
Ces contributions sont souvent très intéressantes et je vous invite à en prendre connaissance.
De nombreux pays en développement qui se sont industrialisés ou sont dans une période d’industrialisation, tout en étant dans une période de croissance de leurs émissions, adoptent des mesures très importantes, beaucoup plus radicales que dans les pays développés. Ils ont complètement intégré le fait qu’il n’y aura pas de développement pour eux sans prise en compte de l’enjeu climatique.
Regardez aussi celles de pays comme le Gabon ou l’Éthiopie. Ces pays se fixent des objectifs très ambitieux alors qu’ils ont très peu d’émissions. Malgré des besoins de développement énormes, ils font le choix politique d’un développement durable complètement soutenable. Le journal Le Monde d’hier ou d’aujourd’hui a fait paraître sur le sujet un article très significatif sur l’Ethiopie.
Deuxième point : le Fonds vert pour le climat.
Quelques clarifications s’imposent. On confond en effet souvent le Fonds vert avec les 100 milliards – qui ont d’ailleurs été adoptés en même temps.
Les 100 milliards, c’est un engagement politique intrinsèque au fonctionnement de la négociation. C’est un engagement pris par les pays développés – en raison de leur responsabilité historique dans les phénomènes climatiques – d’apporter un soutien aux pays du Sud. Il s’agit plus précisément de 100 milliards annuels en 2020, de source publique et privée – sans que l’on sache encore quelle sera la part de l’une et de l’autre source.
Le Fonds vert, c’est 10 milliards de capitalisation initiale – une capitalisation pour quatre ans, à laquelle nous nous sommes engagés l’année dernière. Cela représente à peu près 2,5 milliards de décaissement annuel.
Dans les quatre années qui viennent, la contribution du Fonds vert aux 100 milliards atteindra donc à peu près 2,5 milliards par an.
Mme Martine Lignères-Cassou. Le Fonds vert va participer aux 100 milliards ?
M. Antoine Michon. Oui, mais seulement pour 2,5 milliards, aux côtés d’autres sources, comme par exemple les contributions bilatérales. Pour vous donner une idée, la contribution française bilatérale aux 100 milliards est d’un montant équivalent, puisqu’elle atteint aujourd’hui à peu près 2,5 milliards.
Sans doute doit-on s’attendre en 2018 à une recapitalisation du Fonds vert, peut-être d’un montant supérieur. Mais ce sont les ordres de grandeur.
Les premières contributions ayant été versées au Fonds vert, celui-ci a atteint un niveau suffisant pour être opérationnel. Cela s’est passé la semaine dernière, et c’était donc un moment important. Maintenant, il faut que les pays présentent des projets qui seront soumis au conseil d’administration. Nous espérons que les premières décisions de financement interviendront avant la fin de l’année. Le mécanisme est en train de se mettre en place. C’est un mécanisme assez novateur, qui a été négocié entre les pays.
M. Tancrède Voituriez. Certes, ces milliards de dollars peuvent donner le tournis. Et puis c’est très compliqué, d’autant que les chiffres divergent. Mais c’était un peu le but de notre exposé que de répondre aux interrogations des uns et des autres.
En fait, derrière les chiffres, il y a des discussions politiques, qui portent sur le périmètre du financement climat. En effet, on ne sait toujours pas ce que c’est que le financement climat. On sait malgré tout qu’il ne coûte pas beaucoup plus cher d’investir dans du bas carbone que dans du conventionnel. C’est une bonne nouvelle. Mais il y aussi une mauvaise nouvelle, qui est que, en dépit de cela, la réallocation vers du bas carbone ne se fait pas. Peut-être aurait-il été finalement beaucoup plus simple de constater qu’il manquait beaucoup d’argent et donc d’aller en chercher, que de s’apercevoir qu’il n’en manque pas beaucoup mais que l’on n’arrive pas à réallouer les fonds.
Maintenant, on peut se demander pourquoi il faudrait conserver l’objectif des deux degrés, si la hausse de la température atteint déjà trois ou quatre degrés à certains endroits. Les deux degrés ont tout de même une vertu : obliger à se projeter à un horizon très lointain, à faire des exercices, à monter des scénarios de transition ou de modification de l’économie. Par exemple, pour maintenir les deux degrés en 2050, il faudrait réduire les émissions au moins d’un facteur quatre en Europe ; on serait alors dans un tout autre monde. Se livrer à ces exercices permet de secouer un peu les économies et les sociétés, et de leur montrer que l’on ne discute pas d’un changement de trajectoire à la marge, mais d’un monde qui change à grande vitesse. C’est cela, le signal des deux degrés.
Ensuite, il est exact que la recherche, la technologie et l’innovation ne sont pas comptabilisées actuellement dans le périmètre de la finance climat. Mais l’innovation n’arrive pas comme cela. On n’augmentera pas les dépenses de R & D sur de nouvelles technologies s’il n’y a pas véritablement de consensus, s’il n’y a pas d’engagement pour renoncer à certaines trajectoires et en explorer d’autres. Une injonction vers plus de R & D, sur du bas carbone ou sur de l’atténuation, sera sans effet puisqu’il faut que ces investissements et cette innovation rapportent suffisamment. Or aujourd’hui, on juge que n’est pas le cas.
Par ailleurs, il faut abandonner l’idée, qui a été véhiculée, d’une nouvelle Révolution industrielle. Il n’y aura pas une « super technologie » comme il y a eu le moteur à explosion ou l’électricité. Il y a des grappes de technologie qu’il va falloir coordonner, et qui vont éventuellement ouvrir des sentiers de transition très vertueux en termes de carbone. Mais même cela ne se commande pas par des budgets de recherche et développement. C’est hélas un peu plus compliqué.
Passons au cadre d’investissement qui pourrait permettre cette réallocation.
On insiste beaucoup sur le prix du carbone. Celui-ci a de nombreux inconvénients, mais dans les manuels, il a beaucoup d’intérêt : il rend objectivement très chères des technologies qui, sinon, ne le seraient pas. La taxe carbone, quant à elle, n’est pas suffisante pour atteindre des objectifs de réallocation et de décarbonation profonde.
L’alternative, la normalisation, peut avoir une certaine efficacité mais elle est plus difficile à mettre en place. Elle prend du temps, car elle suppose des accords sectoriels qui dépassent les pays. Mais des initiatives ont été prises et des discussions sont en cours sur l’acier, le ciment, les autres éléments qui entrent dans le périmètre du système ETS européen – ou, en français, système communautaire d’échanges et de quotas d’émissions (SCEQE).
Plutôt qu’une taxe carbone à cinq euros, on pourrait imaginer de mettre en place des accords sectoriels avec des références technologiques obligeant, par exemple, à produire du ciment de telle ou telle manière. Même si cela nécessite une coordination beaucoup plus large que la négociation d’un prix carbone avec un ajustement aux frontières, il ne faut pas l’exclure. Les accords sectoriels réglementaires permettent à un pays d’imposer un ajustement aux réglementations intérieures. Selon l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), il est en effet possible d’avoir des réglementations internes plus élevées que ce que l’on observe à l’extérieur.
En dernier lieu, je tiens à préciser que ce n’est pas la taxe carbone qui fait fuir les industries européennes hors d’Europe. Cette taxe est à 5 euros et, pour l’instant, cela ne change rien au problème de compétitivité des industries européennes.
M. Benoît Leguet. Je commencerai par quelques précisions complémentaires sur les énergies fossiles.
D’abord, le chiffre de 5 000 milliards de dollars a été cité. Mais attention, ce n’est pas un coût budgétaire : c’est le coût des externalités liées aux subventions aux énergies fossiles. Le coût budgétaire pour les États est d’un autre ordre de grandeur : 500 milliards de dollars.
Ensuite, bien évidemment, une subvention aux énergies fossiles, c’est un prix négatif du carbone. Donc, si l’on veut un prix du carbone, il faut commencer par enlever les prix négatifs. Cela dit, si ces subventions sont mises en place, c’est aussi pour de bonnes raisons, et notamment pour gérer un certain nombre de conséquences sociales.
Maintenant, je vais essayer de faire l’impossible synthèse entre les différentes contributions et questions qui ont été apportées au débat, que je résumerai entre contraintes et innovation, recherche et développement.
Je partirai d’une métaphore. Si l’on est sorti de l’âge de pierre, ce n’est pas parce que l’on était à court de pierres ; il y en a encore beaucoup. On en est sorti grâce à la recherche et à l’innovation, qui nous ont permis de mettre au point d’autres technologies. C’était il y a quelques centaines de milliers d’années. Aujourd’hui, la situation est légèrement différente. Certes, on peut espérer que des technologies vont arriver – technologies « miracles » ou amélioration des technologies existantes. Mais il faudra de toutes les façons sortir du pétrole avant d’en avoir épuisé la dernière goutte. Pour y parvenir, on peut supposer qu’un certain nombre de contraintes seront tout de même nécessaires. Donc ce n’est pas technologie « ou » contraintes, c’est technologie « et » contraintes. Il faut les deux.
J’en viens au Climate Finance Day, évoqué par un certain nombre d’entre vous.
Je tiens tout d’abord à faire une rectification : la Caisse des dépôts n’a pas annoncé qu’elle désinvestissait du charbon ou du fossile. Nous avons pris des engagements qui sont de nature différente, mais qui sont, selon moi, beaucoup plus efficaces.
Nous avons annoncé que nous allions mesurer l’empreinte carbone de notre portefeuille, et rendre public le chiffre avant la fin 2015. Une fois cette empreinte carbone mesurée, nous allons la réduire d’ici à 2020 : de l’ordre de 30 % à 35 % sur le secteur immobilier, et de 15 % sur les infrastructures.
Pour réduire les émissions d’un portefeuille, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez évidemment vendre des participations carbonées et racheter des participations moins carbonées. Mais si vous travaillez sur le long terme, vous pouvez engager un dialogue actionnarial avec les entreprises dont vous détenez une part du capital et leur demander d’adopter des résolutions climatiques. C’est plutôt cette voie que nous allons privilégier, en engageant un dialogue actionnarial bien compris dans l’intérêt de nos participations et de la gestion du risque. Évidemment, si l’on n’arrive pas à instituer un dialogue actionnarial fructueux, d’autres voies seront sans doute envisagées, comme le désinvestissement ou l’allègement du portefeuille sur certains segments de l’économie. Les engagements qui ont été pris par la Caisse des dépôts visent donc plutôt le long terme. Mais cela commence maintenant.
Par ailleurs, l’un de vous a demandé si la mobilisation des acteurs était suffisante, et comment s’assurer que les engagements seront respectés.
La mobilisation des acteurs est-elle suffisante ? Oui et non. À l’occasion du Climate Finance Day, un certain nombre d’acteurs ont pris des engagements. Est-ce suffisant ? Non, mais c’est un très bon premier pas.
J’observe qu’il y a un an, on n’aurait pas imaginé d’organiser ce genre de manifestation avec les investisseurs, les banquiers, les assureurs et les régulateurs. Mais cette année, la communauté financière est venue, non pas pour parler d’une seule voix car il y a encore beaucoup de discussions d’ordre technique en son sein, mais pour parler de la même chose : climat et carbone.
Il faudra suivre les engagements qui ont été pris. Cela peut demander un peu de matière grise et un peu de technique. Mais je suis confiant sur le fait que les députés, la société civile et de nombreux acteurs nous y aideront.
Enfin, est-ce que l’objectif de 100 milliards de dollars par an est tenable ? Oui, ça l’est tout à fait – reportez-vous aux chiffres que nous vous avons donnés. Ils sont d’ailleurs déjà là. Ou plus exactement, si on veut les trouver, on les trouvera. Reste à savoir où l’on mettra le curseur. Mais encore une fois, ce n’est pas la question posée sur le long terme. Les 100 milliards par an, c’est un geste, un engagement politique. Comme au patinage artistique, c’est une figure imposée. Si l’on rate cette étape, on ne pourra pas continuer. La vraie question est celle des 1 000 milliards ou, en d’autres termes : comment réallouer le capital vers du bas carbone ? Ne nous trompons pas d’objectif.
M. Stanislas Dupré. Je ne pourrai pas non plus répondre à toutes les questions, mais je vais me pencher sur quelques-uns des points qui ont été soulevés.
D’abord, quel regard porter aujourd’hui sur la mobilisation de la finance ? J’ai l’impression qu’il y a une très bonne dynamique de mobilisation. En revanche, une partie du signal est peut-être mal interprétée par les acteurs. Parfois, il y a des malentendus. On a parfois aussi tendance à se leurrer sur l’importance de ce qui est annoncé.
Ensuite, j’aimerais revenir sur un sujet déjà abordé par M. Leguet, et faire remarquer que réallouer des actifs financiers dans un portefeuille, ce n’est pas la même chose qu’investir dans l’économie réelle. Si vous voulez, par exemple, désinvestir des portefeuilles financiers des énergies fossiles et que cela ait un impact sur l’économie réelle, il faut atteindre une masse critique et que d’autres investisseurs fassent la même chose que vous.
Il est intéressant de constater, quand on travaille cette question sur le plan technique, qu’il n’y a personne à l’échelle mondiale, et a fortiori au sein de la Banque de France, du Trésor ou ailleurs, qui cherche à comprendre quel est l’impact du secteur financier sur le financement de l’économie. Il n’existe pas de modèle pour cela : on peut parler de « trou noir ». Or pour comprendre l’impact environnemental, il faut d’abord comprendre l’impact sur les investissements et sur l’activité économique. Et on est bien en mal de le faire.
Si l’on fait un bilan à date en rapport avec cette question, on voit qu’une dynamique est amorcée au niveau des banques. Il y a effectivement de vrais investissements qui ne trouveront pas de financement, notamment dans le secteur du charbon. Cela s’explique en partie par la conjoncture économique de ce secteur, qui n’est pas bonne et qui facilite les annonces.
Quelles seront les prochaines étapes ? D’après moi, une mise en cohérence plus nette du secteur public bancaire sur ces questions. Et sans doute en discutera-t-on au G 7 le mois prochain.
À propos des investisseurs, je dirais qu’ils ont beaucoup plus tendance à faire des annonces « Canada Dry ». Ils annoncent qu’ils vendent des actifs mais, finalement, cela ne change pas grand-chose. La voie suivie par la Caisse des dépôts et présentée par M. Leguet semble beaucoup plus intéressante, mais elle est aujourd’hui minoritaire.
Autre point : le risque carbone semble être la prochaine bulle qui affole le secteur financier, si l’on se réfère aux déclarations de certaines banques centrales, des investisseurs, etc. Il faut voir qu’il y a aujourd’hui beaucoup de communications sur le sujet. Certes, des investigations réelles sont faites, notamment par la Banque d’Angleterre. Certes, les analystes et les agences de notation font des calculs sur ce que pourrait être l’impact d’un scénario « deux degrés ». Mais dans le cœur de leur modèle, le pourcentage de chances qu’ils prennent en compte est proche de zéro. C’est un élément à garder en tête : on commence à s’y intéresser, mais ce n’est pas encore intégré dans les modèles.
Par ailleurs, il me semble crucial, pour les décideurs politiques – notamment les parlementaires – de se former dans les années à venir sur ces questions. Ceux d’entre vous qui s’y intéressent devraient suivre des formations d’une journée ou deux. Nous sommes prêts à vous les dispenser gratuitement. Cela vous permettrait d’interpréter les signaux, de comprendre ce qui change vraiment, et d’allouer de la manière la plus efficiente possible des crédits publics qui sont contraints.
Je vais vous donner deux exemples pour appuyer mon propos.
Premièrement, si le projet de loi sur la transition énergétique oblige les investisseurs à rendre des comptes sur leur empreinte carbone, il n’y a quasiment aucun investissement qui ait été fait jusqu’à présent par les pouvoirs publics, à l’échelle mondiale, pour développer des méthodes en la matière. Quant à ceux qui ont été faits par le secteur privé, ils sont très faibles. Se pose donc aujourd’hui la question de la mise en œuvre effective de cette obligation. Je pense qu’avec une meilleure compréhension de ces questions, on aurait pu anticiper la situation.
Deuxièmement, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a vu ses subventions réduites. Elle a dû rogner sur ceux de ses budgets consacrés à cette question, au moment où des injections massives de crédits auraient pourtant été nécessaires. L’ADEME fait au mieux avec les crédits dont elle dispose, mais je trouve qu’il y a là une contradiction dans les choix faits par l’État, qui appuie en même temps sur la pédale de frein et sur la pédale de l’accélérateur.
Ensuite, je ne suis pas sûr de partager totalement l’analyse de M. Voituriez sur le côté « volontariste » de la R&D. J’ai travaillé dans le secteur du ciment et il est clair qu’il faudrait y intégrer une nouvelle technologie pour que celui-ci puisse décarboner comme cela est prévu dans les scénarios. Or, quelles que soient les contraintes qui seront mises sur ce secteur en termes de négociations dans les dix, vingt ou trente années à venir, cela n’aura que peu d’influence sur les investissements de R&D. En effet, les émissions se matérialiseraient au-delà de quinze ou vingt ans, et le secteur financier n’a pas cette capacité d’anticipation. Cela signifie que dans ce secteur, il faudrait que des investissements en R & D soient décidés maintenant pour que la décarbonisation puisse se mettre en place dans vingt ans. Mais ce n’est pas ce qui se passe. Quand je travaillais pour ce secteur, à l’échelle mondiale, on investissait dans ce domaine moins que mon salaire – qui, à l’époque, n’était pas très élevé. Il y a donc encore de gros efforts à faire.
Je terminerai mon propos sur le rôle joué par l’Europe. Il est clair que c’est elle qui est la plus à même de se mobiliser et d’intervenir là où il le faut. Il me semble donc important que les actions menées au niveau national s’articulent avec celles qui sont menées au niveau européen.
Mme Catherine Quéré, présidente. Je vous remercie pour votre participation à cette table ronde.
24. Audition de M. Bernard Guirkinger et de M. Gaël Virlouvet, rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental (CESE), sur leurs avis « Réussir la conférence climat 2015 » et « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques » (14 octobre 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce n’est pas la première fois que la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire auditionne des rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental. À la suite des contacts que j’ai pris, il y a quelques années, avec Anne-Marie Ducroux, présidente de la section de l’environnement du CESE, j’ai décidé d’auditionner régulièrement les rapporteurs du Conseil sur les sujets et thématiques intéressant notre Commission.
Nous avons ainsi reçu, le 13 mars 2013, M. Jean Jouzel, climatologue, et Mme Catherine Tissot-Colle, présidente de la FEDEM, co-rapporteurs d’un avis sur la transition énergétique ; le 8 octobre 2013, Mme Catherine Chabaud, sur son avis « Quels thèmes et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? » ; le 14 mai 2014, M. Antoine Dulin et M. Allain Bougrain-Dubourg, sur l’avis sur « l’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique » ; le 3 juin 2014, Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section de l’environnement, M. Marc Blanc et M. Allain Bougrain-Dubourg, sur l’avis « Agir pour la Biodiversité ».
Aujourd’hui, nous accueillons à nouveau Anne-Marie Ducroux, ainsi que deux rapporteurs du CESE : M. Bernard Guirkinger sur l’avis « Réussir la conférence climat 2015 » et M. Gaël Virlouvet sur l’avis « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques ».
Mme Anne-Marie Ducroux, présidente de la section de l’environnement du Conseil économique, social et environnemental. Je remercie les membres de votre Commission pour l’intérêt dont ils font preuve à l’égard des travaux du CESE, et de la section de l’environnement en particulier. Notre section a été l’une des plus auditionnées par l’Assemblée nationale, ce dont je me réjouis, car il est très important à nos yeux, et à ceux du président du Conseil, Jean-Paul Delevoye, d’entretenir des relations mutuelles de coopération, de compréhension et d’échange : en effet, nos rôles sont complémentaires.
En plus des recommandations « climat » figurant dans nos autres avis, notamment ceux relatifs à la transition énergétique, dont il a été tenu compte dans la loi votée en juillet 2015, nous avons produit trois avis portant spécifiquement sur le climat : les deux qui vous sont présentés aujourd’hui, ainsi qu’un troisième portant sur l’adaptation climatique, que nous tenons à votre disposition. Nous avons en effet tenu à travailler sur les deux volets des politiques climatiques que sont l’atténuation d’une part, l’adaptation d’autre part. La section des affaires européennes et internationales s’est, pour sa part, plutôt intéressée aux aspects de la COP21 relatifs aux négociations.
Globalement, les enjeux du climat ont réuni un très large consensus au sein du CESE. Il n’y a eu aucune discussion sur la nature de l’enjeu climatique, et en particulier de ses origines anthropiques. Nous avons trouvé des acteurs très mobilisés, animés par une vraie envie d’agir et de faire valoir des solutions, dans une dynamique positive plutôt que dans une attitude critique qui paraît aujourd’hui dépassée.
Les avis ont été votés à une très large majorité, ce qui atteste là encore de l’appropriation des enjeux et, je l’espère, des recommandations formulées. Je ne pourrai rester jusqu’à la fin de cette réunion, devant rejoindre la section de l’environnement que je préside tous les mercredis, mais je ne doute pas que Bernard Guirkinger et Gaël Virlouvet répondent à toutes vos questions.
M. Bernard Guirkinger. On peut se demander pourquoi le CESE travaille sur la question des négociations climatiques, et pourquoi sa section des affaires européennes et internationales s’est emparée de ce sujet pour la deuxième fois, après avoir rendu un premier avis sur la conférence de Cancún de 2010.
Le premier objectif du Conseil est de faire de la pédagogie et de mobiliser autour des négociations internationales qui vont avoir lieu, en montrant les enjeux ainsi que la difficulté de parvenir à un accord. Nous avons pris conscience, en travaillant sur la question des changements climatiques et de la COP21, du fait que les négociations à venir n’étaient pas tant de nature environnementale que de nature économique et géopolitique.
Notre deuxième objectif consiste à exprimer les attentes de la société civile vis-à-vis de négociateurs. Il n’y a plus de débat au sein du CESE sur l’origine humaine du changement climatique, et notre intervention vise aussi à traduire l’impatience, pour ne pas dire l’exaspération, que l’on peut ressentir en constatant la difficulté à conclure un accord, alors que l’on travaille depuis une vingtaine d’années sur ces questions, dont on connaît désormais les enjeux au regard des conséquences dramatiques qui sont à craindre.
Nous assumons notre rôle militant en prenant le relais de la société civile, y compris en dehors de nos frontières, puisque nous avons travaillé avec des associations internationales et de nombreux conseils économiques et sociaux de par le monde afin de les mobiliser sur ces questions. Un avis a été adopté récemment à Moscou, et le CESE a organisé plusieurs réunions associant des membres de la société civile travaillant dans des enceintes équivalentes à la nôtre. Nous avons eu à cœur de montrer, notamment aux pouvoirs publics, que la société civile était prête à agir, et que les acteurs économiques et syndicaux, ainsi que les ONG, prenaient déjà de nombreuses initiatives afin de contribuer à l’atténuation et à la lutte contre le changement climatique. Nous avons donné plusieurs exemples internationaux montrant que de très nombreuses choses sont faites partout dans le monde, notamment en Chine – beaucoup plus active qu’on ne l’imagine dans ce domaine – et aux États-Unis, en particulier en Californie.
Il est impressionnant de voir à quel point les syndicats ont pris la mesure des enjeux liés aux changements climatiques. La Confédération syndicale internationale (CSI) se prononce très clairement pour un autre mode de production et de consommation, et est parfaitement consciente des enjeux que cela implique en termes d’emploi dans les secteurs d’activité qui vont devoir s’adapter et les nouveaux secteurs d’activité qui vont émerger. La secrétaire générale de la CSI a déclaré en 2014 : « Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte ». Ce que demandent les syndicats aujourd’hui, c’est que l’on anticipe l’engagement de la transition écologique en ouvrant des négociations, en renforçant les plateformes de négociation telle l’Organisation internationale du travail (OIT), et en accompagnant, en termes de formation, toutes les personnes dont l’emploi est susceptible d’être impacté.
Nous nous sommes peu étendus sur la nature de l’accord attendu, considérant que le débat n’est pas d’ordre juridique. Ainsi, nous n’avons pas utilisé l’adjectif « contraignant » : nous considérons qu’il faut un accord juste, global et ambitieux, basé sur des engagements réciproques, et à partir duquel il faudra encore créer une dynamique afin de renforcer continuellement les engagements pris par les différentes parties, mesurer, contrôler et améliorer ces engagements, et mettre en œuvre les plans d’action qui seront définis.
Le Fonds vert pour le climat et les engagements pris à ce sujet à Copenhague constituent également un point très important. Tous ceux qui s’intéressent à la négociation savent qu’il s’agit là d’une question de confiance : c’est la manifestation de la responsabilité différenciée des différentes parties. Les pays en voie de développement attendent, sur ce point, une concrétisation des engagements pris, en particulier sur ce chiffre mythique de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. C’est une somme considérable et un engagement qu’il va falloir honorer, ce qui va demander des efforts aux pays développés. Le Président de la République a déclaré en janvier 2015 que la taxe sur les transactions financières serait entièrement affectée au Fonds vert – une démarche que nous soutenons.
Nous avons attiré l’attention de toutes les parties sur l’importance de la gouvernance du Fonds vert, qui va être à l’origine de flux d’argent considérables. La société civile demande à être partie prenante des conseils d’administration du Fonds vert. L’OCDE vient de publier une analyse dans laquelle elle a miraculeusement identifié 60 milliards d’euros qui seraient d’ores et déjà disponibles. On peut être perplexe devant ce chiffre qui, à notre sens, n’a pu s’obtenir qu’en additionnant choux et carottes, c’est-à-dire dons et prêts, aides au développement et sommes d’autre nature.
Pour ce qui est de la fiscalité, le CESE réclame plus de fiscalité écologique et moins de fiscalité sur le travail. La seule façon de faire évoluer les comportements des acteurs économiques est d’agir soit sur la réglementation et les normes – ce qui relève de la compétence du législateur –, soit sur la fiscalité, afin de faire évoluer les comportements des acteurs économiques. Nous considérons qu’émettre des gaz à effet de serre constitue une pollution, donc une externalité négative, et qu’il convient en la matière d’appliquer le principe « pollueur-payeur » et de taxer les émissions, soit sous forme de marché de droits à polluer, soit sous forme de redevances pollution – ma préférence allant à cette deuxième solution compte tenu de la difficulté qu’il y a à faire fonctionner un marché.
S’il est souvent question de la Californie dans l’actualité en raison des problèmes de sécheresse auxquels elle est confrontée, cela fait plus de dix ans qu’elle travaille régulièrement, et avec une grande continuité d’un gouverneur à l’autre. Cet État a mis en place des taxations sur toutes les émissions de gaz à effet de serre, toutes les énergies fossiles, ce qui a eu des conséquences très importantes sur le plan économique : aujourd’hui, ce n’est pas un hasard si la Californie est en train de prendre une longueur d’avance en matière de fabrication de voitures électriques. Alors que la question du stockage de l’électricité va jouer un rôle majeur dans les années qui viennent, c’est en Californie que l’on investit le plus actuellement, et que des industriels commencent à travailler à très grande échelle sur cette question.
Nous sommes très partisans du principe « put a price on carbon » – fixer un prix pour le carbone – et considérons même que, de ce point de vue, nous vivons un moment historique. Tous ceux qui réclament aujourd’hui un prix du carbone sont surpris de constater que les grands acteurs économiques adhèrent à cette démarche – plus de 1 000 entreprises ont signé l’appel de la Banque mondiale – et une grande partie des leaders du secteur énergétique se sont prononcés en faveur d’un prix du carbone. Il y a donc une chance à saisir.
M. Gaël Virlouvet. Je suis très heureux de venir vous présenter le rapport « 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques ». Au cours de la préparation de cet avis, nous avons invité les députés Arnaud Leroy et Martial Saddier à venir nous faire part de leurs points de vue sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est donc logique qu’aujourd’hui, nous venions vous exposer les travaux que nous avons menés avec leur appui.
Je vous présenterai successivement les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, les constats que nous avons faits et les préconisations que nous formulons.
Pour ce qui est des enjeux, nous avons rapidement pris conscience que la COP21 allait constituer un moment fort de focalisation sur le climat. Depuis quelques années, on assiste à une dramaturgie médiatique de la COP, s’achevant par la constatation que celle-ci n’a pas permis d’aboutir à un accord significatif et constitue donc un échec – on a parfois l’impression que le deus ex machina que l’on s’attendait à voir surgir ne s’est jamais montré. En réalité, les négociations internationales et la lutte contre le changement climatique concernent les modes de vie de l’ensemble des habitants du monde ; de ce fait, les avancées que l’on peut obtenir dans ce domaine sont forcément lentes – ce qui ne nous empêche pas d’espérer que nous en verrons de significatives en décembre prochain. Pour ne pas ressortir de la COP21 avec la gueule de bois, il faut resituer la lutte contre le changement climatique dans une continuité s’étalant sur plusieurs dizaines d’années. Parler de vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique, c’est aussi mettre en lumière ce qui s’est fait en amont de la COP en France, et évoquer ce qui pourrait se passer après – de ce point de vue, on peut espérer que la COP va avoir un effet stimulant.
Les avancées de la COP21 seront, à notre sens, d’autant plus importantes qu’elles trouveront leur origine à l’échelle territoriale : aucune négociation internationale ne peut être totalement déconnectée de ce qui se passe sur les territoires. Il était donc intéressant de se pencher sur la réalité française en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Le premier constat que nous ayons fait, c’est que la France a agi depuis vingt ans : si c’est une évidence, elle n’est pas suffisamment rappelée. Entre 1990 et 2000, l’objectif national n’a consisté qu’à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre après leur décrue au cours des années 1980, notamment grâce à la montée en puissance du nucléaire ; notre objectif était très modeste sur cette période, mais il a été atteint. Depuis 2000, nous avons diminué de 13 % les émissions de gaz à effet de serre en France, en particulier dans les secteurs énergétique et industriel et, dans une moindre mesure, dans le secteur agricole ; quant au secteur des transports, il n’y a été obtenu aucune diminution des émissions.
Nous constatons, par ailleurs, que la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique a été, jusque dans les années 2000 à 2005, une politique engagée principalement par le niveau national, en excluant presque totalement l’initiative territoriale. C’était alors un petit groupe composé d’ingénieurs et de fonctionnaires de haut niveau rattaché au ministère de l’environnement – ou parfois au Premier ministre, au sein de la mission interministérielle sur l’effet de serre – qui impulsait la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il n’y avait donc pas de réalité territoriale de la lutte contre le réchauffement climatique, tout au plus une réalité sectorielle, par silo.
La réalité territoriale a émergé au début des années 2000, avec la mise en application des premiers agendas 21 dans les territoires, qui, pour certains, ont pris une dimension « énergie-climat », avec le soutien de l’ADEME, qui a aidé les territoires à s’intéresser non seulement à la question énergétique, mais aussi à celle du climat. En 2004 est apparue la possibilité d’élaborer des plans climat volontaires dans les territoires ; les premiers de ces plans ont servi de modèle pour la massification des plans climat territoriaux intervenue à l’issue de la loi Grenelle, qui a constitué un véritable point de bascule pour l’implication des territoires dans la lutte contre le changement climatique.
Enfin, notre troisième constat est que la territorialisation progressive de la lutte contre le changement climatique, initiée à partir de la seconde moitié des années 2000 et poursuivie avec la loi de transition énergétique votée par votre assemblée au cours de l’été dernier, s’est accompagnée d’une décentralisation des enjeux énergétiques : lorsqu’on a commencé à parler de climat dans les territoires, on a également décentralisé les questions énergétiques.
J’en viens à nos préconisations, toutes liées aux difficultés observées. La première difficulté notée, c’est qu’alors que la participation de tous est requise dans la lutte contre le changement climatique, la politique nationale est confiée à la ministre chargée de l’environnement, sans pouvoir interministériel lié. La deuxième difficulté, c’est qu’il n’y a pas d’instance officielle de dialogue et de suivi de la politique climat au niveau national : s’il existe un conseil national de l’eau et un conseil national des déchets, il n’y a pas de conseil national du climat, en dépit de l’importance de la politique à mener en la matière.
Nous proposons donc une gouvernance lisible, tenant en deux points. Il s’agit d’abord de doter la politique climat d’une dimension interministérielle en faisant en sorte qu’elle soit assumée par le Premier ministre, notamment devant le Parlement. Il y a eu débat sur le point de savoir si la dimension opérationnelle devait rester entre les mains du ministre de l’environnement ou être confiée au Premier ministre, et ce débat n’a pas été tranché en section. Pour ma part, je pense que le ministre doit rester responsable de cette dimension opérationnelle, puisqu’il existe une direction générale de l’énergie et du climat, que l’on voit mal rattachée au Premier ministre. Nous proposons également de confier le suivi de la politique climat à une instance de dialogue unique, qui pourrait être le Conseil national de la transition écologique (CNTE) ou un conseil national du climat.
Une autre difficulté consiste dans le fait que la mobilisation des acteurs repose sur la proximité. Beaucoup de solutions étant territoriales ou locales, les politiques territoriales sont essentielles dans la lutte contre le changement climatique. Cela dit, la contribution des territoires à l’atteinte des objectifs nationaux est peu lisible. Il faut donc responsabiliser les territoires en les dotant de contrats d’objectifs climat – définissant, par exemple, les objectifs d’un territoire en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il s’agit d’inclure ces objectifs territoriaux dans les objectifs nationaux et d’améliorer l’articulation entre les politiques sectorielles d’une part – en matière de d’énergie, de transport, d’industrie – et les politiques territoriales d’autre part.
Le troisième groupe de difficultés réside dans le changement conséquent attendu dans les modes de vie. Or, le changement climatique est encore peu abordé à l’école et le savoir-faire d’accompagnement au changement est relativement limité en France – de ce point de vue, les Anglo-Saxons sont bien meilleurs que nous. Il convient donc de densifier le contenu « climat » des programmes scolaires – encore davantage que cette année, où une circulaire ministérielle a incité à un effort en ce sens. Par ailleurs, il faut aussi dynamiser la recherche en France sur l’accompagnement au changement : nous ne devons pas laisser les Anglo-Saxons nous distancer sur ce point. Enfin, nous devons favoriser la mobilisation grâce à une semaine nationale du climat et des moyens de communication et de proximité.
Le quatrième ensemble de difficultés est celui lié aux transports. Le transport routier est le premier émetteur de CO2, avec 25,1 % des émissions de CO2. Les émissions du secteur routier ont augmenté de 9 % entre 1990 et 2012 : non seulement nous n’avons pas réussi à réduire ces émissions, mais elles ont même augmenté !
La loi Grenelle de 2009 avait fixé pour objectif de revenir en 2020 au niveau de 1990. Malheureusement, nous ne sommes pas sur cette trajectoire aujourd’hui : la distance entre le domicile et le travail continue d’augmenter, et la taxe kilométrique poids lourd a été abandonnée – au grand regret du CESE, qui a toujours soutenu le principe de l’écotaxe. Nous proposons d’initier un Grenelle du transport et de la mobilité afin d’avancer sur ces questions, en donnant une franche impulsion à la dynamique en matière de mobilité.
Le cinquième groupe de difficultés réside dans le fait que le prix du carbone n’incite pas à la réduction des émissions des gaz à effet de serre, et que certaines politiques publiques favorisent même les émissions. Sur ce point, nous partageons une préconisation avec la section des affaires internationales : il s’agit de refléter, dans le cadre économique, la préférence collective pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre – concrètement, de donner un prix incitatif au carbone, et de commander un audit sur l’impact des investissements et aides publics en matière de carbone.
En conclusion, ce n’est pas en faisant peur au sujet du climat que nous parviendrons à mobiliser : en procédant de la sorte, nous ne ferions que contribuer à ce que les Français cèdent à la tentation de repli à laquelle ils sont parfois soumis. Nous devons mobiliser sur des valeurs positives : en d’autres termes, donner envie. Il se trouve que la lutte contre le changement climatique, qui constitue un enjeu mondial, ouvre aussi de nouvelles opportunités économiques, puisque tous les territoires y sont confrontés et vont donc avoir besoin de solutions. La France doit conserver son leadership dans la course mondiale que constitue la lutte contre le changement climatique. Nous devons nous montrer offensifs, en promouvant les solutions développées en France, en assurant une veille à l’international – ce que nous faisons insuffisamment – et en encourageant l’investissement des acteurs français dans les structures et réseaux internationaux œuvrant sur le climat. Il ne faut pas laisser aux seuls Anglo-Saxons la définition des normes qui régiront demain le monde en matière de lutte contre le changement climatique : il est essentiel que les Français contribuent à l’édiction de ces normes.
Par ailleurs, l’accueil de la COP21 doit être bénéfique à la politique française de lutte contre le changement climatique. Cela signifie que nous devons fournir de l’information fiable aux Français, et ouvrir un vrai débat, où les climato-sceptiques n’ont plus leur place – il n’y en a plus un seul au CESE, et ils sont désormais très rares au sein de la communauté scientifique –, portant sur les moyens qui nous permettront de limiter le réchauffement à plus 2 °C : c’est le sujet numéro un dans les médias français en amont de la COP.
Il s’agit donc de parler des solutions, comme l’a fait le Gouvernement, mais aussi – et cela reste à faire – de capitaliser la mobilisation de tous les acteurs – entreprises, syndicats, monde scientifique, associations – à laquelle on assiste actuellement autour de la COP21, et d’établir un bilan afin de contribuer à pérenniser et amplifier la dynamique française de lutte contre le réchauffement climatique.
M. Jean-Yves Caullet. L’un des premiers objectifs de la COP21 doit être de permettre à notre pays de retrouver son rôle et son ambition d’universalité dans la réflexion et dans les propositions, mais aussi en termes d’action et d’exemple. Je ne m’étendrai pas sur la nature juridique de l’accord : nous savons tous qu’elle est conventionnelle, et que cet accord ne va pas nous faire passer des ténèbres à la lumière. En revanche, le fait qu’il y ait un accord global sera le signe d’une avancée et constituera un succès pour la France – qui obligera notre pays au niveau national comme international.
Pour ce qui est du financement, vous avez parlé d’une taxation sur les transactions financières, mais croyez-vous que la réflexion et le travail autour de la COP21 puissent accoucher d’un système global ? Nous avons adopté ici même, il y a quelques jours, un amendement en loi de finances ayant pour objet d’élargir la taxe sur les transactions financières aux transactions intraday – c’est-à-dire l’achat et la revente d’un titre au cours d’une seule journée. Pensez-vous que la COP21 pourrait faciliter la globalisation du système, ou que nous devrons toujours nous contenter d’une addition de systèmes ?
En ce qui concerne la gouvernance, nous avons tous en tête les mêmes schémas classiques de représentativité, désignation, articulations et institutions. Mais quelle place pourrait être faite aux réseaux, notamment les réseaux sociaux – nationaux et internationaux – pour que la société civile cristallise son influence dans la gouvernance de l’après COP21 ?
Vous avez parlé du prix du carbone, et je crois qu’il y a effectivement un paradoxe à constater que le monde de l’entreprise – en particulier dans le secteur énergétique – est en avance sur les pouvoirs publics, alors qu’il semble dans le même temps souhaiter un guide pour prendre les décisions stratégiques, et surtout éviter d’être surpris par des décisions politiques brutales, qui pourraient avoir de graves conséquences.
L’enjeu des transports interpelle tout particulièrement notre Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Est-il normal d’évoquer ces deux thèmes séparément ? Finalement, dans le cadre de l’aménagement du territoire au sens d’un aménagement de l’économie, de la présence des ressources humaines, matérielles et capitalistiques, pour produire, n’a-t-on pas fait trop confiance à la performance technique du transport ? En Île-de-France, notamment, il me semble que l’on a trop souvent vu les transports comme une variable d’ajustement, et considéré qu’il serait toujours possible de trouver un moyen de remédier à la saturation des infrastructures. Ce modèle mérite aujourd’hui d’être remis en question, étant donné que le secteur des transports est le seul où nous ne parvenons pas à progresser. Quelle est votre opinion sur une transition vers le gaz, et quel serait l’impact sur le secteur des transports si nous accompagnions de façon résolue une transition des produits pétroliers vers le gaz, censé produire moins d’émissions ?
Vous avez parlé d’engagements territoriaux, mais de quels moyens et compétences techniques les territoires disposent-ils pour conduire une politique décentralisée ?
Enfin, dans le prolongement de ce que vous avez dit au sujet de l’école, je voudrais évoquer la formation supérieure : pourquoi ne forme-t-on pas des ingénieurs, qui pourraient proposer des solutions pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, comme ce fut le cas précédemment pour l’électrification ou l’adduction d’eau potable ? Le changement climatique ne constitue-t-il pas un enjeu suffisamment important ?
M. Jean-Marie Sermier. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », a dit le président Jacques Chirac lors du IVe Sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg. Depuis une quinzaine d’années, les gouvernements qui se sont succédé dans les différents États du monde – notamment les États développés – s’efforcent de trouver des solutions afin de préserver notre capacité à rester sur cette planète. Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause un changement climatique qui ne se résume pas à un simple réchauffement, mais va engendrer des modifications susceptibles de se traduire par des effets dévastateurs. De même, l’origine anthropique de ce phénomène est admise de façon unanime : c’est bien l’homme qui est à l’origine de l’évolution climatique dont nous ressentons les premiers effets et qui, dans le meilleur des cas, pourra être contrôlée à l’horizon 2100 à environ plus 2 °C. Encore faudrait-il que cet objectif soit encore à notre portée, ce qui n’est pas certain : si l’on se réfère aux tendances observées depuis trente à quarante ans, il est bien plus probable que nous nous dirigions vers un réchauffement de l’ordre de 4 °C à 5 °C.
Dans ce contexte, s’intéresser à la réussite de la COP21 est sans doute important, mais pas essentiel. L’objectif que nous devons poursuivre n’est pas de réussir la COP21 pour que la France en tire un motif de gloire, mais de faire en sorte que la prise de conscience qui a déjà eu lieu – plus largement qu’on ne le dit dans les pays en voie de développement – puisse déboucher sur des mesures extrêmement précises. Les discours tenus au niveau national, européen et mondial, ne peuvent plus être discordants, en particulier sur cette question essentielle qu’est l’émission de CO2 : un message très clair doit être envoyé sur la nécessité de favoriser les énergies rejetant le moins de gaz à effet de serre. De ce point de vue, si la France a tenu un certain nombre de ses engagements, c’est grâce à la politique de maintien, voire de maintien de l’énergie nucléaire, qu’elle a menée durant des années. On ne peut donc pas, dans un texte de loi, envisager de réduire drastiquement la part du nucléaire, et prétendre dans le même temps réduire le volume de CO2 rejeté dans l’atmosphère. De ce point de vue, nos voisins allemands ont été confrontés à de très grandes difficultés après avoir pris la décision de mettre fin au nucléaire.
Il est important de faire des progrès en termes de gouvernance. Vous avez évoqué celle mettant en œuvre les réseaux, tandis que d’autres ont parlé des associations. Pour ma part, je m’en tiendrai aux gouvernements, car on sent bien que nous sommes très loin, à l’heure actuelle, d’une gouvernance internationale.
Enfin, il est extrêmement important que nos chercheurs, excellents dans le domaine scientifique, s’améliorent dans le domaine de la communication : ils doivent apprendre – en faisant appel à des experts, si besoin est – à trouver les mots justes, afin que notre société comprenne l’importance de ce sujet.
M. Bertrand Pancher. Je remercie les membres du CESE pour leurs rapports, comme toujours de grande qualité. Je partage avec eux la conviction que les solutions de demain se construiront avec le concours de l’ensemble des acteurs de la société civile : il n’appartient pas aux responsables politiques de les définir à eux seuls.
La COP21 aboutira à un accord qui, si ambitieux soit-il, ne résoudra pas la question du réchauffement climatique : après la conférence, nous devrons continuer à imaginer et à mettre en œuvre des modèles de régulation sur le plan national, européen et international car, sans ces modèles, rien ne pourra se régler. En la matière, la fiscalité écologique est un levier indispensable, que nous devons constamment faire progresser. La gouvernance nationale doit également être améliorée et rendue plus stable. À cet égard, il convient de s’interroger sur les moyens à attribuer, soit à un grand ministère de l’écologie, soit à un ministère du long terme directement rattaché au Premier ministre : en tout état de cause, la question de la gouvernance du long terme doit être posée, car notre instabilité réglementaire et fiscale est l’un des premiers obstacles à la mise en place de stratégies environnementales efficaces.
Sur le plan européen, le modèle de demain est-il celui d’une meilleure gouvernance et d’une plus grande stabilité de nos stratégies en matière de marché des émissions de carbone – ce que l’on désigne par l’expression Emission Trading Scheme (ETS) – et une ouverture des ETS à d’autres modes de production des gaz à effet de serre, notamment le transport, ou celui d’une taxation du carbone aux frontières de l’Europe ? Alors que de telles questions paraissaient totalement hors de propos, pour ne pas dire taboues, il y a quelques années, elles sont aujourd’hui sur la table – l’ancien commissaire européen Michel Barnier vient d’ailleurs de signer une tribune très intéressante à ce sujet. Quelle est votre position sur ce point ?
Sur le plan international, c’est encore plus confus : rien n’est structuré en matière d’émissions de gaz à effet de serre. La solution consiste-t-elle en un système de bonus-malus entre les pays, où ceux qui polluent le plus sont ceux qui payent le plus, selon des modalités restant à définir ? Convient-il de tarifier le carbone par grandes zones économiques ? Est-il envisageable d’appliquer des normes sectorielles, selon un système qui laisse espérer des avancées, notamment dans le domaine du transport automobile ? Enfin, en matière de finances, la régulation des placements et des investissements ne se pose pas seulement au niveau national, mais bien à l’échelle internationale. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
M. Jacques Krabal. Il importe d’entendre ce que dit la société civile sur la problématique du dérèglement climatique, c’est pourquoi les rapports du CESE, qui travaille sur la question depuis dix ans, présentent un si grand intérêt. Nous devons tous œuvrer à la réussite de la COP21, sans nous demander si cela va profiter au Gouvernement. Si un premier pas a été fait avec la reconnaissance unanime de la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique, la question de la diplomatie climatique reste extrêmement compliquée. Vous nous proposez de surmonter la dramaturgie habituelle des conférences internationales en organisant des ruptures, mais une telle entreprise n’a rien de facile. Tout dépend de la brutalité de la rupture et de sa proximité avec la réalité du terrain, vécue au quotidien par les citoyens et les acteurs économiques et sociaux. Tout dépend également du lien qui doit nécessairement être retissé entre le local et le global, entre la régulation mondiale et les initiatives des forces vives territoriales.
Vous comparez les politiques climatiques déployées avec plus ou moins de réussite dans d’autres pays, notamment la Chine, les États-Unis ou la Suède, ce qui permet de constater que tout est possible en la matière, le meilleur comme le pire. La question de l’appropriation de l’enjeu climatique est essentielle. Constatant qu’en termes de mobilisation, il reste beaucoup à faire, vous saluez les actions menées dans ce domaine, que ce soit par l’Association des Journalistes de l’environnement et du climat (AJEC21), ou conjointement par le ministère de l’environnement et le ministère de l’éducation nationale. Vous soulignez également le risque, qui peut sembler paradoxal, d’une surexposition médiatique temporaire, suscitant des espoirs qui pourraient se trouver déçus. Si vous aviez un seul conseil à nous donner pour que la mobilisation puisse être amplifiée jusqu’à aboutir à une véritable appropriation de la préoccupation climatique par les citoyens, quel serait-il ?
Partageant votre constat selon lequel la population française reste encore relativement peu associée, nous soutenons la possibilité pour les collectivités locales de solliciter directement le Fonds vert et, plus largement, les financements internationaux, ainsi que la possibilité pour les pays en développement de recourir au Fonds vert pour l’obtention d’un appui dans l’élaboration de leurs politiques publiques visant à adapter leur trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le soulignez, sans avancée sur les financements, il n’y aura pas d’accord à Paris pour confirmer et renforcer la décision prise à Copenhague de mobiliser 100 milliards de dollars de fonds publics et privés à partir de 2020 pour les pays en développement. L’Agence française de développement (AFD) a consacré plus de 2,5 milliards d’euros au climat, et contribue à hauteur d’un milliard de dollars sur quatre ans au financement du Fonds vert. Comme on le voit, le compte n’y est pas, et notre diplomatie doit s’engager activement pour mobiliser les banques de développement, les pays industrialisés et le secteur privé, et pour trouver des financements innovants. Pensez-vous que des améliorations soient apparues depuis le vote de votre rapport en avril dernier ?
Comme l’a dit tout à l’heure Mme la présidente Anne-Marie Ducroux, le CESE aborde la question du climat dans un esprit de consensus – vos deux rapports ont d’ailleurs été adoptés à l’unanimité. Je pense que cet état d’esprit devrait inspirer les parlementaires que nous sommes, mais aussi les instances diplomatiques internationales. La raison du plus fort ne doit pas être toujours la meilleure, et les pays dominants doivent faire preuve d’une plus grande écoute si nous voulons aboutir à un accord utile à tout le monde.
M. Philippe Plisson. Chacun ici est convaincu de l’importance de l’enjeu que représente la COP21 pour la France, pays organisateur, mais aussi et surtout pour l’avenir de la planète.
Comment pensez-vous qu’il soit possible d’accompagner les pays en voie de développement vers la prise en compte du défi climatique, autrement que dans le cadre d’un événement catastrophique majeur, alors que les populations de ces pays aspirent à une croissance économique dont ont largement bénéficié, et parfois abusé, les pays dits développés dont nous sommes ?
La France a fait un grand pas vers la prise en compte du réchauffement climatique dans les politiques publiques, notamment avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. En dépit des restrictions budgétaires, un effort de 10 milliards d’euros sera consenti sur trois ans au profit des secteurs du transport, du logement et de l’énergie. Vous avez mis en avant, dans votre rapport, l’importance du travail spécifique à accomplir vers le lien entre climat et aménagement du territoire. Pouvez-vous nous donner quelques pistes concrètes relatives à l’aménagement agricole et industriel, ainsi qu’à l’urbanisation ?
Enfin, nous sommes maintenant à quelques semaines de la COP21. Quel sera pour vous l’indicateur majeur de la réussite de cette conférence ?
Mme Sophie Rohfritsch. Ma question s’adresse à M. Gaël Virlouvet. L’une des préconisations de votre rapport consistait à mobiliser les entreprises, en particulier les PME, et à les mettre en réseau. Une initiative semblable avait déjà été lancée à la suite de la Conférence sur le climat qui s’était tenue à Doha en 2012, avec la mise en place du réseau Global Compact. Ce réseau s’est structuré et rassemble aujourd’hui 8 000 entreprises, mais ce n’est que l’année dernière que les PME françaises ont été invitées à s’y joindre, comme vous le soulignez. Aujourd’hui, quel est l’état de la mobilisation que vous appelez de vos vœux ? Théoriser les solutions au réchauffement climatique est une chose, mais il serait beaucoup intéressant que les acteurs concernés se saisissent du sujet et agissent, notamment par le biais de ce type de réseaux.
M. Yannick Favennec. L’un des enjeux centraux des négociations qui vont se tenir dans quelques semaines à Paris est d’obtenir des avancées concrètes et significatives, contrairement à celles résultant de la Conférence de Copenhague de 2009, contenues dans un accord final juridiquement non contraignant pour les États signataires. Après ce que l’on a appelé l’échec de Copenhague, la COP21 est particulièrement attendue, en ce qu’elle doit permettre un accord universel fixant notamment les engagements étatiques pris pour lutter contre le réchauffement climatique au-delà de 2020.
La COP21 sera aussi l’occasion de négocier l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre, auxquelles les États doivent s’engager pour la période de l’après 2015. La lutte contre le réchauffement climatique, véritable pierre d’achoppement dans les négociations à venir, nécessite des engagements concrets et actifs. Alors que des pays nouvellement industrialisés, comme l’Inde et la Chine, refusent d’être tenus responsables des émissions ayant permis le développement économique des pays occidentaux, certains États industrialisés comme les États-Unis, le Canada, la Russie et l’Australie, ne semblent pas très enclins à mettre en place des politiques de réduction des émissions. L’avenir des négociations sur ce point ne vous semble-t-il pas particulièrement flou, alors que notre planète est désormais engagée dans une course contre la montre à l’enjeu crucial ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je souhaite la bienvenue parmi nous à Marie Le Vern, dont l’arrivée marque à la fois le rajeunissement et la féminisation de notre Commission. Vous avez la parole, chère collègue.
Mme Marie Le Vern. Je vous remercie, Monsieur le président. Monsieur Bernard Guirkinger, vous soulignez dans votre rapport la nécessité de susciter l’adhésion et la participation des populations aux négociations environnementales de la COP21, et appelez les pouvoirs publics à un effort de pédagogie en direction des citoyens par le biais des associations, fondations, organisations syndicales et patronales. Des efforts ont été faits en direction des enfants, de la primaire au collège, au travers d’actions visant à l’éducation au développement durable ; de même, au sein de notre assemblée, les enjeux de la COP21 ont été pris en compte dans le cadre du Parlement des enfants. Pourtant, à deux mois de la conférence, on constate que les 15-30 ans restent faiblement mobilisés. Ainsi, un sondage a récemment révélé que dans cette tranche d’âge, deux jeunes sur trois ne savent pas ce qu’est la COP21 ; ils sont, par ailleurs, peu optimistes quant à l’issue des négociations et aux solutions institutionnelles et politiques qui pourraient en résulter.
On ne peut que regretter que cette génération passe à côté de l’événement fondateur pour demain qu’est la COP21. Au regard de vos recommandations, comment évaluez-vous la mobilisation de la population et de la société civile française sur cet enjeu, et comment jugez-vous l’effort de pédagogie du Gouvernement que vous appeliez de vos vœux ? Vous préconisez que les États fassent figurer dans leurs contributions nationales un volet sur les modalités d’information et de participation du public à la prise de décision. À votre connaissance, dans quelle mesure cela a-t-il été fait ?
M. Jean-Louis Bricout. Vous avez dit que la contribution des territoires sur l’enjeu climat était essentielle. J’ai trouvé le bilan que vous avez dressé un peu pessimiste. Il me semble que les écoles mènent des actions pédagogiques sur l’environnement et le climat. Les programmes des territoires à énergie positive (TEPOS) et les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV) actuellement mis en place montrent que tout n’est pas négatif.
En revanche, vous avez raison, dans les territoires dits en décrochage, la contribution à l’enjeu climatique est parfois annexe. La précarité sociale est souvent liée à la précarité énergétique. Vous indiquez dans votre avis qu’il faudrait une action forte des pouvoirs publics en matière pédagogique. Pouvez-vous préciser quel pourrait être l’investissement des collectivités locales dans ce domaine ?
M. Guillaume Chevrollier. Messieurs les rapporteurs, votre rapport préconise de responsabiliser davantage les collectivités locales, estimant que la participation de tous est indispensable. Vous envisagez une meilleure articulation entre l’État et les territoires entraînant une clarification des objectifs donnés aux collectivités, vous recommandez une responsabilité croissante des territoires dans les émissions de gaz à effet de serre et vous demandez la fixation d’objectifs de réduction définis dans le cadre du Schéma régional climat air énergie (SRCAE).
À l’heure où le Gouvernement réduit de manière drastique les dotations allouées aux collectivités territoriales, il convient d’accompagner financièrement ces collectivités dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations. Il faut allier des moyens en phase avec l’ambition affichée dans le domaine environnemental.
Vous avez indiqué que la société civile est prête à s’investir. Mais vous n’avez pas suffisamment parlé du secteur agricole qui est particulièrement concerné par le changement climatique. Les agriculteurs sont déjà mobilisés pour préserver leur capacité de production et s’investir dans le cadre de la transition énergétique dans les territoires.
M. Stéphane Demilly. Chateaubriand écrivait : « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. » C’est par cette citation que commence l’exposé des motifs d’une proposition de loi que j’ai déposée récemment dans le cadre de la COP21. Cette proposition a pour objet d’assurer le suivi des engagements pris par la France dans le cadre des accords adoptés lors des différentes conférences, en obligeant l’État à présenter un rapport annuel devant le Parlement.
À quelques semaines de la COP21, la question n’est plus en effet de savoir si des engagements seront pris par les États mais quelle sera la nature de ces engagements et s’ils seront tenus.
Tous, autour de cette table, nous suivons de près les débats qui entourent la COP21 et tous nous partageons la même inquiétude qui est finalement résumée dans le titre de l’avis du CESE « Réussir la COP21 ». L’heure n’est plus au constat, l’heure n’est même plus aux propositions. Les constats ont été faits à de nombreuses reprises et nous sommes abreuvés de littérature sur le sujet. Limiter à deux degrés le réchauffement est en lui-même un aveu de l’acceptation de la situation dramatique dans laquelle nous sommes déjà.
Les mesures à prendre pour freiner le réchauffement sont connues et, si les dirigeants internationaux n’agissent pas d’eux-mêmes, c’est la société qui doit les y contraindre, qu’ils soient responsables associatifs, chefs d’entreprise, élus ou citoyens engagés. C’est là que je rejoins les rapports du CESE, tout comme j’applaudis l’initiative « La France des solutions » que vous lancez avec l’association Reporters d’espoirs. Dans la présentation de cet événement, vous écrivez sur votre site : « Le pessimisme national contraste avec l’incroyable vitalité des initiatives locales » et vous lancez astucieusement le pari : « Et si on démultipliait la visibilité des citoyens, entrepreneurs, agriculteurs, acteurs publics associatifs qui prennent l’initiative ».
La COP21 ne sera pas réussie simplement si une belle photo des chefs d’État satisfaits est prise ni parce qu’un beau document sera signé ; elle le sera si, sur le terrain, les acteurs locaux mettent en marche une machine.
Je souhaite donc que vous puissiez nous parler de cette initiative « la France des solutions » et des implications que nous pouvons y puiser.
M. Charles-Ange Ginesy. Messieurs les rapporteurs, vous dites que la société civile est prête à agir, beaucoup plus que ne l’imagine le monde politique. N’y a-t-il pas un vrai problème de vulgarisation ?
Les responsables sont-ils suffisamment informés ? Sont-ils en mesure de prendre les bonnes mesures ? « Les rapports des experts à l’attention des décideurs politiques et des grands publics sont incompréhensibles. » C’est ce que nous indique une étude publiée par la revue Nature. Le Groupement d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) signale qu’une réflexion est en cours pour mieux partager les connaissances sur le climat. La climatologue française Valérie Masson-Delmotte reconnaît que les publications du GIEC sont d’un accès très difficile pour les non-spécialistes. Il est nécessaire de mieux communiquer et de mieux vulgariser l’information. Quel est votre avis sur ce sujet ?
J’ai eu l’occasion d’auditionner, dans la perspective du programme de recherche lié à la biodiversité et au développement durable, des responsables de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et de l’Agence nationale de la recherche (ANR). J’ai pu constater que, s’ils sont tous mobilisés pour la COP21, ils n’ont pas les moyens d’y satisfaire, en tout cas ils ne sont pas prêts à y participer. Jean-Marie Sermier a posé la question de la recherche et de l’implication de la recherche en vue de la COP21. Que pouvez-vous ajouter à cela ?
Enfin, vous parlez d’un lien nécessaire avec les territoires et vous avez raison. Quelles sont, au-delà du constat que vous faites, les préconisations que vous pouvez nous donner pour la mise en œuvre de modalités pratiques ?
Mme Françoise Dubois. Je veux saluer les collectivités territoriales, les ONG ou encore les mouvements associatifs qui sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Je m’interroge sur la mobilisation citoyenne en faveur de la COP21. J’ai encouragé, dans le département de la Sarthe, des initiatives éducatives dans des établissements scolaires en lien avec des structures associatives. Ces initiatives sont absolument remarquables. Mais lorsque la population s’intéresse à cette conférence internationale, pourtant majeure pour l’avenir de notre planète, je n’ai pas le sentiment d’un déferlement d’enthousiasme et d’espoir. J’aurais aimé connaître votre sentiment sur ce point. Partagez-vous ce diagnostic ? Si oui, quelles en sont les raisons ?
M. Jacques Kossowski. Cet été, l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a appelé à la mobilisation des maires des villes du monde entier sur le climat. Nous devons entendre ce message avec force. Après tout, ces élus sont notamment en Europe. Ils sont les premiers concernés par l’aménagement, l’urbanisme, l’éclairage public, les réseaux de chaleur, la mobilité, la mise en place de ce que l’on appelle la smart city.
Les villages et les villes émergent sur la scène nationale et internationale, comme en témoigne l’organisation du forum des collectivités locales à Durban, et commencent à jouer un rôle important dans la transition énergétique. Je souhaite que vous traciez les perspectives de ce rôle croissant que vont jouer les communes et les métropoles dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment, dans la recherche de cet objectif, voyez-vous l’articulation entre les échelons européen, national, communal et métropolitain ?
Mme Geneviève Gaillard. Avec la COP21, nous vivons un moment historique et nous espérons tous qu’elle aboutira.
Nombreux sont mes collègues qui ont parlé de l’aide au développement. Ce sujet nous intéresse, à travers l’Agence pour le développement et le Fonds vert. Je reviens d’une mission à Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète, où la déforestation de la forêt primaire est monumentale. La population utilise le bois pour faire cuire les légumes alors que l’électrification est possible…
Cette année, la France va diminuer les crédits en faveur de l’aide publique au développement puisqu’ils passent de 2,77 à 2,6 milliards d’euros, ce qui n’est pas un signe enthousiasmant. Que faire pour les pays qui veulent s’inscrire dans une démarche de limitation des perturbations par le climat ? Vous préconisez dans votre rapport une utilisation efficace et équitable du Fonds vert. Comment ? Peut-on les obliger à certaines actions ? Je connais d’autres pays qui sont dans la même situation que Madagascar. Pensez-vous que les pays les plus en difficulté peuvent recevoir davantage, comment et sous quelle forme ?
M. Jean-Pierre Vigier. Les pays du G20 font des efforts concernant l’évolution de l’intensité carbone puisqu’elle aurait chuté de 2,7 % entre 2013 et 2014. Pour autant, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé de 0,5 % en 2014. Pour limiter à deux degrés le réchauffement climatique, la baisse de l’intensité carbone devrait atteindre 6,3 % par an au niveau mondial. La France est un bon élève en réalisant la deuxième plus forte réduction de l’intensité carbone. Cependant, les mauvais élèves du G20 sont des pays d’envergure comme le Brésil ou l’Inde où l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre a atteint des seuils élevés, voire très élevés.
À la veille de la COP21, sans vouloir être pessimiste, pensez-vous que la mobilisation internationale est suffisamment forte pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés ?
M. Michel Lesage. À mon tour, je tiens à féliciter les rapporteurs du CESE pour le travail qui a été réalisé et les propositions qui ont été faites. Toutefois, ils n’ont pas évoqué la question de l’eau. C’est d’ailleurs souvent le cas lors de diverses réunions et colloques sur ce sujet. On parle souvent des émissions de gaz à effet de serre, de la transition énergétique, des mobilités et des transports mais peu de l’eau alors que c’est le premier élément concerné par les dérèglements climatiques. J’en veux pour preuve la baisse de la pluviométrie, l’intensification des catastrophes naturelles ou encore l’élévation du niveau de la mer. L’eau menacée est désormais menaçante. J’ajoute que les pressions sur la ressource sont aussi à l’origine de plus en plus de tensions entre les pays. Bref, c’est un véritable enjeu de développement humain.
Avez-vous mené des réflexions sur ce sujet, et quelles sont-elles ? Comment intégrer un objectif eau ambitieux dans la COP21 ? Comment intégrer l’eau dans les priorités de financement climat pour cette conférence ?
M. Alain Chrétien. La COP21 va se tenir du 30 novembre au 11 décembre prochain. Connaissez-vous le déroulement des négociations et leur fonctionnement en termes de prise de décision ? Certaines décisions seront-elles prises à l’unanimité, à la majorité et dans quel ordre thématique ? On parle beaucoup de grands enjeux, mais plus concrètement connaît-on le programme durant ces dix jours que tout le monde qualifie d’historiques ? Faudra-t-il faire pression et montrer nos exigences ou bien est-ce une boîte noire dans laquelle seuls ceux qui ont un sésame pourront entrer et découvrir les résultats ?
M. Laurent Furst. Comme d’habitude, on fait un procès aux transports individuels. Mais il faut regarder les chiffres. En 1980, la France comptait 21 millions de véhicules, contre 38 millions en 2014. Notre pays était alors en retard par rapport aux autres pays occidentaux en ce qui concerne l’équipement des ménages et des entreprises. Ce retard a été rattrapé depuis. Actuellement, la population augmente de 0,4 à 0,5 % par an alors que le parc de véhicules progresse de 0,2 %, c’est-à-dire que nous sommes complètement sortis de cet accroissement massif du parc de véhicules. Vous prenez toujours en compte l’évolution de la consommation et des gaz mais jamais de la dynamique du parc. Or notre pays connaît un plateau en termes d’équipement du parc de véhicules.
En renouvelant tout le parc de véhicules avec des véhicules plus modernes, on économiserait entre 15 et 20 % d’émissions de gaz à effet de serre. Or l’âge moyen des véhicules était de 6 ans en 1990, contre 8,3 ans en 2013. De plus, le parc moyen de véhicules vieillit et se renouvelle de moins en moins. Il faut changer le paradigme d’analyse et regarder les chiffres avec objectivité.
La commission d’enquête visant à évaluer les conséquences sur l’investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l’État aux communes et aux EPCI a constaté que la baisse des dotations aux collectivités locales s’est déjà traduite par une baisse de l’offre en transports en commun urbains et interurbains de 2,5 % alors que nous n’en sommes qu’au tiers de la baisse des dotations aux collectivités locales. Il y a donc un antagonisme incroyable entre l’objectif recherché et les conséquences de la baisse des dotations aux collectivités locales.
J’ai déposé une proposition de loi sur l’autoconsommation électrique. Vous avez parlé du projet de batterie domestique de Tesla. C’est un projet extraordinaire pour un pays comme le nôtre qui possède une grande surface de toitures. Toutefois, ce que l’on ne maîtrise pas, c’est notre culture électrique faite de grandes productions industrielles et nucléaires avec des polytechniciens. La production déconcentrée et l’autoconsommation, c’est-à-dire ce qui ne passe pas par notre réseau, ne sont pas dans notre culture. Que peut-on faire pour changer cette culture ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Faire disparaître la pensée unique !
Mme Geneviève Gaillard. Très bien !
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La France compte aujourd’hui 31 millions de véhicules de tourisme, dont 9 à 10 millions de véhicules particulièrement polluants qui sont des véhicules diesel anciens. La fiscalité sur le diesel est un vrai sujet compte tenu de ses conséquences au plan environnemental et sanitaire – en la matière, je vous renvoie au rapport fait par la Sénat – et de l’actualité récente avec l’affaire Volkswagen.
Nous avons examiné un amendement de M. Jean-Yves Caullet qui visait à corriger l’écart de fiscalité qui existe entre le gazole et l’essence sur cinq, six ou dix ans. Actuellement, l’écart est de 15 centimes par litre. En multipliant 400 millions par 15, on atteint 6 milliards d’euros, ce qui n’est pas négligeable.
Il faut adresser aux utilisateurs et consommateurs d’énergie fossile un signal prix suffisamment fort si l’on veut qu’ils modifient leur comportement. Certains pensent que cette compensation doit se faire uniquement sur le gazole tandis que d’autres estiment qu’il faut augmenter le prix du gazole et diminuer celui de l’essence. Personnellement, je pense que la deuxième solution serait une erreur parce que l’objectif est de diminuer la part des énergies fossiles dans le mix énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas considérer que le gazole est une énergie fossile mais pas l’essence. Actuellement, on constate que la consommation d’essence et de gazole augmente en raison de la baisse du prix du baril de pétrole. J’estime qu’il faudra augmenter dans le temps la fiscalité sur le gazole sans diminuer celle sur l’essence.
Le relèvement de 2 centimes du prix du gazole rapporte près d’un milliard d’euros. Avec cette somme non négligeable, il faut mettre en place des mesures d’acceptation. Ces mesures concernent bien entendu les automobilistes à titre individuel qu’il faut aider à changer leur véhicule polluant et ancien. Il faut aider également un certain nombre de secteurs d’activité qui bénéficient d’exonérations – je pense au secteur du transport routier. Enfin, il faut donner des moyens financiers à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour développer les transports en commun et les infrastructures alternatives à la route, qu’il s’agisse du rail ou de la voie d’eau. L’objectif n’est pas, au travers de l’augmentation de cette taxe, d’alimenter le budget de l’État, mais de mettre en œuvre une politique pertinente et cohérente qui incite les agents économiques à s’engager sur la voie de la transition bas carbone.
Messieurs les rapporteurs du CESE, faut-il, de votre point de vue, augmenter le prix du gazole et baisser celui de l’essence ou faut-il seulement augmenter le prix du gazole pour corriger cet écart de 15 centimes par litre ?
M. Jacques Kossowski. Ce matin, Ségolène Royal a dit qu’il fallait diminuer le prix de l’essence et augmenter celui du diesel.
M. Jean-Louis Bricout. Ce n’est pas forcément une bonne solution !
M. le président Jean-Paul Chanteguet. J’ai évoqué ce sujet car je sais que le débat existe. Il est important que les rapporteurs du CESE s’expriment sur ce point et sur toutes les questions que vous avez soulevées.
M. Bernard Guirkinger. Monsieur le président, nous n’avons pas travaillé sur la question de la fiscalité sur le gazole et l’essence. Dans la mesure où nous sommes favorables à la fiscalité écologique et au signal prix, il me semble évident qu’il faut être cohérent et maintenir des prix élevés. Je regrette qu’une TIPP flottante n’ait pas été mise en place et que l’on ne profite pas des baisses comme celle que l’on a constatée récemment sur le prix du pétrole pour augmenter un peu la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Il n’y a pas de honte à dire qu’un tel dispositif peut permettre à l’État d’alimenter ses recettes et d’en diminuer d’autres. En tout cas, c’est l’esprit dans lequel travaille le CESE depuis plusieurs d’années.
Les entreprises sont convaincues que le changement climatique est une réalité. Elles veulent se préparer aux marchés de demain qui concerneront plutôt toutes les technologies susceptibles de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Aussi veulent-elles avoir une vision à moyen terme. C’est pourquoi elles réclament une fiscalité sur les énergies fossiles mais aussi une fiscalité stable parce qu’une entreprise qui investit se projette forcément sur plusieurs années.
Il ne faut pas sous-estimer l’action des actionnaires privés. Je suis frappé de voir de plus en plus d’investisseurs privés faire pression sur les entreprises pour savoir si les engagements qu’elles prennent sont sincères. Il ne faut pas sous-estimer les patrons qui se projettent aussi vers cette prise de conscience collective sur les conséquences du changement climatique. Enfin, il y a ceux qui prennent des engagements, même quand la loi ne les y oblige pas, et qui doivent rendre des comptes à un moment donné parce que toute une série d’activistes le demande.
Aujourd’hui, les entreprises ont donc intérêt à ce que de vraies actions soient engagées en matière de lutte contre le changement climatique.
Vous me demandez si l’on peut imaginer le grand soir où l’on aura fixé un prix mondial du carbone. Personnellement, je n’y crois absolument pas. La législation restera forcément organisée par sous-ensembles à l’échelle des États ou de groupements d’États comme l’Union européenne. Il me paraît important que la COP21 ait la volonté de fixer un prix sur le carbone. Plusieurs d’entre vous ont souligné que la COP21 n’était pas un aboutissement, que ce ne serait pas le grand soir et que tout restera à faire ensuite. Il faudra suivre les engagements et continuer à faire pression sur les moins vertueux en ce qui concerne le prix du carbone. S’il faut une législation française sur le prix du carbone, le vrai périmètre c’est l’Europe. Il ne faut pas écarter la nécessité d’une taxation à l’entrée du territoire européen. C’est une évolution tout à fait souhaitable.
Si un engagement collectif est pris pour fixer le prix du carbone, il ne faut pas sous-estimer que dans la mesure où ils se préparent au marché de demain, les acteurs économiques vont demander à leur gouvernement de mettre en place une fiscalité carbone. C’est ce que font les Chinois qui, bien que réticents à accepter des contraintes de la part des autres pays, travaillent sur les questions de pollution, d’énergie solaire sous forme thermique ou électrique. Aux États-Unis, si le scepticisme est encore présent il n’empêche que des sous-ensembles travaillent sur les marchés de demain, comme le montre l’exemple californien.
Si l’on ne peut pas mettre au point un grand système, dès lors qu’une dynamique sera engagée les choses iront dans la bonne direction dans un deuxième temps.
Le choix des mots est très important. Il faut parler de changement climatique plutôt que de réchauffement climatique, certains pouvant encore croire que c’est une bonne chose.
En ce qui concerne la gouvernance, de par mon parcours personnel j’avais une vision plutôt hiérarchique et simpliste des choses. Je considérais qu’il y avait des chefs qui donnaient des ordres, des politiques, etc. (Sourires) Mais cela ne marche plus de cette façon-là. Aujourd’hui, vous êtes obligé de dialoguer avec les parties prenantes, avec la société civile et c’est cela qui est source de progrès. Je suis absolument persuadé que c’est la société civile beaucoup plus que les partis politiques qui est en train d’inventer le monde de demain.
Mesdames, Messieurs les députés, utilisez la société civile, gérez leurs contradictions. Le CESE parvient à faire voter des choses extraordinaires. Mais tous ceux qui les votent au CESE ne tiennent pas forcément le même discours à titre individuel, quand ils sont à l’extérieur. Il faut donc mettre les différentes parties de la société civile face à ses propres contradictions. Bien sûr, il y a un paradoxe entre la mobilisation de la société civile française et la mobilisation des citoyens. Mais je suis beaucoup moins pessimiste que vous, Madame Dubois. En effet, on ne peut pas demander aux citoyens de s’intéresser tout à coup à une négociation internationale particulièrement complexe et alors qu’ils ont perdu toute confiance dans les institutions. Cela dit, les citoyens ne se désintéressent pas autant qu’on peut l’imaginer des questions environnementales. Il y a une sensibilité environnementale qui se développe.
Madame Marie Le Vern, je vous trouve très pessimiste à l’égard des jeunes. Ils sont plutôt modernes, ils ont envie de changer les choses, ils prennent des initiatives. L’action du Gouvernement en matière de pédagogie a été très sincère. Je pense, en particulier, à ce qui a été fait par l’éducation nationale.
Il n’y a pas suffisamment de débats politiques sur le terrain en ce qui concerne le changement climatique. Or je suis persuadé que pour trouver un consensus autour d’un nouveau projet politique, il faut associer la société civile et organiser le débat sur le terrain.
Vous nous avez interrogés sur la formation supérieure. Je suis ingénieur de formation. J’ai réalisé, à travers le Grenelle de l’environnement, que notre pays formait des ingénieurs sans jamais leur expliquer quelle était la contribution de la nature. Jusqu’à présent, on ne leur parlait pas de la biodiversité. Les choses commencent à changer, mais notre pays reste dominé par les sciences rationnelles. On pense que les solutions viendront toujours des mathématiques, de la physique et de la chimie. En la matière, il faut faire un effort collectif. Dans notre avis figure une phrase de Descartes qui considérait que la nature devait être au service de l’homme et qu’il fallait absolument la dominer. Il est assez intéressant de réfléchir à notre culture dans ce domaine. C’est très spécifique à la France.
Monsieur Alain Chrétien, vous nous faites beaucoup d’honneur en nous demandant comment va fonctionner dans le détail la COP21. Je rappelle que nous ne sommes pas partie prenante. La COP21 rassemblera 190 parties prenantes, des États ou des groupes d’État. Beaucoup de choses se passent avant cette conférence.
Depuis que je suis attentivement ce dossier, je vois de nombreux signaux positifs, par exemple l’accord bilatéral sur le climat signé entre la Chine et les États-Unis. Certes, ces signaux ne sont pas à la hauteur de l’objectif de limiter à deux degrés le réchauffement climatique, mais on le savait, d’où l’importance de la dynamique qui sera impulsée derrière. Je pense que la France est très mobilisée et qu’elle réalise un travail exceptionnel au niveau international.
Le texte de vingt pages qui vient d’être mis sur la table est très intéressant. Pour une fois, on arrive à le lire en entier. (Sourires)
Monsieur Michel Lesage, j’ai passé l’essentiel de ma carrière professionnelle dans le domaine de l’eau. Aussi, je vous remercie pour votre question. Bien évidemment, l’eau est la première concernée par le réchauffement climatique et elle contribue à créer des catastrophes, comme on l’a encore vu récemment.
Nicolas Hulot insiste beaucoup sur le fait que le changement climatique est l’injustice suprême, c’est-à-dire que les premiers à en subir les conséquences sont ceux qui n’y sont pour rien, à savoir les pauvres qui habitent dans des pays en voie de développement. Dans les pays développés, les premiers touchés sont aussi les plus modestes d’entre nous. D’où l’importance d’être extrêmement vigilants en matière de conséquences sur les plus pauvres de la mise en place d’une fiscalité écologique.
Les pays en développement aspirent à la croissance, à consommer davantage d’énergie. D’où leur réticence à signer des engagements les concernant. Je suis persuadé qu’ils ont envie, comme les autres pays, d’être sur les marchés de demain. La gestion du Fonds vert doit être crédible. Il faut créer un climat de confiance qui incarne cette responsabilité différenciée qu’on accepte. Mais lorsque l’on parle de responsabilité différenciée, je ne suis pas sûr que l’on mesure bien la portée des mots. Cela veut dire que les pays développés qui sont responsables de 70 ou 80 % du stock des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère acceptent une responsabilité particulière vis-à-vis de ceux qui sont affectés directement aujourd’hui. On parle de 100 milliards de dollars par an en direction du Fonds vert sans expliquer que cela va nous demander, à nous pays riches, un effort supplémentaire alors que nous n’arrivons même pas à atteindre notre objectif collectif de 0,7 % en direction de l’aide au développement. Aujourd’hui, la France stagne tranquillement à 0,4 %.
Je vous remercie pour toutes vos questions. J’ai eu plaisir à vous écouter.
M. Gaël Virlouvet. À mon tour, je me réjouis que nos travaux suscitent toutes ces questions.
Vous avez été nombreux à poser des questions sur les territoires, à la fois en ce qui concerne la partie maîtrise d’œuvre et les moyens.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, le Grenelle de l’environnement a massifié les choses. Nous avons demandé à chaque territoire de produire un plan climat-énergie territorial. En la matière, certains départements, comme les Alpes-Maritimes et l’Ille-et-Vilaine, se sont fortement investis. Puis la loi sur la transition énergétique a apporté des clarifications. Dans ce texte, vous avez clairement indiqué que la planification est nationale, qu’elle est régionale avec les SRCAE et locale avec les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) confiés aux intercommunalités. Le schéma de lutte contre le réchauffement climatique est donc désormais lisible. L’articulation étant définie, on sait qui a la maîtrise d’œuvre.
La section environnement du CESE estime que la loi n’a pas défini concrètement ce que l’on fait quand on a un PCAET. Doit-on seulement regarder les émissions de gaz à effet de serre produites par la collectivité ? Doit-on mobiliser l’ensemble du territoire ? Si l’on veut des réponses territorialisées, il faut bien évidemment mobiliser l’ensemble du territoire. Pour ce faire, il faut des moyens, des animateurs qui aillent chercher les acteurs du territoire, les amènent à s’impliquer, à proposer des actions de lutte contre le changement climatique. L’outil qui permet cela, c’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). C’est ce que l’on a su faire en matière de réduction des déchets. Il s’agit d’accélérer le mouvement et d’apporter une aide aux territoires via l’ADEME en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique.
M. Jacques Krabal a évoqué les comparaisons internationales qui figurent dans notre rapport. Nous avons procédé à des comparaisons pour montrer que chaque pays a sa propre manière d’avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. On n’avance pas de la même manière quand on est en Chine, aux États-Unis, en Suède ou en Italie, mais tous les territoires le font dans un seul et même objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut que la France trouve sa manière d’avancer, tout en sachant que dans notre pays la diversité des territoires est une réalité.
Madame Françoise Dubois, vous avez constaté que l’appropriation citoyenne n’était pas suffisante localement. Ce n’est pas le constat que je fais. Au contraire, je n’ai jamais vu une telle mobilisation. Lors du Grenelle de l’environnement, la mobilisation était très forte, essentiellement au plan national. Et dans les territoires, on se posait des questions. Hier soir, j’étais à Saint-Malo où j’ai participé à une soirée sur l’eau et le changement climatique. Il y avait 200 personnes dans la salle, toutes intéressées par le sujet. Les conseillers du CESE chargés de la question du changement climatique nous disent que les choses bougent dans les territoires, que les écoles s’y intéressent.
Mme Françoise Dubois. En milieu rural, c’est plus difficile !
M. Gaël Virlouvet. Mais si les trois quarts des lycéens ne connaissent pas la COP21, peu importe ! Ce qui compte, c’est qu’il y ait une dynamique en faveur du climat. Quand on demande aux Français si le changement climatique aura une répercussion sur leur vie, les trois quarts répondent par l’affirmative.
Il faut savoir qu’il y a vingt-cinq ans, même les défenseurs de l’environnement n’étaient pas convaincus du changement climatique. Les progrès qui ont été accomplis depuis sont extraordinaires. Évidemment, il nous reste d’importantes marges de manœuvre. D’abord, nous constatons que, dans les territoires, aucun éducateur à l’environnement ne parle du climat et très peu de l’énergie.
Certes, l’appropriation citoyenne n’est pas suffisante, mais elle est bien plus forte qu’elle ne l’a jamais été en matière environnementale.
Mme Françoise Dubois. Tant mieux !
M. Gaël Virlouvet. Il y a deux jours, j’ai effectué le contrôle technique de mon véhicule. La personne qui a fait ce contrôle technique savait que quelque chose était en train de se passer sur le climat.
Tous les membres du CESE ont voté l’avis sur la COP21 – il n’y a pas eu de vote contre, seulement quelques abstentions – pour envoyer ce message que la société civile est derrière le Gouvernement et le Parlement dans la lutte contre le changement climatique. Nous partageons l’objectif du facteur 4 qui a été fixé à l’horizon 2050. Nous savons qu’il ne sera pas facile à atteindre, mais nous avons envie d’essayer.
Mme Marie Le Vern a posé la question de l’évaluation de la mobilisation de la population et de l’implication du Gouvernement. Pour ce faire, il faut compter le nombre d’événements qui sont mis en place. Si cet indicateur n’est pas parfait, il montre la dynamique qui existe dans les territoires. En revanche, il est difficile de mesurer l’évaluation de l’implication du Gouvernement. J’observe un effort de communication très important depuis le mois de septembre, mais il est perturbé par le contexte international.
Monsieur Guillaume Chevrollier, le secteur agricole est très mobilisé en termes d’adaptation et on comprend bien pourquoi, mais il peut mieux faire en termes d’atténuation. Depuis un an, on sent un frémissement. Les chambres d’agriculture ont publié des documents sur les actions réalisées par les agriculteurs à l’occasion du salon de l’agriculture. Il y a un début d’appropriation du sujet. Il faut maintenant amplifier la démarche.
M. Laurent Furst a évoqué les transports. C’est une question difficile. Il faut savoir que les Suédois, qui sont les bons élèves en matière de lutte contre le changement climatique, connaissent eux aussi une augmentation du nombre de véhicules. Il faut trouver des solutions. Cela passe par un Grenelle transports. Les acteurs de la société civile estiment que les objectifs qui ont été fixés lors du Grenelle de l’environnement sont bons mais que l’on a mis trop de temps à mettre en place les moyens. L’écotaxe en est le meilleur exemple puisque sept ans après on l’a abandonnée. Il faut retrouver une impulsion en matière de transports et de mobilité. Pour cela, il faut réunir les acteurs, montrer que l’on a envie d’avancer sur cette question et passer à l’action avec des moyens. L’écotaxe est un système qui tient la route. Il doit être remis sur pied.
Monsieur Jean-Yves Caullet, l’ancien président de l’autorité environnementale considérait que chaque projet d’infrastructure d’aménagement du territoire devait montrer en quoi il contribuait à atteindre le facteur 4 en 2050, si le facteur 4 est un objectif important pour la nation, ce que je crois.
M. Jean-Paul Chanteguet et M. Laurent Furst ont évoqué la question de la fiscalité du gazole. Nous en avons discuté au sein de la section environnement du CESE. La réponse de M. Bernard Guirkinger convient parfaitement. Si l’on demande, d’un côté, le renforcement de la fiscalité carbone, on ne peut pas, de l’autre, s’amuser à baisser les taxes sur l’essence, d’autant que l’avancée la plus importante à mes yeux depuis 2012, a été d’inclure une assiette carbone dans la TICPE. Si on commence à diminuer l’assiette carbone qui s’applique aussi bien au gazole qu’à l’essence, cela signifie que l’on réduit ce qui ressemble à une taxe carbone qui a été mise en place en 2014.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Son impact est très limité !
M. Gaël Virlouvet. Exactement !
Le CESE appelle à un prix du carbone qui soit significatif. Le prix du gazole doit rattraper celui de l’essence et pas l’inverse.
Monsieur Bertrand Pancher, le CESE estime qu’il faut revoir la fiscalité environnementale afin qu’elle soit prise en compte dans l’ensemble du système fiscal avec un rééquilibrage en faveur de la fiscalité environnementale. Je vous renvoie à notre avis sur le financement de la transition écologique qui est très clair. Le CESE, s’il n’est pas unanime, partage en tout cas un consensus relatif sur ce besoin en fiscalité.
Notre avis n’aborde pas la question de l’eau. L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse est mobilisée sur la lutte contre le changement climatique. Les autres agences ont du mal à le faire, notamment l’Agence Loire-Bretagne qui ne considère pas l’eau comme un sujet prioritaire cette année. Or le réchauffement global de la planète, s’il aboutit à des dérèglements locaux, entraînera une mise en tension de toutes les relations autour de l’eau. J’en veux pour preuve ce qui s’est passé à Sivens l’année dernière. Il existe déjà des tensions très vives sur l’eau. Si l’on y ajoute un facteur de pression qu’est le changement climatique, on ne fera qu’accroître ces tensions entre acteurs, ce qui renvoie aux gouvernances à mettre en place. Je le répète, la gouvernance sur le changement climatique doit exister au niveau national à travers un conseil national du climat ou quelque chose d’équivalent.
Les gens qui travaillent dans les territoires sur le climat ne sont pas en lien avec l’administration centrale, ce qui veut dire que la tête n’est pas reliée aux pieds. Il faut corriger ce phénomène. C’est la tête qui a impulsé pendant dix ans l’activité de la France en matière de lutte contre le changement climatique. Il se trouve qu’elle est composée essentiellement du corps des mines, ce qui veut dire que l’on a un corps d’ingénieurs qui s’intéresse à la question climatique. Il me semble donc que la question de la formation supérieure en matière de lutte contre le changement climatique n’est pas si aiguë, même s’il faut renforcer les formations sur l’énergie, l’agriculture, l’économie circulaire et les déchets.
M. Jean-Yves Caullet. Peut-être faut-il modifier le nom de l’école ! (Sourires.)
M. Gaël Virlouvet. Mais je ne suis pas sûr que l’on ait besoin d’une formation spécifique climat aujourd’hui.
Stéphane Demilly a demandé quelle serait la récupération de la COP21 par les territoires. Il appartient à chaque territoire de s’organiser pour relancer la dynamique dans les plans climat air énergie territoriaux, d’organiser des réunions au niveau local lors de la COP21 ce qui permettra de rendre visible le plan climat au niveau territorial. Ensuite, il faudra profiter de l’effet de cette conférence pour continuer à mobiliser les acteurs. Là encore, la réponse est territoriale.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Messieurs, je vous remercie pour la qualité de votre rapport et de nos échanges. Notre réunion d’aujourd’hui a montré qu’il était utile que nous continuions à dialoguer avec les rapporteurs du CESE.
25. Audition de M. Philippe Guettier, directeur général du Partenariat français pour l’eau, et de M. Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail « eau et climat », sur le thème « eau et climat » (17 novembre 2015)
M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’horaire de cette réunion est un peu inhabituel, mais j’ai pensé qu’il valait mieux organiser cette audition avant la COP21 – vingt et unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques –, qui doit s’ouvrir dans deux semaines à Paris.
Monsieur le directeur général, vous évoquerez la problématique de l’eau, la manière dont elle doit être intégrée dans les stratégies d’atténuation du dérèglement climatique et d’adaptation à ce dérèglement, ainsi que la manière dont les financements internationaux, en particulier le Fonds vert pour le climat et le Fonds d’adaptation, pourraient être ciblés sur la gestion durable de l’eau.
Auparavant, je donne la parole à notre collègue Jean Launay, qui est à l’origine de cette audition.
M. Jean Launay. J’ai pensé qu’il serait judicieux, à la veille de la COP21, de faire le lien entre la problématique de l’eau et celle du climat, en auditionnant le directeur général du Partenariat français pour l’eau (PFE). Je vous remercie, Monsieur le président, d’avoir accédé à ma demande.
Je suis membre du conseil d’administration du PFE. Trois parlementaires français, dont Michel Lesage et moi-même, ont participé au Forum mondial de l’eau en Corée du Sud en avril dernier. Dans le cadre du processus parlementaire, les Coréens avaient préparé un projet de résolution qui n’évoquait pas la COP21. Nous avons réussi à le faire modifier, afin qu’il mentionne le lien entre les politiques de l’eau et le climat. Au moment où la France se prépare à accueillir la COP21, malgré les événements qui la frappent, il nous semble utile de nous concentrer sur la problématique de l’eau, notamment sur l’importance des politiques de l’eau, sur le problème de la rareté de l’eau et son incidence sur les mouvements de population, ainsi que sur les enjeux de paix – je préfère dire « de paix » plutôt que « de guerre » – liés à l’eau.
M. Philippe Guettier, directeur général du Partenariat français pour l’eau. Je remercie Jean Launay d’avoir pris l’initiative d’organiser cette audition et vous prie d’excuser M. Brice Lalonde, porte-parole du PFE, qui n’a malheureusement pas pu se joindre à nous cet après-midi.
Le PFE est une plate-forme qui réunit environ 120 acteurs français du secteur de l’eau, publics et privés, actifs à l’échelle internationale. Ceux-ci sont répartis en six collèges : État et établissements publics ; acteurs économiques ; parlementaires et collectivités territoriales ; organisations non gouvernementales (ONG), associations et fondations ; institutions de recherche et de formation ; experts qualifiés dans le secteur de l’eau. Nous intervenons sur les questions relatives au « petit cycle » de l’eau, c’est-à-dire l’eau et l’assainissement pour les villes, mais aussi, de manière croissante depuis trois ans, au « grand cycle » de l’eau, c’est-à-dire l’eau pour l’agriculture et l’eau pour l’énergie. Nous avons un double mandat : d’une part, plaider dans les enceintes internationales, qu’elles soient officielles – nous travaillons avec les Nations unies sur les questions liées au climat – ou plus informelles – nous participons au Forum mondial de l’eau, dont la dernière édition s’est tenue en Corée du Sud ; d’autre part, valoriser collectivement les savoir-faire français en montrant qu’ils sont efficaces en France et à l’étranger.
En septembre dernier, un objectif dédié à l’eau a été adopté dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015. C’est un événement très important pour le secteur de l’eau car, jusqu’à ce jour, la communauté internationale avait très peu statué dans ce domaine. Aujourd’hui, plusieurs initiatives sont prises pour doter le secteur de l’eau d’une gouvernance internationale. La France devra veiller à ce qu’elles soient cohérentes, voire en prendre elle-même un certain nombre. C’est essentiel si l’on veut que l’objectif dédié à l’eau que je viens d’évoquer soit mis en œuvre de manière efficace et suivi dans les différents pays concernés. La France a un grand rôle à jouer en la matière.
J’en viens à la question du climat. L’objectif premier de la COP21 est d’aboutir à un accord pour limiter le réchauffement de la planète à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. C’est l’enjeu de l’atténuation. Mais il y a un autre enjeu au moins aussi important dans le cadre de la COP21 : celui de l’adaptation. En effet, les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète seront très longtemps présents dans l’atmosphère. Et le changement climatique est à l’œuvre depuis au moins une décennie. Certaines régions et certains pays sont déjà touchés, notamment le Maghreb et le Machrek, mais aussi l’Espagne. Ils doivent donc s’adapter, ce qu’ils ont commencé à faire. Or la question de l’eau est centrale dans la problématique de l’adaptation. Lorsque l’on discute avec les bailleurs de fonds internationaux et les responsables des pays concernés, notamment des pays du Sud, on se rend compte que 80 % des projets d’adaptation concernent l’eau.
Il existe quatre risques liés au changement climatique en ce qui concerne l’eau : les inondations et l’élévation du niveau de la mer, les grandes sécheresses, la dégradation de la qualité de l’eau, la dégradation des écosystèmes. Les grandes sécheresses sont devenues presque récurrentes dans plusieurs endroits du monde, par exemple au Maroc, en Californie ou dans le sud du Brésil, notamment dans l’État de Sao Paulo. La dégradation de la qualité de l’eau tient non seulement à la baisse de la quantité d’eau dans les rivières à certaines périodes de l’année, qui conduit à une plus grande concentration des polluants, mais aussi à une élévation de la température de l’eau, qui peut poser des difficultés notamment pour le refroidissement des centrales thermiques ou nucléaires – ce problème concerne aussi la France. Quant à la dégradation des écosystèmes, véritables « éponges » qui jouent un rôle majeur en matière de dépollution, elle est induite tant par la réduction du débit des rivières que par le réchauffement de l’atmosphère.
L’adaptation doit donc être un volet majeur de la COP21 et des COP suivantes – car, bien évidemment, la COP21 ne permettra pas de régler tous les problèmes liés au changement climatique. La question de l’eau, en particulier, doit trouver sa place dans les négociations internationales sur le climat. La COP22 qui se tiendra à Marrakech en 2016 constituera une étape essentielle à cet égard.
La COP21 repose sur quatre piliers.
Le premier est l’accord lui-même. Celui-ci évoque la problématique de l’adaptation – ce qui constitue une avancée par rapport aux COP précédentes –, mais pas celle de l’eau.
Deuxième pilier : les financements. De nombreuses questions se posent à cet égard : quid des financements pour l’atténuation et pour l’adaptation ? Comment vont-ils se constituer ? Quel en sera le montant ? On évoque le chiffre de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Le secteur de l’eau étant central pour l’adaptation, on peut penser a priori qu’il bénéficiera d’une partie de ces financements, mais encore faut-il s’atteler à cette tâche.
Troisième pilier : les engagements pris par les différents pays en matière d’atténuation, mais aussi – c’est moins connu – d’adaptation. Le PFE a récemment analysé les engagements pris par 150 des 195 pays parties à la convention. Environ 80 % d’entre eux évoquent l’adaptation et, au sein de ces derniers, une proportion analogue mentionne la question de l’eau. Ainsi, l’eau apparaît comme une priorité pour de nombreux pays. Il faut donc apporter des réponses en la matière.
Dernier pilier : l’« agenda des solutions ». Il s’agit d’un élément nouveau dans les COP. À cet égard, nous avons beaucoup de choses à faire valoir puisque, dans le secteur de l’eau, les solutions existent et sont mises en œuvre à différents endroits dans le monde, mais à une échelle modeste. L’enjeu est donc de faciliter les décisions afin de développer beaucoup plus largement les projets d’adaptation dans le secteur de l’eau, en particulier dans les pays en développement, ce qui suppose des financements adaptés.
Dans certains secteurs, notamment l’agriculture et l’énergie, les acteurs ont été capables de faire passer des messages et de plaider efficacement au niveau international. À l’inverse, jusqu’à récemment, la communauté internationale de l’eau n’avait pas été suffisamment unifiée et solidaire pour imposer la question de l’eau dans les négociations internationales, notamment lors des COP. Si elle a obtenu l’adoption, en septembre dernier, d’un objectif dédié à l’eau dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015, c’est que, pour la première fois, ses différentes composantes ont su se rapprocher et travailler ensemble. Elle doit désormais continuer les démarches auprès des Nations unies, des gouvernements et des sociétés civiles pour que, progressivement, la question de l’eau soit prise en compte de manière ambitieuse dans les négociations sur le climat. Nous sommes conscients que ce travail prendra plusieurs années.
Très récemment, une initiative a été prise en ce sens par une quinzaine de grandes organisations du secteur de l’eau, sur la proposition du PFE et de ses membres : le 2 décembre prochain, nous organiserons une journée thématique sur l’eau dans le cadre de la COP21. Il s’agit d’un premier pas, dont l’objectif est de rendre visible la question de l’eau et du climat. Le slogan de cette journée sera : « Climate is water » – « Le climat, c’est l’eau ». Nous ferons passer plusieurs messages communs : l’eau et le climat sont intimement liés ; il faut agir pour que la question de l’eau trouve sa place dans les négociations sur le climat ; des financements sont nécessaires ; il convient de valoriser les solutions existantes ; le bon niveau territorial pour agir est celui du bassin versant. Ce dernier message tient beaucoup à cœur aux acteurs français : en France, la gestion de l’eau est traditionnellement décentralisée au niveau des bassins.
Le matin du 2 décembre, donc, deux grands événements se tiendront en parallèle au Bourget. D’une part, dans la zone bleue réservée aux négociations, qui sera accessible uniquement aux personnes accréditées par les Nations unies, une série d’engagements en faveur de l’eau et du climat seront signés par plusieurs catégories d’acteurs : les organisations de bassins, les villes, les entreprises et les jeunes. Les bassins concernés sont non seulement ceux qui relèvent d’un seul pays, mais aussi les grands bassins transfrontaliers. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux dans le monde et constituent un enjeu considérable. Car l’eau peut être un facteur de paix : si nous promouvons la gestion par bassin au niveau international, c’est bien pour faire en sorte que les pays qui partagent un même bassin travaillent ensemble pour régler les questions liées à l’eau.
D’autre part, dans l’espace dédié à la société civile, qui sera plus facilement accessible même si le système de sécurité sera largement renforcé, se déroulera une conférence visant à valoriser, y compris de façon ludique, les solutions des acteurs de l’eau du monde entier, publics et privés, à même de répondre aux défis de l’avenir. Elle sera suivie d’une conférence de presse internationale, à laquelle participeront plusieurs hauts responsables politiques, mais aussi des chefs d’entreprise, des représentants d’ONG, des élus locaux et des scientifiques.
L’après-midi du 2 décembre, des acteurs de l’eau de tous les pays organiseront une myriade d’événements au Grand Palais pour diffuser les messages collectifs que j’ai mentionnés et valoriser, là encore, les solutions dans le secteur de l’eau. Il est en effet nécessaire de sensibiliser le grand public et de faire de la pédagogie en expliquant simplement les relations entre l’eau et le climat, qui demeurent souvent mal comprises, même dans la sphère des décideurs. Les acteurs français de l’eau interviendront sur les trois sites, via le PFE.
La journée du 2 décembre devrait être précédée, le 30 novembre, – j’emploie le conditionnel – d’un panel de chefs d’État et de gouvernement consacré spécifiquement à la question de l’eau et du climat, à laquelle il s’agit de donner une plus grande visibilité politique.
M. Stéphane Demilly. Dans le rapport « Eau et climat : agir pour l’avenir » qu’il a publié en avril dernier, le PFE dresse un constat saisissant concernant la situation de l’eau dans le monde. Vous soulignez notamment que, d’ici à 2050, si rien n’est fait, on comptera plus de 200 millions de déplacés environnementaux dans le monde et que, d’ici à 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions victimes de pénuries d’eau absolues. Vous rappelez aussi que les écosystèmes d’eau douce ont perdu 76 % de leurs espèces entre 1970 et 2010. Ces constats terribles ne sont pas nouveaux, mais le grand public commence à peine à les découvrir, notamment grâce aux débats dans les médias à l’approche de la COP21.
Si l’on commence timidement à prendre conscience des conséquences du changement climatique s’agissant de l’eau, les actions tardent à venir. Ainsi que vous l’avez indiqué dans votre rapport, l’année 2015 est stratégique à cet égard : du Forum mondial de l’eau en Corée du Sud en avril dernier à la signature d’un accord global en matière de lutte contre le dérèglement climatique pour l’après-2020 lors de la COP21 de Paris en décembre, les décisions qui seront prises seront déterminantes.
Dans votre rapport, vous avez présenté vingt-cinq solutions « climato-compatibles » à mettre en œuvre et, en juin dernier, dans un plaidoyer pour l’eau, vous avez annoncé l’organisation de plus de cent actions lors de la COP21. Dans vos différentes publications, deux points m’ont semblé décisifs : le fait d’aboutir à un accord juridiquement contraignant à l’issue de la COP21 et la question complexe mais stratégique du financement international, notamment via le Fonds vert pour le climat et le Fonds d’adaptation, afin de soutenir les régions les plus pauvres et les plus menacées de notre planète. Pouvez-vous nous donner des précisions concernant ces deux axes, qui sont très étroitement liés ?
L’Agence française de développement (AFD) et le PFE s’efforcent de valoriser les projets climato-compatibles auprès des différents décideurs et financeurs, notamment du Fonds pour le climat, des banques de développement et des fonds privés. Pouvez-vous nous faire un point sur ce travail et sur ses résultats ?
M. Michel Lesage. Votre intervention rappelle les enjeux de la COP21 liés à l’eau. Vous avez raison : par rapport aux thèmes à la mode, tels que les émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique ou les défis agricoles, la question de l’eau fait l’objet de bien moins de débats. Or l’eau est le principal vecteur de manifestation des effets du dérèglement climatique. À côté des sécheresses et des inondations, ces effets se font également sentir en matière d’alimentation, de santé publique et d’accès à l’eau potable. L’eau est donc, Jean Launay l’a souligné, à la fois un enjeu de développement et de paix.
En matière de gouvernance, vous estimez que le bon niveau de gestion de l’eau est le bassin versant. En France, même si c’est difficile, nous parvenons à articuler les échelons fonctionnels des politiques publiques – les bassins – et les échelons institutionnels de la République : l’État, les régions, les départements et les autres collectivités. Les récentes lois de décentralisation confient d’ailleurs, à l’horizon 2018-2020, les compétences relatives à l’eau aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les régions sont également impliquées ; la Bretagne va ainsi coordonner l’action dans ce domaine.
Quel est votre point de vue sur ces enjeux de gouvernance, en particulier à l’échelle internationale ? Comment articuler l’action par bassins hydrographiques et la structuration institutionnelle et territoriale des États ?
M. Jean-Marie Sermier. Dans un monde qui privilégie l’image et la communication sur l’action, il faut veiller à ce que ces constats, récurrents depuis une décennie, donnent lieu à une véritable prise de conscience et à une action au quotidien porteuse de changement. Vous n’avez pas évoqué le travail que vous menez avec les grandes entreprises. Dans le secteur de l’eau, la France dispose de groupes qui exportent et d’un savoir-faire technologique important ; quelles sont vos relations avec ces grandes entreprises françaises ? Le PFE s’y associe-t-il à l’étranger, pour plus d’efficacité ?
M. Jean-Louis Bricout. Vous avez beaucoup parlé des liens entre climat et eau, et des conséquences du dérèglement climatique : inondations, sécheresses, dégradation de la qualité de l’eau et des écosystèmes. La COP21 doit être l’occasion de rechercher des résultats opérationnels. Les méthodes d’adaptation doivent notamment être graduées et régulièrement revues ; pouvez-vous revenir sur les solutions proposées ?
M. Gérard Menuel. Le lien entre le climat, l’eau et la végétation représente une évidence. Les surfaces, cultivées ou non, évoluent en fonction de la présence de l’eau, et tous ceux qui voyagent à travers le monde ne peuvent que constater l’importance de cette ressource dans le développement. Ce constat est particulièrement criant en Afrique subsaharienne ; beaucoup d’initiatives locales, souvent portées par des ONG ou des associations, ont permis d’aménager des puits et d’installer des pompes. Pourtant, ces actions à petite échelle montrent rapidement leurs limites, notamment à cause de la pollution. Dans le domaine de l’électricité – autre enjeu essentiel –, la mobilisation à grande échelle menée par Jean-Louis Borloo semble porter davantage de fruits.
Comment comprendre que l’accès à l’eau ne fasse pas l’objet d’un élan comparable, alors qu’il s’agit de la base de la chaîne alimentaire et d’un élément crucial du changement climatique ?
Vous avez été ambitieux dans votre présentation ; êtes-vous également optimiste ?
M. Jean-Pierre Vigier. Je voudrais aborder le sujet sensible du stockage de l’eau – un facteur de compétitivité, mais également de biodiversité et d’aménagement du territoire. La ressource hydrique est un atout essentiel pour la France qui jouit d’un climat tempéré exceptionnel ; mais alors que notre géographie nous permet de stocker l’eau, nous ne le faisons pas, freinés par une série de normes. Les ministères concernés devraient s’associer pour développer le stockage de l’eau à l’échelle nationale : une politique volontariste dans ce domaine deviendrait un levier majeur de compétitivité pour notre agriculture, qui souffre actuellement. Qu’en pensez-vous ?
Mme Valérie Lacroute. L’impact des contributions nationales – qui ont été définies par chaque État pour le 1er octobre dernier – est encore incertain ; toutefois, ces efforts ne permettent pas de limiter la hausse de la température mondiale en deçà des 2 °C ; on s’approcherait plutôt des 2,7 ou 3 °C. La clause de rendez-vous quinquennal, dès 2025, devient donc absolument nécessaire. Énergiquement soutenue par l’Union européenne, cette clause a-t-elle une chance de voir le jour ?
La fixation d’un prix carbone représente l’un des outils privilégiés pour orienter les entreprises émettrices à investir dans les technologies « bas carbone ». Le système européen d’échange de quotas d’émission, créé en 2005, a depuis fait école. Il constitue aujourd’hui le premier marché mondial du carbone et couvre une large portion des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ce mécanisme pose un problème de compétitivité aux entreprises du même secteur, mais de pays ou de continents différents, et risque de conduire à des délocalisations. La conférence de Paris parviendra-t-elle à le généraliser à l’échelle mondiale ? À défaut, je suis favorable à un mécanisme de compensation aux frontières, compatible avec les règles de l’OMC, qui empêcherait que des biens importés produits sans utiliser de technologies propres ne viennent concurrencer ceux qui sont fabriqués dans des États comme la France, où les industriels sont astreints à une discipline stricte en cette matière. Cela vous semble-t-il réaliste ?
M. Guillaume Chevrollier. Votre organisation a raison de soulever l’importance de l’eau sur notre planète. L’accès à cette ressource représente un besoin vital pour tous les êtres humains. Vous avez rappelé les difficultés auxquelles fait face une partie des populations : en Afrique subsaharienne, plus de 300 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Il faut donc que la COP21 soit l’occasion de susciter une véritable mobilisation, mais sans négliger la question des moyens. Le récent discours à l’Assemblée nationale du président du parlement panafricain – qui travaille en lien avec Jean-Louis Borloo – a éclairé la façon concrète dont est conduite l’électrification de l’Afrique. Comment lancer une opération d’envergure en faveur de l’accès à l’eau, à l’échelle du continent africain ? Comment mobiliser les financements sans pour autant créer d’usine à gaz ? En effet, les politiques de bassin recèlent beaucoup de complexités administratives, qu’il importe d’éviter.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous l’avez dit, 80 % des projets relatifs à l’adaptation concernent directement le secteur de l’eau. Décidé en décembre 2014 à Lima, l’agenda des solutions qui regroupe les initiatives de collectivités territoriales, de filières industrielles et d’entreprises, constituera le quatrième pilier de l’accord de Paris. Donnera-t-il au secteur de l’eau la visibilité qui lui manque ?
M. Philippe Guettier. Sur certains sujets, Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail « eau et climat » et ancien directeur de l’agence de l’eau Adour-Garonne, qui connaît bien la question des bassins, sera plus à même de vous éclairer.
Dans mon propos liminaire, j’ai omis de souligner que la question de l’eau se pose en tant que telle, avant tout changement climatique. Aujourd’hui, dans le monde, près de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable ; 2,5 milliards de personnes ne bénéficient pas d’un assainissement digne, vivant sans toilettes. Dans le monde, 90 % des pollutions émises par les activités humaines rejoignent les eaux superficielles ou souterraines sans aucun traitement. Ces chiffres n’ont rien à voir avec le changement climatique, qui ne fait que renforcer ces tensions – malheureusement, avant tout dans les zones qui pâtissent déjà de grandes difficultés. Quelle que soit l’importance du climat, la question de l’eau dans le monde ne s’y résume donc pas.
En septembre dernier, la communauté internationale a franchi un pas important en adoptant un objectif dédié à l’eau dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015. Cet objectif concerne bien sûr l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais également la lutte contre la pollution, la gouvernance et l’efficacité des usages – comment utiliser moins d’eau dans la production, industrielle ou agricole, et dans la vie quotidienne –, tout comme la préservation des écosystèmes aquatiques. Il rassemble donc, pour la première fois, toutes les dimensions de l’eau. Son adoption peut encourager les pays à inscrire l’eau parmi leurs priorités politiques – ce qui est aujourd’hui loin d’être le cas dans les pays en développement qui connaissent pourtant de sérieux problèmes dans ce domaine –, à voter des textes législatifs relatifs à l’eau et à y dédier des financements.
En effet, hormis la petite part de l’aide internationale – qui représentera, pour l’ensemble du climat, 100 milliards d’euros par an à partir de 2020 –, le secteur de l’eau est financé par les pays eux-mêmes. Or si notre culture de la gouvernance par bassins s’est largement répandue, permettant de gérer la majorité des bassins du monde au niveau territorial, en associant les différents usagers, la question du financement reste généralement entière. Très peu de pays ayant mis en place la gestion par bassins ont introduit des dispositions législatives permettant de prélever de l’argent sur les pollutions ou sur la quantité d’eau utilisée, afin de financer une vraie politique de l’eau. Il faut donc encourager l’augmentation des financements nationaux.
Les bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux ne doivent pas pour autant arrêter de financer les projets ; mais les financements internationaux ne représenteront jamais qu’une petite part de l’argent nécessaire pour développer l’accès à l’eau potable, l’assainissement, la lutte contre la pollution et la préservation des écosystèmes. Il faut franchir un cap majeur et faire bénéficier le monde de notre savoir-faire, car il est très difficile, pour un pays, de mettre en place des modalités pérennes de financement. Ainsi, le Maroc s’est doté depuis vingt-cinq ans d’une dizaine d’agences de bassin, mais le premier système de financement a commencé à voir le jour il y a quelques années seulement : un prélèvement sur l’eau utilisée et sur les rejets de pollution de certains industriels. Mais cela ne représente qu’une petite part de l’argent nécessaire pour financer une politique de l’eau efficace au Maroc. Cette situation se retrouve dans beaucoup de pays du monde ; il s’agit d’un point sensible, difficile à changer.
M. Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail « eau et climat ». Ancien directeur d’une agence de l’eau, je vis également ma quatrième COP ; je souhaite donc partager mon expérience avec vous.
En matière de gouvernance, la difficulté vient de ce que le problème du climat est universel et de long terme – on parle d’impact à trente ou cinquante ans –, alors que les problèmes de l’eau se gèrent à une échelle locale et avec un horizon plus court. À notre époque, la mondialisation conduit à raisonner de plus en plus à court terme, mais il faut arriver à intégrer, dans nos réflexions et dans les outils de planification de l’eau, cet horizon plus long. Par ailleurs, notre système de bassins est très efficace.
S’agissant des solutions, je partage l’avis exprimé à propos des barrages. J’ai vécu trois années de sécheresse où l’on aurait pu construire des barrages dans le Sud-Ouest ; mais l’on n’a pas pu trouver d’accord social entre ceux qui les souhaitaient – les agriculteurs – et ceux qui les refusaient – les écologistes. Le problème n’était ni technique, ni financier, et les difficultés environnementales pouvaient sans doute être résolues ; c’était notre modèle agricole tout entier qui était ici interrogé, et l’on n’a pas su s’entendre sur les modalités de développement d’une offre supplémentaire d’eau.
M. Jean Launay. Cela n’a pas changé !
M. Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail « eau et climat ». Un des mots d’ordre fondamentaux, face aux problèmes climatiques, est celui de la résilience. Nous allons vers un monde où il faut se placer dans une logique de long terme, alors que les incertitudes sont très grandes. Cela est vrai du climat en général, et de l’eau tout particulièrement. Nous devons donc imaginer des solutions réversibles. Or faire des économies d’eau est plus facile que de construire des barrages – un chantier qui s’étale sur vingt ans. C’est pourquoi des campagnes menées actuellement affirment qu’il faut commencer par la perméabilisation des territoires, qui fait appel au potentiel de la nature. La notion de résilience m’apparaît donc fondamentale.
Je suis d’accord, Madame la députée, avec vos propos sur les Intended Nationally Determined Contributions (INDC) et sur le prix du carbone, même si cette dernière mesure n’a pas fonctionné. Les financements en jeu – quelque 100 milliards d’euros – devraient être comparés aux subventions versées aux entreprises exploitant les énergies fossiles et aux utilisateurs de celles-ci, qui s’élèvent, d’après les travaux des économistes, à 400 ou 500 milliards par an. Le problème du prix du carbone a donc été mal posé. Plus généralement, la COP manque de transparence : les 100 milliards d’euros ont été annoncés à Copenhague, puis repris par les différentes conférences, sans que l’on sache à quoi cette somme correspond. S’agit-il de subventions, de prêts concessionnels ou ordinaires, d’investissements des entreprises dans les pays en développement ? Comment juger si un dossier est éligible ou non à ces nouveaux financements ? Tous les organismes financiers, y compris l’AFD, annoncent désormais que la moitié de leurs financements sont des financements « climat » ; mais l’on ne sait pas aujourd’hui qualifier correctement un dossier « climato-sympathique ». (Sourires)
Ce flou arrange les pays donateurs, pour lesquels il s’agit de dépenses, mais également certains pays récepteurs : ainsi, les pays forestiers n’ont pas forcément envie que l’on clarifie ce que signifie une gestion durable de la forêt… Mais si l’on veut progresser, il faut en sortir.
Nous sommes aujourd’hui à la fin du processus de Kyoto, et la COP de Paris signe le début d’une nouvelle phase. Lors de la COP précédente, le monde était bipolaire, divisé en pays riches – considérés comme ayant pollué la planète – et pays émergents. Aujourd’hui, chacun se rend compte que nous sommes tous solidaires et que les pays émergents rejettent désormais davantage de gaz à effet de serre que les pays développés.
M. Philippe Guettier. Pour ce qui est du rôle des grandes entreprises françaises du secteur de l’eau, le PFE réunit plusieurs types d’acteurs, publics et privés. Les trois grands groupes – Suez, Veolia et la Saur –, tout comme EDF, en font évidemment partie. Mais notre collège des entreprises intègre également une myriade de PME et de PMI du secteur de l’eau, qui représentent un vivier extraordinaire d’innovation. Notre mission consiste à valoriser non une entreprise en particulier – Suez ou Veolia –, mais les savoir-faire collectifs et l’ensemble de la filière, qui existe grâce au concours des collectivités territoriales, des maîtres d’ouvrage et des ONG qui travaillent sur les questions sociales.
Enfin, Monsieur le président, l’agenda des solutions représente une opportunité pour le secteur de l’eau, car il permet de valoriser les nombreuses réponses aux problèmes. Mais s’il mérite d’être pleinement investi, il ne constitue qu’un des quatre piliers de la COP qui serviront de base à l’accord de Paris.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous vous remercions pour vos réponses.
II. EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Lors de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la commission a procédé à l’examen du rapport d’information sur le passage à un monde décarboné.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mes chers collègues, alors que la conférence des Nations Unies a débuté, il m’apparaît important que notre commission se réunisse pour débattre de la COP21 et de l’après COP21.
Je vous propose de valoriser les travaux que nous avons menés depuis deux ans sur le thème de la lutte contre le changement climatique. Je vous demanderai en fin de séance d’approuver la publication d’un rapport dont je vais vous présenter la première partie, et qui contiendra également les comptes rendus des auditions et des tables rondes que nous avons organisées. Nous avons entendu de nombreuses personnalités – dont Gilles Bœuf, ancien président du Museum national d’histoire naturelle, Hervé Le Treut, climatologue, Jean-Marc Jancovici, Pascal Canfin, Jean Jouzel, Stéphane Le Foll, etc. Nous tenons aujourd’hui notre vingt-quatrième réunion, depuis le mois d’octobre 2012, sur le changement climatique, ses conséquences et les moyens utilisés tant pour l’atténuer que pour nous y adapter.
Notre intérêt pour le sujet s’explique par l’aspect multiple de cette problématique, qui embrasse l’ensemble des champs d’intervention de notre commission. Et, en ce jour, nous devions, me semble-t-il, nous rassembler, alors même que se déroulent au Bourget les négociations pour la signature de l’accord de Paris. Par ailleurs, je rappelle que notre Assemblée a voté la semaine dernière une proposition de résolution « pour accéder, au-delà de la COP 21, à une société bas carbone », et que se tiendra salle Victor Hugo, vendredi 4 décembre, et dans l’hémicycle, samedi 5 prochain, le sommet des législateurs de Globe qui réunira des parlementaires de quarante-trois pays ainsi que des assemblées panafricaine, européenne et andine.
Ce matin, l’ensemble des groupes politiques que vous représentez va pouvoir s’exprimer tant sur les enjeux de la COP21 que sur l’action que pourrait mener la France, au-delà de la réunion de Paris, lors de son année de présidence qui démarre le 30 novembre.
Pour ma part, je voudrais présenter les grandes lignes du rapport d’information que nous ferons figurer dans le document, qui rassemblera, comme je viens de vous le dire, les comptes rendus de nos différentes réunions de travail sur le sujet.
Je commencerai par un rappel de l’historique des COP.
En 1988, deux institutions des Nations Unies, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), créent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Dix-huit mois après sa création, celui-ci publie son premier rapport d’évaluation, qui conduit l’Assemblée Générale des Nations unies à préparer une convention sur le climat. Le 14 juin 1992, le sommet de Rio marque la structuration du régime climatique sous la houlette onusienne. Le 21 mars 1994, la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique entre en vigueur après la signature de cinquante pays. La première Conférence annuelle des parties (COP) se tient en 1995 à Berlin, et la vingt et unième a donc lieu, en ce moment, à Paris.
Au fil des réunions, une nouvelle géopolitique du climat se met en œuvre, qui se caractérise par la lente montée en puissance du thème de l’adaptation par rapport à celui de l’atténuation. En parallèle, se met en place le dispositif de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD), et de nouveaux pays deviennent incontournables, comme la Chine ou le Brésil. À la COP de Copenhague, en 2009, le problème climatique apparaît pour la première fois moins comme un problème environnemental que comme un problème de « décarbonisation » du capitalisme, mettant en jeu des intérêts économiques concurrentiels énormes et des enjeux énergétiques vitaux. Mais la gouvernance onusienne reste marquée par une gestion apolitique du problème, centrée sur la question de l’approvisionnement continu et bon marché en combustibles fossiles et par une gestion isolée, alors que le climat est inséparable de l’énergie, des modes de développement et de la mondialisation économique et financière. Enfin, elle est handicapée par l’illusion de pouvoir mener l’inévitable transformation industrielle et sociale de manière centralisée. Il devient donc urgent de désenclaver, de repolitiser et de reterritorialiser les négociations climatiques.
Il ressort ensuite de ce rapport d’information l’idée que le passage à un monde décarboné n’est plus négociable.
L’extraordinaire accélération des émissions de gaz à effet de serre provoque, via l’accumulation du gaz carbonique dans l’atmosphère, l’augmentation des températures, l’acidification des océans, la montée des eaux, les inondations, la multiplication des sécheresses et des incendies, la fonte des glaciers, la désertification et toutes sortes d’événements météorologiques extrêmes. Des migrants climatiques commencent à quitter par millions certaines régions devenues submersibles ou incultivables. Selon les experts du GIEC, seules des mesures prises à grande échelle pourraient contenir le réchauffement aux deux degrés au-delà desquels les êtres humains n’auront plus de prise sur un monde largement marqué par l’instabilité et la violence, affectant en premier lieu les régions les plus déshéritées et, au sein de celles-ci, les femmes. La COP21 constitue donc un rendez-vous essentiel pour décider de la survie, non pas de la planète, mais de l’espèce humaine qui la peuple.
À l’origine de ce désastre annoncé, se situe notre modèle de développement, marqué par un recours massif aux énergies fossiles depuis la révolution industrielle mais surtout depuis le milieu du XXe siècle et particulièrement dans les pays développés, dans la mesure où aujourd’hui 80 % de l’énergie est consommée par 20 % de la population. Demain, il deviendra vital, selon les mots de François Hollande, de « renoncer à utiliser 80 % des ressources d’énergies fossiles facilement accessibles, dont nous disposons encore ». En somme, la survie de l’espèce humaine impose de passer à une société bas-carbone. Cette obligation est d’autant moins contestable que les changements dans la composition chimique de l’atmosphère et l’effet de serre anthropique sont irréversibles à l’échelle humaine. En outre, au fil du changement climatique, apparaissent de nouveaux éléments, comme la fonte du permafrost, qui pourrait devenir une cause majeure de réchauffement, puisqu’il contient deux fois plus de carbone que toute l’atmosphère.
En parallèle, la biodiversité subit les effets du changement climatique, qui concourt à la disparition d’espèces animales et végétales et à la destruction d’écosystèmes. Au final, l’empreinte écologique de l’humanité sur la planète croît à une vitesse exponentielle, alors que la population mondiale, de plus de 7 milliards aujourd’hui, devrait atteindre 9,6 milliards en 2050. En 2015, l’Humanité avait, dès le 13 août, consommé toutes les ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an… Nous sommes aujourd’hui entrés dans l’ère de l’anthropocène, caractérisée par l’influence prédominante de l’homme sur la planète et par son aptitude à la transformer.
Ce constat d’échec oblige à raisonner autrement. Il ne s’agit pas d’adapter le modèle, mais d’en changer. Demain il ne suffira pas d’inventer de nouvelles régulations, de définir de nouveaux garde-fous ou d’espérer que le progrès technique nous sauve. Il nous faudra trouver d’autres façons de produire, de consommer, de travailler, de financer, d’habiter, de circuler et d’échanger, partir en reconnaissance des tentatives réussies de résilience, combattre l’inertie grâce à des minorités agissantes, entrer en résistance contre tous ceux qui s’obstinent à tirer pour eux les derniers profits du système actuel au détriment du plus grand nombre et, au final, inventer de nouvelles façons d’être au monde. Cette transition sera celle des citoyens, des territoires et des entreprises, dont les initiatives les plus robustes et les plus résilientes devront être repérées et diffusées. Mais elles devront être encouragées par une gouvernance internationale, garante de la réorientation des grands flux financiers.
Je terminerai ma présentation par une courte description des chemins de la transition à suivre vers un modèle plus soutenable.
La transformation du système énergétique est évidemment en première ligne. L’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) affirme que la France pourrait obtenir 100 % de son électricité à partir d’énergies exclusivement renouvelables dès 2050, et que cela ne coûterait pas plus cher que le maintien du nucléaire à 50 % de la production électrique en 2025. Mais il faudra aussi encourager partout l’efficacité et la sobriété énergétique, et mettre en place un modèle décentralisé de l’énergie qui rapproche la production de sa consommation, créant ainsi une appropriation du service et une prise de conscience de sa valeur.
Il faut ensuite donner un prix au carbone, alors qu’aujourd’hui seulement quelque 17 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par des systèmes de quotas, des taxes ou des normes d’émission. Mais les prix du carbone restent trop bas pour être efficaces. L’idée d’un « corridor de prix » encadrant des niveaux plafond et plancher, appliqué par une avant-garde de pays pourrait enclencher le processus avant que le mécanisme ne puisse s’appliquer à l’ensemble de la planète. À l’intérieur de chaque pays, l’impact de la taxe carbone sur les ménages les plus pauvres devrait être,par ailleurs, compensé via un crédit d’impôt.
Il faut en parallèle arrêter les subventions aux énergies fossiles : 200 milliards de dollars sont versés chaque année par quarante États, selon l’OCDE, 550 milliards de dollars pour le monde entier en comptabilisant les subventions transnationales, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et 5 300 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international (FMI) qui ajoute les subventions camouflées, sous forme de non prise en compte des coûts liés à la pollution.
Il faut ensuite pousser les acteurs publics et privés à désinvestir dans les énergies fossiles. Le mouvement enclenché porte aujourd’hui sur quelque 2 600 milliards de dollars. Il témoigne de la prise de conscience de la part des gestionnaires d’actifs financiers du risque carbone, que les investisseurs sont en droit de voir pris en compte.
Il faut également remettre en cause fondamentalement le système financier tel qu’il s’est développé depuis une trentaine d’années, en interdisant les produits financiers indexés et/ou dérivés des énergies fossiles, en mettant en place la taxe sur les transactions financières au sein de la coopération renforcée européenne portant sur une large assiette, et en dotant la lutte contre le changement climatique de financements pérennes. C’est là qu’intervient la promesse du versement aux pays en développement de 100 milliards de dollars par an, dont une part majoritaire de dons, pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Les fonds publics devront évidemment mobiliser de nouvelles ressources et ne pas provenir du transfert de budgets déjà existants et consacrés à d’autres enjeux de l’aide au développement, que l’on diminuerait d’autant.
Enfin, si l’énergie constitue à la fois le cœur de la crise climatique, le moteur de notre développement et donc la politique à réformer en première urgence, les villes, les usines, les campagnes sont autant d’espaces concrets où doivent s’inventer de nouvelles manières d’être au monde, dictées par une politique de sobriété en carbone. Un urbanisme résilient, de nouvelles formes d’économie circulaire, fonctionnelle, sociale et solidaire, une agriculture résiliente au changement climatique et favorable à la biodiversité, la restauration et la protection des puits de carbone que sont les terres, les océans et les forêts, constituent autant de chantiers à développer. Parallèlement, les montagnes et les outre-mer doivent être valorisés comme des réserves de patrimoine et des espaces prioritaires d’innovation en matière de lutte contre le changement climatique.
Enfin, ce combat passe évidemment par la prise en compte des actions des acteurs non étatiques que sont les villes, les territoires, les entreprises et les citoyens, que l’accord de Paris devrait rassembler sous le chapitre de l’Agenda des solutions.
Je conclurai mon propos en rappelant que l’accord de Paris, quel que soit son niveau de réussite, ne sera pas un point d’arrivée mais un point de départ pour la réalisation d’une nouvelle économie bas-carbone. Il convient donc que la France, qui présidera, durant une année, la COP après la réunion de Paris, s’engage à porter un nouveau modèle de développement à l’intérieur de ses propres frontières et au-delà, au sein de l’Union européenne bien sûr mais également avec le plus grand nombre de pays, afin de constituer une sorte d’avant-garde sur la voie de la transition.
Je vais maintenant passer la parole à tous ceux d’entre vous qui souhaiteront s’exprimer. Je précise qu’en raison de la solennité du moment, aucune limitation de parole ne vous sera imposée.
M. Christophe Bouillon. Monsieur le président, il peut sembler étonnant, voire paradoxal, de situer cette démarche au-delà de la COP21 qui vient à peine de s’ouvrir. C’est pourtant cohérent : comme vous venez de le rappeler, la COP21 ne constitue pas un aboutissement, mais bien un point de départ, quasiment « l’année zéro » de la société bas carbone que vous appelez de vos vœux.
Le rapport que vous venez nous présenter est excellent pour plusieurs raisons.
Il est excellent parce qu’il porte l’empreinte de vos convictions, reconnues et appréciées, et met en valeur le travail que notre commission conduit depuis plusieurs mois. En outre, il est conforme à l’exposé des motifs de la résolution que nous avons adoptée la semaine dernière et qui a emporté la conviction de nombreux parlementaires.
Il est excellent parce qu’il constitue une véritable feuille de route pour la justice climatique. Il traite des nombreux enjeux de la COP21, conditions de la réussite d’un accord que nous souhaitons à la fois universel, ambitieux, vérifiable, contraignant, financé et différencié. Et il contient aussi des propositions fortes pour aller au-delà même de cet accord.
J’ai identifié quelques-uns de ces enjeux.
L’atténuation tout d’abord : le fait que 180 États, à l’origine de 95 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), aient décidé d’une contribution nationale, montre qu’un pas important a d’ores et déjà été franchi ; la quinzaine d’États signataires du protocole de Kyoto n’en produisaient que 15 %. Mais les engagements pris dans ces contributions ne nous placent pas encore sur la trajectoire d’une limitation du réchauffement à deux degrés Celsius. Nous en sommes encore à trois.
C’est pourquoi la question de l’adaptation est aussi importante. Nous vous avons souvent entendu affirmer avec force que la COP21 ne doit pas être « l’atténuation de l’atténuation ». L’adaptation également s’impose, autrement dit la nécessité d’accompagner et de prendre des mesures fortes en faveur des pays déjà impactés par des dérèglements climatiques : phénomènes météorologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer, perte de la biodiversité, déplacements de populations. Il faut donc traiter aussi bien la question de l’adaptation que celle de l’atténuation.
On se souvient de l’intervention émouvante prononcée la semaine dernière par un de nos collègues sur la situation des territoires et des États insulaires que l’on sait menacés de disparition. Ceux-ci ont besoin à la fois de compensations financières et d’un accompagnement technologique, pour ne pas être dépassés par les événements qu’ils vont subir.
Cela étant, le financement est essentiel à la réussite des négociations. Le Fonds vert pour le climat devrait drainer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 ; on n’est pas loin du but, mais il faudra encore progresser. La taxation des transactions financières offre des opportunités de financement qu’il ne faudrait pas négliger.
Le rapport traite également de responsabilité. Vous l’avez dit, le concept d’une responsabilité commune mais différenciée pourrait satisfaire tout le monde. Mais ce n’est pas le cas, dans la mesure où un certain nombre de pays, notamment les pays émergents, considèrent que la responsabilité incombe d’abord aux pays industrialisés. De fait, les experts du GIEC et de nombreux contributeurs situent bien la responsabilité du changement climatique dans le modèle même des pays industrialisés, qu’il ne faudrait pas reproduire dans les pays émergents. Il faut donc plutôt prendre en compte la capacité respective des États, qui elle-même dépend des contextes nationaux.
Autre enjeu essentiel : la question du contrôle et de la vérification de l’application des engagements. Ce qui implique bien évidemment de réfléchir à la nature même de l’organisme qui en sera chargé.
Quel est sera le rôle l’Agenda des solutions ? On voit bien que les contributions nationales ne suffiront pas. Comme aime à l’expliquer notre collègue Arnaud Leroy, les entreprises, les territoires, et la société civile dans son ensemble devraient apporter leur propre contribution. Cela me semble en effet indispensable.
Quelle forme prendra l’accord ? Votre proposition d’une clause de revoyure fait son chemin. Le fait de se retrouver au moins tous les cinq ans aurait un effet cliquet et permettrait, au fur et à mesure, d’élever le niveau d’engagement.
Reste surtout la question du prix du carbone. Monsieur le président, vous avez utilisé toutes les occasions possibles – et même le texte relatif à la transition énergétique pour la croissance verte – pour porter une telle idée. Cette idée est en effet essentielle si l’on a vraiment la volonté de se tourner vers une société bas-carbone.
Je terminerai par trois interrogations : qu’en est-il des transferts de technologie ? Pouvez-vous d’ores et déjà dessiner « l’avant-garde climatique » que vous appelez de vos vœux ? Enfin, ce beau plaidoyer pour le climat n’est-il pas tout, sauf le procès de l’énergie ?
M. Charles-Ange Ginesy. Monsieur le président, je me ferai le porte-parole des Républicains. Comme l’a dit mon collègue, ce rapport d’information porte votre empreinte. Vous avez organisé de très nombreuses auditions de personnalités qualifiées et d’experts, qui nous ont permis d’avancer. Et aujourd’hui, dans le contexte un peu particulier qui est celui de la COP21, vous nous présentez un rapport excellent.
La COP21 trouve son origine en 1988, avec la formation du GIEC et les rapports qui s’en sont suivis. Sur le plan médiatique, encore aujourd’hui, et peut-être davantage aujourd’hui qu’hier, on peut parler d’une crise de conscience. Celle-ci a permis de réveiller et de sensibiliser nos populations à la réalité du réchauffement climatique dans lequel la responsabilité de l’homme est engagée, et à la nécessité de prendre d’urgence certaines mesures.
La COP21 aurait pu être un moment historique, qu’il s’agisse des contributions nationales ou des objectifs de limitation de la hausse des températures. Mais aujourd’hui, nous voyons bien que les deux degrés de hausse maximale des températures qui nous sont annoncés ne seront pas respectés. En effet, si l’on additionne – sans préjuger de ce qui pourra advenir dans les jours qui viennent – toutes les contributions nationales, cette augmentation sera, au minimum, de trois degrés.
En outre, il s’agit d’engagements déclaratifs sans aucune valeur contraignante. Nous voyons bien que les chefs d’État se désengagent en la matière. En réalité, nous n’avons aucune idée sur la nature de l’outil juridique qui naîtra de la COP21.
Le texte issu du sommet de Bonn, qui servira de base aux négociations, n’est pas consensuel. Et comme le président Obama l’a clairement exprimé, on sait d’ores et déjà que les États-Unis n’accepteront pas un accord juridiquement contraignant. La rencontre du président Xi Jinping avec le président Hollande n’a rien produit de concret. Certes, le président chinois s’est engagé aux côtés de la France à poursuivre sur la voie d’un accord contraignant et périodiquement révisé. Mais cette promesse, en définitive, reste vide. Peut-on se réjouir de la forme d’un accord avant que le fond n’ait été négocié ?
Du reste, à supposer que l’on parvienne à un accord contraignant, on peut se demander de quels moyens nous disposerions pour l’apprécier et le faire respecter. L’institution d’une clause de revoyure tous les cinq ans ne résout pas le problème d’un éventuel non-respect des engagements nationaux. Un accord juridiquement contraignant n’aura aucun effet s’il n’est pas accompagné d’un mécanisme efficace de contrôle et de sanctions.
Enfin, le financement n’y est pas. Dans son dernier rapport, l’OCDE évalue à 61,8 milliards de dollars les financements collectés en 2014 pour le climat ; mais il s’agit plus d’une valeur de référence pour les pays donateurs que d’une évaluation objective des crédits existants. Le Fonds Vert ne compte pas pour l’instant, car les 9,4 milliards récoltés en 2014 ne représentent rien par rapport à ce que nous pouvons attendre d’un financement pérenne.
À l’évidence, les espoirs que nous fondons de cette COP21 ne sont pas à la hauteur des espérances dont vous faites part dans votre rapport d’information.
Je conclurai en saluant à nouveau la qualité des travaux que nous avons pu réaliser sous votre présidence. Et comme je suis de ceux qui considèrent que chaque jour doit apporter sa bonne nouvelle, je suggérerai que, régulièrement, tout au long de l’année, on prenne des mesures. Vous nous en avez donné l’exemple aujourd’hui en rebondissant à propos des péages d’autoroute : c’est la démonstration de l’importance du travail mené au quotidien. Nous saluons votre détermination. Soyez assurés de notre soutien.
Certes, les Français sont sceptiques sur l’issue de la COP21. Ils sont 85,3 % à ne pas croire qu’elle permettra de prendre un grand virage en matière d’environnement. Mais bien que le sommet de Kyoto n’ait pas été un grand rendez-vous, gageons que celui de Paris apportera sa pierre à l’édifice. Et peut-être contribuerons-nous, ne serait-ce que modestement, à faire progresser les choses.
M. Bertrand Pancher. Monsieur le président, j’ai lu et relu le rapport d’information que vous nous présentez, et que je trouve également de très bonne qualité.
Je crains toutefois que la COP21 ne se termine par une énorme « gueule de bois » de la communauté internationale… Les engagements sont forts, la mobilisation intense. Les déclarations sont belles et les engagements généreux – au moins pour le moment. Mais comme on le dit : « chat échaudé craint l’eau froide ». Depuis bien des années nous avons très souvent constaté, à l’issue de ces conférences internationales, qu’il y a loin de la coupe aux lèvres !
Comment jugerons-nous de la réussite ou de l’échec de la COP21 ? On le fera sur la base de trois ou quatre éléments.
Premier élément : l’accord sera-t-il juridiquement contraignant ou pas ? Si l’on s’en tient à une déclaration de bonnes intentions, avec des clauses de revoyure régulières, c’est mieux que rien. C’est le moyen de savoir d’où l’on part, et de se rendre compte si l’on se dirige vers une augmentation des températures de trois, de quatre, voire cinq degrés. Mais demain ou dans les années qui viennent, cet accord sera-t-il juridiquement contraignant ? Pour le moment, on n’en prend pas le chemin.
Je pense que l’on aurait eu intérêt à revisiter l’accord de Kyoto. Certes, il n’a pas été appliqué. Reste qu’il prévoyait des dispositifs juridiquement contraignants. Certes, des pays s’en sont aussitôt dégagés. Certes, on n’a pas appliqué les sanctions prévues sur le plan international. Malgré tout, nous devrions, selon moi, nous engager vers des formes d’accords juridiquement contraignants. Il en est bien question dans votre rapport d’information ; mais peut-être aurait-il fallu travailler davantage sur ce point ; rien ne dit qu’on aurait pu faire mieux tous ensemble.
Quoi qu’il en soit, il ne faudrait pas que l’on se sépare en se contentant des engagements qui auront été pris. En effet, que risque-t-il de se passer après ? Alors même que protocole de Kyoto prévoyait un dispositif contraignant, les États-Unis n’ont pas hésité à s’en retirer et le Canada à faire exploser ses gaz à effet de serre.
Deuxième élément, que vous examinez en détail dans votre rapport d’information : la mobilisation financière en faveur des pays en développement, qui devrait atteindre 100 milliards d’euros par an d’ici à 2020. Autrement dit rien… si ce n’est du recyclage de moyens existants. Tout le monde dit qu’il ne faut pas s’en inquiéter, on finira bien par payer. Mais personne n’est dupe…
Dans votre rapport, et je trouve que c’est très intéressant, vous insistez sur les moyens de lever ces fonds, et vous en appelez à la communauté internationale comme à la communauté nationale. Je pense notamment à la taxe sur les transactions financières. Regardons d’abord comment, dans nos formations respectives, nous avons défendu cette taxe ! On a fait de grandes déclarations, mais une fois revenus dans nos partis politiques, ce n’était plus la priorité des priorités…
Cela dit, nous verrons, en fin de semaine, ce que cela donnera : quels engagements, et sur la base de quels moyens nouveaux ? Reste que jamais on n’a vu autant d’argent circuler, et je pense que nous devons tous nous mobiliser sur la question des transactions financières.
Troisième élément : le système de régulation. Nous devons reconnaître modestement que c’est d’abord la société civile et les entreprises réunies à l’UNESCO il y a quelques mois qui se sont mobilisées en faveur de la taxation du carbone.
Vous insistez beaucoup sur les mécanismes de taxation du carbone. Encore faudra-t-il qu’à un moment ou un autre, la communauté internationale s’interroge sur leur mise en place. Ce n’est pas le tout de donner un prix au carbone : comment le faire prendre en compte dans les échanges ? Comment faire en sorte qu’un bien carboné revienne beaucoup plus cher à l’achat qu’un bien décarboné ? Comment faire en sorte que l’importation d’un bien carboné soit davantage taxée que celle d’un bien décarboné ? Et en fin de compte, comment mobiliser l’OMC et l’amener à comprendre que le culte du libre-échange, exempté de toute taxe, a maintenant vécu ?
Monsieur le président, votre rapport s’apparente plutôt à un « agenda des solutions », incontestablement utile (Sourires) : oui, il faut davantage taxer les transactions financières si l’on veut contribuer à l’aide au développement ; oui, il faut supprimer partout, à commencer dans notre pays, tous les mécanismes financiers soutenant la production de carbone. Il y a là un ensemble de réflexions tout à fait intéressantes, qui pourraient constituer une feuille de route pour notre pays et toutes nos formations politiques.
J’y vois enfin un appel à changer notre mode de développement, basé sur une consommation exacerbée… La France, vous l’avez rappelé, présidera la COP pendant un an. Ce sera l’occasion de commencer à travailler sur notre modèle de consommation. Si le Président de la République veut y associer l’ensemble des formations politiques, et la nôtre en particulier, nous serons au rendez-vous.
M. Jean-Louis Roumégas. Monsieur le président, n’ayant pas eu l’occasion de suivre vos travaux préparatoires, je découvre avec plaisir votre rapport. Mais plus qu’un rapport, j’y vois une profession de foi en faveur du climat.
J’approuve ce qui a été dit jusqu’à présent, notamment sur la nécessité de disposer d’instruments financiers pour donner corps à la transition que vous appelez de vos vœux. Je tiens cependant à insister sur un aspect à mes yeux insuffisamment abordé : la déforestation, ses causes et les dégâts qu’elle entraîne.
On travaille beaucoup sur les émissions des GES, mais on parle peu de ce phénomène qui va en s’aggravant. On estime aujourd’hui qu’une surface équivalente à celle de la Belgique disparaît tous les ans. Les causes en sont bien connues et sont directement liées au modèle de développement actuel, très compétitif et consumériste.
La forêt disparaît d’abord parce que l’on veut produire de l’huile de palme et développer les agrocarburants. Je tiens d’ailleurs à dénoncer cette fausse solution : pour produire des agrocarburants, et remplacer le pétrole, on détruit la forêt ou on utilise des terres agricoles destinées à l’alimentation. C’est donc une très mauvaise solution – en tout cas quand on ne prend pas sur les déchets agricoles pour les produire.
La forêt est ensuite menacée par les projets de grands barrages, autre fausse bonne idée : pour produire de l’énergie hydraulique, on détruit des forêts. Je le dis d’autant plus vivement qu’en Amazonie, ce sont des entreprises françaises qui construisent ces barrages. Là encore, ce qui peut sembler bon pour le climat a des conséquences dramatiques.
Enfin, il ne faut pas oublier les importations de bois illégaux, dont nous sommes les premiers consommateurs en Europe, mais qui viennent de ces mêmes régions. Nous avons essayé de renforcer la lutte contre ce trafic, mais je crois qu’il faut vraiment aller plus loin.
Au-delà du problème de la déforestation, il y a celui de la survie des peuples de la forêt, qui vivent en harmonie avec elle. Ce sont eux, qui maintiennent un équilibre avec la forêt, qui sont les premières victimes de cette déforestation. On assiste à de véritables génocides et de véritables écocides, en particulier en Amazonie.
J’aimerais que l’on insiste sur ces aspects et que les États s’engagent, non seulement sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais sur la préservation, voire la régénération des massifs forestiers, absolument indispensables pour limiter le taux de carbone – ce sont des « puits » de carbone – et lutter contre les méfaits du réchauffement climatique.
M. Jacques Krabal. Monsieur le président, je voudrais vous remercier d’avoir présenté ce rapport. La commission du développement durable est tout à fait dans son rôle lorsqu’elle contribue à la réflexion qui est menée pour lutter contre le changement climatique, en particulier dans le cadre de la COP21.
Avant d’aller plus loin, n’hésitons pas à dire que cette COP est déjà un premier succès, ne serait-ce que par le nombre d’États représentés. Mais au-delà, tout le monde s’accorde pour souligner l’ampleur de la mobilisation sociale et privée, ce qui n’a pas forcément été le cas dans toutes les COP qui se sont tenues jusqu’à ce jour.
Par le passé, les négociations ont toujours été difficiles, et nous n’aurons jamais un accord parfait, comme l’a prévu Ban Ki-moon. Malgré tout, nous allons vers un compromis qui, de mon point de vue, devrait permettre de mieux lutter contre le dérèglement climatique. C’est en effet un impératif économique et de sécurité qui s’impose à nous tous.
D’une certaine façon, les dégâts du dérèglement climatique, à l’instar des récents attentats, ont entraîné une prise de conscience collective. Comme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique est devenue un objectif prioritaire.
Ce rapport comprend une cinquantaine de pages, divisées en chapitres, et aborde de nombreux points, comme les objectifs de long terme, la réduction des émissions de GES, l’adaptation climatique, et bien sûr la problématique du financement, déjà largement évoquée.
Pour ma part, j’insisterai sur la question de la gouvernance. En effet, la COP n’est pas une finalité, comme le président Jean-Paul Chanteguet l’a rappelé. Il faudrait donc mettre en place un suivi des engagements pris à cette occasion. Je pense que notre commission pourrait, au niveau national, devenir le lieu où pourrait être fait le point de l’état d’avancement de la société bas carbone que nous souhaitons. Nous devrions y réfléchir.
On vient d’évoquer les effets de la déforestation ; se pose également la question du changement aquatique, dont on ne parle pas assez non plus, et qui est une des conséquences du changement climatique. Un de nos collègues du Pacifique l’a évoquée hier en séance.
Bien sûr, il est difficile de savoir ce qui risque de se passer. Mais il serait bon de s’intéresser davantage aux systèmes d’alerte précoce, qui ont connu des avancées phénoménales. Car les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques sont aussi les plus pauvres et les plus démunis.
Les chiffres sont là : entre 1970 et 2012, 2 millions de personnes sont mortes, et à l’échelle de la planète, les dégâts sont estimés à 2 400 milliards de dollars. Comme on l’a rappelé hier à l’occasion de la présentation du système d’alerte précoce à laquelle participaient, sous l’égide d’Annick Girardin, secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie, de nombreux chefs d’État, il faut faire preuve de solidarité pour aider les pays menacés. Parmi, eux, une île dont le point le plus haut culmine à deux mètres au-dessus de la mer… La France est parmi les pays plus qualifiés pour apporter une telle aide. Si l’on pouvait déjà limiter le nombre de morts causés par le dérèglement climatique, ce serait une avancée essentielle sur le plan humain.
D’un point de vue anecdotique, il y a, dans le rapport, tout un passage sur l’économie circulaire et sur la nécessité de changer de paradigmes, dans le monde en général et en France en particulier. Je pense que, sous le contrôle de François-Michel Lambert, président de l’institut de l’économie circulaire, nous avons encore beaucoup de progrès à faire au niveau local, notamment en matière de réglementation : avec lui, nous avons rencontré hier les représentants du recyclage des pièces automobiles.
Aujourd’hui, on doit partout faire bouger les lignes. Je sais que nous en sommes capables. Des initiatives concrètes ont déjà été lancées en marge de la COP21 : électrification de l’Afrique, soutien aux technologies vertes et aux systèmes d’alerte par le biais de CREWS, etc.
Le rôle que jouera la France pendant la COP21, mais aussi au-delà, est majeur. Comme l’a dit François Hollande, nous sommes face à un mur que nous avons nous-mêmes bâti et qui est la résultante de la façon dont nous avons vécu. Mais ce mur n’est pas infranchissable. Je l’ai dit en préambule, la lutte contre le dérèglement climatique est aussi importante que la lutte contre le terrorisme. Et le nombre de migrants doit continuellement nous interpeller.
Je terminerai donc en parodiant Jean de la Fontaine : « En toutes choses, dans le cas du dérèglement climatique comme ailleurs, il faut considérer la fin ». Et en l’occurrence, il s’agit de l’homme sur cette planète, en un mot de l’humanité.
M. Patrice Carvalho. Monsieur le président, je vous félicite pour ce rapport. J’apprécie vos conclusions empreintes d’objectivité, tout en restant très mesurées.
La COP21 s’est ouverte lundi au Bourget en présence de 150 chefs d’État et de gouvernement. Chacun a souhaité que ce sommet débouche positivement – ce qui est mieux que s’ils avaient dit le contraire. Nous sentons bien néanmoins les obstacles à franchir ; ceux dont le développement dépend le plus des énergies carbonées l’ont déjà fait savoir.
Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental (GIEC), rendu public en novembre 2014, a élaboré quatre scénarios. Le plus probable, en l’état actuel de l’évolution du réchauffement climatique, est le scénario le plus pessimiste. Il table sur une poursuite des émissions de gaz à effet de serre et une hausse des températures de cinq degrés.
Par conséquent, seul un scénario de réduction des GES est en mesure de maintenir la température sous le seuil de deux degrés. C’est un défi de taille car cela implique de réduire nos GES de 10 % par décennie.
Les engagements annoncés par les États parties prenantes de la COP 21 nous situent davantage à trois degrés qu’à deux degrés. Voilà donc un premier obstacle.
Le second obstacle touche au contenu des négociations et ce à quoi nous voulons aboutir.
L’efficacité commanderait que des objectifs contraignants soient fixés ; mais beaucoup n’en veulent pas. Ainsi John Kerry, le secrétaire d’État américain, a déclaré au Financial Time qu’il n’y aurait pas d’objectifs de réduction juridiquement contraignants, comme cela avait été le cas dans le protocole de Kyoto. Il faut reconnaître aux États-Unis une belle constance : ils avaient signé le protocole de Kyoto, mais ne l’avaient jamais ratifié… Ce qu’ils appellent aujourd’hui de leurs vœux, pour le sommet de Paris, c’est une simple déclaration, ce qui ne servirait à rien et ruinerait toute possibilité de limiter le réchauffement climatique sous la barre de deux degrés centigrades.
En réalité, ce sur quoi nous butons réside dans la contradiction existant entre les impérieuses exigences climatiques, qui nous commandent de réduire nos GES, et un mode de production et de développement fondé sur le productivisme, une consommation énergivore et le dumping social, autrement dit la main-d’œuvre à moindre coût. Dans ces conditions, l’envahissement des lois du marché dans toutes les activités humaines rend périlleuse la signature des accords internationaux qui seraient nécessaires.
Pour prendre des engagements communs, il nous faudrait un monde de coopération. Or nous sommes dans un monde de compétition et de concurrence : pour gagner des parts de marché, il faut les arracher à d’autres ; pour vivre un peu mieux, il faut que d’autres vivent moins bien…
Tant que nous ne reconsidérerons pas nos modes de développement et de production, qui n’ont pas seulement consacré le dumping social mais aussi le dumping environnemental, tant que nous ne placerons pas le climat au centre des négociations sur le commerce mondial, nous peinerons à avancer et à trouver des solutions pérennes.
Le troisième obstacle concerne les pays en développement.
Les négociations butent sur l’engagement pris en 2009 à Copenhague par les pays du Nord, de fournir aux pays du Sud 100 milliards de dollars à partir de 2020 afin de les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à se développer de manière plus propre. Si cette promesse n’est pas tenue, il y a fort à craindre que les pays du Sud ne signent pas.
Aujourd’hui, les contributions annoncées s’élèvent à environ 10 milliards d’euros. Les pays du Sud sont confrontés non seulement à la question de leur développement sur un mode propre, mais aussi aux problèmes rencontrés en raison des chocs climatiques, chiffrés, selon la Banque mondiale, à 200 milliards de dollars.
L’enjeu est énorme, car si nous sommes aujourd’hui confrontés à l’exode de milliers de personnes fuyant la guerre et la barbarie, nous pourrions être confrontés demain à un flux de réfugiés climatiques. Si on évalue à 22 millions le nombre de personnes ayant dû abandonner leur domicile en 2013 à cause de désastres météorologiques ou hydrologiques, soit trois fois plus que le nombre de personnes déplacées à cause d’un conflit, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050, selon l’ONU. C’est dire l’urgence.
Voilà les trois obstacles à franchir, ou au moins à réduire, si nous voulons que la COP21 contribue à la préservation de la planète.
M. Jacques Kossowski. Merci beaucoup, monsieur le président, et félicitations pour votre rapport d’information.
Avant le début des travaux de la COP21, quelque 170 pays ont listé les engagements qu’ils comptaient prendre en matière de lutte contre les émissions de GES. Et lors de l’ouverture de la Conférence au Bourget, la plupart des chefs d’État ont tenu à les réaffirmer publiquement. Mais même si un accord contraignant devait être signé entre l’ensemble des participants, comment serait-il possible de vérifier in situ que les obligations souscrites par chacun sont bien respectées ? Certes, j’ai entendu Mme Ségolène Royal déclarer que les modes de contrôle feraient partie de l’accord, s’il y en avait un. Mais dans les faits, quels sont les organismes internationaux susceptibles de contrôler les États sans risquer de s’ingérer dans leurs affaires intérieures ? Peut-on faire reposer la surveillance sur les seuls satellites ?
J’ai deux propositions, peut-être un peu utopiques, à vous soumettre, monsieur le président.
Pourquoi ne pas demander que les maires des grandes villes se réunissent une fois par an ? Après tout, ils ont un réel pouvoir en matière d’urbanisme. À cette occasion, ils pourraient refuser telle ou telle construction qui serait néfaste pour l’environnement, par exemple la construction d’une usine risquant d’accroître exagérément les émissions de gaz à effet de serre sur un territoire. Au moins les uns et les autres pourraient-ils communiquer. Aujourd’hui, on attend tout des Chefs d’État. Ces derniers sont élus pour cinq, huit ou dix ans selon les pays. Mais ont-ils vraiment un pouvoir ? Le pouvoir n’est-il pas plutôt dans les mains des maires qui représentent la population ?
Dans le même ordre d’idées, nous aussi, nous avons un pouvoir au sein de cette commission. Ne pourrions-nous pas, à l’échelon national et quels que soient les gouvernements en place, essayer de peser et voir ce qui se fait ? Essayons pour une fois, de partir d’en bas pour essayer de nous faire entendre.
Cela peut paraître utopique. Mais pourquoi ne pas essayer ?
M. Gilles Savary. Monsieur le président, permettez-moi d’abord de vous féliciter pour avoir pris l’initiative de ce rapport, qui honore notre commission et notre Assemblée. C’est une contribution forte de la représentation nationale à la COP21. Autrement, nous aurions été muets.
Ce rapport, en raison de sa qualité, restera à n’en pas douter une référence pour l’avenir. Je suis persuadé qu’on en reparlera dans les années qui viennent, parce que c’est le sens de l’Histoire.
J’ai entendu ce que l’on dit. J’ai lu la presse. Je pense qu’il faut garder la mesure de ce qui est en jeu. Mais ce qui est en jeu bouleverse les mentalités, interpelle les souverainetés nationales, remet en cause les modes de vie. C’est bien pourquoi il ne faut pas trop demander au plan politique, comme l’a fait remarquer mon collègue Jacques Kossowski. Mais il ne faut pas relâcher le volontarisme.
J’observe que par rapport à Kyoto et Copenhague, les pays ont été plus nombreux à se mobiliser et à fournir des contributions. Et surtout, en dix ou quinze ans, le débat fondamental sur le réchauffement climatique et sa composante humaine est maintenant derrière nous. Il y a un consensus pour réagir de façon concrète, parce que les faits s’imposent : Ainsi, par exemple, dans ma région, on ne peut que constater que le vin a gagné un degré en vingt ans et que cette année, les vendanges ont débuté fin août. Et ce ne sont pas là des estimations d’experts, mais des réalités bien concrètes.
Aujourd’hui, de nombreux pays contribuent parce qu’ils sont assaillis de sécheresses, d’inondations, d’orages, de submersions. Comme l’a dit le Président de la République, si l’on ne s’engage pas, ce sera la guerre, avec des migrations fulgurantes. Nous avons déjà bien du mal à faire face aux migrations liées à une guerre classique, une guerre par les armes. La situation est donc grave.
Dans un tel contexte, je voudrais aborder deux questions
D’abord, je m’interroge sur le Fonds vert pour le climat. Personnellement, je doute toujours des politiques de subventionnement. Elles sont morales, elles sont compassionnelles, elles nous exonèrent de bien d’autres devoirs. Mais je ne voudrais pas qu’elles aient le même destin que les politiques d’aide au développement des quarante ou cinquante dernières années. Je suis persuadé que c’est sur le prix du carbone qu’il faut jouer.
D’une part, la taxation du carbone est une subvention versée par le Nord au Sud. Mais il faut faire vite : lorsque le Sud sera un grand producteur de carbone, ce ne sera plus tout à fait le cas. D’autre part, par une modification d’effets relatifs, nous serons amenés à changer notre mode de vie, dans la mesure où un mode de vie carboné serait plus cher qu’un mode de vie qui ne le serait pas.
Je considère que c’est un enjeu absolument considérable. Nous devrons donc mettre en place une gouvernance, sinon une gouvernance générale de la lutte contre le réchauffement climatique, au moins une gouvernance du carbone dans le monde.
J’entends bien qu’il y a une taxe sur les transactions financières (TTF). Mais cette approche morale de la question va inévitablement se heurter à l’égoïsme des nations et à la protection de leurs propres places financières. Nous savons bien que dans un monde concurrentiel, la mise en place d’une taxe financière est une solution certes élégante, mais pas forcément efficace. Cela dit, monsieur le président, vous avez pris la précaution de dire qu’il fallait que cette taxe ait une large base et une faible contribution.
Voilà pourquoi, selon moi, c’est sur le carbone qu’il faut absolument faire porter nos efforts, en conditionnant tout au prix carbone, y compris nos droits de douane et nos échanges internationaux. C’est très important. Si l’on y parvient, on aura fait un bond considérable.
Enfin, si nous voulons substantiellement modifier notre modèle économique, nous allons devoir ouvrir de façon beaucoup plus vigoureuse le chantier de la modification et de la réforme de notre comptabilité économique. Il faut calculer la valeur en intégrant les externalités, et modifier notre mode de calcul de la valeur, en ne se fondant plus sur le PIB matériel d’aujourd’hui. On sera alors sur des bases infiniment plus favorables pour mener ce combat contre le réchauffement climatique.
M. Yannick Favennec. Je voudrais à mon tour vous féliciter, monsieur le président, pour ce rapport et évoquer une question qui me paraît être un enjeu fondamental de l’accord de Paris : la révision des engagements.
En effet, parmi les éléments du succès du rendez-vous de la COP21, la décision des États de se revoir pour réviser régulièrement à la hausse les contributions nationales est cruciale, notamment dans la mesure où il n’y aura pas d’accord possible sur une trajectoire de baisse des émissions mondiales.
Les engagements actuels des États sont de fait insuffisants. Avant l’ouverture de la COP21, les 148 États – dont les 28 États membres de l’Union européenne – ont remis au secrétariat de la convention climat leur « contribution nationale envisagée » à la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour l’horizon 2030. Malheureusement, le bilan agrégé des promesses de ces pays, qui totalisent 85 % des émissions globales, est clair : non seulement les engagements pris ne permettront pas de réduire les émissions mondiales d’ici à 2030, mais celles-ci continueront d’augmenter.
Selon le thermomètre des engagements, publié le 9 octobre dernier par la Fondation Nicolas Hulot, les émissions mondiales passeraient ainsi de 49 gigatonnes (GT) d’équivalent CO2 en 2010 aux alentours de 60 gigatonnes en 2030, ce qui nous propulse vers un réchauffement supérieur à trois degrés, autrement dit une catastrophe annoncée.
Selon le PNUE, dans le cadre de la tendance actuelle, sans efforts d’atténuation supplémentaires, les émissions mondiales seraient de l’ordre de 96 gigatonnes en 2030. Alors que, pour être en phase avec l’objectif de deux degrés, il faudrait les avoir ramenées à 42 gigatonnes à cette date pour ensuite les diviser par deux en 2050 et arriver à zéro en 2100.
Autrement dit, les engagements de Paris, qui ne ramènent ces émissions qu’à 60 gigatonnes, ne représentent que le tiers de l’effort qui serait nécessaire d’ici là.
Face au bilan médiocre des contributions nationales et à la gravité des enjeux, il est fondamental de prévoir d’emblée une révision régulière à la hausse de ces contributions. Les efforts d’atténuation des parties signataires à l’accord de Paris doivent devenir plus ambitieux au fil du temps.
M. François de Rugy. Merci pour ce rapport, qui permet d’avoir un débat de qualité.
Je souhaite avoir un message global optimiste. Même si la situation du climat est très difficile, on a beaucoup progressé au fil des différentes conférences. Pour la première fois, la quasi-totalité des États sont venus avec des engagements chiffrés et prêts à s’engager sur un accord, sans avoir le pied sur le frein, comme le faisaient par exemple les États-Unis et la Chine à Copenhague.
Cette conférence n’est pas une fin en soi, au sens où on aurait tout réglé parce qu’on aurait un accord ou parce que tout serait fichu à défaut d’accord ambitieux. Elle est plutôt une étape, qui doit permettre d’aller le plus loin possible et en appellera d’autres.
Quels que soient les résultats de cette conférence, il faudra que chacun agisse là où il le peut, au niveau européen, au niveau national, comme au niveau des collectivités locales. Je rappelle d’ailleurs que les régions ont été désignées, dans la loi de transition énergétique et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), comme les collectivités chefs de file pour la mise en œuvre de la politique climat-énergie sur nos territoires.
S’agissant du prix du carbone, la combinaison entre le système de la taxe carbone et celui des échanges de quotas permettra d’avancer. Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs réfléchissant à ces questions climatiques depuis longtemps, mais aussi ceux de l’énergie, y compris les grandes compagnies énergétiques et pétrolières, et les grandes institutions financières et économiques mondiales – comme la Banque mondiale ou le FMI – en conviennent : le levier principal, c’est de donner un prix au carbone. Je me réjouis que la France ait repris ce chantier interrompu en 2010, qu’on a appelé la contribution climat-énergie. Même si le démarrage est modeste, le système est enclenché. J’espère que nos collègues continueront sur tous les bancs à lui apporter leur soutien – car j’entends ici ou là, y compris hier, lors de la séance des questions au Gouvernement, certaines remises en cause.
Il faut absolument poursuivre dans cette voie : le processus progressif la rend acceptable par les citoyens et les acteurs économiques. Mais la trajectoire doit en même temps être fixée, sans qu’on puisse en dévier, faute de quoi les acteurs économiques cesseront de faire les investissements nécessaires pour s’adapter et atteindre des objectifs bas carbone.
Enfin, monsieur le président, je signale que, sur la carte du réseau ferré national affiché dans la salle de votre commission, manque une ligne de chemin de fer rouverte – le cas est assez rare – entre Nantes et Châteaubriant. Je vous invite donc à la rectifier…
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Ces cartes ont été installées lorsque cette salle était celle de la Commission de la défense. Si vous souhaitez financer leur remplacement,… (Sourires)
Mme Sophie Errante. Merci pour cette feuille de route, monsieur le président, merci aussi pour les rencontres que vous avez organisées et les échanges que nous avons pu avoir au sein de l’Assemblée, avec, notamment, un collectif de femmes africaines, des étudiants américains ou des représentants des territoires ultramarins.
Comme le disait le Président de la République – propos que vous rappelez justement à la page 22 de votre rapport – « Il s’agit de mettre la France en capacité de porter un nouveau modèle de développement. Car les défis ne se divisent pas… ».
Il y a en effet des raisons d’être optimiste : on partait de très loin. Derrière le charbon et le pétrole, il y a des financements de partis, de gouvernements, ainsi que d’une société et de familles qui en vivent. Il est donc difficile d’imposer un modèle à tout le monde. Il faut avoir cela à l’esprit quand on évoque les gouvernements réticents à des engagements contraignants et comprendre qu’ils sont placés dans des situations parfois très compliquées.
Le Fonds vert n’entrant en application qu’en 2020, que fait-on en attendant, sachant que nos interlocuteurs nous ont déjà alertés sur les dégâts des dérèglements climatiques dont ils sont d’ores et déjà victimes ?
Par ailleurs, qu’attend-on de la COP22 au Maroc ? Quel travail pourrions-nous mener au sein de notre commission, mais aussi du Parlement, pour que la mise en œuvre d’un véritable changement de modèle soit suivie d’effet ? On constate en effet, au travers de la forte participation à la COP de Paris des visiteurs institutionnels et économiques, une envie de donner une réalité à une autre économie, plus transparente et plus durable.
Mme Geneviève Gaillard. Ce rapport, dont je vous félicite, nous convient et est à l’image du travail que nous réalisons dans cette commission depuis longtemps.
Je suis optimiste car nous avançons un peu, mais je crains que les actions ne puissent suivre les paroles. Dans ces négociations internationales, le diable est toujours dans les détails…
À l’époque où le développement durable était traité au sein de la Commission de la production et des échanges, chargée des affaires économiques, on voyait déjà que les parlementaires n’étaient pas tous d’accord sur un certain nombre de sujets, parmi lesquels l’agriculture. Je demande donc si tous nos collègues partagent désormais la même vision de la situation et des actions à mettre en place : c’est la condition indispensable pour avancer.
La question se pose de la même manière au plan international : on a beau entendre les Américains ou les Chinois dire qu’ils sont dans une dynamique, j’attends de voir les financements et les actions qui seront mis en place. On connaît bien les difficultés que nous avons à soutenir une pêche durable, alors que les ressources de la mer s’épuisent ou à lutter contre la déforestation, quand les Chinois poursuivent celle-ci en toute impunité en continuant à utiliser du bois de rose.
Je ne crois pas que, dans une économie de marché capitaliste, on puisse avancer aussi vite que possible. Les intérêts financiers restent toujours les moteurs de l’économie.
Par ailleurs, nous n’aidons pas les pays en développement les plus pauvres, mais ceux dont on sait qu’ils sont capables de rembourser et qui ont déjà engagé une dynamique. Or, dans certains pays très pauvres, certains problèmes tels que la corruption empêchent d’avancer.
Enfin, je suis heureuse que le Président de la République se soit engagé hier sur une somme de 1 milliard d’euros pour le lac Tchad, le fleuve Niger et la grande muraille verte. Mais comment allons-nous nous y prendre ? Je souhaiterais que notre résolution sur la grande muraille verte et les financements que nous allons y consacrer soient approuvés par l’ensemble des parlementaires. Mais je ne suis pas sûre que nous ayons tous demain cette unanimité pour faire en sorte que la lutte contre le changement climatique réussisse et que nos changements de modèles de production et de consommation ne tardent trop à venir.
M. Michel Heinrich. Je voudrais aussi saluer, monsieur le président, la qualité de votre rapport, qui servira sans doute de document de référence, et vous remercier du travail fait depuis plus de deux ans au sein de notre commission dans la perspective de cette COP.
Je regrette que l’énergie soit la grande absente du projet d’accord en discussion. Celui-ci n’évoque pas en effet les grandes perspectives énergétiques ni ne remet en cause l’énergie fossile, pourtant responsable de près de 80 % des émissions de CO2. Il ne présente pas non plus de perspectives chiffrées de développement des énergies renouvelables.
Et accessoirement, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis refusent toute contrainte en matière d’émissions de CO2…
M. François-Michel Lambert. Merci pour ce rapport, qui permet de bien structurer nos travaux.
Je suis néanmoins un peu critique sur votre approche de l’économie circulaire qui, bien plus que la gestion des déchets, est un modèle de développement, recherchant en permanence l’intensification de la productivité des matières et des ressources tout en les préservant. Il s’agit de repenser notre modèle destructeur d’économie linéaire en créant des flux permanents en boucle vertueuse.
L’économie linéaire est toute à la fois destructrice de ressources et responsable d’une grande partie des émissions de CO2 : 10 % des gaz à effet de serre du monde sont dus à la production des métaux, de l’extraction minière à la fabrication de matières. Je vous invite donc à compléter sur ce point votre rapport, par ailleurs remarquable sur tout ce qui touche à la fiscalité et aux financements. Je vous suggère de lire à cet égard le rapport du club de Rome, qui sera présenté le 15 décembre, réalisé sur cinq pays européens – la Suède, l’Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la France – et qui montre que par une politique coordonnée sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, nous pourrions générer 50 000 emplois nets en France et 1,5 point supplémentaire de PIB, tout en réduisant de 60 % les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne devons pas oublier que 10 % de la population mondiale produit 70 % de ceux-ci et que nous faisons partie de ces 10 %.
Mme Marie Le Vern. Merci pour la qualité de ce rapport. Vous insistez sur la nécessité d’adopter des comportements et des activités plus économes en carbone, de même que sur celle de « restaurer la terre et de cultiver au lieu d’exploiter ». La formule est jolie (Sourires).
Je suis élue de Seine-Maritime, qui fait figure de mauvais élève concernant la part de terre agricole convertie au biologique dans la surface agricole utile – moins de 1 %. Même si nous enregistrons une progression du nombre d’exploitations passant à ce mode de culture, nous restons dans la moyenne basse.
Je suis frappée par les difficultés, y compris culturelles, que rencontrent les agriculteurs quand on évoque les méthodes de l’agriculture biologique ou agroécologique, alors que le modèle conventionnel est subventionné, à bout de souffle, et ruine les terres et la santé des paysans sans garantir de revenu digne. On est bien là face à une problématique de développement durable et de conversion de notre société au bas carbone. Je m’interroge donc sur notre capacité à faire évoluer massivement et rapidement les esprits, en dépit des initiatives louables des pouvoirs publics en faveur des méthodes agroécologiques.
Mme Sophie Rohfritsch. Je me joins au concert de louanges qui vous ont été adressées, monsieur le président, pour le travail accompli, grâce aussi aux auditions que nous avons menées ensemble sur le sujet.
Ce rapport pourrait être le plus ambitieux de la COP21, car il se focalise notamment, avec une multitude d’exemples à l’appui, sur l’action de terrain des citoyens et des collectivités locales comme moyen le plus efficace en faveur d’une reconversion de notre modèle, acceptable et mesurable dans ses effets. C’est un beau message d’espoir, auquel je m’associe.
M. Jean-Jacques Cottel. Je vous félicite aussi pour ce rapport très intéressant. Vous parlez d’une nouvelle façon d’être au monde : notre mode de vie, de plus en plus consumériste, est bien à revoir et l’éducation à l’environnement, à ce nouveau modèle, doit être une priorité pour nos jeunes générations.
Pouvez-vous préciser les pratiques agricoles, encore marginales, qu’il serait souhaitable de développer ? Vous paraît-il possible de les mettre en œuvre rapidement ? Comment encourager les acteurs à cette fin ?
Par ailleurs, pouvez-vous apporter des précisions sur le nouvel accès au foncier que vous proposez, alors qu’on connaît dans certains secteurs une course au foncier effrénée, notamment dans le domaine agricole ? Il faut impérativement poursuivre le travail dans ce domaine.
Mme Valérie Lacroute. Je vous félicite aussi pour ce rapport et pour nous donner l’occasion de nous exprimer sur la COP21, notamment sur des initiatives locales, telles que l’idée de Jacques Kossowski de réunir les maires des grandes villes. Cette COP peut être l’occasion d’élaborer une sorte de boîte à outils pour les collectivités. J’espère que nous n’accoucherons pas d’une souris.
La COP21 sera aussi le rendez-vous des entreprises, qui jouent un rôle important. Le développement économique repose à la fois sur l’efficacité économique et la préservation de l’environnement. Cette position est désormais partagée par nombre d’entreprises, qui considèrent que le prix de l’inaction serait, à terme, plus élevé que celui de l’action.
La COP21 parviendra-t-elle à généraliser les mécanismes de tarification des émissions de carbone ? Aujourd’hui, les entreprises demandent un « signal prix » fort, permettant d’orienter les investissements vers des technologies économes en énergie, afin de préserver notre planète. Il est important que l’ensemble des pays adoptent les mêmes mécanismes pour que les entreprises les plus vertueuses ne se trouvent pas concurrencées par celles se délocalisant vers des pays dont la législation serait beaucoup moins contraignante.
Deuxièmement, il importe de promouvoir un mix énergétique mettant l’accent sur les sources d’énergie qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Je pense, bien sûr, au photovoltaïque, à l’éolien, à la biomasse, mais aussi au nucléaire – je rappelle que le GIEC fait figurer ce dernier parmi les sources d’énergie non carbonées. Je m’arrêterai là…
M. François-Michel Lambert. Cela vaut mieux !
Mme Françoise Dubois. La déforestation est une catastrophe mondiale aux conséquences irréversibles. Elle décime notamment les peuples autochtones, qui sont les premiers protecteurs et garants de la biodiversité. Il faut aussi considérer à cet égard le déplacement, voire la disparition, de toute une faune indispensable au bon fonctionnement de la nature.
L’être humain ne décide pas du milieu d’habitation des espèces. Les scientifiques essaient de sensibiliser les responsables, mais ne font, hélas ! que constater les dégâts. Les enjeux économiques et les intérêts financiers sont considérables. Reste que cette déforestation à outrance a, peut-être, été un des vecteurs importants du dérèglement que nous vivons aujourd’hui.
M. Laurent Furst. Merci, monsieur le président, de nous permettre d’avoir ces débats dans le calme, la sérénité et l’amitié.
La COP21 peut être appréhendée à deux niveaux différents : la recherche d’un consensus sur un objectif, mais aussi la construction d’une conscience mondiale, qui s’élabore réunion après réunion. En cela, la contribution de cette COP est importante, comme le seront les suivantes et le furent les précédentes : l’échec de Copenhague, lui-même, a été un élément constitutif de cette prise de conscience.
Je note, par ailleurs, que l’on ne parle plus de la notion de « peak oil » – « pic pétrolier » –, en raison du développement des gaz de schiste, des pétroles bituminés et des nouveaux gisements découverts au large des côtes et en Arctique. On croyait hier que le problème se réglerait par lui-même, puisqu’il n’y aurait plus de pétrole. Désormais, on est entré dans une logique simple : l’homme doit renoncer à consommer de l’énergie fossile, non du fait de la nature, mais du choix qu’il opère.
Si les pays occidentaux sont peut-être culturellement et économiquement armés et pourront financer leur transition énergétique, les six septièmes de l’humanité ne pourront se développer que s’ils ont accès à une énergie peu chère. Or, on voit mal l’humanité en croissance renoncer à la consommation. Dès lors le problème est devenu mondial et ne se pose pas dans les seuls pays occidentaux, et encore moins en France où d’ailleurs nous émettons moins de GES que bien d’autres nations. Comment faire en sorte, de ce fait, que la consommation d’énergie fossile soit dépassée technologiquement pour les pays du Sud ? C’est bien dans le développement de technologies nouvelles et leur diffusion à faible coût dans ces pays que l’on trouvera les solutions au problème des gaz à effet de serre, pour que l’homme renonce enfin à consommer ce que la nature lui offre pourtant à profusion.
Ces questions me semblent relever de trois domaines : climatique, économique et éthique. À cet égard, il est un indicateur que j’aimerais connaître : quelle quantité d’émissions de CO2 chaque homme de la planète peut-il émettre pour qu’on ne dégrade pas le climat – ce qui devrait constituer l’objectif de tous les habitants du monde ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. La réponse est : deux tonnes par habitant et par an…
Mme Sabine Buis. Je voudrais aussi m’associer aux louanges qui vous ont été adressées, monsieur le président. Plus qu’un rapport, c’est une véritable feuille de route, voire d’une profession de foi. Je suis heureuse que nous puissions nous retrouver sur ces propositions.
Mais pouvons-nous nous en contenter ? Comment aller plus loin ? Nous sommes tous d’accord pour faire des questions du prix carbone et du financement nos priorités, mais aussi pour explorer peut-être d’autres pistes, comme celle de l’économie circulaire. Dès lors, comment pouvons-nous faire pour, en tant que membres de cette commission, parler d’une seule voix au sujet de ce rapport pour avoir du poids politiquement et, au-delà de la COP21, défendre plus largement les ambitions que nous avons ?
M. Jacques Alain Bénisti. Je souhaite aussi vous féliciter, monsieur le président, car votre rapport est courageux : il place nos dirigeants devant un bon nombre de contradictions. Ainsi, quand vous parlez de densification raisonnée et de la nécessité d’un rapprochement domicile-travail, c’est du bon sens, mais on aimerait que vous soyez davantage entendu dans les hautes sphères !
Plusieurs députés. Oui !
M. Jacques Alain Bénisti. L’imposition des opérations d’intérêt national (OIN) entraîne, par exemple, une surdensification des logements, notamment dans les territoires de la petite couronne, déjà totalement saturés en logements et en circulation, ce qui aggrave l’effet de serre et va à contresens des préconisations de la COP21.
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Merci à tous.
Je poursuis avec vous un objectif : faire en sorte que notre commission ait une véritable existence, que ce soit au travers les textes qu’elle examine ou des sujets qu’elle aborde ou dont elle se saisit, de ses réflexions et de ses propositions. Il est vrai que nous pouvons avoir quelquefois le sentiment de ne pas trouver toute notre place, mais certains sujets nous permettent de dialoguer ensemble et de faire avancer la réflexion.
Je me suis posé la question de savoir comment notre commission pouvait être associée à la préparation de la COP21 et je me suis très vite rendu compte que la gouvernance climatique est par essence onusienne – autrement dit, ce sont les diplomaties qui sont chargées de la préparer. Reste que s’il y a un accord, celui-ci devra être ratifié par tous les parlements du monde – et pour ce qui nous concerne, d’abord par l’Union européenne, puis par les parlements des États membres.
La position de la France est tout à fait particulière, puisqu’elle accueille la COP. Elle aura un statut de facilitateur jusqu’aux 11 ou au 12 décembre, puis d’acteur en pleine responsabilité, qui devra prendre des initiatives, sachant qu’elle va présider la COP pendant un an – Laurent Fabius en assume la présidence depuis le 30 novembre, et jusqu’à la fin 2016. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cette proposition de résolution et formulé nos demandes sous forme d’actions à prendre après la COP21.
La gouvernance climatique onusienne, au bout de vingt-trois ans, s’essouffle selon moi, même si nous ne devons pas négliger les progrès accomplis. J’en cite toujours trois : elle aura permis aux pays en développement de s’exprimer – d’ailleurs, depuis le début, ils se sont regroupés au travers du G77 ou d’un groupement des pays les plus vulnérables – ; elle aura permis à la société civile de faire de même ; elle aura permis d’acter, comme l’a fait la conférence de Copenhague, la nécessité de mettre en place des politiques évitant de dépasser le seuil d’augmentation de deux degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Autrement dit, son bilan est loin d’être négatif.
Reste que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Nous sommes face à une urgence climatique car ces gaz ne disparaissent pas au bout d’un an : nous avons créé un stock très important, qui continuera à exister pendant des dizaines ou des milliers d’années. Même si demain nous ne produisions plus de GES, nous serions confrontés à une augmentation de la température. L’emballement qui pourrait se produire présente donc un risque particulièrement important.
Si nous voulons rester en dessous des deux degrés, il faudra rehausser les engagements pris par les différents pays. Dans la mesure où l’accord de Paris serait mis en œuvre à partir de 2020, la première révision se ferait en 2025, mais ce sera peut-être déjà trop tard. Il faudrait que la première révision intervienne avant 2020. Ce qui se passera dans les cinq ans qui viennent est particulièrement important.
La COP21 marquera une étape déterminante : nous sommes passés du système « top-down » au système « bottom-up ». Le protocole de Kyoto, ratifié en 2005, a marqué la gouvernance climatique et les engagements pris pour la première période ont normalement été mis en œuvre entre 2008 et 2012. Il avait fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux pays industrialisés et aux anciens pays du bloc de l’Est. Il était contraignant politiquement et moralement, mais aussi juridiquement – un peu –, dans la mesure où on avait prévu des mécanismes de sanctions, selon lesquels les pays qui ne respectent pas leurs engagements seront pénalisés dans le cadre de la deuxième période – par une augmentation de 30 % de leurs objectifs de réduction. Mais que s’est-il passé ? Le Canada et le Japon, constatant rapidement qu’ils ne tiendraient pas leurs engagements, se sont aussitôt retirés du protocole. Je ne crois donc pas que l’accord de Paris puisse être un texte juridiquement coercitif, qui se traduirait par d’éventuelles sanctions à l’égard des États-Unis ou de la Chine. Reste qu’il sera contraignant politiquement, sans doute aussi moralement – même si je regrette bien sûr qu’il ne le soit pas aussi juridiquement.
N’oublions pas que les engagements sont pris, non par la communauté internationale, mais par les pays eux-mêmes, certains étant d’ailleurs forts et d’autres en retrait.
Le dispositif « bottom-up » consiste à demander aujourd’hui aux pays les engagements qu’ils veulent prendre à l’horizon 2030. Autrement dit, nous sommes dans une logique radicalement différente. Or 183 pays – représentant 95 % des émissions de gaz à effet de serre – sur 196 ont fait des propositions, ce qui est un véritable succès.
Mais certains de ces pays, qui se sont engagés sur des INDC – Intended Nationally Determined Contribution, autrement dit des contributions décidées au niveau national – ont conditionné leur engagement au soutien financier de la communauté internationale – c’est le cas de nombreux pays en développement. Par ailleurs, certains États n’ont pas pris d’engagement, ou s’ils en ont pris, ils sont particulièrement limités. Il serait naïf de penser que tous les pays ont le même intérêt à lutter contre le réchauffement climatique. Les intérêts des pays producteurs de pétrole par exemple n’ont rien à voir avec ceux des pays dits vulnérables : il est vrai à cet égard que les engagements de l’Arabie saoudite ou du Qatar sont pour le moins a minima. Reste que 183 pays ont déposé leurs INDC.
Bien sûr, nous irons, hélas, au-delà d’une augmentation de deux degrés. Nous sommes à un point de rupture concernant la gouvernance climatique, d’autant qu’il y a un fait nouveau fondamental : la décision, à Lima, de mettre en place l’agenda des solutions, qui recense de manière non exhaustive toutes les initiatives prises dans le monde par les collectivités territoriales, par les territoires, par les entreprises, par les filières industrielles, par les citoyens. Pour moi, il constitue un élément devant permettre l’instauration d’une nouvelle gouvernance climatique, plus équilibrée, dans la mesure où ce sont, à l’évidence, les acteurs non étatiques qui permettront de mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique. La COP21 a, de fait, montré la mobilisation des citoyens, des entreprises, des territoires et des collectivités. Celles-ci, et notamment les communes, sont organisées et il existe plusieurs associations internationales les regroupant.
Le point 16 de notre proposition de résolution préconise d’ailleurs que soit institutionnalisé l’agenda des solutions par la création d’un conseil à cet effet, composé de représentants des différentes initiatives pour le climat et de la société civile, d’experts, de représentants de gouvernements nationaux et d’organisations internationales, dont les travaux seraient coordonnés par un haut représentant pour l’action climat. C’est là une proposition à mes yeux particulièrement forte, sachant que l’après-COP21 doit conduire à des initiatives nouvelles, notamment de la France.
Le chiffre de 100 milliards de dollars évoqué à Copenhague ne correspond pas au financement du Fonds vert, aujourd’hui doté d’environ 10 milliards. Ce fonds vient d’ailleurs de décider de financer un certain nombre de projets, qui concernent souvent les énergies renouvelables.
La France a demandé à l’OCDE de faire un bilan des financements climatiques mobilisés aujourd’hui, privés ou publics. Le chiffre avancé, qui est de l’ordre de 60 milliards d’euros, fait l’objet d’un débat. Pour passer de 60 à 100 milliards, la marche est relativement haute ; reste que les banques – la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou la Banque asiatique de développement – se sont engagées à augmenter leur financement.
Même si demain nous arrivions aux 100 milliards d’euros, rappelons que les moyens consacrés à l’adaptation doivent être beaucoup plus importants. Ils mobilisent pour l’heure seulement 17 % des 60 milliards que j’évoquais ; il faut bien davantage, et surtout sous forme de dons, alors qu’ils sont généralement mobilisés sous formes de prêts. Cela peut se comprendre pour l’atténuation ; mais pour l’adaptation, nous avons besoin de dons. La Fondation Nicolas Hulot considère d’ailleurs que sur les 100 milliards, 30 devraient être consacrés à l’adaptation ; nous en sommes loin.
Nous avons la possibilité de mettre en place des financements innovants, qui ont été identifiés par Pascal Canfin et Alain Grandjean ; mais, au-delà de la taxe sur les transactions financières, il y a un autre outil utile : la vente aux enchères des quotas de carbone sur le marché européen. Le problème est que ce marché ETS ne fonctionne pas – le prix de la tonne de carbone fluctuant entre 5 et 8 euros, alors qu’il devrait être plutôt de 15 à 20 euros. Si demain on mettait en place une nouvelle gouvernance permettant d’avoir un prix du carbone sur ce marché, qui concerne 11 500 entreprises, cela permettrait, dans le cadre de la vente aux enchères, de mobiliser des moyens financiers non négligeables – sur quinze ans, la somme estimée est de 230 à 350 milliards d’euros, dont une partie pourrait être affectée au climat, en particulier au financement de l’aide internationale.
La France va modifier le régime de l’Agence française de développement (AFD), qui va être adossée à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui devrait lui permettre de disposer d’une structure financière plus importante et d’emprunter davantage sur les marchés financiers. Derrière cette capacité d’emprunt accrue se profile une augmentation de notre aide au développement et de l’aide internationale au climat sous forme de prêts – ce qui n’est pas suffisant et suppose de trouver d’autres moyens financiers.
Pour ce qui est du développement de l’agriculture biologique, nous n’atteignons effectivement pas les objectifs fixés. Dans la loi sur le Grenelle de l’environnement, l’objectif était que 20 % de la surface agricole utile soit en agriculture biologique en 2020, contre seulement 4 % aujourd’hui… Nous en sommes loin. Nous proposons, dans notre proposition de résolution, de demander à l’Union européenne qu’elle prenne mieux en compte, au moment de la révision de la politique agricole commune (PAC), les enjeux climatiques et environnementaux, ce qui permettrait de réorienter cette politique.
J’ai, en outre, bien noté les remarques de notre collègue François-Michel Lambert sur l’économie circulaire et nous sommes prêts bien entendu à entendre ses propositions.
Mme Sophie Errante. Dans le cadre du Parlement des enfants, nous allons faire travailler les enfants sur la question du changement climatique. Sommes-nous autorisés à échanger avec eux sur ce rapport et la proposition de résolution ?
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Oui, dans la mesure où vous nous autorisez à publier le rapport ! (Sourires)
(Le président Jean-Paul Chanteguet interroge la Commission)
Puisqu’il n’y a pas d’objection, le rapport sera donc publié. Je vous remercie.
*
La Commission autorise la publication du rapport d’information.
© Assemblée nationale